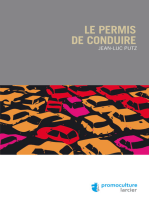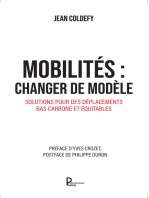Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Cheminements Mixtes Charte Cyclable
Cheminements Mixtes Charte Cyclable
Transféré par
TaGaDaCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Cheminements Mixtes Charte Cyclable
Cheminements Mixtes Charte Cyclable
Transféré par
TaGaDaDroits d'auteur :
Formats disponibles
Les cheminements mixtes
Ces cheminements, que l'on appelle aussi, voie partagée, cheminement piétons/cycles ou encore trottoir cy-
clable, sont réalisés un peu partout en France. Ils sont réalisés très souvent sur des trottoirs existants ou nou-
vellement créés, que ce soit en zone urbaine, interurbaine ou hors agglomération.
Ces aménagements ne sont pas répertoriés au Code de la route, ne sont supportés par aucune signalétique ver-
ticale ou horizontale réglementaire et ne correspondent à aucune règle technique d'aménagement routier.
Dans le cadre des réunions de travail du Cotech au CERTU en vue du Code de la rue, ce sujet a été abordé à plu-
sieurs reprises en préalable à la définition du trottoir. Une future définition, en cours de validation auprès de
la DSCR, devrait clarifier, nous l'espérons très rapidement, les données techniques d'application : “ Partie de
la route affectée à la circulation des piétons, distincte de la chaussée et de tout emplacement aménagé pour
le stationnement. Sa limite est repérable et détectable” (nouvel alinéa Article R 110-2).
Le trottoir n'est pas une chaussée, le vélo étant un véhicule il n'a donc pas sa place sur le trottoir.
Tout le monde est bien d'accord sur cette application, mais il reste à la traduire dans les faits sur le terrain.
Réaliser une piste cyclable au niveau du trottoir demande donc l'application de la définition “limite détectable et
repérable”. Une simple ligne de peinture ou une couleur de surface différente ne suffit pas, et la mise en
place d'une signalisation horizontale, voire verticale, est actuellement en dehors de toute prescription légale.
Au delà de toute signalisation, l'inversion
de la position de la zone cyclable et celle
dédiée à la végétation résoudrait l'en-
semble des problèmes de cohabitation
piétons/cycles.
Aujourd'hui, les cheminements mixtes se développent un peu partout sans aucune réglementation et
en dehors de toute légalité liée au Code de la route. Deux conséquences pratiques à cette situation :
• la densité de piétons est importante et ils “s'approprient” l'ensemble de la zone. Ils “renvoient”
les cyclistes sur la route ou la rue.
• la densité de cyclistes est importante et ils “s'approprient” l'ensemble de la zone. Ils “renvoient”
les piétons ailleurs car la cohabitation n'est pas assurée.
Pour certains, ces aménagements mixtes, qu'ils soient pistes
cyclables, ou encore pistes à hauteur du trottoir, ont été réalisés 2
sur des zones particulières où l'emprise “n'était pas possible”, sous
réserve de travaux importants et coûteux, d'autres n'ayant au-
cune contrainte, mais s'inspirant de la pratique existant en Alle-
magne ou dans d'autres pays européens.
Dans la ville de Strasbourg, comme dans d'autres agglomérations fran-
çaises, des pistes cyclables sont également ouvertes aux piétons. Aussi,
ces équipements perdent-ils toute leur finalité et sont inefficaces.
La photo n° 2 est prise à proximité de l'une des universités; la densité des
piétons aux heures de pointe au droit des arrêts du Tram est telle que la
circulation des cyclistes est quasiment impossible...
Charte cyclable - Fédération française de cyclotourisme
Les cheminements mixtes
Autres exemples :
De nombreux exemples à travers la France démontrent qu'il est urgent que soient définies des règles pour
uniformiser les réalisations et des références légales pour la mise en œuvre de ce type d'aménagements.
L'exemple cité ci-après se situe en région parisienne à Voisin-le-Bretonneux (78) (photos 3 et 4).
Si la différence d'aménagement cyclable se dispense d'explication, la particularité de ceux-ci mérite par contre
d'être citée :
• Les deux aménagements ci-dessous se trouvent le long de la même route de part et d'autre de celle-ci,
et le changement de”statut” : piste cyclable/cheminement piéton séparés (photo 4), et cheminement
mixte piétons/cycles (photo 3), est lié à la présence d'un carrefour à feux.
• Avant le carrefour à feux : piste cyclable/cheminement piétons séparé et après le carrefour à feux :
cheminement mixte piétons/cycles.
Cette situation ne doit pas perdurer, aucun des usagers qu'ils soient piétons, (valides, non voyants ou mal
malentendants), PMR ou cyclistes, ne s'y retrouve. Les problèmes d'insécurité routière liés à une mauvaise
organisation de la cohabitation, doivent être pris en compte rapidement.
Nota : l'éducation, l'information et la sensibilisation, si elles sont nécessaires, ne régleront pas ces
problèmes.
3 4
Les ponts et les passerelles
Les cours d'eau et les voies ferrées ainsi que les grands axes routiers et autoroutiers, constituent d'importantes
“zones de coupures” qui allongent les parcours et découragent la pratique du vélo. Il est donc important de
permettre aux cyclistes de les franchir sans faire de grands détours.
La largeur de la chaussée ne permet pas toujours de créer des bandes ou des pistes cyclables séparées de la
partie trottoir, tout en permettant à ces dernières la bonne prise en compte du traitement des extrémités
(photo 5).
Charte cyclable - Fédération française de cyclotourisme
Les cheminements mixtes
Beaucoup de collectivités utilisent alors la solution de “dépannage” : le cheminement mixte sur trottoir.
La photo n° 6 ci-dessous illustre bien cette situation à Strasbourg où pour le passage d'un pont, les cyclistes
sont “autorisés” à utiliser le trottoir pour rejoindre un carrefour à feux et ensuite avoir la possibilité d'em-
prunter une piste cyclable bidirectionnelle à la hauteur du trottoir (photo n° 7).
En ce qui concerne ce passage de pont, la décision (“supportée” par un arrêté municipal ) a été prise par rap-
port à la très faible densité de piétons constatée sur cet axe déplacement.
Nota : nous pouvons néanmoins nous poser la question suivante: En cas d'accident et de mise en
justice, que vaudra un tel arrêté vis à vis du Code de la Route actuel, si une autorisation de circu-
lation n'a pas été faite auprès de la CCDSA (Commission consultative départementale de sécurité
et d'accessibilités) ?
6 7
L'exemple allemand
Lors d'une visite récente à Strasbourg et ses environs, nous avons eu l'opportunité de voir plusieurs chemi-
nements mixtes. La photo n° 8 nous montre celui réalisé sur un bras du Rhin en direction de la commune de
Kehl. Celui-ci réalisé sur une passerelle en est une autre illustration, où le cheminement des cyclistes est au-
torisé avec les piétons, alors que la réciprocité exclusive pour les piétons existe sur la passerelle sur le “côté
opposé” avec une jonction de rive à un niveau différent mais relié entre eux . Culture différente, mais aussi
règles légales et administratives différentes…
Plus loin, la rentrée dans Kehl se fait sur le même principe (photo 9)
Charte cyclable - Fédération française de cyclotourisme
Les cheminements mixtes
Les exemples britanniques
Dans ce pays, il existe beaucoup de passerelles pour franchir les voies rapides. Pour une nouvelle passerelle
cyclistes/piétons, les Britanniques préconisent une largeur minimum de 2,70 m (1,20 m pour les piétons,
1,50 m pour les cyclistes), tout en précisant qu'une largeur de 3,50 m est préférable. Cependant, il existe de
nombreuses passerelles en périphérie d'agglomération où la largeur utilisable atteint seulement 2 m
(photos 10 et 11).
10 11
Si les trafics piétons/cyclistes sont peu importants et les pentes de l'ouvrage faibles, une largeur de 2 m est
suffisante pour permettre aux cyclistes/piétons de se croiser correctement.
Pour ce type d'ouvrage, il est parfois nécessaire de raccorder le niveau d'utilisation par des escaliers. Ceux-
ci seront alors munis d'une goulotte, ce qui permet au cycliste de monter et descendre en poussant son
vélo (photo 12).
12
➲ Les demandes de la FFCT :
Afin de répondre d'une part à la généralité de ces aménagements mixtes, et d'au-
tres part à la particularité de certains cas restant à définir, tels que:
• la faible densité potentielle de l'un ou des deux usagers, piétons ou cyclistes
• les problèmes techniques (argumentés et chiffrés) liés aux manques d'emprise
que ce soit sur et sous ouvrage contraint) ou en section courante,
nous demandons que des règles précises soient définies pour la réalisation de tels
aménagements cyclables et piétonniers, la création d'un nouveau panneau de po-
lice, ainsi que leur définition au Code de la route.
Il va sans dire que la décision finale d'application d'un tel aménagement, devra être
validée systématiquement suite à une demande faite auprès de la CCDSA.
Charte cyclable - Fédération française de cyclotourisme
Vous aimerez peut-être aussi
- Avenir de l’automobile: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandAvenir de l’automobile: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Voie Ferrée PDFDocument41 pagesVoie Ferrée PDFAhmed Bougacha67% (6)
- DT3944 - Les Trottoirs Sur Les Ponts Et Aux Abords ImmediatsDocument50 pagesDT3944 - Les Trottoirs Sur Les Ponts Et Aux Abords ImmediatsbriankimbjPas encore d'évaluation
- Voie Ferrée-Chemin de FerDocument41 pagesVoie Ferrée-Chemin de FerKoffi Jean-Jacques Goli100% (2)
- 11.excavation Et TrancheefDocument34 pages11.excavation Et TrancheefHamid KhoutnaPas encore d'évaluation
- Aménagements Pour Les VélosDocument40 pagesAménagements Pour Les VélosDaval Bruno100% (1)
- Dimensionement Des ChausseeDocument40 pagesDimensionement Des ChausseeYounes Adda100% (5)
- Autourote en AlgerieDocument15 pagesAutourote en AlgerieNöah100% (1)
- Cours de RoutesDocument79 pagesCours de RoutesCyrille Jefedjie Fezeu100% (1)
- Dimensionnement D'une PasserelleDocument35 pagesDimensionnement D'une PasserelleHamzaBftlPas encore d'évaluation
- Guide D'aménagement de La Voirie.Document50 pagesGuide D'aménagement de La Voirie.Sherif Running AwayPas encore d'évaluation
- Profil en LongDocument22 pagesProfil en LongGenie0% (1)
- Dimensions-Cohérence Des DimensionsDocument27 pagesDimensions-Cohérence Des DimensionsAlexis DesagePas encore d'évaluation
- Guide Technique L'éclairage Des Carrefours À Sens GiratoireDocument68 pagesGuide Technique L'éclairage Des Carrefours À Sens GiratoirethebaudPas encore d'évaluation
- Carrefour Giratoire 2Document22 pagesCarrefour Giratoire 2Kawtar AddalPas encore d'évaluation
- Rapport Accidents Tramway 2013Document46 pagesRapport Accidents Tramway 2013solideo85Pas encore d'évaluation
- Guide Aménagement Bandes-Pistes-Cyclables-Charte-CyclableDocument6 pagesGuide Aménagement Bandes-Pistes-Cyclables-Charte-CyclableMouna DeghaliPas encore d'évaluation
- MTQ - Guide D'application Rue Partagée - 2019Document16 pagesMTQ - Guide D'application Rue Partagée - 2019mateusz.kowalczykPas encore d'évaluation
- Annexe 3 Recommandations Techniques Du CEREMADocument9 pagesAnnexe 3 Recommandations Techniques Du CEREMAImane OuzeralaPas encore d'évaluation
- Les Autres UsagersDocument25 pagesLes Autres UsagersKa MarkotingPas encore d'évaluation
- Dossier de Presse Rue Du LéguéDocument4 pagesDossier de Presse Rue Du LéguéCamille NdrPas encore d'évaluation
- Espaces Partages Entre Pietons Et Cyclistes RdADocument8 pagesEspaces Partages Entre Pietons Et Cyclistes RdATaGaDaPas encore d'évaluation
- Dossier Technique Double Sens Cyclable MazagranDocument6 pagesDossier Technique Double Sens Cyclable MazagranJerod LeonPas encore d'évaluation
- Berthod FDocument18 pagesBerthod FHéctor Estruch PérezPas encore d'évaluation
- 003 Cours Carrefour GHAFFARDocument10 pages003 Cours Carrefour GHAFFARMaimouna RadjaiPas encore d'évaluation
- VPT 18032010 Cle7868a3Document25 pagesVPT 18032010 Cle7868a3TaGaDaPas encore d'évaluation
- Fi04120 Velo f41 VelostrasDocument12 pagesFi04120 Velo f41 VelostrasLCVR 14Pas encore d'évaluation
- PDF CarffourDocument44 pagesPDF Carffouranass.s2elPas encore d'évaluation
- 09 PRESTO Infrastructure Fiche Action Carrefours GiratoiresDocument7 pages09 PRESTO Infrastructure Fiche Action Carrefours GiratoiresEttr TtrPas encore d'évaluation
- FI01719 Amenagement Carrefour F07 GiratoireDocument12 pagesFI01719 Amenagement Carrefour F07 GiratoireTaGaDaPas encore d'évaluation
- Fiches Cyclabilite 2022Document69 pagesFiches Cyclabilite 2022Amina HASSASPas encore d'évaluation
- r79 Les Pistes Cyclables - La Solution BetonDocument8 pagesr79 Les Pistes Cyclables - La Solution BetonkaoutarPas encore d'évaluation
- Chapitre I VoirieDocument24 pagesChapitre I VoirieDominique KouekamPas encore d'évaluation
- Carrefours A FeuxDocument7 pagesCarrefours A Feuxgoaltoday50% (2)
- AmenagementsCyclablesProvisoires-VF CeremaDocument23 pagesAmenagementsCyclablesProvisoires-VF CeremabobPas encore d'évaluation
- Cour N°2Document7 pagesCour N°2Chahinez AllaliPas encore d'évaluation
- IBSR Fiche CVCB-2Document4 pagesIBSR Fiche CVCB-2TaGaDaPas encore d'évaluation
- Ameliorer La Securite Et Reduire La Vitesse en AggloDocument139 pagesAmeliorer La Securite Et Reduire La Vitesse en AggloHammoutiPas encore d'évaluation
- Code de La RueDocument17 pagesCode de La RueTaGaDaPas encore d'évaluation
- 1127T10 - Les Poids LourdsDocument4 pages1127T10 - Les Poids LourdsTaGaDaPas encore d'évaluation
- Carrefours - Giratoires UrbainsDocument6 pagesCarrefours - Giratoires UrbainsNour YacinePas encore d'évaluation
- Travail PratiqueDocument28 pagesTravail PratiqueKeren KILIBANGAPas encore d'évaluation
- Cou Rs de Rou Ecole Nat. Sup. Des TP Yaounde Cameroun - WatermarkDocument79 pagesCou Rs de Rou Ecole Nat. Sup. Des TP Yaounde Cameroun - WatermarkAly OuedryPas encore d'évaluation
- Chap1 Les Travaux de VoiriesDocument16 pagesChap1 Les Travaux de Voiriesfructenn championPas encore d'évaluation
- Trottinetteselectriqueschangements 2022 FRDocument2 pagesTrottinetteselectriqueschangements 2022 FRNatalia GalasPas encore d'évaluation
- Voirie Urbaine: Voiries UrbainesDocument11 pagesVoirie Urbaine: Voiries UrbainesAbderrahim BoulanouarPas encore d'évaluation
- Parc Rambot Recours Gracieux HGDocument14 pagesParc Rambot Recours Gracieux HGDemocratie pour AixPas encore d'évaluation
- Guide Voirie Et Aménagements CyclablesDocument164 pagesGuide Voirie Et Aménagements CyclablesDaRKoS1969Pas encore d'évaluation
- Les Aires Piétonnes - MémoireDocument28 pagesLes Aires Piétonnes - MémoireKhaled BentalhaPas encore d'évaluation
- Chapitre IV VRD 2017-2018 - LES VOIRIES2Document87 pagesChapitre IV VRD 2017-2018 - LES VOIRIES2RamiPas encore d'évaluation
- Chapitre IV VRD 2020-2021 - Les Voiries 20-21Document94 pagesChapitre IV VRD 2020-2021 - Les Voiries 20-21faouziaPas encore d'évaluation
- CH2 Les Voiries PDFDocument9 pagesCH2 Les Voiries PDFAbdennour MammerinePas encore d'évaluation
- Cir Rout Chap 4Document47 pagesCir Rout Chap 4Abou SoroPas encore d'évaluation
- Autres Usagers de La RouteDocument5 pagesAutres Usagers de La RoutetitiPas encore d'évaluation
- Amenagement-Points-D - Arret BusDocument52 pagesAmenagement-Points-D - Arret BusfffPas encore d'évaluation
- Giratoires Et Bus A Haut Niveau de Service BHNSDocument95 pagesGiratoires Et Bus A Haut Niveau de Service BHNSyoussef.abidar2015Pas encore d'évaluation
- Introduction Chap 1Document4 pagesIntroduction Chap 1mussariPas encore d'évaluation
- Géfra: - Jumelage Des Plates-Formes Ferroviaires Et Routières Ou AutoroutièresDocument46 pagesGéfra: - Jumelage Des Plates-Formes Ferroviaires Et Routières Ou AutoroutièresAhmed HLPas encore d'évaluation
- Présentation1 Trafic Avantages Inconvenient SolutionsDocument14 pagesPrésentation1 Trafic Avantages Inconvenient SolutionsMarouane EzzaimPas encore d'évaluation
- Mobilités : changer de modèle: Solutions pour des déplacements bas carbone et équitablesD'EverandMobilités : changer de modèle: Solutions pour des déplacements bas carbone et équitablesPas encore d'évaluation
- Guide d'aménagement et de gestion : Parcs de planche à roulettes: Efficients et efficaces - Accessibles et sécuritaires - Adaptés au loisir des usagersD'EverandGuide d'aménagement et de gestion : Parcs de planche à roulettes: Efficients et efficaces - Accessibles et sécuritaires - Adaptés au loisir des usagersPas encore d'évaluation
- Les 8 Recommandations Du Cerema - WCF-50-PPT-CEREMA-partie-1Document14 pagesLes 8 Recommandations Du Cerema - WCF-50-PPT-CEREMA-partie-1TaGaDaPas encore d'évaluation
- Formations La GazetteDocument36 pagesFormations La GazetteTaGaDaPas encore d'évaluation
- Accès Cyclable IKEA - État ExistantDocument1 pageAccès Cyclable IKEA - État ExistantTaGaDaPas encore d'évaluation
- Conges AnnuelsDocument3 pagesConges AnnuelsTaGaDaPas encore d'évaluation
- Plan D'implantation Abri CoomaDocument1 pagePlan D'implantation Abri CoomaTaGaDaPas encore d'évaluation
- Accès Cyclable IKEA - Traversées Parallèles Et Petit RefugeDocument1 pageAccès Cyclable IKEA - Traversées Parallèles Et Petit RefugeTaGaDaPas encore d'évaluation
- Annexe 3 Recommandations Techniques Du CeremaDocument27 pagesAnnexe 3 Recommandations Techniques Du CeremaTaGaDaPas encore d'évaluation
- Le Profil en TraversDocument23 pagesLe Profil en TraversTaGaDaPas encore d'évaluation
- Accès Cyclable IKEA - Traversée Et PlateauDocument1 pageAccès Cyclable IKEA - Traversée Et PlateauTaGaDaPas encore d'évaluation
- Accès Cyclable IKEA - Traversées Séparées V2-ObjetDocument1 pageAccès Cyclable IKEA - Traversées Séparées V2-ObjetTaGaDaPas encore d'évaluation
- Savonnières - Picto LaVDocument1 pageSavonnières - Picto LaVTaGaDaPas encore d'évaluation
- Annexes - Au .Guide .Amenagements - Sur .Routes - DepartementalesDocument132 pagesAnnexes - Au .Guide .Amenagements - Sur .Routes - DepartementalesTaGaDaPas encore d'évaluation
- Vitesseetpanneauagglo Cle6999caDocument12 pagesVitesseetpanneauagglo Cle6999caTaGaDaPas encore d'évaluation
- Annexes Reglement Voirie Departementale 1205Document90 pagesAnnexes Reglement Voirie Departementale 1205TaGaDaPas encore d'évaluation
- Accès Cyclable IKEA - Traversées Séparées-ObjetDocument1 pageAccès Cyclable IKEA - Traversées Séparées-ObjetTaGaDaPas encore d'évaluation
- Reglement Voirie Departementale 1205Document66 pagesReglement Voirie Departementale 1205TaGaDaPas encore d'évaluation
- f38 Microregulation WebDocument8 pagesf38 Microregulation WebTaGaDaPas encore d'évaluation
- Sortileges Mauvaises ReponsesDocument2 pagesSortileges Mauvaises ReponsesTaGaDaPas encore d'évaluation
- Profils en Travers CLDocument13 pagesProfils en Travers CLTaGaDaPas encore d'évaluation
- Catalogue Cerema 2018Document24 pagesCatalogue Cerema 2018TaGaDaPas encore d'évaluation
- Changements BB2020Document16 pagesChangements BB2020TaGaDaPas encore d'évaluation
- AccidentologieDocument186 pagesAccidentologieChawki ZerroukiPas encore d'évaluation
- Classification RoutesDocument4 pagesClassification RoutesRabbii AmanakouPas encore d'évaluation
- Conclusion: Chapitre I-Le Régime Juridiques de La ConteneurisationDocument10 pagesConclusion: Chapitre I-Le Régime Juridiques de La ConteneurisationHamda Mohamed100% (2)
- SodaPDF Converted Dzexams 3am Francais E1 20200 356333Document4 pagesSodaPDF Converted Dzexams 3am Francais E1 20200 356333Nesrine BoulesnamPas encore d'évaluation
- Rapport Securite Aerienne 2020Document60 pagesRapport Securite Aerienne 2020Meryem FaddalPas encore d'évaluation
- V3 IATG-08.10 FRDocument29 pagesV3 IATG-08.10 FRayoubPas encore d'évaluation
- Analyse de La Circulation RoutièreDocument26 pagesAnalyse de La Circulation RoutièreAbdoul Fatré KienouPas encore d'évaluation
- Spa de Levage-1Document1 pageSpa de Levage-1ridamerdan89Pas encore d'évaluation
- Liste Matériel Bge KharroubDocument12 pagesListe Matériel Bge Kharroubyoussef EL KHAYATIPas encore d'évaluation
- Detroit de MessineDocument31 pagesDetroit de Messineaminmebarki7Pas encore d'évaluation
- Reval Pont Nav Quart PasserelleDocument4 pagesReval Pont Nav Quart Passerellekarim wahraniPas encore d'évaluation
- Signalisation HorizontaleDocument2 pagesSignalisation HorizontaleFofana NH YoussoufPas encore d'évaluation
- PCSI-TIPE AirbagDocument12 pagesPCSI-TIPE AirbagRachid BenjalouajaPas encore d'évaluation
- Le ConducteurDocument11 pagesLe ConducteurjosianzabaPas encore d'évaluation
- Techniques de DesincarcerationDocument32 pagesTechniques de DesincarcerationÁngel BarrioPas encore d'évaluation
- Integral 177Document88 pagesIntegral 177SARRPas encore d'évaluation
- Panneaux de DangerDocument2 pagesPanneaux de DangerBryan NoumiPas encore d'évaluation
- BoureuseDocument11 pagesBoureuseNoureddine SlimaniPas encore d'évaluation
- SNCF Réseau - Maîtrise de La Végétation - Réseau Ferré NationalDocument14 pagesSNCF Réseau - Maîtrise de La Végétation - Réseau Ferré NationalGlodi AlbiniPas encore d'évaluation
- Code AutoécoleDocument9 pagesCode Autoécoletsilavinarakotomavo2002Pas encore d'évaluation
- Securite de Quai ExpressoDocument7 pagesSecurite de Quai Expressozouahi oualidPas encore d'évaluation
- Code UicDocument21 pagesCode UiclatyrniangPas encore d'évaluation
- Nep2010 2 Amour Zinsou Port de CotonouDocument11 pagesNep2010 2 Amour Zinsou Port de CotonouThierryPas encore d'évaluation
- Les Normes Et Réglementations Routes Et VRDDocument7 pagesLes Normes Et Réglementations Routes Et VRDsnake10042003Pas encore d'évaluation
- Gestion de ParcDocument3 pagesGestion de Parcjonathan.monde200Pas encore d'évaluation
- METL en Chiffres Version FR 28052015Document36 pagesMETL en Chiffres Version FR 28052015Ayman AymanPas encore d'évaluation
- Cerfa 14024-01Document2 pagesCerfa 14024-01BENZPas encore d'évaluation
- 02 CG AéDocument31 pages02 CG AéJean PreiraPas encore d'évaluation