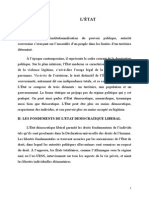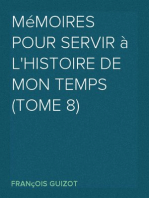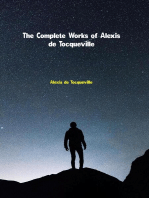Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
RI-Synthèse2-Q5-Yxz
RI-Synthèse2-Q5-Yxz
Transféré par
zhouyaxinmtlCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
RI-Synthèse2-Q5-Yxz
RI-Synthèse2-Q5-Yxz
Transféré par
zhouyaxinmtlDroits d'auteur :
Formats disponibles
Yaxin ZHOU
Quand en 1979, Waltz a introduit la notion de structure internationale en RI, les États souverains
étaient ses objets d’études principaux. Pour Waltz, cela ne relève que de l’évidence : ce sont les
États qui décident de la guerre et de la paix, ils ont fait émerger un système d’anarchie
internationale et c’est sur eux que la pression systémique pèse (Waltz, 1979). Vingt ans après,
Wendt a précisé que l’anarchie systémique à la Waltz est en fait une anarchie westphalienne, une
anarchie non sans normes, une anarchie dans laquelle les États s’interagissent entre eux et avec la
dynamique systémique : les États se mettent d’accord sur la reconnaissance mutuelle et sur des
règles interétatiques, ils construisent et sont construits par la structure anarchique (Wendt, 1999).
Pour Waltz et Wendt, les États et la structure internationale, sont de toute évidence, les objets
principaux en RI. Cependant, cette approche état-centrique et euro-centrique est-elle encore
pertinente avec la décolonisation et la globalisation ? À une époque où la légitimité même des
termes l’État, la souveraineté et la structure internationale sont remis en question, à l’intérieur
comme à l’extérieur des territoires souverains, la réponse me semble négative.
Au tournant du 20e siècle, à la lumière de la globalisation et de la décolonisation, les débats
autour des États souverains et de la structure internationale ont été relancés. Néanmoins, cette fois-
ci, la dynamique était tout autre. Plutôt que de prendre les relations interétatiques et les États pour
acquis, un nombre croissant de chercheurs se questionnaient sur l’origine de ces deux constructions
politiques et sur le pouvoir qu’elles introduisent et font internaliser dans la communauté
internationale. D’abord, l’origine et la légitimité des États souverains sont réexaminées en
profondeur. Dans Sovereignty : organized hypocricy, Krasner a distingué quatre types de
souveraineté étatique, à savoir la souveraineté légale internationale, la souveraineté westphalienne,
la souveraineté domestique et la souveraineté d’interdépendance (Krasner, 1999). Si les deux
premières souverainetés étatiques sont assurées par la reconnaissance mutuelle des autres États
1 Les États et la structure internationale à l’ère post-coloniale et de globalisation (T2-Q5)
Yaxin ZHOU
souverains (et donc sont assurées par l’autorité des États sur la scène internationale), les deux
dernières sont garanties par l’autorité mais aussi par le contrôle effectif sur le territoire (Krasner,
1999). Cependant, force est de constater que les deux penchants de la souveraineté étatique :
externe et interne sont tous les deux menacés à l’ère de la globalisation. La souveraineté externe,
incluant la reconnaissance légale internationale (la souveraineté légale internationale) et la
territorialité et l’exclusion d’intervention extérieure (la souveraineté westphalienne), est défiée par
les États souverains eux-mêmes : par la convention ou le contrat quand les États choisissent de
céder une partie de leurs souverainetés en faveur des autres intérêts ; et par la coercition ou
l’imposition quand les États sont forcés d’accepter la concession sur leurs souverainetés par les
contraintes matérielles ou par la menace d’existence (Krasner, 1999). Dans toutes ces quatre
déviations des souverainetés externes, les États souverains, bon gré ou mal gré, amenuisent
l’exclusivité de leurs souverainetés, à un degré divers.
La souveraineté interne quant à elle, voit sa légitimité s’effriter à mesure que le pouvoir
étatique sur le territoire se décentralise et se disperse au sein de la société, au profit des acteurs
non étatiques et privés (Strange, 1996). Les États souverains, semblerait-il, ne jouissent désormais
plus d’une autorité absolue, leurs retraits sur la scène internationale et dans la vie quotidienne des
citoyens amènent Susan Strange à parler du déclin des États (Strange, 1996). Dans The Retreat of
the State, Susan Strange a constaté que la relation État-marché a complètement changé au
détriment de l’État avec la globalisation : la force du marché mondial agit par la finance, la
technologie et le commerce et cette force transforme la relation État-Marché-Société dans deux
sens : (1) L’État perd progressivement ses compétences exclusives sur les affaires régaliennes : la
sécurité, la monnaie, la taxation etc., (2) L’État n’arrive pas à exercer un contrôle efficace sur les
nouveaux défis. Dans tous ses sens du terme, la souveraineté se détache de l’État en même temps
2 Les États et la structure internationale à l’ère post-coloniale et de globalisation (T2-Q5)
Yaxin ZHOU
que les différents aspects de la souveraineté sont exercés et assumés de manière différente par les
acteurs non-étatiques (Strange, 1996).
Ensuite, avec le changement de rapport de force entre l’État et les autres acteurs, la
structure internationale se transforme en structure globale dans laquelle les politiques
deviennent une activité commune de tous les agents globaux. Cette transition vers une structure
globale a commencé dans un premier temps par une prise de conscience de la hiérarchie et
l’injustice derrière la structure internationale qui pourtant se prétend anarchique. Dans Regimes of
Soverignty : International Morality and the Africain Condition, Grovogui se questionnait sur la
légitimité du système westphalien international : à qui en fait profit le régime de souveraineté ? En
comparant le processus de l’établissement du régime westphalien en Belgique et en Suisse d’un
côté et celui du Congo de l’autre, Grovogui a démontré que le régime de souveraineté et ses règles
découlées que les chercheurs en RI considèrent souvent comme allant de soi, légitimes et
universelles ne sont que le produit des intérêts et des désirs des pays occidentaux (Grovogui, 2002).
Autant dans le cas de la Belgique et de la Suisse, ce régime de souveraineté était le résultat de
l’équilibrage du pouvoir des grandes puissances, autant ce régime constitue aujourd’hui une excuse
pour blanchir le passé colonial des pays européens et pour justifier leur néo-colonialisme : ils
déplorent l’état en faillite des pays africains, selon leurs critères westphaliens. Ils y interviennent
et instaurent un régime de souveraineté, un régime qui fonctionne et qui aurait fait de ces pays
africains de vrais États. Grovogui a ainsi dénoncé la hiérarchie et la condescendance systémiques
internalisées dans le régime de souveraineté, ce régime sert à la fois à légitimer les pouvoirs
occidentaux et à délégitimer les autres régimes politiques : pour avoir une reconnaissance du
système international (qui est en fait de nature westphalienne), il faut d’abord devenir un joueur
westphalien et donc se soumets aux intérêts des pays qui le sont déjà.
3 Les États et la structure internationale à l’ère post-coloniale et de globalisation (T2-Q5)
Yaxin ZHOU
Dans un deuxième temps, la transition passe de la révélation de la nature hiérarchique et
coloniale de la structure internationale actuelle à la reconception et la reconstruction d’une
nouvelle structure globale et inclusive. Dans son livre Global Indigenous Politics, A subtle
revolution, Lightfoot a décrit à quoi ressemble une telle structure. Comme Giovogui, Lightfoot a
commencé ses arguments par déconstruire la structure internationale actuelle : Il estime que la
structure actuelle ne devrait plus jouir de la même légitimité qu’elle en avait, car celle-ci ne traduit
qu’une distribution asymétrique et inégale du pouvoir entre les pays occidentaux d’un côté et les
peuples colonisés de l’autre. La structure internationale est, en fait un outil des colonisateurs pour
qui internaliser leur discours colonial et stabiliser le rapport de pouvoir (Lightfoot, 2016). Pour
remplacer cette structure westphalienne par une nouvelle structure globale et post-coloniale,
Lightfoot pensait à intégrer d’autres acteurs que les États occidentaux dans la communauté globale,
en l’occurrence les peuples autochtones. Longtemps laissés dans l’oubli, le combat que les peuples
indigènes mènent pour rentrer dans la structure internationale contribue en effet à transformer la
structure et les pratiques de politiques globales : (1) il contribue à élargir les droits humains pour
inclure les droits collectifs qui revendiquent à la fois les droits doux, à savoir la culture, l’éducation,
la langue, l’identité et la spiritualité ; et les droits durs, à savoir le droit au territoire et le droit à
l’autodétermination d’un entité non-étatique ; (2) il pousse à réfléchir sur les termes centraux en
RI, sur le pouvoir derrière ces termes et sur leur pertinence dans une ère post-coloniale et de
globalisation, comme l’État, le libéralisme et la diplomatie, pour n’en citer que quelque uns ; (3)
il favorise le changement de paradigme dans la perspective des normes internationales : les normes
n’émergent pas nécessairement des États mais aussi des autre acteurs non-étatiques et avec ces
derniers, l’ordre politique mondial peut se concevoir de manière différente pour se détacher
désormais d’une approche euro-centrique et état-centrique.
4 Les États et la structure internationale à l’ère post-coloniale et de globalisation (T2-Q5)
Yaxin ZHOU
On aurait compris, le regard vers les États, la souveraineté et le système international a
complètement changé, l’époque où l’État pouvait réclamer ses prérogatives sur les affaires
domestiques et internationales est révolue. Aujourd’hui, la légitimité de l’État est contestée à deux
degrés. Le premier degré consiste à déplorer le déclin des États dans sa capacité d’assumer et
d’exercer ses responsabilités sur les dossiers nationaux et internationaux. Les États doivent
désormais composer avec d’autres acteurs non-étatiques à l’intérieur comme à l’extérieur de leurs
frontières. Le deuxième degré représente une approche plus critique qui s’intéresse aux
conséquences néfastes de ce système étatique westphalien sur les acteurs non-étatiques et sur les
États dits en faillite. L’approche euro-centrique est remise en question et le terme État même est
réexaminé avec une perspective post-coloniale. Quand Waltz concevait sa théorie de structure,
dans son imaginaire, cette construction métaphysique de structure est constante et stable, quoique
les États au sein de cette structure changent leurs comportements. Je serais curieuse de connaître
sa réponse sur la structure mondiale actuelle où les États devraient composer avec la montée en
puissance des acteurs non-étatiques et que le régime de souveraineté en soi est délégitimé de tous
les sens.
Bibliographie
Grovogui, Siba N. “Regimes of Sovereignty: International Morality and the African Condition.”
European Journal of International Relations 8, no. 3 (September 1, 2002): 315–38.
https://doi.org/10.1177/1354066102008003001.
Krasner, Stephen D. “Sovereignty and Its Discontents.” In Sovereignty: Organized Hypocrisy.
Princeton: Princeton University Press, 1999. https://www.jstor.org/stable/j.ctt7s9d5.
Lightfoot, Sheryl R. “Indigenous Politics as Global Change.” In Global Indigenous Politics: A
Subtle Revolution. London: Routledge, 2016. https://www.routledge.com/Global-
Indigenous-Politics-A-Subtle-Revolution/Lightfoot/p/book/9781138477858.
———. “Post-Colonial Completion, a New Vision of What the Post-Colonial Can and Should
Mean.” In Global Indigenous Politics : A Subtle Revolution. London: Routledge, 2016.
5 Les États et la structure internationale à l’ère post-coloniale et de globalisation (T2-Q5)
Yaxin ZHOU
Strange, Susan. “The Declining Authority of States.” In The Retreat of the State. Cambridge:
Cambridge University Press, 1996. https://www.cambridge.org/core/books/retreat-of-the-
state/7DD0CC1340A7BC649FD9671BF2ACBE94.
———. “The State of the State.” In The Retreat of the State. Cambridge: Cambridge University
Press, n.d.
Waltz, Kenneth N. “Anarchic Orders and Balances of Power.” In Theory of International Politics.
Sydney: Addison-Wesley Publishing Company, 1979.
Wendt, Alexander. “The State and the Problem of Corporate Agency.” In Social Theory of
International Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
6 Les États et la structure internationale à l’ère post-coloniale et de globalisation (T2-Q5)
Vous aimerez peut-être aussi
- Dictionnaire Des Relations InternationalesDocument66 pagesDictionnaire Des Relations InternationalesYounes Kraifa100% (1)
- Dissertation 2Document9 pagesDissertation 2malak alyya100% (6)
- Corrige 2016 DCG Ue6 Finance D Entreprise v0106Document7 pagesCorrige 2016 DCG Ue6 Finance D Entreprise v0106MarimanePas encore d'évaluation
- DOC-20240430-WA0010.Document4 pagesDOC-20240430-WA0010.XERIXXUPas encore d'évaluation
- ENCG Systeme PolitiqueDocument8 pagesENCG Systeme PolitiqueAbdelkhalek OuassiriPas encore d'évaluation
- Relations Internationales 2 SemestreDocument25 pagesRelations Internationales 2 SemestreImane RouassiPas encore d'évaluation
- RI-S5-cours 5Document15 pagesRI-S5-cours 5zhouyaxinmtlPas encore d'évaluation
- Un Gouvernement Mondial Est Il Envisageable VieDocument1 pageUn Gouvernement Mondial Est Il Envisageable VieIldevert Mboutsou BouilaPas encore d'évaluation
- ÉtatDocument5 pagesÉtatMbaye Babacarish BanePas encore d'évaluation
- Relations Internationales v2Document69 pagesRelations Internationales v2j.sgdb91Pas encore d'évaluation
- 1 Les EtatsDocument30 pages1 Les EtatsGleb VitushokPas encore d'évaluation
- Relations InternationalesDocument14 pagesRelations Internationalescheikhou baPas encore d'évaluation
- 1 - Introduction Aux Relations InternationalesDocument3 pages1 - Introduction Aux Relations Internationalesdahmani lotfiPas encore d'évaluation
- 1 La Notion DEtatDocument10 pages1 La Notion DEtatflorentbrunet4488Pas encore d'évaluation
- Relations InternationalesDocument63 pagesRelations InternationalesAnjaranomenjanahary Sombiniaina Jasara AndryPas encore d'évaluation
- Relations InternationalesDocument11 pagesRelations InternationalesAndra Dăogaru-CrețanuPas encore d'évaluation
- Relations InternationalesDocument107 pagesRelations Internationalesj.sgdb91Pas encore d'évaluation
- Relations Internationales 4Document72 pagesRelations Internationales 4abdillahi.elanioouPas encore d'évaluation
- Relations Internationales 1Document7 pagesRelations Internationales 1célia btvlPas encore d'évaluation
- Qu'Est-ce Que L'état - AnakalyptoDocument6 pagesQu'Est-ce Que L'état - AnakalyptoiKa LuxicePas encore d'évaluation
- Relations Internationales-ConvertiDocument14 pagesRelations Internationales-ConvertiSalma AdraouiPas encore d'évaluation
- Systeme PolitiqueDocument110 pagesSysteme PolitiqueMohamed89% (9)
- Exposé 1 - L - État Dans Le Système InternationalDocument15 pagesExposé 1 - L - État Dans Le Système InternationalClemPas encore d'évaluation
- td2 Fini Constit PDFDocument7 pagestd2 Fini Constit PDFHélène Dabert LatapyPas encore d'évaluation
- La Genèse Du Pouvoir Politique Et La Constitution de LDocument7 pagesLa Genèse Du Pouvoir Politique Et La Constitution de LmeryemelkobbaPas encore d'évaluation
- L'Etat ImportéDocument10 pagesL'Etat Importégueye100% (1)
- Cours de Sociologie de l'Etat-2Document62 pagesCours de Sociologie de l'Etat-2tsd7mqdvtmPas encore d'évaluation
- Note Cours 8 FévrierDocument7 pagesNote Cours 8 Févrieraudrey dufort-savardPas encore d'évaluation
- Relations Internationales - PDF-1Document28 pagesRelations Internationales - PDF-1tsirofiarifeno60Pas encore d'évaluation
- ExtraitDocument9 pagesExtraitSteeven VillagePas encore d'évaluation
- Relations Internationales Africaines A. Définition Des RIA: Les RIA Se Définissent Comme Un Ensemble Des RapportsDocument3 pagesRelations Internationales Africaines A. Définition Des RIA: Les RIA Se Définissent Comme Un Ensemble Des Rapportsdavidmulenda238Pas encore d'évaluation
- Chapitre 2 SCIENCE POLITIQUEDocument8 pagesChapitre 2 SCIENCE POLITIQUElinabamba84Pas encore d'évaluation
- Chap2 Etat Comme InstitutionDocument7 pagesChap2 Etat Comme InstitutionOuissal EilaPas encore d'évaluation
- Instit Internationales L1Document77 pagesInstit Internationales L1Adam BENHMIMPas encore d'évaluation
- Syllabus Marie-SoDocument126 pagesSyllabus Marie-SoAlexia LouisPas encore d'évaluation
- 2023 Chapitre 2 OrganiserDocument32 pages2023 Chapitre 2 OrganiserClara-Maria LaredoPas encore d'évaluation
- Cours de Science PolitiqueDocument28 pagesCours de Science Politiqueandry michaël RajaoharisonPas encore d'évaluation
- Cours de Droit International Public - PR TCHEUWA Jean Claude - Campus Principal de Soa - DF2Document52 pagesCours de Droit International Public - PR TCHEUWA Jean Claude - Campus Principal de Soa - DF2claude konde100% (1)
- Dissert PDFDocument8 pagesDissert PDFTatiana CardonPas encore d'évaluation
- TD 3 Né Orã© AlismeDocument2 pagesTD 3 Né Orã© AlismeLexance OkyeriPas encore d'évaluation
- Relations Internationales Semestre I (Cours)Document15 pagesRelations Internationales Semestre I (Cours)kirladjoPas encore d'évaluation
- Un Monde Sans SouverainetéDocument263 pagesUn Monde Sans SouverainetémugemaPas encore d'évaluation
- Auteurs et concepts de sciences politiquesDocument12 pagesAuteurs et concepts de sciences politiquesqhqrvtjpfqPas encore d'évaluation
- Relations Internationales — WikipédiaDocument37 pagesRelations Internationales — WikipédiaLandry KouamPas encore d'évaluation
- Introduction Aux Relations InternationalesDocument32 pagesIntroduction Aux Relations Internationaleslau_18100% (1)
- Pouvoir Et Contre-Pouvoir À L'ère de La MondialisationDocument8 pagesPouvoir Et Contre-Pouvoir À L'ère de La MondialisationFenzi2013Pas encore d'évaluation
- Elements Fondamentaux Du Droit Constitutionnel ClassiqueDocument26 pagesElements Fondamentaux Du Droit Constitutionnel ClassiquekabbouriPas encore d'évaluation
- PPT-RI CompressedDocument22 pagesPPT-RI Compressedtomris bayraktutarPas encore d'évaluation
- ExtraitDocument9 pagesExtraitManal TataPas encore d'évaluation
- Cours - Histoire de L'anthropologie PolitiqueDocument45 pagesCours - Histoire de L'anthropologie PolitiqueEdouard KachPas encore d'évaluation
- Droit International PrivéDocument53 pagesDroit International PrivéSélène HéliorePas encore d'évaluation
- La naissance de l'état en occidentDocument5 pagesLa naissance de l'état en occidentLisa JuinPas encore d'évaluation
- Chapitre 4 Élève SecondeDocument13 pagesChapitre 4 Élève SecondeServiteur d’AllahPas encore d'évaluation
- UntitledDocument45 pagesUntitledRafael KebadianPas encore d'évaluation
- Sociologie PolitiqueDocument29 pagesSociologie PolitiqueMayeul Mazars-GirardetPas encore d'évaluation
- 487 1187 1 PBDocument34 pages487 1187 1 PBYangoPas encore d'évaluation
- TD ConstitDocument14 pagesTD ConstitSabrina MlkPas encore d'évaluation
- Mémoires pour servir à l'Histoire de mon temps (Tome 8)D'EverandMémoires pour servir à l'Histoire de mon temps (Tome 8)Pas encore d'évaluation
- De la Démocratie en Amérique, tome deuxièmeD'EverandDe la Démocratie en Amérique, tome deuxièmeÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (54)
- La démondialisation ou le chaos: Démondialiser, décroître et coopérerD'EverandLa démondialisation ou le chaos: Démondialiser, décroître et coopérerPas encore d'évaluation
- 8 PSGBohuietVol046201850 58Document10 pages8 PSGBohuietVol046201850 58Chiraz BouzidiPas encore d'évaluation
- Ebook VintedDocument72 pagesEbook Vintedmath mrlPas encore d'évaluation
- Compo 2em LleDocument2 pagesCompo 2em Lledihia0% (1)
- L'alimentation Bio Réduit Sensiblement Les Risques de CancerDocument42 pagesL'alimentation Bio Réduit Sensiblement Les Risques de CancerhasnaiboucettaPas encore d'évaluation
- Histoire de La Médecine Au Maroc Antique: Parb. BelkamelDocument10 pagesHistoire de La Médecine Au Maroc Antique: Parb. Belkamelchohra khaledPas encore d'évaluation
- MOUKHALISS Mehdi LST Techniques DanalyseDocument28 pagesMOUKHALISS Mehdi LST Techniques Danalysekhalfi mustaphaPas encore d'évaluation
- Plantes M Dicinales Et Principes Actifs La Notion de Race ChimiqueDocument10 pagesPlantes M Dicinales Et Principes Actifs La Notion de Race Chimiquebrahim chalhoubPas encore d'évaluation
- Bac 3 ExhaureDocument14 pagesBac 3 ExhaureMayenge victoirePas encore d'évaluation
- LQL - Re - Certificat Pour Filler - MEAC Et PIKETTY - Avril 2016Document2 pagesLQL - Re - Certificat Pour Filler - MEAC Et PIKETTY - Avril 2016damien.ogerPas encore d'évaluation
- Chapitre 5 Géné À Courant ContinuDocument20 pagesChapitre 5 Géné À Courant Continupasteur1588% (8)
- IN 406-01-06 - Définition - Des - Niveaux - de - GerbageDocument5 pagesIN 406-01-06 - Définition - Des - Niveaux - de - GerbageOuidadPas encore d'évaluation
- Analyse Financiere Eniem 2010-2011-2012Document46 pagesAnalyse Financiere Eniem 2010-2011-2012Farid MohammediPas encore d'évaluation
- Plan Etudes Ti PDFDocument301 pagesPlan Etudes Ti PDFWassim LaabidiPas encore d'évaluation
- Magoe Cours Electronic 01Document96 pagesMagoe Cours Electronic 01mauricetappaPas encore d'évaluation
- Chap 9Document7 pagesChap 9bibi dancePas encore d'évaluation
- AFCONS - DESIGN - Design Basis Report - Francais - 2020-12-30Document24 pagesAFCONS - DESIGN - Design Basis Report - Francais - 2020-12-30Adrian FrantescuPas encore d'évaluation
- Devis Lot 1Document8 pagesDevis Lot 1Lamine TRAOREPas encore d'évaluation
- Les Pompes Et Amorceurs: SommaireDocument19 pagesLes Pompes Et Amorceurs: Sommairezyad chlyahPas encore d'évaluation
- Guide Bonnes Prévention BTP 5Document347 pagesGuide Bonnes Prévention BTP 5Ghassen BachaPas encore d'évaluation
- Supervision 68Document80 pagesSupervision 68lazizirosa23Pas encore d'évaluation
- Ch1 Introduction Aux Systemes EmbarquesDocument18 pagesCh1 Introduction Aux Systemes EmbarquesImene DjariPas encore d'évaluation
- Plan Du Travail: La Satisfaction Relationnelle Chez Les Couples Ayant Un Enfant LeucémiqueDocument15 pagesPlan Du Travail: La Satisfaction Relationnelle Chez Les Couples Ayant Un Enfant LeucémiqueAmna BaltiPas encore d'évaluation
- Discours Environnement MatthewDocument1 pageDiscours Environnement MatthewPhilippe CosentinoPas encore d'évaluation
- 5e7f447ca666f VOCABULAIREDUJUDOKADocument11 pages5e7f447ca666f VOCABULAIREDUJUDOKASeghir AmarouchePas encore d'évaluation
- CoursadminDocument66 pagesCoursadminWil AdouPas encore d'évaluation
- Agence Congolaise Pour La Creation Des Entreprises Bulletin Des Statistiques Sur La Creation Des Entreprises Au Congo DE 2015 À 2021Document26 pagesAgence Congolaise Pour La Creation Des Entreprises Bulletin Des Statistiques Sur La Creation Des Entreprises Au Congo DE 2015 À 2021KOLASPas encore d'évaluation
- Documentation Com Ae200Document12 pagesDocumentation Com Ae200norichtatyPas encore d'évaluation
- Nestle FRDocument2 pagesNestle FRbess17100% (1)
- Produits SanteDocument155 pagesProduits Santecarye AriePas encore d'évaluation