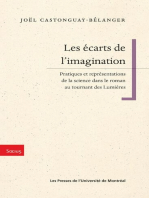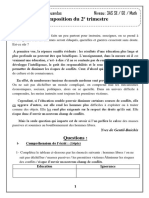Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Brunschwig Empiresetimprialismes 1965
Brunschwig Empiresetimprialismes 1965
Transféré par
Ota Benga BengaTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Brunschwig Empiresetimprialismes 1965
Brunschwig Empiresetimprialismes 1965
Transféré par
Ota Benga BengaDroits d'auteur :
Formats disponibles
Empires et impérialismes
Author(s): Henri Brunschwig
Source: Revue Historique , 1965, T. 234, Fasc. 1 (1965), pp. 111-122
Published by: Presses Universitaires de France
Stable URL: https://www.jstor.org/stable/40950064
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide
range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and
facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at
https://about.jstor.org/terms
Presses Universitaires de France is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend
access to Revue Historique
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 11:10:28 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Empires et impérialismes
Richard Kœbner, le médiéviste renommé pour ses travaux d'histoire
urbaine, fut chassé de l'Université de Breslau par les nationaux-socialistes
et obligé de s'intéresser à des problèmes que la documentation imprimée
permettait d'élucider, lorsqu'il enseigna à l'Université de Jérusalem.
Cela le conduisit à l'histoire diplomatique et à l'histoire coloniale. Il y
appliqua très scrupuleusement les techniques d'érudition et apporta,
dans ce que son disciple appelle avec peut-être un peu d'emphase sa
méthode sémantique, un soin particulier à réunir un très grand nombre de
références propres à déceler l'évolution du sens des termes politiques. Son
livre, Empire, a sans doute été plus documenté à Londres, où Kœbner
avait pris sa retraite, qu'en Israël. M. H. D. Schmidt en a revu le manuscrit
après la mort de l'auteur en 1958, et a utilisé les milliers de fiches laissées
par ce dernier, pour rédiger et compléter un autre volume sur l'im-
périalisme. La méthode sémantique nous paraît, en l'espèce, avoir
consisté à transférer en Angleterre Y Ideengeschichle qui, depuis un siècle,
a surtout prospéré en Allemagne. Rechercher l'origine d'un terme,
s'appliquer à déceler les diverses acceptions qu'il revêtit dans le temps et
dans l'espace, résumer les doctrines qu'il engendra et les polémiques
auxquelles celles-ci donnèrent lieu, ranimer les sentiments éveillés par
ces idées et les passions qui en résultèrent, expliquer ainsi les événements
que ces idées et ces passions provoquèrent, c'est, en somme, contribuer à
l'histoire de l'opinion publique. Celle-ci s'enflamme en effet pour certains
thèmes qui paraissent essentiels à certains peuples et à certains moments ;
distinguer le thème fondamental commun aux tendances diverses de
l'opinion, c'est révéler le critère d'une génération historique et mon-
trer pour quelle cause ses membres estimaient digne de vivre et de
mourir.
Il faut évidemment, pour exécuter un projet aussi ambitieux, des
connaissances étendues d'histoire générale et une vaste culture. Ceux qui
s'y essaient sont généralement gênés par le manque d'ouvrages consacrés
111
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 11:10:28 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Henri Branschwig
à la définition exacte de l'acception des termes politiques, dont le sens varie
si souvent. Des livres comme ceux de Kœbner et de M. Schmidt leur seront
donc particulièrement utiles.
L'un et l'autre des ouvrages en question pèchent cependant par la
même limitation de leur recherche au domaine britannique. Le médiéviste
Kœbner s'est appliqué à préciser le sens du mot latin imperituri. Il en suit
l'évolution, de la République à l'Empire romain, puis insiste sur la liaison
qui s'établit entre le concept impérial et le christianisme. Elle est accomplie
sous Charlemagne, dont l'Empire sacré prépare le Saint Empire romain-
germanique. Les humanistes, Italiens surtout, contribuèrent ensuite
à rendre au terme d'empire le sens de souveraineté que les différents
États adoptèrent, sans pour autant abandonner la référence géographique
au Saint Empire romain-germanique. Ainsi émerge l'idée d'un Empire
britannique à partir d'Henri VIII. Mais il y aurait lieu d'étudier aussi la
constitution des Empires portugais et espagnols, géographiquement
distincts du Saint Empire, puis des thèses du roi de France, « empereur en
son royaume ». L'auteur s'en tient à l'évolution du concept d'Empire en
Angleterre ; il signale le développement de l'idée d'Empire maritime et
analyse longuement les idées et les sentiments des Anglais et des colons
américains sur l'Empire jusqu'à la Révolution américaine. La plus grande
partie de l'ouvrage montre combien puissante était cette conscience
d'appartenir à une même communauté, chez Franklin par exemple ou chez
les Canadiens, aussi bien que chez Burke ou chez Adam Smith. Les mêmes
sentiments s'expriment à propos de l'Irlande au lendemain de l'indépen-
dance américaine.
Un bref chapitre sur l'Empire français, sur Napoléon et sur l'éclipsé
des empires après 1815, clôt ce livre qui apporte beaucoup de références,
mais paraît mal équilibré. Une allusion à Bodin ou à Grotius, dans le
chapitre sur les humanistes, nous laisse sur notre faim. Si l'auteur a
bien montré que, sous la Révolution française, « Empire » s'oppose à
« Monarchie », bien avant la création de l'Empire autocratique de Napoléon,
il ne recherche pas l'évolution du terme en France entre le xvie et le
xvine siècle. La France ne l'intéresse que par rapport à l'Angleterre et
parce que l'Empire de Napoléon Ier introduisit en Angleterre un sens
nouveau du mot Empire1.
Le volume rédigé par M. H. D. Schmidt est intitulé Impérialisme,
histoire et signification d'un terme politique. Terme qui, selon les recherches
de l'auteur, a changé de sens douze fois entre 1840 et 1960. D'origine
britannique, il désigna d'abord, en Angleterre, le régime politique institué
par Napoléon III. En France, le terme apparaît dans un Supplément au
Dictionnaire de VAcadémie, de F. Raymond en 1836, avec le sens de
1. Richard Kœbner, Empire, Cambridge, University Press, 1961, in-8°, vi-393 p.
112
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 11:10:28 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Empires et ìmpérialismes
« doctrine des impérialistes », ces derniers étant « partisans du gouver-
nement impérial ». Le complément du Dictionnaire de V Académie accepta
ces termes avec le même sens, en 1842. A ce moment, ils se référaient
évidemment à la légende napoléonienne, « impérialisme » ne se confondant
pas avec « bonapartisme » ; ce dernier terme désignait les rares partisans
de Louis-Napoléon, dont la conspiration avait lamentablement échoué à
Boulogne en 1840. Mais il y avait un « esprit impérialiste » auquel, après la
crise d'Egypte de 1840, les légitimistes firent allusion dans un article de La
Quotidienne du 21 décembre 1840 : « Le parti bonapartiste n'est plus rien.
Le parti impérialiste reste puissant... Le parti impérialiste, c'est le parti
militaire de l'Empire..., le parti de l'épée..., le parti de l'honneur. » La
Quotidienne a eu de 3 000 à 5 000 abonnés. Une Revue de V Empire, loyaliste
à l'égard de Louis-Philippe, vivifia entre 1842 et 1845 les souvenirs
du règne de Napoléon Ier. Louis-Napoléon, d'autre part, s'efforçait
d'opposer à la monarchie constitutionnelle ses Idées napoléoniennes, qui se
référaient à un « système impérial » propre à plaire aux militaires. Il y
aurait lieu de rechercher ici la liaison entre ce sentiment et cette doctrine,
encore vagues, de l'impérialisme et le nationalisme français, tels que nous
les rencontrons, à cette époque, surtout dans les milieux de la Marine et de
l'Armée. Après le coup d'État, impérialisme désigna clairement, en
Angleterre et en Allemagne comme en France, le système de gouvernement
français, autoritaire, militaire, égalitaire, et hostile à la liberté d'opinion.
Un Charles Dilke le définit bien lorsque dans son Greater Britain, publié
en 1868, il parla d'un impérialisme anglais installé dans l'Inde aux dépens
de l'aristocratie indigène : l'impérialisme, dit-il, est « un despotisme
exercé sur un peuple démocratique, comme nous le voyons en France...,
c'est l'égalité sous un despotisme paternel ».
Tel est le point de départ. Au cours des quatre chapitres qui suivent,
l'auteur étudie la genèse d'un sentiment impérial en Angleterre, où la
désinence d' « Empire britannique » s'appliquait dans la première moitié
du siècle soit au Royaume-Uni, soit à l'Angleterre et à ses colonies, soit
aux seules dépendances d'outre-mer. Les nombreux débats parlemen-
taires sur la fondation de nouvelles colonies blanches, sur leur statut
et sur leur avenir, les discussions sur l'abolition du parti colonial, la
concession de gouvernements responsables aux colonies, la défense des
dépendances, appelèrent constamment le terme d'empire sur les lèvres
et sous les plumes des hommes politiques, des fonctionnaires et des
publicistes.
Ces derniers, entre 1865 et 1872, achevèrent de rebritanniser le terme
en invoquant le sentiment impérial anglais. Un Thring ou un Dilke, en
constatant l'évidente communauté de civilisation, de langue et d'institu-
tions entre les peuples britanniques, estimaient ces liens suffisants et
considéraient l'indépendance comme le but logique de l'évolution des
113
REV. HIST. CCXXXIV. 1. 8
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 11:10:28 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Henri Brunschwig
colonies. Dilke glorifiait « l'Angleterre, mère de nations libres ». Disraeli
n'a pas, comme on le croit parfois, créé une nouvelle doctrine impérialiste.
Mais, engagé dans la défense des intérêts anglais en face des puissances, il
invoqua volontiers - dans son discours de Crystal Palace en particulier -
cette sentimentalité. Sans élaborer un programme nouveau, sans prati-
quement rien faire de plus que ses prédécesseurs, il eut la nostalgie d'un
empire compact, organisé, capable d'agir, et contribua sûrement à en
répandre l'idée.
Le terme d'impérialisme devint alors, dans la bouche des libéraux, un
slogan péjoratif contre la politique d'expansion coloniale de Disraeli. Mais,
parallèlement, la ligue pour la fédération impériale changea l'acception du
terme, qui, de slogan partisan, devint l'expression d'un idéal commun aux
intellectuels de tous les partis, qui rêvaient d'organiser l'union anglo-
saxonne à travers le monde. C'est à ce moment, entre 1880 et 1900, que
l'Afrique fut intégrée dans l'idéal impérial et que la passion impérialiste,
sous l'égide de Chamberlain, atteignit son apogée dans l'opinion publique
anglaise. L'auteur insiste ensuite, à juste titre, sur l'importance de la guerre
des Boers, qui rendit au terme d'impérialisme la coloration partisane qu'il
avait revêtue en 1878. Il fut associé aux intérêts du capitalisme minier,
aux horreurs des camps de concentration, à la désapprobation des opinions
publiques étrangères, et condamné par les libéraux. De fait, en dehors du
monde anglais, le terme « impérialisme » fut, au début du xxe siècle, presque
toujours accompagné de l'adjectif « britannique » ; il désigna une politique
d'expansion égoïste et injuste.
La critique marxiste intervint alors pour dissocier l'impérialisme de
la nation britannique et pour en faire, sous l'influence de Hobson et de
Hilferding, un système d'exploitation du monde par le capitalisme finan-
cier. La thèse de Lénine, développée par les communistes, qui divisèrent
le monde en deux camps, capitaliste et socialiste, se répandit largement
parmi les populations sous-développées et dans les colonies orientées vers
leur affranchissement. L'impérialisme pour celles-ci s'opposait à leur
nationalisme. Mais il apparaît de plus en plus, dans le monde contemporain,
que la souveraineté absolue d'un État n'est plus possible, et, si le terme
d'impérialisme est de plus en plus souvent invoqué, il ne correspond plus,
chez tous ceux qui le mentionnent, à une même idée. Le seul trait commun
à tous serait sans doute que l'impérialisme apparaît toujours comme
moralement injuste.
Le soin apporté par M. Schmidt dans la définition successive des accep-
tions du terme, l'abondance de ses références, font de son livre un précieux
instrument de travail. Il est dommage qu'il n'ait pas, dans un bref
chapitre de conclusion, résumé les différentes définitions qu'il commente.
Un tableau indiquant la date, l'origine et l'élément caractéristique de
chaque impérialisme ferait bien ressortir l'originalité de l'ouvrage. De
114
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 11:10:28 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Empires et impérialismes
même, pour ce livre comme pour le précédent, une bibliographie facili-
terait les références. Les notes, rejetées à la fin du volume, obligent souvent
à feuilleter longtemps ces pages pour trouver la première mention de
Yop. cit. Si, enfin, le terme d'impérialisme n'a pas été utilisé ailleurs qu'en
Angleterre, avant le développement de la critique marxiste, pour désigner
la politique d'expansion coloniale, il faudrait le souligner. Nous ne sommes
par certains qu'il n'ait jamais été invoqué sous la IIIe République, ni que
les pangermanistes n'aient jamais assimilé leur programme à celui des
impérialistes anglais. On déplore que les recherches de l'auteur n'aient
pas été aussi approfondies en ce qui concerne les puissances continentales
qu'à l'égard de la Grande-Bretagne1.
« Berceau du colonialisme », pense M. Georges Masselman en étudiant
l'histoire des origines de l'Empire hollandais. « Trading Imperium », disait
Gœn dans son grand rapport de 1614 (p. 308), ce qui fait regretter que
Kœbner n'ait pas recherché l'emploi du terme par les Hollandais et par les
Portugais. Mais l'affirmation liminaire de M. Masselman, à savoir que le
caractère propre du colonialisme moderne réside en l'investissement de
capitaux en vue de profits, et non en la conquête et en le peuplement de
terres nouvelles, paraît de toute façon discutable. Gar, si même on
l'admettait, les Portugais pourraient encore disputer aux Hollandais le rôle
de précurseur. Cette page de préface est sans doute la plus faible du livre.
Car celui-ci est excellent. C'est une intelligente synthèse des rivalités
commerciales et coloniales en Extrême-Orient dans la première moitié du
xviie siècle. Une bibliographie de 22 pages choisit pour le lecteur tous les
ouvrages essentiels, jusqu'en 1962 ; il y manque, curieusement, dans la
section sur la Méditerranée, la thèse de M. Braudel ! L'auteur sait dégager
l'essentiel et conserver le détail pittoresque qui humanise son étude. Il
résume l'histoire économique des Pays-Bas, décrit les voyages de décou-
verte, la recherche des routes par le Nord et par le Sud, vers les épices,
analyse les techniques commerciales et les constitutions des premières
compagnies, qui précédèrent celle des Indes orientales. Un tableau de
l'Extrême-Orient avant l'ingérence portugaise, du rôle joué par l'Islam,
des courants commerciaux, une appréciation du monopole portugais, une
biographie de Cœn et de son rival anglais, Jourdain, des précisions sur les
conditions sanitaires de la navigation lointaine, une analyse attentive de la
rivalité anglo-hollandaise fourniront aux étudiants et aux enseignants de
tous les degrés d'excellents bilans de l'état actuel de nos connaissances. Des
croquis nombreux et clairs, six tableaux reproduits hors texte, dont quatre
bons portraits, un index détaillé permettent à l'historien non spécialisé
et non expert en néerlandais de se mettre au courant de la genèse de
1. Richard Kœbner and Helmut Dan Schmidt, Imperialism. The story and signi-
ficance of apolitical word, 1840-1960, Cambridge, University Press, 1964, in-8°, xxvi-432 p.
115
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 11:10:28 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Henri Brunschwig
l'Empire des Pays-Bas ou de se référer rapidement à un point quelconque
de son histoire1.
M. Frédéric Mauro publie dans « La Nouvelle Clio » un volume sur
L'expansion européenne de 1600 à 1870. Vaste sujet, téméraire entreprise,
si l'on songe que l'auteur ne disposait que de 400 petites pages, dont 100
sont consacrées à la bibliographie. Des choix s'imposaient donc, et, si l'on
ajoute aux chapitres de la deuxième partie, intitulée « Nos connaissances »,
ceux de la troisième, « Débats et combats. Direction de recherche »,
on distingue aisément les principaux intérêts de l'auteur. Cette distinc-
tion entre les connaissances et les débats est sans doute imposée par la
conception générale de la collection Clio. Elle nous paraît fâcheuse,
car il est agaçant de devoir chercher ailleurs les compléments aux
données d'un texte, dont chaque chapitre gagnerait à déboucher sur les
débats.
La tendance générale de l'ouvrage est d'insister sur l'expansion écono-
mique plutôt que sur les motivations politiques. Cela nous vaut de bons
chapitres sur l'évolution commerciale, agricole, industrielle, sur les
problèmes monétaires ou sur les techniques maritimes. Par contre, les
problèmes concernant les Missions religieuses sont résumés en 25 pages, le
développement politique et l'administration des colonies sont expédiés en
10 pages, l'histoire générale des Empires hollandais et anglais est extrême-
ment succincte, et tout ce qui concerne l'abolition de la traite et de
l'esclavage est à peu près sacrifié. Si « le cas français » est plus développé,
11 n'est, sauf à propos de l'Algérie, pas très bien expliqué. Un « débat »
pourrait s'ouvrir entre la thèse traditionnelle de la motivation surtout
économique, et celle de la politique de prestige.
L'ensemble est utile et rendra service, même si les étudiants ne sont
pas tous en état de comprendre la formule de Fisher, qui leur est jetée entre
les dents, page 321, sans un mot d'explication. La bibliographie est
copieuse, trop peut-être pour les étudiants qui ne pourront pas distinguer
les ouvrages essentiels. Au risque de s'exposer à des critiques, on pourrait,
dans une réédition, les marquer d'un astérisque. A la même occasion,
pourquoi ne pas éliminer des livres aussi évidemment périmés que le
Crockaert, et mentionner quelques ouvrages utiles : les divers tomes de la
Cambridge, le vieux Gafïarel pour la France, le Schramm pour l'Allemagne,
le Neumark et le Marais pour l'Afrique du Sud, voire même, pourquoi pas ?
le Brunschwig sur l'Afrique noire2.
La tendance philosophique propre à l'historiographie allemande se
retrouve dans les propos de M. Gustav Adolf Rein. Pour les 75 ans du
1. Georges Masselman, The craddle of colonialism, New Haven et Londres, Yale
University Press, 1963, in-8°, x-534 p., ill.
2. Frédéric Mauro, L expansion européenne (IoUV-IõvU), Fans, Fresses universi-
taires de France, 1964, in- 16, 417 p., « Nouvelle Glio ».
116
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 11:10:28 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Empires et impérialismes
professeur hambourgeois, ses amis et ses disciples ont édité un choix
de ses articles sur l'Europe et l'outre-mer. Le plus récent date de 1958,
le plus ancien remonte à 1911. La plupart ont été écrits entre 1920 et 1941
et sont empreints d'une mesure, d'une volonté de se distancer du sujet, qui
incitent l'auteur à passer du récit des événements à l'essai philosophique.
Il s'intéresse aux systèmes, diplomatiques plutôt qu'économiques, aux
idéologies. Les vingt articles, comptes rendus, conférences de l'auteur des
Rivalités européennes en Amérique du Nord au XVe et au XVIe siècle (1925),
et de L'expansion européenne à travers le monde (1931), sont groupés en
trois rubriques : « Histoire générale d'outre-mer ; Australie et Amérique ;
Afrique. » On les lit sans ennui et sans passion. Certains sont nettement
périmés. D'autres plaisent par le soin de la composition, le style, et le
parfum des idées, discrètement conformistes - et banalisées, si jamais
elles ont été originales1.
Pour M. Manfred Nussbaum, « impérialisme » ne peut signifier
qu'exploitation capitaliste selon la stricte doctrine marxiste-léniniste. Son
étude sur la politique coloniale allemande au temps de Bismarck, Caprivi,
Hohenlohe, documentée aux archives de Potsdam, est précieuse et le serait
davantage encore si un index permettait de s'y référer plus aisément.
L'auteur se fonde par ailleurs sur une bibliographie presque exclusivement
allemande. Il en résulte une appréciation incomplète du rôle de l'affaire
d'Egypte, très discuté ces derniers temps par les historiens anglais, et
certaines surprenantes méprises, comme, par exemple, page 72, la mention
des voyages du Français Brazza dans la région du Congo et du Niger ! Le
ton, très polémique, que l'auteur croit devoir adopter, surtout dans les
premiers chapitres, qui n'apportent pas grand-chose de neuf, est un peu
agaçant. L'interprétation marxiste de faits connus n'exige pas l'injure à
ceux qui négligent les facteurs économiques, et l'influence évidente de ces
derniers n'exclut pas les autres aussi totalement que l'auteur le veut. Les
quatre premiers chapitres reprennent l'histoire des visées coloniales des
armateurs allemands avant 1884. Ils insistent sur la pression tentée pour
obliger le gouvernement à intervenir, et sur l'échec devant le Reichstag, du
projet de subvention à la Société issue de la faillite de Godefïroy aux
Samoa en 1880. L'auteur pense que c'est à cette date qu'il faut faire
remonter le début de la politique coloniale allemande, plutôt qu'à 1884.
Ce n'est pas très convaincant et n'a aucune importance. La question du
protectionnisme et de la « soupape de sûreté » indispensable est exposée
selon les thèses traditionnelles. Des documents nouveaux renforcent ce
qu'on savait sur le groupe des armateurs et des banquiers (Hansemann)
sur l'exportation de l'alcool de pommes de terre, qui représentait un b
tiers des exportations allemandes outre-mer, sur la genèse des proje
1. Gustav Adolf Rein, Europa und Übersee. Gesammelte Aufsätze, Göttingue, Mu
terschmidt, 1961, 347 p., in-8°.
117
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 11:10:28 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Henri Brunschwig
africains de Woermann, Lüderitz et F. Colin, qui rêvaient de libérer leur
commerce du contrôle des tribus courtières en Afrique, et de créer des
plantations, sur le scandaleux commerce de la main-d'œuvre mélanésienne
aux Samoas.
Le chapitre V apporte une documentation nouvelle sur la mission de
Nachtigal, en particulier sur l'affaire de la baie de Dubreka, au large de
îles de Los. Mais comment expliquer qu'à propos du Cameroun l'auteur n
cite pas l'ouvrage, publié en 1960, de M. Stœcker, qui est cependant de l
même obédience ?
Le chapitre VI constate l'échec de la politique coloniale et multiplie
les statistiques sur le commerce extérieur. Cela n'exclut pas les profits
privés, qui sont analysés au chapitre suivant. On en arrive ainsi au dernier
chapitre consacré à l'intervention du capitalisme monopolisateur après la
conférence de Berlin et surtout au début du xxe siècle.
Ce petit livre, rapidement écrit, ne transforme donc pas profondément
l'idée qu'on se faisait de la colonisation allemande. On savait que les
armateurs avaient souhaité l'expansion politique, que Bismarck avait
tenté d'en éviter les frais au contribuable par son système des chartes, que
l'État finalement avait été obligé d'assumer les charges et que de gros
profits privés avaient été réalisés à ses dépens. On connaissait les abus,
révélés par le socialiste Noske et par des libéraux bien avant 1914.
Les documents d'archives exhumés par l'auteur rendent cependant
son ouvrage fondamental ; ils apportent sur la mission Nachtigal
d'utiles précisions et réunissent des textes et des statistiques inédits ou
épars1.
Sa conception de l'impérialisme est évidemment la même que celle de
M. Joachim Peck, dans une étude de la même collection sur l'impérialisme
allemand et la Chine en 1937. Celui-ci cependant débute par un chapitre sur
le comportement réciproque des deux gouvernements allemands de Bonn
et de Potsdam, à l'égard des peuples d'Asie et d'Afrique. Il y explique que
l'impérialisme est toujours nécessairement intimement lié au colonialisme.
Ce dernier n'exige pas la possession de colonies ; il peut s'exercer par diverses
pressions et par des contrôles économiques ou militaires sur des peuples
indépendants. Ce « néo-colonialisme », forme contemporaine de l'impé-
rialisme de l'Allemagne fédérale, qui se présente aux peuples décolo-
nisés comme anti-colonialiste, recherche, comme tout impérialisme, des
monopoles économiques exercés aux dépens des peuples en voie de
développement.
Entre les deux guerres, la République de Weimar et le « IIIe Reich »,
1. Manfred Nussbaum, Vom « Kolonial Enthusiasmus » zur Kolonialpolitik der Mono-
pole. Zur deutschen Kolonialpolitik unter Bismarck, Caprivi, Hohenlohe, Berlin, Akademie-
Verlag, 1962, in-8°, 167 p., 13,20 DM. « Studien zur Kolonialgeschichte und Geschichte
der nationalen und kolonialen Befreiungsbewegung. »
118
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 11:10:28 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Empires et impérialismes
dépourvus de colonies, ont mis au point des méthodes impérialistes de
« contrôle indirect » des peuples d'Asie et d'Afrique. A ces méthodes
s'oppose l'honnêteté de la République démocratique, qui condamne
purement et simplement toute atteinte à la liberté, à la souveraineté, à
l'intégrité des peuples.
L'exemple développé ensuite en 53 pages est celui de la tentative de
médiation de l'Allemagne entre la Chine et le Japon, entre 1937 et 1940. La
tentative n'aboutit pas. Cent dix pages de documents illustrent cet effort
d'insinuation allemande en Chine, que nous n'analyserons pas en détail. Les
documents sont tirés uniquement des archives allemandes et il n'y a pas de
bibliographie. L'ouvrage intéresse donc le spécialiste d'histoire diplo-
matique, apte à confronter ces inédits allemands avec les mémoires et
documents des autres intéressés. Nous retrouvons dans ce dernier livre la
dernière acception recensée par M. Schmidt du terme impérialiste, devenu
un slogan utilisé tant par les peuples de couleur que par les communistes
pour désigner les intentions et les menaces prêtées aux peuples
occidentaux1.
Dans Kolonialismus und Neokolonialismus in Nordafrika und Nahost,
le Pr Rathmann réunit quinze études sur l'exploitation colonialiste
et néo-colonialiste. Certaines sont d'un grand intérêt : le recours aux
archives de Potsdam a permis à M. Lothar Rathmann de donner en
77 pages une étude détaillée du B.B.B. Travail fondamental, qui comble
une lacune dans nos connaissances et abonde en précisions d'ordre financier
et politique. De même, le bref article de M. Sarkisov sur l'entrée de la
Turquie aux côtés de l'Allemagne en 1914 révèle que les initiateurs en
furent les Jeunes Turcs. Ce furent eux qui, dès 1913, réclamèrent l'envoi
de la mission militaire de Liman von Sanders. Ils comblèrent ainsi les vœux
des impérialistes allemands tout prêts à développer leur emprise sur la
Turquie. La main dans la main, ils amusèrent la Russie par des négociations
dont le seul but était de leur donner le temps de mobiliser l'armée
turque, et, finalement, d'attaquer la Russie en mer Noire.
Le chapitre initial de M. Nimschovsky sur la pénétration allemande au
Maroc est solidement documenté, cite un bref article en allemand de
MM. Guillen et Miège et ignore les quatre volumes de Le Maroc et V Europe
de M. Miège. Il apporte cependant une masse de documents tirés des
archives de Potsdam, qui complètent heureusement les informations un
peu minces que M. Miège avait réunies sur cette question. Par contre, un
bref aperçu, très polémique, de M. Luckaja sur la politique coloniale
française au Maroc de 1912 à 1920, manque totalement de la documenta-
tion d'archives, qui obligera forcément à diversifier et à nuancer son
1. Joachim Peck, Kolonialismus ohne Kolonien. Der deutsche Imperialismus und
China, Berlin, Akademie-Verlag, 1961, in-8°, 188 p., 10 DM. « Studien zur Kolonialge-
schichte und Geschichte der nationalen und kolonialen Befreiungsbewegung. »
119
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 11:10:28 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Henri Brunschwig
argumentation. L'étude de M. Ivanov sur la colonisation officielle en
Tunisie, de 1892 à 1914, était plus facile à documenter. L'auteur a surtout
utilisé les procès-verbaux de la conférence consultative de la Régence. Il a
bien compris la rivalité entre les colons d'origine française et italienne, et la
description qu'il donne des procédés de spoliation des terres, ainsi que ses
conclusions sur l'échec politique de l'opération, nous semblent justes.
Les études de la deuxième moitié du livre paraissent plus discutables.
Traitant du mandat français en Syrie, M. Brandt n'a pas eu accès aux
archives. Dès lors ses 28 pages, dont six sur les rapports franco-syriens
du début du xvnie siècle à l'effondrement de l'Empire ottoman, ne
suffiraient même pas à un simple commentaire de la partie de la biblio-
graphie qu'il a négligé de consulter.
M. 'Abd Al Fatah Haikal expose la version nationaliste égyptienne
de l'exploitation coloniale de l'Egypte par l'Angleterre. Mme Scholze
condamne l'impérialisme anglais en Irak de 1932-1939, M. Ludouveit
consacre 25 pages à l'impérialisme allemand en Turquie pendant la
deuxième guerre mondiale, M. Mohammed Ali A§ Suharï 20 au colonialisme
britannique dans le Yémen du Sud jusqu'en 1962, d'après une documen-
tation arabe. Des articles sur le néo-colonialisme français en Algérie, sur la
rivalité anglo-américaine pour le pétrole, sur l'Irak et l'Iran contemporains
font incliner vers le journalisme un livre d'abord fondé sur l'érudition.
L'ouvrage se termine par 75 pages de M. Paul Friedlaender sur
l'expansion impérialiste de l'Allemagne en Orient depuis la « décolonisa-
tion ». L'auteur y fait le procès de l'aide aux pays sous-développés,
qualifiée de « colonialisme collectif » et oppose l'aide désintéressée
de la République démocratique au néo-colonialisme de la République
fédérale.
Dans tous ces travaux, le terme de néo-colonialisme désigne, en gros,
l'aide aux pays sous-développés telle qu'elle est pratiquée par l'Occident
et quels que soient ses modalités ou ses auteurs, tantôt isolés, tantôt
groupés autour d'un même plan. Cette aide est considérée comme l'ultime
manifestation du capitalisme monopoleur, de l'impérialisme économique
qui survit à la décolonisation politique1.
A ces problèmes de la décolonisation se rattache le Panafricanisme
sur lequel M. Hanspeter F. Strauch publie un bon ouvrage de synthèse2.
Il en retrace la genèse, après Burghardt du Bois, Padmore, MM. Decraene
et Colin Legum, et analyse les efforts d'organisation des états africains
et l'évolution des divers groupements qu'ils ont formés jusqu'en 1964. Il
1 . Kolonialismus und Neokolonialismus in Nordafrika und Nahost - Kritische Unter-
suchungen. Berlin Akademie-Verlag, 1964, 488 p. in-8°.
2. Hanspeter F. Strauch : Panafrika. Kontinentale Weltmacht im Werden ? Anfänge,
Wachstum und Zukunft des afrikanischen Einigungsbestrebungen. Mit Vorwort von
Leopold S. Senghor. Zurich, Atlantis Verlag, 1964, in-8°, 415 p.
120
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 11:10:28 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Empires et impérialismes
examine ensuite la collaboration des états africains aux organisations
internationales, les tentatives d'uniformisation des institutions de ces
états en vue de leur future fédération en un empire panafricain, et l'atti-
tude des autres puissances mondiales à son égard.
Qu'un état africain uni ne soit pas près de naître, M. Leopold S. Senghor
dans une brève préface, en convient : « J'ai dit, écrit-il, que l'Unité afri-
caine était un Mythe. Cela ne veut pas dire qu'elle soit une « utopie ». Pour
mieux apprécier ce dernier point, il faudrait, à côté des doctrines et des
programmes que l'auteur analyse clairement, un chapitre sur les réalités
africaines démographiques, économiques et sociales ; cela permettrait
au lecteur de connaître les obstacles auxquels se heurte aujourd'hui la
réalisation de cet idéal. Un index alphabétique ne déparerait pas non
plus ce solide travail.
* *
A considérer ces termes d'empire
ont presque toujours eu deux accep
désigné à la fois l'autorité morale, c
autrui, la souveraineté de l'État,
rénové par les humanistes de tou
cette souveraineté s'exerce, espac
conquis, ce qui donne une résonan
du terme.
A ce propos, si l'on rappelle combien la notion de frontière a été lente
à se dégager en Europe des conceptions féodales de suzeraineté et de
vassalité, on peut se demander dans quelle mesure l'expansion coloniale
a contribué au triomphe de la limitation géographique de la souverai-
neté. Les frontières entre les Empires d'outre-mer ont, dans la plupart
des traités de partage conclus depuis l'accord hispano-portugais de
Tordesillas (1494), presque toujours été tracées sur des cartes géogra-
phiques, sans aucun de ces chevauchements que le droit féodal maintenait
en Europe.
L'impérialisme, de même, a désigné tout à la fois une politique d'expan-
sion, belliqueuse, et par conséquent plus ou moins injuste - ce fut le
cas des rivalités du xvme siècle, de la conquête de l'Inde, du partage de
l'Afrique, - et une politique d'organisation des empires, moralement
approuvée par les Européens mal informés sur les abus qu'elle pouvait
engendrer à l'égard des indigènes ; ce fut le cas de la mise en valeur de
Java, de la Ligue pour la fédération impériale britannique, de la politique
indigène française. Cet impérialisme-là était apprécié de façon positive,
car il n'apparaissait pas belliqueux, mais au contraire lié au progrès
pacifique de « la civilisation » occidentale. Ainsi, l'U.R.S.S. peut-elle à la
fois condamner l'impérialisme occidental engagé dans des guerres colo-
121
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 11:10:28 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
IL Brunschwig - Empires et impérialismes
niales, et poursuivre la russification de l'Asie russe conquise par les tsars.
La politique d'assistance au Tiers Monde ressortit à l'impérialisme
bienfaisant, lorsqu'on la considère du point de vue des sacrifices consentis
par les anciens conquérants, et apparaît aux yeux des partis d'opposition
indigènes comme une simple séquelle de l'impérialisme conquérant.
Henri Brunschwig,
Directeur d'Études
à V École pratique des Hautes Études, VIe section.
122
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 11:10:28 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Vous aimerez peut-être aussi
- Civilisation MoeursDocument8 pagesCivilisation Moeursbeebac2009Pas encore d'évaluation
- Mesianismo Político. La Etapa Romántica - J. L. TalmonDocument595 pagesMesianismo Político. La Etapa Romántica - J. L. Talmonmoltenpaper100% (2)
- Cassirer 2Document8 pagesCassirer 2Romain PtrPas encore d'évaluation
- 1970 Deuxième Impromptu (Non Annoté)Document5 pages1970 Deuxième Impromptu (Non Annoté)Psych- art-chitecturePas encore d'évaluation
- FaceBook Pour Les NulsDocument316 pagesFaceBook Pour Les NulsBelhamidi Mohammed Houssame100% (2)
- Faelli Nicolas 2016 TheseDocument341 pagesFaelli Nicolas 2016 Thesechohra khaledPas encore d'évaluation
- Les Mouvements Littéraires Du XVIIIè SiècleDocument16 pagesLes Mouvements Littéraires Du XVIIIè SiècleAnabella Estefanía Zambrano Monserrate100% (5)
- Mauss La NationDocument51 pagesMauss La NationNicéphore Jünge100% (1)
- Les - Precurseurs - de - La - Revolution - FrancaiseDocument6 pagesLes - Precurseurs - de - La - Revolution - FrancaiseGENESIS RAMOSPas encore d'évaluation
- Le 18eme SiecleDocument5 pagesLe 18eme Sieclelinamohamadi2007Pas encore d'évaluation
- Siècle Des LumièresDocument11 pagesSiècle Des LumièresDavid LOPEZ--TOMASPas encore d'évaluation
- 304709217Document21 pages304709217Krisnhamurty Ben-Tchoukry MocktarPas encore d'évaluation
- Hri FinalDocument72 pagesHri FinalClara-Maria LaredoPas encore d'évaluation
- Les LumieresDocument5 pagesLes LumieresAdamPas encore d'évaluation
- EvolutionnismeDocument14 pagesEvolutionnismeRebèl Jan Batis ViksamaPas encore d'évaluation
- Le Siècle Des LumièresDocument6 pagesLe Siècle Des LumièresRebèl Batayè SankaraPas encore d'évaluation
- 1973 Marc FerroDocument21 pages1973 Marc FerroJimena LemesPas encore d'évaluation
- QuDocument4 pagesQuMohamed AdrourPas encore d'évaluation
- Seminaire 4 - Le ClassicismeDocument16 pagesSeminaire 4 - Le ClassicismemăruţaPas encore d'évaluation
- Polycope Pour Le Cours Histoire Des Idées Au XVIIIe Siècle-1Document22 pagesPolycope Pour Le Cours Histoire Des Idées Au XVIIIe Siècle-1zarouk.anass.comPas encore d'évaluation
- Se Préparer Au ContrôleDocument4 pagesSe Préparer Au ContrôleAbdelilah AboulouayPas encore d'évaluation
- HTTPSWWW - halwar.snIMGpdfle Siecle Des Lumiere Xviii Siecle PDFDocument3 pagesHTTPSWWW - halwar.snIMGpdfle Siecle Des Lumiere Xviii Siecle PDFBrandly GervaisPas encore d'évaluation
- Le Siecle Des Lumiere Xviii SiecleDocument3 pagesLe Siecle Des Lumiere Xviii SiecleMohamed DialloPas encore d'évaluation
- FR412 H. Belhaj. Histoire Des Idees Et Des ArtsDocument72 pagesFR412 H. Belhaj. Histoire Des Idees Et Des ArtsRachidPas encore d'évaluation
- Le Mouvement Des Nationalités en EuropeDocument4 pagesLe Mouvement Des Nationalités en EuropespycrowPas encore d'évaluation
- PM Delpu Nathan Dã©finitif-2Document18 pagesPM Delpu Nathan Dã©finitif-2nasser.ashtiewiPas encore d'évaluation
- Fiche n1 Travaux Encadrés CandDocument2 pagesFiche n1 Travaux Encadrés CandAbdo azaime100% (1)
- Qu'est-Ce Que L'ancien Régime ?Document29 pagesQu'est-Ce Que L'ancien Régime ?Camila MuñozPas encore d'évaluation
- Genet, Les Langages de La PropagandeDocument21 pagesGenet, Les Langages de La PropagandeCin HamlinPas encore d'évaluation
- Cosmopolitisme G CormDocument8 pagesCosmopolitisme G CormMarwan ZoueinPas encore d'évaluation
- 1LBHE22F Introduction Nation Nationalité État-Nation 2022-2023Document4 pages1LBHE22F Introduction Nation Nationalité État-Nation 2022-2023Léane AgeorgesPas encore d'évaluation
- Texto de Los NacionalismosDocument8 pagesTexto de Los NacionalismosSabri Salerno FiaschePas encore d'évaluation
- Mouvement LittéraireDocument6 pagesMouvement Littéraireaziz yahyaPas encore d'évaluation
- Aurélien Aramini Michelet La Philosophie de L'histoireDocument59 pagesAurélien Aramini Michelet La Philosophie de L'histoiretrofouPas encore d'évaluation
- Le Siècle Des LumièresDocument5 pagesLe Siècle Des LumièresSabri alkassasPas encore d'évaluation
- Intellectuel Rã©publicainDocument7 pagesIntellectuel Rã©publicainEmeuryPas encore d'évaluation
- Beaud, Olivier, L'empire Et L'empire Colonial Dans La Doctrine Publiciste Française de La Troisième République, 2015Document77 pagesBeaud, Olivier, L'empire Et L'empire Colonial Dans La Doctrine Publiciste Française de La Troisième République, 2015andresabelrPas encore d'évaluation
- Le XVIIIe Siècle en FranceDocument4 pagesLe XVIIIe Siècle en FranceMDelCarmenSalasSánchezPas encore d'évaluation
- Calviè L. - Antiquité Et Révolution Française Dans La Pensée Et Les Lettres Allemandes À La Fin Du XVIIIe SiècleDocument23 pagesCalviè L. - Antiquité Et Révolution Française Dans La Pensée Et Les Lettres Allemandes À La Fin Du XVIIIe SiècleannipPas encore d'évaluation
- Michel Winock - "Désormais, C'est Le Média Qui Fait L'intellectuel"Document8 pagesMichel Winock - "Désormais, C'est Le Média Qui Fait L'intellectuel"denis100% (1)
- Le Siècle Des Lumières Et La Conscience IntellectuelleDocument20 pagesLe Siècle Des Lumières Et La Conscience IntellectuelleKhadija Maama100% (1)
- Michelet Le - Peuple GrangeDocument30 pagesMichelet Le - Peuple GrangeTarek daymiPas encore d'évaluation
- Socio Po 1er ChapDocument9 pagesSocio Po 1er ChapLambert LouisPas encore d'évaluation
- L'Europe Face A L'islam - VIIe - Olivier HanneDocument468 pagesL'Europe Face A L'islam - VIIe - Olivier HanneThiriardPas encore d'évaluation
- RomanDocument24 pagesRomanquychau2306Pas encore d'évaluation
- Les LumièresDocument2 pagesLes Lumièresmartirosyanivan7Pas encore d'évaluation
- 1 HUMANISME ET RENAISSANCE - CompDocument17 pages1 HUMANISME ET RENAISSANCE - Compbasma.elaounyPas encore d'évaluation
- Essai Sur Les Idees PolitiquesDocument17 pagesEssai Sur Les Idees PolitiquesÉric TonkaPas encore d'évaluation
- CH9 - XIXe - XXe SiècleDocument12 pagesCH9 - XIXe - XXe Sièclebcyqthr264Pas encore d'évaluation
- Fiches Sur Les MouvementsDocument8 pagesFiches Sur Les Mouvementsmatuszak.carlaPas encore d'évaluation
- LASOTA de ANDRES Carmen 6TC - Synthèse 18ème SiècleDocument2 pagesLASOTA de ANDRES Carmen 6TC - Synthèse 18ème SiècleAla LalaPas encore d'évaluation
- Les LumièresDocument4 pagesLes LumièreslaffarguePas encore d'évaluation
- La Poésie Du Moyen Âge Au XVIIIème SiècleDocument5 pagesLa Poésie Du Moyen Âge Au XVIIIème Siècletom.heraud5Pas encore d'évaluation
- Revision Littérature 1èreDocument2 pagesRevision Littérature 1èreThierno ThiawPas encore d'évaluation
- Siècle Des Lumières - WikipédiaDocument42 pagesSiècle Des Lumières - WikipédialordychancertsieloPas encore d'évaluation
- Funerals Politics and Memory in Modern FDocument44 pagesFunerals Politics and Memory in Modern FvecePas encore d'évaluation
- RenaissanceDocument21 pagesRenaissanceJohnRakotoHacheimPas encore d'évaluation
- Pour Une Histoire Comparée Des Cours Européennes. Norbert Elias Et Louis Marin - Deux Modèles D'interprétationDocument16 pagesPour Une Histoire Comparée Des Cours Européennes. Norbert Elias Et Louis Marin - Deux Modèles D'interprétationUlyssePas encore d'évaluation
- 3 Cefef 4986 Eb 7862Document19 pages3 Cefef 4986 Eb 7862the5thsymPas encore d'évaluation
- FRancaisDocument8 pagesFRancaisKarimPas encore d'évaluation
- Les carts de l’imagination. Pratiques et représentation de la science dans le roman au tournant des LumièresD'EverandLes carts de l’imagination. Pratiques et représentation de la science dans le roman au tournant des LumièresPas encore d'évaluation
- Owona Lanaissancedu 1973Document22 pagesOwona Lanaissancedu 1973Ota Benga BengaPas encore d'évaluation
- Noubissie Outre - 1631-0438 - 2007 - Num - 94 - 354 - 4262Document29 pagesNoubissie Outre - 1631-0438 - 2007 - Num - 94 - 354 - 4262Ota Benga BengaPas encore d'évaluation
- GonidecDocument31 pagesGonidecOta Benga BengaPas encore d'évaluation
- Nken LouisPaulAujoulatFigure 2010 1Document28 pagesNken LouisPaulAujoulatFigure 2010 1Ota Benga BengaPas encore d'évaluation
- Ebolo LimplicationDesPuissances 1999Document44 pagesEbolo LimplicationDesPuissances 1999Ota Benga BengaPas encore d'évaluation
- Mandel-Lesrtrcisseursde Sexe Cameroun - 2008Document25 pagesMandel-Lesrtrcisseursde Sexe Cameroun - 2008Ota Benga BengaPas encore d'évaluation
- Onomo Fouellefack Diplomatie - Traditionnelle - Et - Rapprocheme Citation LMACDocument23 pagesOnomo Fouellefack Diplomatie - Traditionnelle - Et - Rapprocheme Citation LMACOta Benga BengaPas encore d'évaluation
- Eugeunéisme Dans Le Japon Moderne ContemporaiDocument374 pagesEugeunéisme Dans Le Japon Moderne ContemporaiOta Benga BengaPas encore d'évaluation
- Beckers OutsiderDocument19 pagesBeckers OutsiderOta Benga BengaPas encore d'évaluation
- RAWLSDocument33 pagesRAWLSjohannkabran2021Pas encore d'évaluation
- VANEL 2016 Archivage 3Document454 pagesVANEL 2016 Archivage 3Houcino HoucinePas encore d'évaluation
- ITIL v4 ExercisesDocument2 pagesITIL v4 ExercisesAbabacar Diouf0% (1)
- Frontière, Territoire Et Mémoire À Figuig, Oasis Des Confins MarocainsDocument14 pagesFrontière, Territoire Et Mémoire À Figuig, Oasis Des Confins MarocainsdzairdialnaPas encore d'évaluation
- GazaDocument1 pageGazaSo SolaPas encore d'évaluation
- 3e HIST T2 L3 Union AfricaineDocument6 pages3e HIST T2 L3 Union AfricaineKOUADIO JULIEN FIENIPas encore d'évaluation
- Réussir Dans Sa Fonction de ManagerDocument5 pagesRéussir Dans Sa Fonction de ManagerloicbockformationPas encore d'évaluation
- Journal 0942012Document40 pagesJournal 0942012Mariem AzzabiPas encore d'évaluation
- Exam 3as SCDocument3 pagesExam 3as SCsara25Pas encore d'évaluation
- Manuel Du Voyageur en Italie (... ) Giegler Jean-Pierre Bpt6k56988717Document712 pagesManuel Du Voyageur en Italie (... ) Giegler Jean-Pierre Bpt6k56988717mediacalabriaPas encore d'évaluation
- Annales29T2 FRDocument54 pagesAnnales29T2 FRMed GianiniPas encore d'évaluation
- 004 1-Loi N°2008-013 Du 23 Juillet 2008 Sur Le Domaine Public de L'etat.Document9 pages004 1-Loi N°2008-013 Du 23 Juillet 2008 Sur Le Domaine Public de L'etat.RAMAROKOTO Tantely Fetra NarindraPas encore d'évaluation
- Appel Fouad LarouiDocument4 pagesAppel Fouad LarouihattabsatPas encore d'évaluation
- Tchadien de La DiasporaDocument4 pagesTchadien de La DiasporaKhalil Hassan SoubeiPas encore d'évaluation
- PPP Mission de L'anapejDocument26 pagesPPP Mission de L'anapejDaghay Rachid100% (1)
- Amiard-Chevrel AgitpropDocument22 pagesAmiard-Chevrel AgitpropPauloPas encore d'évaluation
- LDP HTR Anglais1re 22Document6 pagesLDP HTR Anglais1re 22Sergio FernandesPas encore d'évaluation
- 1280 PDFDocument24 pages1280 PDFdknewsPas encore d'évaluation
- Pays Du Monde Et Leur Capitale en 2023Document7 pagesPays Du Monde Et Leur Capitale en 2023bationovalery8Pas encore d'évaluation
- PL 3666Document172 pagesPL 3666meinne ahmedPas encore d'évaluation