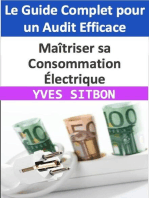Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
DM 090 0035
DM 090 0035
Transféré par
Abdellah el hianiTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
DM 090 0035
DM 090 0035
Transféré par
Abdellah el hianiDroits d'auteur :
Formats disponibles
Consommation d’énergie et théorie des pratiques : vers des
pistes d’action pour la transition énergétique
Patricia Roques , Dominique Roux
Dans Décisions Marketing 2018/2 (N° 90), pages 35 à 54
Éditions EMS Editions
ISSN 0779-7389
DOI 10.7193/DM.090.35.54
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
Article disponible en ligne à l’adresse
https://www.cairn.info/revue-decisions-marketing-2018-2-page-35.htm
Découvrir le sommaire de ce numéro, suivre la revue par email, s’abonner...
Flashez ce QR Code pour accéder à la page de ce numéro sur Cairn.info.
Distribution électronique Cairn.info pour EMS Editions.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le
cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque
forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est
précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
Décisions Marketing n°90 Avril-Juin 2018, 35-54
Consommation d’énergie et théorie des pratiques :
vers des pistes d’action pour la transition
énergétique
Patricia Roques* et Dominique Roux**
*
IUT Nice Côte d’Azur
**
Université de Reims Champagne-Ardenne
Résumé
Dans un contexte d’incitation à la réduction énergétique, quels sont les leviers d’action sur les comportements
de consommation des individus, au-delà des valeurs qu’ils associent à la maîtrise de leur consommation ? Sur la
base d’une étude qualitative menée avec 40 répondants d’un même complexe locatif réhabilité, cette recherche
mobilise la théorie des pratiques appliquée au contexte de la consommation énergétique. Après avoir présenté et
discuté ce cadre d’analyse peu usité en marketing, elle propose une typologie de profils. Ceux-ci intègrent à la fois
les savoir-faire, les routines et les significations attachées à un ensemble d’activités consommatrices d’énergie,
mais aussi le système d’équipement incorporé au logement et les incitations/prescriptions qui ont accompagné le
programme de réhabilitation énergétique. Les résultats enrichissent les approches comportementales par la prise
en compte de l’environnement socio-technique des individus et fournissent une série de recommandations utiles
aux bailleurs sociaux comme aux organisations publiques ou marchandes engagées dans ces problématiques.
Mots-clés : consommation d’énergie, théorie des pratiques, efficacité énergétique, sobriété, réhabilitation thermique
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
de l’habitat social.
Abstract
Energy consumption and practice theory: towards possible courses of action for energy transition
In a context in which energy reduction is encouraged, what are levers for action on individuals’ consumption
patterns beyond values associated to the mastering of their energy use? On the basis of a qualitative study carried
out with 40 informants from the same rehabilitated rental complex, this research first proposes a theorization of
energy practices. After having presented and discussed the practice-theory framework still new in the marketing
field, we propose a typology of profiles. These incorporate the know-how, routines and meanings associated with
a set of energy-consuming activities, but also the system of equipment incorporated in housing and the incentives/
prescriptions that accompanied the program of energy rehabilitation. The results enrich behavioral approaches by
taking into account individuals’ socio-technical environment and provide a series of useful recommendations to
social landlords as well as public and commercial organizations involved in these issues.
Keywords: energy consumption, practice theory, energy efficiency, sobriety, energy rehabilitation of social housing.
Pour contacter les auteurs : patricia.roques@unice.fr ; dominique.roux@univ-reims.fr
DOI : 10.7193/DM.090.35.54 – URL : http ://dx.doi.org/10.7193/DM.090.35.54
Roques P. et Roux D. (2018), Consommation d’énergie et théorie des pratiques : vers des pistes d’action pour la
transition énergétique, Décisions Marketing, 90, 35-54.
36 – Décisions Marketing n°90 Avril-Juin 2018
La question de la transition énergétique est au connu sous le nom d’« effet rebond »4. La
cœur des débats et des politiques publiques réduction de la consommation d’énergie,
qui considèrent comme urgentes la transfor- obtenue par une plus grande efficacité et un
mation des modes de vie et leur réorientation meilleur rendement des équipements, semble
vers des logiques de soutenabilité (Bourg donc insuffisante à elle seule pour atteindre
et al., 2016). Réduire la demande d’énergie les objectifs de réduction fixés à l’horizon
constitue en effet un enjeu majeur en lien 2050. Elle appelle donc pour certains un
avec l’épuisement ou la rareté des ressources, engagement plus radical vers la sobriété,
et, de façon cruciale, avec la problématique consistant à redimensionner, limiter, réduire
du changement climatique. Celle-ci renforce ou mutualiser les équipements (Bourg et al.,
2016). De plus, alors que deux personnes sur
l’impératif d’une diminution de la demande
trois déclarent s’imposer régulièrement des
en énergie1, dans laquelle le secteur rési-
restrictions sur plusieurs postes budgétaires
dentiel représente 27 % de la consommation
et que les gains de pouvoir d’achat des mé-
totale en France2, soit presque autant que les
nages (+1,6 % par rapport à 2016) sont érodés
transports et davantage que l’industrie. Aussi,
par l’inflation (+1 %) provoquée par la hausse
des politiques publiques, contraignantes ou des prix de l’énergie5, les individus continuent
incitatives, ont été mises en œuvre dès 1974 à investir dans l’acquisition d’équipements
à la suite des chocs pétroliers, avec l’objectif électriques ainsi que dans les abonnements
principal d’accroître l’efficacité énergétique (téléphonie, télévision payante, Internet) qui
des logements. Désormais, la transition éner- leur sont liés6. De fait, les changements de
gétique fait l’objet d’une loi3 qui vise à lut- comportements des individus semblent très
ter contre le dérèglement climatique comme insuffisants en dépit de leurs attitudes favo-
à renforcer l’indépendance énergétique du rables ou des valeurs qu’ils associent aux
pays. Y sont favorisées les mesures suscep- économies d’énergie (Innocent, François-
tibles d’encourager les économies d’énergie Lecompte et Le Gall-Ely, 2016 ; Zélem,
par la rénovation des logements, et incitant 2010). Brisepierre (2011) confirme également
par ailleurs les individus à se doter d’équipe- que la sensibilité écologique n’entraîne pas à
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
ments efficaces. Pourtant, en dépit des efforts elle seule plus de sobriété énergétique, ni de
accomplis et poursuivis à marche forcée, changement radical dans les pratiques qui
l’Agence Européenne pour l’Environnement fonctionnent chacune selon des logiques dif-
(AEE) soulignait récemment que les deux férentes. Par exemple, consommer de l’éner-
tiers des gains liés à l’efficacité énergétique gie pour se chauffer n’est pas similaire au
sur les vingt dernières années ont été contre-
4/ European Environment Agency (2015),
balancés par des augmentations de consom- Progress on energy efficiency in Europe, Odyssee
mation, liées notamment à la multiplication energy efficiency index (ODEX), EU28, p.14, http://
www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/
des équipements et des usages, phénomène progress-on-energy-efficiency-in-europe-2/assess-
ment-1
1/ Voir les travaux de l’Agence Internationale de 5/ de Guigné A. (2017), L’Insee relève à 1,8% la crois-
l’Energie IEA/AIE et les conclusions de la COP 21, sance de 2017, Le Figaro. Accessible depuis l’adresse :
21e Conférence des Parties sur le climat, conférence http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/10/05/
des Nations Unies sur les changements climatiques, 20002-20171005ARTFIG00257-l-insee-releve-a-
tenue à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. 18-la-croissance-de-2017.php
2/ ADEME (2016), L’efficacité énergétique en 6/ CREDOC (2013), Enquête « Conditions de
Europe, http://www.connaissancedesenergies.org/ vie et aspirations des Français », La diffusion des
sites/default/files/pdf-pt-vue/efficaciteenergetique technologies de l’information et de la communi-
eneurope.pdf cation dans la société française, n° 297. http://
3/ La loi de transition énergétique pour la crois- www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-
sance verte a été publiée au JO du 18 août 2015. CREDOC_2013-dec2013.pdf
Marketing responsable – 37
fait d’en user pour jouer sur un ordinateur ou étudiés et servent (ou non) les objectifs de ré-
pour cuisiner de manière récréative. Réussir duction définis par les acteurs institutionnels.
la transition énergétique passe donc par une
Les pratiques ont été analysées par le biais
compréhension plus fine de l’ensemble des
d’une étude qualitative et par observations
pratiques de consommation affectant de ma-
menées auprès de 40 répondants d’un en-
nière positive ou négative la consommation
semble de logements sociaux locatifs de la
énergétique, mais également des normes so-
région Provence-Alpes-Côte d’Azur ayant
ciales et de l’environnement matériel dans les-
fait l’objet du même programme de réhabi-
quels elles s’insèrent (Moloney et Strengers,
litation thermique, incluant un programme
2014). L’objectif de cette recherche est donc
d’accompagnement et de sensibilisation des
de proposer une typologie d’individus basée
usagers. Ce programme, soumis au volonta-
sur un ensemble de pratiques qualifiées selon
riat et suivi par un tiers de notre échantillon,
leur caractère favorable ou défavorable à la
comportait un volet collectif avec des réu-
réduction de leur consommation énergétique.
nions d’information et d’échanges entre parti-
Cette typologie intègre l’environnement dans
cipants sous la forme d’ateliers et un volet in-
lequel les individus sont placés, c’est-à-dire
dividualisé avec des visites au domicile. Pour
l’infrastructure matérielle (les installations du
éviter tout biais lié à des différences socio-
logement et les divers appareils acquis) ainsi
économiques marquées dans l’échantillon, et
que les normes sociales que sont par exemple donc susceptibles d’entacher la comparabilité
la température de chauffage recommandée des résultats (Gram-Hanssen, 2008), la re-
d’un logement, les « bons gestes » évitant la cherche a été menée auprès d’une population
déperdition de chaleur, le temps nécessaire homogène placée dans des conditions simi-
pour une douche, etc. (Shove, 2003). Nous laires, c’est-à-dire confrontée par nécessité
mobilisons pour cela la théorie des pratiques (et non par choix) au même programme de
(Reckwitz, 2002 ; Schatzki, 1996, 2002 ; réhabilitation énergétique. Un inventaire du
Warde, 2005 ; Shove et Pantzar, 2005) qui système technique incorporé au logement,
considère les comportements, énergétiques soit l’ensemble des dispositifs tels que chau-
en l’occurrence, comme la résultante plus
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
dières, radiateurs, chauffe-eau et thermostats
ou moins routinisée d’un ensemble indisso- nécessaires à la régulation de la température,
luble de « significations, de compétences et a été réalisé. Il a été complété par une phase
d’objets » qui constituent les dimensions cen- d’entretiens qualitatifs visant à comprendre
trales de la pratique (Dubuisson-Quellier et les activités des individus, les buts qu’ils
Plessz, 2013). La théorie des pratiques pro- poursuivent, le sens qu’ils donnent à leurs
longe l’approche des coûts/bénéfices attachés pratiques et à leur consommation d’énergie,
à certaines facettes sociales, hédoniques, et les règles auxquelles ils se conforment ou
utilitaires, cognitives, expressives et éthiques non, en suivant les cinq dimensions iden-
de la maîtrise de la consommation électrique tifiées par Gram-Hanssen (2008) dans le
(Innocent, François-Lecompte et Le Gall- contexte de la consommation énergétique.
Ely, 2016), en ré-enchâssant ces valeurs et L’analyse de ce matériau a permis de distin-
comportements dans le contexte social, tech- guer quatre profils : les « volontaires », les
nologique et institutionnel qui les façonne « responsables », les « empêchés » et les « ré-
(Stephenson et al., 2010). A l’instar de Dujin, fractaires ». Notre approche présente deux
Maresca et Vedie (2012), elle propose de contributions. Premièrement, elle enrichit la
considérer la manière dont ces usages, ap- théorisation des pratiques dans le domaine de
préhendés dans leur épaisseur collective, l’énergie (Gram-Hanssen, 2008 ; Stephenson
épousent (ou non) les hypothèses comporte- et al., 2010) en tenant compte d’un large
mentales dont sont porteurs les programmes éventail d’activités susceptibles d’impacter
38 – Décisions Marketing n°90 Avril-Juin 2018
la consommation énergétique, notamment de recherche en économie comportementale
par l’introduction croissante d’appareils élec- exclusivement centrées sur l’individu et celles
triques et électroniques additionnels dans le portant plus largement sur l’habitus comme
logement qui consomment de grandes quan- trace des structures sociales (Bourdieu,
tités d’« énergie grise », engendrent de forts 1980). La théorie des pratiques initiée par
impacts environnementaux (terres rares, ob- Schatzki (1996) et Reckwitz (2002) permet
solescence rapide, déchets) et induisent des de réconcilier les approches micro/macro en
consommations externes non comptabilisées considérant que les dimensions cognitives et
au titre des consommations résidentielles symboliques de la consommation sont une ex-
(réseaux, serveurs). Deuxièmement, en qua- pression directe du social, incarnée dans des
lifiant la valence de ces comportements – fa- routines : « Une pratique est un type de com-
vorables ou défavorables à la réduction de la portement routinisé qui se compose de plu-
consommation énergétique –, cette recherche sieurs éléments, interconnectés les uns aux
fournit aux acteurs institutionnels et aux bail- autres : les formes d’activités corporelles, les
leurs sociaux une typologie de profils reflé- formes d’activités mentales, les “choses” et
tant leur aptitude au changement. De plus, leur utilisation, les connaissances de base
appuyée sur la théorie des pratiques, cette sous forme de compréhension, de savoir-
typologie met au jour les dimensions les plus faire, d’états émotionnels et de motivations »
discriminantes selon les profils, facilitant (Reckwitz, 2002, p. 249). La théorie des pra-
ainsi pour chacun l’identification des leviers tiques vise ainsi à saisir les comportements
d’action possibles. comme « performances observables » et entre-
lacs d’activités et de représentations qui sont
guidés par des buts, façonnés par des normes
La consommation d’énergie à (Schatzki, 2002) et enchâssés dans un envi-
la lumière de la théorie des ronnement matériel particulier (Reckwitz,
pratiques 2002 ; Warde, 2005). La théorie des pratiques
considère que ces comportements ne sont pas
Dans la littérature, de multiples approches produits par des acteurs sociaux purement
ont été mobilisées pour comprendre les dé-
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
rationnels, mais continuellement recréés par
terminants de la consommation énergétique eux en tant qu’acteurs (Giddens, 1984). La
(Innocent, François-Lecompte et Le Gall-Ely, théorie des pratiques dont les approches ne
2016 ; Lutzenhiser, 1992 ; Stephenson et al., sont pas toutes convergentes ou stabilisées
2010 ; Wilson et Dowlatabadi, 2007). Comme (Encadré 1) a été plus directement adaptée
le montrent ces auteurs, les recherches em- au domaine de la consommation énergétique,
pruntent à toutes les disciplines, de la psy- en particulier le confort thermique (Gram-
chologie environnementale à la sociologie, en Hanssen, 2008). Son apport est de considérer
passant par la micro-économie et l’économie les différentes dimensions constitutives des
comportementale (Dujin, Maresca et Vedie, pratiques, au-delà d’une approche anthro-
2012). Les modèles psychologiques visant à pocentrée (dirigée sur l’individu et ignorant
expliquer ou prédire les comportements ayant son environnement matériel) et purement
montré leurs limites, des travaux ont proposé délibérative (centrée sur le caractère prédic-
des approches systémiques de la « sociolo- tif des discours déclarés, en ignorant le poids
gie de l’énergie ». Les premiers travaux ont des routines incorporées, des structures et
développé la notion de « cultures de l’éner- des contraintes). En raison de sa pertinence
gie » (Lutzenhiser, 1992) en se référant aux pour le domaine étudié (Dubuisson-Quellier
styles de vie des individus. Ce faisant, ils vi- et Plessz, 2013), cette approche a été privilé-
saient à combler le fossé identifié par Wilson giée dans cette recherche. Dans la continuité
et Dowlatabadi (2007) entre des traditions de Warde (2005) et Schatzki (1996, 2002),
Marketing responsable – 39
Gram-Hanssen (2008) analyse les routines découpage opéré par Schatzki (2002) entre la
de régulation thermique dans un contexte « compréhension pratique » – c’est-à-dire les
résidentiel homogène ayant bénéficié d’un routines physiques et mentales incorporées
programme d’affichage environnemental. De par les individus – et « l’intelligibilité pra-
Warde (2005), elle retient les quatre dimen- tique », autrement dit le sens qu’ils donnent
sions d’analyse des pratiques : les formes de à ce qu’ils font. Son modèle intègre les règles
compréhension de la manière de faire les explicites et les savoirs tacites qui font d’une
choses, le niveau d’engagement des indivi- grande partie des activités domestiques des
dus dans leurs pratiques, les procédures (ou tâches routinières auxquelles les individus
normes de comportements) qu’ils partagent sont capables de prêter un sens. Il en va ainsi
autour du « faire » et du « dire », et les objets de l’extinction de l’éclairage dans les pièces
présents dans leur consommation. Sur la pre- inoccupées dans l’intention, tacite, de ne pas
mière dimension, elle conserve toutefois le gaspiller. Considérant aussi la dimension
Encadré 1 : Une synthèse des recherches sur la théorie des pratiques
En dépit de sa qualité d’intégration des niveaux micro et macro, la théorie des pratiques n’est pas homo-
gène (Dubuisson-Quellier et Plessz, 2013). Epistémologiquement d’abord, les approches anglo-saxonnes
(Schatzki, 1996, 2002 ; Reckwitz, 2002) voient dans les pratiques des formes de réalisation du social
couplées à des arrangements matériels. Différemment, la praxéologie de Bourdieu (1980) cherche plutôt
à comprendre le mode de reproduction des pratiques tandis que la sociologie de l’acteur-réseau consti-
tue une troisième voie, orthogonale à la précédente, dans laquelle les pratiques sont des points d’entrée
pour analyser la constitution des faits stabilisés. Empiriquement ensuite, les dimensions retenues pour
caractériser les pratiques ne sont pas identiques d’un chercheur à l’autre. Schatzki (2002) n’incorpore ni
la technologie ni la culture matérielle, alors que celles-ci sont des éléments centraux dans le « tournant
non-humain » qui donne aux objets une agence symétrique à celle des acteurs (Shove et Pantzar, 2005 ;
Warde, 2005). La difficulté d’opérationnalisation du cadre théorique proposé initialement par Reckwitz
(2002) aboutit également à des propositions de simplification, celle de Warde (2005) ne considérant que
quatre éléments et celle de Shove et Pantzar (2005) agrégeant les normes et les formes de compréhension
de l’activité sous la notion globale de « compétences » (Tableau 1).
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
En raison de son adéquation au domaine de l’énergie, nous nous référons ici au cadre de la théorie des
pratiques proposé par Gram-Hanssen (2008) qui dégage cinq dimensions :
1. le degré de compréhension pratique et d’appropriation des éléments incorporés ou acquis (routines
d’usage des appareils, gestion de leur mise en veille, manipulation des robinets thermostatiques,
etc.) ;
2. l’« intelligibilité pratique » et les raisons d’être des routines incorporées : il s’agit de saisir les jus-
tifications et les rationalisations données par les individus pour expliquer ce qu’ils font dans leurs
activités quotidiennes ;
3. les engagements et significations accordées aux pratiques : ces dimensions se rattachent au désir
et au sens donné à ce qui est fait, par exemple chauffer ou améliorer le confort de son logement,
réaliser des travaux d’isolation ou d’embellissement, acheter des équipements de loisirs, s’extraire
du logement pour d’autres activités moins énergivores (comme jouer dehors, faire du sport ou fré-
quenter une bibliothèque) ;
4. les règles, prescriptions et influences (Rules, Knowledge, langage) (Gram-Hanssen, 2008) : elles
proviennent des sources proximales ou distales auxquels les individus disent se conformer ou non.
On distingue les « prescriptions » actives que sont les consignes données par le bailleur social après
la réhabilitation thermique, les « incitations » relayées par les médias et les « informations » fac-
tuelles en lien avec la consommation d’énergie (factures, étiquetages énergétiques…) ;
5. les éléments matériels appréhendés au travers de l’observation du système énergétique incorporé
au logement (systèmes de chauffage, de ventilation et de production d’eau chaude sanitaire) et des
équipements additionnels – les appareils acquis par le ménage (électroménager, équipements audio-
visuels, électroniques, etc.).
40 – Décisions Marketing n°90 Avril-Juin 2018
Tableau 1 : Une synthèse des principales approches de la théorie des pratiques
Shove et Gram-Hanssen,
Schatzki, 2002 Reckwitz, 2002 Warde, 2005
Pantzar, 2005 2008
Compréhen-
Corps sion pratique
Savoir-faire
Intelligibilité Compréhen- Esprit incorporés
pratique sion pratique Compréhension Compétences
Intelligibilité
Agent pratique
Structures Raison d’être
Process des routines
Règles Savoirs Procédures Règles, savoir,
langage
Structures téléo-affectives Discours
(fins, projets, buts, croyances,
Engagement Significations Engagements
émotions) Langage et significations
Compréhension générale des pratiques
Choses Objets de Produits Éléments
consommation matériels
Source : Gram-Hanssen, 2008
matérielle de la consommation, son modèle cette recherche se propose de combler pour
prend en compte l’influence de la technologie appréhender plus efficacement les leviers de
induisant certaines conduites (par exemple, réduction de la consommation énergétique.
un thermostat délègue aux appareils le réglage Notre approche consiste à analyser comment
de la température, un « compteur intelligent » un ensemble de pratiques et d’éléments cogni-
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
complété d’un dispositif de feed back vise à tifs, normatifs, et matériels qui les entourent
informer les individus de leur consommation interagissent (Moloney et Strengers, 2014),
pour les inciter à la réduire) (Dujin, Maresca et selon quels critères leur hétérogénéité peut
et Vedie, 2012). Toutefois, si Gram-Hanssen être comprise en dépit d’une relative unifor-
(2008) met au jour des différences dans les mité des conditions de vie.
comportements de régulation thermique de
ses interviewé(e)s, elle ne saisit pas l’impact
Méthodologie de la recherche
d’autres pratiques (Moloney et Strengers,
2014), par exemple faire la lessive ou la cui- La collecte de données a été réalisée auprès de
sine, travailler ou se distraire, qui impliquent 40 individus (Annexe 1) dont la sélection est
elles-mêmes des modes d’usage du système présentée dans l’encadré 2. L’étude comporte
incorporé au logement, mais aussi l’achat et une phase d’observation et de recensement
l’utilisation de matériels complémentaires factuel des éléments du système matériel, et
(appareils électro-ménager, équipements in- une phase d’entretien orientée par le cadre
formatiques, chauffages d’appoint, etc.). De de compréhension des pratiques (Gram-
plus, Gram-Hanssen (2008) ne fait pas appa- Hanssen, 2008). Ont été considérés, d’une
raître ce qui pourrait être favorable ou défa- part, l’acquisition d’appareils potentiellement
vorable à la réduction de la consommation consommateurs d’énergie à l’usage (équipe-
énergétique des individus, deux limites que ments électroménagers et équipements au-
Marketing responsable – 41
Encadré 2 : Echantillonnage et méthode d’analyse
L’étude a porté sur une population initiale de 200 locataires de logements réhabilités appartenant à quatre
bailleurs sociaux de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur [Famille et Provence et Logirem à Vitrolles
(13) ; Terre du Sud Habitat, à La Seyne sur Mer (83) ; Côte d’Azur Habitat à Nice (06)]. L’ensemble des
quatre résidences concernées ainsi qu’au moins un appartement dans chacune d’elles ont été directement
observés. Des entretiens ont été conduits avec les bailleurs sociaux et la maîtrise d’ouvrage déléguée
pour comprendre les évolutions du système technique et les choix de réhabilitation thermique effectués.
Un échantillon de 40 individus a été ensuite extrait (à raison de 10 par bailleur) en faisant varier les
principaux critères sociodémographiques – âge, genre, composition du ménage – et pour le niveau de
formation, le revenu, et l’activité professionnelle, en respectant les caractéristiques de la population de
locataires du logement social. Nous avons également veillé à retenir des individus ayant, pour un tiers,
participé à une action particulière de sensibilisation (les deux autres tiers, bien que conviés, n’y ont pas
participé). Introduire de la variance dans la participation au programme avait pour but d’éviter de limiter
l’étude à une population particulière, plus responsabilisée, les travaux montrant que les individus les plus
actifs dans la réduction énergétique sont aussi ceux qui sont les plus sensibilisés aux économies d’éner-
gie (ADEME, 2016 ; Huzée et Cyssau, 2007). Au final, les individus présentent un grand nombre de
caractéristiques communes : ils sont tous locataires, éligibles au logement social, situés dans le premier
quintile de revenus et appartiennent aux catégories socio-professionnelles « employés », « ouvriers »
ou « inactifs », avec un faible niveau de formation. En outre, ils n’ont aucun litige avec leur bailleur
et occupent leur logement depuis au moins une année entière postérieurement à la réhabilitation. Les
individus interrogés forment au final une population homogène dont l’hétérogénéité des pratiques de
consommation énergétique est à comprendre à l’aune des engagements, des significations, des routines,
de l’incorporation des normes, du suivi (ou non) des prescriptions externes en matière de réduction éner-
gétique, et surtout du sens qu’ils donnent à ce qu’ils font (Annexe 1).
Les éléments observés dans le logement ainsi que les discours des répondants ont été codés en suivant
la grille théorique de Gram-Hanssen (2008), faisant ainsi émerger des sous-dimensions illustratives.
Pour chacune, le comportement observé et/ou déclaré du répondant a été codé comme favorable ou
défavorable à la réduction de la consommation d’énergie. Les profils ont ensuite été agrégés, de proche
en proche, selon leur densité (maximale vs minimale) d’orientations favorables ou défavorables à la
réduction énergétique. Nous avons d’abord séparé les profils aux pratiques majoritairement favorables
vs défavorables, puis affiné l’analyse de ces groupes en fonction des nuances qu’ils présentaient dans
leurs pratiques : du côté favorable, les « volontaires » et les « responsables » ; et du côté défavorable, les
« empêchés » et les « réfractaires ». Ces profils définissent quatre « idéaux-types ». Chaque individu est
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
affecté à un et un seul profil en considérant le nombre de similitudes qu’il présente avec les caractéris-
tiques les plus représentatives du profil. L’annexe 2 présente les quatre profils-types identifiés.
diovisuels, de loisirs et de communication), non consommatrices d’énergie, inciter les
constituant de ce fait un premier « temps » autres à réduire leur consommation, etc.).
de cette consommation, et d’autre part, les
pratiques d’usage, moment de la consomma-
Proposition d’une typologie
tion effective, en différenciant la gestion du
d’individus et de leurs pratiques
système incorporé au logement et celle des
favorables/défavorables à une
équipements « meubles » acquis et implantés
réduction de la consommation
par le ménage. A ces deux types de pratiques
d’énergie
– d’acquisition et d’usage –, les entretiens ont
permis d’ajouter d’autres activités, non direc-
tement liées au système matériel, mais sus- Le « volontaire » : sobre par
ceptibles de réduire la consommation d’éner-
conviction, allocentré et prosélyte
gie, même si celles-ci n’en constituent pas D’une manière générale, ce profil se caracté-
toujours la finalité première (par exemple, rise par une capacité de compréhension des
sortir de chez soi et pratiquer des activités éléments techniques liés à ses équipements
42 – Décisions Marketing n°90 Avril-Juin 2018
et une forte conscientisation de sa consom- pas beaucoup la télé » (Béatrice). Ce profil
mation, cherchant à communiquer aux autres attache également beaucoup d’importance à
son désir d’économie. la relation aux autres, aux activités pratiquées
en commun : « Cet après-midi, on est allé à
1. Degré de compréhension pratique et la bibliothèque avec les jeunes et il y a plein
d’appropriation des éléments incorporés de jeux » (Nuria). Il montre également un fort
Le système incorporé au logement ne semble besoin d’ouverture et des valeurs morales et
pas lui poser de problème particulier comme éthiques marquées (Innocent, François-
l’illustre la compréhension, par Mélania, de Lecompte et Le Gall-Ely, 2016) : « Faut
la finalité de ses équipements : « Ils ont mis penser aussi à d’autres, parce que nous on
un double vitrage : la déperdition avec le a tout, le bon Dieu il nous a donné tout. Les
chauffage est réglée. Maintenant on peut ré- pauvres, il y en a qui n’ont rien » (Nuria).
gler le chauffage ». Le fonctionnement de ce Alors que Gram-Hanssen (2008) passe sous
dernier ne crée aucune difficulté spécifique, silence la dimension sociale des pratiques,
pas plus que la gestion courante de ses appa- nos résultats montrent le rôle que ce profil
reils électriques domestiques. joue sur son entourage, en étant fier de par-
tager ses engagements à moins consommer :
2. L’intelligibilité pratique et les raisons d’être « Je parle avec les voisins parce qu’on est
des routines tous concernés, même si ça vient pas dans
La consommation d’énergie du « volontaire » les conversations… On peut perdre ses habi-
est fortement conscientisée dans les gestes tudes » (Carl). Le « volontaire » cherche de
quotidiens : « Eteindre les lumières en sor- fait à être partie prenante des campagnes de
tant d’une chambre », « attendre que le lave- réduction énergétique en relayant les infor-
linge soit plein pour éviter de faire des demi- mations autour de lui. Il manifeste une forte
charges » (Jacqueline). A l’instar d’un couple dimension « réalisation de soi » (Innocent,
étudié par Gram-Hanssen (2008) qui désire François-Lecompte et Le Gall-Ely, 2016)
épargner et sait comment le faire, le « volon- qui s’exprime à travers ses talents de com-
taire » se montre sobre par conviction, mais munication et sa volonté d’inciter les autres
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
aussi par économie. « Les enfants ils disent : au changement : « L’union fait la force. On
“Maman, il faut choisir ça, l’appareil il a peut éclaircir, on peut montrer des flyers,
ça, il a ça”. Et nous on suit, on va acheter : montrer aux gens que ça marche, faire venir
moi je suis comme tout le monde » (Nuria). des amis à la maison. Regardez ! Nous on
Comme le relève à regret cette répondante, ne consomme pas, on paye moins cher que
il bute sur certains compromis liés aux exi- certains autres » (Nuria).
gences de son entourage.
4. Les règles, prescriptions et influences
3. Les engagements et les significations Le « volontaire », qui s’alimente des sources
accordées aux pratiques d’informations environnantes, tend à s’y
Les aspirations du « volontaire » sont multiples conformer et à les mettre à profit : « On
et, de manière significative, très tournées vers trouve plein de choses dans les associa-
l’extérieur (sortir de chez soi, prendre l’air, tions, on entend plein de choses, on écoute
lire, jouer avec un enfant) : « J’ai du temps : et à chaque fois on passe le message à nos
je fais du vélo, je ne reste pas à la maison à enfants, aux gens qu’on connaît et tout ça »
regarder la télé » (Laurence), tout en n’ayant (Béatrice). Chez ce profil largement préoccu-
pas pour finalité première la réduction de sa pé par les niveaux de consommation d’éner-
consommation d’énergie : « Je joue avec ma gie des appareils acquis, il n’y a pas d’aspira-
petite fille, je l’amène à un jardin, on regarde tion particulière à un niveau de confort plus
Marketing responsable – 43
élevé : « Maintenant lorsque vous achetez un même si je paye pareil » (Bernard). Si, inci-
appareil ménager c’est écrit ce qu’il va dé- demment, son niveau de consommation lui
penser. Vous allez prendre un A+ ou A, vous est rappelé, par les factures notamment, il vit
n’allez pas prendre B, C, D » (Jacqueline). Il sa situation comme le résultat d’un contexte
manifeste simplement une attention aux pres- ou de limites sur lesquels il ne peut agir :
criptions en faveur d’équipements les moins « Avant, il y avait la campagne, ils pouvaient
énergivores possibles. aller jouer dehors. Je vais leur dire quoi ?
Allez jouer dans le parking ? Il faut bien
5. Les éléments matériels du système les occuper, on a peur quand ils sortent »
énergétique incorporé et acquis (Paméla). L’intelligibilité des pratiques bute
Le « volontaire » se satisfait en général d’un de fait contre des besoins perçus comme fon-
niveau d’équipement standard : « J’ai aména- damentaux et irréductibles : « Chez moi je
gé par rapport à nous. J’aime bien cuisiner : ne peux pas faire grand-chose puisqu’il y a
il y a un peu de matériel » (Murielle), même actuellement tout d’éteint sauf le téléphone.
si, sous la pression de l’entourage et notam- Ce n’est pas à moi qu’il faut dire ça, c’est
ment des enfants, il peut avoir tendance à aux autres qui consomment beaucoup »
céder, à multiplier ou renouveler ses équipe- (Bernard). Ce qui dépasse le cadre strict de
ments (téléphonie par exemple). son action débouche ainsi sur un report de
responsabilité sur d’autres acteurs.
Le « responsable » : efficace sans perte
de confort et sans changer le monde 3. Les engagements et les significations
accordées aux pratiques
Son approche pragmatique fait de ce profil le
champion économique de la « chasse au gas- Le « responsable » est en quelque sorte le
pi » en dépit d’une faible conscientisation des champion de l’efficacité, tant lors de l’acqui-
consommations associées aux équipements sition d’équipements supplémentaires – « Je
acquis du fait qu’il ne souhaite pas se priver préfère qu’elle soit en classe A et qu’elle
d’un certain confort. consomme moins d’électricité et qu’elle
consomme moins d’eau » (Madona) – que
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
1. Degré de compréhension pratique et dans la chasse au gaspillage, par exemple
d’appropriation des éléments incorporés avec un équipement quasi-systématique en
Ce profil est globalement attentif aux per- ampoules basse consommation ou l’extinc-
formances des matériels et à la gestion du tion systématique de ce qui consomme « pour
système incorporé dont il s’applique à com- rien » et ne contribue pas immédiatement au
prendre et s’approprier l’usage, comme confort. L’intérêt financier de ses comporte-
Bernard, très attentif aux explications de ments, toutefois, est patent : « Le but c’est
l’animateur de la campagne de sensibilisa- économiser l’énergie et le portefeuille à la fin
tion : « Le monsieur de l’énergie m’a dit que de l’année » (Pierre). Porté par sa conception
c’était un thermostat et quand il fait froid enthousiaste d’un comportement efficace, le
ça s’allume et quand il fait un peu chaud ça « responsable » ne semble guère percevoir
baisse, c’est automatique ». la possible dissonance qui existe entre ses
micro-gestes économes et son niveau d’équi-
2. L’intelligibilité pratique et les raisons d’être pement, souvent élevé, et donc fortement
des routines consommateur d’énergie.
Le « responsable » est conscient de sa
consommation dans ses moindres routines : 4. Les règles, prescriptions et influences
« Je ne laisse jamais les appareils en veille » Sensible à la réduction de la consommation
(Maya) ; « Je me suis habitué à éteindre tout, d’énergie, le « responsable » désire bien faire
44 – Décisions Marketing n°90 Avril-Juin 2018
en suivant les prescriptions ou les informa- 1. Degré de compréhension pratique et
tions fournies. Cette orientation fait que le d’appropriation des éléments incorporés
« responsable » est un participant actif à la Sur le registre de la performance des sys-
campagne de sensibilisation, mais seulement tèmes incorporés au logement, l’ « empê-
sur les comportements de son entourage di- ché » ressent particulièrement l’existence de
rect, quitte à s’y substituer : « La veille des défauts et dysfonctionnements, générateurs
téléviseurs, il parait qu’il faut les éteindre. d’inconfort et consommateurs d’énergie. La
Mon mari, il dit que c’est ridicule parce qu’il gestion de la température est problématique
est obligé de la rebrancher. Je l’éteins der- aussi, car la compréhension de certains sys-
rière lui » (Sophie). Au final, le « respon- tèmes n’est pas assurée ou incomplète : « Je
sable » désire bien faire : « Pour avoir un ne sais pas si c’est utile les robinets thermos-
groupe, il faudrait déjà avoir des gens moti- tatiques. Moi, quand il fait froid, je les mets
vés : chez nous ils ne sont pas motivés. Je au maximum » (Francine). Des gestes mala-
me recentre sur ma famille » (Josette), mais droits, voire contre-performants, peuvent
contrairement au « volontaire », il s’en tient à même ainsi apparaître – ouvrir les fenêtres
agir sur ce qu’il maîtrise, à son niveau, sans plutôt que réguler la température avec les
la dimension prosélyte qui caractérise le pro- robinets thermostatiques – et ceci d’autant
fil précédent. plus si les équipements incorporés présentent
des dysfonctionnements. En cela, il fait écho
5. Les éléments matériels du système à l’un des couples interrogés par Gram-
énergétique incorporé et acquis Hanssen (2008), étonné, par méconnaissance
Les résultats montrent que la volonté du des dispositifs de régulation, de ses faibles
« responsable » de réduire sa consommation performances énergétiques en dépit de la
trouve sa limite dans celle de ne pas se pri- température basse du logement.
ver : « On adapte tout pour se sentir bien. Le
grand écran [pour la télévision] on s’est fait 2. L’intelligibilité pratique et les raisons d’être
plaisir… Il est en 3D, il fait 140 de dimen- des routines
sion. Les enfants sont autonomes : ils ont la Tout en étant conscient de l’intérêt de tenir
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
télé, la chaîne hi-fi, la console, la tablette, la compte un jour de l’efficacité énergétique7,
totale » (Paméla). Ces besoins se traduisent l’ « empêché » ne parvient pas à y investir.
de fait par le nombre et les caractéristiques En cela, il confirme le constat critique de
des appareils possédés (audio-visuel, infor- Moloney et Strengers (2014) pour qui la res-
matique, communication) qui engendrent une ponsabilité des gestes écologiques est impu-
forte croissance de la consommation d’éner- tée aux individus, dont une partie d’entre
gie spécifique non prise en compte dans l’ap- eux ne peut pas financièrement les assumer.
proche de Gram-Hanssen (2008). L’ « empêché » ne voit donc pas comment
faire plus ou autrement que ce qu’il fait déjà :
L’ « empêché » : frugal malgré lui « Pour moi, pour l’instant, c’est machinal.
Ce que je fais je ne pourrais pas l’enlever,
Dans les profils orientés plutôt défavorable-
ment, l’ « empêché » est caractérisé non seu- 7/ Sur la question des incitations à la réduction de
lement par des revenus faibles, une situation la consommation d’énergie, l’étude ADEME (2016)
souligne que 53 % des répondants sont d’abord gui-
sociale difficile ou précaire (telle que famille
dés par des considérations économiques, 29 % citant
monoparentale, faibles revenus, handicap, l’augmentation de leur facture énergétique et 24 % le
activité réduite ou chômage), mais aussi par fait que leur situation financière l’impose. De même,
une difficulté à peser sur le cours des choses. une étude l’enquête Environnement Opinion Way
2015 pour l’ADEME indique qu’être locataire est le
Se percevant vulnérable, il est méfiant et tend premier frein à la réalisation de travaux de rénova-
à se replier sur lui-même. tion énergétique.
Marketing responsable – 45
on ne peut pas enlever ses habitudes comme 5. Les éléments matériels du système
ça, malgré que l’on soit dans un quartier énergétique incorporé et acquis
spécial » (Françoise). De fait, la référence Se restreignant par nécessité absolue du fait
aux routines se manifeste sous l’angle d’une de sa situation économique, l’« empêché »
continuité existentielle, structurante, et donc dispose d’un niveau d’équipement person-
difficilement modifiable. nel souvent basique, le coût d’appareils per-
formants étant souvent généralement hors
3. Les engagements et les significations de portée financière : « J’ai une seule télé,
accordées aux pratiques c’est un écran d’il y a très longtemps : c’est
En dépit de ses difficultés à s’extraire de sa encore un tube cathodique » (Aline). Au
situation, l’ « empêché » demeure ouvert à final, la question qui se pose à propos de ce
de possibles changements : « Oui, c’est pos- profil est la direction vers laquelle il pour-
sible de réduire la consommation d’énergie rait « migrer » en cas de desserrement de ses
de moitié mais il faut trouver une astuce et contraintes.
quand on a cinq enfants sur le chemin ce
n’est pas simple » (Moktar). Si Aline tente de Le « réfractaire » : quand réduire, c’est
faire agir ses proches : « Au quotidien, je le régresser
dis aussi à ma fille pour essayer de la sensi- A l’extrémité du continuum d’orientations
biliser un peu. Éteins l’eau, éteins la lumière défavorables, le « réfractaire » refuse toute
quand tu sors de ta chambre. Dès qu’il y contrainte énergétique, manifestant un désin-
a un truc, éteins-le », son influence sur les térêt pour une démarche de réduction, que
autres n’est pas absente, mais reste d’ampleur celle-ci soit perçue comme une régression ou
modeste. comme une peur de perdre sa liberté.
4. Les règles, prescriptions et influences 1. Degré de compréhension pratique et
En raison de ses contraintes, l’« empêché » d’appropriation des éléments incorporés
est sensible à l’information mais son atten- Ce qui le caractérise de manière évidente,
tion se porte davantage sur le montant de c’est son incompréhension délibérée, son
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
sa facture d’énergie que sur le niveau réel désintérêt pour une meilleure maîtrise de
de sa consommation. Il existe même parfois l’usage de l’énergie, ou encore ses approxi-
une confusion entre facturation et quantité mations ou interprétations erronées des sys-
consommée, par exemple lorsque le bailleur tèmes techniques, qu’il s’agisse des équipe-
social lui reverse un trop perçu (en fonction ments acquis comme l’illustre Fabienne :
de la réalité de ses charges), interprété à tort « J’ai tous les appareils qui restent en veille,
comme une baisse de sa consommation. la chaîne hi-fi, tout ça, mais ça consomme
Malgré une méfiance, voire une certaine dé- pas beaucoup », mais aussi du système de
fiance aux autres, l’« empêché » peut manifes- chauffage incorporé.
ter une attente par rapport à l’apport potentiel
de tiers de confiance identifiés : « Je ne vois 2. L’intelligibilité pratique et les raisons d’être
pas comment je pourrais réduire ma facture, des routines
je demanderais conseil. Je m’adresserais à Globalement, ses pratiques ne sont pas por-
EDF, c’est les seuls qui pourront nous don- teuses de réduction ou de maîtrise de sa
ner des conseils à ce niveau-là » (Francine). consommation, mais empreintes de fata-
De fait, sa situation sociale d’isolement nuit à lisme, avec l’idée qu’on ne peut rien y changer
la réceptivité et à l’acceptation des prescrip- (Moloney et Strengers, 2014) : « C’est comme
tions qui se heurtent souvent à son sentiment la taxe d’habitation, on n’a pas le choix, on
d’impuissance. la paye » (René). Pour la plupart, les routines
46 – Décisions Marketing n°90 Avril-Juin 2018
quotidiennes, bien qu’énergivores, sont justi- « C’est plus les grandes sociétés qui devraient
fiées par le désir d’éviter des efforts cognitifs faire attention. Ceux qui brûlent, les usines,
qui viseraient à changer l’existant : « La télé c’est plus à eux de défendre la planète »
est en veille 24h/24, la télé… c’est une ques- (Mickaël). De fait, le « réfractaire » est peu
tion de commodité et en fait je ne me suis ja- perméable à l’influence, aux prescriptions ou
mais posé la question » (Lucette). De même, aux informations fournies sur la consomma-
le critère de consommation énergétique n’est tion : « C’est pas facile la différence entre le
jamais pris en compte lors de l’achat d’appa- double A et le triple A. Même les vendeurs ils
reils additionnels. ne savent pas. Tout ça c’est de la rigolade »
(Rose). En revanche, à l’instar de Mila qui
3. Les engagements et les significations indique : « Ça serait bien d’encourager de
accordées aux pratiques cette manière : s’il y a un bonus, je pense
Le « réfractaire » se caractérise par un re- qu’il y aura plus de personnes qui feront
fus marqué de toute contrainte énergétique. attention », il se déclare sensible aux récom-
Bien qu’il affirme ne pas gaspiller, on per- penses économiques comme possibles leviers
çoit dans son orientation une forme d’inertie, de changement, une suggestion déjà formulée
voire de résistance. Toutes les pratiques sont par Bertoldi, Rezessy et Oikonomou (2013).
donc considérées comme irréductibles : on
ne peut pas faire moins, on ne peut pas faire 5. Les éléments matériels du système
mieux. Pour les plus âgés comme Daniel énergétique incorporé et acquis
(80 ans), c’est la crainte de régresser qui do- S’agissant de son niveau personnel d’équipe-
mine, par référence au passé, à ce qui a pu ment, le « réfractaire » n’est pas caractérisé
être acquis ou conquis en termes de niveau par une diversité ou un nombre d’appareils
de vie et de confort : « On revient à la lampe particuliers, sa limite étant surtout liée à sa
à huile de mon grand-père… A un certain capacité financière.
âge j’ai connu la guerre, les restrictions, le
En résumé, le cadre d’analyse fourni par la
manque de ceci, le manque de cela. En faire théorie des pratiques permet de mettre en
plus, non, c’est pas possible ». Pour les plus
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
relief les dimensions et composantes les plus
jeunes, c’est le sentiment de perte de liberté caractéristiques de chaque profil, facilitant
ou de diminution du confort qui est patent. ainsi l’identification des leviers de la réduc-
Quel que soit l’âge, on constate également un tion de la consommation d’énergie. Parmi
refus d’anticiper l’avenir comme le montre les individus orientés favorablement – volon-
Mahmoud : « On n’a qu’une seule vie, pour- taires et responsables – l’analyse montre que
quoi on va se priver de plein de choses alors la dimension la plus contrastée est l’intelligi-
qu’on peut vivre normalement ? », soulignant bilité pratique et les raisons d’être des rou-
un ancrage hédoniste dans l’ici et maintenant tines incorporées. Ainsi, là où le volontaire
par défaut de visibilité du lendemain. cherche à faire agir les autres, le respon-
sable privilégie le résultat immédiat et tend
4. Les règles, prescriptions et influences à se substituer à eux pour agir à leur place.
Le « réfractaire » fait parfois référence à Parmi les individus orientés défavorablement
des tensions face auxquelles la pression à la – réfractaires et empêchés –, les résultats
réduction de consommation d’énergie est res- montrent que la dimension la plus contras-
sentie comme inadmissible. En découle un tée porte sur les engagements et significa-
rejet de la responsabilité que le discours éco- tions. Chez le réfractaire, les pratiques sont
logique cherche à faire porter aux individus choisies tandis que pour l’empêché elles sont
(Moloney et Strengers, 2014), responsabilité essentiellement contraintes. Le second carac-
que le « réfractaire » reporte sur d’autres : tère distinctif relève du degré de compréhen-
Marketing responsable – 47
sion pratique, l’empêché cherchant à gérer gie et de freins à sa réduction. Toutefois, cha-
au mieux sa consommation contrairement cun des profils identifiés présente des leviers
au réfractaire qui considère l’existant comme d’action spécifiques que nous détaillons à la
inamovible. suite (Tableau 2).
Donner au « volontaire » le rôle de
Discussion et implications pour leader d’opinion dans son entourage
l’action
Les individus se rattachant au profil « vo-
Les résultats ci-dessus, appuyés sur la théorie lontaire » et dans une certaine mesure, au
des pratiques, soulignent l’enchevêtrement de profil « responsable », manifestent, au-delà
facteurs générateurs de consommation d’éner- de leur propre pratique, une satisfaction et
Tableau 2 : Synthèse des profils, objectifs et modalités d’action pour favoriser la réduction de la
consommation d’énergie
Caractéristiques princi- Modalités d’action
Profil Principaux objectifs d’action
pales du profil spécifiques
Volontaire Être partie prenante de L’inciter à exprimer ses convic- Soutenir sa propension à agir
sa maîtrise énergétique tions, l’inciter à se comporter sur les autres
comme un leader d’opinion Lui donner un rôle de block-
leader dans l’immeuble et les
associations de quartiers
Responsable Être efficace mais sans Consolider sa propension à Accroître son accessibilité aux
remise en cause de son l’efficacité équipements efficaces et amé-
« confort » liorer l’efficacité de gestion de
ses équipements
Dissocier la réduction énergé- Promouvoir des alternatives
tique de l’idée de privation sobres (pratiquer un sport, parti-
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
ciper à des activités collectives)
Empêché Être dans l’incapacité Rendre l’efficacité accessible Multiplier les caractéristiques
économique à faire plus efficaces des équipements à
ou mieux en dépit d’une prix inchangé
possible volonté de L’inciter à partager des équipe-
changement ments
Rompre l’isolement Favoriser le « parrainage » entre
voisins (par le « volontaire »)
Réfractaire Être dans la peur de la Montrer l’intérêt financier de Donner des exemples concrets
réduction de consom- l’efficacité d’usage sans inci- avec chiffrage des gains
mation assimilée à une dence sur le service rendu
régression…
…ou à une entrave Assurer l’efficacité des équipe- Systématiser l’incorporation
ments hors de l’utilisateur des caractéristiques efficaces
Lui donner envie d’imiter les dans les appareils (coupure de
autres veille des appareils)
Promouvoir des modèles
socialement valorisants, corro-
borés par des témoignages de
proximité
48 – Décisions Marketing n°90 Avril-Juin 2018
même une fierté à s’engager dans la maî- Aider le « responsable » à passer de
trise de leur consommation, dans laquelle ils l’efficacité énergétique à la sobriété
trouvent une valeur morale et de réalisation Recherchant activement de l’information et
(Innocent, François-Lecompte et Le Gall- pouvant consentir à des efforts de gestion
Ely, 2016 ; Özçaglar-Toulouse, 2009). Cette afin de minimiser sa consommation d’éner-
implication déborde du cadre personnel pour gie pour un service rendu identique (effica-
souligner la valeur sociale de ces comporte- cité), le « responsable » n’accepte pas pour
ments (Bertrandias, 2012). Il est donc impor- autant l’idée d’une privation associée à la so-
tant d’inciter ces individus à exprimer leurs briété. S’il accepte de réduire la consomma-
convictions, à se comporter comme des lea- tion de ses équipements (et par là son impact
ders d’opinion car, se voyant attribuer une financier), c’est donc en adoptant un compor-
conscience écologique par les personnes de tement d’« altruiste » calculateur (Hopper et
leur entourage, ils sont susceptibles de les Nielsen, 1991) qui s’insère facilement dans
aider à faire évoluer leurs pratiques. Le « vo- son mode de vie et n’implique aucune renon-
lontaire » pourrait alors se voir confier des ciation à ses pratiques. Plusieurs recomman-
actions de sensibilisation lui conférant un rôle dations s’imposent. En premier lieu, il est
d’entraînement ou de block-leader (Hopper essentiel d’entretenir sa propension à l’effi-
et Nielsen, 1991). Comme le montrent ces cacité en lui conseillant les équipements les
auteurs dans le domaine du tri/recyclage, plus performants et en lui fournissant des
l’effet d’imitation de ces volontaires modi- préconisations de gestion de ses appareils.
fie les comportements de leurs voisins sans En second lieu, il convient aussi de le sen-
qu’il y ait besoin d’agir sur leurs attitudes. A sibiliser à l’effet rebond auquel il ne lie pas
la différence des actions de sensibilisation de toujours nécessairement la possession d’équi-
type top-down (Moloney et Strengers, 2014), pements supplémentaires. Ainsi, il convient
les relations sociales de voisinage créent de l’informer que sa consommation n’est pas
une « accessibilité spatiale » qui produit et seulement liée à la gestion de ses appareils,
pérennise de tels changements (Bertrandias, mais aussi à son niveau d’équipement. Cela
2012). En outre, la proximité et la simili- suppose d’agir sur la conscientisation des
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
tude de situation que constitue « l’accessibi- pratiques gourmandes en équipements nou-
lité sociale » (Bertrandias, 2012) favorisent veaux ou supplémentaires et sur la manière
l’écoute et l’acceptation par mimétisme, alors dont celles-ci s’enracinent dans la vie des
que des organismes extérieurs sont parfois individus (Shove, 2010). Bien que Shove sou-
perçus comme lointains, sinon intéressés à la ligne la difficulté du travail de déconstruc-
promotion d’un discours écologique respon- tion de l’existant, pourtant essentiel à un
sabilisant (Moloney et Strengers, 2014). En véritable changement, des pistes peuvent être
complément, un « parrainage » de voisinage trouvées en incitant ces individus à adop-
permettrait de créer une relation de confiance ter des activités substitutives (Spurling et
entre le « volontaire » et le parrainé, inscri- al., 2013), notamment celles qui, comme le
vant l’action dans la durée, la quotidienneté sport, les activités sociales, la fréquentation
et l’espoir de voir partager l’action par plus d’une bibliothèque ou d’un espace collectif
d’individus. L’enrôlement des « volontaires » dans le quartier, sont sobres en énergie. Cette
pourrait se faire par le biais des personnels réorientation des pratiques en dehors du loge-
accompagnant la mise en place des pro- ment, espace de forte consommation pourrait
grammes, à la fois pour détecter ces profils avoir prise sur ce profil sensible aux discours
et leur fournir un local et des documents environnementaux. Par ailleurs, une autre
d’information à diffuser et discuter lors de piste est à retenir du côté des fabricants/dis-
ces rencontres. tributeurs qui consisterait d’une part à valo-
Marketing responsable – 49
riser, dans les publicités, des modèles sobres a été évoqué plus haut. Une telle formule de
que le « responsable » aurait envie d’imiter, parrainage pourrait donc être une première
d’autre part à réélaborer les composants ma- voie de passage, sécurisée et sécurisante,
tériels de la pratique en développant l’effica- pour des individus souvent repliés sur eux-
cité énergétique et l’éco-design des produits mêmes et peu confiants dans leurs moyens de
(Spurling et al., 2013). progresser.
Rompre l’isolement et desserrer les Libérer le « réfractaire » du sentiment
contraintes de l’« empêché » de régression ou d’entrave
Ce profil, particulièrement vulnérable et Le « réfractaire » est celui qui oppose les plus
contraint, présente néanmoins une sensibilité fortes résistances au changement de compor-
environnementale qui mérite d’être prise en tement énergétique. La perspective d’une
compte. C’est en premier lieu sur l’efficacité réduction (à la fois des équipements et de la
énergétique que les efforts doivent porter, consommation induite par leur utilisation)
plutôt que sur la sobriété à laquelle ces in- est associée à une sobriété contrainte qui
dividus sont contraints. Aussi, maintenir un peut être ressentie comme une atteinte à sa
niveau de qualité irréprochable des systèmes liberté ou à son plaisir (Innocent, François-
incorporés (pour le chauffage, la ventilation, Lecompte et Le Gall-Ely, 2016). Ces peurs
l’eau chaude sanitaire) et leur fournir des sont alors une façon de légitimer son blo-
modes d’emploi facilement compréhensibles cage à réduire sa consommation. De fait, les
sur la manière de s’en servir sont deux prio- risques de résistance à des formes de com-
rités pour éviter qu’ils n’adoptent des gestes munication trop injonctives appellent des so-
contre-performants. En second lieu, dans le lutions plus subtiles, basées sur l’architecture
sillage des initiatives collaboratives, le par- de choix. Celle-ci peut consister, en phase
tage, la mutualisation ou le prêt d’appareils d’acquisition, à le diriger vers des équipe-
entre voisins pourraient venir pallier la fai- ments dotés d’un haut niveau d’efficacité qui
blesse de leurs équipements, sans surcoût pourraient ainsi réduire sa consommation
financier et sans impact écologique supplé- énergétique sans altérer le service et sans
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
mentaire. Ainsi, Borel, Roux et Demailly éveiller un sentiment de régression ou d’en-
(2016) soulignent les motivations sociales à trave. En outre, ces équipements pourraient
échanger des objets dans un réseau de prêt être dotés de fonctionnalités favorisant une
entre voisins à Toulouse où l’interconnais- utilisation elle-même efficace, par exemple
sance est forte. Par ailleurs, l’ « empêché » un dispositif par défaut d’interruption auto-
exprime généralement le besoin d’échapper matique de la veille, incluant une fonction de
à son contexte socio-économique fait d’isole- réactivation aussi simple d’usage qu’une télé-
ment, de précarité, d’insécurité, de vulnéra- commande. Si ces préconisations ne sont pas
bilité, de manque d’information. Stimuler des propres au « réfractaire », elles doivent être
orientations sociales plus positives – discuter généralisées en raison même de l’existence
avec d’autres, participer à un projet collectif, de ce profil, peu enclin à suivre des directives
et échanger des « tuyaux » sur de bonnes pra- ou à les appliquer spontanément. En second
tiques à la fois économiques et écologiques – lieu, mettre en avant les gains économiques
pourrait être une piste prometteuse. Un tiers obtenus sans incidence sur le service attendu
de confiance tel un proche, une personne serait de nature à valoriser l’intérêt de l’effi-
connue (voisin, gardien…) pourrait servir cacité énergétique en phase d’usage. Il serait
de médiateur de proximité, rôle qui pourrait donc profitable de fournir au réfractaire,
également être confié au « volontaire » dont le très attentif aux charges occasionnées par sa
caractère prosélyte et le rôle de block-leader consommation énergétique, des encourage-
50 – Décisions Marketing n°90 Avril-Juin 2018
ments sur les économies réalisées au fil du cation publique environnementale (Ministère
temps qui, actuellement, ne sont pas direc- de la Transition écologique et solidaire,
tement visibles dans ses factures. La géné- ADEME ou fournisseurs d’énergie). En effet,
ralisation des nouveaux « compteurs intelli- la réduction de la consommation d’énergie
gents » pourrait jouer ce rôle de rétroaction peut résulter de l’efficacité et/ou de la sobrié-
en lui donnant le sentiment d’être maître de té : il importe donc de considérer le point de
sa consommation et de ses dépenses. Plus vue du consommateur différemment de celui
encore, le « réfractaire » se déclarant réceptif du fournisseur d’énergie. En effet, si pour
à l’idée d’une récompense ou d’un « bonus », ce dernier l’unité de mesure est la quantité
un programme d’incitations financières ex d’énergie consommée (quel que soit le ser-
ante liées aux économies réalisées, couplé vice), pour le premier, c’est le volume ou la
à un système de suivi en temps réel de leur qualité de service obtenu qui se révèle essen-
consommation pourrait se révéler intéressant tiel. Il est donc nécessaire que la communica-
(Bertoldi, Rezessy et Oikonomou, 2013 ; tion publique insiste sur la maximisation de
Zhao et al., 2012). Cette recommandation l’expérience de service de l’utilisateur plutôt
concerne en particulier les bailleurs sociaux que de lui faire craindre sa dégradation. La
et l’information qu’ils pourraient leur fournir, communication visant la sobriété doit égale-
à la fois sur leurs gains de consommation ment tenir compte des profils. Elle s’adresse
et sur les économies réalisées. En troisième prioritairement au « responsable » et au « vo-
lieu, ces mêmes acteurs pourraient publier lontaire », et non au « réfractaire » pour qui
des chiffrages de consommation compara- les discours de réduction risquent de susciter
tifs dont l’efficacité a été démontrée (Allcott, de la résistance et appellent d’autres actions,
2011). En effet, la théorie de l’engagement par exemple des incitations économiques,
appliquée au domaine de l’énergie montre moins problématiques sur ce point.
que les individus auxquels on demande un
geste – par exemple réduire l’usage d’une
climatisation – s’y tiennent quand cet enga-
Conclusion
gement est public et l’oublient quand il est Les individus, au quotidien, consomment de
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
privé (Pallack et Cummings, 1976). Au final, l’énergie dans leur cadre résidentiel, c’est-à-
des systèmes d’incitation douce pariant sur dire dans ce qui est à proprement parler le
des effets d’imitation pour orienter les com- « foyer » de leur existence, objet de toutes les
portements dans le sens souhaité (Thaler et attentions et forme d’extension de soi. Il appa-
Sunstein, 2008) pourraient avoir prise sur les raît toutefois que la consommation d’énergie
« réfractaires » sans les priver de liberté. n’est ni une fin, ni une pratique en soi, mais
Au-delà de chaque profil, une recommanda- « un moment » au sein d’autres pratiques
tion d’ensemble concerne la tarification ac- (Warde, 2005). Elle est la contrepartie néces-
tuelle de l’énergie. Il conviendrait en effet de saire d’autres activités inductrices de consom-
remplacer le système dégressif actuel (le prix mation énergétique pour un service attendu.
de revient du kWh diminue avec l’augmen- L’énergie a également comme particularité
tation de la consommation) par une tarifica- de ne pouvoir être utilisée directement : sa
tion progressive de l’énergie (le prix du kWh consommation est nécessairement liée à celle
consommé augmente avec la consommation), d’équipements spécifiques à chaque service.
qui se révèlerait plus cohérente pour dissua- Prenant appui sur la théorie des pratiques et
der toute tendance à épuiser la ressource. son application au contexte de la consomma-
tion d’énergie (Gram-Hanssen, 2008), nous
Au-delà, notre recherche présente un intérêt avons montré, à l’instar de Spurling et al.
plus général pour les acteurs de la communi- (2013), que les pratiques ne sont pas le simple
Marketing responsable – 51
résultat d’un choix individuel, ni d’une appré- des habitations individuelles. L’analyse pour-
ciation des simples coûts et bénéfices liés à rait également être poursuivie dans le sens
la maîtrise des consommations énergétiques de l’approfondissement du rôle des sources
(Innocent, François-Lecompte et Le Gall-Ely, d’influence, informatives ou prescriptives, et
2016), mais qu’elles sont enchâssées sociale- des phénomènes d’acceptation, de rejet ou
ment et matériellement. En cela, la théorie des de résistance qu’elles peuvent engendrer. En
pratiques propose un éclairage systémique des effet, les techniques de nudge, a priori jugées
comportements qui évite deux grands écueils peu intrusives, ne seront efficaces que si (ou
(Geels et al., 2015) : soit considérer, dans tant que) les individus ne les perçoivent pas
une perspective « révolutionnaire », que la comme des tentatives de manipulation de
sobriété ne peut être atteinte qu’en suivant les leurs comportements. Enfin, des études quan-
préceptes de la décroissance, sans considérer titatives pourraient utilement compléter cette
le caractère socialement marqué et souvent
première approche, en incluant notamment
élitiste de ces mouvements ; soit penser, dans
la mesure de l’idéologie politique. En effet,
une perspective « réformiste », qu’il suffit de
celle-ci semble entraîner une réception dif-
peser sur les attitudes ou les choix pour obte-
férente des nudges selon la sensibilité idéo-
nir des effets durables sur les comportements
logique des individus (Costa et Kahn, 2010),
(Allcott, 2011). Ces deux approches relèvent
de positions idéologiques opposées mais se appelant ainsi à leur usage différencié selon
rejoignent sur le principe d’une (ir)rationa- les profils. Finalement, il apparaît aussi que
lité des décisions prises par les individus. les individus sont soumis à des injonctions
A contrario, notre approche considère que paradoxales – consommer vs économiser,
l’individu est d’abord pris dans des routines, optimiser leurs usages vs réduire leurs équi-
enserré dans un système de normes sociales pements. Il serait donc utile d’analyser, dans
et contraint par un environnement socio-tech- une perspective systémique, la manière dont
nique particulier. Nous considérons, à l’instar différents types d’acteurs – économiques, ins-
de Gram-Hanssen (2008) que la théorie des titutionnels et pro-environnementaux – s’em-
pratiques est pertinente et utile pour l’analyse parent de la question énergétique et pèsent,
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
de ces comportements. Notre étude enrichit la parfois de manière contradictoire, sur leurs
théorie à la fois dans son application et dans comportements.
son exploitation : en intégrant toutes les activi-
tés susceptibles de peser sur leur consomma-
tion, notamment l’acquisition d’équipements
Références
électriques supplémentaires au-delà du seul ADEME (2016), Changer les comportements, faire
système incorporé au logement ; en proposant évoluer les pratiques sociales vers plus de du-
une typologie utile à la formulation de recom- rabilité. L’apport des sciences humaines et so-
mandations différenciées pour chaque profil ciales pour comprendre et agir, Rapport d’étude.
selon le caractère favorable ou défavorable Allcott H. (2011), Social norms and energy conser-
de leurs activités/comportements. Nos résul- vation, Journal of Public Economics, 95, 9-10,
tats comportent toutefois certaines limites, 1082-1095.
portant tout d’abord sur le contexte d’obser- Bertoldi P., Rezessy S. et Oikonomou V. (2013),
vation. Il est ainsi possible que d’autres envi- Rewarding energy savings rather than energy ef-
ficiency: Exploring the concept of a feed-in tariff
ronnements puissent faire émerger de nou-
for energy savings, Energy Policy, 56, 526-535.
veaux profils, ou d’autres nuances dans les
Bertrandias L. (2012), Influences informationnelle et
pratiques. Par exemple, il n’est pas sûr que les
normative sur les comportements du consomma-
« volontaires » observés ici soient similaires à teur, Mémoire en vue de l’obtention de l’Habili-
ceux qui pourraient assumer un rôle de leader tation à Diriger des Recherches en Sciences de
d’opinion dans un quartier résidentiel avec Gestion, Université Toulouse Capitole.
52 – Décisions Marketing n°90 Avril-Juin 2018
Borel S., Roux D. et Demailly D. (2016), La place Lutzenhiser L. (1992), A Cultural Model of House-
des enjeux sociaux et environnementaux dans la hold Energy Consumption, Energy, 17, 1, 47-60.
consommation collaborative : le point de vue des Moloney S. et Strengers Y. (2014), Going green?:
usagers, PICO Working paper, Paris, IDDRI. The limitations of behaviour change pro-
Bourdieu P. (1980), Le sens pratique, Paris, Editions grammes as a policy response to escalating re-
de Minuit. source consumption, Environmental Policy and
Governance, 24, 2, 94-107.
Bourg D., Dartiguepeyrou C., Gervais C. et Perrin
O. (2016), Les nouveaux modes de vie durables. Özçaglar-Toulouse N. (2009), Quel sens les consom-
S’engager autrement, Lormont, Editions le Bord mateurs responsables donnent-ils à leur consom-
de l’Eau. mation ? Une approche par les récits de vie,
Recherche et Applications en Marketing, 24, 3,
Brisepierre G. (2011), Les conditions sociales et or-
3-23.
ganisationnelles du changement des pratiques de
consommation d’énergie dans l’habitat collectif, Pallack M. et Cummings W. (1976), Commitment
Thèse de sociologie, Université Paris Descartes. and voluntary energy conservation, Personnality
and Social Psychology Bulletin, 2, 27-30.
Costa D. et Kahn M. (2010), Energy conservation
nudges and environmentalist ideology: evidence Reckwitz A. (2002), Toward a theory of social
from a randomized residential electricity field practices: A development in culturalist theori-
experiment, NBER Working Paper, n° 15939. zing, European Journal of Social Theory, 5, 2,
243‑263.
Dubuisson-Quellier S. et Plessz M. (2013), La théo-
rie des pratiques. Quels apports pour l’étude Schatzki T.R. (1996), Social Practices. A Wittgens-
sociologique de la consommation ?, Sociologie, teinian approach to human activity and the so-
4, 4. https://sociologie.revues.org/2030, consulté cial, Cambridge, Cambridge University Press.
le 3/12/2016. Schatzki T.R. (2002), The site of the social: A philo-
Dujin A., Maresca B. et Vedie M. (2012), Changer sophical account of the constitution of social life
les comportements. L’incitation comportemen- and change, University Park, Pennsylvania State
tale dans les politiques de maîtrise de l’énergie University Press.
en France, Paris, Cahiers de Recherche du CRE- Shove E. (2003), Comfort, cleanliness and conve-
DOC, n° 295. nience. The social organization of normality,
Oxford and New York, Berg.
Geels F.W., McMeekin A., Mylan J., Southerton
D. (2015), A critical appraisal of Sustainable Shove E. (2010), Beyond the ABC : Climate Change
Consumption and Production research: The re- Policy and Theories of Social Change, Environ-
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
formist, revolutionary and reconfiguration posi- ment and Planing A, 42, 6, 1273-1285.
tions, Global Environmental Change, 34, 1-12. Shove E. et Pantzar M. (2005), Consumers, produ-
Giddens A. (1984), The constitution of society: Out- cers and practices, Journal of Consumer Culture,
line of the theory of structuration, Cambridge, 5, 1, 43-64.
Polity Press. Spurling N., McMeekin A., Shove E., Southerton
Gram-Hanssen K. (2008), Heat comfort and prac- D. et Welch D. (2013), Interventions in practice:
tice theory. Understanding everyday routines of re-framing policy approaches to consumer beha-
energy consumption, Proceedings of the SCORE viour, Sustainable Practices Research Group
Conference, Brussels, mars, 53-72. Report.
Hopper J.R. et Nielsen J.M. (1991), Recycling as al- Stephenson J., Barton B., Carrington G., Gnoth
truistic behavior: normative and behavioral stra- D., Lawson R. et Thorsnes P. (2010), Energy
tegies to expand participation in a community cultures: a frame work for understanding energy
recycling program, Environment and Behavior, behaviours, Energy Policy, 38, 10, 6120-6129.
23, 2, 195-220. Thaler R.H. et Sunstein C.R. (2008), Nudge: Impro-
Huzée M.-H. et Cyssau R. (2007), Maîtrise de la ving decisions about health, wealth, and happi-
demande d’énergie par les services d’individua- ness, New Haven, Yale University Press.
lisation du chauffage, Rapport de recherche pour Warde A. (2005), Consumption and theories of prac-
le compte de l’ADEME. tice, Journal of Consumer Culture, 5, 2, 131-153.
Innocent M., François-Lecompte A. et Le Gall-Ely Wilson C. et Dowlatabadi H. (2007), Models of
M. (2016), La valeur associée à la maîtrise de la Decision Making and Residential Energy Use,
consommation électrique : multi-dimensionna- Annual Review of Environmental Resources, 32,
lité et bivalence, Décisions marketing, 83, 5-28. 2, 1-35.
Marketing responsable – 53
Zhao T., Bell L., Horner M.W., Sulik J. et Zhang J. Zélem M.-C. (2010), Politique de maîtrise de la de-
(2012), Consumer responses towards home ener- mande d’énergie et résistances au changement.
gy financial incentives: A survey-based study, Une approche socio-anthropologique, Paris,
Energy Policy, 47, 8, 291-297. L’Harmattan, coll. « Logiques sociales ».
Annexes
Annexe 1 : Caractéristiques sociodémographiques des 40 répondants
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
54 – Décisions Marketing n°90 Avril-Juin 2018
Annexe 2 : Adaptation de la grille théorique de compréhension des pratiques (Gram-Hanssen, 2008)
à une population de locataires de l’habitat social réhabilité thermiquement et présentation des quatre
profils-types
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
© EMS Editions | Téléchargé le 15/05/2024 sur www.cairn.info (IP: 160.177.184.177)
Vous aimerez peut-être aussi
- La Revue ÉnergétiqueDocument4 pagesLa Revue ÉnergétiqueDalila Ammar50% (4)
- Politique QHSE - Liste Des Objectifs Fixés Au PersonnelDocument2 pagesPolitique QHSE - Liste Des Objectifs Fixés Au Personnelismailov25Pas encore d'évaluation
- Afnor Energies - Etude Audits EnergetiquesDocument6 pagesAfnor Energies - Etude Audits EnergetiquesZiyad ElamraniPas encore d'évaluation
- La DDA et les nouvelles règles en matiere de distribution d' assurances: AnalyseD'EverandLa DDA et les nouvelles règles en matiere de distribution d' assurances: AnalysePas encore d'évaluation
- De La Conduite Du Changement AGILEDocument9 pagesDe La Conduite Du Changement AGILEvladPas encore d'évaluation
- Fi00217 f05 Exploitation Maintenance InstrumentationDocument12 pagesFi00217 f05 Exploitation Maintenance InstrumentationMohamed CIPas encore d'évaluation
- QDM 194 0169Document5 pagesQDM 194 0169Rahma BarkitPas encore d'évaluation
- Système de Gestion D'energieDocument15 pagesSystème de Gestion D'energiemoudjedPas encore d'évaluation
- Zaidi Le Management de La LégitimitéDocument23 pagesZaidi Le Management de La Légitimitén9.francePas encore d'évaluation
- Resg 118 0045Document20 pagesResg 118 0045Fabrice GUETSOPPas encore d'évaluation
- Plaquette LPMEER 2020Document4 pagesPlaquette LPMEER 2020Pablo AntonioPas encore d'évaluation
- QDM 151 0091Document11 pagesQDM 151 0091Hamza ABPas encore d'évaluation
- La Consommation D'Energie Dans L'Habitat Entre Recherche de Confort Et Imperatif EcologiqueDocument87 pagesLa Consommation D'Energie Dans L'Habitat Entre Recherche de Confort Et Imperatif Ecologiquehamsangels96Pas encore d'évaluation
- Transitions2050 Infographie s3Document1 pageTransitions2050 Infographie s3ZorattiPas encore d'évaluation
- Re 067 0005Document3 pagesRe 067 0005OladeleIsaiahPas encore d'évaluation
- RSE Determ-2017Document14 pagesRSE Determ-2017SINI DELIPas encore d'évaluation
- 201506-MDE - Plaquette Audit Énergetique en EntrepriseDocument8 pages201506-MDE - Plaquette Audit Énergetique en EntrepriseCOOLPas encore d'évaluation
- Vse 188 0038Document20 pagesVse 188 0038Aloin C DavidPas encore d'évaluation
- Les Usages de L Energie Dans Les EntreprDocument139 pagesLes Usages de L Energie Dans Les EntreprNoureddine BelazouguiPas encore d'évaluation
- Hume 291 0025Document23 pagesHume 291 0025Liana RamanandafyPas encore d'évaluation
- Resg 106 0091Document22 pagesResg 106 0091sitraka AndriatsilavinaPas encore d'évaluation
- ZZ7164-C-Guide - Les Architectures Connectées Incontournables - 13avril2023Document18 pagesZZ7164-C-Guide - Les Architectures Connectées Incontournables - 13avril2023rot3522Pas encore d'évaluation
- Nakhla 2006Document14 pagesNakhla 2006Serp YelmazPas encore d'évaluation
- Resg 131 0215Document27 pagesResg 131 0215Sansan Corneille KambouPas encore d'évaluation
- Politique Energetique UhaDocument1 pagePolitique Energetique UhaAntoine lazarus MaomyPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 - SMÉ Et Audit EnergétiqueDocument17 pagesChapitre 2 - SMÉ Et Audit Energétiquehajji100% (2)
- Gestion de Lenergie Et Optimisation Du Systeme MuDocument10 pagesGestion de Lenergie Et Optimisation Du Systeme MuThiery NDEME MESSINAPas encore d'évaluation
- Les Règles D Une Coopétition Entre Pme Le Cas Du Gie Chargeurs Pointe de BretagneDocument13 pagesLes Règles D Une Coopétition Entre Pme Le Cas Du Gie Chargeurs Pointe de BretagneYassirZariPas encore d'évaluation
- Rimhe 010 0105Document20 pagesRimhe 010 0105MandyPas encore d'évaluation
- Les Marques Des DistributeursDocument16 pagesLes Marques Des DistributeursChayma RbPas encore d'évaluation
- Construction Exploitation Centrales Production Generation Energie ElectriqueDocument32 pagesConstruction Exploitation Centrales Production Generation Energie ElectriqueDM NGUYENPas encore d'évaluation
- 1 - Manuel de Management Des ÉnergiesDocument12 pages1 - Manuel de Management Des Énergiesهدوء calmePas encore d'évaluation
- Subprogram Parcours Valorisation Des Energies Renouvelables Et Transition EnergetiqueDocument6 pagesSubprogram Parcours Valorisation Des Energies Renouvelables Et Transition EnergetiqueMoubarak MoubarakPas encore d'évaluation
- L'orientation Déontologique E PreiratDocument20 pagesL'orientation Déontologique E PreiratTaffyd MaertinsPas encore d'évaluation
- Aitmassaoud Mohammed TP1Document12 pagesAitmassaoud Mohammed TP1yassinePas encore d'évaluation
- Web MME-Mastere Specialise en Management Des Marches de L-Energie 6097Document9 pagesWeb MME-Mastere Specialise en Management Des Marches de L-Energie 6097eliorapdgPas encore d'évaluation
- Master EnergieDocument5 pagesMaster EnergieRai luxe en livePas encore d'évaluation
- Maitriser Les Techniques de Tarification en ReassuranceDocument2 pagesMaitriser Les Techniques de Tarification en ReassuranceBison-Fûté LebesguesPas encore d'évaluation
- Cours OptimisationDocument43 pagesCours OptimisationYoussef BOUFRADPas encore d'évaluation
- Méthode ABCDocument13 pagesMéthode ABCMorad Abou AbdillahPas encore d'évaluation
- CCV Et Chaine de ValeurDocument16 pagesCCV Et Chaine de ValeurDieudonné SAWADOGOPas encore d'évaluation
- Ems Mori 2019 01 0025Document21 pagesEms Mori 2019 01 0025Xavier DeguercyPas encore d'évaluation
- CDC Etude Faisabilite Autoconsommation PV Martinique Fev2017Document22 pagesCDC Etude Faisabilite Autoconsommation PV Martinique Fev2017Lance DineroPas encore d'évaluation
- Mme 2022 PlaquetteDocument9 pagesMme 2022 PlaquettedanielsinkotPas encore d'évaluation
- Les Stratégies Discursives: Enjeux Épistémologiques Et MéthodologiquesDocument20 pagesLes Stratégies Discursives: Enjeux Épistémologiques Et MéthodologiquesAWA DIOPPas encore d'évaluation
- Resg 097 0023Document22 pagesResg 097 0023Aloin C DavidPas encore d'évaluation
- APAVE Guide - Sobriete Energetique 102022Document16 pagesAPAVE Guide - Sobriete Energetique 102022Inza TimitePas encore d'évaluation
- Sim 223 0087Document37 pagesSim 223 0087Xavier DeguercyPas encore d'évaluation
- ZZ7164 C Architectures IncontournablesDocument34 pagesZZ7164 C Architectures Incontournablesrot3522Pas encore d'évaluation
- Rimhe 006 0080Document13 pagesRimhe 006 0080Khanoufi othmane abdennasserPas encore d'évaluation
- Med 183 0029Document21 pagesMed 183 0029godwe ernestPas encore d'évaluation
- Fiche ISO 50001 WebDocument2 pagesFiche ISO 50001 WebMahjoubPas encore d'évaluation
- Cep 044 0103Document17 pagesCep 044 0103Ashreff IdjPas encore d'évaluation
- These Audace ManagementDocument7 pagesThese Audace ManagementkelemfabricePas encore d'évaluation
- Brochure Energie Et Marches 2023Document2 pagesBrochure Energie Et Marches 2023Felício BarãoPas encore d'évaluation
- Resg 118 0065Document30 pagesResg 118 0065Fabrice GUETSOPPas encore d'évaluation
- Projet Asmae Imane AnoirDocument18 pagesProjet Asmae Imane AnoirRikali AnoirPas encore d'évaluation
- 2016 11 18 Guide Pratique ATEE Solutions TelereleveDocument54 pages2016 11 18 Guide Pratique ATEE Solutions TelereleveAl MabPas encore d'évaluation
- Fiche Formation RTCMDocument1 pageFiche Formation RTCMmajidPas encore d'évaluation
- Maîtriser sa Consommation Électrique : Le Guide Complet pour un Audit EfficaceD'EverandMaîtriser sa Consommation Électrique : Le Guide Complet pour un Audit EfficacePas encore d'évaluation
- Reglt 2020 01 Version RecueilDocument100 pagesReglt 2020 01 Version RecueilEmma RobertPas encore d'évaluation
- InterviewDocument13 pagesInterviewEmma RobertPas encore d'évaluation
- Indicateurs MEL Avril 2023Document86 pagesIndicateurs MEL Avril 2023Emma RobertPas encore d'évaluation
- Avril 2023Document7 pagesAvril 2023Emma RobertPas encore d'évaluation
- GMP 052 0039Document21 pagesGMP 052 0039Emma RobertPas encore d'évaluation
- Indicateurs Stratégiques Avril2023Document40 pagesIndicateurs Stratégiques Avril2023Emma RobertPas encore d'évaluation
- 21 Plan de Financement Provisoire Douai - Ace. Vefa Rue de La Herse Rue de La HerseDocument52 pages21 Plan de Financement Provisoire Douai - Ace. Vefa Rue de La Herse Rue de La HerseEmma RobertPas encore d'évaluation
- RCG 024 0063Document31 pagesRCG 024 0063Emma RobertPas encore d'évaluation
- Beslay Gressier Texte Final RéviséDocument22 pagesBeslay Gressier Texte Final RéviséEmma RobertPas encore d'évaluation
- QDM 219 0147Document61 pagesQDM 219 0147Emma RobertPas encore d'évaluation
- Finance MentDocument1 pageFinance MentEmma RobertPas encore d'évaluation
- ManaDocument13 pagesManaEmma RobertPas encore d'évaluation
- Courrier Invitation Soutenance Emma RobertDocument1 pageCourrier Invitation Soutenance Emma RobertEmma Robert100% (1)
- Apdem 033 0014Document3 pagesApdem 033 0014Emma RobertPas encore d'évaluation
- PFI LIV DOUAI 95 HERSE Version Avec CalculetteDocument3 pagesPFI LIV DOUAI 95 HERSE Version Avec CalculetteEmma RobertPas encore d'évaluation
- Arss 221 0064Document17 pagesArss 221 0064Emma RobertPas encore d'évaluation
- Conseil Supérieur de La Propriété Littéraire Et ArtistiqueDocument153 pagesConseil Supérieur de La Propriété Littéraire Et ArtistiqueEmma RobertPas encore d'évaluation
- Densité Urbaine - Quand Collectivités Locales Et Organismes HLM Agissent Ensemble - L'Union Sociale Pour L'habitatDocument8 pagesDensité Urbaine - Quand Collectivités Locales Et Organismes HLM Agissent Ensemble - L'Union Sociale Pour L'habitatEmma RobertPas encore d'évaluation
- Transition EnergetiqueDocument9 pagesTransition EnergetiqueEmma RobertPas encore d'évaluation
- ChapI - Rappels Stabilité Des SystèmesDocument28 pagesChapI - Rappels Stabilité Des SystèmesibrahimPas encore d'évaluation
- La Cour Internationale de Justice Et La Coutume InternationaleDocument3 pagesLa Cour Internationale de Justice Et La Coutume InternationalewyzychuigunsPas encore d'évaluation
- Generalites Sur LosteologieDocument4 pagesGeneralites Sur LosteologieWissam TizaPas encore d'évaluation
- EMD2-juin 2006 KADIDocument2 pagesEMD2-juin 2006 KADIMamadou DionePas encore d'évaluation
- M.cote, G.paradis, Les Dictionnaires Generaux de Philosophie en Langue FrancaiseDocument19 pagesM.cote, G.paradis, Les Dictionnaires Generaux de Philosophie en Langue FrancaisepalatinuxPas encore d'évaluation
- Carlos Alberto González Sánchez - Universidad de SevillaDocument34 pagesCarlos Alberto González Sánchez - Universidad de SevillaHenrique Grandinetti de BarrosPas encore d'évaluation
- ProductBrochure EC15CtoEC20C FR 31A1006320 201003Document16 pagesProductBrochure EC15CtoEC20C FR 31A1006320 201003jonbzh1Pas encore d'évaluation
- Barthélemy Charles - Erreurs Et Mensonges Historiques - Tome 03Document287 pagesBarthélemy Charles - Erreurs Et Mensonges Historiques - Tome 03Arwen KellerPas encore d'évaluation
- Poly Adc 1ste Cours 1920 eDocument52 pagesPoly Adc 1ste Cours 1920 eismailPas encore d'évaluation
- BalaamDocument55 pagesBalaamYaya mahamat EmmanuelPas encore d'évaluation
- Statut Du Mawlid en IslamDocument51 pagesStatut Du Mawlid en IslamSekou Mohamed SamakePas encore d'évaluation
- HTA MaligneDocument6 pagesHTA MaligneSan DeutschPas encore d'évaluation
- Définition de La Technologie PDFDocument3 pagesDéfinition de La Technologie PDFNesrine Nes100% (1)
- Les CoursesDocument82 pagesLes Coursesmohamedboumansour1Pas encore d'évaluation
- Chapeau! 4 Programmations FrançaisDocument19 pagesChapeau! 4 Programmations FrançaisAlberto Casas RodriguezPas encore d'évaluation
- Arrêté Du 23-12-16 - Postes H Et B Tension de Distribution D'énergie ÉlectriqueDocument20 pagesArrêté Du 23-12-16 - Postes H Et B Tension de Distribution D'énergie ÉlectriqueNader GhrabPas encore d'évaluation
- Tissu ConjonctifDocument48 pagesTissu ConjonctifYouness Khalfaoui100% (1)
- Comment Attirer Tout Ce Que Vous Voulez PDFDocument2 pagesComment Attirer Tout Ce Que Vous Voulez PDFphilosophe662511Pas encore d'évaluation
- Fiches Pathologies GénétiquesDocument5 pagesFiches Pathologies GénétiquesRomPas encore d'évaluation
- 1 G en Eralit Es: 222. Exemples D' Equations Aux D Eriv Ees Partielles Lin EairesDocument3 pages1 G en Eralit Es: 222. Exemples D' Equations Aux D Eriv Ees Partielles Lin EairesJean Djibersou BiryangPas encore d'évaluation
- CV Actualisé TYF 3Document8 pagesCV Actualisé TYF 3Tahp Yassine FadoulPas encore d'évaluation
- ATD ConvertiDocument18 pagesATD ConvertiHouria RaibPas encore d'évaluation
- Guide TFC Yamine MoniziDocument8 pagesGuide TFC Yamine MoniziKingtayPas encore d'évaluation
- RMU710B-1 2 Manuel Technique FR PDFDocument72 pagesRMU710B-1 2 Manuel Technique FR PDFe-genieclimatique.comPas encore d'évaluation
- Analyse Sémiologique Du Graffiti 04160097 PDFDocument69 pagesAnalyse Sémiologique Du Graffiti 04160097 PDFJulio LealPas encore d'évaluation
- Le Risque de Taux D'intérêtDocument15 pagesLe Risque de Taux D'intérêtYousra MoufidPas encore d'évaluation
- Liste Des Fournitures Scolaires Sec 1 22-23Document2 pagesListe Des Fournitures Scolaires Sec 1 22-23ayaPas encore d'évaluation
- Supply Chain Management NVDocument27 pagesSupply Chain Management NVoumaima labaiouiPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 Commande Vectorielle D'une GSAPDocument7 pagesChapitre 2 Commande Vectorielle D'une GSAPzakariamenzer2000Pas encore d'évaluation
- Conference Bacque PDFDocument11 pagesConference Bacque PDFTourde BabelPas encore d'évaluation