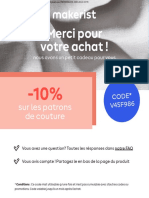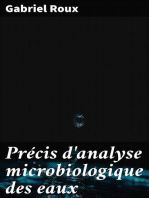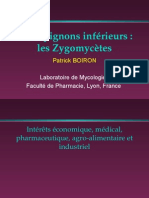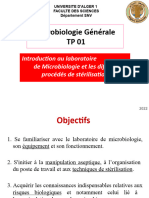Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
TP Microbiologie
TP Microbiologie
Transféré par
mojakovichCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
TP Microbiologie
TP Microbiologie
Transféré par
mojakovichDroits d'auteur :
Formats disponibles
UNIVERSITE DE NOUAKCHOTT FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DEPARTEMENT DE BIOLOGIE
MANUEL DE TRAVAUX PRATIQUES DE MICROBIOLOGIE BG2
Par
Aminetou Bent Mohamed
Aicha mint Sidi Baba
2007 - 2008
1
SOMMAIRE
TP. N 1 - RGLES SUIVRE DURANT LES TRAVAUX PRATIQUES DE MICROBIOLOGIE TP. N 2 - LA STRILISATION TP. N3 - UTILISATION DES MILIEUX DE CULTURE TP. N 4 - EXAMEN MACROSCOPIQUE DES CULTURES TP. N 5 - ISOLEMENT DE COLONIES PURES TP. N6 - LEXAMEN MICROSCOPIQUE DES BACTRIES TP. N7 - EXAMEN APRS COLORATION T P. N 8 - COLORATION DIFFERENTIELLE DE GRAM TP. N 9 - INFLUENCE DE LA VARIATION DE CERTAINS FACTEURS PHYSIQUES SUR LA CROISSANCE DES MICROORGANISMES TP N 10 - ETUDE DE LA SENSIBILIT AUX ANTIBIOTIQUES
couvillon
Bec Bunsen
Botes de Ptri Autoclave
grattoir Flacon pour milieu de culture
Etuve
TP. N 1. RGLES SUIVRE DURANT LES TRAVAUX PRATIQUES DE MICROBIOLOGIE
OBJECTIFS : Se familiariser avec un laboratoire de microbiologie, son quipement et son fonctionnement l. Visite des locaux : Structure Prsentation des gros matriels (tuves, autoclave, )
2. Prsentation d'un poste de travail : Matriels (bec bunsen, pipettes, verres, bchers anse, pinces lame,...), Produits (eau, alcool, colorants divers,.)
3. Les consignes de scurit : - Procder un lavage minutieux des mains, avec brossage des ongles avant et aprs les manipulations, et avant toute sortie mme momentane de la salle de TP. - viter les ouvertures des fentres pendant les manipulations - Ouvrir avec prcaution les rcipients contenant des cultures microbiennes, afin d'viter toute projection. - Flamber, avant et aprs manipulations, les anses mtalliques utilises pour les prlvements, en commenant par chauffer la partie moyenne de l'instrument afin de desscher les restes de culture avant de porter l'extrmit dans la flamme, ceci pour viter toute projection. - Prvenir immdiatement le responsable de TP en cas de bris d'un rcipient contenant une culture en cas de contamination accidentelle d'un manipulateur ou tout incident dispersant le matriel microbien. -Interdiction formelle de boire, manger et fumer pendant les TP -Striliser tout le matriel septique la fin de la manipulation microbiennes ainsi que leur destruction afin d'viter toute contamination. -Prendre toutes dispositions indispensables pour la mise l'abri des souches
4. Mise en vidence de la prsence de micro-organismes au laboratoire 1. Matriel : milieux gloss en boite de Ptri, couvillon, eau de robinet, cheveu, bec Bunsen, pice de monnaie. 2. Mode opratoire : Prendre 3 milieux gloss en boite de Ptri : - diviser la boite n1 en 2 secteurs : dposer un cheveu sur le premier et quelques gouttes deau du robinet sur le second. - diviser la boite n2 en 4 secteurs : appliquer une trace de doigt sur le premier, refaire lopration sur le second aprs stre lav les mains, dposer une pice de monnaie sur le troisime, frotter un couvillon sur la paillasse et appliquer celui-ci sur le dernier secteur. -laisser la troisime boite ouverte au dessus de la paillasse (environ 10 min). Remarque : une srie de 5 boites de Ptri de 8cm de diamtre est laisse ouverte sur une paillasse prs dun bec Bunsen allum. A la fin de la manipulation, regrouper les diffrentes boites de Ptri et les placer ltuve 37C / 24 heures. Remarque : pour viter que leau de condensation dans les botes de Ptri perturbe la surface du milieu glos, on place les botes en position retourne dans ltuve. Poste de travail
Eau de
Javel
Portoirs tubes
Verre pied + instruments
Zone dair strile
Bec Bunsen
TP. N : 2 - LA STRILISATION La strilisation est l'opration qui consiste liminer les micro-organismes d'un objet, et ce de manire durable. En microbiologie, le but de la strilisation est d'une part de matriser les micro-organismes introduits dans le milieu d'tude, et d'autre part d'viter la contamination du milieu extrieur et des personnes. Il existe deux grands moyens de Strilisation : 1. La chaleur 2. La filtration I. La strilisation par la chaleur La chaleur dtruit les bactries et les spores. On distingue les procds chaleur sche ou humide . 1. Chaleur sche : a. Flambage : Le passage dans la flamme (bec BUNSEN) de la surface de matriel non inflammable assure une parfaite strilisation. On strilise de cette faon les fils de platine et les pipettes Pasteur.
Zone de strilit dun bec bunsen
a.
B. Four pasteur : C'est un four-tuve air chaud et sec. Il est utilis 180C pendant 90 minutes. Cet appareil n'est utilis que pour la strilisation de la verrerie pralablement nettoye et sche ou de matriels mtalliques (instruments de dissection) pouvant tolrer de trs hautes tempratures.
Le matriel ainsi strilis sera laiss dans ltuve jusqu son refroidissement complet, puis stock labri des poussires. b. 2. Chaleur humide La strilisation par la chaleur humide, reconnat trois modalits - la strilisation lautoclave - La Pasteurisation, - La Tyndallisation a. Autoclave : cest un appareil indispensable dans un laboratoire de microbiologie. Le chauffage a lieu sous pression de vapeur deau, une temprature de 120C pendant une dure qui varie en fonction du milieu, de la temprature utilise et du volume des rcipients. Ce procd tue toutes les cellules vgtatives et les endospores. b. Pasteurisation : la pasteurisation est un traitement chaud de liquides, tuant des pathognes mais pas forcment toutes les bactries. Les tempratures de la pasteurisation se situent entre 75 80C. c. Tyndallisation : La tyndallisation est une srie de 3 chauffages bref des tempratures de 70C intervalles rguliers, ceci afin de laisser aux formes rsistantes la possibilit de germer pour les tuer au chauffage suivant. Par exemple la destruction des pathognes du lait se fait par un cycle de 63C pendant 30 minutes suivie de 73C pendant 15 minutes II. La filtration La filtration est une technique qui consiste faire passer un liquide travers un filtre dont les pores ont un diamtre de 0,2 m. Les micro-organismes sont trop gros et sont donc retenus par le filtre. Cette technique est intressante lors d'utilisation de produits thermolabiles comme certains acides amins aromatiques, vitamines, hormones de croissance, acides nucliques et une bonne partie des antibiotiques. III. Autres procds de strilisation Certaines matires (Plastiques, Caoutchous ) ne tolrent pas lautoclave ou se dtriorent rapidement aprs des expositions rptes la chaleur.
1. Radiations : La strilisation par les U.V. est utilise au laboratoire pour la dcontamination de lair et des paillasses situes sous la hotte de protection. Le rayonnement nagit que de faon directe et sa pntration est faible. Dautres radiations (rayons X), peuvent servir pour la strilisation industrielle des boites de Ptri en matire plastique et de produit pharmaceutiques. 2. Agents chimiques : Ils sont utiliss en gnral pour la dsinfection des salles de travail et pour la destruction des germes ports par des instruments souills. Ce mode de strilisation doit tre systmatiquement pratiqu dans le laboratoire pour les lames et pour la verrerie qui ne passe pas en autoclave.
TP. N3 - UTILISATION DES MILIEUX DE CULTURE Les micro-organismes exigent pour leur croissance des aliments. Ces aliments leur sont fournis au laboratoire par des milieux nutritifs ou milieux de culture. Pour permettre le dveloppement des microbes le milieu doit : *contenir tous les aliments ncessaires en quantit suffisante et en proportion relative convenable : le milieu doit tre nutritif et quilibr. *avoir un pH, une pression osmotique, une viscosit des caractristiques physicochimiques compatibles avec la vie microbienne. Comme les besoins nutritionnels des microorganismes et les conditions de leurs dveloppements sont trs varis il n'existe videmment aucun milieu universel sur lequel tous les microbes soient capables de se multiplier. Toutefois, certains milieux conviennent au dveloppement d'une grande varit de germes microbiens ; le choix de tels milieux repose sur la connaissance de l'habitat naturel et de la physiologie alimentaire du groupe de germes que l'on dsire cultiver. D'une manire trs gnrale, on peut distinguer : 1. Milieux synthtiques : Prpars exclusivement avec des produits chimiques purs. Le milieu synthtique de composition bien dfinie, constitue le milieu de culture idal. Ce type de milieu permet d'obtenir des rsultats comparables et de dceler avec prcision les modifications qu'il subit au cours du dveloppement microbien. Il n'en est gnralement pas de mme avec les milieux non synthtiques qui sont constitus par des lments complexes de composition variable. Les milieux synthtiques conviennent surtout aux moisissures (champignons microscopiques) mais fort peu aux bactries. 2. Milieux complexes : milieu dont on ne connat que partiellement la composition. Ces milieux de culture peuvent contenir des extraits de levure (cellule de levure dshydrate et lyses) qui fournissent une source d'acide amin de vitamine et d'azote, des extraits de malt apportant une source de carbone, des peptones (protine animale, de poisson, de casine de lait) source d'azote organique qui intresse les individus htrotrophes. (Ex. bouillon nutritif, bouillon au soja.). Parmi ces 2 types de milieu, il existe des milieux slectifs : qui vont permettre de slectionner le type de bactries qui pourront cultiver dessus, alors que tous les autres micro-
organismes prsents sont inhibs. Un milieu de culture est rendu slectif pour une espce microbienne lorsque sont seules satisfaites les exigences nutritives et les conditions de dveloppement particulires cette espce Les principaux facteurs de slection microbienne utiliss seuls ou en association sont : *la temprature dincubation *Le pH du milieu *La facult dutiliser une source nutritive dtermine (carbone, azote). *La rsistance laction bactricide dun antiseptique ou dun antibiotique. Les milieux sont soit liquides, soit solides. On utilise frquemment la glose ou agar-agar un polymre de sucre tir d'une algue rouge. Elle ne constitue qu'un support du milieu de culture. Capable d'absorber 200 250 fois son poids d'eau, la glose forme une gele qui se liqufie 65-70 en refroidissant, cette gele demeure en surfusion jusqu' 40-45 et prend une masse aux tempratures infrieures. La glose est gnralement incorpore aux milieux liquides la dose de 15 20%. Les milieux solides prsentent un grand intrt en Microbiologie. Ils permettent, lorsque la technique d'ensemencement est convenable, le dveloppement des germes en colonies apparentes, isoles les unes des autres, provenant en principe, de la multiplication d'un seul germe (clone) et partir desquelles peuvent tre obtenues des cultures pures.
Mode opratoire
Matriels : - 2 bchers de 500 ml, thermomtre, agitateur, bec bunsen, trpied et sa grille, boites de ptri, des tubes vis ou cotonns striles, pince en bois ou gants Produits : Bouillions nutritif (BN) et Glose Nutritive (GN), en poudre, Eau distille,
10
Protocole : Peser la masse ncessaire de poudre GN pour 250 ml d'eau distille. Dissoudre la poudre dans le diluant l'aide de l'agitateur. Chauffer au bec bunsen jusqu' l'bullition Laisser refroidir la prparation dans le cne strile du bec bunsen Lorsque la prparation a atteint une temprature infrieure 60C couler dans des boites de ptri et des tubes vis striles
11
TP. N 4 - EXAMEN MACROSCOPIQUE DES CULTURES L'examen macroscopique des cultures est le premier examen effectu partir de l'isolement aprs incubation. L'aspect des colonies dpend du milieu utilis de la dure et de la temprature de l'incubation. Il ne pourra tre dcrit convenablement qu' partir de colonies bien isoles : les colonies sont d'autant plus petites qu'elles sont rapproches. La colonie peut apparatre la surface du milieu de culture pour les germes arobies, ou tre en profondeur pour les germes anarobies 1. Aspect de colonies en surface sur milieu solide 1.1. La taille Elle peut tre mesure l'aide d'une rgle gradue pour les grandes colonies. Il est possible aussi d'utiliser le microscope au grossissement le plus faible pour mesurer la taille des petites colonies en utilisant de micromtres oculaires.. 1.2. La forme Allure de contours : lisse, dentels, dchiquets, irrguliers Relief : surface bombe, demi-bombe, plate. Centre : parfois surlve, parfois ombilique (en creux) 1.3. L'aspect de la surface La surface dune colonie bactrienne peut tre lisse, rugueux, renvoyer la lumire de faon leur donner un reflet mtallique ou un aspect iris. 1.4. L'opacit Les colonies sont dcrites comme : Opaques (ne laissent pas passer la lumire) Translucides (laissent passer la lumire mais on ne voit pas les formes au travers, comme le verre dpoli) Transparentes (laissent passer la lumire et voir les formes au travers, comme le verre, on parle de gouttes de rose"
12
1.5. La consistance Au moment du prlvement il est possible d'apprcier si les colonies sont grasses, crmeuses (on obtient facilement des suspensions homognes), sches ou encore muqueuses (on obtient difficilement des suspensions homognes). 1.6. La couleur et/ou pigment Plusieurs colonies nont pas une couleur bien dfinie (blanc, gris). Par contre, certaines bactries produisent un pigment insoluble qui donnent un aspect bien caractristique la colonie (rose, jaune, rouge ), tendis que dautres produisent un pigment soluble qui diffuse et colore le milieu 2. Aspect des colonies en profondeur : 1. Colonies rgulires en formes de lentilles, 2. Colonies irrgulires de formes diffuses et floues. 3. Aspect des colonies en surface sur glose linaire 1. filiformes 2. lgrement envahissantes avec bords onduls 3. lgrement envahissantes avec bord rod 4. envahissante II. Aspect de la pousse en milieu liquide Les bouillons nutritifs sont aussi utiliss pour cultiver les bactries. Dans un bouillon la croissance microbienne se traduit par lapparition dun trouble ou opalescence mais laspect varie selon les espces. III. Mode opratoire : a. Milieu solide : Repiquer diffrentes aspects et formes de colonies sur des tubes de glose linaire Incuber 37C pendant 24 h Observer) les diffrents aspects.
13
b. Milieu liquide : Repiquer laide dune anse de platine des colonies diffrentes dans des tubes de bouillon nutritifs Flamber lanse aprs chaque repiquage Incuber 37 C pendant 24 48h Observer les diffrents aspects de pousse en milieu liquide
Elvation :
bombe Bomb
plate Plate
Ombilique
ombilique
A bords surlevs
Forme :
Vue par dessus
ronde Ronde
A bords dentels Irrgulire
En toile En toile
14
TP. N5 - ISOLEMENT DE COLONIES PURES Les germes se trouvent souvent dans la nature sous forme de mlange de plusieurs espces. Isoler c'est sparer les divers micro-organismes contenus dans le prlvement initial. Un isolement peut tre envisag pour : Sparer des micro-organismes diffrents au sein d'un mlange (prlvement par exemple) Purifier une souche contamine ou contrler sa puret. L'isolement peut tre ralis par puisement de la semence en talant le produit initial la surface d'un milieu solide appropri. Pendant l'incubation, chaque micro-organisme dpos se multiplie pour donner un clone de cellules identiques. Lorsque les microorganismes dposs sont suffisamment loigns. le clone se dveloppe abondamment pour produire une colonie (amas de cellules identiques). L'objectif de l'isolement est donc d'obtenir pour chaque micro-organisme diffrent des colonies distinctes. Les colonies obtenues, en talant une souche pure, doivent toutes prsenter les mmes caractres. A l'oppos, l'isolement d'un mlange donnera autant de colonies diffrentes que de micro-organismes diffrents contenus dans ce mlange. Notez : deux colonies de mme aspect et de mmes caractres ne contiennent pas forcment des micro-organismes identiques Rappel : les boites doivent tre places couvercle en bas 1. Matriel par groupe Eau physiologique (tube de 9ml) Anse de platine Glose nutritive Boite de ptri
2. Principe Diluer dans de leau physiologique une fraction du mlange de germe jusqu' obtention dune suspension opalescente, Prlever ensuite une fraction de cette chantillon dilu puis taler sur la plus grande surface possible de milieu nutritif a laide dun instrument disolement (anse de platine, pipette pasteur boutonnes etc.).
15
Le nombre de germe restant sur linstrument sera de plus en plus faible, ce qui va permettre dobtenir des colonies distantes les une des autres. 3. Mode opratoire (Technique utilisant la boite de ptri) : a. Mthode de nevot Prlever laide de lanse de platine une fraction de linoculum Ensemencer par stries fines et trs serres le premier demi- cercle Flamber lanse de platine, laisser refroidir Ensemencer le deuxime demi- cercle Flamber lanse de platine Ensemencer le troisime demi-cercle
b. Technique des 4 sries de stries Tracer sur le fond extrieur de la boite de ptri deux diamtres perpendiculaires sparant la boite en quatre secteurs. Prlever l'anse (strile) la suspension ou le bouillon dans le cne strile. Avec la main gauche maintenir entrouverte la boite dans le cne strile et taler le prlvement par stries trs serres dans une moiti de quadrant (quadrants 1 et 2 - Flamber l'anse et laisser refroidir Etaler nouveau le prlvement par stries serres dans la moiti correspondante aux quadrants 2 et 3. Flamber l'anse et laisser refroidir. Rpter une dernire fois l'talement en stries serres dans la moiti correspondante aux quadrants 3 et 4 c. technique de buttiaux : On se sert dune pipette pasteur boutonne; la petite boule est plonge dans linoculum, ensuite on balaye toute la surface de la glose.
16
Dpt initial
17
TP. N6 - LEXAMEN MICROSCOPIQUE DES BACTRIES Lobservation microscopique permet de faire une tude morphologique des cellules dune espce bactrienne. Elle comprend : I. Examen ltat frais Cest lexamen microscopique de bactries vivantes, en milieu liquide. Il permet dapprcier leur mobilit (ou immobilit) et leur morphologie. Prparation : 1. A partir dune culture en milieu liquide : Dposer sur une lame propre soit le contenu dune anse de platine soit une petite goutte laide dune pipette Pasteur. Recouvrir la goutte dune lamelle. 2. A partir dune culture sur milieu solide : Dposer une gouttelette de liquide (milieu liquide ou eau) sur la lame. Prlever une trace de culture lanse de platine et lmulsionner dans le liquide. Recouvrir dune lamelle. 1. Flamber lanse de platine
2. Dposer une goutte de la suspension bactrienne
3. Recouvrir d'une lamelle
18
TP. N7 - EXAMEN APRS COLORATION Lexamen aprs coloration permet dobserver des bactries tues fixes sur une lame et ayant subi laction dun ou plusieurs colorants. Les colorations, ralises sur des frottis sches et fixes, sont classes en : Coloration simple (un seul colorant) Coloration diffrentielle type Gram Colorations spciales des structures bactriennes (capsules, spors.).
Remarque : La ralisation de frottis de bonne qualit est une condition pralable toute coloration. 1. Ralisation des frottis : Les frottis doivent tre tals en couche mince et rgulire, puis schs et fixs. 1. Etalement sur lame de verre : 1. Notez la rfrence de lchantillon sur une lame parfaitement propres et dgraisses, 2. Prlevez strilement laide dune anse de platine une goutte de culture bactrienne et talez un film mince, 2. Schage : Le schage est effectu laire libre jusqu ce que le frottis prsente un aspect mat. 3. Fixation du frottis sec : Cette tape consiste tuer les bactries et les coller sur la lame, sans en altrer la structure. La fixation seffectue par la chaleur : La lame, tenue par une pince (frottis situ sur le dessus) est passe 3ou 4 fois dans la flamme du bec Bunsen. Laisser refroidir avant dentreprendre une coloration.
19
1. Identifier la lame
2. Dposer une goutte deau
3. Flamber lanse dune
4. Prlever une partie colonie isole
5. Mlanger les bactries avec la goutte deau lair
6. Laisser scher ltalement
7. Fix le frottis en passant dlicatement et rapidement la lame 2-3 fois au dessus de la flamme 20
I. COLORATIONS SIMPLES : (Coloration au bleu de Mthylne) La coloration au bleu de mthylne peut apporter des informations concernant la morphologie des germes. Mode opratoire : Sur le frottis fix et refroidi : - Faire couler la solution de bleu de mthylne phniqu jusqu' ce que toute la lame soit recouverte. - Laisser agir 1 minute. - Rincer abondamment la lame avec le jet d'une pissette d'eau distille, ou l'eau du robinet jusqu' limination des colorants en excs. - Scher l'air ou sur une platine chauffante, ou encore scher dlicatement entre deux feuilles de papier filtre fin (ou buvard), sans frotter. - Examiner au microscope, objectif immersion. Rsultats Les bactries sont colores en bleu sombre. Cette coloration est intressante pour l'observation rapide des frottis mais elle permet seulement l'tude de la morphologie des bactries. Bleu de mthyln e
1. Raliser un talement sur lame
2. Coloration au bleu de mthylne
3. Elimination du bleu de mthylne
21
TP. N 8 - COLORATION DIFFERENTIELLE DE GRAM Cest la coloration de base en bactriologie qui permet de distinguer les bactries en Gram positif et en Gram ngatif, cette distinction est fondamentale pour leur identification. En effet, le violet de gentiane se fixe sur des composants cytoplasmiques et aprs ce temps de coloration, toutes les bactries sont violettes. Chez les bactries Gram ngatif, la paroi, riche en lipides, laisse passer l'alcool (ou le mlange alcool + actone) qui dcolore le cytoplasme alors que, chez les bactries Gram positif, la paroi constitue une barrire impermable l'alcool et le cytoplasme demeure color en violet. Ractifs : Violet de gentiane phnique Lugol (iodo-iodure de potassium) Alcool 95% (ou mlange alcool absolu+ 1/5me dactone) Safranine (ou Fuchsine phnique de ziehl)
Mode opratoire : 1. Raliser un frottis et le fixer la flamme 2. Verser le Violet de Gentiane sur la lame ; laisser en contact 1 minute 3. Jeter le colorant et finir de la chasser par la solution de Lugol ; laisser agir le Lugol environ 1 min 4. Jeter le Lugol et faire couler de lalcool sur la prparation ; rincer immdiatement leau 5. Recouvrir la prparation de Safranine, laisser agir environ 1 min. laver abondamment. 6. Scher au dessus de la flamme dun bec Bunsen. Rsultats : A lissue de cette coloration, on peut distinguer : - Des bactries colores en violet fonc ; elles ont gard le violet, le gram elle sont dites Gram positif ; - Des bactries colores en rose ou rouge ple ; elles ont perdu le violet, le Gram elles sont dites gram ngatif.
22
Anse boucle
1. Prlever une partie dune colonie isole
2. Raliser un talement sur lame
Frottis vers le haut
3. Fixer la chaleur
Colorant
4. Raliser les tapes de coloration
23
TP. N 9 - INFLUENCE DE LA VARIATION DE CERTAINS FACTEURS PHYSIQUES SUR LA CROISSANCE DES MICROORGANISMES Un certains nombre de facteurs physique externes peuvent intervenir dans le dveloppement des microorganisme. La variation de certains entre eux (pH du milieu, la temprature, la pression osmotique etc.) peut acclrer, retarder, ou arrter la croissance microbienne. Nous tudions dans cette sance linfluence de la variation de temprature. Variation de la temprature Pour chaque microorganisme, on dfinit une temprature optimale de croissance pour laquelle le dveloppement est maximal, une temprature minimale en de de laquelle il ny a plus de croissance et une temprature maximale au dla de laquelle le dveloppement est stopp 1. But de exprience Il sagit dapprcier les valeurs limites de la temprature et la valeur optimale de croissance dun germe donn (germe msophile) 2. Matriel par groupe 5 tubes de bouillons nutritifs (contenant 5 ml de milieu) Anse de platine Boites ensemences par le germe tudier
3. Mode opratoire Marquer chaque tube de la temprature correspondante : + 4C, 20C,37C,44Cet 55C. Ensemencer les cinq tubes avec la souche microbienne a tudier Incuber immdiatement chaque tube a la temprature indique. La dure dincubation est de 24 h, mais elle peut tre prolonger jusqu' 48 h ( pour 20C) ;voir une semaine (pour + 4C) 4. Lecture des rsultats
24
On note par le systme des croix le dveloppement des germes dans les tubes (-) : absence de pousse (+) : lger trouble douteux (+) : lgre turbidit, visible (++): dveloppement assez important (+++) : trouble maximale
Remarque : Pour plus de prcision, il est prfrable de dterminer la densit optique des tubes avec un turbidimtre.
25
TP N 10 - ETUDE DE LA SENSIBILIT AU ANTIBIOTIQUES Les antibiotiques sont des composs chimiques, labors par un micro-organisme ou produit par synthse et dont lactivit spcifique se manifeste dose faible sur les microorganismes. La dtermination de la sensibilit dune bactrie divers antibiotiques est dune grande importance en microbiologie. Elle permet llaboration des milieux disolement slectifs, le contrle dune infection par chimiothrapeutique et enfin elle peut tre utilise comme approche dans la caractrisation et lidentification bactrienne. Lantibiogramme dune souche peut tre dtermin en milieu liquide par la mthode de la CMI (concentration minimale inhibitrice) ou par la technique des disques. 1. Matriel par groupe Disques de celluloses imprgnes dantibiotique Boite de ptri + de glose Culture microbienne en suspension Rteau
2. Mode opratoire Couler la glose dans une boite de ptri Laisser prendre en masse Prlever 2 ou 3 gouttes de la suspension bactrienne, les dposer a la surface de la glose les taler avec un rteau Sassurer que la surface de la glose est bien sche, et y dposer les disques de celluloses imprgnes dantibiotique Placer la boite de ptri basse temprature +4C pendent 15 30mn afin de permettre aux antibiotiques de diffuser dans la glose avant que les bactries ne commencent se multiplier Retirer la boites du rfrigrateur et la placer dans lincubateur, la temprature optimale de croissance du germe a tudier( 37 C) pendent 24 h Rappel : les boites doivent tre places couvercle en bas 3. Lectures des rsultats
26
Lactivit de chaque antibiotique sera apprcie, par le diamtre de laurole dinhibition provoqu autour du disque Remarque : Cette mthode est une application de la diffusion en glose .Le diamtre de laurole dpend de la vitesse de diffusion de lantibiotique dans la glose.
27
Vous aimerez peut-être aussi
- Microbiologie médicale I: agents pathogènes et microbiome humainD'EverandMicrobiologie médicale I: agents pathogènes et microbiome humainÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Cours Electrocinetique - L1 ElmDocument41 pagesCours Electrocinetique - L1 ElmMarine100% (1)
- Analyse Des Denrées AlimentairesDocument208 pagesAnalyse Des Denrées AlimentairesImène Laib96% (46)
- Biologie MoléculaireDocument204 pagesBiologie MoléculaireGHERMI .M100% (4)
- Strategie de Developpement Du Sous Secteur UrbainDocument297 pagesStrategie de Developpement Du Sous Secteur Urbainstephane100% (1)
- TD 1 Les Milieux de Culture Utilisés en Microbiologie AlimentaireDocument34 pagesTD 1 Les Milieux de Culture Utilisés en Microbiologie Alimentaireamina imenePas encore d'évaluation
- VirologieDocument307 pagesVirologieAmina86% (14)
- VirologieDocument307 pagesVirologieAmina86% (14)
- Beret Babs Patron de Couture - Made by Oranges Francais - 2128508Document9 pagesBeret Babs Patron de Couture - Made by Oranges Francais - 2128508Nizar SilliniPas encore d'évaluation
- Analyse BactériologiqueDocument61 pagesAnalyse Bactériologiquebionana90% (10)
- Techniques D'identificationDocument87 pagesTechniques D'identificationKawtar Kaaboub98% (40)
- TP de Microbio Des Produits LaitiersDocument10 pagesTP de Microbio Des Produits LaitiersFati98% (50)
- Manuel Des TP Institus PasteurDocument35 pagesManuel Des TP Institus PasteurAzzedine Laloui86% (22)
- Controle Microbio Des AlimentsDocument119 pagesControle Microbio Des AlimentsAmina94% (31)
- Controle Microbio Des AlimentsDocument119 pagesControle Microbio Des AlimentsAmina94% (31)
- BactériologieDocument122 pagesBactériologieAmina100% (6)
- Examen de L'état FraiDocument4 pagesExamen de L'état Fraiilou77% (26)
- StérilisationDocument9 pagesStérilisationI.m. Daniel100% (1)
- Des Techniques de StérilisationDocument19 pagesDes Techniques de Stérilisationalmnaouar100% (2)
- 13.analyses MicrobiologiquesDocument37 pages13.analyses MicrobiologiquesTaha Oukase100% (10)
- Cours 5 - Les Milieux de Culture - ÉtudiantDocument54 pagesCours 5 - Les Milieux de Culture - ÉtudiantMidouri DjafferPas encore d'évaluation
- TP de Systématique BactérienneDocument35 pagesTP de Systématique BactérienneChadli Derafa98% (54)
- TP Ananou (Réparé)Document21 pagesTP Ananou (Réparé)nadia100% (4)
- Parasitologie - Notions GénéralesDocument23 pagesParasitologie - Notions GénéralesAmina100% (5)
- Les Ascomycètes Et Les LichensDocument91 pagesLes Ascomycètes Et Les LichensAmina100% (3)
- Exercices Etude Dune Installation Solaire PhotovoltaïqueDocument3 pagesExercices Etude Dune Installation Solaire PhotovoltaïqueAymen HssainiPas encore d'évaluation
- TP de MicroDocument21 pagesTP de MicroJohanna Miller90% (40)
- UntitledDocument130 pagesUntitledEcole monprofesseurdepianoPas encore d'évaluation
- Enterobactérie FinalDocument32 pagesEnterobactérie Finalismail bd100% (5)
- Microbiologie médicale II: stérilisation, diagnostic de laboratoire et réponse immunitaireD'EverandMicrobiologie médicale II: stérilisation, diagnostic de laboratoire et réponse immunitairePas encore d'évaluation
- Les Maladies MicrobiennesDocument134 pagesLes Maladies MicrobiennesAmina100% (17)
- Les Maladies MicrobiennesDocument134 pagesLes Maladies MicrobiennesAmina100% (17)
- Stérilisation Et Préparation Des Milieux de CultureDocument7 pagesStérilisation Et Préparation Des Milieux de CultureKhaoula Hazourli100% (1)
- Milieux Culture MicrobiologieDocument12 pagesMilieux Culture Microbiologiecakebuilder67% (3)
- An2 Microbiologie TP Les Milieux de CultureDocument56 pagesAn2 Microbiologie TP Les Milieux de CultureAya Medusa100% (4)
- Chap4 StérilisationDocument7 pagesChap4 StérilisationImane TLPas encore d'évaluation
- Champignons Inférieurs: Les ZygomycètesDocument28 pagesChampignons Inférieurs: Les ZygomycètesAmina100% (11)
- Lumiere Du Thabor 23Document27 pagesLumiere Du Thabor 23Paul LadouceurPas encore d'évaluation
- Compte Rendu TP Ecologie MicrobienneDocument11 pagesCompte Rendu TP Ecologie MicrobienneHalaleila Leila100% (1)
- Linux - TP 2Document2 pagesLinux - TP 2Omaf Aluoy100% (1)
- Les Milieu de CulturesDocument4 pagesLes Milieu de Culturesilou94% (18)
- LES MILieux EnterobacteriesDocument7 pagesLES MILieux Enterobacteriesismail bd100% (5)
- Microbiologie GénéraleDocument16 pagesMicrobiologie GénéraleRayène BekirPas encore d'évaluation
- Le StaphylococcusDocument65 pagesLe StaphylococcusAsmaa EssbaiPas encore d'évaluation
- Manuel Des TP LaitsDocument19 pagesManuel Des TP LaitsChet AHmedPas encore d'évaluation
- UntitledDocument535 pagesUntitledIbtissam NaimPas encore d'évaluation
- Examen Cytobacteriologique Des Urines IPADocument76 pagesExamen Cytobacteriologique Des Urines IPAHadjab lyes95% (19)
- Ufed User Manual CellebriteDocument397 pagesUfed User Manual CellebriteDam LanPas encore d'évaluation
- La Galerie Api20eDocument6 pagesLa Galerie Api20eismail bd100% (4)
- Procédure Analyses Bactériologique 2009Document94 pagesProcédure Analyses Bactériologique 2009J-Paul Déto100% (7)
- TP SalmonellaDocument9 pagesTP SalmonellaMidouri Djaffer100% (1)
- Galerie API Rapid 20eDocument3 pagesGalerie API Rapid 20enicole_didine100% (4)
- Examen Macroscopique Et Microscopique Des Cultures BactriensDocument3 pagesExamen Macroscopique Et Microscopique Des Cultures Bactrienssara81% (16)
- Manuel-de-travaux-pratiques-de-microbiologie (3)Document20 pagesManuel-de-travaux-pratiques-de-microbiologie (3)Sifo saidaniPas encore d'évaluation
- TP Bactériologie IDocument8 pagesTP Bactériologie IsonnyPas encore d'évaluation
- tp1 - KHDocument6 pagestp1 - KHBOUMECHHOUR Fatima100% (1)
- TP 1: Presentation Du Laboratoire de Microbiologie .: (Tapez Le Sous-Titre Du Document)Document8 pagesTP 1: Presentation Du Laboratoire de Microbiologie .: (Tapez Le Sous-Titre Du Document)BOUMECHHOUR FatimaPas encore d'évaluation
- TP Microbiogie (3) CorrDocument23 pagesTP Microbiogie (3) CorrAmine ChettouhiPas encore d'évaluation
- TP3 MicrobioDocument2 pagesTP3 MicrobiokenzovalgerPas encore d'évaluation
- Chapitre 1Document6 pagesChapitre 1aminaPas encore d'évaluation
- TP1 Microbiologie GénéraleDocument4 pagesTP1 Microbiologie GénéraleAbdu KadirPas encore d'évaluation
- TP Microbiologie DR MESSISDocument12 pagesTP Microbiologie DR MESSISBøũdįāf KhäwlåPas encore d'évaluation
- Stérilisation Materiels MicrobioDocument13 pagesStérilisation Materiels Microbiomoh.elmourabitPas encore d'évaluation
- La SterilisationDocument2 pagesLa SterilisationAboubacar Sidiky TraoréPas encore d'évaluation
- TP N1 Partie2 L2Document4 pagesTP N1 Partie2 L2ahmedsaied03inspPas encore d'évaluation
- 11) Sterilisation - DR HakemDocument22 pages11) Sterilisation - DR Hakemaminatouat381Pas encore d'évaluation
- Chap Ii W M1 CqahDocument13 pagesChap Ii W M1 CqahSabrına YaakoubiPas encore d'évaluation
- Stérilisation 2017Document5 pagesStérilisation 2017Rabia khouildiPas encore d'évaluation
- ANALYSES MICROBIOLOGIQUES - Chapitre 2Document32 pagesANALYSES MICROBIOLOGIQUES - Chapitre 2Benyoucef AmelPas encore d'évaluation
- TD - 02 StérilisationDocument15 pagesTD - 02 StérilisationBenyoucef AmelPas encore d'évaluation
- Les Opérations PharmaceutiquesDocument7 pagesLes Opérations PharmaceutiquesMaelys BressonPas encore d'évaluation
- TD 1 Introduction Au Laboratoire de MicrobiologieDocument111 pagesTD 1 Introduction Au Laboratoire de Microbiologiebouzidaya478Pas encore d'évaluation
- 1er TD ÉtudiantDocument9 pages1er TD ÉtudiantSârâh YàçïnePas encore d'évaluation
- TP Microbiologie Generale IulDocument51 pagesTP Microbiologie Generale Iulmanarkhatib905Pas encore d'évaluation
- ProtocoleDocument3 pagesProtocolehamenniPas encore d'évaluation
- Wa0021.Document9 pagesWa0021.Megui SakhoPas encore d'évaluation
- Les DeutéromycètesDocument32 pagesLes DeutéromycètesAmina100% (8)
- Ia1cm 24kv 50aDocument2 pagesIa1cm 24kv 50aTAPSOBA LASSANEPas encore d'évaluation
- GeotechniqueDocument22 pagesGeotechniqueAllou AchrafPas encore d'évaluation
- 65 - Trouble Délirant Persistant.Document2 pages65 - Trouble Délirant Persistant.TinaPas encore d'évaluation
- Non À L'occidentalisation de L'école !Document7 pagesNon À L'occidentalisation de L'école !Mohamed DahmanePas encore d'évaluation
- La Vérité Chez ArendtDocument3 pagesLa Vérité Chez Arendtmomokoko344076Pas encore d'évaluation
- SMQ 2020Document64 pagesSMQ 2020Touhemi Ben SadokPas encore d'évaluation
- DR Baichi Intro Economie de Sante 1Document28 pagesDR Baichi Intro Economie de Sante 1Billy05 BillyPas encore d'évaluation
- Apostila Est HíbridoDocument195 pagesApostila Est HíbridoEduardo NagelPas encore d'évaluation
- Projet 2Cn v1Document22 pagesProjet 2Cn v1yassine.oualiPas encore d'évaluation
- AUGUST - 1992 - 38!1!50 Nouveaux Sermons de Saint Augustin Pour La Conversion Des Païens Et Des Donatistes IIIDocument30 pagesAUGUST - 1992 - 38!1!50 Nouveaux Sermons de Saint Augustin Pour La Conversion Des Païens Et Des Donatistes IIINovi Testamenti FiliusPas encore d'évaluation
- Universite Hassan Ii Casablanca: L'importance de La Gestion de Trésorerie Dans Une PMEDocument28 pagesUniversite Hassan Ii Casablanca: L'importance de La Gestion de Trésorerie Dans Une PMEIsmail Ait SalhPas encore d'évaluation
- RLP-Liberté Pour Apprendre RogersB PDFDocument13 pagesRLP-Liberté Pour Apprendre RogersB PDFRawanPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage Meditel PDFDocument20 pagesRapport de Stage Meditel PDFYassineMalekiPas encore d'évaluation
- Activité 4 - Traduire Un Problème Par Une Inéquation (Élève)Document2 pagesActivité 4 - Traduire Un Problème Par Une Inéquation (Élève)PROJET PROPas encore d'évaluation
- Statistique Descriptive & Probabilités: DR: Najat Moradi FSTHDocument47 pagesStatistique Descriptive & Probabilités: DR: Najat Moradi FSTHValhala aPas encore d'évaluation
- Radiocristallographie 1Document14 pagesRadiocristallographie 1dibrawan18Pas encore d'évaluation
- Fre Sub g13 Notes Conflit de Generation Mrs JuggessurDocument6 pagesFre Sub g13 Notes Conflit de Generation Mrs Juggessurndiayemoise92Pas encore d'évaluation
- Discussion WhatsApp Avec WIEUX FDocument24 pagesDiscussion WhatsApp Avec WIEUX FWIEUXPas encore d'évaluation
- Présentation Pdu Dakar Horizon 2025Document67 pagesPrésentation Pdu Dakar Horizon 2025Fabrice PassalePas encore d'évaluation
- 2006-03-03ven - Le Monde Des LivresDocument12 pages2006-03-03ven - Le Monde Des LivresFranck de la MataPas encore d'évaluation
- Benacquista, Tonino - Tout A L'egoDocument79 pagesBenacquista, Tonino - Tout A L'egolaghboulePas encore d'évaluation