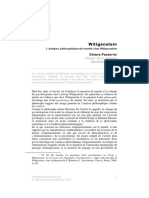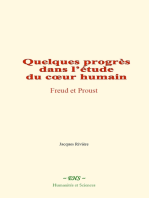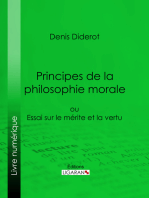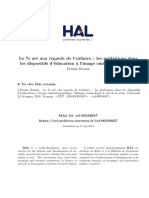Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Debut Intelligence A
Debut Intelligence A
Transféré par
joan capterCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Debut Intelligence A
Debut Intelligence A
Transféré par
joan capterDroits d'auteur :
Formats disponibles
Pierre JANET (1932)
Membre de lInstitut Professeur au Collge de France
Les dbuts de lintelligence
Premire partie (chap. I IV) Deuxime partie (chap. I et II)
Un document produit en version numrique par Jean-Marie Tremblay, bnvole, professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi Courriel: jmt_sociologue@videotron.ca Site web: http://pages.infinit.net/sociojmt Dans le cadre de la collection: "Les classiques des sciences sociales" Site web: http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html Une collection dveloppe en collaboration avec la Bibliothque Paul-mile-Boulet de l'Universit du Qubec Chicoutimi Site web: http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
Cette dition lectronique a t ralise par Jean-Marie Tremblay, bnvole, professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi partir de :
Pierre Janet (1932) Les dbuts de lintelligence
Une dition lectronique ralise partir de l'article de Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence. Paris : Ernest Flammarion, diteur, 1935. Rdition : Rio de Janeiro, Americ-Edit, 1972, 276 pages.
Premire partie (chap. I IV) Deuxime partie (chap. I et II)
Polices de caractres utilise : Pour le texte: Times, 12 points. Pour les citations : Times 10 points. Pour les notes de bas de page : Times, 10 points. dition lectronique ralise avec le traitement de textes Microsoft Word 2001 pour Macintosh. Mise en page sur papier format LETTRE (US letter), 8.5 x 11) dition complte le 11 mai 2003 Chicoutimi, Qubec.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
Table des matires
Introduction, par Pierre Janet, 29 dcembre 1932.
LES DBUTS DE LINTELLIGENCE Premire partie : Les premiers stades psychologiques
Chapitre I 1. 2. 3. Chapitre II 1. 2. 3. 4. Le problme de l'intelligence lmentaire L'intelligence en gnral La place de l'intelligence lmentaire parmi les tendances Les moyens d'tude Les actes rflexes et les actes perceptifs La hirarchie psychologique Les actes rflexes Les actes perceptifs Les caractres des actes suspensifs
Chapitre III Les conduites sociales 1. 2. 3. Les caractres des actes sociaux Les deux lments d'un acte social Les crmonies
Chapitre IV Les sentiments et le jeu 1. 2. 3. Les sentiments, rgulations de l'action Le jeu L'exploitation du jeu
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
Deuxime partie : Les premiers objets intellectuels
Chapitre I 1. 2. 3. 4. 5. 6. Chapitre II 1. 2. 3. La direction du mouvement et la route Les premires organisations du mouvement La direction en avant Le dtour Le renversement de la direction La droite et la gauche La route La position, la grande place du village La notion de position Les divers points de l'espace Le point de vue
VOIR LA SUITE DANS LE SECOND FICHIER Chapitre III La production, l'outil 1. 2. 3. Les caractres de l'outil L'acte de la production Le mcanisme psychologique de l'outil
Chapitre IV La ressemblance, le portrait 1. 2. 3. Chapitre V 1. 2. 3. Le problme de la ressemblance Le rle du portrait dans la ressemblance La construction du portrait La psychologie de la forme La thorie philosophique de la forme La forme et la matire La conduite de la forme
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
Docteur PIERRE JANET Membre de l'Institut Professeur au Collge de France
Les dbuts de l'intelligence
Paris : Ernest Flammarion, diteur, 1935. Rdition, 1972. AMERIC = EDIT.
Retour la table des matires
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
Les dbuts de lintelligence (1932)
Introduction
Par Pierre Janet, 29 dcembre 1932.
Retour la table des matires
Ces tudes sur les actions intellectuelles lmentaires, intermdiaires entre la conduite de l'animal et celle de l'homme, sur ces conduites qui prparent le langage ont t l'objet de plusieurs enseignements. Elles ont t prsentes d'abord dans la premire partie de mon cours au Collge de France de 1912-1913, la seconde partie de ce cours portait sur la mmoire considre au mme point de vue. L'analyse de ces actions intellectuelles lmentaires a t reprise d'une manire plus rsume dans mon cours l'cole de Mdecine de Londres en 1919. Ce cours a t publi en partie dans le British journal of psychology, medical section (oct. 1920, janv. et juil. 1921), quelques-unes des recherches sur le panier, le portrait, le langage ont t rappeles dans mon livre De l'angoisse l'extase, 1926, I, p. 215. L'tude de la mmoire comme action intellectuelle a t dveloppe dans le cours tout entier du Collge de France qui lui a t consacr, 1927-1928, et ce cours a t publi la librairie N. Maloine sous le titre de L'volution de la mmoire et de la notion de temps, 1928. L'intelligence lmentaire elle-mme a t expose dans un cours complet de 25 leons au Collge de France, 1931-1932. Enfin. la plus importante partie de ces leons, les plus caractristiques viennent de
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
faire l'objet d'un enseignement la Facult de philosophie de Buenos Aires (septembre-octobre 1932). Comme les leons du Collge de France avaient t remanies pour tre prsentes au public argentin, et comme j'attache une certaine importance la publication de ces tudes sur les premires formes de l'intelligence, je n'ai pas pu laisser publier telles quelles les notes si bien prises par M. Miron Epstein, comme je l'avais fait pour mes cours sur la mmoire, sur la personnalit, sur la force et la faiblesse psychologiques, la librairie N. Maloine. J'ai rdig toutes ces leons entirement en me servant bien entendu des notes de M. Miron Epstein. C'est M. Miron Epstein qui a commenc la publication de mes cours au Collge de France et qui a fait ainsi connatre plusieurs de ces enseignements. je le remercie vivement du grand travail qu'il a fait et qui m'a encourag continuer cette publication. Ces leons sur l'intelligence lmentaire ont d tre quelque peu remanies. J'ai t amen runir dans un mme chapitre plusieurs leons qui avaient t prsentes d'une manire un peu diffrente et j'ai rduit notablement les dernires leons qui soulevaient des problmes nouveaux et qui commenaient dpasser le stade de l'intelligence lmentaire. Peut-tre ces questions seront-elles reprises d'une manire plus complte dans mon prochain cours sur la croyance. Cette rdaction plus complte de ces leons me permet de prendre davantage la responsabilit des tudes qui sont ici prsentes. Les tudes publies dans ce volume qui a pour titre Les dbuts de l'intelligence portent sur les divers stades des tendances afin de permettre de situer l'intelligence lmentaire sa place dans le tableau hirarchique des tendances psychologiques, puis elles portent sur l'tude des premiers objets intellectuels, la route, la place, l'outil, le portrait, la forme. Quelques autres objets intellectuels, le panier, la part du gteau, le personnage, le symbole seront tudis dans un autre volume qui aura pour tire l'Intelligence avant le langage, et qui paratra prochainement. Pierre Janet 29 dcembre 1932.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
Pierre Janet, Les dbuts de lintelligence (1932)
Premire partie Les premiers stades psychologiques
Retour la table des matires
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
Les dbuts de lintelligence (1932) Premire partie : Les premiers stades psychologiques
Chapitre I
Le problme de l'intelligence lmentaire
Retour la table des matires
chaque instant tout le monde parle de l'intelligence et on semble comprendre de quoi il s'agit, mais il est vraiment trs difficile de prciser. Un matre d'cole, un professeur nous diront facilement : "cet enfant est trs paresseux, il ne sait pas grand'chose, mas cela s'arrangera, car il est trs intelligent" et ils diront d'un autre : "c'est un bon petit garon, plein de bonne volont, il travaille, il apprend beaucoup, il est un puits de science ; mais que voulez-vous qu'on en fasse, il est si peu intelligent". Sans doute ces paroles nous donnent dj une petite indication au moins ngative ; pour ces professeurs, ne rien savoir n'empche pas d'tre intelligent, savoir beaucoup, tre un puits de science n'empche pas d'tre bte ; mais si nous demandons au professeur : " quoi voyez-vous que celui-l est intelligent et que celui-ci est bte ?" il ne nous rpondra rien de prcis et nous sentirons le vague de cette notion populaire de l'intelligence.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
10
-1L'intelligence en gnral.
Retour la table des matires
Peut-tre pourrions-nous tirer de ces premires rponses une indication gnrale. Le professeur a l'air de croire que la petite fille intelligente qui ne travaille pas russira dans la vie et que le gros garon qui est bte n'arrivera rien. L'intelligence se prsente comme un pouvoir, comme une puissance dont nous disposons notre avantage ; l'intelligence sera au point de vue psychologique une condition de l'efficience de l'action. Il est de mode de rpter que l'homme est bien faible dans le monde, "que la moindre chose, qu'un grain de sable suffit pour l'craser", c'est la fois juste et faux. L'homme a sans doute peu de pouvoir dans ce monde, mais il a quelque pouvoir. Quand je dplace un papier sur la table je fais peu de chose mais je fais quelque chose : le destin, les lois naturelles avaient voulu que ce papier ft ma droite, je l'ai mis ma gauche, j'ai chang quelque chose dans l'ordre du monde. On nous rpte que l'homme a peu de dure, qu'il passe comme une ombre sans laisser de trace. Mais enfin il y a des hommes qui ont bti des cathdrales ; ces cathdrales ont chang quelque chose dans la rgion et ce changement se prolonge pendant des sicles. On dirait que l'homme a du pouvoir non seulement l'endroit o il est, mais encore l'endroit o il n'est pas : je puis dplacer un livre ct de moi, mais je puis aussi le jeter deux mtres, un endroit o je ne suis pas. L'architecte qui a bti la cathdrale a jet son action en avant dans le temps et il a encore de l'efficience des sicles aprs sa mort. De quoi dpend cette efficience ? Si nous le savions nous pourrions la gouverner, l'augmenter indfiniment et nous deviendrions matres de tout, matres mme de la mort, comme disait M. Bergson. Nous pouvons cependant dire que cette efficience dpend de bien des choses dont les unes sont en dehors de nous, dans les rencontres fortuites de notre organisme et des choses extrieures, et dont les autres sont en nous dans notre organisme, dans notre vie. Une de ces conditions qui sont en nous consiste prcisment dans ces conduites intelligentes : toutes choses gales d'ailleurs, une action intelligente a plus d'efficience, dans le temps, qu'une action bte. Par exemple une dcouverte scientifique qui transforme la vie des hommes dans de vastes rgions et pendant des sicles rentre dans ce groupe des actions intelligentes. Cette ide d'efficience peut encore se prciser un peu, car les modifications du monde que nous considrons pour apprcier cette efficience ne sont
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
11
pas quelconques. Si par un mouvement maladroit, je fais tomber par terre un vase prcieux construit par un artiste il y a longtemps, j'ai eu de l'efficience, puisque j'ai chang quelque chose dans le monde et dtruit ce qui durait depuis un sicle ; mais on ne me fera pas de compliments, on dira que je n'ai rien fait d'intelligent. Pour que l'efficience de l'acte soit apprcie comme intelligente, il faut que son effet soit favorable aux dsirs, aux tendances des hommes, qu'elle permette aux hommes de vivre plus, de vivre mieux pendant plus longtemps. C'est l ce qu'on appelle l'adaptation d'un tre son milieu, c'est un changement de son tat qui lui permet de conserver sa propre nature, de la dvelopper au milieu de choses qui ne sont pas identiques lui-mme, que ne sont pas lui-mme. C'est pourquoi l'intelligence a t comprise le plus souvent comme une condition qui favorise l'adaptation de l'tre vivant. L'intelligence devient ainsi une des proprits de la matire vivante, une cause importante de l'efficience des tres vivants. On est arriv trs vite dans ce sens d'normes et vagues gnralisations : l'adaptation du corps aux conditions dans lesquelles il est plac, la construction de l'organisme qui lui permet de manger, de respirer, de remuer ont t considres comme une uvre intelligente, comme le type de l'intelligence. Je rappelle ce propos un livre que j'ai trouv trs sduisant, La psychologie organique, 1925, qui est signe d'un pseudonyme, Pierre jean. Cet auteur montre de l'intelligence dans toutes les cellules, dans les champignons, dans les fleurs ; il signale particulirement l'intelligence des capucines qui cherchent avec ingniosit orienter leurs feuilles perpendiculairement aux rayons du soleil et fuir l'ombre qui les gne. je ne refuse pas cette qualification d'intelligence aux capucines qui sont videmment des fleurs trs spirituelles : je crains seulement qu'il n'y ait l bien des mtaphores peu prcises, l'emploi des mots "intelligence, sentiment, mmoire" dans tous ces cas me parat un peu aventureux, car on arrivera confondre l'intelligence avec la vie, ce qui n'claircira ni l'une ni l'autre. N'en est-il pas un peu de mme dans le beau livre de MM. von Monakow et Mourgue, Introduction biologique la neurologie et la psychopathologie, 1928, o ces auteurs nous dcrivent des instincts intelligents dans l'dification de l'embryon ? Les faits sont bien observs, mais les mots semblent employs d'une faon abusive. Nous ne connaissons gure la nature de la vie et les conditions de ses adaptations, n'est-il pas dangereux d'identifier tout de suite ces conditions inconnues avec l'une de nos conduites qui nous russit dans certaines situations particulires et que d'ailleurs nous sommes loin de connatre avec prcision ? On pourrait rappeler ce propos une pense de Gustave le Bon : "Le savant capable de rsoudre avec son intelligence les problmes rsolus chaque instant par les cellules d'une crature infime serait tellement suprieur aux autres hommes qu'il pourrait tre considr par eux comme un Dieu". Il n'est pas bon de confondre tout de suite tous ces procds d'adaptation inconnus avec notre intelligence qui ne doit tre que l'un d'entre eux et peut-tre l'un des plus infimes. C'est une des formes de la philosophie romantique de ramener tout un principe de vie que nous ne sommes gure pour le moment capables de comprendre. Notre tche est beaucoup plus modeste, nous cherchons au point de vue psychologique prciser un peu la nature de cette efficience spciale que nous appelons l'intelligence, nous essayons de prciser dans quels cas nous qualifions d'intelligentes certaines conduites des hommes ou mme des animaux.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
12
Rappelons d'abord une petite histoire de psychologie animale qui nous a amuss il y a trente ans. Deux professeurs franais se trouvaient en voyage dans une petite ville d'cosse, Inverness ; ils ont t un jour accosts par un chien pagneul d'allure fort aimable qui paraissait dsireux de lier connaissance avec eux. Ce chien portait son cou une tirelire sur laquelle taient inscrits le nom d'une institution charitable et la prire de mettre un penny dans la petite bote. Ces voyageurs intrigus et sduits par les manires du chien ont voulu mettre un penny dans la tirelire ; mais le chien ne parut pas satisfait, il les empcha de mettre la pice dans la bote et la prit entre ses dents. Les deux professeurs intrigus suivirent le chien dans quelques dtours et le virent entrer dans une boulangerie. Celui-ci s'approcha de la patronne et dposa le penny dans sa main, elle le prit et donna en change au chien un petit pain ; le chien immdiatement mangea le pain et retourna au grand trot ses occupations. Ces deux observateurs ont racont ce fait bizarre dans un petit article de la Revue scientifique et ils concluaient : "Ce chien est tout simplement un voleur qui s'entend avec la boulangre pour tromper l'institution charitable. Sa conduite est videmment dplorable au point de vue moral, mais elle est trs remarquable au point de vue psychologique. Ce chien a compris le proverbe : "Charit bien ordonne commence par soi-mme", en outre il a su faire de la boulangre sa complice et il arrive se procurer des petits gteaux avec beaucoup d'intelligence." Cet article provoqua une grande admiration pour l'intelligence du chien d'Inverness. Mais l'affaire n'en resta pas l : quelques semaines aprs, le directeur de l'institution charitable envoya la Revue scientifique un article de rectifiation en disant : "Vous donnez notre chien moins de moralit et plus d'intelligence qu'il ne convient, car c'est nous qui l'avons dress ce mange. Ce chien n'est nourri que par les petits pains qu'il gagne de cette manire. La boulangre n'a donn qu'un petit pain d'un demi-penny et a remis la diffrence dans la tirelire." Immdiatement l'opinion publique se retourna et dclara que le chien d'Inverness ne mritait plus sa rputation d'intelligence. Ce revirement de l'opinion nous montre qu'un certain caractre important de l'intelligence disparaissait aprs les explications du directeur. Nous avions cru d'abord que le chien avait invent sa conduite complique et adapte, mais nous apprenons que l'invention ne lui appartient pas car elle a t faite par l'institution, c'est elle qui a t intelligente et non le chien. Cette petite histoire prcise dj un caractre de l'intelligence : nous appelons intelligent un acte qui, en quelque chose, est original, qui sorte de l'tre lui-mme et qui ne vient pas des autres. Un acte habituel, devenu mcanique ne peut tre intelligent que dans son origine, dans sa premire construction et pour l'apprcier il faut remonter ces dbuts. Ce caractre de l'invention, de l'apparition nouvelle est cependant trop gnral : tout changement qui apparat spontanment dans un tre vivant n'est pas un acte intelligent, car l'volution de la vie nous prsente chaque instant de tels changements. Une autre observation portant cette fois sur une conduite humaine peut prciser quel point l'action doit tre modifie pour tre qualifie d'intelligente.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
13
Il y a quelques annes, j'avais diriger une malade dj ge de 76 ans dans des conditions morales assez particulires. Cette personne avait Paris une situation assez leve : son ge, sa fortune, le nom de son mari qui avait t un personnage politique important, ses enfants qui avaient de grandes situations et mme le rle qu'elle avait jou elle-mme autrefois, tout la rendait digne de tous les gards et mme de tous les respects. Malheureusement l'ge et des troubles nerveux avaient beaucoup modifi son caractre et son attitude : elle ne surveillait plus ni sa tenue, ni sa propret, dans la conversation elle disait trop souvent des choses mal propos, elle avait surtout de mauvaises habitudes au point de vue de l'alimentation et de la boisson. Une garde dcore du nom de dame de compagnie devait tre place auprs d'elle et je m'efforai d'expliquer cette personne quelle tait la situation : d'un ct une dame infiniment respectable et qui s'en rendait compte, auprs de laquelle il fallait avoir constamment une attitude respectueuse et mme un peu admirative ; de l'autre un certain abaissement psychologique qui obligeait prendre des prcautions, exiger certains soins, supprimer des aliments et des boissons dfendus, arrter des bavardages inconsidrs, etc. La garde parut comprendre et promit tout ce que je demandais. Quelques jours aprs, cette garde vint me trouver et se prsenta avec une certaine agitation pour me faire des reproches assez vifs : "Vous m'avez donn, disait-elle, des ordres absurdes, parce qu'ils sont contradictoires et inexcutables : d'un ct vous voulez que j'aie pour cette dame tous les respects possibles, je l'accepte parfaitement ; mais alors je serai son infrieure, car le premier des respects c'est l'obissance et elle va me faire faire, vous le savez bien, des absurdits. D'autre part vous me dites de lui faire faire des choses qu'elle ne veut pas faire, de l'empcher de manger et de boire sa faon, de sortir seule et de s'garer dans les rues, de bavarder tort et travers, tout cela je le comprends fort bien ; mais pour le faire il me faut commander, c'est alors moi qui serai la suprieure, car celui qui se fait obir est le suprieur. Je veux bien tre l'une ou l'autre, l'infrieure ou la suprieure, mais c'est une absurdit que de me commander d'tre l'une et l'autre la fois ; choisissez ce que je dois tre." De ce discours, j'ai conclu que cette femme tait trop bte et qu'elle tait incapable de remplir une mission dlicate qui demandait de l'intelligence. mon avis, une femme intelligente peut fort bien avoir l'air infiniment respectueux, se montrer en apparence trs docile et en mme temps ne faire que ce qu'elle veut et commander fermement en ayant l'air d'obir. Bien des femmes sont capables de jouer ce rle. Cette petite histoire mdicale est peut-tre instructive : elle nous montre un caractre essentiel de l'intelligence pratique et peut-tre une des raisons de son pouvoir. La garde nous paraissait sans intelligence, quand elle nous offrait de choisir l'une ou l'autre de deux conduites prcises, anciennes, dj organises avec prcision par les habitudes sociales, et ce que nous considrions comme intelligent c'tait une troisime conduite personnelle, nouvelle, adapte ce cas particulier et intermdiaire entre les deux conduites banales et traditionnelles. On peut prendre un autre exemple pour prciser ma pense, car il s'agit ici d'une question dlicate qui va prendre une grande importance dans toutes ces
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
14
tudes : on connat ces appareils de distribution automatique qui sont souvent placs dans les gares ; sur ces appareils il y a des sries de boutons qu'il faut presser pour obtenir une chose ou une autre dont le nom est inscrit au-dessous de chaque bouton. Le premier bouton nous donne des pastilles de chocolat, le second de la poudre de riz, le troisime des bonbons aciduls. Si un enfant veut des pastilles de chocolat il presse le premier bouton, s'il veut des bonbons aciduls il presse le troisime. Mais un enfant capricieux et gourmand a dans la tte l'ide bizarre de mettre la fois dans sa bouche une tablette de chocolat et un bonbon acidul ; comme il n'a qu'une seule pice et ne peut presser qu'un seul bouton, comment obtiendra-t-il un petit sac contenant moiti de l'un et moiti de l'autre ? Notre enfant sort de la gare et va dans une boutique o une aimable marchande lui confectionne immdiatement le petit sac qui contient une moiti de pastilles et une moiti de bonbons : l'appareil automatique tait bte, la marchande a t intelligente. Encore un exemple puisque la question me parat grave au dbut : un homme dsire un costume neuf et pour faire des conomies il entre dans un magasin de confections. "C'est bien simple, lui dit-on, tes-vous grand ou petit, tes-vous gros ou maigre ? Nous avons des costumes qui habillent parfaitement les grands, les petits, les gros ou les maigres." L'acheteur reste interdit : "C'est, dit-il, que j'ai le malheur de n'tre ni grand ni petit, ni gros ni maigre, je suis maigre de la poitrine et je suis gros du ventre." Aucun costume confectionn ne lui va et il est forc de retourner chez son tailleur qui, en homme intelligent, lui fera un costume sur mesure, intermdiaire entre les diffrents costumes tout faits. Le souvenir de la garde choisie pour la vieille dame n'est pas sans une certaine importance philosophique. Ce que nous lui demandions sous le nom de conduite intermdiaire entre deux autres, c'tait ce qu'on peut appeler une conduite sur mesure, une conduite relative certaines circonstances et cette observation introduit dans la conception de l'intelligence une notion trs importante, la notion de relation, de rapport. Dans toutes les sciences on parle perptuellement de rapports et la plus grande difficult de ces tudes c'est de comprendre les rapports. Un enfant que l'on initie aux mathmatiques a bien de la peine comprendre ce que c'est qu'une fraction, que la moiti ou le quart sont des rapports entre un et deux ou entre un et quatre et il faudra qu'il comprenne peu peu bien d'autres rapports, car toutes les mesures et toutes les lois ne sont que des rapports. Les notions qui permettent aux hommes de parler du temps, mme d'une manire lmentaire, les notions d'hier, de demain, d'avant et d'aprs ne sont aussi que des rapports. Le malheureux enfant ne peut pas se rfugier dans sa famille, car il ne peut comprendre qu'il a un pre, une mre, des frres, sans comprendre une foule de relations. Quand l'enfant va essayer de se reprsenter un peu ce qui se passe autour de lui il va tomber sur les rapports de causalit, de finalit, qui essayent de mettre un peu d'ordre dans l'univers ; cette notion de rapport est partout fondamentale dans ce qu'on appelle l'intelligence. Nos deux observations bien simples sur le chien d'Inverness et sur la garde de la vieille dame semblent avoir prcis un peu le problme de l'intelligence. Elles nous montrent qu'il y a une conduite invente par l'individu, nouvelle au moins par certains cts, qui consiste prendre dans bien des circonstances un juste milieu, qui consiste placer une action jusque-l inconnue entre deux
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
15
actions dj bien connues, c'est--dire agir d'une manire relative. Cette conduite semble au point de dpart de toutes les notions de rapport, des rapports de grandeur, de succession, de production qui remplissent les sciences. Ces conduites que l'on entrevoit ont un grand caractre, elles semblent minemment fructueuses pour les hommes, ceux qui les pratiquent sont visiblement suprieurs aux autres et la science qui en est sortie a multipli normment l'efficience de l'homme. tudier l'origine et la formation de ces conduites relationnelles, essayer d'expliquer ce qui fait leur puissance ce serait certainement comprendre une grande partie de l'intelligence.
-2 La place de l'intelligence lmentaire parmi les tendances.
Retour la table des matires
Comment pouvons-nous faire une pareille tude et comment pouvonsnous parvenir l'examen psychologique des rapports qui ont t dj si souvent tudis au point de vue logique ? Sans critiquer ces tudes logiques des rapports qui sont souvent fort belles, je dirai simplement qu'elles m'inquitent un peu parce qu'elles abordent les choses par le ct o elles sont le plus difficiles comprendre. Ces rapports de ressemblance, de contenance, de causalit tels qu'ils existent aujourd'hui dans la philosophie, dans les sciences et mme dans le langage courant sont compliqus, abstraits, mlangs intimement avec une foule d'interprtations faites au cours des sicles. Ce sont des langages et des croyances superposs ces relations elles-mmes et il n'est pas facile de dbrouiller cet cheveau. Bien souvent la psychologie a procd de la mme manire. Depuis Descartes surtout elle prenait son point de dpart dans la pense et tudiait les ides telles qu'elles sont actuellement formules par notre langage intrieur. Mais ce sont l les faits les plus compliqus qui constituent pour la science un bien dangereux point de dpart. La psychologie un peu nouvelle qui s'est dveloppe depuis quelques annes me parat plus modeste et plus simple. Elle considre la conscience et la pense intrieure comme des complications dont il faut au dbut rserver l'tude. Elle veut tudier d'abord les faits psychologiques de la mme manire qui a permis de comprendre un peu les faits physiques et les faits biologiques en les tudiant au dehors tels qu'ils se prsentent nos regards. Or les faits psychologiques tudis au dehors sont des conduites, c'est--dire des ensembles d'actes, des mouvements des bras, des jambes, du corps entier et surtout de la bouche, car les hommes sont surtout des animaux bavards. Aprs les premires adaptations des tres vivants qui ont t les fonctions viscrales de la digestion, de la respiration, les tres vivants semblent avoir utilis des adaptations d'une autre nature, par
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
16
des mouvements extrieurs de leurs membres et des dplacements de leur corps. Ce sont ces actes que nous considrons comme les phnomnes psychologiques les plus simples, dans une psychologie de la conduite. Avant les ides de rapport et les raisonnements sur les rapports il y a des conduites particulires dont nous venons de voir des exemples, dans la conduite de la marchande aimable qui mlange pour le petit garon les chocolats et les bonbons, dans la conduite du tailleur qui fait un vtement sur mesure. Nous dirons que ce sont des conduites relationnelles qui mettent en relation plusieurs termes les uns avec les autres. Ces conduites nous semblent plus lmentaires que les ides de rapport qui en sont sorties par le perfectionnement du langage. Par consquent, dans la mesure o cela nous sera possible, ce sont ces conduites relationnelles prparatrices des rapports que nous devons tudier en premier lieu. On peut encore indiquer cet objet de nos tudes d'une autre manire. Aujourd'hui, chez un homme adulte, les rapports sont contenus dans le langage, c'est le langage qui contient toute l'intelligence qu'ont acquise nos anctres et qu'ils nous ont lgue. Ce que nous voulons tudier, c'est la formation de ces conduites intellectuelles qui ont prcd le langage et qui en ont permis la formation, c'est l'intelligence avant le langage. S'il en est ainsi, il nous faut chercher la place de ces conduites relationnelles au milieu de toutes les autres actions que les hommes ont peu peu appris faire. Une psychologie de la conduite devient ncessairement une psychologie gntique qui range les conduites observes dans un certain ordre en mettant au dbut les conduites qui nous paraissent les plus simples et audessus les conduites plus leves suivant leur ordre de complication et aussi, quand nous pouvons le souponner, suivant leur ordre d'acquisition. Les intervalles entre les oprations successives qui sont comme des paliers ne doivent pas tre trop grands pour que nous puissions nous reprsenter un peu l'ascension qui a t faite. C'est, en somme, dans cette dification de la psychologie, la conduite de l'chelle, c'est--dire la conduite que nous avons vis--vis d'une chelle. Les chelons successifs ne doivent tre spars les uns des autres que par des intervalles adapts l'cartement de nos jambes. Vous voyez dj dans cette allusion l'chelle une indication de notre tendance recourir des conduites infrieures pour expliquer les suprieures ; ici la notion de l'chelle nous prpare comprendre les paliers de l'volution. Nous avons t amens tablir, d'une faon malheureusement encore bien fragile, ce tableau de la hirarchie des tendances ou mieux de la hirarchie des oprations psychologiques. A propos de ce tableau, je suis heureux de pouvoir vous signaler un livre crit en espagnol qui le prsente d'une manire intressante et utile. M. B. Subercaseaux, qui a suivi mes cours au Collge de France, a bien voulu en prsenter un rsum dans des confrences qu'il a faites au Chili. Son livre, Apuntos de psicologia comparada, 1928, rsume bien l'essentiel de cet enseignement. Si nous considrons ce tableau, nous admettrons facilement d'aprs nos remarques prcdentes que les conduites relationnelles ne doivent pas tre places parmi les tendances suprieures qui utilisent le langage et dont l'l-
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
17
ment essentiel est la croyance. Dans ces tendances assritives, rflchies, rationnelles, se trouvent des croyances, des ides gnrales, des mesures, en un mot des rapports compliqus qui ncessitent le langage. On peut, comme on l'a fait souvent aujourd'hui, dsigner sous le nom de plan verbal l'ensemble de ces oprations suprieures qui drivent du langage. Les conduites relationnelles doivent tre au-dessous puisque nous venons de les dfinir de l'intelligence avant le langage. Mais il ne faut pas non plus placer nos conduites relationnelles trop en bas du tableau, parmi les conduites lmentaires des premiers animaux que nous y avons places sous le nom de conduites rflexes et de conduites perceptives. Ces conduites simples et rgulires ressemblent la pression des boutons de l'appareil de distribution ou bien aux habits tout faits de la maison de confections, elles ne prsentent pas du tout les caractres de nos conduites relationnelles. Ces deux groupes de conduites, les conduites suprieures aprs le langage et les conduites tout fait infrieures des rflexes et des perceptions sont aujourd'hui trs bien tudies les unes et les autres. Vous avez bien connu ici les tudes de M. Lvy-Bruhl sur les premires croyances des peuples primitifs, qui doivent tre places au dbut des tendances suprieures et les tudes de M. Piron sur les rflexes sensoriels qui se placent dans la partie infrieure du tableau. Mais il y a entre ces deux parties du tableau un espace probablement assez considrable o nos connaissances sont trs restreintes : on a peu tudi ce passage curieux des actes instinctifs aux langages et aux croyances humaines. Quand on essayait de faire autrefois une carte de l'Afrique, on mettait beaucoup de dtails sur le littoral, mais on rservait au centre de grands espaces blancs que l'on appelait "terrae incognit, les terres inconnues". Dans la carte de l'esprit humain nous pouvons mettre aussi terrae incognitae sur les vastes rgions o s'laborent probablement les conduites relationnelles qui vont aboutir au langage. Remarquez que les gographes ne se taisaient pas tout fait sur les terrae incognitae, ils en parlaient un peu. Ils nous disaient : une terre inconnue c'est une terre entoure de tous cts par des terres qui sont connues, et cet entourage donne dj quelques petits renseignements sur la dimension de la rgion inconnue, il en donne un peu plus qu'on ne croit sur son contenu. Supposez par exemple que le gographe qui a dcrit en Afrique une terre inconnue remarque que d'un ct il y a de petites rivires qui se dirigent vers cette terre ; ces rivires sont connues, certaines d'entre elles vont traverser la rgion inconnue. Puis un autre gographe dira de son ct : de cette terre inconnue, je vois dboucher dans la mer un grand fleuve, ce fleuve est visible, il se jette dans la mer, et sort de cette terre. L'esprit humain n'aura pas de peine dire : ces petites rivires doivent traverser la terre inconnue, et se runir plus ou moins ensuite pour arriver faire un fleuve. Je ne connais pas la marche du fleuve, mais il est probable qu'il existe dans cette terre inconnue et je vais au moins mettre par des points la marque d'un fleuve imaginaire. Dans l'esprit humain il y a ainsi galement des rgions inconnues, mais on en connat le point de dpart : les conduites instinctives de l'animal ; et aussi le rsultat : la fameuse notion de rapport. Il est probable qu'entre les deux il s'est fait un travail, comme il s'en est fait un pour le fleuve dont je vous parlais tout
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
18
l'heure, il s'est fait un travail que nous pouvons peut-tre connatre par un rapprochement entre le point de dpart et le point connu d'arrive. Bien plus, ces terrae incognitae ne sont pas compltement vides, il y passe des caravanes, des avions les survolent, ces avions n'ont pas tout vu, mais ils disent cependant, de temps en temps : nous avons cru voir quelque chose, nous avons aperu le sommet de montagnes, et petit petit il y a des renseignements, des lots de connaissances qui permettent de marquer quelques points sur ces terres inconnues. Eh bien, si nous considrons les documents relatifs l'intelligence, je crois que nous avons des lots de ce genre et plus de renseignements que nous ne pensions si nous voulons bien les chercher l o ils se montrent bien en vidence.
-3Les moyens d'tude.
Retour la table des matires
Il y a autour de nous bien des documents vivants qui peuvent nous renseigner sur ces fonctions si peu connues, intermdiaires entre les fonctions rflexes et le langage humain. Ce sont d'abord les tres vivants qui dans leur dveloppement se sont arrts ce stade. Nous savons bien que des animaux infrieurs, des reptiles ne possdent gure que les rflexes et les actes perceptifs infrieurs. Mais il y a certainement des animaux qui vont plus loin. Sans doute ils ne parlent pas, ils ne sont pas parvenus au plan verbal, mais ils nous montrent chaque instant des marques videntes d'intelligence quoiqu'elle ne soit pas parvenue au langage. Mais c'est l justement notre problme, celui de l'intelligence avant le langage. tudier cette intelligence de l'animal suprieur doit tre une partie importante de notre travail. Or nous avons justement sur ce point un livre remarquable consulter : un psychologue allemand, M. Khler, a t retenu pendant la guerre de longs mois dans l'le de Tnriffe o il y avait un dpt de singes suprieurs, de chimpanzs destins des laboratoires de microbiologie. M. Khler a entretenu avec ces singes d'excellentes relations et il s'est efforc de les bien connatre. Ses expriences sur l'intelligence des chimpanzs et en particulier sur l'usage qu'ils savent faire de l'outil sont de la premire importance. je dirais mme qu'elles nous surprennent et qu'elles nous montrent chez cet animal un degr d'intelligence que nous ne souponnions pas. Je ne rappelle qu'un seul exemple brivement, car nous en reprendrons la discussion dans une des leons prochaines sur l'outil. Un singe, dont le nom mrite de passer la postrit, Sultan, est dans sa cage et convoite une banane
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
19
place en dehors de la grille. Il cherche d'abord l'attirer lui avec un bton, ce que je trouve dj trs joli, mais le bton est trop court. Eh bien, je passe aujourd'hui sur les dtails, Sultan remarque un autre bambou plus mince et il arrive l'enfiler sur le premier, ce qui fait un long bton suffisant pour attirer la banane. Il ne s'agit pas l de mditation philosophique ni de systme du monde, mais je n'hsite pas dire que ce singe a fait une action intelligente, extrmement intelligente ; je dirai mme qu'elle m'tonne et qu'elle parat dpasser ce qu'on peut attendre de cet animal : ce singe se conduit intelligemment. A ct et peut-tre dj un peu au-dessus du singe nous voyons le petit enfant que l'on commence tudier aujourd'hui beaucoup. justement, il faut signaler l'histoire d'une petite fille amricaine qui n'avait pas encore trois ans et que son pre, par curiosit psychologique, a mise dans une cage exactement comme les singes. Le psychologue a propos cette enfant la plupart des problmes que M. Khler posait ses chimpanzs et nous pouvons constater avec satisfaction pour notre espce que cette petite fille ne s'est pas montre infrieure aux chimpanzs. je n'ai pas besoin de rappeler les livres de M. Piaget, de Genve. je regrette un peu que M. Piaget s'occupe beaucoup de l'enfant qui parle et peut-tre pas assez de l'enfant qui joue et qui agit ; mais il nous fournira des renseignements prcieux sur les actes intelligents de la division et du rangement dont nous aurons parler plus tard. Il nous faut tenir compte aussi des travaux si nombreux sur les primitifs, en particulier des belles tudes de M. Lvy-Bruhl. Mais dj ici il faut tre prudent, car le primitif de M. Lvy-Bruhl est encore plus bavard que les enfants de M. Piaget. Avec eux nous entrons un peu trop dans les croyances du plan verbal. Cependant, les murs et les institutions de ces populations sont pour nous trs instructives. Pour moi-mme, j'ai l'habitude, dans mes ouvrages, de me servir particulirement des observations psychologiques que me fournissent mes malades, tous ceux qui souffrent de ces troubles innombrables qui vont des nvroses aux alinations. Les malades dont je m'occupe le plus souvent ne peuvent gure, en ce moment, nous tre utiles, car, malgr leurs troubles, ils restent, en gnral, beaucoup trop suprieurs aux chimpanzs. Leurs troubles nous feraient plutt connatre le mcanisme des croyances qui sont d'un stade suprieur l'intelligence lmentaire. Il nous faudra plutt utiliser des malades plus profondment atteints, que fort heureusement je vois moins souvent. Les confusions mentales, les dlires infectieux de forme onirique dterminent des abaissements au stade de l'intelligence lmentaire et mme au-dessous. Nous trouverons l, sous une forme exagre, les phnomnes du rve dont l'tude est aujourd'hui si la mode. L'tude si difficile des idiots et des imbciles devra y tre ajoute. Mais une forme trs triste et trop frquente des maladies de l'esprit est bien plus importante pour nous, je veux parler des dtriorations de la conduite Conscutives aux hmorragies crbrales. Les hmiplgiques droits ont presque toujours en mme temps perdu la parole et sont devenus des aphasiques.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
20
Cette perte de la parole les met justement au stade dont nous poursuivons l'tude, ils n'ont plus que l'intelligence lmentaire au-dessous du langage et encore cette intelligence lmentaire est chez eux frquemment trouble. Le professeur Henry Head, de Londres, a fait sur ces malades de longues et belles tudes runies dans ses deux gros volumes sur l'aphasie et les questions connexes, il nous donnera sans cesse les plus prcieux renseignements. Il y a cependant, mon avis, une tude qui domine toutes les autres et j'avais longuement insist sur elle dans mes premires leons au Collge de France en 1912-1913 sur les premiers actes de l'intelligence et dans mes leons l'Universit de Londres sur les stades psychologiques, 1920 1. Les premiers actes humains de la perception donnent naissance des objets, objets alimentaires.. objets sexuels, objets redoutables, etc. Ces objets ne sont discerns dans la nature que par les tendances correspondantes de l'alimentation, du sexe, de la fuite. Eh bien, les actes intellectuels lmentaires dont nous nous occupons crent aussi des objets fort curieux qui sont bien distincts des prcdents et qui mritent d'tre appels des objets intellectuels. Il y a dans le monde, non seulement des fruits ou des rochers ou des lions, mais il y a la route, la place publique, la porte, l'outil, le portrait, le panier, la part du gteau, les tiroirs de l'armoire, le drapeau, le mot. Comprendre ces objets singuliers qui visiblement n'ont pas t crs par la nature mais par l'homme, voir leur rapport avec les conduites qui leur ont donn naissance, c'est le meilleur moyen de comprendre l'intelligence lmentaire. Voil bien des objets d'tude, je n'ai pas la prtention de les traiter tous compltement dans ces petits livres, j'espre seulement intresser leur tude et indiquer l'tat actuel de ces questions.
The british Journal of psychology, 1921.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
21
Les dbuts de lintelligence (1932) Premire partie : Les premiers stades psychologiques
Chapitre II
Les actes rflexes et les actes perceptifs
Retour la table des matires
L'intelligence d'une manire gnrale s'est prsente comme une sorte d'invention personnelle, comme une adaptation nouvelle de la conduite des circonstances particulirement complexes. Une femme nous a paru sans intelligence quand elle n'tait pas capable de combiner deux actions anciennes en une seule. Une telle intelligence peut prsenter bien des degrs, elle peut s'exercer sur des actes qui sont eux-mmes dj des combinaisons intellectuelles, il y a pour ainsi dire des intelligences du deuxime et du troisime degr. Ces formes suprieures de l'intelligence dpendent avant tout du langage, car les nouvelles combinaisons ne peuvent gure se faire qu'entre des actes prcdents rsums et prsents sous forme de langage. Mais on doit considrer d'abord une intelligence lmentaire, celle qui effectue des combinaisons entre des actes simples qui ne sont encore que des mouvements des membres dj donns dans la constitution de l'organisme et dans celle des instincts. Ce sont ces actes primitifs, antrieurs l'intelligence lmentaire, qu'il faut d'abord rsumer pour pouvoir comprendre ce que l'intelligence lmentaire leur ajoute.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
22
-1La hirarchie psychologique.
Retour la table des matires
La conduite des tres vivants se perfectionne de plus en plus et nous parat acqurir une efficacit, de plus en plus grande dans l'espace et dans le temps, c'est ce qui frappe nos regards quand nous voyons les diffrences qui distinguent les tres les uns des autres. Ce progrs est trs lent et au premier abord il y a peu de diffrence d'un animal un autre, il s'agit d'une srie continue. Nous sommes forcs pour la prcision de la description de distinguer des paliers o l'volution est plus apparente ; la science applique ici la description des conduites un procd de l'intelligence lmentaire que nous aurons tudier propos de l'chelle, de l'escalier. Dans l'escalier nous tablissons des marches dont l'cartement est proportionnel la puissance de nos jambes, dans les classifications volutives nous tablissons des divisions souvent un peu arbitraires et correspondantes notre capacit de distinguer les actes les uns des autres. Cette tude a permis d'tablir un tableau hirarchique des tendances, tableau videmment trs rsum mais qui permet de voir quels sont les actes au-dessous de l'intelligence lmentaire et les actes qui se sont dvelopps au-dessus 1. Le tableau ci-dessous prsente en haut les tendances des actions trs lmentaires qui existent mme chez les animaux infrieurs et en descendant les tendances des actes de plus en plus levs. Tendances des actes rflexes ; Tendances des actes perceptifs ou suspensifs ; Tendances des actes sociaux ; Tendances des actes intellectuels lmentaires ; Tendances des actes du plan verbal, actes assritifs ; Tendances des actes rflchis ; Tendances des actes rationnels e ; Tendances des actes exprimentaux ; Tendances des actes progressifs. Parmi les actes les plus levs de l'intelligence lmentaire nous trouvons au premier plan le langage. Sans doute le langage tel qu'il existe aujourd'hui est bien diffrent des actes de l'intelligence lmentaire et des premiers objets intellectuels, de la route ou du panier. Il n'est plus comme eux un acte particulier et relativement simple adapt des circonstances bien dtermines, il intervient partout tout propos, il remplace toutes les autres actions. Il s'agit l d'un rle spcial du langage qui caractrise une conduite suprieure souvent dsigne aujourd'hui sous le nom de conduite du plan verbal. Cette utilisation du langage qui transforme toutes les actions prcdentes n'appartient pas en
1
propos de ce tableau hirarchique des tendances, cf. De l'angoisse l'extase, 1926, I, p. 201.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
23
effet ce que nous appelons l'intelligence lmentaire. Mais avant de faire du langage cet usage spcial, avant de s'en servir comme substitut de toutes les actions, il a fallu d'abord le crer, l'organiser d'une manire moins ambitieuse. On peut remarquer qu'aujourd'hui un autre objet intellectuel, l'outil, a pris galement un dveloppement norme, et qu'il intervient dans presque toutes les actions. Mais on peut observer une poque chez l'animal et chez l'homme o l'outil n'avait pas pris cette extension dmesure. Le langage a commenc de mme par des commandements isols faits par quelques individus seulement et compris seulement par quelques autres. Les quelques formules verbales qui avaient t inventes taient utilises isolment de temps en temps dans quelques circonstances, comme les outils ou les paniers. Ce n'est que plus tard que l'homme, parvenu au plan verbal avec la croyance, a donn au langage le rle que nous lui voyons aujourd'hui. Il s'est donc prsent au dbut comme l'une de ces oprations intellectuelles que nous tudions ; nous aurons donc, la fin de ces tudes, prsenter quelques rflexions sur ces premires formes du langage et sur les actions qui en drivent immdiatement comme le commandement, le rcit et les premires numrations. Mais il faut d'abord acqurir quelques notions sur les actions infrieures au-dessous de l'intelligence lmentaire qui ont t le point de dpart de celleci. Quel est le phnomne apparent chez les tres vivants que nous devons considrer comme le dbut des phnomnes psychologiques ? Les philosophes, le plus souvent, ludent la question en mettant au point de dpart l'intelligence et la pense, conues d'ailleurs d'une manire fort vague. Nous ne pouvons pas le faire puisque nous essayons de nous reprsenter l'intelligence et la pense comme des formes d'action humaine dtermines apparaissant plus tard un stade dj lev du dveloppement psychologique. Une hypothse trs intressante a eu jusqu' nos jours une grosse influence sur les tudes psychologiques, c'est l'hypothse de Condillac qui fait commencer toute l'activit de l'esprit avec le phnomne que l'on a dsign sous le nom de "sensation". On appelle sensation la couleur bleue de ce papier telle qu'elle est dans notre conscience et non dans le monde extrieur, c'est un lment conscient, abstrait de la perception du papier, c'est ce qui reste dans la conscience de cette perception quand on retire l'extriorit, la forme de l'objet, le schma de cet objet et tous les actes qui dpendent de ce schma perceptif. Toute la psychologie est fonde sur cette sensation et, quand on a voulu appliquer les mthodes scientifiques la psychologie, c'est cet lment abstrait de la perception, cette sensation que l'on a voulu mesurer, dont on a cherch les relations avec les phnomnes physiques extrieurs. Cette hypothse condillacienne est-elle bien satisfaisante et ne nous a-telle pas entrans depuis deux sicles dans une mauvaise voie ? Ce prtendu lment est encore au point de vue psychologique bien complexe, il est surtout caractris par la conscience interne et personnelle, la statue de Condillac "se sent odeur de roses". Ce caractre d'intriorit suppose la distinction de l'extrieur et de l'intrieur qui ne peut se comprendre que par l'analyse des conduites perceptives et des conduites du sentiment qui sont dj des phnomnes psychologiques bien complexes. La vie interne a t prsente comme la premire, comme la plus fondamentale, la suite de considrations philosophiques ; elle n'a exist en fait que trs tardivement.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
24
En fait, on ne peut pas constater de telles sensations isolment. Il est impossible de dmontrer que l'enfant commence par avoir le got du lait isolment quand il tte, puisque. nous le voyons faire en mme temps une foule de mouvements. Ce n'est que tardivement chez des adultes que nous Pouvons avoir affaire des sujets qui nous disent : "je vois du bleu et je ne vois que cela." Ce sont des sujets intelligents et dresss qui, dans une perception totale et complexe d'un papier et d'un appareil, ont appris isoler un lment dsign par un mot et porter sur lui leur attention peu prs exclusive. On n'tudie pas ainsi, comme on le croit, un phnomne simple et primitif, mais un, tat d'esprit fort compliqu. Un grand nombre des difficults de la psychologie exprimentale dpendent de ce malentendu sur le choix du phnomne considr comme lmentaire. La philosophie mme a toujours t trs embarrasse pour rattacher les actes de l'homme qui ont les phnomnes psychologiques essentiels cet lment considr comme purement interne. Descartes, qui l'on attribue la considration de la pense comme point de dpart de la vie de l'esprit, ne parlait du "cogito" qu'au point de vue philosophique. Il a t aussi l'un des premiers tudier un autre phnomne comme primordial quand il dcrivait dans un schma clbre un homme assis auprs d'un feu qui retire sa main quand elle est brle. Ce mouvement lmentaire si bien tudi par Descartes et par Malebranche est devenu "l'acte rflexe", et toute une psychologie a t difie qui prend cet acte rflexe comme point de dpart. Griesinger commenait dj dire que tous les mouvements de l'homme n'taient que des complications de l'acte rflexe. Depuis cette poque, un grand nombre d'crivains ont dvelopp cette ide, on peut rappeler entre autres les noms de Laycock, 1844, de Carpenter, de Horwicz, de Bonatelli, de Herzen, de Charles Richet, et surtout de Bechterew. Ce dernier a soutenu formellement que tous les phnomnes psychologiques pouvaient tre prsents comme des complications de ces rflexes primitifs. Sans doute cette conception soulve bien des difficults et il sera ncessaire d'ajouter au rflexe bien des lments en grande partie nouveaux, bien des inventions, si l'on veut, d'actes nouveaux qui ne sont pas uniquement des combinaisons de rflexes, mais qui ajoutent d'autres lments. Mais l'ide gnrale reste juste : pour nous qui considrons la psychologie scientifique, bien distincte d'une psychologie philosophique ou mtaphysique, comme une tude des conduites des tres vivants, cette conception des actes rflexes comme les plus simples que nous connaissions, au point de dpart des autres conduites psychologiques nous semble aujourd'hui la plus juste et la plus fconde au moins comme hypothse de travail.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
25
-2Les actes rflexes.
Retour la table des matires
Ces actes rflexes que nous considrons par hypothse comme la forme la plus simple des conduites psychologiques prsentent un certain nombre de caractres. Il est vident que la dtermination de ces caractres comporte quelque degr d'abstraction, car la dtermination d'un lment ne peut tre faite qu'en liminant dans l'observation d'une chose complexe les parties ou les caractres qui nous semblent. exceptionnels et accessoires. Un acte rflexe est une raction compose de mouvements bien dtermins une stimulation externe galement bien dtermine. Le mouvement que l'on observe, plus ou moins compliqu, est toujours le mme quand la stimulation elle-mme reste identique. Il dpend de la contraction un certain degr de certains muscles plus ou moins nombreux et d'une succession rgulire de ces contractions dans un certain ordre. Dans l'ouvrage de MM. von Monakow et Mourgue, Introduction biologique l'tude de la neurologie et de la psychopathologie, 1928, ces contractions successives dans un ordre bien rgl sont compares une mlodie ; il y a dans le fonctionnement de l'organisme des mlodies cintiques qui montrent une organisation des mouvements dans l'espace et dans le temps. On pourrait comparer cette organisation celle qui se manifeste par la mise en marche de disques de phonographe. Pour constater cette rgularit du mouvement dans l'acte rflexe il faut que la stimulation soit galement trs prcise. Il s'agit de telle pression, de tel contact, de telle brlure, de tel phnomne lumineux dtermin non seulement dans sa qualit, mais aussi dans sa quantit : si la stimulation est trop faible, le rflexe ne se produit pas, moins que la sommation des stimulations dans un temps trs court n'amne une intensit suffisante, La stimulation doit encore tre faite sur un point dtermin des tguments. M. Sherrington a bien montr ce caractre en tudiant sur des animaux dcrbrs le clbre "scratch reflex", le rflexe du grattage. Le mouvement de gratter est fait par telle patte de l'animal, avec tels muscles, avec telle intensit, sur tel point de la peau suivant l'endroit de la peau qui est stimul ; il diffre ds que cette stimulation s'exerce sur un autre point mme voisin du premier. Cette dtermination du rflexe est si prcise que cet acte ne semble point prsenter de degrs, il existe ou il n'existe pas et prsente un haut degr ce caractre "du tout ou rien" qui semble essentiel dans les conduites lmentaires. Quand le rflexe est dclench, il se produit jusqu'au tout d'une manire complte sans pouvoir tre telle ou telle phase de son activation. On le voit
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
26
bien dans le rflexe de la dglutition qui se produit compltement ou qui ne se produit pas. Nous avons souvent tudi les phases de l'activation qui jouent un rle si important dans des actes un peu plus levs ; ici il ne peut tre question que de deux phases, la latence quand le rflexe ne se produit pas, mais reste simplement possible, et la consommation quand l'activation est complte et arrive son terme. C'est ce que nous avons rsum en disant que le rflexe est un acte explosif par opposition aux actes suspensifs qui caractrisent les conduites perceptives. ces caractres bien connus par les physiologistes, peut-tre pouvons-nous ajouter quelques dtails particuliers intressants pour nos tudes psychologiques. Le rflexe est pour nous un acte simple qui rpond une seule stimulation actuellement prsente et qui ne s'adapte pas d'avance, d'autres stimulations possibles aprs la premire. Un objet plac devant les yeux ne dtermine dans l'acte rflexe que des ractions simples d'accommodation visuelle suivant son clairage et sa distance. Quand la raction consiste en des actes plus complexes adapts la nature de l'objet, aux stimulations nouvelles qu'il peut dterminer quand on s'approche de lui, quand on le prend, quand on le mange, nous ne dsignons plus ces actes plus complexes par le nom de rflexes. Le rflexe est galement simple en ce qu'il se prsente comme un seul acte qui a son unit, qui n'existe que sous cette forme totale, qui ne peut pas tre dcompos en plusieurs actes plus simples, susceptibles de se prsenter isolment dans d'autres circonstances. Nous venons de parier du plan verbal dans lequel des actes de langage se mlent des mouvements des membres. un commandement ou une invitation, nous rpondons extrieurement ou intrieurement par une formule verbale : "oui, j'accepte" et nous excutons en mme temps par des mouvements des membres l'acte demand. Il y a une division de l'acte en deux parties, l'une verbale et l'autre particulirement motrice, ces deux parties d'ailleurs sont dj connues comme pouvant se prsenter isolment. Cette complication tout fait caractristique des actes d'un niveau plus lev n'existe pas encore dans l'acte que nous considrons comme rflexe au point de vue psychologique. Enfin l'acte simplement rflexe n'est pas modifi par ces rgulations psychologiques qui caractrisent les sentiments : l'effort n'augmente pas normalement les rflexes pupillaires, la tristesse ou la joie ne le transforment pas directement. Sans doute plusieurs rflexes provoqus simultanment par plusieurs stimulations qui agissent au mme moment peuvent jusqu' un certain point agir l'un sur l'autre. Mais cette action rciproque quand il s'agit de rflexes lmentaires consiste surtout en une inhibition de l'un de ces actes par l'autre qui accapare "la voie commune", comme, dit M. Sherrington. Les belles expriences de M. Pawlov sur les rflexes conditionnels, ont t faites le plus souvent sur des animaux suprieurs, elles nous prsentent dj des conduites intermdiaires entre les rflexes et les actes perceptifs. Un chien qui salivait quand de la viande tait place dans sa bouche a appris saliver en entendant un coup de sifflet. Le rflexe de la salivation n'est pas modifi en lui-mme, mais il se produit d'avance en relation avec une stimulation possible et future. Il en est de mme quand l'acte de s'asseoir est dclench la simple vue du fauteuil. Il s'agit de ces associations de rflexes par un schma perceptif que nous tudierons prochainement. Bien entendu, les combinaisons de rflexes en un acte nouveau qui n'est identique ni l'un ni l'autre des actes primitifs sont
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
27
d'un niveau plus lev encore, nous les retrouverons prcisment propos des actes intellectuels lmentaires. Ces actes rflexes que nous considrons comme les plus simples des conduites psychologiques prsentent sur la sensation de Condillac de nombreux avantages qui facilitent les tudes psychologiques. Ils ne sont pas comme la sensation des philosophes une conception abstraite, ils peuvent tre tudis rellement dans des conditions particulires sous une forme relativement pure. Les rflexes peuvent tre constats isolment chez les animaux les plus simples qui, probablement, n'ont pas d'autre forme de conduite psychologique : des mollusques, des insectes ne prsentent pas d'autres conduites que la conduite rflexe. Les tropismes de Lb ne sont qu'une forme particulirement simple de certains rflexes. Il est probable que l'enfant trs jeune, dans les premiers jours de la vie et peut-tre mme avant la naissance, dans l'utrus de sa mre, ne prsente que des actes rflexes simples. Les premires actions de tter, d'uriner, d'expulser le mconium sont de ce genre. Les tudes sur les blesss de la colonne vertbrale avec des sections de la moelle pinire diverses hauteurs permettent de constater sur les membres situs au-dessous de la lsion des mouvements rduits la forme de rflexes psychologiques. Nous trouvons une tude complte de ces mouvements dans l'ouvrage de M. L'Hermite, La section totale de la moelle dorsale, 1919. Ces tudes si importantes sur les mouvements des membres aprs les sections de la moelle pinire ont t pousses trs loin dans le beau livre de M. Sherrington sur les animaux dcrbrs, The integrative action of the nervous system, 1910. C'est la ncessit de rendre les animaux tout fait insensibles dans les expriences de vivisection montres aux lves qui a amen M. Sherrington tudier les sections exprimentales de la moelle. Il a rencontr bien des difficults pour conserver en vie de tels animaux dcrbrs et il a t amen tudier leur comportement ; ses tudes ont fait avancer beaucoup notre connaissance des actes rflexes lmentaires. On retrouvera ces actes rflexes, mais sous une forme moins pure, chez les individus de l'espce humaine que la maladie a rduits une vie vgtative. J'ai eu l'occasion d'tudier deux idiotes qui taient bien au-dessous des animaux suprieurs et qui ne prsentaient gure que des actes rflexes simples. On retrouvera de tels actes isols dans les tats de dmence profonde. Ds que l'enfant a dpass les premiers jours ou les premires semaines de la vie extra-utrine, ses actes prennent ordinairement des formes plus compliques et dans la description psychologique nous devons les placer un stade suprieur. Le plus souvent le changement se fait par le phnomne de "la prise de conscience". Cette opration de la prise de conscience consiste le plus souvent dans l'addition d'un acte suprieur celui qui tait excut sous une forme infrieure. Nous avons souvent remarqu ce propos que toutes les ractions du stade infrieur ne sont pas ainsi transformes en actes du stade suprieur. Une partie plus ou moins considrable de ces ractions continue garder la forme infrieure. C'est ce qui donne naissance aux actes qui ont provoqu tant de controverses sous le nom d'actes subconscients. Nous savons que l'homme cherche transformer en langage toutes ses actions, mais un certain nombre de ces actions restent non exprimes verbalement, et quelquefois mme ne peuvent pas l'tre, comme on le voit, en tudiant ce qu'on a appel l'ineffable. Un acte subconscient n'est pas autre chose qu'une action qui
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
28
a conserv une forme infrieure au milieu d'autres actions d'un niveau plus lev : des croyances de forme lmentaire que nous avons appeles autrefois assritives dans un esprit capable de rflexion peuvent souvent se prsenter comme subconscientes. Il en rsulte que chez l'homme adulte et normal bien des ractions peuvent rester l'tat de rflexes, quelques-unes restent bien simples comme le rflexe patellaire, le rflexe pupillaire, mais en gnral leur tude demande des prcautions car il faut se mfier de l'intervention toujours possible de phnomnes d'un ordre suprieur qui viennent compliquer ces rflexes. Ce qui nous intresse particulirement, c'est que sous diffrentes influences la tension psychologique, le degr d'lvation moyenne des conduites d'un individu peuvent s'abaisser. Nous voyons cet individu rtrograder, revenir des formes de conduites plus simples, plus anciennes qu'il avait dpasses. Il peut revenir, au moins momentanment, de simples ractions rflexes, comme cela arrive dans l'accs pileptique le plus grave. C'est l'tude de tels phnomnes qui nous a amen autrefois considrer les convulsions comme les formes les plus simples de l'activit psychologique rduite la forme rflexe. Cette rduction la forme rflexe, au lieu d'tre gnrale et de se prsenter pour tous les actes d'un individu, peut bien plus souvent n'tre que partielle et affecter seulement telle ou telle action particulire. La plupart des actes qui au dbut ont pris une forme suprieure quand ils ont t constitus pour la premire fois, tendent se dgrader par la rptition habituelle. Un grand nombre de nos actions habituelles, quand l'attention ne porte pas sur elles, se rapprochent la longue des actes rflexes. En rsum, l'acte rflexe sous sa forme la plus simple est le fonctionnement d'un organe dj constitu par la vie et apparaissant tout form la naissance. Les premiers rflexes sont les ractions des organes dj constitus et les rflexes acquis correspondent probablement la formation de nouveaux organes. Les actes de l'alimentation, de la dglutition, de la respiration, de la miction, de la dfcation sont constitus en mme temps que les organes euxmmes. Leur origine se confond avec celle de l'organisme. Un petit nombre de rflexes sont acquis et rsultent de l'activit de l'tre quand elle prend au dbut une forme suprieure et quand elle cre son tour des dispositions organiques qui se conservent sous une forme primitive.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
29
-3Les actes perceptifs.
Retour la table des matires
Immdiatement au-dessus de ces actes rflexes se prsentent dans le groupe trop confus des actes instinctifs des actes que nous pouvons appeler des actes perceptifs. Les actes rflexes taient dtermins par une stimulation sur les tguments et n'avaient pas d'autre effet que la modification de cette stimulation. Une irritation trop vive a lieu sur la peau, le membre s'carte et cette irritation cesse ou diminue ; une lumire trop vive atteint la rtine et la pupille, en se resserrant, diminue la quantit de lumire qui entre dans lil. Les actions que nous appelons perceptives semblent dtermines par l'action des objets extrieurs et non plus simplement par des stimulations superficielles, elles cherchent modifier ces objets eux-mmes au lieu d'carter simplement des stimulations sur la priphrie du corps. Un oiseau voit quelque distance des grains sur le sol, il s'en rapproche, les prend dans son bec et les mange ; un renard entend distance le bruit que fait une poule ou sent l'odeur d'un lapin, il court aprs la poule ou le lapin, les attrape, les tue et s'en nourrit ; un lapin poursuivi par un carnassier le fuit, court son terrier et s'y rfugie. Dans tous ces actes, le point de dpart est dtermin par un objet complexe, la proie alimentaire ou le terrier et l'acte aboutit une utilisation de cet objet et sa transformation : il y a adaptation des objets et non simplement des stimulations superficielles. Il est vrai que cet objet dtermine lui aussi des stimulations la surface du corps : au point de dpart des actes prcdents il y a la vue du grain, l'odeur de la proie, la vue du terrier qui sont des stimulations de ce genre et qui sont suivies de leurs rflexes primitifs. Mais ces objets ne dterminent pas une seule stimulation laquelle l'animal se bornerait s'adapter, l'objet en dtermine un grand nombre : le lapin poursuivi par le renard n'a pas seulement une odeur, il a un aspect visuel et surtout un got quand le renard le mange. L'acte qui est dclench par la stimulation initiale ne s'adapte pas seulement cette stimulation, mais toutes les autres que l'objet provoquera successivement, il s'adapte des stimulations qui n'existent pas encore, mais qui ne surviendront que plus tard grce l'acte lui-mme. Cette adaptation un ensemble de stimulations futures et simplement possibles caractrise les conduites perceptives. Pour bien montrer ce caractre de l'acte perceptif et le rle de l'objet, il est utile de revenir un peu sur l'acte rflexe et de remarquer combien il est insuffisant pour assurer l'adaptation vitale. Les actions rflexes sont petites, de peu d'tendue dans le temps et dans l'espace, elles ne peuvent nous protger
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
30
que contre des dangers immdiats. Nous cartons le bras quand on nous pince mais seulement quand le pincement est dj sur notre peau, la main qui avance pour nous pincer ne provoque pas encore le rflexe d'cartement quand elle est loigne de la peau. Une protection de ce genre arrive souvent trop tard et ne prserve pas de la blessure. Pour parer davantage au danger il faudrait carter le bras avant le pincement, faire une raction prventive, ce que le rflexe ne semble pas capable de faire. Le rflexe une fois dclench ne peut plus tre arrt ni modifi dans sa direction, il ne peut S'adapter aux mouvements, aux changements de la cause offensive. Un individu qui tire un coup de fusil sur un oiseau ne l'atteindra pas s'il ne tient aucun compte des mouvements de l'oiseau ; le rflexe ressemble ce coup de fusil, c'est une bombe qui clate immdiatement sans se proccuper des changements qui ont lieu pendant l'clatement. Aussi l'action rflexe tend-elle Se compliquer et dans certains cas elle semble corriger ses dfauts ; les rflexes peuvent se succder l'un aprs l'autre d'une manire utile quand ils prennent la forme que l'on peut appeler celle des rflexes en cascade. Une premire action rflexe dtermine une modification du milieu, cette modification amne un second rflexe qui amne lui-mme une nouvelle modification et ainsi indfiniment. S'il se trouve que cette srie de modifications du milieu et cette srie de rflexes soient bien coordonnes et se dveloppent dans la mme direction, un rsultat pratique peut tre obtenu. On peut reprsenter cette. srie de rflexes en cascade par la figure 1.
Prenons comme exemple la srie de rflexes provoqus chez un animal par la faim ; le trouble organique a dtermin une agitation, un dplacement du corps. Ce dplacement du corps a mis en face de lil un objet mouvant qui, agissant sur la rtine, dtermine un second rflexe, le dplacement de la tte vers cet objet. Ce mouvement de la tte permet un effluve d'agir sur l'odorat, nouveau rflexe de mouvement de tout le corps vers l'objet ; maintenant notre animal court aprs sa proie ; ce mouvement met le museau de l'animal en contact avec cette proie, ce contact dtermine le rflexe de l'ouverture de la bouche et la suite, toujours en cascade, la mastication, la dglutition, etc. Grce cette srie de rflexes en cascade l'animal a pu se nourrir. Oui, mais quelles conditions ? la condition qu'il y ait une succession continue de hasards favorables. Il faut que le premier mouvement amne par hasard la vue d'une proie, il faut que le second mouvement dtermin par cette vision amne une excitation de l'odorat, il faut que l'acte rflexe dtermin par l'odorat amne un contact, etc. Pour que cette succession de rencontres se produise, il faut supposer un milieu excessivement favorable. On peut imaginer que la vie primitive se dveloppe dans des mers remplies d'tres vivants o le moindre dplacement de l'animal amenait la vue et l'odorat d'une proie ; dans ces conditions la vie a pu se maintenir par des rflexes en cascade de ce
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
31
genre. Mais dans des circonstances moins heureuses, dans des milieux moins riches en proies nutritives, des hasards de ce genre ne se produiraient pas. Quel est le progrs ncessaire ? Il faut une conduite qui propos du premier rflexe amne immdiatement tous les autres comme si leurs stimulations taient donnes. Admettez pour le moment que ces rflexes soient runis les uns avec les autres comme on l'observe dans les rflexes conditionnels de M. Pawlow, et qu'il suffit de la premire stimulation pour les dterminer tous successivement. Le chien de M. Pawlow salivait l'odeur de la viande, il salive maintenant en entendant un coup de sifflet, comme si le coup de sifflet voquait aprs son rflexe auriculaire propre le rflexe de l'odeur de la viande ; ces rflexes successifs sont unis dans une mme action perceptive d'ensemble qui produit la suite de la premire stimulation le mme rsultat qui n'tait obtenu que par la srie des stimulations successives. On peut reprsenter cette conduite d'ensemble qui remplacera la srie des rflexes par la figure 2.
Nous pouvons, avec M. Revault d'Allannes, donner le nom de conduite schmatique ou de schma perceptif cette conduite d'ensemble qui amne plus ou moins compltement ou en abrg cette srie d'actions rflexes. Si nous laissons de ct les animaux sociaux chez lesquels ces conduites perceptives sont un peu diffrentes, on peut dire que la plupart des instincts des animaux sont constitus par des conduites schmatiques de ce genre plus ou moins compliques. Il est probable que chez le petit enfant des conduites de ce genre remplacent vite les rflexes primitifs. Au dbut, il fait le mouvement de tter quand le mamelon touche ses lvres. Puis l'acte de tter deviendra plus complexe, il contiendra des mouvements de la tte et des bras et il sera dclench par la simple vue de sa mre ou par un bruit particulier qui annonce la tte. Le schma perceptif est dclench par l'une des stimulations qui jouent un rle dans l'acte total. On peut comprendre cette forme d'activit schmatique en tudiant les erreurs trs caractristiques qui peuvent se produire dans son activation ; nous avons souvent tudi ces troubles des conduites perceptives sous le nom de "trompe-l'il". Il est intressant de rappeler ce phnomne parce que nous aurons le rapprocher plus tard de la conduite si intressante du portrait. Le schma perceptif qui est lui-mme trs prcis et trs systmatis est dclench par une stimulation quelconque qui au dbut est trs vague et qui peut faire partie de plusieurs objets diffrents. L'animal commence l'acte de la poursuite d'une proie dtermine l'occasion d'une ombre qui passe sur sa rtine : cela peut tre trs adroit et dans bien des cas cela russit. Mais cette ombre peut tre celle d'un ennemi qu'il faudrait fuir ou d'un rocher qu'il
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
32
suffirait d'viter et l'animal commence tout de mme un acte de poursuite qui peut amener sa perte. Ce trompe-lil est si frquent et si important que l'homme est arriv plus tard l'utiliser. Il a remarqu que certaines stimulations particulires amenrent chez lui la conduite perceptive en relation avec l'loignement de l'objet. Lorsque deux lignes droites au dbut parallles semblent converger ensuite vers un point, nous commenons faire les actes de poursuite une grande distance. L'artiste qui peint un paysage nous prsentera des routes dont les deux bords ne restent pas parallles mais convergent vers un point du tableau. Nous aurons l'illusion de la profondeur et de la distance et l'artiste aura utilis pour nous procurer cette illusion les lois du trompe-l'il. Ce petit phnomne du trompe-l'il met bien en vidence la nature de l'acte perceptif qui consiste dans le dclenchement d'un acte schmatique complet propos d'une stimulation partielle. On peut dire que la vie psychologique d'un grand nombre d'animaux est compose d'un nombre considrable de ces schmas perceptifs qui constituent une partie essentielle des instincts. Sans doute ils peuvent entraner une foule d'erreurs qui ont t bien releves par tous ceux qui ont fait des expriences sur ces instincts et qui ont montr les erreurs que l'on peut provoquer en dterminant chez l'animal une de ces stimulations qui, d'ordinaire, dpendent d'un objet dtermin, mais qui dans ces cas ne lui appartiennent pas. Sans doute ces conduites schmatiques devenues instinctives sont loin d'avoir l'efficience que nous verrons dans les conduites intellectuelles plus leves, mais elles n'en sont pas moins bien suprieures aux simples rflexes. Elles permettent des conduites plus compliques, aux effets plus lointains ; elles procurent une adaptation permanente et rendent possible, au moins dans certains cas, une certaine rgulation de l'action, bien suprieure l'explosion des rflexes.
-4Les caractres des actes suspensifs.
Retour la table des matires
Nous pouvons peut-tre prciser un peu plus les caractres d'un acte perceptif ainsi constitu. Sans doute on retrouve dans ces conduites la rgularit et le dterminisme qui caractrisaient l'acte rflexe. L'action est strotype, car l'animal poursuit une proie, construit son terrier toujours de la mme manire. Cette action peut tre assez longue, un animal carnassier poursuit une proie pendant plusieurs heures, un oiseau met plusieurs jours faire son nid ; il s'agit l d'une srie de mouvements bien plus complexes que ceux de la mlodie kintique des actes rflexes, mais la suite des mouvements reste toujours la mme. Cette srie de mouvements dclenche rgulirement par
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
33
telle ou telle stimulation dtermine est plus souvent peu variable. C'est mme ce rigoureux dterminisme de l'acte instinctif qui est le point de dpart des "trompe-l'il", de toutes les erreurs que l'an peut dterminer dans les actes instinctifs ou modifiant les stimulations de l'action. Il n'en est pas moins vrai qu'il y a dans ces conduites perceptives des lments de variabilit et presque de libert beaucoup plus grandes que dans les rflexes. Ces conduites sont plus longues et pendant qu'elles s'accomplissent, l'animal peut recevoir d'autres stimulations qui changent l'action en cours. Tandis que le rflexe dpend d'une seule stimulation, l'acte perceptif en comporte au moins deux : la premire au dbut qui est en quelque sorte prparante, car elle veille et prpare l'acte schmatique, le lance en quelque sorte dans une direction ; la seconde dchanante, car elle dtermine le passage la consommation finale. L'odeur du lapin a dclench l'acte de la poursuite et dj le schma total de manger le lapin, mais il faut le contact de la peau sur les lvres pour amener la consommation de cet acte de manger le lapin. D'autres stimulations peuvent jouer un rle dans l'intervalle entre celles-ci et peuvent modifier plus ou moins l'activation du schma. L'odeur du lapin a dclench l'acte de la poursuite, mais la vue d'un ct ou de l'autre change chaque instant la direction de la poursuite. Ici intervient le rle de l'obstacle qui peut faire natre d'autres actes schmatiques qui inhibent plus ou moins le premier. C'est le point de dpart de l'acte intellectuel du dtour dont nous aurons bientt nous occuper. Nous voyons bien ces complications dans des actes que nous avons autrefois tudis longuement et que nous appelions les conduites perceptives de situation. Supposons qu'un renard veuille attraper une poule, il la surveille, veut se jeter sur elle : perception simple. Mais, en mme temps, il voit le gardien du poulailler avec une fourche la main, qui le menace ; il y a l une stimulation qui joue le rle d'obstacle ; cette stimulation le dirige vers un sens oppos, vers la fuite. Il y a conflit entre les deux tendances, la poursuite de la poule et la fuite devant la fourche. Ce conflit se rsout d'une faon ou de l'autre et, aprs un arrt momentan, le renard peut revenir la poule. Sans doute je ne crois pas qu'il s'agisse tout de suite d'une conduite intellectuelle dans laquelle il y a rgulirement invention d'une conduite intermdiaire et nouvelle avec recherche de cette conduite. La combinaison des deux conduites est encore plus ou moins mcanique et consiste surtout en oscillations. Mais il n'en est pas moins vrai que ces conduites de situation vont devenir le point de dpart des conduites intellectuelles. Enfin il y a un caractre des actes perceptifs qui prend nos yeux une grande importance. Le rflexe nous a paru un acte explosif rgi par la loi du tout ou rien, une stimulation suffisait pour faire clater toute la conduite rflexe dans de bonnes ou dans de mauvaises conditions. La nature essentielle de l'acte perceptif qui rclame deux ou plusieurs stimulations, les unes prparantes, les autres dchanantes, supprime ce caractre explosif. La premire stimulation ne suffit pas elle seule pour amener la consommation de l'acte, il faut une seconde stimulation dchanante. Le carnassier qui poursuit une proie ne se met pas mordre et avaler ds que l'acte de manger du lapin est veill par l'odeur. Il mordrait dans le vide et il n'arriverait rien ; il ne fait des actes de ce genre que s'il y a des erreurs dues un trompe-l'il. Le plus souvent il est oblig de suspendre l'acte schmatique qui a t veill par la premire stimulation. Il ne l'abandonne pas compltement, car alors il oublierait la
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
34
chasse et n'aurait plus l'attitude ncessaire la capture de telle ou telle proie, il ne laisse pas la tendance cet acte schmatique retomber dans la latence. Comme il n'arrive pas non plus la consommation, il doit maintenir l'activation de la tendance dans une disposition spciale intermdiaire entre la phase de la latence et la phase de la consommation. C'est ce que, dans notre cours d'une anne spcialement consacr l'tude des phases de l'activation nous avons appel la phase de l'rection. Dans cette phase la tendance veille, tire de la latence, n'arrive pas la consommation, mais reste cependant assez active pour diriger la conduite dans un certain sens et pour lui donner un aspect caractristique de la tendance elle-mme. Cette apparition de la phase 'de l'rection ajoute aux deux phases de la latence et de la consommation qui existaient seules au stade du rflexe me semble avoir une grande importance. Ce sera plus tard le point de dpart de beaucoup de conduites intellectuelles, puis de la rflexion et de la mmoire. La phase de l'rection dans l'activation d'une tendance donne lieu une manire bizarre d'agir : dans cette phase, l'acte existe d'une certaine manire au point d'tre nettement reconnaissable et d'autre part il n'existe pas compltement puisqu'il ne dtermine pas les mouvements extrieurs caractristiques ; cet tat d'rection d'une tendance va jouer plus tard un rle considrable dans la pense, qu'il serait bien difficile de comprendre si on ne connaissait pas cette forme particulire que peuvent prendre les actions. Pour le moment cette phase de l'rection intervient dans certains actes instinctifs comme dans l'acte de faire le guet, de guetter une proie. Un animal, dont la vue ou l'odorat ont reu une premire stimulation amenant l'acte schmatique de manger une proie dtermine, ne se met pas immdiatement manger, ni mme courir, il reste souvent couch par terre, immobile sur le passage de cette proie. C'est l une conduite bien remarquable, car il est souvent important de se retenir d'agir et, comme on le dit vulgairement, il est bon de tenir son fusil charg. La conduite n'est plus immdiatement explosive, c'est une bombe retardement qui a t prpare par une premire stimulation et qui n'clatera qu' une seconde stimulation provoque par l'apparition de la proie bonne porte. Mais cet intervalle entre les deux stimulations est rempli par un acte particulier, celui de l'attente qui est la transformation spciale de la phase de l'rection. Nous ne pouvons tudier ici compltement lattente sur laquelle nous avons longuement insist dans le cours sur la mmoire, publi en 1928. L'animal qui fait le guet n'a pas encore la mmoire proprement dite, mais il commence savoir attendre, faire des actions retardes qui sont, comme nous l'avons vu, le principe de la mmoire. Quand nous attendons la visite d'un ami, nous n'avons pas immdiatement la conduite qui consiste recevoir cet ami et lui parler, sauf quand il y a des erreurs et des prcipitations dans la conduite difficile de l'attente. Mais nous ne sommes pas tout fait inactifs et nous ne laissons pas compltement dans la phase de la latence cette conduite de la rception de tel ami, nous interrompons d'autres occupations, nous prenons une attitude spciale. Nous conservons les actes de la rception d'une manire particulire et nous faisons cet acte spcial de l'attente qui est encore une forme de l'rection.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
35
L'attente se complique par la recherche : cet acte de la recherche suppose que vous savez ce que vous cherchez, c'est--dire que vous avez dj en rection la conduite que vous dsirez avoir vis--vis de l'objet cherch. Mais, cependant, vous ne faites pas cette action compltement puisque vous n'avez pas l'objet sous la main. Vous ne vous habillez pas compltement si vous cherchez un de vos vtements. Cet acte vis--vis de l'objet cherch est encore maintenu la phase de l'rection comme dans une espce d'attente. Mais vous ne restez pas immobile comme dans la vritable attente, vous n'attendez pas que ce vtement apparaisse tout seul devant vous. Il faut que tout en maintenant l'acte en rection pour ne pas oublier ce que vous cherchez, vous fassiez autre chose. Une sorte d'agitation intervient pour favoriser l'apparition de l'objet cherch. La recherche est une complication de l'attente par des mouvements plus ou moins habiles pour favoriser l'apparition de l'objet qui permettra de consommer l'acte maintenu en rection. On voit par ces quelques exemples combien la phase de l'rection, caractristique des tendances perceptives, joue un grand rle dans les actes instinctifs comme dans les actes plus levs. C'est pour mettre en vidence l'importance de l'rection dans les actes perceptifs que nous avons souvent dsign ces actes perceptifs par le nom de tendances suspensives. Il s'agit en effet de tendances qui peuvent s'arrter diffrents moments de leur activation et qui peuvent rester quelque temps en quelque sorte suspendues sans aboutir immdiatement la consommation complte. C'est cette forme de l'action arrte la phase de l'rection qui donne nos perceptions leur aspect le plus commun. Quand nous percevons un objet, un fauteuil par exemple, nous disons qu'en le voyant nous savons ce qu'est cet objet, que nous le reconnaissons, mais nous croyons ne pas faire d'action ce moment, car nous restons debout, immobiles en percevant le fauteuil. Il y a l une illusion, en ralit nous avons dj en nous l'acte caractristique du fauteuil, ce que nous avons appel le schma perceptif, ici l'acte de nous asseoir d'une manire particulire dans ce fauteuil. Toutes les tudes sur l'agnosie montrent bien que ce symptme est toujours associ avec quelque forme de l'apraxie. Le malade qui ne sait plus du tout s'asseoir dans le fauteuil ne reconnat pas l'objet pour un fauteuil. C'est parce qu'il n'a pas en lui l'veil de l'acte caractristique du fauteuil qu'il ne le reconnat pas. Pour que ce fauteuil soit un fauteuil et non un livre il faut qu'un dtail de l'objet veille la tendance s'asseoir d'une faon particulire. Mais ce qui est remarquable, c'est que cet acte ainsi veill ne s'active pas compltement et qu'en fait nous ne faisons pas l'acte de nous asseoir, de mme que nous ne mangeons pas immdiatement tous les objets que nous percevons cependant comme comestibles. L'acte caractristique, l'acte schmatique de cet objet reste cette phase particulire que nous venons d'appeler la phase de l'rection. Ce sont ces schmas perceptifs veills la phase de l'rection qui constituent, au point de vue psychologique, ce que nous appelons les objets. "C'est notre acte, disait M. Bergson, qui dcoupe dans la continuit du monde les objets que nous utilisons". Le schma perceptif veill et maintenu la phase de l'rection contient d'abord les actes caractristiques de l'objet, s'asseoir dans un fauteuil, boire dans un verre, manger avec une cuiller. Mais il est modifi chaque instant
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
36
par des caractres variables des stimulations qui nous parviennent. Aux mouvements caractristiques de l'usage se joignent des mouvements de dplacement du corps ncessaires pour atteindre l'objet, c'est--dire pour pouvoir porter la consommation le schma perceptif. Ces dplacements sont variables dans leur grandeur et dans leur direction, ils ne font pas partie essentielle de la conduite de l'objet lui-mme, ils viennent seulement la modifier, ils ajoutent aux caractres fondamentaux de l'objet un dtail important, sa distance. Ces mouvements accessoires de dplacement ne sont pas les mmes pour tous les objets : si je veux toucher cette lampe je dois faire un mouvement gauche, si je veux prendre ce morceau de craie je dois faire un mouvement droite. Ne cherchons pas pour le moment la signification de ces mots "droite, gauche", constatons seulement que ce sont des mouvements diffrents, qui contribuent sparer les objets les uns des autres. Parmi les objets qui sont ainsi spars les uns des autres il y en a un qui joue un rle essentiel, c'est l'objet que nous appelons notre corps, le corps propre. Celui-ci bien des points de vue ressemble aux autres objets, mais il a aussi des caractres distinctifs trs importants. Notre propre corps est dtermin comme les autres par nos conduites perceptives ; nous avons vis--vis de lui des conduites particulires, qui ne sont pas les mmes vis--vis des autres. On remarquait autrefois que nous avons une sensation tactile double ; mais nous avons vis--vis de notre corps des conduites beaucoup plus simples : la premire de toutes, c'est que nous ne le mangeons pas, nous ne le blessons pas, nous avons des gards pour lui. Il y a l un ensemble de conduites conservatrices qui ne sont pas les mmes que pour le corps des autres. Si nous considrons les conduites de dplacement qui sparent les objets, nous remarquons qu'il nous faut un dplacement pour tous les autres objets, mais que seul le corps propre fait exception, c'est le seul objet que nous puissions toujours atteindre sans avoir effectuer un dplacement. Cet objet particulier, le corps propre, nous sert de point de dpart, de point de repre pour apprcier la distance de tous les autres objets. J'emploie ici ces mots "point de dpart, point de repre" qui se rattachent des conduites intellectuelles que nous devons tudier prochainement, parce que, comme je l'ai dit bien souvent, l'observateur des faits psychologiques possde lui-mme les actes suprieurs qu'il ne doit pas forcment retrouver chez les sujets et il doit s'en servir dans son interprtation scientifique sans les attribuer au sujet. C'est l une des difficults de ce genre d'observations : nous y avons dj insist propos de nos leons sur la mmoire. Le corps propre parat spar de tous les autres objets qui prennent alors un caractre nouveau, qui deviennent non seulement distants les uns des autres, mais des objets extrieurs. Sans doute cette extriorit des objets va jouer un rle considrable dans notre vie psychologique quand elle s'opposera l'intriorit des phnomnes de conscience aprs l'volution des actes secrets, de la pense intrieure transforme par des conditions sociales. Il n'est pas encore question de cette extriorit absolue, il suffit maintenant que les objets paraissent tous distants du corps propre qui a pris une importance particulire. Ce caractre de la perception est si net que dans les dlires les phnomnes psychologiques qui semblent analogues des perceptions prennent surtout l'apparence de l'extriorit ; nous l'avons dj remarqu souvent propos des dlires de perscution.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
37
Nous ne pouvons aujourd'hui, dans ce rsum rapide, tudier la longue volution qui a peu peu transform un grand nombre d'actes rflexes ou conduites perceptives. Rappelons seulement que bien des conduites intermdiaires pourraient tre constates dans cette transformation. Les rflexes lointains dont parle M. Sherrington dterminent des ractions des objets carts du corps, des mouvements de dplacement de tout le corps antrieurs aux actes de consommation. Les rflexes conditionnels de M. Pawlov sont dj presque compltement des schmas perceptifs. La stimulation devenue efficace donne naissance une raction complexe qui dpendait primitivement d'un autre rflexe, il y a dj une association, une combinaison de plusieurs actions rflexes runies par une conduite schmatique. Il a fallu une longue volution pour rendre ces transformations plus compltes et tous les instincts ont un long pass. Il me semble peu probable que des rflexes conditionnels de ce genre aient t crs uniquement par des successions rgulirement fortuites de stimulations. Il faudrait un bien grand hasard pour remplacer l'action intelligente de l'exprimentateur qui aujourd'hui cre dans le laboratoire de tels rflexes. Il y a eu des mutations, des inventions qui ont perfectionn les rflexes comme les corps et qui ont cr ces caractres nouveaux de l'action, le schma perceptif et la phase de l'rection. M. Bergson spare compltement l'intelligence de l'instinct et nous verrons, en effet, des diffrences importantes, mais cette sparation ne doit pas tre exagre. Nous savons d'ailleurs que ces actes de divers degrs peuvent se mler. Nous venons de remarquer que par l'effet de l'habitude des actes suprieurs peuvent arriver prsenter des caractres du rflexe ; il est facile de voir de mme que des actes qui ont pris la forme suprieure au dbut nous apparaissent ensuite comme des instincts.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
38
Les dbuts de lintelligence (1932) Premire partie : Les premiers stades psychologiques
Chapitre III
Les conduites sociales
Retour la table des matires
L'tude des conduites sociales, surtout dans des socits humaines que l'on dit primitives quand elles sont en ralit d'un stade psychologique assez lev, est aujourd'hui fort la mode. Une thse prsente surtout par Durkheim et qui a t reprise par beaucoup d'auteurs donne une origine sociale la plupart des oprations intellectuelles et considre nos ides, nos jugements, nos classifications, nos principes de la raison comme d'origine exclusivement sociale. Il y a sans doute beaucoup d'exagration dans cette thse qui ne fait pas une part suffisante aux inventions individuelles. Beaucoup de socits animales ont exist depuis des sicles sans parvenir aux conduites intellectuelles suprieures. Mais il y a cependant beaucoup de vrit dans ces affirmations simplement exagres. Les conduites intellectuelles que nous avons tudier se sont dveloppes chez des hommes et mme chez des animaux vivant en socit et les animaux qui montrent le moins d'intelligence sont ceux qui vivent isolment.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
39
L'analyse psychologique des conduites sociales nous montre un progrs sur les conduites perceptives et nous rvlent bien des lments psychologiques qui vont jouer un rle considrable dans les conduites intellectuelles. Faut-il en conclure que l'intelligence est uniquement un fait social et qu'elle s'explique uniquement par le fait de vivre en socit ? Les actes d'intelligence contiennent des lments sociaux parce qu'ils sont des actes suprieurs aux faits sociaux et construits sur ceux-ci. Si nous considrons des difices assez levs qui comportent plusieurs tages, il est bien vident que les derniers tages dpendent en quelque manire des tages infrieurs. Le second tage repose ncessairement sur le premier et prsente dans son plancher des lments du plafond du premier tage ; si celui-ci n'existait pas, le second n'existerait pas non plus. Mais on ne peut pas dire que toute la maison dpend uniquement des caves, car dans bien des cas ces caves peuvent exister seules sans qu'un difice ait t construit sur elles, il faut ajouter aux caves bien des choses pour arriver aux tages suprieurs. Au lieu de rpter que l'intelligence dpend des conduites sociales, on pourrait aussi bien dire qu'elle dpend des conduites rflexes sans lesquelles l'tre intelligent n'aurait pas pu vivre. Le physiologiste pourrait aller plus loin et soutenir que l'acte intellectuel dpend de la vie du corps et de la vie du systme nerveux. Cette exagration ne serait pas plus absurde que celle du sociologue. Disons donc seulement que la vie sociale et les conduites sociales sont des conduites psychologiques intermdiaires entre les conduites perceptives et les conduites intellectuelles et qu'elles ont prpar le dveloppement de ces dernires. Nous avons autrefois consacr toute une anne, 1911, l'tude des conduites sociales chez les animaux et chez les hommes et nous devons maintenant nous borner rappeler dans ces conduites les caractres qui prparent les actions proprement intellectuelles.
-1Les caractres des actes sociaux.
Retour la table des matires
Si nous nous plaons au point de vue psychologique nous ne pouvons pas caractriser les conduites sociales par le seul fait pour des animaux de vivre en groupe. Des animaux qui se dplacent peu peuvent tre runis par le hasard des naissances ou par des circonstances qui favorisent leur alimentation dans tel endroit. Il faut constater une certaine modification de ces conduites qui les distinguent des conduites perceptives prcdentes. Ces conduites nouvelles peuvent elles aussi faire partie des instincts, mais il s'agit d'instincts d'un ordre plus lev.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
40
Les actes perceptifs taient caractriss par des adaptations des objets spars les uns des autres. Un certain schma perceptif constitu par des sries de mouvements simultans ou successifs tait dclench par une des stimulations manes de l'objet mais restait le mme pour un objet dtermin et s'il se transformait ce nouveau schma donnait naissance un objet diffrent. Les conduites sociales qui se superposent aux conduites perceptives contiennent aussi, naturellement, ces premires adaptations des objets qui sont ici des tres vivants particuliers, le plus souvent de la mme espce que l'individu considr mais qui peuvent tre d'une espce diffrente. Un animal social distingue ceux qu'il traite socialement des autres objets, des arbres, des rochers ou mme des autres animaux et il a d'abord vis--vis d'eux certaines conduites perceptives. Mais s'il se borne ces conduites perceptives il n'a pas encore de conduites proprement sociales. C'est pour cela que j'hsite fonder les conduites sociales sur le simple fait que les individus d'un groupe social ne s'attaquent pas d'ordinaire, ne se mordent pas, ne se mangent pas entre eux. Il y a bien des objets et mme des tres vivants que le mme animal n'attaque pas et ne mange pas et qui ne font pas partie de son groupe social, vis--vis desquels il n'a pas de conduite sociale. Il est plus dlicat de se prononcer sur les conduites sexuelles et sur les conduites des parents vis--vis de leurs petits que l'on considre souvent comme les premires des conduites sociales. Il est possible que ces conduites sexuelles et parentales aient t le point de dpart des conduites sociales mais elles ne sont pas elles-mmes des conduites ncessairement sociales. L'acte sexuel ou mme l'acte de la lactation peuvent exister comme simples rflexes psychologiques. L'objet sexuel, l'animal trs jeune peuvent tre de simples objets provoquant des schmas perceptifs particuliers. Il est possible qu'une certaine confusion entre le corps propre de la mre et le corps du petit qui a la mme odeur et le mme contact joue un rle important : la mre se conduit vis--vis de ses petits comme vis--vis de son corps propre, elle les nourrit, les tient propres, les tient au chaud comme elle fait pour elle-mme. Espinas a dj propos pour les soins pendant l'incubation une interprtation de ce genre 1. Je ne considre les conduites sexuelles comme sociales que lorsqu'elles deviennent plus compliques, par exemple quand le mle courtise la femelle et quand celle-ci rpond ces conduites du mle d'une faon particulire. Les conduites parentales ne deviennent sociales que lorsque aux simples conduites vis--vis d'un objet particulier s'ajoutent des modifications, par exemple quand le mle et la femelle se partagent la besogne de l'ducation des petits. Il y a en effet chez certains animaux des conduites nouvelles qui s'ajoutent au schma perceptif et qui transforment l'objet. Pour dsigner cet objet transform vis--vis duquel un animal a des conduites sociales nous empruntons M. Baldwin le nom de "socius" parce que les mots usuels, "semblable, prochain, compatriote" ont des sens diffrents et plus restreints. Il s'agit d'un tre vivant de la mme espce ou quelquefois d'une autre espce pour qui on a des
Cf. G. Davy, l'uvre d'Espinas, Revue Philosophique, septembre-octobre 1923, p. 236.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
41
conduites amicales ou agressives, peu importe, mais toujours plus complexes que les conduites perceptives et de nature particulire. Ces caractres nouveaux des conduites sociales sont assez nombreux, mais nous ne devons, au dbut, n'en retenir qu'un seul qui suffira pour sparer ces conduites des perceptives. En plus de leur conduite vis--vis du socius considr comme un objet particulier, avec schma perceptif d'adaptation l'objet tout entier, les animaux sociaux adaptent leur conduite aux actes particuliers du socius. Il s'agit, si l'on veut, d'une raction l'objet momentanment et superficiellement transform par les actions qu'il accomplit. Un objet cr par un schma perceptif doit rester toujours le mme ou bien il se transforme compltement et provoque un autre schma perceptif. Du pain reste toujours du pain et ne peut pas devenir du poison sans cesser d'tre du pain et sans que soit modifie dfinitivement toute la conduite perceptive. Un socius aussi peut devenir un ennemi sans cesser d'tre un socius et mme plus tard sans perdre son nom. Une vache se sauve toujours devant un lion qui pour elle n'est pas un socius, elle ne se sauve que momentanment devant une autre vache du troupeau qui la menace et continue rester dans le troupeau avec cette mme vache. Je dois modifier constamment ma conduite vis--vis d'un socius suivant son attitude et c'est cette adaptation l'action du socius qui se prsente sous bien des formes dans les conduites sociales et qu'il faut tudier pour les comprendre. Il est plus facile d'tudier les conduites sociales chez les hommes et on a trop souvent considr les socits de l'Australie et de l'Amrique du Nord comme primitives et comme reprsentant les premires formes de ces conduites. Cependant presque toute la vie sociale des hommes est dj imprgne d'intelligence, elle est dj trs complique non seulement par le langage mais par la croyance qui nous mettent immdiatement un stade bien suprieur : les rites que l'on tudie sont le plus souvent des formes de conduites sociales transformes par le langage et la croyance. On retrouverait peut-tre ces conduites sociales primitives dans certaines maladies de l'esprit. Un article de M. Roubinovitch dans le Trait de psychiatrie de G. Ballet fait allusion certains idiots qui ne savent pas parler mais qui ont dj des conduites sociales. Ils aiment tre ensemble, ils s'associent dans quelques jeux ; on pourrait peut-tre rechercher dans les dmences des rgressions intressantes des conduites sociales. Mais il faut constater que de telles tudes sont difficiles et qu'elles ont t jusqu' prsent peu avances. C'est surtout chez les animaux - la condition de ne considrer ni les animaux trop infrieurs encore au stade perceptif, ni les animaux trop levs chez qui l'intelligence lmentaire joue un rle - que l'on trouvera trs nettement les conduites simplement sociales. Les premiers actes vraiment sociaux peuvent tre groups sous le nom d'actes d'imitation. C'est ce que Tarde soutenait quand il disait que "la socit peut se dfinir une collection d'tres en tant qu'ils sont en train de s'imiter entre eux ou en tant que sans s'imiter actuellement ils se ressemblent et que leurs traits communs sont la copie d'un mme modle" 1. M. Waxweiler disait aussi : "La socit est caractrise par la disposition l'imitation la
1
Matagrin, La psychologie de G. Tarde, 1900, p. 119.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
42
palinethie qui se trouve dans les plus hautes socits comme dans les plus basses. La tendance au panurgisme, la tendance emboter le pas, s'emballer sur un titre la Bourse ou pour un gnral sur un cheval noir caractrise la socit" 1. Cette conception de Tarde a t critique : pour qu'il y ait des actes d'imitation, disait-on, il faut qu'il y ait dj une socit 2. Cela est certain, mais les tendances proprement sociales ne se prsentent pas dans les premires formes de la vie, elles supposent auparavant des tendances rflexes et des tendances perceptives, c'est--dire un grand nombre d'instincts qui ont rendu possible, dans certaines conditions, la vie en commun, plus ou moins durable ; c'est dans cette vie en commun que se dveloppent des conduites nouvelles caractristiques d'une vie sociale et ces tendances proprement sociales nous paraissent revtir la forme des conduites de l'imitation. La description des actes d'imitation est fort ancienne ; sans remonter plus haut, on se rappelle que les magntiseurs franais en tudiant les phnomnes de suggestion sont arrivs se proccuper de l'imitation et en ont fait des peintures bien vivantes. "Regardez patre un troupeau de moutons, disait l'un d'eux, ne dirait-on pas qu'un rseau invisible unit entre eux tous ces animaux et les entretient dans une parfaite communaut de mouvements et d'instincts ? Ils marchent ou s'arrtent ensemble avec le berger qui les conduit ; tous le suivent ou se suivent la file sans que jamais personne ait song leur faire une vertu de ce genre de fidlit. Qu'un pied d'herbe frache suspende la marche d'un d'entre eux, tous s'arrtent son exemple ; que le chien, au contraire, harcle le dlinquant, la frayeur que celui-ci prouve se communique de proche en proche et l'motion est gnrale. Tous les moutons enfin sont des moutons de Panurge" 3. On doit rappeler aussi dans le livre de Groos la description des jeux imitatifs : "L'instinct le plus important chez le jeune mouton qui se manifeste aprs l'instinct de tter est celui qui le pousse suivre tout mouton qui s'loigne" 4. Cet auteur dcrit ensuite un grand nombre d'oiseaux qui imitent non seulement le mouvement mais les bruits et les chants. Durkheim nous dit avec plus de prcision : "Il y a imitation quand un acte a pour antcdent immdiat la reprsentation d'un acte semblable extrieurement accompli pour autrui sans que, entre cette reprsentation et l'opration, s'intercale aucune opration intellectuelle partant sur les caractres de l'acte" 5. Cette dfinition de Durkheim me semble intressante car elle met bien en vidence ce fait essentiel que c'est la perception de l'acte d'un autre qui semble rgler l'excution des actes de celui qui imite. Cette disposition faire le mme acte quand on peroit cet acte chez un autre a jou un grand rle dans le dveloppement de la vie sociale. Non seulement elle a rendu plus uniformes les actes des membres de la socit et leur a facilit la vie en commun, mais en outre elle a rendu ces actes plus faciles, plus rapides et plus parfaits, car les actes les plus utiles ne sont plus invents au hasard par chacun isolment, ils sont rpts par tous avec plus de
1 2 3 4 5
Waxweiler, Esquisse d'une sociologie, Bruxelles, 1906, p. 150. Baldwin, Interprtation sociale, 1899, p. 473. Teste, Le magntisme expliqu, p. 30 ; cf. Perrier, Journal du magntisme, VIII, p. 58. Groos, Les jeux des animaux, 1902, p. 190. Durkheim, Le suicide, 1912, p. 115.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
43
facilit et de rapidit quand ils ont bien russi chez quelques-uns. La transmission des actions qui ne pouvait se faire que d'une manire rare et trs lente par l'hrdit se fait maintenant par l'imitation qui va prparer le commandement et l'instruction. Cette imitation d'abord instinctive devient plus tard consciente et rflchie, elle joue un rle dans la sympathie et dans les jugements de ressemblance, comme disait dj Malebranche, Sans doute Malebranche s'avance un peu trop vite quand il confond trop l'obissance avec l'imitation et quand il fait intervenir les croyances dans l'imitation le, ; esprits forts par les esprits faibles, mais il est vrai que les actes d'imitation sont au point de dpart de l'volution qui nous conduira aux actes intellectuels et aux croyances. Le point de dpart de toute cette volution est la constitution de l'acte d'imitation chez l'animal qui imite et, il ne faut pas l'oublier, chez l'animal qui est imit. Il ne faut pas croire, en effet, que ce dernier soit absolument inactif dans l'acte de l'imitation. Non seulement il fait l'acte le premier sans attendre un modle, mais il accepte, il tolre que les autres le suivent et rptent ses actions. Bien plus, dans bien des cas, il favorise cette imitation en se plaant la tte du troupeau dans la marche, en se mettant en vidence, en poussant au dbut de l'acte un cri particulier que les autres peuvent entendre. Il devient ainsi le meneur et semble percevoir l'imitation des autres car il en jouit et agit plus fortement quand il est ainsi en spectacle. Il y a dans ces conduites sociales d'imitation une action et une raction rciproques qui modifient l'acte lui-mme. L'essentiel est toujours que cette modification est dtermine par la perception de ce mme acte excut par un autre. Dans notre ancienne srie de cours sur l'imitation, en 1911, nous tions dispos chercher le point de dpart de ces conduites dans un fait dont nous venons de signaler l'importance propos dus instincts maternels dans la confusion du corps des autres avec le corps propre de l'animal qui imite. La perception d'un acte excut par un autre devenait en quelque sorte identique un commencement de ce mme acte par le corps propre. Cet acte veill ainsi de la latence et lev la phase de l'rection pouvait plus facilement se dvelopper. Le rflexe kinesthsique qui, comme nous l'avons vu, maintient un acte commenc dans la mme direction, contribue maintenir cette activation. Je ne faisais intervenir que postrieurement, comme dveloppements de l'imitation, les inventions relatives la perception des actes des autres et la recherche d'une certaine ressemblance qui, videmment, n'existent pas ds le dbut. Ce rle donn la confusion du corps propre avec le corps du socius a t vivement critiqu dans un livre remarquable, celui de M. Paul Guillaume, L'imitation chez l'enfant, 1925. M. Guillaume fait surtout observer que le corps du socius n'est pas donn l'esprit de la mme manire que le corps propre. Celui-ci tait connu par des sensations internes du mouvement, l'autre tait fourni par des sensations visuelles et auditives tout fait diffrentes, l'assimilation tait impossible. On pourrait discuter un peu cette objection : le corps du socius n'est pas donn par des sensations, il est constitu par un schma perceptif construit sur un ensemble de rflexes et le corps propre est probablement un schma perceptif du mme genre. On note souvent dans des tats de dlire ou de rve la confusion de ces deux schmas. Mais je crois
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
44
cependant l'objection juste : ces deux schmas portent sur l'ensemble du corps et ne donnent pas la perception des actes. L'enfant n'a de ses propres actes qu'une notion fort confuse et indirecte et il ne peut gure les assimiler aux actes des autres. La perception des actes des autres qui caractrise les conduites sociales rsulte du dveloppement mme de l'imitation et n'en est pas le point de dpart. M. Guillaume proteste contre le nom d'instinct donn l'acte de l'imitation 1, car il ne s'agit pas d'un acte simple, rgulirement donn sans acquisition personnelle de l'tre vivant. On parle trop vite de l'instinct de l'imitation propos d'une ressemblance des actes qui dpend seulement d'une identit de constitution chez la mre et chez l'enfant de l'identit des actes rflexes ou perceptifs chez les divers socii. Cette discussion qui n'a pas une grande importance roule entirement sur la sens donn au mot "instinct". Si on dcide de rserver ce mot pour des actes trs lmentaires, trs simples, trs rguliers, peu variables et en apparence immdiatement acquis sans exprience personnelle, on peut dire que les actes des stades rflexes et perceptifs mritent seuls le nom d'instincts et l'imitation ne sera pas un instinct. Si on donne ce mot une extension un peu plus large, en y comprenant des conduites un peu plus complexes et variables, susceptibles de plus d'inventions et d'expriences personnelles, mais cependant peu prs identiques chez tous les tres d'une mme espce, se dveloppant de la mme manire et au mme ge et paraissant soumis l'influence de l'hrdit, on pourra dire que l'instinct s'tend plus loin et englobe une grande partie des actes sociaux et l'imitation en particulier. C'est cause du vague de ce mot instinct que j'ai distingu avec plus de prcision les stades psychologiques lmentaires. L'essentiel est de retenir que l'imitation est un acte complexe qui n'est pas donn immdiatement avec le schma perceptif du socius et qu'il comporte la construction d'actes particuliers d'un stade plus lev. M. Paul Guillaume prend pour point de dpart de la conduite de l'imitation les actes que M. Baldwin dcrivait sous le nom d'imitation circulaire, d'imitation de soi-mme. "Le phnomne de l'imitation est caractris par une raction telle que le mouvement provoqu par la premire excitation provoque une nouvelle excitation analogue la premire et qui engendre son tour un mouvement semblable... C'est une raction qui tend maintenir et reproduire le processus d'excitation" 2. Un enfant, dcrit par Preyer, qui avait trouv amusant d'ouvrir puis de refermer le couvercle d'une bote, a rpt cet acte 79 fois de suite. Ensuite, l'enfant s'intresse un objet extrieur, la trace noire que laisse un crayon sur le papier et c'est cette perception intressante qu'il cherche reproduire par des ttonnements et des slections de mouvements en tenant au dbut le crayon n'importe comment. "Ce n'est pas l'acte en tant qu'ensemble de mouvements qui est imit, ce sont ses effets, seuls lments sensibles communs au modle et la copie" 3. Ce n'est que peu peu que l'enfant s'intresse au mouvement de la main qui tient le crayon, par drivation de l'intrt qu'il portait la trace noire, puis au crayon. Si l'acte de manger est intressant, la cuiller de vient intressante et plus tard la main qui tient la
1 2 3
Paul Guillaume, L'imitation chez l'enfant, 1925, p. 71. Baldwin, Le dveloppement mental chez l'enfant et dans la race, 1877, p. 321, 941 ; cf. A. Forel, L'me et le systme nerveux, 1906, p. 34. P. Guillaume, op. cit., p. 117.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
45
cuiller. "La perception des mouvements du modle ayant acquis par association la proprit motrice, elle la garde mme en l'absence de l'objet dont le rle ducateur est termin." Il y a toute une volution, toute une srie de dcouvertes oui amnent la reproduction de la perception des objets, puis la reproduction des mouvements d'autrui. Ces conduites se compliquent de plus en plus, elles amnent la connaissance des mouvements des autres et celle des mouvements du corps propre, elles aident la connaissance et la reprsentation "de la personne physique et morale qui se construit l'image de celle des autres et qui ragit sur elle". En mme temps l'individu qui imite apprend tre imit, tolrer qu'un autre le suive et rpte ses mouvements parce qu'il ressent dans cette perception de l'imitation une certaine excitation satisfaisante. Bientt il arrive rechercher cette excitation spciale du "tre imit" et il prend des attitudes qui favorisent cette imitation par les autres. L'animal ou l'enfant parvenu ce stade d'imitateur a une tendance faire l'acte ds qu'il peroit le commencement de cet acte chez le socius. Il imite des actes qui ne sont pas compltement excuts, qui ne sont que commencs. Cette conduite va tre le point de dpart des conduites intentionnelles qui ragissent non seulement l'acte, mais aux intentions des autres peine manifestes. Elle va tre le point de dpart d'un phnomne qui va prendre plus tard une grande importance, l'expression, puis le signal. Nous dsignerons par ce mot le dbut de l'acte dj perceptible, dj provocateur d'imitation avant que l'acte soit complet Nous aurons plus tard insister sur la diffrence entre le signe intellectuel et ce signal simplement social ; nous n'indiquons ici que le dbut da signal. De mme que l'imitateur apprend ragir ainsi ds le dbut de l'acte, celui qui est imit apprend insister sur ces dbuts de l'acte et transformer la simple expression en vritable signal. Ces conduites d'imitation se perfectionnent en effet par l'effort conscient qui cherche rendre l'imitation de plus en plus parfaite et qui va jouer un rle dans la constitution de la ressemblance. Mais il ne faut pas trop confondre les conduites simplement sociales et les conduites intellectuelles lmentaires qui prsentent bien des formes de transition. L'imitation se perfectionne, en effet, par l'effort conscient qui cherche la rendre plus par. faite et qui joue un rle dans l'dification de la ressemblance. Mais il ne faut pas rattacher tous ces perfectionnements la seule imitation, car ils arrivent sortir des conduites sociales et prendre les caractres des conduites intellectuelles lmentaires. Ces conduites d'imiter et d'tre imit peuvent enfin se combiner : comme le dit M. Guillaume, "l'enfant traite d'autres personnes comme on le traite luimme, en enfant, mais il est capable de renverser les rles, de prendre le rle des parents, des professeurs et d'enseigner ce qu'on lui a enseign" (p. 161). Le jeu se prte, comme nous le verrons dans la prochaine tude, une alternance des rles, "l'agent devient le patient et l'enfant se peroit dans la personne de son partenaire, dans le rle qu'il vient de jouer. Ainsi se forme la notion de deux rles, agir et ptir, faire peur et avoir peur, consoler et tre consol" (p. 194). Nous voyons commencer ici le caractre double des conduites sociales qui me parat trs important et que nous avons dj vu jouer un
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
46
grand rle dans les sentiments des malades perscuts 1. Mais nous n'avons pas insister sur ce caractre propos de l'imitation, car nous allons le voir bien plus dvelopp dans les conduites de la collaboration. L'imitation, en effet, est le plus simple des actes sociaux et les conduites perceptives prcdentes n'y sont que lgrement modifies. Comme le disait autrefois Cabanis, un lion qui regarde un oiseau voler n'imite pas un vol, et Groos dit aussi : "un lionceau qui voit un poisson nager n'aura pas d'impulsion nager" 2. L'imitation, si on la considre seule, ne cre pas des actes entirement nouveaux. Elle donne aux actes perceptifs une nouvelle stimulation trs intressante, la vue des actes du socius ; elle excite des tendances qui taient la phase de la latence et les fait monter des phases plus leves ; elle modifie plus ou moins leurs moyens d'excution. Un mouton retir du troupeau mange moins que s'il tait rest dans le troupeau ; un enfant remue et joue plus activement s'il est avec des camarades qui courent comme lui. Plus tard des actes comme ceux du dessin et de la peinture sont effectus plus habilement en reproduisant les conduites d'un matre. Mais l'imitation laisse l'acte entier peu prs tel qu'il tait : il s'agit, le plus souvent, dans les imitations simples, de manger, de marcher, de poursuivre une proie, ce qui existait dj, moins parfait peut-tre, dans les actes perceptifs. Il n'en sera plus tout fait de mme dans les actes sociaux plus levs de la collaboration.
L'action sociale la plus importante, celle que je considrais autrefois comme caractristique du stade social, est la collaboration. Les divers individus du groupe ne font plus tous ensemble exactement le mme mouvement comme dans l'imitation : ils semblent avoir chacun une conduite particulire et diffrente, Mais l'ensemble de ces actions particulires amne un rsultat unique et avantageux pour tous et dtermine chez tous un mme sentiment de triomphe. Ils semblent s'aider les uns les autres dans une tche commune dont ils font chacun une partie diffrente. On peut prendre comme exemple la conduite d'une bande de loups qui attaque un troupeau de moutons : ils se divisent en deux groupes dont l'un attaque les moutons et cherche en enlever un, tandis que l'autre, sans paratre se soucier des moutons, attaque le chien, le harcle et l'occupe pendant que les socii prennent le mouton que d'ailleurs ils mangeront tous ensemble. Cette division apparente des actions, malgr l'unit du terme, se retrouve dans toutes les socits un peu suprieures. Les fourmis ou les abeilles qui ne cherchent au fond qu' entretenir la vie de la fourmilire ou de la ruche sont divises en groupes distincts qui ont des fonctions diffrentes. Les unes s'occupent de la propret de la maison, les autres de son approvisionnement, celles-ci du soin des larves, celles-l de la dfense contre les ennemis, etc. Les exemples et les varits de cette collaboration peuvent tre multiplis indfiniment. Certains animaux sont capables non seulement de dfendre le groupe mais de donner un socius des soins particuliers. Dans la thse curieuse de M.
1 2
Journal de psychologie, 15 avril - 15 mai 1932. Groos, Les jeux des animaux, 1902, p. 74.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
47
Bouchinet, Les tats primitifs de la mdecine, 1890, on trouve beaucoup d'exemples qui nous montrent chez les animaux non seulement un instinct de se soigner eux-mmes, mais encore, quoique plus rarement chez des animaux sociaux, un instinct de se secourir les uns les autres. Ces actions de surveillance et d'assistance mutuelles, que nous avons tudies autrefois se rattachent aux conduites de collaboration. Cette collaboration en effet peut prendre toutes les formes. M. Waxweiler y rattache toutes les formes "de connivence, de conjuration, de complot, de coalition, etc." Nous verrons plus tard comment cette collaboration engendre les actes si importants du commandement et de l'obissance, comment elle donne -naissance au langage. Des actes de collaboration de ce genre dj bien complexes me semblent driver de plusieurs conduites prcdentes : ils prsentent ce caractre des conduites perceptives qui ne sont pas entirement dclenches tout d'un coup mais qui ont besoin, pour arriver la consommation, de plusieurs stimulations successives. Ils prsentent aussi ce caractre que nous venons de noter dans les conduites sociales, c'est que l'acte entier, ou plutt le schma total de l'acte, est "veill par le signal, par les premires manifestations de l'acte chez les socii avant que l'acte soit rellement consomm. L'animal ne prend chez les soccii que ce signal de l'acte, puis il n'imite plus, il excute l'acte sa manire et y joint ses propres inventions. Dans l'acte d'assistance on peut admettre qu'une certaine attitude du socius affam veille le schma de l'acte de manger. Mais l'acte de manger soi-mme n'est pas le mme que l'acte de faire manger un autre, il y a l une transformation et une invention propos de l'acte primitif de manger. Ces excutions partielles de l'acte total que chacun ralise sa faon ont d tre trs nombreuses et souvent trs inefficaces. Nous verrons plus tard propos de l'intelligence des singes que ces animaux essayent de faire une action en commun, mais qu'ils collaborent trs mal et souvent se gnent les uns les autres. Beaucoup de ces actions particulires ont t limines, les plus utiles seulement, celles qui servaient rellement luvre commune ont t conserves.
Nous avions signal autrefois, propos de nos cours sur l'imitation, un livre curieux et amusant de Mme Mary Austin, La psychologie du troupeau 1. Ce petit livre dcrit d'une manire pittoresque certaines conduites des animaux dans les grands troupeaux. Nous savons que dans les troupeaux qui errent sur les montagnes, une certaine vache porte une cloche et marche toujours en tte. On ne l'a pas choisie pour cet honneur, elle s'est dsigne elle-mme ; car dans ces troupeaux il y a des animaux, toujours les mmes, qui marchent en tte et d'autres qui ont l'habitude de suivre la queue du troupeau. Cette habitude est si bien ancre que l'on ne peut pas leur faire changer ces positions respectives, jamais l'animal qui s'est plac derrire ne consentira marcher l'avant-garde. Ce petit livre nous signale un cas embarrassant : le troupeau s'est engag dans une impasse et se trouve devant un mur, il faut reculer et faire tte-queue. Mais cela est trs difficile, car les animaux qui sont en queue ne consentiront jamais se retourner et marcher les premiers. Il faut que les animaux de tte qui se trouvent devant l'obstacle passent au travers de tout le troupeau pour reprendre la tte dans la direction oppose et que tous les autres animaux se
1
Science, n 631, Revue scientifique, 1907, 1, p. 630.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
48
retournent successivement. Cette disposition chez les uns marcher les premiers et chez les autres marcher la suite est la premire manifestation des tendances hirarchiques qui vont se superposer aux conduites d'imitation et les transformer. C'est le point de dpart de "la cphalisation sociale, c'est-dire des processus qui aboutissent crer parmi les membres d'une troupe une subordination de la majorit des individus une minorit ou mme un seul" 1. Dans les socits plus simples que nous venons de dcrire, les membres du groupe s'imitent les uns les autres sans qu'un individu particulier semble particulirement dsign pour marcher le premier. Le rle de chef ne parat pas troitement li l'individu : si celui qui jouait un rle disparat, un autre prend sa place et les autres animaux se comportent vis--vis de lui comme ils faisaient vis--vis du premier chef. Dans les socits plus leves le rle de chef est davantage li l'individu et ses qualits personnelles et quand il disparat il y a dans le groupe un manque et un dsordre. Cette acceptation de la supriorit n'est pas encore la vritable obissance puisqu'il n'y a pas de commandement formul par le langage, mais elle suppose cependant une conduite complexe de collaboration. Le schma total de l'acte est subdivis et le sujet considre l'acte du chef comme une partie de l'acte total et sa propre action comme une autre partie. Mais, en outre, il donne toujours chacun une mme partie et il se rserve lui-mme la conduite qui se rapproche le plus de l'imitation. La rpartition s'est systmatise et nous voyons natre la distinction du chef et du sujet, des adultes et des jeunes, nous voyons se dvelopper le dressage des jeunes qui prpare l'ducation et l'enseignement. Cette distinction des rles tant bien tablie, l'attribution de ces rles l'un plutt qu' l'autre est loin d'tre immdiatement fixe, elle n'est pas encore le rsultat d'un instinct bien tabli. Il faut que les diffrents membres du groupe reconnaissent nettement et continuellement l'un d'entre eux comme chef ou comme sujet et il faut que cet individu lui-mme accepte cette situation et prenne l'habitude de jouer le rle qu'elle comporte sans chercher le changer. Dans certains cas cette rpartition des rles est dj faite par des conduites prcdentes des uns et des autres et elle est accepte. C'est ce qui se passe, comme nous l'avons souvent remarqu, pour des individus gs, faisant depuis longtemps partie du groupe, pour ceux dont la situation est en quelque sorte officielle, c'est--dire dj admise par tous. Ces individus jouent leur rle de chef ou de sujet d'une faon en quelque sorte automatique, sans action spciale pour le modifier. Mais dans bien des cas cette rpartition officielle n'est pas encore faite d'une manire systmatique et dfinitive ; les jeunes, les nouveaux venus dans le groupe, n'ont pas encore une place bien dtermine, ni aux yeux des autres, ni pour eux-mmes. Il faut qu'ils prennent cette place, qu'ils sachent l'acqurir, la conserver et la faire reconnatre par tous. Certains individus acceptent facilement des places subalternes qui conviennent l'tat de leurs forces et leurs sentiments. Mais un grand nombre ambitionne des situations suprieures qui paraissent prsenter des avantages. Plusieurs cherchent marcher en tte du
1
E. Waxweiler, Esquisse d'une sociologie, 1906, p. 221.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
49
troupeau quoique cette position ne puisse tre Occupe que par un seul : l'un fait obstacle l'autre. Les sentiments de l'effort de la colre interviennent dans la rgulation de l'acte et une lutte commence pour obtenir des autres socii la situation prdominante. Cette lutte prend bien des formes, depuis la simple concurrence sexuelle, la lutte pour marcher en tte, jusqu' l'effort pour provoquer l'admiration pour acqurir du prestige. "Il est douteux, disait Tarde, que les premiers chefs aient toujours rgn par la force, la terreur ou l'imposture, leur pouvoir tenait plutt du prestige et d'une sorte de don magntique." Toutes ces oprations varies oui ont pour but d'acqurir et de faire reconnatre par les autres une place dans la hirarchie sociale constituent ces conduites de valorisation sociale que nous avons si souvent tudies. Rappelons seulement que ces actes de valorisation sociale, comme toutes les conduites difficiles, peuvent prsenter bien des troubles chez ceux qui les exagrent, qui cherchent toujours imposer leur domination et chez ceux qui n'arrivent pas poursuivre assez loin ces luttes sociales et qui souffrent de tous les troubles de la timidit. C'est l, comme nous l'avons vu l'anne dernire, le point de dpart de bien des obsessions et de bien des dlires. Cet acte de valorisation difficile provoque des efforts exagrs chez le dominateur et des peurs chez le timide ; il amne la raction mlancolique de l'chec chez le perscut, avec une disposition l'objectivation sociale et intentionnelle qui est le point de dpart des dlires 1.
-2Les deux lments d'un acte social.
Retour la table des matires
Ces conduites d'imitation et de collaboration nous permettent de prciser les caractres des actions du stade social que nous avons indiques brivement en dbutant. Les actions perceptives donnaient naissance des objets particuliers ; les actes sociaux ont galement cr un objet spcial que nous avons appel le socius. Le socius n'est pas autre chose qu'un tre vivant capable de provoquer chez certains autres tres vivants ces actes de caractre particulier, les actions sociales. De telles actions prsentent un premier caractre qui les distingue des conduites perceptives. Celles-ci sont adaptes leur objet dans son ensemble : le schma perceptif veill par une des stimulations qui viennent de l'objet est dtermin une fois pour toutes et n'admet pas, sans changer compltement, des modifications importantes de cet objet. Comme nous le disons : "Du pain ne
1
Journal de psychologie, 15 mai 1932, p. 418.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
50
peut pas devenir du poison sans cesser d'tre du pain et, sans que soit modifie toute la conduite perceptive, un socius ami peut devenir un ennemi sans cesser d'tre le socius et mme sans perdre son nom" 1. Au contraire les actes sociaux ne sont pas adapts une fois pour toutes au socius, ils varient selon que se modifie ce socius lui-mme. Cette modification du socius laquelle les conduites sociales doivent s'adapter est constitue par ses actes et le premier caractre des actes sociaux consiste dans leur adaptation aux actes du socius, adaptations surajoutes celles du schma perceptif de ce socius qui subsiste. je dois modifier constamment ma conduite au cours mme de l'action suivant la raction qu'elle provoque chez le socius dont je suis oblig de tenir compte. Il en rsulte une certaine reprsentation de ces actes du socius qui s'est forme peu peu par le mcanisme de l'imitation et toute action sociale comporte, outre l'action personnelle du sujet, cette reprsentation des actes du socius laquelle il doit s'adapter. Dans l'acte perceptif, l'individu qui mange un fruit n'a pas ce moment d'autre action que celle de manger ce fruit ; dans la conduite sociale, l'individu qui agit doit avoir en mme temps la reprsentation des actes de raction du socius qui constitue pour lui une deuxime action simultane la premire. Ce caractre double de l'acte social sera particulirement visible dans l'acte du commandement que nous tudierons plus tard. Un acte command est un acte divis en deux parties excutes, l'une par le chef, l'autre par le sujet. Mais le chef ne peut pas ignorer la partie de cet acte excute par le sujet qu'il commande, qu'il surveille, qu'il rcompense ou qu'il punit en raison de l'excution de cette partie. Il doit donc maintenir simultans un acte de commandement qui est la premire partie de l'acte total et l'action de surveillance de la conduite du sujet qui obit. "Cette complexit de l'action sociale, si visible dans le commandement et dans le langage, se retrouve dans toutes les actions sociales. Compatir la douleur d'autrui ne consiste pas seulement faire des actes pour le soulager, mais rpter en dedans de nousmmes, la phase de l'rection, les actes que nous ferions si nous avions la mme souffrance. Plaindre et tre plaint sont lis ensemble comme parler et tre parl, comme commander et obir. On ne lutte pas contre un socius de la mme faon que contre un orage, on mle aux actes de la lutte la reprsentation des actes du socius, on pense qu'il nous combat en mme temps qu'on le combat. On ne peut pas regarder quelqu'un sans avoir envie de prendre l'attitude que l'on aurait s'il nous regardait. On ne peut pas suivre quelqu'un sans la reprsentation qu'il fait l'acte de "tre suivi". On ne peut pas mpriser, har, insulter quelqu'un sans la reprsentation qu'il se tient comme un individu mpris, ha, insult. Il n'y a pas de matre sans esclave, de professeur sans lves, de pre sans fils. Les conduites sociales ont pour une grande part contribu la construction de notre personnalit, mais elles y ont contribu en nous donnant la personnalit du socius en mme temps que la ntre et ces deux personnalits sont restes toujours plus on moins mlanges" 2. C'est ce caractre double des actions sociales auquel M.
1 2
Cf. Les sentiments dans le dlire de perscution, Journal de psychologie, 15 mars 1932, p. 232. Journal de psychologie, 15 mars 1932, p. 227.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
51
Baldwin faisait allusion quand il appelait ces actions "des conduites rciproques" 1. Ce caractre double est si important qu'il complique beaucoup les souvenirs, les imaginations, toutes les reprsentations des actions sociales. Dans la perception, au moment mme de l'action, nous discernons facilement quelle est l'action que nous faisons nous-mmes et quelle est l'action qui appartient au socius. Mais dans les reprsentations de ces actes, cette distinction devient beaucoup plus difficile et donne lieu beaucoup d'erreurs. La distinction dpend toujours de l'addition de certains sentiments qui donnent l'action un caractre personnel ou un caractre tranger. Mais quand les sentiments sont veills d'une manire incorrecte, ils amnent bien des confusions dans "l'agir et le ptir" si indissolublement associs. Des troubles importants comme les sentiments d'emprise et les dlires de perscution peuvent en rsulter. Les conduites sociales ainsi caractrises par la raction aux actes du socius et par le caractre double de l'action ont t trs utiles et ont permis un plus grand dveloppement de la vie psychologique. Elles ont d'abord augment la porte et la puissance des mouvements : un individu au stade perceptif n'agit qu'autour de lui, dans un cercle limit et en proportion de ses forces ; associ avec beaucoup d'autres il agit beaucoup plus loin et beaucoup plus fortement. Une seule fourmi ne peut pas couper une branche d'arbre ; si elle est runie des milliers d'autres elle dtruira des arbres entiers. En outre, un individu perceptif ne peut ragir qu' des stimulations proches qui agissent sur ses organes des sens ; si un socius se trouve plac la distance maxima laquelle il peut se faire entendre, et si ce socius l'avertit, notre individu ragira des stimulations beaucoup plus facilement. Quelle que soit l'importance de ces progrs et d'autres du mme genre, l'importance la plus grande des actions sociales consiste dans ce fait que la runion des deux actions en une seule prpare les combinaisons intellectuelles. Ces deux conduites diffrentes : marcher en avant et suivre, prsentent chez les hommes bien des formes varies. Il est vrai que ces conduites humaines deviennent bien plus nettes et bien plus faciles tudier quand on considre des hommes qui parlent : nous reprendrons cette tude aprs le langage, surtout propos de la croyance. Nous devons seulement tudier ici la forme lmentaire que prennent ces actes leur dbut en examinant quelques exemples. Tandis que la plupart des actions considres au point de vue social ont leur stimulant l'extrieur, dans les actions et surtout dans les paroles des socii, certains actes paraissent spontans et avoir leur point de dpart en nousmmes. Il est probable que des volutions de tendances qui arrivent des phases de besoin et d'rection, des associations de souvenirs, de paroles, que tout un travail plus ou moins conscient veille ces actes particuliers. Ces actes
1
Baldwin, Le darwinisme dans les sciences sociales, 1911, p. 39.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
52
que nous appellerons actes d'initiative prennent souvent la forme des actes destins tre imits, des actes de commandement. Sous le nom gnral d'actes inspirs nous comprenons au contraire toutes les actions qui ont manifestement une origine sociale, qui ont t veilles par la vue de l'acte excut par un autre ou par le commandement de ce socius. Ils prennent, en effet, le plus souvent, la forme des actes imits ou des actes d'obissance. Nous retrouvons dans ces actes d'initiative ou dans ces actes d'inspiration le caractre double des actions sociales. Nous ne pouvons nous reprsenter notre initiative sans nous reprsenter en mme temps que les autres ne font pas ou n'ont pas fait jusqu' prsent le mme acte, qu'ils ont fait des actes diffrents qui, d'ailleurs, nous paraissent infrieurs aux ntres, que, s'il font maintenant le mme acte, ils le font par imitation ou par obissance. En un mot nous n'avons pas un acte d'initiative sans nous reprsenter chez les autres un acte inspir et nous pouvons nous imaginer chez l'animal qui marche en tte du troupeau et qui regarde en arrire pour voir s'il est suivi une complication de ce genre. Les actes inspirs, qui semblent l'inverse des premiers, en sont si bien une partie que l'on ne peut avoir le sentiment d'inspiration propos d'un acte sans se reprsenter en mme temps que ce mme acte est chez un autre un acte d'initiative qui devient un objet de notre imitation ou qu'il est un commandement reu par nous. L'attribution un de nos actes de la forme de l'initiative ou de la forme de l'inspiration dpend de la prpondrance donne dans la reprsentation l'un ou l'autre de ces deux lments et, par consquent. de sentiments surajouts. Comme ces sentiments sont des ractions secondaires ajoutes l'acte, il faut nous demander pourquoi tel sentiment est veill de prfrence et pourquoi il s'attache l'une ou l'autre partie de cet ensemble. La conduite diffrente des animaux du troupeau se rattache des caractres psychologiques fondamentaux qui distinguent les actes d'initiative et les actes d'inspiration. Les actes d'initiative peuvent prsenter certains avantages et amener une certaine excitation qui les fait rechercher, mais ils sont toujours plus difficiles et plus coteux. Tout acte nouveau exige une plus grande dpense de force. Les actes d'imitation plus simples et moins excitants sont beaucoup plus conomiques. L'exemple de l'acte excut devant nous ajoute une excitation la faible force de la tendance et rend la rptition du mme acte plus facile. Cela est si vrai que des animaux accidentellement spars du troupeau ne savent plus agir isolment ; leur acte n'tant plus prcis, excit par l'exemple du chef, n'ayant plus d'cho chez les autres btes du troupeau, devient beaucoup plus difficile et se montre au-dessus des faibles forces de l'animal isol. Nous sommes forcs de constater que, mme parmi les divers individus d'un troupeau, en apparence bien semblables, il y a des forts et des faibles. "Penser spontanment, disait Tarde, est toujours plus difficile que de penser par autrui, il y a comme un sommeil dogmatique, une magntisation continue." Il en rsulte que les sentiments au moment o l'on agit d'une manire ou d'une autre ne sont pas les mmes : il y a un sentiment d'effort et un sentiment de triomphe chez l'initiateur. Cette raction de triomphe donne naissance des ides et des croyances de commandement obi et, par consquent, des ides de puissance. En gnral, l'obissance n'est pas accompagne par les
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
53
mmes sentiments de triomphe, elle se prsente plutt avec un tat d'indiffrence et un sentiment de fatigue. Celui qui obit constamment se sent mlancolique et vaincu : "J'obis tout le monde et au diable", disait une malade affaiblie. Ces complications se montrent dans d'autres actions sociales auxquelles nous ne pouvons faire ici qu'une brve allusion. Chez les animaux les plus levs, et surtout chez l'homme, se prsentent les actes du don et du vol. Les hommes, et dj quelques animaux, rattachent leur personne des objets extrieurs : c'est le fait des appartenances. Celles-ci, au dbut, sont des parties de la personnalit et plus tard deviennent des proprits rattaches la personnalit par des conduites spciales. Les hommes se conduisent vis--vis de ces objets comme-ils se conduisaient vis--vis de leur propre corps : ils respectent ces objets chez les autres et ne mangent pas leurs aliments, de mme qu'ils ne mangeaient pas le corps des socii ; ils dfendent les appartenances comme ils dfendent le corps propre. Mais ils peuvent aussi par certains actes modifier plus ou moins les appartenances : faire un don c'est faire passer une appartenance personnelle un autre, renoncer aux actes d'appartenance sur un objet et accepter qu'ils soient faits par un autre ; voler c'est faire l'acte inverse. Ces actes du don et du vol sont des actes doubles comme les actes d'initiative et les actes inspirs : on ne peut avoir conscience de l'un ou de l'autre sans se reprsenter la fois sa propre conduite d'appartenance vis--vis d'un objet et la conduite d'appartenance d'un autre propos de ce mme objet. Le changement d'appartenance dans un sens ou dans l'autre prendra l'aspect du don ou du vol suivant les sentiments surajouts. D'une manire gnrale les actes du don et du vol sont plus excitants, les actes du recevoir et du tre vol sont plus dprimants. Quand un individu constate une modification de ses appartenances et quand cette modification prend un caractre social, il est trs influenc dans son apprciation de la situation par les sentiments qu'il prouve : s'il constate une diminution de ses appartenances en prouvant de la joie, il croira volontiers qu'il a fait un don ; s'il sent une dpression il se croira vol. Cette intervention des sentiments dans des actions complexes peut amener des erreurs et nous avons dj tudi bien des troubles bizarres dans les apprciations de la proprit. Des actes sociaux trs importants peuvent tre dsigns par ces mots : "le montrer et le cacher". Ces actes que nous allons voir bientt sous leur forme intellectuelle ont leurs dbuts dans les simples conduites sociales. La mre montre de la nourriture ses petits et la poule picore devant les poussins, le paon tale sa roue devant la femelle ; bien des animaux cachent leur nourriture pour que d'autres ne la mangent pas, comme l'avare cache ses trsors pour qu'on ne les lui vole pas. L'acte de montrer son corps, se montrer est souvent ncessaire pour courtiser la femelle, pour tre choisi, tre suivi, pour commander ; c'est la conduite du "tre en public" ou du "tre prsent, tre accessible aux perceptions et aux ractions des autres". Inversement se dveloppe la conduite de se cacher qui a t au dbut une des formes de la dfense la plus usite. On se cache, on est cach quand les autres ne peuvent ni nous percevoir ni nous atteindre, quand pour eux on est absent. C'est ce qui dtermine la conduite du
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
54
"tre seul" quand on chappe la perception de tous les autres par la distance, par l'obscurit, par les objets opaques. C'est une conduite particulire voisine des conduites du "tre deux, tre plusieurs, tre devant le matre, tre dans la foule, tre en public". Une autre complication remarquable se prsente quand ces actes de montrer et de cacher sont appliqus nos propres actions et surtout aux commencements d'actions, aux actes en rection, aux sentiments. Il faut placer ici "les actes publics" qui provoquent chez les autres les attitudes de prsence ; ce sont des actes accomplis devant les autres, porte de leurs perceptions, de manire qu'ils puissent ragir pour nous aider ou nous arrter. Ces actes sont devenus le point de dpart du langage car on montre surtout dans le langage les gestes qui caractrisent le dbut de l'acte. La conduite qui consiste cacher non son corps, mais ses actes, donne naissance aux actes secrets, aux intentions, aux penses. Comme nous l'avons tudi dans le cours sur "la pense intrieure", 1926, la pense est la forme que prend l'acte du "tre seul", l'acte du secret quand il est pouss son dernier terme. Nous avons bien vu que cette proprit de la pense d'tre intrieure, de ne provoquer de raction qu'en nous-mmes n'est pas une qualit primitive de certaines conduites, mais qu'elle est une forme de conduite sociale lentement acquise au cours des sicles. Il est ncessaire de bien comprendre ce caractre actif de la conduite de la pense, pour expliquer tous les troubles qu'elle peut prsenter. Toutes ces conduites sont des conduites sociales : dans l'acte du "tre seul" entre encore la reprsentation des autres hommes et surtout d'une personne dtermine que l'on cherche particulirement viter. Il ne s'agit pas du tout de la conduite primitive de l'isolement chez des tres qui ont toujours vcu isols ; il s'agit de la conduite d'tres qui vivent en socit, qui ont des attitudes spciales devant les autres et qui, momentanment, suppriment ces attitudes. On se sent seul quand on se reprsente qu'on n'est pas surveill, que l'on n'a plus d'gards observer, que l'on simplifie sa conduite en se reprsentant les actes que l'on supprime. La conduite de l'intention et la conduite de la pense n'existeraient probablement gure chez un homme qui aurait toujours vcu isol, si toutefois on peut le concevoir. N'ayant aucune raison de cacher ses actes ou ses intentions, il n'aurait construit ni la conduite du secret ni la conduite de la pense. Il pense et il a conscience de penser parce qu'il a en mme temps la reprsentation de l'accueil qui serait fait ses intentions, parce qu'il veut viter la publicit. Il rsulte de ce caractre social que tous ces actes, aussi bien ceux de tre seul et du secret que ceux de la publicit sont galement des actes doubles comme le commandement et l'obissance. On ne peut pas se sentir bien en public, se sentir peru et compris sans se reprsenter l'attitude que les autres prennent vis--vis de nous et celle qu'ils auraient en notre absence, s'ils ne nous voyaient pas et ne nous comprenaient pas, puisque prcisment on cherche viter cette dernire attitude des autres. On ne peut pas avoir conscience du secret de la pense sans se reprsenter l'opinion qu'auraient les autres s'ils la pntraient. Ici encore il y a une distinction difficile faire entre deux termes toujours unis et qui ne prennent une valeur diffrente que par l'intervention des sentiments. Ces deux conduites publique et secrte ont chacune leurs avantages et leurs inconvnients. Suivant les circonstances et surtout suivant l'tat des forces de l'individu, il prfrera l'une ou l'autre et
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
55
caractrisera l'une ou l'autre de ces conduites par des sentiments de joie ou de tristesse. Ces rflexions montrent un peu la complexit des conduites sociales, leur caractre double et le rle des sentiments dans leur interprtation.
Aprs ces rsums un peu abstraits de nos anciennes leons, un exemple peut mettre en relief les complexits que peut prsenter la conduite d'un animal au niveau social et je vous rappellerai les prouesses d'un chien de berger. J'ai assist dans les Pyrnes au travail d'un chien de berger tout fait isol pour rassembler un troupeau. Les troupeaux de la montagne sont souvent plus embarrassants que ceux de la plaine, car ils se composent d'animaux diffrents, de bufs, de vaches, de moutons et surtout de chvres, ces animaux capricieux et difficiles qui, l'heure de rentrer, se plaisent grimper sur des rochers inaccessibles. L'table se trouvait sur un versant d'une valle, parcourue au fond par un torrent, et le troupeau tait dispers de l'autre ct du vallon, au del du torrent. Le fermier se posta sur un rocher du versant o tait l'table et envoya simplement le chien de l'autre ct, sans l'accompagner. Le chien dvala le versant, traversa le torrent et se trouva de l'autre ct, plus d'un kilomtre de son matre qu'il ne pouvait plus entendre mais qu'il pouvait encore voir de temps en temps : il tait seul, abandonn son initiative. Pendant une heure il courut dans les bois, les prs et les rochers pour dcouvrir les btes une une. Quand il en avait trouv une, il se montrait elle, la poursuivait et la forait descendre jusqu'au bord du torrent. Il eut beaucoup de peine avec les chvres, et de temps en temps il gmissait au pied d'un rocher trop difficile escalader et sur le sommet duquel la chvre le narguait. Les btes rassembles, il sembla les compter en en faisant le tour et en ramenant un animal qui s'garait, puis il fit tout seul traverser le torrent par son troupeau et le conduisit sur le versant o tait rest son matre. je ne vous ai pas dit qu'au dbut il y avait prs du chien de berger un autre petit chien, encore trs jeune et incapable de travailler. Ce jeune chien s'tait arrt avant le torrent et se bornait suivre des yeux le travail de son an, comme s'il assistait un cours. Quand le torrent fut travers par le troupeau, le vieux chien cessa de travailler et il laissa le petit chien conduire les btes jusqu' l'table, ce qui tait facile ; il remonta de son ct en flnant et se rendit seulement auprs du fermier pour rclamer quelques caresses. On pourrait dcrire dans la conduite de ce chien de berger la plupart des oprations de l'intelligence lmentaire que nous allons tudier : le dtour, la production d'un travail et d'un rsulta, prvu, la collaboration et la division des actes, le commandement et peut-tre le dbut de l'enseignement. Ce qu'il cherche faire, le schma de l'acte total, est bien de faire rentrer l'table toute ses btes qu'il connat ; il n'oublie pas cet acte puisqu'il finit par l'accomplir, mais bien souvent il court dans une direction tout fait oppose, il fait en mme temps d'autres actes tout diffrents et compliqus, il ragit sans cesse de petites difficults qui se prsentent au cours de l'acte total. C'est bien l l'essentiel des actes de collaboration, des futurs actes de commandement bien diffrents de la simple action du meneur que nous tudierons plus tard chez le chien de chasse courre. Nous sommes tout fait aux dbuts de l'intelligence et il ne s'agit cependant que des conduites sociales un peu perfectionnes qui nous serviront de transitions pour arriver l'intelligence.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
56
-3Les crmonies.
Retour la table des matires
Je voudrais rappeler encore un autre fait social qui prendra une grande importance, celui des ftes, des crmonies qui existent dj chez les animaux sociaux et qui va avoir un grand dveloppement dans les populations humaines primitives. Le livre d'Espinas sur Les socits primitives, le livre de J.-C. Houzeau, Les facults des animaux compares celles des hommes, le livre de Kropotkine, Mutual aid, nous dcrivent beaucoup de ces runions, les assembles des hirondelles avant le grand voyage, celles des pies, des corbeaux, celles des singes qui font grand tapage en frappant sur des troncs d'arbres, etc. 1. On trouve beaucoup de ces runions chez les primitifs, elles existent encore aujourd'hui avec beaucoup de complications. Durkheim, dans son livre sur Les religions primitives, a fait une description reste classique d'une de ces crmonies, des ftes de l'Ichtyschiuma chez les Australiens. Cette crmonie est clbre la fin de la priode sche, quand la vgtation va renatre et que les animaux vont pulluler. Ces populations sauvages interrompent leurs travaux ordinaires, ils font souvent de longs trajets pour arriver se runir ; costums d'une manire spciale", ils dansent et crient en commun dans une mme enceinte. Puis ils absorbent tous ensemble une nourriture spciale, chacun mange une pince d'une poudre faite avec des chenilles dessches et crases. Cette prparation de la crmonie, cette sorte de communion que font tous ces individus en mangeant ensemble un peu du mme aliment, leurs cris, leur tapage, leur joie tout cela se retrouvera dans la plupart des runions populaires. Ce qui caractrise ces crmonies, c'est d'abord la runion et l'effort pour se runir, quand ils vivent d'ordinaire disperss. C'est ensuite la communaut des actes souvent peu utiles en eux mmes qui sont faits visiblement en vue de crer cette uniformit : ils sautent, ils crient tous ensemble de la mme manire, ils mangent le mme aliment. L'effort vers l'uniformit est si grand que l'on expulse les individus non conformes et que des gardes placs autour du lieu de runion empchent les trangers de pntrer dans le terrain rserv. Cet effort pour arriver la prise de conscience du groupe est si frappant que Durkheim n'tait pas loin d'admettre une sorte d'me du groupe qui se constituait et qui acquerrait une vie propre. Nous n'osons pas aller si loin et nous ne constatons d'actions en rapport avec le groupe que chez les individus
1
Waxweiler. Esquisse d'une sociologie, 1906, p. 89.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
57
mmes qui le constituent. Mais il est juste de remarquer chez eux des actions particulires en rapport avec l'uniformit des membres de la socit, actions qui vont devenir le point de dpart de vritables objets intellectuels comme le totem du groupe. "L'association pour la vie, disait Tarde, se nourrit de similitudes, on ne s'allie, on ne s'aime vraiment qu'entre semblables" 1. Mais les similitudes sont rares et on peut les attendre longtemps si on se borne profiter des similitudes fortuites. Ce qui caractrise les socits, c'est que les individus remarquent les similitudes quand elles existent, qu'ils les cherchent et qu'ils travaillent les produire. Ce qui est aussi caractristique dans ces ftes, c'est l'excitation qu'elles procurent tous ceux qui y prennent part. Les alinistes avaient dj signal les phnomnes d'excitation dans les maladies mentales et, dans plusieurs ouvrages, j'avais montr le rle de l'excitation dans le traitement des nvroses et les recherches l'excitation psychologique chez les malades 2. Durkheim a voulu appliquer l'interprtation des conduites crmonielles des primitifs ces notions de psychologie pathologique. Il a montr que ces individus qui se runissent de cette faon sont satisfaits et joyeux pendant la fte et qu'ils sortent rconforts, plus capables qu'auparavant d'affronter le travail pnible et les luttes de la vie. Cette excitation qui arrte les dpressions, qui soulve l'homme au-dessus de lui-mme en rendant ses actions de la force et de la tension est un phnomne aujourd'hui bien connu. L'excitation apparat sous bien des influences : elle peut tre conscutive l'usage de certains aliments et mme de certains poisons, elle est produite par le simple exercice de certaines actions, comme les mouvements violents et les cris. Mais elle apparat surtout la suite de certaines actions sociales et c'est l le point de dpart de bien des recherches de la domination, de la direction ou de l'amour. Nous voyons ici cette excitation sociale sous sa forme la plus simple dans ces runions et ces ftes, elle dpend de l'imitation, de la conformit elle-mme, des danses et des cris en commun. Comme disait Tarde, "c'est la foule qui se donne en spectacle elle-mme, qui attire et admire la foule". Durkheim a fait une tude intressante sur les consolations de la tristesse par les runions, les crmonies bruyantes qui se font autour des enterrements. La douleur des parents du mort, au lieu d'tre augmente par les manifestations plus ou moins vraies de la douleur des autres, est diminue par l'excitation que causent la runion, l'imitation d'une foule considrable.. Un point sur lequel il faut insister, c'est que cette excitation par la runion ne se produit pas ici d'une manire accidentelle comme cela arrive probablement dans des runions d'animaux. Cette excitation semble avoir t plus ou moins constate et recherche, ces primitifs cherchent la reproduire sans se rendre bien compte du procd qu'ils emploient. Il s'agit, en ralit, d'un acte de jeu dont nous tudierons le mcanisme : on recherche une raction de triomphe aprs des actions rduites, simples et peu coteuses. L'intelligence sera plus tard le dveloppement de ces premiers phnomnes sociaux qui amnent l'excitation et la joie. Cette excitation sociale n'apparat pas seulement dans les grandes ftes o la foule est runie, elle peut tre procure par des runions beaucoup moins
1 2
Tarde, Revue philosophique, 1893, 11. p. 579. Les mdications psychologiques, 1919, III. Les traitements par l'excitation.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
58
nombreuses avec des individus dtermins. Les hommes trouvent cette excitation dans les relations sexuelles, dans l'exercice de la domination sur un petit nombre de personnes, dans les compliments et les flatteries qu'ils reoivent de quelques personnes. Ces individus, dont on attend le rconfort, forment un groupe distinct de la socit complte dont nous venons de parler, nous les avons dsigns sous le nom de groupe des familiers. L'anne dernire, en tudiant les sentiments des perscuts, nous avons remarqu que ces malades, sauf dans les dernires priodes, n'prouvent pas leurs sentiments d'emprise propos d'une personne quelconque. Le perscuteur se recrute toujours dans ce groupe spcial des familiers. Il s'agit d'individus auprs desquels nous avons l'habitude de rechercher les excitations sociales, par la conversation qui est un jeu du langage, par des controverses qui sont des jeux de la bataille, par des dominations, des exigences de compliments et de caresses. Toujours nous attendons des familiers des conduites spciales qui nous donnent des excitations et des joies. Le dlire de perscution vient souvent d'un insuccs dans la recherche de ces excitations sociales. Les runions amicales entre des individus dtermins commencent de bonne heure et prparent l'intervention de l'intelligence dans ces groupements sociaux.
C'est ainsi que le groupe se constitue psychologiquement : la runion d'un certain nombre d'tres vivants de la mme espce commence accidentellement comme consquence de la gnration ou des circonstances externes qui rassemblent ces tres au mme endroit. La socit se forme ensuite par une sries de conduites qui transforment ces premiers rassemblements mcaniques en une runion psychologique forme et entretenue par des conduites sociales. Des ractions perceptives particulires analogues celles du corps propre ont constitu l'homme distinct des autres objets et vis--vis duquel on a dj des conduites particulires, puis de nouvelles conduites, les ractions aux actes et l'imitation qui sont les premires conduites sociales ont constitu le socius. On peut dire que les premires formes des runions de ces socii ont t quelque chose d'analogue ce que nous appelons aujourd'hui la foule : "Tous les visages ont le mme masque, toutes les voix ont le mme cri ; voir dans toutes les figures l'image de son dsir, entendre dans toutes les bouches la preuve de sa certitude, chacun se sent emport sans rsistance dans la conviction de tous... Le corps social est vritablement ralis, la reprsentation de la socit survit la ralisation de la socit" 1. La foule, sous cette forme infrieure, n'existe plus gure aujourd'hui que sous forme momentane la suite d'une dpression gnrale. Des actes nouveaux et plus prcis se surajoutent aux premiers actes sociaux, en particulier les conduites hirarchiques, les recherches de l'excitation dans les runions publiques ou particulires qui sont des sortes de jeu des actions sociales. Ces nouvelles conduites donnent naissance aux socits hirarchiques, dans lesquelles se groupent non seulement les compatriotes, mais encore les familiers. On a dit quelquefois que les socits taient fondes par la force du groupe qui s'imposait l'individu, comme Durkheim l'a quelquefois laiss entendre. Ce n'est pas trs intelligible, car, pour que la socit ait cette force, il faudrait qu'elle existt dj. La socit ne se forme pas non
1
H. Berr, La synthse historique, 1911, pp. 167-168.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
59
plus par la guerre, comme l'a dit Le Dantec. Elle se forme graduellement par une srie d'actes invents par l'homme, puis rpts, superposs les uns aux autres, parce qu'ils taient utiles et qu'ils amenaient des progrs.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
60
Les dbuts de lintelligence (1932) Premire partie : Les premiers stades psychologiques
Chapitre IV
Les sentiments et le jeu
Une des modifications les plus intressantes de l'action humaine qui se rattache troitement aux conduites sociales, a donn lieu aux divers sentiments que nous considrons comme des formes de l'action. Le sentiment qui a jou un grand rle dans les conduites intellectuelles lmentaires est le jeu et c'est sur lui que nous insisterons particulirement.
-1Les sentiments, rgulations de l'action.
Retour la table des matires
Les sentiments out toujours embarrass les psychologues, surtout ceux qui s'intressent avant tout aux actes et la conduite, car on ne peut pas dire que les sentiments d'un homme soient chez lui des actions absolument comparables aux autres. Les actes sont caractriss par les circonstances extrieures qui les provoquent et par les mouvements que nous excutons : manger, se promener, parler, se distinguent bien de cette manire. Les sentiments, au contraire, peuvent rester les mmes dans des circonstances diffrentes et quand les mouvements excuts sont diffrents. Un homme peut tre toujours triste indpendamment des actes varis qu'il excute : il peut tre triste en
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
61
mangeant, en se promenant, en parlant. Inversement, un mme acte, l'acte de se promener ou l'acte de parler peut tre accompagn d'un sentiment tout diffrent. Un homme peut se promener avec fatigue, avec ennui, avec tristesse ou avec gaiet : quelque chose a chang en lui sans que l'acte ait vritablement chang. Cette addition, ce mlange des sentiments avec des actions quelconques, montrent que le grand nombre des sentiments apparents dpend de la combinaison de quelques sentiments simples avez les actions prcdentes du niveau perceptif ou du niveau social. Nous ne nous occuperons donc pas de l'amour ou de la haine qui sont des modifications des conduites sociales par des sentiments, nous ne nous occuperons que de quatre sentiments fondamentaux, l'effort, la fatigue, la tristesse et la joie. Les explications de ces sentiments par de simples tats de conscience ont toujours t plus ou moins vides et confuses : on se bornait dire peu prs dans quelles circonstances un homme tait triste ou joyeux et on empruntait aux potes et aux romanciers des descriptions o se mlaient aux sentiments une foule de choses trangres. C'est pourquoi, au sicle dernier, la suite des travaux de W. James et de Lange, on s'est prcipit un peu vite sur la thorie dite priphrique ou viscrale des sentiments. Ceux-ci n'taient plus constitus que par quelques modifications des fonctions viscrales, de la respiration surtout, et de la circulation dont on avait cru constater la coexistence avec la conscience du sentiment. "Nous sommes tristes, disait James, parce que nous pleurons, sorry because we cry." Cette thorie qui a eu son heure de clbrit, parce que la mode joue un rle dans les thories scientifiques comme dans la forme des chapeaux, est aujourd'hui en forte rgression. On n'a gure pu vrifier exactement la concidence sur laquelle elle se fondait et on a constat, au contraire, que toutes les perturbations viscrales pouvaient accompagner un sentiment quelconque. Les mmes troubles viscraux peuvent tre font exagrs dans une foule de maladies physiques sans que les sentiments soient nettement modifis. J'ai t amen dans mon dernier ouvrage, De l'angoisse l'extase, 2 vol. 1928, prsenter une autre interprtation des sentiments, capable de rendre des services pour comprendre les troubles des sentiments qui se prsentent dans une foule de nvroses et de psychoses. Les sentiments dpendent de fonctions qui jouent un grand rle dans l'organisme, les fonctions de rgulation. Il n'y a pas seulement dans l'animal une fonction de la respiration et une fonction de la circulation, il y a des appareils et des fonctions de rgulation de la respiration ou de la circulation qui, suivant les circonstances et les besoins, augmentent ou diminuent la respiration et la circulation. Les actes des tres vivants dpensent des forces, quoique la nature de ces forces psychologiques soit encore peu connue. Suivant leur nature, suivant leur complication et leur perfection ou parce que leur acquisition est plus ou moins rcente, les actes sont plus ou moins coteux. D'autre part, l'organisme qui doit excuter ces actes a plus ou moins de ces forces psychologiques sa disposition. Des rgulations psychologiques tantt augmentent la force dont dispose une tendance pour s'activer ; tantt, au contraire, la diminuent, et
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
62
surtout arrtent, dans certains cas, l'excution de l'action tantt d'une manire, tantt d'une autre. Ces rgulations de l'action ont un rapport troit avec les conduites sociales et il semble probable que c'est au niveau des conduites sociales qu'elles se sont dveloppes. Un grand caractre des conduites sociales c'est qu'il s'agit de ractions des actes et non uniquement de ractions des objets, comme dans les conduites primitives. L'homme apprend ragir aux actes de ses semblables, de ses socii, comme disait M. Baldwin, et ensuite il applique cette conduite lui-mme et il apprend ragir ses propres actions. Cette raction nos propres actions semble trange, car l'action est plutt faite pour ragir aux stimulations du monde extrieur ; mais notre action devient analogue un objet extrieur qui dtermine une raction et il est probable que ces ractions nos propres actions sont au dbut l'lment essentiel de la conscience. chaque instant nous encourageons ou nous augmentons une de nos actions comme si nous nous disions nous-mmes : "il est important de faire ce travail, il faut le continuer cote que cote", c'est un langage analogue celui que nous aurions en parlant un enfant qui ne travaille pas assez bien ; ou bien nous arrtons un de nos actes en nous disant nous-mmes ce que nous dirions un voisin : "non il ne faut pas faire cela, ce serait bte et dangereux". Les sentiments sont justement constitus par cet ensemble de ractions nos propres actes et c'est de cette manire, en considrant les sentiments comme des rgulations de l'action, qu'on peut leur donner une place dans une psychologie de la conduite et les expliquer de la mme manire que les autres phnomnes psychologiques. Cette interprtation donne une rponse au problme que nous posait la nature des sentiments et leur diffrence avec l'action. Tous les sentiments, disions-nous, l'effort, la fatigue, la tristesse, la joie peuvent accompagner une mme action et sans la transformer en ellemme lui donner seule. ment un ton diffrent. Inversement toutes les actions, mme des actions trs diffrentes les unes des autres, peuvent donner naissance un mme sentiment, prendre le mme ton, tout en conservant leurs caractres distinctifs. C'est que des rgulations diffrentes peuvent s'appliquer une mme action, de mme qu'un ingnieur peut acclrer ou ralentir une mme machine. C'est qu'une mme rgulation peut s'appliquer des actions diffrentes, de mme que l'on peut aussi bien provoquer l'acclration d'une automobile que d'un moulin. On peut manger avec ardeur ou avec effort, on peut tre fatigu de manger, on peut s'arrter de manger avec tristesse ou avec joie et ce que je viens de dire de l'acte de manger, on peut l'appliquer la promenade, la lecture, une action quelconque. Cette interprtation gnrale des sentiments comme une rgulation de l'action pourrait se rattacher aux conceptions de Spinoza, de Dumont, de Marshal, de Rauh sur le rapport des sentiments avec les forces de l'organisme : il ne s'agit pas des forces relles de l'organisme, mais d'une apprciation de ces forces suivant la manire dont l'excution de l'action se prsente. Sous cette forme, cette thorie des sentiments peut rendre de grands services dans l'tude des troubles pathologiques qui les affectent si souvent. Pour comprendre un peu comment s'opre cette rgulation qui donne naissance aux sentiments, je vous conseille d'tudier particulirement un trouble
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
63
maladif trs frquent et mon avis trs important que l'on peut appeler l'tat de vide ou le sentiment du vide. C'est un tat pathologique trs curieux, caractris par l'absence complte de tout sentiment ou par la seule persistance d'un sentiment de perte des sentiments. Les malades semblent encore agir correctement et percevoir exactement les diffrents objets mais ils rptent : "je ne fais plus rien comme autrefois, je ne vois plus aucune chose comme je la voyais. Autrefois les objets et les actions taient intressants, ils me provoquaient quelque satisfaction, quelque plaisir ; maintenant, rien ne m'intresse, rien n'a plus de valeur aucun point de vue, rien n'est joli, mais rien n'est laid, tout est insignifiant, les objets n'ont plus de valeur". Alors le malade exagre de plus en plus cette ngation de la valeur, il l'exprime de bien des faons, il rpte : "les objets et mme les actions sont des choses artificielles, ce ne sont plus des choses naturelles, c'est fait la machine, cela ne signifie rien du tout". Ou bien ils disent : "les objets qui je parle taient autrefois des personnes mais il n'y a plus d'tres humains, personne ne vit, je suis au milieu de morts ; tous les gens que je vois ont perdu la vie". Ils ne reconnaissent plus aux personnes qu'ils continuent percevoir correctement les caractres sociaux qu'ils leur donnaient autrefois. "Oui, cette personne ressemble exactement ma femme, on ne peut pas imaginer une imitation, un sosie plus parfait, mais ce n'est pas ma femme, ce n'est pas mon enfant". Ces malades terminent par des expressions bien typiques qui ont tonn autrefois et qui ont fait donner souvent la maladie le nom de maladie du doute : "Rien de ce que je vois n'est rel, les objets n'existent plus, ce sont des ombres, des fantmes, des rves, des choses tout fait irrelles." Pour comprendre un peu ces paroles tranges, rappelons un exemple que j'ai souvent discut. Une jeune femme, mre de famille, raconte de la manire suivante le dbut de sa maladie, la premire crise caractristique. Elle tait assise dans un fauteuil et regardait ses pieds sa petite fille ge de deux ans qui jouait sur un tapis. L'enfant s'avise d'une action fcheuse : elle veut grimper sur une chaise du ct du dossier et tire sur le dossier de cette chaise pour se soulever. La mre de famille ne bouge en aucune faon, mais elle prouve un sentiment bizarre : "le spectacle qui tait sous mes yeux m'a tout coup paru trange, mystrieux, il me semblait que ce n'tait plus une chose terrestre, de notre monde rel, mais quelque chose d'thr qui se passait loin de la terre". Et elle restait immobile en contemplation. Dans le deuxime volume de mon livre sur L'angoisse et l'extase j'ai essay d'analyser cette observation de sentiment du vide. Une femme normale qui assisterait cette scne se serait prcipite sur l'enfant pour l'empcher de tomber en arrire et de se blesser ; mais, comme disait cette jeune mre : "cette conduite je l'aurais eue la veille, mais ce moment je n'ai pas boug et je ne pensais pas bouger, je voyais ce qui se passait, c'est tout, cela ne m'inspirait absolument rien". C'est cette suppression de la raction maternelle, cette disparition de toute envie de cette conduite normale qui constitue le symptme et qui fait natre le sentiment de l'trange et de l'irrel. Cette supposition a t vrifie dans un grande nombre d'observations du mme genre. Un individu n'a pas seulement une perception qu'il contemple comme s'il tait au spectacle ; quand il est dans la ralit il. ragit cette perception, il y ajoute une foule d'actions secondaires qui sont ncessites par sa situation et
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
64
par ses habitudes. Il est dans l'tat de vide, et dans l'irrel quand propos d'un fait rel il se conduit comme il le ferait au spectacle, quand il n'ajoute la perception aucune action secondaire. La rgulation sentimentale consiste essentiellement dans l'addition de ces actions secondaires qui, par leur prsence, modifient l'action primaire, l'augmentent ou la diminuent, l'arrtent de diverses manires. La premire de ces ractions, la plus simple, est une addition d'actions secondaires qui augmentent la force de l'action primaire : c'est le mcanisme de l'effort. L'homme a t compar bien souvent une automobile qui n'a pas seulement un moteur fonctionnant toujours de la mme manire, mais qui a aussi un acclrateur. L'acte secondaire qui a aussi une charge, une certaine force psychologique, ajoute sa force celle de l'action primaire et en augmente la force et la vitesse. Un colier travaille mdiocrement, en travaillant une question de son programme ; il pense qu'il va tre refus son examen et cette peur active son travail et dtermine un effort. Dans l'automobile, il n'y a pas seulement un acclrateur, il y a des freins, qui ont une action inverse et qui diminuent la vitesse de la voiture. Il y a dans l'organisme une raction de ce genre qui est la conduite du repos. L'veil de cette conduite du repos, par des modifications particulires de l'action, dtermine ce ralentissement de l'action que nous appelons le sentiment de la fatigue. De mme qu'il y a des individus toujours tendus qui font perptuellement des efforts exagrs et inutiles, comme les obsds, il y a des individus paresseux qui tendent vers l'inertie et qui sont continuellement dans un tat d'inaction morose. Une troisime raction est plus grave, c'est la raction de la grande tristesse, la raction mlancolique. Ce qui la caractrise c'est la pense catastrophique : propos de toute action peine commence survient la pense que cette action conduit d'horribles catastrophes : "Si je laisse ma mre venir me voir dans la maison de sant avec l'enfant de mon frre, la voiture se prcipitera contre un arbre et ils seront tous crass." La tristesse est, au fond, la peur de l'action, la raction de l'chec perptuel, la raction du recul. L'automobile a aussi une marche arrire ; la marche arrire chez nous, c'est la terreur de l'action que nous sommes en train de faire et le recul dsespr. J'insiste un peu plus sur la conduite de la joie et sur la raction qui la caractrise et que nous pourrons appeler la raction du triomphe. Cette raction est galement comme la raction prcdente une raction d'arrt. Quand une action a russi, quand elle a amen le rsultat que nous dsirions, il est inutile de la continuer, nous nous puiserions pour rien, il faut l'arrter. Mais cet arrt aprs le succs est bien diffrent de l'arrt mlancolique. Dans le sentiment de l'chec, le problme pos par l'action est loin d'tre rsolu, le danger est toujours le mme, une action n'a pas russi, il a fallu l'arrter, mais on ne peut rester immobile, il faut inventer et recommencer Une autre action jusqu' puisement des forces. Dans le succs la situation est tout autre, le problme est rsolu, il n'y a plus rien faire. Le jeune homme qui vient d'chouer un examen est forc de prparer de nouveau cet examen ; celui qui vient d'tre reu non seulement n'a plus d'examen prparer, mais il est libre
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
65
d'oublier compltement tout ce qu'il a appris ; c'est l la rsultat le plus net de la rception un examen. Cet arrt, cette liquidation de tout le travail prcdent amne un rsultat trs important, il rend disponibles les forces qui taient employes faire l'action prcdente, prparer l'examen, retenir dans la mmoire ce qu'on avait appris. Ces forces n'ont plus d'emploi, on est libre d'en faire ce que l'on veut et la raction du triomphe est surtout caractrise par le gaspillage de ces forces. Nous ne faisons aucune action sans une prparation de forces. Quand vous partez en voyage, vous prenez de l'argent la banque et vous mobilisez des capitaux. Les forces sont mobilises de mme quand vous commencez un acte et, tant que vous continuez l'acte, vous gardez ces forces mobilises. Maintenant l'acte est fini, qu'allez-vous faire de ces forces mobilises ? Thoriquement il serait sage de les remettre la banque. Dans l'esprit il y a des banques, des placements de ces forces mobilises ; vous pouvez les mettre en rserve. Mais on n'est pas toujours si sage et quand les forces sont mobilises et qu'on sent de l'argent dans son portefeuille, dont on n'a pas immdiatement besoin, avant de le replacer on commence le dpenser. Il y a une raction caractristique du triomphe qui est le gaspillage. Le gaspillage n'est pas toujours mauvais, il a mme des avantages. Quand on arrte le travail de l'examen et qu'on gaspille les forces prpares, il y a une foule d'organes fatigus, qui travaillaient mal parce qu'ils n'avaient pas de force, qui reprennent leur bon fonctionnement s'il y a une force plus grande. Prenons un candidat qui se nourrissait trs mal jusqu' l'examen et qui va dvorer ds qu'il sera reu. Toutes les fonctions de l'organisme participent ce bnfice, le corps se dveloppe, tous les organes sont plus solides. Bien entendu, les fonctions psychologiques prennent leur part dans ce gaspillage de forces et quand il y a un succs et un triomphe, toutes nos fonctions sont meilleures ; l'individu qui a t reu au baccalaurat, qui a abandonn le latin et le grec, se souvient mieux de ses amis et connaissances, des distractions qu'il prenait : une foule de souvenirs ressuscitent. Nous avons tudi souvent une forme amusante de ces rsurrections : dans certains tats mlancoliques, des sujets qui avaient perdu un certain nombre de fonctions rcuprent dans le succs des forces qu'ils n'avaient plus, et dclarent retrouver leurs amis et leurs plaisirs. je vous ai parl ce propos d'une petite malade qui disait : "Oh, je vais beaucoup mieux, j'ai retrouv Ernestine, mon amie, que je croyais avoir perdue dans la priode de tristesse prcdente 1." Le succs est donc une trs bonne chose pour les hommes, il apporte une foule de forces l'organisme. Il en rsulte que les hommes aiment le succs, le triomphe et la joie, tandis qu'ils n'aiment pas la tristesse et c'est pour cela qu'ils cherchent se procurer la joie de toutes les faons. Ces notions sur le
1
De l'angoisse l'extase, 1926, II, pp. 408, 424.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
66
triomphe et sur l'amour du triomphe vont nous permettre de comprendre ce phnomne psychologique si curieux, le phnomne du jeu.
-2Le jeu.
Retour la table des matires
Pour arriver comprendre un peu les conduites intellectuelles, nous avons besoin de rappeler quelques notions sur les actes de jeu d'o elles sortent souvent et sur les sentiments dont le jeu n'est qu'une forme particulire. Un objet intellectuel au premier chef c'est le portrait, la statue qui au fond sont des objets bien bizarres. La statue d'un personnage, le portrait d'un ami, c'est d'un ct ce personnage, cet ami lui-mme et nous avons devant le portrait quelques-unes des attitudes que nous avons habituellement devant l'ami ; mais d'autre part ce n'est videmment pas lui, car notre ami n'est videmment pas un morceau de papier : nous soulevons ce portrait, nous le mettons dans un tiroir, ce que nous ne pouvons faire avec l'ami : c'est lui et ce n'est pas lui. Eh bien, nous avons des conduites qui ressemblent beaucoup celle-ci : quand des enfants jouent la bataille, il y a une bataille puisqu'il y a des combats et qu' la fin il y a des vainqueurs et des vaincus, mais d'autre part on convient de ne pas se faire du mal les uns aux autres, ce qui est absurde dans une bataille, et la fin aucun des belligrants n'est rellement supprim ou exclus puisqu'ils fraternisent tous ensemble : c'est une bataille et ce n'est pas une bataille. Comme le portrait de l'ami tait l'ami et ne l'tait pas. Pour comprendre le portrait et plusieurs autres actes intellectuels du mme genre nous avons besoin d'avoir prsentes l'esprit quelques notions sur le jeu. quoi reconnaissons-nous le jeu 1 ? C'est un ensemble d'actions, de mouvements des membres, de paroles, de combinaisons intellectuelles quelquefois considrables : les enfants qui jouent, remuent beaucoup, ils sont quelquefois couverts de sueur, comme s'ils avaient fait un grand travail. Les hommes et les femmes bavardent dans les salons, c'est toute une crmonie ; la prsidente de la rception, qui se reconnat dans le salon ce fait qu'elle n'a pas de chapeau sur la tte tandis que les autres darnes ont gard le leur, surveille ses invits ; elle a peur que la conversation ne s'arrte, car la rgle de ce jeu c'est qu'il y ait tout le temps une personne qui parle ; elle provoque celle qui n'a pas encore parl et la pousse lancer elle aussi sa petite chanson, je veux dire son petit discours : tout ce monde se donne beaucoup de peine pour parler. Les hommes, quand ils ont fini leur travail srieux, jouent aux dominos, aux checs, aux cartes et font encore avec peine une foule de combinaisons intellectuelles.
1
Sur les thories du jeu, cf. De l'angoisse l'extase, 1926, II, pp. 432-437 ; La force et la faiblesse psychologique, 1930, p. 147.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
67
Dans tous ces jeux on voit une activation de toutes les fonctions psychologiques. Mais un grand caractre fort tonnant distingue ces actions de toutes les autres, c'est que ce sont des actions qui ne servent de rien. Considrons les jeux des enfants et en particulier le jeu de la bataille qui est si frquent. La guerre, la bataille sont des actions srieuses les hommes, elles ont un but : c'est de supprimer l'adversaire, on le tue, on l'carte de la socit de manire ne plus le rencontrer, en un mot le vainqueur doit supprimer le vaincu. Or, que font les enfants quand ils jouent la bataille ? Ils ont une conduite vraiment absurde. Ils admettent au dbut une convention bien ridicule, c'est qu'on ne doit pas se faire de mal. Quelle singulire ide puisqu'on se bat pour supprimer, pour tuer l'adversaire ! Ce qui est le plus trange c'est qu'ils tiennent leur parole ; aprs la bataille il n'y a ni morts ni blesss, personne n'est supprim et ils vont tous manger ensemble leur goter, sans aucune rancune. Les hommes qui jouent aux cartes et qui se battent aussi prennent la prcaution de jouer entre eux des haricots secs ou des menues monnaies sans valeur. Leur jeu est l'acte de chercher ruiner l'adversaire et ils ne lui prennent rien du tout. Les jeux sont donc de singulires actions dans lesquelles on fait beaucoup d'efforts en apparence absolument pour rien. Cependant on constate que le jeu est trs dvelopp chez un grand nombre d'tres vivants : nous admettons sans hsitation que les enfants des hommes jouent beaucoup, qu'ils ont des jeux de toute espce et surtout des jeux avec des mouvements violents qui ne font rien d'utile, de grandes courses pour n'aller nulle part et pour rester en somme au mme point. Chose remarquable, le jeu des enfants est une marque de leur intelligence et nous devons nous mfier d'un enfant qui ne joue pas : c'est souvent une marque d'arriration mentale. Nous prouvons plus d'embarras quand il s'agit des adultes, nous rptons souvent sans rflexion que les adultes ont jou dans leur enfance et que maintenant ils ne jouent plus parce qu'ils sont devenus srieux. Dfions-nous des gens srieux ou qui se croient srieux ; les adultes continuent jouer normment. On ne parle pas seulement des jeux de cartes, des dominos, des checs, des dames et de la politique qui sont leurs jeux apparents et avous. Mais ils jouent bien d'autres jeux sans le reconnatre ouvertement. Ils mangent trop, ils boivent trop et d'une manire raffine qui demande des efforts et qui ne sert absolument de rien. Nous jouons avec la parole, avec le raisonnement, avec l'enseignement mme. Est-il bien certain que dans nos confrences, prtendues scientifiques, il n'y ait pas une part de reprsentation, de comdie, d'exhibition et que nous ne cherchions les uns et les autres nous intresser, nous exciter, nous amuser au fond, plutt qu' faire des dcouvertes scientifiques. Il y a dans la vie humaine des actions la fois physiques et morales qu'on appelle les actes de l'amour ; je n'ose pas dire tout haut ce que j'en pense de peur de provoquer l'indignation. Mais, en un mot, est-ce que l'amour humain est entirement identique l'amour des animaux qui font tranquillement leur petite affaire de temps en temps avec le premier individu du sexe oppos et qui ensuite n'y pensent plus ? L'homme a raffin, l-dessus, plus que sur toute autre chose ; il a invent des complications folles, des convenances, de la
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
68
pudeur, des qualits esthtiques et morales et surtout il a prcis son choix sur une personne particulire sans laquelle il croit n'tre plus bon rien. On vient de publier de nouveau en franais le livre clbre du grand aliniste viennois Krafft Ebing, complt par le professeur Moll, de Berlin, sur les perversions sexuelles et on m'a de mand d'crire pour cette nouvelle dition une prface. je me suis permis de dire que ces auteurs taient beaucoup trop srieux et qu'ils sont trop graves dans un sujet qui n'est pas si grave que cela. Il y a dans les conduites sexuelles une part norme de jeu et de comdie : toutes ces conduites bizarres sont des tentatives pour s'exciter avec le sexe, comme on s'excite avec l'alcool et la morphine, et on ne les comprendra pas si on n'y met pas la part du jeu. Pour ne pas insister sur tous ces problmes retenons que les hommes et les femmes adultes jouent normment, seulement ils ont chang un peu la nature des jeux d'enfants ; nous aurons chercher pourquoi. Ce qui est curieux c'est que les animaux jouent aussi. Qui n'a admir les jeux vraiment dlicieux voir du petit chat et mme du jeune chien ? Vous connaissez un livre remarquable d'un auteur allemand, M. Karl Groos, Les jeux des animaux, 1902, qui montre chez une foule d'animaux ce qu'il appelle la pseudo-activit du jeu et qui montre le lien troit de cette activit avec l'imagination artistique. je vous rappelle les travaux du professeur amricain J. M. Baldwin sur le jeu qu'il appelle aussi une pseudo-action, une quasi-action. On connat moins les travaux d'un Franais, M. L. Grard-Varet, 1902, sur le jeu chez l'animal et chez l'homme qui nous parle des relations du jeu et du rve, ce qui me semble un peu exagr. Mais j'ai dj fait allusion aux manifestations intellectuelles des singes et des chimpanzs, en particulier, propos des travaux si intressants de M. Khler. Il ne faut pas oublier que le chimpanz est fort capable de jouer beaucoup. Ils jouent avec tous les objets qui sont leur disposition, avec leur petit gobelet qu'ils s'amusent remplir d'eau, vider, avec tous les bouts de bois, de fil de fer, de ficelle, avec les pelures des bananes ; ils sont aussi satisfaits que possible en enfonant un bout de fer dans une fente de bois ; en gnral ils se plaisent dchirer, dmembrer, briser, sans aucun intrt pratique. Ils font des culbutes, marchent sur les mains, c'est--dire dansent sans avancer, en restant sur place, ou font des rondes autour d'un arbre, comme les enfants, avec une sorte de rythme. un des pieds frappant plus fort que l'autre. "Cela rappelle, dit M. Khler, les cortges des peuples sauvages 1." En un mot, cet animal que nous avons jug intelligent joue beaucoup comme les enfants. Depuis longtemps les psychologues se sont efforcs de comprendre ce jeu singulier, cette action qui dpense rellement des forces et qui ne sert de rien. Une action est faite pour dterminer une certaine modification dans le monde extrieur et dans l'organisme ; on mange pour introduire un aliment utile dans le corps, on combat pour dtruire un adversaire dangereux et pour conserver sa propre vie. Que peut bien signifier une action qui conserve la dpense de mouvements et qui supprime tous les bnfices rels de l'action, n'est-ce pas une action en contradiction avec toutes les autres ? Aussi toutes les thories du jeu vont-elles avoir toujours le mme caractre. Elles cherchent un rsultat pratique du jeu, rsultat que nous n'apercevons pas au premier coup d'il, une utilit vitale du jeu qui doit exister puisque ce genre d'activit paradoxale s'est
Khler, L'intelligence des singes suprieurs, 1927, p. 302.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
69
conserv et dvelopp au travers des gnrations et qu'il existe encore chez les tres vivants considrs comme les plus intelligents. Une thorie qui a t longtemps prdominante est la thorie du jeu ducateur qui a t bien prsente dans l'ouvrage de M. Karl Groos dont je viens de parler et qui a t reprise plus tard par M. Baldwin. Tous les instincts qui existent latents chez l'animal la naissance sont loin d'tre ce moment tout fait dvelopps, ils ont besoin d'exercice pour pouvoir fonctionner d'une manire parfaite. Le petit chat doit savoir attraper les souris, il s'exerce ce mtier en courant aprs des feuilles d'arbre. L'oiseau doit savoir voler, il s'exerce en battant des ailes d'une manire en apparence inutile. Le petit enfant doit savoir lutter et se dfendre dans la vie, il faut qu'il apprenne se battre. Dans cet apprentissage il risquerait de mauvais coups si la bataille tait srieuse, elle est transforme en jeu et on prend des prcautions comme dans les exercices gymniques des enfants. Plusieurs auteurs comme M. Victor Dpasse 1 iront jusqu' dire que le travail est sorti du jeu, ce qui me parat un peu exagr. Cette thorie a eu des consquences assez importantes dans la pdagogie, et une poque rcente on s'est imagin qu'il fallait transformer en jeux tous les travaux des petits enfants et des coliers. On a illustr de belles images les alphabets et on a essay de transformer en comdies amusantes tous les enseignements. Il y a mme eu une littrature et un thtre qui ont eu la prtention de prsenter la morale et la science d'une manire amusante : castigat ridendo mores. Je ne suis pas bien sr que le thtre moralisateur soit bien amusant, ni que le thtre amusant soit ncessairement trs moral ; il y a l bien des illusions. Les enfants qui on prsente de belles images pour les faire apprendre lire prfrent le plus souvent jouer autre chose. Mais le principe mme de cette thorie du jeu soulve bien des objections. Est-il certain qu'un instinct ne puisse se dvelopper que par des jeux de ce genre ? On a souvent observ que des animaux trs jeunes conservs en cage, isols, jusqu'au moment de l'closion de leurs instincts, les prsentent d'un seul coup d'une manire complte. Des oiseaux conservs dans une petite cage savent parfaitement voler du premier coup. Les actes instinctifs sont imparfaits dans les premiers essais parce que l'instinct et ses organes nerveux n'ont pas encore tout leur dveloppement. On n'a pas bien dmontr que cet apprentissage soit ncessaire ni qu'il doive se faire sur cette forme du jeu. En effet, le jeu altre considrablement l'action, il en supprime le caractre srieux, c'est--dire l'essentiel. Est-ce vraiment courir aprs une souris vivante pour la manger que de courir aprs une feuille morte que le petit chat n'a aucune envie de manger ? Il est certain que dans certains cas particuliers le jeu joue un rle dans l'ducation qui s'en sert l'occasion, mais qui ne l'invente pas. Une autre hypothse intressante est celle qui a t prsente d'abord par le pote allemand Schiller, puis dvelopp par Herbert Spencer. Le jeu serait une dcharge de l'nergie psychologique surabondante, "overflow of energy". L'animal, surtout dans sa jeunesse, aurait sa disposition une nergie trop considrable qui le gnerait. Comme cette nergie ne se dpense pas chez lui
1
V. Depasse, Revue scientifique, 1903, 1, p. 577.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
70
par des actes srieux, il prouve le besoin de la dcharger tort et travers par des actes sans but, en apparence inutiles, mais qui servent au moins dpenser des forces psychologiques surabondantes 1. Les tudes trs intressantes de M. Claparde se rattachent en partie cette conception : "le jeu permet une dcharge d'motion nuisible sous une forme non nuisible" ; l'auteur se place dans une situation intermdiaire entre les deux thories prcdentes et sur bien des points les dpasse 2. Cette thorie du jeu-dcharge m'inquite un peu : nous avons dj tudi bien souvent les vraies dcharges dans les convulsions pileptiques ou hystriques et nous n'avons pas constat de jeu, ni d'amusement dans ces dcharges. On se trompe souvent en disant que les tats d'agitation qui se rapprochent des dcharges sont des tats de gaiet. Bien souvent on constate dans les tats de manie aigu le sentiment du vide bien plus que le sentiment de la gaiet. L'observation de l'enfant oui joue ne me parat gure favorable cette interprtation. Voici un enfant qui sort d'une longue classe, il est fatigu et sans entrain. Vous dites qu'il va se dcharger en jouant pendant la rcration, mais se dcharger de quoi ? Il s'est dj bien trop dcharg pendant la classe et je crains qu'il ne lui reste bien peu d'nergie dpenser. Il se met cependant jouer, d'abord avec une certaine peine, et quand il a jou pendant une heure avec une gaiet croissante il rentre en classe avec de bien meilleures dispositions. Il tait puis la fin de la classe, il est recharg la fin de la rcration par le jeu qui s'est montr tout le contraire d'une dcharge.
-3L'exploitation du jeu.
Retour la table des matires
Dans mon dernier ouvrage, De l'angoisse l'extase, o j'ai analys tous les sentiments depuis l'angoisse la plus profonde jusqu'au bonheur de l'extase, j'ai essay, sinon de prsenter une thorie nouvelle du jeu, du moins d'attirer l'attention sur certains de ses caractres dont on n'avait pas assez tenu compte 3. Un trait essentiel du jeu qu'il ne faut pas oublier c'est que le jeu est amusant. Le jeu, quand il est russi, amne une joie d'une nature un peu particulire, mais qui n'en est pas moins une joie avec tous les caractres de la
1 2 3
Cf. Paul Souriau, Le plaisir et le mouvement, Revue scientifique, 1889 ; L. Grard Varet, Le jeu chez l'animal et chez l'homme, lbid., 1902, 1, p. 485. Claparde, Institut belge de pdologie, 1912. De l'angoisse l'extase, 1926, II, pp. 436-437.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
71
raction de triomphe que nous venons d'tudier. Le jeu procure le sentiment du succs, l'arrt de l'effort avec le gaspillage dans tout l'organisme des forces mobilises, il procure l'augmentation des forces, le rveil des activits qui taient somnolentes faute de forces, la rcupration des souvenirs et des sentiments, les perfectionnements des actions et les inventions nouvelles. En un mot, le jeu nous procure tous les avantages d'une action russie. C'est l, si je ne me trompe, le fait essentiel et c'est cause de ce caractre essentiel que l'homme et l'animal se sont mis jouer. Tous les tres ont senti les avantages de la joie qui vient aprs la russite des actions et ils ont recherch ce Succs et cette joie. Comme il arrive souvent dans les industries, le produit secondaire, accessoire, est devenu plus important que le produit principal. On s'est bien souvent dsintress du rsultat principal et primitif de l'action, du terme rel de l'alimentation, de la marche et de l'amour, pour ne s'occuper que du rsultat accessoire de la joie produite par le succs de l'action quelle qu'elle ft. Or, cette joie dpend de la raction de triomphe et du gaspillage qu'elle dtermin des forces mobilises pour l'action et il faut prendre quelques prcautions pour que ce gaspillage et cette joie puissent tre rellement avantageux. Pour cela il est ncessaire que toutes les forces mobilises pour l'action ne soient pas toutes dpenses dans l'excution de l'action elle-mme, parce que, mme si on arrtait l'action, il n'en resterait plus rien gaspiller. Bien souvent la victoire n'enrichit ni le vainqueur ni le vaincu, puisqu'ils se sont tous les deux puiss et vids pendant la guerre. Pour que ces conduites puissent procurer un triomphe avantageux, il faut d'abord qu'elles soient conomiques, qu'elles dterminent une dpense de forces aussi petite que possible. Si vous voulez avoir des bnfices en revendant un titre la Bourse, il faut commencer par ne pas l'acheter un cours trop lev. Pour conomiser dans l'excution de l'action il faut en supprimer le caractre trop srieux, trop rel, car c'est le rel qui complique la vie et qui exige des dpenses de forces ; il faut une bataille o on ne tue pas, car tuer et tre tu c'est trop srieux, cela excite des tendances la conservation de la vie qui ont de trop grandes forces et qui, mises en activit, nous ruinent. Mais, cependant, il ne faut pas trop rduire l'action et lui enlever trop de ralit, car elle n'aurait plus d'intrt et ne mobiliserait plus assez les forces de l'organisme, et quand on ferait l'arrt de l'action il n'y aurait pas de gaspillage. Prenons comme exemple ces personnes qui jouent aux cartes. Quelquefois elles se contentent de jouer des haricots secs : c'est un procd qui a l'avantage de ne pas dpenser. Mais il y a des joueurs qui diront : "Non, si on ne joue que des haricots secs, je ne joue pas bien et quand je gagne, je n'ai pas de triomphe." Cela veut dire : "je n'ai pas mobilis assez de forces et quand je gagne, je n'ai pas de gaspillage. Mettez un sou, pour avoir l'air de gagner de l'argent : alors cela excite mes tendances au commerce, je mobiliserai des forces et quand j'aurai gagn, je serai beaucoup plus content, parce qu'il y aura un gaspillage des forces." Il faut donc que l'action ne soit pas trop grave ni trop petite ; il y a des prcautions prendre et on a employ le mot "s'amuser" pour dsigner ces triomphes en quelque sorte artificiels, parce que d'ordinaire le triomphe et les
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
72
vraies joies surviennent aprs les vraies actions excutes jusqu' leur consommation relle, tandis qu'ici le triomphe se produit avant la consommation vritable et sans les dpenses qu'elle rclame ; il s'agit d'un triomphe prmatur et prpar par des prcautions spciales. Or ce sont tout justement ces prcautions qui constituent le jeu ; la rgle du jeu de la bataille c'est de ne pas se faire de mal pour que les combattants ne dpensent pas trop de forces dans l'attaque ou dans la dfense. Nous avons remarqu que les jeux des adultes ne sont plus les mmes que les jeux des enfants ; c'est parce que les forces des adultes et des vieux ne sont plus les mmes que celles des enfants, cela fatiguerait trop les vieux de jouer la balle ou au chat perch ; ils ont transform le jeu de la balle en un jeu de golf qui est plus calme. En mme temps on prend des prcautions pour que le jeu reste srieux, on joue des fiches, mais on imagine que ces fiches reprsentent des millions. Quand on fait jouer des enfants on promet un gteau au vainqueur et on lui dcerne des flicitations. Le jeu, comme j'ai essay de le montrer, est une exploitation intelligente du phnomne du triomphe qui termine les actions russies. Les animaux et les hommes commencent par dpenser un peu dans une action bien organise pour tre aussi conomique que possible et ils tirent de la russite de cette action facile tous les bnfices possibles. Il y a ainsi dans la vie un grand nombre d'actions qui sont des spculations de ce genre, le sommeil, les crmonies, les dners, les boissons alcooliques et mme, si j'ose le dire, les passions de l'amour : toutes ces conduites sont des jeux et des spculations plus ou moins heureuses. Il est bien probable que cette conduite bizarre qui n'existe pas chez l'animal primitif, ni chez l'idiot, a commenc d'abord d'une manire fortuite l'occasion de ces "trompe-l'il" dont j'ai montr l'importance dans la thorie des perceptions. Puis elle s'est dveloppe cause de ses grands avantages et elle a t recherche activement quand se sont dveloppes les rgulations de l'action. Les animaux puis les hommes ont appris jouer avec toutes les tendances, tirer parti pour les triomphes prmaturs de l'alimentation, de la boisson, de l'amour, du combat, de la parole, etc. et toutes les conduites de l'art sont sorties de ce jeu perfectionn. Ainsi entendu Comme une exploitation du triomphe, le jeu s'introduit dans toutes les fonctions psychologiques, et cette recherche de l'enrichissement facile, de l'excitation, transforme la conduite ; le fait de savoir jouer est un fait vraiment intelligent, c'est un moyen d'augmenter nos forces, et de les augmenter naturellement par un dveloppement de l'organisme ; c'est un des lments de l'volution humaine. C'est pourquoi ce jeu va intervenir dans la cration de toutes les fonctions suprieures, et l'homme n'est arriv la science et la philosophie que parce qu'il savait jouer.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
73
Pierre Janet, Les dbuts de lintelligence (1932)
Deuxime partie Les premiers objets intellectuels
Retour la table des matires
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
74
Les dbuts de lintelligence (1932) Deuxime partie : Les premiers objets intellectuels
Chapitre I
La direction du mouvement et la route
Pendant que se dveloppaient ces conduites sociales, grandissaient galement chez les tres vivants d'autres conduites que l'on peut runir sous le nom de conduites de direction. Les directions les plus lmentaires se prsentent dj chez des animaux assez simples, les directions les plus compltes qui aboutissent l'tablissement de la route, de la grand'place, de la porte sont plus tardives. Quoiqu'il soit impossible d'tablir des coupures nettes dans une volution aussi continue, elles inaugurent le stade que nous dsignons sous le nom de stade de l'intelligence lmentaire.
-1Les premires organisations du mouvement.
Retour la table des matires
La science du monde physique explique tous les phnomnes physiques ou chimiques par des mouvements, mouvements des astres, mouvements des corps, mouvements des atomes et mme des lectrons dans l'atome. Il me semble probable que la science psychologique doit expliquer tous les faits qui se passent dans l'esprit comme des actions, des mouvements de notre corps.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
75
Ces deux catgories de mouvements, le mouvement de la lune ou le mouvement d'une feuille morte emporte par le vent et le mouvement d'un animal qui se dplace, sont-ils exactement les mmes ? J'en doute. Une belle thse de philosophie et de mtaphysique pourrait avoir pour titre "tude sur un petit chat qui joue avec une feuille morte". L'auteur aurait d'un ct le mouvement physique de la feuille morte emporte par le vent et de l'autre le mouvement si gracieux du petit chat qui court aprs la feuille et qui la relance. Ce serait un beau travail qui aborderait peut-tre les questions du dterminisme absolu et de l'indterminaison relative du futur. Mais aujourd'hui ce sujet est trop beau pour nous et nous n'aborderons que l'un de ces mouvements, le mouvement du petit chat devant une tasse de lait. Le petit chat est en A et il dsire boire la tasse de lait qui est en B ; le passage de A en B sera le trajet et la ligne que trace sur le sol ce trajet ; la forme de ce trajet sera la direction. Cette direction de A en B est des plus importantes, car si le petit chat avait march vers C il n'aurait jamais eu son lait. Si pour venir faire des cours Buenos-Aires, je m'tais dirig vers l'Angleterre et si j'avais travers la Manche au lieu de l'Atlantique, je ne serais jamais arriv. La direction est si importante qu'on l'applique mme en dehors de la marche dans l'espace, on l'applique la conduite des affaires et l'organisation de la vie et nous disons vulgairement d'un homme qui a russi, qu'il a bien dirig sa barque. Il y a mme des hommes trs dvous qui ont le courage de donner une direction aux affaires de l'tat. Dans ces diffrentes directions, depuis celle du petit chat vers sa tasse de lait jusqu' la direction d'un ministre, il y a bien des degrs et des transformations. Entre la direction tout fait simple et instinctive et la direction scientifique, il nous faut chercher le point intermdiaire o la direction est devenue intelligente, car cela nous mon a la forme la plus simple et la plus typique de l'intelligence qui a, ce moment, invent la route. Si on dpasse les mouvements rflexes primitifs qui sont simplement explosifs, la plupart des mouvements des tres vivants taient dj dirigs, c'est--dire qu'ils taient modifis pendant leur excution en relation avec les circonstances environnantes. Une des plus importantes modifications dpend de la rgulation de l'quilibre du corps pendant ses dplacements, les autres modifications peuvent tre rattaches un ensemble de rgulations connues sous le nom de rgulations kinesthsiques. On a dcrit depuis longtemps un ensemble de phnomnes psychologiques que l'on appelait le sens musculaire ou le sens kinesthsique. Nous ne pouvons accepter de placer au dbut de l'volution psychologique la sensation de Condillac ; nous ne pouvons rattacher une sensation musculaire primitive la connaissance des parties du corps et de leur mouvement. Les expriences psychologiques que l'on prtend faire sur le sens musculaire sont faites en ralit sur des jeunes gens dj capables de parler et dont les phnomnes psychologiques relatifs au mouvement sont bien loin d'tre des sensations lmentaires. Cette prtendue conscience des mouvements dpend de notions bien plus compliques et plus tardives, de la connaissance du corps propre, de la connaissance des actes, du dcoupage et de l'analyse des actes chez des individus qui ont dj appris faire des mouvements indpendants de leurs bras, de leurs doigts et qui ont appris connatre les mouvements des autres hommes.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
76
Les rgulations kinesthsiques sont beaucoup plus simples : l'une des plus simples est bien dcrite par M. Sherrington. Elle consiste dans la modification du mouvement suivant la position dans laquelle se trouve le membre au dbut de ce mouvement. Si je veux porter ma main droite a ma bouche, ce qui est un acte perceptif simple, je dois faire un mouvement tout fait diffrent si ma main droite est en bas sur mes genoux ou si elle est en haut sur ma tte. Il y a l dj une adaptation du schma qui se fait d'une manire rflexe 1. M. Head n'est pas loin de considrer cette raction rgulatrice comme dj intellectuelle ; nous ne la considrons que comme un premier dbut d l'intelligence. Nous avons dj souvent insist sur une autre rgulation qui consiste dans le maintien d'un membre dans une position dtermine. La pathologie nous offre ce propos un symptme fort curieux dans ls phnomnes de la catatonie et de la catalepsie. On sait que, si on soulve le bras de certains malades, si on donne aux doigts de la main une position particulire, cette attitude bizarre qui, chez un homme normal, serait immdiatement interrompue par la chute du bras, se maintient exactement la mme pendant un temps assez long, vingt minutes ou une demi-heure. Le sujet ne parat pas se proccuper de cette position anormale de son bras et ne songe pas la modifier. L'tude de ces attitudes permanentes a beaucoup intress au moment des recherches sur l'hypnotisme et la suggestion, puis elle a t dlaisse pendant un certain temps ; cette tude recommence aujourd'hui et elle a provoqu des travaux remarquables. Il me semble utile dans l'tude de ce symptme de prendre quelques prcautions et de sparer certaines formes de cette permanence des attitudes qui ne se rattachent pas directement notre tude des rgulations kinesthsiques. Au plus bas degr, si on considre ce phnomne au point de vue psychologique, je placerai des permanences d'attitudes qui sont uniquement physiques et qui dpendent d'un certain tat des articulations. J'ai propos de les appeler des attitudes canaboplgiques, du mot grec [mot grec] qui veut dire mannequin d'artiste, des attitudes de mannequin. Pour une raison quelconque, les articulations sont plus serres, leur frottement est plus dur et le simple poids du membre ne suffit pas pour les faire fonctionner. On peut observer des raideurs de ce genre dans des lsions articulaires du rhumatisme. je crois qu'on peut galement les observer quand les muscles qui environnent l'articulation sont trop tendus, quand il y a exagration du tonus musculaire. On constate des raideurs de ce genre chez certains mlancoliques et dans quelques tats d'obsession. je me demande avec hsitation si les observations intressantes de MM. Claude et Baruk sur les permanences d'attitudes chez des animaux intoxiqus ne pourraient pas tre rapproches de phnomnes de ce genre. l'autre extrmit de la srie psychologique de ces permanences d'attitudes je placerai les attitudes cataleptiques que nous avons autrefois tudies chez des malades hystriques ou chez des sujets hypnotiss. Leur interprtation a t bien donne par Bernheim, d'ailleurs elle avait t propose auparavant de la mme manire par les magntiseurs qui comme Bertrand admettaient le rle des phnomnes psychologiques. Il s'agit ici de phnomnes de croyance : le sujet croit que son mdecin dsire qu'il garde le bras en l'air et qu'il lui en donne l'ordre. Cette croyance est accepte et excute par le
1
Head, Sensation and the cerebral cortex, Brain, 1918, p. 156.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
77
mcanisme de la suggestion. On peut d'ailleurs, chez ces mmes sujets, dterminer des attitudes tout fait semblables par la suggestion verbale. Entre ces deux groupes de faits se placent les permanences d'attitudes que l'on peut appeler les attitudes catatoniques que l'on peut observer chez des sujets plus ou moins confus et indiffrents, au cours de la dmence prcoce par exemple. Le membre n'offre pas la mme raideur que dans le premier cas, un lger attouchement suffit pour le dplacer et lui donner une autre position qui sera conserve comme la premire, il ne s'agit plus ici de raideur articulaire, ni de demi-contracture des muscles. Il ne peut plus tre question non plus d'une croyance en gnral trop complique pour ces malades ; on constate d'ailleurs qu'ils ne sont aucunement suggestibles par la parole, le bras une fois lev on ne peut pas en provoquer le dplacement par de simples suggestions verbales comme on le fait si facilement chez les cataleptiques. On est dispos alors dire que les phnomnes psychologiques n'interviennent pas, ce qui est fort exagr. J'ai eu l'occasion de faire sur plusieurs malades et en particulier sur une dmente prcoce intressante que je dsignais sous le nom d'Agathe une srie d'observations dont j'ai prsent un rsum au Congrs de psychiatrie franais Angers, 1927. Quand le bras d'Agathe est mis en l'air et qu'il reste dans cette position, on peut le charger de divers objets sans qu'il tombe : je lui ai fait porter un volume in-8 sans qu'il tombt, les contractions musculaires s'adaptaient aux changements du poids. J'ai not que les habitudes et les sentiments de la malade jouaient un rle dans ces attitudes catatoniques. Quand j'ai cess de voir la malade frquemment et quand elle est devenue moins familire avec moi, elle a cess de prsenter ces attitudes catatoniques quand je soulevais le bras. Mais ce moment elle est devenue catatonique pour Arnaud qu'elle voyait tous les jours : il faudrait tudier ces modifications de la catatonie chez les dments prcoces en relation avec les modifications de leurs sentiments. Enfin j'ai signal ce congrs un autre petit fait : l'attitude catatonique provoque par une personne persiste trs longtemps tant que cette personne reste dans la chambre et tant que sa prsence est perue par la malade, elle cesse brusquement si cette personne sort de la chambre et observe l'insu de la malade. Je ne crois pas qu'il faille parler ce propos de croyances et de suggestions comme dans les cas de catalepsie, cette malade trs dmente n'est gure prcisment suggestible, il s'agit mon avis de phnomnes psychologiques infrieurs au niveau de la croyance. Si on veut bien y rflchir, il est facile de constater que nous avons une disposition naturelle la catatonie et qu'il y a chez l'homme normal la mme rgulation qui amne la permanence des attitudes. je sors pour mettre une lettre la poste et je tiens cette lettre entre le pouce et l'index de la main gauche, mais en rentrant aprs quelque temps je constate que j'ai oubli de jeter cette lettre dans une bote lettres et que je la tiens toujours entre deux doigts de la main gauche. Il y a, dira-t-on, une distraction qui m'a empch de faire l'acte de mettre la lettre la poste, mais il faut aussi noter que mes doigts ont conserv exactement, mon insu, la mme position, puisque la lettre n'est pas tombe. A chaque instant nous constatons que depuis quelque temps une main est reste immobile dans une poche en tenant un morceau d'toffe ; nous conservons trs souvent des positions identiques sans nous en apercevoir. Ce qui distingue l'homme normal du malade que nous appelons catatonique, ce n'est donc pas que chez l'homme normal fasse dfaut cette tendance
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
78
la permanence des attitudes, c'est qu'il a bien plus souvent d'autres ractions qui inhibent cette rgulation la permanence et qui changent l'attitude. Nous surveillons davantage nos attitudes car nous avons besoin d'viter les poses ridicules et d'adapter chaque instant nos membres des mouvements ncessaires. Les malades ont beaucoup moins cette surveillance et toutes les circonstances qui diminuent encore la surveillance ou qui l'veillent momentanment augmentent ou diminuent la disposition la permanence des attitudes. La malade dont je viens de parler, Agathe, s'abandonne avec plus de confiance quand elle est en prsence d'un mdecin qu'elle connat beaucoup, se surveille un peu plus quand elle le connat moins et toutes les modifications des sentiments, tous les veils d'intrt des actions nouvelles modifient la catatonie. L'tude de ce singulier symptme nous a montr que l'une des rgulations les plus lmentaires du mouvement est celle du maintien des attitudes. Il faut y ajouter une raction qui maintient le mouvement dans la mme direction et qui rtablit avec une sorte d'obstination cette direction quand elle a t accidentellement modifie. Considrons un poisson qui avance dans l'eau dans une certaine direction, le mouvement des vagues le dplace continuellement et devrait chaque instant modifier cette direction. Cependant le sens de la natation reste le mme, car la direction est chaque instant redresse et maintenue telle qu'elle tait primitivement Ce sont l sous trois formes les premires rgulations du mouvement qui se joignent au sens de l'quilibre et qui sont le point de dpart des rgulations de plus en plus intelligentes de la direction.
-2La direction en avant.
Retour la table des matires
Cette direction qu'il faut rtablir et conserver comment est-elle tablie ? Nous venons de dire qu'il y a bien des progrs dans l'tablissement de la direction, il y a donc une premire direction lmentaire au point de dpart de ces progrs, nous l'appellerons la direction directe. Cette direction simple et directe du mouvement est dtermine avant tout par la forme du corps des tres vivants et par l'organisation des premiers rflexes. De bonne heure les corps vivants ont prsent deux extrmits : une tte et une queue, une pointe antrieure dans une partie du corps et une pointe postrieure dans une autre. Les premiers rflexes sont organiss de telle manire que le corps et la queue suivent la pointe antrieure et marchent dans la mme direction o elle est tourne, o elle avance. Il n'est pas toujours facile de dire exactement o est la pointe dans la tte : chez les animaux infrieurs comme chez les vers, la pointe est bien sa place
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
79
au bout de la tte, mais chez des tres suprieurs il y a bien des organes accessoires, les oreilles, les yeux, le crne qui sont venus embrouiller les choses et qui semblent dborder la pointe. je crois que malgr les apparences nous avons encore une pointe qui n'est pas tout fait sa place, cette pointe c'est le bout du nez. Il y a l une petite boule qui m'intresse, elle ne sert pas prcisment la respiration, car les narines s'arrtent avant cette petite boule, la peau de cette petite boule est particulirement sensible, presque autant que l'extrmit de l'index et cette sensibilit est chez nous superflue, car nous n'avons plus l'habitude de fouiller dans notre assiette avec le bout du nez. Cette petite boule est chez l'homme un organe rsiduel comme les mamelles chez l'homme qui ne sait plus s'en servir. C'est un reste du museau du chien, du groin du porc, du petit doigt au bout de la trompe de l'lphant, c'est un organe qui a t essentiel et qui ne l'est plus, car tout passe. La premire organisation rflexe de la direction tait dtermine par les impressions au bout du nez. Les rflexes taient disposs de telle manire que tout le corps suivait la direction du bout du nez qui, tantt se portait vers un objet intressant, tantt se dtournait d'un contact dsagrable. La raison principale de la direction de la pointe et du nez, c'est la conservation et l'augmentation d'une stimulation agrable ou importante. La pointe se dirige de telle sorte que l'odeur intressante soit la plus forte possible et que sa force aille en augmentant. On pourrait, ce propos, tudier les lois des tropismes de Loeb qui s'appliquent bien aux organismes lmentaires. D'autres organes des sens, ceux des oreilles et surtout des yeux, sont venus compliquer les choses. Un physiologiste, qui s'occupait surtout de la vue et de l'ophtalmologie, M. Nuel, s'est beaucoup intress ces premiers rflexes de direction dans un livre remarquable encore important consulter aujourd'hui, La vision, 1904. Cet ouvrage est crit d'une manire qui nous semble bizarre. L'auteur a voulu, ce qui se comprend, expliquer tout par des mouvements, sans faire intervenir la conscience et il a voulu supprimer toutes expressions qui rappelaient des faits de conscience. Aussi a-t-il d se forger un langage, au premier abord difficile comprendre : au lieu de dire le toucher, il dira tangoraction ; au lieu de dire la vue, il dira photo-raction, il faut s'habituer ce langage. M. Nuel nous explique trs bien que les rflexes de l'odorat, de l'oue, de la vue se sont coordonns avec les rflexes du toucher au bout du nez, et le corps tout entier s'est habitu suivre la direction que prenaient les yeux. C'est ce que M. Nuel appelle les projections radiaires, les projections des sensations l'extrmit des rayons visuels, surtout quand les deux yeux convergent et le mouvement de tout le corps dans cette direction. Quand la lumire manant d'un objet vient exciter un point d'une rtine, l'il a un premier rflexe, il se meut de manire amener la stimulation sur le foyer, sur le point de la plus grande sensibilit rtinienne ; un second rflexe amne la convergence des yeux dans la mme direction, Ce temps-l est un peu diffrent chez les animaux qui ont les yeux des deux cts de la tte et qui ne convergent pas Comme nous. Un troisime rflexe amne la direction de la pointe, c'est--dire du bout du nez, par un mouvement de la tte dans le mme sens. Enfin, nous revenons aux anciens rflexes qui faisaient marcher tout. le corps dans la direction de cette ancienne pointe et tout le corps se dirige vers l'objet qui a provoqu la stimulation visuelle. Cette direction est maintenue et perfec-
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
80
tionne par un ensemble de conduites rflexes que l'on runissait autrefois sous le nom de sens musculaire ou sens kinesthsique, et qui ne sont pour moi que des rflexes de maintien et de rtablissement de la direction directe. Les choses vont s'embrouiller quand une difficult trs particulire va se prsenter, c'est ce que nous pourrons appeler la difficult de l'obstacle. Nous venons de voir que tous les objets ne dterminent pas des conduites d'attraction, ne donnent pas naissance des mouvements de l'ensemble du corps vers l'objet, comme les grains placs devant les yeux de la poule. Il y a bien des objets qui dterminent des rflexes inverses, de fuite ou d'cartement. Un lapin qui voit ou qui sent le renard n'avance pas vers lui, il s'enfuit. La plupart des tres vivants sont construits de manire ne pas craser leur nez contre des objets durs, ils ne se lancent pas en avant contre des rochers, contre un mur, contre un arbre. Avez-vous remarqu comme dans la rue nous vitons habilement de nous cogner contre les becs de gaz ou contre les boutiques et cela sans rflexion, instinctivement ? Ces deux conduites de la direction vers certain, objets et de l'cartement loin d'autres objets sont bien simples quand elles se prsentent sparment. ce qui arrive d'ordinaire. Mais il y a un cas trs curieux dans lequel les choses s'embarrassent, c'est dans les cas de la transparence de l'obstacle. J'ai toujours t tonn que les psychologues ne se soient pas intresss davantage au problme de la transparence et de l'opacit ; de mme, comme je vous le dirai plus tard, qu'ils ne se sont pas occups suffisamment de l'absence et de la prsence, il y a l de jolies tudes faire. Qu'est-ce que c'est qu'un obstacle transparent ? C'est toujours un obstacle, un objet qui arrte le mouvement en avant et qui rend impossible la direction en avant vers l'objet. Mais ce n'est un obstacle que pour le mouvement du corps, ce n'est pas un obstacle pour les perceptions, il laisse passer les odeurs, les sons et surtout les rayons lumineux ; ce sera une glace ou un grillage qui laisse passer les odeurs et surtout les rayons lumineux mais qui arrte les mouvements en direction directe vers l'objet. Cet obstacle transparent est philosophiquement trs grave : les premiers rflexes olfactifs ou visuels sont constitus non seulement par la stimulation visuelle, mais par la raction motrice correspondante. Il n'y a pas de sparation entre la sensation et le mouvement, comme les philosophes l'ont invent ou plutt il n'y a pas de sensation telle que l'imaginait Condillac. Le rle de l'obstacle transparent est de sparer les deux choses ou plutt de provoquer la premire excitation de l'tre rflexe qui consiste aller vers l'objet et le saisir, mais sans pouvoir arriver la consommation de cette tendance. C'est ce qui a appris aux hommes qu'il y a loin de la coupe aux lvres, qui lui a fait dire le vers clbre ! "Tout objet que la main n'atteint pas n'est qu'un rve." Cela a t le point de dpart de la distinction de la ralit et du rve, cela a permis la cration de la sensation. Cet obstacle transparent chez des tres inintelligents amne tout simplement la suppression de la direction directe en avant. Vous connaissez l'histoire du brochet et du petit poisson qui est dans tous les manuels de psychologie. Le brochet a la mauvaise habitude de se prcipiter sur tous les petits poissons qu'il voit et de les dvorer, c'est l'instinct et la direction directe. On a mis dans
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
81
le mme aquarium un brochet et un petit poisson, mais on les a spars l'un de l'autre par une glace transparente. Le brochet s'est prcipit et il s'est cras la pointe du nez contre la glace. Aprs bien des tentatives et des meurtrissures de ce genre, le brochet cessa compltement de se prcipiter contre le petit poisson. A ce moment, on enleva la glace qui divisait en deux l'aquarium et le petit poisson eut tout de mme la vie sauve, car le brochet avait perdu le rflexe de la direction directe contre lui. C'est l le rsultat de l'obstacle transparent chez les animaux sans intelligence. Le dbut de l'intelligence s'annonce par l'apparition d'une autre raction qui est celle du dtour.
-3Le dtour.
Retour la table des matires
L'acte qui intervient dans cette circonstance dramatique est l'acte du dtour, trs intressant pour nous parce qu'il est peut-tre le plus simple des actes intelligents et qu'il peut nous montrer des caractres importants qui vont plus ou moins se retrouver dans tous les autres.
Autrefois dans mon premier cours de 1913 sur ces questions de l'intelligence lmentaire, j'ai dj tudi le dtour, mais je dois vous recommander surtout le livre de M. Khler sur l'intelligence des singes suprieurs o cette tude donne lieu des expriences bien intressantes. "L'exprimentateur, ditil, cre une situation de ce genre o la voie directe vers le but n'est pas praticable, mais qui laisse ouverte une autre voie indirecte. L'animal est plac dans une situation dont il doit avoir autant que possible une perception
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
82
d'ensemble, il doit alors montrer qu'il sait rsoudre le problme par le moyen dtourn qu'on lui laisse" 1. Voyons d'abord la disposition matrielle de l'exprience (fig. 3) : On placera les animaux le long d'un mur infranchissable en A, devant eux sera une grille et devant ce grillage on placera l'appt en B, des grains, un morceau de viande ou, quand il s'agit de singes, une banane ou des quartiers d'orange dont ils sont trs friands. Du ct droit de cette grille sera un obstacle C qu'au dbut nous ferons galement transparent, un petit mur par dessus lequel les animaux peuvent voir ou, si vous voulez, une cage galement en treillage transparent. Pour avoir l'appt, l'animal ne doit pas aller directement en avant, il doit se retourner en arrire et contourner l'obstacle.
Cette exprience a t reprise et singulirement complique par deux psychologues franais, MM. Paul Guillaume et Ignace Meyerson, qui ont publi leurs recherches sous le nom de "Dtour avec des instruments", dans le journal de psychologie du 15 mars 1930, p. 230. Ces auteurs ont utilis pour ces expriences les singes du Musum de Paris et ceux de l'Institut Pasteur. Ces sujets sont capables de se servir d'un bton ; nous reverrons plus tard cet usage du bton avec dtails quand nous parlerons de l'outil ; pour le moment admettons-le comme un fait. Ce n'est plus le singe lui-mme qui doit faire un dtour pour atteindre la banane, c'est la banane qu'il faut faire faire un dtour en la poussant avec le bton. L'exprience, en effet, est dispose de la manire suivante le singe est enferm dans sa cage en A (fig. 4), il ne peut pas sortir, mais il a un bton la main ; devant la cage est place une bote ouverte en B dont les parois latrales sont assez hautes pour qu'il soit impossible de les faire franchir la banane, mais dont la paroi du fond est enleve. Il faut, avec le bton, non pas l'attirer soi, car la paroi de la bote s'y
Khler, L'intelligence des singes suprieurs, traduction franaise de M. Guillaume, 1927, p. 4.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
83
oppose, mais la pousser d'abord loin de soi pour la faire sortir par le fond, la faire contourner la bote et la ramener enfin dans la cage.
Dans ces conditions, comment les animaux vont-ils se comporter ? Remarquons d'abord un gros fait trs important : il y a de nombreux animaux qui ne peuvent rien comprendre ce qu'on leur demande ; des moutons, des chevaux ne savent pas se tirer d'affaire. je n'affirme rien de net pour des chevaux, je ne sais pas si l'exprience a t faite, je suis dispos croire qu'elle ne russirait pas. M. Khler a surtout expriment avec des poules qui, je le rpte, ont montr peu de gnie. La poule qui voit du grain travers le grillage se prcipite tout droit vers lui ; elle butte contre le grillage, mais elle ne fait rien de plus, elle continue pousser devant elle. La dception lui cause une certaine agitation, elle bat des ailes, saute sur le grillage et mme elle court droite et gauche par simple agitation. Il peut arriver qu'aprs un temps assez long la poule agite finisse par dpasser en arrire l'obstacle et alors le contourne (fig. 5). Mais ce n'est pas la solution du problme du dtour, le mouvement correct est survenu par hasard, uniquement sous la pousse de l'instinct primitif de la direction directe. Ces animaux n'ont pas le dtour et ne manifestent pas ce premier degr de l'intelligence lmentaire. Heureusement d'autres animaux se comportent tout fait autrement. Le chien, en gnral, n'a pas d'hsitation, il embrasse la situation d'un coup d'il et rsolument tourne en arrire, l'inverse de la direction primitive, contourne l'obstacle et va manger le morceau de viande. Quant au singe et surtout au chimpanz, notre cousin germain, il est magnifique : cette exprience n'est pour lui qu'un jeu, il est capable, comme nous le verrons, de faire bien d'autres choses plus merveilleuses. Notons seulement ici qu'il se tire bien d'affaire dans l'exprience du tiroir : avec son bton il pousse la banane au fond, la fait sortir, lui fait longer le tiroir, l'attire ensuite dans la cage et enfin la mange avec satisfaction. On lui a jou tous les tours possibles, on met la banane dans un vrai labyrinthe dont il faut lui faire suivre les dtours, on a mis des trous qu'il faut faire viter la banane sous peine de la perdre ou de retourner en arrire comme au jeu de l'oie, le chimpanz fait tout ce que l'on veut. Il ne s'agit plus ici de mouvements fortuits comme dans le cas de la poule, il n'y a plus les oscillations latrales indfiniment prolonges du dbut, il y a un mouvement unique, continu, sans interruption, jusqu'au but ; la solution semble tre apparue complte tout d'un coup. N'oublions pas que ces expriences ont t reproduites sur des petits enfants : une enfant de deux ans et une autre
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
84
petite fille d'un an et trois mois se comportrent aussi bien qu'un chimpanz, nous pouvons tre fiers. M. Khler, en relatant ces expriences, fait jouer un rle considrable au sens de la vue. Il remarque qu'une des conditions essentielles du succs c'est que l'appt reste toujours visible malgr l'obstacle. Si l'obstacle est opaque sur une partie plus ou moins considrable du trajet du dtour, il y a des animaux qui se perdent en route ou bien qui oublient de quoi il tait question, qui jouent sur le chemin avec un objet quelconque ou oublient la banane, comme le petit chat qui laisse la feuille avec laquelle il joue pour courir aprs une autre. Mais un grand nombre d'animaux russissent trs bien malgr l'opacit de l'obstacle. jetez un chien qui est dans la chambre un morceau de viande par la fentre, beaucoup de chiens sont parfaitement capables de courir la porte, de descendre l'escalier et de courir sous la fentre prendre la proie. Beaucoup d'animaux intelligents acceptent de grands dtours. Je me rappelle une observation de M. Revault d'Allonnes : son chien gmissait en le voyant sur le haut d'un talus qu'il ne pouvait grimper, il s'lana sur le chemin jusqu' une grande distance o le talus s'abaissait, put alors monter et rejoindre son matre aprs une course assez longue. Dans ces cas une reprsentation visuelle de l'objet doit persister malgr l'absence de perception actuelle de l'objet. M. Khler insiste beaucoup sur cette persistance de la vision de l'objet en mme temps que la vision de l'obstacle. C'est cette simultanit des deux visions qui permet de percevoir ce qu'il appelle la structure de la situation. M. Khler se rattache une cole de psychologie allemande trs intressante qui s'appelle la thorie de la forme, "gestalt theorie", que nous aurons tudier particulirement. Il y a l sans doute, dans cette vision des deux choses, un lment important du problme. Je crois qu'il ne faut pas tre satisfait trop vite, d'autres sens, d'autres reprsentations comme celles de l'odorat peuvent jouer le mme rle que la vision. D'ailleurs, il est vident que la vision ne suffit pas : les poules, quand l'obstacle est transparent, ont parfaitement et dans tout le trajet la vision de l'appt et de l'obstacle et elles n'y comprennent rien. Dans d'autres cas l'obstacle qui a t visible peut avoir des limites moins nettes et disparatre, au moins en apparence, sans que cela supprime le dtour. Un renard veut prendre une poule, c'est l'aspect visible au dbut ; mais il aperoit aux environs un homme arm d'une fourche, ce qui ne lui dit rien qui vaille. Il fait de grands dtours sans longer l'obstacle, il change d'attitude, il se cache, il se faufile et il arrive prendre la poule sans recevoir un coup de fourche, c'est bien compliqu comme combinaison visuelle. Il faut constater ici un fait psychologique essentiel, quitte ne pas le comprendre ; comme nous verrons ce fait peu prs chaque leon, nous aurons peut-tre l'occasion de l'approfondir un peu. N'oublions pas que la situation cre par nous et qui n'est pas trs frquente dans la nature, celle de l'obstacle transparent, met en prsence deux tendances opposes : la premire est la tendance la direction directe vers l'objet, la seconde est la tendance s'carter de l'obstacle.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
85
Ces deux tendances sont dj plus compliques qu'on ne le croit et leur conservation au cours d'un long trajet ne se fait pas facilement. Si je ne craignais de trop compliquer ces premires tudes, je vous dirais que la conservation de la direction directe exige dj des changements perptuels de cette direction. Ds que l'animal a couru dix pas en arrire ou du ct droit, la direction de la banane n'est plus la mme. Il faut qu'il y ait en lui des mcanismes qui modifient cette direction primitive suivant tous les mouvements qu'il fait. M. Sherrington nous faisait dj remarquer que le mouvement de porter la main la bouche ne peut pas tre le mme quand notre bras est en l'air, ou quand il est en bas, ou quand la main est dans notre dos. Il faut, chaque instant, adapter cette direction et nous devrions, propos de cela tudier ce qu'on appelait autrefois le sens musculaire, le fameux sens kinesthsique que je vous ai propos de comprendre d'une tout autre manire, comme un ensemble de rflexes rgulateurs. La perception de l'obstacle est elle-mme complique et quand le renard s'loigne trs loin de l'homme la fourche, il a une notion de l'obstacle toute spciale. Quoi qu'il en soit, il y a des animaux, comme les poules, chez qui ces deux tendances restent isoles, en opposition l'une avec l'autre. C'est toujours l'appareil distributeur de la gare dont un bouton donne des pastilles de chocolat et l'autre des bonbons aciduls. La poule n'est pas capable, comme le petit garon, de trouver la marchande intelligente qui donnera dans un seul sac un mlange des deux. D'autres animaux se comportent comme la marchande, ils mlangent les deux. Dans mes cours sur la mmoire, j'ai tudi les actes de l'attente, les actes de la recherche, les actions diffres, etc., qui, sous diverses formes, ralisent cette combinaison. Le dtour nous montre la premire et peut-tre la plus simple de ces combinaisons. Peut-tre nous rvle-t-il ds le dbut un caractre essentiel de l'intelligence.
-4Le renversement de la direction.
Retour la table des matires
L'tude du trajet et mme du dtour ne suffit pas pour nous expliquer la direction intelligente ; une petite observation mdicale sur laquelle il faut revenir va nous montrer une nouvelle complication du problme. Il y a bien des annes j'ai eu l'occasion d'observer un cas que je trouve fort curieux, qui, en tous les cas, doit tre rare, car je ne l'ai vu qu'une seule fois. Une jeune femme de 29 ans, que dans l'article o j'ai eu l'occasion de parler d'elle (journal de Psychologie, mars-avril 1908), je dsigne par les lettres Wyx..., est venue se plaindre en disant : "qu'elle n'tait pas trs malade, mais
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
86
qu'elle tait cependant trs malheureuse parce qu'elle tait toujours l'envers". - "je ne demande pas mieux, lui dis-je, que de vous remettre l'endroit, si c'est possible ; mais il faudrait d'abord savoir ce que vous appelez tre l'envers." Voici ce qu'elle ressent : dans quelque endroit qu'elle aille, qu'elle marche pied ou qu'elle soit en voiture, elle a le sentiment qu'elle avance dans une direction tout fait oppose celle qu'il faudrait rellement prendre pour se rendre l'endroit o elle veut aller ; en ralit, elle suit la direction correcte qu'on lui indique ou que lui indique le nom des rues, elle se laisse entraner sans protester par la voiture, mais elle en souffre, car elle a tout le temps le sentiment que cette direction qu'on lui impose est fausse et qu'il faudrait avancer dans la direction tout fait oppose, en sens inverse. Ce sentiment, en apparence absurde, a commenc subitement un soir, en rentrant chez elle, aprs un long et fatigant voyage en chemin de fer, peu de temps aprs un accouchement. Il s'est prolong d'abord six mois, puis un sjour dans une campagne qu'elle ne connaissait pas du tout l'a rtablie pour dix-huit mois. Plus tard, aprs un nouveau voyage pnible, le sentiment de renversement a recommenc et il dure depuis plus d'un an. Des observations mdicales de ce genre sont loin d'tre inconnues. je rappelle surtout une tude remarquable du professeur A. Pick, de Prague, en 1908, publie en rponse mon article. Pick rappelait dans la littrature mdicale plusieurs cas de ce genre, puis il dcrivait plusieurs observations personnelles fort intressantes. D'ailleurs, ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'observation de Wyx... c'est la persistance et la longue dure du trouble, car nous avons peu prs tous prouv de temps en temps un sentiment analogue. Quand j'ai parl de ce fait au Collge de France, plusieurs de mes auditeurs se sont hts de m'crire pour me raconter ce qu'ils avaient prouv du mme genre ; pour ma part je l'ai constat bien des fois. Quand je sors d'une bouche de mtropolitain, surtout si j'ai lu pendant le trajet, sans m'occuper des stations, je me sens l'envers, j'ai envie d'aller d'un ct et l'intelligence, le nom des rues me montrent qu'il faut aller de l'autre ct. Souvent en chemin de fer, surtout la nuit, je suis ennuy parce que le train marche l'envers et nous ramne notre point de dpart. Vous pourriez tous certainement retrouver dans votre mmoire de telles impressions. D'ordinaire ces impressions sont trs passagres, tandis que j'ai pu examiner loisir la malade dont je vous parle. Cet examen, cependant, tait loin d'tre fructueux, car j'ai cherch en vain chez elle un autre trouble de la sensibilit ou du mouvement qui pt tre mis en relation avec le premier. Toutes les sensibilits taient normales ; j'ai mme pu, en plaant la malade sur la plaque tournante de Mach, contrler qu'elle sentait parfaitement, les yeux ferms, toutes les rotations et tous les arrts. Les explications de ce sentiment qui ont t donnes et que je ne peux vous rappeler toutes ne me satisfont gure. Binet, en particulier, en 1894 et 1895, disait qu'il s'agit simplement d'une erreur d'orientation, quand on ne sait plus exactement dans quelle direction est le point o on veut aller. Cela me parat trs inexact : ces malades ne sont pas mal orients, ils savent trs exactement la ligne de la direction, ils ne la placent pas inexactement ; mais c'est leur mouvement sur cette ligne qu'ils renversent, ils n'orientent pas mal, ils orientent l'envers, ce
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
87
qui n'est pas la mme chose. Il est bien vident que chez la jeune femme dont je parle, aprs un accouchement rcent et un voyage fatigant, il y a eu un trouble nvropathique, une persvrance de l'impression analogue une suggestion et une obsession, mais cela n'explique pas le sentiment initial de renversement qui est devenu une obsession. Il s'agit bien d'un trouble dans la marche vers un certain point, car il n'y a pas de trouble si elle ne songe pas sortir pour aller quelque part, c'est quelque chose dans la direction de la marche qui est troubl. Cela nous apprend d'abord qu'il y a dans la direction d'autres lments que ceux qui viennent d'tre dcrits, d'autres lments que le trajet de dtour lui-mme. Oui, il y a autre chose que le trajet lui-mme, il y a le sens dans lequel on le parcourt, car un trajet quelconque peut tre parcouru dans deux sens. On peut aller de notre situation initiale vers l'objet, quand le singe va de sa place vers la banane, et on peut aller de l'objet vers notre place initiale, quand le singe rapporte la banane dans sa cage. Nous pouvons mme remarquer que nous venons de voir les deux formes du trajet : le singe de M. Khler va dans le premier sens vers la banane, les singes de MM. Guillaume et Ignace Meyerson sont dans le second sens quand ils font revenir la banane avec un bton. Ces observations, mme si nous ne les comprenons pas, nous instruisent et nous font connatre un lment curieux du trajet encore plus intellectuel peuttre que le dtour, c'est l'aller et retour. Le billet d'aller et retour des chemins de fer correspond une notion intellectuelle trs remarquable. Mais, me direz-vous, l'aller et retour dont vous parlez n'est pas une chose si remarquablement intelligente, cette action existe partout. Les poules que vous avez trouves si btes et les pigeons qui ne sont pas beaucoup plus malins savent sortir de leur poulailler ou de leur nid le matin et y retourner le soir. Tous les animaux qui ont des petits savent s'loigner d'eux pour chercher la pture et la leur rapporter. Au risque de vous paratre manier le paradoxe je vous dirai que je ne suis pas sr que l'oiseau sache prendre un billet d'aller et retour. Entendons-nous, je veux bien que le pigeon ait un aller, un dpart caractris mme par une certaine tristesse ; je veux bien qu'il ait un retour avec mme une certaine joie ; mais ce dont je doute, c'est qu'il ait un aller-retour, qu'il runisse en un seul et mme acte ces deux actions de l'aller et du retour. Pour qu'il y ait cette runion il faudrait me prouver que le pigeon rpte exactement, mais l'envers en revenant, le mme trajet en rptant les mmes dtours, mme s'ils sont devenus inutiles, qu'il fait des efforts pour chercher les rpter. Il est probable que pour lui l'aller et le retour sont des actes successifs, diffrents les uns des autres, dtermins chacun son heure par des stimulations diffrentes et que ce n'est pas un seul et mme acte renvers. Il n'y a qu'un exemple dans lequel un insecte semble chercher un retour de ce genre. Si vous lisez l'article de M. V. Cornetz sur l'orientation dont je viens de vous parler 1, vous verrez que la fourmi au retour, arrive une certaine distance de la fourmilire, cherche une piste ayant servi des allers et qu'elle la prend pour un retour. Mais les fourmis sont, comme nous le verrons, capables de tant de choses extraordinaires.
1
V. Cornetz, Orientation, direction, Journal de psychologie, 15 mai 1929, p. 375.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
88
Chez les hommes il n'y a plus de doute, le meilleur exemple de l'allerretour c'est l'histoire du petit Poucet que ses parents veulent perdre dans les bois et qui, en allant, sme sur son passage des petits cailloux afin de retrouver la mme piste au retour. Ce qui prouve cette union en un seul acte de l'aller et du retour c'est l'observation de notre malade l'envers, elle runit si bien l'aller et le retour qu'elle les confond ou plutt les renverse. Nous faisons un progrs dans son interprtation en constatant que son trouble consiste non dans un dfaut d'orientation, mais dans une confusion de l'aller et du retour, dans une direction qu'elle connat trs bien, mais dont elle ne distingue pas bien le sens.
-5La droite et la gauche.
Retour la table des matires
Ce n'est qu'un pas dans l'interprtation, car ordinairement les hommes distinguent l'aller et le retour. Comment s'y prennent-ils et qu'est-ce qui manque notre malade ? Il y a videmment de petits signes qui nous indiquent que c'est l'aller ou que c'est le retour, quand l'objet vers lequel on se dirige reste visible, et nous avons vu l'importance de cette visibilit. Quand nous allons, l'objet est devant nous, quand nous revenons l'objet est derrire nous et nous ne le voyons qu'en nous retournant. Quand on avance vers lui l'objet grandit, quand on s'en loigne il diminue. Mais prcisment le problme de l'aller et du retour ne se pose que dans des trajets assez longs o l'objet cesse d'tre visible. Je crois qu'il faut tenir compte d'une chose trs importante dont nous n'avons pas encore parl propos de la direction, je veux parler des objets latraux que l'tre vivant touche, sent et surtout voit ses cts pendant qu'il avance dans un sens ou dans l'autre. Sans doute les objets latraux restent les mmes dans l'aller et dans le retour puisque nous avons admis que la direction restait la mme, mais il y a une diffrence capitale. Quelle est donc cette diffrence ? Une seule et elle est simple : cette diffrence, c'est que les objets ne sont pas les mmes droite qu' gauche dans l'aller et dans le retour. Quand nous entrons dans notre appartement, nous avons certains objets droite et nous en avons d'autres gauche et quand nous sortons de l'appartement les objets sont renverss : ceux qui taient droite se placent gauche. C'est cette modification de la situation droite et gauche
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
89
qui est le seul moyen que nous ayons de nous orienter dans un trajet dont nous ne voyons pas le terme. Nous voici amens devant la fameuse opposition du ct droit et du ct gauche qui est bien, si j'ose ainsi dire, la croix des philosophes, car il n'y a rien de plus obscur que cette singulire proprit de l'espace de donner naissance un ct droit et un ct gauche. Rappelonsnous seulement que, grce aux trois dimensions de notre espace, nous pouvons tourner sur nous-mmes et qu'en tournant nous changeons la place des trois dimensions. En me tournant droite, je mets ce qui tait en avant ma gauche et en tournant encore d'un quart de cercle je mets ma gauche ce qui tait ma droite. En un mot, en nous tournant de 90 nous avons chang tous les objets droite en objets gauche et rciproquement. La distinction de l'aller et du retour est lie la distinction du ct droit et du ct gauche et si vous voulez me montrer l'aller et le retour chez des animaux, il faudra me montrer chez ces animaux la distinction du ct droit et du ct gauche. Sans doute les animaux sont capables de tourner dans l'espace, comme ils sont capables de revenir au nid, mais ils font le mouvement de tourner sans en prendre conscience, sans se rendre compte que le mouvement aprs avoir tourn se fait dans la mme direction, mais l'envers. C'est, je crois, l'historien anglais Carlyle qui a le mieux philosoph sur ce qu'il appelle la plus ancienne institution humaine celle qui distingue la main droite de la main gauche. Il y a, dit-il en 189 1, des actes sociaux comme celui de faucher un champ qui seraient impossibles si tous les moissonneurs n'avaient pas la main droite du mme ct. Nous arrivons une conclusion singulire : la notion d'aller-retour qui est un caractre de l'intelligence lmentaire dpend de la distinction du ct droit et du ct gauche et celle-ci devient un signe net d'intelligence. Les animaux obligs de marcher sur leurs pattes n'ont gure que des mouvements symtriques. Il me semble qu'on ne nous a pas suffisamment montr si les singes suprieurs ont une main droite et une main gauche ; il est probable que la distinction doit commencer chez eux avec les dbuts de l'intelligence. Cette distinction devient complte chez l'homme qui n'est pas identique des deux cts. Avez-vous remarqu que le ct gauche de la tte, notre oreille gauche en particulier, est plus perfectionn, mieux fait et plus sensible que le ct droit de la tte ? Puis la division se poursuit en changeant de ct et le ct droit du corps est plus parfait, plus sensible et prsente des mouvements plus forts, plus prcis que le ct gauche. Le petit bb a d'abord des mouvements symtriques, puis il apprend les sparer et il arrive la supriorit du ct droit. Quelles que soient les raisons assez nombreuses et diffrentes que l'on a donnes de cette supriorit du ct droit, il ne faut pas oublier qu'il y a l un progrs dans la distinction des proprits de l'espace et une forme de l'intelligence. Or, tout justement la pathologie nous apprend qu'il y a trs souvent chez des malades des troubles dans la distinction du ct droit et du cot gauche, ce sont les troubles que l'on dsigne sous le nom d'allochirie (autre main). Leur tude a commenc avec les travaux de Hammond 1879, de Obersteiner (de Vienne) en 1881, de Weiss 1891, de Bosc 1892. Permettez-moi de vous rappeler mes propres tudes sur ce curieux phnomne en 1890, 1892, 1898, puis prennent place les articles de Head, 1906 et l'tude de M. Jones dans le Brain, 1907, qui rpond en partie la mienne.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
90
Il est impossible de reprendre maintenant l'tude de l'allochirie qui est si intressante et que je vous invite continuer car il y a encore bien des choses comprendre et les dcouvertes que l'on pourra faire auront des consquences normes non seulement pour l'tude de l'intelligence, mais pour l'tude de l'espace. Rappelons seulement le caractre essentiel des cas typiques, tels qu'ils taient dans mon observation d'une malade dsigne par M... (Stigmates mentaux des hystriques, 1893, p. 67 ; Nvroses et ides fixes, 1898, I, p. 234). Le sujet paraissait avoir une sensibilit peu prs normale, il distinguait les piqres et les contacts faits sur son poignet et il les localisait bien puisqu'il disait : "vous me piquez sur la main, vous me touchez sur le poignet". Mais quand on posait une question de plus : "sur quel poignet vous ai-je touch ?" il rpond toujours, et ce qui est bizarre, il rpond toujours faux. Quand il s'agit du poignet droit il dit toujours poignet gauche et quand il s'agit du poignet gauche il dit toujours poignet droit. Je crois avoir fait faire cette poque un petit progrs cette tude en montrant que cette erreur bizarre avait des degrs, que les sujets commenaient par confondre compltement la droite et la gauche dans ce que j'appelais la synchirie. Mais comment et pourquoi les sujets en arrivent-ils, aprs avoir mlang leurs deux cts, les renverser et mettre rgulirement l'un la place de l'autre ? Mes anciennes explications donnes en 1892 dans ma thse de mdecine me paraissent aujourd'hui bien insuffisantes. je compte sur vous pour les reprendre et les complter. Pour le moment nous ne devons tirer qu'une seule conclusion, c'est qu'il y a une relation trs troite entre les symptmes de l'allochirie et le singulier renversement de la direction que nous venons de constater chez notre malade Wyx. Celleci nous dit : "je suis l'envers, je sens que je sors de la Salptrire quand j'y entre." Faisons une remarque sur la porte d'entre de la Salptrire : celle-ci est assez monumentale et des deux cts de la grande porte il y a deux grands murs blancs ; sur l'un de ces murs, gauche quand on entre, il y a une statue de Charcot, sur l'autre mur, droite en entrant, il n'y a que des affiches. je demande alors cette femme : "Quand vous entrez l'hpital, de quel ct est la statue de Charcot ?" Elle n'hsite pas du tout et me rpond : "Elle est droite. - Mais non. - Ah ! je sais bien que je l'ai vue gauche, mais c'est ce qui m'a renverse, je la croyais droite." Par consquent, nous avons maintenant un commencement d'explication de l'illusion du renversement. Ces gens-l se reprsentent droite ce qui est gauche et gauche ce qui est droite ; ils renversent les objets, non pas d'une manire vague mais par rapport au ct droit et au ct gauche. Wyx..., quand elle vient l'hpital, s'attend trouver la statue de Charcot sa droite, c'est ce qu'elle appelle entrer la Salptrire ; or, en arrivant elle voit la statue sa gauche, comme elle est rellement : elle a alors le sentiment de sortir et elle dit qu'elle est l'envers. Remarquez, en effet, que cette malade, diffrente en cela de M..., n'a pas d'allochirie dans les perceptions. Elle dit bien qu'elle est pique droite quand on la pique droite, elle place bien droite un objet qu'on lui montre rellement droite. C'est parce qu'il y a une opposition entre sa reprsentation et sa vision qu'elle se sent l'envers.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
91
Nous avons tous un besoin perptuel de mettre un certain accord entre nos reprsentations des lieux et nos perceptions. Quand je marche vers le Collge de France, en traversant le Boulevard Saint-Michel, je me dis instinctivement : "le Palais de Justice est ma gauche, le Luxembourg est ma droite" et je suis satisfait en constatant que c'est exact, ce qui me garantit le bon sens de ma marche. La pauvre humanit fait ainsi un effort perptuel pour se raccrocher ce qui est rel et pour ne pas trop s'garer dans ses rves, mais elle n'y russit pas toujours. J'ai beaucoup insist dans mes divers ouvrages sur le langage inconsistant, sur la mmoire inconsistante, c'est--dire sur des paroles, des rcits qui ont compltement perdu le contact avec la ralit. Il y a, de mme, des reprsentations inconsistantes et en particulier des reprsentations de latralit inconsistantes. Essayons de nous rappeler dans quelles conditions se produit chez nous ce renversement du sens de la direction. Nous sommes dans le mtro en train de lire le journal ou nous sommes dans un train qui passe sous un tunnel et nous n'avons ce moment aucun moyen de vrifier notre reprsentation de la latralit. Nous avons ce moment une reprsentation des objets qui pourraient tre droite et de ceux qui pourraient tre gauche, mais cette reprsentation est tout fait arbitraire, inconsistante. Le plus souvent cette reprsentation qui continue les perceptions prcdentes est exacte et nous n'avons aucune surprise la sortie. Mais cette reprsentation peut tomber faux, comme il n'y a que deux cts, le droit et le gauche, l'erreur ne peut tre que dans le renversement complet et en arrivant au jour nous sommes l'envers. Il est vrai que nous corrigeons assez vite, car nous sommes habitus sacrifier -nos rves la ralit. Mais des malades affaiblis ne savent pas faire ce sacrifice et accepter le rel, alors ils restent l'envers. On trouverait bien des exemples d'un mcanisme semblable dans les illusions ; je crois, en particulier, qu'il faudrait tenir compte galement de ces reprsentations vagues de localisation dans l'interprtation de l'illusion des amputs que nous aurons probablement l'occasion d'tudier plus tard 1.
-6La route.
Retour la table des matires
Ce premier acte intellectuel prsente un caractre essentiel que nous verrons se prciser de plus en plus ; ce n'est pas un acte simple comme les premiers rflexes, c'est un acte mixte qui contient une combinaison de deux conduites simples prcdentes. Le dtour est dj une combinaison de la direction directe et de la direction l'oppos de l'obstacle. L'aller-retour est une combi1
Cf. Hmon, L'illusion des amputs, Revue philosophique, 1910, II, p. 290.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
92
naison de l'acte d'aller avec certains objets sa droite et de l'acte de retour avec les mmes objets sa gauche. Remarquons dj que les deux lments peuvent tre combins de manire ingale ; on est plus ou moins prs des deux extrmits de l'objet convoit ou de l'obstacle, du terme de l'aller ou du terme du retour et cette conduite est capable de bien des varits. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de les voir de plus en plus. Existe-t-il quelque chose qui puisse rsumer tout ce que nous venons de dire sur la direction depuis le dtour jusqu'. l'aller-retour ? Aux premiers actes intellectuels correspondent comme leur expression matrielle des objets intellectuels. Il y a un objet bien remarquable qui correspond tous ces actes de direction, c'est la route. Les 'animaux ne connaissent pas la route, car celle-ci est caractrise par l'aller-retour qu'ils n'ont pas, ils ne runissent pas les deux trajets inverses dans une mme action d'ensemble et, par consquent, ils ne font pas de route. Sans doute ils les suivent peu prs quand elles ont t faites par d'autres et surtout quand on les maintient sur la route, ce que les chiens n'aiment pas. Vous m'arrterez en disant qu'on observe des routes animales, de longues voies des chenilles processionnaires qui cheminent toutes la suite les unes des autres dans le mme trajet. Il s'agit l d'une route. Des traces tactiles ou odorantes sont laisses sur le sol par les premires et les autres suivent cette trace par de simples rflexes. Pour construire une route qui demeure aprs notre passage, il faut penser que nous reviendrons, que d'autres iront et reviendront, il faut l'aller-retour. En vous disant que l'animal n'est pas capable de comprendre la route, il me vient un scrupule. Les fourmis sont des animaux remarquables, capables de tout. N'a-t-on pas racont que dans le Jardin botanique de Fontainebleau des jeunes gens avaient la mauvaise habitude de jeter leurs bouts de cigarettes encore allums sur une fourmilire. Les fourmis ont trouv cette plaisanterie de fort mauvais got et elles ont pris l'habitude de concentrer sur le petit feu des jets d'acide formique pour l'teindre. Des fourmis qui sont capables de devenir des pompiers ne peuvent-elles pas inventer la route ? Un jardinier, mal avis, avait fait sur un tronc d'arbre un cercle de goudron pour empcher les fourmis de monter sur cet arbre tous les matins et d'en descendre tous les soirs. Les premires fourmis qui essayent de passer sont prises dans le goudron, mais bientt une dcision est prise par l'esprit de la fourmilire, comme dit Maeterlinck. Les fourmis reviennent en portant chacune dans leurs mandibules un tout petit grain de sable. Elles dposent les uns prs des autres leurs petits grains de sable sur le goudron et passent par-dessus en scurit. J'oserai presque dire qu'elles ont fait une route et mme une route pave. Voil des observations qu'il faudrait confirmer, rpter et varier pour voir les dbuts de l'intelligence chez les animaux. Les hommes ont appris faire des routes et les premires marques de la civilisation dans un pays sauvage, ce sont les routes qui le traversent. C'est l'expression de la direction, de l'aller-retour, de la distinction du ct droit et du ct gauche, c'est la premire conqute de l'intelligence sur l'espace. Cette premire conqute sera le point de dpart de toutes les autres : Euclide n'aurait pas fait la gomtrie si des hommes avant lui n'avaient pas dj fait des routes.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
93
Que de notions nouvelles nous avons acquises par le dveloppement de la direction qui est partie du dtour et qui aboutit l'aller-retour et la distinction de la droite et de la gauche. Pour arriver comprendre la notion de rapport entre deux choses, il fallait l'esprit la notion de la rciprocit, la notion des caractres et des actions rciproques. Nous jugeons souvent le degr de l'intelligence d'un enfant par sa capacit pour bien comprendre l'action rciproque. On a propos, ce propos, ce qu'on appelle le test des trois frres. A un enfant encore jeune, g de trois ou quatre ans par exemple, vous posez cette question : "As-tu un frre ?" Il rpond : "Oui, j'ai un frre, Paul." - "Et Paul, a-t-il un frre ?" Le petit enfant, tonn, nous dit alors : "Mais non, Paul n'a pas de frre, c'est moi qui ai un frre." Il prend la notion de frre d'une manire absolue et ne comprend pas qu'elle se retourne, que si lui, jean, est le frre de Paul, Paul, son tour, est le frre de jean. Cette notion de rciprocit est bien la consquence de l'allerretour ; il faut non seulement aller dans un sens, mais comprendre que dans la mme direction on peut aller en sens inverse. Les notions rciproques sont des notions qui sont identiques l'une l'autre, sauf qu'elles sont tout le contraire l'une de l'autre. Nous apprenons disposer ensemble tout en les opposant le haut et le bas, l'avant et l'arrire, le rapide et le lent, le mouvement et le repos, le chaud et le froid, le propre et le sale, le dur et le doux, le bon et le mauvais, la lumire et l'obscurit, le conscient et l'inconscient, etc. Tout cela drive de l'aller et du retour, c'est la mme chose et c'est tout le contraire. Il est essentiel pour nous de distinguer les notions qui comportent cette rciprocit et qu'on appelle rversibles de celles qui ne la comportent pas et qui sont irrversibles. L'espace comporte de la rciprocit, nous pouvons y marcher dans les deux sens. Mais jusqu' prsent le temps ne comporte pas cette rciprocit. Nous marchons dans le temps, toujours en avant, en faisant des actions les unes aprs les autres. C'est une route trs mauvaise o nous ne savons marcher que dans un seul sens, en passant btement de la jeunesse la maturit, la vieillesse, comme les plantes qui ne savent que pousser en avant, comme les animaux qui reviennent au nid sans comprendre que c'est un retour. L'espace prsente des phnomnes rversibles, le temps est pour nous irrversible. C'est ce que le pote exprimait si bien dans des vers clbres que je vous demande la permission de vous rappeler. Le livre de la vie est le livre suprme Qu'on ne peut ni fermer ni rouvrir son choix. Le passage attachant ne s'y lit pas deux fois Mais le feuillet fatal se tourne de lui-mme. On voudrait s'arrter la page o l'on aime Et la page o l'on meurt est dj sous nos doigts. C'est peut-tre parce que nous sommes encore trop btes. Un jour l'homme saura pratiquer dans le temps l'aller-retour, revenir sa jeunesse et revoir ceux qu'il a aims, qui se sont arrts avant lui et qui sont rests en arrire.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
94
La possibilit du retour aprs l'aller remplit, en effet, nos esprits : bien des ides morales sur la rparation, le remords et les recommencements de la vie sont des retours en arrire. Un grand nombre d'obsessions chez les malades consistent dans la haine du prsent, le dsir immodr et enfantin d'arrter le temps, de revenir en arrire jusqu' l'enfance et de recommencer la vie. De grandes philosophies, sans parler du retour ternel de Nietzsche, sont fondes sur l'ide du recul en arrire. Dernirement M. Masson Oursel nous montrait, la Socit psychologique de Paris, que bien des philosophies orientales admettent au fond "la pense rebours" ; pour elles le vritable but de la pense est de supprimer ce monde mal venu et de faire tourner l'envers "la roue du monde". Comprendre l'aller-retour c'est aussi comprendre le mouvement relatif, c'est savoir qu'un homme crois par nous sur la route est par rapport nous sur le retour quand nous sommes sur l'aller. C'est savoir que pour rencontrer un homme qui vient vers nous il suffit de l'attendre. C'est aussi comprendre l'opposition et le contre-pied : les fonctions primitives ne sont pas opposes l'une l'autre, il n'est pas exact que l'excrtion soit l'oppos de l'alimentation, ni les muscles ni les mcanismes ne sont exactement les mmes. Mais les oppositions vont natre avec l'intelligence, nous verrons des actes de remplir et de vider le premier, de faire le portrait et de reconnatre le portrait, de dire oui et de dire non. Ce sont toujours des drivs de l'aller-retour. Que de notions intellectuelles de la plus grande importance drivent de ces actes si simples de la direction sur une route. On ne comprendra l'esprit qu'en tudiant ces premires conduites si simples. C'est ce que nous continuerons faire en examinant les actes qui prcisent la situation et l'objet qui rsume la situation, c'est--dire la grande place du village.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
95
Les dbuts de lintelligence (1932) Deuxime partie : Les premiers objets intellectuels
Chapitre II
La position, la grande place du village
Retour la table des matires
Quand on interroge un malade qui se prsente la consultation, il y a une question qu'on lui pose habituellement. On lui demande d'abord son nom et son adresse ; mais en gnral, quand on a des inquitudes sur son tat mental, on lui pose une nouvelle question : "Mon ami, dites-nous donc o vous tes en ce moment-ci ? O sommes-nous ?" et on ajoute en gnral : "Quel jour sommes-nous ? " Parfois le malade rpond bien, il dit : "je suis dans le cabinet du mdecin, dans tel hpital qui se trouve au sud de Paris", ou bien il rpond : "nous sommes aujourd'hui lundi 11 janvier, en hiver". Quand un malade rpond comme cela, tout le monde est content. Au contraire, quand le sujet est embarrass, quand il hsite, et semble ne pas savoir dans quelle ville, dans quel pays, dans quel endroit il est, quand il ne sait pas quelle date, quel jour de la semaine, quelle heure de la journe nous sommes, le mdecin crit sur sa fiche "malade dsorient dans l'espace et dans le temps" et ce caractre devient immdiatement un symptme trs inquitant.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
96
Cette interrogation est beaucoup plus commune que nous ne le croyons, la socit et mme la Police se montrent vis--vis de nous d'une extrme indiscrtion. Elles nous demandent chaque instant notre nom et notre adresse et il faut que nous puissions rpondre que nous sommes tel endroit et que nous comptons nous rendre tel autre, que nous demeurons dans tel endroit et que nous savons nous y rendre en partant de l'endroit o on nous rencontre. Ce sont l des notions de position extrmement communes que tout le monde doit possder, elles jouent un rle mme dans le langage et certaines langues ont encore un cas locatif. Ces notions sont, cependant, au fond, beaucoup plus compliques qu'elles ne paraissent. Dans les examens dont nous parlons, la position du sujet doit tre exprime par des paroles, mais il est facile de voir que les paroles ne sont ici que l'expression d'une attitude, d'une conduite relatives la position qui est au-dessous des paroles. Bien des malades dsorients, qui ne savent pas o ils sont, n'ont aucun trouble de la parole et ils pourraient trs bien exprimer leur position s'ils en avaient une et si un trouble plus profond n'avait pas drang les conduites dont dpend la position.
-1La notion de position.
Retour la table des matires
La position a, comme la direction, une longue volution, elle finit son terme par devenir une position sociale, une position hirarchique dans la socit et elle peut prsenter alors toutes sortes de troubles chez des gens qui se placent toujours au-dessus ou au dessous de tous les autres. Mais elle a aussi d'humbles points de dpart et elle sort de la perception de l'endroit o nous sommes actuellement et de notre situation dans cet endroit. Les physiologistes tudient beaucoup aujourd'hui les rflexes de posture. Ce sont des rflexes qui dterminent non la contraction d'un muscle isol, mais de nombreuses contractions d'une foule de muscles qui maintiennent une certaine attitude d'ensemble de notre corps. Il y a des rflexes de posture qui nous maintiennent debout en quilibre sur nos jambes, ou qui nous maintiennent assis ou couchs. Il y a des rflexes qui maintiennent notre quilibre mme si nous levons un bras ou si nous remuons la tte 1. ces rflexes de posture il faut ajouter ce que j'tudiais autrefois propos de perception sous le nom de rflexes de situation. Chaque perception d'un objet ou d'un ensemble d'objets dtermine des mouvements ou des attitudes
1
Pour trouver un rsum des tudes sur ces rflexes on peut consulter un ancien travail de Victor-Henri dans l'Anne psychologique de 1895, le travail important de M. Head, de Londres, Sensation and cerebral cortex, dans le Brain de 1918, ou le petit livre trs intressant de M. Henri Piron, Le cerveau et la pense, 1923.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
97
particulires. Un animal ne se tient pas de la mme manire devant la nourriture ou devant une femelle. Son attitude change mme beaucoup si la nourriture est abondante ou prcaire, si la femelle est seule ou entoure d'autres mles. Diffrentes perceptions qui dterminent chacune des mouvements diffrents se combinent en une attitude particulire : un renard voit une poule et s'apprte la poursuivre et la prendre, mais en mme temps il voit le fermier la fourche la main, perception dsagrable qui le dispose fuir. Il prend une attitude intermdiaire en se dissimulant, en se faufilant, en faisant le guet. Nous avons tous des attitudes de situation de ce genre ; nous ne nous tenons pas de la mme manire devant un homme, devant une femme, devant un enfant, devant une table. Toutes sortes d'influences se combinent pour nous faire prendre une certaine attitude, dans un salon, dans une salle manger o on dne ou dans une salle de confrence o on coute des histoires psychologiques. Ces attitudes de situation, combines aux rflexes de posture, nous donnent une premire notion de l'endroit o nous sommes et nous convient dire que la notion de position dpend simplement de la perception du lieu et des rflexes de situation qui l'accompagnent. Eh bien, un peu de rflexion nous montre tout de suite qu'il n'en est rien, cette situation suffit aux animaux infrieurs qui probablement ne se situent pas autrement, mais elle est tout fait insuffisante pour l'homme qui a une tout autre notion de sa position. Hffding, le grand philosophe danois, qui vient de mourir, disait dj que le lieu gomtrique diffre du lieu sensible 1, mais, mon avis, il n'expliquait pas assez cette distinction. Nous pouvons rendre immdiatement sensible cette insuffisance du sentiment de la situation par une observation mdicale qui m'a paru trs intressante et que j'ai dj prsente plus compltement dans mon dernier ouvrage De l'angoisse l'extase. Il s'agit d'un officier franais, le capitaine Zd..., bless la tte pendant les batailles de Champagne : il avait reu une balle un peu au-dessus et derrire l'oreille gauche ; cette balle avait pntr obliquement dans la rgion occipitale du cerveau, s'tait arrte sur la paroi oppose du crne et bien que repre exactement par la radioscopie elle n'avait pu tre extraite. Au dbut, le bless prsenta les troubles classiques en relation avec les blessures de la rgion occipitale du cerveau ; il perdit compltement la vision psychique, consciente au dbut, quoiqu'il et conserv les rflexes oculaires. Puis il recommena voir, mais dans une moiti seulement du champ visuel, il prsenta de l'hmianopsie typique ; le champ visuel se transforma peu peu et prit la forme du rtrcissement circulaire, appel souvent rtrcissement hystrique. La vision paraissait se rtablir, mais le malade prsentait de tels troubles mentaux qu'on ne voulut pas le garder l'hpital militaire du Val-de-Grce et qu'il me fut adress. Nous n'avons nous occuper aujourd'hui que d'un seul symptme parmi les troubles nombreux qu'il prsente. Il arrive dans mon cabinet en tenant le bras d'un soldat, car il prtend tre incapable de marcher seul. Il me reconnat, me salue aimablement et s'installe correctement dans son fauteuil, mais immdiatement il commence gmir et exprimer une plainte singulire : "je suis horriblement malheureux, parce que je suis perdu, compltement perdu dans le monde, parce que je ne sais jamais o je suis."
1
Hffding, La pense humaine, 1911, p. 199.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
98
Cette dsorientation complte dans l'espace parat bien trange chez un homme qui est entr correctement, qui ne se trompe pas du tout sur la perception des objets, qui me reconnat et qui reconnat trs bien mon cabinet dans lequel il est dj venu plusieurs fois. Bien mieux, ces notions, relatives la situation, il peut parfaitement les exprimer en paroles. Il rcite trs bien mon adresse, 54, rue de Varenne, et il sait aussi rciter l'adresse laquelle il habite dans un autre quartier de Paris. Il ne lui manque donc rien sur la posture ni sur la situation, mais il proteste toujours : "Mes paroles ne signifient rien, savoir parler ce West rien, c'est ce qu'il y a de plus bte au monde. je parle bien et je n'en suis pas moins un idiot rduit zro. je rcite votre adresse, je reconnais que je suis dans votre cabinet, mais cela ne fait rien, je suis tout de mme compltement perdu, sans savoir o je suis." Cette observation ne montre-t-elle pas bien que la notion de position est quelque chose de plus que la notion de situation ? L'examen du malade explique trs bien cette diffrence : "Je suis perdu, dit-il, parce que je ne sais jamais ce qu'il faut faire pour aller quelque part ; je suis ici dans votre cabinet, je le sais bien, Mais comment faut-il faire pour. en sortir, je ne sais pas du tout o est la porte, ds que je ne la vois plus ; je ne sais pas o est l'escalier, o est la rue. je rcite mon adresse, c'est entendu, mais je ne sais pas du tout ce qu'elle signifie. La maison o j'habite est-elle en face, en arrire, droite, gauche., je n'en sais absolument rien. Et je ne peux pas me servir d'un plan de Paris, je ne comprends absolument rien une carte, je ne sais plus ce qu'elle veut dire, c'est joli pour un officier !" Nous reviendrons plus tard sur le problme de la carte, mais remarquons dj un fait bien net. Ce malade se sent perdu, quoiqu'il ait bien le sentiment de la situation, parce qu'il a perdu la reprsentation des directions, parce que, partir du point o il est et que donne la situation, il ne sait pas ce qu'il faut faire pour se rendre d'autres points, la porte, la rue, sa maison. Or ce qu'il faut faire pour se rendre ces points c'est une marche plus on moins prolonge dans une certaine direction. Dsignons cette marche particulire d'un nom gnrique, c'est un voyage, j'entends par ce mot la marche, sa longueur et sa direction. Se rendre compte exactement de sa position c'est runir dans l'esprit non seulement la perception de la situation prsente, mais la reprsentation du voyage qu'il faut faire pour aller d'autres endroits dtermins. je suis ici bien loin de chez moi, mais je ne suis pas tout fait perdu, d'abord parce que je compte sur vous, mais surtout parce que, la perception de cette salle, je joins la pense nette du voyage de retour Paris. Cela est vident dans toute orientation : quand le commandant d'un bateau fait le point, il ne dtermine pas seulement sa situation, car il sait bien qu'il est sur l'eau et que le soleil est en haut, mais il dtermine en mme temps sa direction pour aller Rio ou Buenos-Aires et la longueur du chemin qui reste parcourir, et c'est l ce qu'il crit sur la petite feuille qui indique le point aux voyageurs. Quand on demande un malade s'il est bien orient, s'il connat bien sa position, on ne se contente pas d'une rponse sur la situation : "je suis dans une salle blanche devant un mdecin." On lui demande, en outre, la direction qu'il va prendre pour sortir de l'hpital, pour aller la place voisine, pour rentrer chez lui.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
99
Il y a donc un "chez lui" : la position est comme toujours incarne dans un objet qu'elle cre. Le premier de ces objets c'est notre maison, notre chambre. Le primitif avait sa case, et nous ne sommes pas rassurs, dans un pays tranger, avant d'avoir un htel qui devient notre maison et une chambre, c'est par l que nous commenons. Cette maison, cette petite case du sauvage, est troitement rattache sa personne, elle constitue, comme disaient les sociologues, une de ses appartenances. Nous aurons en parler quand nous arriverons la personne, l'individualit. Mais cette position dans notre chambre a de grands inconvnients au point de vue intellectuel. Ce point de vue, nous le verrons de plus en plus, est le point de vue social, il rclame une entente entre plusieurs individus. Or nous sommes nombreux et chacun de nous a sa chambre, ce qui va faire d'innombrables chambres dont nous ne pourrons pas retenir les positions. La socit et la police dont je vous parlais interviennent et nous disent : votre chambre est une position trop personnelle, elle ne nous intresse que dans des cas trs particuliers ; il vous faut une position que tout le monde puisse connatre et la socit a invent La grande place du pays. Nous savons quelle importance a la place du village, la place de l'glise, la grand place, comme on dit encore dans nos campagnes. Nous sommes tous orients par rapport une grand'place : "Ramenez-moi la place de la Concorde et je saurai me dbrouiller." Les places qui servent de point de repre ont t caractrises par des rites sociaux, des distinctions de clans, c'est l'endroit o tait plac le drapeau du groupe, de la tribu. Nous avons chacun une conduite particulire pour nous rendre de la grand'place notre chambre. Nous retrouvons donc aujourd'hui un second objet artificiel cr par l'intelligence lmentaire, la grand'place que nous ajouterons la route dcouverte dans la dernire tude. La grand'place n'est pas plus que la route un objet naturel comme un fruit ou un rocher. Si on supprime les hommes il n'y a pas plus de grand'place que de route. C'est bien un objet intellectuel qui n'existe que par l'intelligence humaine. La position correspond donc une conduite psychologique analogue la conduite de la direction. Cette conduite aussi est double, elle consiste combiner, dans une seule action, les rflexes de situation et la reprsentation du voyage vers la grand'place. Cette combinaison intellectuelle a t probablement tardive car elle est assez complique. Il est probable que bien longtemps les premiers animaux se sont borns des rflexes de situation. Dans la dernire leon je vous disais que des animaux qui sortent du nid, des fourmis par exemple qui sortent de la fourmilire et qui y rentrent, n'ont pas ncessairement la conduite de l'aller et retour. Nous voyons aujourd'hui que des animaux qui vont et qui viennent assez correctement divers endroits n'ont pas ncessairement la notion de leur position. Nous l'avons bien vu par l'observation du capitaine Zd... Ces tres ont des perceptions de situation successives, chacune suffit au moment prsent. C'est peu peu, quand il s'est agi de voyages lointains, quand des relations sociales plus dveloppes ont rendu ncessaire l'indication de notre position aux autres pour qu'ils puissent
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
100
nous retrouver sans nous voir, qu'il a fallu prciser la situation et la transformer en position par une action intellectuelle double.
-2Les divers points de l'espace.
Retour la table des matires
Ces premires conduites de position d'o vont sortir tant de formes du langage comme les cas locatifs, tant de jugements et bientt, en les combinant avec les conduites de contenance, toute la gomtrie, ont une importance considrable et nous devons noter, mme dans cette intelligence lmentaire, les formes varies qu'elles peuvent prendre. Remarquons d'abord que ces conduites de position, comme les conduites de direction, se prsentent ncessairement sous deux formes. Il s'agit de conduites essentiellement sociales, car un tre isol qui ne se proccuperait pas de ses semblables peut trouver sa nourriture et son nid uniquement par des conduites perceptives et par des conduites de situation. C'est quand il a besoin de faire connatre aux autres o il est, sans le montrer effectivement, qu'il a besoin de ces conduites relationnelles. Il nous faut alors nous proccuper de notre position nous, par rapport la grand'place, pour que les gens de la grand'place puissent venir nous rejoindre et il faut tenir compte aussi de la position de la place par rapport nous pour que nous puissions aller faire visite aux autres sur cette place. Ce sont les deux aspects de la position comme l'aller et le retour taient les deux aspects de la direction. Ces deux conduites ne diffrent que par l'importance donne l'un des deux termes de l'action : quand il s'agit de faire venir les autres vers moi, c'est ma situation actuelle, les perceptions de cette situation qui sont l'essentiel et qui sont la phase de consommation. Le voyage qui doit tre fait par les autres n'est que reprsent la phase de l'rection, Quand il s'agit de ma visite moi sur la grand'place, c'est le voyage qui est essentiel et qui s'excute la phase de la consommation. Ma situation actuelle que je dois quitter est ncessaire pour fixer la direction elle-mme, mais elle n'est plus que reprsente. Il est inutile d'insister sur la position des objets, qui peut tre assimile ici la position des autres hommes, ou notre propre position. Placer un objet c'est lui donner une position. Bien souvent pour prciser la direction d'un courant, les physiciens nous disent d'imaginer un homme, un autre ou nousmme, qui nage dans le courant et le courant ou l'objet aura la mme direction ou la mme position que l'homme.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
101
Il n'en est pas moins vrai que ces positions attribues aux objets ou aux autres hommes semblent pouvoir tre trs varies. C'est que dans cette position des objets nous avons introduit un lment complexe qui peut luimme prendre bien des formes, le voyage. Ce voyage peut tre long, ce qu'on apprciera par la raction de l'effort et par la raction de la fatigue, l'objet prendra une position loigne. Le trajet peut tre facile et rapide, sans aucun effort, et l'objet deviendra un objet proche juxtapos un autre. Le voyage peut comporter des mouvements divers qui sont dj distingus les uns des autres par les conduites perceptives du corps propre et les objets seront placs au-dessous, au-dessus, ct, droite ou gauche ; ils vont devenir droits ou renverss suivant que leur position correspond ou ne correspond pas aux reprsentations. J'insiste surtout sur les positions intermdiaires si importantes pour toute l'volution des rapports. Un objet est intermdiaire entre notre situation initiale et un objet particulier ou, si l'on veut, la grand'place, quand dans le voyage on l'atteint avant l'autre objet ou avant la grand'place. Cette conduite d'intermdiaire dont nous voyons le dbut va se prciser quand s'organiseront les conduites de la contenance. Il me semble trs important pour tous ceux d'entre vous qui s'occupent de la psychologie des enfants ou de la psychologie des malades de remarquer que ces conduites en apparence si simples qui donnent une place aux objets sont en ralit tardives et fragiles. Dans un trs grand nombre de cas les troubles de ces conduites de position deviennent trs nombreux. Vous connaissez les tudes de M. Piaget sur les jugements de relation chez les enfants, nous les reverrons d'ailleurs encore plusieurs fois. M. Piaget insiste beaucoup sur la difficult qu'prouvent les petits enfants pour comprendre les positions intermdiaires. Un enfant comprend trs bien qu'une petite fille soit blonde de couleur claire, il comprend galement qu'une autre petite fille ait les cheveux bruns de couleur fonce, mais il ne peut pas comprendre qu'une troisime petite fille soit entre les deux, plus fonce que la premire et plus claire que la seconde. Je regrette un peu que M. Piaget ne considre ce propos que des jugements compliqus sur des relations de couleur et des jugements exprims par des paroles. C'est probablement qu'il a voulu vous laisser de belles tudes faire sur les conduites de position intermdiaire et sur leurs lacunes, telles qu'elles sont mises en vidence par les mouvements et par les jeux des enfants. Ces troubles lmentaires des conduites de position ont justement t bien tudis, peut-tre pour la premire fois, par M. Head, de Londres, chez les aphasiques, chez ces malades qui, la suite d'une hmorragie crbrale, ont perdu le langage. Ces malades, on ne le savait pas assez, ne peuvent plus mettre un objet entre deux autres, ne savent plus placer une allumette sur une autre et encore moins mettre une allumette en croix sur une autre, ou ct d'une autre, paralllement. Ces troubles de localisation lmentaire varient normment suivant une foule de conditions ; nous aurons d'ailleurs souvent y revenir 1. Bien entendu, c'est la question de l'origine des notions lmentaires de la gomtrie qui est en jeu.
1
Cf. ce sujet l'article fondamental de M. Head, Sensation and the cerebral cortex, Brain, 1908 ; bien entendu le grand ouvrage de M. Head sur l'aphasie ; ensuite, entre autres tudes, les articles de M. Pick, de Prague, sur Les dsordres de l'orientation ; les recher-
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
102
Passons une autre varit des conduites de position qui est aussi sous la dpendance des caractres du voyage. Ce qui est si grave dans le voyage, c'est l'acte de partir et aussi l'acte d'arriver : au dpart et l'arrive dominent les conduites de situation qui effacent un peu les conduites de voyage. Ces deux tapes du voyage sont si graves que leur excution a donn naissance, comme la position elle-mme, des objets intellectuels particuliers. Savez-vous quel est l'un des objets les plus importants de cette salle au point de vue de l'intelligence, c'est la porte. La porte est le plus souvent caractrise par un objet physique, une planche de bois ou de mtal qui spare un endroit d'un autre et qui peut, en se modifiant lgrement, permettre le passage d'un de ces endroits dans l'autre ou l'empcher, c'est ce qu'on appelle ouvrir et fermer la porte. Cette forme particulire de la porte sera mieux comprise quand nous tudierons le panier et le couvercle du panier. Pour le moment la porte est simplement un endroit plus ou moins tendu o on change de situation ; avant d'arriver la porte on est dans le salon avec les attitudes qu'il comporte, aprs la porte on est dans la rue, en public, avec de tout autres attitudes. C'est un point de dpart et d'arrive, c'est un endroit qui correspond aux actes d'entrer et de sortir avec les changements d'attitude qu'ils comportent. La porte est dans notre vie une chose grave, les malades nvropathes le savent bien puisqu'ils prsentent des troubles particuliers en rapport avec la porte. Quand on veut conduire un malade ngativiste et rsistant, c'est toujours au passage des portes qu'il y a les plus grandes batailles. Si ce malade-l n'aime pas les portes, d'autres ont pour elles une affection exagre : les hsitants, les douteurs qui ne savent jamais nettement s'ils veulent tre dans la salle ou s'ils veulent rester dehors veulent un sige tout prs de la porte, ou ils restent debout entre les battants des portes et ils encombrent le passage. La porte exprime une notion de position si complique qu'elle n'existe pas ou qu'elle existe peine chez l'animal. Quand on voit certaines araignes qui mettent leurs ufs au fond d'un tube et qui ensuite ferment le tube par un opercule, on peut se demander si elles ne connaissent pas la porte. Il s'agit plutt d'un obstacle, d'une protection qu'il faudra dtruire pour sortir, ce n'est pas une vraie porte qui s'ouvre et se ferme quand on entre et quand on sort. Les abeilles me paraissent plus intressantes, elles ne mettent pas l'entre de la ruche une vraie porte, mais elles sont capables de rtrcir l'ouverture avec de la cire pour empcher un bourdon d'entrer, elles savent donc qu'il faut passer par l pour pntrer chez elles. Les abeilles font encore mieux, elles placent l'une d'entre elles en sentinelle auprs de l'ouverture pour qu'elle surveille les entrants et les sortants. N'est-ce pas dj le concierge qui existe avant la porte et qui la prpare ?
ches de M. Bouvier sur l'aschmatie, Revue neurologique, 1905 ; le petit livre bien intressant de M. A. Kaploun, Psychologie gnrale tire du rve, 1919 ; l'article si important de M. Cassirer sur Les troubles du symbolisme, dont nous parlerons dans un prochain chapitre et des tudes rcentes de MM. R. Gordon et R. Normand, sur ces troubles de la conduite au-dessous du langage, The british Journal of psychology, general section, July, 1932.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
103
Il faudrait suivre dans l'humanit chez les primitifs et chez les enfants l'histoire de la porte, ce qui n'a gure t fait. Nous rencontrerions chez les primitifs les rites d'entre et de sortie qui sont si caractristiques et qui existent encore aujourd'hui quand on dit "bonjour" et "au revoir" sur le pas de la porte. Quand un congrs ou simplement quand un cours commence, il y a un prsident qui dclare la sance ouverte et qui donne la parole l'orateur et quand le congrs ou quand le cours est fini le mme prsident prononce "la clture de la sance" et dit aux auditeurs : "Vous pouvez vous en aller". Il est vrai que ce sont l des portes places dans le temps, ce qui est plus compliqu, mais ces rites d'entre et de sortie, de commencement et de fin ont leur simple origine dans l'espace. L'importance de ces portes vient de l'action qu'elles expriment, les portes sparent deux conduites de situation sociale ; en dedans la conduite prive, celle de la famille, au dehors la conduite en public. C'est toujours la distinction des priodes du voyage et des conduites de situation qui est en cause. Enfin, nous devons signaler, au moins rapidement, des positions sur des points spciaux, en particulier les positions sur la surface du corps propre. On ne se sert plus beaucoup d'un instrument le compas de Weber, l'sthsiomtre de Brown-Squard, qui tait d'un grand usage dans ma jeunesse. Nous mesurions l'cartement des deux pointes de l'instrument qui tait encore distingu par le sujet quand on oprait sur la peau de son bras deux pressions simultanes et nous nous figurions par cet examen mesurer la finesse de la sensibilit tactile. J'avais dj remarqu cette poque bien des irrgularits bizarres ; certains sujets qui paraissaient d'autre part bien sensibles apprciaient trs mal cet cartement des deux pointes mme quand il tait considrable. J'ai mme dcrit une malade qui ne sentait jamais qu'une seule piqre mme quand on la piquait simultanment au bras et la jambe : il y avait certainement un malentendu dans l'emploi de cet instrument. Une tude dj ancienne de Victor Henry, en 1898, a montr qu'il fallait distinguer la sensation proprement dite, celle de la douleur par exemple, et la prcision de la localisation qu'il proposait d'appeler le sens du lieu et qu'il considrait comme une opration psychologique bien diffrente. M. Head a singulirement confirm et prcis cette diffrence ; pour lui la distinction des deux pointes de l'sthsiomtre n'est plus du tout une sensation, c'est une opration purement intellectuelle qui comporte des localisations et des apprciations de leur diffrence. C'est l un phnomne qui se rattache la notion de la forme et la notion des degrs, suprieures mme la simple localisation. M. Head va jusqu' localiser ces deux oprations dans des rgions de l'encphale trs diffrentes, la pure sensation, la sensation protopathique comme il l'appelle, est place dans les lobes optiques et la distinction des localisations dans l'corce crbrale. Nous voyons ici un exemple des dangers auxquels est expose la psychologie exprimentale, il ne faut pas trop s'efforcer de mesurer au millime de millimtre des oprations et des fonctions dont on n'a pas suffisamment dtermin la nature. Voil quelques exemples des si nombreux phnomnes de l'esprit qui dpendent de la notion de position.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
104
-3Le point de vue.
Retour la table des matires
La conduite de la position, si nous pouvions l'tudier compltement, nous rserverait encore bien des problmes. Il est seulement ncessaire de vous rappeler, en vue de nos futures tudes, un de ses plus grands caractres, sa mobilit. Considrons un moment une illusion visuelle assez clbre qui a t prsente par Helmholtz sous le nom d'illusion de Sinsteden et qui a donn lieu, rcemment, un article philosophique fort intressant de M. Paliard, dans la Revue philosophique de juin 1930. Transportons-nous dans un pays o il y a encore des moulins vent, en Hollande par exemple, et le soir, au crpuscule, quand on voit mal le moulin lui-mme, mais quand on voit encore les ailes se dtacher sur le ciel, regardons-les tourner. Nous allons avoir alors les uns contre les autres une singulire querelle - les uns diront en regardant la moiti suprieure de la circonfrence dcrite par les ailes qu'ils voient trs bien les ailes tourner de gauche droite, dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais l'autre partie des spectateurs va protester avec indignation et dclarera que, trs videmment, les ailes, dans la moiti suprieure du cercle, tournent de droite gauche, en sens inverse des aiguilles d'une montre. Si, au lieu des auditeurs de ce cours, gens d'esprit philosophique et modr, il y avait devant ce moulin deux peuples diffrents, ces affirmations contradictoires dtermineraient des insultes, des haines et une guerre terrible : on a fait de grandes guerres pour moins que cela. Pour comprendre cette illusion prenons un autre exemple : regardez votre montre, dans le sens normal., le cadran tourn vers vous, les aiguilles tournent de gauche droite dans la moiti suprieure. Maintenant, supposez que votre montre soit transparente, il existe d'ailleurs des cadrans en verre de ce genre. Regardez votre montre l'envers par transparence et vous verrez rellement les aiguilles tourner de droite gauche. Pourquoi les choses se passent-elles ainsi ? Nous. ne pouvons pas l'tudier : c'est encore un tour de cette fameuse opposition du ct droit et du ct gauche, de leur changement quand on fait l'aller et le retour ; quand nous sommes bien en face d'un homme, son bras gauche est en face de notre bras droit et quand nous tournons derrire son dos, c'est son bras droit qui se met devant notre bras droit, mais ne retenons qu'une chose c'est que les aiguilles de la montre tournent de gauche droite ou de droite gauche suivant que nous sommes placs devant elles ou derrire elles.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
105
Il en est de mme pour les ailes du moulin, elles tournent dans un sens quand vous tes placs devant elles, devant leur axe, elles tournent dans le sens oppos quand vous tes placs derrire elles, derrire le moulin. Dans la demiobscurit du crpuscule vous ne distinguez pas bien si vous tes devant les ailes ou derrire le moulin et suivant les dispositions de votre imagination vous vous placez devant ou derrire. Nous ne faisons pas tous la mme supposition et c'est pour cela que nous nous sommes querells. Nous apprenons ainsi que notre position change absolument l'aspect des choses et que le moindre dplacement du corps peut changer notre position ; c'est ce qu'on appelle le point de vue. Suivant le point de vue o nous nous plaons nous voyons les choses d'une manire ou d'une autre. Nous apprenons aussi, par cet exemple, que nous avons la facult de changer notre point de vue suivant la position que nous prenons ou que nous imaginons prendre. Ce changement de position est si important que sans le remarquer nous l'utilisons chaque instant dans une foule de raisonnements. Prenons une opration arithmtique bien simple que l'on enseigne constamment aux malheureux petits enfants. On veut apprendre un enfant additionner 7 + 5 et, pour le lui faire comprendre, on le prie d'crire la srie des 7 premiers nombres partir de 0 ; il le fait correctement. On lui dit alors : "Maintenant, c'est bien simple, compte encore jusqu' 5." L'enfant, docile, reprend sa ligne de chiffres et rpte 1, 2, 3, 4, 5. Le professeur se fche et lui dit : "Mais non, il faut compter jusqu' 5 partir de 7." L'enfant, docile, rcite 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et dit en gmissant qu'il ne trouve pas de 5 ; le professeur le traite d'imbcile. Mais ce que le professeur a oubli de dire l'enfant c'est qu'il faut compter 5 partir de 7 en considrant ce 7 comme un 0. L'enfant comptait toujours partir de 0, mais il mettait ce 0 n'importe o dans le tableau. Il faut qu'il apprenne maintenant mettre le 0 la place du 7. L'essentiel de l'addition est le dplacement du 0, le dplacement de la position de dpart. Un grand nombre de raisonnements arithmtiques et gomtriques dpendent de ces changements de posisition, de ces dplacements de position. Le plus tonnant de cette histoire, c'est que le petit enfant finit par faire des additions et des soustractions sans avoir compris le travail tonnant qu'on lui demandait. Cette libert de l'esprit qui sait changer son point de vue est une qualit essentielle, car il est un changement de point de vue qu'il est essentiel de savoir faire. C'est une grande vertu que de savoir sortir de son point de vue soi, de sa position habituelle pour pouvoir se placer dans le point de vue des autres. La maladresse de l'esprit consiste souvent dans une certaine raideur qui fige les hommes dans leur point de vue et qui les rend incapables de se placer un autre point de vue, ou mme de comprendre qu'il y en ait un autre galement possible. Quand nous sommes souples, capables de changer de position et de point de vue, nous comprenons et nous excusons les opinions des autres, nous savons dire : "non, ce n'est ni un criminel, ni un menteur, quand il prtend voir tourner les ailes du moulin dans un autre sens que je ne le vois moi-mme, c'est simplement un brave homme qui, dans la demiobscurit, s'est imagin tre en arrire du moulin, tandis que j'imaginais tre en avant et il ne faut pas lui dclarer la guerre." Malheureusement, cette gymnastique est difficile faire et toutes les faiblesses, toutes les maladies de l'esprit la suppriment. Les enfants, disait M.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
106
Piaget, sont caractriss par des jugements absolus, ils sont longtemps incapables de former des jugements relatifs. Ils restent placs leur point de vue et ne comprennent pas qu'il puisse en exister d'autres. Bien des maladies de l'esprit sont du mme genre et nous montrent l'enttement dans une fausse position de l'esprit d'o il est bien difficile de les faire sortir. Retenons de notre tude le danger des positions fausses, dispositions absolues et immuables, surtout quand il s'agit de positions sociales. De se croire toujours et absolument au-dessus d'un autre est tout aussi absurde que de se croire toujours au-dessous, car certains points de vue on est audessus et certains autres on est en-dessous. Sachons que la notion de position si primitive qu'elle soit est aussi importante que difficile et qu'elle joue un rle considrable dans les progrs de l'esprit.
Pierre Janet (1932), Les dbuts de lintelligence, Premire partie du livre
107
Vous aimerez peut-être aussi
- Daniel Lagache La Psychanalyse Et La Structure de La PersonnalitéDocument40 pagesDaniel Lagache La Psychanalyse Et La Structure de La PersonnalitéViviana VePas encore d'évaluation
- Georges Didi-Huberman, PhasmesDocument121 pagesGeorges Didi-Huberman, PhasmesAnonymous 9ep4UXzRxxPas encore d'évaluation
- Colette SOLER, L'inconscient À Ciel Ouvert de La Psychose, Presses Universitaires Du Mirail, 2002Document7 pagesColette SOLER, L'inconscient À Ciel Ouvert de La Psychose, Presses Universitaires Du Mirail, 2002SchwindenhammerPas encore d'évaluation
- Oeuvre Chronologique de Lacan - Mme BeladinaDocument3 pagesOeuvre Chronologique de Lacan - Mme BeladinaAndre BeladinaPas encore d'évaluation
- Miracles Scientifiques Du Coran Et de La SunnaDocument23 pagesMiracles Scientifiques Du Coran Et de La SunnaISLAMICULTURE93% (15)
- Rene Lew Positions 13 ProfesserDocument2 pagesRene Lew Positions 13 ProfesserFélix Boggio Éwanjé-ÉpéePas encore d'évaluation
- JANET (1915) Valeur de La Psychanalyse de FreudDocument3 pagesJANET (1915) Valeur de La Psychanalyse de FreudCamila DagfalPas encore d'évaluation
- Georges Poulet, Les Metamorphoses Du CercleDocument3 pagesGeorges Poulet, Les Metamorphoses Du CercleIlasca IulianaPas encore d'évaluation
- Art Et SpatialitéDocument274 pagesArt Et SpatialitéGKF1789Pas encore d'évaluation
- De L'induction Chez AristoteDocument12 pagesDe L'induction Chez AristoteThierrytradePas encore d'évaluation
- Pierre Janet - de L'angoisse À L'extase - T2 - P1Document297 pagesPierre Janet - de L'angoisse À L'extase - T2 - P1Casablanca, MoroccoPas encore d'évaluation
- Psychanalyse - Freud - 1919 L'inquiétante ÉtrangetéDocument29 pagesPsychanalyse - Freud - 1919 L'inquiétante ÉtrangetésagnehPas encore d'évaluation
- Janet Pierre. - de L'angoisse À L'extase, Tome I, P. 2 - Les Croyances - P. 3 - Les Troubles Intellectuels Dans Le Délire ReligieuxDocument220 pagesJanet Pierre. - de L'angoisse À L'extase, Tome I, P. 2 - Les Croyances - P. 3 - Les Troubles Intellectuels Dans Le Délire ReligieuxMarinaPas encore d'évaluation
- Pierre Janet - La Medecine PsychologiqueDocument157 pagesPierre Janet - La Medecine PsychologiqueCasablanca, Morocco100% (2)
- Benjamin - Sur Quelques ThèmDocument32 pagesBenjamin - Sur Quelques ThèmkairoticPas encore d'évaluation
- 9791036907104Document32 pages9791036907104Laura GonzalezPas encore d'évaluation
- Guiraud - Les Meurtres Immotivés PDFDocument115 pagesGuiraud - Les Meurtres Immotivés PDFprotonpseudoPas encore d'évaluation
- Corvez, M. L'Être Et L'étant Dans La Philosophie de Martin Heidegger.Document24 pagesCorvez, M. L'Être Et L'étant Dans La Philosophie de Martin Heidegger.Fafaidegger100% (1)
- L'optimisme D'schopenhauerDocument61 pagesL'optimisme D'schopenhauerMaya BFeldmanPas encore d'évaluation
- Marc Richir, Les Structures Complexes de Limagination Selon Et Au Delà de HusserlDocument43 pagesMarc Richir, Les Structures Complexes de Limagination Selon Et Au Delà de HusserlGabriel Jiménez TaviraPas encore d'évaluation
- Hegel Et Le Possible RéelDocument26 pagesHegel Et Le Possible RéelGKF1789Pas encore d'évaluation
- Michel Foucault A MunsterlingenDocument3 pagesMichel Foucault A MunsterlingenMatias AbeijonPas encore d'évaluation
- Barthes, Roland - L'aventure Sémiologique - Seuil (1985)Document365 pagesBarthes, Roland - L'aventure Sémiologique - Seuil (1985)mysteremagrittienPas encore d'évaluation
- Merleau Ponty Lecteur de BiranDocument25 pagesMerleau Ponty Lecteur de BiranNekoPas encore d'évaluation
- Martin Heidegger - Concepts Fondamentaux (1985, Gallimard) - Libgen - LiDocument161 pagesMartin Heidegger - Concepts Fondamentaux (1985, Gallimard) - Libgen - LiDaalPas encore d'évaluation
- Actualité de La HaineDocument88 pagesActualité de La HaineClaudio Bernardes100% (1)
- Choplin Hughes de La Phénoménologie À La Non PhilosophieDocument174 pagesChoplin Hughes de La Phénoménologie À La Non Philosophiektk100Pas encore d'évaluation
- s20 EncoreDocument303 pagess20 EncoreundcoPas encore d'évaluation
- Berkeley - Des Principes de La Connaissance HumaineDocument8 pagesBerkeley - Des Principes de La Connaissance HumaineStephanie Hernandez100% (1)
- II - FERENCZI Juillet 1914-Décembre 1919Document561 pagesII - FERENCZI Juillet 1914-Décembre 1919Marina Fraga DuartePas encore d'évaluation
- Lacan - Antigone Dans L Entre Deux MortsDocument19 pagesLacan - Antigone Dans L Entre Deux MortstodologuePas encore d'évaluation
- Maine de Biran - Ouvres InéditsDocument604 pagesMaine de Biran - Ouvres InéditsmancolPas encore d'évaluation
- Vernant-Ambigüité Et Renversement - OEdipe Roi - OptDocument31 pagesVernant-Ambigüité Et Renversement - OEdipe Roi - OpthugocarlosveraPas encore d'évaluation
- RFP 1984 IdentificationDocument43 pagesRFP 1984 IdentificationlgrisaPas encore d'évaluation
- H. Phénoménologie de La Pauvreté. N. Depraz Conférence Colloque P. Livet 18 Sept. 2006Document12 pagesH. Phénoménologie de La Pauvreté. N. Depraz Conférence Colloque P. Livet 18 Sept. 2006Natalie DeprazPas encore d'évaluation
- Caillois, Roger - La Nécessité D'espritDocument190 pagesCaillois, Roger - La Nécessité D'espritMartin Carr100% (1)
- CRP Cohen Halimi 2007 2008Document27 pagesCRP Cohen Halimi 2007 2008Sacha DobridiovskyPas encore d'évaluation
- Marc Richir - Phénomène Et InfiniDocument21 pagesMarc Richir - Phénomène Et InfinigillesduteauPas encore d'évaluation
- Extrait de Heidegger (Problèmes Fondamentaux de La Phénoménologie, 1928) PDFDocument4 pagesExtrait de Heidegger (Problèmes Fondamentaux de La Phénoménologie, 1928) PDFRaphaelPas encore d'évaluation
- Jacques Lacan - Le Séminaire de Jacques Lacan, Livre 23, Le Sinthome (Seuil, 2005)Document253 pagesJacques Lacan - Le Séminaire de Jacques Lacan, Livre 23, Le Sinthome (Seuil, 2005)Pedro FelizesPas encore d'évaluation
- Leçon Inaugurale de Ian HackingDocument11 pagesLeçon Inaugurale de Ian HackingSimone AvilaPas encore d'évaluation
- Françoise Gorog-Notes Sur Les Présentations de Lacan À Sainte-AnneDocument2 pagesFrançoise Gorog-Notes Sur Les Présentations de Lacan À Sainte-AnneFengPas encore d'évaluation
- Le Panpsychisme Leibnizien - BouveresseDocument15 pagesLe Panpsychisme Leibnizien - BouveresseAlabernardesPas encore d'évaluation
- Rambeau Deleuze Et L'inconscient Impersonnel PDFDocument8 pagesRambeau Deleuze Et L'inconscient Impersonnel PDFSenda SfercoPas encore d'évaluation
- Maleval. Approche Structurale en PsychopathologieDocument16 pagesMaleval. Approche Structurale en PsychopathologiePW6Pas encore d'évaluation
- Lacan Derrida Le MalentenduDocument9 pagesLacan Derrida Le Malentenduabdallah azaouiPas encore d'évaluation
- Ouvrage ErhenbergDocument3 pagesOuvrage ErhenbergSandy MandinPas encore d'évaluation
- À Propos D'un Cours Inédit de Michel Foucault Sur L'analyse Existentielle de Ludwig Binswanger (Lille 1953-54)Document25 pagesÀ Propos D'un Cours Inédit de Michel Foucault Sur L'analyse Existentielle de Ludwig Binswanger (Lille 1953-54)nluxonPas encore d'évaluation
- Wittgenstein PastoriniDocument17 pagesWittgenstein PastoriniMikael MoazanPas encore d'évaluation
- Baudry - Ecriture Fiction Idéologie - Tel QuelDocument11 pagesBaudry - Ecriture Fiction Idéologie - Tel Queltomgun11Pas encore d'évaluation
- 2253055395Document224 pages2253055395Cauã Vieira da SilvaPas encore d'évaluation
- Lacan Resumes Commentes Des Seminaires 1 A 17 1953 1970Document448 pagesLacan Resumes Commentes Des Seminaires 1 A 17 1953 1970Jonathan Ler100% (1)
- Séminaire Le TransfertDocument397 pagesSéminaire Le Transfert29discoverPas encore d'évaluation
- Freud (1914) Remémoration, Répétition Et (Bilangue)Document10 pagesFreud (1914) Remémoration, Répétition Et (Bilangue)apellon7Pas encore d'évaluation
- Conférence de Q. Meillassoux Sur Mallarmé - Le Signifiant OpaqueDocument6 pagesConférence de Q. Meillassoux Sur Mallarmé - Le Signifiant OpaquepanoptericPas encore d'évaluation
- Quelques progrès dans l’étude du cœur humain : Freud et ProustD'EverandQuelques progrès dans l’étude du cœur humain : Freud et ProustPas encore d'évaluation
- Méditations cartésiennes d'Edmund Husserl: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandMéditations cartésiennes d'Edmund Husserl: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- De l'âme d'Aristote: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandDe l'âme d'Aristote: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- La Destination de l'homme de Johann Gottlieb Fichte: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLa Destination de l'homme de Johann Gottlieb Fichte: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Principes de la philosophie morale: ou Essai sur le mérite et la vertuD'EverandPrincipes de la philosophie morale: ou Essai sur le mérite et la vertuPas encore d'évaluation
- La Crise Des Subprimes - Rapport Du CAEDocument284 pagesLa Crise Des Subprimes - Rapport Du CAEFrançois DelattrePas encore d'évaluation
- Lymphatic SystemDocument15 pagesLymphatic SystemCasablanca, MoroccoPas encore d'évaluation
- Le Nouvel Ordre Des BarbaresDocument32 pagesLe Nouvel Ordre Des BarbaresdootjeblauwPas encore d'évaluation
- Code Marche Public MarocDocument63 pagesCode Marche Public Marocdrlaaroussi100% (9)
- Codes RegimesDocument4 pagesCodes RegimesCasablanca, MoroccoPas encore d'évaluation
- Calculs Commerciaux Ter-TceDocument99 pagesCalculs Commerciaux Ter-TceAziz Aouragh100% (1)
- Alfred Adler - L'enfant DifficileDocument177 pagesAlfred Adler - L'enfant DifficileCasablanca, Morocco100% (2)
- Alfred Adler - Pratique Et Théorie de La Psychologie IndDocument147 pagesAlfred Adler - Pratique Et Théorie de La Psychologie IndCasablanca, Morocco50% (2)
- Sciences PolitiquesDocument206 pagesSciences PolitiquesCasablanca, Morocco100% (8)
- Alfred Adler - Pratique Et Théorie de La Psychologie Individuelle 1Document154 pagesAlfred Adler - Pratique Et Théorie de La Psychologie Individuelle 1Casablanca, MoroccoPas encore d'évaluation
- Pierre Janet - Debut de L'intelligence BDocument52 pagesPierre Janet - Debut de L'intelligence BCasablanca, Morocco100% (1)
- Pierre Janet - La Medecine PsychologiqueDocument157 pagesPierre Janet - La Medecine PsychologiqueCasablanca, Morocco100% (2)
- Alfred Adler - Le Sens de La VieDocument162 pagesAlfred Adler - Le Sens de La VieCasablanca, Morocco100% (5)
- Du Contrat Social (JJ Rousseau)Document152 pagesDu Contrat Social (JJ Rousseau)Casablanca, Morocco100% (1)
- Intelligence Avant Le LangageDocument166 pagesIntelligence Avant Le Langagetadjoura1100% (1)
- Pierre Janet - de L'angoisse À L'extase - T2 - P1Document297 pagesPierre Janet - de L'angoisse À L'extase - T2 - P1Casablanca, MoroccoPas encore d'évaluation
- Alfred Adler - L'enfant DifficileDocument177 pagesAlfred Adler - L'enfant DifficileCasablanca, Morocco100% (2)
- Delacroix - L'enfant Et Langage PDFDocument67 pagesDelacroix - L'enfant Et Langage PDFRodrigo CornejoPas encore d'évaluation
- Pierre Janet - de L'angoisse À L'extase - T1 - p2Document140 pagesPierre Janet - de L'angoisse À L'extase - T1 - p2Casablanca, Morocco100% (1)
- Alfred Adler - Pratique Et Théorie de La Psychologie IndDocument147 pagesAlfred Adler - Pratique Et Théorie de La Psychologie IndCasablanca, Morocco50% (2)
- Alfred Adler - Pratique Et Théorie de La Psychologie Individuelle 1Document154 pagesAlfred Adler - Pratique Et Théorie de La Psychologie Individuelle 1Casablanca, MoroccoPas encore d'évaluation
- Alfred Adler - Complement NevroseDocument12 pagesAlfred Adler - Complement NevroseCasablanca, MoroccoPas encore d'évaluation
- Alfred Adler - Le Sens de La VieDocument162 pagesAlfred Adler - Le Sens de La VieCasablanca, Morocco100% (5)
- Rencontre Parents Enseignantes CPGDocument17 pagesRencontre Parents Enseignantes CPGapi-181840872Pas encore d'évaluation
- Structuration Et Conception de La Recherche Quantitative - 2018-01-10Document3 pagesStructuration Et Conception de La Recherche Quantitative - 2018-01-10Sofiane DouifiPas encore d'évaluation
- Fiche N°12 - L Analyse TransactionnelleDocument3 pagesFiche N°12 - L Analyse Transactionnellesamsam100% (1)
- Recueil Théorie de L'EngagementDocument12 pagesRecueil Théorie de L'EngagementAmadouPas encore d'évaluation
- Ikigai de La Passion Au Job de ReveDocument40 pagesIkigai de La Passion Au Job de ReveDakkar de Bundelkhand100% (2)
- Paulo Coehlo The Devil and Miss PrymDocument16 pagesPaulo Coehlo The Devil and Miss PrymInaPas encore d'évaluation
- 1000 Citations PhilosophiquesDocument221 pages1000 Citations PhilosophiquesPablo Sene100% (4)
- Symbolisme Des RunesDocument41 pagesSymbolisme Des Runesgregory berlemont100% (3)
- 01 Actes Document General 2Document68 pages01 Actes Document General 2frbeg48Pas encore d'évaluation
- These PerrineBoutinDocument419 pagesThese PerrineBoutinCezar MigliorinPas encore d'évaluation