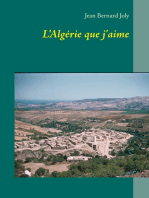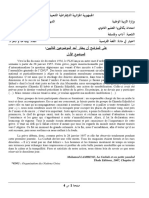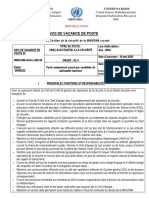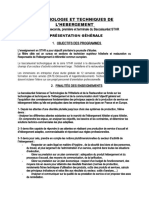Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
La Grande Maison.m.dib
Transféré par
HacerMellalCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
La Grande Maison.m.dib
Transféré par
HacerMellalDroits d'auteur :
Formats disponibles
LA GRANDE MAISON Une maison norme et grouillante comme il s'en trouve tant dans les villes algriennes.
La faim animale, la panique, la gn-rosit, la gentillesse, le bonheur d'un cadeau reu (surtout si c'est quelque chose manger) tissent le drame quotidien de ces existences qui, dans ce cadre sordide et tumultueux, demeurent insaisissables aux trangers. Omar, le petit hros de ce roman, n'est pas un observateur impersonnel et froid on s'en doute. Dans la souffrance, la vio-lence - et, par l-dessous, l'amour il se hausse la compr-hension de l'vnement et de la condition des siens. Nous sommes en 1939, anne dcisive pour le monde moderne. Lorsque parut, en 1952, la premire dition de La Grande Maison, Maurice Nadeau crivit dans Le Mercure de France que Mohammed Dib est, de tous les romanciers nord-africains celui qui risque de nous toucher le plus . Le succs croissant de cette uvre tant en France, o elle a obtenu le Grand Prix Fnon de Littrature, qu' l'tranger, o elle a t traduite en une vingtaine de langues, confirme ce jugement. La Grande Maison, tout comme L'Incendie, Le Mtier tisser ou Un t africain, rpond bien cette dfinition que donne Mohammed Dib de l'art du romancier, notre poque : Une uvre ne peut avoir de valeur que dans la mesure o elle est enracine, o elle puise sa sve dans le pays auquel on appartient, o elle nous introduit dans un monde qui est le ntre avec ses complexits et ses dchirements.
Mohammed Dib LA GRANDE MAISON ROMAN
ditions du Seuil
VERSION DFINITIVE ISBN 2-02-028312-3 (ISBN 2-02-000807-6, dition broche) (ISBN 2-02-000479-8, 1" publication poche) ditions du Seuil, 1952 et 1996 Le Code de la proprit intellectuelle interdit les copies ou reproductions destines une utilisation collective. Toute reprsentation ou reproduction intgrale ou partielle faite par quelque procd que ce soit, sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaon sanctionne par les articles L 335-2 et suivants du Code de la proprit intellectuelle.
-Un peu de ce que tu manges ! Omar se planta devant Rachid Berri. Il n'tait pas le seul ; un faisceau de mains tendues s'tait form et chacune qumandait sa part. Rachid dtacha un petit bout de pain qu'il dposa dans la paume la plus proche. -Et moi ! Et moi ! Les voix s'levrent en une prire ; Rachid protesta. Toutes ces mains tentrent de lui arracher son croton. -Moi ! Moi ! -Moi, tu ne m'en as pas donn ! -C'est Halim qui a tout pris. -Non, ce n'est pas moi ! Harcel de tous cts, le gosse s'enfuit toutes jam-bes, la meute hurlante sur ses talons. Estimant qu'il n'y avait rien en tirer, Omar abandonna la poursuite. Il s'en fut ailleurs. D'autres enfants grignotaient tran-quillement leur quignon. Il louvoya longtemps entre les groupes. Puis, d'un trait, il fondit dans la cohue, arracha son pain un courtaud. Il courut ensuite se perdre au centre de l'cole, o il fut aspir par le tourbillon des jeux et des cris. La victime ne sut que brailler sur place. Il y avait des lves qu'il ranonnait, quotidienne-ment. Il exigeait d'eux sa part, et s'ils ne s'excutaient pas sur-le-champ ils ramassaient souvent des voles. Dociles, ceux-l partageaient leur goter et lui tendaient les deux moitis pour qu'il en prlevt une son choix. L'un d'eux se cachait-il pendant toute une rcration, il ne s'obstinait gure dans son forfait. Il venait guetter Omar soit la sortie de l'cole, soit une autre rcra-tion. Du plus loin qu'il l'apercevait, il commenait pleurer. Il recevait sa correction et finissait par remettre un goter entier Omar. Mais les plus russ dvoraient leur pain en classe. -Je n'ai rien apport aujourd'hui, disaient-ils. L'enfant retournait ses poches. Omar faisait main basse sur tout ce qu'il trouvait en sa possession. -Alors, tu l'as donn un autre pour le cacher ? -Non, je le jure. -Ne mens pas ! -Je le jure.
-Ne viens pas me demander de te dfendre, hein ! -Je te jure que je t'apporterai demain un gros morceau. D'un geste, l'enfant montrait les dimensions du pain qu'il promettait. Omar lui jetait la calotte par terre, la pitinait, pendant que le coupable poussait des plaintes de chien molest. Il protgeait ainsi ceux que les grands lves tyrannisaient ; la part qu'il prenait n'tait que son salaire. Ses dix ans le plaaient entre les gaillards du cours suprieur, dont la moustache noircissait, et les morveux du cours prparatoire. Les grands, pour se venger, s'attaquaient lui, mais n'obtenaient rien, Omar n'ap-portait jamais de pain. Lui et ses adversaires sortaient de ces combats le nez et les dents en sang, leurs sor-dides habits effilochs un peu plus. C'tait tout. A Dar-Sbitar, Omar se procurait du pain d'une autre faon. Yamina, une petite femme aux jolis traits, reve-nait chaque matin du march avec un plein couffin. Elle priait souvent Omar de lui faire de petites commissions. Il lui achetait du charbon, remplissait son seau d'eau la fontaine publique, lui portait le pain au four... Yamina le rcompensait son retour en lui donnant une tranche de pain avec un fruit ou un piment grill - de temps en temps, un morceau de viande ou une sardine frite. Quel-quefois, aprs djeuner ou dner, elle l'appelait. Quand l'enfant soulevait le rideau - l'heure du repas, chaque famille baissait le sien -, elle lui disait d'entrer, appor-tait un plat o elle gardait quelque chose de bon, cassait la miche ronde et blanche et plaait le tout devant lui. - Maintenant mange, mon garon. Elle le laissait et vaquait dans la pice. Yamina ne lui offrait que des reliefs, mais propres ; les plus diffi-ciles n'auraient rien trouv y redire. La veuve ne le traitait pas comme un chien ; et cela lui plaisait. Ne pas tre humili. Omar ne savait pas o se mettre devant tant d'gards. Il fallait que chaque fois Yamina le pres-st pour l'encourager toucher aux aliments. Un petit, un mioche de rien du tout, aux grands yeux noirs comme de l'anthracite, au visage ple et inquiet, se tenait l'cart. Omar l'observait : debout contre un pilier du prau, les mains derrire le dos, il ne jouait pas, celui-l. Omar fit le tour de la cour, surgit de der-rire un platane, et laissa tomber ses pieds ce qui lui restait d'un croton. Il fit mine de ne point s'en aper-cevoir et continua de courir. Arriv bonne distance, il s'arrta, et l'pia. Il le vit de loin fixer le bout de pain, puis s'en saisir d'un geste furtif et mordre dedans. L'enfant s'tait ramass sur lui-mme. Son torse exigu tait emmaillot dans une veste de coutil d't kaki ; ses jambes frles sortaient des tuyaux d'une trop longue culotte. Une joie anglique clairait ses traits : il se retourna face au pilier. Omar ne comprenait pas ce qui lui arrivait, sa gorge se contractait. Il courut dans la grande cour de l'cole, et sanglota. -C'est le djeuner ? Ani pluchait des cardons indignes, courts et pi-neux. -Oui, le djeuner. -A quelle heure allons-nous manger ? Il est onze heures et demie.
-Nous mangerons quand a sera prt. -Maudits soient les pre et mre de ces cardons. Omar s'apprta ressortir. -Va. Les hommes ne sont pas faits pour la maison. Sa mre pensait Si Salah, le propritaire, qui avait horreur des enfants de ses locataires. Il leur interdisait de s'amuser dans la cour ; s'il les y surprenait, il les bousculait et houspillait leurs parents. Ceux-ci n'avaient jamais le courage de lui rpondre ; quand ils le voyaient, ils se figeaient dans une attitude humilie ou se rfugiaient dans leurs chambres. En face du pro-pritaire ils se sentaient envahis par le respect o les jetait une crainte sans bornes. En l'absence de Si Salah, sa femme, vieille figure chafouine, les assaillait de ses cris d'orfraie. Omar dans la maison cette heure-ci, c'tait la calamit. Il resta. - Tu n'as pas honte, fille ! Ani tenta de le saisir par un bras. Peine perdue. Il se droba. Soudain elle lana le couteau de cuisine avec lequel elle tailladait les cardons. L'enfant hurla ; il le retira de son pied sans s'arrter et se prcipita dehors, le couteau la main, suivi par les imprcations d'Ani.
Les yeux immenses de Veste-de-kaki exprimaient une interrogation avide de bte apeure. Omar y lisait l'attente, l'espoir frmissant, l'inquitude. Mais, peu peu, un sourire l'illumina. Deux rides dures naquirent sous les ailettes de son nez et lui tirrent le visage. Omar vint droit vers lui. Il mit quelque chose dans sa petite patte troite. L'enfant plongea ses regards dans les siens sans rien dire. - Ferme les yeux et ouvre la bouche, ordonna Omar. Confiant, Veste-de-kaki ferma les yeux et ouvrit la bouche. Omar retira sa main prestement du fond d'une poche et lui dposa un bonbon sur la langue. Et il disparut. Omar ni personne n'osait toucher, sans encourir de grands chtiments de la main des matres, les quelques fils de ngociants, de propritaires, de fonctionnaires qui frquentaient l'cole. On risquait beaucoup les attaquer : ceux-l avaient leurs courtisans parmi les lves et les instituteurs. L'un d'eux, Driss Bel Khodja, un garon bte et fier, n'exhibait chaque rcration pas seulement du pain, ce qui tait dj beaucoup, mais encore des gteaux et des confiseries. Il s'adossait un mur, ses hommes liges Autour de lui, et bfrait posment. De temps en temps, quelqu'un se baissait pour ramasser des miettes qui tombaient. On n'avait jamais vu Driss faire le geste de donner : Omar ne comprenait pas pourquoi tous l'entouraient ainsi. tait-ce l'obscur respect que leur inspirait un tre qui mangeait chaque jour sa faim ? taient-ils fascins par la puissance sacre, incarne en cet enfant mou et sot ? Driss avait un camarade qui se chargeait de son sac de cuir, broderies d'argent et d'or, la sortie de quatre heures. D'autres, quand approchait l'heure d'entrer en classe, allaient le chercher et lui tenaient compagnie en chemin. Ils ne se sparaient de lui que lorsque la cloche sonnait. C'tait qui se mettrait ses cts, qui pose-rait une main sur son paule. Il avait coutume d'acheter des torracos, du calentica, des piroulis, il possdait mme de l'argent ! Aux petits marchands qui s'installaient dans la rue noire d'coliers, un peu avant une heure, il prenait cinq ou six cornets de torracos, distribuait un grain chacun de ses compagnons. Si ceux-ci se plaignaient, ou se moquaient, il geignait plus fort qu'eux : - Et moi, que va-t-il me rester ? Vous voulez que je vous donne tout ? Chaque matin invariablement, il racontait, aprs s'tre empiffr, ce qu'il avait mang la veille. Et, la rcration de l'aprs-midi, son repas du jour. Il n'tait question que de quartiers de mouton rtis au four, de poulets, de couscous au beurre et au sucre, de gteaux aux amandes et au miel dont on n'avait jamais entendu les noms : cela pouvait-il tre vrai ? Il n'exagrait peut- tre pas, cet imbcile !... Les enfants, devant toutes les victuailles qui hantaient ses discours, bahis, demeu-raient l'air perdu. Et lui, rcitait toujours l'incroyable litanie des mets qu'il avait dgusts. Tous les yeux levs vers lui le scrutaient bizarrement. Quelqu'un, haletant, hasardait : -Tu as mang tout seul un morceau de viande grand comme a ? -J'ai mang un morceau de viande grand comme a. -Et des pruneaux ?
-Et des pruneaux. -Et de l'omelette aux pommes de terre ? -Et de l'omelette aux pommes de terre. -Et des petits pois la viande ? -Et des petits pois la viande. -Et des bananes ? -Et des bananes. Celui qui avait pos ces questions se taisait. Omar errait, explorant la cour ; o tait Veste-de- kaki ? Il rencontrait plusieurs de ses camarades, qui il se heurtait brutalement ; ceux-ci l'accrochaient au passage, le hlaient. Mais pas de trace de l'enfant. Il jura brusquement qu'il ne le reverrait plus. D'ordi-naire il l'apercevait contre le mme pilier du prau. Veste-de-kaki paraissait rang, il se tenait tout le temps loin des autres garons. La cloche qui annoncerait la fin de la rcration n'allait pas tarder carillonner. Dans la cour, la surex-citation atteignait dj le paroxysme. Les jeux se fai-saient plus violents, les cris vrillaient l'atmosphre. C'taient bien l les signes avant-coureurs des dernires minutes : Omar en tait averti par son instinct d'colier. L'vnement prit dans sa pense un sens tragique. H cherchait toujours Veste-de-kaki. Il parut tout coup ne tenir la vie que par de vagues attaches. Tout se fit trange autour de lui ; Veste-de- kaki n'tait nulle part. Qu'allait-il devenir sans Veste- de-kaki ? La cloche retentit. Omar se mit en rang avec ses camarades. Il imaginait Veste-de-kaki - chez ses parents sans doute ? - qui l'attendait, il l'imaginait assis devant une meda, il l'imaginait jouant dans la cour d'une grande maison... Le matre cingla l'air de sa fine baguette d'olivier et les lves pntrrent en file par deux dans la classe. Omar dirigea ses regards devant lui, sa bouche trem-bla. Son angoisse se prolongeait, il s'imagina que Veste- de-kaki tait mort. Mais l'instant o il refermait la porte, la silhouette grle de l'enfant traversait au trot la cour de l'cole.
A peine s'embotrent-ils dans leurs pupitres que le matre, d'une voix claironnante, annona : -Morale ! Leon de morale. Omar en profiterait pour mastiquer le pain qui tait dans sa poche et qu'il n'avait pas pu donner Veste-de-kaki. Le matre fit quelques pas entre les tables ; le bruis-sement sourd des semelles sur le parquet, les coups de pied donns aux bancs, les appels, les rires, les chu-chotements s'vanouirent. L'accalmie envahit la salle de classe comme par enchantement : s'abstenant de res-pirer, les lves se mtamorphosaient en merveilleux santons. Mais en dpit de leur immobilit et de leur application, il flottait une joie lgre, arienne, dan-sante comme une lumire. M. Hassan, satisfait, marcha jusqu' son bureau, o il feuilleta un gros cahier. Il proclama : -La Patrie. L'indiffrence accueillit cette nouvelle. On ne com-prit pas. Le mot, camp en l'air, s'y balanait. -Qui d'entre vous sait ce que veut dire : Patrie ? Quelques remous troublrent le calme de la classe. La baguette claqua sur un des pupitres, ramenant l'ordre. Les lves cherchrent autour d'eux, leurs regards se promenrent entre les tables, sur les murs, travers les fentres, au plafond, sur la figure du matre ; il apparut avec vidence qu'elle n'tait pas l. Patrie n'tait pas dans la classe. Les lves se dvisagrent. Certains se plaaient hors du dbat et patientaient benotement. Brahim Bali pointa le doigt en l'air. Tiens, celui-l ! Il savait donc ? Bien sr. Il redoublait, il tait au cou-rant.
- La France est notre mre Patrie, nonna Brahim. Son ton nasillard tait celui que prenait tout lve pendant la lecture. Entendant cela, tous firent claquer leurs doigts, tous voulaient parler maintenant. Sans per-mission, ils rptrent l'envi la mme phrase. Les lvres serres, Omar ptrissait une petite boule de pain dans sa bouche. La France, capitale Paris. Il savait a. Les Franais qu'on aperoit en ville viennent de ce pays. Pour y aller ou en revenir, il faut traverser la mer, prendre le bateau... La mer : la mer Mditerra-ne. Jamais vu la mer, ni un bateau. Mais il sait : une trs grande tendue d'eau sale et une sorte de planche flottante. La France, un dessin en plusieurs couleurs. Comment ce pays si lointain est-il sa mre ? Sa mre est la maison, c'est Ani ; il n'en a pas deux. Ani n'est pas la France. Rien de commun. Omar venait de surprendre un mensonge. Patrie ou pas patrie, la France n'tait pas sa mre. On apprenait des mensonges pour viter la fameuse baguette d'olivier. C'tait a, les tu-des. Les rdactions : dcrivez une veille au coin du feu... Pour les mettre en train, M. Hassan leur faisait des lectures o il tait question d'enfants qui se pen-chent studieusement sur leurs livres. La lampe projette sa clart sur la table. Papa, enfonc dans un fauteuil, lit son journal et maman fait de la broderie. Alors Omar tait oblig de mentir. Il compltait : le feu qui flambe dans la chemine, le tic-tac de la pendule, la douce atmosphre du foyer pendant qu'il pleut, vente et fait nuit dehors. Ah ! comme on se sent bien chez soi au coin du feu ! Ainsi : la maison de campagne o vous passez vos vacances. Le lierre grimpe sur la faade ; le ruisseau gazouille dans le pr voisin. L'air est pur, quel bonheur de respirer pleins poumons ! Ainsi : le labou-reur. Joyeux, il pousse sa charrue en chantant, accom-pagn par les trilles de l'alouette. Ainsi : la cuisine. Les ranges de casseroles sont si bien astiques et si relui-santes qu'on peut s'y mirer. Ainsi : Nol. L'arbre de Nol qu'on plante chez soi, les fils d'or et d'argent, les boules multicolores, les jouets qu'on dcouvre dans ses chaussures. Ainsi, les gteaux de l'Ad-el-Sghir, le mouton qu'on gorge l'Ad-el-Kbir... Ainsi la vie ! Les lves entre eux disaient : celui qui sait le mieux mentir, le mieux arranger son mensonge, est le meilleur de la classe. Omar pensait au got du pain dans sa bouche : le matre, prs de lui, rimposait l'ordre. Une perptuelle lutte soulevait la force anime et liquide de l'enfance contre la force statique et rectiligne de la discipline. M. Hassan ouvrit la leon. -La patrie est la terre des pres. Le pays o l'on est fix depuis plusieurs gnrations. Il s'tendit l-dessus, dveloppa, expliqua. Les enfants, dont les vellits d'agitation avaient t forte-ment endigues, enregistraient. -La patrie n'est pas seulement le sol sur lequel on vit, mais aussi l'ensemble de ses habitants et tout ce qui s'y trouve. Impossible de penser tout le temps au pain. Omar laisserait sa part de demain Veste-dekaki. Veste-de- kaki tait-il compris dans la patrie ? Puisque le matre disait... Ce serait quand mme drle que Veste-de- kaki... Et sa mre, et Aoucha, et Mriem, et les habi-tants de Dar-Sbitar ? Comptaient-ils tous dans la patrie ? Hamid Saraj aussi ? -Quand de l'extrieur viennent des trangers qui prtendent devenir les matres, la patrie est en danger. Ces trangers sont des ennemis contre lesquels toute la population doit dfendre
la patrie menace. Il est alors question de guerre. Les habitants doivent dfendre la patrie au prix de leur existence. Quel tait son pays ? Omar et aim que le matre le dt, pour savoir. O taient ces mchants qui se dcla-raient les matres ? Quels taient les ennemis de son pays, de sa patrie ? Omar n'osait pas ouvrir la bouche pour poser ces questions cause du got du pain. -Ceux qui aiment particulirement leur patrie et agissent pour son bien, dans son intrt, s'appellent des patriotes. La voix du matre prenait des accents solennels qui faisaient rsonner la salle. Il allait et venait. M. Hassan tait-il patriote ? Hamid Saraj tait-il patriote aussi ? Comment se pouvait-il qu'ils le fussent tous les deux ? Le matre tait pour ainsi dire un nota-ble ; Hamid Saraj, un homme que la police recherchait souvent. Des deux, qui le patriote alors ? La question restait en suspens. Omar, surpris, entendit le matre parler en arabe. Lui qui le leur dfendait ! Par exemple ! C'tait la premire fois ! Bien qu'il n'ignort pas que le matre tait musul-man - il s'appelait M. Hassan -, ni o il habitait, Omar n'en revenait pas. Il n'aurait mme pas su dire s'il lui tait possible de s'exprimer en arabe. D'une voix basse, o perait une violence qui intriguait : - a n'est pas vrai, fit-il, si on vous dit que la France est votre patrie. Parbleu ! Omar savait bien que c'tait encore un mensonge. M. Hassan se ressaisit. Mais pendant quelques minutes il parut agit. Il semblait tre sur le point de dire quelque chose encore. Mais quoi ? Une force plus grande que lui l'en empchait-elle ? Ainsi, il n'apprit pas aux enfants quelle tait leur patrie.
A onze heures, aux portes mmes de l'cole, une bagarre s'engagea coups de pierres. Elle se poursuivit encore sur la route qui longeait les remparts de la ville. Violentes, parfois sanglantes, ces rencontres duraient des journes entires. Les deux camps, composs de gamins de quartiers diffrents, comptaient bon nombre de tireurs hors ligne. Ceux du groupe d'Omar l'empor-taient par leur habilet, leur prestesse, leur tmrit. Ils taient les plus redouts, bien que peu nombreux. Quand on disait : les enfants de Rhiba, on voquait de vrais dmons que personne ne prtendait mettre la raison. Que de fois ils avaient poursuivi leurs adver-saires au centre mme de la ville et jusqu'au Grand Bassin en semant la terreur parmi les paisibles citadins ! Par ces journes d'hiver, comme une bande de cha-cals, ils envahissaient des chantiers o ils arrachaient des planches qu'ils brlaient. Ils alimentaient de grands feux qu'ils entretenaient dans les terrains vagues et se rassemblaient autour, grands et petits, mettant des cris bizarres pour rompre le silence. Pour ses jeux, Omar ne connaissait d'autres lieux que la rue. Personne, et sa mre moins que quiconque, ne l'empchait, quand il se rveillait, de courir vers la rue. Ils avaient dmnag des dizaines de fois, mais dans chaque quartier il existait un passage au milieu des derbs, des lotissements en construction, que tous les enfants de l'endroit lisaient comme lieu de leurs bats. Omar passait l son temps libre, autant dire toute la journe ; dcidant souvent qu'il n'avait rien d'intres-sant faire l'cole, il rejoignait les autres gamins. On aurait tonn sa mre si on se ft avis de lui dire qu'il n'tait pas bien indiqu de laisser un enfant traner de la sorte, n'importe o, qu'il risquait de se dvoyer, d'acqurir des gots de vagabondage et de paresse. Qui sait ? Puisqu'il n'tait pas simplement livr ses seules fantaisies mais aussi l'influence de garons plus gs que lui, des garnements bruyants, cyniques, chapar-deurs qui infestaient ces quartiers. Leur ge, leurs poings leur permettaient de le dominer. Ces drles, que rien n'intimidait, erraient dans la ville en qute de mauvais coups tenter, de plaisanteries brutales. Ils ne perdaient jamais l'occasion de donner libre cours l'insolence dont se doublait leur obscure angoisse. Ils se montraient encore plus rudes et plus irrespec-tueux la vue des habitants honntes et bien mis. Ceux-ci les considraient d'un il malveillant, les traitaient de propres--rien, capables de tout... Mais les enfants n'en avaient cure ! Comme des forcens, ils s'opposaient tout de suite entre eux, ds qu'ils se retrouvaient, et se livraient bataille. Cela se terminait la plupart du temps dans le sang. Il y en avait toujours qui finissaient par recevoir un caillou en plein visage ou sur le crne. Lorsque dans un camp le sang jaillissait, ceux du camp d'en face prenaient leurs jambes leur cou avec de grands cris de joie sauvage, de longs : Hou ! Hou ! de mpris, qu'ils accompagnaient d'agiles cabrioles. Les autres s'appro-chaient avec gne des victimes, leurs bras retombant gauchement le long du corps. Ils gardaient longtemps les cailloux dans les mains ; leurs poches en taient bourres. Ils dvisageaient les blesss et, sans mot dire, s'loignaient. Ils se dbarrassaient de leurs pierres et du mme coup de la mauvaise conscience qui les avait submergs un instant. Ils s'en allaient en proie une vive allgresse, tandis que les blesss fondaient bruyamment en larmes. Les plus courageux serraient les dents et se taisaient ; ils ne quittaient les lieux du combat qu'arms de toutes leurs pierres. Depuis qu'il avait eu la tempe ouverte, Omar prenait peur de ces bagarres.
Les tout-petits se trouvaient enrls d'office pour rcuprer sur le champ de bataille, o ils taient pousss de force, tous les cailloux que les adversaires se lan-aient. Les grands qui faisaient la guerre taient souples et adroits. Face l'ennemi, ils voyaient venir les pro-jectiles et les esquivaient temps. Mais les ramasseurs, continuellement baisss, n'avaient aucune protection. Si quelque pierre les atteignait, les ans ne s'en sou-ciaient pas plus que si elle avait frapp un mur. De ces enfants anonymes et inquiets comme Omar, on en croisait partout dans les rues, gambadant nu- pieds. Leurs lvres taient noires. Ils avaient des membres d'araigne, des yeux allums par la fivre. Beaucoup mendiaient farouchement devant les portes et sur les places. Les maisons de Tlemcen en taient pleines craquer, pleines aussi de leurs rumeurs.
Jeudi. Omar n'avait pas classe. Ani ne savait comment se dfaire de lui. Elle dposa au milieu de la pice un brasero bourr de poussire de charbon qui brlait difficilement. On pensait : c'en est fini du froid ; puis l'hiver faisait un brusque retour sur la ville et inci-sait l'air avec des millions d'artes tranchantes. A Tlemcen, quand en fvrier la temprature tombe, il neige srement. Omar appliquait sur le carreau ses pieds, qui taient de glace. Les jambes nues jusquaux genoux, vtus d'une mince tunique retrousse par -dessus des pantalons de toile, les paules serres dans un fichu en haillons, Ani grondait, prise d'une agitation fbrile. - Omar, resteras-tu tranquille ! fit-elle. L'enfant couvait le brasero. Il en remua le fond. Quelques braises vivotaient dans la cendre. Il se rtis-sait les mains, qui blanchissaient peu peu, normes comme des fruits blets, et les appliquait sur ses pieds. Le dallage rouge vif faisait mal voir. Omar se recro-quevilla devant le fourneau... Le brasero dfaillait dans la chambre sombre et humide. Omar ne rchauffait que ses mains ; ses pieds le dmangeaient irrsistiblement. Le froid, un froid immobile, lui griffait la peau. Il cala son menton sur ses genoux. Accroupi en chien de fusil, il amassait de la chaleur. Ses fesses poses sur une courte peau de mouton pele taient endolories. Il finit par somnoler, serr contre lui-mme, avec la pen-se lancinante qu'il n'y avait rien manger. Il ne restait que de vieux crotons que la tante leur avait apports. La matine, gristre, s'coulait minute aprs minute. Soudain, un frmissement lui parcourut le dos : il se rveilla, les jambes engourdies et pleines de fourmille-ments. Le froid pinait intolrablement. Le fourneau avait disparu : Ani l'avait emport. A l'autre extrmit de la pice, assise en tailleur, le brasero pos sur une de ses cuisses, elle marmonnait toute seule. Elle le vit ouvrir les yeux : -Voil tout ce que nous a laiss ton pre, ce propre- -rien : la misre ! explosa-t-elle. Il a cach son visage sous la terre et tous les malheurs sont retombs sur moi. Mon lot a t le malheur. Toute ma vie ! Il est tran-quille, dans sa tombe. Il n'a jamais pens mettre un sou de ct. Et vous vous tes fixs sur moi comme des sangsues. J'ai t stupide. J'aurais d vous lcher dans la rue et fuir sur une montagne dserte. Mon Dieu, qui pouvait l'arrter prsent ? Son regard noir, tourment, luisait. -Mon destin de malheur, murmura-t-elle. Omar se taisait. Elle en voulait srement quelqu'un. Mais qui ? Elle commena par se rpandre en diatribes contre des fantmes. L'enfant, devant cette colre qui montait, ne comprenait plus. Y avait-il quelqu'un d'autre dans la chambre ? Grand-mre, mais...
Grand-mre Mama tait couche derrire Omar. Ils l'avaient recueillie la veille ; son fils l'avait garde trois mois ; c'tait maintenant au tour d'Ani de la prendre pendant trois mois aussi. Grand-mre Mama tait para-lytique. Elle conservait nanmoins sa lucidit ; son regard bleu, net, brillait de son ancien clat : presque enjou. Pourtant, malgr le rayonnement de bont qui en manait, ses yeux se figeaient en une expression froide et dure certains moments. Son visage, un joli petit visage de vieille, rose, propre, tait encadr d'une gaze blanche. On devait aider Grand-mre pour tout, pour manger, se retourner, faire ses besoins... Omar frissonnait insensiblement. Dposant le bra-sero par terre, Ani pivota sur place et regarda Grand- mre : -Pourquoi ne te garde-t-il pas, ton fils ? Quand tu servais de domestique sa femme pendant des annes, tu tais intressante ! Quand tes pieds ne t'ont plus por-te, il t'a jete comme une ordure ? Maintenant tu n'es plus bonne rien ? C'est a ? Ani se dressait sur ses genoux pour lui souffler sa rancune au visage. Grand-mre essaya de l'apaiser : -Ani, ma fille. Ma petite mre ! Maudis le Malin, c'est lui qui te met ces ides en tte. -Puisses-tu touffer sur ta couche ! Pourquoi n'as-tu pas refus de te laisser amener ici ? -Que pouvais-je faire, ma petite ? -C'est sa femme qui t'a envoye chez moi. Lui, il lui lcherait les pieds. Elle travaille pour le nourrir et il passe son temps rouler dans les cafs. Fils de chien qu'il est ! Tais-toi, je ne veux pas t'entendre. Je ne veux pas entendre le son de ta voix ! Tais-toi ! Tais-toi ! Dieu vous a jets sur moi comme une vermine qui me dvore. Les yeux de Grand-mre suppliaient. Omar eut envie de courir vers la rue, de sortir. Il voulait crier ; mais le visage de sa mre s'interposa entre lui et la porte. Il s'aplatit contre terre et ne remua plus. Il tait prt hurler ; s'il se faisait entendre des voisins, peut-tre accourraient-ils et le dlivreraient-ils de l'impitoyable treinte de sa mre. Mais elle ne le toucha pas ; il resta couch sur le sol jusqu'au moment o, d'une voix perante, elle lui commanda : -Lve-toi ; viens. Il se redressa et s'approcha avec une lenteur calcule. D'un signe de tte, elle lui enjoignit de soulever Grand- mre. Il redressa son aeule avec Ani. Omar se demandait ce qui allait se passer. Il suivait sa mre avec anxit quand il s'aperut qu'elle entranait Grand-mre dehors. Grand-mre, affole, ne s'arrtait pas d'im-plorer : -Ani, Ani, ma fille ! Ani les tirait tous les deux. Ils s'en allrent, empor-tant la vieille femme tout au long de la galerie, jusqu' la cuisine, o Ani, lchant prise, la laissa s'effondrer mollement sur le carrelage. Omar tremblait. Les plaintes de Grand-mre taient empreintes d'une angoisse sans nom, et si effrayantes qu'il ressentit le besoin de hurler son tour.
La cuisine de l'tage tait une grande pice aux murs noirs, pave de larges dalles encombres de toutes sortes d'objets ; dmunie de porte, elle tait envahie par un petit jour peureux. Le froid ici touchait la mort. Ani semblait avoir dcouvert ce qu'elle dsirait. Retirant une chaise poudreuse du milieu du bric--brac, elle la posa derrire Grand-mre qu'elle fit asseoir dessus ; en s'loignant, elle dit son fils : -Viens, toi. Ils abandonnrent la vieille dont le visage plissait. Son regard vacillait. Mourir, mourir , disait-il. Omar hurla. -Tu es fou, de crier comme a ? Ani se jeta sur lui. -Tu sais ce qu'il va t'arriver, fit-elle dans un chu-chotement. Omar inclina la tte ; brusquement il dit : -Je m'en fous ! Et il se sauva ; elle le suivit grandes enjambes. Il traversa la cour d'un seul lan et regagna le vestibule pour fuir dans la rue. Arrive la porte, sa mre, qui n'avait pas son voile, ne put aller plus loin. Elle l'acca-bla de maldictions. -La ferme, putain ! rpliqua-t-il. Il prit le large. Des passants venaient dans la ruelle : Ani se retira. Quand ils furent devant la maison, elle les pria travers la porte de lui ramener son fils. Mais Omar, dj loin, filait toute allure. En rentrant, Ani referma la porte, retirant ainsi au gamin la possibilit de revenir sans qu'elle en ft avertie.
Il tranailla dehors, le temps qu'elle pt oublier sa colre. Il retourna ensuite Dar-Sbitar. Il se coulait vers la chambre, quand Ami l'aperut. Aussitt, elle bondit ses trousses. Omar se sauva. Il se mit blasphmer. - Maudite ! Maudits, tes pre et mre ! Il galopa de nouveau vers la rue. Un vent glacial balayait l'troite venelle. Il chercha un endroit o s'abriter. Il renonait revenir Dar-Sbitar maintenant ; mais il tait furieux d'avoir t mis la porte de cette manire. Une entre d'immeuble : il s'y faufila. Il se tapit entre le battant, qui tait pouss, et une poubelle. Son pied le tourmentait ; la blessure de l'autre jour, rouverte, lui faisait mal. Le vent s'brouait sans arrt dans cette mai-son. Qu'allait-il faire prsent ? Le froid lui lchait la figure. En de pareils moments, il souhaitait retrouver son pre, son pre qui tait mort. Mais ce qu'il dcouvrait tait intolrable : son pre ne reviendrait jamais auprs de lui, personne ne pouvait le ramener. Il n'allait pas passer toute la nuit dans la rue ! Se voir administrer une correction, ds qu'il apparatrait la maison, ne l'effrayait pas. Que lui importait ! on pouvait tout lui faire : il ne s'y opposerait pas. Il tait comme mort, rien ne lui arriverait qui l'intresst. Il ne souffrait pas ; il ne souffrait plus ; son cur tait de pierre. Il avait dcid d'aller s'offrir aux coups sans tenter de se soustraire aucun, et de voir quelles seraient les limites de sa rsistance. Il portait en lui un dfi ; qui, le premier, se fatiguerait, lui d'endurer ou les autres de le faire souffrir ? Or, il tait persuad qu'il ne lcherait pas, qu'il tiendrait jusqu'au bout. C'est cela : il devait rentrer, rien d'autre faire. Pourquoi fuir ? Mais, pourquoi ne pas se tuer ? Ne pas se jeter du haut d'une terrasse ? Il chercha autour de lui : personne dans le corridor. Il se roula en boule pour se faire plus petit dans son coin. C'tait a, c'tait a : mourir. Qui se soucierait de lui, aprs ? Un petit accident et puis on est tranquille. Sa mre ne le retrouverait plus. C'tait le meilleur tour qu'il pouvait imaginer de lui jouer. Un claquement de pas rsonna ses cts ; il sursauta. Dj la nuit. Comment tre chez soi, dans une chambre ? Et son cur qui cognait, norme... Blotti prs de cette pou-belle, allait-on le prendre pour un mendiant ? Mais non ! Dans cette maison de Franais, si on venait s'apercevoir de sa prsence, on ne le prendrait pas pour autre chose qu'un petit voleur. On ameuterait contre lui les locataires, le quartier mme, et tout Tlemcen... Il se glissa l'extrieur. Personne ne l'avait remar-qu. A prsent, il faut rentrer. Ce n'est qu'un jeu que tout cela. Sa mre n'a aucune raison de lui administrer une racle. A aucun moment, elle n'a eu l'ide de le faire souffrir. A mesure qu'il se dirigeait vers Dar-Sbitar, Omar entendait de stridents hurlements. Il reconnaissait cette voix. Il hta le pas. Il n'avait rien mang depuis le matin, et ses jambes trs faibles ne le portaient plus. Ces cris, c'tait sa mre, poste l'entre de Dar-Sbitar, qui les lanait.
-Omar ! Omar ! s'poumonait-elle. Des gens passaient, silencieux et indiffrents. Attar-des, fantomales dans leurs voiles blancs, des femmes se pressaient. Il parvint devant la maison. Ani le vit. Saisi de panique, il s'arrta. -Entre, fit-elle. Omar demeura immobile. Il se cramponna au mur, car il se sentait sans forces. Les criailleries de sa mre s'accenturent. -Gorha ! Quilla ! L'image de Grand-mre tale sur le carreau de la cuisine, incapable de bouger, avec des lueurs d'pou-vante dans les yeux, lui revint l'esprit. tait-elle encore vivante ? Sa mre l'avait-elle frappe ? Il eut l'impression que tout s'croulait autour de lui. De nou-veau, il voulut cesser de vivre. Il pleura doucement. Les pieds nus de sa mre et le bas de sa robe traversrent vivement la rue. Elle tait devant lui sans son hak, mais il faisait nuit noire. Ani l'entrana par le bras ; ils retraversrent la ruelle et s'enfoncrent dans la maison. Ils n'avaient pas encore parcouru le vestibule qu'Omar s'croula. Sa mre le souleva. L'enfant interrogea son regard tendu qui le fixait. Elle le transporta jusqu' la chambre et le dposa sur sa peau de mouton. Elle l'tendit, la tte pose sur un bras. Omar ne bougea pas. La figure de sa mre s'loigna. Sur sa litire, l'enfant ne soufflait mot. Il lui semblait qu'il tait couch ici depuis des sicles. Lorsque le tintamarre et les bruits de voix qui lui remplissaient la tte s'teignirent, il se sentit abandonn, solitaire, rejet de la vie. Il entendit encore quelques voix toutes proches. Quel frisson le long de son corps ! Quelque chose lui disait qu'il allait sombrer ou disparatre. Il entrouvrit les yeux. Sa mre tait en train de faire ses prires ; debout, raide, elle se tint ainsi longtemps ; soudain, pli en deux, son corps se brisa. Elle se prosterna, face contre terre. Omar avait mal aux yeux ; il ne pouvait plus rien voir, n'ayant mme pas la force de tenir ses paupires carquilles. Et ses jambes frmissaient sans fin. Il commenait avoir si mal d'tre tendu. Quand viendrait le repos ?
Mars vint. Le deuxime dimanche de ce mois fut un jour mmorable pour Dar-Sbitar...
Rveill comme par un coup d'ailes, Omar bondit sur ses pieds. Dar-Sbitar bourdonnait. La rumeur rem-plissait les moindres recoins de l'norme maison, gagnait les renfoncements les plus sombres, cependant que des coups violents, impatients, taient assens la porte extrieure. Omar et ses deux surs sortirent de la chambre. Sans bien voir o elle plaait ses pas, tout ensommeille, Ani accourut vers la rampe de fer qui courait le long de la galerie. Des mches flottaient en broussaille au- dessus de sa tte, son foulard ne pouvait les retenir. -Qu'est-ce qui se passe ? Elle arrangea sa coiffure. -Mais que se passe-t-il donc ? C'tait un tumulte incomprhensible : les locataires s'lanaient htivement des pices, les uns la suite des autres, et se rassemblaient dans la cour. Des chu-chotements, de brusques clats de voix, des vagisse-ments de nourrissons, des frlements de pieds nus se rpandaient dans les galeries, la cour, les chambres : c'en tait fait du calme et de l'paisse tideur du matin. Les premires lueurs de l'aube pointaient. La nuit se dissipait, comme en cachette. Des coups de heurtoir, puis des coups de bottes,branlrent sans arrt la grande porte cloute qui demeurait close. Personne, l'intrieur, ne chercha s'en approcher. On s'interrogeait : -Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui arrive, bonnes gens ! Omar sauta dans l'escalier et disparut si prestement que sa mre n'eut pas le temps d'esquisser un mouve-ment. -Omar ! Omar ! Reviens... La fivre noire t'em-porte ! L'enfant s'infiltra dans le groupe de femmes qui s'tait form dans la cour et stationnait l'entre du vestibule. -Chut ! Chut ! ordonna-t-on. -Ani, tais-toi, s'cria Zina. Bouh ! laisse-nous en-tendre ce qui se passe. Qu'est-ce que cette catastrophe ? Sans se rendre aux injonctions qui lui parvenaient de toutes parts, Ani s'obstinait vituprer : -Omar ! Quilla ! Reviens, si tu ne veux pas que je te coupe en morceaux. Ses menaces restrent sans effet, comme d'habitude. Il se fit bientt une animation anxieuse, frmissante. Les femmes se consultaient sur ce qu'il fallait faire. Allait-on ouvrir ou non ? L'inquitude s'emparait de chacun. A petits pas, la vieille Acha vint dans la cour en s'appuyant aux murs. Levant les yeux au ciel : -Mon Dieu, si tu veux bien accepter ma prire, pro tge-nous, implora-t-elle mi-voix.
Elle s'agenouilla. Ses lvres remuaient impercepti-blement. Les hommes avancrent de quelques pas. Ils n'all-rent pas plus loin que le seuil de chaque chambre. Quelques-uns s'occupaient resserrer le cordon de leur culotte bouffante. Une femme dcida : -Par Dieu, j'ouvrirai et on saura bien qui c'est ! C'tait Sennya qui jurait ainsi : celle-l, elle n'avait peur de rien, elle faisait toujours ce qu'elle disait. -a ne peut tre que la police. Tu n'entends pas le bruit qu'ils font ? Il n'y a qu'eux pour s'annoncer de la sorte. L'homme qui jeta ces paroles haute voix se tut. Tout le monde pensa comme lui. a ne pouvait tre que la police. Sennya entrouvrit tout de mme la porte et passa sa tte dans l'entrebillement : c'taient bien des policiers - une dizaine -, masss dans la ruelle ! Sennya eut un mouvement de recul. Mais elle se matrisa et leur demanda ce qu'ils venaient chercher ici. Cette Sennya, elle avait du courage ! -Nous n'avons ni voleurs, ni criminels, chez nous ! dit-elle. Que voulez-vous ? -Ce que nous voulons ! rpliqua un agent. Laisse le passage. La troupe de policiers s'engouffra dans le vestibule. Parmi eux, trottait un petit gros en costume marron clair. Il faisait attention ne pas le tacher. Effares, les femmes se dispersrent et disparurent en un clin d'il dans les premires pices qui s'taient prsentes elles. La peur leur faisait perdre la tte comme une vole de moineaux. Omar se trouva seul dans la cour. Son sang buta contre ses tempes. Des agents de police ! Son cur voulait jaillir de sa poitrine. Clou sur place, il aurait dsir pouvoir crier : Maman ! Son front tait moite. Brusquement il hurla : -Les agents de police ! Les agents de police ! Les voil ! Les voil ! Il pensa : Ma, je t'en supplie, je ne te referai plus de peine ; protge-moi, protge-moi, seulement. Il souhaita ardemment la prsence d'Ani prs de lui pour qu'elle le recouvrt de sa toutepuissance de mre, pour qu'elle levt autour de lui une muraille impossi-ble franchir. Les agents lui faisaient si peur ; ces agents, il les dtestait. Sa mre, o tait-elle ? O tait ce ciel tutlaire ? Il continua crier : -Les policiers ! Les policiers ! Retrouvant d'un coup l'usage de ses jambes, il courut se terrer chez Lalla Zohra.
Les agents de l'ordre occupaient la cour ; ils s'adres-srent la maison : -N'ayez pas peur. Ne craignez pas pour vous. Nous ne sommes pas venus vous faire du mal. Nous n'accom-plissons que notre travail. Dans quelle chambre habite Hamid Saraj ? L'agent qui avait parl Sennya au dbut discourait cette fois en arabe. Aucune rponse. Dar-Sbitar semblait avoir t abandonne en une seconde par ses occupants ; on la sentait pourtant attentive. -Alors, vous ne savez pas ? L'air s'paississait mesure que se prolongeait le silence. Les policiers sentaient que DarSbitar tait devenue brusquement ennemie. Dar-Sbitar s'enfermait dans sa crainte et dans son dfi. Dar-Sbitar, dont ils avaient troubl le sommeil et la paix, montrait les dents. Les policiers frappaient le dallage sonore de leur talon. L'cho largissait le vide qui s'tendait entre les gens de la maison et les hommes de l'Autorit. Tout coup une porte claqua avec fracas au rez-de- chausse, et la courte stature de Fatima apparut. Les argousins, en une charge lourde, arrivrent sur elle. -Ne vous donnez pas de mal, leur dit-elle. Mon frre n'est pas ici. Deux agents dj l'entouraient, mais cela ne parais-sait pas l'affecter ; les autres policiers s'taient introduits en un clin d'il dans sa chambre. Alors, une une, les femmes revinrent dans la cour. La vieille Acha, sans aucune apprhension, dclara : -Qu'a-t-il fait, ce garon? Nous le connaissons depuis qu'il courait dans la rue. Nous n'avons jamais rien eu lui reprocher. Il ne ferait pas de mal une mouche. Avec quoi ferait-il du mal ? Comprenaient-ils, ou ne comprenaient-ils pas ? Les hommes de la force publique ne bronchaient pas ; leurs yeux vides ne se fixaient sur rien. Un moi de ruche excite agitait la demeure, les femmes s'entretenaient toutes la fois ; le brouhaha s'enflait. Les policiers fouillaient la pice : ils avaient emmen Fatima l'intrieur de la chambre. En mme temps, des sanglots partirent du recoin sombre o Omar tait blotti. Alors l'enfant se souvint qu'il s'tait rfugi chez Lalla Zohra. Il ne savait pourquoi, par exemple. Mais il tait content. Une brave femme, Lalla Zohra ; il l'aimait bien. Son visage portait une expression de dou-ceur jamais vue chez d'autres ; elle ne cessait pas de sourire. Les pleurs continuaient. Menoune, malade, tait cou-che l, depuis que son mari l'avait renvoye chez sa mre. La vieille femme la veillait. -Rendons grces au Ciel pour ses bienfaits, pro-nona Lalla Zohra. Ses regards taient tourns vers la cour.
Menoune rptait dans ses sanglots : -De ma vie, ma petite mre. De ma vie. Ces paroles ritres sur un ton d'absolue certitude avaient fait tressaillir le cur d'Omar : quelque chose de dfinitif, semblait-il, venait de se dcider. Omar en eut vaguement le pressentiment. Il considra la forme tendue. Lalla Zohra assise ses cts, les jambes croises, embrassait de temps autre la malade, trs branle. Dans ses deux mains, elle lui enfermait les siennes. -Tu seras gurie, ma chrie. Dans un mois. Tu retourneras auprs de tes petits... Si tu es bien sage. Le docteur l'a ditLa vieille femme parlait comme un enfant. Omar fit effort sur lui pour demeurer tranquille. La voix de Menoune s'leva, pleine de tristesse. - Je sais trs bien que je vais mourir, ma petite mre. Je ne te reverrai plus ; je ne reverrai plus mes enfants, de ma vie. Elle baissa la voix. Elle redit De ma vie, mes enfants . Et elle se calma. Aprs quelques instants d'accalmie, elle se mit chantonner voix basse : Quand la nuit se brise Je porte ma tideur Sur les monts acrs Et me dvts la vue du matin Comme celle qui s'est leve Pour honorer la premire eau : trange est mon pays o tant De souffles se librent, Les oliviers s'agitent Alentour et moi je chante : - Terre brle et noire, Mre fraternelle, Ton enfant ne restera pas seule Avec le temps qui griffe le cur ; Entends ma voix Qui file dans les arbres Et fait mugir les bufs.
Brusquement, Menoune recommena pleurer. Sa mre voulut parler, mais ne put que secouer la tte. Elle regarda Omar, puis autour d'elle comme pour implorer aide et rconfort. La voix de Menoune modulait cet instant une antienne funbre qui n'tait destine qu' elle-mme. - Vous ne reverrez plus, dit-elle, plus votre mre, mes enfants. Le doux visage de Lalla Zohra parut fatigu ; l'enfant ressentit cette peine comme une parcelle d'une immense douleur. Le premier moment de frayeur pass, les femmes, qui avaient retenu leurs maris dans les chambres, s'en-hardissaient, narguant la marchausse. Fatima parut, l'agent qui lui serrait le bras l'ayant repousse dehors. Elle se prit pousser des lamenta-tions interminables et s'envoya de grandes tapes sur les cuisses. Sa plainte monta, vrillante, et Dar-Sbitar tout entire vibra, pntre de part en part par la maldiction qu'elle profra. Le cur et la raison des locataires cdrent sous la puissance de cette note stridente. De toute la maison, monta alors une rumeur inquitante. Cette lamentation de haine et de fureur annonait le malheur qui venait grandes enjambes d'entrer dans DarSbitar. Les agents remuaient les papiers que Hamid avait runis chez sa sur. Ils les ramassaient et, pour cela, mettaient la pice sens dessus dessous. Fatima s'arrta de crier ; elle se plaignit doucement : -Bouh, bouh, que va devenir mon frre ? Que vont- ils lui faire ? Bouh, bouh, pour mon frre... Son dsespoir difficile dborder, monotone, infiniment lourd, cheminait comme un charroi fatigu. Dans sa chambre, Menoune dlirait faiblement. Depuis quelques jours, elle mlait tout. Elle perdait cons-cience et ignorait ce qui se passait. Elle rptait encore : -Je ne vous reverrai plus, mes petits. Son chant revint sur ses lvres, trs doux, dchirant : Ce matin d't est arriv Plus bas que le silence, Je me sens comme enceinte, Mre fraternelle, Les femmes dans leurs huttes Attendent mon cri. Sans se rendre certainement compte de ce qu'elle disait, elle reprit plusieurs fois : Mre fraternelle,
Les femmes dans leurs huttes Attendent mon cri. Omar, indcis, ne comprenait quelle aide il pouvait apporter. Les policiers remplissaient la grande demeure de leurs mouvements. Quand partiraient-ils ? Il couta encore le chant qui s'leva de l'obscurit de la chambre. Pourquoi, me dit-on, pourquoi Vas-tu visiter d'autres seuils Comme une pouse rpudie ? Pourquoi erres-tu avec ton cri, Femme, quand les souffles De l'aube commencent A circuler sur les collines ? Tout en haut de l'habitation, un autre cri de femme explosa ; c'tait Attyka, une pauvre possde, qui lan-ait ces clameurs. Il se forma un son aigu qui rsonna sans relche, perant le cur endolori des gens de la maison. Et l'air se mit trembler. - Nous ne sommes venus que pour perquisitionner, hennit le petit gros. Voil tout ! Omar ne demandait plus un morceau de pain tremp dans l'eau de la fontaine : quand les plus grands mal-heurs fondent sur nous, ils nous suffisent pour tromper notre faim. Il ne pensait plus sa faim ; elle stait estompe, devenue lointaine, et ne veillait en lui que comme un vague haut-le-cur qu'il ne parvenait pas refouler. La tte lui tournait ; il mastiquait sa salive et l'ava-lait. Cela lui donnait une bizarre sensation de nause. Il ne rencontrait qu'un vide l'intrieur de lui-mme : au-dessus de ce vide, se balanait le souvenir de ce qu'il avait mang la veille. Mais comment, avec un dgot semblable, pourrait-il encore tolrer un peu de nourriture ? Cette cendre des longues heures o il n'avait eu aucun aliment, il n'arriverait jamais la cra-cher, la cracher entirement. Moi qui parle, Algrie, Peut-tre ne suis-je Que la plus banale de tes femmes Mais ma voix ne s'arrtera pas De hler plaines et montagnes ; Je descends de l'Aurs, Ouvrez vos portes pouses fraternelles,
Donnez-moi de l'eau frache, Du miel et du pain d'orge. Le chant peine flotta-t-il une fois de plus dans la pice que les policiers firent irruption. Ils s'immobili-srent ; ils ne distingurent d'abord rien dans la pnom-bre. Leur hsitation fut de courte dure, et, sans plus tarder, ils renversrent tout. S'approchant de Lalla Zohra et de sa fille, atterre, ils tranrent la malade, qui fut dcouverte jusqu' mi- jambes. Ils furetrent l'endroit o elle tait couche. Les sanglots de Menoune retentirent et se transfor-mrent en un appel ardent qui traversa la chambre bou-leverse. Ce cri de chagrin, par lequel elle et dsir expulser le mal qui lui rongeait la poitrine, jaillit plus puissant que le tapage et le tohu-bohu mens par les gens de la police. Et brusquement il redevint un chant. Je suis venue vous voir, Vous apporter le bonheur, A vous et vos enfants ; Que vos petits nouveau-ns Grandissent, Que votre bl pousse, Que votre pain lve aussi Et que rien ne vous fasse dfaut, Le bonheur soit avec vous. Les policiers interloqus interrompirent leur fouille ; ils abandonnrent la chambre et s'en furent de nouveau dans la cour. Ils avaient interdit Fatima d'entrer chez elle. Elle s'accroupit dans la cour avec ses gosses autour d'elle et attendit. Ils fouillrent encore dans les livres d'Hamid, s'emparrent de quelques volumes, de vieux journaux et de papiers. Ils en emportrent une partie et parpillrent le reste dans la pice et la cour. Enfin ils s'en allrent ; Fatima put rentrer dans sa chambre. La police oprait dans le quartier pour mille raisons : des jeunes gens et des hommes mrs furent emmens ainsi, qu'on ne revit plus. A Dar-Sbitar s'levaient encore les protestations vhmentes du vieux Ben Sari ; mais les forces de l'ordre taient parties. -... Je ne veux pas me soumettre la Justice, clamait-il. Ce qu'ils appellent la justice n'est que leur jus-tice. Elle est faite uniquement pour les protger, pour garantir leur pouvoir sur nous, pour nous rduire et nous mater. Aux yeux d'une telle justice, je suis toujours coupable. Elle m'a condamn avant mme que je sois n. Elle nous condamne sans avoir
besoin de notre culpabilit. Cette justice est faite contre nous, parce qu'elle n'est pas celle de tous les hommes. Je ne veux pas me soumettre elle... Ae, cette colre, on ne l'oubliera pas ! Ni la prison o des ennemis enferment nos hommes. Des larmes, des larmes, et la colre, crient contre votre justice... elles en auront bientt raison, elles sauront bientt en triompher. Je le proclame pour tous : qu'on en finisse ! Ces larmes psent lourd et c'est notre droit de crier, de crier pour tous les sourds... s'il en reste dans ce pays... s'il y en a qui n'ont pas encore compris. Vous avez compris, vous. Allons, qu'avez- vous rpondre ?...
Ani versa le contenu bouillant de la marmite, une soupe de ptes haches et de lgumes, dans un large plat en mail. Rien de plus, pas de pain ; le pain man-quait. -C'est tout ? s'cria Omar. Une tarechta sans pain ? En arrt devant la meda et le plat qui fleurait le piment rouge, Omar, face sa mre, Aoucha et Mriem, se dressait, les jambes cartes, dans l'embra-sure de la porte : -Et c'est tout ? rpta-t-il. Cette fois c'tait avec colre et dpit. -Il n'y a plus de pain, dit Ani. Le pain que nous a apport Lalla est fini depuis hier. -Comment allons-nous manger la soupe, Ma ? -Avec des cuillers. Les cuillers plongrent dans le plat : aussitt Omar s'accroupit auprs des autres. Ils lapaient en silence, avec une rgularit quasi mcanique, la soupe qui leur bouillantait la bouche. Ils l'aspiraient et ils avalaient : une sensation de bonne chaleur leur descendait l'intrieur du corps. C'tait bon, la soupe de l'hiver. -Fille, doucement. Aoucha sursauta. -Euh, moi ? Elle s'touffa, le visage en feu sous l'effet de la gn-reuse bouillie ; mais elle ne s'arrta pas pour autant de lamper avec sa cuiller. -Regarde Mriem, souffla-t-elle. -Tu ne veux pas tout manger, Mriem ? menaa alors Ani. -Ne te gne pas, si tu veux tout manger, ajouta Aoucha. Mriem, la plus jeune, redressa la tte : tous la fix-rent dans le blanc des yeux. Elle baissa la tte. Le piment de Cayenne avec lequel Ani piait la soupe leur cuisait la langue ; ils buvaient. Ils rebuvaient et rebuvaient encore, et le ventre leur ballonnait. C'tait pour cette raison qu'Ani faisait de telles tarechta. -C'est pour a ! recommandait leur mre. Bientt le peu de soupe qu'elle avait servi fut ab-sorb ; les cuillers ne raclaient plus que le fond du plat. Leur faim se rveillait prsent, excite par la nour-riture brlante qu'ils avaient ingurgite.
Les enfants s'arrachrent le plat qu'ils rcurrent avec acharnement. Ils recueillirent encore quelques gouttes de bouillie. Force leur tait d'avoir recours l'eau pour se remplir l'estomac. Penchs sur le grand seau qui tait pos ct d'Ani, ils achevrent de se rassasier. Ani leur avait demand : -Mouchez-vous, les gosses, avant. Tout de suite, ils s'cartrent de la meda et ramp-rent, chacun vers un coin. L'un suivant l'autre, ils s'allongrent sur le sol ; le silence se rpandit dans la pice. Assise sur une peau de mouton, Ani tendait ses jambes devant elle. Plusieurs minutes s'coulrent ainsi ; se dtachant d'une contemplation sans objet, elle pria Aoucha d'enlever vite cette meda. -Toujours moi. Je me souhaite la mort. Peut-tre aprs serai-je tranquille ! A son tour, elle ordonna Mriem de l'aider dbarrasser. Empoignant toutes deux la meda, les filles s'loi-gnrent vers la cuisine, la petite reculons, Aoucha la poussant devant elle. A cette heure-l les locataires se renfermaient chez eux : Dar-Sbitar se reposait. C'tait l'heure de la sieste. En ces premiers jours de mars, on se serait presque cru en t. Dans la chambre chacun se verrouillait sur une pense personnelle. Il faut que nous ayons le ventre bien creux, songeait Ani. Ils s'taient tous couchs sans s'tre regards. Figures de chien ! Figures de mauvais augure ! pensaient- ils. Figures, figures de lune ! Sans s'tre regards. Les autres jours, o ils savaient qu'il n'y avait rien manger, sans demander d'explication, ils s'allon-geaient sur une couverture, une peau de mouton, par terre, ou mme le dallage, et observaient un silence obstin. Le moment du repas, ils feignaient de l'ignorer. Parfois Mriem pleurait un peu. Le reste de la journe, ils taient moins sombres. Seulement quand se rapprochait l'heure de manger, leur unique proccupation rapparaissait : alors Mriem et Omar interrompaient leurs jeux, arboraient des mines farouches. Jadis Ani parvenait les calmer avec un stratagme : ils taient encore des bambins. A condition qu'elle et un peu de charbon, le soir, elle faisait chauffer la marmite et la laissait bouillir. Aux enfants qui attendaient patiemment, elle disait de temps en temps : -Un peu de calme. Ils poussaient de profonds soupirs rsigns ; le temps passait. -Petits, a sera prt dans un instant.
Un assoupissement invincible les terrassait, fondant du plomb sur leurs paupires. Ils s'endormaient, som-braient dans le sommeil, leur patience ne durant jamais longtemps. Dans la marmite, il n'y avait que de l'eau qui chauffait. Zoulikha, qui habitait en bas, s'y prenait elle aussi de la mme faon avec ses enfants, quatre moutards tenant peine en quilibre sur leurs pattes molles. Le pain faisait aussi frquemment dfaut chez elle que chez Ani. -Que voulez-vous de moi ? criait-elle. Pauvre de moi ! Vous tes ma honte. O irai-je vous chercher ce pain ? Elle prenait alors une poigne de haricots secs qu'elle semait toute vole dans la chambre. Se jetant sur le sol, les marmots les cherchaient et ds qu'ils dcou-vraient un des grains blancs parpills, ils se mettaient le grignoter. Les petits se calmaient et la mre avait la paix pour un moment. -Alors ? vous avez djeun ?... s'enquit la voisine qui se posta sur la marche de l'entre. -Ae ! Ne disons pas, Zina ma chre, que nous avons djeun. Disons seulement que nous avons tromp la faim, rpliqua Ani. Nous souhaiterions, bien sr ; nous souhaiterions... Ani parut s'abmer dans une grande rflexion. tait-ce aprs les paroles de la femme ? -Nous passons notre temps tromper la faim, reprit- elle. Silencieusement, elle rit. -La faim djoue, n'est-ce pas ? Ce que nous faisons tous les jours, commenta la femme. Elle voulait sans doute dire qu'elle en avait l'habitude aussi. -Nous souhaiterions quelque chose de plus copieux cette heure, poursuivit Ani, qui ne prit pas garde ce que disait Zina. J'en conviens... Nous n'arrivons mme pas avoir des fves ou des petits pois. Ils ne cotent presque rien en ce moment. -Qui ne voudrait pas en avoir ? reconnut l'autre. La femme reprit : -Mon fils Hamadi travaille. Mais a n'est pas plus facile, la vrit. -a, petite sur, dit Ani, c'est moi qui suis le travailleur de la famille. Ae ! qu'est -ce que je n'ai pas vu ! Qu'est-ce que je n'ai pas vu ! Cette voisine se montrait toujours crmonieuse et polie ; avec Ani, elle tait encline plus de dfrence encore. -Et moi, dit-elle. Je n'ai rien vu ?... Zina se prit d'abord parler sur un ton de confidence. Mais elle s'interrompit. Elle hsitait. Non point qu'elle et fini de parler : elle regardait Ani et ses gosses et voyait qu'ils avaient leur content de misre.
-Ils sont trois hommes, mes fils. Les femmes, trois aussi : moi et mes deux filles. Et il n'y a qu'un seul qui apporte manger. Mme avec la force qu'il a, mon deuxime ne peut pas faire vivre cinq autres personnes. Mais ceux qui ne travaillent pas tiennent tout de mme manger ! Elle n'tait pas enchante, Zina, de les avoir acca-bls. Ces paroles superflues, elle et souhait ne les avoir pas prononces. Elle et voulu que quelqu'un l'arrtt, elle ne le pouvait pas d'elle-mme. -Pardonne-moi... protesta Ani. Elle essaya de paratre aussi polie que la femme. -Moi, si j'tais toi, je ne parlerais pas comme a. Les enfants couchs sur le sol ne desserraient pas les dents, n'esquissaient pas un seul geste. Ils coutaient discrtement. Aoucha se souleva un peu, considra les deux femmes, et reprit sa position. -Comme on voudra, rtorqua la voisine. En fin de compte, a revient au mme. -C'est que moi, s'excusa Ani, je ne dissimule pas ma pense. Je dis ce que j'ai dans le cur. Je crois devoir te dire que tu es un peu injuste. -J'ai pour toi l'admiration la plus grande, approuva la voisine. Travailleuse telle que je te connais, tu dois tre l'orgueil de ta famille, et sa providence. L'orgueil de ceux qui vivent avec toi... Qui vivent de ton travail... J'ai de l'admiration !... -Oui, c'est moi qui travaille pour tous ici. Tu les vois de tes yeux ? L'ane pissait sur elle quand leur pre me les a laisss. Elle se retourna, les montra d'un geste de la main : Omar eut l'impression que c'tait la merveille du monde qu'elle dcouvrait la vue de la voisine. Ani, l'auteur et le matre de cette uvre, se redressa, ses regards brillaient d'un rel sentiment d'orgueil. Elle sourit modestement. -Je dis que je travaille pour eux, ajouta Ani. C'est sr. Je me fatigue, je me tracasse, je me casse la tte- Mais c'est leur bien. Le bien qui leur est d. Il arrive jusqu' eux, leur bouche mme. Personne ne pourra le leur ter. Les crotes de pain rassis que leur donnait tante Hasna, taient-elles dues aussi ? Omar retourna la ques-tion en tous sens et ne sut que rpondre. Il fallait le croire : sinon, comment expliquer que Lalla, d'elle- mme, en allant tous les jeudis au cimetire, poussait jusqu'ici pour leur apporter ces vieux crotons cassants ? Dfrente, Zina coutait. -C'est pour a que je disais que tu es un peu injuste. Toi et tes enfants, vous mangez ce qui vous est d. -J'en conviens, acquiesa la bonne femme. Mais que de fois on oublie ces choses. -a veut dire qu'on perd espoir.
Les enfants se sentaient vaguement fiers de leur mre. -C'est moi qui travaille, rappela encore Ani. Et c'est mon sang que j'use ce travail. Mais c'est d. -Je ne mets pas en doute. Ne l'ai-je pas toujours dit ? Tu es une femme courageuse. Travailleuse. Tu ptris toi-mme ton pain, roule ton couscous, et lave ton linge. Et tu sues pour faire vivre tes enfants. Un temps ; Zina reprit : -Mais je ne crois pas que nous, mme en nous tuant la tche... Ani se leva. Elle ramassa sa peau de mouton et se plaa auprs de la voisine, coude coude. -Nous n'y parviendrons jamais. Nous ne sommes pas assez forts ce jeu-l, conclut la femme. -C'est... Comment tu as dit ? interrogea Ani. -Le sou est trop haut accroch, pour nous, pauvres. Quand nous peinerons nous rompre les os, nous n'y arriverons pas. Et si nous ne travaillons pas... Pour man-ger, attends demain : voil ce qu'on te dit, toujours demain. Et demain n'arrive jamais. -Juste, dit Ani. Elle fit des efforts visibles pour rflchir. Elle ne par-venait pas encore remuer ses ides. -C'est ce qu'il faut savoir ! s'exclama-t-elle. -Mon dfunt mari le disait, expliqua la voisine. Il essayait de le faire comprendre aux autres. Rsultat : il a t jet en prison. Tant et tant de fois. -Parce qu'il disait a ? -Pas plus. -On ne met pas un homme en prison parce qu'il prononce une parole juste ! -Pourquoi, dis-moi, ce matin, ces envoys du mal-heur ont fait leur apparition chez nous ? N'est-ce pas pour emmener Hamid Saraj ? -Comme un flau du ciel, jura Ani. Maudits soient-ils tous, et maudit celui qui les a envoys ! -Hamid est un coupeur de routes ? Ani ne trouvait rien dire. -Il n'y a plus de dshonneur aller en prison main-tenant, expliqua Zina. Si on y jette cet homme, ce sera une fiert pour ceux qui iront aprs lui. -Zina, ma petite sur ! -La vrit, par Dieu !
-Celui qui m'a effraye, moi, c'est le petit gros. -C'tait le commissaire. Tu as remarqu ? Il avait des yeux dont les btes n'auraient pas voulu. L'incrdulit toila les traits d'Ani, qui eut l'air d'une petite fille cet instant. -Nous voyons ce que nos hommes endurent ! mit- elle tout bas. -Mon mari tait comme Hamid. Hamid a d dire des choses ! convint la voisine. Certainement beaucoup de choses. Ce fut au tour de Zina de paratre fire. Cependant elle demeura songeuse. Ani aurait voulu en profiter pour revenir son premier sujet de conversation. Elle n'oubliait pas, elle non plus, sa fiert. Mais les deux femmes se mirent penser ensemble Hamid. Qu'allait-il advenir de lui prsent que les autorits taient venues le chercher ? Les premiers temps, personne ne s'tait aperu de la prsence de cet homme, jeune encore, nouvellement install dans la maison. Son arrive avait t discrte. Personne ne l'entendait parler. Il ne manifestait son existence que d'une manire trs rserve. Cela fut considr comme un degr pouss de bonne ducation. C'tait tout de mme chose rare. Il gardait le silence, et vraiment personne ne prtait attention lui. Mais quand on apprit qu'il venait de Turquie, tous les regards convergrent vers lui, chacun s'tonnant de ne l'avoir pas remarqu auparavant. Hamid Saraj portait bien ses trente ans et, en dpit de la simplicit que lui confrait son air naf et dbon-naire, il n'tait pas ncessaire d'tre fin observateur pour deviner en lui un homme qui avait beaucoup vu et, comme on dit, beaucoup vcu. Son maintien tait paisible et ferme, exempt toutefois de sans-gne. Il par-lait d'une voix basse, agrable, un peu tranante. Petit de taille, il tait nanmoins trapu. On se serait attendu de sa part des rflexes rapides, une parole prompte et facile. Mais il tait surprenant de voir sa dmarche lente, ses gestes lourds et puis-sants, d'entendre sa voix discrte. Sa vie, pour ceux qui l'approchaient, paraissait pleine de secrets. Tout jeune encore, g de cinq ans, il avait t emmen en Turquie, lors de la grande migration qui fit fuir tant de gens de chez nous pendant la guerre de 14, quand l'enrlement devint obligatoire. En Turquie, quinze ans, Hamid disparut et Dieu seul sait o il alla se fourrer. Absent pendant plusieurs annes, il ne donna de nouvelles ni ses parents, ni son unique sur, reste en Algrie. Et sa famille rentra de Turquie sans tre informe sur son sort. Un beau jour, il rapparut. La police surveilla ses alles et venues. Le plus tonnant, c'tait l'expression de ses yeux verts, trs clairs, qui semblaient voir plus avant dans les gens et les choses. Et quand il parlait, sa voix nette fixait les paroles que son curieux regard semblait lire dans le lointain... Des rides sillonnaient dj son large visage. Il perdait ses cheveux et cela lui faisait un front incroyablement haut. Il tait rare de ne pas dcouvrir dans les poches de son large paletot, vieux et gris, des livres brochs dont la couverture et les pages se dtachaient, mais qu'il ne laissait jamais perdre. C'est lui qui avait prt Omar ce livre qui s'intitulait Les Montagnes et les Hommes ; l'enfant
l'avait dchiffr patiemment, page aprs page, sans se dcourager ; il lui avait fallu quatre mois pour en venir bout. Au dbut les voisines questionnaient : - O a-t-il appris lire ? Et elles pouffaient de rire. Fatima, sa sur, rpliquait : -Il a appris tout seul. Si vous ne voulez pas me croire, venez voir ! Elles s'approchaient du seuil de la chambre : les plus curieuses glissaient leur tte par l'chancrure du rideau qui masquait la porte, puis se retiraient vivement, confuses. C'est la nuit que Hamid lisait, la lueur d'une petite ampoule. La nuit tait un moment de rpit. L'atmosphre de surexcitation de Dar-Sbitar flchissait ds huit heures du soir. On attendait ce moment pour respirer. En ce temps-l, les femmes allaient souvent pier Hamid. Il tait toujours en train de lire. Elles s'en retournaient en courant, avec des mouvements de vola-tiles effarouchs, dans un grand froissement de robes. -Oui, c'est vrai ! -Nous l'avons vu de nos propres yeux. Elles riaient. Point de scepticisme cette fois. Elles riaient tout simplement parce qu'elles trouvaient bizarre qu'un homme lt des livres. Pourquoi lui seul, parmi tous les hommes qu'elles connaissaient ? Ces pais bouquins aux pages incalculables, couvertes de signes en rangs serrs, noirs, petits, comment pouvait-on y comprendre quelque chose ? -Il est drle, ton frre, dit une des femmes Fatima. Il n'est pas comme nos hommes. Et pourquoi ? Il veut peut-tre devenir un savant... Elles s'esclaffaient de plus belle. Mais elles tmoignrent Hamid plus de respect encore, un respect nouveau, qu'elles ne comprenaient pas elles-mmes, qui s'ajoutait celui qu'elles devaient de naissance tout homme. Elles regardrent dsormais Hamid comme celui qui serait en possession d'une force inconnue. La considration dont il jouissait leurs yeux grandit dans une proportion presque inimaginable. Leurs maris le salurent avec plus de respect aussi. Tant il est vrai que chez nous la science bnficie d'une grande vnration, si grande que parfois elle se laisse facilement abuser par de faux savants, comme par de mauvais prophtes. Hamid, lui, ne remarquait rien de tout cela. Comme il n'avait pas davantage remarqu, les premiers jours, la curiosit des femmes. Jusque-l les habitants de Dar-Sbitar ne lui prtaient qu'une attention vague et amuse, qui il faut le recon-natre l'avantage de ces simples gens - ne fut jamais irrvrencieuse. De mmoire de locataire, leur curio-sit, et certes ils n'en manquaient point, n'avait t malveillante.
Mais si une question les proccupait, lorsqu'ils en venaient parler de Hamid, c'tait de savoir pourquoi il lisait tant. A cette question, ils ne purent jamais don-ner une rponse satisfaisante. -Bien sr ! Il tait comme Hamid Saraj, poursuivit Zina. Elle ne permit pas Ani de placer un mot. Elle parlait sans interruption ; et son insu, elle venait de faire un bel accroc la dignit d'Ani. -Tout comme Hamid, rpta encore la femme. Ren-trer, sortir, ne s'apercevoir de rien, c'est tout ce qu'il savait faire. Il ne connaissait pas de repos. Son visage s'assombrit. Peu peu une colre sourde s'y alluma mais elle rsistait mal sa fatigue. -Comme lui, notre homme ne mangeait pas, ne dor-mait pas. Il ne vivait que pour ses runions ; il ne vivait pas, tant il pensait a. Nous restions des jours et des semaines sans le voir la maison. Nous ne pouvions rien lui dire. Il ne parlait pas beaucoup, il parlait de moins en moins. Nous n'avions pas le courage de lui dire qu'il n'y avait pas de pain. Il souffrait. Des fois, il se mettait parler. C'tait comme de l'eau dans un lit de pierres sches. Il parlait, parlait. Nous ne compre-nions pas toujours. Qu'est-ce que nous sommes ? Une pauvre femme, sans plus ? Nous n'avons pas t instruites et prpare connatre. De ses rendez-vous mys-trieux, il revenait chang. Il portait une ide qui le tourmentait. Des jours, nous dcouvrions une expres-sion de triomphe dans ses yeux. C'tait effrayant. Il avait ses moments ; il ne se retenait plus. Nous les avons eus, grondait-il. Ils ont t obligs de cder. Quelle victoire ? disions-nous. Il n'expliquait pas ; il n'ajoutait plus un mot. Il se plongeait dans ses rflexions. Nous avions cru au dbut qu'il buvait ou frquentait. Qu'est-ce que nous nous imaginions ? Mais non ! Nous aurions prfr a, la vrit ! ces discus-sions dans les fonds des boutiques, les cafs, les maisons des quartiers loigns. Puis nous emes peur pour lui. La police commenait enquter sur son compte. Mais nous n'osions pas ouvrir la bouche. Et que lui dire, Ani ma sur ? Il voyait bien que nous dprissions de faim ? Il comprenait beaucoup de cho-ses. Beaucoup trop. C'est lui qui montrait aux autres le chemin. Les gens venaient solliciter ses conseils. Mais pour ce qui tait de lui, il tait plong dans le noir. Il disait : Ces runions, ces alles et venues, ces longues absences, c'est pour une vie meilleure. Si c'tait pour a, pouvions-nous l'empcher de faire ce qu'il disait ? Surtout que c'tait pour changer la vie des pauvres gens et les rendre heureux. Eh ! a le rendait furieux quand nous lui disions qu'il se jetait beaucoup trop dans ces affaires. Mais lui, il voulait retourner le monde, s'il en avait eu la force... ou se crever... ou nous ne savions quoi encore... Pauvre femme, nous ne comprenions rien ces choses-l. Nous laissions faire et nous nous tai-sions. Quand les enfants commenaient pleurer parce qu'ils jenaient depuis la veille, petite sur, nous pen-sions devenir folle. Ceux que tu vois grands aujourd'hui n'taient que de la mouture d'orge. Et o donner de la tte ? On avait tout vendu, on ne possdait plus rien... Puis il est parti. Quand il est mort, il ne nous avait pas laiss de quoi dner la premire nuit. Zina finit par s'exprimer avec un accent de gravit dans la voix qui, par-del les rumeurs d'une peine ina-paise, fit natre une trange srnit dans la pice.
-Ce n'est certainement pas parce qu'il n'tait pas fort, ni capable, que mon mari n'avait pas de travail. Mais il avait des ides qui lui couraient dans la tte. -Bien sr, que c'est pour a. Ani l'avait coute en silence tout ce temps-l. -Il tait capable et fort, je ne doute pas, dclara- t-elle. -Il avait ses ides. Mais il n'y avait rien dire contre lui. Il voulait marcher selon ses ides, mais il a toujours march honnte et digne. Il n'y avait rien lui repro-cher. -Donc ce n'tait pas de sa faute, dit Ani, qui se tut de nouveau. -Oui, reprit Zina. Justement, qui a dit que c'tait de sa faute ? Et de qui tait-ce la faute ? -Tu le demandes ? dit la veuve. -Oui, de qui est-ce la faute ? Les deux femmes ne purent faire disparatre ni luder la question qu'elles venaient de se poser malgr elles. Ani replia son bras sous sa tte et, n'y tenant plus, s'tendit sur le pas mme de la chambre, l'endroit o elle causait avec la voisine. Elle regarda le plafond, perplexe. La femme se leva pour partir. Ani haussa lgrement les paules et dclara la veuve : -Va savoir de qui c'est la faute ! La voisine lui tourna le dos et s'en alla en hochant la tte.
Depuis que les forces de police avaient perquisitionn, aucun autre incident nouveau ne troubla l'existence de la grande maison. Hamid Saraj tait convoqu frquemment au commissariat, c'tait dsormais un fait coutumier. Lentement le printemps arriva. Il libra les premires feuilles, frles et frmissantes, de la vigne dont la ramure emmle coiffait la cour. A Dar-Sbitar mme, une pre douceur se glissa, invisible, entre les vieux murs gris, et vint se rfugier au cur des locataires. Certes, cette joie, les gens de Dar-Sbitar ne l'identi-firent pas tout de suite. Mais c'tait cela, le printemps. D'abord peu de chose. Puis a lve comme une quantit merveilleuse de pain. Et la blancheur touffante d'aot remplaa la flambe du printemps. Omar connut alors les grandes vacances : trois mois sans approcher l'cole.
Dar-Sbitar tenait du bourg. Ses dimensions, qui taient trs tendues, faisaient qu'on ne pouvait jamais se prononcer avec exactitude sur le nombre de loca-taires qu'elle abritait. Quand la ville fut ventre, on avait amnag des voies modernes et les difices neufs repoussrent en arrire ces btisses d'antan disposes en dsordre et si troitement serres qu'elles composaient un seul cur : l'ancienne ville. Dar-Sbitar, entre des ruelles qui serpentaient pareilles des lianes, n'en paraissait tre qu'un fragment. Grande et vieille, elle tait destine des locataires qu'un souci majeur d'conomie dominait ; aprs une faade disproportionne, donnant sur la ruelle, c'tait la galerie d'entre, large et sombre : elle s'enfonait plus bas que la chausse, et, faisant un coude qui pr-servait les femmes de la vue des passants, dbouchait ensuite dans une cour l'antique dont le centre tait occup par un bassin. A l'intrieur, on distinguait des ornements de grande taille sur les murs : des cra-miques bleues fond blanc. Une colonnade de pierre grise supportait, sur un ct de la cour, les larges galeries du premier tage. Ani et ses enfants logeaient, comme tout le monde ici, les uns sur les autres. Dar-Sbitar tait pleine comme une ruche. La famille avait dmnag de maison en maison, plusieurs fois ; c'tait toujours dans une demeure comme celle-l qu'ils chouaient, et dans une seule pice. Les jeudis matin, tante Hasna venait les voir ; elle entrait en mme temps que Mansouria, la petite cou-sine. Tous appelaient celle-ci la petite cousine. Elle arri-vait comme a, chez les uns comme chez les autres : on la faisait asseoir. Elle mangeait ce qu'il y avait. Quant Grand-mre, ses trois mois chez Ani taient passs depuis longtemps dj. Grandmre, partir de ce moment, fut abandonne Ani pour de bon. Ses filles et son fils avaient refus de la reprendre. Lorsque tait venu le moment de l'emmener, ils avaient dclar qu'il tait imprudent de dmnager continuellement la pauvre vieille. Elle n'avait plus de force, et n'en avait pas pour longtemps vivre. Il tait plus simple qu'on l'entretnt chez Ani, du moment qu'elle y tait, si on voulait avoir piti d'elle. Ils lui apporteraient manger, s'occuperaient d'elle, la nettoieraient. - Elle ne manquera de rien, tu verras, disaient-ils Ani. Tout comme si elle tait chez nous. Elle ne te gnera pas et tu n'auras rien dpenser pour elle. C'est ce qu'ils disaient. Mais compter du jour o Grand-mre se trouva dfinitivement ancre chez Ani, elle s'ajouta aux trois bouches que celle-ci avait nourrir. Quelquefois l'une ou l'autre de ses filles venait. Elles pleuraient les trois quarts du temps, se lamentaient sur cette triste vie ; la fin, elles s'en allaient sans avoir rien fait. Ani les cinglait de paroles qui leur dchiraient le cur. Elle leur faisait honte, devant toutes les femmes. Ses deux surs ne savaient comment la retenir ; elles frmissaient et tentaient de la calmer. -Bouh ! Bouh ! Tais-toi, ya Ani. Les voisines entendent tout. -Je le dis justement pour qu'elles entendent. Et elle criait plus fort.
Cela n'arrangeait gure les choses : et sans doute Ani le comprenait-elle, mais de se disputer ainsi la soulageait un peu. Elle ne les vit plus revenir, au bout de quelque temps. Quant au frre, c'tait plus simple : il ne mit jamais les pieds chez elle. Omar continuait d'aller l'cole franco-arabe, manquant assez rgulirement les classes et recevant pour cette raison, sur les paumes, les jarrets, le dos, la baguette du matre ; elle cinglait comme pas une. L'aube, ce jour-l, le surprit moiti endormi : la clart frache et neuve s'infiltrait dans la grande mai-son ; cours, pices, escaliers, galeries formaient un sys-tme trange et compliqu, plein de rumeurs peine la lumire surgissait-elle. A l'tage d'en haut, une porte fut pousse avec bruit et le calme se reforma. Une minute, deux minutes... Le silence dura jusqu' l'ins-tant o brusquement on secoua le portail d'entre qui tenait par le bas un cadre de bois mal scell au mur. La porte grina ; finalement, elle cda. Renvoye toute vole, elle claqua en branlant les profondeurs de la maison. Moulay Ali sortait le premier. Il tait serre-freins sur les trains de marchandises de la ligne Tlemcen-Oujda. Aprs qu'il eut donn le signal, d'autres pas isols mar-telrent le dallage de la cour ; des voix furent touffes. A partir de ce moment, la porte extrieure s'ouvrit et se referma sans arrt. Ils furent plusieurs quitter la vaste demeure. Yamina bent Snouci allait Socq-el- Ghezel vendre ses deux livres de laine, files la veille. Sa fille, Amaria, et Saliha bent Nedjar partirent aussi de la maison. Elles travaillaient dans des manufactures de tapis ; cinq ou six gars montrent la filature de la Ppinire. Le sommeil de Dar-Sbitar fut fendu coups de hache et le jour s'installa pauvrement dans la chair des gens. Les femmes auraient voulu rester couches, avec leurs jambes dans quel tat ! De toutes parts fusrent des appels, des cris d'en-fants ; les conversations commenaient, les bruits d'eau, les premires imprcations. Omar et aim que le sommeil se prolonget. Il vou-lait dormir. Et il croyait qu'il dormait. Les coins les plus obscurs de la chambre, o la nuit se pelotonnait toujours, tressaillaient doucement ; dans une vieille odeur de fume lourde et cre les corps abandonnaient le sommeil en geignant. Il tait trop tard pour dormir sans crainte. Le jour se tenait en faction devant chaque porte. Dans la chambre, Omar fut surpris d'entendre la voix de sa mre ; celle-ci s'entretenait tout bas avec une voisine, sans doute. Elle parlait sans arrt. Ce murmure monotone sem-blait ne point devoir finir. Son ton tait grave. Les paroles qu'Ani prononait paraissaient venir d'un lieu trs loign, d'un autre temps. Les mots n'avaient pas grande importance. Il n'y avait que cette espce de plainte entte, qu'on et pu prendre pour une prire, qui devenait obsdante et ne cessait de poursuivre Omar et de le torturer dans la somnolence o il se laissait aller. Ani se tut et un silence sans fissure s'amoncela dans la chambre. Omar ne se rendormirait plus. Il restait les yeux grands ouverts dans le noir. De la cour, un soleil allgre vint bousculer la pnom-bre. Une odeur de caf flottait dans l'air frais du matin. La femme tait l, assise au fond de la pice ! tait-ce une illusion ? Omar la
croyait partie. Avait-il rv ? Ani parlait sans une pause. Encore tourdi par le som-meil, l'enfant se redressa. H vit les deux formes vagues plonges dans la demi-nuit qui rgnait dans la chambre, pendant que le grand jour clatait au-dehors. Ani resserrait le foulard qui recouvrait sa tte. Le henn allumait ses cheveux qui eussent d tre gris. Devant elle, brillait un plateau de cuivre jaune, avec quelques tasses de faence. Du ct d'Omar, des cou-vertures rejetes, une grande pice de coton gris, des peaux de mouton taient en dsordre : elles portaient encore les empreintes des corps qui y avaient dormi. Aprs une seconde d'interruption provoque par le mouvement de l'enfant, elles se remirent converser toutes les deux ensemble. Omar comprit qu'il tait question du mariage de sa cousine. Zina s'inclina vers Ani et lui dit quelque chose qui la troubla. Les deux femmes s'taient tues. Omar n'y comprenait rien. Elles eurent un lger dplacement de tte de son ct. Tout coup, Ani s'cria : -Je ne serai tranquille que lorsque je saurai. -Je te dirai tout. Elles parlaient de sa cousine, Omar en tait de plus en plus certain. -On pense, continua la femme, que personne n'a rien vu. On l'a vue. Mourad a voulu la tuer et il l'a blesse. Chienne ! Chienne ! Zina se retourna pour cracher : tfou ! -Tu en es sre ? demanda Ani. J'ai entendu dire a. Mais je n'ai rien voulu croire. Quand une femme ouvre les yeux, c'est pour regarder un seul homme. Son mari. Une jeune fille, il faut lever un bon mur entre elle et le monde. Ani avait l'air sincrement chagrine. Avec tout ce qu'on lui disait ! Elle ne devait pas paratre afflige devant la voisine, pensait-elle. Omar regardait les deux femmes, assises. Il continuait les surveiller sans vri-table intention. Il devinait qu'une maladie accablait sa cousine, en son corps ou en son me, et qu'elle devait cote que cote chercher la rmission de ses maux. Il se leva et s'en fut vers le seuil. Sa mre le happa au passage : -O vas-tu ? s'enquit-elle. -Aux cabinets. Ani se remit chuchoter passionnment avec l'autre femme, qui tait la veuve dont la chambre tait contigu la leur. Omar descendit dans la cour. Les cabinets se trouvaient dans la cuisine commune. Devant la porte, aussitt une femme se posta, attendant qu'Omar sortt. Jamais tranquille. Un seul trou pour tout le monde ! C'tait
incroyable. Omar se mit mditer, chassant de sa pense la femme qui montait la garde, le visage contract. En sortant, il se cogna elle : -Toi, lui lana-t-elle, il faut t'attendre des demi- journes. -Va chier dans la rue, si tu n'aimes pas attendre. -Omar ! Omar ! gronda Aoucha qui arrivait dans la cuisine. -Tte de juif ! murmura la femme. Elle s'engouffra dans les cabinets en relevant ses jupes. -On n'a pas besoin de te voir pour savoir que tu es l, ajouta sa sur. Un tintement de plats heurts brisa l'air ; on lavait la vaisselle cette heure. Khediouj nettoyait la maison, jetait de l'eau dans la cour pleins seaux, sur les murs aussi jusqu' hauteur du genou. Ensuite, avec une ardeur aveugle, elle donnait des coups de balai. Omar traversait la galerie pour revenir chez lui et il eut l'impression que quelqu'un faisait des signes dans son dos. Il se retourna : c'tait Zhor. Du fond de leur chambre, elle frottait ses bras nus. Sa mre tait Zina, la petite femme qu'il avait laisse en grande conversa-tion avec Ani. La jeune fille tait comme dconcerte et en proie une vive agitation. Omar dcida de s'loi-gner ; allait-elle sortir ? Zhor tait sur le point de lui dire quelque chose, mais ce moment-l il se dirigea subitement vers leur chambre. Cependant il se retourna encore pour la regarder. -Omar, roucoula-t-elle faiblement, viens, je t'en prie. Elle lui lana par trois fois son appel ; au dernier, il y alla. Elle s'approcha de lui. Il la sentait debout contre son corps, dont la tideur l'envahit. Soudain, elle lui donna un violent coup de genou dans l'aine. Omar jeta un petit cri et tomba terre en sanglotant. Zhor se pencha sur lui et lui billonna la bouche de sa main. Il dut s'immobiliser pour ne pas tre touff ; il se tint tranquille. La main de la jeune fille glissa le long du corps d'Omar sans difficult. Il perut alors le bruit soyeux d'un corps qui s'tendait ses cts. Rete-nant sa respiration, Zhor ne remuait pas plus que si elle dormait. Il se dgageait d'elle une odeur sucre, chaude : celle d'un fruit mr et intact. Puis elle fut secoue de frissons. Plusieurs fois elle essaya de cares-ser l'enfant, mais ses efforts demeurrent vains : elle ne parvenait gure surmonter l'indcision qui paraly-sait ses mouvements. Aprs un instant, elle se souleva et se cala sur un coude. S'inclinant lgrement vers Omar, elle s'aperut qu'il la fixait. L'enfant se sentait secrtement li ce corps de femme l'abandon. Une douceur sourde s'amassait en lui, qui finit par faire place un sentiment de dpaysement. Brusquement il prouva une scurit jamais connue et qui lui semblait familire. Singulire scurit, puisqu'il ne tarda pas ressentir un malaise qui se changea vite en angoisse. -Non ! Non ! Ne pleure pas, je t'en supplie. Je n'ai pas voulu te faire mal. Tu es mon frre. Elle se renversa de nouveau sur lui. Puis sa voix se fit plus souterraine, plus rauque. Zhor se mit en devoir de le dorloter, tout comme s'il et t un petit enfant. Des mots graves sortaient de sa bouche, enveloppaient Omar, mais il n'en comprenait pas le sens.
-Va... Cesse, cesse de pleurer. Je n'ai pas voulu le faire exprs... Mon frre... Elle le berait. On et dit qu'elle pensait autre chose, qu'elle tait attire vers d'autres lieux. C'tait en elle une peine lointaine qui remontait. Qui la rendait si triste ? - Je t'embrasse, Omar. Tu ne pleureras plus, tu finiras de bouder. Tiens ! Elle s'appuya sur lui et ses seins s'crasrent sur son paule. Omar sentit son odeur qui lui plaisait, quoi-qu'elle ft natre en lui une vague envie de vomir qui montait le long de sa gorge et lui chavirait le cur. Mais ce qui l'amusa le plus, ce fut de toucher, en intro-duisant la main par l'chancrure de la tunique de Zhor, la petite touffe de poils noirs et friss qu'elle avait sous l'aisselle. Zhor riait ; elle lui enleva la main. Elle fut toute surprise quand il l'embrassa son tour, et elle se rembrunit. Lentement, mais aussi avec force, elle le repoussa et se mit debout. -Ne reste pas couch l, petit frre. Il faut que je me dpche d'enlever tout a. Plus de la moiti du jour a dj pass. Leur literie, en travers de laquelle Omar tait tendu, occupait le centre de la pice. Il se leva et allait s'loigner, mais elle le retint. -Je vais Bni Boublen, lui dit-elle. Mon beau-frre Kara Ali viendra me chercher. Il a vu ma mre, ma sur a beaucoup d'ouvrage sur les bras. Il faut que je l'aide. Si a te plat, je t'emmne avec moi... comme la dernire fois... Demande ta mre si elle veut te laisser venir. -Combien de jours vas-tu rester Bni Boublen ? -Quatre jours peut-tre... rpondit-elle.
Omar se retrouvait souvent en tte tte avec Zhor et chaque fois il dcouvrait cet univers de l'affection qui l'inquitait. Aussi n'en parlait-il personne. Bien sr, c'tait extraordinaire, Dar-Sbitar. Aussi ce senti-ment prenait-il chez l'enfant un caractre clandestin. L'affection qui liait Omar Zhor poussait comme une fleur sur un rocher sauvage. En bas, dans la cuisine, on actionna la poulie du puits, et le seau glissa ; il y eut un heurt brutal, suivi d'un clapotement d'eau, quand le seau remonta. Un brou-haha confus peuplait la maison. Ani avait du caf ce matin. Omar, lui, reut un bout de pain. Sa mre, quand elle avait quelque argent, n'achetait du caf que pour elle. Avec d'autres jeunes filles, Aoucha et Mriem, au milieu des groupes, proraient tue-tte, en bas. Mais elles remontrent incontinent, retournant l'ouvrage, lorsqu'elles entendirent crier Ani, dont la voix s'en-flait, s'enflait, aigre et menaante, depuis que trois ou quatre de ses appels taient rests sans rponse. Les hommes sortaient tt, aussi les apercevait-on rarement. Ne demeuraient l que les femmes : la cour, sous les branches enchevtres de la vigne, en regor-geait. Elles l'emplissaient de leurs alles et venues. Elles encombraient la porte d'entre. Dans la cuisine, une cuisine pour Titans, elles palabraient n'en plus finir autour du puits. Chaque pice, ayant recel durant la nuit une kyrielle de bambins, les restituait jusqu'au dernier au lever du jour : cela se dversait dans un indescriptible dsordre, en haut comme en bas. Les marmots, le visage luisant de morve, dfilaient un un. Ceux qui n'taient pas encore aptes se servir de leurs jambes rampaient, les fesses l'air. Tous pleuraient ou hurlaient. Ni les mres ni les autres femmes ne jugeaient utile d'y prter plus d'attention que cela. Les braille-ments que la faim ou l'nervement faisaient clore dominaient une rumeur nourrie, parmi laquelle parfois jaillissait un cri de dsespoir. Tous ces enfants s'chap-paient dans la rue.
Quand avec prcipitation Omar entra, Ani, serrant les coudes contre sa taille, se levait pour accueillir tante Hasna. Les deux femmes s'embrassrent. Ani, mar-mottant des souhaits de bienvenue et de bonne sant, observa une pause brve sans relcher son treinte. Elle appliqua derechef force baisers la tante. Il et t vain de vouloir en dterminer le nombre. Elle dvida ensuite le chapelet des : Comment vas-tu ? Comment va un tel ? Comment va une telle ? Comment va... La rponse, prte, parvenait simultanment : Trs bien, Dieu te garde. Tante Hasna essouffle par la monte des escaliers ne tenta pas de retourner ses souhaits Ani. Tante Hasna dbordait de tous les cts. Suant grosses gouttes sous une coiffe pointue, des foulards verts et un chle rose, son visage charnu et lourd luisait. Les rides canalisaient sa transpiration jusqu'aux profondeurs du cou. Elle cli-gnotait douloureusement : des larmes paisses coulaient de ses paupires ronges. Ani, qui s'tait prcipite pour la recevoir, s'empressait autour d'elle. Lalla - tous la nommaient Lalla, y compris Ani -, Lalla touffait. Sans doute Ani ne s'tait-elle pas dmene autant que l'exigeait la dcence. - Viens l. Entre donc, assois-toi ici. Elle jeta des regards autour d'elle, prit encore deux peaux de mouton dans un coin o quelques-unes, plies en deux, taient disposes en pile. -Donne, rclama Lalla. Je ne suis pas venue pour camper des mois. Je suis monte grandpeine. Bouh ! Je n'ai plus la force d'arriver jusqu'ici, fille de ma mre. Laisse, laisse. Je me trouve bien sur le pas de la porte. Comment pouvez-vous vivre... Ouf ! Ouf ! Tout en s'apprtant se poser par terre, elle ajouta : -Alors, tu as renonc remettre les pieds au cime-tire ? -Qu'irais-je faire l-bas, Lalla ? J'ai tant de travail ici. Celui dont je visiterais la tombe ne m'a laiss ni fermes ni maisons pour que je le pleure. Qui veut mou-rir allonge ses jambes. -Tu as raison ; chez toi, tu es bien mieux. Les femmes ne s'y rencontrent que pour faire marcher leur langue. Tu n'as pas perdre ton temps avec ces pron-nelles. Tu as des enfants : occupe-t'en. Ton mari est mort. La mort a t pour lui une couverture d'or. A quoi te servirait d'aller contempler sa tombe ? Tu ne sais pas ce qu'elles racontent ? Je me demande o elles apprennent tout a, les filles de Satan. Beaucoup d'hommes seront arrts, disent-elles. -Ha ha! Entortille dans l'immense hak de laine blanche, Lalla s'affala et, du cordon qui lui ceignait les reins, elle dtacha un mouchoir avec lequel elle s'pongea le visage. Elle s'venta sans pouvoir prononcer d'autres paroles. Quand elle retrouva son souffle, elle rpta plusieurs fois : -Il n'y a de Dieu qu'Allah ! Une odeur doucetre, comme celle des bains, se dgagea de son corps en sueur et envahit la pice. Des plis de son voile, tante Hasna retira un paquet, qu'elle tendit Ani.
-Elles disent qu'on en a mis dj plusieurs en prison dans chaque ville, reprit-elle. Ces hommes font de la politique et troublent l'esprit des gens. Une fois l o ils doivent tre, tout le monde sera tranquille. -Bouh, Lalla ! -Eh, ils veulent dfier le Franais. Ont-ils des armes, ont-ils du savoir dans la tte ? Va donc ! Ils n'ont que leur folie et leur misre. Qu'ils se tiennent cois, a vau-drait mieux pour eux. Pourront-ils lutter contre le Franais ? -Nous n'en savons rien. -Moi, je sais. Ce sont des imbciles. Ce qu'ils veu-lent, c'est supplanter le Franais. Ils sauront gouverner, eux ? Tante Hasna souffla son mpris : homph... homph ! -Hamid, fit remarquer Ani,... la police est venue encore le chercher, il y a trois jours. -Il fait de la politique ! tonitrua tante Hasna. En trompetant cette phrase, toutes les chairs de son visage tremblrent. -Qu'il cherche du travail, mugit-elle, qu'il prenne femme et fonde un foyer, plutt que de perdre son temps prcher des billeveses qui le conduiront en prison ; ce ne sera pas mieux, crois-tu ? -Si tu avais vu, Lalla, le premier jour o les hommes de la police sont entrs tout coup... Maintenant nous commenons nous y habituer. -Pourquoi, fille de ma mre, fait-il ce mal lui- mme et autrui ? a n'entre pas dans ma tte. Il n'y a que la prison qui attend un homme comme lui. -Lalla, que dis-tu ? Bouh ! Bouh ! Sa sur, la malheureuse, comment s'en trouverait-elle ? -O sont les filles ? demanda-t-elle, changeant de conversation. -En bas. -Elles feraient mieux de t'aider au lieu de prorer avec des cerveles. -Omar m'aide un peu ; c'est qu'elles font un peu de lessive. Les jambes croises en tailleur, Omar tait effective-ment assis au pied de la machine coudre. Il donnait les derniers coups de ciseaux aux empeignes d'espa-drilles que sa mre lui avait jetes aprs en avoir ter-min le piquage. -Et celui-l, il s'en tire de son apprentissage ? S'il ne t'apporte que dix sous, c'est toujours a. Ce n'est qu'une femelle. Hon ! Et encore une fille vaut mieux que lui. Tout le temps fourr la maison. Ma pauvre Ani ! Tu es la proie de ces enfants sans cur qui te sucent les sangs. Avec eux, tu n'arriveras rien.
-Je vais l'cole, moi, intervint Omar, sans consi-dration pour les paroles de sa tante. Et j'apprends des choses. Je veux m'instruire. Quand je serai grand, je gagnerai beaucoup d'argent. -Renonce tes ides, dit Lalla avec humeur. Il te faudra travailler comme une bte si tu veux seulement vivre. Ceux qui n'ont pas mis les pieds dans une cole meurent de faim ? L'instruction, ce n'est pas pour toi, ver de terre. Qu'est-ce que tu te crois pour prtendre l'instruction ? Un pou qui veut s'lever au-dessus de sa condition. Tais-toi, graine d'ivrogne. Tu n'es que pous-sire, qu'ordure qui colle aux semelles des gens de bien. Et ton pre, lui, a-t-il t l'cole ? Et ton grand-pre, et tes aeux ? Et toute ta famille, et tous ceux que nous connaissons ? Tu auras tre un homme, ou tu seras cras. Il te faudra supporter la duret des autres, tre prt rendre duret pour duret. N'espre pas le bon-heur. Qui es-tu, qui es-tu, pour esprer le bonheur ? N'espre pas vivre tranquille, n'espre pas. Ses yeux bleutres tremblaient au fond de leurs cavits comme un liquide pais et trouble. L'angle dur de sa mchoire au pli amer imprimait une sorte de vio-lence sa physionomie. - coute ce qu'on te dit, conseilla la mre sur un ton dfrent pour tante Hasna.
Lalla serrait sa main noueuse sur un chapelet aux grains noirs et polis dont elle ne se sparait jamais. Elle en faisait glisser les boules du matin au soir entre ses doigts, machinalement. Une brusque somnolence s'empara d'elle. Ses lvres bougrent d'elles-mmes ; on ne perut plus que le cli-quetis des grains tombant l'un sur l'autre. -Alors, tu vas l-bas ? dit-elle, se rveillant soudain. Ani fit oui de la tte. -Tu vas apporter des coupons ? Sais-tu au moins quoi tu t'exposes ? Toutes les femmes qui viennent par la douane sont dshabilles. On les fouille et on regarde ce qu'elles portent. Tu veux qu'il t'arrive une mauvaise histoire et que tout le monde le sache... Comment ferastu, si on te colle une amende et qu'on te confisque les tissus ? Moi, je m'en lave les mains. Ani esprait parvenir Oujda sans encombre. Elle avait recommand aux enfants de n'en parler per-sonne. Il ne fallait pas qu'on apprt dans la maison pour-quoi elle allait Oujda. Elle n'avait aucune honte faire de la contrebande. Il f allait craindre le mauvais il. Celui que poursuit le mauvais il ne rcolte que malheurs. -coute-moi, conseilla Lalla. Il faut rester tran-quille. C'est tout ce que je peux te dire. Deux femmes du voisinage avaient remis dj l'ar-gent Ani pour qu'elle leur prt de quoi faire quatre robes chacune. Elle valua devant Lalla le bnfice que lui laisserait l'opration. Elle ne savait pas bien comp-ter, Omar lui avait fait tous les calculs, qu'elle rptait Lalla bahie, avec un air d'importance et beaucoup de gravit. Les chiffres qu'elle citait fascinaient tante Hasna. Elle tait experte les manier, force de les ressasser depuis plusieurs jours. -Va, pronona finalement Lalla. Et n'ouvre pas le bec ici. N'en fais part personne. Dieu t'aidera et te protgera : tu nourris des orphelins.
Ani promit : -J'irai cette fois et ne recommencerai plus. C'est surtout parce que j'ai donn ma parole aux deux femmes. Elle se rpandit en plaintes amres sur le sort qui avait plac entre ses mains trois enfants. Quand donc allait grandir Omar, son garon, pour la soulager de son faix ? Une fille ne compte pour rien. On la nourrit. Quand elle devient pubre, il faut la surveiller de prs. Elle est pire qu'un aspic, cet ge-l. Elle vous fait des btises ds que vous tournez le dos. Ensuite il faut se saigner les veines pour lui constituer un trousseau, avant de s'en dbarrasser. Ani avait dbit la mme antienne, dix, cent, mille fois. Ses deux filles travaillaient pour-tant et aidaient la famille vivre. Mais la mre ne renon-ait pas ses jrmiades. -A ton retour d'Oujda, dit Lalla, tu m'expliqueras comment tu auras fait pour passer la douane. J'ai quel-que argent, oh trs peu ! quatre sous : tu nous appor-teras quelques coupons. -Oui, Lalla. Tu verras le bnfice que nous ferons ! Voil. Lalla commenait par dire qu'on ne devait pas faire une chose ; elle s'chauffait, devenait intransi-geante. Quelques instants aprs, tout tait oubli. Omar trouvait cela inadmissible : se ddire continuellement, vivre dans une perptuelle contradiction. Il observait ces revirements longueur de journe dans son entou-rage. Il tait sr que sa mre, qui leur avait ordonn, avec des menaces, de ne rien faire savoir de son pro-chain voyage, irait elle-mme, la premire, raconter avec force dtails tout ce qu'elle se proposait de faire, qui voudrait l'entendre. Tante Hasna, de son ct, ne manquerait pas non plus de confier la chose toutes celles qu'elle connaissait. -Je commence me prparer pour le mariage, dit Lalla, pensant maintenant autre chose. Sa fille cadette tant fiance depuis presque un an, les prparatifs des noces taient l'objet de commen-taires sans fin. Ce mariage tait devenu, pour tous, le Mariage. Il ne pouvait en exister d'autres. -Je me prpare pour le Mariage, disait-elle. Toi, ajouta-t-elle, tu connais ton rle. Ani opina. -Il n'y aura pas de plus belles noces, poursuivit Lalla. Les gens merveills s'en iront le publier dans toute la ville. Rien ne sera pargn. Lui - elle nommait ainsi son mari, comme le veulent les bonnes manires -, lui, fera des sacrifices considrables qui consacreront notre honorabilit. Tu comprends bien que nous y sommes obligs. Ani, ma sur, nous avons un rang tenir. Qu'y faire ? -Le jour du Mariage, Lalla, sera quel jour ? ques-tionna Omar. Sa mre rpondit : -Ferme ta bouche, toi.
-J'espre que tu travailles bien, dit tante Hasna, pour changer de sujet : celui-ci tait trop important. L'un de ses fils avait plac chez un barbier Omar, qui devait s'y rendre en sortant de la classe de l'aprs-midi. Lalla et Ani espraient ainsi qu'il s'initierait au secret de la taille du poil humain. Mais Omar avait oubli depuis plusieurs jours d'y aller. Ce dtail, tante Hasna l'ignorait. -Tu te montreras digne de la confiance que nous avons mise en toi. Cette place, nous l'avons eue avec beaucoup de mal. Heureusement que nous t'avons dcro-ch cette situation qui t'assurera un avenir respectable et odorant. Coiffeur dans le centre mme de la ville ! N'est-ce point beau ? Quel avenir, avorton ! Quelle reconnaissance ne me dois-tu pas ! Moi, qui ai tant insist auprs d'Abdelkrim pour te caser l. Sans moi, que serais-tu devenu ? Pour moi, que ne dois-tu faire ! Rends-toi digne de cette marque d'intrt. Travaille. -Lalla, merci pour le moyen de gagner ma vie en savonnant le poil de la tte et du visage des paysans. Ds le premier jour, j'excellai dans cet art et j'tonnai mon patron et les paysans eux-mmes. C'est ce que je ne referai pas, car depuis ce jour, je n'y suis plus retourn. -Quilla ! Sa mre avait honte pour lui. Il ne se montrait pas la hauteur de la confiance qu'on lui tmoignait. Tante Hasna, lui galement : -N'en parlons plus. Puis elle enchana : -Et ce fainant de Hamid Saraj, c'est bien vrai qu'il a t emprisonn par les autorits ? -Non, ya Lalla. -Alors il bourrera encore les gens de mots comme il le faisait chaque coin de rue. Ceux qui l'coutent per-dent leur temps et emportent du vent dans leur crne ! -Si on y rflchit, a n'est pas drle. Le malheureux ! -Tu n'as pas chang, toi. -On a compris beaucoup de choses. Si ce qu'il dit se ralise, ce sera le bonheur de tous les pauvres gens. -Toi, tu crois ce que racontent ces communistes. Tu seras encore comme a toute ta vie. Tu vois comment ils finissent ? En prison. Qu'est-ce qu'ils y gagnent ? La prison. -Comment n'a-t-on pas le cur qui fait mal, en assistant des choses semblables ? Visiblement agace, Lalla reparla des affaires qui l'intressaient. -Partout les gens proclameront cette anne : ce Mariage dpasse en splendeur tout ce qui s'est vu jusqu' prsent. Dommage que cette bta de Djenat, ma belle-sur, soit morte.
Pour le coup, elle en aurait crev, mais alors de jalousie et d'envie, plus srement que de sa maladie. C'est bien dommage ! Quant au rle d'Ani dans le mariage, nous n'en dirons que deux mots. Au fond d'elle-mme, celle-ci n'tait pas tellement d'accord sur le sans-gne avec lequel tante Hasna disposait d'elle. Lalla avait dcid d'engager deux rtisseuses qui apprteraient la grande tambouille, mais elle avait peur des fuites. Elle dsirait qu' Ani se charget de compter les morceaux de viande, de surveiller les maritornes prposes la cuisson et les pique-assiettes qui organiseraient des incursions dans la cuisine. -Si on n'y fait pas attention, toute la nourriture s'en ira dans le pan de leurs jupons, confia Lalla. Cela, Ani le savit.
Quoiqu'elle aimt conomiser sur tout, Lalla tait de ces personnages qui mangent tous les jours. Se rassasier chaque jour que Dieu fait lui confrait de la respecta-bilit. Elle aidait Ani et ses enfants supporter les moments de dnuement. Elle les pourvoyait en mor-ceaux de pain bis. Des quignons entams, parfois souil-ls. Mais ramollis la vapeur et prpars par la mre, ils redevenaient tout fait mangeables. Ils gardaient encore les relents des mets qu'ils avaient touchs sur la meda de tante Hasna. Il est comprhensible que l'arrive de Lalla ft attendue avec impatience. Omar, intervalles rguliers - il prenait soin cepen-dant d'espacer ses visites -, se rendait chez sa tante. Il l'appelait de la porte d'entre, craignant de s'engager plus avant dans cette demeure profondment silen-cieuse. Mais elle reconnaissait sa voix et lui ordonnait, du fond de la maison, d'entrer. Lorsqu'il se prsentait elle, tout embarrass, elle dversait sur sa tte un dluge de questions. - O allais-tu comme a ? Pourquoi es-tu venu ? Qui t'a envoy ? Veux-tu quelque chose ? -Je suis venu seulement..., essayait-il de rpondre, sans pouvoir donner de raisons satisfaisantes. Il se sentait si intimid qu'il tait le seul avoir compris ce qu'il avait dit. A la faon dont Lalla l'assail-lait de questions, il saisissait qu'elle ne l'encourageait nullement rpondre ; il ne s'en tirait pas aisment avec elle. Ses demandes ne ncessitaient du reste aucune rponse. Sans plus s'occuper de lui, elle mar-monnait ses prires. Parfois mme, entre deux phrases, elle reprenait son oraison. Omar finissait par chuchoter du bout des lvres : -Lalla, je voudrais un morceau de pain... La prire de tante Hasna s'arrtait net. Lalla l'exa-minait intensment. C'tait la seconde que l'enfant redoutait. Invoquant les saints, se plaignant de rhumatismes qui lui ankylosaient le dos, elle se relevait. D'une commode, elle retirait une miche habille d'un linge lgrement humide. Avec un couteau, elle dcoupait une tranche de ce pain dont Omar conservait toujours dans la bouche le got d'humidit et l'imperceptible odeur de moisi. Qu'il tait bon, avec cette saveur. Elle renvoyait vite le garon chez lui. - Va-t'en. Ne reste pas ici. Et ne trane pas dans les rues ; fais attention aux voitures, tte de linotte. Dominant sa joie, il se sauvait, sa tranche de pain la main. Tante Hasna habitait l'autre extrmit de la ville. Lorsqu'elle venait la maison elle restait toute la mati-ne, bien qu'elle protestt grands cris et jurt ds son entre, en manire de politesse, qu'elle ne passerait qu'un quart d'heure, pas une seconde de plus. Lalla essayait d'aider Ani ; elle ne pouvait pas grand-chose ; personne sa place n'aurait pu faire davantage.
La conversation retint tante Hasna jusqu' l'heure de midi. La vieille femme s'attarda encore, avant de son-ger partir, demander ce que devenait Mansouria, la petite cousine. Ani l'assura vaguement qu'elle tait venue les voir, il n'y avait pas longtemps. -Mais elle est toujours noire, Lalla. Noire ! -Je la connais, ma pauvrette. On dirait qu'il y a dix ans qu'elle n'est pas alle aux bains. Enfin ! Si elle se montre chez toi, envoie-la-moi. J'ai quelque chose pour elle. Quoi, Lalla met des choses de ct pour la petite cousine maintenant et ne pense pas nous ? Nous sommes devenus des riches, nous ? Le cur d'Ani se pina. A bon droit elle s'estimait frustre. Et c'est moi qu'elle veut faire travailler pour ses noces, comme si j'tais son esclave ! On se croit tout permis avec nous. Elle n'a pas voulu dire ce qu'elle va donner la petite cousine. Quand Lalla voulut se lever, ce fut une affaire. Elle s'arc-bouta des deux mains contre le sol et souleva, pour commencer, son arrire-train dmesur. Ani l'adjurait cependant de rester djeuner. -Tu partiras l'aprs-midi, quand l'air frachira. A cette heure, on se consume, dehors. Ani lui adressa toutes les prires qu'on prononce en pareille circonstance pour retenir un hte. L'usage le voulait, pauvre Ani ! Qu'avait-elle offrir ? Sous la masse de chairs et d'toffes que formait Lalla, sortit un filet de voix : -Je ne peux pas. Bouh ! Non, non, Ani. Comment serais-je reue par mes brus... Il faut que je m'en aille. Si vous avez manger, gardez-le pour vous ; il n'est point besoin que je le partage avec vous. Ani n'en persista pas moins la retenir. Ramassant son hak autour d'elle, Lalla parvint en fin de compte se camper sur ses jambes et, ce faisant, pronona le nom d'Allah plusieurs fois de suite.
Les enfants dversaient de pleins seaux sur le carrelage. Aussitt rpandue, l'eau s'vaporait en une vague ardente. Ils s'enlisaient sans espoir dans cette fournaise. C'tait cruel, cette force aveugle qui les submergeait. Ils n'en finissaient pas de lutter contre elle. -Impossible de se rafrachir par ce soleil de mal-heur ! profra Aoucha. Il faut de l'eau ! -Faut de l'eau, beaucoup d'eau, disait Ani. C'est plus qu'une ghenne ici. Allez en bas, amenez ce que vous pouvez d'eau. Ne tranez pas... Ils titubaient, comme ivres. -N'y a pas de raison. Le soleil ne s'arrtera pas de chauffer, observa Omar. L'atmosphre tait irrespirable. -a ne me dit rien d'aller et de venir tout le temps, pleurnicha Mriem. Pour de l'eau qu'on verse. L'esca-lier est pire qu'une chelle... On se rtit le cuir des pieds. Mais elle faisait comme les autres. Omar tranait une vieille marmite. Ses deux surs, Aoucha et Mriem, charriaient l'eau dans des bidons. Du puits, dont ils faisaient grincer la poulie sans discontinuer, tout tait inond sur leur passage... Omar hissait son rcipient comme il pouvait. Aprs une marche, il le dposait sur la suivante et ne se faisait pas faute d'en rpandre un peu chaque fois. Il arrivait tout de mme grimper l'escalier. De l, il fonait tte baisse vers la chambre. Seule Ani ne bougeait pas. Cloue devant sa machine coudre, elle piquait des empeignes qui s'chappaient de son aiguille en chapelets. De la voix, sans dtacher les yeux de son ouvrage, elle incitait les gosses transporter plus d'eau. Son corps suivait le rythme de la mcanique. On aurait dit qu'elle rvassait. Mais pour peu que leur va-et-vient du puits la cham-bre se relcht, elle suspendait son travail et un regard suffisait. Ils se remettaient jeter de l'eau sur le sol et les murs nus, toujours plus d'eau. La machine recom-menait tourner, et les paules anguleuses de leur mre pousaient son mouvement uniforme. Ds cet ins-tant, Ani, malgr la prcision de ses gestes, agissait comme en dormant. Il n'y avait qu' pntrer dans leur galetas pour se rendre l'vidence. Il tait vain de parler de fracheur, et pourtant Ani en avait besoin pour travailler. C'est mme un miracle qu'on n'y et encore trouv aucun d'entre eux foudroy. Dehors l'air tremblait, tombait en cendre : un pou-droiement gris. Tout tait dlav dans un enfer de lumire. A chaque pas, les enfants butaient contre les murailles que dressait la chaleur dessche d'aot ; le ciel en bullition vomissait des tourbillons de mouches que des odeurs de fosses attiraient. Ces journes lchaient sur le quartier une puanteur subtile, tenace, de charogne que ni les coups d'air ni la chute de tem-prature nocturne ne parvenaient dfaire. Le silence tournait, rond comme une meule. L'norme demeure restait muette ; les locataires ne bronchaient pas. Tous, cette heure, fermaient leurs portes et se rfugiaient dans les profondeurs de la maison. Au plus secret des pices, o l'obscurit semblait avoir t prise au pige, palpitait le souffle d'innom-brables existences.
Il n'y avait que les enfants d'Ani qui taient debout. Nanmoins, en dpit de leur ardeur, ils se sentaient en proie un sombre dcouragement. Le ronronnement de la machine coudre remplissait la chambre avec ent-tement. N'y tenant plus, les enfants mirent cul terre pour souffler. Omar observa avec un morne tonnement le dallage qui schait. Ses frusques taient trempes ; qu'importe. Il n'avait envie de rien, cette sensation d'humidit sur la peau le soulageait un peu. La grande sur continuait la navette entre le puits et la chambre, ses seaux au bout des bras. Voyant Mriem se tordre de rire ne plus pouvoir tenir debout, Omar fut gagn par la contagion. Ani remarqua le jeu auquel ils se livraient. Elle croisa les bras et sans quitter sa machine loucha de leur ct en dodelinant la tte. -Encore ! Ne vous arrtez pas. Cela les refroidit instantanment. Elle se leva. Il fallait se tenir hors de sa porte. -Tu peux courir, lui dclarrent-ils. Ils lui glissrent entre les doigts comme de l'eau. Ils contrefaisaient sa mimique dsordonne. -Omar ! Prends garde, tu t'en repentiras. Arrive ici, a vaut mieux pour toi. Sans s'arrter de crier, elle le fixait entre quatre- z-yeux. Allait-elle bientt finir de hurler ? -C'est moi, Omar. C'est bien moi. C'est moi ! Elle mit l'index sous l'il droit pour lui signifier qu'il n'avait rien esprer de sa mansutude : -Tu ne perds rien attendre. -Je t'enquiquine. Le mieux pour lui, de toute vidence, tait de se dbi-ner. Et hop ! en moins de deux dans la rue, avant que l'une de ses surs ne vnt l'empoigner et de force le pousser vers la mre. Il laissa celle-ci se saouler de cris. Mriem, elle, rampa vers sa mre comme une chienne. De la rue, Omar l'entendit beugler. videmment Ani les avait produits, personne ne disait le contraire, encore qu'elle ne leur et pas demand leur avis. Mais, moi, je n'ai rien demand. Il est vrai que je ne pouvais gure parler alors. Maintenant c'est fait, je suis ici ; qu'elle nous fiche au moins la paix. J'entends ne pas me laisser marcher sur les pieds, serait-ce par celle qui m'a nourri du lait de sa mamelle. Omar rsolut d'attendre dehors. Il fallait voir quand elle attrapait l'un ou l'autre, et jusqu' cette grande perche d'Aoucha. Elle leur tannait la peau. Elle allait fort en besogne. Il valait encore mieux qu'aucune femelle ne s'avist ce moment-l de lui brailler que ce n'tait pas juste, que ce n'est pas comme a qu'on lve des enfants. Ani vituprait plus fort, si c'tait encore possible :
-Comment, je ne peux plus les battre ? Ils ne sont pas mes enfants ? Qu'est-ce que vous me baillez l ? Et si je veux les tuer, moi ? Je ne peux pas ? Qu'est-ce qui m'en empchera ? Ils ne sont pas moi ? Elle se tournait vers les voisins, qui tenaient rester bonne distance, et la contemplaient. -Je vous siffle les sangs, mettez-vous bien a dans la tte. Je sais lever mes enfants. Dans le respect. Suis-je de ces femmes, croyez-vous, qui laissent leur progniture sans ducation ? -Un de ces jours, songea Omar, on rglera tous ces comptes. Il jouait devant la maison en attendant que le grain s'loignt. Soudain plusieurs voix clatrent l'int-rieur : elles partirent en mme temps. Il entra pour voir. Agglutines dans la cour, les femmes vocifraient en agitant convulsivement les bras. La plupart orientaient leurs regards vers la chambre d'Ani. D'autres chan-geaient des explications. Ces dernires se mirent aussi de la partie. Une vraie arquebusade ! Elles clamaient plus fort les unes que les autres. Omar n'y comprenait rien. Apparemment ces rcriminations visaient sa famille. -Il n'est plus possible de les supporter ! Ils nous empoisonnent l'existence ! Une locataire du rez-de-chausse prit Ani partie cause du bruit que faisait sa machine coudre. -Ae, mes aeux ! Ce fracas ne nous laisse aucun rpit. La nuit, mon mari n'arrive pas fermer l'il. Il faut bien qu'il dorme, ce pauvre homme, pour trimer le lendemain. Mais elle ne se fatigue pas de coudre jusqu' minuit. Cratures de Dieu, le coupable n'est personne d'autre que cette mcanique infernale. -La faute en est, proclama une autre, plutt ses btards qui tranaillent avec leurs bidons tout le temps de la sieste. -Leur mre ne fait rien pour les calmer, cette fielleuse ! Toutes ces voix exaspres vibraient durement. Ce ne furent la fin que plaintes stridentes. De longtemps, on n'avait entendu pareil raffut. Le feu couvait depuis pas mal de jours ; a n'tait un mys-tre pour personne. De brves rpliques avaient crpit de temps autre. Mais les femmes, a ne leur suffisait pas. Elles s'agitaient, bout de nerfs, le sang piqu. Cet aprs-midi, la fin de la sieste, l'orage devait crever. Il le fallait bien, sinon elles seraient toutes devenues folles. Il y en avait qui ne disaient rien. Mais, entre leurs dents, elles sifflaient toutes sortes de maldictions. Celles-l, il fallait chtier leur hypocrisie. Omar exhiba son petit membre sous leurs yeux et fit des gestes obscnes. A cette vue, elles piaulrent en montrant son chose du doigt. Il les insulta et cracha devant lui. Ds lors une grande confusion troubla Dar-Sbitar et ne fit que s'amplifier.
Les glapissements attirrent, des maisons voisines, d'autres femmes ; celles-ci avaient coutume de rappli-quer au moindre pet. Elles se serraient en groupe muet l'entre. Dans leur prcipitation, elles n'avaient eu pour la plupart que le temps de jeter sur leur tte, qui une serviette, qui un chle, ou seulement le rebord de la tunique trousse par-derrire. Dj, elles s'avan-aient, sans vergogne, jusqu'au milieu de la cour. Une femme ne sait gure rsister aux premires annonces d'une querelle. Celles qui ne pouvaient venir par la rue accouraient en traversant les terrasses ; on observait l-haut des grappes humaines qui se penchaient pour couter. Ani, qui avait abandonn sa machine, tenait tte cette mnagerie dchane. Elle rpondait tantt l'une, tantt l'autre, seconde par ses deux filles. Les fem-mes runies furent impuissantes contre elles trois, mal-gr tout ce qu'elles leur dgoisrent. Ani et sa niche leur assenaient des paroles qui leur taillaient des morceaux tout vifs du cur. Sur ces entrefaites, un tre la dmarche sautillante, envelopp dans plusieurs robes comme un oignon, se trana avec inquitude vers le centre de Dar-Sbitar. On ne remarqua pas d'abord sa personne. Mais quand les autres virent cette crature naine et ronde, le tumulte cessa d'un coup. Toutes restrent bouche be. On s'carta pour lui laisser le passage. La vieille, s'immobilisant enfin, porta les mains aux hanches et tenta de lever la tte vers Ani, mais dut y renoncer. C'tait la propritaire ; quel silence ! -Qui es-tu ? Qui es-tu, pronona-t-elle la fin d'une voix de petite fille, toi qui te permets de retourner ma maison ? Je te dis que tu es envieuse de la tranquillit des gens qui valent mieux que toi. Taisez-vous, vous autres, laissez-moi causer. J'ai longtemps attendu ce jour ; laissez-moi dire ce que j'ai sur le cur. Tu envies nos plaisirs et nos joies. Nous en avons toutes assez, tu m'entends, assez de sentir tes regards sur nous. Ton il nous a suffisamment fait de mal. Vous allez, toi et tes btards, dguerpir de ma maison, sinon vous la quitte-rez de force. Quelques femmes l'approuvrent pendant qu'Ani plissait. -Moi, vieux garagouz ! Tu crois que je t'envie, moi ? rtorqua celle-ci. Plutt, je te plains. Tes joies, je ne les gne pas, mais Dieu les gnera. Pense que chaque jour te rapproche de la tombe ; tu n'attends pas la mort alors qu'elle est en toi dj. Et tu passes ton temps contem-pler les murs de ta maison ; qu'ils tombent sur toi. Misrable ! Mets Dieu dans ton cur et sache que la mort est suspendue au-dessus de ta tte. Tfou ! crapaud malfaisant. -Que la mort t'emporte, toi, emporte ta famille, emporte tous tes proches. Je suis ici chez moi, lcheuse d'assiettes. Je te montrerai qui je suis. -Moi, je travaille pour nourrir quatre bouches. As-tu jamais travaill une journe de ta vie, femme strile ? Non, coup sr. -Tes pareilles sont au bordel, le seul endroit qui te convienne. -Nous sommes pauvres, mais notre rputation d'hon-ntes gens est intacte, Dieu merci ! -Tu n'es qu'une mendiante ! -Tu oublies peut-tre, bouche d'gout qui dborde, que ton frre a crev en prison. Tas de voleurs !
Le cur d'Ani tait prs d'clater. -Taisez-vous. Silence, femmes ! C'tait Zina qui avait lanc cet ordre du premier tage. Les femmes, le sifflet coup, considraient cette gneuse qui venait tout gcher. Qu'est-ce qu'elle avait celle-l, encore ? -coutez. Il a t arrt. Ma fille Zhor, que voici, a vu les gendarmes lui mettre les chanes aux mains. Elle pourra vous le dire. Elle poussa Zhor vers la balustrade. La troupe des, femmes berlues levait la tte. -Qui a t arrt ? On ne sut laquelle d'entre elles avait pos cette ques-tion. Alors un terrible pressentiment pesa sur toutes les ttes. La maison, touche, le comprit ce cri. Elle se couvrait d'ombre brusquement. -Qui ? Vous demandez qui ? s'tonna Zina. Les femmes n'y taient pas. Faisaient-elles les idio-tes ? Elle rpta avec mpris : -Vous ne comprenez pas ? Alors Fatima explosa. -Ha ha ! Mon frre. Son cri partit, s'enfla de plus en plus. -Ha ha ! Mon frre. Ha ha ! Mon frre. Bouh ! Bouh ! Bouh ! Dans l'atmosphre charge d'angoisse, de ressenti-ment, de misre, Dar-Sbitar subit un instant d'garement. Au-dehors de la grande maison, guettait l'en-nemi ; il attendait son heure pour bondir. Les femmes avaient oubli leur querelle en un instant ; Dar-Sbitar se repliait sur elle-mme. Zhor raconta ce qu'elle avait appris - et non vu de ses propres yeux - chez sa sur, Bni Boublen. Elle redescendait de l-haut, quand la nouvelle circula : Hamid Saraj venait d'tre apprhend avec plusieurs fellahs. On ne parlait la campagne que de ces arrestations. Une des femmes se mit dire : -Lekhal Mohammed n'tait-il pas un homme que tout le monde connaissait en ville ? N'a-t-il pas t arrt dans la rue le mois pass sans qu'on en sache la raison ? Et quelques jours aprs, sa femme n'est-elle pas alle la maison de la Sret ? Elle voulait prendre de ses nouvelles et lui porter manger. Quelle ne fut pas sa surprise de voir sortir le vieux mdecin Vertuel - elle disait Bertouel. Et Bertouel n'est-il pas le mde-cin des morts ? L'aprs-midi un cadavre tait transport l'hpital militaire. Lekhal n'avait jamais eu affaire la justice jusqu' ce jour. Il est arriv dans les locaux de la police en bonne sant. Il en est ressorti trois jours aprs, mort. -Que dis-tu ?
Fatima se frappa les cuisses en poussant un hurlement. En attendant, Omar prenait le jeu au srieux. Sa joie d'exister tait si forte et il s'y donnait si entirement qu'il tait de la sorte suffisamment occup. Il vivait pour ainsi dire impunment, et tout son plaisir. Il s'abandonnait l'insouciance, protg qu 'il tait par son enfance. Il avait terriblement faim, toujours, et il n'y avait presque jamais rien manger la mai-son ; il avait faim au point que certaines fois l'cume de sa salive se durcissait dans sa bou-che. Subsister, par consquent, tait pour lui l'unique proccupation. Il tait cependant habitu n'tre jamais rassasi ; il avait apprivois sa faim. A la lon-gue, il put la traiter avec l'amiti due un tre cher ; et il se permit tout avec elle. Leurs rap-ports s'tablirent sur la base d'une courtoisie rciproque, attentive et pleine de dlicatesse, comme seule une ample comprhension sau-rait en faire natre entre gens qui se jugent d'abord sans la moindre complaisance et se reconnaissent ensuite dignes l'un de l'autre. Grce cette entente, Omar renversa toutes les indiffrences, filles de la peur et de la paresse. Et s'il avait song donner voix ce qui tait profondment enfoui en lui, il se serait n'en pas douter exprim en ces termes: Mre bien-aime, Mre faim, je t'ai rserv les mots les plus tendres... Que de soirs il s'agenouilla ses pieds, l'me et les yeux absorbs dans le plus vaste amour, tandis qu'elle souriait, souriait... et s'approchait de lui, l'environnait de sa douce et indulgente prsence. Et lui s'assoupissait d'un sommeil vigilant sous le mouvement de ses mains lgres, trop lgres.
Lorsque le calme se rtablit un peu, Omar entendit sa mre jeter appel sur appel. L'impatience faisait che-vroter sa voix qui lanait l'un aprs l'autre les noms de ses gosses. Par-dessus la rumeur qui dominait encore la maison, elle leur enjoignait de revenir. La colre la tenait toute. Ce n'tait pas le moment de se mettre en tte de lui dsobir. Faire obir sa progniture lui tait encore une consolation, un soulagement. Ani avait eu tant de malheurs dans sa vie, une misre qui durait depuis tant d'annes que ses nerfs s'taient uss dans la lutte quotidienne. Ds qu'un de ses enfants apparaissait, elle le poussait l'intrieur de la pice. L'un aprs l'autre, ils reurent un coup de poing entre les omoplates. Toutefois la dernire, Mriem, manquait, mais personne ne s'en inquita. Elle finirait bien par arriver. La nuit se fit plus noire. Quelques femmes obstines s'acharnaient converser en bas. La faim, de plus en plus lancinante, faisait gargouil-ler les intestins des petits. Timidement d'abord ils demandrent manger. Ani paraissait crase. Tous ensemble alors ils l'implorrent. Elle se leva, distribua de vieux morceaux de pain, avec une moiti de concom-bre, une pince de sel. Omar pluchait sa part. Il ne jeta pas les pelures. Il s'en colla quelques-unes sur le front et les tempes et en prouva une sensation de froid aigu. Il mangea celles qui restaient. Ensuite il poudra de sel la pulpe et y mordit. Les lvres claquaient doucement. Ani, la bouche pleine, appela, en regardant la porte : -Mriem ! Mriem ! Elle cria de faon qu'elle pt tre entendue de loin. -Dieu du ciel ! s'exclama-t-elle. Viens manger, Mriem. Qu'est-ce que tu fais ? Rien ne signalait que la fillette ft dans la maison. -Elle est sortie, se dit tout haut Ani. A cette heure, mon Dieu. Ah ! malheureuse que je suis, malheureuse. Elle se remit mcher lentement. Peu aprs, elle souleva le rideau qui masquait la porte. Elle aperut Mriem un pas du seuil. Elle des-cendit la marche d'entre. Sa fille, immobile, la regar-dait. -Qu'est-ce que tu as ? -Si ces femmes parlent autant, c'est parce qu'elles ne savent pas se taire. La mort vaut mieux que a. La voix de Mriem tait fragile, irrelle. -Tu n'as pas faim ? demanda Ani. -Si. -Eh bien, viens manger. -Pourquoi ne m'as-tu pas appele ?
Le visage de Mriem tait impassible. De la voir ainsi, de voir les ombres de son me transparatre sur ses traits, sans trop savoir pourquoi, Omar eut peur. Il lui arrivait souvent de surprendre en lui un tel dchire-ment. Chaque fois il s'en dfendait avec dsespoir. Son regard revint sur elle. Il vit dans ses yeux une prire. Le seul dsir de Mriem tait-il de quitter la vie ? Il s'tonna d'avoir eu cette pense. Elle semblait se retourner, anxieuse, pour fixer la nuit. Toute cette eau ne servait rien. Ils le savaient tous. Au soir, la chaleur fondit sur eux. Leurs corps furent moites. Une nuit haletante commena. Presses par la mre, les deux filles tendirent les peaux de mouton au milieu de la pice. Omar gagna la sienne. La lumire d'une ampoule lectrique sans abat-jour, accroche au pla-fond, trouait la nuit. A travers ses paupires closes, il sentait la pointe de cette lumire qui pntrait ses chairs. Au seuil du sommeil, il se rappela la prsence de deux femmes. Etaient-ce Zina et sa fille Zhor ? Elles chu-chotaient avec Ani. Omar fut agit par un trange malaise. Les regards des trois femmes lui donnaient de la fivre. Cette conversation touffe, rapide, persistait. Une psalmodie. Soudain ses genoux devinrent froids, l'espace d'une seconde. Les femmes semblaient craindre de parler. Elles le dvisageaient la drobe, en silence, du fond de la chambre. Omar en voulut aux intruses. Cette chambre o il esprait tre tranquille, voil qu'il tait oblig de la har cause de ces ombres assises. Que pouvaientelles avoir faire avec sa mre ? Quelqu'un parla dans la cour. Tout coup il lui devint impossible de suppor-ter plus longtemps les regards des femmes. Une boucle de lumire et de silence se refermait sur lui. Lumire et silence n'taient plus que tnbres. Cela ne dura qu'une seconde et il oublia vite ses souffrances. Voici que la cour tait pleine de femmes qu'attirait l'atmosphre d'excitation et de scandale qui ne cessait de rgner dans Dar-Sbitar ; des voix se mlaient sans s'accorder ; des dialogues commenaient dans un mur-mure furtif et explosaient dans l'exaspration gnrale - les femmes taient ce soir-l particulirement dcha-nes. Pourquoi cette foule tait-elle indigne ? - Sors de l, Omar, lui lana l'une d'elles. Tu seras maudit toute ta vie. Une autre se frappait les cuisses comme s'il s'agis-sait d'un deuil ; elle jetait en l'air une plainte stridente qui zbrait la nuit tel un hurlement de mort. Toutes, avec une dcision implacable, pitinrent ce qui se trou-vait par terre, dans la chambre, autour d'Omar. Leurs rcriminations taient profres avec des voix si aigus et si funbres que, durant plus d'une heure, l'enfant n'eut l'esprit occup que par elles, ayant tout oubli de sa souffrance. Il revint lui et se rendit compte que plus aucun bruit ne parvenait leur chambre. Avec mille prcautions, il essaya de comprendre ce qui s'tait pass. Le silence qui succdait tout ce tumulte tait droutant, beaucoup plus mme que les paroles incohrentes perues quelque peu auparavant. Il eut la sensation que tout cela venait d'un autre monde. Dans son estomac, les aliments qu'il avait pris - pain et concombre - formaient un poids de plus en plus lourd.
Omar avait fini par confondre Dar-Sbitar avec une prison. Mais qu'avait-il besoin d'aller chercher si loin ? La libert n'tait-elle pas dans chacun de ses actes ? Il refusait de recevoir de la main des voisins l'aumne d'un morceau de pain, il tait libre. Il chantait s'il vou-lait, insultait telle femme qu'il dtestait, il tait libre. Il acceptait de porter le pain au four pour telle autre, et il tait libre. Mais en dpit du sentiment farouche que lui procurait cette apparence d'indpendance, a n'allait pas. Irrductible, pur, un instinct implacable, toujours en veil, le dressait contre tout. Omar n'acceptait pas l'existence telle qu'elle s'offrait. Il en attendait autre chose que ce mensonge, cette dissimulation, cette catastrophe qu'il devinait. Autre chose. Et il souffrait non parce qu'il tait un enfant mais parce qu'il tait jet dans un univers qui se dispensait de sa prsence. Un monde ainsi fait, qui apparaissait irrcusable, il le hassait avec tout ce qui s'y rattachait. Il ne croyait pas aux paroles des grandes personnes, il ne reconnaissait pas leurs raisons, faisait peu de cas de leur srieux, rcusait leur assurance. Sous leurs regards souverains, il se consolait en secret de son jeune ge en comptant sur l'avenir pour prendre sa revanche. l,es images de bon petit garon ou de mauvais sujet qu'on se faisait de lui ne procdaient que d'une qui-voque. Quelque chose pourtant l'empchait obstinment de connatre la vie pleine et comble. Un voile le sparait de cette dcouverte. Il en prenait son parti avec cette aisance qui parat chez les enfants comme un dtache-ment. Cependant, assig par les puissances obscures qui menaaient son existence, ce n'tait pas sans un grand dsarroi qu'il avanait dans l'univers qui tait le sien. Ses parents, de mme que tous ceux qui s'agitaient sans fin autour de lui, prenaient, semblait-il, leur parti de ce bagne. Ils essayaient de rduire leur existence l'chelle d'une cellule de prison. Il y avait bien dans chacune de ces existences une haute lucarne d'o tom-bait un petit jour anmi. Mais nul ne songeait se demander d'o provenait cette clart. Fallait-il lever les yeux ? En avait-on le temps ? Impossible. On trottinait d'une peine l'autre avec un affairement de fourmis, le nez terre. Mais certains, des fous, tout prendre, tout coup se jetaient, on ne savait pourquoi, contre cette fentre, se collaient aux barreaux qui la dfen-daient solidement, pour crier au ciel bleu - quoi ? Dar-Sbitar vivait l'aveuglette, d'une vie fouette par la rage ou la peur. Chaque parole n'y tait qu'in-sulte, appel ou aveu ; les bouleversements y taient sup-ports dans l'humiliation, les pierres vivaient plus que les curs. Ani dclarait souvent : - Nous sommes des pauvres. Les autres locataires l'affirmaient aussi. Mais pourquoi sommes-nous pauvres ? Jamais sa mre, ni les autres, ne donnaient de rponse. Pourtant c'est ce qu'il fallait savoir. Parfois les uns et les autres dcidaient : C'est notre destin. Ou bien : Dieu sait. Mais est-ce une explication, cela ? Omar ne comprenait pas qu'on s'en tnt de telles raisons. Non, une explication comme celle-l n'clairait rien. Les grandes personnes connaissaient-elles la vraie rponse ? Voulaient-elles la tenir cache ?
N'tait-elle pas bonne dire ? Les hommes et les femmes avaient beaucoup de choses cacher ; Omar, qui considrait cette attitude comme de la purilit, connaissait tous leurs secrets. Ils avaient peur. Alors ils tenaient leur langue. Mais de quoi avaient-ils peur ? Il en connaissait, des gens comme sa famille, leurs voisins et tous ceux qui remplissaient Dar-Sbitar, des maisons comme celle-l et des quartiers comme le sien : tous ces pauvres rassembls ! Combien ils taient nom-breux ! - Nous sommes nombreux ; personne qui sache compter suffisamment pour dire notre nombre. Une motion curieuse le pntra cette pense. Il y a aussi les riches ; ceux-l peuvent manger. Entre eux et nous passe une frontire, haute et large comme un rempart. Ses ides se bousculaient, confuses, nouvelles, avant de se perdre en grand dsordre. Et personne ne se rvolte. Pourquoi ? C'est incomprhensible. Quoi de plus simple pourtant ! Les grandes personnes ne comprennent-elles donc rien ? Pourtant c'est simple ! simple ! C'est simple. L'enfant continuait : c'est simple. Cette petite phrase se rpercutait dans son cerveau endolori et semblait ne point devoir s'vanouir. - Pourquoi ne se rvoltent-ils pas ? Ont-ils peur ? De quoi ont-ils peur ? Elle se prcipitait dans sa tte une allure vertigineuse. Pourtant, c'est simple, c'est simple ! Une drive sans fin... Et voil que le souvenir de Hamid parlant une trs grande foule se dresse dans son esprit. Hamid disait : Pourtant, c'est simple.
Le local de la rue Basse est comble. On entendrait voler une mouche. Dans la foule compacte, personne ne bouge. Les hommes coutent : des gens de la cam-pagne, des fellahs, qui ont apport leur odeur cre, une odeur puissante de terre retourne, de champs. Immo-biles, ils coutent. Quelqu'un parle. Leurs djellabas brunes au poil rche paississent l'atmosphre de bue. L'air tide du local en est tout alourdi. Les djellabas ont absorb toute la pluie du matin, que les fellahs avaient reue sur le dos en venant de leurs campagnes pied. Ils ont circul un peu en ville avant de se retrou-ver la runion. L'homme parle dans le fond de la salle. Dans l'atmosphre sombre, s'lvent des fumes de tabac. Le lieu reoit une maigre lumire d'une fen-tre haut place. On entend fort bien les paroles. Les travailleurs de la terre ne peuvent plus vivre avec les salaires qu'ils touchent. Ils manifesteront avec force. L'orateur cite en exemple des domaines que connaissent les fellahs. Il faut en finir, avec cette misre. Ses phrases, claires, donnent une sensation rconfortante : tout ce qu'il dit est juste. Un homme qui parle comme a, on a confiance en lui. Ses raisons n'ont rien de sombre- ment passionn. Les ouvriers agricoles sont les premires victimes vises par l'exploitation qui svit dans notre pays. Son ton demande que chacun comprenne, que rien ne soit laiss dans l'ombre. Il faut que toutes les expli-cations soient fournies, toute obscurit dissipe. Et l'orateur dit que les travailleurs de la terre vont vers de grandes luttes. Il a le ton de celui qui prend part chaque assistant. Il entretient celui-ci de la question, ensuite celui-l, puis cet autre... Des salaires de 8 et 10 francs par jour. Non, ce n'est plus possible. Il faut une amlioration immdiate des conditions de vie des ouvriers agricoles. Il faut agir rsolument pour atteindre ce but. Les yeux des hommes renferment des regards pro-fonds. Les travailleurs unis sauront arracher cette victoire aux colons et au Gouvernement gnral. Ils sont prts pour la lutte. A cet instant une troupe d'enfants entre brusque-ment, conduite par Omar qui sent aussitt deux mains d'homme se fermer sur ses maigres paules. Il se retourne : un fellah debout derrire lui le maintient. Il ne peut plus gure bouger ; les autres garons non plus. Alors ils renoncent changer des appels, courir de plusieurs cts. Ces hommes sont des fellahs, mais bien gentils. Les gamins font comme eux. Ils coutent. Ils deviennent srieux mesure que l'heure passe. L'homme desserre insensiblement son emprise et ses mains se font lgres : bientt Omar ne les sent plus ; le fellah les a enleves. Un grand calme se forme en lui. Omar ne sait plus partir de quel moment il s'est mis couter. Et il retrouve ou reconnat en lui ce qui est dit. A moins de mourir de faim, disent les colons, les indignes ne veulent pas travailler. Quand ils ont gagn de quoi manger un seul jour, leur paresse les pousse abandonner le travail. En attendant, ce sont les fellahs qui travaillent pour eux. De plus ils les volent. Ils volent les travailleurs. Et cette vie ne peut plus durer.
C'est a, pense Omar. Soudain, il frmit : il reconnat Hamid, au fond de la salle, qui parle ; c'est lui ! C'est donc Hamid... Ces paroles qui expliquent ce qui est, ce que le monde connat et voit, c'est trange, la vrit, qu'il se soit trouv quelqu'un des ntres pour les dire : de cette faon calme, nette, sans aucune hsitation. Notre malheur est si grand qu'on le prend pour la condition naturelle de notre peuple. Il n'y avait per-sonne pour en tmoigner, personne pour s'lever contre. C'est du moins ce que nous croyions. Et il se trouve des hommes qui en discutent devant nous, qui le dsi-gnent du doigt : Le mal est l. Nous ne pouvons faire moins que de rpondre : oui. De tels hommes sont forts. Et ils sont savants et courageux : ils connaissent la vrit comme nous la connaissons, nous. Et pas autre-ment. Et ils ont du mrite : ils peuvent en parler et l'exposer comme elle est. Nous, si nous essayons d'ouvrir la bouche pour en dire quelque chose, nous restons bouche be. Nous n'avons pas encore appris parler. Cette vie est la ntre pourtant, nous la revivons tous les jours. Seulement nous la sentons mieux la char-rue ou la pioche la main, ou dans les fruits que nous arrachons, ou dans la gerbe de bl que d'un coup de faucille nous tranchons. Mais quand nous rencontrons des hommes comme celui-l, qui nous en font part avec cette science, qui ne ramnent pas des histoires de loin pour nous embrouiller, nous savons rpondre : c'est cela. Parce que nous comprenons. Dans leur bouche, notre vie est bien comme ils l'expliquent. Ils nous ins-pirent confiance. Ces hommes, dans les paroles des-quels nous nous reconnaissons, nous pouvons parler, marcher avec eux. Nous pouvons aller de l'avant avec eux. Ils vivaient en effet comme le disait Hamid Saraj. Omar monta plusieurs fois Bni Boublen avec Zhor dont la sur tait marie l-haut. Dans le haut Bni Bou-blen, les cultivateurs taient leur aise, comme chez Kara Ali. Mais sur l'autre versant... Un jour, Omar, avec ses camarades, s'tait baign dans le bassin qui se trouvait la limite des terres de Kara, o l'eau s'enfouissait dans la verdure, entre des figuiers, des mriers, des micocouliers. De l, partait un sentier qui dvalait au loin dans la campagne. Omar eut l'ide subite de le prendre pour voir o il menait. Il pensait qu'aprs ces cultures il en rencontrerait d'autres, mais il tomba net sur la route de Sebdou. Le bas Bni Boublen se trouvait cet endroit-l. Tout comme le disait Hamid, les gens nichaient dans des trous de la montagne, hom-mes, femmes, enfants et btes. Au-dessus de leur tte, il y avait un cimetire, les vivants logeaient sous les morts.
Des lignes de constructions lointaines se dressaient dans l'embrasure noire de la porte et se profilaient dans la nuit. Leur nettet meurtrissait la pense. Cette vision veilla dans le cur d'Omar le sentiment de quelque chose qu'il oubliait, qui, telle une douleur qu'on est sr de devoir ressentir dans la seconde qui suit, allait d'un coup affluer son cur. Mais ce qu'on oublie n'est jamais aussi terrible : ces maldictions que les femmes avaient jetes sur lui tantt ! Et brusquement, sa vie lui apparut dans toute sa duret. Il tait condamn l'endu-rer jamais. Dehors, nuit d'aot. Une rverbration sans chaleur rongeait de sa blancheur le ciel. Omar vit cette chambre clatante et sombre. Le seuil baignait dans la lune ta-le jusqu'aux pieds des dormeurs qu'elle lchait insensiblement. Il ne cessait de se retourner sur sa couche ; l'insom-nie s'emparait de lui. Ses vtements le gnaient. Au plus fort de la nuit, des dmangeaisons les prenaient tous. Les ongles raclaient un ventre, des fesses, des cuisses, longuement. Les punaises, ds que l'obscurit s'tablissait, se coulaient hors de leur cachette et s'infil-traient dans leur literie. Les murs taient pourtant chau-ls, mais on en dcouvrait toujours. Ani allumait plusieurs reprises, la nuit, et en crasait quelques-unes. Le jour, on remarquait de longues tranes brunes laisses sur les murs par le doigt qui les crabouillait. Il n'y avait rien faire. Mme sans punaises la peau grattait toujours. Pour n'avoir pas se dvtir devant ses surs, Omar s'endormit avec sa chemise et sa culotte. Un morceau de vieille bche lui servait de couverture. Dans l'obs-curit, il rejeta la bche, enleva ses habits et se coucha mme le carreau, tout nu. Il prouva pendant quelques instants une sensation de fracheur. Une nuit, sa mre avait suggr d'asperger d'eau toutes les couches. Lui, il transforma la sienne en une vritable mare et s'tendit dessus. Mais il fut tellement malade par la suite qu'il n'eut plus envie de recommencer. Le rideau de l'entre tait relev, et la porte, dans le noir pais de la pice, creusait une profonde troue claire sur le monde nocturne. De sa place Omar obser-vait le ciel qui se transformait en une vague phospho-rescence o les toiles se noyaient. Il tait couch prs de sa mre ; de l'autre ct, dormaient ses surs. Il n'osait regarder par l, redoutant que ses yeux habitus l'obscurit ne lui montrassent ses surs galement nues. Il resta un instant fascin par cette pense. En lui flottait un lger malaise. Soudain un souffle d'air frais frla sa peau. Il enten-dait les respirations profondes et rgulires. Il se surprit dnombrer les toiles. Chaque fois que l'une d'elles rayait le ciel, c'tait comme un poinon qui pntrait son cur. Il ferma les yeux pour n'tre plus vu par elles. La chaleur, que la faim accompagnait constamment, leur faisait des nuits sans sommeil. Cependant, plus que la chaleur, la faim restait pour eux terriblement pr-sente. Dans le corps d'Omar c'tait comme une flamme insaisissable qui lui procurait une certaine ivresse. Devenue tout coup trop lgre, trop fragile, sa chair ne lui permettait pas de s'enfoncer dans l'paisseur de la nuit o le sommeil n'est que sang et dsirs. Une vgtation aux racines flottant entre ciel et terre absor-bait son corps, le vidait comme une cosse. Des plantes miraculeuses, comme autant de fuses, atteignaient leur pleine croissance et mouraient en quelques secondes. Et seul, persistait ce petit feu lointain dont la pointe lui brlait les entrailles, tandis qu'il voguait, perdu, intgr aux vagues immobiles de la nuit.
Ani brusquement parla. A qui s'adressait-elle ? Qui l'entendait ? Ne parlait-elle que pour elle-mme ? - Ce travail me dmolit la poitrine. Je n'en peux plus. Mes jambes sont sans force. Tout ce que je gagne ne suffit pas pour acheter assez de pain. Je travaille autant que je peux pourtant. Et quoi a sert ? Omar se rendit compte qu'Aoucha coutait. Sa sur ane ne disait mot. Lui aussi, coutait. Un sentiment de gne intolrable l'envahit. O tait sa mre, dans quelle nuit ? Aoucha ne dormait pas. Ani observa un long silence. Ces bruits mats, c'tait elle qui les faisait. Elle ten-dait les jambes sur le carrelage, ou bien elle appliquait les bras et les paumes contre le sol. L'insomnie torturait Ani. Omar guettait dans le noir ses moindres mouve-ments, mais ne voulait pas qu'elle st qu'il tait veill. Lorsqu'elle se remit parler, ce fut tout aussi inattendu que la premire fois. -Nous n'allons pas rester comme a, reprit-elle. Aoucha, tu peux garder les enfants, toi, si je m'absente. Je suis dcide aller Oujda ; j'apporterai encore d'autres coupons de soieries. Plusieurs femmes font a continuellement. Pourquoi ne le ferais-je pas, moi aussi ? Ma sur Mama ne voyage pas pour rien. Il ne se passe pas de semaine sans qu'elle fasse au moins un voyage. Tu crois que a ne lui rapporte rien ? Et pourquoi abandonne-t-elle son vieux et ses enfants pour y aller si souvent ? Elle gagne de l'argent, c'est sr. J'irai moi aussi. Tu garderas les enfants pendant que je ne serai pas ici. - Oui, maman, rpondit faiblement Aoucha. La ville d'Oujda se trouve 90 kilomtres, de l'autre ct de la frontire. Ceux qui russissaient introduire des tissus de contrebande en Algrie les revendaient bon prix. Ils ralisaient des gains substantiels. Jusqu'au moment o on mettait le grappin sur eux. Ils payaient alors avec usure mais ne se gurissaient pas de leur passion. C'en est une, que la contrebande, mme si elle constitue un gagne-pain dangereux (mais ncessaire) pour les populations frontalires. C'est un chass-crois quelquefois tragique avec les douaniers. Nombreux taient les hommes et les femmes qui s'adonnaient ce trafic. Les femmes sous leur haik avaient plus de chances cependant de passer inaperues. La police de frontire n'exigeait d'elles aucune pice. (Qui a vu une Mauresque se plier une formalit ?) Mais sa mre saurait-elle encore chapper aux douaniers ? Elle tait bien passe la premire fois, mais cette fois-ci, passerait-elle ? Omar se rvoltait, rageait de toutes ses forces. Aller en prison... Elle ? Ce n'tait pas possible. On peut voler, et il constatait qu'autour de lui on volait constam-ment : il ne voyait pas ce qu'il y avait de rprhensible enfreindre la loi. Mais quand il en arrivait la pense du chtiment, une panique le saisissait qui affolait sa chair. Il avait peur de la souffrance. Son corps l'appr-hendait jusque dans la souffrance d'autrui, par une sorte de transposition instinctive. Non, sa mre ne s'en irait pas Oujda, il n'arrivait pas l'admettre. Devait-il lui communiquer ses apprhensions ? Devait-il tenter de la dtourner de son projet ? Hlas, il savait qu'il se tairait et dissimulerait son angoisse. D'ailleurs sa mre se serait sans nul doute moque de lui. Et s'il et insist, elle l'aurait rabrou. Un gamin. De quoi se mle-t-il ? C'est une chose srieuse que la vie ! Il y avait aussi d'autres murs dresss entre eux.
Cette nuit servit Ani prparer ses plans. Faire de la contrebande : Omar l'avait dj entendue exposer ses projets Lalla ; c'tait pour Lalla qu'elle allait voyager cette fois. Elle essayait de lutter. Elle ruminait sans cesse des plans. Par quels moyens gagner un peu d'argent ? Omar ne pouvait croire que pour augmenter leur revenu sa mre acceptait, avec cette lgret, d'encourir la prison. La somme qu'elle recevait pour son travail tait si ridicule, il est vrai, que c'en tait exasprant ; il n'y avait pour ainsi dire pas d'issue leur situation. Depuis plusieurs mois qu'Ani cousait ces empeignes d'espa-drilles, ils n'avaient pas mang une seule fois leur faim. Omar l'aidait dans son travail ; mais rien n'y fai-sait. Ani avait pens un moment vendre sa machine. Mais elle tait leur dernire dfense contre le dnue-ment complet ; aussi changea-t-elle d'avis. Pendant combien de temps le produit de sa vente aurait-il nourri cinq bouches ? Pas longtemps, sans aucun doute. Et quand ils auraient eu tout mang, jusqu'au dernier sou... que seraient-ils devenus ? Ani conservait donc prcieu-sement la machine, qu'elle avait eue aux premiers temps de son mariage : Quand le miel tait dans du bois de sureau. Cette machine lui rappelait les quelques jours heureux qu'elle avait connus durant sa vie conjugale. Depuis quinze ans, c'est--dire bien avant la mort de son mari, elle avait commenc l'utiliser pour les faire vivre. Elle avait fait d'abord du piquage pour les cor-donniers, pendant longtemps. Ensuite elle reut de l'ouvrage d'un Espagnol, nomm Gonzals, qui avait une fabrique d'espadrilles. Il fallut accepter le travail et le maigre salaire qu'il lui offrait ; et trop heureuse encore ! Sinon l'ouvrage lui passait sous le nez. D'autres n'auraient pas mieux demand que d'en avoir davantage le jour de la rpartition. Aussi se mit-elle coudre ces empeignes d'espadrilles en grosse toile blanche et raide, sans souffler mot.
Mais Ani avait chang plusieurs fois de travail. Elle avait card et fil de la laine. Ensuite, elle se mit faire des arraguiats Puis des feutres fouls la main. A prsent, elle piquait la machine. Elle avait eu, indniablement, beaucoup de mtiers. Pourtant elle ne gagnait jamais de quoi suffire. Et tout le monde dpendait, y compris Grand-mre dsormais, du peu qu'elle touchait. Elle tait devenue anguleuse, tout en gros os. Depuis longtemps, tout ce qui fait le charme d'une femme avait disparu chez elle. Efflanque, elle avait aussi la voix et le regard durs. Le samedi aprs-midi, Omar l'accompagnait chez Gonzals, l'Espagnol. Un homme-bedaine, ce Gonzals ! Ses joues, aussi grosses que des fesses, lui bouf-faient le visage. Ce jour-l, il faisait le compte des femmes qui tra-vaillaient pour lui ; et il les payait. Pendant qu'il faisait ses calculs, Ani se tournait vers Omar : - Compte, toi aussi, pour voir si c'est bien a. Omar venait exprs pour vrifier la somme que lEspagnol leur remettait. Sa mre ne savait pas compter. Mais ce ntait pas uniquement pour cela quil laccompagnait. Il devait retenir dans sa tte combien de douzaines on leur rglait, et combien dargent on leur donnait. Elle, tous ces chiffres, elle les embrouillait et narrivait jamais y comprendre grand-chose. Une fois la maison, les oprations de vrification commenaient : -Et celles quon a faites lautre jour, elles y sont, dans son compte ? Omar se remettait tout calculer depuis le dbut pour savoir si les empeignes en question y taient. -Oui, elles y sont. -Et celles que je lui ai portes, il y a quatre jours, part ? -Mais on les a ajoutes tout lheure, tu le sais bien. Elles se trouvent dans le compte. -Je voulais tout simplement te demander si tu en es bien sr. -Oui, jen suis sr. -Dj comme a, on ny arrive pas. Si on commence en oublier, cest la fin de tout. Ainsi, pendant des heures. Quelquefois, le soir, avant de se coucher ou mme le lendemain, alors que tout tait fini, compt une fois pour toutes, elle interrogeait Omar nouveau, tandis quon parlait dautre chose. -Est-ce que par hasard tu nas pas omis les quatre douzaines que louvrier de Gonzals est venu lui-mme apporter la maison ? Ce nest pas moi qui suis alle les prendre. LEspagnol na peut-tre pas pens les marquer.
Omar la rassurait ; il lui rpondait quelles taient comprises avec le reste. Il nen sa vait rien, la fin. Il prfrait lui dire oui, pour lapaiser. Comment pouvait - on sy retrouver avec sa manire de compter ? Sa mre posait largent quelle rapportait la maison sur sa robe tendue entre ses jambes. Il y avait de quoi manger du pain, ce jour-l. -Voil pour la farine, disait-elle. Vous voyez com-bien il en faut ? Mriem avait les yeux fixs sur les pices et les billets mls. -Combien ? demandait-elle. Et Ani rpondait : -Il faut tout a. Elle faisait un tas part. La petite appelait Omar. -Regarde, lui disait-elle. Il faut tout a pour la farine seulement. -Bien sr, idiote, rpondait son frre. -Comment est-ce possible ? -Cest comme a. -Mais il ne nous restera pas beaucoup, autant dire presque rien. Lautre tas tait constitu de quelques monnaies. -Rien que pour le pain, vous voyez combien il en faut, disait la mre. Pour les autres choses, ny pensons pas. Ce serait se rendre malade pour rien. -Pourquoi tu ne travailles pas plus pour avoir un gros tas dargent ? interrogeait Mriem. -Fille ! Tu vois que je nen peux plus. En effet, Ani trimait beaucoup ; elle ne sarrtait pour ainsi dire jamais. Le soir, le sommeil prenait les enfants, qui sendormaient, mais elle travaillait toujours. Et quand ils se levaient, le lendemain matin, ils la trouvaient en train de travailler. -On pourrait avoir de la viande, Ma. Ce serait magnifique. Hein ? Du couscous avec de la viande bouillie, arros de sauce. Quest-ce que tu en dis ? -Faites-moi taire cette folle ! disait la mre. Ani, immobile, contemplait cet argent en quoi se rduisait toutes ses fatigues. Omar pensait aussi tout ce quils pourraient manger de bon. Des tortillas confectionnes avec de la farine dans laquelle on ajoute de loignon, du persil hach et des dbris de poisson. Ou des sardines frites, tiens ! Ou tout simplement de loignon frit.
La petite Mriem se rcitait tout ce quon pouvait manger et quon ne mangeait pas, nentendant pas les : Tais-toi ! tais-toi ! de sa mre, croyant mme que cette dernire lcoutait. Sortant brusquement de sa rflexion, Ani scria : -Quest-ce que tu dis ? Ne me suis-je pas assez tue au travail ? Tu trouves que ce nest pas assez ? O irai-je prendre de largent pour avoir manger les choses que tu dis ? Si tu le sais, toi, jirai. Mriem fondit en larmes. -Mon Dieu, gmissait Ani. Bouh ! Bouh ! Faites-la taire, ou alors je ne sais pas ce que je lui ferai. La petite hoquetait de plus belle. -Vous voulez que jaille faire la voleuse, que jaille traner avec les mles, dans la ville basse ? deman-dait Ani. Est-ce ma faute si nous ne pouvons pas ache-ter autre chose ? Il semblait soudain quAni navait plus la force de supporter sa fatigue. Il ny avait pas beaucoup de travail dans la ville. La population des journaliers, des tisserands, des babou- chiers tait inscrite au chmage. Mais ne touchaient quelque chose que ceux, naturellement, qui se rendaient aux chantiers de chmeurs, crs pour fonctionner pen-dant quelques mois. Les inscrits y taient admis deux semaines ou trois, ensuite ils cdaient la place dautres. Les listes taient longues : beaucoup attendaient leur tour. Et tout le monde avait faim. Les dernires semaines du printemps et tout lt, cest--dire prs de la moiti de lanne, les tisserands cessent toute activit ; il ny a plus gure douvrage durant ce temps-l. Pour les babouchiers, il en est de mme. Ils produisent pour les gens de la campagne ; les fellahs nachtent que lorsque la rcolte est mene bout. Les artisans de la ville passent ainsi la moiti de lanne tenter de se faire inscrire aux chantiers de chmeurs. Comme quelques-uns dentre eux taient aussi des musiciens, ils jouaient dans les mariages, les ftes de circoncision, ou dans les cafs, au ramadan. Cela nempchait pas leurs enfants davoir continuellement faim. Ils gagnaient une misre pour des nuits entires de veille. Leurs femmes travaillaient aussi. Mais, femmes et hommes runis, ils ny arrivaient pas. Non pas que leurs efforts fussent insuffisants : si on avait calcul leur gain la peine quils se donnaient, tous eussent t riches lheure quil est... Il y en avait qui trouvaient encore le moyen de boire avec le peu dargent qui leur tombait entre les mains. En si grande quantit des fois que cela leur valait la dsapprobation et mme le mpris de tout le quartier. Ainsi de temps en temps, le vendredi ou les jours de fte, Mohammed Cherak, le meilleur tisserand et lun des plus rputs athltes de la ville, se mettait sans raison assommer ses admirateurs en vocifrant comme un possd. Dchans, les gamins rassembls en nues insolentes le poursuivaient jets de pierres quils accompagnaient de cris hystriques. -Dido borracho ! Dido borracho !
-Je suis saoul, moi, enfants de votre mre ? Lhomme sarrtait et les couvrait dinjures. Sans cesser de profrer des hues, les gosses senfuyaient prcipitamment. Cherak navanait plus. Oscillant sur ses jambes, il les menaait dun geste obscne de la main. Et il pous-sait un grognement de satisfaction, puis maugrait tout seul. -Vauriens ! Vous ne comprenez pas ce que jai dans le cur. Alors vous ne savez pas pourquoi je me saoule... Enfin, tant pis. Je vais encore boire, puisquil ny a rien dautre faire. Saisissant loccasion, Si Salah, homme pieux la barbe bien soigne, sapprochait alors et commenait lexhorter : -Ya Mohammed, voyons, comment oses-tu te conduire ainsi ? Est-ce possible quun bon musulman agisse comme tu le fais, toi, en ce moment ? Regarde- toi. Vois dans quel tat tu te mets sous les yeux de tous les gens du quartier qui taiment et qui ont tant destime pour toi. Et pourquoi ? Le sais-tu au moins toi-mme ? Eh bien, rponds, malheureux. Ne se rendant aucune injonction du vieillard, qui le chapitrait tout en lissant sa grande barbe, ivre mort, Mohammed riait et bafouillait : -Ma vie passe inutilement. Je ne la regretterai pas. Et largent, en voil ! Tant que vous en voudrez. Dun geste brusque, il semait en pleine rue poignes de la monnaie sur laquelle fondaient aussitt les gamins. Ahmed Dziri, le pre dOmar, qui fut de son vivant un bon menuisier, lui aussi quest-ce quil ne buvait pas ! Il avait fait presque toutes les boiseries des belles demeures de lpoque. Mais Ahmed Dziri senivrait de plus en plus : un jour, il tomba malade, il res ta couch plusieurs mois. Puis il mourut. Il tait mort depuis si longtemps quOmar nen gardait plus aucun souvenir. Cest comme sil navait jamais eu de pre, layant si peu connu. Ctait un mal la poitrine, lui avait -on dit, dont il ne pouvait gurir. Ani, veuve, tait reste avec quatre enfants : deux filles, Aoucha et Mriem, et deux garons, Djilali et Omar. Deux ans peine aprs la disparition du pre, elle perdit Djilali, g de huit ans, qui fut emport par la mme maladie : encore un mal la poitrine, lui avait-on dit.
La nuit abrupte et claire flambait avec douceur. Toutes les nuits, cette poque, avaient la mme pre limpidit. Le sommeil gagnait Omar, ouvrant une grande anfractuosit dans la profonde blancheur noc-turne, mais ne le reposait pas. Autour de lui, partout, quelque chose bougeait, se frayait un passage jusqu lui... Il lui semblait ne pas avoir cess de parler jusqu cette minute. Le fond de sa gorge, comme corch, tait tout meurtri. Ce ntaient que quelques mots, larges et incomprhensibles, les mmes, quil sobstinait ressasser sans fin. Us passaient en trombe travers son esprit. Tout au long de son sommeil, tandis quil avanait dans un univers dmantel, il lanait dimmenses appels quune autre personne, croyait-il, lui renvoyait la vole impitoyablement. Par instants, il aurait jur que ses paroles taient celles dun autre, et que lui reprenait. Et tout coup, il tait transport au milieu dun noir clatement davenues. L, des hommes dsempars tapis dans les coins lassaillaient, saccrochaient dsesprment lui, chaque pas. Des cris proches et jamais saisis fusaient ; des espaces vides se succdaient. Omar se sentait tout dpouill du dedans et dfait. Il ne persistait en lui quun enttement violent survivre ; survivre malgr les luttes mortelles quil soutenait ; survivre. Cette terreur, Omar la voyait. Elle se rpercutait en lui, qui tait l, dress sur sa couche, les pieds replis sous lui. Et il pensa : Certainement, cest la peur de Grand-mre. Il comprenait distance quelle avait peur. Peur dtre seule, dtre dans la cuisine, isole avec son mal. Elle ne cessait dimplorer au plus fort de la nuit, alors que toute la maison sabmait dans la lthargie. Elle sinterrompait durant quelques minutes. Elle coutait sans doute si on lui rpondrait. Sarrtait- elle par peur aussi ? Ses appels avaient tir Omar du sommeil. Nul ny rpondait, le mutisme touffait la vieille maison. Omar imagina le noir qui pesait partout, sappuyait contre la porte de la chambre, menaant, hostile. Cette chose norme dont on naurait su dire le nom guettait dans la cour. Doucement, venant de loin, la voix de Grand-mre slevait encore. Elle bavardait pour rompre la lassitude, non cette bonne lassitude des corps vigoureux, mais celle de lge. Ses pauvres penses se frayaient une voie travers la peur, la mala-die, mais surtout la vieillesse. Dans la chambre dAni, on dormait. Les respirations de rythmes diffrents sentrecroisaient dans une atmo-sphre dense. Quelquun soupirait de temps en temps dans son sommeil ; ctait Ani. Une plainte parvint du fond des tnbres. Grand- mre se lamentait : -Ani ! Ani ! On la sentait sans force. -Ani, tu me laisses toute seule, ma petite fille. Quest-ce que je tai fait ? Pourquoi, Ani ? Pourquoi ? La voix ttonnait et semblait vouloir agripper quelquun quelle narrivait pas atteindre. Personne dans la chambre ne bougeait. Ils sombraient tous dans lengourdissement qui sabat sur les misrables comme sur des proies vivantes, sans merci, pour se dissoudre au bout du compte dans un dsarroi sans fin. Cette angoisse vorace qui affluait de laeule vers le cur de lenfant btissait autour deux une citadelle sans ouvertures, un monde ferm inexorablement.
Omar savait lavance ce qui allait se passer le lendemain. On portait manger Grand-mre dans la mme cuelle de fer dont lmail clat par endroits dessinait de larges toiles noires. Ani la posait ses pieds, avec la nourriture du jour, sans la nettoyer ; il sy formait un fond graisseux qui adhrait aux parois et formait crote. -Pourquoi appelais-tu tant cette nuit ? Tu es folle ! pestait Ani au-dessus de sa tte. Alors on na pas une minute de rpit avec toi ? Grand-mre attendait que sa fille sloignt. Elle se ratatinait sur elle-mme. Grand-mre avait peur, comme un enfant ou un petit chien, de recevoir des coups. Toute ploye, le dos comme bris, elle reposait, la tte sur ses genoux. Sans se redresser, elle clignait du ct dAni. Omar tait assis par terre ses pieds. -H, Marna ! tonitruait Ani dans son oreille en poussant vers elle lcuelle. Tu ne vois pas que je tapporte manger? Ou bien ce que japporte te dplat ? La vieille femme ne remuait pas. Ani se saisissait de lustensile puis empoignait la tte de Grand-mre et lui fourrait lcuelle sous le nez. -Oui, ma fille, jai vu. Pourquoi me traites-tu comme a ? -Tiens, mange ! lui disait Ani en la secouant sans mnagement. Elle bredouillait quelques mots entre ses dents : Puisses-tu manger du poison. Grand-mre, avec des mouvements dagacement, sans se retenir prenait lcuelle de sa main qui tremblait dune manire affolante et la rejetait au sol, sous sa chaise. Ani, qui lui calait la tte, retirait son bras et la figure de Grand-mre retombait sur ses grosses rotules. La vieille femme navait plus la force de se maintenir droite ; elle tait irrmdiablement casse, impotente. Ani sen allait en grognant. Grand-mre, aprs stre assure que sa fille tait partie, se hasardait relever la tte et posait son regard bleu sur Omar. Il nchappait pas lenfant quelle se rendait peine compte de ce qui lui arrivait. Sa fai-blesse ne lui permettait plus de se garer des violences dAni et, dans son regard noy, tremblait lextrme misre de la bte bout de souffle. Elle laissait retomber sa tte. Une frle lueur brillait cependant telle une tincelle vive dans ses prunelles embues. Elle venait de le reconnatre. Ctait la joie de le sentir prs delle qui, du fond de son regard, avan-ait vers lui, vacillante. -Ah ! Cest toi, Omar ? Je nai plus que toi. Elle mettait ces propos dans un demi-sommeil ; Grand-mre ne faisait plus attention rien depuis quel-que temps, sauf quand on lui apportait manger ; alors elle sagitait un peu. Puis elle pivotait de la tte, allon-geait le bras, et puisait sa pitance dans le rcipient pos ses pieds. Avec ses doigts au toucher daveugle, elle ramenait ce quelle pouvait vers sa bouche qui, souvrant de biais, se tordait. Elle mangeait en gmis-sant. Ses vtements
taient souills dune large tache de graisse, lendroit o reposait sa bouche. Grand-mre se couvrait de dtritus daliments que ses lvres ne pouvaient retenir. Omar et Aoucha murmuraient toujours lorsque Ani rabrouait Grand-mre. -Toi, pourquoi la traites-tu mal ? La mre les toisait. -Moi ! sexclamait-elle. Moi, traiter mal ma propre mre ? Quand lai-je donc mal traite ? Quand ! Quand ! Ils demeuraient confus et incli-naient la tte. Ils rptaient : quand donc ? -Maintenant, disait-elle, jai travaill jusquau bout. Vous le voyez mon visage, vous le voyez mon corps. Et vous voyez, au bout du compte, rien : seulement plus de fatigue quavant, et un peu moins bonne au travail. Quand nous aurons travaill toute la vie, au bout il nous reste lhospice ou la mendicit. Si la mort survient alors, nous dirons : tant mieux. La mort, pour nous, est une couverture dor. Mais si cette mort narrive pas, ne veut pas de nous, et si, ne pouvant plus abattre de la besogne, nous continuons tout de mme vivre, voil la calamit. Si ce nest pas la tombe qui vient nous ce moment, cest nous qui devons aller elle. Et si nous le pouvons, nous devons lacheter avec de largent. Nous aurons vcu et ce sera fini. Nous aurons vu des malheurs et il ny aura plus rien qui nous tente ici-bas. Le cur naura rien regretter. Nous naurons gard notre deuil de rien. Quand nous ne servons plus, nous pouvons penser que nous avons dj trpass. Dans ce cas, il vaut mieux que la mort nous emporte le plus tt possible. Nous aurons trop vcu. Quil en soit ainsi et tout rentrera dans lordre. Les enfants taient stupfis. -Quoi donc ? demandait encore avec animation Ani. -Ce que tu disais, rpondait sa fille ane. Qu'uni- personne travaille jusqu'au bout, et quand elle n'a plus la force de trimer, elle a fini de vivre. a peut tre un bien, comme a peut, des fois, ne pas... -Comment : ne pas tre un bien ? s'criait la mre. Quelqu'un qui est un poids, qui mange aux dpens des autres, qui a besoin de quelqu'un pour le dshabiller... Quand les gens se trouvent tre des pauvres... Ils observaient leur mre tous les trois. Leurs regards se dirigeaient ensuite vers la porte de la chambre, du ct de la cuisine... Aoucha esquissait un geste. Elle aurait voulu tenir en laisse les paroles de sa mre. Si elles parvenaient Grand-mre ? Les enfants se per-suadaient qu'il suffisait que ces mots fussent prononcs pour tuer srement leur aeule. Ani aussi se tournait du ct de la cuisine. Du moment qu'un tre humain devient un poids... pensait Omar. Et Omar aidait souvent Grand-mre. Cela veut dire qu'il l'aidait vivre. Il n'avait jamais senti qu'elle tait un poids. Mais une personne peut apporter manger toute une famille, et nanmoins tre un poids. Un enfant est-il un poids ? Je ne peux pas comprendre ces choses-l.
Certains jours, au lieu de manger, Grand-mre aban-donnait son bras qui pendait au-dessus de l'cuelle, sou-levait la tte un bref instant, regardait, d'un ct et d'autre, remuait sur le carreau nu ses deux mains irri-tes, puis geignait longuement. -Vous l'entendez ! disait Ani ses enfants. Ils se tenaient dans la pice et laissaient Grand-mre dans la solitude de la cuisine. -Quand a ne va pas, c'est tout de suite moi qu'elle appelle. Ani faisait signe Omar : -Regarde ce qu'elle veut, disait-elle. Et ne reste pas longtemps l-bas. Grand-mre mchait des phrases indistinctes et gmissait encore. Elle se plaignait. Omar croyait com-prendre travers ses paroles embarrasses qu'elle tait dlaisse. Elle disait que des chiens venaient rdailler autour d'elle, la nuit, et qu'on ne voulait pas la croire. Ces btes lui dvoraient les jambes sitt que l'obscurit accaparait la maison. Ani, qui avait maintes fois dj entendu cette his-toire, lui rtorquait qu'elle rvait, et l'accusait de men-songe : elle voulait se rendre intressante aux yeux des locataires et attirer leur piti. -Ce sont les folles fantaisies de ton imagination. Tu ne convaincras personne avec tes sornettes, concluait sa fille. Mais un soir, Omar surprit un chien qui montait jusqu' elle, attir sans doute par la nourriture qu'il trouvait dans l'cuelle. Grand-mre fut incapable de la lui disputer, comme de le chasser. A la lueur instable et sanglante d'un cul de bougie fix au sol, l'animal parut de proportions monstrueuses l'enfant. Matrisant son affolement, Omar parvint cependant le chasser. A dater de cette poque, on se rendit compte que c'tait surtout cause d'une forte odeur de dcompo-sition insaisissable, mais perceptible de loin pour leur odorat aiguis, que venaient les btes. L'odeur devenant suffocante, on comprit qu'elle venait de Grand-mre. Ani dcida de lui enlever les linges qui lui envelop-paient les jambes et les pieds. Depuis longtemps ses membres infrieurs taient gourds, ne lui servant plus, enfls dmesurment. Une sorte de liquide qui ressemblait de l'eau s'en coulait. On ne renouvelait plus les chiffons, et le jour o Ani les lui ta, ils virent tous grouiller des vers dans la chair blanche et molle. Le monde imprieux et meurtrier de la nuit s'effon-dra cette seconde par pans entiers : le jour montait. Omar s'endormit peu peu, vent par le souffle ardent et lger de la faim. Dans son inconscience, il fut averti du jour qui s'approchait, et un immense soula-gement l'envahit. Son corps se dtendit, apais et confiant. C'tait l'instant de la dlivrance. Il s'aban-donnait au sommeil prsent. Il n'avait qu' se laisser glisser et dormir, dormir, dormir...
Un jour passait. Puis un autre. Et un autre encore. La misre rendait tristes les gens de DarSbitar. Chez Ani, ils taient comme ils avaient toujours t. Il y avait seulement un peu plus de misre. Les enfants tenaient un peu moins solidement sur leurs jambes. Les visages, la maison, se creusaient, devenaient plus gris. Les yeux, constamment dilats, avaient chez tout le monde un clat fivreux. Pourtant, chose extraordinaire, en ville, Omar croisait des tres souriants, bien portants, repus. Joyeux dans le malheur, dans le dnuement gnral. Entre eux, ils devaient srement changer des illades quand personne ne les surveillait...
On parlait beaucoup dsormais. Les deux filles tra-vaillaient depuis deux mois dans une manufacture de tapis. Aoucha apportait son gain de la semaine, la cadette aussi, le sien, mais moins important parce qu'elle tait plus jeune. Elles dposaient cet argent dans la main de la mre. Et elles suggraient ce qu'on pou-vait acheter. Il tait certainement possible de prendre un peu plus de farine. Omar coutait en silence : si nous pouvions seulement avoir plus de pain, beaucoup de pain, songeait-il. Parce qu'elles gagnaient de l'argent, elles avaient envie de tout : On pourrait peut-tre acheter de la viande de temps en temps. N'est-ce pas, Ma ? Pas vrai, vous tous ? Au moins un jour par semaine. Et, peut- tre, des ufs. a cote moins cher que la viande. On fera une omelette aux pois chiches. Et des haricots, c'est encore moins cher. Et du riz. Qu'en pensez-vous, vous autres ? Avec l'argent qu'on a. Elles poursuivaient, intarissables. Ani les regardait et laissait dire. Elles dbitaient tout ce qu'elles voulaient ; la fin, la mre coupait net ce bavardage. Elles apportaient l'argent, bon ; mais a ne comptait pas. -Qu'en pensez-vous, vous autres ? demandaient- elles encore. -C'est la mre qui dcide ici, ou quoi ? disait Ani. Bon ! bon Dieu. Alors c'est elle qui parle. Elle vous dit : Quatre pains par jour, a veut dire trois kilos de farine acheter tous les jours. Bon. a veut dire qu'il faut d'abord acheter de la farine. Ani comptait la somme. Omar tait d'accord avec sa mre. D'abord du pain. Autant qu'il tait possible d'en avoir. Ses rves ne visaient pas plus haut. Dcontenances, ses surs finissaient par dclarer : -Comme on vivrait mieux s'il n'y avait pas tant de pain acheter. Elles ne pensaient qu' la viande, aux ufs, au riz. Quelques lgumes cuits l'eau, un ragot ne faisaient pas leur affaire. Ani et Omar pensaient que la soupe pour faire passer le pain c'tait suffisant. Il y avait le loyer et la lumire payer : soixante francs par mois. Ils revenaient la maison ce jour-l, Omar en avant, un couffin au bras contenant des herbes, des lgumes avaris qu'il avait ramasss entre les tals du march, Ani, derrire, dans son hak blanc qui s'effilochait de plus en plus sur les bords, un grand seau dbordant lui tirant les bras. Lui, apportait de quoi manger, elle, de l'eau de la fontaine commune pour boire. Dans la mai-son, le puits tait trop prs des cabinets, si prs qu'il y avait des infiltrations. Ani ne voulait pas de son eau. Arrive la porte, elle dposa le seau lourdement. D'une voix surexcite, elle appela sa fille. Elle n'avait plus la force d'avancer. Aoucha accourut, lanant un cri joyeux de l'intrieur de la maison ; Ani maugra, excde. Elle n'tait pas d'humeur supporter des gamineries. Elle tait incapable de parler tant sa respi-ration tait sifflante. Omar, lui, rentrait la mort dans l'me de ces fouilles qu'il faisait dans les tas de balayures du march cou-vert. Il s'en allait la dcouverte de lgumes qui pus-sent tre rcuprs ; s'il en trouvait, il les glanait et les enfouissait dans son couffin. Il revenait avec une immense rancur. Cette besogne, il devait l'accomplir quotidiennement en sortant, onze heures, de l'cole.
Lorsqu'il entendit, tout d'un coup, rsonner la voix rjouie de sa sur, il vit rouge. Il n'apprcia pas, non plus, la plaisanterie. Sa colre allait clater en jurons ; Aoucha, imprieusement, leur fit : -Chut ! Avec de grands signes de bras, elle les exhorta rentrer vite. Puis elle tendit l'oreille vers la cour de la maison, comme si elle craignait que ses paroles ne fus-sent surprises. La jeune fille paraissait extraordinaire- ment mue. Ses airs mystrieux les intrigurent. -Quoi ? Veux-tu parler ? cria Ani. Dis ce que tu as dire. Tu seras tranquille, aprs. -Non, Ma, murmura Aoucha. Il ne faut pas que les voisines le sachent. Le mauvais il. -Prends le seau et rentrons, commanda Ani. Sa voix faiblit, se fit hsitante ; le pressentiment du malheur s'emparait d'elle. Frquemment il rompait en elle toutes les digues et submergeait son cur. On la voyait du plus haut degr d'excitation tomber alors dans la prostration la plus profonde. -Nous n'avons pas besoin de a, pronona-t-elle entre ses dents. Le Seigneur nous a amplement accord ses bienfaits. Ani, comme toutes les femmes, disait les bienfaits pour dire les malheurs. -Nous en avons assez. Nous ne savons plus o les mettre. Le mauvais il s'est manifest en nous tant et plus... Bouh ! Bouh ! -C'est vrai, Ma, rpliqua Aoucha. On ne pouvait rien faire dans cette maison, sans que trois cents yeux vous piassent. -Avance, toi. Ne reste pas plant l, imbcile, rpri-manda Ani. Docilement, Omar les suivit. Aoucha fila, lgre malgr le poids du seau plein, en faisant de tout petits pas. Elle portait le bidon devant elle des deux mains, et se gardait bien d'en rpandre une seule goutte. Dans son impatience, elle incitait sa mre se presser. Un accent de contentement se trahissait tout de mme dans sa voix. En dpit de la peine qu'elle se donnait, elle tait de plus en plus incapable de le dguiser. Aprs tout, il ne se passait peut-tre rien de terrible. -Vite, Ma ! suppliait Aoucha en traversant la cour toute allure. Omar fermait la marche et mditait. -Ma, qu'est-ce que le mauvais il ? -Le diable t'emporte. -Tu verras, Ma, promit Aoucha. Elle avait dj plac le seau dans la chambre et tait revenue. -Tu verras, tu seras tonne, bien tonne.
Aprs l'intense rverbration de la cour, leurs yeux ne distingurent plus rien dans la pnombre qui noyait la pice. Ils furent plongs comme dans une eau noire et reposante. L'blouissement du dehors les aveuglait encore. Du fond, une voix appela : c'tait Mriem, qu'ils ne voyaient pas. -Ma, Ma ! Viens voir. Le mme accent de plaisir contenu perait dans sa voix. -Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? questionna Ani. Mais que se passe-t-il chez moi ? Je suis sortie peine un instant, j'ai tout juste pris le temps d'aller la fontaine, et voil que tout est sens dessus dessous maintenant. Je ne vous reconnais plus. Parlez ! ordonna-t-elle. Elle jura avec cette voix stridente qui tait d'ordi-naire la sienne. -Viens ; approche-toi. Regarde de tes yeux, disaient ses filles. Aoucha ne songeait plus refouler sa joie prsent. Ani lana sa fille : -De quel ct es-tu ? -Ma, continua d'appeler Mriem. Oh Ma ! -Il a d arriver quelque chose. Mes filles sont folles. Ani cria : -Qu'y a-t-il ? Parlerez-vous, oui ou non ? -Ma ! Ma ! gloussa encore la petite Mriem. -Idiote ! dit sa mre. Pourquoi crie-t-elle : Ma, Ma ? Un rire montait, sans fin, dans la gorge de la petite. En cho elle rpta encore : Ma ! Ma ! -Comment ? Tel fut le cri qui parvint de l'autre extrmit de la chambre. Omar leva la voix ; il demanda : -Elle nous dit de nous dpcher d'aller voir. Eh bien, allons voir. -Ferme-la, toi, menaa sa mre. Aoucha dansait. Elle courait tout le long de la cham-bre, faisait des signes, interpellait sa mre avec des mots affectueux. Elle excuta une pirouette, tourna sur elle- mme, et dansa encore. Habitus la demi-obscurit de la pice, ils distin-gurent Mriem assise auprs d'un panier de roseau qui paraissait aussi grand qu'elle. Elle passait le bras dans l'anse comme on tient une amie. Et ce panier la panse volumineuse semblait tout plein. Ani n'avait jamais eu de
paniers comme celui-ci : d'o pouvait-il bien venir, qui l'avait apport ? Et de quoi tait-il rempli ? -Des pommes de terre ! explosa Aoucha en se trmoussant. Ce sont des pommes de terre, Ma. Des pommes de terre ! Ces mots se transformrent en un chant qui s'ampli-fia au point de paratre insens. Ils s'interpellaient tous et rpondaient ensemble. -Des pommes de terre. -Il y a aussi des cardes dans le panier. -Et des cardes. -Et des fves aussi. -Et des tomates. -Tout a. -Et de la viande, Ma. De la viaaaande. De la viaaaande. Regarde, Ma, un grand paquet. De la viande aussi ? Les filles tournoyaient en chantant, se baladaient dans la chambre : Des pommes de terre ! Des cardes ! De la viande ! Le bonheur les rendait folles. Seule, la mre conservait son sang-froid ; elle paraissait mme abasourdie. Peu importait aux enfants, bien sr, d'o venait toute cette abondance. Puisque ces richesses taient chez eux, elles taient eux. Mais Ani demeu-rait muette. Elle se demandait probablement d'o leur tombait tout cela. Ses filles remarqurent son air proccup. Mais elles ne se lassaient pas de crier, chanter, danser. Elles se roulrent par terre, puis, la fin, elles se cal-mrent. Ani attira sa grande fille et la fit asseoir devant elle. -Maintenant, tu vas tout me raconter. D'o as-tu eu ces lgumes, cette viande, enfin tout ce panier ? L'interrogatoire se poursuivit longuement : question, rponse ; question, rponse. Leur colloque tait ponctu tout au long d'exclamations de surprise : Est-ce bien vrai ? Regarde voir. Et, n'en plus finir, de : Bouh ! Bouh ! de plaisir, dans lesquels pointait la honte devant un don si magnifique et si gnreux. Ani se mit elle aussi faire des clins d'il, gesticuler comme sa fille. Et, de temps en temps, elle jetait des cris dubitatifs : Ha ha ! La mre et la fille se lanaient cette interjection. -Ha ha ! disait Ani. -Ha ha ! disait Aoucha. -C'est comme a ? demandait la mre.
-Oui, c'est comme a, disait Aoucha. Elle recommena son histoire. -C'est comme a qu'il a dit. Comme a et comme a. Elle la racontait pour la deuxime fois. Comme a et comme a. D'abord une voisine, puis une autre, avaient appel Ani. Aoucha rpondit d'en haut qu'elle tait sortie. -C'est pour quoi ? -Quelqu'un vous demande la porte, dirent les deux femmes, d'en bas. Tu ne l'as pas entendu. Depuis un quart d'heure qu'il appelle, il doit avoir mal la gorge. C'est un homme. Les deux femmes n'apercevaient pas Aoucha. -Je n'ai rien entendu, dit celle-ci. J'tais occupe. De l, on ne peut entendre personne. Je vais voir. C'tait un homme, en effet. Il parlait comme a, et elle montra comment : elle mit des sons qui paraissaient des aboiements. Elle fut soudain prise d'un fou rire qui l'interrompit. -Je me suis mise derrire la porte pour qu'il ne me voie pas. Je l'ai pris pour un tranger. Je ne le connaissais pas. A travers la porte, je lui ai demand : Qu'est-ce que tu veux ? Et il m'a parl comme je vous le disais. Moi, je le voyais : il n'est pas trs beau... -Cholra ! Jeune comme tu es ! pesta Ani. -Mais il avait l'air bon et il riait : Ani n'est pas ici ? dit-il. C'est dommage. Ani, c'est ma cousine. Dis- lui, c'est Mustapha qui est venu la voir. Ah ! j'aurais bien aim la trouver chez elle. Tu ne me connais mme pas ? Dis-lui, c'est Mustapha, le fils de Lalla Kheira. Ae, ma pauvre cousine. Il y a une ternit que je ne l'ai pas vue. Il a criaill tout a dans son drle de parler. Il y avait de la bont sur son visage. Je ne sais pas s'il existe beaucoup de gens aussi gentils que lui. Le cousin Mustapha lui remit alors par la porte entre-bille ce panier de roseau. -Si lourd, que j'ai eu les bras casss pour le soulever toute seule. Et il s'en alla. -Dis bien ta mre que c'est le cousin Mustapha. Nous chrissons tous notre cousine Ani. Hlas, nous ne la voyons pas souvent. Ce sont des temps bizarres, que ceux-ci. Nous vivons des jours o les gens ne peu-vent plus rendre visite leur propre famille. Vous les enfants, portez-vous bien. En rentrant le panier, Aoucha prit soin de ne pas attirer la curiosit des voisines. -Heureusement qu' ce moment-l, il n'y avait aucune d'elles dans la cour. Ce n'est pas une chance, hein, Ma ? -Bouh ! c'est mon cousin.
Ani se dcidait enfin parler. -Oui, c'est lui, Mustapha. Le fils de Lalla Kheira. Et je suis sortie juste au moment o il est arriv. Sa grand-mre et ma mre sont surs, de pre et de mre. Et qu'est-ce qu'il a dit encore ? Une nouvelle fois, Aoucha fit le rcit de tout ce qui s'tait pass et dit. -Il a l'air bon. Il riait, ajoutait-elle chaque fois. Les rumeurs vagues de la maison se confondaient avec leur conversation qui ne se terminait plus. -Je crois que je vais appeler Zina, pour qu'elle voie, murmura Ani. Aoucha se rebiffa. -Tu crois ? Je ne sais pas. Moi, je crois que non. -La pauvre Zina ! Elle a un cur sans malice. Elle nous aime bien. Elle se rjouit de tout ce qui nous arrive d'heureux. -Parce que si elle sait, tenta d'expliquer Aoucha, si elle sait... -Quoi ! si elle sait... s'tonna la mre. Aoucha gmit presque. -Bouh ! Ma. -Il faut que je l'appelle. Dcidment Ani y tenait. -Ce n'est pas notre meilleure voisine ? Elle n'a pas t bonne pour nous ? Il faut. Une pareille occasion ! De sa place, elle appela de toutes ses forces. -Zina ! Zina ! Ya Zina ! Ses yeux souriaient imperceptiblement. -Elle n'est peut-tre pas dans la maison, protestait encore Aoucha. Lointaine, une voix s'leva. Zina rpondait enfin. -Qui est-ce qui m'appelle ? Ani lui renvoya en cho : -C'est moi... Nous t'attendons ; viens. Elle dit aux enfants : -Elle va tomber des nues. Vous allez voir a. Vous rirez bien. Lasse d'attendre, elle expdia Omar la voisine qui n'accourait pas assez vite son gr.
-Dpche-toi, t'a dit Ma, fit Omar la femme. -Elle ne veut pas que je me mette courir, dit Zina, surprise. Je n'ai pas tes jambes, mon fils. Que se passe- t-il ? Pourquoi est-ce qu'elle ne vient pas, elle ? Tout en parlant ainsi, elle htait tout de mme le pas. A peine franchit-elle le seuil : -Tu vois, lui dit Ani. -Je vois quoi ? demanda la voisine. Quelques instants aprs, toutes les femmes de Dar- Sbitar discutaient ensemble : quelquesunes debout au milieu de la cour, d'autres devant le pas de leurs portes. Celles qui logeaient en haut appuyaient leur corps sur la rampe de fer. Ce caquetage devint gnral : on parlait du panier qu'Ani avait reu. Ani, triomphante, s'effor-ait de rprimer son orgueil, mais c'tait plus fort qu'elle : il clatait sur toute sa personne. Aoucha, d'une voix de tte, racontait l'extraordi-naire vnement ; sa mre l'interrompait pour en pour-suivre le rcit sa place. Les femmes commentaient au fur et mesure. Le soir, quelques voisines se runirent chez Ani qui narra son pass, sa jeunesse. Avant son mariage... elle tait heureuse ; elle parla de tous ses parents, vifs et morts... Ce fut une journe harassante. Ni elle ni sa fille ne purent exhaler une parole le lendemain : elles avaient toutes les deux la gorge prise.
Il y eut quelque chose de chang. Durant les jours qui suivirent, Ani resta beaucoup plus longtemps auprs de Grand-mre. Les deux femmes ne se dispu-trent plus. Grand-mre cessa ses jrmiades. Ani fut prvenante, la plus prvenante des femmes. Cela ton-nait ; mais tait-ce vraiment quelque chose de nou-veau ? On les avait vues dj d'accord. C'tait Ani, entourant Grand-mre, qui semblait tre la mre, bien-veillante et tendre. Alors pourquoi cela les tonnait-il ? Pourquoi cela paraissait-il nouveau ? Omar pensait Grand-mre. Et il pensait sa mre. Aux paroles qu'elle prononait sur ce qu'tait Grand- mre. Sans aucun doute, ces paroles leur apprenaient long sur elle. Elle aussi, elle avait beaucoup souffert. - Qu'est-ce qu'elle n'a pas lutt, disait Ani. Qu'est- ce qu'elle n'a pas couru ! Son fils ? Un fils dnatur. Et sa mre, que voici, courait tout le temps comme une petite fille. Elle passait ses journes faire des commissions pour sa bru. Il trouvait a bien. Il laissait faire. Et quand elle venait manger, lui et sa femme se querellaient. Ils lui faisaient faire les comptes du march sou par sou. Ces comptes ne pouvaient jamais tre justes. Son fils criait alors. La femme faisait comme si elle voulait le calmer, maisc'tait pour mieux jeter de l'huile sur le feu. Une vipre, je vous dis. Et la pauvre vieille s'loignait de la table. Ils abandonnaient eux-mmes leur repas. Ma petite mre n'osait plus manger toute seule. Elle attendait. Elle attendait. Mais ils ne revenaient ni l'un ni l'autre. Elle se levait finalement sans manger. Le fils partait son travail sans manger. Sa femme restait sans manger. Mais, quand ma mre sortait, elle chauffait le repas et bfrait toute seule. La vie de ma mre tait comme a. Vous voyez l'tat dans lequel elle se trouve maintenant. Pourquoi ? Ils taient tous runis autour de Grand-mre ; la petite cousine aussi tait avec eux. Pendant que sa fille parlait de la sorte, Grand-mre avait enfoui sa tte entre ses genoux. Et pendant qu'ils pensaient tous au destin de Grand-mre, la petite cousine dit : -Quand ils ne sont plus en tat de vivre, ils le sen-tent. Ils comprennent tout de suite... Pourquoi la petite cousine parlait-elle comme cela, alors que tout le monde se flicitait de la longue exis-tence de Grand-mre qui tenait contre vents et mares ? -Ils hsitent ; on ne peut pas dire ce qu'ils ressen-tent. Mais la chose a lieu comme a. Et ils compren-nent... Qu'est-ce qui forait la petite cousine parler comme cela ? Elle s'arrta finalement. Mais elle ajouta tout aus-sitt : -Quand ils deviennent un poids... pour les autres- Mme pour eux... ils sont un poids... Elle voulait dire cela depuis un quart d'heure. D'une main, elle souleva Grand-mre. Elle essayait de la maintenir toute droite ; peut-tre prouvait-elle la mme sensation que les enfants : lorsqu'on s'adressait Grand-mre, qui avait la tte pose sur ses genoux, on avait l'impression qu'on ne parlait personne. Man- souria, la petite cousine, voulait voir son visage. Elle continua : - Quand ils le comprennent, a veut dire qu'ils se sont mis dj en route.
Bien tenue par les bras de Mansouria, Grand-mre restait raide. Mais bientt un poids formidable com-mena la tirer en avant, et son buste s'affaissa. Le visage de Grand-mre, force d'tre baiss, s'tait allong comme celui d'une bte. Grand-mre paraissait tout de mme comprendre ce qui se disait autour d'elle. L't tait dj trs avanc. Personne ne pouvait plus approcher Grand-mre tant l'odeur qui s'en dgageait tait irrespirable. Cette odeur s'installait autour d'elle, et plus rien n'arrivait la dissiper. Ds que le soleil tombait, l'odeur s'talait. Elle adh-rait aux souffles tides de la nuit. Elle rampait jusqu' ceux qui taient dans les chambres. Imprgne, Dar- Sbitar en tait pntre jusqu' la pierre. Par ces nuits d't, Grand-mre bavardait seule. Elle marmottait longuement, puis elle se mettait chevroter. Ils avaient oubli pendant un certain temps quoi res-semblait son parler de vieille. Et, prsent, il ne se passait plus de nuit sans qu'elle comment, soudain, monologuer sans raison. Son murmure demi inco-hrent roulait longtemps dans sa gorge avec un bruit de ressac. De quoi parlait-elle ? Que voulait-elle ? On finissait par comprendre qu'elle se plaignait. Elle disait qu'on la rejetait comme une chose inutile. Tout cela, dit dans son ancien idiome, se transformait en lamentations qui emplissaient Dar-Sbitar. Ce n'tait plus un tre humain qui se plaignait, mais bien la nuit entire et tout ce qui rdait alentour, mais bien la lourde, l'inconsolable maison. La voix de l'aeule ouvrait un passage une dtresse immmoriale. Au milieu de ces divagations pleines des tnbres et de la souffrance du monde, Ani lui criait de s'arrter. -C'est comme a, Ani, ma petite fille ? rpondait Grand-mre. Sa parole redevenait alors comprhensible. -Tais-toi, vieille de malheur ! -Tu n'as pas de cur. Tu n'as pas piti de celle qui t'a mise au monde. Dormir et me laisser ? Elle appelait Omar. -Tu es le seul, geignait-elle, avoir piti de moi. Elle lui demandait de venir auprs d'elle. Ses pieds enfls taient devenus normes. Ils repo-saient sous elle, entours de chiffons. Il tait rare qu'elle ft satisfaite de sa position sur la chaise. Quand il le pouvait, Omar tentait de la faire bouger. Il la soulevait un peu en la prenant des deux mains sous les aisselles. Mais elle tait terriblement pesante ; seul, il ne pouvait rien faire : c'est peine s'il parvenait la remuer.
A pareille heure, il lui tait impossible d'affronter l'obscurit de la pleine nuit pour arriver jusqu' elle. Depuis quelque temps, Grand-mre parlait beau-coup ; on s'aperut qu'elle tait aux prises avec une grande force, dans une lutte invisible. La famille, dans son tonnement, n'en revenait pas. La vieille femme, malgr l'tat d'extrme misre physique o elle se trou-vait, semblait assez forte pour faire reculer la puissance, muette et sourde, qui l'assaillait. Mais, coup sr, il y avait quelque autre force, de nature indtermine, qui la secondait dans son combat. Et sans que personne s'y attendt, l'engagement prit fin. Grand-mre revint vers le monde des vivants, dlaissant les bords noys de brume qu'elle avait ctoys, elle revint, douce, apaise. Elle reconnut tout le monde. Un rayonnement manait d'elle, une sorte de joie. C'tait une femme naine, la petite cousine, dj vieille elle aussi. Ses cheveux crpus blanchissaient. Toujours souriante. C'est bien vrai qu'elle avait l'air d'une ngresse. Un teint jaune, blafard plutt. C'tait une parente ; une parente loigne. Et peut-tre pas parente du tout, au fait. Mais elle appelait Ani : ma petite cousine . Ani l'appelait aussi ma petite cou-sine . Pauvre Mansouria. Elle les aimait. Mais elle tait terriblement sale. Ses vtements taient si noirs que c'en tait effrayant. Elle les aimait tout de mme. Elle n'allait pas souvent au bain. Seulement, mme quand elle en sortait, c'tait la mme chose : elle restait noire. Car elle se remettait sur le dos les mmes haillons crasseux. Elle arriva ce matin chez Ani et se mit sourire. Mansouria vivait de la sorte. Elle allait chez les uns et chez les autres. Elle recevait un morceau des uns ; on lui donnait des effets chez les autres. Il n'y avait pas se mettre en frais avec elle. Eh bien, justement, ce jour-l il y avait quelque chose manger : une poigne de riz qu'Ani gardait comme la prunelle de ses yeux. Ani l'avait sortie de sa cachette parce que ce jour-l l'occasion en valait la peine. Elle avait dit aux enfants : - Puisque la petite cousine est venue, il vaut mieux manger ce riz aujourd'hui. On a plaisir retrouver les choses qu'on met de ct et qu'on oublie. Pourquoi cacher ce riz plus longtemps ? Il y avait aussi des lgumes ; il en restait de ceux que le cousin Mustapha avait apports trois jours plus tt. Mais le croiriez-vous : la petite cousine voulut les quit-ter lorsqu'elle sut qu'il y avait manger. -Pas du tout ! dit Ani. On ne peut pas dire que ce soit grand-chose, cette poigne de riz. Tout de mme, tu vas rester. Ils avaient compris, Ani autant que les enfants, qu'elle ne tenait partir que parce que, justement, elle savait qu'il y avait manger. Comme si elle n'tait venue que pour manger, et partir ! Pauvre petite cou-sine. Elle souriait chacun d'eux, et ne se souciait pas de ce qu'on lui disait. Comme si un repas royal l'attendait ailleurs. On voyait bien qu'elle s'en irait ; mais elle restait assise, les jambes croises et le buste tout raide ; les enfants la contemplaient. Elle riait, regardant parfois Ani, et parfois les gosses. Puis de nouveau Ani. Elle les regardait tous, avec son petit rire tendre au coin des lvres, et se raidissait encore plus en redressant son buste. De temps en temps, elle disait :
-Ah, ma petite cousine. Puis elle ajoutait : -Ma petite cousine, je vous aime tous, toi et tes enfants. Dieu m'est tmoin ! Sitt arrive, elle tait alle voir Grand-mre, qu'elle avait commenc arranger. Elle l'avait tire par les bras pour la mettre debout. Grand-mre s'tait ainsi repose pendant quelques secondes. Ensuite Mansouria l'avait replace commodment sur sa chaise troue, et lui avait fait sa toilette. Grand-mre aussi l'appelait comme les enfants : ma petite cousine . Elle ne se lassait pas de rpter tout le temps que Mansouria s'occupait d'elle : -Dieu te tienne en sa sainte garde, ma petite cousine. Dieu t'ait en sa sauvegarde ! -Bien sr, nous avons vcu trop longtemps, disait Mansouria. Tu sais comment on dit ? Quand quelqu'un vit trop longtemps, c'est un poids pour lui-mme et pour les autres. Grand-mre ne l'interrompait pas. L'avait-elle enten-due mme ? -Tu ne voudrais pas me faire croire, reprit Mansou-ria, que c'est parce que nous avons pris l'habitude de vivre. Et qu'on ne veut plus changer d'habitude. Elle se tut. Puis elle rpta avec une tout autre voix : -C'est vrai... On prend l'habitude. Mansouria eut un hochement de tte. Elle tait main-tenant seule ct de Grand-mre, dans la cuisine. -Je n'y avais pas encore pens... Elle voulait s'excuser. Elle se redressa encore plus. -Mais j'espre, dit-elle de nouveau Grand-mre, en s'inclinant vers son oreille, j'espre tout de mme que tu voudras bien m'excuser. Elle se tut encore, serra les lvres, et son visage parut plus menu que d'habitude, un pauvre visage terni, les joues en trous. Elle n'avait sans doute plus de dents. Elle se mit debout, mais elle chancela. Alors elle se rassit. De nouveau, elle se remit debout et revint auprs d'Ani et des enfants. Elle souriait toujours. Quel sou-rire ! C'tait le sourire d'une vieille qui voulait mourir. -Peut-tre qu'ils ont raison, les gens qui mangent, s'ils n'aiment pas ceux qui ne mangent pas. Personne ne parlait. Personne ne lui avait rien demand. Et voil qu'elle disait ces mots maintenant. Ils ne semblaient pas tre venus tout seuls. C'avait d la travailler pendant un bout de temps, et maintenant qu'ils avaient clos sur sa langue, elle paraissait touttonne d'avoir dit pareille chose. Tous les regards taient dirigs vers elle, la scrutaient. Est-ce qu'on l'interrogeait ? Personne n'avait pos de question. Pour-tant il y en avait bien une, mais ils ne
pouvaient ou ils ne savaient la poser. Elle tait l, et leur tte la charriait. Ils ne la reconnurent que lorsque la petite cousine avait parl de cette faon : - Ils ont peur de ceux qui ont faim. Parce que d'avoir faim donne des ides pas comme celles de tout le monde. Et seul Satan saurait o ils vont chercher leurs ides bizarres , disentils. Pas vrai ? Tantt, je me disais : On peut bien prendre l'habitude de la vie et mme y prendre got. Et au fond, elle n'est pas si mau-vaise que cela... Et, de fil en aiguille, je me disais : Pourquoi n'aurions-nous pas, nous aussi, notre part de bonheur ? Et si on pouvait seulement manger. Ce serait notre bonheur. Si ce n'est que cela, le bonheur, pour-quoi ne pourrait-on pas manger un peu ? Quand je dis : Nous, ce n'est pas de nous qui sommes l, les uns prs des autres, c'est de nous et des autres que je veux parler. En voil des penses, n'est-ce pas, mes enfants ? Ce sont des paroles de ceux qui ne mangent pas , diraient- ils. Peut-tre est-ce vrai ? Je sens comme a. Et que c'est comme a qu'il faudrait dire les choses. Ils ouvraient, les mioches, de grands yeux. Ils taient tout de mme surpris de voir la petite cousine parler de choses qu'on ne comprenait pas bien. C'tait la premire fois qu'elle parlait si longuement. Ils taient bahis. Elle, la petite cousine, baissait la tte comme honteuse. Il fallait bien en convenir, il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose de chang. Mansouria qui se mettait causer de la sorte : le monde n'tait plus le monde. Mais qu'estce qui changeait, bon sang debon sang ? Qui aurait pu le dire ? Omar aurait pay cher pour savoir de quoi il retournait. Mais, c'est sr, la petite cousine ne le savait pas elle-mme. Tte basse, elle rptait : -Ils ne disent pas a ? Ils ne disent pas a ? Sa question s'levait comme un gmissement cepen-dant qu'il semblait tous que son visage s'enveloppait peu peu de brume, qu'il devenait de plus en plus gris : il n'y avait pas se tromper, c'tait la brume de la faim. Si on se laisse prendre par cette brume, il arrive un moment o l'on ne peut plus s'arracher elle. Omar connaissait cela. Et tous ceux qui ont eu faim. Et quand cette brume vous a bien recouvert, vous ne sentez mme plus la faim. Aprs un moment, les voiles se dchirent, et tout apparat dans un scintillement, dans un clat insoutenable : on revoit le monde, mais bien diffrent de ce qu'on l'a laiss avant de s'enfoncer dans cette nue calme et muette. La petite cousine ne gmissait plus. Elle tait proba-blement parvenue cette seconde o la brume se dis-sipe tout d'un coup pour laisser briller de tous ses feux un univers tranquille. Avec des mouvements imprcis, la petite cousine essayait de se dbarrasser de ses toiles d'araigne. Son corps eut de vagues tressaillements, et, la fin, ses mains s'appuyrent sur la meda. On comprit qu'elle voulait se lever. Elle soupira : -Oui, il le faut... Personne ne sut ce qu'il fallait. Les enfants, seuls prsent avec elle dans la cham-bre, ne trouvaient quoi lui dire. L'inconnu affluait de tous les coins du monde, bat-tant de sa houle la chambre.
Dbordante, sa dtresse devant la vie se rpandit sur eux. Ils n'auraient jamais cru qu'elle avait autant de profondeur. Si vivre est une habitude, sait-on depuis combien de temps on en a pris l'habitude ? Il arrive qu'on veuille changer. Mais partir de cet instant la vie ne vous concerne plus. Tiens ! C'est ce qu'elle avait voulu dire. Elle n'avait plus rien attendre, la petite cousine, et mme plus rien redouter. La vieillesse ressemble au sommeil. Elle dormait, et c'tait la vie qui lui apparais-sait comme un rve. Dj son corps s'effaait. Cette vieille femme n'tait plus elle-mme. Elle aurait voulu dire a aussi. Elle ne l'avait pas dit. A ce moment, Ani surgit, une terrine entre les mains. Elle la tenait avec prcaution du bout des doigts par les anses. C'tait chaud. Ils savaient qu'il y avait du riz dedans qui venait d'tre cuit avec une larme d'huile et beaucoup d'eau. Cela le rendait un peu pteux ; mais quelle importance ! Ils ne se formalisaient pas pour si peu. Il y avait aussi de l'ail dans le riz, beaucoup d'ail, un poivron, de la tomate peut-tre, des feuilles de lau-rier, bon Dieu ! Comme cela devait tre bon ! La terrine aurait pu tenir dans le creux des mains. Et ils taient six. Nom de Dieu ! si seulement ils avaient du pain ! Ils auraient alors aval une grande bouche de pain avec une petite cuillere de riz. -a touffe, expliquait Aoucha. Mais tant pis. On ne demande qu' touffer si c'est en mangeant. La petite cousine avait rudement raison quand elle disait qu'il vous vient quelquefois des ides bizarres. Mais Omar songeait : -On a des ides, c'est sr. Mais elles ne sont en rien bizarres. Des ides qu'on a assez de cette faim, que c'en est trop. On veut savoir le comment et le pourquoi des choses. C'est des ides, a ? C'tait peut-tre des ides. L, seulement, il y avait six personnes de qui la faim rongeait la chair. On ne comptait pas les autres, les milliers et les milliers du dehors, de la ville, du pays tout entier. Forcment on avait des ides. - Ce n'est pas compliqu quand six personnes ont faim. La faim, c'est simple : c'est la faim, ni plus ni moins. Alors ? Alors il voulait savoir le comment et le pour-quoi de cette faim. C'tait simple, en effet. Il voulait savoir le pourquoi et le comment de ceux qui mangent et de ceux qui ne mangent pas. Ani avait eu une seconde d'hsitation quand, reve-nant de la cuisine, la terrine de riz entre les mains, elle avait vu la petite cousine. Elle se dirigea vers la meda qui tait dj installe au centre du groupe d'enfants. Les pauvres ont tous des antennes fines. La petite cousine faisait des efforts pour se soulever. Lorsqu'elle fut sur ses pieds, titubant lgrement, elle tendit son visage du ct des
petits. Elle eut un air absent durant quelques secondes. Puis elle fit quelques pas, en vacil-lant. Elle se rapprochait de la porte. La petite cousine arriva devant le rideau ; le grand jour en rendait trans-parent le tissu aux fleurs dcolores. Elle en releva un coin, s'arrta, et tourna les yeux vers eux. Elle inclinait insensiblement la tte en avant. Elle voulait se glisser sous le rideau qu'elle arrivait grand-peine soulever. Elle se pliait presque en deux. On et dit qu'elle avait mal au ventre et qu'elle se baissait pour comprimer sa douleur. -J'ai beaucoup parl aujourd'hui, trop parl. Vous me le pardonnerez, murmura-t-elle. Mais je ne voudrais pas que vous me reteniez. Je vous ai dj remercis. Je vous ai dj salus. Il faut vraiment que je m'en aille. Lorsqu'elle eut fini de parler, personne ne lui rpon-dit. Elle demeura l. Elle tenait partir mais on aurait cru aussi qu'elle hsitait. Ses regards se posaient sur Ani qui tait assise, avec ses enfants, devant la meda. -Vraiment ? Ani laissa chapper ce mot comme une plainte touf-fe. Les yeux de la petite cousine se dtournrent. Aucun des enfants ne soufflait mot. Omar voulut l'appeler, mais il ne sortit de sa gorge qu'un son rauque. Tiens, lui aussi. Il geignait : mmm... Il n'avait plus la force de s'arracher ses toiles d'arai-gne. Aoucha et Mriem ne bronchaient pas non plus. Ani, qui suivait la petite cousine du regard, avait pos son poing sur la peau de mouton, comme si elle voulait se lever afin de retenir Mansouria. C'tait bien son ide : la retenir, la faire asseoir parmi les enfants. Mais tait-ce tout ? Ne lui disait-elle pas de rester ? songeaient les enfants. Aucun d'entre eux ne desserra les dents. Qu'au- raient-ils pu faire du moment que leur mre demeurait muette ? Bon sang, de quoi avaient-ils peur ? De la garder manger, alors qu'il n'y avait pas du riz pour tout le monde. -Reste, ma petite cousine, dit Ani. Tu ne peux pas partir, maintenant que nous avons apport manger. Reste : tu n'as rien faire chez toi ? Cette dernire question tait de la politesse. -Tu ne vas pas partir, poursuivit Ani. S'il n'y a pas manger pour tous, cela n'a aucune importance. De toutes les faons, le djeuner est prt et servi, avec toi ou sans toi. A prsent que nous soyons cinq ou six... a nous fait plaisir que tu restes, dit-elle encore, en couvant les enfants du regard. Et son regard contenait un drle de sourire. -Les enfants seront contents que tu restes. Omar poussa un soupir. Ani se remit parler.
-Reste, tu n'as rien faire. Tu ne vas pas partir. Et s'il n'y a pas suffisamment manger pour tout le monde, a n'a pas d'importance... Tu nous feras plai-sir... Les enfants seront contents... Ani ne paraissait pas pouvoir arriver au bout de ce qu'elle avait commenc dire. Elle parlait pour parler. Elle parlait peut-tre pour se soulager. Elle devait tre contente de parler. C'tait visible. Le bien-tre montait dans son cur. Mansouria se mit chuchoter comme si elle et voulu s'adresser uniquement Ani. Mais ils causaient tous la fois, bruyamment ; personne n'entendit ce qu'elle disait. A l'expression de son visage, on aurait pens qu'elle dsirait leur confier la raison qui lui commandait de partir. Mais nul ne saisit cette expres-sion. Tout cela n'tait sans doute encore que de la poli-tesse. Maintenant ils avaient peur qu'elle les quittt. -Oui, c'est comme a, dit alors la petite cousine d'une voix distincte. Elle marcha droit jusqu'au seuil qu'elle franchit ; de l, elle se retourna pour les saluer d'un signe, et le rideau retomba derrire elle. Ils apercevaient encore sa silhouette menue et raide travers la fine rsille du rideau. Ils l'entendirent rpter : -Oui, c'est comme a. Tous les regards convergeaient sur son ombre. Sans se lever, Ani lui cria : -Reviens nous voir.
Les gens de Dar-Sbitar avaient plusieurs fois de suite entendu cette sirne au cours des semaines prcden-tes ; on l'essayait rgulirement. On leur avait bien dit que la guerre allait clater. Elle claterait certaine-ment : dans la maison, ils s'taient faits cette ide. On en discutait tout propos. Celui qui dchanerait cette guerre, disait-on, tait un homme puissant. Son emblme, cette croix aux branches bizarrement casses qui ressemblait une roue, recouvrait les murs de la ville, trac au charbon, la craie. Il y avait des croix gantes peintes au goudron ct de l'inscription : Vive Hitler ! On se retrouvait partout nez nez avec ce sceau et ces inscriptions. L'homme qui portait le nom d'Hitler tait tellement fort que nul n'aurait os se mesurer avec lui. Et il partait conqurir le monde. Et il en serait le roi. Et cet homme si puissant tait l'ami des musul-mans : quand il aborderait les rivages de ce pays, les musulmans jouiraient de tout ce qu'ils dsireraient, leur bonheur serait grand. Il priverait de leurs biens les juifs qu'il n'aimait pas et qu'il tuerait. Il serait le dfenseur de l'islam et chasserait les Franais. D'ailleurs la cein-ture qui lui serrait la taille portait la chahada : Il n'y a de Dieu qu'Allah, et Mohammed est son prophte !Cette ceinture ne le quittait ni jour ni nuit. C'est pour-quoi il tait invincible. Les exercices d'alerte taient entrs dans les murs. On disait : -Ah ! la voil qui crie. Et, de fait, des plaintes prolonges tournoyaient dans l'air. -Aujourd'hui, pourtant, elle est enrhume. -Comment, enrhume ! -A cause du temps qui est l'humidit. Cependant quand elle rsonna pour de bon, ils eurent l'impression de l'entendre pour la premire fois. C'tait un aprs-midi de septembre ; Omar passait par la place de la Mairie. Elle lcha son mugissement sauvage. Elle tait place sur les toits de l'difice muni-cipal. Cela dbuta sur une note grave, qui se haussa rapidement au plus aigu, monta droit comme un jet vers le ciel et y demeura suspendue pour de longues secon-des, immobile, comme si le ciel lui-mme engendrait ce son strident. Puis elle s'affaissa brusquement. Omar ne manquait jamais, lorsqu'il longeait la mai-rie, d'escalader, d'un ct, les marches de l'entre, pour les sauter toutes la fois, de l'autre. Il tait sur la mar-che suprieure, immobile et stupfait. En un instant, il se rappela l'trange sensation qui l'avait parcouru quand la sirne s'tait dchane. Une gifle ou plutt un souffle violent s'tait abattu sur lui. Il tait dj au bas de l'escalier public, le cur battant. Enfin, il s'lana, dans la rue, en proie la panique. Filant travers la ville, il croisait des hommes et des femmes qui, eux aussi, couraient dans tous les sens. Savait-on pourquoi ? Savaient-ils o aller ? Les femmes pleuraient et s'abordaient, les yeux rouges. Et elles poursuivaient leur chemin en faisant retentir les rues de leurs sanglots. Les hommes s'loignaient htivement. Des rideaux de fer taient rabattus. Les principales sorties taient noires de monde, les gens se pressaient : ils voulaient se rendre quelque part, semblait-il ; ils marchaient, taciturnes, la mine sombre ; certains s'in-terpellaient ; dans leur voix perait un frmissement qui rendait toute parole incertaine.
Et, en un rien de temps, les rues se dpeuplrent. Omar galopait travers une ville dserte. Il rencontrait de loin en loin un agent de police ou un chien errant. Quel vide ! La vie se retirait de Tlemcen dont le grand soleil avait pris possession. Tout d'un coup, comme si la ville ne vivait plus depuis des millnaires, ses larges avenues redevenaient d'immenses voies solitaires et antiques o les bruits s'taient tus, ses difices, des temples d'un culte perdu, et son vaste silence, la farou-che paix de la mort qui tincelait dans l'ardeur du jour. Tlemcen prolongeait son existence dans la pierre. Aprs le premier affolement, ce calme vigilant, cette solitude passagre apportaient Omar des chos mena-ants. Le danger faisait ainsi sa brusque apparition dans un trange apaisement. Omar tait de plus en plus persuad qu'il n'attein-drait jamais Dar-Sbitar, qu'il n'en finirait pas de par-courir cette ville qui se mtamorphosait lentement en une enceinte maudite. Quelque chose de terrible lui arriverait avant. Le danger, comme une ombre haute et souveraine, groupait les immeubles, les jardins. Et Omar se prcipitait perdre haleine ; la gigantesque silhouette le suivait longs sauts brusques et saccads. L'enfant sentait sa prsence dans le dos. Le malheur, le malheur qu'on avait attir par cette sirne tait finalement arriv. S'engouffrant toute allure dans Dar-Sbitar, il s'allongea face contre terre sitt qu'il fut devant sa mre et put enfin pleurer tout agit de tremblements. Ani le prit dans ses bras et l'attira contre elle. Son agitation tomba d'un coup. Un vide bienfaisant l'envahissait, le mme vide qu'il avait ressenti tout l'heure. Omar coutait les battements rapides de son cur. Il attendit, puis ses yeux s'ouvrirent peu peu. Il se retrouvait l'ore d'un pays singulier. Quelle impression de rveil ! Plus rien n'avait d'importance ; le monde avait t dchir par le mugissement de la bte sans visage. -C'est la fin du monde. La fin du monde. Projetant ces derniers mots avec vhmence, la femme qui s'adressait Ani ajouta : -Au sicle quatorzime, ne cherche point de salut, est-il dit. Ne sommes-nous pas au quatorzime sicle ? -C'est bien le quatorzime sicle, confirma la vieille Acha. -Alors tout le monde va mourir ? -Tout le monde, femme. -Tout le monde, et nous aussi ? -L'heure de la justice arrive. Les femmes devinrent muettes. Quelques-unes lev-rent les yeux au ciel. Soudain une clameur redoutable retentit. Attyka, d'un coup, s'effondra par terre, au centre de la cour. Un remue-mnage se fit autour d'elle. Tandis que certaines essayaient de la soulever et de l'apaiser, elle haletait et se dbattait furieusement ; tout en bavant, elle profrait dans un rle : -Le quatorzime sicle ! Satan ! Satan !
Transporte chez elle, elle se calma en un clin d'il. Attyka avait souvent des crises : elle s'en relevait et, vite aprs, ne s'en souvenait plus. Elle se remettait deviser et paraissait mme plus gaie. Le dialogue des femmes reprit : -C'est signe de guerre. -C'est sr ! -Quoi ? Ce qui vient d'arriver Attyka ? C'est signe de rien. -C'est selon. -Allez ! ne racontez pas d'histoires. Elle est comme a, Attyka ; nous la connaissons depuis longtemps. Pourquoi voulez-vous que ce soit signe de quelque chose ? -Chut ! Chut ! Des voix d'hommes s'levrent dans la ruelle, tout prs de la maison. Profonde, grave, une semblait appar-tenir un homme d'ge. On reconnut alors la voix de Si Salah. -Rentrez dans vos demeures. Tout ce qui arrive l ne vous concerne pas. Une autre rpliqua : -C'est la guerre pourtant. a n'est pas rien. -Le moment de vrit est arriv, rpondit quelqu'un. -Oui, c'est la guerre, on ne peut pas le nier. Le dialogue reprenait, encore plus accabl. -On ne croit plus de nos jours. On ne croit plus et c'est un malheur ! -Oui, c'est un malheur. -Dieu prpare le chtiment de ses cratures. Si Salah, posment, murmura : -Maintenant, regagnez vos maisons. Les hommes qui nous gouvernent savent ce qu'ils font. -Dieu fasse que tu dises vrai. Mais nous n'en som-mes pas certains. -Mais non ! C'est nous qui rcolterons les calami-ts ; sur nous tout retombera. -Occupons-nous de nos affaires. Nous aurons de l'ouvrage abattre jusqu' la fin de nos jours. Qu'on nous laisse en paix ! Dans Dar-Sbitar, le visage illumin, Attyka ressortit de sa chambre en s'poumonant : -La fin du monde !
Les femmes pouvantes par la prophtie rptrent : -Dans quarante jours. Gesticulant au milieu de la maison, Attyka poussa encore des hurlements. Les filles de la possde accou-rurent et l'entranrent chez elle. Elle eut deux attaques dans la journe ; cela ne s'tait jamais vu jusque-l. A la nuit tombante, Omar sortit pour aller chercher une miche de pain au four banal. C'tait sa course prfre. D'ordinaire il rechignait quand il fallait faire n'importe quelle commission. Il s'y drobait en invoquant chaque fois la mme raison : -Alors, toujours moi ? Il n'y a que moi, ici. Et pour-quoi pas Aoucha ou Mriem ? Autant il essayait de se soustraire aux autres servi-tudes, autant celle-l lui plaisait. Il arrivait au four. Quelle joie de contempler toutes les miches tales au sol sur des panneaux de bois, des tafors et des plateaux de mtal, qui attendaient d'tre enfournes par un homme tout noir dont les paules et la tte mergeaient de la fosse du fond. Devant l'entre du four incandescente, le boulanger agitait ses bras, poussait, ramenait, sans arrt, une longue pelle en bois. Il l'enfonait charge de miches cuire puis il la res-sortait vide. Dans cet antre profond le pain dispensait une vague blancheur, et les recoins perdus dans l'ombre sentaient le pain nouveau. Il s'attardait devant ce spectacle ; il ne s'en lassait pas ; c'tait rconfortant, grave. Il aimait rapporter la maison le pain encore brlant dont la crote craquait. Chemin faisant, il en dtachait les asprits, les petites pointes trop cuites et les cro-quait. Il ne pouvait se permettre de rentrer avec un pain entam ! il tait alors bon pour une tripote. Quel plaisir de transporter cette bonne miche ! Omar la serrait contre sa poitrine et elle le rchauffait en rpandant son odeur apptissante. Dehors, la ville de nouveau grouillait telle une four-milire. Tous les Tlemcniens, et-on dit, s'taient donn rendez-vous dans la rue, tant il y avait foule. Aprs le vide brusque de l'aprs-midi, cette multi-tude d'hommes, de femmes, d'enfants qui s'coulait lentement renaissait de sa peur. La grisaille dore du crpuscule de septembre apportait elle-mme une atmo-sphre de gravit. Un sens nouveau des choses et des tres, oubli jusqu'ici, et brusquement retrouv, rappro-chait les hommes. Tout cela et sembl ridicule un jour avant. Les Tlemcniens s'taient donn le mot ; ils sor-taient dans les rues d'un commun accord : il tait facile d'imaginer qu'ils avaient quelque chose de la plus haute importance se dire. Mais on attendait toujours celui qui prendrait la parole le premier. Cela, naturellement, n'arriva pas. Que voulait exprimer cette foule si impo-sante ? Pourquoi taitelle l ? Voulait-elle protester contre la guerre ? Mais pourquoi, pourquoi alors se tai-sait-elle ? Elle relevait la tte lentement : elle tait sre d'elle-mme, de ce qu'elle portait en elle, gauche encore mais puissante et farouche. On les avait toujours aids ne pas penser ; prsent surgissait devant eux, pleine de menaces, obscure, ttue, leur propre aven-ture ; et tous ces hommes, toutes ces femmes demeu-raient nus devant eux-mmes. Ils avaient laiss leur cur disponible, en repos. Mais le malheur les touchait de son poing et ils se
rveillaient. Combien alors se sentaient vivants ? Bien qu'ils aient encore la bouche amre, ils commenaient rire de se retrouver ensemble. En dcouvrant cette foule presque heureuse, Omar oublia le pain. Emport par cette mare imptueuse, il n'eut aucune peur, bien qu'il se vt loin de la maison, et s'y glissa, au beau milieu. En dpit de sa petite taille, de sa faiblesse d'enfant, il s'abandonnait au courant qui le traversait et le portait dans le mme sens. Il n'tait plus un enfant. Il devenait une parcelle de cette grande force muette qui affirmait la volont des hommes contre leur propre destruction. Toutes les rues dversaient cette foule dans la place de la Mairie. Ce fut l que s'assemblrent les Tlemcniens. Des milliers de pieds battaient le pav d'un bruit sourd, indfiniment rpt ; leurs voix bruissaient comme une usine loin-taine en pleine activit. Les lumires de la ville ne bril-laient pas encore et on avanait dans l'obscurit gran-dissante. On ne reconnaissait plus les visages mais on marchait cte cte. Alors les voix se reconnaissaient, se rejoignaient au-dessus des ttes. -Krimou, es-tu l ? -Oui, et toi ? -Oui, moi aussi. Je suis par l. -Alors, c'est la guerre, ou quoi ? -Oui, la guerre. Puis une autre conversation s'engageait. -C'est la guerre a, Kader. Fils dnatur de ta mre, comment vas-tu faire ? -H, je ferai comme tout le monde. On ira au front. -Tu sais au moins tenir un fusil ? Comment feras-tu quand on te donnera un fusil ? -Tu viendras me montrer. Deux Franais parlaient ct d'Omar. -Ils nous ont eus maintenant, les cochons, avec leur guerre. -Je disais bien qu'ils ne faisaient que mentir quand ils juraient qu'il n'y aurait pas de guerre. On nous avait bien dit qu'ils s'taient mis d'accord Munich... -Il va falloir se dmerder. Leur guerre, on l'a sur le dos maintenant. Cette absence d'clairage semblait avoir un sens aussi. On attribuait dsormais, sans rime ni raison, une signification tout, un mot jet la cantonade, aux lampes qui ne s'allumaient pas, la marche saccade de cette foule... Aussi quand les rues de la ville s'illu-minrent tout coup, un ah ! gnral fut pouss par toutes les poitrines, qui furent allges d'un poids for-midable. Les lumires publiques venaient de s'allumer, ce soir-l, l'heure habituelle. On finit par se trouver comme une fte ; une exal-tation grisante faisait mousser l'air ; on s'agitait, une grande houle semblait soulever la population. On parlait et riait fort.
Omar rentra fort tard la maison. Quand elle le vit, sa mre lui demanda d'une voix blanche : -O est le pain que tu es all chercher ? Ae ! Il l'avait compltement oubli. O avais-je la tte, se dit-il. Bon, a va recommencer, les cris, les jurons, et les coups. Sa mre tait hors d'elle. -Mais o tais-tu, dis-moi un peu ? Jusqu' cette heure dehors, et nous en train d'attendre ? S'il n'y a pas de quoi le tuer, ce chien errant ! Va de ce pas cher-cher le pain. Si tu ne reviens pas avec, je te conseille de ne pas mettre les pieds ici. -Mais c'est la guerre, Ma ! -On ne mange pas parce que c'est la guerre ? Ce n'tait pas ce qu'il voulait dire. Elle ne le compre-nait pas. Et il ne parvenait pas formuler sa pense. -C'est la guerre ! C'est la guerre ! Il ne put articuler autre chose. -Tu es devenu idiot ? C'est entendu, c'est la guerre. Les voisines jacassaient malgr l'heure tardive. -Quand ses fils et ses filles allaient au bal, et ne pensaient qu' leur toilette, disaient-elles, l'Allemand tait en train de fabriquer des armes. Et voil le rsultat. -Quel malheur, pauvre France ! -Elle ne mritait pas a. Omar courut au four banal travers le ddale des ruelles sombres. Ferm ! Il tait au moins neuf heures du soir. Il savait o habitait le patron du four : c'tait au fond d'une impasse un peu perdue. Mais il ne s'y aventurerait pas seul, dt-on lui couper la tte. Omar se posta l'entre du passage dans l'espoir que sur-viendrait un passant qui voudrait l'y emmener. Il inter-rogea la rue du regard ; personne n'arrivait. Avec une voix tremblante, il appelait les gens qu'il voyait che-miner distance, et pleurait de dsespoir. Pouvait-on l'accompagner chez le patron du four ? Il se trouva enfin un vieillard qui le prit par la main et le conduisit devant la maison porte carre. Omar dut cogner trs fort et longtemps avant qu'on ouvrt. -Qui est-ce ? ronchonna une voix de l'intrieur. -C'est moi, Omar. Le patron rousptait fort. -C'est maintenant que tu viens chercher ta miche, garnement ? Et ici, par-dessus le march, chez moi ? Va-t'en au diable. Tu viendras demain la prendre au four.
L'enfant commena se lamenter afin d'apitoyer Kaddour. Mais celui-ci lui referma la porte au nez sans flchir ; Omar l'en empcha en s'arcboutant au lourd battant et pleura de vraies larmes. -Oncle Kaddour, Allah te protge ! Viens me donner mon pain. Le bon Dieu t'accordera une fortune. Qu'il te conduise La Mecque ! Le monstre ! Il ne se rendit la prire de l'enfant que lentement et contrecur, lorsque Omar s'puisant en supplications perdit tout espoir de le voir jamais sor-tir de sa noire tanire. Serrant le pain des deux mains contre sa poitrine, le garon se pressait. Les ruelles solitaires avaient pris leur visage nocturne. Omar trottait sans vritable hte et n'prouvait plus aucune inquitude. Il tait attentif au calme qui l'entourait comme une eau apaisante. Un sentiment de scurit s'emparait de lui. Il se retrouvait l'intrieur d'un monde fraternel. Les venelles se lovaient et dbouchaient sans fin l'une dans l'autre. De distance en distance, des ampoules lectriques y creu-saient de profondes clairires de lumire. Cet clairage qui se heurtait toutes les maisons poses de travers dcoupait un jeu de patience et de mystre. Le cur d'Omar tressaillit. De joie ? On ne saurait le dire. Pourtant c'tait de la joie qui soulevait son cur ainsi : une sensation qui l'envahissait par vagues claires. D'o venait ce bonheur qui s'oubliait en lui ? La guerre : Omar revit cette foule la tombe de la nuit qui appelait de toute son me l'clairage public ; quel immense soulagement quand la place s'illumina tout coup. La guerre, il ne savait ce que c'tait. La guerre... et autre chose, se prolongeaient comme une joie secrte dans son cur. Omar se jetait dans le sillage de sensations qui le conduisaient au seuil d'une terre inconnue. Ce qu'il y avait eu d'inusit dans l'atmosphre de la ville, durant cet aprs-midi, happait encore sa pense. Curieu-sement, il eut la sensation d'avoir soudain grandi depuis que les cris de la sirne avaient retenti. Tout en se sachant encore un enfant, il comprenait ce que c'tait que d'tre un homme. Mais cette intimit imprvue avec ce qu'il serait plus tard se dfaisait rapidement. Omar rouvrait les yeux sur son horizon d'enfant. Il ne lui venait plus l'esprit de se retourner vers cet avenir envelopp d'une obscurit qu'aucune force ne pntrait. Il arriva devant la porte de Dar-Sbitar, grande ouverte, et cria tue-tte : -Aoucha ! Aoucha ! La bouche d'ombre opaque, profondment encais-se, avala son appel. Omar attendit. -Aoucha ! fit-il de nouveau. Veux-tu venir ? Je suis l. Il se passa quelques secondes et l'enfant perut un bruit touff de pieds nus qui couraient sur le dallage. -Entre ! dit sa sur ane de l'extrmit du vestibule. -Anesse ! Tu n'entends pas quand on t'appelle ? -Et toi, Tata-ma-petite-sur ! Il faut qu'une femme vienne te conduire ? -Assez, idiote ! Un petit rire fusa dans le noir comme un feu follet. Aoucha se moqua :
-Regardez-le ; il sait commander. Quel homme ! Au centre de la maison, Omar se sentit plus son aise : des pices claires parvenait la vivante rumeur qui animait Dar-Sbitar l'ore de la nuit. D'une pous-se brusque et sournoise, le garon envoya sa sur valser au milieu de la cour... Puis il se rua vers leur chambre. Il carta le rideau de l'entre et tendit la miche sa mre. - Btard ! fit Ani. Il sourit, comprenant la tendresse qui se masquait sous l'injure. Omar s'accroupit lui aussi avec les autres, devant la mda, et surveilla sa mre qui rompait le pain contre son genou. OF
Vous aimerez peut-être aussi
- 2 As Projet 3 Récit de Voyage PDFDocument31 pages2 As Projet 3 Récit de Voyage PDFHacerMellal72% (89)
- Evaluation UlysseDocument5 pagesEvaluation UlysseElodie MartinezPas encore d'évaluation
- Le Fait DiversDocument38 pagesLe Fait DiversHacerMellal80% (10)
- Driss Chraibi - Vu-Lu-EntenduDocument104 pagesDriss Chraibi - Vu-Lu-EntenduKhawla Mehenni100% (1)
- 4am Manuel 2021 - OptimizedDocument161 pages4am Manuel 2021 - OptimizedLa Perle Perla100% (1)
- La Grotte Éclatée Yamina MechakraDocument60 pagesLa Grotte Éclatée Yamina MechakraHacerMellalPas encore d'évaluation
- Le Roman de Renart (Analyse de l'oeuvre): Comprendre la littérature avec lePetitLittéraire.frD'EverandLe Roman de Renart (Analyse de l'oeuvre): Comprendre la littérature avec lePetitLittéraire.frPas encore d'évaluation
- Écrire Un Récit D'aventuresDocument6 pagesÉcrire Un Récit D'aventuresCarmenPas encore d'évaluation
- Analyse de La Nouvelle Mon Oncle Jules de Guy de Maupassant 3ème FrançaisDocument1 pageAnalyse de La Nouvelle Mon Oncle Jules de Guy de Maupassant 3ème FrançaisIts SousPas encore d'évaluation
- 1 As - Projet 1 Entier (5 Séquences)Document74 pages1 As - Projet 1 Entier (5 Séquences)HacerMellal83% (36)
- Les Tribulations Du Dernier SIjilmassiDocument23 pagesLes Tribulations Du Dernier SIjilmassiElhoussain Bouras100% (1)
- Exercices ReecritureDocument4 pagesExercices ReecritureGabriella VernettoPas encore d'évaluation
- Du Roman Au Film : L'Enfant NoirDocument19 pagesDu Roman Au Film : L'Enfant NoirDennys Silva-ReisPas encore d'évaluation
- Publications El - Maleh Edmond AmranDocument2 pagesPublications El - Maleh Edmond AmranLouis MehmesPas encore d'évaluation
- LCFF Magazine N°38 AbonnéDocument27 pagesLCFF Magazine N°38 AbonnéRaquel Marcos SánchezPas encore d'évaluation
- L'Interdite Malika MokeddemDocument197 pagesL'Interdite Malika Mokeddemchelariuroxana100% (7)
- Mithra Et Le MithriacismeDocument25 pagesMithra Et Le MithriacismeSamuel Vincent Béranger BiteauPas encore d'évaluation
- La Petite Fille Du RééverbèreDocument131 pagesLa Petite Fille Du RééverbèreIbrahim Maiga50% (2)
- Théâtre Power PointDocument7 pagesThéâtre Power PointOlesea Mura0% (1)
- L'Analyse Logique de La PhraseDocument3 pagesL'Analyse Logique de La PhraseDaniel DuartePas encore d'évaluation
- Au Commencement Etait La Mer - Maissa BEYDocument127 pagesAu Commencement Etait La Mer - Maissa BEYSofiane BellPas encore d'évaluation
- Recueil de Sujets Pour Les 2 AsDocument27 pagesRecueil de Sujets Pour Les 2 AsHacerMellal100% (5)
- Composition 2asDocument3 pagesComposition 2asHacerMellal83% (6)
- 3as Francais AsDocument4 pages3as Francais AsHacerMellalPas encore d'évaluation
- Cherchell AujourdDocument4 pagesCherchell AujourdHacerMellal33% (3)
- Grille D'évaluation de L'oralDocument2 pagesGrille D'évaluation de L'oralHacerMellal100% (1)
- Cours ModalisationDocument2 pagesCours ModalisationHacerMellal100% (9)
- Etude Ethnobotanique Dans Le Sud-Est de Chlef (Algerie Occidentale)Document18 pagesEtude Ethnobotanique Dans Le Sud-Est de Chlef (Algerie Occidentale)Akrem ZouabiPas encore d'évaluation
- Zoulikha OUDAI Heroine Epique Dans La Femme Sans Sepulture Dassia DJEBARDocument90 pagesZoulikha OUDAI Heroine Epique Dans La Femme Sans Sepulture Dassia DJEBARSãb RïnãPas encore d'évaluation
- Les Emplois Du TempsDocument28 pagesLes Emplois Du TempsHacerMellal100% (1)
- DDDDDDocument20 pagesDDDDDAbdou WhtasPas encore d'évaluation
- Mission 2004 Comment Accroitre Les Performances Par Un Meilleur ManagementDocument336 pagesMission 2004 Comment Accroitre Les Performances Par Un Meilleur Managementludtch3321Pas encore d'évaluation
- Le Futur Exercices Et CorrigeDocument6 pagesLe Futur Exercices Et CorrigeToutouPas encore d'évaluation
- Dzexams Bac Francais LP 20161 1125856Document7 pagesDzexams Bac Francais LP 20161 1125856HacerMellalPas encore d'évaluation
- Conte NuDocument48 pagesConte NuHacerMellalPas encore d'évaluation
- Le Temps Des SecretsDocument24 pagesLe Temps Des SecretsMarie SanchezPas encore d'évaluation
- Etranger de Camus PDFDocument2 pagesEtranger de Camus PDFJeannePas encore d'évaluation
- La Grande Maison de MDocument2 pagesLa Grande Maison de MAbdov Alex0% (1)
- Lecture Proposition D'adoption Texte N2 Séquence 1 PDFDocument2 pagesLecture Proposition D'adoption Texte N2 Séquence 1 PDFFatima ZahraPas encore d'évaluation
- Cours - Français Portrait Physique Et Moral - 9ème (2011-2012) Mlle SarraDocument7 pagesCours - Français Portrait Physique Et Moral - 9ème (2011-2012) Mlle SarraKarem SaadPas encore d'évaluation
- FICHE DE LECTURE SUR LA RUE CASES NègresDocument5 pagesFICHE DE LECTURE SUR LA RUE CASES NègresLe vrai patPas encore d'évaluation
- Le Chevre de Monsierut Seguin PDFDocument4 pagesLe Chevre de Monsierut Seguin PDFcynPas encore d'évaluation
- Exercices de Relations Logiques-1Document3 pagesExercices de Relations Logiques-1Silvia Calabrese100% (1)
- Devoir MensuelDocument4 pagesDevoir Mensuelali moktarPas encore d'évaluation
- Les Synonymes Et Les PériphrasesDocument2 pagesLes Synonymes Et Les PériphrasesMohaChebi100% (1)
- Résumé L Assommoir - ZolaDocument3 pagesRésumé L Assommoir - ZolaSheela NaPas encore d'évaluation
- Cm2 Evaluation Verbe NomDocument2 pagesCm2 Evaluation Verbe Nommona lisaPas encore d'évaluation
- DictéesDocument21 pagesDictéesmostabouPas encore d'évaluation
- Cycle 7 - Récit PolicierDocument9 pagesCycle 7 - Récit PolicierSoundous Assila ChaifaPas encore d'évaluation
- Abdelhak Serhane - Les Temps NoirsDocument126 pagesAbdelhak Serhane - Les Temps NoirsMerleauPas encore d'évaluation
- 2zaZnPLgamv-3. Francais 6e - Le Monstre Et Le HérosDocument3 pages2zaZnPLgamv-3. Francais 6e - Le Monstre Et Le HérosVanessa Nassar100% (1)
- Devoir de Synthèse N°3 - Français - 2ème (2010-2011) Mme Yengui Bouhajeb SoniaDocument4 pagesDevoir de Synthèse N°3 - Français - 2ème (2010-2011) Mme Yengui Bouhajeb SoniadhouhaPas encore d'évaluation
- Les Temps Du Recit Imparfait Passe SimpleDocument4 pagesLes Temps Du Recit Imparfait Passe SimpleAsia Al-QadhiPas encore d'évaluation
- 6 006 Tombeza PDFDocument64 pages6 006 Tombeza PDFReda Bendimerad100% (1)
- Eval 3Document2 pagesEval 3Abdelkader MernissiPas encore d'évaluation
- Acte 4, Scène 3 Analyse PDFDocument2 pagesActe 4, Scène 3 Analyse PDFOrignalQuébécoisPas encore d'évaluation
- Oeuvre de Tahar Ben JellounDocument1 pageOeuvre de Tahar Ben Jellounelenachiriac885123Pas encore d'évaluation
- La Grippe A Comprehension Orale Exercice Grammatical Jeux de R - 64206Document3 pagesLa Grippe A Comprehension Orale Exercice Grammatical Jeux de R - 64206ViktoriaPas encore d'évaluation
- Entraînement À La Production ÉcriteDocument6 pagesEntraînement À La Production Écriterastignac2007Pas encore d'évaluation
- 3.rapport La Mémoire de L'autreDocument20 pages3.rapport La Mémoire de L'autreAyoub BrchPas encore d'évaluation
- Le Racisme Expliquc3a9 C3a0 Ma FilleDocument3 pagesLe Racisme Expliquc3a9 C3a0 Ma Fillesyvain78100% (1)
- Questions de Compréhension Le Petit Chose, Alphonse Daudet+Document3 pagesQuestions de Compréhension Le Petit Chose, Alphonse Daudet+guedri100% (1)
- Pédagogie de L'erreurDocument32 pagesPédagogie de L'erreurAnnabel LaurinoPas encore d'évaluation
- Quel 1Document1 pageQuel 1Mirela Irina SucalaPas encore d'évaluation
- 1AS Exam - La Nouvelle Réaliste MélodieDocument3 pages1AS Exam - La Nouvelle Réaliste MélodieSof FlinePas encore d'évaluation
- Théories de La Littérature - Cours M1 - DadciDocument70 pagesThéories de La Littérature - Cours M1 - DadciIsaek IsberabahPas encore d'évaluation
- Prevert BarbaraDocument7 pagesPrevert BarbaraOpret RalucaPas encore d'évaluation
- 01 Fiche Synthese Le Surnaturel Et La Litterature Fantastique B2 PDFDocument5 pages01 Fiche Synthese Le Surnaturel Et La Litterature Fantastique B2 PDFmatou100% (1)
- Sauver Par Son ChienDocument2 pagesSauver Par Son ChienloubnaPas encore d'évaluation
- La NominalisationDocument1 pageLa NominalisationMoha Elcasawi100% (1)
- Fichier WebDocument14 pagesFichier WebElénaBroscoi100% (2)
- 81FYBRDWB0217Document30 pages81FYBRDWB0217paolaPas encore d'évaluation
- Forme ImpersonnelleDocument1 pageForme ImpersonnelleNouha Mezloug100% (1)
- Voyage au bout de l'enfer en Algérie: Le Soleil ne se lèvera pas demainD'EverandVoyage au bout de l'enfer en Algérie: Le Soleil ne se lèvera pas demainPas encore d'évaluation
- Le Comportement Matériel Chez Les AnimauxDocument2 pagesLe Comportement Matériel Chez Les AnimauxHacerMellal100% (2)
- Evaluation CahierDocument2 pagesEvaluation CahierHacerMellalPas encore d'évaluation
- CE Lettre OuverteDocument8 pagesCE Lettre OuverteHacerMellalPas encore d'évaluation
- Fiche de Lecture: Eldorado de Laurent Gaudé:: Titre: AuteurDocument9 pagesFiche de Lecture: Eldorado de Laurent Gaudé:: Titre: AuteurLucie GomezPas encore d'évaluation
- Examen 3+ Corrige Francais TCST T3Document3 pagesExamen 3+ Corrige Francais TCST T3HacerMellal50% (2)
- La Nouvelle RéalisteDocument1 pageLa Nouvelle RéalisteHacerMellalPas encore d'évaluation
- Case Val 20 Cent ElevDocument7 pagesCase Val 20 Cent ElevHacerMellalPas encore d'évaluation
- 1ère As Texte Écriture Manuel p10Document2 pages1ère As Texte Écriture Manuel p10HacerMellal84% (44)
- 1ère As - ProjetsDocument47 pages1ère As - ProjetsHacerMellal73% (11)
- Technique DDocument2 pagesTechnique DHacerMellal100% (1)
- Cours de 2AS PI Séq 1Document7 pagesCours de 2AS PI Séq 1HacerMellalPas encore d'évaluation
- Cours de 2AS PI Séq 1Document7 pagesCours de 2AS PI Séq 1HacerMellalPas encore d'évaluation
- Compte Rendu CritiqueDocument1 pageCompte Rendu CritiqueHacerMellal70% (20)
- Benteftifa MohamedDocument3 pagesBenteftifa MohamedHacerMellalPas encore d'évaluation
- 3SEDocument4 pages3SEHacerMellalPas encore d'évaluation
- 3 LeDocument3 pages3 LeHacerMellalPas encore d'évaluation
- Argumenter (Le Pour Et Le Contre)Document4 pagesArgumenter (Le Pour Et Le Contre)HacerMellalPas encore d'évaluation
- Le Seigneur Et Ephraïm - Jacob LorberDocument5 pagesLe Seigneur Et Ephraïm - Jacob Lorberestaran0% (3)
- Bi Grammaire Chapitre 3Document30 pagesBi Grammaire Chapitre 3Oumar SaadouPas encore d'évaluation
- MINUSMA-GAO-L-005-20 Assistant Securite-GL-3 - Gao PDFDocument3 pagesMINUSMA-GAO-L-005-20 Assistant Securite-GL-3 - Gao PDFBoubacar TourePas encore d'évaluation
- Notebook MF1442 3Document41 pagesNotebook MF1442 3ScribdTranslationsPas encore d'évaluation
- L'essence Double Du Langage Selon Gilbert HottoisDocument6 pagesL'essence Double Du Langage Selon Gilbert HottoisRui MascarenhasPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 Supervision IndustrielleDocument6 pagesChapitre 1 Supervision IndustrielleJunior IssonguiPas encore d'évaluation
- AntidotesDocument9 pagesAntidotesStradin Bien-aimePas encore d'évaluation
- L'art de Faire Émerger L'intelligence Collective Comme Processus de Changement Émergent - Caroline DurandDocument182 pagesL'art de Faire Émerger L'intelligence Collective Comme Processus de Changement Émergent - Caroline Duranddella guerraPas encore d'évaluation
- Presentation Generale Du Programme en HebergementDocument3 pagesPresentation Generale Du Programme en HebergementMohamed Kandra CamaraPas encore d'évaluation
- Rapport Sur COMPTABILITÉ MAROCAINE COMPTABILISATION DES ÉCARTS DE CHANGE.Document4 pagesRapport Sur COMPTABILITÉ MAROCAINE COMPTABILISATION DES ÉCARTS DE CHANGE.MOHAMED El ALAOUIPas encore d'évaluation
- Liberation - Jeudi 28 Septembre 2017Document36 pagesLiberation - Jeudi 28 Septembre 2017jijePas encore d'évaluation
- S1-4 fONCTIONS CONTINUESDocument2 pagesS1-4 fONCTIONS CONTINUEST3C GamingPas encore d'évaluation
- Circulaire DGS 3A 667 Bis Du 10 Octobre 1985Document3 pagesCirculaire DGS 3A 667 Bis Du 10 Octobre 1985mourad laatatPas encore d'évaluation
- Sur Un Air D'offenbachDocument12 pagesSur Un Air D'offenbachscribdPas encore d'évaluation
- La Revolution FrancaiseDocument5 pagesLa Revolution Francaisealehandro ozarPas encore d'évaluation
- Horaires Aleop 312 1-9-2023 Au 28-6-2024 PDFDocument7 pagesHoraires Aleop 312 1-9-2023 Au 28-6-2024 PDFtitouanmacheferPas encore d'évaluation
- Chap 6 - Diag de ClassesDocument16 pagesChap 6 - Diag de ClassesalaesahbouPas encore d'évaluation
- 0 Guide-Maison-Ind - Neuve - Archi150413 PDFDocument40 pages0 Guide-Maison-Ind - Neuve - Archi150413 PDFABELWALIDPas encore d'évaluation
- Ballèvre Et Al - 2013 - SGMBDocument93 pagesBallèvre Et Al - 2013 - SGMBNicolas PetitmagnePas encore d'évaluation
- PP Complet BoucettaDocument354 pagesPP Complet BoucettaRakia BenPas encore d'évaluation
- Le Logement FLE Copie Professeur-5Document54 pagesLe Logement FLE Copie Professeur-5nelisnoemiePas encore d'évaluation
- Etude de Marche Des FromagesDocument3 pagesEtude de Marche Des FromagesMeryem Nejma100% (2)
- Maquette Du Master Génie Civil - Master PDFDocument4 pagesMaquette Du Master Génie Civil - Master PDFMohammed Mammar KouadriPas encore d'évaluation
- Compte Rendu - at CAO Elec S2Document36 pagesCompte Rendu - at CAO Elec S2boukariPas encore d'évaluation
- Annexe Archeologie Projet Fevrier 2011Document126 pagesAnnexe Archeologie Projet Fevrier 2011Pierre KinyockPas encore d'évaluation