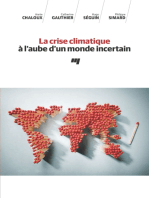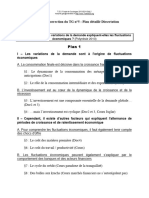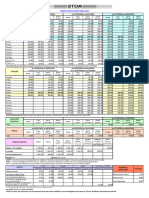Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Analyse Explicative de Loffre Et La Demande de Transport Maritime 2010
Analyse Explicative de Loffre Et La Demande de Transport Maritime 2010
Transféré par
Allache Abderrahman0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
7 vues40 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
7 vues40 pagesAnalyse Explicative de Loffre Et La Demande de Transport Maritime 2010
Analyse Explicative de Loffre Et La Demande de Transport Maritime 2010
Transféré par
Allache AbderrahmanDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 40
MEEDDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
Etude du suivi de loffre et de la demande de transport maritime
MEEDDM DTMRF Barry Rogliano Salles
- ANALYSE EXPLICATIVE -
SUR LEVOLUTION DU TRANSPORT MARITIME INTERNATIONAL
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
2
ANALYSE EXPLICATIVE
SUR LEVOLUTION DU TRANSPORT MARITIME INTERNATIONAL
SUR LES 10 DERNIERES ANNEES ET TENDANCES RECENTES
1 CONTEXTE GENERAL p. 3-6
2 LA CONSTRUCTION NAVALE p. 7-9
. Lvolution rcente de la construction navale dans le monde
. Un tat des lieux par pays et par zones gographiques
3 LE TRANSPORT MARITIME DE PETROLE BRUT ET DE PRODUITS PETROLIERS p. 10 14
. La demande de transport de ptrole brut
. La flotte de ptroliers transporteurs de brut
. La demande de transport de produits ptroliers
. La demande de navires transporteurs de produits ptroliers
4 LE TRANSPORT MARITIME DE GAZ p. 15-17
. Le transport de gaz naturel liqufi
. Le transport de gaz de ptrole liqufi et de gaz chimiques
5 LE TRANSPORT MARITIME DE VRACS SECS p. 18-23
. La demande de transport de vracs secs
. La flotte de vraquiers
6 LE TRANSPORT MARITIME DE CONTENEURS p. 24-30
. Les grandes routes maritimes conteneurises
. Loffre maritime
. Les stratgies face la crise
. Les perspectives moyen terme
7 LE TRANSPORT ROULIER ET DE PASSAGERS A COURTE DISTANCE p. 31-32
. Ltat du march
. La structure de la flotte
8 LE SECTEUR DE LA CROISIERE p. 33-34
. Perspectives gnrales
. Les acteurs du march de la croisire
9 LA DEMOLITION ET LE DESARMEMENT DES NAVIRES p. 35-37
. La dmolition des navires de commerce
. Le dsarmement ou le changement de destination des navires de commerce
10 SECTEUR PORTUAIRE p. 37-39
ANNEXES CHIFFRES p. 40-92
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
3
ANALYSE EXPLICATIVE
SUR LEVOLUTION DU TRANSPORT MARITIME INTERNATIONAL
ET TENDANCES RECENTES
1 CONTEXTE GENERAL
Croissance mondiale, changes
internationaux et demande de transport
maritime
Principaux moteurs de la croissance de la demande
de transport maritime, la croissance de lconomie
et des changes mondiaux se sont brutalement
interrompus la fin de lanne 2008. Le premier
signe tangible de cette interruption a t larrt
quasi immdiat des activits de trading sur les
matires premires (octobre 2008), dont le
fonctionnement repose principalement sur la
fluidit des marchs de capitaux. Suite au
sauvetage du systme financier organis par les
tats le flot des changes commerciaux a pu
rapidement reprendre mais les repres qui
staient constitus au cours des 5 annes
prcdentes avaient compltement disparu :
volution du prix des matires premires,
disponibilit du crdit et des liquidits, rythme de
croissance soutenu, et surtout la confiance, dont la
disparition sest matrialise par le retour dun
risque gnralis de solvabilit de la contrepartie,
quelle que soit la nature de lopration conomique
concerne.
Les secteurs maritimes ont ragi diffremment
ce nouveau contexte. Les transports
conteneuriss, dont le repli tait dj amorc
depuis lt 2008 nont pas subi le mme choc que
les matires premires, mais la baisse des trafics a
t quasi continue jusquau second semestre de
2009. Les transports ptroliers ont rsist quelques
temps aprs le dclenchement de la crise
financire mais lajustement progressif des quotas
de production de lOPEP la nouvelle donne de
lconomie relle mondiale a port un coup
fatal au march en tout dbut danne 2009.
Quant au secteur du vrac, cest lui qui a enregistr
la rupture la plus brutale avec des baisses
dactivit de 15 20% entre les mois de novembre
2008 et de fvrier 2009.
Le reste de lanne 2009 sest droul de manire
relativement conforme aux prvisions pour les
secteurs du conteneur et du ptrole, seul le
secteur du vrac sec, et plus particulirement du
minerai de fer a pris lensemble des observateurs
par surprise. Les consquences de la crise sur
lindustrie minire chinoise, ainsi que leffet massif
cr par le plan de relance gouvernemental, ont
provoqu une augmentation sans prcdent des
importations chinoises de minerai de fer. Le
transport maritime en a largement bnfici
permettant au march de se redresser de manire
totalement inattendue !
Il aura fallu attendre la fin de lanne pour voir
samorcer un rebond dans les domaines du
transport ptrolier et du transport de conteneurs.
Les efforts raliss dans ces deux secteurs en
termes de dmolition, de dsarmement de navires
et de rorganisation, ont fini par porter leurs fruits.
La reprise conomique constate au dernier
trimestre 2009 et au cours des premiers mois de
2010 ont permis une remonte des taux de fret,
soulageant la trsorerie des armateurs qui auraient
difficilement support quelques mois
supplmentaires de disette.
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
4
Lanalyse de chacun de ces secteurs est dtaille
dans les chapitres suivants de ce document.
Transport maritime et cot des matires
premires
Alors que jusquau milieu de lanne 2008
lvolution du prix des matires premires pouvait
tre vue comme lun des signes de la poursuite de
llan de croissance engag en 2008, il en est
aujourdhui tout autrement.
Cest notamment le cas du prix de lnergie. Certes
le prix du brut a considrablement baiss depuis
lt 2008 (jusqu 145$/baril contre 80$/baril
aujourdhui et 40/45$/baril dbut 2009), mais les
pays producteurs ont russi retrouver des
niveaux de prix quasi identiques ceux de lanne
2007.
Comme le prix des soutes maritimes est trs
fortement li celui du brut, on imagine assez
facilement les difficults auxquelles peuvent faire
face les armateurs avec des taux de fret qui, selon
les cas, ont baiss de 40 70% !
Malgr tout, seuls les grands oprateurs de porte-
conteneurs ont mis en place de manire
relativement coordonne des politiques de
rduction des vitesses (et donc des
consommations) qui leur ont permis dabaisser
limpact du cot de lnergie sur leur budget soute
et sur leur cot unitaire ( la boite transporte).
La rupture provoque par la crise financire et son
impact quasi immdiat sur le prix des matires
premires a paradoxalement renouvel lintrt
des investisseurs sur ces dernires. Une partie du
rebond enregistr au cours de lanne 2009 est d
des mouvements de portefeuille en faveur des
matires premires et des achats spculatifs
pariant sur une remonte des cours.
Le prix de lnergie reste donc une composante
majeure et structurante de lvolution des
transports maritimes. Le secteur du transport
conteneuris en particulier se convertit
actuellement un mode de fonctionnement
prenant en compte un niveau lev du cot de
lnergie sur le long terme, ce qui ne sera pas sans
consquence sur lorganisation des chanes
logistiques terrestres qui en dpendent.
Transport maritime et finance
Les annes 2003 2008 ont t celles de la
normalisation du secteur maritime vis--vis du
systme bancaire et des marchs financiers.
Jusqu une priode rcente les financements
maritimes reposaient essentiellement sur les
crdits hypothcaires traditionnels, voire certains
systmes spcifiques comme les KG allemands ou
les quirats franais. Avec lexplosion des frets et
laffichage de taux de rentabilit rarement atteints
dans lhistoire du transport maritime, et sur une
priode aussi longue, le secteur a attis lintrt
des investisseurs. Les introductions en bourse des
compagnies maritimes se sont multiplies et les
capitaux ont coul flot dans une industrie
jusqualors financirement trs conservatrice et
quelque peu mprise par la sphre financire.
Paradoxalement, avec la crise et ses
consquences, ce ne se sont pas les marchs
boursiers qui ont connu le plus de difficults avec
le secteur maritime, mais les banques. En effet,
aprs une priode dinquitude gnralise, les
armateurs prsents en bourse ont plutt bnfici
du regain dintrt port sur les matires
premires. Par ailleurs, les banques tant
devenues de plus en plus frileuses vis--vis du
secteur, les armateurs se sont retourns vers les
marchs pour trouver des financements.
La baisse des taux de fret a non seulement
entran la faillite de quelques armateurs ou
oprateurs, mais elle est surtout venue rapidement
bout des trsoreries et a ncessit la
rengociation des financements obtenus au cours
de la priode prcdente. Les banques ont
globalement jou le jeu, prfrant rorganiser
leurs portefeuilles que de crer une crise
systmique en prcipitant la faillite de ce qui aurait
t le Lehman Brothers du transport maritime.
Il semble toutefois quaujourdhui les banques
aient atteint une certaine limite et quune nouvelle
vague de rengociations ou de rchelonnement
ne se finisse pas de la mme manire. Il y a fort
parier quune baisse durable du march dans lun
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
5
ou lautre des secteurs du maritime nentraine une
vague dannulation de commandes, de faillites
et/ou de rachats et de fusions dune toute autre
ampleur que celle de 2009.
Transport maritime et quilibre des forces
Dans ce contexte de crise, la Chine est sortie
renforce et cela sest retranscrit sous divers
aspects dans le transport maritime mondial.
Ainsi, n a assist un dplacement vers lAsie des
flottes que ce soit au niveau de lvolution des flux
ou des problmatiques de pavillon et de proprit
des navires.
Le graphique ci-dessous illustre cette volution
structurelle au niveau du contrle des flottes,
phnomne qui confirme la monte en puissance
de lAsie au dtriment de lEurope autrefois acteur
majeur dans de domaine.
En ce qui concerne lvolution des changes et la
ventilation par type de marchandise, 3 grandes
tendances sont retenir :
- Une croissance soutenue et constante des 10
dernires annes avec un TCAM de prs de 5%.
- Une baisse des volumes pour la priode 2008-
2009, phnomne que le secteur navait pas connu
depuis le milieu des annes 80.
- La part de plus en plus importante prise dans les
changes toutes marchandises confondues
Perspectives gnrales pour 2010
Si la reprise de la croissance et des changes
mondiaux semble aujourdhui de plus en
plus solide, et ce malgr la monte
croissante de certains risques souverains, le
cycle conomique propre au secteur
maritime na pas encore produit tous ces
effets. La question de la surcapacit de la
flotte en service, mais aussi et surtout du
carnet de commandes des chantiers navals
(abord en dtail dans le chapitre suivant),
reste devant nous.
Les annulations de commandes, les reports
de livraisons et les rengociations de
financement ont permis la construction
navale de ne pas seffondrer avec la quasi
disparition des nouvelles commandes en
2009. Mais, ces ajustements nont pas rgl
la totalit du problme et la masse des
navires construits par les chantiers semble
devoir continuer peser durablement sur
lventualit dune reprise durable dans la
plupart des secteurs du maritime.
La conjoncture maritime de lanne 2010
reposera donc sur trois principaux piliers :
Tout dabord et cest une vidence,
sur la solidit de la reprise
conomique mondiale, mais cette
fois-ci avec une capacit de
rsistance ou dadaptation du march
(plus de livraisons, moins de
dmolition, moins de trsorerie)
beaucoup plus faible en cas daccroc
de croissance.
Ensuite sur la stabilisation des prix de
lnergie qui jouera normment sur
le niveau de profitabilit des
armateurs dans une priode de taux
de fret bas.
Enfin sur la bonne volont des
banques et des marchs financiers
dont la contribution est essentielle
la stabilit du systme dans son
ensemble.
Si la crise systmique a jusquici t vite,
le risque nest donc toujours pas derrire
nous. Reste que plus la capacit de
rsistance des acteurs est grande plus la
situation actuelle pourra perdurer. Il y a fort
parier quen labsence dune nouvelle
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1900
(16,6 m gt)
1939
(68,5 m gt)
1957
(110,2 m gt)
1972
(268,3 m gt)
1988
(403,4 m gt)
2010
(857,7 m gt)
ROW
Main Open
Registers
China+Japan
+HK+Singapore
USA
Greece
Europe
(excl. Greece)
(incl. Sec.
Regist.) year
(world fleet)
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
1
9
7
0
1
9
7
1
1
9
7
2
1
9
7
3
1
9
7
4
1
9
7
5
1
9
7
6
1
9
7
7
1
9
7
8
1
9
7
9
1
9
8
0
1
9
8
1
1
9
8
2
1
9
8
3
1
9
8
4
1
9
8
5
1
9
8
6
1
9
8
7
1
9
8
8
1
9
8
9
1
9
9
0
1
9
9
1
1
9
9
2
1
9
9
3
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
Echanges Maritimes Mondiaux depuis 1970
Containers Other Dry Cargo Grain Coal
Iron ore LNG Oil Products Crude
(millions de
+4,7%
+0,5%
+3,4%
+4,6%
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
6
vague de faillites, de dmolition et
dannulation/report de commandes, nous
soyons revenus des quilibres de march
semblables ceux que nous connaissions
avant le boom de 2003.
Quid des Etats dans ce contexte ? Il semble
quen dehors de la Chine, dont le
volontarisme a permis de traverser lanne
2009 sans trop dencombres, leur possibilit
daction envers le transport maritime et la
construction navale soit aujourdhui de plus
en plus limite.
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
7
2 LA CONSTRUCTION NAVALE
Historiquement lindustrie de la construction
navale de navires de commerce est un
secteur dans lequel les marges sont
relativement faibles. Base pour lessentiel
sur la production de navires en srie avec
une forte concentration de main duvre et
de matires premires, il nest pas
surprenant que les pays asiatiques aient (
commencer par le Japon dans les annes
60/70, la Core dans les annes 90 et la
Chine dans les annes 2000)
progressivement capt lessentiel de la
production. A linverse la fabrication de
navires uniques ou en petites sries et avec
un fort contenu technologique est longtemps
rest lapanage des pays occidentaux.
Il semble quaujourdhui, hormis quelques secteurs
trs spcifiques comme la croisire ou certains
domaines de loffshore, il ne reste que trs peu de
secteurs dans lesquels loutil de production
europen puisse encore tre comptitif. A limage
de ce quavait t le boom de la construction de
ptroliers dans les annes 70, la priode comprise
entre 2003 et 2008 a reprsent une exception
dans la mesure o les prix des navires neufs se
sont envols et dune situation de surcapacit
structurelle, le march de la construction navale
est devenu un march de vendeur au bnfice des
constructeurs. Ces derniers ont pu pendant un
temps slectionner leurs clients, imposer leurs
designs, et augmenter leurs prix bien au-del de
laugmentation du cot de leurs inputs (salaires,
nergie, acier).
La situation sest brutalement renverse avec la
crise de la fin de lanne 2008. Le niveau des frets
stant effondr, la valeur de march des navires
en commande (livrables rapidement) a t divise
par 2 voire 3 selon les types de navires. Les
nouvelles commandes de navires se sont elles
aussi effondres, non seulement en raison de la
dgradation des perspectives, mais aussi de larrt
brutal des commandes purement spculatives dont
lexistence ntait due qu la hausse continue de la
valeur des actifs, rengociables sur le march de
seconde main, mme avant leur livraison. Le
secteur de la construction navale nest pas loin
cette poque davoir vcu un phnomne
semblable celui des subprimes amricains qui
ont fond leur succs sur une indexation de la
capacit dendettement des particuliers sur la
valeur de lactif financ. A partir du moment o,
non seulement la valeur du bien seffondre, mais
quelle noffre aucune perspective moyen terme
de se redresser de manire significative, une
spirale de dfaillances ou au mieux de
rengociation des termes de financement
senclenche immanquablement.
A la diffrence des subprimes pour lesquels les
dbiteurs individuels se sont rapidement retrouvs
insolvables, le milieu armatorial sortait fin 2008
dune priode de plus de 5 ans deuphorie des
marchs. Les bilans des compagnies maritimes et
de chantiers taient, pour la plupart, trs solides et
le bras de fer avec les banques et les chantiers a
davantage tourn une course au
rchelonnement, au refinancement et
ltalement de la dette et du carnet de
commandes, quau bain de sang dannulations et
de faillites que lon aurait pu escompter au tout
dbut de la crise. A titre indicatif dans le courant
de lanne 2009 cest plus de 30% des navires
dont la livraison a t repousse, et seulement
12% qui ont fait lobjet dannulations.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
EVOLUTION OF THE WORLD ORDERBOOK SINCE 1974
(m. tb)
(Source: Lloyd's Register / BRS)
-
50 000 000
100 000 000
150 000 000
200 000 000
250 000 000
300 000 000
350 000 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 May 2010
NEW ORDERS PER YEAR SINCE 2003
Containerships > 300 teu
Bulkers > 15,000 dwt
Tankers > 25,000 dwt
Total excl. Offshore
dwt
1,890
ships
2,270
2,090
2,980
5,440
2,140
180
300
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
8
Alors quaujourdhui le march des frets a retrouv
des couleurs, mme si la situation reste trs
fragile, il est intressant de faire un point dtape
sur la situation du carnet de commandes mondial
et des chantiers de construction. Plusieurs
questions restent poses, et tout dabord celle du
rapport entre le carnet de commandes et les
besoins de transport dans les annes venir.
- Avec un taux de renouvellement de la
flotte situ aux alentours de 50% il est
clair aujourdhui que le carnet de
commandes du secteur du vrac sec est
encore largement surcharg. Toutefois,
prs de la moiti des nouvelles
commandes du premier trimestre de
lanne 2010 ont t des vraquiers ! En
effet, commander des navires aujourdhui
50% moins cher quil y a deux ans peut
apparatre comme une dcision
conomiquement logique, en dpit de
lexcs du carnet de commandes par
ailleurs. Les ajustements (reports de
livraisons ou annulations) dans ce secteur
se font trs court terme, les armateurs
faisant le choix de prendre ou non
livraisons de leurs navires au gr des
fluctuations du march des frets.
- Avec un taux de renouvellement de 28%
(contre prs de 45% il y a deux ans) le
secteur ptrolier sest montr beaucoup
plus raisonnable que celui du vrac. En
outre, llimination acclre des navires
simple-coque (pour des raisons la fois
rglementaire et conomiques) devrait
permettre dattnuer limpact des livraisons
venir. Cest aujourdhui davantage sur
les incertitudes reposant sur lvolution de
la demande ptrolire que repose
lessentiel du dsquilibre venir et qui
dterminera lvolution des marchs. Le
secteur ptrolier na pas connu les mmes
excs que son homologue du vrac et trs
peu dannulations de commandes ont t
enregistres. Les ajustements (reports de
livraisons) se font aussi en gnral court
terme, mais elles nont pas suffi
redresser le march en 2009. Il a fallu
attendre la fin de lanne, un hiver rude et
une forte croissance de la dmolition pour
amliorer quelque peu la situation.
- Le secteur des porte-conteneurs a lui aussi
eu procder de lourdes rengociations
de son carnet de commandes. Toutefois
celles-ci ont abouti des rsultats assez
diffrents du vrac sec ou du ptrole. Les
navires tant en gnral commands en
grandes sries et pour le lancement
chelonn de services devant attendre la
livraison du dernier navire pour atteindre
leur vitesse de croisire, les reports de
livraisons se sont tals sur une plus
longue priode.
La deuxime interrogation est relative la capacit
de rsistance des cranciers. La vague de
rengociation des engagements a t telle en 2009
que lon estime quelle ne peut gure aller plus loin
cette anne. Les banques ont atteint un certain
seuil au-del duquel aucun effort supplmentaire
ne semble pouvoir leur tre demand. Cest pour
cette raison quaujourdhui la moindre inflexion des
marchs pourrait entrainer davantage
dannulations de commandes que lan pass.
Certains armateurs ont aussi tent (avec plus ou
moins de succs) de faire appel aux marchs
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
220,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PRODUCTION DES CHANTIERS D'ICI A 2012
"Ships delayed f rom previous year"
Others
Containerships
Dry Bulk Carriers
Tankers
(000 tpl)
71.8
m. dwt
73.8
83.1
91.7
( sur la base des commandes fermes en Mai 2010)
102.4
yc. 11.8
retards
152.6
yc. 47.3
retards
141.8
yc. 29.7
retards
66.8
yc. 29.5
retards
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
220,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
LIVRAISONS ET ANNULATIONS
Cancellations as at Apr 2010
Total deliveries
(000 tpl)
0.1%
0.6%
8.6%
14.8%
7.7%
13.1%
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
9
financiers afin de suppler la frilosit des
banques, mais les incertitudes qui psent
actuellement sur les bourses mondiales rendent ce
type doprations beaucoup moins aises.
Lindustrie de la construction navale est
donc aujourdhui un tournant de son
histoire. Courant 2009 le carnet de
commandes chinois est pass devant celui
de la Core en nombre de navires et en
volume. Les chantiers corens sont
confronts la ncessit de diversifier leur
activit afin la fois de conserver un plan de
charge satisfaisant, mais aussi de se
concentrer sur des secteurs plus
rmunrateurs. Mme la construction de
mthaniers qui a assur une bonne partie
des commandes et des marges des chantiers
corens au cours des annes 2000, est en
recul depuis plusieurs annes.
Les plus grands constructeurs tels que
Samsung, STX, Daewoo et Hyundai ont
entrepris une diversification dans quelques
domaines dont loffshore ptrolier (plates-
formes, FPSO), lnergie (centrales
thermiques, solaire, oliennes terrestres et
offshore) ou le raffinage. Cette reconversion
permet aux sites industriels de compenser la
baisse des commandes de navires de
commerce qui es passe de plus de 5 000 en
2007 environ 300 en 2009 !
Cette crise (qui nen est pas encore
rellement une) de la construction navale
marque sans aucun doute lamorce dun
nouveau cycle bas dans ce secteur industriel
qui, sous la pression des capacits de
production mises en service en Chine, ne
devrait pas pouvoir redresser de si tt ses
prix et ses marges dexploitation.
0
40 000
80 000
120 000
160 000
200 000
240 000
280 000
320 000
360 000
400 000
Quarterly Evolution of World Orderbook by
Shipbuilding Area since 2005
Rest of the World
East. Europe
West. Europe
Japan
China
S. Korea
(m. gt)
34.8%
17.6%
37.7%
1.9%
1.5%
6.6%
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
10
3 LE TRANSPORT MARITIME DE PETROLE
BRUT ET DE PRODUITS PETROLIERS
Lanne 2009 restera comme une des annes
les plus compliques de la dernire
dcennie. Elle aura t marque par un
double effet ngatif li la baisse de la
demande ptrolire et un afflux de
nouveaux navires sur le march.
Pour sadapter au march et satisfaire leurs
clients, les armateurs ont du accepter des
taux de fret ngatifs.
Le march sest rquilibr en raison dun
haut niveau de dmolition et de lutilisation
dune partie de la flotte pour du stockage.
3.1. Perspectives gnrales du march
La production
La production mondiale a atteint 84.4 millions
barril/jour en baisse de 2% et revient son niveau
de 2006.
Production
OPEP
Production
hors OPEP
Total
2004 29,6 53,3 82,9
2005 30,7 53,5 84,2
2006 30,5 53,9 84,4
2007 30,2 54,6 84,8
2008 31,2 54,8 86,0
2009 28,8 55,7 84,4
2010 (P) 28,4 56,6 85,0
Production de mondiale de ptrole en million de
barils par jour
Stratgie de production OPEP
La stratgie de lOPEP qui consiste une
rgulation de sa production pour maintenir des
cours un niveau dfini a conduit ses membres
rduire la production 28.8 millions de b/j pour
faire face la baisse de la demande mondiale de
brut.
La part de la production de lOPEP est dsormais
de 34.1% alors quelle tait de 35.7% il y a 5ans.
Les runions de lOEP de fin dcembre 2009 et de
mars 2010 ont maintenu le statu quo concernant
les quotas de production avec pour objectif de
maintenir les taux un niveau oscillant autour de
75$.
Stratgie de production hors OPEP
La production des pays non OPEP a atteint 56.6
millions de baril/jour en hausse de prs d1 million
par rapport 2008 alors que dans le mme temps,
les pays de lOPEP baissaient leur quota de 2.5
millions de baril.
Les principaux producteurs au sein des pays hors-
OPEP sont la Russie, le Mexique, la Norvge et le
Kazakhstan mais contrairement lOPEP
ladaptation de leur production est beaucoup moins
flexible et ils ne disposent pas des mmes marges
de production. LAmrique du Nord et lAmrique
latine sont les zones qui ont le plus contribu
laugmentation de la production non OPEP.
La consommation
La crise mondiale a induit une consommation et
une demande de transport maritime ptrolier en
berne. Seuls les besoins de la Chine continuent
progresser ce qui induit une rorganisation globale
des flux de transport de brut et de produits
ptroliers.
Les principaux effets de lvolution
production/consommation sur le transport
maritime :
- Mme si lOPEP ne reprsente que 35% de
la production mondiale de ptrole, elle
gnre plus de 50% du transport maritime
ptrolier. Cest pourquoi il est primordial
de suivre les dcisions de ses membres au
niveau des quotas de production.
- Les baisses de production ont eu un effet
considrable sur le march des frets. Pour
lanne 2009, la baisse de production de
lOPEP sest fait ressentir durement pour
de nombreux armements.
3.2. Le transport de ptrole brut
Le march a t contraint du ct de loffre ainsi
que du ct de la demande. Leffet conjugu de
larrive sur le march de nouveaux navires la
diminution des quotas de lOPEP a provoqu une
chute marque des taux de fret.
La demande de transport maritime de
ptrole brut
Trafic maritime de
brut (M.t)
Variation
2005 1 720 -1,9%
2006 1 756 2,1%
2007 1 775 1,1%
2008 1 800 1,4%
2009* 1 787 -0,7%
2010* 1 850 3,5%
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
11
Le trafic maritime de brut a connu une baisse de
0.7% au niveau global, consquence directe de la
crise conomique mondiale.
Si lon regarde de manire, plus dtaille, on
remarque une confirmation de la tendance
(observe lors des 3 dernires annes) une
rorganisation gographique des flux..
Lvolution la plus significative concerne les trafics
en provenance du Moyen Orient. Ainsi les volumes
changs entre le Moyen Orient et lextrme orient
progressaient de 3% entre 2006 et 2008, alors que
dans le mme temps, la dcroissance tait de prs
de 20% pour les flux Moyen Orient Europe.
En parallle, les importations de lAmrique du
Nord au niveau global ont baiss de plus de 4%.
Loffre de ptroliers transporteurs de brut
Les livraisons de navires transporteurs de brut en
2009 ont cru de plus de 50% par rapport 2008
pour atteindre 33.7 millions de tpl.
Dans le mme temps, la dmolition a atteint 4,8
millions de tpl soit plus du double de 2008 mais
nanmoins insuffisant pour absorber la surcapacit
lie lentre sur le march de nouveaux navires.
La conjonction de ce phnomne et de la lgre
baisse de la demande expliquent la chute
vertigineuse des taux de fret.
Lanne 2010 devrait tre affecte
significativement par la date limite de disparition
des navires simple coque dune part et par les
consquences sur la production off-shore de la
mare noire dans le Golfe du Mexique.
Les taux de fret pour le transport de ptrole
brut
Le graphique ci-aprs illustre lvolution des taux
de fret par type de navire.
La chute a t continue depuis le 2
nd
semestre
2008 avant de connatre un lger sursaut fin 2009.
Les routes qui ont le plus souffert sont celles
destination de lEurope et des Etats Unis
contrairement celles vers lAsie qui ont profit de
la croissance indienne et chinoise.
Sur les routes Moyen Orient Europe, les
armateurs nont pas couvert leurs cots
dexploitation et certains rendements se sont
retrouvs ngatifs.
-50 000
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
j
a
n
v
.
-
0
5
a
v
r
.
-
0
5
j
u
i
l
.
-
0
5
o
c
t
.
-
0
5
j
a
n
v
.
-
0
6
a
v
r
.
-
0
6
j
u
i
l
.
-
0
6
o
c
t
.
-
0
6
j
a
n
v
.
-
0
7
a
v
r
.
-
0
7
j
u
i
l
.
-
0
7
o
c
t
.
-
0
7
j
a
n
v
.
-
0
8
a
v
r
.
-
0
8
j
u
i
l
.
-
0
8
o
c
t
.
-
0
8
j
a
n
v
.
-
0
9
a
v
r
.
-
0
9
j
u
i
l
.
-
0
9
o
c
t
.
-
0
9
j
a
n
v
.
-
1
0
VLCC 260,000t Moy. Or. / Extr. Or. SUEZMAX 130,000t Afr. de l'O. / Etats-Unis
AFRAMAX 80,000t Baltique / Continent PANAMAX 70,000t Carab. / Golfe du Mex.
Le march des VLCC
Le fondement du march des VLCC est
lexportation de brut du Moyen-Orient vers les
grandes zones de consommation (principalement
Etats-Unis, Europe, Extrme Orient).
Le march des VLCC a souffert le plus durement
de la crise.
Taux de fret
Les routes ont t affectes de manire disparate.
Ainsi les axes destination de lEurope et des
Etats-Unis ont particulirement subi les
consquences de la crise alors que la demande
chinoise et indienne a maintenu un semblant
dquilibre sur la route Moyen-Orient Extrme
Orient. Le taux de fret au voyage pour un VLCC
sur la liaison Moyen Orient / Extrme Orient tait
de 59 438$ en jan 2009, 5 906$ en septembre
2009 et 38 813 en dc 2009. Ces chiffres illustrent
lincroyable volatilit du march.
Flotte / livraisons
Actuellement la flotte de VLCC est compose de 74
navires simple coque et 463 navires double coque.
Par ailleurs, le taux de renouvellement reste
particulirement lev puisque 190 navires sont en
commande. Lge moyen de la flotte est de 8 ans,
le fait que lquivalent de 30% de la flotte va
entrer sur le march dans les 3 annes venir va
accentuer la relative jeunesse de la flotte de VLCC.
-
20 000 000
40 000 000
60 000 000
80 000 000
100 000 000
120 000 000
140 000 000
160 000 000
180 000 000
200 000 000
end 1998 end 1999 end 2000 end 2001 end 2002 end 2003 end 2004 end 2005 end 2006 end 2007 end 2008 end 2009
VLCC ELIGIBLE FLEET 1998-2009
DH non DH Eligible
(200,000 dwt & over)
Less than
25 yrs
Less than
15 yrs
Double Hull
only
(Dwt)
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
12
Lanne 2010 sera intressante suivre du fait de
lchance dexploitation des navires simple coque.
Le nombre de navires simple coque encore en
utilisation a fortement baiss lors des dernires
annes du fait des restrictions imposes par les
compagnies ptrolires sur les flottes ligibles.
Lavenir de cette flotte se trouve dans la
conversion en FPSO ou en stockage flottant.
Le march des Suezmax
Le Suezmax peut transporter entre 120 000 et
200 000 tpl, il est principalement positionn sur
des routes telles que Afrique de lOuest Etats
Unis Cte Atlantique ou au dpart de la Mer noire
et de la Mditerrane.
Taux de fret
Le ratio entre le point haut de mars et le point bas
atteint en juillet est de 1 pour 9.
Lutilisation des Suezmax pour du stockage a
permis de limiter les phnomnes de surcapacit.
Lanne 2010 ne sannonce pas sous les meilleurs
auspices puisque lutilisation de la flotte pour
stockage devrait progressivement disparatre et 62
nouveaux navires devraient entrer sur le march.
Flotte / livraisons
La flotte de Suezmax est compose de 407 navires
dont 29 simple coque et 378 double coque. 125
navires sont actuellement en commande. 45
constructions neuves se sont ajoutes la flotte
en 2009 alors que dans le mme temps 13 navires
sortaient de la flotte. Lge moyen des Suezmax
est lgrement suprieur celui des VLCC mais il
reste assez faible autour de 9ans.
-
10 000 000
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
60 000 000
70 000 000
end 1998 end 1999 end 2000 end 2001 end 2002 end 2003 end 2004 end 2005 end 2006 end 2007 end 2008 end 2009
SUEZMAX ELIGIBLE FLEET 1998-2009
DH non DH Eligible
(120,000 -200,000 dwt)
Less than
25 yrs
Less than
15 yrs
Double Hull
only
(Dwt)
Le march des Aframax
Les Aframax peuvent tre positionns sur plusieurs
marchs que ce soit le transport de brut sur des
routes spcifiques ou encore les produits
ptroliers. Cette tendance une utilisation pour le
transport de produits ptroliers tend se
confirmer. Au niveau de la localisation par route,
les Aframax oprent majoritairement en Mer du
Nord, Mditerrane, sur certaines routes en
Moyen-Orient et Asie et dans la zone Carabes.
Les capacits des navires se situent entre 80000 et
120000 tpl mais la plupart des nouvelles livraisons
entrent dans la fourchette 105 000 115 000tpl.
Taux de fret
Les variations au cours de lanne 2009 ont t
fortement marques. Les taux de fret sont passs
de niveaux historiquement bas voire ngatifs en
aot septembre des niveaux corrects en dbut
danne (janvier mars). La zone lOuest de
Suez a relativement mieux rsist que la zone Est.
La surcapacit de tonnage a aussi affect le
segment de march des Aframax malgr des
volumes ex-Russie en croissance notable.
Flotte / livraisons
La flotte dAframax est compose de 71 navires
simple coque et 784 navires double coque ; 179
sont actuellement en commande. La flotte est
relativement jeune avec 8 ans dge moyen. Lge
devrait continuer baisser si lon prend en compte
les navires qui devaient intgrer massivement le
march au cours des prochaines annes. Au
niveau de la sortie des navires simple coque, le
march des Aframax est relativement en avance
sur le calendrier si lon compare avec les autres
segments de march
-
10 000 000
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
60 000 000
70 000 000
80 000 000
90 000 000
100 000 000
end 1998 end 1999 end 2000 end 2001 end 2002 end 2003 end 2004 end 2005 end 2006 end 2007 end 2008 end 2009
Aframax Eligible Fleet 1998-2009
non Eligible non DH DH
(Dwt)
Less than
25 years
Less than
15 years
Only
Double
Hull
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
13
3.3. Le transport de produits ptroliers
Ce march est en profonde mutation au niveau de
la structure des changes. Autant les zones de
production de ptrole brut varient assez peu,
autant les zones de raffinage sont en constante
volution.
Lvolution de la consommation (croissance
exponentielle du parc de vhicules chinois,
modifications du mix essence/gasoil en Europe)
ainsi que les nouvelles capacits de raffinage mises
en service (Moyen-Orient, Inde) sont les principaux
sous-jacents de ces volutions.
La demande de produits ptroliers et de
transport maritime
Les principaux produits transports sont :
- Lessence
- Les middle distillates
- Le naphta
- Les fuels
Lanne 2009 est caractrise par une forte chute
du transport maritime de produits ptroliers (-6%).
La logique est relativement proche de celle
constate sur le march de transport de brut, mais
la chute est plus marque du fait que le secteur
est tir uniquement par la demande et non guid
par un subtile trade-off production / demande
comme pour le transport de brut.
Trafic maritime de
produits ptroliers
(M.t)
Variation
2005 495 7,4%
2006 525 6,1%
2007 553 5,3%
2008 575 4,0%
2009* 540 -6,1%
2010* 550 1,9%
Loffre de ptroliers transporteurs de
produits
Lanne 2008 avait t une anne exceptionnelle
au niveau du nombre de navires entrs sur le
march. Les livraisons pour lanne 2009 sont
restes un niveau trs lev (13,2 millions de
tpl) mais la dmolition a permis denrailler le
phnomne de surcapacit endmique au
transport maritime de vrac liquide. Lvolution de
la taille moyenne des navires est plus marque sur
le march du transport de brut.
Les rendements journaliers qui ont atteint un pic
en septembre-octobre 2008 sont dsormais aux
alentours de zro sur certaines routes. Le march
sest redress lapproche de la fin danne 2009
pour mettre fin prs dune anne dun niveau
difficilement soutenable. Le march destination
de lAsie sest mieux port.
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
j
a
n
v
.
-
0
6
m
a
r
s
-
0
6
m
a
i
-
0
6
j
u
i
l
.
-
0
6
s
e
p
t
.
-
0
6
n
o
v
.
-
0
6
j
a
n
v
.
-
0
7
m
a
r
s
-
0
7
m
a
i
-
0
7
j
u
i
l
.
-
0
7
s
e
p
t
.
-
0
7
n
o
v
.
-
0
7
j
a
n
v
.
-
0
8
m
a
r
s
-
0
8
m
a
i
-
0
8
j
u
i
l
.
-
0
8
s
e
p
t
.
-
0
8
n
o
v
.
-
0
8
j
a
n
v
.
-
0
9
m
a
r
s
-
0
9
m
a
i
-
0
9
j
u
i
l
.
-
0
9
s
e
p
t
.
-
0
9
n
o
v
.
-
0
9
j
a
n
v
.
-
1
0
22,000 t (Diesel) UK/France
37,000 T (Ss Plomb) Cont/US
29,500 t (Nafta) NAF/Cont
30,000 t (Diesel) Sing/Japan
Le march des LR tankers
Les LR tankers disposent dune capacit de
chargement suprieure aux plus traditionnels MR
tankers avec un tirant deau comparable ce qui
leur permet daccder la plupart des ports en
Amrique du Nord ou en Europe.
Ces navires sont diviss entre les LR1 et les LR2
selon les capacits et les marchs.
Concernant les LR2, 41 navires ont t livrs en
2009 soit 41% de la flotte. Ce segment de march
relativement nouveau a t fortement privilgi.
Cet afflux de nouveaux navires a induit une chute
des taux des 2/3. Le transport de gasoil entre
Extrme-Orient et Europe ainsi que les
mouvements de naphta entre lEurope et lExtrme
orient ont permis de soutenir les volumes
transports.
Concernant les LR1 (ou Panamax tankers), 55
livraisons ont eu lieu en 2009, pour une flotte
totale de 425 navires (370 double coque et 45
simple coque). 87 navires sont par ailleurs en
commande.
En zone Atlantique, les difficults trouver des
volumes transporter a conduit une concurrence
accrue avec le segment de march infrieur : les
Medium Range. A linverse, lest de Suez, lentre
en service des raffineries indiennes a boost le
march.
-
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
30 000 000
35 000 000
end 1998 end 1999 end 2000 end 2001 end 2002 end 2003 end 2004 end 2005 end 2006 end 2007 end 2008 end 2009
Panamax Product Tankers (53-80K dwt) Eligible Fleet 1998-2009
non Eligible non DH DH
(Dwt)
Less than
25 years
Less than
15 years
Only
Double
Hull
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
14
Le march des MR tankers
Le segment des MR tankers constitue le cur du
transport de produits ptroliers occup jusquau
milieu des annes 90 par les Handy Tankers.
Ces navires dont la capacit est comprise entre
40000 et 60000 tpl sont pour la plupart revtus,
c'est--dire capables de transporter des produits
raffins.
La flotte est trs importante avec prs de 1100
navires dont 1020 double coque. En fin danne
2008, le carnet de commandes reprsentait
environ 50% de la flotte existante avec un ge
moyen de la flotte en service de 7ans. La taille
moyenne est en constante augmentation avec un
fort intrt pour les navires de plus de 50 000tpl.
La baisse conjoncturelle de la consommation
mondiale associe la baisse des importations
amricaines de ptrole. A lest de Suez, les
rendements ont t meilleurs en profitant de la
tension lie la zone de piraterie du golfe dAden.
-
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
30 000 000
35 000 000
40 000 000
45 000 000
50 000 000
end 1998 end 1999 end 2000 end 2001 end 2002 end 2003 end 2004 end 2005 end 2006 end 2007 end 2008 end 2009
MR Product (40 - 53K dwt) Eligible Fleet 1998-2009
non DH DH
(Dwt)
Less
than 25
years
Less than
15 years
Only
Double
Hull
Le march des Handy Tankers
La tendance du march est un remplacement
des Handy tankers (20 000 40 000tpl) par les MR
Tankers, ce phnomne est illustr par lge
relativement plus lev des Handy Tankers (plus
de 12 ans) et par un ratio double coque / simple
coque plus faible que sur les autres segments de
march (450/129).
Les rendements ont t assez contraints toute
lanne malgr une hausse lie aux tempratures
hivernales particulirement basses qui ont
bnfici aux navires Ice class .
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
15
4 LE TRANSPORT MARITIME DE GAZ
4.1 Le transport de gaz naturel liqufi
La progression exponentielle du transport de LNG
depuis le dbut des annes 2000 a connu un coup
de frein au cours des annes 2008-2009.
Les sous-jacents du dveloppement de la dernire
dcennie (la diversification gographique de
lapprovisionnement des sources nergtiques des
grands pays industrialiss ainsi que lvolution du
type doffre de produits nergtiques) sont
toujours prsents.
Nanmoins, le ralentissement de lconomie
mondiale a induit une baisse de la demande de gaz
naturel, phnomne comparable au secteur
ptrolier.
Loffre et la demande de gaz naturel liqufi
Lvolution des capacits de production, des
capacits portuaires (terminaux) et des capacits
de transport maritime (construction de navires
GNL) sont fortement intercorrls. Le montant des
investissements et la dure de mise en service
implique une coordination de toute la chane
logistique (de la production au transport). En cela,
il est intressant de suivre les phasages
douverture des sites de production pour anticiper
lvolution du march.
Par ailleurs, il existe parfois des dcalages entre la
mise en service des sites production de GNL et la
livraison des navires GNL. Les navires tant
souvent conu pour un service spcifique, on peut
assister des dcalages offre/demande qui ont
une influence importante sur les taux de fret.
Pour 2009, la tendance est en ligne avec les 2
annes prcdentes, cest--dire une quasi
stagnation des volumes transports. Lanne 2010
semble plus porteuse du fait dune conjonction de
signes positifs. La reprise de la croissance
mondiale aura bien sr un impact sur le secteur
mais ce sont principalement la mise en service des
capacits dimportation et de production qui vont
tirer les volumes dchanges.
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
LNG (mt)
Projets de sites de production
Ltat du portefeuille de projets GNL engags et
pour lesquels la dcision finale dinvestissement a
t prise ne diminue pas. Ainsi la capacit de
production mise en service devrait tre denviron
100 millions de tonnes/an de liqufaction. En
Europe de lOuest notamment, la libralisation a
stimul les projets de terminaux gaziers terre
comme en offshore (par ex : projet Adriatic LNG).
Les projets au Qatar constituent prs de 40% des
capacits futures. Ils confirment la volont des
pays du Moyen Orient de conforter leur position
sur ce march et contribuent un nouvel quilibre
des flux entre zones.
Pour lanne 2009, 2 projets majeurs en Asie-
Pacifique retiennent lattention :
- Projet Gorgon en Australie (3x 5millions de
tonnes par an)
- Projet PNG en Papouasie Nouvelle Guine
(6.5 millions de tonnes par an)
Le ple Pacifique devient trs important pour les
capacits de production et cette tendance ne
devrait que samplifier en lien avec la vigoureuse
croissance conomique des pays proximit
(Chine, Inde.)
Dans les annes venir, les pays offrant les
potentiels les plus importants sont les pays Ouest-
Africains (Nigria), la Russie et le Qatar. De
nombreux pays prvoient de dvelopper leur projet
dimportation grce des navires de regazification
(Argentine)
Le graphique ci-aprs compare les carnets de
commande des navires avec les projets de
production de LNG et illustre le dcalage entre les
capacits de transport maritime et les capacits de
production. Nanmoins, ce dsquilibre devrait
sinverser partir de 2010 avec un net
retournement de tendance.
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
16
0
10
20
30
40
50
60
70
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
9 000 000
10 000 000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Cbm
Mtpa
LNG Projects v. Deliveries
Pending LNG Projects (Mtpa)
Firm LNG Projects (Mtpa)
Deliveries (Cbm)
Mtpa Cbm
La flotte de mthaniers
La flotte de mthaniers comprend actuellement
335 navires, les capacits globales offertes sont de
prs de 47 millions de m3. Les capacits restent en
progression marque (+13%) mais marquent
nanmoins un lger inflchissement du rythme de
croissance de plus de 20% au cours des 2
dernires annes.
Evolution de la flotte de mthaniers
0
10 000 000
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
60 000 000
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
*
Sphere
Autre
Membrane
39 navires sont actuellement en commande ce qui
est loin des chiffres des dernires annes.
Deux grandes technologies sont actuellement
utilises dans le secteur du transport de GNL :
- La technologie des sphres
Cette technologie a t fortement privilgie
jusqu la fin des annes 90. Aujourdhui seuls 2
chantiers japonais continuent construire ce type
de navire qui ne reprsentent plus que 10% du
march.
- La technologie des membranes
La membrane est la technologie la plus utilise
depuis le dbut des annes 2000. Elle prsente
lavantage dune exploitation plus facile et des
cots de construction moindre.
Les chantiers corens sont les principaux acteurs
sur le segment de la construction de mthaniers
mme si les chantiers chinois sont en train
dinvestir le secteur.
4.2 Le transport de gaz de ptrole liqufi et
de gaz chimiques
Le gaz de ptrole est issu de deux processus de
production diffrents lun bas sur le raffinage
ptrolier, et lautre en tant que produit rsiduel de
lextraction de gaz naturel.
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
*
GPL (mt)
GPL (mt)
Pour lanne 2009, les volumes transports de GPL
ont subi une inflexion de plus de 7%, mais les
analystes prvoient un retour la croissance pour
2010.
Si lon analyse de manire plus globale lvolution
des volumes depuis le dbut des annes 2000, la
progression a t continue et 2009 constitue une
rupture de tendance.
La demande de GPL est fortement tire par les
besoins de chauffage et de production industrielle
et donc fortement corrle avec lactivit
conomique ce qui explique pour partie les chiffres
baissiers de 2009.
Le Moyen Orient domine les exportations
mondiales devant lEurope du Nord et des pays qui
confirment leur monte en puissance tels que
lIndonsie ou lAustralie.
La limitation de loffre de GPL pour lanne 2009
sexplique dune part par des retards de mise en
service de capacits de production et par des
problmes techniques dans certains pays
producteurs.
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
17
La flotte de gaziers GPL
Petits gaziers (3-12000 m3)
Les capacits de transport des petits gaziers
continuent de progresser avec plus de
2 600 000m3.
Ce segment a mieux rsist malgr un grand
nombre de livraisons en 2008. Les priodes de
non-emploi ont t beaucoup moins marques que
sur les segments de taille suprieure.
Gaziers (12-25000 m3)
Le segment des gaziers entre 12000 et 25000m3
est de moins en moins privilgi puisque les
capacits globales de ce type de navire sont en
baisse de 6%.
La crise conomique a fortement affect le secteur
de la ptrochimie largement utilisatrice de ce type
de navires.
La baisse des taux de fret a nanmoins t moins
marque que sur les autres marchs du fait dune
offre de capacits en diminution.
Gaziers (25-43000 m3)
Cette catgorie de navires voit ses capacits
globales proposes sur le march progresser de
plus de 20% et devraient atteindre 2 000 000m3
en 2010.
Ce segment a aussi souffert dun afflux de
constructions neuves en 2008 et 2009 qui a
perturb lquilibre du march. Ce march devrait
soffrir un lger bol dair avec la reprise du trafic
dammoniaque et de quelques contrats GPL.
Grands gaziers dont VLGCs
Un nombre significatif de grands gaziers sont
entrs sur le march en 2008-2009 pour atteindre
12 519 000m3 de capacit globale, mais lanne
2010 devrait marquer une dcrue.
La flotte actuelle de VLGCs comprend aux
alentours de 140 navires dont prs dun tiers de la
flotte a t livre en 2008 et 2009.
Lanne 2009 a t particulirement difficile pour
les VLGCs avec une demande moribonde et des
livraisons qui ont accentu le dsquilibre
offre/demande.
Les navires dont les capacits se situent entre
43 000 et 60 000m3 ont souffert de la comptition
des navires de taille voisine.
-
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
Grands Gaziers 50-85 000 m3
Gaziers 25-43 000 m3
Gaziers 12-25 000 m3
Petits gaziers 3-12 000 m3
Le march des frets du gaz de ptrole
Le dsquilibre offre/demande du march avec des
capacits limites et une arrive massive de
nouveaux navires commands entre 2006 et 2008
a induit une certaine volatilit du march. Ces
facteurs sont variables selon les segments de
march.
Si lon rentre dans le dtail des taux de fret par
type de navire, les VLGCs ont progress de 60%
entre dcembre 2008 et dcembre 2009 alors que
les segments infrieurs ont connu des baisses
entre 12 et 37%.
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
18
5 LE TRANSPORT DE VRAC SEC
5.1 La demande de transport de vrac sec
Bien que moins impressionnant que dans le
secteur des biens manufacturs
conteneuriss, la croissance des changes de
marchandises transportes en vrac sec a t
trs forte durant la dernire dcennie.
Minerai de fer
Incontestablement, lorigine de ce dynamisme de
la demande de transport se trouve en Chine. Entre
2000 et 2008, la production dacier y a presque
quadrupl, gnrant en consquence une
demande de fer trs importante. Entre 2003 et
2009, les tonnages de fer transports par voie
maritime ont cru un rythme annuel de plus de
10%.
Les proportions de la demande de transport entre
les 6 principales marchandises taient en 2009 les
suivantes : 43% pour le minerai de fer, 28,5%
pour le charbon thermique, 12% pour les crales,
11% pour le charbon sidrurgique et 5% pour la
bauxite et le phosphate runis. Lactivit
sidrurgique reprsente donc aujourdhui plus de
54% du march puisque les utilisateurs de fer et
de charbon sidrurgiques sont identiques. Cette
part est en progression depuis lan 2000 (elle
reprsentait alors 49%) et sest fait principalement
au dtriment de la part des crales qui est en
baisse quasiment constante depuis les annes
1990.
Les annes 90 avaient t marques par une
croissance modre de la demande de transport
maritime qui tait entraine par la hausse des flux
de transport de charbon thermique. La
libralisation des marchs de llectricit dans
certains pays occidentaux avait entrain un besoin
important pour ce combustible dont lutilisation
requiert peu dinvestissement.
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
DEMANDE DE TRANSPORT MARITIME DE VRAC SEC
Phosphate
Bauxite
Grain
Charbon thermique
Charbon sidrurgique
Minerai de fer
m. tonnes
(6 principales marchandises uniquement)
Incontestablement, la dcennie suivante fut
marque par la croissance de la production
sidrurgique. Comme nous lavons mentionn plus
haut, cette activit a connu un bond vertigineux en
Chine. Ce pays, plus que tout autre, a entrain la
production mondiale dacier dans une ascension
vertigineuse. En 2000, la production mondiale
slevait 850 millions de tonnes mtriques dont
127 millions pour la Chine. Juste avant la crise
conomique mondiale en 2007, les sidrurgistes du
monde ont produit 1 350 millions de tonnes dont
489 millions uniquement en Chine. On mesure
ainsi la contribution de lindustrie chinoise la
croissance de ce secteur dactivit. La crise
conomique qui a clat la mi-2008 a entrain
une chute considrable de la production mondiale
dacier. En quelques mois, les sidrurgistes ont
considrablement rduit leurs activits avec une
chute globale de 30% de la production mensuelle.
Si les pays occidentaux ont t les plus fortement
touchs avec des baisses avoisinant les 50%, lAsie
na pas t pargne par cette situation.
Nanmoins, ds le dbut de lanne 2009, la
sidrurgie chinoise, aide par un ambitieux plan de
relance du gouvernement, sest redresse au point
de battre nouveau des records de production au
milieu de lanne. La sidrurgie devrait rester au
cur des enjeux du transport maritime dans les
annes venir.
De fait, le minerai de fer est devenu la premire
marchandise transporte dans le secteur du vrac
sec. Il sest dautant plus dvelopp que la Chine,
qui parvenait tre presque auto suffisante aussi
bien en charbon quen minerai de fer dans les
annes 90, a du rapidement importer ce dernier
lment faute de ressources suffisantes sur son
territoire. LAustralie est le premier fournisseur de
la Chine avec une part reprsentant prs de 40%
de ses importations, elle a t en mesure
daugmenter considrablement ses capacits
dexportations ces dernires annes. Suivent
ensuite lInde et surtout le Brsil qui tend devenir
un acteur des plus importants dans le jeu des
importations chinoises. La volont chinoise de
rduire sa dpendance vis--vis de lAustralie la
pousse rechercher de nouveaux fournisseurs
mme si ceux-ci sont plus loigns
gographiquement.
LAustralie, le Brsil et lInde sont aujourdhui, les 3
principaux exportateurs de minerais mondiaux
avec respectivement des tonnages de 329, 270 et
114 millions de tonnes en 2009. Ces Etats seront
au cur des futurs dveloppements du march du
fer grce leurs impressionnantes rserves. Les 3
grandes compagnies productrices, les australiens
BHP Billiton et Rio Tinto et le brsilien Vale
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
19
contrlent de facto une large part de la production
mondiale. Du fait de la pression sur la demande de
minerais ces dernires annes, elles sont
actuellement en mesure dimposer des conditions
tarifaires plus favorables leurs yeux dont la
principale manifestation est la volont rpte
dobtenir une nouvelle base contractuelle pour le
prix du fer (fixation trimestrielle et non plus
annuelle).
Dans cette nouvelle donne mondiale, les
importations sont restes relativement stables
(prs de 150 millions de tonnes par an) avant de
chuter de faon brutale en 2009 suite la crise
conomique (environ 100 millions de tonnes). Ces
importations proviennent largement du Brsil qui
reprsente plus de 50% du tonnage global. Le
Canada, la Sude et la Mauritanie fournissant la
majeure partie des volumes restants.
Charbon
De son cot, le transport maritime de charbon na
pas connu une phase dexpansion aussi forte que
le minerai de fer. La croissance des volumes y a
t beaucoup modre aussi bien dans le charbon
thermique que sidrurgique.
En dpit de la crise conomique survenue en
septembre 2008, les exportations de charbon ont
continu de progresser. Si la croissance annuelle
moyenne des volumes stait tablie 7% durant
la priode allant de 2003 2007, le ralentissement
conomique a ralenti la progression 3% en 2008.
Les pays exportateurs connaissent actuellement
des fortunes diverses. Les plus fortes variations
concernent lAfrique du Sud, fournisseur
traditionnel des pays europens, qui a vu ses
volumes baisser ces dernires annes du fait de
problmes oprationnels dans lexploitation et
lacheminement du charbon, et les Etats Unis qui,
profitant dun dollar relativement faible ces
dernires annes, ont largement augment leurs
exportations.
Mais les 2 principaux acteurs mondiaux restent
lAustralie qui dispose de rserves gigantesques et
lIndonsie dont lextraction est en plein essor et
qui est proche de devenir le premier exportateur
mondial.
Du cot de la demande de charbon, les plus
grandes volutions se trouvent une nouvelle fois
en Chine. Alors que la Chine ntait un importateur
net de charbon que depuis 2007 (compte tenu de
sa gigantesque production qui lui permettait dtre
autosuffisante), lanne 2009 a t marque
partir du 2
me
trimestre par un dcollage
vertigineux des importations qui ont atteint 126
millions de tonnes sur lanne, soit 15% des
importations mondiales. Dans un contexte de crise
conomique mondiale, cette nouvelle demande a
permis une lgre progression des tonnages
transports de charbon. Les prvisions laissent
penser que le pays pourrait prendre ds lanne
2010 la premire place des pays importateurs de
charbon devant le Japon. Ce nouveau leadership
pourrait bien redistribuer les cartes des grandes
routes maritimes du charbon : si lAustralie et
lIndonsie ont t en capacit en 2009 de ragir
face cette demande, lavenir reste incertain et
dpendra des capacits des pays adapter leur
production.
Crales
Le secteur des crales est celui qui a enregistr la
progression la plus faible au cours de la dcennie.
Si la saison 2007/2008 a t relativement riche en
terme dchange avec 244 millions de tonnes
transports, les volutions restent relativement
faibles compares au minerais de fer et au
charbon. A titre comparatif, les volumes taient de
220 millions en 2000. Les volutions de ces
changes restent fortement des conditions
techniques, politiques et mtorologiques des
productions agricoles des zones de cultures ce qui
engendre une certaine volatilit des changes.
Les principales zones dexportation en 2009 taient
les USA (80Mt), lArgentine (11Mt), le Canada 19,5
(Mt), lAustralie (17,5Mt), et lUE (21,5Mt). Si
dimportantes variations saisonnires peuvent
modifier les flux, ces 5 rgions sont toujours en
tte. Les changes mondiaux de crales se
rpartissent principalement entre le bl, le mas,
lorge et le riz. Mais le transport maritime
nintervient que sur une part limite de la
production mondiale de crales puisque la
production mondiale annuelle slve environ
1 700 millions de tonnes annuelles.
Le Japon reste le premier importateur de crales
avec prs de 25Mt de tonnes par an
(essentiellement du mas), suivi par la Core du
Sud et lEgypte avec chacun entre 11 et 13Mt, puis
viennent ensuite lArabie Saoudite (10Mt), le Brsil,
lAlgrie et lIndonsie dont les besoins sont
compris entre 6 et 10Mt.
Les petits vracs
A ct des grands vracs tels que nous avons pu les
dcrire ci-dessus, coexistent de nombreuses
marchandises sches transportes dans des
navires de vrac tels que, la bauxite et lalumine, le
phosphate, le nickel, le cuivre, mais aussi les aciers
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
20
et la ferraille, le ciment, les produits forestiers ou
le sucre.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
(en M. de tonnes)
Demande de transport de "petits vracs"
Sucre
Tourteaux de
soja
Ciment
Engrais (excl.
Phosphate)
Produits
forrestiers
Acier et
ferrailles
En termes de tonnages ce sont les aciers et la
ferraille qui occupent la premire place avec plus
de 200 millions de tonnes transportes. Ils
reprsentent pratiquement les mmes tonnages
que les trafics de crales mais ceux-ci sont
essentiellement sur des navires de taille infrieure
40 000 tpl et sur des liaisons intra-rgionales.
Viennent ensuite les produits forestiers
(notamment les grumes) qui comptent pour
environ 170 millions de tonnes, la bauxite et
lalumine (70 mt), le ciment, (60 mt), le sucre (45
mt) et le phosphate (30 mt).
5.2 - La flotte de vraquiers
Si lon englobe tous les navires de vrac dune taille
suprieure 15 000 tpl, la flotte au second
trimestre 2010 se composait de 7 196 navires pour
un port en lourd total de 477 millions tonnes. La
rpartition par tranche de taille est la suivante :
Handysize (15-40 000 tpl) 2 547 navire pour 72,6
millions de tpl, Handymax (40-60 000 tpl) 1 922
navires pour 95,3 millions de tpl, Panamax (60-
80 000 tpl ou <32,3m larg.) 1 535 navires pour
118,8 millions de tpl et enfin Capesize (>80 000 tpl
et >32,3 m larg.) 1 192 navires pour 197,3 millions
de tpl. Malgr leur nombre plus faible, ce sont les
Capesize qui reprsentent la catgorie la plus
importante en terme de tonnage dans la flotte des
vraquiers avec une part de plus de 41,4%.
Capesize
La dfinition dun vraquier Capesize repose sur son
incapacit franchir le Canal de Panama, cest
dire, un navire de plus de 32,3 m de large. Mais le
segment inclut une large palette de tailles (de
80 000 plus de 300 000 tpl) et nous verrons
lorsque nous aborderons le segment des Panamax,
que la distinction entre les deux catgories est de
plus en plus complexe effectuer.
Les Capesize reprsentent le navire de rfrence
dans le transport de vrac sec. Disposant des plus
grandes capacits de transport, leur utilisation est
concentre sur les produits faisant lobjet des flux
les plus importants, savoir le minerai de fer et le
charbon.
0
20 000 000
40 000 000
60 000 000
80 000 000
100 000 000
120 000 000
140 000 000
160 000 000
en
commande
< 5 ans 5 9 ans 10 14 ans 15 19 ans 20 24 ans 25 et plus
FLOTTE CAPESIZE PAR CLASSE D'GE
tpl (>80 000 tpl ou >=32,3m larg.)
882
navires
427
188
173
195
127
82
Age moyen = 11,1 ans
La flotte de Capesize est actuellement en pleine
mutation. Les taux de fret record enregistrs pour
ce type de navire ont entrain une vague de
commandes considrable. Le carnet de
commandes reprsente aujourdhui 74,8% des
capacits de la flotte en service. Ce chiffre est
dautant plus impressionnant que les navires qui
pourraient tre ligibles la dmolition sont
linverse relativement peu nombreux (la capacit
des navires de plus de 25 ans reprsente 6% de la
flotte). Les premires livraisons lies
lengouement pour la construction de capesize ont
dj eu lieu comme en tmoigne limportance des
navires rcents au sein de la flotte et devrait se
poursuivre au moins jusquen 2012. Cependant, la
capacit du march intgrer cette flotte reste
une incertitude. La chute des taux de fret a
entrain un certain nombre dannulations ou de
reports de livraison. De telles pratiques pourraient
perdurer dans les annes venir.
Jusqu la vague de commandes, le march des
navires over-panamax pour le transport de vrac
tait trs largement domin par le segment des
Capesize standardiss entre 120 000 et 220 000
tpl. Si cette situation ne sera pas compltement
remise en cause (ce segment de taille conservera
une supriorit en termes dunits et de capacits)
mais nous avons assist ces dernires annes de
nouveaux segments de la flotte.
Le dveloppement de routes maritimes de plus en
plus longues (tel que celle entre le Brsil et la
Chine) a pouss les armateurs rechercher des
conomies dchelle. Ds 2007, des commandes
ont t pass pour des navires dune capacit
largement suprieure 300 000 tpl alors que ceux-
ci taient inexistants auparavant. La reconversion
de VLCC simple coque en VLOC a galement t
pratique durant cette priode : 40 VLCC pour 10
millions de tpl ont ainsi t transforms pour le
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
21
transport du vrac sec. La flotte de VLOC est
compose actuellement de 93 navires pour 25
millions de tpl avec un carnet de commandes de
106 navires pour 33 millions de tpl.
Ces navires seront pour lessentiel exploits
destination de la Chine qui concentre aujourdhui le
nombre le plus important de terminaux VLOC au
monde (10 dont 3 acceptants des navires de plus
de 300 000 tpl).
A lautre extrmit de la flotte des Capesize, on
trouve un segment qui tait galement trs rduit
par le pass. De nombreuses commandes ont t
ralises pour des navires dun design over-
panamax (80 000 tpl ou largeur>32,2m) mais ne
dpassant pas les 120 000 tpl. Lorigine de
lmergence de ces navires correspond aux
anticipations concernant llargissement du canal
de Panama. Prvue pour 2015, louverture des
nouvelles cluses devrait permettre ces navires
demprunter ce passage. Actuellement, 197 navires
dit small panamax sont en service pour 18,5
millions de tpl. Le carnet de commande slve
quand lui 309 navires pour 30,5 millions de tpl.
Panamax
Les Panamax constituent une flotte prsente sur
des trafics plus diversifis. Contrairement aux
Capesize, on retrouve ces navires sur dautres
trafics que le minerai ou le charbon tels que le
grain, la bauxite et le cuivre. Ces navires ne sont
pas grs, ce qui leur impose la desserte de ports
suffisamment bien quips et disposant dun tirant
deau suffisant (14 15m).
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
30 000 000
35 000 000
40 000 000
45 000 000
en
commande
< 5 ans 5 9 ans 10 14 ans 15 19 ans 20 24 ans 25 et plus
FLOTTE PANAMAX PAR CLASSE D'GE
tpl (60 000 80 000 tpl ou <32,3m larg.)
532
navires
351
333
287
170
131
263
Age moyen = 13,4 ans
La flotte de Panamax actuellement en service
slve 1 535 navires pour un total de 112
millions de tpl. Cette flotte se distingue cependant
des autres flottes par un renouvellement moins
spectaculaire que les autres. En effet, avec 532
navires en commande (41 millions de tpl), elle ne
reprsente que 36,7% de la flotte actuellement
en service. De plus, les navires potentiellement
ligibles la dmolition sont relativement
nombreux avec 263 Panamax de plus de 25 ans
(17,5 millions de tpl soit 15,7% de la flotte en
service). Lors de la chute des taux de fret fin 2008,
une vague de dmolition de Panamax avait alors
eu lieu avec des dmolitions approchant les
livraisons dalors. Cette situation sest nanmoins
retourne avec la reprise de lactivit pour ces
navires.
Car les livraisons de ces navires sont restes
jusqu prsent relativement stables (aux alentours
de 1,25 millions de tpl par trimestre) durant ces
dernires annes et cette flotte a pu apparaitre
certains moments comme proposant une offre plus
rduite que dautres, ce qui a eu un effet positif
sur ces taux de fret durant ces derniers trimestres.
Mais le rythme de livraisons devrait
considrablement sacclrer durant le second
semestre 2010.
Comme nous lavons vu plus haut, une partie de la
raison dtre de cette flotte pourrait sestomper
dans les annes venir avec llargissement du
canal de Panama mais galement par la
concurrence de navires de plus petite taille qui ont
les faveurs des armateurs. Reste que ces navires
sont toujours adapts pour de nombreux ports
aujourdhui.
Handymax
Lengouement pour ces navires dont la taille se
situe entre 40 000 et 60 000 tpl est relativement
rcent et sexplique par lmergence de trafics
intra-rgionaux. A linverse des navires cits plus
haut, les Handymax (galement nomm
Supramax) disposent gnralement dune
manutention bord leur permettant des escales
dans un large nombre de ports. On retrouve ces
navires sur des trafics trs varis et assez similaire
au Panamax, avec la diffrence quils se
concentrent sur des distances plus courtes. Ils sont
particulirement utiliss pour les trafics intra-Asie.
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
30 000 000
35 000 000
40 000 000
45 000 000
50 000 000
en
commande
< 5 ans 5 9 ans 10 14 ans 15 19 ans 20 24 ans 25 et plus
FLOTTE HANDYMAX PAR CLASSE D'GE
tpl
(40 000 60 000 tpl)
798
navires
600
407
337
166
161
251
Age moyen = 11,8 ans
La vritable mergence de cette classe de navires
date de la seconde moiti des annes 90. On a
depuis assist une monte en puissance
progressive qui conduit faire de cette flotte une
des plus dynamiques quil existe.
Elle est aujourdhui compose de 1 922 navires en
service pour 95 millions de tpl mais plus de la
moiti de la flotte et de la capacit en service
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
22
moins de 10 ans. Sa croissance devrait tre
particulirement forte dans les annes venir
puisque le carnet de commandes est compos de
pas moins de 798 navires pour un tonnage total de
45 millions de tpl, soit 47,2% de la flotte actuelle !
Il existe une marge rduite de rduction de la
flotte dans la dmolition puisque les navires de
moins de 25 ans ne sont que 251 (11 millions de
tpl soit 11,7% de la flotte en service). Ces navires
taient autrefois considrs comme le haut du
segment des navires handysize et sont donc
gnralement dune taille plus faible que les
navires actuellement construits.
A limage des capesizes, ces navires ont fait lobjet
dune frnsie de commande similaire durant la
priode de hausse des taux de fret. Entre dbut
2007 et mi 2008, 811 nouvelles commandes
dhandymax ont t ralises. Ce chiffre est par la
suite tomb zro compte tenu des incertitudes
sur un march qui peut montrer des signes de
surcapacit lavenir. Cependant, la trs forte
baisse des cots la construction a de nouveau
attir quelques armateurs vers les chantiers
partir du second semestre 2009.
Handysize
Les Handysize constituent un type de navire
prsent dans lensemble des zones gographiques.
Son principal avantage rside dans ses capacits
nautiques qui lui permettent un accs dans
quasiment dans tous les ports. De fait, ces navires
sont quasiment tous grs pour rpondre aux
besoins de petits ports faiblement quips.
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
30 000 000
35 000 000
en
commande
< 5 ans 5 9 ans 10 14 ans 15 19 ans 20 24 ans 25 et plus
FLOTTE HANDYSIZE PAR CLASSE D'GE
tpl
(15 000 40 000 tpl)
690
navires
443
250
338
143
250
1123
Age moyen = 19,8 ans
Cette flotte comporte le plus grand nombre
dunits du march du transport de vrac sec, avec
2 547 navires en service (pour un tonnage global
de 73 millions tpl). Les Handysize se distinguent
par la structure de leur flotte : elle est compose
dun trs grand nombre de navires
particulirement gs. Plus de 1 200 navires ont
plus de 25 annes de service (1 373 si on compte
partir de 20 ans). Si on considre que cette flotte
est susceptible de sortir du march dans les
annes venir, cela reprsenterait 43,8% du
tonnage en service actuellement. A lautre bout de
la flotte, les commandes ne sont pas la hauteur
de ces sorties potentielles. Mais avec 690 navires
(22 millions tpl, 30,7% de la flotte en service) qui
sont actuellement en commande, cette flotte a
nanmoins profit de lenvole des commandes de
navires pour le vrac sec.
Taux de fret
La priode rcente a incontestablement t
marque par un cycle exceptionnel pour les taux
de fret de vrac sec. A partir de la fin 2003, des
records ont rgulirement t battu et les taux se
sont maintenus des niveaux levs jusqu la mi-
2008.
Cette situation reposait sur plusieurs facteurs.
Du cot de loffre, la priode prcdente avait t
marque par de relativement faibles commandes
qui ne permettaient pas de faire face une hausse
soudaine de la demande. Dautre part, lorsque
cette demande a surgi et que les premires
hausses de fret ont t constates, les armements
ont eu du mal placer de nouvelles commandes :
les chantiers ont donn priorit aux commandes de
ptroliers et de porte-conteneurs.
Or, cest prcisment ce qui sest produit : les
demandes de matires premires ont t
particulirement fortes durant cette priode.
Comme nous lavons vu, les besoins industriels de
la Chine et du sud est asiatique en gnral ont
largement contribu ce phnomne avec
dimportant trafic de fer et de charbon. De plus, les
sources dapprovisionnement de cette rgion ont
t de plus en plus loignes contribuant
accroitre encore davantage la demande de
transport maritime. Enfin, en corolaire cette
situation, la congestion portuaire a atteint des
records durant cette priode contribuant du mme
coup rduire loffre dans un march tendu.
Tous les ingrdients ont donc t runis pour
entrainer une forte hausse des frets. A la fin de
lanne 2003, le taux daffrtement dun Capesize
sest rapidement lev pour dpasser les
80 000$/j. Jusquen 2006, il voluera un niveau
compris entre 30 000 et 70 000$/j. Une nouvelle
envole aura lieu partir de 2007, le taux
daffrtement se maintiendra pendant plus dun an
au dessus de 100 000$/j et dpassant mme
momentanment le seuil des 200 000$/j en mai
2007.
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
23
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
janv.-01 janv.-02 janv.-03 janv.-04 janv.-05 janv.-06 janv.-07 janv.-08 janv.-09 janv.-10
US$ / tonne
Taux de fret au voyage - Vrac sec
Capesize Tubarao / Rotterdam (Minerai)
Capesize Gladstone / Rotterdam (Charbon)
Panamax Richards Bay / Le Havre (Charbon)
Durant le second semestre de 2007, le secteur
sera rattrap par la ralit de la crise. La brutale
chute de la demande de transport lie la baisse
de lactivit industrielle et larrive massive de
nouveaux navires sur le march a entrain une
chute spectaculaire. En novembre 2008, le taux
daffrtement dun Capesize stablissait en
moyenne moins de 4 000$/j ! Un niveau qui ne
permet pas de couvrir les frais dexploitation du
navire.
Dans ces conditions, les perspectives pour lanne
2009 apparaissaient bien sombres. Avec de trs
nombreuses livraisons prvues durant lanne et
une conomie mondiale en plein marasme, on
pouvait alors sattendre des niveaux de fret
particulirement bas. Mais contre toute attente, un
rebond de lactivit a eu lieu au milieu de lanne
et a permis une forte remonte de taux de fret. En
juin 2009, laffrtement dun capesize seffectuait
un niveau moyen de 80 000$/j !
La raison dun tel rebond se trouve aussi bien au
niveau de loffre que de la demande. Echauds par
des taux particulirement bas au dbut de lanne,
de nombreux armateurs sont parvenus a repouss
les livraisons prvues au premier semestre : titre
dexemple pour les capesize, sur les 22,9 millions
tpl livrs en 2009, seuls 7,5 millions tpl taient
sorties des chantiers durant la premire moiti de
lanne. Dans le mme temps, la dmolition a fait
nouveau son apparition dans ce secteur avec une
sortie de flotte globale pour les vraquiers de 31,6
millions de tpl sur lanne 2009.
Alors que loffre ragissait avec une certaine
vigueur la baisse des taux de fret de la fin 2008,
la demande a affich une vigueur inespre. Les
matires premires ayant atteint leur plus bas
niveau depuis 2005, de nombreux acheteurs ont
t attir par cette opportunit. Au premier dentre
eux, les groupes industriels chinois qui ont effectu
des achats massifs la fois pour rtablir leurs
stocks bas prix mais galement pour rpondre
une demande intrieure nouveau en croissance
suite au plan de relance massif du gouvernement
chinois. Cette nouvelle demande sest galement
manifeste sur des routes maritimes plus longues.
Les taux de fret relativement bas dans un premier
temps ont rendu les exportations de fer du Brsil
plus comptitives, notamment face lAustralie.
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
24
6 LES LIGNES REGULIERES
6.1 La situation du march
La baisse soudaine de la consommation dans
les pays occidentaux, en particulier les
Etats-Unis, mais aussi les pays dEurope de
lOuest, la suite de la crise conomique et
financire qui avait dbut au 3
me
trimestre
2008, a entrain une chute brutale de la
demande de transport conteneuris sur tous
les grands marchs. Cette chute des volumes
transports a de plus concid avec une
augmentation importante de la capacit de
transport mise en ligne par les oprateurs
maritimes qui avaient anticip que la
croissance des volumes enregistre depuis
2003 se maintiendrait jusqu la fin de la
dcennie.
La conjonction de ces lments a fait de 2009 la
pire anne quait connue lindustrie du transport
conteneuris depuis ses dbuts dans les annes
60. En effet, alors que les principaux marchs
conteneuriss, ceux reliant lExtrme Orient aux
conomies dveloppes avaient connu des
augmentations de volume annuelles suprieures
15%, la crise conomique et financire a eu un
impact considrable sur les flux des deux marchs
principaux, les trafics en sortie dAsie vers lEurope
et en sortie dAsie vers lAmrique du Nord, qui ont
subi une baisse de 15 % et de 7 %
respectivement. Le march transatlantique, dj
atone les annes prcdentes, a lui aussi chut de
25 % du fait de la faiblesse du US$.
Cette baisse des volumes transports sest
accompagne sur ces secteurs dune chute brutale
des taux de fret par rapport 2008, du fait de la
concurrence effrne que se sont livr les
oprateurs dans la premire moiti de lanne afin
de remplir leurs navires ou tout au moins de
prserver leurs parts de march.
Ce phnomne peut avoir t amplifi sur les
routes Asie/Europe par la fin des Confrences
Maritimes et linterdiction faite aux armements de
fixer en commun les taux de fret.
Les volumes Nord Sud ont moins souffert de la
crise mais nont pas progress en 2009, seul le
march intra asiatique, tir par la demande
chinoise, a connu une croissance de 3%.
Les grandes routes maritimes
conteneurises
Les grands secteurs du transport conteneuris sont
toujours en 2009 le transpacifique, la route
Asie/Europe (Nord et Mditerrane), le
transatlantique et le trafic intra Asie. Depuis le
dbut des annes 2000, la croissance du trafic
mondial en conteneurs est tire par les
exportations de la Chine qui reprsentent 70 %
des volumes en sortie dAsie, principalement vers
lEurope et lAmrique du Nord. Ces secteurs on
connu dans cette priode une augmentation de
leurs volumes de 15 et 10 % respectivement par
an, ce qui a motiv les investissements normes
raliss par les armateurs. La rcession soudaine
renvers la tendance en 2009 sur ces deux routes
maritimes, seul le trafic intra Asie connaissant une
progression de ses volumes.
Lvolution de la demande dans les annes venir
est pour une grande part lie la rapidit de la
reprise de la consommation aux Etats-Unis et en
Europe.
La chute des volumes a eu pour consquence un
effondrement des taux de fret, la caractristique
de ceux ci tant une trs forte sensibilit la
conjoncture : une dgradation mme mineure du
rapport entre offre et demande rsulte
immdiatement en une baisse prononce des taux
de fret ngocis entre chargeurs et armateurs. La
baisse des taux de fret a de plus t amplifie par
la diminution des surcharges combustible faisant
suite la baisse du prix du ptrole partir de lt
2008.
La baisse des taux de fret a t particulirement
proccupante sur les liaisons en sortie dAsie vers
lEurope et lAmrique du Nord. Cest en effet pour
ces routes que sont calibrs les principaux
investissements des armateurs en navires et sur
celles-ci quils ralisent leurs profits, les trajets
retours vers lAsie ne pouvant tre au mieux
considrs que comme servant au
repositionnement des conteneurs, tant les volumes
et les taux de fret sont bas. Il convient dailleurs
ce sujet de noter que cette situation structurelle de
dsquilibre des flux aboutit au fait que les
exportateurs europens et nord amricains sont
subventionns par les consommateurs de leurs
pays respectifs, seuls les flux et les taux de fret en
sortie dAsie justifiant la qualit et le nombre des
services maritimes en place.
Par ailleurs, les effets de la suppression au 3
me
trimestre 2008 par la Communaut Europenne de
la drogation au droit de la concurrence dont les
Confrences Maritimes (organes de concertation
des armateurs et oprateurs maritimes cres au
19me sicle et organisant le secteur des lignes
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
25
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Evolution du trafic conteneuris (en M d'evp
Europe /Asie
Asie/Europe
Europe/Am. du Nord
Am. du Nord /Europe
Am. du Nord/Asie
Asie/ Am. du Nord
rgulires : rpartition des services maritimes et
des parts de march, dtermination des taux de
fret et des surcharges, change dinformation sur
les volumes de trafic, arbitrage des conflits etc..)
jouissaient sont difficiles chiffrer mais cette
suppression a certainement contribu
leffondrement des taux de fret constat en 2009.
Cette volution de la rglementation, destine
accroitre la transparence des prix du transport
maritime, ne peut que renforcer la concurrence
entre les compagnies et terme oprer une
slection entre celles-ci, les plus faibles ne pouvant
pas rsister cette nouvelle pression
concurrentielle.
Containerization International & ELAA
Asie Europe
- Volumes
La chute des volumes a t particulirement
sensible entre lAsie et lEurope du fait du coup
darrt port la consommation des mnages
par la crise conomique. Les trafics se sont
pratiquement effondrs durant les 2 premiers
trimestres, avec une baisse de, respectivement
18 % et 23 % par rapport aux trimestres
correspondants de lanne 2008. Une amorce
de reprise sest cependant fait sentir ds le
3
me
trimestre du fait dun retour de la
demande pour de nombreux biens de
consommation, tels les produits
technologiques, cette reprise tant conforte
par le niveau lev de luro. En consquence,
lanne a mieux fini quelle avait commenc, le
4
me
trimestre tant au mme niveau que le
trimestre correspondant en 2008 (il convient
cependant de remarquer que les effets de la
crise conomique se faisaient dj sentir au
4
me
trimestre 2008). Sur un rythme annuel, la
baisse des volumes a t de prs de 15 %.
En ce qui concerne les trafics entre lEurope et
lAsie, les volumes aprs avoir t mdiocres
durant le 1
er
semestre se sont affermis durant
le 2
me
semestre prsentant mme une hausse
de 29 % au 4
me
trimestre, par rapport au
trimestre correspondant de 2008. En rythme
annuel, la croissance a t de 4,5 %. Cette
amlioration ne doit pas cependant pas faire
oublier le dsquilibre considrable des
changes, le ratio ayant t en 2009 de 2
conteneurs exports dAsie vers lEurope pour
1 dans le sens contraire (Ce ratio tait de 3
pour 1 au plus fort de la conjoncture en 2008)
- Frets
La chute des taux de fret en sortie dAsie vers
lEurope a t vertigineuse au dbut de lanne
2009, ceux-ci stablissant un niveau moyen
de 1023 US$ par EVP au 1
er
trimestre par
rapport un niveau de 2030 US$ par EVP au
1
er
trimestre 2008, soit une baisse de prs de
50 %. Ce niveau est rest stable jusquau 4
me
trimestre ou une amlioration a commenc
se faire sentir du fait de laugmentation des
volumes. Sur un rythme annuel, la baisse des
taux de fret a t de 40 % par rapport 2008.
En ce qui concerne les taux en sortie dEurope
vers lAsie, la chute a t moins forte, de
lordre de 25 %, mais sur des taux de fret dj
trs bas.
Transpacifique
- Volumes
Les volumes entre lAsie et lAmrique du Nord
ont trs fortement baiss en 2009, dans la
continuit du second semestre 2008, la crise
de limmobilier aux Etats-Unis ayant donn un
coup darrt la consommation des mnages,
qui tait le vecteur principal de la croissance.
La chute des volumes a t particulirement
forte au 1
er
semestre 2009, une lgre reprise
se faisant sentir durant le second semestre.
Sur un rythme annuel, la baisse des trafics
dans le sens Asie/Amrique du Nord a t de
7,3 %.
En sortie dAmrique du nord vers lAsie, les
volumes ont baiss malgr la faiblesse du US$,
ce qui illustre lincapacit du secteur industriel
nord amricain profiter dun taux de change
comptitif et de taux de fret bas pour relancer
ses exportations. Il faut dailleurs remarquer
que les exportations des Etats-Unis vers lAsie
sont essentiellement constitues de papiers et
cartons recycler et de produits agricoles
(coton et crales)
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
26
0
500
1000
1500
2000
2500
T1 08 T2 08 T3 08 T4 08 T1 09 T2 09 T3 09 T4 09
Evolution des taux de fret 2008/09 (en US$)
Asie/ Amriquedu Nord
Amrique duNord/ Asie
Europe/AmriqueduNord
Amrique duNord /Europe
Europe/Asie
Asie/Europe
- Frets
Sur le transpacifique, les taux de frets ont
souffert de la baisse des volumes mais dans
une moindre mesure que sur la route
Europe/Asie, la baisse ayant t de 28 % sur
lanne dans le sens Asie/Amrique du Nord et
de 18 % dans le sens Amrique du Nord/Asie
Transatlantique
- Volumes
Les volumes ont fortement baiss sur le
Transatlantique en 2009, la chute intervenant
principalement dans le sens Europe/Amrique
du Nord, du fait du niveau lev de lEuro par
rapport au US$, ce qui a renchri le cout des
importations dans un contexte de crise. La
baisse des volumes a t de 25 % en 2009,
mais il faut rappeler que les trafics avaient
dj chut de 28 % en 2008, ce qui illustre le
caractre sinistr de cette route.
Dans le sens Amrique du Nord/Europe, les
volumes ont baiss de 15 % alors quils
avaient augment de 23 % en 2008.
- Frets
Dans ce contexte morose, les taux de fret ont
subi une baisse importante dans le sens
Europe/Amrique du Nord, de lordre de 24 %
tandis quils se maintenaient dans le sens
Amrique du Nord/Europe en ne perdant que 3
%
Les changes Intra Asie
Les flux Intra Asie sont difficiles apprcier dans
la mesure o ils recouvrent des situations trs
diverses, du simple cabotage ctier la liaison au
long cours entre Asie du Nord Est et Asie du Sud
Est. Il est cependant intressant de noter que ces
flux ont progress de plus de 3 % en 2009, tirs
par la consommation chinoise, ce pays se
fournissant principalement dans la zone asiatique
pour lapprovisionnement de ses biens
intermdiaires et de consommation.
Les flux nord sud
Les trafics Nord/Sud sont relativement mineurs en
termes de volume et de matriel naval mis en
uvre. Ils prsentent cependant lintrt dtre
dans certains cas des trafics de niche
prservs dune concurrence trop vive (Carabes
ou Pacifique) ou des gisements potentiels de
croissance (Amrique du Sud et sous continent
Indien par exemple). Ils ont mieux rsist la
crise en 2009 que les grandes routes Est Ouest en
ne diminuant en moyenne que de 3 % par rapport
2008.
Source : Containerisation International
6.2 La situation de loffre maritime
La brutalit de la crise, succdant une longue
priode deuphorie dans le transport maritime, a
pris les armateurs et les oprateurs au dpourvu,
les obligeant revoir durgence leur stratgie de
dveloppement. Outre les mesures de court terme
telles que la re-dlivrance des navires affrts, la
mise la chaine des navires sans emploi, la
suppression de lignes et la diminution de la vitesse
de service, les oprateurs ont du revoir le niveau
de leurs commandes qui reprsentait en 2008 60
% de la flotte en service et risquait de crer un sur
tonnage massif.
- Diminution de la capacit de
transport sur les liaisons Est-Ouest
Le phnomne le plus marquant de lanne 2009 a
t la diminution massive de la capacit mise en
ligne par les oprateurs de lignes conteneurises.
Au cours des 17 mois qui se sont couls entre le
mois dAot 2008 (le pic du march) et la fin 2009,
la capacit sur les trois principales routes Est-
Ouest a chut de prs de 24 %, passant de 916
000 evp 700 000 evp par semaine.
Les liaisons les plus affectes ont t les routes
Asie-Mditerrane-Europe, qui ont enregistr des
rductions de capacit de 25 %, contre 21 % pour
la route Asie-Amrique du Nord. La chute de 25 %
sur les routes Asie-Mditerrane-Europe a eu un
impact significatif sur la baisse de la demande et
de lemploi de navires porte-conteneurs, en raison
de la distance plus importante que sur les liaisons
Asie-Amrique du Nord, ce qui implique quun plus
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
27
0
50
100
150
200
250
300
350
2009 2010 2011 2012
Nombre de navires VLCS/ULCS
10000/15500 evp
7500/10000 evp
grand nombre de navires est utilis pour effectuer
un service rgulier, en gnral hebdomadaire.
Pour ce qui est de la route Europe-Amrique du
Nord, loffre de tonnage a t ampute de 25 %,
cette dernire ne reprsentant toutefois que 30 %
de la capacit des deux autres principales routes
Est-Ouest.
Cette raction rapide des oprateurs face la crise
a vit leffondrement total des taux de fret et a
permis de limiter dans une certaine mesure les
pertes dexploitation mme si celles-ci sont restes
trs importantes. Cette discipline inhabituelle
montre par les oprateurs est dautant plus
paradoxale quelle correspondait dans le temps la
fin du systme confrenciel.
- Croissance de la taille des navires
Lanne 2009 a vu une acclration de la taille
moyenne des navires porte conteneurs. Il convient
de rappeler que la croissance de la taille moyenne
des navires est une donne fondamentale du
transport conteneuris. Dune capacit unitaire
denviron 1 000 evp la fin des annes 60, la taille
des porte-conteneurs na cess de crotre depuis :
les premires units dont la taille excdait les
dimensions des cluses de Panama ont t lances
la fin des annes 80 avec des navires denviron
4 500 evp et la barre de 10 000 evp a t franchie
en 2006 avec la livraison du Emma Maersk dune
capacit de plus de 14 000 evp. Les navires de
plus de 10 000 EVP reprsentent aujourdhui plus
de la moiti du carnet de commandes en termes
de capacit de transport. Une partie dentre eux
(dont la srie des Emma Maersk) ne pourra pas
franchir les nouvelles cluses de Panama, prvues
tre oprationnelles en 2015
Source :
BRS-Alphaliner
Seuls quelques ports en Europe, en Amrique du
Nord et en Asie sont capables daccueillir ces
navires. Les rotations mises en place avec ces
derniers impliquent donc la rduction du nombre
des ports desservis et le relais de services
secondaires (de feedering) sur les ports de
deuxime rang. Les armateurs ont
progressivement mis en place de vritables
plateformes de transbordement rgionales dont la
fonction est de servir de point dclatement de
multiples services intercontinentaux. Ces
plateformes nont bien souvent pas ou trs peu
darrire pays (hinterland) capable de gnrer ou
dabsorber du fret, elles sont quasi exclusivement
des outils logistiques au service de la productivit
des armateurs de ligne rgulire. (Ex. Gioia Tauro
et Algsiras pour AP Moller, Malte et Tanger pour
CMA CGM,..). Le contrle de ces outils est devenu
un lment cl de la stratgie des grands
armateurs.
Etat de la flotte
Au 31 Dcembre 2009, la flotte cellularise
comptait 4 719 navires totalisant 13 057 000 evp,
en augmentation de 5,6 % par rapport lanne
prcdente, soit la plus faible progression
enregistre depuis 10 ans. Pour mmoire, au 1
er
janvier 2000, la flotte de navires porte conteneurs
comprenait 2615 navires pour une capacit de
4 528 000 evp. La flotte a donc doubl en nombre
et tripl en capacit en 10 ans, le taux moyen de
croissance ayant t suprieur 10 % sur la
priode. Ces chiffres impressionnants illustrent le
formidable dveloppement du transport
conteneuris avec la mondialisation des changes
et la place toujours plus grande prise par la Chine
dans ceux-ci.
Cette volution de la flotte la fois quantitative
(nombre de navires) et qualitative (taille des
navires) est une caractristique importante du
transport conteneuris. Il est difficile de prvoir
aujourdhui si cette croissance de la taille des
navires va se poursuivre ou si lon a atteint une
taille maximum de ceux-ci.
Du fait des reports de livraisons, seuls 269 navires
pour 1 071 000 evp (soit 4 000 evp/navire) ont t
livrs en 2009. Les armateurs ont en effet utiliss
tous les moyens leur disposition pour ngocier
avec les chantiers le report dans le temps des
livraisons des navires commands. Ces
ngociations avec les chantiers navals ont aussi eu
pour objet dannuler ou de transformer en
vraquiers ou ptroliers les navires commands les
annes prcdentes pour livraison en 2010 et
2011 et dont la construction tait moins avance.
Paralllement ces mesures quantitatives, les
oprateurs ont procd une rvision qualitative
de leur flotte en privilgiant leurs navires les plus
gros et les plus modernes dans la refonte de leurs
services Est/Ouest, en particulier les navires de
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
28
plus de 10 000 evp qui avaient t commands
massivement en 2007 et 2008 (Il convient
dailleurs de noter que ces navires ne peuvent tre
utiliss que sur les routes entre lAsie et lEurope)
et en transfrant les navires plus petits sur les
services Nord/Sud, ces diffrents mouvements
permettant de rationaliser et de concentrer les
dessertes sur les routes principales.
Autre fait marquant, seules deux commandes de
navires cellulariss de 1 060 evp ont t
enregistres en 2009, ce qui ne stait pas vu
depuis la prcdente crise la fin des annes 90.
De plus, ces commandes ont t les seules
passes en 15 mois depuis le dbut de la crise
financire. Dans le mme temps, 350 000 evp ont
t retirs du carnet de commandes suite des
annulations ou des conversions de commandes de
porte-conteneurs en dautres types de navires,
vraquiers ou ptroliers. Le carnet de commandes
est tomb 4 720 000 evp au 1er janvier 2010,
soit 36 % de la flotte en service. Cette baisse est
trs significative par rapport au niveau historique
atteint la fin du 1
er
semestre 2008 avec 7 100
000 evp, lorsque le carnet de commandes
atteignait 60 % de la flotte en service suite aux
commandes massives de navires de 10 000 14
000 evp passes dans leuphorie gnrale par tous
les grands armateurs.
Le fait significatif est que ce carnet de commandes
est trs dsquilibr en faveur des navires de plus
de 4 000 evp, qui en reprsentent 90 % en
capacit. Les commandes de navires de plus de
4 000 evp reprsentent 55 % de la capacit de la
flotte en service, alors que les navires de tailles
infrieures nen reprsentent que 9 %.
Lafflux de grands navires a des consquences
directes sur la structure du march. La croissance
rapide de la flotte des navires de plus de 9 000 evp
a provoqu une acclration de la concentration
des services, en particulier sur les routes reliant
lExtrme-Orient lEurope du Nord. Ces navires
permettent de raliser des conomies dchelle et
dabaisser le cot de la cellule, notamment lorsque
le prix des soutes est lev.
Les oprateurs, surpris par lampleur du
retournement de la conjoncture en 2009, ont
vivement ragi face la croissance inquitante du
nombre de navires neufs de plus de 9 000 evp
(VLCS) inemploys durant les trois premiers mois
de lanne. Ils ont donc rorganis leurs services
afin damliorer les taux de remplissage, tout en
utilisant les navires les plus grands leur
disposition. Le nombre de VLCS immobiliss est
ainsi tomb de 24 units au mois de mars une
demi-douzaine au mois de juin. En employant au
maximum leurs plus grands navires, les oprateurs
bnficient ainsi d'conomies dchelle, dont l'effet
crot avec la hausse du prix des soutes. Les
oprateurs disposant d'importantes flottes de VLCS
et ULCS (14 000 evp) ont ainsi pu mieux rsister
aux effets de la crise, alors que les compagnies de
taille moyenne nayant pas la possibilit de mettre
en ligne des flottes homognes de grands navires,
ont subi tous les effets de celle ci. Le contre
exemple de cette dmonstration est cependant
Evergreen, qui avait fait le choix de ne pas
commander de navires de plus de 8 000 evp ni de
passer de commandes massives, et a en
consquence limit ses pertes au prix dune forte
rosion de ses parts de march.
Phnomne exceptionnel, en 2009 204 navires
pour 380 000 evp ont t dmolis (en 2008,
85 000 evp seulement avaient t dmolis (dont
52 000 durant le 4
me
trimestre). Lanne 2009
aura dcidment t une anne de rupture,
puisque une des caractristiques des navires porte
conteneurs tant leur longvit et la demande
ayant pratiquement t constante depuis leur
lancement, le niveau des dmolitions tait
traditionnellement extrmement faible, ne
reprsentant quun pourcentage infime des
arrives de navires neufs.
Ces retraits du march ont encore renforc le
caractre juvnile de la flotte de portes conteneurs
dont la moyenne dge est de 10 ans et seulement
de 7,7 ans si on rapporte la moyenne la capacit
(les navires les plus rcents tant aussi les plus
gros)
Stratgies face la crise
Devant lampleur de la crise, les oprateurs de
lignes conteneurises ont ragi trs rapidement en
prenant diverses mesures dconomie :
- Baisse de la capacit mise en ligne et
rationalisation des services : en procdant
des accords de partage de capacit avec
leurs concurrents, les oprateurs ont pu
conserver des services quivalents tout en
retirant des navires et en assurant des
taux de remplissage amliors
- Mise de navires la chaine et retour des
navires affrts : Tandis quils rendaient
massivement leurs propritaires les
navires affrts en fin de charte, les
principaux oprateurs maritimes ont pris la
dcision de mettre la chaine leurs
navires en proprit inutiliss (ce qui ne
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
29
stait pratiquement jamais vu pour des
porte-conteneurs), afin de limiter la
capacit disponible. En dcembre 2009,
533 navires porte conteneurs taient
inemploys, reprsentant 11,7 % de la
capacit totale active. Les armateurs
noprant pas leurs navires eux-mmes ont
t particulirement pnaliss par cette
situation, les navires leur tant rendus en
priorit sans espoir pour eux de trouver
dautres emplois pour ceux-ci.
- Passage par le Cap au lieu de Suez : Dans
leur recherche dconomies, les oprateurs
ont aussi durant lanne 2009 fait passer
par le Cap certaines lignes entre lAsie et
lEurope, vitant ainsi le canal de Suez au
prix dun rallongement du temps de transit
de plus dune semaine. Cette mesure avait
en fait pour but rel de modrer les
ambitions des autorits du canal en termes
daugmentation de la redevance. Une fois
le message compris, les navires ont
retrouv leurs routes normales.
- Exploitation vitesse rduite ou slow
steaming : Cette mesure, trs mdiatise
par les oprateurs, a permis dune part de
rduire le nombre de navires inemploys,
plus de navires tant ncessaires pour
accomplir une mme rotation (par
exemple, 9 ou 10 navires entre lAsie et
lEurope au lieu de 8) et de diminuer la
consommation moyenne (celle-ci tant
exponentielle par rapport la vitesse du
navire) et les missions de CO. Elle nest
cependant pas sans risque pour les
appareils de propulsion des navires qui
sont conus pour une certaine vitesse et
sencrassent lorsquils sont utiliss une
fraction de leur puissance nominale (sauf
pour les moteurs trs rcents pourvus
dune gestion lectronique individuelle des
cylindres).
Lensemble des mesures ci-dessus a eu pour
consquence de faire baisser la capacit sur les
trois principales routes Est-Ouest de prs de 24 %
en la faisant passer de 916 000 evp 700 000 evp
par semaine entre Aot 2008 o la capacit offerte
avait atteint son maximum et la fin 2009.
Les baisses de capacit ont t les plus fortes sur
les liaisons Asie-Mditerrane-Europe et
transatlantique qui ont enregistr une chute de
25 %, contre 21 % pour la route Asie-Amrique du
Nord.
Situation financire des compagnies
Alors que 2008 avait t lanne des records pour
les rsultats des compagnies de ligne, 2009 a vu
une dgradation sans quivalent de ces mmes
rsultats, avec des pertes estimes 20 milliards
de US$ pour lensemble des oprateurs du fait de
la chute simultane des taux de fret et des
volumes transports. Quoique aucune faillite dun
armement important nait eu lieu jusqu prsent,
tous les oprateurs ont t durement touchs par
la crise et ont du prendre des mesures de
sauvegarde. Les grands acteurs du march nont
pas t pargns, Maersk Line ayant enregistr
une perte de 2,1 milliards de US$ et CMA/CGM de
1,3 milliards de US$.
Maersk 2 029 142 15,6% 2 055 256 14,9%
MSC 1 468 982 11,3% 1 538 787 11,2%
CMA CGM 985 351 7,6% 1 046 181 7,6%
APL 482 702 3,7% 556 546 4,0%
Evergreen 622 805 4,8% 554 316 4,0%
Hapag Lloyd 495 681 3,8% 518 034 3,8%
COSCO 489 440 3,8% 452 406 3,3%
CSCL 446 678 3,4% 436 446 3,2%
Hanjin 368 825 2,8% 427 878 3,1%
NYK 424 126 3,3% 393 565 2,9%
1er janvier 2009 09-mars-10
Capacits evp et parts de march des principaux
oprateurs de ligne rgulire
Source : AXS Alphaliner
Les 3 mga carriers (Maersk Line, MSC et
CMA/CGM) taient en effet en phase de croissance
et la baisse des revenus les a frapp de plein fouet
alors que leur programme de commandes de
navires tait son maximum.
Le poids de ces commandes est sans doute le
facteur le plus inquitant dans le proche avenir. En
effet, celles-ci ont t passes alors que les prix
des navires taient au plus haut, et la crise a fait
chuter de moiti la valeur de ceux-ci en 2009. Les
armateurs doivent donc faire face un
endettement massif pour des actifs qui se sont
considrablement dprcis et face des banques
dont la frilosit a t amplifie par leurs propres
revers. La clause loan to value prsente dans
de nombreux contrats de prts et qui stipule que
les actifs assujettis doivent tre rvalus chaque
anne en fonction de leur valeur relle (le prix de
march), reprsente en particulier une vritable
pe de Damocls pour les armateurs, le prix des
porte-conteneurs ayant t divis par 2 entre 2008
et 2009.
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
30
La situation est particulirement proccupante
pour les armateurs non oprateurs (principalement
les KG allemands, qui ont vu revenir leurs navires
frts sans espoir de remploi immdiat, ou alors
des taux de charte ne couvrant pas leurs cots et
dont les navires commands en spculation
risquent de ne pas trouver dutilisation dans les
annes venir.
Perspectives moyen terme
La crise a t brutale mais son volution risque de
sinscrire dans la dure. En effet la crise
conomique et financire mondiale sest surajoute
un afflux massif de tonnage qui aurait pos
problme de toute faon, les armateurs ayant tabl
sur un taux de croissance de la demande de 15 %
par an sur le moyen terme. Les mesures prises par
les oprateurs et le retour de la croissance des
exportations chinoises au dernier trimestre 2009
ont permis de faire revenir les taux de fret un
niveau proche de celui de 2008, donnant un ballon
doxygne aux trsoreries exsangues des
compagnies. La conjoncture reste cependant
fragile et la reprise conomique tarde se
manifester, en particulier aux Etats-Unis.
Les rsultats des oprateurs et des armateurs de
porte-conteneurs risquent dtre durablement
dgrads par le poids de leurs investissements, la
faiblesse des taux daffrtement et par le cot des
navires sans emploi.
La capacit de la flotte de navires porte conteneurs
qui augmentait au rythme annuel de 10% depuis
le dbut des annes 90 a connu une acclration
de sa croissance partir de 2007 pour atteindre un
taux annuel de plus de 14%, afin de rpondre
laugmentation des changes de biens de
consommation, particulirement en provenance de
Chine. Le retournement brutal de la conjoncture
fin 2008 a eu pour effet de crer un excdent de
capacit de grande ampleur qui prendra du temps
se rsorber.
Le graphique ci-aprs prsente les projections de
rapport entre loffre (capacit mise en ligne) et la
demande de transport en fonction de diffrentes
hypothses de croissance de la demande. Un
retour lquilibre entre offre et demande en 2013
impliquerait une croissance de 15% par an de
cette dernire. Dans le cas dune augmentation
annuelle de la demande de 10%, cet quilibre ne
serait atteint quen 2014.
-4,0
-2,0
-
2,0
4,0
6,0
8,0
Jan 2009 Jan2010 Jan 2011 Jan2012 Jan2013 Jan 2014
Surcapacit de la flotte de porte conteneurs de 2009 2014
en fonction de la croissance des changes
0%
+ 2.5%
+ 5%
+7.5%
+10%
+15%
Millions evpu
Source : BRS-Alphaliner
A plus long terme, lincertitude concernant le prix
et la disponibilit du ptrole va reprsenter une
contrainte importante pour le transport maritime
de ligne. Le dveloppement du transport de
conteneurs a t jusqu prsent en effet non
seulement caractris par laugmentation de la
taille des navires, mais aussi par laccroissement
constant de la vitesse de ceux-ci. En cas
daugmentation importante du cot du combustible
sur le long terme, toute la logique de desserte des
lignes maritimes doit tre repense, comme la
dmontr la situation cre par le doublement du
prix du combustible au 2
me
trimestre 2008, qui
avait contraint les oprateurs maritimes prendre
des mesures durgence (diminution la vitesse des
navires, suppression descales, augmentation du
nombre de navires etc).
Laugmentation prvisible du cot du combustible
au fur et mesure de la diminution des ressources
disponibles reprsente donc un challenge
important pour la pertinence du modle
conomique mis en place par tous les grands
armateurs de ligne maritime. La rponse
actuellement apporte par les oprateurs avec la
mise en place de services vitesse rduite est elle
une mesure purement conjoncturelle ou est elle
destine sinscrire dans le long terme ? Le dbat
nest pas tranch, les chargeurs ayant aussi leur
mot dire, le ralentissement des navires ayant
pour consquence une augmentation des stocks
flottants et donc du cout des marchandises
transportes.
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
31
7 LE TRANSPORT ROULIER
7.1 Etat du march
Le march du transport roulier ne peut se
comparer avec celui du conteneur, dans la mesure
ou ce type de transport a pratiquement disparu
des routes intercontinentales face la concurrence
du conteneur. Cette concurrence sest tout dabord
fait sentir sur les routes longues, notamment sur
les trafics transatlantiques o les rouliers, trs
prsents dans les annes 80 et 90 ont
pratiquement disparu pour laisser la place des
services entirement conteneuriss. Les porte-
conteneurs tant beaucoup moins cher lachat
capacit gale, et plus conomiques exploiter,
lavantage en termes de manutention, offert par le
roulage, a t largement compens par les taux de
fret plus bas proposs par les services
conteneuriss. De plus, le dveloppement des
services conteneuriss permettant doffrir des
frquences de plus en plus soutenues, a donn
aux chargeurs une souplesse plus grande et la
mise en place dune logistique flux tendu.
Les services rouliers se sont progressivement
replis sur des lignes courte ou moyenne
distance, particulirement dans la zone europnne,
limitant de ce fait le bnfice que le secteur a pu
tirer du boom des changes intercontinentaux ces
dernires annes.
La concurrence des services conteneuriss
sexerce cependant de plus en plus sur les liaisons
courtes, o les lignes conteneurs peuvent offrir
une qualit de service quasi quivalente aux
services rouliers mais un cout bien moindre.
La monte rapide du prix des soutes a aussi
dfavoris les navires rouliers, notamment sur les
liaisons courtes ou moyennes sur lesquelles le
poste carburant est trs important du fait de la
vitesse leve ncessaire pour maintenir des
services comptitifs face la route.
Cette pression constante sur les revenus navait
pas incit les armateurs renouveler leurs flottes
qui souffraient depuis plusieurs annes dun dficit
de tonnage moderne. Les navires commands en
2007 et 2008 pour faire face au vieillissement de
la flotte sont malheureusement arrivs sur le
march au plus fort de la crise en 2009, ce qui a
pos problme pour leur trouver un emploi et a
fait chuter les taux daffrtement. En contrepartie,
les navires anciens, gnralement plus petits et
avec un rapport performance/consommation moins
favorable, ont pu ainsi partir la dmolition.
Par ailleurs, le dveloppement des autoroutes de la
mer t ralenti en 2009 par la crise financire et
conomique qui a oblig les armateurs reporter
certains de leurs projets prts daboutir malgr les
efforts faits par les Etats, lUnion Europenne et
certains ports pour les aider dmarrer. Ce
transfert modal de la route vers la mer reste plus
que jamais souhaitable et devrait participer la
relance du transport roulier en Europe mais il
faudra encore attendre plusieurs annes avant de
voir ces projets prendre une ampleur significative.
Le march des navires rouliers reste donc plus que
jamais fragile et seuls des groupes denvergure
europenne disposant de flottes importantes ou
des oprateurs spcialiss sur des niches trs
particulires sont susceptibles aujourdhui de se
dvelopper de faon significative. En 2009, leur
stratgie a t de rationaliser et de rorganiser le
dploiement de leurs flottes : les routes les moins
profitables ou dficitaires ont t fermes et les
services ont t dgrads.
7.2 Structure de la flotte
La structure de la flotte de navires rouliers est
fragmente en plusieurs catgories de navires dont
les principales sont :
- Les navires pur RoRo : cette flotte est
compose de 550 units dun tonnage
moyen de 8.200 TPL et de 22,5
annes dge moyen.
- Les navires RoRo/LoLo ou Conro
(capables de charger les marchandises
par roulage ou en manutention
verticale : 76 units dun tonnage
moyen de 18.400 TPL et de 24 annes
dge moyen. Il sagit donc de navires
de grande taille et destins aux
services intercontinentaux, en gnral
nord/sud. Cest une flotte vieillissante
dont le renouvellement nest assur
que par quelques armateurs
spcialiss (Delmas, Grimaldi).
- Situs part, car ne participant pas en
gnral aux services de ligne, les Pure
Car Carrier (PCC): cette flotte trs
spcialise dans le transport de
vhicules neufs est compose de 775
units dun tonnage moyen de 14.460
TPL / 4.100 VL et de 15 annes dge
moyen. Elle a connu un taux de
renouvellement important malgr la
crise que traverse lindustrie
automobile depuis plusieurs annes,
37% de la capacit de la flotte ayant
moins de 5 ans.
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
32
Dans le contexte de crise que traversait l transport
roulier en 2009, les livraisons de navires neufs
(hors PCC) ont du tre rvises la baisse : sur les
30 navires dont la livraison devait intervenir cette
anne, seuls 10 ont effectivement t mis en
service. Neuf navires ont t repousss 2010 et
le reste a t annul.
Les commandes de navires neufs ont videmment
aussi souffert de la conjoncture, et seuls 5 navires
ont t commands en 2009 (dont 4 par le mme
armateur, Messina), contre 30 en 2008.
Par contre les dmolitions se sont acclres, avec
33 navires vendus cet effet contre 16 en 2008.
Comme il a t dit plus haut, les retraits de flotte
ont concern des navires anciens et de petite
taille, avec un ge et une taille moyens
respectivement de 30,6 ans et de 1 100 ml
Une des spcificits du transport roulier de
marchandises est quil peut tre effectu soit par
des navires purs RoRos, soit par des navires
mixtes, passagers/vhicules ou RoPax. Dans le
premier cas, il sagit de transporter des remorques
non accompagnes, alors que dans le deuxime il
est possible de transporter soit des camions
accompagns de leur chauffeur, soit des
remorques non accompagnes. En Europe les 2
mthodes coexistent et il est difficile laquelle
lemportera, tant les opinions sont divergentes sur
le sujet. En tout tat de cause, le dbat a rebondi
fin 2009 avec lannonce de louverture dune
autoroute de la mer entre Montoir et Gijn par
LDA et Grimaldi en employant des navires Ropax,
l ou des navires RoRos avaient t initialement
prvus.
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
33
8 LE SECTEUR DE LA CROISIERE
Perspectives gnrales
Aprs une croissance continue plus de 8% sur
les 15 dernires annes, lanne 2009 a marqu un
inflchissement de tendance. Nanmoins le secteur
a beaucoup moins souffert que le reste des
marchs du transport maritime.
Le march de la croisire est dcorrl des autres
secteurs du transport maritime et se rapproche
plus spcifiquement des marchs du tourisme et
des loisirs.
La mise en service des navires mga a largi le
champ de la clientle et a permis doffrir des
croisires un cot moindre.
La demande de croisire
Le nombre de passagers croisiristes sest accru de
2.6% pour atteindre 19,5 millions de passagers au
niveau mondial.
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
Autres
Europens
Amricains
Evolution du nombre de passagers ayant achet
une croisire dans le monde
Dans le mme temps, la rpartition gographique
des passagers est reste sensiblement la mme
avec la zone Amrique qui absorbe prs des 2/3 de
la demande. Nanmoins, la zone Europe continue
sa progression et son dynamisme ne se dment
pas. Le secteur de la croisire en Europe semble
ne pas encore avoir atteint sa maturit. La marge
de progression dans certains pays dont la France
semble leve.
64%
27%
9%
Amricains
Europens
Autres
Rpartition par zone gographique des passagers
ayant achet une croisire en 2009
En analysant spcifiquement chacun des marchs,
les grandes tendances suivantes ressortent
Carabes
Le march Cariben reste le principal march
mondial. Nanmoins, lanne 2009 et notamment
lhiver a marqu une surcapacit. Pour lanne
2010, la capacit semble tre excdentaire ce qui
devrait maintenir la pression sur les prix.
Mditerrane
Le march Mditerranen est constitu dun
nombre lev de ports avec des infrastructures
ddies en France, Italie, Espagne, Turquie, Grce
notamment.
Les navires sont exploits sur des priodes de plus
en plus longues et les oprateurs cherchent
lisser leur activit hors pics saisonniers avec des
rabais et des croisires thmatiques.
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
2
0
1
1
2
0
1
2
Autres Europe
Espagnols
Italiens
Anglais
Allemands
Franais
Evolution du march europen de la croisire en Europe
Les acteurs du march de la croisire
MSC Croisires, dernier entrant dans le domaine
de la croisire, continue sa perce sur le march
mditerranen.
Les 3 principaux groupes continuent de truster
plus de 75% du march. La tendance la
concentration et au rachat sest attnue, le
march semble avoir atteint sa maturit et son
quilibre des forces.
Le big three reprsente quasiment 350 000 lits
bas
PARTS DEMARCHE DES COMPAGNIES DE CROISIERE
(nb couchettes) En service % serv. En commande % serv.
Carnival 188 100 47% 22 796 46%
RCCL 85 782 21% 13 964 28%
Genting-NCL 28 970 7% 4 200 8%
MSC 23 986 6% 3 502 7%
Louis Cruises 10 440 3% - 0%
Autres 74 199 18% 8 692 18%
Total 402 799 100% 49 652 100%
Source: BRS Mars 2010
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
34
Carnival
Carnival regroupe 11 oprateurs dont les
principaux sont Carnival Cruise Lines, Costa
Croisires et Princess Cruises. A noter quOcean
Village va cesser ses activits.
Le groupe Carnival reprsente plus de 200 000 lits
bas (et 104 navires) en lgre progression sur
lanne 2009.
RCCL
Le portefeuille de Royal Caribbean International
intgre 7 oprateurs dont Royal Caribbean et
Celebrity Cruises pour un total avoisinant les
100 000 lits bas (46 navires).
MSC Croisires
MSC Croisires continue sa croissance pour
atteindre une capacit de quasiment 24000 lits. La
compagnie italo-suisse est en passe court/moyen
terme dintgrer le Big three .
Louis Cruises
Louis Croisires maintient un positionnement sur
des niches de march en Mditerrane
(notamment les Iles Grecques).
Lvolution de la flotte
Le nombre total de navires de croisire fin 2009
est de 440. La recherche dconomies dchelle a
pouss les amateurs dopter pour des navires de
type post-panamax . Lexemple du Oasis of
the seas livr courant 2009 illustre cette nouvelle
gnration de navires.
La flotte non active a fortement progress (+50%
en tonnage compar 2008) pour absorber un
relatif ralentissement de la demande.
Capacits offertes par zone gographique
47%
25%
13%
9%
6%
Carabes
Amrique du Nord
Mditerrane
Europe du Nord
Autres
La crise du crdit a induit comme dans les autres
secteurs une baisse significative des commandes,
ainsi seuls 2 navires ont t commands en 2009.
Nanmoins, si laugmentation du nombre de
passagers se maintient au niveau des 10 dernires
annes environ 7%, plus de 30 nouveaux navires
seront ncessaires. Actuellement 22 navires sont
en commande.
Evolution du carnet de commandes
-
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
1
9
9
0
1
9
9
1
1
9
9
2
1
9
9
3
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
l/b under 30,000 gt
l/b 30,000 to 100,000 gt
l/b over 100,000 gt
10
2
5
9
9
10
10
13
0
18
22
15
1
4
4
14
21
16
4
20
La construction navale
Les commandes de 2009 ont t historiquement
basses avec seulement 2 navires commands.
La construction navale de navires de croisire est
regroupe dans les mains de 3 chantiers :
- STX
- Meyer Werft
- Fincantieri
Au niveau des carnets de commande, Fincantieri
reste leader avec 12 navires devant Meyer avec 8
navires et STX avec 3 navires.
Les livraisons
Carnival et RCCL ont mis sur la croisire de masse
et les conomies dchelle que pouvaient prsenter
les navires de plus 3000 passagers.
Une part non ngligeable des navires actuellement
en commande rentre fait partie de la catgorie des
navires de plus de 3000 pax mais ces navires ne
seront pas la norme en tout cas brve chance.
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
35
9 LA DEMOLITION ET LE DESARMEMENT
DES NAVIRES
Vue densemble du march
La dmolition est lune des variables essentielles
de lquilibre entre loffre et la demande sur la
plupart des marchs du transport maritime. Cest
un march part entire qui, tout en tant
intimement li aux volutions du march du
transport maritime, rpond ses propres logiques.
Son rle sera particulirement crucial dans les
annes venir compte tenu des potentielles
surcapacits qui pourraient se manifester dans
nombre de march.
Son volution reste nanmoins conditionne par
des donnes structurelles de la flotte. Ainsi, elle
aura un rle particulirement important dans les
secteurs du vrac sec et du vrac liquide o il existe
de nombreuses units relativement ges. Si la
flotte de porte-conteneur offre moins dopportunit
compte tenu de son ge plus rcent, elle a
rcemment fait lobjet de ses premires
dmolitions massives suite la crise.
La priode faste du transport maritime partir de
2003 jusquau dbut de la crise conomique, avait
rendu le recours cette pratique assez peu
attractive. Le manque de navires sur les marchs
avait pouss les armateurs a conserv leurs
navires gs qui parvenait relativement facilement
trouver une rentabilit sur les marchs.
Mais suite la chute spectaculaire des taux de fret
la fin de lanne 2008 sur lensemble des
marchs, certains secteurs ont atteins des niveaux
de revenus qui ne permettait mme pas la
couverture des frais dexploitation. Cette situation
a rendu nouveau attractive le recours la
dmolition pour de nombreux armateurs, dautant
plus que les impressionnants carnets de
commandes ne laissaient pas beaucoup despoirs
dun retour durable aux taux de fret antrieur.
Pour de nombreux armateurs, larbitrage a alors
bascul en faveur dun gain immdiat pour des
navires dont la valeur commerciale tait faible. Les
dmolitions ont alors connu un bond significatif.
Lanne 2009 a t une anne record en terme de
volume puisque 35,2 millions de tpl ont fait lobjet
dune dmolition. Cependant, tout aussi important
quil soit, ce volume dtruit ne reprsente que
31% des capacits entres en service cette mme
anne. Cest certes beaucoup plus que la priode
prcdente (ce ratio tait de 7,6% en 2007), mais
encore assez loign de chiffres que nous avons
pu connatre la fin des annes 1990 (plus de
75% en 1998 et 1999).
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Evolution du nombre de navires de commerce dmolis par type
Autres
Porte-conteneurs
Vraquiers
Tankers
Cargos
LInde et lAsie se sont progressivement imposes
comme les deux principales zones de dmolition
des navires au cours des annes 80 et 90. Les
chantiers de dmolition europens, surtout actifs
en Espagne jusqu la fin des annes 90, ont
pratiquement tous disparus sauf quelques sites,
souvent spcialiss dans les navires de petites
taille ou les bateaux de pche. Seule la Turquie
conserve encore des capacits significatives de
dmolition en activit. Ce pays est dailleurs
parvenu a conserv ses parts de marchs suite au
regain dactivit dans le secteur. Avec 79 navires
dmolis en 2009 pour 600 000 tpl, il sagit de la
plus forte activit de la dcennie pour les chantiers
turcs.
LInde reprsente plus de 35 % du march de la
dmolition. Son principal site de dmolition se
trouve Alang dans lEtat du Gujarat.
Le Bengladesh dispose dune trentaine de sites de
dmolition, principalement situ proximit de la
ville de Chittagong et qui sont spcialiss dans les
ptroliers de forts tonnages. Ce positionnement sur
le segment des grands navires rend sa part de
march plus fluctuante, aux environ de 30%. En
termes de tonnage, il sagit par contre du premier
pays de la dmolition.
Le Pakistan est galement prsent sur ce march
avec des volumes qui, bien quayant profit du
nouveau recours la dmolition, reste
relativement limit avec une part de march
infrieure 8%.
La Chine semblait avoir quelques peu abandonne
cette activit pour se concentrer sur la
construction navale. Le nombre de navires dmolis
dans ses chantiers avait fortement chut au milieu
des annes 2000, pour se limiter une trentaine
dunit. Lanne 2009 aura invers la tendance.
Les commandes de dmolition ont t de 345
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
36
units et ce pays sest hiss momentanment au
second rang mondial pour cette activit devant le
Bangladesh, tmoignant de sa capacit ragir
aux volutions du march. A la diffrence du sous-
continent indien, ces chantiers sont souvent plus
mcaniss et donc offrent de meilleures conditions
de scurit.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
en USD par tonne
dplacement lge
Evolution des prix moyens la dmolition depuis 1997
Vraquier - Pakistan/Inde
Tanker - Pakistan/Inde
Lvolution du prix moyen la dmolition a
directement ragit aux vnements marquant du
transport maritime. Lorsque les taux de fret taient
en plein essor, les chantiers ont t confront de
grandes difficults pour rendre leurs services
attractifs et ont par consquent t oblig doffrir
des rmunrations particulirement avantageuses
pour les armateurs. Le retournement de la
situation a eu un effet parallle sur les prix la
dmolition : ceux ci ont trs fortement chut en
2009.
Les moteurs de la dmolition
Le choix du recours la dmolition rsulte pour
larmateur dun arbitrage entre les revenus esprs
de lexploitation et ceux rsultant de la dmolition.
Les revenus de lexploitation seront directement
lis lenvironnement conomique du secteur mais
galement lobsolescence technique. En effet, les
navires plus ags sont gnralement moins bien
adapts lexploitation commerciale, font lobjet
dune maintenance couteuse en immobilisation et
financirement et ont gnralement des
consommations de combustibles plus importantes.
Un navire devient candidat la dmolition
pour deux motifs principaux, son obsolescence
technique et les conditions conomiques du
march.
Analysons tout dabord les conditions
conomiques. Un navire ancien est un navire plus
difficile exploiter, car moins adapt aux besoins
des affrteurs ; consommant davantage de fuel ;
ncessitant davantage darrts techniques, mais
qui a lavantage dtre la plupart du temps
entirement amorti. Ces navires sont gnralement
employs sur le march spot et rarement
attach des chartes de long terme.
Larmateur propritaire dun navire en fin de vie
fera donc larbitrage entre ce quil peut obtenir sur
le march court terme (revenu net tir du navire)
et la valeur de la tonne de poids lge de son navire
la dmolition. Ainsi les navires en ge dtre
dmolis peuvent, en fonction du niveau des frets,
voir leur dure de vie prolonge ou rapidement
courte.
Lobsolescence technique dun navire svalue en
gnral lors de ses visites techniques, tous les 5
ans ou tous les 2 ans pour les ptroliers
anciens. Elle sestime en fonction du montant des
travaux raliser pour que le navire conserve sa
classe et sa valeur intrinsque et commerciale.
La convention de Hong Kong
La dmolition navale a souvent eu mauvaise
presse du fait de son caractre potentiellement
dommageable sur le plan environnemental et
humain. La situation parfois dcrite dans les
chantiers du sous continent indien montre une
activit hautement dangereuse pour les salaris et
dvastatrice pour lenvironnement.
Lapplication de la convention de Ble sur les
changes de dchets dangereux peine
sappliquer aux navires. Le Ban Amendement qui
devait interdire lexportation de dchets hors de
lOCDE nest jamais entr en vigueur et les Etats
du sous continent indien ne lont jamais sign.
Ainsi, certains armateurs peuvent par le biais dun
changement de pavillon obtenir les autorisations
ncessaires pour le transfert de leurs navires la
dmolition.
Pour remdier cette situation, le 15 mai 2009 a
t adopt la convention de Hong Kong au sein de
lOMI visant lencadrement de lactivit de la
dmolition pour la rendre plus vertueuse sur le
plan social et environnemental. Ces mesures sont
aussi bien lies au navire (conception, entretien,
etc.) quau chantier lui-mme.
Nanmoins, cette nouvelle rglementation reste
relativement peu contraignante puis que la
responsabilit est assume par lEtat du pavillon et
non par larmement. De plus, les retours en
provenance des chantiers indiens, bengalis et
pakistanais indiquent que ceux-ci font de multiples
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
37
pressions pour quune lecture laxistes de ces textes
soient retenues dans leur pays respectifs. Il est
dailleurs permis de douter de la capacit de ces
chantiers, qui reposent sur des techniques peu
avances, de se mettre jour des nouvelles
normes.
Perspectives de la dmolition
La poursuite dune activit soutenue de la
dmolition semble inluctable. Les annes fastes
du transport maritime ont entrain la prolongation
de vie dun nombre relativement important de
navires que la seule anne 2009 ne parviendra pas
absorber.
Cette obsolescence technique sajoutera larrive
dun nombre important de navires neufs
actuellement en construction et dont la mise en
service pse dores et dj sur le niveau des frets.
Dans certains segments de la flotte (vraquiers
Handysize ou petits ptroliers) les gnrations de
navires construits dans les annes 70 sont encore
trs nombreuses et apporteront leur flot de
candidats la dmolition durant les prochaines
annes.
Cette acclration, inluctable, de la dmolition
risque de faire face une pnurie de chantiers en
mesure de rpondre cette demande en
application des nouvelles rgles environnementales
concernant le traitement des mtaux lourds et de
lamiante.
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
38
10 LE SECTEUR PORTUAIRE
A linstar du transport maritime, le monde
portuaire a connu une phase dexpansion dans les
annes 2000 avant dtre durement frapp par la
crise la fin de la dcennie. A limage dune
conomie mondiale tire par la croissance
asiatique, les places fortes portuaires semblent
stre durablement install dans les grands ports
du sud est asiatique et de la Chine en particulier
qui a t en mesure de multiplier ses
investissements pour permettre une croissance
conomique reposant largement sur sa faade
maritime et sa capacit exporter des produits
manufacturs mais galement de plus en plus
importer des matires premires.
Mais ce dynamisme des changes asiatiques a
galement aviv une nouvelle concurrence entre
les ports lautre bout de la route commerciale qui
ont cherch capter ces trafics potentiels pour
leurs dveloppements.
10.1 Vrac sec
Les principaux ports dexportation de fer australien
sont Dampier et Port Hedland. Se trouvant sur la
cte Nord Ouest de lAustralie, dans lEtat
dAustralie occidentale, ces ports particulirement
isols sont relis par dimmenses lignes de chemin
de fer aux plusieurs mines dont les principales sont
respectivement Tom Price (Rio Tinto) et Newman
(BHP Billinton). Dampier est galement un port
dexportation de gaz mais le minerai de fer
reprsente 80% de son trafic soit 112Mt contre
155Mt Port Hedland. Ce dernier port fait lobjet
actuellement de projet de dveloppement qui
devrait lui permettre prochainement daccroitre ses
capacits dexportation de 18Mt par an.
Second grand pays dexportation, le minerai de fer
du Brsil transite en premier lieu par le port
Tubaro (100Mt). Ce port priv appartient au gant
du secteur Vale tout comme le port de Punta de
Madeira situ lembouchure de lAmazone et qui
exporte chaque anne prs de 80 millions de
tonnes de fer. Enfin sur la cote Sud du pays, on
trouve les terminaux de Guaba Island et Sepetiba
Bay qui ont des exportations atteignant 60Mt. Ces
terminaux ont largement particip la croissance
des exportations de minerais brsiliens vers la
Chine. Ces derniers terminaux ne disposent pas
encore des capacits pour accueillir les plus grand
capesize actuellement en service (VLOC).
Les exportations sud africaines sont actuellement
ralises depuis le port de Salhanha Bay au nord
du Cap qui exporte environ 35 millions de tonnes
de fer par an. Ce port bnficie dexcellentes
conditions nautiques et dispose dun tirant deau
de 23,7m qui lui permet laccueil de tous les
vraquiers actuellement en service.
Les importations europennes dpendent
galement de Nouadhibou en Mauritanie qui
assure lintgralit des exportations de fer du pays
mais dont les restrictions nautiques ne permettent
que les escales de small capesize (moins de
120 000 tpl). Environ 20Mt sont galement
exportes du port canadien de Seven Island au
Qubec. Ce port ralise actuellement dimportant
investissement visant laugmentation de ses
capacits de manutention et lamlioration de son
pr-acheminement.
Enfin, Narvik en Norvge, port dexportation de la
mine de fer sudoise de Kiruna et Gallivare est
encore important pour la sidrurgie europenne
avec des exportations qui slvent entre 15 et 20
millions de tonnes par an.
10.2 Ptrole et produits ptroliers
Les principales zones de production de ptrole sont
le Moyen Orient, lAfrique de lOuest, le Golfe du
Mexique, la Mer du Nord et la Russie. Dans cette
logique, les ports significatifs dexportation de
ptrole sont les suivants :
- Ras Tanura (Arabie saoudite)
- Forcados (Nigeria)
- Loop (Golfe du Mexique)
- Sullom Voe (Mer du Nord)
- Kozmino (Russie)
Les principaux terminaux dexportation de ptrole
sont contrls par les plus grandes compagnies
ptrolires mondiales. Le port de Ras Tanura en
est un des exemples les plus significatifs puisquil
sert de point de sortie la production dAramco la
principale compagnie saoudienne. Le terminal est
configur pour lexportation de ptrole brut et de
LPG produits dans les champs ptroliers saoudiens.
Au total, 18 quais permettent daccueillir des
navires dune capacit maximale de 550 000 tpl
(VLCC). En outre, le terminal offre des capacits
de stockage de plus de 33 millions de barils et un
projet de raffinerie devrait voir le jour court
terme. Juaymah constitue lautre infrastructure
portuaire majeure de lArabie Saoudite en ce qui
concerne les exportations de ptrole.
Le terminal de Forcados au Nigria est lune des
principales infrastructures de lAfrique de lOuest. Il
est exploit par le gant ptrolier Shell. Mme si
les exportations ont souffert de linstabilit
politique dans la rgion, il reste une rfrence en
ce qui concerne lexportation de brut dans la
rgion. Le terminal est configur pour charger
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
39
400 000 barils par jour. La route Forcados Golfe
du Mexique est un lment de rfrence de
lanalyse des taux de fret pour les Suezmax.
Le terminal de Sullom Voe est aussi un bon
lment danalyse des infrastructures portuaires de
la mer du Nord. Il est situ dans un endroit recul
des les Shetlands. Les volumes de ptrole produits
en Mer du Nord sont en dcroissance sur les
dernires annes et une grande partie est
achemine sur le continent europen par pipeline.
Ce terminal est nanmoins lune des principales
infrastructures dexportation de ptrole et de GPL
en Europe. Il est utilis pour le transport des
volumes produits par une vingtaine de champs
ptroliers off shore (Ecosse et Norvge) ensuite
transports vers les raffineries europennes. Le
terminal est opr par BP et les principaux navires
y escalant sont des Handy tankers (des navires
jusqu 400 000tpl y ont escal).
Le LOOP (Louisiana Offshore Oil Port) est situ
dans le Golfe du Mexique, il constitue la plus
importante infrastructure ptrolire portuaire du
Golfe du Mexique (Shell en est un des principaux
actionnaires). Il est lun des seuls ports amricains
capable daccueillir des VLCCs. Le terminal est
organis autour de 3 balises de dchargement
flottantes. Les capacits de stockage sont
denviron 50 millions de barils de ptrole brut. 13%
du ptrole tranger import par les Etats-Unis
transite par le LOOP soit 1,2 millions de baril par
jour.
Le terminal de Kozmino est intressant dun point
de vue gostratgique et symbolise la volont de
la Russie de profiter de sa faade maritime
orientale pour exporter ses produits nergtiques
vers la Chine, le Japon et la Core. La Russie a
investi 2 milliards de dollars ce terminal qui est
connect par pipeline avec les champs ptroliers
de Sibrie. Rosneft est le principal investisseur
dans ce projet.
En ce qui concerne les importations ainsi que les
activits de raffinage, Rotterdam et Singapour
semblent incontournables.
Rotterdam est un des points dentre principaux
en Europe en ce qui concerne le ptrole, environ
100 millions de tonnes sont importes chaque
anne devant Anvers plus de 20 millions de
tonnes. 6 raffineries oprent dans lenceinte
portuaire et le port dispose de plus de 12 millions
de m3 de capacit de stockage de brut.
Singapour est le 3
me
centre de raffinage le plus
important dans le monde, sa capacit de raffinage
est de 1.5 millions de barils par jour. Le
positionnement gographique de Singapour ainsi
que ses infrastructures en font un acteur
incontournable dans la gostratgie lie au ptrole.
En 2009, plus de 14000 tankers ont accost
Singapour soit une capacit de transport thorique
totale de 420 millions de tpl.
10.3 Conteneurs
Lorganisation portuaire dans le secteur du
transport maritime conteneuris en Europe peut
aisment se diviser en 2 zones gographiques.
En Europe du Nord, domine un rseau portuaire
organis autour de ports reposant sur le modle
gateway et disposant dun hinterland
important. Cest notamment le cas du port du
Havre (hinterland de lle de France), dAnvers et
Rotterdam (hinterland du bassin du Rhin) et de
Hambourg (hinterland de lEurope de lEst).
Cependant, la stratgie des armateurs a galement
pouss les armements faire de ces ports des
hubs rgionaux. Une part importante du trafic y
est transborde dans le reste de lEurope du Nord
(de lAtlantique la Baltique).
Au sud de lEurope, domine un modle bien plus
segment. Les principaux hubs des armements ont
souvent la seule vocation de plateforme de
transbordement et se distingue par consquent
des ports gateway . Le choix de ces ports
repose sur des critres gographiques, financiers
et de productivit portuaire. Chaque armateur
dispose de hub mditerranen qui lui permet une
desserte rgionale via le transbordement. Pour
CMA-CGM, les hubs sont situs Marsaxlokk sur
lle de Malte et Tanger Med. Ce dernier port a
une activit en plein essor et sert galement la
desserte de la cote Ouest africaine. Il permet ainsi
de profiter des conomies dchelle des plus
grands porte-conteneurs venant dAsie vers
lEurope sur ce leg. Tanger Med est galement
utilis par les autres armements dans le mme
cadre. Pour Maersk et MSC, les principaux hubs
sont respectivement Algeciras et Valencia en
ajoutant le hub commun aux deux compagnies
Gioa Tauro au sud de lItalie.
Au Moyen Orient, cest le port de Duba qui domine
lactivit portuaire au sein du Golfe Persique avec
un trafic annuel en 2009 de 11,2 millions devp. Le
port de Salalah est un important port de
transbordement. Situ au sud de la pninsule
arabique, au Oman, son activit permet la desserte
de la cte est africaine via le transbordement de
lignes situs sur laxe Europe-Asie.
Les 3 grands ports conteneurs asiatiques sont
Shangha, Singapour et Hong Kong qui occupent
les 3 premires places du podium mondial en
Analyse explicative sur lvolution du transport maritime international (2009) Juin 2010
MEEDM DGITM/DST/PTF BRS-MLTC
40
terme de trafics. Si Hong Kong a perdu ces
dernires annes sa premire place il faut
nanmoins noter que sa proximit avec la ville
frontalire de Shenzhen et dans une moindre
mesure avec le port de Guanzhou reflte sans
doute mieux le dynamisme du transport
conteneuris dans cette rgion. Sur une centaine
de kilomtres se trouvent ainsi le 3
me
, 4
me
et 8
me
port mondial en termes de trafic, soit une somme
de 57,1 millions devp !
De manire gnrale, la majorit des ports chinois
est en plein essor. Si on considre le classement
des ports en 2009, 7 des 20 premiers ports
conteneurs du monde sont chinois alors que lon
en comptait que 3, 10 ans plus tt.
LAmrique du Nord est divise entre les ports de
la cote Ouest amricaine dont le trafic a t
particulirement dynamique lors de la dernire
dcennie grce aux massives importations
provenant dAsie et une cote Est domin par des
changes transatlantiques qui ont progress un
rythme bien moins lev. Les ports mitoyens de
Los Angeles et de Long Beach ont eu un trafic
global de 11,9 millions devp, ce qui en fait de loin
le 1
er
port amricain du conteneur. Reli un
important rseau routier et ferroviaire, il dispose
de fait dun hinterland immense. De tailles plus
modestes, les ports dOakland et de Vancouver
sont galement dimportantes portes dentre pour
le trafic asiatique.
La cote Ouest est toujours domine par le port
historique des Etats-Unis quest New York. Avec
5,27 millions devp, il reste un grand port
conteneur devant le port de Savannah et de
Virginie.
Vous aimerez peut-être aussi
- 4 Transport MaritimeDocument61 pages4 Transport MaritimeMohammed Jaija100% (5)
- Tableau de Bord À Marsa MarocDocument38 pagesTableau de Bord À Marsa MarocArrias Fatifleur78% (9)
- Grand Port Maritime de Marseille: Le Dernier Rapport Annuel (2012)Document25 pagesGrand Port Maritime de Marseille: Le Dernier Rapport Annuel (2012)GometMediaPas encore d'évaluation
- Analyse de La Rentabilité Les ExercicesDocument8 pagesAnalyse de La Rentabilité Les Exercicesndt67% (3)
- La crise climatique à l'aube d'un monde incertainD'EverandLa crise climatique à l'aube d'un monde incertainÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Rapport Managem 2008Document115 pagesRapport Managem 2008hind263100% (1)
- Rap Marsa MarocDocument37 pagesRap Marsa MarocfatimazahraaaPas encore d'évaluation
- Matrice Swot OcpDocument26 pagesMatrice Swot OcpMustapha Mar100% (3)
- Regime Juridique de La Tierce Detention - Mai2003Document121 pagesRegime Juridique de La Tierce Detention - Mai2003Helloshus100% (1)
- La Responsabilite Du TransporteurDocument11 pagesLa Responsabilite Du TransporteurHelloshus100% (1)
- BoulangerieDocument60 pagesBoulangerierachid1605100% (2)
- Chapitre I. Rôle Économique Du PortDocument23 pagesChapitre I. Rôle Économique Du PortOmar DhifallahPas encore d'évaluation
- DIVORCE ABIDJAN-21-tpiDocument3 pagesDIVORCE ABIDJAN-21-tpiHelloshus75% (4)
- Tanger Med CherfaouiDocument29 pagesTanger Med CherfaouiDeanna BarrettPas encore d'évaluation
- Principales Mesures de Simplification Des Procedures de Dedouanement v032014Document12 pagesPrincipales Mesures de Simplification Des Procedures de Dedouanement v032014Chaimae EL MoussaouiPas encore d'évaluation
- Le Transport Maritime Et Défi de Gigantesme Des NavireDocument88 pagesLe Transport Maritime Et Défi de Gigantesme Des NavireOum Kaltoum Semlali50% (2)
- NAVIRES+DU+MAROC+ La+Leçon+de+Stratégie+MaritimeDocument15 pagesNAVIRES+DU+MAROC+ La+Leçon+de+Stratégie+MaritimetimouyassupPas encore d'évaluation
- Dynamisation Du Secteur de Transport Routier InternationalDocument217 pagesDynamisation Du Secteur de Transport Routier InternationalGadiri MarocPas encore d'évaluation
- Catalogue Electrotren 2015Document66 pagesCatalogue Electrotren 2015luistontoPas encore d'évaluation
- Transport Maritime 2006-fDocument116 pagesTransport Maritime 2006-fapi-3778102100% (4)
- MEMOIRE Carine EFOUTAMEDocument52 pagesMEMOIRE Carine EFOUTAMEjoel menguePas encore d'évaluation
- EMSA - Impact of The COVID 19 - FRDocument18 pagesEMSA - Impact of The COVID 19 - FRRanya JbaliPas encore d'évaluation
- Barometre 2009 de L'économie de La Mer PWCDocument64 pagesBarometre 2009 de L'économie de La Mer PWCFrederic BonnefoiPas encore d'évaluation
- 1 Le Marché Travaux Dirigés 2018Document6 pages1 Le Marché Travaux Dirigés 2018fahdPas encore d'évaluation
- Litiges Entre Freteurs Et Affreteurs Au VoyageDocument24 pagesLitiges Entre Freteurs Et Affreteurs Au VoyageHakim HaddouchiPas encore d'évaluation
- Lindustrie de La Croisière Entre Croissance Et DéfisDocument4 pagesLindustrie de La Croisière Entre Croissance Et DéfisskyrlPas encore d'évaluation
- Résumé de la védioDocument2 pagesRésumé de la védiosokaina.elkhaderPas encore d'évaluation
- La Logistique Maritime Et Portuaire Et Les Échanges Internationaux. Étude de Cas L'algérie.Document19 pagesLa Logistique Maritime Et Portuaire Et Les Échanges Internationaux. Étude de Cas L'algérie.Addam AbdelghaniPas encore d'évaluation
- L. Fedi L'hégémonie Des Alliances Stratégiques Dans Le Transport Maritime de Lignes PDFDocument16 pagesL. Fedi L'hégémonie Des Alliances Stratégiques Dans Le Transport Maritime de Lignes PDFlaurent.fedi2100% (1)
- Armateurs Et Alliances Dans Le TransportDocument4 pagesArmateurs Et Alliances Dans Le TransportBabay OumaymaPas encore d'évaluation
- Article 2216Document32 pagesArticle 2216Kha DiijaaPas encore d'évaluation
- AES Transport Maritime Et PortsDocument12 pagesAES Transport Maritime Et PortszinebPas encore d'évaluation
- Copper and Cobalt TradeDocument56 pagesCopper and Cobalt TradeVictor E RosezPas encore d'évaluation
- Quels Sont Les Fondements Du Commerce International Et de LDocument11 pagesQuels Sont Les Fondements Du Commerce International Et de LChristophe RouxPas encore d'évaluation
- 2018-M-040-06 - La Tranformation Du Modele Economique Des GPMDocument86 pages2018-M-040-06 - La Tranformation Du Modele Economique Des GPMairb airbPas encore d'évaluation
- Cours Élève Mers Et OcéansDocument5 pagesCours Élève Mers Et Océansfrederic amadonPas encore d'évaluation
- Freteurs Affréteurs LitigesDocument86 pagesFreteurs Affréteurs LitigesfaridPas encore d'évaluation
- Environnement International TDDocument2 pagesEnvironnement International TDincotermsPas encore d'évaluation
- Environnement International TDDocument2 pagesEnvironnement International TDincotermsPas encore d'évaluation
- Cargo2010 Enjeux Environnementaux PlaisanceDocument11 pagesCargo2010 Enjeux Environnementaux PlaisancedavidPas encore d'évaluation
- 4 Transport MaritimeDocument61 pages4 Transport MaritimeBayane KMHPas encore d'évaluation
- LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT PORTUAIREDocument20 pagesLA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT PORTUAIREYoussefdrm BessadimrPas encore d'évaluation
- Tableau de Bord A Marsa MarocDocument38 pagesTableau de Bord A Marsa MarocdanadanaPas encore d'évaluation
- 2QH1G1 Seg2 2Document10 pages2QH1G1 Seg2 2Mohamed JouiniPas encore d'évaluation
- Cimem7d23 FRDocument20 pagesCimem7d23 FRRim OuachaniPas encore d'évaluation
- Projet de Rapport Activité ADC 2010Document23 pagesProjet de Rapport Activité ADC 2010Francis Ntongo EkaniPas encore d'évaluation
- Analyse Detaillee Filiere Nautique Et Navale International Fevrier 2020 PDFDocument68 pagesAnalyse Detaillee Filiere Nautique Et Navale International Fevrier 2020 PDFDiana KassabPas encore d'évaluation
- Onu 2021Document31 pagesOnu 2021ABASS SALAHPas encore d'évaluation
- Note de Synthese Isemar 33Document7 pagesNote de Synthese Isemar 33Said DiasPas encore d'évaluation
- TextDocument19 pagesTextElhadj LyPas encore d'évaluation
- Faculté Des Hydrocarbures Et de La Chimie Économe Et Commercialisation Des HydrocarburesDocument6 pagesFaculté Des Hydrocarbures Et de La Chimie Économe Et Commercialisation Des Hydrocarbureswassim.oulmi101Pas encore d'évaluation
- Les Actes Des 10es Assises Du Port Du FuturDocument14 pagesLes Actes Des 10es Assises Du Port Du FuturFlorian HazoPas encore d'évaluation
- Be 8530Document8 pagesBe 8530chakib agoudjilPas encore d'évaluation
- 2013 TG5 CorrectionDocument3 pages2013 TG5 Correctionsecoucamara261092Pas encore d'évaluation
- 8 6902 D50a2553 PDFDocument5 pages8 6902 D50a2553 PDFKAMALOSPas encore d'évaluation
- Q1 - Mers Et Océans Vecteurs Essentiels de La MondialisationDocument6 pagesQ1 - Mers Et Océans Vecteurs Essentiels de La Mondialisationcamille.fourtierPas encore d'évaluation
- 13-Article Text-49-1-10-20200726Document22 pages13-Article Text-49-1-10-20200726hajar alalouPas encore d'évaluation
- Des Échanges Internationaux en Constante ÉvolutionDocument2 pagesDes Échanges Internationaux en Constante ÉvolutionDipper PinesPas encore d'évaluation
- Age Des Navires Flot MondialeDocument36 pagesAge Des Navires Flot MondialeMēđ GouigaPas encore d'évaluation
- Doc-Détroit - de - Gibraltar Des Réseaux Mondiaux Aux Enjeux Locaux de DéveloppementDocument16 pagesDoc-Détroit - de - Gibraltar Des Réseaux Mondiaux Aux Enjeux Locaux de Développementcentredoc2022Pas encore d'évaluation
- MinneDocument37 pagesMinneJihan SadikPas encore d'évaluation
- 2016-02-04-misserDocument30 pages2016-02-04-missernickelluboya91Pas encore d'évaluation
- Tribune Des Métaux 1Document12 pagesTribune Des Métaux 1Aréa OverPas encore d'évaluation
- Copie Economie Du GabonDocument3 pagesCopie Economie Du GabonmbimbodevdasPas encore d'évaluation
- full download Livre Du Professeur Geographie Terminale Anne Vanacore Edition 2020 Hatier 2020Th Edition Anne Vanacore online full chapter pdfDocument70 pagesfull download Livre Du Professeur Geographie Terminale Anne Vanacore Edition 2020 Hatier 2020Th Edition Anne Vanacore online full chapter pdffayrepblish363Pas encore d'évaluation
- Decision de Justice Droit Commercial Ivoirien 3Document19 pagesDecision de Justice Droit Commercial Ivoirien 3HelloshusPas encore d'évaluation
- Decision de Justice Droit Commercial Ivoirien 4Document14 pagesDecision de Justice Droit Commercial Ivoirien 4HelloshusPas encore d'évaluation
- Decision de Justice Droit Commercial Ivoirien 1Document13 pagesDecision de Justice Droit Commercial Ivoirien 1HelloshusPas encore d'évaluation
- Services Phytosanitaire CiDocument31 pagesServices Phytosanitaire CiHelloshus100% (1)
- Decision de Justice Droit Commercial Ivoirien 2Document20 pagesDecision de Justice Droit Commercial Ivoirien 2HelloshusPas encore d'évaluation
- Rapport Annuel Groupe BCGEDocument136 pagesRapport Annuel Groupe BCGEHelloshusPas encore d'évaluation
- Credit Documentaire Par UbsDocument102 pagesCredit Documentaire Par UbsHelloshus100% (1)
- Droit de L'entreprise FullDocument85 pagesDroit de L'entreprise Fullpocket_0012001Pas encore d'évaluation
- CA QA O6T2S1 Module1 T6-A3 Act11 Mini-DialogueDocument2 pagesCA QA O6T2S1 Module1 T6-A3 Act11 Mini-DialogueAnastasia VolkovaPas encore d'évaluation
- Mon CoursDocument86 pagesMon CoursHiba MansuriPas encore d'évaluation
- Orelle 3 Vallees Tarifs Forfaits Ski 2022 2023 3 Fr.2a9a4bd8Document2 pagesOrelle 3 Vallees Tarifs Forfaits Ski 2022 2023 3 Fr.2a9a4bd8the_sebastian09Pas encore d'évaluation
- Conduire 4 Roues 2012 4AS - DINDocument2 pagesConduire 4 Roues 2012 4AS - DINmanoncarquin2005Pas encore d'évaluation
- Fiscalité Des Opérations Commerciales InternationalesDocument62 pagesFiscalité Des Opérations Commerciales InternationalesYaSsErInOPas encore d'évaluation
- Livre Micro Economie Exercices Corrigés Azizi Partie 1Document128 pagesLivre Micro Economie Exercices Corrigés Azizi Partie 1nada333100% (10)
- BCG FinancierDocument28 pagesBCG Financierba9ePas encore d'évaluation
- Étude Franche-Comté "Efficacité Énergétique, Quels Emplois Pour Demain ?" - Partie 1 Etat Des LieuxDocument85 pagesÉtude Franche-Comté "Efficacité Énergétique, Quels Emplois Pour Demain ?" - Partie 1 Etat Des LieuxFranche-ComtéPas encore d'évaluation
- Tchapga Et FeudjoDocument19 pagesTchapga Et FeudjoSINI DELIPas encore d'évaluation
- XX PDFDocument20 pagesXX PDFSANAE NASSIRIPas encore d'évaluation
- 1 - Régulation Économique - Cours BtsDocument3 pages1 - Régulation Économique - Cours BtsEmy PHILIPPE DURANDPas encore d'évaluation
- BAC2018STMG Pondichery Corrigé MDODocument3 pagesBAC2018STMG Pondichery Corrigé MDOLETUDIANT0% (1)
- Quelles Sont Les Finalites Des Organisations Publiques Management Des Organisations Bac STMGDocument5 pagesQuelles Sont Les Finalites Des Organisations Publiques Management Des Organisations Bac STMGAzer AzePas encore d'évaluation
- Législation en Matière FiscaleDocument184 pagesLégislation en Matière Fiscalemulambastephanie4Pas encore d'évaluation
- Développement Economique Local Et Régional (PDFDrive)Document112 pagesDéveloppement Economique Local Et Régional (PDFDrive)CheikhPas encore d'évaluation
- Notice Exe11Document3 pagesNotice Exe11ABELWALIDPas encore d'évaluation
- Td5 Correction 4Document6 pagesTd5 Correction 4ysfPas encore d'évaluation
- CT185 PDFDocument27 pagesCT185 PDFLEBONGO100% (1)
- Gestion de Trésorerie Et Risque de Change++Document23 pagesGestion de Trésorerie Et Risque de Change++Najib Bakkar100% (1)
- Revision Du Catalogue Des Types de RouteDocument17 pagesRevision Du Catalogue Des Types de RouteazertyPas encore d'évaluation
- Cours 16Document4 pagesCours 16Halim SarriPas encore d'évaluation
- Faut Il Supprimer Le Service PublicDocument5 pagesFaut Il Supprimer Le Service PublicSiTe IPAGPas encore d'évaluation
- Cameroon Government Projects DPBF 2021 Français-1Document150 pagesCameroon Government Projects DPBF 2021 Français-1luphumzokebeni1Pas encore d'évaluation
- Investir-5 Mars 2022Document42 pagesInvestir-5 Mars 2022dreadnight89Pas encore d'évaluation