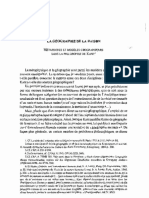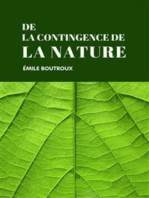Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
L'Être Et L'étant Dans La Philosophie de Martin Heidegger
L'Être Et L'étant Dans La Philosophie de Martin Heidegger
Transféré par
vince340 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
28 vues24 pagesTitre original
L'Être Et l'Étant Dans La Philosophie de Martin Heidegger
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
28 vues24 pagesL'Être Et L'étant Dans La Philosophie de Martin Heidegger
L'Être Et L'étant Dans La Philosophie de Martin Heidegger
Transféré par
vince34Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 24
Maurice Corvez
L'tre et l'tant dans la philosophie de Martin Heidegger
In: Revue Philosophique de Louvain. Troisime srie, Tome 63, N78, 1965. pp. 257-279.
Citer ce document / Cite this document :
Corvez Maurice. L'tre et l'tant dans la philosophie de Martin Heidegger. In: Revue Philosophique de Louvain. Troisime srie,
Tome 63, N78, 1965. pp. 257-279.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/phlou_0035-3841_1965_num_63_78_5305
L'tre et Ftant dans la philosophie
de Martin Heidegger
Voici un demi-sicle que se prolonge la mditation du philo
sophe allemand, Martin Heidegger, sur le sens de l'Etre. Ses der
niers crits, propos de Nietzsche (1961) et de Kant (1962), n'ont
pas d'autre objet. De lui, plus que de maint autre penseur, on
peut dire qu'il n'a qu'une ide, laquelle il ramne toute chose,
et qu'il orchestre, au cours des annes, avec une prodigieuse vir
tuosit. Cette ide, cette unique intuition, sa seule toile (1), il
ne se lasse pas de l'interroger. Qu'est-ce que l'Etre ? Qu'est-ce
que nous entendons vraiment quand nous prononons ce mot
tre ?
D'avoir pos la question de l'Etre dans toute sa rigueur, et
d'y avoir donn un essai de rponse, est, pour le matre allemand,
un titre de gloire qui ne passera pas, et, pour nous, le motif d'une
ncessaire reconnaissance. Mais ce renouveau de la mtaphysique,
en dpit de sa profondeur et de son originalit, ne laisse pas de
poser lui aussi des questions, car l'ontologie heideggrienne est
loin de composer avec cette autre ontologie que nous tenons pour
intgralement vraie. Ou plutt, elle reste en route l'gard de la
pleine vrit, bien qu'elle croie pouvoir fonder sur ses lumires
partielles des condamnations et des rejets que nous estimons in
justifis.
On a prtendu, ces derniers temps, que Heidegger avait reni
ses travaux de jeunesse, adopt des positions nouvelles : l'un des
signes en tait qu'il avait renonc donner une suite sa pre
mire grande uvre : Sein und Zeit. Mais c'est l pure illusion.
Heidegger reste fidle lui-mme. A l'intrieur de l'Etre, tel qu'il
f> < Auf einen Stern zugehen, nur dite*.. . , Au der Erfahrang de Denkpn
(Pfullmgen, Neske, 1954), p. 7.
258
' Maurice Corvez
l'a entrevu ds l'origine, son point de vue se dplace, son horizon
s'largit : ses thses de base demeurent inchanges.
Il nous a sembl qu'il serait d'un grand intrt de retracer
rapidement son itinraire plus exactement, de sauter dans son
cercle (2), en commenant par les assertions initiales et de
rejoindre le philosophe au bord de l'abme mystrieux o il ne
cesse de plonger son regard. Peut-tre alors pourrons-nous voir
mieux et le prix et les limites de sa rflexion, et tenter, sinon de
la dpasser, du moins de la situer en fonction de certaines ex
igences de la pense philosophique.
Dans une premire partie, nous nous proposons de dire : 1 ce
qu'est l'Etre pour Heidegger, et ce qu'est l'tant ; 2 comment s'arti
culent, ses yeux, ces deux dimensions ontologiques ; 3 l'insuff
isance de l'explication.
Une deuxime partie examinera les rapports de l'Etre et du
Dasein, avec l'espoir de trouver une origine commune ces deux
composantes de l'Etre, origine qui pourrait fournir l'explication
adquate de l'identit relle de l'Etre et de l'tant dans la dualit
de leurs aspects formels.
I
L'Etre et l'tant
1. Qu'est-ce que l'Etre ?
Qu'est-ce que l'tre en tant qu'tre ? On l'entend de plusieurs
manires (va v Xysxai rcoXXax&) : comme proprit ou comme
possibilit, actualit, comme vrit, comme scheme des catgories.
On le pense et on le dit de toute chose. Plus large que toutes
les sortes d'tants, il ne peut se dfinir comme eux par genre
prochain et diffrence spcifique : son concept est vague,
non pas vide, mais le plus gnral et le plus obscur de tous les
concepts.
Un premier discernement du sens de l'Etre nous est rendu
possible par la comprhension confuse que nous en avons. Selon
cette vise pr-ontologique, nous sommes mme de nous de-
<*) San tatd Zrti (Tubingen, Niemeyer, 1949), p. 315.
L'Etre
et l'tant chez M. Heidegger 259
mander : que sont les tants en tant qu'tants ? Par quoi un tant
est-il ce qu'il est } Qu'est-ce qui le qualifie comme tant (S1 ? Ou
encore : quelle est la dtermination de l'tre, simple, unifie, qui
commande et pntre toutes les significations que l'on attribue
l'tre ? Quelle est la commune origine de toutes les modalits de
l'tre ? Ce sera l l'tre en tant que tel : le caractre le plus fon
damental des tants.
L'tre de l'tant n'est pas lui-mme un tant. Il n'est pas
davantage l'ensemble des tants (die Allheit des Seienden), ni
quelque fondement ultime du monde, extrieur lui. Une pre
mire rponse affirmative pourrait tre : ce qui fait qu'un tant
est un tant, c'est son tance (ou son tantit), oota, Seiendheit,
comme on dit : ce qui fait qu'un homme est un homme, c'est son
humanit. L'humanit qu'on la considre, avec Platon, comme
une Ide spare, ou, avec Aristote, comme l'essence constitutive
de l'homme porte l'universel prsente un commencement
d'explication : celui d'une structure commune, ou idale, laquelle
participent les hommes individuels. Ainsi de l'tance, l'gard des
tants particuliers.
Mais ce n'est l qu'une rponse insuffisante, un simple passage
du singulier et du multiple l'un et au gnral. N'y a-t-il pas un
au-del de l'tance elle-mme, un sens plus profond de l'tre de
l'tant comme tel ?
Heidegger ici n'hsite pas. L'tance n'est qu'un mode spcial
de l'tre, la manire d'tre des tants qui sont dans le monde. Si
l'tre comme tel tait l'tance, Dieu lui-mme devrait tre consi
dr comme un tant, comme l'Etant suprme, et l'on comprend
que cette dnomination, applique l'Etre mme, ne laisserait pas
de prter quivoque. Ainsi donc faut-il dgager l'tre de l'tant,
l'tre comme tel, indpendamment (au-del) du mode d'tre ralis
dans les tants, et btir une ontologie vraiment fondamentale.
Heidegger est persuad que jusqu'ici, jusqu' lui, et depuis Socrate
et Platon, la mtaphysique s'en est tenue l'tude de l'tance.
Elle ne pouvait faire mieux. Mais le moment historique est venu
de fonder la mtaphysique, de dcouvrir et d'laborer son essence
(Wesen), qui sera la Mtaphysique de la Mtaphysique .
Voyons d'abord la mthode. Elle est uniquement, et jusqu'au
O Sein und Zeit, p. 6.
260
Maurice Corvel
bout, phnomnologique. Emprunte Husserl, mais applique
d'autres domaines. Etre, c'est avoir un sens, un sens pour nous :
l'tre vrai est l'tre tel qu'il est pour l'homme. De plus, cet tre
doit se montrer par lui-mme, directement. Il est alors phnomne.
La phnomnologie permet une chose de se faire voir, d'appar
atre par soi-mme, de se montrer telle qu'elle est. L'ontologie
n'est possible que comme phnomnologie, et la phnomnologie
est ontologie w. Ainsi le processus par lequel un tant est (ou
vient tre) concide avec ce qui le rend manifeste <s>. Pour
Heidegger, le phnomne par excellence est l'Etre lui-mme, parce
que, tant le plus cach, c'est lui qui a le plus besoin d'tre mis
en lumire.
Etre, c'est donc avoir un sens pour l'homme. Mais qu'est-ce
que l'homme ? Par quelle possibilit de lui-mme a-t-il accs
l'Etre ? La question sur le sens de l'Etre est un mode d'tre de
l'tant que nous sommes. En quoi consiste cette modalit ? C'est
par l'analyse de notre structure ontologique qu'il faut aborder l'onto
logie gnrale. L'homme n'est pas un tant comme les autres. Il
possde l'ide d'tre. Il se comprend aussi dans son tre : son tre
lui est ouvert. Seul parmi les tants, il est dou du pouvoir de
faire irruption dans leur ensemble, de les tirer de l'obscurit (<> par
son ek-sistence : cette structure singulire qui le caractrise le
plus profondment comme homme (son essence), en l'ouvrant
l'Etre et son tre.
Si nous voulons obtenir l'horizon ncessaire lrf comprhens
ion et l'explicitation de l'tre en gnral, nous voici donc invits
l'analyse de l'tre de l'homme, de son mode d'tre, de son
tre-l (Da-sein), tel qu'il constitue pour lui la possibilit de se
rendre les tants manifestes dans leur ultime profondeur ontolo
gique.
L'tre-l de l'homme, capacit fondamentale d'atteindre l'Etre,
ne se limite pas un savoir thorique. L'Etre doit tre pens dans
son intime corrlation avec l'essence de l'homme en sa totalit,
non pas seulement avec sa raison. Et, pour tre plus assur de
<*> Sein and Zeit, p. .
(S) On pense a l' Esse est percipi de Berkeley, mais ce n'est pas la mme
chose. Mentionnons au passage que, pour nous aussi, l'tre a la proprit
essentielle de se rendre manifeste l'homme: l'tre est lumire et vrit, mais
l'aspect lumineux de l'tre n'est pas le tout de l'tre.
<*> Sein uni Zeit, p. 206.
L'Etre et l'tant chez M. Heidegger 261
ne pas se mprendre, on tudiera cette essence comme elle se
montre, d'emble et le plus souvent, dans la banalit de la vie
quotidienne.
Cette banalit quotidienne se dploie dans le monde, au con
tact des tants qu'il renferme. Ek-sistante, elle est aussi transcen
dante par rapport ces tants, au-del desquels elle se pro- jette.
La premire composante ontologique (ek-sistentiale) du Dasein
est la comprhension {Verstehen), qui oriente et lance la tran
scendance vers l'Etre des tants. Cette ouverture extatique la
lumire de l'Etre implique un engagement avec les tants, un com
merce concret avec le monde. C'est au sein d'un total affront
ement avec les tants intra-mondains que l'Etre pourra se montrer,
dans cet espace ontologique (le Da) o s'accomplit le pro
cessus de la manifestation. L'Etre est dissimul dans les tants.
L'expansion de l'ek-sistence vers l'Etre constitue, en son actualit
dynamique, un moment de suprme achvement, celui de la rv
lation ontologique.
L'analytique de la constitution primordiale de l'homme met en
lumire deux autres caractres existentiaux du Dasein : la dis
position affective et le logos. Disons seulement que la dispo
sition consiste dans un veil de l'ordre affectif (non pas psy
chologique, ou anthropologique, mais ontologique), donnant lieu
une exprience concrte dont la profondeur et la richesse dpassent
celles de toute saisie purement reprsentative. C'est surtout par
l'angoisse, lorsque l'homme se dcouvre jet parmi les tants
et essentiellement dpendant leur endroit, que cette exprience
devient rvlatrice de l'tre cach de l'homme et du monde.
Quant au logos, troisime dimension de la structure existen-
tiale de l'tre-l, il concerne l'tre pour autant que celui-ci rend
possible l'intelligibilit et le langage. Selon ce logos originel, l'Etre
se dvoile comme la source de l'articulation des concepts et des
mots, ainsi que du pouvoir qui rend le Dasein capable d'amener
l'expression ce qu'il saisit par la comprhension et la disposition.
Les trois existentiaux qui composent le noyau ontologique du
Dasein en nous rfrant l'Etre par-del les tants, ne forment
qu'une seule essence, un unique dynamisme, que dsigne le mot
de souci {Sorge) (T>. L'tre de l'homme est souci. C'est par lui
H S<n'n and Zeit, p. 57.
262 Maurice Corvez
que le Dasein est dans ce monde, qui n'est pas seulement l'e
nsemble des tants, l'univers de la Nature et de l'Histoire, mais,
plus profondment et selon son concept ontologique, un horizon
qui se dcouvre l 'tre-l, principalement dans la mesure o
l'homme y trouve accs par l'emploi de ses instruments. Le monde
en tant que tel (la mondanit) se rapporte ultimement l'tre-l.
Sa profondeur est celle de l'Etre lui-mme (8). L'tre-l se pense
comme tre-dans-le-monde. Le phnomne monde dsigne la
structure d'un moment constitutif du Dasein, un caractre de l'tre-
l lui-mme '", un existential.
L'analyse existentiale ne dbouche pas sur l'tre du monde
sans passer par ces structures majeures que sont l'espace et le
temps. C'est partir du temps surtout, terme ultime de l'explo
ration des tants, que l'tre-l, dvoilant la temporalit (son fon
dement), peut comprendre implicitement l'Etre et l'expliciter <10).
A l'horizon transcendantal de la temporalit se manifeste l'Etre
lui-mme, dont le temps est comme le prnom . Le caractre
temporel de l'Etre le rvle la manire d'une Prsence <u) (An-
Weaen), elle-mme dimension constitutive (avec l'essence du pass
et du futur) du temps originel vcu par le souci, et structurant le
Dasein selon une modalit particulire. Sous sa forme originair
ement tridimensionnelle (ek-statique), la temporalit est l'tre de
l'tre-l dans sa comprhension dynamique de l'Etre.
La temporalit fonde l'historicit de l'Etre. Elle en est la con
dition de possibilit, comme elle est le mode d'tre temporel de
l'tre-l lui-mme. L'tre-l est en soi historique , de cette his
toricit fondamentale qui se confond avec l'Etre. Son explicitation
ontologique devient, en elle-mme et ncessairement, une interpr
tation de l'Histoire, la faon d'un accomplissement de la com
prhension. L'Etre comme Histoire est l'Etre lui-mme, et rien
d'autre (18).
Avec la saisie ontologique du monde, du temps et de l'his-
<*> Kant und dm Problem der Metaphynk (Frankfurt, Klostermann, I95I),
pp. 152, 153.
<* Sein und Zeit. p. 64.
( Ibid., p. 17.
<"> Ce qui rend les tants capables d'tre prsents a l'homme, et les hommes
prsents les uns aux autres: la prsence d'une chose prsente, da$ An we ten eine
Anwesenden.
<"> Nietzsche (Pfullingen, Neske, 1961), vol. H. p. 489.
L'Etre et l'tant chez M. Heidegger 263
toire, explicitant la description existentiale et transcendante de
l'tre-l de l'homme, Heidegger a dgag puissamment un domaine
(Da), qui est exclusivement celui de l'Etre en gnral. Il nous faut
maintenant, pour caractriser plus distinctement ce niveau onto
logique, signaler brivement les attributs fondamentaux de l'Etre
comme tel.
L'Etre est transcendance, en ce sens qu'il apparat au Dasein
comme situ au-del de tous les tants, y compris cet tant privi
lgi qu'est l'homme lui-mme. La transcendance institue une d
imension d'ouverture qui englobe tous les tants et constitue le
lieu ontologique l'intrieur duquel l'homme se tient, ou dans
lequel il peut entrer. Cette rgion est celle o l'Etre et lui-mme
peuvent se rencontrer en ce qu'ils ont de plus intime <18>. Elle est
le Da de l'Etre, la place (St'tte) o se produit, par une soudaine
irruption, la brche dans l'obscurit : la rvlation de l'Etre.
Quand on le considre du point de vue des tants, l'Etre se
montre au Dasein sous les espces du Nant. L'Etre est le Nant (14).
Ce qui veut dire qu'il est autre que les tants : le non-tre des
tants. Il est pens comme quelque chose qui ne se confond
pas avec les tants du monde. Ce Nant s'adresse au Dasein
travers certains sentiments , l'angoisse spcialement, par quoi
le Dasein, ouvert lui-mme dans son unit, est profondment
troubl au sujet de ses possibilits. Le Nant est comme le voile
de l'Etre {der Schleier des Seins) : il le cache tout en le laissant
apparatre <1S>.
A la faveur de l'angoisse, l'Etre se dvoile dans un domaine
de lumire, une claircie, ou plutt, selon un processus d'ill
umination {Lichtung), une fulguration. Mais, en mme temps qu'il
dcouvre les tants, et dans la mesure o il le fait, il se drobe
lui-mme, dans son Etre, comme nant des tants. Interrog dans
sa lumire propre (aus ihm selbst), partir de lui-mme, l'Etre,
par quoi sont les tante, se manifeste comme vrit. La vrit
est le non-cach. Elle fait apparatre l'Etre comme il est. Le sens
de l'Etre est sa vrit (18). L'essence de la vrit est la vrit
<"> Was ist Metaphysik ? (Frankfurt, Klortermaim. 1955), p. 14.
("> Kant und das Problem der Metaphysik, p. 214.
<"> Was ist Metaphysik?, p. 51.
<"> Was ist Metaphysik ?> P- 19.
264 Maurice Corvex
de l'essence (lT>, c'est--dire : la vrit, pense comme manifest
ation originelle, n'est autre chose que l'essence dans sa vrit,
l'tre essentiel, l'Etre. Mais l'Etre, en mme temps qu'il illumine
les tants et les fonde dans leur vrit propre, se retire, s'enfonce
et demeure dans le mystre. Cependant, en manifestant les tants,
en leur donnant un sens, l'Etre- Vrit les a fait surgir des tnbres,
les a librs, et le Dasein avec eux, libre dans la lumire transcen-
dantale.
Il semble que ces lments suffisent pour le but que nous nous
proposions, savoir : dgager, avec assez de nettet, la sphre
ontologique , ou l'Etre, dans toute son extension et toute sa
profondeur.
Cette sphre existentiale se trouve manifestement au cur d'un
autre domaine que peuplent les tants, envisags dans leurs dter
minations spcifiques et individuelles, et qu'on appelle le domaine
ontique, par opposition au domaine ontologique. Ce secteur ontique
comprend tout ce qui n'est pas l'Etre comme tel. C'est le monde
de la reprsentation , celui des objets et des sujets, le monde
de la logique et de l'humanisme, celui de la science et de la tech
nique, le monde enfin de la mtaphysique traditionnelle qui, s'oc-
cupant de l'essence ou de l' existence , n'a pas surmont la
pense de l'tance, n'a pas atteint l'Etre comme tel [da$ Sein al
Solchen, da Seyn).
2. Comment s'articulent l'ontique et l'ontologique ?
Ces deux dimensions de l'Etre, Ontologique et Ontique, ainsi
dtermines, nous voudrions saisir la manire dont elles s'articulent.
Heidegger a pass toute sa vie scruter la nature de cette liaison.
A sa suite, essayons d'abord de voir comment il a pens ce rap
port de l'tre l'tant que, depuis les tout premiers dbuts de
sa rflexion, il a appel la diffrence ontologique {die ontolo-
gische Differenz).
Il convient de se rappeler que l'Etre dont on a parl n'a de
porte ontologique qu'au sens o la lumire immdiate de la vrit
lui en donne une. De l'Etre, la pense ne sait rien d'autre que
ce qui en apparat au Dasein, en tant mme qu'il apparat, dans
les limites d'une apparition toute directe, non mdiatise.
<"> Vont Wesen der Wchrhrit (Frankfurt, Klottermann, 19M), p. 26.
VEtre et Vtant chez M. Heidegger 265
L'Etre est prsent tout tant. Il est la Prsence : ce par
quoi et en quoi les tants peuvent tre eux-mmes prsents
l'homme. C'est sa lumire qui les claire tous. L'tant n'est jamais
sans l'Etre, puisqu'il n'est que par lui, et dans la mesure o l'Etre
lui donne d'tre. L'tant est-il vritablement ? Oui : il est, de par
l'Etre ; mais, en mme temps, il n'est pas, puisque tout lui vient
de l'Etre, sans qu'il dtienne l'tre en lui-mme. Bien que con
tract dans l'tant et li lui, immerg en lui (eingenommen)
et sensibilis par lui {durchstimmt), l'Etre n'est pas vraiment par
ticip par l'tant, reu, imbib dans l'tant. L'tant, illumin par
l'Etre, qui s'exprime et se reflte en lui, est ; il est de par sa
relation l'Etre ; l'Etre lui donne d' tre ; il le fait tre ,
au sens transitif, non causatif de l'expression : il ne lui donne pas
l'tre.
Ce n'est pas que l'Etre soit spar de l'tant, comme le serait
une sorte de cadre . L'tre n'est jamais sans les tants (18> : c'est
l'affaire de l'Etre d'tre l'tre de l'tant (19), comme il appartient
l'tant d'tre dans l'Etre. Les prpositions de et dans marquent
la distinction de l'Etre et de l'tant, mais sans prjudice d'une
certaine corrlation qui existe entre eux, une mutuelle dpendance.
Certes, il y a une scission (Schied) entre les deux, qui donne nais
sance la diffrence . L'Etre peut se manifester assez clair
ement comme lui-mme pour nous permettre de le discerner dans
sa diffrence d'avec les tants ; ds l qu'il n'est pas un tant, il
n'est pas saisi par lui-mme, indpendamment des tants comme
s'il tait spar, mais il est saisi en lui-mme et pour lui-mme,
travers le comportement de l'homme l'gard des tants. Cepend
ant, si diffrent qu'il soit, l'Etre demeure prsent aux tants.
Son caractre diffrentiel (ngatif), bien qu'intrinsque sa vraie
nature et inscrit dans son dynamisme propre, fusionne, en la sim
plicit du processus de la vrit, avec le pouvoir de manifestation
qui, brillant dans les tants, leur permet de sortir des tnbres.
<"> La pense de Heidegger semble avoir vari sur ce point, au moins dans
son expression. Le texte original de Was ist Metaphysik ?, Nachwort (1943),
portait: L'Etre vient la prsence sans les tants, ... Zur Waharheit des
Seins igehrt, dass das Sein wohl west ohne das Seiende (p. 46) ; en 1949,
l'occasion d'une introduction ajoute au texte primitif, on lit: c L'Etre ne vient
jamais la prsence sans les tants , ... 'Das Sein nie west ohne das Seiende .
<" Hohwege {Frankfurt, Klostermann, 1950), p. 335; Vont Wesen de$
Grundet (Frankfurt, Klostermartn, 1949), pp. 41, 42.
266
Maurice Corvez
Les tants reoivent de l'Etre leur part dans le processus de la
rvlation, mais l'Etre les tient en main , les garde dans sa
vrit, et dans la leur, dans la vrit de leur essence et de ses
limites (rcpa), tandis que lui-mme est l'dtpx^ et l'ueipov, prcis
ment parce qu'il ne se confond pas avec les tants. Il les pousse
dehors en quelque sorte, mais, il les contient aussi en lui, il les
recueille, les conserve en sa Prsence (20) : leurs racines sont en
fouies dans l'lment fondamental qu'il est pour elles (21).
La distinction de l'Etre et de l'tant n'est pas une simple dis
tinction de raison , mais, d'autre part, elle n'est pas assimilable
cette distinction relle qui existe entre deux entits dj consti
tues et spares sur le plan ontique de la reprsentation. La
diffrence doit tre prise au sens profond qu'voque le verbe
dif-ferre : se porter l'un l'autre, comme si les deux partageaient
un domaine demeurant intrieur chacun ; comme s'il y avait une
commune mesure par laquelle chacun est mesur, une dimension
singulire des deux, une unit primordiale en raison de laquelle
chacun adhre l'autre et hors de laquelle ils surgissent tous les
deux. La diffrence rapporte l'un l'autre l'Etre et l'tant par
le fait mme qu'elle les spare en deux. On peut dire que les
deux corrlatifs ne font qu'un (Selbe) en raison de leur inte
rdpendance (Zusammengehoren), mais leur diffrence ne peut tre
volatilise comme elle le serait s'ils taient les mmes (Gleiche).
Heidegger, au dbut de sa recherche, avait insist davantage
sur la distinction, le langage emprunt la Mtaphysique ne
lui permettant pas de faire mieux (22). Aujourd'hui la dpendance
est mieux marque, bien qu'il soit toujours entendu qu' son ori
gine la diffrence ne peut venir que de l'Etre et demeurer dans
sa Prsence, car elle est le processus de l'Etre lui-mme se faisant
prsence (dfas Wesende des Seins selbst) (23>. C'est l'Etre qui com
prend et suscite la diffrence . En l'Etre, tout rayonnement,
toute mission dans les tants est, originairement, accomplie (schon
vollendet) (24). L'Etre est absolument transcendant (25). Les tants
<*) Holzwege, p. 339.
<> Was isi Metaphynk ?, p. 8.
(") Vom Wesen des Grandes, p. S.
W Nietzsche, il, p. 489.
<*> Was ist Metaphysik ?, p. 31.
<"> Sein und Zeit, p. 36.
L'Etre et l'tant chez M. Heidegger 267
sont mdiatis par lui : il est l'Ouvert qui leur permet de se ren
contrer, il tablit leurs mutuelles relations. Mais lui, source de la
mdiation, n'est pas mdiatis : il est l'im-mdiat, que l'explici-
tation phnomnologique se propose de mettre en plein jour.
Tel est, semble-t-il, le rsultat substantiel auquel a pu aboutir
l'exploration de Heidegger au sujet de la distinction entre l'Etre
et les tants. Ds le dbut, il s'tait demand comment l'tre
(oala) dont parlait Aristote pouvait tre prsent aux quatre genres
de cause qui prsidaient son avnement. Le mystre n'est pas
clairci aujourd'hui. Peut-on affirmer que l'Etre est ? Sans doute,
si l'on donne au mot est un sens dynamique, transitif (26). L'tant
est-il ? Oui, de par l'Etre, nous l'avons dit. Que l'tant soit, ou
que l'Etre soit : quoi de plus nigmatique, s'tonne le philosophe ?
Nous ne sommes pas encore parvenus au cur de ce mystre
de la manifestation de l'Etre dans l'tant (37).
3. Insuffisance de l'explication
Heidegger ne voit pas comment s'unissent intimement l'Etre
et l'tant. Nous serait-il permis d'exprimer discrtement notre pen
se ce sujet ?
II semble qu' nous en tenir la formulation que nous venons
de rapporter, nous en restions une corrlation entre l'Etre et
l'tant qui se situe uniquement sur le plan ontologique. C'est
l'intrieur de l'Etre, hors de l'tant, que prend place la diff
rence , la distinction. La diffrence est l'Etre, et non pas le r
sultat de quelque acte extrinsque qui diviserait l'Etre et les
tants. A son origine, elle est le processus de l'Etre lui-mme,
dont le pouvoir consiste uniquement en ceci que l'-vnement (le
n'en) se produit (28). Chose curieuse, puisque l'un des termes de
la relation , l'tant, s'oppose prcisment au terme ontologique.
On a beau dclarer que ladite relation est une relation toute sp-
* I . ?-
ripp]
(>4) En 1957, Heidegger accepte que l'on parle ainsi (Identitt and Different (PMlingen. Neske, 1957). p. 62. <"> Was ist Metaphyaik ?, p. 23: Was bleibt rStselhafter. dies, dass Seiendes ist, oder dies, dass Sein ist ? Oder gelangen wir auch durch dise Besinnung noch nicht in die Nahe des Rfttsels, das sich mit dem Sein des Seienden ereignet hat? (') Nietzsche, il. p. 489.
268
. - Maurice Corvez
ciale, ontologique, il reste que, pour tre intelligible au sen
le plus existential du mot la distinction ne peut faire abstraction
de l'un des termes de la relation. Si cette relation est tout onto
logique, elle ne peut rejoindre rellement le terme ontique sans
contracter quelque chose d'ontique, sans perdre quelque chose
de son caractre purement ontologique. A moins qu'on ne l'en
tende d'une relation de pure raison : ce qui semble bien tre
le cas, ici.
On pourrait dire alors que l'Etre est rellement prsent l'tant,
mais selon une relation qui n'aurait de ralit que du ct de
l'tant. On pense invinciblement la relation qui existe entre Dieu
et ses cratures. Dieu n'est pas touch par cette relation ; il de
meure sa transcendance ; mais la crature n'en dpend pas moins
rellement de lui. Aussi en irait-il de l'tant par rapport l'Etre.
Il ne peut tre sans l'Etre ; l'Etre ne peut tre sans lui (ce qui
n'est absolument pas le cas de Dieu) ; leur liaison ne sort pas de
la rgion de l'Etre, ou, du moins, ne noue pas l'Etre l'tant,
le laisse sa transcendance intouchable, et n'est donc que de
raison en lui, par rapport l'tant.
Mais alors, si l'tre de cet tant n'est son tre que parce que
l'Etre, qui lui donne d'tre, ne se rapporte lui que selon une
relation et appropriation de raison (ds l que seul cet tant se
rfre rellement l'Etre), voici que l'Etre lui-mme se trouve,
par le fait de cette relation particulire, relgu dans une solitude
et srnit olympienne, soustrait aux distinctions et relations relles
qui vont s'instaurer dans tout le domaine de l'ontique. L'Etre sera
assurment le fondement, la source, la vrit de ces rapports int
rieurs au monde. Ils ne seront que par lui. Mais lui, en lui-mme,
pur trait de clart , il ne sera pas ml leur ordre et leurs
remous. L'Etre est Ce qu'il est {Es ist Es selbst). Immuable, il
rgentera toutes les dterminations, mme mtaphysiques , dont
la varit et la valeur ( leur plan) viendront de lui, sans que rien
n'atteigne sa parfaite homognit et unit.
Cette constatation revt nos yeux une importance capitale,
car il y va du sort de la saine mtaphysique, de ses positions les
plus fondamentales, les plus lourdes de consquences. Il faut avoir
le courage de dire, face la pense exigeante de Heidegger, que
la vraie profondeur n'est pas celle de l'abstraction la plus dlie.
Quand un monde abstrait ne peut s'articuler intelligiblement avec
la ralit intgrale et manifeste, si pur et profond qu'il paraisse.
L'Etre et l'tant chez M. Heidegger 269
en fait il n'est plus qu'un fantme. Avec l'intention de s'lever
au-dessus de l'tant et de l'tance pour saisir son fondement
ultime, et fonder ainsi la mtaphysique elle-mme, Heidegger en
vient pratiquement dtacher l'Etre de l'tant.
Il ne sert de rien de dire que la pense de la diffrence
ne relve pas de l'ordre de la reprsentation et de l'intelligible.
Ce qui transcende le monde des concepts proprement dits, on peut
bien le qualifier d'inaccessible, d'inapprochable (29>, mais, s'il est
pensable, on doit pouvoir en parler et se faire comprendre, du
moins selon quelque analogie qui donne accs au sens du mystre.
Sinon on parle pour ne rien dire. On s'autorise de certaines intui
tions radicales ; on leur fait un sort en quelque mesure spar ;
et l'on cherche ensuite la formule comprehensive qui r-unisse ces
lments dissocis. En vain, bien entendu. La ralit est plus com
plexe et plus une la fois que ne le sont nos abstractions et nos
penses . Ce n'est pas parce que ces penses transcendantes se
prsentent spares l'esprit et dans l'esprit, que la ralit totale
est, pour autant, divise en elle-mme. On dirait mais la chose
serait vrifier que Heidegger n'a pas t insensible la thorie
de Duns Scot sur la nature de la distinction existant entre ce
qu'on appelle les degrs mtaphysiques des tres. La fameuse dis
tinction formalis ex natura rei , qui n'est pas relle et qui
cependant est antrieure toute apprhension de la raison, pourrait
bien tre l'origine de la dissociation que nous incriminons. Mais
applique la diffrence entre l'Etre et l'tant, et explicite avec
le caractre absolu que lui a donn Heidegger, elle ne permet
plus de sauvegarder la vritable unit du rel. Celle-ci est rompue,
brise dans le miroir de phnomnes qui, malgr leur souplesse
prtendue, n'arrivent pas se rejoindre pour nous donner du monde
des tants une image qui respecte leur identit foncirement onto
logique.
L'Etre et l'tant, tels qu'ils sont distingus selon l'exigence
phnomnologique (par une sorte d'abstraction formelle), ne sont
plus vraiment identiques. Duns Scot, malgr sa distinction formelle
ment relle, peut sauver l'identit des termes distincts, parce qu'il
les considre comme identiques un troisime, dont on les abstrait.
Ce troisime est ici l'tant ontico-ontologique, le complexe existant,
<*> Erlutorungen xu Hdlderlin Dichtung (Frankfort, Klottermann, 1951),
p. 61.
270
* Maurice Corvet
l'essence de l'homme. Librs l'tat pur, tant et Etre, ne peuvent
plus se rejoindre, autrement que par une corrlation qui n'est pas
relle de part en part.
On verra mieux, dans un domaine plus dfini, celui de la
causalit, les consquences de la dissociation heideggrienne. Sur
le plan ontique, les rapports de succession, de dpendance, de
causalit, ne sont pas mconnus : les lois qui rgissent l'univers
des tants s'imposent l'adhsion de l'esprit. Mais les tante ne
sont pas l'Etre ; l'Etre qui les fait tre, garde ses distances, ne
se mle ni leurs aventures ni leurs jeux bien composs. Les
tante sont, sans tre en eux-mmes. Tout ce que l'on pourra comp
rendre, induire ou dduire de leur comportement, sera vrai, un
certain niveau, mais non de cette vrit profonde, ontologique, qui
est l'apanage de l'Etre se manifestant au Dasein, et aux pieds de
laquelle vient expirer, comme une mare montante, tout ce qui
se meut par elle, mais en dehors d'elle.
Chercher alors transcender le monde des tante par les voies
de la causalit, en s'appuyant sur l'tre en tant que tel, cet Etre
dont Heidegger pense qu'il n'est pas rellement identique l'on-
tique, semble prtention absolument vaine. Car ces pauvres tante
sont comme vides de la prcieuse ontologie ; leurs liaisons, leurs
conditions de possibilit, se dveloppent dans le seul domaine de
l'etance. Cause incause, premier Ncessaire, Etre suprme, etc.,
ne seront jamais que les dnominations d'un Etant, le plus lev
des tante, mais tranger l'Etre de Heidegger. Dieu, vu la
lumire de la causalit, n'est que le Dieu de ces philosophes,
fascins par la causalit du faire , incapables d'atteindre l'or
igine essentielle de cette causalit.
Quand Heidegger imagine que les scolastiques en sont rests,
dans leur mditation de l'Etre, au niveau de l'tance, il se m
prend singulirement. Leur elucidation de la causalit envisage, au-
del des dterminations catgorielles, l'tre en tant que tel, et c'est
sur lui qu'ils prennent appui pour remonter jusqu' un Premier,
hors du conditionnement, et qui est, non pas l'essence dgrade
de Dieu , mais l'Etre par essence. L'abstraction de l'tre comme
tel (au-del de l'tance) n'a pas besoin, pour tre authentique, de
se faire sparation, pas mme cette sorte de sparation o la
ralit de la relation ne subsiste que de l'un des cts.
L'Etre et l'tant chez M. Heidegger 271
Une ontologie qui russit dissocier ainsi l'Etre de l'tant,
au point de rduire les liaisons ontiques un complexe de ra
lits sans densit fondamentale, ou existentiale, d'o l'existence
de l'Etre par essence {Ipsum Esse per se subsistens) ne puisse tre
induite, doit tre reconnue comme gravement insuffisante. Si encore
elle se contentait de dire qu'elle ne voit pas comment on pourrait
fonder l'existence d'un tel Etre. Mais non : toute preuve mta
physique est frappe de relativit, pour cette raison que l'absolu
de l'Etre n'y est pas engag. Cette mprise est extrmement regret
table, et s'il est vrai qu'elle n'est pas mprise l'gard de cer
taines mtaphysiques mal inspires, elle l'est bel et bien l'gard
de certaines autres, qui comptent dans l'histoire de la philosophie.
Maintenant, s'il tait vrai que Heidegger cherche au-del de
la diffrence un principe simple de diffrenciation, qui raliserait
entre l'Etre et les tants une unit plus assure, peut-tre ne serions-
nous pas acculs l'impasse que nous venons de dnoncer. Nous
allons rencontrer ce problme, pos en des termes plus dcisifs,
propos des rapports entre l'Etre et le Dasein, mais il nous faut
d'abord examiner la position de notre philosophe sur la relation
de l'Etre avec cet tant particulier qu'est l'homme lui-mme.
L'homme est l'tant o l'Etre se manifeste, y trouvant la place
(le Da) dont il a rigoureusement besoin pour tre. Ce Da-sein, nous
le verrons, ne se confond pas absolument avec l'Etre : il dsigne
le mode d'tre propre l'homme et appartient l'ordre ontolo
gique. L'homme est le Da dont la nature est d'tre ouverte
l'Etre <so>. Qu'en est-il de la relation de ce Da l'homme et, par
lui, de l'Etre l'homme ?
L'tre du Dasein (son essence) rside uniquement dans le fait
que son tre est. C'est son tre pur et simple, tel qu'il se montre
et s'offre comme possibilit ontologique au milieu de la ralit des
tants. Cette possibilit de l'ek-sistence est aussi avoir tre ,
devoir tre : le fondement de toute ralisation ontique, situ
au-dessus d'elle (31>. Au-dessus de la ralit de l'homme lui-
mme, de sa talit , c'est--dire de son tre spcifique (dfini
<"> Einfhrung in die Metaphytik (Tubingen, Niemeyer, 1953), p. 156.
<") Sein und Zeit, p. 38.
272
, Maurice Corvez !
par une quiddit dtermine) et de l'individualit particulire de
tout Dasein.
Cependant le Dasein n'est pas totalement spar de l'aspect
empirique, ni mme mtaphysique , de l'homme. Il est essen
tiellement rfr (angewiesen) aux tants du monde, essentiellement
dpendant d'eux, engag dans un comportement continuel avec
eux. Cet engagement, qu'il soit impos par les circonstances, ou
seulement le fait d'un libre choix, ne va pas sans quelque rapport
avec la dimension ontique de notre tre, appele aussi existentielle,
selon qu'elle n'est pas dlie de l'ek-sistence, ou de 1'
existential,
qui en structure la quotidiennet.
Aussi bien l'analyse existentiale est-elle enracine dans l'exis
tentiel, dfaut de quoi elle resterait sans fondement (32>. Les deux
dimensions, ontologique et ontique, de l'homme, 1' existential et
l'existentiel, ne sont donc pas spares. Ce sont les dimensions
d'un phnomne unique, et elles se conditionnent mutuellement.
Le Da est un vnement qui prend place dans l'homme ; la com
prhension que l'homme a de son tre est inscrite dans sa consti
tution ontique, dans son engagement existentiel.
Mais si le Dasein est souvent considr comme l'quivalent
de l'homme (33), si on parle souvent du Dasein humain, qui nous
expliquera comment le Da s'articule avec l'homme, en tant que
celui-ci est un tant ? Le Dasein est toujours mien, nous dit-on ;
le fait d'tre mien est un caractre fondamental du Dasein (34>.
Mais comment se fait la liaison et l'unit ? La structure ontologique
est plus originelle (ursprunglicher) : o se trouve le point de ren
contre, si le Da est la diffrence entre l'ontique et l'ontologique ?
On ne voit mme pas clairement si l'homme du Dasein est indi
viduel ou collectif. Et si c'est moi, tel tant, qui comprends l'Etre,
comment cette comprhension peut-elle tre mienne ? L'Etre est
plus proche de moi que ne le sont les tants, puisque c'est lui qui
me fait tre ce que je suis. Mais il est aussi le plus loign. Je
suis structur en vue de mon comportement avec les tants. Or
l'Etre n'est pas un tant ; je ne peux me comporter avec lui comme
avec les tants : il est donc loin, le plus loin. Et le Dasein, o
l'Etre se projette, partage cet loignement, et me laisse comme
homme, comme tant, mon insignifiance ontologique.
(*) Sein und Zeit, pp. 13, 315.
<"> Kant und das Problem der Metaphymk, pp. 13, 205-206.
(M> Sein und Zeit, pp. 42, 43.
L'Etre
et l'tant chez M. Heidegger 273
La diffrence ontologique entre l'Etre et tout tant se montre
donc irrductible une vritable unit. Mme entre l'homme et
son Dasein (ontologique) l'abme n'est pas combl. Le survol de
l'Etre reste aussi accentu. Si le Dasein o il se montre est mien,
ce n'est encore qu'une relation de raison , partant de l'ontolo
gique vers l'ontique, qui m'en assure : l'unit de l'homme est
brise.
Dans le prolongement de cette analyse des rapports de l'Etre
et de l'tant, aussi bien de l'tant du monde que de l'tant hu
main, c'est la relation entre l'Etre et le Da-sein que nous vou
drions maintenant examiner, dans l'espoir de dcouvrir une voie
de dpassement, une issue vers une notion authentique de l'Etre
qui nous permette de surmonter les difficults que nous avons ren
contres jusqu'ici.
Le Dasein nous est prsent, dans l'analyse existentiale, comme
identique l'Etre. C'est l une ide de base de Sein und Zeit,
o nous lisons, par exemple, que l'analytique ontologique du
Dasein est elle-mme l'ontologie fondamentale (35). Cette affi
rmation sera, il est vrai, nuance par Heidegger lui-mme, avec
le progrs d'une rflexion dont nous allons suivre les tapes.
II
L'Etre et le Dasein
Le Sein et le Dasein se situent au mme niveau ontologique
et leur sort est intimement li. L'Etre n'est pas sans le Dasein,
et le Dasein n'est pas sans l'Etre. Ils surgissent en mme temps,
sont dcouverts ensemble (36). Car l'Etre qui s'ouvre au Dasein
n'est pas seulement l'tre des tants mais aussi l'tre du Dasein
lui-mme. Aussi bien la vrit originelle, et donc l'Etre lui-mme,
est seulement pour autant que le Dasein est (37). Le processus de
l'Etre, son -vnement, s'accomplit avec l'achvement de la com
prhension existentiale ; le Dasein est constitu simplement par une
structure relationnelle l'Etre comme tel (Bezug zum Sein).
("> Sem und Zeit, p. 14.
<"' Allerdings nur solange Dasein ist, d. h. die ontische Mglichkeit von
Seinverstandniss, 'gilt es', Sein... {Sein und Zeit, p. 212).
(") Sein und Zeit, p. 230.
274 Maurice Corvez
L'Etre et le Dasein sont donc essentiellement corrlatifs. Ils
apparaissent en mme temps et disparaissent de mme. Telle est
l'illumination phnomnologique. Dans cette lumire, Heidegger a
vu d'abord le pro-jet du Dasein vers l'Etre, travers son irruption
(Einbruch) dans le monde des tants. Plus tard, il comprendra que
ce projet est provoqu par le jet de l'Etre lui-mme dans son Da,
dans le Dasein. Sous de multiples formes, la primaut de l'Etre
sur le Dasein est alors exprime. L'Etre se dcouvre son Da,
dans son Da. Il se donne lui (es gibt das Sein) : il est le donateur
et le don. Il s'adresse au Dasein, s'envoie lui (Geschichi), se
termine lui, qui ralise de ce fait sa destine privilgie (Schickr
sal). En ce Da, l'homme se laisse librement tre le Da de l'Etre ;
il regarde l'Etre, selon que par lui, il s'assume lui-mme comme
son Berger (Hire des Seins) <38>. Se pro-jetant au dehors (dans le
Da), l'Etre le domine de toute manire et en tout temps. Le Da,
en son accomplissement, procde ainsi de l'Etre et lui appartient
totalement.
A mesure que se dveloppe la rflexion de Heidegger, le Dasein
est exprim plus habituellement par le terme de pense {Denkfin),
et l'Etre par celui de Logos, principe originel de la conceptuali
sation et du langage (qui est la Maison de l'Etre). On parle moins
du souci et des existentiaux : le Dasein, c'est la Pense (une pr
pense humaine), abouche l'Etre-Logos.
Selon sa nature mme, l'Etre se rvle et se cache travers
le Da. Il demande qu'on le pense. Il le fait (beansprucht) sous la
forme d'une parole adresse au Da {Anspruch) et qui attend une
rponse (Entsprechen). Cet appel au Dasein procde de la gnr
osit de l'Etre. Sa voix silencieuse (lautlose Stimme) est nigma-
tique. Elle exige, et laisse libre. La pense est acquiescement, con
sentement, son initiative. L'Etre se donne la pense, cho de
sa voix. La pense se repose (beruht) en l'Etre-Logos, dans la tran
quillit d'une totale rcollection de soi (39), dans la docilit d'un
complet abandonnement : c'est le recueillement du Dasein vers et
dans l'Etre-Logos, son entre dans l'Ouvert, accomplissement de
la libert, par la dlivrance l'gard des reprsentations.
La pense n'est pas la mme chose que le Logos. Elle n'est
<) Holztoege, p. 321.
(**) Vortrge und Aufaatze (Pfullingen, Neske, 1954), p. 206.
L'Etre
et l'tant chez M. Heidegger 275
pas le Logos lui-mme. Elle ne fait rien de plus que d'tendre
(Xysiv) ce qui dj est tendu devant, et dont le fait d'tre tendu
ne dcoule jamais de la pense, mais rside dans la Pose recueil
lante, dans le Logos. Cette Pose recueillante est en mme temps
l'clair qui fait ressortir l'tant dans la lumire de sa prsence.
Elle conduit d'avance chaque chose au lieu assign son tre :
la fulguration brusquement gouverne. Omni-prsente, elle recueille
les tants, les rassemble en eux-mmes, les compose entre eux.
Ainsi l'Etre domine, de part en part. Le Dasein habite dans
l'Etre comme dans son lment. Il est ek-sistant dans la vrit de
l'Etre. Par le souci, par la pense, il garde (hutet) la vrit, il se
constitue le Gardien de l'Etre.
Bien que dominant le Dasein en totalit, l'Etre ne laisse pas
d'avoir besoin de lui. Il se produit dans et par l'acte de penser.
La pense de l'Etre aide l'Etre tre lui-mme ; elle accomplit
(vollbringt) la relation de l'Etre l'homme ; elle le laisse tre lui-
mme : origine et fondement. Le Da sert les besoins du Logos,
auquel il appartient. Il lui permet de trouver son domaine dans
l'humanit historique (40>. S'enracinant lui-mme dans son Da, le
Logos lui confie la tche de constituer une place de manifestation
parmi les hommes qui aide l'Etre venir comme vrit.
Ainsi l'Etre et le Dasein se conditionnent mutuellement. L'Etre
est premier, mais il ne peut rien sans le Dasein. Et cela est rel
ativement facile comprendre quand on a dfini l'Etre : ce qui
apparat au Dasein. Mais la diffrence , la nature de l'appar
tenance rciproque (Zusammengehrenlassen) (41> qui s'instaure
entre eux n'en est pas claircie. Nous savons du moins qu'elle est
penser dynamiquement, comme un passage de l'Etre au Da
(comme le jet au Da), et aussi comme le jet du Da l'Etre. Le
Da se trouve tre le lieu o la diffrence prend place, et nous
nous tenons dans cette diffrence (42). La diffrence est l'Etre lui-
mme. Bien que l'Etre ne soit pas un terme de relation, lui-mme
est la relation <43). On ne dpassera pas ces formules. Etre et
Dasein se distinguent, non pas comme des entits relles (on-
(**> Was i$t Metaphynk ?. p. 50.
<41> Identiiat und Differenz, p. 31.
<4*> Nietzsche, H, p. 207.
<"> Brief liber den Hitmanimtu (Bern, Francke, 1954), p. 77.
276
Maurice Coroez
tiques), mais, dans leur profondeur ontologique, comme deux
aspects d'un phnomne unique.
Face cette diffrence , cette dualit , Heidegger ne
trouve pas la paix totale de l'esprit. L'esprit ne se repose vraiment
que dans l'unit, dans l'Un. Aussi longtemps qu'il n'y est pas par
venu, il demeure dans l'inquitude. C'est pourquoi la question :
cette diffrence n'aurait-elle pas un centre ? devient, pour notre
philosophe, toujours plus lancinante. Le foyer de la diffrence, s'il
en est un, pourrait-il nous apparatre, un jour ?
Il semble que la voie est au moins ouverte. Dj en 1944,
Heidegger parlait (dans son Essai : Logos) d'un point central, unit
ultime, originelle, qui serait au principe de la diffrence. Plus
tard, en 1952, il est question d'une troisime chose {ein drittea)
au-del de l'Etre et du Dasein (elvai et voev), et qui serait donc
la premire, la source (*4). Enfin, en 1957, une origine profonde
est voque, qui serait simplicit (Einfache), et mme quelque
chose de purement singulier, un singulare tantum, qui permette
l'Etre et son Da de s'appartenir mutuellement (4S>. Ni le Logos
ne peut tre un exhaussement du Xeyeiv (la pense) mortel, ni ce
dernier n'tre que l'imitation du Logos et l'acceptation de sa
mesure. Alors l'tre qui se dploie dans le Xyetv de l'jioXoYeV
(Dasein) et l'tre qui se dploie dans le Xyetv du Logos ont tous
deux une provenance plus originelle dans le milieu simple qui se
trouve entre les deux <46).
Mais existe- t-il, pour une pense mortelle, un chemin qui con
duise ce point central, ce singulare tantum, qui serait le diff
renciant ?, demande Heidegger. Le chemin le plus ncessaire
notre pense conduisant vers ce Simple, qui demeure ce qu'il
faut penser sous le nom de Logos, il est long, remarque le philo
sophe, et peu de signes encore sont l pour nous le montrer.
Ce singulare serait-il ce quelque chose qui passe travers
l'mission de l'Etre, selon qu'elle persvre au long de l'Histoire ?
Une seule mission n'puise pas le pouvoir cach qu'a l'Etre de
<**> Was heisst DenJfeen ? (Tubingen, Niemeyer, 1954). p. 147.
<> VortrSge und Aufatze, p. 225; Identilat und Differenz, p. 29.
<**' Dann hat sowohl das Wesende im Xyetv des ^oXoyttv al auch da*
Wesende im Xiyetv des Adyo zugleich ein enfanglichere Herkunft in der ein-
fachen Mitte zwischen beiden. Gibt es dahin fur sterbliches Denken einen
Weg ? , Vortmge und Aufsatze, p. 225.
L'Etre
et l'tant chez Af. Heidegger 277
se rvler. C'est la multiplicit de ces missions qui constitue l'His
toire. Chaque mission est identit de l'Etre et de la pense,
mais, pour fonder l'unit de l'Histoire, ne faudrait-il pas une Ident
it de ces identits ? Que serait cette Identit ? Non pas une
gnralit abstraite valable pour tous les cas. Pas davantage une
loi, qui garantirait la ncessit de quelque processus comme dialec
tique (47). Alors ? Heidegger ne pourrait-il poursuivre sur sa lance ?
S'il a pu, sans les sparer compltement, dissocier ce point
l'Etre de l'tant, l'ontologique de l'ontique (pour cette raison que,
phnomnologiquement, leurs concepts ne se confondent pas),
pourquoi, ds l que je puis penser l'Etre, sans distinction aucune
d'Etre et d'tre-l, de Sein et de Dasein, ne lui attribuerais-je pas
une essence {Wesen), elle aussi dgage de ce qui cependant ne
cesse de dpendre d'elle ? L'Etre vraiment pur, cette fois, serait
manifest thmatiquement. C'est bien lui qui serait alors le Ph
nomne. Il ne serait ni l'Etre, ni le Dasein, mais la source des
deux, YUr-Grund. Cet -vnement ultime de la vrit serait, nos
yeux, l'un des noms du vrai Dieu.
Si Heidegger ne pouvait voir dans la diffrenciation que le
processus de l'Etre lui-mme, tel qu'il l'a conu dans son oppos
ition au Da8ein (**\ c'est qu'il aurait recul devant l'exigence de
fonder ultimement ce qui demeure encore divis. Comment ex
pliquer ce refus ? Sans doute, dira-t-on, parce que cet Etre-Source
n'apparat pas immdiatement (sans medium) : il ne serait que le
principe postul selon une requte de l'esprit laquelle on n'ac
corde pas de crdit. Le Seyn, au contraire, est immdiat : on ne
peut le rcuser, mme si on ne peroit pas clairement ses attaches
avec l'tant. C'est la mthode phnomnologique, trop exigeante,
trop troite, qu'il faudrait alors s'en prendre, du moins quand elle
se prsente comme le moyen le plus rigoureux d'atteindre la vrit.
Cependant mesure que l'Etre dvoile son mystre sous des
aspects de plus en plus positifs, l'aspiration atteindre le but se
fait toujours plus aigu pour notre philosophe. Dans Sein und Zeit,
l'Etre n'apparat que sous les espces de la fmitude. Aux yeux de
Heidegger vieillissant, les missions de l'Etre sont encore finies,
mais l'Etre se montre sous un jour qui ouvre un singulier chemin
vers l'infini. L'Etre est Gnrosit et Libralit, Gracieuset et
<"> IdentitSt und Different, pp. 65, 66.
(> Nietzsche, n, p. 489.
278 Maurice Corvez
Grce, Source de joie, Batitude et Srnit, le Saint et l'Esprit,
Trsor, Richesse inestimable, Plnitude cache. Il est le Tout, le
Simple, le Seul et l'Unique, la grande Origine. Inexhaustible (49),
ineffable, il est le mystre cach et oubli, le AY)$-r), en lequel
repose l'A-Ai/j^eia : la primordiale obscurit d'o jaillit la manifest
ation de la vrit.
Heidegger ira-t-il plus loin ? Sa pense s'est considrablement
dprise de sa rigidit initiale. Ses propres formules ne le satisfont
pas. Il reconnat la finitude de son effort, interroge sans repos, est
tout attention la voix silencieuse . Il n'a pas dit son dernier
mot. Le dialogue avec la vrit est sans fin (das Endlose) ; il y a
des questions qui ne s'teignent jamais (50). Il est possible que se
dcouvre un horizon plus originel, plus universel, o serait puise
la rponse au fatidique : que signifie tre ? .
Mais chaque penseur doit demeurer dans sa ligne, n'a que son
propre chemin (51). Il n'est pas question de rfuter. Suggrer, peut-
tre, interroger ensemble ? Ce que Heidegger a vu, il l'a bien vu,
et personne ne l'en fera dmordre. Pourra-t-il entrevoir, et surtout
affirmer l'Etre absolu ?
Il n'est pas douteux que l'approche phnomnologique est,
malgr sa rigueur, tonnamment dcevante. Sa base de dpart,
rduite l'apparition immdiate de la lumire ( une sorte de
contact) laisse hors de son champ de vision des vrits pourtant
indclinables, des problmes essentiels, pour elle sans signification
parce qu'ils n'entrent pas dans ses perpectives. Si ces perspectives
taient suffisamment larges, on ne pourrait qu'applaudir. Mais avec
ce prsuppos troit ! En voulant fonder la mtaphysique, Heidegger
a fui dans l'abstraction d'un monde qui n'est plus le monde rel.
Son ontologie n'est pas un aspect du monde ; elle en est le survol :
un horizon qui ne la rejoint pas effectivement. Son message serait-il
dfinitif, comme eschatologie de l'Etre, au point qu'il suffirait
dsormais de l'approfondir ? Nous ne le pensons pas. Une phno
mnologie puriste qui n'ouvre les yeux qu' une certaine lumire,
qui se ferme rsolument toute autre et relativise, du haut d'une
<"> Kant xind das Problem der Metaphyaik, p. 204.
<"> Was ist Metaphysik ?, p. 40.
(M) Doch ist jedem Denkenden je nur ein Weg, der Seine, zugewiesen, in
dessen Spuren er immer wieder hin und her gehen muss , Holzwege, pp, 194, 195-.
L'Etre et l'tant chez M. Heidegger 279
grandeur usurpe, les dmarches les plus assures de l'intelligence,
ne saurait fonder une ontologie correcte.
Heidegger a le sens de l'Etre universel, transcendantal par son
extension tout, au-del de toute catgorie. Son Etre, dans son
abstraction mme, demeure actuellement et implicitement prsent
tout tant, comme doit l'tre un vritable transcendantal. Le
lien est seulement dtendu qui rattache l'Etre l'tant (52), ce qui
permet d'isoler cet Etre que nulle distinction intrinsque, nulle
relation ontologique, ne peut mettre en condition. Nous disons bien
que l'tre transcendantal considr abstraitement en lui-mme est
indivis. Mais cet tre n'existe pas dans la ralit des choses .
Par lui, formellement, existent (sont) les tants, dont il ne se dis
tingue pas rellement. Seul l'tant est, de par son tre, qui le
constitue intrinsquement, lui donne d'tre vraiment, non pas seule
ment en vertu d'une relation un Etre demeurant son splendide
isolement, malgr ses avances rserves la multitude des tants.
Lyon. Maurice CoRVEZ, o. P.
<*> L'Etre {Seyn) de Heidegger, comme notre en commune, implique l'acte
d'tre (actus essendt) et l'essence ontologique. Il n'est pas spar totalement de
l'tant spcifique et individuel, mais sa prsence a tout tant, bien que dter
mine par celui-ci, ne fait pas que, dans sa dtermination mme, il se confonde
rellement avec lui. Le Seyn a donc un aspect transcendantal, mais il n'est pas
identique notre transcendantal en. Les autres transcendantaux : l'un, le vrai,
le bien, dont nous disons qu'ils sont convertibles avec Yens, sont atteints aussi
dans le Seyn, mais imparfaitement, comme l'tre lui-mme. 'Le recul phnomn
ologique du Seyn se traduit par un distancement ontologique {la c diffrence ),
car Heidegger ne veut rien savoir, ou ne peut rien savoir (a cause de sa mthode)
de ce que l'Etre est en lui-mme. Il sait tout ce que l'on dit de l'tant (de ses
modalits, de ses principes et de ses causes), mais comme son Etre n'y est pas
absolument engag, il n'a pas de densit propre. Sa densit propre n'apparat
pas im-mdiatement, mais seulement a travers ses modes: le retrancher de ses
modes, par une distinction relle, c'est le vider de toute ralit, de toute
substance. On peut bien parler des richesses de l'Etre , de c l'ensemble des
articulations et relations qu'il comporte: la diffrence, l'abme, demeure;
l'Etre est spar rellement, bien que tout vienne de lui et remonte vers lui.
Cet Etre est univoque, comme celui de Duns Scot, selon la dtermination
ontologique commune et indiffrencie dont il affecte les tants. D'autre part,
on pourrait lui reconnatre une sorte d'analogicit. En effet, cet Etre commun n'est
pas tout fait spar des tants: une certaine relation les unit. Si bien qu'a
tout prendre, considrant que les tants sont (ontiquement) , selon des modes
diffrents, analogues, on peut dire que l'Etre pouse quelque chose de leur ana-
logicit dans la mesure o il fait un avec eux (si imparfaitement que ce soit), par
cette prsence de caractre spcial que nous avons tent de dfinir.
Vous aimerez peut-être aussi
- Marc Richir, Annales - 2003Document221 pagesMarc Richir, Annales - 2003Gabriel Jiménez TaviraPas encore d'évaluation
- Bernard Mabille - Hegel L'épreuve de La ContingenceDocument2 pagesBernard Mabille - Hegel L'épreuve de La ContingenceSombre Arcane ZinePas encore d'évaluation
- L'Unité de L'être ParménidienDocument14 pagesL'Unité de L'être Parménidienvince34100% (1)
- Aspect de La Phenomologie Non SymboliqueDocument9 pagesAspect de La Phenomologie Non SymboliqueJoelle MesnilPas encore d'évaluation
- 24 - Initiation Et Réalisation SpirituelleDocument193 pages24 - Initiation Et Réalisation SpirituelleGauthier Pierozak86% (7)
- La Différence Ontologique Chez M. HeideggerDocument29 pagesLa Différence Ontologique Chez M. Heideggervince34Pas encore d'évaluation
- Jan PatockaDocument5 pagesJan PatockakappamakikappaPas encore d'évaluation
- La Biographie D'empédocle - Bidez (1894)Document187 pagesLa Biographie D'empédocle - Bidez (1894)Babilonia Cruz100% (1)
- La Phénoménologie de Husserl Comme MétaphysiqueDocument30 pagesLa Phénoménologie de Husserl Comme MétaphysiqueLandry SEKIPas encore d'évaluation
- La Methode Allegorique Chez Les Stoicie PDFDocument28 pagesLa Methode Allegorique Chez Les Stoicie PDFJérôme RobinPas encore d'évaluation
- Le Nombre Entier Dans TheeteteDocument20 pagesLe Nombre Entier Dans TheetetelangoustmanPas encore d'évaluation
- Franck, La VeritéDocument20 pagesFranck, La VeritéGros Caca LiquidePas encore d'évaluation
- L'intelligence Gagnée Par L'intuition ?Document13 pagesL'intelligence Gagnée Par L'intuition ?zincq.aurelien100% (1)
- Dastur, Francoise - Le Concept de Science Chez Heidegger Avant Le Ant Des Annees TrenteDocument22 pagesDastur, Francoise - Le Concept de Science Chez Heidegger Avant Le Ant Des Annees TrentetragicboogiePas encore d'évaluation
- Les Miracles D'empédocle - Christine MauduitDocument22 pagesLes Miracles D'empédocle - Christine Mauduitvordevan100% (1)
- Combes Joseph - DAMASCIUS LECTEUR DU PARMÉNIDE (1975) PDFDocument29 pagesCombes Joseph - DAMASCIUS LECTEUR DU PARMÉNIDE (1975) PDFSteven WilliamsPas encore d'évaluation
- Jean Hyppolite - Genèse Et Structure de La Phénoménologie de L'esprit de Hegel - CHAPITRE 1Document11 pagesJean Hyppolite - Genèse Et Structure de La Phénoménologie de L'esprit de Hegel - CHAPITRE 1Calac100% (1)
- Moreau Joseph La Signification Du ParmenideDocument36 pagesMoreau Joseph La Signification Du ParmenideaoaddiePas encore d'évaluation
- Alexander, Robert - La Refondation Richirienne de La PhenomenologieDocument399 pagesAlexander, Robert - La Refondation Richirienne de La PhenomenologieGabriel Jiménez TaviraPas encore d'évaluation
- Les Formes IntelligiblesDocument5 pagesLes Formes Intelligiblesgregorykudish100% (1)
- La Logique Comme Question en Quête de La Pleine Essence Du Langage by Martin HeideggerDocument109 pagesLa Logique Comme Question en Quête de La Pleine Essence Du Langage by Martin HeideggerMaher FadhliPas encore d'évaluation
- Le Probleme de La Methode Dans La Philos-2Document155 pagesLe Probleme de La Methode Dans La Philos-2slim tobePas encore d'évaluation
- CRP Cohen Halimi 2007 2008Document27 pagesCRP Cohen Halimi 2007 2008Sacha DobridiovskyPas encore d'évaluation
- KANT, Essai Pour Introduire en Philosophie Le Concept de Grandeur NégativeDocument20 pagesKANT, Essai Pour Introduire en Philosophie Le Concept de Grandeur NégativeAnonymous NE7Bwby7Pas encore d'évaluation
- Les Méditations CartesiennesDocument26 pagesLes Méditations Cartesiennesjules borrelPas encore d'évaluation
- Articles D'henry MaldineyDocument3 pagesArticles D'henry MaldineyfabrigenePas encore d'évaluation
- Franck - Heidegger Et Le ChristianismeDocument73 pagesFranck - Heidegger Et Le ChristianismeGros Caca LiquidePas encore d'évaluation
- Delbos, Le Spinozisme, 1913Document234 pagesDelbos, Le Spinozisme, 1913hugomaxEPS100% (1)
- Diderot Chardin Et La Matiere SensibleDocument18 pagesDiderot Chardin Et La Matiere SensibleJose MuñozPas encore d'évaluation
- Foucault - Leçon Sur NietzscheDocument20 pagesFoucault - Leçon Sur Nietzschescrazed100% (1)
- Courtine, Jean-François - La Question de L'être Aujourd'HuiDocument10 pagesCourtine, Jean-François - La Question de L'être Aujourd'HuiLesabendio7Pas encore d'évaluation
- Simondon - Le Temps, Père de Toutes Choses . Chronos - Kronos PDFDocument11 pagesSimondon - Le Temps, Père de Toutes Choses . Chronos - Kronos PDFTiago da Costa GuterresPas encore d'évaluation
- Hugo Rahner. Mythes Grecs Et Mystère ChrétienDocument4 pagesHugo Rahner. Mythes Grecs Et Mystère ChrétienTiffany BrooksPas encore d'évaluation
- Nishida Kitaronotes Et GlossaireDocument55 pagesNishida Kitaronotes Et GlossaireTRIBYPas encore d'évaluation
- Lecture Historique Ou Lecture Analytique de Platon? - Yvon LafranceDocument11 pagesLecture Historique Ou Lecture Analytique de Platon? - Yvon LafranceAlfonso FlórezPas encore d'évaluation
- CRPDocument50 pagesCRPoiromdamPas encore d'évaluation
- Didier Franck, Le SensibleDocument7 pagesDidier Franck, Le SensibleGros Caca LiquidePas encore d'évaluation
- Trouillard - La Moné Selon ProclosDocument12 pagesTrouillard - La Moné Selon ProclosRupertoPas encore d'évaluation
- Dixsaut M. - L'analogie IntenableDocument29 pagesDixsaut M. - L'analogie IntenableannipPas encore d'évaluation
- Mort, Mystère Et Oubli Dans La Pensée de Heidegger. MarquetDocument22 pagesMort, Mystère Et Oubli Dans La Pensée de Heidegger. MarquetNicolas Di BiasePas encore d'évaluation
- La Transcendance Immanante - BouddhismeDocument12 pagesLa Transcendance Immanante - BouddhismeRodrigo Barros GewehrPas encore d'évaluation
- Plotin - Jean François Pradeau - Luc Brisson Traités 7 21. 2 Flammarion - 2003Document537 pagesPlotin - Jean François Pradeau - Luc Brisson Traités 7 21. 2 Flammarion - 2003valentina merico100% (1)
- Joseph Moreau - L'Idée Platonicienne Et Le RéceptacleDocument14 pagesJoseph Moreau - L'Idée Platonicienne Et Le RéceptacleduckbannyPas encore d'évaluation
- Cattin La Décision de PhilosopherDocument127 pagesCattin La Décision de PhilosopherGros Caca LiquidePas encore d'évaluation
- VrinDocument22 pagesVrinpetarPas encore d'évaluation
- Jeanluc Marion Figures de Phenomenologie Husserl Heidegger Levinas Henry Derrida 1Document222 pagesJeanluc Marion Figures de Phenomenologie Husserl Heidegger Levinas Henry Derrida 1Antonia FigueroaPas encore d'évaluation
- L'hénologie Comme Dépassement de La MétaphysiqueDocument21 pagesL'hénologie Comme Dépassement de La Métaphysiquem54237Pas encore d'évaluation
- PLATON, L. Robin Tadd. Phedon 1926Document290 pagesPLATON, L. Robin Tadd. Phedon 1926André Decotelli100% (1)
- Conférence de Q. Meillassoux Sur Mallarmé - Le Signifiant OpaqueDocument6 pagesConférence de Q. Meillassoux Sur Mallarmé - Le Signifiant OpaquepanoptericPas encore d'évaluation
- Frege Sens RéférenceDocument23 pagesFrege Sens RéférenceAmåury CachøtPas encore d'évaluation
- Kant Geographie - La Geographie de La RaisonDocument7 pagesKant Geographie - La Geographie de La RaisonAnonymous slVH85zYPas encore d'évaluation
- Chretien L'Analogie Selon PlotinDocument15 pagesChretien L'Analogie Selon PlotinTheophilos KyriakidesPas encore d'évaluation
- La Causalité Du Bien Et La Métaphysique Du Mélange PlatonicienDocument45 pagesLa Causalité Du Bien Et La Métaphysique Du Mélange PlatonicienMaxime PorcoPas encore d'évaluation
- Le Problème Moral Dans La (... ) Delbos VictorDocument604 pagesLe Problème Moral Dans La (... ) Delbos VictorFabianaPas encore d'évaluation
- Benoist, Cours Sur HeideggerDocument55 pagesBenoist, Cours Sur HeideggerGros Caca LiquidePas encore d'évaluation
- Entre Mimesis Et AnalogieDocument10 pagesEntre Mimesis Et AnalogieAxelle JéromePas encore d'évaluation
- Etre Au Devenir 1Document392 pagesEtre Au Devenir 1Thechosen WolfPas encore d'évaluation
- Le Monde Cattin Paris IVDocument26 pagesLe Monde Cattin Paris IVOmid DjalaliPas encore d'évaluation
- Recherches Sur Dietrich de Freiberg by Joël Biard, Dragos Calma, Ruedi ImbachDocument260 pagesRecherches Sur Dietrich de Freiberg by Joël Biard, Dragos Calma, Ruedi ImbachThi ArmadasPas encore d'évaluation
- Principes de la philosophie morale: ou Essai sur le mérite et la vertuD'EverandPrincipes de la philosophie morale: ou Essai sur le mérite et la vertuPas encore d'évaluation
- Jacques-Alain Miller, Donc, Cours 1994-1995Document233 pagesJacques-Alain Miller, Donc, Cours 1994-1995Schkrippe100% (1)
- Notions de Logique Mathematique - Tim Van Der LindenDocument63 pagesNotions de Logique Mathematique - Tim Van Der LindenBPas encore d'évaluation
- Argum ScientifiqueDocument15 pagesArgum ScientifiqueGABANIGABANIPas encore d'évaluation
- Andre Cresson Et Rene Serreau Hegel Sa Vie Son Oeuvre Sa Philosophie Paris Puf 1949 130425184900 Phpapp02 PDFDocument144 pagesAndre Cresson Et Rene Serreau Hegel Sa Vie Son Oeuvre Sa Philosophie Paris Puf 1949 130425184900 Phpapp02 PDFsrinPas encore d'évaluation
- LEIBNIZDocument15 pagesLEIBNIZFelicy AussiPas encore d'évaluation
- Charles de Koninck - Da Alma e Do Bem ComumDocument142 pagesCharles de Koninck - Da Alma e Do Bem ComumLeonildo JuniorPas encore d'évaluation
- Leibniz Et La Langue Adamique PDFDocument20 pagesLeibniz Et La Langue Adamique PDFJo GaduPas encore d'évaluation
- Sur L'argumentationDocument4 pagesSur L'argumentationJENIFFER SANCHEZ RUBIOPas encore d'évaluation
- Le Paradoxe Dans Le LangageDocument13 pagesLe Paradoxe Dans Le LangageSanae KamiliaPas encore d'évaluation
- Coll - La Définition (OCR FR) PartDocument38 pagesColl - La Définition (OCR FR) Part140871raph100% (1)
- 2ème ANNEE SECONDAIRE PDFDocument65 pages2ème ANNEE SECONDAIRE PDFSali LeaderPas encore d'évaluation
- Cours Logique Formelle - Partie 2Document12 pagesCours Logique Formelle - Partie 29raya nchallaPas encore d'évaluation
- Stengers Entretien L'invention Des Sciences 1993Document22 pagesStengers Entretien L'invention Des Sciences 1993sofidavilaPas encore d'évaluation
- Deleuze-Cours Sur Spinoza PDFDocument531 pagesDeleuze-Cours Sur Spinoza PDFabbraxasPas encore d'évaluation
- Chap 1Document14 pagesChap 1NoussaPas encore d'évaluation
- Platon Z Oc Oeuvres CompletesDocument308 pagesPlaton Z Oc Oeuvres CompletesFahmi Ben Hfaiedh100% (1)
- La Pensee Ethique Contemporaine - Russ Jacqueline, Leguil Clotild PDFDocument71 pagesLa Pensee Ethique Contemporaine - Russ Jacqueline, Leguil Clotild PDFZoraRosaPas encore d'évaluation