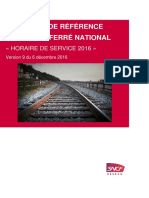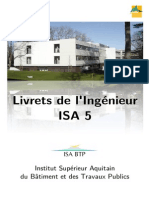Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
T 66
Transféré par
André Germain MbogbaTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
T 66
Transféré par
André Germain MbogbaDroits d'auteur :
Formats disponibles
0Couverture:0Couverture
30/07/08
11:00
Page 2
C OLLECTION
T 66
TECHNIQUE
C I M B TO N
TUNNELS
FERROVIAIRES
La voie bton, solution pour amliorer
la scurit des usagers
et lintervention des secours
chap tunnel 30-07-08 FAB:chap tunnel 25/07/05
30/07/08
11:55
Page 2
La voie bton, solution pour amliorer la scurit
Les contributions louvrage
Serge
Jean-Franois
Pierre
Jean-Marc
Christophe
HORVATH
SCHMAUCH
GARIOUD
POTIER
CHEVALIER
Cimbton
Colonel (er) de Sapeurs-pompiers
Lieutenant-colonel de Sapeurs-pompiers
SNBPE
AGILIS
avec la participation de :
Wolfgang GERLACH
Grard HERBAUX
Jacques NARDIN
EDILON
Consultant
Consultant
chap tunnel 30-07-08 FAB:chap tunnel 25/07/05
30/07/08
11:55
Page 3
Avant-propos
Les arguments en faveur de la voie bton dans les tunnels ferroviaires
sont trs nombreux :
amlioration des conditions dintervention des secours;
vacuation facilite des usagers en cas daccidents;
amlioration de la prennit de louvrage;
rduction des nuisances;
augmentation du confort des passagers;
oprations de maintenance et dentretien plus rapides
et plus simples;
mise en conformit au gabarit europen sans retailler le tunnel;
optimisation du gabarit en construction neuve;
augmentation de la visibilit du fait de la clart du bton;
rduction de la consommation dnergie lectrique
pour lclairage.
Tous ces avantages concourent concevoir des tunnels ferroviaires intgrant pleinement le concept de dveloppement durable.
chap tunnel 30-07-08 FAB:chap tunnel 25/07/05
30/07/08
11:55
Page 4
La voie bton, solution pour amliorer la scurit
Sommaire
1 - La ncessaire amlioration des conditions de scurit
2 - Les tunnels ferroviaires, enjeux de socit
3 - Les tunnels ferroviaires en France
4 - La pose de voies ferres en Europe et dans le monde
5 - La voie fixe ou voie bton
11
5.1 - Principe de construction
5.2 - Principaux types de voies sans ballast
5.2.1 - Traverses en bton noyes dans la dalle en bton
5.2.2 - Exprimentation franaise dune voie attache directe
5.2.3 - ERS (Embedded Rails Systems) systme de voie noye
sans attache dans la dalle en bton de type Edilon
5.3 - Les points forts de la voie bton
5.3.1 - Avantages financiers
5.3.2 - Avantages techniques
5.3.3 - Scurit des usagers et intervention des secours
5.3.4 - Diminution du bruit
5.4 - lments prfabriqus en bton
5.5 - Voie exprimentale de la ligne TGV Est
5.6 - Comparaison technique voie bton - voie ballaste
5.7 - Approche conomique
6 - Lvaluation des risques et lamlioration de la scurit
en tunnels ferroviaires
6.1 - Les risques daccident
6.2 - Les aspects oprationnels
6.3 - Les accs au tunnel
6.4 - La progression lintrieur du tunnel
6.5 - Les dispositions relatives la sret
11
12
12
14
16
18
18
18
19
19
20
21
23
24
24
24
25
26
26
27
chap tunnel 30-07-08 FAB:chap tunnel 25/07/05
30/07/08
11:55
Page 5
7 - Gestion des oprations de lutte contre lincendie
27
7.1 - Engagement des moyens de secours
7.2 - Variables essentielles impactant la scurit en tunnel
7.3 - Composantes oprationnelles
7.3.1 - Dlai d'intervention
7.3.2 - Sauvetage des personnes
7.3.3 - vacuation
7.3.4 - Prservation de l'environnement
28
28
30
30
31
31
31
7.3.5 - Propagation de l'incendie
7.3.6 - Contraintes oprationnelles
7.3.7 - Qualit du milieu
7.4 - Tableaux rcapitulatifs des problmatiques et des contraintes
31
32
32
32
8 - Conclusion
35
chap tunnel 30-07-08 FAB:chap tunnel 25/07/05
30/07/08
11:55
Page 6
La voie bton, solution pour amliorer la scurit
Tunnel du Pragal (Portugal) dune longueur de 2 km, mis en service en lan 2000.
Ce systme de voie bton procure un accs ais aux vhicules de secours
et de maintenance.
Photo : Edilon
chap tunnel 30-07-08 FAB:chap tunnel 25/07/05
30/07/08
11:55
Page 7
Au cours de ces dernires annes, plusieurs socits ferroviaires europennes se
sont rsolument engages moderniser leur rseau ferroviaire et favoriser
linnovation technique tout en amliorant les conditions globales de scurit. De
nombreuses tudes, suivies de ralisations, montrent la fiabilit de ces techniques.
De plus, la rduction des cots est relle et la scurit globale des ouvrages est
augmente. Transposer ces techniques dans les tunnels pour amliorer la scurit
est ainsi devenu une ralit.
1 - La ncessaire amlioration des conditions de scurit
Comme les tunnels routiers, o depuis 1949 on a dnombr prs de quarante
incendies significatifs, les tunnels ferroviaires peuvent tre aussi le sige de catastrophes et dincendies svres. Pour ces derniers, vingt-trois sinistres ont t
recenss et analyss, dont six en France, parmi lesquels deux ont marqu les
esprits, aussi bien par leur intensit que par les pertes en vies humaines ou les
pertes dexploitation.
Le premier a lieu en 1972, anne o le Tunnel de Vierzy (Aisne) est le sige dun
trs grave accident : suite un boulement, deux trains de voyageurs se percutent
de front. On dnombrera plus de cent morts. Ce sinistre conduira la SNCF
accrotre les investigations des tunnels, en vue de procder leur rnovation.
Le second accident a eu lieu en 1996 : le draillement et lincendie dune navette
de fret dans le tunnel sous la Manche causent dimportants dsordres la structure et la voie de cet ouvrage, avec pour consquence la fermeture du tunnel
pendant deux ans. Par la suite, dautres incendies ont mis en vidence la faiblesse
des moyens de prvention et de secours pour procder lvacuation des personnes. La difficult se dplacer sur le ballast est alors mise en exergue.
2 - Les tunnels ferroviaires, enjeux de socit
Il sagit, avant tout, dune question de prservation de notre environnement et
dune volont politique tant franaise queuropenne. Le transport des marchandises et des produits dangereux ou combustibles qui les composent devrait, en
effet, se faire par voie ferre plutt que par route. Le transfert dune partie des
marchandises de la route vers le rail, de part le dveloppement du ferroutage,
auquel il faut ajouter laugmentation du trafic voyageurs, agit statistiquement
sur les risques daccidents, notamment dans les sections en tunnels. En consquence, comme pour les tunnels routiers, les tunnels ferroviaires sont soumis aux
mmes risques daccidents. La socit civile, nacceptant pas les consquences
chap tunnel 30-07-08 FAB:chap tunnel 25/07/05
30/07/08
11:55
Page 8
La voie bton, solution pour amliorer la scurit
Les rails encastrs dans la dalle en bton
permettent aux engins de secours de rouler
sur la voie de la gare dAlcobendas
(banlieue de Madrid).
des catastrophes, les socits concessionnaires et les autorits administratives
doivent mettre toutes les chances de leur ct, en donnant la meilleure scurit
possible aux ouvrages potentiellement dangereux.
3 - Les tunnels ferroviaires en France
Prs de 1 532 tunnels reprsentant 640 km de voies ferres ont t recenss en
France, seuls 1 300 tunnels sont en exploitation. Il convient de noter que :
4 tunnels ont plus de 5 km de longueur ;
15 tunnels ont de plus de 3 km ;
27 tunnels ont de plus de 2 km ;
116 sont suprieurs 1 km.
La construction de prs de 50 % de ces tunnels date de la seconde moiti du
XIXe sicle. Ils comprennent pratiquement tous une pose des voies sur traverses et
ballast. Si cette technique permet de respecter au mieux les contraintes gomtriques du plan de roulement (profil en long et dvers), il convient de souligner
chap tunnel 30-07-08 FAB:chap tunnel 25/07/05
30/07/08
11:55
Page 9
ses inconvnients incontournables, gnrs par
la mise en uvre elle-mme :
lusure de la voie est invitable, il convient alors
de procder des rechargements;
les quantits de roches concasses utilises
pour la ralisation du ballast sont importantes
et ces matriaux se rarfient ;
la mise en uvre gnre du bruit et de la
poussire ; des dispositions particulires doivent tre prises pour respecter les conditions
de travail ;
le ballast suse et doit tre renouvel ;
les cots dentretien sont importants.
4 - La pose de voies ferres en Europe et dans le monde
Lentretien du rseau est, pour tout concessionnaire, une ncessit vitale et une
charge financire de premire importance. En cas dusure prmature et/ou
dincidents, le trafic est dtourn ou bien la vitesse est rduite, avec tous les
retards et consquences pour lconomie du gestionnaire, comme pour celle du
client initial.
Il faut savoir quen Grande-Bretagne, le rseau ferr britannique est en crise
cause du cot trop lev de la maintenance des voies ballastes. Or, chaque anne
les cots de maintenance augmentent et maintenir le rseau en tat est une
bataille perdue davance. En Europe, un virage semble toutefois pris avec la
mise en service dune voie bton ou voie directe sur le Channel.
On peut estimer que cest au dbut du XXe sicle que sont apparues les premires
poses de voies bton. Cette solution a t juge intressante dans les ouvrages
souterrains.
C'est la fin des annes soixante, dbut des annes soixante-dix, que sont
proposes des solutions pour des liaisons grandes lignes au Japon. La voie
bton sans ballast y est maintenant systmatiquement retenue pour les nouvelles lignes.
En Allemagne, la premire exprience date de 1972 : un tronon de 740 m a t
ralis en gare de Rheda. Cest dans ce pays, que cette technique a suscit le plus
dintrt. Depuis 1997, 145 km de voies bton ont t construites, dont plus de
30 % en tunnels.
chap tunnel 30-07-08 FAB:chap tunnel 25/07/05
30/07/08
11:55
Page 10
La voie bton, solution pour amliorer la scurit
Tunnel de 7 800 m,
station dAlcobendas
en Espagne.
En Europe, outre lAllemagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne et au Portugal,
la voie bton est de plus en plus utilise, lair libre comme dans les tunnels ferroviaires. Il est, en effet, dmontr que mme si le cot dinstallation de la voie
fixe par rapport la voie traditionnelle en ballast est plus lev, les surcots
sont rapidement amortis grce une diminution importante des cots de maintenance et une plus grande disponibilit de la voie.
La voie fixe en bton permet datteindre une vitesse de 300 km/h, dans des
conditions conomiques et avec un niveau de confort optimal pour lusager.
En Espagne, le Ministre de la Construction impose une voie bton ds que
le tunnel dpasse 1 km de longueur.
En Espagne, gare
dAtocha Madrid,
train grande vitesse
sur voie bton.
10
chap tunnel 30-07-08 FAB:chap tunnel 25/07/05
30/07/08
11:55
Page 11
5 - La voie fixe ou voie bton
Plusieurs techniques existent actuellement, toutes utilisent une dalle en bton
arm installe soit en continu grce une machine spcialise (machine coffrage
glissant), soit en lments prfabriqus, soit par la mise en uvre de bton coul
en place. Ces techniques sont :
le systme spcialis de traverses en bton noyes dans la dalle en bton ;
lattache directe de la voie sur selles ;
le rail noy ou Embedded Rail System (ERS) : les rails sont maintenus dans des
gorges moules dans le bton par lintermdiaire dune rsine souple.
5.1 - Principes de construction de la voie bton
Dans les poses de voies classiques, les traverses reposent sur la plate-forme par
l'intermdiaire du ballast dont le rle est de :
rpartir les efforts transmis ;
donner la voie une lasticit suffisante pour supporter les efforts statiques et
dynamiques ;
assurer une limitation des dplacements transversaux.
La voie bton est une superstructure pour laquelle le ballast, susceptible de se tasser, est remplac par des couches d'assise constitues de dalles en bton.
Ce type de voie doit assurer les mmes fonctions que la voie traditionnelle par la
superposition de diffrents tages de raideurs dcroissantes.
SUPERSTRUCTURE
Rail
Fixation du rail
Traverse
Couche portante en bton
Couche portante base de liant hydraulique
Couche de protection contre le gel
Sous-sol
INFRASTRUCTURE
11
chap tunnel 30-07-08 FAB:chap tunnel 25/07/05
30/07/08
11:55
Page 12
La voie bton, solution pour amliorer la scurit
L'lasticit et l'amortissement ncessaires absents de la couche d'assise trs
rsistante sont assurs par la fixation du rail ou par un matriau lastique sous
les traverses. L'avantage sur le ballast est que l'lasticit est ici parfaitement
contrle et se dgrade beaucoup moins sous l'effet des sollicitations dynamiques.
partir de ces principes, diffrentes solutions techniques existent, elles peuvent
tre classes de la faon suivante :
fixations ponctuelles (avec ou sans traverse) ;
pose continue (rail enrob ou insr).
5.2 - Principaux types de voies sans ballast
5.2.1 - Traverses en bton noyes dans la dalle en bton
Les traverses peuvent tre maintenues en place de plusieurs faons : la plus courante est lutilisation de ballast. Si cette mthode est trs avantageuse la
construction, elle ncessite cependant une hauteur totale de voie importante et
beaucoup dentretien.
Une autre technique existe, consistant noyer la traverse dans un bton de calage.
La pose est facilement ralisable et ncessite peu de maintenance. Les traverses
sont quipes dinserts qui permettent la mise la hauteur de la voie, avant le
coulage du bton. Les techniques de bton pomp trouvent en tunnel un emploi,
optimal. Les photographies de la page suivante montrent les diffrentes tapes de
la construction dune voie.
Si ce type de voie peut tre utilis en tunnels ferroviaires, laccs des moyens
dentretien, et notamment des vhicules de type routier, est toutefois limit. La
hauteur de construction est proche de celle dune voie ballaste, ce qui limite
laccs de vhicules routiers pour les oprations dentretien, mais favorise, en
revanche, les conditions de cheminement des personnels ou lvacuation des
usagers en cas dincidents ou daccidents.
12
chap tunnel 30-07-08 FAB:chap tunnel 25/07/05
30/07/08
11:55
Page 13
Les diffrentes tapes de la construction de la voie :
1 pose des traverses en bton sur la chape en bton ;
2 disposition darmatures intermdiaires ;
3 positionnement des rails (selles, boulons, ressorts) ;
2
3
4 installation des bordures latrales (auget) ;
5 constitution de la dalle
dfinitive.
4
5
13
chap tunnel 30-07-08 FAB:chap tunnel 25/07/05
30/07/08
11:55
Page 14
La voie bton, solution pour amliorer la scurit
5.2.2 - Exprimentation franaise dune voie attache directe
Les travaux de pose dune voie ferre attache directe sur dalle mince en bton
arm ont t raliss dans le tunnel ferroviaire situ de Moret Lyon, louest de
la gare de Saint-Martin dEstraux, dans le dpartement de la Loire. Le tunnel non
lectrifi, doubles voies, dune longueur de 1 382 m, a fait lobjet de travaux de
rhabilitation et de rnovation en 2003.
La mise en uvre dune paisseur importante de ballast et lencombrement de
lassainissement conduisaient raliser, en terrain rocheux, des travaux de terrassements importants. Pour saffranchir de ces travaux de droctage lourds et coteux, le matre douvrage a retenu une solution technique permettant doptimiser
lencombrement vertical de la voie et de sa structure dassise, par la ralisation
dune dalle mince en bton, associe une pose de voie directe sur selles. Cette
solution permet de rserver les possibilits dvolution ultrieures en matire des
gabarits GB et dlectrification. Innovante pour la France, cette technique ouvre les
perspectives de prenniser le dbouch et le dgagement des gabarits et de
rduire les interventions dentretien des voies.
14
chap tunnel 30-07-08 FAB:chap tunnel 25/07/05
30/07/08
11:55
Page 15
Tunnel sous
La Manche
(cross over).
La surface de la dalle mince en bton arm est rgle
avec une tolrance de lordre du centimtre. Les rails
sont fixs sur des selles lastiques. Celles-ci sont rgles
puis scelles dans le bton, permettant dobtenir le
niveau exact du plan de roulement des rails, conformment aux tolrances prescrites par la SNCF. Cette
pose permet denvisager une augmentation future de la
vitesse des trains. Elle facilite son entretien par lemploi
de matriels mcaniss et informatiss.
Aujourdhui, les cots dentretien des voies et les renouvellements des traverses et du ballast sont consquents.
De plus, ces travaux ncessitent dimportants tonnages
en matriaux (granulats) et leur mise en uvre ncessite
des prcautions en raison de lespace confin (dgagement de poussires, etc.).
Le rail est fix par lintermdiaire dune selle en acier ou en bton de
rsine scelle dans la dalle en bton arm. Le principal avantage en
est la faible hauteur du complexe dalle-support de voie.
15
chap tunnel 30-07-08 FAB:chap tunnel 25/07/05
30/07/08
11:55
Page 16
La voie bton, solution pour amliorer la scurit
5.2.3 - Le rail noy ou ERS (Embedded Rails Systems)
Il sagit dun systme de fixation en continu : les rails sont maintenus dans une
engravure qui peut tre moule dans une dalle en bton. La caractristique principale du systme ERS est labsence totale des lments de fixation traditionnelle,
tels que les plaques, les boulons, les selles, les ressorts, etc.
Aprs rglage et calage, le rail est enrob et coll par une rsine bi-composante,
dont les capacits mcaniques sont fonction des besoins du projet (attnuation de
bruit ou des vibrations). Cette rsine doit rester invariable dans le temps et rsister au rayonnement et aux agressions chimiques, thermiques et mcaniques. De
plus, elle doit tre facile employer dans des conditions courantes de chantier :
conditionnement adapt des composants ;
consistance et temps de polymrisation rgls en fonction du travail raliser ;
collage parfait sur toutes les surfaces ;
insensibilit lhumidit.
Principaux points forts du systme ERS :
rduction des bruits et des vibrations ;
augmentation de la dure de vie des rails grce au support vertical et au
calage latral en continu par la rsine lastique et par labsence de forces
dynamiques induites par la flexion des traverses ;
rduction de la hauteur de la construction (tunnels, ouvrages dart, gares) ;
technique utilisable pour toute la gamme des rails existants ;
soudage et meulage des rails sans contraintes en dehors de la rservation ;
rglages avec outillage courant ;
entretien rduit au minimum : plus de fluage des patins, plus de pices desserres ou corrodes ;
remplacement ais du rail.
La dalle en bton de la ligne de mtro n 8, Madrid,
prsente un videment permettant la sauvegarde des
personnes tombes sur la voie et facilitant le nettoyage.
16
chap tunnel 30-07-08 FAB:chap tunnel 25/07/05
30/07/08
11:55
Page 17
Mise en uvre du systme ERS
Le bton est rgl devant la machine
laide dune pelle hydraulique.
La plateforme aprs passage de la
machine coffrage glissant (slip-form).
Vue en coupe dune
dalle en bton pour une
voie grande vitesse.
2 400
Mise en place de la rsine de
fixation du rail dans la rservation
de la dalle en bton.
17
chap tunnel 30-07-08 FAB:chap tunnel 25/07/05
30/07/08
11:55
Page 18
La voie bton, solution pour amliorer la scurit
5.3 - Les points forts de la voie bton
5.3.1 - Avantages financiers
Ils sont perceptibles aussi bien
dans le cot de construction que
sur les dpenses dentretien.
Cot de construction :
rduction du cot de la ralisation par la possibilit daugmenter le gabarit du tunnel (lors des
travaux de rnovation) ou de
diminuer le diamtre du tunnel
(surface btonne, excavations)
en travaux neufs ;
rduction du temps de pose des
rails (le rglage et le coulage sont
plus simples que dans le cas des
fixations classiques) en tenant
compte de lensemble des paramtres, la pose en rail noy est
comparable aux systmes existants.
Construction sur ballast
Construction sur voie bton
Rduction du diamtre
du tunnel
Dpenses pour lentretien :
entretien pratiquement nul pour le rail (plus de rglages ou de boulons resserrer);
accs facile pour les vhicules sur pneus (inspection et entretien de
lquipement du tunnel) ;
rparations ponctuelles sur les rails facilites (remplacement des rails casss,
rechargement des rails uss) ;
dans le cas daccident grave (choc, draillement ou feu) sil est ncessaire de
remplacer des longueurs importantes, le support nayant pas boug, les
rglages et la pose seront bien moins chers quavec des fixations classiques.
5.3.2 - Avantages techniques :
le rail est naturellement isol lectriquement ;
le collage continu donne des valeurs ngligeables de dilatation mme sur des
grandes longueurs ;
la dure de vie des rails est augmente par le support en continu, grce la disparition de leffet ondulatoire (usure excessive du rail sur les traverses) et des
efforts de fatigue.
18
chap tunnel 30-07-08 FAB:chap tunnel 25/07/05
30/07/08
11:55
Page 19
5.3.3 - Scurit des usagers et intervention des secours :
le support (dalle en bton) est incombustible ;
laccs aux vhicules routiers des premiers secours est possible sans dispositifs
supplmentaires ;
lvacuation des passagers nest pas gne par les rails, les traverses ou tous les
autres dispositifs de fixation.
5.3.4 - Diminution du bruit
Le bruit est un lment de confort incontournable. Le systme ERS permet la
diminution du bruit solidien grce sa rigidit et labsence totale de ponts
acoustiques entre rail et support. Le bruit arien est galement diminu par
lencapsulage du rail (effet de silentbloc ).
Nota
La flexibilit du produit de fixation des rails peut tre adapte
selon les valeurs absorbantes
recherches.
Mesures comparatives entre une voie ballaste
et une voie noye dans la gamme
des frquences 25 31,5 Hz, le systme ERS
rduit de 10 dB (A) le bruit de roulement.
Nota
Le systme ERS a t install dans de nombreux pays depuis 1982 et notamment dans le mtro de Londres, le tunnel sous la Manche, les tunnels Lantau
Hong Kong, Pragal au Portugal, Alcobendas en Espagne, Gothanbourg en
Sude, Zaragooza en Espagne, Pijnacker, Den Haag, Utrecht et Goolboog
aux Pays-Bas.
19
chap tunnel 30-07-08 FAB:chap tunnel 25/07/05
30/07/08
11:55
Page 20
La voie bton, solution pour amliorer la scurit
5.4 - lments prfabriqus en bton : rapidit de mise en place
La fabrication en usine de plaques dappui ou de dalles prfabriques pour voie
ferre est une alternative la constitution dune dalle coule en place. Les premires applications ont t ralises aux Pays-Bas, il y a plus de 30 ans.
La prfabrication en usine dlments de dimensions importantes (de 2 8 m de
long pour 2,60 m de large et 20 cm dpaisseur) permet des tolrances de fabrication de lordre de 0,1 mm.
Les lments peuvent tre soit en bton arm ou prcontraint, de rsistance C 55,
conforme la norme NF EN 206-1. Les armatures permettent la rpartition des
sollicitations et charges. Les dalles ainsi ralises peuvent recevoir tous les systmes, quils soient ERS ou classiques ; les fixations de rails sont pr-installes.
Pose de dalles prfabriques
Lausane de 4 m de longueur.
Les dalles sont alignes puis le
jointement est effectu grce
un mlange de mortier de
ciment.
20
chap tunnel 30-07-08 FAB:chap tunnel 25/07/05
30/07/08
11:55
Page 21
Le transport des plaques est effectu par un
engin classique de transport ; sur place, un
engin de levage portique, utilisable lair libre
comme en tunnel, permet le bon positionnement de chaque plaque pralablement
numrote conformment la gomtrie de la
voie.
La pose des lments est effectue sur une
couche portante base de ciment de 20
30 cm dpaisseur. Les plaques sont ajustes sur
chantier grce des lments de calage. Les
plaques sont ensuite lies entre elles par un
mortier de scellement.
Platelage PVF sur bibloc. Les lments prfabriqus,
utiliss dans les passages niveau, peuvent tre employs
galement dans les tunnels.
5.5 - Voie exprimentale de la ligne TGV Est
Suite aux problmes dexploitation des voies grande vitesse ballastes par RFF,
il a t dcid de raliser une voie exprimentale sur le trac de la LGV-Est. Cette
voie se trouve au nord de MONTYON (77), sur la commune de Chauconin.
Le projet reprsente deux voies de 1 800 ml chacune, incluant un appareil de voie
permettant le passage dune voie sur lautre. La section est dcompose en deux,
la moiti en courbe avec des dvers accusant jusqu 10 %, le reste tant en alignement droit.
Les dalles, qui reposent sur une grave ciment dpaisseur variable, sont fortement
ferrailles, environ 150 kg/m3.
Lobjectif est de faire circuler les TGV 320 km et de suivre lvolution et le comportement de la voie en bton.
21
chap tunnel 30-07-08 FAB:chap tunnel 25/07/05
30/07/08
11:55
La voie bton, solution pour amliorer la scurit
Les extrmits des dalles
ont t ancres par des
palplanches afin dviter
les dplacements de dalles
lors du passage du TGV.
Coupe type
en alignement droit
Coupe type en courbe
Spcificits de ralisation
Les tolrances attendues (5 mm),
obligent lutilisation de systmes de
guidage automatiques de dernire
gnration, comme le DPS, qui apportent une entire satisfaction.
Malgr la prsence continue darmatures, des joints ont t raliss tous
les 5 m par sciage sur une largeur de
4 mm et une profondeur de 1 cm.
22
Page 22
chap tunnel 30-07-08 FAB:chap tunnel 25/07/05
30/07/08
11:55
Page 23
Des barbacanes sont disposes tous les 5 ml afin de pouvoir vacuer les eaux
interstitielles qui pourraient tre mises en pression lors du passage des trains.
Une tanchit recouvre toute la dalle avant mise en place des traverses et du
bton de blocage.
Les contraintes de ralisation
Elles proviennent principalement du mode dapprovisionnement du bton. Les
voies LGV se trouvent en campagne avec des accs difficiles. Le fait davoir choisi
de raliser les voies en conservant le passage des trains travaux a accentu les difficults de ralisation et ralenti considrablement la vitesse davancement. Sans
contrainte, une cadence minimum de 500 ml/j est tout fait ralisable.
Pour raliser le chantier, le bton a t approvisionn par train au niveau de la
machine.
Formulation du bton
Le bton de voie utilis est un C35/47 dos 370 kg/m3 de CEM III en granulomtrie 0/20 + entraineur dair + plastifiant, plasticit de mise en uvre S1.
5.6 - Comparaison technique voie sans ballast voie ballaste
Voie avec ballast
Avantages
Inconvnients
Tenue de la gomtrie
de voie apte lusage
Niveau sonore faible
Projections de ballast
grande vitesse
Irrgularit des
proprits rhologiques
Rsistance latrale au
dplacement limite
Transfert des vibrations
lev
Matrise grande
vitesse
Largement mcanise
Faible sensibilit aux
imperfections de
fabrication
Prix matris
Utilisation de quantits Cadences rapides
importantes de granulats (en fonction de
lapprovisionnement
en bton)
Expriences trangres
favorables
Matrise globale des
cadences et des cots
Techniques de
maintenance
parfaitement matrises
Dgradation du ballast
volution long terme
de la gomtrie de voie
Obligation dun suivi
des oprations de
contrle
Conception
Construction
Maintenance
Voie bton
23
Avantages
Inconvnients
Rduction de la
missions sonores
hauteur de la structure bien que plus leves
Rgularit des propri- plus facile traiter
ts rhologiques
Pas de dfragmentation
de ballast
Haute rsistance aux
dplacements latraux
et longitudinaux
Exprience franaise
rduite sur le contrle
et la surveillance de
ce type de voies
Transition voie bton
/ voie ballaste
demandant une
ralisation rigoureuse
Grande durabilit
Exprience franaise
gnrale de la voie bton faible vis--vis de la
sans action de reprise ou maintenance des rails
de nivellement
chap tunnel 30-07-08 FAB:chap tunnel 25/07/05
30/07/08
11:55
Page 24
La voie bton, solution pour amliorer la scurit
5.7 - Approche conomique
Le point de vue conomique est primordial dans le choix dune pose de voie
bton (sans ballast). Une vision globale intgrant la fois les cots de construction
et les cots dexploitation simpose. Si lenveloppe finale leve a t un frein au
dveloppement de cette technique, aujourdhui, la prise en compte, dune part,
des cots globaux et, dautre part, des critres de dveloppement durable, permet de relativiser cette affirmation.
La pose de voie bton est particulirement intressante pour les tunnels ferroviaires ainsi dailleurs que sur les ponts.
Les oprateurs japonais ont la meilleure expertise de ces oprations. Les cots de
construction des voies sur dalle en bton au Japon sont de lordre de 1,3 1,5 fois
ceux des voies classiques.
Sur les ponts et viaducs, lavantage des voies sur dalles est plus net grce au gain
de poids mort sur les infrastructures. La voie sur dalle bton permet un maintien
de ltat des voies plus long que la voie classique. Il nexiste aucun phnomne
de dfragmentation du ballast. Ce facteur sintgre dans les cots de maintenance
qui sont dun rapport 4 en faveur de la voie bton.
En conclusion, et selon lexprience japonaise, lexcdent dinvestissement
de la voie bton est amorti entre deux et six annes dexploitation. Il convient
de souligner que lexprience allemande dans ce domaine conduit des
conclusions similaires.
6 - Lvaluation des risques et lamlioration de la scurit
6.1 - Les risques daccident
Les accidents en tunnels se traduisent par les mmes effets que ceux ayant lieu
lair libre. Sans tre exhaustif, on peut citer les points suivants.
Les draillements dun convoi : plusieurs centaines de voyageurs peuvent tre
impliques. Il sagit alors, pour les services de secours, de procder lvacuation
de nombreuses personnes, suivant le type de train (mtro, RER, TER ou TGV). Le
risque dun incendie est alors toujours possible. Quand des marchandises sont en
cause, la solution retenue pour les secours sera fonction de la dangerosit des
marchandises transportes.
24
chap tunnel 30-07-08 FAB:chap tunnel 25/07/05
30/07/08
11:55
Page 25
Tunnel de Pragal (voie daccs pompiers en bton), on distingue le
poteau dincendie pour lalimentation de la colonne sche.
Les collisions frontales ou lors de croisements de trains : des oprations de
dsincarcration des passagers et le traitement ventuel dincendies sont mener
Dans ces oprations, et compte tenu de la configuration des lieux, les secours doivent intervenir dans des conditions dfavorables (clairage rduit, troitesse et
espace confin, gaz toxiques, vapeurs, etc.).
Les incendies sont les risques les plus graves pour les tunnels ferroviaires et les
mtros. Selon les situations (incendie de train de voyageurs, transport de matires
dangereuses ou de marchandises, etc.), les paramtres concernent le dveloppement des fumes, les tempratures, la destruction des quipements, les victimes et leur vacuation, la dure de lopration, les moyens mettre en uvre,
la pnibilit de lopration.
Le lecteur pourra utilement se rfrer la revue Le Sapeur-pompier magazine
Accidents ferroviaires en milieu ouvert et ferm paru en septembre 2004. Les
articles reprennent les travaux du groupe de travail Scurit dans les tunnels
de la FNSPF (Fdration nationale des Sapeurs-pompiers de France).
6.2 - Les aspects oprationnels
Les difficults pour traiter ces accidents sont lies aux contraintes dapproche des
secours. Il convient de rduire les dlais dintervention et dvacuation afin de permettre aux voyageurs de pouvoir chapper aux dangers des fumes et aux secours
darriver au plus prs du sinistre. La rapidit sans transfert de charge est primordiale.
25
chap tunnel 30-07-08 FAB:chap tunnel 25/07/05
30/07/08
11:55
Page 26
La voie bton, solution pour amliorer la scurit
6.3 - Les accs au tunnel
Les moyens de secours doivent pouvoir intervenir dans les dlais les plus courts
lune ou lautre des ttes de tunnel. La construction de chemins daccs rservs
aux vhicules et engins spciaux des pompiers et secouristes est ncessaire.
Limplantation de la plupart des tunnels se situant en zone montagneuse, avec des
pentes fort pourcentage, les pistes doivent tre utilisables par tous temps. Le
traitement des chemins daccs par stabilisation au ciment est souvent une bonne
solution.
La ralisation dune route stabilise (la route en bton est une solution durable)
accompagne dune aire permettant laccueil des secours, la mise en place dun
poste de commandement et ventuellement dune zone de pose hlicoptre
est ncessaire.
Les vhicules rails-routes qui pourraient
quiper les pompiers napportent
quune capacit ponctuelle et ne permettent pas une vacuation rapide et
importante des blesss et passagers
notamment dans les tunnels de grandes
longueurs.
Les solutions suisse ou allemande du
train de secours ne sont pas en usage en
France.
26
DR Magazine Le Sapeur-pompier
Les matriels de secours du type brancards, tuyaux, pompes, etc., approvisionns par les pompiers ou stocks aux
ttes du tunnel, doivent pouvoir tre
transports lintrieur, au plus prs
de lendroit du sinistre. Des solutions de
transport par lorries obligent des
reprises de matriels conduisant
des pertes de temps supplmentaires
et des capacits de volumes transports
trs rduites.
DR Magazine Le Sapeur-pompier
6.4 - La progression
lintrieur du tunnel
chap tunnel 30-07-08 FAB:chap tunnel 25/07/05
30/07/08
11:55
Page 27
6.5 - Les dispositions relatives la sret
Les voies ferres sont, comme on a pu le vrifier rcemment, trs sensibles aux
malveillances. La voie bton, de part la simplicit de ses formes, constitue une
parade dissuasive contre ces actions.
7 - Gestion des oprations de lutte contre lincendie
en tunnel ferroviaire par les secours extrieurs
(sapeurs-pompiers)
Dune manire gnrale, la mission des sapeurs-pompiers consiste intervenir,
par ordre de priorit, sur :
les personnes ;
les biens ;
lenvironnement.
Bien que chaque intervention soit spcifique, les oprations de lutte doivent
rpondre une mthode dengagement des secours rationnelle et rpondant
lobjectif initial (missions gnrales).
Sagissant des tunnels tant routiers que ferroviaires, les secours doivent faire face
des incendies pouvant tre particulirement violents et difficiles combattre.
Lanticipation et la planification de lengagement des secours impliquent la dfinition dune conception tactique pralable tout engagement des personnels et des
moyens avec pour but certes dassurer la mission gnrale mais aussi de prserver les personnels dintervention.
DR Magazine Le Sapeur pompier
Des principes gnraux sappliquent et doivent permettre :
dinvestir au plus vite le tunnel par ses accs (avec les moyens oprationnels
utiles) ;
de sauver les usagers et dteindre les foyers ;
de reconnatre les lieux ;
de mener les oprations de commandement ;
de matriser les dispositifs techniques de scurit et de gestion du tunnel.
Pour atteindre cet objectif, lapplication dune doctrine dintervention simpose. Il
convient davoir des schmas prtablis dengagement des secours tant en engins
de secours spcifiques quen personnel. Leur mission sera alors fixe avant leur
engagement par le poste de commandement avanc dispos au plus prs du
sinistre. Un Poste de commandement principal lextrieur du tunnel assure la
coordination gnrale.
27
chap tunnel 30-07-08 FAB:chap tunnel 25/07/05
30/07/08
11:55
Page 28
La voie bton, solution pour amliorer la scurit
7.1 - Engagement des moyens de secours
Pour permettre un engagement des moyens rapide et sr, assurer les reconnaissances et les sauvetages ventuels, il est ncessaire de pouvoir arriver rapidement
et en scurit au plus prs du foyer.
Se pose alors la praticabilit du cheminement. Lexprience montre que la voirie
peut tre difficilement praticable du fait :
des fumes denses qui peuvent occuper la totalit de la section (gaz toxiques
pour les personnels et pour les vhicules) ;
des obstacles rencontrs (voitures en travers, objets ou lments ayant chut, etc.);
de la qualit de la chausse ou de la voie.
Plus les cheminements et les accs seront praticables, plus lauto-vacuation
des usagers et leur sauvetage seront faciles et la mise en uvre des moyens
dextinction rapide.
7.2 - Variables essentielles impactant la scurit en tunnel
Pour le cas particulier des tunnels, il est quelques lments connatre. Quatre
variables sont prendre en compte :
le contenant ;
le contenu ;
les usagers ;
laction des secours.
Le contenant prsente des caractristiques fixes connues et figes.
Le contenant est variable.
Il concerne les vhicules et leur contenu.
Quatre grandes familles de vhicules sont rescences :
les voitures lgres ;
les poids lourds conventionnels ;
les autocars ;
les transports de liquides inflammables.
Deux grandes familles de sinistres sont possibles :
incendies spontans rsultant d'un dysfonctionnement technique ;
incendies rsultant d'un accident de la circulation.
La conjonction de ces deux familles permet de dfinir des scnarios dintervention
et/ou de mise en situation qui peuvent tre ou ne pas tre traits par les secours.
28
chap tunnel 30-07-08 FAB:chap tunnel 25/07/05
30/07/08
11:55
Page 29
Organisation de laccs des secours dans le mtro de Madrid
la station dAlcobendas (mtro de
Madrid), un ascenseur permet
la descente des vhicules de secours
ou de maintenance, directement
sur la voie en bton ERS.
29
chap tunnel 30-07-08 FAB:chap tunnel 25/07/05
30/07/08
11:55
Page 30
La voie bton, solution pour amliorer la scurit
Scnario dintervention selon les quatre grandes familles de vhicules
et les deux grandes familles de sinistres
Puissance
de l'incendie
Voitures lgres
Volume de fumes Temps de monte
produites
de puissance
20 40 m3/s
2 6 MW
Dysfonctionnement technique
Extinction facile
15 30 minutes
Accidents de la circulation
Extinction facile
< 15 minutes
Poids lourds conventionnels
50 100 MW
40 90 m3/s
Dysfonctionnement technique
Extinction possible
< 10 minutes
Accidents de la circulation
Extinction difficile
Trs rapide
Autocars
50 100 MW
Dysfonctionnement technique
Extinction difficile
Accidents de la circulation
Transports de liquides inflammables
Dysfonctionnement technique
60 90 m3/s
< 10 minutes
Extinction trs difficile
De 100 300 MW
Trs rapide
3
90 300 m /s
Extinction trs difficile impossible
< 10 minutes
Extinction impossible
Immdiat
Accidents de la circulation
7.3 - Composantes oprationnelles
Dans tous ces cas les secours devront faire face des situations qui font intervenir
les paramtres suivants : dlai dintervention, sauvetage des personnes, vacuation, prservation des biens, propagation de lincendie, contraintes oprationnelles et milieu.
7.3.1 - Dlai d'intervention
Il sagit en fait du dlai darrive des secours sur les lieux. Ce dlai comprend :
le dlai de raction de lexploitant (le cas chant) ;
la prise dappel ;
son interprtation ;
lalarme du ou des centre(s) de secours concern(s) ;
le dlai de dpart des secours ;
le dlai de route.
titre dexemple concret, en 7 minutes, les secours nauront parcouru tout au
plus que 3 ou 4 km, compte tenu de tout ce qui prcde.
30
30/07/08
11:55
Page 31
DR : soldats-du-feu.com
chap tunnel 30-07-08 FAB:chap tunnel 25/07/05
Pendant tout ce temps, lincendie se dveloppe librement. Tout va trs vite.
Lors du rcent incendie dans le tunnel du Frjus, en juin 2005, 700 mtres du tunnel, prsentant une section de 50 m2, ont t totalement envahis par la fume et
les gaz de combustion en 7 minutes. Cet exemple explique la difficult pour les
secours de ne pouvoir effectuer tous les sauvetages des usagers en cours
dvacuation.
7.3.2 - Sauvetage des personnes
Le sauvetage concerne les personnes valides autant que celles mobilit rduite
(et pas seulement en fauteuil roulant mais aussi les enfants et les personnes
ges), ou encore ncessitant une dsincarcration.
Compte tenu des dlais dintervention, il est vident que le sauvetage ne peut
tre complet.
Lauto-valuation des usagers vers des espaces scuriss est imprative.
Se pose alors la ncessit dintgrer le comportement humain des personnes en
situation dincendie dans un environnement ferm comme les tunnels.
7.3.3 - vacuation
Lvacuation devrait se drouler en trois phases :
auto-valuation vers un sas ou un espace scuris ;
prise en compte de la prsence dusagers par lexploitant ;
vacuation assiste par les secours vers lune des deux ttes.
7.3.4 - Prservation de l'environnement
Il sagit de limiter, autant que faire se peut, les dgts linfrastructure, dans le but
de pouvoir remettre louvrage en service le plus rapidement possible.
Le rsultat final dpend aussi de la qualit intrinsque de ladite infrastructure avant
le sinistre.
31
chap tunnel 30-07-08 FAB:chap tunnel 25/07/05
30/07/08
11:55
Page 32
La voie bton, solution pour amliorer la scurit
7.3.5 - Propagation de l'incendie
La propagation de lincendie seffectue de vhicule vhicule et/ou de vhicule
vers lenvironnement du tunnel (matriaux combustibles, cbles, chausse, etc.)
Les puissances et surtout les pouvoirs fumignes dvelopps font que lincendie
va gnrer une forte quantit de fumes imbrles haute temprature. En parcourant le tunnel, cette fume va retrouver de lair frais, donc de loxygne. Ces
fumes vont alors se r-enflammer spontanment et enflammer dautres vhicules
ou tout autre matriau combustible quelles trouveront sur leur passage, quelquefois sur des distances trs importantes (exemple : 300 m au tunnel du MontBlanc). Cela produit une raction en chane, tant que du combustible est prsent
de loin en loin (phnomne dit de flash-over en continu). Ceci explique alors pourquoi les sapeurs-pompiers parlent dimpossible oprationnel .
7.3.6 - Contraintes oprationnelles
Les sapeurs-pompiers doivent prendre en compte les critres suivants : les fumes
opaques et toxiques, la chaleur et le rayonnement.
Ces contraintes dcoulent directement de la propagation de lincendie, sachant
aussi que les fumes paisses et charges de suie (rsultant de la combustion des
carburants, des pneumatiques, de certains chargements, etc.) vont reprsenter
autant de difficults pour les
secours (chaleur intense, visibilit nulle, camras thermiques
oprationnelles comme rseau
de vido-surveillance inoprants, etc.).
La conception dun tunnel
caractrise son type : ouvert,
ferm, combustible, facilitant la
propagation. Dans un sinistre
en milieu ouvert, le flux de chaleur et les fumes peuvent
slever librement dans un
environnement infini . Il en est tout autrement en tunnel (milieu ferm) puisque
les contraintes gomtriques de louvrage font que la seule chappatoire est, dans
bien des cas, le tunnel lui-mme ! Cela suffit expliquer les phnomnes de flashover en continu.
32
DR : soldats-du-feu.com
7.3.7 - Qualit du milieu
chap tunnel 30-07-08 FAB:chap tunnel 25/07/05
30/07/08
11:55
Page 33
7.4 - Tableaux rcapitulatifs des problmatiques et des contraintes
Tableau rcapitulatif de lintgration des problmatiques et des contraintes
Voitures
lgres
DT
AC
Dlais d'intervention
Poids lourds
conventionnels
DT
AC
Autocars
DT
AC
Transports de liquides
inflammables
DT
AC
+++
+++
+++
+++
IO
+
+++
IO
+++
IO
IO
+
(1)
IO
+++
+++ IO
IO
+++
+++
IO
+++
IO
IO
+++
IO
IO
IO
IO
IO
vacuation des personnes
+?
+++
IO
IO
Prservation du tunnel
+++
+++
++++
++++
d'autres vhicules
la structure
0
0
+
0
+++
+
+++
+++
+
+
+++
+++
+++++
+++++
+++++
+++++
Dissymtrie
+++
+++
+++
+++
+++++
IO
Fumes
+++
+++
+++
+++
+++++
+++++
Chaleur
+++
+++++
Longueur des tunnels
+++
+++
IO
IO
Sauvetage des personnes :
assistance simple
mobilit rduite
avec dsincarcration
Propagation de l'incendie
+++++ +++++
1. Potentiellement, excessivement variable,
en fonction des circonstances.
Facteurs favorisant les situations
rencontres :
1. Dimensions des tunnels
2. Existence d'une autre galerie
3. Choix des matriaux
4. Systmes d'extinction automatiques
5. Services d'incendie et de secours
(publics, privs)
6. Qualit des donnes disponibles
7. Comportement des usagers
8. tat physique des usagers
IO : impossible oprationnel
0 : joue un rle secondaire dans la russite
de l'intervention
+ +++++ : niveau de la contrainte
DT : Dysfonctionnement technique
AC : Accident
Tableau de synthse des facteurs favorisant les situations rencontres
Voitures
lgres
Poids lourds
Transports de liquides
Autocars
conventionnels
inflammables
DT
AC
DT
AC
DT
Dimension des tunnels
+++
+++
Existence d'une autre galerie
+++
Choix des matriaux
+++
+++
+++
AC
DT
AC
IO
IO
+++
+++++
+++++
+++
+++++ +++++
Extinction automatique
+++
+++++
+++
+++++
Services d'incendie et de secours
+++
+++++
+++
+++++
IO
IO
Qualit des donnes disponibles
+++
+++
+++
+++
+++++ +++++
+++++
+++++
Comportement des usagers
+++++ +++++
tat physique des usagers
+++
+++
+++
+++
+++++ +++++
DT : dysfonctionnement technique
AC : Accident
33
chap tunnel 30-07-08 FAB:chap tunnel 25/07/05
30/07/08
11:55
Page 34
DR : soldats-du-feu.com
La voie bton, solution pour amliorer la scurit
34
chap tunnel 30-07-08 FAB:chap tunnel 25/07/05
30/07/08
11:55
Page 35
8 - Conclusion
La pose de voie sur dalle en bton arm,
une solution pour amliorer la scurit et la sret.
La ncessit pour les pompiers davoir accs lintrieur du tunnel dans les dlais
les plus rapides, conduit envisager la mise en uvre de solutions techniques leur
permettant dentrer directement avec leurs vhicules de secours et de rouler sur
les voies (ce qui est impossible avec des voies poses sur ballast).
Une des solutions alternatives consiste supprimer le ballast pour fixer directement les rails sur une dalle en bton arm.
De telles techniques existent depuis plusieurs annes et sont rgulirement appliques pour la construction de voies en tunnels ferroviaires ou dans les mtros, y
compris pour des lignes grandes vitesses.
35
chap tunnel 30-07-08 FAB:chap tunnel 25/07/05
30/07/08
11:55
Crdit photographique
Cimbton, Edilon, soldats-du-feu.com,
Journal des Sapeurs-pompiers
suisses & FSSP, Agilis,
tous doits rservs.
dition aot 2008
Page 36
Mise en page et ralisation
Amprincipe Paris
R.C.S. Paris B 389 103 805
Impression
0Couverture:0Couverture
30/07/08
11:00
Page 1
Vous aimerez peut-être aussi
- DRR HDS 2016M v06-12-2016 PDFDocument128 pagesDRR HDS 2016M v06-12-2016 PDFهلال خالدPas encore d'évaluation
- CT T59 PDFDocument22 pagesCT T59 PDFRadhi BHPas encore d'évaluation
- Air Tunnels RoutiersDocument34 pagesAir Tunnels RoutiersKamel HebbachePas encore d'évaluation
- Guide D'application EC 3 & 4Document8 pagesGuide D'application EC 3 & 4EugéniePas encore d'évaluation
- ENPC2015 Ventil SecuDocument117 pagesENPC2015 Ventil SecuAbderrahmane LaHssiniPas encore d'évaluation
- Tome III: MatériauxDocument30 pagesTome III: MatériauxDimitri TasPas encore d'évaluation
- 13877-1 Chaussées en Béton - Partie 1 MatériauxDocument11 pages13877-1 Chaussées en Béton - Partie 1 MatériauxChoffo YannickPas encore d'évaluation
- 58Document86 pages58Mohamed MehdiPas encore d'évaluation
- 76-02 F - Tirants D'ancrage KellerDocument4 pages76-02 F - Tirants D'ancrage KellerAbdelrahmanTahiriPas encore d'évaluation
- Les Emissaires en Mer - Conférence Du 19.10.2010Document24 pagesLes Emissaires en Mer - Conférence Du 19.10.2010KHALDOUNPas encore d'évaluation
- Recommandation Pro Rage Chapes Dalles Sur Plancher Bois Neuf 2013 07Document0 pageRecommandation Pro Rage Chapes Dalles Sur Plancher Bois Neuf 2013 07modjibePas encore d'évaluation
- 744 TunnelsDocument57 pages744 TunnelsGiorgio FantauzziPas encore d'évaluation
- PEER 140404 3 Amiante HAP-OdeonHDocument18 pagesPEER 140404 3 Amiante HAP-OdeonHPOLY DavidPas encore d'évaluation
- Extrait 42219210 PDFDocument97 pagesExtrait 42219210 PDFMohamed Ange NAPOPas encore d'évaluation
- Les VoiriesDocument65 pagesLes VoiriesmohamedPas encore d'évaluation
- Fascicule 74 - FinalDocument290 pagesFascicule 74 - FinalKamano BengalyPas encore d'évaluation
- Cerema Fiche 1 - Tramway Et VisibilitéDocument12 pagesCerema Fiche 1 - Tramway Et Visibilitéjtex2Pas encore d'évaluation
- Boa 72Document61 pagesBoa 72HAHAPas encore d'évaluation
- Calcul Des Longrines PDFDocument3 pagesCalcul Des Longrines PDFFoudilYouyouPas encore d'évaluation
- Guide Technique 2013 BUSCADocument292 pagesGuide Technique 2013 BUSCAmatheuroquencourt100% (1)
- Beton PDFDocument21 pagesBeton PDFHala YahPas encore d'évaluation
- Cahier Des Charges - SUIVI Aire de Repos Ain Nehala Hammam Boughrara REV01Document37 pagesCahier Des Charges - SUIVI Aire de Repos Ain Nehala Hammam Boughrara REV01Khaled YadidouPas encore d'évaluation
- Dsi Systemes de Precontrainte Dywidag Cable FR PDFDocument36 pagesDsi Systemes de Precontrainte Dywidag Cable FR PDFRingoPas encore d'évaluation
- Pont ST Michel ToulouseDocument19 pagesPont ST Michel ToulouseMounir RIACHEPas encore d'évaluation
- Ponts Dalles À Pouterelles Ajourées PrécontraintsDocument114 pagesPonts Dalles À Pouterelles Ajourées Précontraintssam hadPas encore d'évaluation
- Cours TunnelsDocument80 pagesCours TunnelsAbakarTahir100% (1)
- La Fissuration Des Chaussées RigidesDocument345 pagesLa Fissuration Des Chaussées RigidesAMGPas encore d'évaluation
- GuideTechnique LCPC MATURODocument70 pagesGuideTechnique LCPC MATUROMeyer EdouardPas encore d'évaluation
- Décompte Ibnou Rochd 3°Document30 pagesDécompte Ibnou Rochd 3°Mohamed KanzoutPas encore d'évaluation
- DA 2019 2020 00173 Extrait Tome V Signalisation RoutiereDocument556 pagesDA 2019 2020 00173 Extrait Tome V Signalisation RoutierealexmauromatiPas encore d'évaluation
- Conception Et Réalisation Des Travaux SouterrainsDocument3 pagesConception Et Réalisation Des Travaux SouterrainsBrahim khouildatPas encore d'évaluation
- To2998 - BN4Document26 pagesTo2998 - BN4Nuno Telmo LopesPas encore d'évaluation
- Séparateurs Modulaire de Voie SMV - SETRADocument6 pagesSéparateurs Modulaire de Voie SMV - SETRAalexoplayPas encore d'évaluation
- Structure FerroviaireDocument198 pagesStructure FerroviaireWajdi Ben SaidaPas encore d'évaluation
- Presentation Cours 1 Ecole Nationale Des Travaux Publics (Kouba)Document258 pagesPresentation Cours 1 Ecole Nationale Des Travaux Publics (Kouba)Ishaq Entp0% (1)
- DT6820Document84 pagesDT6820Lahad DiaPas encore d'évaluation
- Livret ISA5Document87 pagesLivret ISA5Mustapha BeramiPas encore d'évaluation
- Béton Et OA (Tome 2) - Coulis Etc PDFDocument211 pagesBéton Et OA (Tome 2) - Coulis Etc PDFKyser SosePas encore d'évaluation
- 965 SolsfondationsDocument104 pages965 SolsfondationsAntoine PhilippePas encore d'évaluation
- CT T71 PDFDocument164 pagesCT T71 PDFNomade VoyageurPas encore d'évaluation
- Boa 37 PDFDocument32 pagesBoa 37 PDFAissaabderrahimPas encore d'évaluation
- Ouvrages en Terres ArmréesDocument176 pagesOuvrages en Terres ArmréesAbdelouahab TOUATIPas encore d'évaluation
- Projet Tunnel Ferroviaire Sour Le Détroit de GibraltarDocument20 pagesProjet Tunnel Ferroviaire Sour Le Détroit de GibraltarL'Usine NouvellePas encore d'évaluation
- Instruction Technique EtatDocument221 pagesInstruction Technique EtattotoPas encore d'évaluation
- CT T63Document73 pagesCT T63عثمان البريشيPas encore d'évaluation
- 3.4.6.N.E La Ventilation Des Logements en Copropriété - Guide ARC-UNARC - Oct2011 PDFDocument28 pages3.4.6.N.E La Ventilation Des Logements en Copropriété - Guide ARC-UNARC - Oct2011 PDFvannho020Pas encore d'évaluation
- Dispositifs de Retenue Des Véhicules 2 - Dispositifs Latéraux Métalliques (Mai 1988)Document124 pagesDispositifs de Retenue Des Véhicules 2 - Dispositifs Latéraux Métalliques (Mai 1988)Takanori YasudaPas encore d'évaluation
- Matelas de GabionsDocument3 pagesMatelas de GabionsRafik KaderPas encore d'évaluation
- Rehabilitation InstallationsDocument81 pagesRehabilitation InstallationsMouhsineAtb100% (1)
- Gare Multimodale: Université Badji Mokhtar Annaba Département D'architectureDocument93 pagesGare Multimodale: Université Badji Mokhtar Annaba Département D'architectureSoùHéiLPas encore d'évaluation
- In 0678 Equipement Électrique de La Voie. Isolement Des Appareils de Voie Unifiés. V1 Du 05-02-2007Document35 pagesIn 0678 Equipement Électrique de La Voie. Isolement Des Appareils de Voie Unifiés. V1 Du 05-02-2007Mustapha El OuardiPas encore d'évaluation
- Réhabilitation Des AutoroutesDocument44 pagesRéhabilitation Des AutoroutesmahdouchfkiPas encore d'évaluation
- Synad 2Document159 pagesSynad 2Arij Naily Ep HammamiPas encore d'évaluation
- 1yB1HFCbxm3GgOJW13ZV0 skXN9TfwM0b PDFDocument170 pages1yB1HFCbxm3GgOJW13ZV0 skXN9TfwM0b PDFRida BldPas encore d'évaluation
- 3254, Note D Info 29 IDRRIM Norme Chaux - F PDFDocument12 pages3254, Note D Info 29 IDRRIM Norme Chaux - F PDFLoïc KleinPas encore d'évaluation
- FormatecDocument26 pagesFormatecJocelyn zienlet SOMDAPas encore d'évaluation
- Precontrainte Exterieure - SETRA - 1990Document134 pagesPrecontrainte Exterieure - SETRA - 1990viniciusltPas encore d'évaluation
- 06 Le Pont de Hong Kong Zuhai Macao Le Barreau Autoroutier de Hong KongDocument9 pages06 Le Pont de Hong Kong Zuhai Macao Le Barreau Autoroutier de Hong KongRayen ChihiPas encore d'évaluation
- Chaussees en Beton 1Document54 pagesChaussees en Beton 1mahdouchfki100% (1)
- Catalogue WIM 2019Document16 pagesCatalogue WIM 2019André Germain MbogbaPas encore d'évaluation
- Sign Fa Pphm130222Document4 pagesSign Fa Pphm130222André Germain MbogbaPas encore d'évaluation
- NF P 98 086 2011 Dimensionnement Structurel Des Chaussées RoutièresDocument76 pagesNF P 98 086 2011 Dimensionnement Structurel Des Chaussées RoutièresAndré Germain MbogbaPas encore d'évaluation
- Giratoire 2019 v2Document45 pagesGiratoire 2019 v2André Germain MbogbaPas encore d'évaluation
- Panneaux Iisr Annexe Arrete 1967 VC 20200515 Cle5ea4ea-1Document80 pagesPanneaux Iisr Annexe Arrete 1967 VC 20200515 Cle5ea4ea-1André Germain MbogbaPas encore d'évaluation
- Iisr 6epartie VC 20190109 Cle2edec1Document36 pagesIisr 6epartie VC 20190109 Cle2edec1André Germain MbogbaPas encore d'évaluation
- Signalisation GeneralitesDocument5 pagesSignalisation GeneralitesAndré Germain MbogbaPas encore d'évaluation
- 1947, RNSR SV 29102013 BDDocument54 pages1947, RNSR SV 29102013 BDAndré Germain MbogbaPas encore d'évaluation
- Iisr 7epartie VC 20190109 Cle2aca89Document81 pagesIisr 7epartie VC 20190109 Cle2aca89André Germain MbogbaPas encore d'évaluation
- Iisr 9epartie VC 20200515 Cle2f91c8Document51 pagesIisr 9epartie VC 20200515 Cle2f91c8André Germain MbogbaPas encore d'évaluation
- Tome 5 - Caracteristiques de Lhabitat Et Cadre de Vie Des PopulationsDocument188 pagesTome 5 - Caracteristiques de Lhabitat Et Cadre de Vie Des PopulationsAndré Germain Mbogba100% (1)
- Enquête de Tachnique Nouvelle - SOCOTEC - RockwoolDocument10 pagesEnquête de Tachnique Nouvelle - SOCOTEC - RockwoolAndré Germain MbogbaPas encore d'évaluation
- Conception, Fabrication Et Mise en Œuvre de Façades Rideaux Mixtes Bois-AluminiumDocument160 pagesConception, Fabrication Et Mise en Œuvre de Façades Rideaux Mixtes Bois-AluminiumAndré Germain MbogbaPas encore d'évaluation
- ExtraitDocument8 pagesExtraitAndré Germain Mbogba0% (1)
- AFGC DP 10-10 - Nouvelles Informations Sur Les EmballagesDocument4 pagesAFGC DP 10-10 - Nouvelles Informations Sur Les EmballagesWalid CherakiPas encore d'évaluation
- Mémorial Des Poudres Et Salpêtres, Tome 7, 1894 - FranceDocument384 pagesMémorial Des Poudres Et Salpêtres, Tome 7, 1894 - FranceLite Rato100% (1)
- ACFrOgAlOhoHnDku DxVFHJzy-jcIvQzg10IlRT3dn50JqByBhPg2YokLH10mvNw Hi4zA78VJRH74l6gXqrQmY4JmEZMFDVM9LMXYkJnkJk5egxZSqxeMLo XMY5QUDocument69 pagesACFrOgAlOhoHnDku DxVFHJzy-jcIvQzg10IlRT3dn50JqByBhPg2YokLH10mvNw Hi4zA78VJRH74l6gXqrQmY4JmEZMFDVM9LMXYkJnkJk5egxZSqxeMLo XMY5QUAmirah Amirouche80% (5)
- 1 - 2 Le Chauffage CulinaireDocument13 pages1 - 2 Le Chauffage CulinaireThierry DucosPas encore d'évaluation
- 0 1 PDFDocument277 pages0 1 PDFDenisPas encore d'évaluation
- Alum Carmine DryDocument11 pagesAlum Carmine DryJhonny JhonnyPas encore d'évaluation
- AttachmentDocument155 pagesAttachmentFabrice KontchouPas encore d'évaluation
- Gestion Du Traitement Des Déchets MédicauxDocument104 pagesGestion Du Traitement Des Déchets MédicauxErickRodríguezCastañedaPas encore d'évaluation
- Cours Thermochimie 2020-2021Document229 pagesCours Thermochimie 2020-2021darjidoumanPas encore d'évaluation
- FIL5704Document95 pagesFIL5704Leila BachiriPas encore d'évaluation
- Exercices Corriges Avec Les AlcenesDocument5 pagesExercices Corriges Avec Les AlcenesGaëlle NGNIE100% (2)
- Résistance Au FeuDocument150 pagesRésistance Au FeuZakaria ZinounPas encore d'évaluation
- 5LT TolueneDocument14 pages5LT TolueneMezniPas encore d'évaluation
- Anneaux Et Concrétions PDFDocument105 pagesAnneaux Et Concrétions PDFMortadha Rabah100% (8)
- Ssiap 1Document158 pagesSsiap 1ludovic197050% (2)
- Fiche Securité Barbe A PapaDocument6 pagesFiche Securité Barbe A Papakhalid chouibaPas encore d'évaluation
- EXP-PR-UT100-FR Slides Le Gaz InerteDocument64 pagesEXP-PR-UT100-FR Slides Le Gaz InerteStive Ozimba EbomiPas encore d'évaluation
- Fiche Tectnique Des Extincteurs MobilesDocument5 pagesFiche Tectnique Des Extincteurs Mobilesالطاهر فرديPas encore d'évaluation
- Combustion ChapII Partie 2Document54 pagesCombustion ChapII Partie 2Youmna ToumPas encore d'évaluation
- Epreuve: P.C.T: L'épreuve Comporte Deux Parties Indépendantes Que Le Candidat Traitera Dans L'ordre VouluDocument2 pagesEpreuve: P.C.T: L'épreuve Comporte Deux Parties Indépendantes Que Le Candidat Traitera Dans L'ordre VouluLechercheurPas encore d'évaluation
- ChapII SMP6 M36 20-21Document20 pagesChapII SMP6 M36 20-21Brahim El jaadanyPas encore d'évaluation
- Combustion Des Alcanes PDFDocument2 pagesCombustion Des Alcanes PDFMolly50% (2)
- Fiche Signalétique: 1. Produit Chimique Et Identification de L'EntrepriseDocument7 pagesFiche Signalétique: 1. Produit Chimique Et Identification de L'EntrepriseKourfiaDiabyPas encore d'évaluation
- ISF Cellule: SP C2: Alcanes Année Scolaire 2021/2022 Classe: 1S2Document2 pagesISF Cellule: SP C2: Alcanes Année Scolaire 2021/2022 Classe: 1S2Papa DiagnePas encore d'évaluation
- LECON 14, Module III (1.1)Document8 pagesLECON 14, Module III (1.1)Marcor nlengPas encore d'évaluation
- Form38 190423 Moni 1 2 Entr FRDocument71 pagesForm38 190423 Moni 1 2 Entr FRDENOUPas encore d'évaluation
- TP Ghali Infroi Hydo OléoDocument16 pagesTP Ghali Infroi Hydo OléoKarim BchirPas encore d'évaluation
- FDS Carbothane 133 HB - A - 10 2015Document11 pagesFDS Carbothane 133 HB - A - 10 2015Ayman JadPas encore d'évaluation
- Copie de Révision 2022-2023 (ST)Document167 pagesCopie de Révision 2022-2023 (ST)Benisha IgnatiusPas encore d'évaluation
- Ménage Écologique, Économique Et Sans Danger PDFDocument12 pagesMénage Écologique, Économique Et Sans Danger PDFCamille VacziPas encore d'évaluation