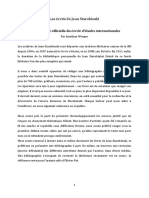Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Espace Textuel Narratologie PDF
Espace Textuel Narratologie PDF
Transféré par
Vero VeraTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Espace Textuel Narratologie PDF
Espace Textuel Narratologie PDF
Transféré par
Vero VeraDroits d'auteur :
Formats disponibles
Article
La littrature et lespace
Antje Ziethen
Arborescences: revue dtudes franaises, n 3, 2013.
Pour citer cet article, utiliser l'information suivante :
URI: http://id.erudit.org/iderudit/1017363ar
DOI: 10.7202/1017363ar
Note : les rgles d'criture des rfrences bibliographiques peuvent varier selon les diffrents domaines du savoir.
Ce document est protg par la loi sur le droit d'auteur. L'utilisation des services d'rudit (y compris la reproduction) est assujettie sa politique
d'utilisation que vous pouvez consulter l'URI https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
rudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif compos de l'Universit de Montral, l'Universit Laval et l'Universit du Qubec
Montral. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. rudit offre des services d'dition numrique de documents
scientifiques depuis 1998.
Pour communiquer avec les responsables d'rudit : info@erudit.org
Document tlcharg le 24 November 2015 01:04
Arborescences
Antje Ziethen
LA LITTRATURE ET LESPACE
Antje Ziethen
Universit McGill
Prlude
Tantt morphique, tantt mtaphorique, le recours la notion despace en littrature est pratique
courante. Ce fait sexplique, entre autres, par la prdisposition du langage spatial pouvoir sriger
en un mtalangage capable de parler de toute autre chose que de lespace (Alonso Aldama 2009
citant Greimas 1976 : 130-131). En tmoigne, par exemple, LEspace littraire de Maurice Blanchot
qui emploie le terme au sens figur. Pour cet rudit, lespace littraire se dployant entre lauteur,
le lecteur et luvre constitue un univers clos et intime o le monde se dissout (Blanchot 1955 : 46). Les mditations de Blanchot la fois critiques et philosophiques sur la littrature, luvre comme origine, la solitude, lartiste et linspiration partent du principe que [l]artiste
[] ne se sent pas libre du monde, mais priv du monde, non pas matre de soi, mais absent de soi,
et expos une exigence qui, le rejetant hors de la vie et de toute vie, louvre ce moment o il ne
peut rien faire et o il nest plus lui-mme (Blanchot 1955 : 54). La notion despace littraire introduite par Blanchot est donc investie dun sens trs spcifique et diffre, nous allons le voir, de celle
mobilise par les approches dites gocentres que nous exposons dans le prsent article. Leurs dmarches consistent plutt clairer la fonction de lespace au sens gographique et gomtrique
au sein du texte littraire. Parmi ces approches, nous comptons la gopotique (White 1994 ;
Bouvet 2011), les romans-gographes (Brosseau 1996), la gocritique (Westphal 2007 ; Tally 2011),
la gographie de la littrature (Moretti 2000 ; Piatti 2008), la pense-paysage (Collot 2011), la narratologie de lespace (Dennerlein 2009 ; Nnning 2009 ; Ryan 2009) et lcocritique (Garrard 2004 ; Zapf
2006 ; Posthumus 2011 ; Suberchicot 2012). Elles se sont dveloppes, pour la plupart, dans le sillage du spatial turn qui se manifeste dans les sciences sociales et humaines ds les annes 1990. Le
spatial turn sappuie sur la prmisse que lespace est impliqu dans toute construction du savoir
(Cosgrove 1999 : 7) faisant en sorte que les chercheurs have begun to interpret the spatiality of human life in much the same way they have traditionally interpreted [] the historicality and sociality of
human life (Soja 2000 : 7 ; italiques dans loriginal). Les nouvelles approches en littrature rfutent
lide reue que lespace soit simple dcor, arrire-plan ou encore mode de description. Ds lors, il
3
Arborescences
Antje Ziethen
ne se rsume plus une fonction de scne anodine sur laquelle se dploie le destin des personnages
mais simpose comme enjeu digtique, substance gnratrice, agent structurant et vecteur signifiant.
Il est apprhend comme moteur de lintrigue, vhicule de mondes possibles et mdium permettant
aux auteurs darticuler une critique sociale. Notre objectif est de prsenter un survol la fois diachronique et thorique mme si ncessairement non-exhaustif de diffrentes thories axes
sur lespace en littrature pour faire ressortir leurs mthodes, objectifs, divergences et convergences.
1.
Du chronotope la smiosphre
La thorie littraire a t longtemps dvoue la dimension temporelle du rcit. Toutefois, des dcennies avant le spatial turn, deux chercheurs, notamment Mikhal Bakhtine et Youri Lotman, ont
dmontr que les structures spatiales du monde fictionnel sont fondamentales la production du
sens. Leurs rflexions continuent alimenter les recherches en littrature, raison pour laquelle nous
souhaitons exposer ici leurs contributions la thmatique de lespace. Pour Bakhtine et Lotman,
lorganisation de lespace fictionnel est spculaire de la vision du monde qui sy rattache. Le texte
littraire plus quil ne rcupre fidlement le modle spatial partir duquel la ralit est construite
le transforme et le transpose potiquement (Frank 2009 : 64). Cependant, les approches des deux
thoriciens ne se recoupent pas pour autant. Les travaux de Lotman sinscrivent dabord dans une
tradition narratologique et stendent ensuite une smiotique culturelle tandis que la pense bakhtinienne articule une potique historique fonde sur le genre littraire. Bakhtine constate, en effet,
que la littrature rvle, travers ses marques gnriques, les constellations spatio-temporelles spcifiques une poque historique. Le genre repose sur des chronotopes que Bakhtine dfinit comme
le[s] principa[ux] gnrateur[s] du sujet et les centres organisateurs des principaux vnements
(Bakhtine 1978 : 391). En leur sein, le temps se matrialise dans lespace (Bakhtine 1978 : 391). Le
chronotope permet lauteur de faire sens de son poque et de transposer en narration le monde
dont il est issu. Il est pour ainsi dire la condensation artistique-littraire dun espace-temps rel .
Bakhtine identifie plusieurs types et degrs chronotopiques do linstabilit inhrente la
notion qui peuvent coexister, sentrelacer, se succder, se juxtaposer, sopposer (Bakhtine
1978 : 393). Les chronotopes primordiaux, voire transhistoriques, tels que la rencontre, le seuil et la
route, traversent plusieurs genres romanesques mme si leur fonction change avec le temps. Dautres
chronotopes, secondaires, constituent llment fondateur dun genre en particulier, comme par
exemple le chteau en relation au roman gothique. Sy ajoutent galement des noyaux spatio4
Arborescences
Antje Ziethen
temporels la nature, lidylle, le salon qui se retrouvent chez certains auteurs ou dans les uvres
dune tendance littraire spcifique. Curieusement, la signification mme du chronotope oscille, chez
Bakhtine, entre thme , genre et univers humain ainsi que la dj signal Mitterand (Mitterand 1990 : 93-95). La polysmie du terme saccompagne dun dsquilibre entre ses deux composantes (chronos et topos). Plusieurs chercheurs ont constat que Bakhtine, malgr son intention premire, privilgie le temps lespace (Brosseau 1996 : 99). Cette prfrence se prsente dj dans le
titre de son tude Formes du temps et du chronotope qui confre au temps une plus grande importance en le nommant sparment (Frank 2009 : 65). Aussi lespace se trouve-t-il moins au centre
de lintrt que les actes et les vnements qui sy rattachent.
Youri Lotman, en revanche, propose un concept qui met en avant les relations spatiales
souvent au dtriment du temps. Son travail sest impos dans le champ littraire, surtout en narratologie, grce sa capacit de dcrire non seulement les donnes spatiales dun texte mais galement sa
dimension non-spatiale, voire mtaphorique (Dennerlein 2009 : 28-29). Associant les structures narratives des modles culturels, luvre de Lotman srige, de fait, en vritable thorie de smiotique
culturelle. Dans La Structure du texte artistique (Lotman 1973), Lotman explique que lattachement des
tres humains au rgne du visuel, voire du spatial, est une donne anthropologique, mme anatomique. Notre corporalit et notre conscience corporelle font en sorte que nous structurons lespace
selon des oppositions binaires : haut/bas, gauche/droite, devant/derrire. Ce modle spatial du
monde devient dans [l]es textes un lment organisateur, autour duquel se construisent aussi ses caractristiques non spatiales (Lotman 1973 : 313). Plus prcisment, le schma spatial axiologique et
asymtrique se trouve la base de modles culturels, transposs dans le texte, o il reprend les polarits valable-non-valable, bon-mauvais, les siens-les trangers, accessible-inaccessible,
mortel-immortel, etc. (Lotman 1973 : 311).
Lotman distingue la topographie, cest--dire la reprsentation despaces concrets dans
un texte littraire et variable dune uvre lautre, de la topologie qui cristallise les structures de base,
savoir les constantes, communes tous les textes dune culture (Lotman 1974 cit dans Frank
2009 : 66). Lexemple le plus pertinent dune telle figure topologique est la frontire qui divise tout
lespace du texte en deux sous-espaces, qui ne se recoupent pas mutuellement (Lotman 1973 : 321).
La scission spatiale saccompagne de lmergence de deux champs smantiques opposs auxquels
sont associs des personnages particuliers. Pour que se noue une intrigue, il faut un pas outre la
frontire pour dpasser ses dlimitations smantico-spatiales. Le protagoniste qui dfie ainsi la structure binaire dclenche alors une chane dvnements et, par consquent, le sujet du texte. Pour
5
Arborescences
Antje Ziethen
Lotman, le texte littraire, de par son insparabilit dun sujet et, par extension, dun mouvement
transfrontalier prohibitif, dploie un potentiel transformatif en dconstruisant le modle binaire du
monde (Frank 2009 : 68).
Maintes critiques ont t formules au sujet de la thorie structuraliste de Lotman. Katrin
Dennerlein, par exemple, dplore que lespace ne soit dfini quen termes de relations entre deux
lments. Sefface, de la sorte, la nature concrte des lments derrire limportance de la position
quils occupent lun par rapport lautre. Elle constate, en paraphrasant Lotman, quil nimporte
gure si un texte parle de Saint-Ptersbourg ou de Moscou tant que ces lieux participent dune relation binaire telle que ville-campagne ou capitale-province (Dennerlein 2009 : 31). Lobservation faite
par Dennerlein est juste dautant plus que les approches gocentres dveloppes dans les annes
1990 et 2000, tout en conservant laspect relationnel de lespace, insistent galement sur la spcificit
de ses constituants. La polmique la plus rcurrente concernant luvre de Lotman, cependant, met
en question le schma dichotomique du texte artistique (Frank 2009 : 68). En loccurrence juge trop
statique et hermtique, labstraction extrme du modle lotmanien ne permettrait pas de tenir
compte de la complexit des structures ni des exceptions la rgle. Quoique ces inquitudes ne
soient pas sans fondement, particulirement lgard de ses premiers crits, les ides de Lotman sur
la notion de smiosphre, articules plus tard dans sa carrire, pourraient les dissiper sinon les attnuer.
Michael Frank fait remarquer quil se produit un glissement de focale, de la structure vers le mouvement, de la stase vers la dynamique (Frank 2009 : 70, notre traduction). En effet, la frontire qui
est initialement un simple dispositif de sparation, se mue, dans La smiosphre, en interstice, savoir
en espace de rencontre, dinteraction, de traduction mais aussi de tensions et de conflit. De par son
contact perptuel avec lAutre, la priphrie smiosphrique constitue un lieu de rvolution et de
cration, contrairement son centre qui se fige dans des normes tablies. Dans la zone limitrophe,
un processus dchange constant est luvre, la recherche dun langage commun, une kone ; de
sorte qu partir de systmes smiotiques croliss de nouvelles smiosphres voient le jour (Lotman 1999 : 38). Lotman concde galement quau-del dune frontire unique, la smiosphre est
travers[e] par des frontires de diffrents niveaux (Lotman 1999 : 32). Mme si Lotman reste
attach un systme dualiste (dune smiosphre lautre, de la priphrie smiosphrique au centre),
il attnue le caractre monolithique de son modle en louvrant aux influences multiples, voire
lhtrognit. Si lon se fie Lotman, ces processus seraient transposs dans le texte artistique selon une esthtique propre la littrature qui rend lisibles les mcanismes de division et
dhybridation, de fixation et de dterritorialisation. Il nous semble que, nonobstant leur approche
6
Arborescences
Antje Ziethen
diffrente, les thories de Lotman et de Bakhtine convergent vers un point commun qui fait natre le
sujet partir du mouvement, de la transgression spatiale et de la confrontation avec autrui. Ce fait se
reflte autant dans la topologie de la frontire chez Lotman que dans les chronotopes transhistoriques du seuil, de la rencontre et de la route chez Bakhtine.
2.
Lespace comme mtaphore
Tandis que Lotman part de lespace en littrature pour en dduire un systme smantique, dautres
chercheurs procdent dun cheminement inverse, faisant appel lespace (en termes mtaphoriques)
afin dillustrer le fonctionnement du systme smantique dun texte. Dans ce cas, ce nest pas
lespace concret qui se trouve au centre de lintrt mais les dmarches artistiques transposes en
images spatiales.
When the notion of space refers to a formal pattern, it is taken in a metaphorical
sense, since it is not a system of dimensions that determines physical position, but a
network of analogical or oppositional relations perceived by the mind. It is the synchronic perspective necessitated for the perception of these designs and the tendency
to associate the synchronic with the spatial that categorizes them as spatial phenomena. (Ryan 2009)
Dans cette perspective, la forme spatiale de Joseph Frank (Frank 1945), par exemple, dcrit des
procds narratifs en littrature qui bouleversent la chronologie du rcit sans pour autant labolir
en juxtaposant des scnes ou vnements dans un effet de simultanit. Ce type dorganisation
narrative identifie par Frank privilgie alors les relations synchroniques au dtriment dune composition diachronique. Initialement considre comme caractristique de la littrature moderniste et
avant-gardiste (Barnes, Eliot, Pound), la forme spatiale conserverait sa pertinence mme dans la littrature contemporaine. Selon Frank, elle stend trois niveaux : le langage, la structure et la rception (Smitten 1981 : 15). Au niveau du langage, la forme spatiale se manifeste, en posie par exemple,
dans labsence de connecteurs causaux/temporaux entre les mots et les groupes de mots, faisant en
sorte que le texte devient fortement autorfrentiel (Smitten 1981 : 17). Sur le plan de la structure, ce
mme procd sapplique aux paragraphes et chapitres dun roman. Lexistence de fils narratifs simultans, les allers-retours entre vnements et/ou personnages ainsi que leur prsentation discontinue perturbe la syntaxe narrative traditionnelle (Smitten 1981 : 19). La logique spatiale de Frank
repose sur le postulat quen posie moderne, [t]he primary reference of any word-group [] is to
something inside the poem itself, i.e., the system of self-reflexive signs that constitute the text
Arborescences
Antje Ziethen
(Frank 1981 : 231). Cette dmarche ncessite une plus grande implication du lecteur lequel est amen
relier les lments disparates du rcit par un travail hermneutique. La rception constitue de la
sorte le troisime niveau de la forme spatiale.
Dans Spatial Form: Thirty Years After (Frank 1981), Frank tablit des parallles aux recherches de Genette (publies vingt ans aprs son article sminal) qui, lui aussi, emploie la notion
despace plutt dans un sens figur. Pour Genette, le rapport entre la littrature et lespace sexprime,
en premier lieu, dans la spatialit du langage o chaque lment se qualifie par la place quil occupe
dans un tableau densemble et par les rapports verticaux et horizontaux quil entretient avec les lments parents et voisins (Genette 1969 : 45). En deuxime lieu, il rfre la spatialit du texte qui
ne rside pas seulement dans des rapports horizontaux de voisinage et de succession, mais aussi dans
des rapports quon peut dire verticaux, ou transversaux, de ces effets dattente, de rappel, de rponse,
de symtrie, de perspective, au nom desquels Proust comparait lui-mme son uvre une cathdrale (Genette 1969 : 46). Cest particulirement ce point qui rappelle la forme spatiale ainsi que
Frank le constate lui-mme. Cependant, Genette ajoute un troisime aspect de la spatialit littraire
quil appelle lespace smantique (Genette 1969 : 47). Chaque mot se charge de significations littraire et figure dployant de la sorte un espace qui se creuse entre le signifi apparent et le signifi
rel abolissant du mme coup la linarit du discours (Genette 1969 : 47). Si lon se fie cette dernire dclinaison de lespace chez Genette, le trope de lironie ou mme lintertextualit pourraient
tre qualifis, par extension, de dispositifs spatiaux. la diffrence de Bakhtine et de Lotman mais
aussi des approches gocentres prsentes ci-dessous, la notion despace chez Frank et Genette ne
sapplique pas la reprsentation dun paradigme tridimensionnel. Elle ne mobilise pas non plus de
rapport rfrentiel entre fiction et ralit. Le texte y devient entit hermtique, autonome, purg de
toute rfrence extra-textuelle. Puisant ses origines dans le modle smiotique saussurien prnant
lauto-rfrentialit du langage, cette textoltrie (Pavel 1986 : 9) est pratique par les structuralistes et rige en principe par Derrida pour qui il ny a pas de hors-texte (Derrida 1985 : 227).
Tandis que pour Frank et Genette, le texte plus prcisment sa structure smantique
se laisse apprhender en termes de spatialit, pour dautres chercheurs, lespace (surtout urbain) se
laisse apprhender en termes de textualit. Dans un premier temps, cette transposition est propose
par des critiques littraires et smiologues (Barthes 1970 ; Barthes 1985 ; Butor 1982 ; Greimas 1976 ;
Stierle 2001 ; Westphal 2000). Roland Barthes constate que [l]a cit est un discours, et ce discours
est vritablement un langage : la ville parle ses habitants, nous parlons notre ville [] (Barthes
1985 : 265). Et le smiologue de poursuivre que la ville est lisible, car elle se compose de signifiants
8
Arborescences
Antje Ziethen
(rues, btiments, quartiers, etc.) qui sont smantiquement chargs sa lecture tant effectue par
les usagers qui se dplacent en son sein : [L]a ville est une criture ; celui qui se dplace dans la ville,
cest--dire lusager de la ville (ce que nous sommes tous), est une sorte de lecteur qui, selon ses obligations et ses dplacements, prlve des fragments de lnonc pour les actualiser en secret
(Barthes 1985 : 268). Dans La ville comme texte (Butor 1982), Michel Butor, quant lui, qualifie
la ville duvre littraire, voire de roman, dont les personnages, la langue ou le style peuvent varier
dun quartier (chapitre) lautre (Butor 1982 : 36-37). Il voque la notion de grammaire urbaine
lorsquil constate que les quartiers dune ville se dtachent du tissu urbain en dveloppant leur
propre style, leurs propres langues (Butor 1982 : 38). Cependant, Butor dcle aussi un autre aspect
de cette quation. La ville, pour lui, constitue une construction discursive, difie partir dune accumulation de textes autant sur la ville que dans la ville (les signes, inscriptions, panneaux). Toute
ville, tel laffirment le Paris de Benjamin ou le Tokyo de Butor et de Barthes, est toujours aussi un
discours qui, parfois, prcde lespace car anticip par lindividu avant mme quil ne le dcouvre en
personne (Butor 1982 : 33).
Dans un deuxime temps, les anthropologues et gographes, tels que Michel de Certeau,
Edward Soja, Jane M. Jacobs et James S. Duncan, recourent galement une correspondance entre
espace et texte (de Certeau 1990 ; Lynch 1960 ; Soja 1989 ; Jacobs 1996 ; Duncan 1990). Pour
lanthropologue Michel de Certeau, lespace urbain est une question de perspective, la fois une
immense texturologie , qui se donne lire par le recours une distanciation de type visuel, mais
aussi un dchiffrement des seuils o cesse la visibilit o les pratiques ordinaires
des marcheurs rcrivent la ville et ses rseaux chacun de leurs pas en de multiples arts de
faire (Certeau 1990 : 141). Pour les gographes, lespace urbain transmet, dans un langage morphique , des informations qui sont dcodes, leur tour, par les habitants-lecteurs (Spain 1992 : 17).
Ce jeu de miroir entre espace et texte permet certainement de mieux visualiser, exprimer ou cartographier , respectivement, les phnomnes littraires ou spatiaux, mais il ne constitue pas en soi un
outil qui permet tudier lespace en tant qulment constitutif du roman.
3.
Lespace romanesque
linstar de Bakhtine et de Lotman, la grande majorit des thories de lespace en littrature prennent pour objet dtude le roman. En Belgique et France, ce sont surtout les travaux de Jean
Weisgerber et dHenri Mitterand qui ont fait avancer les connaissances dans ce domaine. Ayant
9
Arborescences
Antje Ziethen
constat quen thorie littraire, lespace romanesque na pas la place qui lui revient, ces chercheurs
se sont interrogs sur sa fonction dans le rcit. Pour eux, lespace romanesque est celui o se droule lintrigue (Weisgerber 1978 : 227), ou encore lespace-fiction , voire les coordonnes topographiques de laction imagine et conte (Mitterand 1980 : 192). tudiant le roman moderne du
XVIII
sicle, Jean Weisgerber dfinit lespace en termes relationnels et sinscrit ainsi dans le sillage de
Lotman. Il rcupre lide que le rcit se construit partir de structures spatiales binaires telles que
gauche/droite, haut/bas ou encore avant/arrire. Celles-ci se rattachent galement un jugement de
valeur ou des significations particulires dpassant alors le domaine spatial (Weisgerber 1978 : 1517). Certes, vu sous cet angle, Weisgerber ne semble rien apporter de nouveau. Son ingniosit repose toutefois sur le fait quil pressent la ncessit dune tude interdisciplinaire. Pour lui, [l]espace
romanesque est un espace vcu par lhomme tout entier, corps et me, et ds lors voisin de ceux que
reprsentent le peintre et le sculpteur, quinvoquent les prtres, qutudient sociologues, linguistes,
gographes, psychologues et ethnologues (Weisgerber 1978 : 11-12). Lespace romanesque na rien
dun espace euclidien ni mathmatique mais sapparente celui qutudient les sciences humaines
(Weisgerber 1978 : 11), savoir un espace jonch dobstacles, cribl de fissures, dfini par des directions et lieux de privilgis, bourr de sons, de couleurs, de parfums (Weisgerber 1978 : 19). En
outre, Weisgerber conteste la relgation de lespace aux sphres du dcor et de la description. La
thorie littraire traditionnelle ne lui confrait quune fonction ornementale ou dencadrement,
lexcluant de la sorte de toute progression chronologique, de lavancement de lintrigue, de
lvolution des personnages et de la production de sens (Brosseau 1996 : 84 et 87). Synonyme de
mode de description, lespace produisait essentiellement un effet du rel . Weisgerber, en revanche,
lve lespace au mme rang quun personnage. Qui plus est, lespace est, dune part, le produit dun
processus dynamique impliquant plusieurs points de vue (narrateur, personnages, lecteur) et, de
lautre, la base dun modle qui stend tous les niveaux du rcit. Par consquent, lanalyse de
lespace donne accs la signification totale de luvre (Weisgerber 1978 : 227). Autre lment
novateur, lespace nest pas donn mais se construit au fur et mesure (Weisgerber 1978 : 29) par
les gestes, les motions et les sens (oue, toucher, odorat, vue). La thorie de Weisgerber est appuye
et complte par les rflexions de Mitterand esquisses dans Le Discours du roman.
Mitterand dfinit lespace initialement comme le champ de dploiement des actants et de
leurs actes, comme circonstant, valeur dterminative, de laction romanesque (Mitterand 1980 :
190). Or, son analyse de Ferragus de Balzac lamne remettre en question lopposition rigide, en
10
Arborescences
Antje Ziethen
smiotique, entre actant et circonstant. Par consquent, il se prononce en faveur dune actancialisation de lespace qui souligne le rle fondamental de ce dernier :
Lorsque le circonstant spatial, comme dans Ferragus, devient lui seul dune part la
matire, le support, le dclencheur de lvnement, et dautre part lobjet idologique
principal, peut-on encore parler de circonstant, ou, en dautres termes, de dcor ?
Quand lespace romanesque devient une forme qui gouverne par sa structure propre,
et par les relations quelle engendre, le fonctionnement digtique et symbolique du
rcit, il ne peut rester lobjet dune thorie de la description, tandis que le personnage,
laction et la temporalit relveraient seuls dune thorie du rcit. Le roman, depuis
Balzac surtout, narrativise lespace, au sens prcis du terme : il en fait une composante essentielle de la machine narrative. (Mitterand 1980 : 211-212)
Pour Mitterand, lespace fait merger le rcit, dtermine les relations entre les personnages et influe
sur leurs actions. Sa production ne relve pas uniquement de la description mais rsulte dune concertation entre plusieurs lments (narration, personnages, temps, actions). Faisant cho Lotman,
Mitterand affirme quune tude spatiale ne doit pas se limiter une dmarche purement topographique mais exige galement une topologie qui dgage ses valeurs symbolique et idologique. Il appelle alors tablir un rpertoire morphologique et fonctionnel des lieux romanesques, analogue
celui que propose Philippe Hamon pour les personnages (Mitterand 1980 : 193). Comme Weisgerber, il revendique une rvision de la thorie littraire qui tient compte du fait que lunivers fictionnel
est bel et bien un espace-temps dont les deux composantes sont pied dgalit. Certes, Mitterand se
limite lanalyse dun seul texte et ne parvient pas encore formuler une thse fondamentale de
lespace romanesque, mais encore demeure-t-il quil a prpar la voie dans laquelle dautres recherches allaient suivre.
Mitterand voque les recherches entreprises par Roland Bourneuf dans le domaine de
lespace romanesque (Mitterand 1980 : 193) qui nous semblent fort intressantes. Dans son article
Lorganisation de lespace dans le roman (Bourneuf 1970), Bourneuf aborde le sujet sous trois
angles diffrents mais complmentaires : lespace dans sa relation avec lauteur, avec le lecteur, avec
les autres lments constitutifs du roman (Bourneuf 1970 : 80). Le premier aspect sapparenterait
une potique de lespace, telle que propose par Bachelard (Bachelard 1957), qui tudie la reprsentation de lespace, sa perception et sa signification psychologique confres par lauteur. Le second
aspect renvoie une interfrence de lespace imaginaire et de lunivers rel du lecteur dj identifie
par Michel Butor dans Lespace du roman . Le lieu romanesque est [] une particularisation
dun ailleurs complmentaire du lieu rel o il est voqu (Butor 1964 : 43). Et Bourneuf
dajouter [d]o la ncessit pour le romancier de suggrer cet espace, dassurer lunit de ses diverses composantes, d organiser des parcours en ne traitant plus ces dcors comme des lieux
11
Arborescences
Antje Ziethen
statiques, mais en utilisant leurs ressources dynamiques (Bourneuf 1970 : 81). Le troisime aspect
repr par Bourneuf, donc la relation de lespace avec les autres lments du roman, soulve la question de savoir quelle ncessit interne du roman rpond lorganisation de lespace (Bourneuf
1970 : 82). Comme Weisgerber et Mitterand, il considre lespace au mme titre que lintrigue, le
temps ou les personnages comme un lment constitutif du roman (Bourneuf 1970 : 82). Une
tude de lespace romanesque devrait, dans un premier temps, reconstituer la topographie dun
roman (Bourneuf 1970 : 82) afin didentifier la forme globale : [s]ystme ouvert ou ferm, espace
uni- ou multipolaire, organisation en toile, en vecteur, en cercle, en spirale (Bourneuf 1970 : 85).
Dans un deuxime temps, il sagit den discerner la signification, voire la valeur topologique pour en
dgager la conception du monde traduit par lespace romanesque. Bourneuf finit par distinguer deux
types despaces romanesques : un espace-cadre, un espace-dcor qui accompagne les personnages,
leur sert d environnement sans vraiment en conditionner les actes, et un espace-sujet, un espaceacteur sans quoi, la limite, personnages, action et rcit cessent dexister (Bourneuf 1970 : 92-93).
Cette distinction nest pas trs convaincante, non seulement en raison des dmonstrations faites par
Bourneuf lui-mme mais aussi de la notion despace lequel nest notamment plus considr comme
un simple cadre. Bourneuf se contente ici dun compromis qui ne rejette pas compltement la faon
conventionnelle de comprendre lespace romanesque. Somme toute, nous pouvons constater que les
tudes de Weisgerber, Mitterand et Bourneuf dtiennent beaucoup de similarits, car, pour ces chercheurs, lespace romanesque est plus que la somme des lieux dcrits (Bourneuf 1970 : 94). Toutefois, ces tudes demeurent encore trop parses pour former un cadre thorique substantiel et cohrent. Il faut attendre les annes 1990 et 2000 pour que se formalisent des approches plus
systmatiques et interdisciplinaires.
4.
La narratologie spatiale
Depuis une quinzaine dannes, les narratologues se penchent plus intensivement sur la question de
lespace afin de remdier au dsquilibre spatio-temporel qui sest install dans leur discipline. Ils
dplorent que la narratologie ait longtemps privilgi le temps lespace, alors que ce dernier est
aussi indispensable la structure du monde narr que lest le temps, car les vnements ne se droulent pas seulement un moment prcis mais galement dans un endroit particulier (Dennerlein 2009 :
4). Pour pallier ces lacunes, des chercheurs tels que Marie-Laure Ryan, Ansgar Nnning et Katrin
Dennerlein, pour nommer les plus importants, ont dfrich la voie vers une narratologie de lespace.
12
Arborescences
Antje Ziethen
Ryan distingue quatre formes et niveaux diffrents despace narratif : spatial frames, setting, story space,
story world et narrative universe. Les spatial frames correspondent aux environs immdiats des vnements
tels que le salon, la chambre ou le port. Ils se succdent et se relaient suivant le mouvement des personnages. Plus stable que les spatial frames, le setting se rfre, plus gnralement, lenvironnement
social, historique et gographique au sein duquel se droule lintrigue (Ryan donne lexemple du Dublin petit-bourgeois du
XX
sicle). Le story space comprend tous les spatial frames ainsi que les lieux
mentionns dans le rcit sans quils soient lis un vnement (ceci inclurait, par exemple, les lieux
auxquels rvent les personnages). Dpassant lunivers du texte, sensu stricto, le story world se compose
du story space que nous venons de prsenter et de limaginaire complmentaire du lecteur qui sappuie
sur des connaissances culturelles et des expriences relles. While story space consists of selected
places separated by voids, the narrative world is conceived by the imagination as a coherent, unified,
ontologically full and materially existing geographical entity, even when it is a fictional world that
possesses none of these properties (Fictional vs. Factual Narration) (Ryan 2009). Quant au narrative
universe, Ryan le dfinit comme la somme des espaces-temps, autrement dit des mondes parallles,
dans le texte quils soient existants ou non-existants (hypothtiques, rvs, fantasms, etc.). Tous ces
niveaux despace narratif se rvlent au lecteur progressivement au fil du temps de la lecture (Ryan
2009). linstar de Weissgerber et Mitterand, Ryan conteste aussi lide que lespace narratif se construit uniquement dans les moments de suspension narrative. Mme si elle reste attache la description comme stratgie discursive principale de production spatiale, Ryan insiste simultanment sur
des moyens plus dynamiques qui incluent les mouvements des personnages, leurs perceptions, la
description narrativise et les informations spatiales relies aux vnements (Ryan 2009). Du ct
des lecteurs, lespace narratif se met en place avec la lecture par le biais dun modle mental ou, plus
prcisment, dune carte cognitive. Mental maps [] are both dynamically constructed in the
course of reading and consulted by the reader to orient himself in the narrative world (Ryan 2009).
Dans cette perspective, Ryan propose galement la notion de cartographie narrative, moyen qui
tant donn les contraintes du langage ce qui a trait la reprsentation spatiale faciliterait la visualisation et lactualisation de lespace narratif par le lecteur. Lanalyse de lespace narratif ne se limite donc pas sa seule discursivit verbale mais devrait stendre sa forme graphique/visuelle
(cartes, diagrammes, tableaux) autant sur le plan de la production que de la rception littraire (Ryan
2003 : 333-364).
Dans Formen und Funktionen literarischer Raumdarstellung: Grundlagen, Anstze, narratologische Kategorien und neue Perspektiven , le narratologue Ansgar Nnning propose un modle
13
Arborescences
Antje Ziethen
danalyse de lespace fictionnel bien diffrent. Dpassant la nature purement structurelle et hirarchique de lapproche de Ryan, il se penche sur les trois procds par lesquels sopre la production
de lespace fictionnel : la slection (axe paradigmatique), la combinaison/la configuration (axe syntagmatique) et la perspectivisation (axe discursif). Nnning dfinit le premier procd comme la slection, par lauteur, dlments extratextuels et intertextuels, cest--dire de matriel qui se rfre
autant au milieu social qu des textes littraires antrieurs (architexte). Nnning sarrte surtout sur
les lments extratextuels puisquils permettent de mettre en lumire le rapport entre les espaces
narrs, les espaces rels et les modles culturels de lespace (Nnning 2009 : 40, notre traduction).
Le procd de slection illustre alors que le texte littraire ne se calque pas sur la ralit mais construit un espace proprement fictionnel partir de fragments htrognes quil rarrange et faonne
sa guise. Ce constat mne Nnning au deuxime procd de la production littraire de lespace, celui
de la configuration, qui tablit des relations entre les lments spatiaux choisis. La configuration,
terme emprunt Ricur qui lutilise en rfrence au temps, sopre partir de procds narratifs et
esthtiques propre la littrature, faisant merger un tout cohrent. Il souligne pourtant que cet univers reste un simulacre, ontologiquement trs diffrent du monde rel. Convoquant la notion de
structure chez Jameson qui la lui-mme emprunte Althusser, Nnning insiste sur le fait que la
structure spatiale dun texte littraire est plus que la somme de ses lments.1 Elle se construit plutt
comme un rseau de relations dopposition et de correspondance entre les lments slectionns
(Nnning 2009 : 42). Il rappelle quen littrature, le monde nest jamais reprsent ni peru dans sa
totalit. Sa reprsentation ne peut se faire que par mtonymie. Les relations entre les lments mtonymiques, tablies par la configuration, font en sorte que se cre une structure dorganisation spcifiquement fictionnelle (Nnning 2009 : 43). La perspectivisation, troisime procd convi par Nnning, dtermine si lespace fictionnel se construit partir dun ou plusieurs narrateurs, des dialogues
entre personnages, des voix dadultes ou denfants, de narrateurs fiables ou non-fiables, etc.
Enfin, il faut faire tat de Die Narratologie des Raumes (La Narratologie de lespace) de Katrin
Dennerlein (Dennerlein 2009), jusqualors ltude la plus systmatique sur le sujet. Lauteure commente, dun il critique, les tudes existantes en proposant aux lecteurs un large rpertoire de termes
bien dfinis tout en dvoilant limportance du processus dialogique de production et de rception.
Informe par des tudes en linguistique cognitive, en psychologie, en gographie et sociologie,
1 This is the sense in which this structure is an absent cause, since it is nowhere empirically present as an element, it
is not a part of the whole or one of the levels, but rather the entire system of relationships among those levels. (Jameson 1081 : 36, cit dans Nnning 2009 : 42-43).
14
Arborescences
Antje Ziethen
ltude de Dennerlein semble, de prime abord, sinscrire dans le tournant spatial. Toutefois, il savre
que lauteure se distancie demble des concepts despace relationnel et constructiviste. Elle adhre
plutt la notion despace en tant que contenant (Dennerlein 2009 : 9) qui prcde son contenu. Il
est indpendant de notre perception, se constitue en objet concret, se caractrise par un dedans et un
dehors et au sein duquel se positionnent les hommes et les choses (Dennerlein 2009 : 71). Dennerlein tudie, en premier lieu, la production narrative de lespace travers des rfrences spatiales.
Parmi ces dernires, elle compte des toponymes, des noms propres, des termes gnriques (tat,
quartier, grange, bote, avion, etc.), des adverbes dictiques (ici, l), certains verbes et prpositions.
L o les rfrences spatiales explicites font dfaut, dautres moyens peuvent voquer des structures
spatiales : les identits (statut social, profession, etc.) des personnages, les vnements/actions ainsi
que la reprsentation mtonymique (i.e. des cloches pour une glise et, par extension, une ville ou un
village). La production de lespace fictionnel ne repose cependant pas uniquement sur ces informations textuelles mais sopre par les interfrences dun lecteur-modle. Dennerlein constate alors, en
second lieu, que lespace fictionnel srige en modle mental du lecteur ; ide dj lance par Ryan.
En mettant le processus de rception au centre de lintrt, lauteure dmontre que la construction
des reprsentations mentales chez le lecteur dpend galement de son savoir et de ses modles culturels. Afin danalyser comment les informations spatiales du texte sont organises et hirarchises au
sein du modle mental du lecteur, elle prsente, en dernier lieu, les techniques de la reprsentation de
lespace, en loccurrence sa mdiation par les vnements (narration, lespace en sa qualit de scne)
et sa mdiation indpendamment dun vnement (description). Outre la description, Dennerlein
voque galement les modes de rflexion, du commentaire et de largument comme moyens possibles de mdiation non-vnementielle. Dun ct, cette dmarche lui permet de dterminer quelles
informations sont cognitivement signifiantes, savoir retenues et intgres dans le modle mental.
De lautre, elle peut dmontrer si et quel point ces informations dterminent/modifient le modle
mental au cours de la lecture. Il convient de souligner que Dennerlein fournit ici une dmonstration
convaincante de la production de lespace autre que par la description, subvertissant de la sorte ce
lieu commun de la thorie littraire canonique. Ajoutons que la notion despace en tant que contenant avec laquelle travaille Dennerlein soppose celle implicite dans les approches que nous allons
passer en revue et qui comprennent lespace (fictionnel) comme le produit/le producteur des interactions et relations de diffrents actants.
15
Arborescences
5.
Antje Ziethen
La gographie littraire et la gocritique
Il nest gure surprenant que ltude de lespace fictionnel ait suscit une convergence de la littrature
et de la gographie, discipline spatiale par excellence. Les premiers rapprochements remontent
dailleurs dj lAntiquit ainsi que le constate Bertrand Lvy, car le premier gographe fut Homre (Lvy 2006 : 3). Lvy, lui-mme gographe, convie la littrature en tant que source
dinspiration, de stimulation et de rflexion : Lesprit des lieux, lidentit des rgions, la personnalit
des villes, le caractre des nations [] ; la littrature est irremplaable pour cerner ces caractristiques travers le vcu, individuel et social (Lvy 2006 : 13-14). Quoique les gographes regardent
parfois dun il mfiant la nature mimtique de la littrature, savoir le fait quelle ne copie pas le
rel gographique, ils lui attribuent une fonction sociale , tant donn que [l]a littrature
dimagination ne dpeint pas le monde tel quil est mais tel quil devrait tre ou tel quil pourrait
tre (Lvy 2006 : 11). Yi-Fu Tuan constate mme que [t]rs souvent, lart anticipe la science
(Tuan 1978 : 194 ; notre traduction). Henri Desbois, lui aussi gographe, considre que la littrature est une allie du gographe, mais ltude des gographies littraires est surtout enrichissante
quand elle peut nous aider regarder diffremment notre gographie (Desbois 2002 : 4). Il remet
en question laporie qui sparerait une gographie objective dune littrature subjective : [E]xiste-t-il
une objectivit du territoire qui ne passe pas par une exprience physique singulire du lieu ? (Desbois 2002 : 4).
Le frottement interdisciplinaire a galement t identifi par le gographe Marc Brosseau.
Dans son ouvrage intitul Des romans-gographes, il documente non seulement la rencontre entre la
gographie et la littrature depuis les annes 70 mais avance que la littrature constitue en elle-mme
une sorte dtude gographique. Par consquent, les chercheurs devraient cesser de concentrer
uniquement les regards sur le contenu gographique du roman, mais d[en] examiner [l]a propre faon de faire de la gographie (Brosseau 1996 : 20). Brosseau explique quau dpart, les gographes recouraient avant tout un corpus de romans ralistes et naturalistes, aux rcits de voyages
et aux romans urbains pour en dgager la valeur documentaire (Brosseau 1996 : 29). Avec
lmergence de la gographie humaine de type phnomnologique sy ajoutaient galement les ouvrages (auto-)biographiques afin de comprendre dans quelle mesure lespace est peru et vcu, cest-dire investi de pratiques, dimages, dmotions, de significations et de subjectivits (Brosseau 2003 :
18). Enfin, la lumire des tudes postcoloniales et culturelles, les gographes se sont rorients vers
une critique de la reprsentation hgmonique de la diffrence (classe, genre sexuel, ethnicit, ge et
16
Arborescences
Antje Ziethen
sexualit) dans la littrature postcoloniale, la science-fiction, le roman policier et la littrature de jeunesse (Brosseau 2009 : 215-216). Ils se sont rendus lvidence que tout savoir, tout discours et
toute reprsentation est insparable de sa situation dnonciation et de sa charge idologique. Or,
aucun de ces trois courants gographiques ne sest arrt sur les qualits strictement littraires du
texte, savoir sa poticit, sa fictionnalit, limaginaire et le style. Les chercheurs se sont content
dextraire les donnes empiriques du texte afin de tester des hypothses gographiques (Brosseau
1996 : 51) articules au sujet dun rfrent prcis. Ainsi, au lieu dtudier luvre potique dans sa
globalit, ils ont privilgi lapproche la fragmentation et le morcellement.
Depuis le renouvellement du champ gographique dans les annes 90, nombre de chercheurs
sefforcent de tenir compte du fait que les romanciers contemporains ne fournissent pas seulement
la gographie des documents prcieux, ils sont eux-mmes, leur manire, gographes ; il y a
une pense spatiale du roman, qui a une faon propre de faire de la gographie (Collot 2011).
Brosseau lui-mme tudie cet aspect dans les romans de Sskind, Dos Passos, Gracq, Tournier et
Bukowski o il aborde le topos de la ville, la gographie olfactive des lieux ou limaginaire des basfonds. Il affirme que :
[L]iterary analysis is no longer seen as a monologic endeavour aimed at illustrating or
demonstrating a preformulated hypothesis. [] [G]eographers no longer tend to see
the fictive dimension of literature as a problematic barrier to overcome or neutralize,
but rather as an important source with which to engage for epistemological insight.
(Brosseau 2009 : 214)
La confluence des savoirs ne se produit pas seulement du ct de la gographie mais galement dans le champ littraire. La gographie de la littrature (Moretti 2000 ; Piatti 2008), par
exemple, sappuie sur la cartographie afin de mieux comprendre comment la gographie russit
engendrer le roman de lEurope moderne (Moretti 2000 : 14). Il convient de prciser quil ne sagit
pas seulement dune cartographie de la littrature mais bien dune gographie (Piatti 2012 : 263) qui utilise les instruments analytiques tels les cartes dans lobjectif de formuler des conclusions, autant sur
la cration littraire que sur la diffusion et la circulation de produits littraires. Moretti et Piatti sont
conscients des critiques suscites par leur mthode forcment rductrice et fragmentaire. Piatti rpond dailleurs ces reproches dans son article Mit Karten lesen. Pldoyer fr eine visualisierte
Geographie der Literatur (Piatti 2012). Elle y souligne que le recours aux mthodes dabstraction et
de quantification est toujours contrebalanc par un travail hermneutique, la fois comparatiste et
contextualisant, qui sefforce de trouver des rponses aux questions souleves par les cartes (Piatti
17
Arborescences
Antje Ziethen
2012 : 273). Moretti, pour sa part, signale que le travail dun gographe de la littrature ne se termine
pas avec une carte, il y commence.
Les projets de Moretti et de Piatti relvent concomitamment de lhistoire littraire car ils se
rvlent la fois diachronique et comparatiste. En sappuyant sur un large corpus de textes provenant dpoques et despace diffrents, les deux chercheurs ont cr un inventaire cartographique qui
reprsente des catgories diverses despaces fictionnels sur un ensemble de cartes. Pour Moretti, la
gographie est un aspect essentiel du dveloppement et de linvention littraires ; cest une force active, concrte, qui imprime sa marque sur les textes, sur les intrigues, sur les systmes dattente
(Moretti 2000 : 9). Son entreprise gographique se dcline en deux objectifs : tudier la fois lespace
imaginaire et lespace historique, cest--dire lespace dans la littrature et la littrature dans lespace
(Moretti 2000 : 9). Dans un premier temps, les cartes de lAtlas font alors voir les gographies imaginaires des romans ltude (lieux, frontires, mouvements) ainsi que la logique interne de la narration : lespace smiotique, dintrigue, autour duquel la narration sauto-organise (Moretti 2000 : 11).
Grce un systme terminologique et des catgories diffrencies, Moretti parvient inclure un
grand nombre dinformations dans ses cartes telles que la localisation prcise, les parcours, les rencontres, le degr de rfrentialit, et les fonctions/qualits des espaces reprsents (voir Piatti 2012 :
275). Dans un deuxime temps, Moretti prsente des cartes illustrant le march du roman, savoir la
prsence du canon littraire dans les catalogues des bibliothques du
XIX
sicle, la part quy occu-
pent les romans trangers, les lieux de publication du roman anglais et dautres lments encore.
Barbara Piatti, quant elle, a pour objectif dcrire lhistoire de la littrature du point de vue
de la scne, voire de lendroit de laction .2 Visant les rgions du Vierwaldstttersee et du Gotthardgebiet
en Suisse, elle situe les lieux concrets, les lieux sans localisation prcise, les lieux transforms ou dplacs, les voyages/mouvements travers la rgion et les frontires politiques variables. En outre, les
cartes indiquent les lieux partir desquels les personnages rvent ou se souviennent dautres lieux.
Selon Piatti, la littrature construit des lieux et des espaces tantt entirement fictifs tantt gographiquement situables et reconnaissables (Piatti 2008 : 16). La gographie littraire suppose donc un
rapport rfrentiel entre fiction et ralit. Certes, ce rapport ne se fonde pas sur une mimsis, voire
une quivalence identique. Toutefois, la littrature produit des mondes parallles qui pourraient tre
lis au ntre, qui pourraient avoir merg du ntre (Piatti 2008 : 30). La frontire entre les deux
mondes savre permable, permettant un change dans les deux directions. En ce sens, lespace
https://www.ethlife.ethz.ch/archive_articles/071005_Literaturatlas/index_EN
18
Arborescences
Antje Ziethen
constitue une zone de contact o lespace imaginaire chevauche la gographie relle, la dpasse, la
rtrcit et, parfois, entre en contact avec elle (Piatti 2008 : 31).
La gocritique saligne avec le point de vue de Piatti.3 Autant Bertrand Westphal (2007) que
Robert T. Tally (2011) partent du fait que ralit et fiction ne sexcluent pas mutuellement. Dans le
sillage de Marc Aug, Westphal affirme que, dans le monde postmoderne, le terme rel est instable et ambigu. [D]un tat o les fictions se nourrissaient de la transformation imaginaire du rel,
nous [sommes passs] un tat o le rel sefforce de reproduire la fiction (Aug 1997 : 169, cit
dans Westphal 2007 : 148). Il se rfre notamment aux notions de simulacre et despaces rels-etimaginaires proposes respectivement par Baudrillard (1981) et Soja (1996), voquant galement
lide que [l]e clivage entre rel et fiction est minimal (Westphal 2007 : 149). Dans Postmodernist
Fiction, Brian McHale rsume la problmatique, non sans ironie, par la question : Real, compared to
what ? (McHale 1987 : 84). Selon Westphal, cest la littrature postmoderne qui sadapte le mieux
cette nouvelle version du rel, le rel dralis ; cest peut-tre elle qui offre les meilleures options
de lecture du monde, en vertu de sa fictionnalit mme (Westphal 2007 : 150). Westphal argue que
la nouvelle spatialit inhrente notre condition postmoderne sexprime dans les mtaphores spatialisantes du temps, dans la mobilit de lespace (transgressivit) ainsi que dans le lien troit entre le
monde et le texte (rfrentialit).
En quoi consiste donc lapproche gocritique ? La thorie de Bertrand Westphal conjugue les
tudes littraires la gographie, aux tudes urbaines, larchitecture, la philosophie et la sociologie. Substituant une approche gocentre une approche gocentre, la gocritique ne gravite pas
autour dun auteur ou dune poque historique mais se concentre sur un espace spcifique que ce
soit une rgion, une ville, un pays, etc.4 La dmarche gocritique se veut la fois synchronique, diachronique, thmatologique et imagologique. Ses principes de multifocalisation, de polysensorialit
(visuel, sonore, olfactif) et sa vision stratigraphique (verticale, strates temporelles) ont pour objectif
de diversifier les perspectives, de contrebalancer les subjectivits (les strotypes) et de rvler le
caractre dynamique de la reprsentation spatiale en littrature. De la sorte seront produites des
connaissances plus inclusives et gnrales sur le lien entre le monde qui nous entoure et celui de nos
fantasmes (Prieto 2011 : 25). Or, une gocritique ainsi conue ncessite ltude dun large corpus et,
par consquent, ne se prte pas celle dun seul texte do son application limite. Qui plus est, la
3 Le terme a t forg par Bertrand Westphal et Robert T. Tally, indpendamment lun de lautre. Tally fait explicitement
rfrence la gophilosophie de Deleuze et Guattari et la gohistoire de Braudel.
4 Il existe, entre autres, des tudes gocritiques sur la rgion de la Mditerrane, la ville de Lisbonne, la Transylvanie, la
ville de Montral, sur lespace forestier, lespace dans les uvres de Jules Verne et celui dans la nouvelle qubcoise.
19
Arborescences
Antje Ziethen
dmarche repose sur limplication non pas dun seul chercheur mais dun groupe de chercheurs afin
de mener bien le projet comparatiste (Tally 2013 : 143). Eric Prieto et Robert Tally font galement
remarquer que Westphal, de par son rattachement au rfrent, semble exclure les espaces intimes,
domestiques ou purement fictifs qui ne figurent sur aucune carte (Prieto 2011 : 22-23; Tally 2013 :
144). Michel Collot, lui aussi, interroge la priorit du ralme en gocritique (et dailleurs aussi en
gographie de la littrature) qui semble relguer lcriture, limagination et lingniosit de lauteur en
arrire-plan. Selon lui, une approche gocentre doit tablir un quilibre entre page et paysage , savoir entre analyse thmatique et stylistique (Collot 2011).
Robert T. Tally Jr. partage avec Westphal la proccupation pour les phnomnes spatiaux en
littrature. Quoique leurs thories convoquent les mmes penseurs de lespace (Bachelard, de Certeau, Deleuze, Foucault, Harvey, Jameson, Lefebvre, Soja, etc.), leurs conceptions de la gocritique
divergent. Tally lentend dans un sens plus large : Geocriticism or spatial critical theory, then, is
broadly understood to include both aesthetics and politics, as elements in a constellation of interdisciplinary methods designed to gain a comprehensive and nuanced understanding of the everchanging spatial relations (Tally 2013 : 113). Les relations et pratiques spatiales dont il parle se manifestent galement en littrature. Toutefois, pour Tally, la gocritique applique la littrature ne
consiste pas en une analyse de la reprsentation littraire dun espace spcifique, tel que vis par
Westphal. Il propose de dvelopper de nouveaux modles thoriques et critiques afin de mieux
comprendre la manire dont les auteurs et les lecteurs cartographient (map) le monde. Ses rflexions sinspirent particulirement de la notion de cartographie cognitive (cognitive mapping) de Jameson (Jameson 1991). Chez Jameson, tel que le fait remarquer Tally, la dfinition du terme se dcline en deux volets. Dune part, elle constitue une pratique du postmodernisme enabl[ing] a
situational representation on the part of the individual subject to that vaster and properly unrepresentable totality which is the ensemble of societys structures as a whole (Jameson 1991 : 51). De
lautre, dtache de ce premier sens subjectif et phnomnologique, elle atteint une porte gnrale
(objective) et globale permettant la socit de faire sens du systme du capitalisme tardif (Tally
1996 : 414). Tally transpose la cartographie cognitive dans un contexte littraire. Selon lui, ce procd permet aux auteurs de cartographier les espaces sociaux de son monde et de les rarranger travers le verbe potique, de leur insuffler un sens particulier. Le lecteur gocritique lit les cartes fictionnelles dployes par lauteur, faisant, son tour, appel au procd de cartographie cognitive et
aux thories spatiales afin danalyser la production de lespace dans luvre littraire.
20
Arborescences
6.
Antje Ziethen
La gopotique, lcocritique et la pense-paysage
Le souci de lenvironnement et de lquilibre cologique a fait irruption dans le champ littraire dans
les annes 1990. Quoique environnement ne soit pas synonyme despace, les deux se chevauchent et
se caractrisent par le rapport intime que lhumain noue avec eux. Pour ces raisons, nous accordons
ici la gopotique et lcocritique une place parmi les approches gocentres. Par leur nature
transdisciplinaire, les deux thories dpassent le cadre littraire en intgrant autant les sciences humaines que les sciences naturelles. La pense-paysage de Michel Collot sera galement prsente,
car la notion de paysage touche aux reprsentations, formes et perceptions dun espace spcifique.
Mais commenons par la gopotique. Le terme a t introduit par le pote cossais-franais et fondateur de lInstitut international de gopotique Kenneth White. Il la dfinit :
[] comme une thorie-pratique transdisciplinaire applicable tous les domaines de
la vie et de la recherche, qui a pour but de rtablir et denrichir le rapport HommeTerre depuis longtemps rompu, avec les consquences que lon sait sur les plans cologique, psychologique et intellectuel, dveloppant ainsi de nouvelles perspectives
existentielles dans un monde refond.5
La gopotique, dont les prcurseurs seraient Humboldt, Thoreau, Nietzsche, Rimbaud et
Segalen, refuse d'tre rduite une vague expression lyrique de la gographie (White 2008 : n. p.),
mais merge dune conscience gographique (White 1987 : 89) et dune capacit produire un
nouveau rapport entre ltre humain et son environnement. Rachel Bouvet prcise que la gopotique est la fois un [c]hamps de recherche et de cration qui vise concilier deux dmarches
diffrentes, lune oriente vers la connaissance et marque par la rigueur et la logique, lautre vers
lcriture ou la pratique artistique et faisant jouer les ressorts de lintuition et de la sensibilit (Bouvet 2008 : 127). Les gopotes se distinguent par un nomadisme autant intellectuel (White 1994 : 27)
que physique, privilgiant le voyage, le mouvement et la transgression des frontires gographiques/linguistiques/disciplinaires. Le nomadisme se fonde sur des lectures extensives et lappel du
dehors. Selon Bouvet, [l]a posture critique insparable de ce mouvement vers le dehors nous conduit remettre en question la culture dont nous avons hrit, sdentaire pour la grande majorit, et
ses postulats les plus profondment enracins (Bouvet 2008 : 7). Les gopotes explorent ainsi la
ville, le dsert, les rivires, locan, la fort autant physiquement que littrairement. Dans son manifeste intitul Le Plateau de lAlbatros. Introduction la gopotique (White 1994), White ouvre des pistes
www.kennethwhite.org/geopoetique
21
Arborescences
Antje Ziethen
multiples qui demeurent pourtant assez clates. Symptomatique du nomadisme clbr par la gopotique, chaque chercheur est amen dfinir lui-mme la dmarche suivre.6
La pense-paysage de Michel Collot (Collot 2011b) a des affinits avec la gopotique en cela
quelle sinterroge sur la manire dont la relation intime entre lhomme et le monde, ltre humain et
son environnement, trouve son expression dans les arts mimtiques. Elle aussi dpasse le cadre littraire afin de sriger en principe inhrent la philosophie, la peinture et la littrature. Collot met en
avant la notion de paysage qui, pour lui, tmoigne de la multidimensionnalit des phnomnes humains et sociaux, de linterdpendance du temps et de lespace, et de linteraction de la nature et de la
culture, de lconomique et du symbolique, de lindividu et de la socit (Collot 2011b : 11). Sans
forcment obir un principe dialectique dont laporie intrinsque se neutraliserait dans un mouvement de relve hglienne, le paysage donne lieu un affranchissement du dualisme invtr de la
pense occidentale , un dpassement dun certain nombre doppositions qui la structurent,
comme celles du sens et du sensible, du visible et de linvisible, du sujet et de lobjet, de la pense et
de ltendue, de lesprit et du corps, de la nature et de la culture (Collot 2011b : 18). Bref, le paysage
nous invite penser autrement (Collot 2011b : 12). Dfiant la sparation doxique, depuis Descartes, de la res cogitans et res extensa, de lesprit et du corps, la notion de paysage les runit par sa nature phnomnologique. Le paysage est le produit dune interaction entre lhomme et lespace. Suivant Merleau-Ponty, Collot comprend la conscience comme une manire dtre au monde, une
conscience qui est corporelle, et, par consquent, spatiale. Esprit et corps, sujet et espace sont pris
dans une posture dialogique, une interdpendance, faisant en sorte que la spatialit du sujet fait cho
la subjectivit de lespace qui lentoure (Collot 2011b : 20), car tout en reliant lindividu au
monde, le paysage renvoie toujours une image de soi. La pense paysage, tout comme la gopotique,
se fonde sur le principe de louverture et du dehors (Collot 2011b : 33) qui suscite la confrontation
autant avec soi-mme quavec lautre. Selon Merleau-Ponty, il est impossible pour un sujet de regarder un objet sans que son propre corps soit enferm dans la perspective. Enfin, le paysage reprsente un phnomne qui rsiste la solidification puisque le corps et avec lui le point de vue
est en constant mouvement. Dans La Pense-paysage, Collot se consacre, entre autres, ltude de
Depuis son instauration, lInstitut de gopotique sest archiplis faisant en sorte quil existe maintenant des satellites
travers le monde, notamment au Qubec (La traverse Atelier qubcois de gopotique), en France (Le Goland Atelier gopotique dAquitaine et le Centre gopotique de Paris), en Allemagne (LAtelier des deux rives), en Suisse (Centre Suisse de gopotique), en cosse (Scottish Center for Geopoetics), en Italie (Studio italiano di geopoetica), en Serbie (Centre gopotique de Belgrade) et
dans le Pacifique (Centre gopotique de Nouvelle-Caldonie) (voir Bouvet 2011).
6
22
Arborescences
Antje Ziethen
quatre crivains Yves Bonnefoy, Andr du Bouchet, Ren Char et Julien Gracq dont lcriture sest
beaucoup inspire de la peinture, de lart du paysage et de la gographie.
lencontre de la gopotique et de la pense paysage, qui se veulent surtout une potique
et une sensibilit, lcocritique constitue plutt un outil analytique. Les origines de ce champ tel quil
se prsente aujourdhui remontent aux annes 90, priode pendant laquelle il sest dvelopp surtout
aux tats-Unis et en Angleterre. Les chercheurs partagent la conviction que la crise environnementale que nous vivons actuellement est la troublante expression matrielle de prsupposs philosophiques, des convictions pistmologiques, des principes esthtiques et impratifs thiques de la culture moderne (Gersdorf et Mayer 2006 : 9 ; notre traduction). Greg Garrard, lauteur dEcocriticism,
la qualifie de mode danalyse dcidment politique (Garrard 2004 : 3 ; notre traduction) et de pratique critique explicitement centre sur la terre. Prise dans un sens large, lcocritique se dfinit
comme ltude de la relation entre lhumain et le non-humain travers lhistoire culturelle impliquant galement une analyse critique du terme humain mme (Garrard 2004 : 5 ; notre traduction). Catrin Gersdorf et Sylvia Mayer nous proposent une dfinition plus prcise qui prsente
lcocritique comme une mthodologie
that re-examines the history of ideologically, aesthetically, and ethically motivated
conceptualisations of nature, of the function of its constructions and metaphorisations in literary and other cultural practices, and of the potential effects these discursive, imaginative constructions have on our bodies as well as our natural and cultural
environments (Gersdorf et Mayer 2006 : 10)
Sa spcificit repose avant tout sur son affinit avec lcologie. Mme si les cocritiques ne se disent
pas cologues, ils cherchent acqurir une comptence cologique en se familiarisant avec les enjeux
des disciplines axes sur lenvironnement (philosophie, cologie, tudes environnementales, gographie) (Garrard 2004 : 5).
Que la littrature constitue un domaine privilgi pour lcocritique sexplique, selon Stphanie Posthumus, par le fait quelle est le lieu par excellence do lon imagine de nouveaux modes de
vivre, de nouvelles ralits, et donc, de nouveaux rapports au monde, la plante et la terre (Posthumus 2011 : 86). Dans ce champ, lcocritique sest traditionnellement penche sur les reprsentations de la nature, de la wilderness et de lidylle pastorale dans luvre des crivains amricains ou anglais (Emerson, Thoreau, Fuller, Wordsworth). Toutefois, des chercheurs ont rcemment jet les
bases dune cocritique franaise (Posthumus 2011) et compare (Suberchicot 2012) afin de tenir
compte du fait que chaque culture produit ses propres concepts de la nature, ses propres discours
cologiques, ses propres rapports au milieu (Heise 2008 : 60-61 ; cit dans Posthumus 2011 : 87).
23
Arborescences
Antje Ziethen
Louise Westling constate pourtant que lcocritique ne dispose pas encore dun cadre thorique suffisamment prcis afin dclairer la relation historiquement, politiquement et socialement mutable
entre les cultures et leurs conceptions respectives de nature (Westling 2006 : 26). Rcemment, les
tudes postcoloniales ont galement assimil lapproche cocritique en abordant, en littrature, des
thmes plus explicitement cologiques tels que la pollution, la gestion des dchets et laccs leau
potable (DeLoughrey et Handley 2011, Tiffin et Huggan 2009). Encore un autre volet de recherche
gravite autour des reprsentations de lanimalit dans la littrature et conteste, ce faisant, la perspective trop souvent anthropocentrique. Toutefois, lcocritique ne devrait pas seulement tudier la manire dont la littrature intgre des propos environnementaux ou cologiques mais aussi considrer
lcriture et la forme mme des textes comme une incitation faire voluer la pense cologique,
voire comme une expression de cette pense (Blanc, Pughe et Chartier 2008 : 17). La littrature
de par ses principes potique et esthtique mme peut contribuer redfinir un modle cologique de lhumanit et de la culture (Zapf 2006 : 53). Lcocritique devrait donc pousser la question
sur la manire dont la fictionnalit de la littrature influe sur les discours et institutions culturels par
ce processus de dfamiliarisation et de transformation symbolique de la ralit et, par extension,
de la nature qui lui est inhrent (Zapf 2006b : 53). La zone de contact entre fiction et ralit, littrature et environnement, culture et nature explore par les cocritiques donne lieu une mise en
question des dogmatismes poststructuralistes voulant que toute rfrence la nature est en soi dores
et dj une construction discursive et culturelle idologiquement motive. Ceci dit, lcocritique se
doit aussi de transcender la prmisse objectiviste de lcologie traditionnelle.
While the natural sciences tended to regard everything cultural as naturally determined, the cultural sciences declared everything natural a cultural construct.
Against this mutual blindness, it would be the task of ecologically inspired literary
and cultural studies specifically to focus on the interaction and interrelatedness of
culture and nature without neglecting the inescapable linguistic and discursive mediatedness of that interrelationship. (Zapf 2006b : 51)
En guise de conclusion, soulignons que les approches littraires cites partent du principe que la
littrature est dune certaine faon lie la ralit et contribue ainsi la constitution despaces quelle
reprsente. Cet aspect est troitement li aux notions de rfrentialit et de performativit qui ont
fait un retour dans le champ littraire aprs une priode formaliste et structuraliste. La frontire
entre le monde fictif et rel est permable, permettant un change dans les deux sens. [I]n one direction, in constructing fictional worlds, the poetic imagination works with material drawn from
actuality; in the opposite direction, fictional constructs deeply influence our imaging and understanding of reality (Lubomr Doleel 1998 : p. X ; cit dans Piatti 2008 : 23-24). Thomas Pavel, auteur de
24
Arborescences
Antje Ziethen
Fictional Worlds, met en garde contre un sgrgationnisme qui rige une frontire tanche entre les
mondes fictionnels et le monde rfrentiel (Pavel 1986 : 11). Une telle vision enlve la littrature
toute valeur thique, existentielle, politique ou didactique (Ryan 2012). Mikhal Bakhtine crit ce
sujet :
En dpit de limpossibilit de confondre le monde reprsent et le monde reprsentant, en dpit de la prsence immuable de la frontire rigoureuse qui les spare, ils
sont indissolublement lis lun lautre, et se trouvent dans une action rciproque
constante []. Luvre et le monde dont elle donne limage pntrent dans le
monde rel et lenrichissent. Et le monde rel pntre dans luvre et dans le monde
quelle reprsente []. (Bakhtine 1978 : 394)
La littrature est, en ce sens, dote dun pouvoir dmiurgique qui fait delle un enjeu culturel et
idologique, pas seulement lchelle individuelle, mais aussi collective (Lvy 2006 : 11). Lorsque
nous lisons le texte et son espace, de quelle que faon que ce soit, nous apprenons non seulement
plus sur le processus potique mais galement sur la manire dont nos imaginaires, mouvements,
pratiques sociales faonnent le monde dans lequel nous vivons.
Rfrences bibliographiques
Alonso Aldama, J. 2009. Espace et mtalangage : dfense du territoire . Nouveaux actes smiotiques
(en ligne : http://revues.unilim.fr/nas/document.php?id=2893, consult le 11 mai 2013).
Attigner, G. (2007). The geography of literature . ETH Life. (en ligne
https://www.ethlife.ethz.ch/archive_articles/071005_Literaturatlas/index_EN
Aug, M. 1997. LImpossible voyage. Le tourisme et ses images. Paris : Rivages.
Bachelard, G. 1957. La Potique de lespace. Paris : Presses universitaires de France.
Bakhtine, M. 1978. Esthtique et thorie du roman. Paris : Gallimard.
Barthes, R. 1970. LEmpire des signes. Paris : Flammarion.
Barthes, R. 1985. Smiologie et urbanisme . LAventure smiologique. Paris : ditions du Seuil. 261271.
Baudrillard, J. 1981. Simulacres et simulation. Paris : ditions Galile.
Blanc, N, T. Pughe et D. Chartier. 2008. Littrature & cologie : vers une copotique . cologie
& Politique, no36, Paris, 17-28.
Blanchot, M. 1955. LEspace littraire. Paris : Gallimard.
Bouvet, R. 2008. Pour une approche gopotique de la lecture. Avances dans lunivers de Victor
Segalen . R. Bouvet et K. White (dirs.). Le nouveau territoire. Lexploration gopotique de lespace.
Montral : Universit du Qubec Montral, Figura, Centre de recherche sur le texte et
limaginaire. 127 - 145.
25
Arborescences
Antje Ziethen
Bouvet, R. 2011. Les Territoires traverss en gopotique : champ, archipel, contres, espaces culturels . La Traverse. Atelier qubcois de gopotique (en ligne : http://latraversee.uqam.ca/entr-ede-blogue/les-territoires-travers-s-en-g-opo-tique-champarchipel-contr-es-espaces-culturels,
consult le 27 mars 2012).
Brosseau, M. 1996. Des Romans-gographes. Essai. Paris : LHarmattan.
Brosseau, M. 2003. LEspace littraire entre gographie et critique . R. Bouvet et B. El Omari
(dirs.). LEspace en toutes lettres. Montral : ditions Nota bene. 13-36.
Brosseau, M. 2009. Literature . R. Kitchin et N. Thrift (dirs.). International Encyclopedia of Human
Geography. vol 6. Oxford : Elsevier. 212218.
Bourneuf, R. 1970. LOrganisation de lespace dans le roman . tudes littraires, vol. 3, no1, Qubec,
77-94.
Butor, M. 1964. LEspace du roman . Essais sur le roman. Paris : Gallimard. 48-55.
Butor, M. 1982. La Ville comme texte . Rpertoire V. Paris : ditions de Minuit. 33-42.
Certeau, Michel de. 1990. LInvention du quotidien. Paris : Gallimard.
Collot, M. 2011. Pour une gographie littraire . LHT 8 (en ligne :
http://www.fabula.org/lht/8/index.php?id=242, consult le 09 aot 2012).
Collot, M. 2011b. La Pense-paysage : philosophie, arts, littrature. Arles : Actes Sud ; Versailles : ENSP.
Cosgrove, D. 1999. Mapping Meanings . D. Cosgrove (dir.). Mappings. London : Reaktion. 1-13.
DeLoughrey, E. et G.B. Handley (dirs.). 2011. Postcolonial Ecologies. Literatures of the Environment. New
York : Oxford University Press.
Dennerlein, K. 2009. Die Narratologie des Raumes. Berlin : Walter de Gruyter.
Derrida, J. 1985 De la grammatologie. Paris : Minuit.
Desbois, H. 2002. Introduction : Territoires littraires et critures gographiques . Gographie et
cultures, no44, Paris, 3-4.
Doleel, L. 1998. Heterocosmica : Fiction and Possible Worlds. Baltimore : Johns Hopkins University
Press.
Duncan, J. S. 1990. The City as Text: The Politics of Landscape Interpretation in the Kandyan Kingdom.
Cambridge, England ; New York : Cambridge University Press.
Frank, J. 1945. Spatial Form in Modern Literature. An Essay in Two Parts . The Sewanee Review,
vol. 53, no2, Baltimore, 221-240.
Frank, J. 1981. Spatial Form: Thirty Years After . J. Smitten et A. Daghistany (dirs.). Spatial Form
in Narrative. Ithaca : Cornell University Press. 202-243.
Frank, M. C. 2009. Die Literaturwissenschaften und der spatial turn: Anstze bei Jurij Lotman und
Michail Bachtin . W. Hallet et B. Neumann (dirs.). Raum und Bewegung in der Literatur. Die Literaturwissenschaften und der Spatial Turn. Bielefeld : Transcript Verlag. 53-80.
Garrard. G. 2004. Ecocriticism. London ; New York : Routledge.
Genette, G. 1969. La littrature et lespace . Figures II. Paris : Seuil. 43-48.
26
Arborescences
Antje Ziethen
Gersdorf, C. et S. Mayer. 2006. Nature in literary and cultural studies : defining the subject of ecocriticism an introduction . C. Gersdorf et S. Mayer (dirs.). Nature in Literary and Cultural Studies. Transatlantic Conversations on Ecocriticism. Amsterdam; New York : Rodopi. 9-24.
Greimas, A. J. 1976. Pour une smiotique topologique . Smiotique et sciences sociales. Paris : ditions
du Seuil. 129-157.
Hallet, W. et B. Neumann. 2009. Raum und Bewegung in der Literatur : Zur Einfhrung . W.
Hallet et B. Neumann (dirs.). Raum und Bewegung in der Literatur. Die Literaturwissenschaften und der
Spatial Turn. Bielefeld : Transcript Verlag. 11-32.
Heise, U. 2008. Sense of Place and Sense of Planet. The Environmental Imagination of the Global. Oxford :
Oxford University Press.
Jacobs, J. 1996. Egde of Empire: Postcolonialism and the City. London ; New York : Routledge.
Jameson, F. 1991. Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism. Durham : Duke University
Press.
Lvy, B. 2006. Gographie et littrature. Une synthse historique . Le Globe. Revue genevoise de littrature, tome 146, Genve, 25-52.
Lotman, Y. 1973. La Structure du texte artistique. Paris : Gallimard.
Lotman, Y. 1974. Zur Metasprache typologischer Kulturbeschreibungen . Y. Lotman. Aufstze sur
Theorie und Methodologie der Literatur und Kunst. Kronberg : Scriptor. 338-377.
Lotman, Y. 1999. La Smiosphre. Limoges : Presses Universitaires de Limoges.
Lynch, K. 1960. The Image of the City. Cambridge, Mass.; London, England : MIT Press.
McHale, B. 1987. Postmodernist Fiction. New York : Methuen.
Mitterand, H. 1980. Le Discours du roman. Paris : Presses Universitaires de France.
Mitterand, H. 1990. Chronotope romanesques : Germinal . Potique, no81, Paris, 89-103.
Moretti, F. 2000. Paris : ditions du Seuil.
Nnning, A. 2009. Formen und Funktionen literarischer Raumdarstellung : Grundlagen, Anstze,
narratologische Kategorien und neue Perspectiven . W. Hallet et B. Neumann (dirs.). Raum
und Bewegung in der Literatur. Die Literaturwissenschaften und der Spatial Turn. Bielefeld : Transcript
Verlag. 33-52.
Pavel, T. G. 1986. Fictional Worlds. Cambridge, Mass.; London, England : Harvard University Press.
Piatti, B. 2008. Die Geographie der Literatur: Schaupltze, Handlungsrume, Raumphantasien. Gttingen :
Wallstein Verlag.
Piatti, B. 2012. Mit Karten lesen. Pldoyer fr eine visualisierte Geographie der Literatur . B.
Boothe, P. Bhler, et. al. (dirs.): Textwelt-Lebenswelt. Interpretation Interdisziplinr. Tome 10.
Wrzburg : Knigshausen & Neumann. 261-288.
Posthumus, S. 2011. Vers une cocritique franaise : le contrat naturel de Michel Serres . Mosaic :
A Journal for the interdisciplinary study of literature, vol. 44, no2, Winnipeg, 85-100.
Prieto, E. 2011. Geocriticism, Geopoetics, Geophilosophy, and Beyond . R. T. Tally. (dir.). Geocritical Explorations : Space, Place, and Mapping in Literary and Cultural Studies. New York : Palgrave MacMillan. 13-28.
27
Arborescences
Antje Ziethen
Ryan, M.-L. 2003. Narrative Cartography: Toward a Visual Narratology . T. Kindt et H.-H. Mller (dirs.). What is Narratology ? Questions and Answers Regarding the Status of a Theory. Berlin ; New
York : Walter de Gruyter. 333-364.
Ryan, M.-L. 2009. Space . Handbook of Narratology. P. Hhn, J. Pier, W. Schmid et J. Schnert
(dirs.). Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 420-433. (en ligne: http://www.lhn.unihamburg.de/article/space, consult le 12 mai 2013).
Ryan, M.-L.. 2012. Possible Worlds . P. Hhn, J. Pier, W. Schmid et J. Schnert (dirs.). The Living
Handbook of Narratology. (en ligne : http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/possible-worlds,
consult le 12 mai 2013).
Smitten, J. 1981. Introduction : Spatial Form and Narrative Theory . J. Smitten et A. Daghistany
(dirs.). Spatial Form in Narrative. Ithaca : Cornell University Press. 15-34.
Soja, E.W. 189. Postmodern Geographies. A Reassertion of Space in Critical Social Theory. London ; New
York : Verso.
Soja, E.W. 1996. Thirdspace : Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places. Cambridge,
Mass. : Blackwell.
Soja, E.W. 2000. Postmetropolis. Critical Studies of Cities and Regions. Oxford, UK ; Malden, Moyen ge :
Blackwell Publishers.
Spain, D. 1992. Gendered Spaces. Chapel Hill : University of North Carolina Press.
Stierle, K. 2001. La Capitale des signes. Paris et son discours. Paris : ditions de la Maison des sciences de
lhomme.
Suberchicot, A. 2012. Littrature et environnement. Pour une cocritique compare. Paris : Honor Champion.
Tally, R.T. 1996. Jamesons Project of Cognitive Mapping : A Critical Engagement . R.G.
Paulston (dir.). Social Cartography : Mapping Ways of Seeing Social and Educational Change. New
York : Garland, 1996. 399-416.
Tally, R.T. (dir.) 2011. Geocritical Explorations. Space, Place, and Mapping in Literary and Cultural Studies.
New York : Palgrave MacMillan.
Tally, R.T. 2013. Spatiality. London, New York : Routledge.
Tiffin, H. et G. Huggan. (dirs.) 2010. Postcolonial Ecocriticism. Literature, Animals, Environement. New
York : Routledge.
Tuan, Y. 1978. Literature and Geography : Implications for Geographical Research . D. Ley et
M.W. Samuels (dirs). Humanistic Geography. Prospects and Problems. Chicago : Maaroufa Press.
194-206.
Warf, B. et S. Arias. 2009. Introduction : The Reinsertion of Space into the Social Sciences and
Humanities . B. Warf et S. Arias (dirs.). The Spatial Turn : Interdisciplinary Perspectives. London :
Routledge. 1-10.
Weisgerber, J. 1978. LEspace romanesque. Lausanne : Lge dhomme.
Westling, L. 2006. Literature, the Environment, and the Question of the Post-human .
C. Gersdorf et S. Mayer (dirs.). Nature in Literary and Cultural Studies. Transatlantic Conversations
on Ecocriticism. Amsterdam; New York : Rodopi. 25-47.
28
Arborescences
Antje Ziethen
Westphal, B. 2000. Pour une approche gocritique des textes. Esquisse . B. Westphal (dir.). La
Gocritique mode d'emploi. Limoges : Presses universitaires de Limoges. 9-39.
Westphal, B. 2007. La Gocritique : rel, fiction, espace. Paris: Minuit.
White, K. 1987. Le Pote cosmographe: vers un nouvel espace culturel : entretiens, 1976-1986. Bordeaux :
Presses Universitaires de Bordeaux.
White, K. 1994. Le Plateau de l'Albatros. Introduction la gopotique. Paris : Grasset.
White, K. 2008. La gopolitique . Kenneth White. www.kennethwhite.org.
Zapf, H. 2006a. Literature and Ecology : Introductory Remarks on a New Paradigm of Literary
Studies . Anglia - Zeitschrift fr englische Philologie, vol 124, no1, Berlin, 110.
Zapf, H. 2006b. The State of Ecocriticism and the Function of Literature as cultural ecology .
C. Gersdorf et S. Mayer (dirs.). Nature in Literary and Cultural Studies. Transatlantic Conversations
on Ecocriticism. Amsterdam; New York : Rodopi. 49-69.
Ziethen, A. 2013. Go/Graphies postcoloniales. La potique de lespace dans le roman mauricien et sngalais.
Trier : WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier.
29
Vous aimerez peut-être aussi
- Modèle Projet ProfessionnelDocument3 pagesModèle Projet ProfessionnelVero Vera95% (37)
- Modèle Projet ProfessionnelDocument3 pagesModèle Projet ProfessionnelVero Vera95% (37)
- Reel Irreel Chez PerecDocument51 pagesReel Irreel Chez PerecAnonymous saZrl4OBl4Pas encore d'évaluation
- Historique Du Concept D'intertextualitéDocument46 pagesHistorique Du Concept D'intertextualitéboukhemis manel100% (1)
- Espèces D'espaces - Georges Perec - Galilée - 1992Document70 pagesEspèces D'espaces - Georges Perec - Galilée - 1992Noara Quintana96% (26)
- Henri Michaux La Philosophie Tirée Par Les CheveuxDocument17 pagesHenri Michaux La Philosophie Tirée Par Les CheveuxJack PattersonPas encore d'évaluation
- Marie-Hélène Brousse La GuerreDocument9 pagesMarie-Hélène Brousse La Guerrehadar_poratPas encore d'évaluation
- Lire dans la nuit et autres essais: Pour Jacques DerridaD'EverandLire dans la nuit et autres essais: Pour Jacques DerridaPas encore d'évaluation
- Dehors, Chaos Et Matières Intensives Dans La Philosophie de Gilles Deleuze - Mengue, Philippe PDFDocument25 pagesDehors, Chaos Et Matières Intensives Dans La Philosophie de Gilles Deleuze - Mengue, Philippe PDFJulius1982Pas encore d'évaluation
- Cf36 La Pensee Ecologique Et Lespace Litteraire CompletDocument185 pagesCf36 La Pensee Ecologique Et Lespace Litteraire CompletStéciePas encore d'évaluation
- La Vie LittéraireDocument721 pagesLa Vie LittérairebleitesPas encore d'évaluation
- Aby Warburg - Production Symbolique PDFDocument16 pagesAby Warburg - Production Symbolique PDFMuro CasteloPas encore d'évaluation
- L'inframince en 5 MinutesDocument2 pagesL'inframince en 5 MinutesMarc VayerPas encore d'évaluation
- Maurice Blanchot Et Michel Foucault: Hétérotopies Par Manola AntonioliDocument22 pagesMaurice Blanchot Et Michel Foucault: Hétérotopies Par Manola AntonioliVero Vera100% (1)
- La Porosité Au Monde. L'écriture de L'intime Chez Louise Warren Et Paul ChamberlandDocument350 pagesLa Porosité Au Monde. L'écriture de L'intime Chez Louise Warren Et Paul ChamberlandjcbazinetPas encore d'évaluation
- Au Croisement de Maurice Blanchot Et de Francis PongeDocument12 pagesAu Croisement de Maurice Blanchot Et de Francis PongeCrisisDeLaPresenciaPas encore d'évaluation
- Jean-Luc Steinmetz - La Littérature Fantastique-JerichoDocument104 pagesJean-Luc Steinmetz - La Littérature Fantastique-JerichoBenhani Said100% (1)
- LAPPRAND M (2020) Pourquoi L'oulipoDocument177 pagesLAPPRAND M (2020) Pourquoi L'oulipoAlexandre GuimarãesPas encore d'évaluation
- 05 - Corps Pornocratique - Emotions.Document40 pages05 - Corps Pornocratique - Emotions.Aurélien MarionPas encore d'évaluation
- La Critique HistoriqueDocument3 pagesLa Critique HistoriqueHassan ElhassanPas encore d'évaluation
- L'espace Des MotsDocument41 pagesL'espace Des MotseurostijlPas encore d'évaluation
- Critiques Dans Un Souterrain - Rene GirardDocument139 pagesCritiques Dans Un Souterrain - Rene GirardCarlosPas encore d'évaluation
- Jean-Luc Nancy L Intrus Selon Claire DenisDocument8 pagesJean-Luc Nancy L Intrus Selon Claire DenisrhaissampPas encore d'évaluation
- Beckett & MélancolieDocument9 pagesBeckett & MélancolienanaquiPas encore d'évaluation
- Les Impasses de l'Art moderne: Langage et crise du sensD'EverandLes Impasses de l'Art moderne: Langage et crise du sensPas encore d'évaluation
- Martin Mees - Nerval, Une Poétique "Magnétique". Substrats Philosophiques D'une Écriture RomantiqueDocument17 pagesMartin Mees - Nerval, Une Poétique "Magnétique". Substrats Philosophiques D'une Écriture RomantiqueMartin M.Pas encore d'évaluation
- Stévance. Duchamp, Compositeur PDFDocument295 pagesStévance. Duchamp, Compositeur PDFLorenaPas encore d'évaluation
- GéocritiqueDocument4 pagesGéocritiqueminawsPas encore d'évaluation
- Poétique d'Aristote: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandPoétique d'Aristote: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- La Géocritique Selon Westphal (Note de Lecture)Document6 pagesLa Géocritique Selon Westphal (Note de Lecture)houcine720% (1)
- Les Ecrits de Jean Starobinski PDFDocument44 pagesLes Ecrits de Jean Starobinski PDFSoledad RodriguezPas encore d'évaluation
- Dear Ed ActionDocument110 pagesDear Ed ActionGabriela DincaPas encore d'évaluation
- Blanchot Lecteur de Lautréamont: L'activité Du Texte Et La Passion de La ConscienceDocument7 pagesBlanchot Lecteur de Lautréamont: L'activité Du Texte Et La Passion de La ConsciencePierrePachetPas encore d'évaluation
- Critica - L'Image Ouverte. Motifs de L'incarnation Dans Les Arts VisuelsDocument3 pagesCritica - L'Image Ouverte. Motifs de L'incarnation Dans Les Arts VisuelscodillosPas encore d'évaluation
- Mythe Et RhétoriqueDocument280 pagesMythe Et RhétoriqueChems al HanifPas encore d'évaluation
- Analyse Des Mythologiques de Claude Lévi-StraussDocument26 pagesAnalyse Des Mythologiques de Claude Lévi-StraussLycophronPas encore d'évaluation
- Bachelard Et Le VinDocument12 pagesBachelard Et Le VinGabriel Kafure da RochaPas encore d'évaluation
- Le Liban Comme MétaphoreDocument34 pagesLe Liban Comme MétaphoreNafissMesnaouiPas encore d'évaluation
- La Profondeur Et L'éclatement de L'imageDocument142 pagesLa Profondeur Et L'éclatement de L'imageGeraldo G. BrandãoPas encore d'évaluation
- Sur Michaux Et Whitehead, L'infini Turbulent Et Le Swing CosmiqueDocument3 pagesSur Michaux Et Whitehead, L'infini Turbulent Et Le Swing Cosmiqueze_n6574Pas encore d'évaluation
- Aristote, Le DiaphaneDocument3 pagesAristote, Le DiaphaneAlbertinePas encore d'évaluation
- Pierre Missac - Aphorisme Et Paragramme PDFDocument7 pagesPierre Missac - Aphorisme Et Paragramme PDFMark CohenPas encore d'évaluation
- La Case Blanche: Théorie Littéraire Et Textes PossiblesDocument278 pagesLa Case Blanche: Théorie Littéraire Et Textes Possiblesvdb59100% (2)
- Scubla - A Propos de La Formule Canonique, Du Mythe, Et Du RiteDocument11 pagesScubla - A Propos de La Formule Canonique, Du Mythe, Et Du RiteMaurizio GallinaPas encore d'évaluation
- Bachelard - Main 2Document122 pagesBachelard - Main 2Foad WMPas encore d'évaluation
- ALLOA Merleau-Ponty, Tout Un RomanDocument3 pagesALLOA Merleau-Ponty, Tout Un Romanemeliebonnet100% (1)
- Mengue - Deleuze Et La Question de La Vérité en LittératureDocument19 pagesMengue - Deleuze Et La Question de La Vérité en LittératureAndré Paes LemePas encore d'évaluation
- Le Marteau de Michel-Ange (Y. Hersant)Document12 pagesLe Marteau de Michel-Ange (Y. Hersant)rgqesgegePas encore d'évaluation
- Beckett Et La PhilosophieDocument17 pagesBeckett Et La Philosophieeduardo_mondragon_3Pas encore d'évaluation
- VI - Usages Et Variations (249-376) PDFDocument128 pagesVI - Usages Et Variations (249-376) PDFgfyourslfPas encore d'évaluation
- La Dissertation Explicative - DevDocument3 pagesLa Dissertation Explicative - DevÉdouard DiakePas encore d'évaluation
- Le Sens Du Poetique. Approche PhenomenologiqueDocument33 pagesLe Sens Du Poetique. Approche PhenomenologiqueJérémie LeloupPas encore d'évaluation
- Bergson - Le Rêve (L'energie Spirituelle)Document13 pagesBergson - Le Rêve (L'energie Spirituelle)kairoticPas encore d'évaluation
- E.verhagen, La Photographie ConceptuelleDocument3 pagesE.verhagen, La Photographie ConceptuelleTérence PiquePas encore d'évaluation
- La Double Nature de L'image D'auteur PDFDocument16 pagesLa Double Nature de L'image D'auteur PDFllerenas100% (1)
- Milner - Les Paradoxes Du SolitaireDocument10 pagesMilner - Les Paradoxes Du Solitaireoutof_spacePas encore d'évaluation
- Les Ecrits de Jean Starobinski PDFDocument44 pagesLes Ecrits de Jean Starobinski PDFSoledad RodriguezPas encore d'évaluation
- L'Imaginaire, Le Symbolique Et Le Réel Dans L'imagepdfDocument35 pagesL'Imaginaire, Le Symbolique Et Le Réel Dans L'imagepdfPépé HuguesPas encore d'évaluation
- Ce Que Parler Veut DireDocument198 pagesCe Que Parler Veut DireukubatchPas encore d'évaluation
- Narrateur Et Interpretation Des Termes Deictiques Dans Recit de FictionDocument17 pagesNarrateur Et Interpretation Des Termes Deictiques Dans Recit de FictionIdir MazighPas encore d'évaluation
- Revue Formules, Revue Des Littératures À Contraintes #5 Pastiches Collages Et Autres ReecrituresDocument304 pagesRevue Formules, Revue Des Littératures À Contraintes #5 Pastiches Collages Et Autres ReecrituresSCHIAVETTA Angel BernardoPas encore d'évaluation
- Les Écrivains devant l'impressionnisme de Denys Riout: Les Fiches de Lecture d'UniversalisD'EverandLes Écrivains devant l'impressionnisme de Denys Riout: Les Fiches de Lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Scan - Bernabei - 2023 12 07 15 35 11Document1 pageScan - Bernabei - 2023 12 07 15 35 11Vero VeraPas encore d'évaluation
- MAYORGA. Pensando en Iberia - Los Debates en Torno A La Unificación Hispano-Portuguesa en El Exilio Republicano en MéxicoDocument12 pagesMAYORGA. Pensando en Iberia - Los Debates en Torno A La Unificación Hispano-Portuguesa en El Exilio Republicano en MéxicoVero VeraPas encore d'évaluation
- Le Spatial Turn en Littérature. Changement de Paradigme Et TransdisciplinaritéDocument13 pagesLe Spatial Turn en Littérature. Changement de Paradigme Et TransdisciplinaritéVero VeraPas encore d'évaluation
- Lacan Regard TableauDocument17 pagesLacan Regard TableauVero VeraPas encore d'évaluation
- Espace Moderne - Merleau-Pnty Et PanofskyDocument26 pagesEspace Moderne - Merleau-Pnty Et PanofskyAnonymous Ko9TtBC4Pas encore d'évaluation