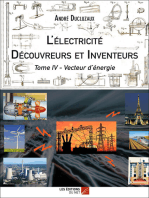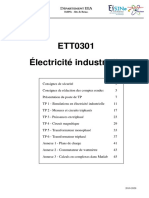Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Machine Asynchrone
Transféré par
jaweherCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Machine Asynchrone
Transféré par
jaweherDroits d'auteur :
Formats disponibles
Sp gnie lectrique
ATS Machine asynchrone
MACHINE ASYNCHRONE
Le moteur asynchrone est, de beaucoup, le moteur le plus utilis dans lensemble des applications
industrielles, du fait de son faible cout, de son faible encombrement, de son bon rendement et de son
excellente fiabilit.
Son seul point noir est lnergie ractive, toujours consomme pour magntiser lentrefer. Les machines
triphases, alimentes directement sur le rseau, reprsentent la grande majorit des applications ;
supplantant les machines monophases aux performances bien moindres et au couple de dmarrage nul sans
artifice.
Autrefois, sa mise en uvre (dmarrage et variation de vitesse) se rvlait compliqu mais tout cela s'est
rsolu grce aux progrs de l'lectronique de puissance. La consquence de ce dveloppement de
l'lectronique de commande fait que le moteur asynchrone est maintenant utilis dans des domaines trs
varis :
- Transport (TGV est , tramways)
- Industrie
- Production d'nergie (olienne)
- .
1. RAPPEL DES NOTIONS DE TRIPHASE
2
Une alimentation triphase est constitue de 3 tensions identiques dcales d'un angle 3
.
e1 = E sin(wt), e2 = E sin(wt-2/3), e3 = E sin(wt+2/3).
Pour dlivrer cette nergie, on a besoin de 3 cbles correspondants chacune des tensions (appeles phases)
et ventuellement d'un autre cble (le neutre) permettant le retour du courant lorsque les courants ne sont
pas quilibrs. (i1+i2+i30)
L1
V1
L2 U13 M
L3 3
On peut alors trouver deux types de tension :
- tension simple : tension entre phase et neutre, note gnralement V : ex V1
- tension compose : tension entre 2 phases, note U : ex U13=V1-V3
Dans un rseau quilibr, la relation en valeurs efficaces entre les deux types de tension est : U=3. V
En France, le rseau triphas distribu par EDF est un rseau 230/400 V.
En rgime sinusodal quilibr, on peut calculer les puissances lectriques par les formules suivantes :
Puissance active en W : P=3.V.I.cos = 3.U.I.cos
Puissance ractive en Var : Q=3.V.I.sin = 3.U.I.sin
Puissance apparente en VA : S=3.V.I=3.U.I
Lyce P. Mends France Epinal
Cours machine asynchrone 1
Sp gnie lectrique
ATS Machine asynchrone
2. CONSTITUTION
La machine asynchrone est constitue de deux lments principaux : (cf diaporama)
Le stator : constitu de trois enroulements (bobines) parcourus par des courants alternatifs triphass et
possde p paires de ples ("nombre de bobinage triphas au sein dans le stator")
Le rotor : Partie tournante du moteur. Le rotor peut tre constitu par un bobinage triphas, mais, le plus
souvent, Il est constitu dune masse mtallique dont de laluminium pour lallger. On parle alors de rotor
cage dcureuil.
Bote bornes
Bobinage stator
Ailette de
refroidissement
Ventilateur
Plaque signaltique
Rotor en cage
d'cureuil Arbre
3. COUPLAGE DU STATOR
Rq : Le stator peut tre aliment selon deux couplages : toile ou triangle. La tension aux
bornes des enroulements (bobinages) ne sera pas la mme suivant le couplage.
Couplage toile :
Le schma de raccordement est donn ci-contre :
Dans ces conditions, l'enroulement voit ses bornes la tension
simple du rseau.
Exemple : sur le rseau EDF classique 230/400, un moteur coupl
en toile aurait une tension sur chaque bobinage du stator de
230V.
Lyce P. Mends France Epinal
Cours machine asynchrone 2
Sp gnie lectrique
ATS Machine asynchrone
Couplage triangle :
Le schma de raccordement est donn ci-contre :
Dans ces conditions, l'enroulement voit ses bornes la tension compose du rseau.
Exemple : sur le rseau EDF classique 230/400, un moteur coupl en toile aurait
une tension sur chaque bobinage du stator de 400V.
Les plaques signaltiques des Moteurs asynchrone indiquent quel couplage raliser
en fonction de la tension compose du rseau, puis les grandeurs nominales du
moteur pour le couplage considr.
On trouve ce type d'indication :
4. PRINCIPE (POUR LES MAS A CAGE D'ECUREUIL)
Les courants alternatifs dans les bobinages du stator vont crer dans l'entrefer (espace entre rotor et stator)
un champ magntique tournant la vitesse :
-1
w S : pulsation de synchronisme du champ tournant en rad.s .
s -1
w : pulsation des courants alternatifs en rad.s . = 2..f
p
p : nombre de paires de ples.
Le champ tournant balaie les bobinages rotoriques et va crer des courants induits dans le rotor en court-
circuit (loi de Lenz). Ces courants (de pulsation g.w) vont eux mme entrainer un champ magntique qui va
s'opposer aux causes qui lui ont donn naissance. L'interaction de ces deux champs magntiques va alors
crer un couple qui va entrainer le rotor en rotation.
Le rotor tourne la vitesse n plus petite que la vitesse de synchronisme ns. On dit que le rotor glisse par
rapport au champ tournant. On introduit alors une variable caractrisant la vitesse de rotation du rotor.
Ce glissement g va dpendre de la charge.
-1
n n s Ns : vitesse de rotation de synchronisme du champ tournant (tr.s ).
g s -1
N : vitesse de rotation du rotor (tr.s ).
ns s -1
S = 2nS (rad.s ) et
-1
= 2n (rad.s )
w
De la relation prcdente, on peut aussi tirer l'expression : = (1 g) S = (1 g) p
Lyce P. Mends France Epinal
Cours machine asynchrone 3
Sp gnie lectrique
ATS Machine asynchrone
5. MODELISATION
En fonctionnement triphas quilibr, la machine asynchrone peut tre modlise comme un transformateur
triphas, dont le secondaire aurait une pulsation g.w
Moyennant quelques approximations (en ngligeant notamment les pertes joules au stator), on peut donner
un modle monophas de la machine asynchrone dans lequel tout est ramen au stator.
1 = . 1 avec
m rapport de
transformation rotor/stator : m=V20/V1
R2 reprsente les pertes joules du rotor ramenes au stator
Rpf reprsente les pertes fers au stator
Lm : inductance magntisante (magntisation de la carcasse mtallique du moteur et de l'entrefer)
X2 reprsente les flux de fuite.
1
R
2
est une rsistance fictive. La puissance consomme par cette rsistance reprsente la puissance
lectrique transforme en puissance mcanique.
Ce schma n'est qu'un modle. La plupart de ces lments n'ont pas d'existence physique.
6. BILAN DES PUISSANCES
Les pertes dans la machine asynchrone sont dues aux :
- pertes joules stator : PJS=3.R1.J1 ( voir ce que vaut J en fonction du couplage)
2
- pertes fer : (hystrsis et courant de Foucault): Pf 3 1
- pertes joules rotor : PJS=3.R2.I2 Rq : on a galement la relation PJR=g.PTr avec PTr puissance
2 2
transmise au rotor PTr = 3
1
- pertes mcaniques Pm
Lyce P. Mends France Epinal
Cours machine asynchrone 4
Sp gnie lectrique
ATS Machine asynchrone
7. COUPLE ELECTROMAGNETIQUE
On peut, partir du schma quivalent, calculer l'expression de la puissance mcanique moteur puis en
dduire le couple moteur.
Ptr= . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .( 3 : car 3 phases gales dans le moteur) or 1 = . . . . . .
donc : Ptr= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . .
2 2
3. 3..
On en tire : = 2 = 2
(2 )2 +( 2 )
(2 )2 +( 2 )
3. 1
Soit = .2
2 . + 2
2 .2
On peut connaitre le maximum de couple que peut fournir le moteur d'aprs l'expression de Cm en rsolvant
l'quation
= 0.
3.
En rsolvant l'quation, on trouve que ce maximum de couple est obtenu pour gmax= 2 Cmax= =
2 2.2 .
3. 3.
= 2.
2.2 .. 2 .
2Cmax
On peut alors crire le couple sous la forme : =
+
On peut alors tracer l'volution du couple en fonction du glissement ou de la vitesse rotor :
zone linaire
couple de
dmarrage
zone instable
hypersynchrone zone linaire
On constate sur ces courbes qu'il y a une zone (lorsque le glissement est faible, prs de la vitesse de
synchronisme) o le couple est linaire par rapport la vitesse. Cette zone correspond au point de
fonctionnement nominal du moteur.
Lyce P. Mends France Epinal
Cours machine asynchrone 5
Sp gnie lectrique
ATS Machine asynchrone
Le couple de dmarrage s'obtient en prenant g=1. La zone g>gmax est instable, ces points ne sont parcourus
qu'en rgime transitoire.
Lorsque g<0, le rotor tourne une vitesse suprieure la vitesse de synchronisme. On est alors en
fonctionnement hypersynchrone. La machine asynchrone fonctionne en gnrateur (mode de
fonctionnement des oliennes).
8. POINT DE FONCTIONNEMENT DU MOTEUR
On va ici tudier comment trouver le point de fonctionnement du moteur (c'est dire le couple fourni et la
vitesse de rotation) lorsque l'on accouple le moteur une charge mcanique.
Deux mthodes de dtermination sont possibles :
a) par le calcul
Le couple de la charge mcanique peut s'exprimer en fonction de la vitesse de rotation.
Ex : Si le moteur est destin entrainer un ventilateur, le couple de charge du ventilateur est proportionnel
au carr de la vitesse. On a Cr=k.N
Pour obtenir la vitesse de fonctionnement, il suffit alors d'crire l'galit entre le couple fourni par le moteur
et le couple de charge, puis on rsout l'quation : Cu= Cr , qui devient Cem=Cr si le couple de perte est nglig
(pertes mcaniques).
Rq : le couple moteur est souvent exprim en fonction du glissement, pour pouvoir rsoudre l'quation, il
faut donc exprimer la vitesse de rotation en fonction de g :
N= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L'galit en rgime permanent du couple moteur et du couple de charge donne la relation :
2
3.
2
= . ( . )2 on obtient g, puis on en dduit C et .
(2 )2 +( 2 )
b) graphiquement
On obtenir directement C et en traant sur le mme
graphe la caractristique Cu=f() et Cr= f(). Souvent, on
nglige le couple de perte (pertes mcaniques), on a alors
Cu=Cem.
Exemple : Pour une application de pompage le couple est
proportionnel la vitesse Cr=kN. On obtient alors le
trac suivant :
Le point de fonctionnement est alors obtenu par
l'intersection des deux courbes. On lit donc
graphiquement la valeur de la vitesse et du couple.
Lyce P. Mends France Epinal
Cours machine asynchrone 6
Sp gnie lectrique
ATS Machine asynchrone
Exemple de charges : sec, visqueux...
Machine puissance Machine couple
constante (enrouleuse, constant (levage,
compresseur, essoreuse) pompe)
Machine couple Machine couple
proportionnel la vitesse proportionnel au carr
(pompe volumtrique, de la vitesse
mlangeur) (ventilateur)
9. DEMARRAGE ET VARIATION DE VITESSE
Lors du dmarrage d'une machine asynchrone on constate un pic de courant entre 4 et 8 fois le
courant nominal. Pour remdier ce problme, plusieurs mthodes sont employes :
- dmarrage toile-triangle (les bobinages de la machine vont tre soumis dans un premier
temps une tension rduite, tension nominale/3, puis la tension nominale)
- ajout d'une rsistance au stator
- augmentation progressive de la tension grce un auto-transformateur ou un gradateur
Dans les applications ncessitant une variation de
vitesse, on utilise un onduleur (cf cours onduleur).
L'onduleur est un montage lectronique permettant
de crer un systme de tensions triphases dont on
peut rgler la fois, la frquence et l'amplitude.
Les industriels proposent des variateurs intgrant un
pont de diode intgrant la gnration de tension
continue et l'onduleur permettant la cration de
rseau triphas variable en amplitude et en frquence.
Pour que l'on soit dans la plage de fonctionnement nominal du
moteur, il faut conserver g0. Le seul moyen de faire varier la
vitesse est alors de modifier la vitesse de synchronisme
2
= =
Mais pour ne pas modifier la valeur du couple en fonction de la
vitesse, on va fonctionner avec un rapport constant.
3 2 1
(Rappel : Cem= ( ) .2 , donc si est constant,
2 + 2
2 .2
le couple max ne change pas.)
Lyce P. Mends France Epinal
Cours machine asynchrone 7
Vous aimerez peut-être aussi
- L'Électricité - Découvreurs et Inventeurs: Tome IVD'EverandL'Électricité - Découvreurs et Inventeurs: Tome IVÉvaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (2)
- Exercices d'optique et d'électromagnétismeD'EverandExercices d'optique et d'électromagnétismeÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Cours - Mas Mon ResumeDocument39 pagesCours - Mas Mon ResumeAZIZ81936Pas encore d'évaluation
- Chapitre 2-1Document10 pagesChapitre 2-1Oussama JaafariPas encore d'évaluation
- Machine AsynchroneDocument16 pagesMachine AsynchroneEr-Rhahmani MedPas encore d'évaluation
- Cours Machines AsynchronesDocument53 pagesCours Machines Asynchronesminoungou constantPas encore d'évaluation
- Machine AsynchroneDocument7 pagesMachine AsynchroneFatma Borgi Ep SaadaouiPas encore d'évaluation
- TP Machine AsynchroneDocument5 pagesTP Machine AsynchroneMohammed Reda GailaPas encore d'évaluation
- Cours Commande CH 1 2 3 ToDocument32 pagesCours Commande CH 1 2 3 ToZaki ZakariaPas encore d'évaluation
- TP n03 Moteur A Courant Continu Elm s5!20!21 1Document3 pagesTP n03 Moteur A Courant Continu Elm s5!20!21 1Ondjy Manchiny ValmirPas encore d'évaluation
- Sae Cours Bokovi PDFDocument74 pagesSae Cours Bokovi PDFPALOUKI100% (2)
- Simulation Des Machines À Courant Continu Dans L PDFDocument10 pagesSimulation Des Machines À Courant Continu Dans L PDFKa AissaPas encore d'évaluation
- Machines SynchronesDocument16 pagesMachines SynchronesAyoub AkoucharPas encore d'évaluation
- TP3 VCS AcDocument6 pagesTP3 VCS AcKaneki KenPas encore d'évaluation
- Exam Machine ElectriqueDocument4 pagesExam Machine ElectriqueAYMEN BOUJEMELPas encore d'évaluation
- Mande de MAS-1Document8 pagesMande de MAS-1Hakim Madrid100% (1)
- Memoire FinaleDocument110 pagesMemoire FinaleBouchakour Salim86% (7)
- TP Commande D'une Machine À Courant Continu1Document9 pagesTP Commande D'une Machine À Courant Continu1OkbaPas encore d'évaluation
- Moteur BrushlessDocument17 pagesMoteur BrushlessChouaib WaidPas encore d'évaluation
- TP Machine 02 Et 01Document12 pagesTP Machine 02 Et 01Îslãm MïmøPas encore d'évaluation
- TP 1Document7 pagesTP 1Toufike ElallamPas encore d'évaluation
- Electrotechnique 2 GET - Chap III - Machine SynchroneDocument13 pagesElectrotechnique 2 GET - Chap III - Machine Synchronerajaa latifiPas encore d'évaluation
- TP MasDocument16 pagesTP MasMajected92100% (1)
- Moteur Synchrone AutopiloteDocument6 pagesMoteur Synchrone AutopilotebberrehailPas encore d'évaluation
- Chapitre 4 MAS G15Document29 pagesChapitre 4 MAS G15Coumba Laobė NdiayePas encore d'évaluation
- Ett0301 - TPDocument45 pagesEtt0301 - TPMohamed Amine100% (1)
- TP3 - Master-CE - S2 - Techniques de La Commande ÉlectriqueDocument7 pagesTP3 - Master-CE - S2 - Techniques de La Commande Électriqueabd elhamid mabroukPas encore d'évaluation
- Note de Cours Commande de MachineDocument43 pagesNote de Cours Commande de MachineBahriPas encore d'évaluation
- TD4 2021Document3 pagesTD4 2021Abdou ElakPas encore d'évaluation
- Demarreur Progressif Gradateur Angle de Phase PDFDocument3 pagesDemarreur Progressif Gradateur Angle de Phase PDFHous SamPas encore d'évaluation
- Moteur SynchroneDocument11 pagesMoteur SynchroneAhmed MidoPas encore d'évaluation
- TP1 4eme Altern Synch Electro - CDocument3 pagesTP1 4eme Altern Synch Electro - CilyPas encore d'évaluation
- Présentation de La MCCDocument11 pagesPrésentation de La MCCOmarPas encore d'évaluation
- Commande DTC Cinq Niveaux À 24 Secteurs D'un Moteur Asynchrone Par Méthodes IntelligentesDocument9 pagesCommande DTC Cinq Niveaux À 24 Secteurs D'un Moteur Asynchrone Par Méthodes IntelligentesbenbouhenniPas encore d'évaluation
- Chap 4 Machine SynchroneDocument20 pagesChap 4 Machine Synchroneali hadjiPas encore d'évaluation
- Chapitre3 Technique de La Commande ÉlectriqueDocument11 pagesChapitre3 Technique de La Commande Électriqueاشر اقPas encore d'évaluation
- Variateur de VitesseDocument10 pagesVariateur de VitesseKossayEssidPas encore d'évaluation
- Tp1 PDFDocument4 pagesTp1 PDFMohamed amirPas encore d'évaluation
- TD Machine AsynchroneDocument2 pagesTD Machine AsynchronezakariaPas encore d'évaluation
- BROCHURE MACHINE 4ème EMDocument58 pagesBROCHURE MACHINE 4ème EMSalif diakité100% (1)
- Examen 2015 L3 FinalDocument2 pagesExamen 2015 L3 FinaljobPas encore d'évaluation
- Examen Variation de Vitesse - 2022Document12 pagesExamen Variation de Vitesse - 2022MOURAD EL MENDILIPas encore d'évaluation
- 4.1. Convertisseur1Document23 pages4.1. Convertisseur1Omar BarmakiPas encore d'évaluation
- Modélisation Machine AsynchroneDocument5 pagesModélisation Machine AsynchroneMohammed Reda GailaPas encore d'évaluation
- Theoreme de FerarriDocument4 pagesTheoreme de FerarriKamita Medias100% (1)
- Travaux Pratiques Commande MAS Commande PDFDocument31 pagesTravaux Pratiques Commande MAS Commande PDFLEBONGOPas encore d'évaluation
- Variateur de VitesseDocument10 pagesVariateur de Vitesseyouri59490100% (1)
- TP MCCDocument14 pagesTP MCCMohamed BenalyPas encore d'évaluation
- Machine À Courant ContinuDocument6 pagesMachine À Courant ContinuAli_Ghom_9843100% (1)
- Exercices MCCDocument4 pagesExercices MCCEl Idrissi Hajar0% (1)
- Le Registre de Configuration Et Le WatchDogDocument2 pagesLe Registre de Configuration Et Le WatchDogashraf hmidaniPas encore d'évaluation
- TD Avec Solution MASDocument79 pagesTD Avec Solution MASOűłď Ællēm MöĥãmëdPas encore d'évaluation
- TD3 Machine Asynchrone BISDocument2 pagesTD3 Machine Asynchrone BISnawzat100% (1)
- MCC DétailléDocument13 pagesMCC Détailléoumaima arbiPas encore d'évaluation
- TP01 MCCDocument4 pagesTP01 MCCazeraqwPas encore d'évaluation
- Exercices Moteur AsynchroneDocument17 pagesExercices Moteur AsynchroneismailPas encore d'évaluation
- Rapport Alternateur TriphaseDocument9 pagesRapport Alternateur TriphaseSami ZakhnoufPas encore d'évaluation
- TD OnduleursDocument3 pagesTD OnduleursFatima EzzahraPas encore d'évaluation
- Commande Des MachineDocument130 pagesCommande Des Machinearbaoui11Pas encore d'évaluation
- Respuestas Al Examen de ATC A y BDocument2 pagesRespuestas Al Examen de ATC A y BSilvia Ribes CatalaPas encore d'évaluation
- Piscca2023-Termes de ReferenceDocument6 pagesPiscca2023-Termes de ReferenceLucien RutashaPas encore d'évaluation
- Edt SMP 1 PDFDocument3 pagesEdt SMP 1 PDFismail elaameryPas encore d'évaluation
- Catalogue Formation NexcomDocument52 pagesCatalogue Formation NexcomCastro FidèlePas encore d'évaluation
- L2 Architecture DordinateurDocument5 pagesL2 Architecture DordinateurMichel MusasaPas encore d'évaluation
- Au Bord de L'eau by MaupassantDocument7 pagesAu Bord de L'eau by MaupassantCarmelita RolandezPas encore d'évaluation
- Livre de La Vache Du CielDocument2 pagesLivre de La Vache Du CielBabacar Latgrand DioufPas encore d'évaluation
- Les SauvegardesDocument8 pagesLes SauvegardesInsaf AchourPas encore d'évaluation
- Code Des Douanes - MarocDocument88 pagesCode Des Douanes - MarocbvbarcPas encore d'évaluation
- Coordonnateurs: PhilippeDocument10 pagesCoordonnateurs: Philippemansouri noureddinePas encore d'évaluation
- TD 1 Glucides 23-24Document1 pageTD 1 Glucides 23-24evrard.kinnenonPas encore d'évaluation
- 6 NotationDocument4 pages6 NotationrayamPas encore d'évaluation
- Grand Oral SesDocument2 pagesGrand Oral Sesapi-657069168Pas encore d'évaluation
- Carte Du Bénin: Informations Pratiques Et PrésenDocument11 pagesCarte Du Bénin: Informations Pratiques Et PrésenFerekou DouarouPas encore d'évaluation
- Poly Proba Stat V2Document32 pagesPoly Proba Stat V2Med MouzounPas encore d'évaluation
- Manuel Street Triple RSDocument248 pagesManuel Street Triple RSfranck.massolPas encore d'évaluation
- Différences Essentielles Des Puits ZDocument16 pagesDifférences Essentielles Des Puits ZSlim.BPas encore d'évaluation
- Service Redal FRDocument15 pagesService Redal FRRachid mhajiPas encore d'évaluation
- Saltoetcompagnie - MHM .ProgrammationzonecDocument5 pagesSaltoetcompagnie - MHM .ProgrammationzonecsoizigPas encore d'évaluation
- Exercices La Reproduction Sexuee Ches Les Plants A Fleurs1Document8 pagesExercices La Reproduction Sexuee Ches Les Plants A Fleurs1sarah nabilPas encore d'évaluation
- Exercice Type Brevet 2Document2 pagesExercice Type Brevet 2houda khaterPas encore d'évaluation
- Chapitre 5 Big DataDocument6 pagesChapitre 5 Big DataSYRINE SDIRIPas encore d'évaluation
- Devoir 1 Modele 5 Physique Chimie 1er Bac Semestre 1Document3 pagesDevoir 1 Modele 5 Physique Chimie 1er Bac Semestre 1Ikram Baya100% (1)
- 43316451Document37 pages43316451MrManagerPas encore d'évaluation
- 08 75 9p BaguelinDocument9 pages08 75 9p Baguelinmichael2Pas encore d'évaluation
- Cerballiance Res 20210706 210706L5007201Document1 pageCerballiance Res 20210706 210706L5007201Vsevolod SazonovPas encore d'évaluation
- Serie TD Proba 2020 2021 Gmec1 1Document8 pagesSerie TD Proba 2020 2021 Gmec1 1أشرف عبودPas encore d'évaluation
- Algorithmes MLDocument4 pagesAlgorithmes MLJulePas encore d'évaluation
- Definitions Et Exo-1Document3 pagesDefinitions Et Exo-1hawad2483Pas encore d'évaluation
- b1 Junior Modéle Des ÉpreuveDocument20 pagesb1 Junior Modéle Des ÉpreuveMARIA GIL GANPas encore d'évaluation