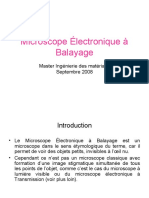Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Memoire Fin de Cycle - Deploiement FTTH Mixte
Transféré par
Benie DE DieuTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Memoire Fin de Cycle - Deploiement FTTH Mixte
Transféré par
Benie DE DieuDroits d'auteur :
Formats disponibles
République de côte d’ivoire
Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique
Promotion : 2016 - 2017 Année académique : 2017 - 2018
MEMOIRE DE FIN CYCLE
Pour l’obtention du
DIPLOME D’INGENIEUR TELECOMS
Option : Réseaux Informatiques et télécommunications
ETUDE ET DEPLOIEMENT D’UN RESEAU
FTTH MIXTE :
Cas de la cité des Arts de COCODY
Professeur encadreur : Présenté par :
M. DJILE Guy-Fabre M. KRA Franck
Ingénieur Réseaux Télécoms Elève Ingénieur
Dédicace
A mes parents
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
Remerciement
Le présent travail a été réalisé grâce aux efforts conjugués de plusieurs
personnes à qui je voudrais exprimer ma profonde gratitude.
Merci :
Au directeur général de l’établissement CEFIVE le cadre de la
formation
A mon encadreur Monsieur DJILE Guy- Fabre Ingénieur Réseaux
et Télécoms pour sa disponibilité
Aux autres enseignants pour leur conseil pendant la formation
Au personnel de l’établissement
A tous mes frères, sœurs et ami(e)s pour leur sincère
encouragement
Merci enfin à tous ceux qui de prêt ou de loin ont contribué à la
réalisation de ce projet.
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
SOMMAIRE
INTRODUCTION………………………………………………………………..….………..5
PREMIERE PARTIE : CADRE D’ETUDE…………………………………….…………..6
Chapitre I : Présentation du projet ………………………………………….........7
Chapitre II : Etude, critique de l’existant et problématique…………..……..11
Chapitre III : Propositions de solutions et choix de la solution………........13
DEUXIEME PARTIE : ETUDE DE LA SOLUTION RETENUE………………..….…..22
Chapitre I : Etude générale de la fibre optique………………………………...23
Chapitre II : Système et composant de la transmission par fibre optique..36
Chapitre III : Le réseau d’accès FTTH………………………………………….40
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
TROISIEME PARTIE : DEPLOIEMENT DE LA SOLUTION……………………..…...58
Chapitre I : Etude et déploiement du réseau d’accès FTTH……….….…….59
Chapitre II : Déploiement du réseau d’accès FTTH vertical ……….………..63
Chapitre III : Mise, œuvre de la solution & coût du projet…………………..66
CONCLUSION……………………………………………………………………………..68
LISTE DES FIGURES………………………………………………….…………………74
LISTE DES TABLEAUX……………………………………………….…………………76
BIBLIOGRAPHIE………………………………………………………….………………77
WEBOGRAPHIE…………………………………………………………….…………….78
ANNEXE……………………………………………………………………………………79
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
INTRODUCTION
Les réseaux à très haut débit sont un facteur de compétitivité et de croissance pour
les territoires. Par leurs très grandes capacités de transmission dans les deux sens,
ils libèrent les échanges et permettent les usages simultanés et le partage de
documents professionnels ou personnels.
Aussi, le développement des nouveaux usages et services tels que le "triple-play"
nécessite dorénavant des débits que le réseau téléphonique traditionnel ne permet
pas d’offrir. Dans un marché des télécommunications en pleine essor, le réseau
d’accès constitue le pivot essentiel pour la distribution des débits souhaité pas les
usagers et la stabilité des applications haut débit. Dans ce contexte, la refonte des
réseaux d'accès n'apparaît plus aujourd'hui comme une alternative, mais constitue
une condition essentielle au maintien de l’attractivité numérique des territoires.
Cependant, Les débits actuels des réseaux d’accès existants sont limités et les
usages numériques nécessitent de plus en plus de débit. Pour y remédier, le projet
<< ETUDE ET DEPLOIEMENT D’UN RESEAU FTTH MIXTE :
Cas de la cité des Arts de COCODY>> a été initié.
Le projet va répondre aux questions :
- Quels sont les processus de déploiement d’un réseau FTTH et comment
l’optimiser ?
- Comment s’effectue le raccordement final des abonnés ?
Pour mener à bien notre projet, nous identifierons d’abord les insuffisances des
réseaux d’accès actuels, ensuite nous procéderons au choix d’une technologie
d’accès adapté aux exigences du marché et enfin une étude descriptive de la
solution choisie accompagnée de sa valorisation.
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
PREMIERE PARTIE :
CADRE D’ETUDE
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
CHAPITRE I : PRESENTATION DU PROJET ET DES RESEAUX D’ACCES
I.1 Présentation du projet
I.1.1 Le projet
Grâce au développement du haut débit, nous laissons derrière nous les souvenir de
la lenteur des modems de première génération. Avec le développement de la fibre
optique, la qualité des connexions fait encore un bond en avant. De quoi s’agit-il et
comment fonctionne-t-elle ?
Les connexions haut et très haut débit ont permis de fluidifier et accélérer les
communications. En transportant les données à la vitesse de la lumière, sur un
signal lumineux conduit dans une fibre de verre ou de plastique plus fine qu’un
cheveu, le FTTH permet un débit environ 100 fois plus élevé que le réseau ADSL! Le
terme s’utilise lorsque la fibre est déployée du nœud de raccordement optique (là où
les équipements de transmission de l’opérateur sont implantés) jusqu’à l’abonné. Le
FTTH se distingue de l’ADSL, qui utilise des réseaux en cuivre combiné à la fibre
optique.
I.1.2 Objectif du projet
Les objectifs du projet sont les suivants :
- couvrir intégralement le territoire en Très Haut Débit d’ici 2022
- Mettre en place dans cette cité des infrastructures de télécommunication de
dernière génération.
- Y déployer des supports et technologies de dernière génération.
I.1.3 Intérêt du projet
L’intérêt de ce projet se décuple en plusieurs points à savoir :
- Créer un accès aux services TIC de dernière génération
- Créer un accès un internet de haut débit pour une bonne fluidité pour les
habitants
- Permettre l’accès aux services de télévision numérique.
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
- Etc.
I.1.4 Présentation de la cité des Arts de COCODY
Aux lendemains des indépendances, l'Etat de Côte d'Ivoire a entrepris de donner un
toit à chacun de ses citoyens. Pour réaliser cette volonté politique, le gouvernement
ivoirien a mis à contribution ses spécialistes en la matière, des sociétés à capitaux
publiques.
C'est ainsi que les sociétés ivoiriennes de construction et de gestion immobilière
(SICOGI), de promotion immobilière (SIPIM) et de gestion financière et de l'habitat
(SOGEFIHA), ont rivalisé d'ardeur pour offrir à la ville d'Abidjan des logements.
Ainsi, ont été construites des maisons basses en bande, et des appartements à la
grande joie des cadres moyens de l'époque pouvant s'offrir des cadres de vie
agréables parmi lesquelles la cité des Arts de Cocody.
Elle est située à Cocody en face de l’ISTC non loin de l’INSAAC.
Figure 1 : La Cité des Arts
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
I.2 Présentation des réseaux d’accès
I.2.1 Définition du réseau d’accès
Le réseau d’accès est aussi appelé : la boucle locale. Il est parfois désigné par
l’expression derniers kilomètres du réseau. Il est constitué de la partie du réseau qui
relie le terminal de l’utilisateur et le réseau de l’opérateur. L’opérateur possède à la
fois le réseau cœur et le réseau d’accès. Le réseau d'accès (ou boucle locale) est
donc la partie du réseau qui permet de connecter les locaux du client (Customer
Premises) aux réseaux de transport des opérateurs historiques de
télécommunications ou aux fournisseurs d'accès Internet. Il se caractérise par une
portée limitée.
I.3 Méthodes de réalisation
La boucle locale peut être réalisée de plusieurs manières. Les principales familles
sont :
— le câble métallique aérien ou en conduite sous terre ;
— la fibre optique aérienne ou en conduite sous terre ;
— la radio utilisant différents systèmes radio (différentes méthodes d’accès,
différentes fréquences, etc.).
I.3.1 Le Câble métallique
La boucle locale en câble métallique cuivre est la méthode historique la plus connue
et répandue qui a été utilisée pour la fourniture de services de téléphonie.
Le raccordement entre l’abonné et le point de distribution le plus proche s’effectue à
l’aide de câbles métalliques en cuivre. Ces câbles peuvent être :
— sous-terre utilisant des conduites bien spécifiques et traversant des chambres
destinées à permettre le tirage, la division et le raccordement des câbles ;
— aériens ; cette solution est adaptée aux zones où le génie civil ne peut être
envisagé ou dans le cas de solutions provisoires
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
I.3.2 La fibre optique
La fibre optique a été introduite dans les réseaux de télécommunications depuis plus
de vingt ans. Elle a été stimulée par l’apparition des réseaux Internet qui ont mis en
évidence les insuffisances en termes de débit des réseaux Cette insuffisance a été
clairement sentie avec l’accroissement rapide de la demande des services intégrant
sur le même support la voix, les données et la vidéo. La fibre optique présente
plusieurs particularités techniques qui font d’elle le support le plus prisé aujourd’hui :
— sa très grande bande passante (tout le spectre lumineux) permettant la
transmission des débits très élevés (jusqu’à 1 Gbit/s pour les fibres multimodes ces
débits sont dépassé actuellement avec le NGPON) ;
— sa faible atténuation qui permet d’atteindre de longues distances sans
régénération du signal ;
— son insensibilité aux rayonnements électromagnétiques ;
— son faible encombrement du point de vue masse et diamètre ;
— son insensibilité à l’humidité.
I.3.4 Boucle locale radio BLR
La quatrième alternative pour mettre en place la boucle locale dans un réseau
téléphonique est l’utilisation des liaisons.
Le principe est de remplacer la dernière partie (réseau d’accès ou boucle locale et
branchement) du réseau par des liaisons radio. La partie transport peut rester
identique aux autres méthodes et peut être réalisée en utilisant du câble coaxial, de
la fibre optique ou des faisceaux hertziens.
La boucle locale radio peut être déployée de manière rentable et efficace pour les
applications particulières suivantes :
— desserte de zones denses pour offrir le service fixe et des services multimédia ;
— desserte de zones denses pour permettre une certaine mobilité ;
— desserte de zones moyennement ou peu denses pour offrir des services de
téléphonie ;
— desserte de zone en habitat diffus pour offrir le service universel.
10
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
CHAPITRE II : ETUDE, CRITIQUE DE L’EXISTANT ET PROBLEMATIQUE
II.1 Présentation et critique de l’existant
Contexte du projet
Notre projet consiste à déployer un réseau d’accès haut débit pour desservir à une
cité
Présentation et étude de l’existant (prière séparer la P et la critique svp)
Nous avons effectué une visite en vue de réaliser une étude optimale. Cette visite a
permis de faire l’état des lieux, car il s’agit d’une cité déjà desservie par infrastructure
télécom. Nous avons également interrogé les habitants et les techniciens chargés
de la maintenance dans cette zone. Cette démarche nous a permis d’en ressortir les
informations suivantes :
- Présence de poteaux et chambres souterraines à l’intérieur de la cité
- Il existe des conduits ou passage de câbles aménagés pour le tirage de câble
de télécommunication dans les bâtiments.
- Il existe également des passages aménagés en apparent pour le déploiement
de réseau informatique.
- Les besoins des habitants se caractérisent par des services à la pointe de la
technologie et gourmand en débit.
- Le réseau d’accès actuel présent sur le site est limité en termes de débit à
offrir aux habitants de cette zone.
- Etat de Vieillissement très avancé du réseau d’accès desservant cette cité.
- Maintenance difficile voire impossible.
- Réseau saturé.
11
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
II.2 Problématique (mettre le pb en gras)
Au regard du constat que nous avons fait lors de la visite de la cité, il importe de se
poser les questions suivantes : comment et par quel support pourrait-on fournir un
meilleur accès aux services de télécommunication à la cité des Arts ?
12
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
CHAPITRE III : PROPOSITIONS DE SOLUTIONS ET CHOIX DE LA SOLUTION
Le dernier tronçon vers l’utilisateur du réseau actuel qui connecte les locaux du
client au reste du réseau de l’opérateur est principalement composé de la
technologies et ADSL. Les insuffisances de cette technologie sont inhérentes à la
nature des liaisons mises en œuvre. Cependant étant limité en termes de débit et de
portée, cette technologies n’offre pas des conditions optimales pour un service stable
et performant pour l’utilisation des applications gourmands en bande passante et
inter actif.
Par ailleurs, le secteur des télécommunications a connu une explosion spectaculaire
ces dernières années qui a vu la naissance de plusieurs services numériques. La
fourniture de ces services impose donc d’optimiser ou de mettre en place des
réseaux d’accès haut débit voir très haut débit. Il apparait donc clairement que pour
le cas de notre cité une amélioration du réseau d’accès existant s’impose.
Pour ce faire, il est à envisager plusieurs possibilités technologiques au nombre des
quels nous retenons proposons : la WIMAX, les VSAT et la fibre optique
Figure 2 : Download théorique en fonction de la distance modem/NRA
13
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
Tableau1 : Débit nécessaire par logement
III.1 Les différentes techniques de mise en œuvre possible
III.1.1 Première technique de mise en œuvre : La WIMAX
III.1.1.1 Présentation de la WIMAX
WiMAX (acronyme pour Worldwide Interoperability for Microwave Access) désigne
un standard de communication sans fil. Aujourd'hui il est surtout utilisé comme
système de transmission et d'accès à Internet à haut débit, portant sur une zone
géographique étendue. Ce terme est également employé comme label commercial, à
l'instar du Wi-Fi.
III.1.2.2 Forces et faiblesses
La Wimax présente d'énormes avantages tant du côté du client que de l'opérateur.
Pour l'opérateur :
· Elle lui évitera des dépenses énormes liées aux travaux de génie civil ;
· Une facilité et une rapidité de déploiement ;
· Une bonne flexibilité permettant une facile extension du réseau.
· Bien adaptée dans les régions rurales à faible densité de population ainsi que dans
les zones urbaines.
Pour le client :
14
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
· Il n'aura pas à attendre plus longtemps pour son raccordement,
· Le débit est constant égale ou supérieur à 2Mbit/s
Cependant, les conditions météorologiques (fortes pluies, brouillard,) ralentissent
énormément la propagation des ondes radio causant ainsi une diminution en débit de
la liaison ou une interruption de la connexion si ces conditions s'aggravent. Outre ces
aléas climatiques, il faudrait prendre en compte les démarches nécessaires auprès
des agences de régulation pour l'attribution des fréquences à utiliser (pour
l'opérateur). Nous ajouterons aux inconvénients les conséquences des ondes radio à
haute fréquence (plusieurs GHz) sur l'organisme. Bien que ce problème prête encore
discussion.
AVANTAGES INCONVENIENTS
Faible travaux de génie civil Sensible aux hydrométéores tels
1,6 à 5 kilomètres de rayon que les fortes pluies et les
5 à 10 Mbit/s masques
La mobilité Influence de la distance sur le
débit
Tableau2 : avantages et inconvénients de la WIMAX
III.1.1.3 Architecture du réseau
15
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
Figure3 : Architecture d’un réseau WIMAX
III.1.2 Deuxième technique de mise en œuvre : La technologie
VSAT
III.1.2.1 Présentation des VSAT
VSAT signifié terminal à très petite couverture (en anglais Very Small Aperture
Terminal). Il s’agit d’une technique de communication et de transmission de données
par satellite qui utilise des satellites en orbites gestionnaire autour de la terre. Cette
technologie consomme des bandes de fréquences de types Ku (bande 12,5-14.25
GHz), ou de type C (bande 3400-6650 MHz). Le VSAT est aussi un système qui
repose sur le principe d’un site principal appelé HUB ou station terrienne et d’une
multitude de point distante nommée station VSAT, la station VSAT permet de
connecter un ensemble de ressource en réseau.
III.1.2.2 Forces et faiblesses des VSAT
Un réseau de type VSAT est constitué d’un hub central, d’une station terrestre
principale, de station VSAT distantes et d’un segment spatial. La station hub est
toujours plus importante que les stations distantes. Pour la gestion des
communications, les données transmises par ce type de réseau empruntent deux
segments, l’un terrestre et l’autre spatial.
- Le segment terrestre est constitué de hub et des stations terrestres. Elle est
constituée de trois éléments : une antenne satellite fixe ; une tête satellite contenant
un système électronique pour gérer les signaux en émission et en réception ; un
boitier intérieur pour gérer les connexions entre les équipements des utilisateurs et le
satellite
- Le segment spatial, quant à lui, représente les liens établis à la fois en partant et en
venant du satellite. Le fait d’utiliser un satellite géostationnaire pour la couverture
permet d’avoir une large couverture. Ceci rend possible la création du réseau global
à une échelle intercontinentale très rapidement.
16
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
Le principal désavantage du VSAT est son prix. En effet, le hub qui est l’élément
central du réseau impose un investissement de base important.
- Partant du fait que la technologie VSAT utilise les satellites en orbite
géostationnaire, cela demande un minimum de latence d’environ 250 millisecondes
pour chaque voyage.
- Le VSAT nécessite un personnel qualifié
- Un temps de réponse élevée à cause du chemin parcouru par le signal
Avantages Inconvénients
- VSAT permet d’offrir tous types de - Coût élevé
services - Temps de latence
- Systèmes très évolutifs - Couverture fixe
- Débits jusqu’à 155Mbits/s - Asymétrie de la liaison
- Une panne du HUB paralyse le
réseau
- Liaisons sensibles aux
hydrométéores tels que les fortes
pluies et les masques ;
TABLEAU 3 : Avantages et inconvénients des VSAT
III.1.2.3 Architecture d’un réseau VSAT
17
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
Figure 4 : Architecture d’un réseau VSAT
III.1.3 Troisième technique de mise en œuvre : La Fibre Optique
III.1.3.1 Présentation de la fibre optique
La fibre optique est un guide d’onde qui exploite les propriétés réfractrices de la
lumière. C’est un câble qui contient un fil de verre ou en plastique capable de
conduire la lumière. Elle permet de transmettre, à la vitesse de la lumière, les
signaux qui transportent la voix entre les téléphones (filaires ou mobiles), les images
et le son entre les centres de production des chaines de télévision et les téléviseurs,
ou encore les données numériques entre deux ordinateurs connectés au réseau
internet ou à un réseau d’entreprise. Elle est habituellement constituée d’un cœur
entouré d’une gaine. Le cœur de la fibre a un indice de réfraction légèrement plus
élevé (différence de quelques millièmes) que la gaine et peut donc confiner la
lumière qui se trouve entièrement réfléchie de multiples fois à l’interface entre les
deux matériaux (en raison du phénomène de réflexion totale interne). L’ensemble est
généralement recouvert d’une gaine plastique de protection. Lorsqu’un rayon
lumineux entre dans la fibre à l’une de ces extrémités avec un angle adéquat, il subit
de multiples réflexions totales internes. Ce rayon se propage alors jusqu’à l’autre
extrémité de la fibre optique sans perte, en empruntant un parcours zigzag. La
propagation de la lumière dans la fibre peut se faire avec un très peu de pertes
même lorsque la fibre est courbée. Il faut noter ici qu’il existe deux types de fibres
optiques : les fibres optiques monomodes et les fibres multimodes, respectivement
18
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
utilisées sur des longues distances (intercontinentales) et les courtes distances
(100m à 2km)
III.1.3.2 Forces et faiblesses de la fibre optique
Forces Faiblesse
Insensibilité aux rayonnements Demande de gros moyen de génie
électromagnétique civil
Distance de couverture importante Très fragile
Débit très élevé (1 000 térabits par Nécessite des techniciens
second) hautement qualifiés
Moins de maintenance après
installation
TABLEAU 4 : Forces et faiblesses de la fibre optique
III.1.3.3 Schéma d’une fibre optique
FIGURE 5 : Transmission de l’information à travers une fibre optique
19
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
FIGURE 6: Transmission de l’information à travers une fibre optique
III.2 Choix de la solution
Une étude comparative des technologies sus évoqués nous permettra de justifier le
choix de la technologie d’accès pour le présent projet.
La comparaison de ces techniques de transmission se fera sur la base de certains
critères que le sont : le type services supporté, le débit de transmission, la stabilité et
la fiabilité du support et le cout du déploiement.
WIMAX VSTAT Fibre Optique
Informations Données, Voix Voix, données, Voix, données,
transmises vidéo vidéo, jeux
interactifs
Débits faible élevés illimité
Stabilité moyenne moyenne excellente
Temps de Court Long Court
déploiement
Coût du déploiement acceptable coûteux relatif
Maintenance moyen moyen faible
20
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
Tableau 5 : Tableau comparatif des technologies d’accès WIMAX, Vsat, FO
Notre choix s’est fait par rapport de la technologie la plus adaptées à nos besoins. La
technologie de la fibre optique a été retenue à cause de sa capacité à transporté plus
d’informations sur de plus longue distance et sa grande capacité en bande passante.
C’est une technologie d’accès qui regorge les aspects suivants :
Aspect technique :
La fibre optique permet des débits de transmission élevé pouvant atteindre
plusieurs gigabits par seconde. La fibre optique présente peu d’altération et une
stabilité chimique et thermique. Le verre est très stable. La boucle locale peut
théoriquement atteindre les 40km
Aspect économique :
Rapport prix/performances avantageux, spécialement pour les très longues
distances de transmission et la pose des câbles est plus économique en raison
du poids moindre et de la section de câble plus petite.
Aspect environnemental :
Les réseaux de nouvelle génération, en particulier ceux à base de fibres optiques,
sont de manière directe et indirecte plus respectueux de l’environnement.
Optimisation des déplacements et des équipements, faible consommation, faible
empreinte carbone. La fibre optique, grâce à la nature lumineuse du signal
véhiculé, ne consomme pas d’énergie entre le centre technique (répartiteur ou
sous-répartiteur) et l’abonné. De plus, même si une atténuation du signal reste
mesurable, une bien plus grande distance peut être couverte. Ainsi, ce nombre
d’équipements actifs consommateurs d’énergie est moindre et de plus faible
puissance.
21
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
DEUXIEME PARTIE :
ETUDE DE LA SOLUTION
RETENUE
22
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
CHAPITRE I : ETUDE GENERALE DE LA FIBRE OPTIQUE
I.1 La fibre optique
La fibre optique est un moyen de communication qui fonctionne par l’envoi de
signaux optiques à travers des brins de fibre de verre ou de plastic extrêmement
purs, de l’épaisseur d’un cheveu. La lumière est guidée vers le centre de la fibre qui
est appelé cœur. Le cœur est entouré d’un matériau optique appelé gaine qui
emprisonne la lumière dans le cœur en utilisant une technique optique appelée
réflexion totale interne. La fibre elle-même est recouverte par un revêtement
secondaire (buffer coating) pour la protéger de l’humidité et des dommages
physiques. Le revêtement est la partie qu’on dénude pour la terminaison ou
l’épissure.
Le cœur et la gaine sont habituellement faits de verre ultra-pur, bien que certaines
fibres soient faites totalement en matière plastique ou composées d’un cœur de
verre et d’une gaine plastique. Le cœur est conçu pour avoir un indice de réfraction
supérieur à celui de la gaine, un paramètre optique qui est une mesure de la vitesse
de la lumière dans le matériau. L’indice de réfraction inférieur de la gaine fait se
courber les rayons lumineux lorsqu’ils passent du cœur à la gaine et provoque la
réflexion totale interne pour piéger la lumière dans le cœur à un certain angle, lequel
définit l’ouverture numérique de la fibre. La fibre de verre est couverte d’un
revêtement de protection en plastique appelé revêtement secondaire (buffer coating,
en anglais) qui la protège de l’humidité et d’autres dommages. Davantage de
protection est fournie par le câble qui maintient les fibres et les éléments de renfort à
l’intérieur d’une couche protectrice externe appelée enveloppe.
23
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
I.1.1 Structure de la fibre optique
La fibre optique est en fait un mince fil de verre protégé par deux couches de
revêtement thermoplastique. Le diamètre du verre est de 125 micromètres, le
diamètre extérieur du revêtement est de 250 micromètres.
Figure 7 : Structure d’une fibre optique
Le verre est constitué de deux parties : le cœur optique d'un diamètre 9 micromètres
sur les structures monomodes et une gaine optique de diamètre 125 micromètres.
L'ensemble verre, plus revêtement thermoplastique constitue ce qu'on appelle la fibre
nue. Le revêtement est appliqué lors de la fabrication de la fibre, il est conservé tout
au long de la vie de la fibre. Il n'est retiré que pour des opérations très spécifiques,
des opérations d'épissurage ou connectorisation. Immédiatement après ces
opérations, la fibre est reprotégée, soit par des manchons, soit par le corps même du
connecteur.
24
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
I.1.2 Identification de la fibre
Dans un câble, les fibres sont identifiées par leur couleur, cette couleur est soit un
mince film coloré rajouté sur la fibre, soit directement la couleur du revêtement
secondaire teintée dans sa masse. Ce deuxième procédé dit Colorlock présente une
bien meilleure résistance dans le temps.
I.1.3 Types de fibre optique
Les deux types de fibres sont la multimode et la monomode. Dans ces catégories,
les fibres sont identifiées par leur diamètre de cœur et de gaine exprimés en microns
(un millionième de mètre), par exemple 50/125 microns pour une fibre multimode.
La plupart des fibres ont un diamètre extérieur de 125 microns – un micron est un
millionième de mètre et 125 microns sont 0,005 pouces – un peu plus grand qu’un
cheveu humain moyen.
I.1.3.1 La fibre multimode
Dans la fibre multimode, la lumière se déplace dans le cœur en de nombreux rayons,
appelé modes. Elle possède un cœur plus grand (presque toujours 50 ou 62,5
microns) qui prend en charge la transmission de plusieurs modes (rayons) de
lumière. Le multimode est généralement utilisé avec des sources LED à des
longueurs d’onde de 850 et 1300 nm (voir ci-dessous) pour des réseaux locaux
(LAN) plus lents et des lasers à 850 (VCSEL) et 1310 nm (laser Fabry- Perot) pour
des réseaux fonctionnant à 1 gigabits par seconde ou plus.
La fibre multimode à saut d’indice a été le premier type de fibre conçu. Le cœur de
fibre multimode à saut d’indice est constitué entièrement d’un seul type de matériau
tandis que la gaine optique est faite d’autre type de matériaux avec des
caractéristiques optiques différentes. Elle a un affaiblissement plus élevé et elle est
trop lente pour de nombreuses utilisations, en raison de la dispersion provoquée par
les différentes longueurs de trajet des différents modes qui voyagent dans le cœur.
La fibre à saut d’indice n’est pas très utilisée.
La fibre multimode à gradient d’indice utilise des variations dans la composition du
verre dans le cœur afin de compenser les différentes longueurs de trajets des
modes. Elle propose des centaines de fois plus de bande passante que la fibre à
saut d’indice jusqu’à environ 2 gigahertz. Deux types sont utilisés, 50/125 et
62,5/125, ces chiffres représentant les diamètres cœur/gaine en microns. La fibre
25
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
multimode à gradient indice est principalement utilisée pour les réseaux locaux, LAN,
la fibre au bureau, les systèmes de surveillance par télévision à circuit fermé et
d’autres systèmes de sécurité.
I.1.3.2 La fibre optique plastique
La fibre optique plastique (FOP) est une fibre à grand cœur (environ 1 mm),
généralement à saut d’indice, qui est utilisée pour les réseaux courts, à faible
vitesse.
PCS/HCS (« plastic or hard clad silica », fibre de silice gainée de plastique) a un plus
petit cœur de verre (environ 200 microns) et une gaine de plastique mince.
I.1.3.3 La fibre monomode
La fibre monomode possède un cœur beaucoup plus petit, d’environ 9 microns
seulement, de sorte que la lumière ne se déplace que dans un rayon (mode). Elle est
utilisée pour la téléphonie et la télévision par câble avec des sources laser à 1300 et
1550 nm, car elle a une perte inférieure et sa bande passante est virtuellement
illimitée.
Dans la fibre monomode, le cœur est tellement rétréci que la lumière ne peut se
déplacer que dans un rayon. Cela augmente la bande passante presque à l’infini –
mais elle est limitée, dans la pratique, à environ 100’000 gigahertz – c’est quand
même énorme ! La fibre monomode présente un diamètre de cœur de 8 à 10
microns, spécifié comme « diamètre de mode de champ », c’est-à-dire la taille
effective du cœur, et un diamètre de gaine de 125 microns. La fibre monomode est
utilisée pour les réseaux extérieurs tels que télécommunications, FTTH, TVCA,
réseaux municipaux et liaisons de données longues comme la gestion de réseaux de
distribution. Certains réseaux fédérateurs LAN à grande vitesse, généralement sur
les campus, utilisent des fibres monomodes.
Les fibres spécialisées ont été développées pour des applications qui nécessitent
des spécifications de performance de fibre uniques. Des fibres insensibles à la
flexion, à la fois multimodes et monomodes, sont utilisées pour les cordons de
raccordement et les fibres dans des espaces réduits. Des fibres monomodes dopées
à l’erbium sont utilisées dans les amplificateurs à fibre, ces dispositifs utilisés dans
les réseaux de distance extrêmement longue pour régénérer les signaux. Certaines
26
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
fibres sont optimisées pour la bande passante à des longueurs d’onde spécifiques
pour les systèmes DWDM ou pour inverser la dispersion chromatique. Il s’agit d’un
secteur actif dans le développement de la fibre.
FIGURE 8: types de fibre optique
Types et tailles de fibres
La fibre est disponible en deux types de base, monomode et multimode. Sauf pour le
cas des fibres utilisées dans des applications spécialisées, la fibre monomode peut
être considérée comme une taille et un type à part entière. Si vous travaillez sur des
télécommunications longues distances ou des câbles sous-marins, vous pourrez
avoir à utiliser des fibres monomodes spécialisées.
FIGURE 9: Taille des fibres optiques
27
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
Les fibres multimodes étaient à l’origine fabriquées en plusieurs tailles, optimisées
pour différents réseaux et sources, mais l’industrie des données les a standardisées
à un cœur de fibre de 62,5 au milieu des années 80 (la fibre 62,5/125 a un cœur de
62,5 microns et une gaine de 125). C’est ce qu’on appelle maintenant le standard de
fibre OM1. Récemment, étant donné que des réseaux à 1 gigabit et 10 gigabit sont
devenus largement utilisés, une vieille conception de fibre a été relancée. La fibre
50/125 a été utilisée à partir de la fin des années 70 avec des lasers pour des
applications de télécommunications avant que la fibre monomode devienne
disponible. La fibre 50/125 (standard OM2) offre une bande passante plus élevée
avec les sources laser utilisées dans les réseaux locaux en gigabits et peut
permettre aux liaisons en gigabit de parcourir de plus longues distances. Le nouveau
OM3 ou fibre optimisée pour le laser 50/125 est considérée aujourd’hui par la plupart
comme le meilleur choix pour les applications multimodes.
Les fibres à saut d’indice les plus courantes sont des fibres optiques en plastique qui
ont généralement un diamètre de 1 mm. Silice gaine de matière plastique ou de la
silice dur revêtu possèdent une gaine en plastique sur un cœur en verre et ont
généralement un diamètre de 250 microns avec un cœur de 200 microns.
I.1.4 Caractéristique de la fibre optique
Les caractéristiques habituelles des fibres sont la taille (diamètre cœur/gaine en
microns), le coefficient d’affaiblissement (dB/km à des longueurs d’onde appropriées)
et la largeur de bande (MHz-km) pour des fibres multimode et la dispersion
chromatique et modale de polarisation pour la fibre monomode. Même si les
fabricants ont d’autres caractéristiques de conception et de fabrication de la fibre
répondant aux normes de l’industrie telles que l’ouverture numérique (l’angle
d’acceptation de la lumière dans la fibre), l’ovalité (la rondeur de la fibre), la
concentricité du cœur et de la gaine, etc., ces spécifications ne concernent
généralement pas les utilisateurs qui cherchent des caractéristiques pour l’achat ou
l’installation.
Affaiblissement (ou atténuation)
La spécification première de la fibre optique est l’affaiblissement. L’affaiblissement
(également appelé atténuation) est une perte de puissance optique. L’affaiblissement
28
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
de la fibre optique est exprimé par le coefficient d’affaiblissement qui est défini
comme la perte de la fibre par unité de longueur, en dB/km. L’affaiblissement varie
de façon significative avec la longueur d’onde de la lumière.
FIGURE 10: Affaiblissement en fonction de la longueur d’onde
L’affaiblissement de la fibre optique est le résultat de deux facteurs, l’absorption et la
diffusion. L’absorption est provoquée par l’absorption de la lumière et la conversion
en chaleur par des molécules dans le verre. Les absorbeurs principaux sont des
OH+ résiduels et des dopants utilisés pour modifier l’indice de réfraction du verre.
Cette absorption se produit à des longueurs d’onde distinctes, déterminées par les
éléments absorbant la lumière. L’absorption par OH+ est prédominante, et survient le
plus fortement autour de 1000 nm, 1400 nm et au-dessus de 1600 nm.
La principale cause de l’affaiblissement est la diffusion. La diffusion se produit
lorsque la lumière entre en collision avec des atomes individuels dans le verre et est
anisotrope. La lumière qui est diffusée à des angles en dehors de l’ouverture
numérique de la fibre est absorbée dans la gaine ou transmise de nouveau vers la
source. La diffusion est également fonction de la longueur d’onde, proportionnelle à
la quatrième puissance inverse de la longueur d’onde de la lumière. Ainsi, si vous
doublez la longueur d’onde de la lumière, vous réduisez les pertes de diffusion par 2
à la puissance 4 ou 16 fois.
Par exemple, la perte de la fibre multimode est beaucoup plus élevée à 850 nm
(appelée longueur d’onde courte) à 3 dB/km, tandis qu’à 1300 nm (longueur d’onde
29
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
dite longue) elle n’est que de 1 dB/km. Cela signifie qu’à 850 nm, la moitié de la
lumière est perdue chaque km, tandis que seulement 20% sont perdus à 1300 nm.
Par conséquent, pour la transmission à longue distance, il est avantageux d’utiliser la
longueur d’onde pratique la plus longue pour un affaiblissement minimal et la
distance maximale entre les répéteurs. Ensemble, l’absorption et la diffusion
produisent la courbe d’affaiblissement d’une fibre optique en verre typique indiquée
ci-dessus.
Les systèmes à fibres optiques transmettent dans des « fenêtres » créés entre les
bandes d’absorption à 850 nm, 1300 nm et 1550 nm, où la physique permet
également de fabriquer des lasers et des détecteurs facilement. La fibre plastique a
une bande de longueur d’onde plus limitée, ce qui limite l’utilisation pratique à 660
nm et des sources LED.
L’affaiblissement de la fibre multimode à gradient d’indice dépend également de la
façon dont la lumière est transmise dans la fibre, ce qu’on appelle la distribution de la
puissance du mode. La bande passante est également affectée par la distribution de
la puissance du mode, de sorte que les effets modaux dans les fibres multimodes
sont discutés ci-dessous.
Bande passante
La capacité de transmission de l’information de la fibre multimode est limitée par
deux composants distincts de dispersion : le composant modal et le composant
chromatique. La dispersion modale provient du fait que le profil d’indice de la fibre
multimode n’est pas parfait. Le profil à gradient d’indice a été choisi pour permettre
théoriquement à tous les modes d’avoir la même vitesse de groupe ou vitesse de
passage sur la longueur de la fibre. En faisant que les parties extérieures du cœur
aient un indice de réfraction plus faible que les parties intérieures du cœur, les
modes d’ordre supérieur accélèrent à mesure qu’ils s’éloignent du centre du cœur,
compensant ainsi leur plus long chemin.
L’indice de réfraction
Lorsqu'un faisceau lumineux heurte obliquement la surface qui sépare deux milieux
plus ou moins transparents, il se divise en deux: une partie est réfléchie tandis que
l'autre est réfractée, c’est-à-dire transmise dans le second milieu en changeant de
direction.
30
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
L'indice de réfraction, souvent noté n, est une grandeur caractéristique d'un milieu,
décrivant le comportement de la lumière dans celui-ci; il dépend de la longueur
d'onde de mesure mais aussi de l'environnement dans lequel se propage la lumière.
Il est obtenu en divisant la vitesse de la lumière dans le vide (Cv=299792Km/s) par la
vitesse de cette même onde dans le matériau. Plus l'indice est grand, et plus la
lumière est lente.
FIGURE 11: réfraction de la lumière
C'est ce principe qui est utilisé pour guider la lumière dans la fibre. La FO comprend
ainsi deux milieux : le cœur, dans lequel l'énergie lumineuse se trouve confinée,
grâce à un second milieu, la gaine, dont l'indice de réfraction est plus faible.
I.2 Les câbles à fibre optique
Le câble fournit aux fibres une protection contre le stress lors de l’installation et de
l’environnement une fois qu’elle est installée. Les câbles peuvent contenir d’une à
plusieurs centaines de fibres. Les câbles sont disponibles en trois variétés : gainage
serré avec un revêtement plastique épais sur les fibres pour leur protection,
principalement utilisé à l’intérieur ; câble à gaine intermédiaire flottante, où les fibres
avec seulement un revêtement secondaire se trouvent à l’intérieur de tubes en
plastique ; câble à ruban, où les fibres sont transformées en rubans pour permettre
de petits câbles avec le plus grand nombre de fibres possible.
31
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
FIGURE 12: Câble à fibre optique
Enveloppe : Revêtement extérieur robuste sur le câble. Les câbles installés
à l’intérieur des bâtiments doivent respecter les règlementations de
prévention des incendies en utilisant des matériaux d’enveloppe spéciaux.
Éléments de renfort : Fibres d’aramide (Kevlar est le nom commercial de
chez Dupont) utilisées comme éléments de résistance dans le câble pour
permettre de tirer sur le câble. Le terme est également utilisé pour la tige
de fibre de verre utilisées dans certains câbles pour le rigidifier afin
d’empêcher le vrillage.
Armure : Décourage les rongeurs d’endommager le câble par la
mastication.
I.2.1 Les câbles intérieurs
Les câbles intérieurs ont une gaine sans halogène ignifugée, ils sont de
différentes couleurs, généralement de couleurs claires pour être le moins
apparents possible à l'intérieur. La plage de température est relativement
réduite. Le paramètre le plus important est le comportement au feu. Il s'agit de
s'assurer que le câble ne propage pas le feu et n’émette pas de substances qui
peuvent être dangereuses en cas d'incendie. Depuis le premier juillet 2017, les
câbles intérieurs doivent répondre au Règlement Produit de Construction, RPC.
32
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
FIGURE 13: Câbles intérieur
I.2.2 Les câbles extérieurs
Les câbles extérieurs conduits, ils ont une gaine polyéthylène chargée au noir
de carbone pour présenter une bonne résistance aux UVs, cela leur confère
une couleur noire. Ils ont une plage température d'opération plus étendue
que les câbles intérieurs. Les propriétés environnementales clés sont :
l'étanchéité, la résistance aux UVs. En termes de propriétés mécaniques, ils
doivent présenter une bonne résistance à la traction et à l'écrasement pour
pouvoir être posés par tirage dans les conduites.
FIGURE 14: Câbles extérieurs conduite
33
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
Les câbles extérieurs aériens sont très proches des câbles conduits : ils ont une
plage de température d'opération plus étendue et ils représentent encore une
meilleure résistance à la traction parce qu'une fois posés, ils doivent pouvoir
résister aux intempéries, vent, gel et le cumul d'un poids de gel sur le câble et
du vent.
FIGURE 15: Câbles extérieurs aérien
Les câbles intérieurs-extérieurs, on peut distinguer deux types de câbles : les
câbles simple gaine et les câbles double gaine. Les câbles double gaine ont une
gaine extérieure en polyéthylène. Cette gaine est retirée lorsque le câble
circule en intérieur. La gaine interne est en matériau ignifugé. Les câbles simple
gaine ont une gaine sans halogène, ignifugé et résistantes aux UVs. En termes
d'aspect, ils peuvent avoir différentes couleurs, les propriétés sont souvent des
compromis entre celles d'un câble purement intérieur et celles d'un câble
purement extérieur.
34
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
FIGURE 16: Câbles intérieur-extérieur
I.2.3 Normes des fibres optiques
TABLEAU 6 : Normes des fibres optiques
35
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
CHAPITRE II : SYSTEMES ET COMPOSANTS DE LA TRANSMISSION PAR
FIBRE OPTIQUE
II.1 Liaisons de données à fibre optique
FIGURE 17: Liaisons de données à fibre optique
Les systèmes de transmission à fibres optiques utilisent des liaisons de données qui
travaillent de manière similaire au schéma ci-dessus. Chaque maillon de fibre se
compose d’un émetteur sur une extrémité d’une fibre et d’un récepteur à l’autre
extrémité. La plupart des systèmes fonctionnent par transmission dans un sens sur
une fibre et dans le sens inverse sur une autre pour un fonctionnement en duplex
intégral. Il est possible de transmettre dans les deux sens sur une fibre mais il faut
pour cela des coupleurs et la fibre est moins chère que les coupleurs. Les réseaux
optiques passifs FTTH (PON) sont parmi les seuls systèmes utilisant la transmission
bidirectionnelle sur une seule fibre, car leur architecture de réseau est basée autour
de coupleurs.
36
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
FIGURE 18: Système de transmission
La plupart des systèmes utilisent un « émetteur-récepteur » qui inclut à la fois
l’émetteur et le récepteur dans un seul et même module. L’émetteur prend une
entrée électrique et la convertit en un signal de sortie optique à partir d’une diode
laser ou LED. La lumière provenant de l’émetteur est couplée dans la fibre avec un
connecteur et est transmise à travers le réseau de câbles à fibre optique. La lumière
provenant de l’extrémité de la fibre est couplée à un récepteur, où un détecteur
convertit la lumière en un signal électrique qui est ensuite conditionné de manière
appropriée pour son utilisation par l’équipement de réception.
II.2 Sources pour les émetteurs à fibre optique
Les sources utilisées pour les émetteurs de fibres optiques doivent répondre à
plusieurs critères : elles doivent être à la longueur d’onde correcte, être capables de
moduler suffisamment rapidement pour transmettre des données de manière efficace
et être couplées à la fibre.
Quatre types de sources sont couramment utilisés, LED, lasers Fabry-Perot (FP),
lasers à rétroaction répartie (DFB) et émetteurs-récepteurs à base microlaser
(VCSEL). Tous convertissent les signaux électriques en signaux optiques, mais sont
par ailleurs des dispositifs tout à fait différents. Toutes les quatre sont de minuscules
dispositifs semi-conducteurs (puces). Les LED et VCSEL sont fabriqués sur des
plaquettes semi-conductrices de telle sorte qu’ils émettent de la lumière à partir de la
surface de la puce, tandis que les lasers DFB et PF émettent du côté de la puce, à
partir d’une cavité laser créée au milieu de la puce.
37
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
FIGURE 19: Différentes sources pour les émetteurs
Les LED ont des puissances beaucoup plus faibles que les lasers et leurs modèles
de lumière en sortie, plus grands et divergents, les rendent plus difficiles à coupler
aux fibres, ce qui les limite à un usage en fibres multimodes. Les lasers ont des
sorties de lumière plus petites et plus resserrées et sont faciles à coupler à des fibres
monomodes, ce qui les rend idéaux pour les liaisons longue distance à haute
vitesse. Les LED ont beaucoup moins de bande passante que les lasers et sont
limitées aux systèmes d’exploitation à environ 250 MHz ou à 200 Mb/s. Les lasers
ont une capacité de bande passante très élevée, la plupart d’entre eux étant utile à
des valeurs bien supérieures à 10 GHz ou 10 Gb/s.
II.3 Détecteurs pour récepteurs à fibres optiques
Les récepteurs utilisent des détecteurs à semi-conducteurs (photodiodes ou photo
détecteurs) pour convertir les signaux optiques en signaux électriques. Les
photodiodes de silicium sont utilisées pour les liaisons de courtes longueurs d’onde
(650 pour FOP et 850 pour la fibre de verre MM). Les systèmes de longues
longueurs d’onde utilisent généralement des détecteurs InGaAs (arséniure de
gallium indium) car ils ont moins de bruit que le germanium, ce qui permet des
récepteurs plus sensibles.
II.4 Composants de transmission à fibres optiques spéciaux
II.4.1 Multiplexage en longueur d’onde
Etant donné que la lumière de différentes longueurs d’onde ne se mélange pas à
l’intérieur de la fibre, il est possible de transmettre des signaux à plusieurs longueurs
38
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
d’onde différentes sur une seule fibre, et ce simultanément. Si la fibre elle-même est
peu coûteuse, l’installation de nouveaux câbles peut être onéreuse, donc l’utilisation
de fibres installées pour transporter des signaux supplémentaires peut être très
rentable.
Le multiplexage en longueur d’onde (WDM) a été utilisé pour la première avec la
fibre multimode dans les premiers temps de la fibre optique, en utilisant à la fois du
850 et du 1310 nm sur une fibre multimode. Actuellement, les réseaux monomodes
peuvent transporter des signaux à 10 Gb/s sur 64 longueurs d’onde ou plus, ce qui
est appelé Multiplexage en longueur d’onde dense (DWDM). Les systèmes
multimodes par WDM ont eu moins de popularité, mais certaines normes utilisent le
WDM pour transporter des signaux multiples à plus de 1 Gb/s sur de la fibre
multimode optimisée pour le laser.
II.4.2 Performance de liaison de donnée et bilan énergétique de
liaison
Mesurer la qualité de la transmission de données
Tout comme avec le fil de cuivre ou la transmission radio, la performance de la
liaison de données avec la fibre optique peut être déterminée par la façon dont celle-
ci transmet des données ; dans quelle mesure le signal électrique reconverti sur le
récepteur correspond à l’entrée de l’émetteur.
Bilan énergétique de la liaison
Le bilan énergétique optique de la liaison est déterminé par deux facteurs, la
sensibilité du récepteur, qui est déterminée dans la courbe de taux d’erreur binaire
ci-dessus, et la puissance de sortie de l’émetteur dans la fibre. Le niveau de
puissance minimum qui produit un taux d’erreur binaire acceptable détermine la
sensibilité du récepteur. La puissance de l’émetteur couplée dans la fibre optique
détermine la puissance transmise. La différence entre ces deux niveaux de
puissance détermine la marge de perte (bilan énergétique) de la liaison.
39
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
FIGURE 20: Bilan énergétique
CHAPITRE III: LES RESEAUX D’ACCES OPTIQUES FTTH
Il existe plusieurs architectures possibles pour aller depuis le point d'accès
technique de l'opérateur (point de présence ou NRO) jusqu'à l'abonné (FTT«
Home ») : P2P, PON, AON
III.1 Point à point (P2P)
III.1.1 Forces et faiblesses
Le point à point est une transposition du réseau téléphonique. La fibre est déployé de
bout en bout de l’OLT au NRO jusqu’au local de chacun de ces abonnés.
Inconvénients, chaque fibre étant dédié à un abonné, il y aura autant de fibre que
d’abonnés. Ce qui entraine parfois de lourds investissements en génie civil. La
bande passante n’étant pas partagée, les liaisons sont sécurisées et les débits
peuvent atteindre les dizaines de Gbits/s.
III.1.2 Schéma d’une architecture P2P
40
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
Figure 21 : Architecture point à point (P2P)
III.2 Point à multipoint passif (PON)
III.2.1 Forces et faiblesses
Le PON est une architecture FTTH qui permet, par un système de coupleur passé
placé sur le réseau, de regrouper jusqu’à 128 abonnés sur une même fibre. A la
source les données des différents abonnés sont émises les unes à la suite des
autres. Le flux lumineux émis sur la fibre principale allume simultanément chacun
des fibres terminales. Les données transmises sur la partie commune du réseau sont
donc diffusées à la totalité des terminaux présents sur le coupleur. Ces coupleurs
optiques sont des composants passifs de faible cout et d’encombrement réduit. Le
terme passif s’applique au coupleur qui ne comporte aucun élément électronique et
ne nécessite aucune alimentation électrique.
III.2.2 Schéma d’une architecture PON
Figure 22 : Architecture point à multipoint passif (PON)
III.3 Point à multipoint actif (AON)
III.3.1 Forces et faiblesses
L’AON est un mixte du P2P et du PON. Sur le principe du PON, il consiste à
remplacer les coupleurs passifs par des éléments actifs tel sue le switch et le routeur
qui permettrons des débits équivalents au P2P. Mais l’inconvénient réside dans
l’hébergement des éléments actifs qui imposent aux opérateurs la construction de
locaux sécurisés équipés d’énergie
41
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
III.3.2 Schéma d’une architecture AON
Figure 23 : Architecture point à multipoint actif (AON)
III.4 Architecture proposée
III.4.1 Comparaison des trois architectures
Architectures Avantages Inconvénient
- Le système - La maintenance
permet de d'une fibre peut
regrouper jusqu'à concerner
128 abonnés sur plusieurs
une seule fibre abonnés.
PON optique. - La bande
- Le coût de passante d'une
déploiement est fibre est partagée
réduit
- la rapidité du
déploiement
- Réserver aux
zones à densité
élevées
- Meilleure - coûts
sécurité d'installation plus
- Débit garanti élevés
- Evolution plus - Implémentation
P2P simple vers des onéreuse
débits plus élevés - le déploiement
est plus lent
- Débit élevé - Nécessite un
amplificateur et un
multiplexeur actif
- Architecture très
AON complexe
- Gros
investissement
pour le routeur et
le switch
Tableau 7 : comparatif des architectures PON, P2P et AON 42
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
III.5 Architectures retenues
Notre choix a été opéré en tenant compte du type déploiement à faire, le cout
d’investissement et du délai. Nous choisissons donc l’architecture PON avec sa
technologie GPON pour son coût bien plus faible en infrastructures. Aussi, en Gpon il
est possible de mettre jusqu'à 64 abonnés sur un même arbre (aussi appelé tronc
GPON). Chaque arbre représente une fibre entre le point de mutualisation et le NRO.
Le débit de l'arbre Gpon est de 2488 Mb/s partagé en download et 1244 Mb/s en
upload. Le nombre maximum d'abonnés sur un arbre est de 64.
III.6 Règle de déploiement d’un réseau FTTH
Principes de déploiement
Les études technico-économiques sur les différents scénarios de déploiement d’une
architecture point à multipoints ont montré l’impact de l’occupation des ports PON
sur les coûts. En effet les équipements de centre sont aujourd’hui encore coûteux ;
minimiser leur nombre lors du déploiement initial permettra à la fois de lisser
l’investissement et de bénéficier au mieux de la baisse du coût des OLT dans les
années à venir.
La stratégie de déploiement doit donc répondre à cette préoccupation d’occuper au
mieux et au plus vite les coupleurs pour avoir un nombre de clients par port PON
permettant une mutualisation maximale des équipements de centre.
D’autre part, un réseau point à multipoints étant par nature figé et peu flexible, il est
nécessaire de penser à son évolutivité dès sa conception afin que celle-ci ne s’avère
pas trop pénalisante et coûteuse par la suite. Il ne faut pas cependant, que la prise
en compte de cette évolutivité soit rédhibitoire pour la rentabilité du réseau en phase
de déploiement.
La suite du document s’attachera donc à préciser des règles d'ingénieries simples,
fiables et robustes, qui garantissent un équilibre entre une montée en charge des
clients sur ce réseau et un investissement raisonnable les premières années. En
particulier, elles doivent permettre :
- une bonne rentabilité du réseau dès le début du déploiement,
43
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
- une évolution du réseau vers un taux de raccordement clients de 100% à
terme, avec le minimum de réaménagements réseau possible (et les moins coûteux).
Définitions
- PTO (Prise Terminale Optique) : prise optique du client. Elle est reliée au Pb
par un câble de branchement mono-fibre.
- PB (Point de Branchement) : placé au plus près du client final, c’est le premier
point de flexibilité rencontré en remontant vers le NRA. C’est à partir de ce
point que les clients sont raccordés au réseau par un câble individuel (le câble
de branchement). Ce point n’intègre jamais de fonction de couplage.
- BTI (Boitier de Transition d’Immeuble) : placé en pied d’immeuble, le BTI est
avant tout un point de brassage à l’interface entre la Boucle Locale et le
câblage d’immeuble permettant de garantir l’interopérabilité de l’immeuble
avec les autres opérateurs. Côté réseau, le BTI permet de recevoir le(s)
câble(s) d’adduction de différents opérateurs tiers afin de les raccorder au
câblage de la colonne montante. Côté clients, il est le point de départ du
câblage vertical d’immeuble qui va permettre de desservir les PB auxquels
seront branchés les clients. Le BTI permet ainsi de brasser les FO issues du
réseau vers n’importe quel client de l’immeuble. Il peut intégrer une fonction
de couplage (de 2e niveau).
- Pour les pavillons et les immeubles de petite taille, on utilisera des BTI, dits
BTI d’îlot qui seront installés à l’extérieur (sur trottoir, en façade …) ou dans
un local technique tiers. Ces BTI d’îlot sont actuellement en cours d’étude et
vont être expérimentés.
- PA (Point d’Aboutement) : placé dans une chambre à proximité des
immeubles,
- PE : permet d’éclater un câble pour desservir plusieurs immeubles. Son rôle
est de permettre d’optimiser et d’apporter de la flexibilité au réseau PON.
- PDZ (Point de Distribution de Zone) : c’est le point de flexibilité le plus en
amont du réseau PON. Il est situé à un point de convergence de
l’arborescence de génie civil en amont d’un groupe de PE qui lui sont
rattachés. C’est le siège du premier niveau de couplage.
44
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
- PEP (Point d’Epissurage et de Piquage). Il est situé à un point de
convergence de l’arborescence de génie civil en amont des PDZ. Il n’y a
aucune fonction de couplage dans cette boite.
- Colonne montante : on entend par colonne montante l’ensemble du câblage
intérieur de l’immeuble (BTI, PB, câble), qui permet la liaison BTI - PB (cette
colonne montante est également désignée sous le nom de câblage vertical).
- Distribution de niveau 2 : On entend par distribution de niveau 2 les liaisons
PA-BTI (PA et BTI non inclus).
- Distribution de niveau 1 : On entend par distribution de niveau 1 les liaisons
PDZ-PA (PA inclus).
- Transport : On entend par transport la liaison NRA-PDZ (PDZ inclus).
- Le schéma ci-après montre un réseau PON avec ses principaux points de
flexibilité. Le cas des clients situés dans les zones « 0 » (zone directe) sera
traité dans un chapitre spécifique.
III.6.1 Description de l’ingénierie
L’architecture FTTH qui a été retenue est une architecture PON (Passive Optical
Network). Le PON est une architecture point à multipoints basée sur les éléments
suivants :
Une infrastructure fibres optiques partagée nécessitant la mise en place de
coupleurs dans le réseau. Le nombre de niveaux de couplage dépend du budget
optique, mais typiquement, il est possible de superposer 2 niveaux.
Un équipement de centre faisant office de Terminaison Optique de Ligne (OLT),
qui d’une part reçoit (émet) les flux en provenance (à destination) des différentes
plates-formes de services au travers de ses interfaces réseau et d’autre part les
diffuse (reçoit) aux (de la part des) clients par l’intermédiaire de cartes appelées
cartes PON, au travers de l’infrastructure passive.
Un équipement d’extrémité appelé ONT (Terminaisons de Réseau Optique)
III.6.1.1 Contraintes techniques
Bilan optique entre OLT et ONT
Le budget optique entre l’équipement centre (OLT) et l’équipement client (ONT) doit
être compris entre 13 et 28 dB aux deux longueurs d’ondes 1310nm et 1490 nm.
45
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
Les valeurs maximales d’affaiblissement à prendre en compte pour le calcul
prévisionnel du budget optique sont les suivantes :
- 1 dB pour la marge dite de « vieillissement des lasers »
- 0,1 dB pour une épissure soudée (s’il y a au moins dix soudures en cascade)
- 0,2 dB par épissure mécanique
- 0,25 dB pour un pigtail connectorisé SC/APC
- 0,5 dB par connexion (1 raccord + 2 fiches optiques)
- 0,36 dB/km à 1,3 µm pour la fibre optique (0,22 à 1,55 µm)
La perte d’insertion maximale à 1,3µm apportée par les coupleurs est la suivante :
- 3,6 dB pour les coupleurs 1 vers 2
- 16,5 dB pour les coupleurs 1 vers 32
Taux de couplage
- Le taux de couplage doit être limité à 1/64.
- Dans le cadre de notre projet nous avons retenu 2 niveaux de couplage : 2
vers 2 et 1 vers 32.
III.6.1.2 Conception du réseau du PA au NRO (NRA)
En suivant la logique de conception du réseau FTTH, les différentes phases de la
conception du réseau FTTH Transport + Distribution1 sont :
- Le Transport et la Distribution1 seront dimensionnés pour permettre, sans
nouvelle pose de câble, le raccordement de 100% des clients de la zone considérée.
- Les règles d’implantation des coupleurs sont précisées dans la suite de notre
document
La réalisation d’un projet pertinent reposera sur les éléments suivants :
46
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
- des données d’urbanisme permettant d’obtenir le nombre de logements
résidentiels et de locaux professionnels par adresse. Ces données sont
indispensables pour la réalisation du pointage,
- une connaissance précise de l’architecture GC existante et de sa
disponibilité : saturation des conduites et des chambres car il faut s’assurer de la
possibilité d’y implanter les protections d’épissure utilisées en tant que PA et PDZ,
- toutes données complémentaires (optimum, typologie de la zone…) utiles afin
d’optimiser la mise à disposition des ressources (nombre de coupleurs et
raccordement des branches).
III.6.1.2.1 Le pointage
Cette étape consiste à identifier sur un fond de plan le nombre d’équivalents
logements dans chaque immeuble et à en déduire le potentiel de clients PON pour
chaque adresse.
On ne fera pas de distinction entre les résidentiels, les professionnels, en ce qui
concerne le mode d’adduction. Parfois les câblages cuivre sont distincts, on ne
refera pas deux câblages FO distincts.
Règles de pointage et calcul du nombre d’équivalents logements à raccorder :
Sont à prendre en compte les logements Résidentiels (1 FO par logement), les
locaux professionnels (1 FO par local professionnel).
Équivalents Logements = Nombre de logements résidentiels + Nombre de locaux professionnels
III.6.1.2.2 Casage, calcul des zones d’influence de PA
Tous les immeubles allant jusqu’à 200 équivalents logements doivent être pris en
compte dans le casage.
Au-delà de 200 équivalents logements, les BTI de ces immeubles ont la
fonctionnalité d’un PDZ (C1 dans le BTI) et seront donc raccordés directement sur un
PEP. Le nombre d’équivalents logements n’est donc pas à prendre en compte pour
le casage pour ce type d’immeubles. Leur besoin en fibre n’est pas à intégrer dans le
calcul de la D1.
47
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
Important : il faudrait s’assurer que ces immeubles correspondent à une seule
copropriété et de ce fait on aura bien un PRI avec des C1 donc un PDZ. Cela
impacte uniquement le câble de transport. Sinon on devra placer autant de PRI que
de copropriétés, qui seront alors traités derrière un PE si ces copropriétés ont moins
de 200 équivalents logements. Cela impacte le dimensionnement des D1.
Zone d’influence d’un PA :
Pour rappel, le PE est le point d’interface entre distribution de niveau 1 et distribution
de niveau 2. Il est situé dans une chambre à proximité des immeubles à desservir.
Physiquement, dans la majorité des cas le PE sera réalisé en utilisant une protection
d’épissure optique (PEO) taille 2 144 FO FTTH (fournisseur 3M). Cette protection
d’épissures optiques comporte :
- une entrée double acceptant 2 câbles de diamètre maximum 18mm, cette
entrée double sera utilisée afin de raccorder le câble de distribution1,
- 12 ou 16 entrées/sorties de diamètre 6 à 12mm, celles-ci permettront de
raccorder les immeubles situés dans la zone adressable de ce PA. (distribution 2),
- elle comprend également 12 cassettes compatibles avec l’implantation de
coupleurs 1:8 (un par cassette).
o Règle 1 : afin de prendre en compte les évolutions éventuelles de
l’habitat on dimensionnera les zones d’influence de PA en limitant à 10 le
nombre de BTI raccordables à un PA.
o Règle 2 : Les cassettes supplémentaires pouvant être affectées au
lovage et stockage des fibres non raccordées ou bien dans le cas de coupure
du câble en amont ou en aval du PA, pour la gestion des soudures. On pourra
donc, sur un PA donné, raccorder au maximum 48 clients couplés au PA.
Identification des immeubles :
Le pointage étant réalisé, l’étape suivante consiste à identifier 2 catégories
d’immeubles :
- les immeubles de petite taille (moins de 6 équivalents logements) où
l’implantation d’un BTI d’immeuble n’est pas justifiée,
48
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
- les immeubles plus importants (à partir de 6 équivalents logements) où des
BTI devront être implantés.
Identification des immeubles de faible capacité < 6 équivalents logements -
principes de raccordement de ces immeubles au BTI.
Ces équivalents logements seront raccordés au réseau FTTH via un BTI multi-
immeubles, dit BTI d’îlot. La taille de ces BTI sera limitée à 24 équivalents
logements.
Identification des immeubles de capacité ≥ 6 équivalents logements -
principes de raccordement de ces immeubles au PA.
Pour achever le dimensionnement de la zone d’influence, il conviendra de rattacher
les immeubles équipés de PA à concurrence du nombre d’entrées /sorties qui restent
disponibles.
III.6.1.2.3 Dimensionnement de la Distribution de Niveau 1
La distribution de niveau 1 prendra en compte les besoins pour 100% des
équivalents logements, ainsi l’évolutivité du réseau sera assurée sans pose d’un
nouveau câble.
Zone d’influence d’un PDZ :
Pour rappel, le PDZ est le point d’interface entre le transport et la distribution de
niveau 1. Il se trouve à un point de convergence de l’arborescence de génie civil en
amont d’un groupe de PE, qui lui sont rattachés.
La zone d’influence (ZI) du PDZ regroupe un nombre entier de zones d’influence de
PE.
La zone d’influence d’un PDZ est déterminée par la capacité du contenant.
Il conviendra de choisir la taille de PEO la plus adaptée à la zone de PDZ ciblée.
o Casage
o Délimitation de la zone d’influence d’un PDZ
49
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
FIGURE 24: Casage et délimitation zone PDZ
La zone comprend 10 PE. Le nombre inscrit dans chaque zone de PE indique le
nombre de fibres utiles nécessaires en distribution de niveau 1 pour alimenter
chaque PE.
Dimensionnement des câbles de distribution de niveau 1
50
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
FIGURE 25: Dimensionnement câbles de distribution
L’exemple de la figure ci-dessus indique le nombre de fibres utiles nécessaires au
raccordement de chaque PE, ce qui permettra de déduire la capacité des câbles de
distribution de niveau 1. Sur la figure 12 on a représenté le réseau de distribution 1
nécessaire au raccordement de tous les PE de la zone.
Conception des réseaux de distribution de niveau 1 - préconisations :
1) On privilégiera, la pose de câbles de FO de grosse capacité et on utilisera la
technique du piquage en affectant un nombre entier de modules 12 FO à chaque PE,
ceci permettra : de générer des fibres de réserve utilisables en cas de dérangement,
de limiter les risques de dérangement lors des interventions en PE.
51
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
2) On privilégiera, quand le choix est possible, l’utilisation de chambres sous
trottoir afin de faciliter les ré-interventions
3) Le PE sera toujours placé à l’extérieur des immeubles (sauf cas d’un PE
destiné à l’usage unique d’un immeuble) dans une chambre dont les dimensions et
l’encombrement sont compatibles avec la protection d’épissure utilisée et les loves
de câbles induits.
4) Le ratio « nombre de PE / PDZ » est très variable en fonction du type
d’habitat. Au vu des sites en prédéploiement un ratio de l’ordre de 6 à 10 PE pour
une zone de PDZ de 1200 équivalents logements est correct.
III.6.1.2.4 Dimensionnement du transport
Cette partie de réseau bénéficiant des 2 niveaux de couplage, un nombre réduit de
FO permet d’alimenter le PDZ. Ainsi, la partie transport sera, elle aussi,
dimensionnée à 100%.
Dimensionnement des besoins en transport pour chaque PDZ
Deux méthodes sont proposées pour la conception des transports FTTH :
La méthode « pas à pas » qui repose sur une approche plus fine qui nécessite, au
préalable sur la zone à traiter, le dimensionnement exhaustif des zones d’influence
de PE,
La méthode « globale » qui repose sur une approche prenant en compte les
potentiels par ZSR cuivre, méthode à réserver pour les zones annexes à celles
retenues pour un déploiement immédiat. Elle permet de prévoir les modules
supplémentaires à mettre en attente pour le traitement ultérieur de ces zones
annexes.
On préconise la solution « pas à pas » qui permet :
- Une meilleure exploitation des PDZ.
- Un dimensionnement plus fin des transports.
52
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
Le nombre de fibres nécessaires sera obtenu par addition du nombre de fibres utiles
nécessaires pour chaque zone de PE, divisé par 8 pour tenir compte du niveau de
couplage C1 en PDZ.
Nbre FO transport = Arrondi sup. [(Σ Nbre FO utiles (FU) nécessaires en distri 1) /8]
Conception de l’axe de transport - préconisations :
1) La conception et le dimensionnement des câbles de transport se feront en
prenant en compte l’ensemble des PDZ (du programme en cours et à venir)
accessibles par un même axe de GC. Dans la mesure du possible, on se limitera à
des câbles de 144 FO (exceptionnellement 288FO).
2) Dans le cas où le transport dessert plusieurs PDZ, il sera opportun de placer
les contenants en dehors du parcours du transport. Cette pratique :
• limite les risques de dérangement, toute intervention dans un PDZ (pose d’un
nouveau C1 par exemple) ne pourra affecter les autres PDZ alimentés par ce même
câble de transport,
• permet de rechercher pour le PDZ un emplacement facile d’accès (on
privilégiera les chambres sous trottoir),
• simplifie la conception par l’affectation exclusive de l’ensemble des cassettes
et sorties de la PEO à la desserte de la zone d’influence du PDZ.
53
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
FIGURE 26: Transport – principe de raccordement
Le câble PEP – PDZ sera dimensionné en fonction du nombre de modules calculé
au début de ce paragraphe. Pour une zone d’environ 1200 équivalents logements le
câble est un 24 FO et la boite une PEO T3. Tous les modules seront tirés jusqu’au
PDZ.
3) Aucune ressource FO supplémentaire ne devra être réservée en transport à
des fins de maintenance. En effet, le câble étant dimensionné à 100% de la zone, les
méthodes de dimensionnement étant larges et l’affectation des FO à un PDZ se
faisant par module 12 FO entier, des FO de réserve seront de fait présentes. Tout
surdimensionnement est donc à proscrire.
III.6.1.2.5 Cas particulier des zones directes «proches» dites
zone «0» : Lieu d’implantation du niveau de couplage C1
Solution 1 : C1 dans l’armoire passive au NRO
Dans cette architecture, les coupleurs C1 seront installés dans l’armoire passive
implantée au NRA.
54
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
Solution 2 : C1 en PDZ positionné en infra au NRO ou en chambre
L’ingénierie applicable sera alors totalement identique à celle mise en œuvre pour
les clients derrière PDZ.
Les zones directes représentant un nombre important d’équivalents logements, la
couverture PON de ces zones peut requérir l’implantation de plusieurs PDZ. La zone
directe sera donc en pratique divisée en plusieurs zones, chacune étant traitée
séparément.
Il n’y a pas de préconisation a priori, ce sont les éléments « terrain » qui amèneront à
choisir l’emplacement des PDZ.
La solution C1 en PDZ (placé en chambre) en réduisant le nombre de fibres
nécessaires en sortie de NRO pour assurer la liaison NRO-PDZ sera d’autant plus
conseillée :
- que les PE et l’emplacement possible pour le PDZ sont éloignés du NRO,
- que le GC à emprunter est saturé,
- si la chambre possible pour le siège de PDZ est facile d’accès et n’est pas
saturée.
III.6.1.2.6 Règle de mise en place et d’allumage des
coupleurs C1
Lors du déploiement du réseau
Du fait des coûts encore élevés des ports PON, la conception du réseau recherchera
donc à optimiser l’utilisation de ces cartes, c'est- à-dire s’approcher le plus possible
des 64 clients raccordés par port, l’objectif minimum étant un taux de remplissage de
50% des équipements PON.
En règle générale, pour un PDZ correctement dimensionné (aux environs de 1200
équivalents logements et 8 à 10 PE), on implantera 3 C1 au PDZ. Les 24 branches
de ces coupleurs C1 seront raccordées (par fusion) aux câbles de distribution 1, ce
55
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
qui permettra d’allumer en moyenne 3 fibres par PE. Si le PDZ comprend plus de 8
PE, on n’implantera pas de C1 supplémentaire mais on réduira le nombre de fibres
allumées sur les PE de moindre potentiel.
On pourra adapter le nombre de C1 en fonction des PRI prévisibles sur la zone. Par
exemple si on a de nombreux PRI d’ilot, le troisième C1 ne sera peut être pas utile.
On pourra aussi privilégier les PE ayant beaucoup d’immeubles d’au moins 25
équivalents logements.
III.6.2 Évolutivité du réseau
Bien que cette modalité ne porte que sur le transport et la distribution de niveau 1, on
parlera ici de l’évolutivité du NRO jusqu’au BTI
- Le BTI est dimensionné en fonction de la taille de l’immeuble et permet de
desservir tous les clients à 100%. Le taux de pénétration n’a donc aucun impact sur
le dimensionnement de ce point fonctionnel.
- Les règles d’implantation des coupleurs C2 au-delà du taux de pénétration
initial de 25%, permettent de ne jamais revenir poser un nouveau câble sur la partie
distribution de niveau 2. Les règles de dimensionnement des liaisons PA-BTI
permettent donc de s’affranchir de toute sensibilité au taux de pénétration.
- Les zones d’influence de PA ayant été dimensionnées pour couvrir les
besoins jusqu’au taux de pénétration 25% (en particulier, 48 clients maximum
couplés au PA), il peut se faire que des saturations interviennent au niveau de ce
contenant si la demande est très forte. En fonction du contexte et des perspectives
d’évolution de la demande dans la zone du PA, il conviendra alors de :
o Dans un 1er temps, récupérer les ressources en C2 au niveau du
PE, issues des résiliations,
o En dernier recours, implanter des C2 au niveau de PRI d’immeubles
ou d’îlots, puis muter des clients initialement couplés au PE.
56
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
- La distribution 1 ayant été dimensionnée au taux de pénétration 100%,
l’évolutivité sur cette partie se fera naturellement et il n’y aura pas d’extension à
réaliser sur ce segment de réseau.
- Au niveau de PDZ, le fait de prendre une PEO T3 pour environ 1200
équivalents logements permet d’atteindre le taux de pénétration de 100%
- Le transport a été dimensionné pour 100% de la taille des zones d’influence
de PDZ. Quel que soit le taux de pénétration réel, aucune extension de réseau ne
sera nécessaire.
III.6.3 Génie civil
La logique d’optimiser les coûts, nous conduit à éviter, autant que peut se faire, de
créer du GC.
57
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
TROISIEME PARTIE :
DEPLOIEMENT DE LA
SOLUTION
58
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
CHAPITRE I : ETUDE ET DEPLOIEMENT DU RESEAU D’ACCES FTTH
I. Présentation du site prière utiliser une couleur unique pour
délimiter la citée
FIGURE 27: Cité des arts
59
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
NOM DU SITE Cité des Arts TYPE : Cité
COORDONNEES 5.3463827 -4.0039916,17
GPS
VILLE/COMMUNE ABIDJAN COCODY
TYPE Immeuble X
D’HABITATION
Maison basse X
Duplex X
TABLEAU 8: Présentation du site
II. Ingénierie du réseau d’accès de la cité
FIGURE 28: Ingénierie du réseau d’accès
III. Etude la cité
Pointage
60
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
26 Equivalent logement
12
24
4
12
12
18
24
5
12
12
7
4
24
24
12
FIGURE 29: Pointage des logements de la cité
Le site comprend 220 logements repartis comme suit :
o 20 villas pavillonnaires
o 6 bâtiments de 12 appartements
o 1 bâtiment de 18 appartements
o 4 bâtiments de 24 appartements
o 1 immeuble de 26 appartements
Il faut noter que les bâtiments sont constitués de blocs de 6 logements avec chaque
bloc disposant de sa colonne montante.
Découpage et dimensionnement
61
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
Distribution 1 Equivalent logement
Distribution 2 Point de branchement
Chambre de tirage
26
Point d’aboutement
Pb7/6FO Itinéraire câble
Pb8/6FO
12
72FO/36U
Pb9/6FO Pb10/6FO Point de distribution de zone
5 24 Pb11/6FO
Pb1/6FO Pb12/6FO
Pb2/6FO
Pb3/6FO
12
Pb20/6FO
Pb21/6FO
12
144FO/72U
Pb6/6FO Pb17/6FO
18
24
Pb18/6FO Pb19/6FO
Pb15/6FO
Pb16/6FO
Pb13/6FO 12
Pb14/6FO
12
5
7
Pb3/6FO Pb4/6FO
24
Pb5/6FO
4 Pb8/6FO Pb6/6FO
Pb9/6FO
24 Pb10/6FO
Pb11/6FO
Pb1/6FO Pb2/6FO
12
144FO/TOD1
144FO/TOD2
PDZ
FIGURE 30: Casage et dimensionnement de la cité
Sachant que la distribution ne peut contenir que 144 brins de fibre au PDZ et
connaissant le nombre d’équivalent logement (220 logements), le découpage de
notre site se fera en deux blocs avec une distribution pour chacun de ces blocs soit
144Fo par bloc.
Quantification
Nous utiliserons pour le déploiement les matériels suivant :
- 6 PA
- 2 Câbles 144FO
- 1 Câbles 72FO
- 2 Câbles 48FO
- 32 Câbles 6FO
- 35 PB
62
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
L’étude et le déploiement concernant l’immeuble des 26 appartements fera l’objet
d’une étude particulière qui sera détaillée dans le chapitre suivant.
63
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
CHAPITRE II: DEPLOIEMENT VERTICAL
II.1 Architecture de déploiement
FIGURE 31: Description générale de l’immeuble
II.2 Dimensionnement du réseau
Sachant que le nombre de logement est de 26, le câblage de l’immeuble se fera à
partir d’un boitier de transition d’immeuble de 36FO sur lequel seront raccordé les
brins provenant des PB.
Nous rappelons ici qu'il est impossible (techniquement et économiquement) que le
nombre de fibres remontant au point de branchement soit égal à la somme des
usagers potentiels. Cette constatation n'impose que l'architecture du réseau de
desserte présente des points de flexibilité.
Connaissant le nombre d'usagers ou abonnés, dans le cadre de ce projet, nous
devons alors déterminer le nombre de PB, de PTO et de câble FO pour notre réseau.
26 logements/ 6 brins=4.33 points de branchement. (5 PB de 6 brins)
64
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
Le raccordement des abonnés se fera par accès directe du câble de branchement
optique du point de branchement en conduite jusqu’au salon des différents
appartements dans la boite dérivation encastré; continuité assurée le long des
angles, des plaintes et autour des portes jusqu’à la TV ou sera fixée la PTO. La
distance séparant la boite de dérivation au PB est environ 50m avec 1 PTO par
logement
II.3 Position des PB
Tableau 9 : Disposition des PB dans l’immeuble
65
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
II.5 Plan de câblage
Figure 32 : Plan de câblage immeuble
66
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
CHAPITRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA SOLUTION ET COUT DU PROJET
III.1 Mise en œuvre
La mise en œuvre nécessite les étapes ci-dessous :
Réalisation de l’étude
Tirage du câble FO du PDZ vers les chambres de tirages de l’immeuble, des
différents bâtiments et des villas
Fixation des PB en façade dans les bâtiments et sur poteau
Fixation du BTI dans l’immeuble
Pose des fourreaux dans l’immeuble
Tirage du câble FO du BTI jusqu’à l’emplacement différents PB de l’immeuble
Fixation des PB
Passage du câble de branchement du PB jusqu’au domicile des usagers
Fixation des PTO et fusion chez les abonnés
Test de recette
67
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
III.2 Evaluation financière
Description Unité Quantité C.U (CFA) C.T (CFA)
Boitier d'étage + K7 Pce 4 30000 120000
Prise Terminale Optique (PTO) 1 sortie Pce 26 5000 130000
Boitier transition immeuble, PBO T2 + K7 Pce 1 165000 165000
Câble Vertical G657 1FO Ivoire M 1500 350 525000
Câble Vertical G657 48FO Ivoire M 30 327 9810
Gaine orange M 30 600 18000
Sleeve (Smoov) 40 mm U 26 1000 26000
Pose et tirage colonne montante M 30 500 15000
Tirage sous conduite M 1500 500 750000
Fixation sur façade M 6 200 1200
Raccordement plus mesure U 26 15000 390000
Main d’œuvre ingénieur 450000
Main d’œuvre Techniciens 250000
Formation 450000
Fournitures diverses 50000
Total 3 350 010
Tableau 10 : Estimation financière du projet
68
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
CONCLUSION
La réalisation de ce projet nous a permis de comprendre toutes les difficultés
inhérentes aux différentes étapes d’exécution d’un projet à savoir l’étude, la
planification, le déploiement et la formation. Au nombre de ces difficultés nous
avons : le choix de la solution, le passage des câbles et la gestion des ressources
Pour faire face à toute ces difficultés, il nous a fallu avoir recours à nos
connaissances théoriques, collaborer avec des personnes expérimentées et parfois
à faire appel à notre ingéniosité.
Nous retenons que la FTTH constitue aujourd’hui le socle et le pilier qui permet au
réseau d’accès de monter en haut débit.
Ce travail étant une œuvre humaine, ne manque pas d'imperfections. C'est pourquoi
nous restons ouverts à toutes vos suggestions et remarques afin à des fin
d’amélioration d'atteindre la perfection.
69
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
GLOSSAIRE
ADSL : Assymetric Digital Subscriver Line : Technologie de transmission de signaux
numériques sur les paires cuivre utilisées dans le réseau de distribution du RTC
Antenne : dispositif servant à émettre et à recevoir des ondes radio. L’antenne
habituellement conçue pour concentrer les ondes reçues ou émises.
AON : Active Optical Network : Architecture de réseau FTTH mettant en œuvre une
double étoile active et des composants électroniques actifs dans le réseau d’accès.
B
Bande passante : désigne la capacité de transmission d’une liaison. Elle détermine
la quantité d’information en bite/s qui peut être transmise simultanément
Base station : station de base Son rôle est de commander un certain nombre
d’antenne
BLR : Boucle locale radio
BPI : Boîtier de Pied d’Immeuble ; Composant de la couche optique passive
positionné en pied d’immeuble et permettant de desservir les usagers de l’immeuble.
B-PON : Broadband Passive Optical Network
Cloud : recouvre l'ensemble des solutions de stockage distant
CPL : Courant Porteur de Ligne
Cœur : Centre de la fibre à travers lequel la lumière est guidé
Débit : Vitesse de transmission de l’information
Dispersion : correspondant à l'existence de différentes vitesses possibles pour la
propagation des ondes.
70
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
DSLAM : Digital Subscriber Line Access Multiplexer ; Équipement d’interface
permettant de concentrer les accès ADSL au niveau du répartiteur cuivre du NRA
DTI : Dispositif de Terminaison d’intérieur ; Equipement de la couche optique passive
décrivant la prise terminale d’abonné également dénommée Point d’Accès (PA)
DWDM : Dense Wawelength Division Multiplexing; Technique de multiplexage
(optique) en longueur d’ondes permettant de véhiculer plusieurs signaux sur la
même fibre optique, par la mise en œuvre de plusieurs (jusqu'à 100 canaux) dans la
même fenêtre de transmission (1550 nm)
E-PON : Ethernet Passive Optical Networks ; Technologie de réseau PON
standardisée par l’IEEE (IEEE 802.3ah) et fondée sur la norme Ethernet
Faisceaux : Flux unidirectionnel d’onde radio concentrée dans une direction
particulière
FH: Faisceau Hertzien
FTTB : Fiber To The Building Architecture de réseau de distribution sur fibres
optiques où la terminaison optique est située en pied d’immeuble et dessert les
logements situés dans l’immeuble (10 à 50)
FTTC : Fiber To The Curb Architecture de réseau de distribution sur fibres optiques
où la terminaison optique est située sur le trottoir et dessert un faible nombre de
logements (10 à 20)
FTTD : Fiber To The Desk Architecture de réseau de distribution sur fibres optiques
où la terminaison optique est située dans le bureau
FTTH : Fiber To The Home Architecture de réseau de distribution sur fibres optiques
où la terminaison optique est située dans le logement des usagers
FTTLA : Fiber To The Last Amplifier Architecture de réseau de distribution hybride
sur fibres optiques et coaxial (HFC), où la terminaison optique est située au dernier
amplificateur. La distribution finale est réalisée sur câble coaxial
71
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
FTTN : Fiber To The Node Architecture de réseau de distribution sur fibres optiques
où la terminaison optique dessert un nombre important de logements (250 à 1000)
G
G-PON : Gigabit-capable Passive Optical Network Technologie de réseau PON
standardisée par l’ITU-T
HDSL : High-bit-rate digital subscriber line est une technologie de connexion
INTERNET DSL symétrique, la vitesse de transfert d'Internet vers le PC (dowload)
est la même que celle de l'ordinateur vers le WEB
HFC : Hybrid Fiber Coax Architecture de réseau large bande basée sur l’introduction
de technologies optique sur le transport, tout en assurant la distribution finale vers
les abonnés par des technologies coaxiales arborescentes
LAN : Local Area Network ce terme désigne un réseau informatique local qui relie
des ordinateurs dans une zone limitée, comme une maison, école, laboratoire
informatique, ou immeuble de bureaux.
Modem : abréviation de modulateur-démodulateur c’est un appareil qui transforme
les signaux numériques en signaux analogiques et vice versa
NRA : Noeud de Raccordement d'Abonné Terme utilisé dans le contexte du
dégroupage pour désigner le local de raccordement associé au CAA
NRO : Nœud de Raccordement Optique
OLT : Optical Line Termination Terminaison optique du réseau d’accès située dans
le central de rattachement
72
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
ONT : Optical Network Termination Terminaison optique du réseau
PA : Prise d’aboutement
PB : Point de branchement des abonnés
PC : Physical Contact Désigne une technique utilisée dans les raccordements fibre
optique et qui permet de mettre en contact et d'aligner deux extrémités de fibre
Pigtail : Les pigtails ont les mêmes caractéristiques que des cordons, à la différence
qu'ils ne sont connectorisés que d'un seul côté. Ils permettent le raccordement par
épissurage mécanique ou fusion
PON : Passive Optical Network Réseau Optique Passif - Terme générique
regroupant les architectures de réseau d’accès de type partagé et fondé sur les
technologies fibres optiques. Elles se déclinent généralement en PON-RF
(radiofréquence), E-PON (PON Ethernet) et A-PON (PON ATM)
PR : Point de Raccordement d’usagers Noeud de l'architecture du réseau d'accès à
partir duquel sont branchés les clients
PTO : Prise Terminal Optique
P2P : Point à Point Terme utilisé pour décrire une architecture de réseau Point à
Point
SC/APC : Physical Contact Connecteur SC de type APC
TRIPLE PLAY : Services Internet, Voix et TV
VOD : Vidéo à la demande
VSAT: Very Small Aperture Terminal; terminal à très petite ouverture d’antenne
désigne un système de télécommunication qui utilise des antennes paraboliques
73
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
W
WIMAX: Worldwide Interoperability for Microwave Access désigne un standard de
communication sans fil.
74
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
LISTE DES FIGURES
N° DESCRIPTION PAGE
1 La Cité des Arts 7
2 Download théorique en fonction de la distance modem/NRA 12
3 Architecture d’un réseau WIMAX 15
4 Architecture d’un réseau VSAT 17
5 Transmission de l’information à travers une fibre optique 19
6 Transmission de l’information à travers une fibre optique 19
7 Structure d’une fibre optique 24
8 types de fibre optique 27
9 Taille des fibres optiques 27
10 Affaiblissement en fonction de la longueur d’onde 29
11 réfraction de la lumière 30
12 Câble à fibre optique 31
13 Câbles intérieur 33
14 Câbles extérieurs conduite 33
15 Câbles extérieurs aérien 34
16 Câbles intérieur-extérieur 35
75
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
17 Liaisons de données à fibre optique 36
18 Système de transmission 36
19 Différentes sources pour les émetteurs 37
20 Bilan énergétique 39
21 Architecture point à point (P2P) 40
22 : Architecture point à multipoint passif (PON) 41
23 Architecture point à multipoint actif (AON) 41
24 Casage et délimitation zone PDZ 50
25 Dimensionnement câbles de distribution 51
26 Transport – principe de raccordement 54
27 Cité des arts 59
28 Ingénierie du réseau d’accès 60
29 Pointage des logements de la cité 60
30 Casage et dimensionnement de la cité 61
31 Description générale de l’immeuble 63
32 Plan de câblage immeuble 65
76
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
LISTE DES TABLEAUX
N° DESCRIPTION PAGE
1 Débit nécessaire par logement 13
2 avantages et inconvénients de la WIMAX 14
3 Avantages et inconvénients des VSAT 16
4 Forces et faiblesses de la fibre optique 18
5 Tableau comparatif des technologies d’accès WIMAX, Vsat, 20
FO
6 Normes des fibres optiques 35
7 comparatif des architectures PON, P2P et AON 42
8 Présentation du site 59
9 Disposition des PB dans l’immeuble 64
10 Estimation financière du projet 67
77
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
BIBLIOGRAPHIE
DOCUMENTS :
- GUIDE TO THE FIBER OPTICS & PREMISES CABLING
- Les Réseaux de Guy Pujolle, 4e Edition, Eyolles, 1088 pages
- Mémoire d’ingénieur << EXTENSION DE LA COUVERTURE VHF DE
L’ASECNA EN COTE D’IVOIRE>> de M. DJILE Guy-Fabre
- Support de cour << COUR DE FH >> de M. N’GUESSAN REMI
78
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
WEBOGRAPHIE
SITES INTERNET :
http://www.lafibresfr.fr/page.php?url=pourquoi_la_fibre visité le
12/01/2018
https://www.memoireonline.com/11/15/9288/m_Deploiement-d-
un-reseau-d-acces-a-fibres-optiques-dans-la-commune-de-
Matete-par-la-technologie-FTTH23.html visité le 12/01/2018
https://www.techniques-ingenieur.fr/base-
documentaire/archives-th12/archives-reseaux-et-
telecommunications-tiate/archive-1/boucle-locale-te7400/ visité
le 27/01/2017
http://www.leclere.fr/etude-de-cas/solution-fil-acces-internet-
par-faisceau-hertzien/ visité le 27/02/2018
http://www.vendeenumerique.fr/comprendre-le-numerique/les-
solutions-alternatives/le-wimax/ visité le 01/03/2018
https://fr.wikipedia.org/wiki/WiMAX visité le 03/02/2018
https://fr.wikipedia.org/wiki/ADSL visité le 03/02/2018
79
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
ANNEXES
80
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
ANNEXE 1 : CHAMBRE LA PLUS PROCHE
On ne voit pas la chambre
81
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
ANNEXE 2 : ADDUCTION AU SOUS-SOL
82
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
ANNEXE 3 : CHEMINEMENT VERS BTI
83
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
ANNEXE 4 : CHEMINEMENT VERS BTI
84
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
ANNEXE 5 : EMPLACEMENT BTI AU SOUS-SOL
85
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
ANNEXE 6 : HAUT DE LA COLONNE MEZZANINE
86
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
ANNEXE 7 : EMPLACEMENT PB
87
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
ANNEXE 8 : EMPLACEMENT PB
88
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
ANNEXE 9 : POINT DE BRANCHEMENT OPTIQUE
(3M)
89
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
ANNEXE 10 : CABLE OPTIQUE DE DIAMETRE 6mm
90
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
ANNEXE 11 : PRISE TERMINALE OPTIQUE
91
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
Table des matières
Dédicace................................................................................................................................ 1
Remerciement....................................................................................................................... 2
SOMMAIRE............................................................................................................................ 3
INTRODUCTION..................................................................................................................... 5
PREMIERE PARTIE : CADRE D’ETUDE...............................................................................6
CHAPITRE I : PRESENTATION DU PROJET ET DES RESEAUX D’ACCES....................7
I.1 Présentation du projet....................................................................................................7
I.1.1 Le projet...............................................................................................................................7
I.1.2 Objectif du projet.................................................................................................................7
I.1.3 Intérêt du projet...................................................................................................................7
I.1.4 Situation géographique de l’immeuble.............................................................................8
I.2 Présentation des réseaux d’accès..................................................................................9
I.2.1 Définition du réseau d’accès.............................................................................................9
I.3 Méthodes de réalisation..................................................................................................9
I.3.1 Câble métallique.................................................................................................................9
I.3.2 le câble fibre optique.......................................................................................................10
I.3.3 Boucle locale par courants porteurs en ligne (CPL)...............Erreur ! Signet non défini.
I.3.4 Boucle locale radio BLR...................................................................................................10
I.4 Méthodes d’accès......................................................................Erreur ! Signet non défini.
CHAPITRE II : ETUDE, CRITIQUE DE L’EXISTANT ET PROBLEMATIQUE....................11
II.1 Présentation et critique de l’existant............................................................................11
II.2 Problématique.............................................................................................................12
CHAPITRE III : PROPOSITIONS DE SOLUTIONS ET CHOIX DE LA SOLUTION.............14
III.1 Les différentes techniques de mise en œuvre possible..............................................15
II.1.1 Première technique de mise en œuvre : L’ADSL..................Erreur ! Signet non défini.
II.1.1.1 Présentation de l’ADSL..........................................................Erreur ! Signet non défini.
II.1.1.2 Forces et faiblesses................................................................Erreur ! Signet non défini.
II.1.1.3 Architecture du réseau...........................................................Erreur ! Signet non défini.
II.1.2 Deuxième technique de mise en œuvre : La WIMAX.................................................15
II.1.2.2 Forces et faiblesses.....................................................................................................15
II.1.2.3 Architecture du réseau.................................................................................................16
92
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
II.1.3 Troisième technique de mise en œuvre : Les faisceaux hertziensErreur ! Signet non
défini.
II.1.3.1 Présentation d’un faisceau hertzien.....................................Erreur ! Signet non défini.
II.1.3.2 Forces et faiblesses des faisceaux hertziens.....................Erreur ! Signet non défini.
III.1.3.3 Schéma d’une liaison par FH...............................................Erreur ! Signet non défini.
II.1.4 Quatrième technique de mise en œuvre : La technologie VSAT..............................17
III.1.4.1 Présentation des VSAT..............................................................................................17
III.1.4.2 Forces et faiblesses des VSAT..................................................................................17
III.1.4.3 Architecture d’un réseau VSAT.................................................................................18
III.1.5 Cinquième technique de mise en œuvre : La Fibre Optique....................................19
III.1.5.1 Présentation de la fibre optique.................................................................................19
III.1.5.2 Forces et faiblesses de la fibre optique....................................................................19
III.1.5.3 Schéma d’une fibre optique.......................................................................................20
III.2 Choix de la solution retenue.......................................................................................21
DEUXIEME PARTIE : ETUDE DE LA SOLUTION RETENUE.............................................23
CHAPITRE I : ETUDE GENERALE DE LA FIBRE OPTIQUE..............................................24
I.1 La fibre optique............................................................................................................. 24
I.1.1 Types de fibre optique......................................................................................................24
I.1.1.1 La fibre multimode.........................................................................................................26
I.1.1.2 La fibre optique plastique..............................................................................................27
I.1.1.3 La fibre monomode........................................................................................................27
I.1.2 Caractéristique de la fibre optique..................................................................................29
I.2 Structure et normes de la fibre optique.........................................................................32
I.2.1 Câble à fibre optique...................................................................Erreur ! Signet non défini.
I.2.2 Normes des fibres optiques.............................................................................................34
CHAPITRE II : PANORAMA DES RESEAUX FTTX............................................................37
II.1 Panorama des architectures de desserte de type fttx................................................37
II.1.1 Types d'architectures déployées.......................................Erreur ! Signet non défini.
II.1.2 Topologies intermédiaires fttx...................................................................................38
II.1.3 Topologies ftth..................................................................Erreur ! Signet non défini.
II.2 Tests recette et mise en service..............................................Erreur ! Signet non défini.
II.2.1 Test et recette du câblage d’immeuble...................................Erreur ! Signet non défini.
II.2.2 Test et recette de l'installation d'usager..................................Erreur ! Signet non défini.
CHAPITRE III: LE RESEAU FTTH.......................................................................................41
93
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
III.1 Point à point (P2P).....................................................................................................41
III.1.1 Forces et faiblesses........................................................................................................41
III.1.2 Schéma d’une architecture P2P...................................................................................41
III.2 Point à multipoint passif (PON)...................................................................................41
III.2.1 Forces et faiblesses........................................................................................................41
III.2.2 Schéma d’une architecture PON..................................................................................42
III.3 Point à multipoint actif (AON)......................................................................................42
III.3.1 Forces et faiblesses........................................................................................................42
III.3.2 Schéma d’une architecture AON..................................................................................42
III.4 Architecture proposée.................................................................................................43
III.4.1 Comparaison des trois architectures............................................................................43
III.5 Architectures retenues................................................................................................43
TROISIEME PARTIE : DEPLOIEMENT DE LA SOLUTION................................................60
CHAPITRE I : NORME ET PRINCIPE DE DEPLOIEMENT D’UN RESEAU FTTH
VERTICAL............................................................................................................................ 61
I.1 Principe de Déploiement...............................................................................................61
I.1.1 Les motivations d’une mutualisation..................................Erreur ! Signet non défini.
I.2 Architecture du câblage d’immeuble.......................................Erreur ! Signet non défini.
I.2.1 Boitier de pied d’immeuble (BPI)........................................Erreur ! Signet non défini.
I.2.2 Points de raccordement (PR).............................................Erreur ! Signet non défini.
I.2.3 Points d’abonnés (PA).......................................................Erreur ! Signet non défini.
I.2.4 Typologies des immeubles.................................................Erreur ! Signet non défini.
I.2.5 Architecture pour les petits immeubles...............................Erreur ! Signet non défini.
I.2.6 Choix d’un système de câblage.........................................Erreur ! Signet non défini.
I.3 La pose du câblage....................................................................Erreur ! Signet non défini.
I.4 Dimensionnement......................................................................Erreur ! Signet non défini.
CHAPITRE II: SYNOPTIQUE, MISE EN ŒUVRE ET COUT DU PROJET..........................64
II.1 Architecture de déploiement........................................................................................64
II.2 Dimensionnement du réseau.......................................................................................64
II.3 Position des PB.............................................................................................................66
II.4 Mise en œuvre...............................................................................................................66
II.5 Plan de câblage.............................................................................................................67
II.6 Evaluation financière....................................................................................................68
CONCLUSION...................................................................................................................... 69
94
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
LISTE DES FIGURES........................................................................................................... 75
LISTE DES TABLEAUX.......................................................................................................77
BIBLIOGRAPHIE..................................................................................................................78
WEBOGRAPHIE................................................................................................................... 79
ANNEXES............................................................................................................................. 80
95
Mémoire de fin cycle ingénieur RIT *CEFIVE 2016-2017* Franck KRA
Vous aimerez peut-être aussi
- FTTH Comprendre Le Déploiement de La Fibre en 10 Minutes.01 PDFDocument24 pagesFTTH Comprendre Le Déploiement de La Fibre en 10 Minutes.01 PDFoualou100% (3)
- Etude D'un Système FTTH (Fiber To The Home)Document76 pagesEtude D'un Système FTTH (Fiber To The Home)asmaa dine88% (8)
- Rapport de StageDocument37 pagesRapport de StageTb Ayda83% (40)
- FTTH PDFDocument87 pagesFTTH PDFkarim100% (2)
- La Technologie Fiber To The Home FTTHDocument15 pagesLa Technologie Fiber To The Home FTTHNizar MouhssinePas encore d'évaluation
- Étude Et Installation Du Réseau Optique FTTH - Présenté Par DEHMANI Et NEBBACH. Encadré Par MAZOUZIDocument71 pagesÉtude Et Installation Du Réseau Optique FTTH - Présenté Par DEHMANI Et NEBBACH. Encadré Par MAZOUZIBOUZANA Elamine62% (13)
- PFE Soufiane Hanafi FTTH V1convertiDocument74 pagesPFE Soufiane Hanafi FTTH V1convertiHamza Azgaoui100% (3)
- Guide Déploiements FTTHDocument24 pagesGuide Déploiements FTTHtest100% (1)
- Memoire FTTHDocument19 pagesMemoire FTTHzoomtn83% (6)
- Memoire Fin de Cycle 1Document107 pagesMemoire Fin de Cycle 1Benie DE Dieu100% (2)
- Norme GC FTTHDocument24 pagesNorme GC FTTHzoomtn100% (2)
- Expose FTTHDocument31 pagesExpose FTTHMed Fateh67% (3)
- Rapport de Stage Jean-EliséDocument41 pagesRapport de Stage Jean-EliséJey Wendyida82% (11)
- PFE Installation MSAN Et Deploiment de La Fibre OptiqueDocument43 pagesPFE Installation MSAN Et Deploiment de La Fibre OptiqueYassine Tihad100% (2)
- Bureau D'etude FTTHDocument70 pagesBureau D'etude FTTHNIKIEMA Francklin Powell100% (1)
- La Grammaire Des Premiers Temps V1 Reponses Corriges PDFDocument32 pagesLa Grammaire Des Premiers Temps V1 Reponses Corriges PDFadastraperalasporci100% (2)
- Les Figures de StyleDocument4 pagesLes Figures de StylemouadhPas encore d'évaluation
- Rituel CBCS Pour Chevaliers Et EcuyersDocument94 pagesRituel CBCS Pour Chevaliers Et EcuyerskimonthPas encore d'évaluation
- Etude Et Optimisation Des Liaisons OptiquesDocument84 pagesEtude Et Optimisation Des Liaisons OptiquesSââ MîîrPas encore d'évaluation
- Microscope Électronique À BalayageDocument29 pagesMicroscope Électronique À BalayageS0UM0HPas encore d'évaluation
- MEMOIRE Mouhamadou ThiamDocument69 pagesMEMOIRE Mouhamadou ThiamMouhamed Thiam100% (3)
- Cours FTTH ProfDocument9 pagesCours FTTH Profben fatma ahmedPas encore d'évaluation
- Stage Fibres OptiquesDocument130 pagesStage Fibres OptiquesFrank Daurel85% (26)
- D Ploiement de La Fibre Optique FTTHDocument12 pagesD Ploiement de La Fibre Optique FTTHKarim StopeurPas encore d'évaluation
- Etude, Conception Et Dimentionnemt D'un Réseau Très Haut Débit Pat (BOUZERAA - DJAMAA) - Encadreur HASHASDocument62 pagesEtude, Conception Et Dimentionnemt D'un Réseau Très Haut Débit Pat (BOUZERAA - DJAMAA) - Encadreur HASHASBOUZANA Elamine100% (1)
- Rapport Fibre OptiqueDocument33 pagesRapport Fibre OptiqueSafoine GabtniPas encore d'évaluation
- Projet Finale Gpon VFDocument32 pagesProjet Finale Gpon VFAbdoulaye DIOUF75% (4)
- Etude de Cas Reseau FTTH IsgeDocument71 pagesEtude de Cas Reseau FTTH IsgeNIKIEMA Francklin Powell67% (3)
- Fibre OptiqueDocument22 pagesFibre OptiqueHachem MoulayPas encore d'évaluation
- Tunisie ETUDE FTTHDocument27 pagesTunisie ETUDE FTTHzoomtn86% (7)
- Règles Ingénierie FTTH Orange v2 1Document36 pagesRègles Ingénierie FTTH Orange v2 1Khaled_Noordin100% (3)
- Généralités Sur La Fibre OptiqueDocument16 pagesGénéralités Sur La Fibre OptiqueAnt'Hony KoumbaPas encore d'évaluation
- Projet Fibre Optique FinalDocument17 pagesProjet Fibre Optique FinalJoseph Naja100% (1)
- Expose FTTH DjiléDocument51 pagesExpose FTTH DjiléBenie DE DieuPas encore d'évaluation
- Expose FTTH DjiléDocument51 pagesExpose FTTH DjiléBenie DE DieuPas encore d'évaluation
- Memoire Ingenieur Reseaux Telecom Maintenance Fibre Optique Par Kouie GerardDocument79 pagesMemoire Ingenieur Reseaux Telecom Maintenance Fibre Optique Par Kouie Gerardabkarimtc92% (25)
- Etude Détaillé Du Réseau FTTH (Part 1 and 2)Document18 pagesEtude Détaillé Du Réseau FTTH (Part 1 and 2)بن عمر مالك100% (1)
- Corrigé UE11 - DCG 2011Document17 pagesCorrigé UE11 - DCG 2011Med Reda BouasriaPas encore d'évaluation
- Projet FTTXDocument10 pagesProjet FTTXDaddah Elbechir100% (1)
- Rapport en F-ODocument43 pagesRapport en F-OSafoine GabtniPas encore d'évaluation
- PFE Rapport Mariem V1Document49 pagesPFE Rapport Mariem V1gharbi mariem50% (2)
- Blondel - La Religion. Le Problème de La MystiqueDocument40 pagesBlondel - La Religion. Le Problème de La MystiquemolinerPas encore d'évaluation
- Etude Comparative Entre l'ADSL Et La FibreDocument100 pagesEtude Comparative Entre l'ADSL Et La FibreLeilaKenzo100% (1)
- Technologie FTTXDocument10 pagesTechnologie FTTXRonaldo Atindokpo100% (3)
- Etude Et Simulation Des Pertes Dans Une Liaison Fibre Optique Avec Application PDFDocument65 pagesEtude Et Simulation Des Pertes Dans Une Liaison Fibre Optique Avec Application PDFGhâdaAouini100% (1)
- FTTHDocument6 pagesFTTHAmina Ben100% (2)
- Cas Maintenance Fibre Optique 12Document23 pagesCas Maintenance Fibre Optique 12sevemasse100% (2)
- Réseau D Accès Fibre Optique en Configuration FTTX - HADJI Et ADJALA - Copie PDFDocument74 pagesRéseau D Accès Fibre Optique en Configuration FTTX - HADJI Et ADJALA - Copie PDFkhaoula latreche0% (1)
- Réseau À Haut Débit Sur Fibre Optique (ABABOU)Document27 pagesRéseau À Haut Débit Sur Fibre Optique (ABABOU)redaPas encore d'évaluation
- Technologie FTTXDocument24 pagesTechnologie FTTXFaty Gueye100% (1)
- Expose ReflectoDocument40 pagesExpose ReflectoBenie DE Dieu100% (2)
- Présentation Memoire KoffiDocument14 pagesPrésentation Memoire KoffiBenie DE DieuPas encore d'évaluation
- Présentation Memoire KoffiDocument14 pagesPrésentation Memoire KoffiBenie DE DieuPas encore d'évaluation
- Memoire FibreDocument64 pagesMemoire Fibresanokho ndiaye100% (1)
- PfeDocument38 pagesPfeAnouar Aleya88% (8)
- Rapport Pfa1 SihamyahansalDocument56 pagesRapport Pfa1 SihamyahansalSiham Yahansal100% (1)
- MemoireDocument70 pagesMemoireChristian Kapuya83% (6)
- Étude Et Simulation D'un Réseau FTTH Basé Sur La Norme G-PON-convertiDocument96 pagesÉtude Et Simulation D'un Réseau FTTH Basé Sur La Norme G-PON-convertiJacky MichelPas encore d'évaluation
- Memoire FTTH - Simon Descarpentries - M2 AE EPU 2007-2008 - IAE ToursDocument51 pagesMemoire FTTH - Simon Descarpentries - M2 AE EPU 2007-2008 - IAE ToursAyman AniKedPas encore d'évaluation
- Cours Reseaux Generalites Fibre OptiqueDocument21 pagesCours Reseaux Generalites Fibre OptiqueTDMA2009100% (2)
- Memoire ADSLDocument40 pagesMemoire ADSLSofi Sel67% (6)
- Rapport BOLLYDocument55 pagesRapport BOLLYFranck Nikiema0% (1)
- Chapiter3 1Document19 pagesChapiter3 1Ziad Rebahi100% (2)
- Etude Et Simulation D'une Chaine de Transmission Numerique Sur Fibre Optique Haut Debit PDFDocument80 pagesEtude Et Simulation D'une Chaine de Transmission Numerique Sur Fibre Optique Haut Debit PDFCire djoma Diallo100% (1)
- Groupe1 L3RTDocument24 pagesGroupe1 L3RTyhanthomassgbPas encore d'évaluation
- Extension Du Réseau de Tunisie-Télécom À Mise en Place D'un Pop À Paris PDFDocument50 pagesExtension Du Réseau de Tunisie-Télécom À Mise en Place D'un Pop À Paris PDFmaherr1Pas encore d'évaluation
- Les Methodes de Base Du Layout Page 23 PDFDocument59 pagesLes Methodes de Base Du Layout Page 23 PDFAhmed MsfPas encore d'évaluation
- Document 22Document11 pagesDocument 22Oceni SadidPas encore d'évaluation
- Me Moire VoipDocument74 pagesMe Moire VoipShafty ShaftPas encore d'évaluation
- Mémoire 11Document28 pagesMémoire 11Judor TOUTAPas encore d'évaluation
- Les Protocoles de Base TCPDocument17 pagesLes Protocoles de Base TCPBenie DE DieuPas encore d'évaluation
- Manuel D'utilisation D'un Réflectomètre Optique OTDR EXFODocument209 pagesManuel D'utilisation D'un Réflectomètre Optique OTDR EXFOBenie DE DieuPas encore d'évaluation
- Système PBX de Téléphonie Internet IPXDocument9 pagesSystème PBX de Téléphonie Internet IPXBenie DE DieuPas encore d'évaluation
- 06 - Responsable Approvisionnement - DUENAS MDocument7 pages06 - Responsable Approvisionnement - DUENAS MBenie DE DieuPas encore d'évaluation
- Système PBX de Téléphonie Internet IPX Petro SanteDocument7 pagesSystème PBX de Téléphonie Internet IPX Petro SanteBenie DE DieuPas encore d'évaluation
- Fo 1Document2 pagesFo 1Benie DE DieuPas encore d'évaluation
- Fibres Optiques PDFDocument26 pagesFibres Optiques PDFGoblenPas encore d'évaluation
- Cours Cäblage InformatiqueDocument45 pagesCours Cäblage InformatiqueBenie DE DieuPas encore d'évaluation
- Presentation - Mémoire 27 - 10 - 2018 Kra FranckDocument12 pagesPresentation - Mémoire 27 - 10 - 2018 Kra FranckBenie DE DieuPas encore d'évaluation
- Presentation - Mémoire 27 - 10 - 2018 Kra FranckDocument12 pagesPresentation - Mémoire 27 - 10 - 2018 Kra FranckBenie DE DieuPas encore d'évaluation
- Techniques AdministrativesDocument44 pagesTechniques AdministrativesBenie DE DieuPas encore d'évaluation
- Presentation Du SigfaeDocument12 pagesPresentation Du SigfaeBenie DE DieuPas encore d'évaluation
- Paul H Assogba - Ra RMT Benin & Eetd BeninDocument5 pagesPaul H Assogba - Ra RMT Benin & Eetd BeninBenie DE DieuPas encore d'évaluation
- EMDG B10010 01 7700 SWT - 3000 - Teleprotection FRDocument12 pagesEMDG B10010 01 7700 SWT - 3000 - Teleprotection FRATTAH Régis Patrick AusséPas encore d'évaluation
- Support Etudiant Maint-Teleconduite Oct 2016Document146 pagesSupport Etudiant Maint-Teleconduite Oct 2016Benie DE DieuPas encore d'évaluation
- T Rec L.26 200212 S!!PDF FDocument22 pagesT Rec L.26 200212 S!!PDF FBenie DE DieuPas encore d'évaluation
- Matrice Multi CritèresDocument57 pagesMatrice Multi CritèresOthmane AouinatouPas encore d'évaluation
- Notice de Sécurité IncendieDocument114 pagesNotice de Sécurité IncendieYasser MeftouhPas encore d'évaluation
- Techniques D Obfuscation de Code Chiffrer Du Clair Avec Du ClairDocument20 pagesTechniques D Obfuscation de Code Chiffrer Du Clair Avec Du ClairMouhamed Rassoul GueyePas encore d'évaluation
- Justificatif LienDocument1 pageJustificatif Lienimmavillena0Pas encore d'évaluation
- 5analyse TypomorphologiqueDocument10 pages5analyse Typomorphologiqueyasmine bouheloufPas encore d'évaluation
- 201 Coute - NR 4 2023Document68 pages201 Coute - NR 4 2023luPas encore d'évaluation
- Exposé SVT Les Minerais A MadagascarDocument7 pagesExposé SVT Les Minerais A MadagascarJohan RaharisonPas encore d'évaluation
- Facture Freemobile 20231230Document2 pagesFacture Freemobile 20231230ashwineuPas encore d'évaluation
- Cours n2Document4 pagesCours n2Sophie BarrierePas encore d'évaluation
- Voie LactéeDocument34 pagesVoie Lactéejulian perezPas encore d'évaluation
- TD1 Me ÜmoiresDocument3 pagesTD1 Me ÜmoiresalaeelhassanyPas encore d'évaluation
- MR 258 Super5 4 5 9Document259 pagesMR 258 Super5 4 5 9Van Aster EricPas encore d'évaluation
- Projet 02. Séq 02. BOUSEKKINE Anfel 2Document25 pagesProjet 02. Séq 02. BOUSEKKINE Anfel 2Renda ReziguiPas encore d'évaluation
- Parkside PKS2000-4 (Tronçonneuse)Document20 pagesParkside PKS2000-4 (Tronçonneuse)Georges KouroussisPas encore d'évaluation
- 0709 ArduinoDocument6 pages0709 Arduinohamza ayechePas encore d'évaluation
- 7.3.3 - Herminette - Rapport FinalDocument44 pages7.3.3 - Herminette - Rapport FinalMajdouline SeddikiPas encore d'évaluation
- Les 7 Étapes À Franchir Afin D'être Utile Et Profitable Pour Dieu - Le Blog ParolevivanteDocument12 pagesLes 7 Étapes À Franchir Afin D'être Utile Et Profitable Pour Dieu - Le Blog ParolevivanteEmmanu’EL “1CORTH2:5” MikamonaPas encore d'évaluation
- Inf302 TDDocument34 pagesInf302 TDRio LoboPas encore d'évaluation
- Economie IndustrielleDocument4 pagesEconomie IndustrielleLatifa HadekPas encore d'évaluation
- Techniques D'elevage Intensif Et D'alimentation de Poissons Et de CrustacesDocument19 pagesTechniques D'elevage Intensif Et D'alimentation de Poissons Et de CrustacesDao SouleymanePas encore d'évaluation
- Chap2 Presentation Du CloudDocument16 pagesChap2 Presentation Du CloudImene Ben SalemPas encore d'évaluation
- Sicareme Assurances: Certificat D'Assurances Etudes + Stages POLICE #470.2020.00000049Document1 pageSicareme Assurances: Certificat D'Assurances Etudes + Stages POLICE #470.2020.00000049Aladine MardyPas encore d'évaluation
- Liste Des Variétés de PoiresDocument3 pagesListe Des Variétés de Poiresmohamedadjeb2001Pas encore d'évaluation
- Expose Equipements de Production Tarek SenigraDocument5 pagesExpose Equipements de Production Tarek Senigratarek senigraPas encore d'évaluation