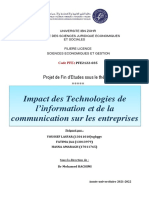Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
1 PB
1 PB
Transféré par
tahaTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
1 PB
1 PB
Transféré par
tahaDroits d'auteur :
Formats disponibles
Revue Économie, Gestion et Société N°26 août 2020
REALITE DES SYSTEMES D’INFORMATION DANS L’UNIVERSITE
MAROCAINE
Par
Yahya EL MOUNTASSIR
Docteur en Sciences Economiques et Gestion, Université Sidi Mohamed Ben
Abdellah de Fès.
elmountassir.yahya@gmail.com
&
Abdelaziz BERDI
Docteur chercheur en Sciences Economiques et Gestion, Université Sidi
Mohammed Ben Abdellah de Fès- Maroc.
Abdelazizberdi@gmail.com
&
Nabil SEGHYAR
Doctorant à la FSJES de Kenitra, Laboratoire de Recherche « Recherche
en Sciences de Gestion des Organisations » (RSGO), Université Ibn Tofail.
Seghyar.nabil@gmail.com
&
MOHAMMED ACHRAF NAFZAOUI
Enseignant chercheur à l’ENCG KENITRA, Laboratoire de Recherche en
Sciences de Gestion des Organisations, UNIVERSITÉ IBN TOFAIL-
Maroc.
achrafnafzaoui@yahoo.fr
Résumé :
L’université est devenue un acteur de la compétition mondiale, non seulement en termes
d’éducation ou de recherche, mais d’une façon plus stratégique encore dans la bataille livrée
au sein du marché de l’emploi. Le développement des Technologies de l’Information et de la
1
http://revues.imist.ma/?journal=REGS ISSN: 2458-6250
Revue Économie, Gestion et Société N°26 août 2020
Communication (TIC) a conduit le tissu universitaire, en quelques décennies, à un véritable
espace mondial de l’information. Les TIC ont donc ouvert les universités sur l’extérieur,
facilité les comparaisons et donc initié une mise en concurrence de fait.
Face à de tels constats, lesquels confrontés à des perpétuelles mutations de l’environnement,
source d’incertitudes multiples, tant économiques, politiques, technologiques, que culturelles
et sociales, les dirigeants des établissements universitaires sont désormais contraints d’ajuster
leurs stratégies en fonction de nouveaux paramètres intégrant une complexité croissante, une
incertitude et une pression concurrentielle sur les différents échiquiers nationaux et
internationaux. Les SI s’identifient à cette démarche stratégique d’aide à la décision qui
constitue une réponse au défi de la révolution économique, marquée par le contexte de
mondialisation des échanges et d’émergence de la société de l’information.
Mots clés : Université, Management, Système d’Information universitaire, Acteurs,TIC.
Abstract:
The university has become an actor in the global competition, not only in terms of education
or research, but in a more strategic way in the battle of labor market. The development of
Information and Communication Technologies has led the academic fabric, in a few decades,
to a truly global information space. ICT have opened the universities to the outer surface, the
contributed almost all the academic institutions to a real competition.
Faced with such observations, which are confronted with perpetual changes in the
environment, source of multiple uncertainties, both economic, political, technological,
cultural and social, the university leaders are now forced to adjust their strategies to a new
parameter with increasing complexity, uncertainty and competitive pressure on the various
national and international chessboards. IS is identified with this strategic approach to
decision-making, which is a response to the challenge of the economic revolution, marked by
the context of globalization of trade and the emergence of the information society.
Key words: University, Management, Information systems of the university, Actors, ICT.
http://revues.imist.ma/?journal=REGS ISSN: 2458-6250
Revue Économie, Gestion et Société N°26 août 2020
Introduction
Dans un monde mondialisé et des économies globalisées, l’information est devenue un actif si
cher faisant partie du patrimoine des entreprises à côté de ses ressources (matières premières,
technologies, etc.). Cette information implique sa gestion à travers la mise en place d’outils
efficaces, entre autres les Systèmes d’Information (SI)1. A cet effet, actuellement, l’usage des
Systèmes d’Information représente une part entière de notre quotidien. Leur gestion et
conception représentent à ce jour un problème majeur des organisations (Flory, 1990). Ainsi,
le domaine des SI a certes, une forte composante technologique et informatique, mais il n’en
représente qu’une partie parmi un ensemble plus vaste.
Il s’agit donc de concevoir la façon dont circule et se stocke l’information de manière efficace
et cohérente pour toutes les activités d’une organisation, d’un réseau d’entreprises, d’une
administration publique, des relations entre établissements, des citoyens et même des
gouvernements. Le SI tend à s’orienter vers des ensembles plus globaux, du fait que
l’information traitée par l’homme est une connaissance à gérer (Tisseyre, 1999).
Notre intérêt sera de mettre en exergue les évolutions et les typologies d’un outil
incontournable pour la gestion de l’information des organisations. Cet outil, désormais appelé
« système d’information », existe sous de nombreuses formes et types selon ses utilisations.
Particulièrement, Le SI d’une université est constitué d’un ensemble de ressources organisées
qui ne se limite pas aux seules ressources informatiques, mais qui couvre tous les domaines
d’activité de l’université, de l’organisation et du suivi de l’enseignement et de la recherche
aux différents domaines de gestion (ressources humaines, finances et comptabilité,
valorisation, patrimoine...). Son objectif est de collecter, traiter, transformer, stocker et
diffuser l’information de façon organisée et structurée.
L’objectif de cet article est d’introduire la notion de SI dans un contexte universitaire. Il nous
semble opportun de se poser dans ce cadre la question suivante : quelle réalité des systèmes
d’information dans le contexte universitaire marocain ? Nous allons tenter de répondre à cette
question à double niveau : nous nous arrêtons dans un premier point sur l’état de l’art des SI,
puis dans un deuxième temps nous entamons les bases de gestion par les SI dans un contexte
universitaire marocain.
1. Les SI : état de l’art
Cette partie revient sur la définition, la littérature des SI et la distinction entre ces derniers et
le domaine de l’informatique.
1.1. Le SI : Définition
Le concept de SI se compose de deux termes importants : système et information. Un système
est un assemblage d'éléments reliés entre eux, compris dans un ensemble plus grand.
Généralement, un système est constitué de composants (ou d'éléments) organisés ensemble
dans le but de faciliter le flux d'informations, de matières ou d'énergie (Maharrar, 2014). Une
information est un renseignement qui accroît la connaissance concernant une personne, un
1
Nous utiliserons désormais tout au long du texte l’abréviation SI comme références au système d’information.
3
http://revues.imist.ma/?journal=REGS ISSN: 2458-6250
Revue Économie, Gestion et Société N°26 août 2020
objet ou un événement déterminé. L’information peut être : objective (quand elle reflète un
ensemble de données porteur de sens) et subjective (quand elle résulte de l’interprétation d’un
ensemble de données)(Sornet et al, 2016).Le SI peut se définir par son objectif, qui est
d’assurer la saisie, la conservation, le traitement et la circulation des informations, de façon à
ce que chacun, dans l’organisation, puisse disposer au bon moment des données dont il a
besoin pour remplir sa tâche (Sornet et al, 2016).
En France ce sont les travaux, entre autres, de Le Moigneet Melese qui démontrent une
représentation de l’organisation connexe, à trois niveaux, à l’articulation desquels s’aperçoit
une première définition du SI : « Le système d’information est l’ensemble des informations et
des fonctions de traitement de l’information qui permettent la réalisation des processus de
l’établissement »(Le Moigne, 1974 &Melese, 1976) ; c’est-à-dire, un système qui pilote, qui
gère et un système physique qui exécute. Cependant, dans les années soixante, le résultat nous
conduit à déduire que l’on a le plus souvent abouti à des îlots d’automatisation autonomes, et
des efforts ont été considérablement entrepris. Ses derniers ont nous a permis de rassembler
plusieurs activités de base au niveau de ce que nous avons qualifié d’opérationnel.
Pour Reix, un SI peut être définit comme : « un ensemble organisé de ressources en matériel,
logiciels, personnel, données, procédures permettant d’acquérir, de traiter, de stocker, de
communiquer des informations (sous forme de données, textes, images, sons, etc.) dans et
entre des organisations »(Reix, 2004).
De manière générale, un SI est un ensemble de ressources qui permettent de gérer des
informations dans une entreprise donnée.
1.2. Les SI : littérature
Depuis de nombreuses années à la base de la conception d’applications, le SI est le système
intermédiaire entre le système décisionnel et le système opérationnel (Le Moigne, 1977). Ce
dernier permet de réaliser les différentes fonctions de l’organisation, tandis que le système
décisionnel donne la possibilité de prendre des décisions. Pour bien fonctionner, ces deux
systèmes doivent s’appuyer sur une information cohérente mise à jour. Donc, le SI doit
garantir la fiabilité et l’adéquation de l’information.
Dans les années quatre-vingt, l’approche systémique est apparue dans le cadre de ce débat,
comme une organisation en place et un environnement externe ayant une importance
déterminante (Harrington, 1985). Quand on aborde les SI, il est nécessaire de commencer par
le préliminaire : l’ordinateur, sans bien omettre que ce point de départ technique soit
prédominant. La diversité des technologies de l’information et de la communication n’a pas
été incontestablement escortée d’une meilleure compréhension de l’information. Nous avons
vu que le paradigme informationnel a été soutenu dès les années cinquante avec la
cybernétique, science du pilotage.
Dans son analyse de l’évolution des SI, Berdugo, a considéré l’information dans son ensemble
à travers deux visions différentes :
La première est que l’information est considérée comme une matière brute à exploiter
c’est-à-dire des « Ressources » ;
4
http://revues.imist.ma/?journal=REGS ISSN: 2458-6250
Revue Économie, Gestion et Société N°26 août 2020
La deuxième considère l’information comme une construction dérivée d’un jugement
individuel ou personnel (Berdugo, 1993).
De ce fait, on peut admettre que les conséquences de ces deux points de vue au niveau des
décisions et de l’organisation sont différentes. Dans certains cas, des excès peuvent conduire à
trop de rationnel ou d’irrationnel, à trop d’analyse ou à trop d’intuition, à trop de formel ou à
trop d’informel. L’information n’est pas un outil isolé ou isolable, elle doit naturellement
pointer une différence puisqu’elle fait partie d’un ensemble.
Bien que cela n’ait vraiment été perçu que dans les années soixante-dix, il demeure encore
vrai aujourd’hui. Historiquement, les premières activités informatisées furent la comptabilité,
la gestion des stocks, la facturation. La démarche de la conception était simple, classique,
séquentielle et n’impliquait aucun changement dans les habitudes de travail ou d’activité, seul
le moyen de réalisation était différent. Au fur et à mesure, les institutions informatisaient leurs
activités opérationnelles de base en les programmant sur des ordinateurs. En effet, « C’était
l’entreprise mono-produit, mono-fonction, mono-usine, ce sont les années soixante, où
l’entreprise est alors vue comme un système cybernétique » (Tardieu &Guthmann, 1991).
Par rapport à l’avènement du concept de comptabilité budgétaire apparu dans cette période,
les flux d’information touchant des domaines comme les prévisions, la production, les
commandes, les consommations et les dépenses sont rassemblés à des fins de suivi d’écarts
hiérarchisés. Les premiers systèmes de gestion de base de données et de réseaux font leur
apparition au niveau du management. De ce fait, des informations ordonnées remontent au
siège des institutions en provenance de différentes origines.
Les premiers groupements, coopérations ou associations pour de grands projets ont eu lieu,
mentionnant ici le cas Sandoz-Hoffman-Laroche et Ceiba dans le domaine pharmaceutique
visant, au début de leur activité, à mettre à la disposition de leurs chercheurs toutes leurs
documentations et leurs recherches en cours, sous le nom des «Chemicals Abstracts ».
A noter qu’un premier regroupement des ressources informatiques a eu lieu, dans les années
soixante-dix, où l’organisation est vue comme une entité dotée de sa propre mémoire et
capable d’organiser un processus de décision(Tardieu &Guthmann, 1991).Pour Simon aux
U.S.A., le modèle IPS2 apparaît, ce dernier repose sur la conviction que les raisonnements
humains et les décisions postérieures sont structurables, ensuite normalisables et enfin
programmables, conformément à certains processus modélisables sur un ordinateur. Davis,
Olson, Peaucelle et Ajenstat (Davis et al, 1986) véhiculent des contributions consistantes dans
ce domaine à partir de cette période. Pour le Moigne, on parle du modèle OID3 et concernant
la phase pratique, on peut mettre l’accent sur la méthode Merise, le SI est à l’articulation des
systèmes de pilotage opérationnel (Le Moigne, 1974).
Dans cette perspective, ces différents modèles ont pour rôle d’être des schémas ou des
représentations des organisations telles qu’elles fonctionnent, en se basant sur toutes les
informations dites formelles, en élaborant des tableaux de bord avec des informations
2
Information Process System.
3
Opération-Information-Décision.
5
http://revues.imist.ma/?journal=REGS ISSN: 2458-6250
Revue Économie, Gestion et Société N°26 août 2020
transformées à des fins managériales (Weick, 1995). De ce fait, on adopte de plus en plus des
moyens encore sophistiqués pour faire remonter les informations des niveaux opérant aux
niveaux tactiques pour en faire des analyses stratégiques.
Au cours des années quatre-vingt, la richesse des données et des informations archivées dans
les fichiers et les bases de données, et qui sont échangées à travers les réseaux, encouragent de
nombreuses institutions à avoir une vue plus systémique, une vision beaucoup plus générale
du rôle des technologies de l’information, au niveau managérial. Les concepts de management
des systèmes d’information, des systèmes interactifs d’aide à la décision4, de l’utilisation de
systèmes experts se divulguent sous forme de progiciels réalisés clés en main.
La mise en relation d’un ensemble de propositions dans des interfaces, permet aux utilisateurs
d’aller un pas en avant, dans l’entretien homme-machine, qui se fait d’une manière la moins
séparée du dialogue courant humain. La création du langage Prolog forme un apport
significatif à savoir des domaines d’investigation importants : les systèmes d’interprétation
des données et des informations pas assez personnalisés ou spécifiques à l’institution, la
facilité d’utilisation, la maintenance en continu de tels systèmes. De ce fait, la multitude des
outils s’étend encore plus qu’ils soient matériels, logiciels et progiciels : optimisation des
communications via des réseaux et des satellites, PAO5, CAO6, robots, graphismes, vidéos,
lasers, EDI7. Les requêtes se multiplient auprès des directions informatiques, la maintenance et
la documentation, des systèmes deviennent de plus en plus délicats. Ceci est dû au besoin de
flexibilité d’évolution, marqué par l’environnement industriel, commercial, régional et
international.
Ce n’est que dans les années quatre-vingt avec des travaux comme ceux de Porter aux U.S.A.
que l’organisation doit désormais tirer parti des opportunités stratégiques qui se présentent, et
donc elle est concernée par la compréhension de son environnement, en particulier au niveau
concurrentiel. Aussi bien, la dimension stratégique des SI se manifeste-t-elle (Porter, 1989).
Après cet aperçu sur la revue de littérature des SI, nous jugeons opportun de passer en revue
la différence entre un SI et un système informatique.
1.3. La différence entre le SI et le domaine de l’informatique
Fréquemment, les deux termes produisent des fois l’objet de confusion. La notion de SI est
souvent interprétée en tant que système informatique. Cependant, ce dernier désigne
simultanément l’architecture technique et applicative des postes de travail. Néanmoins,
l’architecture technique (hard) est composée des processeurs, des bus applicatifs, des
périphériques d’entrée et de sortie, des capacités de mémoire, des protocoles de
communication. L’architecture applicative (Soft) est constituée des systèmes d’exploitation,
logiciels, progiciels et navigateurs à partir desquels les acteurs utilisent l’outil informatique
pour la réalisation de leurs activités (Chantal Morley, 2001).
4
Nous entamons les systèmes d’aide à la décision en détail dans la 3èmesous-section du présent chapitre.
5
Production assistée par ordinateur.
6
Conception assistée par ordinateur.
7
Echange de données informatiques.
6
http://revues.imist.ma/?journal=REGS ISSN: 2458-6250
Revue Économie, Gestion et Société N°26 août 2020
Par contre, le SI, fait le lien entre l’organisation des établissements (stratégie, activité, modes
de coordination, etc.). Les besoins des acteurs et les alternatives offertes par l’outil
informatique, consistent à décrypter les modes de fonctionnement de l’organisation au travers
des flux d’informations que les acteurs initient, échangent et diffusent pour leurs besoins. Sa
mission tend vers une modélisation du fonctionnement des organisations en termes de flux
pour apercevoir et faire évoluer le triptyque « Besoins des utilisateurs, Organisation, Système
informatique » (Matheron, 1991).
Différent du système informatique, le SI est une action de compréhension informationnelle de
l’organisation (cette différence sera illustrée à partir de la figure n°1). Le concept du SI
(Bertalanffy, 1971) est composé de deux mots qui sont « système » et « information ». Le mot
« système » renvoie à l’idée de systémique qui préconise des modes d’ajustements
cybernétiques dans un environnement ouvert. Le mot « information », quant à lui, désigne
simultanément un média, des langages et des constructions de sens.
Le rapprochement de ces deux mots constitue un champ de pratiques et de théories dont le
dénominateur commun est d’envisager toute organisation comme un ensemble de flux
d’information conditionné par les besoins des acteurs en relation avec la stratégie de
l’organisation (Simon, 1982).
Ainsi les alternatives offertes par les technologies ont permis d’automatiser des processus de
plus en plus variés et complexes. Mais certains processus ne sont pas encore automatisés,
parce qu’ils réclament une prise de décision ou des orientations purement humaines, non
encore modélisées. Ce travail de modélisation consiste, en fonction des méthodes, à
représenter les besoins présents et futurs des utilisateurs, à partir de leurs communications,
données et traitements (Rumbaugh et al, 1995).
De même lorsqu’on fait appel aux techniques informatiques, la mise en place d’un processus
d’intelligence économique dans un SI, exige une grande réflexion de la part des dirigeants,
qui démarre au niveau des processus de l’organisation. De ce fait, Il est indispensable
d’appréhender et de prendre en compte les besoins et contraintes des acteurs des processus.
Donc, il faut désigner une équipe multidisciplinaire composé de plusieurs acteurs intervenant
directement ou indirectement dans la réalisation de ce processus au sein de l’université.
2. Les bases de gestion par les SI dans un contexte universitaire marocain
La conception d’un SI est basée sur un dialogue perpétuel entre les spécialistes des différents
métiers et les experts du système. Celui-ci est en effet une structure vivante, qui évolue sous
l’influence des facteurs externes (législation, normes…) et internes (changements de
périmètre, évolution des métiers, évolution de l’organisation…), et sous l’effet de
l’obsolescence des technologies. La combinaison de ces facteurs rend parfois difficile
l’évolution des SI (Weick, 1982).
2.1. Le SI, au cœur de l’activité des établissements universitaires marocains
Le SI a pour rôle principal, de servir les activités des établissements, dont il est le support de
ses processus, comme gérer les services, le personnel et produire de l’information rapide et
efficace, ou au cœur de métier, comme distribuer les savoirs et les connaissances, qui
7
http://revues.imist.ma/?journal=REGS ISSN: 2458-6250
Revue Économie, Gestion et Société N°26 août 2020
nécessitent aujourd’hui une gestion ou un traitement d’information. C’est pourquoi, le
système d’information concernant l’ensemble de l’établissement de l’université est bien au
cœur de toutes ses activités. Les nouvelles technologies offrent de plus en plus d’opportunités
et permettent aussi :
L’enlèvement de la barrière du temps et de l’espace, grâce aux réseaux ;
La capacité de traiter des volumes de données très importants ;
L’automatisation des processus de gestion qui sont de plus en plus complexes.
Subséquemment, les nouvelles technologies notées (NTIC) consentent à un établissement de
développer de nouvelles activités et de nouveaux services pour ses acteurs, ses enseignants-
chercheurs, ses doctorants et ses étudiants au service de ses objectifs stratégiques. Le
développement des technologies de l’information et de la communication pour
l’enseignement (TICE) rend particulièrement visible le besoin de disposer en temps voulu
d’une information fiable et partagée par les différents acteurs (gestionnaires, enseignants,
chercheurs) (Weick, 1982).
De nos jours, tous les établissements marocains disposent d’un SI plus ou moins abouti, qui
répond plus ou moins, à des objectifs internes ou externes à savoir la transmission des
informations, la consolidation des données, le pilotage et l’édition des documents. Donc, pour
aboutir au bon fonctionnement de cette composition, la participation de tous les acteurs aux
différents stades de sa conception et de son assistance, constitue une nécessité indispensable
pour le développement des établissements.
2.2. Description d’un SI type de l’université
Prescrit comme « l’outil spécifique à chaque établissement, qui permet depuis un poste de
travail banalisé de l’université d’accéder aux ressources numériques acquises ou produites par
celle-ci : catalogue de la bibliothèque, catalogues collectifs, bases de données, réseau de
cédéroms, périodiques électroniques, documents pédagogiques, thèses numérisées, rapports
de recherche, sélections de sites internet, etc. » (Jolly, 2001), le SI a pour obligation de
procurer ses portails documentaires. Cependant, il doit également se déterminer comme un «
élément du SI global de l’université », avec lequel il se doit d’être incorporé et de
communiquer (Figure n°2).
De même, des passerelles peuvent développer l’intégration, la communication et les liens,
favoriser les interactions et l’interactivité entre les composants du SI, entre les portails de
toutes les composantes universitaires, pour faciliter l’accès aux ressources et aux services en
ligne, dont les usagers ont besoin. En voici quelques exemples :
Un outil collectif : l’annuaire LDAP permettant de gérer les droits d’accès au SIU, au
bureau virtuel, aux ressources et services de la bibliothèque ;
Des données à partager : liens entre les données APOGEE8 et HARPEGE9 et le fichier
8
Application pour l’organisation et la gestion des enseignements et des étudiants : est un progiciel de gestion
intégrée (PGI) développé par l’Agence de mutualisation des universités et des établissements (AMUE) depuis
1995. Il est destiné à la gestion des inscriptions et des dossiers des étudiants dans les universités Marocaines
depuis 2004.
8
http://revues.imist.ma/?journal=REGS ISSN: 2458-6250
Revue Économie, Gestion et Société N°26 août 2020
des inscrits à la bibliothèque ;
Des flux d’informations à organiser : liens entre le portail de l’université et le portail
du SCD (actualités, services, manifestation, ressources, etc.) ;
Des services communs : carte multiservices, la carte d’inscription à la bibliothèque,
messagerie, outils de travail et de communication du bureau virtuel.
Un SI de l’université présente à la fois un système de gestion et de communication, qui peut
intégrer des ENT10, qui offrent à leurs tours une multitude de services
complémentaires11.Dans la figure suivante, nous présentons une vision globale d’un SI et les
interactions principales.
En se référant à la figure n°3 en annexes, le SI peut être approché sous quatre angles :
Relationnel : répond-il aux missions de l’établissement et est-il vecteur d’échange
avec l’extérieur ?
Informationnel : permet-il la circulation et le partage d’informations ?
Fonctionnel : couvre-t-il les besoins fonctionnels des métiers ?
Technique et applicatif : a-t-il une couverture applicative suffisante et fonctionne-t-il
opérationnellement ?
Concernant le volet recherche, un SI peut être représenté comme porté sur la figure n°4 en
annexes.
2.2.1. Domaines d’activités des SI dans les établissements universitaires marocains
Les différents types d’activités de l’établissement s’organisent par domaines. Ces domaines
métier forment le sous-ensemble des activités dédiées à la finalité même de l’établissement et
les domaines support représentent des fonctions d’aide à la réalisation des activités du
domaine métier. Ces différents types d’activités de l’établissement sont illustrés dans la figure
n°5 en annexes.
2.2.2. Des processus
Dans nos établissements, les processus attachés au SI sont multiples, on peut mentionner par
exemple, les processus d’inscription administratif et pédagogique d’un étudiant, de
recrutement du personnel, de paie ou autre. Chaque processus peut être lui-même décomposé
en sous-processus.
La décomposition de l’efficacité de ces processus (Guta & Raghunathan, 1989) a pour finalité
de mettre en évidence le séquencement des activités de l’établissement et de visualiser
l’organisation autour de ces activités pour atteindre un résultat. Les processus décrivent
l’activité de l’établissement comme, les entrées nécessaires, les produits de sortie, la suite
d’activités requises et les acteurs de ces activités.
9
Un élément du système d’information des établissements pour la gestion des ressources humaines et pour le
pilotage des compétences et des personnels de l’enseignement supérieur.
10
Environnement Numérique de Travail.
11
Agence bibliographique de l’enseignement supérieur. Présentation générale du portail documentaire sudoc,
France ,17-09-2004.
9
http://revues.imist.ma/?journal=REGS ISSN: 2458-6250
Revue Économie, Gestion et Société N°26 août 2020
Cette approche permet de se focaliser sur la compréhension du fonctionnement global de
l’établissement et non sur celle des différents métiers vus individuellement. Elle permet aussi
de poser un cadre de travail commun pour tenter d’optimiser les modes de fonctionnement et
d’effectuer des comparaisons d’un établissement à l’autre. Un processus se définit par :
Un objectif à atteindre ;
Un événement déclencheur ;
Des objets métier : ce sont les principaux produits d’entrée, de sortie ou
intermédiaires, des processus, comme par exemple un diplôme, une fiche de paie, une
facture ;
Un mode opératoire : enchaînement de tâches ou d’activités ;
Des règles de gestion qui apportent des précisions sur le fonctionnement ;
Éventuellement des applications informatiques qui en sont le support ;
La description des flux : informations échangées.
La figure n°6 en annexes est librement inspirée de ces méthodes et illustre le processus cible
pour la définition de l’offre de formation pédagogique dans un établissement. Ainsi, les
processus se décomposent en activités qui peuvent être automatisées. Par exemple :
La production d’un bulletin de paie est complètement automatisable à travers un
logiciel de paie ;
En revanche, le processus de traitement et d’analyse des réponses à un appel d’offre
ou celui de la conception d’un programme d’enseignement l’est beaucoup moins.
Les processus peuvent faire l’objet d’une évaluation afin de mesurer leur apport au bon
fonctionnement de l’établissement. Cette analyse permet de mettre en évidence des problèmes
et des carences éventuelles :
Fragmentation : trop d’acteurs décomposent le processus ;
Inefficience : le processus consomme trop de ressources par rapport à son résultat ;
Incomplétude ou inutilité d’informations : des données sont manquantes ou au
contraire inutiles.
Les processus sont régulièrement décrits à travers des schémas qui comportent un système de
règles et de signes permettant d’exprimer une pensée et de communiquer une idée. Leur
description s’appuie sur différentes méthodes ou langages de modélisation dont les plus
communément utilisés sont Merise (Panet & Letouche, 1994) et UML12.
2.2.3. Des acteurs intervenant au processus d’élaboration du SI universitaire
La notion d’acteur est exclusivement dépendante des processus dans lesquels ils sont
impliqués, un acteur n’a pas forcément le même rôle d’un processus à l’autre.
Dans un établissement, la typologie des acteurs du SI est largement variée. On y distingue,
d’une part, des acteurs producteurs qui agissent sur les processus (les décideurs, les
12
Le langage de modélisation unifié, de l’anglais Unified Modeling Language , est un langage de modélisation
graphique à base de pictogrammes conçu pour fournir une méthode normalisée pour visualiser la conception
d’un système. Il est couramment utilisé en développement logiciel et en conception orientée objet.
10
http://revues.imist.ma/?journal=REGS ISSN: 2458-6250
Revue Économie, Gestion et Société N°26 août 2020
enseignants/chercheurs, et les gestionnaires par exemple) et, d’autre part, ceux qui sont
bénéficiaires des résultats de ces processus (les étudiants, les personnels…).
Il est à noter aussi qu’un acteur peut être à la fois producteur et bénéficiaire d’informations
pour le SI, c’est le cas d’un étudiant qui se renseigne de l’information sur son dossier et qui
consomme en même temps des services rendus par le SI (accès à des cours, octroi de bourse).
2.2.4. Traitement des informations
Les informations sont un ensemble de données retraçant les outils de gestion, la qualité et la
fiabilité des données sont indispensables, elles conditionnent l’efficacité du SI dans une
organisation. Or, les informations qui forment le SI peuvent être de qualité, de fraîcheur et de
précision très variables. L’accessibilité et la fiabilité des données peuvent aussi être
hétérogènes au sein même de l’établissement.
Pour être de bonne qualité, une information mérite d’être contrôlée et corrigée aussi
fréquemment que possible. Des informations d’origines multiples peuvent être soumises à des
exigences de qualité très différentes. Par exemple, la cohérence des données recueillies, lors
de l’inscription pédagogique d’un étudiant, n’est pas forcément contrôlée de la même manière
d’un service d’une composante à l’autre. En d’autres termes, le périmètre englobé par certains
concepts métiers peut être différent selon la source de l’information. On peut rappeler comme
exemple la notion de « l’inscription », lorsqu’une inscription correspond à une inscription
principale, d’autres acteurs peuvent la considérer à la fois une inscription principale et
secondaire.
Le concept de structure d’enseignement peut être décrit selon une granularité différente d’un
acteur à l’autre dans l’établissement. La notion de discipline n’est pas appréhendée de la
même manière selon les métiers. Les travaux menés, à travers des cadres de cohérence du SI
de l’enseignement supérieur et de la recherche participent, à la clarification de nombreux
concepts partagés, notamment par le biais de nomenclatures et de dictionnaires de données.
2.2.5. Des référentiels
Le management ne peut pas se concevoir aujourd’hui sans recours à un ou plusieurs
référentiels (Cigref, 2009) se sont des ensembles d’informations transversaux au SI et qui sont
partagés entre les acteurs. Un référentiel peut se définir comme un ensemble cohérent de
données ayant une définition sémantique commune et répondant au besoin de langage
commun entre plusieurs acteurs appartenant à des entités organisationnelles différentes ou à
une même entité (Rivière et al, 2013).
Les référentiels permettent de modéliser, d’organiser et de regrouper les informations en une
seule représentation. Ceci évite les problèmes potentiels d’incohérence et de multiples saisies.
Un effort de travail sur les référentiels de l’établissement augmente donc considérablement la
fiabilité du SI. Par exemple, le référentiel du personnel de l’établissement, le référentiel des
structures organisationnelles, le référentiel des communes, le référentiel des locaux. Lorsque
chacun des domaines de l’établissement dispose d’un ensemble d’informations qui lui est
propre et dont il est maître, on parle alors de référentiel de domaine. Par exemple, le domaine
des ressources humaines est en général maître de la base d’informations du personnel de
11
http://revues.imist.ma/?journal=REGS ISSN: 2458-6250
Revue Économie, Gestion et Société N°26 août 2020
l’établissement. Ce référentiel sert à effectuer la gestion administrative des employés, la
gestion des emplois, des carrières. Le domaine de scolarité est maître des informations
relatives aux étudiants.
Parallèlement, il existe des référentiels partagés entre plusieurs domaines, il est porté par une
application maître qui garantit l’unicité de l’information et qui le met à la disposition des
autres applications (appelées souvent clientes du référentiel). Par exemple, le référentiel des
structures organisationnelles d’un établissement qui est utilisé par plusieurs domaines à savoir
le domaine comptabilité/finances, le domaine ressources humaines, les informations issues de
la base des ressources humaines et de la base scolarité.
Dans notre environnement universitaire, deux référentiels essentiels doivent être positionnés :
le référentiel des personnes et le référentiel des structures. A terme, le référentiel des locaux
(surfaces, salles, patrimoine) doit compléter cet ensemble. La notion de référentiel doit être
distinguée de celle de nomenclature. Cette dernière présente une définition des données qui
structurent le référentiel, c’est l’inventaire descriptif et exhaustif des états que peut prendre
une information dans l’ensemble du référentiel. C’est peut-être par exemple une classification,
une typologie ou une liste d’items.
Une définition stable est associée à chaque élément de la nomenclature. Plusieurs
nomenclatures proviennent de référentiels externes à l’établissement : pays (codes ISO :
Organisation Internationale de Normalisation), régions, départements, communes, codes
postaux, grades. Les nomenclatures internes peuvent être librement définies par
l’établissement.
Un référentiel d’établissement est soit externe, soit interne :
Un référentiel externe est un référentiel produit par un autre SI et dont le SI de
l’établissement est client. C’est le cas du référentiel des établissements gérés par le ministère
de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
Un référentiel est interne s’il est construit et géré dans le SI de l’établissement : c’est
le cas du référentiel des personnes. La construction du référentiel peut s’alimenter de
différentes applications : le référentiel des personnes consolide les informations issues de la
base ressources humaines et de la base scolarité. Le référentiel est porté par une application
maître qui garantit l’unicité de l’information et qui le met à la disposition des autres
applications (appelées clientes du référentiel).
2.2.6. Des applications
Les outils informatiques dont disposent les établissements sont souvent très hétérogènes. Les
logiciels viennent de sources différentes (éditeurs, Oracle, développeurs tels que l’Amue, les
consortiums ENT, Cocktail). Ils ont été conçus et évoluent avec leur histoire propre.
Des initiatives locales dans l’établissement ont pu conduire au développement des outils
spécifiques et internes pour couvrir certains processus, déjà partiellement couverts. Par
ailleurs, l’approche par la mutualisation différenciée promue dans nos établissements prône
une mise en œuvre des meilleurs composants logiciels. Par voie de conséquence, leur
intégration doit se construire comme un assemblage entre des composants variés.
12
http://revues.imist.ma/?journal=REGS ISSN: 2458-6250
Revue Économie, Gestion et Société N°26 août 2020
L’infocentre est un outil informatique particulier qui permet d’interroger les bases de données
d’une application sans risquer d’en perturber le fonctionnement. De même, l’entrepôt de
données permet, un rapprochement des données issues des différentes applications
informatiques pour constituer une information composite multi-domaines, répondant aux
besoins de pilotage, les données sont historiées pour permettre d’analyser leur évolution dans
le temps.
L’infocentre est un révélateur de l’hétérogénéité du SI qui définit les règles de conversion
nécessaires pour rapprocher de façon pertinente les informations hétérogènes. Grâce à
l’existence même de ces règles de conversion, il constitue un élément d’intégration dans la
mesure où il permet de rapprocher les données et dans une certaine limite, de pallier à cette
hétérogénéité.
Conclusion
Il s’agissait dans cet article de revenir sur la réalité des SI dans l’établissement universitaire
marocain. Pour y répondre nous nous sommes arrêtés sur l’état de l’art des SI ainsi que les
bases de gestion par ces derniers dans un contexte universitaire marocain. Nous remarquons
que dans la littérature, le concept de SI est très lié au monde de l’entreprise. Pourtant, ce
concept n’est pas le «Monopole » des institutions privées. Cela permet de comprendre que les
SI concernent aussi et également les organisations ou les institutions publiques, entre autres
les universités.
Il n’est pas à démontrer que le SI est devenu un élément stratégique pour un établissement,
structurant les activités et favorisant son attractivité. Cette importance, étant donné le coût
qui lui est associé, justifie de renforcer le pilotage du SI par une démarche coordonnée.
Nos établissements de l’enseignement supérieur ont déjà beaucoup investi dans cette
démarche autour du système d’information. Les nouvelles compétences (humaines,
technologiques, etc.) mises à leur disposition, répondent au besoin de développer un système
d’information global efficace et maîtrisé.
Bibliographie
-Berdugo, A., L’évolution des idées concernant les relations entre « Système d’information et
management des entreprises ». Informatique et Santé, Vol. 6, pp. 8-22, 1993.
-Bertalanffy L.V., La théorie générale des systèmes, Dunod, Paris, 1971.
-Cigref, Les référentiels de la DSI, Etat de L’art, Usage et bonnes pratiques, Octobre, 2009.
-Davis, G. et M. H. Oslon et J. Ajenstat et J-L. Peaucelle, Systèmes d’information pour le
management. Paris, Editions G. Vermette Inc ; Economica, 1986.
-Flory, A. et C. Rolland, Nouvelles perspectives des systèmes d’information. Dans sélection
d’articles du congrès 90 de l’Association informatique des organisations et systèmes
d’information et de décision. Paris, Editions Eyrolles, 1990, pp. 3-40.
-Guta Y.P., Raghunathan T.S., Impact of information systems steering committees on IS
planning; decision Sciences, Vol. 20, pp. 93-777, 1989.
13
http://revues.imist.ma/?journal=REGS ISSN: 2458-6250
Revue Économie, Gestion et Société N°26 août 2020
-Harrington J., Organizational structure and information technology. New York, Prentice Hall
International Ltd, 1985.
-Jacques SORNET&OonaHENGOAT & Nathalie LE GALLO (2016), « DCG8 : système
d’information de gestion (manuel et applications)., Edition Dunod, 2016. p.3.
-Jolly C., Bibliothèques universitaires, BBF, t. 46, n° 6, pp. 50-54, 2001.
-Le Moigne J-L., Les systèmes de décision dans les organisations, Paris, Editions Presses
Universitaires de France, 1974.
-Le Moigne, J. L., La théorie du système général. Paris, Editions Presses Universitaires de
France, 1977.
-MAHARRAR.A, La mise en place d’un système d’information formalisé dans les entreprises
algériennes, Mémoire de Magister en Science de Gestion, 9, 2014.
-Matheron J.P., Approfondir merise tome 1, Eyrolles, Paris, 1991.
-Mélèse J., La gestion par les systèmes. Paris, Editions Hommes et Techniques, 1976.
-Panet G., Letouche R., Merise/2 : Modèles et techniques avancés, Les Editions
d’Organisation, 1994.
-Reix.R, « Système d’Information et management des organisations », édition Vuibert, 5ème
édition.
-Rivière P., Bizingre J., Paumier J., Les référentiels du système d’information, info pro,
Dunod, 2013.
-Rumbaugh J., Blaha M., Premerlani W., Eddy F., Lorensen W., Modélisation et conception
orientées objet, Masson, Paris, 1995.
Septembre, 2004.
-Simon H.A., Models of bounded rationality, Vol1, Cambridge mass, press, 1982.
-Tardieu H. et Guthmann B., Le triangle stratégique. Paris, Les Editions d’Organisation, 1991.
-Tisseyre, R-C., Knowledge Management : Théorie et pratique de la gestion des
connaissances. Paris, Hermes Science Publications, 1999.
-Weick K.E., Educational organizations as loosely coupled systems, Administrative science
quarterly, vol.21, n°1, pp. 1-19, 1982.
-Weick K.E., Sensemaking in organizations, sage, 1995.
14
http://revues.imist.ma/?journal=REGS ISSN: 2458-6250
Revue Économie, Gestion et Société N°26 août 2020
Annexes:
Figure n°1: Système d’information et système informatique
Source : Amue, 2008
Figure n°2 : Système d’information de l’université : un exemple de schéma directeur
Source : Cabinet de consultants Six & Dix, revue, 2005
15
http://revues.imist.ma/?journal=REGS ISSN: 2458-6250
Revue Économie, Gestion et Société N°26 août 2020
Figure n°3 : Visions globales d’un système d’information universitaire
Source : http://www.csiesr.fr/IMG/pdf/fascicule1-rev063.pdf
Figure n°4 : Un sous-ensemble du système d’information couvrant l’activité de
recherche
Source : Melese.J, approches systémiques des organisations, éd. Des hommes et techniques,
1979
16
http://revues.imist.ma/?journal=REGS ISSN: 2458-6250
Revue Économie, Gestion et Société N°26 août 2020
Figure n°5 : Différents types d’activités de l’établissement
Source : Amue, 2008
Figure n°6 : Processus de formation pédagogique dans un établissement
Source : Schéma réalisé dans le cadre des travaux de conception pour le
développement de l’application APOGEE à l’Amue, 1995.
17
http://revues.imist.ma/?journal=REGS ISSN: 2458-6250
Vous aimerez peut-être aussi
- L'ésotérisme Contemporain Et Ses Lecteurs PDFDocument268 pagesL'ésotérisme Contemporain Et Ses Lecteurs PDFFede Rosetti100% (1)
- Etude de Marche CAMEROUN PDFDocument50 pagesEtude de Marche CAMEROUN PDFlegende androide100% (1)
- ERP RenaultDocument39 pagesERP RenaulttahaPas encore d'évaluation
- Présentation Bank of AfricaDocument33 pagesPrésentation Bank of Africataha100% (1)
- Mode Opératoire - TALENDDocument14 pagesMode Opératoire - TALENDtahaPas encore d'évaluation
- Les Grands Auteurs en Systemes D Information PDF PreviewDocument12 pagesLes Grands Auteurs en Systemes D Information PDF PreviewsamiaPas encore d'évaluation
- Les Enjeux Des NTIC Dans LentrepriseDocument10 pagesLes Enjeux Des NTIC Dans LentrepriseSimo Yahiou100% (1)
- La Performance Et Les SI Memoire Master PDFDocument85 pagesLa Performance Et Les SI Memoire Master PDFNour HanePas encore d'évaluation
- Le Système d'information comptable au milieu automatiséD'EverandLe Système d'information comptable au milieu automatiséÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (3)
- Rapport Projet Fin D'étudeDocument98 pagesRapport Projet Fin D'étudeMaher Garfa82% (11)
- 1 PBDocument14 pages1 PBAbdessamad ElguezzamPas encore d'évaluation
- Knowledge Management Poste MarocDocument31 pagesKnowledge Management Poste MarocHamza Airir100% (1)
- 760-Texte de L'article-2337-1-10-20220713Document18 pages760-Texte de L'article-2337-1-10-20220713desmetierslacentralePas encore d'évaluation
- Système D InformationDocument5 pagesSystème D InformationAş Măe100% (1)
- Dans Quelles Mesures Les TIC Jouent-Elles Un Rôle Stratégique Pour Les PME ?Document26 pagesDans Quelles Mesures Les TIC Jouent-Elles Un Rôle Stratégique Pour Les PME ?Paul MadikaPas encore d'évaluation
- F0241 PrefaceDocument4 pagesF0241 Prefacetornodi771Pas encore d'évaluation
- De L'intelligence Économique Vers Le Knowledge Management - Comment Passer de La Gestion de L'information À La Gestion de La ConnaissanceDocument11 pagesDe L'intelligence Économique Vers Le Knowledge Management - Comment Passer de La Gestion de L'information À La Gestion de La ConnaissanceSalim D'ambiancePas encore d'évaluation
- Industrie Accompagnement EntreprenruialDocument8 pagesIndustrie Accompagnement EntreprenruialLaila ElouaratPas encore d'évaluation
- 9468 23206 1 PBDocument21 pages9468 23206 1 PBHicham BènamiPas encore d'évaluation
- SYSTEME d'INFORMATION SAP Et ORGANISATION D' ENTREPRISEDocument164 pagesSYSTEME d'INFORMATION SAP Et ORGANISATION D' ENTREPRISEoaga552Pas encore d'évaluation
- 1 PBDocument20 pages1 PBSouriaAbdelPas encore d'évaluation
- PFE FINAL 2022 HassnaDocument55 pagesPFE FINAL 2022 HassnaMany ArabePas encore d'évaluation
- 1 PBDocument20 pages1 PBkhadija rabibPas encore d'évaluation
- Intelligence Economique 2019-2020Document56 pagesIntelligence Economique 2019-2020Derka coulPas encore d'évaluation
- 248-Article Text-773-2-10-20210526Document24 pages248-Article Text-773-2-10-20210526Meriem HizamPas encore d'évaluation
- x06 (2) Systèmed'InformationetorganisationDocument24 pagesx06 (2) Systèmed'InformationetorganisationSamuel AnokePas encore d'évaluation
- Appel À CommunicationDocument7 pagesAppel À CommunicationRania GbPas encore d'évaluation
- 690-Texte de L'article-2080-1-10-20220611Document22 pages690-Texte de L'article-2080-1-10-20220611Seny FALLPas encore d'évaluation
- Fiche de LectureDocument20 pagesFiche de LectureYassine BoughaidiPas encore d'évaluation
- Communication Entrepreneuriat SocialDocument17 pagesCommunication Entrepreneuriat SocialTALBI MOHAMEDPas encore d'évaluation
- Intelligence Economique 2019-2020-ConvertiDocument61 pagesIntelligence Economique 2019-2020-ConvertiJean Eudes YamblePas encore d'évaluation
- L'écosystème Entrepreneurial Pertinent: François LabelleDocument8 pagesL'écosystème Entrepreneurial Pertinent: François Labelleasmae.garsyfyPas encore d'évaluation
- Management Des SiDocument22 pagesManagement Des SiMaxence KOGNAVOPas encore d'évaluation
- L'innovation Ouverte Au Cœur de La Conception Du Système Territorial D'innovation.Document22 pagesL'innovation Ouverte Au Cœur de La Conception Du Système Territorial D'innovation.amor bouslamiPas encore d'évaluation
- LPEC M09 SI Les AxesDocument13 pagesLPEC M09 SI Les AxesGoul ComptaPas encore d'évaluation
- Houssam AboutaiemDocument29 pagesHoussam AboutaiemHoussam TaiemPas encore d'évaluation
- Mémoire CompletDocument140 pagesMémoire CompletEvo LutionPas encore d'évaluation
- 885-Article Text-3180-1-10-20220213Document20 pages885-Article Text-3180-1-10-20220213Nabil ElborrPas encore d'évaluation
- ECONOMIEDocument77 pagesECONOMIEYassi NePas encore d'évaluation
- Aim2019 DelaunayDocument16 pagesAim2019 Delaunaysiham oulmoudenPas encore d'évaluation
- Gestion Des ConnaissancesDocument21 pagesGestion Des ConnaissancesTeam QuestInPas encore d'évaluation
- La Démarche de L'indormatisationDocument19 pagesLa Démarche de L'indormatisationlila xinyuePas encore d'évaluation
- Syllabus 2022 - AUDIT DES RISQUES DES SI - DR GANDAHO - 230508 - 120048Document13 pagesSyllabus 2022 - AUDIT DES RISQUES DES SI - DR GANDAHO - 230508 - 120048Stéphane CamaraPas encore d'évaluation
- El MabroukiDocument12 pagesEl MabroukiPFEPas encore d'évaluation
- Intelligence EconomiqueDocument31 pagesIntelligence EconomiqueHidaye Yılmaz100% (1)
- 593-Article Text-2140-1-10-20210509Document24 pages593-Article Text-2140-1-10-20210509DOHA AMENSOURPas encore d'évaluation
- 1209-Article Text-4269-1-10-20230212Document25 pages1209-Article Text-4269-1-10-20230212lamyaa elmansourPas encore d'évaluation
- Management TechnologiqueDocument56 pagesManagement TechnologiqueFoughali HamdiPas encore d'évaluation
- 605-Texte de L'article-1812-1-10-20220414Document12 pages605-Texte de L'article-1812-1-10-20220414Achraf chtihaPas encore d'évaluation
- Analyse de L'impact de La Mise en Place D'une Stratégie D'intelligenceDocument19 pagesAnalyse de L'impact de La Mise en Place D'une Stratégie D'intelligenceHANNANE HANNANEPas encore d'évaluation
- Sociologie D'entrpriseDocument3 pagesSociologie D'entrprisetodinirinaeliaPas encore d'évaluation
- Aims2015 3504Document26 pagesAims2015 3504Imane LaghlaliPas encore d'évaluation
- Rapport Du Pfe Salah SlimaniDocument8 pagesRapport Du Pfe Salah Slimanisalah slimaniPas encore d'évaluation
- Systeme D4infoDocument10 pagesSysteme D4infogenissa Minkue Mi NzuePas encore d'évaluation
- Présentation 2Document11 pagesPrésentation 2Ayoub KenziPas encore d'évaluation
- L'intelligence Économique Dans La LittératureDocument20 pagesL'intelligence Économique Dans La LittératureSANAE SLIMANIPas encore d'évaluation
- Informatique, Numerique Et Systeme D'information Definition Permietres EnjeuxDocument29 pagesInformatique, Numerique Et Systeme D'information Definition Permietres EnjeuxJaoued LazarPas encore d'évaluation
- Agilité OrganisationnelleDocument14 pagesAgilité OrganisationnelleHIND BENAGUIDAPas encore d'évaluation
- Système D'information Et Organisation de L'entreprise Cas de SonatrachDocument17 pagesSystème D'information Et Organisation de L'entreprise Cas de SonatrachBrahime TouatiPas encore d'évaluation
- Systèmes D'information Expo PDFDocument20 pagesSystèmes D'information Expo PDFwatanemartialPas encore d'évaluation
- 4040 11634 1 SMDocument27 pages4040 11634 1 SMyoussefriifiPas encore d'évaluation
- 1 PB PDFDocument11 pages1 PB PDFAbyr RPas encore d'évaluation
- Retour Sur L'experience de L'administration Numerique Au MarocDocument17 pagesRetour Sur L'experience de L'administration Numerique Au Marockawtar ayPas encore d'évaluation
- L'importance Et Le Déroulement de L'information Financière Au Sein D'un Établissement HôtelierDocument62 pagesL'importance Et Le Déroulement de L'information Financière Au Sein D'un Établissement HôtelierGhassenPas encore d'évaluation
- 5385d1ecd9806 PDFDocument32 pages5385d1ecd9806 PDFTommy Helson100% (1)
- L' Impact Des Tic Sur Les Conditions de TravailDocument12 pagesL' Impact Des Tic Sur Les Conditions de TravailCaroline BaillezPas encore d'évaluation
- Formation Partie Paie V0Document39 pagesFormation Partie Paie V0tahaPas encore d'évaluation
- Contrôle de Gestion Sectoriel Novembre 2021Document29 pagesContrôle de Gestion Sectoriel Novembre 2021tahaPas encore d'évaluation
- Voyage A Caractere Familiale Ou Prive: Les Documents Justificatifs À ProduireDocument5 pagesVoyage A Caractere Familiale Ou Prive: Les Documents Justificatifs À ProduiretahaPas encore d'évaluation
- Le Controle de Gestion Au Sein de L Office Cherifien Des PhosphatesDocument51 pagesLe Controle de Gestion Au Sein de L Office Cherifien Des PhosphatestahaPas encore d'évaluation
- Tableau de Bord Des Titres FinanciersDocument4 pagesTableau de Bord Des Titres Financierstaha100% (1)
- Target CostingDocument5 pagesTarget CostingtahaPas encore d'évaluation
- Contrôle de Gestion en Sien Office Chérifien Des Phosphates OCP 4Document12 pagesContrôle de Gestion en Sien Office Chérifien Des Phosphates OCP 4tahaPas encore d'évaluation
- RapportDocument40 pagesRapporttahaPas encore d'évaluation
- Cas Airbus Et BoeigDocument16 pagesCas Airbus Et Boeigtaha100% (1)
- Tableau de Bord - StockageDocument9 pagesTableau de Bord - Stockagetaha100% (1)
- 1 PBDocument28 pages1 PBtahaPas encore d'évaluation
- Reporting Financier Ste Net CleanDocument8 pagesReporting Financier Ste Net CleantahaPas encore d'évaluation
- Business Intelligence - Séance 2Document11 pagesBusiness Intelligence - Séance 2taha100% (1)
- CV SarahDocument2 pagesCV SarahtahaPas encore d'évaluation
- Business Intelligence - Séance 3Document32 pagesBusiness Intelligence - Séance 3taha100% (1)
- Business Intelligence - Partie 1Document31 pagesBusiness Intelligence - Partie 1taha100% (1)
- Etude de Cas BMCEDocument27 pagesEtude de Cas BMCEtahaPas encore d'évaluation
- Travail A RendreDocument37 pagesTravail A RendretahaPas encore d'évaluation
- P2 PMPDocument8 pagesP2 PMPtaha100% (1)
- Memoire de Magister MAHARARDocument119 pagesMemoire de Magister MAHARARRiz MédPas encore d'évaluation
- Extrait Note Dinformation Opa Visant Les Actions de Ciments Du MarocDocument16 pagesExtrait Note Dinformation Opa Visant Les Actions de Ciments Du MaroctahaPas encore d'évaluation
- RF Clean Net AbderrahimDocument3 pagesRF Clean Net AbderrahimtahaPas encore d'évaluation
- INTRODUCTIONDocument19 pagesINTRODUCTIONtahaPas encore d'évaluation
- Etude de Cas BMCEDocument27 pagesEtude de Cas BMCEtahaPas encore d'évaluation
- PFE: Conception D'un Centre de Recherche en Agro Ecologie À Beni IzguenDocument104 pagesPFE: Conception D'un Centre de Recherche en Agro Ecologie À Beni IzguenWidad GhPas encore d'évaluation
- CVLatifa HORRAFEMDocument8 pagesCVLatifa HORRAFEMjosephchainesPas encore d'évaluation
- Emploi JeuneDocument31 pagesEmploi JeuneAbdellahMoullayPas encore d'évaluation
- ClefsetméthodespourréaliserunauditmarketingenB-To-B S.HEUCLIN ESCTOULOUSEDocument50 pagesClefsetméthodespourréaliserunauditmarketingenB-To-B S.HEUCLIN ESCTOULOUSEBDPas encore d'évaluation
- La Politique AchatDocument2 pagesLa Politique AchatHMOUDOUPas encore d'évaluation
- Le Paradigme Positiviste Et Le Paradigme InterprétatifDocument15 pagesLe Paradigme Positiviste Et Le Paradigme InterprétatifIssa FofanaPas encore d'évaluation
- Exp MotivDocument5 pagesExp MotivIMENE GHOULPas encore d'évaluation
- Soutenance de Thèse - Université de Nice Sophia Antipolis - 19 Juin 2008Document30 pagesSoutenance de Thèse - Université de Nice Sophia Antipolis - 19 Juin 2008Alexandre_PerrinPas encore d'évaluation
- Projets Tude Prof Lettre de Motivation - PDF Filename UTF 8''projets Étude Prof Lettre de MotivationDocument16 pagesProjets Tude Prof Lettre de Motivation - PDF Filename UTF 8''projets Étude Prof Lettre de Motivationzoom zoumbaPas encore d'évaluation
- Ergotoxicologie 1Document17 pagesErgotoxicologie 1Dounia LahoualPas encore d'évaluation
- L Art D Enseigner Et D Étudier Les LanguesDocument610 pagesL Art D Enseigner Et D Étudier Les LanguesÐjShowPas encore d'évaluation
- Model Formulaire VRRDocument16 pagesModel Formulaire VRRTuesou MacherePas encore d'évaluation
- FAO Glossary of AcquacultureDocument424 pagesFAO Glossary of Acquaculturelorenzi2009Pas encore d'évaluation
- Experimentation Approche WebDocument22 pagesExperimentation Approche WebAmélie MoïsePas encore d'évaluation
- Appel Colloque PS 2022 - V7Document4 pagesAppel Colloque PS 2022 - V7Rim SoulaikPas encore d'évaluation
- Recherche Doc Cours Part IIDocument5 pagesRecherche Doc Cours Part IIBadra MahidaPas encore d'évaluation
- L Entrepreneuriat Social Au MarocDocument27 pagesL Entrepreneuriat Social Au MarocAbdalali Ait AzrailPas encore d'évaluation
- Projet de Fin de CycleDocument18 pagesProjet de Fin de Cyclenass aliaPas encore d'évaluation
- Recherche Documentaire 2019Document17 pagesRecherche Documentaire 2019walid benazizPas encore d'évaluation
- Manuel Des Dames Ou L Art de La ToiletteDocument369 pagesManuel Des Dames Ou L Art de La ToilettecaroldggPas encore d'évaluation
- Epistémo VerlyckDocument4 pagesEpistémo VerlyckGabrielle VerlyckPas encore d'évaluation
- Biotechnologie, Recherche Scientifique, Agriculture Et Societe AlgerienneDocument7 pagesBiotechnologie, Recherche Scientifique, Agriculture Et Societe AlgerienneAd Ęł DjeziriPas encore d'évaluation
- Trouver Un Stage en EspagneDocument9 pagesTrouver Un Stage en EspagnemarisaPas encore d'évaluation
- Veille InformationnelleDocument29 pagesVeille Informationnelledcg dcgPas encore d'évaluation
- Chelcea RodicaDocument509 pagesChelcea RodicaLucia UrsuPas encore d'évaluation
- Brochure Polytech SousseDocument28 pagesBrochure Polytech Soussenouha gabsiPas encore d'évaluation