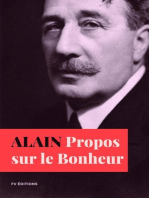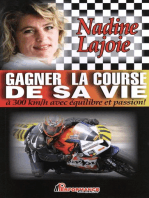Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Groupement Préparatoire Sur Le Mariage
Transféré par
lyblanc0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
1K vues5 pages"la Princesse de Clèves"
parcours individu, morale & société
séquence de première: le roman & le récit du Moyen-Age à nos jours
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce document"la Princesse de Clèves"
parcours individu, morale & société
séquence de première: le roman & le récit du Moyen-Age à nos jours
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
1K vues5 pagesGroupement Préparatoire Sur Le Mariage
Transféré par
lyblanc"la Princesse de Clèves"
parcours individu, morale & société
séquence de première: le roman & le récit du Moyen-Age à nos jours
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 5
Le mariage, félicité idéale ou chaîne aux pieds ?
Groupement de textes préparatoire à la Princesse de Clèves
Table des matières
Extrait 1. Code civil. Code civil. Livre Ier : Des personnes (Articles 7 à 515-13). ............................................................. 1
Extrait 2. Olympe de GOUGES. Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791) ...................................... 1
Extrait 3. JJ ROUSSEAU, Julie ou la nouvelle Héloïse (1751). Extrait de la Seconde partie, lettre II, de Milord à Claire. 2
Extrait 4. FLAUBERT, Madame Bovary, première partie, chapitre 7 (1857).................................................................... 3
Extrait 5. Annie ERNAUX, La femme gelée, Gallimard, 1987. .......................................................................................... 4
Document 6. RAPHAEL, Le Mariage de la vierge, ............................................................................................................ 5
Document 7. Edward HOPPER, Room in NY (1932) ......................................................................................................... 5
Extrait 1. Code civil. Code civil. Livre Ier : Des personnes (Articles 7 à 515-13).
Titre V : Du mariage (Articles 143 à 227)
Article 146. Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.
Extrait 2. Olympe de GOUGES. Déclaration des droits de la femme et de la
citoyenne (1791)
LES DROITS DE LA FEMME. Postambule
Je reprends mon texte quant aux mœurs. Le mariage est le tombeau de la confiance & de l’amour. La femme
mariée peut impunément donner des bâtards à son mari, et la fortune qui ne leur appartient pas. Celle qui
ne l’est pas, n’a qu’un faible droit : les lois anciennes et inhumaines lui refusaient ce droit sur le nom & sur
le bien de leur père, pour ses enfants, et l’on n’a pas fait de nouvelles lois sur cette matière. Si tenter de
donner à mon sexe une consistance honorable et juste, est considéré dans ce moment comme un paradoxe
de ma part, et comme tenter l’impossible, je laisse aux hommes à venir la gloire de traiter cette matière ;
mais, en attendant, on peut la préparer par l’éducation nationale, par la restauration des mœurs et par les
conventions conjugales.
Forme du Contrat social de l’Homme et de la Femme.
Nous N et N, mus par notre propre volonté, nous unissons pour le terme de notre vie, et pour la durée de
nos penchants mutuels, aux conditions suivantes : Nous entendons & voulons mettre nos fortunes en
communauté, en nous réservant cependant le droit de les séparer en faveur de nos enfants, et de ceux que
nous pourrions avoir d’une inclination particulière, reconnaissant mutuellement que notre bien appartient
directement à nos enfants, de quelque lit qu’ils sortent, et que tous indistinctement ont le droit de porter
le nom des pères et mères qui les ont avoués, et nous imposons de souscrire à la loi qui punit l’abnégation
de son propre sang. Nous nous obligeons également, au cas de séparation, de faire le partage de notre
fortune, et de prélever la portion de nos enfants indiquée par la loi ; et, au cas d’union parfaite, celui qui
viendrait à mourir, se désisterait de la moitié de ses propriétés en faveur de ses enfants ; et si l’un mourait
sans enfants, le survivant hériterait de droit, à moins que le mourant n’ait disposé de la moitié du bien
commun en faveur de qui il jugerait à propos.
Voilà à-peu-près la formule de l’acte conjugal dont je propose l’exécution. À la lecture de ce bizarre écrit, je
vois s’élever contre moi les tartuffes, les bégueules, le clergé et toute la séquelle infernale. Mais combien il
offrira aux sages de moyens moraux pour arriver à la perfectibilité d’un gouvernement heureux ! j’en vais
donner en peu de mots la preuve physique. Le riche Épicurien sans enfants, trouve fort bon d’aller chez son
voisin pauvre augmenter sa famille. Lorsqu’il y aura une loi qui autorisera la femme du pauvre à faire
adopter au riche ses enfants, les liens de la société seront plus resserrés, et les mœurs plus épurées. Cette
loi conservera peut-être le bien de la communauté, et retiendra le désordre qui conduit tant de victimes
dans les hospices de l’opprobre, de la bassesse et de la dégénération des principes humains, où, depuis
long-tems, gémit la nature. Que les détracteurs de la saine philosophie cessent donc de se récrier contre
les mœurs primitives, ou qu’ils aillent se perdre dans la source de leurs citations.
Je voudrais encore une loi qui avantageât les veuves et les demoiselles trompées par les fausses promesses
d’un homme à qui elles se seraient attachées ; je voudrais, dis-je, que cette loi forçât un inconstant à tenir
ses engagements, ou à une indemnité proportionnelle à sa fortune. Je voudrais encore que cette loi fût
rigoureuse contre les femmes, du moins pour celles qui auraient le front de recourir à une loi qu’elles
auraient elles-mêmes enfreinte par leur inconduite, si la preuve en était faite. Je voudrais, en même temps,
comme je l’ai exposée dans le bonheur primitif de l’homme, en 1788, que les filles publiques fussent placées
dans des quartiers désignés. Ce ne sont pas les femmes publiques qui contribuent le plus à la dépravation
des mœurs, ce sont les femmes de la société. En restaurant les dernières, on modifie les premières. Cette
chaîne d’union fraternelle offrira d’abord le désordre, mais par les suites, elle produira à la fin un ensemble
parfait.
Extrait 3. JJ ROUSSEAU, Julie ou la nouvelle Héloïse (1751). Extrait de la Seconde
partie, lettre II, de Milord à Claire.
Soyez-en sûre, aimable Claire, je ne m'intéresse pas moins que vous au sort de ce couple infortuné, non par
un sentiment de commisération qui peut n'être qu'une faiblesse, mais par la considération de la justice et
de l'ordre, qui veulent que chacun soit placé de la manière la plus avantageuse à lui-même et à la société.
Ces deux belles âmes sortirent l'une pour l'autre des mains de la nature ; c'est dans une douce union, c'est
dans le sein du bonheur, que, libres de déployer leurs forces et d'exercer leurs vertus, elles eussent éclairé
la terre de leurs exemples.
Pourquoi faut-il qu'un insensé préjugé vienne change les directions éternelles et bouleverser l'harmonie
des êtres pensants ? Pourquoi la vanité d'un père barbare cache-t-elle ainsi la lumière sous le boisseau, et
fait-elle gémir dans les larmes des cœurs tendres et bienfaisants, nés pour essuyer celles d’autrui ? Le lien
conjugal n'est-il pas le plus libre ainsi que le plus sacré des engagements ? Oui, toutes les lois qui le gênent
sont injustes, tous les pères qui l'osent former ou rompre sont des tyrans. Ce chaste nœud de la nature
n'est soumis ni au pouvoir souverain ni à l'autorité paternelle, mais à la seule autorité du Père commun qui
sait commander aux cœurs, et qui, leur ordonnant de s'unir, les peut contraindre à s'aimer.
Que signifie ce sacrifice des convenances de la nature aux convenances de l’opinion ? La diversité de fortune
et d'état s'éclipse et se confond dans le mariage, elle ne fait rien au bonheur ; mais celle d'humeur et de
caractère demeure, et c'est par elle qu'on est heureux ou malheureux.
L'enfant qui n'a de règle que l'amour choisit mal, le père qui n'a de règle que l'opinion choisit plus mal
encore. Qu'une fille manque de raison, d'expérience pour juger de la sagesse et des mœurs, un bon père y
doit suppléer sans doute; son droit, son devoir même est de dire: Ma fille, c'est un honnête homme, ou,
c'est un fripon; c'est un homme de sens, ou, c'est un fou. Voilà les convenances dont il doit connaître ; le
jugement de toutes les autres appartient à la fille. En criant qu'on troublerait ainsi l'ordre de la société, ces
tyrans le troublent eux-mêmes. Que le rang se règle par le mérite, et l'union des cœurs par leur choix, voilà
le véritable ordre social ; ceux qui le règlent par la naissance ou par les richesses sont les vrais perturbateurs
de cet ordre ; ce sont ceux-là qu'il faut décrier ou punir.
Il est donc de la justice universelle que ces abus soient redressés ; il est du devoir de l'homme de s'opposer
à la violence, de concourir à l’ordre ; et, s'il m'était possible d'unir ces deux amants en dépit d'un vieillard
sans raison, ne doutez pas que je n'achevasse en cela l'ouvrage du ciel, sans m'embarrasser de l'approbation
des hommes.
Vous êtes plus heureuse, aimable Claire ; vous avez un père qui ne prétend point savoir mieux que vous en
quoi consiste votre bonheur. Ce n'est peut-être ni par de grandes vues de sagesse, ni par une tendresse
excessive, qu'il vous rend ainsi maîtresse de votre sort ; mais qu'importe la cause si l'effet est le même et
si, dans la liberté qu'il vous laisse, l'indolence lui tient lieu de raison ? Loin d'abuser de cette liberté, le choix
que vous avez fait à vingt ans aurait l'approbation du plus sage père. Votre cœur, absorbé par une amitié
qui n'eut jamais d'égale, a gardé peu de place aux feux de l’amour ; vous leur substituez tout ce qui peut y
suppléer dans le mariage : moins amante qu'amie, si vous n'êtes la plus tendre épouse vous serez la plus
vertueuse, et cette union qu'a formée la sagesse doit croître avec l'âge et durer autant qu'elle. L'impulsion
du cœur est plus aveugle, mais elle est plus invincible : c'est le moyen de se perdre que de se mettre dans
la nécessité de lui résister. Heureux ceux que l'amour assortit comme aurait fait la raison, et qui n'ont point
d'obstacle à vaincre et de préjugés à combattre. Tels seraient nos deux amants sans l'injuste résistance d'un
père entêté. Tels malgré lui pourraient-ils être encore, si l'un des deux était bien conseillé.
L'exemple de Julie et le vôtre montrent également que c'est aux époux seuls à juger s'ils se conviennent. Si
l'amour ne règne pas, la raison choisira seule ; c'est le cas où vous êtes : si l'amour règne, la nature a déjà
choisi ; c'est celui de Julie. Telle est la loi sacrée de la nature, qu'il n'est pas permis à l'homme d'enfreindre,
qu'il n'enfreint jamais impunément, et que la considération des états et des rangs ne peut abroger qu'il n'en
coûte des malheurs et des crimes.
Extrait 4. FLAUBERT, Madame Bovary, première partie, chapitre 7 (1857)
Elle songeait quelquefois que c'étaient là pourtant les plus beaux jours de sa vie, la lune de miel, comme on
disait. Pour en goûter la douceur, il eût fallu, sans doute, s'en aller vers ces pays à noms sonores où les
lendemains de mariage ont de plus suaves paresses ! Dans des chaises de poste, sous des stores de soie
bleue, on monte au pas des routes escarpées, écoutant la chanson du postillon, qui se répète dans la
montagne avec les clochettes des chèvres et le bruit sourd de la cascade. Quand le soleil se couche, on
respire au bord des golfes le parfum des citronniers ; puis, le soir, sur la terrasse des villas, seuls et les doigts
confondus, on regarde les étoiles en faisant des projets. Il lui semblait que certains lieux sur la terre devaient
produire du bonheur, comme une plante particulière au sol et qui pousse mal tout autre part. Que ne
pouvait-elle s'accouder sur le balcon des chalets suisses ou enfermer sa tristesse dans un cottage écossais,
avec un mari vêtu d'un habit de velours noir à longues basques, et qui porte des bottes molles, un chapeau
pointu et des manchettes !
Peut-être aurait-elle souhaité faire à quelqu'un la confidence de toutes ces choses. Mais comment dire
un insaisissable malaise, qui change d'aspect comme les nuées, qui tourbillonne comme le vent ? Les mots
lui manquaient donc, l'occasion, la hardiesse.
Si Charles l'avait voulu cependant, s'il s'en fût douté, si son regard, une seule fois, fût venu à la rencontre
de sa pensée, il lui semblait qu'une abondance subite se serait détachée de son cœur, comme tombe la
récolte d'un espalier quand on y porte la main. Mais, à mesure que se serrait davantage l'intimité de leur
vie, un détachement intérieur se faisait qui la déliait de lui.
La conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue, et les idées de tout le monde y défilaient
dans leur costume ordinaire, sans exciter d'émotion, de rire ou de rêverie. Il n'avait jamais été curieux,
disait-il, pendant qu'il habitait Rouen, d'aller voir au théâtre les acteurs de Paris. Il ne savait ni nager, ni faire
des armes, ni tirer le pistolet, et il ne put, un jour, lui expliquer un terme d'équitation qu'elle avait rencontré
dans un roman.
Extrait 5. Annie ERNAUX, La femme gelée, Gallimard, 1987.
Un mois, trois mois que nous sommes mariés, nous retournons à la fac, je donne des cours de latin. Le soir
descend plus tôt, on travaille ensemble dans la grande salle. Comme nous sommes sérieux et fragiles,
l’image attendrissante du jeune couple moderno-intellectuel. Qui pourrait encore m’attendrir si je me
laissais faire, si je ne voulais pas chercher comment on s’enlise, doucettement. En y consentant lâchement.
D’accord je travaille La Bruyère ou Verlaine dans la même pièce que lui, à deux mètres l’un de l’autre. La
cocotte-minute, cadeau de mariage si utile vous verrez, chantonne sur le gaz. Unis, pareils. Sonnerie
stridente du compte-minutes, autre cadeau. Finie la ressemblance. L’un des deux se lève, arrête la flamme
sous la cocotte, attend que la toupie folle ralentisse, ouvre la cocotte, passe le potage et revient à ses
bouquins en se demandant où il en était resté. Moi. Elle avait démarré, la différence. Par la dînette. Le
restau universitaire fermait l’été. Midi et soir je suis seule devant les casseroles. Je ne savais pas plus que
lui préparer un repas, juste les escalopes panées, la mousse au chocolat, de l’extra, pas du courant. Aucun
passé d’aide-culinaire dans les jupes de maman ni l’un ni l’autre. Pourquoi de nous deux suis-je la seule à
me plonger dans un livre de cuisine, à éplucher des carottes, laver la vaisselle en récompense du dîner,
pendant qu’il bossera son droit constitutionnel. Au nom de quelle supériorité. Je revoyais mon père dans la
cuisine. Il se marre, « non mais tu m’imagines avec un tablier peut-être ! Le genre de ton père, pas le mien
! ». Je suis humiliée. Mes parents, l’aberration, le couple bouffon. Non je n’en ai pas vu beaucoup d’hommes
peler des patates. Mon modèle à moi n’est pas le bon, il me le fait sentir. Le sien commence à monter à
l’horizon, monsieur père laisse son épouse s’occuper de tout dans la maison, lui si disert, cultivé, en train
de balayer, ça serait cocasse, délirant, un point c’est tout. À toi d’apprendre ma vieille. Des moments
d’angoisse et de découragement devant le buffet jaune canari du meublé, des œufs, des pâtes, des endives,
toute la bouffe est là, qu’il faut manipuler, cuire. Fini la nourriture-décor de mon enfance, les boîtes de
conserve en quinconce, les bocaux multi- colores, la nourriture surprise des petits restaurants chinois bon
marché du temps d’avant. Maintenant, c’est la nourriture corvée.
Je n’ai pas regimbé, hurlé ou annoncé froidement, aujourd’hui c’est ton tour, je travaille La Bruyère.
Seulement des allusions, des remarques acides, l’écume d’un ressentiment mal éclairci. Et plus rien, je ne
veux pas être une emmerdeuse, est-ce que c’est vraiment important, tout faire capoter, le rire, l’entente,
pour des histoires de patates à éplucher, ces bagatelles relèvent-elles du problème de la liberté, je me suis
mise à en douter. Pire, j’ai pensé que j’étais plus malhabile qu’une autre, une flemmarde en plus, qui
regrettait le temps où elle se fourrait les pieds sous la table, une intellectuelle paumée incapable de casser
un œuf proprement. Il fallait changer. À la fac, en octobre, j’essaie de savoir comment elles font les filles
mariées, celles qui, même, ont un enfant. Quelle pudeur, quel mystère, « pas commode » elles disent
seulement, mais avec un air de fierté, comme si c’était glorieux d’être submergée d’occupations. La
plénitude des femmes mariées. Plus le temps de s’interroger, couper stupidement les cheveux en quatre,
le réel c’est ça, un homme, et qui bouffe, pas deux yaourts et un thé, il ne s’agit pas d’être une braque.
Alors, jour après jour, de petits pois cramés en quiche trop salée, sans joie, je me suis efforcée d’être la
nourricière, sans me plaindre. « Tu sais, je préfère manger à la maison plutôt qu’au restau U, c’est bien
meilleur ! » Sincère, et il croyait me faire un plaisir fou. Moi je me sentais couler.
Version anglaise, purée, philosophie de l’histoire, vite le supermarché va fermer, les études par petits bouts
c’est distrayant mais ça tourne peu à peu aux arts d’agrément. J’ai terminé avec peine et sans goût un
mémoire sur le surréalisme que j’avais choisi l’année d’avant avec enthousiasme. Pas eu le temps de rendre
un seul devoir au premier trimestre, je n’aurai certainement pas le capes, trop difficile. Mes buts d’avant se
perdent dans un flou étrange. Moins de volonté. Pour la première fois, j’envisage un échec avec
indifférence, je table sur sa réussite à lui, qui, au contraire, s’accroche plus qu’avant, tient à finir sa licence
et sciences po en juin, bout de projets. Il se ramasse sur lui-même et moi je me dilue, je m’engourdis.
Quelque part dans l’armoire dorment des nouvelles, il les a lues, pas mal, tu devrais continuer. Mais oui, il
m’encourage, il souhaite que je réussisse au concours de prof, que je me « réalise » comme lui. Dans la
conversation, c’est toujours le discours de l’égalité. Quand nous nous sommes rencontrés dans les Alpes,
on a parlé ensemble de Dostoïevski et de la révolution algérienne. Il n’a pas la naïveté de croire que le
lavage de ses chaussettes me comble de bonheur, il me dit et me répète qu’il a horreur des femmes
popotes. Intellectuellement, il est pour ma liberté, il établit des plans d’organisation pour les courses,
l’aspirateur, comment me plaindrais-je.
Document 6. RAPHAEL, Le Mariage de la vierge,
170 x 117 cm. Pinacoteca di Brera, Milan (1504)
Document 7. Edward HOPPER, Room in NY (1932)
Vous aimerez peut-être aussi
- Extrait 3 - TANGUY VIEL Texte - NotaireDocument1 pageExtrait 3 - TANGUY VIEL Texte - NotairelyblancPas encore d'évaluation
- Entraînement À La Dissertation - Sujet 1 - CorrigéDocument5 pagesEntraînement À La Dissertation - Sujet 1 - Corrigélyblanc100% (1)
- Corrigé Du DS de Fin de SéquenceDocument8 pagesCorrigé Du DS de Fin de SéquencelyblancPas encore d'évaluation
- Corrigé Dissertation RabelaisDocument3 pagesCorrigé Dissertation RabelaislyblancPas encore d'évaluation
- Cours Classe - Mouvements - Chap 38Document7 pagesCours Classe - Mouvements - Chap 38lyblancPas encore d'évaluation
- Extrait MiroirDocument1 pageExtrait MiroirlyblancPas encore d'évaluation
- Colette - Étude TEXTE 3Document9 pagesColette - Étude TEXTE 3lyblanc100% (1)
- Transversale Sur ColetteDocument12 pagesTransversale Sur Colettelyblanc100% (1)
- COLETTE Textes de La Séquence - Voie Générale - 2023-24Document5 pagesCOLETTE Textes de La Séquence - Voie Générale - 2023-24lyblancPas encore d'évaluation
- Corrigé - Question de Réflexion Louise Labé - 215Document6 pagesCorrigé - Question de Réflexion Louise Labé - 215lyblanc100% (1)
- Hélène DORION - Mes Forêts - Étude Inédite - Version DraftDocument88 pagesHélène DORION - Mes Forêts - Étude Inédite - Version DraftlyblancPas encore d'évaluation
- Ra23 Lycee GT 1 Francais Dorion EntretienDocument5 pagesRa23 Lycee GT 1 Francais Dorion EntretienlyblancPas encore d'évaluation
- Hélène Dorion - Étude Linéaire - Texte 1Document15 pagesHélène Dorion - Étude Linéaire - Texte 1lyblanc100% (2)
- Textes BéréniceDocument10 pagesTextes BérénicelyblancPas encore d'évaluation
- Cours 1 - BéréniceDocument1 pageCours 1 - BérénicelyblancPas encore d'évaluation
- Corrigé de Dissertation - H DorionDocument5 pagesCorrigé de Dissertation - H Dorionlyblanc100% (2)
- Balzac - Le Lys Dans La Vallée - Étude LinéaireDocument10 pagesBalzac - Le Lys Dans La Vallée - Étude Linéairelyblanc100% (1)
- Sujet La Poésie Séquence DORIONDocument1 pageSujet La Poésie Séquence DORIONlyblancPas encore d'évaluation
- Maquette Séquence Bérénice - SecondeDocument1 pageMaquette Séquence Bérénice - SecondelyblancPas encore d'évaluation
- Présentation de La Seconde en FrançaisDocument8 pagesPrésentation de La Seconde en FrançaislyblancPas encore d'évaluation
- L'Année de PremièreDocument7 pagesL'Année de PremièrelyblancPas encore d'évaluation
- Hélène Dorion, Mes Forêts - Présentation GénéraleDocument20 pagesHélène Dorion, Mes Forêts - Présentation GénéralelyblancPas encore d'évaluation
- Récapitulatif EAF 1STMG2 DRAFTDocument5 pagesRécapitulatif EAF 1STMG2 DRAFTlyblancPas encore d'évaluation
- Prépa Oral Seconde Partie ("Salina")Document2 pagesPrépa Oral Seconde Partie ("Salina")lyblanc50% (2)
- Réf. Documentaires - Grand OralDocument10 pagesRéf. Documentaires - Grand OrallyblancPas encore d'évaluation
- Francais Premiere 2023 Amerique Nord Sujet OfficielDocument4 pagesFrancais Premiere 2023 Amerique Nord Sujet OfficiellyblancPas encore d'évaluation
- Exercice de Contraction À Partir de Didier FASSINDocument1 pageExercice de Contraction À Partir de Didier FASSINlyblancPas encore d'évaluation
- Discours Contre La Misère - ClasseDocument1 pageDiscours Contre La Misère - ClasselyblancPas encore d'évaluation
- Simone WEIL - Cours - Classe Du 05 04 2023Document4 pagesSimone WEIL - Cours - Classe Du 05 04 2023lyblancPas encore d'évaluation
- Le Grand OralDocument9 pagesLe Grand OrallyblancPas encore d'évaluation
- L'Ancienne Rhetorique BarthesDocument53 pagesL'Ancienne Rhetorique Barthesintisumajpas100% (1)
- L'âne PourriDocument3 pagesL'âne PourriMiguel OrigamólogoPas encore d'évaluation
- Consécration, Charge, Exécration, Décharge Pour Tout Objet Spirituel-MagiqueDocument3 pagesConsécration, Charge, Exécration, Décharge Pour Tout Objet Spirituel-MagiqueHageldouze100% (1)
- L LatinDocument5 pagesL LatinLetudiant.frPas encore d'évaluation
- Paysages ChateaubriendDocument86 pagesPaysages ChateaubriendAlessandra FrancescaPas encore d'évaluation
- Danse Populaire - Danse SavanteDocument5 pagesDanse Populaire - Danse SavantecollectifsdfSalle des FêtesPas encore d'évaluation
- L'inférence Dans Les Réseaux Bayésiens DynamiquesDocument32 pagesL'inférence Dans Les Réseaux Bayésiens DynamiquesAouatef RkdhPas encore d'évaluation
- ExercicesDocument151 pagesExerciceseric100% (1)
- TravailDocument139 pagesTravailleyoniPas encore d'évaluation
- Hda Ecriture de Soi Serguei 3e LilysunDocument3 pagesHda Ecriture de Soi Serguei 3e LilysunLily SunfishPas encore d'évaluation
- Grilles Évaluation E3c Et ExplicationDocument5 pagesGrilles Évaluation E3c Et ExplicationToni SoaresPas encore d'évaluation
- Sauver Les Différences Des SexesDocument32 pagesSauver Les Différences Des Sexesmassimail2003Pas encore d'évaluation
- Communicationorganisation 498Document14 pagesCommunicationorganisation 498zouhir es salmaniPas encore d'évaluation
- Physique StatistiqueDocument97 pagesPhysique StatistiqueAtif Belaid100% (1)
- Grammaire M4 F17 Identifier Le Verbe 1Document5 pagesGrammaire M4 F17 Identifier Le Verbe 1Youssra SllPas encore d'évaluation
- El Travestismo en La Literatura FrancesaDocument70 pagesEl Travestismo en La Literatura FrancesaWalter RomeroPas encore d'évaluation
- Nelli Extrait Érotique Des TroubadourDocument17 pagesNelli Extrait Érotique Des TroubadourPsyl0wPas encore d'évaluation
- Modèle de La Totalité Dans La Formation de L'impressionDocument3 pagesModèle de La Totalité Dans La Formation de L'impressionYassir SougratiPas encore d'évaluation
- Aubin Deckeyser - Sagesses Africaines Du Jour Et de La NuitDocument4 pagesAubin Deckeyser - Sagesses Africaines Du Jour Et de La NuitwandersonnPas encore d'évaluation
- La Lutte BiologiqueDocument4 pagesLa Lutte BiologiqueΑλ εξέι100% (1)
- Le Livre Triangulaire de Saint GermainDocument74 pagesLe Livre Triangulaire de Saint Germainbabar7777100% (2)
- Hannah Arendt La Crise de La CultureDocument4 pagesHannah Arendt La Crise de La Cultureyouss ef100% (1)
- Compte Rendu Communication (Abdelkhalek SAIDI)Document3 pagesCompte Rendu Communication (Abdelkhalek SAIDI)Abdelkhalek SaidiPas encore d'évaluation
- RoutineDocument2 pagesRoutineDésirée LeroiPas encore d'évaluation
- CHAPITRE 2 L'esprit D'entreprise Part 1 PDFDocument7 pagesCHAPITRE 2 L'esprit D'entreprise Part 1 PDFSergePas encore d'évaluation
- Cours de Théories Orga Master 2 P AccardDocument44 pagesCours de Théories Orga Master 2 P Accardali diakitePas encore d'évaluation
- 07 La Gauche Libertaire de BourdieuDocument10 pages07 La Gauche Libertaire de Bourdieubadid SusskindPas encore d'évaluation
- OuijaDocument3 pagesOuijalyesss21Pas encore d'évaluation
- AMADOU HAMPÂTE BÂ Sa Vie Son Oeuvre PDFDocument40 pagesAMADOU HAMPÂTE BÂ Sa Vie Son Oeuvre PDFIbrahima Sakho100% (4)
- Le Pouvoir De L'Autodiscipline: L’art de tout accomplir sans limiteD'EverandLe Pouvoir De L'Autodiscipline: L’art de tout accomplir sans limiteÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (16)
- Dans la tête du pervers narcissique: Battez-le sur son propre terrainD'EverandDans la tête du pervers narcissique: Battez-le sur son propre terrainÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (3)
- La Pensée Positive en 30 Jours: Manuel Pratique pour Penser Positivement, Former votre Critique Intérieur, Arrêter la Réflexion Excessive et Changer votre État d'Esprit: Devenir une Personne Consciente et PositiveD'EverandLa Pensée Positive en 30 Jours: Manuel Pratique pour Penser Positivement, Former votre Critique Intérieur, Arrêter la Réflexion Excessive et Changer votre État d'Esprit: Devenir une Personne Consciente et PositiveÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (12)
- Aimez-Vous en 12 Étapes Pratiques: Un Manuel pour Améliorer l'Estime de Soi, Prendre Conscience de sa Valeur, se Débarrasser du Doute et Trouver un Bonheur VéritableD'EverandAimez-Vous en 12 Étapes Pratiques: Un Manuel pour Améliorer l'Estime de Soi, Prendre Conscience de sa Valeur, se Débarrasser du Doute et Trouver un Bonheur VéritableÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (4)
- Magnétisme Personnel ou Psychique: Éducation de la Pensée, développement de la Volonté, pour être Heureux, Fort, Bien Portant et réussir en tout.D'EverandMagnétisme Personnel ou Psychique: Éducation de la Pensée, développement de la Volonté, pour être Heureux, Fort, Bien Portant et réussir en tout.Évaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Hygge: L'art Danois de Créer des Habitudes de Confort, de Joie et de Bonheur (Comprend des Activités, des Recettes et un Défi Hygge de 30 Jours)D'EverandHygge: L'art Danois de Créer des Habitudes de Confort, de Joie et de Bonheur (Comprend des Activités, des Recettes et un Défi Hygge de 30 Jours)Évaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (6)
- L'hypothèse du bonheur: La redécouverte de la sagesse ancienne dans la science contemporaineD'EverandL'hypothèse du bonheur: La redécouverte de la sagesse ancienne dans la science contemporaineÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (383)
- Transformez votre vie: Utilisez le pouvoir créateur qui est en vous pour construire votre vie à l'image de ce que vous voulez qu'elle soitD'EverandTransformez votre vie: Utilisez le pouvoir créateur qui est en vous pour construire votre vie à l'image de ce que vous voulez qu'elle soitÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (14)
- Pourquoi la Polygamie et le Divorce en Islam?D'EverandPourquoi la Polygamie et le Divorce en Islam?Évaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (2)
- Les Secrets De La Guérison Mentale : Guérissez Votre Corps Et Votre EspritD'EverandLes Secrets De La Guérison Mentale : Guérissez Votre Corps Et Votre EspritPas encore d'évaluation
- La loi de l'attraction: Un manuel guidé pour manifester avec succès la santé, attirer vos désirs, la richesse, s'aligner sur les conditions de manifestation du bonheur et de l'amour.D'EverandLa loi de l'attraction: Un manuel guidé pour manifester avec succès la santé, attirer vos désirs, la richesse, s'aligner sur les conditions de manifestation du bonheur et de l'amour.Évaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (6)
- La vie n'est pas une tartine de merde: Voyage au fond de soiD'EverandLa vie n'est pas une tartine de merde: Voyage au fond de soiPas encore d'évaluation
- 365 offirmations* pour surmonter dépression, découragement, déprime et être heureux en toutes circonstances [Ce n'est PAS une faute d'orthographe]D'Everand365 offirmations* pour surmonter dépression, découragement, déprime et être heureux en toutes circonstances [Ce n'est PAS une faute d'orthographe]Évaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- 7 Habitudes Qui Vous Rendent Riche: Créer la Richesse Que Vous VoulezD'Everand7 Habitudes Qui Vous Rendent Riche: Créer la Richesse Que Vous VoulezPas encore d'évaluation
- Le Pouvoir Caché Des Mots : Dites Les Bonnes Choses Aux Bonnes PersonnesD'EverandLe Pouvoir Caché Des Mots : Dites Les Bonnes Choses Aux Bonnes PersonnesPas encore d'évaluation
- Je reprends mon temps en main !: La méthode inédite pour gagner 4 heures chaque semaineD'EverandJe reprends mon temps en main !: La méthode inédite pour gagner 4 heures chaque semainePas encore d'évaluation






























































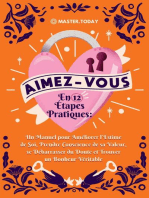













![365 offirmations* pour surmonter dépression, découragement, déprime et être heureux en toutes circonstances [Ce n'est PAS une faute d'orthographe]](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/300645637/149x198/95fd3d02ad/1698713977?v=1)