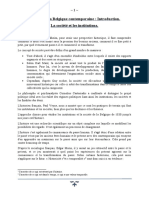Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Colons Arvanito Vlaques
Transféré par
Andoni CushaCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Colons Arvanito Vlaques
Transféré par
Andoni CushaDroits d'auteur :
Formats disponibles
European Journal of Turkish Studies
Social Sciences on Contemporary Turkey
12 | 2011
Demographic Engineering - Part II
On Intentionalism
Nikos Sigalas et Alexandre Toumarkine (dir.)
Édition électronique
URL : http://journals.openedition.org/ejts/4381
DOI : 10.4000/ejts.4381
ISSN : 1773-0546
Éditeur
EJTS
Référence électronique
Nikos Sigalas et Alexandre Toumarkine (dir.), European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011,
« Demographic Engineering - Part II » [En ligne], mis en ligne le 13 novembre 2011, consulté le 06 mai
2020. URL : http://journals.openedition.org/ejts/4381 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ejts.4381
Ce document a été généré automatiquement le 6 mai 2020.
© Some rights reserved / Creative Commons license
1
SOMMAIRE
Intention et contingence
L’historiographie de la violence sur les minorités dans son rapport avec le droit
Nikos Sigalas
La spécificité musulmane dans l’évolution démographique de la Bosnie-Herzégovine durant
la seconde moitié du XIXe siècle (1850-1914)
Philippe Gelez
Crossing the borders in reality and in press: the case of the newspapers Yeni Adım and
Yarın in the late 1920s
Yannis Bonos
How the North was won
Épuration ethnique, échange des populations et politique de colonisation dans la Macédoine grecque.
Tassos Kostopoulos
The Muslim Chams of Northwestern Greece
The grounds for the expulsion of a “non-existent” minority community
Lambros Baltsiotis
Kilkis 1913 : territoire, population et violence en Macédoine
Entretien mené par Nikos Sigalas, les 20 mars et 21 avril 2008, à Athènes, revu et complété par l’interviewé
Léonidas Embiricos
Riots against the Non-Muslims of Turkey: 6/7 September 1955 in the context of demographic
engineering
Dilek Güven
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
2
Intention et contingence
L’historiographie de la violence sur les minorités dans son rapport avec
le droit
Design and contingency. A historiography of violence exerted on minorities in
link with the law
Nikos Sigalas
“The only proper object of hatred or vengeance is
a person or creature, endowed with thought and
consciousness; and when any criminal or
injurious actions excite that passion, it is only by
their relation to the person, or connexion with
him” (David Hume, Enquiries Concerning the Human
Understanding, And Concerning the Principles of
Morals).
1 Le présent numéro est le deuxième d’un long dossier de l’ EJTS ; il sera suivi d’un
troisième et dernier numéro. Conçu à l’origine comme un débat sur le concept
d’ingénierie démographique et les travaux qui s’en réclament en Turquie, ce dossier a
cependant très vite évolué vers une thématique plus large portant sur la violence
contre les populations minoritaires dans l’Empire ottoman, la Turquie et les Balkans,
dans le cadre d’un espace post-ottoman. L’ampleur du dossier et la richesse des articles
qui nous ont été soumis nous ont poussés à élaborer une problématique concernant
l’historiographie de la violence contre les minorités. Cette problématique est
développée dans les trois textes qui encadrent le dossier (les textes introductifs du
premier et du deuxième numéro et la postface du troisième), lesquels, en plus de la
contextualisation des études présentées, ont l’ambition d’explorer quelques pistes
théoriques concernant l’historiographie en question. Ainsi, la présente introduction
reprend le fil de celle du numéro précédent (Sigalas et Toumarkine 2008) – où nous
avions essayé de faire une présentation générale de l’historiographie de la violence
contre les minorités dans la Turquie et les Balkans – dans le but d’esquisser quelques
hypothèses concernant les conditions de possibilité de cette historiographie.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
3
2 Nous allons ainsi dans un premier temps nous pencher sur le mythe de l’Etat conçu
comme un tout cohérent et uniforme, puisqu’une grande partie de l’historiographie qui
nous intéresse suppose un Etat quasiment individué, voire identifié au chef ou aux
dirigeants de l’Etat. Or, ces dirigeants de l’Etat sont censés agir toujours en secret,
planifier secrètement la persécution, l’éviction du territoire ou, même, la disparition des
populations minoritaires. Le secret d’Etat constituera le deuxième objet que nous allons
examiner. Nous nous tournerons ensuite vers le domaine du droit puisque, comme nous
l’avons souligné dans l’introduction du premier numéro (Sigalas et Toumarkine 2008 :
§ 19-26), les concepts de l’historiographie de la violence contre les populations
minoritaires sont très largement empruntés au droit international, tandis que
l’évolution de cette historiographie suit sur l’évolution du droit international
(thématique reprise ici, infra § 22-42). Ici, l’accent sera mis sur un autre aspect du
rapport de l’historiographie qui nous intéresse avec le droit, à savoir son rapport avec
la question de l’intention, notion fondamentale du droit pénal. En d’autres termes, nous
traiterons de l’intentionnalisme1, tendance – explicitement ou implicitement –
dominante dans cette historiographie que nous essayerons de mettre en rapport avec
les régimes de vérité où elle puise sa légitimité. Le domaine du droit est
incontestablement un de ces régimes de vérité. Ainsi, en suivant encore une fois la piste
du droit international, nous allons essayer de cerner le rapport de ses différentes
phases avec la conception intentionnaliste de l’histoire de la violence et de l’oppression
des minorités. Cet examen nous indiquera cependant que le domaine du droit
international n’est pas indépendant, dans son évolution et dans sa façon d’influencer
l’historiographie, d’un régime de gouvernementalité plus général : le libéralisme, voire
pour la deuxième moitié du XXe siècle, le néolibéralisme. Premièrement, parce que le
libéralisme est, dès le départ, doublé d’une augmentation de la demande judiciaire,
tandis que le néolibéralisme projette cette exigence également dans le domaine du
judiciaire, en multipliant les instances et leurs objets (Foucault 2004b : 170-181 ;
Foucault 2001). Deuxièmement parce que le néolibéralisme construit un sujet de
l’activité économique, l’homo œconomicus, qui déborde son domaine d’origine,
l’économie, pour se propulser dans les autres domaines sociaux, y compris dans celui
du droit. De la sorte l’homo œconomicus croise la notion constitutive de la responsabilité
morale, le libre-arbitre, qui est au fond la prémisse de l’intentionnalisme. Cette
rencontre, ainsi que le nouveau moralisme et la conception individualisante de la
responsabilité qui en découlent nous semblent être d’une importance capitale pour
l’ascendant de l’intentionnalisme, à partir du dernier quart du XX e siècle (cette piste
nous a été suggérée par Gérard Noiriel, cf. Noiriel 2008). En dernière analyse, le rapport
entre l’intentionnalisme et les autres systèmes d’interprétation qu’on lui oppose (cf.
infra) s’inscrit implicitement dans le cadre du rapport entre les notions fondamentales
de nécessité et de contingence. Sauf que ce couple conceptuel change complètement de
disposition selon les différents appareillements : selon, par exemple, qu’on place la
nécessité du côté de l’individu et la contingence du côté de l’Etat, ou le contraire.
3 Enfin, si l’on convient que le néolibéralisme, dominant au moins depuis les années 1980
en tant que discours et technique gouvernementale à une échelle mondiale – bien au-
delà du seul domaine économique –, contribue à faire de l’intention un concept
fondamental dans l’analyse historique (celle notamment de la violence de masse contre
les minorités), il reste à s’interroger sur la structure de ce concept. Empruntée au droit
pénal, l’intention a évolué dans le cadre de l’histoire de celui-ci. C’est cette évolution
que nous allons étudier dans la dernière partie de cet article qui examine le statut de
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
4
l’intention en droit pénal, l’évolution de ce statut et les implications du transfert de
cette notion juridique dans l’historiographie.
4 Précisons toutefois que notre ambition ici n’est pas de faire le procès de la notion
d’intention, mais, en étudiant son rapport avec des régimes de pensée dominants – qui
influencent son contenu –, d’essayer de dégager les conditions dans lesquelles cette
notion peut constituer un objet légitime des sciences sociales, i.e. satisfaire aux
conditions dont les sciences sociales ont besoin pour constituer un champs autonome.
5 Commençons par la présentation des études de ce numéro, qui ont été les stimuli de la
problématique que nous allons développer ici.
I. Présentation des études du numéro
6 Nous publions ici trois articles et un long entretien sur la Grèce, un article sur la
Bosnie-Herzégovine sous occupation et administration austro-hongroise, et enfin une
contribution sur la Turquie. Aucun de ces articles ne se sert du concept d’ingénierie
démographique, qui n’est pas utilisé par les chercheurs travaillant sur les Balkans
(Sigalas et Toumarkine 2008 : § 10-18). Ces articles sont tous des études de cas très
fouillées, à l’échelle d’une ville (Istanbul, Kilkis), d’une région (Epire occidentale), d’une
province (Thrace occidentale, Macédoine, Bosnie-Herzégovine). Elles concernent pour
quatre d’entre elles des événements, peu ou pas étudiés : migrations ponctuelles de
Bosniaques musulmans vers l’Empire ottoman dans les années 1880-1900 (Gelez),
pogromes anti-grecs à Istanbul dans la nuit du 6/7 septembre 1955 (Güven), destruction
de la ville de Kilkis et migration de sa population en 1913 (Embiricos), expulsion de
musulmans albanophones d’Epire occidentale en 1944-1945 (Baltsiotis). Mais à partir de
ceux-ci, conjuguant synchronie et diachronie, les articles balaient un temps long qui
vient éclairer l’événement. Celui-ci, à son tour, est une clef pour lire une politique
démographique et sa déclinaison. Les trois articles et l’entretien qui concernent la
Grèce (Baltsiotis, Bonos, Kostopoulos et Embiricos) contribuent à combler les lacunes de
l’historiographie de ce pays relatives à la politique démographique concernant les
minorités2. L’article de Dilek Güven, qui porte sur les violences dirigées contre les Grecs
d’Istanbul et leurs biens pendant la nuit du 6-7 septembre 1955, constitue une
importante contribution de l’unique spécialiste turque de la question. Enfin, l’étude
détaillée de Philippe Gelez s’attache à définir la nature des migrations de Bosniaques
musulmans, à cerner le rôle joué par celles-ci dans la modification des équilibres
démographiques intercommunautaires et à mesurer le rôle joué dans ces migrations
par la politique d’État austro-hongroise.
7 Un des traits communs aux articles de cette seconde livraison du dossier est de
débrouiller le rapport complexe entre territoire et population qu’avait déjà analysé,
dans la première livraison, l’interview concernant l’expulsion des Juifs de Thrace en
1934 effectuée avec Rıfat Bali (2008). Un des points faibles des analyses d’ingénierie
démographiques est en effet de se focaliser sur l’action de l’État contre une population
ou un groupe ethnique, en perdant souvent de vue les considérations territoriales qui
déterminent cette action. Car la « population » n’existe pas sans le « territoire », les
deux émergent ensemble dans les discours et les pratiques qui constituent l’État
moderne (Foucault 2004a). Gouverner une population signifie forcément ordonner un
territoire et vice versa ; ce qui fait du contrôle de la population une façon de
« sécuriser » le territoire, voire de le dominer ou même de le conquérir. Les textes sur
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
5
la Grèce viennent entre autres rappeler fort à propos que les politiques
démographiques menées dans la région frontalière sont singulières, ce que Bali avait
souligné pour la Thrace orientale. Plus encore que le régional, c’est la dimension locale,
ou plutôt le déplacement entre les échelles, qui est largement utilisé dans ce numéro
comme méthode de fragmentation des politiques démographiques et comme un
instrument relativisant la nature ingénieriale de celles-ci. Enfin, Embiricos nous
montre également la spécificité de cette territorialité particulière qu’on appelle « le
front » – territoire surinvesti aussi bien militairement que politiquement – et des
logiques de violence que celui-ci dégage (cf. également Sigalas n.p.). Il nous rappelle
ainsi, toute proportion gardée bien évidemment, le travail récent de Timothy Snyder
(2012), Terres de sang. L’Europe entre Hitler et Staline, qui montre comment le front de l’Est
– formant une territorialité mouvante tout au long de la guerre, suivant les
transformations continuelles de l’horizon de celle-ci – a été un laboratoire de pratiques
d’extermination au-delà de toute imagination préalable, en provoquant également la
destruction de populations habitant très loin de ce front, de part et d’autre de celui-ci 3.
8 Les six textes réunis nous montrent combien la fragmentation est aussi le résultat de la
décomposition de l’Etat en une multitude d’acteurs qui composent et s’affrontent
localement et avec lesquels les populations, objets de cette ingénierie, ne cessent pas de
négocier, et cela quelle que soit la marge de manœuvre qui leur est consentie. Cette
fragmentation fait bien sûr écho aux développements fonctionnalistes/structuralistes
d’un Franz Neumann analysant la compétition pour le pouvoir entre des institutions
comme dans Béhémoth. Structure et pratique du nationalisme-socialisme. 1933-1944 et qui
voyait dans l’affrontement entre les institutions (armée, bureaucratie, parti, industrie)
du régime nazi la dynamique de son système. Neumann croyait à l’éclatement d’un
appareil administratif unifié et donc à l’effondrement du mythe de l’Etat. Ce point de
vue est partagé par la plupart des auteurs de ce numéro, mais pour eux la
fragmentation est beaucoup plus grande et donne à de petits acteurs locaux une marge
d’action, une autonomie et une initiative plus larges, sapant du même coup le schéma
trop simpliste d’une pyramide bien hiérarchisée. La déconstruction du mythe de l’Etat
cohésif et cohérent n’empêche pas ces auteurs de se pencher sur des plans
d’assimilation, de déplacement ou même de massacre des populations minoritaires,
sans pour autant donner à ces plans un statut primordial, c’est-à-dire sans les
considérer comme primant sur tout autre élément du contexte.
9 Enfin, ces six études nous offrent un panorama des politiques démographiques
appliquées, en temps de paix ou en temps de guerre, à des populations considérées
comme minoritaires, dangereuses ou ennemies4. Au centre se trouve la question de la
responsabilité de l’Etat, ou de mécanismes liés à l’Etat, le degré de planification des
violences étudiées, les motifs des planificateurs et des auteurs de celles-ci, etc. Toutes
ces questions pourraient être regroupées sous le terme d’intentionnalité. Or, ces mêmes
études nous permettent de nuancer la notion d’intentionnalité en mettant en relief les
mécanismes administratifs – formés dans la longue durée et plus ou moins autonomisés
du contrôle démocratique5 – qui construisent les minorités, en en faisant des objets d’un
politique nationaliste ou de sécurité nationale, d’une raison d’Etat (comme l’on disait à
l’époque). Ces mécanismes, qui œuvrent souvent en secret, en produisant
inlassablement des plans démographiques, engendrent progressivement les conditions
de possibilité des politiques démographiques effectives, plus ou moins violentes.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
6
II. Intentionnalisme et secret d’Etat
10 A ce niveau un autre problème se pose, qui renvoie à la causalité en histoire : sommes-
nous en droit de raisonner rétrospectivement, d’assigner au rapport entre processus de
construction des minorités et violences finalement perpétrées un statut de nécessité ?
Sans toujours poser la question en ces termes, les chercheurs qui participent à ce
numéro ne sont pas dupes de cette simplification très courante dans l’historiographie
de la violence de masse. Au contraire, leurs études nous fournissent plusieurs éléments,
certains évoqués ci-dessus, pour critiquer cette approche réductionniste (cf. en
particulier dans ce numéro Bonos et Gelez qui questionnent l’existence-même d’une
logique d’ingénierie dans les cas qu’ils étudient). Le problème auquel nous faisons
allusion est d’un ordre général : il concerne le rapport de l’historiographie avec le
présent, avec les questions d’actualité politique, l’expertise et le domaine de la justice.
La réflexion historique part, nécessairement, du présent, des implications présentes du
passé sur lequel elle porte (ce que Marc Bloch [1949] appelle « passé-présent »).
L’histoire est, implicitement ou explicitement, une façon de comprendre le présent, elle
est en quelque sorte emprisonnée dans le présent, dans l’actualité des problèmes passés
qu’elle étudie. Le danger qui en découle est que l’historien, au lieu de chercher, comme
le voudrait Marc Bloch, cette partie du passé qui reste encore vivante dans le présent,
projette simplement le présent sur le passé afin de confirmer des positions liées à des
enjeux d’actualité politique. Or, l’actualité des violences perpétrées dans le passé contre
des minorités – et plus généralement l’oppression de celles-ci – porte plutôt sur la
question de la responsabilité juridique et, partant de l’intention, en laissant peu ou pas
du tout de place à l’analyse sociologique et aux tentatives de prendre en compte le
contexte historique plus large, y compris les facteurs imprévus, contingents. A cela
contribue également le caractère secret des politiques concernant les populations
minoritaires (ou ennemies) qui invite l’imagination à suppléer aux lacunes
documentaires par l’idée d’une action cohérente et uniforme de l’Etat. Tel est souvent
le cas des chercheurs se réclamant de l’« ingénierie démographique », qui ont tendance
à déduire des faits leur planification préalable6.
11 En pratique, toutefois, il y a toujours une dialectique entre intention et contingence (cf.
Embiricos § 17-35) ; des événements de toute sorte, des circonstances imprévues, ou
mal calculées, peuvent induire la radicalisation des plans préalablement conçus, leur
transformation, leur annulation ou même l’émergence de plans totalement nouveaux.
A quoi il faudrait ajouter que les facteurs contingents ne viennent pas nécessairement
de l’extérieur d’un système (par exemple d’un Etat), mais de l’équilibre entre ses
secteurs ou ses segments, du dérèglement de cet équilibre, de l’autonomisation d’un ou
de plusieurs de ces secteurs, voire de leur antagonisme et d’une forme d’anomie
chaotique comme Neumann le supposait. Il y a donc deux formes de contingence qui
prennent au dépourvu les planifications intentionnelles. D’un côté, il y a une
contingence provenant de l’extérieur du système (du régime, de l’Etat ou d’une
communauté par exemple), issue du contexte plus général dans lequel ce système
s’inscrit. On pourrait qualifier cette forme de contingence de « conjoncturelle ». De
l’autre côté, il y a une contingence provenant de l’intérieur du système, issue de
l’interaction entre les différents secteurs qui le constituent, du dérèglement de ces
secteurs ou, même, de leur désectorisation. Cette forme de contingence, illustrée par
les travaux de Neumann, pourrait être qualifiée de « fonctionnelle ». Il est évident que
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
7
ces deux types de contingence interagissent, que la contingence provenant de
l’extérieur d’un système produit du dérèglement fonctionnel au sein de celui-ci et qu’à
son tour, le dérèglement fonctionnel accentue la disposition du système à être
influencé par les facteurs extérieurs. La prise en compte de ces deux formes de
contingence interdit de concevoir un système en vase clos, uniforme et cohérent, tel un
système idéologique. Elle ouvre la voie à la prise en compte de la multiplicité des
facteurs qui composent la réalité historique. D’ailleurs, ce point de vue n’exclut pas
l’intention, la volonté consciente des individus de peser sur le cours des événements,
qui est sans aucun doute un facteur parmi ceux qui influencent l’histoire, mais non
l’unique et non nécessairement le plus déterminant. Lorsqu’on tend à éliminer la
contingence au profit d’une conception simplifiée de l’intention, on tend également à
se représenter un système uniforme (i.e., dans le cas qui nous intéresse, un Etat, un
régime uniforme), qui agit comme un seul individu conscient, d’où la tendance à
identifier le nazisme avec le seul Hitler, ou le régime jeune-turc avec le seul Talat, de
faire du premier le génie criminel qui a, à lui seul, conçu, planifié et ordonné le
génocide juif, tout comme le second le génocide arménien.
12 Alors que, dans la plupart des cas, c’est le contraire qui se passe. La violence de masse
émerge lorsque l’Etat organisé est déréglé : dans le vide de souveraineté que forme le
moment de la conquête (Derrida 1999), dans l’anomie qui régit l’occupation ; lorsqu’un
secteur s’autonomise et fonctionne au-delà des normes générales (cf. Embiricos et
Kostopoulos sur le « mécanisme macédonien ») ; lorsque l’Etat est suppléé par un parti
ou par l’armée ou lorsque – et ce cas est très fréquent – le « parti » et l’armée se
disputent le contrôle de l’Etat, se lançant dans un antagonisme dangereux et
potentiellement criminel.
13 Au fond, le « secret d’Etat » demeure, en quelque sorte, à l’extérieur de l’Etat (pris dans
sa forme juridique et institutionnelle) et ceci malgré sa qualité fondatrice, ou plutôt à
cause d’elle. Le secret d’Etat peut facilement devenir l’affaire de bandits, de hors-la-loi,
paramilitaires ou para-politiques, qui prennent l’Etat au piège, en faisant fi de ses
normes et institutions, sous prétexte de vouloir/pouvoir le sauver. Le « secret » dérègle
l’Etat, le livre à l’antagonisme des secteurs autonomisés, qui disputent le « secret
d’Etat », se réclament de lui. Et les effets de ce dérèglement deviennent d’autant plus
désastreux, d’autant plus criminels que le dérèglement devient la règle, que le secret
embrasse la société, qui devenant sa gardienne s’engloutit dans son anomie. Le secret
d’Etat est affaire de sociologie, c’est à la fois une croyance sociale et un répertoire
d’action para-politique. Les acteurs de celle-ci sont les gardiens, toujours
autoproclamés, du secret ; ils peuvent appartenir à tout milieu social à toute catégorie
professionnelle, toujours prêts à transgresser la loi pour défendre le secret. En vain les
intentionnalistes cherchent la cohérence entre projet et action à la tête de l’Etat. Hitler
n’avait pas besoin de prononcer l’ordre de la solution finale ; ses phrases incomplètes et
indéfiniment allusives suffisaient pour autoriser ses subalternes à commettre la pire
action criminelle, car elles ne faisaient que produire du secret et distribuer l’ordre de
bien le garder7 ; et ce processus se reproduisait à tous les niveaux du régime nazi, qui
restait toujours extérieur à l’Etat et même hostile à celui-ci, qui doublait l’Etat par les
structures du secret. D’ailleurs, la tendance d’attribuer toute la responsabilité du
génocide à Hitler n’a pas uniquement pour résultat un défaut de compréhension du
régime, mais implique également une négation de la « culpabilité allemande » (Jaspers
1946), ou tout au moins la culpabilité nazie.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
8
14 Comme l’a révélé le procès Eichmann, vers la fin de la conférence de Wannsee, les
différents participants se livraient à une surenchère en termes d’inventivité et de
cruauté concernant les méthodes qui devaient être adoptées pour exterminer les
Juifs (Browning 2004 : 413), tandis que Reinhard Heydrich se félicitait d’avoir aussi
facilement réussi à asseoir son autorité sur les représentants politiques et d’affermir le
contrôle de la RSHA8 sur l’ensemble de la « solution finale ». La « question juive » et sa
« solution » formaient alors un enjeu important dans le cadre de l’antagonisme des
différents secteurs du pouvoir nazi : ente personnel politique et dirigeants SS, entre la
SS et l’Etat-major etc. (Cesarani 2005 ; Longerich 2000). Au fond, Heydrich, qui a été
chargé par Göring en juillet 1941 d’organiser la « solution finale » et qui avait organisé
les premières déportations pendant le mois d’octobre de la même année, n’avait besoin
de la conférence de Wannsee que pour légitimer son mandat auprès des autorités
politiques. Ainsi, la conférence n’eut pas l’influence déterminante sur le sort des Juifs
qu’on lui prête d’habitude ; elle fut principalement une mise en scène destinée à fonder
le monopole de Heydrich sur la « solution finale ». Toujours est-il que le procès-verbal
de la conférence rédigé par Eichmann et, à plus fοrte raison, les précisions de ce
dernier à ce sujet pendant son procès, constituent des témoignages très importants de
l’entente des dirigeants politiques nazis concernant l’extermination des Juifs et de leur
collaboration volontaire dans celle-ci. Le « secret » était connu de tous, il n’a pas eu
d’objections, encore moins de résistance ; et ceci à tous les niveaux de l’administration
politique et militaire, qui ont dû être largement mobilisées dans le cadre de l’entreprise
gigantesque du génocide. Bien au contraire, à l’intérieur de cette administration
politique, de cette armée et de cette société englouties dans le « secret » (i.e. la
diabolisation de Juifs et de tout autre ennemi, « susceptible de regarder [le peuple
allemand] de travers » et la nécessité de « s’en débarrasser ») plusieurs personnes se
sont distinguées par leur excès de zèle, leur sang-froid et leur application dans
l’extermination. Aucun document rapportant l’ordre d’Hitler d’exterminer les Juifs ne
suffirait pour expliquer l’étonnant niveau de consentement de larges parties de la
société allemande qui ont, directement ou indirectement, participées au génocide et
leur minutie dans son exécution. Et ce consentement constitue au fond la condition de
possibilité de l’holocauste. Afin de comprendre ceci, il faudrait se pencher plutôt sur la
force de l’antisémitisme – et plus généralement du racisme, de la conception du monde
à travers celui-ci et des théories complètement paranoïaques du complot qui en
découlent – non pas autant en tant qu’idéologie, mais en tant que cadre de mobilisation
et de légitimation. Car, même s’il n’a pas été planifié d’avance, le génocide juif était
d’avance légitimé, dans la mesure où les théories raciales et l’antisémitisme étaient
inscris dans la forme même du Béhémoth nazi et dans celle de ses rapports avec la
société. La surenchère en matière d’antisémitisme, en discours et, encore plus, en acte,
constituait une façon de s’affirmer, de s’imposer par un coup de force dans
l’antagonisme pour le pouvoir, dans ce système anomique qui avait redoublé les
structures hiérarchiques de l’administration politique et militaire avec celles, beaucoup
plus confuses et arbitraires, du parti et de ses différentes organisation satellites. Par
extension, tout antagonisme pour le pouvoir, tout effort pour s’affirmer dans ce
système, pour légitimer les objectifs de celui-ci ou mobiliser en sa faveur les soldats et
les civils, étaient susceptibles de contribuer à l’escalade de la violence contre les Juifs.
Pour cette raison, les débats interminables concernant le document-« pièce à
conviction » qui serait à la base du génocide, nous semblent aussi bien détourner la
recherche de son objectif principal : comprendre le mécanisme social du génocide, que
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
9
porter de l’eau au moulin des négationnistes en acceptant implicitement l’agenda qu’ils
proposent.
15 De façon analogue, il y a aujourd’hui en Turquie, dans les polémiques autour du
génocide arménien, une grande naïveté chez ceux qui centrent le débat sur
« l’ouverture » des archives d’Etat9, comme s’il suffisait de lever le secret pour trancher
la question de la nature de la violence d’Etat ou, plus simplement, pour distinguer les
bourreaux et honorer les victimes. Cette conception place au passage le document
d’archives d’Etat sur le même plan que le texte sacré, vecteur et truchement de la
Révélation. Cette conception, négatrice de tout travail herméneutique, non seulement
fait fi de l’existence d’une langue codée de l’administration, mais surtout se perd dans
une vaine quête de la pièce à conviction fondamentale : de l’ordre criminel émanant de
la tête de l’Etat, de son centre secret. Dans le cas de la Turquie des Unionistes des
années 1910, il est par définition introuvable, parce que le régime jeune-turc consiste
en un dédoublement de l’Etat, désormais flanqué d’un para-Etat, extérieur à celui-ci. Ce
mouvement se décompose en la conquête de l’Etat par le parti, en l’autonomisation de
l’organisation activiste et terroriste Teşkilat-i Mahsusa par l’Etat, en l’antagonisme du
parti avec l’armée, mais aussi entre les fractions du Teşkilat-i Mahsusa liées pour
certaines au parti et pour d’autres à l’armée. Il s’agit bien ici d’une souveraineté du
domaine du secret d’Etat sur l’Etat et d’une très grande autonomisation des secteurs
para-politiques et paramilitaires, au sein même du gouvernement, de l’administration
civile et de l’armée (cf. à titre comparatif, dans ce numéro, Kostopoulos, Embiricos et
Baltsiotis pour une analyse du rôle des bandes et autres milices en Thrace, Macédoine
et Epire). Le génocide ne peut être qu’un fait collectif, un fait de régime (dans le sens
plus large qui prend en compte les chaînes d’interdépendance qui fondent le pouvoir
d’un régime) et non pas le fait d’une ou de quelques personnes. Le « secret d’Etat » n’est
jamais autant secret qu’on le prétend, mais son emprise augmente lorsqu’il est partagé
par une partie de la société : il est d’autant plus puissant et plus criminel lorsque « tout
le monde sait ».
16 Ainsi, une source très intéressante concernant le front de Sarıkamış nous montre que,
bien avant la déportation des Arméniens, les soldats musulmans, décimés par le froid et
par la faim dans le cadre de la manœuvre insensée conçue et commandée par Enver
paşa, étaient prêts à croire aux paroles de ce dernier, attribuant son échec à la trahison
des soldats arméniens, et à « se venger » sur ceux-ci en procédant à des massacres en
grande partie spontanées (Eti 2009). Avant donc le génocide, bien des gens étaient prêts
à croire au « complot arménien » contre l’Etat et à prendre à leur compte la vengeance
de l’Etat. Or les plus dangereux parmi eux étaient ceux qui, comme le docteur
Bahaeddin Şakir, membre éminent du CUP et du bureau du Teşkilat-i Mahsusa, avaient
fait de la mission de « sauver l’Etat » une source d’autorité personnelle leur permettant
d’instaurer un réseau de pouvoir parallèle dans les provinces orientales de l’Empire qui
se trouvaient alors sous le commandement de l’armée. Et la même « mission
salvatrice » a constitué une source de pouvoir pour les collaborateurs et subalternes de
Bahaeddin Şakir (préfets, chefs de gendarmerie, notables locaux, responsables locaux
du parti, forçats mis en liberté, bandits etc.) qui ont pu souvent encaisser les dividendes
de leur participation au génocide arménien et à d’autres « missions sécrètes » par leur
enrichissement et l’acquisition de fonctions civiles et de positions politiques, obtenues
ou conservées pour certains, pendent la guerre d’indépendance et la période
républicaine.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
10
17 La même chose est d’ailleurs valable pour ceux qui, parmi les diplomates, militaires et
bandits ayant formé le « mécanisme macédonien » grec, ont ensuite occupé des
positions importantes dans l’appareil administratif. Tandis que d’autres sont venus
ensuite construire leur carrière de fonctionnaire et d’homme politique en rapport avec
le « secret d’Etat » que constituait l’existence d’une population slave-macédonienne
dans ce pays (cf. Kostopoulos, Embiricos). Ces trajectoires – ainsi que les mécanismes et
enjeux qui se cristallisent autour des questions minoritaires, pour rendre possible
l’oppression et la violence – sont perdues de vue du moment que la recherche est
uniquement focalisée sur l’intention, et que l’on fait de celle-ci une constante,
indépendante des autres éléments du contexte.
III. L’intentionnalisme entre droit international et droit
pénal
18 Toutes ces critiques ne changent rien au fait que l’approche intentionnaliste reste
dominante lorsqu’il s’agit d’étudier la violence de masse et l’oppression des minorités.
Les raisons en sont sans doute multiples et relèvent des modalités collectives
d’appréciation de la vérité. Or ces modalités sont à leur tour influencées par des
régimes de vérité ou, plus précisément de régimes de véridiction, historiquement
identifiables. Parmi ces régimes de véridiction se distingue le domaine du droit, qui est
doté d’un système formel d’appréciation de la vérité.
19 Une raison de l’ascendant des interprétations intentionnalistes est à notre avis à
chercher dans la façon dont le droit influence historiquement notre conception de la
responsabilité. D’ailleurs la violence contre les minorités et leur oppression sont
devenues, depuis déjà le début du XXe siècle, affaire de droit, notamment de droit
international, dans des modalités qui se transforment suivant les différentes phases de
l’évolution de celui-ci. Les événements que les spécialistes de la violence de masse et de
la discrimination des minorités étudient ont été, pour la plupart, saisies par le droit
international ou pourraient potentiellement l’être. De surcroit, le droit a de plus en
plus tendance aujourd’hui d’inclure dans le domaine de sa compétence les questions de
mémoire liées aux violences passées (cf. les lois dites mémorielles). Ainsi,
l’historiographie qui nous intéresse ici chevauche très fréquemment le domaine de
compétence du droit et vice versa (lorsque par exemple les chercheurs sont appelés à
témoigner en tant qu’experts aux procès de criminels de guerre et aux procès des
négationnistes notoires ou lorsque les organisations internationales demandent aux
chercheurs de rédiger des rapports sur les violences perpétrées contre de populations
civiles ou sur l’infraction des droits de minorités). On a déjà constaté que du
chevauchement de ces deux domaines résulte un emprunt de concepts : que
l’historiographie de la violence de masse a tendance à emprunter les concepts du droit
international et que, plus généralement, les évolutions de cette historiographie sont
fortement influencées par les différentes phases du droit international (Sigalas et
Toumarkine 2008 : § 19-26).
20 D’ailleurs la notion d’intention est également un terme de droit : le fondement de la
responsabilité en droit pénal. Or, comment le droit pénal se mêle-t-il de l’histoire de la
violence de masse, qui semble être plutôt de la compétence du droit international ?
Cependant, à regarder de plus près, les choses ne sont pas aussi tranchées : les
domaines de compétence se brouillent, puisque l’évolution du droit international est
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
11
doublée d’une quête pour l’élaboration de dispositifs de justice pénale adéquats pour
juger les coupables des grandes violences perpétrées en temps de guerre contre les
civils. Des tribunaux militaires nationaux, après la grande guerre (cf. les procès des
responsables des massacres arméniens en 1918-1919 à Istanbul, sous occupation
interalliée), nous passons au tribunal militaire international du Procès de Nuremberg,
après la Deuxième Guerre mondiale, pour arriver, après la fin de la Guerre froide, à la
synthèse entre droit international et droit pénal que constituent les Tribunaux pénaux
internationaux pour l’ex-Yougoslavie (1993) et le Rwanda (1994) et, finalement, la Cour
pénale internationale (créée en 2002). Cette quête pour une justice pénale
internationale a par ailleurs contribué à l’élaboration des concepts juridiques
appropriés à celle-ci, tels les crimes contre l’humanité, le génocide et, en partie, de par
ses usages juridiques, la purification ethnique (les deux derniers notions sont
fortement empruntées par l’historiographie de la violence de masse (cf. Sigalas et
Toumarkine 2008 : § 9-18).
21 Cependant, la synthèse effective du droit international avec le droit pénal ne suffit pas
pour expliquer le transfert du concept d’intention dans l’historiographie de la violence
de masse, car ce concept était déjà présent dans l’historiographie en question depuis
ses origines, bien avant la rencontre effective du droit international avec le droit pénal,
au sein des tribunaux pénaux internationaux. C’est donc vers le temps de l’émergence
de cette historiographie qu’il convient de se tourner afin de débrouiller le nœud qui lie
celle-ci aussi bien avec le droit international qu’avec le droit pénal, et partant avec
l’intentionnalisme.
IV. L’historiographie de la violence de masse du point
de vue de son rapport avec le droit international
Les livres sur les atrocités
22 L’historiographie de la violence de masse prend naissance avec les livres ou brochures
sur les « atrocités » (i.e. les livres portant sur des massacres collectifs dans le titre
desquels figurent, à part le mot « atrocités », ceux de « destruction », de « crime » ou de
« martyre » ; plusieurs de ces ouvrages sont intitulés « livre noir »). Les livres en
question sont rédigés soit par des comités internationaux d’experts, soit par des
témoins oculaires (correspondants de guerre, diplomates ou membres d’organisations,
religieuses ou civiles, d’aide humanitaire), soit par des comités désignés par les parties
belligérantes dans des buts de propagande soit, enfin, par des intellectuels appartenant
à des communautés victimes de violences. Ils font sporadiquement leur apparition dans
la deuxième moitié du XIXe siècle (ici les « massacres bulgares » – i.e. commis par les
irréguliers ottomans contre les Bulgares – dénoncés par Gladstone en 1876 ont une
valeur paradigmatique), deviennent plus nombreux vers le début du XX e siècle, pour
connaître un premier grand essor au moment des Guerres balkaniques. C’est pendant
ces guerres que des « livres sur les atrocités » sont rédigés par toutes les parties
belligérantes et c’est à ce moment qu’apparaît également l’Enquête dans les Balkans de la
Dotation Carnegie (1914) (Embiricos). La publication de livres sur les atrocités prend
des dimensions encore plus spectaculaires pendant la Grande Guerre et surtout après la
fin de celle-ci. Les « livres sur les atrocités » publiés alors concernent presque tous les
fronts de la guerre et, encore plus, le front ottoman en raison aussi bien de l’étendue
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
12
sans précédent des violences y ayant été commises, que des enjeux diplomatiques des
conférences de Paris et de San Remo (où ont été négociées les conditions du partage du
territoire ottoman prévu le 8 janvier 1918, par le 12e des quatorze points du fameux
discours du président Wilson au Congrès américain).
23 On pourrait supposer que la profusion en cette période de « livres sur les atrocités »
n’est pas indépendante du processus de refondation du droit international qui aboutit à
la mise en place de la SDN. (fondée en 1919, mais dont la constitution a été demandée le
8 janvier 1918, dans le 14e point du discours de Wilson) et de la Cour permanente de
justice internationale (fondée elle en 1922). Cependant la compétence de ces
institutions se limite au droit international stricto sensu 10 et n’a pas pour fonction de
juger les responsables des violences commises pendant la guerre. Leur fondation ne
suffit donc pas en elle-même à expliquer l’augmentation à cette époque des « livres sur
les atrocités ». Celle-ci devrait plutôt être mise en rapport avec le caractère spécifique
des conférences du « système de Paris », régi par la réaffirmation par le présidant
Wilson du principe de nationalités et sa mise en rapport avec le droit des peuples à
l’autodétermination. Wilson mentionne explicitement le principe des nationalités dans
le 9e des quatorze points du message du 8 janvier 1918 (point concernant la rectification
des frontières italiennes). Or, c’est surtout le dernier des quatre points du discours que
Wilson prononce au Congrès le 11 février 1918 qui permet une association des
modalités d’application de ce principe avec les violences perpétrées pendant la guerre :
« Toutes les aspirations nationales bien définies devront recevoir la satisfaction la plus
complète qui puisse être accordée sans introduire de nouveaux ou perpétuer d’anciens
éléments de discorde ou d’antagonisme susceptibles, avec le temps, de rompre la paix
de l’Europe et par conséquent du monde ». Dans ce contexte, les atrocités commises
pendant la guerre semblaient faire appel à un règlement territorial adéquat pour en
éradiquer la cause, afin d’assurer « la paix de l’Europe et par conséquent du monde ».
24 Pour comprendre cette phrase de Wilson, il faut se rendre compte du fait que son
discours, qui nous semble aujourd’hui véhiculer une nouvelle conception de la
diplomatie, s’alignait en réalité sur un certain nombre des théories, formulées à partir
des années 1870 par les juristes libéraux qui ont fondé l’Institut de droit international
(1873) et militaient pour l’instauration d’un nouvel ordre mondial. Cet ordre mondial
devait, selon eux, abandonner les principes de la vieille diplomatie pour être fondé sur
le droit. En contradiction donc avec les principes de la diplomatie traditionnelle, qui
consistait en un système de négociations et d’accords entre souverains ou entre États,
les juristes en question ont pris les nations pour base de leurs théories et pour sujets du
droit international qu’ils aspiraient de mettre en œuvre. Contestant une conception de
la diplomatie fondée uniquement sur la souveraineté – et selon laquelle l’idée même de
droit international était absurde, vu l’absence d’un « souverain international » – ils
défendaient un point de vue organique respectant l’évolution naturelle des
communautés et des nations (Koskenniemi 2001 : § 48-51). Ce faisant ils puisaient
profondément dans la tradition libérale, toujours méfiante envers à la forme État et
favorable à la forme de nation (cf. infra § 46). Les guerres nationalistes qui ont marqué
leur époque leurs semblaient d’ailleurs indiquer que les ambitions des nations, ou leurs
velléités d’indépendance, allaient continuer à modifier la donne diplomatique et les
frontières des anciens Etats. Et ils étaient loin de se tromper ; sauf que, de leur façon, ils
ont eux aussi contribué à renforcer la position du nationalisme face aux Etats et
empires traditionnels.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
13
25 Le défi que le discours de Wilson lançait au principe de la souveraineté étatique
s’inscrivait donc dans une nouvelle conception du droit international, progressivement
élaborée au cours du demi-siècle écoulé et qui puisait sa cohérence dans la tradition
libérale. En outre, l’équilibre du système que proposaient les pionniers du droit
international n’était plus garanti par l’équilibre des puissances, mais par la prospérité
qu’assurait le libre commerce entre les nations. Ainsi, « les hommes de 1873 » (comme
Martti Koskenniemi appelle la génération des fondateurs de l’Institut de droit
international) s’opposaient fermement à toute forme de protectionnisme économique
(Koskenniemi 2001 : § 57-61). Tandis que, pour insister sur le rapport du credo de ces
derniers avec les principes de la nouvelle diplomatie posés en 1919 par le président
Wilson, celui-ci réclamait, dans le troisième de ses quatorze points, « la levée, autant
que possible, de toutes les barrières économiques ».
26 A côté du libéralisme, les discours et les ambitions des fondateurs du droit
international puisaient aussi dans un autre mouvement, propre à l’entropie du système
pénal de leur temps : la « crise juridique » de la fin du XIX e et du début du XX e siècle
(Foucault 2004b : 255). A cette époque du développement de la criminologie et de la
multiplication des instances et des discours juridiques, le domaine du droit se dilatait
dans toutes les directions, aspirant à embrasser de plus en plus de nouveaux domaines
et objets. Par ailleurs la criminologie, tournée vers l’étude des comportements et
instincts criminels, croisait à l’époque avec l’évolutionnisme d’inspiration
spencérienne. Cet évolutionnisme avait été adopté par les libéraux de la fin du XIX e, qui
avaient échangé contre lui leur ancienne foi en l’état de nature. Avec l’émergence du
droit international, en tant que discours et projet, plutôt qu’en tant que pratique,
toutes les tendances de la criminologie et de l’évolutionnisme spencérien se sont
projetées sur les nouveaux sujets de ce droit : les nations, qui sont également devenues
de la sorte des sujets d’instincts et de pulsions criminelles dues à la « nature » plus ou
moins évoluée de leur civilisation. Les « penchants criminels » et le « niveau
d’évolution » des nations ont constitué ainsi des éléments dont le droit international
devait tenir compte, afin d’assurer le nouvel ordre du monde. C’est enfin dans ce
contexte qu’ont émergés les livres sur les atrocités, fortement influencés par le
discours du droit international naissant, par l’individuation des nations qu’opérait ce
discours (cf. Twiss 1863) et par l’application à ces nations individuées des théories de
l’évolutionnisme et de la criminologie.
27 Les membres de l’Institut de droit international ont accordé depuis le début une grande
importance à la Question d’Orient ; à commencer par les « massacres bulgares » de 1876
(Rolin-Jaequemyns 1876) et la question arménienne ( Rolin-Jaequemyns 1891). Or, à
regarder de près leurs publications sur ce sujet, on constate que leurs jugements
concernant le niveau de développement et les penchants criminels de certaines nations
(la Turquie par exemple, ou la nation arabe) ne différaient pas des jugements du même
type que nous trouvons dans les livres sur les atrocités. Ces jugements – qu’on
qualifierait aujourd’hui, un peu anachroniquement, de culturalistes ou de racistes –
constituaient, pour les adeptes du droit international, des données qui devaient être
prises en compte dans l’effort consenti pour instaurer la paix européenne si fortement
espérée, notamment après la Grande Guerre. La violence sans précédent de ce conflit
mondial avait abattu le prestige de l’ancienne diplomatie de l’équilibre des puissances.
Toutes ces conceptions, attentes et inquiétudes composaient – de concert bien
évidement avec les calculs diplomatiques des vainqueurs de la guerre – le contexte de
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
14
la Conférence de paix de Paris, où le nouveau droit international était enfin autorisé à
prendre effet.
28 Selon Eric Weitz, le « Système de Paris » fut le moment de consécration d’une logique, à
l’œuvre au moins depuis les années 1860, consistant à amener le rapport entre Etat et
population au centre de la diplomatie internationale et du droit international (Weitz
2008). Lors des conférences appartenant à ce système, le concept wilsonien
d’autodétermination des nations (dont l’origine est à chercher dans les écrits des
austro-marxistes puis la reformulation chez les Bolcheviks bien avant d’être repris par
Wilson) a été assimilé à l’idée que les Etats doivent avoir des populations homogènes du
point de vue national. Les grandes violences infligées aux populations civiles pendant la
guerre faisaient croire aux chefs d’Etat et aux diplomates participant à la Conférence
que des peuples différents ne pouvaient plus vivre ensemble, qu’il fallait les
« démêler ». Le « démêlage » se ferait de différentes façons. Il fallait d’abord accorder
l’indépendance aux peuples qui était « prêts », du point de vue de leurs « évolution »,
d’assumer leur propre gouvernement. Les autres, dont l’« évolution se trouvait encore
dans un stade inférieur », devaient être placés sous la tutelle des Etats occidentaux (en
fait de ceux qui avaient gagné la guerre) sous la forme de « mandats » (concept fabriqué
au moment de la Conférence de la Paix pour donner une forme humanistique aux
nouvelles colonisations que générait le système de Paris). Or, ne pouvant multiplier à
l’infini les indépendances et les mandats, les personnes qui ont mis en place le nouveau
système international ont donné au « démêlage » également une forme différente :
celle de la reconnaissance des populations « minoritaires » des différents Etats (ce qui
n’est pas sans rappeler la distinction communiste entre nation, territorialement
souveraine, et nationalité qui, se trouvant minoritaire dans le territoire d’une nation,
profiterait de la reconnaissance de ses droits sans pouvoir prétendre à la souveraineté).
Ils ont ainsi poussé les nouveaux Etats indépendants, ainsi que ceux qui avaient perdu
la guerre, à reconnaître officiellement leurs populations minoritaires et ils ont attribué
à la Société des Nations la tâche de veiller à l’observation des droits de celles-ci (cf.
Baltsiotis à propos des Tchams albanais, Kostopoulos et Embiricos à propos des Slaves
macédoniens). C’est par ces dispositions du système de Paris que le concept de minorité
entre de plain pied dans le droit international et que s’instaure pour la première fois un
protectionnisme des minorités (et non plus des groupes religieux comme cela a été le
cas depuis les traités de Westphalie). Enfin, dans des cas où d’extrêmes violences
avaient été commises envers des populations auxquelles il n’était pas question
d’accorder une indépendance territoriale, le « démêlage » a pris la forme radicale
d’accords bilatéraux d’échange de populations, tel l’échange non obligatoire entre la
Grèce et la Bulgarie, stipulé par le traité de Neuilly et, trois ans plus tard, le grand
échange obligatoire entre la Grèce et la Turquie, inclus dans le traité de Lausanne (que
Weitz considère comme faisant partie du système de Paris) 11.
29 Le système de Paris traduisait ainsi en droit international une conception de la
souveraineté nationale issue de l’expérience accumulée, depuis les années 1860, de
l’extrême violence des conflits nationalistes. Et dans le cadre de cette conception, les
crimes perpétrés contre une population devenaient des arguments en faveur de son
indépendance territoriale (ou, tout au moins, de l’octroi à cette population du statut de
minorité et de sa protection consécutive par la SDN). Ainsi les livres sur les atrocités
qui ont vu le jour à cette époque tenaient lieu d’arguments diplomatiques dans la
négociation des nouvelles frontières de l’Europe, notamment dans le cas des empires en
dissolution, comme l’Empire austro-hongrois et l’Empire ottoman. Ces livres avaient
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
15
pour fonction de documenter les crimes perpétrés contre une population donnée
pendant la guerre (y compris très souvent des violences antérieures à celle-ci), en
nommant, lorsque cela était possible, les victimes et les auteurs et en insistant sur la
nature intentionnelle de ces crimes, leur appartenance à un projet d’annihilation de la
population en question. Cette structure ne correspond pas uniquement aux livres sur
les atrocités rédigés à des fins de propagande (dans le but d’influencer la Conférence de
Paris), mais également à ceux écrits par des comités de savants indépendants, par des
diplomates des pays neutres ou par des membres de comités de secours, impressionnés
par l’étendue des crimes dont ils avaient été témoins.
30 De façon générale, l’essor des livres sur les atrocités était en rapport avec le discours
pacifiste de l’après-guerre : la volonté que cette guerre soit la dernière et les espoirs
investis dans la fondation d’un système international à même de prévenir les conflits
futurs. Car ce pacifisme et la vision du système international lui étant associé étaient
également nourris par les excès de violence et les crimes ayant eu lieu pendant la
guerre. La dénonciation de ces crimes était ainsi un complément nécessaire du discours
pacifiste, sa source de légitimité (et, partant, cette dénonciation devenait la façon de
soutenir des velléités de colonisation ou d’aspiration nationalistes qui adoptaient elles
aussi la forme du discours pacifiste dominant). Si le droit international n’avait pas les
moyens de pénaliser les auteurs de ces crimes juridiquement, de les faire comparaître
devant des tribunaux pénaux internationaux, qui n’étaient pas prévus par le système de
droit international alors en cours de refondation, la diplomatie pénalisait
« territorialement » les « nations criminelles » en faveur des populations victimes. De
ce fait, l’« incrimination des nations » constituait un enjeu diplomatique, sous-tendu
par des enjeux territoriaux. D’où les ressemblances évidentes entre ces livres et les
enquêtes de droit pénal et l’importance donnée dans ces livres à la démonstration de
l’intentionnalité des crimes qu’ils dénoncent.
31 Par ailleurs, l’importance accordée à l’intentionnalité des crimes s’inscrivait dans le
cadre de la « crise du juridique » que nous aborderons plus loin (cf. infra § 54). Le
discours « criminaliste », ayant remplacé le discours « pénaliste » de la première moitié
du XIXe siècle (Foucault 2004b : 255). La psychologie du criminel, alors en vogue,
doublée de la perspective évolutionniste, tendaient à marginaliser la logique utilitariste
de cette dernière période, laquelle, en refusant l’argument du libre-arbitre et dans le
souci de réduire les controverses en jurisprudence, n’accordait à l’intention qu’une
place limitée dans le cadre de l’appréciation juridique (cf. infra § 68-71). C’est justement
ce discours « criminaliste » – contesté ensuite, par exemple par la théorie du droit
positif – qui, transposé dans le domaine du droit international, favorisait, en même
temps que les arguments culturalistes, la tendance à la dénonciation et son
incontournable corollaire, l’intentionnalisme.
32 Il reste que ce discours « criminaliste » a contribué à la production, à cette époque,
d’une très riche documentation concernant les crimes commis pendant les guerres
balkaniques et la Grande Guerre. C’est dans cette documentation que puise abondement
l’historiographie contemporaine de la violence sur les populations minoritaires et
certains de ces auteurs adoptent le caractère dénonciateur et expressément
intentionnaliste de celle-ci.
33 Les chercheurs qui travaillent sur la question des minorités dans les Balkans pendant
l’entre-deux-guerres (cf. Baltsiotis ou Kostopoulos par exemple) se trouvent dans une
situation comparable. En effet, cette période a été, tout au moins du point de vue du
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
16
droit international, une sorte de « printemps des minorités ». Ces chercheurs profitent
d’une riche documentation, issue notamment de l’intervention de la Société de Nations.
En plus d’informer sur la situation et les problèmes des minorités, cette documentation
témoigne de l’enjeu spécifique que celles-ci constituent à cette époque, dans le cadre
des rapports difficiles entre un droit international extrêmement interventionniste et
des Etats nationaux en quête d’une plus grande homogénéité de leur population. Le
conflit entre ces deux logiques va par ailleurs frayer le chemin aux violences contre ces
minorités qui auront lieu dans l’anomie de la fin de la Seconde Guerre mondiale
(Baltsiotis) et de la guerre civile grecque (Kostopoulos). Car le droit international, les
discours et les institutions qui le font exister et les rapports diplomatiques qui
l’imposent, sont également des acteurs de l’histoire des minorités, ils jouent un rôle
décisif dans la constitution de celles-ci en objets de la politique des Etats, ainsi que dans
les modes d’identification de leurs membres. Cette dimension très importante peut
échapper aux chercheurs qui adoptent le point de vue du droit international et se
livrent à une critique systématique de l’Etat.
La guerre froide et l’occultation de la violence de la guerre
34 Curieusement, la tendance à la dénonciation des atrocités et l’incrimination des nations
n’a plus été à l’ordre du jour après la Seconde Guerre mondiale, nonobstant la plus
grande portée et le caractère sans précédent des crimes perpétrés durant celle-ci. Car
le système international mis en place à la fin de cette guerre constituait en quelque
sorte le contraire du système international précédent, dont la faillite était tenue
responsable de l’horrible guerre qui venait de s’achever (sur l’idée que l’ONU n’a pas été
conçue pour défendre le droit des peuples et des minorités, cf. Mazower 2009). En
conséquence, le nouveau système se refusait à tout interventionnisme en faveur des
minorités et proclamait le respect absolu de la souveraineté des Etats, dont les affaires
intérieures – les questions minoritaires y compris – n’étaient plus de la compétence du
droit international (cf. Christopoulos 2000). Cette évolution était sans doute également
influencée par le keynésianisme et la politique du New Deal qui, à l’encontre du
libéralisme, mettaient l’accent sur la souveraineté de l’Etat. Une conséquence
immédiate de cette refonte du droit international fut la disparition de toute littérature
concernant des crimes contre les minorités et des infractions juridiques contre celles-
ci. La culpabilité allemande (Jaspers 1946) était assumée par les Allemands eux-mêmes
et la réflexion sur la guerre prit la forme d’un effort intellectuel pour comprendre les
causes du nazisme. Plus de livres sur les atrocités et plus d’efforts pour criminaliser les
nations. Toute la violence de la guerre était comme absorbée dans la forme rigide du
système international, de l’équilibre nourri justement par l’horreur de la mémoire de
cette violence et des bombes atomiques de Hiroshima et de Nagasaki. Même le génocide
juif constituait alors un sujet occulté. Comme se souvenait Raul Hilberg :
« It is hard now to remember that the Nazi holocaust was once a taboo subject.
During the early years of the Cold War, mention of the Nazi holocaust was seen as
undermining the critical U.S.-West German alliance. It was airing the dirty laundry
of the barely de-Nazified West German elites and thereby playing into the hands of
the Soviet Union, which didn’t tire of remembering the crimes of the West German
“revanchists” » (Finkelstein 2007).
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
17
L’émergence de l’historiographie de l’holocauste et la querelle entre
intentionnalistes et fonctionnalistes
35 Les grandes synthèses sur le génocide juif n’apparaissent que dans les années 1960,
avec le livre de Raul Hilberg, The destruction of the European Jews (1961) ; et il faudrait
peut-être rappeler que pendant cette décennie la discussion concernant les crimes
nazis s’était renouvelée en raison, aussi bien du procès Eichmann (1961) que de la
convention sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité (1968) tandis que,
pendant la même décennie, le « tribunal Russel » (fondé en 1964) élargissait la portée
des concepts de crimes contre l’humanité et de génocide en les utilisant à propos de la
guerre du Vietnam. Dans la décennie suivante la production historiographique
concernant le génocide juif devint l’objet d’une controverse résumée en 1981 par
Timothy Mason comme la querelle entre « intentionnalistes » et « fonctionnalistes »
(Mason 1988) i.e. entre historiens attribuant le génocide « aux actions intentionnelles
d’Hitler, lesquelles découlaient, à un degré plus ou moins grand de nécessité, de ses
idées politiques » (ibid.) et historiens cherchant l’explication du génocide dans le
fonctionnement – ou plutôt le dysfonctionnement – de l’Etat nazi. Dans son essai
intitulé « Intention et explication », Mason critique sévèrement les intentionnalistes
dont la démarche, dit-il, s’oppose à la compréhension du régime du national-socialisme.
La querelle entre intentionnalistes et fonctionnalistes se perpétue pendant les
décennies suivantes. Sauf que dans les années 1980 la place des fonctionnalistes est
prise par des historiens qui, plutôt que sur la fonction ou la structure, se penchent sur
les processus : les différentes phases de la politique anti-juive nazie, ses
transformations et ses impasses par rapport aux événements de la guerre
(Browning 1985 ; Mayer 1988) ; il conviendrait ainsi d’appeler ces historiens
« conjoncturalistes » et non pas fonctionnalistes. En résumant le débat, Ian Kershaw
conclut que ceci a fini par enrichir l’historiographie du génocide en poussant les
fonctionnalistes à accorder plus d’attention à l’idéologie (cf. Kershaw 1985). Enfin, les
études plus pointues sur les attitudes individuelles des soldats et les modes de
justification des crimes (cf. la déshumanisation des victimes, Bartov 1990 et Browning
1992) qui ont vu le jour dans les années 1990 ont contribué à une plus ample
compréhension des mécanismes du génocide.
Retour au protectionnisme des minorités et à l’histoire de la
violence
36 L’essor, à partir des années 1960, des travaux sur le génocide juif constituent cependant
une exception pour l’historiographie de la violence de masse qui est pour le reste quasi
inactive jusqu’aux années 1980, voire 1990. Ce fait est lié, comme nous l’avons expliqué
dans l’introduction du premier numéro du dossier (Sigalas et Toumarkine 2008 :
§ 24-26), à la fin de la Guerre froide et au retour progressif à l’ancien protectionnisme
des minorités. C’est également l’époque où le néolibéralisme devient une doctrine
économique et politique dominante, ce qui contribue à mettre jusqu’à un certain point
entre guillemets le principe du respect inconditionnel de la souveraineté étatique par
le droit international. Le nouveau système protectionniste et, partant,
interventionniste, s’incruste sur le précédent en maintenant dans la forme juridique
(avec cependant quelques infractions notables) le principe d’inviolabilité de la
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
18
souveraineté étatique, tout en créant des nouvelles institutions ayant pour domaine de
compétence le droit pénal international. De plus la Commission européenne et l’OSCE
(restructurée à partir du Sommet de Paris de 1990 et de la Conférence d’Helsinki en
1992) favorisent à cette époque les travaux d’expertise sur les violences perpétrées au
cours de cette décennie, dans les Balkans et ailleurs. A la même époque se développent
aux Etats-Unis les études sur les minorités et sur les génocides (y compris bien sûr le
génocide arménien), ainsi que sur la résolution de conflits (comme nous l’avons
expliqué dans l’introduction au premier numéro, ce sont les trois domaines desquels
est issu le concept d’ingénierie démographique). Pendant la même décennie commence
à se développer en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis une riche historiographie
concernant les origines de la guerre totale (cf. à titre d’exemple Barnhart 1987 ;
Foerster et Nagler 1997 ; Hull 2004 ; Bell 2007). Concernant l’aire géographique qui nous
intéresse ici, on peut noter que, du développement parallèle, dans les années 1990, de
travaux d’expertise sur les violences récentes dans les Balkans et de recherches sur les
droits et l’histoire des minorités, on passe, dans les années 2000, à une effervescence
des recherches sur les politiques démographiques et la violence de masse, touchant de
plus en plus à des sujets tabous (sur le développement de cette historiographie cf.
Sigalas et Toumarkine 2008 : § 9-19, 42-68).
37 Il est par ailleurs intéressant, et pas étonnant en soi, que cette production
historiographique renoue de plusieurs façons avec les livres sur les atrocités du début
du siècle. Car c’était là que cette historiographie s’était arrêtée. Il est donc naturel que
les livres sur les atrocités, comportant souvent une documentation précieuse,
constituent des références de base lorsqu’il s’agit d’étudier les violences nationalistes
de cette époque, occultées en Turquie après la fondation de la République, dans les pays
communistes des Balkans dans le cadre de l’internationalisme communiste et du
respect du statu quo de la Guerre froide et en Grèce sous l’emprise du régime autoritaire
(associant le nationalisme à l’anticommunisme) qui s’instaure après la fin de la guerre
civile. La même chose est cependant valable pour la forme des travaux en question
lesquels, de la même façon que les livres sur les atrocités, empruntent souvent la forme
de l’enquête judiciaire en droit pénal : leurs auteurs essayent d’un côté, de rassembler
une documentation, aussi riche que possible, sur les crimes perpétrés et de l’autre, de
se prononcer, à la lumière de cette documentation, sur l’intentionnalité des auteurs de
ces crimes : apporter des pièces à conviction indiquant l’organisation des crimes en
question ou le fait qu’ils ont été volontairement perpétrés. On dirait même que
concernant l’intention, ils opèrent la même pétition de principe que Mason reprochait
aux intentionnalistes :
« The view that Hitler’s ideas, intentions and actions were decisive, for example, is
not presented in these works as an argument, but rather as something which is
both premise and a conclusion » (Mason 1988 : 9).
38 En d’autres termes, la plupart des études concernant la violence de masse sur les
minorités dans l’aire géographique qui nous intéresse sont implicitement
intentionnalistes, surtout lorsqu’elles se réfèrent à des enjeux de mémoire actuels
(comme celui du génocide arménien) qui prennent de plus en plus une forme à la fois
juridique et diplomatique. Même si des points de vue « fonctionnalistes » ou
« conjoncturalistes » commencent à poindre, ils ont des difficultés pour trouver leur
place dans un champ historiographique fortement déterminé par les enjeux de
mémoire, voire de justice. Car l’intentionnalisme semble être plus approprié pour
combattre le négationnisme, qui reste dans ces pays un courant dominant.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
19
L’intentionnalisme a un rôle à jouer dans le domaine public, tandis que le
fonctionnalisme et toute autre approche relativisant l’intentionnalisme demeurent
pour le présent d’un intérêt uniquement académique.
39 La question demeure donc, d’un point de vue épistémologique, de l’emprise du point de
vue intentionnaliste, au-delà du seul domaine académique, dans l’espace public. Mais
tel n’a pas toujours été le cas, puisqu’il y a eu des périodes où le point de vue
intentionnaliste n’était pas dominant. En effet, l’intentionnalisme semble s’accorder
d’une certaine façon avec le libéralisme ; non pas cependant avec toute forme de
libéralisme (par exemple, pas avec le libéralisme utilitariste du XIX e siècle), mais avec le
libéralisme de la fin du XIXe et du début du XX e siècle qui a adopté l’évolutionnisme
spencérien, ainsi qu’avec le néolibéralisme de la deuxième moitié du XX e siècle,
notamment à partir du moment où celui-ci devient un discours et une pratique
gouvernementale dominante à l’échelle mondiale. On pourrait supposer que ce fait est
dû à la « phobie de l’Etat », qu’on peut détecter chez certains représentants du
néolibéralisme (Foucault 2004b : 77-78). Certes, il y a bien des cas où le néolibéralisme
est devenu une sorte d’idéologie d’Etat (en Allemagne fédérale par exemple ou, d’une
façon différente, aux Etats-Unis). Mais la raison est ailleurs, elle renvoie à la forme de
sujet mis en scène par le néolibéralisme, l’homo œconomicus qui, en débordant le
domaine économique, devint un modèle pour toute autre activité sociale ainsi que,
dans une certaine mesure, pour le domaine du droit. Sujet libre et rationnel, l’homo
œconomicus fait abstraction des chaînes d’interdépendance qui relient entre eux les
individus dans la société, conditionnent leurs choix et les motifs de leurs actions. Pareil
à la fiction juridique de l’« homme raisonnable », il décide toujours en connaissance de
cause, sans jamais succomber à des pulsions inconscientes. La logique de l’homo
œconomicus est ainsi très proche de celle de l’intentionnalisme ( Noiriel 2008), qui
suppose également un sujet libre et rationnel. Sauf que le sujet de l’intentionnalisme
est notamment sujet de responsabilité, sujet coupable. L’intentionnalisme a pour
prémisse le libre-arbitre, fondement nécessaire de la culpabilité. Car, l’intention ne
fonde la responsabilité que dans la mesure où elle se rapporte à un individu dont les
choix sont libres, indépendants de causes extrinsèques par rapport à sa volonté.
40 Peut-on cependant soutenir que l’homo œconomicus est doué de libre-arbitre ? Les deux
notions ont sans doute pour point commun de mettre en scène, bien que sur un plan
différent, un sujet responsable de ses actes et devant nécessairement en subir les
conséquences – ou bien en recueillir les fruits. Ce sont toutefois des notions issues de
traditions philosophiques différentes qui ont, curieusement, commencé par s’opposer.
Dans la philosophie scolastique, le libre-arbitre est censé fonder la contingence des
actions humaines, tandis que le libéralisme classique adopte la doctrine de la nécessité.
Cependant ni les notions ni les traditions philosophiques ne sont immuables. Et s’il est
vrai qu’au XVIIIe siècle, il y a entre le libéralisme et la notion du libre-arbitre une
tension philosophique, cela rend encore plus intéressante l’hypothèse de leur
éventuelle rencontre dans la deuxième moitié du XXe siècle, à l’époque où le
néolibéralisme, de doctrine philosophique, devint une idéologie largement diffusée
ainsi qu’un régime de gouvernementalité dominant. Nous nous proposons donc de faire
ici une digression sur l’histoire de cette tension entre libéralisme et libre-arbitre, qui
permettra de poser les problèmes épistémologiques majeurs concernant
l’intentionnalisme. Pour ce faire nous allons changer de registre et passer de l’analyse
historique à une histoire des concepts.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
20
V. Aux sources de l’intentionnalisme : libre-arbitre et
homo œconomicus
La négation du libre-arbitre par les contractualistes et libéraux du
XVIIIe siècle
41 Dans le christianisme catholique, la théorie du libre-arbitre a constitué la pierre
angulaire de la culpabilité individuelle. Elle y fut introduite par Saint Augustin afin
d’exonérer la Providence divine de la responsabilité du mal fait par les hommes et
rendre ainsi les hommes entièrement coupables de leurs péchés. Repris et développé
par les scolastiques, le libre-arbitre constitua la prémisse théologique de la contrainte
légaliste et, partant, de la coercition légale. Il n’est donc pas étonnant que cette notion
fût contestée par les contractualistes, aussi bien autoritaires (Hobbes) que libéraux
(John Locke), qui ont redéfini la notion de liberté à partir de la condition « négative »
d’absence de coercition. Ils se sont ainsi démarqués de la tradition juridique romaine,
revigorée par les républicains anglais du XVIIe siècle, selon laquelle la liberté était un
droit naturel s’opposant à l’esclavage, voire à la tyrannie (Petit 2002). Pour les
contractualistes, tout droit naturel se rapportait à un état de nature hypothétique, qui
précédait nécessairement la communauté politique (Commonwealth) moderne. D’après
eux, l’homme social n’était pas libre, mais soumis à de fortes contraintes, plus ou moins
nécessaires, selon le degré de liberté que chacun de ces auteurs soutenaient qu’il
faudrait reconnaitre à celui-ci (degré très limité pour Hobbes et très large pour Locke et
les contractualistes écossais). Or, la nécessaire limitation de la liberté naturelle par la
société n’était pas la seule raison pour laquelle les contractualistes s’opposaient à la
notion de libre-arbitre. La raison principale, dont découlait également leur conception
de la liberté, était l’importance qu’ils accordaient à la nécessité. Pour eux, tout ce qui
existait dans le monde résultait de l’enchainement complexe d’une multitude de causes
antécédentes. Et dans ce large tissu causal s’insérait, nécessairement, l’homme et ses
actions, jusqu’aux motifs les plus secrets de celles-ci. Au fond, les contractualistes
anglais et écossais ont décomposé l’individualité morale. La délibération individuelle
était pour eux un processus composé d’une multiplicité de causes intrinsèques (i.e.
psychologiques, que Hobbes appelait passions) et extrinsèques (i.e. sociales) (Kow 2005).
Dès lors, le fait de punir quelqu’un pour un acte, même intentionnel, n’était plus
conforme à la justice divine. Dieu étant la cause première du monde, il devenait
implicitement responsable des toutes les causes s’immisçant dans la délibération des
humains et, par conséquent, dans leurs crimes. Ce à quoi Hobbes répondait qu’en
punissant un criminel on ne prétendait pas à la justice divine, ni n’agissait par
vengeance, mais uniquement pour défendre la société (parce que la peur de la punition
comptait parmi les causes qui pouvaient dissuader un homme de commettre un méfait)
et, donc, comme devaient le soutenir un siècle plus tard les utilitaristes, par souci
d’utilité (idem). L’« utilitarisme » de Hobbes était le pendant indispensable de sa
doctrine de la nécessité et de l’inhérente immoralité de celle-ci (du point de vue tout au
moins de la tradition scolastique). Dans cette voie, Hume devait aller encore plus loin,
niant le cadre-même de la responsabilité juridique, l’identité individuelle. Ce faisant, il
était conscient de saper les fondements moralistes de la punition, puisqu’il savait que :
« The only proper object of hatred or vengeance12 is a person or creature, endowed
with thought and consciousness; and when any criminal or injurious actions excite
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
21
that passion, it is only by their relation to the person, or connexion with him »
(Hume 1777: 76).
42 Ainsi les contractualistes anglais et écossais, ont battu en brèche le libre-arbitre et avec
lui les fondements du moralisme juridique. Dans cette voie allaient persévérer Bentham
et les utilitaristes et libéraux benthamiens du XIXe siècle, qui entreprirent les grandes
codifications du droit et de la pratique judiciaire. Mais à part le libre-arbitre, ceux-ci
allaient nier également le fondement du contractualisme, le droit naturel, en privant la
jurisprudence d’un autre fondement moral, cette fois-ci non religieux mais politique.
Ce faisant, Bentham et ses épigones allaient « démoraliser » le droit (cf. infra § 68-71),
en faire un système fermé, autoréférentiel, quant à son application, en frayant ainsi le
terrain à la théorie du droit pur du XXe siècle, qui conçoit le droit comme un système
normatif fondé non pas sur le principe de causalité mais sur celui d’imputation (Kelsen
2002 : 89-91). Dans cette tentative d’autonomisation du domaine juridique les
utilitaristes croyaient suivre la voie frayée par les économistes écossais qu’il est
convenu aujourd’hui d’appeler libéraux classiques et dont la pensée s’est développée en
quelque sorte en filigrane du contractualisme.
43 Ces derniers ont contesté le postulat de Hobbes selon lequel la liberté naturelle était
fondamentalement asociale, parce qu’elle équivalait à la guerre de tous contre tous.
S’inspirant du modèle du marché, de la multiplication des richesses que rendait
possible un marché libéré des interdictions mercantilistes, ils ont soutenu que,
contrairement à l’avis de Hobbes, ce n’était pas la liberté naturelle que constituait un
danger pour le Commonwealth, mais justement l’abus de coercition du pouvoir, qui
pervertissait les hommes (Binoche 2008). Leur modèle restait fondé sur la nécessité, sur
l’enchainement des causes, sur l’idée de droit naturel. Or, ce droit naturel ayant
maintenant « changé de nature » (la liberté naturelle qui le fondait n’étant plus jugée
dangereuse mais bénéfique pour le Commonwealth), il n’était plus autant en
contradiction avec le droit public et devenait la base nécessaire du contrat social. Ainsi,
tout en opérant une inversion de la théorie politique de Hobbes, les économistes
écossais restaient à l’intérieur du contractualisme. Ce faisant, ils conservaient un
minimum d’« utilitarisme » hobbesien : un minimum de coercition nécessaire pour la
vie sociale. Bien que chez les libéraux classiques, ce minimum de coercition n’était plus
nécessaire pour restreindre la liberté naturelle, mais pour protéger celle-ci des dangers
provenant des autres individus ou des souverains étrangers, aspirant à conquérir leur
pays. Ce « minimum de coercition » se résumait aux quatre droits ou pouvoirs (comme
il a été convenu de les appeler par la suite) régaliens définis par Adam Smith (défense
du territoire, diplomatie, police et justice) qui constituent le noyau de la théorie
libérale de la souveraineté. Et il faudrait préciser que cette théorie de la souveraineté se
voulait en contradiction avec la tradition juridique de la fin du XVII e et du XVIIIe siècle,
au sein de laquelle avait émergé la notion de raison d’Etat, ainsi que celle d’Etat de
police (dans sa forme, plus spécifiquement allemande, de Polizeistaat) (Foucault 2004b :
287-290).
44 Par ailleurs, les libéraux classiques ont déplacé le centre de gravité du politique : au
concept d’Etat ils ont, en grande mesure, substitué – ou, tout au moins, fait prévaloir –
ceux de société civile et de nation, plus conformes à l’idée de droit naturel. S’il est vrai
que dans leurs écrits, ceux d’Adam Smith par exemple, la différence entre nation et Etat
n’est pas toujours concrète, ce glissement reste très important concernant les attributs
de la communauté politique et donnera lieu, au XIXe siècle à des débats incessants
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
22
concernant les différentes formes de gouvernement (sans parler de l’influence du
libéralisme dans l’affirmation et la défense du principe des nationalités).
45 Ce « faible » noyau de souveraineté, que constituaient les quatre droits régaliens,
n’allait pas rester aussi « faible » après être devenu l’objet des travaux de Bentham et
de ses épigones. Ceux-ci allaient élargir considérablement le domaine du juridique, en
suppléant par celui-ci la lacune de pouvoir coercitif que générait, en théorie, la
limitation du domaine d’action directe de la souveraineté étatique. L’amplification
utilitariste du domaine juridique était un corrélat du discours libéral de la fin du XVIII e
et du XIXe siècle. Car, le domaine juridique était conçu comme un champ
d’autolimitation de l’action de l’Etat. Au fond, l’utilitarisme libéral ne concevait pas
d’antinomie entre liberté et contrainte juridique, la vraie antinomie consistant pour lui
dans l’opposition entre la liberté économique et la souveraineté illimitée, telle qu’elle
apparaissait dans la théorie de la raison d’Etat. Les libéraux de cette époque
concevaient le droit comme un moyen de limiter la souveraineté, ou plutôt de la
formaliser, en liant le souverain au moyen de lois générales. Leur point de départ était
l’autonomie axiomatique du domaine économique, l’idée que l’économie – plus
particulièrement le marché – constituait un principe de véridiction irréductible et, en
quelque sorte, « souverain » par rapport à la souveraineté politique. Dans ce contexte,
le souverain juste du Moyen Age (régnant de droit divin) et la raison d’etat, ou l’« etat
de police », du XVIIe et du XVIII e siècle, cédaient leur place au souverain limité par
l’impératif du marché, par le besoin de plier devant la liberté du marché. Le moyen de
cette limitation était l’octroi d’un nombre considérable de droits (ou pouvoirs) du
souverain au domaine juridique lequel devait, entre autres, règlementer le marché
(dont la règlementation était auparavant une prérogative du souverain) de façon à
garantir sa liberté.
L’homo œconomicus : un sujet disposant d’un libre-arbitre positif
46 Ainsi se forme un nouveau sujet, différent du sujet du droit (qui se définissait, on l’a vu,
non plus désormais par son libre-arbitre, mais en fonction de son utilité) : le sujet
économique, qui a pris ultérieurement le nom d’homo œconomicus et dont la liberté de
choisir devait être à tout prix respectée. Car le fait que le marché constituait dès lors le
principe de véridiction par excellence – supérieur même à la souveraineté et devant
lequel la souveraineté devait elle-même s’incliner – revenait à dire qu’il y avait dans le
choix économique individuel quelque chose d’irréductible, échappant à tout principe
d’explication (Foucault 2004b : 171-290). S’il fallait protéger le choix économique
individuel de toute contrainte extérieure au domaine économique, c’était parce que ce
choix constituait un élément premier par rapport aux autres activités humaines, du
point de vue du bonheur de l’ensemble. On ne faisait ainsi pas moins que de postuler le
libre-arbitre du sujet économique (et cela dans une époque où la notion de libre-arbitre
était expulsée du domaine juridique). Ce libre-arbitre économique découlait
directement du fait de l’irréductibilité du choix économique à tout autre domaine
politique, y compris la souveraineté politique et le domaine juridique qui avaient, de
surcroît, la mission de protéger ce libre-arbitre économique : protéger le libre choix des
sujets économiques, duquel seul dépendait la prospérité de la société – ou de la nation.
47 Au fond, tout régime de pensée conserve un équilibre entre nécessité et contingence
(Villeumin 1984). En modifiant la position de l’une, on est toujours obligé de changer la
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
23
position de l’autre. Mais on ne peut exclure d’un régime de vérité aucune de ces deux
qualités fondamentales du devenir (par le rapport dans lequel les différentes formes du
savoir deviennent possibles). Car, la nécessité et la contingence n’existent pas en tant
que telles, il y à nécessité de quelque chose par rapport à une autre chose qui est
considérée comme étant contingente, et vice versa. D’ailleurs dans les différents
systèmes de pensée, ces deux qualités entretiennent un rapport profond avec les
notions morales du bien et du mal. Ainsi, si les actions de Dieu sont arbitraires, même
sous couvert de notre incompréhension de celles-ci, alors les actions des humains sont
nécessaires. Si, au contraire, on veut un Dieu nécessairement bon, ce sont nos actions qui
deviennent libres de sa toute-puissance (même sous couvert de sophistication
théologique, du type : notre liberté est nécessaire à la toute-puissance de Dieu). De
même, si on suppose que la justice du souverain doit régler toutes les activités
humaines, y compris les échanges économiques qui ont lieu dans le marché, alors on a
besoin de maintenir le libre-arbitre du sujet du droit, face à un souverain dont la justice
est nécessaire. Au contraire, si l’on change complètement de perspective, comme cela a
été fait à la fin du XVIIIe siècle, et soutenir que le marché est premier par rapport à tout
autre activité humaine et que de celui-ci découle nécessairement le bonheur de
l’humanité, alors tout le rapport entre ce qui est nécessaire et ce qui est contingent, ou
libre, se transforme. D’abord, pour que le marché soit premier par rapport aux autres
domaines de l’activité humaine, il doit porter en lui son propre principe et doit être par
nature, potentiellement tout au moins, indépendant. Ainsi considéré, le marché ne se
définit plus par rapport à un pouvoir qui le règlemente ou par rapport à une justice qui
le protège, mais par son dynamisme inhérent qui consiste en la somme des choix
économiques individuels. Le principe du marché est donc nécessairement le choix du
sujet économique et c’est de ce choix, de la composition des différents choix de sujets
économiques que découle le bien de l’humanité (ou le bonheur du grand nombre, si l’on
adopte le point de vue utilitariste). Dès lors le système est axé sur le sujet économique,
dont les choix sont premiers par rapport aux autres systèmes de raison (au nom de la
souveraineté ou du droit). En tant qu’il est premier, le choix économique individuel est
libre et, sans avoir besoin d’être bon (i.e. d’être motivé par des sentiments altruistes),
ses résultats, ou plutôt les résultats de la composition de l’ensemble des choix
économiques individuels qui forment le marché, son nécessairement bons pour
l’ensemble des hommes.
48 Le choix économique est donc doté de libre-arbitre, mais ce libre-arbitre économique
est très différent, d’un point de vue moral, du libre-arbitre juridique puisque, au lieu de
fonder la contrainte, le libre-arbitre économique sert à la lever. La raison en est que le
statut du sujet économique est complètement différent de celui du sujet du droit. Le
sujet du droit traditionnel (chrétien et médiéval) est soumis à une souveraineté, divine
ou humaine, qui est première par rapport à lui. Sa liberté n’existe que dans la mesure
où il transgresse les règles, nécessairement bonnes, que lui dicte la souveraineté. En
d’autres termes, le sujet du droit traditionnel n’est libre que pour être puni. Au
contraire, le sujet économique est premier par rapport à la souveraineté qui doit
nécessairement, pour respecter la loi de nature et contribuer au bonheur du monde, se
plier au principe de la liberté du sujet économique. Nous avons ainsi, dans le cas du
sujet économique, une inversion, presque mot à mot, du schéma scolastique concernant
le libre-arbitre. Pour cette raison, les libéraux classiques – et même les utilitaristes et
les néolibéraux – ne parlent jamais de libre-arbitre mais de libre choix et ils sont même
soucieux de distinguer ce libre choix économique du libre-arbitre, négativement
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
24
connoté, puisque lié à la culpabilité (cf. le Discours sur la liberté de John Stuart Mill
[1909], soucieux de distinguer la notion de liberté de celle, pour lui problématique, de
libre-arbitre). Cela n’empêche pas le libre choix économique dont ils parlent de n’être
qu’un libre-arbitre positivement connoté : un libre-arbitre premier par rapport à toute
autre activité politique, qui doit nécessairement s’organiser de façon à pouvoir le
protéger.
La pente individualisante du néolibéralisme et le retour du libre-
arbitre
49 Notre hypothèse est que ces deux formes de libre-arbitre, le libre-arbitre traditionnel
et le libre-arbitre implicite dans l’homo œconomicus, vont à un certain moment se croiser
et que de leur croisement résultera un retour au régime de la responsabilité
individuelle ; ce qui formera la condition de possibilité de l’intentionnalisme. Ce
croisement va avoir lieu à l’intérieur de la gouvernementalité néolibérale, pour un
ensemble de raisons que nous tenterons ici de résumer.
50 Premièrement, la hausse de la demande judiciaire. Ayant pris forme dans une époque
où le capitalisme était en crise et ayant pour premier objectif de répondre au New Deal,
le néolibéralisme était obligé d’accepter l’idée d’une intervention dans la sphère
économique, destinée à donner au capitalisme une forme viable, à refonder la libre
concurrence. Or, pour ce faire, les ordolibéraux et les économistes de l’Ecole de Vienne
(qu’il est convenu de considérer, avec l’Ecole de Chicago, comme les trois sources du
néolibéralisme) ont opté pour le moindre mal, un interventionnisme juridique qui
s’opposait, selon eux, au planisme de l’Etat, l’intervention de nature administrative
ayant des objectifs définis. Pour eux, l’économie devait être le domaine d’une
concurrence libre dont les règles serraient d’un ordre général et, par conséquent,
connues par tous. Leur solution était l’application en économie des principes de l’Etat
de droit (dans la forme allemande du Rechtsstaat [par opposition au Polizeistaat] ou la
forme anglaise de Rule of Law) (Foucault 2004b : 173-180). De cette imbrication de
l’économie avec l’Etat de droit a résulté une croissance de la demande judiciaire, qui
constitue une des caractéristiques du néolibéralisme en tant que système de
gouvernement. Or, cette hausse de la demande judiciaire – qui était prévue à l’origine
pour faire face aux frictions que la libre concurrence allait nécessairement générer
dans un marché règlementé par des lois formelles – ne s’est pas limitée au domaine
économique mais s’est progressivement propulsée dans les autres domaines de la vie
sociale, en multipliant les instances de juridiction et d’arbitrage (notamment à partir
des années 1970 aux Etats-Unis et à partir des années 1980 en Europe). Ce phénomène
constitue une différence très concrète entre le néolibéralisme et la pratique utilitariste
du XIXe siècle. Car si les utilitaristes avaient voulu renforcer au maximum le cadre
juridique, ils tenaient à réduire la place du judiciaire et du jurisprudentiel (Foucault
2004b : 180). D’ailleurs, le néolibéralisme se distingue du libéralisme classique par sa
tendance à généraliser, au niveau de la société, des théories et pratiques concernant, à
l’origine, la sphère économique : faire de l’homo œconomicus un modèle général pour la
société.
51 Or, la croissance de la demande judiciaire a entrainé un élargissement du « domaine
d’objets qui peuvent entrer dans le champ de pertinence d’une action judiciaire », ce
que Michel Foucault définit comme « judiciable » (Foucault 2001). Ce qui a
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
25
automatiquement conduit à une hausse de l’importance de la responsabilité
personnelle, y compris dans les débats publics, dans la mesure où le domaine du
judiciable a de plus en plus tendance à embrasser des objets politiques et des enjeux de
mémoire. Le couplage du néolibéralisme avec l’Etat de droit et l’élargissement
consécutif du domaine du judiciable contribuent ainsi à un rapprochement du libre-
arbitre « positif » de l’homo œconomicus avec le libre-arbitre « négatif » qui fonde la
responsabilité juridique.
52 Cette évolution a d’ailleurs un précédent dans la « crise de la pensée juridique » de la
fin du XIXe siècle et du début du XXe (Foucault 2004b : 255). Cette « crise » –
caractérisée par la multiplication des savoirs autours du crime (conduisant à
l’émergence de la criminologie), couplée avec une « multiplication des instances, des
institutions des éléments de décision », et de la pérennisation exagérée des sentences
« au nom de la loi par des mesures individualisantes en termes de norme » (ibid.) – se
reflète aussi dans une culture de la dénonciation, très caractéristique dans la presse et
les débats publics de cette époque. C’est dans ce contexte qu’a émergé le droit
international, d’où l’importance en son sein des discours criminalistes et
évolutionnistes portant, non plus sur des individus, mais sur des nations.
53 Un autre élément qui contribue au rapprochement entre l’homo œconomicus et le libre-
arbitre juridique est le modèle individualiste, imposé de plus en plus dans l’étude de la
société. Le point de départ de cette tendance est la dénonciation du planisme, du
planisme économique bien évidement, mais également de toute tentative de planifier la
société, qui est accusée de tendances autoritaires plus ou moins latentes (Hayek 1944 ;
Popper 1945). D’ailleurs, chez les néolibéraux, le planisme est généralement taxé de
déterminisme, en même temps que tout analyse en termes de structures sociales. Or,
par sa dénonciation du planisme, l’analyse néolibérale se démarque implicitement du
déterminisme des contractualistes du XVIIIe siècle (au nom duquel ces derniers se sont
opposés à la théorie du libre-arbitre), dont les règles générales étaient adoptées par les
libéraux classiques. A l’encontre des analyses en termes de structures, accusées de
déterminisme, la tendance néolibérale est de centrer l’étude de la société sur l’action
individuelle, à l’image de l’homo œconomicus. Un pivot de cette mutation fut la théorie
du capital humain. Dans l’application de cette théorie à l’étude du comportement
social, les acteurs sociaux sont assimilés aux acteurs économiques disposant des
capitaux (ou des ressources) de type différent (individuel, social, politique, symbolique
…), qu’ils investissent dans différents types de « marchés », non strictement
économiques (cf. Lin 1995). De la sorte, tout comportement social ou politique peut être
assimilé à un calcul économique, plus ou moins réussi. De la même façon, dans les écrits
d’un certain nombre d’études de chercheurs néolibéraux américains, l’homo œconomicus
est substitué au sujet du droit, appréhendé comme un investisseur qui calcule le risque
d’être puni par la loi et les conséquences de sa punition éventuelle (Foucault 2004b :
256-257).
54 Nous observons ainsi la tendance à assimiler le fonctionnement de tous les champs non
économiques à celui du domaine économique et, partant, l’assimilation de l’acteur
social (ou du sujet juridique) à l’homo œconomicus : l’individu raisonnable et intéressé,
seul acteur légitime de la conception néolibérale et seul sujet de responsabilité dans le
cadre de celle-ci. Ce faisant les néolibéraux américains réinventent, implicitement, le
libre-arbitre du sujet social, politique et juridique. Un libre-arbitre, il est vrai, assez
limité d’un point de vue anthropologique, puisqu’il suppose un individu qui fonctionne
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
26
uniquement en termes d’intérêt et dont la liberté consiste au fait de choisir entre
différents types d’« entreprise sociale » à partir d’un calcul du coût et du profit, en plus,
bien évidement, d’un calcul du risque de l’échec.
55 Ainsi, la dénonciation du déterminisme (ou du réductionnisme social) d’un côté et
l’application du modèle de l’homo œconomicus à tout type de comportement humain de
l’autre, convergent à la généralisation de la grille individualiste (ou individualisante)
dans le cadre de la conception néolibérale du monde. Dans ce contexte, le libre-arbitre
individuel s’impose automatiquement (comme nous le voyons par exemple dans
l’œuvre de la prêtresse du néolibéralisme américain, Ayn Rand. Son concept de
l’« égoïsme rationnel » est le fruit de la fusion du libre-arbitre avec un individualisme
radical [cf. Rand 1961 ; Dragoumis à paraître]). D’où également la récurrence de la
problématique du libre-arbitre dans la Philosophy of Mind, développée dans les
universités américaines au cours de la deuxième moitié du XX e siècle (cf. Doyle 2011).
Or, replacé dans un espace public marqué par la croissance du domaine du judiciable, le
libre-arbitre individuel donne prise à une conception de la société axée sur la
responsabilité individuelle et fraye la voie au développement d’un nouveau moralisme.
56 Curieusement, en se centrant sur le libre-arbitre, le néolibéralisme contemporain, dans
sa version américaine notamment, opère un mélange très original entre amoralisme et
moralisme extrêmes, qu’on pourrait résumer comme suit : rien ne doit empêcher
l’expression du libre-arbitre de l’individu (i.e., en contexte néolibéral, l’égoïsme de
l’individu), qui est cependant éminemment responsable pour ses actes et doit être
sévèrement puni lorsque ceux-ci débordent les limites scrupuleusement surveillées de
la légalité. Au fond, le surinvestissement de la liberté individuelle a pour pendant la
croissance illimitée de la responsabilité de l’individu et, partant, l’extrême surveillance
de sa conduite.
57 A ce propos, une dernière remarque s’impose. Si dans ses usages par Augustin et les
thomistes, le libre-arbitre refondait la contingence (qui courait le risque d’être
engloutie par un providentialisme fataliste) ; dans le néolibéralisme, le libre-arbitre
penche plutôt du côté de la nécessité. Il dévient déterministe : en faisant découler toute
responsabilité, pour le bien et pour le mal, du libre choix des individus, il fait de
l’individu, raisonnable par définition (sauf démence médicalement attestée) et
conscient de ces actes, le seul acteur légitime, en faisant abstraction de tout rapport
d’interdépendance sociale. Et de cette manière, les penseurs néolibéraux qui critiquent
le déterminisme sociologique – en lui reprochant d’éluder la contingence – ne lui
opposent qu’un déterminisme individualiste, qui élude la société et son influence sur
l’individu. Car, l’influence de la société sur l’individu est contingente par rapport à sa
liberté de choisir, du moment qu’on accorde à cette dernière un statut de nécessité. Dès
lors il n’est pas difficile de comprendre l’ascendant des interprétations
intentionnalistes, qui prennent pour objet la responsabilité individuelle, en faisant fi
des explications contingentes par rapport à celle-ci (que ces explications soient
fonctionnalistes ou conjoncturalistes).
Les rapports de l’intentionnalisme avec le néolibéralisme
58 Résumons maintenant notre argument concernant le rapport entre l’intentionnalisme
et le néolibéralisme. Au fond, l’intentionnalisme est issu de la convergence de deux
propriétés du néolibéralisme, devenu aujourd’hui une gouvernementalité dominante.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
27
De ces deux propriétés, l’une concerne le rapport du néolibéralisme avec l’Etat et
l’autre son rapport avec le libre-arbitre.
59 Première propriété : le principe de l’autolimitation de l’Etat, mot d’ordre du libéralisme
déjà dans sa forme classique. Bien qu’assigné initialement au seul domaine économique,
ce principe a toujours débordé ce domaine, en donnant naissance au libéralisme
politique et, partant, au principe des nationalités. L’Etat, en s’autolimitant, en
s’opposant à son propre pouvoir – à la raison d’Etat ou à l’Etat de police –, laisse
apparaître ce qui échappe de ce pouvoir : les « minorités » (ou « « nationalités », au
XIXe siècle et au début du XXe) et rend possible leur histoire, qui est forcément l’histoire
de leur oppression, de la violence qui leur est infligée par l’Etat, etc. Une histoire donc,
contre l’Etat, qui incrimine l’Etat – notamment dans le cadre de l’alliance du libéralisme
avec le droit, l’Etat de droit et le droit international. En conséquence, les minorités ne
sont devenues sujets de droit et, partant, sujets de l’histoire qu’à des époques marquées
par l’ascendant du libéralisme. Résumons schématiquement quelques jalons de cette
convergence : 1848 et le principe de nationalités ; la fin du XIX e et le début XX e siècle
avec la naissance du droit international ; la fin de la Grande Guerre avec le discours du
président Wilson renvoyant au principe d’autodétermination des peuples et la création
de la SDN ; à partir de 1989 la réémergence du protectionnisme juridique des minorités
– dans le cadre de l’OSCE, du Conseil d’Europe et de l’essor des ONG – qui fait des
minorités un sujet également d’historiographie. Tandis que les minorités cessent d’être
des sujets du droit et, conjointement, des objets d’historiographie pendant la Guerre
froide – notamment pendant les premières décennies de celle-ci, où même le génocide
juif constitue un sujet tabou – marquée également par des politiques protectionnistes.
60 Deuxième propriété : l’individualisme, composante ancienne du libéralisme mais, dans
un premier temps, uniquement sur le plan économique. Au XIXe siècle, dans le cadre de
la morale victorienne, l’ancrage individualiste du libéralisme a pour conséquence
l’incrimination des classes populaires, jugées responsables de leur état misérable et
dangereuses pour la société, de par leur « immoralité » et leur « penchant pour le
crime ». Cette incrimination – plus exactement, cette discrimination – restait
cependant liée au domaine économique (en tant qu’elle concernait une classe) :
principal domaine que le libéralisme réservait au libre-arbitre. D’où le fait que l’aspect
moraliste aussi bien de la criminologie que de l’évolutionnisme spencérien concerne
notamment les classes populaires. Avec le développement du droit international, ce
moralisme est propulsé également au niveau des nations – que les spécialistes du droit
international ont tendance à individuer. Il en résulte la tendance à émettre des
jugements concernant les instincts et le caractère plus ou moins criminel des nations ;
tendance que nous observons dans les livres sur les atrocités. La portée de
l’individualisme s’est élargie enfin dans le néolibéralisme, qui projette l’homo
œconomicus – et le libre-arbitre qui lui est inhérent – sur l’ensemble de l’activité sociale.
Se forme ainsi une nouvelle grille de lecture du phénomène social – qui est également
la grille d’une nouvelle morale sociale – dans le cadre de laquelle l’accent est mis sur le
choix individuel et, par extension, sur la responsabilité individuelle. En matière de
sociologie ou d’histoire, cette tendance se traduit par l’abandon progressif du
structuralisme et du fonctionnalisme au profit d’un intérêt croissant pour le choix
individuel ; et en matière d’histoire de la violence contre les minorités (ou des crimes
contre l’humanité) au profit d’une focalisation sur la responsabilité individuelle, i.e. sur
l’incrimination de l’individu.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
28
61 Ce sont ces deux tendances (l’incrimination de l’Etat et l’incrimination de l’individu)
qui se combinent à l’intérieur de l’intentionnalisme, qui consiste en gros en la tendance
à incriminer l’individu – ou les individus – à la tête de l’Etat : identifier l’État criminel à
un ou à quelques individus et l’individu, ou les individus criminels (Hitler et les
principaux chefs nazis ou Talât et les unionistes notoires) à l’Etat entier, à tout le
régime, appelé « totalitaire » et supposé hiérarchique et cohérent, et cela – comme il a
été indiqué plus haut – alors que ces Etats ont été justement le contraire : chaotiques et
anomiques, et, pour cette raison, autrement plus criminels.
62 En d’autres termes, ce que nous appelons intentionnalisme est le résultat de la synthèse
de deux courants très importants dans le cadre du néolibéralisme : l’individualisme
(issu de la projection du libre-arbitre économique sur l’ensemble du phénomène social)
et la critique de l’Etat, surtout de l’Etat totalitaire (hiérarchique et planificateur) –
critique cristallisée pendant et après la Seconde Guerre mondiale dans le cadre d’un
effort pour redéfinir le libéralisme, en tant que théorie politique, comme remède aux
trois maux que constituaient le nazisme, le communisme et le keynésianisme
(considéré lui aussi potentiellement totalitariste, cf. Hayek 1944).
63 Enfin un dernier point mérite d’être soulevé par rapport aux fondements de
l’intentionnalisme. Par la voie de la critique de l’Etat totalitaire, l’intentionnalisme
trouve occasionnellement un allié dans le marxisme « révisionniste », ou antistalinien,
attribuant l’écroulement des pays communistes à l’Etat stalinien, bureaucratique et
totalitaire. A partir notamment des années 1980, les critiques marxistes de l’Etat
investissent eux aussi – et de façon encore plus radicale que les libéraux – le terrain de
l’histoire des minorités, en dénonçant le nationalisme et les abus de l’Etat contre
certaines catégories de sa population. En Grèce, par exemple, ce sont les historiens
marxistes révisionnistes qui, plus que les libéraux, se sont attelés à l’histoire de la
violence contre les minorités (cf. Sigalas et Toumarkine 2008 : § 27-33). Tandis qu’en
Turquie – où la question de la violence contre les minorités forme des enjeux de
mémoire beaucoup plus pressants – gauchistes et libéraux ont pareillement occupé ce
champ de recherche (cf. ibid. : § 12-13, 48-49). L’association du néolibéralisme avec
l’Etat de droit et l’opposition commune des deux milieux politiques à l’Etat autoritaire,
issu d’une longue série des coups d’Etats militaires, a incontestablement joué un rôle
très important dans cette convergence. On peut même parler d’un « consensus » entre
certains intellectuels et chercheurs gauchistes et libéraux concernant l’enjeu de la
démocratisation, la liberté d’expression des citoyens kurdes et l’opposition à la
négation du génocide arménien. Et ce « consensus » a formé un contexte propice à la
multiplication des études minoritaires, axées principalement, en Turquie, sur la
critique de l’Etat et des individus qui sont censés l’incarner.
64 Qu’on ne se méprenne pas : nous n’avons pas l’intention ici de nier la responsabilité
individuelle et encore moins l’importance des acteurs individuels dans les questions de
violence de masse et d’oppression des minorités. Notre but, dans les paragraphes qui
précédent, était de mettre en relief quelques unes des conditions de possibilité du
discours intentionnaliste, afin de comprendre les raisons pour lesquelles ce discours
prend souvent une forme axiomatique, s’impose comme une pétition de principe qui
prédétermine le cours et les résultats de la recherche. D’ailleurs, les études de ce
numéro nous montrent clairement que l’intention individuelle tient un rôle très
important dans les phénomènes qui nous intéressent. Or, celle-ci n’est pas un
invariant ; elle évolue en fonction d’une multiplicité de facteurs, normatifs ou
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
29
contingents. Les choix individuels sont parmi les données historiques les plus
difficilement accessibles à l’historien, qui ne peut ni les déduire rétrospectivement des
faits ni les remplacer par des structures. Nous sommes donc loin de défendre un retour
au déterminisme des approches trop normatives et à soustraire à l’individu sa faculté
de choisir. Simplement, nous croyons que ni le libre-arbitre ni l’intention ne doivent
prendre la forme des systèmes d’interprétation monocausale qui réduisent la
complexité des faits sociaux. Si Hobbes et Hume avait contesté le libre-arbitre, ils
l’avaient fait au nom d’une compréhension plus complexe des actions humaines. Et
malgré le fait qu’ils réservaient une place irréductible à la nécessité, ils avaient le grand
mérite d’avoir décomposé le sujet, par trop simpliste, de la responsabilité juridique.
Rien d’intéressant ne peut résulter aujourd’hui de la recomposition de ce sujet, de la
subordination de la recherche en sciences sociales à des domaines extérieurs à celle-ci,
tels le régime de la responsabilité juridique ou de l’économie néoclassique.
65 Car le problème de l’approche intentionnaliste n’est pas de se focaliser sur l’individu, ni
d’étudier la part intentionnelle de ses actions. C’est d’extrapoler l’intention, de la
déduire rétroactivement des faits, à la façon des juges, qui y sont contraints par une
législation visant à l’uniformisation des décisions et à la réduction des controverses en
jurisprudence. En d’autres termes, le problème de l’approche intentionnaliste consiste
au fait qu’elle emprunte son concept d’intention au droit et, plus particulièrement, à la
pratique judiciaire dont le régime de véridiction, l’enquête judiciaire orientée vers la
nécessité du verdict, est forcément différent des conditions d’appréciation de la vérité
en sciences sociales. Pour comprendre la structure de l’intentionnalisme, il convient
donc de se tourner vers le statut de l’intention dans la théorie juridique et vers les
usages de cette notion dans la pratique judiciaire.
VI. L’intention judiciable
66 L’intention est le principal concept moral du droit pénal. Elle correspond grosso modo à
la notion technique de mens rea (l’esprit criminel ou l’intention criminelle), découlant
de l’adage juridique latin actus non facit reum nisi mens sit rea¸ signifiant que l’acte ne
rend pas un individu criminel à moins d’une intention qu’il le soit. Ce principe, qui est
en vigueur dans le droit pénal de la plupart des pays du monde, est rendu dans
l’article 121-3 du code pénal français comme suit : « Il n’y a pas de crime ou de délit
sans intention de le commettre ». Selon ce principe – issu à l’origine de la tradition
juridique du common law, mais repris généralement dans la législation des pays à
tradition romaine – une personne est considérée comme criminelle du moment où sont
réunies les deux conditions fondamentales constituant le crime : l’acte criminel (actus
reus) et l’esprit, ou intention criminelle (mens rea). Plus particulièrement dans le droit
pénal français, l’intention est décomposée en deux facultés principales : la conscience
et la volonté. La conscience y est généralement comprise en tant que conscience
d’infraction de la loi, mais elle peut prendre également la forme de l’état de conscience,
lorsque par exemple la démence constitue un argument plaidant pour l’innocence de
l’accusé. Quant à la volonté, elle peut être interprétée soit en tant que volonté de
commettre l’acte criminel sans désirer forcement son résultat (on parle alors
d’ « intention générale »), soit en tant que volonté de commettre le résultat de l’acte
criminel (auquel cas on parle d’ « intention spéciale ») (Elliot 2001). L’intention spéciale
est nécessaire pour la définition des délits graves, tandis que l’intention générale est
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
30
suffisante pour définir les délits légers. Afin d’illustrer la différence entre ces deux
concepts de l’intention, la juriste Catherine Elliott recourt à l’« idéel hypothétique », i.e.
« extra-juridique » de l’intention en tant que « volonté dirigée vers un but précis ». Ce
« seuil idéel » équivaudrait en gros à l’intention spéciale, par rapport à laquelle
l’intention générale constituerait un seuil de criminalité placé à un niveau inférieur
(Elliott 2001 : 66).
67 À ce « seuil idéel » de la criminalité correspond la conception du crime des « livres sur
les atrocités » et des ouvrages historiques plus récents qui renouent avec cette
tradition et qui tentent de prouver l’« intention spéciale » des criminels : leur volonté
de perpétrer l’acte criminel spécifique dont on les accuse. Il en résulte une conception
de l’histoire fondée sur la volonté, le seuil le plus élevé de criminalisation des auteurs
des crimes que ces livres d’histoire rapportent. Profondément structurés par cette
logique discriminatoire, ces ouvrages ne reconnaissent pas d’autres acteurs historiques
(d’autres sujets agissants) que des auteurs d’actes volontairement accomplis. D’où la
tendance, très marquée dans ce genre d’historiographie, de procéder par inférence, de
déduire la volonté d’accomplir les actes criminels qu’elle étudie (l’intention spéciale)
même lorsque celle-ci n’est pas attestée par les sources ; tendance découlant de la
structure même du verdict judiciaire, qui ne peut pas être prononcé sans trancher sur
l’intentionnalité, i.e. le degré de volition de l’acte criminel.
68 Cependant la conscience et la volition sont des faits psychologiques et le juge n’a pas
facilement accès à la psyché de l’accusé (Elliott 2001). Cette difficulté est contournée au
moyen de la prééminence, dans la majorité des cas, de l’appréciation in abstracto. Selon
cette méthode, le juge n’a pas à s’attarder sur l’appréciation des données spécifiques,
ou « intérieures » au cas examiné, i.e. les données sociales ou les caractéristiques
psychologiques des individus (ce qu’il doit faire dans le cas de l’appréciation in
concreto), mais il doit se rapporter à la fiction juridique de l’homme raisonnable – et
quelquefois, dans le système français, à celle du bon père de famille 13. C’est en
comparant l’attitude des individus du cas examiné avec ce type idéal que le juge se
prononce sur la « normalité » de leurs attitudes et, partant, sur le degré
d’intentionnalité de leurs actes.
69 La question qui se pose est en effet celle du statut de la subjectivité en droit pénal. Ce
statut est régi par une antinomie. D’un côté, la théorie classique du droit pénal accorde
à la subjectivité – à travers la mens rea – une place centrale dans la définition même du
délit (à ce niveau, la référence à la subjectivité fonde le caractère moral du droit pénal).
Or, de l’autre côté, la pratique juridique a tendance à exclure de l’appréciation
juridique l’examen des éléments subjectifs, soit à travers le jugement in abstracto soit à
travers la référence à la jurisprudence (case law). Selon le juriste Alan Norrie, cette
tentative d’évincer, autant que faire se peut, du droit pénal la subjectivité est issue des
travaux de codification d’inspiration benthamienne, effectués dans les années 1830 et
1840. Ces codifications ne s’inspiraient ni d’un souci de cohérence théorique ni d’un
désir de plus grande justice, mais du souci utilitariste de bannir du droit les définitions
concurrentielles.
« Ceci a été accompli à travers l’élimination de toutes les demandes potentielles
reconventionnelles qui seraient issues de l’élément moral requis pour la culpabilité
criminelle. L’élément crucial était le déni de la pertinence du motif quant à la
culpabilité, parce que le motif pouvait former un ‘pont’ moral entre excuse,
justification et intention » (Norrie 1992 :56).
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
31
70 Ce faisant, les comités de codification ont barré la route à tout élément de justification
issu d’un côté, du domaine psychologique (sauf dans les cas médicaux) et de l’autre, des
domaines social et politique. Une fois le « motif » écarté, la défense ne pouvait plus
faire appel ni à l’état affectif de l’accusé ni à son système de valeurs, issues de son
milieu social ou de ses engagements politiques. Ainsi l’« intention judiciable »
(Foucault 2001) fut d’un côté, « factualisée » (et, partant, dissociée de ses aspects
psychologiques) et de l’autre, « individualisée » (découplée de tout élément d’ordre
social ou politique).
VI. Conclusion : Par delà l’« histoire judiciable »
71 Nous pensons que c’est justement cet appauvrissement de l’« intention judiciable » qui
se trouve au cœur du débat entre « intentionnalistes » et « fonctionnalistes ». Car, ces
derniers insistent sur l’analyse précisément des éléments que l’« intention judiciable »
tend à écarter : l’étude du contexte politique et social dans sa complexité irréductible
(pour ne pas mentionner l’aspect psychologique qui n’est pas pris en considération ni
par les uns ni par les autres). Toute la différence est – comme l’écrivait Marc Bloch
(1949) et comme le constate Timothy Mason, en se référant à Burckhardt – celle entre
une démarche qui vise à juger l’histoire et une autre qui cherche à la comprendre. Ces
deux démarches sont-elles incompatibles a priori ? Nous ne saurions pas répondre
généralement, elles semblent cependant l’être lorsque la grille de lecture de l’historien
s’identifie à l’appréciation juridique, lorsque son concept de l’intention se confond avec
l’intention judiciable, dans sa forme actuelle, ayant subi les opérations de l’utilitarisme
benthamien et la tendance générale du droit pénal contemporain vers l’appréciation in
abstracto. Pour que l’intention devienne un concept historique, elle devra être
appréciée in concreto, être affranchie de l’« homme raisonnable » et du « bon père de
famille », pour retrouver son ampleur psychologique et être réintroduite dans le
système social, dans la complexité de chaînes d’interaction et de rapports de pouvoir
qui conditionnent le comportement des individus, dans le hasard des événements
contingents qui modifient leurs décisions et leurs actes. Car, il ne faut pas toujours
« être motivé pour tuer » (Mariot 2003), sans que cela ne dise qu’on ne puisse pas l’être.
72 Une histoire axée sur l’intention judiciable est une « histoire judiciable », une histoire
sujette rétrospectivement aux calculs utilitaristes benthamiens, par collusion avec le
domaine juridique. Elle est une histoire in abstracto i.e. non empirique, car l’empirisme
opère forcement in concreto. Elle est enfin sujette implicitement à un principe de
nécessité, parce qu’elle ne connaît pas des facteurs contingents (par rapport à
l’« homme raisonnable » et le « bon père de famille »), parce qu’elle est dissociée aussi
bien du contexte extérieur (sociologique et politique) qu’intérieur (psychologique) à
l’individu. Car à l’autre bout de la contingence se trouve toujours la nécessité. Et les
logiciens qui se sont consacrés à la taxinomie des systèmes philosophiques selon les
deux pôles antithétiques que constituent la nécessité et la contingence ont constaté le
penchant des systèmes dogmatiques14 pour la nécessité et celui des systèmes dits de
l’examen, pour la contingence. La question se pose donc : où faut-il placer l’histoire,
plus près du dogme ou bien de l’expérience ? Entre les deux extrêmes, il y a bien des
solutions intermédiaires, parmi lesquelles l’historien devrait choisir.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
32
BIBLIOGRAPHIE
Bartov, Omer (1990) Hitler’s Army Soldiers, Nazis and War in the Third Reich, Oxford,
Oxford University Press.
Barnhard, Michael A. (2001) Japan Prepares for Total War: The Search for Economic Security, 1919-1941,
New York - Ithaca, Cornell University Press.
Bell, David Avrom (2007) The First Total War, Boston, Houghton Mifflin.
Binoche, Bertrand (2008) Les trois sources des philosophies de l’histoire, Paris, PUF/Les collections de
la République des Lettres.
Bloch, Marc (1949) Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, « Cahiers des Annales », 3, Paris,
Librairie Armand Colin.
Browning, Christopher (1985) Fateful Months: Essays on the Emergence of the Final Solution, New York,
Holmes & Meier.
Browning, Christopher (1992) Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in
Poland, New York, Harper Collins.
Browning, Christopher (2004) The Origins of the Final Solution : The Evolution of Nazi Jewish Policy,
September 1939 – March 1942 (With contributions by Jürgen Matthäus), Lincoln, University of
Nebraska Press.
Christopoulos, Dimitris (2000) Droit, Europe et Minorités. Critique de la connaissance juridique,
Athènes-Komotini, Éditions Ant. N. Sakkoulas.
Cesarani, David (2005) Eichmann : His Life and Crimes, New York, Vintage.
Derrida, Jacques (1999) « Le siècle et le Pardon », Le Monde des Débats, décembre.
Doyle, Bob (2011) Free Will : The Scandal in Philosophy, Cambridge MA., I-Phi Press.
Dragoumis, Philippos (à paraître) Η ηθική πίσω από την «κρίση», Εκδόσεις Αγρα.
Duff, R. Antony (1990) Intention, Agency and Criminal Liability, Oxford, Blackwell.
Elliott, Catherine (2001) French criminal law, Portland, Willan Publishing.
Eti, Ali Rıza (2009) Bir onbaşının Doğu cephesi günlüğü. 1914-1915, Istanbul, Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları.
Finkelstein, Norman (2007) “Remembering Raul Hilberg”, Counter Punch, August 22, 2007.
Foerster, Stig ; Nagler, Joerg (1997) On the Road to Total War: The American Civil War and the German
Wars of Unification, 1861-1871, Cambridge, Cambridge University Press.
Foucault, Michel (1966) Les Mots et les Choses (Une archéologie des sciences humaines), Paris,
Gallimard.
Foucault, Michel (2001) « La redéfinition du judiciable » [Revue du syndicat de la magistrature,
Justice : 115], Dits et écrits I, 1954-1975, Paris, Gallimard.
Foucault, Michel (2004a) Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France. 1977-1978, Paris,
Gallimard/Seuil, Collection « Hautes Études ».
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
33
Foucault, Michel (2004b) Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France. 1978-1979, Paris,
Gallimard/Seuil, Collection « Hautes Études ».
Friedman, Milton ; Friedman, Rose (1980) Free to choose. A Personal Statement, Harcourt, San Diego.
Hayek, Friedrich (1944) The Road to Serfdom, London, Routledge Press
Hilberg, Raul (1961) The Destruction the European Jews, Chicago, Quadrangle Books.
Hull, Isabel V. (2004) Absolute Destruction: Military Culture and the Practices of War in Imperial
Germany, New York Ithaca, Cornell University Press.
Hume, David (1902) Enquiries Concerning the Human Understanding, And Concerning the Principles of
Morals, Oxford, Clarendon Press. (Réimpression de l’édition de 1777, présentée par L.A.Selby-
Bigge, deuxième édition)
Kelsen, Hans (2002) Pure Theory of Law, Union-New Jersey, The Lawbook Exchange Ltd.
Kant Emmanuel (1869), Critique de la raison pure, Paris, Édition G. Baillière.
Kershaw, Ian (1985) The Nazi Dictatorship – Problems and Perspectives of Interpretation, Londres,
Arnold.
Koskenniemi, Martti (2001) The Gentle Civiliser of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870 –
1960, Cambridge, Cambridge University Press.
Kostopoulos, Tassos (2007) Πόλεμος και εθνοκάθαρση. Η ξεχασμένη πλευρά μιας δεκαετούς εθνικής
εξόρμησης, 1912-1922, Athènes, Βιβλιόραμα.
Kow, Simon (2005) “Necessitating Justice: Hobbes on Free Will and Punishment,” The European
Legacy 10:7 (Décembre ), pp. 689-702.
Legros, Robert (1952) L’Élément moral dans les infractions, Paris-Liège, Recueil Sirey.
Lin, Nan (1995) « Les ressources sociales : une théorie du capital social », Revue française de
sociologie, 36-4. pp. 685-704.
Longerich, Peter (2000) The Wannsee Conference in the Development of the Final Solution. London, The
Holocaust Educational Trust. (Holocaust Educational Trust Research Papers. Vol. 1, no. 2,
1999/2000)
Mariot, Nicolas (2003) « Faut-il être motivé pour tuer ? Sur quelques explications aux violences
de guerre », Genèses. Sciences sociales et histoire (53), décembre 2003, pp. 154-177.
Mason, Thimoty (1989) “Intention and Explanation: A Current Controversy about the
Interpretation of National Socialism”, in Marrus, Michael (ed.) The Nazi Holocaust Part 3, The “Final
Solution”: The Implementation of Mass Murder, Vol. 1, Mecler, Westpoint, CT, pp. 3-20. (1 ère éd. [1981],
in Hischfeld, Gerhard; Kettensacker, Lothar (éd.), Der „Führerstaat“: Mythos und Realität Studien zur
Struktur und Politik des Dritten Reiches, Stuttgart, Ernst Klett, pp. 21-40.)
Mayer, Arno (1988) Why Did the Heavens Not Darken? The « Final Solution » in History, New York,
Pantheon Books.
Mazower, Mark (2009) No Enchanted Palace. The End of Empire and the Ideological Origins of the United
Nations, Princeton, Princeton University Press.
Mill, John Stuart (1909) On Liberty, Harvard, P. F. Collier & Son.
Noiriel, Gérard (2008) “Comment travailler sur le rapport entre État et population : l’ingénierie
démographique à l’aune de la sociohistoire. Entretien avec Gérard Noiriel”, European Journal of
Turkish Studies, 16 : Demographic Engineering - Part I, URL : http://ejts.revues.org/2083
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
34
Norrie, Alan (1992) “Subjectivism, Objectivism and the Limits of Criminal Recklessness”, Oxford
Journal of Legal Studies, 12(1): 45-58.
Petit, Philip (2002) “Keeping Republican Freedom Simple : On a Difference with Quentin Skinner”,
Political theory 30: 339-356.
Popper, Karl (1945) The Open Society and Its Enemies, London, Routledge Press.
Rand, Ayn (1961) For the New Intellectual: The Philosophy of Ayn Rand, New York, Random House.
Rolin-Jaequemyns, Gustave (1876) Le droit international et la question d’Orient, Gand, Au Bureau de la
Revue de Droit International.
Rolin-Jaequemyns, Gustave (1891) Armenia, the Armenians and the Treaties, Londres, Heywood.
Sigalas, Nikos ; Toumarkine, Alexandre (2008), “Ingénierie démographique, génocide, nettoyage
ethnique. Les paradigmes dominants pour l’étude de la violence sur les populations minoritaires
en Turquie et dans les Balkans”, European Journal of Turkish Studies, 16 : Demographic Engineering -
Part I, URL : http://ejts.revues.org/2933
Snyder, Timothy (2012) Terres de sang. L’Europe entre Hitler et Staline, Paris, Gallimard.
Twiss, Travers (1863) The Law of Nations, Considered as Independent Political Communities: On the
Rights and Duties of Nations in Time of War, Oxford, Oxford University Press.
Vuillement, Jules (1984) Nécessité et contingence. L’aporie de Diodore et les systèmes philosophiques,
Paris, Minuit.
Weitz, Eric D. (2008) “From the Vienna to the Paris System: International Politics and the
Entangled Histories of Human Rights, Forced Deportations, and Civilizing Missions”, The American
Historical Review 5 (12/1), pp. 1313-1343.
NOTES
1. La notion d’intentionnalisme est forgée dans le cadre d’un débat historiographique concernant
le génocide juif (cf. infra § 36). Nous élargissons ici son usage dans le cadre de l’historiographie de
la violence contre les minorités et de l’oppression de celles-ci, puisque il nous parait évident que
celle-ci est toujours, explicitement ou implicitement, influencée par l’historiographie de
l’holocauste. Les tendances et les enjeux en sont souvent les mêmes, bien que dans des
proportions différentes et dans le cadre de rapports variant selon le cas étudié et le cadre
politique et épistémologique dans lequel il est étudié. Il nous parait donc important d’expliciter
ce rapport, en faisant communiquer les expériences et en comparant les paradigmes.
2. A l’exception du livre de Tassos Kostopoulos [2007] et d’un nombre restreint d’articles (cf .
Sigalas &Toumarkine 2008 § 27-33).
3. Snyder souligne le fait que le débat entre intentionnalistes et fonctionnalistes s’est développé à
une époque où l’influence du front de l’Est dans l’holocauste n’avait pas encore été mise en relief
(Snyder 2012 : 300).
4. Cf. Sigalas & Toumarkine, 2008, § 9-31.
5. Dans l’entretien que nous avons mené avec lui pour le premier numéro de ce dossier, Gérard
Noiriel souligne que la production des minorités est une spécificité du régime démocratique qui
ne cesse pas de produire du « eux » et « nous » (Noiriel 2008). D’ailleurs la notion elle-même de
minorité semble être liée au principe du vote et à la façon dont ce principe introduit une
discrimination au cœur-même de l’identité gouvernants/gouvernés qu’il contribue à fonder. Or,
en opérant cette discrimination, les régimes démocratiques produisent automatiquement des
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
35
zones d’extériorité : des formes d’état d’exception ou de secret d’Etat dont la gestion est
soustraite au contrôle démocratique. Dans ces zones « grises » de la démocratie demeurent les
minorités, nonobstant le fait que le « secret » qui les concerne peut en fait être objet de débats ou
de propagande politique, sous forme de théories du complot (cf. infra § 8).
6. Concernant spécifiquement la notion d’ingénierie démographique, cette tendance vient de
l’ascendant néolibéral du concept, faisant de la planification le caractère principal des régimes
autoritaires (cf. postface).
7. Cf. la fameuse phrase qu’Hitler aurait prononcée dans une réunion où participait également
Göring et considérée par certains historiens comme ayant déclenché, ensemble avec d’autre
locutions du même type, le processus de la « solution finale » : « Les territoires soviétiques à
l’ouest de l’Oural doivent devenir un “jardin d’Eden germanique” et naturellement cette vaste
région doit être pacifiée sitôt que possible ; ceci se fera de la meilleure façon en abattant
quiconque ose même nous regarder de travers » (Browning 2004 : 309).
8. Reichssicherheitshauptamt : Office central de la sécurité du Reich, fondé en 1939 et dirigé par
Heydrich jusqu’à son assassinat en juin 1942. Au RSHA appartenaient les Einzatzgrupen (groupes
d’intervention), qui opéraient à l’arrière du front et qui ont commencé à massacrer les Juifs,
ensemble avec les commissaires politiques communistes, et toute autre catégorie de la
population suspecte de « menacer » la sécurité du front, pendant les premières étapes de
l’opération Barbarossa. Les Einzatzgrupen étaient directement placés sous l’autorité de Heyndrich.
9. Rappelons que cette exigence est relayée au sommet-même de l’Etat par les acteurs politiques
turcs. Tandis que la plupart de ceux qui en font état connaissent rarement le degré auquel les
archives sont, ou ne sont pas, accessibles.
10. L’institution de Tribunaux Pénaux Internationaux apparait dans les années 1990. Elle
combine le principe de l’« inviolabilité de l’intégrité territoriale des États », affirmée dans la
charte de l’ONU, et un nouvel interventionnisme des pays de l’OTAN après la fin du communisme,
sous couvert de souci humanitaire.
11. En effet la pratique d’échange de populations apparait pour la première fois pendant et après
les Guerres Balkaniques (Embiricos § 36-64). Ce qui corrobore le point de vue de Weitz selon
lequel, au sein du système de Paris, se cristallisaient des tendances du droit international qui
étaient à l’œuvre depuis plusieurs décennies sous l’influence des effets désastreux que les guerres
nationalistes avaient sur les civils.
12. Pour Hume, comme pour Hobbes, la conception moraliste de la punition équivaut au
sentiment de vengeance.
13. Une exception importante à cette règle constitue le jugement de la négligence, qui est
généralement censé être rendu in concreto par le juge. Mais là aussi, dans la pratique, le jugement
subjectif est limité par la référence aux précédents juridiques.
14. La notion du dogmatisme est employée ici selon son usage par Jules Vuillemin dans sa
classification des systèmes philosophiques par rapport aux notions de nécessité et de
contingence (Vuillemin 1984 : 273-356). Cette notion n’est cependant pas très différente de celle
introduite par Kant dans la première préface de la Critique de la raison pure (Kant 1869).
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
36
INDEX
Keywords : minorities, violence, intentionnality, Nazism, anti-Greek pogroms, Bosnia Muslims,
Thrace, expulsions, demographic engineering
Mots-clés : ingénierie démographique, Bosniaques musulmans, contractualisme, expulsions,
pogromes anti-grecs, minorités, intentionnalisme, nazisme, Thrace
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
37
La spécificité musulmane dans
l’évolution démographique de la
Bosnie-Herzégovine durant la
seconde moitié du XIXe siècle
(1850-1914)
The Muslim specificity in Bosnia and Herzegovina demographics in the second
half of the nineteenth century (1850-1914)
Philippe Gelez
Introduction
1 À l’heure actuelle, on trouve en Bosnie-Herzégovine trois grandes communautés
nationales qui se sont développées sur une base essentiellement confessionnelle :
orthodoxes-Serbes, musulmans-Musulmans/Bochniaques et catholiques-Croates, que je
nommerai ici, par simplicité, uniquement de leur nom religieux. Pour se forger une
identité, toutes trois empruntent, entre autres, la voie de la victimisation et affirment
qu’elles ont été sujettes, au cours de l’histoire, à diverses discriminations, exils,
migrations forcées, génocides, etc., le tout à grande échelle.
2 Les musulmans ont particulièrement souffert durant le conflit et ont par conséquent
développé, davantage que leurs compatriotes, une logique victimaire dans leur discours
national. Ils croient trouver dans le XIXe siècle les débuts d’un génocide dont ils sont les
victimes. Et en effet, l’histoire de la Bosnie-Herzégovine au XIXe siècle est pleine de
migrations plus ou moins forcées, auxquelles les musulmans participent souvent. Des
groupes de musulmans chassés de Serbie et du Monténégro, à l’occasion des différentes
guerres pour l’indépendance, vinrent grossir les effectifs de la communauté islamique
provinciale. L’arrivée des Austro-hongrois à l’été 1878, à la suite du Congrès de Berlin,
provoqua à l’inverse une vague d’émigration musulmane en direction de l’Empire
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
38
ottoman, tandis que de la monarchie habsbourgeoise se déversèrent de nombreux
orthodoxes et catholiques, ainsi que quelques protestants.
3 Face à la plupart de ces événements, les narrations et réflexions se développent à partir
d’une critique d’intention : on ne part pas, on est chassé ; on ne vient pas, on est
installé. En masse. C’est dans cette dialectique de l’inerte et du volontaire que se situe
le problème de l’ingénierie démographique telle qu’elle est perçue par les musulmans.
C’est donc de cette dialectique que cet article partira pour remettre en situation la
démographie de la Bosnie-Herzégovine durant la seconde moitié du XIXe siècle et tenter
de lui donner un éclairage nouveau dans le cadre du human engineering concernant la
population bosno-musulmane.
I. Un déclin entamé dès avant 1878
4 Durant la période considérée, la population bosno-herzégovinienne a fait l’objet de huit
recensements, quatre effectués par l’administration ottomane (1851, 1865, 1870 et 1875)
et quatre par les Austro-hongrois (1879, 1885, 1895 et 1910). J’ai longuement détaillé,
dans des articles et mémoires préalables à celui-ci, leurs méthodes et leurs résultats 1.
De fiabilité inégale, ils permettent cependant de découvrir que la population
musulmane suit un trend déclinant dès avant l’arrivée de la double monarchie en
Bosnie-Herzégovine, ce qui s’explique en partie par des comportements sociaux et une
certaine vulnérabilité aux épidémies.
Chiffres généraux
5 synthèse possible de l’évolution démographique de la province au XIX e
Une
siècle est donnée dans le tableau suivant (tab. 1).
Musulmans Orthodoxes Catholiques Juifs Autres Total
1851 340 372 389 933 153 141 1 979 885 425
1865 365 038 463 418 176 229 2 100 1 010 583
1870 382 888 370 448 148 989 2 405 904 730
1875 390 527 402 242 178 815 3 485 978 289
1879 450 305 493 402 213 269 3 459 246 1 160 681
1885 491 652 572 288 265 795 5 805 538 1 336 078
1895 548 632 673 246 334 142 8 213 3 859 1 568 092
1902 576 845 728 176 370 514 9 772 4 354 1 689 661
1903 579 388 733 626 375 015 10 007 4 504 1 702 540
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
39
1904 583 259 744 362 379 106 10 274 4 719 1 721 720
1910 612 137 825 418 434 061 11 868 14 560 1 898 044
1912 626 649 856 158 451 686 12 546 15 372 1 962 411
1913 634 830 867 909 458 999 12 735 15 798 1 990 271
1914 639 989 877 682 468 140 12 936 16 218 2 014 965
1915 638 695 873 593 469 378 13 052 16 412 2 011 130
Tableau 1. Évolution de la population bosno-herzégovinienne entre 1851 et 1915 (limites de 1878,
chiffres absolus).
Source : Philippe Gelez, Atlas statistique, p. 51.
6 J’ai déjà expliqué en quoi les chiffres de 1870 n’étaient pas suffisamment robustes pour
être tout à fait pris en compte. En dehors de ce fait, parmi les nombreuses
considérations que l’on peut tirer d’un semblable tableau, l’une est particulièrement
intéressante pour le propos du présent article : c’est l’évolution des proportions
confessionnelles parmi l’ensemble de la population.
Musulmans Orthodoxes Catholiques Juifs Autres Total
1851 38,44 44,04 17,30 0,22 100
1865 36,12 45,86 17,44 0,21 100
1870 42,32 40,95 16,47 0,27 100
1875 39,92 41,12 18,28 0,36 100
1879 38,80 42,51 18,37 0,30 0,02 100
1885 36,80 42,83 19,89 0,43 0,04 100
1895 34,99 42,93 21,31 0,52 0,25 100
1902 34,14 43,10 21,93 0,58 0,26 100
1903 34,03 43,09 22,03 0,59 0,26 100
1904 33,88 43,23 22,02 0,60 0,27 100
1910 32,25 43,49 22,87 0,63 0,77 100
1912 31,93 43,63 23,02 0,64 0,78 100
1913 31,90 43,61 23,06 0,64 0,79 100
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
40
1914 31,76 43,56 23,23 0,64 0,80 100
1915 31,76 43,44 23,34 0,65 0,82 100
Tableau 2. Part des différentes confessions dans l’évolution de la population bosno-herzégovinienne
entre 1851 et 1915 (limites de 1878).
Source : Philippe Gelez, Atlas statistique, p. 54.
7 La part des catholiques augmente régulièrement depuis 1870, sous l’effet conjugué
d’une natalité importante et d’apports extérieurs plus importants encore. Le reste (juifs
et « autres ») augmente sensiblement, quoique dans des proportions toujours ultra-
minoritaires, en raison d’une forte immigration. D’autre part, les orthodoxes ont une
croissance relative plus lente, mais n’enregistrent pas de véritable recul – toujours à
partir de 1870. C’est peut-être la situation des musulmans qui étonne le plus : leur part
décroît régulièrement dès 1870, un phénomène difficile à expliquer.
8 L’examen des taux d’accroissement naturel accuse de grosses différences selon les
confessions pour les années dont on dispose : 1897, 1913, 1914 et 1915. Ci-dessous, ceux
des années 1897 et 1913 (tab. 3), car les deux années suivantes concernent des années
de guerre.
Natalité
Nés Morts- (enfants Mortalité, Accroissement
1897 Décès Solde
vivants nés vivants), en en ‰ naturel, en ‰
‰
Orientalo- 24
orthodoxes 28 735 34 42,17 530 36,50 4 205 5,67
17
Musulmans 19 451 33 35,33 181 31,50 2 270 3,83
Rimo- 11
catholiques 14 654 48 42,98 095 33,30 3 559 9,68
Juifs
espagnols 318 7 37,49 135 23,60 183 13,89
Autres 133 2 33,98 101 26,70 32 7,28
53 10
Total 63 291 124 39,86 042 33,41 249 6,45
Nés Natalité (enfants Mortalité, Accroissement
1913 Décès Solde
vivants vivants), en ‰ en ‰ naturel, en ‰
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
41
Orientalo- 25 11
orthodoxes 36 844 43,03 093 29,31 751 13,73
16
Musulmans 24 295 38,77 114 25,71 8 181 13,06
Rimo- 12
catholiques 20 103 44,51 790 28,32 7 313 16,19
Juifs espagnols 305 24,31 116 9,25 189 15,06
Autres 786 51,13 360 23,42 426 27,71
54 27
Total 82 333 41,96 473 27,76 860 14,20
Tableau 3. Chiffres de la natalité en Bosnie-Herzégovine pour 1897 et 1913.
Source : Philippe Gelez, Atlas statistique, p. 169.
9 Outre que ces deux tableaux montrent clairement que la Bosnie-Herzégovine est entrée
dans sa phase de transition démographique en 1913, ils prouvent que la population
musulmane s’accroît bien moins rapidement que les deux principaux autres groupes
confessionnels. Le Département des statistiques de l’administration austro-hongroise a
également proposé le tableau suivant (tab. 4) dans le recensement de 1910 :
1895 1910 Accroissement naturel
Abs. % Abs. % Abs. %
Serbo-orthodoxes 673 246 42,93 825 418 43,49 144 407 21,45
Musulmans 548 632 34,99 612 137 32,25 73 694 13,43
Rimo-catholiques 334 142 21,31 434 061 22,87 85 339 25,54
Juifs sépharades 5 729 0,37 8 219 0,43 2 598 45,35
Autres juifs 2 484 0,16 3 649 0,19 877 35,31
Protestants 3 596 0,23 6 342 0,33 1 529 42,52
Autres 263 0,02 8 218 0,43 914 347,53
Total 1 568 092 100 1 898 044 100 309 358 19,73
Tableau 4. Accroissement naturel de la population bosno-herzégovinienne entre 1895 et 1910.
Source : Philippe Gelez, Atlas statistique, p. 169.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
42
10 Là encore, l’examen du taux d’accroissement naturel met les musulmans loin derrière
les autres. On peut essayer de cerner les causes du phénomène à travers un faisceau de
facteurs comportementaux décrit par des documents dès le milieu du XIX e siècle.
Comportement familial
11 Il est difficile de cerner l’horizon mental de la famille tel que le concevaient les
musulmans. On se gardera en tout cas de le quantifier à l’aide du recensement des
foyers tel qu’il apparaît dans les dénombrements ottomans, où il est réparti par
religion. En effet, on ne sait pas exactement ce que recouvre ici le terme de « foyer », et
il est probable que cette réalité connaissait une définition assez floue, tantôt foyer
fiscal et tantôt foyer familial. Dans les recensements austro-hongrois, on pourrait
envisager d’étudier les villages où la population est homogène d’un point de vue
religieux. Mais l’échantillon serait-il représentatif de l’ensemble ? J’en doute.
12 Le fait est que l’on procrée moins dans la famille musulmane, ce qui n’a pas échappé
aux observateurs les plus avertis de l’époque, et les témoignages, sinon les explications,
concordent. Ainsi un fonctionnaire autrichien, Richard von Erco (1813-1871),
remarque-t-il au cours d’une mission officielle en Bosnie effectuée en 1846 que les
musulmans surpassaient en nombre les chrétiens au début du siècle, mais que depuis
lors leur communauté périclite et a tendance à toujours plus se concentrer en ville :
[Les causes de ce phénomène sont] un mode de vie efféminé ; la peste, dont les
Turcs ne se gardent pas, et qui en a emportés un grand nombre ; ainsi qu’un moyen
souvent utilisé par les femmes turques pour ne pas avoir trop d’enfants. À Travnik,
les Turcs changent souvent de femme, lorsqu’elle ne leur plaît plus ils la mettent
dehors et en prennent une autre. Celle qui sort du foyer n’obtient rien hormis les
vêtements et parures que son mari lui a donnés. La conséquence en est que les
femmes n’ont aucun souci de l’entretien de la maison et des enfants, et cherchent
au contraire à s’y soustraire ; et pour avoir la paix ou pouvoir sortir, elles donnent
souvent à leurs enfants de l’opium afin de les endormir 2.
13 Peste, avortement, divorce : ces facteurs se retrouvent le plus souvent dans les
explications données à la natalité relativement basse des musulmans au XIXe siècle On
peut encore citer le consul français en 1865 :
Je ne trouve d’autre explication à ces résultats [la basse fécondité de la population
musulmane] que dans les nombreux avortements clandestins qui sont
malheureusement si fréquents dans l’intérieur des familles musulmanes, coutume
barbare tellement entrée dans leurs mœurs intimes qu’aux yeux de beaucoup
d’entre elles, elle n’a aucun caractère de criminalité. Et qui pourrait dire le nombre
d’infanticides mêmes qui s’accomplissent, on est autorisé à le croire, dans les
harems où les regards de la police et de la justice ne peuvent jamais pénétrer ? Dans
la famille chrétienne au contraire, ces crimes sont tout à fait inconnus, parce
qu’outre que les mœurs y sont beaucoup plus sévères, on y observe plus
rigoureusement les préceptes religieux ainsi que les lois humaines et naturelles 3.
14 Ces explications rejoignent ce que les historiens démographes ont pu constater pour
l’ensemble de l’Empire au XIXe siècle. Du coïtus interruptus à l’avortement, en passant par
l’âge tardif des femmes au mariage, le contrôle des naissances y était répandu, en
particulier chez les musulmans ; l’avortement n’était pas exceptionnel. Dans les années
1830, on le pratiquait tant que l’État prit des mesures pour l’interdire, ainsi qu’en
témoigne un firman du début novembre 1838 adressé à toutes les autorités de Roumélie.
Le sultan y invoque la loi divine (l’avortement équivaut au meurtre d’une personne)
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
43
aussi bien que la loi politique : l’accroissement de la population est facteur de
prospérité pour l’empire4. L’historien Machiel Kiel (1938-) indique très vaguement qu’il
faudrait chercher dans « la psychologie de cette époque » les raisons de ces pratiques 5.
15 On est cependant en droit de douter que l’avortement fût si répandu qu’il affectât le
comportement de toute une frange de la population. Fort de cette réflexion, Élisée
Reclus (1830-1905), le célèbre géographe et anarchiste, se demande « s’il ne faut pas
voir plutôt dans ce phénomène l’effet du bien-être relatif des musulmans et de la
prudence que leur suggère leur condition de propriétaires »6. Cependant, là encore,
l’argument porte à moitié, car tous les musulmans n’étaient pas propriétaires, loin s’en
faut.
Une population vulnérable
16 Des arguments psycho-culturels sont également avancés pour expliquer le retard
démographique des musulmans. Pour l’après-1878, on dépeint une communauté vivant
dans une sorte de léthargie mentale, une moderne apathie, et se démoralisant du fait de
l’émigration ; et on met cet état d’esprit en parallèle avec les taux d’accroissement
naturel ou l’évolution relative de la population, où les musulmans occupent la dernière
place. Que les musulmans aient été abattus par leur situation dans la Bosnie-
Herzégovine austro-hongroise, et qu’ils en aient par conséquence décru en nombre,
c’est tout à fait possible ; mais le phénomène est antérieur à l’arrivée de la monarchie,
et d’autres éléments doivent être avancés pour en compléter l’explication.
17 Peut-être faut-il chercher du côté des épidémies : les musulmans, plus durement
atteints, auraient vu leur dynamisme démographique ralenti sur le long terme. Il est
probable ainsi que les musulmans détinrent la majorité absolue dans l’eyalet depuis les
années 1700 jusque vers 1820, et qu’ils connurent ensuite une sorte de déclin
démographique, ne parvenant pas à se renouveler aussi vite que les autres groupes
religieux. Ceux-ci furent vivifiés par l’apport net de l’immigration, mais surtout par le
dynamisme qu’elle apporta ; au contraire, les musulmans, affaiblis par le choléra,
n’auraient pas pu se renouveler en raison des deux insurrections (1830-1831 et
1850-1851) où nombre d’entre eux périrent (env. 2 500 hommes pour 1850-1851, estime-
t-on7).
18 Plus durement atteints lors des épidémies, les musulmans se seraient relevés plus
difficilement. Cela dit, ce n’est qu’une hypothèse partielle. Après 1878, la natalité reste
basse chez les musulmans, alors même que les conditions sanitaires ont radicalement
changé. Les observations qui sont faites alors ne montrent pas qu’il y ait eu une
surmortalité des musulmans due à des pathologies spécifiques. Certes, il semble que,
par rapport à leurs compatriotes, ils aient été davantage atteints de tuberculose, de
typhoïde – parce que ces maladies se développaient plus facilement en milieu urbain,
essentiellement musulmans – ou encore de syphilis (présente cependant également
chez les catholiques indigènes), petite originalité dont on ignore la cause ; malgré donc
ces pathologies spécifiques, les chiffres mis en cause ne sont guère impressionnants 8.
Taux de féminité
19 Devant ce foisonnement d’hypothèses dont aucune ne satisfait pleinement, on voudrait,
en dernier recours, se retourner vers le taux de féminité. En 1910 (la seule date à
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
44
laquelle il est disponible, communauté par communauté), il est remarquablement bas
(tab. 3).
Indice de Pour 1 000 hommes, nombre de
Hommes Femmes
masculinité femmes
Serbo-
431 206 394 212 109 914
orthodoxes
Musulmans 327 421 284 716 115 870
Rimo-catholiques 222 350 211 711 105 952
Juifs sépharades 4 060 4 159 98 1 024
Tableau 5. Part des sexes dans la population bosno-herzégovinienne de 1910.
Source : Philippe Gelez, Atlas statistique, p. 47.
20 Ce taux est d’autant plus inexplicable qu’on est à l’époque dans le contexte d’une
émigration assez forte, touchant a priori davantage les hommes que les femmes. À la
suite d’Éric Brian (1958-) et Marie Jaisson (1962-), on pourrait expliquer ces différences
par des facteurs culturels, et non naturels, influant sur l’équilibre de la procréation 9 :
ainsi du rôle accordé aux femmes dans chaque religion, primordial chez les Juifs,
secondaire chez les musulmans, plus équilibré chez les chrétiens. Cependant, ce taux ne
correspond pas au sex-ratio dans son acception commune, qui ne concerne que les
nouveau-nés. Il n’indique pas directement d’éventuelle surmasculinité à la naissance,
même si cela reste une explication, parmi d’autres, de ce déséquilibre.
21 On restera donc prudent dans cette voie. Plus que les facteurs culturels, la mort en
couches des femmes explique en bonne partie un tel taux de prévalence masculine ; les
juives, dont la communauté est exclusivement urbaine ou presque, vivent dans de
meilleures conditions d’hygiène et ont un meilleur accès à l’assistance médicale que les
musulmanes, auxquelles est refusée toute assistance masculine et qui sont secondées,
au moment de l’accouchement, par des sages-femmes incompétentes, qui ont plus de
connaissances en magie qu’en obstétrique10.
22 Quoiqu’il en soit, le fait est là : les musulmans procréent moins que leurs compatriotes,
ce que ne viennent pas expliquer d’éventuelles lois de primogéniture ou de
transmission patrilinéaire exclusivistes. La faible natalité musulmane, et sa décrue
régulière, restent à ce jour assez mystérieuses.
II. L’émigration musulmane (1878-1914)11
23 C’est sur fond de dénatalité à long terme que s’inscrit l’émigration des musulmans hors
de leur Bosnie-Herzégovine natale. Le mouvement a été d’autant plus remarqué que
tous les observateurs craignaient qu’il ne commence dès 1878, voire avant. Il a donc
pris très rapidement une puissante dimension politique, que je voudrais analyser
seulement après l’examen de ce que nous disent les statistiques.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
45
Ampleur numérique
24 Le décompte des migrants peut se faire aussi bien à leur départ qu’à leur arrivée au but
de leurs pérégrinations. Quoiqu’il semble évident, d’un point de vue méthodologique,
que seuls les chiffres de départ permettent d’établir une base de réflexion un peu
solide, je m’arrêterai un instant sur les chiffres d’arrivée pour voir jusqu’où on peut les
utiliser.
Chiffres ottomans : au terme du processus
25 Pour le décompte des immigrés à l’arrivée, l’article de référence a été écrit par Kemal
H. Karpat (1925-) sur la période 1878-191212. D’après les statistiques du Bureau ottoman
des statistiques, Karpat indique que 3 499 Bosniaques arrivèrent à Istanbul par bateau
sur cinq années : 1881, 1887, 1900, 1905-1906 et 1906-1907, ce qui fait une moyenne
annuelle de 700. Karpat pense pouvoir doubler cette moyenne parce que « les agents du
Bureau de l’immigration n’étaient pas toujours très vigilants ou attentifs » ; il multiplie
alors les 1 400 annuels par les 34 ans qui séparent 1878 de 1912, et conclut donc qu’il n’y
a pas eu plus de 80 à 100 000 immigrés bosno-herzégoviniens dans l’Empire durant la
période austro-hongroise. Une telle méthodologie semble un peu superficielle. Karpat
suppose trop de choses : 1) la continuité et l’homogénéité du processus dans le temps ;
2) la validité du facteur 2 pour corriger les erreurs du Bureau de l’immigration ; 3) ses
calculs ne sont pas solides, puisque 1 400 x 34 = 47 600, un chiffre bien éloigné des 80 à
100 000 qu’il croit trouver. Je retire de ce simple examen que les statistiques ottomanes
sont peut-être exactes pour les immigrés arrivés à Istanbul, mais qu’elles n’ont en
aucun cas vocation à être généralisées. D’autres chiffres laissent à penser que les
responsables administratifs de la ville n’avaient guère d’idée sur la question et
n’hésitaient pas à gonfler une réalité insaisissable depuis le Bosphore 13.
26 Outre ces problèmes de méthodologie, l’identité des migrants est problématique. Qui se
déclare Bosniaque ? Quelle est la Bosnie-Herzégovine mentale de ceux qui disent en
venir ? Si l’on suit les mouvements de ceux qui se déclarent Bosniaques, on risque fort
de s’intéresser à des populations qui ne sont pas toutes de Bosnie-Herzégovine : après
1878, beaucoup de musulmans parlant serbo-croate se déclaraient Bosniaques (Bošnjak)
quoiqu’ils n’habitassent plus la Bosnie, mais vinssent du Sandjak de Novi Pazar, de
Serbie, du Monténégro, voire du Kosovo. Surtout, l’émigration, si elle ne tournait pas à
l’errance, ne se faisait pas souvent en un seul temps : la première installation n’était
qu’une étape vers des destinations plus orientales ou, dans des cas assez nombreux, un
exil temporaire avant le retour dans la province. Il en résulte que l’on peut
difficilement additionner les chiffres de sources étalées dans le temps et le lieu de
provenance. Par exemple, si l’on additionne 40 émigrés, dénombrés au Kosovo en 1891,
à 30 émigrés dénombrés à Istanbul en 1892, est-on sûr qu’on n’y compte pas les mêmes
personnes ?
Étude de cas sur les décomptes à l’intérieur de l’empire ottoman
27 Prenons quelques exemples. Le premier illustre l’impossibilité de quantifier les
migrations à partir de la destination, car celle-ci n’est pas stable. Le 14 octobre 1883,
l’un des commandants austro-hongrois de Pljevlje a signé un rapport très détaillé sur
les muhacirs de Bosnie-Herzégovine dans le vilayet de Kosovo. La plupart d’entre eux
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
46
détient un certificat d’émigration ou un passeport daté de 1881 ou 1882. Dans le sandjak
de Pljevlje, 135 familles viennent de Bosnie orientale (districts de Foča, Čajniće et
Rogatica). Dans le sandjak de Novi Pazar, 175 familles (et non 136, comme indiqué par le
total du document) ont quitté l’Herzégovine et, pour une cinquantaine d’entre elles se
sont installées à Nova Varoš, la région de Tuzla. On trouve également 43 familles à
Skoplje, soit, au total, un peu plus de 350 familles comprenant environ 1 600 personnes.
Resteront-elles ici ? On n’en sait rien, mais le commandant indique que le Kosovo est
une région de transition vers Istanbul ou l’Anatolie ; il note ainsi qu’en été 1883 passent
par Pljevlje dix familles de Possavine avec l’intention de s’installer en Anatolie 14.
28 Un autre exemple montre la difficulté de suivre les émigrés s’ils se déplacent au bout
d’une génération. Des émigrés bosniaques, notamment, ont pu s’albaniser dans un
premier lieu et repartir ensuite en tant qu’Albanais, et non plus Bosniaques ; ou bien
rester en tant qu’Albanais ; ou bien encore, être albanisés par les agents recenseurs ou
les fonctionnaires. Ainsi, après 1878, des muhacirs du Monténégro et de l’Herzégovine
fondent, au Kosovo, le village de Donji Mazgit ; des albanophones, eux, celui de Mazgit
et d’autres. En 1913, à la suite des guerres balkaniques, l’énorme majorité de ces
Monténégrins et Herzégoviniens, accompagnés de quelques albanophones, émigrent à
Mala Azizija. Dans les mois qui suivent, le mouvement s’intensifie : les croate/
serbophones abandonnent massivement la région pour la partie encore européenne de
l’empire, ou pour l’Anatolie, tandis que les albanophones restent 15. Cependant, que
faut-il entendre par « albanophones » ? Les musulmans de Bosnie et d’Herzégovine qui
avaient émigré en Métohie (région de Prizren) après 1878 furent soumis à une brusque
nécessité d’assimilation dans l’environnement albanais qu’ils ont trouvé là. En
revanche, ceux qui allèrent au Kosovo, plus nombreux, résistèrent mieux à
l’assimilation grâce à des colonies mieux organisées, avec une place de marché centrale
comportant boutiques d’artisans et commerces de subsistance ; ou bien, lorsqu’ils
s’installèrent en ville, ils formèrent des mahale compacts. Moins impliqués en général
dans l’agriculture que leurs compatriotes émigrés en Métohie, davantage soudés, ils
conservèrent plus longtemps leur identité d’origine16.
Chiffres austro-hongrois : à la source du processus
29 Se détourner des sources ottomanes ne relève donc pas d’une méfiance a priori, mais se
justifie par des problèmes méthodologiques très importants, dûs au fait que l’on se
trouve à la fin du mouvement migratoire. Les décomptes à la source ne sont pas
exempts d’incertitudes, mais leur marge d’erreur est bien plus restreinte, surtout que
l’on peut au contraire faire confiance au sérieux avec lequel les Austro-hongrois
surveillaient les frontières bosno-herzégoviniennes avec la Serbie et l’Empire ottoman.
Si l’on suit les chiffres officiels et la littérature locale de l’époque, l’émigration des
musulmans bosno-herzégoviniens se déroula pour l’essentiel en trois vagues : l’une en
1881-1882, à cause de la mise en place de la conscription universelle sous le drapeau
austro-hongrois ; la suivante autour de 1900-1901, lorsque le mouvement musulman de
contestation battait son plein, et dont le principal mobile était l’aversion du
christianisme ; enfin, en 1909-1910, une émigration massive fut observée à la suite de
l’Annexion (1908), car les musulmans n’espéraient plus que la Bosnie-Herzégovine
retournât dans le giron de l’Empire ottoman.
30 L’administration austro-hongroise n’a publié les chiffres détaillés de cette émigration
qu’à partir de 1900 ; avant cette date, on doit se contenter de chiffres globaux et
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
47
approximatifs, bien que les départs (légaux comme illégaux) aient été
systématiquement enregistrés à partir de 188317. Cependant, un document d’archives
prouve que les Austro-hongrois disposaient de statistiques détaillées ; dans une lettre
du 25 avril 1901, Kállay décrit ainsi la courbe des émigrants de 1883 à 1900 :
31 — le gros de l’émigration a eu lieu entre 1883 et 1885, avec un sommet à 2 561
personnes ;
32 — on connaît des mouvements notables en 1888, 1891 ;
33 — de 1893 à 1898 inclus, c’est le calme ;
34 — en 1899, la courbe remonte, mais sans la force des années migratoires précédentes ;
35 — en 1900, le nombre d’émigrés connaît un regain qui surpasse même ce que l’on avait
auparavant (plus de dix fois la moyenne des années précédentes).
36 Ces chiffres étaient connus, semble-t-il, district par district, car Kállay analysa le détail
de Sarajevo18. Pour moi, je n’ai pu établir que ce tableau (tab. 6) :
Tableau 6. Mouvement migratoire des musulmans bosno-herzégoviniens hors de leur province
(1883-1914).
Source : Philippe Gelez, Atlas statistique, p. 111.
37 On dispose de chiffres intermédiaires qui ne divergent qu’infinitésimalement avec ce
tableau. D’autre part, les résultats des recensements de 1895 et 1910 furent mis en
regard des chiffres de l’accroissement naturel sur la période intercensitaire, ce qui
permit de dégager le solde migratoire confession par confession (tableau 7).
Accroissement naturel Accroissement factuel Migration
Abs. % Abs. % Abs. %
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
48
Serbo-orthodoxes 144 407 21,45 152 172 22,60 7 765 1,15
Musulmans 73 694 13,43 63 505 11,58 - 10 189 - 1,86
Rimo-catholiques 85 339 25,54 99 919 29,90 14 580 4,36
Juifs sépharades 2 598 45,35 2 490 43,46 - 108 - 1,89
Autres juifs 877 35,31 1 165 46,90 288 11,59
Protestants 1 529 42,52 2 746 76,36 1 217 33,84
Autres 914 347,53 7 955 3 024,71 7 041 2 677,19
Total 309 358 19,73 329 952 21,04 20 594 1,31
Tableau 7. Solde migratoire de la Bosnie-Herzégovine en 1910
Source : Philippe Gelez, Atlas statistique, p. 47
Le recadrage des historiens à partir des chiffres austro-hongrois
38 Ces totaux, qui donnent une moyenne annuelle un peu au-dessus de 2 000, sont
habituellement augmentés de 60 à 80.000 âmes par les historiens démographes. Selon
eux, en effet, l’Administration austro-hongroise n’aurait compté que les départs légaux
(avec passeports) ; or, font-ils remarquer, les départs illégaux furent très nombreux
puisque la principale population migrante, au moins jusque vers 1900, étaient les
jeunes conscrits déserteurs19. Mais on ne se méfiera pas trop : à partir de 1900, les
chiffres de l’émigration musulmane comptabilisent aussi les départs illégaux, et l’on n’a
pas de raison solide de penser que les autorités en minimalisent le nombre, puisqu’ils
l’explicitent. D’autre part, les chiffres de l’émigration pour 1878-1900 ne sauraient être
trop renforcés, car la courbe d’accroissement démographique des musulmans
deviendrait tout à fait incompréhensible et contredirait la basse natalité de la
communauté, qui est un fait avéré depuis 1870 au moins. Enfin, je ferai remarquer que
les célibataires émigrent rarement de façon irrévocable et que le gros des émigrations
définitives repose sur des familles qui, elles, ne peuvent pas facilement passer en des
points non surveillés de la frontière.
39 Ainsi les historiens démographes donnent, pour l’ensemble de la période, un total de
120 à 140 000 musulmans partis, ce qui me paraît exagéré ; il ressemble à l’estimation
donnée par le journal Srpska Riječ (La Parole serbe) de Sarajevo en octobre 1912 20, qui
avait alors tout intérêt à hypertrophier les chiffres. S’il faut réajuster le total des
émigrés, en comptabilisant les retours, le chiffre de 65 000 me semble plus proche de la
vérité.
40 Cette perte démographique s’étale sur la période 1878-1914, soit 36 ans. Sa traduction
en pourcentages pose un certain nombre de difficultés. Il faudrait tout d’abord la
pondérer avec l’accroissement naturel (AN), ce qui est difficile sachant qu’on ne dispose
de AN que pour quelques années. En posant de façon assez arbitraire que AN = env.
5 000 âmes pour la communauté musulmane en moyenne sur la période, on aurait donc
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
49
la formule suivante : 65 000 / (5 000 x 36 + moyenne (pop. 1878-1915)) = env. 8 %.
Cependant, il faudrait encore pondérer ce nouveau chiffre par le fait que
l’accroissement naturel a été retardé par l’émigration elle-même. En effet, on y compte
un certain nombre d’hommes célibataires en âge de procréer. Il y a eu un cercle
d’entraînement vicieux qui a fait que plus on immigrait, moins on s’accroissait
naturellement.
41 Avec toutes ces approximations, on avancera prudemment que 6 à 7 % de la population
musulmane a quitté la Bosnie-Herzégovine sur une période de 36 ans ; en termes
démographiques, ce n’est pas négligeable, mais pas alarmant non plus.
42 Les administrations de Sarajevo et Vienne se méfiaient grandement des départs, quelle
que soit la communauté concernée ; de même qu’elle s’inquiéta des musulmans, de loin
les plus nombreux à partir, l’administration austro-hongroise se pencha avec
sollicitude sur le cas de l’émigration herzégovinienne en Amérique, essentiellement
orthodoxe, et énonça un certain nombre de principes destinés à l’endiguer.
Remarquable par son conservatisme, cette politique démographique et confessionnelle
eut recours à de nombreux moyens limitatifs. La première méthode reposa sur
l’influence des chefs traditionnels, à laquelle les Ottomans recouraient eux aussi 21.
Simultanément, on avait recours à la loi et à l’amende : pour endiguer le mouvement,
l’administration avait émis une ordonnance le 11 octobre 1883 afin de restreindre
l’émission de passeports, ce qui n’avait été efficace que dans une certaine mesure car la
plupart des émigrés étaient en réalité de jeunes hommes déserteurs, qui s’en allaient de
façon illégale22.
Causes
43 La coïncidence des trois vagues d’émigration avec des événements sociaux ou
politiques a longtemps poussé à négliger d’autres causes possibles : 1884 et la loi de
conscription ; 1900 et les débuts de la contestation politico-religieuse dans la
communauté bosno-musulmane ; 1909, à la suite de l’annexion. Mais à partir des
années 1970, on a au contraire donné la priorité aux explications s’appuyant sur le long
terme économique (appauvrissement, surpopulation agricole, etc.). De fait, on a là une
convergence de facteurs, dont aucun n’est suffisant à lui seul.
Le point de vue des Austro-hongrois
44 Les causes de l’émigration ont fait l’objet de discussions parmi les administratifs
austro-hongrois dès 1901. L’administration territoriale, et en particulier le chargé des
affaires civiles, Hugo Kutschera (1847-1909), pensaient qu’au-delà de l’agitation
politico-religieuse née en 1899, la principale raison de l’émigration reposait sur le
passage d’une économie de subsistance à une économie de marché 23. Kállay repoussa
cette explication, préférant l’argument religieux. Selon lui, les pics d’émigration ne
correspondaient pas aux conséquences d’événements économiques : ainsi la mauvaise
récolte de 1897, que n’avait pas rééquilibrée celle de l’année suivante, n’avait engendré
aucune émigration ; la modeste activité industrielle qui avait pris son essor n’avait eu
aucun effet non plus sur le phénomène. Le commissaire gouvernemental pour la ville
de Sarajevo avait eu beau remarquer, en 1899, que c’étaient surtout des artisans qui
quittaient la capitale : cela n’expliquait aucunement les variations du mouvement dans
le temps, ni l’explosion de 190024.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
50
Le débat historiographique actuel
45 Dès cette époque, les avis se partageaient entre cause matérielle et cause mentale ou
religieuse. Toute la suite des historiens balance entre ces deux pôles. Grosso modo, les
historiens nationalistes préfèrent l’explication religieuse ou mentale ; les historiens
marxisants, l’explication économique. À notre époque, cette dernière est donc le plus
sérieusement étayée, même par des penseurs que l’on ne pourrait pas qualifier de
marxistes. Ainsi Dževad Juzbašić (1929-) –, à la suite de Kutschera, a cherché à établir
les causes des départs grâce à la sociologie des migrants. Sa réflexion se base sur la
ventilation socioprofessionnelle des émigrés de 1910, soit 17 191 personnes au total
dont 17 044 musulmans (99,14 %)25. Presque 3 émigrés sur 4 sont des paysans « libres »,
et un peu moins d’un sur 7 est ouvrier agricole. Un nombre insignifiant est métayer ou
propriétaire. Or, fait remarquer Juzbašić, la classe des paysans « libres » est très
appauvrie en 1910, en particulier dans sa partie musulmane, comme le prouve le fait
qu’on y compte le plus de sans-terre : 9 226 familles musulmanes, 6 266 orthodoxes,
4 189 catholiques et 769 « autres ». Plus généralement même, les sans-terres sont les
plus nombreux dans la communauté musulmane (8,73 %). L’administration territoriale
elle-même s’accordait à dire que dans les années précédant 1910, les musulmans
s’étaient prolétarisés, ce qui influa sur leur émigration après 1908. Ainsi les
observateurs administratifs de Krajina et d’Herzégovine, les principaux foyers
d’émigration, mettaient en avant que les migrants se recrutaient parmi les plus pauvres
et que les propriétaires terriens n’émigraient que très peu26.
46 Dans ce contexte, Juzbašić pense avec l’Administration Territoriale que les lettres
prometteuses de ceux qui avaient déjà émigré jouèrent un rôle important parmi ces
miséreux. On retrouve exactement les mêmes phénomènes que pour les orthodoxes
d’Herzégovine orientale en Serbie, 6 ou 7 ans auparavant : il circulait des bruits selon
lesquels la Porte distribuait gratuitement quatre ou cinq dönüms (un demi-hectare) aux
muhacirs (immigrés musulmans dans l’Empire ottoman), ainsi qu’une paire de bœufs. La
population croyait également que bientôt serait introduite en Bosnie-Herzégovine
l’école élémentaire obligatoire et que trois ans après l’annexion (octobre 1908), toute
émigration serait définitivement interdite. Juzbašić introduit ensuite des finesses de
réflexion : des causes plus locales, mais qui eurent un retentissement dans l’ensemble
de la province, jouèrent encore. Ainsi de l’installation de non-musulmans dans des
localités majoritairement ou uniquement musulmanes ; des mauvais rapports
interconfessionnels, comme à Nevesinje où les orthodoxes avaient obtenu la majorité
des sièges au conseil municipal et où les politiques musulmans restaient désunis ; ou
encore, de l’utilisation des pâtures et forêts dans le district de Gacko ; de la désertion ;
enfin, de la question agraire qui, pensait-on, allait se régler en défaveur des
propriétaires27.
47 En bref, Juzbašić se range à l’avis du vice-consul austro-hongrois à Skoplje qui, en
février 1910, observe que les émigrés de Bosnie-Herzégovine sont des fanatiques et des
ignorants, issus des plus basses couches de la population 28.
Nouvelle proposition sur les motivations de l’exil
48 Le fait est que cette analyse tient en un précaire équilibre. En effet, les paysans dits
« libres » ne sont pas tous musulmans, loin s’en faut ; et pourtant, presqu’aucun paysan
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
51
« libre » chrétien ne part. Il ne semble donc pas que la cause économique soit première
ici. Il faut plutôt voir que le facteur psycho-religieux est indissociablement lié aux
considérations économiques : il a agi comme un puissant levier sur l’indéniable
pauvreté de ceux qui se décidèrent à partir. D’un point de vue psychologique, les
émigrés représentent la maigre part de population qui n’a pas su se plier jusqu’au bout
à l’effort d’adaptation nécessaire ; d’un point de vue religieux, ils pensent que la vie
dans un pays chrétien est contraire à la loi divine ; d’un point de vue social, ce sont le
plus souvent des déshérités. Il est frappant de ne pas lire plus souvent que l’un des plus
puissants dilemmes des musulmans de cette époque fut de savoir s’ils avaient la
permission de vivre sous un sceptre non-musulman, et que les réponses positives
données par les oulémas modernistes ne furent jamais bien accueillies par la
population29.
49 Je préfère ainsi partager les causes de l’émigration entre des variables sociales et un
dénominateur commun : la religion, qui motive la destination ottomane. Ce cadre
souffre une seule exception : le départ des fonctionnaires ottomans en 1878, pour qui la
Bosnie était seulement une affectation de service ; aucune religion n’entre ici en
compte et la nécessité du retour au domicile familial et administratif explique tout.
Autrement, l’Empire ottoman est un choix, souvent dicté par une religion vécue jusque-
là comme une position privilégiée et dominante. Le premier vrai moment d’émigration
prend naissance en 1882-1884, au moment de l’introduction du service militaire. On
estime que 8 000 personnes quittèrent la Bosnie-Herzégovine30. Le principal motif de
désertion est le refus de servir dans l’armée d’une puissance chrétienne. Certains
fuirent sans papiers, d’autres en obtinrent de faux. On sait ainsi que les musulmans qui
voulaient se rendre en Amérique obtenaient facilement des passeports falsifiés de la
part du consulat ottoman de Dubrovnik31, qui avait des activités peu claires de ce point
de vue.
50 Quelques documents austro-hongrois datant de 1902 apportent un éclairage cru sur la
réalité de l’exil et la nécessité du retour32. Cette année-là, on observa un mouvement de
retour assez important (1 031 personnes : 713 immigrés légaux et 318 déserteurs) et
l’administration territoriale organisa des auditions pour en connaître les raisons ; un
choix parmi 296 exemplaires conservés de ces documents a été publié sous forme de
résumés33. Les rapports d’interrogatoires comportaient des questions préformulées
dont le but visible était de retracer l’itinéraire des muhacirs bosniaques. On peut
distinguer deux grands types de parcours, celui des célibataires et celui des ménages.
51 Les célibataires ne recevaient ni maison ni terre, mais seulement une minuscule aide
financière pour un an. Comme aucun ne savait le turc, qu’ils étaient pour la plupart
illettrés et sans qualifications, leur existence après cette première année s’avérait plus
que difficile. Ils trouvaient à s’employer, le plus souvent, chez des Bosniaques immigrés
de plus longue date et qui avaient réussi à s’installer. En milieu urbain (à Ankara, par
exemple), ils bénéficièrent parfois d’un gîte gratuit dans un medrese. Quant aux
ménages, ils obtenaient terre, toit et subsides – parfois les trois, parfois la maison ou les
subsides seulement. Mais les terres étaient mauvaises, les maisons petites et malsaines
et les sommes d’argent reçues ou gagnées, très modestes voire misérables.
52 Aucun des muhacirs ne déclara qu’il avait quitté la Bosnie-Herzégovine à la suite de
vexations. Pour la plupart, l’espoir de trouver une vie meilleure (bonluk) avait été la
principale raison ; pour les jeunes hommes (la plus grande partie des auditionnés) avait
en premier lieu compté la désertion. Beaucoup d’entre eux n’avaient à l’origine pas de
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
52
biens. On disait qu’en « Turquie », la vie était facile et peu chère, et que le sultan
donnait gratuitement à chaque muhacir un toit et une maison ; du moins, qu’on pouvait
gagner de jolies sommes. Un rêve américain, en quelque sorte.
53 Certains partirent d’eux-mêmes ou bien à l’appel d’un parent déjà installé dans
l’empire, d’autres persuadés par des voisins qui eux-mêmes partaient ou prévoyaient
de partir, bernés par la propagande ; les derniers fuyant une situation familiale
orageuse. Partis seuls ou en groupe de deux ou trois, curieux de voir ce qui se passait
dans l’empire, ils se rendaient en général à Skoplje, où on les faisait attendre, pour les
convoyer à Salonique, qu’ils atteignent pour un certain nombre (non précisé). Puis ils
embarquaient pour l’Anatolie centrale, où le gouvernement ottoman les envoyait là où
il l’avait décidé. Dès Skoplje, ils recevaient un peu d’argent chaque jour.
54 On ne connaît pas la proportion de ceux qui s’installèrent en Anatolie, ni leur part
relative à l’ensemble des émigrés. En Turquie proprement dite, ils s’installèrent d’abord
au Nord-Ouest de l’Anatolie, dans la région de Marmara et des bassins de la Sakarya.
Particulièrement nombreux dans la région de Bursa, ils formaient quelquefois de gros
villages qu’ils appelèrent « Bosna Köy ». Mais on les rencontrait aussi à İnegöl, Kütahya,
Karamürsel, Ankara et Adana ; à Eskişehir et ses environs, et dans l’hintelrand
smyrniote. Ils manifestaient leur solidarité en se regroupant souvent à l’intérieur de
petites régions, dans quelques villages34.
55 Mais tous ne parvinrent pas à s’installer. Laissé à l’état misérable qu’il avait vainement
tenté de fuir, un certain nombre rentra à pied en mendiant sa nourriture ou en
travaillant de-ci de-là pour payer son voyage. Dans leur errance, quelques-uns
s’adressèrent à un moment ou à un autre aux services consulaires austro-hongrois – à
Constantinople, Smyrne, Skoplje, Niš ou Belgrade, et en reçurent quelques florins afin
d’assurer leur rapatriement par train. Une fois rentrés, ils jugeaient qu’ils avaient été
mal reçus par les habitants de l’empire ; beaucoup se plaignaient du climat anatolien.
56 Pour quelques-uns d’entre eux, l’administration territoriale fit élever trois villages dans
le district de Prnjavor, qui accueillit ainsi non seulement des colons de la monarchie
mais aussi les fils prodigues de la province. La plupart de ceux qui furent auditionnés
était originaire de Krajina.
Attitude des Austro-hongrois
57 L’administration territoriale n’eut donc aucune attitude revancharde, trop soucieuse de
préserver son image auprès des musulmans restés dans la province, qui auraient jugé
scandaleux de ne pas accueillir les émigrés de retour. Le souci de ménager a caractérisé
l’attitude des Austro-hongrois envers les musulmans durant leur mandat.
Une politique de tolérance joséphienne
58 En été 1878, lors de leur arrivée en Bosnie-Herzégovine, les Austro-hongrois se
heurtèrent à la résistance armée des musulmans, aidés parfois des orthodoxes. Il n’y
eut aucune mesure répressive à l’encontre de la population. Seuls quelques chefs
rebelles furent exécutés ou condamnés à la prison, tandis que d’autres prirent le
chemin de l’exil à Constantinople. Les biens des musulmans, leurs coutumes et leur
religion furent garantis – promesse tenue non seulement par les hauts responsables
administratifs, qui traitent à égalité avec les musulmans, mais aussi par la majorité des
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
53
fonctionnaires de district. Certes, certains commirent des erreurs de jugement fondées
sur des a priori religieux, mais elles furent peu nombreuses et des membres des trois
principaux groupes confessionnels eurent à s’en plaindre. En revanche, la mentalité
générale de la province, en particulier parmi les élites, était à une certaine méfiance
vis-à-vis des étrangers, et tout faux pas était interprété comme une brimade. À ce titre,
la peur de la catholicisation, qui tournait par moments à la psychose collective, était
très répandue parmi les musulmans ; elle n’avait pourtant presque aucune réalité sur le
terrain. Les opposants au régime austro-hongrois en exagérèrent le pâle fantôme et
politisèrent la question selon un renversement de la dynamique d’émancipation des
chrétiens durant la fin de la période ottomane, qui s’était appuyée sur une politisation
des conversions à l’islam35. Si la peur de la catholicisation ne poussa pas directement à
l’émigration, elle entretint, avec d’autres éléments, un fonds de méfiance qui plaça la
solution de l’émigration au premier plan sur l’horizon d’attente des musulmans.
59 Les Austro-hongrois déployèrent pourtant d’importants efforts pour maintenir les
musulmans sur place et les protéger, au même titre que les autres, des malintentionnés.
Il est faux de dire qu’ils favorisèrent l’émigration musulmane et empêchèrent le retour
de ceux qui voulaient se réinstaller sur leurs terres, que les autorités auraient donné à
des colons36. Non seulement on n’en a aucune preuve, mais cela va dans le sens inverse
de leur politique générale. L’administration territoriale a plutôt contrarié la Porte, qui
mit en place des « commissions de muhacirs » au Kosovo afin de les y attirer et les y
installer dans les meilleures conditions possibles37. Ainsi l’une des inquiétudes de
l’administration territoriale fut de savoir à qui elle profitait. En 1901, Kállay remarqua
qu’un certain nombre de paysans libres musulmans étaient partis de villages où la
communauté islamique détenait la majorité ; il voulut savoir qui avait racheté ces
terres38. Il existait, en effet, des spéculateurs fonciers. C’est ainsi que les terres des
« Américains » (orthodoxes) de Nevesinje leur furent habilement soustraites par un
commerçant orthodoxe de Stolac, Pero Lalić39. Le chargé des affaires civiles, Hugo
Kutschera, ordonna donc, le 19 décembre 1901, à toutes les autorités de district de
mener sur ce problème une enquête rétroactive à compter de 1900, et prorogeable sur
les années à venir40 ; je n’en connais malheureusement pas les résultats. Peut-être
craignait-on que la propriété de ces terres passât entre les mains d’orthodoxes (parmi
les plus grosses fortunes provinciales) ; mais le danger des étrangers était
explicitement désigné aussi. En réalité, la peur prédominante est celle de bousculer de
l’extérieur l’équilibre et l’implantation territoriale des diverses confessions ; il faudrait
que tout se fasse avec le consentement de chacun.
Complications diplomatiques autour de la crise de l’annexion (1908)
60 De façon générale, l’histoire de l’administration austro-hongroise en Bosnie-
Herzégovine peut se décrire comme la construction des libertés légales des personnes,
définies par leur religion, face aux autres. Comme le dit Dževad Juzbašić, la thèse selon
laquelle l’émigration profitait à l’administration territoriale est insoutenable. Elle n’a
vu son intérêt que dans la préservation des rapports confessionnels, estimant qu’elle
pouvait en retirer des bénéfices politiques et humanitaires. C’est ce que montre la
politique ottomane durant les années qui ont suivi l’annexion (octobre 1908). Afin de se
gagner la confiance des cercles musulmans, le ministre commun des Finances d’alors,
István Burián (1851-1922), n’a pas hésité à faire quelques sacrifices financiers.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
54
61 En 1910, face à la troisième vague d’émigration – la plus spectaculaire – l’opinion en
Serbie réagit vivement. Prétendant que l’Autriche-Hongrie voulait installer des colons
sur les parcelles laissées par les émigrés, la propagande nationaliste serbe ajouta que
cela satisfaisait également les intérêts des Jeunes-Turcs pour leurs plans de
colonisation de la Macédoine. C’est ce qu’écrivirent Jovan Cvijić et toute la presse serbe
de l’époque ; ils en appelèrent aux Bosniaques de ne pas laisser la terre, et mirent
l’accent sur le facteur psychologique de l’émigration.
62 Pourtant, Burián souligna dans sa correspondance administrative que cette émigration
était dangereuse en ce qu’elle bouleversait l’équilibre des confessions 41. Fin février
1910, l’administration territoriale refusa aux autorités du cercle de Banja Luka de
racheter les parcelles des émigrés, considérant qu’elle alimenterait de cette manière le
courant d’émigration s’exposerait aux reproches de chasser l’islam. D’un autre côté, on
ne pouvait pas empêcher l’hémorragie sous peine de susciter les plaintes de ceux qui
voulaient partir. Le point de vue des administrateurs était qu’il fallait garder dans la
province les musulmans qui croyaient en l’avenir, non pas dans une perspective
communautaire, mais en s’engageant à collaborer avec les autres pour le bien de la
commune patrie. C’est pour cette même raison que Burián, opposé à toute
germanisation ou magyarisation de la Bosnie, refusa aux colons les deux mandats
parlementaires qu’ils réclamaient à la Diète. Il considérait qu’il fallait les abandonner
au processus d’assimilation auquel ils étaient déjà bien exposés en milieu urbain, car
cela concourait à leur propre bien42.
63 Burián se fit donc l’avocat de la cause bosno-musulmane. Il demanda à Aerenthal
(1854-1912) de représenter à la Porte qu’elle ne trouvait pas son intérêt à favoriser à
l’immigration depuis la Bosnie-Herzégovine43. En effet, parmi les Jeunes-Turcs,
quelques-uns menaient une politique démographique active. Nazim Bey (1870-1926)
avait fait son cheval de bataille de l’installation des muhacirs. En novembre 1910, la
convention annuelle des Jeunes-Turcs convint qu’il fallait encourager l’immigration
dans l’empire, particulièrement celle des musulmans de Bosnie-Herzégovine, afin
d’être installés le long des voies de chemin de fer44. Nazim Bey lui-même était persuadé
que l’émigration des musulmans de Bosnie-Herzégovine allait dans le sens des intérêts
des Austro-hongrois45. Par la suite (en 1913), les Jeunes-Turcs enverraient les muhacirs
bosniaques en Anatolie orientale, là où, pensaient-ils, ces musulmans balkaniques
oublieraient le plus facilement leur langue, leurs traditions et leur culture nationale ;
cette politique de relocalisation ne fut cependant pas strictement appliquée 46.
64 Les nombreux émigrés de Bosnie-Herzégovine, en particulier ceux de la région de
Salonique, vivaient dans la misère. Faim, soif, misère, absence de travail, dysenterie,
nombreux furent ceux qui périrent. Les politiques bosno-musulmans l’apprirent et
demandèrent à Burián d’autoriser les retours de ceux qui le voulaient mais en étaient
empêchés par les autorités ottomanes. Burián relaya la requête à Aerenthal dès la fin
1910 et en 1911, se parant de raisons humanitaires. Selon lui, ces émigrés, une fois
rentrés dans leur patrie, auraient des conditions de vie plus décentes. Outre, très
certainement, une réelle commisération, Burián cherchait à gagner les faveurs des
politiques bosno-musulmans. Il se heurta néanmoins à Aerenthal aussi bien qu’à
l’administration territoriale. Le ministre des Affaires étrangères émit des réserves : en
vertu de l’alinéa 2 de l’article 3 du protocole austro-turc du 26.II.1909, ceux qui
franchissaient la frontière ottomane avec passeport étaient reconnus comme citoyens
ottomans, au contraire de ceux qui émigraient illégalement, considérés toujours
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
55
comme ressortissants bosno-herzégoviniens. D’autre part, l’administration territoriale
craignait que les retournés ne soient une charge supplémentaire pour le budget
territorial47.
65 Burián, cependant, insista auprès d’Aerenthal et on engagea des pourparlers avec la
Porte. Comme lors des négociations autour de l’Annexion, les Ottomans mirent en
avant leurs intérêts financiers et économiques : ils avaient déjà distribué des aides
importantes aux émigrés. Ils déclarèrent donc qu’ils ne feraient pas d’obstacles dans la
mesure où les émigrés rembourseraient les sommes qu’on leur avait données 48. Les
retours ne furent pas aussi nombreux qu’escomptés.
66 La Première Guerre balkanique allait les précipiter. À la fin de 1912, soumis par les
armées alliées à de nombreuses maltraitances, l’avenir de ces muhacirs s’annonçait plus
incertain encore dans le cadre des États balkaniques. Ces mesures vexatoires étaient en
partie provoquées par le fait que sur le front, on trouvait du côté ottoman, dans les
régiments de Bachibouzouks bosniaques, environ 20 000 soldats émigrés, ou fils
d’émigrés de Bosnie-Herzégovine – auxquels s’était joint un petit groupe de volontaires
de Bosnie-Herzégovine, peut-être 500 au total ; ces volontaires semblent s’être partagés
entre musulmans bosno-herzégoviniens enthousiastes, d’une part, et d’autre part sujets
ottomans d’Albanie qui se trouvaient à cette époque en Bosnie-Herzégovine et étaient
soumis à la conscription ottomane49.
67 Les très nombreuses familles bosno-musulmanes qui habitaient les vilayetsde Skoplje,
Salonique, Bitola, ou encore le sandjak de Novi Pazar, furent ainsi privées de leurs biens
ou prirent peur devant l’avance des armées victorieuses. Ne pouvant rien espérer du
côté ottoman, ils se souvinrent que l’Autriche-Hongrie leur avait ménagé en Bosnie-
Herzégovine, sinon une vie confortable, du moins la sécurité de la vie. Ils adressèrent
donc des demandes de retour aux autorités consulaires de la monarchie 50.
68 Devant la fuite massive des districts de Petrič, Melnik, Serez, Strumica et Katerina, les
Austro-hongrois estimèrent à environ 50 000 le nombre de candidats au retour, et
certains leaders politiques musulmans de la province affirmèrent qu'on en comptait
environ 100 000 [sic]. Leur rapatriement commença dans la seconde moitié de
novembre 1912 et dura intensivement jusqu’à la mi-mars 1913, lorsque furent appliqués
les critères de retour adoptés par l’administration territoriale : ne seraient acceptés
que ceux dont les moyens permettraient de subvenir à leurs besoins (en l’occurrence,
pas grand’ monde).
69 Durant ces quatre mois, 5 000 personnes environ bénéficièrent d’un retour par voie de
mer – on avait interdit les autres moyens de transport. Embarqués à Salonique, les
fuyards étaient accueillis à Trieste où ils devaient se soumettre à une quarantaine
sévère car le choléra venait d’apparaître à Istanbul. Puis ils étaient acheminés par
chemin de fer jusqu’en Bosnie. Cependant, le passage interdit de Novi Pazar fut une
voie d’entrée pour environ 1 000 personnes, malgré l’hiver.
70 Ce furent en tout 1 500 familles environ – 6 000 personnes qui revinrent s’installer dans
leurs districts d’origine, soit la Krajina dans la plupart des cas (Bihać, Cazin, Ključ,
Prijedor, Gradiška et Prnjavor). Un certain nombre de muhacirs avaient abandonné
l’idée de leur retour, persuadés à Salonique par des agents du Croissant rouge égyptien
et par les autorités ottomanes d’aller s’installer en Anatolie. À la mi-janvier, 1 200
personnes avaient ainsi renoncé à la Bosnie et étaient parties vers l’Anatolie ou le
Proche-Orient51.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
56
71 La presse donne quelques autres chiffres, à manier avec plus de prudence. Le 30 octobre
1912, Srpska Riječ (La Parole serbe) de Sarajevo rapporte ainsi que 60 000 immigrés
musulmans en Macédoine aimeraient revenir, et qu’à la fin de ce mois d’octobre, 1 600
déserteurs ottomans avaient trouvé refuge dans la province annexée. Le 18 mars 1913,
c’est Narod (Le Peuple) de Sarajevo qui estime à 4 000 environ, dont 1 600 enfants, le
nombre d’émigrés revenus en Bosnie-Herzégovine à l’occasion des guerres
balkaniques52.
Conclusion
72 L’émigration des musulmans entre 1878 et 1914 relève d’un réflexe religieux.
Conditionnée par de nombreux facteurs socio-économiques, elle a représenté un choix
des élites de la communauté qui ont entraîné à leur suite une population privée de
repères. Il n’y avait aucune raison de craindre l’administration austro-hongroise, ni
même les autorités ecclésiastiques catholiques : aucune brimade sérieuse, aucune
conversion forcée ne sont enregistrées53.
73 On sort ainsi de considérations morales, sur une histoire qui essaierait de peser la faute
des uns et des autres. Il n’y a pas de reproches à émettre, pas de faute à trouver. Or,
l’émigration bosno-musulmane avait donné lieu dès 1910 à un tel discours judiciaire
sous la plume de l’anthropogéographe Jovan Cvijić (1865-1927). Dans un article paru
cette année-là, il proposait une gradation des migrations en général qui pourrait
prendre en compte ce phénomène particulier. Il pensait trouver des causes
économiques à la racine des émigrations traditionnelles ; à l’opposé, ce mouvement des
musulmans bosno-herzégoviniens n’aurait eu de causes que civilisationnelles. La
caractéristique en aurait été le refus de la modernité et de la soumission à un pouvoir
chrétien, voire l’incapacité à s’y adapter. D’un côté, la nécessité ; de l’autre, le choix.
Cvijić allait plus loin : il soupçonnait l’administration territoriale de Sarajevo de
soutenir cette émigration, ou même de l’avoir programmée à partir de 1908 avec les
encouragements des Jeunes-Turcs. On était en présence d’une ingénierie
démographique sournoise et anti-yougoslave54.
74 C’est dans le même cadre analytique qu’il faudrait procéder à l’analyse de l’immigration
austro-hongroise en Bosnie-Herzégovine durant la même période : elle a fait l’objet de
débats et de polémiques presque aussi fortes que l’émigration musulmane. On accusait
cette fois-ci les Austro-hongrois de vouloir convertir au catholicisme les musulmans et
orthodoxes locaux, ou encore de catholiciser la province. Un nouveau tour de passe-
passe rhétorique pour simplifier une réalité beaucoup plus complexe.
NOTES
1. Philippe Gelez, Atlas statistique de la Bosnie-Herzégovine au XIXe siècle. Mémoire sur la démographie,
accompagné d’un atlas, 2009, mémoire de troisième année de l’EfA déposé à Athènes, pp. 9-65 ;
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
57
Philippe Gelez, « Les méthodes de recensement en Bosnie-Herzégovine durant le 19 e siècle », in
Balkanologie, 12/2, à paraître.
2. Hamdija Kapidžić (éd.), Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine u XIX vijeku, Sarajevo, Naučno
društvo NR BiH, 1956, pp. 34-35.
3. Ministère des Affaires étrangères [MAE], Correspondance commerciale et consulaire [CCC]
Sarajevo, vol. 1, 31.III.1865.
4. Donald Quataert, « The Age of Reforms, 1812-1914. Population », in Halil Inalcik & Donald
Quataert (éds), An Economic and Social History of the Ottoman Empire. Volume Two :
1600-1914,Cambridge Universeity Press, 1994, p. 788 ; Dušanka Bojanić-Lukač & Tatjana Katić (éds),
Maglajski sidžili 1816-1840., Sarajevo, Bošnjački institut, 2005, p. 59 ; Muhamed Hadžijahić,
« Šerijatsko-pravne ustanove o umjetnom pobačaju i njihova primjena u islamskoj državi »,
Mjesečnik pravničkog društva u Zagrebu 66 (1940), 8, [pagination perdue].
5. « Discussion III », in Markus Koller & Kemal H. Karpat (éds), Ottoman Bosnia. A History in Peril,
Madison, The University of Wisconsin Press, 2004, p. 155.
6. Élisée Reclus, Nouvelle géographie universelle. La terre et les hommes. III : l’Europe centrale (Suisse,
Austro-Hongrie, Allemagne), Paris, Hachette et Cie, 1884, p. 267bis (t. I, p. 204 dans l’édition de 1872).
À ce propos, voir Georges Castellan, « Peuples et nations des Balkans à la veille du Congrès de
Berlin (1878) d’après Élisée Reclus », in Revue des Études sud-est européennes, 15 (1977), 2, pp.
279-293.
7. Ahmet S. Aličić, Uređenje bosanskog ejaleta od 1789. do 1878. godine, Sarajevo, Orijentalni institut,
1983, p. 69.
8. Louis Olivier, « La science, les services scientifiques et les œuvres intellectuelles en Bosnie-
Herzégovine », in L. Olivier(éd.), La Bosnie et l’Herzégovine, Paris, Armand Colin/Revue générale des
sciences pures et appliquées, [1901], pp. 164, 168 et 170.
9. Éric Brian & Marie Jaisson, Le Sexisme de la première heure. Hasard et sociologie, Paris, Raisons d’agir éditions,
2007.
10. La situation était comparable chez les catholiques de Slavonie au XVIII e siècle, cf. Robert Skenderović,
« Zdrastvene reforme Marije Terezije u slavonskom Provincijalu i Generale normativum sanitatis iz 1770. »,
Scrinia slavonica 5 (2005), pp. 121-122.
11. J’écarte tout de suite de la bibliographie valable l’article de Vojislav Bogićević, « Emigracije muslimana
Bosne i Hercegovine u Tursku u doba austro-ugarske vladavine 1878.-1918. god. (Izvod iz opsežnijega rada :
Emigracije stanovništva Bosne i Hercegovine u doba austro-ugarske vladavine 1878.-1918.) », Historijski
zbornik 13 (1960), pp. 175-188. Le court commentaire à cet article qu’a rédigé Muhamed Hadžijahić, qui n’a
pu lui être arraché que sous la contrainte, n’est valable qu’en ce qu’il donne un aperçu bibliographique
intéressant (« Uz prilog Prof. Vojislava Bogićevića », ibid., pp. 189-192).
12. Kemal H. Karpat, « The Migration of the Bosnian Muslims to the Ottoman State, 1878-1914 : An Account
Based on Turkish Sources », in Markus Koller & Kemal H. Karpat (éds), Ottoman Bosnia. A History in Peril,
Madison, The University of Wisconsin Press, 2004, pp. 121-140.
13. Mustafa Imamović, Historija Bošnjaka, Sarajevo, Preporod, 1997, p. 371. Une source parle de
72 000 musulmans émigrés de Bosnie entre 1900 et 1905 ; les chiffres austro-hongrois n’en
décomptent que 13 750 sur cette période, alors même que l’administration territoriale redoublait
d’attention sur ce sujet.
14. Ferdinand Schmid, Bosnien und die Herzegowina unter der Verwaltung Österreich-Ungarns ,
Leipzig, Veit, 1914, pp. 249-252 ; Мита Костић, « Преглед босанско-херцеговачких
мухаџира и њихових првака по косовском вилајету 1883 године », Istoriski časopis, 1
(1948), 1-2, pp. 252-253.
15. Branko Bošković, « Naseljenici na Kosovu i Metohiji (1918-1941) i njihov progon (1941-1944),
s posebnim osvrtom na bosansko-hercegovačke naseljenike », in Nusret Šehić (éd.), Migracije i
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
58
Bosna i Hercegovina (materijali s naučnog skupa „Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog
srednjeg vijeka do najnovijih dana — njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj
zemlji“, ordžanog u Sarajevu 26. i 27. oktobra 1989. godine, Sarajevo, Institut za istoriju.Institut za
proučavanje nacionalnih odnosa, 1990, pp. 411-417.
16. Branko Bošković, « [discussion] », in Nusret Šehić (éd.), Migracije i Bosna i Hercegovina, pp. 614-615.
17. Nikola Jarak, Poljoprivredna politika Austro-Ugarske u Bosni i Hercegovini i zemljoradničko
zadrugarstvo, Sarajevo, ND NR BiH, 1956, p. 41. On trouvera certainement d’autres documents
d’archives qui synthétisent la période antérieure à 1900. Smail Balić indique qu’il existe un
document intitulé « Auswanderungen aus Bosnien und der Herzegowina 1879-1897 » sous la cote
ABH ZVS 18.527/1898 (Smail Balić, « Deutschsprachiges archäologisches und historisches
Schrifttum über Bosnien und die Herzegowina vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis 1918 », in
Südost-Forschungen, 30 (1971), pp. 197-244). D’après le personnel des archives, cependant, il
semble que ce document n’existe pas.
18. Archives de Bosnie-Herzégovine [ABH] Ministère Commun des Finances (GMF) 398/1901, du
25.IV.1901, égarée dans le fonds Zemaljska Vlada Sarajevo [ZVS] 1901, 307 60/34.
19. Ilijas Hadžibegović, « Moderne migracije u Bosni i Hercegovini i nacionalni odnosi (Skica za
studiju) », Prilozi Instituta za istoriju 23 (1987), p. 64 ; Илијас Хаџибеговић, « Миграције
становништва у Босни и Херцеговини 1878-1914. године », Prilozi Instituta za istoriju 11-12
(1975-1976), pp. 313-316.
20. Милорад Екмечић, « Утицај Балканских ратова 1912.-1913. на друштво у Босни и
Херцеговини », in id., Радови из исотрије Босне и Херцеговине XIX века, Belgrade, BIGZ, 1997,
pp. 401-2.
21. ABH Landesregieurung (LR) Präsidium, 809/1884, du 18.IX.1884. Plus de détails chez Philippe
Gelez, Safvet-beg Bašagić (1870-1934) : aux racines intellectuelles de la pensée nationale chez les
musulmans de Bosnie-Herzégovine, Athènes, EfA, 2010, pp. 122-126.
22. Ferdinand Schmid, Bosnien und die Herzegowina unter der Verwaltung, p. 249-252 ; Мита
Костић, « Преглед босанско-херцеговачких мухаџира и њихових првака по косовском
вилајету 1883 године », Istoriski časopis, 1 (1948), 1-2, pp. 252-253.
23. Илијас Хаџибеговић, « Миграције становништва », p. 313. Voir aussi Gaston Gravier,
« Emigracija Muslimana iz BiH », Pregled 1 (1909-1910), 7-8 (15.I.1910), p. 475.
24. ABH Ministère Commun des Finances (GMF) 398/1901, du 25.IV.1901, égarée dans le fonds
ZVS 1901, 307, 60/34.
25. Les réflexions de Kapidžić sur la question ne sont pas intéressantes dans la mesure où il se
borne à marquer l’écrasante majorité de ruraux, ce qui est une vérité de Lapalisse pour la Bosnie-
Herzégovine de cette époque, très peu urbanisée. Voir Dževad Juzbašić, « O iseljavanju iz Bosne i
Hercegovine poslije Aneksije 1908. godine », in id., Politika i privreda u Bosni i Hercegovini pod
austrougarskom upravom, Sarajevo, ANUBiH, 2002, p. 489.
26. Ferdo Hauptmann, « Privreda i društvo Bosne i Hercegovine u doba austrougarske vladavine
(1878-1918) », inPrilozi za istoriju Bosne i Hercegovine, Sarajevo, ANUBiH, 1987 (Pos. izdanja LXXIX/
18), p. 185-6 ; Dževad Juzbašić, « O iseljavanju poslije Aneksije », pp. 489-490.
27. Dževad Juzbašić, « O iseljavanju poslije Aneksije », pp. 489-491.
28. Dževad Juzbašić, ibid., p. 490.
29. Fikret Karčić, « Jedna važna fetva o pitanju iseljavanja Bosanskih Muslimana u vrijeme
Austro-Ugarske uprave », Prilozi Instituta za istoriju 27 (1991), pp. 41-48.
30. Илијас Хаџибеговић, « Миграције становништва », p. 311.
31. Hamdija Kapidžić, « Ekonomska emigracija », in id., Prilozi za istoriju, pp. 212-213.
32. Mina Kujović, « O bosanskim muhadžirima, », version on-line sur le lien http://
glasnik.gracanica.net/arhiva/22/index.php?id=94.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
59
33. Mina Kujović estime que 95% de ceux qui revinrent étaient des déserteurs illégaux. Mais elle donne ce
pourcentage sur les 296 formulaires d’auditions qu’elle a épluchés. Or, il est probable que les autorités se
sont aprticulièrement intéressées aux jeunes hommes, qui devaient faire leur service militaire et qu’ils
n’était pas difficile, de ce fait, de convoquer au poste de gendarmerie ou au district.
34. Alexandre Toumarkine, Les migrations des populations musulmanes balkaniques en Anatolie (1876-1913),
Istanbul, ISIS, 1995, p. 83.
35. Philippe Gelez, « Se convertir en Bosnie-Herzégovine (c. 1800-1918) », in Süd-Ost Forschungen
68 (2009), pp. 86-131.
36. Mustafa Imamović, Historija Bošnjaka, Sarajevo, Preporod, 1997, pp. 367-368.
37. Mustafa Imamović, Historija Bošnjaka, p. 368.
38. ABH GMF 398/1901, du 25.IV.1901, égarée dans le fonds ZVS 1901, 307, 60/34.
39. Hamdija Kapidžić, « Pokret za iseljavanje srpskog seljaštva », in id., Prilozi za istoriju, p. 21.
40. ABH ZVS 1901, 307, 60/29.
41. Dževad Juzbašić, « O iseljavanju poslije Aneksije », pp. 491-492.
42. Id., ibid., p. 494.
43. Id., ibid., pp. 491-492.
44. Alexandre Toumarkine, Les Migrations, pp. 51-52.
45. Dževad Juzbašić, « O iseljavanju poslije Aneksije », p. 491.
46. Fuat Dündar, « The Settlement Policy of The Committee of Union and Progress », in Hans-
Lukas Kieser (éd.), Turkey Beyond Nationalism. Towards Post-Nationalist Identities, London, IB Tauris,
2006, pp. 39-40. Pour la période ultérieure, lire notamment Vladan Jovanović, « Iseljavanje
muslimana iz Vardarske banovine : između stihije i državne akcije », in Mile Bjelajac (éd.), Pisati
istoriju Jugoslavije : viđenje srpskog faktora, Beograd, Institut za noviju istoriju Srbije, 2007, str.
79-99 ; Vladan Jovanović, « In Search of Homeland ? Muslim Migration from Yugoslavia to Turkey
1918-1941 », Токови историје 12 (2008), pp. 56-67.
47. Id., ibid., pp. 491-492.
48. Id., ibid., p. 493.
49. Милорад Екмечић, « Утицај Балканских ратова 1912.-1913. на друштво у Босни и
Херцеговини », in id., Радови из исотрије Босне и Херцеговине XIX века, Belgrade, BIGZ, 1997, p.
418 ; Dževad Juzbašić, « Uticaj Balkanskih ratova 1912/1913. na Bosnu i Hercegovinu i tretman
agrarnog pitanja », in id., Politika i privreda, p. 461.
50. Tomislav Kraljačić, « Povratak muslimanskih iseljenika iz Bosne i Hercegovine u toku Prvog
balkanskog rata », in Nusret Šehić (éd.) Migracije i Bosna i Hercegovina, pp. 151-152.
51. Id., ibid., pp. 152-161.
52. Милорад Екмечић, « Утицај Балканских ратова », pp. 401-402.
53. Philippe Gelez, « Se convertir en Bosnie-Herzégovine (c. 1800-1918) », Süd-Ost Forschungen,68
(2009), pp. 86-131.
54. Јован Цвијић, « О исељавању босанских Мухамеданаца », Српски књижевни гласник
24/1 (1910), n°12, pp. 906-917 ; nombreuses rééditions, entre autres in Јован Цвијић, Говори и
чланци, Beograd, 1921, pp. 253-264. L’un de ses meilleurs disciples, Vaso Čubrilović (1897-1990),
poursuivra cette réflexion en la généralisant dans un article de 1930 intitulé « Политички
узроци сеоба на Балкану од 1860-1880 год. », Glasnik Geografskog društva ,16 (1930), pp. 26-49.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
60
RÉSUMÉS
Intervenant à la suite de l’occupation austro-hongroise de leur province (août 1878), l’émigration
des musulmans de Bosnie-Herzégovine est un processus complexe, lié en premier lieu à une
situation économique déplorable et aggravé par une natalité ralentie depuis quelques décennies
déjà avant 1878. On ne peut pas intégrer ce mouvement migratoire dans le cadre des
déplacements volontaires de population qui existaient à l’époque dans l’aire balkanique : la
politique bosno-herzégovinienne de l’Autriche-Hongrie était aux antipodes de tels déplacements,
car elle s’appuyait en bonne partie sur l’élément musulman afin de stabiliser la province.
Muslim emigration from Bosnia-Herzegovina after Austro-Hungarian occupation (1878) is a
rather complex process, tied before all with a disastrous economic situation and aggravated by a
deceleration in natality for some decades already before 1878. This migratory movement may not
be considered as part of forced population displacements which existed at that time in the
Balkan aerie. On the contrary, Austro-Hungarian in Bosnia-Herzegovian had the exact opposite
aim, because it leaned in good party on the Muslim element to stabilize the province.
INDEX
Keywords : Bosnia and Herzegovina, Bosnia Muslims, emigration, Ottoman Empire, identity,
victimization
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
61
Crossing the borders in reality and
in press: the case of the newspapers
Yeni Adım and Yarın in the late 1920s
Yannis Bonos
1 This article focuses on the way two newspapers contributed to the control of public
opinion. More precisely, this case study gives an insight into the ways the editors of
Yeni Adım (in Turkish, ‘The New Step’) and Yarın (in Turkish, ‘The Day After’), which
appeared in Xanthi in late September 1926 and in late July 1927, respectively, kept
silent about the migration that took place in mid-October 1928 on the Greek-Turkish
land border. Insofar as the emigration of ‘non-exchangeables’ 1 from Greece has been
attributed to the demographic engineering operated by the Greek state in the 1920s,
this case study on the ways two editorships made use of the mid-October 1928
discussions on emigration to Turkey touches upon the broader issue of the government
of a minority by consent.
2 In the most detailed account of the interwar emigration of ‘non-exchangeables’ from
Greece, H. Öksüz related their immigration to Turkey to the settlement of exchanged
refugees by the Greek state in the border territory which lies to the west of Turkey and
to the south of Bulgaria (Öksüz 2004: 250-278). By stressing, however, the geopolitical
importance of that territory named Western Thrace after the Balkan Wars (1912-13) for
the Ottoman, Bulgarian and Greek states, Öksüz neglected, as have several scholars
interested in the history of the ‘non-exchangeables’ in Greek Thrace, the question of
how that minority population was governed.
3 From that novel perspective, the main interest of this case study lies with the
disciplinary function of Yeni Adım and Yarın editorships within the ‘non-exchangeables’
who talked both about the Greek refugee settlement and the emigration to Turkey. In
fact, opinion control and consensual government in Greek Thrace has never received
the attention given by scholarly literature to state demographic plans since the 1920s
(Doxiadis 1928: 53-69; Schultze 1937; Öksüz 2004: 250-278; Hersant 2009: 141-162;
Dalegre 1997; Koutsoukos 2012).
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
62
1. Demographic engineering from 1878 to 1928
4 Ottoman concerns about populations’ faithfulness in the areas of Gümülcine 2 and
Dedeağaç3 manifested itself clearly during the 1877-78 war with the Romanov Empire.
During that war, which ended with an Ottoman defeat and a treaty providing for the
creation of a Bulgarian state, Abdul Hamid II thought of using the refugees who fled en
masse from the battlefields and banditry zones as a defensive wall for the vilayets lying
between Adrianople (in Turkish, Edirne) and Yanya (in Greek, Ioannina) (Toumarkine
2000: 202). In order to defend its last possessions in the Balkans from rival nationalisms
and competing imperialisms, the Ottoman state tried to settle the 1877-78 war refugees
in a territory inhabited by Bulgarian- and Greek-speaking Christians by, first,
prohibiting emigration from the Balkan provinces to the Anatolian vilayets. Then, it
tried to make out of the body of destitute refugees a means of defense of the Empire by
distributing them across the newly founded provinces such as the sanjak of Gümülcine
established on the border with the autonomous vilayet of Eastern Rumelia (Şimşir 1970:
120; 279).
5 Administrative and consular reports as well as letters to Istanbul newspapers depict
quite dramatically the precarious state of the refugees, their struggle for livelihoods,
their conflicts with the ‘Muslim’ and ‘Christian’ subjects of the Sultan, and their
expectations from the Ottoman sovereign. According to an agent of the French consul
in Salonika who gathered information about the refugees in the plains of İskeçe (in
Greek, Xanthi / in Bulgarian, Sketcha), half of them were accusing the Sultan of being a
traitor while others were expecting ‘the elimination of the infidels as a remedy for the
situation’ (Şimşir 1968: 486). Under that popular pressure, the Ottoman state started to
take care of the wounded, the widows and the orphans by establishing institutions such
as the hospitals and orphanages proposed for the area of Gümülcine in summer 1878. 4
After the creation of the Commission for the General Administration of Refugees (in
Turkish, İdare-i Umûmiye-i Muhâcirîn Komisyonu), the Ottoman state must have pursued
more meticulously its demographic engineering in the border territories of İskeçe,
Gümülcine, Dedeağac and Dimetoka (in Greek, Didymotiho / in Bulgarian, Dimotika).
6 In fact, Ottoman demographic engineering in the vilayet of Adrianople and more
particularly in its southwestern provinces such as the recently established (1884)
sanjak of Dedeagac has to be further examined. A brief survey of the relevant Ottoman
archives which have to be closely scrutinized shows that the Ottoman authorities were
not so respectful of the Sultan’s desires to prevent refugee flows to Anatolia. 5 According
to a later rough estimation, the subjects supposedly loyal to the Ottoman state 6 rose
only by 5%, up to the 65% of the population living in the sancaks of Gumulcine and of
Dedeagac from 1888 to 1906 (Schultze 1937: 236). However, thousands of refugees
moved to these sanjaks following the annexation of Bosnia to the Austro-Hungarian
Empire in 1908 (Trifonov 1989: 105-106 cited by Crampton 2007: 430). According to the
president of a Greek irredentist association (1918-19) who later became minister of
health and welfare of the Greek state (1922-28), the Ottomans had pursued colonization
by transferring people from Bosnia, Bulgaria and other countries (Doxiadis 1928:
53-69).
7 Following the Balkan Wars (1912-13) and the partition of the Andrianople vilayet
between the Ottoman Empire and the Bulgarian kingdom, demographic engineering in
the former Gümülcine and Dedeağac sancaks underwent a major change. Contrary to
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
63
widespread belief, demographic engineering in the Aegean Thrace (in Bulgarian,
Belomorska Trakija) was not pursued just by the Bulgarian state but by the Ottoman
state too. As the Young Turks were hoping to regain control of the lost sancaks, the
Ottoman state tried to preserve a population presumably loyal to it by prohibiting
emigration to the Ottoman part of Thrace (Yıldırım Ağanoğlu 2001: 111 cited by Öksüz
2004: 250-278). For the same reason, the Bulgarian governments carried out a
demographic engineering following the massive displacements caused by regular
troops and irregular forces during the wars. More particularly, the Bulgarian and the
Ottoman governments had agreed to settle about 50.000 refugees in the properties
abandoned by an equal number of refugees who had departed from Aegean Thrace and
the new vilayet of Andrianople (Ladas 1932: 18-20). The struggle between these states to
achieve population balances in accordance with their leaders’ aspirations continued
throughout the Great War.
8 Since 1914, various Ottoman bureaus like the state security and the Dedeağac consulate
issued warnings and orders to prohibit emigration of Muslims and non-Muslims to the
vilayet of Andrianople (Osmanlı belgelerinde Batı Trakya 2009: 90, 112, 114, 122). More
numerous were, however, the reports on the pressure put through different means by
the Bulgarian state on presumably disloyal populations to emigrate to the Ottoman
Empire (ibid.: 64, 90, 92, 96, 100, 122). Among the most important incentives for
emigration was the colonization of, first, the lands next to the Ottoman and the Greek
borders and, then, of the countryside around the towns (Schultze 1937: 238). The
settlement of emigres from the Bulgarian hinterland and of refugees forced to leave in
the Balkan Wars from the later Greek and Serbian parts of Macedonia as well as the
Ottoman part of Thrace had been assigned to a central committee in Sofia which
directed 16 subcommittees operating in Aegean Thrace (Koutsoukos 2012: 154). Until
autumn 1915 when the Ottoman district of Dimetoka was annexed to Bulgaria, the
Bulgarian authorities had managed to settle about 35.000 refugees and settlers (ibid.:
157-8). From the late 1916 on, demographic engineering in the Aegean Thrace kept on
less energetically on Bulgaria’s part due to the Great War.
9 With the end of the war, the Ottoman state’s involvement faded as the Greek state tried
to override the Bulgarian demographic arrangements. According to the treaty of
Neuilly-sur-Seine (27 November 1919), Bulgaria renounced ‘in favor of the Principal
Allied and Associated Powers all rights and title over the territories in Thrace’ and
reached an agreement with Greece ‘respecting reciprocal voluntary emigration of the
racial, linguistic and religious minorities in Greece and Bulgaria’. Consequently, the
Allied Government of Western Thrace (in French, Gouvernement de la Thrace
Interalliée), the French-led military administration which replaced the Bulgarian civil
authorities in the former Bulgarian Thrace, dealt with the rival population plans of the
Greek and Bulgarian delegates awaiting the Paris peace conference’s final decisions on
the future of the former Ottoman territory. As the Greek and Bulgarian delegates to the
Allied Government struggled to achieve population figures in accordance with the
principle of the national self-determination, the partisans of Cafer Tayyar, founding
member of the Turkish nationalist Association for the Defense of the Rights of Thrace
(in Turkish, Trakya–Paşaeli Müdafa’-i Hukuk Cemiyet-i Osmaniyesi), and the followers of Ali
Riza, grand vizier of Mehmed VI, disagreed over the repatriation of around 45.000
refugees living in the Andrianople vilayet to the part of Thrace under Allied
occupation.7 In fact, the Turkish plan to increase the majority population by expelling
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
64
refugees from the Balkan Wars and the Great War was abandoned as the Greek army
marched towards the occupied Ottoman capital in early summer 1920.
10 Following the treaty of Sevres (10 August 1920), the Greek state pursued the
demographic engineering initiated a year ago in Allied-occupied Thrace. In this effort,
Greek authorities tried to avoid events that would harm the image which they had to
build on the liberal principles of minority protection. However, the Greek attempt to
gain the support of public opinion in England and France as well as the sympathy of the
minorities in Greece with the irredentist objective expressed by the slogan Greece of
two continents and of five seas suffered, two years later, the well-known outcome of
the Greek military campaign in Ottoman Thrace and Anatolia. In autumn 1922, the
Greek defeat by the National Forces (in Turkish, Kuvvayi Milliye) was followed by the
exodus of more than a million people from their homelands. Faced with an
unprecedented state of exception, the Greek state managed to use in a few years a large
number of these refugees as a means of demographic engineering, as the principal
advocate of the Greek Great Idea had recommended from his place of exile:
[…] the successful solution of the problem will contribute to the recovery in a few
years from the burdens that the unfortunate end of the war leaves to us and to the
consolidation, after the collapse of Greater Greece, the consolidation of the Great
Greece whose borders will never be secure unless Western Thrace and Macedonia
become Greek countries from both political and ethnological points of view. 8
‘Non-exchangeables’ responses to the Greek-Turkish exchange
11 Following the massive arrival of refugees in Greece, the League of Nations’ High
Commissioner for Refugees, F. Nansen (1861-1930), mediated between the Greek and
the Turkish governments for the rapid settlement of these refugees. At the end of five
months of negotiations, Greek and Turkish delegates at the Lausanne peace conference
agreed on the compulsory exchange of Greek and Turkish populations with the
exception of ‘the Greek inhabitants of Istanbul and the Moslem inhabitants of Greek
Thrace (League of Nations 1925: 77-87)’. ‘Non-exchangeables’ emigration from Greek
Thrace evolved according to the Greek demographic engineering and the Turkish no-
emigration policies.
12 Provisional measures taken for the relief of the refugees (forced cohabitation, seizure
of buildings, cattle and crops) as well as the long-term policy executed by the Refugee
Settlement Commission for about 200.000 of these exchanged refugees in Greek Thrace
(land redistribution, construction of new villages and city quarters) culminated in the
exodus of about 2.000 families of ‘non-exchangeables’ to Turkish Thrace by early 1925
(Pelagidis 1997: 199). However, the number of the ‘non-exchangeables’ who had
emigrated from Greece to Bulgaria cannot be easily estimated. 9 Since November 1923,
the Turkish state tried to prevent ‘non-exchangeables’ from emigrating by denying
them Turkish citizenship10 and citizenship rights such as the right to the lands
abandoned by the exchanged in Turkey and distributed by the state to the exchanged
who were coming from Greece (Öksüz 2004: 250-278). Although the Turkish authorities
drove back to the Greek border the ‘non-exchangeables’ who applied for asylum or
looked for land in Turkey, ‘non-exchangeables’ fled Greek Thrace as is evidenced by the
repeated orders of the Greek General Staff ‘for the prohibition of illegal emigration and
measures for the collection of information on relevant movements.’ 11
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
65
13 In fact, a general will to leave from Greek Thrace was widespread, at least, since
autumn 1924. In that autumn, Mehmet Hilmi (1902-29), chief editor of Yeni Ziya (in
Turkish, ‘The New Light’), a newspaper appeared in Xanthi in June 1924, acknowledged
that:
Today the population of Thrace waits impatiently for the roads to Turkey to open.
Everyday, in front of the Turkish Consulate and of the [Mixed] Exchange
Commission, hundreds of persons ask to immigrate to Turkey by denying that
they’re Thracians. There is no civil servant, no solution to which they did not
appeal.12
14 This absolutely intelligible desire to leave Greek Thrace – in fact, the population
increase since autumn 1922 and Greek demographic engineering resulted in the rapid
increase of cheap manpower, the cost of living, of the property-related crime and of
racist violence – began to fade away by early 1925.
15 According to the report submitted by E. Ekstrand and M. de Lara ‘on the situation of the
Greek minority in Istanbul and of the Turkish minority in Western Thrace’, after the
field trip of the Mixed Exchange Commission, almost all of the ‘representatives of the
Turkish minority stated categorically their desire to leave Western Thrace in order to
go to Turkey (in many cases, by abandoning their property without indemnity).’ 13
However, the lower strata of the social pyramid expressed, according to the same
report, just their feelings ‘of fear for the future and of resentment for their reduction to
a minority after the establishment of refugees in Thrace’. In fact, the question of
emigration to Turkey or remaining in Greece had turned through the April 1925 field-
trip into a debate on whether these views reflected free will or whether they were the
result of pressure put on minority representatives by the Greek and Turkish
authorities. The two state authorities’ efforts to convey to the Mixed Exchange
Commission completely opposing impressions of the conditions of the minority in
Greece are quite obvious, if one considers two reports classifying minority
representatives as either friends or enemies of the national states.
16 In the first case, a Turkish official reported to the Turkish ministry of foreign affairs
that Hafiz Salih (1868-1934) and Hafiz Galip (1880-1948), two prominent politicians in
Greek Thrace, as well as Mustafa Ağa, deputy in the Greek parliament, and Hafiz
Nezvad, mufti of Komotini, ‘were able to explain in every detail the situation.’ 14 On the
contrary, the deputy from Xanthi, Mestan Efendi had been found ‘involved into
activities against the Turks’. In the second case, the mufti of Alexandroupolis, Haci
Veleddin, denounced to the Greek authorities the Turkish consul in Komotini and the
Turkish delegate to the Komotini 9th Exchange Sub-commission for having tried to
engage a notable of Alexandroupolis to ‘declare his desire to immigrate to Turkey since
the Greek administration behaves in a prejudiced manner towards Muslims.’ 15 As an
outcome of the Exchange Commission’s field trip, two ‘secret’ parties had been created.
17 The first was led by Hafiz Galip. According to the Greek intelligence service, it
addressed a plea to the Turkish consulate in Komotini in which ‘the godsend M. Kemal
was begged to save them and to see to their transfer to an area in Turkey where they
would settle together.’16 The second party, under the leadership of the deputy Mustafa
Ağa, was in favour of staying in Greece and had not taken any action against its
opponents. In fact, both parties mediated between ‘non-exchangeables’ and state
authorities in Greek Thrace without informing the public.17
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
66
2. Caught between silence and clattering noise
18 Since the Balkan Wars (1912-13), state authorities gathered information on acts of
violence in order to fight against rival national claims by attracting public outcry. For
example, the Greek Ministry of Foreign Affairs considered turning Turkish speaking
populations against Bulgaria by collecting complaints for the Bulgarian army’s conduct
and dispatching these denunciations through special agents in Xanthi to the Istanbul
papers that were read by these populations (Glavinas 2005: 157-172). In that respect,
Turkish-language public sphere in Xanthi and, generally, in the part of Thrace which
came under Greek rule in May 1920 underwent a major change in 1924.
19 Up until then Turkish-language newspapers published in Istanbul and the Greek
bureaucracy had been the main recipients and conduits for complaint letters. In
January 1924 the founding of a Turkish Consulate in Komotini 18 provided an additional
channel for such letters or for oral complaints. Very soon the Turkish and the Greek
bureaucratic services (the General Administration of Thrace, the Consulate of Turkey
and the 9th Exchange Sub-commission) engaged in a battle over the monopoly on
information channels. In April 1924, for instance, the Governor General of Thrace asked
the muftis of Komotini, Xanthi, and Alexandroupolis to make publicly known that non-
exchangeables could make their complaints either by visiting him or by writing to him
in Turkish without paying extensive amounts for translations in Greek. 19 Accordingly,
the two states’ contest for the title of the minority protector expanded to both ‘high-
level’ issues such as the nomination of the Komotini mufti and to ‘low-level’ matters
such as the establishing of information networks. Soon enough, intelligence service
employees began to doubt the trustworthiness of their colleagues in state security and
to denounce them to their directors for collaboration with the enemy. 20 Afraid of the
success of the Turkish Consulate in recruiting informants and its claim to stand for
minority rights, Greek authorities thought of multiplying public protest channels.
20 Accordingly, Greek authorities authorized V. Evaggelidis, general secretary of Xanthi
Tobacco Trade Union and the Greek Communist Party’s candidate in the 1923 elections,
to publish Yeni Ziya, a newspaper that, since 10 June 1924, advocated communism as it
had been defined by the Comintern.21 As soon as Yeni Ziya began to attract a regular
audience, the General Administration of Thrace, instead of closing down the newspaper
in accordance with the 1923 martial law clauses on the press, 22 to assist a group of
political refugees who had helped the Greek army in Anatolia and worked since autumn
1922 as informants for the Greek authorities and as teachers at minority schools in
publishing a newspaper. Itila (in Turkish, ‘Elevation’) appeared in Xanthi in mid-august
1924 in order to struggle against communism and Kemalism; the chief editor of Yeni
Ziya rejected Itila’s discourse as false accusations (in Turkish, jurnal) and stigmas (in
Turkish, leke). Through this spectacular debate, the older, more comprehensive divide
between progressives and conservatives evolved into a confusing divide between state
partisans or supporters of Turkey and supporters of Greece23 as we saw in the reports
on the field trip of the Joint Exchange Commission in spring 1925.
21 The ‘non-exchangeables’ population in Greek Thrace appeared divided in regard to the
question of which national state would supposedly be its protector, a divide that has
recurred several times since then. In early February 1926, for instance, the Governor
General of Thrace called ‘non-exchangeables’ to exercise the right to opt for Turkish
nationality until the 6th of August 1926.24 Although this call conformed perfectly to the
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
67
clauses of international agreements, a good number of the ‘non-exchangeables’
thought that the Greek state used this clause in order to make them leave. This was, at
least, what the president of the Turkish delegation to the Joint Exchange Commission
reported to Akşam (in Turkish, ‘Evening’), a daily newspaper published in Istanbul. 25 By
interpreting public opinion, the chief editor of Yeni Yol (in Turkish, ‘The New Way’), a
weekly which appeared in Xanthi after the closing of Yeni Ziya in January 1926,
criticized the Governor’s initiative as being the minimum the Greek state was required
to do in order to secure the Lausanne treaty:
Above all, we request that the government apply the part of the Lausanne treaty
regarding the minorities, that is, to take rapid action to secure the rights and well-
being of the Turks of Thrace.26
22 In fact, the general impression that the Greek state did not really care about the ‘non-
exchangeables’ in Thrace spread among them with the rumor about a new population
exchange. Aziz Nuri, the editor of Adalet (in Turkish, ‘Justice’), which appeared in
Komotini in spring 1926, denounced that rumor about Thrace and Istanbul minorities’
exchange as a weapon in the hands of the supporters of the Kemalist reforms:
However, in spite of the articles of Anatolian and Thracian newspapers on that
issue, some people of bad character who do not feel too ashamed to put forward
that, after the forthcoming exchange, the assistance will be great to those who wear
a hat, do not abstain from putting out that propaganda.27
23 In fact, journalists’ and bureaucrats’ mediation produced so much noise as silence.
Since newspaper editors such as A. Nuri or M. Hilmi spoke on behalf of the ‘non-
exchangeables’ who used these newspapers by reading them collectively or by posting
letters, these people progressively lost their appetite for true dialogue which is free
from any kind of mediation (Debord 2002 :8), by consuming quite willingly the
newspapers’ black and white blurring images of Greece and Turkey, Islam and
Kemalism, and good and evil. As it happened in other parts of the world in the interwar
period, the development of the Turkish-language press in Greek Thrace contributed to
the control of the public opinion in making everybody incapable of distinguishing
between the true and the false: propaganda, slander, lies and denials, flattery and
rumor became the key words in the everyday ‘dialogue’ between the opposing sides of
the public sphere. The public debate about whether the modernists and the
conservatives were telling the truth in their newspapers about a ‘common good’, the
‘Turks’ or the ‘Muslims’, Greece or Turkey, developed as long as the Greek bureaucracy
followed the liberal principles of the government by consent.
24 Following the closing of Yeni Yol in spring 1926 and the second banishment of M. Hilmi
for communist propaganda (Sarris 1992: 493-496), Greek authorities allowed Sabri Ali, a
young teacher from Xanthi, to publish a new newspaper. Yeni Adım appeared in Xanthi
on 30 September 1926, amid the electoral campaigns of ‘the progressive and the
conservative groups.’28 After the elections of November 1926, M. Hilmi struggled
together with Osman Nuri and Hifzi Abdurrahman, his constant companions since the
Yeni Yol days, for ‘the progress and the rights of the Turks of Western Thrace’.
However, the emphasis put on human, citizen and minority rights since April 1927
made the Greek authorities to consider whether they should get rid of Hilmi’s group
once and for all29 or whether they should counter Yeni Adım’s impact by the same
means. As in the case with Yeni Ziya, liberal thought prevailed by allowing a new
newspaper next to Yeni Adım.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
68
25 Yarın appeared in Xanthi on 22 July 1927 under the editorship of H. Fehmi, a political
refugee from Turkey appointed like other political refugees as teacher in minority
schools in Xanthi. According to the first editorial, the newspaper’s aims were to ‘fight
against atheism and to reveal its plot to destroy the traditional beliefs in the conscience
of the common people by efforts that are incompatible with the elite’s level.’ 30 In fact,
Mustafa Sabri, grand vizier assistant in Damad Ferid’s governments (1919-20), and his
son Ibrahim undertook to fight Kemalism and more generally ideas of progress and
belonging coming from the Enlightenment on the grounds of Islamic philosophy and G.
Le Bon’s works. Editorials and articles on the ‘apostate Ankara regime’ and on the
‘hypocrites, the covert enemies of Islam’ provoked angry reactions from Yeni Adım and
from the Turkish diplomatic missions in Greece. The fierce polemics about the nature,
aims and scope of the Kemalist reforms and of their adherents in Greek Thrace and,
above that divide, the pressure of the Turkish embassy in Athens made the Greek
authorities consider banishing the editors of Itila and Yarın towards the end of 1927.
However, the Greek authorities abstained from that measure (Tsioumis 1994: 126).
26 In fact, the Greek bureaucracy rarely exercised repressive censorship and even more
rarely a preventive one on the Turkish-language press in Greek Thrace. When a
newspaper article was judged prejudicial on the Greek state’s image, the state security
officers in Xanthi or the Governor General in Komotini summoned the newspaper
editors to their offices for a talk on the veracity of their writings, on the arguments or
the tone of their language and tried to extract promises to toe the line in the future. 31
Cases of seizing copies from selling points32 or at the borders, in the case of newspapers
imported from Istanbul,33 were quite rare. As a general rule, the Turkish-speaking
public sphere in Greek Thrace had been structured on the democratic principles of the
freedom of speech and of the press which were subject to the limitations brought by
the Greek laws on the state of exception and on the press. What was then the role of
Yarın and Yeni Adım editors in disciplining those who talked about emigration to
Turkey?
3. Crossing the Greek-Turkish borders in October
1928: the state responses
27 Since the beginning of 1928, ‘non-exchangeables’ by the dozens defied Greek and
Turkish measures against emigration from Greek Thrace. In response to the repeated
requests of Turkish authorities to prevent the emigration of people whom ‘the
government of the republic cannot send back given the affinity of race 34’, the Governor
General of Thrace maintained that ‘no more than a hundred to two hundreds landless,
unemployed or extremely nationalist Turks would take advantage of the opportunity if
all restrictions were abolished and emigration to Turkey was authorized.’ 35 Within less
than a month the Greek authorities were confronted with a ‘particularly intense wave
in the district of New Orestiada,’36 a town opposite Adrianople. The management of the
situation by the state started after the request of the General Administration of Thrace
to the Greek ministry of foreign affairs for further instructions.
28 Athens called both the General Administration of Thrace and the General Staff to issue
‘relevant orders on the prohibition of departures in groups or individually, such as the
order no. 12010 of 20 October 1926.’37 Four days later, the foreign affairs ministry asked
the Administration ‘to establish and dispatch a detailed table of illegal emigrants by
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
69
name and by village.’38 At the same time, civil and military authorities under the
Governor General in the Turkish part of Thrace tried to find and expel the refugees
back to Greece ‘where they were mistreated anew.’39 The Turkish Delegation to the
Joint Exchange Commission had already appealed to ‘the humanist sentiments of the
honourable commission in order to take action in view of an end to the martyrdom of
this unfortunate population’. After that appeal, the case was brought to the knowledge
of the Commission which was preparing its third field trip to investigate on the state of
the ‘non-exchangeables’ in Greek Thrace (Tsioumis 1994: 90).
29 According to the Turkish Delegation, a violent expatriation was taking place. ‘Under
the pressure exerted by Greeks and because of the difficulties to which they are
constantly subject, Turkish refugees from Western Thrace flow en masse in the vilayet
of Andrianople.’40 Contrary to the Turkish claims, the Greek delegation argued that
these refugees were either landless, indebted to private individuals or encouraged by
‘secret propaganda by some Turks that the Turks of Western Thrace will be exchanged.’
41
The conflict between Turkish and Greek officials on the motives of the October
emigrants went on through the exchange of documents giving more details on the
expectations of these refugees and on the ways of their emigration towards Turkey.
30 In addition to the drought that had made the crossing of the Maritsa River easier at
certain points,42 refugees had profited from the behaviour of the border authorities.
Greek police did not really check to see if holders of Greek passports had been granted
a Turkish visa or not.43 Between July 25 and October 29, Greek authorities had issued
119 passports to Turkey and 69 passports to Bulgaria, to the requests of 258 and 95 non-
exchangeable individuals, respectively.44 After the mid-October investigation, the
General Administration identified 96 missing ‘non-exchangeables’ and estimated 60
more absentees as illegal refugees to Turkey. But as has already been suggested, having
a passport or not did not make a real difference. Since the Turkish Consulate in
Komotini refused to grant visas, Greek border authorities did not bother to check for
the Turkish state’s approval.45 Taking advantage of that behaviour, refugees rid
themselves of state identity papers before presenting themselves as fugitives to the
Turkish border authorities.46 At that second checkpoint, refugees were either stopped
and sent back to Greece or allowed to enter Turkey by the border authorities who
presumably sympathized with the refugees’ hopes and fears.
31 Some of these migrants were refugees who had left from Bulgaria to Greece in the
Balkan or the First World wars and lived in Greek Thrace landless. Others had left
following those who emigrated recently to Turkey from Bulgaria and Serbia. 47 Others
had received letters by relatives telling them on the coming exchange of the minorities
in Istanbul and Greek Thrace.48 Young people tried to avoid military service in the
Greek army while others were not able to pay back loans to traders or shopkeepers.
Others could not stand the muftis’ measures against the partisans of the Kemalist
reforms and vexations by the Greek police or civil servants.’ 49 All these claims made by
the Turkish and the Greek delegations to the Joint Exchange Commission gave rise to a
tussle behind the doors where the Turkish delegate informally proposed the exchange
of minorities and his Greek counterpart argued that the Turkish delegation was just
trying to promote the image of Turkey as the sole national state interested in the
minority in Thrace.50 While, then, the Joint Exchange Commission investigated ‘the
situation of the Turkish minority in Western Thrace’ once more, Yarın and Yeni Adım
editors did their best to express the opinions of the ‘non-exchangeables’.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
70
Crossing the Greek-Turkish borders in autumn 1928: press
responses
32 Without any doubt, the news about the ill-fated venture of the emigrants and the
separate efforts of Greek and Turkish authorities to identify them and return them to
the status of non-exchangeable spread rapidly among ‘non-exchangeables’, both via the
Greek authorities searching for absentees as well as the emigrants who had been sent
back and spoke about their misfortunes. It is also quite possible that the news also
spread through the field trip of the Joint Exchange Commission despite its presumed
efforts to avoid negative publicity. For their part, the editors of Yeni Adım and Yarın
tried to cover up the whole case by echoing the public debate on the emigration affair.
33 The editor of Yeni Adım, M. Hilmi, touched upon the heated discussion by arguing that
‘under these conditions life for us is impossible.’ 51 This idea was not new, of course.
Since spring 1927, Hilmi was claiming that ‘Turks are now thinking of how to escape
from this place.’52 With time, Hilmi insisted more and more on this proposal which
made his most close friends abandon the group around Yeni Adım towards the end of
November 1927 (Kırlıdökme 2008: 450-451). According to R. Kırlıdökme, O. Nuri and
Hifzi Abdurrahman were unhappy with the submission of Hilmi to the wills of the rich
group that funded the newspaper (Kırlıdökme 2000: 9). If, as the Greek authorities were
pleased to say,53 Yeni Adım received financial support from the Turkish state via the
Turkish Consulate in Komotini, then we have to admit that M. Hilmi had become a
highly accomplished journalist:
Under these conditions life for us becomes certainly impossible. Because our
masters desired it in this way, they pushed us into such results. Since 1924, all the
rich, broad-minded, wide-awake Turks of the homeland went from Xanthi and
Komotini [to Turkey]. Today every Turk is looking for an opportunity to escape. The
Turkish people of the villages and of the town of Komotini flee in groups. 54
34 Through this vague reference to an emigration from Komotini and the surrounding
villages (a careful reader can easily notice that the editor maintains his silence on the
destination of the rich and poor emigrants from Greek Thrace), M. Hilmi skipped over
what had really happened on the Greek-Turkish borders in mid-October 1928. The
presentation of the emigration as a result of a supposedly foreign and yet familiar
power (‘our masters’) did not of course intend to put into question the paternalism
displayed by the Greek and the Turkish states in minority protection since 1923-24. By
silencing any possible critics of the Greek and the Turkish responses to the ‘non-
exchangeables’ emigration, M. Hilmi did not try to hide the news from the public but to
keep on serving a part of the public opinion by defining what could be publicly known
and said in an usual event such as the mid-October 1928 emigration to Turkey. In the
next issue of Yeni Adım, for instance, Hilmi repeated what he had first told in 1927: ‘We,
the Turks of Western Thrace, remain are a mass remaining like a hostage between two
governments.’55
35 Banality advances, of course, when supposedly new and fresh ideas are being repeated.
Following an editorial on a statement which reveals in fact the financial limitations of
the Greek demographic engineering,56 Yeni Adım provided a series of articles in a form
of a memorandum to both governments and the Joint Exchange Commission about the
scarcity of land and pastures, the lack of security,57 national and religious harassment,58
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
71
despair and disarray. As anyone familiar with the newspaper could have predicted,
Hilmi claimed that ‘non-exchangeables’ should be removed from Greek Thrace. 59
36 On the other hand, Yarın editors covered up the emigration incident by reporting some
cases of unsuccessful emigration to Turkey. In the first case, according to Progrès, a
Thessaloniki newspaper, ‘Muslims from Serbia, Romania and Bulgaria had, in recent
days, abandoned their plans of immigrating to Turkey.’60 According to the Yarın editors,
a person who had met a pater familias from Serbia on the train from Alexandroupolis
to Komotini had told the newspaper editors that this family had set off back ‘home’
because the Turkish border authorities had forced his women to remove their
headscarves.61 In fact, Yarın’s insistence that emigrants from the Balkans to Turkey had
a sudden change of heart cannot be understood independently of its editors concern
for authority within the public opinion.
37 If Yarın mentioned the October 1928 emigration from Greek Thrace, it would offer an
explicit refutation of the warnings about the ‘apostate and atheist Ankara regime’. In
other words, that episode would make perfectly clear that the influence of an
‘uncontested’ authority such as the former Shaikh al-Islam had certain limits. This is
also true for the chief editor of Yeni Adım who contented himself with mentioning
vaguely emigration from Greek Thrace without reporting on the bad fortune of the
immigrants. From that perspective, the editors of Yarın equally diverted public
attention from the Greek and the Turkish states’ reactions and plagued ‘non-
exchangeables’ in Greek Thrace by the problem of making choices free of the
constraints placed by the Kemalist regime on the Muslim way of life. This is quite
explicitly said in the call made, after the first article on the Muslims’ withdrawal from
immigration to Turkey, to believe in Yarın’s warnings without being eyewitness of the
Turkish authorities’ political zeal on the border (‘he would not have believed it if he
hadn’t seen it himself’). By lying about the will of the Turkish state to keep ‘non-
exchangeables’ out of Turkey, the editors of Yarın called on them to disregard Yeni Adım
’s pleas for immigration to Turkey and to give their consent to the Lausanne
settlement.
In place of a conclusion
38 Following the Greek military defeat in Anatolia and the arrival of more than a million
refugees in Greece, life conditions changed radically for both these refugees and the
people who were exempted from the population exchange agreed in early 1923 at
Lausanne. As the Greek state undertook to settle these refugees – by carrying on the
continuing policies of demographic engineering introduced by the Ottoman Empire and
pursued by the Bulgarian state – in the territory claimed by the Bulgarian, Greek and
Turkish nationalisms; ‘non-exchangeables’ in Greek Thrace began to leave collectively
either to Turkey or to Bulgaria. The ‘non-exchangeables’ who remained in Greek
Thrace continued to passionately discuss leaving or living in a place which could hardly
remind them of their hometowns due to the state of exception that followed the
massive arrival of refugees and the large-scale Greek demographic engineering.
39 In that debate, which is really hard to reconstruct because of many gaps in the Greek
and the Turkish state archives and of the lack of several Turkish-language newspapers
edited in Xanthi and in Komotini during the 1920s, the disciplinary function of the Yeni
Adım and Yarın editorships cannot be underestimated. Following the October 1928
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
72
emigration to Turkey, the editors of Yeni Adım and Yarın lapsed into silence all by
expressing the conflicting views, ideas, or beliefs of ‘non-exchangeables’ about life in
Greece and in Turkey. Speaking in the name of all the ‘non-exchangeables’ who lived in
Greek Thrace, M. Hilmi expressed the idea of leaving the place immediately, while M.
Sabri and his companions were advocating exactly the opposite, without any of them
telling the public the whole truth about that autumn’s emigration to Turkey and, more
precisely, how the Greek and Turkish state authorities tried to return emigrants to the
status of ‘non-exchangeables’. In fact, the opinion control and the government by
consent of the ‘non-exchangeables’ in interwar Greek Thrace should be more
thoroughly investigated by using with precaution all that had been brought to their
knowledge through means of mass communication like Yeni Adım and Yarın.
BIBLIOGRAPHY
Agamben, Giorgio (1998) Homo sacer. Sovereign power and bare life. Palo Alto, CA: Stanford
University Press.
Agamben, Giorgio (2005) State of exception, Chicago, University of Chicago Press.
Agamben, Giorgio (2011) The Kingdom and the Glory. For a theological genealogy of economy and
government, Palo Alto, CA, Stanford University Press.
Ağanoğlu, H. Yıldırım (2001) Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Balkanların makûs talihi göç, Istanbul, Kum
Saati yay.
Alivizatos, Nicolaos (1979) Les institutions politiques de la Grèce à travers les crises 1922-1974, Paris,
LGDJ.
Başer, Edip (2000) ‘Mütareke’den sonra İstanbul hükümetleri ve Trakya politikaları,’ unpubl. PhD
dissertation, University of Ankara.
Crampton, Richard, J. (2007) Bulgaria, Oxford and New York, Oxford University Press.
Dalègre, Joëlle (1997) La Thrace grecque. Populations et territoire, Paris, L’Harmattan.
Debord, Guy (2002) The Society of the Spectacle (trans. by Ken Knabb), Canberra, Treason Press.
Orig. ed. 1967.
Doxiadis, Apostolos (1928) ‘Apeleftherosis-ypodoulosis thrakiki. Metanastefsis kai egatastasis
thrakiki 1920-1927’, Thrakika, 1, pp. 53-69 (in Greek).
Glavinas, Ioannis (2005) ‘The perception of Muslim minority in Greece in Greek and Bulgarian
policy and strategy (1912-1923)’, Etudes balkaniques, 4, pp. 157-172.
Hersant, Jeanne (2009) ‘Souveraineté et gouvernementalité: la rivalité gréco-turque en Thrace
occidentale’, Critique internationale, 45, pp. 141-162.
Kirlidokme, Riza (2000) ‘Batı Trakya Türklerinin geçmişini yazarken biraz dikkatli olalım’,
Gündem, 29, p. 9.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
73
Kirlidokme, Riza (2008) ‘Yeni Adim [Neo Vima]’, in L. Droulia, G. Koutsopanagou (eds.) Egyklopedia
tu ellinikou tipu 1784-1974, Athens, National Hellenic Research Foundation, vol. 4, pp. 450-451 (in
Greek).
Koutsoukos, Vassilis (2012) ‘Apo tin aftokratoria sto ethniko kratos: khorikes opsis tis
ensomatossis tis Thrakis,’ unpubl.. PhD dissertation, University of Crete.
Ladas, Stephen P. (1932) The Exchange of Minorities: Bulgaria, Greece and Turkey, New York, The
Macmillan Co.
League of Nations (1925) ‘Greece and Turkey - Convention concerning the Exchange of Greek and
Turkish Populations and Protocol, signed at Lausanne, January 30, 1923’, Treaty Series, no. 807, pp.
77-87.
Öksüz, Hikmet (2004) ‘The reasons for immigration from Western Thrace to Turkey (1923-1950)’,
Turkish Review of Balkan Studies, 9, pp. 250-278.
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı (2009) Osmanlı Belgelerinde Batı Trakya, Istanbul, Düzey
Matbaacilik (in Turkish).
Pelagidis, Stathis (1997) Prosfygiki Ellada (1913-1930). O ponos kai i doxa, Thessaloniki, Kyriakidi Bros.
Sarris, Neoklis (1992) Exoteriki politiki kai politikies exelixeis stin proti tourkiki dimokratia, Athens,
Gordios.
Schultze, Joachim Heinrich (1937) Neugriechenland: eine Landeskunde Ostmakedoniens und
Westthrakiens mit besonderer Berücksichtigung der Geomorphologie, Kolonistensiedlung und
Wirtschaftsgeographie, Gotha, J. Perthes.
Şimşir, Bilal N. (1968/1970) Rumeli’den Türk göçleri. Emigrations turques des Balkans. Turkish
emigrations from the Balkans, Belgeler-Documents, Ankara, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü/Türk
Tarih Kurumu.
Toumarkine, Alexandre (2000) ‘Entre Empire ottoman et Etat-nation turque: les immigrés
musulmans du Caucase et des Balkans du milieu du XIXe siècle à nos jours,’ unpubl. PhD
dissertation, Paris IV University.
Trifonov, Staiko (1989) Antanta v Trakiya, 1919-1920, Sofia, Kliment Ohridski (in Bulgarian).
Tsioumis, Konstantinos (1994) ‘I musulmaniki mionotita tis Ditikis Thrakis ke I ellinoturkikes
skesis (1923-1940),’ unpubl. Phd dissertation, Univ. of Aristotle.
APPENDIXES
Sources and abbreviations
• AMFA: archive of the Ministry of Foreign Affairs (Athens)
• AVBM: archive of E. Venizelos, Benaki Museum (Athens)
• BCA: Prime Minister archive of Republican period (Ankara)
• BOA: Prime Minister archive of Ottoman period (Istanbul)
Selected newspapers
• Adalet (‘Justice’), Komotini, unknown period of publication
• Yarın (‘The Day After’), Xanthi/Komotini, from 22 July 1927 to 5 September 1930
• Yeni Adım (‘The New Step’), Xanthi, from 30 September 1926 to 5 September 1930
(available issues)
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
74
• Yeni Yol (‘The New Way’), Xanthi, from 11 February 1926 to 6 March 1926
• Yeni Ziya (‘The New Light’), Xanthi, from 10 June 1924 to 5 January 1926
NOTES
1. ‘Non-exchangeable’ or ‘established’ were two equivalent terms introduced in opposition to the
terms ‘exchangeable’ or ‘exchanged’ by the Convention on the Exchange of Greek and Turkish
Populations, signed at Lausanne on January 30th 1923. Following the Article 2 of the Convention,
‘the following persons shall not be included in the exchange provided in Article 1: (a) the Greek
inhabitants of Constantinople (b) the Moslem inhabitants of Western Thrace. All Greeks who
were already established […]’. For a full text of the Convention, see League of Nations, 1925: 77-87.
2. In Bulgarian, Giumurdjina / in Greek, Giumuldjina, since 1920, in Greek, Komotini.
3. In Bulgarian and in Greek, Dedeagatch, since 1920, in Greek, Alexandroupolis.
4. Osmanlı belgelerinde Batı Trakya, 2009: 288.
5. www.devletarsivleri.gov.tr
6. It would be important to remind here G. Agamben’s philosophical inquiries (1998, 2005, 2011)
on the origins of the state/sovereign power and of the power in its governmental and spectacular
aspects in the West, which calls into question the easygoing understanding of the state loyalty
and, more particularly, the opposition between friend and enemy which is fundamental in
western politics according to the jurist C. Schmitt (1885-1985).
7. While C. Tayyar and his followers were for the repatriation of these refugees in order to make
clear the majority in the former Bulgarian Thrace, the Istanbul government under A. Riza was
afraid both of the Entente reaction to that repatriation and of the Muslim population’s
weakening in the vilayet of Andrianople during the Paris peace conference, for more details see
Başer, 2000: 135-140.
8. Venizelos, 17 October 1922, letter to the Greek Ministry of Foreign Affairs, no. 3435, AVBM, D.
42.
9. Scattered archival documents mention emigration of groups of 84 or 135 ‘non-exchangeables’
to Bulgaria, see for instance, the reports dated 7 September 1924, BCA, 30.10/219.479.8 and 8
October 1924, BCA, 30.10/219.479.12.
10. This becomes clear from the application made by the General Director of Consular and
Commercial Affairs of the Turkish ministry of Foreign Affairs to the undersecretary of the Prime
Minister’s office for an exception of a clerk in the General Direction of Consular and Commercial
Affairs from the provisions of the 4 November 1923 governmental decision, see document dated
16 May 1926, BCA, 30.10/116.808.2.
11. General Staff order no. 5703/2413, prot. no. 9926 / 19 August 1926, AMFA, D. 1926/Γ/68/ΑΠΕ;
D. 1926/Γ/68/VI. A second order issued by the General Staff in 20 October 1926 is mentioned by
the Greek Ministry of Foreign Affairs in mid-October 1928, see infra.
12. Hilmi, ‘Kirpikleri uzundur yarık hayale sığmaz; bu eski misaldir, mızrak çuvala sığmaz’,Yeni
Ziya, no. 35 / 15 November 1924, p.1.
13. Report of the neutral members of the Mixed Exchange Commission to the League of Nations, 29
November 1925, AMFA, D. 1928/80.7.
14. Report of the General Direction of Political Affairs of the Turkish Ministry of Foreign Affairs,
prot. no. 22642/102, 12 May 1925, BCA, 30.10/253.708.44.
15. Reports of the mufti of Alexandoupolis, 25 and 27 April 1925, AMFA, D. 1930/B.
16. Confidential communication of May bulletin of intelligence service by the General
Administration of Thrace, prot. no. 889 / 15 June 1925, AMFA, D. 1925/A/2,1.
17. Ibid.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
75
18. For relevant information see bureaucratic correspondence between 29 December 1923 and 15
June 1924 conserved in BOA, HR. IM.
19. Circular by the Governor General of Thrace to the muftis of Thrace, prot. no. 13087 / 29 April
1924, AMFA, D. 1924/B/33, 2.
20. Communication of a Circassian chief bandit by the Special Security Service, prot. no. –
[missing] / 21 June 1924, AMFA, D. 1925/A/2,1.
21. It would be important to remember that the political program of the Comintern included
since 1923-24 the independence of Macedonia and Thrace from the Balkan nation states. This fact
provides a good indication of the Greek authorities’ eagerness to undermine wishful thinking
about the continuation of the Kuvvayi Milliye task, through confusion, more precisely, by
consenting to the diffusion of an emancipation plan opposed both to Turkish irredentism and to
Greek nationalism.
22. On the progressive extension of the provisions of the martial law in Greece since autumn
1922, see Alivizatos, 1979: 19 and passim.
23. Pro-Turkey minority members claimed that minority’s progress would result from the
Kemalist reforms and that the minority’s protection was ensured by the Turkish state against the
Greek state. Conversely, pro-Greece minority members argued that minority’s existence
depended on the minority’s protection by the Greek state from Kemalist atheism. Throughout
the debate, the Greek state appeared as if it opposed Kemalist modernization, while the Turkish
state appeared as the protector from Greek nationalism and the persecutor of the Muslim way of
life.
24. Report by the president of the 9th Exchange Sub-Commission, 18 February 1926, AMFA,
D. 1930/B.
25. Telegram by the Greek Consulate in Istanbul, 18 February 1926, AMFA, D. 1930/B.
26. Hilmi, ‘Ehem muhime tercih olunur’, Yeni Yol, no. 2 / 15 February 1926, p.2.
27. Nuri, ‘Mübadele yoktur ve olamaz! Aldanmayalım’, Adalet, no. 7 / 23 May 1926, p.1.
28. Hilmi, ‘Nasıl mebus isteriz?’, Yeni Adım, no. 1 / 30 September 1926, p.1.
29. Confidential report by the deputy of the Governor General of Thrace, prot. no. 14578 / 16 July
1927, AMFA, D. 1929/B/61.
30. Fehmi (?), ‘Mesleğimiz’, Yarın, no.1 / 22 July 1927, p.1.
31. Hilmi, ‘Rodop Vali-i Umumisi – Ğarbi Trakya Türkleri ve Yeni Adım’, Yeni Adım, no. 40 / 4 May
1927, p.1-2.
32. Hilmi, ‘Nazar-i dikkate’, Yeni Ziya, no. 40 / 20 December 1924, p.3.
33. Hilmi, ‘Sansür’, Yeni Adım, no. 97 / 18 February 1928, p.2.
34. Notice by the Turkish ambassador to the Greek minister of Foreign Affairs, prot. no. 8746 / 21
July 1928, AMFA, D. 1927-28/93.2 (B)
35. Report by the Governor General of Thrace, prot. no. 920 / 13 September 1928, AMFA, D.
1927-28/93.2 (B)
36. Encrypted telegram by the General Administration of Thrace to the Greek Ministry of Foreign
Affairs, prot. no. 11302 / 13 October 1928, AMFA, D. 1929/B/37.
37. Order by the Greek Ministry of Foreign Affairs to the Greek General Staff, prot. no. 11025 / 15
October 1928, AMFA, D. 1929/B/37
38. Encrypted telegram by the Greek Ministry of Foreign Affairs to the General Administration of
Thrace, prot. no. 11302 / 19 October 1928, AMFA, D. 1929/B/37. Due to the lack of relevant
information, we cannot describe this extraordinary population census.
39. Report by the Turkish delegation to the Mixed Exchange Commission, no. 29295 / 22 October
1928, AMFA, D. 1928/80.7.
40. Report by the Turkish delegation, no. 29295 / 22 October 1928, AMFA, D. 1928/80.7. Compare
to the report by the Turkish Ministry of Interior, 24 October 1928, BCA, 30.10/81.530.12.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
76
41. Report by the Greek delegate to the 9th Exchange Commission to the Greek vice-president of
the Mixed Exchange Commission, 23 October 1928, AMFA, D. 1928/80.7
42. Ibid.
43. Ibid.
44. It seems that passports were issued on the request either of a single person or of a group
leader like a family chief. According to Greek estimates, twenty-two families had immigrated
illegally to Turkey from 25 July to 29 October 1928, see report by the deputy Governor General of
Thrace, prot. no. 1057 / 29 October 1928, AMFA, D. 1929/B/37.
45. Ibid.
46. Ibid.
47. Ibid.
48. If this was true, it implies that Greek authorities were checking private correspondence.
49. Report by the Greek delegate to the 9th Exchange Commission to the Greek vice-president of
the Mixed Exchange Commission, 23 October 1928, AMFA, D. 1928/80.7
50. Ibid.
51. Hilmi, ‘Bu şerait dahilinde hayat bizim için imkânsız’, Yeni Adım, no. 160 / 17 October 1928, p.
1.
52. Hilmi, ‘Lozan muahedenamesinin ma’hud maddesi – imha tedbirleri – muhacir iskânı – Turkia
kaçakları – netice…’, Yeni Adım, no. 39 / 24 April 1927, p.1; Hilmi, ‘Bir az da mebuslarla
konuşalım…’, Yeni Adım, no. 42 / 14 May 1927, p.1.
53. Confidential report by the Administration Inspector, A. L. Dasios, prot. no. 8922 / 25 June
1927, AFAM, D. 1927/93.3 (2).
54. Hilmi, ‘Bu şerait dahilinde hayat bizim için imkânsız’, Yeni Adım, no. 160 / 17 October 1928, p.
1.
55. Hilmi, ‘Muhtelit Mübadele Komisyonları geliyormuş, ne görecekler?’, Yeni Adım, no. 161 / 20
October 1928, p.1.
56. ‘If this coffee shop can contain 100 people and we have to put 200 people in it, then we must
either kill or throw out 100 of them’ was a statement made by a Refugee Settlement Commission
agent and illustrated, following M. Hilmi, very well the non-exchangeables’ situation in Greece.
See M. Hilmi, ‘Vazıyetimiz hakkında pek güzel bir misal’, Yeni Adım, no. 162 / 24 October 1928, p.
1.
57. Hilmi, ‘Vazıyetimizin icmali (Mukaddeme)’, Yeni Adım, no. 167 / 10 November 1928, pp.1-2.
58. Hilmi, ‘Vazıyetimizin icmali (Millî ve dinî hakaretler)’, Yeni Adım, no. 168 / 14 November 1928,
pp.1-2.
59. Hilmi, ‘Vazıyetimizin icmali (Netice)’, Yeni Adım, no. 169 / 17 November 1928, p.1.
60. Fehmi (?), ‘Geç değil mi?’, Yarın, no. 33 / 23 November 1927 – 10 Cemaziyel’ahır 1347, p.3.
61. Fehmi (?), ‘Gözüyle görmeden inanmamış!’, Yarın, no. 35 / 21 December 1927 – 8 Receb 1347,
p.3.
ABSTRACTS
Contrary to what the title of this article may eventually lead to understand, this paper is mainly
about the management of public opinion by the editors of two newspapers published in interwar
Thrace, Yeni Adım and Yarın. More precisely, this paper focuses on their use of the news that
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
77
spread by mid-October 1928 among the ‘non-exchangeable’ inhabitants in Greek Thrace,
regarding the emigration of their fellows to Turkish Thrace and the reactions of the Turkish and
Greek authorities to that small scale migration. The emigration of ‘non-exchangeables’ from
Greek Thrace has already been considered as the main reaction of that people who had been
exempted, in early 1923, from the compulsory exchange of Greek and Turkish populations, to
state policies that aimed to settle ‘exchangeables’ in Thrace. While offering a historical account
of the Greek demographic engineering in two Ottoman provinces which had formed a Bulgarian
province between 1913-19, this paper describes how ‘non-exchangeables’ debated the emigration
to Turkey, which has been curiously neglected as an issue of public debate by current scholarship
on that minority. The paper also dwells on the transformation of the public sphere of ‘non-
exchangeables’ following the establishment of a Turkish Consulate in Komotini and the spread of
Turkish-language newspapers from Xanthi and Komotini. My focus then tries to identify the
ways people tried to pass the Greek-Turkish border in autumn 1928, the ways the Turkish and
Greek authorities tried to stop that ‘leak’ of ‘non-exchangeables’ and to reassign that status those
who had tried to leave it, and, at last, the ways Yeni Adım and Yarın editorial teams spoke about
these particular events in the name and place of their audiences, the ‘Western Thrace Turks’ and
the ‘Muslims of Western Thrace’ respectively. Since this investigation rests on information and
opinions exchanged through newspapers, the present paper necessarily addresses the need to
move from the traditional approach of the ‘state minority policy’ towards questions of
‘government by consent’.
INDEX
Mots-clés: Bulgarie, émigration, ingénierie démographique, Empire ottoman, non-échangeables,
musulmans, Thrace de Grèce
Keywords: Bulgaria, emigration, demographic engineering, Greek Thrace, non-exchangeables,
Muslims, Ottoman Empire
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
78
How the North was won
Épuration ethnique, échange des populations et politique de colonisation
dans la Macédoine grecque.
How the North was won. Ethnic cleansing, population exchange and settlement
policy in Greek Macedonia.
Tassos Kostopoulos
1 S’il est une région de la Grèce où l’ « ingénierie démographique » fut appliquée comme
un élément plus ou moins constant de la politique étatique, c’est bien la Macédoine.
Après l’incorporation de cette région dans le royaume grec en 1913 et jusqu’aux années
1960 au moins, des plans pour la transformation radicale de la composition ethnique de
sa population se sont succédés pendant des décennies ; certains de ces projets avaient
l’aval enthousiaste de la « communauté internationale » de leur temps, tandis que
d’autres étaient formulés dans le secret le plus absolu ; une partie de ces plans ont été
appliqués, d’autres sont restés finalement sur le papier. En général, pourtant, cette
politique a produit des résultats impressionnants : la Macédoine grecque est
aujourd’hui une province de caractère national grec, avec des îlots de minorités
ethniques qui hésitent pourtant à se déclarer publiquement comme telles ; elle ne
ressemble en rien avec la région multilingue, multiethnique et multiconfessionnelle
occupée par les armées helléniques il y a plus d’un siècle.
2 Il faut cependant noter ici que la notion d’ « ingénierie démographique », sans doute
très utile pour désigner une activité étatique aspirant au changement radical de la
composition ethnique des régions contestées ou perçues comme telles, présente
néanmoins des problèmes de généralisation considérables. D’après les spécialistes qui
ont introduit ce terme dans le discours politique et scientifique, l’ « ingénierie
démographique » peut comprendre des formes d’action étatique aussi diverses que
l’instrumentalisation ou le trucage des recensements, les politiques pro-natalistes,
l’assimilation des groupes minoritaires, les transferts de population, la colonisation des
régions frontalières, la promotion des mouvements sécessionnistes et / ou
irrédentistes, l’exercice de pressions économiques discriminatoires sur des groupes
minoritaires, les restrictions à l’entrée des immigrants sur le territoire national ou
même l’encouragement de l’émigration pour atténuer les pressions économiques et
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
79
sociales créées par la surpopulation (Bookman 1997: 32-4 ; Weiner et Teitelbaum
2001 : 55-7). D’autres analystes circonscrivent son usage aux seuls mécanismes
complémentaires de l’épuration ethnique (réalisée par des moyens ouvertement
violents ou plus subtilement par des politiques discriminatoires) et du peuplement des
régions contestées avec des colons faisant partie de groupes ethniques proches du
pouvoir (McGarry 2000). Il y a même des cas où le terme « demographic engineering » est
utilisé principalement pour décrire des politiques infiniment plus meurtrières, comme
le génocide arménien (Şeker 2007).
3 On doit donc clarifier dès le départ les pratiques que l’État grec a mis en œuvre pour
transformer le paysage démographique dans ses provinces macédoniennes, depuis
l’incorporation de ces territoires en 1912-1913 (et même avant cette date) jusqu’aux
années 1960. Il faut d’abord dire que les pratiques en cause n'ont jamais atteint le
niveau du massacre généralisé comme dans le cas arménien, avec des déportations
massives de populations entières en vue de leur destruction physique. Le nombre des
assassinats politiques fut toujours limité, même pendant les années où la guerre faisait
rage dans la région (guerres balkaniques de 1912-1913, première et seconde guerres
mondiales, guerre civile grecque de 1946-1949). On peut cependant noter l’existence,
ponctuellement, de véritables campagnes d’épuration ethnique, avec destruction
physique des lieux et expulsion des habitants au-delà des frontières ; c’est plutôt le
modus operandi « à l’israélienne », pratiqué par l’armée et les autorités grecques, qui ont
profité des circonstances de guerre pour appliquer un terrorisme sélectif à l'encontre
des communautés visées afin de contraindre une partie substantielle du groupe
ethnique indésirable à s’exiler1. Beaucoup plus intéressants sont les plans qui étaient
élaborés (et souvent matérialisés) en temps de paix et qui envisageaient la
transformation ethnique du terrain par des moyens plus sophistiqués et moins violents.
En tout cas, le changement le plus radical dans ce domaine est apparu non comme le
résultat d’une planification à long terme de la part des gouvernements helléniques,
mais comme celui de l’intervention de la « société internationale » de l’entre-deux-
guerres pour régler une fois pour toutes la Question d’Orient : on se réfère à l’échange
réciproque, à grande échelle et obligatoire, des minorités nationales de la région.
4 La politique macédonienne de l’État grec pendant le XXe siècle balance constamment
entre l’intervention démographique, visant à éliminer ou au moins à réduire
démographiquement les minorités ethniques dans la région, d’un part, et la politique
assimilatrice qui a comme but la transformation des populations « xenophones » en
« Grecs purs », de l’autre. La première est d’habitude considérée par le plupart des
acteurs intervenant sur le terrain comme une condition préalable essentielle pour le
succès de la seconde :l’ « ennemi national » étant perçu comme composé de la faction
nationaliste de ces mêmes communautés dont on envisage l’assimilation linguistique et
nationale, une épuration sélective des noyaux non-assimilables s’impose comme
première priorité, afin que l’intégration nationale de la partie qualifiée comme ayant
« une conscience nationale fluide2 » soit enfin possible. Cette tactique de
« saucissonnage » produit pourtant de nouvelles ruptures au sein de la population
destinée à l’assimilation, forçant une partie de cette dernière àréévaluer son attitude
envers le nationalisme et l’État-nation grecs. Au fils des ans, on enregistre ainsi une
régénération permanente de l’ennemi intérieur (i.e. de celui qui est perçu comme tel)
qu’il faut à nouveau éloigner du territoire national. Cercle vicieux ou rocher de Sisyphe,
selon l’angle choisi par l’observateur…
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
80
5 Une dernière remarque, sur les acteurs de l’ingénierie démographique qu’on va décrire
dans cet article.Jusqu’à l’incorporation de la Macédoine méridionale dans l’État grec en
1912-1913, toute planification politique concernant la région convoitée est l’œuvre
exclusive d’un appareil centralisé : diplomates, envoyés spéciaux et dirigeants du
Comité macédonien constitué à Athènes en 1904 pour mener une propagande armée
dans le territoire ottoman sans implication officielle du gouvernement grec.Pendant la
première décennie de la souveraineté grecque sur la région, cette tradition centraliste
survit plus ou moins, en même temps qu’on perçoit l’introduction des nouveaux
acteurs dans le jeu : des cadres supérieurs de l’armée et de la bureaucratie
administrative, ainsi que quelques politiciens locaux issus des luttes nationales de l’ère
ottomane. C’est seulement après l’échange de populations des années 1920 qu’on
observe une « démocratisation » de ce processus, avec l’intervention spontanée d’une
pléïade de cadres de rang intermédiaire ou même subalterne (par exemple de simples
maîtres d’école)qui proposent au gouvernement ou à ces représentants des mesures à
prendre pour « éradiquer le problème » de la présence d’une minorité en Macédoine
grecque.La presse locale et – surtout – celle d’Athènes contribuent aussi à créer un
climat de danger national imminent et réclame des mesures spéciales pour que ce
danger soit écarté. On peut cependant s’interroger sur l’existence d’une « main
invisible » de l’appareil sécuritaire profond derrière ces interventions « spontanées » ;
la fourniture aux journalistes de passage de listes de villages « dangereux », l’existence
de rapports d’instituteurs quasi-identiques mais théoriquement composés par des
personnes différentes à quelques années de distance (sur ces rapports, découverts dans
les archives, cf. Iliadis 1931, Papadopoulos 1936)éveillent le soupçon.La situation
pendant l’immédiat après-guerre est, elle, totalement différente : une multitude
d’acteurs locaux s’exprime alors sur l’amplitude et les modalités de l’épuration des
« éléments étrangers ». Si la décision finale est toujours l’œuvre des instances centrales
du gouvernement et de l’appareil administratif, cette mobilisation indique cependant
un état d’esprit généralisé au niveau des appareils nationalistes locaux, qui a beaucoup
contribué au développement d’une campagne d’épuration ethnique de facto sur le
terrain.Il faut enfin noter que cette tradition d’intervention nationaliste, exigeant et
proposant des mesures « radicales »,pour sécuriser le pays une fois pour toutes contre
l’ennemi intérieur, a survécu à un certain degré durant la décennie sanglante des
années 1940; des politiciens locaux et des agents des services secrets sur place ont ainsi
continué au fils des ans à « bombarder »l’appareil central avec des projets d’ingénierie
démographique, et cela jusqu’aux années 19703.
I. AVANT L’ORAGE (1870-1912)
6 Le problème le plus crucial auquel le Royaume de Grèce a été confronté avant (et
immédiatement après) l’annexion en 1913 de la partie méridionale de la Macédoine,
était le hiatus entre le discours nationaliste dominant, qui postulait le caractère
majoritairement grec de la région, et les réalités ethniques rencontrées par ses agents
sur le terrain. D’après les statistiques officielles grecques, établies a posteriori et
sanctionnées officieusement par la Société des Nations dans les années 1920, environ
1 205 000 personnes habitaient en 1912 dans la future Macédoine grecque, dont 513 000
Grecs (42,6 %), 475 000 musulmans (39,3 %), 119 000 « bulgarisants » (9,9 %) et 98 000
« divers », en majorité des Juifs (Pallis 1925 : 11-3, SdN 1926 : 163-5). En fait, sur à peu
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
81
près 1 250 000 habitants, la population chrétienne grécophone de la région ne dépassait
pas 360 000 individus (29 % du total), tandis que les musulmans, toutes langues
confondues, étaient au moins 450 000 et les chrétiens slavophones entre 250 000 et
300 000. En ce qui concerne la population de la Macédoine ottomane entière en 1912,
elle peut être estimée aux alentours de 2 500 000 dont 900 000 musulmans, 900 000
chrétiens slavophones divisés depuis longtemps en trois ou quatre « partis nationaux »
rivaux (bulgare, grec, serbe et – à partir du début du XXe siècle – macédonien), 360 000
chrétiens grécophones, quelques 100 000 Valaques, entre 70 000 et 90 000 Juifs, des
petites minorités de chrétiens albanophones ou turcophones plus un nombre
indéterminé de Tsiganes) (Kostopoulos 2002, 2007 : 25-6, 157-66) 4.
7 La dispersion géographique de l’élément « grec pur », c’est-à-dire grécophone, posait
des difficultés supplémentaires pour les architectes de l’irrédentisme grec : la plupart
des chrétiens grécophones habitaient le littoral et les provinces de la Macédoine du
sud-ouest frontalières de la Grèce ; plus au nord, la présence grecque était confinée à
quelques centres urbains, « encerclés » par une campagne plus ou moins slavophone. «
Au nord de la ligne qui relie [les villes de] Kastoria, Niaousta, Salonique, Serres et Drama il n’y
a aucune commune grécophone, sauf Meleniko », constatait par exemple en 1903 le
diplomate Ion Dragoumis, un des défenseurs le plus ardents de l’implication politico-
militaire de la Grèce dans les affaires macédoniennes (Petsivas 2000 : 623) 5. Ses
remarques sont partagées par la totalité des concepteurs de la politique extérieure
hellénique dans leurs analyses confidentielles, en pleine contradiction avec le discours
officiel qui mettait lui l’accent sur l’ « hellénisme éternel » de la région. Konstantinos
Paparrigopoulos par exemple, père fondateur de l’historiographie nationale grecque et
en même temps président de l’Association pour la propagation des Lettres grecques
(organisme semi-officiel fonctionnant comme service de renseignements et de
pénétration politique vers les territoires irrédents de l’Empire ottoman), constatait
aussi en 1884 que, au nord de cette même ligne, « la langue grecque n’est parlée nulle part
comme langue maternelle, exception faite pour Meleniko et en partie pour Nevrokop »
(Paparrigopoulos 1884 : 3c).
8 Malgré cette situation ethnique peu propice à l’irrédentisme grec, la Macédoine était
convoitée pour des raisons plutôt « historiques », économiques et – surtout –
géostratégiques : elle constituait le corridor indispensable pour l'établissement d’une
continuité terrestre entre le royaume grec et ses terres irrédentes dans la Thrace
orientale grécophone et Constantinople, la capitale du futur État byzantin reconstitué
par la « Grande Idée » (Paparrigopoulos 1884 : 7a-7b). La proposition stratégique de
Paparrigopoulos, adoptée par les gouvernements de l’époque et idéologiquement
validée – malgré son avis – par la délimitation théorique d’une Macédoine
« historique » qui devait être réduite « aux seuls endroits où l’Hellénisme pouvait se
présenter comme prépondérant » (Paparrigopoulos 1885), était la démarcation de trois
« zones » différentes dans la Macédoine ottomane, en allant de l’ouest vers l’est, zones
délimitées conformément au degré de l’influence nationale grecque dans chaque
région. La zone la plus au nord était considérée comme « définitivement perdue » pour
l’hellénisme, tandis que la plus méridionale (où la population chrétienne était
grécophone ou totalement liée au « parti grec ») fut désignée comme « purement grecque
» ; la zone centrale, presque totalement « xenophone », constituait enfin l’enjeu
principal du conflit national acharné entre les mouvements nationaux grec et bulgare
(Paparrigopoulos 1884).
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
82
9 La lutte gréco-bulgare pour l’allégeance de la population slave de la Macédoine était
surtout une bataille politique, utilisant toutes les modalités d’un jeu partisan classique
pour renforcer son « parti » (et affaiblir ou démanteler celui de l’adversaire) dans
chaque ville, village ou hameau du pays. Dans la première décennie du XX e siècle, cette
confrontation politique, de même que la lutte identique serbo-bulgare plus au nord, se
sont transformées en guerre civile entre les partis nationaux rivaux. Le point de
rupture fut la révolte avortée d'Ilinden (1903), qui aboutit à la crise ouverte du
mouvement autonomiste macédonien et à l’intervention des puissances européennes
qui préconisèrent une future « modification dans la délimitation territoriale des unités
administratives » de la région « en vue d’un groupement plus régulier des différentes
nationalités » – préconisation que tous les intéressés ont interprété comme le premier
pas vers le partage définitif de la Macédoine6. En marge de cette lutte politico-militaire,
des plans ont été néanmoins dressés à diverses reprisespar l’appareil dirigeant grec
pour entraîner des changements dans l’équilibre ethnique de certaines régions du pays
qui étaient considérées comme importantes du point d'un point de vue stratégique 7. La
première proposition de ce genre a été probablement formulée en 1880 par Athanasios
Eftaxias. Envoyé par le gouvernement d’Athènes en Macédoine pour étudier la situation
du pays et donner son avis sur la politique nationale à suivre, Eftaxias a rédigé un petit
livre de 48 pages, « imprimé à compte d’auteur » et diffusé dans un cercle limité
d’initiés. Il y explique que la prépondérance ethnique de l’élément slave dans les
provinces macédoniennes ne laisse qu’un seul champ d’action à l’intervention grecque :
l’achat massif par des entrepreneurs grecs de tchifliks et l’usage musclé de la raison
patronale pour forcer leurs cultivateurs slavophones à s’helléniser du point de vue
national mais aussi linguistique, grâce aux écoles grecques qui seraient créées et
entretenues par les nouveaux propriétaires dans leurs villages. Une fraction du revenu
produit par cette entreprise devait financer les activités assimilatrices organisées par
un « conseil des citoyens de bonne réputation » basé à Salonique. Le succès économique
était considéré comme assuré d’avance, étant donnée la dépréciation de la valeur de la
terre et de la main d’œuvre agricole dans la partie européenne de l’Empire ottoman
après la guerre russo-turque de 1877-1878 (Eftaxias 1880). Malgré leur originalité, peut-
être aussi à cause de celle-ci, les propositions d’Eftaxias n’ont guère influencé le modus
operandi de l’appareil grec – inertie qui s'explique surtout par le niveau peu élevé du
capitalisme grec de l’époque, qui par ailleurs n’a pas encore épuisé son potentiel
expansionniste à l’intérieur du royaume, et par l’inexistence des entreprises de grande
taille capables d’un effort systématique au-delà des frontières (Hatziiosif 1993 : 147).
L’existence des propriétaires grecs de tchifliks et leur activité en faveur de la cause
nationale hellénique resta alors le résultat exclusif d’une « main invisible » de l’État
grec guidant les forces purement économiques8.
10 Plus radicales encore étaient les propositions faites par Ion Dragoumis, au début du XX e
siècle. En sa qualité de chargé d’affaires du consulat de Serres, il dressa en décembre
1903 un plan pour l’hellénisation des populations slavophones, centré non pas sur la
pénétration scolaire, qui était considérée comme insuffisante, mais sur l’intervention
économique et le contrôle de la terre, en envisageant même la colonisation des régions
contestées par des « Grecs purs » [καθαρούςΈλληνας], c’est-à-dire grécophones. La
présence de ces derniers dans les communautés « xénophones » était considérée
comme indispensable pour l’assimilation linguistique progressive des autres habitants,
à condition que les colons grécophones soient surveillés « pour ne pas perdre eux-
mêmes leur langue ». Dans son rapport, Dragoumis reconnaissait les difficultés
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
83
inhérentes à une telle entreprise : malgré l’abondance des populations grecques
« enclines à émigrer », notait-il, la canalisation de cette émigration vers la Macédoine
était très difficile à cause des mauvaises conditions de vie prévalant là-bas, mais aussi
parce que très peu des Grecs étaient disposés à travailler la terre « comme des serfs »
dans les tchifliks9. La solution proposée était le soutien financier des futurs colons par
une banque ou société agricole, après consultation de celle-ci avec le gouvernement
grec (Petsivas 2000 : 628-30). Trois ans plus tard, Dragoumis a élaboré ses plans avec
encore plus de précision dans un rapport de 22 pages qu’il a rédigé alors qu'il était
consul à Dedeağaç (aujourd’hui Alexandroupoli). Dans ce document, des mesures sont
proposées pour stopper la « descente graduelle » des populations slavophones vers le
sud et les centres urbains de la Macédoine (et de la Thrace), « descente » qui s’opérait
depuis des siècles pour des raisons purement économiques, mais qui, avec l’avènement
du réveil national bulgare et l’aube de l’ère démocratique en Europe, représentait
désormais un danger pour la prépondérance grecque au sein de la population
chrétienne locale. À ces nouveaux venus qui se répandaient « comme une infection ou
comme la gale », écrit Dragoumis, l’appareil grec devait opposer une politique de
guerre économique menée si possible en coopération avec les autorités ottomanes. Le
plan prévoyait entre autres l’interdiction de nouvelles installations de paysans
slavophones dans les villes et de l'achat de terre par eux, interdiction motivée
officiellement par le danger posé par les comitadjis slaves contre l’ordre public ; les
moukhtars patriarchistes devaient ainsi être incités à refuser de cautionner n’importe
quel transfert de terre aux mains de slavophones exarchistes, nouveaux venus ou
simplement non enclins à l’hellénisation ; une guerre économique larvée empêcherait,
enfin, le développement de ces slavophones déjà installés sur place. Dans les villes, les
professionnels slavophones devraient être remplacés par des boulangers et des
fourniers épirotes « invités sur place » sans beaucoup de bruit ; aussi discrètement
seraient aussi remplacés les domestiques, valets et serviteurs slavophones chez les
particuliers ou dans les magasins grecs. Dans la campagne, une Banque agricole irait
acheter massivement des terres pour y installer des agriculteurs grecs « locaux ou
transférés d’autres territoires grecs ». En général, selon le vocabulaire de Dragoumis,
l’idée centrale du projet était de pallier le »manque d’un nombre satisfaisant de Grecs »
dans les régions convoitées par le recours généreux à « l’usage de l’argent grec » ; ses
promoteurs pouvaient pourtant « aller jusqu’à la violence » pour atteindre leur but
(Dragoumis 1906 : 17-22).
11 Le degré avec lequel ces idées furent appliquées dans la pratique reste à clarifier. Au
début du XXe siècle, le capitalisme grec était certes beaucoup plus extraverti et
dynamique que vingt ans auparavant, quand le livre d’Eftaxias avait été « imprimé
comme manuscrit » ; les obstacles « techniques », économiques ou purement politiques
rencontrés en cours de route restaient néanmoins assez considérables. Dans les
archives diplomatiques de l’époque, on trouve souvent des propositions concrètes pour
le rachat de tel ou tel tchiflik, suivies dans plusieurs cas par la suggestion de
l’implantation de « familles grecques » sur place. Le chef du Comité gréco-macédonien
d’Athènes, Panagiotis Danglis, cherche par exemple en 1909 « cinquante familles
grecques au moins, pour les installer dans les villages de Berantsi et Mogila, propriétés
de M. Oikonomou, pour être utilisées comme appui et lieu de résidence aux
propagandistes grecs envoyés dans la région de Monastir » ; dans ce même rapport,
Danglis propose au ministère des Affaires étrangères le rachat d’une partie du tchiflik de
Novak, dont le propriétaire était grec, pour effectuer une implantation similaire,
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
84
justifiée par des raisons d’ordre stratégique (Danglis 1909). Presque simultanément, le
consul grec de Serres, Antonios Sahtouris, sonne le tocsin face à la mobilisation des
paysans slavophones par l’aile gauche de l’ex-ORIM (Organisation révolutionnaire
interne macédonienne)10, qui demandait la répartition de la terre aux
cultivateurs. Dans cette perspective, qui aurait comme conséquence pour la Grèce « la
perte de la zone contestée [de la Macédoine], c’est-à-dire de la question
macédonienne », Sahtouris propose aussi l’achat sélectif des tchifliks (appartenant à des
« nôtres » ou considérés comme « stratégiques » à cause de leur situation), pour les
attribuer aux paysans sous des conditions assurant à long terme leur loyauté envers le
« parti grec ». La négociation pour la distribution des terres devait ainsi avoir lieu entre
le consulat et les chefs des communautés, les paysans n’obtenant la propriété des
champs qu’après dix ou vingt ans, durée estimée suffisante pour leur assimilation et
pour « la préparation d’une nouvelle génération grecque » dans les villages. Pour
faciliter ce processus, le consul envisageait aussi l’installation dans ces mêmes villages
« de familles agricoles grécophones de Lazes, de Caucasiens ou d’autres réfugiés » (Pop-
Gueorgiev et Shishkov 1918 : 44-8). La possibilité de la colonisation par des Lazes était
aussi invoquée par Danglis, dans ces projets pour la région de Monastir (Danglis 1909).
La matérialisation de ces plans fut néanmoins assez discutable. On sait, par exemple,
que quelques-unes des propositions en cause furent rejetées par les banques sondées
pour leur financement, sous prétexte qu’elles n’avaient pas les capitaux nécessaires ou
que les prêts hypothécaires sortaient du cercle de leurs activités (Hatziiosif 1993 : 159).
Un cas assez exceptionnel fut ainsi celui du village d’Elovo (aujourd’hui Elatia), dans le
kaza de Florina : quand les propriétaires turcs de ce tchiflik albanophone annoncèrent à
l'automne 1906 leur disposition à le vendre, le consulat grec du Monastir soutint son
achat par la communauté patriarchiste locale avec des prêts alloués par la Banque
d’Orient sous garantie de l’État grec ; cette intervention était considérée comme vitale
pour le maintien du rapport des forces dans la région, étant donné que les champs du
tchiflik étaient aussi convoités par les paysans slavophones des villages voisins Dolno
Kotori (aujourd’hui Kato Ydroussa) et Koutchkoveni (aujourd’hui Perasma). Le tchiflik
fut finalement acheté en deux phases, en 1907 et 1909, et quinze familles albanophones
du village voisin Belkamen (aujourd’hui Drosopigi) y furent installées après 1909
(Giagiorgos 2000 : 143-4 ; Musée de la lutte macédonienne 1997 : 310-2 ; Dimaras 1909).
12 Si le manque relatif de crédits disponibles de la part de l’État grec (engagé, dans le
même temps, dans un effort politico-militaire de grande envergure pour la
reconstitution du « parti grec » déciméen Macédoine après la révolte d’Ilinden) peut
expliquer les limites de l’implication étatique dans l’achat des tchifliks, l’absence de
l’initiative privée dans ce domaine doit être surtout attribuée au climat politique et
social instable créé par la révolte des paysans slavophones encadrés par le guérilla de
l’ORIM. D’après les Mémoires de Periklis Argyropoulos, à l’époque membre de la
direction du Comité gréco-macédonien d’Athènes, « l’occasion était unique » grâce à la
baisse des prix des terres et l’encouragement de l’installation des Grecs parmi la
population slavophone de la part des autorités ottomanes ; cette même conjoncture a
cependant empêché le financement de l’entreprise par des sources privées : « La
question de recherche des capitaux était posée ; peut-être pouvait-on trouver de
l’argent en Égypte. On a fait des efforts, mais l’affaire n’a pas marché. Il n’était pas
facile pour des entrepreneurs de venir s’installer dans un pays en état de révolution »
(Argyropoulos 1970 : 57).
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
85
13 Il faut noter ici que des problèmes similaires ont troublé, dans le même temps, les
efforts du camp adverse dans le même domaine. La distribution immédiate de la terre
aux cultivateurs fut surtout le slogan de l’aile gauche de l’ORIM, qui a en vain essayé
d’imposer une réforme agraire radicale par le moyen de la mobilisation paysanne
(Sahtouris 1909). Le programme des nationalistes bulgares des Clubs constitutionnels,
par contre, excluait explicitement toute possibilité d’expropriation massive des terres,
mettant plutôt l’accent sur la protection des droits de propriété des paysans et le retour
des terres saisies par des beys musulmans après la révolte de 1902-1903 (SBKK
1910 : 97-111 ; Tomov 1946 : 59 ; Hristov 1964 : 173-4). Un projet de l’Exarchat bulgare,
pour la création d’un « Fonds tchifliks » destiné à l’achat des terres et à leur distribution
aux paysans slavophones aux conditions favorables, échoua lui aussi quand deux
métropolites détournèrent l’argent pour se procurer des immeubles de luxe pour leur
propre logement (Laftchiev 1994 : 104-5, 111). L’acquisition des champs par des paysans
ordinaires, là où elle s’est produite avant les guerres balkaniques, fut donc l’œuvre de
l’initiative « privée » des familles élargies locales, et grâce à l'argent des émigrants aux
États-Unis, qui profitèrent de la situation pour forcer des propriétaires musulmans à
leur vendre quelques lopins à des prix avantageux (Karavidas 1931 : 212, 221 et 223 ;
Razboinikov 1913 : 51-8).
14 Dans les villes, le programme de Dragoumis était appliqué beaucoup plus
systématiquement par l’appareil grec. C’est surtout à Salonique, ville où l’élément grec
prédominait sur l’élément slave mais était clairement en minorité face aux
communautés israélite et musulmane11, que l’ « Organisation grecque », dirigée par
Athanasios Souliotis, a livré une guerre économique et organisé un terrorisme politique
pour bloquer la progression de l’ « ennemi » sur leterrain social. Comme but principal,
l’organisation a posé « la réaction à l’installation des Bulgares dans la ville et la
neutralisation de ceux qui s'y trouvaient déjà » (Souliotis 1907 : 12). Entre autres, des
lots de terre furent achetés pour l’installation de 15-20 familles grécophones au centre
du quartier purement exarchiste de Kilkis Mahala et l’édification d’une église
patriarchiste dans le quartier, également exarchiste, d’Aghia Triada. La reconnaissance
officielle d’un troisième quartier bulgare dans le faubourg de Çavuş Monastir était
entravée, grâce au blocage par l’organisation de tout achat d’immeuble par des
exarchistes, action qui a empêché la concentration des 40 familles exarchistes
(propriétaires de leur domicile) nécessaires pour une telle reconnaissance de la part des
autorités et la désignation d’un moukhtar particulier du mahalle. L’activité
professionnelle des commerçants, professionnels et travailleurs exarchistes fut aussi
compromise par le déclenchement d’une guerre économique totale, commencée par
une campagne terroriste intracommunautaire (« punition » des Grecs qui faisaient des
transactions économiques avec des « schismatiques ») pour acquérir vite sa propre
dynamique, avec la participation spontanée des couches sociales qui en tiraient des
avantages (comme par exemple les maçons grecs, qui ont ainsi délogé du marché leurs
concurrents bulgares). La tendance des commerçants grecs de la ville à étendre ce
boycott contre la communauté israélite de la ville fut au contraire repoussée par les
dirigeants de l’organisation, qui estimaient que la neutralité – au moins – de l’élément
juif était indispensable pour le succès de leur entreprise (Souliotis 1907). Des
propositions similaires, pour une « guerre économique sourde et systématique » contre
la présence juive à Kavala, étaient cependant faites en septembre 1907 par le vice-
consul grec de cette ville à majorité grecque, pour contenir l’installation de familles
israélites dans la ville et sa transformation en « une seconde Salonique » (Souidas 1907).
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
86
Le développement d’une communauté bulgare à Kavala, la présence même de
commerçants et de travailleurs slavophones dans la ville, furent d’ailleurs empêchés
par des mesures violentes. Après consultation entre les représentants diplomatiques de
Grèce et les autorités locales, les résultats du recensement officiel ottoman de
1905-1906 furent aussi falsifiés, avec l’inscription de 206 Bulgares seulement (tous
désignés comme « travailleurs de passage »), quand leur nombre réel était estimé aux
alentours d’un millier et beaucoup d’entre eux étaient des résidents permanents
(Musée de la lutte macédonienne 1997 : 255-6)12.
15 Plus meurtriers furent les massacres aveugles perpétrés par les bandes grecques contre
des slavophones sans armes qui travaillaient comme journaliers agricoles, meuniers,
bûcherons, charbonniers ou faucheurs dans les régions grécophones du sud de la
Macédoine. Presque une centaine de ces « Bulgares » furent noyés dans le rivière
Aliakmonas en mai 1905 (Karavas 1999 : 325-6 et 2006 : 267-9), vingt-cinq autres tués à
Isvor (Chalcidique) en novembre 1907 et une quinzaine égorgés devant leurs enfants
aux alentours de Katerini en février 1907 (Dakin 1966 : 313-4 ; BPP 1908 : 20 ; Direction
historique de l’armée 1979 : 269) ; les incidents moins sanglants étaient plus fréquents
(Kakavos 1972 : 131, 150, 167 et 168). Si des raisons de sécurité ont parfois été invoquées
pour justifier les tueries de ce genre, leur justification la plus fine fut cependant celle
énoncée par un journaliste anglais à la solde du gouvernement grec : « Du point de vue
des Grecs », écrit dans son livre Allen Upward, « ces manœuvriers sans armes étaient
l’avant-garde d’une armée d’invasion, qui venait pour occuper et annexer le territoire
grec. S’ils avaient essayé d’entrer dans le Royaume de Grèce, ils auraient été repoussés
de la même façon que les immigrants chinois sont repoussés par les États-Unis ; des
méthodes aussi pacifiques sont néanmoins impossibles quand le gouvernement se
trouve dans les mains de quelqu’un d’autre » (Upward 1908 : 107) 13. D’après le bilan du
consulat grec de Salonique pour l’année 1908, l’action des bandes grecques dans la
péninsule grécophone de Chalcédoine réussit à « écarter la descente des ouvriers
bulgares qui avait lieu autrefois » (Rapport 1908 : 30). Le règlement des bandes opérant
dans cette même région percevait d’ailleurs clairement comme leur devoir principal
l’interdiction forcée de « tout contact [des habitants] avec des Bulgares, des Roumains,
des bandits ou autres éléments criminels sous peine de mort » ; la bande devait être
mise au courant de la présence de telles personnes dans chaque agglomération par le
chef du comité du village, qui était aussi responsable de leur arrestation immédiate
(Laourdas 1961 : 68-9, 72).
16 Encore plus ambitieux, un projet de colonisation de la Macédoine ottomane par des
Grecs de Bulgarie, chassés de leurs domiciles par le pogrom anti-grec de 1906 14, resta
néanmoins lettre morte. À cette fin, le consul grec de Salonique avait même sondé
l’inspecteur général de la Macédoine, Hilmi Pacha, obtenant son accord pour ces
implantations15. « Je pense que toute l’affaire doit être poursuivie sans trop de bruit »,
peut-on lire dans son rapport adressé au ministère des Affaires étrangères, « pour
placer des Grecs, des agriculteurs surtout, à des points stratégiques afin de couper la
continuité des populations bulgarophones. Pour cela on a besoin de dépenses
véritables, parce que les immigrants n’accepteront jamais de servir dans des tchifliks,
mais ils seront attirés s'ils comptent sur l’acquisition des terres. […] Il n’y a aucun doute
que cette mesure renforcera étonnamment l’Hellénisme » (Coromilas 1906). Malgré
tout l’enthousiasme, et les incitations officielles des émigrants potentiels par les
autorités consulaires grecques à s’orienter vers la Macédoine ou la Thrace ottomane
(Zalokostas 1908), il semble pourtant que les Grecs quittant la Bulgarie n’avaient pas
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
87
envie de se trouver encore une fois dans une situation trop proche du conflit qui les
avait contraints à s'expatrier. Aucune installation des Grecs de la Roumélie orientale
n’est par conséquent enregistrée dans les régions de la Macédoine proches de Salonique
avant 1912, et il semble encore moins possible que de pareilles implantations aient eu
lieu dans des endroits plus éloignés et moins sûrs ; les « colons » en cause ont préféré
s’installer à Athènes ou dans la plaine fertile de Thessalie (Maravelakis-Vakalopoulos
1955). Quelques uns d’entre eux seront pourtant transférés plus tard, dans les années
1920, en Macédoine « pour des raisons démographiques » (Maravelakis-Vakalopoulos
1955 : 175-6).
II. DU BON USAGE DES ÉPURATIONS ETHNIQUES
(1912-1925)
Guerres de libération (1912-1913)
17 Les guerres balkaniques de 1912-1913 aboutissent à l’incorporation de la moitié de la
Macédoine dite « géographique » au Royaume de Grèce. Pour l’irrédentisme grec,
c’était une grande victoire, équivalent à la réalisation de 90 % de ses aspirations les plus
avancées sur le territoire macédonien. De toutes les régions qui étaient convoitées, une
bande de terre de moins de 20 kilomètres, au nord de la frontière, restait seulement
hors des « Nouvelles Provinces » grecques16. Cette victoire était pourtant assombrie par
l’insécurité régnante, véritable menace pour la stabilité du nouveau régime, et par la
possibilité d’une révolte nationaliste des populations « étrangères » du pays
(Kostopoulos 2002). En novembre 1913, cette possibilité était corroborée par l’accord
entre le Comité jeune-turc et l’ORIM pour une action armée coordonnée contre les
« occupations » grecque et serbe de la Macédoine. Comme d’habitude, cet irrédentisme
était alimenté par l’existence de dizaines de milliers de réfugiés, qui espéraient (mais ils
en étaient empêchés) revenir dans leurs foyers. La colonisation de la nouvelle province
avec des « Grecs purs » était donc considérée comme indispensable pour le
renforcement des « éléments loyaux » et la consolidation de son appartenance à l’État
grec.
18 Pendant les guerres balkaniques, des atrocités furent commises par tous les
belligérants contre la population civile « de l’adversaire » dans les zones occupées,
produisant l’exode de dizaines des milliers de réfugiés. D’après des statistiques
grecques officielles (mais tenues secrètes)17, quelques 45 000 « Bulgares » et presque
20 000 Musulmans ont fui la Macédoine grecque avant la fin des hostilités. 14 544
« Bulgares » et environ 60 000 Musulmans sont partis dans l’immédiat après-guerre
(1913-1915), avant le débarquement des forces de l’Entente et la transformation de la
région en champ de bataille de la Première Guerre mondiale 18. Du point de vue
géographique, la plupart de ces réfugiés provenait de la Macédoine centrale (23 000
« Bulgares » et 45 000 Musulmans) et Orientale (20 000 « Bulgares » et 33 500
Musulmans) ; la Macédoine occidentale était au contraire relativement épargnée pour
ce type de déplacements (seuls 707 « Bulgares » et 4 234 Musulmans partis entre 1912 et
1915). En même temps, 161 272 réfugiés grecs et 44 000 Musulmans étaient venus
s’installer en Macédoine après avoir quitté leurs foyers dans la « nouvelle Bulgarie »
(région de Pirin et Thrace occidentale), la Thrace orientale, l’Asie Mineure et – dans une
moindre proportion – le Caucase19.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
88
19 Dans quelle mesure cet exode était-il non seulement voulu mais aussi dû à des
planifications antérieures ? On ne peut, bien sûr, pas nier la violence des armées
« libératrices » : des villes entières, comme la partie musulmane de Yenice (aujourd’hui
Giannitsa), Kilkitch / Kukuş (aujourd’hui Kilkis)20, Serrès ou Nigrita périrent dans les
flammes pendant les hostilités ; d’autres comme Melnik furent incendiées par leurs
habitants qui partirent pour ne jamais revenir ; des quartiers « ennemis » dans des
villes ou des villages mixtes ont également été saccagés, parfois réciproquement, par le
groupe ethnique ou le parti national victorieux du moment (Kostopoulos 2007 : 35-59,
Dotation Carnegie 1914). Il faut cependant pouvoir distinguer entre trois types de
violence : la violence produite dans le cadre (et comme conséquence inévitable) des
hostilités, celle qui ressort des haines réciproques accumulées dans un passé plus ou
moins récent, et la politique organisée d’épuration ethnique pratiquée par les
belligérants. Dans le cas des atrocités commises par l’armée ou des civils armés grecs
contre la population musulmane pendant la première guerre (1912-1913), la
documentation disponible ne permet pas d'émettre une telle hypothèse : des villages
sont anéantis et des paysans « turcs » sont fusillés (ou simplement massacrés) dans la
fureur de la bataille ou en représailles, après avoir résisté à l’avancée de l’armée
grecque dans la région de Kozani – Kailar (aujourd’hui Ptolemaida) en novembre
1912 et / ou après avoir détruit des villages chrétiens. Il existe aussi des cas de
violences perpétrées à des fins différentes, comme la vengeance personnelle, le viol ou
le pillage ; il manque cependant la volonté de la part des autorités militaires grecques
de forcer la population musulmane à s’enfuir. Même le prince Constantin, général en
chef de l’armée grecque et futur roi du pays, dans sa correspondance particulière,
exprime des sentiments de pitié pour les épreuves des civils « turcs » (Constantin
1925 : 83-4). Ce qui n'est du tout le cas avec le second ennemi, le Bulgare, dont les
« représentants locaux » étaient considérés dès le début comme un problème
démographique à résoudre. Cette attitude envers les Musulmans doit être plutôt
attribuée à la mentalité dominante de l’époque dans la région, en ce qui concerne le
destin des Musulmans des pays « libérés » : considérés comme incapables de vivre sous
la domination chrétienne, ils allaient tôt ou tard partir pour ce qui restait de la
« Turquie » ; nul besoin donc d’avoir recours à l’usage d’une violence qui pourrait
compliquer les choses. De plus, dans le cadre de la guerre diplomatique latente entre
les alliés pour le partage du butin, le gouvernement grec a œuvré pour obtenir l’appui
des élites musulmanes locales (qui se sentaient en danger face à leurs métayers
slavophones mobilisés par l’armée bulgare ou les bandes de l’ORIM) pour qu’ils se
déclarent publiquement en faveur de l’incorporation de leur pays à l’État grec, au lieu
de la Principauté bulgare21.
20 Les desseins du commandement grec envers la population slavophone (et surtout
exarchiste) était tout à fait différents. Ainsi, dès le mois de décembre 1912, c’est-à-dire
six mois avant le déclenchement final des hostilités entre les ex-alliés, le prince
Constantin déclarait à son environnement que « le seul titre dont il rêvait était celui de
tueur de Bulgares » (Danglis 1965 II : 57). Un document rédigé pendant les premiers
jours (ou même heures) de la deuxième guerre balkanique, en juin 1913, est très
édifiant sur la planification de l’attitude de l’armée grecque envers les populations
chrétiennes slavophones de la zone des opérations. Il est signé par le commandant
Konstantinos Mazarakis, ancien chef de bande en Macédoine sous le nom de guerre
« Kapetan Akritas », désormais à la tête des bandes des « scouts » irréguliers faisant
partie de l’armée hellénique. En bref, Mazarakis classifie les villes et villages du champ
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
89
de bataille par langue maternelle mais surtout par leur appartenance à l’un ou à l’autre
« parti national », indiquant par exemple des villages « sur lesquels on peut
s’appuyer », ceux où il existe des « factions pro-grecques fanatiques ». On fait la
distinction entre agglomérations « bulgarisantes » [βουλγαρίζονταχωρία] et celles qui
« macédonisent » [μακεδονίζουσι] ou entre villages « macédonophones hellénisés par
l’école » et leurs voisins qui constituait des « centres de propagande bulgare depuis
toujours » ; le rédacteur du document va jusqu’à signaler quelques villages parmi les
« bulgarisants fanatiques » de la plaine de Kilkis qui appartenaient, comme tchifliks, à
des propriétaires grecs et disposaient « de surveillants en majorité fiables » (Mazarakis
1913). Ce document est analysé dans ce dossier de l'EJTS par Leonidas Embirikos. La
plupart des villes et villages (ou des groupes de villages), classifiés ici comme
résolument ennemis, ont été détruits par l’armée grecque et ses auxiliaires pendant les
hostilités. La plus grande victime de cette politique fut la ville de Kilkis (ou Kukuş),
habitée totalement par des exarchistes slavophones et détruite par l’armée grecque le
soir même de sa « libération »22. Malgré les versions officielles, selon lesquelles Kilkis
avait été incendiée soit par accident pendant la bataille soit par ses habitants avant leur
fuite en Bulgarie, l’évènement fut salué avec exclamations par l’appareil de propagande
nationaliste de l’époque : « Kilkis, le nœud des bandits, le centre des comitadjis, le cœur
des cannibales, la patrie de Daneff [i.e. Premier ministre bulgare], c’est fini ! », lit-on par
exemple dans une description populaire de la guerre (Anonyme 1913 : 9). Encore plus
éloquente est la description par le général Alexandros Mazarakis, frère de
Konstantinos, de ses sentiments (et ceux de ses collègues) face à la destruction de la
ville par le feu: « Notre joie était grande », écrit-il dans ses Mémoires, « non seulement
pour la victoire, mais aussi parce que Kilkis était considérée depuis longtemps comme
la ville bulgare la plus fanatique » (Mazarakis 1948 : 51) 23.
L’après-guerre immédiat (1912-1915)
21 Les guerres balkaniques terminées, un débat public s’est exprimé dans la presse et le
Parlement de Grèce sur l’avenir de la Macédoine, entre défenseurs de la proposition
officielle du ministère des Affaires intérieures (qui prévoyait la soumission de la région
à un régime d’exception pour deux ou trois décennies, et qui était basée sur le
précédent roumain de la Dobroudja du Nord) et les partisans de son assimilation totale
et rapide dans l’État grec. Parmi les arguments avancés par les défenseurs de la
première option, le plus courant était – naturellement – la composition ethnique
défavorable de la population macédonienne, les « tendances séparatistes » entre
nationalités ainsi que leur passé de luttes armées et de massacres réciproques. Le
Premier ministre Venizélos s’est publiquement prononcé en faveur de l’assimilation
totale. Seule exception : au niveau de l’administration locale, l’élection des chefs de
commune par les habitants fut suspendue provisoirement – en fait, jusqu’ à 1925 24.
22 La réhabilitation des réfugiés a offert une possibilité de plus pour la transformation du
territoire ethnique selon les nécessités nationales et sécuritaires du royaume. La raison
d’État qui a guidé l’action de l’administration est parfaitement analysée par le
commandant Athanasios Exadaktylos, cadre de l’état-major de l’armée, dans un rapport
rédigé moins de deux mois après la fin des hostilités. Rappelant à ses lecteurs que
« cette question est étroitement liée à des raisons militaires et ethniques », il désigne
sur la carte une région étendue de la frontière jusqu’aux alentours de Salonique et
« peuplée, à quelques exceptions près, par des populations de langue et de nationalité
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
90
étrangères ». Ensuite, la région est divisée en trois zones, chacune avec une
composition ethnique différente (A : « presque exclusivement des Musulmans », B :
« Bulgares », C : « Musulmans et Bulgares, les premiers étant en majorité ») 25. « Le
changement du caractère ethnique de la zone ABC par des mesures diverses », lit-on,
« est urgent pour atténuer le désavantage politique et militaire d’avoir sur la zone
frontalière exclusivement des populations inamicales ou même ennemies ». Pour en
arriver là, Exadaktylos a proposé l’exclusion des réfugiés musulmans de toute
agglomération au nord et à l’est de Salonique (ils devaient être transférés dans le sud de
la Macédoine ou plutôt en Thessalie) et le peuplement de chaque zone par des groupes
de colons spécifiques: « Dans la partie A [Musulmans, région de Drama et de Chari
Chaban] il faut installer des réfugiés grecs qui proviennent de la Thrace occidentale,
comme ils parlent la langue grecque et ils pratiquent la même agriculture
[probablement le tabac]. Dans la partie B, peuplée par des Bulgares [environs de Demir
Hissar], il faut installer les grécophones de Meleniko et ceux de la Thrace occidentale
qu’il ne serait pas possible d’établir dans la zone A. Dans la partie C [Musulmans et
Bulgares, Kilkis et environs], il faut installer ceux de Strumica et de ses villages, ainsi
que ceux de Petritch » – ce dernier groupe étant composé uniquement de patriarchistes
slavophones. L’État devait enfin faire barrage à chaque tentative de fuyards
slavophones de la guerre pour regagner leurs domiciles. Cette interdiction devait être
appliquée contre les ex-métayers et ouvriers agricoles des tchifliks, car ceux-ci
constituaient un double danger, du point de vue non seulement national mais aussi
social : sous le régime ottoman, « la plupart des sans-terre étaient parmi les éléments
les plus turbulents », auxquels « la propagande bulgare avait inspiré des idées
révolutionnaires et socialistes » avec, comme résultat, « la création plusieurs fois de
questions agricoles » (Exadaktylos 1913 : 5-6). À peine formulée, cette imbrication de
menaces « nationale » et « sociale » devient une constante du discours étatique
sécuritaire dans les décennies suivantes.
23 Le commandant Exadaktylos n’était naturellement pas le seul à soutenir le peuplement
organisé de la Macédoine. D’autres cadres administratifs ont également pris la parole
pour appuyer ce projet. Efhtymios Boudonas par exemple, directeur du Bureau
d’éducation publique de Salonique et ancien inspecteur général des écoles grecques en
Macédoine avant 1912, soutient en avril 1914 que « le mixage systématique des
grécophones dans la région de langue étrangère accélérera énormément l’hellénisation
du pays ». Ses modèles sont les villes de Serres et de Niaousta (aujourd’hui Naoussa), où
l’existence d’un noyau grécophone considérable a permis l’assimilation linguistique
d’ « une multitude de gens de langue étrangère, venus en famille des alentours pour
s’installer » dans la ville. Par contre, il rappelle que les villes non grécophones de
Florina, de Monastir, de Korçë ou de Vodena (aujourd’hui Edessa) ont prouvé qu'elles
étaient incapables, non seulement d’helléniser les immigrants mais aussi de s’helléniser
linguistiquement elles-mêmes, malgré l’existence de très forts « partis grecs ». Avec
l’implantation des réfugiés, l’État peut ainsi « multiplier ces îlots assimilateurs » dans
l’arrière-pays macédonien (Boudonas 1913 : 3). Quelques temps après, le représentant
de l’administration à Magiadağ ne peut pas dissimuler son soulagement quand, dans
une région où, jusqu’à la fin des guerres balkaniques, il n’existait que des Turcs et des
Chrétiens bulgarophones exarchistes, sans « aucun Grec grécophone », et où le parti
grec était représenté par « de rares Grecs bulgarophones, de sentiments douteux dans
leur majorité ou de semblables salariés qui suçaient la richesse nationale », « la
situation ethnique a été modifiée à hauteur d'un tiers de la population » grâce à
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
91
l’installation de quelques 4 500 « Grecs fervents » de Thrace et du Caucase. La ligne de
la frontière était désormais « habitée par des réfugiés de notre race » (ομογενείς)
(Konstantinidis 1914). Il semble, pourtant, que des voix se soient aussi élevées contre
l’encouragement de l’émigration des Grecs de la Bulgarie vers la Macédoine. Quelques
jours seulement après le traité de Bucarest, en août 1913, le journal prestigieux
d’Athènes Akropolis a été obligé de publier deux articles successifs pour rejeter l’idée
que l’exode des Grecs entraînerait la perte éternelle pour la Grèce de leurs pays
d’origine incorporés à la Bulgarie. La protection nécessaire de la frontière y était aussi
invoquée, avec comme modèle le peuplement allemand de la Pologne (Koutoupis 1913).
24 Malgré l’abondance relative des futurs colons, l’application pratique du programme
devait pourtant surmonter trois obstacles sérieux : le manque de crédits, la résistance
passive d’une partie des intéressés (qui, provenant des milieux urbains, n’avaient pas
toujours envie de s’installer dans les provinces) et surtout l’instabilité politique
intérieure et internationale généralisée après le déclenchement de la Première Guerre
mondiale. Des 117 548 réfugiés énumérés par la direction des Domaines de l’État du
ministère des Finances en 1916, plus d’un tiers se trouvait ainsi installés à
Salonique (pratique qui, néanmoins, ne contrevenait pas au besoin d’helléniser la
capitale cosmopolite de la Macédoine grecque). Les autres étaient installés dans 343
villes et villages, la plupart dans les régions où il y avait des maisons désertées par leurs
anciens habitants musulmans ou slavophones ; en tout, les services responsables du
logement des réfugiés n’ont bâti jusqu’au printemps 1916 que 834 nouvelles maisons
dans 9 agglomérations, dont 433 en Macédoine orientale et 295 dans la ville
reconstruite de Kilkis, pour héberger une partie des réfugiés de Strumica (Direction des
Domaines de l’État [DDE] 1916 : 7 et 22-32 ; Kanaginis 1918 : 19). Hors de Salonique, la
majorité immense des réfugiés habitait en 1915 les régions de la Macédoine centrale
(plus de 30 %) et surtout orientale (plus de 50 %), tandis que dans la Macédoine
occidentale, éloignée du front éventuel d’une guerre avec la Bulgarie ou la Turquie, on
a installé moins de 3 % du total. En général, on constate que les instructions du
commandant Exadaktylos ont été plus ou moins suivies : les anciens habitants de
Strumica et Dedeağaç étaient établis dans la région de Kilkis, ceux du Pirin à Demir
Hissar et ses alentours ; quand aux réfugiés de Xanthi, on les a installés dans les plaines
de Drama et de Chari Chaban (DDE 1916 : 5 ; Pallis 1915 : 1). Les deux tiers des Grecs
(Rum) de l’Asie Mineure arrivés en Macédoine après le pogrom anti-grec organisé par
les Jeunes-Turcs en 1914 ont de leur côté préféré rester dans la ville de Salonique (Pallis
1915 : 1). La docilité de tous les nouveaux venus à se soumettre aux impératifs de la
colonisation n’était pourtant pas acquise. Peu de temps après leur débarquement à
Salonique, par exemple, les premiers immigrants grecs du Caucase ont contacté le
consul russe de la ville, demandant leur rapatriement en Russie (Xanthopoulou-
Kyriakou 1996 : 284). Une analyse rétrospective de l’entreprise, rédigée en 1918 par le
directeur de Peuplement, précise d’ailleurs qu’il a fallu des mesures sévères pour
« extirper les mauvaises habitudes » et « minimiser les déplacements arbitraires et sans
raison des réfugiés hors de leurs campements » (Kanaginis 1918 : 4, 18). Les aspects
répressifs de la colonisation ne se limitaient cependant pas à la mise au pas des réfugiés
indociles. En 1914 déjà, le représentant gouvernemental dans l’arrondissement de Kato
Thodoraki informait son supérieur que les réfugiés installés dans sa région étaient
« devenus littéralement un fléau pour leurs voisins non-grécophones ». Il demandait
ainsi le renforcement de la gendarmerie locale, pour parvenir à « la restriction des
délits des réfugiés » contre les slavophones et la protection des biens de ces derniers
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
92
(Haralambidis 1914 : 37)26. Il n’était pas le seul à constater que la pression exercée par
les réfugiés était le facteur déterminant qui poussait les Slaves macédoniens à
s’expatrier (Kontogiorgi 2006 : 204-5). Il faut noter enfin que le traitement inégal en
faveur des réfugiés était sanctionné par la politique officielle de l’État. Selon la loi 350
votée en 1914 pour régler « l’établissement des colons de notre race [ομογενείς] en
Macédoine et ailleurs », chaque famille de colons allait recevoir des lots de terre
« entiers », tandis que l’allocation de terre aux familles de métayers ou des travailleurs
agricoles indigènes dans les (mêmes) tchifliks expropriés dépendait du capital productif
qu’elles avaient à leur disposition27.
La Grande Guerre et l’après-guerre (1915-1922)
25 Entre 1915 et 1918, la Macédoine grecque a été broyée, comme le reste de l’Europe, dans
l'abattoir de la Première Guerre mondiale. Les parties centrale et occidentale de la
région ont été occupées par les forces de l’Entente, la partie orientale par les armées
allemande et bulgare. Toute activité de réhabilitation des réfugiés a été donc de facto
suspendue. De plus, des dizaines de villages ont été détruits ou simplement évacués par
les belligérants et les opérations militaires ont généré des dizaines de milliers de
nouveaux réfugiés.28 Dans le sillage de ces opérations, il y a eu aussi des règlements de
compte de tout genre. Après la réoccupation de Florina par l’armée française en 1916,
par exemple, les troupes irrégulières grecques qui faisaient parti des forces de l’Entente
ont fusillé massivement des habitants « bulgarisants » ou musulmans de la ville et de
ses environs (Grigoriou 1916 ; Modis 1950 : 241-2). De l’autre côté du front, l’occupation
bulgare de la Macédoine orientale a eu comme résultat quelques centaines des « morts
violentes » et environ 30 000 morts de faim. La commission spéciale constituée par les
Alliés pour enregistrer les atrocités de l’adversaire a attribué ces derniers à une
politique planifiée, « résultat des intentions criminelles du gouvernement bulgare »
qui, par « une famine voulue, organisée, entretenue et exploitée […] n’a fait mourir de
faim que ceux dont il voulait la disparition » pour « falsifier l’ethnologie » du pays
(Commission interalliée 1919 : 8, 431). Pourtant, ni l’identité ethnique des victimes ni
leur orientation nationale ne justifiaient en fait de tels résultats : l’analyse minutieuse
des informations détaillées contenues dans le rapport de la Commission interalliée (et
dans celui d’une autre commission, purement grecque, composée de professeurs de
l’université d’Athènes) montre que les résultats catastrophiques de la famine de 1917
étaient plus liés à des caractéristiques de la production agricole locale ou à la position
sociale des victimes qu’à des desseins d’épuration ethnique. 29 Au contraire, des critères
basés sur l’appartenance ethnique et nationale ont clairement surdéterminé les
expulsions (et la soumission à des travaux forcés) d’une grande partie de la population
grecque après l’entrée en guerre officielle de la Grèce contre la Bulgarie, en juin 1917.
Au total environ 28 000 personnes furent « expulsées », dont quelques milliers ont péri
de faim et des conditions inhumaines de leur traitement 30. De plus, pendant la première
phase de l’occupation bulgare (1916), la petite ville « grécisante » de Bayraklı Cumaya
(aujourd’hui Irakleia) et deux villages éloignés de la frontière – l’un valaque et l’autre
slavophone avec une forte présence du « parti grec » – ont été détruits par l’armée
bulgare, leurs habitants transférés en Bulgarie pour des raisons évidemment
« démographiques » (Kostopoulos 2007 : 288-9).
26 La victoire de l’Entente et la récupération de la Macédoine orientale en 1918 ont offert
aux autorités grecques une seconde occasion pour transformer la matrice ethnique des
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
93
régions qui étaient considérées comme le plus « problématiques ». En Macédoine
occidentale, une première mesure justifiée par les circonstances fut l’arrestation des
habitants slavophones qui avaient suivi l’armée bulgare dans sa retraite en 1916, puis
étaient retournés dans leurs foyers après la fin des hostilités. Les services de sécurité
ont ensuite procédé à un premier tri, déférant devant les cours martiales celles des
personnes arrêtées qui étaient suspectées d’avoir commis des actes contre la
souveraineté grecque ; quand aux autres, qui n’étaient accusées que de fuite devant
l’avancée des forces de l’Entente, elles devaient être expulsées après une procédure
sommaire (Iliakis 1920 : 61-2). Des procédures encore plus redoutables ont été utilisées
dans le reste de la Macédoine grecque, une ordonnance secrète du quartier général de
l’armée prévoyant, en décembre 1918, l’arrestation massive des « personnes suspectées
d’être touchées par le bulgarisme » [υπόπτωνβουλγαροπλήκτωνατόμων] et leur expulsion
au-delà des frontières. Selon un rapport du 2e corps militaire basé à Salonique
(23.1.1919), des arrestations de « personnes suspectes » furent menées « par étapes et
méthodiquement, afin qu’aucun éclat ne se produise et que les autorités françaises
locales ne comprennent rien de nos actions ».
27 Les arrêtés étaient transférés par le train à Salonique, où une direction spéciale de
l’armée était chargée de leur refoulement (Prantounas 1919 : 2 ; 2 e corps militaire
1919 : 1). Le ministère des Affaires militaires a de son côté suggéré en avril 1920 que
l’émigration des familles bulgarophones macédoniennes dont les chefs se trouvaient
déjà en Bulgarie était dans l’intérêt de la Grèce et ne devait donc pas être empêchée par
les autorités (Armée de Thrace 1920). Cette activité invisible était accompagnée par des
suggestions centrées sur la nécessité d’un changement radical de la démographie
ethnique du terrain – changement qui pouvait être effectué par la déportation des
populations « bulgarisantes » (ou simplement slavophones) et la colonisation de leurs
terres avec des familles grécophones venues d’autres provinces du pays (Iliakis
1920 6 : 95-7 ; Pradounas 1919 ; Modis 1920). Il y avait cependant des divergences entre
les différentes propositions, sur la fonctionnalité et l’envergure de chaque mesure à
prendre. Le remplacement par exemple des agriculteurs slavophones des plaines de la
Macédoine occidentale par des colons grécophones de la Grèce du Sud, envisagée par le
colonel Mazarakis en 1919, était rejetée par le gouverneur général de la région, Ioannis
Iliakis, pour des raisons politiques et sociales mais aussi économiques : une telle
mesure, selon lui, ne priverait pas seulement le pays d’une nouvelle génération
slavophone qui serait infiniment plus loyale que leurs aînés. Elle risquait également de
provoquer le déclin de l’agriculture locale, parce qu’il y avait peu de chances de trouver
des colons qui pourraient s’acclimater aux conditions difficiles de la région. Par contre,
Iliakis pensait que des déportations « exemplaires » devaient être organisées
publiquement, visant des familles entières dont les chefs étaient considérés comme
dangereux pour la sécurité publique, afin de « terroriser tous ceux qui pourraient
réagir » à la politique d’assimilation. De petites colonies grécophones pouvaient aussi
être implantées sans bruit, là où il y avait des terres disponibles, pourvu que le
responsable en tête du projet assimilateur ait les mains libres pour assumer une telle
entreprise (Iliakis 1920 : 95-7, 62, 111). Directeur de la préfecture et futur représentant
parlementaire de Florina, Georgios Modis se montrait en même temps plutôt intéressé
pour construire sur place des appuis sociaux par la création de nouveaux clivages à
l’intérieur des communautés slavophones : après avoir reconnu que la densité de la
population locale ne permettait pas la colonisation de la région à grande échelle, il
proposa la relégation de 10-15 familles de chaque village « bulgarisant », « choisies
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
94
parmi les plus fanatiques », et la confiscation de leurs fortunes immobilières ; si on ne
pouvait pas trouver de colons grecs pour s’y installer, les lopins de terre des expulsés
devaient être vendus aux enchères pour créer une classe de propriétaires ayant un
intérêt matériel à résister à chaque tentative de retour au statu quo ante. Dans le même
temps, il était possible d’attirer des colons des territoires voisins restés sous
domination serbe : la ville de Florina serait peuplée par des habitants grécisants de
Monastir ou des valaques patriarchistes des bourgs de Tirnovo, Megarovo, Nizopol et
Krushevo, tandis que dans la zone frontalière il faudrait installer des paysans
(slavophones mais farouchement pro-grecs) des villages de Morihovo. Le mécanisme de
colonisation pouvait d’ailleurs fonctionner aussi en sens inverse, avec le transfert
massif des familles slavophones vers les nouveaux territoires grecs de l’Asie Mineure
(Modis 1920). Le transfert de la fortune immobilière des familles expulsées à des « gens
excellents avec des sentiments nationaux prouvés » était aussi suggérée par la 4 e
division de l’armée, qui considérait le peuplement de la Macédoine par des réfugiés de
Thrace ou de l’Asie Mineure comme contrevenant à l’intérêt national ; ces derniers
devaient retourner dans leurs foyers, pour que la présence grecque y soit renforcée
(Pradounas 1919 : 2).
28 Resté finalement sur le papier, un autre projet conçu par le conseiller militaire de
Venizélos pendant la conférence de Paix est néanmoins assez révélateur de la façon de
penser des hommes d’État de l’époque. En contrepartie de l’acquisition éventuelle de la
poche bulgare de Stroumica et d’une partie de la Macédoine du Pirin par la Serbie, le
colonel Alexandros Mazarakis a proposé le rattachement des villes frontalières serbes
de Doiran et de Gevgelija, avec leur arrière-paysimmédiat, à la Grèce – si nécessaire, en
échange des terres de la région de Florina incorporées à la Grèce après les guerres
balkaniques. Son raisonnement était basé sur des considérations d’ordre purement
stratégique (nécessité de pousser la frontière gréco-serbe le plus loin possible de
Salonique) mais aussi d’ordre ethnique (volonté de minimiser le nombre de
slavophones ayant dans le passé appartenu au « parti bulgare », en les remplaçant par
des musulmans jugés « inoffensifs » pour les intérêts nationaux grecs). D’après
l’analyse de Mazarakis, dans la région convoitée de Doiran-Gevgelija habitaient en 1912
environ 40 000 personnes, dont 9 981 « Grecs » (c’est-à-dire patriarchistes), 7 443
« bulgarophones exarchistes » et 23 495 « Turcs » (i.e. musulmans). Leur subordination
à la Grèce était considérée comme préférable au maintien de la population de même
taille de la région de Florina qu’on proposait de céder à la Serbie : si le nombre des
« Grecs » dans les deux cas était presque identique, les « schismatiques » orthodoxes de
Florina représentaient le double (environ 20 000) et celui des musulmans la moitié
(environ 10 000) de ce que l’État grec devait obtenir après l’échange. L’incorporation
des slavophones orthodoxes (même « bulgarisants ») à la Serbie était jugée préférable
pour cette dernière au maintien d’une population musulmane, parce que « grâce à la
parenté de la langue ils seraient assimilables plus vite » dans l’espace national serbe ou
yougoslave (Mazarakis 1919)31. L’idée fut cependant rejetée par le gouvernement de
Venizélos, pour ne pas nuire à son alliance avec Belgrade (Hassiotis 1997 : 363).
Échanges de populations et colonisation (1922-1925)
29 Le problème le plus difficile à résoudre, pendant la première décennie de
l’administration grecque de la Macédoine, était le manque relatif de ressources – non
seulement financières mais aussi humaines – pour entretenir une œuvre si immense de
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
95
colonisation intérieure. En 1914, après le premier pogrom jeune-turc contre les
communautés grecques de la Thrace orientale et du littoral de l’Asie Mineure, le
gouvernement de Venizélos a essayé de réguler l’épuration ethnique en cours par un
traité d’échange mutuel des populations en théorie volontaire. Les négociations entre
les deux pays n’ont pourtant abouti à aucun accord, tandis que la direction politico-
religieuse des Grecs de Turquie a dénoncé publiquement le projet comme « un acte
honteux d’achat et vente » et « un délit véritable contre l’humanité »
(Anagnostopoulou 1997 : 536-8, 597-604 ; Pentzopoulos 1962 : 54-7). Huit ans plus tard,
la défaite des armées grecques en Asie Mineure et le déracinement sanglant des
communautés orthodoxes de la région ont finalement conduit en Grèce plus d’un
million de réfugiés, à la disposition absolue des architectes de la politique nationale. Les
traités internationaux de Neuilly-sur-Seine (1919) et de Lausanne (1923) ont de surcroît
donné l’aval de la communauté internationale de l’époque au solde définitif du reliquat
de la Question d’Orient par un échange généralisé des minorités nationales. Le premier
traité prévoyait l’échange formellement « volontaire » des Bulgares de la Grèce avec
des Grecs de la Bulgarie ; le second traité ordonnait l’échange obligatoire de la
population entière des Grecs orthodoxes de Turquie avec les Musulmans de Grèce,
exception faite seulement pour les minorités musulmane de la Thrace occidentale et
grecque orthodoxe habitant à Istanbul et dans les îles d’Imbros et de Ténédos 32. Au
total, 354 647 Musulmans et 52 600 Bulgares ont quitté la Grèce tandis que de 1 300 000
à 1 400 000 Grecs de Turquie et de Bulgarie ont pris leur place 33. Il s’agissait d’une
transformation colossale du substrat démographique du pays. 34 Malgré toutes les
réticences et protestations émises à l'époque35, elle a fini par être universellement
considérée comme l’étape cruciale qui a assuré une fois pour toute l’homogénéité
nationale et la sécurité à long terme du territoire grec, surtout en ce qui concerne la
Macédoine. Grâce à l’établissement des réfugiés, cette région multiethnique et instable
s’est transformée en une province grecque typique, avec des minorités ethniques qui ne
dépassaient pas, officiellement, 11,2 % de la population locale (Ancel 1930 : 121-2 ;
Wurfbain 1930 : 37 ; Mavrogordatos-Hamoudopoulos 1931 : 12-6 ; Penzopoulos
1962 : 125-40 ; Miliotis 1962 : 6 ; Kofos 1964 : 47-8 ; Tsoukalas 1974 : 26 ; Svoronos
1975 : 128-9 ; Mavrogordatos 1983 : 226). Selon un des représentants de la Grèce dans
les sous-comités constitués pour surveiller l’échange des populations, la convention de
Neuilly constituait donc la seconde victoire décisive de l’Hellénisme contre la présence
slave dans « la péninsule grecque » (c’est-à-dire balkanique) après la bataille de la passe
de Kleidi en 1914 (Miliotis 1927 : 1).
30 Dans quelle mesure l’implantation des réfugiés en Macédoine grecque était-elle
planifiée et organisée pour altérer la matrice ethnique de la région et à quelle échelle ?
Pour répondre à cette question il faut distinguer trois logiques et échelles différentes :
l'une générale, nationale et provinciale, concernant le transfert d’une majorité des
réfugiés en Macédoine et les autres régions à coloniser (comme la Thrace occidentale) ;
une autre, intermédiaire, liée à la sélection des régions macédoniennes prioritaires
pour la colonisation ; et enfin une troisième, de micro-échelle, qui visait au
dépeuplement ou à la « neutralisation » de certains villages (ou groupes de villages)
considérés comme dangereux (ou simplement gênants) du point de vue de la sécurité
nationale. La documentation à notre disposition prouve que, dans les trois cas, il y a eu
une planification relative, concrète, de la part des autorités et les services responsables
pour l’établissement des réfugiés, même si les résultats finaux ne correspondaient pas
toujours aux idées conçues au départ.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
96
31 En ce qui concerne l’échelle nationale, il ne fait aucun doute que la plupart de la
colonisation des années 1920 a eu lieu en Macédoine : des 1 221 849 réfugiés recensés en
1928, 638 253 (52,2 % du total) ont été installés dans cette province (Tsitselikis
2006 : 43). En avril 1923, selon un recensement provisoire des réfugiés effectué avant
que l’échange et l’implantation ne soient officiellement entamés, ce pourcentage n’était
que de 32,46 % (255 273 réfugiés en Macédoine sur un total de 786 431 dans toute la
Grèce). On constate de surcroît que la concentration de réfugiés dans la ville de
Salonique est circonscrite de manière drastique entre 1923 et 1928, leur nombre
passant de 88 612 à 92 598, soit de 34,71 % des réfugiés installés en Macédoine à 14,51 %
seulement. Environ 80 % de toutes les installations agricoles réalisées par la
Commission d’implantation des réfugiés (ΕΑΠ) se trouvent d’ailleurs en Macédoine
(SdN 1926 : 71-2 ; Ancel 1930 : 150). La logique d’ingénierie démographique n’était pas
naturellement la seule à déterminer ce processus : d’autres facteurs, comme l’espace
vidé par les Musulmans et les Bulgares aussi « échangés », la densité de la population
existante ou la disponibilité des terres fertiles qui pouvaient être exploitées à l’aide de
travaux d’assèchement, ont aussi joué un rôle crucial ; l’ingénierie sociale également,
sous la forme de la création d’une classe de petits propriétaires paysans pour lutter
contre le radicalisation politique née avec la prolétarisation de la masse des réfugiés
(Kontogiorgi 2006 : 97-110).
32 Le choix des lieux exacts à peupler était aussi l’œuvre de l’ΕΑΠ qui, en plus des 53 572
maisons laissées dans les villages de la Macédoine par les Musulmans et les Bulgares
échangés, en a fait construire 36 822 autres pour le logement des nouveaux venus (SdN
1926 : 72). Dans ses Mémoires, le Premier ministre de l’époque Stylianos Gonatas
explique qu’on a préféré installer les réfugiés ruraux « près de la frontière, pour
densifier la population qui vivait là et pour [organiser] une défense immédiate contre
des bandes d’envahisseursirréguliers » (Gonatas 1958 : 265). Une carte publiée par la
commission classifiant tous les villages de la Macédoine grecque en villages « de
réfugiés », « indigènes » (i.e. de populations déjà sur place) ou « mixtes » (Ancel
1930 : 148-9) montre cependant que la plupart des premiers sont localisés dans les
provinces orientales ou autour de Salonique. En Macédoine occidentale, il y a une forte
concentration de villages des réfugiés dans les plaines de Kozani et de Kailar
(aujourd’hui Ptolemaida) autrefois habitées surtout par des Turcs, tandis que la zone
frontalière avec la Yougoslavie est restée presque complètement habitée par des
« indigènes » slavophones. On reviendra plus tard sur cette « omission », qui pendant
l’entre-deux-guerres sera constamment dénoncée par les gardiens de la sécurité
nationale. Toutefois, il ne faut pas penser que l’aménagement des colonies rurales fut
l’œuvre de la seule dynamique spontanée de la quête de logement par les réfugiés,
comme on l’a soutenu au nom de la raison d’État(Pelagidis 1994 : 187 ; Kallianiotis
2007 : 40). La logique politique de l’entreprise est clairement énoncée dans un rapport
confidentiel du directeur général de la Colonisation, S. Goudas, rédigé à Salonique en
mars 1924 et adressé à la direction de Colonisation du ministère de l’Agriculture. Le
rapport est accompagné d’une carte des campements de réfugiés construits jusque-là et
de tableaux statistiques détaillés indiquant le nombre, par village et bureau de
colonisation, « des familles qui ne sont pas purement grecques ainsi que celles grecques
parlant une autre langue que le grec » [ταςοικογενείαςταςμηακραιφνώςΕλληνικάς, ωςκαιτας
Ελληνικάςξενοφώνουςτοιαύτας]. Selon le document, ces matériaux étaient produits en
1923 « sur la base des renseignements des autorités de colonisation sur place, avec la
coopération des autorités politiques et militaires, et avaient comme objectif la
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
97
vérification par notre service des éléments étrangers en Macédoine et l’insertion
relative des colonies des réfugiés au milieu d’eux, d’une telle façon qu’ils deviennent
désormais complètement inoffensifs » [τηνυπότηςυπηρεσίαςημώνεξακρίβωσιντωνξένωνεν
Μακεδονίαστοιχείωνκαιτηνκατ’ αναλογίανπαρεμβολήνπροσφυγικώνσυνοικισμώνμεταξύτούτων
ειςτρόπονώστενακαταστώσιντελείωςακίνδυναεφεξής]. En faisant un premier bilan de
l’entreprise, le rapport explique que « ce principe » (de la neutralisation stratégique
des « éléments étrangers ») « a été observé par notre service où les conditions diverses
(existence des logements, de la terre, etc.) l’ont permis et qu’on va continuer à
l’observer désormais sous les mêmes conditions » (Goudas 1924 : 1). Les tableaux
statistiques joints au rapport sont encore plus intéressants, car ils nous laissent deviner
quelques-unes des modalités de l’exécution du plan. Des quatorze bureaux de
colonisation, huit seulement ont procédé à une classification des habitants non-
grécophones selon leurs sentiments nationaux présumés, les divisant en familles
« slavisantes » [σλαυΐζουσαι], « roumanisantes » [ρουμανίζουσαι], « albanisantes » [
αλβανίζουσαι] ou « grecques parlant une autre langue que le grec » [ελληνικαίξενόφωνοι,
toutes langues confondues]36. Cinq autres bureaux ont simplement classifié tous les
habitants « non-grécophones » dans la catégorie des « éléments étrangers » tout
court37. Il y a eu, enfin, deux bureaux qui n’ont presque pas pu trouver dans leur
domaine d’ « éléments étrangers »38. Les conséquences finales d’une telle appréciation
sur le destindes habitants des villages concernés restent pourtant discutables : s’il est
par exemple vrai que 13 des 15 villages de la région de Kilkis qualifiés comme
« slavisants » ont été complètement vidés de leur population slavophone en 1924, le
même sort a été aussi subi par beaucoup de villages voisins considérés comme peuplés
de « Grecs non-grécophones » (Simovski 1998 B : 69-136). Il semble donc que le fichage
en cause n’était qu’un facteur parmi d'autres qui ont déterminé le dénouement de
l’entreprise. Une chose est à noter, cependant : l’omission totale (même de la liste des
« grecs non-grécophones ») de certains villages slavophones distingués dans le passé
par leur attachement actif à la cause hellénique, comme par exemple Bahovo
(aujourd’hui Promahoi) dans la région de Almopia, Katranitsa (aujourd’hui Pyrgoi) et
Dolno Gramatikovo (aujourd’hui Kato Gramatiko) dans la région de Eordaia. La ville de
Kilkis, peuplée après 1913 par des réfugiés slavophones, mais « grécisants », de
Strumica en est aussi complètement absente, tandis qu’à Edessa on ne mentionne que
les 600 familles « slavisantes » de la ville, en passant sous silence la population
slavophone mais traditionnellement patriarchiste qui formait la majorité des habitants.
L’interprétation la plus plausible de cette négligence est que les compilateurs des
tableaux n’étant pas très sûrs de l’utilisation finale de leur produit, ils ont ainsi voulu
protéger les dites communautés face à toute éventualité.
33 À côté de la direction générale, d’autres services responsables de la sécurité publique et
nationale sont aussi intervenus dans le processus de colonisation pour influencer son
application. Deux documents de l’armée grecque rédigés à la même date (9 avril 1925)
sont très éclairants sur ce point. Le premier rapport provient du quartier de la 11 e
division et fait l’inventaire de quinze villages à l’ouest de Vardar (12 habités par des
« indigènes » slavophones et 3 par des Valaques) où, malgré l’établissement de
nombreux réfugiés, l’officier en charge voit une situation démographique gênante :
« Dans les villages enregistrés ci-dessus », lit-on, « la densification [de la population]
n’est aucunement possible, à cause du manque de terre cultivable, bien que leur
densificationpar des réfugiés soit nécessaire pour paralyser chaque action anti-
nationale des habitants, étant donné que ces habitants, quoique caractérisés comme
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
98
des indigènes, n’ont pas de sentiments purement grecs, ce qui est d’ailleurs évident par
la langue bulgare et valaque qu’ils parlent » (Tsaktsiras 1925 : 3) 39. Plus intéressant
encore est le second document, une « étude » de 22 pages, élaborée par l’état-major de
la 10e division de la Macédoine occidentale, dans laquelle on examine – région par
région – le caractère suffisant ou non de l’installation des réfugiés du point de vue de la
sécurité nationale. Εn général, le rédacteur de l’étude constate que la situation est plus
ou moins satisfaisante dans les départements de Katerini, Veroia, Naousa et Kozani,
grâce au grand nombre de réfugiés et à l’existence d’une population grecque indigène
considérable. Dans la plaine de Giannitsa, la situation est aussi considérée comme
stabilisée, avec l’installation de 5 472 familles réfugiées et la prépondérance numérique
de l’élément pro-grec local sur les 1 744 familles « non purement grecques » demeurées
sur place. Aux alentours de Kastoria, enfin, la colonisation est jugée « suffisante » après
l’installation de 1 866 familles de réfugiés dans 28 villages. Au contraire, dans les
régions d’Edessa – Ostrovo (aujourd’hui Arnissa), de Florina, de Korestia et de Prespa, le
maintien sur place de milliers de « Bulgares fanatiques » provoque des cris d’alarme et
la demande d’une colonisation complémentaire, malgré l’aveu qu’il n’y a point de
terres à distribuer. Les propositions de la division sont ainsi centrées autour de
l’installation dans les montagnes de familles d’éleveurs ou bûcherons grécophones,
réfugiés ou Sarakatchans (populations nomades en voie de sédentarisation). On propose
aussi le morcellement des lopins de terre déjà alloués pour pouvoir entretenir plus des
réfugiés, le rachat des fortunes immobilières par l’État pour loger des colons,
l’établissement des colons sans terre subventionnés par l’État pour leur subsistance, le
transfert même des réfugiés déjà établis – sans toucher à leur propriété – vers des
villages slavophones voisins pour surveiller de près leurs habitants « dangereux ». Les
villages qu’il faut neutraliser sont cités un par un, avec des informations
complémentaires sur leur composition ethnique, le degré de « danger » que chacun
d’entre eux constitue pour la sécurité nationale (on distingue même entre villages
« fanatiques » et « non fanatiques », que l’on doit traiter de façon différente) et les
possibilités qu’on entrevoit pour des installations nouvelles. On ne s’intéresse pas aux
sommes totales : dans la région de Karadjova (aujourd’hui Aridaia), par exemple, le
départ de la majorité musulmane des plaines et le remplacement de cette dernière par
des réfugiés ne calme pas l’inquiétude causée par l’existence de six villages slavophones
« bulgarisants » dans la montagne. Même dans la région de Kailar, où l’installation des
réfugiés est déjà caractérisée comme « asphyxiante », on demande encore des colons
pour mettre hors-jeu deux bourgs (Emporio et Komanos) qu’on qualifie de
« majoritairement bulgarisants » (Salvanos 1925). Moins d’un mois plus tard, l’état-
major du 3e corps d’armée communique cette dernière proposition à la direction
générale de la Colonisation40. Intéressante enfin est la description des traits généraux
du problème : la population slavophone divisée en trois catégories, les « Grecs
fanatiques » ne comptent selon les analystes de la division qu’une à cinq familles dans
chaque village (ou même aucune, dans certains cas). La masse des « Bulgares
fanatiques » est évaluée entre ¼ et ½ de la population des villages (exception faite pour
certains cas, où tous les habitants y appartiennent) ; quand au reste des slavophones –
entre ½ et ¾ du total –, ils se disent « Macédoniens » et sont désignés par l’armée
comme « privés de conscience nationale, indifférents au fait d'être Grecs ou Bulgares,
donc presque inoffensifs » (Salvanos 1925).
34 La face à peine cachée de l’entreprise ainsi planifiée, fut l’emploi de l’installation des
réfugiés comme une arme d’épuration ethnique d’une grande partie des Macédoniens
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
99
slavophones sans effusion de sang. Malgré le caractère formellement volontaire de
l’échange gréco-bulgare, la violence était utilisée par les deux États pour persuader
leurs minorités indésirables de vider la place. Dans le cas de la Bulgarie, la pression sur
la minorité grecque était exercée surtout par l’intermédiaire des comitadjis de l’ORIM.
Dans le cas de la Grèce, c’était plutôt la masse des réfugiés, par son volume écrasant et
avec le soutien actif des autorités administratives et policières, qui a contraint les
« Bulgares » de partir. Le plus souvent, cette pression a pris la forme de l’installation
des familles des réfugiés dans les maisons des slavophones et l’appropriation forcée de
leurs biens : « Les réfugiés entraient massivement dans les villages des indigènes
macédoniens », raconte un cadre de la commission, « et leur arrachaient les lopins de
terre déjà labourés (parce que les réfugiés en ce temps-là ne pouvaient pas labourer),
leurs étables, une partie de leurs maisons, leurs poules, leurs casseroles etc., et encore
ils les insultaient, en les appelant Bulgares. Il y avait donc une pression et un danger
réel et très lourd pour les [populations] indigènes » (Karavidas 1931 : 354-5). Une partie
de ces derniers a en vain essayé de se défendre en optant pour la citoyenneté serbe
(Kostopoulos 2000 : 105-9). La contribution de cette pression au départ des
« Bulgares » est depuis longtemps un lieu commun pour les historiens et d’autres
analystes (Ancel 1930 : 210-1 ; Wurfbain 1930 : 35, 81-5 ; Ladas 1932 : 107-8 ; Mihailidis
2003 : 267-78 ; Kontogiorgi 2006 : 206-15). Il ne faut cependant pas voir dans ces
incidents des confrontations spontanées entre communautés locales revendiquant la
même terre ou d’autres ressources vitales ; derrière la masse destituée des réfugiés il
n’est pas difficile de discerner la main des autorités ou au moins de leur faction la plus
dure. Dans les années suivantes, par exemple, on peut noter des récriminations des
partisans du nettoyage ethnique total contre « certains politiciens locaux », accusés de
ne pas avoir laissé les services de sécurité chasser tous les slavophones de la Macédoine
occidentale grecque (Miliotis 1927 : 2 ; Fessopoulos 1948 : 125 ; Zafeiropoulos 1948 : 6 ;
Ouranis 1934 : 305-6 ; Bramos 1953 : 74 ; Skordylis 1994 : 69-70). Le fondateur et
dirigeant du premier service secret de Grèce assure, par exemple, que son Service de
sécurité générale d’État [ΥπηρεσίαΓενικήςΑσφαλείαςτουΚράτους, ΥΓΑΚ] « est intervenu
activement et de façon décisive pour faire appliquer exactement la convention relative
à l’émigration gréco-bulgare »41 mais ses efforts ont été sabotés par « des politiciens
grecs » – qualifiés aussi de « politicards sans scrupule » – « pour ne pas perdre des
votes » (Fessopoulos 1948 : 81, 125). En octobre 1924, la 6 e division de l’armée grecque
qualifiait comme « extrêmement mishellénique » le comportement d’un officier
anglais, membre du sous-comité mixte, qui avait simplement expliqué aux paysans
slavophones de la Macédoine orientale leur droit, prévu par le traité de Neuilly (27
novembre 1919), de ne pas céder aux pressions pour s’expatrier s’ils ne le voulaient pas.
Ironie du sort, ce même officier a été auparavant éloigné de la sous-commission mixte
de Thrace « extrêmement partial en faveur des intérêts grecs » (6 e division 1924 :
Diamantopoulos 1924). Aussi éloquents sont enfin les détails du sauvetage du « village
héroïque » de Petrovo (aujourd’hui Agios Petros) dans la région de Goumenissa. Selon
les mémoires d’un officier et ancien coordinateur de la propagande armée grecque
avant 1912, « le village a couru le risque d’être déporté pendant l'implantation des
réfugiés, comme non-grécophone et n’inspirant pas confiance, à cause de l’ignorance
des autorités sur son passé national. Heureusement, le commandant du corps d'armée
de Salonique, auquel les paysans s’étaient adressés, avait par hasard servi au consulat
[de Salonique] pendant la Lutte macédonienne et connaissait donc les services rendus à
la nation par ce village ; il est alors intervenu et écarté le danger de leur déportation »
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
100
(Kakavos 1972 : 113). Dans les archives de Philippos Dragoumis, un des politiciens qui
s'est opposé à l’expulsion sans distinction de toute la population slavophone, on trouve
la dépêche angoissée de ces paysans qui, leurs sous-officiers vétérans des guerres
helléniques en tête, « imploraient » les autorités de tenir compte de leur passé et
identité nationale : « Notre village, qui pendant la domination turque a lutté contre la
propagande bulgare, se trouve aujourd’hui en état de persécution par des organes du
pouvoir, qui utilisent des mesures contraignantes pour nous forcer à nous expatrier en
Bulgarie. Nous sommes poussés à partir en Bulgarie à cause de l’établissement violent
des réfugiés, quantitativement disproportionné, dans nos maisons et nos terres. […]
Nos frères les réfugiés, poussés [par les autorités] nous menacent de catastrophe si
nous ne partons pas. […] Nous sommes des Grecs et nous préférons mourir sur le sol
sacré grec » (Petrovo 1924). Si de telles choses sont arrivées à des gens ayant un tel
passé (et les connections conséquentes avec des gens au pouvoir), on peut facilement
imaginer ce qu’il s’est passé en 1923-1925 avec les communautés slavophones moins (ou
pas du tout) liées à l’État grec. D’après Philippos Dragoumis, l’établissement des
réfugiés a pris dans les régions slavophones un caractère complètement agressif,
« comme si la Macédoine n’était pas un pays grec mais une colonie conquise de main de
fer » [δορυάλωτοςαποικία] (Dragoumis 1925 : 76).
III. UNE TÂCHE INACHEVÉE ?
Entre-deux-guerres (1925-1940)
35 Une fois l’échange des populations et l’établissement des réfugiés complétés, le substrat
ethnique de la Macédoine grecque était décidément transformé et la souveraineté de
l’État sur la région cimentée non seulement de jure mais aussi dans les faits. D’après le
recensement officiel de 1928, les six départements macédoniens de la Grèce étaient
peuplés par 1 412 477 habitants, dont 1 342 311 (95 %) étaient des chrétiens orthodoxes
et 1 165 553 (82,5 %) étaient classés comme grécophones. Les seules minorités
considérées comme « nationales » par les autorités grecques étaient la communauté des
juifs séfarades, concentrée surtout dans la ville de Salonique, et la petite faction de la
population valaque qui optait ouvertement pour une identité (et éducation minoritaire)
roumaine, sous la protection des accords gréco-roumains de 1913. Complètement
différent était le traitement de la population slavophone orthodoxe, que le
recensement de 1928 limitait à 81 984 habitants tandis que leur nombre réel était
estimé par l’appareil administratif, scolaire et sécuritaire de l’époque entre 162 500 et
200 000 au moins (Kostopoulos 2000 : 29-33 et 2003 : 65-6, 73-4 ; Mihailidis
2003 : 219-242). D’après ces statistiques secrètes, qui n’ont pas cessé de peser le
« sentiment national » [εθνικάφρονήματα] de la population en cause, environ 100 000
slavophones nourrissaient des sympathies pour la Bulgarie ou « des sentiments slaves
déclarés » [δεδηλωμένωνσλαυικώνφρονημάτων] ; une petite partie d’entre eux était
souvent caractérisée, de manière confidentielle, comme une minorité nationale bulgare
existante de facto mais pas de jure. Faute d’un règlement définitif du contentieux gréco-
bulgare qui comprendrait la reconnaissance catégorique par Sofia de la souveraineté
grecque sur la Macédoine méridionale (dite « égéenne »), même les gouvernements le
plus libéraux n’étaient cependant pas disposés à reconnaître de quelconques droits
minoritaires aux « Bulgares » ou « Slaves macédoniens » du pays. Cette politique se
reflète dans les revirements éphémères de la première moitié des années 1920, quand
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
101
Athènes a reconnu l’existence d’une minorité bulgare, puis serbe et enfin macédono-
slave en Macédoine grecque avant de faire machine arrière dans tous les cas. La même
logique l’a aussi emporté dans le cas de l’introduction d’un manuel pour le primaire en
langue slave rédigé avec des caractères de l’alphabet latin (le fameux « Abecedar »), qui
fut ensuite rejeté par la population locale à l’instigation commune de l’appareil
sécuritaire grec et des noyaux nationalistes pro-bulgares (Kostopoulos 2000 : 88-111,
2002 : 383 ; Kofos 1964 : 48-9 ; Mihailidis 2003 : 201-17, 250-8 ; Divani 1995 : 130-61,
298-348). Une constante de la politique étatique de la période envers la population
slavophone était la campagne scolaire pour l’assimilation linguistique des nouvelles
générations, doublée d’un barrage de propagande officielle et médiatique demandant
l’abandon total de l’usage « du patois local » par ses locuteurs stigmatisés et/ou sa
prohibition absolue par les autorités. Cette campagne fut parfois accompagnée de
mesures policières et a connu son apogée pendant la dictature fascisante de Metaxas
(1936-1941), quand la moindre parole en langue slave – même dans l'espace privé – fut
interdite par un ordre de la direction générale de la Macédoine et que les
contrevenants furent soumis à des amendes d’argent ou, sur le modèle du fascisme
italien, à l’absorption forcée et humiliante de l’huile de ricin en public (Kostopoulos
2000 : 73-87, 112-80)42.
36 Pendant tout l’entre-deux-guerres, la seule présence d’une population slavophone
minoritaire en Macédoine grecque continuait à provoquer des cris d’alarme dans la
presse locale et nationale, de la part de ceux qui se considéraient comme les gardiens
de l’intérêt national. Une bonne partie de leurs propositions, qui coïncident, à un degré
impressionnant, avec celles de l’appareil sécuritaire et paramilitaire de l’époque, est
axé sur la nécessité d’achever la transformation démographique du pays par des
installations complémentaires de réfugiés. Dans une série d’articles et un discours
reproduit comme brochure financée par le ministère grec des Affaires étrangères,
Konstantinos Faltaïts (écrivain, folkloriste mais aussi un des propagandistes
nationalistes officieux les mieux connus de l’époque)43 énumère 18 villages de Florina-
Kastoria où l'on devait installer de 10 à 20 familles « de réfugiés montagnards
pontiques, des nomades Sarakatchans et des Grecs de la Roumélie orientale » pour
neutraliser toute possibilité de guérilla de la part des villageois slavophones (Faltaïts
1927 : 15-6). Dans sa réponse, publiée dans les journaux, le député local Georgios Modis
s’est contenté d’observer qu’une telle colonisation était pratiquement impossible, étant
donné que la terre cultivable des villages cités « n’est pas suffisante pour les habitants
indigènes » (Modis 1927). Plus pratique, le secrétaire général de l’Association pour la
propagation des Lettres grecques Dimitriadis proposait en août 1927 « le déplacement
vers l’intérieur [du pays] de la population bulgare des régions frontalières au moins » et
son « remplacement » par des colons grecs. Comme prétexte pour un tel déplacement
les autorités pouvaient utiliser « la menace communiste » ou autres justifications
créées (ou mises en valeur) par les organes sur place. Il propose également toute une
gamme de mesures à prendre par les fonctionnaires de l’État pour « rendre la vie de la
population bulgare impossible dans ces endroits et l’obliger à partir presque
volontairement » [sic] (Dimitriadis 1927 : 2). En janvier 1936, une combinaison pareille
de déplacements de population « graduellement et progressivement », de confiscation
des terres, de pression organisée financière et fiscale, de colonisation enfin de la « terre
ainsi récupérée » par des « anciens combattants en Macédoine [μακεδονομάχους] et des
réfugiés ou paysans sans terre grécophones » était une fois encore proposée par le
même fonctionnaire (Dimitriadis 1936 : 4). Il n’est pas le seul à prôner une telle
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
102
politique : des instituteurs nationalistes locaux demandent aussi la colonisation
supplémentaire des villages slavophones avec « des familles de réfugiés » et le
déplacement des slavophones « suspects ou connus pour leurs sentiments bulgares »
(Iliadis 1931 : 14 ; Papadopoulos 1936 : 11). Les agissements, plutôt rares, de l’ORIM sur
le territoire grec provoquent d’habitude des propositions analogues de la part des
services de sécurité et des cadres administratifs de la région. Suite à l'apparition aux
environs de Florina d’une dizaine de comitadjis fuyant la Yougoslavie et l’attentat raté
d’une trio terroriste contre la présence yougoslave à la Foire commerciale de Salonique
en automne 1927, les autorités administratives, militaires et policières locales ont par
exemple demandé de la direction générale de la Macédoine l’évacuation massive « de
tout village suspect et dangereux » par ceux de ses habitants qui avaient un passé
compromettant et l’instigation d’ « un courant artificiel d’émigration » parmi les
slavophones « pour l’épuration parfaite du terrain » (Kalevras 1927 : 5-8). Les instances
supérieures – de la direction générale jusqu’au ministère des Affaires étrangères – étant
plus préoccupées de l’image internationale du pays que de la répression intérieure des
sympathisants présumés de l’ORIM, ces mesures n’ont pas été pourtant sanctionnées 44.
Après la première phase de la colonisation, les autorités se trouvent confrontées
d’ailleurs à une nouvelle pénurie des ressources humaines et l’émergence d’un
mouvement de population au sens inverse : de nombreux réfugiés installés près de la
frontière désertent progressivement leurs villages pour gagner les villes plus au sud, en
quête de sécurité et/ou de conditions de vie plus supportables (Balkos 1931 : 4 ;
Païzanos 1933). Face à ce développement, mais aussi pour des raisons strictement
partisanes, le métropolite de Sidirokastro propose en 1933 à la direction générale de la
Macédoine de combler les lacunes ainsi créées avec l’installation de nouveaux colons
royalistes originaires du Péloponnèse à la place des réfugiés venizelistes partis
(Vassilios 1933). Il faut noter aussi la frustration généralisée des responsables devant
l’échec total de la colonisation en ce qui concerne l’assimilation linguistique des
« indigènes » : une bonne partie des réfugiés installés sur place dans la Grèce du Nord
étant des chrétiens non-grécophones (souvent des Karamanlides ou des Pontiques
turcophones), ils étaient non seulement incapables de forcer leurs voisins à utiliser la
langue grecque dans leurs contacts quotidiens, mais ont appris le patois slave local
pour pouvoir communiquer avec eux (Kostopoulos 2000 : 83-4). D’où la mise en garde
constante d’Athènes par les autorités locales sur le fait que si on allait installer de
nouveaux réfugiés dans leurs régions, ceux-ci devaient obligatoirement être
grécophones. Un cas spécial, quoique numériquement réduit, a été celui des quelques
milliers des réfugiés slavophones de l’Asie Mineure [Τρακατρούκηδες] qui, dans les
conditions chaotiques de 1922-1925, étaient installés parmi des villages aussi
slavophones des environs du Mont Païko (Mitsopoulos 1971 : 302-3).
37 Si la demande d'une « colonisation supplémentaire » a été frustrée, une autre forme
d’épuration ethnique a été mise en route à partir de 1927 : la privation des émigrants
« allogènes » [αλλογενείς] de leur citoyenneté grecque après leur départ pour les pays
d’Outre-mer. Comme base juridique on a utilisé un décret présidentiel spécial
promulgué en août 1927, selon lequel les « citoyens grecs allogènes qui quittent le
territoire grec sans intention de retour, se dépouillent de leur citoyenneté grecque,
ainsi que leurs enfants qui émigrent avec eux ». La mesure était appliquée pour la
première fois sur quelques milliers de Valaques, définitivement partis de Grèce en 1926
pour s’installer dans la Dobroudja roumaine. Le second groupe visé était les
Macédoniens slavophones qui depuis le début du siècle émigraient en Amérique
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
103
provisoirement, pour gagner de l’argent qu’ils allaient ensuite investir dans leur pays
d’origine. Selon une « note introductive » du chef du service central des Étrangers
adressée en février 1931 au Premier ministre Venizélos, cette émigration continue
offrait aux autorités grecques « l’occasion de réduire la petite minorité bulgare encore
existante en Macédoine et en Thrace », pourvu que des mesures vigoureuses soient
prises pour bloquer le rapatriement de ceux des émigrants qui étaient considérés
comme « dangereux pour [les] intérêts nationaux ». En 1929-1930, le ministère des
Affaires intérieures a compilé ainsi une « liste noire » de 924 émigrants, à qui la
citoyenneté devait être retirée. Très vite on a pourtant compris qu’une partie
importante des proscrits était déjà revenue de l’Outre-mer (et qu'ils ne pouvaient donc
pas être considérés comme « ayant quitté le territoire grec sans intention de retour »),
tandis que 105 autres étaient inclus dans la liste sans la moindre preuve contre eux !
Plus sérieuse encore était la prise de conscience que les réactions provoquées par la
mesure mettaient en question l’assimilation en cours de toute la minorité slavophone
dans la communauté imaginaire néo-hellénique.Après divers aléas bureaucratiques et
le blocage « temporaire » du retour des personnes impliquées dans leurs foyers, la
citoyenneté fut finalement retirée définitivement à un tiers environ des inscrits dans la
« liste noire » pendant la dictature de Metaxas (Kostopoulos 2003a : 53-5). Ce n’était que
le début d’un processus qui allait durer jusqu’à la fin des années 1990.
38 Avec la dictature de Metaxas sont ressorties des tiroirs des propositions antérieures
pour une seconde vague colonisatrice de la zone frontalière. En 1936, l’état-major de
l’armée a demandé la relocalisation de tous les habitants « de conscience nationale
douteuse » de la frontière gréco-bulgare, où l’on était en train de construire un système
des fortifications en prenant comme modèle la ligne Maginot, et leur remplacement par
des « familles de paysans transférées de la Vieille Grèce [i.e. les provinces grecques
situées au sud du Mont Olympe] et ayant un sentiment national vigoureux ». Le préfet
de Florina a aussi demandé le prolongement de cette zone à coloniser vers l’ouest,
jusqu’à la frontière albanaise, proposition que l’état-major a accepté (Kyriakos 1940 : 1).
D’après le plan du chef de l’état-major, le maréchal Alexandros Papagos, les
slavophones « suspects » devaient être installés à l'intérieur du pays, dans des
domaines expropriés (propriétés de monastères, etc.) qu’ils devraient ensuite
rembourser ; dans la seule Macédoine orientale, leur place serait prise par 3 500
familles « ayant des sentiments grecs fervents », subventionnées dans un premier
temps avec un crédit de 110 millions de drachmes (Papagos 1937). Malgré la résolution
présumée de la dictature et le caractère théoriquement très urgent de l’entreprise, le
projet n’a cependant pas été matérialisé – exception faite d’un nombre indéterminé
d’indigènes expulsés du périmètre des nouvelles fortifications, qui étaient déclaré
« zone interdite ». Début 1940, on discutait encore sur l’agence qui serait chargée de
l’œuvre, la direction de Colonisation et la Banque agricole se disputant sa réalisation.
La guerre qui a éclaté en octobre de la même année a mis fin à toute planification. Resta
aussi sur le papier une autre facette du même plan qui prévoyait une émigration
massive et organisée des populations frontalières en Amérique du Sud sur la base d’un
accord avec le gouvernement argentin (Kyriakos 1940). La seule mesure d’ « ingénierie
démographique » pratiquement appliquée par le régime fut ainsi la prohibition absolue
de tout achat non autorisé de terre dans tous les départements frontaliers du pays qui
étaient déclarés « zone surveillée » [επιτηρούμενηζώνη]. Selon les instructions du
maréchal Papagos, un citoyen classifié par les services de sécurité ou l’armée comme
« ayant une conscience nationale bulgare fluide » [βουλγαρόφρωνρευστήςσυνειδήσεως]
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
104
avait le droit d’acheter des immeubles dans son lieu de résidence, tandis qu’un autre
classé comme « personne dangereuse ayant un sentiment bulgare » [επικίνδυνος
βουλγαρόφρων] ne pouvait en aucun cas obtenir l’autorisation délivrée par le Comité de
sécurité publique local qui était nécessaire pour la légalisation d’une telle transaction.
L’objectif final de la prohibition était la transformation de la composition ethnique de
la population frontalière, en instituant un mécanisme de contrôle sur la vie
économique de la zone (Papagos 1939).
Occupation, Libération et projets d’épuration (1941-1949)
39 La Seconde Guerre mondiale a complètement bouleversé tous ces projets. Après
l’invasion allemande et la fuite du gouvernement royaliste au Moyen Orient en avril
1941, la Grèce a été morcelée en trois zones d’occupation. La Macédoine orientale et la
Thrace grecque étaient cédées « temporairement » à la Bulgarie, qui y a démantelé
l’administration grecque et procédé à une campagne d’épuration ethnique organisée,
pour évincer la population grecque (surtout les réfugiés) et peupler la région (appelée
« Province de l’Égée » [Беломорието]) par environ 100 000 colons bulgares ; une partie
de ces derniers étaient des ex-habitants du pays, partis entre 1913 et 1930, d’autres
simplement des fonctionnaires en quête d’un meilleur emplacement. En juin 1942, une
loi spéciale a obligé les habitants à obtenir la nationalité bulgare ou quitter leurs foyers
dans les neuf mois suivants, provoquant ainsi l’exode de dizaines de milliers de
récalcitrants. Plus de 2 000 Grecs ont été aussi exterminés pendant les représailles qui
ont suivi la répression de la révolte de la population grecque de la région de Drama,
sous direction communiste, en octobre 194145.D’après les statistiques officielles
bulgares, les Grecs qui comptaient à peu près 78 % de la population de la « Province de
l’Égée » (et au moins 86 % de celle de la Macédoine orientale) en 1941-1942, en mai 1943
étaient réduits à 67,4 % seulement, tandis que le nombre des « Bulgares chrétiens »
avait augmenté, passant de 43 750 (les 38 600 en Macédoine orientale) à 101 538
(Jaranov 1942 ; Jontchev 1993 : 71-2, 108 ; Kofos 1964 : 100-2 ; Kotzageorgi 1996). Le reste
de la Macédoine grecque est restée sous l’administration des autorités collaboratrices
grecques, sous le contrôle militaire des armées allemande et italienne (cette dernière
circonscrite à une partie seulement de la Macédoine occidentale). Une partie
considérable de la population slavophone a participé en 1941 aux manifestations de
célébration de la chute de l’ancien régime (attitude peu étonnante, si on tient compte
de la répression linguistique sévère infligée par la dictature grecque sortante) et
quelques 14 000 à 18 000 chefs de famille étaient inscrits dans les annexes locales du
« Club bulgare de Salonique »46. En 1943-44, entre 3 000 et 4 000 slavophones ont aussi
été enrôlés, bon gré mal gré, dans les formations armées de milices collaboratrices
organisées initialement par un « Comité macédo-bulgare de l’Axe » [Македоно-
БългарскиКомитетприОста], soutenu et subventionné par le commandement italien, et
plus tard par l’ORIM sous la tutelle nazie (Kostopoulos 2003b). Beaucoup plus nombreux
furent les slavophones qui adhérèrent au mouvement de la résistance pro-communiste
de EAM-ELAS, qui leur promettait un statut de minorité nationale reconnue avec des
droits linguistiques et politiques, garantis pour la première fois depuis leur
incorporation dans l’État grec.
40 Cette « double trahison » (nationale et politique) de la part de la minorité slavophone a
provoqué une vive réaction de la part des milieux nationalistes – aussi bien des
nationalistes résistants à l’Occupation que de ceux qui ont collaboré ouvertement avec
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
105
l’occupant. Pendant toute l’année 1944, divers rapports rédigés en vue de la libération
ont envisagé l’expulsion massive et violente des slavophones de la Grèce du Nord. « On
ne peut plus parler de leur maintien sur le territoire grec. Dans toute la Macédoine,
l’épuration est devenue une conviction et une nécessité générale », écrit par exemple
Dimitrios Lambrakis, propriétaire des journaux libéraux d’Athènes Eleftheron Vima et
Athinaïka Nea, dans une lettre adressée en janvier 1944 au Premier ministre du
gouvernement d’exil, Emmanuel Tsouderos. Le nombre de « ceux qui doivent déserter
le territoire grec » parmi les slavophones y est évalué à 100 000. Lambrakis explique
aussi que « ces populations sont solidement enracinées dans la terre, et qu'il faudrait
une pression sévère pour qu’elles se soient déracinées » avec leurs familles (Lambrakis
1944). En octobre 1944, le chef du 2e bureau de l’état-major de l’armée royaliste
restructurée en exil envisageait aussi « l’extermination ou au moins l’expulsion en
Bulgarie des Bulgares qui n’ont pas été échangés en 1923 » 47. Leur expulsion devait
avoir lieu « immédiatement, dès l’apparition de circonstances propices » mais en tout
cas « avant la paix ». L’utilisation de « mesures sévères contre les Grecs bulgarophiles »,
dont la punition devait être « publique, rapide et brutale », y était aussi proposée, pour
que « les futurs Bulgares ne trouvent pas d'exemples à imiter ». On rappelait enfin que
« Byzance s’[était] calmée dès que [l’empereur] Basile le Tueur de Bulgares [avait]
aveuglé 10 000 Bulgares » (Vrettos 1944 : 4). En avril 1946, le spécialiste Christophoros
Christides, ancien membre de la Commission mixte gréco-bulgare qui avait organisé
l’échange des années 1920, estimait à son tour qu’il fallait « évacuer définitivement,
hors de la frontière de notre pays, 60-70 000 Slaves macédoniens des régions de Florina,
Kastoria et Pella » et mettre à leur place « des Grecs purs, des Crétois si possible »
(Christides 1946 : 7)48. La même « solution définitive » de la « question slave » de la
Grèce du Nord était enfin proposée non seulement par des nationalistes de toute sorte,
qui qualifiaient les Macédoniens slavophones comme « les Sudètes de la Grèce »
(Kostopoulos 2000 : 199-200) mais aussi par l’ambassadeur de Grande-Bretagne auprès
du gouvernement royal. « Il semblait préférable que la Grèce ne contienne pas la
moindre trace de minorités slaves », écrivait Sir Reginald Leeper à son ministre des
Affaires étrangères, Antony Eden, le 27 novembre 1944, estimant qu’ « on devait
trouver une patrie pour peut-être 120 000 Slaves macédoniens au nord de la frontière
grecque de 1941 » (Leeper 1944)49.
41 Au niveau local, des propositions similaires sur le traitement spécial des slavophones
furent avancées en 1945-46 par des cadres de l’appareil administratif et policier ou par
des personnalités éminentes du milieu politique nationaliste local. Dans la plupart des
cas, les compilateurs de ces rapports concentraient leurs flèches sur la partie de la
population slavophone présentée comme bulgarophile (ou slave-macédonienne)
pendant l’Occupation, dont l’expulsion sommaire était demandée, en essayant de
protéger en même temps ceux des slavophones considérés comme « ayant des
sentiments nationalistes [grecs] » [εθνικόφρονες] ou « inoffensifs ». D’habitude, on
classifiait les habitants en cause par catégories, d’après leur « sentiment national » et /
ou leur « attitude » quotidienne, en proposant un traitement différencié de chaque
catégorie. Le chef de division de la Fondation de sécurité sociale de Salonique, Kostas
Samaras, divise par exemple en février 1945 les slavophones en trois catégories : ceux
« ayant des sentiments nationaux slaves » [σλαυόφρονες], qui sont estimés à environ
50 000 ou 30 % de la population slavophone du pays, ceux qui « sont restés grecs »
(estimés aussi à 30 %) et, enfin, ceux qui sont considérés comme « ayant une conscience
fluide » [ρευστής συνειδήσεως] « mais plutôt proche de l’idéologie grecque » (40 % du
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
106
total ou environ 65-70 000). La première catégorie devait être « éloignée de ses régions
de domicile », tandis que les autres 70 % « étaient ou pouvaient devenir des Grecs ».
Quand au transfert des « Bulgares impénitents », il devait se matérialiser « avec
beaucoup d’habilité et de finesse, pour que cela ne constitue pas une reconnaissance
officielle » de l’existence d’une minorité nationale (Samaras 1945 : 6). Le maire de la
ville d’Edessa, K. Sivenas, classifie poursa part les slavophones « bulgarisants » en trois
autres catégories, suivant le degré de nuisance à la patrie. La première catégorie est
composée par tous ceux qui pendant l’Occupation étaient armés, soit par les autorités
italiennes, allemandes ou bulgares, soit par la résistance pro-communiste de l’EAM-
ELAS. Ses membres devaient tous être expulsés en famille de la Grèce, leur fortune
immobilière confisquée par l’État. Le même destin attendait aussi les familles de ceux
des slavophones qui allaient être condamnés à mort et exécutés pour des actes
criminels. L’expulsion de la deuxième catégorie, celle des « notables » des villages
incriminés, était aussi proposée, à condition que cette mesure ne crée pas de problèmes
d’ordre diplomatique. Sansle cas contraire, elle devait être traitée comme relevant de la
troisième catégorie. Cette dernière comprenait « la masse poussée à manifester son
absence de conscience nationale sans pour autant participer à une activité plus
sérieuse » et devait aussi être punie, afin qu’on arrive à« l’éradication définitive de la
minorité slavo-macédonienne »: on prévoyait la condamnation collective de ses
membres pour « indignité nationale », la confiscation de la moitié de leurs biens et leur
transfert en Grèce du Sud ou aux îles, disséminés par groupes de 3 à 5 familles de
proche parenté dans chaque village, pour ne pas pouvoir s’entremarier et être donc
forcés de s’assimiler dans la population locale (Sivenas 1945 : 2-3). Un autre rapport,
trouvé dans les archives de Philippos Dragoumis et dont l’auteur reste anonyme,
préfère la classification du même groupe ethnique en trois catégories différentes. Le
premier groupe, celui des « agents, dirigeants, propagandistes conscients et
collaborateurs avec l’ennemi » serait puni « tout de suite très sévèrement » et éloigné
des arrondissements frontaliers, mais « avec beaucoup d’habilité pour qu’on ne donne
pas aux Yougoslaves et aux Russes des prétextes de protester ». Les forces armées
britanniques présentes dans la région devaient « fermer les yeux ou même aider
secrètement les autorités grecques pour effectuer un tri ». La seconde catégorie, celle
des slavophones qui « s'étant manifestés comme sympathisants des Bulgares ou de
l’autonomie [de la Macédoine] par peur ou par faiblesse de caractère, sans avoir
participé à des actes concrets contre la nation ou pour l’autonomie », catégorie qui
incluait la majorité de la population en cause, serait traitée comme un troupeau de
« brebis égarées » à qui on devait faire comprendre « qu’il n’y avait aucune possibilité
pour que le régime grec ou la puissance anglaise ne prédominent pas » sur place. Si
nécessaire, ses membres pouvaient « être terrorisés habilement ». La troisième
catégorie, enfin, était composée par des « gens de langue autre que le grec qui avaient
fait preuve d’endurance nationale, de solidité et de l’amour pour la patrie », et devait
être rémunérée matériellement « par tous les moyens », en obtenant par exemple les
biens immobiliers de leurs compatriotes expulsés du pays (Anonyme 1945). La
« persécution impitoyable » et l’expulsion généralisée de tous les slavophones qui
avaient exprimé des sentiments nationaux non grecs, « qu’ils soient 5, 10, 20, 30 [ou] 50
milliers », était aussi défendue en 1945 par l’inspecteur adjoint des écoles dans la région
d’Amyntaio, qui félicitait le chef de la gendarmerie locale pour « son œuvre patriotique
de répression de ces ennemis sordides de la Patrie ». Il allait jusqu’à demander la
punition des « Grecs importants » de la région qui osaient se présenter comme témoins
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
107
à décharge des slavophones avec lesquels ils étaient liés par des « liens politiques et
familiales » (Nakos 1945). D’autres rapporteurs se déclarent pour « l’extermination
totale » de tous les slavophones impliqués soit dans les groupements
collaborationnistes soit dans le mouvement de résistance de l’EAM-ELAS, par une
« épuration étudiée et dirigée » par les autorités officielles, « pour qu’elle ne prenne
pas la forme d’un massacre généralisé » (Liakos 1945) ou précisent village par village les
agglomérations slavophones de leur juridiction qui « sont la cause principale du mal »
et dont « le problème doit être réglé de façon radicale » (Préfet de Pella et al. 1945). Il y
a aussi ceux, qui, comme le préfet de Florina, écartelés entre la nécessité absolue
d’ « épurer notre frontière des Bulgares » et le peuplement de la zone frontalière par
« des Grecs purs de l'intérieur », d’une part, et la conscience qu’une telle mesure
risquait « de créer une question minoritaire », de l’autre ; ils finissent par « clamer avec
une voix de stentor que dans ce territoire, sanctifié par le sang de milliers des Grecs, il
n’y a pas de Bulgares mais seulement des Grecs » (Mavridis 1945a). Il faut noter, enfin,
que les schémas d’épuration ethnique formulés en 1945 n’étaient pas limités aux seuls
slavophones, mais ils englobaient aussi d’autres groupes. Les réfugiés d’origine
caucasienne, par exemple, quoique « Grecs purs » du point de vue ethnolinguistique, y
étaient surtout visés comme un élément « propice à l’anarchisme », « qui n’a pas du
tout l’intention de s’acclimater dans le climat national grec ». En réalité, ils avaient
simplement participé massivement au mouvement de résistance pro-communiste,
activité considérée alors par les autorités comme « anti-grecque » (Mavridis
1945b : 2-3 ; Sivenas 1945 : 5 ; Dragoumis 1948 : 16).
42 Plus pratique est la focalisation de l’appareil étatique sur le danger purement électoral
posé par la coopération de la minorité slave avec le mouvement communiste. En mars
1945, par exemple, le colonel Anastasios Dalipis propose au 2 e bureau de l’état-major
l’annexion de la sous-préfecture grécophone de Voïo (ou au moins de 31 de ses villages)
à la préfecture voisine de Kastoria, où l’élément slavophone était plus que visible (75
villages sur 110), « pour modifier la composition de la population » et « servir à des fins
nationales sur tous les plans ». Des arguments économiques, administratifs et de
transport y sont aussi avancés, mais ils sont clairement considérés comme secondaires
(Dalipis 1945). En octobre 1945, le 2e bureau de l’état-major a à son tour proposé
l’inscription d’environ 800 nomades Sarakatchans grécophones, « ayant tous des
sentiments nationalistes » [άπαντεςεθνικώνφρονημάτων], dans les listes électorales des
préfectures de Florina, Kastoria et Pella : étant donné que ces préfectures « présentent
une fragilité [ευπάθειαν] à cause de l’élément slavophone », on précise « des raisons de
nécessité nationale suprême imposent l’augmentation du volume des votes grecs [sic]
pour neutraliser le vote de ceux qui ont des sentiments slaves » [προςεξουδετέρωσιντων
ψήφωντωνσλαυοφρόνων] (Dromazos 1945). Deux mois plus tard, une politique encore
plus décisive est proposée par un officier de la direction des renseignements de l’état-
major, Epameinondas Vrettos. Son rapport classe les préfectures de la Macédoine selon
la probabilité qu’une alliance possible entre communistes et « slavisants »l’y
emporte50et déclare qu’ « à tout prix, ni un seul député non nationaliste ne doit pas être
élu » dans les préfectures de Pella, Kastoria et Florina, en insistant sur le fait qu’ « il y a
un danger » que ces élus puissent « se rendre à [la Chambre de] Skopje au lieu [de celle]
d’Athènes ». Parmi les mesures préconisées pour éviter une telle élection, on distingue
la mobilisation des ouvriers slavophones « sérieusement rémunérés » pour qu’ils se
trouvent loin de leur pays pendant le scrutin ; l’exercice de la « pression
psychologique » par la gendarmerie (secrètement) et les candidats nationalistes
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
108
(ouvertement) sur les villageois ; le transfert des unités militaires d’autres régions pour
voter sur place ; la privation du droit de vote « des communistes et des pro-bulgares
dangereux », ainsi que des candidats communistes ou considérés comme « ayant des
sentiments slaves » ; enfin, la promesse faite aux slavophones officiellement classifiés
comme « ayant une conscience slave » qu’ils seraient « réhabilités » si ils votent pour
les candidats grecs nationalistes. À long terme, pourtant, l’officier du 2 e bureau estime
que « de ces gens-là, il faut faire à nouveau des Grecs par une assimilation nouvelle ou il
faut les exterminer à temps, soit par des pressions économiques, pour qu’ils soient
obligés de quitter la Grèce, soit par n’importe quelle mesure violente » (Vrettos
1945 : 4-9, 12-3). Lors des élections qui ont eu lieu le 31 mars 1946, l’abstention politique
de la gauche (et du centre-gauche) a résolu le problème d’une façon quasi-automatique.
43 Le premier pas officiel vers la résolution de la « question slave » du pays était de
cartographier le terrain. En octobre 1945, les ministres de la Justice, de l'Intérieur et
des Affaires militaires promulguéune décision commune (N° 115/10/28/15 du 25.10.45)
pour le recensement officiel des citoyens classifiés comme « ayant des sentiments
bulgares » [βουλγαρόφρονες] ou « roumains » [ρουμανόφρονες], avec une distinction entre
« causes aggravantes » (Liste A) et « causes atténuantes » (Liste B). Ce tri était confié à
des comités spéciaux établis au niveau de la préfecture et composés par des chefs de
l’administration publique, des procureurs et des officiers de la gendarmerie (Vlastaris
1945). Le bilan final dressé en juillet 1946 énumérait 104 655 personnes « ayant un
sentiment bulgare » dans la Macédoine (dont 99 206 « sur base de critères aggravants »
et 5 449 seulement « sur base des critères atténuants » (Theotokis 1946 : 1) 51. Un autre
comité, envoyé sur place en septembre et composé par trois hommes-clés de la scène
politique nationaliste de la Macédoine (Ph. Dragoumis, G. Modis, D. Andreadis) a aussi
compilé des statistiques similaires, sur la base de renseignements fournis par les
autorités locales, administratives, militaires, policières et ecclésiastiques, mais aussi sur
la documentation trouvée dans les archives de la direction générale de la Macédoine, à
Salonique. Les statistiques ainsi établies étaient déposées à la direction générale de la
Macédoine, à l’état-major de l’armée et au ministère des Affaires étrangères (Modis
1945 ; Dragoumis 1948 : 12). La comparaison entre les deux listes au niveau des
préfectures indique que les critères appliqués étaient peut-être similaires mais
sûrement pas identiques : dans la préfecture de Florina, par exemple, la première
commission a compté 31 829 « bulgarisants » (30 937 dans la liste A et 892 dans la liste
B), tandis que la seconde a énuméré 32 369 « bulgarisants » et 15 554 « slavophones
ayant une conscience fluide ». Dans la préfecture de Kastoria, les chiffres respectifs
étaient 11 380 – tous des « causes aggravantes » – et 13 516 (Theotokis 1946 : 1 ; Listes
1945). Une approche plus minutieuse des listes détaillées conservées dans les archives
de Philippos Dragoumis peut dévoiler d’autres incohérences : par exemple la
classification de villages ayant été armés par la milice collaboratrice bulgaro-
macédonienne comme « ayant une conscience nationale grecque » 52, tandis que
d’autres qui avaient participé à la résistance (en refusant d’être armées par le Comité
bulgare ou l’ORIM) étaient désignés comme majoritairement « bulgarisants » 53. Dans un
article publié en 1948, Philippos Dragoumis nous donne une clé pour interpréter cette
manipulation: « la dernière occasion offerte aux dupes [παρασυρμένοι]parmi les
villageois bulgarophones pour prouver qu’ils se sont repentis et qu’ils ont décidé de
rester désormais des Grecs ont été les élections du 31 mars 1946. En fait, avec
l’abstention du P.C.G., il était facile de vérifier leur repentir : il suffisait qu’ils aillent
voter et qu’ils ne s’abstiennent pas » (Dragoumis 1948a : λδ΄ ). Le glissement graduel du
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
109
pays dans la guerre civile, et la nécessité pour le camp gouvernemental d’assurer la
loyauté d’une partie des slavophones « exposés » auparavant a imposé le déplacement
de la ligne officielle de démarcation entre « Grecs » et « Slaves » à l’intérieur des
groupes ethnolinguistiques. Des nécessités moins avouables, comme la protection des
réseaux clientélistes des politiciens nationalistes dans les villages « stigmatisés », ont
aussi joué un certain rôle. Une partie des effectifs du camp gouvernemental dans les
villages slavophones était d’ailleurs composée d’anciens « bulgarisants » partisans de
l’ORIM fascisante. Sous l’influence de l’émigration bulgaro-macédonienne aux États-
Unis, regroupée autour de l’Organisation patriotique macédonienne (MPO), ces
nouveaux venus dans le camp « nationaliste » grec propageaient une ligne politique
selon laquelle les slavophones ne devait pas prendre parti – comme communauté
distincte – dans cette « guerre civile des Grecs », mais supporter les autorités
« légitimes » (ou reconnues comme telles par les gouvernements occidentaux) et
attendre la fin du conflit pour demander à l’Occident le respect de leurs droits
minoritaires (Kostopoulos 2000 : 205). Le résultat final de ce choix est jusqu’à
aujourd’hui décelable sur le terrain : dans plusieurs villages slavophones, le noyau dur
des nationalistes grecs locaux est composé de familles ayant des ancêtres dans
l’ancienne « Okhrana » pro-bulgare pendant l’Occupation, qui ont ensuite été enrôlés
dans le camp gouvernemental pendant la guerre civile54. Même dans les filières du KYP
(les services secrets grecs) des années 1950 et 1960, des gens ayant participé aux milices
collaboratrices pro-bulgares sont qualifiés comme « ayant une conscience nationale
fluide », tandis que les anciens résistants slavophones de EAM-ELAS sont toujours
classifiés comme « bulgarisants » ou « slavisants » (KYP 1965 : Annexe C) 55.
44 Les délibérations de l’appareil gouvernemental et administratif central sur l’utilisation
définitive de ce fichage ont duré plus de quatre années. En 1946, le ministre de l’Ordre
public et une commission de l’armée dirigée par le chef de l’état-major se sont
finalement déclarés pour « l’éviction (expulsion) du territoire grec des gens ayant des
sentiments bulgares », dont le nombre était estimé aux alentours de 100 000, et ont
proposé au gouvernement d’intégrer cette épuration aux demandes officielles de la
Grèce adressées à la Conférence de la Paix (Theotokis 1946 : 3). Le représentant grec à la
Commission d’enquête de l’ONU, Alexis Kyrou, a ainsi officiellement demandé en mars
1947 à la communauté internationale de « débarrasser » la Grèce « de la plupart » de
ses habitants slavophones. « La solution radicale de ce problème », a-t-il insisté,
constituait la condition sine qua non pour la pacification du pays (Ministère de la Presse
1947 : 158-60). Dans les années suivantes, des délibérations successives sur le même
« problème » ont eu lieu à l’initiative du ministère des Affaires étrangères. On a conclu
qu’une déportation massive des « bulgarisants » était pratiquement « impossible, parce
qu’elle produirait des réactions de nature diplomatique et économique ». On a donc une
fois encore reclassé théoriquement la population en cause en trois catégories : « ceux
qui agissent dangereusement » [επικινδύνωςδρώντες], dont on a décidé l’éloignement des
provinces frontalières, « ceux qui ont une conscience bulgare mais qui s’abstiennent de
toute manifestation », et « ceux qui évitent toute manifestation ». Le ministère de
l’Ordre public a été chargé de compiler les listes des personnes relevant de la première
catégorie et qui devaient être transférées. Au printemps 1949, cette compilation était
presque terminée : le 11 mars 1949, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères,
Panayotis Pipinelis, a informé le conseil des Affaires politiques du ministère que le
nombre des « bulgarisants fanatiques » à déplacer était estimé entre 10 000 et 20 000.
Après leur déplacement, ils seraient privés de leur citoyenneté grecque et de leur
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
110
bulletin de travail. Pipinelis a ajouté qu’il fallait agir vite et mettre en valeur la
déclaration récente du Parti communiste et de son front slave-macédonien (NOF) en
faveur d’une Macédoine autonome56 ; autrement, dans un climat plus apaisé, il y avait le
danger « que la politique de l’indulgence prédomine, comme d’habitude, et que ces
messieurs restent sur leur place pour menacer de nouveau l’intégrité et la paix de notre
pays » (Conseil des Affaires politiques 1949 : 16-7). Les décisions finales sur la question
furent prises le 23 mars 1949, par une réunion convoquée à Athènes par le chef des
forces armées, le maréchal Alexandros Papagos, avec la participation des représentants
de tous les ministères ou services impliqués, ainsi que de certaines personnalités-clefs
du monde politique nationaliste. Le texte intégral des décisions prises pendant cette
réunion n’a jamais été retrouvé jusqu’à présent. On connaît seulement une partie des
décisions relative à la nomenclature officielle visant l’ensemble des membres du groupe
ethnolinguistique – qu’on devait dès lors appeler seulement des « slavophones », toutes
les autres désignations étant interdites (Kostopoulos 2004 : 385-6). L’historiographie
officielle de la République de la Macédoine ex-yougoslave fait référence à une copie de
ces décisions, selon laquelle l’accent était missur l’assimilation de la minorité dans la
nation grecque et pas sur son expulsion. Le texte intégral du document n’a pas été
publié jusqu’à présent (Macedonian Academy 1993 : 82-3). Plusieurs propositions faites
entre 1947 et 1949 pour un échange des minorités entre la Grèce et la Yougoslavie
furent d’ailleurs également rejetées par l’Assemblée générale de l’ONU et divers
gouvernements occidentaux. Les raisons principales de ce rejet étaient l’inexistence
d’une minorité grecque digne de ce nom dans la Macédoine yougoslave, ainsi que
l’inquiétude d’Athènes face aux conséquences à long terme d’une telle négociation
(King 1949 ; Kofos 1964 : 173-4 ; Lagani 1996 : 124-8).
45 Grâce à trois documents de 1950, récemment trouvés dans les archives privées de
Konstantinos Vovolinis,on a cependant appris que le 11 juillet 1949, quelques jours
avant le déclenchement de l’offensive finale de l’armée gouvernementale contre la
guérilla communiste, le Conseil des ministres avait décidé « définitivement » le
transfert de environ 15 000 slavophones, considérés comme « représentant un danger
pour la sécurité nationale », de la région frontalière à d’autres régions éloignés de la
Macédoine (Péloponnèse, Crête, Lesbos, Samos etc.).Ce transfert devait être mené à
bien de façon organisée : les « délogés » pourraient emmener avec eux tous leurs biens
mobiliers ;du point de vue légal ils seraient traités comme des « victimes des bandits » [
συμμοριόπληκτοι] et pas comme ennemis de l’État ;on leur distribuerait de nouvelles
terres issues des domaines d’État ou de l’expropriation de domaines de l’Église
orthodoxe ; les terres de 22 monastères de Péloponnèse devaient aussi être
réquisitionnées le plus vite possible.Le manque d’argent acependant obligé les autorités
à réviser encore une fois leur projet le 19 août, réduisant à 2 000 familles (8 000
personnes) seulement le nombre de ceux qui allaient être immédiatement délogés. Un
comité, basé à Salonique, était chargé de régler les détails techniques du transfert. Le 5
novembre, la phase préparatoire de projet était achevée; on n’attendait plus que
l’allocation des crédits nécessaires (25 milliards de drachmes)pour le lancer.Mais le
ministère des Finances n’a pas approuvé cette dépense et la mise en oeuvre du plan a
été une fois de plus ajournée. Les élections du mars 1950, la défaite de la droite et la
formation d’un gouvernement centriste qui avait promis des mesures de
« réconciliation nationale » ont aussi contribué à l’abandon provisoire du projet, de
même que le rétablissement des rapports diplomatiques entre la Grèce et la
Yougoslavie (Papagos 1950 ; Nikolopoulos 1950 ; MAE 1950). En décembre 1950, le chef
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
111
des forces armées, le maréchal Alexandros Papagos, a ainsi recommandé au
gouvernement l’application d’un autre plan, « de longue haleine », prévoyant « le
transfert graduel » – et pas collectif – au sud de la Grèce « des familles ou des individus
slavophones qui avait dans le passé agi contre la nation » et leur remplacement par
« des familles nationalistes d’autres régions du pays » (Papagos 1950).
L’épuration de facto (1945-1949)
46 Malgré tous ces revirements, l’épuration ethnique d’une grande partie de la population
slavophone de la Macédoine grecque a été une réalité indéniable pendant les années
1940, surtout dans les régions frontalières de Kastoria, de Prespa et d’Almopia, qui ont
été transformées en champ de bataille entre l’armée démocratique des communistes et
l’armée nationale gouvernementale. En réalité, on peut discerner diverses vagues
successives d’émigration forcée de la population slavophone, avant et après le
déclenchement officiel de la guerre civile.
47 Au printemps 1945, quelques milliers des « bulgarisants » de la Macédoine orientale ont
été expulsés massivement vers la Bulgarie par la guérilla nationaliste locale. En avril
1945, la petite ville de Kato Nevrokopi fut par exemple évacuée de tous ses habitants
slavophones (environ 1 600) qui n’avaient pas fui avec l’armée bulgare en octobre 1944.
La logique de l’entreprise, analysée par son organisateur, le chef de bande Hristos
Taskas57, dans ses mémoires inédites, était plutôt simple : il fallait se débarrasser d’un
« guêpier du bulgarisme » stratégiquement important, dont les habitants avaient en
plus acclamé avec enthousiasme les partisans procommunistes, et en même temps
vider des agglomérations pour loger les réfugiés grecs qui retournaient chez eux dans
la région (Taskas s.d.: 309, 317-30). Au total, on estime qu’environ 10 000 Macédoniens
se sont réfugiés en Bulgarie en 1944-1945 (Kofos 1964 : 148). En 1945-1946, la « terreur
blanche » dirigée contre la gauche et ses alliées (mais aussi contre la minorité
slavophone toute entière) a produit une nouvelle vague de 13 000 réfugiés de la
Macédoine centrale et occidentale en Yougoslavie, où il y en avait déjà 4 000 venus en
1944 et 500 qui avaient fui en 1941-1943. Sur un total de 9 500 réfugiés jusqu’à la fin
1945, les slavophones représentaient 8 664 (Katsanos 2008 : 55 ; Mihailidis 2004 : 46-7).
48 La généralisation du conflit en 1947 et la constitution d’un « gouvernement provisoire »
par les partisans ont offert des nouvelles possibilités d’ingénierie démographique.
Estimant que la « zone libérée » de l’armée démocratique se transformait en une sorte
de petite « Macédoine autonome » (grâce à ses écoles slaves et l’auto-administration
communale pratiquée sous contrôle communiste), le ministre de la Grèce du Nord,
Aristeidis Bassiakos, a proposé en janvier 1948 une politique d’épuration ethnique du
champ de bataille de toute présence slavophone : « Il est nécessaire que cette situation
soit remise en cause et que son extension soit entravée par des opérations militaires
qui ne vont pas épargner les villages bulgares de cette région », écrivait-il au ministère
des Affaires étrangères, « d’une telle façon que, même si nos forces militaires se
retirent, les bandits qui retourneront ne trouvent ni leurs maisons ni leurs villages »
(Bassiakos 1948). Cette méthode de la terre brûlée était déjà appliquée par l’armée
contre des villages spécifiques de Vitsi (Perikopi, Baptchor [rebaptisé après coup
Poimeniko], Polykerasos, Koryfi etc.) et devait l’être une seconde fois en 1948-1949 dans
la zone frontalière de Kastoria (Dendrohori, Krystalopigi). Dans certains cas, les villages
incendiés étaient ultérieurement rasés par des bulldozers, exception faite seulement
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
112
pour leurs églises (Pop-Janevski 1996 : 142, 149). Au printemps 1948, une grande partie
de la zone slavophone de Grammos a été évacuée de ses habitants, enfuis massivement
en Yougoslavie (Kirjazovski 1989 : 41-2). Pendant l’offensive militaire de l’été 1948,
l’armée a aussi essayé d’expulser violemment vers la frontière – ou vers les lignes de la
guérilla – les familles des slavophones civils de sa zone, avec des résultats ambivalents
(Dragoumis 1948 : 17-8). Au total, 46 villages slavophones représentant une population
de 20 913 personnes en 1940 ne sont pas du tout mentionnés dans le premier
recensement de l’après-guerre (Pejov 1968 : 172-5). La minorité était enfin décimée par
le départ d’une partie considérable de la population de la zone frontalière avec les
partisans vaincus en août 1949. D’après les statistiques officielles de l’appareil
communiste, environ 20 000 des 55 000 réfugiés politiques installés en URSS ou en
Europe de l’Est après la défaite de l’armée démocratique étaient des « Slavo-
Macédoniens », ainsi que 18 000 des 25 000 réfugiés en Yougoslavie (Kirjazovski 1989 :
53-5 ; Mihailidis 2004 : 48, 58-9 ; Katsanos 2008 : 54-5). Environ 20 000 autres avaient
péri pendant les hostilités, selon les estimations de l’historiographie officielle de la
République de Macédoine yougoslave (Kiselinovski 1990 : 140 ; Simovski 1998 A : xlv).
Pour le camp victorieux, cet exode constituait « les effets secondaires bénéfiques » [the
beneficial side-effects] de la tragédie de la guerre civile : « la Grèce », écrit avec
soulagement l’expert officiel du ministère grec des Affaires étrangères Evangelos Kofos,
« a été ainsi délivrée d’une minorité ayant une conscience étrangère qui avait menacé
activement sa sécurité et sa paix intérieure » (Kofos 1964 : 186).
49 Le destin des « bandits » partis, ainsi que celui des membres de la minorité ayant
simplement émigré à l’étranger avant ou pendant les années 1940, fut scellé pendant la
décennie suivante avec la déchéance massive de leur citoyenneté grecque et la
confiscation de leurs biens immobiliers, même dans le cas où leurs familles étaient
restées dans le pays. La privation de la citoyenneté fut effectuée par deux lois
différentes. La première, la décision LZ du Parlement (1947), visait ceux qui se
trouvaient à l’étranger « pendant la rébellion courante » [διαρκούσηςτηςπαρούσης
ανταρσίας] et aidaient activement la lutte des partisans. Son application fut néanmoins
surtout réelle après la fin des hostilités, sur la base d’une fiction de droit qui a prolongé
la durée légale de la guerre civile jusqu’à juillet 1962 ! Au total, 22 366 citoyens grecs de
toute langue maternelle ont été privés de leur citoyenneté par cette voie. La seconde loi
était le décret présidentiel de 1927 déjà utilisé contre les « citoyens grecs allogènes qui
quittent le territoire grec sans intention de retour », remplacé en 1955 par une clause
identique figurant dans l’article 19 du nouveau Code de la citoyenneté grecque. Des
milliers des slavophones émigrés ou réfugiés politiques à l’étranger ont perdu leur
citoyenneté sur la base du décret de 1927, par des actes administratives qu’on ne
publiait pas dans le Journal officiel (Kostopoulos 2003a : 56-60). D’après un premier
recensement, incomplet, basé sur les archives du ministère des Affaires étrangères,
dans le seul trimestre de décembre 1949 à février 1950, on avait retiré leur citoyenneté
à au moins 1 436 des « allogènes » qui avaient quitté la Macédoine grecque pour gagner
la Yougoslavie, la Bulgarie, la France, les États-Unis, le Canada, l’Australie ou d’autres
pays. En mai 1950, on en a encore déchu 162. La procédure était dirigée par les
« centres » locaux (au niveau des préfectures) du « service des étrangers » [Υπηρεσία
Αλλοδαπών] du ministère de l'Intérieur, le principal service secret du pays entre 1938 et
1953. Les listes compilées par ces « centres d’étrangers » faisaient la distinction entre
les « allogènes ayant perdu la citoyenneté grecque après d’être partis en Bulgarie » et
ceux qui étaient partis « en Yougoslavie et vers d’autres pays étrangers ». Des listes
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
113
similaires, concernant les habitants radiés de chaque village étaient ensuite envoyées
par le directeur du ministère de l’Intérieur aux préfectures responsables, ordonnant la
suppression de leurs noms des registres communaux. Dans un cas typique, 58 hommes
et 20 femmes du village de Xino Nero, partis du village entre 1911 et 1949, ont été
effacés des registres d’état-civil en juin 1950. Le même mois, une procédure identique a
visé 86 hommes et 66 femmes dans le village voisin de Vevi et 30 hommes et 13 femmes
dans celui de Meliti. Le bilan complet de cette pratique administrative reste à faire 58. En
ce qui concerne l’application de l’article 19 après 1955 (et jusqu’en 1998, quand il a été
aboli sans effet rétroactif), on sait de source officielle qu’au total on a privé de leur
citoyenneté 13 406 non-musulmans, des Macédoniens slavophones dans la plupart des
cas. Quand à la confiscation des fortunes immobilières, on a utilisé quatre lois
différentes : deux décisions (Μ et Ν) votées par le Parlement pendant la guerre civile,
une loi de la dictature de Metaxas (1539 /1938) prévoyant la prise par l’État des lopins
de terre abandonnés et un acte constituant de 1945 qui autorisait la confiscation totale
ou partielle des biens des personnes condamnées pour collaboration avec l’occupant
(Sotiropoulos 1991). La mesure était conforme à la proposition faite pendant les
délibérations officielles de 1948-1949, d’ « envoyer à temps [εν καιρώ] leurs familles »
aux fuyards excommuniés du corps national, « s’ils ne les avaient déjà emmené avec
eux » (Dragoumis 1948 : 17) – avec la petite différence que cet « envoi » était matérialisé
par la privation des ressources vitales et non par la voie purement administrative d’une
expulsion formelle.
IV. L’APRÈS-GUERRE CIVILE : QUE FAIRE DES
« INEXISTANTS » ?
50 Après la fin de la guerre civile et le « règlement » des détails juridiques non résolus
jusqu’alors, la question macédonienne était désormais officiellement « inexistante »
pour la Grèce. Malgré l’amélioration des relations avec la Yougoslavie dès 1950, Athènes
a constamment refusé de discuter avec Belgrade du traitement et même de l’existence
d’une minorité macédonienne slave dans la Grèce du Nord (Katsanos 2008). Le
rétablissement des relations avec la Bulgarie en 1964 et l’alliance informelle gréco-
bulgare ente 1976 et 1989 ont été aussi effectués sur la même base, facilités par le refus
de Todor Zhivkov d’aborder même le sujet (Kostopoulos 2000 : 285). Cette politique
était ratifiée par la disparition graduelle de toute référence statistique officielle à la
diversité linguistique ou religieuse dans le pays. Le dernier recensement où on
enregistre la langue maternelle des habitants est celui de 1951 ; ses données sont
répertoriées par préfecture et sous-estiment évidemment la taille des groupes
linguistiques non grécophones. Au total, 41 167 personnes (dont 35 894 en Macédoine)
étaient enregistrées comme ayant une « langue maternelle slave », tandis que
seulement 10 346 étaient présentées comme la pratiquant[ομιλούντεςσυνήθως]. Le
contraste avec les statistiques secrètes compilées en même temps par les services de
sécurité ou avec les rapports annuels des cadres scolaires locaux est plus que frappant.
Le département de Florina est par exemple présenté dans le recensement de 1951
comme étant peuplé par 14 476 de Slavophones seulement ; le recensement secret
effectué sur place par le service de renseignement de l’État (KYP) en 1954 y enregistre
pourtant 43 546, dont 12 549 classifiés comme ayant « une conscience nationale
étrangère ou fluide ». En 1965, le même service y recense 51 859 slavophones, tandis
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
114
qu’une estimation de 50 000 est avancée en 1965 par les cadres locaux qui informent le
diplomate Dimitrios Bitsios et l’expert Evangelos Kofos de l’envergure du « problème ».
Dans les départements voisins de Kastoria et de Pella, le recensement de 1951 ne
compte que 1 009 et 9 353 slavophones, contre les 17 229 et 42 627 trouvés par le KYP en
1954 et les 40 000 et 45 000 qu’estiment respectivement les interlocuteurs de Bitsios et
de Kofos en 1965 (Kostopoulos 2000 : 222-4 ; 2003 : 66, 73-4). Loin d’être réglé
définitivement, le « problème » d’une minorité formellement « inexistante » mais
toujours présente sur place continuera donc de troubler les dirigeants d’Athènes
pendant leurs délibérations sous le sceau du secret d’État.
51 Un document révélateur des préoccupations de l’appareil sécuritaire dans l’immédiat
après-guerre est le rapport rédigé en mai 1952 « sur les slavophones vivant en Grèce »
par D. Vlastaris, chef de la direction générale pour les Étrangers (le principal service
secret de l’époque). Après une revue historique assez conventionnelle de la question
macédonienne, il arrive à la conclusion que « l’existence en Macédoine des éléments
slavisants, qu’on ne peut ignorer ou nier, constitue un problème pour nous ». Ses
propositions s’arrêtent encore une fois sur un programme d’épuration ethnique
sélective, doublée de la consolidation des « acquis » créés sur le terrain par la guerre
civile. D’abord, il faudrait que le rapatriement possible des réfugiés de la guerre civile
en Yougoslavie, estimés a environ 20 000 et « dont le problème est rendu complexe,
puisqu’ils ont laissé en Grèce des familles nombreuses », se fasse sur une base de
sélectivité absolument ethnique: « Pour ces personnes, le critère principal est l’origine
slave. Il faut refuser fermement le retour de toute personne d’origine slave, quelles que
soient les circonstances qui l’ont amené dans les pays slaves (fuyards, déportés forcés,
déportés volontaires partis en 1941, bandits communistes) ». Cette exclusion doit
s’appliquer aussi à la partie slavophone des « enfants enlevés par les communistes » en
1948 (éloignés du champ de bataille et transférés dans des écoles et jardins d’enfants
des pays du bloc socialiste), malgré la campagne internationale lancée alors par
Athènes pour leur rapatriement immédiat. Seulement dans le cas où leurs parents
étaient restés sur le territoire grec, on était « obligé par les faits d’accepter leur
rapatriement ». « Etant donné » pourtant « que leurs conditions de vie dans les pays du
rideau de fer étaient meilleures – dans la plupart des cas au moins – de celles que leur
famille pouvaient leur offrir aujourd’hui », on était sûr que « la nostalgie de cet
environnement maintiendrait ces enfants dans un lieu d’attachement au slavisme » ; il
ne faudrait donc pas les « abandonner dans leurs domiciles », mais les « rééduquer sur
une base nationale » dans des établissements étatiques. Comme seconde mesure à
prendre D.Vlastaris proposait de « faciliter le départ des personnes ou des familles
d’origine slave pour n’importe quel pays de l’étranger », en donnant la priorité aux
familles de réfugiés politiques et d’ « enfants enlevés ». La troisième mesure reprenait
les propositions antérieures d’autres cadres nationalistes pour « le transfert de familles
entières et leur établissement obligatoire dans la Grèce du Sud » (Vlastaris 1952 : 21-2).
52 Le chef de la direction générale pour les Étrangers n’était pas le seul à proposer des
mesures de ce genre. D’après l’expert du ministère des Affaires extérieures sur les
questions balkaniques pendant plus de trois décennies (1963-95), Evangelos Kofos, « des
réflexions pour un déplacement interne des restes de la population slavophone loin de
la région frontalière furent reformulées » par l’appareil militaire et sécuritaire
« jusqu’au milieu des années 1950 au moins » (Kofos 2008 : 368). Un tel rapport, rédigé
par la 15e division de l’armée (couvrant la région de Kastoria et les environs de Prespa)
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
115
en 1955, découvert et présenté récemment par l’historien Spyros Karavas, prévoit
l’interdiction absolue de tout rapatriement des réfugiés slavophones dans la zone
frontalière, la levée de toute entrave à l’émigration de la population slavophone à
l’étranger – « en famille, si possible » – et la colonisation des villages abandonnés par
des paysans grécophones (Karavas 2009). La dernière proposition du genre a peut-être
été faite en décembre 1958 par le chef de l’état-major de la Défense nationale,
Athanasios Frontistis, après un conseil tenu à son initiative avec la participation des
représentants du ministère des Affaires étrangères, du KYP et de la direction générale
pour les Étrangers. Dans le mémoire préparé alors par Frontistis, « on souligne le
danger posé par la présence d’une minorité compacte de langue autre que le grec [
παρουσίασυμπαγούςξενοφώνουμειονότητος] dans une région frontalière névralgique » ;
comme solution on y proposait « des mesures de toutes sortes, de nature éducative,
policière, militaire etc. pour l’assimilation et l’hellénisation des slavophones », mais
aussi « d’autres mesures qui aspiraient au déracinement et l’aliénation de cet élément
en facilitant et encourageant l’ émigration des slavophones à l’étranger, le refus
intransigeant de rapatrier les fuyards slavophones et le transfert méthodique et
graduel des personnes ayant une conscience slave en divers points au sud de la rivière
Aliakmon » [τηνμεθοδικήνκαικατάστάδιαμεταφοράντωνσλαυσυνειδήτωνειςδιάφορασημεία
νοτίωςτουΑλιάκμονος]. Ces propositions n’ont pourtant finalement pas été enterinées
par le pouvoir politique. Au contraire, le ministre des Affaires étrangères Evangelos
Averoff et le Premier ministre Konstantinos Karamanlis ont approuvé un projet
différent, élaboré en juin 1959 par Konstantinos Heimarios (chef de la 1 ère direction du
ministère des Affaires étrangères), D. Nikolareïzis et Thrasyvoulos Tsakalotos
(ambassadeur à Belgrade), où l’on reprenait les mesures assimilatrices proposées par
Frontistis en excluant tacitement sa stratégie de « déracinement ». L’objectif principal
était alors l’apprentissage parfait du grec par la nouvelle génération des slavophones
« afin que, finalement, ils rejettent par accoutumance le slave » [ίνατελικώςδιατου
εθισμούαποβάλουντηνσλαυικήν] (Heimarios 1963 : 1-4).
53 Dans quelle mesure toutes ces propositions ont-elles finalement été mises en œuvre par
l’administration grecque pendant les décennies suivantes ? D’après Kofos, le rejet des
projets de déplacement forcé organisé et de colonisation massive de la zone frontalière
est dû « à des raisons sociales, politiques, mais aussi économiques » (2008 : 368). Un
obstacle presque impossible à surmonter était sans doute la difficulté de trouver des
colons disposés à laisser leurs maisons dans le reste de la Grèce pour aller s’installer
dans une région sous-développée et ravagée par la guerre, dans des conditions
climatiques défavorables. On doit également tenir compte du fait que, dans les années
1950, après une décennie d’aventures où a été remise en cause la souveraineté de la
Grèce sur ses provinces septentrionales, la tendance dominante était plutôt inverse : la
fuite des « akrites »59 vers les centres urbains situés plus au sud. Un autre facteur qui a
probablement influencé l’abandon des projets pour une colonisation étendue, était les
intérêts particuliers des agents locaux du camp nationaliste à qui on avait permis
l’exploitation tacite des fortunes abandonnées par les « fuyards ». La colonisation
organisée des villages désertés fut donc entreprise à une échelle modeste, dans la
région de la Prespa et aux frontières de la préfecture de Kastoria avec l’Albanie, à
l’initiative exclusive de l’état-major de l’armée. Dans la région de Prespa, des 7 663
habitants recensés en 1940 ne sont restés à la fin de 1949 que 1 319 seulement : 834
réfugiés jusqu’alors déplacés vers les grandes villes, qui étaient retournés dans le
sillage de l’armée gouvernementale, et 485 personnes « trouvées » sur place par les
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
116
forces gouvernementales après la défaite de la guérilla (Kostopoulos 2000 : 219). En mai
1952, l’état-major a commencé à y installer quelques centaines de familles d’anciens
nomades épirotes sans terre qui appartenaient au groupe ethnique des Arvanito-
valaques mais qui politiquement étaient des conservateurs nationalistes grecs ; en 1965,
ces « colons » [έποικοι], comme ils étaient désignés dans le vocabulaire officiel, ne
dépassaient pas le nombre de 1 630 (KYP 1965 : Annexe A). Deux autres villages
slavophones, situés à des points stratégiques près de la frontière albanaise et
complètement détruits pendant la guerre civile, Dendrohori et Krystallopigi, ont été
reconstruits en 1957-1958 dans le cadre de l’ « Assistance royale » et peuplés par des
colons du même groupe ethnique. Il semble néanmoins que ce processus ait rencontré
des résistances provenant du noyau dur de l’administration locale. L’existence de ces
résistances est indiquée par les protestations répétées d’un membre du Parlement qui
se présentait comme le lobbyiste principal des colons (Gyiokas 1959-1966), ainsi que par
les articles de la presse athénienne gouvernementale, qui est allée jusqu’à menacer
publiquement d’exil dans le camp d’internement insulaire d’Aï Stratis les membres du
très officiel Comité d’expropriations de Florina accusés de « saboter » la politique de
colonisation (Roussen 1957 ; Aristotelis 1957).
54 Ce qu’on ignore enfin c’est l’étendue réelle de l’application du décret législatif 2536 de
1953 « sur le repeuplement des régions frontalières et le renforcement de leur
population », selon lequel toute fortune immobilière abandonnée pendant trois ans au
moins par son propriétaire « émigré clandestinement ou sans autorisation à
l’étranger » passait de façon automatique à la propriété de l’État, même si la famille de
son propriétaire continuait de l’administrer. Le même décret ordonnait aussi la
confiscation des lots de terre distribués pendant la réforme agraire des années 1920, si
leur propriétaire était parti du village sans avoir quitté le territoire grec (s’il était, par
exemple, réfugié interne ou personne déplacée pendant la guerre civile). D’autres
articles prévoyaient l’installation de colons sans terre « animés par une conscience
nationale saine » (selon l’exposé introductif du décret), sur les terres ainsi confisquées,
avec l’aval indispensable de l’état-major de l’armée. D’anciens soldats, gendarmes,
sous-officiers ou officiers des forces armées et de la gendarmerie pouvaient aussi y être
installés, même s’ils étaient déjà propriétaires de terres et indépendamment de la taille
de leur fortune (Décret 2536). La discussion du décret au Parlement a bien montré que
l’objectif prioritaire de cette mesure était les slavophones déplacés provisoirement par
la guerre civile, dont le retour dans leurs villages était empêché pour des « raisons de
sécurité », et pas les habitants grécophones d’Épire ou de Thrace occidentale qui
entraient dans la même catégorie (Kostopoulos 2000 : 221). Sa mise en œuvre massive a
été pourtant pratiquement reportée pour quelques années à cause des tremblements de
terre dévastateurs survenus sur les îles ioniennes et en Thessalie, qui ont capté la
plupart des crédits destinés normalement à la colonisation. En 1957,le décret 2536 a été
déclaré anticonstitutionnel par le Conseil d’État ; un autre décret (3800/1957) a
pourtant « légalisé » a posteriori toute affectation de terres survenue entre temps
(Gyiokas 1979 : 146-7, 155-6, 159-60 ; Katsanos 2000 : 84-5).
55 En ce qui concerne l’incitation à l’émigration, les témoignages oraux des habitants
insistent sur le fait que les cadres de l’administration locale ont exercé toutes sortes de
pressions sur la population slavophone pour la faire partir outre-mer. Les émigrants de
cette catégorie étaient pourvus de passeports « délivrés pour un voyage » [δι’ ένταξείδιον
], formule cryptée qui, dans le jargon bureaucratique du ministère de l'Intérieur, se
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
117
traduisait comme « sans droit de retour » [άνευδικαιώματοςεπιστροφής]. Dès son départ,
le titulaire d’un tel passeport relevait des dispositions de l’article 19 du Code de la
citoyenneté permettant la révocation de sa citoyenneté pour « avoir quitté le territoire
grec sans intention d’y retourner » (Maniatakos 1959). Il semble, d’ailleurs, qu’une
partie de l’appareil policier et judiciaire ait exploité pour son propre compte la
situation, faisant la tournée des villages slavophones et privant les futurs émigrants de
leurs ressources modestes pour leur procurer des passeports60. Selon les données
statistiques de KYP, 6 713 personnes ont émigré entre 1950 et 1960 du seul département
de Florina ; 45,4 % d’entre d’eux étaient classés comme « ayant une conscience
nationale étrangère ou fluide » – pourcentage beaucoup plus large que la
représentation de cette catégorie sur la population slavophone locale (28,8 %), sans
compter les autres groupes ethnolinguistiques. Pendant les années suivantes,
l’ouverture des pays de l’Europe occidentale a provoqué une intensification du courant
migratoire (13 249 personnes parties du même département entre 1961 et 1964
seulement, dont les 9 659 en Europe). Les agents de KYP exprimaient cependant leur
inquiétude devant le fait que les émigrants partis en Europe provenaient de plus en
plus des familles considérées comme « ayant des sentiments contrôlés » [ηλεγμένων
εθνικώνφρονημάτων], évolution qui provoquait un « danger que la région soit privée de
son élément “dynamique” ayant des sentiments grecs » (KYP 1965 α: Annexe Θ΄). Une
pareille inquiétude a été aussi exprimée en 1955 par la 15 e division de l’armée, qui a
demandé au gouvernement l’interdiction totale de l’émigration des habitants
considérés comme nationalistes et anticommunistes [εθνικόφρονες] et la promotion – au
contraire – de l’émigration familiale « des anarchistes et de ceux ayant des sentiments
slaves », dont le départ n’était pas jusqu’alors autorisé (Karavas 2009 : 135-7). À noter
enfin l’existence d’un dossier ultra-secret dans les archives de l’ancienne Cour royale,
composé en 1966-1967 par le bureau du Roi et intitulé « Macédoine - Thrace. Question
d’émigration ». À notre demande de consultation, l’Éphorie des Archives générales
d’État a répondu que, après avoirconstaté que le dossier en cause « contenait des
documents qui relèvent de l’article 36§10 de la loi 1946/1991é (c’est-à-dire éliés à
l’intérêt national et relevant de la politique extérieure de l’État »), une commission
spéciale serait convoquée pour décider sur le sujet61. À notre connaissance, cette
pratique administrative, peu courante, était jusqu’alors utilisée pour bloquer l’accès
des chercheurs à des archives officiellement « ouvertes », mais considérées comme trop
« sensibles ». Plus que le contenu présumé du dossier en cause, cette réévaluation
officielle du concept de la sécurité nationale dans le domaine historiographique peut
cependant être due aux changements survenus récemment au niveau des institutions
responsables : le président de l’Éphorie des archives qui s’est prononcé sur notre
demande, nommé à ce poste en novembre 2007 par le gouvernement de Konstantinos
Karamanlis, avait aussi servi comme président de l’Établissement national de radio et
de télévision (EIRT) sous la phase la plus brutale de la junte militaire (entre mai et
juillet 1974)62.
56 On a déjà vu que, dès la fin des années 1950, la politique étatique a mis l’accent sur
l’assimilation linguistique des slavophones plutôt que sur leur expulsion. Mises à part
quelques manifestations clairement répressives, comme les prestations de serment
collectives de villages entiers pendant l’été 1959 (sous le regard triomphant des
autorités régionales) qu’ils vont abandonner l’usage de leur « patois étranger
exécrable » [τρισκατάρατονξενικόνιδίωμα], cette politique assimilatrice était surtout
centrée autour des programmes « souples » : création de jardins d’enfants dans les
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
118
villages pour couper les bébés de l’usage familial « du patois » pratiqué surtout par les
vieux monolingues, construction de « Maisons d’enfants » pour la récréation organisée
de la jeunesse villageoise dans un environnement absolument grécophone, envoi des
bons élèves issus des villages slavophones comme boursiers dans des internats au sud
de la Grèce, distribution gratuite de magazines populaires grecs auprès des particuliers
etc. – tout cela accompagné d’une campagne de propagande intensive proclamant que
l’intérêt personnel et collectif des « Grecs bilingues » leur imposait de ne pas
transmettre la connaissance « du patois » slave macédonien à leurs enfants
(Kostopoulos 2000 : 234-44, 263-76). En juin 1962, la surveillance de ce programme était
confiée à un conseil de coordination créé par le Premier ministre Konstantinos
Karamanlis. Son but déclaré était d’ « affronter la dite minorité slavomacédonienne »,
et il jouissait du « soutien moral et matériel » de la très active reine Frederika (Conseil
de coordination 1963). Au départ, ce programme touchait seulement les trois
préfectures de Florina, Kastoria et Pella qui étaient considérées comme « en danger »
ou « fragiles » [ευπαθείς] par excellence, à cause de leur nombreuse population
slavophone, mais il s’est progressivement étendu à presque toutes les régions où
vivaient des communautés slavophones (départements de Paionia dans la commune de
Kilkis et d’Eordaia dans celle de Kozani, communes de Serres et peut-être de Drama).
L’avènement de la junte militaire en 1967 n’a pas beaucoup changé les choses dans ce
domaine, exception faite de la multiplication des fonds à la disposition des responsables
de la campagne assimilatrice. On a aussi transféré de force les habitants des quelques
villages slavophones montagnards de Florina, de Kastoria et de Pella dans la plaine,
pour des raisons « de développement » mais aussi sécuritaires 63. La démocratisation
radicale de la vie politique et sociale de la Grèce après la chute de la dictature en 1974
et la victoire électorale de PASOK en 1981 a au contraire apporté de nombreux
changements ; leur étude est cependant hors du sujet de notre article. Il faut pourtant
noter ici que, même après la constitution du premier gouvernement socialiste, les
services de sécurité continuaient à proposer des mesures d’assimilation linguistique et
de surveillance policière de la population slavophone qui n’avaient pas trop à envier les
recettes du passé. Le chef du service de Sécurité nationale (ΥΠΕΑ) demandait par
exemple en 1982 le transfert obligatoire des fonctionnaires slavophones dans d’autres
endroits du pays, la création d’un réseau de leaders d’opinion payés pour faire de la
propagande « contre l’usage du patois dans leur cercle social », l’encouragement par le
commandement de l’armée du mariage de ses subordonnés militaires « avec des
femmes issues des villages où on parle le patois » (pour bloquer une fois pour toutes
son usage intrafamilial) etc. (Kapelaris 1982).
57 Une mesure décisive fut pourtant prise dans les années 1980 par le gouvernement de
PASOK : l’exclusion des réfugiés politiques slavophones de la guerre civile du
rapatriement général promis par le mouvement socialiste avant sa première victoire
électorale. D’après la décision commune n° 106841/29.12.1982 des ministres de
l’Intérieur et de l’Ordre public, annoncée triomphalement par le Premier ministre
Andreas Papandreou pendant la fête de Noël 1982, seuls les réfugiés politiques qui
étaient « d’origine ethnique grecque » [Έλληνεςτογένος] avaient droit au rapatriement
libre et sans conditions. Les exclus de cette politique « de conciliation nationale »
étaient, selon la jurisprudence du Conseil d’État, ceux parmi les réfugiés qui avaient
une origine ethnique non grecque et qui « par leurs actions et leur attitude générale
exprimaient des sentiments témoignant de l’absence d’une conscience nationale
grecque, de sorte qu’ils ne pouvaient pas être considérés comme assimilés dans la
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
119
nationalité grecque, qui est composée de personnes liées par des traditions, des
aspirations et des idéaux communs » (Conseil d’État 1981). Une double procédure a été
ainsi mise en place et les réfugiés politiques issus de communautés ou de familles
grécophones ont ét automatiquement rapatriés (et, grâce aux lois ultérieures
1540/1985 et 1863/1989, indemnisées pour la confiscation de leurs biens et autres
souffrances du passé), tandis que ceux issus de familles mixtes slavophones ont été
obligés, dans le meilleur des cas, de subir un processus humiliant de « rééducation »
politique et nationale, afin de prouver leur « conscience nationale grecque ». La raison
officielle de cette exclusion était (et continue toujours d’être) la protection de la
« pureté nationale » de la Macédoine de toute « réintroduction d’une minorité
nationale ennemie » dans le territoire grec. Même des mesures de courte durée, comme
la permission faite aux réfugiés politiques bannis de visiter leurs lieux d’origine pour
quelques jours pour « des raisons humanitaires » pendant les campagnes électorales de
1985 et de 2003, ont provoqué la mobilisation nationaliste des représentants de l’ « État
profond » contre « l’irresponsabilité des politiciens »64. Cette politique d’exclusion met
en outre en doute la « grécité » des familles des réfugiés « d’origine non grecque » qui
sont restées – et continuent à vivre – sur le sol grec. En d’autres termes, elle est
équivalente à une reconnaissance officielle tacite de l’existence de la minorité si déniée
; reconnaissance qui n’aspire pas à l’intégration totale de ce groupe dans le reste de la
société grecque mais, au contraire, s’exprime par un acte d’exclusion.
BIBLIOGRAPHIE
Adanır, Fikret (1979) Die Makedonische Frage, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden.
Ancel, Jacques (1930) La Macédoine. Son évolution contemporaine, Librairie Delagrave, Paris.
Anonyme (1913) ΗμερολόγιοντουΕλληνοβουλγαρικούπολέμου [Journal de la guerre gréco-bulgare],
Athènes.
Anonyme (1945) Bibliothèque Gennadeios [Athènes] - Archives de Philippos Dragoumis, dossier
104, doc. 88, « Comment est-il nécessaire d’affronter la situation dans la Grèce du Nord », s.l.n.d.
Aristotelis (1957) «Φτάνει πια!» [Assez!], Aristotelis, 2 (3-4.1957).
Armée de Thrace (1920), Archives Historiques du ministère grec des Affaires extérieures, dossier
1924/B37.5, Armée de Thrace au ministère des Affaires extérieures, Andrinople 30.8.1920, no
55431/4848.
Balkos, Vassilios (1931) Bibliothèque Gennadeios [Athènes] - Archives de Athanasios Souliotis,
dossier 2II, doc.113a, Préfet de Florina V. Balkos au Ministère de l’Assistance, Florina 16.6.1931,
no 8107.
Bassiakos, Aristeidis (1948), Archives historiques du ministère grec des Affaires extérieures,
dossier 1948/128.2, ministre de la Grèce du Nord A. Bassiakos au ministère des Affaires
extérieures, Salonique 28.1.1948, n° 82.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
120
Boudonas, Efthymios (1914), Archives grecques historiques et littéraires [Athènes] - Archives de
Georgios Streit, dossier 11, E. Boudonas « Note confidentielle sur l’hellénisation des non-
grécophones et la politique à adopter à l’égard des étrangers », Salonique 5.4.1914.
BPP (1908) British Parliamentary Papers, série Turkey, n° 3, Londres, mai 1908.
Bramos, Kostas (1953) Κώστας Μπράμος, ΣλαβοκομμουνιστικαίοργανώσειςενΜακεδονία. Προπαγάνδα
καιεπαναστατικήδράσις [Organisations slavo-communistes en Macédoine. Propagande et activité
révolutionnaire], Salonique.
Christides, Christophoros (1946) Bibliothèque Gennadeios [Athènes] - Archives de Philippos
Dragoumis, dossier 104, doc. 133, Chr. Christides, « Note sur la situation en Macédoine
Occidentale (avril 1946) », Athènes 19.4.1946.
Christides, Christophoros (1949) Le camouflage macédonien à la lumière des faits et des chiffres,
Société hellénique d’éditions S.A., Athènes 1949.
Commission Interalliée (1919) Rapports et enquêtes de la Commission Interalliée sur les violations du
droit des gens, commises en Macédoine orientale par les armées bulgares, Berger-Levrault, Nancy-Paris-
Strasbourg.
Conseil des Affaires politiques (1949), Archives historiques du ministère grec des Affaires
extérieures, dossier 1950/38.3, Συμβούλιον Πολιτικών Υποθέσεων, « Actes de la 138 e séance du
conseil des Affaires politiques présidé par le sous-ministre permanent des Affaires extérieures M.
P. Pipinelis, vendredi 11.3.1949 », 25 pp.
Conseil de coordination (1963) Archives Générales d’État [Kavala] – Archives du bureau de
coordination des Écoles minoritaires, dossier 11, Conseil de coordination constitué par la décision
no 3507/13a/20/23-6-1962 du président du Conseil, « Compte Rendu no 1/1963 », Athènes
19.3.1963.
Conseil d’État (1981) Décision no 57/1981 du Conseil d’État grec.
Coromilas, Lambros (1906) Archives Historiques du ministère grec des Affaires extérieures,
dossier 1910/82, rapport du consul grec de Salonique L. Coromilas adressé au ministère des
Affaires extérieures, Salonique 18.8.1906, n° 432.
Dakin, Douglas (1966) The Greek struggle in Macedonia, 1897-1913, Institute of Balkan Studies,
Salonique.
Dalipis, Anastasios (1945), Bibliothèque Gennadeios [Athènes] - Archives de Philippos Dragoumis,
dossier 104, doc. 110, Colonel A. Dalipis au 2e bureau de l’état-major de l’Armée, Athènes
27.3.1945 ; doc. 111, A. Dalipis, « Note pour le 2 e bureau de l’état-major de l’Armée” (s.l.n.d.) ; doc.
115, liste des 31 « villages de la sous-préfecture de Voïon qui seront rattachés à la préfecture de
Kastoria », s.l.n.d.
Danglis, Panagiotis (1909), Archives du Musée Benakis [Athènes] - Archives de Panagiotis Danglis,
dossier 23, lettre de P. Danglis au ministre des Affaires extérieures, Athènes 19.2.1909, n° 125,
partiellement publiée dans Danglis 1965, vol. I, pp. 380-381.
Danglis, Panagiotis (1965), Παναγιώτης Δαγκλής, Αναμνήσεις - Έγγραφα – Αλληλογραφία [Souvenirs,
documents et correspondance du général Panagiotis Danglis], Vivliopoleion E.G. Vagionaki,
Athènes 1965, 2 vol.
Décret 2536 (1953), ΕφημερίςτηςΚυβερνήσεως [Journal Officiel] No 1953/A/225 (27.8.1953), Décret
Législatif 2536 signé le 23.8.1953 « sur le repeuplement des régions frontalières et le
renforcement de leur population » ; l’exposé introductif signé par S. Markezinis et L. Apostolidis
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
121
est publié dans ΑρχείονΒουλής [Les Archives du Parlement], période 12.12.1952-14.11.1954, vol. IΙΙ,
Athènes 1957, pp. 273-274.
Dekazos, Panagiotis (1913) ΠαναγιώτηςΔεκάζος, ΗΝάουσατηςΜακεδονίας [Naoussa de Macédoine],
Typografeion M. Mantzevelaki, Athènes.
Dekazos, Panagiotis (1914) Παναγιώτης Δεκάζος, ΑιγεωργικαίσχέσειςτηςΜακεδονίας [Les relations
agraires en Macédoine], P. Leonis, Athènes.
2ème corps militaire (1919) Archives historiques du ministère grec des Affaires extérieures, dossier
1919/A/5/4, rapport adressé au Quartier général de l’armée grecque, 23.1.1919.
Diamantopoulos, Iraklis (1924) Archives historiques du ministère grec des Affaires extérieures,
dossier 1925/B37.2, Ir. Diamantopoulos au 3e corps militaire, Salonique 10.10.1924, n° 81.
Dimaras, Konstantinos (1909) Archives historiques du ministère grec des Affaires extérieures,
dossier 1910/A/18, rapports du consul grec du Monastir K. Dimaras adressés au ministère
Affaires extérieures, Monastir 28.1.1909, no 98 et 27.2.1909, n° 183.
Dimitriadis, P. (1927) Archives du Musée Benakis [Athènes] - Archives de Eleftherios Venizelos,
dossier 373, rapport du secrétaire général du SDEG P. Dimitriadis adressé au Premier ministre Al.
Zaïmis, Athènes 16.9.1927, n° 16.
Dimitriadis, P. (1936) Archives historiques du ministère grec des Affaires extérieures, dossier
1935-1939/A/6/9a, « Note confidentielle » de P. Dimitriadis « sur la population bulgarophone en
Macédoine », [Athènes] 20.1.1936.
Direction des domaines de l’État (1916) Υπουργείον Οικονομικών – Διεύθυνσις Κτημάτων Κράτους,
ΈκθεσιςπερίτωνενΜακεδονίαπροσφύγων [Rapport sur les réfugiés en Macédoine], Imprimerie
Nationale, Athènes.
Direction historique de l’Armée (1979) Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού, ΟΜακεδονικόςΑγώνκαιταεις
Θράκηνγεγονότα [La Lutte Macédonienne et les événements en Thrace], Athènes.
Divani, Lena (1995) Λένα Διβάνη, Ελλάδακαιμειονότητες [Grèce et minorités], Nefeli, Athènes.
Dotation Carnegie (1914) Dotation Carnegie pour la Paix Internationale, Enquête dans les Balkans,
Centre européen de la dotation Carnegie – George Crès & Cie, Paris.
Dragostinova, Theodora (2008) « Speaking National: Nationalising the Greeks of Bulgaria,
1900-1939 », Slavic Review, 67/1, pp. 154-181.
Dragoumis, Ion (1906), Bibliothèque Gennadeios [Athènes] - Archives de Ion Dragoumis, rapport
de I. Dragoumis adressé au ministre des Affaires extérieures Alexandros Skouzès, Dedeağaç
9.3.1906, n° 80.
Dragoumis, Philippos (1925) Φίλιππος Δραγούμης, Εκλογήπολιτικώνδημοσιευμάτων (1922-1925)
[Sélection des articles politiques (1923-1925)], Estia, Athènes.
Dragoumis, Philippos (1948), Bibliothèque Gennadeios [Athènes] - Archives de Philippos
Dragoumis, dossier 104, doc. 160, Ph. Dragoumis, « Mémoire sur les populations frontalières
bulgarophones, adressé à l’Etat-Major de l’Armée », Athènes 12.11.1948. Le même document se
trouve aussi dans les Archives historiques du ministère grec des Affaires extérieures (dossier
38.3).
Dragoumis, Philippos (1948a) «Εισαγωγή» [Introduction], dans le livre de Δημήτριος
Ζαφειρόπουλος, ΤοΚΚΕκαιηΜακεδονία [Le P.C.G. et la Macédoine], Athènes, pp.ιε΄-λθ΄ .
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
122
Dromazos, G. (1945) Archives historiques du ministère grec des Affaires extérieures, dossier
1945/39.7, Vice-Général G. Dromazos au MAE Grec, Athènes 13.10.1945, no 88791.
Eftaxias, Athanasios (1880) Αθανάσιος Ευταξίας, ΤοέργοντουΕλληνισμούενΜακεδονία [L’oeuvre de
l’Hellénisme en Macédoine], Typografeion K. Vlastou, Athènes.
Eldârov, Svetlozar (1993) Светлозар Елдъров, СръбскатавъоръженапропагандавМакедония
(1901-1912) [La propagande armée serbe en Macédoine, 1901-1912], V.I. Komplex « Sv. G.
Pobedonosets », Sofia.
État-major (1919) État-major général de l’armée grecque, Tables ethnologiques de la population des
départements de Serres et Drama, Athènes.
Exadaktylos, Athanasios (1913) Archives du Musée Benakis [Athènes] - Archives de Eleftherios
Venizelos, dossier 8, A. Exadaktylos, « Note sur l’installation des réfugiés », Athènes 2.10.1913.
Faltaïts, Konstantinos (1927) Κ. Φαλτάϊτς, ΤονούμαςστηνΜακεδονία [Attention à la Macédoine!],
Typografeion A. Deli, Athènes 1927 ; cf. aussi, son article dans Eleftheros Logos (Athènes) 9.5.1927.
Le financement de la brochure par le ministère des Affaires extérieures a été révélé par le journal
local de Florina, Eleghos (25.11.1927).
Fessopoulos, Georgios (1948) Γ.Θ. Φεσσόπουλος, Ηδιαφώτισις (προπαγάνδα) [L’instruction
(propagande)], Tilpeloglou, Athènes.
Giagiorgos, Kitsos (2000) Κίτσος Γιαγγιώργος, Μπελκαμένη [Belkamen], Diogenis, Athènes.
Gonatas, Stylianos (1958) Στυλιανός Γονατάς, Απομνημονεύματα 1897-1957 [Mémoires 1897-1957],
Athènes.
Goudas S. (1924) Librairie Gennadeios [Athènes] - Archives de Konstantinos Karavidas, dossier 26,
rapport du Directeur Général de la Colonisation S. Goudas adressé à la Direction de Colonisation
du Ministère de l’Agriculture, Salonique 3.3.1924, n° 454.
Gounaris, Vassilis (1994) Βασίλης Γούναρης, « Οι σλαβόφωνοι της Μακεδονίας. Η πορεία της
ενσωμάτωσης στο ελληνικό εθνικό κράτος, 1870-1940 » [LesSlavophonesdelaMacédoine. Le
chemin de l’intégration dans l’État nation grec, 1870-1940], Makedonika, 29, pp. 209-237.
Grigoriou, Stefanos (1916) Στέφανος Γρηγορίου, « Αναμνήσεις 1903-1916 » [Souvenirs 1903-1916],
manuscrit inédit en la possession de l’auteur.
Gyiokas, Panagiotis (1959-66) Mémoires adressées aux premiers ministres Konstantinos
Karamanlis (28.7.1959 et 10.12.1962) et Stephanos Stephanopoulos (15.3.1966), photocopies en la
possession de l’auteur.
Gyiokas, Panagiotis (1979) Παναγιώτης Γυιόκας, Σκέψειςκαιδιαλογισμοίτηςφυλακής [Pensées et
réflexions de prison], Salonique.
Haralambidis, D. (1914) Archives historiques de la Macédoine [Salonique] - Archives de la
direction générale de la Macédoine, dossier 14, ff.34-37, rapport du représentant gouvernemental
à Kato Thodoraki D. Haralambidis au sous-gouverneur de Kilkis, Kato Thodoraki 14.12.1914, n°
621.
Hassiotis, Loukianos (2004) Λουκιανός Χασιώτης, Ελληνοσερβικέςσχέσεις 1913-1918 [Les relations
gréco-serbes 1913-1918], Vanias, Salonique.
Hatziiosif, Hristos (1993) Χρήστος Χατζηιωσήφ, « Η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας στις
αρχές του 20ου αιώνα και οι συνέπειές της στην εξωτερική πολιτική » [L’extraversion de l’économie
grecque au début du vingtième siècle et ses conséquences sur la politique extérieure], dans
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
123
l’ouvrage collectif ΗΕλλάδατωνΒαλκανικώνπολέμων, 1910-1914 [La Grèce des guerres balkaniques,
1910-1914], ELIA, Athènes, pp. 143-60.
Heimarios, Konstantinos (1963) Bibliothèque Gennadeios [Athènes] - Archives de Philippos
Dragoumis, dossier 96.11, doc.205, Ministère des Affaires extérieures – 1 ère direction politique, K.
Heimarios, « Note sur les Slavophones de la Macédoine occidentale », ultra-secret, Athènes
21.6.1963. Ce document a été publié entièrement par le défunt Tassos Tilios dans Зора, 6 (1.1995),
pp. 14-15, sans référence à sa source.
Hristov, Hristo (1964) Христо Христов, АграрнитеотношениявМакедонияпрез XIX в. иначалото
на XX в. [Les relations agraires en Macédoine pendant le XIX e et le début du XXe siècle], Bâlgarska
Akademija na Naukite, Sofia.
Iliadis, Periklis (1931) Bibliothèque Gennadeios [Athènes] - Archives de Philippos Dragoumis,
dossier 104, doc.14, rapport du maître d’école primaire P. Iliadis « Sur la situation sentimentale,
linguistique etc. des Macédoniens slavophones et les mesures qui sont nécessaires pour leur
hellénisation la plus rapide », Vyssinia 31.8.1931.
Iliakis, Ioannis (1920) Archives du Musée de la lutte macédonienne (Salonique), rapport du
gouverneur général de Florina-Kozani I. Iliakis au ministère des Affaires extérieures, Kozani
22.1.1920, 115 pp.
IostisKyriakis (2007) Ιός της Κυριακής, «Μακεδονία, μια ελληνική αποικία; Η συζήτηση του 1913 για
τις ‘Νέες Χώρες’» [Macédoine, unecoloniegrecque ? Ledébatde 1913 surles “NouvellesProvinces”],
Eleftherotypia, 27.10.2007, pp. 53-55.
Jaranov, Dimitâr (1942) ДимитърЯранов,
«НародностниятсъставнанаселениетовБеломорскатаОбластпрезпоследнитеосемдесетгодини»
[Lacompositionnationaledelapopulationdelarégiond’Egéependantlesdernièresquatre-
vingtannées], БеломорскиПреглед, 1 (1942), pp. 291-316.
Jontchev, Dimitâr (1993) ДимитърЙончев, БългарияиБеломорието[LaBulgarieetlaRégiond’
Egée], Sofia.
Kakavos, Dimitrios (1972) Δημήτριος Κάκκαβος, Απομνημονεύματα (Μακεδονικός Αγών) [Mémoires
(LutteMacédonienne)], EtaireiaMakedonikonSpoudon, Salonique.
Kalevras, Ahilleas (1927) Archives Historiques du Ministère Grec des Affaires Extérieures, f.
1928/28.2, rapport du Directeur Général de la Macédoine A. Kalevras au Ministre des Affaires
Intérieures, Salonique 29.10.1927, s.n.
Kallianiotis, Athanasios (2007) Αθανάσιος Καλλιανιώτης, « Οι Πρόσφυγες στη Δυτική Μακεδονία
(1941-1946) » [Les réfugiés en Macédoine occidentale (1941-1946)], thèse de doctorat non publiée,
Université Aristoteleion de Salonique, Salonique.
Kanaginis, P.G. (1918) Archives historiques du ministère grec des Affaires extérieures, dossier
1918/AAK/B(4), directeur de Peuplement P.G. Kanaginis, « Le peuplement de la Macédoine »,
Salonique 30.7.1918, 36 pp.
Kapelaris, Dimitrios (1982) Service de Sécurité nationale, « Machination contre la Macédoine »,
Athènes 16.2.1982, No 6502/7-50428, document entièrement publié par Dimitris Psarras dans «Οι
ανθέλληνες Έλληνες. Οι φάκελλοι που δεν καίγονται» [Les Grecs anti-grecs. Les fiches qui ne sont
pas brulées], Scholiastis, 79 (9.1989), pp. 9-11.
Karavas, Spyros (1999) Σπύρος Καράβας, « Το παλίμψηστο των αναμνήσεων του καπετάν Ακρίτα »
[Le palimpseste des souvenirs du capitaine Akritas], Historica, 31 (12.1999), pp. 291-330.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
124
Karavas, Spyros (2006) Σπύρος Καράβας, « Το παραμύθι της Πηνελόπης Δέλτα και τα μυστικά του
Μακεδονικού Αγώνα » [Le conte des fées de Pinelopi Delta et les secrets de la Lutte
Macédonienne], dans Αλ. Π. Ζάννας (s.l.d.), Π.Σ. Δέλτα. Σύγχρονεςπροσεγγίσειςστοέργοτης [P.S. Delta.
Des approches modernes de son œuvre], Librairie d’Estia – Musée Benakis, Athènes 2006,
pp. 193-289.
Karavas, Spyros (2009) Σπύρος Καράβας, « Οι ‘ξενοσυνείδητοι’ της XVης Μεραρχίας » [Les « gens
ayant une conscience étrangère » selon la 15e division], Arheiotaxio, 11 (6.2009), pp. 111-143.
Karavas, Spyros (2010) Σπύρος Καράβας, ‘Μακάριοι οι κατέχοντες την γην’. Γαιοκτητικοί σχεδιασμοί προς
απαλλοτρίωση συνειδήσεων στη Μακεδονία, 1880-1909 [‘Heureuxceuxquipossèdentlaterre’. Des plans
de propriété foncière visant à au rapt des consciences en Macédoine, 1880-1909], Vivliorama,
Athènes.
Karavidas, Konstantinos (1931) Κωνσταντίνος Καραβίδας, Αγροτικά. Έρευνα επί της οικονομικής και
κοινωνικής μορφολογίας εν Ελλάδι και εν ταις γειτονικαίς σλαυϊκαίς χώραις [Questionsrurales. Enquête
sur la morphologie économique et sociale en Grèce et dans les pays voisins slaves], Imprimerie
Nationale, Athènes.
Katsanos, Konstantinos (2008) Κωνσταντίνος Κατσάνος, « Το Mακεδονικό Ζήτημα (1950-1967) : Η
γιουγκοσλαβική οπτική » [La Question macédonienne (1950-1967) : le point de vue yougoslave],
dans ΤοΜακεδονικόσταξένααρχεία [La Question macédonienne à travers les archives étrangères],
Etaireia Makedonikon Spoudon, Athènes, pp. 23-104.
King, Cecil (1949) FO 371/1826/R11209, Cecil King to London, Belgrade 12.11.1949.
Kirjazovski, Risto (1989) РистоКирjазовски, Македонскатаполитичкаемиграциjаодегеjскиот
делнаМакедониавоИсточнаЕвропа [L’émigration politique macédonienne de la partie égéenne
de la Macédoine vers l’Europe de l’Est], Kultura, Skopje.
Kirjazovski, Risto (1995) РистоКирjазовски, МакедонцитеиодноситенаКПJ иКПГ, 1945-1949 [Les
Macédoniens et les relations entre le P.C.Y. et le P.C.G., 1945-1949], Kultura, Skopje.
Kiselinovski, Stoyan (1990) СтоjанКиселиновски, ЕгеjскиотделнаМакедониjа (1913-1989) [La
partie egéenne de la Macédoine (1913-1989)], Kultura, Skopje.
Kofos, Evangelos (1964) Nationalism and Communism in Macedonia, Institute for Balkan Studies,
Salonique.
Kofos, Evangelos (1989) The impact of the Macedonian Question on civil Conflict in Greece (1943-1949),
Hellenic Foundation for Defense and Foreign Policy, Athènes.
Kofos, Evangelos (2003) ΕυάγγελοςΚωφός, «Απροσδόκητεςπρωτοβουλίες» [Des initiatives
inattendues], To Vima 25.6.2003. Cet article a été aussi traduit en anglais et reproduit dans le site
semi-officiel Macedonian Heritage : « Unexpected Initiatives. Towards the settlement of a Slav-
macedonian minority in Macedonia? », http://www.macedonianheritage.gr/Opinion/
Comm_20030710Kofos.html.
Kofos, Evangelos (2008) ΕυάγγελοςΚωφός, « Ελληνικόκράτοςκαιμακεδονικέςταυτότητες
(1950-2005) » [État grec et identités macédoniennes (1950-2005)], dans Ioannis Stefanidis - Vlassis
Vlassidis - Ev. Kofos (s.l.dir.), Μακεδονικέςταυτότητεςστοχρόνο [Identités macédoniennes à travers
le temps], Ekdoseis Pataki – Idryma Mouseiou Makedonikou Agona, Athenes, pp. 355-418.
Koliopoulos, Ioannis (1994) Ιωάννης Κολιόπουλος, Λεηλασία φρονημάτων. Το μακεδονικό ζήτημα στην
κατεχόμενη Δυτική Μακεδονία, 1941-1944 [Un « pillage » d’opinions. La question macédonienne dans
la Macédoine occidentale occupée, 1941-1944], Vanias, Salonique.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
125
Konstantine (1925) A king’s private letters. Being letters written by King Konstantine of Greece to Paola
princess of Saxe-Weimar during the years 1912 to 1923, Eveleigh Nash & Grayson Ltd, Londres.
Konstantinidis, E. (1914) Archives historiques de la Macédoine [Salonique] - Archives de la
direction générale de la Macédoine, dossier 13, ff.28-30, rapport de E. Konstantinidis adressé au
préfet de Salonique, Magiadağ 10.12.1914, no 1185.
Kontogiorgi, Elisabeth (2006) Population exchange in Greek Macedonia. The rural settlement of refugees,
1922-1930, Clarendon Press, Oxford.
Kostopoulos, Tasos (2000) ΤάσοςΚωστόπουλος, Ηαπαγορευμένηγλώσσα. Κρατική καταστολή των
σλαβικών διαλέκτων στην Ελληνική Μακεδονία [Lalangueinterdite. Répression étatique des dialectes
slaves en Macédoine grecque], Mavri Lista, Athènes.
Kostopoulos, Tasos (2002) Τάσος Κωστόπουλος, « Ετερογλωσσία και αφομοιωτικοί σχεδιασμοί: η
περίπτωση της Ελληνικής Μακεδονίας μετά την απελευθέρωση (1912-1923) » [Langues étrangères
et projets d’assimilation : le cas de la Macédoine grecque après la libération (1912-1923)],
Historica, 36 (6.2002), pp. 75-128.
Kostopoulos, Tasos (2003) « Counting the ‘‘Other’’: Official Census and Classified Statistics in
Greece (1830-2001) », Jahrbücher für Geschichte und Kultur Südosteuropas, 5, pp. 55-78.
Kostopoulos, Tasos (2003a) Τάσος Κωστόπουλος, « Αφαιρέσεις ιθαγένειας. Η σκοτεινή πλευρά της
νεοελληνικής Ιστορίας (1926-2003) » [Privations de citoyenneté. La face cachée de l’histoire
grecque moderne (1926-2003)], Syghrona Themata, 83 (12.2003), pp. 53-75.
Kostopoulos, Tasos (2003b) Τάσος Κωστόπουλος, «“Αξονομακεδονικό” Κομιτάτο και Οχράνα
(1943-44). Μια πρώτη προσέγγιση » [Comité « axo-macédonien » et Okhrana (1943-44). Une
première approche], Arheiotaxio, 5 (5.2003), pp. 40-51.
Kostopoulos, Tasos (2004) Τάσος Κωστόπουλος, « Το όνομα του Άλλου. Από τους
‘Ελληνοβούλγαρους’ στους ‘ντόπιους Μακεδόνες’ » [Lenomdel’Autre: des « Gréco-Bulgares » aux
« Macédonienslocaux »], inΜειονότητες στην Ελλάδα [MinoritésenGrèce],
aireiaSpoudonNeoellinikouPolitismou, Athènes, pp. 367-403.
Kostopoulos, Tasos (2006) Τάσος Κωστόπουλος, « Ο εμφύλιος Μακεδονικός Αγώνας (1904-1908) :
εκδοχές του κρατικού μονοπωλίου της συλλογικής μνήμης » [Laguerrecivilemacédonienne
(1904-1908) : versionsdumonopole étatiquedelamémoirecollective], Historica, 45 (12.2006),
pp. 393-432.
Kostopoulos, Tasos (2007) Τάσος Κωστόπουλος, Πόλεμος και εθνοκάθαρση. Η ξεχασμένη πλευρά μιας
δεκαετούς εθνικής εξόρμησης, 1912-1922 [Guerreet épurationethnique. La face oubliée d’une
expédition nationale de dix ans, 1912-1922], Vivliorama, Athènes.
Kotzageorgi, Xanthippi (1996) « Population changes in Eastern Macedonia and in Thrace: the
legislative “Initiatives” of the Bulgarian Authorities (1941-1944) », Balkan Studies, 37/1,
pp. 133-164.
Koutoupis, Thalis (1913) Θ[αλής] Κουτούπης, «Τοζήτηματωνπροσφύγων» [La question des
réfugiés], Akropolis, 13 & 14.8.1913.
KYP (1965) ΚρατικήΥπηρεσίαΠληροφοριών[Service de renseignements de l’Etat], «‘Μακεδονικόν’.
Υφισταμένη εν τω νομώ Φλωρίνης Κατάστασις » [‘Question macédonienne’. La situation existante
dans le département de Florina], texte dactylographié de 23 p. en la possession de l’auteur, s.l.,
23.5.1965.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
126
KYP (1965a) Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών[Service de renseignements de l’Etat], «Συνοπτική
έκθεσις περί των γιουγκοσλαβικών ενεργειών εις τον νομόν Φλωρίνης και της εν αυτώ
καταστάσεως» [Rapport sommaire sur les activités yougoslaves dans le département de Florina et
la situation qui y règne], juin 1965, copie en la possession de l’auteur.
Kyriakos, Georgios (1940) Archives générales d’État – Archives de Ioannis Metaxas, dossier 92,
ministre de l’Agriculture G. Kyriakos, « Note sur l’exposé soumis par le chef de division de la
Banque agricole H. Vasmatzidis sur la colonisation des régions frontalières », Athènes 14.2.1940.
Laftchiev, Stefan (1994) Стефан Лафчиев, СпомениотБългарскатаЕкзархия [Mémoires de
l’Exarchat Bulgare], Universitetsko Izdatelstvo « Sv. Kliment Ohridski », Sofia.
Lagani, Irini (1996) ΕιρήνηΛαγάνη, Το ‘Παιδομάζωμα’ καιοιελληνογιουγκοσλαβικέςσχέσεις 1949-1953 [La
« rafle des enfants » et les relations gréco-yougoslaves 1949-1953], Sideris, Athènes.
Lambrakis, Dimitrios (1944) Archives générales d’Etat – Archives de Emmanouil Tsouderos,
dossier E16, doc. 038, lettre de D. Lambrakis, à E. Tsouderos, Athènes s.d., reçue en janvier 1944.
Laourdas, Vasileios (1961) Βασίλειος Λαούρδας, «Έγγραφα εκ του αρχείου του καπετάν Βάλτσα»
[Des documents des archives du capitaine Valtsas], Hronika tis Halkidikis, 1, pp. 53-73.
Leeper, Reginald (1944) FO 371/20431/1009/67, télégramme de R. Leeper à Antony Eden, Athènes
27.11.1944, n° 57.
Liakos, A. (1945) Bibliothèque Gennadeios [Athènes] - Archives de Philippos Dragoumis, dossier
68, doc. 28, A. Liakos, « Mémoire. La Grèce du Nord et les propagandes étrangères y agissant »,
s.l.n.d.
Listes (1945) Bibliothèque Gennadeios [Athènes] - Archives de Philippos Dragoumis, dossier 69,
docs. 446 et 447, « Liste des communautés de la Préfecture de Florina », et « Liste des
communautés et des campements de la Préfecture de Kastoria », s.l.n.d.
Macedonian Academy (1993) Macedonian Academy of Sciences and Arts – Council for Research
into S.E. Europe, Macedonia and its relations with Greece, Skopje.
MAE (1950) Archives de Konstantinos Vovolinis [Athènes], dossier 1876, doc. 4, « Relocation des
Slavophones de la Grèce du Nord dans des régions du sud », document du ministère des Affaires
extérieures, signé par Z. Stefanou (?), sans date ou numéro, mais classifié comme « ultra-secret »
(Άκρως Απόρρητον), attaché à Papagos.
Maniatakos, Ch. (1959) Ministère de l’Intérieur – direction générale d’Émigration et des
Passeports, Ch. Maniatakos, « Note de service sur les mesures à prendre concernant la question
des nationaux et des allogènes qui partent vers les pays du Rideau de Fer sans droit de retour »,
Athènes 13.1.1959, copie en possession de l’auteur.
Maravelakis, Maximos – Vakalopoulos, Apostolos (1955) Μάξιμος Μαραβελάκης – Απόστολος
Βακαλόπουλος, ΑιπροσφυγικαίεγκαταστάσειςεντηπεριοχήΘεσσαλονίκης [Les installations des réfugiés
dans la région de Salonique], Etaireia Makedonikon Spoudon, Salonique.
Mavridis, Athanasios (1945a) Archives historiques du ministère grec des Affaires extérieures,
dossier 1945/39.11, Préfet de Florina A. Mavridis « Rapport sommaire sur les événements
intervenus dans la région de Florina et causés par des bulgarophones de l’année [sic] 1941-1945 »,
Florina 15.5.1945, no 21.
Mavridis, Athanasios (1945b) Archives historiques du ministère grec des Affaires extérieures,
dossier 1945/39.11, Préfet de Florina A. Mavridis « Rapport court sur la composition et l’activité
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
127
des habitants de la région de Amyntaio pendant les dernières quatre années », Florina 26.5.1945,
n° 33.
Mavrogordatos, Mihail – Hamoudopoulos Armodios (1931) Μ[ιχαήλ] Μαυρογορδάτος – Α[ρμόδιος]
Χαμουδόπουλος, ΗΜακεδονία. Μελέτηδημογραφικήκαιοικονομική [La Macédoine. Étude
démographique et économique], Papadopoulos-Marinelis, Salonique.
Mavrogordatos, George (1983) Stillborn Republic. Social coalitions and party strategies in Greece,
1922-1936, University of California Press, Berkeley.
Mazarakis, Alexandros (1919) Librairie Gennadeios [Athènes] - Archives de Philippos Dragoumis,
dossier 15, doc. 51, rapport du colonel A. Mazarakis au premier ministre E. Venizelos, s.l.
17/29.3.1919.
Mazarakis, Alexandros (1948) Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν, Απομνημονεύματα [Mémoires],
Ikaros, Athènes.
Mazarakis, Konstantinos (1913) Archives de la Société Historique & Ethnologique de la Grèce
[Athènes] - Archive de K. Mazarakis-Ainian, dossier 7a, doc.2b, K. Mazarakis, «Γενικαί
πληροφορίαι περί του εθνικού φρονήματος των εν τη ζώνη των επιχειρήσεων κατοίκων»
[Informations générales sur le sentiment national des habitants de la zone des opérations], s.d.
[juin 1913].
McGarry, John (2000) “‘Demographic engineering’: the state-directed movement of ethnic groups
as a technique of conflict regulation”, Ethnic and Racial Studies, 21/4 (7.1998), pp. 614-638.
Mihailidis, Iakovos (2003) Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Μετακινήσεις σλαβόφωνων πληθυσμών (1912-1930). Ο
πόλεμοςτωνστατιστικών [Déplacements des populations slavophones (1912-1930). La guerre des
statistiques], KEMO – Kritiki, Athènes.
Mihailidis, Iakovos (2004) Ιάκωβος Μιχαηλίδης, «Σλαβομακεδόνες πολιτικοί πρόσφυγες στη
Γιουγκοσλαβική Μακεδονία» [Réfugiés politiques slavo-macédoniens dans la Macédoine
yougoslave], in ΠρόσφυγεςσταΒαλκάνια. Μνήμηκαιενσωμάτωση [Réfugiés dans les Balkans. Mémoire
et intégration], Ekdoseis Pataki - Idryma Mouseiou Makedonikou Agona, Athènes, pp. 43-82.
Mihalakopoulos, Andreas (1927) Archives historiques du ministère grec des Affaires extérieures,
d. 1928/28.2, réponse « très secrète » du ministre des Affaires extérieures A. Mihalakopoulos aux
ministères des Affaires militaires, des Affaires intérieures et des Communications, Athènes
10.12.1927, n° 14471.
Miliotis, Panagiotis (1927) Archives du Musée Benakis [Athènes] - Archives de Eleftherios
Venizelos, dossier 243, rapport de P. Miliotis adressé au ministère des Affaires extérieures, mars
1927.
Miliotis, Panagiotis (1962) Παν. Μηλιώτης, ΗενΝεϋγύΣύμβασιςτηςελληνοβουλγαρικήςμεταναστεύσεως
της 14/27 Νοεμβρίου 1919 καιηεφαρμογήαυτής [La Convention pour l’émigration gréco-bulgare signée
à Neuilly le 14/27.11.1919 et son application], EMS-IMXA, Salonique.
Mitsopoulos, Thanassis (1971) Θανάσης Μητσόπουλος, Το 30 οΣύνταγματουΕΛ.ΑΣ. [Le 30e régiment de
l’ELAS], Editex, Genève.
Modis, Georgios (1920) Archives historiques du ministère grec des Affaires extérieures, dossier
1920/123.4, rapport du directeur de la préfecture G. Modis adressé au préfet de Florina, s.l.
[Florina], s.d. [< 1.11.1920].
Modis, Georgios (1927) réponse aux articles de K. Faltaïts, Eleftheros Logos (Athènes) 9.5.1927.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
128
Modis, Georgios (1945) Archives historiques du ministère grec des Affaires extérieures, d.
1945/12.4, lettre « strictement personnelle » de G. Modis au directeur général du ministère Léon
Melas, Salonique 4.10.1945.
Modis, Georgios (1950) ΓεώργιοςΜόδης, ΜακεδονικόςΑγώνκαιΜακεδόνεςαρχηγοί [Lutte
macédonienne et chefs macédoniens], Etaireia Makedonikon Spoudon, Salonique.
Morris, Benny (1988) The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949, Cambridge University
press, Cambridge.
Morris, Benny (2001a) Righteous Victims. A history of the Zionist-Arab Conflict, 1881-2001, Vintage
Books, New York.
Morris, Benny (2001b) “Revisiting the Palestinian Exodus of 1948”, in Eugene L. Rogan & Avi
Schlaim (eds), The War for Palestine. Rewriting the History of 1948, Cambridge University Press,
Cambridge, pp. 37-59.
Musée de la lutte macédonienne (1997) ΜουσείοΜακεδονικούΑγώνα, Ηελληνικήαντεπίθεσηστη
Μακεδονία (1905-1906). 100 έγγραφααπό το Αρχείο του Υπουργείου των Εξωτερικών της Ελλάδος
[Lacontre-offensivegrecqueenMacédoine (1905-1906). 100 documents des Archives du ministère
des Affaires étrangères de Grèce], Salonique.
Nakos, Panayotis (1945) Archives historiques du ministère grec des Affaires extérieures, d.
1945/39.9, rapport de l’inspecteur adjoint des écoles dans la région d’Amyntaio, P. Nakos, au chef
de la gendarmerie d’Amyntaio, Amyntaio 27.6.1945, n° 53.
Naltsas, Anastasios (1918) Archive historique de la Macédoine [Salonique] - Archives de la
direction générale de la Macédoine, dossier 102, Α. Naltsas, tableau des « expatriés » par
nationalité, pays d’origine, période d’émigration et port du départ, s.l.n.d. [Salonique,
>30.3.1915].
Nikolopoulos, Petros (1950) Archives de Konstantinos Vovolinis (Athènes), dossier 1876, doc. 3, le
général de brigade P. Nikolopoulos au ministère des Affaires extérieures, V.S.T. 902 [Athènes]
3.5.1950, n° 24/1/5/90, « Urgent – Secret ».
Ouranis, Kostas (1934) Κώστας Ουράνης, « Η ελληνικότητα της Μακεδονίας » [Le caractère grec de
la Macédoine], article publié en 1934 et reproduit dans Ταξίδια : Ελλάδα [Voyages : la Grèce], Estia,
Athermanes.
Païzanos, S. (1933) Bibliothèque Gennadeios [Athènes] - Archive de Philippos Dragoumis, dossier
26, docs. 213b et 213c, rapports du chef du Service d’Agriculture de Sintiki S. Païzanos adressés à
la direction générale d’Agriculture et de Colonisation, Sidirokastro 1.8.1933, n° 4824 et
19.10.1933, n° 6579.
Palamiotis, Georgios (1914) Γεώργιος Παλαμιώτης, ΓεωργικήέρευνατηςΜακεδονίας [Étude agricole
de la Macédoine], Elliniki Georgiki Etaireia, Athènes.
Pallis, Alexandros (1915) Α.Α. Πάλλης, ΓενικαίστατιστικαίτωνπροσφύγωνΜακεδονίαςμέχριτέλους
Ιουνίου 1915 [Statistique générale des réfugiés de la Macédoine jusqu’à la fin juin 1915], document
inédit, Bibliothèque Gennadeios.
Pallis, Alexandros (1925) Α.Α. Πάλλης, Στατιστικήμελέτηπερίτωνφυλετικώνμεταναστεύσεων
ΜακεδονίαςκαιΘράκηςκατάτηνπερίοδο 1912-1924 [Étude statistique sur les migrations raciales en
Macédoine et en Thrace pendant les années 1912-1924], Athènes.
Pallis, Alexandros (1925a) « Racial migrations in the Balkans during the years 1912-1924 », The
Geographical Journal, 66/4 (10.1925), pp. 315-31.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
129
Papadopoulos, Georgios (1936), Archives générales d’État – Archives de Ioannis Metaxas, dossier
36, rapport confidentiel du maître d’école primaire G. Papadopoulos « sur l’état des opinions, la
situation linguistique etc. des Macédoniens slavophones, des habitants surtout de la Macédoine
occidentale, et les mesures qui sont nécessaires pour leur hellénisation la plus rapide », Edessa
5.5.1936.
Papagos, Alexandros (1937) Archives générales d’État – Archives de Ioannis Metaxas, dossier 92,
Chef de l’état-major de l’armée A. Papagos, « Exposé sur la colonisation des régions frontalières
et la relocation des personnes suspectes », Athènes 8.12.1937, attaché au rapport de A. Papagos à
I. Metaxas, Athènes 8.12.1937, n° 36095.
Papagos, Alexandros (1939) Archives historiques du ministère grec des Affaires extérieures,
dossier 1939/17, réponse d’A. Papagos à la direction de Colonisation du ministère de
l’Agriculture, Athenes 24.4.1939, N° 67139/6/33.
Papagos, Alexandros (1950) Archives de Konstantinos Vovolinis (Athènes), dossier 1876, doc. 3, le
Maréchal Papagos au président du Conseil et au ministère des Affaires extérieures, V.S.T. 902
[Athènes] 18.12.1950, n° 24/1/5/117.
Paparrigopoulos, Konstantinos (1884), Bibliothèque Gennadeios [Athènes]- Archives de Stefanos
Dragoumis, dossier 214, doc. 7, rapport du président de l’Association pour la propagation des
lettres grecques K. Paparrigopoulos adressé au ministre des Affaires extérieures Alexandros
Kontostavlos, Athènes 11.3.1884, n° 243.
Paparrigopoulos, Konstantinos (1885) Archives historiques du ministère grec des Affaires
extérieures, dossier 1885/ΑΑΚ/ΙΒ, réponse de Paparrigopoulos au ministre des Affaires
extérieures (sur la proposition du ministère concernant la délimitation d’une « Macédoine
historique » excluant les régions macédoniennes les plus au nord, qui devraient être rebaptisées
probablement « Dardanie »), Athènes 3.1.1885, no 1.738. Document publié entièrement par « Ios »
dans Eleftherotypia (24.2.2001).
Pappe, Ilan (2004) A History of Modern Palestine. One Land, Two Peoples, Cambridge University Press,
Cambridge.
Paschalidis, Dimitris – Hatzianastasiou, Tasos (2003) ΔημήτρηςΠασχαλίδης –
ΤάσοςΧατζηαναστασίου, ΤαγεγονότατηςΔράμας (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1941). Εξέγερσηήπροβοκάτσια;
[Les événements de Drama (septembre- octobre 1941). Révolte ou provocation?], Societé
départementale pour le développement culturel, social et touristique du Département de drama
(D.E.K.PO.T.A.), Drama.
Pejov, Naum (1968) Наум Пеjов, МакедонцитеиграѓанскатавоjнавоГрциjа [Les Macédoniens et
la guerre civile en Grèce], Institut za Natsionalna Istorija, Skopje.
Pelagidis, Efstathios (1994) ΕυστάθιοςΠελαγίδης, ΗαποκατάστασητωνπροσφύγωνστηΔυτικήΜακεδονία
(1923-1930) [L’établissement des réfugiés en Macédoine Occidentale (1923-1930)], Adelfoi
Kyriakidi, Salonique.
Pentzopoulos, Dimitri (1962) The Balkan exchange of minorities and its impact on Greece, Mouton,
Paris - Le Hague.
Petrovo (1924) Bibliothèque Gennadeios [Athènes] - Archives de Philippos Dragoumis, dossier
104, doc. 4, télégramme des habitants de Petrovo au gouvernement d’Athènes, Salonique
2.8.1924.
Petsivas, Giorgos (2000) Γιώργος Πετσίβας (επιμ.), ΊωνοςΔραγούμη. ΤατετράδιατουΊλιντεν[Les cahiers
d’Ilinden de Ion Dragoumis], Ekdoseis Petsiva, Athènes.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
130
Polyhroniadis, Konstantinos (1913) Κ. Δ. Πολυχρονιάδης, «Μελέτηπερίτηςδιοικήσεωςτων
ανακτηθεισώνχωρώντηςΜακεδονίας» [Étude sur l’administration de régions reconquises de la
Macédoine], Imprimerie Nationale, Athènes.
Pop-Gueorgiev, Jordan ; Shishkov, Stoyan (1918) Йордан Поп-Георгиев – Ст[оян] Шишков,
Българитевсерскотополе [Les Bulgares dans la plaine de Serres], Hr. Danov, Plovdiv 1918.
Pop-Janevski, Lazo (1996) Лазо Поп-Jаневски, КостурскотоселоД’мбени [Le village D’mbeni de
Kastoria], Skopje.
Pradounas, A. (1919), Archives historiques du ministère grec des Affaires extérieures, dossier
1919/A/5/4, rapport de la 4e division de l’armée grecque (Colonel A. Pradounas) adressé au 2 e
corps militaire, 21.1.1919.
Préfet de Pella et al. (1945) Archives grecques historiques et littéraires [Athènes] - Archives de
Hristos Zalokostas, dossier 11, projet de rapport du préfet, du procureur et du chef de la
gendarmerie de Pella, s.l. [Edessa] n.d.
Raktivan, Konstantinos (1951) Κωνσταντίνος Ρακτιβάν, Έγγραφακαισημειώσειςεκτηςπρώτης
ελληνικήςδιοικήσεωςτηςΜακεδονίας (1912-1913) [Documents et notes de la première administration
grecque de la Macédoine (1912-1913)], Etaireia Makedonikon Spoudon, Salonique.
Rapport (1908) Bibliothèque Gennadeios [Athènes] - Archives de Athanasios Souliotis, dossier 4III,
doc. 352, consulat grec de Salonique, “Έκθεσις των γεγονότων και της καταστάσεως εν τη
περιφερεία Θεσσαλονίκης κατά το έτος 1908” [Rapport sur les événements et la situation dans la
circonscription de Salonique pendant l’année 1908], s.l.n.d., 32 pp.
Razboinikov Αnastas (1913) A[настас] Разбойников, ЧифлигарствотовМакедонияиОдринско[Le
système des tchifliks en Macédoine et la région d’Andrinople], Internatsionalna Petchatnitsa K.
Tentchov, Salonique.
Recensement (1923) Υπουργείον Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως - Τμήμα Στατιστικής,
Απογραφήπροσγύγωνενεργηθείσακατ’ Απρίλιον 1923 [Ministère de l’Hygiène et de l’Assistance -
Section Statistique, Recensement des réfugiés effectué en avril 1923], Athènes.
Recensement (1928) Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστικά αποτελέσματα της
απογραφής του πληθυσμού της Ελλάδος της 15-16 Μαϊου 1928. τ.Ι. Πραγματικός και νόμιμος
πληθυσμός. Πρόσφυγες [Service de Statistique générale de la Grèce, Résultats statistiques du
recensement de la population de la Grèce de 15-16.5.1928. vol.I. Population de fait et de droit.
Réfugiés], Imprimerie Nationale, Athènes.
Rossos, Andrew (1991) “The Macedonians of Aegean Macedonia : a British Officer’s Report, 1944”,
Slavonic and East European Review, 69/2 (4.1991), pp. 282-309.
Roussen, K.A. (1957) Κ.Α. Ρουσσέν, «Η ‘επιτροπή απαλλοτριώσεων’ του νομού Φλωρίνης αφήνει εξ
ολοκλήρου ανυπεράσπιστον την μεθόριον» [Le « comité pour les expropriations » de la préfecture
de Florina laisse la frontière complètement sans défense], reportage publié dans Kathimerini et
reproduit par le journal Ethnos de Florina (8.6.1957, pp. 1-2).
Sahtouris, Antonios (1909) Archives grecques historiques et littéraires [Salonique] - Archives de
Aggelos Anninos, dossier 1.2, rapport rédigé par le consul grec de Serres A. Sahtouris et adressé
au ministère des Affaires extérieures, Serres 28.2.1909, n° 135, partiellement publié dans Pop-
Georgiev-Shishkov (1918 : 39-44).
Salvanos, G. (1925) Archives historiques de la Macédoine [Salonique] - Archives de la direction
générale de la Macédoine, dossier 108, 10e division (G. Salvanos), « Étude sur la composition
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
131
ethnique de la zone couverte par la division et de la possibilité d’y installer des réfugiés », Veroia
9.4.1925.
Samaras, Kostas (1945) Bibliothèque Gennadeios [Athènes] - Archives de Philippos Dragoumis,
dossier 68, doc. 11, rapport de K. Samaras à Ph. Dragoumis « sur l’attitude des slavophones et des
valaquophones de la Grèce du Nord pendant l’Occupation », Athènes 27.2.1945.
SBKK (1910) Союз на Българските Конституционни Клубове, Дневницинаучредителнияи
вторияконгреси [Actes du congrès de fondation et du deuxième congrès], Jordan P. Jartsev & Cie,
Salonique.
Şeker, Nesim (2007) “Demographic Engineering in the Late Ottoman Empire and the Armenians”,
Middle Eastern Studies, 43/3 (5.2007), pp. 461-474.
Shopoff, Atanas (1904) Les réformes et la protection des Chrétiens en Turquie, 1673-1904, Plon, Paris.
Siljanov, Hristo (1943) Христо Силянов, Освободителните борби на Македония. Том II. След
илинденското възстание, OsvoboditelniteborbinaMakedonija. TomII. Sled Ilindenskoto vâzstanie [Les
luttes de libération de Macédoine. vol. II. Après la révolte d’Ilinden], Dăržavna Pečatnitsa, Sofia.
Simovski, Todor (1998) Тодор Симовски, НаселенитеместавоЕгеjскаМакедониjа [Les endroits
habités dans la Macédoine egéenne], Skopje 1998, 2 vol.
Sivenas, Konstantinos (1945), Bibliothèque Gennadeios [Athènes] - Archives de Philippos
Dragoumis, dossier 104, doc. 89, K. Sivenas « La minorité slavo-macédonienne », Salonique
20.7.1945.
6e Division (1924), Archives historiques du ministère grec des Affaires extérieures, f.1925/B37.2,
6e division de l’armée grecque, « Bulletin général des informations du mois d’octobre 1924 »,
Serres 4.11.1924.
Skordylis, Kostas (1994) Κώστας Σκορδύλης, «Μειονότητες και προπαγάνδα στη Βόρειο Ελλάδα
κατά το Μεσοπόλεμο. Μια έκθεση του Γ.Θ. Φεσσόπουλου» [Minorités et propagande dans la Grèce
du Nord pendant l’entre-deux guerres. Un rapport de G. Th. Fessopoulos], Istor, 7 (12.1994),
pp. 43-91.
Sofoulis, Manolis (2007) ΜανώληςΣοφούλης, Ημερολόγιοπολέμου (1906-1941) [Journal de guerre
(1906-1941)], Éditions Grigori, Athènes.
Societé des Nations (1926) L’établissement des réfugiés en Grèce, Genève 1926 [cité ici dans la
traduction grecque: ΚοινωνίατωνΕθνών, ΗαποκατάστασητωνπροσφύγωνστηνΕλλάδα, Trohalia,
Athènes].
Sonnichsen, Albert (1909) Confessions of a Macedonian Bandit, Duffield & Co., N. York.
Sotiropoulos, Haralampos (1991), H. Sotiropoulos, « Mémoire sur les fortunes des Slavo-
macédoniens en Grèce », [Athènes] 29.10.1991, document de 4 pages en la possession de l’auteur.
Souidas, Nikolaos (1907)Archives historiques du ministère grec des Affaires extérieures, dossier
1907/5, rapport du vice-consul N. Souidas adressé au ministre des Affaires extérieures
Alexandros Skouzes, Kavalla 29.9.1907, n° 407.
Souliotis, Athanasios (1907), Archives du Musée Benakis [Athènes] - Archives de Panagiotis
Danglis, dossier 25, rapport de 25 pages rédigé par Athanasios Souliotis, Athènes 22.2.1907.
Vice-Ministère de la Presse (1947) Υφυπουργείον Τύπου και Πληροφοριών, ΗεναντίοντηςΕλλάδος
κομμουνιστικήεπιβουλή [La conspiration communiste contre la Grèce], Athènes.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
132
Stavridis, Eleftherios (1924) Ελευθέριος Σταυρίδης, «Επί της ανταλλαγής των πληθυσμών» [Sur
l’échange des populations], Kommounistiki Epitheorisi, 2.1924, pp. 54-58.
Svoronos, Nikos (1975) Νίκος Σβορώνος, ΕπισκόπησητηςνεοελληνικήςΙστορίας [Histoire de la Grèce
moderne], Themelio, Athènes.
Taskas, Hristos (s.d.), Archives générales d’État [Kavala], Χρήστος Τάσκας, « Απομνημονεύματα
1944-1945 » [Mémoires 1944-1945], manuscrit inédit de 167 pp.
Theotokis, Spyros (1946) Bibliothèque Gennadeios [Athènes] - Archives de Philippos Dragoumis,
dossier 104, doc. 134, le ministre de l’Ordre public Sp. Theotokis au ministère des Affaires
étrangères, Athènes 24.7.1946, n° 115/10/26/78.
Tomov, Angel (1946) Ангел Томов, « Македонските партии след младотурския преврат »
[Les partis macédoniens après le coup d’État des Jeunes-Turcs], МакедонскаМисъл, II/1-2
(9-10.1946), pp. 53-61.
Tsaktsiras, Ioannis (1925) Archives historiques de la Macédoine [Salonique] - Archives de la
direction générale de la Macédoine, dossier 108, 11e division (I. Tsaktsiras), « Rapport sur
l’implantation des réfugiés dans le zone couverte par la Division », Salonique 9.4.1925.
Tsitselikis, Konstantinos (2006) Κων/νος Τσιτσελίκης, «Εισαγωγή του επιμελητή» [Introduction de
l’éditeur], dans Ηελληνοτουρκικήανταλλαγήπληθυσμών [L’échange des populations gréco-turque],
KEMO – Kritiki, Athènes, pp. 15-48.
Tsontos-Vardas, Georgios (2003) Γεώργιος Τσόντος Βάρδας, Ο Μακεδονικός Αγών. Ημερολόγιο
1904-1907 [Laluttemacédonienne. Journal 1904-1907], EkdoseisPetsiva, Athènes.
Tsoukalas, Konstantinos (1974) Κων/νος Τουκαλάς, Η ελληνική τραγωδία [Latragédiegrecque],
Olkos, Athènes.
Vakalopoulos, Konstantinos (1983) Κων/νος Βακαλόπουλος, Ο Βόρειος Ελληνισμός κατά την πρώιμη
φάση του Μακεδονικού Αγώνα (1878-1894)
[L’HellénismeduNordpendantlaphaseprécocedelaLutteMacédonienne (1878-1894)],
InstituteforBalkanStudies, Salonique 1983.
Vassilios (1933) Bibliothèque Gennadeios [Athènes] - Archives de Philippos Dragoumis, dossier 26,
doc. 213a, lettre du Metropolite Vassilios de Sidirokastro au Directeur Général de la Macédoine
Ph. Dragoumis, Sidirokastro 20.6.1933, no 569.
Vlachos, Nikolaos (1935) Βλάχος Νικόλαος, Το Μακεδονικόν ως φάσις του Ανατολικού Ζητήματος,
1878-1908[La Question macédonienne comme phase de la Question d’Orient, 1878-1908], Ed. G.S.
Hristou, Athènes.
Vlastaris, Dimitrios (1952) Archives générales d’État [Kavala] – Archives du Bureau de
Coordination des Ecoles Minoritaires, dossier 11, direction généralepour les Étrangers, « Rapport
sur les slavophones vivant en Grèce », Athènes 1.5.1952, n° 421/3/3/11.
Vrettos, Epameinondas (1944) Archives grecques historiques et littéraires [Athènes] - Archives de
Epameinondas Vrettos, dossier 1, rapport pour les minorités de la Thrace occidentale adressé à
l’état-major de l’armée grecque royaliste en exil, Le Caire 3.10.1944.
Vrettos, Epameinondas (1945) Archives grecques historiques et littéraires [Athènes] - Archives de
Epameinondas Vrettos, dossier 1, rapport de E. Vrettos « sur des questions de sûreté d’activité de
propagande ennemie au détriment de notre territoire », Athènes 20.12.1945, Strictement secret.
Weiner, Myron & Teitelbaum, Michael (2001) Political demography, demographic engineering,
Berghahn Books, N. York - Oxford.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
133
Wurfbain, André (1930) L’échange gréco-bulgare des minorités ethniques, Payot, Paris 1930.
Xanthopoulou-Kyriakou, Artemi (1996) “The Migration of Pontic Greeks from the Russian
Caucasus to Macedonia (1912-1914)”, Balkan Studies, 37/2, pp. 271-288.
Zafeiropoulos, Dimitrios (1948) ΔημήτριοςΖαφειρόπουλος, ΤοΚΚΕκαιηΜακεδονία [Le P.C.G. et la
Macédoine], Athènes .
Zalokostas Evgenios (1908), Archives historiques du ministère grec des Affaires extérieures,
dossier 1908/2, rapport de l’ambassadeur grec à Sofia E. Zalokostas adressé au ministre des
Affaires extérieures Goergios Baltatzis, Sofia 20.9.1908, n° 728.
Zarkovic-Bookman, Milica (1997) The Demographic Struggle for Power. The Political Economy of
Demographic Engineering in the Modern World, Frank Cass, London – Portland.
NOTES
1. Pour le cas exemplaire de l’épuration ethnique « àl’israélienne », le lecteur peut se référer aux
travaux classiques de Benny Morris (1988, 2001a et 2001b) et Ilan Pappe (2004).
2. Le terme « fluide », traduit ici littéralement du grec, exprime ici la non-cristallisation d’une
conscience nationale en cours de formation et encore fluctuante.
3. Pour un exemple de cette littérature, cf. les rapports adressés par le député de Kastoria,
Panayiotis Gyiokas, à divers responsables politiques de l’appareil central d’État (ministres de la
Défense, de l’Agriculture et des Affaires étrangères, Premier ministre, chef des services secrets,
secrétaire général du ministère de la Grèce du Nord) entre 1949 et 1969 et publiés par lui à la fin
des années 1970 (Gyiokas 1979 : 131-203).
4. Mes calculs sont basés sur le croisement des statistiques secrètes compilées à l’époque par
l’appareil diplomatique grec et l’Exarchat bulgare (classifiant la population macédonienne par sa
langue maternelle et sa confession religieuse) avec les résultats officiels du recensement grec de
1913 (qui n’a compté officiellement que le nombre des habitants de chaque ville ou village).
5. Toutes les villes mentionnées appartiennent aujourd'hui à la Grèce, sauf Meleniko (Melnik)
qui fut incorporée à la Bulgarie. Après les guerres balkaniques, ses habitants grecs l’ont quitté
pour se réfugier en Grèce.
6. D’après l’article 3 du programme de Mürzsteg (Shopoff 1904 : 575). Pour la confrontation
armée entre partis nationaux en 1904-08, cf. Vlachos 1935 ; Dakin 1966 ; Direction Historique de
l’Armée 1979 ; Adanır 1979 ; Siljanov 1943 ; Sonnichsen 1909 ; Eldârov 1993 ; Tsontos-Vardas 2003.
Pour la représentation commémorative de cette guerre civile dans l’historiographie grecque :
Kostopoulos 2006.
7. Pour une excellente description de ces plans élaborés avant 1912, cf. Karavas 2010.
8. Pour les propriétaires grecs des tchifliks, cf. entre autres Dekazos 1913 : 25-41 et 1914 : 85, 92 et
102 ; pour leur rôle dans les activités du « parti grec » local : Vakalopoulos 1983 : 114.
9. Un passage du rapport, révélateur de l’imbrication des luttes nationales avec celles de classe,
trahit la frustration de Dragoumis face à l’incapacité de ses interlocuteurs, cadres locaux du
« parti grec », à sortir du cadre interprétatif d’une ère déjà révolue : « Tant de fois j’ai écouté des
Grecs répondre à ma question « jusqu’où vont les villages bulgarophones vers le sud ? « , par la
phrase: « Mais ce sont des tchifliks! », c’est-à-dire : « De quoi avez vous peur ? Les habitants de ces
villages sont des serfs, comme des bêtes. La terre est possédée par les nôtres ou des Turcs ». Ces
bulgarophones sont sûrement des bêtes, mais des bêtes parlant le bulgare, des bêtes qui un jour
peuvent acheter la terre, parce qu’il n’y a aucune garantie que le propriétaire turc ou grec ne la
vendra pas à ses serfs quand ils vont lui offrir un prix avantageux » (Petsivas 2000 : 629).
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
134
10. Вътрешна Македонска Революционна Организация (BMPO), organisation
révolutionnaire fondée en 1893 à Salonique, ayant pour but l’autonomie de la Macédoine par la
révolution armée et constituée surtout (mais pas uniquement) par des chrétiens slavophones.
L’organisation a changé plusieurs fois de nom, reflétant l’évolution de ses rapports
contradictoires avec la Bulgarie et son orientation nationale ; le nom définitif d’ORIM fut
officiellement adopté en 1905.
11. D’après le recensement officiel grec d’avril 1913, Salonique était peuplée par 61 439
Israélites, 45 867 Musulmans (« Ottomans »), 39 956 Grecs, 6 263 Bulgares et 4 364 « Étrangers »
(Raktivan 1951 : 51).
12. D’après ce même recensement, Kavalla était habitée aussi par 11 241 Grecs, 8 562 « Turcs »,
1 862 Juifs et 7 Valaques (Archives historiques du ministère grec des Affaires étrangères, dossier
1906/80, « Rapport de l’Inspecteur général des écoles grecques D. Sarros sur Kavalla », Salonique
24.12.1906).
13. En ce qui concerne le soudoiement du journaliste, « avocat, écrivain et poète » anglais Allen
Upward et sa rémunération de 4 500 francs par le gouvernement grec « pour les services qu’il a
accepté [d’] offrir dans la Question macédonienne », il existe une documentation abondante dans
les Archives historiques du ministère grec des Affaires étrangères (d. 1907/71).
14. Pour une description (et justification) de ce pogrom par un intellectuel nationaliste bulgaro-
macédonien : Siljanov 1943 : 234-55. Pour une analyse distanciée, cf. Dragostinova 2008 : 159-61.
15. « Entre autres, je lui ai posé la question de ce que la Turquie va faire si les Grecs quittant la
Bulgarie venaient s’établir en Macédoine. Il m’a répondu que, en ce qui le concerne, il ne
s'opposerait pas à leur implantation » (Coromilas 1906).
16. Cette bande incluait néanmoins la petite ville grecque de Meleniko (aujourd’hui Melnik) et les
villes de Monastir (aujourd’hui Bitola), Strumica, Gevgelija et Nevrokop (aujourd’hui Gotse
Deltchev), dont une partie considerable de la population adhérait au « parti grec » ; les villages
des environs appartenaient cependant dans leur immense majorité aux « partis » bulgare ou
macédonien.
17. Les statistiques semi-officielles d'Alexandros Pallis, compilées pendant l’entre-deux-guerres,
n’indiquant que des chiffres respectivement réduits à moitié ou encore plus : on n’admet que 15
000 « Bulgares » et 10 000 Musulmans fuyards en 1912-13 et on « oublie » complètement le départ
des « Bulgares » en 1913-1915. Les Musulmans partis en 1913-15 sont par contre estimés à
« 100-115 000 environ » ; la méthode suivie pour leur évaluation est cependant très discutable
(Pallis 1925 : 5-6, 11-3 et 1925a :317-8 et 320-4).
18. Une note de Anastasios Naltsas, chef du service des passeports de la préfecture de Salonique
après 1912, estime à 45 000 le nombre des « Bulgares » qui sont partis pendant la deuxième
guerre de 1913 ; quand aux Musulmans, il donne un total de 13 000 « expatriés » par le port de
Salonique en 1912-1913, 57 593 par le même port en 1913-1915 et 6 300 par le port de Kavalla
pendant toute la période 1912-15 (Naltsas 1918). Une statistique sans date, indiquant le nombre
des habitants par préfecture et « nationalité » en 1912 (avant la guerre) et en août 1915 (après les
déplacements des populations les plus importants), recense 43 647 « Bulgares » et 82 698
Musulmans « émigrés » du pays entre les deux dates (Kostopoulos 2002 : 105) ; en ce qui concerne
la Macédoine orientale (préfectures de Serrès et de Drama), ses chiffres sont réaffirmées par deux
autres statistiques : la première, inédite, se trouve dans les Archives du Premier ministre de
l’époque Eleftherios Venizelos ; l’autre fut publiée par l’état-major de l'armée grecque en 1919
(État-major 1919).
19. D’après les chiffres officiels, 34 112 réfugiés grecs sont venus de la « nouvelle Bulgarie »,
60 926 de la Thrace orientale restée sous domination ottomane, 19 250 de l’Asie Mineure et 3 260
du Caucase (Pallis 1915 : 1). Tous les Musulmans avaient fui la « nouvelle Bulgarie » en août-
septembre 1913 (Exadaktylos 1913). Il faut noter ici que, entre 1913 et 1915, 189 190 Musulmans
ont quitté la « nouvelle Serbie » (94 816) et la « nouvelle Bulgarie » (94 374) pour gagner
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
135
l’Anatolie, en passant par le port de Salonique (Naltsas 1918). On ignore combien des 44 208
réfugiés du 1913 sont inclus dans ce dernier total.
20. Sur Kilkis cf. interview avec Leonidas Embiricos dans ce dossier.
21. La correspondance diplomatique relative à cet effort se trouve aux Archives du MAE grec
(dossiers 1913/8 et 1913/9).
22. Pour une description des événements par l’officier grec qui entra le premier dans la ville,
cf.Sofoulis 2007 : 76-7. Pour d’autres témoignages : Dotation Carnegie 1914 : 78-9. La « libération »
de la ville (où en 1913 il n’y avait point des Grecs, ni même des « patriarchistes slavophones ») est
commémorée officiellement chaque année le 21 juin.
23. Il faut noter que dans la traduction française des Mémoires du général publié en 1979 par le
très officiel Institut d’études balkaniques de Salonique (IMXA), le passage cité est complètement
censuré (p. 111).
24. Pour une première présentation de ce débat aujourd’hui totalement oublié, cf. Ios tis Kyriakis
(2007). Les propositions officielles sont publiées dans Polyhroniadis 1913.
25. La carte en cause n’a malheureusement été repérée dans aucune archive. Du contexte on
peut supposer que la zone A est celle de Drama et de Chari Chaban, la zone B la plaine de Demir
Hissar (aujourd’hui Sidirokastro), et la zone C la région de Kilkis.
26. Il faut noter que les exactions de ce « fléau » étaient commises contre un élément
numériquement égal : selon le même rapport (p. 35), les réfugiés établis dans l’arrondissement de
Kato Thodoraki (ex-Dolno Todorak) étaient 2 605 face à 2 498 « bulgarophones » et 9 458
musulmans indigènes.
27. Les métayers que possédaient les semailles nécessaires et deux animaux de labour avaient
droit à des lots de terre « entiers » ; ceux qui n'en avaient qu’un, allaient recevoir des demi-lots.
Encore plus défavorisés étaient les travailleurs agricoles, dont chaque famille recevait seulement
20-30 000 m2.
28. Au total, 94 villages de la Macédoine orientale ont été complètement détruits ; dans la zone
contrôlée par l’Entente, on compte 92 villages rasés et 48 « à moitié détruits » dans les seuls
arrondissements de Florina, Kilkis, Enotia et Nigrita, ainsi que tous les villages de Karadjova
(Kostopoulos 2007 : 288).
29. La famine a surtout touché les couches les plus défavorisées de la population urbaine de
Kavala, Serrès, Drama et Pravi, ainsi que les villages producteurs de tabac dans la région du Mont
Pangaion qui dépendaient traditionnellement des importations de céréales pour leur
alimentation. Parmi les victimes, un grand nombre étaient des musulmans ou des chrétiens
slavophones, même exarchistes. Pour une analyse détaillée de ces données par région, groupe
ethnique et classe sociale, cf. Kostopoulos (2007 : 281-99).
30. Selon la Commission interalliée, les expulsés étaient environ 40 000 (p. 20), nombre qui n’est
pourtant pas confirmé par les informations données par cette même source au niveau de
l’arrondissement (p. 49, 140-9, 327, 431 et 697). D’après le rapport, 10 à 12 000 habitants de la
région ont aussi gagné la Bulgarie volontairement, pour éviter la famine. Environ 12 000
personnes de toutes les catégories n’avaient pas regagné leurs foyers au début de 1919.
31. Un autre argument pour l’incorporation de la région au Royaume de Grèce fut avancé en
même temps par le colonel Konstantinos Mazarakis, frère d’Alexandros et chef de la mission de
l’armée grecque en Bulgarie après l’armistice : « La destruction totale [par la guerre] des villes de
Doiran et de Gevgelija et des leurs alentours, où pas un seul habitant n’y est resté », écrivait-il en
novembre 1918, « pourrait faciliter l’adjudication de ces pays [à la Grèce], parce qu’il ne s’agit
plus des habitants soi-disant serbes ou serbisants, mais d’une parcelle de terre et de ruines »
(Kostopoulos 2007 : 86-7).
32. Il y a eu aussi d’autres exceptions pour des populations qui étaient considérées comme
appartenant à des nationalités différentes. Les musulmans Albanais de l’Épire furent ainsi exclus
de l’échange, tandis que quelques milliers de Bulgares orthodoxes d’Asie Mineure partirent en
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
136
Bulgarie. Parmi les orthodoxes de Turquie, l’échange était limité à ceux qui relevaient du
Patriarcat d’Istanbul, laissant sur place les ouailles des autres Patriarcats ou églises nationales
autonomes (Tsitselikis 2006 : 25-31).
33. D’après le recensement officiel de 1928, 1 221 849 réfugiés habitaient en Grèce, dont les
151 892 qui étaient venus avant août 1922 et 1 069 957 depuis cette date ; 626 954 provenaient
d’Asie Mineure, 256 635 de Thrace orientale, 182 169 du Pont Euxin, 38 458 d’Istanbul, 49 027 de
Bulgarie, 47 091 du Caucase, 11 435 de Russie, 6 057 de Serbie et 2 498 d’Albanie (Pentzopoulos
1962 : 99, Tsitselikis 2006 : 43). Sur le degré d’exactitude de ces données officielles, cf.
Pentzopoulos (1962 : 98-9) et Kostopoulos (2007 : 264-5).
34. Ainsi que de la « Nouvelle Turquie ». Pour la Bulgarie, l’envergure de la transformation fut
bien moins radicale, étant donné que les Grecs ne constituaient qu’un groupe minoritaire
relativement peu nombreux, comparé aux populations musulmanes qui y étaient (et restent)
d’une taille considérable.
35. En janvier 1923, il y a eu des manifestations à Athènes contre le caractère obligatoire de
l’échange ; cf.Tsitselikis (2006 : 31-4). Le fait le plus révélateur est pourtant le refus de tous les
hommes d’État impliqués d'assumer la responsabilité de la paternité du projet (Pentzopoulos
1962 : 61-7). Pour la position des communistes grecs, qui ont dénoncé « l’immense bazar humain
de Lausanne » comme une « traite d’esclaves » et un mécanisme de « prolétarisation violente des
masses populaires » échangées, cf.Stavridis (1924).
36. Bureaux de colonisation de Veroia, de Boemitsa (aujourd’hui Axioupoli), de Gianitsa, de
Salonique, de Kastoria, de Kilkis, de Sidirokastro et de Florina.
37. Bureaux de colonisation de Drama, d’Edessa, de Kailaria (aujourd’hui Ptolemaida), de Kozani
et de Serrès.
38. Bureaux de colonisation de Katerini (tous les Valaques de la région étant considérés comme
Grecs) et de Langada (ou parmi 854 familles slavophones trois seulement ont été classifiées
comme « slavisantes »).
39. Détail significatif : pendant la dictature du général Metaxas (1936-1941) ce même officier, en
sa qualité de préfet de Florina, est un des acteurs notoires de la lutte étatique contre l'usage de la
langue slave ; en 1931, d’ailleurs, il se trouve à la tête des phalanges fascistes de l’organisation
EEE (Ethniki Enosis Ellas) qui ont « visité » cette même ville (Kostopoulos 2000 :125, 171-3 et 178).
40. Archives historiques de la Macédoine [Salonique] - Archives de la direction générale de la
Macédoine, dossier 108, Chef de l’état-major du 3e corps d'armée. Tetsis à la Commission
d’établissement des Réfugiés, Salonique 4.5.1925, no 705/639.
41. Formule intéressante qui trahit la conception de l’appareil sécuritaire sur un échange des
populations qui, selon la lettre de la convention, devait être complètement « volontaire »…
42. La répression aveugle de la slavophonie sous Metaxas est depuis longtemps reconnue par
l’historiographie semi-officielle grecque (Kofos 1964 : 50, Gounaris 1994 : 234). Il faut cependant
noter l’émergence, depuis une quinzaine d’années, d’une école historiographique révisionniste
qui essaie de nier son impact sur la population (Koliopoulos 1994:51) ou même la justifier comme
mesure qui « protégeait » les slavophones du danger d'incompréhension pendant les transactions
commerciales (Kallianiotis 2007 : 46) !
43. Il a commencé sa carrière en dénonçant les atrocités kemalistes en Asie Mineure en 1921 ; il
l’a terminée en 1943 comme apôtre de l’ « alliance éternelle » – dès la préhistoire ! – entre Grecs
et Allemands contre la barbarie aussi éternelle des sous-hommes « venus de la steppe »
(Kostopoulos 2007 :20).
44. La seule mesure « démographique » approuvée fut l’éviction graduelle et discrète des
réfugiés arméniens établis dans la zone frontalière (Mihalakopoulos 1927).
45. Pour une liste détaillée des victimes, cf. Paschalidis - Hatzianastasiou 2003. Des 2 140 victimes
dont les noms sont connus, 1 547 ont été tuées dans le département de Drama, 483 dans celui de
Serrès et 110 dans le département de Kavala.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
137
46. Leur nombre, selon des sources grecques, variant de 14 149 à 18 426 entre octobre 1942 et
avril 1944 (Kostopoulos 2000 : 188). Il faut pourtant tenir compte du fait que parmi eux se
trouvaient beaucoup de grécophones, qui s’étaient « inscrits comme Bulgares » pour
s'approvisionner en vivres ou pour se protéger contre les représailles et autres mesures
répressives de l’armée d’occupation allemande, alliée de la Bulgarie.
47. Formellement, le rapport de Vrettos se réfère à l’épuration de la Thrace occidentale occupée
par la Bulgarie, sa logique s'étend cependant aussi à la Macédoine grecque.
48. Trois ans plus tard, le même auteur expliquait, dans une édition semi-officielle adressée au
public étranger, que « l’unique désir » des Grecs était « d’être débarrassés des quelques milliers
de Slaves établis encore en Grèce, car, qu’ils le veuillent ou non, ces derniers furent et
demeureront des fauteurs des troubles dans les Balkans » (Christides 1949 : 104).
49. Il semble néanmoins que l’ambassade britannique à Athènes soit vite revenue sur cette
proposition, après la lecture d’un rapport sur la composition ethnique de la région de Florina
rédigé au début décembre par le capitaine Patrick Evans, ancien officier de liaison avec les unités
locales d’ELAS. En prenant conscience que « la population slave de la Macédoine occidentale » est
« plus homogène, moins mélangée avec des réfugiés ou autres Grecs » et « considérablement plus
nombreuse que ce qu’indiquent les figures officielles grecques », ainsi que le fait que le
mouvement autonomiste local est lié aux (alliés) yougoslaves plutôt qu’à l’(ennemi) bulgare, les
diplomates anglais arrivent à la conclusion que « le problème de la Macédoine occidentale semble
être d’une forme plus ou moins différente de celle qu’on observait jusqu’ici » et que « le transfert
des Slaves macédoniens semble ainsi être un problème beaucoup plus difficile que ce qu’on
croyait » (FO 371/43649/R22039, British Embassy to the Southern Department, Athens 12.12.1944,
No 156/19/44 ; pour le rapport d’Evans, cf. Rossos 1991).
50. Parmi les régions où il y avait « une proportion forte des gens ayant des sentiments slaves »,
on estimait la puissance de cette alliance à 60 % dans la préfecture de Pella, 45 % dans celle de
Florina, 30 % à Kastoria et 15-20 % à Kozani. Dans les préfectures macédoniennes où cette
proportion était considérée comme « négligeable », le pourcentage respectif de l’alliance était
estimé à environ 20 % dans la région de Salonique, 35-40 % à Kilkis, 20-25 % à Serres et 15-20 % à
Kavala et à Drama.
51. Y figuraient aussi 5 492 et 3 232 « bulgarisants » de deux listes dans la Thrace occidentale
(parmi eux de nombreux Arméniens et Grecs non slavophones) et 2 740 Valaques
« roumanisants » de toute catégorie (chiffre considéré comme très inférieur à la réalité).
52. Cas des villages de Lakkomata et de Korissos, dans la préfecture de Kastoria.
53. Cas des villages de Dendrohori, de Vevi et d’Agios Panteleimonas, dans la préfecture de
Florina.
54. Résultats d’une enquête de l’auteur en Macédoine centre-occidentale grecque (préfectures de
Florina, Pella et Kozani) en septembre 2008.
55. La différence entre les deux catégories avait des conséquences sérieuses au niveau de la vie
quotidienne : les enfants des personnes « ayant une conscience nationale fluide » pouvaient par
exemple entrer dans le service public (exception faite des forces armées ou des services de
sécurité), tandis que ceux des « slavisants » en étaient exclus.
56. Pour ces évènements, cf. Kofos (1964 : 177-84 ; 1989 : 26-31) et Kirjazovski (1995 : 95-177).
57. Lui-même était un slavophone du village voisin de Pagoneri, qui ne fut pas touché par le
purge.
58. Les informations citées proviennent des documents qui se trouvent dans le dossier 1950/63.4
des Archives historiques du ministère grec des Affaires étrangères.
59. Les akrites sont des unités auxiliaires irrégulières de l’armée grecque chargées de la garde des
zones frontalieres. Ils tirent leur nom d’unités similaires employées sous l’Empire byzantin.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
138
60. Pour une telle entreprise, cf. Librairie Gennadeios – Archives de Philippe Dragoumis, dossier
91, doc. 74, « Note sur l’affaire de l’adjudant-chef G. Gritzalis et le service pour les Étrangers de
Kastoria », Kastoria 3.7.1950.
61. Archives générales d’Etat – Archives de la Cour royale, d. 390, « Μακεδονία - Θράκη.
Μεταναστευτικόν (1966-1967) », et réponse écrite du président de l’Éphorie des archives
générales d’État, Konstantinos Manafis à l’auteur, Athènes 29.5.2009, no Φ2/175.
62. Pour plus de détails sur ce sujet, cf. Ο Ιός της Κυριακής, «Φαιά ‘επανίδρυση » στα ΓΑΚ [Une
« refondation » brune aux Archives générales de l’État], Eleftherotypia 7.3.2009.
63. Les villages ainsi transférés sont Trivouno et Koryfi dans le département de Florina, Kromni
et Agios Athanasios dans celui de Pella, ainsi qu’une partie du groupe des villages de Korestia
dans le département de Kastoria.
64. La principale et décisive intervention contre tout rapatriement des réfugiés politiques,
qualifié de « colonisation arbitraire par une minorité nationaliste étrangère des régions
frontalières des départements macédoniens du pays », a été celle du spécialiste du ministère grec
des Affaires extérieures sur les Balkans pendant trois décennies (1963-1995), Evangelos Kofos (cf.
Kofos 2003).
INDEX
Mots-clés : Grèce, Ingénierie démographique, Macédoine
Keywords : Greece, demographic engineering, Macedonia
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
139
The Muslim Chams of Northwestern
Greece
The grounds for the expulsion of a “non-existent” minority community
Lambros Baltsiotis
1 This paper focuses on the hypothesis that the expulsion of Muslim Chams from
Western Epirus during the later part of 1944 and beginning of 1945 by the guerrilla
forces of EDES, resisting the Italo-German occupation occurred, contrary to
conventional wisdom, not only as a result of the Chams’ collaboration with the forces of
occupation, but rather as an outcome of state policy, a policy which was embedded in
the prevailing nationalistic ideology of the Interwar period.
2 We argue that following the earlier Greek-Turkish and Greek-Bulgarian exchanges of
populations, the expulsion of Muslim Chams was part of a policy of the Greek state to
exercise its alleged right to oust “non-Greeks” from its territory. Within the
parameters of this ideological framework, legislatively and practically as well as
domestically and internationally, the visibility of the Muslim Chams had to be lessened.
The target was the minimization of their physical presence through the reduction of
their numbers and the reduction of their distinctiveness as a separate religious and
linguistic group.
3 In what follows we will attempt to present evidence of the growing hostility between
the two religious communities (Orthodox and Muslim) of this part of Western Epirus
which occurred independently of their linguistic affinities. 1 This growing hostility was
tolerated if not stirred by the Greek state itself. The Government and the state
bureaucracy utilized an instigative approach to increase hatred between the
communities in order to successfully attain the aforementioned aims.
4 Subsequently we trace the methods that the Greek governmental and public
administrative bodies used in order to eradicate the presence and surviving evidence of
the Muslim Chams in the area. There were two additional factors which facilitated the
execution of these policies: the greater freedom of action the state felt with the
imposition of a “state of emergency” in Greece starting from the period of expulsion up
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
140
until the early 1950s as well as the activities of the “deep” state as a powerful actor up
until the fall of the Colonels’ dictatorship in 1974.
1. The land and the people
5 During the beginning of the 20th Century, the northwestern part of the Greek region of
Epirus was mostly populated by an Albanian-speaking population, known under the
ethnonyme “Chams” [Çamë, Çam (singular)in Albanian, Τσ(ι)άμηδες, Τσ(ι)άμηςin Greek].
The Chams are a distinct ethno-cultural group which consisted of two integral religious
groups: Orthodox Christians and Sunni Muslims. This group lived in a geographically
wide area, expanding to the north of what is today the Preveza prefecture, the western
part of which is known as Fanari [Frar in Albanian], covering the western part of what
is today the prefecture of Thesprotia, and including a relatively small part of the region
which today constitutes Albanian territory.
6 These Albanian speaking areas were known under the name Chamouria 2 [ Çamëri in
Albanian, Τσ(ι)αμουριά or Τσ(ι)άμικο in Greek]. With the exception of the short lived
sanjak of Reşadiye, which was founded in 1910, 3 this region never constituted a distinct
administrative division under Ottoman rule. It was annexed to Greece in the later half
of 1912, when the Ottoman Empire was retreating from a large part of the Balkan
Peninsula as a result of the Empire’s defeat in the First Balkan War. This was also the
period when Albanian independence was declared.
7 Applying linguistic principles, the whole area constituted an Albanian speaking
enclave, isolated at least in strict geographical terms, with a continuum of Albanian
language in today’s Albania and adjoining areas, i.e, Kosovo and the Republic of
Macedonia. In the north-eastern part of that area, east to the city of Filiat(i) within
Greek territory, a Greek speaking area began growing and expanding eastwards to
today’s Albanian territory and up to the coast of Albania.
8 According to an official document 3,676 Greek speaking and 30,726 Albanian speaking
Muslims were living in the sandjak of Reşadiye. 4 For the Preveza sanjak the same
document provides a figure of 2,610 Greek-speaking Muslims. Based on this document
it seems that more than 32,000 Muslims, plus 900 Muslim Gypsies, were unofficially
recorded as living in that area annexed to Greece.5 An additional 12,640 “Albanian-
speaking Greeks” were also reported to inhabit the area. These figures were relatively
overstated with regards to the Muslim population and underestimated with regards to
the Albanian speaking Christians.6 According to a document based on the 1920 census,
after the flight of Muslim emigrants in 1913-1914, the number of the Muslims residing
in Epirus fell to 26,000 persons.7 In 1936, while some of the families had already
migrated to Turkey and Albania, the Albanian Consul at Yanina (Yanya in Turkish),
counting the Muslim population village by village, established the population of
Chamouria at 23,048 persons.8
9 The Albanian speaking area was quite compact and well marked by the local geography,
as the Greek speaking communities were settled at the eastern mountainous areas.
Chamouria and Prevezaniko were also symbolically distinguished as the land where the
Arvanitēs9lived. We can rather confidently argue that Muslim and Christian Chams of
the plains made up a distinct “ethno-economic” group.10 However, there was a
particular pattern in the settlements of religious groups inside the area of Chamouria
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
141
annexed to Greece: most Muslim villages were located at the center of the area, while
the large majority of the Christian Orthodox Albanian speaking villages were to the
south and the east of the area.11
10 Although the langue-vehiculaire of the area was Albanian, a much higher status was
attributed to the Greek language, even among the Muslims themselves. Thus, during
the late Ottoman era, besides the official Ottoman Turkish, Greek functioned as a
second, semi-official language, accepted by the Ottoman Administration. This
characteristic can be followed partly from public documents of the era.
2. The situation prior to annexation
11 During the late 19th century, with the development of the Albanian national movement,
the city of Yanina (the administrative center of the sanjak and the vilayet), and, to a
lesser extent, Preveza in the south and the town of Filiati in the north all played an
important role in promoting the expansion of Albanian nationalistic activities among
Muslims. On the other hand, with the exception of certain elites and prominent
families, there is no evidence that Albanian nationalist ideology had gained strong
support from the local Muslim population: the pro-Albanian Leagues [Bashkimi] were
quite weak in Chamouria,12 while the Albanian language schools, which appeared after
the Young Turk revolution, hardly attracted any attention, despite the fact that they
were established by pro-Albanian elites in the small towns of the area. 13
12 The Albanian-speaking, Orthodox population did not share the national ideas of their
Muslim neighbors and remained Greek-oriented, identifying themselves as Greeks. 14
Consequently, following the annexation of the area by Greece they identified
themselves with the Greek state and, concomitantly, with the Greek nation. But the fact
that this Christian population was in close contact with Muslims, spoke the same
language and was in geographical proximity to Albania proper was a source of constant
anxiety for the Greek state. The state perception was that this partly monolingual
Christian population, some of whom were ignorant of the Greek language, could easily
be recruited to the ranks of Albanian nationalists. As a local writer puts it, the opening
of Albanian language schools in 1909, and the consequent spreading of propaganda,
constituted a “very dangerous” mixture for Christians living in the area. The same
assessment had already been expressed on an official level by the Greek Consul at
Yanina in 1912.15
13 Yet this situation was not a novelty. Prior to this period, Chamouria was already a
nuisance both for the Greek state and the Christians of Epirus who identified
themselves as Greeks. As the less ambitious Greek irredentists’ target in 1912 was to
include all the areas up to a line including Korçë-Gjirokastër-Himarë within the
frontiers of the expanded Greek state, the aim was to obscure the fact that the
Christian, or even the Muslim population, didn’t speak Greek but Albanian. 16
Concealing the existence of the Albanian language appeared as a concept as soon as the
possibility of Greek expansion into Epirus appeared. Dimitrios Hassiotis, a historian and
politician who supported Greek claims, writes in 1887 that in the whole of the
Chamouria region, only in Paramythia do “some of the inhabitants understand the
Albanian language for commercial reasons” (author’s emphasis). 17 The initial distortion
of facts was followed by an effort to account for the allegedly “occasional” use of
Albanian. This “appeal to hope” is not only applied to the distortion of the linguistic
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
142
reality of the area as perceived by non natives, but is extended to a wider spectrum of
facts and evaluations. An example of the way this “appeal to hope” was accepted as
reality is that Greek officers in the interwar period truly believe that Italy and
“Albanian propaganda” are to blame for the reactions of the Muslims in Chamouria and
not Greek policies implemented in the area.18
14 The fact that the Christian communities within the territory which was claimed by
Greece from the mid 19th century until the year 1946, 19 known after 1913 as Northern
Epirus20, spoke Albanian, Greek and Aromanian (Vlach), was dealt with by the adoption
of two different policies by Greek state institutions. The first policy was to take
measures to hide the language(s) the population spoke, as we have seen in the case of
“Southern Epirus”. The second was to put forth the argument that the language used
by the population had no relation to their national affiliation. To this effect the state
provided striking examples of Albanian speaking individuals (from southern Greece or
the Souliotēs) who were leading figures in the Greek state. As we will discuss below,
under the prevalent ideology in Greece at the time every Orthodox Christian was
considered Greek, and conversely after 1913, when the territory which from then
onwards was called “Northern Epirus” in Greece was ceded to Albania, every Muslim of
that area was considered Albanian.21
15 The existence of a region (Chamouria) whose population was roughly half Muslim and
almost entirely Albanian speaking was considered a serious problem for the Greek
state, which had to be confronted both practically and discursively. Every pro-Albanian
movement in these areas had to be eliminated by all means. 22
3. The pre-1923 period
16 As soon as Greece annexed the lands of today’s Greek Macedonia and Epirus in 1913,
and Western Thrace in 1920, the state had to deal with the existence of a large Muslim
population within its new territories. This population spoke a variety of languages and
had a diverse social background, ranging from rich chiftlik [ çiftlik in Turkish]
landowners to a large number of landless workers, who cultivated the land in the
chiftliks, as well as small farm-owners. The Balkan Wars, and Turkey’s ensuing hostile
policy towards its Greek-orthodox [Romioi] Christian populations, who demanded
recognition of their national identity and declared their inclusion in the Greek nation,
also affected the situation of Greece’s Muslim population.
17 The newly annexed lands were known, in Greek legal texts and in political discourse, as
the Nēes Chorēs [ΝέεςΧώρες], literally New Territories. After the annexation of these
territories by Greece as a consequence of the Balkan Wars, a rather large number of
Muslims who lived in these lands emigrated to Turkey, especially in the course of 1914.
However, some of these people soon returned. Simultaneously, new legislation
provided for the imposition of restrictions on the property rights of the Muslim
population inhabiting the New Territories.23As a result, the Muslim population felt
uncertain about its future, partly because of the newly implemented legislation and
partly due to the general political atmosphere that was prevalent at the time. 24
18 Today there is sufficient archival evidence to support the position that, although the
enforcement of the aforementioned legislation also affected the Muslims of Epirus, 25
the Central Greek Government had issued specific guidelines that allowed for better
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
143
treatment of the Muslims that were of “Albanian origin” in the New Territories. 26 As a
result, in certain instances the laws were not implemented in a strict fashion or in an
absolutely consistent manner.
19 In Chamouria there were numerous chiftliks and bastaines27 which belonged to Muslim
landowners28 known as beys. Although in Balkan and western historiography beys have
in general been portrayed as religious, conservative and somewhat slothful oriental
figures, numerous beys of Chamouria, and other Albanian speaking areas, did not
correspond to this stereotype. They had internalized at least some western ideas, such
as women’s rights, participation in higher education, etc. At the beginning of the 20th
century these beys were oscillating between the discovery of their own (Albanian)
nationalism and the safety provided by belonging to the Ottoman Empire. By acting as
Ottoman elites, these notables had achieved high ranks as officers of the Sublime Porte.
Furthermore, there were individual beys, largely from the southern areas of Chamouria,
who remained cemaat [cemaat-i İslami]oriented, even after the area’s annexation to
Greece.29
20 Besides beys, it seems that the majority of the Muslim population consisted of middle
sized estate owners. The land they owned varied in size, fertility and production.
Although there is no sufficient written proof to support the idea, it’s almost certain
that families owning very small parcels of land, or just a few small fields and a small
number of sheep, were not an exception and were also present in villages. 30
21 Although Muslim Chams were not eager to fight on the side of the Ottoman army
during the Balkan Wars, they were nevertheless treated by the Greek army as de facto
enemies, while local Christians were enlisted in the Greek forces. For example, a few
days after the occupation of the area of Chamouria by the Greek Army, 72 or 78 Muslim
notables were executed by a Greek irregular military unit in the religiously mixed town
of Paramythia, evidently accused of being traitors.31 During the Balkan War, in late
1912, when Muslim Chams were fighting on the side of the Ottoman Army, and
Christian Chams on that of the Greek Army, several local conflicts emerged. 32 While
there is no Greek source describing the behavior of the Greek army against the Muslim
population after they seized the area, there are several relevant descriptions in
Albanian sources.33 There are only indirect (but clear) references to atrocities
committed by the Greek army.34 It should be noted that in the spirit of the times,
offensive acts such as defilement of mosques and, obviously, looting, would most
certainly have taken place.35
22 At the same time, a freeze was imposed by the Greek state on the sale of land. Local
Christians, some of them landless farmers working at the chiftliks, were impatient to
improve their financial and social condition under the new “Christian” authority. From
the very beginning of the area’s annexation it appears that issues related to real estate
and vakf property, as well as demands for raises in income, were being advanced. 36
According to a law passed in 1914, the occupation of abandoned plots owned by
Muslims was permitted, and from 1917 onwards this regulation was enforced even
retroactively.37 The sale of land by Muslims was also forbidden from the period starting
from 1913 until 1920, although it seems that the prohibition was not strictly applied
throughout this period.38
23 The behavior of the Greek Army, in conjunction with the legislation implemented at
the time, deeply affected the Muslims and confirmed the first serious fissure between
the Christian communities and the Greek State on one side, and the Muslim
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
144
communities on the other. Tensions between Muslims and Christians in the area began
in the late 19th century when the Christian element gradually improved its financial
and social status.39 Soon after 1912-1913 it had a major ally to fulfill its ambition: the
Greek state. Nonetheless, there is no strong evidence that mass migration towards
Turkey occurred after the annexation of the area by the Greek State, not even in the
year 1914, unlike most areas in Greek Macedonia where this was evidently the case.
Despite this it is certain that there were several individuals, families and extended
families that migrated to Turkey or Albania after 1913, although there is scant evidence
for these individual cases40. The evidence provided by secondary sources suggests that
emigrants were mostly from Paramythia and the southern region. 41 It is also recorded
that during the period of 1915-1916 there was a remarkable outflow of migrants to the
United States. These people were departing, almost exclusively, from Filiati and the
nearby villages.42
24 Furthermore we would argue that a second clash between the two sides occurred
during the short invasion of the Italian army of the area in the spring of 1917. Although
this occupation never really attracted the attention of researchers, there is evidence
from the HAMFA proving that Muslim Chams received the Italian Army as their
liberator. This was not only due to the fact that at that time Italy had claimed
protection over Albania and was supporting Albanian interests, but mainly because
Muslim Chams were persuaded that the annexation of the area to Greece was
something that could be reversed, thus recovering the higher social and financial status
they previously enjoyed.43 The mass enlisting of Muslims of Margariti to the Italian
army,44 in an area where the pro-Albanian movement was quite weak, if not totally
absent, illustrates the haphazard way in which the local population delt with this issue.
25 In the year 1919 the livelihood of the Muslim communities had been drastically
reduced, putting them in a state of “misery” as described by the Greek Authorities. This
situation persisted despite the fact that “violence” against Muslims and the
infringements upon their properties seemed to have gradually decreased, 45 albeit
temporarily.
26 In the same period, when the Muslim Chams were still considered by Greek politicians
to be Muslim rather than Albanian, theories that they were of Greek origin were
sporadically reintroduced into public discourse: for example in a contemporary article
they were described as “Epirotēs converted to Islam” who speak a dialect differing from
Albanian and of greater affinity to Greek.46 The question of the Greek origin of Muslim
Chams was a weapon to be used for many purposes. For instance, the theory of a
possible common Greek-Albanian, Pelasgic (or even Illyrian) origin- very popular
among Greeks and Albanians during late 19th and early 20 th century- was initially used
as an argument to pursue expansionist Greek claims in Albanian-speaking territories.
This discourse of Greek or common origin of the Muslim Albanian Chams was directed
to the Muslim community itself as well as international observers, Greek politicians
and Greek officials of the local administration.47N. I. Anaghnostopoulos, the author of
this article, was a well known agronomist/scientist of the Interwar period, closely
associated with the Agrarian Bank [ΑγροτικήΤράπεζα]. Written during the debate on the
exchangeability of the Muslim Chams, his essay defends their right to remain in Greece
and calls for a softer policy approach towards them. It appears that the only way to
persuade the state to let them continue to live in the area was to base his argument on
an assumed common origin with the Greeks.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
145
4. The period 1923-1928
27 The Greco-Turkish exchange of populations and the way it was implemented in the
area was, we argue, a determining factor in the rift amongst the population. In fact the
exchange seems to have gradually led Muslims to veer towards Albania in search of
protection, and in general, led to the creation of stronger links between the Albanian
state and the Muslim population of Chamouria. Albanian nationalism at the hands of
Muslim villagers and elites was turned into a useful tool for exerting pressure on Greek
state nationalistic demands such as the creation of Albanian schools first appeared
after the mid 1920s. Albania was gradually viewed by the community as a kin-state.
28 The compulsory exchange of populations between Greece and Turkey was based on the
criterion of religion as foreseen under the Lausanne Convention. More specifically, the
exchange was based on classifying people according to the notion of millet, and/or of
genos, [γένος in Greek] the latter being the way in which the concept was conveyed into
Greek national ideology. The adoption of the criterion of religion was suitable for both
countries, as it freed them from concerns relating to ambiguous terms such as
“national consciousness”, which was difficult to prove, and from the language
criterion, which would have challenged the Greek and Turkish nation-building process
and national claims.
29 It must be remembered that during this period no other Balkan state or nationalist
movement was eager to claim the loyalty or allegiance of the Slav, Greek, Aromanian
and Romani speaking Muslims of Macedonia, some of whom had already migrated to
Turkey. This however was not the case for the Albanian and Greek speaking Muslims of
Epirus.48 The Albanian state, supported by Italian politics, opposed the exchange of the
(Muslim) Albanian population of Greece, declaring that this population was Albanian
and not Turkish. Finally, in 1926, that is three years after the negotiations and the
diplomatic bargaining had ended, the Muslim population of Chamouria was classified as
being of “Albanian origin” [αλβανικήςκαταγωγής in Greek] and was exempted from the
population exchange,49 thereby surpassing the religion criterion. However, the intense
diplomatic rally regarding the fate of the relevant populations, as was well described by
Greek sources of that time, had a much darker and more obscure dimension. The
unwavering determination of the Greek state to include the Muslims of Chamouria in
the exchange of populations, alongside policies that were implemented in the field and
forced upon the local population, which were in turn augmented by the determination
of local officers and the local Christian population, led to extreme effects on the
ground.
30 Some of the measures and regulations that were imposed during this period were
common for all large estate owners. For example the 1920 regulation, regarding the
return of a percentage of crops to the landless farmers, applied to all large landowners.
However some others affected Muslims only. According to the Decree of February 13 th
of 1923, the expropriation of (real estate) property was permitted for landless farmers
and refugees as a measure of retribution. On October 2nd of 1923, the General
Administration (Governorate) of Epiros announced, once again, restrictions on the sale
and the renting of Muslims’ properties.50
31 Furthermore, numerous land expropriations had taken place under the banner of
agrarian reform. They affected the totality of landowners, most of who were to be
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
146
found in the New Territories. Amongst them were many Muslims. Nonetheless, it was not
only the landowners of chiftliks who lost their property. Several Muslim farmers who
owned a few stremmata51 of land were, illegally, included in the expropriations. A
striking example of this is the case of the “Paramythia-Siametia” expropriation. In this
case, the local Committee, responsible for deciding which lands were to be
expropriated, determined that the whole town of Paramythia would be expropriated,
including the gardens.52 Only houses were exempt. 53 Other cases include villages which
had mixed population or they were situated at the edge of the Muslim inhabited area,
like Petrovitsa and Dragoumi.
32 Μost serious violations of the law and the relevant procedures regarding the
expropriations of lands occurred with regard to the issue of a. the non-restitution of
300 stremmata to the owners of former chiftliks, b. the false classification of specific
land possessions as bastaina –even though they were actually chiftliks–, c. the
expropriations of small scale lands which were classified as chiftliks and d. the extreme
delays, which lasted up to several years, in the issuing of decisions for compensations
regarding the land that had already been expropriated. These compensations were for
discreasfullylaw amounts or token payments vis-à-vis the value of the land. 54 It seems
that in some cases it was more opportune to declare oneself as having Albanian
nationality rather than Greek since in that way it would perhaps be possible to salvage
some property, such as one’s houses.55 The comparison of figures on expropriations
that took place in Epirus as opposed to other areas is enlightening since it shows large
discrepancies in terms of the number of expropriations that were carried out. 56 Even
until the early 30s, when the établis (non-exchangeable individual) certificates were
issued by the Greek Authorities for the Muslims of Chamouria, the populations were
not the real holders of their properties.
33 The presence of a population considered hostile to national interests near the frontier
caused anxiety to Greek officials which was exacerbated by a militaristic perception of
security and territory.57 The central Greek state was eager to push the “hostile”
population to migrate to Turkey. To that end it utilized harassment tactics which were
carried out by local paramilitary groups. This was a practice that was well known and
had been adopted as early as the period of the Balkan Wars. 58 In other cases it just
forced people to leave the country, after handing down ultimatums. 59
34 For instance, as late as February 1925, the General Administration of Epirus undertook
the task of carrying out a special operation with the purpose of persuading them to
leave the country.60 Two years earlier, Greek refugees from Asia Minor had been settled
in the area. These newcomers were used as a tool for applying more pressure against
Muslims for them to decide to leave Greece. The newcomers took advantage of the land
expropriations, and settled in the houses of Muslims. These actions were in accordance
with legal provisions applicable to the whole territory of Greece. 61 It is highly probable,
therefore, that some Muslims, pressed by the legislation relating to expropriation and
the presence of refugees who presented a threat to them, sold their estates and
remained landless.62
35 The restrictions imposed on the right to sell, rent or even cultivate land, due to the
consideration of Muslims as “exchangeable”, gradually led to the financial devastation
of the Muslim population.63
36 In addition, it appears that there was one more specific local group whose interests
clashed directly with those of Muslims: The Greek speaking mountainous population.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
147
These were mainly stock-breeding herdsmen, without fertile land, who had been
seeking in vain an improvement of their financial position for some time. From their
perspective, Chams were in possession of land which did not really belong to them, as
they were not part of the nation.64
37 Thus, in the eyes of the Administration and the Greek population of the area, the
prospect of the Chams remaining in Greece was a misfortune that had to be reversed. 65
This perception would obviously guide their actions for a long time to come, until the
final act of the drama was played out.
38 There is no evidence suggesting that the Muslim population was strongly opposed to
the idea of migrating to Turkey.66 Although no one was willing to leave his/her land
indefinitely, several sources indicate that as a destination Turkey was far more
appealing than Albania. This was also due to the poor economic situation in the latter
which was well-known to the people in the area. This phenomenon of warm regard
towards migration to Turkey by the Muslims was widely used by Greek nationalist
historians in order to prove the “Turkish consciousness” of the population. This notion
also confused Greek politicians and diplomats of the time who, insisting on this
assertion, failed to comprehend that the population had gradually been “nationalized”,
thus constituting a de facto Albanian national minority.
39 Meanwhile, measures were taken on behalf of the Greek state towards the creation of
new schools and kindergartens in the Muslim villages. Koranic courses in the majority
of primary schools were banned. Even relevant interpretations of the Holy Koran by
the chief of the local gendarmerie [Χωροφυλακήin Greek]were used in order to ensure
attendance of boys and girls in the new mixed schools. 67 Interestingly, this was the time
when the first application for the creation of a community school, whose curriculum
would also include the teaching of the Albanian language, was filed. 68
40 Parallel measures were taken at the same time regarding the language in Christian
Albanian speaking villages. The most important and easily confirmed measure
consisted of opening kindergartens in villages selected either by the absence of
knowledge of Greek or by their demographic importance. According to a 1931
document, these villages included Aghia, Anthoussa, Eleftheri[o], Kanallaki, Narkissos,
Psakka, Aghios Vlassios, Kastri (Dagh) and Draghani. 69
5. The period of the de facto existence of a national
minority
41 It was probably not until after 1926, and certainly after 1928, that Muslim Chams felt
secure enough about remaining in Greece. And in this period the Greek state seemed to
have come to terms with their presence. Muslim Chams had gradually started to create
a type of leadership strong enough to stand up for the whole group. This leadership
stood at quite a distance from the Greek political system and had intimate ties with
Albania. These representatives would complain to the League of Nations against Greece,
apply for the creation of schools where the Albanian language would be taught, and
send their children to study in Albania. There is sufficient evidence that the Greek
state’s perception of the existence of a national Albanian Muslim Chams minority,
living in extreme poverty, was already present in the early 1930s. 70
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
148
42 A concrete description of the lives of the Muslims is clearly referred to in a special
report drawn by K. Stylianopoulos, the “Inspector” in charge of Minority issues, who
was directly appointed by the Prime Minister Eleftherios Venizelos and was
accountable to him. The report relates to us in graphic terms that “[…] persecutions and
heavier confiscations, even led to the decision of classifying as chiftlik the town of Paramythia
[…] and in that way small properties and gardens had been expropriated against the
Constitution and the Agrarian law; not a single stremma was left to them for cultivation and for
sustaining their families, nor were the rents of their properties paid to them regularly (some of
them being even lower than a stamp duty). They were not permitted to sell or buy land, and were
forced to evaluate their fields at ridiculously low prices (as low as 3 drahmi per stremma), […],
only to be imprisoned for taxes not paid for land already confiscated or expropriated”. 71
43 Moreover, a matter that was also important to them besides the community wealth/
land possession concerned an entire spectrum of methodical harassment tactics against
the population.72 The financial weakness of the community, and the policies of the
Greek administration which intended to force them to emigrate, led finally to the
(re)appearance of emigration in the early 30s. This was despite the fact that in 1931 the
uncertain status of the non-exchangeability of the Muslim Chams was apparently
resolved by providing them with special établis documents,73 albeit three years after the
political realization that they would not be exchanged. In the eyes of the community
this long delay confirmed once more that they were not welcomed by the Greek state. 74
44 In 1931 there was already a rather numerous Cham community originating from
Greece settled in the Sarandë area.75 We are not quite sure if the emigration of Muslims,
as referred to above, ever came to a halt. Nevertheless, in the years between 1932 and
1933 a new flow of migration made its appearance.76
45 Various documents indicate that the Greek Authorities either prompted dislocation, or,
as one document vividly puts it, “all of our services, but most of all the Sub-prefecture
and the Gendarmerie [Χωροφυλακή] οf Filiati and Igoumenitsa are working hardly to
reinforce the [migration] flow”.77 Practical incentives were provided to individuals and
most of all to families wanting to migrate to Turkey. Another mechanism that was used
in some cases was the demographic disruption of Muslim communities targeting the
disassociation of the social web of the communities with a view to put additional
pressure to emigrate.78
46 This migration flow presents a prima facie controversial acknowledgment in
consideration of the fact that we have mentioned that an Albanian national minority
was called into being: The great majority of the emigrants chose to leave for Turkey 79
and not Albania. However, a closer reading of the relevant documents indicates that
the Greek Authorities were unofficially encouraging (legal) migration to Turkey while
discouraging, or even forbidding, migration to Albania. 80 One more fact that should not
be underestimated is that there was an underground migration to Albania, which was
not documented in the reports of Local Authorities to the Centre (since, for instance, no
passports were issued) and only indirectly referred to in Greek sources. However, this
migration is testified to by the relevant Albanian bibliography which includes the
testimonies of members of the community. This underground migration of individuals
and families to Albania continued until 1940.81
47 It is mostly after 1932 that this flow of migration increased considerably, despite the
fact that the Greek Sate at the time, at least the Government and the Ministry of
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
149
Foreign Affairs, attempted to lessen the hitherto applied hard-line policies against
Muslim Chams.82 Still, in practice these regulations were not really implemented. 83
48 In the 1930s it was obvious that the Chams were viewed as a hostile population and “a
lost cause for “Hellenism””. Attempts to create any kind of viable links between the
community and the Greek Administration were deemed fruitless as there were few
limits imposed on the hard line policies apart from the consideration of the image of
the state abroad and the policies of reciprocity applied concerning the Greek Minority
of Albania, which in turn had become a major national issue after the Greek Army’s
defeat in Asia Minor. It is evident from various documents at HAMFA that in general the
Ministry of Foreign Affairs is sparing of approving the petitions of local authorities
concerning deportations, prohibitions against entering Greece (“red notes”) and
deprivations of citizenship of males, the latter often exaggerating their reports. As it is
the Ministry of Foreign Affairs which finally decides on major minority affairs , is not
rare to justify its decisions on the “national interests” and the ‘effects on the Greek
minority in Albania” when rejecting hard line proposals of the local or regional
authorities, the Army and the Gendarmerie.84 On the other hand, local policy makers
were often acting arbitrarily, even without informing the central administration for
their acts.85
49 In 1935 half a dozen of teachers were appointed to teach the Albanian language, a
number that gradually doubled.86 This was a measure taken on an unofficial reciprocal
basis vis-à-vis Greek schools operating in Southern Albania and especially those in the
Himarë region.87
50 For the Greeks, Muslim Chams were by now a community that was not considered as
equal and was certainly treated as inferior.88 It appears that this perception was so
widely accepted that it was explicitly expressed in an official text: When the Greek
government was accused in front of the League of Nations in 1936 for its policy against
the Albanian Minority (i.e. Muslim Chams), and with special reference to the issue of
the education of children in their mother tongue, the Greek official response was as
follows: “in the free public schools, they learn their local idiom through the religious teaching
which is given to them in Albanian and is amply sufficient for their cultural needs”. 89
51 Finally, so as to exercise better control over the minority, the Greek state created in
late 1936 a new prefecture, that of Thesprotia, consisting of areas that previously
belonged to the Prefectures of Ioannina (Yanina) and Preveza, embodying all the
Muslim population.90
52 Although not officially recognized as a national minority, Muslim Chams gradually
gained an underground semi-official recognition as a national minority. As Albania
became their kin-state and the discourse of the minority reproduced the typical
national minority claims of the Interwar period, the Greek Administration gradually
faced up to the facts. As mentioned above, it is quite interesting that the ethnonyme
used in the internal administrative documents shifts from “Ottomans” and “Muslims”
to “Albanians” and “of Albanian origin” in the mid 1930s. Even some newspapers in
Athens refer to “Albanians” without being condemned by the authorities, although the
official discourse never adopted the term “Albanian minority”. This situation is vividly
described in a document of 1936 sent to MFA by the Governor General of Epirus: “We
would deeply appreciate your particular position regarding the national and religious
minority in Chamouria. Is it considered a recognized minority or not?” (author’s
emphasis).91
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
150
53 In the official censuses of the Greek State in the Interwar period there is major
manipulation involving the numbers of the Albanian speakers in the whole of the Greek
territory. In the census of 1920 the Greek State registered 35,959 Orthodox Albanian
speakers in Old Greece, the Albanian language being absent in Epirus,while in the 1928
census records for Epirus were as follows: 144 Muslims Turkish-speakers, 17,009
Muslims Albanian speakers and 2,030 Muslim Greek-speakers, completely disregarding
the Christian Albanian speakers from Old Greece, by counting only 95 persons as
Orthodox Albanian speakers for the whole of Greece.92 The issue here is not the
underestimation of the numbers of speakers as such, but the vanishing and reappearing
of linguistic groups according to political motives, the crucial one being the
“stabilization” of the total number of Albanian speakers in Greece.
54 Language was still an issue even for Christians, especially in Western Epirus, although
the state felt quite secure about their loyalty towards it. But those who live amidst
Muslims in the newly created prefecture of Thesprotia continued to be classified as
Albanian speaking homogeneis.93The term homogeneis (c.f. of the same genos) was used
exclusively for non Greek citizen “Greeks” living in the neighboring states, and in the
case of Albania, for both Greek and non Greek speaking Orthodox of the south.
6. The cycle of revenge
55 When the Italian Army invaded Greece from Albania on October 28, 1940, an Italian-
supported irredentist discourse was already present in both Albania proper and among
numerous communities of Chams who had fled from Greece to Albania. Individuals who
had been educated in Albanian schools, or had joined the Albanian army and
Gendarmerie, acted –to use a contemporary term– as a lobby for the Muslim Cham
cause. While the role of Kosovar refugees in Albanian Interwar politics has been well
documented by academic research, the role played by the Cham diaspora has been
overlooked. An example that shows the involvement of Cham refugees in these matters
is the appointment of a Cham, rather than a Kosovar in 1935, as the head of the
“Refugees Rehabilitation Committee”.94
56 The very day Italy invaded Greece, the leaders of the Cham community were arrested
and sent into exile, an action which in retrospect has been heavily criticised, as it gave
the Muslim community indubitable proof of the negative perception of Greek
Authorities towards the Chams.95 This measure left them without leadership, a fact that
probably influenced their behaviour against the Greeks in the ensuing months. 96 When
the Cham refugees went to fight on the side of the Italian Army that was invading
Greece, they turned against the local Christian population, who were favoured by the
policies of the Greek state. In the following days however the Greek army reoccupied
the area, exiled nearly the entire male Cham population,97 and turned a blind eye to the
atrocities committed by local Greeks against Chams.98
57 The clashes that followed for several weeks should be treated as the final breach
between the two communities. According to Greek historiography, the subsequent
establishment of the Italian occupation forces in the area and the gradual appearance
of a quasi-administrative network of Chams from late 1942 onwards are responsible for
the Muslim Cham exodus that occurred in 1944 and 1945.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
151
58 In fact, the reaction of the Muslim population during the period 1941-1944 could have
been foreseen. The Chams tried to regain some of their real estate property and the
power they had lost during the preceding decades.99 By the year 1943 they were more
systematically employed as army personnel by the German occupation Forces that took
control over the area after the Italian capitulation. The trouble was not caused only by
the battles against Greek resistance guerrillas. Conditions of war typically offer
opportunities to shift the power-balance between different groups, and the Chams took
advantage of the given circumstances in a way historically common to the area:
Exhibition of their power through atrocities, murders, theft of flocks and any other
type of movable property etc. could be witnessed as a recurring phenomenon. 100 A
striking incidence of such power games is described by Yannis Sarras. According to his
account, approximately 300 armed Muslims invaded the village of Kastri, in order to
take revenge for the lootings which occurred two and a half years earlier in the Muslim
village of Parapotamos (ex-Varfani) by the inhabitants of the Albanian speaking,
orthodox villages of Kastri and Agios Vlassios. After three days of negotiations in the
village the two parties came to an agreement. Part of this agreement was the return of
the domestic animals and the rest of the loot that had been taken. However when the
loot was presented in front of the committee the Muslims of Parapotamos refused to
accept them saying, “We came here to administer justice and our superiority” and left the
village.101
59 The final act began to unfold when the Greek guerrilla forces of EDES, which was active
in the areas inhabited by Muslims, took control of the situation at a time when the
Muslim armed military forces had already been deprived of the support of the German
Army. EDES [ΕΔΕΣ] was an active and powerful resistance group, operating mostly in
the region of Epirus.102 The other active resistance group, which was operating over the
whole of Greece was the left wing guerilla army ELAS [ΕΛΑΣ]. This group’s presence in
the area extended to the mountains of Mourgana in the northeastern part of the
present prefecture of Thesprotia, where no Muslim settlements existed. When the
Germans withdrew, battalions of EDES guerillas shot and slaughtered not only the
surrendering armed forces of Muslim Chams but also women and children, a practice
which they generally adopted when entering Muslim villages. This was mainly the case
for the Karvounari, Parga, Trikoryfo (ex-Spatari), Filiati and most of all Paramythia
towns where approximately 300 persons were murdered.103 In total more than 1,200
persons were murdered. Some Albanian sources suggest that the number is as high as
approximately 2000.104 The Muslim population left the country at the end of 1944 and
the local Christian population contributed to this exodus105 by looting and killing,
although there were cases where local people offered protection, and thus some lives
and properties were saved from the EDES guerillas and the threat posed by the armed
groups or even families of local Christians.
60 A few hundred Muslims stayed behind. 127 of them were counted in the 1951 census,
while the rest, whose number remains unknown and in need of research, converted to
Christianity and intermarried with Greeks.106
7. A predictable exodus
61 It is not certain whether the ethnic cleansing that occurred during this period was part
of a well organized plan. This is perhaps a question that we will never be able to answer
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
152
given the total absence of written evidence. The assumption that the Paramythia
massacres that took place on June 1944 were an ad hoc, isolated incident is rather
unconvincing since it was followed by other similar events. The same tactics were used
in September of the same year and were repeated again later. On the other hand, even
if we assume that the massacres that happened had been spontaneous, their results
were nevertheless later welcomed by the re-established Greek state after the liberation
from Nazi occupation.
62 The conflict with the Muslims appears to have been foretold for some time: “It emerges
from a great number of reports and relevant documents and published work, that
Zervas seemed to have no intention of any collaboration with the Chams from the very
beginning of [EDES]”.107 The creation of the Cham-Albanian side-administration in the
area should have played a role in the decisions of the politicians in 1945: An area south
of “Northern Epirus”, which all the political parties, even the Communist Party of
Greece, were demanding to be annexed to Greece in 1946, had been threatened with
quasi-annexation by Albania. How can the persistence of EDES fighters in attacking the
unarmed and miserable Chams who had returned to the Filiati region in early 1945 108 be
explained if not with the purpose of their expulsion from Greece?
63 In 1945 and 1946 the prosecution of more than 2100 Chams, mainly males, followed.
They were sentenced as war criminals and collaborators with the Occupation Forces in
absentia.109Their real estate assets (occasionally even those of their spouses and
children) were subjected to general confiscation.110 The same regulations applied for
the rest of the Muslim Chams, as persons “who abandoned their properties and acted
against the [Greek] nation abroad”.111 These confiscated properties passed onto the hands
of the Greeks, and not always through formal legal means. Similarly, urban real estate
properties passed to the Greek state by means of a law passed in 1938. Rural estates had
the same fate after the implementation of new legislative provisions of the period
between 1952 and 1959.112 All these regulations did not exclusively target the Chams.
They also affected the communists who left Greece after their defeat in 1949. In
addition there were more austere provisions adopted for the populations that lived
near the border [παραμεθόριοςin Greek], which at that time included nearly all of
Northern Greece. It is evident from the legislation, that the consequences of these
policies, suffered by the Slav Macedonians and the Chams, were known and consciously
carried out as an essential aim of the state policy during that period 113 This is also
proved by the fact that these regulations did not apply to the Muslim Turks of Western
Thrace who left Greece after 1940.114
8. The disappearance of the minority and “ethnic
cleansing”115
64 The atrocities that took place against the Muslim population are not mentioned in any
official documents. They are absent even from confidential documents exchanged
between the administrative bodies themselves.116 This does not only demonstrate that
the Cham issue was a closed case for the Greek state but it also suggests that the state
wished to completely eradicate any evidence of what had happened during that
turbulent period.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
153
65 After the war, a very limited number of printed material mostly originating from local
writers undertook the task of presenting the “realities” of the period of war, with the
implicit aim of justifying the ethnic cleansing that had taken place. A few years after
the expulsion, a propaganda booklet was published entitled “Chams and Chamouria.
Descendants of perjurers--Yesterday’s collaborators with the Occupation Forces and war
criminals-Today’s chiefs of the communist gangs”.117The booklet referred to the crimes of
the Chams even though “the Greek state stood scandalously in favour of [them]”. The writer
is making an argument for the Greek origin of the Chams, who according to him were
converted to Islam and were “obliged in time to learn the Albanian language,” and
estimates their number at16,661.118 This booklet was the second printed work that
made reference to the case. The first one was published in 1945, 119 but never attracted
any attention. As Giorgos Margaritis notes, the theory arguing for a natural criminal
tendency among the Chams was put forward and, in a fashion also adopted by the later
booklet, was meant to justify the bloody cleansing of the minority. 120 During the
interwar period a similar theory had been used to explain the financial destruction of
the community: It was a result of their laziness and their dislike of education.
66 As has become apparent, the theory of the Greek origin of Muslim Chams became
dominant after the exodus. The aim was to prove that all the lands that comprised
Chamouria had been inhabited by Greeks in fact, that the whole of the Greek territory
had a purely Greek history which could not have been claimed by foreign states and
opponent national histories, protecting the unredeemed part of their nation, so the
solution was to consider them former Greeks who betrayed their nation by converting
to Islam in the first instance and by identifying themselves with an alien nation in the
second. The territory was claimed through its population, which in the era of the
nationalities principle became the normative approach.
67 Another book entitled Grief and tears of Thesprotia, published most probably in the late
1960s, repeats the assertion that the Muslims of the area were local Greeks converted
by force to Islam and forced to learn the Albanian language. The Muslims of Thesprotia
were counted at 16,661, once again through playing with the numbers of the unofficial
figures of the 1940 census.121 The writer refers to the “outrageous favours” they enjoyed
due to the efforts of the Greeks and the Greek state and describes the crimes of those
“human-looking monsters”.122
68 In 1986 Vassilis Krapsitis published what turned out to be the most popular book to
that date. A large part of it is dedicated to the atrocities committed by Muslims, while
reference to the Paramythia massacre occupies no more than a footnote. The narrative
of the Greek origin of the Chams is repeated, just like the arguments about their forced
conversion to Islam and their Greek-mother tongue, for a majority of the population.
Following the 1940 census the author claims that 18,576 Muslims were registered in the
area.123 A year earlier, the same author had published another book, dealing with the
history of the town of Paramythia. Evidently, there were certain chapters focusing on
“War crimes” of Muslim Chams but utter silence on the Paramythia massacres. More
importantly, the same book includes a sub-chapter entitled “[The Paramythia
Muslims].Full Greeks converted to Islam”, where the usual references and arguments are
made.124
69 A slightly different approach appears in the writings of Spyros Mousselimis, a local
teacher. In his major work, first published in 1973 but best known after its 1997 edition,
he accepts the forced conversion theory, and takes a step further, declaring that the
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
154
Albanian [αρβανίτικαin the original text] language of “Christian and Turk Chams” has
Greco-Pelasgic roots and that both were descendants of the Dorians. He avoids focusing
on the 1940-1945 period, except for scattered references, one of which was the looting
and burning of the Muslim village of Gardiki. In a line he refers to the “revenge and
pogrom” against the “Turks” at Paramythia by the guerrillas. 125
70 These publications going back as far as the mid 1980s clearly show a deliberate erasure
of memory regarding the Muslim Chams from public discourse. What is specifically
understated each time is the fact that for a lot of Christians of the area Albanian
remained their mother tongue.126
71 In contrast, prior to the 1990s there were only two books that had the courage to
address the facts. The first one, written by a local named Yannis Sarras, member of the
leftist resistance organisation EAM, reveals the atrocities against Muslim Chams, by
reference to distinct incidents. His book, although not well known and difficult to find
even at the time it was published, is also the only one that examines the Albanian
linguistic tradition of the area.127 The second book is written by a member of the armed
leftist resistance group ΕΛΑΣ[ELAS], in which the atrocities and murders against the
Muslim population are also described.128
72 The fact that from the early 1980s onwards the Albanian-speaking communities of
Southern Greece started to investigate their roots and linguistic traditions necessitated
the invention of yet another conceptual construction. This new concept appeared at
the same time with reference both to the Arvanitic communities of southern Greece
and to the Chams. In 1989 Krapsitis published a book on the (Christian Cham) Arvanitēs.
In that book herepeats the constructions regarding their origin and their (proto-)
Greek language,129 as an attempt to disconnect them from the Muslim Chams.
Simultaneously, an attempt is made to disconnect their language from proper Albanian,
the corresponding standard official language, stating that it is not Albanian but Arvanitic,
an idiom quite similar with the arvanitika language spoken in Southern Greece. 130
73 The theory of the Greek origin of the Chams appears even in scientifically oriented
works. As it often happens in such cases, sources are purposefully left without
verification. In the following example a Greek propaganda book is employed to support
the hidden argument that those lands were inhabited by Greeks: “these Albanian
speaking Moslems, who were descendants of the Christian inhabitants of Thesprotia and
who had been converted to the Muslim religion and had lost contact with the Greek
language during the Ottoman rule” (author’s emphasis).131 In one sentence, the writer
manages to support the Greekness of the people and of the area. They were
autochthonous, so there were no “population invasions”; they were Greeks who “lost”
their language and Christians (the other accompanying trait of Greekness) who lost
their faith; those facts changed due to the evil “Ottoman rule”. These conclusions are
based on two footnotes from the book of Ioannis Archimadritis, a propaganda book par
excellence.
74 The erasure of the Cham past in general was further assisted by the fact that the Chams
were considered to be a “hostile population”132 even in communist Albania, a black sheep
in the “heroic resistance of the Albanian people”.133 Leonidas Embirikos has pointed out
that there is a complete absence of works by local authors presenting the history of
their village, in contrast to a common practice throughout Greece. 134 If we consider that
even in the case of Macedonian/Bulgarian speaking villages there are at least a dozen
books on the history of the villages, with some actually making direct or indirect
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
155
references to their linguistic alterity, we presume that in the case of Chamouria there
are two issues that local authors do not want to deal with: the linguistic alterity, a
common language with Muslims (and Albanians) and the 1944-1945 incidents.
75 In view of the above, the sudden reappearance of the Cham issue in Albanian political
and public discourse surprised and frightened Greece in every respect. Greek semi-
official discourse was based on propaganda books and leaflets published in the previous
decades and was unable to address the evidence that sprang forth from the opposite
side. Even local Greeks were frightened, as they started to worry about their properties.
76 It is in this context that in 1993 when the Cham issue was already being discussed in
Albania, a scholarly book attempted to reconstruct the history of the interwar period.
In this book, arguments related to the Greek origin of the Muslims are supported and
the non-Albanian national consciousness of the Chams is emphasised. With regard to
the whole spectrum of the issues specific to this period, key questions such as the
property issue and past discriminatory policies are not examined. There is a mention of
the unsuccessful denunciation by the Albanian Government to the League of Nations in
1928. At this point the writer conflates the issue of Greek refugees (from Turkey) with
that of the estate policies, a common trick, aimed at justifying Greek positions. 135
77 From mid-nineties, with the emergence of the issue in bilateral Greek-Albanian politics,
a few more publications came into view.136 Their common aim was to emphasize the
“criminal behavior” of Muslim Chams and conceal the ethnic cleansing they were
subjected to. The theories of Greek origin and forced conversion to Islam were still
present.137
78 Krapsitis’ 1986 book and Michalopoulos’ book, are easily found in bookstores accessible
to the wider public. These are the two books which have shaped public ideas on the
Cham issue.
79 In all these published works it is common practice to focus only on numbers of
Albanian speaking Muslims, leaving out those who were considered by the Greek
censuses as Greek speaking. In this manner the total number of Chams is
underestimated as a mere 2,000 persons.138But even when presenting the census the
authors use various ploys in order to reduce the number of Muslims. Although Krapsitis
in his 1986 book counts 18, 576 Muslims according to the unofficial data of the 1940
census, others using the same census arrive at a figure of 16,661 persons, following
Chariton Lambrou’s lists. Lambrou used rather primitive manipulations in order to
reduce the number of the Muslim population: He totally omitted the Muslim population
of certain villages139 and in villages where there was a mixed population the count for
Muslims is transferred to the category of Christians and vice versa. 140 Besides, there is
enough evidence to prove that even “Krapsitis’ census” underestimates the Muslim
population for at least 2,500 persons.141
80 The stigma of the killings, or as we name it the blood stigma, which is carried by the
local Christian population, helped the administration to make the Cham issue
absolutely disappear from public discourse. Unlike the case of Slav-Macedonians,
Muslim Chams were all gone, with no signs of any natural presence after the War. By
collaborating with the Occupation Forces they had also lost their support from the Left.
142 Moreover the local Christians generally benefited from the expulsion in addition to
the fact that quite a lot took part in the 1944-1945 incidents. Consequently, it was easy
for state institutions to render the Chams invisible.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
156
81 The Albanian language, and the Christian population who spoke it- and still do- had to
be concealed also, since the language was perceived as an additional threat to the
Greekness of the land. It could only be used as a proof of their link with the Muslims,
thus creating a continuum of non-Greekness.143 In this way, in the History of the Greek
Nation [ΙστορίατουΕλληνικούΈθνους], a collection, and most importantly, a multi-
volume work with the official purpose of securing as well as of normalizing Greek
history, the Albanian language is reportedly absent in the south of the Souha line.In
other words, south of Himarë-Gjirokastër-Suhë-Leskovik the population was Christian
and Greek speaking.144
82 The process of extinguishing any signs of previous minority existence occurred both in
real and symbolic ways. The villages of Muslim Chams were repopulated by Greek
speaking populations from the adjacent mountainous areas and Vlachs, immediately
after their expulsion. The central Holy Mosque of Paramythia was not only blown up
but was symbolically gouged in order to underline the end of the Muslim presence in
the area.145 Gradually, in a period of less than ten years, nearly all mosques and
especially minarets, visible symbols of Muslim presence, were demolished. 146 One of the
last acts of the“cleansing of history” is the blowing up of the mosque at the village of
Polyneri (ex-Koutsi,) by a (Christian) villager, during the time of the Colonels’
Dictatorship.147 A tiny Muslim community and, until recently, the last imam of Epirus
still survive in this village.148
83 What has turned the Chams into an absolutely invisible minority is the erasure of their
existence from every public registration roll. In their case it seems that the withdrawal
of their citizenship was not the outcome of a legal procedure. In accordance with the
regulations in force at the time (under article 4 of the 12.08.1927 Decree) persons not
belonging to the Greek genos [αλλογενείς in Greek] could be deprived of their
citizenship if they had left Greek territory with no intention of return. 149 Even though
the legal paths of these deprivations of citizenship can be traced for the cases of Slav-
Speaking Macedonians, Muslim-Turks, Jews and other groups deprived of their
citizenship rights, this is not the case for Muslim Chams. Seemingly, a different
procedure was employed for them. The reason for this difference is, we presume, that
what we are dealing with in the Chams’ case it is not an issue of deprivation of
citizenship through individual decisions, issued by the prefect/the Ministry of Interior
(Affairs) and the Ministry of Military Affairs, but rather an erasure or destruction of all
relative documents. Specifically, this refers to the destruction of the municipality
registrations records [δημοτολόγιαinGreek], and the special “Males Registration Roll” [
ΜητρώαΑρρένωνin Greek]. The latter registry was, at that time, under the jurisdiction of
the Ministry of Military Affairs. According to a document classified as “urgent and
secret” of the Ministry of Military Affairs to the Recruiting Office of Igoumenitsa and
the Prefecture of Thesprotia (doc. A. Π. 50862/Φ. 38254, Athens, the 16 th of Dec. 1947)
the Ministry directed the above mentioned local authorities to erase the names of
Muslims from the Males Registration roll as they were considered as being already
deprived of their Greek citizenship (under the 1927 Decree).150 Today, no registration of
a Muslim Cham can be traced in the municipality or Males registries.151 Municipalities,
on the other hand, have fabricated untenable justifications for this irregularity. 152 It is
worth mentioning that the deprivation of citizenship was also implemented in Epirus,
in the remaining population of Moslems, numbered a few hundred persons, in
accordance with article 19 of the Greek Nationality Code (Act) up until its revocation in
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
157
1998.153 The implementation of article 19 in Epirus demonstrates best that the state
policy was that the slightest sign of Muslim Cham existence in the area had to be
eradicated.
Conclusion
84 It could be argued that it was not officially the state that committed ethnic cleansing,
an argument put forth worldwide by various states and for a variety of similar cases. In
the Cham case, however, the state herself was both undisturbed by this ethnic
cleansing and received its results favorably. Napoleon Zervas, the leader of EDES, was
considered a hero by the state and had a subsequent career as a prominent member of
the political system. Furthermore, the state backed up the ensuing absolute
obliteration of Chams. Their expulsion was far from being perceived as an “historical
mistake”: it was seen as an act of salvation for the area and for Greece at large. 154
85 As we have shown, the continuous anxiety of the Greek authorities to reduce as much
as possible the existence of the minority and to mute the development of a national
Albanian minority in Chamouria, was transformed into physical expulsion when these
measures were not deemed sufficient. This “reduction” included the numbers of
persons and their representation in registries, their land and property, leading to a
reduction finally in their total presence, their national affiliation and their entitlement
to fair treatment. The dominant perception was that the lands near the border had to
be Greek, not only because it adjoined the frontier of another state, but also because it
was inconceivable after the Lausanne Treaty that a non-Greek in every sense (i.e.
religion and language) could own Greek land, or simply exist inside Greek territory,
while claiming not to be Greek. In this sense the compactness of the Albanian speaking
area in Western Epirus, from a certain period onwards, did not constitute a danger to
the Greek state in terms of a possible shift of its Christian Albanian speaking population
towards Albania. The danger lay in the fact that this land could continue to be viewed
as Albanian, the land of Arvanitēs (see above). “[T]he idea of “hellenising” the land of the
Chams was made possible by the ideology of human exchanges and the lack of legal protection
for these minorities during the interwar period”,155 as stated by Georgia Kretsi. This deep
rooted anxiety of the Greek state, as disclosed by the patterns of policy implementation
in the region, led to the gradual minoritization and nationalization of the group, 156 a
process that shaped its complete and utter exclusion from the Greek nation-state.
Following these processes the next step for a solution to the issue was their expulsion,
given that there would be no major bilateral or international risk of protest and
conditions of war presented the most favorable chances for a total expulsion to take
place. The expulsion was facilitated by the general tendency of Eastern European states
to proceed to the mass expulsion of their German minorities at the end of the War
through the argument of the explicit intervention of the German state, as well as their
open identification with Germany.
86 The intention of the State was quite clear: the expulsion of Muslim Chams through
their inclusion in the Greco-Turkish population exchange. Although not realized
through this exchange, state policies directed at the reduction of the population of
Muslim Chams were a prelude to the expulsion that would take place later. The exact
time and means of this expulsion were under a constant process of negotiation. We
argue that the intention of the state found, at the time, nomination in the actions of the
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
158
Armed Forces which were acting as forces of national resistance. These forces, in the
presence of an absent or later weak state and with its blessing, were acting on behalf of
the “nation” and the state. As the state gained back its strength, the actions of the
guerilla forces were accepted as the state’s own operational policy. When we look at
other war-related cases in the postwar Greek state, despite its staunch anti-
communism and partial staffing by members of armed groups responsible for
atrocities, there still were cases where individuals responsible for atrocities were
sentenced and were far from being rewarded. The absolute “non punishment” and the
“reward” of those individuals related to the expulsion of Chams, are strong indicators
that these policies were both accepted and formed part of state policy.
87 The total disappearance of an albeit officially unrecognized minority that once existed
was disturbed only after the emergence of the issue in post-communist Albanian
politics. But less than fifty years were sufficient to erase all memory of the Chams from
the minds of the Greeks. With the exception of the locals themselves, everyone else in
Greece, from politicians to most historians,157 is convinced or pretends that (Muslim)
Chams never existed in Greece. The process of erasure/muting was so successful, that
even the anchormen of Greek television speak of “the pseudo-Chams” or “the self-so-called
Chams”.
88 87. For the importance of the operation of Greek schools at Himarë and the
significance it played at the decision of the Greek Administration to permit the
instruction of the Albanian language in a few schools see E. Manda…, op. cit., p. 105,
where relevant Albanian and Greek sources sited. Although the instruction of the
Albanian language is related on the point of time with the opening permission of
private schools for the Greek minority in Albania and such reciprocity tactics are
traced in Albanian archives (see N. Clayer “L’albanisation de la zone frontière albano-
grecque et ses aléas dans l’entre-deux-guerres », Actes du colloque Frontières et
territories dans les Balkans, EFA, Athènes, September 2006 (under publication)), there is
no relevant evidence in Greek archives.
NOTES
1. It’s worth mentioning that the Greek speaking Muslim communities, which were the majority
population at Yanina and Paramythia, and of substantial numbers in Parga and probably Preveza,
shared the same route of identity construction, with no evident differentiation between them
and their Albanian speaking co-habitants. These last mentioned Muslim communities were in
some cases bilingual in Greek and Albanian (see the specific chapter “La question de la langue
dans quelques villes et bourgades de l’Épire”, in Lambros Baltsiotis,L’albanophonie dans l’État grec.
Expansion et déclin des parlers albanais, diplôme de l’EHESS, Paris, 2002, pp. 305-312).
2. In certain sources Chamouria includes the Greek-speaking area to the east of the city of Filiati
and does not include the Albanian speaking area of Fanari, named alternatively “Prevezaniko”.
The official name of the area north of the Acheron river is Chamouria in all Greek state
documents for the whole Interwar period.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
159
3. For the sanjak of Reşadiye see Michalis Kokolakis, ΤούστεροΓιαννιώτικοΠασαλίκι. Χώρος, διοίκηση
και πληθυσμός στην Τουρκοκρατούμενη Ήπειρο (1820-1913), Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών 74, Athens, 2003, pp. 160-162.
4. EleftheriosVenizelosArchive, f. 8/1913 “Στατιστικός πίναξ πληθυσμού Βιλαετίου Ιωαννίνων
(Ηπείρου)». This registration is based on the Ottoman “1908 census”, by doubling the numbers as
only males were counted at 1908. It seems that the language figures are estimations made by
Greek officials. For the Ottoman census of 1908 and its accuracy, see K. Kokolakis, …, , op. cit., pp.
276-277, 509.
5. This figure does not include more than 4500 inhabitants of the Muslim villages of the Konispol
area of the kaza of Filiati annexed to Albania.
6. See L. Baltsiotis, L’albanophonie…, op. cit., pp. 272-280.
7. Historical Archive of the Ministry of Foreign Affairs (HAMFA), Athens, 1923, file 6.7. After this
document the number of Muslims was estimated as following: a) at the Prefecture of Jianina:
2,300 Greek speaking, 700 Turkish speaking and 16,500 Albanian speaking b) At the Prefecture of
Preveza: 900 Greek speaking, 300 Turkish speaking, 5,300 Albanian speaking and 100 Romani
speaking. According to various estimations the Muslim population of the town of Yanina did not
exceed 2,200 persons, while a reasonable estimation for the rest of the prefecture, excluding the
area that later formed the prefecture of Thesprotia and the town of Parga, would lie between 10
to 15 hundred persons.
8. See Kaliopi Naska (ed.), Dokumente për Çamërinë (1912-1939), Drejtoria e Përgjithshme e
Arkivave, Tirana, 1999, pp. 682-685. The Consul mentions that around six hundred persons
should be added to the numbers for the Filiati region, as his records are not accurate for this
area. He also notes that seven hundred people from this area had migrated to Turkey. He
assumes a maximum of 25 to 28,000 Muslim Chams residing in the area.
9. Until the Interwar period Arvanitis (plural Arvanitēs) was the term used by Greek speakers to
describe an Albanian speaker regardless of his/hers religious backround. In official language of
that time the termAlvanos was used instead. The term Arvanitis coined for an Albanian speaker
independently of religion and citizenship survives until today in Epirus (see Lambros Baltsiotis
and Léonidas Embirikos, “De la formation d’un ethnonyme. Le terme Arvanitis et son evolution
dans l’État hellénique”, in G. Grivaud-S. Petmezas (eds.), Byzantina et Moderna, Alexandreia,
Athens, 2006, pp. 417-448.
10. See L. Baltsiotis, L’albanophonie…, op. cit., p. 29, where one can also find examples of the ethnic
division between the Greek speaking and Albanian speaking Christian population, even at Fanari.
11. The western limit of the area is the Ionian/Adriatic coast. For a detailed enumeration of the
Albanian speaking settlements of the area and their religious identity, see ibid , pp. 272-311,
393-397, 422-428 et Annexes pp. 552-594.
12. Excluding the one of Filiati (See Eleftheria Nikolaidou, ΗΑλβανικήκίνησηστοΒιλαέτιΙωαννίνων
καιησυμβολήτωνΛεσχώνστηνανάπτυξήτης, E.H.M.-I.M.I.A.X., Yanina 1984, passim).
13. For a description of the Leagues and the educational initiatives in Chamouria, Preveza and
Yanina, see Leonidas Embirikos, Histoire de la langue albanaise en Grèce de la création de l’État
hellénique jusqu’à nos jours, Diplôme de l’EHESS, Paris 2002, pp. 117-120 and E. Nikolaidou,…, op. cit.,
passim).
14. We consider as the following reasons to have led to the near complete absence of pro-
Albanian feelings amongst the Orthodox population of the area: a. the non existence of an
Albanian speaking Christian elite, made up of both landowners and merchants. In any case, a well
educated orthodox coming form the orthodox Albanian speaking community can hardly be
located in Chamouria b. A rather large percentage of the Christian population consisted of
landless farmers and small scale land owners who lived in comparatively small villages. c. The
larger settlements were Greek-speaking or Greek-speaking oriented independently of the
religion of the inhabitants d. The hegemony of the Greek language held over both religious
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
160
groups in the greater area, from Yanina to Korçë and from Preveza to Përmet, (see L. Baltsiotis,
“ΟιΑρβανίτες”, S. Seferiadis & D. Papadimitriou (eds.),ΑφιερωματικόςτόμοςστονΓιάννηΓιανουλόπουλο
, Athens, 2011 (in press)).
15. See L. Embirikos, Histoire…, op. cit., pp. 106, 114.
16. It is quite characteristic that it was in 1880, when the British Valentine Chirol visited the
Christian “Albanian” village of Tourkopalouko (today Kypseli, at the northwest part of the
Preveza prefecture), that his confidence for his Greek friends in Yanina “was first shaken”. He
was surprised that no one in the village spoke or understood any other language than Albanian
although his friends “had assured me that south [of the river] Kalamas there were no Albanian
communities” (V. Chirol, “Twixt Greek and Turk, or Jottings during a journey through Thessaly,
Macedonia and Epirus, in the Autumn of 1880”,Blackwood’s Edinbrurgh Magazine, n. 785, March
1881, p. 313).
17. See Dimitrios Hassiotis, ΔιατριβαίκαιΥπομνήματαπερίΗπείρου, αδελφοίΠερρή, 1887, pp. 51-52.
18. This is a continuously repeated assertion of Greek state officers.
19. The region that, according to the Greek claims, should have been included to Greece is
named “Northern Epiros” (ΒόρειοςΉπειροςin Greek) and the Christian inhabitants of the area
Vorioepirotēs [Βορειοηπειρώτες].
20. Under the term Northern Epirus is recognized, in Greek irredentist, nationalistic
bibliography and public discourse, the area of today’s Albania that includes Korçë, Gjirokastër
and Himarë.
21. A typical example of this procedure is the bilingual edition of the (Greek) Army
Headquarters, ΧάρτηςεθνογραφικόςτηςΒορείουΗπείρουτω 1913-Carte ethnographique de l’Épire du nord
en 1913, ΓενικόνΣτρατηγείονΕλληνικούΣτρατού, Thessaloniki, 1919.
22. For example, the impartial, otherwise known by Greeks as “moderate” president of the
Albanian Club of Yanina was assassinated in the summer of 1912, probably after an order of the
pro-Greek League Ipirotiki Etairia (see L. Embirikos…, op. cit., p. 162).
23. For the relevant legislation, see H. A. Kossivas, Νομοθεσίαδιοικήσεωςμουσουλμανικώνκαι
ανταλλαξίμωνακινήτων,Π. Λίβα & Γ. Χάντζου, Athens, 1928, passim.
24. For instance the Muslims in Epirus were temporarily not permitted to freely move in the
area (HAMFA, 1920, 151.4, The Staff of the Army to the Governor General of Epirus, 30.06.1919).
25. We mention for example, the restrictions for Muslim landowners to sell or hire their land
after 1917, see Konstandinos Tsitselikis, Old and New Islam in Greece. Legal and Political aspects,
(under publication), especially the chapter: “Property Rights on Real Estate Belonging to
Muslims”.
26. Ministry of Foreign Affairs 07.05.1918, Ministry of Agriculture 01.10.1918, The Government
Commissary for Kozani and Florina January 1917 (HAMFA, 1918, B/AAK-1). For the 1917 decisions
of the Council of Ministers not to implement the regulations concerning the abandoned plots in
Epirus and its implementation at least by 1919 see K. Tsitelikis…, op. cit.
27. Bastaina is a kind of large scale property on which the farmer, although not owning the land,
has more rights compared to a chiftlik farmer: The right of cultivation can be sold or inherited
and the farmer can not be evicted from the land he cultivates.
28. Despite the myth that Chamouria had only chiftliks, comparisons with other areas show that
Epirus in general had the same percentage of chiftlik distribution with that of Macedonia and
lower than that of Thessaly (see Kostas Vergopoulos, Τοαγροτικόζήτημα, Εξάντας, Athens 1975, p.
136).
29. For the variations in the political attitudes of the beys and the integration of part of them
into modern society see Nathalie Clayer, Aux origines du nationalisme albanais. La naissance d’une
nation majoritairement musulmane en Europe, Karthala, Paris, 2007, pp. 33-41.
30. According to a 1936 document, at the Muslim village of Liopsi there are 170 families. More
than one hundred of them “prosper” as they own land at the Chamouria plain, the rest of them
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
161
being “poor and driven to desperation” , The Local Authorities Inspector [attached at the General
Governance of Epirus], Jianina 30.07.1936, HAMFA, 1936, 21.1. At the document it is underlined
that at the neighboring village of Kotsika 150 persons left to Turkey during 1926-1927, reducing
the current (at 1936) population to 450. One can suppose that the emigrants were coming from
the “poor” families, although further research should be undertaken.
31. Seeamongothers, N. Y. Ziangos, Αγγλικός Ιμπεριαλισμός και Εθνική Αντίσταση, vol. A, Athens,
1978 p. 255, H. Minga, Çamëria, vështrim historik, Tirana, 2006, pp. 85-86.
32. We must add that some of the “volunteer” units who were fighting on the side of the Greek
Army, were coming from the area. This factor, most probably contributed to the increase of
armed clashes. For a more detailed narration of the fighting and the battles that occurred in the
area during late 1912, the use of local population and the burning of villages by both sides see K.
D. Sterghiopoulos, ΤοΜικτόνΗπερωτικόνΣτράτευμακατάτηναπελευθέρωσιντηςΗπείρου (Οκτ.-Νοεμ. 1912),
Athens, 1968.
33. See for example K. Naska (ed.)…, op. cit., pp. 1-104.
34. For example see HAMFA, The Vice-governor of Paramythia to the Ministry of Internal Affairs,
30.03.1917 (1917/A/4X(16)).
35. Two written examples that come to us from the Greek side can illustrate the point. At his
diary, a Greek officer describes his sadness when he visited a mosque outside the city of Arta, at
the Imaret settling, and found it defiled by Greek soldiers (see, Lindia Tricha (ed.), Ημερολόγιακαι
γράμματααπότομέτωπο. ΒαλκανικοίΠόλεμοι 1912-1913, Ε.Λ.Ι.Α.,Athens 1993, p. 75. We should mention
that no battle or resistance to the Greek Army took place in the Imaret area.
The lieutenant of the Greek Army Dimitrios (Takis) Botsaris, after a looting incident during the
First Balkan War, pronounces an order that “from this time on every one who will dare to disturb
any Christian property will be strictly punished” (see K.D. Sterghiopoulos…, op.cit., pp. 173-174).
In pronouncing the order in this manner he left Muslim properties without protection. Botsaris,
coming from Souli, was a direct descendant of the Botsaris’ family and was fluent in Albanian. He
was appointed as lieutenant in charge of a Volunteers’ company consisting of persons originating
from Epirus and fighting mostly in South Western Epirus.
36. For the Greek policy at the area during the first two years after the annexation to Greece see
Eleftheria Nikolaidou, ΗοργάνωσητουΚράτουςστηναπελευθερωμένηΉπειρο, Δωδώνη, ΧVI, 1987,
pp. 497-609.
37. K. Tsitselikis…, op. cit., H.A. Kossivas…, op. cit., passim.
38. K. Tsitselikis…, op. cit.
39. For the financial and social changes at the area during the last decades before the annexation
of the area to Greece see Yannis Sarras, ΙστορικάλαογραφικάπεριοχήςΗγουμενίτσας 1500-1950, Athens,
1985, passim. As the author puts it regarding the arrogant behaviour of Christians against
Muslims “Muslims had restricted their reactions to Christians, in a self-defence mode, they were
reacting only in the case that an offence against them was taking place” (ibid, p. 227). The gap
created during late 19th century between religious denominations of the Ottoman Empire is
described in N. Clayer, Aux origins…,op. cit., pp. 540-549.
40. See Hajredin Isufi, “Politika e shtetit grek për dëbimin e popullsisë çame në vitet 1914-1928
dhe qëndresa shqiptare, Studime Historike, 1-4, 1993, pp. 60-77, Georgia Kretsi, “austauschbar –
nicht-austauschbar: Albanophone Muslime (Çamen) und andere Grenzbevölkerungen der
Zwischenkriegszeit im Kräftefeld ethnischer Identitätskonstruktion und Entmischungspolitik”,
Jahrbücher zur Kultur und Gesellschaft Südosteuropas Bd. 4, pp. 205-231, pp. 225-226.
41. It’s quite indicative that already by 1920 inhabitants of Margariti could be found serving in
the Albanian Army (HAMFA, 1920/155.1, The 2/24 company (based at Margariti) to V Military
Area Headquarters, doc. dated the 26th of May 1920). For the fact that persons originating from
Chamouria were serving in the Albanian army or were employees at the Albanian public services,
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
162
see various documents at HAMFA, 1921.10.1. Most of them were coming from the area of
Margariti, where a lot of Muslims were landless farmers.
42. This is an in-progress research concerning the on-line Archives of Ellis Island (see
www.ellisisland.org), and the difficulties that the transliteration of names into English caused in
handling its completion. The declaration of those people as belonging to the Albanian “Race or
People” is not a safe proof of a national affiliation. The context of the question “Race or People”
is not to be examined in this paper.
43. For some descriptions of the reactions of the Muslim population of the area against the
Italian Army and their collaboration, see various documents at HAMFA, 1917, A/4/X (16) and
1916-1917, A/IV. In some cases the Muslims raised Italian flags. For the Muslims’ “personal
revenge” against local Christians see the document dated the 30 th of March 1917 of the Sub-
Governor of Paramythia to the Ministry of Foreign Affairs (HAMFA, 1917, A/4/X (16)).
44. HAMFA, 1920/155.1, The 2/24 company (based in Margariti) to V Military Area Headquarters,
doc. dated the 26th of May 1920.
45. HAMFA, 1919, A/5/10, δ, The General Governance of Epirus to the Ministry of Foreign Affairs,
23.05.1919.
46. Epirotes in this context means “pure Greeks”. See. N. I. Anaghnostopoulos,
«ΟιΜουσουλμάνοιτηςΗπείρου», Κοινότης, 12th of Oct. 1923, pp. 11-14.
47. For the use of the Illyrian argument, in other words “the common ancestors of both the
Albanians and the Greeks” in front of the League of Nations by the Greek Chargé d’Affaires in order
to reconstruct the criteria of origin, see League of Nations, Official Journal, Feb. 1925, Annex 717,
p. 247.
48. The Albanian claims on the Albanian speaking population of the areas of Kastoria [Kostur in
Albanian] and Florina [Follorinë in Albanian] did not ensure the non inclusion of this Albanian
speaking Muslim population in the Greco-Turkish exchange of populations. Nevertheless, these
claims and related struggles were far from leading to any major bilateral or international debate.
49. According to a basically common legal process, a few hundred more individuals, Muslims,
living mostly in urban centers declared themselves to be of “Albanian origin” and some others
obtained Albanian nationality and thus avoided their inclusion in the exchange process. On the
other hand the (Muslim) population of Preveza, and the majority of that of Yanina and of the
small towns of Konitsa, Parga and Poghoniani (ex-Voshtina), were considered “Turks by origin”
and were included in the exchange of the populations.
50. See Ioannis Nikolaidis, ταΓιάννινατουΜεσοπολέμου, vol. VII, Yanina 1993, p. 104. These heavy
restrictions were legally covering all Muslims, but they didn’t affect those who were part of the
exchange of populations as they left the country. For instance the prohibition of selling up to half
of the gathering plot was quite hard for the farmers.
51. One stremma is 1,000 square meters, roughly one fourth of an acre.
52. The term garden we referred to what in Greek used to be called baxēs [from Turkish bahçe] or
kēpos, an area usually adjoining the house, not larger than a few square meters were seasonal
plants and groceries were being cultivated for domestic consumption.
53. HAMFA, 1935, A/4/9/2, the General Inspector of the Central Department (of the Ministry of
Agriculture) to his Ministry, 29.09.1932.
54. HAMFA, 1935, A/4/9/2, the General Inspector of the Central Department (of the Ministry of
Agriculture) to his Ministry, 07.08.1931. In most cases the compensations were not given until the
early 1930s.
55. For an exemplary case see HAMFA, 1934 A/4/I/1, Ministry of Agriculture, nr.
141865/17.01.1934.
56. Until 1928 2,000,000 stremmata of large real estate of arable and non-arable land had been
expropriated in Epirus out of 1,450,000 stremmata of arable land. The corresponding numbers
are 2,550,000 and 8,760,000 stremmata for Macedonia and 2,730,000 and 4,000,000 stremmata for
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
163
Thessaly (see Konstandinos Tsoukalas, Εξάρτησηκαιαναπαραγωγή. Οικονομικόςρόλοςτων
εκπαιδευτικώνμηχανισμώνστηνΕλλάδα (1830-1922), Θεμέλιο,Athens [1977] 1987, p. 82 andG. Kretsi,
“FromLandholdingtoLandlessness. The Relationship between the Property and Legal Status of the
Cham Muslim Albanians”, JGKS 5, 2003, pp. 125-138).
57. See for example the document of the Ministry of Military Affairs to the Ministry of Foreign
Affairs, dated 4 May 1925 in which the author vividly asks for the speediest departure possible of
the Muslims for reasons of “military security in the frontiers” (HAMFA, 1925, Γ/68/Χ).
58. It must be underlined though that there is little evidence to support that this was the result
of a general, organized plan, but rather one among many other tactics followed by central and
local officilas. For several reports of this indirect enforcement to leave Greece for Turkey see the
1922-1925 (and 1926) documents at Kaliopi Naska (ed.),…, op. cit. and Ibrahim Hoxha, Viset
kombëtare shqiptare në shtetin grek, “Hasan Tahsini”,Tirana 2000, passim (critical).
59. For example, that was the case with some families in Parga (interview with Mr H., İzmir
2007).
60. HAMFA, 1925, f. Γ/68/Χ.
61. The great majority of the refugees were resettled when it was decided that the Muslim
population would not be exchanged.
62. See Giorgos Margaritis,Ανεπιθύμητοισυμπατριώτες: Εβραίοι-Τσάμηδες. Στοιχεία για την καταστροφή
των μειονοτήτων της Ελλάδας, Βιβλιόραμα, Athens 2005, pp. 141-142.
63. Expessions like “trying [financial] situation” or “miserable situation” are repeated at the
administrative reports of the early 30s (see HAMFA 1935, A/4/9 /2, various documents).
64. Ibid, p. 143.
65. “For the sake of [Greek] national interests they should have been exchanged a long time ago”,
writes the Commander of the Corfu Garrison in his monthly report the 4 th of October 1924
(HAMFA, 1924, A/2/14). At that time Corfu was closely related with the opposite coast, that is,
Chamouria and the Albanian ports.
66. See Eleftheria Manda, ΟιΜουσουλμάνοιΤσάμηδεςτηςΗπείρου (1923-2000), IMXA,Thessaloniki 2004,
passim.
67. See among others Konstandinos Tsioumis,
“ΠροβλήματαεκπαίδευσηςμειονοτήτωνκατάτονΜεσοπόλεμο. Περίπτωση των Μουσουλμάνων
Τσάμηδων της Θεσπρωτίας”, Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, [2000], pp. 397-409.
68. It is not until 1927 that Greek sources start referring to the Albanian language and schools
issue. The following year the Albanian nationalists of Filiati tried to operate a female school, in
which certain subjects were conducted in Albanian (see Lambros Baltsiotis research at L.
Embirikos…, op. cit, pp. 163-164).
69. Inspection of the Elementary Schools of Paramythia [sub-prefecture], 27.02.1931, HAMFA,
1935, A/4/9.
70. From that time on, the documents coming from Ministries, the General Governance of Epirus
and generally high rank officers are partly referring to “Albanians”, “persons of Albanian
origin”, and not “Muslims” or “Ottomans” as they usually did in the past. (HAMFA, various files
1930-1937).
71. Report, 15.10.1930, Archive of Eleftherios Venizelos, Minorities, f. 58/173/4573. See the more
detailed report on illegal real estate expropriations and confiscations and the financial results
upon the Muslim population at the documents contacted by the General Inspector of the Central
Department (of the Ministry of Agriculture) to his Ministry, dated 13. 01. 1932 and 07.08.1932
(HAMFA, 1935, f. A/4/9/2),where he underlines that even plots of 2-3 stremmata had been
expropriated.
72. For example, even Ali bey Dino, a former MP and a member of the Greek intelligentsia was
arrested for pro-Albanian propaganda as late as 1928 (see I. Nikolaidis, ταΓιάννινατουΜεσοπολέμου,
Yanina 1995, vol. VII, pp. 253-254). Ali bey Dino, not in fact connected with Albania, had raised a
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
164
petition for the expropriations that took place at the village of Draghoumi in front of the League
of Nations. For the land issue plus various other issues related to discrimination against Muslims
see the Memorandum that a seven member committee dispatched to the dictator Theodoros
Pangalos (see the printed version ΥπόμνημαΑλβανώντηςΤσαμουριάς, Θ. Τζαβέλλα,Athens 1926. See
also K. Naska (ed.)…, passim and E. Manda…, op. cit., pp. 17-136.
73. See also above. The adventures of individuals or families that had initially chosen the
Ottoman-Turkish nationality but remained in Greece as non-exchangeable ended in 1933 (HAMFA,
1934, B/2/IX, The Ministry of Foreign Affairs to the Ministry of Agriculture, 28.04.1933).
74. For the discriminatory policy of the Greek state in the Interwar period see also (To be read
with a critical eye), E. Manda…, op. cit., pp. 25-132.
75. HAMFA, 1934/A/4/1, Petition of Y. Zordoumis et al. to the Governor General of Epirus
(09.05.1931).
76. HAMFA, 1935. A/4/9/1, various documents.
77. HAMFA, 1935, A/4/9/3, Sub-prefecture of Thyamis to the Ministry of Foreign Affairs,
30.09.1932.
78. At 1935 the local Administration of the Gendarmerie of Preveza proposes the re-settlement of
semi-transhumant families, namely skinitēs [in reality mostly Vlachs resided at the area, L. B.] in
every Muslim village (see the document dated 30.05.1935 at HAMFA, 1935, A/21/I).
79. See for example the document: Ministry of Foreign Affairs, α.π. 8089/Α/21/Ι, 12.08.1932
confirming the “definite settlement” of 17 Muslim (Cham according to the document) families from
the sub-prefecture of Filiati to Turkey against one family to Albania for the year 1932 (HAMFA,
1935, A/21/I). According to another document regarding the sub-prefecture of Filiati for the year
1932, 86 Muslims settle to Turkey against 51 to Albania (The Sub-prefect of Thyamis to
MFA,Filiati, 30.09.1932, HAMFA, 1935, A/21/I). The above document contains the higher ratio of
persons migrating to Albania compared with those migrating to Turkey from a variety of
documents found at the HAMFA.
80. General Administration of Epirus to the Sub-Prefecture of Thyamis, Yanina, 12.11.1932
(HAMFA, 1935, A/21/I).
81. For an attempt to record this migration see Ibrahim Hoxha…, op. cit., pp. 226-231, where more
than 300 families are numbered.
82. See the note dated 13.01.1932, Minorities Section, Prime Minister’s Bureau (HAMFA, 1935, A/
4/9/2).
83. IoannisKtistakis, « Περιουσίες Τσάμηδων και Αλβανών στην Ελλάδα. Άρση του εμπόλεμου και
διεθνής προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου», Dikē,vol. 37, 2,2006, pp. 171-203, passim.
84. See indicatively the disapproval of the Gendarmerie proposal for the deprivation of the
citizenship (through the erasure from the “Males Registration Roll”) of Muslim Cham teachers
residing in Albania and work in Albanian public schools for “reasons of purposefulness ” (MFA to
Governance General of Epirus, Athens, 15.10.1936). The “Légation de Grèce en Albanie” is much
more clear when justifying its disapproval for the same case: If Greek authorities will not provide
with (Greek) passports these teachers, Albania will act in a reciprocal way for the numerous
teachers originating from Greece and teaching in the minority schools in Albania (The Greek
Delegation [Embassy] in Albania to MFA, Tirana, 23.01.1936 (HAMFA, 1936, φ. 21).
85. At middle 1936 the Greek Ambassador at Tirana complains to his Ministry for the reason that
he had been informed by civilians for the “measures” taken in Chamouria. He writes that the
“extremely hard and brutal measures” taken against Chams were the result of the initiatives of
the Gendarmerie Officer Stavridis, originating from “Northern Epirus”, who was manipulated by
various individuals (The Greek Delegation [Embassy] in Albania to MFA, Tirana, 22.06.1936,
HAMFA, 1936, φ. 21).
86. See E. Manda…, op. cit., pp. 100-108, K. Naska (ed.)…, op. cit., pp. 662-699, L. Baltsiotis research
at L. Embirikos…, op. cit., pp. 165-172.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
165
88. Quite vividly the Greek Communist Party newspaper Rizospastis refers to the “Unimaginable
suffering of the Chamouria Albanians” (29.11.1934) and the “Scandalous misbehaviours of the
Greek authorities in Chamouria” (12 and 13.12.1934).
89. Official Journal, League of Nations, Dec. 1936 (C. 292.1936.I), pp. 1415-1417. Notice the use of
the word idiom instead of language.
90. According to the suggestion of the General Administration of Epirus to the Ministry of
Foreign Affairs (the 24th of October 1936), the presence of Albanian Muslims and the difficulties
in “administrating” them from a far away capital calls for the creation of a new prefecture
(HAMFA, 1937, A4/9).
91. Yanina, 28.03.1936, HAMFA, 1936, φ. 21.
92. In this way, only 20 non-Muslim Albanian-speakers are recorded in Epirus. It’s only in
Macedonia that 1,119 persons are listed, leading to a total of 18,773 Albanian speakers for all of
Greece (see ΓενικήΣτατικήΥπηρεσίατηςΕλλάδος,ΣτατιστικάαποτελέσματατηςΑπογραφήςτουπληθυσμού
τηςΕλλάδοςτης 15-16 Μαϊου 1928, ΙV, Athens, 1935, pp. κστ΄-κθ΄. The Orthodox Albanian-speakers’
“return” to Southern Greece and Epirus, Macedonia and Thrace also present at this time, at the
1951 census (7,357 are counted in Epirus). Only in the 1940 census, never completed due to the
beginning of War, Muslim and Orthodox Albanians appear (32,712 Orthodox and 16,899 Muslims,
the vast majority of the latter residing in Epirus ( see L. Baltsiotis, L’albanophonie…, op. cit., pp.
170-171).
93. See the document “The Social Security Ministry to the Ministry of Foreign Affairs,
25.02.1933”, HAMFA, 1938, f. 23: “For the dissemination of the Greek language in both the
population of Albanian speaking homogeneis and Turcoalbanians”.
94. HAMFA, 1935, A/4/3, The VIII Division to the Ministry of Military Affairs, 13.08.1935.
95. At that time Albania had become an Italian protectorate. Muslim Chams, being unofficially
considerd Albanians, eventually were treated as hostile population.
96. SeeY.Sarras, Ιστορικά…, op. cit., pp. 615-617, andfromthesameauthor, Μνήμεςτηςτραγικής
περιόδου 1936-1945,Στ. Βασιλόπουλος, Athens 2001, pp. 38-41.
97. See I. Hoxha…, op. cit., pp. 309-320. The Greek authorities classified them as “political
hostages” [πολιτικόςόμηρος].
98. See Y. Sarras, Ιστορικά…, op. cit., pp. 629-632. The writer notes that these atrocities were
undertaken under the “State’s tolerance” and that even civil servants took part in them.See also
another book of the same author, Μνήμες…, op. cit., pp. 51-53.
99. For the negotiations and the agreements concerning the expropriated land see G.
Margaritis…, op. cit., pp. 156-159, E. Manda…, op. cit., pp. 144-145. It’s quite interesting in that
sense to look at the way the Chams were reacting at the tax collection (see the Report of the
Financial Inspector of the Ministry of Finance, dated the 22 nd of June of 1942 at G. Margaritis…, op.
cit., pp. 182-183).
100. The highest semi-documented number of Greeks murdered or killed, armed or not, is
around 450 for the Prefecture of Thesprotia and 46 for that of Preveza (See, the relevant Report
of the ad hoc created Committee, consisting of locals or of Epirotic origin: Εκθεσιςτωνγενομένων
ζημιώνενγένειΗπείρουαπότηςκηρύξεωςτουΕλληνο-ιταλικούπολέμου (28-10-1940) μέχριτηςτελικής
απελευθερώσεωςτηςΟκτώβριος 1944, ΒιβλιοθήκηΗπειρωτικήςΕταιρείαςΑθηνών 58, Athens 1987.
Another Greek source counts roughly 450 Christians who died of non natural causes between
1940-1945 (see the extended report of the Greek National Bureau of War Crimes to the Ministry of
Foreign Affairs, dated the 19th of July 1946, Filippos Dragoumis Archive, f. 73/3, doc. 106). As it is
expected there is not a single word mentioning the atrocities against the Muslim population. In
light of other sources, we think that a number of 300 to 350 can easily be verified. Higher
estimations include some double registrations as N. Y. Ziangos has demonstrated (see N. Y.
Ziangos…, op. cit., vol. A, pp. 250, 254, 265-266).
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
166
101. Ses Y. Sarras, Μνήμες…, op. cit., pp. 71-73. This incident is, from our point of view, quite
characteristic of a different way of thinking and acting in this period, as the notions of right and
justice had different meanings in those communities compared to today.
102. Despite social democratic elements in its program and discourse, EDES gradually followed
an anti-communist path, loyal to the right wing political powers existing prior to WWII in Greece.
103. For the case of Paramythia see E. Manda…, op. cit., pp. 178-182, where the writer tries to
identify the reasons of the massacre. It is widespread in the local discourse that the Paramythia
slaughter was a justified act of revenge against the execution of the 45 (Christian) notables of the
town that took place during the Occupation with the participation, if not the instigation, of the
Muslim Chams.
104. According to a “name and place of origin list”, more than 1,200 were murdered. This
number does not include armed men killed during fights or skirmishes with the Greek guerilla
forces. Their name list counts 260 persons, several dozens of them coming from the Konispol area
(see I. Hoxha…, op. cit., pp. 449-499). The Memorandum of the Anti-fascist Committee of the Çami
Immigrants in Albania to the United Nations Security Council counts 2, 877 victims (See G.
Margaritis…, op. cit., p. 211). Some hundreds of Chams died in Albanian territory due to hardships
experienced after the evacuation of Chamouria.
105. Some of them returned in early 1945, when the ELAS left wing guerrillas temporarily took
control of the area, and fled again to Albania, after being attacked by EDES once more and losing
nearly one hundred more souls. For a general but very well-focused description of the 1940-1945
period see Georgia Kretsi, “The “Secret” past of the Greek-Albanian Borderlands. Cham Muslims
Albanians: Perspectives on a Conflict over Historical Accountability and Current Rights”,
Ethnologia Balkanica, vol. 6, 2002, pp. 171-195. For a glossing over of the atrocities committed
against the Greeks and an emphasis on the Muslims’ antifascist contribution, see, Beqir Meta,
“Spastrimi etnik i popullsisë shqiptare muslimane të Çamërisë”, Univers 1(Tirana), 2001, pp.
83-96.
106. Except for two small communities that mostly avoided conversion, namely Kodra and
Koutsi (actual Polyneri), the majority of others were baptized. Isolated family members that
stayed behind were included in the Greek society, and joined the towns of the area or left for
other parts of Greece (author’s field research in the area, 1996-2008).
107. E. Manda,…, op. cit., pp. 162-163.
108. See above and ibid, p. 204.
109. SeeIliasSkoulidas, Όψεις του δοσιλογισμού στην Ήπειρο: «Ερήμην καταδικασθέντες»
Τσάμηδες», Egnatia, (inpress).
110. I. Ktistakis…, op. cit.
111. Without discussing in detail the legislation that permitted this take over by the state, it
should be underlined that some of the legislation was primarily used for the communist
guerrillas that fled the country after the end of Civil War at 1949. It’s quite difficult to track the
exact legislation that was implemented in every case: Urban and rural land is occupied
[κατάληψις] according to a “Mandate of the Administration of Public Estate” as early as August
1945 for the urban land and late September for the rural one (archive of the author).
112. Ibid.
113. See Tassos Kostopoulos’ contribution in this volume.
114. See the relevant legislation at I. Ktistakis…, op. cit.
115. We adopt the term ethnic cleansing although it was formed at the nineties during the
Yugoslav Wars. Concerning the history and the use of this term, see Alice Krieg-Planque,
“Purification ethnique”. Une formule et son histoire, CNRS,Paris, 2003.
116. See for instance the report of the Greek National Bureau of War Crimes to the Ministry of
Foreign Affairs above.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
167
117. CharitonLambrou, Οι Τσάμηδες και η Τσαμουριά. Απόγονοι παλαιών εξωμοτών-Χθεσινοί δοσίλογοι
και εγκληματίαι πολέμου-Σημερινά πρωτοπαλλήκαρα του κομμουνιστοσυμμορισμού, Athens, 1949.
118. For the manipulation of numbers see below.
119. Th. Y. Papamanolis, ΚατακαϋμένηΉπειρος. Το φρικτόν δράμα των κατοίκωντης Θεσπρωτίας και η
συνεργασία των Αλβανών μετά του άξονος 1940-1944, Ίκαρος, Athens, 1945 (2 ndedition: Ελεύθερη
Σκέψις, Αθήνα, 1999). We note that the writer claims that EDES should not have treated the
Chams in such a … “conciliatory manner”(ibid, p. 149).
120. G. Margaritis…, op. cit., p. 134.
121. For those manipulations see below.
122. Ioannis Archimandritis, Τσάμηδες-ΟδύνηκαιδάκρυατηςΘεσπρωτίας, Γεωργιάδης,[Athens], n.d.
123. See Vassilis Krapsitis, ΟιμουσουλμάνοιΤσάμηδεςτηςΘεσπρωτίας, Athens, [1986], pp. 15-25,
130-133, 170-172.
124. V. Krapsitis, Η Ιστορία της Παραμυθιάς, Athens 1985, 2ndedition 1991.
125. SpyrosMousselimis, Ιστορικοί περίπατοι ανά τη Θεσπρωτία, Yanina [1973], 3 rdedition 1997.
126. L. Embirikos emphasizes the fact that in the case of Christians we face an “occultation totale
”,”total occultation” even by the left wing local writers who dare to deal with the 1944-1945
incidents in a more objective way (see L. Embirikos…, op. cit., p. 189).
127. SeeY. Sarras, Ιστορικά…, op. cit.
128. N. Y. Ziangos, Αγγλικός Ιμπεριαλισμός και Εθνική Αντίσταση, vol. I-V, Athens, 1978-1981.
129. VassilisKrapsitis, Αρβανίτες- «Παγά [Πηγή] λαλέουσα Ελληνισμού και Ορθοδοξίας, Π.
Παρασκευόπουλου,Athens, 1989.
130. See L. Baltsiotis, L’albanophonie…, pp. 100, 107.
131. Dimitris Michalopoulos, “The Moslems of Chamuria and the exchange of populations
between Greece and Turkey”, Balkan Studies 27, (Thessaloniki) 1986, pp. 303-313, p. 304. Vassilis
Krapsitis publishes one more book at 1992, entitled Ηιστορικήαλήθειαγιατουςμουσουλμάνους
Τσάμηδες(Athens), mainly repeating his previous publicationΟιμουσουλμάνοιΤσάμηδες…, op. cit.
132. According to an interview given by Ramiz Alia to the Greek journalist Tassos Telloglou (see
Telloglou’s presentation “How attractive is the Cham issue in today’s Albania?”, in the
conference organized by the Minorities’ Research Group Center entitled “The Cham issue.
History and current trends”, held at Panteion University, Athens the 21 st of February 2008).
133. As Georgia Kretsi points “the persecution of the Albanian Muslim minority was not even
mentioned in history text books [in Albania]” (G. Kretsi, “The “Secret” Past…, op. cit., p. 190).
134. L. Embirikos…, op. cit., p. 211. He collected five cases where relics of Albanian speech of the
area were published, plus one more in a purely scientific revue. In one case the local writer just
presents some words in order to prove their relation with the ancient Doric Greek dialect (ibid,
pp. 212-213).
135. See Dimitris Michalopoulos, Τσάμηδες, Αρσενίδη, Athens, 1993, passim.
136. Some of them, written by individuals with an ultra nationalistic, far-right background, tried
to create an atmosphere of paranoia and conspiracy theories, going as far as to talk about
guerrilla Cham forces in Greece (see Ap. P. Papatheodorou, ΟιΜουσουλμάνοιΤσάμηδες, UCK-UCC
[UÇK-UÇÇ]-Αλβανοί-Τούρκοι, ΠΑ.ΣΥ.ΒΑ.-Σ.Φ.Ε.Β.Α., Thessaloniki, 2002). Others did not gain any
popularity even by the local audience such as the book of Ch. N. Tsakas, ταεγκλήματατωνΤσάμηδων
στηνΠάργακαιτηνπεριοχήτης, Parga, 1992.
137. See for example the booklet by the associate professor of the Theological School at
Thessaloniki University Michail Tritos, Τσάμηδες. ΕπίμαχοπρόβλημαΕλλάδοςκαιΟρθοδόξουΕκκλησίας
Αλβανίας, Κυρομάνος, Thessaloniki 2003 where he writes that “by their own will [they] deserted
Thesprotia, afraid of the sentences they could face from Greek Justice for their unacceptable
atrocities […] against local Greeks” (p. 11). He supports their Greek origin and gives the number
of Muslims in 1940 at 16,661.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
168
138. See L. Baltsiotis, L’albanophonie…, op. cit, pp. 277-279.
139. Indicatively, the figure for Parga has no Muslim inhabitants in contrast to 150 Muslims in
that of Krapsitis’ counting.
140. For example, for Perdika (ex-Arpitsa), at that time a big Muslim village with a small
Christian community consisting mainly of refugees, he gives the figure of 1649 Christians and 130
Muslims while Krapsitis gives the figure of 150 Christians and 1600 Muslims (see a more detailed
description at L. Baltsiotis, L’albanophonie…, op. cit., pp. 591-594).
141. For instance, the figure for the Muslim population of Syvota (ex-Mourtos or Volia) in
Krapsitis is 310 persons, while in a document of 1932, following the 1928 census, the sub-prefect
of Thyamis records 679 inhabitants (HAMFA, 1935, A/4/9, The sub-prefect of Thyamis to the
Bureau of the Prime-Minister (Filiati the 21st of March 1932). Mourtos, a purely Muslim
settlement, was not a village with a large influx of emigrants to Albania and Turkey and the
figure given by Krapsitis can not be supported by the relevant evidence. Theofficial 1940
censuspublicationscount 883 residentsatSyvota (seeΣτοιχείασυστάσεωςκαιεξελίξεωςτωνΔήμωνκαι
ΚοινοτήτωνΝομούΘεσπρωτίας, ΚεντρικήΈνωσιςΔήμωνκαιΚοινοτήτωντηςΕλλάδος, Athens Jan. 1962,
p. 37).
142. Slavic-speaking Macedonians being the spine of the communist Democratic Army of Greece (
ΔΣΕ) during the Civil War, found some support amongst the leftists in Greece.
143. A rather striking example of this erasure can be identified in a special supplement
dedicated to Epirus, attached to the Sunday edition of a top selling and respected Greek
newspaper. There are a lot of references to the Aromanian speaking Vlachs, even a reference to
the half dozen slav-speaking villages of mount Grammos, almost uninhabited, but not the
slightest reference to the Christian Albanian speaking villages («Ηπειρος», ΗΚαθημερινή-Επτά
Ημέρες, Sunday 09.07.2000). Nearly 130 years after the writings of Greek irredentists, while the
Slav presence is acceptable in Epirus, the Albanian one is not.
144. SeeVassiliosKondisat Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών,Athens 1977, vol. 13,
pp. 387-394, 388-389. The Suha line is not an invention of the writer, but of the irredentist Greek
policies of the last quarter of nineteen century.
145. Interview in 2000, ex-mayor of Paramythia appointed during the dictatorship.
146. Today there are only three semi-demolished minarets standing, one in Margariti, the other
in Katavothra and the third one in Kotsika.
147. No process of pursuing charges against the offender took place (Author’s field research
2004).
148. Author’s field research 1997-2008.
149. This article was later modified and entered the Greek Nationality Code (Act) as article 19,
which was in force until 1998.
150. Another relevant order was sent at the 29 th of Dev. 1947 entitled “Erasure of the Males
Registration Roll of Muslims of Albanian origin” (Φ.9905/13/Α2/ΙΙΙ, General Headquarter (Γ.Ε.Σ.)).
Both documents are in the author’s personal archive.
151. On the contrary Slav-Macedonians and Turks that were deprived of the Greek nationality
“exist” in the registries with the specific indication concerning the deprivation of their
nationality, the number of the relevant decision and the legal basis.
152. After the petition of M. D. to the Municipality of Paramythia concerning his registration at
the Municipality records, the Mayor for the years 1998 and 1999 justifies in three different ways
on the issue of the “non existence” of the relevant registration (author’s personal archive).
153. This affected a few dozens persons. These data result from the author’s unpublished
research in the Council of Citizenship Archives.
154. The protagonist of the expulsion, N. Zervas, in a letter to one of his comrades, dated 1953
writes: “Our fellow country men of the area must recall once more who got rid of the Muslim Chams
[Arvanitēs at the text] who were pushing down the neck of Hellenism for five hundred years”. The
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
169
letter is published at the book of Sp. Mousselimis , op. cit., pp. 103-104 and there is no doubt so far
of its authenticity.
155. Georgia Kretsi, “From Landholding…”, op. cit., p. 136.
156. As Georgia Kretsi puts it “[I]t is arguable that the social process of minoritization of the
Cham group was intimately linked to a politics of possession and dispossession” (See ibid, p. 126).
157. The absence of scholarly works in Greece concerning the Cham issue up to the late eighties
is not due only to self-censorship in the academic community. It’s also the result, according to
our view, of the erasure process that took place.
INDEX
Keywords : Chams, Demographic engineering, Epirus, Greece, Muslims, Orthodox
Mots-clés : Chams, Épire, Grèce, Ingénierie démographique, musulmans, orthodoxes
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
170
Kilkis 1913 : territoire, population et
violence en Macédoine
Entretien mené par Nikos Sigalas, les 20 mars et 21 avril 2008, à Athènes,
revu et complété par l’interviewé
Kilkis 1913: Territory, Population and Violence in Macedonia
Léonidas Embiricos
I. L’événement et son impact démographique
1 Nikos Sigalas : En juin 1913, lors de la deuxième guerre balkanique, l’armée grecque a
procédé à des violences qui ont conduit la population orthodoxe entièrement
slavophone et exarchiste (c’est-à-dire affiliée à l’exarchat bulgare et non au patriarcat
orthodoxe d’Istanbul) de la province de Kilkis en Macédoine (dans la partie aujourd’hui
grecque), au nord de Salonique, à déserter la région. Je vous demanderais d’abord de
décrire cet événement.
2 Léonidas Embiricos : L’événement auquel vous faites référence est l’un des épisodes
les moins connus de l’histoire des deux guerres balkaniques, du moins du point de vue
de l’historiographie grecque. Il a eu peu d’écho en Europe occidentale. En Grèce, il
faudra attendre 2007 pour que paraisse l’ouvrage de Tassos Kostopoulos, Guerre et
nettoyage ethnique (Kostopoulos 2007)qui, pour la première fois , traite des violences
commises par l’armée grecque pendant les guerres de 1912 à 1922 et aborde l’affaire de
Kilkis, en la replaçant dans son contexte, la deuxième guerre balkanique. Lors de la
première guerre balkanique, l’armée bulgare a été la plus organisée et la plus puissante
des quatre armées alliées ; elle a livré les combats les plus sanglants à Lüleburgaz,
Pınarhisar, Kırkilise et Bulayır, empêchant ainsi les troupes ottomanes de venir en aide
aux armées de Macédoine ; les Serbes ont livré une grande bataille à Koumanovo et
l’apport des Grecs a été surtout important sur mer, leur flotte empêchant la flotte
ottomane de débarquer des contingents en Europe. Les Bulgares ont voulu pousser
jusqu’à Istanbul pour s’en emparer mais ont été arrêtés devant la formidable ligne de
fortifications de Çatalca et la vigueur de la défense ottomane de la capitale. Pendant ce
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
171
temps, les armées serbe et grecque ont investi la majeure partie de la Macédoine. Des
provocations de part et d’autre donnant lieu à des incidents sanglants, dont le plus
grave a déclenché la bataille de Voulchista (sur les versants nord du mont Pangée,
entre troupes grecques et bulgares), aboutissent alors à l’attaque organisée de l’armée
bulgare, ordonnée par le chef de l’état-major, le Général Savov et le roi Ferdinand de
Bulgarie contre les positions serbes et grecques en plusieurs points de la ligne de
contact entre les zones d’occupation des trois armées. Cette attaque avait beau
s’inscrire dans la suite des provocations et incidents sanglants et constituer
probablement un chantage territorial et une démonstration de force, elle déclencha
une formidable riposte des armées des deux autres puissances, déjà liées par un traité
d’alliance au sein de l’Alliance. L’armée bulgare fut rappelée, mais trop tard ; la guerre
entre ceux qui, la veille, étaient encore alliés contre les Ottomans, avait commencé. La
deuxième guerre balkanique a été brève et très violente. Les Alliés grecs et serbes
dominèrent très vite la situation sur le terrain. La Bulgarie n’avait sur le front grec que
des effectifs assez faibles. Ayant sous-estimé l’armée grecque, elle avait rassemblé le
gros de ses troupes sur le front serbe. Par ailleurs, les attaques des Ottomans, d’un côté,
voulant récupérer Andrinople, et des Roumains de l’autre, exigeant la Dobroudja du
sud, plus tard appelée le « Quadrilatère », en guise de compensation, ont pris au
dépourvu l’armée bulgare et ont contribué à la victoire rapide des armées serbe et
grecque.
3 L’armée grecque a commencé sa contre-offensive dans la région de Salonique. Pendant
la première guerre balkanique, la zone d’occupation bulgare recoupait la zone
d’occupation grecque sur une ligne allant de l’Axios/Vardar, à la hauteur de Kilkis,
jusqu’au bassin du Bas Strymon/Strouma et à l’embouchure de ce fleuve dans le golfe
d’Orphano (actuellement Strymonikos Kolpos). Cette zone, au nord et à l’est de
Salonique – où se superposaient les deux zones d’occupation grecque et bulgare – la
grande ville étant la pomme de discorde, avait été, après la prise de celle-ci par les
Grecs, un foyer de tension extrême, les deux armées voulant y marquer leur occupation
et, en période de paix, le théâtre de la bataille rangée susmentionnée de Voulchista
(Zoroyannidis 1975 : 45-87 ; Gardikas-Katsiadakis 1985) où des irréguliers grecs s’étaient
infiltrés, tout comme à l’est de l’Axios des irréguliers bulgares s’étaient infiltrés sur le
mont Païko(Zoroyannidis 1975 : 45-87 ; Ministère des Armées 1934- III 1 EAECA –
BGASD, dos. 113/2, doc. 37, 24/6/1913, doc. 38, 28/6/1913). La majeure partie des
batailles a été livrée dans les trois grandes vallées de l’Axios/Vardar, du Strymon/
Strouma et du Nestos/Mesta. Kilkis (nom grec de la ville, appelée en bulgare et en
macédonien Koukouch et en turc Kılkıç), est située au nord de Salonique, dans la région
de la Macédoine méridionale dont la population slavophone avait sans doute le plus
massivement, et depuis très longtemps, quitté le patriarcat de Constantinople, d’abord
en faveur de l’union avec Rome (tout en maintenant le rite orthodoxe), puis pour rallier
l’exarchat bulgare. La population orthodoxe de Kilkis et en partie celle de Dojran, ainsi
que celle des deux kaza de Dojran et d’Avret Hisar était donc pratiquement entièrement
exarchiste – à l’exception de quelques uniates et de la communauté patriarchiste de la
ville de Dojran (Karavas 2002a, 2003b). Les Grecs considéraient cette région comme le
« rempart du bulgarisme » en Macédoine. Les journaux grecs s’y référaient comme à
« l’acropole [i.e. citadelle] du bulgarisme ».
4 Après une bataille meurtrière de trois jours contre les positions bulgares à Kilkis,
l’armée grecque – ayant fait preuve d’une très grande endurance, en perdant environt
10 000 effectifs (ensemble avec la bataille de Lahana) – a occupé la ville (Mazarakis
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
172
Ainian 1930 : 50). Sa population a quitté la région en suivant l’armée bulgare.
Lorsqu’elle est entrée dans la ville, au matin du 4 juillet, l’armée grecque a trouvé celle-
ci quasiment déserte, à l’exception de l’orphelinat catholique où environ 400 personnes
avaient trouvé refuge. Les quelque 70 personnes qui se trouvaient encore dans la ville
auraient été tuées (Dotation Carnegie 1914) et, le soir du 4 juillet, la ville entière a été
incendiée. Les seules sources grecques dont j’ai connaissance, faisant état de l’incendie
allumé par les Grecs, sont les journaux tenus, d’une part, par le soldat volontaire
Manolis Sofoulis, de Samos, récemment publié (Sofoulis 2007 : 77) et, d’autre part, par
le soldat enrôlé comme « proscope » (cf infra. § 20), Chryssanthos Nostrakis, de Milos,
que sa fille, Éléni Dalambira, a fait paraître dans la gazette locale de la péninsule de
Halakas, éditée par ses soins, Antilogos ap’ to Halaka, avant de le rééditer dans un livre
qui réunit des documents concernant ses ancêtres (Dalambira 1988 cf. annexe XXII). Le
premier des deux soldats, témoin oculaire de l’incendie allumé par l’armée grecque,
note : « Bientôt sont entrées d’autres unités et, vers le soir, ils y F0
5B Kilkis 5D ont mis le feu
F0
de tous les côtés et elle a brûlé presque entièrement » ; le second, lui, l’apprendra
quelques jours plus tard, lors d’une mission qu’il effectue à Kilkis comme officier de
liaison militaire avant de s’enrôler dans la bande d’andartès (cf. infra note 10 et § 15)
grecs de Gyparis. Voici ce qu’il dit sur Kilkis : « Kilkis est une bourgade assez belle et
grande, bâtie dans un site très pittoresque. Nous l’avons trouvée entièrement détruite
par le feu allumé par nos propres troupes, parce qu’elle était la métropole du
bulgarisme en Macédoine » (annexe XXII). Trente-neuf villages de la région ont connu
plus ou moins le même sort. Après l’incendie de Kilkis, les habitants de la plupart de ces
villages, cédant à la panique, ont quitté leurs foyers pour trouver refuge dans le
royaume bulgare et, pour certains, dans ce qui fera partie du territoire serbe. Ceux qui
n’avaient pas eu le temps de gagner la Bulgarie ont souvent été victimes de violences :
tel fut notamment le cas des gens qui avaient trouvé refuge dans le village d’Akıncalı,
où l’armée grecque commit des massacres et des viols. Des tirs d’obus semaient la
panique parmi les colonnes de fugitifs cherchant à gagner la Bulgarie (Dotation
Carnegie 1914 : 320 – Lettre d’un soldat grec confisquée par l’armée bulgare). Après le
départ des habitants, l’armée, aidée par des musulmans locaux (ayant beaucoup
souffert du fait des comitadjis pendant l’occupation bulgare), a mis le feu aux villages.
Tous ces événements sont décrits dans le rapport de la Dotation Carnegie (1914 : 77-82).
5 Aux villages de la région de Kilkis il faut ajouter 13 villages exarchistes de la région de
Gevgelija/Guevguéli qui ont connu le même sort ; la ville de Gevgelija, en revanche,
bien que située sur la ligne du front, n’a pas été incendiée, probablement parce qu’elle
comptait un pourcentage élevé de patriarchistes, tout comme celle de Dojran. Trois
villages valaques roumanisants, farouchement pro-bulgares de la même région ont été
également incendiés, à l’endroit précis où il y avait eu infiltration d’irréguliers bulgares
(cf. infra § 120-127). Les violences et les exactions perpétrées dans la région de Gevgelija
et dans la région occidentale de Kilkis proche du Vardar et du lac de Doïrani/Dojran
sont décrites dans un rapport du consul général de France à Salonique, Jousselin
(Annexe I et XI). Ce rapport, fondé sur une enquête menée par ses soins sur le terrain
vingt jours après les événements, corrobore en grande partie la description du rapport
Carnegie (1914 : 82-83, 307-310) et celle, plus détaillée du professeur bulgare, Lioubomir
Miletič (Lubomir Miletitch, figurant dans la bibliographie sous la forme Lioubomir
Miletič 1913 : 39-42).
6 N. S. : Peut-on parler d’une évacuation totale de la région de Kilkis ?
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
173
7 L. E. : Quasi-totale, oui ; seuls quelques villages ont en partie échappé à l’exode et à la
destruction. La majeure partie de la population du village de Ravna (aujourd’hui
Issoma), par exemple, a échappé à l’expulsion. C’était un des rares villages de la région
comportant un pourcentage écrasant de population patriarchiste ; certaines sources le
mentionnent comme appartenant au district de Nigrita (nahiye de Nigrita, kaza de
Serrès), du fait de son rattachement au diocèse patriarchiste de Nigrita, bien qu’il soit
situé sur les flancs sud du Karadağ (nahiye de Karadağ, chef-lieu Dolno Todorak)
(Kăncov 1900 : 166, 180). Sa population exarchiste l’a pourtant quitté et son quartier
exarchiste a été brûlé. Le village de Mirovo (voisin de Issoma, aujourd’hui Helliniko,
dont une partie des habitants est toujours slavophone), vraisemblablement
patriarchiste, a sans doute été épargné. Le village uniate de Todorak a échappé à
l’incendie et a conservé une partie de sa population malgré le pillage. D’autres villages
situés aux confins de la région ont également gardé en partie leur population, comme
çiftlik appartenant à des Grecs. Tel est le cas de Yanès et de Kilindir (aujourd’hui
Métalliko et Kherso), dont la population est partie lors de l’échange de populations
volontaire entre la Grèce et la Bulgarie, suivant les termes de la convention signée
parallèlement au traité de Neuilly de 1919. Des habitants de la région qui, au moment
des événements, se trouvaient à Salonique ou dans d’autres régions du territoire grec,
voire dans les nouveaux territoires serbes, ont pu réintégrer ultérieurement leurs
villages. Parfois, ils se sont installés dans d’autres villages, leurs maisons ayant été
réduites en cendres.
8 N.S. : Sur quel type de sources peut-on s’appuyer pour préciser le nombre d’individus
qui ont quittés la région ?
9 L.E : Ce type de calcul est très difficile et il faut y procéder avec grande précaution. Afin
d’arriver à une approximation fiable, on doit croiser les sources disponibles et
travailler en équipe avec d’autres spécialistes. C’est ce que nous avons essayé de faire
avec Tassos Kostopoulos.
10 Nous avons pris comme point de départ un document confidentiel de la commission de
rétablissement des réfugiés (d’Asie Mineure et de Thrace Orientale), émanant du
département de statistiques de la direction générale de Colonisation de Macédoine,
daté du 3 mars 1924 à Salonique, accompagnant une « carte ethnologique de
la Macédoine »1 (Kontogiorgi 2006 : 209-213). Ce document constitue une source
précieuse pour mieux saisir la situation démographique de la région de Kilkis parce
que, même si postérieure au traité de Neuilly (duquel ont précédé plusieurs départs
sporadiques vers la Bulgarie, notamment après la défaite de celle-ci pendant la guerre
mondiale), elle est antérieure au départ définitif de tous les échangés bulgares. Elle
constitue donc le dernier dénombrement administratif, pour approximatif qu’il soit,
avant le grand changement de donne que constitue l’exode des Bulgares de Grèce suite
à l’intensification des pressions qui leur sont faites pour s’inscrire au processus
d’échange lors de l’arrivée massive des réfugiés grecs d’Asie Mineure (Kontogiorgi
2006 : 213 ; Kostopoulos 2011). Ce document est d’ailleurs très probablement produit
dans le contexte de l’échange avec la Bulgarie et peut avoir servi pour définir les
populations dont le départ était souhaité (ibid.). Le document en question est censé
renseigner le gouvernement sur les convictions politiques « slavisantes »,
« roumanisantes » et « albanisantes » des habitants de la Macédoine grecque. Il fait
aussi mention des familles « non-grécophones mais helléniques ». Le document nous
donne donc pour la région de Kilkis 493 familles « slavisantes » réparties dans 15
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
174
villages et 1 495 familles « non-grécophones mais helléniques » réparties par petits
groupes dans 47 villages – qui se recoupent en partie. Selon le Comité mixte d’échange
gréco-bulgare, la totalité des familles « slavisantes » a quitté le pays. En même temps, a
aussi émigré une partie des familles « non-grécophones mais helléniques ». Leur
départ, comme dans d’autres régions de la Macédoine grecque, n’a pas non plus été
toujours spontané.
11 Afin d’analyser ce document – constituant le dernier instantané que nous possédons
d’un paysage démographique qui s’est ensuite intégralement modifié – il fallait le
croiser avec des sources démographiques, souvent plus précises, bien que
fragmentaires, qui sont plus proches des événements. Tassos Kostopoulos a constitué
une base de données concernant tous les villages slavophones de la Macédoine
grecque2. En nous appuyant sur cette documentation, nous avons essayé ensemble de
vérifier les données rapportées par la source de 1924 que je viens de mentionner
concernant la région de Kilkis et les parties grecques des kazas de Dojran et de
Gevgelija. S’agissant plus particulièrement de Kilkis après la guerre de 1913, nous avons
croisé trois documents principaux : a) le premier dénombrement grec effectué par
l’armée en 1913, qui ne contient pas de données ethniques (Ministère de l’Économie
nationale 1915), b) une liste des villages et des caractéristiques ethniques de leurs
habitants, établie par la sous-préfecture de Kilkis en 1914 3 et c) un rapport du
représentant administratif de l’arrondissement de Kato Thodoraki (Dolno Todorak) à la
sous-préfecture de Kilkis, comportant des données sommaires concernant les trois
catégories de slavophones indigènes, musulmans et réfugiés (toutes origines
confondues)4. Pour expliquer la complexité de ce calcul, il faut préciser que la sous-
préfecture de Kilkis avait été, à l’époque, divisée en deux arrondissements : celui de
Kilkis et celui de Kato Thodoraki. En ce qui concerne l’arrondissement de Kilkis, le
calcul est relativement facile, la liste de la sous-préfecture nous indiquant que la
population slavophone indigène est répartie dans 7 villages, dont 6 ne comptent pas
d’autres populations5 tandis qu’un seul, Amatovo n’a que deux familles slavophones
indigènes. Dans l’arrondissement de Kilkis, nous avons pu ainsi dénombrer,
immédiatement après les événements, environ 690 slavophones indigènes.
L’arrondissement de Kato Thodoraki présente une difficulté, du fait que sa population
slavophone est répartie dans 9 villages mixtes6. Il est donc impossible de calculer pour
cet arrondissement la répartition de la population slavophone par village à partir du
dénombrement de 1913 et de la liste de la sous-préfecture de 1914. Heureusement, le
rapport du représentant administratif de Kato Thodoraki nous fournit le total
sommaire des slavophones indigènes de cet arrondissement, qui s’élève à 2 498
personnes. En additionnant ces deux chiffres, nous arrivons à celui de 3 188 habitants
slavophones indigènes pour toute la sous-préfecture de Kilkis7. Ce chiffre n’a, bien
entendu, qu’une valeur approximative, étant donné le décalage d’une année entre,
d’une part, le dénombrement de l’armée, effectué en 1913 pendant les mois tumultueux
qui ont suivi les événements et, de l’autre, le rapport du représentant administratif de
Kato Thodoraki, daté lui de 1914. Il n’est pas impossible que certains paysans qui
avaient quitté la région en 1913 pour d’autres directions que la Bulgarie ou qui, au
moment des événements, étaient en déplacement en Grèce aient regagné leurs villages
ou des villages voisins en 1914. Ces mouvements me semblent pourtant d’une
importance démographique relativement faible. Ce qui me porte à croire que le chiffre
de 3 188 constitue une juste approximation des slavophones indigènes restés dans la
région. La comparaison de ce dernier chiffre avec celui de 17 475 slavophones,
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
175
« bulgares » pour l’auteur, avancé pour la région de Kilkis par une statistique effectuée
en août 1912 par Siméonov (découverte dans les archives d’État bulgares par
Kostopoulos), nous donne approximativement 14 000 anciens habitants manquant, soit
ayant abandonné la région, soit décédés. Ce chiffre approximatif rejoint par ailleurs
celui de 13 000 - 14 000 fourni par Michaïlidis (2003), qui utilise en partie les mêmes
sources. À cela il faut ajouter les expatriés des régions de Dojran qui ont constitué
l’arrondissement de Archanguéli (Akıncalı) et de Gevgelija, qui ont constitué
l’arrondissement de Mayadağ (aujourd’hui Fanos) de la sous-préfecture de Kilkis, plus
tard rattaché à l’éparchie (sous-préfecture) de Paionia (capitale Goumenissa, en bulgare
et en macédonien Goumendjé) du département de Salonique et plus tard Kilkis, ainsi
que ceux des régions de Langada (en turc Langaza, en bulgare et en macédonien
Lagadina) et de Salonique ; ce qui porte le nombre des expatriés de la région appelée
plus tard Macédoine centrale à 23 000 personnes (Kostopoulos 2000 : 31).
12 Revenons à présent au document de 1924 qui nous livre un instantané de la région dans
les limites de la nouvelle division administrative, selon laquelle l’éparchie de Kilkis du
département de Salonique inclut, outre l’ancien kaza d’Avret Hissar (correspondant aux
deux arrondissement de Kilkis et de Kato Thodoraki de l’ancienne administration
grecque), l’arrondissement d’Archanguéli (Akıncali, actuellement Mouriès constituant
la partie du kaza de Dojran incorporé à la Grèce) 8. Les quelques villages de l’ancien kaza
de Gevgelija incorporés à la Grèce à l’ouest de l’Axios – ces régions comptant aussi
quelques anciennes populations exarchistes résiduelles n’ayant pas participé à l’exode
de 1913 – lesquels sont mentionnés dans la liste du document en question dans la partie
qui concerne le Bureau du Comité d’échange de Gouménissa. Le nombre de 493 familles
slavisantes fourni par ce document donne un chiffre approximatif de 2 000 à 2 500
personnes, légèrement inférieur donc à celui que nous avons calculé pour 1914. Quant
aux 1 495 familles « non-grécophones mais helléniques » du document de 1924, il s’agit
évidemment en partie des réfugiés de la région de Strumica (infra § 41-46) et des
habitants des rares villages patriarchistes de la région (tels Ravna et Mirovo). Toutefois,
il est indubitable que ces dernières populations sont inférieures au chiffre de 1 500
familles donné par le document. Pour arriver grosso modo à ce chiffre, il nous faut
ajouter les 200 familles albanophones patriarchistes de Mandrica (Mandritsa), en
Thrace bulgare (Arvanitadès), installées à Ambar-Koy, dont une centaine venue en mars
1914 et cent autres vers 1917, pendant l’occupation bulgare de la Macédoine orientale
grecque où elles étaient initialement installées, comptabilisées en partie dans le
document (Maravélakis - Vakalopoulos 1993 F0 5B 1955 5D :
F0
295-298 ; cf. infra § 109 ;
Kontogiorgi 2006 : 210-211). Nous ne savons pas si, en 1924, date à laquelle est rédigé le
document, étaient déjà installées dans la région les familles orthodoxes échangées
d’Asie Mineure pour beaucoup de langue non grecque, dont une majorité de
turcophones du Canik (Pont-Euxin occidental, Bafralidès), plus des turcophones de
Cappadoce (Karamanlidès), quelques kurdophones de Bakoouz de Diyarbakır
(Kiourtsidès), quelques arménophones chalcédoniens (Haïkhoroumidès), des
slavophones du nord-ouest de l’Asie Mineure (Trakatroukidès), ainsi que des
turcophones de Thrace orientale (Gagavouzidès).
13 N. S. : Les Grecs n’ont donc pas touché à la population musulmane de la région.
14 L. E. : On ne s’est pas occupé de la population musulmane. Au contraire, on la
considérait plutôt comme ayant des sympathies pro-grecques. La population
musulmane ne faisait pas partie des enjeux de la seconde guerre balkanique. En
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
176
juin 1913, la coalition des quatre États orthodoxes F0 2D Grèce, Serbie, Monténégro et
2D se scinde ; la Bulgarie attaque la Serbie et la Grèce. La Roumanie, autre pays
Bulgarie F0
orthodoxe, et l’Empire ottoman attaquent la Bulgarie, la première pour s’approprier le
« Quadrilatère », le second pour reconquérir Andrinople et les territoires perdus en
Thrace orientale au cours de la première guerre balkanique.
15 Pour répondre plus précisément à votre question, je dirais que non seulement la
population musulmane ne constitue pas pour les Grecs l’enjeu que l’on aurait pu
penser mais que c’est même tout le contraire : pendant la guerre de 1913, les alliés
gréco-serbes avaient accusé leurs adversaires d’atrocités contre les musulmans et, les
Grecs en particulier, s’étaient arrogé le beau rôle de garants de la sécurité des sujets
musulmans. Or, pendant la première guerre balkanique, chacun des quatre alliés
orthodoxes s’était livré à des exactions contre des segments de la population
musulmane qui constituaient des obstacles à la consolidation de son territoire F0 2D
certains musulmans s’étant opposés par les armes aux armées « chrétiennes » F0 2D ou
encore avait tout simplement soumis la population musulmane à des pillages ou à une
violence aveugle pour se venger de « cinq siècles d’oppression turque » ; ce qui a
provoqué un exode massif de musulmans vers l’Empire ottoman. Les Serbes s’en étaient
pris aux Albanais et aux Turcs, les Grecs et les Bulgares surtout aux Turcs. Ajoutons que
les Grecs, notamment les auxiliaires de l’« Armée mixte d’Épire », avaient commis des
violences contre les musulmans albanais Chams (cf. Baltsiotis 2011). Les Grecs avaient
procédé à des massacres de musulmans à Kaylar et à Yenice Vardar et les Bulgares en
Thrace orientale, à Kilkis et ailleurs – tout cela est exposé en détail dans le rapport de la
Commission Carnegie (Dotation Carnegie 1914). Tassos Kostopoulos, dans son livre
récent (2007), donne une image très claire des violences exercées contre les musulmans
pendant la première guerre balkanique. Outre les exactions perpétrées par des bandes
de comitadjis contre la population musulmane, les Bulgares ont tenté de convertir de
force à l’Orthodoxie les Pomaks (musulmans bulgarophones) 9. Cela dit, lors de la
seconde guerre balkanique, nous assistons à la formation de bandes musulmanes,
utilisées comme auxiliaires par les armées chrétiennes, tout comme les milices
chrétiennes de vétérans des années précédentes qui s’étaient affrontées en Macédoine (
četnik pour les Serbes, comitadjis pour les Bulgares et andartès pour les Grecs), parfois
directement liés aux états-majors10.
16 Curieusement, la population musulmane, pourtant très nombreuse, n’a pas constitué
un enjeu démographique majeur dans la question macédonienne pour les États
orthodoxes en ce qui concerne la polémique sur les statistiques (signalons toutefois
deux exceptions : les Pomaks et les Torbèches11, qui permettent aux Bulgares de gonfler
les chiffres de la slavophonie bulgaro-macédonienne et de présenter une région plus
uniformément slavophone, et les Albanais qui, à l’inverse, contrecarrent les prétentions
des Serbes sur la « Vieille Serbie » et la Macédoine du nord-ouest, puisque, dans
beaucoup de kazas, ils sont déjà à l’époque majoritaires). En octobre 1913, au moment
du tracé de la frontière du nouvel État albanais, les Serbes « pacifient » les villages
albanais musulmans de Dibra, en état de révolte depuis le mois de septembre 1913, sous
la houlette du chef insurgé, Albanais musulman du Kossovo, Jésus Bolétin (Issa
Bolétinac) et il faudra la menace autrichienne et l’intervention des grandes puissances
pour qu’ils mettent fin à ces procédés12. En octobre également, les Grecs commencent
aussi à évacuer des villages musulmans – pour y installer des réfugiés grecs de la
Thrace bulgare, de la Thrace ottomane, d’Asie Mineure et du Pont Euxin (Dotation
Carnegie 1914 : 192-193 ; Sigalas 2012). Signalons toutefois que ces États, en août 1912,
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
177
sont préoccupés par la politique démographique menée par l’Empire ottoman quant à
l’installation des populations musulmanes réfugiées et visant à consolider ce territoire
menacé, dans une époque où sa souveraineté y est chancelante.
II. Intention et contingence
17 N. S. : Considérez-vous l’éviction de la population orthodoxe de Kilkis comme un acte
délibéré de l’armée grecque ?
18 L. E. : À mon avis, cette région a été vidée de sa population chrétienne par l’action
délibérée de l’armée grecque. Mais l’intentionnalité de cette action, et au-delà sa
spécificité, ont pu passer inaperçues en raison des violences extrêmes et généralisées
des deux guerres balkaniques et des grands mouvements de populations qu’elles ont
provoqués. Les responsables grecs ont beau affirmer que les Bulgares de la région de
Kilkis ont quitté le territoire parce qu’ils ne pouvaient accepter la souveraineté
grecque, on peut interpréter différemment cet exode et la grande panique qui l’a
précédé, en prenant en compte les actions violentes de l’armée grecque et des bandes
de miliciens (andartès et proscopes), qui sont passées après l’armée dans les villages qui
n’avaient pas été entièrement abandonnés. Voyons, par exemple, ce qui est advenu
dans la région de Kilkis – avant même la destruction délibérée de la ville et des villages,
les violences commises contre la plupart des habitants exarchistes qui sont entrés en
contact avec l’armée – ou sur les autres théâtres de la guerre gréco-bulgare. Et, sur ce
point, nous avons des preuves qui émanent de différentes sources non grecques, encore
que les témoignages les plus probants soient ceux de soldats grecs qui, dans des lettres
adressées à leurs proches, leur avouent, souvent non sans horreur, plus rarement avec
satisfaction, les violences et les destructions, viols, massacres et incendies dont l’armée
grecque s’est rendue coupable sur tout le théâtre des opérations, sur ordre du roi ou
des chefs militaires. Les colis postaux acheminant cette correspondance ont été saisis
par l’armée bulgare et les lettres, une fois établi qu’il s’agissait bien de lettres, ont été
publiées en extraits avec l’enveloppe d’origine, en fac-similé, en Bulgarie (Extraits fac-
similés 1913) et intégralement reprises dans le rapport de la Commission Carnegie, puis
citées par tous les auteurs postérieurs aux événements dans le cadre d’une mise en
cause des agissements grecs. Les Grecs, pour leur part, exception faite de l’ambassadeur
de Grèce à Paris, Athos Romanos, qui tenta de mettre en doute l’authenticité de ces
lettres (annexe XVII), se sont toujours refusés à tout commentaire officiel. Les deux
sources citées, le Rapport sur la guerre dans les Balkans publié un an après les événements
par la Commission Carnegie (Dotation Carnegie 1914) et le livre publié en 1913 à Sofia
sous la direction du professeur bulgare Lioubomir Miletič (Lubomir Miletitch) sur Les
atrocités grecques en Macédoine, en bulgare et en français 13, évoquent en détail ces
événements. Le premier, bien que pro-bulgare, montre très clairement les agissements
des puissances par rapport aux populations et les raisons politiques qui ont amené les
armées à traiter de telle ou telle manière une population donnée. En troisième lieu, il y
a les rapports des consuls des puissances à Salonique et des ambassades à Sofia,
Athènes, Belgrade et Istanbul.
19 Le livre de Miletič (1913) est beaucoup mieux documenté que son équivalent grec sur
les atrocités bulgares (Anonyme 1914) et contient des témoignages des victimes
bulgares de toutes les régions du front, qui se sont réfugiées en divers endroits en
Bulgarie. En revanche, le livre grec non seulement se signale par un déni total des
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
178
événements de Kilkis, Dojran et Gevgelija, mais allègue que les Bulgares auraient brûlé
eux-mêmes la ville de Kilkis, ce qui est faux (Anonyme 1914 : 66-68, annexe XI). Il
présente des témoignages souvent tendancieux, comme ceux de René Puaux, du Temps,
Jean Leune, de l’Illustration, Magrini, du Secolo, Vladimir Tordoff, de Outro Rossije et de
bien d’autres. Il décrit longuement, en les exagérant parfois, les violences qu’ont subies
les musulmans du fait de l’armée bulgare et de ses auxiliaires, afin de mieux étayer la
thèse de la barbarie bulgare et d’établir que cette armée s’est rendue coupable
d’exactions y compris là où il ne s’en était pas exercé contre les Grecs. La seule mention
de l’incendie de Kilkis dû aux Grecs émane du roi Constantin qui, reprenant mot pour
mot les accusations du roi Ferdinand, les dément et les retourne contre celui-ci,
prétendant que le feu, initialement dû à l’explosion d’obus durant la bataille, avait été
ensuite propagé à dessein par les Bulgares (Anonyme 1914 : 22). S’agissant du rapport
de la Commission Carnegie (1914), l’accueil à bras ouverts des enquêteurs-auteurs par
le gouvernement de la Bulgarie vaincue qui leur donne accès à toute source disponible
– contrairement à l’attitude des gouvernements grec et serbe14 qui leur ont souvent
rendu difficile l’accès à l’information et au terrain – les a incités à prendre
sérieusement en compte les explications avancées par les Bulgares (là où celles des
Grecs et des Serbes faisaient défaut) et à atténuer la sévérité de leur jugement envers la
Bulgarie. C’est, à mon sens, ce facteur, ainsi que la suggestion exprimée avec emphase
que le traité de Bucarest (10 août 1913) devrait être révisé en faveur de la Bulgarie pour
éviter des guerres futures, davantage que la composition de cette commission 15, qui
rendent ce travail pionnier pro-bulgare. Par conséquent, il n’y a rien d’étonnant à ce
que la Bulgarie invoque largement ledit rapport pour clamer ses « droits nationaux » et
sa « justification morale », ce qui ne fait qu’accroître la méfiance des Grecs et des
Serbes envers celui-ci.
20 Il ressort donc des faits rapportés par la Commission Carnegie, que nous avons par
ailleurs croisés avec d’autres sources, que, sur toute la longueur du front, l’armée
grecque n’a brûlé presque exclusivement que des villages exarchistes. Une source
grecque, que j’ai déjà citée à propos de l’incendie de Kilkis, émanant du soldat Nostrakis
(annexe XXII), relate le passage des bandes grecques après l’entrée de l’armée grecque
dans la plupart des contrées tenues par l’armée bulgare. Les bandes ont continué les
exactions pour « extirper les foyers de malfaiteurs » F0 5B en grec, kakopïi 5D (« bulgares », il
F0
va sans dire). C’est, à ma connaissance, le seul récit qui fasse état de l’action de ces
bandes, apparemment sans aucune autocensure de l’auteur, ni censure des éditeurs
ultérieurs, et qui relate les faits avec le plus grand naturel. Le volontaire ne dissimule
pas son horreur devant la violence extrême, bien que non continue, qu’exercent ces
bandes à l’arrière du front afin de poursuivre, là où l’armée n’avait pas chassé la totalité
des habitants « bulgares », le « nettoyage » F0 5B ekkatharissi 5D sélectif et censé faire
F0
exemple pour tous ceux qui montreraient une quelconque velléité de loyauté envers la
Bulgarie, tel cet homme exécuté par les andartès, pour être le père de deux volontaires
de l’armée bulgare. Ce qui nous montre les différences entre les procédés sommaires
des bandes et ceux de l’armée d’occupation, ainsi que la continuité entre crimes de
guerre, perpétrés par une armée, et la violence de ce banditisme, lequel, bien que déjà
constitué par la lutte des bandes de 1904 à 1908 en ce que vous avez appelé un
banditisme politique (Sigalas 2012), emprunte, tout en les amplifiant, des traits du
banditisme traditionnel F0 2D pillages, extorsions, viols, tortures, assassinats (cf. infra §
55-69) –, le but étant désormais de contraindre tout le monde soit à fuir soit à se
déclarer Grec par le biais de la conversion au Patriarchisme. Le journal évoque une
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
179
forme édulcorée de viol, « l’entremetteuse » agissant pour le compte de l’armée
conquérante auprès d’une population méprisée, humiliée et terrorisée, orchestrant le
consentement de certaines femmes, ainsi que la différence entre l’accueil enthousiaste
des « Grecs » et l’accueil contraint, mêlé de peur, de certains autres, comme ceux
décrits par l’auteur dans la bourgade de Syrnova (Zirnovo, aujourd’hui Kato
Névrokopi), lesquels veulent se présenter comme « Grecs » alors que l’auteur les
soupçonne d’être « Bulgares » (Dalambira 1988, Annexe XXII). Si le journal de ce soldat,
unique en son genre, ne parle guère de la logique de la violence d’une guerre telle que
celle que nous décrivons, parce que son auteur n’en est pas conscient lui-même, il nous
permet cependant de comprendre que telle ou telle ville ou tel village sont brûlés ou
rasés plutôt que tels autres, comme par exemple la ville de Kilkis elle-même (cf. supra, §
4) ou le village de Kalapot, Kaza de Zikhna (aujourd’hui, Panorama ; cf. Miletič 1913 : 53).
L’armée grecque n’est pas intrinsèquement plus violente que les autres qui sont
engagées dans cette guerre, toute armée étant capable, dans certaines situations, de ce
type d’exactions. Ce qui importe est de tenter de déceler la signification de cette
violence par rapport à l’enjeu démographique. Il est ainsi possible de répertorier trois
types de violence. En premier lieu, il y a la violence massive de l’armée qui, par la
crainte d’exactions qu’elle suscite, induit la fuite d’une population F02D notons que plus
les batailles sont violentes, plus la peur grandit 2D , auquel cas les villages sont brûlés
F0
pour effacer au maximum les traces et empêcher tout retour. En second lieu, il y a la
violence des bandes qui peut être concomitante avec celle de l’armée ou postérieure à
celle-ci et qui vise à soumettre et à dissuader toute velléité de loyauté envers l’État de
l’adversaire ; éventuellement plus sporadique, cette violence-ci s’exerce arbitrairement
à l’encontre de personnes victimes d’une délation de la part des fractions « grecques »
du village ou de la ville, et entraîne, comme dans toute guerre civile, de multiples
règlements de compte mais fait aussi bénéficier parfois tout un village de la protection
de ces mêmes fractions grecques, le nombre des victimes étant alors nul ou insignifiant
parmi les habitants dont la « loyauté » est ainsi « achetée ». En troisième lieu, il y a la
violence traditionnelle du pillage des bandes armées, aguerries dans la guerre de
bandes ; un pillage s’exerce à la façon d’une razzia, ce qui permet à ces mêmes bandes
de se payer sur l’habitant et de s’enrichir. Bien qu’apparemment non politique, ce
troisième type de violence, dans la mesure où il est circonscrit à ceux qui sont désignés
comme des ennemis, opère sur le même mode que les deux premiers types. Il s’agit,
dans les trois types de violence que j’évoque, de ce que vous appelez « l’autonomisation
du banditisme politique » (Sigalas 2012). L’extrême violence de la campagne militaire
des premiers jours de la guerre gréco-bulgare est due à cette autonomisation du
banditisme politique. C’est désormais l’armée elle-même, sous les ordres du roi
Constantin, qui adopte le comportement habituel des bandes. Ici, il faudrait préciser
qu’une partie des « bandes » grecques est organisée pour recevoir les volontaires,
principalement des Grecs sujets ottomans, surtout Crétois et Macédoniens. Ces bandes
sont encadrées par des officiers de l’armée régulière, souvent connaisseurs du terrain,
des populations et de la situation politique ou par des anciens chefs de bande intégrés
dans l’armée. Ce corps, appelé corps des proscopes (Proskopi) et institué par un
capitaine de l’armée, lui-même impliqué dans la guerre des bandes de 1904 à 1908,
passait pour plus régulier que ses équivalents bulgares (comitadjis). La flexibilité de
l’engagement volontaire, explicitée par Nostrakis, sujet grec enrôlé de son plein gré
dans l’armée régulière mais ayant opté plus tard pour les proscopes, nous offre une
image très claire des façons d’opérer de ces derniers et de leurs violences. Cette
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
180
typologie de la violence que je viens d’évoquer ne s’applique pas de la même manière
aux Serbes : ceux-ci veulent seulement, s’agissant des Slaves macédoniens, éliminer les
réseaux liés à l’adversaire, induire une loyauté envers la Serbie en nommant d’emblée
serbe la population slave-macédonienne, et convertir au patriarchisme serbe les
exarchistes. Leur violence, impliquant aussi, mais dans une moindre mesure que celle
exercée par les Grecs, des incendies et des violences exercées contre la population, n’en
a pas moins généré un exode important vers la Bulgarie. Les Bulgares, pour leur part, se
montrent, pendant la deuxième guerre balkanique, d’une extrême violence envers la
population grecque grécophone, comme à Nigrita, Demirhissar, Serrès et Doxato (cf.
infra § 61-69) et veulent probablement la chasser partiellement ou entièrement, encore
que leur action se limite à certaines villes, bourgs ou villages notoirement grécophones,
comme Nigrita au tout début de la guerre et ne devient massive qu’après le grand
exode bulgare consécutif aux batailles de Kilkis-Lahana. Quant aux Slaves
patriarchistes, minoritaires dans les régions d’occupation bulgare, sauf à Nigrita et à
Langada, perçus d’office comme Bulgares, on les oblige, dès que la deuxième guerre
balkanique éclate, à devenir exarchistes. Notons que, pendant l’occupation bulgare
consécutive à la première guerre, ces mêmes populations avaient fait l’objet de
harcèlement visant à leur faire rallier l’Église bulgare. Voici ce que dit à ce propos, du
temps de l’occupation bulgare, le métropolite de Melnik, Constantin : la « théorie des
Bulgares concernant nos bulgarophones consiste à dire qu’il s’agit bien de Bulgares
mais de Bulgares patriarchistes. Les administrateurs bulgares mettent très étroitement
en application cette théorie et, appelant les Grecs, grécomans, les renvoient toutes les
fois où ceux-ci viennent se plaindre de méfaits commis contre eux et ne leur cachent
pas qu’ils s’exposeront à ce traitement tant qu’ils continueront à s’appeler Grecs. »
(Ministère des Armées III 1-1934 : 128)16. Le mode de représailles pour toutes les
armées, comme pour les bandes paramilitaires, est souvent lié, pendant la seconde
guerre balkanique, à une intention démographique et territoriale. En fait, il s’agit
souvent d’un prétexte pour poursuivre l’aménagement démographique d’un territoire.
Concernant précisément le nouveau territoire grec, le fait qu’il n’est pratiquement
resté aucun exarchiste dans la région de Langada, proche de Salonique, seul un nombre
insignifiant demeurant dans celle de Kilkis, stratégique pour son maintien, atteste que
ces violences et les incendies qui les ont suivies constituaient bel et bien des actes
délibérés.
21 N. S. : Ces actes délibérés étaient-ils également des actes prémédités ?
22 L. E. : Avant de répondre à cette question, je voudrais insister sur le fait que les régions
dont l’armée grecque a provoqué l’évacuation pendant la seconde guerre balkanique
avaient une importance stratégique pour les prétentions grecques. Quand je dis ici
« stratégique », je n’entends pas que ces régions avaient une importance militaire, ces
régions étaient stratégiques dans la logique territoriale – plus exactement la logique de
territorialisation – que les Grecs avaient développée, bien avant les guerres
balkaniques, concernant la Macédoine.
23 À cet égard, il faut d’abord prendre en compte les divergences entre les deux acteurs
principaux de l’État grec : le roi Constantin, généralissime de l’armée, et le Premier
ministre Vénizélos, architecte de l’alliance balkanique, du côté grec. Il semblerait que la
politique anti-bulgare ait été nettement plus prononcée du côté du roi que de celui de
Vénizélos. Il est même probable que les incidents intervenus entre Grecs et Bulgares,
pendant la période de paix qui précède immédiatement la guerre, aient été davantage
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
181
le fait d’éléments plus proches du roi que de Vénizélos17. Cela dit, quand la guerre
éclate, les divergences semblent s’être atténuées. Vénizélos, pour sa part, se serait
satisfait de maintenir, avant que la seconde guerre balkanique n’éclate, outre la
Macédoine à l’ouest du Vardar, Salonique, la Chalcidique et la région litigieuse
d’occupation grecque à l’est du Vardar, Nigrita et Langada étant administrées par les
Bulgares ou conjointement par les Bulgares et les Grecs, et aurait été prêt à renoncer à
Serrès et à la région s’étendant à l’est du Strymon en faveur de la Bulgarie (Gardikas-
Katsiadakis 1995 : 182)18. Or, pour Constantin et ceux des dirigeants militaires et
politiques qui partagent son anti-bulgarisme forcené (ce qui ne veut pas dire que ceux
qui étaient plus proches de Vénizélos aient été moins nationalistes que les premiers), il
eut été inadmissible d’abandonner toute velléité sur la Macédoine orientale. C’est
d’ailleurs pendant les guerres balkaniques que l’on voit poindre la différence entre les
deux hommes et leurs camps quand, le roi refusant d’arrêter la guerre de destruction
de la Bulgarie, Vénizélos menaça de démissionner s’il n’avait pas « les mains libres »
lors des négociations de Bucarest. Cette différence se creusera au moment du difficile
choix entre la neutralité et l’alliance avec l’Entente pendant la Première Guerre
mondiale, en 1915.
24 Il faut par ailleurs préciser que l’exode de la population de la région de Kilkis n’est pas
un fait isolé. Il constitue le plus notable d’une série d’événements du même type qui ont
eu lieu dans toute la Macédoine orientale, comme l’attestent clairement les sources que
nous avons mentionnées. Nous nous centrons ici sur la ville et de la région de Kilkis
mais on ne saura pas oublier ce qui s’est passé dans la confrontation armée entre Grecs
et Bulgares sur les autres théâtres militaires du sud de la Macédoine : de Lahana jusqu’à
Serrès et Demirhissar (aujourd’hui Sidirokastro), dans la région de Drama, et au-delà de
la frontière actuelle entre la Grèce et la Bulgarie, à Roupel, jusqu’aux défilés de Kresna
dans le nord de la haute vallée de la Strouma, à Simitli, et jusqu’à Mahomia (aujourd’hui
Razlog, en Bulgarie). Le sort des villages de Kilkis a été aussi celui de tous les villages
exarchistes dans la vallée de Langada/Lagadina, dans une moindre mesure de ceux de
la vallée du Strymon/Strouma et à un moindre degré encore de ceux de la vallée du
Nestos/Mesta. Des violences ont été perpétrées sur toute la longueur du front de la
Macédoine orientale. Les cas les plus notoires de violences sont ceux des villages de
German, Krouchevo et Kirtchevo de la région de Demirhissar (actuellement
Skhistolithos, Akhladohori et Karydohori), (cf. Dotation Carnegie 1914 : 83, 310, 311,
336-338 ; Miletič 1913 : 43-46 ; 107-114). Le nombre d’habitants contraints de quitter la
Macédoine orientale (en dehors des régions qui formeront plus tard la Macédoine
centrale) pendant la deuxième guerre balkanique s’élève à au moins 20 000
(Kostopoulos 2000 : 31 ; Mihaïlidis 2003 : 85-89). Ce qui donnerait un chiffre se situant
entre 35 000 et 40 000, selon Michaïlidis, ou 43 000, selon Kostopoulos, pour les
expatriés bulgares de toute la Macédoine grecque.
25 Je voudrais maintenant m’arrêter, à titre d’exemple, sur trois autres villages
exarchistes, en dehors de la région de Kilkis, dont l’évacuation était importante du
point de vue de la conception grecque du territoire macédonien. Ces villages, sur
lesquels nous n’avons que des informations indirectes concernant des violences
grecques mais dont la population a dû quitter le territoire grec en 1913, sont Zarovo du
Bogdansko, dans la montagne de Langada, Skridjovo, dans les environs de Ziliahova, et
Banica dans le haut Ménécée (en grec, Menikion).
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
182
26 Zarovo fait partie d’un groupe de trois villages, situés tout près de la route qui mène de
Salonique à Serrès, sur la montagne qui sépare les vallées de Langada et du Strymon,
parlant un dialecte slave très archaïque. Il est le seul des trois à avoir rallié l’exarchat,
depuis sa fondation en 1870, les deux autres étant devenus des bastions du
patriarchisme. Sa présence dans ce groupe très stratégique, dont le patriarchisme
fournit une légitimation au contrôle des Grecs sur la montagne et l’axe routier, le rend
très dangereux aux yeux du consulat grec de Salonique avant et pendant la « lutte
macédonienne », ainsi qu’à ceux des autorités ottomanes, considérant les exarchistes,
dans ces villages proches de Salonique, comme de potentiels révolutionnaires,
probablement après les événements du printemps 1903 qui ont ébranlé cette ville.
Figurant dans un opuscule important (mémorandum), un exposé des doléances de la
population bulgare de Macédoine vis-à-vis des autorités ottomanes, comportant une
véhémente dénonciation de la connivence des Grecs avec ces dernières, publié en 1904
par Bérard, et republié indépendamment dans une version plus complète sous le titre
Turcs et Grecs contre Bulgares en Macédoine, mentionne les quatre villages les plus
notoirement exarchistes dans le voisinage immédiat de Salonique : Gradobor
(Gardemborion), Negovan (Xyloupolis) Zarovo et Novo Selo (Néohorouda). Les
fonctionnaires de la police, suivis par l’armée ottomane, signalent aux habitants que le
Sultan ne veut plus d’exarchistes et leur déclarent : « Si vous ne renoncez pas à votre
Église, vous serez exterminés » (Anonyme 1904 : 40). L’intervalle entre les deux guerres
balkaniques exacerbe l’antagonisme gréco-bulgare dans cette région si proche de
Salonique et cruciale pour son maintien. Gradobor et Novo Selo se trouvent à une très
faible distance au nord de Salonique. Ils sont toujours majoritairement slavophones.
Situés avant le « kilomètre 14 » de la ligne de chemin de fer Salonique-Istanbul (limite
reconnue des deux zones d’occupation), ils sont compris dans la zone grecque non
litigieuse (Ministère des Armées III-1932) et n’ont donc pas subi la guerre gréco-bulgare
ni les exactions de 1913, bien que leurs habitants aient probablement été maltraités
sous l’administration vénizéliste de Salonique, entre 1916 et 1918 (Ministère des
Affaires étrangères et des Cultes, 1919). Le capitaine Zoroyannidis, dans son Journal,
publié après sa mort en 1975, raconte qu’il est envoyé en mission à partir du 13
novembre 1912 et jusqu’à l’éclatement de la seconde guerre balkanique, pour
« marquer l’occupation grecque dans les parties non encore prises par l’armée grecque
de la région de Salonique », à savoir la zone de contact entre les deux armées
d’occupation la plus litigieuse, où l’armée bulgare entend elle aussi marquer son
occupation19. Il en ressort que Zarovo, considéré comme bulgare, n’est pas investi par
des détachements grecs alors que les deux autres grands villages de ce groupe
slavophone (Soho et Vissoka, aujourd’hui Ossa) le sont et deviennent le lieu d’un
antagonisme sournois entre armée grecque et bulgare ; l’objectif étant de gagner la
loyauté des habitants slavophones qui, dans le cas de Vissoka, « ne connaissant pas le
grec, n’étaient ni Grecs ni Bulgares, mais dépourvus de sentiment national clair » et ce,
contrairement au village voisin entièrement grécophone de Bérova, qui est « un village
purement grécissime (sic), dont les habitants sont de très purs Grecs, parlant le grec,
bien qu’ils soient entourés de villages bulgares et bulgarophones » (Zoroyannidis : 46,
49 et 51). C’est dans ce climat de tension génératrice de terreur, dès lors que la guerre a
éclaté, que les habitants de Zarovo ont tous quitté le territoire grec pour la Bulgarie 20.
Ils se sont installés pour la plupart près de la ville actuelle de Sandanski en Macédoine
bulgare et en majorité dans le village de Ilindenci, construit par eux-mêmes (Drettas
1980). Le village de Zarovo, repeuplé après 1924 de réfugiés grecs du Pont-Euxin, a pris
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
183
le nom de Nikopolis, ce qui signifie en grec « ville de la victoire », pour commémorer la
bataille de Lahana (livrée contre l’armée bulgare en même temps que la bataille de
Kilkis) qui fut à l’origine de la désertion de Zarovo par ses habitants. Les habitants des
autres villages exarchistes de la région de Langada ont aussi quitté le territoire.
27 Skridjovo se trouve à la limite méridionale de la slavophonie sur le versant méridional
des contreforts du mont Ménécée du sud-est, dans ce qui, en juillet 1913, était en train
de devenir un territoire grec. Dans cette région (de Serrès à Ziliahova), les villages
d’altitude sont tous slavophones, tandis que les villages du piémont, de basse altitude,
sont grécophones ou turcophones chrétiens. La présence de ce grand village
entièrement exarchiste, depuis la fondation de l’exarchat, à l’extrême est, sud-est de la
région, est considéré comme un tremplin potentiel de revendication bulgare de la ligne
de tous les villages slavophones, situés plus à l’ouest, en altitude, répartis en demi-arc
de cercle autour de la ville de Serrès. Ce qui permettrait donc de voir cette ville,
quatrième en importance après Salonique, Bitola et Skopje, comme capitale d’une
région slavophone de montagne, reliée plus fortement à la masse de la population
slavophone des çiftlik de la basse plaine. Ainsi, malgré la très large majorité de
grécophones parmi les Chrétiens de Serrès – seul le quartier de Kamenikia était
slavophone –, la ville semblait isolée de l’étroite ligne des villages grécophones (connus
sous le nom de villages Darnak) et turcophones chrétiens patriarchistes (dont Ziliahova
elle-même, aujourd’hui, Néa Zihni) qui la relient à l’aire majoritairement grécophone
de Nigrita et du Mont Pangée (en grec Pangaion). En contrôlant ce village avant 1908,
les Grecs auraient gagné tout le mont Ménécée à la cause grecque, comme le remarque
le coordinateur de l’action grecque à Serrès (je dois cette information à Tassos
Kostopoulos). Mais ils n’y sont pas parvenus et les habitants du village ont dû partir en
1913, pour la plupart en Bulgarie (Miletič 1913 : 151). Seule une minorité d’entre eux
s’est réfugiée dans quatre villages voisins. Il a été repeuplé dès 1913 de réfugiés grecs de
Thrace et renommé Skopia (en français « Sentinelle »).
28 Finalement, Banica sur la montagne qui relie le Ménécée au Pirin, village entièrement
exarchiste, a connu le même sort que les deux précédents. Bien que ses anciens
habitants l’aient réinvesti lors de l’incorporation de la Macédoine orientale grecque à la
Bulgarie pendant la Première Guerre mondiale, ils ont été à nouveau contraints à
l’émigration après la fin de celle-ci. Ce village reliait la montagne de Serrès avec la
région fortement slavophone des bassins montagneux de Gorno Brodi (en grec, Ano
Vrondou, seconde agglomération du Kaza de Serrès, en grande partie désertée par ses
quelque 5 000 habitants slavophones) et de Zirnovo (Kato Nevrokopi, cf. supra, § 18) et
de la région montagneuse du Pirin du sud (en grec, Orvilos), majoritairement acquises à
l’exarchat. Toutefois, son importance symbolique tient surtout au fait que c’est là qu’a
trouvé la mort, en 1903 le grand chef révolutionnaire macédonien Gotse Deltchef,
originaire de Kilkis. Cette région a aussi été un des principaux refuges du
révolutionnaire fédéraliste macédonien, Jane Sandanski. En 1913, l’armée grecque
aurait bombardé Banica en avançant vers Gorno Brodi : « notre artillerie, du fait qu’elle
est en pays ennemi, n’a pas manqué de bombarder les villages des deux côtés de la
route, excepté ceux qui ont fait acte de soumission » (Zoroyannidis 1975 : 102) 21. Dans
une lettre d’un sergent grec, au nombre de celles qui furent saisies par l’armée bulgare
(Dotation Carnegie : 313), il est question d’un combat engagé avec les comitadjis
bulgares que « nous avons dispersés après en avoir tué le plus grand nombre, incendié
les deux villages Doutli (aujourd’hui Élaionas) et Banitsa, foyers de comitadjis
redoutables et fait passer le tout par le feu et la baïonnette, en épargnant seulement les
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
184
femmes, les enfants, les vieillards et les églises ». Aujourd’hui, seul le clocher de l’église
et quelques ruines à peine visibles témoignent de l’existence révolue de ce village
(Rombou-Levidi 2009).
29 Si je parle de ces villages, c’est pour répondre plus clairement à la question de savoir si
ces actions étaient préméditées ou non. Il est certain que l’état-major grec a été
informé de la « dangerosité » pour la Grèce de la région entièrement « schismatique »
de Kilkis et de plusieurs villages exarchistes de la Macédoine orientale. C’est
probablement aussitôt après le déclenchement de la seconde guerre balkanique qu’un
officier de l’armée grecque, celui-là même qui fut à l’origine de l’institution des
proscopes, grand connaisseur du terrain, du fait de sa participation à la confrontation
armée de 1904-1908, que les Grecs appellent « lutte macédonienne », élabore un guide
détaillé – bien que manifestement rédigé dans l’urgence – de la zone de confrontation
de 1913 entre Grecs et Bulgares. Ce guide montrait clairement la répartition sur le
terrain des populations slavophones patriarchistes et exarchistes, ainsi que les villages
« macédonisants », selon sa propre expression22. Le guide est parfois à ce point détaillé
que, dans certains villages, il mentionne les minorités « de conviction grecque », c'est-
à-dire slavophones patriarchistes, puisque les villages grécophones sont cités en tant
que tels ; les villages slavophones peuvent être nommés indépendamment de leur
conviction et de la région en tant que « macédonophones » ou « bulgarophones ». Le
village de Zarovo, auquel j’ai fait référence plus haut, est considéré comme « se
distinguant pour son fanatisme bulgare et comme étant depuis toujours un centre de la
propagande bulgare », tandis que les deux autres villages parlant le même dialecte
archaïque (Soho et Vissoka) sont décrits comme « hellénisés par les écoles et se
distinguant par leur convictions grecques» ; ces derniers sont enfin différenciés dans le
guide de deux autres villages, hellénophones cette fois-ci (Bérova et Khorouda), dans le
voisinage du groupe de Zarovo. Notons qu’il s’agit de la région où le capitaine
Zoroyannidis effectue sa mission. Il est question de villages turcs, le plus souvent en
tant qu’« amis de l’idée hellénique » et parfois « fanatisés pour nous ». Les villages sont
clairement situés par rapport à des éléments concrets du paysage, tels les routes et les
fleuves, afin d’éviter toute confusion pour quelqu’un qui connaîtrait mal la région. Le
guide s’ouvre sur une référence à la région de Kilkis dont « tous les villages chrétiens
sont de convictions suspectes, certains même fanatiquement bulgarisants, liés à la
bourgade de Kilkis, qui est un centre du bulgarisme et d’organisation des activités
bulgares ». Quant à la ville même de Kilkis, elle est citée plus loin, en tant que « centre
fanatique du bulgarisme, de 8 000 habitants ». Et le guide de continuer : « il y a des
fractions fanatiques grecques à Butkovo (aujourd’hui Kerkini) et Ravna » – ces deux
derniers villages comptent parmi ceux qui ont en partie échappé aux opérations de
l’armée grecque (pour Ravna cf. supra § 7).
30 Le guide s’intitule Informations générales sur les convictions nationales des habitants de la
zone des opérations. Ce qui suggère qu’il s’agit d’un document élaboré juste après que la
guerre eut éclaté, pour servir de repère rudimentaire aux opérations de l’armée. On
peut donc supposer qu’il constitue l’ébauche d’un plan pour l’action de l’armée grecque
à l’encontre des populations slavophones de Macédoine orientale.
31 Bien sûr, ce ne sont là que des hypothèses, l’objectif du guide semblant apparemment
de se borner à indiquer les villages qui seraient bien ou mal disposés envers l’armée
grecque. Quoi qu’il en soit, ce qui est certain, c’est que le choix a été fait par des gens
qui agissaient en pleine connaissance de cause, et qui, dirais-je, avaient même une très
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
185
longue expérience des paramètres de la question macédonienne et une très bonne
connaissance du terrain ; par des gens donc qui avaient déjà une idée claire des
fractions de la population slave de Macédoine « dangereuses » pour les visées grecques
et de celles « favorables à l’idée hellénique » – puisque ce sont surtout ces dernières qui
sont très attentivement définies dans le guide. Comme s’il fallait veiller tout
particulièrement à ne pas s’en prendre à elles – puisque slaves et donc pouvant
facilement être prises pour ennemies. Par conséquent, et même s’il n’y avait pas de
plan préétabli, même si l’état-major grec n’avait pas prévu la deuxième guerre
balkanique – ce qui est peu probable –, ce savoir détaillé sur les filiations politico-
religieuses de la population suffisait pour guider les choix des décideurs grecs.
32 La décision de provoquer l’exode a certainement été prise à cause des opérations
militaires elles-mêmes. C’est la guerre qui offre la possibilité de se débarrasser d’une
population. Je ne pense en aucun cas que, dans une conjoncture autre, une telle
possibilité se serait présentée.
33 Cette décision s'appuie sur une connaissance de la population qui s’est constituée au
cours des longues années du déroulement de la question macédonienne et à partir de
l’expérience politique acquise pendant toute cette période. C’est sur la base de cette
connaissance et de cette expérience qu’ont été prises les décisions qui conduiront à
l’exode de la population de Kilkis et des autres villages de la Macédoine orientale et à
l’incendie de ces derniers pour empêcher la population d’y retourner. Cette
constatation vaut pareillement si l’on admet que cette décision entrait dans un plan
préétabli ou si l’on considère, au contraire – et c’est mon point de vue – qu’il s’agissait
d’une décision ad hoc, prise au moment des événements.
34 N. S. : Vous postulez donc qu’il y a une dialectique entre l’intention et la contingence,
une dialectique qui se déploie sur fond de la raison territoriale grecque qui s’est
constituée pendant les longues années du déroulement de la question macédonienne.
Cette raison territoriale définirait ainsi un répertoire des choix souhaitables pour la
mise en application desquels viendrait trancher la contingence.
35 L. E. : L’intention et la contingence constituent deux vecteurs en théorie indépendants
de la composition desquelles est produit l’événement. La préparation du guide, le choix
de la région de Kilkis, ainsi que d’autres régions de la Macédoine au-delà du Vardar,
témoignent de l’existence d’une logique dans le choix des régions évacuées, peut-être
même d’un plan. Ce plan pourrait avoir été élaboré peu après le début de la seconde
guerre balkanique – en fonction donc du cours des événements et du fait que Grecs et
Serbes d’un côté, Bulgares de l’autre, souhaitaient une nouvelle guerre. Ainsi, même
l’élaboration de ce plan – si l’on suppose que le guide susmentionné en constituait un et
sans exclure la possibilité qu’aient existé d’autres « plans » – avait une part de
contingence. C’est enfin la guerre, avec la part considérable de contingence qu’elle
implique bien entendu, qui donne lieu à sa mise en application. Cependant, il ne faut
pas oublier que, plan ou pas, les décisions de l’état-major grec suivent une logique de
territorialisation, mise en place bien avant les événements.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
186
III. La formation d’un nouvel enjeu démographique et
diplomatique : l’invention de l’échange de populations.
36 N. S. : Je voudrais revenir sur un point : vous avez dit que le départ de la population
slavophone exarchiste de la région de Kilkis et des autres villages que vous avez
mentionnés à titre d’exemple avait un sens stratégique, non pas militaire, mais
stratégique par rapport à la logique territoriale des prétentions grecques dans la
région. Ces actions de l’armée grecque ne procèdent donc pas d’une logique militaire.
37 L. E. : Non, absolument pas. Même s’il a été prouvé pour les deux guerres balkaniques,
et bien au-delà, que, dans une population considérée comme ennemie, des bandes
paramilitaires soutenant la puissance adverse étaient actives sur le terrain, on ne
saurait affirmer qu’il a été nécessaire d’éliminer la population entière d’une région
pour la seule sécurité de l’arrière-front de l’armée. C’est un prétexte que se donnent les
armées et, au-delà, leurs États. Koukouch – comme on l’a mentionné – était la ville
natale du célèbre idéologue et révolutionnaire macédonien, Gotse Deltchev 23. Mais la
région connaissait peu la guerre des bandes. Du fait qu’elle était presque entièrement
acquise à l’exarchat, elle est restée en dehors des grands théâtres de la confrontation
armée entre bandes grecques et bulgares, de 1904 à 1908. L’activité des bandes était
bien plus importante dans d’autres régions que la Grèce a investies pendant la première
guerre balkanique : dans les régions de Macédoine occidentale du vilayet de Manastır,
surtout celles de Florina et de Kastoria, tout comme dans celle de Yenice Vardar (en
grec Yanitsa) du vilayet de Salonique (en turc-ottoman Selanik). Cependant, aucune de
ces régions n’a été impliquée dans des faits guerriers entre alliés chrétiens de la même
manière que celles de Kilkis, de Langada, de Serrès ou de Drama pendant la deuxième
guerre balkanique.
38 Par conséquent, je ne pense pas du tout qu’il y ait eu un quelconque intérêt militaire à
vouloir se débarrasser de la population civile de cette région. Les actes qui amenèrent
l’évacuation de Kilkis sont commandés par la raison territoriale grecque ; ce qui devient
évident si l’on considère l’attitude de la Grèce envers les réfugiés. Jusqu’à l’entrée en
guerre de la Bulgarie du côté des puissances centrales en 1915, la Grèce a
intentionnellement imposé l’exil à la population qui a fui et a toujours refusé, malgré la
médiation de la France et d’autres puissances, de faire en sorte que les paysans ou
citadins ayant quitté le territoire devenu hellénique des villages en question de Kilkis,
de Langada, de Serrès et de Drama, puissent rentrer chez eux. Le droit de retour a donc
toujours été refusé, sous prétexte de la présence d’« éléments de désordre » dans la
population de cette région, notamment du fait que Kilkis était un « nid de Komitadjis »,
alors qu’il est, bien entendu, tout à fait impossible que tout le monde à Kilkis ait été lié
à l’action des bandes macédoniennes clandestines, dont les activités militaires avaient
par ailleurs plus ou moins cessé après le changement de régime dans l’Empire ottoman
en 1908. Selon un document diplomatique français, le ministre grec des Affaires
étrangères de l’époque, Diomidis Panas, aurait dit à l’ambassadeur français à Athènes
que « la ville de Kilkich […] était le repaire des comitadjis les plus coupables, que pas un
de ces hommes, peut-être, n’est innocent de meurtre »(AMAE FAA Série A 288/6, date
illisible – très certainement automne 1913). Vous avez parfaitement raison quand vous
dites dans votre article dans ce dossier (Sigalas 2012) que la violence qui s’abat à cette
époque sur des populations civiles toutes entières est très souvent liée au fait que
certains dirigeants politiques ou militaires grecs et ottomans perçoivent celles-ci
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
187
comme des foyers du banditisme (Anonyme 1904). Ces populations civiles sont ainsi
perçues comme des obstacles au contrôle du territoire qu’elles habitent, comme des
éléments dont il faut, lorsque l’occasion s’en présente, se débarrasser. S’inscrit dans
cette logique la précédente assertion de Diomidis Panas, qui exprime bien une raison
d’État, ou plus spécifiquement, une raison territoriale : empêcher cette population de
rentrer.
39 Dans l’affaire macédonienne, les populations sont vues comme des moyens de
s’approprier un territoire, de le marquer. La population exarchiste compacte de la
région de Kilkis était appréhendée, aussi bien par les Bulgares que par les Grecs, fût-ce
tacitement pour les seconds, comme une preuve du caractère bulgare de cette région,
définitivement devenue, après le traité de Bucarest (10 août 1913), territoire de l’État
grec. De surcroît, cette population était vue comme une « population de comitadjis »
parce que, dans l’esprit des dirigeants grecs, tout comme dans les représentations
populaires grecques de cette époque, tout exarchiste était un comitadji en puissance,
comme il l’avait été aux yeux des Ottomans, dans les derniers temps de leur
souveraineté (Anonyme 1904). Pas question donc de laisser rentrer cette population,
qui était un marqueur du « bulgarisme », et était de surcroît « dangereuse », dans cette
région définitivement acquise à l’« hellénisme ».
40 Je voudrais vous lire intégralement le document diplomatique auquel j’ai fait référence
précédemment, qui rend très explicite la centralité de la question du non-retour des
réfugiés de Kilkis pour la raison territoriale grecque :
« Notre légation à Sofia a fait parvenir au Gouvernement hellénique, par mon
entremise, de nombreuses pétitions de Bulgares, originaires de Macédoine,
demandant à rentrer dans leurs foyers maintenant que l’état de guerre a cessé
entre les deux pays ; le Ministère des Affaires étrangères n’avait jusqu’ici, donné
aucune réponse à ces requêtes. M. Panas m’a dit aujourd’hui que le gouvernement
grec était peu disposé à donner à ces demandes une suite favorable. Il fait valoir que
la ville de Kilkich, à laquelle appartiennent la plupart des réfugiés en question, était
le repaire des comitadjis les plus coupables, que pas un de ces hommes, peut-être,
n’est innocent de meurtre, que la ville a été, depuis l’évacuation par ses habitants
livrée aux réfugiés grecs de Stroumitza et de Melnik. Il se déclare prêt à indemniser
les fugitifs, s’il y a lieu, après décision d’une commission d’arbitrage qui déciderait
si les anciens habitants de Kilkich ont droit à une soulte après attribution des
propriétés grecques de Stroumnitza [sic.] et de Melnik, où les réfugiés bulgares
peuvent s’installer. Mais, en aucun cas, il n’est disposé à admettre le retour sur le
territoire grec de pareils éléments de désordre ».
41 Le dossier de la question des réfugiés est donc traité directement par le ministre des
Affaires étrangères dans le cadre d’une politique démographique cohérente concernant
les territoires nouvellement incorporés. La clef de voûte de cette politique est
l’opposition au retour des populations qui ont fuit. Le durcissement progressif des
expressions du ministre – on notera le passage de l’expression « peu disposé » F0 5B à
donner une suite favorable aux demandes de retour des réfugiés 5D à la formule « en
F0
aucun cas disposé » à la fin du document – ainsi que les propositions d’indemnisation
encore floues, attestent non seulement que le gouvernement a opté clairement pour le
non-retour mais qu’il s’est déjà engagé dans la voie qui mène à la solution de l’échange
des populations (bien que cette formule ne soit pas encore prononcée). Avec
l’installation à Kilkis des Grecs de Melnik et des grécisants slavophones de Strumica
(villes toutes deux adjugées à l’État bulgare), une logique évidente de « réciprocité »
s’instaure, le ministre suggérant « l’attribution des propriétés grecques de Strumica et
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
188
de Melnik où les réfugiés bulgares peuvent s’installer ». Nous voyons ici l’ébauche d’une
politique imposée aux vaincus, consistant en un échange de populations de fait,
s’accompagnant d’un échange de propriétés qui tend, pendant toute la décennie
suivante, à se constituer en proposition juridique et dépasse de loin le cadre de
l’« échange » gréco-bulgare pour se généraliser avec les accords turco-bulgares sur
l’échange restreint et les plans gréco-ottomans pour un échange de population en 1914.
C’est ainsi que s’ébauche progressivement une disposition diplomatique qui est ensuite
internationalement reconnue dans les traités de paix entre puissances balkaniques et
Empire ottoman, entre la Grèce et la Bulgarie à Neuilly et culmine dans la convention
sur l’échange de populations compulsif et généralisé de Lausanne (janvier 1923), qui a
précédé le traité de paix fondateur de la Turquie contemporaine.
42 Ce que je voudrais souligner ici, et qui constitue pour moi le point le plus intéressant de
l’événement que nous traitons, est qu’avec la politique grecque concernant les refugiés
de Kilkis nous voyons pour la première fois apparaître dans l’histoire des Balkans et de
l’Empire ottoman, et au-delà, la logique ainsi que la pratique concrète, de l’échange de
populations. En essayant d’imposer à la Bulgarie un échange de fait, le gouvernement
grec anticipe – je dirais même qu’il rend possible – un règlement diplomatique qui
n’avait pas encore trouvé son expression dans les termes du droit international (qui
était même, de prime abord, jugé « illégal » par les diplomates de l’époque). Je pourrais
si vous le souhaitez revenir plus tard sur la question du droit international (cf. infra §
120-127, 143-145 et 153-158).
43 Pour comprendre comment la question des réfugiés de Kilkis s’inscrit d’emblée dans la
logique d’échange de fait, que la politique grecque veut imposer à la Bulgarie vaincue, il
faut examiner la façon dont cette question est liée à celle des réfugiés patriarchistes de
Strumica (à laquelle Panas avait fait référence cf. supra § 40). La population chrétienne
de Strumica (en grec Stromnitsa, ville importante sur le versant nord de la Belasica, en
grec Bélès24) était presque entièrement slavophone, exarchiste pour un quart environ
et patriarchiste pour trois quarts. Une partie des villages slavophones des environs
était patriarchiste également. Strumica constituait l’extrémité nord des revendications
maximalistes grecques et c’est pour cette raison qu’on s’était efforcé d’y maintenir
contre vents et marées une importante communauté patriarchiste. Que s’est-il donc
passé à Strumica ? Dans un premier temps, après l’occupation de la région (9 juillet),
l’armée grecque incendie les villages exarchistes, sans toucher à la ville elle-même, qui
(tout comme Gevgelija) comptait un pourcentage élevé de patriarchistes. La ville reste
intacte jusqu’aux discussions sur l’attribution de celle-ci à la Bulgarie, dans le cadre du
traité de Bucarest (10 août 1913). Selon les informations fournies par le rapport
Carnegie qui cite à l’appui divers témoignages, dès qu’il a été entendu que la ville ne
ferait pas partie du territoire grec, l’armée a incité sa population patriarchiste,
musulmane et juive à la quitter. On disait aux patriarchistes que « les Bulgares les
massacreraient s’ils ne partaient pas. On leur promit encore qu’on élèverait à Koukoush
une nouvelle Stroumitza sur un plan admirable, et on leur promit qu’ils y recevraient
des habitations et des terres » (Dotation Carnegie 1914 : 87). Les musulmans firent
l’objet de pressions plus fortes. Toujours selon des témoignages rapportés dans le
rapport Carnegie, l’armée a proposé de transporter le mobilier des réfugiés de Strumica
– ainsi que de ceux de Melnik que l’armée avait également incités à émigrer – en
automobile. Enfin, tous les témoins oculaires s’accordent pour dire que c’est l’armée
grecque qui, le 8 août, a mis le feu aux quartiers musulmans et patriarchistes de la ville,
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
189
détruisant les conduites d’eau et les pompes d’incendie, avec l’intention d’attribuer cet
incendie aux habitants eux-mêmes qui ne supporteraient pas le « joug bulgare »
(Dotation Carnagie 1914 ; Aarbakke 2003). Toutefois, le rôle de l’armée dans cet
incendie ne pouvant pas rester secret, les Grecs ont finalement renoncé à prétendre
officiellement que c’étaient les habitants qui avaient brûlé la ville, seuls des particuliers
ayant persévéré dans cette version des faits (Aarbakke 2003, citant Anguélopoulos 1980
: 146-147, 341). Et le rapport Carnegie de conclure :
« L’affaire de Stroumitza [sic.] jette une vive lumière sur une quantité d’événements
semblables où l’intention et l’organisation préalables ne sont pas aussi faciles à
discerner. S’il semble surpasser tout ce que nous avons rapporté jusqu’à présent,
c’est uniquement parce que nous pouvons mieux en suivre le développement »
(Dotation Carnegie 1914 : 197-198).
44 Ce même rapport signale par ailleurs qu’on aurait voulu procéder de la même manière
à Melnik. Jousselin, le consul de France à Salonique affirme que le bruit avait
faussement couru que des massacres avaient eu lieu à Melnik (AMAE FAA Série A
286/10). La rumeur selon laquelle les Grecs auraient brûlé leurs maisons pour ne pas les
livrer aux Bulgares était sans fondement mais semble indiquer que l’intention était bel
et bien là et, si la chose ne s’est pas produite, c’est à cause de la mésaventure de
Strumica. Un article de L’Illustration, du 30 août 1913, intitulé « le suicide d’une ville »,
affirme que la ville avait été brulée par ses habitants grecs, ce qui semble indiquer
qu’une source grecque avait informé préalablement la rédaction du journal –
probablement par l’intermédiaire de son correspondant Jean Leune, dont la
connivence avec les autorités grecques est bien connue par ailleurs – du projet
d’incendier la ville et que le journal ne s’est pas donné la peine de vérifier si ce projet a
été finalement réalisé (L’Illustration, 30 août 1913 : 161). Il est d’ailleurs probable qu’un
plan similaire a été discuté pour les villes de la Thrace occidentale. Avant l’incendie de
Strumica, si l’on en croit le rapport Carnegie (Dotation Carnegie 1914 : 194), « on savait
d’avance à Salonique qu’après l’expatriation forcée des Grecs, des Juifs et des Turcs, la
ville serait vouée à la destruction, comme Xanthi, Gumuljina et les autres villes de la
Thrace25. Les consuls étrangers de Salonique, après avoir reçu des avertissements,
délibérèrent ensemble et télégraphièrent à leurs ambassades pour qu’on fît des
représentations à Athènes. Le gouvernement grec consentit à garder ces localités
jusqu’à l’arrivée de l’armée bulgare ». Une confirmation de ce renseignement nous
donne la dépêche de Bulgaridès, gérant de l’agence consulaire de France à Kavala, à
Jousselin, consul de France à Salonique, daté du 8 septembre 1913 : « Le Gouvernement
hellénique avait formellement défendu aux populations grecques d’incendier les villes
qu’elles abandonnaient et c’est grâce à cette défense formelle que nous n’avons pas à
déplorer la destruction de Xanthis, car les habitants grecs de cette dernière ville
avaient l’intention d’incendier leurs demeures avant de les quitter » (AMAE FAA Série A
288/12).
45 On peut donc penser que, jusqu’à la veille des négociations de Bucarest, certains
dirigeants grecs, le roi, l’armée ainsi qu’une partie du « mécanisme macédonien grec »
espéraient que la nouvelle frontière grecque allait s’établir sur la ligne Gevgelija-
Strumica-Melnik26-Nevrokop (ayant même quelques espoirs que la Thrace occidentale
pourrait redevenir ottomane, cf. infra § 115) et avaient brûlé les villages exarchistes des
alentours sans toucher aux villes elles-mêmes. Mais, dès lors qu’il est devenu clair que
ces quatre villes resteraient en dehors de la Grèce, ils ont incité la population
patriarchiste ou grecque des trois dernières, adjugées à la Bulgarie à Bucarest
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
190
(Gevgelija est revenue à la Serbie), ainsi que celle des villages patriarchistes qui en
dépendent à les quitter pour émigrer dans le nouveau territoire grec et ont brûlé
Strumica. Ces populations ont ainsi servi à la diplomatie grecque pour asseoir la thèse
de l’échange de fait, qui allait devenir la position intransigeante du gouvernement grec
devant l’insistance des Bulgares à réclamer le retour des réfugiés de la Macédoine
orientale, avant qu’ils ne participent à cette logique en Thrace occidentale. Elles ont
également servi à donner après coup l’impression d’une équivalence, voire d’une
réciprocité, faisant apparaître le forfait de Kilkis sous le jour d’une fuite volontaire :
« Grecs » et Turcs de Strumica ont délibérément quitté leur pays avant l’entrée des
Bulgares, ne pouvant accepter l’idée de leur régime ; les « Bulgares » de Kilkis ont de
même volontairement quitté le leur, ne pouvant accepter le régime hellénique.
46 Ainsi, le cas de Strumica illustre bien la dialectique entre intention et contingence dont
je vous ai parlé plus haut. La décision de pousser la population patriarchiste à
l’émigration et de brûler la ville a été prise en quelque sorte ad hoc, en fonction des
évolutions diplomatiques qui ont décidé que celle-ci ne ferait pas partie du territoire
grec. Pourtant, à partir de ce moment, un plan très complet a été rapidement élaboré et
mis en œuvre. Les patriarchistes ont été incités à émigrer – avec les musulmans de la
ville –, leurs biens transportés et leurs quartiers brûlés. Ici, l’intention est manifeste
ainsi que la planification et la mise en application.
47 Ce n’est pas tout : le plan élaboré dans le cas des réfugiés de Strumica – ainsi que celui
sur ceux de Melnik – n’est possible qu’en raison de ce qui c’est passé à Kilkis. C’est le
forfait de Kilkis – les propriétés que sa population a été forcée d’abandonner, dont
l’État grec aurait tôt ou tard à s’occuper aussi bien d’un point de vue démographique
que juridique – qui amènent l’idée d’évacuer Strumica et Melnik, de faire semblant que
leurs populations patriarchistes ont était forcées à émigrer par peur de l’ennemi et par
patriotisme, d’installer enfin celles-ci dans les maisons et les terres abandonnées par la
population de Kilkis, afin d’inventer un cadre de réciprocité dans lequel l’affaire des
réfugiés pourrait être considérée comme étant réglée.
48 Vous voyez donc que ce que j’ai appelé plus haut une logique d’échange de fait se
cristallise progressivement, en fonction des choix rendus possibles par les événements
historiques et les négociations diplomatiques (leur part d’intention et celle de
contingence), pour former enfin une politique consciente et délibérée que les
diplomates français ne tardent pas à déchiffrer, en dénonçant les violations du droit
qu’elle implique, tout en considérant ses avantages éventuels pour la pacification de la
région. Permettez-moi de vous lire à ce propos un extrait d’une dépêche envoyée le 17
octobre 1913 par le chargé d’affaires de la République française à Sofia, au ministre des
Affaires étrangères Stephen Pichon :
« J’ai reçu, d’autre part, dans ces derniers temps du Ministère royal des Affaires
étrangères [bulgare] quatre notes que j’ai l’honneur d’adresser ci-joint en copie à
V.E. Elles signalent les persécutions dont sont l’objet dans les nouveaux territoires
grecs les habitants de race bulgare, soit qu’on les force par la violence à émigrer,
soit qu’on les empêche, après une première émigration, de retourner dans leurs
foyers.
Il semble qu’il y ait de la part des Grecs un plan préconçu pour purger les nouveaux
territoires qu’ils ont conquis de toutes les races étrangères à la leur, bulgare ou
turque, et pour y faire rentrer les habitants de race grecque des territoires
demeurés étrangers. J’en vois une preuve dans la prière qui a été faite à cette
Légation par le gouvernement hellénique de ne plus délivrer de passeport aux
réfugiés originaires des territoires devenus grecs, sans une autorisation préalable
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
191
qui doit être demandée à Athènes, mais qui, jusqu’ici, n’est jamais revenue. Bien
que ce plan soit exécuté avec violence et au mépris de tout droit, il en résultera
peut-être dans l’avenir un état plus stable, les races se trouvant plus naturellement
groupées.
De son côté, le gouvernement bulgare se préoccupe d’établir dans les nouveaux
territoires qu’il va occuper [après le traité de Bucarest] les réfugiés des parties
grecques ou turques de la Thrace et de la Macédoine, qui sont toujours à sa charge,
et qui vont lui fournir des colons, notamment pour les régions de Gumurdjina et de
Stroumitza » (annexe XVIII).
49 Le dernier paragraphe de cette dépêche nous montre également que la Bulgarie, tout
en continuant à réclamer le retour des réfugiés, adopte en partie – en raison du grand
nombre de réfugiés qui affluent dans son territoire suite aux événements en Macédoine
et en Thrace orientale (d’où les Bulgares sont chassés par les Ottomans) – elle aussi la
logique de l’échange, du moins pour la Thrace occidentale, en expulsant les Grecs
indésirables. Son adhésion partielle à ce procédé est mise en évidence par l’annexe du
traité de Constantinople sur l’échange restreint des populations bulgares et
musulmanes dans une profondeur de 20 kilomètres des deux côtés de la frontière
établie après la deuxième guerre balkanique. Les populations en question ayant été déjà
réfugiées de part et d’autre de cette frontière, l’annexe du traité (signé à Andrinople le
15 novembre 1913, un mois et demi après le traité signé le 27 septembre de la même
année) n’a fait en vérité qu’octroyer un statut légal à un fait accompli violent
(Kontogiorgi 2006 : 39 ; Ladas 1932 : 18-20 ; Pentzopoulos 1962 : 54-55) – Elissavet
Kontogiorgi, pour sa part, voit dans cette annexe « le premier échange de populations
dans les Balkans »27.
50 L’adhésion progressive de la Bulgarie à la logique de l’échange de populations est
également lié à une autre dimension du contentieux gréco-bulgare de l’après-guerre
qu’il ne faut pas oublier : la question des otages. Si, comme dans toute guerre, les deux
parties ont fait prisonniers des militaires, l’existence de paramilitaires a été le prétexte,
surtout côté grec, pour étendre les mesures militaires aux civils (notamment les cadres
de l’ancien milet bulgare : notables, prêtres et enseignants d’écoles bulgares et
révolutionnaires notoires). Il a été infligé à ces derniers, tout comme à certains
prisonniers militaires (notamment ceux des régiments macédoniens de l’armée
régulière), un traitement allant bien au-delà de toute convention du droit de la guerre
(annexes IV, V, VI et IX et Dotation Carnegie 1914). La non-reprise des relations
diplomatiques après le traité de Bucarest est surtout liée à cette question des otages
civils et militaires, arrêtés autant en Macédoine grecque occidentale qu’orientale.
Permettez-moi de vous lire à ce propos un passage d’une dépêche envoyé le 18
novembre 1913 par le même chargé d’affaires de la République française en Bulgarie au
ministre des Affaires étrangères, Stephen Pichon :
« Mes télégrammes des quinze derniers jours ont mis votre excellence au courant
du conflit qui s’est élevé entre la Bulgarie et la Grèce au sujet de la remise des
prisonniers de guerre bulgares en Grèce ainsi que de la libération des prisonniers
civils bulgares actuellement détenus à Salonique ou dans les îles par les autorités
helléniques. […]
Quelques empressements que veuille bien mettre notre ministre à Athènes à régler
de nombreux cas particuliers et à transmettre au gouvernement hellénique les
réclamations nombreuses et diverses que je ne cesse de recevoir, il ne semble pas
que le Gouvernement hellénique soit jusqu’ici disposé à faire à l’opinion bulgare les
concessions indispensables au rétablissement des rapports normaux. Qu’il y ait
dans les prisons grecques un grand nombre de comitadjis (amis et anciens
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
192
compagnons du ministre royal des Affaires étrangères) cela n’est pas douteux. Mais
il s’y trouve aussi des prêtres, des instituteurs, d’anciens fonctionnaires des
territoires conquis par les armées bulgares, qui y sont retenus contre tout droit. Les
récits unanimes des prisonniers bulgares revenant de Grèce ne me permettent pas
non plus de douter, (malgré les protestations de M. Panas que M. Deville vient de
me transmettre), qu’ils n’y aient été fort mal traités et que le régime des prisons
politiques en Grèce ne soit indigne d’un État moderne. M. Panas, qui servait
autrefois d’intermédiaire entre le gouvernement hellénique et les bandes de
comitadjis grecs, devrait se montrer plus indulgent pour les amis bulgares de M.
Ghénadieff » (annexe IX).
51 Pour régler le problème des otages, le gouvernement bulgare propose l’arbitrage du
président de la République française, Raymond Poincaré, proposition qui est rejetée par
les Grecs. Le chargé d’affaires français en Bulgarie écrit le 29 décembre 1913 :
« Votre excellence me permettra donc d’exprimer le vœu que le gouvernement de
la République, d’accord avec le gouvernement russe, use de toute son influence à
Athènes pour amener le gouvernement hellénique à fixer enfin un délai à la
libération définitive des quelques centaines de prisonniers bulgares qu’il détient
encore. Il est bien évident que si M. Venizélos a fait en sorte d’éviter l’arbitrage
proposé par le gouvernement bulgare, c’est que son attitude n’est pas soutenable en
droit » (annexe VI).
52 Tout cela n’est pas sans rapport avec la pression que les vainqueurs exercent sur les
vaincus pour faire accepter le principe de l’échange des propriétés et des personnes,
que les diplomates français commencent à percevoir comme une solution préférable F0 2D
2D à la brutalité qui règne de part et d’autre
malgré le mépris du droit qu’elle implique F0
sur le terrain (AMAE FAA Série A 286/8, annexe VIII). Les Bulgares n’ont pu prendre des
otages que parmi les notables grecs de Thrace occidentale et ils les ont relâchés
relativement vite. Immanquablement, ils allaient donc s’acharner contre les
ressortissants grecs de Bulgarie (même ceux de l’ancienne Bulgarie), menaçant de les
expulser, et maltraiter la population grecque de la Thrace occidentale qui leur avait été
adjugée à Bucarest (AMAE FAA Série A 288/27 29/12/1913, Série A 288/29 et 30,
2/1/1914 et Série A 288/31 5/12/1913). Le chargé d’affaires français à Sofia avait bien
saisi le rapport implicite que les persécutions des Grecs de Thrace occidentale
entretenaient avec la question des prisonniers bulgares en Grèce :
« Le gouvernement bulgare ne possède aucun otage grec, il ne m’a pas été difficile
d’en conclure que les persécutions exercées depuis quelque temps en Thrace
n’avaient d’autre but que de procurer au gouvernement bulgare les moyens de
pression qui lui manquent pour obtenir de la Grèce satisfaction » (annexe VI).
53 Ainsi, ceux des Grecs de Thrace occidentale qui ne sont pas partis avec l’armée grecque
après le traité de Bucarest, ont été forcés à émigrer dans les nouvelles provinces
grecques, ne faisant qu’ajouter au contentieux lourd de conséquences qui allait
retarder le rétablissement des relations diplomatiques et fournir l’occasion à la partie
grecque de surenchérir sur les procédés violents mis en œuvre par les Bulgares
(Anonyme 1914) et de noircir encore la mauvaise réputation que ces derniers s’étaient
acquis pendant la deuxième guerre balkanique. Pendant cette crise diplomatique,
l’aménagement démographique de la partie grecque de la Macédoine pouvait se
poursuivre, tout comme celui de la Thrace occidentale bulgare, tributaire des
événements qui ont eu lieu en Macédoine et en Thrace orientale, passée à feu et à sang
pendant la reconquête ottomane, en riposte à la brutalité des Bulgares envers les
musulmans pendant leur marche vers Çatalca, lors de la première guerre, qui avait
provoqué un énorme exode de musulmans. L’exode de Bulgares des nouveaux
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
193
territoires grecs se poursuit, bien que moins important que celui des musulmans 28, sous
l’œil satisfait des autorités grecques (AMAE FAA Série A 289 25/3/1914). Les grandes
puissances, et notamment la France, offrent leurs bons offices en tant
qu’intermédiaires dans la gestion de cette crise, ce qui donne lieu à une volumineuse
correspondance diplomatique (annexe IX). À cette correspondance appartiennent les
passages suivants – issus le premier de la plume du chargé d’affaires français à Athènes
et le second de celle de l’ambassadeur français à Sofia – qui résument bien la question
des réfugiés et des otages, en mettant l’accent sur la logique d’échange qu’elle
comportait, les problèmes qu’elle soulevait du point de vue du droit et l’aval tacite
qu’ils étaient, malgré ceux-ci, en train de lui accorder :
« Il n’est pas contestable, non plus, que l’hellénisation à outrance de Macédoine
soit le but vers lequel tendent aujourd’hui les efforts de la Grèce, dont le plus vif
désir serait de faire émigrer toutes les populations de race bulgare, pour établir à
leur place les réfugiés qui arrivent de Thrace et de Bulgarie. Je tiens de très bonne
source que le gouvernement souhaiterait, par exemple, qu’il fût procédé à un
échange entre les propriétés actuellement vacantes, d’une part à Kilkich, de l’autre
à Melnik, et qu’elles fussent légalement attribuées aux réfugiés, qui resteraient
ainsi définitivement du côté où ils se trouvent aujourd’hui. C’est là une opération
sur laquelle je partage entièrement l’avis de mon collègue de Sofia et quant aux
avantages qu’elle pourrait offrir et quant au mépris du droit qu’elle suppose. Les
dissidents qui se trouveront trop attachés au sol natal pour consentir à transporter
sous d’autres cieux leur foyer familial devront s’helléniser de langue et de religion
sous peine d’être en butte aux pires persécutions » (AMAE FAA Série A 286/8
8/12/1913).
« Les deux gouvernements d’Athènes et de Sophia favorisent également par des
moyens qui gagneraient à s’inspirer des idées de justice et d’humanité l’exode
rapide et général des populations qui, n’étant pas de leur race, ne sont pas
considérées comme “désirables”, ce qui leur permet en même temps d’installer à la
place de celles-ci les exilés victimes de la mauvaise volonté de l’adversaire.
Si je m’en rapporte aux indications reçues par cette Légation, il est permis
d’avancer que cette manière de voir a été adoptée dès la fin d’août par le
gouvernement hellène et que les Bulgares ont agi par réciprocité mais avec une
main plus rude » (annexe VIII).
54 Pour finir sur la logique d’échange de fait qui a été adoptée et fermement défendue du
côté grec concernant les réfugiés de la deuxième guerre balkanique, je voudrais me
référer sur les antécédents de cette logique, qui s’est cristallisée progressivement dans
le cadre des violences contre les populations civiles, commencées en 1905-1906. C’est à
cette époque du déchainement de la guerre des bandes en Macédoine, que les
populations, non uniquement macédoniennes, ont commencé à devenir les otages de
deux stratégies nationalistes agissant sur elles par « réciprocité » : par riposte et
contre-riposte. Après le massacre perpétré en 1905 par les bandes grecques dans le
village de Zagoritsani de la région de Kastoria (cf. infra § 89), qui a fait 78 morts,
l’organisation nationaliste bulgare Bâlgarski Rodoliubets, formée surtout de réfugiés
macédoniens en Bulgarie, a commencé à attaquer les communautés grecques de ce
pays, dont les membres, citoyens bulgares depuis 1878 ou 1885, n’avaient jamais
souffert auparavant de la moindre infraction à leurs droits. Les attaques ont pris en
1906 la forme d’un pogrome généralisé, provoquant le départ en Grèce de plusieurs
dizaines de milliers de personnes (dont la partie la plus importante est par la suite
rentrée, les Grecs de Bulgarie ne constituant pas un enjeu démographique pour ce
dernier pays, mais uniquement, à partir de cette époque, un objet de pression contre la
Grèce). Sans poursuivre suffisamment les coupables, le gouvernement bulgare n’a pas
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
194
non plus restitué les propriétés communautaires grecques confisquées pendant le
pogrome29. Dans cet événement – et notamment dans la pratique administrative qui en
a suivi : l’impunité des coupables et le non-retour des propriétés – nous voyons pour la
première fois s’esquisser une politique démographique concernant des populations
qu’on considère liées à l’ennemi, nonobstant le fait que ces dernières n’avaient
strictement rien à faire avec l’objet du litige : la Macédoine ottomane. Le conflit pour le
territoire se transformait ainsi progressivement en une « guerre démographique »
(selon l’expression de Mark Pinson [1970]), qui contenait en germe la longue série
d’échanges de populations qui allaient suivre. À partir de cette époque, la « guerre
démographique » se poursuit en s’amplifiant, en amont des décisions diplomatiques,
qui viennent accorder rétrospectivement une légalité aux violences perpétrées et
encourageant par là la poursuite de la « guerre démographique », jusqu’à l’épuisement
des munitions : les populations considérées ennemies. Il faudrait par ailleurs souligner
la centralité dans cette « guerre démographique » de l’instrumentalisation des réfugiés,
qu’on installe la plupart des fois parmi les populations qu’on considère liées à l’ennemi
et qu’on pousse à agir contre elles. Tel a été le cas des réfugiés bulgares de Macédoine
et de Thrace orientale, constituant l’instrument des violences perpétrées, après la
seconde guerre balkanique, contre les Grecs de Thrace occidentale, en provoquant
l’exode massif de ces derniers, qui ont constitué à leur tour l’instrument des violences
infligées aux Bulgares et aux musulmans de la Macédoine grecque. Poussé ainsi à
l’émigration massive vers l’Empire ottoman, ces musulmans ont été installés pour la
plupart parmi les populations grecques de Thrace orientale et d’Asie Mineure, qu’ils
ont à plusieurs reprises attaquées, sous l’impulsion du CUP, visant à pousser les Grecs
de ces régions à émigrer (Sigalas 2012). Dans le contexte général de cette guerre
démographique, qui se propageait comme une tache d’encre sur la carte des Balkans et
d’Asie Mineure, l’événement de Kilkis occupe une place spéciale : il constitue la
première mise en application, ad hoc, dans le cours même des événements guerriers,
d’une logique territoriale, antérieurement cristallisée ; et cette mise en application a
été doublée d’une mise en scène médiatique et diplomatique, visant à produire un fait
accomplit, l’échange de fait et d’anticiper sa validation juridique ultérieure. Ce qu’on ne
pouvait pas évidement prévoir c’était la forme que la « guerre démographique » allait
prendre par la suite, après l’échange bulgaro-ottoman, frayant la voie à l’alliance de ces
deux pays, et l’éclatement de la Grande Guerre, qui allait radicaliser davantage la
violence contre les populations civiles et impliquer l’ajournement de la validation
juridique de l’« échange de fait » de Kilkis jusqu’au traité de Neuilly.
IV. Violence et territoire. La spécificité de Kilkis et de
Doxato dans les logiques territoriales des deux
adversaires.
55 N. S. : Vous avez dit que l’attitude de l’État grec envers la population orthodoxe de
Kilkis émanait d’une logique territoriale. Dans cette logique Kilkis occupe-t-il une place
spéciale ? En d’autres termes, pourquoi cette population a-t-elle fait l’objet d’un
traitement plus violent que d’autres de la part de l’armée grecque ? Pourquoi les Grecs
ont-ils provoqué l’exode de la population slavophone de Kilkis et non pas de celle de
Florina ou de Kastoria, par exemple ?
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
195
56 L. E. : Je vais répondre à votre question en commençant par la fin. Vous me demandez
pourquoi les Grecs ont provoqué l’exode de la population slavophone de Kilkis et non
pas celle de Florina ou de Kastoria et j'ajouterais même celle de Vodéna (aujourd’hui
Edessa) ou de Yanitsa. Je pense que sa simple situation, en tant que ville la plus proche
de la capitale du vilayet de Manastır (en bulgare et en macédonien Bitola, en grec
Monastiri ou Vitolia et en serbe Vitolj) vers le sud, fait de Florina (en bulgare et en
macédonien Lerin)une ville-clé pour revendiquer toute la région jusqu’à la capitale du
vilayet, limite vers le nord des revendications grecques à cette époque. Kastoria (en
bulgare et en macédonien Kostur), quant à elle, constitue la visée maximaliste des
revendications bulgares vers le sud-ouest. Ces deux régions voisines comptent parmi
les théâtres des combats les plus durs et les plus envenimés de la lutte entre bandes
grecques et bulgares, ou macédoniennes, entre 1904 et 1908, parce que les deux
adversaires se sont efforcés de les maintenir comme limites extrêmes de leurs
revendications. Mais ces régions, ainsi que toute la Macédoine à l’ouest du Vardar, ont
été investies par l’armée grecque dès 1912. Celle-ci avait alors « libéré les frères
chrétiens », c’est même en leur nom que la guerre avait été déclarée entre les
puissances orthodoxes balkaniques et l’Empire ottoman. Dès lors que ces régions
comptaient des patriarchistes et des exarchistes, les quatre armées alliées avaient
l’obligation de respecter les sujets loyaux à l’une ou à l’autre d’entre elles. À ce
moment-là, on ne discutait pas de l’avenir des territoires et de leurs habitants, tous les
territoires « libérés » constituaient théoriquement, suivant les accords passés avant la
guerre, un condominium des puissances chrétiennes (bien que le principe d’occupation
première ait primé dans la pratique). Néanmoins, dans les contrées macédoniennes
slavophones investies par les Grecs et par les Serbes, on a obligé le clergé exarchiste à
se déclarer patriarchiste, ce qui n’a pas été le cas là où, à Salonique par exemple, la
présence militaire bulgare a protégé les institutions ecclésiastiques (Dotation Carnegie
1914 : 179). L’inverse, mais à une échelle un peu moindre, se serait produit dans les
zones investies par les Bulgares (Dotation Carnegie 1914 : 187-192). Sitôt déclarée la
seconde guerre, on a immédiatement procédé, dans les territoires investis par la Grèce,
de même que dans ceux investis par la Serbie, à l’élimination des personnes-clefs des
réseaux liés à l’adversaire, que ceux-ci soient militaires, ecclésiastiques, scolaires,
commerçants ou comitadjis, ainsi que des élites intellectuelles 30. Elles seules étaient
visées et non pas la population entière – même exarchiste – d’un village ou d’une ville,
comme ce fut le cas dans la Macédoine à l’est du Vardar. C’est une justice militaire qui
s’est imposée, l’« exceptionnalité » de la guerre permettant des procédés expéditifs,
consistant notamment à taxer toute personne ciblée de collaboration avec l’ennemi. En
outre, une partie des soldats bulgares, volontaires de Macédoine, notamment des
régions que la Grèce a ensuite récupérée (sujets ottomans enrôlés volontairement
pendant la deuxième guerre balkanique et particulièrement présents sur le front grec),
a été considérée comme comitadjis et traitée en conséquence. On lit dans une dépêche
du chargé d’affaires français à Sofia :
5B … 5D M. Ghénadieff paraît avoir surtout à cœur le sort des soldats bulgares
« F0 F0
originaires des parties maintenant grecques ou serbes de la Macédoine et qui soit
pendant, soit après la première guerre balkanique, s’engagèrent dans l’armée
bulgare où ils formèrent les légions macédonienne et andrinopolitaine. Ils
combattaient principalement dans la 2e armée commandée par Ivanoff, d’abord au
siège d’Andrinople, puis contre l’armée du roi Constantin. Peut-être le ressentiment
particulier des Grecs contre ces soldats volontaires peut-il s’expliquer ainsi. Mais on
pourrait difficilement soutenir qu’ils ne faisaient pas partie de l’armée régulière
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
196
bulgare. En droit d’ailleurs, ils n’étaient pas Serbes ou Grecs, mais Ottomans. Les
uns portaient la casquette de l’armée bulgare, les autres, comme un grand nombre
de réservistes bulgares, n’avaient aucun uniforme mais ils étaient régulièrement
encadrés et commandés. […]
Les Grecs ont voulu considérer tous les Macédoniens engagés dans l’armée bulgare
comme des comitadjis . Ils en ont clandestinement fusillé un grand nombre ; les
autres sont en prison et seront déférés à des cours martiales » (annexe V).
57 Il y a eu des exécutions sommaires sur place31, des gens emmenés en otages dans des
prisons de l’État grec – ce sont ces otages qui ont constitué l’objet du contentieux
diplomatique dont je vous parlais tout à l’heure – ceux qui ont échappé aux exécutions
ont été extradés plus tard en Bulgarie. Le même sort a été réservé aux membres des
élites citadines bulgaro-macédoniennes de Salonique – après la disparition de la
présence militaire bulgare au tout début de la seconde guerre – comme le vicaire de la
métropolie exarchiste, l’archimandrite Evlogje, et le secrétaire de la communauté
exarchiste de la ville et membre fondateur de l’ORIM, Kristo Batandjiev, torturés sur les
bateaux qui les conduisaient depuis Salonique soit au camp de concentration pour
prisonniers de la presqu’île de Trikéri en Thessalie maritime soit à Ithaque, avant d’être
assassinés et jetés à la mer (Kostopoulos 2007 : 57 ; Dotation Carnegie 1914 : 178-181).
58 Toute la Macédoine investie par la Grèce pendant la première guerre balkanique a subi,
avant, mais surtout pendant la courte guerre de 1913 et aussitôt après, une
« désexarchisation » quasi-totale. Le « retour à la Grande Église » a été proclamé en
grande pompe comme s’il avait été spontané. Ajoutons ici qu’à Yanitsa, où ils étaient
particulièrement présents (davantage encore qu’à Kilkis, même s’ils étaient
minoritaires par rapport aux exarchistes), la plupart des uniates ont été forcés de se
convertir (cf. annexe I).
59 Vous voyez donc que la différence de sort réservé, d’un côté, à la population
slavophone exarchiste de la Macédoine à l’ouest du Vardar F0 2D exception faite des
villages de Gevgelija qui ont subi la guerre 2D et, de l’autre, à celle des régions de Kilkis,
F0
de Langada, de Serrès, et de Drama, tient en partie au contexte de la guerre et à la part
de contingence que celle-ci comporte. L’incorporation dans l’État grec des régions de la
Macédoine occidentale s’effectue dans des conditions tout à fait différentes de celle des
régions de la Macédoine orientale (Michaïlidis 2003 : 73-89). Le contexte de la première
guerre balkanique interdisait toute violence contre des orthodoxes (patriarchistes ou
exarchistes). Et, si la deuxième guerre balkanique pouvait fournir des prétextes pour
l’éviction des populations exarchistes des régions conquises par l’armée grecque dans
sa marche contre l’armée bulgare, elle ne pouvait pour autant légitimer l’évacuation
des populations des régions investies auparavant, du temps de l’alliance. La
« débulgarisation » de ces régions a donc dû prendre la forme d’un passage au crible
sélectif et non pas celle de l’éviction de la population d’un village, d’une ville ou d’une
région toute entière. Une autre différence entre les régions slavophones de la
Macédoine occidentale et celles de la Macédoine orientale tient au fait que les secondes
ont été, pendant sept mois, administrées par les Bulgares et leur armée, ce qui a été
l’occasion pour leurs habitants slavophones d'exprimer plus ouvertement leur
sympathie envers ces derniers et de se déclarer volontaires dans leur armée. Il ne faut
pas perdre de vue, par ailleurs, que, dans le cas de la Macédoine occidentale, pendant la
deuxième guerre balkanique, la zone d’occupation grecque touche la zone d’occupation
serbe, la Serbie, pays allié, administrant lui aussi des populations slaves mais non
serbes. En Macédoine orientale, en revanche, la proximité de la Bulgarie transforme les
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
197
slavophones exarchistes en éléments de potentielle revendication territoriale, les
slavophones patriarchistes pouvant, en raison de leur langue et du fait qu’un grand
nombre d’entre eux n’étaient pas « sûrs » aux yeux de l’administration grecque, n’étant
Grecs que nominalement, constituer un élément qui induit à occulter au maximum leur
présence, en jouant sur la peur née de l’expérience de la seconde guerre balkanique,
peur qui était moins forte dans la Macédoine grecque à l’ouest du Vardar. Dans tous les
recensements postérieurs, on ne retrouve qu’un très petit nombre de slavophones,
l’affaire étant plus facile à occulter qu’à l’ouest du Vardar, du fait de l’exode massif de
1913 et du grand nombre d’échangés lors du processus d’échange après Neuilly. Jusqu’à
nos jours, l’impression qui prévaut est que, dans les départements de Serrès, de Drama
et dans l’éparchie de Langada du département de Salonique, il n’y a pas de population
slavophone ou ex-slavophone importante, ce qui est faux, surtout dans le cas du
département de Serrès.
60 La différence de sort réservé à la population s’explique donc avant tout par le contexte
de l’incorporation de ces régions. Concernant toutefois la région de Kilkis, entre en
ligne de compte un autre facteur qui la différencie, cette fois-ci, également des régions
de Langada, de Serrès et de Drama, et explique pourquoi l’on assiste, en l’occurrence, à
une expulsion massive à l’échelle d’une ville et de sa région, alors que celle-ci est plus
sélective et s’exerce à l’échelle du village dans les trois autres cas. Dans la raison
territoriale grecque, Kilkis occupe une place particulière. Sur ce point, il convient de se
référer d’emblée aux travaux importants que Spyros Karavas (2002a) y a consacré, pour
comprendre la tentative grecque de faire surgir dans cette ville entièrement exarchiste,
comportant une population uniate résiduelle, une communauté patriarchiste. Cette
tentative échoue complètement, ce qui fait que la région demeure la seule de toute la
Macédoine méridionale où l’on chercherait vainement ou presque l’ombre d’un
patriarchiste et, par conséquent, elle ne peut pas être revendiquée par les Grecs, dans la
mesure où c’est à travers sa population qu’un territoire est revendiqué. Toutefois,
compte tenu de la position stratégique que Kilkis occupe dans l’arrière-pays immédiat
de Salonique, les Grecs ne peuvent pas se passer de cette ville. Pour reprendre
l’expression utilisée dans la correspondance diplomatique grecque, c’est une « brèche
ouverte dans le dos de l’Hellénisme », les limites méridionales de cette « brèche »
atteignent la ville même de Salonique, capitale de la Macédoine. En effet, à l’ouest, au
nord-ouest et au nord, Salonique est entourée de villages slavophones, exarchistes pour
certains ; tandis qu’au nord-est, à l’est et au sud-est, vers Langada et la Chalcidique, on
recense dans son voisinage immédiat des villages grécophones. Dans un rapport, A.
Xantopoulo, fondateur de la « Ligue Macédonienne » de Kavala, adressé au ministère
des Affaires étrangères en 1905, écrivait : « si nous n’arrivons pas à dominer Kilkis par
notre travail de prosélytisme, nous nous verrons obligés de la rayer, d’une façon ou
d’une autre, de la carte ». Et Karavas de conclure : « la solution finale, si elle n’a pas été
planifiée d’avance, avait été prévue. C’était d’ailleurs la manière la plus réaliste de
dominer cet espace » (Karavas 2002a : 32).
61 Sur ce point, il serait intéressant de comparer la logique territoriale grecque en
Macédoine avec celle de la Bulgarie et de voir comment cette logique territoriale se
concrétise dans les procédés violents de l’armée bulgare envers les populations civiles
grecques ou slavophones patriarchistes pendant la deuxième guerre balkanique. Pour
ce faire, il convient de se pencher davantage sur les événements de Nigrita (Anonyme
1914 : 55-63, Zoroyannidis 1975) et de Doxato en se référant en passant aux incendies et
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
198
aux violences perpétrés à Serrès (Anonyme 1914 : 122-208) et à Demirhisar (Anonyme
1914 : 75-113).
62 Nigrita était un bourg agricole, entièrement grécophone et chef-lieu d’un nahiye par où
passe la frontière linguistique gréco-slave et où elle est la moins nette de tout son
parcours, très important pour le maintien de l’une ou de l’autre armée dans le bassin
du Bas Strymon sur la route cruciale de Salonique à Serrès et à Sofia. Les nombreux cas
d’insubordination de la population grecque du bourg et des villages des environs
(grécophones ou slavophones patriarchistes) aux décrets de l’administration militaire
bulgare et la tendance de celle-ci à la répression violente, perturbant les bonnes
relations entre les alliés, faisaient de Nigrita le point le plus sensible de la coexistence
pacifique gréco-bulgare (Ministère des Armées III – 1932 et III-1 – 1934). La population
grecque de Nigrita et grecque ou slave patriarchiste des villages voisins (surtout
Dimitritsi) a payé le prix de la configuration territoriale de la région. Celle-ci ouvrait
pour les Bulgares la route de Salonique, pour les Grecs, celle de Serrès. Suite aux
violences de l’armée bulgare envers les habitants, lors de la bataille de Lahana, et à la
sauvage évacuation des lieux, les Grecs découvrent plusieurs morts (Zoroyannidis 1975)
et le bourg incendié. Si les événements de Nigrita n’ont pas eu autant d’écho que ceux
de Serrès et de Doxato, c’est peut-être parce qu’ils ont eu lieu pendant les tout premiers
jours de la guerre et que les cadavres, en tant que preuve du crime, ont, du fait de la
canicule qui régnait, été enterrés très vite par l’armée grecque poursuivant l’adversaire
en fuite, celle-ci ne se préoccupant pas de les exhiber aux journalistes étrangers et aux
consuls des puissances – erreur qu’on a pris soin de corriger par la suite, surtout du
côté grec ; les Bulgares, eux, en pleine débâcle, n’avaient ni assez de temps, ni assez de
moyens ni le contrôle du territoire pour pouvoir songer à réunir des preuves des
violences de l’adversaire. Zoroyannidis lui-même décrit comment il a procédé à
l’enterrement des victimes (Zoroyannidis 1975) ; quant à Jousselin, suspicieux envers
toute allégation grecque, il ne reconnaît pas les violences bulgares (AMAE FAA Série A
286/8 8/9/1913 et annexe II). Les Grecs font venir des journalistes étrangers in situ pour
attester les faits mais trop tard, puisque les corps ont déjà été enterrés (annexe II).
Jousselin, tout en mentionnant l’existence de témoins oculaires israélites à Nigrita et
Serrès, se refuse à rapporter leurs dires, ces derniers eux-mêmes n’ayant pas déposé
par écrit (annexe I). Toutefois, il me semble que c’est après cet avatar, dû à une
mauvaise coordination et à une méconnaissance des procédés de la propagande de
guerre, que la campagne grecque sur les atrocités de l’adversaire s’est perfectionnée.
C’est là, qu’à mon sens, il faut situer la naissance de la stratégie grecque de promotion
des atrocités bulgares : au lieu de répondre directement à des accusations portées
contre soi, on répond en insistant sur les violences plus graves de l’adversaire (cf. infra :
113).
63 Les événements de Serrès impliquent une lutte sans merci pour le maintien de cette
ville, cruciale pour les deux adversaires (parce qu’elle constitue pratiquement la
capitale de la Macédoine orientale), et entraînent des violences extrêmes de part et
d’autre, l’incendie final étant clairement dû aux Bulgares. Les preuves évidentes de ce
forfait ont permis de laisser dans l’ombre les exactions grecques (annexe XIX).
64 Demirhisar (aujourd’hui Sidirokastro) est la capitale d’un kaza entièrement slavophone,
quant à sa population chrétienne (à l’exception de deux ou trois installations
aroumaines et de quelques villages de laboureurs roma orthodoxes) et majoritairement
exarchiste. Seulement dans la ville existait un noyau grécophone, notamment parmi
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
199
l’élite de la population, constituant avec les Aroumains hellénisants de Gorni Proï
(aujourd’hui Anô Poroïa), le support de l’influence culturelle grecque dans la région. Il
n’est donc pas difficile de comprendre pourquoi l’armée bulgare – espérant
probablement, même en retraite, un retour éventuel – a exécuté et jeté dans une fosse
commune soixante-quatorze personnes choisies parmi les notables grecs de la ville.
65 Doxato, dans le kaza de Drama, bourg spécialisé dans la culture et le commerce du
tabac, constituait, avec deux autres villages voisins, une enclave grécophone rurale. Les
villages de la plaine étaient en majorité musulmans turcophones, ceux des piedmonts
et d’altitude au nord étaient slavophones chrétiens et musulmans (turcophones ou
slavophones), ceux du Pangée au sud-ouest ainsi que le littoral étant grécophones
chrétiens et turcophones musulmans. Ce bourg et les deux villages grécophones
avoisinants32 constituaient ainsi le principal argument des prétentions grecques dans le
kaza de Drama : outre cette dernière ville, qui compte une importante communauté
grecque et les villages patriarchistes slavophones de la région, la présence de trois
villages grécophones vient servir la démonstration, qui opère toujours par amalgame
(continuum paysan grécophone-slavophone patriarchiste) du caractère grec du kaza de
Drama. Doxato constituait pour les Grecs le principal lien entre le littoral de Kavala et
Drama. Voici comment le chargé d’affaires de l’Ambassade de France à Athènes,
Poulpiquet du Halgouët, définit la position de ce bourg, dans un rapport de 17 pages qui
constitue l’enquête concernant les atrocités bulgares contre les Grecs la plus proche des
événements33:
« Si l’on ne tient compte que du nombre de ses habitants (2 200 Grecs et 1 900
musulmans), Doxate n’est qu’un village. Mais cette localité est depuis longtemps
considérée comme le centre de l’hellénisme dans la contrée et la richesse qu’elle
tire du commerce des tabacs est proverbiale dans le pays. D’importantes remises en
numéraire venaient précisément de parvenir aux gros commerçants de la ville,
lorsqu’on apprit les premières défaites de l’armée bulgare » (annexe III).
66 Selon les témoignages, surtout bulgares, rapportés par la Commission Carnegie, il y
avait d’abord eu une embuscade armée à laquelle des andartès avaient obstinément
résisté (Dotation Carnegie 1914 : 64-67). L’arrière-garde de l’armée bulgare a fini par
réussir à entrer dans le bourg et a massacré tous les Grecs qu’elle rencontrait dans les
rues, la cavalerie se chargeant de ceux qui fuyaient vers les campagnes. Des musulmans
de Doxato et des villages avoisinants, armés par l’armée bulgare, ont ensuite pillé et
massacré pendant deux jours les Grecs du bourg, se vengeant de ces derniers qui, selon
un autre témoignage (Pelletier 1913 : 62-67), les avaient maltraités et avaient
transformé leur mosquée en église. Ces violences coûtèrent la vie à 500 Grecs au bas
mot. Le bourg fut ensuite incendié et brûla presque entièrement. De tous les
événements violents de la deuxième guerre balkanique, c’est celui qui a connu, avec
celui de Serrès, le plus grand retentissement. Il est décrit en détail dans l’enquête dont
je vous parlais tout à l’heure rédigée par le chargé d’affaires de l’Ambassade de France à
Athènes, Poulpiquet du Halgouët (annexe III).
67 La responsabilité de ce massacre incombe à l’armée bulgare. On pourrait supposer
qu’elle l’avait perpétré pour enlever aux Grecs ce qui a été, comme je l’ai dit, le
principal argument au service de leurs prétentions dans le kaza. Toutefois, la présence à
ce moment des colonnes grecques à une faible distance de la région, ce qui ne laissait
aux Bulgares que peu de chances de garder le bourg, invite à relativiser cette
hypothèse. Il faut aussi compter avec un autre élément non négligeable : la résistance
armée des andartès grecs (des proskopi selon d’autres sources) qui donne aux massacres
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
200
et à l’incendie de Doxato un caractère de représailles. C’est là un facteur qui a sans
doute joué un rôle dans le déclenchement du massacre et qui peut contribuer à
expliquer que les Bulgares aient armé les musulmans contre les Grecs – mais qui
n’exclut en aucune façon qu’un calcul d’ordre territorial soit entré en ligne de compte
chez les dirigeants de l’armée bulgare.
68 Les quatre exemples que je viens de mentionner (Nigrita, Serrès, Demir-hisar et
Doxato) ont un point commun : ce sont des villes, ou bourgs, qui ont eu une importance
particulière pour « l’hellénisme » de leurs régions. De par leur hellénophonie
vernaculaire, et éventuellement par le prestige social de leurs habitants hellénophones,
ces villes et bourgades étaient centrales pour la revendication par les Grecs de régions
dont la population était mixte ou majoritairement slavophone (patriarchiste ou
exarchiste) – et dans le cas de Doxato, bien qu’entouré surtout de villages turcophones
musulmans, parce qu’il soulignait la continuité de la présence grecque entre Kavala et
Drama et ouvrait à la Bulgarie la voie vers le littoral de Kavala, tant désirée 34. Ils
occupaient ainsi une place centrale dans la logique territoriale grecque et, partant,
dans la logique territoriale bulgare, en tant que « positions avancées » de l’adversaire.
De ce fait, on ne peut pas négliger la thèse du chargé d’affaires de la République
française à Athènes, selon laquelle les massacres et incendies en question ont fait partie
d’un plan d’ensemble. Je vous lis une autre partie de son enquête :
« Les atteintes ainsi portées à l’élément grec en Macédoine dénotent une
préméditation, pour peu qu’on considère que les faits incriminés se placent tout
aussitôt après les premières défaites de l’armée bulgare. Ses chefs ont évidemment
éprouvé une vive surprise de leurs échecs et, contraints de reculer devant un
ennemi qu’ils avaient jusque-là méprisé, ils auront voulu faire payer leur
déconvenue aux populations helléniques des territoires qu’ils étaient forcés
d’évacuer. Ce sentiment aurait certes pu se rencontrer chez des détachements
isolés, mais, comment douter que les destructeurs aient obéi à un plan d’ensemble,
lorsqu’on les voit partout aborder les villes de la même manière, chercher à
recruter des complices parmi les musulmans, procéder systématiquement au
pillage, puis à l’incendie, en même temps qu’au meurtre et surtout ne s’attaquer
ainsi qu’à l’élément grec. Car la destruction n’est pas irréfléchie ; parfois il a même
fallu prendre de minutieuses précautions pour éviter qu’elle ne s’étendît à des
propriétés voisines ; un exemple frappant en est offert à Serès, où la Banque de
Bulgarie demeure intacte à côté de la Banque d’Athènes ruinée de fond en comble.
Ce sont là des distinctions que n’eussent assurément point faites des pillards
agissant de leur propre initiative » (annexe III).
69 Cependant il ne faut pas perdre des yeux le fait que, contrairement à la façon de
procéder de l’armée grecque, qui a brulé la ville de Kilkis et les villages de sa région,
ainsi que ceux de celle de Gevgelija, et a brutalisé sa population pendant son avancée,
les incendies et massacres perpétrés par l’armée bulgare ont eu lieu pendant la retraite
de cette dernière. Ce qui relativise l’hypothèse d’une planification préalable ou, tout au
moins, celle d’une planification ayant lieu beaucoup de temps avant les événements.
D’ailleurs, au moment où elle perpétrait ces violences (sauf celles de Nigrita), l’armée
bulgare avait connaissance des événements de Kilkis, que l’opinion européenne
ignorait et que le chargé d’affaires à Athènes semblait ne pas prendre en considération.
Je vous lis une partie de la dépêche par laquelle l’ambassadeur français à
Sofia, De Panafieu, a réagi à la réception de l’enquête de son collègue d’Athènes :
« Notre chargé d’affaires a pu établir que les pillages, les meurtres et les incendies
commis par les Bulgares l’ont été par les troupes régulières, suivant une méthode
unique et un plan d’ensemble. Cela est possible, mais si ces crimes ont été commis,
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
201
ils l’ont été lors de la retraite, quand les troupes ont été contraintes de reculer, à un
moment où l’excitation du combat n’était pas tombée, où l’esprit de vengeance et
l’exaspération étaient encore à leur comble. Ce n’est pas une excuse, j’en conviens,
mais comment juger les troupes grecques qui, après leurs premiers succès de
Koukouche et de Guévguéli, poursuivant sans combat les Bulgares en retraite,
trouvaient le temps d’entourer froidement et méthodiquement chaque village
bulgare, réunissaient les habitants qui n’avaient pas fui, se faisaient livrer tous les
objets précieux que ceux-ci possédaient, puis mettaient le feu au village et aux
récoltes, après avoir massacré les hommes. Tous les villages bulgares traversés par
l’armée grecque ont été traités de cette manière et si l’on ne veut pas ajouter foi aux
affirmations de témoins oculaires qui ont pu échapper par la fuite, les lettres des
soldats grecs qui ont été publiées et dont l’authenticité ne peut être mise en doute,
malgré les efforts de M. Romanos, suffiraient à prouver l’exactitude de ces pillages,
de ces incendies, de ces meurtres » (annexe XVII).
V. La préhistoire de l’événement. La territorialisation
des prétentions grecques et bulgares en Macédoine.
70 N. S. : Si j’ai bien compris, vous soutenez que la violence infligée, pendant la deuxième
guerre balkanique, aux populations civiles de Macédoine ne peut pas être comprise si
on ne se penche pas sur les logiques territoriales des États qui se sont confrontés dans
cette guerre. Ces logiques, formées bien avant les événements en question et assumées
par les élites politiques des États et par leurs états-majors, seraient ainsi
déterminantes, aussi bien pour les planifications de type démographique antérieurs
aux événements, que pour les décisions ad hoc, intervenues dans le cours de ceux-ci.
Vous replacez ainsi les événements en question dans une perspective de longue durée,
celle de la cristallisation des logiques territoriales grecque et bulgare. Pourriez-vous
nous donner plus d’éléments concernant la formation de ces logiques territoriales,
notamment de la logique territoriale grecque qui est plus directement opérante dans le
cas de Kilkis?
71 L.E. : Pour répondre à votre question, il faudrait commencer par un survol de la
conception grecque et de l’intérêt porté par la Grèce à ce territoire ottoman qu’est la
Macédoine pendant les trente années qui ont suivi, d’abord, l’établissement de
l’exarchat bulgare (1870) et, ensuite, les traités de San Stefano et de Berlin (1878). Les
visées grecques sur la Macédoine, qui a été exclue de la Bulgarie de Berlin (ce traité
constituant une révision de celui de San Stefano) ont été bien décrites par Spyros
Karavas dans ses articles sur la cartographie grecque en Macédoine (Karavas 2002b,
2003a). Il faudrait remonter jusqu’à la période, peu après le milieu du XIX e siècle, où les
Grecs découvrent, la nette majorité de l’« élément slave » en Macédoine, méconnue
jusqu’alors du fait de la prépondérance des villes où le grec était parlé comme langue
véhiculaire et dissimulait la campagne, dont l’oralité slavophone ne perçait pas dans la
sphère publique. C’est à partir de cette époque que commence la politisation de
l’élément linguistique. Jusque-là, même lorsqu’elle était connue des Grecs, la
slavophonie de la région n’était pas perçue comme un problème ni comme un obstacle
aux aspirations du nationalisme grec. La découverte par la Grèce de la véritable
étendue de la slavophonie de la région est liée aux précisions qu’apportent la
linguistique et la géographie linguistique en se constituant comme sciences. De 1840
jusqu’au début du XXe siècle, la cartographie de l’époque montre bien comment se
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
202
précise peu à peu la connaissance des frontières linguistiques entre les groupes parlant
grec, slave, albanais, turc, aroumain, etc.
72 N. S. : Permettez-moi d’intercaler ici une question que j’avais préparée. Nous voyons
que les catégories à travers lesquelles les leaders de la politique nationale grecque,
bulgare et serbe pensent les populations de Macédoine ne sont pas axées sur la
nationalité mais sur la religion et la langue vernaculaire et, certaines fois, c’est le cas
pour les Grecs, sur la langue véhiculaire. Il me semble ainsi que les orthodoxes de
Macédoine ne sont pas considérés par les acteurs de ces politiques comme une
population présentant des caractéristiques nationales mais plutôt comme une
population en voie de nationalisation. L’objectif des politiques en question n'est-il pas
d’influer sur le cours de ce processus de nationalisation ? La territorialisation de ces
trois politiques en Macédoine ne passe-t-elle pas par la maîtrise des moyens que lesdits
processus mettent en œuvre ? Enfin, n’est-ce pas lorsque ce processus n’est plus
maîtrisable, lorsqu’on estime en perdre le contrôle, que la violence éclate ?
73 L. E. : Le principal problème auquel les Grecs ont à faire face est la nette ligne de
contact linguistique qui sépare horizontalement, d’ouest en est, la Macédoine ottomane
en deux principales aires eu égard à la langue vernaculaire, avec, au sud, le grec comme
langue vernaculaire de la population rurale et, au nord, le continuum linguistique
bulgaro-macédonien. Cette ligne de contact est le principal fait linguistique de la
Macédoine, séparant celle-ci en deux aires linguistiques principales : l’une où les
locuteurs des parlers grecs sont majoritaires et où il n’y a pas de locuteurs de parlers
slaves, qui est loin d’atteindre les visées grecques, même minimales, et l’autre,
beaucoup plus vaste, où les locuteurs des parlers slaves sont majoritaires, donnant ainsi
à la conception bulgare de la nation le sentiment d’une large prépondérance. La
Macédoine est une catégorie géographique antiquisante, adaptée à la conception
grecque de l’espace, que les Bulgares adoptent en raison de son historicité et de leur
prépondérance démographique dans la région ainsi désignée. Disons qu’elle est le fait
géographique partagé de deux conceptions antagonistes, mais complémentaires, qui
élaborent une dimension ethnique et spatiale de la Macédoine à travers leur conflit
pour s’approprier son territoire. La géographie de la Macédoine est ainsi une
construction gréco-bulgare qui se fait accepter par les autres nationalismes. Quant aux
autres langues qui y sont éventuellement largement parlées, elles constituent pour les
Grecs et les Bulgares des prolongements d’autres aires de peuplement majoritaires, en
dehors de ce qu’il est convenu d’appeler, depuis le milieu du XIX e siècle, la Macédoine.
D’ailleurs, les Bulgares tentent parfois de voir aussi dans le grec un prolongement de
son aire majoritaire de peuplement, pour les contrées limitrophes de l’État grec ou de
l’Épire ottomane et ne considèrent pas le kaza de Katérini comme faisant partie de la
Macédoine (Kănčov 1900). De la même façon, les Grecs s’efforcent parfois de limiter
l’étendue de la Macédoine par le nord, dans le vilayet du Kossovo, afin de réduire
l’écrasante majorité des slavophones parmi les chrétiens de celle-ci. Quant au turc et à
l’albanais, en dehors des prolongements de leurs aires majoritaires, respectivement au
sud-est et à l’ouest, ils se trouvent parlés dans des enclaves, dont certaines très vastes,
le premier sur toute l’étendue de la Macédoine, et en particulier dans la vallée du
Vardar et dans les kazas de Kozani et de Kaïlar (Ptolémaïda), et le second, dans ses
contrées occidentales35. Dans des enclaves ou des îlots disséminés dans la plus grande
partie de la Macédoine, sont parlées aussi d’autres langues, comptant un nombre
inférieur de locuteurs, telles que l’aroumain et le romani, dont l’aire de peuplement des
locuteurs, quant elle est compacte, constitue des niches écologiques 36. Le
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
203
méglénoroumain37 est parlé dans dix villages du nahiye de Nutya 38 (en grec Notia, en
méglénoroumain Nânti), du kaza de Gevgélja, sur le plateau de la haute Karadjova ou
Haut Meglen ou Vlaho-Mogléna (en slave Meglen, en grec Moglena, aujourd’hui
Almopia) et du mont Païko dont l’économie agropastorale ressemble plus à celle de
leurs voisins slaves qu’à celle des Aroumains. Le judéo-espagnol est aussi parlé à
Salonique et dans la plupart des centres urbains par les Juifs séfarades. À Salonique, ce
groupe ethnoreligieux constitue la majorité relative de la population et sa présence
enlève au grec une partie de son prestige, non pas à cause de son parler vernaculaire
espagnol39, mais de sa langue de culture qu’est le français40.
74 La première grande division, celle qui sépare les parlers grecs, au sud, des parlers
slaves, au nord41, constitue la donne majeure de l’antagonisme gréco-bulgare. Pour les
uns, les précisions apportées par le progrès des connaissances sur le terrain durant le
XIXe siècle, vont dans le sens de la territorialisation de leur prétentions, à travers le
critère ethnolinguistique, et continuent de valoir après l’accession à l’autonomie de la
Bulgarie (les limites des parlers slaves, clarifiées par Constantin Jireček ont quand
même été le principal agent de la démarcation des limites de la « Grande Bulgarie » de
San Stefano, sauf pour le littoral à l’est de la Chalcidique avec Kavala) 42. En revanche,
pour les autres, cette ligne et sa relative et courte territorialisation avec le traité de San
Stefano, constitue l’« épouvantail de l’hellénisme », parce qu’elle est bien en deçà des
aspirations les plus modérées de la Grèce et prive Salonique de son hinterland (Karavas
2006b). Il ne reste donc plus qu’une chose à faire : occulter les donnés
ethnolinguistiques, occulter cette ligne de contact linguistique si claire, et ce, que l’on
s’adresse aux grandes puissances ou à l’opinion grecque (cf. Lafazani1994). À cet effet,
on divise la Macédoine horizontalement en trois zones, ce qui permet de faire
disparaître la ligne de contact linguistique. La zone du sud est décrite comme
entièrement grecque, celle du nord comme entièrement bulgare et celle du milieu (qui
est en fait presque entièrement slavophone, mais avec une forte présence du grec
véhiculaire dans les villes, et dans plusieurs villages aroumains, sur lesquels s’appuie la
diffusion du grec véhiculaire dans l’espace rural, et dans laquelle on note une
importante influence du patriarcat) comme mixte (Karavas 2004). Ce schéma est
promulgué en 1884 par l’illustre historien grec Constantin Paparrigopoulos, fondateur
de l’histoire nationale grecque, présidant à l’époque l’Association pour la dissémination
des Lettres grecques (cf. infra § 81), qui n’hésite pas cependant à écrire ouvertement
dans un rapport au ministre des Affaires étrangères à propos de la zone « mixte » du
milieu : « Le grec n’est nulle part parlé comme langue maternelle, sauf à Méléniko
(Melnik) et en partie à Nevrokop » (Karavas 2004). Et même la zone sud qu’il délimite
n’est pas aussi nettement grecque qu’il le voudrait. En traçant arbitrairement une ligne
allant de Kastoria à Serrès43, qui délimiterait la zone sud, Paparrigopoulos coupe en
deux des régions slavophones, laissant à l’intérieur de cette zone d’importantes
étendues peuplées de slavophones, dont la plus vaste est le sud du kaza de Kilkis (Avret
Hisar). Mais il considère que les prétentions grecques ne doivent pas reculer en deçà de
la ligne Bitola-Gevgelija-Strumica-Melnik de la zone du milieu.
75 N. S. : N’est-ce pas la raison pour laquelle les Grecs prennent en aversion les cartes
ethnographiques ?
76 L. E. : Parfaitement. Après la carte « ethnographique» de Kiepert, commandée par
Paparrigopoulos, basée sur le critère de la culture, et la mésaventure de la carte dite
« de Stanford », montée de toutes pièces par Gennadios, les Grecs abandonnent toute
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
204
tentative de visualisation ethnique de la population de la Macédoine (Karavas 2002b,
2003a). Ces deux cartes ont comme point commun la représentation cartographique,
selon des critères et avec des non-dits qui diffèrent de l’une à l’autre, de l’élément de la
culture « prépondérante » au détriment de la langue vernaculaire. Sur ce point, la
conception grecque rappelle celle des Allemands concernant la Silésie, la Poméranie et
les contrées de l’est et celle des Hongrois sur la Transylvanie et le Banat, ces
conceptions étant fondées sur la culture et la langue hégémoniques et non sur un
critère ethnolinguistique.
77 Les « aventures cartographiques de l’ “hellénisme” », pour reprendre le titre de l’article
de Karavas (2002b, 2003a), ne s’arrêtent pourtant pas là. Après la grande crise d’Orient,
pendant laquelle ces deux cartes ont été produites, il n’y aura plus de cartes grecques
d’importance. Alors que les Bulgares, mettant à profit les travaux de nombreux savants
européens, continuent d’amasser des données, avec une précision de plus en plus
grande, de compter la population en prenant en compte la langue vernaculaire, les
Grecs, lorsqu’ils parlent de langue, entendent, comme vous le dites, la langue
véhiculaire – laquelle constitue à leurs yeux une preuve que la population est acquise à
la « civilisation hellénique » (Wilkinson 1951). Le fait que la langue sur laquelle
s’appuient les prétentions grecques en Macédoine est une langue véhiculaire est
pourtant occulté, dans le discours public, sinon à l’étranger où la chose est plus
difficile, du moins à l’intérieur du royaume.
78 La langue grecque est bel et bien la langue du commerce, de l’enseignement des écoles
grecques, qui suivent la norme de l’instruction publique de l’État grec et,
théoriquement du moins, celle du prêche dans les églises dépendant du patriarcat,
même si dans la pratique celui-ci est souvent délivré en slave vernaculaire, en albanais
ou en valaque afin d’être compris par les fidèles. Il faut préciser que la véhicularité de
cette langue avait depuis bien longtemps constitué également un vecteur du
nationalisme grec – peut-être même le principal, comme vous le dites dans votre article
sur le nationalisme et les pratiques de l’écrit (Sigalas 2004). Cette dynamique –
indissociable de la relation qui existe entre le nationalisme et la propagation de l’écrit,
ainsi que du statut très ancien du grec en tant que langue écrite, par rapport aux autres
langues des chrétiens balkaniques, à l’exception notoire des Serbes – devient, dans
l’affaire de Macédoine, non seulement la stratégie principale de propagation du
nationalisme grec parmi les populations non grécophones, mais également un critère
en quelque sorte « ethnique », qui témoigne de la « force de l’hellénisme » dans la
région. Car, comme vous le dites dans votre article sur la version néohellénique du
concept d’hellénisme (Sigalas 2000, 2001), l’importance de ce concept, qui se forme
après la guerre de Crimée, tient au fait qu’il donne une signification nationale à la
véhicularité de la langue grecque parmi les populations orthodoxes non-grécophones
des Balkans – notamment du sud de la péninsule, pour l’époque considérée. Sans
oublier que ce phénomène concerne davantage les couches citadines des villes
balkaniques, au nord de la ligne de contact, et très sporadiquement les populations
rurales. Je dois me référer ici au travail exemplaire d’Andréas Lymbératos (2009) sur
Plovdiv, ainsi qu’à l’article pionnier de Bernard Lory (1992) sur la chronique bulgare
de Muravenov. Le livre de Lymbératos se base sur la lente gestation F0 2D et ce, bien avant
l’éclatement de la question macédonienne, comme un des litiges majeurs de la question
2D des processus, notamment économiques, d’évolution de la communauté
d’Orient F0
orthodoxe d’une localité importante, telle que la ville de Philippoupolis (en turc, Filibè
et à partir du XIXe siècle, Plovdiv en bulgare), vers deux partis politiques : le premier
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
205
ayant une place hégémonique dans la ville et le second voulant se l’arroger et
s’attachant à une autre idéologie nationale, qui veut devenir à son tour hégémonique.
C’est précisément ce genre de monographies, mettant en parallèle des sources grecques
et bulgares, qui nous font en général défaut sur la Macédoine, pour la même époque et
plus tard ; le livre de Nathalie Clayer (2007) sur l’émergence du nationalisme albanais
constitue un exemple équivalent au livre de Lymbératos, à ceci près qu’il ne se focalise
pas sur une ville en particulier mais s’attache à toutes les villes et les régions peuplées
d’Albanais; c’est, du reste, sur les villes de Macédoine que nous avons le plus
d’informations ; font cruellement défaut, en revanche, celles qui auraient trait aux
villages. Pourtant, c’est aux contrées rurales que les Grecs accordent, à partir d’un
certain moment, une importance considérable, surtout aux villages slavophones dans
lesquels le grec véhiculaire est présent. Être locuteur du grec véhiculaire, et
notamment avoir reçu une instruction scolaire dans cette langue, peut créer chez les
slavophones, aroumanophones, albanophones et turcophones orthodoxes une identité
grecque très forte. Or, dans certains cas, nous voyons cette identité s’inverser
totalement au profit d’une identité bulgare, aroumaine, albanaise et même turque, le
cas le plus exemplaire étant à cet égard celui du grand poète d’Ochrid, Stavridis-
Părličev (2000)44. Cela dit, la scolarisation en grec peut générer des communautés plus
ou moins assimilées linguistiquement et idéologiquement où les langues vernaculaires
continuent bel et bien à être parlées dans la sphère privée, tout en étant
volontairement exclues de la sphère publique. La scolarisation en grec maintient la
langue vernaculaire, y compris dans certains cas le grec dialectal parlé, dans un statut
subalterne de langue rurale exprimant les besoins quotidiens d’une communauté
rurale, mais ne parvient presque jamais, du moins jusqu’à l’incorporation de 1913, à
l’éliminer. Du reste, les grécophones ne doivent pas être considérés comme étant tous
nationalisés à l’avance et les instituteurs des écoles grecques s’efforcent de corriger les
particularités dialectales de leurs élèves et de leur faire parler et écrire
« correctement » le grec savant, afin de cultiver leurs « sentiments nationaux » – tout
en s’efforçant parallèlement de recueillir, à des fins ethnographiques, ces mêmes
particularismes qu’ils contribuent à gommer. Les Bulgares, les Serbes et les Roumains
essayent, de leur côté, d’éliminer les particularités macédoniennes et aroumaines (pour
l’enseignement secondaire) dans leurs écoles. Chez les Bulgares en particulier – je dois
cette information à Kostopoulos –, cette pratique devient beaucoup plus sévère, à
mesure qu’une identité macédonienne se dessine. En un sens, le bulgaro-macédonien
est aussi une langue véhiculaire mais elle opère à un autre niveau que le grec, dans des
espaces situés au nord de la ligne de contact et dans les transactions surtout rurales,
alors que le grec opère à un niveau d’échange et de contact de prestige, qui inscrit
l’individu dans un réseau de communication beaucoup plus vaste, atteignant tous les
ports de la Méditerranée orientale. Au nord de la ligne de contact, les citadins chrétiens
parlent souvent le grec véhiculaire et écrivent même le grec, qu’ils soient Grecs,
Bulgares, Albanais, Valaques (Aroumains ou Méglénoroumains), Gagaouzes, Serbes,
voire musulmans, Albanais ou Turcs, alors que les citadins au sud de cette ligne ne
parlent que très rarement le bulgaro-macédonien véhiculaire.
79 Or, les Grecs devaient trouver une façon de représenter dans l’espace ce critère
« ethnique » sui generis qu’était l’hellénisme, et donc la véhicularité de la langue
grecque. C’est ainsi qu’a été produit un ensemble de cartes, célèbres aujourd’hui en
Grèce, représentant la distribution des écoles chrétiennes dans la « Turquie d’Europe »
– sans les vilayets du Kosovo et de Shköder, où les écoles grecques n’ont jamais eu prise.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
206
Le rouge grec y est dominant par rapport au vert bulgare. Y figurent aussi les écoles
roumaines et serbes. Le rayon des cercles indiquant la présence des écoles de chaque
« nationalité » est analogue au nombre d’élèves des écoles pour chaque ville ou village.
Il s’agit des cartes de 1904 de Patroklos Kondoyannis que l’on peut voir aujourd’hui
encore, au ministère des Affaires étrangères grec, placardées bien en évidence sur les
murs de la salle de lecture des Archives historiques et de la salle de conférences.
80 N. S. : Ce que vous venez de décrire concerne la façon dont la partie grecque délimite
sur la carte de Macédoine le territoire qu’elle prétend être son territoire national. Or,
outre le fait qu’elles constituent des ronds, rouges ou verts, sur la carte de
Kondoyannis, les écoles grecques et bulgares – tout comme les écoles serbes et
roumaines – marquent également l’espace réel de la Macédoine en délimitant des zones
considérées comme acquises à la politique grecque ou bulgare. L’antagonisme scolaire
absorbe, dans le dernier quart du XIXe siècle, le gros de l’activité politique des deux
États, grec et bulgare, en Macédoine. S’agit-t-il pour vous d’une action directe de ces
deux États sur la population orthodoxe de la Macédoine ? Ou considérez-vous cette
activité plutôt comme un effort visant à marquer le territoire, qui ne touche pas
directement la population dans son ensemble mais certaines catégories appartenant à
cette population slavophone orthodoxe ?
81 L. E. : Il est évident que, dans les années 1860, et jusqu’au début des années 1870, les
idéologues grecs rêvaient d’helléniser, par le biais de leurs écoles, la population
orthodoxe de la Macédoine, de l’Albanie du sud, d’une bonne partie de la Thrace et
parfois bien au-delà (Skopétéa 1988 ; Sigalas 2004). Or, le déroulement de la question
macédonienne s’accompagne d’un désenchantement progressif de ces idéologues grecs
quant à la « force civilisatrice des lettres helléniques » : d’un côté, il y a l’inertie des
paysans slavophones qui utilisent le bulgaro-macédonien véhiculaire pour leurs
transactions, de l’autre, le prestige social et l’utilité économique grandissants du
bulgare littéraire, celui-ci disputant le terrain au grec véhiculaire et écrit, dans la
mesure où il est beaucoup plus proche de la langue parlée. Les Grecs se rendent
progressivement compte des limites de la pénétration des lettres grecques dans les
régions proprement rurales. Les écoles grecques portent leurs fruits notamment parmi
les catégories de la population slavophone orthodoxe, citadines ou villageoises, qui
s’adonnent au commerce et à l’artisanat. C’est ce qu’attestent la correspondance du
ministère des Affaires étrangères grec avec les consuls grecs en Macédoine et celle de
l’Association pour la dissémination des Lettres grecques (présidée par Constantin
Paparrigopoulos), étudiées de façon exhaustive par Sofia Vouri (1992). Dès lors,
l’ancienne aspiration à helléniser les populations macédoniennes cède le terrain à un
calcul politique plus réaliste : on ne vise plus à s’approprier le territoire par
l’hellénisation des populations chrétiennes tout entières, mais on mise sur la simple
présence des écoles, en tant que gage de la fidélité de la population à la culture grecque,
interprétée comme fidélité au « parti grec ». Il ne faut pas oublier que la présence de
ces écoles, grecques ou bulgares, est peu à peu entièrement subordonnée à
l'appartenance ecclésiastique du village, voire d’une paroisse du village, au patriarcat
ou à l’exarchat. Cette appartenance constitue le soubassement de la territorialisation.
L’espace de la propagation des écoles grecques est, en effet, le territoire ecclésiastique
du patriarcat et celui des écoles bulgares, le territoire ecclésiastique de l’exarchat.
Cependant, il y a imbrication des deux territoires au sein de chaque région, ville ou
village. Et c’est là où se crée l’antagonisme.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
207
82 Il faut commencer par évoquer l’importance majeure de l’apparition de l’exarchat
bulgare, lequel devient l’instrument d’une territorialisation des prétentions nationales
bulgares, fondées sur une connaissance de la très large distribution des parlers
bulgares/macédoniens dans la péninsule balkanique ottomane. De surcroît, l’exarchat
doit s’étendre en Macédoine et en Thrace suivant une logique plébiscitaire, selon
laquelle deux tiers des paroissiens votant pour l’exarchat obtiennent le droit de fonder
un nouveau diocèse rattaché à la nouvelle hiérarchie parallèle. C’est cette logique
plébiscitaire – comportant les caractéristiques de la souveraineté moderne – qui donne
au territoire exarchiste l’aspect d’un territoire national. La Grèce et le patriarcat
d’Istanbul veulent déterritorialiser l’exarchat, ou du moins le confiner territorialement
dans la Bulgarie danubienne – rejoignant ainsi les Ottomans qui abhorrent les
tentatives de regroupement territorial à base nationalitaire, encore qu’ils aient dans un
premier temps accepté l’institution de l’exarchat pour diviser le millet-i rum qu’ils
redoutaient davantage alors à cause du nationalisme grec. Et c’est précisément dans le
cadre de cet effort que se forme la raison territoriale grecque à propos de la
Macédoine45. Dès lors qu’il s’avère impossible d’extirper l’exarchat de la région, on veut
circonscrire les régions dans lesquelles il est présent. Autrement dit, on veut re-
territorialiser le patriarcat, délimiter son territoire, désormais projeté comme
territoire national grec. Le schisme est, en fin de compte, bien venu, malgré les
prétentions contraires du patriarcat – comme l’ont bien montré Paraskevas Matalas
(2002) ainsi que Spyros Karavas (2004 : 161-163) – car il devient le pivot de la
reterritorialisation du patriarcat, ainsi que l’acte fondateur de son cheminement côte à
côte avec le nationalisme grec. Le schisme sépare les patriarchistes des exarchistes à
l’intérieur de la même communauté religieuse, érigeant une frontière symbolique entre
les deux groupes, que l’on voudrait définitive côté grec, et, partant, deux stratégies
identitaires, voire deux régimes d’ethnicité, distincts et même opposés. Une fin du
schisme viendrait mettre fin à ce clivage, ce qui permettrait au nationalisme bulgare de
s’insinuer au plus profond des communautés slavophones, si l’exarchat avait été
canonique. C’est la zone médiane de Paparrigopoulos qui devient le champ de bataille
de l’influence des deux Églises et, encore plus, les régions de la zone méridionale à forte
présence de slavophones. Après le schisme, l’allégeance des paysans slavophones au
patriarcat est interprétée comme une preuve de conscience hellénique, de la même
manière que l’allégeance à l’exarchat passe pour un gage de conscience nationale
bulgare.
83 N. S. : Vous soulignez là un point très important. Devenir exarchiste est un choix : un
choix de caractère nationaliste. En revanche, être patriarchiste, n’en est pas forcément
un, ou en tout cas, n’a pas toujours une connotation nationaliste. Le choix de rester
dans le sein du Patriarchat peut tout simplement tenir à l’inertie naturelle de ses
ouailles ou encore être lié à la peur de l’hérésie.
84 L. E. : … voire à la peur de perdre les subventions allouées principalement par l’État
grec. Le choix peut même résulter, pour les contrées slavophones plus méridionales, de
la participation à un réseau d’émigration lié à la Grèce, à Istanbul, Smyrne ou
Alexandrie. Les exarchistes, eux, se lient de plus en plus à la principauté bulgare, après
sa fondation. Quant à la peur de l’hérésie, c’est par rapport à elle que se révèle l’utilité
du schisme dans la reterritorialisation du patriarcat, celui-ci brandissant allégrement
l’épouvantail de l’« hérésie » afin de maintenir les paysans slavophones dans ses rangs.
Le patriarcat souhaite distinguer les exarchistes, jusque dans l’apparence et dans
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
208
l’habit des prêtres, pour faire prendre conscience aux populations patriarchistes du
péché que l’on commet en adhérant à l’Église « schismatique » bulgare, du danger
qu’on encourt pour le salut de son âme. Rappelons que ce « schisme » n’a pourtant
aucun aspect dogmatique ou rituel, la seule divergence entre patriarcat et exarchat –
en dehors de l’adoption par le second du slavon d’église – étant l’institution (non
canonique) d’une hiérarchie parallèle dans un même État, sur une base nationalitaire.
C’est ce qui va constituer l’accusation d’« ethnophylétisme » sur laquelle se fonde la
condamnation de l’exarchat comme schismatique par le Saint Synode en 1872. Il faut,
par ailleurs, préciser que, toujours selon Paraskevas Matalas (2002), la décision du
synode de proclamer l’Église bulgare schismatique n’intervient qu’au moment où les
Bulgares, refusant de s’accommoder d’un espace territorialement délimité comme la
Bulgarie danubienne, réclament au nom de la logique plébiscitaire de s’étendre en
Macédoine et en Thrace et que le siège de l’Exarque soit maintenu à Constantinople. De
fait, Monseigneur Joseph, Exarque de tous les Bulgares, y demeurera, jouissant par là
même d’une extra-territorialité par rapport à la nouvelle principauté bulgare de 1878
et prenant sous sa houlette non seulement les habitants de celle-ci mais tous les
Bulgares restés directement sous administration ottomane. Ce sont ces « Bulgares » qui
deviennent un objet de litige, puisque nominalement ils étaient administrés par le
patriarcat. Dès lors, dans la mentalité des Grecs, les Bulgares cessent d’être les « frères
bulgares » pour devenir des « schismatiques », voire des « hérétiques ». Quant aux
Macédoniens slavophones qui restent fidèles au patriarcat, ils deviennent d’abord des
« Bulgares orthodoxes » (par opposition aux « Bulgares schismatiques ») puis des
« Grécobulgares » et finalement des « Grecs bulgarophones, slavophones ou
macédonophones », selon les cas et les époques (Kostopoulos 2004), les exarchistes
étant perçus comme des « larbins du panslavisme », alors même que la Russie a tout fait
pour éviter le schisme, mais en privilégiant la fondation de l’exarchat autonome
(canonique) de ses protégés slaves.
85 N. S. : Quel est l’aspect géographique de cette reterritorialisation du patriarcat qui
constitue le but de la politique grecque en Macédoine ?
86 L. E. : Selon Spyros Karavas (2006b), cette reterritorialisation prend la forme de
différents projets de revendications maximales, médianes ou minimales. Elle évolue au
gré des données géopolitiques, de la prise de conscience des forces de l’adversaire et
des difficultés pratiques rencontrées sur le terrain. Les conceptions géopolitiques qui se
forment auront tendance, vers la fin de l’époque examinée, à revenir tacitement aux
positions minimales : il faut atteindre Monastir, sécuriser Salonique, maintenir la
possibilité d’un couloir ouvert à travers la Thrace vers Constantinople et que le tout
puisse être défendable. D’autres paramètres entrent également en compte : s’emparer
de la grande plaine de l’Axios, de la Campanie, des plaines du Strymon/Strouma et du
Nestos/Mesta, ainsi que du bassin de Philippi et de la moitié sud du haut plateau de
Pélagonie, ce qui procurerait les ressources nécessaires à la survie du vieux royaume,
montagneux et pauvre. Ces revendications ne se limitent évidemment pas à la
Macédoine. Elles entrent dans l’élaboration d’un plan d’ensemble qui va de la mer
Ionienne, ou de l’Adriatique, à la mer Noire, mais dans lequel la Macédoine constitue,
territorialement, idéologiquement et politiquement, l’élément central. Encore fallait-il
dépasser l’ancienne conception de l’époque de Capodistria, qui limitait les
revendications grecques, des Monts acrocérauniens au Mont Olympe. C'est-à-dire aux
limites de la grécophonie sub-péninsulaire (Karavas 2004). Cette conception était la
seule à combiner une logique linguistique à une conception géographique antiquisante.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
209
Les revendications des années 1840 et 1850, jusqu’à la guerre de Crimée, outrepassent
les rêves les plus fous de la génération postérieure, faisant coïncider, comme vous le
dites dans votre article, la nationalité grecque avec la communauté orthodoxe de
l’Empire ottoman, moins les principautés autonomes de la Serbie, de la Valachie et du
Bogdan, en incorporant les orthodoxes albanophones, slavophones, valacophones,
turcophones et romaniphones (Sigalas 2004). La nouvelle configuration après le
schisme serait de ne céder que la Bulgarie danubienne. Mais, en vérité, les visées sont
beaucoup plus réalistes et n’utilisent l’argument religieux que pour ne pas entrer
ouvertement en contradiction avec le patriarcat, avant tout préoccupé de ne pas voir se
fragmenter ses anciennes provinces ecclésiastiques – ce qui n’est pas le cas de
l’exarchat dont la conception territoriale est presque entièrement nationaliste.
L’argument religieux sert toujours de prétexte pour la revendication des contrées
méridionales de Macédoine, mais il est pratiquement abandonné s’agissant des
contrées plus septentrionales, qui deviennent la chasse gardée des Serbes en vertu d’un
accord tacite.
87 Des sommes considérables sont dépensées par les Grecs, dans les régions constituant les
revendications minimales46, pour maintenir le paysan dans l’orbite patriarcale, surtout
parce que ce sont les paysans qui font le territoire, et non pas les citadins, bien que le
statut social de ces derniers les rende plus visibles. Le but est de préserver au maximum
les liens de ces paysans et citadins avec le patriarcat. Néanmoins, des îlots se sont
formés et des brèches entament le territoire des revendications minimales lui-même.
Les « apostasies » sont très courantes, tout comme les retours au « bercail »,
moyennant quelques compensations. Kilkis constitue, avec sa région, la brèche la plus
profonde et la plus dangereuse. Elle est une erreur de jeunesse des planifications
grecques, qui n’ont pas su freiner, à une époque très précoce, la formation d’un noyau
uniate directement lié au mouvement bulgare naissant. La majorité de ces uniates sont
passés ensuite à l’exarchat, après un court passage par le patriarcat, moyennant l’octroi
de la liturgie en slavon (Sigalas 2001). Kilkis est probablement la seule de toutes les
villes de la Macédoine méridionale à n’avoir pu maintenir ne serait-ce qu’une petite
communauté patriarchiste. De la même manière que Serrès « irradie » sur sa région
l’« hellénisme », Kilkis, centre politique mais non ecclésiastique, irradie sur sa région le
« bulgarisme » (comme disent les auteurs grecs de l’époque), en faisant d’elle un
bastion politique du nationalisme bulgare. Mais c’est la possession de cette région qui
rend celle de Salonique défendable d’un point de vue stratégique et économique,
puisque la première constitue l’hinterland naturel de Salonique et assure le contrôle de
la vallée du Vardar.
VI. Autour de la territorialité macédonienne
88 N. S. : La ville de Kilkis a donc acquis, dans la raison territoriale grecque, la réputation
d’un obstacle irréductible. Est-ce cette réputation qui l’a préservée de la « lutte
macédonienne » (comme on appelle en Grèce l’intervention grecque armée en
Macédoine) ? Et, plus généralement, quel est le rapport de cette confrontation de
bandes armées avec la territorialisation de prétentions nationalistes que vous venez
d’analyser ?
89 L. E. : Je crois que la « lutte macédonienne » constitue précisément l’étape suivante de
ce processus de territorialisation. Nous remarquons qu’en 1903, pendant la révolte
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
210
d’Ilinden47 – qui a été précipitée par les événements de Salonique, et la situation sur le
terrain des organisations de l’ORIM (Organisation révolutionnaire intérieure de
Macédoine, sous son nom conventionnel français) –, des patriarchistes commencent à
participer, aux côtés des exarchistes, à quelque chose qui est tout à fait étranger aux
visées grecques : la lutte pour l’autonomie de la Macédoine (Monova 1995 48). Il s’agit là
d’un scénario cauchemardesque pour les Grecs, puisqu’il signifie le détachement de la
souveraineté du sultan – sans pour autant signifier détachement de sa suzeraineté – en
faveur d’une légalité et d’une juridiction autres qui transformeraient cette région en un
territoire dont les institutions échapperaient au contrôle grec et qui pourrait
proclamer son indépendance et/ou son union avec une « mère-patrie » autre que la
Grèce. C’est précisément ce que la Grèce est en train de fomenter dans le cadre de la
question crétoise, ce qui s’est déjà produit dans le cas du rattachement de la Roumélie
orientale à la Principauté bulgare, et ce qu’elle redoute de voir se produire en
Macédoine, mais de façon beaucoup plus affirmée, étant donné l’envergure de
l’insurrection. Le but non avoué de la Grèce est le partage, la fragmentation de la
Macédoine géographique et, donc, l’anéantissement dans l’œuf de cette nouvelle
configuration politique susceptible de surgir. Entre temps, il s’avère que le maintien de
la souveraineté du Sultan en Macédoine est toutefois seul capable d’endiguer le projet
autonomiste. Une accession à l’autonomie ou un rattachement à la Bulgarie constituent
un danger mortel pour toute visée d’expansion grecque vers le nord. Spyros Karavas
(2002b, 2003a et 2006b) a très bien saisi la logique de ce processus. Constater que la
politique mise en œuvre peut s’avérer complètement dérisoire produit un effet de choc
et une série de raisons incite alors à faire intervenir des bandes armées dans le
territoire ottoman, contre des bandes locales macédoniennes et une organisation déjà
puissante dans les régions de Bitola, de Florina, de Prespa, de Kastoria et de Khroupista
du vilayet de Monastir, ainsi que dans les régions de Yanitsa, de Goumenissa, de
Gevgelija, de Serrès et de Strumica du vilayet de Salonique. L’objectif est de marquer le
territoire patriarchiste, de le consolider et de faire reculer la propagation de l’exarchat
qui, sans être la force révolutionnaire, constituait à l’inverse une force conservatrice
liée à l’État et à la raison territoriale bulgare, n’en fut pas moins le principal réservoir
de la révolte. C’est une nouvelle configuration territoriale qui apparaît avec
l’organisation et se concrétise avec la révolte. Nous ne nous étendrons pas ici sur les
Verhovistes (comité suprême siégeant à Sofia) qui sont considérés par le nationalisme
macédonien actuel comme un appareil de capture de la Bulgarie concernant cette
organisation locale49. Si l’ORIM a été au début très fortement liée à la Bulgarie, son
activité a généré par la suite une dynamique révolutionnaire plus spécifiquement
macédonienne, ce qui la place par rapport à la Bulgarie sur une orbite plus elliptique.
Une scission de l’organisation antérieure à Ilinden vise à éloigner l’organisation de la
tutelle de l’État bulgare et à lui donner une orientation macédonienne. Notons que c’est
Gotse Deltchev de Kilkis qui est à l’origine de cette scission et confère par là même à
cette dynamique un caractère plus nettement macédonien, sans ôter à celle-ci tout
référant bulgare. C’est cette même dynamique qui permet également l’inscription dans
le mouvement révolutionnaire de patriarchistes, déstabilisant ainsi l’appareil grec,
puisque pour ce dernier être patriarchiste est ou doit être synonyme de grec, la
constitution de cette nouvelle ethnicité se trouvant menacée. L’intervention des bandes
armées grecques, aussitôt après la grande répression ottomane de la révolte,
correspond à ce sentiment de perte de contrôle. Après la répression de 1903-1904, on
assiste à la plus grande conversion à l’exarchat de slavophones patriarchistes, ceux-ci
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
211
ayant compris de manière cuisante qu’il était incompatible d’être à la fois patriarchiste
et révolutionnaire. La Grèce contrôle dorénavant tout locuteur du slave sur son propre
territoire, simple visiteur ou réfugié de Macédoine, et procède à l’extradition de tous
les Slaves, sujets ottomans, susceptibles d’être liés à la « subversion », vers l’Empire
ottoman où ils sont traités comme des terroristes. C’est ainsi que les réseaux bulgares
ou macédoniens d’achats d’armes ou de protection de réfugiés se trouvent démantelés
(Bérard 1904). L’année 1904 inaugure une phase de violence extrême mais de faible
intensité durant laquelle on ramène les brebis perdues au bercail par la force des armes
et de la terreur. À présent, c’est le sang qui sépare les communautés exarchiste et
patriarchiste, traçant entre elles une nette frontière, qui transforme les patriarchistes
en parti grec et les exarchistes en parti bulgare, ou même macédonien. Les bandes
grecques et bulgares s’immitent réciproquement quant à leur façon de procéder pour
atteindre une égale cruauté envers les populations civiles – bien que dans deux cas, au
moins (Zagoritsani/Zagoritchane [aujourdhui Vasiliada] [cf. supra § 54] et la noyade de
la traversée de l’Haliakmon [Karavas 2006a]) les bandes grecques aient franchi le seuil
de la violence uniquement terroriste pour atteindre le niveau d’une violence massive.
Si la région de Kilkis échappe en majeure partie à cette confrontation sourde, c’est
qu’encore une fois il n’y a pas grand chose, voire rien, à obtenir pour les Grecs, la raison
même de l’intervention armée des Grecs étant de « protéger le libre choix des
patriarchistes de rester fidèles à leur église patrimoniale ». Ce qui ne veut pas dire pour
autant qu’il n’y a pas eu confrontation des Kilkissiens avec la police ou l’armée
ottomane et que cette région n’a pas subi plus que d’autres la répression de l’État et ce,
bien avant l’implication des bandes armées grecques (Anonyme 1904 : 42-47 ; Bérard
1904 ; Karavas 2002 a).
90 N. S. : Les agents de la politique grecque sont donc les plus grands opposants au
changement.
91 L. E. : Ils sont pour le maintien de l’ordre établi, donc de l’ordre ottoman (Anonyme
1904 ; Bérard 1904). Du moins jusqu’à l’arrivée au pouvoir des Jeunes Turcs à Istanbul et
de Vénizélos à Athènes. Jusqu’en 1908, il y a alliance tacite avec les autorités ottomanes,
qui ne voient pas d’un trop mauvais œil l’arrivée des bandes grecques, tout en les
invitant à rester discrètes, faute de quoi la légalité ottomane les obligerait à arrêter ces
étrangers armés (il y a eu plusieurs arrestations de bandits grecs, mais les autorités se
sont montrés plus indulgentes envers ces derniers qu’envers les bandits bulgares). On a
ainsi, en dépit des affrontements armés, plusieurs exemples de connivence entre les
autorités et ces bandes (cf. Sorgun 2003 ). Tout se passe comme si les autorités
ottomanes laissaient une part de la sale besogne aux bandes grecques (je me réfère ici
encore aux travaux de Spyros Karavas [2006a])50. Il faut préciser que ces bandes
viennent pour la plupart de la Grèce F02D rares sont, en effet, au départ, les chefs de bande
slavophones locaux qui combattent pour la cause hellénique (les plus importants
d’entre eux étant des convertis de l’ORIM51) F0 2D et que ce sont les succès des Grecs qui
entraînent ensuite une conversion plus massive des locaux. L’objectif est de ramener
par la force des armes les paysans au statu quo ante et donc de réduire les poches
exarchistes, voire de les éliminer complètement du territoire qu’on cherche à
délimiter. Jusqu’en 1908, les Grecs ont réussi à s’implanter solidement sur tout ce
territoire sans pour autant réussir à en extirper l’exarchat ni l’ORIM ; des poches
compactes d’exarchistes et des foyers de révolutionnaires sont restés présentes sur
toute son étendue.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
212
92 N. S. : Kilkis est l’une de ces poches, qui ne peut être réduite, et que les bandes
grecques ne pensent pas pouvoir réduire.
93 L. E. : Il n’y a même pas eu de tentative de la réduire par les armes. En effet, les
confrontations armées ne se déroulent que dans des régions où il y a une présence
notable des deux adversaires et lorsque la situation sur le terrain est instable. Il faut
lire à cet égard l’ouvrage classique de Nikolaos Vlachos La Question macédonienne en tant
qu’étape de la question d’Orient (Vlachos 1935), qui contient une très bonne analyse des
dimensions géographiques de la question. Il a été le seul à cette époque à avoir accès
aux archives du ministère des Affaires étrangères grec. La « lutte macédonienne » a
récemment fait l’objet de plusieurs études qui vont au-delà de la problématique du livre
de l’historien anglais, Douglas Dakin (1976), qui adopte trop souvent un point de vue
proche des positions officielles grecques52.
94 Il faut mentionner à cet égard les travaux pionniers de Dimitris Lithoxoou, qui a ouvert
en Grèce le champ des recherches sur la question, à une époque où aucune source
n’était encore disponible, lors de l’éclatement de la crise sur le nom de la Macédoine. Il
a été le premier, dans un article sur la démographie de la Macédoine grecque, à dissiper
les nuages opaques que tant d’années d’occultation systématique avaient accumulés
autour de la question de la langue et de l’identité en Macédoine dans les sources
« codées » des instances officielles en Grèce, ainsi que de l’historiographie postérieure
qui en traitent (Lithoxoou 1992). En Grèce, on n’avait ni information sur le sujet ni les
mots pour en parler. Lithoxoou a aussi éclairé la « lutte macédonienne » d’une nouvelle
lumière. Le titre de son ouvrage, Lutte anti-macédonienne grecque (Lithoxoou 1998), est
discutable du fait qu’entre 1904 et 1908, le terme « macédonien » n’a pas encore acquis
un sens proprement national. Il est vrai que nous assistons à cette époque à
l’émergence d’une identité macédonienne distincte du sens que lui donnent les
Bulgares ou les Grecs. Or, si cette identité n’est pas un acquis pour l’ensemble de la
population, elle ne l’est pas non plus dans un sens national. Après le congrès de
Salonique de 1896, qui donne à l’organisation de l’ORIM une orientation de plus en plus
en plus locale, on appelle de plus en plus « Macédoniens » les habitants chrétiens de la
région mais en englobant dans cette dénomination d’autres chrétiens que les Slaves –
l’idée de l’autonomie ne pouvant se référer aux seuls Bulgares. Cette appellation
émane, bien sûr, de l’élite macédonienne issue, pour une grande partie, du prestigieux
lycée bulgare de Salonique. C’est par ce biais que l’appellation régionale
« macédonien » devient de plus en plus un ethnonyme mais en désignant les premiers
intéressés, largement majoritaires parmi les chrétiens : les Slaves, au-delà du clivage
patriarchistes-exarchistes (Monova 1995).
95 N. S. : Le titre de l’ouvrage de Lithoxoou est en partie un anachronisme. Celui-ci perçoit
bien que la révolte d’Ilinden est un moment important dans l’histoire de la formation
de l’identité nationale macédonienne. Mais il considère cette identité naissante comme
une donnée qu’il généralise et essentialise, en quelque sorte. Néanmoins, son livre est le
premier ouvrage en grec à avoir montré que l’identité macédonienne était bien là,
qu’elle était une composante du problème et non pas une construction ultérieure,
fabriquée de toutes pièces par le régime titiste – comme on le prétend encore
aujourd’hui en Grèce.
96 L. E. : Il le fait délibérément, afin de mettre en évidence le fait « réactionnaire » de
l’intervention grecque contre le fait « progressiste » et anti-autoritaire de l’ORIM. En
1903, paraît le premier livre théorique sur l’identité macédonienne non bulgare des
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
213
slavophones de Macédoine, signé de Krste Misirkof (1903) « Sur les Affaires
macédoniennes ». Bien qu’il ait été renié par son auteur et très mal reçu en Bulgarie,
cet ouvrage inaugure la formulation idéologique d’une nouvelle identité politique qui
ne serait ni serbe ni grecque et pas non plus bulgare. Cet intellectuel slave de
Macédoine, originaire du village de Postol (Palaia Pella, en Grèce aujourd’hui) qui a
étudié à Saint-Pétersbourg et a séjourné aussi à Belgrade, montre comment il est
possible, sur la base de données politiques, de postuler une identité nationale, qui
pourra ensuite être investie d’éléments linguistiques, ethnologiques, etc., afin de
construire une nation – qui s’avérera plus tard tout à fait viable – en refusant de se
laisser assimiler aux trois identités politiques qui convoitent la région (Dogo 1985).
C’est là une conception très « avant l’heure », une approche tout à fait moderne 53.
97 N. S. : Il y a donc un champ identitaire en formation.
98 L. E. : Parfaitement. On assiste à la formation d’un champ identitaire, qui embrasse la
configuration géographique qu’est la Macédoine slavophone. Ce champ, qui devient
manifeste avec Ilinden, s’est constitué au fur et à mesure du déroulement de la question
macédonienne, étant donné que la population a été entraînée dans un jeu de
négociation identitaire. Prenons un exemple : l’intériorisation progressive de la
délimitation d’un territoire objet de litige, comme la délimitation coloniale du
territoire palestinien – partant d’une géographie historique liée à « l’histoire de l’Église
chrétienne en Terre Sainte », du point de vue des puissances européennes, à la province
ecclésiastique du patriarcat de Jérusalem ou à l’histoire biblique (Laurens 1999 et
2002) – intériorisation qui va impliquer progressivement « la population » dans une
nouvelle configuration conflictuelle. Cette configuration est le produit des réactions
lentes à l’implantation sioniste en Palestine, qui commence depuis la première Aliya
(déjà du temps d’Abdulhamid), pour s’accroître sous le Mandat britannique en 1919
mais ne devient manifeste en tant que palestinienne qu’après le partage par l’ONU en
1947 et surtout après la guerre de 1948 et la genèse du problème des réfugiés
(Hobsbawn 1990). Certes, le cas de la Macédoine est différent : il n’est pas question ici
d’un colonialisme ou d’un impérialisme, qui tout en laissant des territoires comme la
Bosnie-Herzégovine et Chypre sous suzeraineté du Sultan, vont les projeter dans une
ère complètement nouvelle en 1878. Le parallèle réside dans la lente fermentation
d’une identité politique à travers la constitution d’un territoire en objet de litige. La
Macédoine acquiert une définition de plus en plus claire à partir du moment où elle
n’est pas incorporée à la Bulgarie de San Stefano et où ses contrées slavophones
renouvellent leur rapport de dépendance avec la Bulgarie dorénavant autonome, ce qui
donne lieu à un nouvel irrédentisme bulgare, directement lié aux contrées exclues de la
Bulgarie autonome, dont la Macédoine et Andrinople constituent la référence majeure.
C’est dans ce contexte qu’émergent les organisations macédoniennes qui donnent à ce
territoire, déjà marqué par l’antagonisme ecclésiastique, une unité politique distincte.
S’ajoutent l’entrée en jeu de la Serbie avec son propre projet irrédentiste pour la
Macédoine et l’intensification de l’activité grecque dans la région. L’identité politique
macédonienne se forge ainsi au croisement de ces trois projets irrédentistes différents,
à travers la relative autonomisation de l’identité régionale de ces trois constructions
identitaires proposées par les trois irrédentismes aux habitants slavophones de cette
province ottomane. Ainsi, la projection sur cet espace, d’une part, des convoitises des
trois États, qui tentent de composer avec la souveraineté de l’Empire ottoman, et,
d’autre part, des projets diplomatiques des grandes puissances, va induire une
dynamique d’intériorisation de cette configuration géographique, qui se mue
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
214
tacitement en une configuration politique. Pour filer la comparaison avec la Palestine,
c’est cette dynamique qui contribue à marquer, à travers ses avatars politiques, le
territoire qui en est l’enjeu. Ainsi, au-delà des différences, c’est dans un environnement
analogue, marqué par des antagonismes entre grandes puissances et entre
nationalismes locaux, et à des époques légèrement différentes, mais liées à ce qu’on
appelle la question d’Orient, qu’émergent les nouvelles subjectivités géographiques à
substrat politique, macédonienne et palestinienne, dans le continuum slave et
orthodoxe de la Roumélie ottomane, d’un côté, et le continuum arabe du Machreq
ottoman, de l’autre. Dans les deux cas, ces subjectivités géographiques sont le résultat
de l’intériorisation par les individus sur le terrain, des termes dans lesquels les
différents enjeux s’inscrivent dans l’espace (encore que dans des proportions
différentes dans chacun des cas).
99 La « lutte macédonienne » constitue une tentative pour fragmenter ce champ politique
émergeant, casser la dynamique qui est en train de le produire – que celle-ci soit
orientée vers la Bulgarie ou vers une indépendance politique. C’est en cela que cette
lutte est « anti-macédonienne », pour reprendre la formule de Dimitris Lithoxoou qui a
parfaitement saisi cette logique. Mais elle ne s’est jamais exprimée comme telle. Même
lors des pogromes anti-grecs de 1906 en Bulgarie, qui ont conduit au plus grand
affrontement diplomatique gréco-bulgare, il n’a jamais été question d’une Macédoine
autonome (cf. supra § 54). Au contraire, Grecs et Serbes avaient leurs idées propres sur
le partage de la région et, après 1908, les Bulgares ont été obligés de substituer dans
une certaine mesure à leur projet d’autonomie une idée de partage – en s’opposant eux
aussi, de fait, à l’unité de cet espace qui leur aurait été impossible de contrôler. Les
Bulgares redoutaient en particulier de voir se propager en Bulgarie et dans les États
avoisinants ce foyer de subversion politique, confinant parfois à l’anarchisme, que
constituaient les organisations révolutionnaires macédoniennes. Le Premier ministre
bulgare, Ivan Guéchoff54, est très clair sur ce point : « Profondément convaincu en
outre, de la nécessité qu’il y avait de soustraire la question macédonienne au pouvoir
du comité révolutionnaire, comme Cavour arracha des mains des révolutionnaires
italiens la question de l’unité italienne, j’entrai en négociations avec les Serbes »
(Guéchoff 1915 : 30). D’où le compromis serbo-bulgare de 1911 et l’alliance balkanique
de 1912, avec la participation de la Grèce.
100 On ne saurait toutefois oublier qu’en abolissant les privilèges ecclésiastiques, le régime
de 1908 – qui a entre autres constitué une réaction ottomane à la conférence russo-
britannique de Reval/Revel F0 5B aujourd’hui Tallinn 5D (9 juillet 1908) – empêche les
F0
nationalistes grecs, bulgares et serbes de poursuivre leur œuvre de nationalisation à
travers les Églises, ce qui rend celle des réseaux scolaires difficilement opératoire.
L’expérience parlementaire rend plus virulents les débats sur l’ottomanisme, au sein
desquels s’expriment plus clairement les oppositions nationalistes, le parti jeune-turc
accusant les non musulmans, en général,de non fidélité à l’ottomanisme et les
représentants de ces derniers accusant les Jeunes Turcs de trahison de l’ottomanisme
au profit du nationalisme turc. Dans ce contexte, l’ancienne alliance tacite gréco-
ottomane cède la place à la méfiance et les Jeunes Turcs montrent des velléités
d’intervenir plus drastiquement dans l’affaire macédonienne en faveur des musulmans,
sur lesquels ils projettent à leur tour un caractère national. L’impasse dans laquelle se
trouvent, après 1908, les anciens adversaires grecs, bulgares et serbes en Macédoine
donne à l’identité macédonienne la possibilité de s’exprimer plus clairement. C’est ce
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
215
qui explique aussi, je pense, que les trois parties aient opté pour le compromis et donc
pour le partage.
101 Pour être plus précis, le compromis ne devient possible que lorsque les Bulgares en
viennent à accepter l’idée du partage – ce qui ne peut être exprimé ouvertement, car il
aurait provoqué des réactions dans l’opinion publique. Si le compromis passé en 1911
entre Serbes et Bulgares contient déjà un accord territorial avec arbitrage de
l’empereur de Russie en cas de litige55, l’autonomie est toujours appréhendée comme
une éventualité, le partage n’étant envisagé que si cette dernière s’avérait impossible.
Or, les Grecs sont tout à fait hostiles à l’idée de l’autonomie, et s’opposent même à la
mention dans le traité de 1912 de l’article 23 du traité de Berlin (sur le modèle de la Loi
organique de la Crète) qui fait état d’un gouverneur chrétien choisi suivant le principe
des deux tiers, tout comme le sera la langue officielle (i.e. bulgare dans les deux cas), la
mention de cet article dans l’annexe du traité proposé par Ivan Guéchoff, étant
considérée par l’ambassadeur grec à Sofia, Diomidis Panas, comme une tentative de
« venir à l’autonomie par une voie détournée » (Guéchoff 1915 : 67). Finalement, le
traité est signé en mai 1912 avec une vague référence aux « droits découlant des
traités » (Guéchoff 1915 : 69).
102 N. S. : On peut donc parler de trois conceptions fondamentalement différentes de la
question macédonienne par les trois alliés de 1912. Ces trois conceptions ne se
rencontrent que ponctuellement en 1911 avec l’affaiblissement du dogme de l’intégrité
territoriale de l’Empire ottoman pendant la guerre italo-ottomane, pour se séparer à
nouveau en 1913, avec la deuxième guerre balkanique et les événements violents que
vous avez analysés ici. Je voudrais vous demander maintenant comment ces trois
conceptions s’inscrivent dans l’espace. Comment sont construites les trois géographies,
grecque, serbe et bulgare de la Macédoine ?
103 L. E. : Les Serbes ont énormément misé, dès 1880, après que les Autrichiens aient
anéanti leurs visées sur la Bosnie-Herzégovine en 1878, sur la différence entre les
Bulgares et les Macédoniens pour détacher cette population de la Bulgarie, leurs
prétentions se déplaçant désormais vers le sud et la mer Égée (Cvijič 1906). Les
Autrichiens, de leur côté, ont aussi plutôt opté pour la distinction Bulgare/
Macédonoslave, tant que la Serbie, sous la dynastie des Obrénovič, était sous leur
influence directe. Mais ce qui est important pour les Serbes et les Autrichiens, c’est de
montrer que la partie occidentale de la Macédoine (jusqu’à un endroit non clairement
défini, entre le Vardar et la Strouma) n’est pas bulgare. C’est ainsi qu’ils privilégient le
critère linguistique de l’issoglosse je/jat (jatski granica) et des critères ethnographiques
qui, pour la population elle-même, n’ont qu’une importance minime. Or, ces arguments
linguistiques et ethnologiques s’articulent sur des visions politiques bien concrètes : le
débouché sur la mer Égée par le couloir du Vardar jusqu'à Salonique (cf. Katsanos 2008).
104 Afin de relier les Slaves macédoniens à l’histoire grecque antique, les Grecs, eux,
insistent lourdement sur l’antiquité macédonienne à travers leur réseau scolaire. Ils
vont jusqu’à publier un opuscule « anonyme » sur Alexandre le Grand en langue
macédonienne transcrite en caractères grecs. L’objectif est d’associer une identité
locale, non bulgare et non slave, à l’antiquité macédonienne – qui entre dans le grand
récit grec pour pouvoir revendiquer les populations slavophones de la Macédoine – et
d’essayer par ce biais de détacher les Macédoniens slaves des Bulgares et de les
positionner dans l’orbite de la Grèce. Or, c’est justement dans le cadre de cette tentative
grecque et serbe pour détacher les Slaves macédoniens des Bulgares qu’apparaît la
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
216
possibilité d’une nouvelle identité macédonienne, dont je viens de faire mention. Cette
possibilité, qui s’ouvre avant le début du XXe siècle dans la Macédoine encore
ottomane, prend de l’ampleur du fait de la contrainte qu’imposent les trois États sur
cette région, notamment après la révolte d’Ilinden et la répression qui s’ensuit. Ilinden
est donc minorée par les Grecs, traitée de pseudo-révolte et n’est en aucun cas reconnu
comme une révolution (Ion Dragoumis : 2000, malgré l’admiration pour l’organisation
révolutionnaire que cet auteur exprime explicitement dans ses lettres, alors qu’il la tait
dans la sphère publique56) ; Grecs et Ottomans, qui s’appuient mutuellement,
s’obstinent à affirmer qu’elle était fomentée par la Bulgarie, sans véritable implication
des indigènes ou en l’absence de revendications de leur part. Ce qui effraie les Grecs, ce
n’est pas l’identité macédonienne en tant que telle (une forme de laquelle ils ont même
favorisé pour contrer l’identité bulgare), mais le fait que des patriarchistes se disant
Macédoniens s’immiscent dans une révolte qui a pour but l’accession à l’autonomie de
la Macédoine autour d’une territorialité macédonienne ; le fait donc que cette identité
macédonienne, conçue par les Grecs comme l’identité « régionale » d’une région
appartenant à la géographie grecque antiquisante, puisse s’en détacher et
s’autonomiser jusqu’à servir la cause bulgare (ou se constituer autour d’une
territorialité macédonienne). C’est pour cette raison qu’une territorialité
macédonienne, avec ou sans la participation bulgare, ayant comme référent la totalité
du territoire « historique » macédonien, est rejetée d’emblée, l’intérêt territorial grec
ne portant plus que sur la moitié méridionale et l’idée grecque de partage induisant
une logique territoriale susceptible de déboucher sur la solution de l’échange de
populations, encore que celle-ci ne soit pas encore pensée ou formulée de quelque
manière que ce soit. Seuls les patriarchistes sont revendiqués parmi les Slaves, ceux-ci
débordant toutefois la région revendiquée, alors que les exarchistes y sont nombreux.
Là où, comme à Kilkis, la population est compacte, et prise dans des faits guerriers,
l’idée d’un transfert ad hoc apparaît, mais avec l’idée d’un échange contre les
patriarchistes ou les Grecs restés en dehors des nouvelles frontières. Toutefois, pour
convaincre l’adversaire, ce dernier ayant une logique territoriale tout à fait inverse, la
violence semble s’imposer. Eu égard à la logique territoriale, c’est Chypre, en tant
qu’île, qui offre l’exemple le plus clair des deux logiques territoriales contradictoires :
énôssis contre taksim (union contre partition). Au cours du XX e siècle et après la
deuxième guerre balkanique, les exemples équivalents de conflits territoriaux ayant
comme litige les populations et leur répartition territoriale nous en apportent la
confirmation57. Pour revenir à cette stratégie de détour identitaire par l’Antiquité
classique ou hellénistique, elle n’est pas sans rappeler la politique grecque envers les
Albanais orthodoxes du sud, qui tente de faire coïncider frontière confessionnelle et
frontière ethnique afin de pouvoir revendiquer la totalité du vilayet de Yanina (Clayer
2010) à travers la géographie et l’ethnonymie antiquisante des vocables Épire et Épirote
: « Il y a des années, et aujourd’hui encore, le Chrétien albanophone qui affirmait “Είμαι
Αλβανός” (« Je suis Albanais ») disait et dit cela tout bonnement et uniquement du fait
de sa langue maternelle […] Mais aujourd’hui, c’est différent. […] L’albanophone
anciennement grec (Ο πρώην Ελληνικότατος Αλβανόφωνος) doit dire seulement qu’il
est Grec ou encore, si on l’interroge sur son pays d’origine, qu’il est Épirote », écrivait,
en 1908, dans son rapport un émissaire du gouvernement grec à Gjirokastër, exhortant
parallèlement à l’usage du terme Épirote (cette source est mentionnée par Michalis
Kokolakis [2003])58. Mais, dans le cas de l’Épire, le référent grec s’est trouvé
hégémonique après la fondation de l’Albanie indépendante (1912-1913), les termes
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
217
d’Épire et Épirote n’étant plus revendiqués par les Albanais orthodoxes nationalistes,
ceux-ci tendant à les considérer comme une stratégie sémantique de l’irrédentisme
grec envers ce qui, après 1913, est appelé en grec Épire du Nord. Le destin de ce terme
en Albanie, a surtout été d’exprimer cet irrédentisme par rapport aux Orthodoxes (les
trois communautés linguistiques orthodoxes confondues, albanaise, valaque, grecque)
sans s’attacher spécifiquement aux populations que ceux qui en faisaient usage visaient
à helléniser au départ (Albanais orthodoxes surtout mais aussi Valaques). Dans le cas de
la Macédoine, en revanche, le terme Macédonien s’est frayé un chemin de plus en plus
autonome du référent grec antique initialement revendiqué, les Bulgares portant ainsi
un rude coup à l’hégémonisme culturel et symbolique des Grecs auxquels ils le
disputent. Se détachant progressivement de cette appropriation incomplète, ce terme
se constitue en référent identitaire majeur des habitants slaves orthodoxes, exarchistes
et patriarchistes, de la Macédoine ottomane, le faisant même revivre de plus en plus
comme ethnonyme, fonction qu’il tendait à avoir, sans toutefois que cette
appropriation s’accompagne d’une stabilisation sémantique définitive. Son énonciation
trahit la lutte sémantique pour le contrôle et l’appropriation totale, menée par ceux
qui, tantôt le revendiquent, tantôt l’occultent (groupes ethniques ou linguistiques ou
mouvements politiques et États) tout au long du XXe siècle, les Grecs ayant perdu assez
tôt l’hégémonie et le contrôle de ces émanations symboliques. C’est toute l’histoire
grecque qui est réécrite par Paparrigopoulos autour de la Macédoine, le but non avoué
étant la revendication de celle-ci (je reprends ici votre analyse du terme
« Hellénisme »). Il incorpore le royaume antique de Macédoine, avec l’importance qu’il
a dans l’histoire mondiale du fait de l’hellénisation des populations asiatiques, banni
auparavant comme « barbare », celle-ci étant utilisée afin d’insister sur l’hellénisation
actuelle des populations non grécophones mais orthodoxes, Slaves et Albanais surtout,
et combinée avec l’idée libérale de la conscience nationale (Sigalas 2000).
L’hellénisation a permis la christianisation de l’Orient et c’est l’incorporation de
Byzance, elle aussi bannie auparavant, qui permet d’instaurer une continuité entre
l’Antiquité hellénistique et l’Orthodoxie, et par ce biais, de relier « les diverses phases
de l’Hellénisme ». Ensuite la conscience nationale selon les Grecs va être calquée sur la
stratégie française d’appropriation des germanophones d’Alsace et de Lorraine,
invoquant leur participation à la Révolution française, telle qu’elle est énoncée par
Michelet et reprise, après la perte des territoires, par Renan et Vidal de la Blache. Ainsi,
le refus implicite par les Grecs du « principe des nationalités », formulé depuis les
révolutions de 1848 et Napoléon III, est tempéré par l’affirmation de l’idée de
conscience nationale qui vient remplacer une conception de la nationalité fondée sur la
participation à la révolution de 182159. Cette « conscience nationale » est assimilée,
après le schisme, à la volonté des Patriarchistes de rester fidèles à l’ «Orthodoxie »,
interprétée comme une émanation de la réminiscence d’Alexandre et de Byzance (vus
comme gages de la conscience grecque), et à travers la volonté de s’helléniser
linguistiquement60. La part macédonienne de l’identité grecque est, on l’aura compris,
surévaluée, non seulement en Macédoine mais dans l’enseignement dispensé dans
l’ensemble du Royaume grec (Anonyme 2008). Les Bulgares, quant à eux, restent fixés
sur la Bulgarie de San Stefano mais sans remettre en cause les traités qui définissent la
principauté, du moins entre 1885, date de l’union de Roumélie orientale à celle-ci et
1908, année de la proclamation de l’indépendance de la principauté érigée en royaume.
C’est l’idée de l’autonomie de la Macédoine qui assurerait la protection des Bulgares de
Macédoine, conformément aux termes de l’article 23 du traité de Berlin. Cela dit,
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
218
l’exarchat joue le rôle de protecteur et d’unificateur de tous les Bulgares dans la vaste
zone comprise « entre Ohrid et la mer Noire, entre le Danube et la mer Égée où ne vit
qu’un seul peuple », selon le vocable nationaliste bulgare, qui, plus tard, comportera un
volet antiquisant, lequel, par le biais des origines, et non plus seulement par celui de la
langue, essaie d’établir une antériorité par rapport aux Grecs, sous le vocable « Mésie
Thrace Macédoine ». Mais c’est le royaume médiéval bulgare de Samouil qui apporte
une justification historique supplémentaire avec l’Église autocéphale d’Ohrid, grand
centre religieux orthodoxe. Toutefois, les Bulgares ont tant d’arguments dans le
présent linguistique que les justifications historiques ne sont pas aussi nécessaires pour
eux que pour les Grecs et les Serbes, ces derniers insistant sur la présence de leurs
royaumes médiévaux en Macédoine.
105 Tout cela montre bien la mise en œuvre en Macédoine d’au moins trois politiques
distinctes émanant des trois États qui convoitent cette région – auxquelles il faudrait
ajouter les revendications albanaises avec les actions émanant de leurs bandes
nationalistes (surtout musulmanes en 1906, mixtes, orthodoxes et musulmanes après
leur réapparition en 1911) des régions de Korçë, Bitola, Kastoria et Florina (Clayer
2007), des bandes de nationalistes « turcs », dans leur effort de ne pas perdre le
territoire, ainsi que la scission des Aroumains en « grécisants » et « roumanisants »,
appelée « guerre civile » dans la perspective nationaliste aroumaine (Trifon 2005 ;
Thede Kahl 2009). Chacune des trois politiques émanant des trois États, comporte déjà
en puissance les traits d’une future politique démographique. En effet, modifier
l’orientation politique et linguistique d’une population à travers un réseau scolaire et
ecclésiastique visant à nommer et à classer les individus (Gossiaux 2002) constitue bel
et bien une politique démographique. De plus, dans le contexte politique du XIX e et du
début du XXe siècles – et encore aujourd’hui –, une politique linguistique peut
constituer en même temps une politique démographique : ne jamais laisser percer dans
la sphère publique la langue vernaculaire méprisée et politiquement dangereuse, en la
maintenant dans ce que Gal et Irvine (1995) appellent erasure/ muting, rendant invisible
le groupe qui la parle puisque celle-ci est porteuse d’identité. Mais la contradiction
flagrante consiste dans le refus apparent de nommer/classer, alors que tout locuteur ou
toute commune de locuteurs sont répertoriés dans une classification non apparente
mais bel et bien existante et suivis dans leur choix ecclésiastique au départ, national/
politique par la suite, et ce, bien avant l’incorporation à l’État grec de la Macédoine
méridionale, en 1912-1913. C’est le degré de conscience grecque, qui, après cette date,
devient le critère objectif d’une classification comportant tous les traits d’un répertoire
« scientifique » sui generis. Il est clair que, dans le moment de crise que constitue le
changement de souveraineté, la solution pour les exarchistes ayant opté ouvertement
pour que leur langue devienne langue de prestige, consiste soit à quiter le territoire,
soit à être incorporés dans la seule catégorie existante de « patriarchistes », option
identitaire devenue obligatoire si l’on veut être citoyen de l’État, les intéressés devant
bon gré mal gré s’en accommoder. Toutefois, étant donné que la ligne de partage est
toujours fluctuante, on pèse même la conscience des patriarchistes, ceux-ci pouvant
être soupçonnés de sympathies avec l’autre camp. Ce qui entraîne une inversion des
termes : ce sont les Bulgares qui, les premiers, ont obligé les ouailles du Patriarche à
renoncer à leur Église, rendant Bulgares ceux qu’on nomme souverainement Grecs et
donnant un sens national à une identité pré-nationale. Si ces ouailles persistent
massivement dans « leur erreur », comme à Kilkis, puisqu’elles n’ont montré aucun
signe de repentir, elles peuvent être considérées comme perdues à jamais,
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
219
irrécupérables pour le nouvel État qui s’instaure. L’événement de Kilkis constitue, en
fait, un moment de cette politique démographique et ne peut être que partiellement
compris en dehors d’elle. Je préfère parler ici de politique démographique plutôt que
d’ingénierie démographique. Car ce dernier concept – dans ses usages au moins, sinon
dans ces définitions – me semble tourné surtout vers l’action violente exercée par les
États sur les populations, sans prêter suffisamment attention aux politiques de longue
durée qui contribuent à nommer et à classer les individus, à les identifier en
construisant les ensembles politisés que nous appelons des populations. L’« ingénierie
démographique » implique la catégorie juridique des crimes contre l’humanité en se
concentrant surtout sur les moments de la violence et en ôtant à l’interprétation
historique sa profondeur. D’un autre côté, il me semble que la notion d’ingénierie
démographique n’est guère propice pour rendre compte de la multiplicité des acteurs.
En Macédoine, du côté grec, nous avons une série d’acteurs différents, dont les objectifs
peuvent, selon les époques, aussi bien converger que diverger (il va sans dire que cela
vaut pareillement côté bulgare, serbe et, bien sûr, ottoman). Parmi ces acteurs, citons le
patriarcat, l’Association hellénique littéraire de Constantinople, l’Association pour la
dissémination des Lettres grecques d’Athènes, qui agit de concert avec le ministère des
Affaires étrangères et coordonne les actions des consulats, collaborant avec les
métropolites du patriarcat, ou s’opposant à ceux-ci (Karavas 2003b). La nébuleuse de
l’appareil grec s’enrichit ensuite du Comité macédonien d’Athènes, de la Ethniki
Etairia,des associations œuvrant sur place, des organisations clandestines urbaines,
comme celle de Salonique, des journaux tels Embros,des journalistes des principaux
journaux grecs de Salonique et, enfin, des chefs de bandes, venus de Grèce, de Crète, ou
locaux (c’est cet ensemble que j’appelle mécanisme macédonien grec). Sans compter le
jeu des négociations financières ou identitaires et les prises de position, plus ou moins
explicites, des élites de la population locale, surtout slavophone, mais également
valaque (numériquement plus faible mais très importante de par la proximité des
commerçants aroumains avec le parti grec, leur prestige social et leur dissémination
dans les centres urbains à faible présence hellénique ; le réel danger de la perte des
Aroumains, ainsi que des Albanais orthodoxes, équivaudrait à une forte récession du
parti grec). Cette politique est également influencée par plusieurs paramètres
extérieurs au « système grec », comme les organisations révolutionnaires
macédoniennes, les accords de Mürzsteg (1903), le gouvernement ottoman ou les
grandes puissances. Si la stabilité de ces paramètres peut garantir à la politique grecque
une certaine continuité, leur modification, en revanche, serait susceptible de lui
imposer des ruptures, comme la rupture majeure que fut la révolte d’Ilinden,
conduisant le parti grec à engager la lutte des bandes, ou celle de la révolution jeune-
turque, qui entraîna l’abandon de la lutte armée et l’adoption progressive par les trois
pays chrétiens de l’idée du partage, pour éviter toute éventualité d’une affirmation ou
d’une concrétisation de la territorialité macédonienne61.
VII. La campagne de presse grecque concernant les
atrocités
106 N. S. : Je voudrais revenir sur l’événement de Kilkis, et plus précisément sur une
dimension de l’événement que vous avez mentionnée au début de l’entretien : cet
événement est quasiment inconnu, on pourrait parler d’un non événement – sauf pour
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
220
les Bulgares, bien sûr. Non seulement l’éviction de la population slave orthodoxe de
Kilkis n’est pas mentionnée dans l’historiographie nationale grecque (ce qui n’a rien
pour nous surprendre), mais elle n’a pas eu non plus de répercussion dans la presse
internationale de l’époque. Quelles sont les raisons de ce silence ?
107 L. E. : Je pense qu’en Bulgarie non plus on n’a pas trop parlé de Kilkis après la
Deuxième Guerre mondiale. Après 1946, le choix du silence sur l’irrédentisme passé de
la nation a eu pour conséquence un mutisme concernant les déboires du passé ; les
défaites nationales ont donc été oblitérées de la mémoire collective. « Bucarest » et
surtout « Neuilly » ont été interprétés comme l’imposition à la nation de la volonté
injuste des grandes puissances. La connivence avec la Grèce, durant les années 1970, sur
l’attitude envers la Turquie et la Yougoslavie a contribué à épurer le discours public de
tout ce qui aurait pu être susceptible d’envenimer la nouvelle entente. Et cette entente
était fondée sur l’alignement tacite de la politique des deux États envers leurs minorités
turco-musulmanes respectives et le refus partagé de l’identité nationale macédonienne
et de sa concrétisation territoriale dans le cadre de l’État fédéral Yougoslave. Toutefois,
le rapprochement gréco-bulgare a été facilité par l’attitude officielle de la Bulgarie, qui
a explicitement déclaré n’avoir plus aucun intérêt pour les slavophones de Grèce.
108 Dans l’historiographie nationale grecque – comme cela aurait été le cas dans toute
autre historiographie nationale – un événement de ce genre est passé sous silence,
expulsé de la mémoire et dissimulé à l’opinion publique. Au contraire, c’est la « bataille
héroïque de Kilkis », selon la formule consacrée, qui est commémorée, ainsi que la
victoire sur la Bulgarie. Les événements de l’été 1913 sont le fondement même de la
souveraineté grecque en Macédoine. Et les débuts d’une souveraineté sont très souvent
marqués par une extrême violence. Comme le dit Jacques Derrida (1999) dans un texte
intitulé « Le siècle et le pardon », « le moment de fondation, le moment instituteur, est
antérieur à la loi et à la légitimité qu’il instaure. Il est donc hors la loi et violent par là-
même […]. Cette violence fondatrice n’est pas seulement oubliée. La fondation est faite
pour l’occulter ; elle tend par essence à organiser l’amnésie, parfois sous la célébration
et la sublimation des grands commencements » (Derrida 1999). De ce point de vue,
l’événement de Kilkis est le Deir Yassin grec62. Il n’a pas lieu dans une souveraineté
territoriale déjà en place, mais constitue le moment instituteur de cette souveraineté, il
prend place exactement dans le vide de légalité qui précède l’instauration d’un nouvel
ordre et il est de ce fait occulté dans le cadre de ce nouvel ordre qu’il contribue à
instaurer.
109 Or, cette occultation perdure jusque dans le discours des rares habitants ayant connu
les exactions commises par l’armée grecque mais ayant opté pour un retour dans leur
pays. C’est ce qu’atteste notamment le double témoignage de « Pashkalina » de Ambar-
Köy (Kilkis)63, recueilli par l’anthropologue Anastasia Karakassidou (1997 : 126-132) :
après avoir, lors d’une première interview, en 1988, assuré que son village avait été
brûlé par les Bulgares et que son frère et sa sœur avaient été emmenés en Bulgarie par
l’armée bulgare, ladite Pashkalina revient à la fin de sa vie sur ses dires et confie à cette
même anthropologue qu’en réalité l’incendie avait été le fait de l’armée grecque, que
son frère et sa sœur n’avaient pas été enlevés par l’armée bulgare mais étaient réfugiés
au même titre qu’elle dans un village de « Serbie » (i.e. les nouveaux territoires serbes
d’où ils ont eux-mêmes choisi d’émigrer en Bulgarie), précisant qu’elle et ses parents
avaient opté pour le retour en Grèce mais n’avaient jamais pu réintégrer leur village,
puisqu’ils avaient trouvé leur maison brûlée et avaient été contraints de faire coïncider
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
221
leur propre histoire avec la version grecque des événements, pour ne pas ajouter à
l’ostracisme qui les frappait déjà en tant que « Bulgares ».
110 Dans le discours des historiens, il n’est pas rare de voir des auteurs, par ignorance ou
faute de sources suffisantes, mais surtout par autocensure, passer outre les événements
de 1913 s’agissant de l’action grecque, s’en tenant surtout aux exactions bulgares ou
occultant systématiquement toute action violente grecque pendant cette guerre,
encore qu’il faille mentionner ici quelques exceptions à la règle – à côté, bien sûr, de
Karakassidou (1997), Karavas (2002a), Kostopoulos (2007), et, dans la mesure où il utilise
comme source le Rapport Carnegie tout en oblitérant les exactions, Michaïlidis (2003) 64,
tous déjà cités à plusieurs reprises. Dans son chapitre consacré à la deuxième guerre
balkanique, Kostopoulos s’étend longuement sur l’événement de Kilkis et les exactions
grecques en Macédoine orientale, explicitant pour la première fois en Grèce la logique
de l’armée et parlant d’une vaste opération de « nettoyage ethnique » (Kostopoulos
2007 : 47-59). Éléni Dalambira, bien que non historienne – elle est interprète de haut
niveau – a publié le journal de son père, d’abord dans sa petite gazette locale « Antilogos
ap’ to Halaka » puis dans son livre, Progoniko, afin de « montrer les dessous de cette
période d’exaltation nationale ». La première mention de ces exactions figure dans un
recueil de sources sur les Slavomacédoniens établi par Giorgos Margaritis et publié par
Anguélos Eléfandis dans la revue Politis en 1993. Plus tard, intervient la contribution de
Giorgos Margritis à la récente Histoire de la Grèce du XX e siècle (2001), dirigée par Christos
Hadjiossif. Et, plus détaillée, basée sur le rapport Carnegie, celle de Giorgos Nakratzas
(1998) lequel, dans un article paru dans la revue Politis, évoque « les crimes de génocide
de l’armée bulgare à Doxato et de l’armée grecque à Kilkis en 1913 ». Enfin, un roman
récent de Dimosthénis Kourtovik (2007) a pour sujet l’intériorisation de la culpabilité
du fils d’un soldat grec macédonien de la deuxième guerre balkanique ayant participé
aux exactions contre la population orthodoxe locale dans la région de Kilkis (la ville n’y
est pas nommée).
111 Quant au silence de l’opinion internationale autour de l’événement, je pense qu’il tient
en premier lieu au fait que les Grecs, les Serbes et les Roumains et, dans la mesure où ils
récupèrent Andrinople, les Ottomans sont les vainqueurs de la deuxième guerre
balkanique. C’est eux qui, à ce titre, imposent leur point de vue, d’autant mieux accepté
par les grandes puissances que ce sont les Bulgares qui ont attaqué les deux autres
membres de l’alliance. L’attaque bulgare, connue alors sous le vocable d’« attaque
brusquée » ou même de « trahison bulgare », ôte, en effet, toute « raison morale » à la
Bulgarie65. Il n’est plus question de contester les acquisitions ou les pertes des uns ou
des autres. Et le traité de Bucarest, signé aussitôt après la deuxième guerre balkanique,
devient le fondement des États balkaniques pendant le XXe siècle, du moins en ce qui
concerne l’épicentre des tensions territoriales des trois États présents en Macédoine.
112 Votre question est cependant fort intéressante. En ce qui concerne le côté gréco-
bulgare, nous assistons, dès la fin de la première guerre balkanique, ou même avant sa
fin définitive, au croisement des accusations portées de part et d’autre sur le traitement
infligé aux populations civiles dans les zones respectives d’administration. Côté grec,
les dénonciations deviennent virulentes, même avant le déclenchement de la seconde
guerre (annexes X, XI, XIII et XIV). Le contentieux entre, d’un côté, la Bulgarie et, de
l’autre, la Serbie et la Grèce, montre bien le fond territorial de la dispute (annexes XIII
et XIV). Les Bulgares accusent les Grecs de provocations et la situation à Salonique,
l’épicentre des tensions, s’exacerbe, au point qu’au printemps les autorités grecques
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
222
s’opposent à la célébration de la fête des Saints Cyrille et Méthode, temps fort de la
manifestation du nationalisme bulgare dans l’espace de la cité, et considérée comme la
fête nationale de la moins nombreuse des quatre communautés ethno-religieuses de la
ville66. Je voudrais citer ici un document diplomatique français faisant état de la tension
des relations gréco-bulgares à Salonique, quelques jours avant la signature du traité de
Londres du 30 mai, mettant fin à la première guerre balkanique :
« J’ai dit à votre excellence que l’autorité grecque s’était opposée à la célébration
traditionnelle de la fête des Sts Cyrille et Méthode. Du temps des Turcs, le parc
municipal de Betchinar [Beş Çınar] était toujours à cette occasion mis à la
disposition de la communauté bulgare. Les arrestations des Bulgares sont
incessantes et les gens qui parlent bulgare dans la rue sont immédiatement suivis et
surveillés par des agents de la police secrète » (AMAE FAA, Série A 288/37,
29/5/1913).
113 Dès qu’ils attaquent les positions serbes et grecques dans la Bregalnica, à Karassouli,
dans le Vardar et dans la région du Pangée et de Nigrita, déclenchant la deuxième
guerre balkanique, les Bulgares, comme je vous l’ai déjà dit, incendient la bourgade
entièrement grécophone de Nigrita, ainsi que cinq villages voisins, grécophones ou
slavophones patriarchistes, faisant plusieurs victimes. Plus au nord, à Demirhisar, 74
Grecs sont exécutés entre le 8 et le 10 juillet (Dotation Carnegie 1914, anonyme 1914).
Le 11 juillet, Serrès est en grande partie incendiée par l’armée bulgare et ses auxiliaires
comitadjis (sur la controverse autour des événements de Demirhissar et de Serrès,
Dotation Carnegie 1914 ; anonyme 1914 ; Miletič 1913), après que Grecs et Bulgares se
furent allègrement massacrés. Si je répète ces événements c’est pour insister sur leur
enchaînement temporel, la méconnaissance duquel a été instrumentalisée dans la
propagande grecque concernant la violence de la guerre. Le 12 juillet, le généralissime
de l’armée grecque, le roi Constantin déclare « la guerre totale contre la Bulgarie » et
annonce dans un télégramme qu’il va procéder à des représailles, étant donné que « ces
monstres à visage humain F0 5B i.e. les Bulgares 5D ont perdu le droit de se compter parmi les
F0
nations civilisées ». Ainsi, toute violence susceptible de se produire par la suite pourra
entrer dans le cadre de « ces représailles ». Ce sont les événements de Nigrita,
Demirhissar et Serrès qui ont été pris comme prétexte et non pas Doxato, incendié et
massacré par l’armée bulgare le 13 juillet. La destruction de Kilkis a eu lieu le 4 juillet,
elle est donc antérieure aux exactions bulgares, exception faite du cas de Nigrita où les
deux sont quasiment concomitantes. Le roi a prononcé sa prophétie destructrice après
la destruction. La presse n’est pas revenue sur les circonstances exactes de la bataille de
Kilkis et aucun détail en dehors des faits d’armes n’est jamais passé dans la sphère
publique en Grèce. C’est même l’affaire de Nigrita qui a conduit les Grecs à
perfectionner leur propagande de guerre (cf. supra § 62). À l’étranger, l’affaire de Kilkis
et des exactions de Guevguélia n’est pas passée totalement inaperçue ; une lettre
ouverte au Daily Mail (rédigée très probablement par Henry Noel Brailsford), adressée à
sa Majesté le roi de Grèce, et datée du 14 juillet 1913, pose d’une manière pressante la
question de l’extrême violence de la campagne grecque durant la première semaine de
la guerre (EAECA – BGASD, Dossier 113. 2. – Doc. 56b). Le 15 juillet, le roi somme le
gouverneur général de Macédoine, Stéphanos Dragoumis, de répondre aux accusations
du journal, sans lui écrire quoi que ce soit sur les violences commises par l’armée
grecque, n’évoquant que les « horreurs de l’armée bulgare » ; ce qui nous amène à nous
demander jusqu’à quel point les plus hauts fonctionnaires de l’État eux-mêmes étaient
ou non au courant de la violence exercée par l’armée grecque (EAECA – BGASD -
Archive St. Dragoumis - Dossier 113.2 – Doc. 57). À mon sens, au-delà de la loi du silence
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
223
toujours de rigueur au sein des armées, autrement dit du secret militaire, nous sommes
ici face à un mécanisme souvent observé dans des cas analogues : sans être
véritablement au courant des faits réels, qu’ils sont d’ailleurs censés nier
publiquement, les hommes d’État les subodorent, sans chercher non plus à les
connaître vraiment, par peur de se salir, ce qui permet à une administration ainsi qu’à
une opinion publique, habitée par la haine de l’autre et se victimisant soi-même, de
consolider une version des événements et de la propager dans un non-dit fondateur.
Dans le cas qui nous occupe ici, le non-dit se reflète dans l’hésitation sur le nom qu’on
allait donner à la ville après sa destruction. Les réfugiés slavophones patriarchistes de
Strumica ont été installés en grande partie, comme je vous l’ai dit, dans les ruines de
Kilkis, baptisée alors la Nouvelle Strumica (Néa Stromnitsa) (Karavas 2002a ;
Kyramargiou 2003). Toutefois, le nom de Néa Stromnitsa n’a pas tenu au-delà de l’année
1914 et la localité a retrouvé son ancienne dénomination pour commémorer la bataille
qu’y avait livrée l’armée grecque, l’été précédent. Car c’est cette bataille qui devait
rester dans le souvenir et non le transfert de populations, la béance introduite par
celui-ci devant être comblée.
114 Selon le rapport de la dotation Carnegie, les destructions et les violences dues à l’armée
grecque et à ses auxiliaires s’étendent bien au-delà du tracé définitif de la frontière
gréco-bulgare du traité de Bucarest. Le chiffre des déplacés s’approche des calculs de
Brailsford (Kostopoulos 2000 : 31, note 16). Notons que les habitants des villages
intégrés au territoire bulgare après le traité de Bucarest ont regagné leurs foyers.
L’armée n’est pas la seule en cause ; il convient d’ajouter les miliciens chrétiens et
musulmans qui avaient fait alliance avec elle, ainsi que les paysans des alentours ayant
prêté main forte. Lors de son avancée, l’armée grecque a incendié les villages qui
n’étaient pas considérés comme loyaux et la presse grecque a accusé les Bulgares d’en
avoir brûlé une partie. J’ai mentionné au début de cet entretien que l’armée grecque
aurait voulu défendre la ligne Strumica-Melnik-Nevrokop, comme future frontière
entre les deux États, correspondant aux anciennes visées maximales grecques. Mais il y
a eu des villages brûlés, y compris au nord de cette ligne, jusqu’à Simitli et Gorna
Djoumaïa. Le pillage généralisé auquel se sont livrés l’armée grecque, ses auxiliaires et
parfois les musulmans locaux, a peut-être aussi joué un rôle. Il n’est pas impossible que
l’armée, déchaînée après les événements de Doxato et les batailles de Kresna et de
Simitli, ait provoqué ces incendies, mais il est plus probable encore que toute cette
violence soit liée au plan de Constantin visant à provoquer en Bulgarie une crise
militaire et politique telle que le pays soit acculé à demander l’armistice, après une
reddition sans conditions sur le champ de bataille. Ce qui aurait permis d’inclure des
clauses plus rigoureuses dans le traité de paix et de réduire l’importance de la Bulgarie
dans les Balkans. Cet excès de zèle à conduit à l’immolation de 150 villages, soit en
partie soit en totalité (Dotation Carnegie 1914 : 321-323), autrement dit, bien plus que
les 39 de la région de Kilkis. Il s’agissait, en grande majorité, de villages ou de quartiers
exarchistes, mais aussi de 11 villages turcs (situés pour la plupart aux environs de
Strumica et dont les habitants ont été incités à émigrer en territoire grec, ces incendies
sont donc dus au transfert et font partie du « plan Strumica ») et de 3 villages valaques
meglénoroumains roumanisants (Lougountsa, Ossiani et Houma), pro-bulgares, faisant
partie des réseaux de comitadjis et dont les habitants étaient très probablement eux-
mêmes à l’origine de l’infiltration des comitadjis bulgares dans le mont Païko.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
224
115 Il conviendrait d’accorder une plus grande importance aux divergences entre le roi
Constantin, l’armée et le ministre des Affaires étrangères, Coromilas, dans la
conception du territoire qu’il faudrait incorporer à la Grèce. On sait que le roi voulait
comme frontière ce qu’il est convenu d’appeler « le tracé de Makri » à l’ouest de
Dedeağaç (en grec Alexandroupolis), ne laissant aucun débouché sur la mer Égée à la
Bulgarie, et n’envisageait de mettre fin à la guerre qu’avec l’anéantissement total de la
Bulgarie quand, humiliée et défaite, elle aurait demandé l’armistice sur le champ de
bataille. C’est dans cette foulée seulement qu’il aurait pu obtenir la ligne en question à
l’encontre du traité d’alliance conclu avec les Serbes. Ni Vénizélos, ni les Serbes, ni les
Roumains ne voulaient le suivre dans ce délire (Gardikas-Katsiadakis 1995 : 188). Les
tractations avec les Serbes en vue d’une alliance contre les Bulgares comprenaient un
volet territorial qui privait la Grèce de tout espoir d’obtenir comme frontière, au nord,
davantage que la crête du mont Belasica (Bélès), laissant Strumica et Melnik largement
en dehors. Je vois mal comment Vénizélos, grand réaliste et diplomate, qui aspirait
surtout au maintien du littoral avec le port crucial de Kavala, ait pu envisager
d’administrer tant de slavophones hostiles, ou qu’il eût pu défendre, devant l’opinion
internationale, l’incorporation de toutes ces régions considérées comme bulgares, dont
les habitants étaient en grande partie chassés, en vue d’un traité définitif. Les
événements de Strumica, Petrič, Melnik, Startchevo (village patriarchiste du kaza de
Petrič), etc., semblent plus probablement attester, comme je vous l’ai dit au début de
l’entretien, que seul le roi et une partie de son état-major, voulaient, par la destruction
de la Bulgarie, obtenir à la fois la Thrace occidentale, ayant comme frontière l’Empire
ottoman F0 2D une fois celle-ci adjugée à la Bulgarie par le traité de Bucarest, il
encouragea, vainement du reste, l’armée ottomane à avancer avant l’arrivée des
Bulgares jusqu’à Komotini (Gümülcine) et à empêcher la sortie de ces derniers sur le
littoral égéen (Gardikas-Katsiadakis 1995 : 244) F0 2D et la Macédoine au nord du Bélès
(Gardikas-Katsiadakis 1995 : 207-244). Ion Dragoumis, avait entamé des pourparlers
secrets avec les Ottomans en vue d’un accord officieux contre les Bulgares 67. D’un autre
côté, Coromilas et Panas, sont plutôt à l’origine de l’idée de l’échange de populations et
de propriétés et, dans ce but, le choix de Kilkis comme installation des Stromnitsiotes
est exemplaire, ainsi que la nette volonté que table rase soit faite de Kilkis même, où
quelques centaines de Bulgares, surtout uniates, avaient trouvé refuge chez les Sœurs
de la Charité françaises. Cloîtrés entre les murs du couvent, voyant les ruines de leurs
foyers aménagées pour recevoir les Stromnitsiotes, sans rien pouvoir faire (Dotation
Carnegie 1914) et leur mortalité ayant atteint des sommets durant ces huit mois
d’isolement (120 sur 420, selon la source) dans ce qui fut leur propre cité, les derniers
de ces malheureux ont finalement quitté le territoire hellénique à bord du vapeur Boris,
battant pavillon bulgare à destination de Dedeağaç, leurs frais de route, suite à une
intervention du consul général de France à Salonique, Léonin, ayant été payés avec une
grande joie par l’État hellénique (annexe VII). Concernant les atermoiements de la
politique grecque face à la Bulgarie, on lira avec grand intérêt le journal personnel de
Philippos Dragoumis68 (Dragoumis 1988 : 320-406). Ce dernier raconte, entre autres, que
l’armée grecque était arrivée, à la fin du mois de juillet 1913, à la limite de ses
possibilités, que l’armée bulgare était en train de se réorganiser et qu’une contre-
offensive contre le flanc gauche de l’armée grecque avait déjà porté des fruits. Les
Serbes ayant obtenu territorialement ce qu’ils voulaient et ayant arrêté la guerre, les
Bulgares ont ramené des contingents sur le front grec (Margaritis 2001 : 173 ;
Dragoumis 1988 : 355 ; Soulis 1934 : 235-238). L’armée roumaine étant aux portes de
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
225
Sofia, la Bulgarie demande l’armistice mais pas avant que Constantin, qui s’était
jusqu’alors refusé à écouter Vénizélos et le roi Carol de Roumanie, voyant ces revers,
demande à Vénizélos, alors à Bucarest, de faire en sorte que les Bulgares réussissent à
obtenir l’armistice dans les meilleurs délais, afin que la faiblesse de son armée ne soit
pas révélée au grand jour (Gardikas–Katsiadakis 1995 : 226-244). Le correspondant de
Néa Iméra, Spyros Mélas, présent à Bucarest, témoin oculaire des négociations en cours,
nous livre à ce propos son point de vue de journaliste et démontre l’importance
accordée à Kavala lors de ces tractations (Mélas 1972 : 517-544).
116 Après les événements de Doxato, on assiste à l’orchestration d’une campagne de presse
mise en place par les Grecs, dénonçant les atrocités bulgares. Depuis, le vocable
d’« atrocités bulgares en Macédoine », réduit la portée des dénonciations bulgares
quant aux atrocités grecques commises en Macédoine contre les Bulgares. Le consul
français de Salonique, Jousselin et le directeur de la Revue des Nations, Robert Pelletier 69,
dont les analyses ont, du reste, rencontré peu d’écho, ont fort bien saisi le mécanisme
de la campagne de presse grecque que le premier attribue à Dendramis :
« Jusque dans ces derniers temps, La Liberté, fondée par un Grec de
Paris, M. Valsamachi, était dirigée et rédigée en partie par le directeur de la Presse
à Salonique, M. Dendramis, maintenant délégué en Epire. Ancien vice-consul en
Macédoine, M. Dendramis se vante d’avoir organisé dans le temps des bandes d’
andartès fort redoutés des Bulgares. C’est d’ailleurs lui qui a mené toute la
campagne de presse sur les atrocités bulgares » (annexe XII).
117 Dans une autre dépêche Jousselin dresse un tableau d’ensemble de cette campagne :
« J’ai d’ailleurs rapporté au département avec quelle habileté le bureau de presse
cherche à exciter depuis plus de deux mois l’opinion publique européenne contre
les Bulgares. Fausses nouvelles ou nouvelles exagérées, remises par le bureau de la
presse aux petits professeurs, aux représentants de commerce qui sont ici
correspondants des journaux européens ; reproductions par ordre dans les
journaux locaux de ces mêmes nouvelles comme des extraits de la presse
européenne représentant l’opinion de ceux-ci, tout est employé pour donner en
Europe l’impression que la population macédonienne est exaspérée par les cruautés
bulgares, comme pour donner aux gens de Salonique et de l’intérieur l’opinion que
les grand pays d’Europe ont de ces cruautés la preuve la plus sûre » (annexe XI).
118 Nous avons déjà un exemple des plus clairs et des plus frappants de ce que dit Jousselin
dans la grossière erreur que commit L’Illustration en présentant comme un fait réel
l’immolation, non réalisée, de Melnik par ces habitants (cf. supra § 44). Un autre
témoignage allant dans le même sens, vient des archives de l’imprimerie de Laurent
(Lourentzos) Karaoulanis de l’île d’Andros. C’est un télégramme imprimé à plusieurs
exemplaires – pratique en cours dans les régions insulaires de Grèce pour faire circuler
les nouvelles importantes en l’absence de journaux – signé, le 21 juin 1913 (3 juillet du
calendrier grégorien), la veille, donc de la prise de Kilkis, par le directeur du quotidien
Espérini d’Athènes, Petros Yannaros, très proche du palais et de son réseau
d’information. Nous y lisons :
« Des prisonniers bulgares ont informé que l’armée bulgare préparait une attaque
brusquée contre Thessalonique […] Ceci montre l’intention sournoise de la Bulgarie
de s’approprier de nos pays. Roi Constantin. Correspondants étrangers de
Thessalonique se sont plaints à l’Europe contre atrocités des Bulgares et prient Grey
faire pression à la Bulgarie. Danger de massacre de millions de Grecs » (Archives de
l’Imprimerie de Lourentzos D. Karaoulanis dans la ville d’Andros 70).
119 Le dossier figurant dans les archives de Stéphanos Dragoumis – peu fourni en ce qui
concerne la presse et la propagande de guerre pendant l’été 1913, vu la position
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
226
hiérarchique élevée et le prestige dont jouissait celui-ci, d’autant plus que deux de ses
gendres ont perdu la vie en 1904 et en 191371 pour la cause grecque macédonienne – fait
très peu de place aux journalistes étrangers susceptibles d’accréditer les positions
grecques (EAECA – BGASD, doc. 43 et 46) et révèle plutôt quelqu’un qui n’a pas
conscience de l’ampleur de la violence exercée côté grec. Toutefois, ce dossier semble
confirmer que Dendramis est l’organisateur de la campagne de presse fondée sur le
contrôle de l’information qui circule à l’intérieur de la Grèce, celle-ci occultant les
violences grecques et amplifiant au contraire les violences bulgares sans les resituer
dans leur contexte qui est celui de la guerre. Un nombre très restreint de personnes
doit savoir plus ou moins clairement ce qui se passe et ce, bien au-delà du clivage déjà
évoqué Roi/Vénizélos qui n’est guère important sur le champ de bataille ni en matière
de planification ou diplomatie à court ou à long terme par rapport à l’impact des
atrocités. Seules des parties, donc, de ce que j’ai appelé le « mécanisme macédonien
grec » restent porteuses du « secret d’État », crucial pour la reproduction du discours,
le contrôle de l’information, la consolidation du pouvoir des élites locales et non pas de
l’État dans son ensemble, intervenant au moment de cette vacance de pouvoir que
constituent la guerre et la destruction du pouvoir provisoire bulgare en Macédoine
orientale. L’inter-règne bulgare n’existe pas dans la Macédoine à l’ouest de l’Axios et, à
Salonique, nous pouvons pratiquement considérer qu’il y a passation de pouvoir des
Ottomans aux autorités militaires grecques (Karavas 2008). En même temps, la Bulgarie
est quasiment coupée du reste du monde pendant la campagne militaire et la débâcle.
Ses communications sont perturbées, à tel point que même les ambassades des grandes
puissances ont du mal à s’informer convenablement (annexes XVII et XVIII et Dotation
Carnegie 1914, Introduction). Pris au dépourvu, les responsables bulgares n’ont pu
intervenir que dans une très faible mesure au début de la guerre et s’imposer dans la
sphère de la communication internationale et dans ses réseaux, et ce, malgré les efforts
et la bienveillance à leur égard de certains journalistes et spécialistes de haut niveau.
VIII. Le volet du droit international et la question des
minorités dans les Balkans. Le cas des Valaques
roumanisants.
120 N.S. : Le mécanisme grec a donc réussi à gérer son différend avec la Bulgarie vaincue en
évitant au maximum aussi bien l’accusation d’avoir perpétré de crimes de guerre que la
reconnaissance d’un statut minoritaire aux slavophones restés dans son territoire (à
ceux parmi eux qui se seraient réclamer d’une identité bulgare) ; et cela à une époque
où le droit international était en train de se constituer. Si j’ai bien compris votre
propos, la diplomatie grecque a réussi à contourner les questions de droit international
qu’aurait pu soulever le rétablissement de ses relations diplomatiques avec la Bulgarie,
dans l’après-guerre, par la solution sui generis de l’échange de fait. Qu’en est-il des
autres questions minoritaires qu’aurait pu impliquer l’incorporation à la Grèce d’une si
importante partie de la Macédoine ottomane et qui s’inscrivaient dans le cadre des
relations diplomatiques de la Grèce avec ses alliés de la deuxième guerre, la Roumanie
par exemple ? Je me réfère bien évidement à la question des Valaques roumanisants ?
121 L.E. : Vous avez raison de souligner que les guerres balkaniques sont importantes pour
l’introduction dans la diplomatie balkanique des nouveaux concepts du droit
international qui était alors en formation, telle la notion de minorité avec le dispositif
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
227
juridico-politique lui étant associée. Les questions concernant les populations que nous
appelons aujourd’hui minoritaires, étaient jusqu’à cette époque posées pour la plupart
dans des termes de protection des communautés religieuses. Cette logique ne disparait
évidemment pas avec les guerres balkaniques – elle survit en effet jusque à l’échange de
populations gréco-turc, et au-delà – mais, avec ces guerres la question se transforme
qualitativement en s’inscrivant dans le cadre, non plus d’un empire pluriconfessionnel,
même ayant subi plusieurs tentatives de modernisation, mais des relations
diplomatiques entre État-nations modernes.
122 Quant à la question du rapport des guerres balkaniques avec le statut minoritaire des
Valaques de la Grèce, je vous répondrai à travers un exemple concernant un événement
qui a eu lieu pendant la guerre – dans une zone litigieuse (où les corps d’occupations
grec et bulgare menaient pendant l’entre-guerre une coexistence difficile, comme nous
l’avons vu à Langada [Ministère des Armées 1932 ; idem 1934]) – et a eu des répercutions
dans les relations diplomatiques de la Grèce avec la Roumanie et semble avoir joué un
rôle important dans la reconnaissance par l’État grec, pour la première et seule fois
dans son histoire, d’une minorité orthodoxe (bien que le mot minorité ne fût pas
explicitement prononcé).
123 Vous vous souvenez les trois villages meglénoroumains de la Haute Karadjova dont je
vous parlais tout à l’heure à propos des villages incendiés mentionnées dans le rapport
de la commission Carnegie (cf. supra § 114). Concernant les événements qui ont eu lieu
dans ces villages nous connaissions jusqu’à récemment uniquement la missive (citée
par Astérios Koukoudis provenant du fond d’archives de Stéphanos Dragoumis)
adressée depuis Guevguéli, le 13 août 1913, par le vicaire de la métropolie au
gouverneur général de Macédoine,
« Après l’occupation militaire désormais définitive de ces villages, les Serbes s’étant
retirés, les Roumanisants des villages susdits – Loumnitsa/Louvnitsa [aujourd’hui
Skra], Ossiani [Archanguélos], Koupa, Livadia [Mégala et Mikra Livadia, seuls
villages aroumains du groupe], Houma, Verislav [Berislav, aujourd’hui, Périkleia],
Lougountsa [aujourd’hui Langadia] F0 2D , souffrant difficilement un tel changement,
œuvraient sournoisement contre le régime. Ayant secrètement conclu une entente
avec les Bulgares de Guevguéli, avec lesquels, par l’intermédiaire des organes
installés à Guevguéli, Petro Guiofi, Naoum Nikolaos et Géorgios Liokkos, ils se
trouvaient sans cesse en collaboration et en relations de comitadjité [sic. en grec,
skhesis komitadjidistikas]. Et dernièrement, suite aux dernières hostilités et à l’entrée
de l’armée bulgare à Guevguéli, ils se sont soulevés comme s’ils répondaient à un
mot d’ordre, conformément à un plan prémédité, en armes, et ont facilité l’entrée
des comitadjis bulgares dans ces villages, en utilisant ces hommes qui étaient les
instruments et les chefs de ces mouvements. Obligeant, de ce fait, les régiments
d’occupation à se déplacer et à quitter les lieux. Après avoir, à Louvnitsa, par
ailleurs, massacré le malheureux instituteur, Haralambos Gardzias, venu là depuis
Livadia, après l’éloignement de notre armée. Témoignent du fait qu’il en est advenu
ainsi les chiffres de la liste ci-jointe de ceux qui sont impliqués dans l’organisation
révolutionnaire bulgare et de ceux qui ont fui avec les comitadjis bulgares après la
reprise des villages susdits par l’armée grecque » (Koukoudis 2001 : 226-228).
124 La population de ces villages valaques a donc été en partie déplacée, non pas seulement
en tant que « roumaine » mais du fait de sa collaboration avec les Bulgares. Le
problème de ces villages est, en fait, éclairé sous un autre angle que celui de la missive
citée par Koukoudis par deux télégrammes pressants envoyés par Venizélos à
Stéphanos Dragoumis, datés 16 juillet et 3 août 1913, depuis Bucarest où il se trouve et
se bat pour obtenir, selon ses propres dires, « le rapprochement décisif avec la
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
228
Roumanie, que des grands intérêts d’État nous imposent » (EAECA – BGASD 114.1 – doc.
3 3/7/1913). Alors que Venizélos doit absolument et de toute urgence conclure cet
accord, les Roumains lui réclament des explications sur les faits dénoncés au quotidien
bucarestois Le Matin par les organisations macédo-roumaines, faisant état de l’extrême
violence des bandes grecques contre les villages valaques du Haut Meglen. Voici le
premier télégramme de Venizélos :
« Télégramme de Bucarest, le 3 juillet 1913 [calendrier orthodoxe, 16 juillet du
calendrier grégorien]
Gouverneur général de Macédoine, Thessalonique
Dans le journal roumain Matin, a été publié un long mémoire des
Macédonoroumains résidant ici, dans lequel est entre autres mentionné ce qui suit :
Nous ne rappellerons pas les vols, incendies, assassinats et viols perpétrés ailleurs
contre des Roumains par des Grecs, mais nous bornerons au canton de Mogléna,
apportant des preuves fondées sur des documents selon lesquels à ce jour il est
certifié que les mesures prises par les Grecs pour protection des Roumains étaient
l’envoi de criminels fameux, les andartès Karapanos et Mourouzitis, qui ont instauré
une terreur telle que seule l’imagination de criminels avérés peut concevoir. Dès les
premiers jours, ont été assassinés 20 notables, au nombre desquels nous citons
Traianos Troupas et Koupas, assassiné avec son fils par la bande Triandafyllou, K.
Kanakis, Stergios Dékas, Fotis Alit Véanis, Noussos Stergios, Zian Papadimitris, tous
de Livadia, la femme Dimitra, mère de Géorgis d’Ossiani. Les meurtriers ont
continué sans interruption, de nombreux autres notables ayant succombé, au sujet
desquels nous apporterons des preuves dans quelques jours. Les écoles et les églises
ont été fermées, les livres brûlés et les prêtres contraints par la baïonnette de
célébrer en grec. Les Grecs se sont joués des Roumains en leur promettant
protection. Une semaine ne s’était pas écoulée depuis les assurances données par
des Grecs en avril quand l’instituteur de Lougountsa, Stavros Christéas, l’instituteur
d’Ossiani, Troï Pamanos, Vani Tané et Vani Hantzi, ont été battus sans merci, en
sorte que le premier a succombé, Vani Tané est devenu invalide et seul Christéas en
a réchappé en se réfugiant à Thessalonique où le Prince Nicolas a vu ses plaies.
L’instituteur Christéas, en rentrant à Guevguéli, à l’incitation du Prince Nicolas qui
lui avait promis la sécurité, y a trouvé tous les instituteurs roumains avec prêtres et
notables, qui s’étaient réfugiés à Guevguéli sous la protection de l’armée serbe,
ayant échappé à la persécution de Karapanos et de Triantafyllou, lesquels
demandaient aux paysans de ramener dans leurs villages les instituteurs réfugiés à
Guevguéli, des dizaines de paysans ont été battus, dont le père, âgé, de Christéas.
Dès que la nouvelle guerre a commencé, nous avons appris que tous ceux qui n’ont
pas pu se réfugier à Sofia sous la protection de l’armée bulgare, laquelle avait
occupé Guevguéli, ont été massacrés lors de la nouvelle occupation de celle-ci par
l’armée grecque. À ce jour, il est certain que le village d’Ossiani est détruit de fond
en comble et que des centaines de familles de tous les villages [roumains de
Moglena, il va sans dire], ont été passées au tranchant du couteau. Portant à
connaissance les faits ci-dessus, je vous prie en vue instruction stricte et détaillée
de me fournir dans meilleurs délais les moyens de répondre à chacune des
calomnies susmentionnées.
Venizélos » (EAECA – BGASD 114.1 – doc. 2 3/71913)
125 Il est clair que la missive citée par Koukoudis72 fait partie de l’« instruction » demandée
par Venizélos à Dragoumis dans ce télégramme. Ce dernier doit s’être adressé
conséquemment aux autorités ecclésiastiques, donc au diocèse de Guevguéli, à la
juridiction duquel appartient le Haut Meglen. Le Diocèse, enfin, répond par
l’intermédiaire de son vicaire, qui, au lieu de prendre en considération les faits
rapportés dans le télégramme du Premier ministre, sans probablement saisir la gravité
de la situation, conçoit sa réponse sur l’ancien mode polémique de justification par
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
229
accusation de l’adversaire. La missive du vicaire reproduit en effet la rhétorique
habituelle des autorités ecclésiastiques du Patriarchat, particulièrement hargneuses
envers ces Valaques roumanisants et, de surcroît, pro-Bulgares. Or, Venizélos lui-même
n’échappe aux inerties du discours officiel typé. Dans son télégramme il parle de
calomnies et non pas d’accusations, soulignant par là-même qu’il adhère à ce cas de
figure d’homme d’État, que je vous ai décris plus haut à propos de Stéphanos
Dragoumis, consistant à faire comme si on ne croyait pas à la violence émanant des
sbires de son propre parti national et de ses rouages les moins recommandables,
surtout quand il s’agit de haute politique. « De semblables individus sont trop
compromettants pour n’être pas désavoués même par les autorités qui les emploient »,
selon l’expression du chargé d’affaires de la République française à Athènes (bien que
ce dernier se réfère dans cette phrase à l’attitude du gouvernement bulgare envers les
méfaits des comitadjis). Ce mécanisme clandestin mis sur pied par l’État s’avère parfois
incontrôlable, pouvant se retourner même contre l’intérêt de celui-ci.
126 Revenons au contexte de cette correspondance. Venizélos, pressé par les événements et
la situation de l’armée grecque, ainsi que par la position internationale du pays dans
son offensive contre la Bulgarie, ne peut en aucun cas se passer du soutien militaire et
politique roumain. Or, la conclusion d’un traité de coopération militaire se heurte à la
question épineuse des Valaques roumanisants, envers lesquels l’État roumain jouait un
rôle de protecteur. Ces derniers ont accédé au statut de millet par l’irade de 1905 et
s’opposaient farouchement aux Grecs, sans pour autant quitter le patriarcat. Leur
nationalisme atypique se référant à la Roumanie avait des difficultés à se constituer en
revendication territoriale (en raison notamment de leur éparpillement géographique)
et se limitait à la réclamation d’un statut de minorité protégée (Triphon 2005 ; Thede
Kahl 2009). Persécutés par les bandes grecques (Roubin 1913), les Valaques
roumanisants étaient enclins à soutenir les Bulgares, voire à s’allier à eux, car leur
faiblesse démographique les rendait vulnérables. Les Valaques constituaient la pierre
angulaire de la stratégie grecque dans la zone conflictuelle de la Macédoine médiane et
méridionale. Les Grecs percevaient le choix des Valaques affiliés au mouvement
roumanisant d’abandonner le parti grec comme une trahison. En 1913, les bandes
grecques, agissant indépendamment du pouvoir central et de l’administration grecque
se vengent brutalement de la « trahison roumanisante » : le fait notamment que les
Valaques du Haut Meglen sont entrés en contact avec les bandes bulgares au tout début
de la deuxième guère balkanique. Il ne s’agissait en aucun cas d’une décision de l’armée
qui, elle, comme le montrent deux missives de l’administrateur de Vodéna, protégeait
les paysans slaves même exarchistes ou « suspects », un peu plus à l’ouest, à Touchim
(aujourd’hui Aétohori), Sarakinovo (aujourd’hui Sarakini), etc., garantissant leur
sécurité afin qu’ils puissent procéder à la moisson (EAECA - BGASD 113.2 – doc. 37 et 38
des /24/6/1913 et 28/6/1913). Il est intéressant de constater que sous le régime
politico-militaire du Gouvernorat général de Macédoine, l’armée, soumise à une
administration politique, n’adopte plus les pratiques du banditisme politique, comme
elle le fait lorsqu’elle se trouve en campagne contre l’armée bulgare. Le Haut Meglen,
région peuplée de Valaques sédentaires, qui observent un mode de vie agro-pastoral
identique à celui de leurs voisins slaves, occupe une position centrale en Macédoine
méridionale, en contrôlant la vallée du Vardar de l’ouest, de la même manière que
Kilkis, la contrôle de l’est. Il est par là crucial pour les Bulgares comme pour les Grecs et
important pour les Serbes ainsi que pour « la cause roumaine en Macédoine ». La
position de Venizélos est difficile au sens où il doit répondre d’actes qui ne relèvent pas
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
230
nécessairement de l’administration grecque à l’ouest de l’Axios. En effet le Gouvernorat
général, qui reçoit l’ordre d’imposer le respect des communautés roumanisantes ainsi
que celui de leurs écoles et églises, s’y applique sincèrement. À Vérroia et au mont
Vermion, ainsi qu’à Grévéna et dans le Pinde macédonien (régions qui font état d’une
adhésion considérable au parti roumain), Stéphanos Dragoumis a moins de mal à se
faire obéir (malgré plusieurs cas d’insubordination, étouffée sous la menace de l’armée)
que dans le Haut Meglen, convoitée et infiltrée par les Bulgares, proche de l’Axios et du
théâtre principal des opérations militaires – d’où l’acharnement et l’arbitraire des
bandes. C’est le Haut Meglen qui reste l’écharde dans la plaie et, le 3 août, Vénizélos
envoie un télégramme encore plus pressant à Dragoumis, (Annexe XXV), lui suggérant
de demander aux Aroumains hellénisants et même roumanisants, ainsi qu’au consulat
de Roumanie à Salonique un démenti des exactions grecques commises dans le Meglen.
En effet, le dossier de Stéphanos Dragoumis concernant cette affaire ne contient ni un
démenti ni l’aboutissement de l’instruction exigée par le président du Conseil.
Venizélos, reste à Bucarest, après la conclusion du traité militaire jusqu’à la conférence
de Bucarest (qui allait aboutir au traité homonyme), pendant laquelle il essaye
d’obtenir le soutien de la Roumanie à l’octroi de Kavala à la Grèce. C’est de cette
dernière époque que date le deuxième télégramme de Venizélos, nous montrant que
l’affaire du Haut Meglen était devenue un moyen de pression roumaine sur le Premier
ministre grec, duquel le gouvernement roumain cherche à obtenir des concessions
concernant les droits minoritaires des Aroumains. Cédant à la pression le
gouvernement grec finit, non seulement par garantir la protection des écoles
roumaines en Grèce, mais également la constitution d’un évêché aroumain
(Antonopoulos 1917 : 154-156). Ce fait, perçu ultérieurement comme la plus grande
brèche dans la politique minoritaire de la Grèce, entraine, la démission de Stéphanos
Dragoumis (EAECA – BGASD 113.2 – doc. 25, Thessalonique 9/9/1913), immédiatement
après que cette concession lui a été explicité par Panas (EAECA - BGASD 114.1 – doc. 24,
Athènes 8/9/1913), lequel invoque à ce propos « les intérêts supérieurs de l’État ».
Dragoumis, qui était partisan d’un « hellénisme intransigeant » et s’opposait à la
reconnaissance de toute spécificité scolaire et ecclésiastique, se refusait à entériner la
politique de Venizélos (pour ne pas dévoiler les discordes ayant lieu dans le cadre du
gouvernement grec Dragoumis n’a pas rendu public le motif de sa démission). Ainsi le
consul français de Salonique interprète la démission de Dragoumis, comme résultat de
l’antagonisme entre lui et le jeune préfet Argyropoulos, sur fond de l’opposition de
Dragoumis à l’intention libérale de Venizélos d’octroyer la nationalité grecque
immédiatement à tous les habitants de la partie de la Macédoine incorporée à la Grèce ;
ce qui a été fait dès septembre (AMAE-FAA, série A A 27714 3/9/1913). Il faudrait
mentionner à ce propos que la fraction libérale, représentée par le diplomate Nikolaos
Politis, va jusqu’à proposer l’octroi de droits ecclésiastiques et scolaires à toutes les
communautés s’autodéterminant comme d’origine non grecque (bien entendu les
Bulgares) ; proposition qui a été au départ soutenue par Venizélos, et bien évidement la
Bulgarie, mais qui a été refusée catégoriquement par la Serbie (Antonopoulos 1917 :
136-140 ; Mélas 1972 : 534-535 ; EAECA - BGASD dossier 114.1 doc. 4 4/8/1913). Il
faudrait donc souligner que malgré le poids incontestable du mécanisme macédonien
dans les décisions politiques concernant la population slavophone de la Macédoine
grecque – et les questions minoritaires en général – il y a eu également, dans l’État grec,
des hommes politiques, diplomates et membres de l’administration représentant une
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
231
tendance libérale égalitaire, malgré le fait que le mécanisme macédonien et ses avatârs
l’ont emporté la plupart des fois où l’enjeu était décisif.
127 Dans sa lettre de démission, adressé au président du Conseil, Dragoumis, outre son
conservatisme politique, sa position ferme pour l’hellénisation des populations non
hellénophones du royaume et son désaccord avec la création d’un évêché roumain en
Grèce (parce que non canonique), évoque le danger que constitue à son avis la
reconnaissance de tels droits dans un État moderne, ce qui constitue pour lui la
concession d’une partie de la souveraineté de l’État. Bien qu’il soit habitué à réfléchir
dans le cadre d’une conception nationaliste fabriquée pour fonctionner dans l’Empire
ottoman – prenant donc en compte les catégories religieuses à travers lesquelles
l’administration de cet empire nommait et classait ses populations – Dragoumis voit
bien le changement de donne que constitue l’inscription des paramètres de la
question macédonienne dans le cadre d’une souveraineté moderne.
IX. La France, l’Entente et l’instrumentalisation des
atrocités
128 N. S. : Permettez-moi de revenir sur la question de l’occultation de l’événement de
Kilkis par l’opinion internationale et le retentissement consécutif qu’ont eu les
atrocités bulgares. Vous semblez dire que la campagne de presse grecque était sans
comparaison avec la campagne bulgare. Mais, la campagne de presse grecque aurait-
elle été à ce point réussie si elle n’avait pas reçu l’aval de la diplomatie occidentale ?
129 L. E. : La campagne de presse grecque est en effet sans commune mesure avec la
campagne bulgare, quant à la manière dont elle est conduite, surtout après les
événements de Nigrita. Cette campagne commence avant la déclaration de la deuxième
guerre balkanique, parce qu’il y a litige, déjà depuis la prise de Salonique (Karavas 2008,
annexes XIII, XIV). Les trois principaux alliés de la première guerre balkanique ne
parvenant pas à s’entendre sur les territoires à partager, les grandes puissances suivent
attentivement les évolutions sur le terrain. C’est le moment où se constituent les
sphères d’influence des grandes alliances qui se confronteront ensuite dans la Première
Guerre mondiale et il faut signaler que les pays de l’Entente, surtout la France, sont
mieux disposés envers les Grecs et les Serbes qu’envers les Bulgares, dont le souverain
semble être plus à même d’entrer dans la sphère d’influence autrichienne que dans
celle de la Russie, à cause du mécontentement causé par ce qu’il considérait être
l’inéquitable partage des territoires occupés par les alliés pendant la première guère
balkanique. Comme le signale déjà l’ambassadeur de France à Vienne, Alfred Dumaine 73,
dans une dépêche adressée à son ministre avant que n’éclate la deuxième guerre
balkanique, dans l’hypothèse très probable d’une conflagration entre les alliés
balkaniques, la propension de Sofia et de son souverain à exercer une domination
politique et militaire dans la péninsule, encouragée dans ce sens par Vienne
(Larmeroux 191874), pousserait Grecs et Serbes à s’allier contre elle ; et la France, de
même que ses deux grands alliés, redoute avant tout une connivence entre Sofia et
Vienne. Les jeux sont donc presque faits avant l’attaque bulgare, puisque Dumaine,
ainsi que ses homologues de Constantinople, Athènes, Belgrade et Bucarest,
préconisent le soutien de la France à la Serbie et à la Grèce. Il est même impressionnant
de constater que, pour l’auteur de la dépêche, la seule façon d’empêcher la Bulgarie
d’avoir une frontière avec l’Albanie (considérée comme un avant-poste de l’Autriche-
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
232
Hongrie), et d’accroître ainsi son importance stratégique dans les Balkans, serait
d’« éliminer les Bulgares des régions situées sur la rive droite du Vardar » (annexe XV).
Si les Français, à la suite des Serbes, redoutent une frontière commune entre la Bulgarie
et l’Albanie, la solution ne peut être que celle d’une frontière commune entre la Grèce
et la Serbie (Gardikas - Katsiadakis 1995 : 186-187), ce qui semble indiquer qu’une
victoire grecque sur les Bulgares à Kilkis, place forte de ces derniers sur la rive gauche
du Vardar, serait nécessaire. On ne saurait en conclure, bien entendu, que les Français
et leurs alliés auraient été favorables aux exactions de juillet 1913, mais cette crainte
explique dans une certaine mesure la facilité avec laquelle ils ont fait leur
l’interprétation grecque des événements de la deuxième guerre balkanique. Il convient
par ailleurs de signaler que cette dépêche de Dumaine arrive quelques jours après les
pourparlers tenus secrètement entre Serbes et Grecs (Gardikas – Katsiadakis 1995 :
186-203), aboutissant au traité d’alliance de juin 1913 (Ministère des Armées 1934 GI
1934 : 571-592) et, au cours desquels il a été précisément question de la nécessité
absolue d’une frontière commune entre la Grèce et la Serbie. Maurice Bompard,
ambassadeur français à Constantinople, voit dans cette dépêche de Dumaine un point
de vue qui « ne peut manquer d’exercer dans l’avenir une influence considérable sur les
orientations générales de la politique française », mais émet un doute sur la conviction
de ce dernier que la Bulgarie serait inexorablement portée vers la politique
autrichienne (annexe XVI).
130 Il est d’ailleurs clair que de Panafieu, ambassadeur français à Sofia, de même que le
consul français à Salonique, Jousselin – « très hostile envers tout ce qui est grec », selon
la propre expression du chargé d’affaires à Athènes, Poulpiquet du Halgouët, très
enclin, pour sa part, à accorder crédit aux représentants du gouvernement grec –
rencontrent nettement moins d’échos auprès du ministre que leur collègue d’Athènes.
De Panafieu est moins écouté en raison de ses positions légèrement pro-bulgares
(annexe XVII). C’est le point de vue du chargé d’affaires français à Sofia, Dard –
proposant une version des faits plus crue que celle de son ambassadeur, qui nous
permet de mieux saisir les agissements d’Athènes et de Sofia (annexe XVIII). Mais dans
la controverse sur les atrocités intervient l’erreur monumentale du consul français de
Salonique, Jousselin, qui semble appuyer le témoignage d’un protégé français
demeurant à Doxate, selon lequel ce serraient des comitadjis grecs qui ont mis le feux et
commis les extorsions et les massacres ayant eu lieu dans ce bourg (AMAE FAA Série A
286/10 et 11 2/8/1913). Ce témoignage fantaisiste – démenti, ensuite, par l’enquête de
Poulpiquet du Halgouët et du colonel Lépidi – a dû discréditer Jousselin aux yeux de son
ministère et ouvrir la voie à son remplacement, quelque semaines plus tard, par Léonin,
dont les positions étaient plus conformes aux dispositions de la diplomatie française
envers la Grèce, dont la nouvelle souveraineté sur Salonique, qui conserve son
importance pour la France – est dorénavant sans conteste75. Léonin, considère que le
gouvernement hellénique « au point de vue purement politique » n’a pas tort de
favoriser, encore en mars 1914, la poursuite de l’exode bulgare des territoires réunis à
la Grèce : « Moins il y aura de Bulgares dans cette région, plus la sécurité et la paix
seront assurées dans le pays » (annexe VII). Mais la formulation la plus claire de
l’attitude favorable de la France envers le point de vue grec et la raison d’État
hellénique figure dans la lettre de l’ambassadeur de France à Athènes, G. Deville, à son
ministre Doumergue, critiquant l’inconsistance de la Russie dans sa politique
balkanique. Je vous la lis en entier sans nier que, de son point de vue, l’auteur a des
raisons valables de s’exprimer ainsi, encore que ce document montre pourquoi, à un
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
233
niveau d’État, la France soutient à ce point la Grèce et comment le choix s’est opéré
entre les deux attitudes que l’on décèle chez les diplomates français :
« À deux ou trois reprises, le ministre de Russie a insisté auprès du gouvernement
grec pour que la population soi-disant slave des nouvelles provinces annexées à la
Grèce F0
2D on estime qu’elle compte de 200 à 250 000 âmes 2D conservât ses écoles et
F0
ses prêtres. Il se heurta à l’objection que ce serait contribuer à propager l’influence
de l’exarque au détriment du patriarche.
On annonce maintenant le prochain départ de l’exarque pour Pétersbourg, & on a
lieu de penser que ce voyage a pour but de solliciter l’intervention de la Russie afin
de réconcilier ou même de fusionner patriarcat & exarchat.
Si cette tentative réussissait, il n’est pas douteux que la Russie recommencerait ses
démarches à Athènes en faveur de l’acceptation des instituteurs & des prêtres
bulgares dans la région de la Macédoine devenue grecque. L’argument religieux
invoqué n’existerait plus mais le danger politique n’en serait peut-être que plus
grand.
Comment la Russie ne voit-elle pas qu’elle n’a aucun intérêt, au contraire, à
fomenter dans les nouvelles provinces grecques un foyer d’irrédentisme bulgare ?
Sous couleur de protection du slavisme, elle aboutirait à favoriser les menées
divisionnistes & anarchiques de la politique autrichienne qui lui est essentiellement
hostile ; en s’imaginant être slavophile, elle serait réellement anti-russe » 76.
131 Revenons à présent à Salonique et aux intérêts français pour comprendre comment la
situation peut expliquer cette attitude et la tentative pour le moins surprenante
d’occultation d’un problème slave en Macédoine grecque de la part de la diplomatie
française. Les Français sont présents à Salonique à travers leurs intérêts économiques
(qui représentaient un chiffre d’affaires de plus de deux millions de francs or), la
mission laïque, leurs écoles religieuses77, le séminaire de Zeytinlik dont les élèves sont
surtout des uniates bulgares (parfois cités plus tard comme Macédoniens dans les
documents français, cf. AMAE FAA, série A- 278/2-16/7/1919), et enfin à travers
l’importance de l’Alliance israélite universelle, qui propage la francophonie chez les
juifs sépharades, composante majeure de la population, et au-delà de cette
communauté78. L’alliance est le principal agent de la constitution du français en langue
véhiculaire, en remplacement du « spaniol », langue de plus en plus confinée à l’espace
familial. Le français à Salonique est ainsi en train de se diffuser au-delà de la
communauté juive et d’embrasser les élites turques, grecques et bulgares, en tant que
langue de culture dans la ville79. Aussi Jousselin juge-t-il préférable pour les intérêts
français en Orient, comme on les appelle encore, que la ville de Salonique jouisse d’une
autonomie ou soit déclarée ville franche (AMAE FAA, série A 263/2, 7/3/1913). Les
autres options seraient un condominium des trois puissances chrétiennes ou une
incorporation à la Grèce ou la Bulgarie. Les Autrichiens penchent pour la solution d’une
ville franche et, en seconde option, si l’incorporation de la ville à l’une des deux
puissances qui occupent Salonique s’avère nécessaire, pour l’incorporation à la
Bulgarie. Les positions serbes connaissent trois phases successives : dans un premier
temps, ceux-ci soutiennent l’incorporation de Salonique dans leur État (Todorovitch
1913), ensuite ils paraissent plus enclins à l’idée du condominium (AMAE FAA, A
288/34-35, 21/5/1913 et A 288/44, 17/3/1913), pour en venir finalement, avec l’accord
secret, à accepter l’incorporation à la Grèce sous condition de l’institution d’une zone
franche.
132 Jousselin considère la solution grecque comme la pire (Molho 1994). Notons qu’il ne
prend pas en compte la dimension politique de la question des Juifs de Salonique, qui
seraient, selon d’autres diplomates français, plus aptes à entrer dans la sphère
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
234
autrichienne, en raison surtout de l’importance du sionisme en Autriche-Hongrie.
Ainsi, l’ambassadeur de France à Londres, Paul Cambon, écrit, à la même époque, dans
une dépêche au ministre des Affaires étrangères, Stephen Pichon :
133 « Les quelque 70 000 Juifs qui résident à Salonique seraient apparemment très désireux
de transformer cette ville en une petite république israélite qui serait fatalement la
cliente politique de l’Autriche-Hongrie. Pour gagner notre gouvernement à cette cause,
eux et leurs coreligionnaires de France font état des dangers dont la domination
hellénique menacerait l’influence française à Salonique. Danger pour danger, je préfère
la concurrence que l’hellénisme fera à nos écoles, à la prédominance de l’influence
autrichienne dans le gouvernement de Salonique ville libre. Aussi bien l’avenir de nos
écoles, comme la sauvegarde des intérêts économiques et moraux de la colonie
israélite, peuvent parfaitement faire l’objet de garanties spéciales à réclamer à la
Grèce » (AMAE, FAA, Série A 288/41 3/4/1913).
134 L’insécurité des Grecs quant à la possession de Salonique rend ceux-ci extrêmement
déférents envers la communauté israélite de la ville, ce qui amène les Juifs de la ville,
jusque-là suspicieux à leur égard à envisager sous un angle plus positif l’incorporation à
la Grèce (Molho 1994). On voit bien que les puissances de l’Entente, et surtout la France,
penchent ainsi de plus en plus en faveur de la solution « Salonique ville grecque ». Par
ailleurs, après l’attaque de juin, la Bulgarie perd le soutien de la Russie. Le terrain était
miné d’avance : la peur de l’influence autrichienne et la « guerre de conquête » de la
Bulgarie, aspirant à Constantinople, la mettent en porte-à-faux avec les puissances de la
Triple Entente.
135 N. S. : Dans ces conditions donc, les puissances de l’Entente décident de clore le dossier.
136 L. E. : Exactement. Il est clair que les Bulgares rencontrent moins d’écho en tant que
vaincus, encore que les intérêts propres des puissances de l’Entente entrent également
en ligne de compte lorsqu’il s’agit de souscrire à l’une ou l’autre interprétation.
137 La campagne de presse grecque a donc immédiatement instrumentalisé les atrocités
bulgares, tout à fait réelles, à Nigrita, à Demirhissar, à Serrès et à Doxato. L’incendie de
Doxato et le massacre d’une partie de sa population ont eu un retentissement si grand
en Angleterre, en France, en Russie et en Italie, surtout, que l’opinion publique a été
acquise aux thèses de la barbarie des Bulgares et cela, malgré la bonne presse qu’avait
la Bulgarie, du fait de ses progrès et du comportement héroïque de son armée,
présentée pendant la première guerre balkanique comme « l’avant-garde de l’Europe
en Orient » dans la presse internationale. Cette campagne a porté ses fruits ; je n’en
veux pour preuve que le mode de classement des archives à Nantes : les documents des
consulats et des ambassades de France en Grèce et en Bulgarie on été classés dans le
dossier « atrocités bulgares », alors qu’une grande partie d’entre eux évoquent les
atrocités grecques contre les Bulgares. Ce qui atteste que le classement a été opéré
après coup, en fonction non pas du détail des rapports mais de l’évidence de
l’interprétation du moment. Mais, pour reprendre l’analyse de de Panafieu :
« la légende s’est établie d’autant plus aisément que certaines personnalités
étrangères et plusieurs correspondants de journaux lui ont donner l’apparence de
la vérité sans se rendre compte qu’une enquête qui n’est pas contradictoire ne peut
apporter aucune certitude, quelque soin et quelque sincérité qu’on ait mis à la
conduire. Le résultat recherché par les Grecs a été obtenu et, malgré les preuves
évidentes que pourront présenter les Bulgares pour leur défense la légende
subsistera » (annexe XIX).
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
235
138 Stephen Pichon, ministre des Affaires étrangères, de même que son homologue
britannique et l’ambassadeur français à Londres, sont disposés à accréditer les
positions grecques et à passer pratiquement sous silence tous les rapports qui, après la
défaite bulgare, parviennent de Salonique ou de Sofia et font état d’atrocités grecques
(annexe XVIII). Pichon va même jusqu’à se défendre auprès du ministre grec des
Affaires étrangères, Lambros Coromilas, lorsque ce dernier lui demande des
explications à propos d’une lettre qu’il avait adressée à Georges Berry, député de la
Seine, publiée dans un quotidien français sous le titre « les atrocités bulgares. M.
Pichon les confirme » (AMAE, FAA, A286/15, nº 576,22/8/1913). Dans cette lettre, le
ministre français, après avoir appuyé de son autorité les résultats des enquêtes
françaises sur les atrocités bulgares (celles du chargé d’affaires Poulpiquet du Halgouët
et du colonel Lépidi), se référait aussi, cette fois-ci sans donner son avis, à des enquêtes
rapportant des violences commises également par des Grecs (annexe XX). Or, par une
telle attitude, l’Entente ne faisait que pousser davantage la Bulgarie dans les bras des
puissances centrales, au côté desquelles cette dernière entre en guerre deux ans plus
tard. S’il est vrai que Dumaine avait prévu cette évolution, l’attitude adoptée par la
France envers la Bulgarie a contribué davantage encore à la réalisation de sa prophétie.
Son assertion selon laquelle la France déploie des efforts en faveur de la paix exige
d’être relativisée, dès lors qu’on prend en compte le fond du problème, à savoir le
maintien en vigueur du plus puissant irrédentisme au cœur même de l’Europe : la
récupération de l’Alsace et de la Lorraine, qualifiée sous la Troisième République
française de « revanche », et qui est au cœur de l’alliance franco-russe (Nolde 1936). La
mise en place de la Triple Entente qui en découle, avec la participation de l’Angleterre,
est une formidable réponse à la constitution de la Triple Alliance avec l’Autriche-
Hongrie et l’Italie, qui a remplacé l’ « Alliance des trois empereurs » de Bismarck et
intensifié l’antagonisme austro-russe dans les Balkans. En fait, ces deux derniers grands
empires, « les deux puissances les plus intéressées en Macédoine », pourraient être
considérés comme des puissances balkaniques, l’un ayant même en sa possession
formellement depuis 1908 un territoire balkanique ottoman, la Bosnie- Herzégovine,
outre la Croatie et la Dalmatie, territoires balkaniques non ottomans, rattachés à la
couronne de Saint-Étienne et en partie la Transylvanie, le second, outre le
rattachement déjà concrétisé de la Bessarabie, voulant modifier le régime des Détroits
et, à terme, contrôler Constantinople. Il en résulte, après 1912, un antagonisme très vif
au sujet des deux petites puissances slaves des Balkans, la Serbie et la Bulgarie,
l’influence de la Russie en Serbie ayant remplacé celle de l’Autriche depuis le régicide
de 1903 et la guerre des cochons de 1905 (Fay 1930). La Bulgarie se retrouve tiraillée
entre les deux influences, celle de sa libératrice russe, d’un côté, et l’influence
autrichienne, de l’autre, et ce, depuis le changement de dynastie et la politique de
Stamboulov. La France, comme nous l’avons vu, redoute l’emprise autrichienne en
Bulgarie et soutient de toutes ses forces la Serbie, du fait que la Bulgarie, à mesure que
le litige territorial se creuse entre elle et ses alliées, montre des velléités de « trahir le
slavisme » et de rejoindre l’Autriche, laquelle l’aurait incitée à rompre l’alliance, encore
que cela ne soit pas prouvé (Fay 1930 : 403, note 164).
139 Or, après la seconde guerre balkanique, un fait nouveau et exceptionnel dans le
système des alliances atteste que les volontés antagonistes de la Russie et de l’Autriche,
d’une part, de la France et de l’Allemagne, d’autre part, se rejoignent dans l’affaire de
Kavala. Lors des négociations précédant la signature du traité à Bucarest, la France et
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
236
l’Allemagne soutiennent la Grèce dans sa revendication de Kavala, la Russie et
l’Autriche appuyant le rattachement de la ville à la Bulgarie. Comment expliquer cette
contradiction flagrante ? La France, en dépit de quelques réticences initiales quant à
l’attribution à la Grèce de Kavala, afin de ne pas s’aliéner son alliée la Russie (Gardikas-
Katsiadakis 1995 : 226)80, avait déjà appuyé la Grèce pendant la guerre, comme le
prouvent les positions adoptées en plus haut lieu face aux atrocités grecques et
bulgares. N’oublions pas que Doxato, sur la route de Kavala à Drama, est le bourg grec
(situé dans une plaine de population majoritairement turque) qui relie Drama (au nord
de laquelle s’étendent les hautes terres de population majoritairement slave) au littoral
à majorité grecque. Cet élément met en lumière le caractère territorial des agissements
bulgares à Doxato, conserver Kavala, seul port praticable sur le littoral égéen conquis
pendant la première guerre balkanique, constituant l’objectif principal de la Bulgarie.
La France, elle, tout compte fait, a tout intérêt à ce que Kavala revienne à la Grèce pour
limiter une éventuelle présence maritime des puissances centrales, surtout de l’Italie,
en mer Égée, du fait que ce grand port est situé à mi-chemin entre Salonique et les
Dardanelles et que la puissance maritime italienne, autrichienne et ottomane (sous
l’influence de l’Allemagne) pourrait l’utiliser dans une éventuelle conflagration.
Rappelons que la France a par ailleurs des intérêts économiques dans la région,
notamment dans le commerce et le monopole des tabacs, grande richesse locale, que les
Bulgares avaient menacé de confisquer. Au demeurant, c’est un autre facteur qui sera
décisif : le Kaiser, beau-père de Constantin de Grèce, veut, par l’intermédiaire de Carol
de Roumanie, lui aussi un Hohenzollern, hôte de la conférence de Bucarest, « faire
cadeau » de Kavala à la Grèce, l’Allemagne voulant accroître les possibilités éventuelles
d’une adhésion de celle-ci à la Triple Alliance, contrecarrant ainsi les visées de son
alliée l’Autriche-Hongrie qui souhaite, pour sa part, l’ « offrir » à la Bulgarie. Du coup, la
France redouble d’efforts pour conserver son influence à Athènes à travers Venizélos et
gagner la Grèce à la Triple Entente. Pour ne pas perdre son prestige auprès de la Grèce,
la France va ouvertement à l’encontre de son alliée la Russie qui, en ce qui la concerne,
ne veut pas perdre son prestige auprès de la Bulgarie et, de ce fait, unit ses efforts à
ceux de sa pire antagoniste, l’Autriche-Hongrie (Fay 1930 : 410-416). C’est finalement la
France et l’Allemagne qui auront gain de cause, non sans amener au bord de la rupture
la France et la Russie alliées, et provoquer de graves remous entre les deux autres
alliées, l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie. Sir Edward Grey, ministre britannique des
Affaires étrangères, au-dessus de la mêlée, se félicitait ainsi de l’avenir de la paix en
Europe du fait que les alliés ne se suivent pas aveuglément dans leurs choix 81. Kavala
devient grecque, Venizélos ayant fait de son mieux pour la conserver, sachant que
Strumica et Melnik n’étaient même pas négociables. Il ne faut pas oublier la concession
par celui-ci de droits spécieux aux Valaques de Grèce, lui procurant l’aide de son hôte,
le Roi Carol, concernant Kavala. Du reste, les Bulgares, pendant leurs occupations
ultérieures de la Macédoine orientale grecque, ne chercheront pas à s’établir
souverainement à Kilkis, acceptant tacitement le fait accompli, mais à Kavala et dans
son hinterland reliant la Bulgarie à la mer Égée, Kilkis étant l’hinterland de Salonique à
jamais perdu et ne gardant qu’une importance symbolique.
140 Les violences bulgares perpétrées pendant la Première Guerre mondiale contre la
population de la Macédoine orientale grecque82 et de la Macédoine serbe incorporées
dans le territoire bulgare ont entraîné un désintérêt pour le destin de ces populations
chassées du territoire grec, devenus ressortissantes d’un pays que l’Entente a humilié à
Neuilly. En 1918, le professeur Jordan Ivanov (1918) publie un opuscule fondé sur les
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
237
sources du rapport Carnegie (1914), afin de répondre aux arguments développés dans
un meeting pro-grec, tenu à Genève le 17 mai 1918, pour protester contre les violences
de l’occupation bulgare. C’est lui aussi qui publie en 1919, après la défaite bulgare, et
avant la Conférence de Paix, le livre de défense de la Bulgarie devant le Congrès, livre
qui rencontre peu d’écho (Ivanov 1919). En 1919 également, le ministère des Affaires
étrangères et des Cultes de Bulgarie fait paraître un ouvrage en deux volumes intitulé
La vérité sur les accusations contre la Bulgarie. Le premier paragraphe de l’avant-propos
commence ainsi :
« La nouvelle de l’incendie de la ville bulgare de Koukouche et de l’affreux carnage
des Bulgares – massacrés “comme des moineaux” par les troupes grecques lors de
leur entrée en Macédoine Orientale – n’était pas encore parvenue à la connaissance
du monde qu’un des souverains balkaniques lançait le télégramme suivant : […] ».
141 Le télégramme de Constantin auquel j’ai fait référence est cité ici en entier. Et le texte
de continuer :
« la conscience publique troublée ne s’était pas encore ressaisie de ce premier
coup, que des quatre coins de la péninsule des Balkans étaient lancées l’une après
l’autre des nouvelles épouvantables sur les “atrocités bulgares”. Les agences
télégraphiques de Constantinople, Bucarest et Belgrade et surtout celle d’Athènes,
qui, au signal donné, s’étaient mises à l’œuvre avec une énergie fiévreuse,
remplissaient l’air de leurs cris contre les “excès” commis par l’armée bulgare, dont
le monde civilisé n’avait pourtant entendu parler jusqu’alors qu’à propos de ses
hauts faits. Et personne ne se demandait jusqu’à quel point ces communications
répondaient à la vérité » (Ministère [bulgare] des Affaires étrangères et des Cultes,
1919).
142 L’expulsion des Bulgares de Kilkis devient dans ce livre (conçu pour dédouaner la
Bulgarie des nouvelles accusations pour crimes de guerre, lors de son occupation de la
Macédoine orientale grecque et de la Macédoine serbe en 1917-1918) la première étape
d’un récit de victimisation de la nation bulgare, qui s’achève avec « la seconde
spoliation de la Bulgarie » à Neuilly, avec l’amputation de son débouché maritime sur la
mer Egée, la Thrace occidentale, de la poche de Strumica, etc. La mention de Kilkis en
premier lieu ainsi que la tentative de démontrer que le mécanisme de propagande
grecque mise en œuvre autour de l’occultation des événements de Kilkis a été
dévastateur montrent à quel point cet événement est fondateur du révisionnisme
bulgare, qui a persisté jusqu’à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais révèlent
également l’importance du traumatisme qu’il a généré.
X. L’aspect juridique et ses implications durant le
XXesiècle
143 N. S. : Je voudrais revenir sur l’aspect juridique du problème des réfugiés de Kilkis et
des autres régions de la Macédoine orientale incorporée en 1913 à la Grèce ayant connu
le même sort. Comme vous avez dit auparavant, cette question n’a pas été réglée à
Bucarest. Quand s’est-elle définitivement réglée ? À quelle époque passe-t-on de
l’échange de fait à l’échange de droit ? Enfin, la politique démographique poursuivie
dans le cas des réfugiés de Kilkis et de la Macédoine orientale (l’opposition obstinée au
retour de ceux-ci) est-elle mobilisée dans des cas analogues, pendant de périodes
ultérieures de l’histoire de l’État grec ?
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
238
144 L. E. : La question des réfugiés reste en suspens avec la signature du traité de Bucarest,
comme nous l’avons vu à propos de la difficulté de rétablir les relations diplomatiques.
Bucarest règle la question territoriale entre les trois États présents en Macédoine.
Même après le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays au milieu
de l’année 1914, le retour des réfugiés « bulgares » en Grèce ne se concrétise pas,
malgré le désir évident de la majorité d’entre eux (cf. supra note 3 et § 38-42).
L’inexorable choix que fait la Bulgarie d’une alliance avec les puissances centrales,
pendant le difficile « été bulgare »83 de 1915, remettra en cause ce règlement territorial
au nom d’une autre conception émanant de Vienne et, cette fois-ci, de Berlin. Mais la
défaite de 1918 n’en fut que plus écrasante encore. Du point de vue territorial, on
revient à une situation pire encore pour la Bulgarie, puisque le traité de Neuilly
entérine la perte définitive de la Thrace occidentale, au profit de la Grèce, et de la
poche de Strumica et d’autres petites poches, au profit de la Serbie. Une partie des
réfugiés de Kilkis se trouvent ainsi en Macédoine serbe et certains de leurs descendants
sont aujourd’hui en république de Macédoine. L’exode du territoire grec de la
Macédoine orientale se poursuit même après 1914, jusqu’en 1916 (Kontogiorgi 2006 :
204). En 1919, on donne le droit à ceux qu’on considère avoir des sympathies pro-
grecques d’effectuer des courtes visites pour la liquidation de leurs propriétés en Grèce,
en s’opposant toutefois à toute tentative d’installation, des instructions strictes ayant
été données à ce propos aux autorités locales (Kontogiorgi 2006 : 205). En 1920, c’est au
tour des réfugiés grecs de la Thrace occidentale de regagner leurs foyers et à celui des
réfugiés bulgares de Macédoine et de Thrace orientale (installés en 1913-1914) de
quitter le territoire (Michaïlidis 2003 : 150-164 ; Altinoff 1921 ; Dalègre 1997 ; Kalantzis
200884). Le traité de Neuilly prévoit une convention gréco-bulgare d’émigration
réciproque et volontaire des minorités, qui finit par englober l’ensemble de la question
des réfugiés antérieure à la signature de la paix. Et c’est au cours des discussions de la
commission mixte sur l’interprétation de l’article 12 qu’est formulé pour la première
fois un traitement global de la question du mouvement des populations réfugiées d’un
État à l’autre. Or, cette discussion révèle plusieurs points intéressants, que l’on
retrouve dans les deux mémoires du dernier président de la commission mixte, le
commandant belge Marcel de Roover, datés des 6 juin 1921 et 21 août 1921. Elle est en
majeure partie liée à la complexité qu’ajoute pour l’échange la question des biens par
rapport à un tiers pays, l’Empire ottoman, dont la fluctuation des frontières et la
progressive perte des territoires au profit des Grecs et des Bulgares viennent encore
compliquer l’accord direct gréco-bulgare. Cependant, les positions prises par les
délégués de chaque pays montrent que les dispositions de la convention sont sujettes à
différentes interprétations par chacune des parties. Lorsque l’on décide d’inclure dans
le règlement les réfugiés des guerres balkaniques, le représentant grec insiste sur la
nécessité d’y inclure également les populations réfugiées dans l’intervalle entre
l’occupation militaire des nouvelles provinces et l’instauration de la souveraineté – à
savoir, pour ce qui nous intéresse ici, également les réfugiés de Kilkis et des autres
régions de Macédoine orientale qui ont connu le même sort. Les délégués de la Société
des Nations sont évidemment réticents vis-à-vis de cette clause qui mettrait la
convention en contradiction avec le droit international. Afin de satisfaire cette
exigence, mais sans pour autant la nommer, c’est finalement une date très antérieure
qui sera retenue. Le règlement concerne en fin de compte les mouvements de
populations des vingt dernières années, à partir de l’année 1900, en attribuant un statut
juridique aux faits accomplis qui restaient jusqu’à cette époque en dehors du droit 85. Le
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
239
point déterminant de ce règlement juridique demeure pourtant l’article 44 du traité de
Neuilly, qui reconnaît de plein droit la nationalité hellénique à tout ressortissant
bulgare établi sur le territoire grec, à condition toutefois qu’il renonce à sa nationalité
bulgare, le choix de l’une des deux nationalités impliquant la perte définitive de l’autre
(comme il est dit dans l’article 56 du traité de Neuilly), ce qui signifie que celui qui opte
pour la nationalité bulgare sera automatiquement échangé et inversement (Wurfbain
1930 ; Ladas 1932 ; Pentzopoulos 1962). Mais, d’un autre côté, il stipule que l’obtention
de la nationalité hellénique pour tout Bulgare installé sur le territoire grec
postérieurement au 1er janvier 1913 est subordonnée à l’autorisation de la Grèce
(Géorgiadis 1941, Tsitsélikis F0
26 Christopoulos 2008). L’objectif concret de cette clause ne
devient apparent que dans la conclusion du rapport de Marcel de Roover en date du 21
août 1921, seule partie du dossier où mention explicite est faite de la guerre de 1913.
Permettez-moi de vous en lire un passage :
« Les migrations des minorités bulgares
Parmi les minorités bulgares encore en place en Macédoine et en Thrace hellénique,
le désir d’émigrer paraît peu répandu. Il ne faut d’ailleurs pas conclure de là que le
but de la Convention ne serait pas atteint, en ce sens que la migration ne serait pas
RÉCIPROQUE. En réalité, les migrations des éléments bulgares les plus inconciliables
avec le régime hellénique ont pris place avant la mise en vigueur de la Convention,
principalement en 1913, lors de la prise de possession de la Macédoine par les
armées grecques. Et en 1920, lors de l’établissement du régime hellénique en
Thrace, le nombre de ces émigrés dépasse 200 00086, d’après les statistiques
bulgares. Pour les minorités bulgares, l’élément essentiel est donc représenté par
les émigrés : les réfugiés macédoniens et thraciens. Ceux-ci sont généralement dans
une misère profonde. Ils sont organisés en comité pour la défense de leurs droits.
Beaucoup d’émigrés Macédoniens et Thraciens sont venus en délégation nous
présenter leurs desiderata. Le vœu généralement exprimé par eux n’est pas la
liquidation de leurs biens laissés en Grèce conformément à la Convention
d’Émigration, mais au contraire, le libre retour à leur foyer natal. Ils invoquent
l’article 4 du traité sur la Protection des minorités en Grèce 87 pour réclamer ce droit
que la Grèce leur refuse en vertu du même article, différemment interprété.
Ces requêtes sortent évidemment de la compétence de la commission.
Représente-t-elle le désir de la masse des émigrés ou seulement la tendance des
dirigeants de leurs comités ? Nous l’apprendrons.
D’autre part, il paraît hors de doute que, devant le refus de la Grèce d’autoriser leur
retour dans ses provinces ou devant les difficultés qu’elle y mettrait, et trouvant
dans la Convention le moyen de récupérer les biens laissés par eux en territoire
hellénique, un grand nombre d’émigrés Macédoniens et Thraciens se décideront à
recourir à la commission et s’établiront définitivement en territoire bulgare » 88.
145 Ainsi, l’affaire est réglée : l’échange de fait est devenu de droit et la Grèce a maintenu
son objectif principal, entériner juridiquement l’échange et le non-retour des réfugiés,
ainsi que la normalisation de la question des propriétés échangées – mais non sans
avoir induit l’inclusion dans la réciprocité de l’échange les Grecs de la Bulgarie.
146 Je voudrais maintenant répondre au deuxième volet de votre question, concernant la
postérité de la politique démographique grecque inaugurée pendant et tout de suite
après la deuxième guerre balkanique. Je crois en effet que de la politique
démographique en question résulte une mutation dans la politique de la nationalité
(dans le sens juridique) en Grèce. D’après la littérature juridique sur la question, l’octroi
de la nationalité, au sens spécifiquement grec de l’ithagénia (Georgiadis 1941 ;
Christopoulos 2008), devient une composante majeure de la politique grecque envers
les minorités après les traités de Neuilly et de Lausanne (Kostopoulos 2003c ; Baltsiotis
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
240
2004a ; Christopoulos 2006 ; Tsitsélikis F0 26 Christopoulos 2008 : 36-44). Tsitsélikis et
Christopoulos font très judicieusement remarquer que, jusqu’en 1922, la tendance était
à l’inclusion de territoires où habitaient des « nationaux » (homogeneis :congénères)
sujets ottomans. Ce qui impliquait également l’octroi de la nationalité à toute personne
habitant les territoires incorporées à l’État grec, selon un principe libéral égalitaire,
comme ce fut le cas en Thessalie et à Arta, en 1881, et pendant les expansions
territoriales de 1913, malgré la cacophonie par rapport au principe libéral qu’a
constitué, dans ce dernier cas, l’opposition obstinée au retour des réfugiés bulgares de
Macédoine. Tandis que, selon toujours les mêmes auteurs, après cette date et la défaite
des armées grecques en Asie Mineure (laquelle ruine le vaste projet territorial grec avec
la perte définitive de la Thrace orientale et les espoirs de souveraineté grecque dans le
mandat hellénique du sancak d’Izmir), il s’agit désormais d’exclure d’un territoire qui a
reçu sa forme définitive les « allogeneis » (non congénères), citoyens grecs d’origine non
grecque selon les critères de l’administration. Je crois que le cas de Kilkis et de la
Macédoine orientale nous permet de nuancer ce schéma. Là, c’est la guerre, due à une
provocation bulgare, qui donne la possibilité de se débarrasser manu militari, tant que
les circonstances le permettent, du plus grand nombre possible de ceux qui, par la
suite, seront considérés comme allogeneis et même comme les plus dangereux, c’est-à-
dire les slavophones exarchistes. Cela inaugure, à l’intérieur-même de la période
d’expansion territoriale et d’inclusion consécutive des allogeneis, une autre politique,
celle des échanges imposés au vaincu, telle qu’elle a été mise en œuvre, comme nous
l’avons vu, par la Grèce envers la Bulgarie, s’agissant de Kilkis et de Strumica. Le traité
de Neuilly viendra institutionnaliser, désormais avec l’approbation internationale,
l’échange imposé au vaincu89, en maintenant toutefois le principe libéral du choix
individuel, à l’exclusion de facto de ceux qui avaient déjà émigré. Neuilly, inclut dans
l’échange les Grecs de Bulgarie, liés au différent gréco-bulgare depuis 1905-1906, et les
incite ainsi à émigrer en Grèce, sans demander la restitution de leurs propriétés
communautaires, par peur que la Bulgarie ne revendique, par réciprocité, les mêmes
droits pour les Bulgares qui choisiraient de rester en Grèce – comme à partir d’août
1920, l’obligeraient les clauses sur les minorités du traité de Sèvres. C’est à partir de ce
moment que la Bulgarie demande explicitement l’ouverture des écoles et églises
bulgares fermées en 1913. Un document de la mission militaire grecque en Bulgarie,
daté du 5 février 1919 (18 février 1919 du calendier grégorien), que le chef de la
mission, le Colonel Constantin Mazarakis, adresse au président du Conseil (ainsi qu’au
ministère des Affaires étrangères, à l’état-major, au Gouvernorat général à Salonique et
au Gouvernorat général de Macédoine orientale), fait état d’un projet visant à inciter la
population grecque de Bulgarie à émigrer en Grèce, en vue de la signature d’un traité
qui allait définitivement régler les questions des populations minoritaires entre les
deux pays90. Après maintes oscillations le chef de la mission militaire demande à
Venizélos si le maintient des communautés grecques de Bulgarie est plus important que
de céder sur la question de la réciprocité, qui impliquerait l’octroi des droits
minoritaires aux Bulgares de Grèce, question jugée par ce militaire comme étant d’une
importance capitale pour l’État. Après Sèvres, le président du Conseil, décide de ne plus
insister sur la défense des droits de la minorité grecque, i.e. de ceux qui choisiraient de
rester en Bulgarie91. En 1922-1923, ce sera au tour de la Grèce, vaincue, d’être soumise à
l’échange, que la nouvelle Turquie pratiquera à une échelle beaucoup plus vaste envers
elle – et cette fois-ci sans le principe libéral du choix individuel. Parallèlement à la
périodisation de l’histoire de la nationalité grecque, en tant qu’excluante ou incluante,
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
241
établie par Tsitselikis et Christopoulos, qui retiennent avec raison 1922-1923 comme
date charnière, il est possible d’établir une seconde périodisation, Bucarest constituant
la charnière et Neuilly, l’aboutissement d’un processus inauguré durant les guerres
balkaniques et lors de la victoire grecque sur les Bulgares, qui consiste à chasser le plus
grand nombre possible d’indésirables parmi les orthodoxes non patriarchistes, puis les
musulmans mais sans que la période d’expansion territoriale soit considérée comme
close. C’est l’armistice de Moudania qui y met un point final ; la convention de
Lausanne, signée en janvier 1923, telle qu’elle est imposée par la Turquie, est acceptée
par la Grèce qui, retournant la donne, fait un atout de l’afflux énorme de réfugiés grecs
en provenance de Turquie, utilisant ceux-ci à leur insu pour helléniser les nouvelles
provinces et surtout la Macédoine. Kostopoulos (2011) cite un rapport de Exadactylos,
datant de 1913, qui indique clairement qu’on a utilisé aussi les réfugiés de la Macédoine
du nord-est, de Thrace occidentale, de Thrace orientale et d’Asie Mineure pour la même
raison, dès 1913 et 1914 (Sigalas 2012)92. Juste après la clôture définitive du processus
d’échange gréco-bulgare, en décembre 1926, un nouveau décret (décret du 12 août
1927) sur le retrait de la nationalité s’appliquant aux « personnes non grecques
d’origine (allogeneis) et ayant émigré sans intention de revenir », vise les Slaves
Macédoniens qui émigrent à l’étranger et est d’abord appliqué aux Aroumains
roumanisants et surtout aux Valaques roumanisants du Meglen (installés en Roumanie,
avec laquelle n’existait pas de traité d’échange), eux aussi considérés comme allogeneis.
147 Après le coup d’État contre le signataire du traité, Alexandre Stamboliiski, action
appuyée par les fractions bulgares macédoniennes de droite, la Bulgarie se lance à
nouveau dans la spirale de la revendication irrédentiste, comme on le voit poindre dans
les requêtes des comités de réfugiés figurant dans le texte que je vous ai lu. Ce qui
explique en partie la décision désastreuse des élites bulgares de s’allier à Hitler, sans
pour autant déclarer la guerre à l’Union soviétique et sans participer à la campagne
nazie contre ce pays. La nouvelle incorporation par la Bulgarie, en 1941-1944, de la
Macédoine orientale grecque à l’est du Strymon, de la Thrace occidentale grecque et de
la Macédoine yougoslave est d’une extrême violence (Hadzianastassiou & Paschalidis
2003 ; Kotzagéorgi-Zymari 2002). La répression est terrible et une grande partie de la
population grecque émigre à l’ouest du Strymon. Le bourg de Doxato est mis à mal une
troisième fois, de même que plusieurs autres villages et agglomérations de la région. La
retraite de l’armée bulgare et la fin de l’occupation en 1944 sonnent le départ des
colons (qui étaient quasiment tous des anciens habitants des lieux) et d’une partie de la
population slavophone locale qui s’était ouvertement déclarée bulgare.
148 À partir de 1946, après la conférence de paix de Paris, la Bulgarie a renoncé, comme je
l’ai déjà dit, à toute prétention irrédentiste envers ses pays voisins. Il faut toutefois
compter avec un troisième larron qui surgit dès l’entre-deux-guerres, représenté par
les organisations macédoniennes de gauche (Vienne-ORIM unifiée) et qui s’allie à la III e
Internationale. Il est alors question d’une Macédoine et d’une Thrace indépendantes
faisant partie d’une Confédération balkanique socialiste. Les partis communistes de la
Troisième Internationale sont obligés d’accepter cette situation nouvelle à partir de
1924 et jusqu’en 1935. Le Parti communiste grec, malgré les divergences exprimées par
Yanis Kordatos et Thomas Apostolidis (Dangas & Léondiadis 1997) puis, plus tard,
Séraphim Maximos et Pandélis Pouliopoulos quant à la spécificité du cas grec par
rapport aux réfugiés de Turquie installés en Macédoine, est tout de suite accusé par la
République libérale d’appuyer la sécession d’une partie du territoire, ce qui explique en
grande partie l’extrême virulence de l’anticommunisme grec. Des lois sont votées,
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
242
culminant avec la célèbre Idionymon (loi 4229/1929) qui, dans son article premier,
prévoit des sanctions contre ceux qui voulaient, d’une part, renverser le système social
en vigueur par des moyens violents et, d’autre part, la sécession d’une partie du
territoire (Alivizatos 1983 : 86-87 ; Mavrogordatos 1983 : 98-101 ; Carabott 2003). Un
changement des noms de lieux, le plus radical entrepris dans les Balkans, survient
officiellement dans les années 1920 (Kyramargiou 2007 et 2010). Des lois n’ayant
apparemment rien à voir avec la Macédoine mais visant à épurer l’espace de
communication hellénique, comme le paysage linguistique, de tout élément se
démarquant de la vision officielle et du discours normatif du nationalisme grec,
viennent, par le biais de l’éducation, compléter le dispositif légal. Et, je tiens à préciser
qu’au-delà du problème de la Macédoine, est également en jeu la peur grandissante de
la Grèce face à l’Italie et aux missions catholiques françaises et italiennes. Calquée sur
la loi turque concernant l’éducation, cette loi vise aussi à empêcher l’élite grecque de
fréquenter les établissements étrangers et à apaiser les craintes qu’inspire à l’Église le
prosélytisme protestant et surtout catholique (Je dois ces précisions à Tassos
Anastassiadis). Déjà, la révision de la Constitution par Venizélos, en 1911, comptait
parmi ses objectifs la limitation du fonctionnement des « écoles étrangères » sur le
territoire grec, avant la grande expansion territoriale de 1913 (Alivizatos 2007a), mais
après la loi bulgare sur l’éducation publique de 1909, qui entérine institutionnellement
l’abolition des privilèges de type ottoman des communautés grecques, survenue en
1906, et qui impose l’éducation nationale, universelle et obligatoire en bulgare pour
tous les citoyens du royaume ; c’est à cette loi que répond probablement la loi grecque.
Le dispositif légal « se blinde » avec la loi 4862/1931 de Georges Papandréou, ministre
de l’Éducation du gouvernement Vénizélos, le plus démocratique de l’entre-deux-
guerres. Ladite loi régit très strictement le fonctionnement des écoles « étrangères »
sur le territoire grec : elle en limite la fréquentation aux seuls étrangers – à l’exception
éventuelle des Grecs ayant séjourné longtemps à l’étranger –, ne leur délivre une
autorisation de fonctionner qu’à titre provisoire, les rendant ainsi quasiment non
opératoires et quasiment illégales, exige que les enseignants dispensant les cours de
grec moderne et d’histoire soient d’ithagénia grecque, et enfin interdit la présentation
« de livres, d’images et de cartes au contenu inexact ou défavorable à la nation
hellénique ou au régime en vigueur ou à la religion officielle de l’État » (Journal Officiel,
7 janvier 1931), ce qui permet de contrôler toute déviation idéologique, historique ou
cartographique par rapport à la norme grecque (Alivizatos 2007b et surtout 2007a).
Tout parent d’un enfant d’ithagénia grecque, qui fréquenterait lesdites écoles est
passible d’amende et, en cas de récidive, d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à six
mois, sans possibilité d’instruction ; quant aux directeurs qui inscriraient dans leurs
effectifs des enfants d’ithagénia grecque, ils s’exposent à la fermeture de leur école. À
mon sens, cette loi répondait principalement à la volonté que ne soit enseignée en
Grèce aucune autre interprétation de l’histoire du territoire grec et de sa population, au
premier chef, de la Macédoine. L’origine de cette suspicion est à chercher surtout dans
la présence en Macédoine, sous l’Empire ottoman, d’établissements scolaires
protestants et catholiques, surtout français, qui ont en partie perduré sous l’État grec,
l’exemple le plus probant étant l’école des religieuses de Kilkis, très « compromise avec
les Bulgares », selon les dires de Vénizélos lui-même au consul de France à Salonique,
Léonin, qui avait succédé à Jousselin (annexe XXI). Notons que les Israélites constituent
encore à l’époque une fraction très importante de la population de Salonique, ville que
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
243
l’on veut toujours helléniser, et sont susceptibles d’être les agents d’une idéologie
hostile à la souveraineté hellénique (annexe XXIII)93.
149 Le régime dictatorial de Métaxas (1936-1941) met hors la loi le parti communiste,
emprisonne ses membres, interdit par décret que soit parlée en public toute langue
autre que le grec, et instaure un régime de surveillance et d’accès contrôlé pour toutes
les régions frontalières de l’État (Carabott 2003 ; Kostopoulos 2009 ; Rombou-Lévidi
2009). Le mouvement macédonien de gauche s’affirme plus nettement sous l’occupation
dans le mouvement de résistance communiste de Yougoslavie et de Grèce. Sous les
auspices du Parti communiste, une partie de la population slave de Grèce, surtout en
Macédoine occidentale, va embrasser l’idée d’une république macédonienne
indépendante, composante souveraine d’une fédération balkanique, ou au mieux
désirant que soit appliquée la nouvelle consigne du Parti communiste après 1935 à
savoir « l’égalité des droits des Slavomacédoniens à l’intérieur du territoire grec », en
refusant de s’appeler Bulgares, bien qu’une autre fraction de cette population collabore
avec l’occupant (italien, allemand ou bulgare) en se déclarant plus ou moins
ouvertement bulgare ou bien lorgne du côté de l’ORIM fasciste d’Ivan Mihailov qui
promet une Macédoine indépendante, une tendance communément appelée
« autonomisme de droite » introduite dans le jeu grec par les puissances occupantes de
l’Axe. Même en dehors de la zone de souveraineté bulgare (Kostopoulos 2003a,
Koumaridès 2009), il existe encore une forte tendance pro-bulgare, surtout dans la
région de Kastoria. Une troisième tendance reste, quant à elle, profondément attachée
à l’identité grecque qu’elle a développée au cours du siècle qui vient de s’écouler. Cela
dit, les frontières entre ces groupes sont mouvantes et le cours de l’occupation change
radicalement les données. La Grèce avait cru clore ce chapitre avec le traité de Neuilly
et entériner le partage de la Macédoine en trois États nations absorbant les slavophones
macédoniens en tant que citoyens grecs, serbes et bulgares. Mais la solution prônée par
Tito, après l’effondrement de l’État yougoslave de l’entre-deux-guerres, donne
naissance à l’alliance entre Macédoniens slavophones communistes (yougoslaves et
grecs) et résistance titiste ainsi que résistance grecque de l’EAM, encore que cette
dernière alliance ait été plus difficile ; le Parti communiste grec, après 1935 et le
changement de stratégie de la IIIe Internationale qui inaugure la tactique des fronts
populaires, s’en tient désormais à « l’égalité des droits des Slavomacédoniens », déjà
évoquée. Cette alliance est par ailleurs renforcée par le prestige dont jouit, au sein du
monde communiste, Georgi Dimitrov, ancien secrétaire général de la III e Internationale,
qui reconnaît la nation macédonienne.
150 La révolte de 1946 en Grèce et la guerre civile qui s’ensuit, avec la participation
distincte d’organisations macédoniennes slaves en Grèce (NOF, Front de libération
populaire et, à compter du congrès de ce dernier à Prespa dans le village de Psaradès
[Nivica], KOEM, Organisation communiste de la Macédoine de l’Égée) dans une
perspective titiste, et avec une direction des Minorités émanant du ministère de
l’Intérieur du « gouvernement provisoire démocratique », inquiètent considérablement
l’État qui voit là le danger d’une sécession des contrées macédoniennes à majorité
slave, alors que les communistes grecs ne parlaient encore que d’égalité de droits des
minorités. Or, ce qui constitue à cette époque un réel danger pour l’intégrité
territoriale du pays, c’est le plan « Limnès », conçu pendant le troisième Plénum du
Parti communiste, en septembre 1947, qui prévoyait la formation d’une « zone libérée
au nord de la Grèce », constituée de la Macédoine et de la Thrace avec Salonique pour
capitale et susceptible de donner naissance à un second État grec (Iliou 2004 : 204-211,
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
244
75-81), sans qu’il ait jamais été question d’une sécession d’une partie du territoire de la
Macédoine grecque sur une base ethnique. En 1949, les dernières offensives contre
l’ « Armée démocratique », menées le long de la frontière gréco-albanaise, permettent à
l’« Armée nationale » de conduire une vaste opération de nettoyage dans les régions de
la confrontation ; le Parti communiste grec, après la scission entre Tito et Staline, suit
ce dernier et révise, lors du Ve Plénum de janvier 1949, tenu dans les montagnes de la
« Grèce libre », la version titiste de la « macédonéité », avant que celle-ci ne disparaisse
en Bulgarie aussi, mais en réintroduisant le vocable de l’ « autodétermination du peuple
macédonien » (Kofos 1964, 198994), cette fois-ci dans une ligne anti-yougoslave pour
encourager, selon Nikos Zachariadis lui-même, « l’élément slavomacédonien » de
l’armée démocratique, dont il était devenu dès 1948 probablement la force majeure (du
fait que la région la plus compacte tenue par l’armée démocratique jusqu’en 1949 – aux
confins de l’Épire grecque du nord-est et de la Macédoine grecque du nord-ouest, dans
les massifs du Gramos, du Voïo et du Vitsi, dans la vallée de Korestia du haut Haliacmon
et dans le bassin de Prespa – était, pour plus de la moitié, peuplée de slavophones).
C’est sur ce changement que se sont, en grande partie, fondées la formidable répression
étatique, dépassant de loin la Terreur blanche des années 1945-1947 95 et les exécutions
capitales, ordonnées par les tribunaux militaires d’exception, interprétant, après
janvier 1949, l’allégeance des communistes au Ve Plénum comme une trahison suprême.
Les combattants des régiments slavomacédoniens de l’armée démocratique, hommes et
femmes, vaincue en août 1949, les enfants des villages que les communistes ont
emmenés dans les républiques populaires à partir de 1948 96 et la population des villages
de montagne des régions de la frontière où se sont déroulés les derniers combats en
1948 et en 1949, et dont certains ont été bombardés sur le mont Vitsi et à Prespa, lors
de l’opération « Pyrsos » de 1949 (Penis 2007) F0 2D dirigée conjointement par le
généralissime de l’armée grecque, futur maréchal et Premier ministre, Alexandre
Papagos, et le général américain James Van Fleet (Margaritis 2001 II : 498-558) F0 2D vont se
réfugier avec les autres communistes grecs dans les républiques populaires pendant la
Guerre froide (Van Boeschoten 2003).
151 Tous se voient déposséder de la nationalité (ithagéneia) à l’époque de la législation
d’exception en vigueur pendant et après la guerre civile: les Grecs et une minorité de
Slavomacédoniens étant accusés « d’agir contre la nation » (αντεθνικώς δρώντες) à
l’étranger, par le décret parlementaire ΛΖ’ (1947) et, à partir de 1955, le reste des
Slavomacédoniens en vertu de l’article 19 du nouveau Code de la nationalité (Baltsiotis
2004 ; Kostopoulos 2003 ; Christopoulos 2008 ; Kostopoulos 2011). Le décret de 1927 sur
le retrait de l’ithagénia est codifié dans l’article 19 du nouveau code de la nationalité de
1955 (Kostopoulos 2003c ; Baltsiotis 2004 ; Tsitsélitis F0 26 Christopoulos 2008), sous le
régime parlementaire mais farouchement anti-communiste qui perdura jusqu’en 1967,
date du coup d’état des colonels. Avec le rétablissement définitif de la démocratie et de
la république en Grèce, en 1974, le problème acquiert une nouvelle acuité. C’est une
politique démographique à long terme qui reprend le dessus, pour empêcher le
rapatriement des réfugiés slaves macédoniens. Cet article du code de nationalité est
maintenu en vigueur jusqu’en 1998 F0 2D son abrogation n’ayant pas valeur rétroactive
97 F0
2D
dans la disposition transitoire paragraphe 6 de l’article 111 de la nouvelle constitution
de 1975, pourtant très démocratique98 (Kostopoulos 2003 c). Un dilemme surgit alors,
opposant, d’une part, ce qu’on peut appeler la raison d’État, qui refuse catégoriquement
le retour de réfugiés slavomacédoniens regroupés pour une grande partie dans leur
« mère patrie » (Monova 2001), la république socialiste de Macédoine (entité fédérée de
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
245
la République fédérative yougoslave), orientation prise par le parti au plus haut niveau
et, d’autre part, la raison démocratique, qui aurait voulu le retour de tous les exilés de
la guerre civile. C’est la raison d’État, dont la politique démographique constitue le
soubassement le plus important, qui l’emporte. C’est de la perpétuation de ce dogme
d’État qu’il s’agit, avec l’accord, semble-t-il, avant même la chute de la dictature, des
partis politiques parlementaires en exil, PC inclus, car cet accord aurait été la condition
sine qua non de sa légalisation (Skoulariki 2005 ; Skoulariki-Embiricos 2009). Ce qui
révèle qu’au cœur de la refonte de l’État se trouve, immuable, l’exclusion réelle ou
symbolique de ces citoyens ou ex-citoyens d’origine slave (Sigalas 2008). Les réfugiés
communistes se voient finalement accorder le droit de retour et le recouvrement de la
nationalité par le gouvernement du PASOK en 1982, sous réserve qu’ils soient
« d’origine grecque » (hellinès to génos), selon la lettre de la circulaire relative des
Ministères de l’intérieur et de l’ordre public (106841 du 29/12/1982). Cette circulaire
vise directement les Slaves Macédoniens, pour lesquels le recouvrement de la
nationalité est subordonné à un examen au cas par cas. Ainsi, seul un petit nombre
d’entre eux peut reprendre la nationalité grecque, les autres se voyant même refuser
l’accès au territoire grec, étant donné que le régime du visa reste en vigueur pour la
Yougoslavie et la république indépendante qui lui a succédé 99. Vient encore s’ajouter la
loi qui régule la question des propriétés des réfugiés de la guerre civile (1543 de 1985), à
l’exclusion, une fois de plus, de ceux qui sont visés dans la circulaire précédente. Cette
loi, ainsi qu’une autre de 1989, censée effacer définitivement les séquelles et
conséquences de la guerre civile mais en excluant les Macédoniens slavophones dont le
pourcentage parmi les réfugiés politiques de la guerre civile est infiniment plus élevé
que celui qu’il représente par rapport à la population grecque, a un effet pervers. Au
lieu d’effacer les conséquences de la guerre civile, elle ouvre un nouveau champ
d’antagonismes politiques et interétatiques qui est amplifié par l’indépendance de la
république de Macédoine en septembre 1991. Pour expliquer l’occultation, après le
rétablissement de la démocratie en 1974, par les communistes et par la gauche grecque
aujourd’hui, de leur implication dans le fait minoritaire macédonien, il faut rappeler
l’amalgame opéré entre communistes et minoritaires slavomacédoniens (Baltsiotis
2004a), l’opprobre qui pèse sur la gauche communiste étant imputable tout autant à la
lutte qu’elle a menée contre le système social et le retour de la royauté qu’à la position
qu’elle avait prise par rapport au fait minoritaire slavomacédonien. C’était la condition
sine qua non de l’intégration du Parti communiste dans la vie politique de l’après 1974 et
du maintien par celui-ci du consensus autour du non-dit macédonien. C’est là une
interprétation qui va à l’encontre de l’explication avancée par la majorité de la gauche
grecque, y compris celle dite du renouveau, laquelle ne privilégie jamais ce facteur.
Anguélos Élefandis et Philippos Iliou, deux des historiens les plus importants de la
gauche grecque, ont parfois fait exception. Le Parti communiste (KKE), quant à lui,
occulte la dimension minoritaire des stratégies politiques antérieures en même temps
que l’accusation de « trahison » qui, du fait de ses choix concernant la Macédoine,
pesait sur lui depuis 1924. En oblitérant le fait macédonien dans son discours, ce parti a
obtenu sa légalisation en 1974 et son retour sur la scène politique, occultant par là
même son passé internationaliste en faveur d’une position de plus en plus compatible
avec le nationalisme. Ni les organisations des réfugiés elles-mêmes, ni le PC grec, ni le
Parti communiste grec dit « de l’intérieur », ni l’État ne comptabilisent plus ceux des
réfugiés politiques qui se trouvent en Yougoslavie, pays communiste déviant, pourtant
aussi nombreux que tous les autres réunis, établis dans l’ensemble des républiques
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
246
populaires. Après une première tension entre la Grèce et la Yougoslavie, suite à la visite
en Grèce du Premier ministre yougoslave, Milka Planinč, en 1983, laquelle prend à son
compte les doléances du gouvernement fédéré de Skopje, en 1991, l’effondrement de la
Yougoslavie et l’émergence de la république de Macédoine comme entité indépendante
avec laquelle il faudrait dorénavant traiter directement, ramènent sur le devant de la
scène ce problème occulté depuis 1949 en Grèce : l’existence de deux minorités, la
première, exilée dans le pays voisin, qui devient, depuis septembre 1991, sujet du droit
international, la seconde, constituée des Slaves macédoniens qui sont restés dans l’État
grec, souvent des parents proches des réfugiés politiques (Kostopoulos 2003b pour une
lecture critique des recensements grecs). Seule une partie de ces derniers revendique
des droits minoritaires à partir de 1992, leur parti Arc-en-ciel ayant obtenu environ
7 000 voix aux élections européennes de 1994, surtout dans les régions de Florina et
d’Edessa (Gounaris, Michaïlidis, Angélopoulos 1997100 ; Cowan 2001), score qui ne sera
partiellement réitéré qu’en 2009. L’effort d’assimilation et sa longue histoire
(Kostopoulos 2000), bien avant l’intégration de cette population au territoire grec,
constitue le pendant de l’exil, étant entendu qu’il faut inclure dans l’exil, pour ceux qui
restent après 1913 et surtout après 1949 (Kostopoulos 2011), l’émigration
transocéanique. La langue est toujours parlée sur le territoire grec (Ioannidou 1997 ;
Baltsiotis 2003 ; Voss 2003 ; Adamou F026 Drettas
101
2008 ; Van Boeschhoten 2006), malgré
les efforts déployés pour l’éradiquer et lui ôter tout statut de prestige, la langue
officielle de la république de Macédoine n’étant plus acceptée comme langue distincte
et comme langue d’État. De plus, depuis les années 1980, les diplômes des universités de
la république de Macédoine ne sont plus reconnus par l’État grec, ce qui empêche les
étudiants grecs, surtout les slavophones, de poursuivre leurs études dans la république
voisine et, par là-même, d’entrer en contact avec le milieu universitaire et national de
celle-ci (Kostopoulos 2000). Le macédonien, tel qu’il est nommé par la majorité des
locuteurs en Macédoine occidentale grecque, avait jusqu’à une date récente et conserve
peut-être même aujourd’hui un statut de langue véhiculaire utilisée dans les échanges
ruraux, surtout à Florina, Edessa et Gouménissa ; les réfugiés de 1922 ayant, dans les
milieux slavophones, perpétué la tradition de véhicularité de cette langue. En
Macédoine orientale, son usage est moins répandu, la région de Kilkis, vide de
slavophones, venant couper l’ancien continuum et laissant à l’est de l’Axios une zone
dans laquelle la langue est surtout nommée bulgare et où son usage, encore que
géographiquement sporadique, est très intense dans quelques agglomérations
insularisées et où le processus d’identification diffère de celui de la Macédoine à l’ouest
de l’Axios, le champ d’expérience étant différent (Lafazani 1993 ; Rombou-Levidi 2009).
Notons que plusieurs études ont été menées ces dernières années sur les questions
politiques en Macédoine occidentale, surtout dans les départements de Florina et
d’Edessa (Pella) (Yannissopoulou 1997, Van Boechhoten 2000, Rossini 2003) où la
population continuait à faire l’objet de surveillance, même si la tension s’était relâchée
depuis les années 1970, époque de fichage intégral (Papassarandopoulos 1977 pour
Kilkis)..
152 Encore une fois, c’est la raison démographique qui dicte, dans la panique du mécanisme
grec le refus total de tout attribut national et symbolique de la république voisine.
Ainsi, on revient même sur la politique officielle des années 1980 qui, considérant cette
république et son nom comme relevant du droit interne de la Yougoslavie, n’en
contestait pas l’appellation, mais refusait la monopolisation des termes « Macédoine »
et « macédonien » pour désigner la nation et la langue, en soutenant que le terme
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
247
« Macédoine » ne pouvait être entendu que dans son acception géographique. La Grèce
aurait alors été prête à accepter que le terme slavo-macédonien désignât les habitants
slaves de cette république (Skilakakis 1995). Mais le changement intervenu sur la scène
internationale a rendu caduque ladite politique, qui ne pouvait tenir que dans le cadre
d’une Yougoslavie unifiée, pendant les années d’existence de laquelle on pouvait encore
dissimiler à l’opinion grecque la présence institutionnelle de Macédoniens et de leur
république, entité constituante de la fédération, sous le couvert des termes génériques
« Yougoslave » et « Yougoslavie ». La politique officielle grecque, ayant toujours opéré
par voie de circulaires internes, n’ose pas se hasarder à affronter la sphère publique ni
à faire entendre sa voix pour proposer l’appellation de « slavo-macédonien ». C’est, en
effet, l’occultation totale du problème de la minorité potentielle que constituent les
Slaves macédoniens de Grèce et, à plus forte raison, leurs parents exilés pendant la
guerre civile qui résident en république de Macédoine (deux communautés liées à
travers une frontière n’ayant plus la couverture de l’État supranational qu’était la
Yougoslavie fédérative) qui sous-tend la nouvelle politique officielle en vigueur
(Skoulariki 2005). Afin d’occulter toute référence à cet aspect du problème, cette
nouvelle politique met l’accent sur la macédonéité grecque. Cette macédonéité –
élaborée, comme on a vu, depuis le XIXe siècle, pour revendiquer la Macédoine
ottomane contre les revendications bulgares, et perfectionnée après 1945, pour contrer
l’existence d’un problème lié à la sécurité du territoire, et de plus en plus dirigée contre
la Yougoslavie communiste qui accepte en son sein l’entité macédonienne – devient, en
1991, le noyau, hautement symbolique, du discours qu’on oppose à la reconnaissance de
la république de Macédoine. En refusant catégoriquement les attributs de la
souveraineté de cette république, que sont la nationalité et la langue macédoniennes –
ce qui revient à nier l’existence même du groupe ethnique auquel l’idée de cette
nationalité se réfère – on pense être dispensé de l’obligation de reconnaître une
minorité du même groupe ethnique faisant partie du continuum slavophone de la
Macédoine à l’intérieur du territoire grec102. C’est là qu’apparaît l’utilité de l’étanchéité
de l’éducation grecque et de la stérilisation de l’espace de communication nationale : de
celles-ci découle l’ignorance de l’opinion publique sur toute vision de la Macédoine
sortant du discours normatif. Cette ignorance alimentée par les médias qui la
reproduisent et l’amplifient, parvient, l’autocensure aidant, à créer un consensus, qui
contribue, entre 1991 et 1995, au blocage de toute décision concernant la
reconnaissance de la république de Macédoine sous son nom constitutionnel et même,
à l’époque, sous un nom comportant le vocable Macédoine ou macédonien sous quelque
forme que ce soit, ce qui est une façon d’occulter la dimension fondamentale du
problème, à savoir la question minoritaire (Skoulariki 2005). Devant le raz-de-marée
suscité dans l’opinion publique, qui déborde les objectifs de ce que j’ai appelé la raison
d’État, les partis politiques n’osent pas négocier un compromis. La netteté du refus
étant associée à la formation d’une ethnicité grecque macédonienne, antiquisante et
géographique, comprenant toutes les composantes ethniques de la Macédoine grecque,
sans pour autant s’y référer explicitement. C’est l’élite politique grecque macédonienne
qui, indépendamment de toute appartenance ethnique et partisane, devient le relais
d’un « front du refus » (Matalas 2008 : 99-109). De cette façon tous les groupes
ethniques de la Macédoine grecque finissent par s’approprier une identité grecque
macédonienne, qui était initialement – comme je vous ai expliqué auparavant –
proposée aux seuls Slaves Macédoniens d’orientation grecque, afin de poser une
frontière symbolique entre eux et les exarchistes, qualifiés de Bulgares. Ainsi, au cours
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
248
du XXe siècle cette frontière s’est transformée progressivement en une frontière
ethnique (dans le sens de Fredrik Barth), symbolique et politique à la fois, entre d’un
côté, l’ensemble des groupes ethnolinguistiques de la Macédoine grecque et de l’autre,
leurs voisins de la république yougoslave de Macédoine. Ce qui est en cause est une
nouvelle ethnicité, la macédonéité grecque, qui se fonde sur l’exclusion de toute autre
interprétation de la « macédonéité », en enlevant du référant Macédoine tout ce qui
s’écarte du discours normatif grec, lequel met largement à contribution l’archéologie et
l’histoire ancienne, exclut soigneusement toute référence slave et occulte l’histoire
sociale et politique tumultueuse des deux derniers siècles, sa mention passant pour de
la propagande slave. Inversement, un nationalisme très prononcé déferle aujourd’hui
sur les milieux dirigeants de la république de Macédoine, issus principalement du parti
VMRO au pouvoir, en rendant tout dialogue sans espoir d’aboutir à une solution
négociée à l’amiable avec l’État grec par rapport au nom de la république. Se focalisant
sur l’histoire antique et médiévale et l’archéologie, ce nationalisme prend aujourd’hui
une expression symbolique extrême, au point de transformer des espaces centraux de
certaines villes macédoniennes en parcs thématiques d’attraction commémorant les
« deux précurseurs de l’État macédonien », le royaume antique de Macédoine, avec
comme figures emblématiques Philippe et Alexandre le Grand, et le royaume médiéval
de Samuil – ainsi que les saints et érudits orthodoxes Naum et Clément d’Ochride.
XI. Tentative de périodisation du problème minoritaire
après Neuilly
153 N. S. : Ainsi l’événement de Kilkis et la politique démographique qu’il inaugure
pourrait nous aider à comprendre la politique grecque face à sa population slavophone
et, partant, le problème qui a émergé dans les années 1990 avec la république voisine.
Au-delà du seul cadre macédonien, cette politique serrait également déterminante pour
la politique grecque concernant la nationalité juridique, dont vous venez de tracer
l’histoire. En effet, au centre de cette politique, qui se met en place au moment de la
seconde guerre balkanique, se trouve la volonté de nier un fait minoritaire ; par
anticipation au moment de la guerre en question (en se débarrassant de la partie de la
population slavophone la plus susceptible de mettre en question la souveraineté
absolue de l’État grec sur la région, ne serait-ce que par un traité de protection), par la
politique du non retour des réfugiés de Kilkis et, ensuite, des réfugiés slaves
macédoniens de la guerre civile et par les efforts d’éviter tout traité, bilatéral ou
international, pouvant éveiller une revendication minoritaire en Macédoine grecque.
Pouvez-vous nous évoquer brièvement la dimension minoritaire de l’histoire des
populations slaves macédoniennes de l’État grec après le traité de Neuilly ?
154 L.E. : Outre la politique d’assimilation, linguistique et idéologique, aux normes de l’État
grec – qui se poursuit depuis l’époque ottomane, mais dans le cadre institutionnel plus
efficace d’un État national – la politique grecque concernant la population slavophone
de Macédoine grecque se caractérise par les deux éléments que vous venez de
mentionner. C’est d’un côté, l’éviction, lorsque ceci est possible (lors de confrontations
militaires), de portions de cette population et la politique consécutive visant à
empêcher à tout prix le retour de réfugiés. Sur ce point je voudrais mentionner un
document « hautement confidentiel », du 1er mai 1952, provenant de la direction
générale des Ressortissants étrangers du ministère de l’Intérieur, sous le titre « Rapport
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
249
sur les slavophones vivant en Grèce », dans un chapitre duquel, intitulé
« propositions », il est explicitement dit :
« On doit refuser absolument le retour de toute personne d’origine slave, qui s’est
trouvé dans les pays slaves, nonobstant les conditions de son départ (fugitifs,
enlevés violement, partis de leur propre gré en 1941, bandits communistes
[kommounistosymmoritai, i.e. combattants de l’Armée démocratique]). De l’autre côté,
on doit faciliter le départ, vers n’importe quel pays étranger que ce soit, d’individus
ou de familles d’origine slave, et, à plus forte raison, de personnes dont le reste des
membres de la famille appartiennent à la catégorie que nous venons de citer »
(AGEK, dossier 95 B : 21)103.
155 L’autre volet de cette politique consiste dans les efforts pour éviter toute référence à
l’existence en Grèce d’une minorité, bulgare au départ, macédonienne en suite, sur le
plan aussi bien international que national.
156 On peut distinguer trois périodes. La première s’ouvre avec les traités de paix des
environs de Paris concernant le sort des pays membres de l’alliance des puissances
centrales vaincues pour finir avec la Charte de l’ONU. Elle se caractérise par un
protectionnisme des minorités par le biais de la Société des Nations, qui entre jusqu’à
un certain point en contradiction avec l’affirmation, plus catégorique qu’auparavant,
du principe de la souveraineté nationale (Christopoulos 2000). À Neuilly, la
souveraineté de l’État grec dans la partie de la Macédoine et, après 1920, de la Thrace
qui se trouve dans son territoire est renforcée de facto par l’échange de populations et
l’obligation faite aux slavophones qui restent de renoncer à la nationalité bulgare, de
façon à ce que le choix de rester soit interprété comme une preuve de conscience
nationale grecque. Par ailleurs, dans la mesure où il prévoit une réciprocité, les Grecs
de Bulgarie (l’ancienne Bulgarie comprise104) émigrant en Grèce, le traité de Neuilly
peut être considéré par la Grèce comme un règlement définitif de tout différent entre
les deux pays, cette dernière ne réclamant plus de droits pour ceux des Grecs qui ont
fait le choix de rester en Bulgarie. Mais, d’un autre côté, les traités de Sèvres et de
Lausanne insistent plus catégoriquement que tous les traités précédents sur l’obligation
pour la Grèce de respecter les droits de ses minorités. C’est ainsi qu’en 1924-1925, un
protocole entre la Grèce et la Bulgarie est signé sous les auspices de la Société des
Nations sur la reconnaissance réciproque des minorités des deux pays (l’instigateur de
ce protocole du côté grec était l’éminent diplomate Nikolaos Politis, alors ministre des
Affaires étrangères, qu’on a déjà rencontré lors de la conférence de Bucarest). Le
Parlement grec ne ratifie pas ce protocole, de façon « à ne pas annuler l’œuvre
d’hellénisation entreprise depuis des décennies » et à cause de la réaction du Royaume
des Serbes, Croates et Slovènes, qui menace alors de dénoncer les traités avec la Grèce.
Pour ménager les critiques de la Société des Nations, l’État grec publie en 1925 un
abécédaire basé sur des variétés locales du slave macédonien en caractères latins
(Ioannidou 1999), qui n’a jamais été enseigné (Michaïlidis 1999) ; la Société des Nations
s’en satisfait néanmoins. Une autre tentative d’institutionnaliser un cadre de
réciprocité concernant les minorités, avec les Serbes, échut également. Suite à ces
péripéties, la position de la Grèce devient de plus en plus intransigeante, ses diplomates
répétant inlassablement qu’il n’y a en Grèce que des slavophones de conscience
hellénique, puisque ceux qui avaient une conscience bulgare sont tous partis
volontairement aux termes du traité de Neuilly (Kostopoulos 2000). Signalons toutefois
que ce départ n’a pas toujours été aussi volontaire qu’on l’a prétendu. Après 1923 et
l’arrivée des réfugiés grecs de Turquie, de Bulgarie et de Russie, les pressions
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
250
auxquelles étaient soumis les « Bulgares » sont fortes105 (Carabott 2003 : 148-151 ;
Kostopoulos 2011).
157 La deuxième période, inaugurée avec la Charte de l’ONU, se caractérise par un rejet
quasi-total du protectionnisme envers les minorités (ce dernier ayant servi de prétexte
pour la guerre au IIIe Reich et aux autres puissances révisionnistes des traités du
système Versailles), au nom d’un respect absolu du principe de la souveraineté
nationale. Ce cadre donne la possibilité à la Grèce – à qui la guerre civile a permis de se
débarrasser des communistes slaves macédoniens, le silence anglo-américain lui
facilitant les choses, dans le climat des expulsions massives des minorités allemandes
de la plupart des pays d’Europe centrale et orientale – d’enterrer complètement la
question de la minorité slavophone, appelée depuis « question non existante » dans le
discours officiel de l’État. Dans le contexte de glacis que provoque la guerre froide et de
souveraineté renforcée, sans traités bilatéraux entre États sous l’égide de l’ONU, après
les victoires des alliés et la gestion du système mondial par les deux puissances
antagonistes, la réciprocité d’un pays du bloc occidental avec les pays communistes
n’est plus sentie comme obligatoire. La solution de l’échange de populations, est parfois
encore envisagée pendant la guerre civile par l’armée (Karavas 2009 : 142), bien qu’elle
ne corresponde plus à aucune réalité. Dorénavant, le « danger » vient de la Yougoslavie
titiste, « communiste réfractaire » et de moins en moins de la Bulgarie communiste
avec laquelle les relations sont, du reste, chaleureuses depuis 1976. C’est seulement à
partir des années 1960 que l’on commence à percevoir en Grèce que la dynamique
nationale macédonienne émergente n’est pas une machination du « panslavisme » ni de
son « avatar plus récent », le « slavo-communisme », mais qu’elle a une dynamique
indépendante, qui a trouvé un terrain propice dans le cadre de la politique yougoslave,
et qui se constitue en opposition surtout au nationalisme bulgare. Par ailleurs, la Grèce
n’a pas de relations diplomatiques avec Skopje mais avec Belgrade, capitale de la
fédération qui ne se focalise pas sur le différent gréco-macédonien (Walden 1991).
Ainsi, pour la politique grecque, la frontière avec la Yougoslavie est jusqu’à un certain
point encore perçue comme une frontière avec la Serbie.
158 La troisième période s’ouvre sur la chute du communisme, la désagrégation sanglante
de la Yougoslavie, et l’urgence d’un règlement des problèmes de droit international que
pose la conversion des anciennes républiques fédérées des grandes fédérations
communistes en États nations de type libéral. Dans ce contexte, émerge à nouveau
l’ancien protectionnisme concernant les minorités au sein de nouveaux organismes
comme la CSCE, celui-ci se développant, cette fois, dans le cadre des droits individuels
et non dans celui du droit international et sans la contradiction flagrante que
présentait la conception de la SDN dans l’entre-deux-guerres entre une souveraineté
étatique renforcée et un simulacre de souveraineté des instances collectives des
minorités qui ont provoqué l’éclatement du système (Christopoulos 2000). Dans ce
cadre, la transformation de l’ancienne République socialiste fédérative yougoslave de
Macédoine en un État national indépendant (dont l’historiographie nationale est
centrée sur le « partage injuste de la Macédoine en 1913 » et insiste sur la protection
des droits de la minorité macédonienne de Grèce)106 fait resurgir la question de la
minorité macédonienne de la Grèce. C’est cette question qui se trouve derrière
l’insistance de la Grèce à refuser les attributs symboliques de la république de
Macédoine (Embiricos & Skoulariki 2008). En effet, l’émergence de cet État, inexistant
du temps de la signature des traités de Bucarest et de Neuilly, semble miner la valeur
desdits traités, qui constituaient aux yeux des responsables de la politique grecque la
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
251
solution définitive de la question territoriale dans les Balkans. Il semble au fond que la
disparition de ce qui a constitué l’objectif principal de l’État grec dans la deuxième
guerre balkanique, une frontière commune avec la Serbie, a déstabilisé l’ancienne
logique territoriale que la Grèce avait adoptée à partir de cette époque et dont elle ne
paraît pas encore s’être débarrassée. En même temps, le refus des attributs symboliques
de cet État par la Grèce et la Bulgarie, a grandement contribué à l’irruption en
république de Macédoine de la mégalomanie nationaliste actuelle, qui rend tout
discours serein difficile et anéantie les tentatives de médiation sur des bases réalistes
dans une question qui avait depuis longtemps tendance à s’éloigner du domaine de
l’expérience pratique pour se placer au niveau symbolique de l’exclusion de l’autre.
Je tiens à remercier chaleureusement pour les discussions intervenues avant et après le présent
entretien et pour les documents qu’ils ont généreusement mis à ma disposition Tassos
Kostopoulos et Lambros Baltsiotis, historiens et amis. Spyros Karavas, Tchavdar Marinov,
Andonis Polémis, Popi Polemi, Maurice Godelier, Constantin Tsitsélikis, Nikos Alivizatos, Dimitris
Christopoulos, Mihalis Tsapogas, Marika Rombou-Lévidi, Athéna Skoulariki, Miladina Monova,
Nathalie Clayer, Mustafa Fadal, Tassos Anastassiadis, Paraskevas Matalas, Maria Katzourakis,
Yorgos Koutzakiotis, Louis de Stoutz et Elissavet Kontogiorgi m’ont également apporté un
précieux concours et je les remercie pour les informations et les documents qu’ils m’ont fournis.
Mes remerciements vont également à Éléni Dalambira qui m’a confié son livre où figure le
journal de son père, à Diana Spassova qui m’a aidé dans la traduction des textes bulgares et
macédoniens et à Jeanne Roques-Tesson qui a relu ce texte. Je tiens également à exprimer ma
reconnaissance à Milagros Arano, sans l’aide précieuse de laquelle cet entretien, n’aurait pas pu
se réaliser. Je dois enfin mentionner que mes recherches sur l’événement de Kilkis sont dues à
l’incitation de mon ami Anguélos Éléfandis, aujourd’hui disparu.
Postscriptum
Cet entretien a été réalisé au printemps 2008. Dans l’intervalle des trois ans qui se sont écoulés
depuis, plusieurs éléments du contexte international ont évolué de façon à modifier sensiblement
le contexte du discours que j’ai tenu ici.
Premièrement, à l’époque de cet entretien, le gouvernement grec, confiant en sa position au sein
de l’UE et de l’OTAN, venait de violer l’article 11 de l’Accord intermédiaire, selon lequel la Grèce
s’engage à soutenir la candidature de l’Ancienne République yougoslave de Macédoine à toute
organisation internationale. Pour cette violation l’État grec vient d’être condamné par le
Tribunal international de la Haye. Bien qu’elle n’ait pas des conséquences diplomatiques
immédiates, cette décision de la cour de la Haye ébranle le statut de l’Accord intermédiaire, qui
avait grandement contribué à l’apaisement de la crise entre les deux pays. À l’incertitude
concernant les évolutions à venir contribue aussi bien le discours intransigeant et excessif du
gouvernement macédonien actuel, que l’instabilité politique dans laquelle la crise de l’euro est en
train de pousser la Grèce.
Or, le changement de contexte le plus important est issu de la crise de l’euro elle-même. Cette
crise, sensée avoir commencée à cause de la Grèce, a battu en brèche l’ancienne confiance de ce
pays en sa position européenne. Considéré coupable de la crise, la Grèce attire sur elle des
jugements de valeur de type orientaliste allant bien au-delà des standards du politiquement
correct. On n’exagérerait même pas en disant qu’en filigrane du débat international sur la crise
de l’euro, est en train de se former aujourd’hui une nouvelle grille de lecture de l’histoire de la
Grèce qui avance l’idée d’une incompatibilité de ce pays avec le système des valeurs occidentales.
La Grèce est prise dans un régime d’interprétation moraliste qui s’efforce spasmodiquement
d’identifier le coupable de la crise. Inutile de dire que les jugements qui en découlent concernent
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
252
beaucoup moins la Grèce elle-même que le système économique européen, sa structure et les
principes économiques et moraux sur lesquels ce système est sensé s’appuyer (tout comme la
critique du despotisme oriental concernait beaucoup moins les empires orientaux que les
royaumes européens du XVIIIe siècle). Ce régime d’interprétation dominant mène à l’échec toute
tentative d’articuler un jugement différent, en rappelant l’impasse devant laquelle se sont
trouvés après la deuxième guerre balkanique ceux qui contestaient la conviction – partagée par
les alliés de l’Entente – que les Bulgares furent les seuls auteurs des atrocités commises pendant
cette guerre en Macédoine. Sachant donc que la lecture des textes historiques n’est pas
indépendante des régimes d’interprétation dominants, qu’elle est la plupart des fois conditionnée
par les problèmes contemporains auxquels ces régimes tentent à imposer une explication
univoque, j’ai l’inquiétude que les propos que j’ai tenus ici ne soient pas saisi par le régime
moraliste ci-mentionné : qu’ils ne soit pas interprétés comme une preuve supplémentaire de la
« tricherie grecque », du pêché originel que constitue l’incorporation de la Grèce dans le système
européen. En d’autres termes, je voudrais éviter que la complexité de la situation que j’ai essayé
d’analyser dans cet entretien ne soit escamotée sous l’emprise du vocable des « statistiques
grecques », comme elle fut escamotée cent ans auparavant sous l’emprise de celui d’« atrocités
bulgares ».
BIBLIOGRAPHIE
Aarbakke, Vemund (2003) Ethnic Rivalry and the Quest for Macedonia (1870-1913), New York, East
European Monographs/Boulder.
5B 1925 5D , Thessalonique, Μπατάβια.
ABECEDAR (2006) F0 F0
Adamou, Évangélia ; Drettas, Georges (2008) « Slave », in Adamou, Évangélia (éd.)Le nom des
langues II, Le Patrimoine plurilingue de la Grèce, Louvain-La-Neuve, Peeters, pp.107-134.
Altinoff, Ivan (1921) La Thrace interalliée, Sofia, Imprimerie de la Cour.
EAECA – BGASD = École Américaine d’Études Classiques à Athènes. Bibliothèque Génadios
Archives Stéphanos Dragoumis.
AΓΔΜ = Archives du Gouvernorat Général de Macédoine, Thessalonique.
ΑΕΒ = Archives d’Élefthérios Vénizélos, Archives historiques du Musée Bénaki, Dossier 115/1934,
Nº 173/16.
AGEK = Archives générales de l’État à Kavala, Archives des écoles étrangères et minoritaires du
bureau de coordination des écoles minoritaires, « Rapport sur les slavophones vivant en Grèce »,
« hautement confidentiel », issu de la direction générale des Ressortissants étrangers du
ministère de l’Intérieur grec, département B, bureau 2, chiffre d’enrégistrement 421/3/3/11 (ou
II), dossier 95 B. Les Archives des écoles étrangères et minoritaires du bureau de coordination des
écoles minoritaires ont été transférées ailleurs.
Archives de l’Imprimerie de Lourentzos D. Karaoulanis dans la ville d’Andros.
AMAE FAA = Archives du ministère des Affaires étrangères (Nantes), Fonds Athènes Ambassade.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
253
Alivizatos, Nikos (1983) « « ‘Έθνος’ κατά ‘λαού’ » μετά to 1940 », in Tsaoussis, Dimitris (éd.),
Ελληνισμός, Ελληνικότητα, Athènes, Εστία, pp. 81-90.
Alivizatos, Nikos (2007a) « Η επιφυλακτική μεταχείριση των ξένων σχολείων από τον Έλληνα
νομοθέτη 1911- 2007 », participation à la table ronde introductive au Colloque « Voisinages fragiles
- Relations inter-confessionnelles dans le sud-est européen et la Méditerranée orientale », EFA, septembre
2007.
Alivizatos, Nikos (2007b) Πέρα από το 16, Τα πριν και τα μετά, Athènes, Μεταίχμιο.
Ancel, Jacques (1930) La Macédoine : son évolution contemporaine, Paris, Librairie Delagrave.
Andréou, P. Andréas (2003) Κώττας (1863-1905), Athènes, Livani.
Anguélopolos, Athanasios A. (1980) Βόρειος Μακεδονία Ο Ελληνισμός της Στρωμνίτσης, Thessalonique,
ΙΜΧΑ.
Anonyme (1904) Turcs et Grecs contre Bulgares en Macédoine, Paris, Plon.
Anonyme (1914), Αι βουλγαρικαί ωμότητες εν τη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 1912-1913, Athènes,
Π. Δ. Σακελλαρίου.
5B collaborateurspécialiste 5D (2008) « Η νέα Μακεδονική μας
Anonyme (eidikossynergatis) F0 F0
περιπέτεια », Σύγχρονα Θέματα, nº 101, avril-juin, pp. 5-12.
Antonopoulos, Stamatios (1917) Αι συνθήκαι Λονδίνου, Βουκουρεστίου και Αθηνών, Athènes.
Baltsiotis, Lambros (2003) Γλωσσική ετερότητα στην Ελλάδα, Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων
2002-2004, Κλειδιά και αντικλείδια, Athènes, Ministèredel’ÉducationnationaleetdesCultes,
Université d’Athènes.
Baltsiotis, Lambros (2004a) « Η ιθαγένεια στον Ψυχρό Πόλεμο », in Ελληνική Ένωση για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου, Τα δικαιώματα στην Ελλάδα, 1953-2002. Από το τέλος του εμφυλίου στο τέλος
της μεταπολίτευσης, Athènes, Καστανιώτης, pp. 81-123.
Baltsiotis, Lambros (2004b) « Ιθαγένεια και πολιτογράφηση στην Ελλάδα της μετανάστευσης:
(αντι)φάσεις μιας αδιέξοδης πολιτικής », in Pavlou, Miltos; Christopoulos, Dimitris (eds.), Η Ελλάδα
της Μετανάστευσης. Κοινωνική συμμετοχή, δικαιώματα, ιδιότητα του πολίτη, Athènes, ΚΕΜΟ/Κριτική,
pp. 303-337.
Baltsiotis, Lambros ; Embirikos, Léonidas (2007) « De la formation d’un ethnonyme. Le terme
Arvanitis et son évolution dans l’État hellénique », in Grivaud, Gilles; Petmezas, Sokratis (éds.),
Byzantina et Moderna. Mélanges en l’honneur d’Hélène Antoniadès-Bibicou, Athènes, éditions
Alexandria, pp. 417-448.
Baltsiotis, Lambros (2011) « The Muslim Chams of Northwestern Greece: The grounds for the
expulsion of a “non-existent” minority community » European Journal of Turkish Studies, Thematic
Issue No. 12, Demographic Engineering II, http://ejts.revues.org/index4444.html.
Beis, Stamatis (2008) « Οι μειονοτικές γλώσσες στην Ελλάδα », Conférence non publiée faite au
Musée des Instruments populaires grecs en mars 2008.
Bérard, Victor (1904) Pro Macedonia, Paris, Armand Colin.
Bojadjis, Michaïl G. (1813) ΓραμματικήΡωμαϊκήήτοιΜακεδονοβλαχική, Vienne.
Bompard, Maurice (1937) Mon ambassade en Russie, 1903-1908, Paris, Librairie Plon.
Bourgeois, Émile et Pagès, Georges. (1921) Les origines et les responsabilités de la Grande Guerre, Paris,
Hachette.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
254
Βrailsford, Henry Noel (1906) Macedonia, its Races and their Future, Londres, Methuen & Co.
Carabott Philip (2003) « The Politics of Constructing the Ethnic “Other”: The Greek State and its
Slav-Speaking Citizens, ca. 1912 – ca. 1949 », Jahrbücher für Geschiche und Kultur Südosteuropas
(JGKS) 5, pp. 141-150.
Chalkiopoulos, Athanasios (1910) Η Μακεδονία. Εθνολογική στατιστική των βιλαετίων
Θεσσαλονίκης και Μοναστηρίου, Athènes, Τυποργαφείο Νομικής.
Christopoulos, Dimitris (2000) Droit, Europe et minorités. Critique de la connaissance juridique,
Athènes, Sakoulas.
Christopoulos, Dimitris (2006) “Greece”, in Bauböck, Raïner; Ersbøll, Eva; Groenendijk, Kees;
Waldarauch, Harald (eds.) Acquisition and Loss of Nationality. Policies and Trends in 15 European States.
Volume 2: Country Analyses, Amsterdam, Amsterdam University Press, IMISCOE series, pp. 253-287.
Christopoulos, Dimitris (2008) « Péripéties de la nationalité hellénique », in Un Droit pour des
hommes libres, Étude en l’honneur du Professeur Alain Fenet, Amiens, Litec, pp. 411-431.
Clayer, Nathalie (2010) Aux origines du nationalisme albanais : la naissance d'une nation
majoritairement musulmane en Europe, Paris, Karthala.
Clayer, Nathalie (2010) « L’albanisation de la zone frontière albano-grecque et ses aléas dans
l’entre-deux-guerres », Südost-Forschungen68 (2009), 2010(2010), pp. 328-348.
Commission pour l’établissement des Réfugiés - Administration générale de la Colonisation
(1924), nº de Protocole 454, Archives de K. D. Karavidas, Bibliothèque Génadios, Athènes.
Commission pour l’établissement des Réfugiés - Administration générale de la Colonisation
(1928), Κατάλογος των προσφυγικών συνοικισμών Μακεδονίας με τας νέας ονομασίας, Τυπογραφείον:
Εφημερίς Των Βαλκανίων.
Cvijič, Jovan (1907) Remarques sur l’éthnographie de la Macédoine, Paris, Georges Roustan libraire.
Dalambira, Eléni (1988) Προγονικό, Athènes, (à compte d’auteur).
Dalègre, Joëlle, (1997) La Thrace grecque, Paris, l’Harmattan.
Derrida, Jacques (1999) « Le siècle et le Pardon », in Le Monde des Débats, décembre.
Cowan, Jane K. (2001) « Ambiguities of an emancipatory discourse : the making of a Macedonian
minority in Greece », in Cowan, Jane K.; Dembour, Marie-Bénédicte ; Wilson, Richard A. (eds.),
Culture and Rights, Cambridge, Cambridge University Press.
Dangas, Alexandros ; Léontiadis, Giorgos (1997) Κομιντέρνκαιμακεδονικόζήτημα, Athènes, Τροχαλία.
Deville, Georges (1919) L’Entente, la Grèce et la Bulgarie – Notes d’histoire et souvenirs, Paris, E.
Figuière.
Dogo, Marco (1985) Lingua e nazionalità in Macedonia : vicende e pensieri di profeti disarmati, 1902-1903,
Milano, Edizioni Universitarie Jaca.
Dordanas, Stratos (2009) « Το Κιλκίς των προσφύγων: Εγκατάσταση και κοινωνική οργάνωση », in
Koliopoulos, Ioannis; Michaïlidis, Iakovos (eds.),ΟιπρόσφυγεςστηΜακεδονία. Από την τραγωδία στην
εποποιία, Thessaloniki, Μίλητος/Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών, pp. 280-294.
Dotation Carnegie pour la Paix Internationale (1914) Enquête dans les Balkans. Rapports présenté aux
Directeurs de la Dotation par les Membres de la Commission d’Enquête, Paris, Georges Crès et C ie.
Dragostinova, Theodora (2011) Between Two Motherlands. Nationality and Emigration among the
Greeks of Bulgaria, 1900-1914, Ithaca - N.Y. ,Cornell University Press.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
255
Dragoumis, Ion (2000) ΤαΤετράδιατουΊλιντεν, Yorgos Petsivas (ed.), Athènes, ΕκδόσειςΠετσίβα.
Dragoumis, Philippos (1988) Ημερολόγιο. ΒαλκανικοίΠόλεμοι 1912-1913, Athènes/Yannina, Δωδώνη.
Drettas, Georges (1980) La mère et l’outil. Contribution à l’étude sémantique du tissage rural dans la
Bulgarie actuelle, Société d'études linguistiques et anthropologiques de France, Paris.
Dumaine, Alfred (1921) La Dernière Ambassade de France en Autriche, Paris, Plon.
Dunant, Marcel (1917) L’été bulgare, juillet 1915-octobre 1915, Paris, Librairie Chapelot.
Embiricos, Léonidas;Skoulariki, Athèna (2008) «Ο ‘αλυτρωτισμός των Σκοπίων’ ή η αποσιωπημένη
μειονοτική διάσταση του Μακεδονικού », Αυγή, 20 avril.
Extraits fac-similés (1913) Extraits fac-similés de certaines lettres trouvées dans le courrier du 19 e
régiment de la VIIe division grecque, saisi par les troupes bulgares dans la région de Razlog - 1913, Sofia,
Imprimerie de la Cour royale.
Fay, Bradshaw Sidney (1931) Les origines de la Guerre Mondiale, volume 1, Paris, Les éditions Rieder.
Gal, Susan ; Irvine, Judith T. (1995) « The Boundaries of Languages and Disciplines: How
Ideologies Contract Differences », Social Research 62, pp.967-1001.
Gardikas–Katsiadakis, Helen (1995) Greece and the Balkan Imbroglio. Greek Foreign Policy, 1911-1913,
Athènes, Σύλλογοςπροςδιάδοσινωφελίμωνβιβλίων.
Georgiadis, IossifG. (1941) Η ελληνική ιθαγένεια. Αρχαί, ερμηνεία, νομοθεσία, Athènes.
Gossiaux, Jean-François (2002) Pouvoirs ethniques dans les Balkans, Paris, PUF.
Gounaris, Vassilis (1993-1994) « Οι σλαβόφωνοι της Μακεδονίας. Η πορεία της ενσωμάτωσης τους
στο ελληνικό εθνικό κράτος 1870-1940 », Μακεδονικά 29, Thessalonique, pp.209-236.
Gounaris, Vassilis ; Michaïlidis, Iakovos ; Angelopoulos, Giorgos (eds.) (1997) Ταυτότητες στη
Μακεδονία, Athènes, Παπαζήση.
Guéchoff, Ivan E. (1915) L’Alliance Balkanique, Paris, Hachette et Compagnie.
Hadjianastassiou, Tassos ; Paschalidis, Dimitris (2003) ΤαγεγονοτάτηςΔράμας (Σεπτέμβριος-
Οκτώμβριος 1941) – Εξέγερσηήπροβοκάτσια; Drama, ΔήμοςΔράμας.
Hobsbawm, Eric J. (1990) Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality, Cambridge,
Cambridge University Press.
Iliou, Philippos (2004) Ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος- Η Εμπλοκή του ΚΚΕ, Athènes, Θεμέλιο-ΑΣΚΙ.
Ioannidou, Alexandra (1999) « Το Abecedar από φιλολογική σκοπιά », in Tsitsélikis, Κonstantinos
(ed.), Γλώσσες, αλφάβητακαιεθνικήιδεολογίαστηνΕλλάδακαιταΒαλκάνια, Κριτική/ΚΕΜΟ, pp.99-115.
Ioannidou, Alexandra (1997) «Τα σλαβικά ιδιώματα στην Ελλάδα. Γλωσσολογικές προσεγγίσεις και
πολιτικές αποκλίσεις», inGounaris, Vassilis; Michaïlidis, Iakovos; Angélopoulos, Giorgos (eds.)
Ταυτότητες στη Μακεδονία, Athènes, Παπαζήση, pp.89-101.
Ivanoff, Jordan (1918) Bulgares et Grecs devant l’opinion publique suisse, Berne, Paul Haupt, Librairie
Académique.
Ivanoff, Jordan (1919) Les Bulgares devant le Congrès de la Paix, Berne, Paul Haupt, Librairie
Académique.
JournalOfficiel (Εφημερίς της Κυβερνήσεως) (1931, 7 janvier) Περί των ξένων σχολείων, nº 1,
feuillet 2, pp. 3-5.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
256
Kahl, Thede (2009) Για την ταυτότητα των Βλάχων, Athènes, Βιβλιόραμα.
KalantzisGiorgosX. (2008) « Η Απογράφη των πληθυσμών της Δυτικής Θράκης από το Διασυμμαχικό
καθεστώς το 1919 », Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, pp. 337-354.
Kalyvas, Stathis (2006) The Logic of Violence in Civil War, New York, Cambridge University Press.
Kănčov, Vasil (1900) Makedonia. Etnografja i Statistika, Sofia.
Karakasidou, Anastasia N. (1997) Fields of Wheat, Hills of blood. Passages to Nationhood in Greek
Macedonia 1870-1990, Chicago-London, The University of Chicago Press.
Karathanasis, Athanasios (1991) ΟΕλληνισμόςκαιημητρόπολητουΝευροκοπίουκατάτονΜακεδονικό
Αγώνα, Thessalonique, Institut for Balkan Studies.
Karavas, Spyros (2002a) « ΠερίκοινότητοςελληνικήςενΚιλκίς », Athènes, Αρχειοτάξιο 4, mai, pp.
6-32.
Karavas, Spyros (2002b) «Οι εθνογραφικές περιπέτειες του ‘ελληνισμού’ (1876-1878)», Τα Ιστορικά
19 (36), pp. 23-74.
Karavas, Spyros (2003a) «Οι εθνογραφικές περιπέτειες του ‘ελληνισμού’ (1876-1878)», Τα Ιστορικά
20 (38), pp. 49-112.
Karavas, Spyros (2003b) « Πρόξενοι και μητροπολίτες στη Μακεδονία. Η περίπτωση του Παρθενίου
Πολυανής », Athènes, Αρχειοτάξιο 5, mai, pp. 26-39.
Karavas, Spyros (2004) « ΟΚωνσταντίνοςΠαπαρρηγόπουλοςκαιοιεθνικέςδιεκδικήσεις (1877-1875) »,
IV International Congress of History and Historiography of Modern and Contemporary Greece – 1833-2002.
Proceedings, IIvol., Athènes, 2005, vol. I, pp. 149-169.
Karavas, Spyros (2006a) «Το παραμύθι της Πηνελόπης Δέλτα και τα μυστικά του Μακεδονικού
Αγώνα» inΠ.Σ. Δέλτα. Σύγχρονες προσεγγίσεις στο έργο της, Athènes, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, pp.
183-289.
Karavas, Spyros (2006b) «Η μεγάλη Βουλγαρία και η Μικρά ιδέα εν έτει 1878», Τα Ιστορικά 44, juin,
pp. 3-42.
Karavas, Spyros (2008) «101 κανονιοβολισμοί για τη Θεσσαλονίκη», inMathaiou, Anna;
Bournazos, Stratis; Polemi, Popi (eds.), Στην τροχιά του Φίλιππου Ηλιού, Athènes, Μουσείο Μπενάκη,
pp. 75-88.
Karavas, Spyros (2009) Οι « ‘Ξενοσυνείδητοι’ της ΧVης Μεραρχίας», Αρχειοτάξιο 11,Athènes,
Θεμέλιο.
Karavas, Spyros (2010) Μακάριοι οι κατέχοντες την γην. Γαιοκτητικοί σχεδιασμοί προς απαλλοτρίωση
συνειδήσεων στη Μακεδονία, 1980-1909, Athènes, Βιβλιόραμα.
Katsanos, Konstantinos (2008) «Η Μακεδονία των Σέρβων, 1870-1941. Από την Παλιά στη Νότια
Σερβία»,inStephanidis, Ioannis; Vlasidis, Vlasis,Kofos, Evangelos (eds.) Μακεδονικές ταυτότητες στο
χρόνο. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, Ίδδυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα/Πατάκη, Athènes, pp.
211-238.
Kofos, Evangelos (1964) Nationalism and Communism in Macedonia, Thessalonique, Institute for
Balkan Studies.
Kofos, Evangelos(1989) “Η Βαλκανική διαστασή του Μακεδονικού ζητήματος στα χρόνια της
Κατοχής και της Αντίστασης”,inFleischer, Hagen;Svoronos, Nikos (eds.), Ελλάδα 1936-1944,
Δικτατορία-Κατοχή-Αντίσταση, ΑΤΕ, Athènes.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
257
Kokolakis, Michalis (2003) Τούστερογιαννιώτικοπασαλίκι(1820-1913), EIE, Athènes, pp. 58-59.
Konstantakopoulou, Anguéliki (1988) Η ελληνική γλώσσα στα Βαλκάνια (1750-1850). Το τετράγλωσσο
λεξικό του Δανιήλ Μοσχοπολίτη, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Yannina.
Konstantakopoulou, Anguéliki (2008) «Ελληνικές εκδοχές του μακεδονισμού» inAnnaMathaiou ;
StratisBournazos ; PopiPolemi (éd.) Στην τροχιά του Φίλιππου Ηλιού, Athènes, Μουσείο Μπενάκη, pp.
53-74.
Kontogiorgi, Elisabeth (2006) Population Exchange in Greek Macedonia. The Rural Settlement of
Refugees 1922-1930, Oxford, Clarendon Press.
Kostopoulos, Tassos (2000) Η απαγορευμένη γλώσσα. Κρατική καταστολή των σλαβικών διαλέκτων στην
ελληνική Μακεδονία, Athènes, Μαύρη Λίστα.
Kostopoulos, Tassos (2002), «Ετερογλωσσία και αφομοιωτικοί σχεδιασμοί: Η Περίπτωση της
Ελληνικής Μακεδονίας μετά την Απελευθέρωση (1912-1913)», inΤα Ιστορικά, 19(36), pp. 75-128.
Kostopoulos, Tassos (2003) «Αξονομακενοδικό Κομιτάτο και Οχράνα, 1943-1944: Μια πρώτη
προσέγγιση», Αρχειοτάξιο 5, pp. 40-51.
Kostopoulos, Tassos (2003) « Counting the ‘Other’: Official Census and Classified Statistics in
Greece (1830-2001) », Jahrbücher für Geschiche und Kultur Südosteuropas (JGKS) 5, pp. 55-78.
Kostopoulos, Tassos (2003) « Αφαιρέσεις ιθαγένειας. Η σκοτεινή πλευρά της νεοελληνικής ιστορίας,
1926-2003 », Σύγχρονα θέματα 83, février, pp. 53-75.
Kostopoulos, Tassos (2004) «Το όνομα του Άλλου: Από τους ‘Ελληνοβούλγαρους’ στους ‘Ντόπιους
Μακεδόνες’», inΜειονότητες στην Ελλάδα, Athènes, Εταιρία Σπουδών Νεοελληνικής παιδείας και
πολιτισμού (Σχολή Μωραϊτη), pp. 367-403.
Kostopoulos, Tassos (2007) Πόλεμος και εθνοκάθαρση. Η ξεχασμένη πλευρά μιας δεκαετούς εθνικής
εξόρμησης. 1912-1922, Athènes, Βιβλιόραμα.
Kostopoulos, Tassos (2011) « How the North was won. Épuration ethnique, échange de populations
et politique de colonisation en Macédoine grecque », European Journal of Turkish Studies, Thematic
Issue No. 12, Demographic Engineering II, http://ejts.revues.org/index4437.html.
Kotzagéorgis-Zymari, Xanthippi (2002) Η βουλγαρική κατοχή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη
1914 1944, Thessalonique, Παρατηρητής.
Kotzagiorgi-Zymari, Xanthipi (2005) « The Greek Military Mission in Sofia, 1918-1920: Fields and
Coordinates of its Actions », Institute for Balkan Studies (éd.) The Salonika Theater of Operations and
the Outcome of the Grate War, Thessalonique, ΙΜΧΑ.
Koukoudis, Astérios I. (2001) ΟιΟλύμπιοιΒλάχοικαιταΒλαχομογλενά, Thessalonique,Ζήτρος.
Koulouri, Christina (2009) « Εθνική ταυτότητα και ιδιότητα του πολίτη στη σύγχρονη Ελλάδα »,
Σύγχρονα Θέματα, janvier-mars 2009, pp. 8-11.
Koumaridis, Yorgos (2009) « ΣΝΟΦ και σλαβομακεδονικά τάγματα (1943-1944) : μια προσέγγιση »,
Αρχειοτάξιο 11,Athènes, Θεμέλιο, pp. 55-87.
Kourtovik, Dimosthenis (2007) Τι ζητούν οι Βάρβαροι, Athènes, Ελληνικά Γράμματα.
Krainikowsky, Assen I. (1938) La question de Macédoine et la diplomatie européenne, Paris, Marcel
Rivière et Cie.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
258
Kyramargiou, Eléni (2003) Μετoνομασίες των οικισμών της Μακεδονίας 1913- 1940 : Ένας Πίνακας,
Diplôme équivalent à la maîtrise en Sciences humaines et Histoire, sous la direction de Spyros
Karavas, Université de l’Égée.
Kyramargiou, Eléni (2007) Καινούργια ονόματα, καινούργιος χάρτης – Ζητήματα μετoνομασίων οικισμών
της Ελλάδας 19ος-20ος αιώνας, Travail en vue du Diplôme équivalant au DEA en Histoire et
Archéologie, sous la direction de Christos Loukοs, Université de Crète.
Κyramargiou, Eléni (2010) « Καινούργια ονόματα-καινούργιος χάρτης: οι μετoνομασίες των
οικισμών της Ελλάδας, 1909-1928 », Τα Ιστορικά 52 (27), juin, pp. 3-26.
Kyriakidis, StilponP. (1919) Η Δυτική Θράκη και οι Βούλγαροι, Athènes,
Αssociationpourladiffusiondeslutiles, Εκδόσεις Ιωάννου Ν. Σιδέρη.
Ladas, Stephen (1932) The exchange of Minorities. Bulgaria, Greece and Turkey, New York, McMillan.
Lafazani, Dora E. (1994) « Appartenance culturelle et différenciation sociale dans le bassin du Bas-
Strymon : l'intégration nationale d'une région de la Macédoine », CEMOTI 17, pp.123-133.
Lafazani, Dora E. (1993) Appartenance culturelle et différenciation sociale dans le bassin du Bas-Strymon
: Étude d'intégration nationale d'une région macédonienne, Thèse pour le doctorat de nouveau régime,
Paris IV, Institut de Géographie, sous la direction de Paul Claval.
Larmeroux, Jean (1918) La politique extérieure de l’Autriche-Hongrie, 1875-1914, vol. 2, La politique
d’asservissement, Paris, Librairie Plon.
Laurens, Henry (1999) La Question de Palestine I, l'invention de la Terre sainte, Paris, Fayard.
Laurens, Henry (2002) La Question de Palestine II, Une mission sacrée de civilisation, Paris, Fayard.
Lagani, Irini (1996) Το “παιδομάζωμα” και οι ελληνογιουγοσλαβικές σχέσεις 1949-1953. Μια κριτική
προσέγγιση, Athènes, Ι. Σιδέρης.
L’Illustration 30 août 1913, n. 3679.
Lithoxoou, Dimitris (1992) « Η μητρική Γλώσσα των κατοίκων του ελληνικού τμήματος της
Μακεδονίας πριν και μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών », Θέσεις 38, janvier-mars, pp. 39-66.
Lithoxoou, Dimitris (1998) Ελληνικός Αντιμακεδονικός Αγώνας. Από το Ίλιντεν στη Ζαγορίτσανη
(1903-1905), Athènes, Μεγάλη Πορεία.
Lory, Bernard (1992) « Immigration et intégration sociale à Plovdiv au XIX e siècle », Les Balkans à
l’époque ottomane, Revue du Monde musulman et de la Méditerranée, Aix-en-Provence, pp. 95-103.
Lymbératos, AndréasK. (2009) Οικονομία, Πολιτική και Εθνική Ιδεολογία, Η διαμόρφωση των εθνικών
κομμάτων στη Φιλιππούπολη του 19ου αιώνα, Candie, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης.
Mac Dermott, Mercia (1978) Freedom or death. The Life of Gotsé Delchev, Londres, West-Nyack.
Mackridje, Peter (2009) Language and National Identity in Greece 1766-1976, Oxford, University Press.
Maravelakis, Maximos ; Vakalopoulos, Apostolos, (1993) ΠροσφυγικέςΕγκαταστάσειςστηνπεριοχήτης
Θεσσαλονίκης, Thessalonique, Βάνιας.
Margaritis, Giorgos (ed.) (1993) « Η φαντασίωση στην εξουσία. Σλαβομακεδονικά », Ο Πολίτης 121,
janvier-mars, pp. 19-28.
Margaritis, Giorgos (2001a) Ιστορία του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου 1946-1949,vol. I, II, Athènes,
Βιβλιόραμα.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
259
Margaritis, Giorgos (2001b) « Οι πόλεμοι », inHadjiossif, Christos (ed.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού
αιώνα, Athènes, Βιβλιόραμα,pp. 149-187.
Marinov, Tchavdar (2006) L’impasse du passé. La construction de l’identité nationale macédonienne et le
conflit politico-historiographique entre la Bulgarie et la Macédoine, thèse de doctorat à l’EHESS sous la
direction de Anne-Marie Thiesse.
Matalas, Paraskevas (2002) Έθνος και Ορθοδοξία. Οι περιπέτειες μιας σχέσης. Από το ελλαδικό στο
βουλγαρικό σχίσμα, Candie, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης.
Matalas, Paraskevas (2008) « Ο Λεωνίδας, ο Γκρέκο κι ο Μεγαλέξανδρος: Περί (τοπικών)
ταυτοτήτων και άλλων τινών… », inMathaiou, Anna; Bournazos, Stratis; Polemi, Popi (eds.) Στην
τροχιά του Φίλιππου Ηλίου, Athènes, Μουσείο Μπενάκη, pp.99-109.
Mavrogordatos, GeorgesTh. (1983) Stillborn Republic, Social Coalitions and Party Strategies in Greece,
1922-1936, Berkeley - Los Angeles – London, University of California Press.
MazarakisAinian, Alexandre (1930) Ο Ελιγμός του Κιλκίς, Athènes, Γενική Στρατιωτική Επιθεώρησις.
Mélas, Spyros (1972) Οι Πόλεμοι 1912- 1913, Athènes, Μπίρης.
Michaïlidis, Iakovos (1999) « Μειονοτικές ευαισθησίες και εκπαιδευτικά προβλήματα. Η περίπτωση
του Abecedar », in ΤsitsélikisKonstandinos.(ed), Γλώσσες, αλφάβητα και εθνική ιδεολογία στην Ελλάδα
και τα Βαλκάνια, Athènes, Κριτική/ΚΕΜΟ.
Michaïlidis, Iakovos (2003) Μετακινήσεις σλαβοφώνων πληθυσμών, Athènes, Κριτική/ΚΕΜΟ.
Michailidis, Iakovos ; Papanikolaou, Konstantinos (eds.) (2008) Αφανείς γηγενείς μακεδονομάχοι,
Thessalonique, University Studio Press.
Miletitch, Lubomir (Miletič Lioubomir) (1913) Atrocités grecques en Macédoine pendant la guerre
gréco-bulgare, Sofia, Imprimerie d’État.
Miletič, Lioubomir (Miletitch Lubomir) (1925-1927) Materiali za istoriata trema na makedoskoto
osvoboditelno dvijenie, t. I-IX, Sofia.
Ministère des Affaires étrangères (1922) Les Affaires balkaniques. 1912-1914, 3 vol. Paris.
Ministère des Affaires étrangères et des Cultes (1919) La Vérité sur les accusations contre la Bulgarie.
Exposé et documents, Sofia, Imprimerie de l’État, tome I er.
Ministère des Armées. État-major de l’Armée (1932) Rapport de guerre. Ο Ελληνικός Στρατός κατά
τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-1913, TomeIII, OpérationscontrelesBulgares, Athènes, Eθνικό
Τυπογραφείο.
Ministère des Armées. État-major de l’armée (1934) Rapport de guerre. Ο Ελληνικός Στρατός κατά
τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-1913, TomeIII 1, Annexe, OpérationscontrelesBulgares,
Athènes, Eθνικό Τυπογραφείο.
Ministère de l’Économie nationale/direction des Statistiques (1915) Απαρίθμισις των νέων επαρχιών
της Ελλάδος του έτους 1913, Athènes.
Ministèredel’Économienationale/directiondesStatistiques (1923) Πίναξ του πραγματικού πληθυσμού
του απογραφέντος κατά το μεσονύκτιον της 18-19 Δεκεμβρίου 1920, κατά νομούς, επαρχίας ή υποδιοικήσεις,
δήμους, κοινότητας, πόλεις και χωρία, Athènes.
Misirkof, KrsteP. ([1903] 1974) Za Makedonckite
rabotiJubilejnoizdaniepopovodnastogodisnatataodradajnjetonaavtorot, [Sofia] Skopje, I.M.J.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
260
Molho, Rena (1994) « Η αβεβαιότητα της ελληνικής κυριαρχίας στη Θεσσαλονίκη μετά το 1912: ξένη
προπαγάνδα και εβραϊκή κοινότητα », Τα Σύγχρονα Θέματα 52-53, pp. 32-25.
Monova, Miladina (1995) L’Insurrection de la Saint-Élie en Macédoine : De l’idée de libération à l’idée de
peuple macédonien, DEA en Anthropologie sociale, Paris, EHESS.
Monova, Miladina (2001) « De l’historicité à l’ethnicité : Les Égéens ou ces autres Macédoniens »,
Balkanologie Vol. V, n° 1-2 | décembre 2001 , [En ligne], mis en ligne le 02 juin 2008. URL : http://
balkanologie.revues.org/index713.html.
Monova, Miladina (2002) Parcours d’exil, récit de non-retour : les Égéens en république de Macédoine,
Doctorat en Anthropologie sociale sous la direction de Jean-François Gossiaux, Paris, EHESS.
Nakratzas, Giorgos (1998) « Τα εγκλήματα γενοκτονίας : του βουλγαρικού στρατού στο Δοξάτο και
του ελληνικού στρατού στο Κιλκίς το 1913 (σύμφωνα με στοιχεία της CarnegieReport) », Πολίτης
δεκαπενθήμερος 58, pp. 29-31.
Nolde, Boris (1936) L’Alliance franco-russe - Les origines du système diplomatique d’avant-guerre, Paris,
Droz.
Papassarantopoulos, Petros (1977) « Προεκλογική περίοδος στα φακελωμένα χωριά», Αντί85, 12
novembre.
Pelletier, Robert (1913) La vérité sur la Bulgarie, Paris, Eymard & C ie.
Penis, Dimitris (1993) Πρέσπα η Ελληνική, Sofia, Εlma.
Pentzopoulos, Dimitris (1962) The Balkan Exchange of Minorities and its Impact upon Greece, La Haye,
Mouton.
Pinon, René, (1909) L’Europe et l’Empire ottoman, Paris, Perrin.
Pinson, Mark (1970) Demograpic Warfare. An Aspect of Ottoman and Russian Policy. 1854-1866,
Unpublished Ph.D. Thesis, Harvard University, Cambridge Massachusetts.
Portolos, Dimitris-Georges (sans date) Greek Foreign Policy from September 1916 to October 1918, thèse
dactylographiée, non publiée.
5B 1929 5D , Αυτοβιογραφία, Athènes 5B Sofia 5D , ΜαύρηΛίστα.
Prlitchef, Grigor (2000) F0 F0 F0 F0
Psaltis St. V. (1919) ΗΘράκηκαιηΔύναμιςτουεναυτήΕλληνικούΣτοιχείου, Association pour la Diffusion
des livres utiles, Athènes, Εκδόσεις IωάννουΝ. Σιδέρη.
Rombou–Levidi, Marika (2009) Dancing beyond the barre. Cultural Practises and Processes of
Identification in Eastern Macedonia, Thèse pour le Doctorat en Anthropologie sociale à l’Université
de Sussex, sous la direction de Jane Cowan, soutenue en mars 2009, Sussex University.
Rossini, Claudia (2003) “Graecophiles and Macedonophiles: Greek Macedonias Slavic-Speakers,
The Minority Identity Question and the Clash of Identities at Village’s Level”, Jahrbücher für
Geschiche und Kultur Südosteuropas (JGKS) 5, pp. 161-172.
Rubin, Alexandre (1913) Les Roumains de Macédoine, Bucarest, Imprimerie professionnelle Démètre
C. Ionesco.
Seton – Watson, Robert William(1925) Sarajevo, A Study of the Origins of the Great War, Londres,
Hutchinson and Co.
Sigalas, Nikos (1999) La Question des origines et les intellectuels grecs au XIX e siècle, mémoire de DEA à
l’EHESS, Paris.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
261
Sigalas, Nikos (2000) « Hellénistes, hellénisme et idéologie nationale », in Chrysanthi Avlami (éd.),
L’antiquité grecque au 19e siècle : un exemplum contesté ?, Paris, L’Harmattan, pp. 239-291.
Sigalas, Nikos (2001) « Ελληνισμός και εξελληνισμός : Ο σχηματισμός της νεοελληνικής έννοιας
ελληνισμός », Τα Ιστορικά 34, pp. 3-70.
Sigalas, Nikos (2004) « Ιστοριογραφία και ιστορία των πρακτικών της γραφής: Ένα προοίμιο στην
ιστορία του σχηματισμού της νεοελληνικής έννοιας ελληνισμός και στην παραγωγή της ελληνικής
εθνικής ιστοριογραφίας »IVInternationalCongresofHistoryandHistoriographyofModernandContemporaryGreece
– 1833-2002. Proceedings, IIvol., Athènes, 2004, vol. I, pp.103-132.
Sigalas, Nikos (2008) « Περί της κατασκευής του υποκειμένου της δημοκρατίας στην Ελλάδα, από το
1974 έως σήμερα ή Η επιφυλακτικότητα του δικαίου της ιθαγένειας »,
communicationnonpublieprésentéeaucolloque « TheRepublicinTurkeyandFrance. History and
Evolution of the French and Turkish Republican Systems in a European Perspective”, Bilgi
University, 23-24 octobre, Istanbul.
Sigalas, Nikos (2012) « Violence et population à l’époque du banditisme nationaliste. Les violences
contre les Rum sous le gouvernement du CUP (1913-1918) », European Journal of Turkish
Studies: “Demographic Engineering” - Part III (forthcoming).
Simovski, Todor Hristov (1997), Atlas of the Inhabited Places of the Aegean Macedonia, Skopje, Makedonska
Kniga.
Skilakakis, Th. (1995) Στο όνομα της Μακεδόνιας, Ελληνική Ευρωεκδοτική, Athènes.
Skopétéa, Elli (1988) Το «Πρότυπο Βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα, Όψεις του εθνικού προβλήματος στην
Ελλάδα, Athènes, Πολύτυπο.
Skoulariki, Athéna (2005) Au nom de la nation. Le discours public en Grèce sur la question macédonienne
et le rôle des médias (1991-1995), thèse de doctorat à l’Université Panthéon-Assas (Paris II) sous la
direction de Rémi Rieffel, non publiée, soutenue le 17 mars. 2 volumes.
Skoulariki, Athéna (2008) Μακεδονικό: Πόσο δόκιμος είναι ο όρος αλυτρωτισμός ; Σύγχρονα Θέματα,
τεύχος 101, avril-juin 2008, pp. 13-17.
Sofoulis, Manolis K. (2007) Ημερολόγιοπολέμου (1906-1914), Γρηγόρης, Athènes.
Soulis, Dimitrios (1934) Ο Δεύτερος Βακκανικός Πόλεμος κατά των Βουλγάρων, 1913, Athènes.
Todorovitch, Milan I. A. (1913) Salonique et la question balkanique, Paris, A Challamel.
Sorgun, Taylan (2003) Bitmeyen Savaş : İttihad ve Terakki'den Cumhuriyet'e Halil Paşa, Istanbul, Kum
Saatı.
Trifon, Nicolas (2005) Les Aroumains, un peuple qui s’en va, La Bussière, Acratie.
Tsitsélikis, Konstandinos ;Christopoulos, Dimitris (2008) «Από το πολυπολιτισμικό ‘μέγα όνειρον
του Ελληνισμού’ των αρχών του 20ου στην ‘πολυπολιτισμική πραγματικότητα’ των αρχών του 21ου
αιώνα», inChristopoulos, Dimitris (ed.) Το ανομολόγητο ζήτημα των μειονοτήτων μέσα στην ελληνική
έννομη τάξη, Athènes, ΚΕΜΟ/Κριτική, pp.33-67.
Uniongrecquepourlesdroitsdel’Homme (2009) Πρόταση σχεδίου νόμου: Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας,
Athènes, editeur.
Van Boeschoten, Riki (2000) « When Difference matters : Sociopolitical Dimensions of Ethnicity in
the District of Florina », in Cowan, Jane K. (ed.) Macedonia, The Politics of identity and Difference,
Londres, Pluto Press, pp. 28-46.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
262
Van Boeschoten, Riki (2003) « ‘Unity and Brotherhood?’ Macedonian Political Refugees in Eastern
Europe », Jahrbücher für Geschiche und Kultur Südosteuropas (JGKS): 5, pp. 189-202.
Van Boeschoten, Riki (2006) « Code switching, linguistic jokes and ethnic identity: Reading
hidden transcripts in a cross-cultural context », Journal of Modern Greek Studies 24, pp. 344-377.
VardaChristina (1993) « Όψεις της πολιτικής αφομοίωσης στη Δυτική Μακεδονία στο
Μεσοπόλεμο », Τα Ιστορικά, 10/18-19, pp. 151-170.
Vlachos, Nikolaos (1935), Το Μακεδονικόν ως φάσις του Ανατολικού Ζητήματος, 1878-1908, Τύποις
Γερτρούδης Χρίστου, Athènes.
Voss, Christian (2003), « The Situation of the Slavic-Speaking Minority in Greek Macedonia –
Ethnic Revival, Cross-Border Cohesion, or Language Death? », Jahrbücher für Geschiche und Kultur
Südosteuropas (JGKS): 5, pp. 173-189.
Vouri, Sofia (1992) Εκπαίδευση και εθνικισμός στα Βαλκάνια. Η περίπτωση της Βορειοδυτικής Μακεδονίας
1870-1904, Athènes, Παρασκήνιο.
Walden, Sotiris (1991) Ελλάδα-Γιουγκοσλαβία. Γέννηση και εξέλιξη μιας κρίσης, 1961-1962, Athènes,
Θεμέλιο.
Wilkinson, Henry Robert (1951) Maps and Politics. A Review of Ethnographic Cartography of Macedonia,
Liverpool, Liverpool University Press.
Wurfbain, André (1930) L’Échange gréco-bulgare des minorités ethniques, Paris, Payot.
Zaïmis, Théodore (1913) Atrocités bulgares en Macédoine. Faits et documents. Exposé soumis par
le recteur des Universités d’Athènes aux recteurs des Universités d’Europe et d’Amérique,
Athènes, Εστία.
YanissopoulouMaria (1998), Αλμωπία: παρελθόν, παρόν και μέλλον. H ανθρωπολογική προσέγγιση,
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Μακεδονία και Βαλκάνια, Athènes, Αλεξάνδρεια.
Zoroyannidis, Konstandinos. N., Généraldedivision, (1975), Ημερολόγιον πορειών και πολεμικών
επιχειρήσεων 1912-1913, Thessalonique, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου.
NOTES
1. Document émanant de la Commission de Rétablissement des Réfugiés, Direction générale de la
Colonisation, nº de protocole 454. La carte que ce document était sensé accompagner est absente
du dossier. Je remercie Elissavet Kontogiorgi de m’avoir fourni ce document.
2. Cette remarquable base de données est constituée à partir d’une multitude de sources
démographiques, dont les plus importantes sont : les statistiques de Kănčov (1900), celles de
Chalkiopoulos (1910), la statistique ottomane 1912 du sancak de Salonique (puisée dans les
archives de Stéphanos Dragoumis à la bibliothèque Gennadios), une statistique bulgare d’août
1912 réalisée par Siméonov, le dénombrement effectué par l’armée grecque en septembre 1913
(ministère de l’Économie nationale 1915), le dénombrement de 1914 du Gouvernorat Général de
Macédoine (AΓΔΜ dossier 14, Υποδιοίκηση Κιλκίς Προς Γενική Διοίκηση Μακεδονίας, n. de
protocole 3679, 3723 et 3738, 16/11/1914), le recensement officiel de 1920 (Ministère de
l’Économie nationale 1923), la statistique de la Commission de rétablissement des réfugiés de
1928, ainsi que de nombreux autres documents s’échelonnant de la période antérieure à
l’incorporation de la Macédoine dans l’État grec jusqu’à nos jours. Nous avons également pris en
compte l’« Atlas des lieux habités de la Macédoine de l’Égée », établi par Todor Hristov Simovski
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
263
(1997), ainsi que l’étude minutieuse des localités de la Macédoine grecque en 1913, menée par
Éléni Kyramargiou (2003 – non publié).
3. AΓΔΜ dossier 14, Υποδιοίκηση Κιλκίς Προς Γενική Διοίκηση Μακεδονίας, nº deprotocole 3679,
3723 et 3738, 16/11/1914. Parlant des réfugiés de ces villages en Bulgarie, ce fonctionnaire note
qu’ils ont perdu leur foi dans la Bulgarie à cause de l’arbitraire de l’occupation bulgare : « s’ils
sont partis, c’est par peur des représailles de notre armée et ils veulent réintégrer la Grèce, ne se
sentant pas à l’aise en Bulgarie, et affluent massivement à notre ambassade à Sofia pour obtenir
leur retour. » Cf. § 36-40.
4. AΓΔΜ dossier 14, Διοικητικός Αντιπρόσωπος Κ. Θοδωρακίου Δ. Χαραλαμπίδης, nº deprotocole
621, 14/12/1914.
5. Il s’agit des villages de Ali Hocalar avec 72 slavophones indigènes, Karaca Kadi 37, Kilindir 296,
Seslovo 93, Strezovo 63 et Moutoulovo 122.
6. Ano Thodoraki (Gorno Todorak), Kato Thodoraki (Dolno Todorak), Rayanovo, Planitsa,
Kousovo, Buzderek, Moravtsa, Todorovo, Mirovo. Le village de Ravna fait vraisemblablement
partie, même au début de l’administration grecque, de l’arrondissement de Nigrita ; plus tard, il
sera rattaché au département de Kilkis dont il dépend encore aujourd’hui.
7. Stratos Dordanas, dans une étude approfondie parue après la fin de cet entretien, sur les
réfugiés installés dans la préfecture de Kilkis, ajoute aux documents que j’ai déjà cités un
document du Gouvernorat général de Macédoine concernant l’arrondissement d’Archanguéli
(Dordanas 2009 : 281).
8. Ibid.
9. Parmi les nombreuses références à cette conversion forcée, il est intéressant d’en citer une qui
émane des archives diplomatiques françaises et qui, malgré la connotation orientaliste
empruntée au Roi des Montagnes d’Edmond About, montre clairement la connivence entre l’armée,
5B … 5D Les attentats sanglants sont actuellement
les bandes, l’Église et les fonctionnaires : « F0 F0
réservés aux Pomaks, Bulgares musulmans, que l’on veut à toute force ramener à l’Orthodoxie
par les moyens que Charlemagne employait jadis pour convertir les Saxons. D’après notre consul
à Philippopoli, l’agglomération de Tchépina, comprenant neuf villages pomaks, a été récemment
visitée par les comitadjis, assistés de la police, ainsi que cela se passait dans Le Roi des Montagnes. Il
y aurait eu soixante-dix morts, un imam assommé, un Hodja aveuglé et naturellement quelques
filles violées » (Monsieur Dard, chargé d’affaires de la République française à Sofia à Monsieur
Doumergue, président du Conseil, ministre des Affaires étrangères. AMAE FAA Série A 288/27).
10. Il convient de signaler ici la différence entre les volontaires des trois armées et
principalement celles qui séparent, d’un côté, les volontaires macédoniens enrôlés dans l’armée
bulgare (eux-mêmes différant des comitadjis) et, de l’autre, les proscopes, volontaires grecs
commandés par des officiers de l’armée régulière, surtout sujets ottomans. Il y a eu un long débat
lors des discussions du comité mixte gréco-bulgare concernant la délimitation des zones
occupées contestées, le 11 avril 1913, entre Grecs et Bulgares, pour déterminer ce que recouvre
exactement le terme « irréguliers » (Ministère des Armées III 1- 1934 : 49-56).
11. Torbèches : population slavophone musulmane de la Macédoine centrale et occidentale.
12. Signalons que les chrétiens de ces régions, Serbes et Bulgares, ont beaucoup souffert des
violences commises par les Albanais musulmans jusqu’à la « libération » de 1912.
13. Notons que des livres ou des aide-mémoire de ce type ont été par ailleurs produits par la
plupart des belligérants contre leurs adversaires, comme par exemple le livre grec, Atrocités
bulgares en Macédoine orientale et en Thrace (Anonyme 1914), plus élaboré que le rapport publié
précipitamment en 1913 en français par le Recteur des universités d’Athènes, Théodore Zaïmis et
pris en compte, non sans une certaine méfiance, par la Commission Carnegie (Zaïmis 1913).
14. Les Serbes ont carrément interdit l’entrée de la commission sur leur territoire et toute
investigation.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
264
15. Les Grecs sont surtout réticents à l’entrée en Grèce de H. N. Brailsford, membre britannique
de la commission, et à toute investigation qu’il pourrait mener. Une lettre en anglais, adressée à
l’ambassadeur de Grèce à Londres, Gennadios, par Alexandre Pallis, le 20 août 1913, décrit
Brailsford comme anti-grec et suggère de lui interdire, ainsi qu’à toute la commission, l’entrée
sur le territoire grec (EAECA – BGASD, dossier 113.2- doc. 49a). Brailsford envoie une lettre à
Stéphanos Dragoumis, Gouverneur général de Macédoine, lui rapportant qu’un gendarme crétois,
obéissant à des ordres, lui a interdit de prendre le train pour Kilkis ; finalement, Dragoumis lui
accorda l’autorisation (cf. annexe XXIV). Dans son livre, Macedonia, its Races and their Future, 1906,
il dénonçait les violences des bandes grecques en Macédoine après 1904 ainsi que la connivence
gréco-ottomane dans la région. De son côté, Victor Bérard, le membre français de la commission,
officiellement déclaré philhellène, est secrètement redouté comme bulgarophile, après la
publication de son livre, Pro Macedonia, et surtout après la réponse qu’il donne à Néoklis Kazazis,
dans le chapitre intitulé « Aux Hellènes », où il souligne lui aussi cette connivence (Bérard 1904 :
193-209).
16. Serrès, le 28/2/1913, Melénikou Constandinos au ministère des Affaires étrangères à
Athènes, ministère des Armées III1 - doc 69, pp. 128-134.
17. D’une manière équivalente chez les Bulgares, il y a aussi divergence entre, d’un côté, le roi
Ferdinand, l’état-major et surtout le générallissime de l’armée, Savov ainsi que certains leaders
politiques et, de l’autre côté, le Premier ministre, Ivan Guéchoff, architecte de l’Alliance
balkanique (Guéchoff 1915 - Kraïnowsky 1938 : 225-281), modéré et désireux de maintenir celle-ci
jusqu’à la fin.
18. Le livre de Helen Gardikas-Katsiadakis, basé sur des documents diplomatiques grecs et
britanniques, est le plus complet sur les coulisses diplomatiques de cette période de la
Conférence des ambassadeurs à Londres et évoque l’instabilité qui règne entre janvier et mai
1913 : cette position grecque, émanant de Vénizélos, est alors formulée une première fois par ce
dernier qui, par la suite se rétracte en réclamant comme frontière le Nestos (180-183). Elle
aboutira plus tard, suite à une proposition de Gennadios, ambassadeur de Grèce à Londres (195),
sous la forme décrite par Guéchoff, lequel l’attribue à Vénizélos, qui aurait même fait savoir,
avant la deuxième guerre balkanique, qu’il se satisferait d’une frontière constituée par la région
des lacs séparant la presqu’île de la Chalcidique du continent (Guéchoff 1915 : 184-186).
19. Les autorités militaires bulgares n’avaient pas autorisé les détachements du capitaine à
investir la ville de Kilkis, ce qui constituait le début de sa mission (Zoroyannidis 1975).
20. Le rapport Carnegie contient le témoignage de deux personnes de Zarovo, dont une
mentionne que la cavalerie grecque a poursuivi et attaqué les fuyards aux alentours du village
(Dotation Carnegie 1914 : 302) ; Miletič (1913 : 88) a également recueilli des témoignages des
villages voisins de Negovan et de Bogorodica (aujourd’hui Krithia, également connu sous les
noms de Gnoïna et Yeni Koy (Kyramargiou 2003).
21. Vu la description exacte de la topographie de la région par le capitaine Zoroyannidis, il ne
peut s’agir que de Banitsa et Doutli et probablement de Frasten et Mertatovo, les villages ayant
fait acte de soumission.
22. Je dois d’avoir pu consulter ce document à Tassos Kostopoulos, qui l’a mentionné dans son
5B Le Nom de l’Autre 5D (2004).
article « To Onoma tou Allou » F0 F0
23. Pour une biographie de Gotse Deltchev, de tendance pro-bulgare, cf. Mac Dermott, 1978.
24. Montagne dont la crête, longue et étroite, culminant à 2031 m, constitue la ligne de partage
des eaux entre les vallées de la Bregalnica, au nord, et celle du bassin du bas Strymon, au sud,
formant les lacs marécageux de Boutkovo (aujourd’hui Kerkini) et Tahino (en grec T’ ahinou, à ce
jour asséchée), avant l’embouchure de ce fleuve dans le golfe d’Orphano.
25. Melnik et Nevrokop en feraient partie mais pas Guevguélja, attribuée à la Serbie, ce que
confirme clairement l’accord gréco-serbe de juin 1913. Le livre grec sur les atrocités bulgares,
s’adressant aussi aux étrangers, ne fait aucune mention de l’incendie de Strumica par les Grecs,
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
265
excepté dans la réponse du roi de Grèce au roi de Bulgarie, comme le fait Anguélopoulos, qui
s’adresse, lui, à un public exclusivement grec mais n’omet pas de mentionner toutefois que « les
habitants grecs, musulmans, juifs et même beaucoup de Bulgares, se souvenant des atrocités
épouvantables commises par l’armée bulgare pendant leur première occupation, abandonnent
massivement leur pays et leur patrimoine, se réfugiant dans la Grèce nouvelle. C’est là que se
trouvait Kilkis, brûlée par les Bulgares. Ils formèrent un nouveau « pays » (patrida) avec l’aide du
gouvernement grec, la « nouvelle Stromnitsa » (Anonyme 1914 : 74 et Anguélopoulos 1980 : 341).
26. Melnik (en grec Mélénicon) : ville de la Macédoine du nord-est constituant un îlot grécophone
de viticulteurs spécialisés, locuteurs d’une variété propre du grec, entouré d’une mer de villages
céréaliers slavophones. Une minorité de ses habitants était slavophone. Les réfugiés grecs de
Melnik se sont majoritairement installés à Demirhissar.
27. Cf. également Dragostinova 2011 : 81 et note 8. Ce livre paru après l’accomplissement de cet
entretient est l’étude la plus édifiante en ce que concerne les Grecs de Bulgarie.
28. Ce n’est qu’après l’arrivée des réfugiés de Thrace occidentale (Dotation Carnegie : 192-193), et
surtout après l’accord de novembre 1913 entre l’ORIM et le CUP, que commence la persécution
des musulmans de Macédoine orientale grecque (Kostopoulos 2007 ; Sigalas 2012).
29. Cf. Dragostinova (2011 : 39-61).
30. Le ministre des Affaires étrangères français Stephen Pichon écrit à ce propos au chargé
d’affaires de la République française à Athènes : « Le chargé d’affaires de Bulgarie à Paris m’a
signalé, sur l’ordre de son gouvernement que plus de 1 000 Bulgares originaires de Lerina,
Kostour, Vodéna et Salonique, arrêtés par les autorités helléniques au cours de la guerre
balkanique, sont toujours retenus en prison. Ces Bulgares, prêtres, maîtres d’école et
commerçants sont tous des gens âgés, dont le seul crime serait d’être de nationalité bulgare et de
relever de l’Exarchat » (annexe IV).
31. Le témoignage d’un soldat grec, faisant partie de ceux qui furent publiés par la Commission
Carnegie, indique que, sur les mille prisonniers, probablement des volontaires macédoniens du
régiment que toutes les sources militaires mentionnent comme ayant été faits prisonniers à
Nigrita-même (Zoroyannidis 1975 : 92-96, qui, lui, parle de la garde d’élite du roi Ferdinand), seul
un petit nombre se trouvait encore dans les geôles ; les autres avaient été exécutés ou auraient
péri suite aux rigueurs de la détention ; le rapport de la Commission Carnegie cite longuement
des témoignages de prisonniers et rapporte dans le détail les abominables conditions de
détention, voire les violences subies.
32. Çatalca et Edirnecik (aujourd’hui Horisti et Hadriani), dont les populations grécophones, en
majorité chrétiennes, comprenait chacune une communauté musulmane.
33. Cette enquête a constitué une des sources les plus prestigieuses du livre grec traitant des
atrocités bulgares en Macédoine concernant les événements de Doxato et de Serrès (Anonyme
1914), encore qu’elle n’y soit pas reproduite, le nombre de morts et de viols répertoriés par
l’enquête étant de beaucoup inférieur aux chiffres avancés par les Grecs (ceux de Poulpiquet du
Halgouët sont en fait inférieurs à la réalité). Une controverse s’est élevée dans les rangs des
diplomates français sur l’impartialité de ce rapport. L’ambassadeur de France à Sofia, de Panafieu
(annexe XVII) l’ayant contesté, Poulpiquet du Halgouët répond par une nouvelle dépêche (AMAE
A 286/8, n. 395, 8/12/13).
34. L’importance de Doxato dans la logique territoriale bulgare devient plus évidente lorsqu’on
considère que sa population grecque a été brutalisée pendant ses deux occupations ultérieures
par les Bulgares (1916-1918 et 1941-1944).
35. Les kaza de Sarışaban (en grec, Chryssoupolis) et, dans une moindre mesure, ceux de Drama,
Kavala et Pravišta, sont majoritairement turcophones musulmans, alors que l’albanais est parlé
majoritairement dans les kaza de Tetovo (en turc, Kalkandelen), Kičevo, Reka, Dibra (Debar en
slave) et Korçë F0
2D pour peu que, contrairement aux Bulgares qui l’en excluent, on considère cette
dernière comme faisant partie de la Macédoine F0
2D et dans une moindre mesure dans ceux de
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
266
Koumanovo, Struga, Ohrid, Bitola (surtout dans le nahiye de Prespa), Florina et Kastoria. Les
Albanais sont majoritairement musulmans, sauf à Korçë où ils sont majoritairement orthodoxes
mais il y a d’importantes minorités orthodoxes à Reka, Florina et Kastoria et moins importantes à
Bitola (Clayer 2007).
36. Les Aroumains se trouvent dans la montagne (résidence d’été des pasteurs, dans des villages
parfois somptueux ou dans des huttes de transhumance) et dans les villes où ils sont
commerçants ou artisans, les Rom sédentaires, dans les plaines où ils constituent la main-
d’œuvre des grands domaines, parfois dans des villages compacts, ainsi que dans les faubourgs
des villes et des grands villages, où ils sont artisans ou musiciens.
37. Méglénoroumain : langue romane orientale, différente de l’aroumain, cédant le terrain au
slave macédonien ; les locuteurs sont appelés en français méglénoroumains et en roumain
meglenoromâni tandis qu’eux-mêmes s’appellent Valaques (Vlakh). Les deux groupes sont
appelés par les populations qui les entourent, ainsi que par les diplomates qui se réfèrent à eux,
Valaques, sans faire état des éléments importants qui les distinguent, d’un point de vue ethnique,
linguistique et social.
38. Bourgade musulmane de langue méglénoroumaine, chef-lieu du nahiye (Thede Kalh 2009).
39. En judéo-espagnol spaniol ou djudezmo, la lanque calque servant de support écrit étant appelée
ladino.
40. Une partie de ce groupe avait, depuis deux siècles, embrassé l’Islam, et constitue encore au
début du XXe siècle un groupe endogame à l’intérieur de la communauté musulmane de la ville,
parlant encore le judéo-espagnol et connu sous le nom de Dönmè.
41. La ligne de contact entre parlers grecs et slaves passe, grosso modo, à Nistim (Nostimo) et à
Videlousti (Damaskinia, le seul village de cette région comprenant des locuteurs des deux
langues), au sud du village de Nestram (nahiye de Nestram, Nestorion), laissant la ville de Kastoria
comme îlot grécophone à l’intérieur de l’aire slavophone, la moyenne vallée et la boucle de
l’Haliacmon, kaza de Grévéna et kaza de Anasélitsa, entièrement grécophones (les musulmans
compris : Valaadès), légèrement au sud de Kaïlar (Ptolémaïda), au sud de Naoussa (Niaousta en
grec parlé, Neguš en slave), autre îlot grécophone avec deux villages voisins, atteint
l’embouchure de l’Haliacmon, laissant en dehors la totalité du mont Flambouro (Piéria Ori)
grécophone, la ville de Verria et le Roumlouk, entièrement grécophone (sauf l’enclave
slavophone du village de Libanovo, aujourd’hui Aiginio), laissant le village de Koulakia
(aujourd’hui Halastra), anciennement slavophone mais déjà grécophone à l’époque, contourne
Salonique, mais remonte pour comprendre les villages de Baltsa (Mélissohori) et de Demirglava
ou Dryminglava (Drymos), tous deux grécophones, ainsi que Giouvezna (Assiros) et Laïna ou
Laïnovo (aujourd’hui Laguina), Aïvatovo étant slavophone, ainsi que la bourgade de Langada et
plusieurs villages dans le Bassin des lacs séparant la Chalcidique, celle-ci entièrement
grécophone quant aux Chrétiens, du continent. La ligne remonte pour comprendre les quatre
villages sur la rive droite du Bogdano, Negovan ou Ligovan (Xyloupolis), Zarovo (Nikopolis), Suho
(Sohos) et Vissoka (Ossa) mais laissant en dehors les villages voisins de Bérova (Vertiskos) et
Chorouda, grécophones. Le district au sud de Nigrita est grécophone, au nord, majoritairement
slavophone. C’est dans la région comprise entre Salonique et Serrès que la ligne de contact est la
moins claire ; les rives du lac Tahino sont le seul endroit où l’on trouve des villages mixtes,
comportant une partie grécophone et une partie slavophone. La ligne atteint Serrès, limite
septentrionale de la grécophonie, en laissant la ville de Melnik comme enclave avec le village
musulman de Laïlovo, ainsi qu’une partie des villes de Demirhisar et de Nevrokop, seules
agglomérations entièrement ou en partie grécophones au nord de Serrès. La ligne laisse les
villages grecophones Darnak en dehors mais tout le mont Ménécée est slavophone, sauf les
villages d’Anastassia, de Sfélinos au sud, aujourd’hui grécophones (mais ayant été bilingues) et
sept villages turcophones chrétiens. La pointe méridionale des slavophones est constituée par les
villages d’Alistrati, Klepoušna (Agriani), Skridjovo (Skopia), Gračen (Aghiohori). La ligne se
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
267
poursuit jusqu’à Drama, avec une importante enclave grécophone constituée par les trois villages
de Doxato, Edernecik (Hadriani) et Çatalça (Horisti) et la majorité chrétienne de la ville de Drama.
À partir de cette ville, à l’est, la région est entièrement turcophone sur les flancs sud et
slavophone sur les flancs nord des contreforts du Rhodope à partir d’une certaine altitude où se
trouve la plus grande concentration de Pomaks. La grécophonie est beaucoup plus intense en
Thrace à l’est de la ville de Komotini et surtout en Thrace orientale plus on se rapproche
d’Istanbul, le littoral de l’Égée et de la mer de Marmara étant sur toute la ligne turcophone et
surtout grécophone.
42. Les parlers slaves ne sont nulle part en usage sur le littoral égéen de la Macédoine et de la
Thrace, ce qui constitue un problème majeur pour la Bulgarie, son littoral sur la mer Noire ne lui
donnant pas accès à la mer ouverte, du fait que celle-ci est séparée de l’Égée par les Détroits qui
sont contrôlés par l’Empire ottoman. Là où les parlers slaves s’approchent le plus de la mer, à
l’ouest de Salonique, ils en sont séparés par les vastes marécages à l’embouchure des quatre
fleuves qui se jettent dans le golfe de Salonique. Seuls Koçkar et Eski Kavala, villages du littoral à
l’ouest de Kavala, sont slavophones mais musulmans. Cet exposé linguistique (§ 70-78) ne prend
pas en compte la religion, bien qu’elle soit aussi importante que la langue, les Bulgares omettant
le plus souvent cette donnée, tant entre patriarchistes et exarchistes qu’entre Orthodoxes, en
général, et musulmans, ne retenant qu’une catégorie linguistique et se bornant tout au plus à
signaler, comme Kănčov (1900 ; Kontogiorgi 2006 : 230-236), s’il s’agit de chrétiens ou de
musulmans.
43. Kastoria est un îlot grécophone proche de la zone grécophone mais séparé de celle-ci par le
plateau du lac homonyme et les villages du nord du nahiye de Hroupista, entièrement slavophone.
Serrès, quant à elle, peut être considérée comme la pointe septentrionale d’une brèche
grécophone sur les flancs du Ménécée et sur la rive gauche du Strymon, majoritairement
slavophone. Même la zone du sud de Paparrigopoulos, entièrement grecque selon lui, contient de
vastes brèches slavophones.
44. Cette tendance apparaît très tôt avec les Aroumains à Peste et à Vienne avec Bojaci (Michaïl
Bojaci 1813 ; Thede Kahl 2009 ; Mackridje 2009 : 187-192) - Anguéliki Konstandakopoulou 1988),
pour continuer avec les Bulgares et s’étendre aux Albanais (Clayer 2007 ; Sigalas 1999). Il est à
noter que, depuis Bojaci (1813) jusqu’au début du XXe siècle, ce sont surtout les instituteurs ou
enseignants du grec en général, non grécophones, qui deviennent, les premiers, les apôtres de
l’enseignement dans leur langue maternelle et ce, suite à un conflit personnel avec l’élite
grecque, qui en entame le prestige. Des prêtres peuvent parfois suivre une trajectoire analogue :
Papa Kristo Negovan, Papa Eftim Karakhissaridi, alias Ereneröl, Fan Noli constituent les exemples
les plus illustres.
45. Dragostinova (2001 : 23).
46. Spyros Karavas, dans un livre paru après la réalisation de cet entretien, met en évidence un
autre paramètre de la politique grecque en Macédoine ottomane, celui de l’achat par de gens liés
au parti grec de çiftlik appartenant à des musulmans afin de dominer les travailleurs agricoles
slaves, les mettre dans le giron patriarchiste et, le cas échéant, les remplacer par des travailleurs
grecs de l’Empire ottoman ou du royaume de Grèce et former une continuité territoriale par le
fait même de la possession de la terre (Karavas 2010). Ce projet très ambitieux n’a pas pu
évidement se matérialiser – à l’exception de quelques investisseurs, parmi lesquels se
remarquent l’instigateur lui-même du projet, Athanasios Papaloukas Eftaxias et la famille de
grands propriétaires terriens locaux, les Khadjilazarou, slavophones patriarchistes appartenant à
la grande bourgeoisie de Salonique et formant un des piliers majeurs du parti grec. Parmi les
cinq çiftlik de ces derniers,on comptait Yanèsdans la région de Kilkis (c’est d’ailleurs très
probablement grâce à la protection de Khadjilazarou que les paysans de Yanès sont restés sur
place après les événements de juin 1913).
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
268
47. Ilinden : Révolte de grande envergure, organisée par l’ORIM pour l’autonomie de la
Macédoine, revendiquée aujourd’hui par la république de Macédoine comme acte fondateur du
mouvement national macédonien et par les Bulgares comme un haut fait révolutionnaire bulgare
en Macédoine. Les Macédoniens l’appellent seulement Ilinden (jour d’Élie, fêté par les orthodoxes
le 20 juillet), pour souligner l’aspect macédonien de cette révolte, alors que les Bulgares la
nomment Ilinden-Preobrajensko (Preobrajenje : jour de la transfiguration du Sauveur, fêté par
les orthodoxes le 6 août), jour aussi de la déclaration de la révolte également dans la région
d’Andrinople et de la Strandja, ce qui ôte à l’événement son caractère exclusivement
macédonien.
48. Ce travail se fonde sur une nouvelle lecture du remarquable ouvrage de Lioubomir Miletič,
Materiali za istoriata na makedoskoto osvoboditelno dvijenie, t. I-IX, Sofia, 1925-1927, et en particulier
sur les tomes I, II, III, IV et VIII, dans lesquels figurent les récits des principaux responsables
macédoniens recueillis immédiatement après l’insurrection de 1903.
49. « Verhovistes » et « centralistes » ne peuvent en effet être si facilement considérés les uns
comme des instruments de l’État bulgare et les autres comme une émanation du nationalisme
macédonien. Les nuances du différend bulgaro-macédonien sont mises en relief d’une manière
exemplaire dans le travail pionnier de Tchavdar Marinov (Marinov 2006) dont j’ai eu
connaissance après la fin de cet entretien. Je renvoie également à ce travail pour l’analyse des
oscillations dans l’onomastique des organisations révolutionnaires macédoniennes.
50. On doit à Victor Bérard (1904) et à Henry Noel Brailsford (1906 : 209-220) la dénonciation la
plus virulente de cette alliance tacite. Au second, on doit également le portrait le plus évocateur,
brossé par un non Grec, de Monseigneur Germain, métropolite de Kastoria (alias Germanos
Karavanghélis ; pour une dénonciation bulgare avant l’entrée en scène des bandes grecques, cf.
Anonyme 1904 : 46 ; sur le rôle joué plus tard par ce prélat dans le Pont-Euxin en tant que
métropolite d’Amasya, cette fois-ci contre les Turcs, Sigalas 2012); notons que la chose est
également soulignée par un autre auteur français qui a une connaissance profonde de la
Macédoine : René Pinon (1909 : 221).
51. Voir à ce sujet Andréou (2003). Un livre récent entend prouver qu’un grand nombre de
Macédoniens indigènes (toutes langues confondues) ont participé, côté grec, à la « lutte
macédonienne ». Ce qui exprime une tendance récente à mettre en exergue la contribution des
indigènes dans l’effort armé grec en Macédoine. (Michaïlidis & Papanikolaou 2008.)
52. Une bonne partie de ces études sont issues de chercheurs ayant un rapport avec le Musée de
la Lutte macédonienne de Thessalonique et le centre de recherches associé à celui-ci. Ces études,
quelquefois de grande érudition, sont en général limitées par le cadre helléno-centrique que pose
la notion de lutte macédonienne, dans le champ conceptuel de laquelle sont appelées à
fonctionner les instituions ci-mentionnées.
53. Cf. l’excellent exposé de Tchavdar Marinov (2006).
54. Ivan Guéchoff : Premier ministre de la Bulgarie de 1911 jusqu’à son abdication, en mai 1913. Il
ne fut pas Premier ministre pendant la débâcle de 1913, ayant compris l’extrême précarité de sa
position modérée et étant dans l’incapacité de contrôler une Bulgarie où les bellicistes avaient
pris le dessus. Dans son livre sur l’alliance balkanique (Guéchoff 1915), publié en français et en
anglais, il insiste sur les responsabilités partagées « des chauvins de tous les pays balkaniques »,
qui ont entraîné la ruine de l’alliance et la défaite de son pays. Par chauvins il entend, en ce qui
concerne la Bulgarie, la fraction belliciste à laquelle avaient adhéré le roi Ferdinand, le haut
commandement de l’armée, les Macédoniens et tous les partis d’opposition, sauf les agrariens et
les socialistes.
55. Guéchoff, dans son récit, n’accorde pas assez d’importance à la politique russe de
rapprochement des deux États slaves avec les ambassadeurs de Russie à Belgrade et à Sofia,
Hartwig et Nekludov (Fay, Tome I, p. 288).
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
269
56. Les bandes grecques ont d’ailleurs imité l’organisation révolutionnaire et, à bien des égards,
ont tiré un enseignement de leurs méthodes, bien qu’il faille distinguer entre groupes armés
insurgés et groupes armés inféodés au pouvoir, selon la dichotomie établie par Stathis Kalyvas
(2006) (en anglais, insurgents/incumbents), les bandes grecques étant la plupart du temps, selon
cette lecture, du côté des incumbents.
57. Macédoine (Grèce/Bulgarie) 1913, Macédoine orientale grecque /Thrace occidentale bulgare
1913-1914, Macédoine grecque/Thrace orientale ottomane et Asie Mineure 1914, Thrace bulgare/
Thrace ottomane 1913, Grèce/Bulgarie 1919, Grèce/Turquie 1922-1923, Allemagne nazie et URSS
(Polonais-allemands soviétiques) 1939-1940, Pologne/Ukraine/Biélorussie/Lithuanie soviétiques
1944, Inde/Pakistan 1947-1948, Israël (entité juive/entité arabe) 1947-1948, Chypre 1963-1975,
Israël/États arabes 1967-1968, Liban 1975, Croatie/Serbie 1991-1995, Bosnie Herzégovine
1992-1995, république de Macédoine 2001 (Albanais/Macédoniens), Kosovo 1997-1999 et 2004 etc.
Quelques-uns de ces échanges interviennent ad hoc, certains États se réclamant de cette logique ;
pour d’autres, ils sont institutionnalisés à partir de 1919 dans des traités et ce, jusqu’en 1948,
puis, pendant les guerres de Yougoslavie, sont partiellement entérinés par Dayton en 1995 et
l’accord militaire de Koumanovo de 1999.
58. Pour l’analyse de cette source,cf. Baltsiotis & Embiricos 2007.
59. Participation qui avait constitué un critère d’appartenance pour les sujets grecs de l’Empire
ottoman, du fait que les Bulgares ayant participé à cette révolution étaient considérés comme
Grecs ; une agglomération fut réservée à ces derniers sur les flancs du mont Parnès, en Attique,
appelée « synoikismos Thrako - Voulgaro - Servon » (Skopétéa 1988 : 332), et rebaptisée après
l’apparition de l’antagonisme gréco-bulgare Thrako-Makedones.
60. L’idée libérale de la conscience nationale est ainsi de plus en plus considérée comme un
critère rigide d’appartenance alors qu’il ne s’agit que d’une notion dynamique, sujette à une
négociation continue.
61. Il est par ailleurs important de signaler que la politique du ministère grec des Affaires
étrangères s’est forgée dans la deuxième moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle à travers
la prise en compte de tous les paramètres qui ont joué un rôle majeur dans la revendication de la
Macédoine et, en second lieu, de l’Épire et de la Thrace. La « politique nationale » concernant les
minorités non grécophones ou non orthodoxes des parties de ces trois contrées qui ont été
incorporées à la Grèce relève, paradoxalement, encore aujourd’hui de la compétence du
ministère des Affaires étrangères.
62. La comparaison ne concerne pas les chiffres (le nombre des réfugiés palestiniens de 1948
s’élevant à plusieurs centaines de milliers contre quelques dizaines de milliers pour les réfugiés
de la Macédoine orientale grecque de 1913 et le nombre de morts étant sans commune mesure
dans les localités de Deir Yassin et de Kilkis) mais la signification des deux événements dans
l’appropriation du territoire macédonien et palestinien, par la Grèce et Israël respectivement.
63. Aujourd’hui Mandrès, dans le nome de Kilkis entièrement peuplé de réfugiés albanophones
patriarchistes de la bourgade de Mandrica en Bulgarie.
64. Ainsi que Dordanas 2009.
65. Cette attaque a été lancée le 29 juin 1913, sans déclaration de guerre, par le général Savov,
chef de l’état-major, très austrophile. Le général a probablement reçu l’ordre d’attaque du roi
Ferdinand, sans consultation préalable du Parlement ni du Premier ministre Danev (successeur
2D en vain 2D la médiation du
de Guéchoff), qui s’est tout de suite opposé à l’attaque et demandé F0 F0
Tsar pour faire cesser les hostilités. Les Serbes et les Grecs auraient saisi l’occasion pour
« dédouaner » la Bulgarie des territoires occupés par son armée (Guéchoff 1915). Cette attaque
inouïe semble résulter de la confiance du roi et de l’état-major dans la force de leur armée, ainsi
que de leur volonté de procurer à la Bulgarie un avantage dans les négociations pour le partage
des territoires occupés avant que les conscrits, requis en période de moisson, ne soient
démobilisés. Auparavant, il y avait eu plusieurs attaques contre les positions grecques sur le
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
270
mont Pangée, dans l’arrière-pays de Kavala, le général Savov ne considérant pas qu’il existait une
zone neutre entre les positions des deux armées d’occupation (Ministère des Armées 1934, III – I -
G I). Bien que sans doute provoquées également par l’armée grecque, ces attaques ont été
contenues diplomatiquement mais c’est elles qui sont probablement à l’origine de la démission
de Guéchoff.
66. 1. Israélites, 2. Musulmans (Dönmés compris), 3. Roums (Grecs orthodoxes patriarchistes :
Grecs, Valaques hellénisants, slavophones patriarchistes et autres catégories moins nombreuses
de patriarchistes, et 4. Bulgares (Bulgares orthodoxes exarchistes et les quelques uniates).
67. Fils de Stéphanos Dragoumis, écrivain, d’inspiration barèsienne et diplomate, farouchement
pro-ottoman et anti-slave, il fut l’idéologue par excellence du nationalisme grec de son époque,
dans son expression littéraire et idéologique. Il était incapable de percevoir l’évolution de
l’Empire ottoman sous les Jeunes Turcs vers le nationalisme turc et, de ce fait, il dépréciait
Venizélos. Il a été assassiné en 1920 à Athènes par Gyparis, le capitaine du volontaire Nostrakis,
que nous avons déjà rencontré dans les pages du journal de ce dernier.
68. Philippos Dragoumis, juriste, politicien et peintre, fils du gouverneur général de Macédoine
et ex-Premier ministre Stéphanos Dragoumis et frère du diplomate et écrivain Ion Dragoumis,
plusieurs fois député de Florina, a participé au gouvernement d’union nationale au moment de la
Libération (1944), ministre des Affaires étrangères lors de la conférence de paix de Paris.
69. En ce qui concerne Pelletier (1913), il convient cependant de préciser que son parti pris pro-
bulgare le rend exagérément critique envers tout ce qui vient de la Grèce.
70. Je remercie chaleureusement pour la communication de ce document, Andonis Polémis,
érudit, dernier imprimeur de l’imprimerie Lourentzos Karaoulanis d’Andros qui en a organisé les
archives.
71. Pavlos Mélas et Stéphanos Kallergis, ce dernier ayant succombé au choléra pendant la
campagne militaire de 1913.
72. Elle figure dans le même dossier déjà cité des archives Stéphanos Dragoumis.
73. L’historien américain Sidney Bradshaw Fay considère Alfred Dumaine comme une
marionnette de Raymond Poincaré et estime que son ouvrage La Dernière Ambassade de France en
Autriche, Paris, 1921, « manque singulièrement d’information et d’influence » (Fay : 39, 41). La
conception qu’a Maurice Bompard, ancien ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg, à
l’époque ambassadeur à Istanbul, et bras droit de Paul Cambon, de l’attitude de la France envers
la Bulgarie, la Serbie et la Grèce, diffère sensiblement de celle de Dumaine ; il oppose à ce dernier
qu’il faut tenter jusqu’au bout de convaincre la Bulgarie de ne pas rompre l’Alliance balkanique
et reste persuadé que, malgré la politique austrophile de Ferdinand, celle-ci pourrait encore
rester dans le giron de la Russie. Bompard, Lorrain francophone, réfugié après 1871, a écrit, après
son ambassade en Turquie, une notice très clairvoyante sur la question d’Orient (Bompard 1937 :
317-330).
74. Jean Larmeroux reproduit, sans citer ses sources, des lettres de Danev, Savov, et d’autres
Bulgares (1918 : 337-374), qui témoignent de l’extrême bellicisme et de l’austrophilie de ces
militaires et politiciens bulgares, peu avant le déclenchement de la deuxième guerre balkanique.
Il écrit ce livre en 1918, dans le but d’inculper au maximum l’Autriche-Hongrie dans le
déclenchement de la première guerre mondiale. La littérature de cette période émanant des
puissances de l’Entente, avant et peu après le traité de Versailles (1914-1919), entend prouver la
responsabilité exclusive de l’Allemagne et de ses alliés dans le déclenchement de la guerre de
1914, ce qui a été cristallisé dans l’article 231 du traité de Versailles. La Russie bolchevique ne
faisant plus partie de l’Entente depuis la révolution d’Octobre et le traité de Brest-Litovsk, c’est à
la France plus qu’à tout autre allié qu’il incombe de prouver que celle-ci n’est pour rien dans
cette affaire.
75. Le dossier du fonds Athènes-Ambassade des Archives historiques du ministère des Affaires
étrangères à Nantes, auquel nous faisons référence ici, inclut la controverse sur les atrocités
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
271
grecques et bulgares, dont les protagonistes sont Jousselin, consul français à Salonique, Dard,
chargé d’affaires français à Sofia, de Panafieu, ambassadeur français à Sofia, Poulpiquet du
Halgouët, chargé d’affaires français à Athènes qui remplace alors l’ambassadeur Deville, Cambon,
ambassadeur de France à Londres, Descos, ambassadeur de France à Belgrade, le ministre des
Affaires étrangères français Pichon, les ministres des Affaires étrangères grecs et bulgare,
Coromilas et Panas, d’un côté, et Genadief, de l’autre. Les rapports des ces diplomates, rédigés à
partir des enquêtes menées, soit sur le théâtre des atrocités soit d’après les descriptions faites
par des témoins oculaires, sont ensuite centralisés par le ministère et redistribués afin de croiser
les avis des diplomates. Il en ressort une profonde contradiction entre les représentants français
selon qu’ils sont pro-grecs ou pro-bulgares ou qu’ils œuvrent tout simplement pour « les intérêts
français » et privilégient les récits qu’ils jugent moins désavantageux pour la France, ou encore
qu’ils ont accès à une seule version des événements. L’exemple le plus révélateur à cet égard est
sans doute la note manuscrite de Poulpiquet du Halgouët sur un document de Jousselin
accompagnant le témoignage portant sur les « atrocités grecques » à Doxato : « Ce rapport est un
monument de partialité et d’ineptie. Il va tellement à l’encontre des faits les plus évidents et du
sens commun qu’on est stupéfait qu’il ait pu être signé d’un agent français, signature » (AMAE
FAA, Série A 286/10, 2/8/1913). Le dernier document concernant cette controverse, daté le
8/12/1913 est une relecture par Poulpiquet du Halgouët des témoignages bulgares concernant
Doxato, où il évoque Kilkis en tant que contrexemple de Doxato et Serrès et se défendant des
critiques de de Panafieu. Tout en affirmant son manque d’informations lui permettant de
trancher sur la question de l’immolation de la ville par les Grecs, il est porté à accréditer la
version selon laquelle les habitants de cette région l’auraient quitté de leur propre gré avant son
occupation par l’armée grecque, sans que des massacres n’aient eu lieu (AMAE FAA Série A 286/8
8/9/1913).
76. G. Deville, ministre de la République française en Grèce à son excellence monsieur
Doumergue, ministre des Affaires étrangères, Paris. 24/3/1914 (AMAE FAA Série A 289/1). Cf.
également Deville G. (1919).
77. Trois documents diplomatiques français font état de 10 écoles françaises dans la ville et de 35
en Macédoine du Sud, surtout Yenice Vardar, Kilkis et Gevgelija (AMAE, FAA Séries A 278/1,
1/7/1919, 278/2, 1/7/1919 et 278/3, non daté).
78. Je remercie Tassos Anastassiadis et Giorgos Koutzakiotis pour leurs précisions concernant les
intérêts français à Salonique et la présence des écoles et missions catholiques.
79. « L’Organisation de Salonique », organisation secrète grecque œuvrant pour les intérêts du
parti grec à Salonique, avant les guerres balkaniques, s’oppose à la diffusion du français sur les
enseignes des magasins grecs, voulant par ce biais disputer à cette langue son prestige
grandissant au détriment du grec, ce qui témoigne d’un conflit latent, à Salonique même, entre le
grec écrit et véhiculaire et toute langue qui lui dispute en Macédoine méridionale sa place
privilégiée.
80. Paul Cambon, véritable chef de la diplomatie, suivi par Stephen Pichon, ne veut à aucun prix
froisser les susceptibilités de la Grèce, ce qui, tout en montrant la façon dont se constituent des
alliances avec de petits pays au sein des grandes alliances, atteste que l’orientation qu’on voit
poindre dans la dépêche d’Alfred Dumaine est maintenue.
81. Pichon déclare à Delcassé, le 9 août : « l’attitude française est justifiée par notre politique
traditionnelle, par le souci de l’équilibre méditerranéen, par les conditions de la guerre entre la
Bulgarie et la Grèce, par les victoires et les sacrifices de cette dernière, par l’attitude de
l’Allemagne, enfin et surtout par la certitude que j’avais d’une reprise d’hostilités dans
l’hypothèse d’une tentative de règlement différent ». (MAE, Les Affaires Balkaniques, 1912-1914, 3
vol. Paris, 1922, tome II, p. 294, in Fay (1930) : 415, note 191) ; la dernière phrase du ministre
aurait aussi bien pu valoir pour la solution inverse. Le livre de Fay est l’ouvrage le plus important
sur les origines de la guerre mondiale, écrits dans l’entre-deux-guerres, plus important encore
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
272
que ceux de E. Bourgeois et G. Pagès, Les Origines et les responsabilités de la Grande Guerre, Paris
Hachette 1921 et de R.W. Seton – Watson, Sarajevo, A Study of the Origins of the Great War, Londres,
1925.
82. En 1917, la grande majorité des habitants grecs de cette région ont été emmenés en
déportation dans des camps d’internement, surtout à Kitchevo, et à leur place on a installé les
réfugiés de 1913-1915.
83. Je me réfère ici au titre d’un ouvrage écrit du temps de la guerre, évoquant les enjeux en
Bulgarie, avant même le choix de l’une des deux grandes alliances, qui a connu un grand
retentissement (Dunant 1917). Il comporte également un portrait de de Panafieu (Dunant 1917 :
25-27) et explique sa soi-disant bulgarophilie.
84. Les prétentions grecques sur la Thrace orientale et occidentale sont exposées en vue de la
conférence de paix dans le livre de Psaltis (1919) et sur la Thrace occidentale par Kyriakidis
(1919). L’inclusion définitive de la Thrace occidentale dans les prévisions de la convention du
Traité de Neuilly, qui a entamé le départ de quasiment tous les autochtones bulgares, ne
s’effectue que le 26 octobre 1923 (Dragostinova 2011 : 127, 142) – ce qui a aggravé le sort des
Grecs de l’ancienne Bulgarie.
85. Cf. Dragostinova 2011 : 127, 129 et note 50.
86. Jacques Ancel (1930), sur la difficulté d’évaluer le nombre de réfugiés en Bulgarie, ainsi que
sur les péripéties de leur installation et le rôle des organisations macédoniennes, cf. le chapitre
intitulé : « La Macédoine bulgare et les Macédoniens en Bulgarie », pp. 209-259.
87. Il se réfère au traité de Sèvres, désigné également ainsi.
88. Rapport sur les travaux de la Commission mixte d’émigration gréco-bulgare jusqu’au 16 août
1921 (AMAE FAA A 408/409, sans date).
89. Un document de la mission militaire grecque à Sofia en Bulgarie daté du 5 février 1919 (18
février 1919 du calendrier grégorien), que le chef de la mission, le colonel Constantin Mazarakis,
adresse au président du Conseil, et au ministère des Affaires étrangères, à l’état-major, au
Gouvernorat général à Salonique et au Gouvernorat général de Macédoine orientale, fait état
d’un projet incitant la population grecque de Bulgarie à émigrer en Grèce, en vu de la signature
d’un traité qui allait définitivement régler les questions des populations minoritaires entre les
deux pays. Le « rapatriement » des homogeneis était donc à cette date une politique concrète, au
moins pour ces gens qui, comme Mazarakis, l’initiateur de l’institution des Proskopoi, avaient fait
partie intégrante du mécanisme macédonien. Sur cette question cf. également l’étude édifiante
de Theodora Dragostinova (2011 : 77-116), publiée après la fin de cet entretien. Sur la mission
militaire grecque en Bulgarie cf. également Kotzagiorgi-Zymari, 2005.
90. Le « rapatriement » des homogeneis était donc à cette date une politique concrète, au moins
pour ces gens qui, comme Mazarakis, l’initiateur de l’institution des Proskopoi, avaient fait partie
intégrante du mécanisme macédonien. Sur cette question cf. également l’étude édifiante de
Theodora Dragostinova (2011 : 77-116), publiée après la fin de cet entretien. Sur la mission
militaire grecque en Bulgarie cf. également Kotzagiorgi-Zymari 2005.
91. Dragostinova (2011 : 112-113).
92. Dragostinova (2011 : 142), soutient qu’après 1923 les autorités grecques commencent à
interpréter Neuilly sous l’angle de la Convention de Lausanne, dont le caractère obligatoire leur
fait oublier le caractère libéral de Neuilly, ce à quoi contribue également la frustration
qu’engendre à ces autorités l’arrivée d’un si grand nombre de réfugiés (cf. Kontogiorgi 2006).
93. Je remercie chaleureusement Constantin Tsitsélikis de m’avoir fourni ce document.
94. Ce livre important, première étude sérieuse menée par un Grec, s’inscrit toutefois dans une
ligne plus ou moins compatible avec une politique de détente sous les gouvernements du centre
des années 1960 ; il n’a jamais été traduit en grec. Pour une critique des positions sujettes à
variation de cet historien, expert pendant de longues années du ministère des Affaires
étrangères, préposé aux affaires balkaniques, voir Anguéliki Konstandakopoulou (2008).
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
273
95. C’est alors que le PC est déclaré illégal et qu’est ouvert le camp de déportation de
Makronissos destiné à rééduquer idéologiquement les communistes.
96. Selon les autorités communistes, l’objectif était de leur épargner la violence de la guerre et
d’éviter qu’ils ne soient concentrés dans les camps dits « Paidoupoleis » institués par la reine
Frédérique afin de leur inculquer une idéologie nationaliste et anticommuniste, cette initiative
ne concernant pas, du reste, exclusivement des Macédoniens, (plus du tiers d’entre eux étaient
des Macédoniens au sens national du terme [Lagani 1996]).
97. Visant d’abord les slavophones, il sera plus tard utilisé pour priver de la nationalité les
minoritaires turco-musulmans de Thrace occidentale (Kostopoulos 2003 ; Baltsiotis 2004).
98. Christina Koulouri a retracé l’histoire de la nationalité hellénique lors de la présentation de la
proposition d’un nouveau Code de la nationalité hellénique par l’Union hellénique pour les Droits
de l’homme, le 26 mars 2009 (Koulouri 2009).
99. La Grèce exige un visa pour les ressortissants de Yougoslavie (contrairement à la majorité des
pays européens) et ce, pour pouvoir contrôler, surtout via son consulat de Skopje, l’entrée en
Grèce des ressortissants de ce pays, d’origine slavomacédonienne de Grèce, ou des Macédoniens
de Grèce, apatrides. Ce qui entrave, bien entendu, la libre circulation des personnes et des biens à
travers la Yougoslavie, seul pays reliant facilement par voie de terre la Grèce à l’Europe
occidentale, son débouché principal ; la Yougoslavie, par réciprocité, exigeant des Grecs le visa.
L’octroi de la nationalité grecque aux Macédoniens apatrides est subordonné à la non mention du
nom slave initial de leur lieu de naissance en Grèce, le document devant porter l’appellation
officielle grecque qui s’y est substituée. Ceux-ci sont de plus en plus souvent regroupés en
associations, soit d’enfants, soit de combattants, soit selon l’implantation géographique, et
quittent les républiques populaires satellites de Moscou pour la république fédérée de
Macédoine, ce qui les prive du « parapluie » du Parti communiste grec, affilié à Moscou, qui
considère la Yougoslavie titiste comme « révisionniste » et qui dans l’exil ailleurs qu’en
Yougoslavie les considère toujours comme des minoritaires macédoniens, leur réservant une
éducation bilingue, grec et macédonien, ce dernier étant transcrit autrement que le macédonien
officiel. Ces réfugiés se donnent le nom d’Égéens, par référence à la « Macédoine égéenne »,
partie grecque de la Macédoine selon la conception nationaliste macédonienne (Monova 2002 -
Skoulariki 2005).
100. Ce livre représente la première tentative pour rationaliser l’existence d’un problème
minoritaire culturel en Grèce du nord, en soulignant toutefois que la dimension ethnique et
culturelle ne constitue pas un critère de différenciation nationale mais seulement
d’autodétermination individuelle. Pour une critique de cette approche quasi officielle sous le
gouvernement Simitis – bien que différenciée selon les auteurs–, voir Anguéliki
Konstandakopoulou (2008).
101. Bien que cet article ne fasse pas mention du principal nom désignant la langue en
Macédoine grecque à l’ouest de l’Axios: macédonien, en grec makedónika, en macédonien
makedonski (Beis 2008).
102. La contradiction flagrante, qui consiste à refuser d’accorder la nationalité grecque à ceux
qui sont partis à la fin de la guerre civile et déclarés comme d’origine non grecque ou de
conscience slave, alors qu’on refuse de reconnaître leurs frères, sœurs, pères et mères comme
étant autres que Grecs, et ce sur le seul critère de la langue parlée dans leur village d’origine, en
englobant toutes les catégories de populations actuellement slavophones et ex-slavophones de la
Grèce, et en transcendant les anciens clivages établis par l’administration elle-même ou les
services secrets et de sécurité de l’État (exarchistes/patriarchistes, Bulgares/Grecs, bulgarisants/
grécisants, slavisants/grécisants, communistes/non communistes, macédonisants/hellénisants,
anti-grecs/pro-grecs, etc.), permet de dessiner en pointillés, au niveau des rouages de l’État, une
minorité beaucoup plus vaste que celle qui se déclare actuellement « nationalement
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
274
macédonienne », selon la dénomination du parti minoritaire Arc-en-ciel. Précisons qu’il n’y pas
aujourd’hui de droit positif qui fasse défaut aux citoyens grecs provenant du groupe slavophone.
103. Je remercie chaleureusement Lambros Baltsiotis pour la communication de ce document .
104. cf. Dragostinova 2011.
105. L’impact de l’échange était nettement plus important en Macédoine orientale, un peu moins
en Macédoine centrale et peu conséquent en Macédoine occidentale. L’assimilation de ceux qui
restent s’inscrit dans une logique faisant alterner répression et offre d’ascension sociale, sous
condition implicite d’occulter leur spécificité ethnolinguistique (Varda 1993 ; Gounaris 1994 ;
Kostopoulos 2002 ; Carabott 2003 ; Kostopoulos 2011).
106. Ce qui entraîne l’apparition, du côté grec, du terme irrédentisme dans un usage très
souvent abusif (Skoulariki 2008).
RÉSUMÉS
Le long entretien que nous publions ici a une histoire. Léonidas Embiricos est un spécialiste de
l’histoire de la question macédonienne, ainsi qu’un excellent connaisseur du terrain : de la
géographie et de la population de la Macédoine. Nous l’avons contacté depuis la première phase
de préparation de ce dossier et il a proposé d’analyser les événements – très importants pour
l’histoire de la question macédonienne et pourtant très peu étudiés – qui ont eu lieu pendant
l’investissement, en 1913, de la ville de Kilkis et de sa région par l’armée grecque. Nous avons
réalisé un premier entretien en deux séances (en mars et en avril 2008 à Athènes), lors desquelles
nous avons réalisé que les recherches que l’interviewé avait mené sur cette question,
mériteraient un développement beaucoup plus important. Nous lui avons ainsi proposé
d’enrichir le texte de l’entretien et d’y ajouter des annexes avec les documents d’archives dont il
se servait pour son exposé. Le résultat en fut ce texte en ligne, qui constitue en fait un projet de
livre. Après consultation avec l’auteur/interviewé, nous avons opté pour conserver au texte le
statut spécial, à cheval entre l’oral et l’écrit, en souvenir du processus complexe de sa
production. Toutes les dates mentionnées dans ce texte – dont la plupart étaient à l’origine en
calendrier julien – sont transformées en calendrier grégorien.
11 décembre 2011
INDEX
Mots-clés : Bulgarie, deuxième guerre balkanique, exarchistes, Grèce, Ingénierie
démographique, Kilkis, Macédoine
Keywords : Bulgaria, demographic engineering, exarchism, Greece, Kilkis, Macedonia, Second
Balkan War
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
275
Riots against the Non-Muslims of
Turkey: 6/7 September 1955 in the
context of demographic engineering
Dilek Güven
The Policy of national Homogenisation from the
1910’s to the 1940’s.
1 From 1913 to 1914, the national question entered a new era in the Ottoman Empire. The
defeat in the Balkan War of 1912 had been attributed chiefly to an inchoate national
consciousness, and the outbreak of the First World War was seen as an opportunity to
put a new national program into effect. One of the most important steps taken in this
context was revoking the system of capitulations, which was the legal ground for
granting Europeans privileges such as diplomatic immunity, tax exemption, lower rates
of custom duties and the right to establish their own postal services. In addition,
making Turkish compulsory in economic transactions paved the way for replacing
employees in the public sector who were predominantly Christian by their Muslim
counterparts. Thus the conditions that would facilitate the emergence of a “national
bourgeoisie” were created.
2 The concern for homogenising Asia Minor, which was the nucleus of the multi-ethnic
empire, was also ethnically and demographically interrelated with the aforementioned
issue. Demographic engineering was seen as a necessary precondition for establishing a
triumphant nation-state. The settlement policy of 1912-1923 regarding the Greek-
Orthodox population of Asia Minor and the deportation and killing of the Armenian
population should primarily be considered outcomes of the homogenising attempts
that were accomplished in the axis of nation-state.
3 Discrimination against non-Muslim and non-Turkish ethnic groups intensified after the
formation of the Republic in 1923. Although the recently established state guaranteed
the autonomy of minorities within the framework of international law, the
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
276
governments of the 1920s and 1930s explicitly pursued policies of assimilation from
time to time. If the rights and obligations of all citizens before the laws seemed
formally identical, in everyday life, belongingness to the dominant Turkish ethnic
identity formed the basis of the state’s identity policy. The intention of these practices
was to accelerate the processes of nation-state formation, modernisation and
westernisation.
4 The state’s identity policy manifested primarily in the domain of national education.
The significant decrease in the number of minority schools, the requirement that
Turkish be the language of instruction and those schools’ subjection to the Ministry of
National Education’s arbitrary monitoring were keystones in the Turkification process
of the educational institutions belonging to non-Muslim communities.
5 Turkification in the educational domain was supported considerably by the economic
measures by which the state attempted to create a “national bourgeoisie.” To this end,
the Turkish National Commercial Union, whose members were also deputies in the
Turkish Grand National Assembly, was established in 1923. With the help of both the
Turkish Government and the newly established commercial union, it was expected that
Turkish businessmen would acquire a secure position in the country’s financial and
banking sectors. The union was also influential in acquiring the enterprises which used
to belong to the Greek-Orthodox who left Istanbul. Moreover, under certain
circumstances, Greek-Orthodox people were purposely intimidated so that they would
emigrate and their property could be purchased at very low prices. However, the
Turkification of the economy was not limited to the commercial sector. For example,
employees in foreign firms were to be replaced by Turkish employees. Until 1923, 90 %
of the administrative and office posts in foreign firms were filled by non-Muslims. 1 In a
short while, the Turkish government started to pressure foreign enterprises in Istanbul
to transfer all posts to Muslims. Especially the political measures that government had
taken with respect to the economy reveal that the Turkish ethnic identity was thought
as the basic component of demonstration for republic.
6 In addition to the assimilation of minorities, migration and settlement policies were
other means to create ethno-cultural unity within the borders of the newly established
state. For instance, between the years 1929 and 1934, the local administrations
compelled Armenians who were living in the rural areas of Asia Minor to migrate into
urban centres.The secret agents of the Turkish government inculcated Armenians in
Anatolia, especially those in Diyarbakır and Harput, with the idea that leaving Turkey
would be for “their well-being.” The Armenians were assured that if they emigrated,
their properties would be bought in accordance with the regulations, and that they
would leave the country without any difficulty.Between the years 1928-1929, the
Armenians of Sivas were prohibited to leave the provincial borders. At the same time,
since the opportunities for employment were also taken away, economic problems
caused the majority of the Armenians themselves to ask permission from the
government to leave the country. Particularly at the level of local administrations,
there was a noteworthy interest in buying the properties of the Armenian minority at
very low prices to boost the wealth of the ethnically Turkish.According to the account
of the officials of British Consulate, nearly the majority of well-to do Armenians in
Sivas left the city, and the economic activities of the remaining ones were of quite
limited by the middle of 1929.2
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
277
7 Armenian peasants living in the countryside, on the other hand, were forced to move
into big cities or central or eastern districts of the country. This involuntary internal
migration had many “advantages” for the Turkish government: In many cases,
Armenians who were used to living in rural settings could not make a living in the
cities and therefore emigrated to Syria; in addition, controlling and monitoring them
became easier once they were concentrated in smaller areas. Thus the regions that
were cleared of Armenians were offered to the new Turkish settlers, especially from the
Balkans.
8 Nearly six months prior to the implementation of the Settlement Law, Anatolian
Armenians were subject to a new migration wave. In early 1934, six hundred
Armenians, deported from various cities and rural areas to Istanbul within a period of
two months, were settled in Armenian churches and schools and in deserted houses in
Yeniköy and Ortaköy.3
9 During the years prior to their deportation, Armenians were suppressed by local
administrations so that the forced nature of their exile from Anatolia could be
concealed. Turkish police initially tried to provoke local Muslims against Armenians so
that it would appear that the local inhabitants had expelled the “infidels.” This
attempt, however, was unsuccessful. Subsequently, the government settled the émigrés
from the Balkans in Armenian settlements and warned the Armenians that their
properties could be handed over to the newcomers. When instead a peaceful
relationship arose in between Armenians and the Balkan émigrés, the Armenians were
told to move into Istanbul immediately.4 In order to prevent the indictments that the
state was confiscating the properties of Armenians, they were allowed to sell their
possessions. Nevertheless, the prices offered for these possessions were so low that
there was practically no difference between confiscation and selling. The rural
Armenian groups mostly migrated to Syria as a result of not being able to adapt
themselves to the urban areas they settled in. 5
10 The pogrom-like attacks which were organised against Jews with the participation of
state authorities in 1930s should also be considered in this context. Some of the Jews
living in the cities in Thrace were intimidated through threats and economic boycotts.
During the summer of 1934, shops, workplaces and residences of Jews were attacked
(Aktar 2000 ; Bali 1999).
11 The extraordinary Wealth Tax that was approved by the National Assembly in 1942
aimed to eradicate the pioneering role that Armenians, Greek Orthodox and Jews had
had in the economy. This tax was so excessive in many cases that it was impossible to
pay even if they had sold all their possessions (Ökte 1987).
The narrative of the events of 6-7 September 1955.
12 On 6September 1955 at 13.00, Turkish state radio announced that a bomb attack had
taken place at the house in Thessalonica where Atatürk was born, and this news spread
out with two different afternoon copies of the newspaper İstanbul Ekspres. Late in the
afternoon on the same day, a public demonstration was organised in Taksim Square by
various student associations, unions and the “Association of Turkish Cyprus” (KTC).
Following this demonstration, groups started stoning the windows of shops and
businesses that belonged to non-Muslims. In a short while, clusters of people equipped
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
278
with tools to destroy houses, shops, churches and schools rushed into neighbourhoods
around Taksim such as Beyoğlu, Kurtuluş, Şişli, Nişantaşı, which were traditionally
known as non-Muslim residential and business districts. 6 In a similar manner, acts of
violence took place in remoter districts of Istanbul such as Eminönü, Fatih, Eyüp,
Bakırköy, Yeşilköy, Ortaköy, Arnavutköy, and Bebek, in addition to Asian quarters such
as Moda, Kadıköy, Kuzguncuk, Çengelköy, and on the Prince Islands.It is estimated that
approximately one hundred thousand people took part in these attacks. 7
13 The assaults were carried out by organised units consisting of twenty to thirty people
who can be subdivided into provocateurs, leaders, and destroyers. In many cases the
provocateurs carried Turkish flags, or busts and photos of Atatürk and Celal Bayar.
They also distributed KTC badges and rosettes and appealed to people to identify their
homes, shops and cars with Turkish flags.
14 The duty of the group leaders, first of all, was to identify the objects that were to be
damaged. They approached their task methodically. Some of the group leaders carried
lists of the home and work addresses of non-Muslims. A week before the events took
place, the headmen of the involved neighbourhoods were asked to provide home and
work addresses of non-Muslim minorities. According to a report prepared by the
French Consulate, the addresses of non-Muslim minorities were determined by a
special unit as early as the Second World War so that in case of an encounter, their
“neutralisation”8 would be easier. The report also revealed that the rioters were able to
utilise the already registered addresses and information. Just before the uprisings, the
watchmen requested some residents to indicate the door numbers of their homes and
shops. Some non-Muslim homes and shops were distinguished with crosses,
abbreviations like NMG (Non-Muslim Greek), or descriptions such as “non-Turkish” or
“Turkish.”9 The third division, the destroyers, destroyed the pre-determined objects
with stones, cranks, wooden boards, shovels, handsaws and welding machines.The
necessary tools were kept ready at central points inside the city or at bus stops prior to
the attacks.
15 Furthermore, the mobilisation of the perpetrators and their equipment inside the city
was guaranteed by a transportation network composed of private cars, commercial
taxis and trucks, ferries and even military vehicles.The rioters thus easily determined
their targets and accomplished their attacks successfully throughout the city.
16 The vandalism followed the same procedure all over the city. In the case of shops,
assailants initially destroyed the shop windows with stones, or opened the iron
banisters with the help of welding machines or wire scissors. Then, goods and
possessions inside the shop, or the equipments and machinery if the place was a
workshop, were destroyed, either inside or just outside on the street.
17 The churches were also affected by the assaults. The holy images, crosses, icons and
other sacred possessions inside the churches were either destroyed or burnt, or the
whole church was set on fire. Greek-Orthodox cemeteries in Şişli and Balıklı were
particularly damaged. The assailants not only tore down the epitaphs, but also took out
the skeletons, which were either burnt or broken.10
18 The police officers not only confirmed their sympathy to the movement during the
demonstration in Taksim, but also tended to remain passive when public order was
broken and violence occurred.In some districts of Istanbul, security forces did not leave
their premises even when they had witnessed violence.According to reports prepared
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
279
by German Consulate-General, the passivity of the police forces was “the result of not
an official order, but an instruction which principally made room for disregarding the
events.”11 Another crucial point was that the fire brigades were late to attend the places
set on fire, or remained passive, claiming that their equipment was inadequate.
19 Depending on the source that is taken as a chief reference, one can reach different
conclusions about the harm caused by the uprisings. According to an official Turkish
source, 4,214 houses, 1,004 workplaces, 73 churches, 1 synagogue, 2 monasteries, 26
schools, and 5,317 other establishments such as factories, hotels, pubs, etc., were
attacked.12
20 According to an American source, 59 % of the attacked workplaces, and 80 % of
damaged houses, belonged to Greek-Orthodox. Seventeen % of all assaulted workplaces
and 9 % of all damaged houses belonged to Armenians. In addition to these, 3 out of 33
Armenian churches and 4 out of 22 Armenian schools were attacked. 12 % of all
attacked workplaces and 3 % of all destroyed houses belonged to Jewish residents
according to this source.13
21 It is probable that the mob leaders had been instructed to not engage in theft, since
there were crucially few cases of theft during the first wave of rioting. The sentries
located at important crossroads checked whether pedestrians were carrying any stolen
items.
22 The number of reported injuries fluctuates between 300 and 600, but those numbers
include not only victims, but also injured perpetrators.14 It can also be argued, given the
small number of injuries and deaths compared to the destruction caused by the attacks,
that an instruction prohibiting corporeal injury was given. During the attacks, some
perpetrators informed the inhabitants in a calming manner that they would only cause
material damage, and they were given orders only to destroy.
23 In household attacks, Greek-Orthodox women in particular were raped. The Chief
Physician of Balıklı Hospital reported that 60 Greek-Orthodox women were treated
accordingly.15 If we assume that many rape victims concealed what had happened and
avoided medical care, it can be claimed that the actual number of rape victims was
higher.
24 The number of deaths is uncertain; in the Turkish press it was reported that between
11 and 15 people died.16 According to records of the German Consulate General,
economic losses amounted to approximately 150 million Turkish Liras (TL), an amount
equal to the value of 54 million US Dollars in that period. 28 million TL of this financial
damage belonged to Greek citizens, 68 million TL to Greek-Orthodox citizens of the
Turkish Republic, 35 million TL to churches, and 18 million TL to foreigners and other
minorities (Armenians and Jews) respectively.17
25 After the violence was suppressed, on 9 September 1955 the Ministry of Finance
announced the provisions to be taken for the victims of the attacks: tax relief,
providing cheap construction materials, importing glass products, moderating interest
rates on bank loans, easing the process of applying for bank loans and accelerating the
process of determining and compensating the material losses.At first, however, the
expectations that Parliament would materialise funds were not met. Instead, the issue
of compensation became a matter of charity and turned into a donation campaign. At
the end of 1957, 3,247 individuals and corporate bodies had donated a total of 6.533.856
TL to the campaign (Kocabaşoğlu 2000).
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
280
26 On 28 February 1956, the indemnity law, which aimed to reimburse the losses caused by
the events of 6 September 1955, was passed in the National Assembly. However, the
amount assigned for compensation was only 60 million TL, and consequently the losses
were only partially compensated.18
27 Despite the promise made by Prime Minister Menderes that “he would do his best to
compensate the losses in any means,”19 foreign observers characterized the indemnities
as “insufficient, bureaucratic and late.”20 The quick recovery of the businesses that
suffered damage was chiefly attributed to the industriousness and adaptability of the
minorities. The victims themselves regarded the payments not as real compensation,
but as a gesture to please the international public opinion.
The first step of the judicial process: a meagre
indemnity, the usual scapegoat
28 Stating its deep concern about the events, the government initially blamed
“communists” and “treacherous provocateurs” as responsible for the uprisings.Foreign
observers found these explanations doubtful, since undesirable political activities were
often labelled as “surreptitious communism” by the government even though the
actual number of communists in Turkey was quite limited at the time.Besides, it was
obvious that activities of communist and leftist groups were being closely monitored by
the secret police; therefore, it seemed quite unlikely that they could have organised the
attacks. Nevertheless, on 7 September 1955, 48 persons considered communists by the
Police Department were arrested and brought in to Harbiye.21
29 The special tribunals which were established in order to ensure rapid investigation of
the attacks had already made their first interrogations on 10 September
1955.Immediately after the uprisings, Beyoğlu Special Tribunal announced that the
total amount of people under arrest was 5,104, which they classified according to the
locations and categories of their crimes. The indictments prepared by the prosecutors
of the special tribunals accused 1,886 persons of destruction, 1,622 persons for theft,
595 persons for plunder, 333 persons for provocation, 21 persons for arson, and 3
persons for attacking religious premises.22 Other charges included demonstrations
against foreign countries, damaging national interests, communist propaganda,
manslaughter, sabotage, raiding, rape, insulting the government and the army, and
resisting state authority.
30 However, the judges rejected some of the charges because the police forces who
performed the arrests were unable to provide the necessary evidence. In addition to
this, in a report submitted to the Commandership of Beyoğlu Administrative District,
magistrates complained that a considerable number of the arrested was absolutely not
involved in the events.23
31 In the weeks following the events, the Turkish government began persistently
defending the claim that communists were responsible for the attacks. Finally, in the
end of December 1955 the suspected “communists” were released without any
explanation along with many other detainees. The court cases against the suspected
communists and other detainees continued, but they eventually resulted in favour of
the defendants (Dosdoğru 1993).
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
281
Behind the scenes: the organisation of the riots
32 The events of 6/7 September were planned by the Democratic Party (DP) government of
the period, and were accomplished with the participation of the Secret Service, the DP’s
local administrations and organisations guided by the state such as student unions,
youth associations, syndicates and the “Association of Turkish Cyprus” (Kıbrıs Türktür
Cemiyeti - KTC).
33 The KTC was relatively a new organization. According to official explanations, it was
established as a national committee in August 1954 to defend the Turkish minority in
Cyprus against the United Nations and other organisations, and staged protests all over
the country with the encouragement of the National Union of Turkish Students (Milli
Türk Talebe Birliği - MTTB) and the Turkish National Federation of Students (Türkiye Milli
Talebe Federasyonu - TMTF), in addition to the press and the Organisation of Turkish
National Youth (Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı - TMGT). Not only the majority of the
executive board, but also ordinary members in this newly established organisation
cooperated with members of the government, as well as with organisations guided by
state or with other state institutions. The activities of the KTC, which were particularly
expected to reflect the Turkish public opinion on the Cyprus issue, were supported
financially by the government.24 Hikmet Bil, the president of the KTC, and Sedat Simavi,
the owner of the newspaper Hürriyet, contributed a great deal to making the Cyprus
issue a “national matter” through the articles they penned.
34 Kâmil Önal, a journalist and one of the members of executive board, was
simultaneously a member of the National Security Service (MAH). 25 He was assigned to
set up the Anatolian, London and Cyprus branches of the KTC by the executive board.
By the end of 1954, local branches had been established in Konya, Tarsus, Mersin,
İskenderun, Antakya, Gaziantep, İzmir, Balıkesir, Mudanya and Adana, in addition to
district branches in Fatih and Karagümrük in Istanbul.26
35 The KTC had a close collaborative relationship with student and youth associations.
Since the initiative for constituting the association belonged to student organisations,
the majority of the founding members was comprised of TMGT and TMTF members.
36 The KTC acted together with the trade unions that were clearly in the “nationalistic
line;” this collaboration reached a point where there was substantial overlap between
the executive staffs of both institutions. For instance, Bahir Ersoy, who was the top
executive of the Union of Textile and Weaving Industry Workers, was also enlisted as
an executive member of the TMGT, and had previously participated in the initiative
that resulted in the foundation of the KTC.27
37 From August 1955 until the time the events broke out, the activities of KTC increased
remarkably.
38 While the number of local branches in İstanbul was only three until mid-August, at
least ten branches were set up in different regions of İstanbul until the attacks started
on 6 September 1955. Crucially, the İstanbul and Anatolian branches were founded by
members of the DP’s local organisations and trade-union executives. For example,
Serafim Sağlamel, who was the head of the DP’s Zühtüpaşa district division, was also
the head of the Kadıköy branch of the KTC. The executive committee members of DP’s
Zühtüpaşa district division were also the top executives of the KTC’s Kadıköy
branch.The members of the Büyükçekmece, Küçükçekmece, Paşabahçe ve Beykoz
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
282
branches of the KTC were also DP members. Seyfi Lobut, who was the head of the DP’s
Beykoz district division, was also an executive member of the KTC’s Beykoz branch
along with other executives of the local DP division (Dosdoğru 1993).
39 On 16 August 1955, Hikmet Bil, acting on a letter from the Turkish Cypriot leader Fazıl
Küçük warning that Greek Cypriots were preparing a massacre of the island’s Turkish
minority, sent a letter to all branches of the KTC stating the necessity of a “manly
reaction” from the Turkish motherland in order to intimidate London and Athens. 28 On
4September 1955, Hikmet Bil ordered Kâmil Önal to have students burn some Greek
newspapers on Taksim Square in support of the demonstration organised by the KTC’s
London branch. Indeed, the university students Gündüz Gölönü and Hurşit Şahsuvar
incinerated Greek newspapers in front of many members of the press. 29
40 In the last week of August, Önal gave an urgent order to a printing house to prepare
20,000 placards bearing the expression “Cyprus is Turkish,” and commanded a group of
university students, including Aydın Konuralp, Hurşit Şahsuvar, Erol Çetindağ and
Ekrem Yangın, to distribute the placards to main streets and department stores two
days before the attacks.One day before the attacks, on 5 September 1955, Prime
Minister Adnan Menderes had dinner with Hikmet Bil, and told him that he had
received a ciphered telegram from the Minister of Foreign Affairs Fatin Rüştü Zorlu,
who had been visiting London for the Cyprus Conference. The Foreign Minister
reported that he had faced difficulties during the negotiations, that the terms of
negotiation were hard and that during negotiations, he would like to utter Turkish
public opinion to be formed30. In other words, the Minister was demanding more action
from the mainland.
41 Bil reported this information to the executive board of the KTC, which was convened
for an urgent meeting on the same day. In the afternoon of 6 September, after news
reached Istanbul of the bomb attack to Atatürk’s home, Önal made the following
statement to the evening copy of İstanbul Ekspres: “Eventually, we can obviously confess
that we will call to account those who dared lay hands on our sacred values.” 31 While
Önal was handing out posters and copies of the İstanbul Ekspres to a crowd in front of
the TMTF premises, Orhan Birgit, a member of executive board, wrote a declaration on
behalf of the KTC condemning the attack on Atatürk’s home and asking the people to
act in solidarity and to devote themselves to the national oath “Cyprus is Turkish, and
will stay Turkish.”32
42 On 7 September 1955, police arrested 87 members of the administrative committees of
the KTC İstanbul branches along with individuals who had cooperated closely with
them, including Kâmil Önal, Hikmet Bil, Hüsamettin Canöztürk, Nedim Üsdiken, Orhan
Birgit, Hurşit Şahsuvar, Aydın Konuralp and Öztürk Canöztürk. The unification of KTC
branches was banned, and the local branches’ possessions and estates were confiscated.
The alleged reason for these precautions was that the KTC’s activities led to the attacks,
and that the association had veered from its founding principle. Indeed, the number of
KTC members among the more than 3.000 arrested was relatively high. During their
period of detention, some of the leaders of the KTC and the MTTF mentioned that they
were given instructions by state and official authorities to plan and participate into the
attacks. A spy hidden by the Chief Inspectorship of Security among the arrested KTC
members reported that Bil had explicitly mentioned during his detention that “Adnan
Menderes himself had given instructions and financial help for the organisation of the
attacks.”33
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
283
43 Towards the end of December 1955, the 87 executive members of the KTC were
released, and a charge was filed against 17 individuals on 12 February 1956.
44 Though the police reports, which included the testimony of KTC and student union
members stating that they had participated in the attacks in accordance with
instructions given by the members of government, were submitted to the court, the
testimonies were not incorporated into the indictments. The court did not take into
consideration the participation of administrators and ordinary members of the DP’s
local headquarters while preparing the indictments, nor did it take into account the
fact that Kâmil Önal had been working for MAH.
45 In January 1955 the court received a memorandum prepared by the First Division of
Police conveying the fact that the MAH had cooperated with Önal in organising the
attacks, and that DP members also partook in the attacks. However, Kemal Aygün, the
General Director of Police, rejected this memorandum because it did not take into
consideration the Kominform’s activities regarding the Cyprus issue, and ordered Şevki
Mutlugil, another member of the MAH, to prepare a new memorandum. The second
memorandum described the circumstances for the emergence of Kominform and the
methods it used, and quoted political brochures of the organisations confirming the
collaboration with Communist Party of Turkey (TKP).34 The investigation had
apparently disclosed that the methods utilised in the events of 6 September 1955 were
those of the Komintern.
46 As evidence for the Komintern’s involvement in the attacks, the memorandum included
two letters written by Nazım Hikmet, who had previously fled to Soviet Union,
encouraging Turkish workers in Cyprus to collaborate with Greek workers to fight
imperialist dictators on the island. Only the second memorandum constituted the
formal basis for the indictment.
47 Another indication that communists had been involved was that Kâmil Önal, the main
defendant, had collaborated with Komintern while he was in Lebanon working for the
MAH. Önal was said to have made contacts with communists and persons who held
“leftist views” and utilised these contacts during the attacks. 35 Although witness
testimonies revealed that Önal’s collaboration with the MAH continued during his
membership in the KTC, the court disregarded this point. It was taken for granted that
Önal’s mission in MAH had ended before he was involved with KTC, and consequently
the evidence that was burnt by students on Önal’s order could not be related to the
MAH. On this assumption, the court excluded the possibility that the MAH had
participated in the organisation of the attacks.
48 After martial law came to an end, the trial of the 17 defendants, which had been
initiated by the military court on 12 February 1956, proceeded in a civilian court closed
to the public.36 Like the military court, the civilian court did not take into consideration
the evidence of the MAH’s participation. In fact, MAH employees participated both in
the bombing attack in Thessalonica and in announcing it in the İstanbulEkspres
6 September 1955.
49 The night before, a bomb exploded in the garden of Turkish Consulate in Thessalonica.
According to an account given confidentially to a US Embassy staff member by a high-
ranking Turkish bureaucrat, the bombing was realised to justify the attacks in İstanbul
by an “agent-provocateur.”37 According to police investigations, the bomb, which
resulted only in some broken windows, was not actually thrown into the garden, but
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
284
must have been placed by someone among the Consulate staff. The so-called “agent
provocateur” was in fact a student named Oktay Engin. Engin was living in
Thessalonica as part of Turkish minority in Greece, and his education at the Faculty of
Law was covered by a scholarship from the Turkish government. Also a MAH member,
Oktay Engin was assured that he would be given money and a position in return for his
help. With the assistance of the Turkish Consulate in Komotini (Gümülcine), Engin was
brought to Turkey on 22 September 1956.38 Through the personal orders of Prime
Minister Adnan Menderes and the governor of İstanbul Fahrettin Kerim Gökay, Engin
was given a position in the Municipality towards the end of 1956. After performing
some additional tasks for the MAH, he became first a provincial governor, then a
governor in Nevşehir.39
50 On the surface, the events of 6 September were caused by the news of a bomb attack on
the house where Atatürk was born, a story that surfaced only in the boulevard
newspaper İstanbul Ekspres, which was printed in extraordinary numbers that day. The
editor of this newspaper, Mithat Perin, who was also known to have close connections
with the DP, was arrested after the uprisings but released two hours later on the order
given by Prime Minister Menderes personally. The fact that Perin had collaborated
with the MAH became obvious when he addressed a letter to the organisation in 1960
(Yalçın 2002). In his letter, Perin listed the missions he had performed for the MAH, and
requested financial support for his newspaper İstanbul Ekspres.
51 Gökşin Sipahioğlu, the editor of the İstanbul Ekspres at that time, explained in an
interview that the events of 6 September 1955 were organised by the MAH. Sipahioğlu’s
account was confirmed by a brigadier general in an interview conducted in 1991
regarding the structure and working principles of Special Operations:
“The attacks of 6/7 September were certainly planned by the Special Operations
Unit. It was an extremely premeditated operation and it accomplished its objective.
Let me ask you; wasn’t it an extraordinarily successful action?” 40
52 In a hearing on 24 January 1957, the judges of Criminal Court No. 1 decided to release
the defendants. The prosecutor demanded the release on the grounds that Cyprus is
historically a Turkish island and is only a few of sea miles from the motherland, and
that the provocative actions against Turks in Greece and Cyprus caused the events to
break out. The prosecutor’s demand of acquittal was approved by the court on the
grounds that it was impossible for the court to produce a fair verdict based on the
evidence provided by police investigations, the trials at the Court of Martial Law and
the Civilian Court or through the witness testimonies. Moreover, the defendants did
not have criminal intentions. The judges then acquitted the accused of all charges by
unanimous vote. 41
53 According to reports prepared by German and British Consulates-General in İstanbul,
from the government’s side at least President Celal Bayar, Prime Minister Adnan
Menderes, Minister of Interior Namık Gedik, Minister of Foreign Affairs Fatin Rüştü
Zorlu and governor of İstanbul Fahrettin Kerim Gökay partook in the preparation of the
attacks; their aim was, first of all, to create a pressure over London Conference, and
secondly to direct attention away from the domestic political problems. 42 However, the
foreign observers also agreed that the government was surprised by the extent of the
damage caused by the events.
54 After the coup d’état in May 1960, President Bayar, Prime Minister Menderes, Minister
of Foreign Affairs Zorlu and Minister Köprülü were tried at the military tribunal on
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
285
Yassıada Island, and among other charges were the events of 6 September 1955. The
defendants were accused of violating the constitutionally guaranteed citizenship rights
of the Greek-Orthodox minority and of provoking Turkish citizens into demonstration
and violence.43 The courts at both İstanbul and Yassıada were given evidence that the
attacks had been initiated by the government with the collaboration of the secret
service and the DP administration, and that various state-sponsored associations such
as student and youth organisations, trade unions and the KTC had mobilised the
participants, but this partnership was not taken into consideration during the
preparation of the verdicts. During the hearings in İstanbul between 1956 and 1957, the
role of DP members, the leaders of government, and the MAH was overlooked in order
to conceal the fact that the Turkish state was responsible for the attacks. Though the
KTC was charged, its executive boards were acquitted from all accusations, probably
because they threatened to reveal the responsibility of the members of government if
sentenced. The hearings at the military tribunal on Yassıada, on the other hand,
attempted to prove that only government members were responsible for the acts of
violence, thus legitimising the military invention in 1960. The intermingling of the KTC,
MAH, trade unions and student associations was ignored. The innocence of KTC
members was accepted as “verified” by the Court of Martial Law in 1957. The MAH was
still part of the military structure in 1960; thus, pressing charges against MAH staff
might also have brought accusations against the officers of the military regime.
Probably for this reason, the court openly rejected a number of requests by attorneys
to arrange hearings for MAH administrators or executives, on the grounds that “the
MAH’s responsibility was already clarified with the memorandum prepared in 1956.” 44
In this way, members of the Democratic Party were presented as exclusively
responsible for organising and operating the attacks. As a result, the İstanbul and
Yassıada hearings actually served to legitimise the political regimes of 1955 and 1960
instead of clarifying the Events of 6/7 September.
55 The Events of 6/7 September 1955 caused extensive disappointment with the Turkish
Republic among non-Muslims. When the of Democratic Party was established in 1945
and the single party regime of Republican People’s Party (CHP) came to an end with the
transition to a multi-party regime, it was expected that the policies towards minorities
would be liberalised in parallel with the democratisation of country. Indeed, certain
discriminatory treatments against minorities were abolished in this new political era.
Another important reason was the struggle that the CHP, now in opposition, waged to
acquire votes. With the transition to a multi-party regime, it became critical to secure
the votes of non-Muslim minorities, who constituted nearly a third of all voters in
İstanbul.
56 As a consequence of Democratic Party’s election victory in spring 1950, the non-Muslim
minorities hoped that the liberal policies of the new government would also usher in a
democratic approach towards minorities of the country. Some of the steps taken by DP
did in fact reveal a considerably more tolerant approach to minority groups. However,
the happy atmosphere between minorities and the government quickly soured when it
turned out that the DP’s view of minorities was not all that different from the CHP’s.
Non-Muslim minorities began to be treated as secondary citizens, as had been the case
in the Ottoman past. The DP’s liberal minority policy since 1950 proved to be an
impression created by the party’s foreign policy tactics. Finally, the intensification of
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
286
disputes over Cyprus in 1954 brought a complete end to the DP government’s goodwill
toward non-Muslim minorities.
57 The widespread assumption in the scholarly literature that the events of 6/7 September
were exclusively related to Cyprus issue is misleading. The crisis on Cyprus was more of
a “constructed” development that contributed to the deportation process of minorities
since 1920s. Like the Thracian Jews in 1934, non-Muslim minorities were forced to leave
the country as a result of the destruction of their movable and immovable possessions.
The CHP’s policy of cleansing Anatolian towns of Christians and Jews and amassing
minorities in the few metropolises of the country –primarily in İstanbul– was
accomplished before the 1950s. Following this, as is mentioned in a report prepared in
1946, the process that would purge İstanbul of Jews and Christians was to be completed.
45 If it is kept in mind that only slightly more than half of all ruined businesses belonged
to Greek-Orthodox, it is difficult to explain the acts of violence as retaliation towards
Cyprus policy of Greece.
58 The attacks in 1955 should be considered in the context of the political and financial
difficulties that the Menderes government was experiencing at the time. In order to
prevent negative reactions from the opposition and the press, the government adopted
a hostile stance, in turn alienating the educated segments of society. The events of
6/7 September became an excuse for the government to limit the freedom of the press,
the opposition and student movement, and for keeping domestic political
developments under control. Immediately after the attacks, on 7 September 1955,
martial law was promulgated in Istanbul, Ankara and İzmir for six months, and the
National Assembly was temporarily closed down. However, according to report
prepared by German Consulate General, the government decided as early as 24 August
1955, that is, 15 days prior to the outbreak of attacks, to initiate martial law for a year
with the purpose of restraining the activities of the opposition. 46 On 7 June 1956, two
distinct drafts prepared by the government in order to silence criticism from the
Ankara and İstanbul press were passed by the Grand National Assembly. The DP
justified the bills by claiming that exaggerated representations of news such as the
bomb attack on Atatürk’s home “could depress the country and promote crime.” 47
The interaction between the 6-7 September Riots and
the Cyprus Issue
59 Undoubtedly, one of the surprising findings of this study is the contribution of the
British government to the preparation of the events of 6/7 September. After the Greek-
Orthodox majority in Cyprus proclaimed the goal of enosis, that is, of annexing Cyprus
to the Greek mainland, the British imperial administration decided to organise a three-
party conference in London from 29 August to 7 September 1955. The British
government’s rationale was to prevent Greece from bringing the Cyprus issue to the
United Nations, to ease the increasing tension between ethnic groups on the island and
to strengthen Turkey’s position in order to preclude criticism of Britain’s colonialism
(Holland 1998).Above all, London endeavoured to convince Greeks that Turkey also had
a rightful claim to Cyprus. The British knew that their position at the conference, and
later during the probable negotiations in United Nations, would be reinforced “as long
as Turks were awakened from their own passivity” (Nicolet 2001: 59).
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
287
60 Subsequently, Macmillan informed the Turkish Foreign Ministry that he would like
meet with them prior to the conference, and stated that “if Turks put their claims as
sharply as they can at the beginning of negotiations, that would be beneficial both for
them and us.” (Holland 1998: 69). Thus encouraged, the Turkish Minister of Foreign
Affairs Fatin Rüştü Zorlu presented his government’s view in an unusually firm
manner. The Greek delegation did not disguise their bewilderment about the “Turkish
element” in the Cyprus issue, and they held the British government accountable for
Zorlu’s severe approach.48 The only development that prevented the delegates from
leaving London was the suggestion made by Macmillan that the conference should be
carried on bilaterally.
61 The conference in London collapsed because of the attacks in İstanbul, İzmir and
Ankara on 6 September 1955. Not aware of the conspiracy plotted by the Turks, the
Greek Minister of Foreign Affairs apologised for the bomb attack in Thessalonica;
however, Zorlu blamed the Greeks, arguing that their provocative Cyprus policy caused
to the attacks. The Turkish delegation was called back by Menderes, and left London on
8 September 1955. The British responses to the attacks were diverse. While the British
Consulate General Mihalis Stewart called the attacks the “apex of barbarism,” 49 other
members of the British Foreign Ministry were pleased with the Turkish approach of “an
eye for an eye, a tooth for a tooth.”50 Yet another group among the British was pleased
with the burning of a Greek-Orthodox church because it eliminated “an unpleasant
view.”51 The most remarkable response was that of the British Minister of Foreign
Affairs Macmillan; although his colleagues and the British Ambassador in Ankara
recommended that he issue a stern warning to Ankara, he preferred a milder protest. 52
62 The charges by Greeks that the British had participated in preparing the attacks in
İstanbul should also be considered in this context. Immediately after the attacks, the
Greek press held the British government accountable for the events of 6 September
1955.
63 Even official Greek authorities considered the bomb attack in Thessalonica the doing of
British intelligence agents. Though the Greek accusations seem figments of
imagination, there are indications that British were involved in the events. For
instance, the British Ambassador in Athens had already in August 1954 foreseen the
possibility that an event at Atatürk’s parental home would lead to deterioration in
Turco-Greek relations:
“I think Turks started to be concerned about the situation. When I saw my Turkish
colleague, who is also a close friend of mine, he explained that he was worried
about the way things are going. As I mentioned in my message, the relations are not
favourable and it is obvious that seemingly friendly Turco-Greek relations are
indeed fragile, even a slightest shock can be enough. It would be sufficient to incite
a turmoil through an unimportant event such as inscribing a slogan with a piece
chalk on the wall of the house where Atatürk was born.”53
64 In his memoirs published later, Prime Minister Anthony Eden confessed that the only
crucial matter for British government during London Conference was to make known
the disagreement between Turkey and Greece that they had already acknowledged in
the international arena. Moreover, a functionary of the British Foreign Ministry stated
that “If some revolts take place in Ankara that will suit our interest” (Holland 1993).
65 Shortly after the attacks in Turkey, the British Foreign Ministry ordered the News
Office to avoid emphasising news related the destruction of British commodities and
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
288
injuries caused to British nationals, especially in the press. 54 The existence of such an
instruction strengthens the view that the British government provoked Turks into
preparing the attacks.
66 The demand to reimburse the losses suffered by British nationals was withdrawn
because of political decisions made by the British Foreign Ministry. As a result, the
movement against minorities in İstanbul reinforced the position of Britain.
67 As consequence of the events, Turkey was clearly incorporated into the Cyprus conflict
as a third power. Therefore, the continuity of the status quo, that is, the permanence of
British domination over the island, became more probable. Another advantage that the
events of 6/7 September provided for Britain was that the USA changed its Cyprus
policy in the aftermath of the attacks.
68 When Greece announced that it would bring the Cyprus conflict to the United Nations
again in the spring of 1955, the US government tended to support Greek claims. The US
Ambassador to the United Nations Henry C. Lodge’s anti-colonial opinions were well
known by British government. Prior to the London Conference, the United States
moderated its position on the Cyprus issue. A week before three-party-conference,
Americans were still anticipating that an agreement among the three powers would
prevent the Greeks from bringing the issue to the United Nations. If the United States
refused the Greeks recourse to the United Nations, it would be giving up one of its
political principles, which in turn would amount to rejecting an ally’s wish to negotiate
its claim in the United Nations.
69 On 23 September 1955, the United States voted in the UN General Assembly against
including the Cyprus issue on the UN agenda. The United States based its rejection on
the comparative significance of threats to the liberal world order and of maintaining
unity within NATO. Thus the British government eventually achieved its goal of
preventing the Cyprus issue from being debated in the United Nations. The
functionaries of the British Foreign Ministry were aware that the “ambitious approach
of Greece in the UN” could be handled easily with “the active support of USA” and they
received that support as a result of the attacks.55
70 In conclusion, let us examine whether the events of 1955 were a case of demographic
engineering. The answer is affirmative for two reasons. The first is the fact that the
riots both directly and indirectly provoked the non-Muslim population of Istanbul
(Greek-Orthodox, Armenians and Jews) to migrate from the country. Although the
Greek patriarchate and the Greek consulate in Istanbul tried to prevent migration, we
know that in one year after the riots 5,000 young men migrated to Greece. The number
of Greek-speaking residents was reduced from 79,691 in 1955 to 65,139 in 1960. Between
1955 and 1960, 10,000 Jews left Istanbul for Israel. The British consulate reported a
sudden increase of visa applications from non-Muslim minorities after the riots.
71 The second reason for considering the events of 1955 a case of demographic
engineering lies in the definition of the concept as “any deliberate state program or
policy originating from religious/ethnic discrimination or initiated for political reasons
which aim to increase the political and economic power of one ethnic group over
others by manipulating population through various methods.” This was obviously the
case in 1955: a deliberately planned manipulation caused the riots, which subsequently
escaped the control of the organizers.For a majority of the non-Muslim residents, the
events of 6/7 September was evidence that they were not recognized as Turkish
citizens. The belief that they would be subject to discrimination in the future regardless
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
289
of the political party in power strengthened their motive to emigrate. The
developments after 1955 thus also signal the end of religious pluralism in Istanbul.
BIBLIOGRAPHIE
Unpublished Sources
Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (PA AA), Berlin.
Public Record Office, London Foreign Office Correspondence (PRO FO)
Prime Minister’s Office (PREM)
National Archives and Records Administration, Washington (NARA).
Centre des Archives diplomatique de Nantes (CADN)
Archives of Tarih Vakfı: Fahri Çoker Dosyası
Published Sources
Archer, Margaret S. (1988) Culture and Agency: The Place of Culture in Social Theory, Cambridge,
Cambridge University Press.
Aktar, Ayhan (2000) Varlık Vergisi ve “Türkleştirme” Politikaları, Istanbul, İletişim Yayınları.
Alexis, Alexandris (1983) The Greek Minority of Istanbul and Greek-Turkish Relations, 1918-1974,
Athens, Center for Asia Minor Studies.
Akar, Rıdvan (1998) ‘Bir Bürokratın Kehaneti. Ya da bir resmi metinden planlı Türkleştirme
dönemi’, Birikim, Ekim 1998.
Bali, Rıfat N. (1999) Cumhuriyet Yıllarında Türkiye Yahudileri. Bir Türkleştirme Serüveni 1923-1945,
Istanbul, İletişim Yayınları.
Benlisoy, Foti (2000) ‘6/7 Eylül Olayları Öncesinde Basında Rumlar’, Toplumsal Tarih, Eylül 2000.
Çelik, Jaklin (2000) ‘6/7 Eylül 1955, Kumkapı’, Toplumsal Tarih, Eylül 2000.
Demirer, Mehmet Arif (1995) 6 Eylül 1955. Yassıada 6/7 Eylül Davası, Istanbul, Bağlam Yayınları.
Dinamo, Hasan İzzettin (1971) 6-7 Eylül Kasırgası. Istanbul, May Yayınları.
Dosdoğru, Hulusi (1993) 6/7 Eylül Olayları, İstanbul, Bağlam Yayınları.
Holland, Robert (1993) ‘Greek-Turkish Relations, Istanbul and British Rule in Cyprus, 1954-59:
Some excerpts from the British Public Archive’, Bulletin of the Centre for Asia Minor Studies, Athens.
Holland, Robert (1998), Britain and the Revolt in Cyprus 1954-1959, New York, Oxford University
Press.
Kocabaşoğlu, Uygur (2000) ‘6/7 Eolaylarından sonra „Hasar tespit çalışmaları üzerine bir kaç
ayrıntı“’, Toplumsal Tarih, (81), pp. 45-49.
Nicolet, Claude (2001) United States Policy towards Cyprus, 1954-1974: Removing the Greek-
Turkish Bone of Contention, Mannheim and Möhnesee, Bibliopolis.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
290
Ökte, Faik (1987) The Tragedy of the Turkish Capital Tax, Kent, Croom Helm.
Phloros, Alexandros(1955) Ē Nykta Tēs Ektēs Septembriou Eis Tēn Konstantinoupolin Kai Tēn Smyrnēn,
Athēna.
Syllogo Konstantinoupolēton (1955) Ta Gegonota Tēs Konstantinoupolēs. 6-7 Septembriou, 1955,
Athens.
Tachau, Frank (1959) ‘The Face of Turkish Nationalism as Reflected in the Cyprus Dispute’, The
Middle East Journal 13, pp. 262-72.
Topuz, Hıfzı (2000) ‘6/7 Eylül Olayları ve Aknoz Paşa’nın Yasakları’, Toplumsal Tarih, 81, pp. 39-42.
Tsoukatou, Pinelopi (1998) Septembriana 1955: Ē Nichta Ton Kristallon Tou Ellēnismou Tēs Polēs,
Athēna, Ekdoseis Tsoukatou.
Türker, Orhan (1998) ‘6/7 Eylül 1955 olaylarının İstanbul Rum basınındaki yankıları’, Tarih ve
Toplum (177), pp. 13-15.
Yalçın, Soner ; Yurdakul, Doğan (2002) Bay Pipo. Bir MIT görevlisinin sıradışı yaşamı. Hiram Abas,
Istanbul, Doğan Kitapçılık.
Yassıada, Yüksek Adalet Divanı Tutanakları, 6/7 Eylük Hadiseleri, Ankara, 1962.
NOTES
1. PRO FO 371/9114/E4314, Report from the Generalconsulate of Istanbul, 24.04.1923.
2. NARA 867.404/208, Nr. 946, Generalconsulate of Istanbul to State Department, 24.02.1930.
3. NARA 867.4016 Armenians/11, Embassy in Ankara to State Department, 02.03.1934.
4. Ibid.
5. Ibid.
6. Greek newspapers: Eleutheria, 09.09.1955 and Vima 08.09.1955.
7. NARA 782.00/9-1455, Generalconsulate of Istanbul to State Department, 14.09.1955.
8. CADN B Serie C 26, Generalconsulate of Istanbul, 08.09.1955.
9. Ibid.
10. NARA 882.413/9-2755, Generalconsulate of Istanbul to State Department, 27.09.1955.
11. AA PA 264 Türkei 205-00/92.42, Report from the Generalconsulate of Istanbul, 20.09.1955.
12. Archives of the Tarih Vakfı , Fahri Çoker Dosyası, 6 Eylül Hadiseleri Endeksi.
13. NARA 782.00/9-1255, Generalconsulate of Istanbul to State Department, 01.12.1955.
14. Turkish newspapers: Gece Postası, 07.09.1955; Hürriyet, 07.09.1955.
15. PRO PREM 11834/447, Report from the Generalconsulate of Istanbul, 22.9.1955.
16. Turkish newspapers, Yeni Sabah, 08.09.1955; Hürriyet, 08.09.1955; Son Saat, 08.09.1955; Gece
Postası, 07.09.1955; Cumhuriyet, 08.09.1955.
17. AA PA 9 Türkei 205-00/92.42, Report from the Generalconsulate of Istanbul, 11.01.1956.
18. Ibid.
19. AA PA 270 Türkei 211-00/92.42, Report from the Generalconsulate of Istanbul, 25.10.1955.
20. AA PA 9 Türkei 205-00/92.42, Report from the Generalconsulate of Istanbul, 08.09.1956.
21. Archives of the Tarih Vakfı, Fahri Çoker Dosyası, Örfi Idare Beyoğlu Bölgesi 2 No’lu
Mahkemesi, 02.12.1955.
22. Archives of the Tarih Vakfı , Fahri Çoker Dosyası, 6 Eylül Hadiseleri Suç Endeksi.
23. Ibid.
24. AA PA 235 Türkei 211-00/75, Report from the Embassy in Ankara, 01.10.1954.
25. AA PA 9 Türkei 205-00/92.42, Report from the Generalconsulate of Istanbul, 20.02.1956.
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
291
26. Turkish newspaper: Zafer, 16.02.1956.
27. Archives of the Tarih Vakfı, Fahri Çoker Dosyası, 1. Emniyet Şubesi Müdürlüğünce hazırlanan
Fezleke, January 1956.
28. AA PA 9 Türkei 205-00/92.42, Report from the Generalconsulate of Istanbul, 20.02.1956.
29. Archives of Tarih Vakfı, Fahri Çoker Dosyası, Örfi Idare Beyoğlu Bölgesi 2 No’lu Mahkemesi,
02.12.1955.
30. Interview with Hikmet Bil, 15.01.2002.
31. NARA 782.00/2-2056, Report from the Generalconsulate of Istanbul, 20.02.1956.
32. Zafer, 16.02.1956.
33. Archives of Tarih Vakfı, Fahri Çoker Dosyası, Örfi Idare Beyoğlu Bölgesi 2 No’lu Mahkemesi,
02.12.1955.
34. Archives of Tarih Vakfı, Fahri Çoker Dosyası, Milli Emniyetçe hazırlanan Kominform
taktikleri ve Kıbrıs olayları muvzuunda muhtıra, January 1956.
35. NARA 782.00/2-2056, Generalconsulate of Istanbul to State Department, 20.02.1956.
36. AA PA 9 Türkei 205-01/92.42, Report from the Embassy in Ankara, 28.01.1957.
37. PRO FO 371/123858, RG 10344/6, Report from the Generalconsulate of Istanbul, 22.12.1955.
38. NARA 781.00/9-2656, Generalconsulate of Istanbul to State Department, 26.09.1956.
39. Yassıada, Yüksek Adalet Divanı Tutanakları, 6/7 Eylük Hadiseleri, p. 379f.
40. Milliyet, 01.06.1991
41. AA PA 9 Türkei 205-01/92.42, Report of the Embassy in Ankara, 28.01.1957.
42. AA PA 270 Türkei 211-00/92.42, Report from the Generalconsulate of Istanbul, 10.09.1955;
PRO PREM 11834/479, Report from the Generalconsulate of Istanbul, 03.10.1955.
43. Yassıada, Yüksek Adalet Divanı Tutanakları, p. 470f.
44. Yassıada, Yüksek Adalet Divanı Tutanakları, p. 446.
45. CHP 9. Büro´nun Azınlık Raporu Ankara, ca. 1946: Rıdvan Akar “Bir Bürokratın Kehaneti. Ya
da bir resmi metinden planlı Türkleştirme dönemi”, Birikim 110/1998, S. 68-75.
46. AA PA 264 Türkei 205-00/92.42, Report from the Generalconsulate of Istanbul, 20.09.1955.
47. AA PA 265 600-00/92.42, Report of the Embassy in Ankara, 28.08.1956.
48. AA PA 235 Zypern 211-00/92.09, Report of the Embassy in London, 02.09.1955.
49. PRO FO 371/117711, RG 10344/50, Report from the Generalconsulate of Istanbul, 22.09.1955.
50. PRO FO 371/117111/50, 08.10.1955.
51. Ibid.
52. PRO FO 371/117/657, RG 1081/1019, 11.09.1955.
53. PRO FO 371/117642, RG 1081, Report from the Embassy in Athens, 19.08.1954.
54. PRO FO 371/117710, RG 10344/22, 13.09.1955.
55. . PRO FO 371/117657, RG 1081/1004, 03.09.1955.
RÉSUMÉS
A proper analysis of the Events of 6/7 September requires taking into account the ethnic and
religious homogenization practices of the Kemalist elite, the exceptional of democratic and
financial circumstances of the 1950s and the Cyprus conflict. Furthermore, the events should be
seen in connection to the concept of demographic engineering, defined as any deliberate state
program or policy originating from religious/ethnic discrimination or initiated for political
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
292
reasons which aim to increase the political and economic power of one ethnic group over others
by manipulating population through various methods. Under the circumstances, could the events
of 1955 be defined as a such case of demographic engineering?
In order to answer to this question, this paper analyses the political circumstances in Turkey in
the 1950s as a continuation of the 1930s and 1940s, and evaluates the “Events of 6/7 September”
in 1955 in the context of the nationalization and homogenization of the economic sphere. It then
focuses on the following judicial process, and finally on the planning of the riots, emphasizing
the roles of different actors in organising the riots.
INDEX
Mots-clés : Chypre, émeutes, ingénierie démographique, Kıbrıs Türktür Cemiyeti – KTC,
minorités non-musulmanes
Keywords : Cyprus, Demographic engineering, Kıbrıs Türktür Cemiyeti – KTC, Non-Muslim
minorities, riots
European Journal of Turkish Studies, 12 | 2011
Vous aimerez peut-être aussi
- Passé, Mémoire Et Lustration: Le Droit Dans Le Complexe Imbroglio YougoslaveDocument17 pagesPassé, Mémoire Et Lustration: Le Droit Dans Le Complexe Imbroglio YougoslaveLia LiloenPas encore d'évaluation
- Histoire des droits de l'homme de l'antiquité à l'époque moderneD'EverandHistoire des droits de l'homme de l'antiquité à l'époque moderneÉvaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)
- Retour aux Fondamentaux: Pour une République Civique (Manuel à l’usage du citoyen)D'EverandRetour aux Fondamentaux: Pour une République Civique (Manuel à l’usage du citoyen)Pas encore d'évaluation
- Luc Boltanski Énigmes Et Complots. Une Enquête À Propos D - Enquêtes Editions Gallimard - 2012Document404 pagesLuc Boltanski Énigmes Et Complots. Une Enquête À Propos D - Enquêtes Editions Gallimard - 2012Diogo Silva CorreaPas encore d'évaluation
- TD. Anthropologie Politique.Document15 pagesTD. Anthropologie Politique.Moyza DiopPas encore d'évaluation
- La Violence Génocidaire Et Ses CausesDocument4 pagesLa Violence Génocidaire Et Ses Causesmahanesaie248Pas encore d'évaluation
- Guerre juste et droit des gens moderne: Philosophie politiqueD'EverandGuerre juste et droit des gens moderne: Philosophie politiquePas encore d'évaluation
- La Géostratégie Du CrimeDocument3 pagesLa Géostratégie Du CrimeAit Malhou FatimaPas encore d'évaluation
- Histoire Des Idées PolitiquesDocument3 pagesHistoire Des Idées PolitiquesAmaraPas encore d'évaluation
- Analyse Courte 2Document7 pagesAnalyse Courte 2louis.ameglio11Pas encore d'évaluation
- HIP2Document33 pagesHIP2Souad KHAYATI100% (1)
- Le CONTROLE DES JEUNES DEVIANTS: Postface de Laurent MucchielliD'EverandLe CONTROLE DES JEUNES DEVIANTS: Postface de Laurent MucchielliPas encore d'évaluation
- A Quoi Nous Sert Le DroitDocument18 pagesA Quoi Nous Sert Le DroitjulianaaksteinPas encore d'évaluation
- L'État moderne et ses fonctions: Essai sur les sciences économiques et socialesD'EverandL'État moderne et ses fonctions: Essai sur les sciences économiques et socialesPas encore d'évaluation
- P. Bourdieu - Sur L'etatDocument5 pagesP. Bourdieu - Sur L'etatArnOmkarPas encore d'évaluation
- Philippe Nemo, Qu'est-Ce Que L'occident ?Document18 pagesPhilippe Nemo, Qu'est-Ce Que L'occident ?Bruno Acézat-Pellicer100% (4)
- RFSP 0035-2950 1963 Num 13 1 392709 t1 0197 0000 002Document6 pagesRFSP 0035-2950 1963 Num 13 1 392709 t1 0197 0000 002ouchan.yanisPas encore d'évaluation
- ArCoCompletPdf PDFDocument109 pagesArCoCompletPdf PDFPhanieGruwierPas encore d'évaluation
- SWISS UMEF UNIVERSITY of BURKINA FASO - Docx Anthropologie Juridique - MCCP 1 CopieDocument84 pagesSWISS UMEF UNIVERSITY of BURKINA FASO - Docx Anthropologie Juridique - MCCP 1 CopieDirection Générale TTIPas encore d'évaluation
- L'Esprit de Philadelphie - La J - Alain SupiotDocument115 pagesL'Esprit de Philadelphie - La J - Alain Supiotbruno100% (2)
- 3 Lutte Contre Le NégationnismeDocument5 pages3 Lutte Contre Le NégationnismeAnaïs MsrPas encore d'évaluation
- Cohen-Halimi LLPHI 614kant Et L'histoireDocument12 pagesCohen-Halimi LLPHI 614kant Et L'histoireRichardPas encore d'évaluation
- Malinowski - 1933 - Le Crime Et La Coutume Dans Les Sociétés Primitives PDFDocument63 pagesMalinowski - 1933 - Le Crime Et La Coutume Dans Les Sociétés Primitives PDFIaiasouza100% (1)
- Cours Histoire Des Idées PolitiquesDocument68 pagesCours Histoire Des Idées PolitiquesThỏTúiPas encore d'évaluation
- A. Histoire de La Belgique Contemporaine - Introduction.Document3 pagesA. Histoire de La Belgique Contemporaine - Introduction.CloéPas encore d'évaluation
- Politique des limites, limites de la politique: La place du droit dans la pensée de Hannah ArendtD'EverandPolitique des limites, limites de la politique: La place du droit dans la pensée de Hannah ArendtPas encore d'évaluation
- Grand Récit Chez Lyotard PREPRINTDocument14 pagesGrand Récit Chez Lyotard PREPRINTcharlesattend44Pas encore d'évaluation
- HSS523 Poly 2022 Stratégie Et Géopolitique PolycopieDocument98 pagesHSS523 Poly 2022 Stratégie Et Géopolitique PolycopieSIGNE TALLA FRANCK ARMELPas encore d'évaluation
- Des Mythes PolitiquesDocument208 pagesDes Mythes Politiquesethan16Pas encore d'évaluation
- Cep 78Document96 pagesCep 78M. CenziPas encore d'évaluation
- Droit InstitutionnelDocument48 pagesDroit InstitutionnelRania MEKPas encore d'évaluation
- Politique, Télévision Et Nouveaux Modes de Représentation en Amérique LatineDocument36 pagesPolitique, Télévision Et Nouveaux Modes de Représentation en Amérique LatineJesús Martín BarberoPas encore d'évaluation
- Emanuelle Danblon - RhétoriqueDocument16 pagesEmanuelle Danblon - RhétoriqueRodrigo SeixasPas encore d'évaluation
- GIANCOTTI, Emilia - Spinoza Nel 350° Anniversario Della Nascita BDocument55 pagesGIANCOTTI, Emilia - Spinoza Nel 350° Anniversario Della Nascita BBernardo BianchiPas encore d'évaluation
- Théorie ET Praxis DE LA Dictature DU PROLÉTARIAT .... 42Document81 pagesThéorie ET Praxis DE LA Dictature DU PROLÉTARIAT .... 42Hv13 l'enfant EsckobaPas encore d'évaluation
- Désobéissance CivileDocument31 pagesDésobéissance Civilemounir57Pas encore d'évaluation
- Histoire Des Idées PolitiquesDocument44 pagesHistoire Des Idées PolitiquesPierre Taillandier100% (3)
- Bourcier RevuePhilosophiquede 2018Document3 pagesBourcier RevuePhilosophiquede 2018pablo aravenaPas encore d'évaluation
- HIP Histoire Des Idées PolitiquesDocument38 pagesHIP Histoire Des Idées PolitiquesrafiakaranakeziahPas encore d'évaluation
- L'Intersectionnalité en Débat.Document16 pagesL'Intersectionnalité en Débat.yogoamorPas encore d'évaluation
- Il Mito Dello Stato Moderno Nella Fortuna Della Ragion Di StatoDocument18 pagesIl Mito Dello Stato Moderno Nella Fortuna Della Ragion Di StatoRone SantosPas encore d'évaluation
- Violence Et Médiation. Théorie de La Segmentarité Ou Pratiques Juridiques en KabylieDocument17 pagesViolence Et Médiation. Théorie de La Segmentarité Ou Pratiques Juridiques en KabyliekantikorsPas encore d'évaluation
- Tyrannie Et DespotismeDocument49 pagesTyrannie Et DespotismeDavyn Weymers100% (1)
- Histoire de La CommunicationDocument5 pagesHistoire de La CommunicationNabih Cheikh100% (1)
- Delmotte - Elias Et L'égalité Des Sexes, MetooDocument11 pagesDelmotte - Elias Et L'égalité Des Sexes, Metooyf zhuPas encore d'évaluation
- m2 Philosophie Philosophie Politique Et Ethique Finalite Recherche Subprogram Mphbr2 14Document13 pagesm2 Philosophie Philosophie Politique Et Ethique Finalite Recherche Subprogram Mphbr2 14Tony TotiPas encore d'évaluation
- 19 de Quelques AspectsDocument18 pages19 de Quelques AspectsSmith kaitaPas encore d'évaluation
- Violencia Extrema y Delito en El Marco de La Campaña de Represión Clandestina en Argentina (1976-1983)Document11 pagesViolencia Extrema y Delito en El Marco de La Campaña de Represión Clandestina en Argentina (1976-1983)LizPas encore d'évaluation
- Sociologie PolitiqueDocument101 pagesSociologie PolitiqueRacem GassaraPas encore d'évaluation
- Programme vfd2Document5 pagesProgramme vfd2Gilmária SalvianoPas encore d'évaluation
- Synthèse Des AuteursDocument6 pagesSynthèse Des Auteursbertolini thomasPas encore d'évaluation
- (1933) Malinowski, Bronislaw. Moeurs Et Coutumes de MelanésiensDocument115 pages(1933) Malinowski, Bronislaw. Moeurs Et Coutumes de MelanésiensMauro PereiraPas encore d'évaluation
- Site-Seer, Remy - 48-70Document23 pagesSite-Seer, Remy - 48-70Bouta chrysPas encore d'évaluation
- Bataille and SexualityDocument15 pagesBataille and SexualityjorgeivanquintanaPas encore d'évaluation
- Loi #97-243 Du 25 Avril 1997 Modifiant Et Completant La Loi N° 94-440 Du 16 Aout 1994 Determinant La Composition, L'organisation, Les Attributions de La CSDocument63 pagesLoi #97-243 Du 25 Avril 1997 Modifiant Et Completant La Loi N° 94-440 Du 16 Aout 1994 Determinant La Composition, L'organisation, Les Attributions de La CSAnonymous YjArDG071% (7)
- C. Hamel, Faire Tourner Les Meufs' (2003)Document9 pagesC. Hamel, Faire Tourner Les Meufs' (2003)DylSebEvaPas encore d'évaluation
- L'affair DreyfusDocument2 pagesL'affair Dreyfusaraosina12Pas encore d'évaluation
- Decret Executif N 96-208Document1 pageDecret Executif N 96-208chatxxnoirPas encore d'évaluation
- La Géopolitique Pour Les Nuls en 50 Notions Clés by Philippe Moreau-Defarges (Moreau-Defarges, Philippe)Document273 pagesLa Géopolitique Pour Les Nuls en 50 Notions Clés by Philippe Moreau-Defarges (Moreau-Defarges, Philippe)GHAFFAR100% (2)
- Histoire Lycee 1re Chap02Document13 pagesHistoire Lycee 1re Chap02bibi-dz 93Pas encore d'évaluation
- ABRÉGÉ DU PROJET DE SOCIÉTÉ Du Parti Politique Force Démocratique Haïtien Intégré-FDHIDocument93 pagesABRÉGÉ DU PROJET DE SOCIÉTÉ Du Parti Politique Force Démocratique Haïtien Intégré-FDHIDr Eddy delaleuPas encore d'évaluation
- Carte Mentale Chap.1 EMC La République 1Document1 pageCarte Mentale Chap.1 EMC La République 19mbshd8by4Pas encore d'évaluation
- Droit Fiscal International Et EuropeenDocument66 pagesDroit Fiscal International Et EuropeenMehdiChadli0% (1)
- 1846 Em01112015 PDFDocument24 pages1846 Em01112015 PDFelmoudjahid_dzPas encore d'évaluation
- Poncins Léon de - Les Documents MorgenthauDocument76 pagesPoncins Léon de - Les Documents MorgenthauNunusse100% (2)
- Discrimination Des Femmes Dans La Sphère ProfessionnelleDocument6 pagesDiscrimination Des Femmes Dans La Sphère ProfessionnelleMatthieu EscandePas encore d'évaluation
- Dihal Annuaire Des SIAO PDFDocument42 pagesDihal Annuaire Des SIAO PDFDélégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement des personnes sans abri ou mal logées (Dihal)Pas encore d'évaluation
- 7PH06TE0021 - Exemple Explication RousseauDocument3 pages7PH06TE0021 - Exemple Explication RousseauArnault “Arnault”Pas encore d'évaluation
- Premiere Guerre MondialeDocument58 pagesPremiere Guerre MondialeSamya FaninaPas encore d'évaluation
- Dossier Gorz - Fondation de L'ecologie PolitiqueDocument69 pagesDossier Gorz - Fondation de L'ecologie PolitiqueFondationEcolo100% (3)
- Algerie Decret 2018 199 Delegation Service PublicDocument10 pagesAlgerie Decret 2018 199 Delegation Service PublicRaouf TitiwePas encore d'évaluation