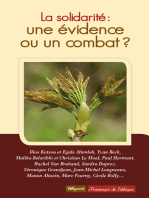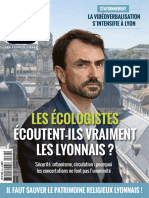Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Humanitude Pour Les Personnes Hébergées Et Les Soignants
Humanitude Pour Les Personnes Hébergées Et Les Soignants
Transféré par
DINO ECOTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Humanitude Pour Les Personnes Hébergées Et Les Soignants
Humanitude Pour Les Personnes Hébergées Et Les Soignants
Transféré par
DINO ECODroits d'auteur :
Formats disponibles
M I L I E U X D ’ H É B E R G E M E N T E T P H I L O S O P H I E D E S O I N S
D O S S I E R
L’Humanitude, pour les personnes
hébergées et les soignants
Philippe Archambault
parchambault@asstsas.qc.ca
DEPUIS 1980, YVES GINESTE ET ROSETTE MARESCOTTI S’OCCUPENT, rents les uns des autres. Cette précieuse individualité constitue une
EN COMPAGNIE D’ÉQUIPES DE SOINS, DE PERSONNES HÉBERGÉES richesse collective. Pour un soignant, respecter le caractère unique
OU HOSPITALISÉES À TRAVERS LE MONDE. CHEMIN FAISANT, ILS ONT de chaque personne s’exprime notamment par une attention et un
DÉVELOPPÉ UNE MÉTHODOLOGIE COMPORTANT PLUS DE 150 TECH ajustement constants à son égard. Sur un plan méthodologique, mais
NIQUES ORIGINALES DE SOINS, MAIS AUSSI UNE PHILOSOPHIE : L’HU aussi organisationnel, cette attitude s’observe, entre autres, dans le
MANITUDE. CETTE FAÇON DE VOIR LE TRAVAIL DES SOIGNANTS SE respect du sommeil, des rythmes et des habitudes de la personne.
RETROUVE AU CŒUR DE L’APPROCHE RELATIONNELLE DE SOINS DE Yves Gineste souligne à quel point, malgré toute la bonne volonté
L’ASSTSAS. du monde, c’est un défi permanent : « Comment reconnaître la personne
dans ce qu’elle a d’unique dans le cadre d’un lieu de vie collectif, par
Lorsqu’il présente sa philosophie de soins, Yves Gineste aime à exemple, possédant de nombreuses contraintes1 ? » Comment con-
citer le premier article de la Déclaration des droits de l’homme : « Tous cilier les besoins et les désirs individuels au sein d’une collectivité
les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils régie par des règlements communs et généraux ?
sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers
les autres dans un esprit de fraternité. » Il nous rappelle que les êtres
humains se sont dotés de repères moraux, de valeurs, pour baliser
leurs actions et la vie en société. Cela vaut, bien sûr, pour les gestes
posés par les soignants. Ces gestes doivent s’accorder aux valeurs
profondes de notre société.
Pour tout soignant, il importe de garder en tête les valeurs et les
principes qui sont au cœur de ses actions. Cela revient à se poser la
question « Que signifie prendre soin d’une personne ? », ou encore
« Qu’est-ce qu’un soignant ? ». Avant même de parler de méthodologie
de soins, Yves Gineste invite à réfléchir sur la dimension éthique de
la relation entre soignant et personne soignée.
Photo : istock.com
Toute personne est unique
Un des principes de l’Humanitude est de reconnaître la singularité
de chaque personne. Malgré nos similitudes, nous sommes tous diffé Semblable aux autres, chaque personne est unique.
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en
dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de
conscience et doivent agir les uns envers les autres
dans un esprit de fraternité. »
OP VOL. 43 NO 1 2020 | 17
D O S S I E R M I L I E U X D ’ H É B E R G E M E N T E T P H I L O S O P H I E D E S O I N S
Dans son enseignement, le coauteur de l’Humanitude ne se montre QU’EST-CE QUE L’HUMANITUDE ?
jamais moralisateur envers les soignants. Il sait trop bien que ceux-ci
œuvrent dans des organisations complexes soumises à des exigences > L’humanitude désigne l’ensemble
et avec des lacunes qui rendent parfois l’éthique du « prendre-soin »
des caractéristiques que les
difficile. Pour cette raison, Yves Gineste insiste sur la participation de
tous les membres de l’organisation. Appliquer l’Humanitude est un hommes possèdent et développent
engagement organisationnel : la haute direction, les gestionnaires in en lien les uns avec les autres.
termédiaires et le personnel soignant doivent être également motivés Par ces caractéristiques, chaque être humain recon
et impliqués. naît les autres êtres humains comme ses semblables.
L’humanitude décrit une relation fondatrice de notre
identité d’être humain. Écrit avec une majuscule,
l’Humanitude désigne la philosophie de soins conçue
par Rosette Marescotti et Yves Gineste.
L’autonomie fonctionnelle de personnes hébergées ou hospitalisées,
nous rappelle Yves Gineste, est encore malmenée. À travers le monde,
les milieux de soins continuent de « fabriquer des grabataires ». De
nombreuses techniques de la méthodologie Gineste-Marescotti ont
pour objectif de redonner une autonomie fonctionnelle à des personnes
Photo : istock.com
alitées depuis des mois, voire des années. Des personnes qui, croit-on,
ne sont plus là. Or, par des paroles et des gestes précis, calculés, il est
Une personne autonome exerce ses choix. possible de rendre l’autonomie, ici l’usage de son corps, la capacité
à se tenir debout et à marcher, à ces personnes.
Respecter l’autonomie
Le principe du respect de l’autonomie (fonctionnelle, psychique, Les liens de confiance
sociale) vient avec une exigence éthique de taille. Il demande « de L’Humanitude met à mal une conception des soins où le soignant,
systématiquement rechercher et de tenir compte du consentement de en position de pouvoir, guérit la personne à partir de son seul savoir.
la personne [tant qu’elle est autonome], de ne pas lui imposer des Elle invite plutôt à concevoir tout soin comme une relation égalitaire
soins de force, de fournir les informations dont elle a besoin pour de complémentarité. Si la personne apprend du soignant, l’inverse est
prendre des décisions, de favoriser les situations où elle peut exercer aussi vrai, et c’est la combinaison de ces savoirs qui contribuent à la
ses choix, etc. » (50). réussite du soin. Cela signifie que le soignant et la personne sont des
Le soignant doit à la fois respecter l’autonomie de la personne et parties intégrantes du soin !
chercher à l’améliorer ou à la maintenir. Cette recherche se fait avec Le principe de loyauté dans la relation est intimement associé à
la personne et vise à restituer à cette dernière « une part de confiance cette vision des soins. Il renvoie à la nécessité pour une personne de
en soi et de la maîtrise sur sa vie atteintes par le handicap ou la ma faire confiance à ceux qui prennent soin d’elle. « La loyauté des actes
ladie » (50). Le respect de l’autonomie dépasse largement la ligne de du prendre-soin, dans la transmission des informations, dans l’expli
conduite pour ne pas faire à la place. Il incite le soignant à utiliser cation des soins [...], mais également dans les gestes, les regards et
« ses connaissances, ses savoir-faire et sa sensibilité pour renforcer les attitudes, est indispensable à l’établissement et au maintien de
le pouvoir de la personne sur elle-même » (52). Selon l’Humanitude, cette confiance » (51). Cette dernière n’est pas le fruit du hasard, elle
le rôle du soignant est d’aider l’autre à prendre soin de lui. ne se produit pas par magie. Elle se construit au fil des interactions
Le soignant doit à la fois respecter
l’autonomie de la personne et chercher
à l’améliorer ou à la maintenir.
OP VOL. 43 NO 1 2020 | 18
M I L I E U X D ’ H É B E R G E M E N T E T P H I L O S O P H I E D E S O I N S
D O S S I E R
Cette conception renforce le sens du travail et le sentiment
moral de faire le bien (ou de bien faire) : deux éléments à la
base de la santé psychologique au travail.
QU’EST-CE QU’UN SOIGNANT ? téristiques particulières, pour préserver ou améliorer son autonomie,
pour accroître sa santé (physique, émotionnelle, psychologique) et sa
> « Un soignant est un professionnel sécurité. Mais qu’en est-il du soignant ? Que gagne-t-il à adopter une
telle approche relationnelle de soins ?
qui prend soin d’une personne qui
La philosophie et la méthodologie de l’Humanitude valorisent le
a des préoccupations ou des soignant dans l’acte de prendre soin. Elles le mobilisent dans son
problèmes de santé pour l’aider humanité, en misant sur un ensemble de compétences relationnelles
à l’améliorer, la maintenir, ou pour accompagner traduites par le regard, la parole et le toucher. Par sa personne même
cette personne jusqu’à la mort. Un professionnel et par la qualité de son approche, le soignant contribue aux soins.
qui ne doit en aucun cas nuire à la santé de cette Cette conception renforce le sens du travail et le sentiment moral de
personne. » faire le bien (ou de bien faire) : deux éléments à la base de la santé
psychologique au travail.
Référence : Gineste, Y., Pellissier, J. (2005). Humanitude. Comprendre la
vieillesse, prendre soin des hommes vieux. Paris, France : Bibliophane- Les gains pour le soignant sont autrement observables lorsqu’on
Daniel Radford, p. 215. considère les personnes hébergées qui présentent des comportements
d’agitation pathologique. Yves Gineste souligne que ces comporte-
ments, perçus comme agressifs, « sont le plus souvent défensifs : la
et demande une bienveillance constante dans les gestes et les pa- personne dont les facultés cognitives sont affaiblies ne parvient plus
roles. Pour ce faire, Rosette Marescotti et Yves Gineste proposent des à reconnaître et à comprendre la situation de soin. » (42) Un soignant
techniques d’approche et de rétroaction qui permettent de tisser des formé à l’Humanitude, ou à l’Approche relationnelle de soins, aura les
liens de confiance, même avec des personnes atteintes de troubles outils pour prévenir ou réduire les agressions. Un gain pour la SST,
cognitifs. mais aussi pour la personne soignée. K
Des soins à la SST RÉFÉRENCE
L’Humanitude s’attache à définir le rôle du soignant en relation 1. Gineste, Y., Marescotti, R., Pellissier, J. (2008). L’Humanitude dans les soins.
avec la personne soignée. Pour cette dernière, les bénéfices d’une Recherche en soins infirmiers, 3(94), p. 49.
relation établie en toute humanitude sont clairs. Reconnaissant la Note : dans le texte, toutes les citations sont tirées de cet article. Le numéro de
personne comme unique, le soignant est là pour protéger ses carac- page est indiqué entre parenthèses pour alléger les notes bibliographiques.
1979 1983
> Professeurs d’éducation physique, Yves Gineste > Passage d’une approche ergonomique à une
et Rosette Marescotti commencent à donner approche humaniste de la manutention. Dévelop
leurs formations de manutention des malades. pement du concept Vivre et mourir debout.
QUELQUES
DATES DE 1993 1998 2000
L’HUMANITUDE > Mise au point des > Développement > Début d’une collaboration féconde avec l’ASSTSAS.
PAM (Programmes d’une philosophie
d’activité minimum) des soins basée
qui transforment les sur une approche 2013
Référence : humanitude.fr
gestes des soignants émotionnelle et le > Début de l’exportation au Japon et de la recherche
en actions de respect des droits universitaire japonaise sur l’Humanitude.
réhabilitation. de l’homme.
OP VOL. 43 NO 1 2020 | 19
Vous aimerez peut-être aussi
- Guérir de Son Passé Avec l'EMDR Et Des Outils D'autosoin - Emmanuel Contamin PDFDocument276 pagesGuérir de Son Passé Avec l'EMDR Et Des Outils D'autosoin - Emmanuel Contamin PDFMélody Nelson92% (12)
- Concepts Fondamentaux en Soins InfirmiersDocument8 pagesConcepts Fondamentaux en Soins InfirmiersZakaria Elhou100% (2)
- Ecole Des PatternsDocument36 pagesEcole Des PatternsImane El Hakmi100% (4)
- Ecole Du CaringDocument43 pagesEcole Du CaringImane El Hakmi80% (5)
- Les Courants de La Pedagogie Contemporaine de Jean BeautéDocument6 pagesLes Courants de La Pedagogie Contemporaine de Jean Beautéinvencaodemorel50% (2)
- Cours de Soins Infirmiers PDFDocument55 pagesCours de Soins Infirmiers PDFamboko84% (93)
- Mécanismes de Défense Et CopingDocument23 pagesMécanismes de Défense Et Copingmohamed amid50% (2)
- 2016 HumanitudeDocument27 pages2016 Humanitudekelt100% (1)
- 012392ar PDFDocument5 pages012392ar PDFAyoub AouniPas encore d'évaluation
- ThéoriesDocument12 pagesThéoriesTY BENZPas encore d'évaluation
- Ue 3 1 Les Theories en Soins InfirmiersDocument45 pagesUe 3 1 Les Theories en Soins Infirmiersdannytmro100% (2)
- Les Neurosciences Cognitives Une Science de Lhomme Capable PDFDocument3 pagesLes Neurosciences Cognitives Une Science de Lhomme Capable PDFbarjotPas encore d'évaluation
- La Régulation Émotionnelle Et La Mentalisation Chez Les Professionnels en Relation D'aideDocument20 pagesLa Régulation Émotionnelle Et La Mentalisation Chez Les Professionnels en Relation D'aideemilie.sauvageauPas encore d'évaluation
- Ateliers en Psychiatrie MASSONDocument145 pagesAteliers en Psychiatrie MASSONIanja Ariniaina AndriamanarivoPas encore d'évaluation
- La Démarche de SoinDocument28 pagesLa Démarche de Soinzourikh2013Pas encore d'évaluation
- Jean Oury - Transfert Et Espace Du DireDocument12 pagesJean Oury - Transfert Et Espace Du DireJean Luis Hourgras100% (1)
- L'approche Interculturelle Dans Le Processus D'aide The Intercultural Approach in The Support ProcessDocument22 pagesL'approche Interculturelle Dans Le Processus D'aide The Intercultural Approach in The Support ProcessMahmoud YagoubiPas encore d'évaluation
- Théorie Et Concepts de L'éducation Corporelle Et PsychomotriceDocument10 pagesThéorie Et Concepts de L'éducation Corporelle Et PsychomotriceDavid Alcantara MirandaPas encore d'évaluation
- CM 2Document13 pagesCM 2zzxtkqy4ykPas encore d'évaluation
- Psycho HumaDocument10 pagesPsycho Humatingir.dafnePas encore d'évaluation
- La solidarité : une évidence ou un combat ?: Essai de psychologique sociale sur l'altruismeD'EverandLa solidarité : une évidence ou un combat ?: Essai de psychologique sociale sur l'altruismePas encore d'évaluation
- Concept Et Théorie ThéoDocument65 pagesConcept Et Théorie ThéojonathanbeissalamPas encore d'évaluation
- Concepts Fondateurs de La Demarche SoignanteDocument39 pagesConcepts Fondateurs de La Demarche SoignanteUM LEONARDPas encore d'évaluation
- Partiel 1.1Document10 pagesPartiel 1.1Julie PourretPas encore d'évaluation
- Chap1 MingantDocument17 pagesChap1 MingantetiennePas encore d'évaluation
- HumanitudeDocument6 pagesHumanitudeDINO ECOPas encore d'évaluation
- Support Cours ISI ASS1. 3 Premiers Cours. Jusqu'Au 14 Nov 23Document62 pagesSupport Cours ISI ASS1. 3 Premiers Cours. Jusqu'Au 14 Nov 23legrandjules22Pas encore d'évaluation
- Cartes Mentales IsfscDocument9 pagesCartes Mentales Isfscy4cfc9grgdPas encore d'évaluation
- Soigner, Le Premier Art de La VieDocument18 pagesSoigner, Le Premier Art de La VieARNAUDAUBRYPas encore d'évaluation
- Memoire Final PDFDocument118 pagesMemoire Final PDFChaima ChayouPas encore d'évaluation
- Institut National de Formation Supérieure Paramédicale ConstantineDocument6 pagesInstitut National de Formation Supérieure Paramédicale ConstantineHamza LolPas encore d'évaluation
- Bientraitance-Avatar CharitéDocument10 pagesBientraitance-Avatar CharitélopiousPas encore d'évaluation
- Thérapie PrimaleDocument8 pagesThérapie PrimaleNadia BerrouanePas encore d'évaluation
- Soin de Base Part 1Document36 pagesSoin de Base Part 1Rayhane Ben Saada100% (2)
- Qu'est-Ce Qu'une Institution Psychiatrique ?: Vassilis KapsambelisDocument14 pagesQu'est-Ce Qu'une Institution Psychiatrique ?: Vassilis Kapsambelisranoarisonnomena6Pas encore d'évaluation
- Petit manuel d'écologie intérieure: Comment prendre soin de soi et du mondeD'EverandPetit manuel d'écologie intérieure: Comment prendre soin de soi et du mondePas encore d'évaluation
- Dev Durable Et NeurosciencesDocument29 pagesDev Durable Et NeurosciencesMusPas encore d'évaluation
- La Systémie EducationDocument3 pagesLa Systémie Educationran harmicPas encore d'évaluation
- Du corps à l'âme: Confidences d’un praticien de la méthode MézièresD'EverandDu corps à l'âme: Confidences d’un praticien de la méthode MézièresPas encore d'évaluation
- Médecine Du Corps, Médecine de L'âme (Véronique Boudon-Millot, Bernard Bourgeois Etc.) (Z-Library)Document159 pagesMédecine Du Corps, Médecine de L'âme (Véronique Boudon-Millot, Bernard Bourgeois Etc.) (Z-Library)JasminePas encore d'évaluation
- Cours de Psychologie de La Sante-1Document35 pagesCours de Psychologie de La Sante-1TELLING AMARGUE Roger100% (1)
- Médecines ParallèlesDocument13 pagesMédecines ParallèlesVictorienPas encore d'évaluation
- Memoire de Belakehal BrahimDocument69 pagesMemoire de Belakehal BrahimWaff EltPas encore d'évaluation
- La Souffrance: Revue Québécoise de Psychologie (2005), 26 (2), 5-7Document4 pagesLa Souffrance: Revue Québécoise de Psychologie (2005), 26 (2), 5-7Hind BannaniPas encore d'évaluation
- Aide Evaluation 4.1Document2 pagesAide Evaluation 4.1yw9gk7fr7qPas encore d'évaluation
- Présentation Pensee 2Document80 pagesPrésentation Pensee 2Chaimae ElPas encore d'évaluation
- Funções Da Sensorialidade No Autismo InfantilDocument19 pagesFunções Da Sensorialidade No Autismo InfantilbaiabaiaPas encore d'évaluation
- 5 La SolidaritéDocument32 pages5 La SolidaritékoloPas encore d'évaluation
- Modèles Et Principes en EPLS - S3 - 19Document17 pagesModèles Et Principes en EPLS - S3 - 19Mohamed TliliPas encore d'évaluation
- Le Travail Social en Addictologie1Document2 pagesLe Travail Social en Addictologie1assistante socialePas encore d'évaluation
- L3-SS - Sequence 6-Determinants Du Recours Aux Soins de Sante - ConclusionDocument6 pagesL3-SS - Sequence 6-Determinants Du Recours Aux Soins de Sante - Conclusionstephane antonioPas encore d'évaluation
- Travail Infirmiere Psychiatrie Et Specificite Soin Infirmier Hopital PsychiatriqueDocument8 pagesTravail Infirmiere Psychiatrie Et Specificite Soin Infirmier Hopital PsychiatriqueMohamed MalfiPas encore d'évaluation
- 2023 - La Psychologie A Une Fonction SocialeDocument5 pages2023 - La Psychologie A Une Fonction Socialenicola.thiryPas encore d'évaluation
- Laviepsychiquedesmurs HHALIDAYDocument51 pagesLaviepsychiquedesmurs HHALIDAYlsPas encore d'évaluation
- L'approche étho-cognitive en psycho-éducation: Un ouvrage de référenceD'EverandL'approche étho-cognitive en psycho-éducation: Un ouvrage de référencePas encore d'évaluation
- Introduction Aux Soins D'hygiene Et de Confort DuDocument31 pagesIntroduction Aux Soins D'hygiene Et de Confort DuASSOUI NADIAPas encore d'évaluation
- Raisonnement Et Démarche Clinique Infirmière .PPT Mode de CompatibilitéDocument58 pagesRaisonnement Et Démarche Clinique Infirmière .PPT Mode de CompatibilitéIssam BelPas encore d'évaluation
- 2019 La Fécondité Des Concepts en Ostéopathie Osteo Magazine1Document3 pages2019 La Fécondité Des Concepts en Ostéopathie Osteo Magazine1Bruno DucouxPas encore d'évaluation
- Ethique Et PrincipesDocument8 pagesEthique Et PrincipesjessieholdiePas encore d'évaluation
- Conceptualisation 2021Document185 pagesConceptualisation 2021x-Abdelali Ait ouaichaPas encore d'évaluation
- Relation D Aide Support Formation Janvier 2022Document55 pagesRelation D Aide Support Formation Janvier 2022Louviot-PrévostPas encore d'évaluation
- Cours PhytomedicamentDocument15 pagesCours PhytomedicamentDINO ECO100% (1)
- Facteurs de Non Adhésion Au Programme de La Prévention de La Transmission de La Mère À L'enfant Du VIH À L'Hôpital Central de YaoundéDocument5 pagesFacteurs de Non Adhésion Au Programme de La Prévention de La Transmission de La Mère À L'enfant Du VIH À L'Hôpital Central de YaoundéDINO ECOPas encore d'évaluation
- Triki 2016CLF22733Document144 pagesTriki 2016CLF22733DINO ECOPas encore d'évaluation
- Evolution Des Habitudes Alimentaires Et Maladies CardiovasculairesDocument6 pagesEvolution Des Habitudes Alimentaires Et Maladies CardiovasculairesDINO ECOPas encore d'évaluation
- Philosophie de SoinsDocument2 pagesPhilosophie de SoinsDINO ECOPas encore d'évaluation
- Article AudreyDocument7 pagesArticle AudreyDINO ECOPas encore d'évaluation
- Wa0059.Document1 pageWa0059.DINO ECO100% (1)
- Aprifel Fiche-Conseil NutritionnelDocument2 pagesAprifel Fiche-Conseil NutritionnelDINO ECOPas encore d'évaluation
- Affections Du Systeme UrinaireDocument30 pagesAffections Du Systeme UrinaireDINO ECOPas encore d'évaluation
- Complications Du Diabète Sucré - Troubles Endocriniens Et Métaboliques - Édition Professionnelle Du Manuel MSDDocument9 pagesComplications Du Diabète Sucré - Troubles Endocriniens Et Métaboliques - Édition Professionnelle Du Manuel MSDDINO ECOPas encore d'évaluation
- Aprifel Fiche-Fruits Legumes CancersDocument2 pagesAprifel Fiche-Fruits Legumes CancersDINO ECOPas encore d'évaluation
- Aprifel Fiche-Fruits Legumes Calories Nutriments AllegationsDocument2 pagesAprifel Fiche-Fruits Legumes Calories Nutriments AllegationsDINO ECOPas encore d'évaluation
- Infirmière-Une Profession Problématique - Anne-Cécile BroutelleDocument4 pagesInfirmière-Une Profession Problématique - Anne-Cécile BroutelleDINO ECOPas encore d'évaluation
- Homme - Être SoignéDocument10 pagesHomme - Être SoignéDINO ECOPas encore d'évaluation
- Troubles de L'équilibre Acide-Base - Troubles Endocriniens Et Métaboliques - Édition Professionnelle Du Manuel MSD7Document2 pagesTroubles de L'équilibre Acide-Base - Troubles Endocriniens Et Métaboliques - Édition Professionnelle Du Manuel MSD7DINO ECOPas encore d'évaluation
- Troubles de L'équilibre Acide-Base - Troubles Endocriniens Et Métaboliques - Édition Professionnelle Du Manuel MSD6Document1 pageTroubles de L'équilibre Acide-Base - Troubles Endocriniens Et Métaboliques - Édition Professionnelle Du Manuel MSD6DINO ECOPas encore d'évaluation
- Aprifel Fiche-Fruits Legumes CardiovasculaireDocument2 pagesAprifel Fiche-Fruits Legumes CardiovasculaireDINO ECOPas encore d'évaluation
- Caring HesbeenDocument20 pagesCaring HesbeenDINO ECOPas encore d'évaluation
- Aprifel Fiche-Fruits Legumes Environnement ObesogeneDocument2 pagesAprifel Fiche-Fruits Legumes Environnement ObesogeneDINO ECOPas encore d'évaluation
- La Philosophie Des Soins InfirmiersDocument4 pagesLa Philosophie Des Soins InfirmiersDINO ECOPas encore d'évaluation
- UntitledDocument272 pagesUntitledDINO ECOPas encore d'évaluation
- Soins Infirmiers, Surveillance Et Traitement Du DiabèteDocument7 pagesSoins Infirmiers, Surveillance Et Traitement Du DiabèteDINO ECOPas encore d'évaluation
- Revue Générale Des Troubles de La Concentration Du Calcium - Troubles Endocriniens Et Métaboliques - Édition Professionnelle Du Manuel MSD2Document3 pagesRevue Générale Des Troubles de La Concentration Du Calcium - Troubles Endocriniens Et Métaboliques - Édition Professionnelle Du Manuel MSD2DINO ECOPas encore d'évaluation
- Revue Générale Des Troubles de La Concentration Du K - Troubles Endocriniens Et Métaboliques - Édition Professionnelle Du Manuel MSDDocument3 pagesRevue Générale Des Troubles de La Concentration Du K - Troubles Endocriniens Et Métaboliques - Édition Professionnelle Du Manuel MSDDINO ECOPas encore d'évaluation
- Acidocétose Alcoolique - Troubles Endocriniens Et Métaboliques - Édition Professionnelle Du Manuel MSDDocument3 pagesAcidocétose Alcoolique - Troubles Endocriniens Et Métaboliques - Édition Professionnelle Du Manuel MSDDINO ECOPas encore d'évaluation
- Revue Générale Des Troubles de La Concentration Des Phosphates - Troubles Endocriniens Et Métaboliques - Édition Professionnelle Du Manuel MSDDocument2 pagesRevue Générale Des Troubles de La Concentration Des Phosphates - Troubles Endocriniens Et Métaboliques - Édition Professionnelle Du Manuel MSDDINO ECOPas encore d'évaluation
- Hypercalcémie - Troubles Endocriniens Et Métaboliques - Édition Professionnelle Du Manuel MSDDocument12 pagesHypercalcémie - Troubles Endocriniens Et Métaboliques - Édition Professionnelle Du Manuel MSDDINO ECOPas encore d'évaluation
- Le Patient Diabétique Musulman: Quelle Approche Culturelle Dans Les Interventions Infirmières en Valais ?Document188 pagesLe Patient Diabétique Musulman: Quelle Approche Culturelle Dans Les Interventions Infirmières en Valais ?DINO ECOPas encore d'évaluation
- Acidocétose Diabétique: Le Manuel MSD Version Pour Professionnels de La SantéDocument7 pagesAcidocétose Diabétique: Le Manuel MSD Version Pour Professionnels de La SantéDINO ECOPas encore d'évaluation
- Antidiabétiques - Les Points EssentielsDocument5 pagesAntidiabétiques - Les Points EssentielsDINO ECOPas encore d'évaluation
- Extractions Dentaires Simples Et Chirurgicales: Khalifa Chaima Résidente MCBDocument48 pagesExtractions Dentaires Simples Et Chirurgicales: Khalifa Chaima Résidente MCBharrystyles06969Pas encore d'évaluation
- Oral SVTDocument13 pagesOral SVTMathildePas encore d'évaluation
- Copie Rapport de Sortie GBVDocument7 pagesCopie Rapport de Sortie GBVArouna DiarraPas encore d'évaluation
- Chapitre 2Document37 pagesChapitre 2MACON824Pas encore d'évaluation
- Les Anomalies PlaquettaireDocument3 pagesLes Anomalies Plaquettairelyna7ots100% (1)
- Evasan AlpiDocument1 pageEvasan Alpinicephore.fankamPas encore d'évaluation
- 08 0 026 Iso TS 22002 2Document24 pages08 0 026 Iso TS 22002 2isomoa100% (5)
- Présentation 1Document15 pagesPrésentation 1Chourouk Ben belgacemPas encore d'évaluation
- Neurologie - Epilepsie 20152Document11 pagesNeurologie - Epilepsie 20152amarantianoPas encore d'évaluation
- 3-Nevoux JDocument43 pages3-Nevoux Jdoud loPas encore d'évaluation
- Culture de Cellules Animales InsermDocument33 pagesCulture de Cellules Animales InsermrlegarPas encore d'évaluation
- Fiche Technique Classic Citron CLDocument1 pageFiche Technique Classic Citron CLSERATPas encore d'évaluation
- Cours Sport Et Santé Mastèr Fac de Droit 2022-2023Document22 pagesCours Sport Et Santé Mastèr Fac de Droit 2022-2023oumaima hliouiPas encore d'évaluation
- 1018 Em21052013Document20 pages1018 Em21052013elmoudjahid_dzPas encore d'évaluation
- Le Livre Des DocteursDocument42 pagesLe Livre Des DocteursNistor100% (1)
- EcbuDocument2 pagesEcbuJacob MadibaPas encore d'évaluation
- Pistolet Exercices Fiche5 StabiliteDocument1 pagePistolet Exercices Fiche5 StabilitesauxPas encore d'évaluation
- Infirmiers Definitifs 2023Document10 pagesInfirmiers Definitifs 2023mathiasma29Pas encore d'évaluation
- Arretez de Vous Sabotage, Vous Êtes Exceptionnel - Benedict AnnDocument29 pagesArretez de Vous Sabotage, Vous Êtes Exceptionnel - Benedict Annbiop100% (3)
- Fiompina Kisoa - PDF Filename Utf-8''Fiompina KisoaDocument22 pagesFiompina Kisoa - PDF Filename Utf-8''Fiompina KisoaHoby RazafitrimoPas encore d'évaluation
- TP Examen Master2Document26 pagesTP Examen Master2Merveille MukendiPas encore d'évaluation
- Le BruitDocument23 pagesLe BruitEric StivaletPas encore d'évaluation
- 6-Loi 88-08 Du 26-Janvier-1988 Medecine VeterinaireDocument3 pages6-Loi 88-08 Du 26-Janvier-1988 Medecine VeterinaireCHERIFPas encore d'évaluation