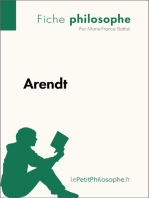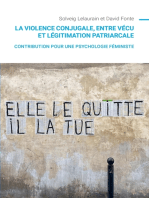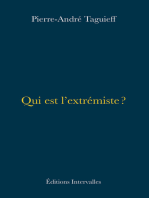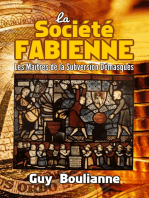Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Cours 2 - La Condition Ouvriere
Transféré par
Leopold ClaudeCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Cours 2 - La Condition Ouvriere
Transféré par
Leopold ClaudeDroits d'auteur :
Formats disponibles
La Condition ouvrière – Simone Weil
Professeur : M. Franck AIGON
Lino LANDRY, MP2I
Lycée Victor Hugo, Besançon
Introduction : La vocation du travail
I. Biographie
Simone Weil a eu une vie très riche, malgré le fait qu’elle fut courte de 1909 à 1943, qui explique qu’elle
n’ait pas pu produire beaucoup d’ouvrages ou de textes.
Elle est une des toutes premières femmes à intégrer l’ENS, et aussi une des premières femmes à avoir
réussi l’agrégation de philosophie. Elle a, dès l’époque où elle était étudiante, participé à des combats
étudiants puis syndicaux quand elle a commencé à enseigner. Et au-delà de cela, elle a participé
quelques semaines à la guerre d’Espagne et à la résistance avant de mourir en 1943 de sa santé fragile
et de son épuisement. L’action était au cœur de sa vie et de son œuvre. Le fait que l’action ait été au
cœur de son existence est quelque qu’elle théorise dans la lettre à Simone Gibert. Le grand promoteur
en est notamment André Gide qu’elle évoque dans sa lettre « La réalité de la vie, ce n’est pas la
sensation, c’est l’activité », il y a aussi une activité de la pensée et de l’intelligence.
Cette promotion de l’action, ce culte de l’engagement, c’est ce qui va la porter dans les années 34-35
à demander congé de son poste d’enseignante afin de s’engager comme ouvrière à l’usine pour réaliser
une expérience. Souhaitant écrire sur la condition ouvrière, elle s’engage à l’usine pour partager
justement la condition des ouvriers. Elle ne souhaite pas parler de la condition ouvrière en surplomb.
L’engagement est au cœur de sa vie, aussi bien dans les combats de sa vie que sociaux. Il y a une autre
forme d’engagement dans sa vie : l’engagement spirituel. On voit un lien se tisser entre cet
engagement social et son engagement spirituel. Une première rencontre avec le christianisme dans la
ville italienne d’Assise (où a vécu Saint François) est une première expérience mystique. Et sans jamais
se convertir, elle va se rapprocher de la spiritualité chrétienne, et notamment du catholicisme et
entretenir une correspondance avec un prêtre dominicain, le père Perrin.
On peut dire que Simone Weil est une figure intellectuelle très importante, mais tout aussi singulière
de la France du 20ème siècle. Elle est issue d’une famille de la bourgeoisie juive intellectuelle. Ce milieu
est intéressant car familialement, elle est à la fois issue d’une bourgeoisie intellectuelle
strasbourgeoise. Son père est médecin athée, progressiste de gauche. L’appartenance à une religion
minoritaire n’est plus un problème depuis plus d’un siècle, la religion étant renvoyée au domaine privé
dans le principe de laïcité. Elle a développé une culture progressiste qui s’est éloignée de la croyance
religieuse, même si le judaïsme continue de structurer la vie familiale.
Du côté maternel, au contraire, c’est l’expérience des Juifs minoritaires, ghettoïsé venant de Galicie. Il
y avait dans sa famille un sentiment habitué d’être minoritaire. La famille maternelle a d’abord émigré
à Anvers avant d’arriver jusqu’à Paris. C’est une famille cultivée, d’esprit cosmopolite. Ce qui semble
avoir soulevé le couple Weil, c’est le goût pour les arts et la culture, un très grand respect pour le
savoir, les valeurs universitaires et l’idée que l’émancipation passe justement par l’excellence
universitaire. En même temps, c’est une famille qui cultive un égard par rapport aux principes religieux.
Cela explique sans doute le fait que l’excellence universitaire soit au cœur de cette famille et que
Simone Weil et son frère André Weil soient devenus une grande philosophe et un grand
mathématicien. Cette visée de l’excellence a, chez Simone Weil, une dimension morale qu’elle exprime
peu avant sa mort, dans une lettre au père Perrin avant de partir pour les Etats Unis en 1942, dans
laquelle on retrouve l’esprit de Simone Weil.
L’inspiration de Simone Weil est clairement cartésienne. Le mot de vérité chez elle tend
essentiellement comme un refus du mensonge, la vérité doit d’abord s’entendre comme un refus du
mensonge, particulièrement du mensonge à soi. La droiture est au cœur de l’engagement de Simone
Weil. On retrouve aussi la croyance en l’égale dignité des êtres humains « n’importe quel être humain,
Lino LANDRY, MP2I
Lycée Victor Hugo, Besançon
même si ses facultés naturelles sont presque nulles ». Sa philosophie requiert un effort d’attention
perpétuel, la volonté de voir, la méthode et la rigueur. L’ignorance est la forme principale de
l’esclavage. A ces notions s’ajoute également une grande sensibilité au malheur qu’elle élargit à la
condition humaine en général. Elle expérimente dans le monde ouvrier le fondement de la condition
humaine. On trouve une progression similaire à celle de Virgile : elle part de la condition ouvrière
comme Virgile partait de la connaissance agricole pour arriver à la condition humaine en général.
« Quelque chose d’essentiel de la condition humaine se donne à voir, se donne à lire de ce que sont
les hommes dans la condition laborieuse, dans la condition de l’homme au travail ».
II. Les grands principes de la philosophie de Simone Weil
Plusieurs notions sont au centre de la philosophie de Simone Weil. Premièrement, le refus du
mensonge, secondement l’égale dignité des êtres humains avec la nécessité d’un engagement et d’un
effort d’attention. S’ajoutent 2 autres notions : une grande attention aux malheurs des hommes, et
enfin la notion de l’amour qui prendra une dimension religieuse et mystique.
Une 5ème notion, l’amour, se découvre déjà dans une certaine forme de solidarité et va prendre petit à
petit une signification d’ordre spirituel et mystique, car sa dernière philosophie est une philosophie
d’inspiration religieuse. Pour toutes ces valeurs, Simone Weil s’est intéressée très tôt à la politique et
s’y est intéressée à partir d’une expérience, sa capacité à voir l’injustice et à en souffrir. C’est d’ailleurs
comme cela qu’elle se résume elle-même lorsqu’elle entre en relation en 1938 avec un grand écrivain
de l’époque, Bernanos, qui a rompu avec son milieu. Par ses idées politiques, il aurait été conduit
comme les autres à approuver les mouvements d’extrême droite mais a fini, par ses idées catholiques,
à les désapprouver. Simone Weil a eu peu le temps d’échanger et se confie sur son sentiment
d’empathie « Depuis l’enfance, mes sympathies se sont tournées vers les groupements qui se
réclament de la hiérarchie sociale ».
Simone Weil devient disciple d’Alain et crée le groupe d’éducation social qui naît de la rencontre
d’étudiants normaliens et d’un syndicaliste, Lucien Cancouët, un camarade de guerre d’Alain devenu
syndicaliste cheminot. C’est une des tentatives de l’époque pour créer des lieux d’éducation populaires
qui aboutira au Théâtre National Populaire de Villeurbanne. Simone Weil s’engage alors dans des
combats syndicaux et dans un syndicalisme révolutionnaire : la révolution prolétarienne. C’est un
mixte du marxisme proche du parti communiste, et de mouvements libertaires proudhoniens. En plus
de son enseignement, elle donne des cours dans des organisations populaires, notamment à la bourse
de Saint Etienne. En effet, son mot d’ordre est celui d’une auto-émancipation de la classe ouvrière, et
elle a des visions assez critiques sur les intellectuels, notamment sur leur mainmise sur le monde
ouvrier tout en n’ayant aucune expérience de ce monde (p.52). Elle prend part au particularisme
ouvrier pour qu’ils prennent la plume, et promeut la culture ouvrière.
L’idée d’une culture ouvrière amènera Simone Weil à s’intéresser au communisme, sans devenir
communiste. Elle vouait une admiration sans bord à la pensée de Marx pour l’apport indestructible de
sa méthode. Marx est un matérialiste qui a su mettre en lumière la mécanique des rapports sociaux,
plus exactement le mécanisme de l’oppression capitaliste en étudiant avec la rigueur d’un physicien
les rapports de force à l’œuvre dans le capitalisme comme dans un champ de forces. Simone Weil s’est
montrée circonspecte à l’égard de l’idée que la rigueur de l’analyse de Marx puisse résulter en des
réformes révolutionnaires. C’est la raison pour laquelle elle n’adhérera jamais au communisme. Elle
ne croyait pas en une révolution ouvrière et estimait que l’URSS n’était absolument pas un état ouvrier,
mais un régime totalitaire et une dictature.
Sa clairvoyance s’élargit à d’autres champs. Au début des années 30, elle décide de partir 2 mois en
Allemagne pour y observer l’évolution du communisme car c’est en Allemagne que le parti
Lino LANDRY, MP2I
Lycée Victor Hugo, Besançon
communiste est le mieux implanté en Europe, il y représente une grande part de l’électorat. Simone
Weil y jugera sur place des rapports de force entre les 3 forces politiques du pays : la social-démocratie,
le parti communiste et le parti d’Adolf Hitler. En octobre 1932, elle publie dans la Révolution
Prolétarienne, « Les premières impressions d’Allemagne » et contre toutes les prédictions de l’époque,
elle prédit la victoire du parti d’Hitler et sa prise de pouvoir totale. Ce n’était pas évident à l’époque,
on voyait que ce parti allait prendre un pouvoir total. Simone Weil le voit tout de suite en réalité que
les partis traditionnels seront balayés par ce vent nouveau.
Or, cette clairvoyance intellectuelle est doublée d’un engagement. Dans une lettre à un de ses amis
responsable de l’école émancipée, elle écrit « ça y est, Hitler est là. Même en l’ayant prévu… » Il y a
chez Simone Weil l’idée d’un engagement et l’idée. Et le travail aussi, s’il n’est pas détourné de son
vrai sens comme dans les usines, est une des formes de l’engagement. Ce sont toutes ces choses-là qui
vont convaincre Simone Weil, évolutionniste, que la gauche révolutionnaire est une impasse, une
illusion « elle critique les vieux dogmes », « J’étouffe dans ce milieu révolutionnaire aux yeux bandés ».
Elle écrit donc un article « Perspective : allons-nous vers la révolution prolétarienne » dans la revue
« Révolution prolétarienne » en décrivant que la révolution communiste n’est pas une solution. Elle ne
renonce pas à l’idée de la révolution ouvrière, mais donne un nouveau programme en redonnant sa
dignité au travail manuel. Elle donne à l’intelligence un objet propre par le moyen du travail. Le
développement de techniques de haut niveau.
En juin 1934, elle rédige une demande de congé pour étude personnelles. Son vœu est de faire la
lumière sur la classe ouvrière et se fait engagée à l’usine et y entre le 4 décembre 1934. Elle n’est pas
la seule à s’intéresser à la condition des ouvriers à l’usine. Georges Orwell part en quêtes des
conditions des ouvriers anglais, de la même façon aux Etats-Unis avec Jack London. C’est un travail de
reporter, non en tant que spectatrice mais en tant qu’actrice. Il s’agit pour elle de se prendre elle-
même comme cobaye afin d’expérimenter dans son propre esprit et dans son propre corps la réalité
d’un esclavage qu’elle définit comme la pulvérisation de l’âme par la brutalité mécanique. S’il y a
d’autres auteurs avant elle qui se sont intéressée à la condition ouvrière, il y a bien dans son regard
quelque chose de singulier. Il s’agit au cours de cette expérience de vivre la souffrance et le malheur
du monde ouvrier. On parle parfois d’une sorte de dolorisme, d’un goût de la souffrance. Cette
expérience va l’épuiser, d’autant plus que sa santé est fragile. Mais cette expérience traduit bien la
critique permanente des intellectuels qui prétendent parler du monde ouvrier sans savoir ce que c’est
sans l’avoir vécu. Selon elle, la pensée doit suivre l’expérience.
Lino LANDRY, MP2I
Lycée Victor Hugo, Besançon
Etude
I. L’expérience ouvrière, ou le tragique de la condition humaine
On parle de condition humaine, car ce que Simone Weil dit du monde ouvrier a une portée beaucoup
plus grande que celle de la condition de l’ouvrier. C’était l’idée de Simone Weil d’explorer la condition
humaine au niveau le plus tragique de l’ouvrier. Son expérience dure 9 mois de décembre à août. Sa
philosophie s’est engagée d’une part, et en même temps, Simone Weil dit elle-même que cette
expérience lui révéla plus que ce qu’elle a imaginé, elle fut une révélation voire un bouleversement.
Elle exprime ce bouleversement dans une lettre à Albertine Thévenot écrit (p52) « Cette expérience
préparée ». Elle parle d’une « légèreté de cœur ?? impossible ». Elle s’explique dans un premier temps
par le fait que l’expérience ouvrière a confronté Simone Weil a une réalité. Cette réalité est que la
condition des ouvriers soumis et malheureux est, au sens propre du terme, une condition d’esclave et
une partie de ses lettres est consacrée à montrer que ce terme n’est pas trop fort ni anachronique
pour caractériser ce dont on parle et légitime l’usage de ce terme d’esclavage.
Deuxièmement, on peut comprendre ce propos par le fait que son expérience, en plus d’être ouvrière,
est humaine tout court car l’ouvrier fait l’expérience de quelque chose de très singulier. Ce dont les
ouvriers font l’expérience est qui est la cause de leur malheur est une condition d’arrachement à la
condition d’homme dont Simone Weil utilisera le terme de déracinement caractérisant toute ces
expériences par lesquelles nous sommes privés de notre humanité. Ce siècle est le siècle de la
révolution industrielle, mais aussi celui des totalitarismes.
Une rédemption cependant semble possible, que Simone Weil entrevoir à travers les grèves de 1936
mais aussi à travers son projet de réforme de l’organisation du travail. Toute cette réflexion s’ouvrira
sur une réflexion d’ordre religieux dans ses dernières pages.
1) L’esclavage moderne
Le terme fort, très fort pourrait sembler anachronique, même si dans un contexte intellectuel influencé
par le marxisme, ce terme n’est pas nouveau au sens que c’est Marx déjà, qui dès le 19ème siècle a
définit la condition des ouvriers comme une condition d’esclave. Mais sa vision reste assez théorique
et antique car il est esclave dans le sens où le salarié ne dispose pas de son temps. Marx reprend de
ça, car le salarié est la forme moderne de l’esclavage. Il ne prend pas en compte la condition de
souffrance qui est celle de l’esclave, et c’est Simone Weil qui ira jusque-là. En effet pour Simone Weil,
non seulement les ouvriers sont des esclaves, mais la condition est pire même que celle des esclaves
de l’Antiquité.
Aristote nous donne une définition de l’esclavage moderne : l’esclavage est une institution qui traverse
toutes les communautés de l’Antiquité et peu d’auteurs en parlent. L’un des rares qui en parle est
Aristote. Il dit que l’esclavage est légitime au terme de plusieurs page de réflexion. Il est légitime en
droit car certains doivent commander, mais dans les faits correspond rarement à ce qu’il doit être car
un citoyen d’une cité peut le devenir en perdant une guerre. Aristote a affranchi tous ses esclaves et
aimait sa femme. Voilà la définition qu’il en donne : « l’esclave est un instrument animé en vue de
l’action ». C’est un instrument comme la charrue, le marteau ou la pioche mais animé, autrement dit
un instrument vivant comme le bœuf ou le cheval. D’ailleurs, dans les exploitations agricoles, peu de
chose le distingue du bœuf ou du cheval, c’est pourquoi il faut en prendre soin. On prend soin de leur
santé et on fait en sorte qu’ils soient performants.
On peut penser que la condition d’esclave, au-delà de la privation de liberté, dans les faits n’a pas été
si malheureuse que ça pendant l’Antiquité, d’autant que l’esclave antique jouit d’une liberté qui est la
liberté intérieure. Et c’est tellement important que l’esclave est un homme qui jouit d’une liberté car
Lino LANDRY, MP2I
Lycée Victor Hugo, Besançon
intérieurement peut maudire son maître et le haïr, et aussi ne pas s’investir au mieux dans son travail,
il y a une expression possible de sa liberté. Justement, tout l’intérêt de la réflexion de Simone Weil est
de remettre le mot d’esclave. Cette condition d’esclave qui est la condition ouvrière est même pire
que celle de l’esclave de l’Antiquité parce que l’ouvrier ne jouit plus de cette liberté intérieure que
pouvait avoir l’esclave. Pour le savoir, il faut avoir travaillé sur ces chaînes de montage. Il pouvait
maudire son maître intérieurement et ne pas être très efficace en ralentissant à certains moments,
mais tout ceci est interdit à l’ouvrier. Travailler dans le ressentiment, c’est risquer un faux mouvement
dans une chaîne de production où tous les gestes sont calibrés. S’il est calculé que l’ouvrier doit tourner
un écrou à une certaine cadence, il n’a plus de capacité mentale pour prendre de la distance par
rapport aux ordres donnés. S’abandonner à la colère ou à la mauvaise volonté, c’est risquer de ne pas
tenir la cadence et de se faire renvoyer (l’esclave ne pouvait pas être renvoyé). L’ouvrier risque le
renvoie, or le renvoi et la précarité de l’emploi est intégrée dans le système de production comme un
instrument de motivation et de mobilisation des ouvriers.
Ce que l’usine moderne a créé, c’est une menace de renvoi. On pourrait dire que dans l’esclavage
moderne, le maître n’a plus besoin du fouet pour imposer sa volonté. Ça ne veut pas dire qu’il n’y a
pas de violence car elle est intériorisée. Ce sont les prémices de ce système que Simone Weil dénonce
(p272) : « La contrainte. Ne jamais rien faire, même dans le détail qui constitue une initiative. ». Il y a
aussi une sorte de précarité qui fait que l’on doit réagir si l’on nous demande de changer d’outil. Le
fouet est intériorité et un mot revient sous la plume de Simone Weil : celui de « dressage » (p323). Par
l’idée de Taylor, il ne faut pas payer l’ouvrier au mois où il tendrait à moins produire, mais à la
production. Il base alors le prix de la pièce par les ouvriers le plus performants, et le salaire n’est pas
suffisant pour ceux qui travaillent le moins efficacement « ce système contient l’essentiel de ce que
l’on appelle aujourd’hui la rationalisation […] Taylor a remplacé le fouet par les bureaux et les
laboratoires » (p314). On pourrait dire que comme l’esclave, l’ouvrier vit dans la soumission et
l’humiliation (p270) « Quand on n’en peut plus, on n’a qu’à forcer. Toujours forcer […] On est là pour
obéir et se taire. On est au monde pour obéir et se taire ». L’ouvrier est condamné à la docilité (la
docilité de la bête de somme, du bœuf attaché à la charrue), et Simone Weil se surprend, à l’occasion,
à éprouver cette docilité (p283) « J’ai été frappé de ce que vous m’avez dit l’autre jour, que la dignité
est quelque chose d’intérieur ». Le stoïcisme n’est plus possible dans la condition de l’ouvrier.
Malgré tout, comme Marx, Simone décrit cet esclavage comme un rapport au temps. Le temps de
l’ouvrier est en effet quelque chose de singulier. Dans la mesure où l’ouvrier est condamné au présent,
c’est-à-dire qu’il est privé de ce qui est l’expérience de la durée. Simone Weil n’emploie jamais le terme
de durée, mais convient parfaitement et vient de la plume de Bergson. On trouve des choses très
proches entre leurs deux pensées. Bergson a fait le fondement de sa réflexion philosophique sur le
temps vécu. Il y a le temps tel qu’il est vécu, vécu en fait comme une continuité ; et il y a la
représentation scientifique du temps bien utile pour la science mais n’a rien à voir avec le temps tel
qu’il est vécu. Le temps scientifique est composé d’instants, tel qu’il peut apparaître dans un tableau
avec des axes, est matérialisé, et il est bien indispensable à la réflexion scientifique. Il ne faut pas le
confondre avec le temps vécu qui n’est pas une succession d’instants puisqu’il n’y en a pas, il y a la
durée, et surtout car être dans le temps et le vivre, c’est être dans le présent qui est toujours lourd,
grossi et enrichi du passé qui se rappelle à nous, qui continue à exister dans le présent ; et de
l’anticipation du futur. Par exemple, dans le moment où nous vivons, l’issue du cours constitue aussi
l’instant que nous vivons avec le repas que nous mangerons, en plus du souvenir. Chacun est constitué
d’échanges permanents en retenant le passé et anticipant le futur. Une expérience de ce qu’est la
durée vécue serait d’écouter la musique : la mélodie suit la précédent et anticipe la suivante. Un
instant présent n’est véritablement vécu que lorsqu’il inclut la capacité de la pensée à utiliser le passé
et anticiper le futur. C’est cet usage du présent qui est interdit à l’ouvrier qui est restreint au présent
Lino LANDRY, MP2I
Lycée Victor Hugo, Besançon
scientifique. En effet, c’est un temps de machine et de production. Autrement dit, son temps se trouve
atomisé et réduit à quelques secondes. Ce que vit l’ouvrier est un véritable rétrécissement de sa durée
vécue (p284) « L’obéissance […] réduit le temps à la dimension de quelques secondes », (p321) « Ce
système a aussi réduit les ouvriers à l’état de molécules », (p267) « Forcer. Forcer encore… ». Il y a une
tentative chez Simone Weil de faire tendre son écriture à la situation à l’usine, par l’usage de phrases
très courtes par exemple ; cette écriture du temps transforme ce qui est raconté.
La soumission à la cadence, l’absence de temps morts, l’état de torpeur, de pesanteur, de vide, voilà
donc la condition de l’ouvrier ; pourrait-on dire d’une expérience qui brise la durée, atomise le temps.
Le temps de l’ouvrier est spatialisé et mécanisé, et pour cause car l’usine tout entière est un outil. Or
ce temps éloigne l’ouvrier de la vraie vie, de la durée vécue ; si bien que le temps de l’ouvrier n’est plus
qu’une succession d’instants, c’est le temps du chronomètre et non celui de la vie. Le temps de
l’ouvrier n’est plus un rythme, ce n’est plus qu’une cadence. Dans un rythme, il y a autre chose : il y a
l’attente, la retenue, l’espérance d’un déséquilibre, le rythme est une liberté. Il n’y a rien entrer le
rythme de la danse, et le travail de l’ouvrier cadencé. Le temps de l’ouvrier n’est plus un rythme, ce
n’est plus qu’une succession d’instants.
2) Le déracinement
C’est un terme très important dans le vocabulaire de Simone Weil car il traduit l’expérience d’hommes
arrachés à leur condition humaine. Arraché, dans un contexte bien particulier qui est celui de l’horizon
mécanisé de l’usine. Le malheur ouvrier réside en effet dans la déshumanisation du travail.
a) La séparation entre la pensée et l’action
Le travail à la chaîne produit une sorte de rétractation de la pensée. Elle est nécessaire car c’est ce qui
permet à l’ouvrier de ne pas trop souffrir de sa tâche, et elle est caractéristique de la condition ouvrière
(p340) : « S’il était curieux, sa curiosité ne serait pas encouragée, et d’ailleurs la même douleur sourde
et permanente […] l’empêche aussi de voyager à travers l’usine et la cloue en un point de l’espace
comme au moment présent. ». L’ouvrier se vide de sa pensée, et non pour imprimer une pensée dans
les choses comme pourrait le raire l’artisan par exemple, mais c’est une opération nulle car il ne gagne
rien à cet échange et ne transforme rien à exécuter les gestes exécutés par d’autres que lui.
La cause principale de cette rétractation de la pensée est la répartition des tâches.
b) La mécanisation du travail
Cette mécanisation du travail qui est la cause du déracinement de l’ouvrier est l’occasion pour Simone
Weil de se livrer à une critique assez vigoureuse du travail dans ces usines et conduit à une critique du
taylorisme qui est l’organisation scientifique du travail. Taylor veut lutter contre la feignantise
systématique en découpant les tâches en les plus élémentaires en les chronométrant pour imposer la
cadence à l’ouvrier. Elle critique aussi le fondement de cette réflexion.
Pour elle, la prétendue rationalisation taylorienne du travail occulte la vraie valeur du travail. Elle
réduit le travail à l’accomplissement de gestes mécanique, transforme la force du travailleur en une
simple force physique, et elle passe à côté de la valeur et du sens spirituel du travail dans la mesure où
le travailleur s’implique et tire un sentiment de soi et de sa propre valeur en se construisant.
En effet, le taylorisme sépare la pensée de l’exécution. Au niveau des ingénieurs qui conçoivent le
travail, il n’a pas perdu sa valeur et reste valorisant, mais du côté du bas de l’échelle, il ne l’est plus. Le
travail authentique est une unité vécue de l’âme et du corps. Or l’ouvrier se voit livrer des tâches dont
il ne voit pas la cause ni la finalité : il n’a pas la compréhension ou la connaissance nécessaire et c’est
le sens même du travail qui s’en va. Et pire, il effectue à l’identique une série de gestes identiques,
juxtaposés, (il prend une feuille de métal, la place dans une presse, actionne le levier, affronte la
Lino LANDRY, MP2I
Lycée Victor Hugo, Besançon
chaleur, dépose la pièce…) si bien que ses gestes sont mécanisés. Le beau geste que l’on maîtrise peut
provoquer une sorte de plaisir. Celui qui maîtrise un geste maîtrise son travail, mais quand le travail en
est réduit aux gestes, il perd sa signification : on est dans une pure et simple mécanisation du corps.
S’il y a bien rationalisation du travail, c’est en réalité celle de l’humain qui est en jeu, celle de l’humain
qui devient matière. C’est ce que dit Simone Weil dans une lettre à Bernanos, elle explique que
l’ouvrier est de la chair à travail, ce n’est plus qu’une chose parmi les choses. Ce que dit Simone Weil
va loin : ce qu’elle montre est que l’ouvrier vaut moins que la machine, car on prend soin de la machine
et elle est choyée, alors que les ouvriers sont interchangeables. Ce n’est pas si simple de remplacer
une machine alors que les ouvriers sont d’autant plus interchangeables que la taylorisation a besoin
d’ouvriers peu ou pas qualifiés. On revient à la condition d’esclavage, ils se transforment en
instruments au sens propre. Elle définit la condition d’ouvrier comme exilé (p339) « Pendant toute sa
journée de travail, l’ouvrier est comme exilé de la condition humaine ». L’ouvrier doit s’approprier les
outils de fabrication non par la propriété juridique, mais par la maîtrise, (p336) « De nos jours, ce n’est
pas seulement dans les magasins […] que les produits du travail entrent seuls en ligne de compte, et
non les travaux qui les ont suscités. Dans les usines modernes, il en est de même. […] Les pièces
circulent avec leurs fiches, […] on pourrait presque croire que ce sont elles les personnes, et les
ouvriers qui sont des pièces interchangeables. […] Les choses jouent le rôle des hommes, les hommes
jouent le rôle des choses. ».
L’expression de sa révolte va plus loin encore (p346) « l’homme est une machine qui obéit à la voix ».
Un tel renversement est contre-nature et constitue un crime. La critique est épatante, l’ouvrier est
exilé. Il se trouve étranger dans son propre lieu de travail. Il n’a plus ce sentiment d’accomplir et ne se
définit plus par son travail mais par sa condition ouvrière qui ne renvoie à aucune compétence si ce ne
sont des actes d’exécutions. Sa capacité à être acteur et maître de ses actions, tout ce qui fait la
grandeur de l’homme au travers de ses actions est effacé : c’est sa dignité même qui se trouve niée.
Pour aller là contre, il faut retrouver le sens spirituel su travail.
3) La spiritualité du travail
a) Les grèves de 1936
Le travail ne saurait se réduire à cette dimension tragique que l’on vient d’énoncer. Une des preuves
serait les grèves de 1936.
Au printemps 1936, une nouvelle coalition politique accède au pouvoir en France, qui est une coalition
d’un certain nombre de partis de gauche avec un soutient du parti communiste conduit par Léon Blum
qui devient président du conseil (le président n’est pas celui qui conduit la politique). Le gouvernement
n’a jamais été à gauche, et le pouvoir est plutôt favorable à un certain nombre de mesures, et ce qui
le caractérise est une sensibilité beaucoup plus grande à la condition ouvrière et aux combats
syndicaux. Mais le gouvernement se trouve débordé par un mouvement social dans l’impatience de
nouvelles mesures et à de nouvelles lois. Les médias dénoncent une manipulation par le parti
communiste, alors que Simone Weil les interprète plutôt non comme un mouvement révolutionnaire
mais comme une flambée sporadique et comme un moment de fête par l’arrivée au pouvoir du
nouveau gouvernement. Bien loin d’ouvrir à la révolution, les grèves ouvrent en effet à un certain
nombre de nouvelles mesures sociales. On en retient les congés payés, la limitation de la semaine de
travail à 40 heures en plus d’un certain nombre de mesures sociales. Les grèves de 1936 sont un
épisode des plus importants du siècle avec mai 1968. Et puis, c’est aussi important car les réformes
sociales qui sont passées à la suite des accords de Grenelle sont les deux grandes réformes sociales
dans le 20ème siècle.
Lino LANDRY, MP2I
Lycée Victor Hugo, Besançon
On est dans un épisode très important de l’histoire du pays et Simone Weil sait le relever avec une
lecture très clairvoyante de l’événement en n’y voyant pas un mouvement révolutionnaire qu’elles ne
sont pas, mais comme un sursaut de dignité de la part des ouvriers. C’est en particulier dans « La vie
et la grève des ouvriers Métallos » (p264) et notamment p275 qu’elle analyse les raisons de la grève :
« Pourquoi les ouvriers n’ont-ils pas attendu la formation du nouveau gouvernement ? […] C’est que
dans ce mouvement il s’agit de bien autre chose que de telle ou telle revendication particulière, si
importante soit-elle. […] Indépendamment des revendications, cette grève est en elle-même une
joie. ». Bien sûr comme le dit la fin du passage, cette fête n’aura été qu’une parenthèse, mais une
parenthèse qui aura changé quelque chose d’essentiel dans l’expérience ouvrière, donc une
parenthèse qui ne se suffit pas à elle-même mais qui doit être prise en charge par une politique, c’est-
à-dire par des réformes. Et là Simone Weil s’affiche comme ouvertement réformiste et radicale. Il ne
s’agit pas de faire la révolution ou de bouleverser la société, mais de réformer. Il faut par des réformes,
donner au monde du travail des repirations qui leur permettront de ne pas avoir recourt à la grève.
b) Les réformes
Les mesures sont très précises (p307) « Concilier les exigences de la fabrication et les aspirations des
hommes qui fabriquent est un problème que les capitalistes résolvent facilement en supprimant l’un
de ses termes : ils font comme si ces hommes n’existaient pas. […] La solution idéale, ce serait une
organisation du travail telle qu’il sorte chaque soir des usines à la fois le plus grand nombre possible
de produits bien faits et des travailleurs heureux. […] Et si une telle solution n’est pas envisageable
n’est pas pratiquement réalisable, c’est justement parce que les besoins de la production et les besoins
des producteurs ne coïncident pas forcément ». Les conditions du travail dans les usines ont
considérablement évolué depuis les années 30. On pourrait énumérer 4 grandes séries de réformes.
• Il faut éduquer le travailleur. Il s’agit à l’école dès l’école d’encourager l’enseignement
technique. Dès les années 30 avec le Front Populaire, certains défendent cette idée des
enseignements techniques. Il faut, à l’usine, dispenser des cours de vulgarisation. Le but pour
l’ouvrier est de parvenir à dominer par la pensée le temps et le processus de production.
• Il faut rendre le lieu de travail familier. L’ouvrier doit pouvoir s’enraciner dans son lieu de
travail. Les ouvriers doivent se sentir à l’usine comme chez eux, et l’usine doit être un lieu
familier. Il s’agit également de permettre à l’ouvrier de s’enraciner dans son lieu de travail qui
doit devenir un espace ouvert où il peut voir ce que font les collègues (ce qui n’est pas le cas à
l’époque) et ce que devient le fruit de son travail. Mais il doit aussi pouvoir parcourir l’usine
lors de visites. L’ouvrier doit s’enraciner dans son lieu de travail, voir évoluer le fruit de son
travail, parcourir l’usine et même pouvoir la faire visiter à sa famille, ce qui lui permet
d’acquérir de la fierté.
• Il faut rendre le travail collaboratif et coopératif.
• Il faut briser les taux de la cadence et que l’ouvrier puisse retrouver le sens du rythme. Il faut
retrouver cette sensation humaine et corporelle que la machine détruit car le rythme est
imposé par la machine.
A travers un travail si spiritualisé, l’ouvrier pourra tendre à la beauté et à la poésie de son travail car il
y a, dans tout travail, une beauté et une poésie qu’il faut savoir retrouver. Cette idée qu’il y a une
poésie inhérente au monde technique est nouvelle.
C’est ainsi que, tout naturellement, tirant les conséquences de son propos, Simone Weil va jusqu’à
affirmer à la fin du recueil dans « Conditions premières d’un travail non servi » la dimension mystique
et religieuse du travail. Elle va plus loin en affirmant même que le travail apparait comme une approche
de la beauté du monde et comme une imitation de la bonté divine, c’est la pensée de Saint François
d’Assise qui a conduit Simone Weil à cette réflexion lors de sa dernière visite religieuse qui l’a conduite
Lino LANDRY, MP2I
Lycée Victor Hugo, Besançon
à une peinture. Il faut voir dans le corps et dans la physique une sorte d’engagement religieux. Simone
Weil va jusqu’à rapprocher le travail de l’eucharistie : le travailleur, par son travail, fait un don de soi
et reçois en échange la beauté du monde. Le travail transfigure le travail au rapport au monde, et
l’homme donne sa vie à l’humanité. Et c’est cela qui permet à Simone Weil de montrer que la
souffrance du travail n’est pas seulement inutile. « Il ne suffit pas de vouloir leur éviter des souffrances,
il faudrait vouloir leur joie. […] La poésie surnaturelle qui devrait baigner toute leur vie devrait aussi
être concentrée à l’état pur, de temps à autre, dans des fêtes éclatantes ».
II. Le corps au travail
Travailler engage le corps car travailler engage une confrontation avec le réel afin de transformer pour
en tirer de quoi satisfaire des désirs ou des besoins. Cette expérience (transformer le réel) est d’abord
une expérience physique et morale qui nécessite de la force et de la ténacité, de l’ardeur, de la patience
parfois qui engage toutes les forces si bien physiques que mentales de l’homme. Cette dimension du
travail, mettre en œuvre des forces, est au centre de la réflexion de Simone Weil puisque pour Simone
Weil, la question du travail relève d’une philosophie de l’action ou de l’engagement comme relevé
dans sa lettre à Simone Gibert où elle oppose la réalité de la vie à la sensation (« La réalité de la vie, ce
n'est pas la sensation, c’est l’activité. »). Autrement dit, le travail se place au cœur même de la réalité
du monde : travailler, c’est faire l’expérience et mettre à l’épreuve la réalité du monde. Le travail est
une expérience qui est au cœur même du rapport de l’humain au réel, et au cœur même de
l’expérience humaine. C’est la place centrale que Simone Weil donne au travail. En effet, faire
l’expérience consiste à s’y frotter par un effort de l’action et de la pensée.
Faire l’expérience du réel, c’est donc agir, on pourrait dire que c’est dans l’action que se trouve
l’expérience par excellence du réel. Cependant, cette expérience du réel à travers le travail n’est pas
forcément une expérience heureuse, et c’est le constat de la condition ouvrière car elle est une
expérience malheureuse du travail. L’expérience ouvrière est le type même d’une expérience
malheureuse au travail et d’une condition tragique, le type même d’un travail qui ne se développe pas
comme il le devrait : d’une action détournée de son sens. On peut développer en plusieurs points cette
dimension.
1) Transformer et adapter
Il y a dans toute activité laborieuse un double mouvement de transformation et d’adaptation. Cela
signifie que travailler, c’est transformer le réel et le rendre conforme et cet effort nous transforme à
son tour. Travailler, c’est aussi faire l’expérience que la réalité résiste et qu’il va falloir revoir ses plans
et s’adapter, voire se remettre en question. Ce double mouvement est caractéristique du type d’effort
qu’il faut dans le travail. Il faut en quelques sortes exploiter l’énergie de la nature à son avantage, la
canaliser et voire en détourner les forces.
Pour Virgile, l’agriculture canalise l’énergie de la nature afin d’en renforcer les produits. Mais chez
Virgile, cette dimension du travail conservait une dimension vertueuse, l’activité de l’agriculteur
consiste en une sélection : il va sélectionner les pieds des vignes, les bœufs et chevaux, dompter et
dresser. L’originalité de l’époque moderne telle que Simone Weil la décrit : ce ne sont plus les produits,
mais désormais les travailleurs eux-mêmes qui font l’objet du travail. La Taylorisation est un moyen de
forcer les hommes à la performance et d’éliminer ceux qui ne parviennent pas aux résultats attendus
(on parle bien de « ressources humaines » comme d’un matériau de construction).
L’adaptabilité, que vante Auguste Detœuf, est une vertu du point de vue des petits patrons, là où la
création industrielle est la plus créative (« Accordez-moi donc que vos deux patrons ne peuvent guère
penser autrement qu’ils ne le font. […] le petit patron ne peut être remplacé que par un patron. […]
De toutes les difficultés qu’a rencontrées l’économie communiste russe, celles qui viennent de la
Lino LANDRY, MP2I
Lycée Victor Hugo, Besançon
suppression du petit commerce, de la petite industrie, de l’artisanat, sont les plus graves […] Quelle
que soit l’économie nouvelle qu’on envisage, le patronat petit et moyen, demeurera. »). L’adaptabilité
est une qualité que le chef d’entreprise doit savoir aussi transmettre à ses employés, c’est d’ailleurs
tout l’enjeu du management. C’est ce que dit Olivier Dehaze « Le propre du chef, c’est de savoir faire
évoluer ses hommes ». Un modèle vertueux peut se construire là-dessus. Si l’entreprise sait
développer le potentiel de chacun, et c’est d’ailleurs une des vertus du travail que de trouver à
développer le potentiel inhérent à chacun. Malheureusement, comme le montre Simone Weil, ce n’est
pas ce qu’il se passe dans l’industrie dont elle parle. Les ouvriers sont tellement adaptables qu’ils en
perdent leur nature, c’est dire ce que l’industrie Taylorienne recherche, ce sont des ouvriers
polyvalents. Et autant au niveau des ingénieurs et de la direction d’entreprise, la polyvalence signifie
compétence ; mais au contraire au niveau des ouvriers, c’est l’inverse. La polyvalence est le contraire
même du développement de compétence. Or, travailler c’est acquérir des compétences. Ils sont
tellement polyvalents qu’ils en perdent leur nature et ne développement aucune compétence et sont
des objets placés par des chef en différents points de l’usine selon les besoins de la production.
L’autre remarque que l’on pourrait faire, que dénonce Vinaver dans le management moderne, c’est de
pousser au maximum la plasticité des employés au risque de leur faire perdre toute identité. Et il
développe cela de façon humoristique lorsque l’on voit Passemar qui aime l’administratif réservé forcé
de changer. Ajoutons à cela que la transformation que le travail fait subir à la nature peut se révéler
vertueuse comme dans le cas de Virgile, mais peut aussi se révéler négative soit parce que l’Homme
n’en maîtrise qu’imparfaitement le processus, soit parce que son aboutissement est néfaste (parmi le
réchauffement climatique, la pollution…) et toutes ces questions sont au cœur de la réflexion sur le
travail. Dans le cas des usines avec Simone Weil, c’est la question de la division du travail qui empêche
le travailleur de comprendre l’intérêt de ses actes. Il est très différent d’être à l’origine ou à la fin d’une
chaîne de production et de réaliser un acte ponctuel. Ce qui pourrait être un travail réformé est selon
elle p257 « Au lieu d’opposer stérilement le machinisme à l’artisanat, il faut cherche une forme
supérieure de travail mécanique où le pouvoir créateur du travailleur ait un champ plus vaste que le
travail artisanal. Il ne faut pas tendre à réduire indéfiniment la part du travail […], mais faire du travail
un moyen pour chaque homme […] de dominer la matière […] Les machines doivent […] lui fournir un
moyen d’entrer en contact avec [la nature] ». Le rêve de loisirs toujours plus développés est un rêve
dangereux car c’est celui qui nous fait supporter de mauvaises conditions de travail.
2) Le corps tragique de l’ouvrier
Une des grandes originalités de la réflexion de Simone Weil est qu’elle s’appuie sur sa propre
expérience à l’usine. Mises bout à bout, ses expériences durent 4 mois et 3 semaines étalées sur 1 an
entrecoupées de pause dues à l’épuisement. Le travail est bien alors une expérience physique. Il faut
bien comprendre qu’à une époque où on analyse d’abord le travail comme un rapport de production
et de domination (Marx), Simone Weil ramène d’abord le travail à ce qu’il est d’abord : une expérience
physique quoi que choisie. Et en remontant au caractère premier, Simone Weil dit des choses
essentielles concernant la réalité du travail : elle révèle d’abord qu’il est une souffrance intime.
a) Une souffrance intime
Simone Weil est maladroite, myope, lente à la tâche, victime de migraines et surtout douée d’une
certaine « manie de pensée » qui la détourne de la tâche qui l’empêche de s’oublier dans le travail
parcellaire. En bref : elle rencontre des difficultés à s’adapter. Ces difficultés révèlent ce qu’il y a
d’étranger à sois (« quel que soit mon bonheur […] je ne suis pas moins heureuse de n’être pas
enchaînée à ce travail. J’ai simplement pris une année de congé pour « études personnes ». Un
homme, s’il est très adroit, très intelligent et très costaud, peut à la rigueur espérer […] arriver dans
l’usine à un poste où il lui soit permis de travailler d’une manière intéressante et humaine […] le travail
Lino LANDRY, MP2I
Lycée Victor Hugo, Besançon
est trop machinal pour offrir matière à la pensée »). L’expression première de cette souffrance intime
est celle de la fatigue.
b) La fatigue
Le corps de l’ouvrier porte ainsi l’empreinte de l’esclavage auquel il est soumis. Simone Weil écrit à
Nicolas « Je suis entrée comme découpeuse […] Je dois avouer que je n’ai pas tenu le coup : j’ai pris
froid, j’ai eu de l’anémie et j’ai dû me reposer ». La fatigue est le symptôme de l’impression d’un travail
qui vampirise l’énergie vitale de l’ouvrier. Le corps s’y trouve vidé de toute énergie, cassé même par la
cadence qu’il faut maintenir (p266) « Je me sens défaillir de fatigue […] Comme est-ce que je vais
pouvoir tenir », (p268) « Le vestiaire n’est pas chauffé, on entre là-dedans juste après avoir travaillé
dans un four ». De cette vampirisation ressort un corps vidé d’âme.
c) Un corps vidé d’âme
Le corps de l’ouvrier devient une machine : il obéit à des ordres et effectue des gestes répétés. Le
Taylorisme a séparé le corps de la pensée. Ce dont l’ouvrier fait l’expérience est la conséquence même
de l’organisation du travail dans une usine taylorienne qui sépare les fonctions de conception des
fonctions de fabrication. Le corps de l’ouvrier est transformé en simple rouage d’une grande machine
dont il n’a même pas la compréhension. C’est un corps mécanisé, mais c’est aussi un corps animalisé,
c’est-à-dire un corps réduit aux sensations animales les plus primaires, un corps qui a faim, un corps
qui a peur, et même un corps qui expérimente quelque chose en deçà de l’animalité, c’est un corps
qui ne peut plus avoir de réaction. L’ouvrier est devenu un instrument qui compte moins que la
machine qui a un état civil et une histoire (p336) « Au niveau de l’ouvrier, les rapports établis entre les
différents postes […] sont des rapports entre les choses, et non entre les hommes. […] On pourrait
presque croire que ce sont elles qui sont les personnes, et les ouvriers qui sont des pièces
interchangeables ».
d) Conclusion
Les ouvriers porteront à jamais les stigmates de leur condition ouvrière, car le travail à l’usine façonne
les corps, transforme les regards. Comme Simone Weil le décrit (p342) « On est dans le métro, le matin,
et déjà quelque chose se lit sur les corps […] les yeux douloureux dans le métro du matin », ce n’est
pas la saine fatigue, c’est la fatigue de l’angoisse, de l’anticipation « La fatigue d’âme encore plus de
corps, les regards […] L’obligation de présenter une carte d’identité en entrant […] La haine et le dégout
de l’usine […] presque sans échanger une parole ». Ces stigmates sont tellement inscrits dans le corps
qu’elle avouera les porter encore en elle dans une lettre au père Perrin datée de 14 mai 1942 « Après
une année d’usine, j’avais l’âme et le corps quelque sorte en morceau […] J’ai reçu là et pour toujours
la marque de l’esclavage ».
Cette expérience cependant n’est pas une fatalité comme le montrent les guerres de 1936, grèves qui
sont la preuve même que le travailleur peut s’alléger de toute cette pesanteur. En 1936, la grève est
joyeuse : les rires et les chansons fusent dans l’usine occupée, la chaleur humaine réchauffe le métal
des machines (p276) « Joie de vivre, parmi ces machines muettes, au rythme de la vie humaine – le
rythme qui correspond à la respiration, aux battements du cœur, aux mouvements naturels de
l’organisme humain – et non à la cadence imposée par le chronométreur. » La pulsation et le rythme
humains ont repris le dessus. L’ouvrier a retrouvé son humanité.
3) Le temps du travail : cadence et répétition
Deux visions opposées traversent les œuvres du programme : d’un côté on a la sérénité du paysan
virgilien satisfait de son travail qui, après le travail, profite d’un repos mérité ; et d’un autre côté, la
définition de Simone Weil d’un travail répétitif qui non seulement use mais détruit au-delà même du
travail le corps de l’ouvrier. La répétition n’est pas forcément négative car c’est en répétant une action
Lino LANDRY, MP2I
Lycée Victor Hugo, Besançon
ou un geste que l’on apprend à la maîtriser. Virgile laisse place à la répétition avec le retour saisonnier
de certains gestes « Le travail des laboureurs revient toujours en cercle, et l’année en se déroulant le
ramène avec elle sur ces traces ». En harmonie avec la nature et avec le monde s’opposent le monde
des ouvriers en usines abrutis par les gestes répétitifs des gestes qu’ils produisent (p265) « Les places
une à une sur une machine […] Poser la pièce […] Je ne vais pas assez vite […] Plus vite, encore plus vite
[…] Il faut faire attention […] Combien est-ce que j’en fait ». La répétition s’accompagne d’une cadence
très rapide afin d’assurer une bonne productivité. En effet, la course au rendement conduit à en
demander toujours plus aux ouvriers, et en cela l’enquête de Simone Weil devient une enquête
journalistique. C’est aussi le témoignage d’une ouvrière (p274) « On m’a doublé le rythme depuis 4
ans ». L’accélération est inhérente à ce mode de production, et caractéristique principale du monde
contemporain, Hartmut Rosa (Accélération) montre que l’accélération un phénomène majeure de la
réalité, et on en est au début.
Il y a une caractéristique essentielle du Taylorisme que Simone Weil tente d’analyser dans une
conférence (p302-306) La Rationalisation. « L’organisation scientifique du travail ». Elle montre que
l’objectif de l’organisation prétendument scientifique du travail est en réalité de faire travailler les
ouvriers toujours plus vite en les dépossédant du contrôle sur leur temps de travail. Tout du temps des
ouvriers est contrôlé, d’où l’importance de la pendule de pointage qui angoisse les travailleurs car leurs
arrivées et leurs départs sont systématiquement contrôlés « Le hasard n’a pas le droit de cité à
l’usine ». Le temps de travail, c’est aussi la cadence et l’alternance des journées de travail et de repos.
L’ouvrier a droit a aussi droit à des week-ends, et pourtant l’ouvrier de Virgile a plus l’impression de
posséder de son temps que l’ouvrier. On est bien loin de la sérénité de l’agriculteur de Virgile car les
week-ends ne sont pas des temps pour soi, mais des temps de repos « Chers amis inconnus qui peinez
dans les ateliers […] je viens vous demander de […] parler un peu de votre travail […] quand on a fait
ses huit heures, on en a marre […] On ne demande qu’une chose, c’est de ne plus penser à l’usine
jusqu’au lendemain […] on n’a rien de mieux à faire que de se détendre ». Au fond, le travail
contraignant transforme les temps de liberté en simple distraction. La distraction n’est pas le loisir,
c’est juste le repos. Enfin, le temps de travail, ou plutôt l’alternance de jours de travail et de non-travail,
c’est aussi la difficile question du chômage. Question d’autant plus difficile que l’on est dans une
grande période de chômage au lendemain de la crise de 1929. La menace du licenciement les contraint
à la tâche. Simone Weil raconte son expérience de renvoi dans une entreprise (p268) « On me renvoie
d’une usine […] Qu’est-ce qu’on a contre moi ? On n’a pas daigné me le dire […] Je lui demande […] je
reçois comme réponse « Je n’ai pas de comptes à vous rendre » et aussitôt il s’en va. […] Au creux de
l’estomac, une sensation qui s’installe […] dans quelle mesure c’est une angoisse, et dans quelle
mesure de la faim. ».
Lino LANDRY, MP2I
Lycée Victor Hugo, Besançon
Vous aimerez peut-être aussi
- Prier 15 jours avec Simone Weil: Un livre pratique et accessibleD'EverandPrier 15 jours avec Simone Weil: Un livre pratique et accessiblePas encore d'évaluation
- Durkheim (Fiche philosophe): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandDurkheim (Fiche philosophe): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frPas encore d'évaluation
- Alain (Fiche philosophe): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandAlain (Fiche philosophe): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frPas encore d'évaluation
- Christine DelphyDocument13 pagesChristine Delphyjuliette1.masselotPas encore d'évaluation
- Gustave ThibonDocument1 pageGustave ThibonMikael MoazanPas encore d'évaluation
- Simone de BeauvoirDocument4 pagesSimone de BeauvoirIrene100% (1)
- Arendt (Fiche philosophe): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandArendt (Fiche philosophe): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frPas encore d'évaluation
- Leçons de philosophie: Les entretiens socratiques de Simone WeilD'EverandLeçons de philosophie: Les entretiens socratiques de Simone WeilPas encore d'évaluation
- Sartre (Fiche philosophe): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandSartre (Fiche philosophe): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frPas encore d'évaluation
- JKBJHVDocument20 pagesJKBJHVEugenio PereiraPas encore d'évaluation
- Prier 15 jours avec Jacques Ellul: Théologien de l'espéranceD'EverandPrier 15 jours avec Jacques Ellul: Théologien de l'espérancePas encore d'évaluation
- Henri de Man. Au Dela Du MarxismeDocument320 pagesHenri de Man. Au Dela Du MarxismeJerónimo RillaPas encore d'évaluation
- Prier 15 jours avec Olivier Clément: Théologien dans le mystèreD'EverandPrier 15 jours avec Olivier Clément: Théologien dans le mystèrePas encore d'évaluation
- Norbert Elias PDFDocument7 pagesNorbert Elias PDFDeroy GarryPas encore d'évaluation
- Penser le travail avec Simone Weil: Comprendre le mondeD'EverandPenser le travail avec Simone Weil: Comprendre le mondePas encore d'évaluation
- Nietzsche (Fiche philosophe): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandNietzsche (Fiche philosophe): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frPas encore d'évaluation
- Le Cercle Proudhon Entre Berth Et ValoisDocument64 pagesLe Cercle Proudhon Entre Berth Et Valoisoliv2gPas encore d'évaluation
- DracinementetbesoinsdelmeDocument1 pageDracinementetbesoinsdelmeFraise MandarinePas encore d'évaluation
- Le deuxième sexe: Analyse complète de l'oeuvreD'EverandLe deuxième sexe: Analyse complète de l'oeuvreÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Claude Lévi-StraussDocument20 pagesClaude Lévi-StraussminaPas encore d'évaluation
- Le Communisme Sovietique Et La Demobilisation Politique Des ChretiensDocument21 pagesLe Communisme Sovietique Et La Demobilisation Politique Des ChretiensFe AgbotonPas encore d'évaluation
- Émile Durkheim: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandÉmile Durkheim: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Le FeminismeDocument5 pagesLe FeminismeFabiola MarinaPas encore d'évaluation
- Lect 142Document1 pageLect 142Daniel Amia somwePas encore d'évaluation
- La violence conjugale, entre vécu et légitimation patriarcale: Contribution pour une psychologie féministeD'EverandLa violence conjugale, entre vécu et légitimation patriarcale: Contribution pour une psychologie féministePas encore d'évaluation
- Emile, ou de l'éducation de Jean-Jacques Rousseau (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvreD'EverandEmile, ou de l'éducation de Jean-Jacques Rousseau (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Cultures Et Religions Du Monde Arabo-Musulman - Manon T.Document18 pagesCultures Et Religions Du Monde Arabo-Musulman - Manon T.Amanite xPas encore d'évaluation
- Emmanuel Terray - Anthropologie Et MarxismeDocument12 pagesEmmanuel Terray - Anthropologie Et MarxismeFábio Ramos Barbosa FilhoPas encore d'évaluation
- SimoneDocument6 pagesSimoneRo garañoPas encore d'évaluation
- L'existentialisme est un humanisme de Jean-Paul Sartre (Analyse approfondie): Approfondissez votre lecture de cette œuvre avec notre profil littéraire (résumé, fiche de lecture et axes de lecture)D'EverandL'existentialisme est un humanisme de Jean-Paul Sartre (Analyse approfondie): Approfondissez votre lecture de cette œuvre avec notre profil littéraire (résumé, fiche de lecture et axes de lecture)Pas encore d'évaluation
- CM Paradigmes SociologiquesDocument17 pagesCM Paradigmes SociologiquesKing IñigoPas encore d'évaluation
- Emmanuel Mounier - Communisme, Anarchie Et PersonnalismeDocument178 pagesEmmanuel Mounier - Communisme, Anarchie Et PersonnalismeCésarSobrinhoPas encore d'évaluation
- Faire de Sa Vie Une Oeuvre D ArtDocument9 pagesFaire de Sa Vie Une Oeuvre D Artdipoc33Pas encore d'évaluation
- Prier 15 jours avec Marcel Légaut: Éveilleur spirituelD'EverandPrier 15 jours avec Marcel Légaut: Éveilleur spirituelPas encore d'évaluation
- FERRERDocument11 pagesFERRERAnnie BPas encore d'évaluation
- SimonDocument7 pagesSimonOsaumen OghoghoPas encore d'évaluation
- Chenavier. S. Weil Management - Dec 2014Document12 pagesChenavier. S. Weil Management - Dec 2014Patrick Yves Chevrel0% (1)
- Compte Rendu - Didier Eribon, Retour À ReimsDocument3 pagesCompte Rendu - Didier Eribon, Retour À ReimsAngelique VannelPas encore d'évaluation
- Module de SociologieDocument91 pagesModule de Sociologieabderrahmane mejdoubiPas encore d'évaluation
- Chenavier. S. Weil Management - Dec 2014Document12 pagesChenavier. S. Weil Management - Dec 2014Hannah PartouchePas encore d'évaluation
- Mémoires d'une jeune fille rangée: Analyse complète de l'oeuvreD'EverandMémoires d'une jeune fille rangée: Analyse complète de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- 1984 de George Orwell (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvreD'Everand1984 de George Orwell (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- La Vertu D'égoïsme - Ayn RandDocument173 pagesLa Vertu D'égoïsme - Ayn RandChafik GraiguerPas encore d'évaluation
- Madeleine ColinDocument9 pagesMadeleine ColingwenaelbidaultPas encore d'évaluation
- Cours: Introduction de La Sociologie (FGB113) Présentation de MAX WEBERDocument19 pagesCours: Introduction de La Sociologie (FGB113) Présentation de MAX WEBERHugues Roodly JeannitePas encore d'évaluation
- Vive L'individualisme ! - 1703320051065Document12 pagesVive L'individualisme ! - 1703320051065Didier CoutanceauPas encore d'évaluation
- Julius Evola - Le Petit Livre NoirDocument40 pagesJulius Evola - Le Petit Livre NoirSeptentri0n100% (2)
- La Société fabienne: les maîtres de la subversion démasquésD'EverandLa Société fabienne: les maîtres de la subversion démasquésPas encore d'évaluation
- Anarchisme: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandAnarchisme: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Étude sur la philosophie en France au XIXe siècle: Le Socialisme et le Positivisme - Saint-Simon, Charles Fourier, Pierre Leroux, Jean Reynaud, Gall, Broussais, Auguste Comte, Proudhon, etc.D'EverandÉtude sur la philosophie en France au XIXe siècle: Le Socialisme et le Positivisme - Saint-Simon, Charles Fourier, Pierre Leroux, Jean Reynaud, Gall, Broussais, Auguste Comte, Proudhon, etc.Pas encore d'évaluation
- Youssef GirardDocument23 pagesYoussef Girardamedeo54Pas encore d'évaluation
- Entretien Avec Lewis MumfordDocument11 pagesEntretien Avec Lewis MumforduPas encore d'évaluation
- Laurent Bouvet, Trajectoire D'un Intellectuel Engagé. V2Document5 pagesLaurent Bouvet, Trajectoire D'un Intellectuel Engagé. V2EmeuryPas encore d'évaluation
- Soumission de Michel Houellebecq (Fiche de lecture): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreD'EverandSoumission de Michel Houellebecq (Fiche de lecture): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- TPno1 InitiationauxAutomatesProgrammablesIndustriels APISiemensS7 300Document6 pagesTPno1 InitiationauxAutomatesProgrammablesIndustriels APISiemensS7 300halim otmanePas encore d'évaluation
- Aviation Pilote 587Document84 pagesAviation Pilote 587laurent jubeau0% (1)
- Délais Et FormalitésDocument1 pageDélais Et Formalitészzouitine7220Pas encore d'évaluation
- Exercice SDocument18 pagesExercice SMohamed ElhajamPas encore d'évaluation
- PlaquetteSMDC PLVDocument16 pagesPlaquetteSMDC PLVAMALLLLLLLPas encore d'évaluation
- Ee Industrie Amee Module 3 PDFDocument26 pagesEe Industrie Amee Module 3 PDFDjebbar AliPas encore d'évaluation
- ISO 9202 2014-Character PDF DocumentDocument10 pagesISO 9202 2014-Character PDF DocumentHocine Chelghoum0% (1)
- Management Bancaire Les Moyens de Collecte Des Ressources de La BanqueDocument2 pagesManagement Bancaire Les Moyens de Collecte Des Ressources de La BanqueMéli SsaPas encore d'évaluation
- DevoirDocument2 pagesDevoirmohammed boufenziPas encore d'évaluation
- Contribution VFO MEPDocument18 pagesContribution VFO MEPvendezioPas encore d'évaluation
- M13-Technique de Vente OFPPT Par WWW - Ofppt1.blogspot - Com - 2Document43 pagesM13-Technique de Vente OFPPT Par WWW - Ofppt1.blogspot - Com - 2YoussefKemlanePas encore d'évaluation
- TD HacheurDocument3 pagesTD HacheurNarutoPas encore d'évaluation
- Dictionnaireduweb Edition2015Document866 pagesDictionnaireduweb Edition2015Loic BastaraudPas encore d'évaluation
- Polycopié Exes Audit VFDocument19 pagesPolycopié Exes Audit VFSoufianeBoumahdiPas encore d'évaluation
- HassanBENALLAL EpurationdeseauxuseesaumarocDocument43 pagesHassanBENALLAL Epurationdeseauxuseesaumarocnaima amzilPas encore d'évaluation
- Erreurs Fréquentes SQLDocument3 pagesErreurs Fréquentes SQLAlioune Badara Thiakame100% (1)
- ExercicesDocument3 pagesExercicesassia.bouhssiniPas encore d'évaluation
- Résumé Module Introduction Aux Sciences Politique Version 1Document11 pagesRésumé Module Introduction Aux Sciences Politique Version 1chamseddine karafi75% (4)
- Pompe A ChaleurDocument8 pagesPompe A Chaleurfarroukh med waelPas encore d'évaluation
- Tavaux Dirigés SoutienDocument9 pagesTavaux Dirigés SoutienOumarou Hamissou50% (2)
- Euro Compliance Peugeot MetropolisDocument58 pagesEuro Compliance Peugeot MetropolisJeff EllorincoPas encore d'évaluation
- Exigences Norme ISO 45001.Document1 pageExigences Norme ISO 45001.Boubacar MbowPas encore d'évaluation
- Exposé de RouteDocument40 pagesExposé de RouteNaomie NdongPas encore d'évaluation
- BC401 - ABAP Objects N3XT FR V5Document178 pagesBC401 - ABAP Objects N3XT FR V5Rokhaya SowPas encore d'évaluation
- Dictionnaire de DonnéeDocument1 pageDictionnaire de Donnéejean5no5l5kangaPas encore d'évaluation
- Programme CNFCCP - Talent ManagementDocument1 pageProgramme CNFCCP - Talent ManagementMoufid KarrayPas encore d'évaluation
- VOIR Marche Du Bois 2020Document204 pagesVOIR Marche Du Bois 2020Bcd CdePas encore d'évaluation
- Invitation Biomr SimemDocument4 pagesInvitation Biomr SimemKhadidja BensmainePas encore d'évaluation
- Ed 7200Document2 pagesEd 7200MahjoubPas encore d'évaluation
- N° Titre de L'ouvrage Auteur Encadreur Date: OEC Liste Des MémoiresDocument56 pagesN° Titre de L'ouvrage Auteur Encadreur Date: OEC Liste Des MémoiresSirine JabesPas encore d'évaluation