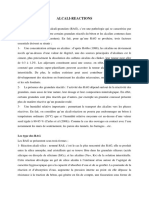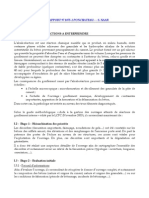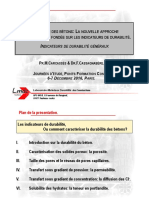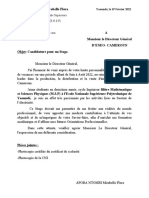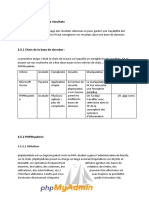Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Béton - Alcali Réaction Et Types de Retrait
Béton - Alcali Réaction Et Types de Retrait
Transféré par
ABID MohamedTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Béton - Alcali Réaction Et Types de Retrait
Béton - Alcali Réaction Et Types de Retrait
Transféré par
ABID MohamedDroits d'auteur :
Formats disponibles
CHAPITRE 2
ORIGINE LIEE AU MATERIAU
1
Les fissures qui affectent les ouvrages, murs, planchers ou autres, ont en général des
causes qui leur sont extérieures, contraintes, mouvements de l’assise, etc.
Elles peuvent aussi résulter de phénomènes qui trouvent leur origine dans la nature des
matériaux eux-mêmes entrant dans leur constitution, comme par exemple, un défaut
d’enrobage.
2 A - Béton
L’objet de ce chapitre est d’aborder les principales pathologies inhérentes au matériau
béton.
C’est ainsi qu’en fonction des actions extérieures auxquelles peut se trouver exposé un
élément d’ouvrage, différents types de dégradations peuvent apparaitre.
Le schéma ci-dessous présente quelques agressions extérieures auxquelles pourra
être soumis un élément en béton, pouvant conduire à la corrosion de tout ou partie de
ses armatures.
Doc. SIKA
EDITIONS GINGER - Collection L’ESSENTIEL - Fissuration - Edition 2020 19
1
CHAPITRE 2
ORIGINE LIEE AU MATERIAU
2 A.1 - ALCALI-RÉACTION
ÆÆ Phénomène
L’alcali-réaction est une réaction endogène, c’est-à-dire que la cause de cette réaction
se trouve au sein du matériau béton : ce sont les composants du béton qui en sont la
cause et non une cause extérieure.
On pourra ainsi voir apparaitre un réseau de fissures au niveau de l’épiderme des
ouvrages.
Les bétons peuvent présenter des désordres qui apparaissent à des délais variables,
allant de deux à plus de dix ans.
Les désordres se traduisent par un ou plusieurs des symptômes suivants :
zz une fissuration sous forme de faïençage à mailles plus ou moins larges, ou
en étoile, ou encore orientée suivant une direction correspondant au sens des
contraintes,
zz des exsudations blanches de gels ou de calcite,
zz des éclatements localisés en forme de petits cônes, qui correspondent à la
réaction de gros granulats en surface,
zz des mouvements et des déformations, visibles dans les gros ouvrages de masse,
tels que les barrages.
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
Conséquences des phénomènes d’alcali-réaction sur des éléments d’ouvrage en béton.
20 EDITIONS GINGER - Collection L’ESSENTIEL - Fissuration - Edition 2020
CHAPITRE 2
ORIGINE LIEE AU MATERIAU
1
Ces phénomènes se produisent lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
zz les agrégats qui entrent dans la composition du béton contiennent de la silice
réactive,
zz l'ouvrage est soumis à un environnement humide,
zz la teneur en alcalins du béton est élevée.
ÆÆ Procédés de réparation
On ne connaît à ce jour aucun procédé qui permette d'arrêter efficacement ce processus.
Afin de freiner l’évolution des réactions, on essaie de limiter les arrivées d’eau : cela
peut passer par la simple application de peintures (simple mais dont l’efficacité est très
limitée), l’injection de résines époxy dans les fissures (mais qui peuvent se ré-ouvrir) ou
la mise en œuvre d’un revêtement d’étanchéité (solution la plus efficace mais coûteuse
et compliquée à mettre en œuvre).
ÆÆ Prévention
Cette pathologie des bétons s’est manifestée pour la première fois en France dans les
années 1970 (cas du barrage de Chambon à côté de Grenoble).
Les recommandations pour la prévention des désordres dus à l’alcali-réaction, établies
par le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées en juin 1994, sont en cours de
révision. A ce titre, il existe quatre normes relatives au phénomène de l’alcali-réaction :
FD P 18-542 (2017) « Granulats - Critères de qualification des granulats naturels pour
béton hydraulique vis-à-vis de l'alcali-réaction »,
XP P 18-594 (2015) « Granulats - Méthodes d'essai de réactivité aux alcalis »,
NF P 18-454 (2004) « Béton - Réactivité d'une formule de béton vis-à-vis de l'alcali-
réaction - Essai de performance »,
FD P 18-456 (2004) « Béton - Réactivité d'une formule de béton vis-à-vis de l'alcali-
réaction - Critères d'interprétation des résultats de l'essai de performance ».
# Pour en savoir plus
Le principe de prévention s’articule sur la détermination d’un niveau de prévention
parmi trois possibilités en fonction de la catégorie de l’ouvrage et de sa classe
d’exposition que l’on peut schématiser selon :
Catégorie d’ouvrage + classe d’exposition climatique ► niveau de prévention.
Les catégories d’ouvrage sont regroupées dans le tableau page suivante. Catégorie
Ouvrages
EDITIONS GINGER - Collection L’ESSENTIEL - Fissuration - Edition 2020 21
1
CHAPITRE 2
ORIGINE LIEE AU MATERIAU
Catégorie Ouvrages
I Ouvrages en béton dont la résistance caractéristique est < 16 MPa
Eléments non porteurs situés à l’intérieur des bâtiments
Eléments aisément remplaçables
Ouvrages provisoires
La plupart des produits préfabriqués en béton
II La plupart des bâtiments et ouvrages de génie civil
III Ouvrages de génie civil pour lesquels l’apparition du risque d’alcali-réaction est jugée
inadmissible (bâtiments réacteurs des centrales nucléaires et réfrigérants, barrages,
tunnels, ponts et viaducs exceptionnels, monuments et bâtiments de prestige)
Les classes d’exposition liées à l’environnement climatique sont résumées dans le
tableau ci-dessous.
Classes d’exposition Types d’ouvrages ou de parties d’ouvrage
Intérieur de bâtiments ou de bureaux
Classe 1
Ouvrages protégés contre les sources d’eau, les intempéries et les
Environnement sec ou peu
condensations
humide
Dallages sur terre-plein drainé
hygrométrie < 80 %
Pièces d’épaisseur inférieure à 50 cm
Gel peu fréquent et peu intense
Intérieurs de bâtiments où l’humidité est élevée (laveries, réservoirs,
piscines, …)
Classe 2
Parties extérieures exposées
Environnement avec Parties en contact avec un sol non agressif et/ou l’eau
hygrométrie > 80 % ou en
Avec gel
contact avec l’eau
Parties extérieures exposées au gel
Parties en contact avec un sol non agressif et/ou l’eau et exposées au gel
Parties intérieures où l’humidité est élevée et exposées au gel
Classe 3
Environnement avec
Parties intérieures et extérieures exposées au gel et aux fondants salins
hygrométrie > 80 % et avec
gel et fondants salins
Gel peu fréquent et peu intense
Éléments complètement ou partiellement immergés dans l’eau de mer ou
éclaboussés par celle-ci
Classe 4 Éléments exposés à un air chargé en sel (zone côtière)
Environnement marin Avec gel
Éléments complètement ou partiellement immergés dans l’eau de mer ou
éclaboussés par celle-ci et exposées au gel
Éléments exposés à un air chargé en sel et au gel
22 EDITIONS GINGER - Collection L’ESSENTIEL - Fissuration - Edition 2020
CHAPITRE 2
ORIGINE LIEE AU MATERIAU
1
A partir d’une classification des ouvrages en trois catégories représentatives du risque
que le maître d’ouvrage est prêt à accepter et de la définition des quatre classes
d’exposition climatique, les recommandations du LCPC déterminent trois niveaux de
prévention allant de A à C qui sont résumées dans le tableau suivant.
Catégorie d’ouvrage Classe d’environnement
1 2 3 4
I A A A A
II A B B B
III C C C C
Pour chacun d’eux, un type de précaution est préconisé.
C’est ainsi que pour le niveau A, il est simplement demandé de s’assurer que les
constituants et leur mélange sont conformes aux normes, sans se préoccuper du
risque d’alcali-réaction.
En revanche, les recommandations sont plus contraignantes pour le niveau B, qui
s’applique à la plupart des ouvrages.
En effet, elles prescrivent un examen de la réactivité des granulats, un établissement
du bilan total des alcalins, la vérification expérimentale de l’absence de risques de
gonflement du béton sur un critère de performance.
Enfin, en ce qui concerne le niveau C, il est recommandé de n’utiliser que des granulats
non réactifs.
####
2 B - Béton et mortier
Le schéma ci-contre nous présente différents
Le béton est poreux
types « d’échanges » au travers du matériau
béton en fonction de la porosité de ce dernier.
DIFFUSION FLUIDE
z Adsorption d ’eau
z Adsorption d ’ions
z Créationde
nouveaux produits
z Dissolution de
produits
ECHANGE DE
z Réarrangement
MATIERE
microstructure
EDITIONS GINGER - Collection L’ESSENTIEL - Fissuration - Edition 2020 23
1
CHAPITRE 2
ORIGINE LIEE AU MATERIAU
2 B.1 - RETRAIT
ÆÆ Phénomène
Le béton est un mélange composé de ciment et d’additions, d’eau, de granulats (sables
et gravillons) et d’adjuvants.
Le ciment et l’eau réagissent pour former des composés hydratés qui, en se solidifiant,
liaisonnent les granulats.
La quantité d’eau nécessaire à l’hydratation du ciment représente environ 25 % du
poids de ce dernier.
Ainsi pour un béton caractérise par un rapport E/C = 0,60 avec une quantité de ciment
C = 300kg/m3, seuls 75 litres d’eau sont nécessaires pour hydrater le ciment. Les
105 litres d’eau supplémentaires contribueront à la création de porosité (soit environ
10,5%) et au phénomène de retrait.
On définit le retrait du béton comme étant une variation dimensionnelle qui met en
cause des phénomènes physiques et/ou chimiques et qui se produit avant, pendant ou
après la prise.
Ces variations dimensionnelles peuvent être la cause de fissurations lorsqu’elles ne
sont pas maîtrisées (insuffisance de ferraillage, absence de joints, …). Il faut cependant
faire la différence entre la fissuration liée au retrait et celle liée au fonctionnement des
ouvrages, cette dernière étant maîtrisée par le dimensionnement (Eurocode).
Tout rajout d’eau intempestif, comme tout bétonnage par temps chaud ou vent
important, ne manquera pas de favoriser les phénomènes de retrait.
Fissuration de retrait au sein d’un dallage
Parmi les différents textes qui mettent en avant ce point, nous trouvons :
L’Eurocode 2 qui traite d’une section « Maîtrise de la fissuration » : on y retrouve
24 EDITIONS GINGER - Collection L’ESSENTIEL - Fissuration - Edition 2020
CHAPITRE 2
ORIGINE LIEE AU MATERIAU
1
la clause 7.3.1 (2) qui précise que «La fissuration est normale dans les structures
en béton armé soumises à des sollicitations de flexion, d’effort tranchant, de torsion,
ou de traction résultant soit d’un chargement direct soit de déformations gênées ou
imposées».
En complément la cause 7.3.1.(3) stipule que « Les fissures peuvent avoir d’autres
causes telles que le retrait plastique ou des réactions chimiques expansives internes au
béton durci. L’ouverture de telles fissures peut atteindre des valeurs inacceptables mais
leur prévention et leur maîtrise n’entrent pas dans le cadre de cette présente section ».
Le DTU 13.3 (NF P 11-213) relatif à la conception, au calcul et à l’exécution des dallages
précise dans l’article 5 « Conception du dallage » que « La fissuration du béton, armé
ou non, étant un phénomène inhérent à la nature du matériau, le présent document vise
à limiter la densité et l’ouverture des fissures sans prétendre éviter leur formation ».
Il est somme toute difficile de distinguer les retraits élémentaires au sein du matériau
béton, car ils se produisent simultanément et sur des échéances de temps plus ou
moins longues.
On distingue « classiquement » cinq types de retrait :
1 – Le retrait plastique qui se produit lorsque le béton est à l’état frais.
Il est défini comme étant la contraction du béton en phase plastique et se développe
lorsque la quantité d’eau qui s’évapore à la surface est supérieure à la quantité d’eau
de ressuage.
La phase plastique est la période pendant laquelle le béton ne présente pas de
cohésion, c’est-à-dire entre la fabrication et le début de prise. Mais comme il est difficile
de mesurer le début de prise sur un béton, le retrait plastique est pris en compte jusqu’à
la fin de prise.
Positionnement du retrait plastique par rapport à la phase plastique
En termes de phénoménologie, ce retrait est en général lié aux déformations du béton
frais par tassement et si ces déformations sont gênées, on voit apparaître des fissures
au droit d’obstacles comme les armatures.
2 – Le retrait de dessiccation : il est lié au séchage et se produit avant, pendant et
après la prise. Classiquement le retrait de dessiccation est de l’ordre de 1 mm/m. La
fissuration qui se développe est due à la dépression capillaire au niveau des ménisques.
EDITIONS GINGER - Collection L’ESSENTIEL - Fissuration - Edition 2020 25
1
CHAPITRE 2
ORIGINE LIEE AU MATERIAU
Les facteurs influant ce séchage sont :
zz le rapport surface/volume : la perte d’eau est plus faible lorsque le rapport surface/
volume est faible,
zz la porosité,
zz le degré hygrométrique de l’air ambiant : le vent est essentiel.
3 – Le retrait thermique est celui qui se développe lorsque les pièces en béton
reviennent à température ambiante après un échauffement consécutif aux réactions
exothermiques d’hydratation. Ce type de retrait concerne les pièces massives
(typiquement 80 cm d’épaisseur) et se manifeste plusieurs heures (voire semaines)
après la mis en œuvre du béton.
4 – Le retrait endogène (ou d’auto dessiccation) qui est lié aux réactions d’hydratation
qui engendrent une contraction du béton et ceci dans des conditions où la dessiccation
ne peut se produire. Ce retrait est la conséquence de ce que l’on appelle la contraction
de Le Chatelier (le volume des hydrates formés est plus faible que celui de l’eau et du
ciment anhydre). S’il est assez important pour les bétons hautes performances (BHP)
ou les bétons très hautes performances (BTHP), il est négligeable pour les bétons
ordinaires.
5 – Le retrait de carbonatation qui est la conséquence de la réaction de la pâte de
ciment hydratée avec le gaz carbonique de l’air. Ce retrait intervient dans une moindre
mesure sauf sur les éléments très minces (plaques).
Il est évident que la fissuration, lorsqu’elle est avérée, est la conséquence de tous ces
types de retrait et qu’il est très difficile de les individualiser.
ÆÆ Prévention
De ce qui précède, on s’aperçoit qu’il n’est pas possible de s’affranchir totalement du
retrait et de ses conséquences.
En revanche, on peut en limiter l’importance à une valeur telle que le phénomène ne se
traduise pas par une fissuration.
Les méthodes couramment employées pour y parvenir sont principalement de deux
types, limitation de la quantité d’eau ainsi que des pertes de laitance qui peuvent se
produire en certains points particuliers des coffrages et renforcement du béton et des
mortiers par des armatures.
Limitation de la quantité d’eau
On y parvient par une formulation adaptée de la composition du béton et par l’emploi
d’adjuvants tels que les plastifiants et super plastifiants qui permettent de maintenir
l’ouvrabilité du béton tout en réduisant notablement le volume d’eau entrant dans le
mélange.
26 EDITIONS GINGER - Collection L’ESSENTIEL - Fissuration - Edition 2020
Vous aimerez peut-être aussi
- La fin du ciment: Les bonnes et les mauvaises raisons d'une technologie sans avenirD'EverandLa fin du ciment: Les bonnes et les mauvaises raisons d'une technologie sans avenirÉvaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (1)
- ELLUL - Le Système TechnicienDocument21 pagesELLUL - Le Système TechnicienAnna LongoPas encore d'évaluation
- Pathologies Des BétonsDocument13 pagesPathologies Des BétonsWiem Zouaoui100% (1)
- Réparation Des Ouvrages en Béton Armé ORANDocument67 pagesRéparation Des Ouvrages en Béton Armé ORANwalid dey100% (1)
- Stockage de Leau Ouvrages en Beton PDFDocument3 pagesStockage de Leau Ouvrages en Beton PDFChems-eddine BenslimanePas encore d'évaluation
- Expo FissurationDocument46 pagesExpo Fissurationkhadim tall100% (1)
- Les FissuresDocument9 pagesLes FissuresChaima BouraouiPas encore d'évaluation
- Durabilite Du BetonDocument71 pagesDurabilite Du Betonkj100% (1)
- Pathologies Et Rehabilitation Des StructuresDocument41 pagesPathologies Et Rehabilitation Des StructuresRyane Yedjer100% (1)
- Maternelle Activités de Psychomotricité en Famille - QUEBECDocument31 pagesMaternelle Activités de Psychomotricité en Famille - QUEBECAymane KalaiPas encore d'évaluation
- Chapitre I Propriétés Des Bétons M1MatDocument9 pagesChapitre I Propriétés Des Bétons M1MatRokiya AzziPas encore d'évaluation
- Bac 2023 Polynésie STI2D Innovation Technologique Et Éco-ConceptionDocument33 pagesBac 2023 Polynésie STI2D Innovation Technologique Et Éco-ConceptionLETUDIANT75% (4)
- Interessant! Durabilité Du BétonDocument11 pagesInteressant! Durabilité Du BétonAicha Ait TiziPas encore d'évaluation
- Cours Pathologies Bât-Mise À Jour 2020-2021Document59 pagesCours Pathologies Bât-Mise À Jour 2020-2021Cheick SawadogoPas encore d'évaluation
- RÉHABILITATION ET MAINTENANCE DES BÂTIMENTS Chapitre 2Document13 pagesRÉHABILITATION ET MAINTENANCE DES BÂTIMENTS Chapitre 2SAIDA GENIE CIVIL100% (1)
- Cross-Reference-Application-Catalogue Zexel MICO Bosch DENSODocument34 pagesCross-Reference-Application-Catalogue Zexel MICO Bosch DENSOHisham Hamdi100% (2)
- Pathologie Du Beton Et Des Elements de RemplissageDocument21 pagesPathologie Du Beton Et Des Elements de RemplissageChokri RekikPas encore d'évaluation
- Cours 1 Pathologie RéhabilitationDocument46 pagesCours 1 Pathologie RéhabilitationLelouch BritaniaPas encore d'évaluation
- PorositéDocument13 pagesPorositéFarid BelalPas encore d'évaluation
- Exam DurabilitéDocument4 pagesExam DurabilitéIbrahim BenarousPas encore d'évaluation
- PorositéDocument14 pagesPorositéFarid BelalPas encore d'évaluation
- Pathologie B-Ton SGIDocument8 pagesPathologie B-Ton SGIkakem61Pas encore d'évaluation
- Alcali-Réactions+ Durabilité BoisDocument8 pagesAlcali-Réactions+ Durabilité BoisRamzi ChemaliPas encore d'évaluation
- La Fissuration Des Ouvrages en BétonDocument7 pagesLa Fissuration Des Ouvrages en BétonAbdou SelkaPas encore d'évaluation
- Chap 4-5-6 Reparation Et Renforcement Des Batiments v1Document18 pagesChap 4-5-6 Reparation Et Renforcement Des Batiments v1Ala SelmiPas encore d'évaluation
- Cour 2Document25 pagesCour 2debboune aminaPas encore d'évaluation
- Fi Pathologie Batiment d12 Desordres Revetements FacadesDocument4 pagesFi Pathologie Batiment d12 Desordres Revetements FacadesACPas encore d'évaluation
- 7-Matériaux de RéparationDocument3 pages7-Matériaux de Réparationsam1gc geniec21Pas encore d'évaluation
- Fi Pathologie Batiment b01 Remontees CapillairesDocument4 pagesFi Pathologie Batiment b01 Remontees CapillairesKhadim NdoyePas encore d'évaluation
- Défauts Du BétonDocument6 pagesDéfauts Du BétonBaye DiopPas encore d'évaluation
- Chiapitre 1Document10 pagesChiapitre 1Boulerbah ToumiPas encore d'évaluation
- CCTP - BA-BP - V3-3 - Cle2f29c4 (1) .OdtDocument161 pagesCCTP - BA-BP - V3-3 - Cle2f29c4 (1) .OdtmohPas encore d'évaluation
- EtanchéitéDocument60 pagesEtanchéitéDriss DoudiPas encore d'évaluation
- A9 Toitures TerrassesDocument57 pagesA9 Toitures TerrassesElhcen ElfarouahPas encore d'évaluation
- PDF 04 Durabilite BA-2 PDFDocument36 pagesPDF 04 Durabilite BA-2 PDFAhmed BenabdelkaderPas encore d'évaluation
- 4 Durabilit BetonDocument30 pages4 Durabilit Betonbadr19eddinePas encore d'évaluation
- Rapport UrbanismeDocument14 pagesRapport Urbanismenajwa bensaidPas encore d'évaluation
- Chap0-3 Diagnostic Des Ouvrages en Genie CivilDocument17 pagesChap0-3 Diagnostic Des Ouvrages en Genie CivilFiras HasniPas encore d'évaluation
- 3 - Recommandations Pour La Prévention Des Désordres Liés Aux Réactions Sulfatiques InternesDocument11 pages3 - Recommandations Pour La Prévention Des Désordres Liés Aux Réactions Sulfatiques InternesÎlyâs BôûsbââPas encore d'évaluation
- T3 FR FissurationDocument24 pagesT3 FR FissurationEmanuelPas encore d'évaluation
- Toumi HamadiDocument10 pagesToumi HamadiBoulerbah ToumiPas encore d'évaluation
- Hapitre N°: Pathologies Des Structures en Beton ArmeDocument6 pagesHapitre N°: Pathologies Des Structures en Beton Armerania hjaiejPas encore d'évaluation
- Chap 6Document30 pagesChap 6Milica SavicPas encore d'évaluation
- Nouvelles Recommandations RSI - BGDocument63 pagesNouvelles Recommandations RSI - BGpersoazizPas encore d'évaluation
- Cours Beton Arme - V1Document179 pagesCours Beton Arme - V1SOROPas encore d'évaluation
- L HumiditéDocument40 pagesL HumiditéHadjer ArchoPas encore d'évaluation
- 1602 Fiche CongoDocument3 pages1602 Fiche CongoMichael Van Minh NguyenPas encore d'évaluation
- Chap 5&6Document18 pagesChap 5&6Guelord MayelePas encore d'évaluation
- Rapports Sur Les Pathologie Des StructureDocument8 pagesRapports Sur Les Pathologie Des StructureaaerPas encore d'évaluation
- Chap 10 PDFDocument100 pagesChap 10 PDFMoutiePas encore d'évaluation
- Résumé Logigramme Décisionnel Gestion OA Atteint de RGIDocument2 pagesRésumé Logigramme Décisionnel Gestion OA Atteint de RGIalexoplayPas encore d'évaluation
- Sikalastic - 220 WDocument3 pagesSikalastic - 220 WYassin AdhriPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 Corrosion Des Armatures Bat3Document14 pagesChapitre 3 Corrosion Des Armatures Bat3chihebamara22Pas encore d'évaluation
- Memento Pathologie - S-Antit 2016-2017Document14 pagesMemento Pathologie - S-Antit 2016-2017Ghasston MradPas encore d'évaluation
- Béton Armé AcDocument43 pagesBéton Armé AcOmayma AbouothmanePas encore d'évaluation
- Stal9781614996569 1873Document4 pagesStal9781614996569 1873mourad mouradPas encore d'évaluation
- Durabilite Classe D Exposition PDFDocument6 pagesDurabilite Classe D Exposition PDFAbdou AmiPas encore d'évaluation
- 2403fiches Patho Reaction Sulfatique PDFDocument4 pages2403fiches Patho Reaction Sulfatique PDFaliPas encore d'évaluation
- Chap 3 Durabilite Du Beton Vis A Vis Des Agents AgressifsDocument42 pagesChap 3 Durabilite Du Beton Vis A Vis Des Agents AgressifsAhmed InfirmierPas encore d'évaluation
- Chapitre 2Document9 pagesChapitre 2Abderrahim BoulanouarPas encore d'évaluation
- 2016 Conference PFCIndicateursde DurabiliteDocument38 pages2016 Conference PFCIndicateursde DurabilitealiPas encore d'évaluation
- Reparation Et ProtectionDocument54 pagesReparation Et Protectionwalid deyPas encore d'évaluation
- Declaration Effectif Chef Etbli Ou MO Cle265c7fDocument1 pageDeclaration Effectif Chef Etbli Ou MO Cle265c7fAymane KalaiPas encore d'évaluation
- Catalogue CSTB Formations 2023Document16 pagesCatalogue CSTB Formations 2023Aymane KalaiPas encore d'évaluation
- NOT LoingDocument16 pagesNOT LoingAymane KalaiPas encore d'évaluation
- 12 - Rockwool - FP - Rockfacade - 202202Document2 pages12 - Rockwool - FP - Rockfacade - 202202Aymane KalaiPas encore d'évaluation
- Brochure Kipstadium Offres EntreprisesDocument2 pagesBrochure Kipstadium Offres EntreprisesAymane KalaiPas encore d'évaluation
- Att e Cahier 3810Document25 pagesAtt e Cahier 3810Aymane KalaiPas encore d'évaluation
- Annexe 18 - Avis Bon Fonctionnement - ExutoiresDocument1 pageAnnexe 18 - Avis Bon Fonctionnement - ExutoiresAymane KalaiPas encore d'évaluation
- EXE9Document3 pagesEXE9Aymane KalaiPas encore d'évaluation
- Attestation Blocs Autonomes Declairage de Sécurité ZSWAPI 1Document1 pageAttestation Blocs Autonomes Declairage de Sécurité ZSWAPI 1Aymane KalaiPas encore d'évaluation
- EXE8Document2 pagesEXE8Aymane KalaiPas encore d'évaluation
- Technico-Commercial: CoursDocument8 pagesTechnico-Commercial: CoursAymane KalaiPas encore d'évaluation
- Correction ExamenP Archiavancées 2022 - VFDocument6 pagesCorrection ExamenP Archiavancées 2022 - VFpfe projetPas encore d'évaluation
- Eurl Leader: Devis Quantitatif Et EstimatifDocument3 pagesEurl Leader: Devis Quantitatif Et EstimatifMahdi RAFFAOUIPas encore d'évaluation
- Recherche TabouDocument30 pagesRecherche TabouNOUHAYLA MAJDOUBIPas encore d'évaluation
- S5 Conception TDDocument20 pagesS5 Conception TDouthmaneoudrhiriPas encore d'évaluation
- Up X898MD PDFDocument9 pagesUp X898MD PDFSteev WolfPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 Vocabulaire de La Métrologie PDFDocument4 pagesChapitre 3 Vocabulaire de La Métrologie PDFfaroukkheddaouiPas encore d'évaluation
- Suite Cahier D'algo Eleves Jeu SerpentDocument3 pagesSuite Cahier D'algo Eleves Jeu SerpentgkhiolkPas encore d'évaluation
- NF - 12811 Norme Europeine Des EchafaudagesDocument20 pagesNF - 12811 Norme Europeine Des EchafaudagesGhiwa CHOKERPas encore d'évaluation
- 1 EMD 14 Décembre 2004 Electronique de PuissanceDocument1 page1 EMD 14 Décembre 2004 Electronique de PuissanceAmadou SARRPas encore d'évaluation
- Prise - de - Mesure CUISINE PDFDocument3 pagesPrise - de - Mesure CUISINE PDFAmir JmiliPas encore d'évaluation
- Decision Recrutement 24ll.t/t.: Dahir Relative Telle Que Modilïée Par Mai Particulier La Nfif Par Janvier LaDocument3 pagesDecision Recrutement 24ll.t/t.: Dahir Relative Telle Que Modilïée Par Mai Particulier La Nfif Par Janvier LaholidaymanPas encore d'évaluation
- Demande de Stage 2022Document4 pagesDemande de Stage 2022Flora ApobaPas encore d'évaluation
- Patrick Modiano - La Petite BijouDocument51 pagesPatrick Modiano - La Petite BijouBraw AntonioPas encore d'évaluation
- Présentation Du Processus DDocument3 pagesPrésentation Du Processus DFranck Sem'sPas encore d'évaluation
- Exercices Pratiques StoryboardDocument2 pagesExercices Pratiques StoryboardJay BeePas encore d'évaluation
- Serie Travail À DomileDocument8 pagesSerie Travail À Domilesaa naaPas encore d'évaluation
- Verins HydrauliquesDocument39 pagesVerins HydrauliquesĄmįñą ĄłłąmPas encore d'évaluation
- Powerpoint FAOUZIADocument20 pagesPowerpoint FAOUZIANoel SomdaPas encore d'évaluation
- DAO-cahier de Charges-Deploiement Ip Telephonie-09-04-2018Document13 pagesDAO-cahier de Charges-Deploiement Ip Telephonie-09-04-2018sedgo.glpi.uemoaPas encore d'évaluation
- Infox, Théories Du Complot Et Biais CognitifsDocument4 pagesInfox, Théories Du Complot Et Biais Cognitifsmourillyes88Pas encore d'évaluation
- MDF2Document4 pagesMDF2MouäädPas encore d'évaluation
- Poster Model Masterial 2020-2021Document1 pagePoster Model Masterial 2020-2021FC Béchö BeckkichaPas encore d'évaluation
- 7MO51TE0321 Partie2-ApprendreDocument19 pages7MO51TE0321 Partie2-Apprendreks3065097Pas encore d'évaluation
- Historique Des CommandesDocument8 pagesHistorique Des CommandesChrif KouidhiPas encore d'évaluation
- CGOC ClientDocument15 pagesCGOC ClientLouay Ben HadjPas encore d'évaluation
- Remote Controller PC ARFHEDocument39 pagesRemote Controller PC ARFHEΔημήτριος ΛαγόςPas encore d'évaluation
- Dante Mélanges de Critique (... ) Bpt6k34138401Document458 pagesDante Mélanges de Critique (... ) Bpt6k34138401SamuelLaperchePas encore d'évaluation