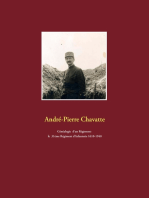Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Rha 361
Transféré par
eric.caillet26Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Rha 361
Transféré par
eric.caillet26Droits d'auteur :
Formats disponibles
Revue historique des armées
252 | 2008
Guerre et cinéma
Édition électronique
URL : http://journals.openedition.org/rha/361
ISBN : 978-2-8218-0516-3
ISSN : 1965-0779
Éditeur
Service historique de la Défense
Édition imprimée
Date de publication : 15 septembre 2008
ISSN : 0035-3299
Référence électronique
Revue historique des armées, 252 | 2008, « Guerre et cinéma » [En ligne], mis en ligne le 16 septembre
2008, consulté le 07 août 2020. URL : http://journals.openedition.org/rha/361
Ce document a été généré automatiquement le 7 août 2020.
© Revue historique des armées
1
SOMMAIRE
Dossier
Le cinéma au service de la défense, 1915-2008
Violaine Challéat
Guerre et cinéma à l’époque nazie
Films, documentaires, actualité et dessins animés au service de la propagande
Claire Aslangul
Les services cinématographiques militaires français pendant la Seconde Guerre mondiale
Stéphane Launey
Les représentations successives de la Résistance dans le cinéma français
Jean-François Dominé
Les guerres de la DEFA
La vision antifasciste du cinéma est-allemand
Cyril Buffet
Variations
Autour du Code de justice maritime (1858-1965)
Une brève histoire de la justice maritime
Jean-Philippe Zanco
La coopération aéronautique franco-italienne pendant la Grande Guerre
Patrick Facon
Les artistes d’avant-garde au combat
Évolution et redéfinition de la pratique de l’art pendant la Grande Guerre (1914-1918)
Carl Pépin
Le personnel de l’aérostation maritime française (1917-1919)
L’exemple des patrouilles de Bretagne et de la Loire
Thierry Leroy
Israël-États-Unis, de la reconnaissance historique à l’alliance stratégique
Histoire des relations stratégiques et diplomatiques, 1948-2004
Gérard Claude
Vincennes
Vincennes dans la Grande Guerre
Alain Marzona et Emmanuel Pénicaut
Revue historique des armées, 252 | 2008
2
Les fonds du Service historique de la Défense
Le fichier général des militaires de l'armée française décédés au cours de la Première Guerre
mondiale
Christian Lemarchand
Lectures
Raymond Boisseau, Ladislas Berchény, magnat de Hongrie, maréchal de France
Paris, Budapest, Szeged, Publication de l’Institut hongrois de Paris, 2006
Jean-Pierre Bois
Laurent Cohen-Tanugi, Guerre ou paix, essai sur le monde de demain
Grasset, Paris, 2007, 231 pages
Alain Marzona
Isabelle Davion, Jerzy Kloczowski et Georges-Henri Soutou (dir.), La Pologne et l’Europe du
partage à l’élargissement (XVIIIe-XXIe siècles)
PUPS, Paris, 2007, 290 pages
Anne-Aurore Inquimbert et Alain Marzona
Eugène-Jean Duval, Aux sources officielles de la colonisation française, tome 1, Études
Éditions Thélès, Paris, 2007
Valérie Caniart
Gérard D. Khoury, Une tutelle coloniale. Le mandat français en Syrie et au Liban.
Écrits politiques de Robert de Caix
Belin, Paris, 2006, 536 pages
Anne-Aurore Inquimbert
Frédéric Lert, Mirage F1, tome 1
Histoire et Collections, Coll. « Les matériels de l’armée de l’Air », 2007, 66 pages.
Gilles Krugler
Serge Métais, Histoire des Albanais, des Illyriens à l’indépendance du Kosovo
Fayard, 2006, 450 pages
Alain Marzona
Axel Poniatowski, Cécile Maisonneuve, Benjamin Franklin
Perrin, 2008, 341 pages
Robert Doughty
François Rouquet, Fabrice Virgili et Danièle Voldman (dir.), Amours, guerres et sexualité
1914-1945
Gallimard – BDIC/Musée de l’armée, 2007, 176 pages
Benoît Lagarde
Thierry Sarmant (dir.), avec la collaboration de Guillaume Lasconjarias, Benjamin Mercier,
Emmanuel Pénicaut et Mathieu Stoll, Les ministres de la Guerre, 1570-1792 : histoire et
dictionnaire biographique
Belin/ministère de la Défense, Paris, 2007, 653 pages
Antoine Boulant
Revue historique des armées, 252 | 2008
3
Dossier
Revue historique des armées, 252 | 2008
4
Le cinéma au service de la défense,
1915-2008
Violaine Challéat
1 Après la naissance de la technique photographique dans les années 1830, les autorités
militaires furent sensibilisées rapidement, mais en vain, au potentiel que la
photographie pouvait représenter pour la stratégie et l’instruction des troupes 1.
En 1895, les frères Lumière mettent au point le cinématographe. Avant même que
l’armée ne s’intéresse directement à ce nouveau vecteur d’information, les premiers
films tournés comptent des scènes à caractère militaire : plus d’une centaine de « vues
militaires » sont ainsi réalisées par les Lumière et leurs opérateurs dès 1896, en France
et à l’étranger 2. Vingt ans après, l’armée française engagée dans un conflit mondial se
dote d’un organisme dédié à la prise de vues animées de ses opérations : la section
cinématographique de l’armée. Dès lors, elle n’aura de cesse d’utiliser cet outil pour
réaliser en temps de guerre comme en temps de paix les films qui serviront à étayer son
discours et à écrire son histoire. Retracer en quelques pages l’évolution de cette
structure et de la façon dont l’armée s’est organisée pour filmer la guerre depuis 1915
relève de la gageure. Nous tenterons d’en préciser les principales caractéristiques, en
invitant le lecteur à consulter les ouvrages indiqués en bibliographie 3.
1915-1919, les années fondatrices
2 La création de la Section cinématographique de l’armée (SCA) intervient en
février 1915, quelques mois avant celle de la Section photographique. Le ministère de la
Guerre entend d’une part rattraper le retard pris sur l’armée allemande, qui s’est
organisée dans ce domaine dès septembre 1914, et d’autre part répondre au souhait des
sociétés de cinéma Gaumont, Pathé, Éclair et Éclipse de pouvoir filmer les combats. Ce
seront donc des hommes en uniforme qui tourneront les seules images du front. Deux
autres ministères, celui des Affaires étrangères et celui de l’Instruction publique et des
Beaux-arts, participent à la création de ces structures. En janvier 1917, les deux
sections sont réunies en une seule, la Section photographique et cinématographique de
l’armée (SPCA) par Lyautey. Le ministre rappelle la même année dans une directive au
Revue historique des armées, 252 | 2008
5
général commandant les armées du Nord et du Nord-Est les deux objectifs principaux
de cet outil, « permettre la réunion d’archives aussi complètes que possible concernant toutes
les opérations militaires » et « rassembler, pour la propagande française à l’étranger, des clichés
et des films susceptibles de montrer la bonne tenue des troupes, leur entrain et les actions
héroïques qu’elles accomplissent ». Cette ligne de conduite dans la réalisation des images
et dans leur conservation à titre d’archives sera désormais, le vocabulaire évoluant,
celle de l’organisme chargé de produire photographies et films pour l’armée. Qu’il
s’agisse de la Section cinématographique, du Service cinéma des armées, puis de
l’Établissement cinématographique et photographique de l’armée et enfin de l’ECPAD,
ceux-ci ont toujours exercé simultanément des fonctions de production et de
conservation.
3 Les premiers opérateurs de la SCA sont des cameramen issus de maisons privées. Leur
travail sur le terrain est rigoureusement encadré : déplacement uniquement sur ordre
de mission du ministère de la Guerre ou du Grand Quartier général, prise en charge sur
le front par un officier d’état-major... Photographes et cameramen travaillent toujours
de concert : leurs images portent ainsi sur les mêmes thèmes. Le matériel utilisé est au
départ celui des opérateurs dans le civil, puis des caméras sont louées. Chacun envoie
ses négatifs à la maison de production à laquelle il est rattaché, qui est chargée du
tirage et du développement des films. Les épreuves montées et dotées de commentaires
sur des cartons sont présentées en commission de censure militaire. L’interdiction par
la censure porte avant tout sur des images qui pourraient nuire au moral de l’arrière et
des troupes ou qui divulgueraient le secret des opérations. Un exemplaire de chaque
film, même censuré, est remis aux archives du ministère de la Guerre avec les épreuves
de tournage. Enfin, le bureau parisien de la section se charge de l’inventaire et de
l’archivage des documents. Des copies de projection sont réalisées pour être diffusées
dans les salles de cinéma françaises et étrangères. À partir de 1917, un film d’actualités
est composé toutes les semaines : sous le titre des Annales de la Guerre, il présente cinq à
six sujets militaires, politiques, internationaux ou artistiques. Chaque numéro des
Annales est tiré à vingt-cinq exemplaires et envoyé dans les pays où des contrats
d’exploitation ont été signés. Ces images sont destinées à rassurer les familles et à
divertir les soldats. En effet, la SCA crée des structures de diffusion spécifiques : le
« cinéma aux poilus » en 1915 et en 1917 « le ciné cantonnements », dans près de
400 salles de projection. Les « tournées cinématographiques » permettent enfin de
projeter ces images dans les zones rurales. Avec le théâtre aux armées, le cinéma des
armées devient le mode de distraction favori des poilus.
4 Neuf cent trente films ont été réalisés par la section entre 1915 et juillet 1919 4. Les
conditions de tournage des images, dans un contexte très encadré, avec la contrainte
d’un matériel encombrant et lourd – l’opérateur transporte caméra, trépied et bobines
en nitrate de cellulose – expliquent que la section filme surtout les à-côtés de la
bataille : les transports de troupes ou d’artillerie, les blessés, les prisonniers, les
cantonnements... Pour compléter ces images, on réalise des mises en scènes. Les images
tournées grâce à des caméras à manivelle sont en noir et blanc et muettes. L’action est
mise en valeur par les cartons, les titres et les intertitres, ou certaines techniques de
colorisation comme le teintage ou le virage. En 1915 et 1916, les nombreux films courts
réalisés constituent des petits sujets sur toutes les facettes de la guerre, et véhiculent
un discours engagé et patriotique.À partir de 1917, le savoir-faire des opérateurs de la
section et les exigences du public contribuent à l’évolution de la production vers un
Revue historique des armées, 252 | 2008
6
réalisme accru. Les cadavres apparaissent à l’écran, les premiers assauts sont filmés en
juillet 1916 dans la Somme et sur la cote 304 à Verdun en juillet 1917. Outre les Annales
de la guerre, le catalogue de la section s’enrichit de films documentaires et de longs
métrages « récapitulatifs » 5. Certains films sont enfin tournés à partir d’un scénario
élaboré, avec des acteurs professionnels dirigés par un réalisateur chevronné 6.
5 Après l’Armistice et avec la démobilisation, la raison d’être de la SPCA disparaît. La
structure est dissoute par arrêté du 10 septembre 1919, les pellicules et les plaques
photographiques sont remises au ministère de l’Instruction publique, les hommes sont
démobilisés.
1919-1945, à la recherche d’un service cinéma des
armées organisé et unifié
6 Au sortir de la guerre, le devenir de la production cinématographique militaire est
hésitant : le matériel de la section doit être en théorie partagé entre le service de
l’intendance, le sous-secrétariat à la liquidation des stocks et l’office central
d’expansion nationale. Par une note du 17 juin 1920, le cabinet du ministre de la Guerre
admet le principe de l’organisation d’une section cinématographique militaire ou
section de l’enseignement par l’image à compter de janvier 1921, rattachée au service
géographique de l’armée. La nouvelle section, installée tout d’abord dans l’Hôtel des
Invalides, ne vit qu’avec une subvention de l’état-major, complétée par des recettes
provenant de cessions et de locations de films et de matériels. En 1927, son chef, le
capitaine Hoffman, est remplacé par le capitaine Calvet qui assurera le commandement
de la section jusqu’en août 1940. Celle-ci compte vingt-trois personnes dans les années
trente. L’armée crée par ailleurs dans chaque région militaire un dépôt de matériel
cinématographique et de films. Le premier film réalisé par cette nouvelle section,
en 1923, est un film d’instruction, La Section au combat. Le capitaine Calvet travaille
également à faire projeter ces films dans l’armée, en faisant doter en matériel corps de
troupes et régions militaires, et à récupérer les négatifs des films tournés pendant la
guerre, cédés depuis par le ministère de l’Instruction publique et des Beaux-arts à la
société des Archives photographiques et cinématographiques d’art et d’histoire. De leur
côté, l’armée de l’Air et la marine pérennisent également leurs capacités de
production : en 1937, l’armée de l’Air crée une section cinématographique, tandis que le
Service cinématographique de la marine voit son activité progresser à compter de 1926.
7 La déclaration de guerre, le 3 septembre 1939, fait entrer la France dans une période
durant laquelle l’information, organisée au plus haut niveau de l’État, mettra à profit
presse, radio et cinéma pour appuyer sa politique. Immédiatement, l’armée adapte
l’organisation de sa section cinématographique à ce nouveau contexte : une équipe
comprenant un officier et plusieurs opérateurs est créée dans chaque armée. La
structure centrale de la section, renforcée par l’arrivée d’officiers et de sous-officiers de
réserve et par la mobilisation de personnels civils du cinéma, s’installe dans des locaux
réquisitionnés de la société Gaumont, rue du Plateau. La guerre influe directement sur
le type de films réalisés par la section : la production de films d’instruction est stoppée,
tandis que naît le Journal de guerre, film d’actualité dont l’édition est hebdomadaire.
Comme en témoigne le réalisateur Jean Delannoy, incorporé en septembre 1939, « le
service [a] pris une ampleur considérable. (…). Chaque semaine, 10 000 mètres de films,
provenant de tous les théâtres d’opérations, étaient acheminés vers le service » 7. À Paris, cinq
Revue historique des armées, 252 | 2008
7
monteurs, dont beaucoup connaîtront une longue carrière dans le cinéma (Jean
Delannoy, René Le Hénaf, Marcel Ichac) sont dédiés à ce Journal de guerre. Les épreuves
de tournage sont soumises à la censure militaire au Grand Quartier général et à la
censure politique du commissariat à l’Information de Jean Giraudoux. Une fois validés,
les films sont sonorisés et commentés, grâce notamment à la voix des journalistes de la
radio nationale. Des copies sont diffusées en France, mais aussi dans les pays alliés et
neutres. La section devient une véritable firme d’actualités militaires, sous la brillante
direction du lieutenant-colonel Calvet, au détriment des maisons civiles dont les
infrastructures ne peuvent pas suivre. En avril 1940, le journal hebdomadaire est
complété par un magazine, Nouvelles du monde, dont seuls huit numéros paraîtront
jusqu’en juin 1940, date à laquelle la section doit se replier en Indre-et-Loire, puis à
Bordeaux. Malheureusement, une partie des archives du service confiées à une
camionnette militaire disparaissent entre Paris et Tours.
8 Avec la signature de l’armistice franco-allemand qui prévoit la démobilisation, l’effectif
du service est réduit à celui du temps de paix. En octobre 1940, le Service géographique
de l’armée (SGA), auquel la section était rattachée, devient un organisme civil, l’Institut
géographique national (IGN). La section cinématographique est alors subordonnée à la
Direction de l’artillerie, sous le nom de Service cinématographique des armées. En
novembre 1940, le service s’installe à Marseille dans les studios de la maison Pagnol.
Son organisation est repensée : il est désormais rattaché administrativement au service
du matériel, et dépend dans son travail du 3e bureau de l’état-major des armées pour ce
qui concerne l’instruction, et du cabinet du ministre (bureau de presse et propagande)
pour les autres productions. En août 1940, le lieutenant-colonel Calvet a été remplacé
par le commandant Brouillard, ancien du 2e bureau. Sous le pseudonyme de Pierre
Nord, celui-ci perpétue l’activité du service qui s’est vu attribuer par l’état-major la
mission de contribuer au message de redressement du pays prôné par l’État français et
d’avoir sur la troupe et sur la jeunesse un effet moralisateur. Dans les faits, le service
bénéficie d’une certaine indépendance pour réaliser les films d’instruction et de
propagande, dont le magazine La France en marche, initié par Pierre Nord, et des films de
long métrage. Il poursuit également son activité de cinémathèque des armées, en
assurant la diffusion de films divertissants et moralisants dans les unités de l’armée
d’armistice. À la fin de l’année 1941, il devient un « service civil du département de la
Guerre », avec les missions suivantes, « concourir à l’instruction et à l’éducation morale de
l’armée ; collaborer à la propagande faite soit pour favoriser le recrutement de l’armée, soit pour
mettre en valeur le rôle que joue celle-ci dans l’éducation morale du pays et dans la sauvegarde
de l’Empire » 8. Par ailleurs, en plus des annexes de la section à Alger et Rabat, des
centres de production sont créés pour les armées de Terre et de l’Air en Algérie, et pour
la marine au Maroc.
9 Le débarquement allié en Afrique du Nord et l’occupation de la zone sud de la France
par les Allemands, en novembre 1942, bouleversent cette organisation : de Marseille, le
service se replie à La Bourboule, dans le Puy-de-Dôme. Pierre Nord, recherché par les
Allemands, entre dans la clandestinité, laissant la direction au commandant Blech.
L’activité du service métropolitain entre dans une période d’atonie. En revanche, pour
les structures présentes en Afrique du Nord, comme la section d’Alger dont l’activité
s’était bornée depuis juin 1940 à la projection de films récréatifs, l’arrivée des alliés
marque le début d’une nouvelle ère. Des équipes renforcées permettent de couvrir les
opérations qui mèneront les troupes alliées et celles de la France libre de l’Afrique du
Nord à la Provence. Les ressources des trois armées sont mises en commun et l’on tente
Revue historique des armées, 252 | 2008
8
d’obtenir des Américains du matériel et de la pellicule, qui n’arriveront qu’à l’été 1944.
À la Libération, le personnel du service se regroupe à La Bourboule avant de regagner
Paris le 1er septembre 1944. Le service produit alors le magazine France-Libre actualités et
des films d’instruction, tout en s’efforçant de rentrer en possession des films dispersés
ou saisis en 1940 par les autorités d’occupation allemandes. Les sections des trois
armées sont réunies, sous la direction du chef d’escadron Raphel, préféré au cinéaste
René Clair. Le service cinématographique des armées, organisme unique pour les trois
armées, est enfin créé par décret du 26 juillet 1946 ; il quitte en septembre 1947 ses
locaux dispersés dans la capitale pour s’installer au Fort d’Ivry.
1946-1968, l’image animée, outil de l’action
psychologique
10 Au sortir de la guerre, le service produit des films d'instruction, souvent très
techniques, des films d'information à caractère promotionnel et développe une forte
activité de reportage. Pour mettre sur pied une stratégie d’information qui contribuera
à construire une identité à la défense nationale dont le général de Gaulle a cherché à
affirmer l’unicité, l’armée dispose de deux terrains d’expérimentation : l’Allemagne et
l’Indochine. Dans la zone d’occupation française en Allemagne, le service développe
pour le Magazine des forces françaises en Allemagne une production de films éducatifs à
l’attention des militaires, afin de leur inculquer les manières à observer « ici, en
uniforme de soldats français, où [ils ont] un rôle à tenir »9. En Indochine, le défi est plus
complexe : cherchant à susciter l’adhésion de la nation en utilisant notamment dans sa
stratégie d’information la figure de l’ennemi, l’armée est confrontée rapidement à la
difficulté de donner un contour clair à celui-ci. Du point de vue de l’organisation, le
Service presse, propagande, information mis en place le 1 er juillet 1948 disparaît en
novembre de la même année au profit du Service moral information (SMI), qui
deviendra, en février 1950, le Service militaire d’information, puis en juin 1950, le
Service presse information (SPI). Ces structures successives sont chargées de
l’information des populations en Indochine et en métropole, mais leur préoccupation
première est le contrôle des correspondants de presse présents en Indochine. La
production du SCA sur le terrain en dépend également. De Hanoï et de Saïgon, les
pellicules sont expédiées par avion à Paris où les films sont montés, puis sonorisés et
enfin mis à la disposition des journaux et des maisons de presse filmée 10. Les
reportages s'attachent dans les premiers temps à légitimer l'action de la France vis-à-
vis des populations locales – mise en valeur industrielle et agricole, mise en place de
structures administratives et scolaires... – en adoptant un ton grandiloquent hérité des
années de guerre. De nombreux sujets, dont les plus emblématiques sont les magazines
Regards sur l’Indochine, proposent une approche ethnologique de cette civilisation qui
fascine les métropolitains. Avec l’intensification des affrontements, les reporters vont
se consacrer quasi exclusivement aux combats que mène le corps expéditionnaire.
L’arrivée sur le terrain en 1950 du général de Lattre de Tassigny, fermement convaincu
de l’importance de l’image et de la communication, renforce la dimension médiatique
de cette guerre. Il crée le SPI et donne aux reporters du SCA tous les moyens pour
exercer au mieux leur métier. En suivant les troupes au plus près des combats grâce à
un matériel relativement mobile (les caméras Bell-Howell par exemple), en partageant
leurs souffrances et parfois leur tragique destin, les cameramen du SCA vont contribuer
Revue historique des armées, 252 | 2008
9
à la naissance du mythe international du reporter de guerre. Bien plus, Schoendoerffer,
Camus, Péraud ou Kowal deviennent aux yeux de leurs camarades de véritables
« soldats de l'image ».
11 En métropole, le ministère des Armées s’organise progressivement dans le domaine de
l’information : de janvier 1946 à mai 1947 sont successivement créés le Service
d’information du ministère des Armées (SIMA), le Service des informations militaires
(SIM) réduit ensuite à une Section des informations militaires, et enfin le Service
d’information du ministère de la Guerre (SIMG) commun au ministre et au chef d’État-
Major général, qui s’appuie sur les antennes développées auprès des trois secrétariats
d’État des armées. En juin 1952, le Service d’action psychologique et d’information de la
Défense nationale (SAPIDN) est créé auprès du cabinet civil du ministre de la Défense. Il
devient, en novembre de la même année, Service d’action psychologique, d’information
et cinématographique des armées (SAPICA), auquel est rattaché l’Établissement
cinématographique des armées.
12 Le nouveau conflit qui se développe en Algérie incite les autorités à amplifier et à
pérenniser ce que l’on appellera désormais « l’action psychologique ». En Algérie
comme en Indochine, il s'agit notamment de légitimer par la communication l'action de
la France, aux yeux de l'opinion, certes, mais avant tout aux yeux des appelés du
contingent qui participent à présent au conflit ainsi qu’aux yeux des autochtones.
Jusqu’à la fin de l’année 1954, le service cinéma fait partie intégrante du SAPICA. En
novembre 1954, il rejoint le service d’information, mais, par décision du 13 avril 1956,
le ministre constitue le Service d’action psychologique et d’information de la défense
nationale et des forces armées (SAPIDNFA) auquel le SCA est rattaché. Dans les faits, la
position de l’établissement est encore discutée à la fin des années 1950. Sur le terrain, le
SCA est fortement implanté avec l’annexe importante d’Alger et deux dépôts
secondaires à Oran et Constantine. Les films, notamment le Magazine militaire Algérie-
Sahara et le Magazine des Armées, insistent sur l'effort consenti pour le développement
des départements algériens, les réformes économiques du plan de Constantine et le
succès de l'industrie pétrolière dans le Sahara. Dans cette guerre qui officiellement n'en
n'est pas une, on évite de présenter des images d'opérations militaires de grande
envergure et le gouvernement général d’Alger s’applique à développer l’action de
proximité, comme celle des compagnies de tracts et de haut-parleurs. En 1958, le retour
aux affaires du général de Gaulle met fin à l'autonomie dont avait pu jouir l'antenne
d'Alger. La structuration de l’information au sein du ministère évolue encore, avec la
création en décembre 1958 du Service d’information et d’études du ministère des
Armées (SIEMA), qui reçoit en 1960 la fonction de porte-parole du ministre et la
coordination des services d’information placés auprès des trois délégués ministériels, le
REPIT (Relations extérieures presse information de l’armée de Terre), le Service
information études air et le Service presse information marine. Le 7 juin 1961, le SIEMA
devient SIECA, Service d’information, d’études et de cinématographie des armées,
rattaché au cabinet du ministre et responsable des antennes nouvellement placées
auprès des trois chefs d’état-major et du délégué pour l’armement, tandis que le SCA
devient Établissement cinématographique des armées (ECA). Ses productions
commanditées par le SIECA ou l’un des états-majors accompagnent désormais la
politique de désengagement de la France en Algérie et commencent à se focaliser sur
les nouveaux objectifs spatiaux et nucléaires du pays.
Revue historique des armées, 252 | 2008
10
1968-1998, le cinéma du service national
13 En 1969, l'ECA devient l’Établissement cinématographique et photographique des
armées (ECPA), rattaché au Service d’information et de relations publiques des armées,
le SIRPA, nouvellement créé par le ministre Michel Debré, en compagnie des quatre
SIRPA créés auprès des états-majors des armées et de la Gendarmerie nationale. Une
instruction ministérielle en date du 13 août 1971 fixe les missions de l’ECPA :
production de tous les films pour les armées, réalisation des reportages intéressant le
ministère, reproduction, diffusion et enfin conservation des films et des photographies.
L'établissement conserve donc sa mission de production de films d'instruction et
d'information, consacrés autant à la politique de dissuasion qu’à la vie quotidienne des
appelés, et se lance dans la fabrication de films plus institutionnels vantant les
nombreux succès de la technologie militaire française. Il ne s’agit plus seulement de
filmer la guerre, mais aussi de documenter la vie de l’armée française en temps de paix,
dans tous ses aspects. Le service national alimente l’établissement en jeunes talents
prometteurs, dans tous les domaines de la production : Claude Lelouch, Rémy
Grumbach ou Alain Darchy feront ainsi leurs premières armes de cinéma ou de
télévision à l’ECPA, dont la production témoigne d’une notable créativité dans la forme
du discours et du point de vue technique (avec par exemple la mise au point de la
« Louma » 11). Dans les années 1970-1980, les équipes de reporters de l’ECPA participent
aux opérations extérieures à Kolwezi, au Liban, au Tchad. L’armée française est alors
partie prenante d’opérations au côté d’autres armées nationales, et bientôt ses
engagements se feront exclusivement sous mandat de l’ONU ou de l’OTAN. À l’heure de
la télévision, l’armée se donne également les moyens d’utiliser ce média de masse : elle
dispose jusqu’à la suspension du service national de différentes émissions télévisées sur
les chaînes hertziennes, les magazines Armée 2000, Magazine Horizon et Top Défense. La
vidéo est utilisée dans la production militaire à partir des années 1980, mais les films
les plus prestigieux sont tournés en 35 mm jusqu’au début des années 1990.
Aujourd’hui, des images au service de l’actualité et de
la mémoire
14 Le 18 avril 2001, l'ECPA devient ECPAD, Établissement de communication et de
production audiovisuelle de la défense, et prend sa structure actuelle d'établissement
public à caractère administratif dépendant du ministère de la Défense, sous tutelle de la
Délégation à l'information et à la communication de la défense (DICOD), qui a remplacé
en 1998 le SIRPA. Fort de 300 personnes, civils et militaires, l'établissement continue à
produire les images d’actualité dont a besoin le ministère. Il est pour ce faire doté
d’équipes – composées au minimum d’un reporter photographe et d’un cameraman
sous la responsabilité d’un « officier image » de l’établissement – susceptibles d’être
envoyées en quelques heures sur ordre de l’état-major des armées ou du ministre de la
Défense, sur les théâtres d’opérations ou en mission intérieure, parfois avant toute
équipe de télévision. La technologie vidéo analogique puis numérique a offert aux
SIRPA d’armées la possibilité de se doter de leurs propres moyens de réalisation
audiovisuelle. La DICOD et l’EMA jouent donc un rôle de coordination dans le domaine
de la communication de défense, et de l’image en particulier, en organisant par
exemple le tour de départ des équipes en opération extérieure grâce aux alertes
Revue historique des armées, 252 | 2008
11
Guépard réparties entre l’ECPAD et le SIRPA Terre. Les progrès technologiques de la
transmission satellite et le développement du numérique ont rendu les images des
reporters presque instantanément disponibles sur le territoire métropolitain, et
accessibles aux chaînes de télévision via le réseau Globecast après validation par l’EMA.
15 Outre les tournages d’actualité, l'établissement réalise des films institutionnels et
promotionnels, principalement sur commande de son ministère, d’autres organes
gouvernementaux et des industriels de défense. La production des films d’instruction a,
en revanche, presque disparu. Des coproductions sont développées, notamment avec
les chaînes de télévision comme la chaîne parlementaire LCP sur laquelle est diffusé
chaque mois depuis 2006 le Journal de la défense réalisé par l’ECPAD. L’établissement s’est
doté en 2007 d’un nouvel outil de production numérique en réseau grâce auquel toutes
les étapes de la réalisation d’un film, de la collecte des images à la conformation finale
en passant par le montage, la création d’effets spéciaux, l’illustration sonore et
musicale, peuvent être conduites quasi simultanément. Les travaux de sauvegarde
réalisés depuis 2005 sur un fonds d’images d’archives riche de 21 000 références de
films rendent enfin les documents anciens plus accessibles et permettent leur mise en
valeur dans des productions de l’établissement, grâce à leur transfert sur des supports
pérennes et à leur traitement documentaire.
16 La modernisation de l’outil de production et des installations de conservation des
archives, ainsi que la mise en œuvre du plan de sauvegarde et de numérisation des
fonds, ont fait entrer l’ECPAD dans une nouvelle ère technologique. L’armée française
s’est ainsi donné les moyens d’assurer de façon pérenne la double mission fixée en 1915
à la SCA, celle d’enrichir chaque jour par des images nouvelles sa mémoire
audiovisuelle et de la conserver pour la transmettre au public.
BIBLIOGRAPHIE
Études concernant l’ensemble de la période :
DARRET (André), « Le cinéma au service de l’armée : 1915-1963 », Revue historique des armées, n°
2/1962, p. 121-131.
LE SEIGNEUR (Jacques) et MOUNIER (Claude), L'image au service de l'histoire ; histoire du cinéma aux
armées, ECPA, 1975.
RATTE (Philippe), Armée et communication, une histoire du SIRPA, SIRPA/ADDIM, 1989, 287 pages.
Images des 90 ans de l’ECPAD, colonel Yann PÉRON (dir.), ECPAD, 2005, 124 pages.
Présentation de l’ECPAD dans Patrimoine sonore et audiovisuel français : entre archives et témoignages,
LEMOINE (Hervé) et CALLU (Agnès) (dir.), Paris, Belin, 2004, 7 tomes.
Principaux travaux universitaires consacrés à une période historique plus restreinte :
BOROT (François), L’Armée et son cinéma, 1915-1940, thèse, université de Nanterre, 1986.
VÉRAY (Laurent), Les films d’actualités français de la Grande Guerre, Paris, éd. SIRPA/AFRHC, 1995.
Revue historique des armées, 252 | 2008
12
LAUNEY (Stéphane), Le service cinématographique de l’armée de Vichy, 1940-1944, maîtrise, université
Paris IV, 2005.
PINOTEAU (Pascal), La décolonisation française au prisme du cinéma militaire, DEA, université de
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, 1987.
DENIS (Sébastien), L’État, l’armée et le cinéma pendant la guerre d’Algérie, thèse, université Paris I,
2004.
ANNEXES
Le film documentaire : l’autre vie des archives
Dans un silence uniquement troublé par la voix pénétrante de Jacques Perrin, les
images défilent sur la toile blanche qui sert d’écran. Assis en cercle, les jeunes
spectateurs boivent les paroles de cette voix venue d’ailleurs tandis que leurs arrière-
grand-pères, ou même leurs grand-pères passent devant eux au rythme maladroit du
cinéma « d’époque ».
Nous sommes à Dakar, dans la cour du centre culturel français, en plein mois d’août.
Les élèves du secondaire viennent de découvrir La Force noire, un film documentaire
produit par l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la
Défense (ECPAD) et réalisé par Éric Deroo. Les applaudissements autant que les
questions qui fusent à la fin de la projection consacrent l’aboutissement d’un projet
audiovisuel de longue haleine. Fruit d’une patiente recherche documentaire et d’un
long travail de numérisation, La Force noire met les archives filmées du ministère de la
défense à la disposition du public en conjuguant sur une « galette » le traitement
documentaire, historique et scientifique d’un sujet ayant suscité polémiques, débats et
finalement intérêt pédagogique.
Traitement scientifique
Présenté la première fois en septembre 2007 aux derniers survivants des régiments de
tirailleurs sénégalais, le film a reçu un accueil ému comme si une partie de cette
mémoire commune était tout à coup éclairée des feux de la légitimité. Mais il est
intéressant d’observer au fil de la diffusion de La Force noire que le film, d’abord
catalyseur des débats, devient petit à petit le support des discussions et trouve un
public parmi les enseignants du secondaire.
Une tendance observée quantitativement aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois parmi
les personnes attachées à l’éducation nationale, au monde associatif combattant et aux
sociétés historiques. Cet intérêt s’est également confirmé à l’étranger puisque le film et
l’exposition pédagogique qui y est associée ont successivement voyagé à Dakar, Bamako
et Tananarive à la demande des instances dirigeantes de ces pays. Cette reconnaissance
étant due en grande partie à l’objectivité et au caractère rigoureux de la réalisation,
n’omettant aucun sujet sensible comme « Thiaroye » ou « le gel des pensions ».
Les bienfaits de la numérisation
Arrivant chez des spectateurs avant tout intéressé par l’information immédiate mais
vers lesquels les fresques historiques, qu’elles soient exactes ou non, trouvent un bon
écho, le documentaire, construit autour des archives, permet aussi de répondre aux
Revue historique des armées, 252 | 2008
13
nouvelles interrogations qui sont suscitées dans la société comme, par exemple, la
restitution d’éléments patrimoniaux aux anciennes colonies. Mais surtout, en extirpant
la pellicule de sa boîte métallique et en lui permettant de devenir éternelle, le
conservateur, l’archiviste et le réalisateur offrent à la vision filmée originale la
possibilité d’être comprise car vue et analysée dans un contexte bien souvent apaisé ou
tout au moins expliqué.
Les bienfaits de la numérisation ne résident pas alors seulement dans la conservation
pérenne d’œuvres et de témoignages mais deviennent des sources d’information
immédiates, dont la diffusion s’accélère par l’intégration aux nouveaux médias.
Le documentaire : juge de paix ?
Ainsi aux moyens traditionnels de diffusion que sont la télévision et le DVD viennent
s’ajouter les millions d’ordinateurs connectés à Internet et pour lesquels les lourds
investissements financiers consentis pour la sauvegarde de cette mémoire prennent
toute leur justification. Le « média de demain » est avant tout celui d’aujourd’hui et
permet déjà aux images de voyager bien au-delà de la simple connaissance du fait
historique. Il offre également au public « profane » un accès à des situations ou à des
périodes historiques connues auparavant seulement au travers d’écrits ou, plus encore
dans le cas de La Force noire, véhiculées par la tradition orale.
Il importe donc que le travail de recherche, de documentation et de scénarisation soit
mené avec un réel souci de mise en perspective. L’image « militante » a existé et existe
encore mais dans la restitution de la mémoire, elle nécessite plus que jamais d’en
connaître les limites. Si elle a été manipulée, mise en scène et déformée grâce à l’image,
dès ses débuts, la réalité historique a cet avantage qu’elle se rappelle souvent à ses
pourfendeurs par les mêmes moyens.
Le documentaire comme juge de paix ? Sans doute pas. Mais comme facteur
d’apaisement, c’est un peu ce qu’ont voulu dire Lansana Diara et ses camarades
tirailleurs dans La Force noire quand ils nous ont adressé leurs sourires et leur fierté
d’avoir été les acteurs de notre histoire commune.
Chef de bataillon Jean-Luc Messager,
chef du pôle commercial, chargé du développement et de la diffusion de l’ECPAD
NOTES
1. En 1861, le photographe Disdéri présente au ministre de la Guerre, le maréchal Randon, son
rapport, De l’emploi de la photographie dans l’armée, des avantages qui peuvent en résulter, des moyens
pratiques de l’y organiser. Sur les représentations photographiques de la guerre, se reporter au
catalogue de l’exposition : Voir, ne pas voir la guerre, BDIC, Somogy, 2001, 351 pages.
2. Voir : AUBERT (Michelle) et SEGUIN (Jean-Claude) (dir.), La production cinématographique des Frères
Lumière, Paris, CNC-BIFI, 1997, 557 pages.
3. Cet article fait suite à celui d’André Darret, « Le cinéma au service de l’armée : 1915-1962 »
paru dans la Revue historique des armées en 1962.
4. L’inventaire des films encore conservés fait apparaître des lacunes très importantes : pour les
années 1915 et 1916, environ 50 % de la production manque à l’appel, contre seulement 14 % pour
1917-1919.
Revue historique des armées, 252 | 2008
14
5. Le service de santé des armées est un cas particulier dans cette production : une centaine de
films lui sont consacrés, avec pour objet l’activité du service ou encore des interventions
chirurgicales enregistrées pour servir de films d’instruction.
6. Dix ans avant Belphégor, Henri Desfontaines réalise pour la SPCA L’Alsace attendait (1917), La
Femme française pendant la guerre (1918), Les Enfants de France pendant la guerre (1918).
7. Cité par J. Leseigneur, L'image au service de l'histoire ; histoire du cinéma aux armées,ECPA, 1975, p.
27.
8. Journal officiel cité par J. Leseigneur, op.cit.
9. Les plus emblématiques de ces films sont les saynètes Chiffonnard et Bonnaloy réalisées par
Pierre Lhomme en 1954.
10. Pierre Schoendoerffer raconte que les reporters ne développaient pas eux-mêmes leurs
pellicules, et qu’il a ainsi découvert ses images à son retour en métropole.
11. Grue légère portant une caméra au bout d'un bras articulé, du nom de ses inventeurs Lavalou
et Masseron.
RÉSUMÉS
En 1915, l’armée française se dote d’un outil spécifique pour produire des images, photographies
et films, qui serviront à l’information mais aussi à l’histoire de la guerre. La section
cinématographique de l’armée, supprimée en 1919, est recréée en 1939. Au sortir de la Deuxième
guerre mondiale, le service cinéma des armées devient interarmées et s’installe au fort d’Ivry,
tandis que le ministère s’organise dans le domaine de l’information et de la communication. Les
équipes de reporters du SCA gagnent leur surnom de « soldats de l’image » au cours de la guerre
d’Indochine et en Algérie. Après les conflits de décolonisation, les caméramans participent aux
opérations extérieures et contribuent à la réalisation de films d’instruction et d’information au
bénéfice de toutes les armées. Les évolutions techniques et le développement de la télévision puis
des nouvelles technologies de l’information permettent aujourd’hui une large diffusion de ces
images d’actualité et des archives cinématographiques de l’ECPAD.
Cinema in the service of defence, 1915-2008. In 1915, the French army had a special unit to produce
images, photographs and films, which provided information about, as well as, the history of the
war. The film section of the army, abolished in 1919, was recreated in 1939. After the Second
World War, the film service supported all the armed forces and operated out of Fort d'Ivry, while
the ministry functioned in the field of [public] information and communication. The teams of
reporters of the SCA gained their nickname "image soldiers" during the wars in Indochina and
Algeria. After the conflicts of decolonization, the cameramen became involved in field
operations and contributed to the making of training films and documentaries for the benefit of
all the armed forces. Technical advances and the development of television, as well as the new
information technologies, now allow wide dissemination of the cinematographic images and
archives of ECPAD.
INDEX
Mots-clés : cinéma, ECPAD
Revue historique des armées, 252 | 2008
15
AUTEUR
VIOLAINE CHALLÉAT
Archiviste paléographe et conservateur du patrimoine, elle est chef du pôle archives à l’ECPAD
depuis 2005, chargée de mission à la Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du
ministère de la défense (2004-2005) et doctorante en histoire contemporaine à l’université Paris I.
Revue historique des armées, 252 | 2008
16
Guerre et cinéma à l’époque nazie
Films, documentaires, actualité et dessins animés au service de la
propagande
Claire Aslangul
1 La guerre et l’image filmique entretiennent en Allemagne de longue date une étroite
relation. La célèbre UFA (Universum-Film AG) est née en 1917 directement de la volonté
de Ludendorff « d’influencer les masses dans l’intérêt de l’État » 1. La diffusion des
premières véritables actualités cinématographiques (Wochenschau) a eu lieu le
23 octobre 1914, peu de temps après le déclenchement des hostilités. Les images
filmées, puis des animations à caractère pédagogique, ont été utilisées dans la
formation des soldats pour expliquer de manière claire le maniement de certaines
armes ou le pilotage des avions. Il ne s’agit pas là cependant d’une spécificité
allemande : le premier dessin animé anglais fut réalisé en 1899 pour soutenir les
troupes engagées dans la guerre des Boers 2…
2 À partir de 1933, dans la mesure où le « combat » (Kampf) est une valeur omniprésente
dans l’idéologie national-socialiste et où tous les médias sont mis au service de la
propagande, ces liens entre guerre et image animée se resserrent encore. Le cinéma
apparaît comme un instrument unique pour conditionner les populations à la
réalisation du programme nazi, incluant dans sa logique même la guerre qui permettra
de donner à la « race des seigneurs » le « territoire qui lui revient de droit » 3. Dans les pages
qui suivent, nous nous pencherons surtout sur la représentation cinématographique de
la guerre proprement dite – au sens d’affrontement entre les nations ; mais il faut
garder à l’esprit que la lutte contre les ennemis internes et celle contre les États rivaux
ne peuvent être complètement dissociées : les mêmes procédés de dénigrement sont à
l’œuvre pour stigmatiser les différents types d’adversaires ; et par ailleurs, la violence
mise en scène, notamment dans les œuvres antisémites, a contribué d’une manière
générale à accoutumer les populations à l’utilisation de la force dans les relations
interhumaines 4.
3 La guerre est un thème important du cinéma nazi dès 1933, à travers entre autres la
propagation de l’idéal du soldat et de la « légende du coup de poignard dans le dos » (qui
implique la promotion de la « guerre de revanche »). Mais une fois arrivée la guerre, le
cinéma doit essentiellement aider les populations à tenir – il propose alors surtout des
Revue historique des armées, 252 | 2008
17
productions divertissantes, qui font oublier les rigueurs du conflit. Évoquer le cinéma
dans la guerre, c’est donc aussi, paradoxalement, parler d’une certaine éviction de la
guerre au cinéma – du moins dans le film de long métrage, car d’autres documents
montrent au contraire les combats à l’envi. Nous verrons à cet égard le rôle
complémentaire des différentes images filmiques. Mais pour comprendre les stratégies
mises en œuvre par les dirigeants nazis, il faut commencer par présenter leurs
conceptions en matière de cinéma et les moyens qu’ils se sont donnés pour les
concrétiser.
Les images animées, un élément central de
l’entreprise de propagande nazie
4 Pour Hitler et Goebbels, la culture en général est un enjeu fondamental : on sait les
efforts qui ont été réalisés pour débarrasser la littérature et les arts de l’influence
étrangère. On connaît les autodafés des livres d’auteurs « enjuivés » dès le
printemps 1933, le discours sur la « guerre de purification et d’extermination » contre
les œuvres picturales dites « dégénérées » en 1937, ainsi que la volonté d’affirmer la
supériorité de l’art « germanique » par l’organisation annuelle d’une Grande exposition
d’art allemand. Dans le domaine du film, on retrouve cette volonté qui cependant,
parfois, mêle à la haine de l’étranger une admiration certaine : ainsi, dans le champ du
film d’animation, pour un Hitler et un Goebbels qui raffolaient des films de Disney au
point de les visionner en cachette 5, il s’agissait de surpasser l’ennemi ; « les Américains
peuvent le faire, pourquoi pas les Allemands ? » répétait Hitler 6. Le discours de Goebbels le
28 mars 1933 affirme d’ailleurs la vocation de l’industrie cinématographique allemande
à devenir une « puissance mondiale », à « conquérir le monde ». Le film apparaît donc
comme un enjeu majeur de la guerre culturelle qui commence dès l’arrivée des nazis au
pouvoir en janvier 1933, bien avant la guerre proprement dite dont elle doit constituer
le prélude 7.
5 Le cinéma est aussi et surtout un vecteur de diffusion de l’idéologie dont l’efficacité est
immédiatement perçue : Goebbels, qui se définit comme un « amant passionné de l’art
filmique » 8 et s’autoproclame « protecteur du film allemand », voit dans le cinéma dès son
discours du 9 février 1934 l’un des « moyens de manipulation des masses les plus modernes »
9. Fritz Hippler écrivait, quant à lui, en 1944 : « En comparaison avec tous les autres arts, le
film, par sa capacité à agir prioritairement sur le sens poétique et l’émotion, donc sur ce qui ne
relève pas de l’intellect, a, d’un point de vue de la psychologie des masses et de la propagande, un
effet particulièrement profond et durable. » 10 La foi des nazis en leur propagande
cinématographique se révèle dans des épisodes tristement célèbres : on sait par
exemple que le film Le Juif Süss (Jud Süss) était projeté aux commandos SS comme
« mise en condition » avant les exécutions de masse 11. Le film Retour au foyer
(Heimkehr), une des productions-clés de la propagande nazie, utilise un intéressant
procédé de « mise en abyme » pour montrer, dans le film lui-même, la puissance
mobilisatrice du cinéma : le tournant est constitué par un épisode où un couple
d’Allemands de Pologne, pendant une projection, refuse de chanter l’hymne polonais
qu’entonnent des spectateurs transportés par le visionnage des actualités montrant
leurs troupes en parade…
6 Le régime nazi reconnaît aussi très rapidement la capacité du film à « chasser l’ennui et
les soucis » 12, bref à divertir les populations au sens étymologique du terme. Dans son
Revue historique des armées, 252 | 2008
18
discours du 27 novembre 1939 devant la Chambre impériale de la culture et les
représentants de l’organisation de loisirs La force par la joie (Kraft durch Freude),
Goebbels affirme ainsi : « Plus les rues sont sombres, plus nos théâtres et nos salles de
cinéma doivent les inonder de leur lumière. Plus les temps sont durs et plus l’art doit
briller et s’élever pour être le consolateur de l’âme humaine. » Et c’est tout
naturellement dans les années 1939-1945 que l’extraordinaire capacité du film à «
enchanter le monde » 13 sera le plus pleinement exploitée – le ministre de la Propagande
et de la Culture populaire note dans son journal le 8 février 1942 : « Le divertissement
est lui aussi aujourd’hui fondamental, si ce n’est décisif dans la guerre. » Notons qu’il
est souvent difficile de faire la différence entre le film de propagande et le film de
divertissement : Goebbels insistait lui-même pour dire que la seule propagande
véritablement efficace était celle qui agissait sournoisement, sans que le public se
rendît compte qu’il était l’objet d’une manipulation, et que les films sans intention
politique apparente pouvaient être diablement efficaces au service du pouvoir 14.
Des moyens considérables …
7 Des moyens énormes sont engagés pour mettre sur pied (et contrôler) une industrie
filmique à la hauteur des ambitions de Goebbels. Si certains projets échouent,
notamment le développement d’une qualité de dessin animé capable de rivaliser avec
celle de Disney, la production cinématographique va néanmoins connaître une
impulsion décisive sous la dictature nazie : la production de courts et longs métrages
augmente nettement – le Reich produit plus de films qu’aucun autre pays en Europe ; et
en 1938, avec presque 5 500 salles de cinéma, soit 2 millions de fauteuils, l’Allemagne se
place au deuxième rang après les États-Unis 15.
8 Dès le 28 mars 1933, Goebbels insiste sur la nécessité, pour l’art cinématographique, de
plonger ses racines dans la doctrine völkisch. Rapidement, les professionnels sont mis au
pas : les Juifs sont exclus, les autres doivent faire partie de la « chambre du cinéma »
pour continuer à exercer leur activité ; leurs films passent en « commission de
censure ». Les nazis contrôlent en amont les capitaux nécessaires à la réalisation des
films par le biais de la Filmkreditbank, et en aval, la critique ainsi que la diffusion. Là où
il n’y a pas de cinéma, plus de 1 500 troupes mobiles organisent des projections ; des
séances spéciales visent notamment les jeunes, dans le cadre des Jeunesses hitlériennes
et dans les écoles. L’Allemagne parvient avec tous ces efforts à faire du cinéma un lieu
important de la culture populaire. On estime en 1934-1935 à 250 millions le nombre
d’entrées annuelles dans les salles obscures ; cinq ans plus tard, le chiffre atteint un
milliard. Les fonds mis en œuvre sont considérables, notamment pour l’industrie du
dessin animé dont Goebbels attend qu’elle rattrape ses vingt années de retard sur
Disney : des dessinateurs de tous les pays sont appelés en renfort. Et pendant la guerre,
ils sont considérés comme si importants qu’on les dispense de service militaire ou de
travail obligatoire dans les usines ; on les installe dans les vastes locaux de l’école juive
de la Kaiserstrasse à Berlin, puis des ateliers sont montés dans les différents pays
occupés, où travaillent jusqu’à 500 animateurs.
Revue historique des armées, 252 | 2008
19
… au service d’une stratégie très élaborée
9 Ces moyens financiers et humains exceptionnels servent une stratégie extrêmement
raffinée. Certains longs métrages ont un caractère propagandiste avoué, et notamment,
on y retrouve comme thème évident celui de la guerre. Certains films sont moins
caricaturaux, plus controversés, agissent de manière plus subtile. La majorité relève de
la catégorie divertissement (Unterhaltungsfilme). Mais au fond, ces longs métrages ne
sont pas toujours forcément l’essentiel, car ce qui compte, ce sont tous les documents
filmiques que le spectateur voit quand il a pénétré dans la salle obscure. Ainsi, dès 1934,
la projection de chaque film doit être précédée de celle d’au moins un « film culturel »
(Kulturfilm), c’est-à-dire, à l’époque, un documentaire qui, sous l’apparence de la vérité
et de la scientificité, distille en réalité l’idéologie nazie 16 ; la guerre contre tous les
ennemis du Reich y est régulièrement présentée comme une conséquence « logique »
de la prétendue « supériorité de la race allemande ».
10 De plus, des actualités (Wochenschau) sont diffusées entre le « film culturel » et le long
métrage, et leur visionnage est obligatoire à partir de 1938 – les caisses du cinéma sont
fermées au début de la séance, ce qui signifie que le spectateur qui veut voir le long
métrage doit subir nécessairement ces actualités. Elles sont sous contrôle renforcé
depuis l’introduction par Goebbels, en 1935, de « l’office allemand des nouvelles », puis
produites de manière centralisée par l’UFA. Elles présentent pendant la guerre des
images authentiques rapportées par les compagnies de propagande qui accompagnent
les différents corps d’armée, et qui doivent donner aux spectateurs l’impression d’être
véritablement au cœur de l’action 17. Ces images sont ensuite habilement mises en son
et en scène dans les studios de Berlin, entrecoupées de séquences animées
pédagogiques montrant l’avancée des troupes sur la carte de l’Europe.
11 Des publicités – ouvertes ou déguisées – renforcent l’impact des messages des autres
documents filmiques 18. Ainsi, pour vanter les mérites d’une marque d’aspirine en 1938,
les dessinateurs montrent des canons bombardant de comprimés les vilains microbes.
Le dessin animé La bataille de Miggershausen (Die Schlacht um Miggershausen, 1940) fait
la promotion de la radio, à l’époque où est lancée la fabrication en masse du « récepteur
du peuple », instrument fondamental de diffusion de l’idéologie : les troupes de petites
radios animées partent à l’assaut d’un village et reçoivent l’ordre « d’occuper les
fermes ! ». Comme le montre ce dernier exemple, il est parfois difficile de cerner de
quelle catégorie relèvent certaines productions : La bataille de Miggershausen était
officiellement classé dans la catégorie du Kulturfilm, bien qu’il n’ait pas de rôle
proprement documentaire. Cette difficulté à cerner l’objet explique sans doute en
partie que les films d’animation, malgré le potentiel d’inventivité qui s’y déploie,
restent le parent pauvre de l’analyse des historiens contemporains 19.
12 On retiendra quoi qu’il en soit la variété et la complémentarité des différents types de
documents filmiques présentés au spectateur ; chacun remplit des fonctions bien
particulières, mais ils sont tous au service de l’idéologie. Et si, pendant la guerre, entre
50 et 80 % des films produits n’évoquent pas les combats, ni directement ni
indirectement, la propagande n’en est que rarement absente : ainsi, par exemple, dans
le film de 1939 sur le médecin et prix Nobel Robert Koch, l’omniprésence du
vocabulaire martial, qui apparaît dans le titre (Combattant contre la mort/Bekämpfer des
Todes) et dans les dialogues, ne peut manquer de frapper le spectateur. Et de toute
façon, même les films les plus apolitiques ont un rôle déterminé dans la stratégie des
Revue historique des armées, 252 | 2008
20
nazis : ils sont conçus pour attirer le spectateur dans les salles obscures 20, où il devra
subir le martèlement des actualités.
D’une guerre à l’autre : les héros guerriers d’hier, des
modèles
13 Parmi les productions de la période nazie, on trouve un grand nombre de films mettant
en scène des épisodes guerriers. Quand ils sont « ancrés » dans une période ancienne,
ils permettent de présenter les héros allemands du passé comme des modèles
(Bismarck ou Frédéric le Grand) et/ou de stigmatiser les nations ennemies. Avec
l’accumulation des difficultés, à partir de 1942, on s’attarde sur des épisodes historiques
douloureux mais qui finalement se sont soldés par des victoires : le récit du siège de
Kolberg, en 1806, doit ainsi encourager les populations de 1945 à croire que même les
luttes les plus féroces ne sont que des étapes vers la libération.
14 Dans la catégorie des films qui diabolisent l’ennemi (pointant à la fois sa fourberie, qui
justifie le combat, et sa faiblesse, qui promet la victoire), on retiendra comme
exemplaires Le malheur des Frisons (Frisennot, 1935) et Ohm Krüger (1941) : le premier
relate la vie paisible des Allemands de la Volga bouleversée par l’arrivée de l’Armée
rouge, dont les soldats brutaux et sanguinaires maltraitent les braves villageois et
violent les filles. Le second raconte un épisode de la guerre des Boers (1899-1902) : on y
voit les Anglais provoquant des émeutes sociales pour justifier une intervention qui
vise en réalité à contrôler les ressources minières sud-africaines. Les exactions contre
les civils sont montrées à l’envi ; en particulier, dans un camp de concentration anglais,
la femme de Krüger est exposée à des traitements inhumains. Le film s’achève sur la
« prophétie » qu’on imagine bienvenue en 1941 : « Un jour, des peuples grands et puissants
se dresseront contre la tyrannie britannique et anéantiront l’Angleterre. Dieu sera à leurs côtés.
Et la voie sera ouverte vers un monde meilleur. » Un autre grand film « historique » mêle
stigmatisation de la « ploutocratie anglaise » et de l’ennemi juif : Les Rothschild (Die
Rothschilds – Aktien von Waterloo, 1940) présente l’ascension sociale de la famille de
banquiers qui repose, selon les scénaristes, sur une tromperie : la diffusion par les
Rothschild (de Francfort, Paris et Londres) d’une fausse nouvelle – la victoire de
Napoléon à Waterloo – entraîne la chute des actions anglaises ; les banquiers, après
avoir dérobé l’argent que leur a confié le prince électeur de Hesse, en profitent pour
bâtir leur fortune. Le commissaire du Trésor britannique s’allie à Nathan Rothschild
pour partir à la conquête de l’Europe.
15 Certaines scènes de ce film sont utilisées dans Le Juif éternel (Der ewige Jude, 1940), qui
est présenté comme un film documentaire, et qui abonde donc dans le sens du récit
historique grâce à une présentation dont le contenu de vérité est apparemment
incontestable. La collusion entre les Juifs et les Anglais est complétée ici par la
dénonciation de l’emprise supposée de la « juiverie cosmopolite » sur le monde
financier américain. Par ailleurs, le documentaire montre des scènes « réelles » de
ghettos polonais, où l’on voit les Juifs vivre au milieu des insectes, et où leur diaspora
est mise en parallèle avec les migrations des rats et la diffusion de la peste. Anglais,
Américains, Polonais « subsumés » dans la figure du « Juif éternel » : l’agitation
antisémite est ici utilisée pour dénigrer tous les ennemis auxquels l’Allemagne a affaire
en cette première période de la guerre. Le procédé illustre à merveille l’un des
Revue historique des armées, 252 | 2008
21
principes de la propagande identifiés par Domenach 21 : celui de la simplification, avec
la réduction de tous les adversaires à la figure d’un ennemi unique.
16 Les épisodes du passé sont donc présentés comme directement liés à l’actualité, à la fois
par la « morale » qu’il faut en tirer, complaisamment présentée dans la bande son, et
par la présentation concomitante de documentaires qui mélangent les différentes
strates temporelles et les aires géographiques, avec toujours le même but : rappeler qui
sont les héros et qui sont les ennemis, de la manière la plus manichéenne possible.
Dès 1925, dans Mein Kampf, Hitler avait mis l’accent sur « l’imbécillité des masses » et
la nécessité d’une propagande simplificatrice, réduite à des messages clairs 22.
17 Parmi les « films culturels » qui accompagnent les longs métrages, on peut aussi
trouver des dessins animés comme Mariage dans la mer de corail (Hochzeit im
Korallenmeer, 1943) qui effectuent un autre type de transposition. Ils transportent le
spectateur dans un monde imaginaire, tout en délivrant souvent un message subreptice
qui renforce l’histoire dramatisée du long métrage, la présentation « objective » du
documentaire, et la description « authentique » des actualités : ici, les gentils poissons
qui préparent leurs noces voient leurs perles dérobées par un méchant poulpe, avec
lequel s’engage une lutte féroce. Rien que de très innocent, si ce n’est que le poulpe
porte une chapka et exécute des danses folkloriques russes, alors que le cortège final
triomphant des poissons est une marche militaire avec des drapeaux aux couleurs du
Reich…
Les héros contemporains et leurs exploits
18 Si la transposition en d’autres époques et d’autres lieux du combat de l’Allemagne
contre différents ennemis est un procédé souvent réquisitionné par la propagande,
d’autres documents cinématographiques sont ancrés plus directement dans le présent.
C’est très net pour un certain nombre de films produits pendant la guerre, qui mettent
en scène des épisodes tout à fait contemporains, afin d’aider les Allemands à croire que
le combat sera victorieux : Sous-marins, vers l’Ouest ! (U-Boot westwärts !, 1941) vante
ainsi les exploits et le sens du sacrifice des marins allemands confrontés aux Hollandais
et aux Anglais.
19 La guerre n’est cependant pas, loin de là, uniquement un thème des productions
d’après 1939. Dès l’arrivée des nazis au pouvoir, les combats de rue des années 1920
et 1930 sont présentés comme une première étape vers la guerre qui redonnera au
Reich sa grandeur bafouée à Versailles en 1919. Les héros et martyrs de la « période de
lutte » (Kampfzeit) qui a permis aux nazis d’arriver au pouvoir sont à l’honneur dans la
fameuse trilogie de 1933 (SA-Mann Brand, Hitlerjunge Quex et Hans Westmar) ; leur combat
contre les communistes, mis en parallèle par des flash-back avec les exploits des héros
de 14-18, laisse augurer des triomphes à venir. Après 1939, les longs métrages
s’attachent encore davantage à montrer la continuité entre la Première Guerre
mondiale et la guerre en cours qu’il faut légitimer : dans Frères de sang
(Blutsbrüderschaft), deux soldats amis vont se séparer en 1918, s’opposer dans l’entre-
deux-guerres (notamment, ils convoitent la même femme), puis se réconcilier « au nom
du sang » et prendre les armes contre « l’ordre de Versailles ».
20 Ici, comme dans d’autres films de propagande guerrière, le spectateur est tenu en
haleine par les intrigues amoureuses qui ponctuent les parcours des héros. Jouer sur
l’émotion (l’admiration, la peur) pour exciter la haine de l’ennemi, c’est aussi la
Revue historique des armées, 252 | 2008
22
fonction de dessins animés comme Le trouble-fête (Der Störenfried, 1940) : un renard
vient semer la terreur dans la forêt – cette forêt, symbole de l’Allemagne, qu’on
retrouve dans La forêt éternelle (Ewiger Wald, 1936) et d’autres films de la tendance «
Blut-und-Boden » ; les hérissons, coiffés de casques de la Wehrmacht, s’unissent aux
abeilles, dont le dard est devenu une mitraillette et qui s’organisent en efficaces
escadrons pour terrasser l’animal malfaisant (qui sert aussi souvent à représenter le
Juif 23) ; la bande son reproduit, pendant le piqué des abeilles, le bruit de la chute des
bombes. L’ancrage dans le présent est assuré par d’autres détails, comme la présence,
dans une séquence, d’une affiche de la campagne contre les espions (Feind hört mit !). La
magie de la couleur – à l’époque où tous les autres documents filmiques sont en noir et
blanc – est très directement mise au service de la propagande guerrière.
21 On comprend qu’il s’agit ici aussi de diffuser l’idée d’une guerre défensive et juste. De
nombreux documents cinématographiques martèlent ce message, comme le fameux
Retour au foyer (Heimkehr, 1941), tourné sur ordre express de Goebbels pour justifier
l’invasion de la Pologne le 1er septembre 1939, et qui est parfois considéré comme le
film de propagande nazie le plus abouti 24. On y voit les Allemands de Pologne réclamer
en vain le respect des minorités et subir les pires humiliations. Ils sont sauvés des
mains de Polonais enragés par les troupes du Reich. La version romancée et
mélodramatique des événements est complétée par les images « authentiques » de
documentaires comme Le baptême du feu. La campagne de Pologne (Feuertaufe. Der Film
vom Einsatz unserer Luftwaffe im polnischen Feldzug, 1939).
Mobiliser (et distraire) toute la « communauté du
peuple allemand »
22 Les films que nous venons d’évoquer sont prévus en général pour une diffusion « tous
publics », même si certains sont interdits aux jeunes ou présentés à certaines catégories
de populations dans des versions édulcorées 25. Mais en temps de guerre, il faut aussi
mobiliser le front de l’arrière – et donc les femmes – de manière plus spécifique 26. Les
héros masculins continuent à être mis en valeur, en particulier les séduisantes figures
de « chevaliers du ciel » : dans Stukas (1941) 27, un jeune officier de l’armée de l’Air
blessé au cours d’un assaut redécouvre le sens du combat en écoutant Wagner à
Bayreuth, et retourne enthousiaste au front. Cependant, les récits d’aventures où les
héroïnes féminines jouent un rôle non négligeable sont légion. Dans Une belle journée
(Ein schöner Tag, 1943), Barbara soutient activement les soldats partis au front en leur
préparant des paquets – elle est tout le contraire de la Petite oie stupide (Das dumme
Gänslein), qui passe son temps à se pomponner et qui, sur fond sonore d’une troublante
mélodie yiddish, cède à la séduction du renard dans un dessin animé de 1944… Dans le
mélodrame Concert pour la Wehrmacht (Wunschkonzert) (1940), qui mélange habilement
l’histoire intime et la grande histoire en train de s’accomplir, le lien entre le front et
l’arrière est maintenu grâce à l’écoute simultanée d’une émission de radio par les deux
protagonistes amoureux. Avec 26 millions de spectateurs, c’est l’un des plus grands
succès commerciaux de l’époque nazie.
23 Un autre film à succès narre l’histoire d’amour entre un aviateur et une chanteuse de
variété. Les séparations dues à la guerre, les blessures du jeune officier mettent à
l’épreuve la valeur d’un Grand amour (Die grosse Liebe, 1941-42) ; l’intrigue fait rêver le
public, l’emmenant dans les théâtres et les paysages de Paris, Rome, du désert africain ;
Revue historique des armées, 252 | 2008
23
et le spectateur garde en mémoire la mélodie de la bande son, qui deviendra l’une des
chansons les plus populaires de la Seconde Guerre mondiale, au titre éminemment
consolateur : « Un jour, un miracle se produira » (« Es wird einmal ein Wunder geschehen »).
Mais il s’agit bien d’un film de propagande guerrière, au cours duquel l’héroïne,
incarnée par Zarah Leander, apprendra l’abnégation et le sens du devoir. D’ailleurs,
comme Concert pour la Wehrmacht, Le grand amour contient des scènes tirées des
actualités tournées sur le front. Et il s’achève sur le couple réuni, qui regarde confiant
vers l’avenir, tandis que le ciel est traversé par des escadrons de bombardiers
allemands.
24 Les différentes formes de documents filmiques visaient à un conditionnement total de
la population, avant et pendant la guerre. Les documentaires et les actualités, avec leur
valeur de « preuve objective », faisaient davantage appel à la raison, au bon sens
commun, tandis que des comédies, dessins animés divertissants, mélodrames et
publicités misaient essentiellement sur l’imagination. La manipulation des émotions
était assurée par d’éloquentes bandes son, commentaires guidant l’interprétation ou
musique habilement choisie. La guerre dans la production filmique nazie apparaît ainsi
comme un thème chatoyant : la guerre « réelle » y est tantôt un véritable sujet, avec ses
héros et ses martyrs, tantôt un simple décor et l’arrière-plan des actions individuelles ;
le combat des bons contre les méchants apparaît de manière plus pernicieuse dans des
productions qui déplacent la lutte dans d’autres temps et d’autres lieux.
25 Diffuser les valeurs essentielles à l’engagement puis à la poursuite des hostilités (le sens
du devoir, le respect de l’autorité, la fidélité jusqu’à la mort), mais aussi faire oublier les
rigueurs du sacrifice, voilà donc ce que devait permettre le cinéma. On ne saurait
évaluer précisément dans quelle mesure l’image animée a effectivement rempli le rôle
que lui avaient assigné les dirigeants nazis ; il n’en reste pas moins qu’elle apparaît
comme un facteur important dans le soutien de la population à la politique
expansionniste de Hitler. Et c’est bien mus par l’idée d’un cinéma de propagande
dangereusement efficace que les alliés, après 1945, ont interdit de diffusion la plupart
des films évoqués dans cet article 28…
ANNEXES
Extraits du discours de Joseph Goebbels à la Chambre cinématographique du Reich, le
15 février 1941. Traduit d’après l’original reproduit in : ALBRECHT (Gerd), Der Film im 3.
Reich, Karlsruhe, Schauburg & Doku Verlag, 1979, p. 70-97.
« Nous autres Nationaux-socialistes sommes les premiers à avoir eu une représentation pratique
de la totalité de la guerre, c’est-à-dire de l’implication absolue et entière de tout le peuple dans la
guerre, (…) loin de l’idée réactionnaire que la guerre serait seulement le fait des soldats (…). C’est
pourquoi nous avons engagé dans le domaine spirituel et psychologique les préparatifs
nécessaires pour ne pas devoir revivre un drame national similaire à celui du 9 novembre 1918.
(…)
Revue historique des armées, 252 | 2008
24
Pour cette raison, ce que nous entendons par propagande, le combat pour l’âme d’un peuple,
prend une autre signification (…). Il ne s’agissait pas pour nous avant tout ou seulement de
conquérir le pouvoir, mais de conserver le pouvoir et de mettre en œuvre tous les facteurs
pouvant nous assurer la conservation de ce pouvoir et du peuple ; le peuple devait garantir notre
pouvoir. Cela veut donc dire que nous devions transporter dans l’esprit de la masse des schémas
de pensée lapidaires, (…) nous devions les rendre primaires, simples, les brosser à grands traits,
de sorte que n’importe quel homme de la rue soit en mesure de les comprendre. (…)
Le film n’est dans ce contexte pas seulement un moyen de distraire, c’est un moyen pour
éduquer, (…) éduquer un peuple à faire valoir ses revendications vitales. Cela, le film peut le faire
cependant aussi par le moyen du divertissement. (…) Il est d’ailleurs tout à fait conseillé de
dissimuler le rôle pédagogique (du cinéma), de ne pas le laisser apparaître au grand jour, d’agir
selon le principe que l’intention ne doit pas être remarquée si l’on ne veut pas ennuyer. C’est bien
cela, le vrai grand art, éduquer sans monter sur scène avec la revendication de l’éducateur,
réaliser certes une mission d’éducation, mais sans que l’objet de l’éducation ne remarque en
aucune manière qu’il est éduqué, c’est cela, d’une manière générale, la véritable mission de la
propagande. La meilleure propagande, ce n’est pas celle dans laquelle les véritables éléments de
la propagande sont visibles, la meilleure propagande, c’est celle qui pour ainsi dire agit de
manière invisible, qui imprègne toute la vie publique sans que les gens, d’aucune manière que ce
soit, aient la moindre conscience qu’il s’agit d’une initiative propagandiste. »
NOTES
1. Lettre de Ludendorff au ministère de la Guerre le 4 juillet 1917, citée in : W OLFGANG (Jacobsen),
ANTON (Kaes), H ELMUT (Prinzler Hans), Geschichte des deutschen Films, Stuttgart/Weimar, Metzler,
2004, p. 37.
2. ROFFAT (Sébastien), Animation et propagande. Les dessins animés pendant la Seconde Guerre mondiale,
Paris, L’Harmattan, 2005, p. 15.
3. HITLER (Adolf), Mein Kampf (1925), Munich, Eher, 1934, p. 739.
4. Cf. le discours de politique étrangère d’Hitler à Munich, le 10 novembre 1938 : « Il était
nécessaire de changer progressivement la psychologie du peuple allemand et de lui montrer lentement qu’il
y a des choses qui, quand on ne peut pas les obtenir par des moyens pacifiques, doivent être imposées par la
force. Pour cela, il fallait non pas propager la violence en tant que telle, mais présenter au peuple allemand
certains faits (…) de telle manière que ce soit la voix intime du peuple lui-même qui finisse lentement par
réclamer, à corps et à cris, la violence. », cité d’après W OLFGANG (Michalka) (éd.), Das Dritte Reich, vol 1,
Munich, DTV, 1985, p. 262.
5. Suite à la réalisation par Disney de films antinazis, les dessins animés américains sont
interdits de diffusion en Allemagne. Goebbels se vante pourtant de pouvoir se les procurer pour
contenter le Führer : « J’ai offert au Führer 12 films de Mickey Mouse pour Noël. Il se réjouit de ce trésor
», note-t-il dans son journal le 20 décembre 1937. Voir les documentaires de Ulrich Stoll, Quand
Hitler rêvait de Mickey – Dessin animé et croix gammée, De Campo, WDR, ARTE, 1999, et Sharon K
Baker, Cartoons go to war, Teleduction, A&E Network, 1995.
6. C ARSTEN (Laqua), Wie Micky unter die Nazis fiel. Walt Disney und Deutschland, Reinbek, Rohwoldt,
1992.
7. Cette continuité/complémentarité entre « guerre des esprits » et « guerre sur le terrain »
apparaît bien dans la première phrase de l’accord conclu entre Goebbels et le chef de la
Wehrmacht, le général Wilhelm Keitel, à propos de la mise sur pied des « compagnies de
propagande » qui accompagneront bientôt les troupes :« La guerre de propagande est reconnue dans
Revue historique des armées, 252 | 2008
25
ses principes essentiels comme aussi importante dans la conduite du conflit que la guerre des armes »,
d’après : HOFFMANN (Hilmar), Und die Fahne führt uns in die Ewigkeit“. Propaganda im NS-Film,
Francfort, Fischer Taschenbuch, 1988, p. 288.
8. Discours du 28 mars 1933.
9. D’après : L EISER (Erwin), "Deutschland erwache!". Propaganda im Film des Dritten Reiches, Reinbek,
Rowohlt, 1968, p. 40.
10. Hippler dans le journal Film-Kurier du 5 avril 1944, cité ici d’après Hoffmann, 1988, op.cit., p. 5.
11. COURTADE (Francis), CADARS (Pierre), Histoire du cinéma nazi, Paris, Eric Losfeld, 1972, p. 196.
12. Goebbels, discours du 28 mars 1933.
13. O’ BRIEN (Mary-Elizabeth), Nazi cinema as enchantment. The politics of entertainment in the Third
Reich, New York, Camden House, 2004.
14. Cf. son discours à la chambre cinématographique du Reich le 15 février 1941. On notera au
passage que parmi les difficultés qui surgissent pour qui analyse de nos jours les films nazis, il y a
justement celle qui est de saisir à sa juste mesure l’intention propagandiste, car en visionnant ces
documents, on est tenté de voir partout de la propagande, ou de ne plus la voir nulle part à force
d’y être plongé. Et on risque aussi de commettre des contresens, car certaines allusions nous sont
aujourd’hui difficilement déchiffrables : les images filmiques ne prenaient autrefois leur sens
qu’insérées dans un réseau d’images courantes pour le public de l’époque – photos de presse,
affiches, illustrations des livres pour enfants, cartes postales, etc.
15. Cf. Courtade & Cadars, 1972, op.cit., p. 31. D’une manière générale, la période nazie étant une
page sombre de l’histoire du cinéma, on est embarrassé de parler des prouesses techniques (et
esthétiques) des années 1933-1945. La diffusion des films de Leni Riefenstahl, par exemple,
provoque chaque fois le même type de controverse. Il faut pourtant bien reconnaître que la
période nazie a été un puissant vecteur de modernisation de l’industrie cinématographique, et le
champ d’expériences artistiques qui ont laissé une empreinte durable sur la culture visuelle de
toute la suite du XXe siècle. Pour une discussion critique de cet épineux sujet et notamment le
décryptage de l’influence de L. Riefenstahl sur le cinéma contemporain, voir par exemple : K ULLER
(Christiane), « Der Führer in fremden Welten : das Star-Wars-Imperium als historisches
Lehrstück ? », Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History, 3 (2006).
16. D ELAGE (Christian), La vision de l’histoire à travers le cinéma documentaire du Troisième Reich,
Paris, L’âge d’homme, 1989.
17. H OFFMAN (Kay), « “Nationalsozialistischer Realismus” und Film-Krieg. Am Beispiel der
“Deutschen Wochenschau” », in : Segeberg Harro (éd.), Mediale Mobilmachung. Das Dritte Reich und
der Film, Munich, Fink, 2004, p. 151-180.
18. AGDE (Günter), « Das Ornament der Sache. Werbe- und Trickfilm im Dritten Reich », Segeberg,
2004, op.cit., p. 45-70.
19. Un seul ouvrage français prend au sérieux les dessins animés comme media privilégié de la
propagande : voir Roffat, 2005, op.cit. Et si l’Allemagne y est bien présentée, il manque encore une
monographie sur le sujet ; en Allemagne, les ouvrages sur le film d’animation donnent le plus
souvent une place marginale à période nazie en particulier et à la potentielle dimension
propagandiste du support en général (voir par exemple : S CHOEMANN (Annika), Der deutsche
Animationsfilm. Von den Anfängen bis zur Gegenwart 1909-2001, Gardez ! Verlag, Sankt Augustin,
2003).
20. Le journal hollandais Film en Kultuur de mars 1944, commentant la diffusion du dessin animé
Verwitterte Melodie qui a bien rempli cette fonction : « Il faut bien avouer que l’amateur des salles
obscures n’aime pas rater les dessins animés. (…). Il y a tellement de choses qui nous manquent pendant la
guerre. On s’est ainsi habitué à ne plus voir de dessins animés américains. Mais voilà qu’arrivent sur les
écrans, et en couleurs, ces sympathiques animaux. »(cité par Roffat, 2005, op.cit., p. 75).
21. DOMENACH (Jean-Marie), La propagande politique, Paris, PUF, 1954.
Revue historique des armées, 252 | 2008
26
22. « Il est mauvais de donner à la propagande les nuances que l’on trouve par exemple dans un
enseignement scientifique. La capacité d’absorption de la grande masse n’est que très limitée, sa
compréhension faible, et en même temps sa capacité à oublier très grande. À partir de ces constats, il faut
que la propagande se limite à un très petit nombre de points et qu’elle martèle ces derniers jusqu’à ce que
l’homme le plus simple parvienne à se représenter ce qu’on veut qu’il se représente », Mein Kampf, op.cit.,
p. 198.
23. Cf. le thème et les illustrations du livre pour enfants d’Elvira Bauer, édité en 1936 par Julius
Streicher aux éditions Stürmer : « Ne te fie pas au renard dans le vert champ, ni au Juif dans son
serment! (Trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud bei seinem Eid!) », ou le dessin animé Le
petit arbre qui voulait d’autres feuilles (Vom Bäumlein, das andere Blätter hat gewollt, 1940): le Juif
cupide qui dépouille l’arbre de ses feuilles d’or est accompagné du renard et du corbeau.
24. Pour l’écrivain Jelinek Elfriede, qui a inséré dans sa pièce Burgtheater des extraits de
dialogues de ce film, c’est « le film le plus terrible de la propagande nazie », cf. l’interview de Jelinek
dans le magazine Format,15 mai 2000. Pour une présentation de l’intrigue et des procédés à
l’œuvre dans ce film, voir : TRIMMEL (Gerald), Heimkehr (Strategien eines nationalsozialistischen Films),
Vienne, Werner Eichbauer, 1998.
25. Dans Le Juif éternel, la version destinée aux femmes et aux enfants fait l’économie de la scène
de la fin, dans laquelle on voit l’abattage rituel des animaux, qui doit présenter les Juifs comme
des « barbares » et légitimer leur exclusion, voire leur élimination. On soulignera que la loi du
16 février 1934 ayant aboli l’interdiction d’entrée dans les cinémas pour les moins de 6 ans, des
enfants très jeunes, avant même leur entrée dans la Hitlerjugend, peuvent assister aux séances
entières… et voir y compris le(s) documentaire(s) et les actualités !
26. Les Allemands ont inventé à ce propos une catégorie de films spécifique, les Durchhaltefilme ;
littéralement, ce sont les « films qui aident à tenir ».
27. On pourrait citer ici aussi D III 88, de1939, et L’escadron Lützow (Kampfgeschwader Lützow)
de1941.
28. Cf. le site www.filmportal.de, sur les critères d’interdiction actuels en Allemagne («
Kriterienkatalog verbotener NS-Filme »). Je tiens ici à remercier les personnes suivantes, qui ont mis
à ma disposition leurs archives privées et m’ont aidée lors de la recherche documentaire : F.Beau,
dessinateur de films animés, S.Roffat et E. Glon, chercheurs, B.Capitain (Deutsches Filminstitut,
Wiesbaden), P.Feindt (Institut des wissenschaftlichen Films, Göttingen), A. Eckardt (Deutsches Institut
für Animationsfilm, Dresde).
RÉSUMÉS
Les dirigeants nazis ont reconnu précocement que le cinéma était « l’un des moyens de
manipulation des masses les plus modernes »(Goebbels, 1934). Des moyens considérables ont alors été
réquisitionnés pour soutenir la politique expansionniste de Hitler et remporter également la
« guerre culturelle ». Au-delà de la diffusion de valeurs martiales, les images filmiques devaient
aussi divertir et faire oublier les rigueurs du conflit. Films historiques et de fiction,
documentaires, « actualités », dessins animés, publicités : avec des stratégies de communication
extrêmement raffinées, le régime a encouragé le développement de productions
cinématographiques aux fonctions complémentaires, et a fait des salles obscures un véritable lieu
de « culture populaire ». Difficiles d’accès, car soupçonnés d’être aujourd’hui encore très
Revue historique des armées, 252 | 2008
27
efficaces, les documents filmiques de cette époque méritent l’attention des chercheurs, qui ont
longtemps négligé certaines sources comme les dessins animés.
War and Cinema in the Nazi era: Movies, documentaries, news, and cartoons in the service of
propaganda.The Nazi leaders recognized early that cinema was “one of the most modern means of
manipulating the masses” (Goebbels, 1934). Considerable resources were then requisitioned to
support the expansionist policies of Hitler and also win the “cultural war”. Beyond the spread of
martial values, film images could also entertain and make people forget the hardships of the
conflict. Fictional and historical films, documentaries, “news”, cartoons, and advertisements:
With communication strategies extremely refined, the regime encouraged the development of
film productions in complementary areas, and made obscure theatres a veritable place of
“popular culture”. Difficult to access, due to suspicions of its still being very effective, the film
footage of that era deserve the attention of researchers, who have long viewed some sources as
cartoons.
INDEX
Mots-clés : Allemagne, cinéma, Deuxième Guerre mondiale, propagande
AUTEUR
CLAIRE ASLANGUL
Normalienne, agrégée d’allemand, diplômée de Sciences-po Paris et docteur en études
germaniques, Claire Aslangul est maître de conférences à l’université Paris IV-Sorbonne. Ses
travaux portent sur la culture visuelle de la guerre dans les œuvres d’art, cartes postales et
affiches du XXe siècle.
Revue historique des armées, 252 | 2008
28
Les services cinématographiques
militaires français pendant la
Seconde Guerre mondiale
Stéphane Launey
1 À la fin des années 1930, dans un contexte de plus en plus marqué par une possible
guerre contre l’Allemagne, le potentiel de l’outil cinématographique en matière de
propagande et de contre-propagande commence a être pris au sérieux par le
gouvernement français. Une circulaire du 25 octobre 1937, signée par le directeur du
service de contrôle des films Edmond Sée, modifie le fonctionnement de la censure en
refusant notamment le visa de production aux films tendant à ridiculiser l’armée ou
susceptibles d’amoindrir son prestige, à ceux pouvant porter atteinte aux sentiments
nationaux des peuples étrangers et ainsi provoquer des incidents diplomatiques.
Ensuite, la circulaire indique que la commission n’accorderait son visa qu’aux films de
guerre et d’espionnage ainsi qu’aux films à scénario militaire ou policiers de toute
nature 1. En effet, les sujets concernant l’armée sont très présents à cette époque dans
la production française : on retrouve à l’écran la figure du militaire dans le film
colonial, le film d’espionnage, la représentation de la Première Guerre mondiale (La
Grande illusion de Jean Renoir sort en 1937), mais aussi d’une manière moins reluisante
dans le comique troupier qui connaît alors un grand succès. La Défense nationale a son
mot à dire dans ce domaine, à la fois en matière de censure, en siégeant à la
commission de contrôle, et, en matière de production, en mettant à disposition de
divers productions du matériel et des troupes ; toutes ces questions sont du ressort de
la Section cinématographique de l’armée (SCA) 2. Cette dernière est l’héritière de la
Section photographique et cinématographique de l’armée (SPCA) créée pendant le
premier conflit mondial et chargée de prendre des images de guerre 3, puis dissoute en
septembre 1919. L’année suivante, le ministère de la Guerre se dote d’une Section
d’enseignement par l’image bientôt appelée Section cinématographique, rattachée au
Service géographique de l’armée (SGA), qui s’attelle à produire des films d’instruction ;
à sa tête, on retrouve des hommes de qualité 4, aidés par des techniciens venant des
firmes civiles lors de leur service militaire. En 1926, le capitaine Joseph Calvet 5 prend la
Revue historique des armées, 252 | 2008
29
direction de la section pour y effectuer un remarquable travail, réalisant notamment
un film sur la Première Guerre mondiale ainsi qu’une série de films à l’occasion de
l’Exposition coloniale de 1931, sur la vie militaire dans les colonies grâce à des images
tournées en Afrique d’octobre à décembre 1930. Mais l’une des réussites de la section
est la banalisation de l’emploi du cinématographe au sein de l’armée ; en effet, la
plupart des corps de troupes sont dotés d’appareils de projection à la fin de la décennie
et des officiers instructeurs sont formés dans chaque région militaire, permettant ainsi
d’effectuer des travaux d’instruction en particulier grâce au cinétir. Ce procédé
novateur « permet de faire du tir réduit à différentes armes dans des conditions très réalistes :
une séquence de combat est projetée, le soldat qui est muni d’une arme équipée pour le tir réduit,
tire sur l’objectif apparaissant sur l’écran ; le film s’arrête après le départ du coup pour
apprécier la qualité du tir »6. Parallèlement, la marine et l’armée de l’Air se dotent d’un
service cinématographique rattaché au service de presse de leur ministère,
respectivement en 1936 et 1937. Ainsi, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, les
différents organes militaires disposent de leur propre cellule cinématographique.
Le cinéma mobilisé
2 Le 29 juillet 1939 est créé le Commissariat général à l’information (CGI) dirigé par Jean
Giraudoux, chargé d’organiser, d’animer et de coordonner les services d’information et
de propagande français 7. Un service cinéma en fait partie, d’abord dirigé par Yves
Chataigneau puis par l’avocat Henry Torrès. Si l’un des objectifs de départ de ce service
est de produire des films de propagande comme Sommes-nous défendus ?, son travail est
peu à peu absorbé par la censure. Dans cette organisation, quel est le rôle joué par la
Section cinématographique de l’armée dès le début de la guerre ? Tout d’abord, la SCA
voit ses effectifs renforcés en septembre 1939 avec la mobilisation d’opérateurs de
prises de vues des firmes d’actualités mais aussi de l’industrie privée avec l’arrivée,
entre autres, de Jean Renoir dont Calvet note qu’il a été « volontaire pour des prises de
vues aux armées, il en a réalisé en Alsace de tout premier ordre. Technicien de valeur, très épris
de son art, excellent camarade et militaire au port correct » 8.Des équipes d’opérateurs sont
constituées au sein des groupes de canevas de tir des neuf corps d’armée et dépendent
du 6e groupe autonome d’artillerie ; leur rôle est de filmer et de photographier 9 le front
mais aussi de divertir la troupe en organisant des projections 10. Mais l’heure n’est plus
aux films d’instruction et les images prises sont envoyées à la section, qui délaisse ses
quartiers sis boulevard Mortier pour s’installer au début des hostilités dans les locaux
de la Gaumont au 35 rue du Plateau dans le 20e arrondissement de Paris. Les prises de
vues servent à la confection du Journal de guerre dont le montage est notamment
effectué par le réalisateur Jean Delannoy. Pendant la « Drôle de guerre » et jusqu’en
mai 1940, son contenu est composé pour l’essentiel d’images de scènes de vie dans les
armées 11; ce journal hebdomadaire filmé a la particularité d’être projeté à la troupe par
les équipes de la section cinématographique, ainsi qu’en Europe et en Amérique du
Nord, mais non dans les salles de métropole, résultat de l’accord réservant la projection
d’images du front aux firmes d’actualités et à leurs journaux. Les intérêts de la presse
filmée sont représentés par Roger Weil-Lorac 12 qui travaille en liaison constante avec la
SCA, seule habilitée à filmer dans la zone des armées et dont les images sont soumises à
la censure exercée par des officiers du Grand Quartier général. De son côté, le Service
cinématographique de la marine (SCM), dirigé par le commandant Coquelin, est chargé
de la distraction des équipages, de la production de films de propagande en liaison avec
Revue historique des armées, 252 | 2008
30
l’industrie privée comme Marine 39 et Front de mer, mais ces films intègrent aussi les
images tournées par ses propres opérateurs embarqués. Enfin, le Service
cinématographique de l’Air 13 (SC Air), installé rue Saint Didier à Paris sous les ordres
du capitaine Lasquellec, fait un travail comparable dans son emploi à celui de la SCA
tout en mettant l’accent sur des techniques spécifiques comme les prises de vues au
ralenti et les photographies panoramiques continues réalisées à bord d’avion. Au mois
de juin, les images de Narvik et de la bataille de Dunkerque sont diffusées dans le
dernier numéro du Journal de guerre et devant l’avancée allemande, la Section
cinématographique de l’armée se replie sur Ballan-Miré 14, à partir du 19 juin 1940,
avant de repartir pour Sauveterre Saint-Denis où son personnel est démobilisé le
15 août (le SC Air se replie quant à lui sur Amboise puis Toulouse). Les films négatifs de
la section, demeurés en Touraine, sont ultérieurement découverts et pris par les
Allemands 15.
L’armée de Vichy
3 Quel est le devenir du cinéma au sein de l’armée d’armistice ? Avec l’État français, on
assiste à une remise en cause de l’industrie cinématographique avec comme leitmotiv
de préserver l’indépendance de cet outil vis-à-vis des Allemands. C’est ainsi qu’est créé
le Comité d’organisation de l’industrie cinématographique (COIC) chargé de défendre
les intérêts du cinéma français 16, et un journal d’actualités unique Journal France-
Actualités-Pathé commence à être diffusé le 15 octobre 1940. Dans l’armée, il est clair
qu’un service cinématographique subsiste et tente de s’organiser après divers aléas. En
effet, le SGA, tutelle de la section cinéma, est dissous dès le mois de juin pour donner
naissance à l’Institut géographique national rattaché au ministère des
Communications ; le matériel de la section est convoité par le nouveau service
cinématographique de l’information, héritier de celui du CGI. Mais grâce à
l’intervention du secrétaire d’État à la Guerre, le général Huntziger, évoquant
l’importance du service « pour l’instruction et la récréation de la troupe [qui] s’est encore
accrue dans l’armée d’armistice à laquelle nous devons consacrer tous nos soins » 17, une entité
cinématographique reste ainsi au sein de l’institution militaire. Comment expliquer
cette volonté des chefs de l’armée de garder un service cinéma ? Tout d’abord, le
général Huntziger 18 est un des seuls à croire au potentiel de l’image animée et ce dès la
campagne de 1940 ; ensuite dans le grand dessein qui est de donner un rôle moteur à
l’armée dans la refondation du pays, le cinéma trouve sa place car son potentiel en
matière d’instruction doit permettre de mettre en pratique les directives du 3 e bureau
de l’armée, dont certains officiers, à l’instar de son responsable le colonel Touzet du
Vigier, sont favorables à une reprise des combats. La direction du nouveau service
cinématographique de l’armée est confiée, à partir du 15 décembre 1940, au
commandant André Brouillard. Cet officier, saint-cyrien, s’est distingué pendant la
guerre du Rif et écrit des romans d’espionnage sous le pseudonyme de Pierre Nord,
dont il signe certaines adaptations pour le grand écran. À la déclaration de la guerre,
Brouillard est chef des services spéciaux de la 9e armée, capturé, il s’évade et travaille
un temps à l’office central de traduction. Les raisons de sa nomination en tant que chef
de service ne sont pas exactement connues, mais l’on sait qu’il signe un mémento
développé sur l’utilité et les risques du cinéma en matière de propagande et qu’en tant
que patriote et militaire, ancien des réseaux Corvignolles 19 et du Centre d’informations
Revue historique des armées, 252 | 2008
31
et d’études du colonel Groussard, il fait partie de ces hommes de droite qui ont comme
projet de continuer le combat contre l’occupant 20.
4 Dès le début de l’année 1941, le SCA devient un service civilisé au sein de l’armée
d’armistice et dépend du service du matériel, mais il n’aura une autonomie complète
qu’à partir de janvier 1942. Le service se trouve en ordre de marche avec comme
mission principale la production « des films d’instruction et d’action morale au profit de
l’Armée, des films de propagande en faveur des engagements et des rengagements, des films
mettant en valeur le rôle de l’Armée dans l’éducation morale du Pays, et dans la sauvegarde de
l’Empire »21. Afin de mener à bien ce programme, le commandant Brouillard se trouve à
Vichy où il est en liaison avec les autorités auxquelles il propose les scénarii à tourner :
le 3e bureau pour les questions d’instruction et le cabinet du secrétariat d’État à la
Guerre pour les questions de propagande 22. L’équipe technique est regroupée au 360
rue Paradis à Marseille, dirigée par Jean Blech et secondé notamment par Jean Velter
chargé du cinéma d’instruction et André Vuatrin pour la diffusion ; ces officiers étaient
déjà présents à la section cinématographique dans les années 1930, élément important
pour une bonne relance de l’activité du service. Le personnel s’élève à 113 personnes
dont près de la moitié sont des techniciens, parfois venus du cinéma privé et engagés
sous contrat. Dans ce dispositif, la réalisation de films d’instruction s’avère être la
priorité du chef du SCA et il est indéniable que les sujets abordés le sont dans l’optique
de préparer la troupe à une possible reprise des combats ; ainsi à l’été 1941, se trouve
terminé un film ayant pour thème l’emploi des explosifs et la mise en chantier d’un
film« d’une certaine ampleur au sujet de l’emploi offensif des unités de l’armée d’armistice » 23;
une partie des tournages s’effectue au camps de Caylus. Un autre volet, et non des
moindres, consiste en la livraison de scènes militaires aux actualités filmées (voir
tableau), mais le rapprochement franco-allemand dans le domaine de la presse filmée
aboutit à la création du journal unique France-Actualités et pousse Brouillard à
développer sa coopération avec le magazine La France en marche produit par Verdet-
Kleber. Ainsi le SCA participe à la production de divers documentaires sur la vie
militaire, interdits de diffusion en zone nord 24 , pour cette société ; d’autre part, le
service réalise des films de propagande avec la mise en avant des troupes d’élite de
l’armée d’armistice, tel le titre Cavalerie française sur le 2 e régiment de dragons du
colonel Schlesser basé à Auch. L’Empire est loin d’être oublié et des équipes 25
sillonnent l’Afrique française pour montrer l’œuvre de l’armée d’Afrique, notamment
auprès des populations du désert ; de même, l’opérateur Potentier est envoyé en Syrie
pour couvrir les événements de l’été 1941. Parallèlement, André Brouillard, en tant
qu’homme de cinéma, s’attelle à produire des films romancés sous son nom de plume.
Un projet intitulé Et d’abord de la tenue est abandonné par manque de costumes
historiques, mais le film La Belle vie 26 est bel et bien réalisé par Robert Bibal et évoque
les raisons de l’engagement de quatre hommes aux origines différentes. Or le film est
mal reçu, car le SCA, étant un service d’État, ne peut concurrencer les productions
privées. Finalement, le général Huntziger demande à ce que le long métrage soit
découpé en quatre parties. Si l’on veut dresser un bilan de l’activité du SCA pour les
années 1941 et 1942, il semble avoir rempli sa mission au vu des 124 films produits
(instruction, actualités, documentaires et deux films romancés) et des 173 reportages
photos effectués 27. En novembre 1942, le coup de tonnerre que constitue l’occupation
par les Allemands de la zone libre change la physionomie du service. En premier lieu,
André Brouillard rejoint la clandestinité où il joue un rôle important comme agent de
renseignement au sein du réseau Eleuthère et l’on peut affirmer qu’à la tête du SCA, il
Revue historique des armées, 252 | 2008
32
mena certaines actions au vu des reproches qui furent faits sur ses nombreux
déplacements en voiture, notamment sur la côte sud-est. Henri Fabiani 28, jeune
opérateur de prises de vues sous contrat en 1941, évoquait quant à lui la présence de
caisses de munitions au sein du matériel technique lors de déplacements en zone libre.
5 Après le départ de Brouillard, le SCA se replie à la Bourboule (Puy-de-Dôme) avec à sa
tête le commandant Jean Blech ; l’équipe en place profite du déménagement pour
camoufler du matériel « de prises de vues et ses archives dans la montagne, en particulier sur
la commune de Murols. Une autre partie de ce matériel était stockée chez des paysans aux
alentours même de la Bourboule : c’était le cas pour les lampes de projection et les tubes radio
(…). C’est ce matériel qui a permis au SCA de reprendre rapidement l’activité qu’il a eu dès
septembre 1944 »29. Sur place, le service ne bénéficie que d’une pension de famille pour
installer son matériel et son effectif tombe à 71personnes ; quant à son activité, elle se
heurte au manque de pellicule qui frappe l’ensemble du territoire. Le SCA 30 réalise des
reportages photographiques et quelques films au profit de la garde et des chantiers de
jeunesse avant de se lancer dans un grand projet de long métrage, qui ne verra jamais
le jour, sur la vie du général révolutionnaire Marceau avec comme réalisateur Henri
Decoin. L’entité cinématographique de la marine, notamment avec des annexes à
Casablanca et à Dakar, subsiste et travaille principalement à des productions
documentaires pour La France en marche.
La France libre
6 Même s’il est embryonnaire à sa création, un service cinématographique existe dès
juillet 1940 à Londres. Son noyau dur est constitué de Français ralliés d’origine
anglaise : le sous-lieutenant Francis Mac Connel, ancien chef de la mission de la SCA en
Norvège en 1939-1940, et Jacques Curtis appelé au SCM qui rejoint Londres après un
périple par le Portugal. Avec un budget minimum, du matériel est acheté, une caméra
et de la pellicule sont prêtées par la Paramount ; l’équipe constituée accompagne le
général de Gaulle dans son périple africain qui commence au mois de septembre avec
l’opération Menace et le projet de débarquement sur Dakar. Dépendants du 2 e bureau,
les opérateurs sont dotés d’une autorisation leur permettant de filmer et photographier
dans tous les territoires britanniques sous contrôle des Forces françaises libres 31.
Parallèlement, le quartier-maître Guy Mas s’occupe des questions cinématographiques
et photographiques au sein du service de propagande des Forces navales françaises
libres (FNFL), il met d’abord en place des séances de cinéma récréatif à bord des navires
français, puis petit à petit filme et photographie les activités FNFL dans tout le
Royaume-Uni, ce qui s’avère être un programme chargé 32. Conjointement, le service de
l’information se dote, dès la fin de l’année 1940, d’un bureau photographique et cinéma
dirigé par Claude Divonne de Boisgelin ; dans un premier temps, le manque de
personnel français fait que les photographies sont faites par des reporters anglais et la
Paramount assure l’exclusivité des prises de vues pour la France libre, avant que
Maxime de Cadenet n’intègre le service en tant que cinéaste et le renfort de Guy Mas.
7 Après le débarquement manqué de Dakar, le SCA des FFL suit la 1 re division française
libre jusqu’à Damas. À Beyrouth, il se trouve rattaché au Service d’information et de
radiodiffusion du gouvernement provisoire du Levant à partir de septembre 1941.
L’équipe initiale est renforcée par la venue de Jean Bramy, ancien chauffeur du général
de Gaulle, et Jean Costa 33 ; malgré des problèmes d’infrastructure liés notamment au
Revue historique des armées, 252 | 2008
33
manque de moyens de locomotion (suite à une panne, la voiture cinéma Humber du
service mise en réparation dans un parc anglais se retrouve en circulation sous une
autre immatriculation, une autre voiture accidentée est ensuite affectée après
réparation au général Kœnig), le SCA devient le producteur d’images pour tous les
territoires de la France libre, hors Royaume-Uni. Les reporters travaillent dans
l’urgence et souvent « dans des conditions qui ne cadrent pas toujours avec un règlement
militaire » 34. Les équipes effectuent divers reportages au départ de Beyrouth dans tout
le Moyen-Orient, mais aussi en Afrique équatoriale française afin de mettre en valeur la
ligne aérienne Damas-Brazzaville. Mais en 1942, l’objectif principal des missions porte
sur les combats dans lesquels les FFL sont engagées en Libye, notamment à Bir Hakeim.
Dès le mois de mars, Kœnig voit d’un mauvais œil l’activité des membres du SCA et des
reporters en général, et entend encadrer leur action par différentes notes : « La
propagande doit donc poursuivre ce seul but : le combat et exalter ce qui le compose : armes,
danger, vie pénible. Notre propagande doit exclure les absurdités de la propagande 39-40 "cette
drôle de guerre". On ne se bat pas avec du théâtre aux armées, des leçons de culture physique,
des marraines, des colis, de la "boustifaille", des barbus. Les photos qui pourraient être vues par
des Français prisonniers, par des Français enfermés en France, captifs chez eux, doivent nous
montrer les armes à la main. »35 Dorénavant, les reporters doivent recevoir des directives
claires du 2e bureau avant leur départ en mission et passer devant le service de censure
avant toute publication36 une fois leur travail fini. Ainsi, à titre d’exemple, une note du
service d’avril1942 mentionne qu’une équipe de propagande est mise à disposition, elle
« sera autonome sous la direction de son chef et sera détachée auprès de la Force L aussi
longtemps que cela sera nécessaire. Elle travaillera sous la direction du général de Larminat, du
général Kœnig et de la délégation du Caire qui s’occupera de la réalisation immédiate des
documents pris dans le désert et de leur transmission à tous les postes extérieurs (…). Je crois
seulement qu’il faudrait attirer l’attention des autorités britanniques sur la nécessité de
soumettre à la censure des FFL tous les documents qui les concernent car je puis constater que
sur trois des erreurs qui ont été relevées à l’encontre de nos photographes, les deux plus
importantes qui concernaient la publication de documents ridicules parues dans la revue
Images sur les FFL, émanaient non pas de nos agents mais de photographes britanniques sur
lesquels nous n’avons malheureusement, jusqu’ici, aucun moyen d’action » 37. Dans ce schéma,
la place du Caire est centrale puisque les studios Misr, dirigés par un Français,
M. Vigneau, permettent le développement et le montage des prises de vues ; un agent
de liaison est chargé de s’occuper des intérêts des FFL en matière de propagande 38 au
Caire. Jusqu’à la fin du conflit et après le départ de Mac Connel 39, le SCA du Moyen-
Orient n’en continue pas moins son activité en filmant notamment : la tournée du
général Legentilhomme à Madagascar et à la Réunion en 1943, l’aide médicale au désert
ou encore des reportages auprès de l’armée soviétique 40.
De l’Afrique du Nord à la fin de la guerre
8 En janvier 1940, une antenne du SCA fonctionne au Maroc chargée de couvrir le théâtre
d’opérations en AFN sous la direction du lieutenant Henri Chomette 41. Un an plus tard,
le commandant Brouillard le rappelle pour s’occuper de la nouvelle section du Maroc,
mais son décès en août 1941, à la suite d’une maladie, semble ralentir l’activité de la
section. En avril 1942, le service d’Alger est remis sur pied au sein de l’armée d’Afrique
avec à sa tête le capitaine Perrin. Le débarquement anglo-américain de novembre 1942
change alors la physionomie du conflit. Dès le mois de décembre, une section de SCA 42
Revue historique des armées, 252 | 2008
34
est créée avec comme buts la constitution d’archives de guerre pour les besoins
historiques, l’instruction avec l’adaptation et la projection de films de l’armée
américaine et éventuellement la production de films d’instruction, la propagande avec
l’édition d’un Journal de guerre, enfin la distraction de la troupe sous le contrôle du 2 e
bureau ; en parallèle, des sections air et marine font partie du service. Le SCA recrute 43
alors des cameramen comme Raymond Méjat et Roger Monteran, anciens reporters en
AFN pour France-Actualités, mais ces derniers doivent venir avec leur propre caméra ; en
outre, une partie du personnel et du matériel, notamment un camion Optiphone équipé
pour les prises de son, provenant de l’équipe du film romancé Destin venu en tournage à
Colomb Bechar juste avant le débarquement, se trouvent intégrés 44. Le siège du service
se trouve 8 rue Wembrenner à Alger et il est dirigé par le commandant Raphel depuis le
mois de juillet 1943. Pendant l’année 1944, des tractations seront menées pour confier
les rênes d’un SCA aux compétences étendues en prévision de la libération du territoire
national au cinéaste René Clair exilé à Hollywood ; celles-ci n’aboutiront pas pour un
faisceau de raisons à la fois politiques et personnelles 45. D’autre part, un fait majeur en
matière de propagande filmée intervient avec la création à Alger en avril 1943 de
l’Office français d’information cinématographique (OFIC) dépendant du commissariat à
l’Information, chargé de « la production, la distribution et la présentation à titre onéreux ou
gratuit de films d’intérêt national concernant les actualités, la propagande ou l’éducation, que
l’initiative privée n’est pas en situation de produire, distribuer ou représenter dans les mêmes
conditions pendant la guerre » 46. L’OFIC, créé pour faire contrepoids à la mainmise
anglaise en matière d’information filmée et par souci d’indépendance, possède divers
bureaux (Alger, Casablanca, Tunis, Le Caire, Londres avec Boisgelin et New York)
chargés de distribuer ses films dans les territoires de la France libre et se dote d’un
magazine d’actualités nommé Ici, la France ; en outre, des images de l’office sont
incorporés à hauteur d’un tiers au magazine d’actualités allié Le Monde libre. Dans cette
organisation, le SCA continue son travail au sein des armées mais se doit de fournir
l’OFIC. Sur le terrain, l’année 1943 voit la couverture de la campagne de Tunisie et la
libération de la Corse ; un renfort important de matériel venant d’une compagnie
photographique américaine 47 entraîne le recrutement de nouveaux personnels au
début de l’année 1944. Pour la campagne d’Italie, une équipe du SCA, dirigée par le
sous-lieutenant Albert Plécy, est détachée auprès du Corps expéditionnaire français
(CEF) avec reporters photographes et cinéastes en nombre variable, et chargée de
recueillir les prises de vues pour les besoins historiques et la confection du Journal de
guerre ainsi que la projection de films récréatifs ou de propagande pour les troupes
dans les cantonnements de repos. L’état-major du CEF est « à même d’orienter son activité
vers les secteurs intéressants »48. Les images prises sont envoyées au siège du service à
Alger pour tous les travaux annexes.
9 Dès juin 1944, le SCA basé à la Bourboule joue un rôle au sein des FFI et les reporters de
l’armée française prennent pied en métropole avec le débarquement de Provence. La
convergence se fait à Paris. Passée l’euphorie, l’armée se remet en ordre de marche
pour la libération du territoire ; le service cinématographique reprend son activité,
notamment grâce au matériel camouflé dans le Puy-de-Dôme, au sein du service de
presse (5e bureau) de la 1re armée. On y retrouve à sa tête le lieutenant-colonel André
Brouillard 49 installé dans des locaux sis au 72 avenue des Champs-Élysées. Bien que
certains membres du SCA basé à Alger reviennent en France, l’heure est à trouver des
cameramen pour couvrir les combats qui s’intensifient à l’hiver 1944, notamment en
Alsace. Pour ce faire, des opérateurs sont engagés sous contrat, ce qui n’est pas du goût
Revue historique des armées, 252 | 2008
35
des techniciens de l’industrie privée. Ainsi, lors du passage du cameraman Henri Persin,
engagé sous contrat comme second opérateur par le SCA, devant le comité d’épuration
de la presse filmée, Henri Alekan (membre du jury et futur chef opérateur de La Bataille
du rail), évoque le fait que « du point de vue professionnel, cette question a besoin d’être
éclaircie car l’on constate que l’armée ne passe pas par les syndicats et ne s’entoure d’aucune
garantie (…) d’une façon générale, il est anormal que quelqu’un qui a été quelques mois en
travail puisse être second opérateur, alors qu’au studio, il faut vraiment des années » 50. En
filigrane se dessine la rivalité qui oppose le SCA au Comité de libération du cinéma
français et aux syndicats de techniciens, souvent d’obédience communiste, notamment
au sujet des actualités filmées 51. Pour l’heure, chaque division et corps d’armée doit
disposer d’une équipe, appartenant au service cinématographique, constitué de trois
reporters 52. À titre d’exemple, un tableau d’effectifs du SCA en date du 22 février 1945
mentionne trente-quatre premiers et seconds opérateurs de prises de vues dans la zone
des armées 53, alors que huit étaient présents au siège parisien du service. Sur le front,
cameramen et photographes font preuve d’un grand courage souvent salué par la
hiérarchie militaire dans la couverture du conflit jusqu’en Allemagne et certains y
laisseront leur vie tels Robert Boissière, Roland Faure, Sivan ou Gaston Madru tué à
Berlin. Parallèlement, le Service cinématographique de la marine 54 reprend ses
activités en liaison avec la production française notamment pour le film La Marine au
combat de Jean Arroy. Quant au SC Air, il se réinstalle rue Saint Didier en
septembre 1944 et s’attelle à produire documentaires et films d’instruction. Mais
surtout, le service recrute dès le début de l’année 1945 de nombreux jeunes techniciens
engagés pour quatre ans, une formation leur étant dispensée à l’école de cinéma du
Signal Corps basée à Astoria près de New York, et devant participer au programme de
propagande aéronautique mis en place avec la création de nouvelles sections dans les
colonies, notamment en Indochine 55. Le SCA envoie lui aussi des reporters en
formation à l’école d’Astoria dès l’été 1945. Sa production est partagée entre la
conception d’un journal d’actualités consacré surtout aux événements militaires avec
des reportages sur la présence française en Allemagne (organisation des
gouvernements militaires, installation des troupes) et un programme de près de trois
cents films d’instruction, certains étant le doublage de films américains. Enfin, le
service se lance dans un rôle de « coproducteur, fournissant la partie technique, c’est-à-dire
la figuration militaire, le matériel de guerre, la documentation, la possibilité d’entrer dans les
zones d’opération ou d’occupation réservées » 56, pour les longs métrages suivants: Fils de
France de Pierre Blondy sur les régiments de chars ou encore Les Démons de la nuit
(d’abord intitulé Âmes qui vivent)d’Yves Allégret évoquant l’action des commandos.
10 Ainsi les services cinématographiques dès la fin de la guerre s’efforcent, comme le note
judicieusement l’historienne Sylvie Lindeperg, de clarifier l’image de l’institution
militaire, brouillée par le legs des années 1940-1944, de soigner les blessures nationales
en procédant à une réécriture cohérente et subtilement lacunaire du dernier conflit et
enfin à justifier les choix politiques du général de Gaulle en redéfinissant le rôle des
différents artisans de la Libération 57, en omettant souvent le rôle des Forces françaises
de l’intérieur. S’il est un bilan à tirer de l’emploi du cinéma pendant le conflit, il est
indéniable que son rôle a été reconnu au sein des armées françaises au regard de
l’existence des différentes entités qui filmaient et photographiaient les faits et gestes
dans une optique de propagande et dans une moindre mesure d’instruction.On peut
voir dans la création en juillet1946 du Service cinématographique des armées, qui
s’installera au Fort d’Ivry à la fin de la décennie, un symbole de la prise de conscience
Revue historique des armées, 252 | 2008
36
des autorités militaires du potentiel de l’outil cinématographique au vu de son emploi
pendant la Seconde Guerre mondiale.
NOTES
1. JEANCOLAS (Jean-Pierre), Le cinéma des Français. Quinze ans d’années trente (1929-1944), Paris,
Nouveau monde éditions, 2004, p. 204.
2. SHD/DIMI, 3 R 145, dossier 1, films de cinéma : appui et participation de l’armée, notamment
aux films Napoléon d’Abel Gance, Quatre de la légion (1924-1939) ; dossier 2, films, actualités
cinématographiques, surveillance des prises de vues durant les manœuvres (1932-1939) ;
dossier 3, films, projet de réorganisation du service géographique de l’armée (section
cinématographique), prises de vues de la ligne Maginot, commission de contrôle
cinématographique, contrôle des prises de vues dans les enceintes militaires et les manœuvres
(1928-1939).
3. VÉRAY (Laurent), Les films d’actualités français de la Grande Guerre, Paris, AFRCH/SIRPA, 1996,
245 pages.
4. SHD/DAT, 8 Y e 56 248, dossier de carrière du chef de bataillon Raymond Hoffmann, chef de la
Section d’enseignement par l’image, avec le grade de capitaine, du 7 octobre 1920 au 1 er avril
1926. Sur la proposition du chef du SGA, il a été désigné par l’état-major de l’armée pour remplir
du 18 mai au 31 juillet 1928, une mission de propagande, au titre de l’enseignement, auprès du
ministère de la Défense nationale turque (académie militaire) ayant pour objet l’installation d’un
institut cinématographique et la confection de films d’instruction.
5. SHD/DAT, 8 Y e 39 559, dossier de carrière du colonel Joseph Calvet. Son activité au sein de la
SCA est reconnu comme en témoignent des lettres de félicitations du ministre de la Guerre : «
S’est tout particulièrement signalé par l’intelligente activité et le dévouement dont il a fait preuve au cours
d’une mission accomplie auprès (…) de l’Armée du Rhin »(8 mars 1928) ; « a créé en outre un grand film
sur l’histoire coloniale française qui constitue un document sans précédent »(9 mai 1932).
6. DUTAILLY (lieutenant-colonel Henry), Les problèmes de l’armée de terre française, 1935-1939, Paris,
SHAT, 1980,p. 236. L’auteur rappelle que « la coopération interarmes provoquée par l’apparition des
chars et de l’aviation contraint [les corps de troupes] à demander le concours d’unités extérieures qui ne
stationnent pas nécessairement dans la même garnison et qui ne sont pas toujours disponibles. Le cinéma
et son dérivé le ciné tir, pallient partiellement cette carence ». Dans cette optique, la circulaire du
25 février 1937 mentionne que l’instruction par le cinéma fait partie des prérogatives du
commandement.
7. MEGRET (Maurice), « Les origines de la propagande de guerre française (1927-1940) », Revue
historique de la Deuxième Guerre mondiale, no 41, janvier 1961, p. 19.
8. SHD/DAT, 8 Y e 9 912, dossier du lieutenant de cavalerie Jean Renoir, notation, 1 er septembre
1940. Deux fois blessé pendant la Première Guerre mondiale, le cinéaste est affecté en qualité de
spécialiste au SGA en octobre 1938 puis mobilisé avec le grade de lieutenant. En décembre 1939, à
la demande du CGI, il part tourner Tosca à Rome et s’exile à Hollywood à la fin de l’année 1940.
9. La photographie représente une part importante du travail, notamment en matière de
propagande, au sein de la SCA et l’appellation « cinématographique » des différentes sections et
services étudiés tout au long de cet article englobe l’image fixe. Pour 1939-1940, la Section
photographique de l’armée a vu travailler en son sein l’historien du cinéma Georges Sadoul et
Revue historique des armées, 252 | 2008
37
Henri Cartier-Bresson. Voir : SADOUL (Georges), Journal de guerre (2 septembre 1939- 20 juillet 1940),
Paris, L’Harmattan, 1994 (2e édition), 250 pages.
10. SHD/DAT, 27 N 84, dossier 6, « Note au sujet du service cinématographique aux armées »,
Grand Quartier général, État-Major général, 3e bureau, 29 septembre 1939.
11. BOROT (François), L’Armée et son cinéma 1915-1940, thèse de doctorat de 3 e cycle sous la direction
de Marc Ferro, Paris X-Nanterre, 1987, p. 285-308. Plus largement sur la SCA de la « drôle de
guerre » consulter la troisième partie « L’effort de guerre de la propagande française 1939-1940 »
(p. 219-334), avec notamment un intéressant dictionnaire des opérateurs aux armées (p. 274-278).
12. Ce dernier démissionnera de son poste à la suite de la décision du CGI de diffuser le Journal de
guerre sur les écrans français à partir de mai 1940.
13. SHD/DIMI, 9 R 727, dossier 16, rapport n o 1501 du capitaine Lasquellec au sujet du
fonctionnement du Service cinématographique de l’Air depuis le début des hostilités, 9 pages,
5 mars 1940. Une autre note fait état de 18 films d’instruction et 8 films de propagande réalisés
avant la guerre ; depuis septembre 1939, outre des documents réalisés dans la zone aux armées
destinés aux actualités hebdomadaires, deux films de propagande sont réalisés : Les Mécaniciens de
l’air sur l’école de Rochefort et Femmes françaises sur l’utilisation de la main-d’œuvre féminine
dans une usine de construction aéronautique. En juin 1940, 12 films de propagande étaient en
cours de sonorisation. En outre, le rapport préliminaire no 1/40 du 3 novembre 1940 sur le SC Air
précise que depuis le conflit, environ 100 000 photographies ont étés prises et 2 films de
propagande réalisés, enfin 2 films d’instruction étaient en préparation.
14. WEIL-LORAC (Roger), Cinquante ans de cinéma actif, Paris, Dujarric, 1977, p. 71. L’auteur précise
qu’une commission avait établi les plans d’un laboratoire de développement et de tirage destiné à
travailler en cas de guerre dans cette commune d’Indre et Loire.
15. SHD/DIMI, 9 R 48, dossier 5, rapport particulier n o 3 au sujet du SCA, 17 février 1941, p. 5 et 6.
16. BERTIN-MAGHIT (Jean-Pierre), Le cinéma français sous l’Occupation, Paris, Perrin, 2002. Voir le
chapitre III « Les premières négociations », p. 34-48. À l’armistice, Jean-Louis Tixier-Vignancour,
partisan de Pierre Laval, est nommé secrétaire général adjoint à l’information responsable du
cinéma et de la radio ; il est relevé de ses fonctions à la fin du mois de janvier 1941. Le COIC servit
de base à la création du Centre national de la cinématographie en 1946.
17. SHD/DAT, 2 P 62, dossier 1, note n o 5199/SP du général Huntziger au vice-président du
Conseil, 30 septembre 1940.
18. BOROT, op.cit., p. 284 et 298.
19. EPSTEIN (Simon), Un paradoxe français. Antiracistes dans la Collaboration, antisémites dans la
Résistance, Paris, Albin Michel, 2008, p. 410. Pour l’auteur, Brouillard s’est rapproché des réseaux
militaires d’extrême droite « redoutant le pacifisme et le défaitisme qu’il croit voir triompher avec le
Front populaire ».
20. SHD/DIMI, fonds BCRA, DP 3 242-75, dossier André Brouillard. Note n o D 2 399/BCRA-C,
France combattante, état-major particulier du général de Gaulle, Londres, 5 septembre 1942. La
note précise que : « Brouillard a été séduit par la possibilité d’avoir un emploi semi-militaire en dehors de
l’armée (…). Il était intéressé et s’est dit : "je vais entrer au SCA". Il en a pris la charge, a commencé par
faire des films de propagande militaire. Il a fait des choses extrêmement bien (…). C’était à Vichy que devait
être le centre de la résistance. »
21. SHD/DIMI, 9 R 48, dossier 5, annexe 4 au rapport d’enquête n o 1 du 31 mars 1943, note no
6439/PRS/CAB pour l’EMA, secrétariat d’État à la Guerre, cabinet du ministre, Vichy, 5 avril 1941.
22. SHD/DIMI, 9 R 48, dossier 5, rapport d’enquête n o 1 du 31 mars 1943, p. 10. Véritable mine
d’informations sur le fonctionnement du SCA de 1941 à 1942, ce rapport précise qu’en matière
d’emploi, le service relevait de deux organes différents : « De l’EMA, pour les questions
d’organisation, de réalisation des films d’instruction, de dotation des corps de troupe en salle de cinéma,
matériels de projection, de photographie, de cinétirs et de formation des opérateurs des corps de troupe ; du
Revue historique des armées, 252 | 2008
38
Cabinet du Secrétariat d’État pour les réalisations de films de propagande et l’organisation des tournées de
propagande. »
23. SHD/DAT, 2 P 62, dossier 1, rapport n o 442 SCA/V du commandant Brouillard sur le
fonctionnement du SCA dans le 1er semestre 1941, secrétariat d’État à la Guerre, SCA, Vichy,
7 juillet 1941, p. 3. Il est évoqué aussi en matière d’instruction la production de quatre films de
cinétir distribués à douze corps de troupe sur seize, la préparation d’un film sur la DCA et la
présentation au 3e bureau d’un film documentaire sur l’alcoolisme.
24. Archives de Paris, 901/64/1 n o 258, dossier de Noël Ramettre, opérateur de La France en
marche,devant le comité d’épuration, 9 novembre 1944.
25. SHD/DAT, 2 P 62 dossier 22, films sur l’Empire colonial français par la mission dirigée par
Maurice Noël avec André Persin et Raymond Picon-Borel comme opérateurs.
26. ECPAD, FT 729, film La Belle vie. Cette production est réalisée en 1941 au studio Nicéa de
Saint-Laurent du Var et bénéficie du travail sur l’image de Willy qui travailla sur les films de
Pagnol, la distribution comporte des acteurs connus comme Claude Dauphin. Un second film
intitulé Un gars de la terre scénarisé par Pierre Nord et réalisé par Robert Bibal se trouve au
montage en mars 1943, malheureusement nous n’avons pu retrouver sa trace après cette date.
27. SHD/DIMI, 9 R 48, dossier 5, rapport d’enquête sur le SCA, Vichy, 31 mars 1943, p. 20 et 21.
28. SHD/DITEEX, 3 K 98, témoignage oral d’Henri Fabiani, CD II plage 1. De même, lors d’une
rencontre avec Jean Blech à Paris vers la fin de l’Occupation, ce dernier laissa entendre à Fabiani
qu’il était dans la Résistance.
29. SHD/DIMI, Résistance, dossier de demande d’homologation FFI de Jean Velter.
30. Sur le sujet du SCA basé en métropole de 1940 à 1944, se reporter à : LAUNEY (Stéphane), Le
Service cinématographique de l’armée de Vichy 1940-1944, maîtrise d’histoire sous la direction de G.-H.
Soutou, Paris IV-Sorbonne, 2005, 112 pages. Consulter aussi la cote SHD/DAT, 2 P 62, qui
renferme la majeure partie des archives du service et SHD/DIMI 9 R 48, dossier 5 qui contient
deux intéressants rapports (en date du 17 février 1941 et du 31 mars 1943) sur le fonctionnement
du SCA.
31. SHD/DITEEX, 1 KT 1 565, papiers Jacques Curtis. Note FFL, état-major 2 e bureau, Londres,
8 août 1940.
32. SHD/DM, TTC 36, dossier propagande, « Frais de transport de films et matériel
cinématographique », FNFL, état-major, Londres, 16 septembre 1942. Cette note nous permet de
suivre une partie de l’activité de Guy Mas : il effectue des prises de vues cinéma à Harwich (côte
est de l’Angleterre) le 12 août, une projection à Beaconsfield (nord-ouest de Londres) le 15 août ;
de nouvelles prises de vues cinéma à Dundee (Ecosse) du 18 au 22 août et à Penzance
(Cornouailles) du 4 au 6 septembre. Enfin, pendant cette courte période, Guy Mas effectue une
projection cinéma à Dundee, le 9 septembre, avant de finir par des prises de vues à Criccieth (côte
du Pays de Galles) du 7 au 13 septembre 1942.
33. Les personnes suivantes ont travaillé au service cinématographique ou en ont accompagné
les équipes : les opérateurs de prises de vues B. Poirée et Jouckadar ; l’adjudant Quigley,
journaliste américain engagé aux FFL ; le sergent Lenhardt, spécialiste du radio reportage ; le
sergent féminin de Segrais ; le sergent pilote Skeddvanoff ; le sergent Février, ingénieur du son ;
le commissaire de la marine Ladune, attaché de propagande FNFL dans le Moyen-Orient.
34. SHD/DIMI, 4 H 327, dossier 1, compte rendu du sous-lieutenant Mac Connel, Beyrouth,
17 novembre 1941. Dans une note no 360/P du 12 décembre 1941, Lassaigne, chef du service
d’information et de radiodiffusion, prend la défense de Mac Connel parti sans ordre de mission
signé de Catroux pour couvrir dans l’urgence l’inspection par Astier de Villatte de l’escadrille des
Forces aériennes françaises libres en Libye. Lassaigne pointe le fait que Londres et New York
réclament des documents sur l’aviation de la France libre. Pour faire face aux demandes, une
seconde équipe est mise sur pied au sein du service cinéma.
Revue historique des armées, 252 | 2008
39
35. SHD/DIMI, 4 H 327, dossier 1, note n o 447/2 du général Koenig sur la propagande par la
photographie, FFL Force L, état-major, 2e bureau, QG, 25 mars 1942.
36. SHD/DIMI, 4 H 327, dossier 1, note n o 459/2 du général Kœnig à l’état-major, 2e bureau FFL
Levant, FFL Force L, état-major, 2e bureau, 27 mars 1942. Kœnig précise qu’« il ne faudrait pas, en
effet, que, trompant notre bonne foi et arguant du fait que la censure anglaise a déjà opéré au Caire, ces
agents profitent de leur passage dans cette ville pour publier des documents non censurés par vous ».
37. SHD/DIMI, 4 H 325, dossier 1, note n o 539/P de Jean Lassaigne, chef du Service d’information
et de radiodiffusion du Levant au général d’armée commandant en chef des FFL au Levant, état-
major, 2e bureau, Beyrouth, 16 avril 1942.
38. SHD/DIMI, 4 H 325, dossier 1, note n o 272/P du Service d’information de la France libre au
Levant au directeur du cabinet militaire, Beyrouth, 27 février 1942. Les attributions du sous-
lieutenant Dalmas sont de trois ordres : liaison avec la délégation de la France libre au Caire pour
tout ce qui concerne la propagande et le service photographique et cinématographique ; liaison
avec les autorités britanniques du bureau de presseet enfin liaison avec les FFL.
39. SHD/DIMI, Résistance, dossier FFL de Francis Mac Connel. Affecté dans les transmissions
en juillet 1943, il finira la guerre au sein de la 2 e DB. À noter que les sous-lieutenants Bongard et
Aubin commanderont successivement le SCA du Moyen-Orient.
40. SHD/DITEEX, 3 K 106, témoignage oral de Jacques Curtis, cameraman du SCA FFL Moyen-
Orient.
41. SHD/DAT, 8 Y e 5 145, dossier du lieutenant de cavalerie Henri Chomette. Né en 1896, frère
aîné du cinéaste René Clair, il vécut dans l’ombre de son cadet héritant du sobriquet « clair
obscur ». Réalisateur du premier film parlant tourné en France (Le Requin, 1930), il est connu pour
avoir eu des positions antisémites.
42. Pour cette partie, consulter la cote SHD/DAT, 7 P 38, dossier 2, organisation et
fonctionnement, notes sur le matériel et l’équipement du SCA, État-Major général de la guerre,
novembre 1943-mars 1946.
43. De manière non exhaustive, l’on peut citer comme membres du SCA basé en AFN : le
capitaine André Lenoël (adjoint au chef du service), Bertrand Flornoy, les cameramen Jean
Hudelot, Goreau, Tahar Hanache, Gilbert Grosjean (Air), Gérard Py (Marine), Éric Hurel, Raymond
Dubois, les photographes Jacques Belin et Marcel Viard, ainsi que Albert Moulin (services
techniques), Kronegger ou encore Jean Jabely.
44. SHD/DITEEX, 3 K 107, témoignage oral d’Albert Moulin, CD I, plage 4.
45. BILLARD (Maurice), Le mystère René Clair, Paris, Plon, 1998, p. 255.
46. AN, 3 AG 271, dossier 3 : « Ordonnance relative à l’OFIC », commissariat à l’Information,
10 mars 1944. L’OFIC est créé par décret du 16 avril 1943, en théorie ses activités prendront fin à
la signature du traité de paix. L’office possédait ses propres reporters notamment militaires dont
les équipes étaient dirigées en opérations par Roger Leroi : les cameramen François Villiers
(SHD/DITEEX, 3 K 133, témoignage oral), Jacques Manier, Marcel Lucien et Paul Adreani (de
l’équipe du film Destin), Christian Gaveau et Maxime Dely, Saffar ; on peut y ajouter les
photographes Pierre Cludy, Fernand Mourier et Germaine Krull. Après la dissolution de l’OFIC,
certains intégrèrent le SCA. Lire aussi l’article « Comment sont produites à Alger les actualités
cinématographiques », Filmafric (Bibliothèque du film), février 1944.
47. Dans les forces américaines, chaque arme possédait son service cinéma et photo. Celui de
l’armée de terre relevait du Signal Corps (Transmissions) et de nombreux techniciens de
Hollywood y travaillèrent, notamment Franck Capra qui commanda le 834 e détachement photo et
produisit la série de documentaires Why we fight. Fait peu connu, le cinéaste John Ford, officier de
marine, dirigea la Field Photographic Branch de l’Office of Strategic Services, chargée notamment de
recueillir des preuves audiovisuelles des crimes nazis en vue du procès de Nuremberg, voir : MAC
BRIDE (Joseph), À la recherche de John Ford, Arles, Institut Lumière/Actes Sud, 2007, p. 455 à 562.
Revue historique des armées, 252 | 2008
40
48. SHD/DAT, 7 P 38, dossier 2. « Équipe du SCA détachée auprès du CEF », projet annexe à la
note no 1267/SCA pour le cabinet du ministre signé Raphel, Alger, 30 mai 1944. Il est fait mention
de quatre équipes de reportages avec chacune un photographe, un cinéaste et un assistant.
49. SHD/DAT, 61/9496, dossier de carrière du colonel André Brouillard. Après avoir appartenu à
l’état-major des FFI, il réintègre l’armée au sein du SCA le 1 er novembre 1944 puis est affecté à la
Direction générale des études et recherches au mois de février 1945. Parallèlement, sous le
pseudonyme de Pierre Nord, il signe le scénario de Peloton d’exécution d’André Berthomieu,
adaptation d’un de ses romans qui sort sur les écrans en octobre 1945.
50. Archives de Paris, 901/64/1 n o 241, dossier d’Henri Persin devant le comité d’épuration de la
presse filmée, 8 novembre 1944.
51. LINDEPERG (Sylvie), Clio de 5 à 7. Les actualités filmées de la Libération : archives du futur, Paris,
CNRS éditions, p. 50-55.
52. SHD/DAT, 10 P 222, note n o 277/5-A « Directives pour le fonctionnement des 5e bureaux des
corps d’armée et des divisions », 1re armée française, état-major, PC, 17 décembre 1944. D’autre
part, une note intitulé « Compte rendu sur l’activité du service propagande » (SHD/DAT 10 P 223)
du 5 novembre 1944 mentionne que : « 2 850 mètres de films ont été pris et envoyés au SCA. Les
actualités ont commencé à les utiliser depuis un mois. Deux films documentaires sont en préparation à
Paris. Un sur le débarquement de Provence, un sur l’ensemble des opérations de l’armée française avant le
débarquement. Ces deux films seront terminés avant un mois. »
53. SHD/DAT, 7 P 33, dossier 6, note n o 894 SCA/D du chef d’escadron Raphel au commandant
Meyer, directeur des services de presse, ministère de la Guerre, cabinet du ministre, SCA, Paris,
22 février 1945. Il est fait état d’un effectif total de 268 personnes. À noter qu’à partir du 1 er
mai 1945 est créée une compagnie autonome de SCA sis au 27 rue de Berri à Paris.
54. Le Film Français, no 39, 31 août 1945, p. 3. La reconstitution d’archives cinématographiques, la
production d’un long métrage sur l’épopée du Jean Bart et de films d’instruction ainsi que le
divertissement du personnel figurent dans les tâches du SCM basé rue Saint Florentin et
commandé par le lieutenant de vaisseau Tremelat.
55. Le Film Français, n° 41, 14 septembre 1945, p. 4.
56. Le Film Français, no 33, 13 juillet 1945. Des images du SCA sont communiquées aux Actualités
françaises ainsi qu’au pool allié à Londres. Le journal d’actualités militaires produit par le service,
qui se doit d’équiper les corps de troupe notamment en Allemagne, est tiré quant à lui à 35 copies
en 35 mm et 43 copies en 16 mm. Mensuellement, les trois services cinématographiques de la
Défense nationale reçoivent 50 000 mètres de pellicule, dont 30 000 mètres pour le SCA.
57. LINDEPERG (Sylvie), Les écrans de l’ombre. La Seconde Guerre mondiale dans le cinéma français
(1944-1969), Paris, CNRS éditions, p. 108. Plus largement, consulter le chapitre IV sur le SCAmiroir
de la « Franceéternelle »(p. 105-130) et le chapitre V « Terre de France » : dans les marges du
cinéma officiel (p. 131-144).
RÉSUMÉS
En septembre 1939, le cinéma est présent au sein de l’armée française sous la forme d’entités
propres à chaque arme produisant en partie des films d’instruction. La mobilisation voit leurs
cameramen et photographes couvrir le conflit. L’armistice de juin 1940 ne met pas en sourdine,
loin de là, l’emploi de l’image filmée. Dans l’armée de Vichy un service cinématographique dirigé
Revue historique des armées, 252 | 2008
41
par André Brouillard, connu sous son nom de plume Pierre Nord, s’attelle à produire des films à
la fois de propagande mais aussi d’instruction dans le but avoué de former la troupe à une reprise
des hostilités. Que ce soit au sein des FFL de Londres à Beyrouth ou encore en Afrique du Nord
avec la France combattante les services cinématographiques militaires gravent sur la pellicule les
combats auxquelles participent les armées françaises. Leur mission se poursuit avec la libération
du territoire national et ce jusqu’en Allemagne. La hiérarchie militaire reconnaît l’utilité de
l’image en créant en 1946 le Service cinématographique des armées.
Cinematographic Services in the French military during the Second World War.In September 1939,
cinema is present in the French army in the form of entities in each branch of service in part to
produce training films. Mobilization saw their cameramen and photographs cover the conflict.
The Armistice of June 1940 did not silence, far from it, use of the filmed image. In the Vichy Army
a cinematographic production directed by André Brouillard, known under the pseudonym of
Pierre Nord, began to produce films that simultaneously were propaganda but also instruction
with the avowed aim of training troops for a resumption of hostilities. Whether in the FFL from
London to Beirut or in North Africa with French fighting forces military service films captured on
film combat involving the French armies. Their mission continued with the liberation of the
national territory and on into Germany. The military recognized the usefulness of the
cinematographic image by creating in 1946 the Cinematic Service of the Armies.
INDEX
Mots-clés : cinéma, Deuxième Guerre mondiale, ECPAD
AUTEUR
STÉPHANE LAUNEY
Titulaire d’un master 2 en histoire contemporaine. Auteur d’un mémoire de maîtrise intitulé, Le
Service cinématographique de l’armée de Vichy 1940-1944, sous la direction du professeur Georges-
Henri Soutou et soutenu en 2005 à la Sorbonne (Paris IV). Il est actuellement en poste au sein du
bureau des témoignages oraux du Service historique de la Défense.
Revue historique des armées, 252 | 2008
42
Les représentations successives de
la Résistance dans le cinéma
français
Jean-François Dominé
1 Les liens entre la Résistance et le cinéma sont, pour ainsi dire, consubstantiels. Dès sa
naissance, la Résistance se donne à voir comme mise en scène d’elle-même. Ostensible
avec les appels du général de Gaulle, souterraine pour la résistance intérieure,
triomphale lors de la descente des Champs-Élysées le 26 août 1944 dans l’unité
nationale enfin retrouvée. Les quatre années de résistance n’ont pas trahi ces débuts
prometteurs. Coups d’éclat, exploits individuels ou collectifs, rendez-vous mystérieux,
mots de passe, voyages clandestins, amitiés, rivalités, trahisons constituent un
matériau sans pareil pour le cinéma. Celui-ci ne manquera pas d’en tirer parti et plus
d’un film inspiré par la période de l’Occupation compte parmi les chefs-d’œuvre du
cinéma français.
1944-1945, la Résistance magnifiée
2 Le format de cet article ne permet pas d’exposer la situation du cinéma français sous
l’Occupation. Sur ce sujet, outre les ouvrages figurant en bibliographie, on consultera
avec profit « Ce curieux âge d’or du cinéma français » par François Garçon dansLa vie
culturelle sous Vichy 1 et Paris 40-44 de Jean-Paul Cointet2.
3 En 1944, le cinéma français est à reconstruire. Salles de projection, studios, machines,
ont été détruits en grande partie ; il faut remplacer les structures administratives
imposées par Vichy et les Allemands. Enfin, il convient de procéder à l’épuration 3 des
professionnels qui ont collaboré. Alain Weber4 note que chacun considère l’épuration
comme le préalable à la reprise des activités. Par circulaire du 2octobre1944, Jean
Painlevé crée le Comité de libération du cinéma français (CLCF) complété en
février1945 par le Comité régional interprofessionnel d’épuration (CRIE). Mais les
résultats seront décevants : trop de dossiers, pas assez de magistrats. Le CLCF est
Revue historique des armées, 252 | 2008
43
chargé de rebâtir l’industrie du cinéma. Il doit en particulier veiller à ce que les films
contribuent à reforger une identité nationale mise à mal par les années de guerre et
d’occupation. C’est ainsi que le cinéma de l’immédiat après-guerre sera un des vecteurs
du mythe de la France résistante. Dans l’euphorie de la victoire, l’opinion accepte cette
vision sans rechigner. À rebours, tout film qui n’y souscrit pas court le risque de l’échec
commercial, tel Les Portes de la nuit de Marcel Carné.
4 Encore faut-il empêcher les opportunistes de profiter de la situation. René Château 5
rapporte comment l’acteur René Lefèvre attaque violemment Jeff Musso qui commence
le tournage de Vive la Liberté : « Un film sur la Résistance ne doit pas permettre à des gens
sans scrupules de gagner de l’argent sur le sang des martyrs. » Et Château de citer un article
anonyme des Lettres françaises du 28 octobre 1944, satisfait de la procédure de contrôle
stricte instituée par la Direction générale du cinéma (DGC) : tout projet de film sera
soumis au CLCF puis au Conseil national de la résistance (CNR), la décision finale
revenant à la DGC. Nous évoquerons trois films produits en cette brève mais
exceptionnelle période : La Bataille du rail (René Clément), Jéricho (Henri Calef) et Le Père
tranquille (Noël-Noël assisté par Clément).
5 La Bataille du rail est probablement le film emblématique de l’immédiat après-guerre
comme du « film de résistance » en général. René Clément s’était illustré dans le genre
du documentaire dont l’un, Ceux du rail, était une sorte d’ébauche de La Bataille du rail.
Ce dernier fut donc envisagé comme un court métrage documentaire en l’honneur de
Résistance-Fer (la Résistance des cheminots). Mais sa qualité lui valut d’être transformé
en long métrage de fiction sur la résistance d’un peuple à l’oppression. Son réalisme,
salué par la critique, relève moins d’un parti pris esthétique que d’un manque de
moyens matériels. En tout cas, il est admis qu’il véhicule une image de la Résistance
digne de son sujet.
6 Jericho d’Henri Calef se situe sur un autre registre. Partant d’un fait réel, le
bombardement de la prison d’Amiens par la RAF en 1944 afin de libérer un groupe
d’otages, il montre la France « non point comme un pays en guerre, mais comme un territoire
soumis à la lie du vainqueur, avec le concours des autorités françaises » (S. Lindeperg) 6.
Animé par un souci de réalisme psychologique, il évitait le manichéisme auquel
l’époque souscrivait volontiers (les héros et les traîtres) pour décrire des personnages
hésitants sur l’attitude à adopter. Autre différence avec La Bataille du rail : le film était
affaire de professionnels. Henri Spaak en était le scénariste, Pierre Brasseur, Pierre
Larquey, Louis Seigner, Jacques Charon et Raymond Pellegrin les interprètes. Il reste
encore très actuel aujourd’hui. Le Père tranquille est un « film à la gloire du Français moyen
apparemment pantouflard et attentiste mais dissimulant sous ses allures bonasses et prudentes
son activité de chef de réseau de résistance locale ». (Jacques Siclier cité par Philippe
d’Hugues) 7. Inspiré d’Alphonse Vergeau, ami du réalisateur et fondateur du réseau
Foch, Édouard Martin, villageois amateur de jardinage n’a rien d’impressionnant mais
cette façade anodine masque d’importantes activités de résistant. Pour Sylvie
Lindeperg, le succès du film s’explique parce qu’il a permis la « cristallisation d’un modèle
héroïque forgé à l’usage exprès du Français moyen » 8. Selon Michel Jacquet, Le Père
tranquille, « laissait planer sur cette passivité l’ombre d’un doute bienveillant » 9.
7 Notons aussi la démystification du faux patriotisme : c’est le traître (le capitaine
Jourdan) qui proclame le sien le plus haut. Enfin, la sensibilité gaulliste de l’œuvre
apparaît d’abord dans le comportement téméraire des maquisards et dans la reprise des
activités antérieures à la fin du film : la Résistance est terminée. On a affaire à un «
Revue historique des armées, 252 | 2008
44
ensemble assez homogène en soi, que définissent quelques traits communs, comme la
dénonciation de la barbarie nazie ou plutôt allemande (les persécutions anti-juives tiennent une
place assez effacée) et le souci de préserver le mythe de l’unité nationale en offrant le visage
d’une France résistante, sauf la poignée de traîtres nécessaires à toute bonne intrigue » 10. Pour
autant, le filon s’épuise assez vite pour avoir été trop exploité. Le public commençait à
se lasser.
1946-1957, la Résistance en retrait
8 Plusieurs facteurs contribuent à faire oublier la Seconde Guerre mondiale et la
Résistance aux Français. D’abord, la longue « traversée du désert » qu’entame le
général de Gaulle à partir de 1946 ; ensuite, la reconstruction du pays et les débuts de la
société de consommation. Enfin et surtout, la guerre d’Algérie, à laquelle participent les
appelés du contingent, devient leur sujet de préoccupation majeur. Quant aux
résistants, ils commencent à vieillir et leurs bulletins d’associations traitent plus de
statuts et de pensions que de faits d’armes. Dans ce contexte, la production
cinématographique délaisse quelque peu la période antérieure. Elle est moins
abondante mais plus ordonnée et privilégie la Résistance institutionnelle (la France
libre). Trois films en ressortent : Le Silence de la mer de Jean-Pierre Melville (1949), Un
condamné à mort s’est échappé de Robert Bresson (1956) et La Traversée de Paris de Claude
Autant-Lara (1956).
9 Le premier rompt avec l’anti-germanisme de l’époque. Officier allemand, Werner von
Ebrenach est logé chez des Français qu’il tente de convaincre des bienfaits de la
collaboration mais dont l’hostilité se traduit par un mutisme total. Une discussion avec
des officiers nazis montre à von Ebrenach l’irréalisme de ses idées. Un attentat perpétré
par des voisins de ses hôtes l’achève moralement ; il demande sa mutation pour le front
russe. Le film souligne également les limites de la résistance passive. Bresson relate
l’évasion d’un résistant interné au fort de Montluc. Il introduit un personnage
récurrent dans le cinéma de la Résistance, le prisonnier (associé au déporté).
Contrairement aux films antérieurs qui évoquaient l’action collective, il s’intéresse aux
réactions de l’individu confronté à la guerre. La Traversée de Paris est d’une tonalité bien
différente. Inspiré par la verve satirique de Marcel Aymé, il décrit une affaire de
marché noir et plus généralement les compromissions et « petits » trafics que favorise
l’Occupation. Autant-Lara développe sa vision pessimiste de l’homme et raille le mythe
de la France résistante. Servi par Bourvil 11, Gabin et de Funès, le film connut un grand
succès commercial.
1958-1969, le renouveau de la Résistance
10 Les onze années qui vont du retour aux affaires du général de Gaulle à son retrait de la
vie politique sont marquées par un regain d’intérêt pour les années d’occupation (Jean
Moulin entre au Panthéon en 1964). De la profusion de films sur cette période, on
retiendra les suivants : Paris brûle-t-il ? de R. Clément (1966), La Ligne de démarcation de
Claude Chabrol (1966), La Grande vadrouille de Gérard Oury (1966) et L’Armée des ombres
de Jean-Pierre Melville (1969).
Revue historique des armées, 252 | 2008
45
11 Après La Bataille du rail (1945), Jeux interdits (1952), Le Jour et l’heure (1962), Paris brûle-t-
il ? est le quatrième film que René Clément consacre à la Résistance. Mais le projet
connaît bien des vicissitudes : le livre de Lapierre et Collins, point de départ du film,
étant favorable à la France libre, le PCF s’inquiète de l’orientation idéologique du film
(or, dans la profession, le personnel est, à cette date, majoritairement syndiqué à la CGT
proche du PCF) ; une rivalité oppose les deux producteurs possibles, Zanuck et Gratz.
Bref, la gestation de l’œuvre est très difficile. Au final, malgré la présence de vedettes
(Alain Delon notamment), le film est peu convaincant. Comme le note Sylvie Lindeperg :
« Première grande fresque de reconstitution française consacrée à la Seconde Guerre mondiale,
[Paris brûle-t-il ?] portait néanmoins le label de la Paramount. » La Bataille du rail exaltait la
Résistance, Paris brûle-t-il ? l’exploite à des fins mercantiles. L’évolution de Clément
montre à quel point les mentalités ont changé en vingt ans.
12 Dans Un jardin bien à moi 12, Chabrol revient sur La Ligne de démarcation. Il explique à
François Guérif que cette œuvre de commande(initialement proposée à Anthony Mann
par le colonel Rémy, auteur de l’ouvrage) est une « utilisation d’un genre, un film de
tradition (…) un pastiche de film sur la Résistance »13 ; plus loin, il précise : « La ligne (…)
c’était un peu des images d’Épinal. C’était l’époque où on voulait faire croire que tous les Français
avaient été résistants. »14 Ainsi, le film de résistance est un « genre » avec ses codes.
Désormais, il ne s’agit plus de films sur la Résistance, mais sur une représentation de la
Résistance.
13 La Grande vadrouille, comédie au succès public phénoménal (Bourvil et de Funès n’y sont
pas pour rien) inverse les codes. Elle abandonne le registre épique ou dramatique sans
pour autant transgresser l’image convenue de la France unie et résistante. Apparaît ici
de manière éclatante un personnage déjà entrevu (Babette s’en va-t’en guerre, Christian-
Jaque1959) et promis à un bel avenir, celui du « héros malgré lui » 15. Ce n’est pas le cas
des personnages de L’Armée des ombres de J.-P. Melville. Gerbier, Mathilde et leurs
compagnons ont choisi d’entrer en Résistance, fût-ce au prix de leur vie. Melville a déjà
abordé le thème (Le Silence de la mer 1949 et Léon Morin prêtre 1961). Ici, il montre les
activités quotidiennes d’un groupe de résistants, leur force et leur détermination mais
aussi leurs faiblesses (s’il faut éliminer l’un des leurs).
14 Basé sur un scénario tiré du récit éponyme de Joseph Kessel, composé lui-même à partir
de souvenirs de résistants, une solide distribution (J.-P. Cassel, P. Crauchet, C. Mann, S.
Signoret, L. Ventura) et une mise en scène très sobre, L’Armée des ombres peut être
considéré comme une œuvre classique. Mais ce film, qui coïncide avec le retrait du
général de Gaulle de la vie politique, marque la fin d’une époque.
1971-1983, la Résistance en question
15 En effet, les successeurs du général de Gaulle, mort en 1970, sont loin de vouer un culte
à la Résistance. Elle agace Georges Pompidou, qui ne fut pas résistant autant que Valéry
Giscard d’Estaing. Par ailleurs, la mode rétro qui règne dans bien des domaines invite à
se retourner sur les années de guerre.
16 En 1971, le film de Marcel Ophüls et Alain de Sédouy, Le Chagrin et la pitié, chronique
d’une ville française sous l’Occupation, conçu pour la télévision mais diffusé en salle
met à mal le mythe gaullo-communiste de la France résistante qui avait tenu bon
pendant un quart de siècle. Composé d’entretiens 16 avec des personnes ayant vécu les
Revue historique des armées, 252 | 2008
46
« années noires », ce film offre le tableau d’une France en demi-teinte, avec très peu de
collaborateurs, très peu de résistants, quelques profiteurs et beaucoup d’attentistes. Il
eut un grand retentissement dans l’opinion.
17 Lacombe Lucien de Louis Malle (1974) pose, à travers le cas du personnage éponyme, le
problème des modalités de l’engagement. Lucien Lacombe est un jeune paysan lotois,
assez fruste, marginal. Il veut entrer dans la résistance locale mais n’est pas accepté.
Dépité, il devient collaborateur, commet des exactions ; hébergé par des Juifs
recherchés par la Gestapo, il tombe amoureux de leur fille, France, s’enfuit avec elle
lorsque le père est arrêté. Peu après, il sera abattu par des résistants 17. Sans doute
influencé par son scénariste, Patrick Modiano, Malle ne condamne pas son « héros ». Il
montre la relativité des engagements idéologiques (ce qui fut peu apprécié par les
associations de résistants) et, mieux, soulève une interrogation qui hantera les
réalisateurs nés après la guerre : en 1940, quel camp aurais-je choisi ?
18 La contestation du mythe résistant passe également par la réhabilitation d’épisodes
oubliés par l’histoire officielle. Frank Cassenti s’y emploie avec L’Affiche rouge (1976)
consacré à l’affaire Manouchian, groupe de la MOI (main-d’œuvre immigrée) dont les
membres ont été exécutés en février 1944. Réalisé avec peu de moyens (en trois
semaines, joué par des acteurs de la troupe d’Ariane Mnouchkine, dans le décor de la
Cartoucherie de Vincennes). Ce film a valeur de témoignage.
19 Judith Therpauve de Patrice Chéreau (1978) choisit un autre angle d’attaque. Veuve d’un
héros de la résistance, cette femme mène son dernier combat : sauver un journal fondé
par des résistants (La Libre République) convoité par une grande entreprise de presse
(allusion à Paris-Normandie racheté par Robert Hersant). Ayant échoué dans sa
mission, elle se suicide. Auparavant, elle a lancé à ses anciens camarades : « La
Résistance ! Les résistants ! C’est fini tout ça. Regardez-vous, regardez-nous, des vieux, des
vieilles, des veuves. » 18 Judith Therpauve clôt ce que l’on peut appeler le cycle Simone
Signoret et la Résistance. Résistante à contrecœur dans Le Jour et l’heure, par choix dans
L’Armée des ombres et finalement désabusée.
20 Entamée avec Le Chagrin et la pitié, cette période de démystification s’achève avec
l’iconoclaste Papy fait de la Résistance de Jean-Marie Poiré (1983). Celui-ci considère que
son œuvre rend un « hommage parodique » aux films sur la Résistance tels que Le Père
tranquille, Le Silence de la mer, La Grande vadrouille, L’Armée des ombres. Faire de la fin du
film une caricature de l’émission Les Dossiers de l’écran est une trouvaille : il ne s’agit
plus de traiter de la Résistance mais de ses représentations. Bien reçu par la
commission de contrôle des films comme par la critique (communiste exceptée), Papy
fait de la Résistance est salué comme une entreprise de démythification. L’historien
Henry Rousso l’analyse ainsi : « Papy (…) est peut-être l’amorce d’une rupture
cinématographique, qui annonce un tournant dans l’imaginaire collectif de cette époque. » 19 Le
succès populaire du film montre que les tabous sont définitivement levés.
1984-1993, aux marges de la Résistance
21 S’ouvre une période au cours de laquelle se développe une approche plus sereine de la
Résistance. Les thèmes dominants sont le regard des femmes, les conséquences de
l’entrée en résistance sur la vie privée et la résistance civile. Comme le note Suzanne
Langlois : « La représentation de la Résistance atteint alors une plénitude certaine, en même
temps que se dépolitise la lutte. Se rejoignent la Résistance, les femmes et le quotidien. » 20
Revue historique des armées, 252 | 2008
47
Claude Chabrol scrute de nouveau la Résistance. D’abord avec Le Sang des autres (1984)
tiré d’un ouvrage de Simone de Beauvoir. Voici ce qu’il en pense : « Ce qui m’intéressait (
…) c’était qu’est-ce que les gens du câble américain recherchent dans cette histoire de Résistance
française ? » 21 ; il observe: « Je pense que la façon dont est montrée l’Occupation dans Le sang
des autres est déjà plus juste [que dans La ligne de démarcation]. » 22
22 Une Affaire de femmes (1988), œuvre plus personnelle, est nettement meilleur. Ce film
s’inspire d’un authentique fait divers. En 1943, Marie-Louise Girard est exécutée pour
avoir pratiqué vingt-six avortements clandestins. Chabrol place l’histoire de Marie
(Isabelle Huppert) en province. Son mari prisonnier (François Cluzet), elle doit subvenir
aux besoins de ses deux enfants. Elle aide une voisine à interrompre une grossesse non
désirée et s’aperçoit qu’il s’agit d’une activité rentable car la demande, si l’on ose
écrire, est forte : liaisons avec des Allemands, passades en l’absence des maris… Marie
entre ainsi dans une voie sans issue. Elle est emprisonnée puis guillotinée. Dans ce film,
il s’agit moins de la Résistance que de la difficulté, surtout pour une femme, de
rechercher l’indépendance et le bonheur sous le régime de Vichy.
23 C’est précisément ce dernier que Chabrol dénonce dans L’Œil de Vichy (1993) en
s’appuyant sur des archives (Pathé, Gaumont, ECPAD) pour montrer la manipulation
des esprits par l’image. L’action de Blanche et Marie de Jacques Renard (1985) se déroule
en 1941 dans un quartier ouvrier d’une petite ville de province. Il s’attache à suivre
l’entrée des deux jeunes femmes (Miou-Miou et Sandrine Bonnaire) dans la Résistance,
l’activité qu’elles y déploient puis, dès la guerre finie, la reprise des travaux qu’elles
effectuaient antérieurement. C’est qu’elles n’ont pas rejoint la Résistance par
conviction personnelle mais pour suivre leur mari. Émouvant, ce film n’a pas trouvé
son public.
24 En revanche, Uranus de Claude Berri (1990) a connu le succès grâce à une distribution
brillante (G. Depardieu, F. Luchini, J.-P. Marielle, P. Noiret entre autres) et à la verve de
Marcel Aymé. On constate que si l’œuvre a été écrite en 1946, il fallut attendre plus de
quarante ans pour que le cinéma ose s’attaquer à ce « brûlot » sur les excès de la
Libération et de l’épuration. Enfin, même si ce n’est pas le cœur de notre sujet, il faut
s’arrêter sur les films relatifs à la mémoire juive. Dès le début des années 1970, l’intérêt
des historiens, comme celui du public, s’est tourné vers l’Holocauste au détriment de la
Résistance. Le cinéma a suivi ce mouvement. Encore faut-il faire une exception pour le
magistral documentaire d’Alain Resnais, Nuit et Brouillard (1955) 23.
25 Avec Le Vieil homme et l’enfant (1966), Claude Berri aborde la question sous un angle plus
intimiste. Suivront Les Violons du bal de Michel Drach (1973) et, plus tard, Shoah de
Claude Lanzmann (1985) et Au revoir les enfants de Louis Malle (1987). Parallèlement,
certaines affaires ont contribué à sensibiliser le public à cette question : grâce accordée
au milicien Paul Touvier par le président Pompidou, attaques contre Maurice Papon
pour son action pendant la guerre, polémiques suscitées par les thèses négationnistes
de Robert Faurisson et enfin, publication par L’Express en 1978 d’une interview de
Darquier de Pellepoix (ancien commissaire aux questions juives) intitulée : « À
Auschwitz, on n’a gazé que les poux. » 24
Depuis 1994, en mémoire de la Résistance
26 Cinquante ans après, on continue de produire des films sur la Résistance. Mais les
réalisateurs nés après la guerre en ont une conception fort différente de celle de leurs
Revue historique des armées, 252 | 2008
48
aînés. Dès 1971, on l’a vu, le mythe de la France résistante avait vécu. En 1995, le
nouveau président Chirac s’inscrit dans cette lignée lorsqu’il reconnaît officiellement la
responsabilité de la France (et pas seulement celle de Vichy contrairement à ses
prédécesseurs) dans les mesures antisémites. Le temps des films épiques est révolu
mais aussi celui de la dérision. Pour Michel Jacquet 25, on est entré dans celui « des
hommages » et il développe : « Le temps de l’Occupation et de la Résistance [prend] statut
d’histoire ancienne. » Par conséquent, produire un film sur cette époque revient
essentiellement à sacrifier au « devoir de mémoire ». C’est le cas de Lucie Aubrac (1997)
de Claude Berri qui retrace l’action de cette résistante exceptionnelle.
27 Deux films montrent que la participation à la Résistance, réelle ou fictive, était, après la
guerre, une référence indispensable à toute carrière. Un héros très discret de Jacques
Audiard (1995), d’après un récit de J.-F. Deniau, dépeint l’itinéraire d’un jeune homme
imaginatif et solitaire, élevé par sa mère (son père est mort au cours de la Première
Guerre mondiale). Pour échapper à la médiocrité et par désœuvrement, il se forge de
toutes pièces un passé de résistant grâce auquel il parvient à des postes de plus en plus
élevés jusqu’à ce que son imposture soit découverte. Effroyables jardins de Jean Becker
(2003) utilise des ressorts analogues. Un instituteur fait le clown le dimanche pour
gagner un peu d’argent. Afin de rehausser son prestige aux yeux de son fils, un ami lui
raconte les exploits de résistant de l’instituteur.
28 Jacquet 26 constate que si la « "veine" des années quarante est apparemment loin d’être
épuisée,(…) on perçoit une tendance à utiliser l’épisode tragique de la débâcle ou l’occupation du
territoire national qui s’ensuivit comme un cadre, une sorte de "paysage" propre à dramatiser
des situations et des caractères relativement banals ». Cette remarque s’applique au film Bon
voyage de Jean-Paul Rappeneau et à celui d’André Téchiné Les Égarés (sortis en 2003).
29 Les deux films qui suivent, Monsieur Batignole de Gérard Jugnot (2002) et Laissez-passer de
Bertrand Tavernier (2002) témoignent d’une « nostalgie respectueuse » (Jacquet). Dans le
premier, Jugnot incarne un charcutier sans opinion très arrêtée mais, harcelé par un
gendre adepte de la Révolution nationale et une épouse arriviste, il va dénoncer son
voisin, un médecin juif que la Gestapo arrête avec sa famille. Batignole peut alors
occuper son appartement et devient le fournisseur attitré de la Gestapo. Mais Simon, un
des fils du médecin, s’échappe et revient à son ancien domicile. D’abord tenté de se
débarrasser de l’enfant, Batignole s’aperçoit qu’il a envoyé une famille en déportation.
Abandonnant sa vie confortable, il emmène l’enfant (et deux cousines également en
danger) en Suisse. Loin de se poser en donneur de leçons, Jugnot reprend à son compte
l’interrogation de Lacombe Lucien : qu’aurais-je fait, à vingt ans, en 1940 ? Par ailleurs, le
film est riche de multiples références : La Traversée de Paris, La Grande vadrouille, Le Vieil
homme et l’enfant notamment.
30 Laissez-passer de Tavernier offre un grand intérêt documentaire puisqu’il présente le
milieu du cinéma pendant l’Occupation. À travers cette description, il renouvelle la
question rituelle du choix en comparant le destin de deux hommes, Jean Aurenche
(Denis Podalydès) et Jean Devaivre (Jacques Gamblin). Le premier refuse
systématiquement les offres d’emploi qui lui sont adressées par la société de production
allemande, la Continental. Devaivre, passionné par son métier, consent à travailler pour
cette entreprise mais c’est aussi une façade car il accomplit des missions pour la
Résistance. Tavernier ne tranche pas entre ces deux attitudes mais montre qu’il y avait
plusieurs manières de résister. Comme le rappelle Jean-Luc Douin 27, ce film souleva une
polémique assez vive. Il fut reproché à Tavernier d’avoir « signé un film poujadiste,
Revue historique des armées, 252 | 2008
49
historiquement ambigu, socialement corporatiste, politiquement réactionnaire et douteux,
esthétiquement suspect de valoriser un "âge d’or" du cinéma français révolu… ». Comme quoi
la période de l’Occupation suscite encore des réactions passionnelles.
Conclusion
31 La guerre achevée, certains ont tenté de poursuivre l’œuvre de la Résistance et son
esprit par le cinéma. Cette tentative a vite trouvé ses limites. En revanche, l’épisode a
offert aux réalisateurs tous les ingrédients susceptibles d’être transposés à l’écran.
Cette richesse a fasciné les cinéastes dont quelques-uns ont consacré plusieurs films à
tel ou tel aspect de la Résistance (Chabrol, Clément, Melville) 28. Ils ont choisi,
interprété, voire déformé les faits selon leur tempérament et leur talent certes mais
aussi en fonction de critères tels que la conjoncture politique et sociale, ou tout
simplement la mode.
32 En d’autres mots, le cinéma a représenté la Résistance d’une manière correspondant le
plus souvent à l’image que s’en faisait l’opinion. C’est pourquoi il l’a tour à tour
magnifiée, explorée, interrogée, critiquée, parodiée, citée et honorée. À considérer la
filmographie de la Résistance, abondante, d’inspiration variée et d’inégale valeur, on
pourrait presque croire qu’il s’agit d’une figure imposée dans la carrière d’un
réalisateur 29. Aujourd’hui, la Résistance est une référence lointaine mais il n’est pas dit
qu’elle ne suscitera pas d’autres œuvres de qualité.
BIBLIOGRAPHIE
BAZIN (André), Le cinéma de l’Occupation et de la Résistance, Paris, UGE, 1975 [il s’agit d’un recueil
d’articles initialement publiés à l’époque dans des revues universitaires à la parution aléatoire vu
la pénurie de papier ; l’ouvrage est précédé d’une préface de F. Truffaut, André Bazin, l’Occupation
et moi].
BERTIN-MAGHIT (Jean-Pierre), Le cinéma français sous l’Occupation, PUF, Que sais-je, 1994.
CHÂTEAU (René), Le cinéma français sous l’occupation, 1940-1944, éd. René Château, coll. La mémoire
du cinéma français, 1995.
JACQUET (Michel), Travelling sur les années noires. L’Occupation vue par le cinéma français depuis 1945,
Paris, Alvik, 2004.
JEANCOLAS (Jean-Pierre), Histoire du cinéma français, Paris, Armand Colin, 2 e éd., 2007.
LANGLOIS (Suzanne), La Résistance dans le cinéma français de fiction (1944-1994), novembre 1996, thèse
de doctorat en histoire université Mac Gill, Montréal, Canada.
LINDEPERG (Sylvie), Les écrans de l’ombre. La Seconde Guerre mondiale dans le cinéma français
(1944-1969), Paris, CNRS éditions, 1997.
MAHUZIER (Albert), Caméra sous la botte, Paris, Les Presses de la Cité, 1963.
Revue historique des armées, 252 | 2008
50
SICLIER (Jacques), La France de Pétain et son cinéma, Henri Veyrier, coll. L’Histoire en question, 1981
WEBER (Alain), La Bataille du film, 1933-1945. Le cinéma français entre allégeance et Résistance, Paris,
Ramsay coll. Cinéma, 2007.
ANNEXES
Les héroïnes de la Résistance
Suzanne Langlois en propose une typologie pertinente : « Les résistantes ne sont
représentées que par quelques catégories qui arrivent à l’écran dans une chronologie
longue :
- La jeune femme célibataire, souvent agent de liaison (…) parfois saboteuse ou
exécutrice, est un personnage qui affirme le parti pris de l’action (…). Il est facilement
transposable dans un récit cinématographique.
- Les femmes et les mères de famille (…) [apparaissent] au tournant des années
1950-1960. [Elles] sont associées à des formes de Résistance plus sédentaires tels les
relais des filières d’évasion, l’aide aux clandestins et aux réfugiés, la presse clandestine,
le camouflage du matériel. Le poids de la vie quotidienne (…) intéresse peu alors que ces
formes de Résistance sont vitales à la survie au jour le jour des clandestins.
- C’est dans les années 1980 que se retrouvent ensemble à l’écran plusieurs générations
de résistantes. Aux motivations classiques s’en ajoutent d’autres, morales et
humanistes La présence plus importante des résistantes contribue à accentuer le
caractère civil d’une grande partie de la Résistance. L’introduction des préoccupations
de la vie quotidienne ramène le monde des résistants vers celui des simples mortels. »
La Résistance ne modifie guère la « représentation des femmes dans la guerre (…). Par
contre, les personnages féminins ont largement contribué à changer la représentation
cinématographique de la Résistance. » Nous en avons déjà rencontré quelques-unes
(Thérèse Dutheil, Mathilde, Judith Therpauve, Blanche et Marie, l’autre Marie, Une
affaire de femmes). Afin de compléter cette série de portraits, voici Marie-Octobre et
Barny.
Marie-Octobre de Julien Duvivier (1959) est un film inspiré d’une histoire de Jacques
Robert. Marie-Hélène Dumoulin (dite Marie-Octobre) incarnée par Danielle Darrieux,
apprend par un ancien officier allemand, quinze ans après la guerre, que son fiancé
Castille, également chef du réseau Vaillance, a été dénoncé par un membre du réseau.
Afin de démasquer le traître, elle convoque ses anciens camarades, dix hommes
d’origine sociale diverse et exerçant des métiers différents, ce qui était souvent le cas
dans la Résistance. Les interprètes sont Blier, Reggiani, Ventura notamment.
Cette vengeance « à retardement », pourrait-on dire, offre une situation inédite.
Comme l’indique Michel Jacquet : « Le personnage féminin, élément central du film, est
le catalyseur d’une situation qui conteste les approches les mieux admises et les plus
édifiantes de l’Occupation et de la Résistance. Personnage symbolique, Marie-Octobre
paraît très isolée dans le paysage cinématographique d’après-guerre. » Le film fut très
bien accueilli par le public, la critique étant plus réservée. Conçue initialement pour le
Revue historique des armées, 252 | 2008
51
théâtre, l’histoire réécrite par Jeanson et Robert, Marie-Octobre deviendra une pièce
trois ans plus tard.
Contrairement à Marie-Octobre, Barny (Emmanuelle Riva), jeune veuve d’un Juif
communiste, peu concernée par la situation née de la défaite et de l’Occupation, sinon
dans ses retombées sur sa vie personnelle. Ayant rencontré un jeune prêtre, Léon
Morin (J.-P. Belmondo), elle tombe amoureuse de lui. Mesurant l’étendue des interdits
qui pèsent sur elle, Barny finit par s’opposer au régime de Vichy qu’elle juge
responsable. Ce film de Melville, dont l’Occupation forme la trame, porte témoignage de
la précarité de la condition féminine à l’époque. Si différents soient-ils, ces personnages
féminins apportent au cinéma sur la Résistance une tonalité spécifique, intimiste et
forte à la fois.
Sorti le 5 mars 2008, Les Femmes de l’ombre de Jean-Paul Salomé a bénéficié d’une large
promotion et d’une sortie dans 450 salles. Pour autant, l’accueil de la critique a été très
mitigé. De fait, après quelques lignes d’explication sur le Special Operation Executive
(SOE) qui lui tiennent lieu de caution historique, le réalisateur accumule
invraisemblances et clichés. Oscillant entre Les Douze Salopards pour l’action et Lucie
Aubrac pour l’imagerie, ce film long et pesant recèle en outre un certain parfum de
bigoterie : le langage est celui du sacrifice, du devoir et du rachat (sont recrutées une
ex-prostituée et l’ex-fiancée d’un officier allemand), un clergyman bénit l’avion et ses
passagères qui partent en mission, le résistant joué par Robin Renucci a pour pseudo
« Melchior » (l’un des rois mages). Quant au personnage de Gaëlle, il frise la caricature.
Elle porte en permanence une chaînette avec une croix, se réfère au catéchisme, fait
promettre à ses compagnes de faire brûler un cierge à la fin de la guerre ; la scène de
son suicide, les bras en croix en récitant une prière, est franchement ridicule. À tout
prendre, le seul personnage attachant est Eddy, le petit voyou qui trafique avec les
Allemands en 1941 et les conduit au poteau s’exécution en 1944 avec la même bonne
humeur. Bref, ces femmes de l’ombre ne risquent pas d’en faire beaucoup à leurs
glorieuses aînées.
Le « héros malgré lui »
Babette s’en va-t’en guerre et La grande vadrouille avaient abordé le thème du « héros
malgré lui » sous l’angle comique. Autres exemples de « héros malgré eux » rencontrés
en chemin : Thérèse Dutheil (Le Jour et l’heure) et Monsieur Batignole (Monsieur
Batignole).
Avec Le Vieux fusil (1975), Robert Enrico propose un film beaucoup plus dur.
Chirurgien à l’hôpital de Montauban, Julien Dandieu (Noiret) proclame volontiers qu’il
ne fait pas de politique. En 1944, les Allemands en pleine déroute remontent vers le
Nord ; inquiet pour sa femme (Romy Schneider) et sa fille, il les envoie dans sa
propriété, un petit château en plein Quercy. Mais un groupe de soldats allemands s’y
est installé et les assassine ainsi que les habitants du village voisin. En le découvrant,
Dandieu est pris d’une frénésie de vengeance ; guidé par sa connaissance des lieux, il va
exécuter méthodiquement les auteurs du massacre. On assiste à une sorte de western
animé par un véritable « héros malgré lui ».
Le Franc-tireur de J.-M. Causse et R. Taverne (1972, ressorti en 2002) montre un
personnage comparable. Juillet 1944. Installé chez sa grand-mère, dans le Vercors, non
loin de Grenoble, Michel Perrat (Philippe Léotard) attend la fin de la guerre ; il est
parfaitement neutre. Sa maison bombardée, il s’enfuit dans la montagne et se joint à un
Revue historique des armées, 252 | 2008
52
groupe hétérogène de maquisards. Pendant trois jours et trois nuits, ils se battent,
espérant en vain le secours des alliés. Seul survivant du groupe, il rentre chez lui et nul
n’entendra plus parler de lui.
L’intérêt du « héros malgré lui » est d’être une personne ordinaire, nullement destinée
à l’héroïsme et que l’événement oblige à sortir de ses schémas comportementaux
habituels.
Liste des films présentés au Festival du film sur la Résistance, intitulé « Le cinéma de ceux qui
ont su dire non » (27, 28, 29 novembre 1998) au Forum des images videothèque de Paris, réalisée
par l’Association mémoire et espoir de la Résistance, présidée par François Archambault, et
placée sous le haut patronage de la Fondation de la Résistance :
- La Bataille du rail, NB, 1945, R. Clément.
- La Libération de Paris, documentaire français tourné du 15 au 26 août 1944, à
l’initiative du CLCF.
- Au cœur de l’orage, documentaire débuté en juin 1944 à l’instigation du CLCF, mais
remanié par J.-P. Le Chanois (et projeté en avril 1948 suivi de « Nous » de J.-P. Vernant).
- Jéricho, NB, 1945, H. Calef.
- Le Père tranquille, 1946, Noël-Noël assisté par R. Clément.
- Le Silence de la mer, NB, 1949, J.-P. Melville.
- Court métrage sur Madame Claude Gérard responsable des Mouvements unis de
Résistance.
- Un condamné à mort s’est échappé, NB, 1956, R. Bresson.
- La Longue marche, NB, 1965, A. Astruc.
- L’Armée des ombres, 1969, J.-P. Melville suivi de La Rose et le réséda documentaire de
9 minutes.
Les acteurs dans la Résistance
Si les acteurs de la Résistance ont beaucoup intéressé les historiens, ce n’est pas le cas
des acteurs dans la Résistance. Les intéressés sont sans doute les premiers responsables
de cette lacune, car ceux qui ont laissé des mémoires sont généralement laconiques sur
la période. Les commentateurs ne sont guère plus loquaces. Ainsi, les vignettes du
dictionnaire de Jean Tulard sont-elles plus que succinctes sur le sujet (il est vrai qu’il
recense non seulement les acteurs français mais aussi étrangers). Certes, René Château
(op.cit.) et Alain Weber (op.cit.) y consacrent quelques pages. Mais c’est à Marie-Agnès
Joubert que l’on doit le premier ouvrage d’ensemble sur la question.
Dans la profession, certains choisirent l’exil (Dalio, Gabin, Michèle Morgan), d’autres la
collaboration (par exemple, en participant au rapprochement culturel franco-allemand
mené par la Propaganda Staffel puis de la Propaganda Abteilung sous l’égide de
l’ambassadeur Otto Abetz et de son subordonné Karl Epting ou en s’affichant dans les
événements de la vie mondaine parisienne aux côtés des Allemands, ce que fit Arletty
au grand dam de sa carrière). De meme, René Bergeron « entraine dans la voie de la
collaboration par Le Vigan, il eut sa carriere brisee en 1944 ». Pierre Blanchar se
montra plus habile : « Pendant la guerre, il tourne plusieurs films dont deux qu’il met
en scene. Mais à la Liberation, invoquant son interpretation de Pontcarral comme un
Revue historique des armées, 252 | 2008
53
acte de resistance, il joue, semble-t-il, les épurateurs à l’egard de ses confreres. » Ceux
qui refusent le régime de Vichy sont confrontés à un dilemme : peut-on exercer le
métier de comédien dans un pays soumis à la censure sans se compromettre avec les
autorités ? Et à un problème pratique : de quelle manière un acteur peut-il résister ?
Marie-Agnès Joubert résout la première question avec élégance : « [Le théâtre] acquit
dans les années 40 toute sa dimension politique. La problématique de la réception,
constante sous l’Occupation est ramenée bien souvent par la critique à un débat
manichéen entre "pièces de collaboration" et "pièces résistantes", est là pour en
témoigner. Chaque réplique devenait prétexte à interprétation. Rien d’étonnant alors à
ce que la pratique théâtrale, sans modifier l’attitude de spectateurs peu désireux de
participer aux affrontements idéologiques de l’époque, ait tourné avec le temps à la
démonstration. Démonstration qui pouvait aussi bien aller dans d’une parade favorable
à l’ordre nouveau, que d’un raidissement face à une situation insoutenable. Dans les
deux cas, le théâtre n’avait de cesse d’agiter sous les yeux de l’occupant l’image d’une
France culturellement intacte. » (op.cit., Introduction, p. 22).
Mais ce patriotisme professionnel, si l’on peut dire, ne suffit pas à certains acteurs qui
veulent s’engager davantage. Mais comment ? Alain Weber note que « sous les feux de
la rampe ou sous les projecteurs, rien ne les prédispose à agir dans l’ombre ». Mené par
la CGT du spectacle, notamment par le réalisateur et scénariste Claude Vermorel, le
combat est à la fois corporatiste ou, plus exactement à usage interne (défense des
conditions de travail), mais également antinazi (il faut échapper au STO).
Distributions de tracts, prises de parole au cours de tournées théâtrales, tous les
moyens sont bons. « En mars 1944, ajoute Weber, la branche du Front national animée
par Julien Bertheau et le décorateur André Barsacq ainsi qu’Armand Salacrou, unissent
leurs efforts avec la CGT. »
Enfin, Weber évoque longuement le sort malheureux de trois acteurs, Harry Baur,
Sylvain Itkine et Robert Lynen, lesquels « représentent ces gens du spectacle qui ont
osé dire non… et qui ont fait selon l’expression de l’époque, leur « devoir de patriote ».
Très jeune (23 ans), Lynen prit le pseudonyme hautement symbolique de l’Aiglon et
proclama que sa mission (convoyer des postes émetteurs) serait « le plus beau rôle de
sa vie ». Ce qui montre que chez les acteurs, la réalité et la fiction se confondent
souvent.
Une structure particulière : le Centre national du cinéma (CNC)
En 1945, le cinéma français est sinistré : salles de projection, labos, studios ont été
endommagés, voire détruits par les bombardements ; ce qui subsiste est trop vétuste
pour être utilisé. Les hommes (acteurs, techniciens, cinéastes) manquent également à
l’appel : il reste encore de nombreux prisonniers, d’autres ne sont pas revenus d’exil,
l’épuration guette ceux qui ont collaboré. Bref, tout est à rebâtir. Cela peut se faire soit
à l’instigation de l’État, ce qui révolte certains, soit à celle de la profession mais celle-ci
est traversée par des conflits d’ordre professionnel et d’ordre personnel.
La loi du 26 octobre 1946 porte création du Centre national du cinema ; assortie de
textes d’application techniques, elle entre en vigueur début 1947. Michel Fourré-
Cormeray est nommé directeur général de l’organisme. Ce dernier est un établissement
public administratif placé sous la tutelle d’un ministre (de l’Information puis de
l’Industrie et, depuis 1959, de la Culture). Son fonctionnement est assuré par des
Revue historique des armées, 252 | 2008
54
subventions servies par le ministère de tutelle et par le versement de cotisations
professionnelles. Il est chargé de préparer les textes législatifs et réglementaires
relatifs au cinéma et de veiller au mode financement, de production et de diffusion des
films.
Le 24 septembre 1948 paraît la première loi d’aide à l’industrie cinématographique. Il
s’agit d’un secours « temporaire » aux producteurs de films français et aux exploitants
de salle. Sa source vient d’un fonds d’aide (futur compte de soutien) alimenté par la
taxe spéciale additionnelle (TSA) perçue sur la vente des billets à l’entrée des salles. Le
directeur général du CNC est désigné comme l’ordonnateur des opérations effectuées
sur ce fonds. En 1953, une seconde loi d’aide à l’industrie cinématographique est votée ;
le décret Malraux du 19 juin 1959 complète le dispositif : à l’aide automatique aux films
s’ajoute une aide sélective. S’esquisse ainsi le mécanisme de l’avance sur recettes. Sont
ainsi posées les bases du « mode de production à la française, système mixte unissant
liberté individuelle du producteur et intervention de l’État ». Sa pertinence se mesure à
la bonne tenue du cinéma français par comparaison avec celui des autres pays
européens.
NOTES
1. RIOUX (J.-P.) (dir.), Bruxelles, Complexe coll. Questions au XX e siècle, 1990, p. 293-313.
2. Paris, Perrin, 2001, 4. « Vivre ou survivre », 5. « Se distraire », p. 157.
3. Sur ce sujet, voir : A SSOULINE (Pierre), L’épuration des intellectuels, Bruxelles, Complexe coll.
Historiques, 1996 [1985] et LOTTMAN (Herbert), L’épuration 1943-1953, Paris, Fayard, 1986.
4. La Bataille du film 1933-1945, le cinéma français entre allégeance et Résistance, Paris, Ramsay coll.
Cinéma, 2007 « Vers la victoire 1944-1945 », « Épuration en tout genre », p. 220.
5. Le cinéma français sous l’occupation 1940-1944, éditions René Château, 1995, « La Résistance au
cinéma », p. 489-498.
6. « Les écrans de l’ombre », La Seconde Guerre mondiale dans le cinéma français (1944-1969), CNRS
éditions, Paris, 1997.
7. « La Résistance prise sur le vif » dans Le cinéma et la guerre, HUGUES (Philippe d’) et C OUTAU-B
ÉGARIE (Hervé) (dir.), Paris, Economica, bibliothèque Stratégie, 2006, p. 141.
8. LINDEPERG (Sylvie), Les écrans de l’ombre. La Seconde Guerre mondiale dans le cinéma français, Paris,
CNRS, 1997, p. 170-171.
9. J ACQUET (Michel), Travelling sur les années noires. L’Occupation vue par le cinéma français depuis
1945, Paris, Alvik.
10. H UGUES (Philippe d’), Les écrans de la guerre.Le cinéma français de 1940 à 1944, Paris, éditions de
Fallois, p. 145.
11. C’est le premier des six films où joue Bourvil et qui se déroulent pendant la Seconde Guerre
mondiale, soit, par ordre chronologique, La Traversée de Paris de Claude Autan-Lara, Le Chemin des
écoliers de Michel Boisrond, Fortunat d’Alex Joffé, Les Culottes rouges d’Alex Joffé, Le Jour le plus long
de Annakin, Martin et Wicki, La Grande vadrouille de Gérard Oury, Le Mur de l’Atlantique de Marcel
Camus. Sur la carrière de l’acteur normand, voir : DUREAU (Christian), Bourvil. Á fleur de cœur,
Paris, éditions Didier Carpentier, 2007.
12. Paris, éditions Denoël coll. Conversations avec…, 1999.
13. 4e conversation, p. 94.
14. 7e conversation, p. 172.
15. Voir annexe II.
Revue historique des armées, 252 | 2008
55
16. Sur ce procédé, voir : F ERRO (Marc), Cinéma et histoire, [Denoël/Gonthier 1977], Gallimard,
Folio, 1993, 3e partie « Les modes d’action du langage cinématographique », XIII : De l’interview
chez Ophüls, Harris et Sédouy, p. 162.
17. Pour l’anecdote, on retiendra que Pierre Blais qui incarnai Lucien Lacombe, ne joua dans
aucun autre film.
18. Cité par L ANGLOIS (Suzanne), La résistance dans le cinéma français de fiction (1944-1994), thèse de
doctorat en histoire, université Mac Gill, Montréal, Canada, 1996, p. 516.
19. Vingtième siècle, no 2, avril 1989, p. 98.
20. LANGLOIS (Suzanne), op.cit., p. 550.
21. 3e conversation, p. 55-57.
22. 7e conversation, p.172.
23. Ce film connut bien des démêlés avec les autorités. La photo d’un gendarme français gardant
le camp d’internement de Pithiviers ayant suscité l’émoi de la Défense nationale, Resnais dut
masquer le képi du militaire avec de la gouache. Sur cette polémique, voir : LINDEPERG (S.), op.cit.,
pages 314 et suivantes.
24. Sur ce point, voir : R OUSSO (Henri), Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, Paris, Seuil Points
Histoire, 1990 [1987], p. 163 et suivantes.
25. Op.cit., p. 105.
26. Op.cit., p. 119.
27. Bertrand Tavernier, cinéaste insurgé, Paris, Ramsay poche cinéma, 2006, p. 98-101.
28. De même, certains acteurs ont joué dans plusieurs films sur ce sujet : Bourvil, Jugnot,
Signoret, Ventura.
29. Ainsi, Jean-Paul Salomé s’y est-il risqué avec Les femmes de l’ombre sorti le 5 mars 2008 et
analysé à l’annexe I « Les héroïnes de la Résistance ».
RÉSUMÉS
Sous l’Occupation, le cinéma est le divertissement populaire par excellence. Malgré leurs efforts,
les Allemands ne parviennent pas à imposer leur production et, dans l’ensemble, la profession est
peu encline à collaborer. L’épuration sera d’ailleurs très limitée. Dans l’immédiat après-guerre
émerge un courant patriotique rapidement tari. Sous la IVe République, la reconstruction mais
surtout la guerre d’Algérie font un peu oublier la Seconde Guerre mondiale et la Résistance. Le
retour du général de Gaulle entraîne un regain d’intérêt pour celle-ci. S’ouvre, en 1970, une
période de remise en cause du mythe de la France unie et résistante qui prévalait jusqu’alors.
Apparaît également un intérêt nouveau pour les aspects méconnus de la Résistance: la mémoire
juive, l’action des étrangers, le rôle des femmes, les excès de la Libération. Depuis une douzaine
d’années, la Résistance est devenue une lointaine référence à laquelle le cinéma rend hommage.
Successive Representations of the Resistance in French Cinema.During the Occupation, the cinema was
the pre-eminent popular diversion. Despite their efforts, the Germans were unable to interfere
with their production and, on the whole, the profession was little inclined to collaborate. The
purge will be very limited. Immediately after the war a patriotic current rapidly dried up. Under
the Fourth Republic, the reconstruction but above all the war in Algeria overshadowed the
Second World War and the Resistance. The return of General de Gaulle brought a renewal of
interest in it. In 1970 began a period of questioning the myth of united and strong France that
Revue historique des armées, 252 | 2008
56
had prevailed previously. A new interest in neglected aspects of the Resistance also appeared:
Jewish memory, the action of foreigners, the role of women, the excesses of the Liberation. For a
dozen years the Resistance has become a distance reference to which cinema renders homage.
INDEX
Mots-clés : cinéma, Deuxième Guerre mondiale, Résistance
AUTEUR
JEAN-FRANÇOIS DOMINÉ
Docteur en histoire, il est attaché d’administration du ministère de la Défense. Affecté au Service
historique de la Défense depuis 1999, il se consacre plus particulièrement aux questions
juridiques intéressant le monde combattant liées notamment aux statuts.
Revue historique des armées, 252 | 2008
57
Les guerres de la DEFA
La vision antifasciste du cinéma est-allemand
Cyril Buffet
1 L’encyclopédie est-allemande du cinéma estime que le film de guerre sert « soit à la
glorification de sentiments chauvinistes et antihumanistes, soit au rejet de la guerre,
par une description réaliste de ses causes et de ses objectifs, de destins individuels,
correspondant aux différentes conditions sociales et historiques » 1. Évidemment, la
RDA prône cette deuxième option, mais elle confère au film de guerre une finalité
idéologique encore plus importante.
2 L’entreprise qui détient en RDA le monopole de production cinématographique – la
DEFA – s’intéresse certes à presque toutes les époques historiques, mais elle privilégie
nettement la période hitlérienne qualifiée de « fasciste ». Cette prépondérance
s’explique par la fonction remplie par la DEFA, à savoir : la construction d’une identité
est-allemande spécifique, fondée principalement sur l’antifascisme. En effet, la
véritable source de légitimation politique de la RDA réside dans la lutte antifasciste
dont la Seconde Guerre mondiale constitue un épisode essentiel. La mission
primordiale de la DEFA consiste à répandre l’idéologie dominante et à l’enraciner dans
la population. Au contraire de la RFA qui revendique la succession légale du III e Reich et
en assume les crimes en versant des réparations aux victimes, la RDA rejette toute
responsabilité et toute continuité historique avec la période nazie. L’historiographie
est-allemande présente 1945 comme la libération de l’Allemagne par les combattants
antifascistes – majoritairement communistes – soutenus par l’Armée rouge. C’est le
mythe fondateur de la RDA, diffusé largement par le cinéma qui a pour mission de le
réactiver sans cesse pour les jeunes générations qui n’ont pas connu la période
hitlérienne. Mais au fil des décennies, cette idéologie dominante perd progressivement
en crédibilité et l’imagerie antifasciste semble imposée, ne répondant plus en tout cas
aux préoccupations et aux besoins de la société 2.
Revue historique des armées, 252 | 2008
58
Guerres du peuple
3 Poursuivant avant tout des buts politiques, le cinéma est-allemand privilégie les
guerres populaires. La DEFA consacre ainsi deux films biographiques à la guerre des
paysans du XVIe siècle. Le premier dresse le portrait de Thomas Müntzer (Martin
Hellberg, 1956), chef religieux dépeint en révolutionnaire guidant les masses
laborieuses, qui renvoie au rôle que le parti communiste s’est lui-même attribué. Celui-
ci surveille du reste attentivement la fabrication de ce film monumental, qui mélange
des séquences théâtrales et des reconstitutions de bataille dont les figurants sont des
policiers habillés en costumes d’époque. Malgré une mise en scène académique et le jeu
hiératique de l’acteur principal, il attire 1,8 million de spectateurs. Dans la mesure où
son message évoque l’unité allemande, la censure opère vingt ans plus tard des coupes,
afin d’éviter de soulever la question nationale. Le second film retrace le destin de Jörg
Ratgeb (Bernhard Stephan, 1978), un peintre contraint de s’impliquer dans la vie
politique. Bien qu’inspiré formellement du western-spaghetti, c’est un cuisant échec
commercial.
4 La guerre de Trente Ans fournit un immense succès, La Demoiselle Christine (Arthur
Maria Rabenalt, 1949) : pour suivre un militaire qu’elle aime, une jeune fille se déguise
en cornette, mais elle réalise que la guerre a transformé cet homme en une brute
épaisse, au point de devoir le tuer en duel. Le film est vu par 4,2 millions de spectateurs,
qui se détournent des tristes « films de ruines » et cherchent à se divertir 3. Pourtant, le
Parti communiste le critique sévèrement, l’accusant de formalisme et d’embellir la vie
de Lansquenet 4. C’est pourquoi il disparaît ensuite de la programmation des
cinémas.Quant à l’adaptation du drame de Brecht, Mère Courage (Peter Palitzsch et
Manfred Wekwerth, 1961), elle souffre de la comparaison avec les mises en scène du
Berliner Ensemble.
5 La Guerre de Sept Ans sert d’abord de toile de fond à Minna von Barrnhelm (Martin
Hellberg, 1962), adaptation conventionnelle du classique de Lessing sur les amours
contrariées du nom d’une noble saxonne amoureuse d’un major prussien. Sur le mode
de la guerre en dentelles, Erwin Stranka réalise deux comédies, l’une pétillante
(Hussards à Berlin, 1971) sur l’occupation de la capitale prussienne par une troupe
hongroise, l’autre moyennement drôle (La bataille volée, 1972) sur le siège de Prague par
Frédéric II. Les guerres napoléoniennes sont presque ignorées, à l’exception de Lützower
(Werner W. Wallroth, 1972), film raté sur un corps franc prussien combattant
l’envahisseur français. Pareillement, la Première Guerre mondiale apparaît rarement,
ouvrant seulement la biographie jdanovienne du leader communiste Ernst Thälmann
(Kurt Maetzig, 1954-1955) ou restant à l’arrière-plan de La Femme et l’Étranger (Rainer
Simon, 1985), racontant l’histoire d’un prisonnier de guerre allemand qui s’évade et
rejoint la femme d’un compagnon de captivité. Bien que le film remporte l’Ours d’or du
festival de Berlin-Ouest, sa diffusion demeure confidentielle.
Prélude espagnol
6 En vérité, la DEFA se concentre sur les guerres perçues comme la continuation de la
lutte antifasciste. C’est pourquoi elle accorde une importance toute particulière à la
guerre d’Espagne. Ignorant les contradictions internes au camp républicain et
valorisant les combattants communistes, elle présente la guerre d’Espagne comme le
Revue historique des armées, 252 | 2008
59
prélude à la Seconde Guerre mondiale. Elle aborde ce thème, en même temps d’ailleurs
que le cinéma ouest-allemand qui conte dans Tant que tu vis (Harald Reinl, 1955)
l’histoire d’une franquiste sauvant un aviateur de la Légion Condor. La DEFA choisit
naturellement l’autre camp.
7 En quatre ans, elle produit trois films sur la guerre d’Espagne qui obtiennent un succès
notable, attirant chacun 1,3 million de spectateurs. Tout d'abord, J’ai soif (Karl Paryla,
1956) raconte l’amour en 1936 d’un paysan et d’une étudiante tuée lors d’un
bombardement de chasseurs allemands ; le paysan rejoint les Brigades internationales,
y rencontre des Allemands antinazis et réalise que leur ennemi est commun. Si le début
impressionne – au pied d’un crucifix planté au milieu de champs arides, un paysan
émiette entre ses doigts la terre desséchée, alors que retentit la supplique du Christ
« J’ai soif » –, la suite souffre d’une interprétation minimaliste et de l’agencement
maladroit de bandes d’actualités et de scènes en studio. Le scénariste est Walter
Gorrisch (1909-1981), qui est successivement officier des Brigades internationales,
interné en France, livré aux autorités nazies, incarcéré trois ans en pénitencier, envoyé
sur le front de l’Est dans un bataillon disciplinaire dont il déserte pour incorporer
l’Armée rouge. Après la guerre, il se consacre à l’écriture et plusieurs de ses livres sont
portés à l’écran.
8 Ensuite, Où tu vas (Martin Hellberg, 1957) est fondé sur un roman qui devait être déjà
adapté en 1949, mais le projet avait alors été abandonné, car les extérieurs devaient
être tournés en Yougoslavie, ce qui n’était plus possible avec le schisme titiste. Ce film
suit l’itinéraire d’un antifasciste allemand qui rejoint les républicains espagnols, suivi
par une doctoresse suisse apolitique qui, par amour, se met au service des Brigades
internationales. Après la victoire franquiste, il est emprisonné dans un camp et elle est
expulsée vers son pays d’origine. C’est un film bâclé, qui soulève la polémique en raison
d’une scène de bordel où la caméra s’attarde sur les cuisses et la poitrine d’une
danseuse, ce qui scandalise de pudibonds apparatchiks. Enfin, Cinq Douilles (Frank
Beyer, 1960) est une réussite indéniable qui met provisoirement un terme à la
désaffection du public à l’égard des productions de la DEFA. Sur un autre scénario de
Walter Gorrisch, c’est un film prenant et expressif. Il rassemble, autour du commissaire
politique allemand Witting, cinq brigadistes de nationalités différentes (un Russe, un
Français, un Espagnol, un Polonais et un Bulgare) chargés de couvrir le repli de leur
bataillon. Mortellement blessé, Witting confie à ses compagnons un message pour le
quartier général – message divisé en cinq morceaux et caché dans des douilles. Hormis
le Français qui se fait abattre par l’ennemi au bord d’une fontaine, ils réussissent à
remplir leur mission et apprennent le contenu du message : la solidarité internationale
et la discipline révolutionnaire sont les garants de la survie et du succès. Ce film se
réfère clairement au genre du western : images fortes, dialogues brefs, scènes d’action.
Sa qualité réside dans la description des tensions physiques auxquelles sont soumis les
brigadistes qui doivent non seulement échapper à leurs poursuivants franquistes, mais
surmonter la canicule, la soif et la faim. Le difficile tournage en Bulgarie contribue à la
crédibilité de l’histoire. Le réalisateur, Frank Beyer (1932-2006), fait du paysage aride et
inhospitalier de la Sierra un véritable personnage. Il réussit à libérer les productions de
la DEFA de la pesante esthétique du réalisme socialiste 5. Le film remporte un large
succès grâce aussi à l’interprétation des acteurs principaux (Erwin Geschonneck,
Manfred Krug, Armin Mueller-Stahl). Ce n’est pas le cas d’une des dernières
coproductions de la DEFA, Nous restons fidèles (Andrei Maljukov, 1989), qui croise les vies
Revue historique des armées, 252 | 2008
60
de six brigadistes entre 1936 et 1946 – un film qui a toutefois le mérite de montrer les
brimades auxquelles sont soumis les combattants soviétiques de retour dans leur pays.
Bons et mauvais Allemands
9 La majeure partie des films de guerre est-allemands concerne la dictature nazie. La
DEFA réalise environ une centaine de films antifascistes, soit 15 % de la production
totale. Outre les « films de ruines » de l’immédiat après-guerre, de nombreux longs
métrages intègrent le second conflit mondial, comme Ceux qui ont aujourd’hui plus de 40
ans (Kurt Jung-Alsen, 1960) qui compare le destin de deux amis d’enfance, un fils
d’ouvrier et un fils d’entrepreneur : pendant la Seconde Guerre mondiale, le premier
fait partie d’un comité antifasciste, le second est un officier fidèle au régime hitlérien ;
en 1960, ils se revoient lors de négociations commerciales : celui-là représente la RDA,
celui-ci est secrétaire d’un ancien fonctionnaire nazi. Ce film est exemplaire de la
dialectique antifasciste développée par la RDA, qui se définit comme le seul État
allemand à avoir vraiment liquidé le passé nazi et établit un parallèle entre l’ennemi
intérieur d’hier et l’ennemi extérieur présent.
10 À l’instar de l’historiographie officielle, la DEFA présente le nazisme comme une
émanation du capitalisme et les nazis comme une clique coupée du peuple qu’ils
méprisent, trompent et oppressent. Évoquant rarement les buts politiques et racistes
du régime hitlérien, les films est-allemands décrivent la guerre comme une entreprise
capitaliste. Par ailleurs, ils privilégient le front de l’Est, ne montrant que l’armée
soviétique, au point d’occulter presque le front occidental et les forces anglo-
américaines, comme si l’URSS avait seule combattu et vaincu l’Allemagne nazie. À
l’inverse du roman original se déroulant à l’Ouest, le film Les Aventures de Werner Holt
(Joachim Kunert, 1965) situe l’action sur le front oriental, la DEFA arguant de ne pas
disposer de matériel militaire américain.
11 Malgré l’orthodoxie antifasciste, la production est-allemande contribue d’une manière
significative à explorer le passé nazi. Le critique ouest-allemand Heinz Kersten estime
même que « l’une des meilleures traditions de la DEFA est la confrontation permanente avec la
Seconde Guerre mondiale » 6. Cette tradition s’affirme à partir de 1957, se maintient une
vingtaine d’années et se manifeste notamment dans le traitement du génocide juif.
12 Grâce à diverses influences extérieures et au processus de déstalinisation, la DEFA
commence, dans la seconde moitié des années cinquante, à réviser sa vision
stéréotypée de l’histoire allemande. À l’image de réalisateurs polonais (Ils aimaient la
vie, Andrzej Wajda, 1957 ; Eroica, Andrzej Munk, 1958) et soviétiques (Le Quarante et
unième, Grigori Tchoukhraï, 1956 ; Quand passent les Cigognes, Mikhaïl Kalatozov, 1957),
des cinéastes est-allemands reconsidèrent la Seconde Guerre mondiale, en insistant
notamment sur le désenchantement de leur génération7. Ils cherchent aussi à riposter à
la vague de longs métrages ouest-allemands qui déferle alors sur les écrans. En effet, la
RFA produit, entre 1954 et 1959, une douzaine de films de guerre qui tend à réhabiliter
la Wehrmacht.Adaptant le best-seller de Hans Helmut Kirst, la trilogie 08/15 (Paul May,
1954-1955) lance la tendance, amplifiée par les énormes succès de Canaris (Alfred
Weidenmann, 1954) et du Général du Diable (Helmut Käutner, 1955), incarné par Curd
Jürgens. Suivent L’Étoile d’Afrique (Alfred Weidenmann, 1956), Requins et petits poissons
(Frank Wisbar, 1957), Taïga (Wolfgang Liebeneiner, 1958), U 47 – Capitaine Prien (Harald
Reinl, 1958), Le Médecin de Stalingrad (Geza von Radvanyi, 1958), Chiens, voulez-vous vivre
Revue historique des armées, 252 | 2008
61
éternellement (Frank Wisbar, 1959)… Ces films visent à convaincre les Allemands de
l’Ouest de la nécessité du réarmement, au moment de la création de la Bundeswehr et de
son intégration dans l’OTAN. Ils associent la campagne de Russie aux souffrances des
soldats et aux exactions de l’Armée rouge, afin de souligner que l’URSS est l’ennemie
mortelle de l’Allemagne8. Par contre, les deux films relatant l’attentat du comte
Stauffenberg contre Hitler (C’est arrivé le 20 juillet, Georg Wilhelm Pabst, 1955 ; Le 20
juillet, Falk Harnack, 1956) passent inaperçus. Cette vague ouest-allemande s’achève
avec Le Pont (Bernhard Wicki, 1959) – œuvre pacifiste sur de jeunes endoctrinés tués
lors d’une opération inutile.
13 À l’instar d’autres cinématographies d’Europe de l’Est, qui profitent du mouvement de
déstalinisation pour s’initier à de nouvelles problématiques et esthétiques, la
production est-allemande développe une introspection rigoureuse qui s’impose avec
Dupé jusqu’au Jugement dernier (Kurt Jung-Alsen, 1957). Inspiré de la nouvelle Camarades
de Franz Fühmann (1922-1984), qui fut SA dans sa jeunesse puis prisonnier de guerre en
URSS, ce film est l’un des plus convaincants tournés par la DEFA durant ces années de
dégel. En juin 1941, trois sous-officiers, stationnés près de la frontière lituanienne,
tuent accidentellement la fille de leur capitaine. L’un des soldats se confie à son père,
un général SS qui sait comment régler l’affaire. Le jour de l’attaque hitlérienne contre
la Russie, il fait « découvrir » le cadavre de la jeune fille et accuse les Soviétiques du
crime. En représailles, le capitaine éploré fait exécuter des otages, mais la vérité lui est
révélée par l’un des soldats qui est abattu par un complice.
14 Dans un style réaliste et laconique, le réalisateur développe une réflexion sur la
perversion des concepts de camaraderie et de communauté, en montrant que la
culpabilité de quelques soldats est inséparable de la responsabilité du peuple allemand.
D’abord comédien en Autriche et en Allemagne, Kurt Jung-Alsen (1915-1976) a, lui aussi,
été soldat et prisonnier de guerre. De retour de captivité, il dirige des théâtres, avant de
passer en 1954 derrière la caméra. Tournant dix films pour la DEFA, il se consacre
ensuite à la télévision. Il réalise, avec Dupé jusqu’au Jugement dernier, son film le plus
exigeant qui est souvent comparé à Ils aimaient la vie ; tous deux sont d’ailleurs
sélectionnés au festival de Cannes en 1957, ce qui constitue une première pour la DEFA.
Mais, si le film de Wajda obtient le prix spécial du Jury, l’œuvre de Jung-Alsen est
seulement projetée hors compétition, sur insistance du gouvernement de Bonn qui
revendique d’être le seul représentant allemand.
15 Le film est cependant vendu à une dizaine de pays dont la Grande-Bretagne. Le Times de
Londres fait l’éloge de cette « allégorie concise et forte sur l’armée allemande » et d’une
mise en scène « remarquable, rigoureuse, dotée d’une âpre poésie » 9. Malgré cette
reconnaissance internationale que couronne un succès public (1,5 million de
spectateurs en RDA), le film suscite les préventions de bureaucrates communistes qui
lui reprochent non seulement d’opérer une distinction spécieuse entre la Wehrmacht et
la SS, mais aussi de risquer de « renforcer certaines tendances pacifistes » au sein de la
population est-allemande, alors que le régime met en avant l’engagement de la RDA au
sein du Pacte de Varsovie.
16 Ce film demeure une rareté dans la production de la DEFA, puisque d’autres projets
thématisant la psychologie des soldats en guerre sont abandonnés. C’est en particulier
le cas de La Maison en feu. Le scénario s’inspire du roman Les heures des yeux morts publié
en 1957 par Harry Thürk (1927-2005), qui participe aux ultimes combats de la guerre.
Bien que le ministère est-allemand de la Culture dénonce son « objectivisme » et son «
Revue historique des armées, 252 | 2008
62
style américain », le livre du « Konsalik de l’Est » remporte un large succès. Dès 1958,
Herbert Ballmann envisage de le porter à l’écran, car il recoupe sa propre biographie : il
est incorporé à dix-huit ans et passe quatre ans en captivité. Il estime
rétrospectivement que c’était le sujet auquel il a été le plus attaché. L’histoire se
déroule durant l’hiver 1944 en Prusse orientale où la jeune Maria cache un officier
russe évadé, en toute connaissance d’un parachutiste allemand qui ne les dénonce pas.
Quand la zone passe du côté soviétique, l’Allemand abat son supérieur qui veut détruire
la ferme de Maria. Le parachutiste se fait tuer par ses compatriotes et l’officier russe
meurt également.
17 Mais Ballmann ne peut mener à terme ce projet, car il en est déchargé à l’été 1959 par
la direction du studio. Déçu de ne pouvoir faire le « un film-clef » pour les jeunes de sa
génération, il quitte en novembre 1959 la RDA, d’autant qu’il craint d’être empêché de
voir sa femme, la comédienne Gisela Uhlen engagée par un théâtre de Berlin-Ouest, où
lui-même fait ensuite carrière comme producteur. La DEFA confie alors à Carl Balhaus
(1905-1968) le projet assorti de substantielles transformations : la figure de l’officier
soviétique est renforcée et le parachutiste allemand doit volontairement passer à
l’ennemi. Le tournage commence en novembre 1959, mais il est interrompu trois mois
plus tard, bien que la moitié du film soit déjà tournée. La représentation des deux
personnages centraux continue de poser un problème idéologique. Malgré
l’introduction de changements supplémentaires et l’appel lancé aux autorités
culturelles par l’actrice principale, Inge Keller, la DEFA abandonne un projet qualifié de
« particulièrement raté » ; la pellicule est considérée comme détruite. Si elle témoigne de
la sorte « d’un manque de courage à l’égard des problèmes de la jeunesse élevée à l’époque du
fascisme » 10, elle manifeste par contre une constance envers le génocide juif, ce qui lui
est rarement reconnu. Elle a en effet eu le mérite de s’intéresser très tôt au sort des
Juifs sous le IIIe Reich, bien avant le cinéma de RFA.
L’étoile de Jacob
18 En même temps qu’il suspend le tournage de La Maison en feu, le studio de RDA produit
Étoiles (Konrad Wolf, 1959), le premier film de fiction allemand entièrement consacré à
l’extermination des Juifs. Il devance de vingt ans la série américaine Holocaust qui,
en 1979, émeut 20 millions d’Allemands de l’Ouest 11. Le scénario est rédigé par
l’écrivain juif bulgare Angel Wagenstein, qui fut un partisan sauvé in extremis de la
peine de mort par l’arrivée de l’Armée rouge. Il conte la déportation vers Auschwitz
en 1943 de Juifs grecs qui font étape dans une petite ville bulgare, où est stationné le
sous-officier allemand Walter que la guerre a transformé en nihiliste. Celui-ci s’éprend
de l’enseignante juive Ruth. À travers cet amour, l’ancien étudiant en art, qui voulait
accomplir son devoir patriotique en tant que soldat, commence à évoluer. Il s’oppose à
son supérieur et ami Kurt, un militaire arrogant et brutal. Ne pouvant empêcher la
déportation de Ruth vers les camps de la mort, il décide de rejoindre les résistants
bulgares.
19 Étoiles est remarquable à plus d’un titre. C’est un film poétique, symbolique et
pénétrant qui s’éloigne de l’habituelle orthodoxie antifasciste. Konrad Wolf décrit
Walter de manière nuancée, avec ses doutes et ses hésitations. Alors que le ministère
est-allemand de la Culture redoutait un mélodrame sentimental, le cinéaste engage une
réflexion profonde sur les dangers menaçant une société et la nécessité impérieuse de
Revue historique des armées, 252 | 2008
63
les combattre. De son côté, le gouvernement de Sofia n’apprécie guère que soit brisé le
tabou de la collaboration bulgare. Ces critiques se taisent après que le film a attiré
1,7 million de spectateurs et obtenu en 1959 le Prix spécial du jury à Cannes, mais en
tant que production bulgare en raison des pressions exercées par la République
fédérale.
20 Comme déjà le premier film de la DEFA, Les Assassins sont parmi nous (Wolfgang Staudte,
1946), Étoiles évoque les crimes de la Wehrmacht, 35 ans avant une exposition
controversée en Allemagne. Le film replace le génocide juif au centre de la barbarie
hitlérienne, ce qui le distingue de la doctrine marxiste classique, qui interprète le
nazisme comme une forme extrême du capitalisme et l’antisémitisme comme une
manœuvre destinée à détourner l’énergie des masses. La lutte des races ne pouvant
supplanter la lutte des classes, la RDA établit une hiérarchie officielle des victimes du
fascisme : les combattants politiques sont valorisés, alors que les persécutés raciaux ou
religieux sont marginalisés ; les Juifs n’occupent que la douzième position 12.
21 Minimisant, elle aussi, la spécificité du phénomène hitlérien, la DEFA inscrit
l’Holocauste dans la logique inhumaine du nazisme. Elle insiste bien davantage sur son
anticommunisme viscéral que sur son racisme 13. Cette perspective est notamment
développée dans Nu parmi les loups (Frank Beyer, 1963), qui est toutefois le premier film
de fiction sur un camp de concentration où est caché un enfant. Le film héroïse le
combat des déportés communistes qui sont nettement identifiés, alors que les Juifs sont
présentés comme des victimes anonymes. L’action a lieu à Buchenwald, où le scénariste
Bruno Apitz a lui-même été interné huit ans. Ce camp fait figure de principal mémorial
de la RDA, en raison, d’une part, de l’exécution du leader communiste Ernst Thälmann
et, d’autre part, de la forte présence de communistes censés avoir seuls libérés
Buchenwald, comme le montre le film, en omettant de mentionner l’arrivée imminente
des forces américaines. Mais le réalisateur se charge lui-même de réviser le mythe de la
glorification de la résistance communiste, en faisant de Jacob le Menteur (1975) le
véritable héros de la tragédie juive. Ce chef-d’œuvre, sur la déportation d’un ghetto
d’Europe orientale, conjugue intensité émotionnelle et message humaniste, ce qui
explique sans doute qu’il soit la seule production de la DEFA jamais sélectionnée aux
Oscars.
Nouvelle vague est-allemande
22 La même exigence morale et artistique habite Gerhard Klein (1920-1970) quand il
dissèque, dans L’Affaire Gleiwitz (1961), la machination ourdie par les nazis pour
déclencher les hostilités contre la Pologne. Ce film rigoureux s’inscrit dans le
mouvement de renouveau esthétique qui régénère alors toutes les cinématographies
européennes, de l’école polonaise au free cinema en passant par la Nouvelle Vague. C’est
la minutieuse reconstitution d’un forfait fondé sur les interrogatoires du principal
instigateur : guidés par l’officier du Service de sécurité Naujocks, qui y vit
tranquillement. À l’aide d’images symétriques destinées « à transmettre au public une
image froide de ces engrenages », Klein, qui fut un résistant communiste arrêté à deux
reprises par la police nazie et un soldat capturé par l’armée britannique, s’attache à
faire une description clinique du système hitlérien de manipulation. Bien qu’il se réfère
à 1939, le message du film revêt une signification contemporaine, en soulignant la
nécessité de la vigilance. Il songe à la guerre froide qu’un incident est susceptible de
Revue historique des armées, 252 | 2008
64
rendre chaude. Or, la sortie du film intervient justement lors d’un tel événement, la
construction du Mur de Berlin. Cette malheureuse concordance le condamne à la
confidentialité, car les rapprochements historiques semblent trop évidents. En outre, la
vision austère de Klein est perçue par le Parti comme « une esthétisation du fascisme » 14.
Le réalisateur présente tout de même son œuvre en 1963 à Hambourg, mais il est
écœuré de constater que la salle est remplie d’anciens SS dont Naujocks.
23 Un autre film de la période traite, lui, de la fin de la guerre : dans Archives secrètes sur
l’Elbe (Kurt Jung-Alsen, 1963), un officier SS négocie avec les services de renseignement
américains la remise du fichier des agents de la Gestapo opérant dans toute l’Europe,
mais un major soviétique, aidé par des résistants allemands, s’en empare et le
transporte en URSS. C’est une histoire édifiante sans grand intérêt historique ou
cinématographique, comme La foudre gelée (Janos Veiczi, 1967), pesante démonstration
relative à un savant qui participe à la construction à Peenemünde des V1 et V2, avant
de se rallier au combat antifasciste. Par contre, Enfants de roi (Frank Beyer, 1962) se
caractérise par un souci de recherche formelle, par l’utilisation d’une composition
calligraphique, de cadrages sophistiqués et d’effets de lumières pour décrire la mise à
l’épreuve d’un grand amour et l’amitié virile d’un communiste et d’un SA qui,
ensemble, rallient les lignes soviétiques.
24 C’est aussi durant la brève phase de relative libéralisation que connaît la RDA après
l’érection du Mur qu’est tourné le principal film de guerre est-allemand. Il s’agit des
Aventures de Werner Holt (Joachim Kunert, 1965), qui entreprend une réévaluation de la
période de la guerre, comme l’avait vainement tentée La Maison en feu. C’est le film
qu’attendait toute une génération et c’est la réplique est-allemande au Pont. Il remporte
un succès phénoménal puisqu’il se classe au premier rang du box office, avec 2,3 millions
d’entrées. Il correspond à une nouvelle approche de la DEFA qui cherche à convaincre
la jeunesse de la justesse de la lutte antifasciste, dans le double but de réaffirmer la
légitimité de la RDA et de susciter son adhésion à « l’État des ouvriers et paysans ».
Rompant avec les fresques staliniennes désincarnées, le studio est-allemand privilégie
désormais l’individualisation des personnages, susceptible de favoriser les processus
d’identification.
25 Inspiré du roman éponyme de Dieter Noll, le film retrace le parcours personnel du
jeune bourgeois Holt, qui a pour ami d’enfance Gilbert Wolzow, un fils d’officier : à la
fin de la guerre, ils sont chargés de défendre une position face aux troupes soviétiques ;
Holt se remémore les principales expériences de sa vie, notamment son engagement
dans l’armée et la rencontre avec la mort. Renonçant à « l’éthique guerrière », il
s’humanise, aidant ainsi une partisane slovaque à fuir. Quand Wolzow exécute un jeune
déserteur, Holt s’empare d’une mitrailleuse et décime des SS fanatisés. Finalement, il
quitte son poste, rentrant à la maison pour retrouver celle qu’il aime. Ce film marque
une triple rupture dans la représentation officielle de l’histoire : le héros est issu de la
bourgeoisie, il ne se convertit pas à la fin au communisme, il ne se range pas non plus
du côté soviétique. Il offre en somme une vision différenciée de la guerre et explore
finement les motivations et les réactions des Allemands face au conflit.
26 Trois ans plus tard, Konrad Wolf entreprend une démarche similaire, mais en
présentant cette fois le point de vue d’un Allemand combattant au sein de l’Armée
rouge. J’avais dix-neuf ans (1968) est en grande partie un récit autobiographique. Comme
Gregor Hacker, le personnage principal du film, le réalisateur a quitté l’Allemagne nazie
pour se réfugier en URSS dont il a acquis la nationalité. En avril 1945, Hacker-Wolf
Revue historique des armées, 252 | 2008
65
revient au pays natal sous l’uniforme soviétique. Il tient un journal de la bataille de
Berlin, du 16 avril au 2 mai 1945. Sa mission consiste à convaincre les soldats allemands
de renoncer au combat. Gregor rencontre chaque jour des Allemands différents,
certains optimistes, d’autres désespérés ou troublés, des fanatiques, des suivistes. Après
que son ami Sascha a été tué lors d’une ultime escarmouche, il se décide à rester en
Allemagne pour y bâtir une meilleure société.
27 Le film s’impose par son authenticité que renforce une construction dramatique
éclatée, correspondant à une réalité historique et subjective composée de moments
tragiques, comiques, absurdes. Wolf s’efforce de détruire la légende de la libération
véhiculée par l’historiographie officielle, en refusant d’idéaliser la rencontre entre
Allemands et Soviétiques et en n’hésitant pas à faire allusion aux viols massifs
pratiqués par les soldats de l’Armée rouge. Wolf porte témoignage sur une époque qui
tend à s’estomper dans les mémoires. Il veut ainsi engager un dialogue avec le passé,
afin d’inculquer une conscience historique aux jeunes générations en leur expliquant
ce que 1945 signifie. C’est en retraçant la trajectoire morale et psychologique d’un
individu, doté en outre d’une double identité (allemande et soviétique), que Wolf
cherche à donner un sens à l’histoire nationale. Il semble que la méthode recueille
l’assentiment des Allemands de l’Est puisqu’ils sont plus de 2,5 millions à voir le film la
première année, ce qui le place en deuxième position juste derrière un film d’Indiens.
J’avais dix-neuf ans se transforme en phénomène de société, d’autant que les écoliers
sont obligés d’assister à sa projection. Mais cette « contrainte mémorielle » entraîne peu à
peu son rejet, ce que Konrad Wolf pressent peut-être lui-même puisqu’il est convaincu
que « chaque génération cherche son propre accès au passé » 15.
28 Un autre film devait au même moment enrichir le débat sur l’attitude des Allemands à
l’égard du nazisme. Mais Les Russes arrivent (Heiner Carow, 1968) est interdit, car il est
accusé de « psychologiser le fascisme », en choisissant pour héros un jeune hitlérien dont
l’évolution ne le conduit pas à l’antifascisme mais au bord de la folie. La monteuse du
film ayant réussi à en sauver une copie, le film est finalement montré vingt ans plus
tard.
L’aventure de la guerre
29 Si la DEFA poursuit dans la veine de la personnalisation, elle cherche cependant à
séduire le public – de moins en moins nombreux et de plus en plus jeune –, en
recourant davantage au divertissement. C’est le temps des comédies musicales, des
westerns, du 70 mm, de la couleur. Le film de guerre n’échappe pas à cette tendance.
Ainsi, Mon Année Zéro (Joachim Hasler, 1970) est présenté comme « une aventure excitante
entre les fronts ». Ce film est du reste réalisé par Joachim Hasler (1929-1995), un
spécialiste du film de genre. Produit pour célébrer le 25 e anniversaire de la fin de la
guerre, il bénéficie du concours des studios moscovites et des unités soviétiques
stationnées en RDA. Il raconte, à la première personne du singulier, comment un soldat
allemand, d’origine ouvrière, survit au désamorçage d’une bombe ordonné par un
supérieur méprisant (interprété au demeurant par le metteur en scène Kurt Jung-
Alsen). Envoyé en éclairage, il est fait prisonnier par l’Armée rouge. Les Russes le
persuadent que le meilleur moyen « de terminer la guerre au plus vite » consiste à enlever
un officier allemand, afin d’obtenir des informations. Avec deux militaires soviétiques,
avec lesquels il finit par sympathiser, il mène à bien la mission émaillée de multiples
Revue historique des armées, 252 | 2008
66
péripéties. Combinant action et comédie, le film remporte un large succès populaire,
car il cherche à montrer la guerre d’une manière palpitante et drôle. En outre, le
« héros malgré lui » est incarné par Manfred Krug, une sorte de Belmondo socialiste qui
est une véritable idole en RDA.
30 Sur un mode plus sérieux, Konrad Wolf traite d’un thème identique dans Maman, je suis
en vie (1977) : quatre prisonniers de guerre allemands décident d’endosser l’uniforme
russe pour, eux aussi, accélérer la fin des hostilités. Vus par leurs camarades comme
des traîtres et par les soldats soviétiques de manière suspecte ou indifférente, ils sont
envoyés en mission derrière les lignes allemandes, mais hésitent à tirer sur leurs
compatriotes, ce qui coûte la vie à leur guide soviétique. Abstraction faite d’une
romance superflue et d’épisodes invraisemblables, c’est une réflexion aiguë sur
l’engagement moral et l’identité nationale. Comme les autres œuvres de Wolf, ce film
sincère délivre un message clair : le seul chemin historiquement vrai est celui de la
résistance antifasciste – un message entendu par 1,4 million de spectateurs : c’est le
succès de l’année ! Le thème du déserteur est repris dans Je veux vous voir (Janos Veiczi,
1978). Bien qu’inspiré d’une histoire vraie, c’est un film de propagande peu convaincant
qui s’inscrit dans le genre des films de partisans largement répandu dans les
démocraties populaires : en 1941, le soldat Fritz Schmenkel rejoint les partisans
soviétiques ; lors d’une mission de renseignement, il est capturé par les nazis qui
l’exécutent ; il est fait héros de l’URSS à titre posthume.
31 Comme Konrad Wolf, d’autres réalisateurs de la DEFA tentent aussi de remettre en
cause certains clichés antifascistes diffusés par l’idéologie dominante. Horst Brandt
reconnaît, dans KLK à PTX (1971), l’existence d’une résistance bourgeoise. Ralf Kirsten
montre, dans Je t’oblige à vivre (1978), un membre du parti nazi qui se sacrifie pour
empêcher son fils de s’engager dans les Waffen SS. Günther Rücker et Günter Reisch
soulignent que La Fiancée (1980) agit davantage par inclination amoureuse que par
conviction politique. Ulrich Weiss ose même prétendre, dans Ton Frère inconnu (1982),
qu’un résistant communiste peut être poussé à trahir.
32 Qu’il traite de la guerre des paysans, de l’Espagne ou de la Seconde Guerre mondiale, le
cinéma de RDA ne cesse en fait de dresser un parallèle avec la guerre froide, encore
plus quand il évoque les conflits contemporains,choisissant au demeurant plutôt la
guerre d’Indochine que celle du Viêt-Nam. Dans L’Escadrille Chauve-Souris (Erich Engel,
1958) des mercenaires américains, commandés par un général sans scrupules,
secondent les efforts français. Se révoltant contre l’oppression colonialiste, un pilote
américain sauve une interprète vietnamienne accusée d’espionnage ; ensemble, ils
s’enfuient chez le Viêt-minh. Plus que par un sujet convenu, le film, presque
entièrement tourné en studio, se distingue par des dialogues laconiques, la
photographie contrastée et la mise en scène soignée d’un réalisateur expérimenté qui
avait monté les premières pièces de Brecht. Cette qualité formelle explique sans doute
que le film attire près de deux millions de spectateurs. Trente ans plus tard, la DEFA
coproduit avec le Viêt-Nam un film superficiel, Le Temps de la Jungle (Jörg Foth et Tran
Vu, 1988), qui s’inspire des souvenirs de légionnaires : un jeune soldat de la Wehrmacht
déserte et rejoint en Afrique la Légion étrangère. Stationné en Indochine, il passe en
1949 du côté vietnamien où il dirige d’abord un groupe de légionnaires allemands,
avant de décider de retourner en Allemagne de l’Est. Ce film continue de seriner
l’antienne antifasciste et de dresser des parallèles entre le passé et le présent, l’Asie et
l’Europe. Mais ce message apparaît déconnecté des réalités, au moment où l’Union
Revue historique des armées, 252 | 2008
67
soviétique est embourbée en Afghanistan, où Gorbatchev engage des réformes
radicales, où la population est-allemande commence à manifester son
mécontentement. La guerre froide s’apprête à se terminer là où elle a commencé,
comme le documente la DEFA.
NOTES
1. WILKENING (Albert), BAUMERT (Heinz) et LIPPERT (Klaus) (dir.), Kleine Enzyklopädie Film, Leipzig,
VEB Bibliographisches Institut, 1966, p. 828.
2. ALLAN (Sean) et SANDFORD (John) (dir.), DEFA. East German Cinema 1946-1992, Londres, Berghahn,
1999, p. 75-76.
3. MÜCKENBERGER (Christiane) et JORDAN (Günter), « Sie sehen selbst, Sie hören selbst… »Die DEFA von
ihren Anfängen bis 1949, Marburg, Hitzeroth, 1994, p. 138-141.
4. HEYMANN (Stefan), «Von allen Kunstarten die Wichtigste… », Berlin, Neuer Weg, 1950, n° 10.
5. SCHENK (Ralf) (dir.), Regie: Frank Beyer, Berlin, Hentrich, 1995, p. 164-169.
6. Cité par Christel Drawer, So viele Träume, Berlin, Vistas, 1996, p. 122.
7. HAKE (Sabine), German National Cinema, Londres, Routledge, 2002, pp. 97 et 101.
8. RAIMUND (Fritz) (dir.), Der geteilte Himmel, vol 2, Vienne, Filmarchiv Austria, 2001, p. 82-84.
9. Cité par Horst Knietzscht, Film gestern und heute. Leipzig, Urania-Verlag, 1967, p. 250.
10. Cité par Ralf Schenk, Das zweite Leben der Filmstadt Babelsberg, Berlin, Henschel, 1994, p.
123-124.
11. Pendant longtemps, il n’y a que deux films « ouest-allemands » (produits avant la partition
du pays) qui abordent la Shoah : d’une part, La route est longue (Herbert Fredersdorf et Marek
Golstein, 1947) qui raconte l’histoire d’une famille juive de Varsovie, depuis sa déportation
jusqu’à son émigration en Palestine ; d’autre part, Morituri (Eugen York, 1948) sur des déportés
juifs qui s’évadent et se réfugient dans une forêt.
12. BERGHAHN (Daniela), Hollywood behind the Wall, Manchester, MUP, 2005, p. 87.
13. FRITZ (Raimund) (dir.), Der geteilte Himmel, op. cit., p. 86-87.
14. POSS (Ingrid) et WARNECKE Peter (dir.), Spur der Filme. Zeitzeugen über die DEFA, Berlin, Ch. Links
Verlag, 2006, p. 168-169.
15. Film und Fernsehen, juillet-septembre 1977, p. 285.
RÉSUMÉS
Le cinéma de RDA intègre la Seconde Guerre mondiale dans le combat antifasciste commencé en
1933 et mené principalement par les communistes. Au-delà des buts de propagande, il contribue
d’une manière exemplaire à explorer le passé nazi, notamment en insistant très tôt sur le
génocide juif. Il reflète également les tensions et les contradictions de la guerre froide. Avec la
Revue historique des armées, 252 | 2008
68
déstalinisation, des cinéastes est-allemands questionnent l’idéologie antifasciste dont tendent à
se distancier les nouvelles générations.
Wars of the DEFA: The anti-fascist vision of East German cinema.Begun in 1933 and led mainly by the
communists, the film of RDA integrates World War II into the anti-fascist struggle. Beyond
propaganda purposes, it contributes in an exemplary manner to the exploration of the Nazi past,
particularly in its focusing on early Jewish genocide. It also reflects the tensions and
contradictions of the Cold War. With de-Stalinization, East German filmmakers question anti-
fascist ideology which seems distant to new generations.
INDEX
Mots-clés : Allemagne, guerre froide, cinéma
AUTEUR
CYRIL BUFFET
Historien, spécialiste de l’Allemagne, il est notamment l’auteur de : Défunte DEFA. Histoire de l’autre
cinéma allemand, Paris, Corlet/7e Art, 2007, 359 pages
Revue historique des armées, 252 | 2008
69
Variations
Revue historique des armées, 252 | 2008
70
Autour du Code de justice maritime
(1858-1965)
Une brève histoire de la justice maritime
Jean-Philippe Zanco
1 « La musique militaire est à la musique, ce que la justice militaire est à la justice » : la justice
militaire n’a pas fait l’objet que de railleries, parfois perfides, comme celle de
Clemenceau, elle a été aussi régulièrement la cible de critiques fort vives, non sans
raison. La justice maritime, sœur de la justice militaire, n’a pas eu son « Affaire
Dreyfus » ; elle a pourtant subi, au début du XXe siècle, le contrecoup du scandale :
entre 1894 et 1926, pas moins de trente-deux propositions parlementaires projetèrent
la réforme de la justice militaire et maritime. Mais le Code de justice maritime, datant
de 1858 (celui de justice militaire, de 1857), se maintiendra à travers tous les vents
politiques jusqu’en 1938. C’est l’histoire qui entoure l’élaboration de ce Code que j’ai
voulu retracer brièvement ici.
Une justice duale dès l’Ancien Régime
2 La justice pénale maritime se caractérise par une double vocation :
• c’est une justice ratione personæ, à la fois disciplinaire et pénale, en vertu de laquelle les
marins doivent être jugés par des marins, comme les militaires le sont par des militaires ;
• c’est aussi une justice ratione loci, définie autour du port ou de l’arsenal, comme lieu
particulier entièrement voué, par nature, à l’activité maritime.
3 Ce principe, absolument fondamental, fait aussi toute la particularité de la justice
militaire de la marine par rapport à la justice militaire de l’armée de Terre. La
distinction entre justice des hommes et justice du port est également très ancienne,
traditionnelle, antérieure même à la grande ordonnance du 15 avril 1689, qui,
cependant, la consacre et lui donne toute sa dimension. Certains textes préexistaient, et
notamment une ordonnance de 1673 réglementant la tenue des conseils de guerre pour
le jugement des crimes commis par les marins, mais l’ordonnance de 1689, préparée par
Colbert et rendue par Seigneulay, constitue le premier véritable Code de justice
Revue historique des armées, 252 | 2008
71
maritime. Elle se divise en treize parties : « Du maître et du capitaine, De l’aumônier, De
l’écrivain, Du pilote et du lamaneur, Du matelot, Des armements sous pavillon étranger, Des
prises, Des naufrages, Des levées de droits dans les ports, Des rades, De la coupe du varech, Des
parcs et pêcheries, Des vols sur les ports. » S’ajoutent d’autres dispositions particulières à la
marine du commerce.
4 La double compétence de la justice militaire maritime est à mettre en parallèle avec
une autre distinction, également due à Colbert, celle de la plume et de l’épée, à l’origine
de l’existence d’un corps spécifiquement voué aux tâches administratives et logistiques
(le commissariat), à côté du « grand corps » navigant et combattant :
• l’amiral, comme chef de guerre, a le pouvoir de rendre la justice – une justice où le pénal se
mêle au disciplinaire – sur les hommes qu’il commande. À bord, c’est le commandant qui
exerce ce pouvoir, en constituant le conseil de guerre. Cependant, l’ordonnance de 1689
encadre très strictement le pouvoir judiciaire de l’amiral (ou du commandant) et la
compétence des conseils de guerre est limitée puisqu’il n’a connaissance que des crimes
commis entre officiers, matelots et soldats. Les crimes de droit commun, et tous ceux
impliquant un individu non-marin et non-militaire, lui échappent, à l’exception de ceux
commis à bord ;
• l’intendant exerce, lui, un pouvoir administratif et comptable et dispose d’un pouvoir
général de police sur l’arsenal. Le tribunal de l’intendant en est l’émanation directe. Sa
compétence, après l’ordonnance du 1er août 1731, est considérablement étendue, puisqu’il
est informé de tous les crimes et délits commis par quiconque (marin ou civil) dans l’arsenal.
5 Quelques textes contribuent à rééquilibrer les pouvoirs de l’intendant par rapport à
celui de l’amiral : une ordonnance du 27 septembre 1776 ôte les crimes de la
compétence du tribunal de l’intendant (à l’exception des vols) pour les faire passer sous
la compétence du conseil de guerre. Mais la dualité justice des hommes/justice du
matériel n’est pas remise en cause, même pas par la Révolution. Dans un premier
temps, les conseils de guerre et les tribunaux d’intendants suivent le même sort que
toutes les juridictions exceptionnelles de l’Ancien Régime et sont supprimés. Deux
textes introduisent dans les juridictions militaires les principes libéraux déjà en
application dans le droit commun, notamment celui du jury : les décrets du
22 août 1790 et 12 octobre 1791. Ces derniers vont constituer ce qu’on appellera, assez
improprement le « Code pénal de la marine » et fonder en tout cas la base de
l’organisation judiciaire maritime pour toute la première moitié du XIX e siècle.
Pourtant, lorsqu’on y regarde de plus près, il n’y a aucune rupture radicale par rapport
à l’organisation d’Ancien Régime :
• le décret du 22 août 1790 réglemente la justice de la flotte, bientôt baptisé « Code pénal des
vaisseaux » ; le décret du 12 octobre 1791 réglemente, quant à lui, la justice dans les
arsenaux, rapidement surnommé « Code pénal des arsenaux » ;
• la continuité avec l’Ancien Régime n’est pas seulement formelle, elle existe aussi en
pratique. Le « Code pénal des vaisseaux » organise la justice à bord autour d’un conseil
martial et d’un conseil de justice, dont les compétences sont, respectivement, criminelle et
correctionnelle ; il renvoie largement, en ce qui concerne les peines et les procédures, à la
législation d’Ancien Régime, ce qui est assez exceptionnel pour un texte révolutionnaire.
Quant à la police des arsenaux, elle s’organise autour d’un conseil d’administration des ports
jugeant des vols et petits délits et d’une cour martiale jugeant des crimes et délits
importants.
Revue historique des armées, 252 | 2008
72
Jusqu’au Code de 1858 : une législation complexe,
éparse et sans unité
6 À l’avènement de l’Empire, une vingtaine de textes épars réglementent la justice
maritime. Là où se fait sentir la nécessité d’une codification et d’une unification de la
réglementation, le régime se contente de perfectionnements de détail. Les deux décrets
impériaux des 22 juillet et 12 novembre 1806 introduisent quelques formes
procédurales, mais ils conservent la partie strictement pénale des décrets de 1790-1791
et consacrent à nouveau la distinction entre justice à la mer et justice des arsenaux. Le
conseil martial est remplacé par un conseil de guerre (on retrouve donc l’ancienne
dénomination) et la cour martiale par un tribunal maritime. Ces deux institutions
perdureront jusqu’en 1938. La Restauration crée dans les ports des conseils de guerre et
des conseils de révision permanents (ordonnance du 22 mai 1816) et fait entrer les faits
de piraterie dans la compétence des tribunaux maritimes (loi du 10 avril 1825). Après
cette date, la législation criminelle maritime change peu. C’est à cette époque que l’on
prend vraiment conscience de l’extrême complexité du système en vigueur, et de la
nécessité d’y remédier par une grande réforme. Plusieurs tentatives seront faites, et
toutes échoueront, anéanties par l’ampleur de la tâche.
7 En août 1827, une commission est constituée en vue d’étudier la refonte générale des
lois pénales maritimes. Après trois ans de travail, elle fournit un projet de Code
imparfait, manquant de simplicité : les tribunaux spéciaux du bagne sont certes
supprimés, mais une nouvelle juridiction est créée, chargée de juger des faits de
piraterie, qui seraient retirés aux tribunaux maritimes. Le projet est enterré en 1830
avec le changement de régime. En juillet 1836, une nouvelle commission est constituée,
sous la présidence du baron Tupinier, directeur des Ports et Arsenaux au ministère de
la Marine. Elle travaille six mois sans produire aucune proposition constructive.
8 Durant trente ans, jusqu’à l’aube du Second Empire, « l’administration de la justice
[maritime] est régie par des lois incomplètes, sans unité, souvent modifiées ou mutilées, suivant
les temps et les circonstances, et dans lesquelles se rencontrent des anomalies ou des lacunes
considérables, que le législateur semble avoir constatées lui-même en renvoyant tantôt aux lois
ordinaires, tantôt aux lois militaires : de là une confusion qui se révèle sans cesse dans la
pratique, des conflits et des incertitudes devant lesquels la Cour de cassation elle-même a plus
d’une fois hésité. Les éléments divers qui, par leur réunion, forment l’armée navale, ont chacun
une juridiction différente, des tribunaux spéciaux, des lois répressives séparées. Le délit de
désertion seul a son tribunal spécial. Enfin, cinq juridictions donnant lieu à la formation de huit
tribunaux ou conseils, exercent la justice en même temps (...).» 1 On distingue en effet à cette
époque :
• les juridictions de la flotte, composées des conseils de guerre et des conseils de justice, dont
l’existence est temporaire, qui siègent à bord et jugent de tous les crimes et délits commis
par les individus embarqués, à l’exception de la désertion ;
• les juridictions des arsenaux, composées des tribunaux maritimes et des tribunaux de
révision, et qui connaissent de tous les crimes et délits commis dans les ports et arsenaux.
Revue historique des armées, 252 | 2008
73
9 Ces deux institutions perpétuent la tradition d’une justice maritime partagée entre
justice des hommes et justice du matériel. Mais, depuis les réformes de la Révolution,
de l’Empire et de la Restauration, s’ajoutent encore :
• les juridictions des corps organisés de la marine, composées de conseils de guerre et de
conseils de révision permanents, et qui jugent les individus appartenant aux corps organisés
de la marine (troupes de marine, équipages de la flotte, gendarmerie maritime, gardes-
chiourmes, etc.) selon les lois et règlements en vigueur pour l’armée de Terre ;
• les juridictions de désertion, composées de conseils de guerre et de conseils de révision
permanents des ports et dont la composition diffère selon que le prévenu appartient aux
troupes de marine ou aux équipages de la flotte ;
• le tribunal spécial du bagne, chargé de juger les forçats selon une procédure exceptionnelle,
qui notamment exclut l’intervention du jury et même, dans certains cas, d’un défenseur.
Vers une justice plus humaine
10 La révolution de février 1848 nourrit de grands projets pour la marine, qui vont tous
dans le sens des valeurs de la nouvelle République : pacifisme, modernisme, humanité.
Le nouveau ministre de la Marine et des Colonies n’est pas un marin, mais un savant:
François Arago, professeur à l’École polytechnique et membre de l’Institut. Dès le
28 février, il fait mettre à l’étude l’amélioration de la ration des équipages ; le 12 mars,
les peines corporelles sont supprimées ; le 21 avril, les déserteurs de l’armée de Mer
sont amnistiés ; le 27 avril, l’esclavage dans les colonies est définitivement aboli.
11 Jusqu’au milieu du XIXe siècle, les peines en vigueur dans la justice maritime
constituaient un vestige médiéval, si l’on en juge par leur singularité. Ces peines étaient
définies par le « Code pénal des vaisseaux » de 1790, lequel, comme on l’a dit, reprenait
largement la réglementation d’Ancien Régime. Elles se partageaient en deux
catégories : peines disciplinaires et peines afflictives. Les peines disciplinaires étaient,
pour les équipages : le retranchement du vin pendant trois jours au plus, les fers avec
anneau ou chaîne traînant au pied, la mise à cheval sur une barre du cabestan pendant
trois jours au plus et deux heures chaque jour, l’attachement au grand mât au plus
pendant trois jours et deux heures chaque jour ; pour les officiers: les arrêts, la prison,
la suspension de fonctions. Les peines afflictives étaient : les coups de corde au
cabestan, la prison ou les fers sur le pont pendant plus de trois jours, la réduction de
grade ou de solde, la cale, la bouline, les galères (qui s’accompagnaient, sous l’Ancien
Régime, de la flétrissure au fer rouge en forme d’ancre), la mort.
12 La bouline était la plus grave des peines corporelles. Elle consistait à faire passer le
coupable torse nu entre deux rangées d’hommes chacun armé d’une garcette et chargé
de le frapper à son passage. Quant à la cale, c’était sans doute le plus spectaculaire de
ces supplices :
« On y procède, lit-on dans l’Encyclopédie Diderot et d’Alembert, en faisant passer
un cartahut dans une poulie frappée à la tête du grand mât et dans une autre au
bout de la grand vergue qui doit être haute ; ensuite avec le bout du dehors du
cartahut qui vient jusqu’à l’entrée du passavant, on amarre un cabillot, à 5 pieds du
bout, pour empêcher de le hisser plus haut; on amarre en même temps un anspect
par le milieu, sur le bout du cordage : après quoi, on fait asseoir le coupable sur cet
anspect, le cartahut entre les jambes et on l’y amarre par les cuisses avec du bitord,
en lui liant les mains au-dessus de la tête dessous le cabillot (...). Après tout cet
appareil, on tire un coup de canon, on hisse un pavillon rouge à un des mâts et le
Revue historique des armées, 252 | 2008
74
patient au bout de la vergue (...). Lorsqu’on a donné le temps à tous les équipages
des bâtiments en rade de le voir, on le laisse tomber librement et de tout son poids
à la mer pour le re-hisser tout de suite à la même hauteur et le replonger autant de
fois qu’il y est condamné. »
13 Une loi du 2 novembre 1790 était déjà venue réglementer les châtiments corporels dans
le sens d’un adoucissement. La peine du cabestan, celle du grand mât, furent abolies,
ainsi que la vieille tradition de la « liane », en vertu de laquelle « les maîtres d’équipage et
principaux maîtres portaient, pour signe de commandement, une liane dont il leur était permis
de se servir pour punir les hommes de mauvaise volonté dans l’exécution des manoeuvres » 2. Il
fut interdit de faire courir la bouline plus de quatre fois de suite et de faire frapper le
condamné par plus de trente hommes, ainsi que, pour le supplice de la cale, de plonger
le « patient » plus de trois fois de suite. En 1848, subsistaient donc les coups de corde, la
cale et la bouline. Du moins en théorie, car en vérité, tous ces traitements brutaux
avaient disparu de la pratique depuis assez longtemps. « Les plus vieux marins de nos jours
attestent que la cale, comme la plupart des autres châtiments, était presque devenue une lettre
morte, et qu’ils ont à peine vu quelque exécution de ce genre. » 3Seuls les coups de corde
continuaient encore à punir les voleurs 4. Le décret du 12 mars 1848 fut donc salué
comme un progrès, mais on ne manqua pas de souligner en même temps sa dimension
essentiellement symbolique.
14 Pourtant, les commandants de navire se sentirent soudain désarmés, privés
d’instruments dont la simple menace constituait une garantie de tenue de la discipline.
Le décret du 12 mars 1848 prévoyait une peine de substitution : l’emprisonnement au
cachot pour une durée de quatre jours à un mois. Châtiment humain, républicain, mais
qui s’avérait peu adapté aux conditions de vie à bord :
• enfermer un matelot, c’était se priver d’une main-d’œuvre essentielle à bord de bâtiments
où la composition de l’équipage était en général calculée au plus juste ;
• d’autre part, ainsi qu’on peut le lire dans une note du ministre Chasseloup-Laubat, en 1851, «
la prison est une peine d’une application difficile et quelquefois dangereuse à bord : le lieu où elle doit
être subie est et doit être dans les parties basses du bâtiment : l’habitation continue de ces lieux est
dangereuse pendant une durée qui peut s’étendre à un mois : elle serait impossible ou mortelle dans les
climats chauds »5. Et on peut imaginer sous quelles conditions pires encore se présente
l’enfermement dans les œuvres basses des nouveaux navires à vapeur, à proximité des
chaudières.
15 Un vrai tableau des peines de substitution aux châtiments corporels restait donc à
imaginer. Ce sera l’objet d’un décret du 26 mars 1852. Mais on envisage aussi de revenir
sur le décret du 12 mars 1848. Le 17 mars 1852, le conseil d’amirauté reçoit un projet
signé d’un juriste spécialiste du droit militaire, Durat-Lasalle, dans lequel l’auteur
prétend « obvier aux plus pressants besoins de la justice à bord des vaisseaux et dans les ports,
en attendant qu’il soit possible de réunir dans un même code un ensemble de dispositions
propres à régulariser complètement le service de la justice maritime » 6. Durat-Lasalle propose
donc l’abrogation pure et simple du décret du 12mars 1848 et il est appuyé par le
directeur du personnel du ministère de la Marine, Layrle, dont dépend le service de la
justice maritime. Le conseil les suit dans ses conclusions et émet le souhait de voir
conféré « implicitement au commandant, dans les cas de nécessité exceptionnelle laissés à son
appréciation, sous sa responsabilité, le droit de recourir aux châtiments corporels supprimés
en 1848 ». Mais, « tout en regrettant l’abolition des coups de corde, en usage en Angleterre, aux
États-Unis, et reconnus comme le châtiment le plus efficace et le plus prompt », l’idée est
repoussée d’abroger le décret de 1848, non par humanité, mais parce que le conseil juge
Revue historique des armées, 252 | 2008
75
que seuls les coups au cabestan constituent une peine efficace ; la bouline, à ses vues,
est « illusoire », quant à la cale, si elle est « une punition assez rigoureuse sur un vaisseau et
l’hiver, [elle] n’est la plupart du temps qu’un jeu sur les petits navires et dans les climats que
parcourent généralement nos bâtiments ». Il propose même d’introduire un nouveau
supplice : l’arrimage dans les haubans. « Cette peine, explique le conseil, est une de celles
qui, sans offrir de danger pour la santé des hommes, atteint le plus vivement les mauvais sujets.
»
16 On reste confondu devant de telles opinions qui, si elles inspirèrent effectivement le
projet de décret de 1852 (l’arrimage dans les haubans était retenu comme peine
alternative à l’escouade de punition), furent heureusement écartées dans le texte
définitif. Finalement, le décret du 26 mars 1852, établit une véritable échelle des peines
alternatives, pour compléter le décret de 1848 :
• à la place des coups de corde au cabestan : dix jours de cachot ou de double boucle, au pain
et à l’eau ;
• à la place de la cale: inaptitude à l’avancement avec retenue de solde, et vingt jours de
cachot ou de double boucle, au pain et à l’eau de deux jours l’un ;
• à la place de la bouline: l’inaptitude à l’avancement, et trente jours de cachot ou de double
boucle.
17 Remarquons enfin que, dans les années 1850, la France fait figure de nation
éminemment progressiste, puisque les châtiments corporels restent en usage partout
ailleurs, aussi bien dans la marine que dans l’armée de Terre, en Allemagne, aux États-
Unis, et bien sûr en Angleterre. « La supériorité de la discipline des Anglais (...), écrit le
commandant La Roncière Le Noury7, n’est que factice, car elle n’est obtenue qu’à la suite de
traitements souvent cruels, de flagellations réitérées qui répugnent violemment à nos habitudes
et à nos sentiments. Malgré ces modes énergiques de répression cependant, les exemples de grave
insubordination sont bien plus fréquents chez eux que chez nous. » Le « flogging » ne sera aboli
qu’en 1879, et le tristement célèbre « cat o’ nine tails » fait aujourd’hui encore partie de
la dimension épique de l’histoire de la Royal Navy, popularisée par une certaine
imagerie.
1851 : premier projet abouti de Code de justice
maritime
18 L’abolition des châtiments corporels n’est qu’une étape : l’idée de remettre à plat toute
la justice maritime revient rapidement à l’ordre du jour avec la II e République. La
commission d’enquête parlementaire, nommée en octobre 1849, pousse dans cette
direction. Mais l’instabilité ministérielle ne permet pas d’initier de vrais projets à long
terme. Le 25 février 1850, enfin, l’amiral Romain-Desfossés, qui sera le ministre de la
Marine le plus longtemps maintenu de toute la IIe République (14 mois et 3 jours)
constitue une commission d’étude, sous la présidence de l’amiral Casy (qui lui-même
avait été ministre, quelques semaines, en 1848). C’est une commission mixte, composée
d’officiers de marine, mais aussi d’un conseiller à la Cour de cassation (Isambert), du
directeur de la justice criminelle au ministère de la Justice (Rief), du chef de bureau de
la justice militaire au ministère de la Guerre (Chénier) et d’un avocat réputé près le
Conseil d’État et la Cour de cassation (Hautefeuille).
Revue historique des armées, 252 | 2008
76
19 La commission se heurte rapidement à de considérables difficultés, tenant
essentiellement à réunir toutes les pièces des travaux des commissions antérieures, et à
cristalliser toutes les considérations sur la justice maritime que j’ai évoquées jusqu’ici :
• Faut-il revenir sur le décret de 1848 abolissant les châtiments corporels ? La commission
imagine une échelle très détaillée des peines de substitution, divisées en peines
disciplinaires d’une part et peines correctionnelles et criminelles d’autre part. Les peines
disciplinaires sont, à bord : le retranchement de vin, le piquet, l’escouade de punition, la
consigne, la suppression du supplément de solde, la retenue de solde, la prison ; à terre : le
piquet, l’escouade de punition, la consigne, la retenue de solde, la salle de police, la prison, le
cachot. Les peines correctionnelles sont : l’inaptitude à l’avancement, la retenue de solde, la
réduction de grade ou de classe, l’amende, la privation de commandement, la prison, les
travaux publics, la suspension de fonctions, la destitution, le boulet ; enfin, les peines
criminelles: la réclusion, la détention, les travaux forcés, la mort. Cette partie du projet
inspirera directement le décret du 26 mars 1852.
• Faut-il abolir l’ancienne distinction entre justice des hommes et justice du matériel ? La
commission fait ici preuve d’innovation : « Un principe introduit pour la première fois dans la
législation maritime a dominé tout le travail, le principe de l’unité de juridiction. Le projet range tous
les individus au service de la marine sous une juridiction unique, à quelque corps, à quelque classe
qu’ils appartiennent. Il les soumet tous au régime de la même loi pénale. La juridiction comprend deux
tribunaux: l’un qui juge les délits les moins graves – le conseil de justice; l’autre qui juge les délits
graves et les crimes – le conseil de guerre. » 8 Les tribunaux maritimes, descendant du tribunal de
l’intendant, sont supprimés ; l’ensemble de la justice maritime se fondera désormais sur un
principe de compétence ratione personae.
20 La commission Casy achève ses travaux le 11 février 1851. Elle propose un « Code de
justice pour l’armée navale » divisé en deux livres : le premier, De la police et de la justice
; le second, Des peines, des délits et des crimes. Un troisième livre sera ajouté, mais on peut
y voir une simple annexe, dans la mesure où il ne contient que des « dispositions spéciales
applicables aux condamnés aux fers et aux travaux forcés détenus dans les établissements de la
marine ». Le 11 mars 1851, la commission adopte son rapport définitif. Le 1 er avril, elle le
remet à l’amiral Vaillant, successeur de Romain-Desfossés, qui, entretemps, a quitté le
ministère. Vaillant donne son autorisation pour l’impression du projet, en vue d’une
diffusion restreinte (440 exemplaires seulement, alors que les publications officielles du
ministère de la Marine sont diffusées à 5 000 exemplaires). Vaillant à son tour cède la
place à Chasseloup-Laubat ; c’est donc ce dernier qui va examiner le travail de la
commission, avec, d’ailleurs, une grande attention, comme en témoigne l’exemplaire
annoté et parafé de sa main conservé aux archives9. Le projet en restera là. Personne ne
semble vraiment enthousiaste à l’idée de remanier le texte dans le sens des
propositions de Chasseloup-Laubat, à commencer par Casy, qui, devenu président du
Conseil des travaux, est désormais à d’autres activités. Le coup de grâce est donné à la
fin de l’année 1851 par Hippolyte Fortoul, devenu ministre de la Marine au sein du
gouvernement dirigé par Saint-Arnaud quelques semaines avant le coup d’État : la
diffusion du projet est interdite, et les exemplaires imprimés mis au pilon, sauf
quelques-uns qui seront archivés. Néanmoins, l’objectif de la commission est atteint : «
Quel que fût le sort réservé à son oeuvre, devait écrire Casy en mars 1851, il importait du
moins que le fruit de si longues recherches, de si difficiles études, ne fût pas, cette fois, perdu
pour l’avenir. » 10 Et en effet, le projet Casy inspirera grandement les auteurs du futur
Code de 1858.
Revue historique des armées, 252 | 2008
77
21 Le projet Casy avait le mérite de la clarté, de la simplicité, de la logique, mais il était
trop radical. Il ne faut pas voir dans les circonstances politiques les seules raisons de
son échec. La perspective de la suppression du tribunal maritime a probablement été
fort mal vue : la Marine ne tenait pas à perdre une partie importante de ses
attributions, à savoir le pouvoir judiciaire exceptionnel qu’elle exerçait, non seulement
sur les océans, mais aussi sur toutes ces parties de terre « sur laquelle la mer exerce une
influence soit de salure, soit de marée », selon la définition du domaine maritime consacrée
dans un classique Traité d’administration de la marine 11.
1858 : le Code de justice militaire pour l’armée navale
22 C’est donc le Second Empire qui achèvera la tâche et qui livrera la première codification
du droit pénal militaire, par deux lois : celle du 9 juin 1857 pour le Code de justice
militaire pour l’armée de Terre, et celle du 4 juin 1858 pour le Code de justice militaire
pour l’armée de Mer.
23 Cet aboutissement tient à un changement radical de politique de l’administration
centrale de la marine à l’égard de la justice. Tout d’abord, l’autoritarisme impérial
permet la mise en place d’un gouvernement stable. Théodore Ducos prend le
portefeuille de la Marine, du 3 décembre 1851 jusqu’à sa mort, le 17 avril 1855.
Armateur de profession, il entreprend de réviser toute l’organisation de
l’administration centrale, et, notamment, crée un bureau de la justice maritime à
l’image de ce qui existait depuis des décennies au ministère de la Guerre. Jusque-là, en
effet, alors que cette dernière administration était équipée d’un bureau de la justice
militaire dirigé par un avocat, la marine répugnait à se doter d’un tel organe, toujours
au nom de la tradition, la spécificité duale de la justice maritime étant présentée non
comme une construction historique et administrative, mais comme une caractéristique
intrinsèque : « La justice maritime doit être envisagée non pas au point de vue abstrait du
légiste, mais bien dans ses rapports avec les hommes et les choses, et (...) ainsi les bureaux où les
hommes et choses de la marine sont les mieux connus doivent concourir chacun pour leur part à
l’exercice de la justice maritime.» 12 En raison du partage entre justice ratione personae et
justice ratione materiae, l’administration de la justice maritime est donc dispersée, au
ministère, entre la direction du personnel, celle du matériel, celle des services
administratifs et celle des colonies.
24 Malheureusement, Ducos, qui décède en pleine activité, n’a pas le temps de développer
les attributions du bureau de la justice maritime, qui reste chargé d’affaires disparates,
et dont l’existence même est largement virtuelle: de1852 à1856, il n’a pas de chef, un
sous-chef proche de la retraite se contente d’expédier les affaires courantes avec deux
autres employés. En1856, le successeur de Ducos décide de reprendre sérieusement la
question de l’élaboration d’un code pénal maritime : c’est l’amiral Hamelin, dont les
compétences administratives sont bien plus limitées que celles de Ducos, et qui se
montre plus soucieux de respecter les traditions et de ménager les grands corps. Le
bureau de la justice maritime est tout simplement supprimé, et la mission de
l’élaboration du Code confiée à un commissaire de la marine de trente-huit ans, Pierre-
Félix Michelin. Ce dernier n’étant pas diplômé en droit, il s’attache alors les services
d’un obscur commis principal du ministère, Émile-Félix Pouyer. Celui-ci est un des
rares licenciés en droit du ministère de la Marine, ayant fait office de secrétaire de la
commission Casy lors des travaux sur le projet de code de 1851. De loin, c’est l’homme
Revue historique des armées, 252 | 2008
78
le plus compétent de l’administration centrale en matière de justice maritime. Mais
c’est un civil : aux yeux d’un vieux marin comme Hamelin, sa parfaite connaissance des
dossiers ne compense pas le fait qu’il n’ait jamais été confronté à la réalité quotidienne
d’un port ou d’un arsenal.
25 Michelin et Pouyer travaillent en duo, sous les ordres directs du ministre. Pas de
commission, donc, et le projet de code échappe même à l’examen du Conseil
d’amirauté. Le 24 juin 1857, quelques jours après la promulgation du Code de justice
militaire pour l’armée de Terre, Hamelin annonce dans un rapport officiel à l’Empereur
que « le travail doit être terminé prochainement ». Une commission mixte est constituée
pour examiner le projet définitif ; elle est présidée par le ministre président du Conseil
d’État, Baroche. Le Code, finalement, sera promulgué le 4 juin 1858.
26 Le Code de 1858 est bien plus conservateur que le projet de 1851, dont il s’inspire
pourtant grandement. S’il reprend par exemple la distinction entre justice à bord,
temporaire et justice à terre, permanente, inventée par le projet Casy, il renonce à
supprimer les tribunaux maritimes, non sans avoir, cependant, tergiversé : « Les marins
ont tenu surtout à respecter la tradition, tout en convenant que, si le tribunal maritime n’existait
pas, peut-être eût-on pu ne pas le créer.» 13 L’objectif n’est pas d’instaurer une unité de
juridiction, mais, tout au moins, de s’en approcher : les tribunaux spéciaux (notamment
celui chargé de juger des faits de désertion, et le tribunal du bagne) disparaissent, mais
trois juridictions continueront de coexister : le conseil de guerre, le conseil de justice, le
tribunal maritime.
Pourquoi une justice exceptionnelle pour la marine ?
27 La tradition suffit-elle à justifier le maintien des tribunaux maritimes ? La marine a
toujours été une arme très technique, très spécifique, située à la pointe des
technologies de son époque. C’était vrai déjà à l’époque de Colbert, où un trois-ponts
constituait la plus extraordinaire machine pouvant être conçue par l’homme ; ça l’est
plus encore sous le Second Empire, où les navires de guerre se dotent de machines à
vapeur, de cuirasses, de canons à gros calibre. Autant d’inventions qu’il faut protéger
aussi bien au stade des plans qu’à celui de la construction. « Un vaisseau est une ville, un
arsenal est un monde », écrit l’amiral La Roncière Le Noury 14, un monde peuplé
d’ouvriers considérés souvent comme turbulents. Après les événements de 1848, une
véritable peur de l’ouvrier saisit les autorités des arsenaux. En octobre 1850, par
exemple, sont découverts des indices qui conduisent à envisager l’existence d’un
complot mettant en cause dix-neuf personnes, dont douze ouvriers de l’arsenal de
Toulon, réputés « socialistes dangereux » ; il est alors envisagé d’utiliser les troupes de
marine pour maintenir le calme dans la ville. Le préfet maritime, qui n’est autre que
l’amiral Hamelin, écrit alors au ministre : « Notre population (...) est composée en partie de
malheureux nomades qui manquent de tout, et d’ouvriers à la journée, hommes sur lesquels les
fauteurs de révolutions exercent généralement beaucoup d’influences désastreuses pour la
société. » 15
28 La justice maritime, au-delà de tous les arguments faisant appel à la spécificité
technique, géographique voire sociologique de la marine, demeure une justice
d’exception, et à ce titre, une machine à surveiller et à punir, aux mains d’un pouvoir
autoritaire. Poser la question de son utilité, c’est poser la question de la légitimité des
justices dérogatoires au droit commun. À l’époque, c’est hors de propos, même sous la
Revue historique des armées, 252 | 2008
79
IIe République : « L’armée de mer et l’armée de terre son sœurs (...). Pour l’une comme pour
l’autre, la règle, la discipline, la fidélité au devoir sont la première condition de force et de
vitalité et c’est pourquoi l’une comme l’autre a toujours tenu à se placer sous la sauvegarde
d’une législation criminelle qui lui fût propre. » 16 L’existence de juridictions spéciales pour
les militaires et les marins peut se justifier par l’existence de deux types d’arguments :
• d’une part, que certains faits ne constituent des infractions que parce qu’ils sont commis par
des militaires ; des juges militaires sont alors les mieux placés pour examiner la portée de
tels actes ;
• d’autre part, que les militaires, quelles que soient les infractions qu’ils puissent commettre,
ne peuvent être jugés, par souci de maintenir la discipline, que par des militaires, censés
être les mieux à même de trancher avec sévérité et exemplarité.
29 Le premier argument peut être qualifié de « technique », le second de « social ». Les deux
sont facilement confondus à l’époque qui nous intéresse.
« On a souvent répété que la discipline était l’âme des armées et leur première
condition d’existence. Mais cette vérité trouve dans les armées navales une de ses
applications les plus saisissantes. La vie du marin est, en effet, toute exceptionnelle.
L’officier qui commande un vaisseau, soumis, même en dehors du temps de guerre,
à des dangers et à des préoccupations incessantes, isolé souvent au milieu de
l’immensité des mers, placé sous le coup de l’énorme responsabilité que lui impose
le salut de son équipage, la conservation d’un matériel de grand prix et quelquefois
l’accomplissement d’une mission importante ; entouré d’hommes qui se voient
éloignés de leur patrie, et que peuvent aigrir l’ennui, les privations et la contagion
d’un mauvais exemple ; ne pouvant compter sur aucune assistance du dehors, cet
officier a besoin, pour lutter contre toutes les éventualités d’une navigation
lointaine et comme condition essentielle de l’exercice du commandement, d’être
investi, dans certaines circonstances, d’un pouvoir absolu, et de disposer, dans tous
les cas, de moyens énergiques de répression. » 17
30 Pouvoir « absolu » n’est pas une expression exagérée, puisque l’article 365 du Code
de 1858, sans aucun équivalent dans le Code de justice de l’armée de Terre, stipule :
« Dans les cas de crime de lâcheté devant l’ennemi, de rébellion ou de sédition, ou de tous autres
crimes commis dans un danger pressant, le commandant d’un navire de l’État, sous sa
responsabilité, peut punir ou faire punir, sans formalité, les coupables. » Aucun homme en
France n’a, à cette époque, plus de pouvoir qu’un officier de marine commandant un
navire de l’État. Il est à noter que, de tous les projets de réforme de la justice militaire
ou maritime qui se sont succédé jusqu’en 1938, aucun n’a spécialement proposé
d’abroger l’article 365, particulièrement contradictoire avec les valeurs démocratiques
les plus fondamentales.
31 De fait, la justice maritime est extrêmement sévère. Sont ainsi punis de mort : trahison,
embauchage, espionnage, révolte, voies de fait sur un supérieur, refus d’obéissance en
présence de l’ennemi, voies de fait sur une sentinelle, abus d’autorité, désertion à
l’ennemi, pillage, destruction volontaire, perte volontaire d’un bâtiment, fait d’amener
le pavillon alors que le bâtiment est encore en état de se défendre, fait d’abandonner
volontairement un convoi ou de se séparer volontairement de son chef militaire, fait de
faillir volontairement à sa mission en temps de guerre, abandon de poste en présence
de l’ennemi. Les circonstances atténuantes n’existent pas. Les juges n’ont qu’une
alternative : l’acquittement ou la condamnation à la peine capitale par fusillade. Les
acquittements sont peu nombreux : dans les premières années d’application du Code,
entre 1859 et 1880, ils varient entre 13 % et 21 % du total des jugements prononcés, et
n’évoluent pas de façon significative. Mais une pratique existe, qui permet d’atténuer la
Revue historique des armées, 252 | 2008
80
sévérité de la loi : les juges du conseil de guerre, ainsi que le défenseur de l’accusé, le
commissaire et le rapporteur, signent conjointement une demande de grâce ou
commutation de peine. Cette pratique se développe rapidement pour devenir quasi
systématique : entre 1859 et 1871, 43 condamnations à mort sont prononcées, pas une
ne sera exécutée. Le nombre de recours en grâce, commutations ou réductions de peine
passe de 91 pour 732 condamnations prononcées en 1859 à 260 pour 303 condamnations
prononcées en 1882.
La fin des juridictions d’exception
32 L’Affaire Dreyfus éveille les consciences quant à l’utilité et à la légitimité des
juridictions d’exception. Mais les quelques réformes timides qui modifient le
fonctionnement de la justice maritime sont essentiellement motivées par des soucis
d’économie : c’est le cas ainsi de l’article 44 de la loi de finances du 17 avril 1906, qui
supprime conseils et tribunaux de révision en temps de paix, pour attribuer leur
compétence à la Cour de cassation. En 1907, s’inspirant de divers projets déposés
précédemment à la Chambre, le gouvernement propose de supprimer totalement les
conseils de guerre permanents aux armées de Terre et de Mer ainsi que les tribunaux
maritimes. « Les juridictions d’exception, est-il noté dans les motifs du projet, inévitable
attribut des régimes d’autorité, disparaissent dès que les peuples, s’éveillant à la liberté, font de
l’égalité de tous les citoyens devant la loi la règle constitutionnelle.» 18 L’argument « social »,
évoqué plus haut, par lequel on justifiait l’existence d’une justice dérogatoire au droit
commun à l’égard des militaires, a vécu. Reste l’argument « technique » :
« Il faut nous rendre à cette évidence qu’il y a une société civile, fondée sur la
liberté, et une société militaire à travers laquelle tous les citoyens passent à un
moment donné, fondée sur l’obéissance. Le juge de la liberté peut-il être le juge de
l’obéissance ? J’aurais bien voulu qu’il fût possible de réduire l’armée et la société
civile à un même droit (...). J’ai estimé que, tant que nous aurons une armée, c’est
un sacrifice auquel il faudra nous résigner que d’avoir des tribunaux spéciaux pour
juger des délits et des crimes qui sont vraiment spéciaux. » 19
33 Cet exposé de Georges Clemenceau n’a pas perdu toute sa valeur puisque, aujourd’hui
encore, un Code de justice militaire demeure (Code du 8juillet1965, modifié par les lois
du 21juillet1982 et du 10novembre1999).
34 La Première Guerre mondiale met évidemment un coup d’arrêt aux projets de réforme.
Mais après le conflit, la réforme de la justice de l’armée de Terre est remise à l’ordre du
jour avec d’autant plus de vigueur que les mutineries de1917 ont achevé de ternir
l’image des juridictions militaires : trop sévères, inadaptées, juges incompétents,
confusion des pouvoirs entre les mains des officiers. Le 9mars1928, un nouveau Code de
justice pour l’armée de Terre est proclamé et précipite la révision de la justice
maritime. Un projet pour cette dernière est déposé à la Chambre le 28février1929, mais
le nouveau Code ne sera promulgué que le 13janvier1938. Cette « sage lenteur », note
Max Gonfreville20, « s’explique beaucoup plus par une indifférence, profondément regrettable,
aux questions législatives que posait le problème de la justice maritime que par le souci d’une
discussion sérieuse de ces questions ». Le Code de 1938 met définitivement fin à la
distinction séculaire entre justice de la flotte et justice des arsenaux. Les faits de
piraterie deviennent de la compétence des tribunaux ordinaires, les tribunaux
maritimes sont supprimés, conseil de guerre et conseil de justice sont fondus en une
juridiction nouvelle appelée « tribunal maritime ». La justice maritime voit son
Revue historique des armées, 252 | 2008
81
organisation calquée sur celle de la justice militaire (le tribunal maritime est le pendant
du tribunal militaire) et de fait, ne se justifie plus en tant que justice autonome que
pour autant que la marine continue de relever d’une administration spéciale. Le
ministère de la Marine, cantonné à la seule marine militaire depuis 1931, devient un
simple sous-secrétaire d’État après 1945, et disparaît totalement en 1958 avec la
création d’un grand ministère de la Défense. De la même façon, la loi du 8 juillet 1965
refond la justice militaire pour lui donner l’aspect qu’on lui connaît aujourd’hui, celui
d’un Code unique pour les trois armées de Terre, de Mer et de l’Air.
NOTES
1. Amiral Hamelin, ministre de la Marine, « Exposé des motifs concernant le projet de Code de
justice militaire pour l'armée navale », 7 février 1858. Publié dans J.-B. Duvergier, Collection
complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’État, Imprimerie
administrative 1858.
2. Idem.
3. Idem.
4. Si l'on en croit La Roncière Le Noury, « La marine et l'enquête parlementaire », Revue des Deux
Mondes, 15 décembre 1849, p. 1073. Il ajoute ces mots, révélateurs de l’état d'esprit des marins de
l'époque : « Depuis le décret, les équipages font eux-mêmes justice des voleurs, et la discipline ne paraît
pas avoir souffert de l'abolition de cette peine, qui était déjà presque abolie en fait. »
5. SHD/DM, CC3-1473, projet de Code de justice pour l’armée navale, par la commission instituée
le 25 février 1850. Exemplaire imprimé annoté par Chasseloup-Laubat.
6. SHD/DM, BB8-882, conseil d’amirauté, séance du 20 mars 1852.
7. LA RONCIÈRE LE NOURY, « La marine et l'enquête parlementaire », Revue des Deux Mondes,
15 décembre 1849, p. 1073.
8. SHD/DM, BB 8-63, cabinet, Compte rendu à M. le ministre par la commission mixte instituée par
décision ministérielle du 25 février 1850, 1er avril 1851.
9. SHD/DM, CC3-1473, projet de Code de justice pour l’armée navale, par la commission instituée
le 25 février 1850. Exemplaire imprimé annoté par Chasseloup-Laubat
10. SHD/DM, CC3-1476, rapport de Casy au ministre, 29 mars 1851.
11. FOURNIER, NEVEU, Traité d'administration de la marine, Berger-Levrault, 1885.
12. SHD/DM, BB8-92, pièce 14. Extrait d’un dossier constitué d'un ensemble de rapports de la
direction du personnel concernant la justice maritime (1855).
13. Amiral Hamelin, ministre de la Marine, « Exposé des motifs concernant le projet de Code de
justice militaire pour l'armée navale », 7 février 1858. Publié dans J.-B. Duvergier, Collection
complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’État, Imprimerie administrative,
1858.
14. LA RONCIÈRE LE NOURY, « La marine et l'enquête parlementaire », Revue des Deux Mondes,
15 décembre 1849, p. 1073
15. SHD/DM, BB8-56, amiral Hamelin, rapport confidentiel au ministre, Toulon, 9
novembre 1850.
16. Rigaud, « Rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner le projet de loi relatif au
Code de justice militaire pour l’armée de Mer », 31 mars 1858. Publié dans la Collection complète des
Revue historique des armées, 252 | 2008
82
lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’État, par J.-N. Duvergier, Imprimerie
administrative, 1858, p. 345-383.
17. Amiral Hamelin, ministre de la Marine, « Exposé des motifs concernant le projet de Code de
justice militaire pour l'armée navale », 7 février 1858. Publié dans J.-B. Duvergier, Collection
complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’État, Imprimerie
administrative 1858.
18. Projet de loi portant suppression des conseils de guerre permanents dans les armées de Terre
et de Mer et des tribunaux maritimes et portant suppression des établissements pénitentiaires
militaires, présenté au nom de Armand Fallières, président de la République française, par Guyot-
Dessaigne, garde des sceaux, ministre de la Justice, par le général Picquart, ministre de la Guerre,
et par Thomson, ministre de la Marine. Journal officiel, Documents parlementaires, session ordinaire,
séance du 21 janvier 1877, annexe no 673, p. 63.
19. Rapport de M. Labori au nom de la commission de la réforme judiciaire, Journal officiel,
Documents parlementaires, session ordinaire, séance du 7 mai 1907, annexe n o 920 p. 336.
Déclaration de Georges Clemenceau à la commission.
20. G ONFREVILLE, Organisation et compétence des juridictions criminelles de la marine militaire,
Rousseau, 1941.
RÉSUMÉS
Si l'on retient l'œuvre de Napoléon Ier en matière législative (Code civil de 1804, Code pénal de
1810), c'est au Second Empire que l'on doit la première codification moderne de la justice
militaire, à travers deux lois, celle du 9 juin 1857 proclamant le Code de justice militaire, et celle
du 4 juin 1858 proclamant le Code de justice pour l'armée navale. Ce dernier texte va régir la
justice militaire maritime pendant quatre-vingt ans. Cet article tente de mettre en lumière
quelques éléments concernant la complexité d'une justice maritime qui ne s'est jamais vraiment
débarrassée de traditions remontant à l'Ancien Régime, en même temps qu'il se penche sur le
lent processus juridique qui mènera au Code de 1858. Enfin, il évoque la remise en cause de la
justice maritime en tant que justice d'exception, au lendemain de l'affaire Dreyfus et de la
Première Guerre mondiale.
The Code of Maritime Justice (1858-1965) – a short history of maritime justice. If we look back to the
work of Napoleon 1st in the realm of legal organisation (the Civil Code of 1804, the Penal Code of
1810), it is to the era of the Second Empire that we must turn to find the first modern codification
of military justice by means of two laws. These were the Law of 9 June 1857 that promulgated the
Code of Military Justice, and that of 4 June 1858 which promulgated the Code of Justice for the
Navy. This latter text went on to regulate maritime justice for the next eighty years. This article
attempts to highlight a few elements concerning the complexity of a code of naval justice, a code
that never really threw off traditions that dated back to the Ancien Régime, at the same time as it
lays emphasis on the slow processes that culminated in the Code of 1858. Finally, it deals with
how the whole area of naval justice was called into question as being a form of ‘exceptional
justice’, in the aftermath of the Dreyfus Affair and the First World War.
Revue historique des armées, 252 | 2008
83
INDEX
Mots-clés : justice militaire, marine
AUTEUR
JEAN-PHILIPPE ZANCO
Docteur en droit, il a publié Le ministère de la Marine sous le Second Empire, Service historique de la
Marine, 2003 (ouvrage primé par l’Académie de marine en 2005) et plusieurs articles consacrés à
l’histoire administrative et à l’histoire maritime.
Revue historique des armées, 252 | 2008
84
La coopération aéronautique
franco-italienne pendant la Grande
Guerre
Patrick Facon
1 La coopération aéronautique interalliée au cours de la Grande Guerre a été l’objet de
fort peu de travaux et l’historiographie est encore plus ramassée quand on s’intéresse à
l’industrie aéronautique, aux transferts de technologies qui s’y rapportent ou encore
aux marchés passés entre les différents pays de l’Entente. Et pourtant, la France peut se
targuer d’avoir été un des piliers de l’effort de guerre dans le domaine de l’aviation, en
livrant aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, à la Belgique, à la Russie, à la Roumanie et
à l’Italie un aéroplane sur cinq et un moteur sur quatre dont elle a assuré la fabrication.
Ici, l’histoire confine au mythe, en conférant aux autorités françaises le beau rôle, celui
d’un État qui aurait approvisionné ses partenaires de la façon la plus désintéressée,
sans penser à autre chose qu’au bien de l’alliance. La réalité est bien différente dans le
sens où non seulement Paris n’a eu de cesse que de protéger jalousement ses intérêts
politiques, stratégiques techniques et financiers, mais que ses alliés n’ont jamais été
traités sur le même pied d’égalité quand il s’est agi de leur porter assistance.
2 Le cas italien se révèle d’autant plus intéressant et singulier qu’il éclaire parfaitement
la problématique énoncée précédemment et que les gouvernements en place à Rome,
même s’ils ont fait allégeance à la Triplice, ont bénéficié dans les années précédant la
guerre d’un soutien non négligeable de la part des Français. Lorsque l’Italie se range
aux côtés de l’Entente, l’idée d’un soutien plus ou moins actif de sa principale alliée
semble certes acquise, mais existe-t-il une politique industrielle commune que les deux
partenaires auraient définie dès avant les hostilités ? Ou bien, rien n’a-t-il été décidé ou
prévu ? Quelle part la France est-elle prête à prélever sur les allocations d’aéroplanes et
de moteurs destinées à ses partenaires au profit de l’aéronautique italienne et
qu’attend cette dernière des avionneurs et des motoristes d’outre-Alpes ? Quelle
ampleur a revêtue cette collaboration et quels calculs politiques et stratégiques avoués
ou non s’y rattachent ? Tels sont quelques-uns des questionnements qui constituent les
Revue historique des armées, 252 | 2008
85
fils d’une étude dont l’élaboration n’a guère été facilitée, loin s’en faut, par la rareté des
documents et la relative pauvreté des fonds d’archives.
La part italienne dans la politique française
d’exportations aéronautiques
3 Comprendre les rapports franco-italiens dans le domaine de l’industrie aéronautique
suppose dans un premier temps d’aborder la politique appliquée par les autorités
françaises en matière d’exportations vers les pays de l’Entente. Dans les années
d’avant-guerre, explique l’historien économiste Emmanuel Chadeau, ces affaires sont
traitées « directement par les dirigeants des firmes françaises à l’occasion de contacts très
parisiens quand (elles ne sont pas négociées) par des intermédiaires spécialisés rétribués à la
commission et susceptibles de fournir des avances immédiates aux producteurs, le plus souvent
des banquiers privés en relation ancienne avec les pays concernés » 1. Ces pratiques sont fort
courantes, notamment de la part de Blériot et de Nieuport ou encore de Farman,
sociétés qui ne subissent aucun contrôle sur les ventes à l’extérieur de la part du
ministère de la Guerre. Ces mêmes constructeurs procèdent également à une assez
large distribution de leurs brevets qui leur rapportent des dividendes élevés, provenant
d’Italie par exemple, où une industrie aéronautique est en gestation. Au total, avant le
conflit, au moins un quart de la production industrielle aéronautique, tant pour les
cellules que les moteurs, prend le chemin de l’étranger, rapportant aux industriels
français des bénéfices d’autant plus conséquents que les prix pratiqués sont bien plus
élevés qu’en France même 2.
4 Lorsque surviennent les hostilités, les maisons en question s’appliquent à conserver
vaille que vaille cette belle rente de situation, tout en fournissant à l’aéronautique
militaire française de vastes quantités de matériels. Les commandes pleuvent d’autant
plus que Paris autorise les entreprises aéronautiques nationales à ravitailler les
aviations alliées, à la condition que de telles opérations puissent être l’objet d’une
vérification de principe de la part des pouvoirs publics. Les gouvernements amis de la
France sont autorisés à s’adresser aux fabricants français de leur choix, à leur passer
commande et à les rétribuer directement. Appliqué tout d’abord à la Grande-Bretagne,
la Belgique et la Russie, ce processus est étendu un peu plus tard à la Grèce et à l’Italie.
5 La situation apparaît bientôt si aberrante et contraire aux intérêts de l’État que, dans
les quelques semaines qui suivent le déclenchement du conflit, le gouvernement
Viviani décide de réagir. Entre décembre 1914 et l’été 1915, un semblant d’organisation
aéronautique interalliée s’emploie, avec plus ou moins de bonheur, à réglementer les
marchés aéronautiques afin d’éviter que, les ventes à l’extérieur étant plus rentables
pour les industriels, ces derniers ne leur donnent la priorité, au détriment de
l’aéronautique militaire française. « Sans création d’organismes particuliers, souligne
Emmanuel Chadeau, mais par le moyen des réunions du GQG, de l’état-major, commença à se
faire jour une organisation aéronautique interalliée. » 3 Dans le même temps, le ministère de
la Guerre prend à son compte les plans de production, non sans stipuler, en juin 1915,
que les ventes en dehors de la France ne dépasseront pas 15 % des avions et des
moteurs sortis des ateliers 4. Ainsi, les exportations d’équipements se retrouvent liées le
plus étroitement qui soit à la définition des besoins nationaux. Enfin, au cours du
dernier trimestre de cette même année, les commandes alliées sont subordonnées à des
autorisations préalables de la part des autorités militaires.
Revue historique des armées, 252 | 2008
86
6 En à peine une année, l’emprise de l’État sur l’activité d’un marché initialement fondé
sur des bases pour le moins libérales s’est donc fait de plus en plus sentir. Toutefois,
l’évolution vers une emprise complète des pouvoirs publics se révèle bien plus lente :
c’est seulement en 1917 que les exportations directes de matériels aéronautiques sont
totalement interdites par le ministère de la Guerre. En procédant de la sorte, Paris ne
fait que réglementer un marché à caractère éminemment stratégique ; mais il n’en
parvient pas moins par là même à convaincre ses grands alliés de l’idée selon laquelle
leurs intérêts seraient mieux défendus par les autorités officielles que par les
industriels eux-mêmes.
7 La définition d’une politique générale et la coordination des besoins exprimés par les
alliés n’en restent pas moins une pure vue de l’esprit. En avril de cette même
année 1917, un service interallié de l’aviation est bien constitué afin de réaliser une
certaine unité dans les programmes, mais aussi et surtout pour encadrer le processus
de coopération franco-américain, incluant à la fois les besoins qui concernent
l’aéronautique militaire française et ceux des aviations de l’Entente. L’existence de cet
organisme n’en reste pas moins des plus éphémères puisque sa suppression intervient
quelques mois plus tard. Le député d’Aubigny, qui a pris à cœur les problèmes
d’aviation au sein de la commission de l’armée, regrette cette dernière initiative, en
soulignant qu’elle s’identifie non seulement à une erreur grave, mais qu’elle marque
l’arrêt presque définitif de tous les efforts entrepris en ce sens 5.
8 À une Italie précipitée dans le conflit européen en mai 1915, la France est-elle en
mesure d’apporter le soutien d’une industrie qui commence à peine à s’adapter aux
nécessités et aux exigences d’un conflit de longue durée ? Pour cette seule année, les
ateliers sortent 4 489 avions et 7 086 moteurs, et la vocation exportatrice que le pays
s’est forgée avant les hostilités continue de s’affirmer avec force. Les avionneurs et les
motoristes français jouent bien « une fonction vitale » 6 à l’égard des aéronautiques
alliées, notamment celle de la Russie et de la Belgique, un peu moins celle de la Grande-
Bretagne. Cette « fonction vitale » transparaît à travers quelques chiffres éloquents, tel
celui d’une production qui dépassera, en quatre années et demie, plus de 50 000 cellules
(représentant 965 types d’appareils différents) et un peu plus de 90 000 moteurs. Aucun
doute n’est possible, l’avionnerie française est assurément parée d’un rôle dominant.
9 La part de ce total dont bénéficient les Italiens constitue à l’évidence un indicateur
précieux de la façon dont les deux pays ont envisagé et conduit leur coopération en
matière de fournitures industrielles. Une première remarque concerne l’antériorité des
rapports franco-italiens dans ce domaine. C’est en effet dès avant la Grande Guerre que
la France, qui voue un quart de sa production aéronautique à l’exportation, noue des
liens avec l’Italie. Si cette dernière se situe assez loin derrière la Grande-Bretagne et la
Russie, son aviation n’en est pas moins équipée, lorsque Rome déclare la guerre à
l’Autriche-Hongrie, d’une quinzaine d’escadrilles dont les matériels sont presque tous
français, qu’il s’agisse des Blériot, des Nieuport et des Maurice Farman (ces derniers
sont produits sous licence par des ateliers situés à Varèse et Turin).
10 Globalement parlant, quelle proportion des avions fabriqués en France tout au long de
la Grande Guerre est-elle délivrée à l’aéronautique militaire italienne de 1915 à 1918 ?
Sur les 51 700 appareils sortis d’usine du 1er août 1914 au 31 décembre 1918, quelque
9 460 (soit environ 20 %) sont pris en compte par les pays de l’Entente 7.
Revue historique des armées, 252 | 2008
87
Livraisons d’avions aux pays de l’Entente (voir annexe 1)
11 La part réservée à l’Italie représente un pourcentage très faible de la production totale,
de l’ordre de 2,5 %, et ce pays ne vient qu’en quatrième position dans l’ordre des
exportations françaises. Si l’on considère le nombre d’appareils acquis par les alliés, les
Italiens, avec 13,7 %, viennent loin derrière les États-Unis qui, en 1917-1918, se taillent
la part du lion (34,8 %). Les échanges industriels avec l’alliée transalpine comptent, à
l’évidence, pour une proportion relativement mineure.
12 La même constatation se dégage lorsqu’on aborde le domaine des moteurs, qui
constitue un autre secteur important des ventes à destination de l’Entente. Le tableau
qui suit en est une très frappante illustration. Au total, la France fournit à ses
partenaires 24 900 des 92 386 moteurs qu’elle produit de 1914 à 1918, un des chiffres les
plus considérables de tous les belligérants.
Livraisons de moteurs aux pays de l’Entente (voir annexe 2)
13 Avec 4,5 %, l’Italie en acquiert près de douze fois moins que les Britanniques et six fois
moins que les Russes. Elle vient aussi largement derrière la Grande-Bretagne, qui reçoit
presque la moitié de ce que reçoivent les alliés.
Une stratégie industrielle commune ?
14 Certes, ce sont avant tout les Britanniques, les Russes et, à partir de 1917, les
Américains qui bénéficient de la manne aéronautique française. Mais comment
expliquer une telle situation ? Les usines transalpines ont-elles produit suffisamment
d’appareils et de moteurs pour satisfaire les besoins de leur propre aviation militaire ?
Ou bien les Italiens bénéficient-ils d’une priorité moindre dans l’ordre des
préoccupations de la France ? Dans quelle mesure la collaboration avec les Italiens
apparaît-elle comme une préoccupation stratégique de première importance aux yeux
des autorités françaises ? Ou encore les besoins italiens dans le domaine de l’aviation
sont-ils inférieurs à ceux des autres alliés de l’Entente, Belgique et Roumanie exclues ?
Une stratégie industrielle commune s’est-elle nouée entre les deux alliées latines ? Des
programmes cohérents, ayant ou non une certaine ampleur, ont-ils été élaborés ou bien
la coopération s’est-elle, en fin de compte, bornée à des accords au coup par coup ?
15 La réponse à toutes ces questions implique de comparer la situation franco-italienne à
d’autres processus, notamment celui qui prend corps entre les États-Unis et la France
en 1917-1918. De tout cela, on peut déduire que jamais la coopération avec l’Italie n’a
atteint le niveau qu’elle a connue avec les Américains ou encore les Britanniques 8.
Pourtant, si aucun accord de coopération industrielle n’a été conclu avec Rome, comme
cela a été le cas avec Washington, de nombreuses et intéressantes initiatives ont été
prises par les deux partenaires, sans toutefois aboutir à des marchés vraiment
importants, même si des opérations de transferts de technologies ont été envisagées et
menées en partie à bien.
16 Dans les 15 % de ventes à l’exportation autorisées par les autorités françaises, l’Italie
semble apparemment ne pas tenir une place conséquente. La consultation des archives
montre pourtant que les demandes formulées par la mission militaire italienne à Paris
ne laissent pas d’être importantes. Comme le font les autres alliés, les Italiens
Revue historique des armées, 252 | 2008
88
procèdent en fonction d’un principe simple qui consiste à commander en France les
matériels qui leur font le plus défaut. Toutefois, parce qu’elles ne disposent elles-
mêmes pas des matériels concernés ou encore qu’elles accordent la priorité au
développement de leur propre aviation ou aux aéronautiques d’autres alliés, les
autorités françaises sont amenées à faire des choix 9.
17 La preuve en est que quelques semaines après son entrée en guerre, à l’été 1915, l’Italie
fait part de son intention d’acquérir dans les plus brefs délais une douzaine de
chasseurs Nieuport pour assurer des missions de défense aérienne sur le front qu’elle
vient d’ouvrir face à l’Autriche-Hongrie. Les demandes s’amplifient en mars 1916 où ce
pays, ayant décidé de s’engager dans un vaste un plan d’accroissement de son
aéronautique, compte bien sur la France pour l’aider à concrétiser son projet. Il s’agit
de construire une « flotte offensive » qui supposerait la livraison de 60 Nieuport
supplémentaires, d’une centaine de moteurs Le Rhône et de 400 mitrailleuses Lewis,
tout en assurant la formation d’une douzaine de pilotes à l’École Nieuport. Les autorités
italiennes sont en effet dans un grand embarras : elles n’ignorent pas que la maison
Macchi, à Varèse, demande de trois à quatre mois pour fournir les avions nécessaires,
et elles savent que les Le Rhône seront très difficiles à faire fabriquer par les motoristes
nationaux. Aussi, pour intéresser les Français à leur cas, insistent-elles sur l’urgence de
la situation et la nécessité d’aller vite, sous peine de graves conséquences militaires.
18 Après traitement par la 12e direction du ministère de la Guerre, la demande est
expédiée au Grand Quartier général (GQG), qui estime impossible de répondre de façon
positive. Joffre argue d’abord du fait qu’il reste 15 escadrilles de Nieuport à former au
sein de sa propre aviation et que les 45 Nieuport fournis mensuellement aux armées du
Nord et du Nord-Est sont à peine suffisants pour assurer le ravitaillement des unités
déployées sur le front. Révélant l’importance mineure qu’il accorde au programme de
son alliée transalpine, il conclut : « Je regrette de ne pas avoir été consulté au sujet de la
cession de Nieuport monoplaces consentie en février au gouvernement italien ; j’aurais
certainement émis un avis défavorable en raison de nos besoins et de ceux des Russes. » 10 La
déception est grande chez les Italiens qui tentent d’actionner de nombreux leviers,
dont le chef de la mission militaire française auprès du GQG, « pour obtenir que le
gouvernement français retire la défense d’exportation et donne à l’armée italienne alliée l’aide
dont elle a en ce moment si grand besoin » 11. Si, au cours du premier semestre de 1916, le
même Joffre autorise la cession de 20 cellules Nieuport pour Le Rhône de 110 ch, il
prévient qu’il n’est pas question de fournir les moteurs correspondants. À ses yeux, ce
sont en effet les besoins du front français qui prédominent et, par ailleurs, il accorde la
priorité à une commande britannique devant être honorée pendant le second semestre.
« Il doit être entendu avec les Italiens, écrit le chef du 1 er bureau du GQG, que la cession de
20 cellules Nieuport pour Rhône 110 HP ne leur confère aucun droit à une fourniture
supplémentaire de moteurs. » 12
19 Les autorités françaises, le GQG de Chantilly en particulier, fondent leur politique sur
un principe des plus simples et élémentaires : l’armement et la constitution des
escadrilles du front occidental passent avant toute autre préoccupation, quelle qu’elle
soit. Dans le même temps, les processus à travers lesquels vont être gérées les
demandes formulées par les alliés de l’Entente dans le domaine de l’aéronautique se
mettent en place. Dès les dernières semaines de 1915, la Direction de l’aéronautique
militaire ne prend plus aucune décision en matière d’exportation de matériels aériens
sans avoir pris auparavant l’avis du commandant en chef.
Revue historique des armées, 252 | 2008
89
20 À la lecture des archives, d’autres éléments d’explication n’en émergent pas moins. Ils
montrent à quel point les facteurs d’ordre stratégique et diplomatique entrent en ligne
de compte dans les choix faits par les militaires français. Se référant aux premières
commandes italiennes, Joffre précise qu’il entend renforcer avant toute chose l’aviation
russe. Les retards enregistrés dans les livraisons de Le Rhône sont même si
considérables que le GQG préconise d’orienter les exportations sur d’autres types de
moteurs, tant pour l’Italie que pour la Russie. Solution « très désirable » selon lui 13, le
commandant en chef français propose même de réduire de façon conséquente la part
italienne pour mieux servir les Russes. Enfin, Chantilly souhaiterait amener l’alliée
transalpine à développer sa propre industrie de manière à pourvoir à ses besoins,
l’instruction d’un certain nombre de pilotes italiens sur Nieuport étant accordée en
effet pour « inciter le gouvernement italien à pousser sa propre fabrication » 14.
21 Les mêmes arguments reviennent sous la plume des militaires français lorsque, en
novembre 1916, la Missione Militare in Francia approche la Direction de l’aéronautique
militaire, confiée à l’époque au colonel Régnier, pour solliciter d’importantes quantités
de matériel : acquisition du plus grand nombre possible de moteurs Hispano-Suiza de
150 ch, parce que les usines SCAT de Turin sont dans l’incapacité de les fournir avant
avril 1917 15 ; achat de Le Rhône de 110 ch, du fait que les ateliers Gnome-et-Rhône de
Turin ne pourront en produire en grandes séries avant le mois de février 1917 ; cession
de chasseurs SPAD Hispano-Suiza de 150 ch, avec leur armement (mitrailleuse Vickers).
Le GQG, toujours préoccupé par l’armement de sa propre aéronautique, limite les
exportations à une vingtaine de SPAD pour le premier semestre de 1917, non sans
susciter une grande déception à Rome 16. Il en va de même en octobre de la même année
où l’Italie souhaite s’équiper du plus grand nombre possible de cellules Nieuport
de 120 ch et de SPAD de 150 ch. La France répond qu’elle peut seulement céder 50 des
premiers et 25 des seconds (il s’agit d’appareils réparés). Le sous-secrétariat d’État à
l’aéronautique militaire et maritime, à l’initiative de son responsable, Jacques-Louis
Dumesnil, ne consent à produire un réel effort qu’après la bataille de Caporetto, en
proposant de lui vendre certains de ses matériels aéronautiques parmi les plus
modernes (50 cellules de SPAD 180 ch sans moteur, 6 SPAD à moteur 180 ch réparés,
20 SPAD à moteur 200 et 75 SPAD 200 ch sans moteur provenant du service des
fabrications de l’aviation) 17.
L’Italie, à l’écoute de la France
22 La France n’est pas seulement le principal fournisseur de ses alliés. En fonction des
circonstances et des besoins, elle ne manque pas de s’adresser à eux pour solliciter les
appareils, les moteurs ou les équipements dont elle a besoin, soit parce que sa propre
industrie n’est pas en mesure de les produire ou parce qu’elle n’entend pas détourner
de précieux moyens à cette fin. Avionneurs et motoristes italiens procèdent en
l’occurrence à de véritables transferts de technologie en direction de l’alliée latine. Ces
processus sont d’autant plus intéressants à analyser que l’Italie est le seul des pays de
l’Entente à s’être montré capable de livrer en aussi grandes quantités des moteurs à
l’aéronautique militaire française, alors que les autres États sont restés très en retrait.
23 Le 14 mai 1917, à Paris, une conférence réunissant Français et Italiens aboutit à la
définition d’un programme de cession de moteurs Fiat A-12 à la 12 e direction, qui en a
le plus urgent besoin. L’affaire est d’une très grande importance puisqu’elle est censée
Revue historique des armées, 252 | 2008
90
porter sur des centaines d’engins de la sorte dans les mois à venir 18. Elle n’en prend pas
moins rapidement une tournure difficile, et aucun des deux partenaires ne parvient à
honorer les engagements pris. Les Italiens, arguant du fait que les industriels concernés
ne sont pas à même de produire au rythme prévu, font savoir qu’ils ne pourront livrer
que 200 Fiat et qu’il leur faudra prélever une partie de la commande sur les lots
destinés à l’armée russe. De leur côté, les autorités françaises tardent à faciliter les
livraisons de matières premières venues des États-Unis en vue de permettre le
lancement du processus de fabrication.
24 L’Italie constitue aussi un recours pour une France qui, en attendant la réalisation d’un
avion de bombardement gros porteur national, s’intéresse à l’acquisition, hormis de
Handley Page britanniques, de bombardiers lourds conçus par Caproni. Le processus
s’enclenche en novembre 1916, lorsque la Direction générale de l’aéronautique
italienne demande l’expédition de l’autre côté des Alpes de moteurs Hispano-Suiza de
200 ch qui pourraient être montés sur des appareils de bombardement Caproni,
fabriqués dans les usines de Milan. « Il s’agirait, précise le capitaine Beltrano, chef de la
Sezione Aviazione, d’un essai qui améliorerait beaucoup notre avion de bombardement en
puissance et rayon d’action, et qui pourrait peut-être permettre à l’industrie aéronautique
italienne de porter unréel concours à l’aviation de notre sœur latine. » 19 On le voit bien à
travers ces quelques lignes, se développer l’idée d’un processus de transfert
technologique profitable à la fois aux Français et aux Italiens. En juin 1917, le capitaine
Pierra, chef de la mission aéronautique française à Turin, confirme le rendement
considérable du Caproni, malgré sa faible puissance motrice : « On peut imaginer
facilement l’installation d’une fabrication de Caproni en France, ajoute-t-il, mais on peut songer
à ravitailler l’escadrille actuelle avec des biplans dont la construction et le rendement paraissent
tout à fait intéressants. » 20 Le capitaine de Kérilis conclut dans des termes identiques, à
l’issue d’une étude qu’il mène sur les Caproni et les services qu’ils ont rendus au front.
25 La France s’intéresse aussi de près à la cession de Caproni à moteurs Isotta, beaucoup
plus puissants. Pierra, lors de sa mission de l’autre côté des Alpes, reçoit l’assurance
que quelques-uns de ces appareils pourraient être livrés à l’été 1917 afin de permettre
des essais opérationnels. Cette proposition prend corps au début de l’automne, lorsque
les autorités italiennes entrent en contact avec le colonel Olivari, attaché militaire
adjoint à l’ambassade de France et chef de la mission militaire française de
ravitaillement en Italie. Les Français ayant donné leur accord, des équipages sont
dépêchés sur place en novembre.
26 Toutefois, dans ce domaine encore, la déception est au rendez-vous. L’aéronautique
militaire française a prévu en effet de se doter d’un contingent de 600 avions de
bombardement pour le mois d’avril 1918, parmi lesquels 250 Breguet 14, 300 Voisin-
Renault et 50 Caproni ; mais les réalisations n’atteignent que 430 appareils en réalité 21.
Dans une lettre en date du 10 juillet 1918, la commission de l’armée signale au
ministère de la Guerre « la faillite des promesses » 22 qui ont été faites. Le Caproni suscite
de grandes désillusions chez les aviateurs et les industriels français. Alors même que
l’aviation de bombardement lourde aurait dû être prête à s’engager dans des opérations
de représailles sur les villes du Rhin dès le printemps 1918, la commission de l’armée de
la Chambre des députés remarque que « les Caproni ont échoué aux essais statiques d’une
façon lamentable. C’était prévu. Un rapport du colonel Dorand, retournant de mission en Italie,
avait signalé que les essais statiques n’avaient pas été faits par la section technique italienne et
qu’il y avait lieu de s’assurer de la solidité des avions avant de passer une commande en France.
Revue historique des armées, 252 | 2008
91
Les ministres responsables, malgré tout, donnèrent un avis favorable à la commande de ces
avions. Et on lança la fabrication. Par leur faute, des mois ont été perdus… » 23
Conclusion
27 On l’a bien vu, la coopération aéronautique franco-italienne pendant la Première
Guerre mondiale embrasse des domaines aussi étendus et variés que les ventes
d’aéroplanes et de moteurs et les transferts de technologies. Pourtant, elle n’en reste
pas moins bien plus réduite et limitée qu’elle ne l’a été avec la Grande-Bretagne, la
Russie ou encore les États-Unis. Malgré leur caractère d’urgence et leur amplitude, la
France n’a pas répondu avec le même empressement aux sollicitations de son alliée et
« sœur latine ». En 1915 et en 1916, elle accorde ostensiblement la priorité à l’armement
d’une Russie dont les défaites la préoccupent au plus haut point. En 1917-1918, hormis
l’intermède de Caporetto, la plus grande partie de l’effort s’oriente vers les États-Unis
dont Paris attend à l’évidence beaucoup, tant sur les plans financier que militaire.
28 À la lumière des processus décrits ici, on voit bien comment les autorités françaises ont
institué une véritable hiérarchisation de l’aide qu’elles ont entendu apporter à leurs
alliés en matière d’aviation, comme sans doute dans d’autres secteurs. L’importance
stratégique des fronts, telle que le GQG la discerne, constitue une des raisons
fondamentales d’une telle attitude. Les intérêts politiques et diplomatiques entrent eux
aussi pour une part conséquente dans la façon dont Paris s’emploie à gérer ses relations
militaires et industrielles avec ses partenaires de l’Entente. Contrôlées de plus en plus
étroitement par l’État, les exportations de matériels aéronautiques dépendent aussi
d’un autre facteur primordial : celui de l’équipement de l’aviation militaire nationale,
qui passe avant toute autre considération. Enfin, l’absence d’une stratégie générale
commune, intégrant des sphères aussi larges et diverses que le politique, le stratégique,
le militaire, l’industriel, l’économique et le financier, explique aussi bien des difficultés.
29 Une fois encore, comme dans le cas des Américains, l’image couramment et
complaisamment répandue dans les années qui suivent la Grande Guerre, d’une France
alliée bienveillante, à l’écoute de ses partenaires, distribuant son aide sans aucune
autre considération que celle de l’intérêt de l’alliance, sort plutôt écornée de l’analyse
des rapports aéronautiques franco-italiens. Plus que les intérêts interalliés, ce sont les
égoïsmes nationaux et le réalisme politique qui constituent la trame fondamentale de
toute cette affaire.
ANNEXES
Livraison d’avions aux pays de l’Entente
Livraisons Pourcentage des Pourcentage des livraisons aux
totales fabrications totales alliés de l’Entente
Revue historique des armées, 252 | 2008
92
États-Unis 3 300 6,3 34,8
Grande- 2 000 3,8 21,1
Bretagne
Russie 2 000 3,8 21,1
Italie 1 300 2,5 13,7
Belgique 400 0,7 4,2
Roumanie 340 0,5 3,1
Livraisons de moteurs aux pays de l’Entente
Livraisons Pourcentage des Pourcentage des livraisons aux
totales fabrications totales alliés de l’Entente
Grande- 12 000 12,9 48,1
Bretagne
Russie 5 750 6,2 23
États-Unis 4 800 5,1 19,2
Italie 1 100 1,1 4,4
Belgique 560 0,6 2,2
Roumanie 340 0,3 1,3
NOTES
1. C HADEAU (Emmanuel), « Alliances stratégiques et intérêts industriels : Les avatars de la
politique aéronautique alliée (1914-1918) », colloque international d’histoire militaire et d’études
de défense nationale « Forces armées et systèmes d’alliances », Montpellier, 3-5 septembre 1981,
actes, Paris, Fondation pour les études de défense nationale, tome II, 1983, p. 506.
2. C HADEAU (Emmanuel), « État, entreprise et développement économique : l’industrie
aéronautique, en France », thèse présentée pour le doctorat es-lettres et sciences humaines, sous
la direction du professeur Maurice Levy-Leboyer, 1985, université de Paris X-Nanterre, tome 2,
p. 361, dactyl.
3. CHADEAU (Emmanuel), « Alliances stratégiques et intérêts industriels », op.cit.
4. Ibidem, p. 361. Cela pour éviter que les prix pratiqués à l’égard de l’aéronautique militaire
nationale ne connaissent une hausse importante, dopés par les prix à l’exportation.
5. SHD/DAA, 1A061, analyse du rapport sur la situation de l’aviation par monsieur d’Aubigny,
membre de la commission de l’armée, s.d.
6. CHADEAU (Emmanuel), « Alliances stratégiques et intérêts industriels », op.cit., p. 506.
Revue historique des armées, 252 | 2008
93
7. Chambre syndicale des industries aéronautiques, « L’aéronautique pendant la Guerre
Mondiale », Paris, de Brunoff, 1919. Les exportations françaises ne se limitent pas aux seuls
avions et moteurs ; elles portent sur quantité de matériels aéronautiques, tels que les armes
(mitrailleuses d’aviation Lewis, Colt, Hotchkiss, etc.) et bien d’autres choses encore. Une note non
datée chiffre de la manière suivante les achats effectués directement aux fabricants français par
le gouvernement italien entre octobre 1914 et décembre 1917 : 59 moteurs Anzani, 35 hydravions
Schreck, 115 chasseurs Hanriot HD.1 et des pièces de rechange pour Voisin. SHD/DAA, 1A118, état
des appareils achetés par le gouvernement italien en France directement aux fabricants français
entre les dates d’octobre 1914 et le 31 décembre 1917.
8. Voir, à ce propos : V ILLATOUX (Marie-Catherine) et F ACON (Patrick), « La coopération franco-
américaine en matière d’aéronautique, 1917-1918 », Revue historique des armées, n o 246, 1/2006,
p. 33-45.
9. Du côté italien, les commandes transitent par le biais d’une mission militaire à Paris, la
Missione Militare in Francia, qui compte une section aviation chargée de traiter de tous les
problèmes liés à l’aviation auprès de la 12e direction (direction de l’aéronautique) du ministère de
la Guerre.
10. SHD/DAA,1A118, note du général commandant en chef au ministre de la Guerre, à propos de
l’aviation italienne, 21avril1916.
11. SHD/DAA,1A118, note du colonel Buffa, chef du bureau aviation, 4 septembre1915.
12. SHD/DAA,1A118, note du général commandant en chef au ministre de la Guerre, à propos du
matériel d’aviation pour l’Italie, 12juin1916.
13. SHD/DAA,1A118, note du général commandant en chef au ministre de la Guerre, à propos du
de l’aviation italienne, 21avril1916.
14. SHD/DAA,1A118, lettre du commandant en chef des armées françaises au ministre de la
Guerre, à propos de l’aviation italienne, 18mars1916.
15. SHD/DAA,1A88, demande d’informations de la Missione militare in Francia, Sezione Aviazione au
colonel Régnier, directeur de l’aéronautique, 28novembre1916.
16. SHD/DAA,1A88, note du GQG sur la cession d’avions SPAD monoplaces à moteur Hispano 150
à l’Italie, 22décembre1916.
17. SHD/DAA, 1A118, note du sous-secrétaire d’État à l’aéronautique militaire et maritime au
commandant en chef du Nord et du Nord-Est, au sujet des commandes du gouvernement italien,
18 décembre 1917. Dans le même temps, la France dépêche de l’autre côté des Alpes 100 Nieuport
à moteur 120 ch et 50 cellules de Hanriot HD.1.
18. SHD/DAA, 1A188, 50 en juin 1917, 100 en juillet, 150 en août, 175 en septembre et 200 par
mois à partir d’octobre.
19. SHD/DAA, 1A88, demande d’informations de la Missione militare in Francia, Sezione Aviazione au
colonel Régnier, directeur de l’aéronautique, 28 novembre 1916.
20. SHD/DAA, 1A88, rapport du capitaine Pierra sur sa mission en Italie du 17 au 23 juin 1917 en
Italie, s.d.
21. « Rapport sur les travaux de la commission de l’armée pendant la guerre 1914-1918
(aéronautique) », par M. d’Aubigny, Paris, 1919, Imprimerie de la Chambre des députés, p. 36.
22. Rapport sur les travaux de la commission de l’armée pendant la guerre 1914-1918, p. 88.
23. Ibidem, p. 88.
Revue historique des armées, 252 | 2008
94
RÉSUMÉS
De 1914 à 1918, la France est le principal fournisseur des pays de l’Entente en matériels
aéronautiques, qu’il s’agisse de cellules, de moteurs ou d’équipements. Parmi ceux de ses alliés
qui bénéficient de son aide figure, à partir de 1915, dès le moment où elle entre en guerre, l’Italie.
Les relations franco-italiennes dans le domaine de l’industrie aéronautique constituent une
illustration éclairante de la politique générale conduite par les autorités françaises à l’égard de
leurs différents partenaires. Elles montrent que loin de tous les considérer sur un pied d’égalité,
elles procèdent à une véritable hiérarchisation du concours qu’elles sont décidées à leur
accorder, en tenant compte de facteurs aussi divers et variés que l’importance stratégique de tel
ou tel front, les circonstances militaires de l’instant et l’intérêt politique ou diplomatique qu’elles
peuvent avoir à un moment quelconque du conflit à agir de la sorte. Par ailleurs, contrôlées de
plus en plus étroitement par l’État, les exportations d’aéroplanes et de moteurs dépendent aussi
d’un autre facteur primordial : celui de l’équipement de l’aviation militaire nationale, qui passe
avant toute autre considération. En définitive, contrairement aux pratiques instituées avec les
États-Unis, la Grande-Bretagne ou encore la Russie, dont elle attend un soutien conséquent, voire
déterminant, la France ne s’intéresse guère avec l’Italie, hormis pendant la dernière année du
conflit et dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, à la définition d’une stratégie
générale commune, intégrant des sphères aussi larges que le politique, le stratégique, le
militaire, l’industriel, l’économique et le financier.
Franco-Italian Aeronautical Cooperation during the Great War.From 1914 to 1918 France is the main
supplier for the Entente countries of aircraft equipment whether frames, motors, or equipment.
Among those allies who benefit from this aid was, after 1915, from the moment when it entered
the war, Italy. Franco-Italian relations in the aviation industry are an illuminating illustration of
the political conduct by French authorities with respect to their various partners. They show that
far from considering all on an equal footing, they proceed by ranking the cooperation they
choose to give them, taking into account factors as diverse and varied as the strategic
importance of this or that front, the circumstances of the moment, and the military, diplomatic
or political interest they may have at any time in the conflict. In addition, monitored more
closely by the state, exports of airplanes and engines also depend on another important factor:
that of equipping the nation's military aviation, which comes before any other consideration.
Ultimately, unlike the practice established with the United States, Great Britain or Russia, from
which it expects substantial, if not decisive, support, France does little with Italy, except during
the last year of conflict and in wholly exceptional circumstances, to define a common strategy
that integrates spheres as wide as political, strategic, military, industrial, economic and financial.
INDEX
Mots-clés : aviation, Italie, Première Guerre mondiale
AUTEUR
PATRICK FACON
Docteur en histoire habilité à diriger des recherches et qualifié aux fonctions de professeur des
universités, il est directeur de recherches au département de l’armée de l’Air du Service
Revue historique des armées, 252 | 2008
95
historique de la Défense. Enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l’université de
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, il est aussi conférencier au CID, à l’École de l’Air, au CESA
et membre de l’Académie nationale de l’air et de l’espace (Toulouse). Il est auteur d’une trentaine
d’ouvrages et de nombreuses études.
Revue historique des armées, 252 | 2008
96
Les artistes d’avant-garde au
combat
Évolution et redéfinition de la pratique de l’art pendant la Grande Guerre
(1914-1918)
Carl Pépin
1 Le présent article s’intéresse au monde des artistes européens dits d’« avant-garde » et
de leurs œuvres à travers la Première Guerre mondiale. Il s’agit de voir et de
comprendre comment cette guerre, premier conflit où la machine semblait dicter de
nouvelles façons de combattre, a pu affecter les manières de penser et de pratiquer l’art
selon le point de vue des avant-gardes (cubisme en France, expressionnisme en
Allemagne et vorticisme en Grande-Bretagne). Ce n’est pas uniquement dans la guerre,
mais aussi à travers la guerre que les artistes mériteraient d’être approchés. Les
anticipations et les conséquences d’un conflit aux dimensions totales sont parties
intégrantes d’une réflexion sur les manières et difficultés de représenter l’horreur. La
recherche se fonde non seulement sur une compréhension des rapports entre style et
technique, mais sur une échelle plus générale entre la conjoncture politico-militaire et
les produits de la culture formelle de cette époque.
2 Bien avant la guerre, les artistes d’avant-garde étaient conscients de leur place dans le
monde moderne. L’industrialisation et la technologie amenèrent un dynamisme qui
accréditait l’idée que le monde ancien se mourait à petit feu. Mais qu’était-ce que la
modernité selon les avant-gardes ? En fait, la question est de savoir comment on peut
comprendre le travail des avant-gardes de cette période dans une optique où le concept
de l’esthétisme d’alors était associé à toutes ces idées de la société : machine, bruit,
vitesse et dynamisme.
La guerre comme événement et expérience : le style
« 14-18 »
3 Les recherches effectuées ne nous ont pas démontré clairement une éventuelle
démarcation entre les avant-gardes d’avant 1914, celles dans la guerre et les
Revue historique des armées, 252 | 2008
97
mouvements d’après-guerre comme le surréalisme par exemple. Au niveau artistique,
cette guerre est souvent approchée comme étant un chapitre, un bref épisode qu’il faut
passer outre. Il serait intéressant de dire que la guerre de 1914-1918 offre un style
artistique propre à l’instar du cubisme, de l’expressionnisme et du vorticisme. Évitant
le concept d’école artistique, nous pensons qu’il existe un style d’avant-garde « 14-18 ».
Par exemple, le Français Amédée Ozenfant, rédacteur de la revue L’Élan, écrivait
en 1915 : « Ceux qui combattent, nos amis, nous racontent à quel point la guerre les a attachés à
leur art ; tout ce qu’ils souhaitent, c’est d’avoir quelques pages afin de l’exprimer. » 1
4 Un autre facteur pouvant introduire la guerre de 1914-1918 dans un courant artistique
propre et inimitable est que les rapports avec l’abstraction sont complètement
bouleversés. Avant le conflit, les artistes qui faisaient des recherches sur l’abstraction
pouvaient saisir les sujets et les retravailler afin de les projeter sous un autre jour.
Pendant le conflit, l’abstraction s’est révélée d’autant plus difficile à embrasser, car les
artistes ne comprenaient pas toujours ce qui se passait. L’abstraction des batailles liée
aux masses, à la mécanisation et à la « brutalisation » 2 de l’homme fut quand même
peinte dans une optique où les artistes progressaient vers l’inconnu. Par conséquent,
les compositions autour du thème de la guerre peuvent difficilement, et en ce sens c’est
quelque peu ironique, être comparées avec d’autres formes d’abstraction contenues
chez les mêmes avant-gardes d’avant et d’après-guerre. L’historien Modris Eksteins a
aussi cité des auteurs d’époque, en l’occurrence Robert Graves, Wyn Griffith et Jacques-
Émile Blanche, en traitant de leur intérêt pour la question de l’autonomie de l’art pour
en conclure, « [tous trois] (…) associent les images et les sons de la guerre à l’art, non pas un
art obéissant aux règles habituelles, mais un art dans lequel les lois de la composition seraient de
provoquer, un art devenu événement et expérience » 3.
5 Les mots « événement » et « expérience » sont ici capitaux dans la définition d’un style
distinct autour de la guerre. Les chocs et les traumatismes causés par l’exposition dans
les tranchées n’ont pas encouragé les artistes survivants à former une sorte d’école
reliée à l’expérience « 14-18 ». En fait, on essayait d’oublier et il était nécessaire de
passer à autre chose comme la recherche de nouveaux styles ou le traitement des
problèmes sociaux contemporains (inflation, chômage, etc.). Les avant-gardes
naissaient et mouraient avec l’expérience. Elles ont pour la plupart rejeté cette
expérience après y avoir goûté. Aussi traumatisante soit-elle, la guerre est aussi une
affaire personnelle qu’on ne peut facilement partager comme des idées.
Comment approcher le sujet
6 L’histoire de l’art et l’histoire militaire ne sont pas des domaines aussi paradoxaux qu’il
puisse en paraître. Nous avons abordé le sujet des artistes d’avant-garde dans la guerre
de 1914-1918 en nous posant la question suivante : pour quelles raisons ces artistes-
soldats furent-ils amenés à redéfinir et repenser, malgré des questionnements déjà
anticipés avant la guerre, la pratique de leur art dans la recherche de l’expression
picturale de ce dernier au moment de la Grande Guerre ? Nous avions d’abord
mentionné les aspects de l’événement et de l’expérience afin d’expliquer ces remises en
question de l’art des avant-gardes. Par contre, la guerre impose aussi un « système de
réflexions » que n’auraient pas connu les avant-gardes dans l’évolution de leur art si le
conflit n’avait pas eu lieu.
Revue historique des armées, 252 | 2008
98
7 Nous pensons que c’est dans un contexte où des nouvelles réalités et réactions
humaines, suscitées par la brutale mécanisation de la guerre, venant s’intégrer aux
fondements (philosophie, méthodes, sujets, etc.) de la peinture d’avant-garde que les
artistes convertis à ces mouvements durent, au moment de la Grande Guerre, repenser
et redéfinir leur art dans la recherche de l’expression picturale de la bataille. Plus
précisément, l’idée d’une prétendue « impossibilité de peindre la guerre » hantait l’esprit
des peintres. Elle édifiait en ce sens le postulat de la première guerre de l’ère de la
modernité tendant à échapper de manière picturale aux avant-gardes. Ne pouvant
comprendre pourquoi, il s’avérait ardu de peindre une sorte d’« inexprimable » liée à
l’horreur des batailles modernes, les artistes ont, pendant et après la conception des
œuvres, amorcé une réflexion que nous nommons « combat intérieur » afin de savoir
s’il était possible de peindre la réalité mouvante et souffrante des batailles.
8 Une fois les œuvres de guerre peintes, il y eut des réactions de la part des critiques et
des artistes eux-mêmes qui se questionnèrent sur les possibilités de « représenter
adéquatement » les horreurs du front de même que sur la valeur symboliquement
guerrière des toiles engendrées. Cet état d’esprit pourrait prendre le nom de « critique
de la réception de l’art ». Enfin, les critiques d’art, le public et quelques peintres en
vinrent à la conclusion que la peinture des avant-gardes traitait de la souffrance et de
l’horreur, mais sans nécessairement être faite de façon toujours naturaliste et palpable.
Peut-on en conclure alors de la force de cette expression picturale d’avant-garde?
Les artistes et les réalités du front
9 Pour peindre l’horreur, les avant-gardes devaient faire comprendre au public que la
guerre n’était pas uniquement un concept, c’était aussi une réalité qui concentrait dans
un espace restreint des spectateurs spécialement choisis pour s’entre-tuer. Autrement
dit, le célèbre adage entre l’arrière et le front, avec tous ses clivages dans les
mentalités, existait aussi chez les artistes. Le front était d’abord un objet palpable. Il
était physique et pouvait susciter l’intérêt sur une toile. Plus encore, il était un sujet de
production. Le front se découpait en plusieurs thèmes qui représentaient des
similarités, mais ayant chacun une histoire spécifique. Ces aspects d’objet et de sujet au
front firent de celui-ci une sorte d’atelier de production. En effet, la tranchée devint un
cabinet de travail possédant ses caractéristiques propres.
10 Cette perspective était relativement nouvelle pour l’époque, car elle entretenait l’idée
que l’exécution des toiles se faisait à la « source », au contact de l’horreur. La peinture
de guerre évoluait de l’aspect « bataille » (exécution en atelier d’après mémoire) vers
l’aspect « horreur » qui se trouvait davantage collé à la réalité puisque la figuration de
l’instant présent obtint la préférence chez les artistes. Cependant, il faut se garder
d’apporter des généralisations excessives étant donné que les artistes ne travaillaient
pas tous de la même manière et peignirent souvent d’après mémoire. Ce qui nous a
amené à établir ce principe de visualisation en deux temps de l’exécution des toiles (de
la bataille à l’horreur), c’est que la Grande Guerre a posé pour la première fois un climat
propice à une redéfinition de la peinture et de sa tâche informelle de représenter la
réalité.
11 Selon Richard Cork, la réalité du front pour les artistes était la suivante : « Au fur et à
mesure que la guerre avalait de plus en plus de jeunes hommes qui s’étaient témérairement
enrôlés, même les plus optimistes parmi les artistes ne pouvaient plus ignorer la réalité de la
Revue historique des armées, 252 | 2008
99
mort dans leur travail. » 4 L’idée que la mort pouvait affecter le travail des peintres, voire
en devenir l’élément central dans l’exécution, n’allait pas de soi au départ. Bon nombre
d’artistes partirent à la guerre avec l’idée que celle-ci serait courte et même
enrichissante pour leur art. Certains artistes perçurent les premiers signes d’horreur de
la bataille non pas d’une manière positive, mais surtout étonnée. Prenons par exemple
le témoignage du peintre cubiste Raymond Duchamp-Villon : « J’ai été capable d’examiner
et de suivre toutes les facettes de la guerre ; une merveille d’un génie incroyable. Parce qu’il faut
l’avouer, la grandeur du front est impressionnante et fournit à l’esprit une nouvelle
compréhension des choses. » 5 Il faut retenir de cette citation l’idée que le front était
d’abord quantitatif dans les moyens matériaux immédiats qui s’y déployaient. Avant de
parler de l’horreur et des difficultés de production reliées aux dures conditions
climatiques, les avant-gardes voyaient d’abord la guerre sous ses formes métriques et
matérielles.
Une guerre invisible mais tragique
12 « Cette guerre est la guerre de l’invisibilité (…). Elle enlève systématiquement à l’artiste
toutes les raisons d’intervenir (…) » 6, ainsi s’exprimait le critique d’art Camille
Mauclair dans la revue L’Art et les Artistes en 1918. Il poussait à l’extrême le principe
selon lequel le sujet et l’objet dans la bataille n’existaient pas. L’entreprise du
camouflage était en partie responsable de ce constat de la part du critique.
Indirectement, c’était la modernité des batailles qui était responsable de cette
invisibilité de la guerre. Toujours selon le critique, les artistes perçurent quelque chose
de la guerre comme des sentiments, des images et des odeurs, mais qu’en retinrent-ils
qui pût être communicable ?
13 En tant que « laboratoire », le front de la guerre invisible, enterrée, obligea en quelque
sorte l’artiste à exercer un repli sur lui-même. Qu’il fût conscient ou non, ce repli opéra
chez l’artiste une évolution, une redéfinition ainsi qu’une réévaluation de sa peinture
en tant que processus intellectuel amenant concrètement un produit sur la toile. Par
ailleurs, nous pensons que l’idée de « tragédie » semblait être une composante
importante dans la perception de cette guerre. Au sens premier, le mot tragédie ne
relevait pas tous les sentiments et émotions suscités par la guerre, mais simplement un
état, une prise de conscience nouvelle de la réalité au jour le jour. Il faudrait parler de
« tragédies » au pluriel afin d’inclure toutes les gammes de perceptions qu’ont pu avoir
les artistes de la catastrophe entre 1914 et 1918.
La place de l’homme dans la bataille
14 L’importance accordée au thème de l’horreur sous-entend un autre thème qui n’a pas
encore réussi à faire sa marque : à savoir celui de la place de l’homme au cœur de cette
guerre. Les soldats sont souvent visibles sur les toiles, mais c’est surtout l’horreur et la
machine qui dominent les compositions tout en dictant à l’homme sa place. En d’autres
termes, il y a peu de marge de manœuvre pour les troupes. En principe, celles-ci
devraient être des sujets, mais elles occupent le plus souvent le rôle d’éléments dans le
décor, voire d’objets. Le cubiste Fernand Léger est on ne peut plus éloquent à ce sujet :
« C’est linéaire et sec comme un problème de géométrie. Tant d’obus en tant de temps sur une
Revue historique des armées, 252 | 2008
100
telle surface, tant d’hommes par mètre et à l’heure fixe en ordre. Tout cela se déclenche
mécaniquement. C’est l’abstraction pure, plus pure que la Peinture Cubiste soi-même. » 7
15 L’importance qu’occupait le canon, cette machine de mort, dans les témoignages fit
naître chez les artistes cette idée qu’il était désormais impossible de dissocier le
désespoir et la folie de la compréhension du carnage en cours. En fait, on se rend
compte que cette guerre n’était pas mécanisée, mais qu’elle subissait un processus de
mécanisation. Au fond de lui-même, l’artiste cherchait à fuir cette idée de mécanisation
du combat, car il gardait espoir que l’homme pût reprendre sa place. Peut-on alors
parler de véritable synthèse entre l’homme et la machine si le premier est la cause de
l’existence du second ? Pourquoi les artistes témoignent-ils de l’absence d’humanité
dans une guerre faite par des machines ? L’homme est en fait la victime de sa folie
créatrice et devient par conséquent le sauf-conduit permettant l’incompréhension de la
réalité. Les artistes étaient donc les parfaits boucs émissaires de ces difficultés de
peindre la guerre, car ils ne la comprenaient pas comme ils l’auraient voulu et, en
somme, la représentation leur échappait 8.
16 En d’autres termes, la guerre ramenait un supposé « Je » conscient de l’homme vers un
« Ça » inconscient, mais acquis avec la douloureuse expérience des combats.
L’impuissance des artistes à écrire et à peindre les combats n’aurait-elle pas résidé dans
cette transformation des sens, liée et acquise avec l’expérience de la bataille ? L’artiste
devait entretenir un dialogue informel avec le spectateur. Voulait-il faire comprendre
au spectateur ce qu’il avait vu ou ce qu’il avait ressenti des combats ? Le problème
aurait peut-être été dans cette difficulté de combiner les deux approches. D’un côté, il
aurait eu l’impression de faire de la peinture de bataille classique à la Édouard Detaille.
De l’autre, l’artiste aurait peint sa guerre, ses tentatives d’exprimer son traumatisme
sans nécessairement se soucier de faire passer un message convaincant.
17 Finalement, toute cette réflexion ouvrait et fermait à la fois la boucle d’un cercle
vicieux que l’expressionniste allemand Max Beckmann nommait la « désolation éternelle
». C’est dire que l’on ne peut pas transcrire dans des mots ou des images particulières
des émotions qui le sont tout autant face au combat. La désolation éternelle consiste
par ailleurs en un certain laisser-aller dans les efforts entrepris afin de décrire ce qu’on
a vu. Le peintre d’avant-garde britannique Percy W. Lewis laissait transparaître ce
laisser-aller de la description dans son témoignage : « (…). Il n’y a pas de réelle raison, ni
de place, à faire l’éloge des soldats, sauf par la voie d’un hymne abstrait. » 9 Lewis se référait à
l’abstraction afin de cacher ce qu’il ne pouvait décrire.
Les fondements des mouvements d’avant-garde dans
la guerre : le désir de continuité
18 Comme nous l’avons mentionné, les artistes au front ont réfléchi sur le déroulement et
les effets de cette guerre. Cela ne les a pas empêchés de se questionner sur des sujets
beaucoup plus familiers reliés à leurs pratiques artistiques. La guerre de 1914-1918 n’a
pas découragé les artistes à philosopher sur leur art. Bien au contraire, le front révélait
sous un autre jour toute cette notion d’approche de l’expérimentation picturale par
rapport à une réalité donnée.
19 En fait, ce front nous est montré à travers des toiles qui semblent respecter les
fondements de base de l’avant-garde d’avant la guerre. Il est question de ces recherches
Revue historique des armées, 252 | 2008
101
poussant une logique jusqu’au bout, ces désirs de toujours aller plus loin en continuité
et en même temps en discontinuité avec le progrès technique. Autrement dit, l’intérêt
porté à la modernité ne semble pas s’être atténué dans les tranchées. La diffusion des
mouvements tels le cubisme, l’expressionnisme et le vorticisme a contribué avant la
guerre à cette « internationalisation du débat esthétique » dont parle Philippe Dagen 10. Il y
avait déjà un vaste réseau d’échanges d’idées qui du jour au lendemain s’est disloqué
pour se retrouver au front avec ce même souci d’expérimentation. Comme le souligne
Modris Eksteins : « La guerre jouait ainsi le rôle d’instigatrice du renouveau révolutionnaire
pour lequel l’avant-garde s’était battue. » 11 Eksteins fait référence à ce nouveau contexte
imposé par la guerre et l’influence de celui-ci sur les manières de peindre. Cette idée
vient quelque peu en contradiction avec celle de Christian Derouet qui soutient que la
guerre avait cassé net le développement des milieux d’avant-garde 12. Nous pensons que
les avant-gardes ont eu à faire face à une adaptation des pratiques artistiques d’avant-
guerre devant la réalité du combat. Il ne semble pas être question de cassure ou de
dislocation dans les manières de peindre par rapport aux acquis d’autrefois, ni d’une
rupture formelle des correspondances entre les artistes.
Les réactions
20 Ce que nous appelons la « critique de la réception » des toiles peintes à travers le thème
de la Grande Guerre se divise en deux catégories : les toiles jugées par leurs auteurs et
ensuite par les critiques. Avant d’être soumises aux critiques, les toiles le furent devant
leurs auteurs eux-mêmes. Nous avons évoqué tout au long de cet article les difficultés
rencontrées par les artistes afin de peindre la guerre. Or, nous pouvons penser que le
produit final n’a pas toujours satisfait son auteur. Certains artistes ont exprimé
clairement leur insatisfaction face à leurs toiles alors que d’autres ont émis un avis
contraire.
21 Le problème de satisfaction ou d’insatisfaction face aux toiles n’était pas seulement
imputable à la présence des artistes au front. Il pouvait l’être en rapport avec toutes les
injonctions imposées aux avant-gardes par les pouvoirs politiques, injonctions qui
forçaient d’une certaine manière les artistes à s’engager en faveur de l’effort de guerre
13
. En d’autres termes, cette problématique s’inscrivait dans un contexte plus général, à
savoir la dualité idéologique entre le front et l’arrière. Les avant-gardes ont jugé leurs
toiles en suivant certaines injonctions politiques. Celles-ci furent souvent émises par
des autorités loin des combats et soucieuses de préserver le moral de la nation
éprouvée. Bien souvent, les artistes ont été critiqués sévèrement parce qu’ils ne
respectaient pas à la lettre toutes ces injonctions.
22 Par ailleurs, le public avait besoin d’être rassuré en temps de crise. Il ne cherchait pas
obligatoirement à comprendre ni à analyser ce qui se passait et l’évolution de la
situation l’intéressait dans la mesure où les faits, même teintés d’éventuels mensonges
et de propagande, étaient clairement expliqués. Chaque individu sait que la guerre
apporte son lot de deuils et de malheurs. Collectivement, il est bon de se donner une
image de confiance et cela passe notamment par des moyens d’expression
traditionnels. Cela pourrait en partie expliquer pourquoi les avant-gardes ont
généralement travaillé chacun pour eux sans nécessairement penser à l’impact que
pouvaient avoir leurs toiles sur l’ensemble de la collectivité. Le public ne se contentait
pas que d’un exemple unique, car il avait besoin de se rattacher à des normes. C’est Jean
Revue historique des armées, 252 | 2008
102
Starobinski qui s’exprimait ainsi : « (…) la figure du destinataire et de la réception de l’œuvre
est, pour une grande part, inscrite dans l’œuvre elle-même, dans son rapport avec les œuvres
antécédentes qui ont été retenues au titre d’exemples et de normes. » 14
23 Cette dernière phrase ne cache pas certaines craintes voulant que la réception de
l’œuvre s’inscrive dans une optique où les gens sont généralement familiers avec les
conventions et qu’un vent nouveau puisse donner parfois une presse négative à tout
artiste qui produit quelque chose de choquant. Dans la guerre, le phénomène se trouve
amplifié, car la société, à qui l’on demande de se serrer les coudes le temps que la crise
dure, est plus sensible à toutes les remises en question sur l’impression des horreurs et
douleurs de la guerre, associées à long terme à l’élément de défaitisme. Il règne cette
méfiance envers les artistes, notamment ceux de l’avant-garde. On ne sent pas qu’eux
aussi puissent prendre part au combat mené par leur nation contre l’ennemi. Dans un
commentaire sur Fernand Léger, Christian Derouet mentionne ce phénomène
d’isolement des artistes parmi la troupe. Pour ce faire, il cite l’écrivain et ancien
combattant français Roland Dorgelès qui s’y était intéressé dans un extrait de son
roman Le Cabaret de la belle femme en 1928 : « Cette façon sévère de juger les artistes n’était
d’ailleurs pas personnelle à notre capitaine et tous ceux qui ont eu l’avantage de faire campagne
en qualité de soldat de 2e classe ont pu observer que, dans l’armée, les artistes n’étaient
généralement pas tenus en grande estime… »15
Conclusion
24 Bien qu’ayant brossé un tableau fidèle de nos démarches méthodologiques dans
l’identification des problèmes reliés à l’art des avant-gardes en 1914-1918, nous avons
volontairement omis d’y inclure des analyses de tableaux. Nous laissons au lecteur le
soin de se forger ses propres interprétations à partir de cette sorte de « Petit guide
d’orientation en histoire de l’art de la guerre de 1914-1918 ». Il relie à la fois les
considérations historiques, politico-militaires et esthétiques dans l’étude de la
production artistique d’avant-garde de ce conflit. Enfin, nous présentons au lecteur une
série de compositions faites par des artistes que nous jugeons représentatifs des
mouvances d’avant-garde de cette guerre. Artistes qui, à l’instar de l’ensemble des
soldats du front, ont traduit du mieux qu’ils le purent leurs traumatismes des
tranchées.
NOTES
1. C ORK (Richard), A Bitter Truth. Avant-Garde Art and the Great War, New Haven & Londres, Yale
University Press, 1994, p. 13. Traduction auteur.
2. Concept élaboré par l’historien américain George L. Mosse. M OSSE (George L.), De la Grande
Guerre au totalitarisme. La brutalisation des sociétés européennes, Paris, Hachettes Littératures, 1999
(1990, 1re éd.). 291 pages.
3. E KSTEINS (Modris), Le sacre du printemps. La Grande Guerre et la naissance de la modernité, Paris,
Plon, 1991, p. 106.
Revue historique des armées, 252 | 2008
103
4. CORK (Richard), op.cit., p. 91. Traduction auteur.
5. Ibid., p. 147. Traduction auteur.
6. D AGEN (Philippe), Le silence des peintres. Les artistes face à la Grande Guerre, Paris, Fayard, 1996,
p. 104.
7. Lettre écrite le 30 mai 1915 au cours de l’offensive française en Artois et citée dans Fernand
Léger, Fernand Léger. Une correspondance de guerre à Louis Poughon, 1914-1918, Paris, Les Cahiers du
Musée national d’Art moderne (hors-série), 1990, p. 36.
8. DAGEN (Philippe), op.cit., p. 138.
9. CORK (Richard), op.cit., p. 76. Traduction auteur.
10. DAGEN (Philippe), op.cit., p. 27.
11. EKSTEINS (Modris), op.cit., p. 246.
12. LÉGER (Fernand), op.cit., p. 3.
13. Nous pouvons citer par exemple l’autocensure, la lutte au défaitisme et l’abandon de
l'abstraction. Voir à ce sujet Christophe Prochasson et Anne Rasmussen, Au nom de la patrie. Les
intellectuels et la Première Guerre mondiale (1910-1919), Paris, Éditions La Découverte, 1996, p. 185.
14. JAUSS (Hans-Robert), Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, 1978, p. 13.
15. LÉGER (Fernand), Fernand Léger. op.cit., p. 3.
RÉSUMÉS
Cet article propose un regard sur le monde des artistes européens dits d’« avant-garde » et de
leurs œuvres à travers la Grande Guerre. Il s’agit de voir et de comprendre comment cette guerre
a pu affecter les manières de penser et de pratiquer l’art selon les vues des avant-gardes. Ce n’est
pas uniquement dans la guerre, mais aussi à travers la guerre que les artistes mériteraient d’être
approchés. Les anticipations et les conséquences d’un conflit à dimensions totalitaires sont
parties intégrantes d’une réflexion sur les manières et difficultés de représenter l’horreur. Cet
article se fond non seulement sur une compréhension des rapports entre style et technique, mais
sur une échelle plus générale entre la conjoncture politico-militaire et les produits de la culture
formelle de cette époque.
Avant-garde artists in battle: The evolution and redefinition of the practice of art during the First World
War (1914-18).This article looks at the world of the so-called ‘avant-garde’ European artists and
their work during the Great War, with a view to seeing and comprehending how the war affected
ways of thinking and practicing art, in the views of the artistic avant-garde. It is not just within
the war but through the war that these artists are worth approaching. The expectations and
consequences of a conflict on a total scale are integral parts of a reflection on the ways and the
difficulties of representing the horror. The article rests not only on an understanding of the
relationships between style and artistic technique but, on a more general scale, on grasping the
relationships between the era’s politico-military conjuncture and its formal cultural production.
INDEX
Mots-clés : art, Première Guerre mondiale, représentations
Revue historique des armées, 252 | 2008
104
AUTEUR
CARL PÉPIN
Né dans la province de Québec (Canada) en 1977, il est doctorant en histoire à l’université de
Laval (province de Québec). Ses recherches, menées sous la direction du professeur Talbot Imlay,
portent sur les relations entre la France et le Québec au cours de la guerre de 1914-1918.
Revue historique des armées, 252 | 2008
105
Le personnel de l’aérostation
maritime française (1917-1919)
L’exemple des patrouilles de Bretagne et de la Loire
Thierry Leroy
Introduction
1 La marine française a mené des expériences d’aérostation depuis les années 1880 à
Toulon, mais ce service a été supprimé en 1904, et au moment où la Grande Guerre a
éclaté, rien n’était plus en place. Ce n’est donc que du 1er mai 1916 que date la décision
d’organiser véritablement une aérostation maritime. Il s’agissait d’un programme
relativement ambitieux, s’inspirant du modèle britannique, qui prévoyait la
construction de douze centres d’aérostation et la commande de trente ballons 1.
2 Les premiers CAM (Centres d’aérostation maritime) ont vu le jour à Boulogne-Marquise
(cédé par les Anglais avec les ballons qui l’équipaient), au Havre-Sainte-Adresse et à
Bizerte-Sidi Ahmed. D’autres devaient suivre à Rochefort, Aubagne, Cherbourg-
Montebourg, Brest-Guipavas, Alger, etc. L’armée, qui n’utilisait plus de ballons à la suite
des mésaventures de l’été 1914, en céda alors plusieurs à la marine. Quant aux hommes,
le génie fournit bien un certain nombre de spécialistes, dans le but d’encadrer les
marins, mais en 1917, la guerre sous-marine poussa la marine à élargir encore le
nombre de ses bases sur le littoral, à un moment où l’armée se retrouvait justement
dans un contexte général de pénurie de personnel.
Sélection et progression du personnel
3 Au début, devant la nécessité d’aller vite, les hommes furent choisis parmi des
spécialistes du service général de la marine et une période transitoire fut admise par le
ministère, durant laquelle les établissements pourraient effectuer eux-mêmes
l’entraînement des personnels. Les commandants de CAM furent même appelés, au
printemps 1917, à décerner les certificats aux hommes remplissant effectivement ces
emplois. Les résultats étaient ensuite transmis aux centres-écoles qui tenaient un état
Revue historique des armées, 252 | 2008
106
général (circulaire du 1er avril 1917) et les marins recevaient alors des points
d’avancement en proportion de la note obtenue.
4 Le personnel spécialisé (volant et d’ateliers) était régi par une circulaire ministérielle
du 19 juin 1917, mais le personnel volant a fait ensuite l’objet d’une nouvelle circulaire
le 18 février 1918. En 1917, des critères physiques de sélection venaient d’être posés par
les médecins militaires pour le recrutement des aviateurs. Ils furent donc également
acceptés pour l’aéronautique maritime, mais ils n’avaient encore rien à voir avec ceux
exigés aujourd’hui. L’acuité visuelle devait être « normale » (cette notion étant laissée à
l’appréciation des médecins) pour un œil et au moins égale à 3/5 e pour l’autre. Le port
de lunettes était néanmoins interdit. Le champ binoculaire faisait également l’objet de
tests, ainsi que la capacité à distinguer les couleurs. De même, l’ouïe devait être
« normale », ainsi que la respiration, le cœur, la résistance aux chocs sensoriels.
5 En 1916, les spécialistes des ballons dirigeables étaient tous formés à Saint-Cyr, sur la
base du génie. Mais en 1917, l’armée régularisa la situation en acceptant de faire passer
celle-ci sous l’autorité de la marine, et le 26 novembre, le ministre de la Marine créa
officiellement le Centre d’aérostation maritime de Saint-Cyr pour accueillir la CEPD
(Commission d’études pratiques des dirigeables 2) qui devait former les officiers pilotes
de dirigeables, les pilotes de direction, les mécaniciens de bord, les mitrailleurs-
canonniers, ainsi qu’une partie des personnels d’ateliers (mécaniciens et tailleurs). Les
radio-TSF étaient formés à l’École d’aérostation maritime de Rochefort. Les
observateurs et les arrimeurs d’aérostation passaient quant à eux, à l’École annexe des
captifs de Brest, en même temps que ceux versés ensuite aux ballons captifs avec
lesquels ils constituaient un corps unique.
6 À partir du 2 août 1918, la formation des équipages des ballons dirigeables fut déplacée
vers l’École d’aérostation de Rochefort, sauf les observateurs qui demeurèrent à Brest 3.
Le personnel des bases d’aérostation progressa encore en nombre jusqu’à la fin de la
guerre, suivant l’agrandissement des centres et l’augmentation du nombre de ballons
affectés. Le CAM Guipavas (Brest) comptait 125 hommes en juillet 1917 et 332 en
novembre 1918 (314 marins et 18 officiers). Dans l’intervalle, le Centre était passé de
zéro à cinq ballons.
Les personnels volants d’aérostation maritime
7 Il n’y avait pas d’équipage type. L’équipage d’un ballon dirigeable était fonction du
volume de celui-ci. Les vedettes Zodiac(2 700-3 000 m³) étaient montées par un officier,
(commandant et pilote d’altitude), un mécanicien pilote de direction, un radio-TSF et
parfois un observateur. Les Astra-Torrès et Chalais-Meudon(6 000 à 8 000 m³) étaient
montés par un officier commandant, un pilote d’altitude, un pilote de direction, deux
mécaniciens faisant également fonction d’observateurs, un radio-TSF. Le Capitaine-
Caussin(9 000 m³) se démarquait avec neuf hommes : un commandant, un second
commandant, un pilote d’altitude, un pilote de direction, deux mécaniciens, un radio-
TSF, un canonnier, un timonier (pour les signaux et la surveillance). Jusqu’à sa cession à
la marine américaine en novembre 1918, l’équipage du Capitaine-Caussin était constitué
de militaires du génie (capitaine Leroy) bien qu’il fût affecté à une base de la marine
(CAM Paimbœuf).
Revue historique des armées, 252 | 2008
107
8 Ces hommes du personnel volant se distinguaient par un insigne métalliquede poitrine,
inspiré de celui des aviateurs militaires, créé par la circulaire ministérielle du
18 avril 1917 en même temps que celui de l’aviation maritime. Les pilotes de dirigeables
avaient pour insigne une « ancre d’argent sur couronne câblée, portant deux ailes dorées et
surmontées d’une roue de gouvernail ». Les insignes des équipages étaient tous identiques
et ressemblaient fort à celui du pilote, à la différence qu’ils n’avaient qu’une seule aile.
Le port de l’insigne était attaché à des conditions d’heures de vol par semestre.
9 Le pilote de ballon dirigeable (pilote d’altitude)était toujours un officier. Initiés à
l’aérostation à bord des ballons libres sphériques à Saint-Cyr (puis à Rochefort en 1918),
ces jeunes officiers apprenaient la physique des gaz, les pressions barométriques,
l’aérodynamique, la chimie de l’hydrogène, la photographie, la météorologie,
l’aérodynamique et le fonctionnement de l’engin (mécanique, toile, électricité) et son
entretien. Ils devaient avoir effectué au moins trois ascensions en ballons libres, pris
part à 25 ascensions à bord de ballons dirigeables et assuré le pilotage sous l’autorité de
l’officier commandant. En outre, ils devaient avoir aussi effectué au moins trois
atterrissages à la barre de direction et trois à la barre d’altitude. Le stage d’instruction
qui durait trois mois en 1917, passa à quatre mois en 1918 4. En cours de formation,
l’élève pilote effectuait des stages dans les CAM afin d’y apprendre la vie
opérationnelle, comme le montre les rôles d’équipage. Les pilotes d’altitude devaient à
terme accéder aux fonctions de commandant de bord.
10 On peut noter que contrairement à ce qu’on pourrait croire aujourd’hui, les volontaires
ne semblent pas avoir été très nombreux, en tout cas au début, en 1916-1917. Par
exemple, Jean du Plessis de Grénédan a écrit qu’on était venu lui « dire que par décision
du commandant en chef, [il] devai[t] être envoyé d'urgence en France pour suivre les cours de
pilote de dirigeable »,et précisait qu’il ne s’était jamais porté volontaire 5. De même, René
Ducom a rapporté 6 qu’il était enseigne de vaisseau sur un cuirassé lorsqu’on lui avait
fait part d’un appel à volontaires pour l’aérostation et qu’il s’était présenté, car «
l’occasion [lui] parut bonne pour changer de vie », malgré les mises en garde de son
commandant qui lui aurait fait comprendre combien il risquait ainsi de limiter son
avenir d’officier.
11 La fonction du pilote de direction(un quartier-maître ou un officier marinier) était de
suivre les caps donnés par le commandant. Sa formation était assez proche de celle des
officiers, mais moins poussée et plus pratique. En 1918, presque tous avaient
initialement une spécialité de manœuvrier, car à la fin du stage d’arrimeur
d’aérostation, le commandant du centre-école pouvait proposer les meilleurs d’entre
eux. Comme les pilotes d’altitude, leur formation durait trois mois en 1917 puis quatre
en 1918, y compris les deux mois d’élèves arrimeurs. Sur les petites unités (vedettes), le
pilote de direction commandait les gaz et assurait également la fonction de mécanicien.
Mais cela pouvait poser problème, car bien souvent les ennuis venaient d’un retard de
réaction. Aussi, sur les plus grandes unités, le pilote de direction disposait d’un
spécialiste.
12 Ces mécaniciens étaient choisis parmi les quartiers-maîtres et seconds maîtres de la
spécialité, plus particulièrement parmi les mécaniciens d’ateliers d’aérostation. Leur
stage, à Saint-Cyr en 1917 et à Rochefort en 1918, durait quatre mois, y compris les trois
mois de formation de mécanicien d’ateliers. En plus de leur métier à proprement
parler, ils devaient connaître la physique et la chimie. Leur rôle était évidemment
important car ils assuraient la bonne marche des moteurs, mais aussi le
Revue historique des armées, 252 | 2008
108
fonctionnement des ventilateurs assurant la tension de la peau lorsqu’on lâchait du
gaz, des dynamos, des alternateurs. Des photographies nous en montrent accroupis sur
les cordes à piano des haubanages, effectuant des réparations en vol. Comme le disait le
capitaine Leroy, commandant du Capitaine-Caussin, « avec des pilotes médiocres et de bons
mécaniciens, on se tirera toujours d’affaire ». Leur certificat leur accordait d’ailleurs un
supplément de points d’avancement plus important qu’aux autres membres de
l’équipage.
13 À bord, les autres membres d’équipages devaient surtout surveiller le large et
rechercher des sous-marins ou des mines. Ils n’agissaient que sur ordre du
commandant, sauf le radio-TSFqui devait être en écoute permanente (les messages
étaient transmis en morse). Celui-ci était recruté parmi les électriciens radio-TSF du
service général. Jusqu’en juin 1917, la fonction de canonnierou de mitrailleurfut
assurée, le cas échéant, par le mécanicien ou le radio, mais la circulaire du 19 juin 1917
créa cette fonction et ils furent alors recrutés parmi les canonniers et les fusiliers
marins. Ceux-ci suivaient un stage de deux mois complété par des séjours à l’école de
tir aérien de Cazaux.
14 L’adjudant Jacquot, ancien mécanicien du Capitaine-Caussin, a raconté 7 que faire passer
les ordres par la voix était difficile en vol, en raison du bruit des moteurs et du vent.
Aussi une bonne entente de l’équipage était-elle nécessaire. Le commandant, par un
geste ou un regard, devait pouvoir obtenir ce qu’il souhaitait. Former un équipage étant
assez délicat, souvent, en changeant de ballon, les commandants demandaient à
conserver leurs hommes auprès d’eux, ce qui leur était, semble-t-il, toujours accordé.
Cela contribuait à développer un « esprit d’équipage » affirmé. Aussi, comme l’a
rapporté encore Albert Jacquot, ils n’aimaient pas laisser « leur » ballon entre
n’importe quelles mains. Ils en assuraient l’entretien courant, et il n’était pas rare, dit-
il, après 10 ou 12 heures de vol, de voir les mécaniciens, tard dans la nuit, aidés d’un ou
deux mécaniciens de la base, remettre le ballon en état pour la mission du lendemain.
Ce n’était que lorsque le problème était plus important que des spécialistes étaient
envoyés du Service de l’aérostation militaire de Saint-Cyr ou de Chalais-Meudon. Plus
tard, après la guerre, des marins non-volants (une quinzaine) ont été affectés à
« l’équipage » des ballons, chargés de l’entretien entre les missions. Mais en 1918, ce
n’était pas encore le cas.
La mission
Le départ
15 Ces départs avaient lieu au petit matin, car les ballons ne volaient jamais de nuit, ni par
plafond bas ou lorsque le vent dépassait 7 m/s au sol. Comme le jour n’était pas
toujours levé, le champ devait être éclairé par des projecteurs. Le ballon était d’abord
sorti du hangar à bras d’hommes, puis le plein des réservoirs d’essence était fait grâce à
des bidons de 50 litres et à une pompe Japy. C’était à ce moment aussi que les
colombophiles (des militaires détachés) apportaient à l’équipage une ou deux boîtes en
osier contenant de deux à quatre pigeons voyageurs élevés au colombier du Centre et
destinés à donner l’alerte en cas d’amerrissage forcé 8. La pesée permettait ensuite de
savoir la charge offensive qu’on allait pouvoir embarquer, ainsi que sa répartition. Le
commandant ordonnait ensuite de lâcher le lest, d’abord des sacs de sable (quelques
Revue historique des armées, 252 | 2008
109
dizaines de kilos selon le volume du ballon), puis après une montée à quelques mètres,
100 litres d’eau qui arrosaient généralement les matelots les plus proches.
La patrouille ou l’escorte
16 Pour des raisons liées aux températures, les dirigeables en patrouilles ne s’élevaient
jamais à de très fortes altitudes et croisaient à peine plus haut que les hydravions avec
lesquels ils travaillaient à proximité des convois de navires (1 000 m au maximum).
Comme il avait été découvert à bord d’un U-boot échoué en Manche que les sous-marins
allemands avaient ordre de ne pas attaquer un convoi protégé par dirigeable, il fut
décidé d’assurer cette escorte chaque fois que la météo le permettrait ; mais en
Manche, Atlantique et mer du Nord, en automne et hiver, la sécurité de la navigation
était souvent confiée aux seuls hydravions.
17 Développée sur les côtes de Bretagne au cours du printemps 1917, l’aérostation
maritime a pu participer pour la première fois aux recherches à partir du 15 juillet. Ce
jour-là, le Capitaine-Caussin, basé à Paimbœuf, repéra un premier champ de mines, et le
25, trois nouveaux objets furent signalés par le même équipage. La réticence du
commandant Rondeleux, chef des patrouilleurs de la Loire, devant les fausses alertes
des équipages des avions de La Baule et de Quiberon, fut alors balayée, car les aérostats
permettaient une identification plus précise que les avions, et au moment où
s’annonçaient les premiers convois américains, il était important de ne pas détacher
inutilement de précieux dragueurs de mines. Lorsque les navires, réunis en convois
depuis le printemps 1917, franchissaient le 22e méridien ouest, ils entraient dans la
zone d’action des sous-marins. Ils commençaient alors à naviguer en virages successifs.
18 L’amirauté fixait chaque semaine quatre ou cinq nouvelles routes d’approche
surveillées vers Brest ou Saint-Nazaire, qui devaient amener les convois à des points
situés à 30 ou 40 milles de la côte. Là, les navires retrouvaient les moyens aériens et de
surface envoyés à leur rencontre pour leur permettre de rallier le port si possible avant
la nuit. Les hydravions ne s’éloignant que rarement au-delà de 20 milles (et les avions
ne quittant pas la côte, pour des raisons de sécurité), les navires étaient alors confiés
aux ballons dirigeables et aux ballons captifs. Les jours de beau temps, les dirigeables
pouvaient même se porter jusqu’à 100 voire 120 milles au large ; le record étant
probablement tenu par un ballon du CAM Guipavas qui se porta à 215 milles de son port
au secours d’un navire en danger.
19 Les rencontres avec les sous-marins furent cependant assez peu nombreuses, en raison
probablement du respect qu’intimaient les aérostats aux sous-mariniers. J’en ai relevé
trois en Bretagne en deux ans. La première est datée du 16 juillet 1917, lorsque le
Capitaine-Caussin lâcha huit bombes sur un sillage suspect, mais il fallut attendre ensuite
le 4 juillet 1918 pour que le CM-2 (enseigne de vaisseau Martinier) du CAM Guipavas pût
lâcher trois bombes au sud-ouest de Penmarch, et le 10 août 1918 pour voir le CM-4
(lieutenant de vaisseau Lidy) attaquer un adversaire de quatre bombes, encore près de
Penmarch où les sous-marins menèrent une partie de leurs attaques cette année-là.
Les tenues de vol
20 S’inspirant de l’aviation militaire, et sur proposition du CAM Dunkerque qui l’utilisait
déjà, l’amiral Lacaze, ministre de la Marine, choisit en janvier 1917 d’adopter la tenue
Revue historique des armées, 252 | 2008
110
de cuir (veste, pantalon doublé de molleton et gants), jugée meilleure que la
combinaison de toile utilisée jusque-là par les CAM de Méditerranée. Les nouveaux
brevetés recevaient leur équipement à la sortie du stage, afin d’être opérationnels dès
leur arrivée au Centre. En dessous, ils devaient porter un passe-montagne, un cache-
nez en laine, un chandail à col montant, et lorsque le froid descendait encore, ils
devaient enfiler des sous-vêtements, des gilets, des chaussettes et des gants en papier
très efficaces 9. Les équipages ayant rencontré quelques difficultés avec les chaussons
qui leur avaient été tout d’abord attribués, ils reçurent en février 1917, des bottes
fourrées du modèle utilisé par des aérostiers militaires. Une brassière de sauvetage, des
lunettes et un bonnet de vol complétaient la panoplie. Ainsi engoncés, les hommes
avaient parfois un peu de mal à gagner leur poste, surtout sur les petites unités, mais à
bord, ils n’avaient guère à bouger et les ascensions pouvaient durer de longues heures,
à la verticale des convois.
21 D’ailleurs, au retour de la mission, après le 3 décembre 1917, ces hommes avaient droit
à une boisson chaude, privilège jusque-là réservé aux équipages des patrouilleurs de
surface après les sorties par mauvais temps. D’après la même circulaire, ils recevaient
aussi un supplément de ration au repas suivant et une prime de vol en raison des
risques courus 10. Ces volants étaient par ailleurs logés, indépendamment de leur grade,
dans des baraquements qui leur étaient propres où ils disposaient de douches, d’une
tisanerie et d’une infirmerie. Ils ne côtoyaient donc que fort peu les non-volants.
Les Centres d’aviation maritime
Les bâtiments et le matériel
22 Les hangars à dirigeables étaient de grandes dimensions pour être capables d’accueillir
deux ou trois ballons chacun. À Guipavas, près de Brest, existaient en 1918, deux
hangars en bois recouverts de fibrociment sur chape de ciment. Le hangar nord
mesurait 200 m de long, 24 m de large, pour 26 m de haut. Le hangar sud était un peu
plus petit, avec 200 m de long, 20 m de large et 22 m de haut. En 1918, un troisième
hangar s’ajouta un peu plus loin sur le champ, pour la marine américaine. Les portes,
en madrier, étaient très lourdes (plusieurs tonnes) mais elles se déplaçaient sur des
rails et grâce à un treuil, deux matelots suffisaient à les manœuvrer.
23 Pour la sécurité, un extincteur, une toile et une baille à eau avaient été disposés entre
chaque ferme de charpente (soit 76 par hangar), et il y avait quatre bouches d’incendie
de chaque côté (soit 8 dans chaque hangar). Les usines à hydrogène étaient en béton car
elles se trouvaient à proximité immédiate des hangars. L’usine de Guipavas comprenait
deux salles abritant les appareils de production (système Lelarge, pour une production
journalière de 600 m³ 11), communiquant avec deux magasins pour la soude caustique et
le ferrosilicium. L’hydrogène était ensuite envoyé directement vers une nourrice de
1 300 m³) d’où une canalisation souterraine le distribuait aux hangars. Des joints d’eau
permettaient de couper à volonté la communication avec les ballons. Les déchets
silicatés étaient ensuite répandus dans des fosses cimentées puis envoyés à la mer par
camions-citernes. Pour les mêmes raisons de sécurité, les soutes à munitions étaient
installées le plus loin possible des avant-ports et de l’hydrogène (200 m au moins), dans
un abri bétonné.
Revue historique des armées, 252 | 2008
111
24 Les CAM se trouvant rarement aux environs de villes importantes, ils n’étaient pas
desservis par le réseau électrique local, mais étaient équipés de groupes électrogènes et
d’une batterie d’accumulateurs qui assurait l’éclairage des logements des officiers, de
l’usine à hydrogène et des hangars. Par contre, à la différence de la plupart des unités
de l’aviation maritime, ces centres disposaient de lignes téléphoniques directes avec
leur préfecture maritime, mais uniquement en raison de leur relative proximité des
ports, car dans un premier temps, seuls les établissements les plus proches avaient été
équipés 12.
La vie à bord
25 Les officiers étaient logés dans des baraquements de bois et de ciment recouverts
d’ardoises, comprenant des chambres individuelles, un carré, des douches, etc. Les
officiers mariniers étaient logés dans des baraquements en fibrociment (deux par
chambre pour les seconds maîtres et chambres individuelles pour les maîtres). Ils
disposaient aussi d’un poste pour les seconds maîtres et d’un autre pour les maîtres.
Mais les équipages (matelots et quartiers-maîtres) étaient logés dans des bâtiments en
fibrociment ou en bois par chambrée de 96 à 192 lits, dont l’isolation n’était pas bonne,
et souvent les matelots se plaignaient du froid en hiver, car les poêles à charbon ne
suffisaient pas toujours à enlever l’humidité des murs.
26 La discipline à bord d’un centre d’aérostation n’avait rien à voir avec celle d’un centre
d’aviation à la même époque. L’état d’esprit y était différent car beaucoup d’officiers de
l’aviation maritime (en particulier les commandants d’unité) avaient servi auparavant
dans des escadrilles de l’armée, au milieu de pilotes issus de l’aviation sportive pour
lesquels le tutoiement était de rigueur, ou venus de la cavalerie où l’individualisme
était considéré comme une qualité. Au contraire, dans l’aérostation, mise en place par
le plan Lacaze de 1916, c’était l’esprit de la flotte qui avait pris le dessus. Le
commandant de Brossard écrit d’ailleurs dans son livre 13, qu’on parle de « sortie de
dirigeable, et rarement de vol »et que « cela le classe dans la famille du bateau. Un dirigeable,
ajoute-t-il, prend l’air comme un bateau la mer. » Alors que la discipline était dans
l’aviation assez « familiale », dans l’aérostation, comme sur les navires de ligne, la
moindre faute était punie de quatre à huit jours de cellule, et on y voit des marins
accumulant les peines. Le local disciplinaire de Guipavas disposait pour cela de douze
places.
Les personnels non-volants
27 Dans les CAM, les non-volants étaient considérés comme personnel « à terre ». Aussi, à
part les spécialistes, l’affectation d’un marin ne devait pas en théorie excéder un an et
la plupart venaient du dépôt de la marine le plus proche. Les spécialistes (arrimeurs,
mécaniciens et voiliers) n’étaient donc qu’une minorité des personnels de la base et se
différenciaient des autres par un insigne de bras qui les autorisait, bien que n’étant pas
du personnel volant, à participer ponctuellement à des vols techniques. Le
commandant du CAM, les officiers, les officiers mécaniciens et les éventuels ingénieurs
portaient également cet insigne pour les mêmes raisons.
28 Les qualifications de ces marins, regroupés par analogie, définissaient bien leur
domaine de compétence et faisaient apparaître encore des différences entre l’aviation
Revue historique des armées, 252 | 2008
112
et l’aérostation. Le premier grouperassemblait les techniciens chargés de l’entretien du
matériel, le deuxième, les hommes chargés de la manœuvre au sol. Une troisième
catégorieétait celle des marins chargés du fonctionnement du centre, hors de son
emploi aéronautique ; c’étaient les personnels de cuisine, les administratifs, etc. Le
reste du personnelse composait de matelots sans spécialité et d’apprentis marins. Dans
le premier groupe (les techniciens), se trouvaient des mécaniciens d’ateliers et des
tailleurs d’ateliers d’aérostation, mais pour la plupart, ces techniciens n’avaient rien à
voir avec l’entretien des ballons proprement dit. À Guipavas, seuls cinq mécaniciens sur
vingt-cinq avaient reçu une formation de spécialiste en aéronautique. Les autres
étaient affectés à l’entretien courant, et notamment à celui du parc automobile, à celui
des pompes à eau, etc.
29 Les mécaniciens d’ateliers d’aérostationavaient suivi un stage de trois mois pendant
lesquels ils avaient appris le fonctionnement des moteurs, mais aussi l’entretien des
treuils, le réglage des soupapes des nacelles, la fabrication de l’hydrogène et l’entretien
des usines. Deux ou trois d’entre eux y étaient en effet affectés sur chaque base. La
fonction n’était d’ailleurs pas sans risque. C’est ainsi que sur neuf marins blessés
en 1917 à Paimbœuf, trois étaient affectés à l’usine à hydrogène (brûlures par soude
caustique). Sans doute en raison des risques et du peu de candidats, ces personnels
étaient logés dans le même bâtiment que les volants et bénéficiaient ainsi de leur
confort relatif.
30 Les tailleurs d’ateliers d’aérostation avaient suivi un stage de deux mois, à l’issue
duquel les meilleurs avaient été désignés pour un complément de durée variable à
l’Établissement central de Chalais-Meudon. Ils devaient connaître la coupe, la couture
et le collage des toiles caoutchoutées des ballons, mais aussi des nourrices et des
canalisations souples amenant le gaz jusqu’aux hangars. C’étaient eux aussi qui
confectionnaient les bouées permettant aux équipages des ballons de communiquer
avec les escorteurs de surface. Les tailleurs d’ateliers et les arrimeurs avaient
également pour mission de surveiller les étanchéités. Pour cela, afin de ne pas vider les
« peaux », ils disposaient de petits ballons d’une centaine de mètres cubes fixés à leur
dos par un harnais, et ainsi, ils pouvaient s’élever le long de l’enveloppe et marcher sur
le sommet des aérostats sans les détériorer. Ils étaient ensuite ramenés au sol grâce à
un fil. Le nombre total des techniciens est allé en augmentant tout au long de
l’année 1917, jusqu’à se stabiliser autour de 22 % des personnels.
31 Le deuxième grouperéunissait les hommes chargés de la manœuvre au sol. Les ballons
nécessitaient un personnel nombreux pour être déplacés, or les arrimeurs
d’aérostation(spécialistes certifiés) n’étaient guère plus de dix à vingt par CAM selon
l’importance de ceux-ci. Il ne fait donc pas de doute que les matelots sans spécialité
(plus de 50 % du personnel) étaient là pour les assister. Les arrimeurs étaient recrutés
de préférence parmi les manœuvriers et les timoniers du service général et pendant
deux mois à l’École de Brest. M. Kernéis (un ancien arrimeur que j’ai rencontré en 1986)
m’a confirmé qu’il fallait entre cinquante et cent hommes pour les manœuvres, selon le
ballon. Ils étaient regroupés de dix à vingt par tiraude sous l’autorité des brevetés
(chefs de cordée) qui obéissaient à un officier responsable de la manœuvre. De même,
les opérations de gonflage nécessitaient la participation du plus grand nombre, parfois
la presque totalité du personnel. Les marins portaient alors des sabots ou des
espadrilles (surtout pas de chaussures à clous) et ne devaient rien garder dans leurs
Revue historique des armées, 252 | 2008
113
poches (surtout pas de clefs ou de couteaux de poche) pour ne pas risquer la moindre
étincelle. Le silence était de rigueur pour entendre les ordres.
32 Dans le sol du grand avant-port de Guipavas, il y avait quatre filières parallèles à l’axe
central. Deux étaient à 25 m de l’axe et servaient au garage du ballon entre les missions.
Deux autres étaient à 15 m de l’axe et servaient à la manœuvre. Dans le petit avant-
port, deux filières étaient placées parallèlement à l’axe central, à 15 m de chaque côté
de l’axe, et pouvaient servir au garage ou à la manœuvre. Sur le champ, des maillons de
chaînes étaient ancrés au sol et formaient un triangle pour l’amarrage des ballons. Les
hommes du troisième groupe étaient chargés du fonctionnement de la base. Ils étaient
en moyenne 10 % des personnels. On comptait quatre ou cinq fourriers, quatre ou cinq
fusiliers marins, six ou sept personnels de bouche, deux colombophiles, des
téléphonistes, un infirmier, un armurier.
33 En 1919, une équipe météo composée d’un ou deux officiers mariniers et de deux ou
trois quartiers-maîtres ou matelots, a été versée dans chaque CAM (circulaire du
18 décembre 1918). Ces hommes dépendaient du service météo de l’aéronautique
maritime et se trouvaient en relation téléphonique avec les sémaphores et les stations
météorologiques des ports militaires. Il était prévu qu’ils fassent des observations à
heures fixes (1 h, 7 h, 13 h, 18 h) et transmettent leurs observations au service de la
météo maritime à Paris. Le chef de station pouvait donc décider de lâcher des ballons
sondes gonflés à l’hydrogène s’il le jugeait utile.
34 En outre, à la fin de 1918, les CAM disposèrent de quelques civils, en vertu de la loi sur
les arsenaux de la marine qui permettait de combler les manques non seulement par
des hommes (les mutilés de guerre avaient une priorité depuis une circulaire de
décembre 1915) mais aussi par des femmes, employées principalement dans des postes
administratifs (dactylographe, secrétaire-copiste, employés aux écritures). Leur
nombre restait néanmoins limité ; pas plus de deux ou trois par CAM. Ce même déficit
en personnel amena également la marine à faire appel à la fin de la guerre à des marins
grecsen assez grand nombre. Les premiers arrivèrent sur l’Atlantique en février 1918,
aussi bien dans les centres d’aérostation que dans les centres d’aviation. Ils
remplaçaient les Français, et de fait, 49 marins grecs inscrits sur le rôle de Guipavas en
novembre 1918 (des gabiers, des mécaniciens, un charpentier et une majorité de
matelots sans-spécialité) représentaient 1/6e du personnel total.
35 En 1918, le fonctionnement des centres d’aérostation maritime était plutôt comparable
à celui des ports de patrouilleurs qu’à celui des bases d’aviation. La proximité de l’air
n’y changeait rien. Le nombre important des non-spécialistes y fut évidemment pour
quelque chose, car dans les unités d’aviation maritime, théoriquement semblables, le
personnel était plus réduit et composé en majorité de techniciens brevetés, volontaires,
soucieux de conserver cette affectation. Mais, il convient de ne pas négliger non plus la
spécificité d’emploi de ces grands aérostats qui les rapprochait davantage aux yeux de
tous, des unités de surface d’où étaient d’ailleurs issus les officiers et les cadres d’une
manière générale et où la discipline était connue pour sa rudesse.
Revue historique des armées, 252 | 2008
114
BIBLIOGRAPHIE
- LEROY (Thierry), La guerre sous-marine en Bretagne (1914-1918) ; Victoire de l'aéronavale, Bannalec,
1990, 254 pages.
- VERCKEN (vice-amiral Roger), Histoire succincte de l’aéronautique navale, 1910-1988, Paris, ARDHAN,
1993, 173 pages.
Sources
- BROSSARD (capitaine de frégate de), Lâchez-tout !, Paris, France-Empire, 1956, 318 pages.
- BRUNOFF (Maurice de), L’aéronautique pendant la guerre mondiale, Ed. Maurice de Brunoff, Paris,
1919, 734 pages.
- DUCOM (René), « Les dirigeables en Manche 1914-1918 », Neptunia, n° 164/1986-4.
- GAUDIN DE VILAINE (lieutenant de vaisseau), La protection de la navigation en Manche et océans, à partir
de la DGSM, École de guerre navale, Paris, 1922, 58 pages.
- PLESSIS (J. du), La vie héroïque de Jean du Plessis, commandant du Dixmude, 1892-1923, Plon, Paris,
1924, 350 pages.
- Bulletins officiels de la marine, 1916-1918.
- La Guerre aérienne, 1917-1918.
- La Vie aérienne, 1919.
Service historique de la Défense/ département marine (Vincennes) :
- SS Ga 149, monographies des Centres de l’Océan.
- SS Ga 181, dossiers des Centres de dirigeables de Guipavas et Paimbœuf.
- SS Ga 72, personnels d’aérostation effectuant des ascensions en opération.
SHD/DM (Brest) :
Rôles d’équipages
- 4E 2259-60, Guipavas 1917.
- 4E 2618-19, Guipavas 1918.
- 4E 2261-62, Paimbœuf 1917.
- 4E 22618-19, Paimbœuf 1918.
NOTES
1. En novembre 1918, l’aérostation maritime française mettait en œuvre 12 CAM totalisant
37 unités souples. Son personnel comprenait 104 pilotes, 175 hommes d’équipages et 2657 non-
volants (vice-amiral Roger Vercken Histoire succincte de l’aéronautique navale 1910-1988, ARDHAN,
1993, p. 34).
2. La CEPD travaillait en relation avec l’Établissement d’aérostation militaire de Chalais-Meudon
et les instructeurs restaient pour la plupart des militaires.
Revue historique des armées, 252 | 2008
115
3. Leur école devenant alors une annexe du Centre de Rochefort. Les examens y étaient effectués
par une commission locale qui transmettait ensuite ses résultats (Bulletin officiel, 2 e
semestre 1918).
4. Ordre du 10 avril 1918 (Bulletin officiel, 1er semestre 1918) modifié par l’ordre du 19 août 1918,
(Bulletin officiel, 2e semestre 1918). Il y en avait donc trois dans l’année.
5. PLESSIS (J. du), La vie héroïque de Jean du Plessis commandant du Dixmude, 1892-1923, Paris, Plon,
1924, p.187-188.
6. DUCOM (René), « Les dirigeables en Manche 1914-1918 », Neptunia, n°164/1986-4.
7. La vie aérienne, 6 mars 1919.
8. L’expérience aurait prouvé que loin des côtes, ils avaient tendance à avoir des problèmes
d’orientation et ne rejoignaient pas toujours leurs cases, ce qui les obligeait à en prendre
plusieurs.
9. Bulletin officiel, 1er semestre 1917, p. 24-27. Ces équipements furent utilisés jusqu’en 1937 et la
fin de l’aérostation maritime française.
10. Les élèves pilotes, s’ils remplissaient les conditions présentées par la circulaire (12 heures de
vol dans le semestre précédent et 24 heures dans le semestre en cours), ouvraient leur droit à ce
supplément.
11. L’usine utilisait de la soude caustique ainsi que du ferrosilicium et de l’eau (2NaOH + Si + H2O
= Na2SIO3 + 2H2). Ce système était préféré à l’électrolyse en raison de la faiblesse de la production
électrique.
12. Thierry LE ROY, La guerre sous-marine en Bretagne (1914-1918) - Victoire de l'aéronavale, autoédité,
Bannalec, 1990.
13. BROSSARD (commandant de), Lâchez-tout !, Paris, France Empire, 1956.
RÉSUMÉS
La marine a mené des expériences d’aérostation à la fin du XIX e siècle mais c’est du 1 er mai 1916,
pour faire face au nouveau péril sous-marin, que date son organisation véritable. Il n’y avait pas
d’équipage type. L’équipage était fonction du volume du ballon, même si certaines spécialités
étaient obligatoires. Le pilote d’altitude était un officier. Il pouvait cumuler cette fonction avec
celle de commandant de bord. Les autres personnels étaient marins ou officiers-mariniers (pilote
de direction, mécanicien, radio-TSF, canonnier, etc.). Cette étude, menée à partir des rôles
d’équipages, a permis de dégager trois groupes : les techniciens, la manœuvre au sol, les autres
marins du CAM. Les spécialistes (brevetés d’ateliers d’aéronautique) étaient peu nombreux. Les
matelots sans-spécialité constituaient même la moitié des personnels de l’aérostation, ce qui
n’était pas le cas dans l’aviation. Le fonctionnement d’un Centre d’aérostation était différent de
celui d’un Centre d’aviation. L’origine des cadres, le nombre important de non-spécialistes
rapprochait davantage ces CAM des ports de patrouilleurs, que des unités d’aviation au personnel
composé de spécialistes.
The personnel of French maritime aerostation (1917-1919): The example of Brittany and Loire patrols.The
Navy conducted aerostation [balloon and dirigible] experiments in the late nineteenth century
but facing the new submarine threat, it began a special study on 1 May 1916. There was not one
type of crew. Although some specialties were required, the crew was based on the volume of the
balloon. The flight pilot was an officer. He could combine this function with that of the captain.
Revue historique des armées, 252 | 2008
116
The other personnel were sailors or petty officers (navigator, mechanic, radio operator, gunner,
etc.). The study focused on the duties of crew members and identified three groups: technicians,
ground control, and other sailors. Specialists (with certified aeronautical skills) were few. Crew
members without a specialty constituted about half the aerostation personnel, which was not the
case in aviation. The operation of an aerostation center was different from that of an aviation
center. The origin of the cadres, the large number of non-specialists made the aerostation
centers resemble patrols in ports more than aviation units composed of specialists.
INDEX
Mots-clés : aérostation, Première Guerre mondiale
AUTEUR
THIERRY LEROY
Docteur en histoire, enseignant dans le secondaire, chercheur associé au CERHIO (UHB Rennes 2,
UBS Lorient), il est l’auteur de La Guerre sous-marine en Bretagne 1914-1918 : victoire de l’aéronavale
(1990, « diplôme Histoire » de l’Aéroclub de France) ; Les Bretons et l’aéronautique des origines à 1939
(2002) et co-auteur de L’Aviation maritime française pendant la Grande Guerre (1999, médaille de
l’Académie de marine) ainsi que de nombreux articles sur l’histoire de l’aviation dans des revues
françaises et étrangères.
Revue historique des armées, 252 | 2008
117
Israël-États-Unis, de la
reconnaissance historique à
l’alliance stratégique
Histoire des relations stratégiques et diplomatiques, 1948-2004
Gérard Claude
Préambule
1 Israël fait figure aujourd’hui de « citadelle de l’impérialisme américain » au Moyen-Orient.
Cette image résulte de l’alliance de l’État hébreu avec les États-Unis. Pourtant, il n’en a
pas toujours été ainsi. Certes, le gouvernement américain a été le premier à
reconnaître, dès le printemps 1948, le jeune État. Mais cette reconnaissance n’obéissait
pas à des considérations stratégiques. Ce sont les contingences du contexte
international, la guerre froide, la détente, les crises au Moyen-Orient, qui expliquent
pour l’essentiel le rapprochement progressif des deux pays. Le début des années 1980
est ici déterminant dans l’inflexion de ces relations bilatérales. Mais le couple a connu
de nombreuses tensions qui n’ont pas altéré ce « mariage de raison » qui dure depuis
plus d’un demi-siècle.
De la reconnaissance de fait à l’alliance stratégique,
1948-1980
2 La reconnaissance immédiate d’Israël par les États-Unis, le 15 mai 1948, ne doit pas
faire illusion. À l’origine, l’Administration américaine ne considère pas l’État hébreu
comme un allié potentiel au Proche-Orient. Bien au contraire, il faudra attendre une
vingtaine d’années pour assister à un changement de stratégie de Washington à l’égard
du nouvel État. 1958 marquera, de ce point vue, une première étape. La décision de
reconnaître Israël est une initiative personnelle du président Harry Truman, dictée
Revue historique des armées, 252 | 2008
118
davantage par des considérations de politique intérieure que par les exigences de
l’environnement géostratégique de la région.
3 La société américaine de l’après-guerre nourrit, en effet, un profond sentiment de
sympathie à l’égard de la cause sioniste. Ce courant est d’abord alimenté par la
communauté juive américaine, anciennement implantée, bien intégrée, puissante et
nombreuse (environ 6 millions de personnes à cette époque). Dans le contexte des
élections présidentielles, elle constitue une force politique majeure et le soutien
traditionnel du Parti démocrate. Les fondamentalistes protestants, fort nombreux dans
les États du sud et du centre-ouest du pays, sont également un atout pour la cause
sioniste. Ils sont influencés par le concept biblique selon lequel la reconstruction de
l’État hébreu en Palestine est la condition du retour de Jésus sur Terre. Vision
prophétique, qui est à l’origine de leur engagement, et certainement de celle du
président Truman que l’on sait profondément croyant. À la fin des années 1940, la
communauté noire est aussi pro-israélienne. Elle l’est car elle partage avec son
homologue juive le sentiment d’être une minorité, ce qui suscite une solidarité de fait.
La communauté juive ne soutient-elle pas dès l’origine le mouvement des « Civils Rights
» ? Il est naturel que les Noirs partagent les revendications nationalistes du
mouvement sioniste. Plus largement encore, les Américains, dans leur majorité, sont
acquis à la cause israélienne par l’image qu’ils ont de ce jeune État : un pays pionnier,
une terre refuge, qui incarne les valeurs occidentales dans un environnement arabe,
hostile par nature. Un peuple courageux, tenace et laborieux. Que de points de
similitude avec l’histoire de l’Amérique et de ses premiers colons. Il n’est pas étonnant
qu’un sondage réalisé en 1948 révèle que neufs Américains sur dix approuvent
l’existence de l’État juif. Les médias et le Congrès se font les relais de ce large sentiment
de sympathie. On comprend, dans ces conditions, l’attitude du président américain.
Mais des considérations stratégiques opposées rendent compte également d’une
certaine réserve de sa politique à l’égard d’Israël. La reconnaissance de son existence ne
signifie nullement une alliance stratégique.
4 La haute administration américaine ne partage pas en effet la sympathie du président
pour la cause sioniste. Elle raisonne selon une logique différente. Pour le secrétaire
d’État John Marshall, son sous-secrétaire R. Levett, et le chef du département du
Proche-Orient Loy Henderson, toute alliance avec Israël porterait ombrage à l’influence
américaine dans la région auprès des États arabes. Le président Roosevelt est très
attentif à cet équilibre lorsqu’il affirme que rien ne sera entrepris en Palestine sans
l’accord de l’Arabie Saoudite et de la Syrie. À Washington, on craint dans ce contexte de
guerre froide naissante, où Américains et Soviétiques se disputent des zones
d’influence, que le rapprochement avec Israël ne favorise des alliances entre l’URSS et
certaines monarchies arabes, ce qui aurait un effet inverse à l’objectif de la « doctrine
Truman » de « l’endiguement ». À cet argument stratégique, Marshall en ajoute un autre,
d’essence historique, emprunté à l’exemple de l’ancienne puissance mandataire dans la
région. Si la Grande-Bretagne est parvenue à se maintenir aussi longtemps en
Méditerranée orientale, c’est grâce à ses alliances durables avec les États arabes. Au
moment où Washington s’apprête à prendre le relais de l’ancienne puissance déchue, il
convient qu’elle adopte, pour « durer », la même ligne de conduite.
5 Ces considérations expliquent le caractère très mesuré des relations entre les États-
Unis et Israël au lendemain de la guerre, et permettent de comprendre la raison pour
laquelle l’alliée stratégique et militaire de l’État hébreu dans les années qui suivent sa
Revue historique des armées, 252 | 2008
119
fondation est la France. Jusqu’à la fin des années cinquante, les Américains refusent en
effet de livrer le moindre armement à Tel-Aviv, laissant ce privilège à la France. Un
rapport, datant du 7 mai 1953, à la veille de la visite au Proche-Orient du nouveau
secrétaire d’État John Foster Dulles, donne clairement les raisons de cette « réserve »
américaine : « À moins d’affaiblir les intérêts américains dans cette région et de subordonner
les impératifs stratégiques américains à la cause sioniste, la relation privilégiée entre les États-
Unis et Israël est considérée comme détournant et affaiblissant la poursuite de la politique
étrangère des États-Unis au Proche-Orient. » On ne peut être plus clair sur les principes de
la diplomatie américaine dans la région. Le nouveau président Eisenhower entend
poursuivre et amplifier la politique « d’endiguement » de son prédécesseur, et la mettre
en application dans la région en ralliant à l’Amérique le plus grand nombre d’États
arabes possible, afin de stopper la progression soviétique. Ce sera le pacte de Bagdad
de 1955. Cela explique la réaction très vive de Washington dans les crises qui
impliquent l’État hébreu, en 1953 et 1956. Le 15 octobre 1953, Israël déclenche une
opération de représailles sur le village jordanien de Qibya, suspecté d’abriter des
feddayins palestiniens responsables de plusieurs raids meurtriers sur ses localités de la
frontière jordanienne. L’opération est vigoureusement dénoncée par les États-Unis à la
tribune de l’ONU. Trois ans plus tard, l’État hébreu décide de s’associer à l’expédition
punitive franco-anglaise contre l’Égypte de Nasser. Il s’agit de se prémunir contre une
éventuelle agression égyptienne. Guerre préventive. Une nouvelle fois Washington fait
pression sur Tel-Aviv (Londres et Paris) pour obtenir, après négociation, le retrait de
Tsahal.
6 L’année 1958, et le second mandat présidentiel de Eisenhower, marquent une première
inflexion dans la diplomatie américaine. Désormais, Israël n’est plus considéré comme
un obstacle à l’établissement d’un ordre américain au Proche-Orient, mais comme un
atout, un allié potentiel. Plusieurs événements rendent compte de ce retournement
progressif de la position américaine. Il faut d’abord considérer la « nouvelle donne »
géopolitique résultant du fiasco de l’expédition militaire franco-anglaise de Suez
en 1956. Elle marque le terme de l’influence de ces deux puissances coloniales en
Méditerranée orientale. La place est désormais vacante. Américains et Soviétiques vont
se disputer dans le cadre de la guerre froide les faveurs des États arabes. La crise
de 1956 montre également l’efficacité du potentiel militaire israélien, le seul
véritablement opérationnel dans la région. La fin des années cinquante est marquée au
Moyen-Orient par le développement d’un mouvement panarabe qui trouve en Abdel
Nasser un leader charismatique de premier plan, et dans la création de la République
arabe unie (qui associe, en un seul État, l’Égypte et la Syrie), sa manifestation la plus
concrète. Le communisme n’est donc plus l’unique menace dans la région. Israël peut
désormais faire obstacle au nationalisme arabe. Les crises qui se produisent en 1957
et 1958 vont lui en offrir l’opportunité.
7 C’est en premier lieu le resserrement de l’alliance militaire syro-soviétique. Elle suscite
la réaction militaire des États-Unis, associés à la Turquie, la Jordanie et l’Irak. Simple
manifestation de force à la frontière syrienne, qui suffit pour calmer les ardeurs du
nouveau régime de Damas. Plus grave est la crise libanaise de 1958 puisqu’elle nécessite
l’intervention militaire américaine. Elle est déterminante dans le retour de la paix
civile. La crise jordanienne de l’été 1958 marque le point d’orgue de cette série de
tensions. Le régime du roi Hussein, en proie à une coalition de nationalistes jordaniens
et de palestiniens, fait appel aux États-Unis qui interviennent avec les troupes
israéliennes pour rétablir l’ordre dans le royaume hachémite. Ces événements
Revue historique des armées, 252 | 2008
120
permettent à Washington de prendre conscience de la valeur stratégique du jeune État
dans une région exposée à des convulsions de plus en plus violentes. Il se révèle un
soutien précieux dans l’effort engagé par la Maison Blanche pour garantir la stabilité
des régimes menacés, tels le Liban et la Jordanie, et un allié dissuasif face à des pays
proches de l’Union soviétique, comme l’Égypte et la Syrie. Ainsi, l’Amérique élabore-t-
elle une nouvelle politique à l’égard d’Israël. Les bases de la coopération militaire et
stratégique entre les deux États sont posées durant le second mandat du président
Eisenhower. Elles seront concrétisées sous les présidences Kennedy et Johnson durant
les années 1960.
8 Le président Kennedy est le premier à considérer véritablement Israël comme un État
allié, intégré dans le dispositif diplomatique et stratégique mondial américain et à
livrer des armes à Tel-Aviv, les missiles Hawk. L’objectif est d’assurer l’équilibre
militaire de la région et de lutter contre l’idéologie communiste de Moscou et le
nationalisme arabe du Caire et de Damas. Le but est également énergétique, en
garantissant à l’économie occidentale le libre accès aux gisements pétroliers du Moyen-
Orient. Son successeur Lyndon Johnson poursuit sans la moindre déviance cette
politique. La guerre des Six Jours en juin 1967 lui en fournit l’occasion, et permet de
consolider la coopération israélo-américaine. C’est pour Israël une nouvelle guerre
préventive afin de garantir la sécurité de son économie et de son territoire, menacés
par l’alliance des pays arabes (Syrie, Égypte, Jordanie et Irak), et par la décision du
président Nasser d’interdire le détroit d’Akaba à sa navigation. Cette guerre éclair
consacre sa victoire, au-delà de toute espérance, et précipite l’échec du nationalisme
arabe. Elle permet également aux États-Unis de jouer un rôle nouveau au Proche-
Orient, celui de médiateur pour la paix. C’est l’objet du discours présidentiel du
19 juin 1967, qui jette les bases d’une paix globale entre Israéliens et Arabes sur le
principe du « respect de l’indépendance politique et de l’intégrité territoriale de tous les États
de la région ». Ce plan, repris dans la résolution 242 des Nations unies, n’est pas appliqué
à cause de l’opposition de l’URSS. Il inaugure cependant un processus de règlement
diplomatique du conflit israélo-arabe. Le conflit promut également l’État hébreu au
rang de seule puissance régionale capable de défendre les intérêts occidentaux et
américains en Méditerranée orientale. Mais il a, en même temps, renforcé la position
soviétique au sein du monde arabe. Peu importe, car pour le gouvernement israélien,
l’essentiel est acquis : le pays a obtenu le statut d’allié privilégié des États-Unis dans la
région, et à ce titre peut prétendre bénéficier de la manne financière et militaire de
l’Amérique, à un moment où la France gaullienne, soutien des premiers jours, se
détourne de lui, pour inaugurer une politique ouvertement pro-arabe. Ainsi sous la
présidence de Richard Nixon (1968-1974), l’aide américaine se fait plus généreuse, et
sous l’impulsion du secrétaire d’État Henry Kissinger, Israël a l’opportunité une
nouvelle fois, dans la crise jordanienne de septembre 1970, de montrer son potentiel et
son utilité stratégique.
9 La diplomatie américaine est dirigée durant les années 1970 par Henry Kissinger.
L’homme est un pragmatique qui a une conception nouvelle du monde et des relations
internationales. Il a une perception multidimensionnelle du pouvoir dans le monde, et
considère avec conviction qu’il n’existe pas de solution globale d’un problème. Toute
avancée ne peut être que progressive, en dénouant patiemment, les uns après les
autres, les fils de la négociation, et en mettant en relation les différents protagonistes.
C’est la diplomatie « des petits pas », qui conduit le secrétaire d’État à privilégier les
contacts bilatéraux, et à multiplier les « va-et-vient » entre les capitales du monde arabe
Revue historique des armées, 252 | 2008
121
et Jérusalem. L’objet ultime étant de tisser entre des États qui s’ignorent des accords de
désengagement limité, afin de créer les conditions d’une paix durable. Le projet
américain est de sécuriser l’environnement géopolitique et stratégique d’Israël. Le
problème comprend deux paramètres : les États arabes, unis et toujours hostiles à
l’existence de l’État hébreu, et le peuple palestinien, sans État, représenté par la jeune
Organisation de libération de la Palestine (OLP) de Yasser Arafat. Sur le dossier
palestinien, la diplomatie américaine va échouer. La conférence de Genève
d’octobre 1977 a montré l’intransigeance des deux parties qui refusent de se
reconnaître mutuellement, malgré les efforts conjugués des Américains (convaincus
que cette question est désormais une donnée incontournable de la résolution du conflit
régional) et des Soviétiques (associés à ce dossier grâce à leur implication en Syrie et en
Égypte).
10 En revanche, la diplomatie américaine parvient à fissurer le « front arabe du refus » en
dissociant l’Égypte de l’alliance anti-juive, et en l’amenant à conclure un traité de paix
et de reconnaissance mutuelle avec Israël. Ce seront d’abord les accords du Sinaï I et II,
en mars et septembre 1975, qui marquent le succès de la « diplomatie Kissinger », puis
quatre ans plus tard, sous l’Administration Carter, ceux de Camp David signés en
mars 1979 qui fixent « le cadre de paix au Proche-Orient » et posent le principe de la «
pleine autonomie de la Cisjordanie et de la bande de Gaza ». Ces accords, dont la conclusion
est permise par le « retournement diplomatique » du président égyptien Anouar al-Sadate,
consacrent le succès de la « doctrine Carter », qui s’inscrit en opposition à celle définie
par Kissinger dans la mesure où elle propose une approche globale des questions
diplomatiques. Même si à moyen terme l’objectif des stratèges de la Maison-Blanche
n’est pas atteint (l’Égypte ne parvient pas à entraîner dans son sillage les autres nations
arabes en créant une dynamique de paix autour d’Israël), l’essentiel est acquis pour
Washington : sécuriser la frontière sud de l’État hébreu et conforter son influence dans
la région. Ce traité ouvre également la voie à une redéfinition de la place stratégique
d’Israël dans la politique américaine au Moyen-Orient.
11 Il faut rappeler que le contexte géostratégique de la région est brutalement bouleversé
en 1979 par deux événements majeurs : la révolution iranienne conduite par l’ayatollah
Khomeyni et l’invasion soviétique de l’Afghanistan. Les Américains perdent en peu de
temps deux positions stratégiques essentielles. On comprend, dès lors, la proposition
d’un mémorandum qui renforce la sécurité (et l’alliance) avec Israël, dont la position
stratégique revêt une importance nouvelle. L’article 3 du texte précise que « si une
violation du traité de paix est jugée une menace pour la sécurité d’Israël, les États-Unis seront
prêts à envisager de toute urgence des mesures telles que le renforcement de leur présence dans
la région, des fournitures d’urgence à Israël et l’exercice de droits maritimes pour mettre fin à la
violation ». En clair, les États-Unis s’engagent ouvertement auprès de l’État hébreu pour
garantir militairement sa sécurité. Ainsi que l’intégrité de toute la zone du Golfe
persique, sur laquelle l’invasion soviétique de l’Afghanistan fait planer une menace
réelle. Le président Carter, quelques mois plus tard, affirme sa détermination à
protéger l’ensemble de la région, en déclarant que « toute tentative par une force
extérieure de contrôler la région du Golfe persique sera considérée comme un assaut contre les
intérêts vitaux des États-Unis, et un tel assaut sera repoussé avec tous les moyens nécessaires, y
compris la force militaire ». Cette nouvelle position de l’Administration Carter sera à
l’origine de la Rapid Deployment Force, créée en 1980. Elle annonce également
l’engagement américain qui caractérisera la présidence de Ronald Reagan.
Revue historique des armées, 252 | 2008
122
L’alliance privilégiée israélienne, 1980-2006
12 La présidence Reagan des années 1980 marque une étape décisive dans l’évolution des
rapports israélo-américains, car elle institutionnalisera la place d’Israël dans la
doctrine américaine. Le nouveau chef de la Maison Blanche affirme très tôt ses
ambitions et les principes de sa politique étrangère. L’Amérique est de retour sur la
scène internationale et la nouvelle administration entend faire oublier les erreurs et les
humiliations du passé. C’est le temps de la « guerre fraîche », où les États-Unis veulent
s’opposer sur tous les terrains et par tous les moyens à l’hégémonie soviétique des
années Brejnev. Le Moyen-Orient devient dans ce contexte un terrain d’affrontement
potentiel, un lieu où l’Amérique souhaite construire un réseau d’alliances, établir un «
consensus stratégique » pour contrer l’influence de sa rivale. L’État d’Israël occupe dans
ce dispositif une place de choix et le président n’hésite pas à l’affirmer plusieurs fois au
tout début de son premier mandat, en reconnaissant publiquement le caractère «
légitime » des implantations de colonies juives dans les territoires occupés et en avouant
son « antipathie » pour les Palestiniens. Propos qui avaient de quoi rassurer et satisfaire
le gouvernement de Tel-Aviv. Pourtant, une fois passé le charme des premières
déclarations d’intention, les relations entre les deux États vont passagèrement
s’obscurcir. D’abord à cause de la décision américaine de livrer des avions de
surveillance AWACS à l’Arabie Saoudite, afin de « renforcer l’environnement stratégique au
Moyen-Orient » et de conforter les liens militaires bilatéraux. Mais ce sont plus encore
les initiatives militaires israéliennes de l’été 1981, contre l’Irak et l’OLP, qui vont
dégrader un instant ces relations. Car ces opérations contre le réacteur nucléaire
irakien de Tuwaitha et le bombardement du quartier général de l’OLP à Beyrouth
portent préjudice à la politique du « consensus stratégique » voulu par Washington. Israël
est condamné par l’ensemble du monde arabe, et par l’opinion publique américaine
(même la communauté juive outre-Atlantique dénonce les victimes civiles de
l’opération sur Beyrouth) ainsi que le Congrès traditionnellement acquis à sa cause. La
réprobation américaine se traduit par la suspension de la livraison d’une commande de
six avions F-16.
13 Mais la tension est de courte durée, car dès la fin de l’année 1981, un mémorandum
d’entente est signé entre les deux États qui officialise le partenariat stratégique
américano-israélien. Il établit une « coopération et une consultation mutuelle afin de faire
face à la menace que représentait l’URSS, ou des forces sous son contrôle, dans la région ». L’État
d’Israël s’impose pour la première fois comme le protecteur des intérêts américains
contre les ambitions soviétiques, comme un allié officiel de l’Amérique. Ce document
souligne autant l’importance politique que militaire du rapprochement. Une entente
que démontre la position de Washington dans l’invasion du Liban en 1982.
14 Israël la justifie par la nécessité de garantir la sécurité de son territoire et le besoin «
d’éradiquer » la menace palestinienne. L’objectif est aussi de créer un État libanais
stable, dégagé de la tutelle syrienne. L’Administration américaine partage ces
arguments. Mais la guerre va prendre une dimension insoupçonnée. L’occupation
complète du Liban, les massacres de populations civiles (à Sabra et Shatila), les
affrontements avec l’armée syrienne, placent l’Administration Reagan dans une
posture difficile à justifier au regard de la communauté internationale, qui dénonce
d’une façon unanime l’excès de l’intervention de Tsahal. D’où l’appel de Washington à
Revue historique des armées, 252 | 2008
123
Tel-Aviv à limiter l’ampleur et l’impact de ses opérations militaires et la volonté de
trouver rapidement une issue diplomatique au conflit. Le Congrès refuse cependant de
recourir à des sanctions économiques, ce qui rend caduques les critiques et les mesures
d’embargo décidées par le président américain. Cette intervention israélienne au Liban
montre finalement comment la solidarité entre les deux alliés a su résister à l’épreuve
des faits. L’évolution de la situation régionale va conduire à un rapprochement plus
étroit et faire de la présidence Reagan un des moments les plus forts de l’alliance
américano-israélienne. L’attentat perpétré contre l’ambassade des États-Unis à
Beyrouth et le renforcement de l’alliance syro-soviétique sont à l’origine de la National
Security Decision 111 d’octobre 1983, qui consacre la coopération avec l’État hébreu
comme une des priorités en matière de politique étrangère de l’Administration
américaine. La directive présidentielle renforce l’entente stratégique en permettant
notamment « le stockage en Israël d’équipements et de fournitures américaines (…) et la
planification conjointe pour toute éventualité, ainsi que la préparation d’exercices militaires
conjoints ». Elle ouvre la voie à une collaboration active et étroite sur le plan stratégique
entre les deux États. Ainsi, au lendemain de la signature de la NSD 111, les deux
ministres de la Défense, Moshé Arens et son homologue américain Caspar Weinberger,
signent un mémorandum, révisant celui de 1979, établissant une coopération en
matière de recherche et développement, permettant aux États-Unis d’offrir leur
soutien logistique à l’État israélien. En février 1987, il est qualifié par le président
Reagan « d’allié principal » des États-Unis, non-membre de l’OTAN. Cette déclaration est
instituée au mois de décembre suivant par la signature d’un accord bilatéral. En
avril 1988, un nouveau mémorandum étend les domaines d’action de cette coopération
bilatérale privilégiée. À l’aide militaire et technologique en matière de recherche
fondamentale s’ajoute une assistance économique en vue d’assurer à l’État hébreu son
autosuffisance.
15 Les années 1980 marquent donc une étape essentielle dans le processus de
rapprochement entre Israël et les États-Unis. Celui-ci devient un allié privilégié de la
diplomatie américaine au Proche-Orient.La perte de l’Iran, les menaces soviétiques sur
l’Afghanistan, sa poussée en Syrie et son soutien à l’Irak en guerre, sont autant
d’éléments qui mettent en relief son importance stratégique pour l’Administration
américaine. La fin de la présidence Reagan coïncide avec des bouleversements
géopolitiques mondiaux majeurs et l’émergence d’une « nouvelle donne » au Proche-
Orient. Ces données conduisent à la définition de nouvelles priorités pour Washington
qui confèrent à Israël une place sensiblement différente dans la diplomatie américaine
et donnent aux relations entre les deux États une configuration nouvelle.
16 L’Amérique a gagné la guerre froide. Avec les nouvelles orientations imprimées à la
diplomatie soviétique par Mikhaïl Gorbatchev à partir de 1986, puis la disparition de
l’URSS en 1991, la politique de « containment » réactivée par la présidence Reagan n’a
plus de légitimité, ni en Europe, ni au Proche-Orient. C’est désormais la doctrine de
« l’élargissement » qui prévaut. Dans ces conditions, Israël perd le rôle stratégique qu’il
occupait dans la région et qui lui avait valu toutes les sollicitudes de Washington.
D’autre part, la seconde guerre du Golfe en 1991 a contribué à marginaliser l’État
hébreu sur la scène régionale. L’Amérique ne l’a pas associé à la vaste coalition punitive
qu’elle a conduite. Elle a même demandé au gouvernement israélien de ne pas riposter
aux attaques ciblées de Bagdad (missiles SCUD). Israël s’est donc trouvé placé au centre
de la polémique et en marge du conflit. La victoire américaine a permis de rehausser le
prestige de sa diplomatie au sein du monde arabe, a légitimé sa présence militaire en
Revue historique des armées, 252 | 2008
124
terre d’Islam, mais a minimisé la position stratégique d’Israël. Un autre élément est
intervenu pour expliquer la nouvelle orientation des relations américano-israéliennes à
partir du début des années 1990. C’est la question palestinienne et l’évolution qu’elle a
connue. La « première Intifada », déclenchée en 1987, a ému la communauté
internationale et l’opinion publique américaine, choquée par le sort des Palestiniens de
« l’intérieur » (Cisjordanie et bande de Gaza), victimes de la politique de
« harcèlement » conduite par le Likoud. En décembre 1987, la résolution 605 des
Nations Unies dénonce « les pratiques d’Israël qui viole les droits du peuple
palestinien ». Le prestige de l’OLP en sort restauré, ce qui permet à son leader, Yasser
Arafat, d’aller plus loin dans ses concessions et ses positions. Dans les différentes
tribunes qui lui sont offertes, il affirme sa volonté de créer un État palestinien
autonome et déclare vouloir reconnaître l’État d’Israël. Pour donner à son organisation
une image de respectabilité reconnue, il affirme également son désir de paix et son
refus du recours au terrorisme. Cette nouvelle posture de la cause palestinienne et la
physionomie plus conciliante de l’OLP vont conduire les États-Unis, et la nouvelle
Administration démocrate Clinton, à considérer la question palestinienne comme
essentielle pour le rétablissement de la paix dans la région. Dans ces conditions, les
relations avec Israël sont placées dans une perspective différente et l’État hébreu est
pressé par son partenaire de contribuer efficacement à la solution de paix.
17 Le processus de paix sera désormais le cadre au sein duquel évoluera l’alliance
américano-isaélienne. L’Administration Clinton va s’impliquer largement dans
l’élaboration de ce processus. Elle est favorisée dans sa démarche, dans un premier
temps, par le retour au pouvoir du Parti travailliste en Israël et l’élection, en juin 1992,
d’Ytzhak Rabin. Le cycle des négociations s’était ouvert en octobre 1990 à Madrid. La
conférence avait inauguré une série de rencontres bilatérales et multilatérales entre
Israël, l’OLP et les États arabes. Les États-Unis encouragent le dialogue sans prendre
part officiellement aux rencontres. Elles aboutissent à l’ouverture des négociations
d’Oslo, au début de 1993, dont le « Processus » conduit à la signature des accords de
Washington du 13 septembre 1993, scellés par une historique poignée de mains entre
Arafat et Rabin, sous le regard entendu et satisfait du président Bill Clinton. Les États-
Unis parviennent à récupérer à leur profit les années de laborieuses négociations entre
Israéliens et Arabes, sans s’y impliquer directement. La « déclaration de principes »,
signée entre les deux parties en septembre 1993, sera complétée par l’accord d’Oslo II,
deux ans plus tard, en septembre 1995.
18 Mais le « Processus d’Oslo » va vite montrer ses limites, car, sur le terrain, la situation
entre les communautés reste tendue, le Hamas refusant toute reconnaissance de l’État
sioniste et cherchant à poursuivre l’Intifada. Les colons juifs, pour leur part, restent
très méfiants et hostiles aux accords. Le principal obstacle à la réussite du processus de
paix a été sa « progressivité » voulue par l’Administration américaine, qui pensait qu’on
ne pouvait résoudre des années de conflit d’un seul coup. Il convenait de procéder
progressivement, « à petits pas », afin de résoudre un à un les problèmes pour arriver
plus sûrement à une solution finale du problème. Erreur de stratégie politique, car peu
à peu, à partir de 1996, les obstacles s’accumulent, la confiance s’érode et la violence
regagne du terrain. Le processus est affecté par l’élection en mai 1996 de Benyamin
Netanyahou, dont le programme comprend une triple négation : non à un État
palestinien, non à toute concession sur le Golan, et non à la division de Jérusalem. Le
nouveau Premier ministre, qui n’a jamais dissimulé son hostilité aux accords d’Oslo,
multiplie les gestes de provocation, comme la reprise de la colonisation en Cisjordanie.
Revue historique des armées, 252 | 2008
125
Il entre en conflit avec l’Administration Clinton qui entame un second mandat et qui
entend faire de la paix israélo-palestinienne la réussite de sa politique proche-
orientale. Le président américain va donc s’impliquer personnellement dans le
processus de paix, et parvenir à imposer au chef du gouvernement israélien l’accord
intérimaire de Wye Plantation d’octobre 1998. Ses efforts sont servis par l’élection
d’Ehud Barak à la tête d’un nouveau gouvernement travailliste en mai 1999. Le Premier
ministre entend donner à la diplomatie israélienne une orientation toute différente de
celle de ses prédécesseurs et de ce fait souhaite renforcer l’alliance avec les États-Unis.
Les Premiers ministres israéliens avaient toujours fait passer les intérêts et la sécurité
d’Israël avant les intérêts stratégiques de leur allié américain et ils avaient toujours
satisfait les revendications de Washington si elles ne portaient pas atteintes aux
intérêts de l’État hébreu. Ehud Barak inverse l’ordre des priorités en voulant satisfaire
les exigences américaines quelles que soient les incidences pour son pays. Cet ancien
chef d’état-major des forces armées considère que la guerre conventionnelle n’est pas
la principale menace qui pèsera sur Israël dans les années à venir, mais le terrorisme et
l’usage d’armes de destruction massive (ADM). Il convient donc de renforcer l’alliance
avec les États-Unis, seuls capables de l’aider à répondre à de telles menaces. Mais ces
considérations stratégiques ne permettent pas de conclure à un accord avec les
Palestiniens et à Camp David en juillet 2000, malgré l’insistance du président Clinton,
les deux partis ne peuvent s’entendre sur un projet global de paix, consacrant l’échec
de la diplomatie américaine sur ce dossier. Pourtant, les efforts de la Maison Blanche
pour apporter une solution de paix ne sont pas vains, car à la veille de l’élection du
président républicain George W. Bush, l’alliance entre les deux États semble la clé la
plus sûre pour parvenir à la résolution de la question israélo-palestinienne.
19 Les attentats du 11 septembre 2001 bouleversent à nouveau la donne des relations
israélo-américaines et les conflits en Afghanistan et en Irak renforcent ces nouvelles
orientations. Les événements du 11 septembre infléchissent d’une façon déterminante
la politique extérieure du nouveau président. Les premiers mois de son mandat sont
caractérisés par une politique étrangère volontairement « humble et modeste », peu
ouverte sur le monde, résolument opposée à celle de son prédécesseur. N’a-t-il pas
déclaré dans un débat présidentiel lors de la campagne électorale qu’il « attachait plus
d’importance au Mexique qu’au Moyen-Orient » ? Même s’il faut nuancer ces perspectives, il
est certain que l’intérêt du président se porte davantage sur le Golfe persique et son
pétrole que sur le Proche-Orient et ses problèmes politiques. La résolution de la
question israélo-palestinienne passe à l’évidence au second plan des préoccupations de
la nouvelle Administration républicaine, qui semble souhaiter se désengager de ce
« bourbier », laissant aux protagonistes le soin de sortir de leurs propres
contradictions. Le déclenchement de la « seconde Intifada » en 2000 semble donner
raison aux stratèges de la Maison Blanche, et expliquer leur prudence dans ce dossier.
20 Le 11 septembre projette l’Amérique sur la scène internationale, et renvoie directement
les Américains aux problèmes moyen-orientaux. C’est de là que vient l’agression. La
région devient donc la zone prioritaire pour la sécurité du pays. Stratégiquement, elle
entre dans le « premier cercle », au centre duquel se trouve Israël. L’objectif des néo-
conservateurs au pouvoir à Washington est de lutter contre le terrorisme international
et de promouvoir la paix dans le monde, en exportant le modèle démocratique et
libéral américain. Quel va être, dans cette perspective, le rôle attribué aux relations
avec Israël ?
Revue historique des armées, 252 | 2008
126
21 Dans leur projet de lutter contre les pays de « l’axe du mal », l’Iran, la Syrie, l’Irak et la
Libye, Israël occupe une place de choix et s’avère un allié stratégique de première
importance. Il présente des atouts majeurs : une expérience de la lutte contre le
terrorisme, un service de renseignement et une armée de qualité (qui a su développer
des tactiques d’interception et de duels aériens, ainsi que des opérations en zones
désertiques). Israël jouit enfin d’une position qui en fait une excellente base logistique
pour conduire des opérations contre les « États parias » voisins. De ce fait, la nouvelle
politique extérieure américaine entend-elle faire de l’alliance avec l’État hébreu l’une
de ses priorités afin de redessiner la carte politique du Moyen-Orient. L’objectif de «
double containment » dirigé contre l’Iran et l’Irak défini par les stratèges de Washington
s’accorde parfaitement avec les projets politiques du gouvernement israélien. Toute la
question est de savoir comment y parvenir ? Israël, partisan de la méthode forte, a
soutenu l’intervention militaire américaine en Irak en 2003 et cautionne le maintien de
ses troupes dans le pays jusqu’à sa pacification complète. Il est aussi favorable à la
méthode coercitive à l’égard de l’Iran des ayatollahs, suspecté d’enrichir de l’uranium à
usage militaire et de financer les organisations islamistes radicales au Liban et en
Palestine. Sur ce terrain, la position américaine diverge de celle de Tel-Aviv.
Washington préfère mettre en avant la négociation et la tempérance. Mais les États-
Unis savent qu’ils pourront compter sur l’alliance d’Israël dans l’éventualité (peu
probable) d’un conflit ouvert avec l’Iran.
22 Le président Bush fait en 2004 du règlement de la question palestinienne l’une de ses
priorités. Elle s’est exprimée dans la publication d’une « feuille de route », d’avril 2003.
Celle-ci prévoyait la formation d’un État palestinien démocratique, libre et reconnu,
ainsi que le gel de la colonisation juive. Un consensus semblait acquis autour de ce
programme. Mais quatre ans après son élaboration, le projet a échoué. Parmi les
nombreux éléments qui en expliquent les raisons, il convient d’avancer les réticences
du gouvernement d’Ariel Sharon et le soutien tacite de Washington. Dans ce dossier, on
perçoit encore l’identité de vue et la « complicité » qui existe entre les deux alliés.
Conclusion
23 Depuis la fondation de l’État d’Israël en mai 1948, les relations israélo-américaines
n’ont cessé de se renforcer. À la reconnaissance compatissante des premières années
qui obéissait d’abord à des motivations de politique intérieure, a très vite succédé un
partenariat stratégique de fait, puis une alliance militaire imposée par l’évolution de la
« donne géopolitique » mondiale et régionale. Les crises et les tensions qui ont ponctué
ces relations n’en n’ont jamais véritablement altéré la solidité. Aujourd’hui, plus que
jamais, les deux alliés ont besoin l’un de l’autre dans la nouvelle configuration
géopolitique qui se dessine au Moyen-Orient.
Revue historique des armées, 252 | 2008
127
BIBLIOGRAPHIE
BEN-ZVI (Abraham), Eisenhower, Kennedy and the origins of the American-Israeli alliance, Columbia
University Press, 1998.
BEN-ZVI (Abraham), The United-States and Israel. The limits of the special relationship, Columbia Press,
1993.
BRZEZINZKI (Zbigniew), Le vrai choix, Odile Jacob, Paris, 2004.
DUROSELLE (Jean-Baptiste) et KASPI (André), Histoire des relations internationales, Armand Colin, 2002.
ENCEL (Frédéric), « États-Unis-Israël : une amitié à démystifier », Le Figaro, 13 novembre 2004.
GILBOA (Eytan), American public opinion toward Israel, Lexington, Massachusetts, 1987.
GRIER (Peter), “The United-States and Israel”, The Christian Science Monitor, October 2001, p. 6-21.
KISSINGER (Henry), White House years, Boston, Little Brown, 1979.
LAURENS (Henry), Paix et guerre au Moyen-Orient, Armand Colin, Paris, 2005.
LIEBER (Robert), “United-States and Israeli relations since 1948”, Middle East review of international
affairs, vol. 2, no 3, September 1998, p. 2-11.
MANSOUR (Camille), Au-delà de l’alliance, Armand Colin, Paris, 1995.
RYNHOLD (Jonathan), “Israeli-American relations and the peace process”, Middle East review of
international affairs, vol. 4, no 2, June 2000, p. 28-56.
RÉSUMÉS
L’alliance entre les États-Unis et l’État d’Israël est récente. La reconnaissance de l’État hébreu en
mai 1948 n’augurait nullement d’une attente ultérieure et répondait à des considérations de
politique intérieure américaine et non à un calcul géostratégique lié à la situation internationale
au Moyen-Orient. Ce sont les circonstances liées à la conjoncture internationale, la compétition
naissante entre l’Union soviétique et l’Amérique qui révéla l’importance stratégique de l’État
d’Israël. Le second mandat du président Eisenhower, à la fin des années 1950, marque de ce point
de vue une étape importante dans le rapprochement entre les deux pays. Ce sont les années 1980
qui marquent cependant l’apogée de l’entente américano-israélienne. C’est le temps où la
« guerre fraîche » retrouve de la vigueur, où Israël recouvre son intérêt stratégique pour
Washington. Une importance qu’elle ne cessera pas de conserver malgré des désaccords et des
tensions passagères, liées au problème israélo-palestinien que les États-Unis s’emploient à
négocier à partir des années 1990. Ce dossier, ainsi que d’autres, montrent combien les rapports
entre les deux puissances ont été ces cinquante dernières années complexes et sont l’une des
clefs pour comprendre le jeu des relations internationales au Moyen-Orient.
Israel-USA, the historical recognition of a strategic alliance. History of strategic and diplomatic relations,
1948-2004.The alliance between the USA and the State of Israel is recent. The recognition of the
Jewish state in May 1948 by no means foresaw any subsequent expectations and responded to
domestic American political considerations and not a geo-strategic calculation linked to the
international situation in the Middle East. It was the circumstances surrounding the
international situation, the emerging competition between the Soviet Union and America that
Revue historique des armées, 252 | 2008
128
revealed the strategic importance of the state of Israel. The second term of President Eisenhower
in the late 1950s marked an important step in the rapprochement between the two countries. It
was the years of the 1980s that marked, however, the height of the US-Israeli agreement. This is
the time when the "second cold war" renewed its intensity, when Washington regained its
strategic interest in Israel. This importance continued despite passing disagreements and
tensions, related to the Israeli-Palestinian problem that the USA attempted to negotiate in the
1990s. This experience, and others, shows how the relationship between the two powers these
past fifty years was complex and is one of the keys to understanding the game of international
relations in the Middle East.
INDEX
Mots-clés : Etats-Unis, Israël, relations internationales
AUTEUR
GÉRARD CLAUDE
Agrégé et docteur en histoire contemporaine, il enseigne actuellement à l’Institut d’études
politiques d’Aix-en-Provence la géopolitique et l’histoire des relations internationales en
Méditerranée. Il a publié notamment deux ouvrages sur ces questions : Migrations en Méditerranée
(2002) et Géopolitique et relations internationales en Méditerranée (2007). Il appartient, en outre, au
groupe de recherches « Histoire militaire, défense et sécurité » dirigé le professeur Jean-Charles
Jauffret à l’Institut d’études politiques d’Aix.
Revue historique des armées, 252 | 2008
129
Vincennes
Revue historique des armées, 252 | 2008
130
Vincennes dans la Grande Guerre
Alain Marzona et Emmanuel Pénicaut
1 La déclaration de guerre et la mobilisation d’août 1914 ont un écho particulier à
Vincennes : le développement de la place dans les années précédentes, la publicité que
lui ont donnée les grandes revues et les visites de prestige des années d’avant-guerre, la
volonté du Reich d’atteindre la capitale font du fort un élément-clé du « camp retranché
de Paris », structure opérationnelle chargée de la défense de la capitale au sein du
gouvernement militaire de Paris. Même si la menace d’une invasion s’éloigne après la
bataille de la Marne, Vincennes garde toute sa place dans l’effort de guerre. Quatre
années durant, la place bourdonne d’une activité incessante et multiforme, parfois
difficile à saisir avec précision, à tel point que le préfet de la Seine lui-même, en
décembre 1917, ne peut que déplorer que « l’autorité militaire apporte [à Vincennes] de si
fréquents et de si imprévus changements à ses installations (…), ces modifications répétées étant
le fait de services sans rapport le plus souvent les uns avec les autres » 1.
2 Les structures de commandement de la place, pourtant, sont stables. Le 2 août 1914, le
général de brigade de réserve Léon Liénard, vieil artilleur, est appelé à prendre le
commandement d’armes de Vincennes, ainsi que celui des dépôts d’artillerie de la
place, bientôt transformé en commandement de tous les dépôts d’artillerie du
gouvernement militaire de Paris 2. Entouré d’un état-major de six officiers, le général
Liénard est ainsi responsable des dépôts de Vincennes, Versailles, Noisy-le-Grand,
Créteil, Saint-Cloud et Paris, qui regroupent des éléments issus de trois régiments
d’artillerie lourde, cinq régiments d’artillerie de campagne, deux escadrons du train et
du parc d’artillerie du 21e corps. Il est remplacé, le 12 décembre 1916, par un autre
artilleur, le général Jean-Joseph Rouquerol, récemment retiré du front où il est accusé
d’avoir fait preuve de mollesse dans le commandement de sa division 3. À la suite d’une
inspection menée par le gouverneur militaire de Paris dans l’un des dépôts qu’il
contrôle, Rouquerol est rapidement prié de se retirer et laisse la place, le
18 septembre 1917, au général Henri Dauvé 4. Celui-ci a passé la plus grande partie de sa
carrière à Vincennes : troupier au 12e régiment d’artillerie, monté par le rang, il est
nommé en 1910 directeur de l’école d’artillerie de la 19e brigade, puis directeur du parc
d’artillerie de corps d’armée de Vincennes l’année suivante et enfin, en 1913, colonel
commandant le 13e régiment d’artillerie. Après s’être illustré sur le front d’Orient, il
Revue historique des armées, 252 | 2008
131
retrouve Paris pour un congé de convalescence, et prend le commandement de
Vincennes en attendant d’obtenir un poste qui lui convienne au front. Son caractère
malcommode retarde cette nouvelle affectation ; ce n’est qu’au mois d’août 1918 qu’il
est nommé commandant de la place de Lille. Le général Edmond Malesset, après avoir
rendu de grands services dans l’organisation de l’artillerie du camp retranché de Paris
au début de l’année 1918, lui succède en décembre 5. Commandant de la place d’armes
de Vincennes et des régiments d’artillerie du gouvernement militaire de Paris, il occupe
ces postes importants jusqu’à son départ en section de réserve, le 3 janvier 1920.
3 Sous l’autorité successive de ces quatre généraux, l’activité de Vincennes s’oriente
d’abord vers le soin des hommes. Pour nourrir les troupes du camp retranché de Paris,
la place se transforme dès l’été 1914 en un immense magasin de subsistances. Dans le
Vieux fort, la manutention connaît un développement spectaculaire, rendu visible par
la construction de dizaines de fours supplémentaires dans la cour située devant la
casemate S. Dans le bois, l’armée s’approprie abattoirs et parcs à bestiaux, soit plus de
50 hectares à l’intersection de la route de la Ferme et de la route de la Faisanderie : la
« division des parcs et abattoirs » de la Direction générale des approvisionnements de
siège du camp retranché de Paris y entretient, en 1914, 25 000 bœufs et 45 880 moutons
qui font de Vincennes, avec Pantin et le bois de Boulogne, l’un des trois plus gros des
vingt-neuf parcs à bétail qui ceinturent la capitale 6. La présence de ce cheptel entraîne,
tout au long de la guerre, d’innombrables déprédations sur les plantations. À la
préoccupation des vivres s’ajoute celle des blessés : alors que l’hôpital Bégin fonctionne
à plein, le service de santé des armées réquisitionne, en novembre 1915, un vaste
terrain au plateau de Gravelle pour y élever un hôpital temporaire. Le don par la Croix-
Rouge canadienne du matériel et des baraquements nécessaires à la construction vaut à
cet « hôpital militaire de Joinville » le surnom d’« hôpital canadien » ; les besoins
sanitaires de la capitale sont tels qu’il est encore considéré, en juillet 1919, comme « un
appoint important absolument nécessaire au service de santé du gouvernement militaire de
Paris » 7.
4 Du point de vue du matériel de guerre, la Première Guerre mondiale est marquée à
Vincennes par l’utilisation maximale de toutes les capacités de stockage, de production
et d’expérimentation du château. Le cadre principal de cette activité est le double parc
d’artillerie, mis en place par le décret du 8 novembre 1911 8. Dès le début des combats,
le parc de la place, sous le commandement du colonel Jacquillat, est chargé de la
réception et du tri des matériels évacués à la hâte des régions du Nord et de l’Est, et de
l’envoi aux armées de tous les matériels dont il dispose, qu’il s’agisse d’artillerie lourde,
de trains blindés ou de munitions : 100 mitrailleuses, 45 000 fusils, cinq millions de
cartouches quittent Vincennes en l’espace de quelques semaines. Les ateliers de
réparation sont mis à contribution en même temps : 900 voitures réquisitionnées
passent à travers leurs chaînes avant d’être envoyées au front, aussi bien que
18 000 fusils ramassés sur le champ de bataille de la Marne par un détachement du Parc
envoyé à dessein. Admiratif, le général Miquel-Dalton, commandant l’artillerie de la
place et des forts de Paris, doit reconnaître en janvier 1915 que « le service des
projecteurs, l’emploi des autos-canons et des trains blindés, les fournitures de toute nature
réclamées par la construction des batteries (grillages, fils de fer, pelles, pioches, etc.),
l’acquisition des groupes électrogènes, le matériel d’artillerie, de mitrailleuses Hotchkiss, de
munitions, d’instruments de précision et, pour le service de la voie étroite, l’achat d’un matériel
de voie et de traction considérable, ont exigé de ce service une activité dont ce résumé ne peut
donner qu’une faible idée » 9. Au traitement du matériel d’artillerie s’ajoutent celui des
Revue historique des armées, 252 | 2008
132
harnachements et ferrures, dont les stocks, vidés par la mobilisation, doivent être
reconstitués d’urgence 10, et celui des transports : entre août et décembre 1914, le parc
voit défiler une moyenne de 100 camions par jour. C’est aussi au parc qu’ont lieu, au
printemps 1915, les premières expérimentations d’armes chimiques françaises, en
réponse aux attaques chimiques allemandes lancées sur Ypres en avril. Dès le mois de
mai, des expériences sont pratiquées quotidiennement au polygone sur des agents
asphyxiants et lacrymogènes, et aboutissent en particulier à la mise au point de la «
vincennite » 11.
5 Le 12 juin, le général Curmer, chargé de mission au Grand Quartier général, donne un
compte rendu saisissant des essais qui lui ont été présentés : « J’ai assisté à Vincennes à
l’essai de projectiles de 75 chargés de : acide cyanhydrique, 20 % ; chlorure d’arsenic, 80 %. Les
effets constatés sur les animaux soumis à ces essais ont montré que le mélange ci-dessus remplit
les conditions demandées pour le chargement des obus destinés à produire des gaz asphyxiants
dans des milieux limités, tels que cantonnements réduits, espaces clos, etc. (…). Des projectiles
appropriés chargés en acide cyanhydrique et chlorure d’arsenic pourraient en outre être utilisés
par les avions dans les mêmes conditions que ci-dessus ou pour atteindre des batteries
dissimulées sous bois. » 12 Conséquence de cette activité effrénée, l’extension
géographique du parc se poursuit tout au long de la guerre : entre octobre 1915 et
juillet 1916, plus de cinquante baraques supplémentaires sont élevées dans le bois,
provoquant autant de contentieux avec les services de la ville de Paris ; au cours de
l’année 1916, les locaux, à l’étroit dans l’enceinte de la Cartoucherie et des ateliers,
débordent la route de la Pyramide et s’étendent sur le champ de manœuvre. En mai
1917, ils se séparent définitivement des ateliers et sont transférés au polygone, entre
les hangars de la Pyramide et les magasins de la Caponnière 13.
6 Le deuxième centre nerveux de Vincennes pendant la guerre se situe à l’atelier. Comme
pour les parcs, l’activité de fabrication connaît une extension formidable. Entre août et
décembre 1914, 90 000 obus et 290 000 gargousses sortent des ateliers de chargement,
dont les effectifs passent en trois mois de 140 à 600 ouvriers. Ils sont mille au
printemps 1918, portant les effectifs de l’ensemble des ateliers à 4 160 personnes le
jour, et 1 581 la nuit. En 1920, on estime que, « pendant la période de 1914 à 1918, la
production journalière des cartouches à l’Atelier de fabrication de Vincennes a cru dans le
rapport de 1 à 16 », alors que « l’accroissement prévu était de 1 à 5 » 14. Le total des balles,
étuis et chargements fabriqués à Vincennes durant toute la guerre s’élève à près d’un
milliard et demi de pièces 15. La présence d’une forte population ouvrière a des
incidences sociales non négligeables. Dès 1914, on installe une crèche de fortune pour
les enfants des personnels de la Cartoucherie et de l’atelier de fabrication ; mais le
recours croissant à la main-d’œuvre féminine, encouragé par le sous-secrétaire d’État à
l’artillerie 16, suscite de nouveaux besoins. En septembre 1916, on bâtit une crèche-
garderie en dur, puis, sur le même terrain, une cuisine coopérative, qui compte
2 000 places lorsqu’elle ouvre ses portes en 1917 17.
7 Les conditions de travail, difficiles, provoquent des tensions entre les ouvriers salariés
des ateliers et les personnels à statut militaire du parc 18, mais aussi entre les ouvrières
de la Cartoucherie et leurs patrons. Au motif que les barèmes réglementant les salaires
ne sont pas respectés, celles-ci se mettent en grève au printemps 1917 : « Dans la nuit du
1er au 2 mars, les 300 femmes travaillant dans l’atelier des balles cessent le travail. Une heure
plus tard, les ateliers des étuis et du chargement se joignent à la protestation (…). À six heures,
l’équipe de jour, forte de 1 500 femmes, se joint à la grève. » 19 L’importance stratégique de la
Revue historique des armées, 252 | 2008
133
fabrication des cartouches contraint la direction de l’établissement à céder aux
revendications, comme le relate le préfet de police : « L’effervescence continuant, la
direction crut bon de renvoyer une dizaine de meneuses. Cette mesure ne fit que surexciter les
grévistes et, pour ramener le calme, on dut leur promettre de réintégrer les ouvrières congédiées
et de payer (…) un acompte de cinquante francs à toutes les ouvrières ayant travaillé sans
interruption depuis le 29 janvier. » 20 Les ouvrières reprennent finalement le travail le
3 mars. Comme les parcs, les ateliers gagnent du terrain sur le domaine de la ville : en
janvier 1917, une voie de chemin de fer perce le bois pour les relier directement à la
gare de Joinville et réduire les ruptures de charge dans l’expédition des marchandises.
Deux mois plus tard, le lieutenant-colonel Lestaudin, directeur des ateliers, demande
l’autorisation au préfet de la Seine d’élever deux nouveaux baraquements en dehors de
l’enceinte des ateliers. Le 11 mai 1918, il réquisitionne encore 800 mètres carrés pour
creuser des tranchées-abris destinées à protéger le personnel en cas de bombardement
aérien.
8 La bataille de la Marne avait mis en valeur, à l’automne 1914, le rôle de l’automobile.
Créés le 27 décembre 1914, les deux Centres d’approvisionnement de matériel
automobile (CAMA) de Vincennes et de Lyon ont pour mission de passer les marchés de
fabrication avec les constructeurs, de réceptionner le matériel avant son envoi aux
armées, et de remettre en état de marche les matériels évacués par les unités au front.
À Vincennes, qui pouvait se targuer d’une certaine expérience 21, le CAMA est constitué
à l’aide du Grand parc automobile de réserve ; commandé successivement par les
lieutenants-colonels Lebreton, Leprince-Ringuet, Johannet et Guiffart, il s’organise
autour d’un Service du contrôle, d’un Service de réception et d’un Service des achats et
de la comptabilité. À la fois entrepôt, atelier et magasin, il occupe plusieurs sites entre
la ville (en particulier dans les entrepôts Knorr réquisitionnés), le Fort neuf, Charenton,
le champ de manœuvre et le camp de Saint-Maur, où se côtoient le « parc des
tracteurs », le garage, le « parc des voitures neuves », le « parc de triage et des vieilles
matières ». Ses effectifs croissent rapidement : on compte 521 personnes en
janvier 1915, et 990 en septembre suivant, parmi lesquels 28 officiers 22. À Charenton,
les ateliers du Centre se divisent en atelier de carrosserie, atelier de mise au point,
atelier de montage des châssis, atelier des machines-outils, atelier des autos-
mitrailleuses, atelier des caoutchoucs et pneumatiques, parcs et fours à bandages 23. La
présence en nombre de matériel automobile permet au général Liénard de mettre en
place des formations d’artillerie à traction automobile 24, qui perdurent après lui : en
novembre 1918, le colonel Jacquillat fait élever trois bâtiments à Saint-Maur pour un «
Cours pratique d’artillerie lourde à tracteur », tandis qu’un « Centre d’organisation d’artillerie
automobile » dispense des cours techniques de conduite et de réparations 25. Le CAMA,
quant à lui, cède progressivement la place au « Centre d’évacuation et de triage du service
automobile », créé le 5 juin 1917. Contraint en avril 1919 d’abandonner le champ de
courses qu’il avait réquisitionné, ce centre déplace ses vieux matériels sur le champ de
manœuvre, où ceux-ci occupent encore une superficie de vingt hectares 26.
9 Si les parcs, les ateliers et le CAMA symbolisent l’activité de la place de Vincennes
pendant la guerre, ils ne peuvent la résumer. Tout au long de ces quatre années, une
multitude d’unités de formation ou d’expérimentation, à l’existence parfois éphémère,
voient le jour successivement ou simultanément, et apparaissent, souvent de façon
fugitive, au détour des textes. Ainsi, à l’automne 1914, l’observatoire télescopique
« Guichard » est testé dans les dépôts d’artillerie ; un cours d’instruction à l’utilisation
des mitrailleuses fonctionne au Vieux fort en 1915 ; en janvier 1916 sont organisés des
Revue historique des armées, 252 | 2008
134
exercices de lancement de grenades chargées sur le champ de courses ; le « Groupe de
canevas de tir » du gouvernement militaire de Paris est formé le 20 juin suivant à partir
du personnel du service topographique du parc de place, avec pour mission de
compléter les canevas de tir et les levers topographiques des lignes de défense de Paris
27
; les 27e et 28e sections de repérage par le son, chargées de la recherche et du
repérage des objectifs de l’artillerie, sont constituées au Fort neuf le 30 novembre 1916 ;
le 11 avril 1917 est créé un « Centre d’organisation des ateliers d’entretien des matériels
modernes » 28… Encore ne s’agit-il là que d’un échantillon.
10 L’activité de la place de Vincennes pendant la guerre reflète et met en valeur les
spécialités, toutes branches de l’artillerie confondues, dans lesquelles la place est
passée maître au cours du XIXe siècle. Alors que le retour à la paix contraint les
autorités militaires à rendre à la ville de Paris les terrains réquisitionnés sans vergogne
pendant les hostilités et que les unités rentrent progressivement dans le cadre qui est
le leur depuis le Second Empire, il aurait été logique que Vincennes ne devienne qu’une
simple caserne aux portes de la capitale. Le maintien d’une activité technique
importante, qui perdure jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale à travers
ateliers de fabrication et commission d’expériences et permet encore à la place de
s’illustrer dans l’histoire des techniques, est sans doute la récompense des compétences
acquises et des efforts fournis tout au long de la guerre.
NOTES
1. Archives de Paris, Pérotin 10653 20, lettre du préfet de la Seine au conservateur du bois, Saint-
Mandé, 28 décembre 1917.
2. SHD/DAT, archives rapatriées de Russie, direction de l’artillerie, dossiers relatifs à la gestion
des commandants de dépôts d’artillerie, « Tableau des commandements en temps de guerre des
dépôts des corps d’artillerie, du train et des parcs d’artillerie de corps d’armée », 23 décembre
1915.
3. SHD/DAT, 9 Yd 633, dossier individuel de J.-J. Rouquerol.
4. SHD/DAT, 13 Yd 63, dossier individuel de H. Dauvé.
5. SHD/DAT, 10 Yd 1083, dossier individuel d’E. Malesset.
6. SHD/DAT, archives rapatriées de Russie, unités de la Première Guerre mondiale, dossier
« camp retranché de Paris ».
7. Arch. Paris, Pérotin 10653 124.
8. Il est parfois difficile de distinguer dans les sources les fonctions respectives du parc
d’artillerie de corps d’armée et du parc d’artillerie de place.
9. SHD/DAT, 23 N 53, « Notice sommaire relatant les opérations faites par l’artillerie du camp
retranché [de Paris] depuis le 27 août 1914 », 31 janvier 1915. La place de Vincennes abrite aussi
le siège du « noyau central » de l’artillerie du camp retranché de Paris.
10. Le service de harnachement du parc est chargé en juillet 1916 de l’ensemble des marchés de
cuir de la région parisienne, afin de limiter la concurrence des établissements de l’artillerie entre
eux et la hausse des prix (SHD/DAT, archives rapatriées de Russie, direction de l’artillerie,
Revue historique des armées, 252 | 2008
135
rapport du contrôleur Gache sur les marchés de harnachement et de cuir du parc d’artillerie de
Vincennes, novembre 1917).
11. L EPICK (O.), La grande guerre chimique : 1914-1918, Paris, Presses universitaires de France, 1998,
p. 113.
12. SHD/DAT, 16 N 903, commentaires de M. Kling, direction du laboratoire municipal de Paris
(obus et gaz asphyxiants), juin-septembre 1915.
13. Le parc d’artillerie régional de Vincennes resta après la guerre du côté ouest de la route de la
Pyramide, en bordure du champ de manœuvre.
14. SHD/DAT, 2 W 197, renseignements fournis aux officiers stagiaires lors de leur visite du
9 février 1920.
15. Ibid.
16. SHD/DAT, 7 N 292, lettre du sous-secrétaire d’État à l’artillerie aux chefs d’établissements
constructeurs, 8 janvier 1916.
17. Bulletin des usines de guerre, lundi 6 août 1917, p. 2.
18. SHD/DAT, 23 N 53, compte rendu de visite des ateliers de Vincennes, 25 octobre 1915.
Certains ouvriers des parcs partirent au front pour se faire rappeler comme ouvriers d’usine
travaillant pour la guerre.
19. CROIX (A.) (dir.), Histoire du Val de Marne, Paris, Messidor, 1987, p. 232.
20. Ibid.
21. Sur l’organisation du service automobile entre 1914 et 1918, voir : NAVARRE (A.-J.), Les services
automobiles pendant la guerre, Paris, 1919.
22. SHD/DAT, 7 N 483 et 487, états de situation du CAMA de Vincennes.
23. Le centre d’approvisionnement de matériel automobile de Vincennes, 1916, anonyme, s.l., non
paginé.
24. SHD/DAT, 10 Yd 1083, dossier individuel de L. Liénard.
25. Centre d’organisation d’artillerie automobile de Vincennes. Cours d’automobilisme appliqué [par le
capitaine Blanchet, professeur au cours pratique d’artillerie à tracteurs], Paris, Dunod et Pinat,
1918.
26. Arch. Paris, Pérotin 10653 25.
27. SHD/DAT, 23 N 65, « Rapport sur les travaux effectués par le groupe de canevas de tir du
GMP », 26 octobre 1917.
28. SHD/DAT, 4 W 354, note de la Direction de l’artillerie, 11 avril 1917.
INDEX
Mots-clés : Première Guerre mondiale, Vincennes
AUTEURS
ALAIN MARZONA
Attaché d’administration, chargé de recherches au département de l’armée de Terre du Service
historique de la Défense
Revue historique des armées, 252 | 2008
136
EMMANUEL PÉNICAUT
Conservateur du patrimoine, chef de la division archives du département de l’armée de Terre du
Service historique de la Défense
Revue historique des armées, 252 | 2008
137
Les fonds du Service historique de la
Défense
Revue historique des armées, 252 | 2008
138
Le fichier général des militaires de
l'armée française décédés au cours
de la Première Guerre mondiale
Christian Lemarchand
1 Le Bureau des archives des victimes des conflits contemporains (BAVCC) conserve, à
Caen (Calvados), sous l'autorité du département interarmées ministériel et
interministériel (DIMI) du Service historique de la Défense (SHD), sur 204 mètres
linéaires, le fichier nominatif de près d' 1 400 000 militaires de l'armée française,
décédés entre le 3 août 1914 et le 1er juin 1919 1.
2 Il s'agit d'un fichier patronymique, d'abord à usage administratif, composé de trois
éléments distincts selon que la mention « Mort pour la France » 2 a été attribuée,
refusée ou n'a fait l'objet d'aucune instruction. Tandis que se manifestent à son égard
un intérêt croissant de la part des familles, des collectivités territoriales et des
historiens, la pertinence de son utilité administrative demeure entière en raison de
l'absence de forclusion opposable aux demandes d'attribution de la mention « Mort
pour la France » au titre de la Première Guerre mondiale.
3 La mise en ligne sur Internet des images, indexées sur le patronyme, des fiches des
militaires morts pour la France au cours de la Grande Guerre, par le ministère de la
Défense, à la date du 11 novembre 2003, sous l'appellation : Mémoire des hommes 3, a
comblé la recherche individuelle familiale et généalogique. L'exploitation séquentielle
à des fins mémorielle ou de recherche historique, dont le critère d'investigation diffère
du nom de famille, reste, quant à elle, du domaine de l'investigation manuelle ou
aléatoire.
Revue historique des armées, 252 | 2008
139
Origine et fonctions administratives du fichier général des militaires
de l'armée française décédés au cours de la Première Guerre
mondiale
4 Ce fichier résulte de l'action du Service de l'état civil, des renseignements aux familles
et successions militaires dont a été doté le ministère de la Guerre, par la loi du
18 février 1916 4, en remplacement de la section du Bureau des archives qui recevait et
enregistrait déjà les avis de décès des militaires aux armées, en application de la loi du
8 janvier 1893 et des instructions du 23 juillet 1894.
5 Ce fichier a une double fonction :
• informer sur la régularisation du décès des militaires tués, disparus ou décédés pendant la
durée de la guerre ;
• informer sur l'attribution de la mention « Mort pour la France ».
1/ Informer sur la régularisation du décès des militaires tués, disparus ou
décédés pendant la durée de la guerre
6 Le législateur, confronté à une guerre massivement meurtrière, s'est attaché au bon
fonctionnement de l'état civil, en définissant les rapports entre les différents acteurs
dont les armées. À cette fin, il institue l'état civil militaire par une loi du
18 février 1916 5 en simplifiant par une loi du 18 avril 1918 6, la correction des actes de
décès erronés ou incomplets dressés tant aux armées que par les autorités municipales
ou consulaires françaises et par les autorités étrangères (depuis le 2 août 1914 et
jusqu'à la fin de la guerre) et, enfin, au sortir du conflit, en organisant par une loi du
28 février 1922 (modifiée), le fonctionnement de l'état civil aux armées dans les
communes libérées de l'occupation ennemie.
7 Les références sur les fiches révèlent que la constitution, dans un ordre strictement
alphabétique, du fichier général a duré au moins deux ans : 1921 (ministère des
Pensions, des Primes et Allocations de guerre) et 1922 (ministère de la Guerre et des
Pensions), à partir des travaux réalisés dans les corps sous l'autorité des officiers
responsables du Service de l'état civil et des sépultures militaires et par le Service de
l'état civil des renseignements aux familles et successions militaires, intégré au
ministère des Pensions par décret du 27 janvier 1920.
2/ Informer sur l'attribution de la mention « Mort pour la France »
8 La mention « Mort pour la France » est un témoignage pérenne de la reconnaissance de
la nation en l'honneur de ceux qui ont donné leur vie pour le pays (loi du 2 juillet 1915).
Sa pérennité est garantie par l'inscription en marge de l'acte de décès par l'officier de
l’'état civil communal, à l'initiative du ministre de la Guerre ou de la Marine. Elle
apparaîtra sur les copies et les extraits de l'acte de décès du militaireet dans tout acte
où sera cité son nom, après l'attribution de la mention. La mention du décès en marge
de l'acte de naissance résulte d'une ordonnance de 1945, dont l'effet non rétroactif
s'applique aussi aux accessoires de l'acte de décès.
9 Le fichier général des militaires de l'armée française « morts pour la France » durant la
Première Guerre mondiale est l'outil informatif de référence jusqu'à la production de
l'acte de décès, dans l'exercice des droits attachés à l'attribution de cette mention. Ces
Revue historique des armées, 252 | 2008
140
droits dont on ne fera pas ici l'énumération ont tantôt le caractère d'un hommage
direct rendu à la mémoire de la victime (individualité et perpétuité de la sépulture
confiée à la garde de l'État, monuments aux morts), tantôt en faveur des ayants cause
(adoption par la nation des orphelins). La loi du 2 juillet 1915 a été modifiée par une loi
du 28 février 1922.
Le fichier général des militaires de l'armée française décédés au
cours de la Première Guerre mondiale : un outil d'orientation vers les
sources de données pour le généalogiste et l'historien
10 Chaque fiche contient :
• les noms, prénoms, lieu de naissance (commune et département, pays), date de naissance,
lieu de décès (commune, département, pays) et date de décès, commune de dernier domicile
à travers la commune de transcription de l'acte de décès, mention « Mort pour la France »
ou non ;
• recrutement : bureau, classe et matricule, affectation (formation, matricule et grade).
11 Le croisement de cette fiche avec le registre des décès de la commune de dernier
domicile et avec l'état signalétique et des services conservé aux archives du
département où était domicilié le décédé lors de son recensement, permet de vérifier
aux sources, les informations qui en ont été extraites pour la renseigner.
NOTES
1. Dont 1 322 000 soldats français. Les pertes totales jusqu’au premier juin 1919 ont été évaluées
à presque 1 400 000 hommes, dont 70 000 indigènes coloniaux et nord-africains et
5 000 légionnaires. Parmi les 1 322 000 Français qui ont péri se trouvait une minorité d’hommes
venus d’Algérie, de Tunisie, des anciennes colonies et de l’étranger, qui n’étaient donc pas
présents en France avant la guerre. Cf. Insee : mouvement de la population 1914-1919 ; et M.
HUBER (Insee) : La situation démographique en 2004 - Mouvement de la population. La pyramide des
âges au 1er janvier 1921. Informations en ligne sur le site Internet de l'Insee.
2. La mention « Mort pour la France » a été créée par la loi du 2 juillet 1915, modifiée par la loi
du 28 février 1922.
3. Mémoire des hommes est une banque d'images numérisées rassemblant toutes les fiches des
militaires « Morts pour la France » durant la Première Guerre mondiale dans le respect du code
du patrimoine. Elle est accessible à l'adresse suivante :
www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr. Il s'agit d'une réalisation du Secrétariat général
pour l'administration mise en œuvre et administrée par la Direction de la mémoire, du
patrimoine et des archives.
4. La loi du 18 février 1916 a créé deux services : le Service des pensions et secours et le Service
de l'état civil, des renseignements aux familles et successions militaires. C'est à ce dernier qu'a
incombé la mission de suivre le sort des militaires entrés dans les formations sanitaires ou
capturés par l'ennemi et de recueillir et d'acheminer les objets ou papiers trouvés sur les
Revue historique des armées, 252 | 2008
141
militaires décédés. (Ministère des Pensions, Recueil officiel des sépultures militaires, 2 e édition, 1934.
Historique du Service des sépultures militaires).
5. Les armées, conformément à une instruction du Grand Quartier général du 2 juin 1915, étaient
déjà pourvues d'un officier responsable du Service de l'état civil et des sépultures militaires
quand fut promulguée la loi du 18 février 1916 créant l'état civil militaire (Ministère des
Pensions, Recueil officiel des sépultures militaires, 2 e édition, 1934 – Historique du Service des
sépultures militaires).
6. La loi du 18 avril 1918 introduit temporairement la rectification administrative des actes de
décès comportant des erreurs d'ordre matériel ou des lacunes à la condition que celles-ci ne
mettent en doute ni le fait du décès, ni l'identité du décédé : cette rectification est faite hors la
saisine du tribunal, sous le contrôle du parquet qui peut soit être à l'origine de la rectification,
soit en être saisi par le ministre des Armées et l'autorité municipale qui doit transcrire l'acte de
décès sur les registres de sa commune ou la famille du défunt.
AUTEUR
CHRISTIAN LEMARCHAND
Chef du bureau des archives des victimes des conflits contemporains (Caen) du département
interarmées, ministériel et interministériel du Service historique de la Défense
Revue historique des armées, 252 | 2008
142
Lectures
Revue historique des armées, 252 | 2008
143
Raymond Boisseau, Ladislas
Berchény, magnat de Hongrie, maréchal
de France
Paris, Budapest, Szeged, Publication de l’Institut hongrois de Paris, 2006
Jean-Pierre Bois
1 Bercsényi Laslo, ou Ladislas de Bercheny, figure emblématique de l’émigration
hongroise au service de la France au XVIIIe siècle, attendait son biographe. C’est le
général Boisseau avec le portrait minutieux de cet homme des Lumières et homme de
guerre. Né en 1689 à Epérijes (Presov, Slovaquie), d’une famille passée au service de
Rakóczi, Ladislas Bercheny part pour l’exil en 1711 et choisit le service de la France
en 1712. Mestre de camp des hussards de Rattky, avec lequel il prend part aux dernières
campagnes de la guerre de Succession d’Espagne, il fait ensuite plusieurs voyages en
Turquie, en particulier en 1720 à l’occasion de la levée parmi les Hongrois fixés à
Rodosto (Tekirdag, Thrace) de son propre régiment, les hussards de Bercheny, placé en
garnison d’abord en Alsace, où il noue des rapports avec Stanislas Leczinski. En 1725,
lorsque le beau-père du roi de France, monte une maison digne de son nouveau statut,
il y comprend Bercheny. Celui-ci, qui ne sera jamais un familier de la cour de France,
devient un assidu de la cour de Chambord, puis de Lunéville, apportant par son
austérité naturelle un contrepoids bienvenu aux frivolités de madame de Boufflers, et
un apaisement aux rivalités entre Polonais et Lorrains… L’essentiel de sa vie est alors sa
carrière militaire, marquée par son engagement dans les guerres de Louis XV jusqu’à sa
mort, depuis la campagne de 1734, jusqu’aux opérations de la guerre de Sept Ans.
L’auteur étudie le détail de toutes ses actions, et le suit dans les grades et
commandements qu’il obtient. Inspecteur général des hussards après la campagne
de 1743, puis lieutenant-général, enfin maréchal de France en 1758, abandonnant en
même temps l’inspection générale des hussards au profit du comte Turpin de Crissé.
Ses campagnes et ses succès lui permettent aussi de développer le modèle des troupes
hongroises au service de la monarchie, ces célèbres régiments de hussards,
particulièrement appréciés de Maurice de Saxe, spécialistes de la petite guerre qui
nourrissent la réflexion de Jeney ou Turpin de Crissé. Le général Boisseau rappelle en
Revue historique des armées, 252 | 2008
144
même temps que Bercheny n’a jamais perdu le souvenir de sa patrie natale. Rétabli
dans les titres, honneurs et privilèges de sa maison en Hongrie grâce à l’accord entre
Louis XV et Marie-Thérèse, il achève sa vie en 1778 dans son château de Luzancy. Le
régiment de hussards qu’il a créé en 1720 reste le plus ancien que compte encore
l’armée française, maintenant 1er régiment de hussards parachutistes.
Revue historique des armées, 252 | 2008
145
Laurent Cohen-Tanugi, Guerre ou
paix, essai sur le monde de demain
Grasset, Paris, 2007, 231 pages
Alain Marzona
1 Spécialiste reconnu des questions internationales, l’auteur s’interroge sur les
bouleversements survenus sur la scène mondiale depuis la chute du communisme en
Europe orientale en 1989 et l’implosion de l’Union soviétique en 1991. Cet ouvrage met
en lumière l’incertitude du monde actuel, où resurgissent des antagonismes nationaux
que la guerre froide – conflit idéologique – avait occultés. De plus, l’émergence de
nouvelles puissances comme la Chine, l’Inde ou la Russie, depuis le milieu des
années 1990, annonce ce que l’auteur décrit comme la « fin de l’ère atlantique ». En effet,
la concurrence de ces nouvelles puissances, ajoutée aux désaccords entre Américains et
un certain nombre de pays européens dont la France – notamment sur les questions
économiques et sur la politique à mener au Moyen-Orient – fragilise le leadership euro-
américain sur la scène internationale. En outre, l’un des aspects les plus intéressants de
la démonstration de l’auteur consiste à mettre en évidence le rôle de la mondialisation
comme le principal acteur de ces bouleversements internationaux. Ce processus aiguise
les rivalités entre États, comme le montre la compétition autour des ressources
naturelles et énergétiques ; les exemples russes et chinois apparaissent ici comme les
plus frappants. À travers cette thèse, l’auteur semble aller à l’encontre des tenants de la
« fin de l’histoire » qui tiennent la mondialisation économique libérale comme l’une des
garanties de la paix mondiale. Néanmoins, dans la dernière partie de l’ouvrage, l’auteur
entend démontrer qu’un nouveau pacte entre Américains et Européens leur
permettrait d’assurer la stabilité de l’ordre international. Selon lui, cette politique
devrait s’appuyer en premier lieu sur une transformation en profondeur des
institutions internationales que sont l’Organisation des Nations unies (ONU) ou
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Laurent Cohen-Tanugi plaide pour une
politique volontariste des Occidentaux qu’il qualifie de garants des « valeurs
démocratiques » en direction notamment du monde arabo-musulman en proie à de
violentes luttes internes et au terrorisme d’inspiration islamiste mais aussi sur les
questions liées à l’écologie (réchauffement climatique, alimentation, accès à l’eau) qui
Revue historique des armées, 252 | 2008
146
touchent l’ensemble de la planète. Cet ouvrage se veut une réflexion sur le monde
contemporain et un point de vue occidental sur les affaires internationales. L’auteur,
tout en prenant en compte les nouvelles données mondiales comme la prolifération
nucléaire et le développement des fondamentalismes religieux, se fait l’avocat d’un
rapprochement entre Occidentaux car la capacité à éviter les conflits « reste aussi
largement entre leurs mains ».
Revue historique des armées, 252 | 2008
147
Isabelle Davion, Jerzy Kloczowski et
Georges-Henri Soutou (dir.), La
Pologne et l’Europe du partage à
l’élargissement (XVIIIe-XXIe siècles)
PUPS, Paris, 2007, 290 pages
Anne-Aurore Inquimbert et Alain Marzona
1 La collection « Mondes contemporains » des Presses de l’université Paris-Sorbonne
publie les actes du colloque, tenu en Sorbonne à l’automne 2004, consacré à la Pologne
et l’Europe. Les dix-sept contributions composant cet ouvrage réunissent historiens
français et polonais et couvrent une période allant de la fin du XVII e siècle à
l’intégration de la Pologne à l’Union européenne. Si le XIX e siècle est marqué par la
« question polonaise », son utilisation par la France (notamment), ses conséquences
pour la Pologne, les Polonais et l’Europe ; le début du XX e siècle voit se cristalliser les
velléités d’indépendance polonaises vis-à-vis de la Russie, de l’Allemagne et de
l’Autriche-Hongrie. Puis à la veille de la Première Guerre mondiale, c’est le dilemme
d’une alliance de la Pologne avec la Russie contre l’Allemagne ou avec l’Allemagne
contre la Russie qui préoccupe Français et Européens. L’essentiel de cet ouvrage est
cependant consacré aux problématiques politico-diplomatiques de l’entre-deux-
guerres, auxquelles se rapportent huit textes. Ainsi sont abordés pêle-mêle : la
politique « polonaise » de la Russie, la place de la Pologne dans la géopolitique
française, les relations militaires franco-polonaises, la politique « européenne » de la
Pologne, l’imbroglio des alliances et les dissensions diplomatico-militaires franco-
polonaises, le problème des minorités ou encore l’importance du facteur soviétique
dans la politique étrangère polonaise. La Seconde Guerre mondiale est l’occasion d’un
nouveau dépècement du pays au profit de l’Allemagne et de l’Union soviétique.
L’attitude plus qu’ambiguë de Staline au moment de l’insurrection de Varsovie entre
août et octobre 1944 et la conférence de Yalta de février 1945 entérinent le sort de la
Pologne, qui voit, toutefois, ses frontières garanties avec l’acquisition des territoires de
l’Oder-Neisse. Le début de la guerre froide marque l’éloignement de la Pologne de
Revue historique des armées, 252 | 2008
148
l’Europe occidentale et de la France en particulier. Néanmoins, les Français, notamment
sous les présidences du général de Gaulle et de François Mitterrand, font de la Pologne
une pièce essentielle de leur politique orientale et de leurs relations avec l’Union
soviétique. En effet, une certaine convergence de vue existe entre les deux pays,
notamment en faveur d’une division de l’Allemagne durant cette période. La chute du
régime communiste en 1989 rendue possible, en outre, par l’action du syndicat ouvrier
Solidarnosc ou par celle de personnalités comme le pape polonais Jean-Paul II, permet au
pays de retrouver sa place sur l’échiquier européen comme en témoigne son adhésion à
l’OTAN en 1999 et plus encore à l’Union européenne en mai 2004. Ainsi, comme
l’affirme Jerzy Kloczowski dans cet ouvrage « on peut constater aussi que pour la première
fois depuis trois siècles, la Pologne peut nourrir une espérance de stabilité et de sécurité
internationale ». En conclusion, les différents articles de cet ouvrage contribuent sans
conteste à une meilleure compréhension de l’histoire mouvementée de la Pologne mais
aussi de son importance au sein du concert européen à travers les convoitises et les
appétits dont elle a été souvent l’objet.
Revue historique des armées, 252 | 2008
149
Eugène-Jean Duval, Aux sources
officielles de la colonisation française,
tome 1, Études
Éditions Thélès, Paris, 2007
Valérie Caniart
1 L’auteur, dans son introduction générale, destine son travail aux étudiants, souhaitant
mettre à leur disposition un inventaire non exhaustif des textes officiels qui ont régi la
politique coloniale de la France des origines au milieu des années 1960. Cet ouvrage, qui
ne constitue que le premier tome sur trois, couvre la période allant des origines (de la
colonisation) au 4 septembre 1870. Une première partie présente la persistance du fait
colonial dans la politique française sur la période définie, la seconde est découpée en
chapitres thématiques tels que l’organisation administrative, judiciaire, les questions
de défense, etc. Chaque chapitre est constitué d’un commentaire de l’auteur agrémenté
de nombreuses citations et est suivi d’un corpus d’annexes. On ne peut que louer
l’auteur d’une telle initiative, d’autant qu’un tel travail présenterait un réel intérêt.
Malheureusement, l’ouvrage souffre de nombreuses approximations tant sur le fond
que sur la forme. On regrette entre autres que l’auteur ne s’explique pas davantage sur
le choix des textes ou sur son découpage chronologique qu’il qualifie lui-même
« d’arbitraire », les références bibliographiques sont bien maigres étant donné
l’ampleur du sujet et le vocabulaire relatif aux institutions de l’Ancien Régime est très
imprécis, voire erroné. Le résultat est davantage un état des lieux des connaissances de
l’auteur sur la colonisation qu’un manuel de référence pour les étudiants.
Revue historique des armées, 252 | 2008
150
Gérard D. Khoury, Une tutelle
coloniale. Le mandat français en Syrie
et au Liban. Écrits politiques de Robert
de Caix
Belin, Paris, 2006, 536 pages
Anne-Aurore Inquimbert
1 Avec cette édition critique des écrits politiques de Robert de Caix, tout un pan de la
politique française en Syrie et au Liban est mis en lumière. Après des études à l’École
libre des sciences politiques (section diplomatique), Robert de Caix de Saint-Aymour
devient, entre autres, publiciste au Journal des Débats. Ses articles sur l’Orient, et à
travers eux sa vision de la politique coloniale de la France, sont vite remarqués. Au
début des années 1900, il se lie avec Philippe Berthelot (qui lui ouvrira les portes du
ministère des Affaires étrangères) et entretient une correspondance avec le maréchal
Lyautey. Au cours de la Première Guerre mondiale, le Quai d’Orsay fait appel à ses
services et lui offre d’intégrer la Maison de la presse (organe de propagande).
S’intéressant à la question du démembrement de l’Empire ottoman au moment des
accords Sykes-Picot en 1916 (Britanniques et Français se partagent les provinces
levantines de l’Empire ottoman), Robert de Caix devient un farouche partisan d’un
mandat français en Syrie. Si bien, qu’en 1919, c’est lui que le secrétaire général du
ministère des Affaires étrangères – Philippe Berthelot – envoie pour négocier avec
l’émir Faysal puis pour épauler le général Gouraud nommé haut-commissaire de la
République en Syrie. Dans les faits, la marge de manœuvre dont il dispose est
conséquente et c’est à lui que revient le rôle délicat de dessiner les lignes de la politique
française en Syrie et au Liban. Cependant, lorsqu’en 1923, le général Gouraud quitte ses
fonctions de haut-commissaire, ce n’est pas Robert de Caix que l’on choisit pour le
remplacer. L’arrivée du général Weygand met donc un terme à son travail au Levant.
Comme le stipule Gérard D. Khoury dans son introduction critique, la mise en œuvre
d’une politique de fractionnement des territoires arabes sous mandat français par
Robert de Caix est la parfaite illustration des principes colonialistes alors défendus par
Revue historique des armées, 252 | 2008
151
la Société des Nations. Principes que l’on ne manque pas de retrouver aujourd’hui dans
la politique américaine en Irak et dont, une nouvelle fois, on ne peut que constater la
faillite.
Revue historique des armées, 252 | 2008
152
Frédéric Lert, Mirage F1, tome 1
Histoire et Collections, Coll. « Les matériels de l’armée de l’Air », 2007, 66
pages.
Gilles Krugler
1 Premier tome d’une série faisant le point sur les différentes versions du Mirage F1, ce
petit ouvrage se donne pour objectif de relater les débuts de la version « C » et « B » de
l’avion français. Dans un style très clair, où la synthèse technique fait souvent place aux
témoignages et aux anecdotes, l’auteur décrit la carrière française du F1 C de la genèse
mouvementée du programme au retrait de l’intercepteur en 2003, en passant par ses
déploiements au Tchad ou aux Émirats arabes unis (opération « Méteil »). Également
évoquée, la version « E » du F1, qui opposé au F-16 lors du fameux « marché du siècle »
ne connut pas le succès attendu, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège
préférant le chasseur de General Dynamics. La version B eut un peu plus de succès
puisque cette version biplace fut commandée à une cinquantaine d’exemplaires dont
vingt pour l’armée de l’Air qui l’utilise encore actuellement pour la transformation
opérationnelle. Avion qualifié de « transition », le F1 marque une réelle amélioration
pour les pilotes français. œuvrant dans les escadres du CAFDA (Commandement air des
forces de défense aériennes), les F1 C et C-200 permettent avant l’arrivée du « 2000 », de
disposer d’un vecteur de défense aérienne crédible, tant par ses capacités propres que
par son électronique (radar Cyrano IV) et surtout par son armement avec notamment le
missile Super 530 F capable d’aller chercher une cible hostile volant à Mach 3 à
60 000 pieds avec un dénivelé de plus 10 000 par rapport au chasseur français. Court,
très bien illustré et bien mené, ce fascicule résume au mieux les trente années de
carrière de la version de chasse pure du F1.
Revue historique des armées, 252 | 2008
153
AUTEUR
GILLES KRUGLER
Revue historique des armées, 252 | 2008
154
Serge Métais, Histoire des Albanais,
des Illyriens à l’indépendance du Kosovo
Fayard, 2006, 450 pages
Alain Marzona
1 Exceptés les travaux de Georges Castellan et ceux, plus récents, de Nathalie Clayer,
l’historiographie en langue française consacrée à l’Albanie reste confidentielle. Cet
ouvrage tend donc à combler ce vide en retraçant l’histoire du peuple albanais, de ses
origines souvent controversées à son actualité la plus récente marquée en dernier lieu
par la guerre du Kosovo en 1999. La première partie de l’ouvrage, intitulée « La langue
fonde la nation », met en évidence l’importance de la langue albanaise comme ciment de
l’identité nationale et comme forme de résistance aux différentes puissances
environnantes. L’auteur insiste sur le développement du sentiment national albanais à
partir de la création de la Ligue de Prizren au Kosovo en 1878, alors que les Albanais
sont à l’époque éparpillés dans les Balkans et soumis à la domination ottomane.
L’histoire médiévale et moderne, avec ses grandes figures et événements comme le
héros national albanais Skanderberg ou la bataille du Champ des merles en 1389, pose
des points de repère essentiels de la conscience nationale albanaise. Ils seront
régulièrement utilisés par les promoteurs de la création d’un État albanais, puis par les
partisans d’une grande Albanie. L’auteur montre également que les différences
linguistiques et religieuses ont souvent freiné l’expression d’un sentiment national
commun. Dans cette première partie, les développements relatifs aux origines du
peuple albanais apparaissent confus, ne permettant pas au lecteur d’avoir une idée la
plus claire possible sur une question, il est vrai, très complexe. La seconde partie « Une
nation éclatée » met en lumière la grande difficulté des Albanais pour apparaître dans le
concert des nations. En effet, la déclaration d’indépendance en 1912 ne rencontre que
peu d’intérêt de la part des puissances européennes. De plus, le découpage étatique
consécutif au démembrement de l’Empire ottoman en 1913 est défavorable aux
Albanais, la moitié des territoires albanophones revenant au royaume du Monténégro,
à la Serbie et à la Grèce. En 1920, l’Albanie retrouve son indépendance même si celle-ci
demeure contrariée par les ambitions territoriales de ses voisines mais également par
l’Italie qui y voit une possibilité d’étendre son influence dans les Balkans. Au cours de la
Revue historique des armées, 252 | 2008
155
Seconde Guerre mondiale, l’Italie constitue même une grande Albanie regroupant les
populations albanophones d’Albanie, du Kosovo et d’une partie de la Macédoine afin de
lutter contre les volontés expansionnistes grecques et yougoslaves. Dans cette
deuxième partie, l’auteur met fortement l’accent sur la question du territoire du
Kosovo, tiraillé entre Albanais et Serbes. L’histoire de cette province ex-yougoslave est
particulièrement bien décrite, notamment les parties consacrées au développement de
l’indépendantisme kosovar dans le courant des années 1970 et à la montée de
l’intransigeance serbe sous l’impulsion de Slobodan Milosevic à partir du milieu des
années 1980. À partir de cette date, un régime de ségrégation est instauré au Kosovo,
renforçant par là même la volonté d’émancipation de la population albanaise. La guerre
du Kosovo et l’arrivée des troupes occidentales dans la région en 1999, conjuguée à
l’isolement de la Serbie et à la chute de Milosevic en 2000, tendent à rendre possible
l’indépendance. Serge Métais conclut sa démonstration par un plaidoyer pour une
reconnaissance internationale de l’indépendance du Kosovo et pour un rapprochement
entre l’Albanie et l’Union européenne. Pour l’auteur, les Européens doivent aussi
prendre en compte l’importance numérique des populations albanophones présentes
également en Macédoine et au Monténégro.
Revue historique des armées, 252 | 2008
156
Axel Poniatowski, Cécile
Maisonneuve, Benjamin Franklin
Perrin, 2008, 341 pages
Robert Doughty
1 Les auteurs de ce livre estiment que Benjamin Franklin est « l’Américain par excellence ».
Fils d’un artisan, fabricant de bougies et de savon, il parvint à dépasser une éducation
primaire limitée pour devenir l’un des plus importants publicistes et écrivains de
l’histoire américaine. Après avoir gagné beaucoup d’argent, il concentra sa grande
intelligence et sa curiosité insatiable sur des inventions et des projets scientifiques.
Puis, en vieillissant, il s’intéressa de plus en plus à la politique. Tout d’abord membre de
l’Académie de Pennsylvanie, il s’impliqua pour la première fois en diplomatie en 1753
au cours des négociations de l’État avec les Indiens. Avant la Révolution américaine, il
vécut plusieurs années à Londres où il représentait l’État de Pennsylvanie puis, par la
suite, d’autres États. En 1776, il aida Thomas Jefferson à écrire la Déclaration
d’Indépendance. Mais son œuvre la plus importante se déroula de 1776 à 1785, lorsqu’il
servit comme ambassadeur en France. Profitant de ce que les citoyens français
appelaient « la franklinomania », il conclut une alliance avec la France qui fut vitale dans
les succès américains dans la guerre contre l’Angleterre. Il joua aussi un rôle
fondamental dans les négociations du traité de Paris de 1783, qui réprima
définitivement la rébellion. Quelques années plus tard, il fut l’un des signataires de la
Constitution des États-Unis qui mit un terme à la fragmentation qui nuisait au nouveau
pays. Au-delà de ces nombreuses contributions, Franklin reste, comme le souligne les
auteurs, un homme paradoxal et complexe. Les Américains se sont souvent référés à lui
au plan de la moralité et de la famille, alors qu’il avait un fils illégitime qui a
ardemment soutenu l’Angleterre au cours de la Révolution et qui a été le dernier
gouverneur britannique du New Jersey. Les Américains le citent aussi dans des
publications sur la frugalité et la vie simple, alors qu’il appréciait au plus haut point les
plaisirs des salons les plus chers de Paris. Les auteurs concluent que Franklin ne peut
pas être vu simplement comme le stéréotype de l’Américain. Ils avancent, cependant,
de manière persuasive qu’il était l’homme universel dont les idées ont touché les
Revue historique des armées, 252 | 2008
157
Européens comme les Américains et dont la vie et le travail continuent à parler aux
gens du XXIe siècle.
Revue historique des armées, 252 | 2008
158
François Rouquet, Fabrice Virgili et
Danièle Voldman (dir.), Amours,
guerres et sexualité 1914-1945
Gallimard – BDIC/Musée de l’armée, 2007, 176 pages
Benoît Lagarde
1 Un thème léger et surprenant que celui des rapports amoureux et de la sexualité dans
les deux guerres mondiales ? Sûrement pas. Amours, guerres et sexualité 1914-1945,
l’ouvrage dirigé par François Rouquet, Fabrice Virgili et Danièle Voldman , publié à
l’occasion de l’exposition éponyme organisée par la BDIC (Bibliothèque de
documentation internationale contemporaine) et le Musée de l’Armée, nous en apporte
la preuve. À la croisée de l’histoire des genres et de l’histoire des guerres, ce livre nous
donne à comprendre et à voir comment et en quoi les conflits mondiaux ont influé sur
les rapports entre hommes et femmes, entre combattants et civils de l’arrière, sur le
plan de la vie intime. Depuis la mobilisation et jusqu’à la fin de la guerre, les auteurs
déterminent six thèmes d’études. Ainsi dès l’entrée dans le conflit, une vision
esthétisée du corps humain pousse chaque pays au combat : soldats virils, femmes
séduisantes à l’arrière et nations incarnées sous des traits féminins font corps pour
marcher vers la victoire. Cette marche implique la séparation des couples et des
familles, séparation durant laquelle il faut maintenir des liens avec l’absent(e) et en
tisser de nouveaux avec les compagnons de fortune. Le contrôle de la sexualité
représente ensuite un enjeu majeur pour les autorités, car les maladies, les mœurs et la
production culturelle demandent à être canalisées. Amour et rencontres trouvent
néanmoins leur place : joie des permissions, homosexualité dans la troupe ou amours
partagées avec l’ennemi font de la guerre un théâtre de passions. Les violences de
guerre comprennent aussi les violences sexuelles, lesquelles apportent humiliation et
souffrance. Enfin le dénouement de la guerre permet aux couples de se reformer et
oblige les combattants à retrouver une place dans la société. Outre la très riche et
parfois étonnante iconographie tirée de l’exposition, l’intérêt de ce livre réside dans les
passionnants articles et les nouvelles perspectives de recherche qui sont proposées au
lecteur. Trente articles d’auteurs d’Europe et des États-Unis, professeurs et chercheurs
Revue historique des armées, 252 | 2008
159
en sciences humaines et sociales, nous démontrent combien guerre et sexualité sont
liées et combien d’aspects, encore assez méconnus, la vie affective et sexuelle peut
revêtir en temps de guerre. Le lecteur saluera également les divers matériaux étudiés :
les sources manuscrites et imprimées, l’imagerie populaire et le cinéma témoignent de
l’impact sur les corps de l’expérience de la guerre. Autant d’études et de pistes de
recherches qui, appuyées par de nombreuses références bibliographiques attestent
bien que l’histoire de l’intime éclaire de manière essentielle l’évolution des sociétés.
Revue historique des armées, 252 | 2008
160
Thierry Sarmant (dir.), avec la
collaboration de Guillaume
Lasconjarias, Benjamin Mercier,
Emmanuel Pénicaut et Mathieu
Stoll, Les ministres de la Guerre,
1570-1792 : histoire et dictionnaire
biographique
Belin/ministère de la Défense, Paris, 2007, 653 pages
Antoine Boulant
1 Dans le prolongement de plusieurs publications déjà éditées à l’initiative de certains
ministères, notamment le Dictionnaire des ministres des Affaires étrangères paru en 2005, le
présent ouvrage a pour objet d’apporter une nouvelle pierre à la construction d’une
histoire générale de l’État en France. Vingt-neuf auteurs – dont douze issus des rangs
du Service historique de la Défense – proposent trente-neuf biographies des ministres
et secrétaires de la Guerre qui, sans se limiter à l’analyse de leur action à la tête de leur
département, fournissent nombre d’éléments sur leur formation, leur carrière
ultérieure et leur vie personnelle. Se succèdent ainsi, dans l’ordre de leur nomination,
personnages illustres – Richelieu, Louvois, Chamillart, Choiseul, Saint-Germain, Ségur…
– et figures plus effacées – Barbezieux, Baüyn d’Angervilliers, Montbarrey… – qui
n’avaient jusqu’ici guère inspiré les biographes. Les textes liminaires consacrés au « roi
de guerre », aux pratiques gouvernementales sous l’Ancien Régime et au
fonctionnement de l’administration de la Guerre depuis Philippe le Bel, replacent les
notices biographiques dans une éclairante perspective d’histoire institutionnelle.
L’apparat critique fait de l’ouvrage un outil de travail particulièrement précieux :
chaque notice biographique est suivie d’un état des sources – manuscrites et imprimées
– et de la bibliographie propre à chaque ministre, tandis qu’une bibliographie générale
Revue historique des armées, 252 | 2008
161
achève le volume. Portraits, illustrations, arbres généalogiques et reproductions des
signatures ministérielles agrémentent la lecture. Cette publication de référence sera
prolongée d’un second volume consacré aux ministres de la Guerre et de la Défense
de 1792 à nos jours.
Revue historique des armées, 252 | 2008
Vous aimerez peut-être aussi
- (Armor) - (Heimdal) Panzertruppen German Armoured Troops 1935 - 1945Document272 pages(Armor) - (Heimdal) Panzertruppen German Armoured Troops 1935 - 1945fordmustang1968100% (5)
- Reinventando Comunidades ImaginadasDocument288 pagesReinventando Comunidades ImaginadasNatalí Durand100% (1)
- Brève Histoire Du Cinéma FrançaisDocument6 pagesBrève Histoire Du Cinéma FrançaisLe Cahier du FLE100% (1)
- Histoire Des Volontaires EtrangersDocument928 pagesHistoire Des Volontaires EtrangersAndré BlittePas encore d'évaluation
- Texte 3 Partie 2 Scène 3 Antoine Lecture Linéaire 2Document2 pagesTexte 3 Partie 2 Scène 3 Antoine Lecture Linéaire 2chiaraguzzo20Pas encore d'évaluation
- L'Aventure Chevaleresque - Eric KohlerDocument2 pagesL'Aventure Chevaleresque - Eric KohlerSombre Arcane ZinePas encore d'évaluation
- 13 Exos Geometrie EspaceDocument17 pages13 Exos Geometrie Espacemogala2392Pas encore d'évaluation
- Mémoire Master RochefortDocument194 pagesMémoire Master RochefortTournesol RelamisiPas encore d'évaluation
- Napoleon Et AusterlitzDocument63 pagesNapoleon Et AusterlitzkalugareniPas encore d'évaluation
- Rha 7676Document158 pagesRha 7676rafacasPas encore d'évaluation
- Armee Francaise Guerre IndochineDocument366 pagesArmee Francaise Guerre IndochineFranck YeghicheyanPas encore d'évaluation
- Africa FichePeda Contribution A Leffort de guerreokBATDocument8 pagesAfrica FichePeda Contribution A Leffort de guerreokBATSerigne Abdou DiopPas encore d'évaluation
- 00004Document71 pages00004Romain BoudetPas encore d'évaluation
- Sebastien Denis Revistas Francesas y Guerra de ArgeliaDocument19 pagesSebastien Denis Revistas Francesas y Guerra de ArgeliaAdriana AmantePas encore d'évaluation
- Les Militaires Aux Archives Nationales Et Au Service Historique de La DéfenseDocument17 pagesLes Militaires Aux Archives Nationales Et Au Service Historique de La Défenseguepier92Pas encore d'évaluation
- 2018 French A Level U4 Resource FolderDocument3 pages2018 French A Level U4 Resource FolderelisPas encore d'évaluation
- La France Et Le NéocolonialismeDocument6 pagesLa France Et Le NéocolonialismeJean-Charles CanossePas encore d'évaluation
- Kok Escalle - Le Chagrin Et La PitiéDocument14 pagesKok Escalle - Le Chagrin Et La PitiéSanjaminoPas encore d'évaluation
- LBC - Gros Titres Et Faits Divers de 1935Document13 pagesLBC - Gros Titres Et Faits Divers de 1935123Pas encore d'évaluation
- BILOMDocument3 pagesBILOMCesareo GonzalezPas encore d'évaluation
- La Republique Secrete 2008 (Olivier ForcadeDocument693 pagesLa Republique Secrete 2008 (Olivier ForcadeSansan Corneille KambouPas encore d'évaluation
- Repertoire Générale Des Sources Manuscrites de L'histoire de Paris Pendant La Révolution Française (Vol. 4)Document704 pagesRepertoire Générale Des Sources Manuscrites de L'histoire de Paris Pendant La Révolution Française (Vol. 4)Vanderlei MarinhoPas encore d'évaluation
- SHDGR Inv 10H T1Document472 pagesSHDGR Inv 10H T1lucamorlandoPas encore d'évaluation
- Controle - 1ere GM L Horreur de La GuerreDocument1 pageControle - 1ere GM L Horreur de La GuerreronantrouillardPas encore d'évaluation
- Batailles & Blindés 01 - Tiger, La Genèse Du Fauve (2003.11-12 - Caraktere)Document67 pagesBatailles & Blindés 01 - Tiger, La Genèse Du Fauve (2003.11-12 - Caraktere)Béliko Toledo100% (1)
- Avions 195 PreviewDocument10 pagesAvions 195 PreviewDeBrialmontPas encore d'évaluation
- Thèse Noulens Tome II Sources Et AnnexesDocument233 pagesThèse Noulens Tome II Sources Et AnnexesThierry Noulens100% (1)
- Guide MarocDocument58 pagesGuide MarocMustaphaDokkaliPas encore d'évaluation
- RV GuerreDocument80 pagesRV GuerreAndrei AlmasanPas encore d'évaluation
- La Guerre 1870-71 Arthur (... ) Chuquet Arthur bpt6k930749hDocument321 pagesLa Guerre 1870-71 Arthur (... ) Chuquet Arthur bpt6k930749hFelix NistorPas encore d'évaluation
- 4GH31TEWB0123U04_CoursHistoireGeographie-U04Document62 pages4GH31TEWB0123U04_CoursHistoireGeographie-U0488j9xj4zpfPas encore d'évaluation
- RC4 Indochine 1950Document31 pagesRC4 Indochine 1950Việt Nam cổ sự quánPas encore d'évaluation
- Du Praxinoscope Au CelluloDocument4 pagesDu Praxinoscope Au CelluloNad ZePas encore d'évaluation
- Historique Du 3e Régiment de (... ) bpt6k62272285Document126 pagesHistorique Du 3e Régiment de (... ) bpt6k62272285ahmedPas encore d'évaluation
- News Mili 12-39Document121 pagesNews Mili 12-39youri59490Pas encore d'évaluation
- Prisonniers de Guerre - Références Gallica PDFDocument12 pagesPrisonniers de Guerre - Références Gallica PDFBonapartePas encore d'évaluation
- Généalogie d'un régiment: le 31ème régiment d'infanterie 1610-1940D'EverandGénéalogie d'un régiment: le 31ème régiment d'infanterie 1610-1940Pas encore d'évaluation
- Dzexams 3as Francais 402954Document3 pagesDzexams 3as Francais 402954zahraPas encore d'évaluation
- Histomag 88 JUIN 1940 RETOUR SUR UNE DEFAITEDocument162 pagesHistomag 88 JUIN 1940 RETOUR SUR UNE DEFAITEDeBrialmont100% (1)
- CH 1 Civils Et Militaires Dans La 1 GMDocument22 pagesCH 1 Civils Et Militaires Dans La 1 GMnaisbais786Pas encore d'évaluation
- Catalogue "Femmes Et Hommes Du Ministère de L'intérieur Dans La Grande Guerre"Document53 pagesCatalogue "Femmes Et Hommes Du Ministère de L'intérieur Dans La Grande Guerre"Ministère InterieurPas encore d'évaluation
- Guide RoumanieDocument46 pagesGuide Roumanieagnanjeanbaptiste447Pas encore d'évaluation
- Ruscio, Alain - Dien Bien Phu Battle PDFDocument15 pagesRuscio, Alain - Dien Bien Phu Battle PDFork6821Pas encore d'évaluation
- 3AS - Projet 1 - Séq 1 - Points de Langue PDFDocument8 pages3AS - Projet 1 - Séq 1 - Points de Langue PDFLamia Lamy0% (1)
- Unpeupleetsonroi Francais Cinema 10aoutDocument6 pagesUnpeupleetsonroi Francais Cinema 10aoutNora MansourPas encore d'évaluation
- Histoire Lycee 1re Chap10Document16 pagesHistoire Lycee 1re Chap10bibi-dz 93Pas encore d'évaluation
- Lycée-Malek-ben-Nabi-hiam-1-1Document2 pagesLycée-Malek-ben-Nabi-hiam-1-1hiambenmoussaPas encore d'évaluation
- En Cours - Alpes Cote Italien Mise en Page 1Document9 pagesEn Cours - Alpes Cote Italien Mise en Page 1AlfasanguePas encore d'évaluation
- Boite Outils - Cinema Documentaire Et Point de Vue de Lauteur 2018Document23 pagesBoite Outils - Cinema Documentaire Et Point de Vue de Lauteur 2018aurorePas encore d'évaluation
- 20201020_NP_CFT_EMSOME_DFSHM_PRIX-INTERCULTURALITE6Document26 pages20201020_NP_CFT_EMSOME_DFSHM_PRIX-INTERCULTURALITE6inscriresitePas encore d'évaluation
- 01 02 Culture MilitaireDocument2 pages01 02 Culture MilitaireSylvain DumasPas encore d'évaluation
- Seconde Guerre Mondiale en EssonneDocument33 pagesSeconde Guerre Mondiale en EssonnegilPas encore d'évaluation
- Archivos Franceses FfiDocument71 pagesArchivos Franceses FfiJosé Manuel Pañeda RuizPas encore d'évaluation
- La Guerre Du Pacipfique A Commence en IndonesDocument317 pagesLa Guerre Du Pacipfique A Commence en IndonesKone AssanePas encore d'évaluation
- Soldats de France N°10Document33 pagesSoldats de France N°10GudulePas encore d'évaluation
- FRAD044 Fi Documents Figures 1939 1945Document3 pagesFRAD044 Fi Documents Figures 1939 1945Lionel BlockPas encore d'évaluation
- Sujet 3am 2017Document2 pagesSujet 3am 2017smatidjamilPas encore d'évaluation
- Le Cinéma FrançaisDocument114 pagesLe Cinéma FrançaisLe Cahier du FLEPas encore d'évaluation
- Histoire Du Cinéma SandrineDocument6 pagesHistoire Du Cinéma SandrineHafssa BouraisPas encore d'évaluation
- FRANOM - 00088 - Ark - 61561 - ns484kfw 2Document9 pagesFRANOM - 00088 - Ark - 61561 - ns484kfw 2wfrybxddxpPas encore d'évaluation
- PDF Brochure de L Armee Coloniale A L Armee NeocolonialeDocument74 pagesPDF Brochure de L Armee Coloniale A L Armee NeocolonialeAlexPas encore d'évaluation
- Le ClassicismeDocument2 pagesLe Classicismejismail100% (1)
- Pec Concomitante EsmsDocument1 pagePec Concomitante EsmsLaëtitia FraissePas encore d'évaluation
- Capsule 2&3 Du 19-12-2023 & 26-12-2023Document43 pagesCapsule 2&3 Du 19-12-2023 & 26-12-2023oussou othmanePas encore d'évaluation
- La Situation ComplexeDocument25 pagesLa Situation ComplexeArouna KonePas encore d'évaluation
- Maria Chapdelaine Dossier Pedagogique CollegialDocument35 pagesMaria Chapdelaine Dossier Pedagogique CollegialBridget LeonardPas encore d'évaluation
- EMC GASTRO-ENTÉROLOGIE Mise À Jour I 2020 PDFDocument50 pagesEMC GASTRO-ENTÉROLOGIE Mise À Jour I 2020 PDFHouda El Moufid100% (1)
- Traités Et Accords Concernant Le (... ) Rouard de bpt6k141228r PDFDocument145 pagesTraités Et Accords Concernant Le (... ) Rouard de bpt6k141228r PDFElamrani KarimPas encore d'évaluation
- Bota GeneralitesDocument58 pagesBota GeneralitesMellah RabhaPas encore d'évaluation
- MémoireDocument68 pagesMémoireamel mtrPas encore d'évaluation
- Convenances Spirituelles de La Voie Adab Et Tariq PDFDocument42 pagesConvenances Spirituelles de La Voie Adab Et Tariq PDFludovic1970Pas encore d'évaluation
- Mathematique FinanciereDocument26 pagesMathematique FinanciereYassin Manass100% (3)
- Boostrap ElazzabyDocument59 pagesBoostrap ElazzabyhassaniPas encore d'évaluation
- Le BachelierDocument642 pagesLe BachelierMr. AndroidPas encore d'évaluation
- Le Petit Forestier 1 2Document20 pagesLe Petit Forestier 1 2Anonymous 476I0KkRPas encore d'évaluation
- Programme Festival Rendez-Vous Contes !Document24 pagesProgramme Festival Rendez-Vous Contes !magali schaalPas encore d'évaluation
- CocaDocument5 pagesCocatheobromine100% (4)
- CHARLES HENRY Cercle ChromatiqueDocument170 pagesCHARLES HENRY Cercle ChromatiqueCarlos López CharlesPas encore d'évaluation
- 100 Mots Espagnol Pas À PasDocument2 pages100 Mots Espagnol Pas À PasDebPas encore d'évaluation
- 22-Comment Être Une Reine de Beauté - 17 ÉtapesDocument7 pages22-Comment Être Une Reine de Beauté - 17 ÉtapesRimelAsahilPas encore d'évaluation
- Financial & Lifestyle Magazine 03 - FR - of Puilaetco Dewaay Private BankersDocument86 pagesFinancial & Lifestyle Magazine 03 - FR - of Puilaetco Dewaay Private BankersDominiek VanwynsberghePas encore d'évaluation
- Memoire de Sortie 3Document123 pagesMemoire de Sortie 3Willy JasminPas encore d'évaluation
- Manuel Du Voyageur en Italie (... ) Giegler Jean-Pierre Bpt6k56988717Document712 pagesManuel Du Voyageur en Italie (... ) Giegler Jean-Pierre Bpt6k56988717mediacalabriaPas encore d'évaluation
- TD4 Régulation Zigler Broida TAP74 Rev3 18012021Document3 pagesTD4 Régulation Zigler Broida TAP74 Rev3 18012021Abderraouf HARCHEPas encore d'évaluation
- VesteDocument5 pagesVesteMaxPas encore d'évaluation
- Les Gisements Et Les Problèmes D'eauDocument9 pagesLes Gisements Et Les Problèmes D'eauGhislain Atche100% (4)
- Ebook - Les 7 Conseils Pour Réussir Son TOEICDocument10 pagesEbook - Les 7 Conseils Pour Réussir Son TOEICaigle d'orPas encore d'évaluation
- Exercices Pages 119,121,173Document2 pagesExercices Pages 119,121,173JudaPas encore d'évaluation