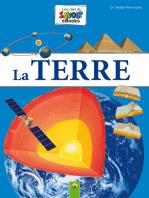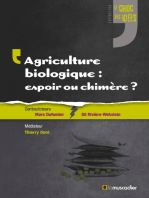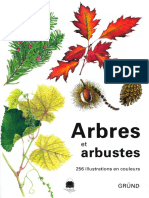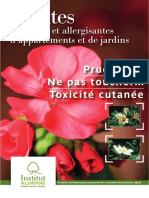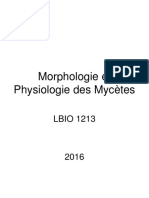Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Les Lichens
Les Lichens
Transféré par
CéliaKrTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Les Lichens
Les Lichens
Transféré par
CéliaKrDroits d'auteur :
Formats disponibles
Les Lichens
Les Lichens ont été considérés longtemps comme
formant un groupe distinct des Champignons et des
Algues, mais on sait depuis le milieu du XIXe siècle
qu'ils ne forment pas une unité systématique
particulière, mais correspondent à un ensemble de
végétaux où doivent rentrer tous les Champignons
vivant en société avec les Algues. Les Lichens forment,
du fait de la physionomie particulière que leur donne
cette association, un groupe spécial. Celui-ci est
essentiellement physiologique, mais très hétérogène au
point de vue morphologique, puisqu'il renferme à la fois
des Ascomycètes (Discomycètes et Pyrénomycètes) et
même quelques Basidiomycètes. Le Champignon est
toujours un représentant d'une de ces familles, mais il
ne se trouve que chez les Lichens, tandis que l'Algue
associée n'est pas exclusive aux Lichens et se retrouve
partout où les conditions extérieures peuvent favoriser
sa croissance et sa multiplication.
Le bénéfice réciproque de l'association de l'Algue et du
Champignon n'est pas identique pour les deux êtres.
L'association, indispensable au Champignon, ne l'est
généralement pas pour l'Algue qui peut exister sans lui.
De plus, aussi, une espèce d'Algue différente ne
correspond pas nécessairement à chaque groupe
("genre") de Lichen, mais la même Algue peut être
associée à des Lichens très dissemblables. De plus,
des Algues très différentes peuvent se rencontrer dans
des Lichens tout à fait voisins et le même Lichen peut
emprisonner en même temps plusieurs Algues de
genres et même d'ordres distincts. Pourtant certains
Lichens s'associent de préférence avec certaines
Algues.
Les Lichens sont des végétaux très répandus dans la
nature. On les rencontre partout, sur les pierres, le sol,
les arbres, les rochers; mais, quel que soit leur
substratum, c'est à l'abri du Soleil direct que le
développement de la plante est le meilleur. Les variétés
("espèces") sont d'autant plus nombreuses dans une
région que celle-ci fournira plus de forêts et de roches
granitiques. Elles affectionnent les endroits incultes où
les plantes à fleurs sont absentes. Mais elles
demandent des conditions de développement
favorables. Il leur faut de l'air, de la lumière, de la
chaleur et de l'humidité, surtout cette dernière. La
sécheresse arrête l'évolution et l'existence des Lichens,
mais ils renaissent à la vie après une longue période de
mort apparente.
Suivant leur aspect extérieur, on a divisé les Lichens en
gélatineux, foliacés, crustacés, fruticuleux. Dans le
premier cas, les filaments du Champignon se ramifient
dans la masse gélatineuse de l'Algue (Nostoc, par
exemple) sans en altérer beaucoup la forme. C'est
l'Algue qui imprime au Lichen son aspect extérieur.
Dans les autres cas, de beaucoup les plus fréquents, où
les cellules vertes de l'Algue sont emprisonnées dans le
tissu compact du Champignon, le Lichen peut s'étaler
en croûte peu épaisse, fixée au substratum dans les
cavités duquel il peut même s'enfoncer et disparaître
presque totalement (L. crustacé) ou bien former une
lame membraneuse, parfois de grandes dimensions
(Peltigera) à bords ondulés ou en lobes, étendus sur un
support auquel elle est fixée par des rhizomes plus ou
moins espacées (L. foliacé). Quant au Lichen
fruticuleux, c'est une petite arborescence dressée,
simple ou ramifiée, ressemblant à un buisson, fixée à
un support en un seul endroit et par une base étroite
(Usnea, Roccella). On peut quelquefois observer une
combinaison de ces différentes formes, comme dans la
Cladonia Rangiferina où le thalle demeure crustacé tant
qu'il siège sur les branches mortes, les écorces, mais
se développe en branches dressées et frutescentes dès
que le vent l'apporte sur la terre humide.
La morphologie et la reproduction des
Lichens
Le thalle des Lichens est dit homoeomère quand l'Algue
y prédomine sur le Champignon, ou quand les cellules
des deux thalles sont mélangées à peu près partout
dans les mêmes proportions; hétéromène, quand le
thalle présente sur sa section transversale plusieurs
couches, et que les cellules de l'Algue y sont localisées
en une couche dite verte, entre la couche dite corticale
et la couche médullaire. La couche verte n'existe chez
les Lichens foliacés que vers la face supérieure; chez
les Lichens fruticuleux elle existe tout autour. La
coloration des thalles est variable. Souvent elle est
terne et grisâtre, plus ou moins verte, quelquefois
blanchâtre, jaunâtre, orangée, brune, noirâtre. Le thalle
d'un Lichen est constitué par deux portions associées,
l'une incolore (thalle de Champignon), formée de
filaments cloisonnés et ramifiés, l'autre chlorophyllée
par le fait de la présence d'une Algue. Celle-ci peut être
une Cyanophycée, une Conferve ou une Protococcée,
une Palmellacée. Le Champignon est toujours un
Ascomycète, sauf le cas d'un Cora ou d'un
Rhipidonema qui sont des Basidiomycètes. L'Algue se
trouve dans la portion aérienne du thalle du Lichen. Les
cellules sont retenues dans un stroma de filaments
rameux enchevêtrés en un massif de
pseudoparenchyme. Le Champignon constitue à lui seul
la partie profonde du thalle, la partie enfoncée dans le
milieu nutritif, formée de filaments rameux isolés, le
mycélium.
Parmelia acetabulum (thalle).
Le principal mode de division des Lichens repose sur
l'aspect extérieur qu'offre le périthèce, tantôt largement
ouvert et étalant son hyménium en forme de coupe ou
de disque comme chez les Discomycètes (le Lichen est
alors dit gymnocarpe), tantôt ouvert seulement par un
pore terminal et gardant la forme d'une bouteille
immergée comme chez les Pyrénomycètes (Lichen
angiocarpe). La structure ne diffère pas de celle du
périthèce des Ascomycètes ordinaires et les cellules de
l'Algue associée y ont fort peu d'importance. Leur
couche dans un Lichen gymnocarpe se prolonge en
formant un rebord saillant autour du disque hyménial.
Dans un Lichen angiocarpe, elles peuvent pénétrer
entre les asques et être poussées jusque dans la cavité
du périthèce. Au point de vue de la formation
proprement dite du périthèce, on rencontre dans les
Lichens les divers modes de production déjà observés
pour les autres Ascomycètes. Le plus souvent, elle
s'opère avec une différenciation précoce de la branche
ascogène. Les asques claviformes ressemblent aussi
dans leurs lignes principales à ceux des Discomycètes
et des Pyrénomycètes. Leur membrane épaisse peut se
gonfler et se colorer en bleu par l'iode. Les spores,
généralement par huit, peuvent varier de nombre, et
aller de deux à trois (Pertusaria) à cent et même
davantage (Bactrospora). Simples ou cloisonnées, elles
ont une membrane externe ordinairement lisse et
diversement colorée. A la maturité, elles sont
violemment projetées au loin à travers une déchirure de
la paroi de l'asque, et germent en poussant un ou
plusieurs tubes, suivant qu'elles sont simples ou
cloisonnées. L'iode colore en bleu les spores d'un grand
nombre de variétés appartenant aux Graphis, etc., en
rose ou en lilas celles du Trypethelium ciberinum ou du
moins leur épispore.
Les Lichens peuvent aussi se reproduire par des
conidies naissant à l'intérieur de bouteilles immergées
dans le thalle et s'ouvrant en dehors par un pore
terminal. Elles ont la forme de petits bâtonnets germant
seulement dans un milieu nutritif approprié ou de corps
ovales ou arrondis, munis d'une réserve nutritive et
pouvant germer dans l'eau pure. Enfin la multiplication
des Lichens peut se faire par des corps particuliers
nommés sorédies, constitués par une ou plusieurs
cellules vertes de l'Algue nourricière, entourées de
toutes parts par une couche de filaments du
Champignon et pouvant, une fois détachées du thalle,
en produire un nouveau.
Sphaerophoron coralloides (thalle).
La symbiose
Le Champignon et l'Algue associés dans le Lichen ont
l'un sur l'autre une influence réciproque. Dans le contact
intérieur des cellules vertes de l'Algue, entourées par
les filaments du Champignon ou même pénétrées par
eux, il s'opère des échanges osmotiques, nutritifs,
réciproques. Le Champignon emprunte à l'Algue une
portion des substances hydrocarbonées qu'elle fabrique
sous l'influence de sa chlorophylle et de la lumière, et lui
rend en retour des matières azotées et albuminoïdes
qu'il produit plus vite qu'elle avec ces mêmes hydrates
de carbone. Le bénéfice, écrivait déjà Van Tieghem
, est assurément beaucoup plus grand pour le
Champignon que pour l'Algue, mais celle-ci, comme
compensation, trouve dans le Champignon un abri
contre la sécheresse, la pluie, le vent. Il y a donc bien
association et bénéfice réciproque; un ménage, un
consortium. C'est d'ailleurs grâce à cette union qu'on
peut considérer les Lichens comme les véritables
créateurs du sol. Une roche nue, un récif émergé, une
pierre extraite de la carrière ne sauraient fournir les
moyens d'existence aux végétaux transportés à leur
surface. Une graine de Phanérogame, une spore de
Mousse n'y sauraient se développer, tandis que
certaines Algues inférieures peuvent vivre à leur
surface, aux seuls dépens de la lumière et de l'humidité,
jusqu'à ce que certains Champignons germant sur elles
viennent les envelopper, les protéger et avec leurs
filaments les fixer à la roche qu'ils désorganisent en y
puisant les sels nécessaires à la synthèse rapide des
matières albuminoïdes, à l'aide des hydrates de
carbone (Van Tieghem). Les portions de roche
désorganisées et les débris des plantes primitives
formeront une couche sur laquelle germeront les
Bryophytes, et plus tard les végétaux à fleurs.
Cetraria islandica.
Van Tieghem a réuni dans le tableau ci-après un certain
nombre de ces associations :
-
Algues Lichens
Cyanophycées Ephebe, Spitonema, Potychidium.
Lichina Racoblenna.
Stigonémées Heppia, Porocyphus, Pannaria.
Rivulariées Coltema, Leptogium, Pannaria, Peltigera.
Scytonémées Omphalaria,Euchylium,Phylliscum.
Nostacées
Chroococcées
Chlororophycées
Beaucoup de Lichens crustacés (Endocarpon, etc.), foliacés
Protococcées et (Physcia, etc.) ou fructiculeux (Cladonia, Evernia, Usnea,
Palmellacées Anaptychia, etc.)
(Cystococcus,
Pleurococcus,
Protococcus, etc.) Cystocoleus, Coegonium, Graphis, Verrucaria, Roccella.
Confervacées
(Chroolepus, etc.) Opegrapha filicina.
Coléochetées
(Phyllactidium).
La démonstration la plus évidente de la constitution double des
Lichens repose sur la possibilité que l'on a d'en effectuer
directement la synthèse sur de l'argile humide. On obtient, en
suivant une spore de Lichen près d'une Algue et en choisissant
des variétés à développement assez rapide, des thalles de
Lichens qui ont pu parvenir à l'état adulte et produire leurs
bouteilles à conidies linéaires au bout de quatre à six semaines,
leurs périthèces mûrs au bout de quatre à cinq mois (Van
Tieghem). Inversement, on peut facilement produire l'analyse du
Lichen et, en détruisant l'association, rendre à l'Algue, avec sa
liberté, sa forme ordinaire et son mode de végétation normal,
tandis que le Champignon disparaît.
Roccella tinctoria.
La systématique des Lichens
On connaît environ 20 000 variétés de Lichens. Les nombreux
groupes que l'on y constitue se répartissent en trois divisions
principales. L'une, la moins importante, comprend les Lichens
Basidiomycètes (Cora, Rhipidonema, groupe appartenant à la
famille des Hyménomycètes et à la tribu desThéléphorés, voisins
des Stereum). Les deux autres (Lichens Ascomycètes) sont les
Lichens Discomycètes (Gymnocarpes) et les Lichens
Pyrénomycètes (Angiocarpes).
Ces deux subdivisions se décomposent elles-mêmes en tribus.
d'après la conformation du thalle. Voici le classement indiqué par
Van Tieghem :
1° Thalle homoeomère, non gélatineux, fruticuleux par la
ramification de l'Algue : Coenogoniurn, Cystocoleus
(Discomycètes); Ephebe, Ephebella (Pyrénomycètes);
2° Thalle homœomère, gélatineux : Psorotrichia, Omphalaria,
Collema, etc. (Disc.); Lichina, Obryzum (Pyr.);
3° Thalle hétéromère, crustacé : Graphis, Arthonia, Calycium,
Lecidea, Biatora, Lecanora, etc. (Disc.); Pertusaria, Verrucaria,
etc. (Pyr.);
4° Thalle hétéromère, foliacé : Parmelia, Sticta, Imbricaria,
Peltigera, etc. (Disc.); Endocarpon (Pyr.);
5° Thalle hétéromère, fruticuleux : Cetraria, Usnea, Roccella,
Cladonia (Disc.); Sphaerophoron (Pyr.).
Un certain nombre de Lichens ont été traditionnellement
recherchés comme plantes tinctoriales. Tels leRoccella tinctoria,
le Parmelia pallescens fournissant l'orseille. D'autres Lichens
fournissent ou ont fourni des ressources alimentaires en certains
pays : le Lichen d'Islande (Cetraria Islandica), avec le thalle
duquel on préparait une farine spéciale; le Parmelia esculenta
(flore du Sahara ), correspondant, à ce qu'on pense, à la manne
des Hébreux, pouvant une fois desséché se détacher sous les
efforts du vent, retomber plus loin sous forme de pluie et
reprendre vie très facilement; le Cladonia rangiferina, pâturage
excellent pour les rennes qui le découvrent sous la neige; le
Pulmonaire du Chêne (Sticta pulmonaria), contenant un principe
amer et pouvant remplacer le houblon dans la fabrication de la
bière. D'autres Lichens enfin ont des usages thérapeutiques.
(Henri Fournier).
Vous aimerez peut-être aussi
- L'écosystème VergerDocument2 pagesL'écosystème VergerGeorgios GropetisPas encore d'évaluation
- Flore Vegetation MediterraneennesDocument74 pagesFlore Vegetation Mediterraneenneshamid_touhamiPas encore d'évaluation
- Agriculture biologique : espoir ou chimère ?: Un débat captivant sur un sujet contemporainD'EverandAgriculture biologique : espoir ou chimère ?: Un débat captivant sur un sujet contemporainPas encore d'évaluation
- L1 Cours - Botanique 3Document37 pagesL1 Cours - Botanique 3Julie DelPas encore d'évaluation
- Cours Ecologie Marine L3 AquacultureDocument88 pagesCours Ecologie Marine L3 AquacultureRifat BALLOTPas encore d'évaluation
- Ecologie Génerale L2 Ecologie Et EnvironnementDocument14 pagesEcologie Génerale L2 Ecologie Et EnvironnementMebtouche ZianePas encore d'évaluation
- BotaniqueDocument4 pagesBotaniqueHtnb0Pas encore d'évaluation
- Age of Sigmar Warcry Hérauts de La DestructionDocument68 pagesAge of Sigmar Warcry Hérauts de La DestructionYukikoSchyzoPas encore d'évaluation
- OrdresDocument62 pagesOrdresblueskyedPas encore d'évaluation
- Chap III Les Grands Biomes TerrestresDocument6 pagesChap III Les Grands Biomes Terrestresfilms et séries en français JL LIKPas encore d'évaluation
- Tpe ForetDocument21 pagesTpe Foretmalik0075Pas encore d'évaluation
- La BiomécaniqueDocument13 pagesLa BiomécaniqueMeriem EL Hàmidii100% (1)
- Vetvicka Vaclav - Arbres Et ArbustesDocument308 pagesVetvicka Vaclav - Arbres Et Arbustesgregory berlemontPas encore d'évaluation
- Guide Recolte Algues 29122013Document54 pagesGuide Recolte Algues 29122013CamilleJérémie Maurice100% (1)
- Classification Des Invertébrés Et VertébrésDocument4 pagesClassification Des Invertébrés Et VertébrésGurugu GuruguPas encore d'évaluation
- Morphogenese VegetaleDocument81 pagesMorphogenese VegetaleAbdelbasset Boubakri100% (1)
- Livre Physio 2023Document49 pagesLivre Physio 2023talakibadebalaki56Pas encore d'évaluation
- Plantes Irritantes & Allergisantes-150dpiDocument44 pagesPlantes Irritantes & Allergisantes-150dpimoulinPas encore d'évaluation
- TP Mammifères DIAPO (2018)Document52 pagesTP Mammifères DIAPO (2018)Bouba SeckPas encore d'évaluation
- Le Systeme Solaire Ce2Document12 pagesLe Systeme Solaire Ce2louveval1976Pas encore d'évaluation
- Cyanobacterie 101 Par Marie-Andree FalluDocument38 pagesCyanobacterie 101 Par Marie-Andree FalluSamjer TotoPas encore d'évaluation
- La Planète Terre Enseignement ScientifiqueDocument15 pagesLa Planète Terre Enseignement ScientifiqueMalak El jadiriPas encore d'évaluation
- Fiche Cours MedisupDocument37 pagesFiche Cours Medisupdudeman67% (3)
- 2nde G2 - La Planète Terre.Document9 pages2nde G2 - La Planète Terre.MK MOSKOUPas encore d'évaluation
- LBIO1213 - Version 2016Document256 pagesLBIO1213 - Version 2016warda MaPas encore d'évaluation
- Le guide de la flore de Tlemcen (Algérie): Tome IID'EverandLe guide de la flore de Tlemcen (Algérie): Tome IIPas encore d'évaluation
- AcarologieDocument20 pagesAcarologieMed Ben GhafforPas encore d'évaluation
- AlguesDocument53 pagesAlguesSolotahiry Rabetsira100% (1)
- Classification Algues PDFDocument9 pagesClassification Algues PDFnehemie nway50% (2)
- Étude Des Migrations de Papillons en FranceDocument5 pagesÉtude Des Migrations de Papillons en FranceParc national de Port-CrosPas encore d'évaluation
- 2.les Forets Tropic Ales PDFDocument10 pages2.les Forets Tropic Ales PDFceft-reunionPas encore d'évaluation
- 2 Arthropodes Arachnides MyriapodesDocument14 pages2 Arthropodes Arachnides Myriapodesmed_yacine100% (1)
- Lutte Biologique Intégrée: Plaquette de Présentation (Aficar)Document2 pagesLutte Biologique Intégrée: Plaquette de Présentation (Aficar)benefred100% (1)
- CoursSVT2 2013Document176 pagesCoursSVT2 2013Mustapha ElamraniPas encore d'évaluation
- Cnidaires PlanchesDocument12 pagesCnidaires PlanchesNabil holmesPas encore d'évaluation
- Acarien Vert Du Manioc 2018Document4 pagesAcarien Vert Du Manioc 2018chadlikamal1315Pas encore d'évaluation
- Champignon Devoir JosephDocument7 pagesChampignon Devoir Josephnathan mutonji kanongePas encore d'évaluation
- EAC - Ecologie Animale Et Cynégétique PDFDocument4 pagesEAC - Ecologie Animale Et Cynégétique PDFKadidiatou BahPas encore d'évaluation
- GLOSSAIREDocument6 pagesGLOSSAIREnothingtodoherePas encore d'évaluation
- Pathologies ParasitairesDocument23 pagesPathologies ParasitairesNadir NanoPas encore d'évaluation
- Mantella Guide FrenchDocument10 pagesMantella Guide FrenchOlga JovanovicPas encore d'évaluation
- CompagnonnageDocument29 pagesCompagnonnageothman berraqPas encore d'évaluation
- ChampignonDocument10 pagesChampignonTakieddine DerouichePas encore d'évaluation
- Chapitre 1 Le Materiel GenetiqueDocument14 pagesChapitre 1 Le Materiel GenetiqueAomine HaPas encore d'évaluation
- Embranchement Des CnidosporidiesDocument2 pagesEmbranchement Des CnidosporidiesNabil holmes67% (3)
- SynécologieDocument17 pagesSynécologieimane imPas encore d'évaluation
- Les aires protégées terrestres de Madagascar: leur histoire, description et biota, tome 1: IntroductionD'EverandLes aires protégées terrestres de Madagascar: leur histoire, description et biota, tome 1: IntroductionPas encore d'évaluation
- Bachiri Arrticle PDFDocument36 pagesBachiri Arrticle PDFechchgadda100% (2)
- Ecologie-L1 GAMDocument96 pagesEcologie-L1 GAMABDOULAYE TYANOPas encore d'évaluation
- Acacia Tortilis Ecologie TunisieDocument251 pagesAcacia Tortilis Ecologie Tunisiezakaria boualPas encore d'évaluation
- Cours 3 MycologieDocument23 pagesCours 3 Mycologieromaissa benchadiPas encore d'évaluation
- La Faune Du Sol Partie 1Document18 pagesLa Faune Du Sol Partie 1Ahmed HamdaouiPas encore d'évaluation
- Meddour - 1992 - Regeneration Naturelle de Cedrus Atlantica Man. Et de Divers Pins Après Incendie Dans L'arboretum de Meurdja (Algérie)Document13 pagesMeddour - 1992 - Regeneration Naturelle de Cedrus Atlantica Man. Et de Divers Pins Après Incendie Dans L'arboretum de Meurdja (Algérie)rachi_medPas encore d'évaluation
- Classe Des ArachnidesDocument9 pagesClasse Des ArachnidesssPas encore d'évaluation
- 11 Fiche Milieux Aquatiques WebDocument4 pages11 Fiche Milieux Aquatiques WebMarwa sbPas encore d'évaluation
- GrainesDocument41 pagesGrainesPaoloRoccaPas encore d'évaluation
- Cours 2 Cnidaires 2021Document9 pagesCours 2 Cnidaires 2021jackPas encore d'évaluation
- Ecoregion MadagascarDocument25 pagesEcoregion Madagascardiana vizcaino100% (1)
- Ravageurs Des Cultures 2017-20181Document59 pagesRavageurs Des Cultures 2017-20181Souzak MelPas encore d'évaluation
- Mémoire Chiheb 2014Document83 pagesMémoire Chiheb 2014alaaloula67% (3)
- Les Nitraria, Plantes Utiles Des Déserts SalésDocument8 pagesLes Nitraria, Plantes Utiles Des Déserts SalésAnonymous e34JgdPqoDPas encore d'évaluation
- Anatomie Chirurgicale de La Région AnaleDocument7 pagesAnatomie Chirurgicale de La Région AnaleIrina FloreaPas encore d'évaluation
- Contribution La Définition Des Types de Végétation Dans Les Régions Tropicales (Exemple de Madagascar)Document25 pagesContribution La Définition Des Types de Végétation Dans Les Régions Tropicales (Exemple de Madagascar)emmaPas encore d'évaluation
- Pnds VascDocument106 pagesPnds VascSara GossPas encore d'évaluation
- BestiaireDocument16 pagesBestiaireSylvain DurandPas encore d'évaluation
- French 5ap22 1trim2Document1 pageFrench 5ap22 1trim2Wassim MelinaPas encore d'évaluation
- Hadef SawsenDocument135 pagesHadef SawsenKenz L'AïdPas encore d'évaluation
- Les AntibiotiquesDocument5 pagesLes Antibiotiqueshind el hamriPas encore d'évaluation
- 2016 Koffi YvonneDocument215 pages2016 Koffi YvonneBadr GourmahPas encore d'évaluation
- Alimentatio ExerciceeDocument1 pageAlimentatio ExerciceeAbdeladim EnnadiPas encore d'évaluation
- Exercice N°5 TP-TD Exploration Fonctionnelle Des MétabolismesDocument3 pagesExercice N°5 TP-TD Exploration Fonctionnelle Des Métabolismesmoi moiPas encore d'évaluation
- Groupe Sanguin PDFDocument6 pagesGroupe Sanguin PDFMery milo100% (1)
- 2007 Enold FRDocument103 pages2007 Enold FRWalidBenHamidouchePas encore d'évaluation
- Isaac Assimov - Le Billard DarwinienDocument6 pagesIsaac Assimov - Le Billard DarwinienYounes BarakaPas encore d'évaluation
- CoursDocument16 pagesCoursFadhila MahmoudiPas encore d'évaluation
- Présentation Power Point: Pratiques Paysannes de Gestion Des Semences Et Diversité Génétique Du Haricot (Phaseolus Vulgaris L) À Cayes-Jacmel, Commune Du Département Du Sud-Est, HaïtiDocument29 pagesPrésentation Power Point: Pratiques Paysannes de Gestion Des Semences Et Diversité Génétique Du Haricot (Phaseolus Vulgaris L) À Cayes-Jacmel, Commune Du Département Du Sud-Est, HaïtiResponsable AAEE BainetPas encore d'évaluation
- Taxonomie PPT PliableDocument20 pagesTaxonomie PPT PliableScribdTranslationsPas encore d'évaluation
- Papillomatose LaryngéeDocument5 pagesPapillomatose Laryngéeadelmiringui2Pas encore d'évaluation
- Chimpanzés de L'afrique de L'ouestDocument240 pagesChimpanzés de L'afrique de L'ouestkermitooPas encore d'évaluation
- FR PU21012 FRDocument41 pagesFR PU21012 FRKhalid AmellalPas encore d'évaluation
- Architecture Et Système Constructif: Cas Des Systèmes de TenségritéDocument216 pagesArchitecture Et Système Constructif: Cas Des Systèmes de TenségritéVinicius RaducanuPas encore d'évaluation
- SVT 1ère D - L4 - LA TRANSMISSION DUN CARACTERE HEREDITAIREDocument10 pagesSVT 1ère D - L4 - LA TRANSMISSION DUN CARACTERE HEREDITAIRENamoryPas encore d'évaluation
- Arthrites RéactionnellesDocument23 pagesArthrites RéactionnellesNadia BordaşPas encore d'évaluation
- Mecanismes de Resistances Aux AntibiotiquesDocument13 pagesMecanismes de Resistances Aux AntibiotiquesSara Ahmed Ouamer100% (1)
- Ajol File Journals - 490 - Articles - 233697 - Submission - Proof - 233697 5785 565946 1 10 20221010Document11 pagesAjol File Journals - 490 - Articles - 233697 - Submission - Proof - 233697 5785 565946 1 10 20221010Losséni DaoPas encore d'évaluation
- Bulletin de Lille, 1916.04publié Sous Le Contrôle de L'autorité Allemande by AnonymousDocument83 pagesBulletin de Lille, 1916.04publié Sous Le Contrôle de L'autorité Allemande by AnonymousGutenberg.org100% (2)
- Activite Antioxydante Des Extraits Des Composes PhenoliquesDocument174 pagesActivite Antioxydante Des Extraits Des Composes PhenoliquesDoudou Sami100% (2)