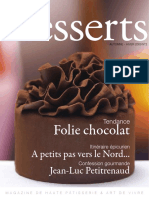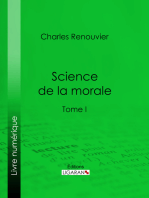Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
GAR08
GAR08
Transféré par
Merlin Saurik0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
4 vues3 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
4 vues3 pagesGAR08
GAR08
Transféré par
Merlin SaurikDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 3
La modalisation dans les controverses, 2015
Les différentes valeurs modales
Les quelques exemples que nous avons jusqu’alors envisagés montrent que les valeurs
modales peuvent être très nombreuses. Afin de traiter cette variété, quelques
considérations développées dans le cadre des travaux logiciens sont nécessaires.
Nous centrant en effet jusqu’alors sur l’approche linguistique de la modalité, nous avons
quelque peu négligé son origine logique que l’on trouve dans les travaux d’Aristote et sa
logique modale dont nous rappelons seulement quelques éléments de base. Notons que
les approches logiques de la modalité ne se limitent pas aux travaux aristotéliciens qui
offrent une conception restreinte de la modalité.
Les modalités logiques
Les modalités logiques expriment un jugement qui porte sur la valeur de vérité, vérité
ou fausseté, d’une proposition dont le rapport au réel peut être :
nécessaire ou absolument vrai : « ce qui ne peut pas ne pas être ».
possible ou ni vrai, ni faux : « ce qui peut être »,
impossible ou absolument faux : « ce qui ne peut pas être »,
contingent ou vrai et faux à la fois : « ce qui peut ne pas être ».
On identifie ainsi les 4 valeurs modales du carré logique aristotélicien connues sous le
nom de modalités aléthiques ou encore de modalités ontiques qui portent sur la
relation existentielle de la proposition à la réalité perçue.
Ces valeurs modales du vrai/faux qualifient par exemple dans la proposition « l’homme est
mortel » le lien entre « être homme » et « être mortel » en termes de vérité/fausseté ou
de validité.
On utilise pour rendre compte de la valeur modale d’une proposition un énoncé composé
d’une subordonnée complétive introduite par une unité modale : « Il est
possible/impossible/certain….que P » et des opérateurs modaux.
Les valeurs modales entretiennent des relations logiques figurées sur le schéma par les
lignes reliant chaque valeur. Chaque valeur modale est donc définie, conceptualisée, en
relation avec les autres valeurs à l’intérieur du système modal ainsi constitué.
Un exemple de carré logique vous est présenté sur le lien suivant :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carr%C3%A9_logique
Les 4 modalités ainsi identifiées par Aristote se retrouvent dans les différentes théories
linguistiques qui les augmentent d’un plus ou moins grands nombre d’autres valeurs.
Elles peuvent notamment être complétées en mettant en relation les apports de la logique
classique avec ceux des linguistes notamment énonciativistes qui imposent de relier la
notion de modalité à la notion de sujet et d’interaction.
Alors la notion de vérité, jusqu’alors impersonnelle, devient plus complexe, elle n’est plus
exclusivement déterminée par un rapport absolu au réel perçu, mais, potentiellement, dans
d’autres cas, par l’attitude et le point de vue du sujet.
Nathalie GARRIC, Université de Nantes
La modalisation dans les controverses, 2015
Comparons par exemple :
(1) La terre est ronde.
(2) Il a certainement beaucoup travaillé.
(3) Nous devons voter.
Le jugement de vérité ou de fausseté est différent selon ces énoncés et de nouvelles
valeurs modales sont identifiées.
Alors qu’en (1), la vérité de la proposition s’impose objectivement de l’extérieur,
elle est validée par le réel ou donnée comme telle ;
en (2), elle est dépendante du locuteur, de sa subjectivité propre, qui a
connaissance d’une charge de travail fournie,
et en (3), elle est également relative, mais indépendante de l’évaluation singulière
d’un locuteur pour convoquer un jugement collectif imposé par une institution.
Selon ce cheminement, la modalité aléthique du nécessaire en 1 qui est mise en
relation en 2 avec le sujet devient dépendante du savoir et de la croyance d’un locuteur,
elle exprime une certitude qui relève de la modalité dite épistémique. En 3, la nécessité
exprimée est construite par l’existence de l’institution de vote, elle relève de l’obligation et
appartient à la modalité dite déontique.
Gosselin (2010) afin de rendre compte de ces distinctions introduit la notion d’instance
de validation à rapprocher du sujet modal de Bally.
Voici son commentaire des trois énoncés suivants :
1a. Il pleut.
1b. Cette voiture coûte très chère.
1c. Il est interdit de fumer dans les lieux publics.
« Ordinairement, un énoncé assertif présente une vérité objective (i.e. indépendante de
tout jugement ; ex. 1a), subjective mais collective (i.e. validée par un ensemble de sujets
; ex. 1b), ou encore une vérité pour une institution particulière (i.e. validée par un système
de conventions ; ex. 1c) ».
L’auteur propose de distinguer trois agents vérificateurs (Berrendonner 1981 : 59) :
L’univers référentiel, l’ordre des choses ou encore « le fantôme de la vérité »
L’opinion commune, la doxa anonyme
Le locuteur et les autres participants de la conversation (JE, TU, IL).
Les modalités objectives aléthiques ou ontiques relèvent du premier agent qui se
conçoit comme un tiers acteur dont la mise en scène vise l’objectivité du jugement formulé
par la construction d’une espèce d’évidence qui relève des lois de la nature.
Les deux autres types de modalités sont subjectifs, elles peuvent mettre en jeu des valeurs
psychologiques et/ou affectives diverses en fonction desquelles elles définissent plusieurs
valeurs :
Les modalités épistémiques concernent la connaissance du monde, elles
marquent l’expression d’une croyance ou d’une opinion. Le sujet réalise un
jugement subjectif et exprime des croyances.
Les modalités appréciatives relèvent du jugement émotionnel/affectif de type
esthétique (beau/laid) ou pragmatique (utile/inutile) par exemple. Le sujet réalise
un jugement subjectif de valeur qui fait que quelque chose est désirable ou
indésirable, espéré ou repoussé de son point de vue.
Les modalités déontiques se réfèrent à un ordre moral ou social pour exprimer
ce qui doit être (obligation) ou ce qui peut être (permission). Elles sont de nature
prescriptives et exercent des contraintes dont l’origine peut être institutionnelle, les
droits et les devoirs, ou intersubjective dans un contexte particulier avec ses lois
propres qui légitime la contrainte.
Nathalie GARRIC, Université de Nantes
La modalisation dans les controverses, 2015
Les modalités volitives expriment un jugement de vérité en termes de volonté.
Le sujet réalise un jugement subjectif et exprime des désirs, des souhaits, de voir
s’accomplir quelque chose.
Les modalités axiologiques impliquent un jugement de valeur, positif ou négatif,
par rapport à une norme, à des conventions édictées par nos institutions. Le sujet
réalise un jugement qui est moralement estimable ou non, louable ou blâmable.
Nathalie GARRIC, Université de Nantes
Vous aimerez peut-être aussi
- 7 Erreurs Financières Que Les Riches Ne Commettent JamaisDocument9 pages7 Erreurs Financières Que Les Riches Ne Commettent JamaisCherif Sylla100% (2)
- Le Positionnement ÉpistémologiqueDocument34 pagesLe Positionnement ÉpistémologiqueKawtar Ka100% (7)
- La Santé MentaleDocument23 pagesLa Santé MentaleRachid DarouichiPas encore d'évaluation
- 2-Desserts 2 CompressedDocument40 pages2-Desserts 2 CompressedCwt ChanPas encore d'évaluation
- Pont RoulantDocument57 pagesPont RoulantHatim Ettaib100% (3)
- Résumé Méthodologie Et Épistémologie de La RechercheDocument20 pagesRésumé Méthodologie Et Épistémologie de La RechercheYassine BoudiPas encore d'évaluation
- 268 Cahiers Du RSA 2010 06Document76 pages268 Cahiers Du RSA 2010 06Moi le Sage100% (1)
- Généralités Sur Les CompresseursDocument20 pagesGénéralités Sur Les CompresseursRaouf BelamriPas encore d'évaluation
- 11 Tutoriel Dinitiation La Demarche Bim en Projet U42 Bts BatimentDocument44 pages11 Tutoriel Dinitiation La Demarche Bim en Projet U42 Bts BatimentGHG100% (1)
- Cours D Éthique Chrétienne Et DéontologieDocument48 pagesCours D Éthique Chrétienne Et DéontologieisraelmobiahPas encore d'évaluation
- Ms Fra 210091Document182 pagesMs Fra 210091Ines HMPas encore d'évaluation
- Méthodologie de Recherche en Sciences de GestiionDocument43 pagesMéthodologie de Recherche en Sciences de GestiionKamal100% (2)
- Amélioration Et Fiabilisation de La Ligne CDCDocument88 pagesAmélioration Et Fiabilisation de La Ligne CDChamza elgarragPas encore d'évaluation
- Resumã© Ouvrage Alain Thietart Methodologie de RechercheDocument55 pagesResumã© Ouvrage Alain Thietart Methodologie de RechercheMariam Nassiri.100% (1)
- En 12681 PDFDocument22 pagesEn 12681 PDFImane KhammouriPas encore d'évaluation
- Charaudeau DiscursDocument12 pagesCharaudeau DiscursMihai VacariuPas encore d'évaluation
- Ress 188Document145 pagesRess 188Meryem RifiPas encore d'évaluation
- Durkheim - Jugements de Valeurs Et Jugements de RealitéDocument13 pagesDurkheim - Jugements de Valeurs Et Jugements de RealitéJulio Santos FilhoPas encore d'évaluation
- CHAPITRE V Enjeux Des Valeurs, MoraleDocument3 pagesCHAPITRE V Enjeux Des Valeurs, MoraleRaphael RAKOTOARIVELOPas encore d'évaluation
- Ethique 2016Document41 pagesEthique 2016Clément GlencoePas encore d'évaluation
- Petev - 1994 - Jugement Juridique Et Jugement MoralDocument8 pagesPetev - 1994 - Jugement Juridique Et Jugement MoralMikeJWalkerPas encore d'évaluation
- Ethique Et MoraleDocument14 pagesEthique Et MoraleGorzo StefaniaPas encore d'évaluation
- Quelles ApprocheDocument17 pagesQuelles ApprocheAmj91Pas encore d'évaluation
- Full Download La Philosophie Morale 4Th Edition Ruwen Ogien Online Full Chapter PDFDocument69 pagesFull Download La Philosophie Morale 4Th Edition Ruwen Ogien Online Full Chapter PDFlyddecyad291100% (2)
- Éthique Et Performance Force de VenteDocument23 pagesÉthique Et Performance Force de VentemissetafraoutPas encore d'évaluation
- Ethique Et MoraleDocument9 pagesEthique Et Moraleshiny_takamiyaPas encore d'évaluation
- LA PHILOSOPHIE MORAL Monique Canto Sperber Ruwen OgienDocument11 pagesLA PHILOSOPHIE MORAL Monique Canto Sperber Ruwen OgienricardoangisPas encore d'évaluation
- HDR Ipb HalDocument297 pagesHDR Ipb HalLouis Yannick EssombaPas encore d'évaluation
- Valeur - Principe - Vertu 3 Patrice PoingtDocument3 pagesValeur - Principe - Vertu 3 Patrice Poingtfidele brouPas encore d'évaluation
- Capture D'écran, Le 2023-10-30 À 17.52.57Document19 pagesCapture D'écran, Le 2023-10-30 À 17.52.57quickdraw199628Pas encore d'évaluation
- Discours Manipulation - Texte LyonDocument14 pagesDiscours Manipulation - Texte LyonCharaf Adam LaasselPas encore d'évaluation
- L'argumentation Dans Une Problématique D'influence: Argumentation Et Analyse Du DiscoursDocument17 pagesL'argumentation Dans Une Problématique D'influence: Argumentation Et Analyse Du DiscoursHakim AjaidiPas encore d'évaluation
- Egp D 03 Theories Ethique 2Document29 pagesEgp D 03 Theories Ethique 2salimarifia42Pas encore d'évaluation
- Cours - Concepts-Types de Jugements-Argumentation - FASTEF - 11-2020Document13 pagesCours - Concepts-Types de Jugements-Argumentation - FASTEF - 11-2020Mamadou Moustapha SarrPas encore d'évaluation
- Cointe 2017 JugementDocument29 pagesCointe 2017 JugementNicolas CointePas encore d'évaluation
- Charolles 1980 Formes Dir Et Indir de LargumentationDocument38 pagesCharolles 1980 Formes Dir Et Indir de LargumentationMaria Albertina TakahashiPas encore d'évaluation
- Chap1 EthiqueDocument33 pagesChap1 EthiqueDenisco NkemgnePas encore d'évaluation
- Texte 1, 2, 3, 4 Michel Foucault Dits Et ÉcritsDocument7 pagesTexte 1, 2, 3, 4 Michel Foucault Dits Et ÉcritsAlix PhanidPas encore d'évaluation
- Version Final IbourkDocument7 pagesVersion Final Ibourkstrong girlPas encore d'évaluation
- Extraits de CopiesDocument3 pagesExtraits de CopiesritchiebellonsainanaPas encore d'évaluation
- A Quoi Sert D'analyse Le Discours Politique ?, Charaudeau, 2002Document12 pagesA Quoi Sert D'analyse Le Discours Politique ?, Charaudeau, 2002DiegoPas encore d'évaluation
- Cours D'ethique Et DeontologieDocument4 pagesCours D'ethique Et DeontologieMilord Longo0% (1)
- Enj 05 Theories EthiqueDocument33 pagesEnj 05 Theories Ethiqueidris.lehtihetPas encore d'évaluation
- Les Modalités - CoursDocument4 pagesLes Modalités - CoursLoukman Guehria100% (1)
- L'éthique Située de l'IA Et Ses ControversesDocument13 pagesL'éthique Située de l'IA Et Ses Controversesfhard5369Pas encore d'évaluation
- Les Théories de La Justice: To Cite This VersionDocument38 pagesLes Théories de La Justice: To Cite This VersionRazanadrasolo FredoPas encore d'évaluation
- TD de Théories Sociologiques Et Sujets SpéciauxDocument4 pagesTD de Théories Sociologiques Et Sujets SpéciauxJanvier NkemePas encore d'évaluation
- Fausse Route: Le Chemin Vers Le Pluralisme Politique Passe-T-Il Par Le Pluralisme Axiologique ?Document13 pagesFausse Route: Le Chemin Vers Le Pluralisme Politique Passe-T-Il Par Le Pluralisme Axiologique ?mourad zegguirPas encore d'évaluation
- Copie de E1B-HK3-S1A-2022-2023-Repères-notionnelsDocument11 pagesCopie de E1B-HK3-S1A-2022-2023-Repères-notionnelsjy.16sbPas encore d'évaluation
- Philosophie Et ScienceDocument8 pagesPhilosophie Et Sciencecheikhounadiopo59Pas encore d'évaluation
- Cours Sur Les ValeursDocument36 pagesCours Sur Les Valeurscalebjulius07Pas encore d'évaluation
- Introduction GeneraleDocument47 pagesIntroduction GeneraleDominique KabambaPas encore d'évaluation
- Disertation CorrigerDocument10 pagesDisertation CorrigerMTPas encore d'évaluation
- La Naturialité Du BienDocument31 pagesLa Naturialité Du BienLe Comte de BronzePas encore d'évaluation
- 2020 Enquete Egalite Etudiants Doc PrincipalDocument87 pages2020 Enquete Egalite Etudiants Doc PrincipalVictoria LevitchiPas encore d'évaluation
- Epis Temo LogieDocument3 pagesEpis Temo Logiemeryfad10Pas encore d'évaluation
- Ultimatum Et Dictateur, Comportements Et NormesDocument14 pagesUltimatum Et Dictateur, Comportements Et Normesham MacuisinePas encore d'évaluation
- Histoire de La Valeur en FinanceDocument51 pagesHistoire de La Valeur en Financefilsdechien100% (7)
- Naturalité BienDocument32 pagesNaturalité BienLe Comte de BronzePas encore d'évaluation
- TRAVAIL REALISE PAR Corection Sujet PhiloDocument7 pagesTRAVAIL REALISE PAR Corection Sujet PhiloL'As De PiquePas encore d'évaluation
- Colas-BlaiseMode D'existence, Modalité Et ModalisationDocument18 pagesColas-BlaiseMode D'existence, Modalité Et ModalisationHind Karou'ati OuannesPas encore d'évaluation
- Repère ÉthiqueDocument55 pagesRepère ÉthiqueAnthony MattaPas encore d'évaluation
- Question DHODocument6 pagesQuestion DHOworldadownPas encore d'évaluation
- Resume Du Cours de Philosophie MoraleDocument15 pagesResume Du Cours de Philosophie MoraleJack NixonPas encore d'évaluation
- 2 1 Theorie EquiteDocument9 pages2 1 Theorie EquiteRbaibi SimohamedPas encore d'évaluation
- Philosophie Terminale Fiche Sur La VeriteDocument4 pagesPhilosophie Terminale Fiche Sur La VeriteSalma R.Pas encore d'évaluation
- Repère ÉthiqueDocument54 pagesRepère ÉthiqueAnthony MattaPas encore d'évaluation
- Psychosociologie de La Communication: Ou Comment Les Choses Existent Par La Façon Dont On Les RegardeDocument9 pagesPsychosociologie de La Communication: Ou Comment Les Choses Existent Par La Façon Dont On Les Regardeahmed serrarPas encore d'évaluation
- Épreuves Dexamen Régional Français N°2 La Boite À MerveillesDocument5 pagesÉpreuves Dexamen Régional Français N°2 La Boite À MerveillesMerlin SaurikPas encore d'évaluation
- L'amitiéDocument1 pageL'amitiéMerlin SaurikPas encore d'évaluation
- La SolidaritéDocument1 pageLa SolidaritéMerlin SaurikPas encore d'évaluation
- Hémon - Créon - Le Choeur 2Document2 pagesHémon - Créon - Le Choeur 2Merlin SaurikPas encore d'évaluation
- Untitled DocumentDocument1 pageUntitled DocumentMerlin SaurikPas encore d'évaluation
- Devoir 1 Modele 6 Francais 1er Bac Semestre 2Document3 pagesDevoir 1 Modele 6 Francais 1er Bac Semestre 2Merlin SaurikPas encore d'évaluation
- 1الإمتحان الجهوي في اللغة الفرنسية 2021 جهة الشرق الدورة العاديةDocument2 pages1الإمتحان الجهوي في اللغة الفرنسية 2021 جهة الشرق الدورة العاديةMerlin SaurikPas encore d'évaluation
- Questions Générales11Document8 pagesQuestions Générales11Merlin Saurik100% (1)
- RarDocument45 pagesRaryoussefrafik220Pas encore d'évaluation
- Chimie-TP4 Determination de QRDocument2 pagesChimie-TP4 Determination de QRChartier JulienPas encore d'évaluation
- Modes de Transmission Des Resistances BacteriennesDocument27 pagesModes de Transmission Des Resistances BacteriennesMélaine BETEPas encore d'évaluation
- TMPDocument2 pagesTMPأنيس بوضيافPas encore d'évaluation
- Transformateurs MonophasésDocument51 pagesTransformateurs MonophasésDo OuPas encore d'évaluation
- Analyse ModaleDocument24 pagesAnalyse ModaleÃSsä LäPas encore d'évaluation
- Récit de Vie Claude Et L'école Avant 15 Ans - Version OriginaleDocument11 pagesRécit de Vie Claude Et L'école Avant 15 Ans - Version Originalebouchezlena1Pas encore d'évaluation
- Facebook PDFDocument1 pageFacebook PDFFab KsmPas encore d'évaluation
- Croix-Bleue Prevention Addictions Ecoles TDR 2021Document5 pagesCroix-Bleue Prevention Addictions Ecoles TDR 2021Luc Djedje DioroPas encore d'évaluation
- Mengue Messi Jean Marie MATRICUL: 17J320 Philosophie 3 Enseignant: DR Azab À Boto ChristianeDocument2 pagesMengue Messi Jean Marie MATRICUL: 17J320 Philosophie 3 Enseignant: DR Azab À Boto ChristianeJo ColmanPas encore d'évaluation
- t2948-1 Graphique Algerie VFDocument1 paget2948-1 Graphique Algerie VFRoza AGGADPas encore d'évaluation
- Renault Captur 2013 FRDocument48 pagesRenault Captur 2013 FRMuhammad Reyhan AdiprasetyoPas encore d'évaluation
- Support de Cours Ethique Et Déontologie Professionnelle - GTDocument14 pagesSupport de Cours Ethique Et Déontologie Professionnelle - GTGOGNO TOPOGRAPHIE SARL INTERNATIONALPas encore d'évaluation
- Thèse M Bennour FinalDocument124 pagesThèse M Bennour FinalMouna Bennour Ep LaarifPas encore d'évaluation
- Screenshot 2021-02-01 at 11.18.13 PMDocument13 pagesScreenshot 2021-02-01 at 11.18.13 PMYousraPas encore d'évaluation
- Mba Finance Et Stratégie D'entrepriseDocument1 pageMba Finance Et Stratégie D'entrepriseMory CondePas encore d'évaluation
- Facture Vente VehiculeDocument1 pageFacture Vente Vehiculeramzi.lamairi75Pas encore d'évaluation
- Economie Des ServicesDocument22 pagesEconomie Des ServiceskhaledPas encore d'évaluation
- Exercices Algos 2020-2021Document7 pagesExercices Algos 2020-2021Mamadou yahya Barry0% (2)
- En 1442Document9 pagesEn 1442BERTRANDPas encore d'évaluation