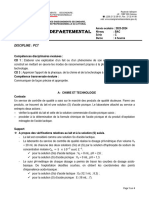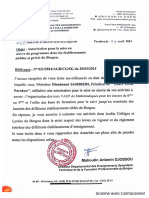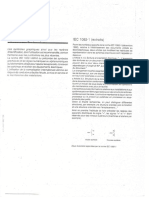Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Compilation Bac Blanc Departemental PCT Serie D
Compilation Bac Blanc Departemental PCT Serie D
Transféré par
BOKINITitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Compilation Bac Blanc Departemental PCT Serie D
Compilation Bac Blanc Departemental PCT Serie D
Transféré par
BOKINIDroits d'auteur :
Formats disponibles
GROUPE LA CERTITUDE
ORGANISATION DE TD, COURS DE RENFORCEMENT, REVISION AUX DIFFERENTS EXAMENS
Lieu : EPP GBEGAMEY SUD
DISCIPLINE – TRAVAIL - RIGUEUR
Tél : 96 38 92 49
EXAMENS BLANCS DEPARTEMENTAUX 2024
PCT BAC
Alibori
Atacora
Atlantique
Borgou
Collines
Couffo
Donga
Littoral
Ouémé
Page 1 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
EXAMEN BLANC DEPARTEMENTAL Borgou 2024 SERIE : D
Compétences disciplinaires évaluées
CD 1 : Elaborer une explication d’un fait ou d’un phénomène de son environnement naturel ou
construit en mettant en œuvre les modes de raisonnement propres à la physique, à la chimie
et à la technologie.
CD 2 : Exploiter la physique, la chimie et la démarche technologique dans la production,
l’utilisation et la réparation d’objets techniques.
CD 3 : Apprécier l’apport de la physique, de la chimie et de la technologie à la vie de l’homme.
Compétence transversale évaluée
CTV 8 : Communiquer de façon précise et appropriée.
A- CHIMIE ET TECHNOLOGIE
Contexte
Dans l’industrie cosmétique et agroalimentaire, de nombreuses molécules sont utilisées
comme réactifs de synthèse d’autres molécules par divers procédés. C’est le cas des parabènes
qui sont utilisés pour empêcher la prolifération de bactéries et du glucose dont la fermentation
donne de l’éthanol. On s’intéresse à la détermination :
du degré alcoolique d’un mélange liquide riche en glucose ;
de la méthode de synthèse des parabènes.
Support
A propos de la détermination du degré alcoolique d’un mélange liquide riche en glucose
Les grains d’orge, comme ceux du mil, contiennent de l’amidon. Lorsqu‘on les fait germer et
sécher (grains maltés), il se développe des diastases qui sont des agents de transformation de
l’amidon en glucose.
Le liquide étudié provient de l’infusion des grains d’orge maltés. Le glucose contenu dans ce
liquide subit, sous l’action de la levure de bière, une fermentation alcoolique pour donner de
l’éthanol et un dégagement gazeux. On considère un échantillon de ce liquide dont la
concentration molaire initiale en glucose est C0. Un suivi cinétique de la fermentation
alcoolique d’un volume V de ce liquide a été fait. Pour cela, on dose le glucose restant dans le
mélange à différentes dates. La concentration molaire de l’éthanol formé est C et celle du
glucose restant est 𝐶 . Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous.
t(en jour) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
𝐶 (en 6 4,7 3,7 2,8 2,2 1,7 1,4 1,1 1,0 0,9 0,8 0,75 0,7 0,7
10 𝑚𝑜𝑙. 𝐿 )
C(en10 𝑚𝑜𝑙. 𝐿 )
Données
Echelles : 1 cm pour 1 jour en abscisses et 1 cm pour 10 𝑚𝑜𝑙. 𝐿 en ordonnées ;
t1 = 5 jours ;
Page 2 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
Formule du glucose : 𝐶 𝐻 𝑂 ;
Masse volumique de l’éthanol : ρ = 790 𝑔. 𝐿 ;
Masse molaire moléculaire de l’éthanol : M = 46 𝑔. 𝑚𝑜𝑙 ;
Le degré alcoolique (d) d’un mélange est le pourcentage en volume d’alcool contenu
dans ce mélange.
A propos des parabènes
Formule des parabènes O
Les parabènes sont des composés dont la formule est sous la OH– –C
O −R
forme −R est un groupe alkyle saturé.
Détermination de la formule d’un parabène E contenu dans une crème à raser
L’hydrolyse du parabène E donne un acide carboxylique AH et un alcool X ;
Une masse mX = 4,5 g de l’alcool X réagit avec le sodium métal et on recueille un volume
V = 840 cm3 de gaz ;
L’oxydation ménagée de X avec la solution de dichromate de potassium donne un
composé Y qui réagit positivement avec la 2,4-DNPH mais sans action sur la liqueur de
Fehling en milieu basique.
Synthèse du parabène E
Pour préparer une masse mE = 17 g de parabène E, on introduit en quantité équimolaire dans
un ballon en verre :
un volume Va = 500 mL d’une solution Sa de l’acide AH ;
un volume VX = 12 mL de l’alcool X ;
un volume V = 2 mL d’acide sulfurique concentré.
A 25 °C, pKa (AH/A−) = 2,7 ;
Masses molaires en g.mol-1 : M(C) = 12 ; M(H) = 1 ; M(O) = 16 ;
Volume molaire gazeux : Vm = 22,4 𝐿. 𝑚𝑜𝑙 ;
Masse volumique de l’alcool X : ρ = 786 𝑔. 𝐿 .
Tâche : Expliquer les faits, décrire l’utilisation du matériel approprié et apprécier l’apport de la
chimie à la vie de l’homme.
Partie 1 : Mobilisation des ressources
1.1. Choisir la bonne réponse parmi celles proposées :
Dans une solution aqueuse contenant le couple acide/base (A/B), l’expression de la constante
[ ][ ] [ ][ ] [ ][ ]
d’acidité Ka est : a) Ka = [ ]
b) Ka = [ ]
c) Ka = [ ]
1.2. Choisir, justification à l’appui, la bonne réponse parmi les suivantes :
Partant d’un mélange initial stœchiométrique, l’expression du rendement d’obtention de C au
cours de la réaction chimique d’équation-bilan αA + βB → γC + δD est :
( ) ( ) ( )
a) r = ( )
; b) r = ( )
; c) r = ( )
1.3. Définir la vitesse de formation d’un produit dans une réaction chimique et préciser
comment on la détermine graphiquement.
Page 3 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
Partie 2 : Résolution de problèmes
2.
2.1. Montrer que la concentration molaire de l’éthanol à une date t est donnée par
C = 2(C0 −𝐶 ).
2.2. Tracer la courbe C = f(t) et calculer la vitesse de formation de l’éthanol à la date t1.
2.3. Déterminer, en pourcentage, le degré alcoolique du mélange étudié à la fin de la
fermentation.
3.
3.1. Prouver que l’alcool X possède trois atomes de carbone puis déterminer les formules semi-
développées des composés AH, X, Y et E.
3.2. Calculer le rendement de la synthèse du parabène E.
3.3. Calculer le pH de la solution Sa d’acide AH.
B- PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE
Contexte
La physique offre à l’homme, des ressources pour interpréter certaines situations de son
environnement. Les lois et principes de cette discipline sont utilisés pour :
expliquer le principe d’un tube cathodique de télévision ;
déterminer les caractéristiques d’une bobine.
Support
A propos du principe d’un tube cathodique de poste téléviseur
- Données :
Charge élémentaire : e = 1,6.10-19 C ;
Masse d’un électron : m = 9 ,1.10-31 kg ;
𝑣 = 2,3. 107 m.s-1 ; B1 = 7,0. 10-4 T ; D = 30
cm ; l = 1,0 cm.
- Approximations : On considère faible la déviation
angulaire du faisceau. Dans ce cas, tanα ≈ sinα ≈ α
avec α en rad ; l << D.
− Un canon émet des électrons qui pénètrent sans vitesse initiale entre l’anode A et la
cathode C. Ils y sont accélérés par une tension UAC et acquièrent la vitesse 𝑣 à la sortie
de la cathode ;
− Le faisceau d’électrons, supposé homocinétique, pénètre par le point O, avec la vitesse
horizontale 𝑣 ⃗ , dans un domaine limité par les plans P1 et P2 où règnent deux champs
magnétiques uniformes 𝐵⃗ et 𝐵 ⃗ normaux au plan de la figure ;
− En l’absence de 𝐵 ⃗ , les électrons décrivent l’arc de cercle 𝑂𝑆 à l’intérieur du champ 𝐵⃗
. Ils sortent en S et décrivent le segment de droite [SI] pour impacter l’écran fluorescent
en I.
Page 4 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
A propos de la détermination des caractéristiques (r, L) d’une bobine
Un circuit oscillant est constitué d’un condensateur de capacité C = 1 µF et d’une bobine
d’inductance L et de résistance r. Dans le but de déterminer L et r, on réalise le montage
schématisé par la figure 1. Le branchement d’un oscilloscope est indiqué sur cette figure. La
f.é.m du générateur est E = 10 V.
− Charge du condensateur : l’interrupteur K est balancé en position (1) ; le condensateur
est totalement chargé et la tension entre ses bornes est uAM = U0 ;
− Oscillations électriques : le condensateur étant totalement chargé, on met l’interrupteur
en position (2) à la date t0 = 0s. A la date t, le circuit est parcouru par un courant
d’intensité i et l’armature (A) porte la charge q ;
− Circuit idéal : dans le circuit idéal, on néglige la résistance r de la bobine. La période des
oscillations dans le circuit est T0 ;
− Circuit réel : l’évolution de la tension uAM = uC observée sur l’écran de l’oscilloscope est
représentée par l’oscillogramme de la figure 2. La pseudo-période des oscillations dans
le circuit est T ;
Relations (R1) : = - ( ) ; (R2) : =𝑒 et 𝐸 sont les énergies
( )
− 𝐸( )
totales emmagasinées dans le circuit aux instants nT et (n+1)T avec n un entier naturel
positif.
Tâche : Expliquer des faits.
C
Partie 1 : mobilisation des ressources i q
1. 1.1. Choisir, parmi les propositions suivantes, la(les) bonne(s) réponse(s). A B
a) 𝑢 = − ; b) 𝑢 = ; c) 𝐸 = C𝑢 ; d) 𝐸 = 2 ; e) i = − ; uAB
f) i = . 𝐸 est l’énergie électrostatique emmagasinée dans le condensateur de capacité C
et traversé par un courant électrique d’intensité i.
1.2. Donner les caractéristiques de la force magnétique agissant sur une particule de charge q
en mouvement dans un champ magnétique uniforme 𝐵⃗ avec une vitesse 𝑣⃗.
1.3. Choisir, parmi les propositions suivantes, la(les) bonne(s) réponse(s).
Page 5 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
Une particule de masse m et de charge électrique q, qui rentre dans un champ magnétique
uniforme 𝐵⃗ avec la vitesse 𝑣 ⃗, effectue un mouvement : a) plan, circulaire et uniforme de
rayon R = | | ;
| |
b) plan, uniforme et circulaire de rayon R = ; c) plan et parabolique de rayon de courbure
R= | |
Partie 2 : Résolution de problèmes
2.
2.1. Déterminer le signe de la tension UAC et le sens du champ 𝐵⃗.
2.2. Justifier l’allure de la trajectoire du faisceau d’électrons dans ce champ 𝐵⃗.
2.3. Calculer la déflexion magnétique O’I du faisceau d’électrons sur l’écran.
3.
3.1. Calculer la valeur de U0, établir l’équation différentielle qui régit l’évolution de la tension
uAM = uC aux bornes du condensateur dans le cas du circuit idéal et en déduire l’expression de
la période propre T0 des oscillations électriques en fonction de L et C.
3.2. Vérifier que le rapport entre deux extrema positifs consécutifs de la tension uC est
sensiblement égal à une constante a.
3.3. Etablir l’expression du rapport en fonction de a et calculer les valeurs de r et L.
( )
EXAMEN BLANC DEPARTEMENTAL LITTORAL SERIE D 2024
A- CHIMIE ET TECHNOLOGIE
Contexte
Un service de contrôle de qualité a saisi sur le marché des produits de qualité
douteuse. Parmi ces produits, se trouvent du lait et une solution (S) d'acide picrique.
Le laboratoire attaché au service a entrepris deux actions :
- vérifier la qualité du lait et celle de la solution commerciale d'acide picrique saisis ;
- procéder à la détermination de la formule chimique de l'acide picrique et du produit
d'oxydation ménagée de l'acide lactique.
Support
A propos des vérifications relatives au lait et à la solution (S) saisis.
- Le lait est considéré comme une solution So d'acide lactique.
- Le laborantin du service de contrôle de qualité réalise le dosage pH-métrique d'un
volume Va = 20 mL de chacune des deux solutions (So) et (S) par la solution d'hydroxyde
de sodium de concentration molaire 𝐶 = 5 × 10 mol. L .
pour la solution (So) d'acide lactique : Vb = 0 mL, pH = 2,6 ; pour la solution (S) d'acide
picrique : Vb = 0 mL, pH = 1,3.
Page 6 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
- Le suivi pH-métrique de chaque dosage a permis de tracer les courbes de dosage
acidobasique. De l’exploitation desdites courbes, on obtient les coordonnées des
points d’équivalence acido-basique :
pour la solution (So) d'acide lactique : E0 (12,1 mL ; 8,3) ; pour la
solution (S) d'acide picrique : E (18 mL ; 7).
Autres Informations
- Sur l’étiquette du flacon de la solution commerciale d'acide picrique, on lit : m = 1 g
d'acide picrique pour 100 mL de solution.
- La valeur expérimentale m de la masse d'acide picrique trouvée dans 100 mL de
solution est acceptable si elle est comprise entre 0,90 g et 1,10 g.
- Plus un lait est frais, moins il contient d'acide lactique. Si la teneur en acide lactique
dépasse 5 g. L , le lait caille. On admettra que le seul acide présent dans le lait est
l'acide lactique de formule chimique 𝐶 𝐻 𝑂 .
- La masse molaire moléculaire de l'acide picrique est M = 229 g. mol.
A propos de la détermination de la formule chimique de l'acide picrique et du produit
d'oxydation ménagée de l'acide lactique
L'acide lactique est un acide carboxylique dont la molécule renferme un groupe
hydroxyle.
L'oxydation ménagée de cet acide par une solution acidifiée de permanganate de
potassium a donné un composé E qui donne un test positif avec la 2,4-DNPH et un
test négatif avec le nitrate d'argent ammoniacal.
L’acide picrique est un composé azoté de formule 𝐶 𝐻 𝑂 𝑁 dont la molécule
comporte un noyau aromatique, un groupe hydroxyle et des groupes nitro
(-NO2) en position méta sur le cycle.
L'analyse élémentaire de l'acide picrique permet de déterminer sa composition
centésimale massique : C : 31,44% ; H : 1,31% ; 0 : 48,9%.
Couple oxydant/réducteur dont l’ion permanganate est un élément : Mn𝑂 /M𝑛 .
Masses molaires atomiques en g. mol : M(H) = 1 ; M(C) = 12 ; M(0) = 16 ;
M(N) = 14.
Tâche : Expliquer des faits et apprécier l'apport de la chimie et de la technologie
à la vie de l’Homme.
Partie 1 : Mobilisation de ressources
1.
1.1 Préciser les caractéristiques de la courbe de dosage d’une solution d’acide fort
et celle d’une solution d’acide faible par une solution de base forte.
1.2 Décrire les tests d’identification d’un aldéhyde et d’une cétone.
1.3 Définir un composé aromatique.
Partie 2 : Résolution de problème
2.
2.1 Donner, sur le même graphe, l’allure de la courbe pH = f (Vb) pour chaque
dosage en y plaçant les points caractéristiques de chaque courbe.
Page 7 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
2.2 Vérifier si l'indication portée sur l'étiquette du flacon d'acide picrique est
compatible avec le résultat expérimental.
2.3 Apprécier l’état du lait.
3.
3.1 Déterminer la formule semi-développée de l'acide lactique et celle du
composé E.
3.2 Ecrire l'équation de la réaction d'oxydo-réduction entre l'acide lactique et les
ions permanganate en milieu acide.
3.3 Déterminer la formule semi-développée de l'acide picrique.
B- PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE
Contexte
Les progrès technologiques ont contribué à l’explication et à l’étude de certains
phénomènes physiques. Ainsi, on peut étudier :
- le mouvement d’une particule chargée dans un champ magnétique uniforme en
vue d’identifier la substance correspondante;
- le fonctionnement d’un circuit (R, L, C) en oscillations libres.
Support
A propos du mouvement de la particule chargée dans un champ magnétique
Dans un spectrographe de masse, on étudie le mouvement des ions issus des
molécules de la drogue consommée par un patient.
Dans la chambre ( I ), les molécules X de la drogue sont ionisées par bombardement
électronique et deviennent des ions 𝑋 de charge électrique q.
Dans la chambre ( II), entre les plaques ( 𝑃 ) et
( 𝑃 ) planes, verticales et parallèles, on applique
une tension 𝑈 telle que 𝑈 = U = 8000 V. Il
règne ainsi entre les plaques ( 𝑃 ) et ( 𝑃 ) un
champ électrique uniforme de vecteur champ 𝐸⃗ .
Les ions 𝑋 pénètrent en 𝑂 sans vitesse dans ce
champ et acquièrent une vitesse v à la sortie en
𝑂 . Ensuite, chaque ion de masse m, animé de la
vitesse 𝑉⃗ , pénètre par 𝑂 suivant l’axe (𝑂 , X)
dans la chambre (III) où règne un champ
magnétique uniforme dont le vecteur champ 𝐵⃗ est orthogonal au plan de la figure et
de norme B = 1,8 T.
• La drogue consommée par le patient peut être de l’héroïne, de la codéine ou de la
morphine.
• Autres données
Page 8 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
- Nombre d’Avogadro: 𝒩 ≃ 6,02 × 10 mo𝑙
- Charge électrique élémentaire : e = 1,6 × 10 C
- Masse molaire moléculaire des drogues en g. mol : héroïne : 369 ; codéine : 299 ;
morphine : 285
- L’ion 𝑋 est recueilli au point A tel que 𝑂 A = 0,242 m.
A propos du fonctionnement du circuit (R, L, C) en oscillations libres
Un technicien réalise le circuit électrique (1) schématisé ci-dessous, dans lequel
le condensateur est initialement chargé. Le circuit fermé est alors le siège
d’oscillations électriques amorties. Pour entretenir les oscillations électriques
dans ce circuit, il réalise le circuit électrique n°2 dans lequel (G) est un
générateur auxiliaire qui maintient entre ses bornes une tension 𝑢
proportionnelle à l’intensité du courant électrique qu’il délivre : 𝑢 = 𝑅 i. La
période des oscillations électriques entretenues est T0. Le schéma détaillé de
(G) est représenté par le circuit 3.
• Informations et données
Le sens du courant électrique choisi dans le circuit 1 est contraire à celui du
courant électrique dans le circuit 2.
R = 100 Ω ; r = 20 Ω ; C = 10 F ; T0 = 2,8.10 s
Tâche : Expliquer des faits et apprécier l’apport de la physique et de la technologie à
la vie de l’Homme.
Partie 1 : Mobilisation des ressources
1.
1.1 Montrer que le mouvement plan d’une particule de charge q, animée d’un
vecteur vitesse 𝑣⃗ dans un champ magnétique uniforme 𝐵⃗ orthogonal à 𝑣⃗ ,
est plan, uniforme et circulaire.
1.2 Etablir l’expression de la masse molaire d’une molécule en fonction de sa
masse m et du nombre d’Avogadro 𝒩.
Page 9 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
1.3 Donner l’expression de la période d’un circuit oscillant (L, C).
Partie 2 : Résolution de problème
2.
2.1 Etablir l’expression de la vitesse v de l’ion 𝑋 au point 𝑂 en fonction de e, m et U.
2.2 Justifier le sens du vecteur champ magnétique 𝐵⃗ pour que les ions 𝑋 soient
recueillis en A.
2.3 Etablir l’expression du rayon R de la trajectoire de l’ion 𝑋 en fonction de U, m, e
et B, puis identifier la drogue X consommée par le patient.
3.
3.1 Justifier, par une équation différentielle régissant la charge q du condensateur du
circuit 1, que ce dernier est le siège d’oscillations électriques amorties.
3.2 Démontrer l’expression de 𝑢 dans le circuit 3 puis établir l’équation différentielle
régissant la charge q du condensateur dans le circuit 2.
3.3 Déterminer la valeur de la résistance 𝑅 pour que les oscillations électriques au
niveau du circuit 2 soient entretenues et en déduire l’inductance L de la bobine.
EXAMEN BLANC DEPARTEMENTAL – ALIBORI SERIE D
ssCompétences disciplinaires évaluées
- CD1 : Elaborer une explication d’un fait ou d’un phénomène de son environnement
naturel ou construit en mettant en œuvre les modes de raisonnement propres à la
physique, à la chimie et à la technologie.
- CD2 : Exploiter la physique, la chimie et la démarche technologique dans la production,
l’utilisation et la réparation d’objets technologiques.
- CD3 : Apprécier l’apport de la physique, de la chimie et de la technologie à la vie de
l’Homme.
Compétence transversale évaluée : Communiquer de façon précise et appropriée.
A- CHIMIE ET TECHNOLOGIE
Contexte
Dans maints domaines, la chimie contribue à l’amélioration des conditions de vie de
l’Homme.
Elle intervient, entre autres, lors de :
– la vérification de la concentration en ions hydrogénocarbonate dans un médicament,
Page 10 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
– l’appréciation de l’état alcoolique ou non d’un automobiliste.
Support
A propos de la vérification de la concentration en ions hydrogénocarbonate dans
un médicament.
Le médicament est une solution aqueuse, contenant entre autres ions, l’ion
hydrogénocarbonate ( HCO−3 ). La concentration molaire en ion hydrogénocarbonate
indiquée sur l’étiquette du flacon contenant le médicament est : 180 mmol. L−1
Manipulation réalisée :
Pour vérifier la concentration molaire en ion hydrogénocarbonate, un volume
VB = 20 mL de la solution est dosée par une solution d’acide sulfurique de concentration
molaire CA = 0,2 mol. L−1. Un suivi pH-métrique du dosage est fait ; la courbe obtenue
après exploitation des données issues de la manipulation présente deux points
particuliers : M(VAM = 4,5 mL ; pHM = 6,4) et N(VAN = 9 mL ; pHN = 4).
- Données :
Les solutions sont supposées à 25°C et pka((CO2,H2O)/ HCO−3) = 6,4.
Appréciation de l’état alcoolique ou non d’un automobiliste
• Un échantillon de volume V0 = 5 mL du sang de l’automobiliste est dissout dans un
volume raisonnable d’acide picrique.
• On procède ensuite à la distillation du mélange précédent et on récupère un volume
raisonnable, soit 𝑉 = 20𝑚𝐿 du distillat, supposé contenir la totalité de l’éthanol se
trouvant dans l’échantillon du sang de l’automobiliste.
• Dans un erlenmeyer, on introduit le volume du distillat et 𝑉 = 10𝑚𝐿 d’une
solution acidifiée de dichromate de potassium (2𝐾 + 𝐶𝑟 𝑂 )), utilisée en excès, de
concentration en ions dichromate 𝐶 = 1,7 × 10 𝑚𝑜𝑙. 𝐿 . Les ions dichromates en excès
sont dosés ensuite par les ions iodure contenus dans le volume 𝑉 = 31 mL d’une solution
d’iodure de potassium ( 𝐾 + 𝐼 ) de concentration molaire 𝐶 = 0,3 × 10 𝑚𝑜𝑙. 𝐿 .
• Autres données :
- La quantité de matière d’éthanol contenu dans le volume 𝑉 du distillat est donnée
par la relation ( R) : 𝑛 = 𝐶 𝑉 − 𝐶𝑉 .
- Couples d’oxydoréduction :𝐶𝑟 𝑂 / 𝐶𝑟 ; ; 𝐼 /𝐼
- On admet que lorsque le taux d’éthanol dans le sang d’un automobiliste est supérieur
à 𝜏 = 0,80𝑔. 𝐿 , celui-ci est en infraction.
- Masses molaires atomiques en g.mo𝑙 : M(O) = 16 ; M ( C) = 12 ; M (H ) = 1.
Tâche : Expliquer des faits et apprécier l’apport de la Chimie et de la Technologie à la vie
de l’Homme.
Partie 1 : Mobilisation des ressources
1.
1.1-Ecrire l’équation-bilan de la réaction de dosage d’un volume VB d’une solution de
monobase faible B de concentration molaire CB par une solution de diacide fort de
Page 11 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
concentration molaire CA puis en déduire la relation qui lie ces concentrations aux
volumes de chaque solution à l’équivalence acido-basique.
1.2- Choisir en utilisant les lettres A, B, ou C, la bonne réponse pour chaque proposition :
N° Début de propositions Suite de proposition à choisir
a. Au cours du dosage d’une solution de base A : à l’équivalence.
faible par une solution d’acide fort, on B : à la demi-équivalence.
obtient une solution tampon C : en fin de dosage.
b. Le pH du mélange à l’équivalence, à 25°C, lors A : égal à 7.
du dosage d’une solution de base faible B : supérieur à 7.
B par une solution d’acide fort est C : inférieur à 7.
1.3- Faire le schéma annoté du dispositif expérimental du dosage effectué.
Partie 2 : Résolution de problèmes
2.
2.1. Identifier chacun des deux points particuliers M et N.
2.2. Préciser les propriétés du mélange obtenu au point M.
2.3. Vérifier l’exactitude de l’indication inscrite sur l’étiquette du flacon contenant le
médicament.
3.
3.1. Ecrire l’équation-bilan de la réaction entre :
- l’éthanol et les ions dichromate ;
- les ions dichromates et les ions iodure.
3.2. Etablir la relation ( 𝑅 ).
3.3. Apprécier l’état alcoolique ou non d’un automobiliste.
B- PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE
Contexte
Lors d’un championnat de physique et de technologie, des candidats sont amenés à :
- déterminer les paramètres dont dépend la portée du tir au cours d’un jeu de lancer du
poids,
- expliquer la nature du signal observé sur l’écran d’un oscilloscope lors du mouvement
d’une bobine accrochée à deux ressorts.
Support
Page 12 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
A propos du jeu de lancer du poids Z ⃗0
𝑉
• La boule est lancée avec un vecteur vitesse
𝑉 faisant un angle ∝ avec l’horizontale.
⃗ 𝛼
A
• La distance OE sur le sol entre le point O et
le point de chute E est appelée distance du lancer. H
- Données :
𝑘⃗ X
H = 2,1 m ; 𝑉 = 14𝑚. 𝑠 ;∝ = rad 𝑗
O 𝑖 E
Intensité de la pesanteur : g = 10m.𝑠
A propos du mouvement d’une bobine accrochée à deux ressorts identiques
• La bobine (B ) de masse , comportant N
spires
de surface S , est accrochée à deux ressorts
identiques à spires non jointives de constante de
raideur K (voir figure ).
• A l’équilibre du système constitué par les Y•
ressorts et la bobine, le centre d’inertie de la O
bobine coïncide avec le point , pris comme origine 𝑖
du repère ( 0, 𝚤⃗). L’allongement de chaque ressort à
l’équilibre est alors ∆𝑙 . N Bobine
• A la date , on tire la bobine vers le bas à
partir de sa position d’équilibre, d’une distance Aimant fixe
S
𝑑 = 5𝑐𝑚 et on l’abandonne sans vitesse initiale.
Figure
• Données :𝑁 = 100 ; 𝑆 = 5,10𝑐𝑚 ; 𝑚 = 200𝑔 ;
𝐾 = 35,34𝑁. 𝑚 .
– Les frottements de l’air sur la bobine sont négligeables.
Explication de la nature du signal observé sur l’écran d’un oscilloscope
• Les bornes de la bobine (B) sont reliées aux voies d’un oscilloscope. Un aimant droit
est maintenu fixe et disposé verticalement, son axe étant confondu avec celui de la bobine
lorsque celle-ci est en mouvement (voir figure).
• Lorsque la bobine est en mouvement, une courbe dont l’allure est celle représentée
par l’oscillogramme, est observée sur l’écran de l’oscilloscope (voir figure).
• A l’instant t, le vecteur surface de chaque spire de la bobine est vertical descendant.
• La résistance de la bobine est supposée négligeable.
• L’intensité du champ magnétique est : 𝐵 = 0,2𝑋 + 𝐾; est l’élongation du centre
d’inertie de la bobine, k est une constante.
Tâche : Expliquer des faits, décrire l’utilisation du matériel approprié.
Partie 1 : Mobilisation des ressources
1.
1.1-Définir la portée et la flèche d’un tir.
1.2-Donner la condition à laquelle un oscillateur mécanique est dit harmonique.
1.3-Répondre par vrai ou faux à chacune des affirmations suivantes :
a) Il apparaît une f.é.m. induite lorsque le flux magnétique à travers un circuit varie.
Page 13 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
b) La f.é.m. induite se manifeste par l’apparition d’un vecteur surface.
c) La f.é.m. induite se manifeste par l’apparition d’une tension électrique aux bornes d’un
circuit ouvert.
Partie 2 : Résolution de problèmes
2.
2.1-Déterminer l’équation cartésienne de la trajectoire du centre d’inertie de la boule et
en déduire sa nature.
2. 2-Etablir l’expression littérale de la portée du tir et en déduire les conditions qu’il
faut remplir pour améliorer la performance du lanceur.
23-Calculer la flèche du tir et la distance du lancer, pour 𝛼 = 𝛼 , la boule étant lancée
avec la vitesse V0.
3.
3.1-Montrer que l’ensemble constitué par la bobine et les ressorts se comporte comme un
oscillateur harmonique puis établir l’équation horaire du mouvement du centre d’inertie
G de la bobine.
3.2-Exprimer le flux magnétique 𝜙(𝑡) qui traverse la bobine à un instant t.
3.3-Expliquer qualitativement la nature du signal observé sur l’écran d’un oscilloscope
puis établir l’expression de la tension 𝑢(𝑡) observée aux bornes de la bobine.
EXAMEN BLANC DEPARTEMENTAL ATLANTIQUE SERIE D 2024.
Compétences évaluées :
CD n°1 : Elaborer une explication d’un fait ou d’un phénomène de son environnement
naturel ou construit en mettant en œuvre les modes de raisonnement propres à la
physique, à la chimie et à la technologie.
CD n°2 : Exploiter la physique, la chimique et la démarche technologique dans la
production, l’utilisation, et la réparation d’objets technologiques.
CD n°3 : Apprécier l’apport de la physique, de la chimie et de la technologie à la vie de
l’Homme.
CTV n°8 : Communiquer de façon précise et appropriée.
Page 14 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
A- CHIMIE ET TECHNOLOGIE
Contexte
Les progrès de la science ont permis à l’homme d’apprécier la qualité de tout ce qu’il
a à sa portée. Un laboratoire par ses compétences est sollicité pour apprécier la
qualité :
- d’un fromage dont le principe actif est un acide carboxylique A ;
- d’un savon préparé.
Support
A propos du fromage.
Détermination de la qualité du fromage
- L’acide carboxylique A est l’un des composés responsables de l’odeur très forte et du goût
piquant de certains fromages : on dit que le fromage est rance.
- Un fromage est rance si le pourcentage en masse 𝑝 de l’acide A qu’il contient est supérieur
ou égal à 4%, c’est -à- dire s’il y a plus que 4 g de l’acide A dans 100g de fromage.
- Le technicien du laboratoire introduit dans un bécher 8 g de fromage fondu auquel il
ajoute d’eau distillée pour obtenir une solution S. Le technicien dose par colorimétrie, la
solution S par une solution d’hydroxyde de sodium de concentration
𝐶𝑏 = 4.0.10-1 mol.L-1. L’équivalence acido-basique est obtenue pour un volume
𝑉𝑏𝐸 = 20 mL de la solution d’hydroxyde de sodium ajoutée.
- Données :
- On notera ici l’acide A par AH.
- Masse molaire de l’acide A : MA = 88 g.mol-1
- Le 𝑝𝐻 du mélange à l’équivalence acido-basique vaut 𝑝𝐻𝐸 = 8,3
- L’indicateur coloré disponible est la phénolphtaléine. Sa forme acide apparait
incolore si [𝐻𝐼𝑛]˃15,84 [𝐼𝑛−] et sa forme basique apparait rose si [𝐼𝑛−] ˃ 4[𝐻𝐼𝑛]
pka(HIn/𝐼𝑛−) = 9,4
Série de réactions chimiques impliquant l’acide A
On réalise les réactions successives ci-dessous. Les composés A , E, F, G, J, K, P et Q sont
des composés organiques avec A l’acide principe actif du fromage.
a) A + CH3 – CHOH – C2H5 → P + ……
b) A + SOCl2 → 𝐾 + ..... + …..
c) P + 𝑂𝐻− → Q + F
d) 2A → G + H2O CH3
e) K + E → C2H5 – CH2 – CO – N – C2H5 + J
d) G + F → T + A
Page 15 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
Tableau 1
Composé Fonction Formule Nom en
organique chimique semidéveloppée nomenclature
officielle
A
E
F
G
J
K
P
Q
T
A propos de l’appréciation de la qualité du savon préparé.
• Le savon est obtenu par la saponification de l’oléine, une huile obtenue à partir de
l’acide oléique (C17H33COOH) et du glycérol (HO-CH2-CHOH-CH2-OH)
• Le protocole de fabrication du savon à base d’huile d’olive est la suivante :
- introduire 50 mL d’eau et une quantité d’éthanol dans un bécher et y ajouter très
doucement 25 g d’hydroxyde de sodium solide en agitant régulièrement jusqu’à
dissolution complète ;
- verser doucement 220 mL d’huile d’olive en agitant pendant une heure pour obtenir
une pâte épaisse ;
On constate au cours de la fabrication du savon, une diminution progressive du pH du
milieu réactionnel
• Le savon préparé est de qualité si le surgraissage (le pourcentage en masse d’huile non
saponifiée lors de la fabrication du savon) est compris entre 5% et 10%.
- Données :
- On considère que l’huile d’olive est uniquement constituée d’oléine ;
- Masse volumique de l’huile d’olive : ρ = 0,91 g·mL–1 ;
Nom Formule Masse molaire moléculaire ( 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1)
brute
Oléine C57H104O6 884
Hydroxyde de NaOH 40
sodium
Glycérol C3H8O3 92
Oléate de sodium C18H33O2Na 304
Tâche: Expliquer les faits, décrire l’utilisation de matériel et apprécier l’apport de la chimie
à la vie de l’Homme.
Page 16 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
Partie 1 : Mobilisation des ressources.
1.
1.1 Faire le schéma annoté du dispositif du dosage réalisé puis écrire l’équation de la réaction
support du dosage réalisé ;
1.2 Donner les caractéristiques d’une réaction de saponification d’un ester ;
1.3. Répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes puis corrige les affirmations
fausses :
a) Un indicateur coloré est approprié pour un dosage colorimétrique lorsque le pHE
(pH du mélange à l’équivalence acido-basique) est inclus dans sa zone de virage.
b) Dans une réaction chimique du type aA +𝑏𝐵 → 𝑐𝐶 + 𝑑𝐷 , A est le réactif limitant si
( ) ( )
> avec 𝑛(𝐴) la quantité de matière de A et 𝑛(𝐵) la quantité de matière de B.
c) l’oléine appartient à la famille des esters de formule générale
Partie 2: Résolution de problèmes
2.1. Reproduire et compléter le tableau 1 puis écrire les équations des réactions b) et e)
2.2 Apprécier la qualité du fromage analysé.
2.3 Vérifier si l’indicateur coloré disponible est convenable pour le dosage
colorimétrique. 3
3.1 Ecrire l’équation de la réaction chimique qui a eu lieu entre l’oléine et la solution
d’hydroxyde de sodium.
3.2 Indiquer, en justifiant, l’évolution attendue du pH du milieu réactionnel au cours de la
fabrication du savon.
3.3 Déterminer le surgraissage du savon préparé puis apprécier sa qualité.
B- PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE
Contexte
Dans l’environnement naturel ou artificiel de l’homme, de nombreux phénomènes
physiques trouvent leurs origines ou leurs explications dans les sciences et techniques.
A cet effet, on s’intéresse à la vérification :
- des constituants de l’alliage de bronze utilisé dans la fabrication d’une coupe dont la
qualité est douteuse ;
- de la valeur de l’inductance d’une bobine.
Page 17 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
Support
Contrôle des constituants chimiques de la coupe.
La coupe est de bonne qualité si elle est fabriquée avec le
bronze (alliage de cuivre et d’étain).
Pour faire dissiper le doute sur les métaux réels utilisés dans la
fabrication de la coupe, une structure de contrôle a obtenu par
un procédé (non exposé ici) des ions des deux principaux
métaux constituant l’alliage.
- Un dispositif permet de sélectionner les ions des deux principaux métaux de
la coupe pour les propulser par le point O, avec une vitesse commune
v = 2,83. 104 m. s−1 dans la région ADFH (figure 1) où règne un champ magnétique
uniforme𝐵⃗ d’intensité B = 0,1T.
- L’intensité du poids de chaque ion métallique est négligeable devant celle
de la force magnétique dans la région ADFH.
- Symbole de chaque ion métallique : 𝑋2+
- Charge élémentaire : e = 1,6.10−19C.
Dans le champ magnétique régnant dans l’espace ADHF, les ions décrivent des
trajectoires circulaires dont la mesure des diamètres a donné les résultats du tableau 1
Tableau 1
Ions Ion 1 Ion 2
Diamètre de la trajectoire 𝑂𝐼1 = 18,8 cm 𝑂𝐼2 = 20
cm
Tableau 2 : Masses de quelques atomes :
Atome Nickel Zinc (Zn) Etain (Sn) Cuivre (Cu)
(Ni)
Ion correspondant 𝑁𝑖2+ 𝑍𝑛2+ 𝑆𝑛2+ 𝐶𝑢2+
Masse de l’atome ou de 58u 68u 118u 64u
l’ion
On donne :
- 𝐷𝑖 = 1,76875. 1024𝑚𝑖 avec 𝑚𝑖 la masse de l’ion métallique. - 1u = 1,66.10−27kg.
Vérification de inductance de la bobine
La bobine porte l’inscription (70mH, 0 𝛺).
Expérience 1
On réalise un circuit électrique série (circuit 1) constitué par un générateur GBF délivrant
une tension triangulaire, un conducteur ohmique de résistance 𝑅 = 130,6𝛺 et la bobine
d’inductance L et de résistance négligeable.
Page 18 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
- La bobine d’inductance L et de longueur ℓ = 8,5 𝑐𝑚 est constitué de 𝑁 = 1000 spires de
rayon r2 = 3,75cm.
- La tension délivrée par le générateur est triangulaire.
- Les tensions 𝑢𝑅(t) et 𝑢𝐿(t) sont respectivement celles aux bornes du conducteur ohmique
de résistance R et de la bobine.
- Voie Y1 : 2V / division ; Voie Y2 : 200mV / division ; base des temps : 10 ms / division
µ0=4𝜋.10-7SI
G.B.F.
Voie Y1
K i
L
R
A B C
Figure 2 Voie Y2 Oscillogramme 1
Expérience 2
On réalise un circuit électrique série (circuit 2) constitué par un
G.B.F délivrant une tension sinusoïdale
𝑢(𝑡) = 𝑈𝑚 sin(𝜔𝑡), un condensateur de capacité
C = 1mF, deux conducteurs ohmiques de résistances
𝑅 = 6,4𝛺 et 𝑟 = 3,6𝛺 et la bobine d’inductance L.
On observe à l’aide d’un oscilloscope bicourbe les Oscillogramme 2
tensions 𝑢(t) et 𝑢𝑅(t) aux bornes respectivement du GBF et du
conducteur ohmique R.
- On fixe la fréquence du G.B.F à la valeur N1 et on observe l’oscillogrammes ci-dessus
avec la même sensibilité verticale sur les deux voies.
- Balayage : 𝑚𝑠/𝑑𝑖𝑣 ; Sensibilité verticale : 10V/div
- On fait varier la fréquence du GBF et on remarque que pour une valeur N0 de la
fréquence, l’intensité efficace atteint son maximum I0
Tâche : Expliquer des faits et apprécier l’apport de la physique à la vie de l’homme.
Partie1 : Mobilisation des ressources.
1.
1.1. Indiquer le sens du vecteur champ magnétique 𝐵⃗pour que les ions métalliques soient
recueillis aux points 𝐼1 et 𝐼2 (voir figure1)
1.2. Ecrire l’équation différentielle du circuit RLC série en régime sinusoïdal forcé puis
choisir la bonne réponse :
a) Pour un circuit inductif la tension u aux bornes du GBF est :
𝛼) en avance de phase sur le courant électrique i dans le circuit ;
Page 19 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
𝛽) en retard de phase sur le courant électrique i dans le circuit ;
c) A la résonance d’intensité électrique (avec RT la résistance totale du circuit RLC) :
𝛼) 𝐼0 = ; 𝛽) 𝐿𝜔0 = ; 𝛾) 𝑈 =
1.3. Définir "résonance d’intensité électrique" puis choisir la bonne réponse :
a) il y a auto-induction en régime permanent ;
b) l’expression de l’inductance d’une bobine est (avec S la surface de l’une de ses
spires, N son nombre total de spires, ℓ sa longueur, r le rayon des spires, I l’intensité du
courant) : 𝛼) 𝐿 = 𝜇𝑁²𝑟² ; 𝛽) 𝐿 = ; 𝛾) 𝐿 =
Partie2 : Résolution de problèmes.
2.
2.1- Montrer que le mouvement d’un ion métallique dans la région ADFH est plan,
uniforme et circulaire.
2.2- Prouver que le diamètre de la trajectoire de chaque ion métallique dans la région
ADFH est 𝐷𝑖 ;
2.3- Confirmer ou infirmer le doute qui pèse sur la constitution chimique de la coupe.
3.
3.1- Indiquer sur le schéma de chacun des circuits 1 et 2 les branchements à réaliser
pour visualiser l’oscillogramme correspondant puis calculer la valeur de l’inductance L
de la bobine.
3.2- Expliquer la trace en créneau observée sur l’oscillogramme 1 puis retrouver la
valeur de L.
3.3. Etablir, à partir d’une construction de Fresnel du circuit 2, l’expression de
l’impédance Z du circuit 2 puis calculer les valeurs de L, 𝑁0 et 𝐼𝑜 et conclure.
EXAMEN BLANC DÉPARTEMENTAL DONGA 2024 SERIE D
• Compétences disciplinaires évaluées :
CD n°1 : Élaborer une explication d’un fait ou d’un phénomène de son
environnement naturel ou construit en mettant en œuvre les modes de
raisonnement propres à la Physique, à la Chimie et à la Technologie.
CD n°2 : Exploiter la Physique, la Chimie et la démarche Technologique dans la
production, l’utilisation et la réparation d’objets technologiques.
Page 20 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
CD n°3 : Apprécier l’apport de la Physique, de la Chimie et de la Technologie à la vie
de l’Homme.
• Compétences transversales évaluées :
CTV n°1 : Exploiter l’information disponible.
CTV n°8 : Communiquer de façon précise et appropriée.
A- CHIMIE ET TECHNOLOGIE
Contexte :
Les extraits ci-dessous traitent de préoccupations scientifiques.
Extrait 1 : « L’eau oxygéné ou le peroxyde d’hydrogène est un composé industriel
important en raison de son pouvoir oxydant et de ses propriétés antiseptiques. Elle
peut subir une auto-oxydoréduction ou dismutation. En dépit de cette dismutation,
l’eau oxygéné est conservée pendant plusieurs mois dans les pharmacies ».
Extrait 2 : « Il y a quelques décennies, les femmes lavaient le linge avec un mélange
de suif (graisse animale) et de la cendre des régimes de palme ».
Un professeur de PCT s’inspire de ces extraits pour proposer à sa classe une
activité d’explication de manipulations portant l’une sur la cinétique de l’eau oxygéné,
l’autre sur la préparation d’un savon à partir du suif. Le professeur a également profité
à cette occasion pour aborder la synthèse d’un dipeptide D à partir de
l’acide 𝛼 − 𝑎𝑚𝑖𝑛é X et d’un autre acide 𝛼 − 𝑎𝑚𝑖𝑛é Y.
Support :
❖ Sur l’eau oxygénée :
L’expérience est réalisée à une température constante et à un volume constant.
Les couples rédox mis en jeu sont : 𝐻2𝑂2 / 𝐻2𝑂 𝑒𝑡 𝑂2 /𝐻2𝑂2. La décomposition de l’eau
oxygéné donne du dioxygène et de l’eau.
A la date t = 0 s, début de l’expérience, la solution de peroxyde d’hydrogène contient
6 × 10−2 mol d’eau oxygénée et son volume est V = 1 L. Le volume 𝑉𝑂2 𝑑𝑒 dioxygène
dégagé est mesuré à différentes dates t et à pression constante. Les résultats de
l’expérience sont consignés dans le tableau suivant :
t (min) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 60
𝑽𝑶𝟐 (𝑳) 0,16 0,27 0,36 0,44 0,50 0,54 0,58 0,61 0,68
[𝑯𝟐𝑶𝟐] (𝟏𝟎−𝟐 𝒎𝒐𝒍 𝑳)
Page 21 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
- La concentration molaire en eau oxygéné restante [𝐻2𝑂2]𝑟 à une date t est
.
donnée par la relation (a) : [𝑯𝟐𝑶𝟐] = 𝐶 − où C est la concentration
.
molaire de l’eau oxygéné à la date t = 0 s.
- Le volume molaire dans les conditions de l’expérience : 𝑉𝑂 = 24 𝐿 𝑚𝑜𝑙.
▪ Échelle de représentation : 1cm pour 5min et 2cm pour 10−2 𝑚𝑜𝑙 𝐿.
❖ Sur la synthèse du suif et sa réaction avec la cendre de régimes de palme :
Le suif est composé majoritairement de stéarine (triester) obtenu par réaction entre
l’acide stéarique ( 𝐶17𝐻35𝐶𝑂𝑂𝐻) et le propan –1,2,3 –triol (𝐻𝑂−𝐶𝐻2 −𝐶𝐻𝑂𝐻−𝐶𝐻2 −𝑂𝐻). La
cendre de régime de palme contient essentiellement de l’hydroxyde de potassium (KOH).
La masse de suif (stéarine) utilisée est m = 89 g, la cendre est en quantité suffisante et le
rendement de la réaction entre le suif (stéarine) et la cendre (KOH) est r = 70%.
M(stéarine) = 890 g/mol.
Sur la synthèse du dipeptide D
• 𝑆𝑏 : solution aqueuse de l’acide 𝛼 − 𝑎𝑚𝑖𝑛é 𝑋 de concentration massique :
𝐶𝑚 = 1,11 𝑔 𝐿. • 𝑆𝑎: solution d’acide chlorhydrique de molarité : 𝐶𝑎 = 0,05 𝑚𝑜𝑙 𝐿
• Volume de la solution 𝑆𝑏 dosée : 𝑉𝑏 = 20 𝑚𝐿.
• Volume de la solution 𝑆𝑎 versée pour obtenir l’équivalence acido-basique :
𝑉𝑎𝐸 = 5𝑐𝑚3.
• Quelques valeurs du pH du mélange obtenu au cours du dosage : 𝑝𝐻1 = 8,6;
𝑝𝐻2 = 2,0.
• Valeur des pKa des couples acide/base des formes sous lesquelles
l’acide 𝛼 − 𝑎𝑚𝑖𝑛é 𝑋 existe en solution aqueuse : 𝑝𝐾𝑎1 = 2,3 𝑒𝑡 𝑝𝐾𝑎2 = 9,7.
• Masse molaire du dipeptide D synthétisé M = 188 g/mol
• D est un dipeptide dans lequel l’acide 𝛼 − 𝑎𝑚𝑖𝑛é 𝑋 est N – terminal.
• La chaîne carbonée du groupe alkyle R- de l’acide 𝛼 − 𝑎𝑚𝑖𝑛é 𝑌 est ramifiée.
Tâche : Expliquer la décomposition de l’eau oxygène, la synthèse du suif ainsi que sa réaction
avec la cendre de régimes de palme et la synthèse d’un dipeptide.
Partie 1 : Mobilisation des ressources
1-
1.1- Établir l’équation – bilan de la réaction de décomposition de l’eau oxygénée à partir
des démis équations d’oxydation et de réduction
1.2- Écrire l’équation de la réaction conduisant à la formation de la stéarine et préciser
les caractéristiques de cette réaction.
Page 22 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
1.3- Donner les trois formes sous lesquelles existe l’acide 𝛼-aminé X en solution
aqueuse et préciser parmi ces trois formes, l’espèce majoritaire dans chacun des
mélanges de pH = p𝐻1 et de pH = p𝐻2.
Partie 2 : Résolution de problème
2-
2.1- Établir la relation (a), reproduire et compléter le tableau du support le puis tracer
sur papier millimétré la courbe [𝐻2𝑂2] = 𝑓(𝑡)
2.2- Déterminer les vitesses de disparition de l’eau oxygéné aux instants t = 10 min et
t = 30 min et en déduire les vitesses de formation du dioxygène à ces mêmes instants
puis justifier en dépit de sa dismutation, la conservation de l’eau oxygéné pendant
plusieurs mois dans les pharmacies.
2.3- Expliquer l’utilisation du mélange du suif et de la cendre de régimes de palme pour
le lavage du linge puis déterminer la masse du savon obtenu à l’issue de la réaction
entre le suif et la cendre.
3-
3.1- Déterminer la formule semi-développée du composé X et préciser son nom usuel
et celui en nomenclature officiel.
3.2- Déterminer la formule semi-développée du composé Y puis donner la
représentation de Ficher de ses énantiomères.
3.3- Nommer le dipeptide D et préciser les étapes de sa synthèse.
B- PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE
Contexte :
Lors des festivités commémorant l’anniversaire d’un collège, divers jeux furent
organisés à l’intention des élèves.
Kpèma s’est intéressé au jeu du mouvement d’une voiture qui gravit une pente et
Kora préfère étudier le circuit du système d’alarme d’une sonnerie.
Gnami leur camarade de classe qui les observait affirme que l’équation cartésienne
de la trajectoire de la voiture lorsqu’elle quitte la piste en A est donnée par la relation
(a). Bola rejette cette affirmation.
Page 23 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
Support :
❖ À propos du jeu de mouvement de voiture
La voiture (considérée comme un point matériel) de x
C
masse totale m gravit une côte de pente 8%
B
(sin 𝛼 = 0,08) d’un plan incliné d’angle α par rapport au
plan horizontal. Le centre d’inertie G de la voiture décrit 𝚤⃗ A ∝
la ligne de plus grande pente représentée par l’axe x’x. 𝑘⃗
À la date t = 0s, le point G est en A qui sera pris comme Figure 1
origine des espaces (xA = 0) à la vitesse VA. À la date x'
t = 𝒕𝟏 ; G est en B à la vitesse VB. Au cours de la montée, le mouvement de la voiture
est assimilable à celui d’un solide en translation rectiligne et les frottements
équivalent à une force 𝑓⃗ parallèle à (x’x) et de valeur constante f. La force motrice
𝐹⃗parallèle à (x’x) a une valeur constante F.
Lorsque G passe en B, la force motrice est supprimée et la vitesse de la voiture en
C s’annule. La force de frottement garde toujours les mêmes caractéristiques et la
voiture rebrousse chemin en C et quitte la piste en A avec la vitesse 𝑉 ⃗. (Figure 1).
𝑭 𝒇
▪ La relation ( ∝) traduisant l’accélération a du véhicule : 𝐚𝒙 = − 𝐠 𝐬𝐢𝐧𝛂 +
𝒎
𝒗𝑩 𝒗𝑨
- la relation (𝜷) : 𝒕𝟏 =
𝒂𝒙
𝒗𝟐𝑩 𝒗𝟐𝑨
- la relation (𝜸) : 𝑳 = 𝟐𝒂𝒙
𝒈𝒚𝟐
▪ (a) 𝒁=− + 𝐲𝐭𝐚𝐧𝛂
𝟐𝒗𝟐 𝟐
𝑨 𝒄𝒐𝒔 ∝
Données numériques : vA = 72 km/h ; vB = 90 km/h ; m = 1000 kg ; g = 10 N/kg ;
f = 400 N ; F = 1800 N
❖ À propos de l’étude du circuit du système d’alarme d’une sonnerie.
Le système d’alarme de la sonnerie est constitué d’un circuit NM comportant une
résistance R, une bobine d’inductance L et de résistance négligeable et un
condensateur de capacité C monté en série et alimenté par un GBF de tension efficace
U (figure 2).
L’étude du circuit avec un oscilloscope cathodique bicourbe donne sur la voie 1 la
tension UNM et sur la voie 2 la tension UBM.
Le balayage fonctionne et l’écran présente l’aspect reproduit sur la figure 3.
Page 24 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
Sur les deux voies, l’échelle des abscisses est de 2,5. 10−3 s/cm, celle des ordonnées
est de 5 V/cm. À l’instant t = 0s la tension uNM(t) est maximale sur la figure 3.
On donne : R = 10 Ω ; U = 10 V ; π2 = 10 ; C = 2 × 10−5 F.
Tâche : Expliquer les faits puis prendre position.
Partie 1 : Mobilisation de ressources
1-
1.1- Énoncer le théorème de l’énergie cinétique et celui du centre d’inertie d’un solide
respectivement entre deux instants 𝑡1 et 𝑡2 et en un point M donné.
1.2- Choisir la bonne réponse correspondante :
a- L’expression des équations horaires 𝑥 = 𝑓(𝑡) et 𝑣𝑥 d’un mouvement rectiligne
uniformément variée qui part d’un point à l’instant 𝑡𝑜 𝑠 est donnée par :
x = ax(t − to)2 + vox(t − to) + xo x = 𝑎 𝑡 +𝑣 t+𝑥
(𝛼′): ; ( 𝛽)
𝑣𝑥 = 𝑎𝑥(𝑡 − 𝑡𝑜) + 𝑣𝑜𝑥 𝑣𝑥 = 𝑎𝑥𝑡 + 𝑣𝑜𝑥
𝑥 = 𝑋𝑚𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑)
(𝛾′) :
𝑣 = 𝜔𝑋 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑)
b- La relation indépendante du temps d’un mouvement rectiligne uniformément varié
est donnée par :
𝒊 :𝑋 + = 𝑋 ; 𝒊𝒊: 2𝑎 d = 𝑉 − 𝑉 ; 𝒊𝒊𝒊: 𝑥̇ + =𝑋
𝒄- Le déphasage |𝜑𝑖/𝑢| est déterminé graphiquement par la relation :
𝑎 ∶ 𝜑/ = ; 𝑏: 𝜑/ = ; 𝑐 : 𝜑/ = ;𝑑: 𝜑/ =
𝒅- L’expression de l’impédance d’un circuit RLC dont la bobine est résistive de
résistance interne r est donnée par la relation :
𝟏
e’ : 𝒁 = (𝑹 + 𝒓)𝟐 + (𝒍𝝎 − )𝟐 ; f’ : 𝒁 = 𝒓𝟐 + (𝑳𝝎)𝟐 ; g’ : 𝒁 = 𝑹𝟐 + (𝑳𝝎)𝟐 ;
𝑪𝝎
h’ : 𝒁 = 𝑼𝑰𝒄𝒐𝒔𝝋
Page 25 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
1.3- Réaliser le schéma d’un circuit (R, L, C) puis indiquer les branchements à
l’oscilloscope permettant de visualiser la tension aux bornes du conducteur ohmique
sur la voie 1 et celle aux bornes du générateur sur la voie 2.
Partie 2 : Résolution de problème
2-
2.1- Établir les relations (𝛼), (𝛽) 𝑒𝑡 (𝛾) puis faire l’application numérique de ces relations.
2.2- Établir l’expression de la distance L’= BC en fonction de VB, f, m, g, α et calculer sa
valeur.
2.3- Prendre position par rapport à l’affirmation de Gnami.
3-
3.1- Déterminer la fréquence N de la tension appliquée au circuit puis donner les
expressions des tensions instantanées uNM(t) et uBM(t).
3.2- Déterminer l’intensité efficace I, l’impédance Z du circuit et le déphasage ϕ entre
l’intensité instantanée i du courant traversant le circuit et la tension instantanée
appliquée aux bornes du circuit.
3.3- Déterminer l’inductance L de la bobine puis calculer sa valeur.
EXAMEN BLANC DEPARTEMENTAL COUFFO 2024 SERIE D
- Compétences disciplinaires évaluées
Page 26 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
• CD 1 : Elaborer une explication d’un fait ou d’un phénomène de son environnement
naturel ou construit, en mettant en œuvre les modes de raisonnement propre à la
physique, à la chimie et à la technologie.
• CD 3 : Apprécier l’apport de la physique, de la chimie et de la technologie à la vie de
l’Homme.
- Compétence transversale évaluée
• CTV 8 : Communiquer de façon précise et appropriée.
A/ CHIMIE ET TECHNOLOGIE
Contexte
Les connaissances en chimie permettent d’apporter des solutions aux certains besoins
humains. C’est le cas de :
- La détermination des informations illisibles sur l’étiquette d’un flacon contenant une
solution S0 d’une monoamine d’un laboratoire ;
- l’étude de la fermentation alcoolique du jus de raisin frais en vin.
Support
Produit ionique de l’eau à 25°C : Ke = 10−14. Masse volumique de l’eau : 𝜌e = 1g.cm – 3.
A propos de la solution S0 de la monoamine
L’amine de la solution S0 est une amine primaire aliphatique. Sa molécule est telle que
l’atome de carbone fonctionnel porte deux groupes alkyles. Sur l’étiquette du flacon
contenant la solution S0, les indications relatives à sa densité d et sa formule chimique
sont illisibles. Seul le pourcentage p en masse d’amine pure de la solution S0 est lisible. Il
vaut p = 63%. Deux tests sont réalisés sur S0 : Test N° 1 : Avec une balance de précision,
on mesure la masse mo d’un volume Vo = 10 cm3 de la solution S0 et on trouve mo = 7,5 g.
Test N° 2 : On dilue un autre volume Vo = 10 cm3 de la solution So dans une fiole jaugée de
façon à obtenir 1 L d’une solution S1. On dose ensuite un volume Vb = 10 cm3 de la solution
S1 avec une solution Sa d’acide chlorhydrique de concentration molaire volumique
Ca = 0,040 mol.L-1 en présence d’un indicateur coloré. L’équivalence acido-basique est
obtenue pour un volume Va = 20 cm3 de la solution d’acide chlorhydrique ajoutée.
A propos de la fermentation alcoolique du jus de raisin frais donnant le vin.
Le vin est une boisson provenant exclusivement de la fermentation du jus de raisin frais.
Mais derrière ce terme « fermentation » se cachent plusieurs transformations. Il s'agit entre
autres de la fermentation malolactique qui consiste en une transformation totale de l'acide
malique présent dans le jus de raisin en acide lactique sous l'action de bactéries suivant
l’équation :
HOOC − CH2 − CHOH − COOH ⎯⎯⎯⎯ CH3 − CHOH − COOH + CO2
Page 27 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
Le dosage enzymatique de l'acide malique restant dans le vin à une température de
fermentation maintenue à 20°C a permis de tracer la courbe suivante représentant la
variation du nombre de moles n d'acide lactique formé en fonction du temps t.
n(en mol)
t(en jours)
30
Tableau présentant l’évolution des nombre de moles na et n d’acide lactique
t(en jours) 0 4 8 12 16 20 28
na(en 10−2 mol) 2,6
n(en 10−2 mol)
na : nombre de moles d’acide malique restant à un instant t. t1 = 0 jour, t2 = 12 jours . L’acide
lactique intervient dans une suite de réactions chimiques traduites par les équations
suivantes :
Tâche : Expliquer des faits et apprécier l’apport de la chimie à la vie de
l’Homme.
Partie 1 : Mobilisation de ressources
1.
Page 28 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
1.1. Donner la propriété des amines mise en jeu lors du dosage d’une solution d’amine par
une solution acide et l’intérêt de la dilution d’une solution concentrée avant son dosage
acido-basique.
1.2. Montrer, à partir de la formule générale des amines primaires que la formule brute
générale des amines à chaine carbonée saturée non cyclique comportant n atomes de
carbone est CnH2n+3N. 1.3. Justifier parmi les propositions suivantes celle(s) qui est(sont)
vraie(s) et corriger celle(s) qui est (sont) fausses :
A) Lorsqu’on abaisse la température d’un mélange réactionnel, la vitesse de formation des
produits de cette réaction augmente.
B) L’acide lactique existe dans la nature sous deux formes spatiales différentes.
C) L’oxydation ménagée des alcools tertiaires donne aldéhyde.
Partie 2 : Résolution de problème
2.
2.1. Calculer, à partir des résultats du test N°1, la masse volumique ρ0 et la valeur de la
densité d de la solution S0 par rapport à l’eau.
2.2. Déterminer la concentration molaire C0 de la solution S0.
2.3. Montrer que la concentration molaire Co de la solution S0 vaut : 𝐶 = (avec M la
masse molaire du monoamine puis déterminer la formule semi-développée et le nom de
ce monoamine.
3.
3.1. Compléter le tableau du support et déterminer le temps de demi-réaction de la
fermentation malolactique étudiée.
3.2. Déterminer la vitesse moyenne de formation de l’acide lactique entre les dates t1 et
t2 d’une part et la vitesse de disparition de l’acide malique à la date t2 d’autre part.
3.3. Identifier (formules semi-développées et noms) les composés A, B, D et E.
B/ PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE
Contexte
La physique est une science exacte qui étudie et qui vise à expliquer l’ensemble des
phénomènes naturels ou provoqués en se basant sur les formules mathématiques par
établissement des lois qui les régissent. On s’intéresse dans ce cadre à:
- l’étude d’un pendule élastique à travers le système de suspension d’un véhicule
Logan ;
- l’identification des caractéristiques du dipôle RLC.
Support
A propos du véhicule Logan
Page 29 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
Le véhicule Logan est constitué d'une
caisse métallique reposant sur ses Figure 1
roues par l'intermédiaire d'une
suspension, formée d'un ensemble de
quatre ressorts avec amortisseurs. On
modélise cette voiture par un pendule
élastique vertical dont les oscillations
sont amorties. Ce pendule est constitué de la masse M (correspondant à la caisse) à
l'extrémité supérieure du ressort de raideur k, équivalent aux quatre. La mise en
oscillation a lieu lorsque l'extrémité inférieure du ressort (correspondant aux roues) subit
un déplacement vertical, par exemple lors d'un passage sur un dos-d'âne (figure 1). Afin
que le confort des passagers soit optimal lors du passage sur un dos-d'âne les réglages
de la suspension sont prévus pour que la caisse retrouve sa position initiale sans osciller.
La résultante des forces responsables des amortissements et 𝐹⃗ = −𝜇𝑣⃗ où 𝜇 est une
constante positive et 𝑣⃗ la vitesse du mouvement vertical. On étudie le mouvement du
pendule élastique dans un repère (0; 𝚤⃗) vertical descendant.
La caisse de la voiture est de masse M = 1095 kg à l'arrêt, sans passager. Le ressort de masse
négligeable est alors comprimé au repos de ∆𝑙0. Lorsque quatre passagers, de masse totale
m=280 kg, montent à bord de la voiture, la caisse s'affaisse d'une hauteur h = 3 cm.
Lorsque qu’un seul passager de masse m1 = 70 kg est à bord, la période propre des
oscillations de la caisse est notée T0.
A propos de l’identification des caractéristiques du circuit (R, L, C) :
On réalise trois expériences avec la même bobine (L, r)
✓ Schémas des montages réalisés au cours des expériences 1 et 2 suivis des
oscillogrammes obtenus :
- Base de temps : 2,5ms/cm.
- Sensibilité verticale sur la voie 1 : 5V/cm.
- Sensibilité verticale sur la voie 2 : 0,5V/cm.
- Valeurs de 𝑟1 et de 𝑟2 ∶ 𝑟1 = 10 Ω ; 𝑟2 = 15 Ω.
Page 30 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
- Tension aux bornes du circuit : 𝑢𝐴𝐷 = 𝑈𝑚 cos(𝜔𝑡).
Schéma du montage réalisé au cours de l’expérience 3 :
- La tension efficace de la tension (S) est maintenue
constante égale à 5V mais sa pulsation est réglable.
- L’intensité efficace maximale du courant électrique
dans le circuit est I0. On donne 𝐶0 = 1𝜇𝐹.
Tâche : Expliquer des faits.
Partie 1 : Mobilisation de ressources
1.1. Remplir le texte à trou en utilisant seulement les chiffres (ne pas recopier le texte)
Un ---(1)------ harmonique est un système physique qui suit un mouvement -----(2)------
autour de sa position d’équilibre sous l’effet d’une force de rappel. Dans un oscillateur
harmonique sans ---(3)--- , sa période ne dépend que de sa ----(4)---- et ---(5)---- du
ressort qui le relie à son point d’équilibre. Cet oscillateur peut être représenté par une
équation -----(6)--- de second ordre de la forme ---------(7)------- mais avec frottement de
coefficient de frottement λ, l’équation est de la forme ------------(8)--------
1.2. Répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes sans recopier les phrases :
a) Dans un circuit RLC série, la tension est en avance sur le courant lorsqu’il est
globalement inductif, c’est-à-dire que la phase du courant par rapport à la tension est
positive.
b) A la résonance d’intensité, l’impédance du circuit est maximale et vaut la résistance
équivalente des conducteurs ohmiques du circuit.
c) La tension efficace aux bornes d’un condensateur est la même que celle aux bornes
d’une bobine non résistive dans un circuit RLC à la résonance d’intensité.
1.3. Reproduire puis compléter la figure du montage de l’expérience 3 en insérant les
appareils de mesure convenables.
Page 31 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
Partie 2 : Résolution de problèmes
2.
2.1. Etudier la condition d’équilibre sans passager puis avec les quatre passagers et
calculer la constante de raideur k du ressort équivalent à la suspension du véhicule. Vérifier
alors que la période propre de l’oscillateur avec un passager à bord est T0 = 0,71 s.
2.2. Lorsque la voiture neuve avec un passager roule sur un dos-d'âne, établir l’équation
différentielle de son mouvement vertical. Nommer et tracer l’allure du régime de
fonctionnement observé.
2.3. L'essayeur recommence l'expérience avec une Logan ayant déjà beaucoup roulé. Ses
amortisseurs étant " fatigués ", l'amortissement de la caisse est moins important. Prévoir le
comportement de la caisse dans ce cas en utilisant le vocabulaire adapté. Tracer sur une
feuille de papier millimétré, l’allure du régime de fonctionnement correspondant.
3.
3.1. Établir l’expression de la tension uAD et celle de l’intensité i du courant électrique
dans le cas de l’expérience 1 et déterminer les valeurs des paramètres r, L et C en utilisant
des deux premières expériences.
3.2. Déterminer la valeur 𝜔0 de 𝜔 pour laquelle I = I0 en exploitant les résultats de
l’expérience 3, puis calculer I0 et le facteur de qualité Q.
3.3. Montrer qu’il existe deux pulsations différentes 𝜔1 et 𝜔2 pour lesquelles 𝐼 = avec
√
ω1 < ω2 et que ces pulsations vérifient la relation ω1ω2 = ω20.
EXAMEN BLANC DEPARTEMENTAL L’OUEME SERIE D 2024
Compétences disciplinaires évaluées :
CD n°1 : Elaborer une explication d’un fait ou d’un phénomène de son
environnement naturel ou construit en mettant en œuvre les modes de
raisonnement propres à la physique, à la chimie et à la technologie.
CD n°2 : Exploiter la physique, la chimie et la démarche technologique dans la
production, l’utilisation, et la réparation d’objets technologiques.
Page 32 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
CD n°3 : Apprécier l’apport de la physique, de la chimie et de la technologie à la vie de
l’Homme.
Compétence transversale évaluée : Communiquer de façon précise et appropriée.
A - CHIMIE ET TECHNOLOGIE
Contexte
Les avancées significatives connues dans le domaine de la chimie et de la
technologie ont permis d’apporter des solutions aux divers besoins des Hommes. On
peut, par exemple, exploiter la chimie pour apprécier la qualité d’un produit,
déterminer la quantité d’un composé ou synthétiser des molécules d’intérêts variés.
A cet effet, un technicien de laboratoire s’intéresse à :
- la synthèse de l’aspine et à la vérification de l’indication portée par une boîte d’un
comprimé d’aspirine de Rhône ;
- la détermination d’un volume de linalol.
Support
Vérification de l’indication portée par la boîte du comprimé d’aspirine
L’acide acétylsalicylique est le principe actif de l’Aspirine. C’est un composé organique
de dont la formule est ci-dessous.
En s’inspirant des informations de la notice d’un médicament d’aspirine, le
technicien de laboratoire élabore les schémas réactionnels suivants :
𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻2 + 𝐻2𝑂 → 𝐴
𝐴 ⎯⎯ 𝐵
2𝐵 ⎯⎯ 𝐷 + 𝐻2𝑂
𝐷+ −COOH ⟶ 𝐹 + 𝐵
OH
Afin de vérifier l’indication 500 mg portée par une boîte d’aspirine de Rhône, un
comprimé d’aspirine a été soigneusement broyé dans un mortier et toute la poudre
obtenue est introduite dans une fiole jaugée de 500,0 mL. Le mortier est rincé à
l’eau distillée pour récupérer dans la fiole, cette eau de rinçage. Le contenu de la
fiole est complété jusqu’au trait de jauge avec de l’eau distillée.
Page 33 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
Le technicien prélève ensuite dans un bécher, un volume Va = 100,0 mL de la solution
d’aspirine qu’il dose rapidement et à froid, avec une solution d’hydroxyde de sodium
de concentration Cb = 5,0.10 – 2 mol.L-1, en présence de la phénolphtaléine. Le virage
de l’indicateur coloré est observé pour un volume V b E = 10,9 mL de solution
d’hydroxyde de sodium versé.
Données : Masses molaires atomiques en g.mol-1 : M(H) = 1 ; M(C) = 12 ; M(O) = 16.
Composés Fonction chimique Formule semi- Nom
organiques développée officiel
A
B
D
F
Détermination du volume de linalol
Le linalol est une molécule aux propriétés hypotensives, antalgiques, relaxantes et
sédatives. Ceci justifie son utilisation en cosmétique. Sa formule semi-développée est
et sa masse volumique est 𝜌 = 858 kg.m-3.
L’oxydation ménagée du produit majoritaire M de l’hydratation complète du linalol
avec une solution acidifiée de dichromate de potassium (2K+ + Cr2O72-), de
concentration molaire 𝐶 = 5.10−2𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1, donne un composé organique T qui réagit
avec la 2,4-DNPH en donnant un précipité jaune et ne présente aucune action avec la
liqueur de Fehling. Le composé M représente les 92% de tous les produits de
l’hydratation du linalol.
Une parfumerie souhaite utiliser un volume V de linalol pour ses produits
cosmétiques. Le technicien constate qu’il faut 100 mL de solution oxydante pour
doser toute la quantité de produit M correspondant au volume V.
Le couple oxydant-réducteur relatif à l’ion dichromate :
Tâche : Expliquer des faits, utiliser le matériel approprié et apprécier l’apport de la
chimie et technologie à la vie de l’homme.
Partie 1 : Mobilisation des ressources
1.
1.1. Donner les caractéristiques d’une réaction de saponification.
1.2. Ecrire l’équation de la réaction de synthèse d’un anhydride symétrique.
1.3. Enoncer la règle de Markov-Nikov sur l’hydratation des alcènes.
Partie 2 : Résolution de problèmes
2.
2.1. Compléter le tableau du support.
2.2. Réaliser le schéma annoté du dispositif de dosage de la solution d’aspirine puis
expliquer pourquoi le dosage est réalisé rapidement à froid.
Page 34 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
2.3. Prendre position par rapport à l’indication de la boîte d’aspirine.
3.
3.1. Justifier que le linalol est un alcool insaturé.
3.2. Ecrire la formules semi-développées et le nom du produit majoritaire M.
3.3. Déterminer le volume V de linalol.
B- PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE
Contexte
Les avancées significatives connues dans le domaine de la physique et de la
technologie ont permis d’apporter des solutions aux diverses préoccupations des
Hommes. On peut, par exemple, exploiter la physique pour étudier le mouvement
d’un corps, comprendre le fonctionnement d’un objet technique ou déterminer les
grandeurs caractéristiques d’un composant électrique.
A cet effet, un groupe d’apprenants s’intéresse :
- au mouvement d’un oscillateur mécanique et d’un projectile ;
- au fonctionnement d’un moteur placé dans un circuit électrique.
Support
A propos du mouvement des objets
Le dispositif de lancement est celui de la
figure ci- contre.
Le ressort est parfaitement élastique, à
spires non jointives et de constante de
raideur K.
Le solide S, fixé à l’extrémité du ressort est
une boule supposée ponctuelle de masse
m = 225 g. A l’équilibre, le ressort est
comprimé de Δl0 = 1,5 cm et le centre d’inertie du solide S au point G0.
Le solide S est écarté de sa position d’équilibre jusqu’au point G1 d’abscisse x1= –5 cm
puis lâché sans vitesse initiale à l’instant t = 0 s.
Lors de son premier passage par la position d’équilibre, le solide S heurte un autre
solide S’ de masse m’= 50 g et immobile au point G0. Il se produit alors un choc
supposé élastique et les vitesses avant et après le choc sont colinéaires.
Données : La distance G0B = 10 cm ; α = 30° ; β = 45° et g =10 N. Kg-1
Fonctionnement du moteur électrique
Le moteur électrique appartient au circuit
électrique du schéma ci-contre et
comportant :
- un solénoïde AB de résistance R1 = 10 Ω,
de longueur ℓ = 1 m, ayant des spires
circulaires de rayon r1 = 5 cm.
Le bobinage du solénoïde est fait avec un
fil de cuivre de rayon r2 = 0,5 mm.
Page 35 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
- un générateur de tension continue, de f .é. m E et de résistance R = 2 Ω.
Le moteur est utilisé pour soulever une charge de masse m = 60 g, sur une hauteur
h = 2,5 m avec un rendement ρ = 85 % .
Lorsque l’interrupteur K est fermé, le moteur ne tourne pas mais lorsque K est ouvert,
le moteur tourne.
Autre donnée : g = 9,8 N.kg -1.
Tâche : Expliquer des faits, apprécier l’utilisation de la physique et de la technologie à
la vie de l’Homme.
Partie 1 : Mobilisation des ressources
1.
1.1. Dire à quelle condition un oscillateur mécanique est harmonique.
1.2. Etablir la relation donnant l’auto-inductance L d’un solénoïde.
1.3. Répondre par vrai (V) ou faux (F) aux affirmations suivantes :
a- L’énergie magnétique emmagasinée par une bobine d’inductance L et
traversée par un courant électrique I est donnée par E = 𝐿𝐼2 ;
b- Le phénomène d’auto-induction se manifeste lorsqu’une bobine est traversée
par un courant électrique continu.
c- La f.é.m d’auto-induction est donnée par la relation 𝑒 = −𝐿 .
Partie 2 : Résolution de problèmes
2.
2.1. Montrer que la constante de raideur du ressort vaut K = 75 N. m-1 et que le solide S
est un oscillateur harmonique sur la portion AB.
2.2. Calculer la vitesse V0 du solide S juste avant le choc et les vitesses respectives V1 et
V’1 des solides S et S’ juste après le choc.
2.3. Vérifier qu’au point B, la vitesse du solide S’est VB = 1,1 m.s-1 puis déterminer les
coordonnées du point de chute D du projectile S’ sur le plan BC.
3.
3.1. Calculer le nombre de spires N du solénoïde et son inductance L.
3.2. Expliquer pourquoi le moteur ne tourne pas lorsque l’interrupteur K est fermé et
pourquoi il tourne lorsque K est ouvert.
3.3. Déterminer la f.é.m. E du générateur.
Page 36 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
EXAMEN BLANC DEPARTEMENTAL COLLINES SERIE D 2024
COMPETENCES EVALUEES :
• CD 1 : Elaborer une explication d’un fait ou d’un phénomène de son
environnement naturel ou construit, en mettant en œuvre les modes de
raisonnement propres à la physique, à la chimie et à la technologie.
• CD2 : Exploiter la physique, la chimie et la technologie dans la production,
l’utilisation et la réparation d’objets technologiques
• CD3 : Apprécier l’apport de la physique, de la chimie et de la technologie à la
vie de l’homme.
- COMPETENCE TRANSVERSALE EVALUEE: Communiquer de
façon précise et appropriée.
A- CHIMIE ET TECHNOLOGIE
Contexte
Les avancées significatives connues dans le domaine de la chimie permettent
d’apporter des solutions aux divers besoins humains. On peut, par exemple,
exploiter la chimie pour apprécier la qualité d’un produit chimique ou synthétiser
des molécules d’intérêts variés. On s’intéresse ici à :
- la vérification de la qualité d’une solution commerciale S
d'acide picrique saisie par un service de contrôle de qualité
sur le marché.
- l’étude des propriétés chimiques du linanol
Support
A propos de la vérification relative à la solution (S) saisie.
Dosage pH-métrique de la solution (S)
- On réalise le dosage pH-métrique d'un volume Va =20 mL de la solution (S)
par une solution de dihydroxyde de magnésium de concentration
Cb = 2,5 x 10-2 mol.L-1.
Pour un volume Vb de solution de dihydroxyde de magnésium versé, les
mesures du pH ont permis d'établir le tableau suivant :
Vb(cm3) 0 4 8 12 16 17 17,5 18 19 22
pH 2,6 3,6 4,2 4,6 5,2 6,3 8 10,5 11 11,3
1 cm pour 1 cm3
- Echelles :
1 cm pour 1 unité de pH
Page 37 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
Informations:
- Sur l’étiquette du flacon de la solution commerciale d'acide picrique, on lit :
m = 1g d'acide picrique pour 100 mL de solution.
- La valeur expérimentale mexp de la masse d'acide picrique trouvée dans 100
mL est acceptable si elle est comprise entre 0,90 g et 1,10 g.
A propos de l’étude des propriétés chimiques du linanol
Le linanol est un liquide odorant très utilisé en cosmétique.
Le technicien d’une parfumerie réalise les tests suivants avec l’un des produits
noté M de l’hydratation complète du linanol :
-
- 𝑇 + 2,4 − 𝐷𝑁𝑃𝐻 → 𝑝𝑟é𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡é 𝑗𝑎𝑢𝑛𝑒 ;
- 𝑇 + 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝐹𝑒ℎ𝑙𝑖𝑛𝑔 → 𝑝𝑎𝑠 𝑑𝑒
𝑟é𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 ;
- 𝑇 + 𝐻é𝑙𝑖𝑎𝑛𝑡ℎ𝑖𝑛𝑒 → 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑜𝑢𝑔𝑒.
Tableau à compléter : Tests d’identification des aldéhydes et des cétones
Composés
Aldéhyde Cétone
Réactifs
2 ,4 - DNPH
Réactif de Schiff
Liqueur de Fehling
Nitrate d’argent ammoniacal ou réactif de
tollens
Tâche : Expliquer des faits, décrire l'utilisation du matériel approprié et apprécier
l'apport de la chimie et de la technologie à la vie de l’homme.
PARTIE 1 : Mobilisation des ressources
1.1. Décrire le mode opératoire du dosage d’un volume Va de la solution d’acide
picrique par une solution de base forte avec un pH-mètre déjà étalonné.
Page 38 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
1-2-Répondre par vrai ou faux puis corriger les affirmations fausses :
a-A une température de 25°C, lorsqu’on dose une solution d’un acide fort par une
solution de base forte ou une solution de base forte par une solution d’acide fort
le pH à l’équivalence acido-basique est toujours égal à 7.
b-Lors du dosage d’une base faible par un acide fort, la courbe pH = f(Va)
obtenue est une fonction croissante, comprenant un point d’inflexion et deux
concavités.
c- Lors du dosage d’une base forte par un acide fort, la courbe pH = f(Va) obtenue
est une fonction décroissante, comportant un point d’inflexion et deux concavités.
1.3. Reproduire et Compléter le tableau du support en utilisant les termes : test
positif ou test négatif.
PARTIE 2 : Résolution de problèmes
2.
2.1. Tracer la courbe pH = f (Vb) et en déduire les coordonnées du point
d’équivalence
2.2. Montrer justification à l’appui, que l’acide picrique est un acide fort.
2.3. Vérifier si l'indication portée sur l'étiquette du flacon d'acide picrique est
compatible avec le résultat expérimental.
3.
3.1- Justifier que le linanol présente une isomérie de configuration puis nommer
ce type d’isomérie.
3.2- Ecrire les formules semi-développées et noms des quatre produits
susceptibles d’être formés lors de l’hydratation complète du linanol puis identifier
les composés M et T.
3.3- Ecrire l’équation de la réaction de passage de M à T.
Page 39 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
B- PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE
Contexte
La plupart des faits et phénomènes de notre environnement s’interprètent
aisément avec les lois et principes établis dans le domaine de la physique. On
s’appuie sur l’application de ces lois et principes pour :
- expliquer le principe d’un jeu : Le jeu de golf, un sport de mains très
passionnant où le joueur frappe sa balle à une vitesse donnée ;
- Vérifier l’efficacité d’une caméra.
Support
A propos du jeu de golf
Le joueur frappe en un point O, la balle avec
une vitesse 𝑣 ⃗ faisant un angle α.
-L’instant de départ de la balle du point O est
pris pour l’instant initial.
-Données : a = 8,0 m ; b = 4,0 m ; h= 30 m,
d = 43 m, D = 52 m ; g =9,8 m.s-2 ;
𝑣 ⃗ = 50 m.s-1 et = 35°
A propos de la vérification de l’efficacité de la caméra utilisée
Le tournage des films documentaires nécessite des appareils pouvant capturer les
images sans attirer l’attention du sujet dont les gestes sont enregistrés. La
technique spectaculaire de capture des proies aériennes du « poisson archer » a
été filmée grâce à un appareil électro-optique. On vise ici l’exploitation des
données recueillies pour vérifier l’efficacité de la caméra utilisée.
Le circuit électrique représenté à la figure 2.1 modélise la partie électronique de
l’appareil électro-optique (caméra) utilisé. Pour identifier le rôle joué par le dipôle
D dans ce circuit électrique, on le supprime et on obtient le circuit électrique de la
figure 2.2.
Page 40 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
On ferme l’interrupteur à l’instant t = 0 s. Les courbes 1 et 2 ci-dessous
représentent respectivement la tension électrique 𝑢𝑐 dans les circuits électriques
2.1 et 2.2.
Une diode électroluminescente (DEL) produit la lumière nécessaire à la capture
des images en émettant des flashs lumineux lorsque la tension électrique est
positive.
L’œil du poisson archer arrive à distinguer deux flashs successifs si la durée
d’extinction de la DEL est supérieure à = 300 .
La caméra utilisée est efficace si elle n’attire pas l’attention du sujet filmé.
On dispose de deux listes A et B suivantes
Liste A : Ensemble de trois affirmations
a. Il y a de pertes d’énergie par
effet Joule.
b. Il n’y a pas de perte d’énergie par effet Joule ;
c. Les pertes d’énergie par effet Joule sont compensées
Liste B : Ensemble de trois oscillateurs électriques
1. Oscillateur électrique qui est le siège d’oscillations libres sinusoïdales ;
2. Oscillateur électrique qui est le siège d’oscillations amorties ;
3. Oscillateur électrique entretenu.
Tâche : Expliquer les faits.
PARTIE 1 : Mobilisation des ressources
1.1. Enoncer le théorème du centre d’inertie.
Page 41 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
1. 2.Attribuer à chaque chiffre de la liste B, la ou les lettres de la liste A qui lui
correspond (ent).
1-3- Donner la nature du régime d’oscillation représentée par chacune des
courbes 1 et 2 du support.
PARTIE 2 : Résolution de problèmes
2.
2.1. Déterminer dans le repère (O; ⃗𝚤 , 𝚥⃗), l’équation
cartésienne de la trajectoire de la balle
2.2. Dire justification à l’appui, si la balle :
- survole le sapin ;
- tombe dans le lac.
2.3. Déterminer la durée d’envol ∆𝑡 de la balle en admettant qu’elle survol le
sapin.
3.
3.1- Expliquer à partir de l’analyse des courbes 1 et 2, le rôle joué par le dipôle D
dans le circuit de l’appareil électro-optique.
3.2- Déterminer l’expression de la tension instantanée 𝑢 dans le circuit de la figure
2.1 après avoir établi l’équation différentielle à laquelle elle obéit.
3.3- Apprécier l’efficacité de la caméra utilisée pour filmer la technique de chasse du
poisson archer.
EXAMEN BLANC DEPARTEMENTAL COUFFO SERIE D 2024
Page 42 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
Page 43 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
Page 44 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
Page 45 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
Page 46 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
Page 47 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
GROUPE LA CERTITUDE
DISCIPLINE – TRAVAIL - RIGUEUR
COURS INTENSIFS juillet 2024
(COURS DE RENFORCEMENT 2024)
Classes ouvertes : 3ème – 1ères (C, D)
Tles (ABCD)
MODALITES DE PAIEMENT
Option 1 : Payez la totalité à l'inscription.
………………………………………………………………………….
Option 2 : Payez 10.000F à l'inscription et le reste au plus tard le lundi 10
juillet 2024
OBJECTIF VISE : PROGRAMMES DES CLASSES OUVERTES
3è SA1 − SA2 − SA3 − SA4
𝑇𝑙𝑒 𝐶𝐷 − SA1 − SA2 − SA3 en deux MOIS.
1è𝑟𝑒𝑠 − SA1 − SA2 − SA3
LIEU : EPP GBEGAMEY SUD GROUPE ABC (après le CEG
GBEGAMEY en face du Collège Notre-Dame des Apôtres
de Cotonou)
DEROULEMENT : Du 03 Juillet au 31 Août 2024
DUREE DE FORMATION : 09 Semaines
JOURS ET HEURES : Du lundi au Jeudi de 8H30 à 13H00
NB : Les inscriptions sont prévues du 01 mai au 17 juin 2024.
Pour plus d’information appeler:96 38 92 49 / 52 81 89 60 / 95 51 17 61
Au Groupe la Certitude, c’est l’expérience et le travail bien.
Page 48 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
Page 49 sur 49
Par le penseur Enseignant de PCT 96 38 92 49 – 95 51 17 61
Vous aimerez peut-être aussi
- Projet Des Lignes Directrices-Normes Techniques Et Modèle de Coûts - Partage D'infra TICDocument30 pagesProjet Des Lignes Directrices-Normes Techniques Et Modèle de Coûts - Partage D'infra TICFrançois chemin100% (1)
- Chapitre 18 Cours L'énergie Des Systèmes ÉlectriquesDocument7 pagesChapitre 18 Cours L'énergie Des Systèmes Électriquesjean06Pas encore d'évaluation
- Bepc Juillet 2021 NewDocument5 pagesBepc Juillet 2021 NewSamuel GBENOSIPas encore d'évaluation
- PUB PCT C Exam Blanc 2023Document44 pagesPUB PCT C Exam Blanc 2023landrylemuelPas encore d'évaluation
- Recueil D'exercices de Sciences Physiques 3è 2020-2021Document64 pagesRecueil D'exercices de Sciences Physiques 3è 2020-2021savadogowmauricePas encore d'évaluation
- Epreuve de Chimie Première CDEDocument2 pagesEpreuve de Chimie Première CDEbachssasmss8Pas encore d'évaluation
- Prepa BepcDocument16 pagesPrepa BepcLe boss EnockPas encore d'évaluation
- Bepc Blanc-2Document1 pageBepc Blanc-2DATSOMOPas encore d'évaluation
- Bepc PCTDocument1 pageBepc PCTYohann NgankongPas encore d'évaluation
- Compilation Bepc Blanc PCT 2024Document33 pagesCompilation Bepc Blanc PCT 2024AdonaïPas encore d'évaluation
- EVALUATION N1 2023 PCT 3eme-1Document2 pagesEVALUATION N1 2023 PCT 3eme-1salahoud-dine soulayePas encore d'évaluation
- Prepa Bac 2023 Physique ChimieDocument36 pagesPrepa Bac 2023 Physique ChimielavrymelchisedecktanohPas encore d'évaluation
- 3e PCTDocument11 pages3e PCTeucludePas encore d'évaluation
- 2ème Devoir Du 1er Semestre PCT 3ème 2018-2019 Ceg AlbarikaDocument2 pages2ème Devoir Du 1er Semestre PCT 3ème 2018-2019 Ceg AlbarikaOladé Ange Sèïvè LokoPas encore d'évaluation
- Chaambane Mohamed Soibaha Exercice 2 (Radioactivité)Document3 pagesChaambane Mohamed Soibaha Exercice 2 (Radioactivité)rihabPas encore d'évaluation
- PCT 3eDocument2 pagesPCT 3eRomario nzouPas encore d'évaluation
- Devoir Communal Tle 2024Document5 pagesDevoir Communal Tle 2024KouadioPas encore d'évaluation
- 1ere D DevoirDocument4 pages1ere D DevoirMarie-Luc Blai100% (1)
- Document PC 3è Pour a.D.S.c-1Document131 pagesDocument PC 3è Pour a.D.S.c-1mathsprof22Pas encore d'évaluation
- PC 3ème - L1 - Masse Et PoidsDocument7 pagesPC 3ème - L1 - Masse Et Poidshappy TPas encore d'évaluation
- DEVOIR DE NIVEAU N°1 LYCEE CLASSIQUE BOUAKE 1ère DDocument3 pagesDEVOIR DE NIVEAU N°1 LYCEE CLASSIQUE BOUAKE 1ère DMarie-Luc BlaiPas encore d'évaluation
- PC 6ème - L6 - Température Dun CorpsDocument9 pagesPC 6ème - L6 - Température Dun CorpsSamuel KouassiPas encore d'évaluation
- Sujet Bepc Blanc 2019 Epreuve de MathematiquesDocument2 pagesSujet Bepc Blanc 2019 Epreuve de Mathematiquesemmanuel cerda adonaïPas encore d'évaluation
- DEVOIR DE PCT 4è 2021-2022 TRIM1Document1 pageDEVOIR DE PCT 4è 2021-2022 TRIM1Pomeyi Kossi EguedimPas encore d'évaluation
- Lycee Scientifique 2023-2024 F5 CompoDocument5 pagesLycee Scientifique 2023-2024 F5 CompoJoel AmahPas encore d'évaluation
- Devoir Corrigé de Synthèse N°1 - Physique-Chimie - 1ère AS (2010-2011) MR Akermi AbdelkaderDocument4 pagesDevoir Corrigé de Synthèse N°1 - Physique-Chimie - 1ère AS (2010-2011) MR Akermi Abdelkaderacademie archimede67% (3)
- 4AS Collège R2Document1 page4AS Collège R2Line Hustling Dollar100% (2)
- Togo BEPC 2016 PhysiquesDocument2 pagesTogo BEPC 2016 PhysiquesDiabel DiopPas encore d'évaluation
- Devoir Du 1er Trimestre PCT Tle C 2022-2023 College ChaminadeDocument4 pagesDevoir Du 1er Trimestre PCT Tle C 2022-2023 College ChaminadeSamuel GbeassorPas encore d'évaluation
- Epreuve Bepc Blanc 2023 Physique Chimie College Monajoce Yopougon Cote D'ivoireDocument3 pagesEpreuve Bepc Blanc 2023 Physique Chimie College Monajoce Yopougon Cote D'ivoireKAMBOU JULESPas encore d'évaluation
- Corrigé Type PCT 3e - 1er TDocument2 pagesCorrigé Type PCT 3e - 1er TCharlotte KpodarPas encore d'évaluation
- DS - 7 - 1472 - 2021 2022 - 86 17 24 28 26 27 25Document13 pagesDS - 7 - 1472 - 2021 2022 - 86 17 24 28 26 27 25Armel Marc KouchoewanouPas encore d'évaluation
- Theori Circuit RLCDocument18 pagesTheori Circuit RLCOumar TraoréPas encore d'évaluation
- TD P6 SP TS1 2024 VFDocument5 pagesTD P6 SP TS1 2024 VFPapa aliou Ba100% (1)
- Exo Physic-Chimie TleDocument50 pagesExo Physic-Chimie TlePriscardPas encore d'évaluation
- DEV PCT 4è 1er TR 22-23Document1 pageDEV PCT 4è 1er TR 22-23GHGPas encore d'évaluation
- TD ALCANE Et TEC 1ère DDocument4 pagesTD ALCANE Et TEC 1ère DNguettia Yao jean Daniel Adou100% (1)
- 20 BEPCblanc MATH 3 Abj1UPdjame3Document3 pages20 BEPCblanc MATH 3 Abj1UPdjame3Khofi Serge KouakouPas encore d'évaluation
- Acide CarboxyliuqeDocument4 pagesAcide CarboxyliuqealphadzoPas encore d'évaluation
- No15 2ndACD 25 Mars 2023 Sujetexa - ComDocument2 pagesNo15 2ndACD 25 Mars 2023 Sujetexa - ComGjhgPas encore d'évaluation
- Sujet Bac STI Physique-Chimie Sujet I 2023Document3 pagesSujet Bac STI Physique-Chimie Sujet I 2023Toumany FofanaPas encore d'évaluation
- 1ère D Eval 4 Physique 2021 LybybokDocument3 pages1ère D Eval 4 Physique 2021 LybybokJoseph HiongPas encore d'évaluation
- TD N5 Introduction A LelectriciteDocument5 pagesTD N5 Introduction A Lelectricitemodouthiao111Pas encore d'évaluation
- Revision 3eDocument2 pagesRevision 3ebertin kaborePas encore d'évaluation
- TPcyclohexanoDocument3 pagesTPcyclohexanoAnis SouissiPas encore d'évaluation
- Bac Blanc Sacre Coeur 2023 CDocument5 pagesBac Blanc Sacre Coeur 2023 CmahamoudibnisPas encore d'évaluation
- Togo BEPC Blanc MathsDocument1 pageTogo BEPC Blanc MathsNamoryPas encore d'évaluation
- TDMeca 8Document3 pagesTDMeca 8Ihsan MokhlissePas encore d'évaluation
- EDHC 3ème L - 6 - L'IMPÔT ET LE DEVELOPPEMENT DE LA NATIONDocument5 pagesEDHC 3ème L - 6 - L'IMPÔT ET LE DEVELOPPEMENT DE LA NATIONkekoucasimir12Pas encore d'évaluation
- Serie D'exercices - Les AtomesDocument2 pagesSerie D'exercices - Les AtomesAmdjed Bahaa100% (1)
- EPREUVE DE PCT 6ieme Séquence 3eDocument2 pagesEPREUVE DE PCT 6ieme Séquence 3ePrince NgalePas encore d'évaluation
- CC3 de 4ème Année CanaanDocument1 pageCC3 de 4ème Année Canaanbrice mouadje100% (1)
- PC Physique Chimie 1994Document6 pagesPC Physique Chimie 1994Mahmoud ChiboubPas encore d'évaluation
- Devoir N 3 6eDocument1 pageDevoir N 3 6eBrahim DahaiPas encore d'évaluation
- Devoir 3 Modele 2 Physique Chimie 3ac Semestre 1Document2 pagesDevoir 3 Modele 2 Physique Chimie 3ac Semestre 1bouthaina taziPas encore d'évaluation
- 1er Devoir Du 2ème Semestre PCT 5ème 2021-2022 Ceg Le NokoueDocument2 pages1er Devoir Du 2ème Semestre PCT 5ème 2021-2022 Ceg Le NokoueHaroldPas encore d'évaluation
- Devoir de PCT 2Document1 pageDevoir de PCT 2Pomeyi Kossi Eguedim100% (1)
- QRet 1 L8 Zu P4 Bby JH QT 9 N CBICl XRNN 1 Ojm GQRB84 TDocument5 pagesQRet 1 L8 Zu P4 Bby JH QT 9 N CBICl XRNN 1 Ojm GQRB84 TOusmane BorePas encore d'évaluation
- EB 2024 Bor Bac D SujetDocument4 pagesEB 2024 Bor Bac D SujetalladayewildinePas encore d'évaluation
- Sujet Bac Blanc 2024 Départemental de L'alibori PCT Serie DDocument4 pagesSujet Bac Blanc 2024 Départemental de L'alibori PCT Serie DCéphas KpodanhoPas encore d'évaluation
- PCT - C OkDocument4 pagesPCT - C OkJerryPas encore d'évaluation
- Vocabulaire PROBABILITEDocument2 pagesVocabulaire PROBABILITEBOKINIPas encore d'évaluation
- Comptabilité SpecialeDocument5 pagesComptabilité SpecialeBOKINIPas encore d'évaluation
- MATHS 3ème CLE ET GRILLE DE CORRECTIONDocument10 pagesMATHS 3ème CLE ET GRILLE DE CORRECTIONBOKINIPas encore d'évaluation
- CamScanner 09-04-2024 13.13Document1 pageCamScanner 09-04-2024 13.13BOKINIPas encore d'évaluation
- POINT FINANCIER DE FESTIVAL GUELEDE AGBON Édition 2024Document5 pagesPOINT FINANCIER DE FESTIVAL GUELEDE AGBON Édition 2024BOKINIPas encore d'évaluation
- DEVOIR 2 1ère C-1Document2 pagesDEVOIR 2 1ère C-1BOKINIPas encore d'évaluation
- DEVOIR 2 1ère AB-1Document1 pageDEVOIR 2 1ère AB-1BOKINIPas encore d'évaluation
- Ee7r5-FEUILLE Chimie 6Document4 pagesEe7r5-FEUILLE Chimie 6EZECKIEL JEFFERPas encore d'évaluation
- Gidea Catalogo No Limits 6lingue 19 06 Rev00Document35 pagesGidea Catalogo No Limits 6lingue 19 06 Rev00Fakemd MoldovaPas encore d'évaluation
- Equation D'une DroiteDocument2 pagesEquation D'une DroiteasriPas encore d'évaluation
- Chapitre 1Document19 pagesChapitre 1Soufiane LafdilPas encore d'évaluation
- Activité Réaction NucléaireDocument4 pagesActivité Réaction NucléairesdfghjPas encore d'évaluation
- Chapitre 1Document4 pagesChapitre 1Amina BadaouiPas encore d'évaluation
- Allarm Code Cummins QSM11 CM570Document30 pagesAllarm Code Cummins QSM11 CM570Islam AttiaPas encore d'évaluation
- Série TD 01 Phénomène de Transfert PDFDocument2 pagesSérie TD 01 Phénomène de Transfert PDFFeial LaPas encore d'évaluation
- Sections 00 1 05 FR en deDocument58 pagesSections 00 1 05 FR en deSIYU CHENPas encore d'évaluation
- LECTRONIQUE DE PUISSANCE - ExercicesDocument11 pagesLECTRONIQUE DE PUISSANCE - ExercicesMarouan EladiPas encore d'évaluation
- Chapitre 2Document8 pagesChapitre 2KhettabPas encore d'évaluation
- Évacuation Des Personnes en Cas D'incendieDocument182 pagesÉvacuation Des Personnes en Cas D'incendiebouraadahakimPas encore d'évaluation
- MMC v1 FinalDocument60 pagesMMC v1 FinalPierre FournierPas encore d'évaluation
- Wegleitung Hangsicherungen FDocument40 pagesWegleitung Hangsicherungen Fموسى الفاطميPas encore d'évaluation
- Chapitre IxDocument17 pagesChapitre IxFerhat Outaleb0% (1)
- Cours19e6.10 Orthogonalité Des Modes NormauxDocument5 pagesCours19e6.10 Orthogonalité Des Modes NormauxMoulay ZoubirPas encore d'évaluation
- Cours ALG3Document19 pagesCours ALG3Aymane ElouadiPas encore d'évaluation
- Correction CNC 2024 Phy1 MPDocument6 pagesCorrection CNC 2024 Phy1 MPWahiba ElanziPas encore d'évaluation
- SCHNEIDER DAT - TeSysD Schuetze FRDocument54 pagesSCHNEIDER DAT - TeSysD Schuetze FRMerveil BorgeasPas encore d'évaluation
- Cours 1Document6 pagesCours 1MadjidAvengersPas encore d'évaluation
- Les Précipitations Tombées À SousseDocument5 pagesLes Précipitations Tombées À SousseDicko AliPas encore d'évaluation
- Symbole Electrique PDFDocument11 pagesSymbole Electrique PDFAlex SkanderPas encore d'évaluation
- 2bex 01 Continuit Ctr1Fr AmmariDocument2 pages2bex 01 Continuit Ctr1Fr AmmariACHRAF DOUKARNEPas encore d'évaluation
- 1es Chap 3 Cours Poly Complete 1Document8 pages1es Chap 3 Cours Poly Complete 1ramaroson.andrianarivoPas encore d'évaluation
- Vray Indirect Illumination - ApeiNe - Vray PDFDocument5 pagesVray Indirect Illumination - ApeiNe - Vray PDFModjo julien ronaldPas encore d'évaluation
- Memoire Fin D Etude 2 3Document70 pagesMemoire Fin D Etude 2 3evilievPas encore d'évaluation
- Charpente MétalliqueDocument16 pagesCharpente MétalliqueIssam BrahimPas encore d'évaluation
- Ouvrage20 - Cours de GéodésieDocument57 pagesOuvrage20 - Cours de GéodésieRaphaelle Josee Olomo NdjonkouPas encore d'évaluation
- Maizisalah Beton Precontraint (+sommaire)Document22 pagesMaizisalah Beton Precontraint (+sommaire)SalahPas encore d'évaluation