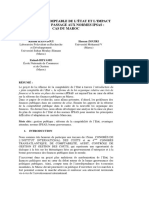Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Assainissement Comptable
Assainissement Comptable
Transféré par
Lucas ScottTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Assainissement Comptable
Assainissement Comptable
Transféré par
Lucas ScottDroits d'auteur :
Formats disponibles
_______________________________
Lexprience algrienne dans le processus dassainissement financier PP. 15 - 28
Lexprience algrienne dans le processus dassainissement financier
CHIHA KHEMISSI Universit de BLIDA
Lentreprise du secteur publique est depuis lindpendance un champ dexprimentation(1). Au rythme des options retenues au cours de son existence, elle a ainsi connu plusieurs mutations afin de sadapter avec les nouvelles donnes conomiques et sociales. Sur le plan financier, ces mutations sexpliquent essentiellement par les actions successives de restructuration et dassainissement financier entreprises par les pouvoirs publics dans le cadre des politiques de redressement des entreprises publiques. IPOURQUOI ASSAINIR LENTREPRISE PUBLIQUE ? Au plan micro-conomique, la pratique de lassainissement financier a pour objectif dallger, voire liminer les contraintes financires dont se trouve confronte lentreprise publique. Cela explique lexistence dun bon nombre dentreprises dont lactif net est ngatif et le fonds de roulement aussi . Dans une telle situation, plusieurs entreprises auraient t ainsi en faillite en raison des dsquilibres financiers aigus qui ont caractris la structure financire de ces entreprises. Pratiquement, les causes du dsquilibre financier peuvent tre imputes aussi bien aux entreprises qua leur environnement conomique et politique. 1les causes imputables aux entreprises Ces causes sont lies directement au lancement des projets dinvestissement dans des conditions dfavorables par leffet de limportance des cots de ralisation, de rvaluation et de fonctionnement de ces projets. En effet, cette situation de sur cot a remis en cause la rentabilit des projets ds leur lancement en production. 2Les cause lenvironnement imputables
blocages, mais aussi par les ingrences extrieures dans la vie de lentreprise A cet effet, il faut signaler que les effets de lenvironnement sur le dsquilibre financier des entreprises publiques sont pervers : Absence de subventions suffisantes pour la majorit dentreprises ; Absence de sanction des rsultats de lentreprise ; Non-adquation de la politique de lemploi et de rmunration, qui avaient pour consquences un accroissement des cots sans parallle avec les rsultats. Rigidit de certains instruments de rgulation en matire de prix, de fiscalit, de crdit, etc. La conjugaison de ces deux types de causes a donn naissance dun systme de production inefficace. Le redressement dun tel systme a ncessit des actions urgentes travers lassainissement financier de la situation du secteur conomique productif.
II- Les objectifs de lassainissement financier
Lassainissement fin,ancier a pour objectifs : Redresser les quilibres financiers des entreprises publiques pour une priode donne en leur permettant de se dvelopper pour les annes avenir ; Mettre lentreprise dans des conditions optimales de relance en matire de production, de productivit, de rentabilit, etc. Donner lentreprise une opportunit capitale lui permettant dune part de sortir de la spirale de difficults financires, dautre part dviter le retour aux dficits enregistrs : Permet lentreprise dtablir des relations de commercialit avec la banque grce sa situation financire assainie.. En effet, lassainissement financier ne constitue en aucun cas une viabilisation total de lentreprise, car sa situation ncessite ltablissement dun diagnostic complet afin de lui doter dun plan de dveloppement qui lui assure sa prennit et sa croissance. - 15 -
Ces causes sont essentiellement le caractre bureaucratique des procdures de planification qui dans la pratique se traduisant aussi bien par des pertes de temps ou/et des
Revu du chercheur / n 01/2002 _______________________________________________________
III- LES DIFFERENTES ACTIONS DASSAINISSEMENT FINANCIER
Afin de renforcer le dveloppement stratgique, les pouvoirs publiques avaient engag un certain nombre dactions en matire de redressement financier travers , notamment deux tapes caractrisant de la vie des entreprises publiques ; lune avec les tentatives de dcentralisation conomique travers la restructuration financire, lautre avec lautonomie des entreprises publiques. 1LA FINANCIERE RESTRUCTURATION
dinvestissement ont contribu lapparition des dficits financiers paralysants. Ainsi, la majorit des entreprises publiques tait dficitaire la fin des annes 70. Le tableau suivant permet dillustrer la situation des dficits de certaines entreprises et le niveau des dcouverts bancaires. (Voir Tableau n1) Il apparat que le recours au crdit bancaire a atteint un remarquable. Pour ces entreprises, ceci explique lexistence dun dficit de trsorerie accentu par labsence de rigueur dans la gestion des composantes du besoin financier dexploitation qui sont, notamment les valeurs dexploitation, les crances inter entreprises, et les dettes dexploitation. Or laggravation du dficit dexploitation dune entreprise lautre rside dans laccroissement des cots non compenss par les produits de lentreprise en plus de plus de limpact des facteurs externes imposs par lenvironnement. Au plan externe, les principaux facteurs dstructurant sont lis au systme de rgulation conomique savoir : la fixation des prix un niveau central sans tenir compte de la ralit des cots au niveau entreprise. Ainsi, la perte subie nest rarement compense par des subventions budgtaires ; le plthore et la complexit en matire dimposition ; la rigidit de la politique de crdit auprs des banques, etc. De telles contraintes, ont bien entendu, un impact dfavorable sur la structure financire des entreprises publiques. Afin de remdier cette situation, il a t demand chaque entreprise dlaborer un plan de restructuration en fonction des donnes comptables et financires quelle dtienne. bLes actions de restructuration
Dans le cadre de rformes engages par les pouvoirs publics durant la premire phase quinquennale(1998-1984), les entreprises du secteur publique ont bnfici en plus de la restructuration organique dune restructuration financire dont les objectifs se rsument ainsi( 2 ) : Lassainissement des entreprises financirement dsquilibres par la rsorption des dficits cumuls au cours de la priode prcdente ; Le traitement de lendettement bancaire, ainsi que des crances et des engagements entre les entreprises issues de la rforme organique ; La rduction du degr de dpendance financire de lentreprise vis vis de lEtat par la concrtisation de son autonomie financire ; Le rtablissement des quilibres financiers sur le court, moyen et le long terme. Dans cette optique, il nous semble utile dvoquer dans un premier temps les facteurs de dstructuration financire, puis dans un deuxime temps les actions prconises dan le cadre de la restructuration financire. aLes facteurs dstructurant de la situation financire Dans ce cadre, lentreprise publique se trouve confronte un ensemble de contraintes financires aussi bien endognes quexognes(3) : au plan micro-conomique, la dstructuration financire rsulte essentiellement de laccumulation importante des sur-cots gnrs par la mauvaise gestion des projets dinvestissement lancs dans le cadre des diffrents plans de dveloppement. Sajoute cela le gonflement des cots dexploitation gnrs par limportance des inputs en matires premires et produits semifinis imports, laccroissement des charges dexploitation accompagn de la faiblesse de la productivit des facteurs, la multiplication des surcots, dexploitation et - 16 -
Les actions dordre interne concernent essentiellement lamlioration de la production et de la productivit, lassainissement de la trsorerie, la gestion des composantes du cycle dexploitation, etc. Les actions externes ne dpendent ne dpendent pas de lautorit de lentreprise, mais elles relvent de celle de lEtat. Il sagit de doter les entreprises dun fonds de roulement, de rviser la structure des prix dans un but de rapprocher celle des cots, de revoir la politique fiscale et celle du crdit afin damliorer la situation financire de ces entreprises. Dans une telle situation, lon peut dire que la convention de restructuration financire comporte la fois des obligations des
_______________________________
Lexprience algrienne dans le processus dassainissement financier PP. 15 - 28
entreprises publiques concernant les actions internes et celles de lEtat concernant les actions externes. b-1 le financement de la restructuration financire Dans ce cadre, 300 entreprises ont bnfici entre 1983 et 1987 dun montant de 60.5 milliards de dinars dgags sous deux formes(voir tableau ci-dessous) : concours dfinitif destins laugmentation du capital social ; concours temporaires par laugmentation du niveau du fonds de roulement. (Voir le tableau n 2) Globalement, il faut signaler que cette premire tentative de rforme financire na pas donn de rsultats escomptables en matire de redressement financier des entreprises publiques. En effet, comment juger de ltat de sant financire des entreprises publiques, lorsquon sait que pour une grande majorit dentre elles, les comptes de situation ne prsentent pas un niveau minimum de fiabilit ? La seconde question qui vient lesprit, cest comment restaurer lquilibre de gestion lorsque aucun effort na t fait pour cerner les causes principales de la dstructuration financire ? A partir de l, le constat faire est que les entreprises dont lquilibre est cens avoir t restaur se sont vite retrouves nouveau dans une situation de dstructuration financire, en un laps de temps record. Cest ainsi que lon dcide de basculer au jour au lendemain en autonomie, une armada de canards boiteux (4 ). 3La mise en uvre du processus des rformes, et le passage lautonomie de lentreprise publique conomique Lassainissement financier opr en 1991 sinscrit dans le cadre des rformes conomiques inities en 1988 qui ont conduit lautonomie des entreprises et la promulgation de la rglementation portant, loi sur la monnaie et le crdit en avril 1990. Sur le plan juridique, les modalits dassainissement financier de lentreprise publique ont t dtermines par les circulaires du ministre de lconomie : n 27 du 16 mars 1991 ; n91/02 du 28 aot 1991. Dans cette optique, il sagit dvaluer limpact des dispositions de lopration dassainissement aussi bien sur la structure - 17 -
bilantielle de lentreprise que sur son fonctionnement. admarche financier de lassainissement
La dmarche retenue dans un premier temps consiste valuer les besoins dordre financier ncessaires au rtablissement de lquilibre financier des entreprises publiques. Il parat utile de rsumer le dispositif mis en uvre pour valuer lactif conomique et les capitaux propres de lentreprise. Ce dispositif devait permettre de dcider de lopportunit de faire passer lentreprise lautonomie ou de temporiser afin de situe des mesures daccompagnement, pour lui permettre dvoluer dans un environnement conomique meilleur. Ce dispositif est bas sur le principe de classification en quatre grandes catgories dentreprises( 5 ) : Les entreprises du groupe A qui prsentent un actif net positif et un fonds de roulement net positif ( juges viables et performantes) ; Les entreprises du groupe B qui prsentent un actif net positif ainsi quun fonds de roulement net ngatif Les entreprises du groupe C prsentant un actif net ngatif et un fonds de roulement net positif ; Les entreprises du groupe D considres comme financirement dstructures avec un actif net ngatif et un fonds de roulement galement ngatif. Dans ce cadre, lassainissement financier supposait le rquilibrage des structures financires des entreprises publiques qui taient classes en quatre groupes selon la situation de leur actif net et de leur fonds de roulement. Ce rquilibrage supposait une consolidation de lendettement des EPE envers lEtat et une prise en charge de son dcouvert bancaire dune manire ou dune autre. A cet effet, le constat dun actif net positif permet laffirmation de passage des EPE lautonomie sans faire appel aux subventions du trsor public. A ce titre, la slection des entreprises des catgories(A et B) vont passer directement lautonomie. Dans une telle situation, le capital social est auto-constitu par lactif net sans faire appel aux concours externes. Concernant les entreprises relevant de la catgorie (C), elle ncessite deux formes de concours, notamment un concours destin rsorber le dficit antrieure, lautre destin
Revu du chercheur / n 01/2002 _______________________________________________________ la dotation en capital. Les entreprises du groupe (D) juges fortement dstructures financirement, ncessite une assistance de lEtat pour lassainissement de leur dficit antrieur, la dotation en capital, et la reconstitution dun fonds de roulement net. En tout tat de cause, les entreprises des catgories C et D, devaient passer par lassainissement financier avant daccder la phase dautonomie. b- Les mesures dassainissement financier Dans ce cadre, les mesures dordre financier engags concernent deux volets ; la reconstitution dun actif net positif , et dun fonds de roulement net positif . La reconstitution dun actif net positif est fonction du niveau des dficits assainir, ainsi que de limportance de lendettement long et moyen terme. Les mesures visant la rsorption de lactif net ngatif selon le cas au 31/12/1990 se rapportent : la transformation de lendettement long et moyen terme en titres participatifs; la dotation dun capital adquat ; lintgration de lcart de rvaluation des investissements. La procdure de reconstitution dun fonds de roulement net positif vise essentiellement la restructuration des dettes long et moyen terme entrant dans la composition des ressources permanentes de lentreprises. A cet effet, un ensemble de mesures sont arrts, notamment : Le renforcement des fonds propres par les titres participatifs ; Le rchelonnement de lendettement long et moyen terme sur une priode allant de 15 20 ans ; Le remboursement des pertes de changes ; La transformation du dcouvert bancaire en crdit long et moyen terme ; La transformation des dettes long et moyen terme en titres participatifs. Pratiquement, lanalyse macro-bilans des entreprises publiques a fait apparatre que la structure du passif est caractris par une lourdeur du fardeau dendettement. Do le remboursement des dettes dans une situation de dsquilibre financier structurel, ne fait quaggraver le dcouvert bancaire qui gnre en contre partie un cot financier en se rpercutant sur la structure des charges dexploitation, ainsi sur la rentabilit de lentreprise. A cet gard, lintroduction des mesures visant - 18 la consolidation et la transformation de lendettement des entreprises a t peru comme un lment de valeur dans lassainissement financier, dou la dcision de transformation dune partie de lendettement vis vis du trsor public en concours dfinitif. Dun point de vu pratique, lapplication de cette mesure a pris une autre forme, du fait que lendettement a t spar en deux catgories( 6 ) : le principal pouvait subir une transformation en fonds social ; la charge financire prend la forme dune exigibilit immdiate Concernant le traitement du dcouvert bancaire, la question tait base la partie juge anormale dpassant 6 9 mois sur le chiffre daffaires, suivant la nature dactivit de lentreprise. Pour les entreprises non autonomes, le dcouvert anormal est transform en crdit moyen et long terme avec un dfr de remboursement de deux ans au moins.. Ainsi le dcouvert consolid ou gel est dans une deuxime phase assaini et transform en obligations ou en titres participatifs, ou rachet par le trsor. A la premire phase, doit succder une phase de recapitalisation aprs llaboration dun plan de redressement. Durant cette phase, les entreprises autonomes ont bnfici des subventions de subventions dquilibre par le fonds spcial pour le soutien de lassainissement (7). Lalimentation de ce fonds provenait de ponctions sur les entreprises excdent financier, et les organismes financiers. Le tableau ci-dessous montre la nature des dpenses effectues par le fonds dassainissement pour lanne 1992(8) . (Voir Tableau n 3) Un autre lment parmi dautres retenu dans lopration dassainissement financier qui est la rvaluation des investissements. La comptabilit repose sur le principe qui stipule lenregistrement des immobilisations au cot historique ; principe qui ne correspond pas des conditions ralistes, et conduisant souvent des valuations comptables non significatives. Cest pourquoi, quil faut procder la correction du patrimoine de lentreprise. Dans ce contexte, lentreprise publique, lors de son passage lautonomie, le souci davoir un actif net positif la conduit instituer une rvaluation de ses immobilisations ( 9 ). En effet, lopration de rvaluation des
_______________________________
Lexprience algrienne dans le processus dassainissement financier PP. 15 - 28
immobilisations gnre un cart de rvaluation qui vient sajouter la rubrique des fonds propres sous forme de plus-value. Sur le plan financier, le fonds de roulement net reste inchang, car le haut du bilan subi la mme variation correspondant au montant de lcart de rvaluation, par contre lactif net subi une modification vers la hausse. bCot et limites de lassainissement financier la restructuration des entreprises publiques, puis leur passage lautonomie nont pas russi relancer le secteur conomique malgr lapport financier considrable, estim 400 milliards de dinars environ . En effet, entre 1991 et 1993, les entreprises publiques ont bnfici dun apport de 274 milliards de dinars (10) du trsor public, sans pour autant assurer leur rentabilit financire et leur efficacit conomique. Pour les deux annes 1994 et 1995, des vnements dordre montaire et financier sont venus aggraver le dsquilibre structurel des entreprises publiques conomiques savoir : lajustement de la parit du dinar algrien ; lajustement du taux de rescompte de 11.5% 0 15% ; lajustement des taux bancaires dbiteurs de 18% 23.50 %. Cette situation a pouss ltat augmenter lenveloppe destin lassainissement financier(11). A la fin de 1995, la facture supporte par le trsor public pour lensemble des oprations dassainissement financier slve 670 milliards de dinars (12). Concernant lachvement de lassainissement financier, il a t prvu pour la fin de dcembre 1996, mais cette chance a t prolong la fin du premier trimestre 1997, suite au feu vert obtenu du fonds montaire international pour la poursuite de laide financire de l Etat au profit des entreprises publiques conomiques. A cet gard, les EPE prsentant une viabilit, bnficiaient du rchelonnement de leur dcouvert en contre partie de garanties travers leurs ngociations avec les banques. Les entreprises industrielles importantes qui sont en ombre de quinze , continuaient de bnficier jusqu la fin mars 1997 des concours financiers du trsor public, or les entreprises non viables devaient faire lobjet dune liquidation. Sur ce plan, lEtat se dsengage aussi du financement du plan de - 19 -
sauvetage des conomiques.
entreprises
publiques
Globalement, les oprations dassainissement financier na pas permis datteindre la totalit des objectifs tracs, mais il faut signaler que certaines entreprises ont pu amliorer leur situation financire, surtout avec les actions engages en parallle, notamment en matire dessaimage, de recentration sur les mtiers de base, de compression deffectif, etc. La crise que vit lentreprise dans lconomie moderne a une incidence directe sur le plan social. Les difficults conomiques, conjoncturelles ou structurelles, le changement des modes de production,les reconversion ,lautomatisation , tous ces phnomnes ont eu pour consquence de rendre prcaire la situation des salaries. Ceux-ci peuvent tout moment se trouver privs demploi au nom de la rentabilit et de lefficacit de lentreprise . Et cest pourquoi la dfense de lemploi et la garantie de sa stabilit sont devenues la principale revendication des organisations salariales, revendications lgitimes que le doit du travail na pu manquer de prendre en considration.(1) Ainsi ou a pu imaginer des solutions lgislatives qui tendent toutes un mme objectif, savoir la prservation de lemploi : rduction du temps de travail, dparts volontaires, abaissement de lge de dpart la retraite etc Lefficacit de ces mesures reste encore lobjet dun dbat trs anim . Une autre disposition contenue dans la Loi 90 -11 du 21 Avril 1990 relative aux relations de travail participe elle aussi cette proccupation . En effet daprs lart. 74 al. 1 de cette loi sil survient une modification dans la situation juridique de lorganisme employeur, toutes les relations de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et les travailleurs .(2) Ainsi seront donc sans influence , les vicissitudes juridiques que peut connatre lentreprise sur le sort des contrats individuels de travail . Ceux ci subsistent entre les salaris et le nouvel exploitant ds lors que la permanence de lentreprise est assure (3).Mais cette disposition,destine garantir lemploi au cas o survient une modification dans la situation juridique de lentreprise est-elle rellement efficace ? Si en apparence elle lest dans la mesure o le salari est tenu labri des changements que connatrait son entreprise, la ralit doit nous conduire tre plus nuanc .
Revu du chercheur / n 01/2002 _______________________________________________________ En limitant dune faon restrictive le domaine o le principe du maintien du contrat doit jouer (I) , et en reconnaissant des prrogatives tendues aux employeurs successifs de mettre fin aux relations de travail lors du(4)transfert dentreprise (II), la jurisprudence rattrape sans doute par les ralits conomiques va battre en brche cett disposition lgislative . I) Domaine dapplication du principe de la continuation du contrat de travail : Le principe de la continuation du contrat de travail saisit un nombre incalculable de situations dans lesquelles sopre un changement dans la condition juridique de lemployeur (A). Cependant, ce principe comporte certaines limites (B) A) champ dapplication : La continuation du contrat de travail doit tre tendue toutes les vicissitudes juridiques de lentreprise , que la cession de celle-ci soit totale (a) ou partielle (b). . a) Application aux cessions totales : Dans son acception la plus simple , la modification de la situation juridique de lentreprise se traduit par le changement de lidentit de lexploitant, donc de lemployeur, comme en cas de cession (5), de succession (6), de fusion (7), de transformation de fonds , ou de mise en socit . Mais la jurisprudence tend le principe de la continuation des contrats de travail toutes les vicissitudes juridiques de lentreprise . Ainsi, il a t dcid que doivent tre considres comme des modifications de la situation juridique de lentreprise : -la prise en location (8) ou la mise en location-grance (9), et linverse , la reprise par le propritaire du fonds lou. (10) - la transformation de la forme juridique de lentreprise (11), - et enfin la filialisation. (12) Mais si dans ces exemples, la modification de la situation juridique de lemployeur laisse intacte lactivit de lexploitation, cest dire lentreprise continue exercer la mme activit sous une direction nouvelle, il est des situation ou cette modification se double dun changement dactivit plus o moins profond . Doit-on alors conclure qu il nya plus continuit de lentreprise condition dexercice du principe , et que le changement de lactivit empche de ce fait la transmission des contrats de travail au nouvel exploitant? La question reoit en jurisprudence une solution nuance . - 20 Ainsi, lorsque lactivit nest pas radicalement diffrente de celle exerce auparavant, on fait appel la notion de connexit pour dcider de la continuation de lentreprise, et partant de la transmission des contrats de travail . Et dans cet ordre dide, il a t jug quun commerce de prt porter peut succder un commerce de tissus et cest toujours la mme entreprise qui continue (14). En revanche si le nouvel exploitant dcide dun changement radical de lactivit , ou mme en conservent la mme activit , apporte des modification importantes aux procds de fabrication, ou au mode dexploitation de lentreprise,il ny a plus continuation de celle-ci, et par consquant doit tre cart le principe de la transmission des contrats de travail . Ainsi il a te jug que lorsque le nouvel exploitant a eu recours la technique dincinration pour la destruction des dchets urbains alors que lentreprise le faisait auparavant par pyrolyse (15), ou lorsque le cessionnaire dcide de changer laffectation dun comion qui ntait par quip spcialement pour un usage dtermin,en camion de transport dordures (16), les salaris ne peuvent se prvaloire de la continuation de leurs contrat de travail faute de la continuation de lentreprise, condition pralable lapplication du principe . En vrit, ce critre de changement profond ou non de lactivit de lentreprise qui conditionne la continuation ou non des contrat de travail nest pas satisfaisant car il nest pas toujours facile cerner .Bien plus, il va lencontre de la finalit mme de la disposition lgislative qui dicte le principe de la transmission des contrats de travail en cas de modification juridique de la situation juridique de lemployeur . En effet, ce critre subordonne la continuation des contrat de travail la permanence de lentreprise alors que ce qui importe rellement est la permanence des postes de travail (17) Et ds lors, si la continuation des contrats de travail , malgr la modification intervenue dans la personne de lemployeur doit tendre garantir la stabilit de lemploi , alors les juges doivent rechercher chaque fois si, malgr le changement apport par le nouvel exploitant, la stabilit de lemploi du salari au regard de ses qualifications naurait pas t assure . Et au critre de la permanence de lentreprise, on substituera un critre plus objectif , celui de la permanence de lemploi (18)
_______________________________
Lexprience algrienne dans le processus dassainissement financier PP. 15 - 28
b) Application aux cessions partielles : Il est acquis, depuis longtemps que les contrats de travail doivent tre maintenus alors mme que la cession de lentreprise nest pas totale (19). Cependant, lapplication du principe de la continuation des contrats en cas de cession partielle de dentreprise ne va pas sans soulever quelques difficults . La premire consiste tracer les contoures de cette notion de cession partielle . On dfinit gnralement lentreprise dans son sens organique-, comme une organisation compose de moyens matriels (biens formant une universalit ) et humains , destine la production de biens et de services (20). Lentreprise est donc apprhende la fois travers les biens quelle met en uvre et les hommes qui contribuent luvre commune, le tout dans une finalit de production . Et comme lors dune cession totale de lentreprise, la jurisprudence veille, mme en cas de transfert partiel ce que la condition de la permanence de lentreprise, pralable au maintien des contrats en cours soit toujours respecte. Ainsi, la cession partielle emportant continuation des contrats de travail doit se traduire par le transfert dune banche dactivit importante dote dune organisation autonome (20), cest dire une entit conomique autonome comprenant des lments dexploitation ( matriel, stockes) et un personnel spcialement affect cette activit (22). Et ceci doit conduire logiquement carter du champ dapplication du principe du mentien des contrats, la cession qui porte sur certains lments dactifs isols, tel quun camion(23) ou une machine(24). Mais plus dlicate est la question de savoir si la transmission de certains lments incorporels peut tre ou non assimile un transfert partiel de lentreprise. La Jurisprudence semble en tout cas ladmettre dans lhypothse de la transmission dune marque . Ainsi il a t dcid que lorsque une entreprise cde une autre le droit dexploiter une de ses marques, les contrats des reprsentation qui en assuraient la diffusion doivent continuer avec le cessionnaire (25) . Cest quen effet, et bien quune marque ne soit pas une entreprise , la jurisprudence semble retenir dans ce cas le critre de la clientle ,car celle-ci reste attache la marque indpendemment de lidentit du fabricant du produit , et lui reste fidle tant que le produit lui donne satisfaction (26). La seconde difficult consiste savoir qui des - 21 -
salaris de lentreprise, lors dune cession partielle doivent tre concerns par la continuation des contrat de travail . On peut en effet imaginer que pendant une cession partielle , le cdant profite pour faire passer au cessionnaire les salaries dont il veut se dbarrasser, soit parce quil sont les moins qualifis , ou tout simplement ceux dont il ntait pas satisfait . Or sur ce point , la jurisprudence considre que seuls sont concerns par le maintien de leurs contrats de travail , les salaris qui taient exclusivement affects lactivit ainsi transfre (27). Bien plus, si lactivit objet de la cession ne bnficiait pas dun personnel spcialement affect, aucun contrat de travail ne pouvait tre mis la charge du cessionnaire(28) . B) Les limites dapplication du principe de la continuation du contrat Au champ dapplication du principe du maintien des contrats de travail , la jurispou dence apporte deux tempraments : Le principe ne recoit application qu la condition que lentreprise ne disparaisse pas(a), et quun lien de droit unisse les deux employeurs successifs (b) . a)Non disparition de lentreprise En exigeant la permanence de lentreprise, ou du moins la continuation dun activit conomique, la jurisprudence, on la vu, exclut les hypothses o le transfert de lentreprise se double dun changement profond de lactivit : il ny a plus de continuation de lentreprise et le personnel ne peut prtendre au maintien de sa relation de travail avec le nouvel employeur .En effet, quand lentreprise originelle meurt pour laisser place une entreprise nouvelle , le personnel peut tre valablement licenci et ne pourra bnficier daucune indemnit de rupture car il ne pourra ni se retourner contre le premier employeur qui invoquera la force majeure, ni contre le nouveau propritaire qui se dfendra de labsence de tout lien de droit entre les salaris de son prdcesseur et lui mme (29). La mme solution est retenue lorsque lentreprise , gnralement pour des motif s conomiques cesse toute activit , puis est reprise par un autre entrepreneur aprs un temps plus au mois long. Dans ce cas , il y a rupture de la continuation de lentreprise et les contrat de travail conclu par le cdant deviennent inopposables au nouvel exploitant . Encore faut-il que la fermeture de lentreprise puis sa reprise soient effectives et opres sans intention de faire chec au maintien des
Revu du chercheur / n 01/2002 _______________________________________________________ contrats de travail . En effet il arrive que lemployeur, pour faciliter la reprise de son affaire libre de tout le personnel, simule la fermeture de lentreprise et procde au licenciement de tout les salaris pour cause de cessation dactivit. Et ainsi , les contrat de travail , rompus avant lintervention de la cession ne sont plus en cours et ne passeront donc pas la change du repreneur (30) . Aussi, la fermeture suivie peu de temps aprs dune rouverture de lentreprise sous une direction nouvelle doit etre considre comme une opration de fraude la loi (31), visant faire obstacle la continuation des contrat de travail, si cette fermeture avait pour seul but de faciliter le transfert de lentreprise (32). Et les licenciement ainsi intervenus doivent tre dclars non pas abusifs mais nuls, autrement dit inopposables aux salaris qui peuvent contraindre le cessionnaire les poursuivre (33). Aussi, la jurisprudence se montre trs hardie rechercher lintention du cdant qui procde la fermeture de lentreprise, et si les licenciements qui y font suite nont pas ts effectus en vue de la cession(34). b) Exigence dun lien de doit Examin sous langle de la technique du droit civil, le principe de la continuation du contrat de travail apparait comme une drogation autre principe, celui de leffet relatif des conventions (35). En effet , layant cause, cest dire le nouvel employeur reste tenu au respect des contrat de travail passs par son prdcesseur alors mme quil nen avait pas t partie . Cette conception civiliste doit logiquement conduire exiger un lien de droit ,cest dire un rapport dauteur ayant cause entre les deux employeurs successifs, dfaut duquel le principe du maintien des contrat de travail ne saurait recevoir application . Or cette logique , qui conduirait ncessairement restreindre le champ dapplication du principe fut vite abandonn, et ds 1934 , la jurisprudence refuse de voir dans ce lien de droit une condition pralable au maintien des contrat de travail en cas de changement dans la personne de lemployeur (36). Pour la Cour de Cassation, ce principe destin a garantir aux salaris la stabilit de leur emploi doit recevoir application dans tous les cas o la mme entreprise continue fonctionner sous une direction nouvelle sans quil y ait lieu de rechercher sil existait ou non des liens de droit entre les employeurs - 22 successifs (37). Ainsi , le principe de la continuation des contrats de travail va devoir jouer dans tous les cas o intervient une modification de la situation juridique de lemployeur, pourvu quil y ait permanence de lentreprise , ou au moins celle de lactivit conomique, mme si aucun lien de droit nunissait les deux exploitants successifs (38) . Mais lextension excessive et parfois mme abusive de ce principe allait dboucher quelquefois sur des situations pour le moins surprenantes notamment en cas de changement de prestataires de services . La situation se prsente comme suit : une entreprise fait appel une socit spcialise pour assurer le service de gardiennage ou de nettoyage, ou lui confie la gestion de sa cantine ou le transport de son personnel. Puis le contrat arriv terme , lentreprise utilisatrice de ces services procde sa rsiliation pour confier cette mme tche une autre socit . Pour la Cour de cassation , lorsque la socit continue assurer le service confi prcdemment une autre socit , il sagit bien de lexploitation de la mme entreprise (39), cest dire que le remplacement dune socit par une autre constitue une modification juridique de lentreprise et conclut tout logiquement que les contrats de travail conclu s par la socit qui a perdu le march doivent tre maintenus par le nouvel exploitant. (40) . Une situation analogue se rencontre encore dans le domaine des travaux publics o deux adjudicataires se succdent dans un mme marche (41) . Mais une telle extension nallait pas manquer de susciter linquitude de la doctrine (42) qui voit dans cette jurisprudence un moyen de fausser le jeu de la libre concurrence conomique ,dans la mesure o une socit qui emporte un march prcdemment dtenu par une autre se voit contrainte soit de conserver les salaris de lentreprise concurrente au risque de se retrouver en situation de sureffectif, soit de procder au licen ciment de ces derniers mais en supportant dans ce cas les indemnits de rupture(43). Bien plus, cette solution dgage par la jurisprudence reserve parfois lentreprise utilisatrice de services de bien mauvaises surprises. Ainsi , cette entreprise qui, lexpiration du contrat procde sa rsiliation parcequelle nest pas satisfaite des services du premier prestataire, et son remplacement par un autre, voit lui revenir
_______________________________
Lexprience algrienne dans le processus dassainissement financier PP. 15 - 28
par le jeu du transfert des contrats de travail ces mmes salaris dont elle tait mcontente !
Sensible sans doute ces critiques, la jurisprudence aprs un demi-sicle marqu par une position dune constance remarquable, opre partir de 1985 un revirement spectaculaire. Cest dabord lAssemble Plnire de la Cour de cassation qui donne le ton en affirmant et dune faon qui ne prte aucune quivoque que la modification de la situation juridique ne pouvait rsulter de la perte dun seul march (44).Ensuite, lui embotant le pas, la Chambre Sociale exigea un lien de droit entre les deux employeurs successifs comme condition essentielle au maintien des contrat de travail. Ainsi il a t dcid, et dans le domaine des travaux publics, que le nouvel adjudicataire nest pas tenu de conserver son service les salaris de lentrepreneur auquel il vient de succder, mme affects au chantier quil vient de reprendre et cela, faute dun lien de droit unissant les deux employeurs (45) La mme solution est retenue lorsque lentreprise utilisatrice de services reprend ledit service confi une socit spcialise pour ensuite assurer elle- mme sa gestion (46) . Donc le principe est dsormais pos : pour quil y ait transmission des contrats de travail , un lien de droit doit exister entre les employeurs successifs, dfaut duquel, le principe doit tre cart. Cependant, lexigence dun tel lien doit tre nuance .En effet sil est admis dsormais quen cas de reprise en gestion directe par lentreprise utilisatrice des services, de certaines activits dites d intendance (gardiennage, nettoyage , transport du personnel ) la continuation des contrats de travail doit tre carte , il en va autrement lorsque lactivit confie ou concde des prestataires extrieurs puis reprise par lentreprise , a trait certains aspects de la production ou de la distribution de ses produits(47) . Il est vrai que de prime abord , on peut penser que les deux situations peuvent tre assimiles car finalement, et dans les deux cas lentreprise reprend ce quelle a concd une autre,mais en ralit, lassimilation est trompeuse . En effet, si dans la premire hypothse (reprise dun activit dintendance ), il y a bien un lien de droit unissant le prestataire et lentreprise utilisatrice des services lors de la cession,ce mme lien fait dfaut lors du retour de cette mme activit lentreprise - 23 -
cdante. On peut mme dire que la reprise par cette dernire de cette activit qui est extrieure son activit proprement dite marque la fin justement de ce lien droit (48) . Au contraire lorsque une entreprise reprend une activit de production ou de distribution prcdemment concde une autre, il sagit bien lorigine dune sorte de dmembrement de lactivit mme de lentreprise cdante (cession partielle ), crant un premier transfert de lexploitation lors de la cession vers lentreprise cessionnaire et un second transfert vers lentreprise cdante cette fois ci au moment de la reprise (49) Et ds lors, la condition de lexistence dun lien de droit se trouvant remplie, lentreprise est tenue au maintien des contrats de travail conclus par le cessionnaire. II) Prrogatives des employeurs successifs quant au contrat objet de la transmission Le contrat de travail ainsi transmis, il reste dterminer les pouvoirs du nouvel employeur Un principe fondamental domine cette question : le cessionnaire ne saurait avoir moins de droits que le cdant, et de ce fait le nouvel employeur pourrait procder la rupture de la relation de travail (A), et a priori sa modification (B). A)Rupture pour lentreprise : rorganisation de
Il est admis et depuis longtemps que la transmission des contrats de travail au cessionnaire ne fait pas chec au doit de celui ci de procder au licenciement de certains salaris lorsquil justifie dune rorganisation de lentreprise (b) . Mais le cdant ne peut pas en principe procder de tels congdiements avant le transfert de lentreprise mme si ce moment l , la rorganisation des services a t dj dcide par le cessionnaire. Mais sur ce point l , la jurisprudence a encore volu (a). a) Rupture avant le transfert de lentreprise Le cdent peut procder lui-mme la rorganisation de lentreprise et au licenciement de certains salaries si au moment du congdiement , la cession ntait pas encore envisage (50). Mais pourrait il oprer ces congdiements en vue de la rorganisation dcide par le cessionnaire ? On peut penser de prime abord que la rorganisation de lentreprises envisage par
Revu du chercheur / n 01/2002 _______________________________________________________ le cessionnaire avant ou au moment de la cession peut lgitimer les licenciements effectus par le cdant avant le transfert de lentreprise, du moins lorsque les salaris licencis nont pas t remplacs. Cest quon effet, la suppression des postes de travail, dcide dj par le nouvel employeur dans le cadre dune rorganisation conduira invitablement au licenciement des salaris aprs la cession(51). Doit-on alors conclure quil serait indiffrent pour ces salaries quils soient licencis avant ou aprs la cession, par lancien employeur ou pour le nouvel exploitant ? Le raisonnement est sduisant mais il nen est pas moins dangereux, car si les salaris effectivement ne subissent pas de dommages lorsque leurs postes de travail sont supprims, il ne faut pas perdre de vue que la cession de lentreprise a souvent lieu suite des difficults conomiques et financires . Or si on admet que lancien employeur puisse licencier dans le cadre dune rorganisation projete par le cessionnaire, les salaris congdis ne peuvent dans ce cas ni se retourner contre ce dernier pour le paiement des indemnits de rupture, et cela pour cause dabsence de tout lien de droit, ni contre leur ancien employeur, celui l tant devenu insolvable. On peut mme imaginer une collusion frauduleuse entre le cdant et le cessionnaire qui par cette manuvre librera ce dernier de payer toute indemnit de rupture en transfrant cette obligation la charge du premier employeur qui de toute faon ne pourra pas payer. Aussi doit-on conclure que si les salaris dans le cas o leurs postes de travail sont supprimes doivent tre de toute faon licencis, autant quils le soient par un cessionnaire solvable que par un cdant en difficults. Cette solution qui est en somme profitable aux salaries en tant quelle laisse intacts leurs droits aux indemnits de rupture a t celle adopte par la Cour de cassation en France qui jusquen 1980 condamnait systmatiquement tous les licenciements antrieurs une cession dentreprise (55). Mais un arrt du 31 janvier 1980(56) marque un revirement inattendu dune jurisprudence jusque l constante(57), en admettant dsormais que le principe de la continuation des contrats de travail ne fait pas ncessairement obstacle ce que, avant mme que ne sopre la cession, le salari soit licenci compte tenu de la rorganisation laquelle le futur exploitant a dores et dj dcid de procder(58) . - 24 Cette solution, critiquable sur le plan du droit car elle bat en brche le principe mme du maintien du contrat du travail, peut trouver sa justification par ailleurs en ce quelle rend plus aise la transmission des entreprises en difficults en dchargeant lacqureur de payer les indemnits de rupture, permettant ainsi de sauvegarder loutil de production et de conserver au moins une partie des postes demploi. b) Rupture lentreprise . aprs le transfert de
Si le nouvel exploitant dispose des mmes prrogatives qui taient celles de lancien employeur, il devient vident que le principe qui soppose seulement lextinction automatique des contrats par le seul fait du changement ninterdit pas lemployeur,aprs transformation,de rorganiser lentreprise en licenciant le personnel qui lui parat inutile, la condition de respecter les rgles relatives aux ruptures(59) Et cest peu prs cette formulation que la Cour de cassation en France sen tient lorsquelle dcide que la modification de la situation juridique de lentreprise ne fait pas chec au droit que possde lemployeur de rorganiser son entreprise en supprimant des emplois qui lui paraissent inutiles(60). Et justement, le transfert de lentreprise est trs souvent suivi de la rorganisation de ses services car dans la plupart des cas ,la cession de lexploitation intervient suite des difficults conomiques (financires, structurelles ou autres). Mais le pouvoir de rorganisation que possde le nouvel employeur ne tend nullement contrarier le principe du maintien des contrats de travail, car si les conditions du transfert sont remplies, le cessionnaire ne peut sopposer la continuation de ces contrats. Ceux-ci passent bien la charge du nouvel employeur qui peut ce moment,mais ce moment seulement provoquer leur rupture (61), selon les rgles de droit commun en la matire, cest dire suivant les mcanismes applicables aux licenciements pour cause conomique, (62) Et cest ce cessionnaire quincombera alors la charge de payer les indemnits de pravis et de licenciement. Or,cest sur ce point l justement que le transfert du contrat de travail deviendra profitable au salari licenci ( 63). En effet et selon une jurisprudence constante, les indemnits de rupture doivent tre calcules sur la base de la totalit de
_______________________________
Lexprience algrienne dans le processus dassainissement financier PP. 15 - 28
lanciennet acquise en y incluant le temps pass chez lancien employeur (64) . Ainsi, et par leffet du maintien du contrat de travail, le salari reste attach une seule entreprise, peu importe que celle-ci ait chang de statut juridique,ou chang de propritaire. Le travailleur est tenu par un seul contrat de travail qui englobe toute lactivit dans son ensemble. Et la jurisprudence, poussant ce raisonnement encore plus loin, dcide dans ce cas prcis, que lanciennet passe au service de lancien employeur doit tre prise en compte non seulement pour le calcul de lindemnit de pravis et de licenciement, mais encore pour le calcul des indemnits des congs pays(65), et lindemnit de dpart en retraite (66). Elle exige mme que le certificat de travail contienne les mentions relatives lensemble des activits du salari dans lentreprise, y compris celles exerces sous lgide de lancien employeur(67). Et dans ce mme ordre dide, il a t soutenu que lanciennet acquise chez le prcdant employeur doit tre prise en compte lorsquil sagit de dterminer lorde des licen ciments, cot bien sur des autres critres, tels que lexprience dans le poste, la qualification professionnelle ou les charges de famille (68). Ainsi, et grce au principe du maintien du contrat de travail, la carrire professionnelle du salari cesse dsormais dtre traite de manire parcellaire et fragmente, pour tre apprhende de faon globale et unitaire,lorsquelle sest droule au service dune mme exploitation conomique. Mais si cette solution est largement favorable au salari, elle nen lui rserve pas moins quelquefois de dsagrables surprises. Ainsi, il a t dcid que le nouvel exploitant est tout fait fond invoquer lappui du licenciement du salari transfr, des fautes ou des ngligences professionnelles commises par lui alors quil se trouvait sous lautorit de lancien employeur (69). B)Modification du contact de travail par le nouvel employeur. Le transfert du contact travail au nouvel employeur sopr de plein droit, et aucune formalit nest exige. Le salari de son cot ne peut sopposer ce transfert, sauf se voir imputer la rupture du contrat qui sen suivrait.(70). Mais en invoquant cette notion de transfert, - 25 -
on imagine souvent que cest le mme contrat conclu par lancien employeur qui passe, avec toutes ses conditions et modalits, la charge du nouvel exploitant. Mais cette supposition heurterait directement le principe selon lequel le transfert des contrats de travail doit mettre le cessionnaire dans la mme situation qui tait celle du cdant. Il ne peut pas avoir moins de droits que lui. Or ce dernier, fort de son pouvoir de direction, avait la possibilit de modifier le contrat de travail (71). Pourtant, certaines Cours dappel en France avaient estim que le nouvel exploitant tait tenu, par leffet du transfert, de reprendre sans modification possible les contrats en cours, et avaient conclu quun licenciement intervenu suite une modification substantielle du contrat, refuse par le salari, doit tre considr comme abusif. Mais ces dcisions ont toutes encouru la censure de la Cour de cassation pour qui la poursuite du contrat en cours nimpliquait pas automatiquement le maintien de tous les avantages acquis, quils soient ou non essentiels 72 ) ). Ainsi, la modification du contrat de travail en cas de substitution dun employeur un autre rejoint les solutions de droit commun en la matire. Tout dabord, le nouvel employeur peut imposer des modifications qui ne portent pas sur un lment essentiel du contrat( 73). Si le salari refuse, il pourrait tre considr comme dmissionnaire, ou licenci pour faute grave, ce qui, dans les deux cas le privera des indemnits de rupture(74). Par contre, si la modification propose par le nouvel employeur porte sur un lment essentiel du contrat (75), et si le salari la refuse, la rupture sera alors imputable lemployeur (76) qui sera condamn payer les indemnits de pravis et de licenciement(77) . La modification de la situation juridique de lentreprise ne fait donc pas barrage au nouvel employeur de pouvoir apporter des modifications au contrat de travail ainsi transmis lui. Et lon ne pourrait mme pas objecter que la modification dcide par le nouvel employeur , lorsquil refuse de confirmer le salari dans les conditions qui taient les siennes dans ses rapports avec son ancien employeur , tendrait faire chec au principe du maintien du contrat , car on ne peut refuser au cessionnaire ce quon admettrait au cdant. Et donc, par leffet du transfert, la continuation du contrat de travail est certes
Revu du chercheur / n 01/2002 _______________________________________________________ assure, mais pas ncessairement aux mmes conditions. Dans ces moments difficiles de chmage et de prcarit, ce nest pas le moindre mrite de ce principe.
Tableau n 1 : Situation du dficit et du dcouvert bancaires de certains entreprises la fin de 1979 ( en millions de dinars )
ENTREPRISES SONACOME SN SEMPAC SOGEDIA ONACO SNMC NIVEAU DU 6300 731 511 2184 2181 NIVEAU DU 850 775 1186 515 4420 DECOUVERT BANCAIRE DEFICIT DEXPLOITATION
Source : Documents MPAT, cit par A.BRAHIMI, OP.CIT, p.227.
Tableau n2 : Plan de restructuration financire de 300 entreprises publiques Concours dfinitifs - Consolidation des rsultats - Consolidation des DLT - Contribution du budget en argents frais Total Montant Concours temporaires 2 24.50 3 7.71 34.20 - Emprunts LT octroys par le trsor public - Crdits CT octroys par les banques Total 7.10 26.30 19.20 Montant
Source : Elabor partir des mesures financires externes de restructuration financire
- 26 -
_______________________________
Lexprience algrienne dans le processus dassainissement financier PP. 15 - 28
Tableau n3 : Dpenses engages par la fonds dassainissement pour 1992 Unit : en milliards de DA OPERATION Rcapitulation des banques EPE autonomes : pertes de changes ( dettes au 31-12-90 ) EP non autonome : pertes de changes Rmunration du dcouvert consolid de 22 EPE Rmunration des 22 EPE Cot du Gel du dcouvert des EPL Pertes de change en 1992 des banques sur emprunts extrieurs non rtrocds aux entreprises Total
Source : Conseil National de Planification
MONTANT
4.00 4.00 5.00 3.50 2.50 2.00 21.20 42.50
__________________________________ (1) A.M.HACHEMI, Assainissement financier : bilans et perspectives , in lentreprise et la banque, 1994, p.59 (2) A.BRAHIMI : 1991, 392 (3) Il sagit de contraintes internes qui sont imputables lentreprise et des contraintes externes qui sont imputables lenvironnement. (4 ) S. AOUMEUR , in hebdomadaire n26, 1990, p.22 (5 ) Cahier de la rforme n4, rapport sur lingnierie financire, mars 1988, p.152 et 153 (6) Y.DEBBOUB, 1995, p.128
(7) Dcision du Ministre de lconomie n27 du 16/03/1991, n 9102 du 28/08/1991.
(8) Loi des finances pour 1992 (9) Article 13 de la loi des finances complmentaire pour 1988, suivie des dcrets n90/103 en vu de fixer les conditions de rvaluation du 27/03/1970 et n93/250 du 24/10/1993.
(10) Revue lEconomie n 17, sept 1994, p.20. (11) Loi des finances complmentaire pou 1994 (12) Dbat national sur le dveloppement conomique et la politique sociale, du 29/09 au 03/10/1996 (Palais des nations)
Rfrences bibliographiques
1- A.BRAHIMI : Lentreprise algrienne, 1991,OPU
- 27 -
Revu du chercheur / n 01/2002 _______________________________________________________
2- Cahiers du CREAD n39 : Le trimestre 1997 , 1997 3- Y. DEBBOUB : Le nouveau mcanisme economique 1995, OPU. 3- Ecotechnics : Lanne conomique et sociale , 1998 4- Guide indicatif de lassainissement comptable et financier, CNC, avril 1998 5- H.BENISSAD : La rforme conomique en Algrie , 1991,OPU 6- M.BELAIBOUD : Gestion stratgique de lentreprise algrienne , 1985,OPU 8- Rapport gnral relatif lautonomie de lentreprise,1988 9- Rapport du FMI, Algrie : Stabilisation et transition lconomie de march , 1998 10- Rapport sur la situation conomique et sociale dans le monde, 1995, Nations Unies.
- 28 -
Vous aimerez peut-être aussi
- Relations Internationales. Cours, Exercices CorrigésDocument327 pagesRelations Internationales. Cours, Exercices CorrigésSanusi FaithfullGod AkimPas encore d'évaluation
- Final RestructurationDocument23 pagesFinal RestructurationKhadija Lm100% (2)
- Prospective Maroc 2030 - Les Finances PubliquesDocument96 pagesProspective Maroc 2030 - Les Finances PubliquesomarsrvPas encore d'évaluation
- Restructuration Financiere Outil de Relance de L'activiteDocument2 pagesRestructuration Financiere Outil de Relance de L'activiteMOUSSA DIABATEPas encore d'évaluation
- Restructuration Financiere Outil de Relance de L ActiviteDocument2 pagesRestructuration Financiere Outil de Relance de L ActiviteAbdoulaye BakayokoPas encore d'évaluation
- Pas MarocDocument4 pagesPas MarocMehdiPas encore d'évaluation
- Incitations FiscalesDocument12 pagesIncitations FiscaleshbyPas encore d'évaluation
- Secteur Des Etablissements Et Des Entreprises Publiques Au MarocDocument34 pagesSecteur Des Etablissements Et Des Entreprises Publiques Au MarocyassinedoPas encore d'évaluation
- Questions Des ExamsDocument5 pagesQuestions Des Examsfatimazahrasaadouni696Pas encore d'évaluation
- Resume Final GESTION EEPDocument4 pagesResume Final GESTION EEPkamalPas encore d'évaluation
- Restructuration FinanciereDocument2 pagesRestructuration FinancieregharbiachrafPas encore d'évaluation
- Performance LofDocument15 pagesPerformance LofadilPas encore d'évaluation
- Réforme de LOLFDocument6 pagesRéforme de LOLFRéda TsouliPas encore d'évaluation
- مزانيةDocument27 pagesمزانيةMoh GibaPas encore d'évaluation
- Comprendre Les Mesures Nouvelles de La Loi de Finances 22-18Document16 pagesComprendre Les Mesures Nouvelles de La Loi de Finances 22-18Valentin DONGMOPas encore d'évaluation
- La Methode BBZ Dans Le Secteur Public LiDocument29 pagesLa Methode BBZ Dans Le Secteur Public LiCi MohammedPas encore d'évaluation
- Gestion Budgétaire PubliqueDocument14 pagesGestion Budgétaire PubliqueHala RhPas encore d'évaluation
- La Qualite de La DepenseDocument13 pagesLa Qualite de La DepenseNoura Asta barkaPas encore d'évaluation
- Tom 1 FRDocument603 pagesTom 1 FRsini123Pas encore d'évaluation
- Rapport D'Enquete: Inspection Générale Inspection Générale Des Affaires Sociales Des FinancesDocument58 pagesRapport D'Enquete: Inspection Générale Inspection Générale Des Affaires Sociales Des Financesbawoumotom n'datouPas encore d'évaluation
- Politique Relance GabonDocument13 pagesPolitique Relance GabonNathanPas encore d'évaluation
- Politique BudgetaireDocument11 pagesPolitique BudgetaireAfoudi MarouaPas encore d'évaluation
- La Crise Au MarocDocument68 pagesLa Crise Au Marocfifix13100% (1)
- Politique BudgetairesDocument1 pagePolitique BudgetairesSalma HllPas encore d'évaluation
- La Décentralisation Fiscale Vecteur de Modernisation de L'administration Publique en AlgérieDocument29 pagesLa Décentralisation Fiscale Vecteur de Modernisation de L'administration Publique en AlgérieShaïma BMAPas encore d'évaluation
- Schema Directeur Reforme EtatDocument45 pagesSchema Directeur Reforme EtatchokamPas encore d'évaluation
- Le Post Covid Au MarocDocument14 pagesLe Post Covid Au Marocabdelaliantid27Pas encore d'évaluation
- Info Covid 19Document9 pagesInfo Covid 19Tahir SalamiPas encore d'évaluation
- Rapport Bengrich Version FinaleDocument29 pagesRapport Bengrich Version FinaleImane BlaliPas encore d'évaluation
- Gestion Axée Sur Les RésultatsDocument8 pagesGestion Axée Sur Les RésultatsAbdEssamad RbahPas encore d'évaluation
- Accompagnement de La Reprise Progressive de L'activité ÉconomiqueDocument6 pagesAccompagnement de La Reprise Progressive de L'activité ÉconomiqueSlimani Alaoui SouadPas encore d'évaluation
- Management Fiscal Intro Sup'managementDocument17 pagesManagement Fiscal Intro Sup'managementMahamadou SANOGOPas encore d'évaluation
- Republique Du Congo - Rapport Diagnostic 2018Document55 pagesRepublique Du Congo - Rapport Diagnostic 2018PAKAPas encore d'évaluation
- 2ème Partie Teams 6Document4 pages2ème Partie Teams 6touimar hamzaPas encore d'évaluation
- Entreprises en Difficultés Droit TunisienDocument47 pagesEntreprises en Difficultés Droit TunisienINES100% (1)
- 38f93062804049f11d3c1f0e6a40b5a8 (1)Document1 page38f93062804049f11d3c1f0e6a40b5a8 (1)Hamza TijaniPas encore d'évaluation
- CR 2022-03 Croissance Structure Fiscale FDocument21 pagesCR 2022-03 Croissance Structure Fiscale FNourhen KarmaPas encore d'évaluation
- Assainissement Et Soutenabilité Des Finances Publiques Au MarocDocument6 pagesAssainissement Et Soutenabilité Des Finances Publiques Au MarocSanaa benzinebPas encore d'évaluation
- La Devaluation Du Franc Cfa en 1994Document3 pagesLa Devaluation Du Franc Cfa en 1994Gbon Bêma Coulibaly100% (1)
- Gestion Axée Sur Les RésultatsDocument7 pagesGestion Axée Sur Les RésultatsAyoub AitelkhayatPas encore d'évaluation
- Article 26Document16 pagesArticle 26yssinePas encore d'évaluation
- La Titrisation Au Maroc Innovation Au Service Des Acteurs Économiques Et FinanciersDocument123 pagesLa Titrisation Au Maroc Innovation Au Service Des Acteurs Économiques Et FinanciersRtui MedPas encore d'évaluation
- FinanceDocument19 pagesFinanceChi chouPas encore d'évaluation
- التسيير العمومي الجديد كآلية لتحسين حكامة مؤسسات القطاع العام PDFDocument20 pagesالتسيير العمومي الجديد كآلية لتحسين حكامة مؤسسات القطاع العام PDFabdelillah kahlouchePas encore d'évaluation
- Premiere Partie Memoire EnaDocument42 pagesPremiere Partie Memoire EnacyberPas encore d'évaluation
- Processus D'élaboration Des Budgets Dans Les EntreprisesDocument44 pagesProcessus D'élaboration Des Budgets Dans Les EntreprisesSidmou MerzouguePas encore d'évaluation
- BUDGETDocument16 pagesBUDGETHala RhPas encore d'évaluation
- Seminiare Sur La Bonne Gouvernance Des Finances PubliquesDocument4 pagesSeminiare Sur La Bonne Gouvernance Des Finances PubliquesB.IPas encore d'évaluation
- Note Pres LC 50 21 Reforme EEP FRDocument10 pagesNote Pres LC 50 21 Reforme EEP FRdell inspironPas encore d'évaluation
- 17 BeninDocument13 pages17 BeninJuste WillPas encore d'évaluation
- Enjeux de La TitrisationDocument39 pagesEnjeux de La Titrisationmalvert91Pas encore d'évaluation
- Rapport Financement PermanentDocument33 pagesRapport Financement Permanentmoussaid soukainaPas encore d'évaluation
- Réforme Des EEPDocument18 pagesRéforme Des EEPOuidad ElbahilyPas encore d'évaluation
- Hasnaoui PDFDocument17 pagesHasnaoui PDFDriss El HadaouiPas encore d'évaluation
- Wa0009Document45 pagesWa0009Johann KonaPas encore d'évaluation
- Intro Et PassageDocument2 pagesIntro Et Passagejoan5colonPas encore d'évaluation
- Impacts de L'application Des Normes IPSASDocument4 pagesImpacts de L'application Des Normes IPSASben dhaouiaPas encore d'évaluation
- FPDocument4 pagesFPissam handarPas encore d'évaluation
- Faits Saillants Du Rapport D'activités de La Cour Des Comptes 2013Document105 pagesFaits Saillants Du Rapport D'activités de La Cour Des Comptes 2013Ahmed KabilPas encore d'évaluation
- RapportDocument29 pagesRapportImane BlaliPas encore d'évaluation
- Le tableau de bord prospectif: Les 4 composantes essentielles pour une stratégie d'entreprise à long termeD'EverandLe tableau de bord prospectif: Les 4 composantes essentielles pour une stratégie d'entreprise à long termePas encore d'évaluation
- Audit ExterneDocument24 pagesAudit ExterneMaha Ben BrahimPas encore d'évaluation
- Audit SocialDocument20 pagesAudit SocialLucas ScottPas encore d'évaluation
- Controle de GestionDocument41 pagesControle de GestionLucas ScottPas encore d'évaluation
- Gouvernance Audit Et Contrôle de GestionDocument33 pagesGouvernance Audit Et Contrôle de GestionLucas ScottPas encore d'évaluation
- Comptabilité Et Finance Des EntreprisesDocument9 pagesComptabilité Et Finance Des EntreprisesLucas ScottPas encore d'évaluation
- Dossier Administratif 2017-2018Document6 pagesDossier Administratif 2017-2018Anonymous 7mIdRLCDPas encore d'évaluation
- Guide MarocDocument5 pagesGuide MarocelyPas encore d'évaluation
- Tran Duc Thao - Qui Est Trần Đức ThảoDocument8 pagesTran Duc Thao - Qui Est Trần Đức ThảomcshaoPas encore d'évaluation
- M0248MPGEO15Document74 pagesM0248MPGEO15gridechPas encore d'évaluation
- 1697 Em26052015 PDFDocument21 pages1697 Em26052015 PDFelmoudjahid_dzPas encore d'évaluation
- La Question Morale Du Bonheur PDFDocument11 pagesLa Question Morale Du Bonheur PDFAnonymous 6N5Ew3Pas encore d'évaluation
- L' Habitat InsalubreDocument224 pagesL' Habitat InsalubreSelma Abalhssain MestassiPas encore d'évaluation
- (PDF) L'implementation de La Budgetisation Axée Sur Les Résultats Au MarocDocument16 pages(PDF) L'implementation de La Budgetisation Axée Sur Les Résultats Au MarocJoussef PlitoPas encore d'évaluation
- StratA Gies Romanesques PDFDocument452 pagesStratA Gies Romanesques PDFRIDA ELBACHIR100% (1)
- La Rotonde, Édition Du 17 Septembre 2018Document16 pagesLa Rotonde, Édition Du 17 Septembre 2018La_RotondePas encore d'évaluation
- Coup D'etatDocument6 pagesCoup D'etatMamadou NgomPas encore d'évaluation
- Procedure SoutenanceDocument1 pageProcedure Soutenancezidan2003Pas encore d'évaluation
- Les Territoires Dans La MondialisationDocument8 pagesLes Territoires Dans La Mondialisationclaro legerPas encore d'évaluation
- EDHC 3ème DEVOIR COMMUN N°1Document2 pagesEDHC 3ème DEVOIR COMMUN N°1Younousse N'djaPas encore d'évaluation
- Testez. Votre Style d' AnimateurDocument3 pagesTestez. Votre Style d' Animateurimel.chatons2000Pas encore d'évaluation
- 3 La Realisation de La PaieDocument7 pages3 La Realisation de La PaieMohamed DiarrasPas encore d'évaluation
- ChomageDocument15 pagesChomageJunior KoskoPas encore d'évaluation
- Ostracisme CorrectionDocument2 pagesOstracisme Correctionmehdi benPas encore d'évaluation
- Leroux (Alfred), Recherches Critiques Sur Les Politiques de La France Avec L'allemagne de 1292 À 1378, 1882.Document312 pagesLeroux (Alfred), Recherches Critiques Sur Les Politiques de La France Avec L'allemagne de 1292 À 1378, 1882.Francophilus VerusPas encore d'évaluation
- 41 RH Apreciation PG 148 A 170-2Document23 pages41 RH Apreciation PG 148 A 170-2Sanaa BenaagidPas encore d'évaluation
- 13 Le Vote Pondéré La Matrice de DécisionDocument2 pages13 Le Vote Pondéré La Matrice de DécisionkawtarPas encore d'évaluation
- الإطار المرجعي الدولي للحماية الاجتماعيةDocument311 pagesالإطار المرجعي الدولي للحماية الاجتماعيةYoyo KokoPas encore d'évaluation
- Les Concepts Clés de L'entraide Sociale Sont La Solidarité, La Coopération Et L'altruismeDocument4 pagesLes Concepts Clés de L'entraide Sociale Sont La Solidarité, La Coopération Et L'altruismeShoto's girlPas encore d'évaluation