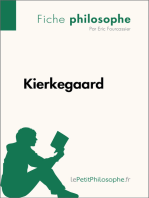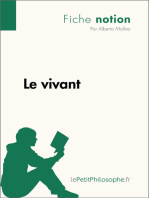Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Bréhier Philosophie 1
Bréhier Philosophie 1
Transféré par
eadu_tomaCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Bréhier Philosophie 1
Bréhier Philosophie 1
Transféré par
eadu_tomaDroits d'auteur :
Formats disponibles
@
mile BRHIER
(1876 -1952)
Histoire de la philosophie
Tome premier LAntiquit et le Moyen ge
Un document produit en version numrique par Pierre Palpant, bnvole, Courriel : ppalpant@uqac. ca Dans le cadre de la collection : Les classiques des sciences sociales fonde et dirige par Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi Site web : http : //www.uqac.ca/Classiques_des_sciences_sociales/ Une collection dveloppe en collaboration avec la Bibliothque Paul -mile Boulet de lUniversit du Qubec Chicoutimi Site web : http : //bibliotheque.uqac.ca/
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
Cette dition lectronique a t ralise par Pierre Palpant, bnvole, Paris. Courriel : ppalpant@uqac. ca partir de :
HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE, Tome premier. LAntiquit et le Moyen ge.
par mile BRHIER (1876 - 1952)
Librairie Flix Alcan, Paris, 1928, 788 pages en un volume. Polices de caractres utilise : Times New Roman, 10 et 12 points. dition numrique complte Chicoutimi le 31 dcembre 2005.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
NOTE CSS
Un clic sur @ en tte et fin douvrage, et en tte des chapitres et sections, permet de rejoindre la table des matires. En nimporte quel point, presser Ctrl-Pos 1 ou Ctrl Begin permet de rejoindre la tte douvrage, presser Ctrl-Fin ou Ctrl-End permet den rejoindre la fin. Liens : Nous navons indiqu aucun lien spcifique vers des sites traitant de tel ou tel thme. Nous renvoyons vers la page des Classiques : Ressources en philosophie qui donne une slection de sites importants disponibles en philosophie. A signaler toutefois un lien de lHistoire vers Les Classiques lorsquapparat pour la premire fois un auteur ayant sur ce dernier site une page de liens vers des sites de philosophie. En revanche, nous avons souhait lier lHistoire aux uvres des philosophes cits par . Brhier. La Bibliotheca Classica Selecta de lUniversit catholique de Louvain a recens les sites prsentant des textes, trs souvent intgraux, de lAntiquit. Nous les avons trs frquemment utilis en liens, et notamment : Nimispauci, http://ugo.bratelli.free.fr/ http://remacle.org/ Itinera Electronica, http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/intro.htm Les Jardins de Lucullus, http://mapage.noos.fr/Anaxagore/Lucullus.html Lacadmie de Nice, http://www.ac-nice.fr/philo/ Philoctetes, http://philoctetes.free.fr/ Pour le Moyen ge, les sites sont moins nombreux. Nous avons surtout li : http://www.jesusmarie.com/ Saint Augustin, http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/augustin/ Saint Thomas dAquin, http://docteurangelique.free.fr/ Le Gorgias est tlcharger du site des Classiques. A noter quassez souvent, les pages lies nont pas de signet intrieur dapprocher le passage recherch. Nous avons alors souvent plac, juste aprs lment permettant dapprocher le passage par utilisation de la Edition/Rechercher : il faut alors entrer comme lment de recherche les lettres inscrits entre crochets : [xxxx]. IMPORTANT Les fichiers pdf prsents pour lHistoire de la Philosophie permettent les liens partant du corps de texte, mais ne permettent pas les liens partant des notes. Une solution a t adopte pour le tome II, compte tenu du faible nombre de liens partant des notes. Cette solution na pas t retenue pour le tome I, o les dparts de liens en note sont beaucoup plus nombreux, et les utilisateurs de fichiers pdf perdent donc l un lment important Si vous dsirez bnficier des liens en notes, nous vous conseillons lutilisation des fichiers doc, au besoin avec les visionneuses Word Viewer disponibles gratuitement sur Internet, qui permettent une lecture parfaite. Deux adresses de tlchargement, la premire pour Windows 95, 98 et NT, la seconde pour les Windows plus rcents : http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9BBB9E60-E4F3-436DA5A7-DA0E5431E5C1&displaylang=FR http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=95e24c87-8732-48d5-8689ab826e7b8fdf&displaylang=fr permettant le lien, un commande ou chiffres
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
TABLE DES MATIRESI
Introduction I. Priode hellnique. II. Priode hellnistique et romaine. III. Moyen ge et Renaissance
Bibliographie Index TOME II
I. PRIODE HELLNIQUE @ CHAPITRE PREMIER : Les prsocratiques.
I. La physique milsienne. II. Cosmogonies mythiques. III. Les pythagoriciens. IV. Hraclite dEphse. V. Xnophane et les Elates. VI. Empdocle dAgrigente. VII. Anaxagore de Clazomnes. VIII. Les mdecins du Ve sicle. IX. Les pythagoriciens du Ve sicle. X. Leucippe et Dmocrite. XI. Les sophistes.
CHAPITRE II : Socrate CHAPITRE III : Platon et lAcadmie.
I. Platon et le platonisme. II. La forme littraire. III. But de la philosophie. IV. Dialectique socratique et mathmatiques. V. Dialectique platonicienne. VI. Lorigine de la science. Rminiscence et mythe. VII. Science et dialectique de lamour. VIII. Revision de lhypothse des ides. IX. Lexercice dialectique du Parmnide. X. La communication des ides. XI. Le problme des mixtes. La division. XII. Le problme cosmologique. XIII. Lenseignemest oral de Platon. XIV. Philosophie et politique. XV. La justice et la temprance. XVI. Le problme politique. XVII. Justice sociale. XVIII. Nature et socit. XIX. Lunit sociale. XX. Dcadence de la cit. XXI. Le mythe du politique. XXII. Les lois. XXIII. Lacadmie au IVe sicle aprs Platon.
CHAPITRE IV : Aristote et le Lyce.
I. Lorganon :les topiques. II. Lorganon (suite) : les analytiques. III. La mtaphysique. IV. Critique de la thorie des ides. V. La thorie de la substance. VI. Matire et forme : puissance et acte. VII. Physique ; les causes, le mouvement, le temps, le lien, le vide. VIII. Physique et astronomie : le monde. IX. La thologie. X. Le monde. XI. Ltre vivant : lme. XII. Morale. XIII. La politique. XIV. Le pripattisme aprs Aristote.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
II. PRIODE HELLNISTIQUE ET ROMAINE @ CHAPITRE PREMIER : Les Socratiques.
I. Caractres gnraux. II. Lcole mgarique. III. Les Cyniques. IV. Aristippe et les Cyrnaques.
CHAPITRE II : Lancien stocisme
I. Les Stociens et lHellnisme. II. Comment nous connaissons lancien stocisme. III. Les origines du stocisme. IV. Le rationalisme stocien. V. La logique de lancien stocisme. VI. La physique de lancien stocisme. VII. La thologie stocienne. VIII. Psychologie de lancien stocisme. IX. Morale de lancien stocisme.
CHAPITRE III : Lpicurisme au IIIe sicle.
I. Epicure et ses lves. II. La canonique picurienne. III. La physique picurienne. IV. La morale picurienne.
CHAPITRE IV : Prdication morale, scepticisme et nouvelle Acadmie au IIe et au IIIe sicle.
I. Polystrate lpicurien. II. Lhdonisme cynique. III. Pyrrhon. IV. Ariston. V. La nouvelle Acadmie au IIIe sicle : Arcsilas. VI. La nouvelle Acadmie au IIe sicle : Carnade.
CHAPITRE V : Les courants dides au Ier sicle avant notre re.
I. Le moyen stocisme : Pantius. II. Le moyen stocisme (suite) : Posidonius. III. Les picuriens du Ier sicle. IV. La fin de la nouvelle Acadmie.
CHAPITRE VI : Les courants dides aux deux premiers sicles de notre re.
I. Caractres gnraux de la priode. II. Le stocisme lpoque impriale. III. Musonius Rufus. IV. Snque. V. pictte. VI. Marc-Aurle. VII. Le scepticisme au Ier et au IIe sicle. VIII. La renaissance du platonisme au IIe sicle. IX. Philon dAlexandrie. X. Le nopythagorisme. XI. Plutarque de Chrone. XII. Gaius, Albinus et Apule. Numnius. XIII. Renaissance de laristotlisme.
CHAPITRE VII : Le Noplatonisme.
I. Plotin. II. Noplatonisme et religions orientales. III. Porphyre. IV. Jamblique. V. Proclus. VI. Damascius.
CHAPITRE VIII : Hellnisme et christianisme aux premiers sicles de notre re.
I. Considrations gnrales. II. Saint Paul et lhellnisme. III. Les apologistes au IIe sicle. IV. Le gnosticisme et le manichisme. V. Clment dAlexandrie et Origne. VI. Le christianisme en Occident au IVe sicle. VII. Le christianisme en Orient au IVe et au Ve sicle.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
III. MOYEN GE ET RENAISSANCE @ CHAPITRE PREMIER : Les dbuts du moyen ge.
I. Considrations gnrales. II. Orthodoxie et hrsies aux IVe et Ve sicles. III. Le Ve et le VIe sicle : Boce. IV. La Raison et la Foi. V. Jean Scot rigne.
CHAPITRE II : Le Xe et le XIe sicle.
I. Caractres gnraux. II. La controverse de Brenger de Tours. III. Critique de la philosophie la fin du XIe sicle. IV. Saint Anselme. V. Roscelin de Compigne.
CHAPITRE III : Le XIIe sicle.
I. Les Sententiaires. II. Lcole de Chartres au XIIe sicle : Bernard de Chartres. III. Alain de Lille. IV. Guillaume de Conches. V. Le mysticisme des Victorins. VI. Pierre Ablard. VII. Les polmiques contre la philosophie. VIII. Gilbert de la Porre. IX. Lthique dAblard. X. La thologie dAlain de Lille. XI. Les hrsies au XIIe sicle. XII. Jean de Salisbury
CHAPITRE IV : La philosophie en Orient.
I. Les thologiens musulmans. II. Linfluence dAristote et du noplatonisme. III. Al Kindi. IV. Al Farabi. V. Avicenne. VI. Al Gazali. VII. Les Arabes en Espagne : Averros. VIII. La philosophie juive jusquau XIIe sicle. IX. La philosophie byzantine.
CHAPITRE V : Le XIIIe sicle.
I. Caractres gnraux. II. La diffusion des uvres dAristote en Occident. III. Dominique Gondissalvi. IV. Guillaume dAuvergne. V. Dominicains et Franciscains. VI. Saint Bonaventure. VII. Albert le Grand. VIII. Saint Thomas dAquin. IX. Saint Thomas dAquin (suite) : La raison et la foi. X. Saint Thomas dAquin (suite) : La thorie de la connaissance. XI. Saint Thomas dAquin (suite) : Les preuves de lexistence de Dieu. XII. Saint Thomas dAquin (suite) : Interprtation chrtienne dAristote. XIII. Laverrosme latin : Siger de Brabant. XIV. Polmiques relatives au thomisme. XV. Henri de Gand. XVI. Gilles de Lessines. XVII. Les matres dOxford. XVIII. Roger Bacon. XIX. Witelo et les perspectivistes. XX. Raymond Lulle.
CHAPITRE VI : Le XIVe sicle.
I. Duns Scot. II. Les Universits aux XIVe et XVe sicles. III. Les dbuts du nominalisme. IV. Guillaume dOccam. V. Les nominalistes parisiens du XIVe sicle : La critique du pripattisme. VI. Les nominalistes parisiens et la dynamique dAristote. VII. Occamisme, scotisme et thomisme. VIII. Le mysticisme allemand au XIVe sicle : Eckhart.
CHAPITRE VII : La Renaissance.
I. Caractres gnraux. II. Les divers courants de pense. III. Le platonisme : Nicolas de Cuse. IV. Le platonisme (suite). V. Les padouans : Pomponazzi.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
VI. Le dveloppement de laverrosme. VII. Le mouvement scientifique : Lonard de Vinci. VIII. Le pyrrhonisme : Montaigne. IX. Moralistes et politiques. X. Un adversaire dAristote : Pierre de la Rame. X. Le platonisme : Postel et Bodin. XI. Le platonisme italien : Telesio. XII. Le platonisme italien (suite) : Giordano Bruno. XIII. Le platonisme italien (suite) : Campanella.
@ BIBLIOGRAPHIE Gnrale I. Priode hellnique. II. Priode hellnistique et romaine. III. Moyen ge et Renaissance
* ** INDEX DES NOMS
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
10
INTRODUCTION
Les Postulats de lHistoire de la Philosophie
@ a sembl parfois que lhistoire de la philosophie ne pouvait tre quun obstacle la pense vivante, un alourdissement et une gne pour qui slance vers la vrit. Ne crois point au pass ! fait dire Emerson la nature. Je te donne le monde neuf et point trenn toute heure. Tu songes, aux instants de loisir, quil y a assez dhistoire, de littrature, de science derrire toi pour puiser la pense et te prescrire ton avenir ainsi que tout avenir. Aux heures lucides, tu verras quil ny a pas encore une ligne dcrite 1 . Paroles de pionnier conqurant, qui craint comme une sourde rancune du pass contre la libert de lavenir. Et cest aussi, en un autre sens, la libert de lesprit, lautonomie du dveloppement de la raison, que Descartes dfendait contre les forces du pass, en rebtissant pied-duvre ldifice de la philosophie. Il ny a, il est vrai, que trop de raisons de redouter le pass, lorsquil prtend se continuer dans le prsent et sterniser, comme si la seule dure crait quelque droit. Mais lhistoire est prcisment la discipline qui envisage le pass comme tel, et qui, mesure quelle le pntre davantage, voit, en chacun de ses moments, une originalit sans prcdent et qui jamais ne reviendra. Loin dtre une entrave, lhistoire est donc, en philosophie comme partout, une vritable libratrice. Elle seule, par la varit des vues quelle nous donne de lesprit humain, peut draciner les prjugs et suspendre les jugements trop htifs. Mais une vue densemble sur le pass philosophique est-elle possible ? Ne risque-t-elle pas, cause de lnorme complication des faits, dtre ou bien trs difficile, si elle ne choisit pas et veut seulement se laisser aller au rythme de penses indfiniment multiples, ou bien superficielle, si elle choisit ? Il est certain que lon ne peut pas se reprsenter le pass sans y classer les faits de quelque manire ; ce classement implique certains postulats. Lide mme dentreprendre une histoire de la philosophie suppose en effet que lon a pos et rsolu, dune manire tout au moins provisoire, les trois problmes suivants :
p.2 p.1 Il
I. Quelles sont les origines et quelles sont les frontires de la philosophie ? La philosophie a-t-elle dbut, au VIe sicle, dans les cits ioniennes, comme ladmet une tradition qui remonte Aristote, ou a-t-elle une origine plus ancienne soit dans les pays grecs, soit dans les pays orientaux ? Lhistorien de la philosophie peut-il et doit-il se borner suivre le dveloppement de la
1
Autobiographie, I, 273, traduction R. Michaud.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
11
philosophie en Grce et dans les pays de civilisation dorigine grco-romaine, ou doit-il tendre sa vue aux civilisations orientales ? II. En second lieu, jusqu quel point et dans quelle mesure la pense philosophique a-t-elle un dveloppement suffisamment autonome pour faire lobjet dune histoire distincte de celle des autres disciplines intellectuelles ? Nest-elle pas trop intimement lie aux sciences, lart, la religion, la vie politique, pour que lon puisse faire des doctrines philosophiques lobjet dune recherche spare ? III. Enfin, peut-on parler dune volution rgulire ou dun progrs de la philosophie ? Ou bien la pense humaine possde-t-elle, ds le dbut, toutes les solutions possibles des problmes quelle pose, et ne fait-elle, dans la suite, que se rpter indfiniment ? Ou bien encore les systmes se remplacent-ils les uns les autres dune manire arbitraire et contingente ? De ces trois problmes, nous pensons quil ny a aucune solution rigoureuse, et que toutes les solutions que lon a p.3 prtendu en donner contiennent des postulats implicites. Il est pourtant indispensable de prendre position sur ces questions, si lon veut aborder lhistoire de la philosophie ; le seul parti possible est de dgager trs explicitement les postulats contenus dans la solution que nous admettons. I La premire question, celle des origines, reste sans solution prcise. A ct de ceux qui, avec Aristote, font de Thals, au VIe sicle, le premier philosophe, il y avait dj en Grce des historiens pour faire remonter au del de lhellnisme, jusquaux barbares, les origines de la philosophie ; Diogne Larce, dans la prface de ses Vies des Philosophes nous parle de lantiquit fabuleuse de la philosophie chez les Perses et chez les gyptiens. Ainsi, ds lantiquit, les deux thses saffrontent : la philosophie est-elle une invention des Grecs ou un hritage quils ont reu des Barbares ? Il semble que les orientalistes, mesure quils nous dvoilent les civilisations prhellniques, comme les civilisations msopotamienne et gyptienne avec lesquelles les cits de lIonie, berceau de la philosophie grecque, ont t en contact, donnent raison la seconde de ces thses. Il est impossible de ne pas sentir la parent de pense quil y a entre la thse connue du premier philosophe grec, Thals, que toutes choses sont faites deau, et le dbut du Pome de la Cration, crit bien des sicles auparavant en Msopotamie : Lorsquen haut le ciel ntait pas nomm, et quen bas la terre navait point de nom, de lApsou primordial, leur pre, et de la tumultueuse Tiamat, leur mre tous, les eaux se confondaient en un 1. De
1
Delaporte, La Msopotamie, Bibliothque de synthse historique, 1923, p. 152.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
12
pareils textes suffisent au moins pour nous faire voir que Thals na p.4 pas t linventeur dune cosmogonie originale ; les images cosmogoniques, que, peut-tre, il prcisa, existaient depuis de longs sicles. Nous pressentons que la philosophie des premiers physiologues de lIonie pouvait tre une forme nouvelle dun thme extrmement ancien. Les recherches les plus rcentes sur lhistoire des mathmatiques ont amen une conclusion analogue. Ds 1910, G. Milhaud crivait : Les matriaux accumuls en mathmatiques par les Orientaux et les gyptiens taient dcidment plus importants et plus riches quon ne le souponnait encore gnralement il y a une dizaine dannes 1. . Enfin les travaux des anthropologistes sur les socits infrieures introduisent de nouvelles donnes qui compliquent encore le problme de lorigine de la philosophie. On trouve, en effet, dans la philosophie grecque, des traits intellectuels qui nont leur analogie que dans une mentalit primitive. Les notions quemploient les premiers philosophes, celles de destin, de justice, dme, de dieu, ne sont pas des notions quils ont cres ni labores eux-mmes, ce sont des ides populaires, des reprsentations collectives quils ont trouves. Ce sont, semble-t-il, ces notions qui leur servent de schmas ou de catgories pour concevoir la nature extrieure. Lide que les physiologues ioniens se font de lordre de la nature, comme dun groupement rgulier dtres ou de forces auxquels la destine souveraine impose leur limite est due au transport de lordre social dans le monde extrieur ; la philosophie nest peut-tre, son origine, quune sorte de vaste mtaphore sociale. Des faits aussi tranges que le symbolisme numrique des Pythagoriciens qui admettent que tout est nombre sexpliqueraient par cette forme de pense quun philosophe allemand appelait rcemment la pense morphologico-structurale des primitifs et quil opposait la pense fonctionnelle p.5 fonde sur le principe de causalit ; comme la peuplade nord-amricaine des Zunis fait correspondre la division de leur race en sept parties, la division en sept du village, des rgions du monde, des lments, du temps, ainsi les Pythagoriciens ou mme Platon dans le Time inventent continuellement des correspondances numriques du mme ordre 2. La ressemblance affirme dans le Time entre les intervalles des plantes et lchelle musicale nous parat compltement arbitraire et la logique nous en chappe tout autant que celle de la participation, tudie par M. Lvy-Bruhl dans ses travaux sur la mentalit primitive. Sil en est ainsi, les premiers systmes philosophiques des Grecs ne seraient nullement primitifs ; ils ne seraient que la forme labore dune pense bien plus ancienne. Cest sans doute dans cette mentalit quil faudrait rechercher lorigine vritable de la pense philosophique ou du moins dun de
1 2
Nouvelles tudes sur lhistoire de la pense scientifique, Paris, 1910, p. 127. Cassirer, Die Begriffsform im mythischen Denken, Leipzig, 1922.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
13
ses aspects 1. A. Comte navait pas tort en voyant dans ce quil appelait le ftichisme la racine de la reprsentation philosophique de lunivers ; maintenant que, par le folklore et les tudes sur les peuples non civiliss, on a une connaissance plus prcise et plus positive de ltat desprit des primitifs, on pressent mieux tout ce qui en subsiste dans la mtaphysique volue des Grecs. Ainsi les premiers philosophes de la Grce nont pas eu vraiment inventer ; ils ont travaill sur des reprsentations de la complexit et de la richesse mais aussi de la confusion desquelles nous pouvons difficilement nous faire une ide. Ils avaient moins inventer qu dbrouiller et choisir, ou plutt linvention tait dans ce discernement lui-mme. On les comprendrait sans doute mieux, si lon savait ce quils ont rejet, quen sachant ce quils ont gard. Dailleurs, lon p.6 voit parfois des reprsentations refoules rapparatre ; et la pense primitive sous-jacente fait un effort continuel, qui russit quelquefois, pour renverser les digues dans lesquelles on la contient. Si, malgr ces remarques, nous faisons commencer notre histoire Thals, ce nest donc pas que nous mconnaissions la longue prhistoire o sest labore la pense philosophique ; cest seulement pour cette raison pratique que les documents pigraphiques des civilisations msopotamiennes sont peu nombreux et dun accs difficile, et cest ensuite parce que les documents sur les peuples sauvages ne peuvent nous fournir des indications sur ce qua t la Grce primitive. * La question des frontires de lhistoire de la philosophie, connexe de celle des origines, ne peut tre non plus rsolue avec exactitude. Il est indniable quil y a eu, certaines poques, dans les pays dExtrme-Orient et surtout dans lInde, une vraie floraison de systmes philosophiques. Mais il sagit de savoir si le monde grco-romain, puis chrtien dune part, le monde extrme-oriental de lautre ont eu un dveloppement intellectuel compltement indpendant lun de lautre : dans ce cas, il serait permis de faire abstraction de la philosophie de lExtrme-Orient dans un expos de la philosophie occidentale. La situation est bien loin dtre aussi nette : pour lantiquit dabord, les relations commerciales faciles quil y a eu partir dAlexandre jusquaux invasions arabes entre le monde grco-romain et lExtrme-Orient ont rendu possibles les relations intellectuelles. Nous en avons des tmoignages prcis ; les Grecs, voyageurs ou philosophes, ont beaucoup crit sur lInde cette poque ; les dbris de cette littrature, particulirement aux IIe et IIIe sicles de notre re, tmoignent p.7 tout au moins dune vive curiosit pour la pense indienne. Dautre part, au haut
1
Voyez sur la question le livre trs frappant de F. M. Cornford, From religion to philosophy, London, 1912.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
14
moyen ge, sest dveloppe en pays musulman une philosophie dont la pense grecque, aristotlicienne ou noplatonicienne, formait certainement lessentiel, mais qui, cependant, ne parat pas avoir t sans subir, diverses reprises, linfluence du voisinage indien. Or, on verra quelle place cette philosophie arabe a eue dans la chrtient, depuis le XIIIe sicle jusquau XVIe. Cest donc une question fort importante de savoir quels sont les degrs et les limites de cette influence, directe ou indirecte. Mais cest aussi une question fort difficile : linfluence de la Grce sur lExtrme-Orient, qui est aujourdhui prouve en matire dart, a t sans doute trs forte dans le domaine intellectuel, et beaucoup plus forte que linfluence inverse de lInde sur lhellnisme. tant donne lincertitude des dates de la littrature indienne, les ressemblances entre la pense grecque et indienne ne peuvent pas tmoigner de laquelle des deux vient linfluence. Il semble bien que ce soit seulement sous linfluence grecque que les Hindous aient donn lexpos de leurs ides le caractre systmatique et ordonn que nos habitudes intellectuelles, hrites des Grecs, nous font considrer comme li la notion mme de philosophie. Malgr ces difficults, une histoire de la philosophie na pas le droit dignorer la pense extrme-orientale. Toutefois, dans un ouvrage lmentaire comme celui-ci, nous navons nullement exposer, pour elle-mme, la philosophie indienne ; cette tche, encore difficile pour les spcialistes 1 cause du petit nombre dtudes de dtail, serait, pour nous, impossible. Il faudra donc nous contenter de noter soigneusement, parmi tous les courants non hellniques qui apparatront au cours de la philosophie occidentale, ceux qui ont pu venir du lointain Orient. La tche nous sera beaucoup plus facile pour p.8 lpoque voisine de nous, o les travaux des orientalistes, depuis le dbut du XIXe sicle, nont pas t sans influence sur la philosophie ; nous pourrons peut-tre alors nous rendre compte de la nature dune influence qui continue jusqu lpoque actuelle.
II
Notre second problme est celui du degr dindpendance de lhistoire de la philosophie lgard de lhistoire des autres disciplines intellectuelles. Mais nous refusons de le poser dogmatiquement, comme sil sagissait de trancher la question des rapports de la philosophie, prise comme une chose en soi, avec la religion, la science ou la politique. Nous voulons le poser et le rsoudre historiquement ; cest dire quil ne peut admettre une solution simple et uniforme. Lhistoire de la philosophie ne peut pas tre, si elle veut tre
1
Cf. Oltramare, Histoire des ides thosophiques dans lInde, 2 vol. 1907 et 1923. Masson-Oursel, Esquisse dune histoire de la philosophie indienne, Paris, 1923 (Geuthner).
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
15
fidle, lhistoire abstraite des ides et des systmes, spars des intentions de leurs auteurs, et de latmosphre morale et sociale o ils sont ns. Il est impossible de nier que, aux diffrentes poques, la philosophie a eu, dans ce que lon pourrait appeler le rgime intellectuel du temps, une place trs diffrente. Au cours de lhistoire, nous rencontrons des philosophes qui sont surtout des savants ; dautres sont avant tout des rformateurs sociaux, comme Auguste Comte, ou des matres de morale, comme les philosophes stociens, et des prdicateurs, comme les cyniques ; il y a, parmi eux, des mditatifs solitaires, des professionnels de la pense spculative, comme un Descartes ou un Kant, ct dhommes qui visent une influence pratique immdiate, comme Voltaire. La mditation personnelle tantt est la simple rflexion sur soi, et tantt confine lextase. Et ce nest pas seulement cause de leur temprament personnel quils sont si diffrents, cest cause de ce que la socit, p.9 chaque poque, exige dun philosophe. Le noble Romain, qui cherche un directeur de conscience, les papes du XIIIe sicle qui voient dans lenseignement philosophique de luniversit de Paris un moyen daffermir le christianisme, les encyclopdistes qui veulent mettre fin loppression des forces du pass demandent la philosophie des choses fort diffrentes ; elle se fait tour tour missionnaire, critique, doctrinale. Ce sont l, dira-t-on, des accidents ; peu importe ce que la socit veut faire de la philosophie ; ce quil y a dimportant, cest ce que celle-ci reste, au milieu des intentions diffrentes de ceux qui lutilisent ; quelles que soient leurs divergences, il ny a de philosophie que l o il y a une pense rationnelle, cest--dire une pense capable de se critiquer et de faire effort pour se justifier par des raisons. Cette aspiration une valeur rationnelle nest-elle pas, peut-on penser, un trait assez caractristique et permanent pour justifier cette histoire abstraite des doctrines, cette histoire de la raison pure , comme dit Kant, qui en a esquiss lide 1 ? Suffisant pour distinguer la philosophie de la croyance religieuse, ce trait la distinguerait aussi des sciences positives ; car lhistoire des sciences positives est compltement insparable de lhistoire des techniques do elles sont issues et quelles perfectionnent. Il ny a pas de loi scientifique qui ne soit, sous un autre aspect, une rgle daction sur les choses ; la philosophie, elle, est pure spculation, pur effort pour comprendre, sans autre proccupation. Cette solution serait fort acceptable, si elle navait pour consquence immdiate dliminer de lhistoire de la philosophie toutes les doctrines qui font une part la croyance, lintuition, intellectuelle ou non, au sentiment, cest--dire des doctrines matresses ; elle implique donc une opinion arrte sur la philosophie, bien plus quune vue exacte p.10 de son histoire. Isoler une doctrine du mouvement dides qui la amene, du sentiment et de lintention qui la guident, la considrer comme un thorme prouver, cest remplacer
1
Critique de la Raison pure, Mthodologie transcendentale, chapitre IV.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
16
par une pense morte une pense vivante et significative. On ne peut comprendre une notion philosophique que par son rapport lensemble dont elle est un aspect. Combien de nuances diffrentes, par exemple, dans le sens du fameux : Connais-toi toi mme ! chez Socrate, la connaissance de soi signifie lexamen dialectique et la mise lpreuve de ses opinions propres ; chez Saint-Augustin, elle est un moyen datteindre la connaissance de Dieu par limage de la Trinit que nous trouvons en nous ; chez Descartes, elle est comme un apprentissage de la certitude ; dans les Upanishads de lInde, elle est la connaissance de lidentit du moi et du principe universel. Comment donc saisir cette notion et lui donner un sens, indpendamment des fins pour lesquelles on lutilise ? Une des plus grosses difficults que lon puisse opposer lide dune histoire abstraite des systmes, cest le fait que lon pourrait appeler le dplacement de niveau des doctrines. Pour en donner un exemple saillant, songeons aux ardentes polmiques, continues durant des sicles, sur les limites des domaines de la foi et de la raison. On pourrait trouver bien des doctrines donnes un certain moment comme de foi rvle et considres dautres comme une doctrine de raison. La scheresse et la pauvret de la philosophie proprement dite dans le haut moyen ge sont compenses par les trsors de vie spirituelle qui, de la philosophie paenne, sont passs dans les crits thologiques de saint Ambroise et de saint Augustin. Laffirmation de limmatrialit de lme, qui chez Descartes est rationnellement prouve, est pour Locke une vrit de foi. Quoi de plus frappant que la transposition que Spinoza a fait subir la notion religieuse de vie ternelle, en linterprtant par des notions inspires du cartsianisme ! De ces faits que lon pourrait aisment multiplier, il rsulte que lon ne p.11 caractrise pas suffisamment une philosophie en indiquant les doctrines quelle soutient ; il importe bien plus de voir dans quel esprit elle les soutient, quel rgime mental elle appartient. Cest dire que la philosophie ne saurait tre scinde du reste de la vie spirituelle, qui sexprime encore par les sciences, la religion, lart, la vie morale ou sociale. Le philosophe tient compte de toutes les valeurs spirituelles de son temps pour les approuver, les critiquer ou les transformer. Il ny a pas de philosophie, l o il ny a pas un effort pour ordonner hirarchiquement les valeurs. Ce sera donc une proccupation constante de lhistorien de la philosophie de rester en contact avec lhistoire politique gnrale et lhistoire de toutes les disciplines de lesprit, bien loin de vouloir isoler la philosophie comme une technique spare des autres. Seulement ces rapports avec les autres disciplines spirituelles ne sont nullement uniformes et invariables, mais se prsentent de manire fort diffrente selon les poques et les penseurs. La spculation philosophique peut tre ordonne tantt la vie religieuse, tantt aux sciences positives, tantt la politique et la morale, quelquefois lart. Il est des moments o
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
17
prdomine le rle dune de ces disciplines, tandis que les autres seffacent presque ; ainsi, au cours de lantiquit classique, nous assistons, en gros, une dcroissance graduelle du rle des sciences, accompagne par la croissance du rle de la religion : tandis que, lpoque de Platon, lvolution des mathmatiques a un intrt tout particulier pour lhistorien, ce sera, lpoque de Plotin, linvasion des religions orientales du salut qui devra appeler lattention ; cest ce moment que nous devrons nous poser le problme, encore si difficile rsoudre, de linfluence propre du christianisme sur la philosophie. Lpoque actuelle voit, autour de la philosophie, une lutte dinfluence assez pre pour que cette mditation sur le pass ne soit pas tout fait inutile.
III
est un troisime problme, sur lequel lhistorien de la philosophie est manifestement oblig de prendre position. La philosophie a-t-elle une loi de dveloppement, ou la succession des systmes est-elle contingente et dpendant du hasard des tempraments individuels ? Cette question est entre toutes importante ; lhistoire de la philosophie a, derrire elle, un long pass, qui pse lourdement sur elle ; elle a, particulirement sur le point qui nous occupe, des traditions auxquelles il est rare quelle ne saccommode pas plus ou moins. Ce sont ces traditions que nous voulons dgager afin de les apprcier comme il convient. Lide de considrer lhistoire de la philosophie dans lensemble et lunit de son dveloppement est une ide relativement rcente. Elle est un aspect de ces doctrines des progrs de lesprit humain qui se font jour la fin du XVIIIe sicle ; dune part la philosophie positive dAuguste Comte, dautre part la philosophie de Hegel incluent en elles comme lment ncessaire une histoire des dmarches philosophiques de lhumanit ; lesprit humain ne se dfinit pas, en sisolant de sa propre histoire. Telle navait pas t du tout lhistoire de la philosophie laurore de lpoque moderne. Notre histoire de la philosophie est vritablement ne lpoque de la Renaissance, lorsque lon dcouvrit en Occident les compilateurs de la fin de lantiquit, Plutarque, dont les crits renferment un trait Sur les opinions des philosophes, Sextus Empiricus, Stobe, les Stromates de Clment dAlexandrie et surtout les Vies des Philosophes de Diogne Larce qui rassemble en un inexprimable dsordre des dbris de toutes les uvres antiques dhistoire de la philosophie depuis les travaux des disciples dAristote. Par ces auteurs souvraient, sur la diversit des p.13 sectes antiques, sur la succession des chefs dcole et des coles elles-mmes, des perspectives qui avaient entirement chapp la pense mdivale. Les
p.12 Il
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
18
premires histoires imitrent sans plus ces compilations ; ce furent des traits comme celui de Burleus sur les Vies des Philosophes (1477). Il suit de l que lhistoire se limite dabord la philosophie antique ou, plus exactement, la priode qui va jusquau premier sicle de notre re, cest--dire jusqu lpoque o sarrtent en gnral les compilateurs que nous avons nomms ; lhistoire de la philosophie antique postrieure sintroduit, il est vrai, grce ltude directe des grandes uvres noplatoniciennes ; mais lantiquit se trouve ainsi compltement spare du moyen ge, et lide quil pourrait y avoir une continuit de lun lautre chappe compltement. Cette sparation est si accuse que Jonsius, recueillant les sources de lhistoire de la philosophie, se borne encore en 1649, sauf en un court chapitre, mentionner les crivains anciens qui ont crit sur lhistoire de la philosophie (De Scriptoribus historiae philosophic, libri IV, 1649). Pourtant, cette poque, lhistoire de la philosophie du moyen ge a commenc tre tudie pour elle-mme ; Launoi crit une histoire des coles mdivales 1. Lhistoire de la philosophie est donc avant tout ce moment lhistoire des sectes ; cest ainsi que la conoit Bacon dans les plans quil trace des sciences 2. Lhistoire des sectes est pour lui une partie, la dernire, de lhistoire littraire. Lhistoire littraire, dans son ensemble, a pour objet de montrer lorigine, les progrs, les rgressions et les renaissances des doctrines et des arts . Quon y ajoute, dit Bacon, les sectes et les controverses les plus clbres qui ont occup les doctes ; quon numre les auteurs, les livres, les coles, la suite des p.14 chefs dcole, les acadmies, les socits, les collges, les ordres. Cest le plan baconien que suit Georges Horn, lauteur de la premire histoire gnrale de la philosophie, qui mne le dveloppement depuis les origines jusquau XVIIIe sicle ; la prface renvoie Bacon, et le titre complet de louvrage en indique bien le caractre : Historiae philosophicae libri septem, quibus de origine, successione, sectis et vita philosophorum ab orbe condito ad nostram aetatem agitur 3. Ce qui lintresse, cest moins lanalyse et la connaissance prcise du contenu des doctrines que leur numration et leur suite ; il a, lgard de lhistoire de la philosophie proprement dite, la position que lhistoire de lglise a lgard de celle des dogmes ; et, pas plus quil nexiste ce moment dhistoire des dogmes, il nexiste une histoire vritable de la philosophie. Cest que le but des hommes de la Renaissance nest pas de sinformer du pass, mais bien de le restaurer et de faire remonter lesprit humain ses sources vives. Aussi lon se passionne pour la secte que lon tudie ; on nest pas historien du platonisme sans tre en mme temps platonicien. Il y a ainsi
1
De Scholis celebrioribus seu a Carolo magno seu post Carolum per occidentem instauratis, 1672. 2 De Dignitate et augmentis scientiarum, liv. II, chap. IV. 3 Lugduni Batavorum, apud J. Elzevirium, 1645.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
19
des platoniciens et des stociens, des picuriens et des acadmiciens, et mme des prsocratiques. Lhistoire tire de ces chocs le plus grand profit ; Marsile Ficin fait connatre Platon et Plotin ; dans la premire moiti du XVIIe sicle, Juste Lipse tudie avec attention et classe lensemble des textes connus sur les stociens ; Brigard, dans son Circulus Pisanus, appelle lattention sur les premiers physiciens de la Grce ; Gassendi cherche donner un portrait fidle dpicure 1. Cest dans ces travaux des sectaires plutt que dans les travaux drudition pure quil faut chercher lhistoire proprement dite des doctrines. Une de ces sectes a, au point de p.15 vue qui nous occupe, une importance particulire, cest celle des acadmiciens et des pyrrhoniens ; un des arguments traditionnels du scepticisme est en effet lexistence de la diversit des sectes ; et une des sources principales de lhistorien est le grand trait de Sextus Empiricus : Contre les Dogmatiques, dit et traduit en partie par Henry Estienne en 1562 ; Sextus y expose trs longuement les variations dopinion sur un mme sujet. Il y a cette poque bien des acadmiciens et il nen est pas qui nemploient le mme procd 2. Ainsi de toute lrudition de la Renaissance, on ne recueille quun rsultat, cest la fragmentation de la pense philosophique en une infinit de sectes ; ou bien lon choisit une de ces sectes, et lon est sectaire son tour ; ou bien on les dtruit lune par lautre et lon est sceptique. On ne pouvait chapper cette fatalit quen dgageant entirement la philosophie de la philologie ; ce fut luvre des grands penseurs du XVIIe sicle ; ds 1645, Horn remarque avec beaucoup de raison que son sicle, avec Descartes et Hobbes, est le sicle des philosophes, tandis que le prcdent avait t celui des philologues ; ce que lon veut maintenant, ce nest plus restaurer une secte, ni substituer une secte nouvelle aux anciennes, cest trouver, par del les opinions des sectes, dans la nature mme de lesprit humain, les sources de la philosophie vritable. Dans ces conditions nouvelles, ou bien lhistoire de la philosophie continuera tre purement et simplement lhistoire des sectes ; elle ne fera alors qunumrer les erreurs ou aberrations de lesprit humain et elle ne sera quune encombrante rudition ; ou bien elle devra transformer profondment ses perspectives et ses mthodes.
Ficin, Theologia platonica, 1482 ; Brigard, Circulus pisanus ; de vetere et peripatetica philosophia, 1643, 2e d. 1661 ; Juste Lipse, Manuductio ad philosophiam stoicam, Physiologia Stoicorum, 1604. Gassendi, Commentarius de vita, moribus et placitis Epicuri seu animadversiones in decimum librum Diogenis Lartii, 1649 ; Syntagma philosophiae Epicuri, 1659 ; cf. encore Magnenus, Democritus reviviscens, 1648. Cf. par exemple Guy DE BRUS, Les dialogues contre les nouveaux acadmiciens, Paris, 1557, o, dans un dialogue entre Baf et Ronsard, lauteur expose les diverses opinions des philosophes qui napportent que confusion dans nos esprits (p. 65).
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
20
Que lhistoire de la philosophie soit comme un muse des bizarreries de lesprit humain, cest le thme commun des p.16 rationalistes du XVIIe et du XVIIIe sicle. Pour expliquer ce jugement dfavorable sur le pass, il faut voir de quelle manire il leur tait prsent par les histoires de la philosophie. Encore dans le grand travail de Brcker, lHistoria critica philosophiae (1741-44), qui, jusqu la fin du XVIIIe sicle et en particulier chez les encyclopdistes, est louvrage le plus utilis, se rencontre un schma traditionnel du dveloppement historique, qui vient de la Cit de Dieu de saint Augustin 1 et qui a subsist travers les sicles : la philosophie part du commencement du monde ; les Grecs ont menti en disant quils taient les premiers philosophes ; ils ont en ralit emprunt leurs doctrines Mose, lgypte et la Babylonie. Le premier ge de la philosophie nest donc pas lge grec, mais lge barbare ; presque tous les historiens, jusqu Brcker, commencent par une longue srie de chapitres sur la philosophie barbare : la philosophie qui a une origine divine sest transmise aux patriarches juifs, puis de l aux Babyloniens, aux mages chaldens, aux gyptiens, aux thiopiens, aux Indiens, et mme aux Germains. Cest seulement ensuite que les Grecs ont recueilli ces traditions, qui seffaaient de plus en plus ; elles dgnrent chez eux en une infinit de sectes ; elles aboutissent dune part au scepticisme de la nouvelle acadmie, qui est la fin de la philosophie, dautre part au no-platonisme qui sefforce de corrompre la philosophie chrtienne. En un mot, lhistoire de la philosophie est lhistoire dune dcadence graduelle et continue de lesprit humain ; de cette dcadence la preuve est le nombre des sectes qui ont remplac lunit originelle. La pense grecque, en particulier, nest ni un point de dpart, ni un progrs ; la fantaisie individuelle, en se donnant libre cours, a dcidment presque dtruit ce que gardaient encore de vrit les traditions orientales. Les Grecs nont pas du tout, on le voit, dans ces vieilles p.17 histoires de la philosophie, la place et la valeur quils prendront plus tard. Cette critique des Grecs provient des pres de lglise ; presque tous les philosophes du XVIIIe sicle, Voltaire en particulier, qui ne cesse de railler Platon, adhrent pleinement au vieux prjug. Mais il y a plus ; on apporte les mmes prventions lgard de la philosophie moderne ; cest le fond du Trait des systmes de Condillac (1749) ; tous les systmes philosophiques sont le fruit de l imagination . Un philosophe rve facilement. Combien de systmes na-t-on pas faits ? Combien nen fera-t-on pas encore ? Si du moins on en trouvait un qui ft reu peu prs uniformment par tous ses partisans ! Mais quel fonds a-t-on pu faire sur des systmes qui souffrent mille changements, en passant par mille mains diffrentes ? 2 Tel est, au XVIIIe sicle, laboutissant du jugement de la philosophie sur son propre pass ; il rsulte du conflit entre une conception de lhistoire datant
1
Livre VIII, chap. IX ; comparer CLMENT DALEXANDRIE, Stromates, liv. I dbut ; JUSTE LIPSE au dbut de sa Manuductio ad physiologiam stocam utilise ces textes. 2 uvres compltes, Paris, 1803 ; t. III, p. 7 ; p. 27.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
21
de la Renaissance et une conception nouvelle de la philosophie. Mais simultanment et ds le XVIIe sicle, par un mouvement inverse, la conception de lhistoire et la perspective sous laquelle on voit le pass se transforment. Le thme nouveau, cest lide que lunit de lesprit humain reste visible travers la diversit des sectes. Ds le dbut du XVIIe sicle (1609), dans son Conciliator philosophicus, Goclenius stait efforc de classer, sur chaque sujet, les contradictions des sectes ; et il ne dressait cette liste dantinomies que pour les rsoudre et pour montrer quelles ntaient quapparentes. Ce syncrtisme qui affirme laccord de la pense philosophique avec elle-mme est considr par Horn comme le rsultat vritable de lhistoire de la philosophie 1. A ce syncrtisme, qui efface les diffrences entre les sectes, est li lclectisme qui, lui aussi, est au-dessus de toute secte p.18 mais qui, an lieu de runir, choisit et distingue. Il ny a quune secte, dit dj Juste Lipse, en laquelle nous puissions nous inscrire avec scurit ; cest la secte clectique, celle qui lit avec application et qui choisit avec jugement ; extrieure toute faction, elle deviendra facilement la compagne de la vrit. Cet esprit de conciliation et dclectisme, qui a au XVIIe sicle, en Leibniz, un illustre reprsentant 2, anime la grande Historia critica philosophi de Brcker 3, la source o tous les crivains de la seconde moiti du XVIIIe sicle ont puis leurs connaissances en histoire de la philosophie. Le vritable usage de lhistoire, cest de faire connatre les caractres qui distinguent la vraie philosophie de la fausse. Lhistoire de la philosophie dveloppe une sorte dhistoire de lintelligence humaine , elle montre quelle est la puissance de lintelligence, de quelle manire elle a t arrache aux tnbres et claire par la lumire de la vrit, comment elle est parvenue, travers tant de hasards et dpreuves, la connaissance de la vrit et de la flicit, travers quels mandres elle sest fourvoye, de quelle manire elle a t ramene la voie royale. 4 Lhistoire des sectes nest donc quun moyen de nous affranchir des sectes. Lclectisme, de Brcker pntre dans lEncyclopdie ; Diderot dans larticle clectisme y loue lclectique qui ose penser de lui-mme, et, de toutes les philosophies quil a analyses sans gard et sans partialit, sen faire une particulire et domestique . Mais le syncrtisme et lclectisme ne sont pas la seule manire dinterprter le pass et de dominer la diversit des sectes. Lon cherche aussi, tout en maintenant cette diversit, y trouver un lien et une continuit historique. Dans un ouvrage un peu antrieur celui de Brcker, Deslandes
1 2
Historia philosophica, Leyde, 1645, p. 323. Voyez aussi. J.-C. Sturm, Philosophia eclectica, 1686, et Physica eclectica, 1697-1722, et J.-B. du Hamel, De consensu veteris et nov philosophiae, 1663 ; vue densemble de lhistoire de la philosophie chez Leibniz ; uvres, d. Gerhardt, t. VII, p. 146-156. 3 Jacobi Bruckeri historia critica philosophiae a mundi incunabulis ad nostram aetatem perducta, Lipsiae, 1742-44, 5 vol. 4 Brcker, p. 10-21.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
22
proteste contre p.19 lide mme dune histoire des sectes 1. Recueillir sparment les divers systmes des philosophes anciens et modernes, entrer dans le dtail de leurs actions, faire des analyses exactes de leurs ouvrages, ramasser leurs sentences, leurs apophtegmes et mme leurs bons mots, cest l prcisment ce que lhistoire de la philosophie contient de moins instructif. Le principal, mon avis, cest de remonter la source des principales penses des hommes, dexaminer leur varit infinie et en mme temps le rapport imperceptible, les liaisons dlicates quelles ont entre elles ; cest de faire voir comment ces penses ont pris naissance les unes aprs les autres et souvent les unes des autres ; cest de rappeler les opinions des philosophes anciens et de montrer quils ne pouvaient dire effectivement que ce quils ont dit. Ces efforts pour dgager lhistoire de la philosophie de la poussire des sectes, trouvent naturellement un appui chez les thoriciens du progrs. Pour Condorcet, la division de la philosophie en sectes est un tat ncessaire mais passager, dont la philosophie saffranchit peu peu, tendant ne plus admettre que des vrits prouves , et non plus des opinions. Dans cette perspective historique, la Grce a une place spciale, parce que lespce humaine doit reconnatre en elle linitiative dont le gnie lui a ouvert toutes les routes de la vrit. 2 Lhellnisme nest plus considr comme une dcadence, mais comme un dbut. Ainsi se fixe un cadre du dveloppement historique de la philosophie, o lon voit une philosophie purement occidentale commenant avec les penseurs grecs de lIonie, trouvant son type en Socrate qui voulait non faire adopter par les hommes un nouveau systme et soumettre leur imagination la sienne, mais leur apprendre faire usage de leur raison ; cest cette philosophie qui, aprs la longue clipse du moyen p.20 ge, se ralise pleinement avec Descartes. On en a fini avec le fatras de la prtendue philosophie barbare et orientale et les accusations de plagiat contre les Grecs. En revanche il faut bien dire tout ce que laisse en dehors de lui ce schma des progrs de lesprit humain, si rpandu au XVIIIe sicle finissant, et qui est en somme rest celui de nos histoires de la philosophie, cest tout le christianisme et tout lOrient. Les penseurs du XVIIIe sicle ont donc cherch introduire unit et continuit dans lhistoire de la philosophie ; or toute la premire partie du XIXe sicle a vu un effort pour construire ce qui navait t quesquiss. On cherche prsent un principe de liaison interne qui permette de comprendre en elles-mmes les doctrines et den saisir la signification historique. On proteste contre la lgret avec laquelle sont rejetes comme absurdes des
1
Histoire critique de la philosophie, o lon traite de son origine, de ses progrs et des diverses rvolutions qui lui sont arrives jusqu notre temps ; Amsterdam, 1737 ; t. I, p. 3 et p. 5. 2 Esquisse dun tableau historique des progrs de lesprit humain (crit en 1793) ; quatrime et neuvime poques.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
23
ides qui ne sont pas les ntres, alors quelles sont des aspects ncessaires de lesprit humain. Ce qui manquait le plus aux historiens, ctait le sens historique, la perception dlicate des nuances du pass. Cest ce quindique trs bien Reinhold, dans un article de 1791 sur le concept de lhistoire de la philosophie : La raison pour laquelle, dit-il, lhistoire de la philosophie apparat dans nos manuels comme une histoire de la folie des hommes plutt que de leur sagesse, pour laquelle les plus clbres et souvent les plus mritants de lantiquit sont maltraits de la faon la plus indigne, pour laquelle leurs regards les plus profonds dans le sanctuaire de la vrit sont mal interprts et compris comme les plus plates des erreurs, cest que lon comprenait mal leurs ides, et on devait mal les comprendre parce que, en les jugeant, on sen tenait aux principes postrieurs dune des quatre sectes mtaphysiques principales, ou parce quon tait habitu par les mthodes de la philosophie populaire prvenir les recherches les plus profondes par les oracles du sens commun. 1 Cest le programme de Reinhold que Tennemann a suivi dans son Histoire de la philosophie 2 ; cette histoire ne doit supposer daprs lui aucune ide de la philosophie ; elle nest que la peinture de la formation graduelle de la philosophie, la peinture des efforts de la raison pour raliser lide dune science des lois de la nature et de la libert.
p.21
Mais le principe dunit interne se prsente lui-mme de deux manires : dune part comme principe dune classification des doctrines qui se flatte de faire rentrer dans un petit nombre de types, dpendant de la nature de lesprit, toutes les sectes possibles ; dautre part, comme un dveloppement graduel dont chaque doctrine importante constitue un moment ncessaire. Le premier point de vue est celui de de Grando 3. Il dclare positivement quil abandonne, comme la fois strile et impossible, lancienne mthode de lhistoire des sectes. Les opinions philosophiques qui se sont produites dans les divers pays et dans les divers ges sont tellement varies, tellement nombreuses que le plus savant et le plus fidle recueil ne fera que jeter le trouble et la confusion dans nos ides et nous accabler sous le poids dune rudition strile, moins que des rapprochements heureusement prpars ne viennent guider lattention 4. A l histoire narrative il faut substituer, selon les expressions de Bacon, l histoire inductive et compare ; elle consiste dabord dterminer le trs petit nombre de questions primitives auxquelles doit rpondre chaque systme ; daprs ces rponses, on peut saisir lesprit de chacun deux et les grouper en classes naturelles ; cette
1
Uber den Begrif der Geschichte der Philosophie, dans Flleborn, Beitraege zur Geschichte der Philosophie, I, 1791, p. 33. 2 Geschichte der Philosophie, Leipzig, 1798-1819, 11 vol. 3 Histoire compare des systmes de philosophie relativement aux principes des connaissances humaines, Paris, an XII, 1804, 3 vol. 4 Introduction, p. 23.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
24
classification faite, on pourra les comparer, saisir leur point de divergence, et, enfin, considrant chacun deux comme autant dexpriences faites sur la marche de lesprit humain, juger quel est le meilleur. De fait la question primitive qui p.22 donne de Grando la base de sa classification, cest celle de la nature de la connaissance humaine ; lhistoire des systmes devient un essai de philosophie exprimentale , qui montre lpreuve la valeur de chaque solution donne au problme de lorigine de la connaissance. La mthode de Victor Cousin najoute pas beaucoup celle de Grando. Cest une sorte de moyenne entre la mthode du botaniste qui classe les plantes par famille, et lexplication psychologique qui les rattache aux faits primitifs de lesprit humain. Ce qui trouble et dcourage, dit-il au dbut du cours de 1829, lentre de lhistoire de la philosophie, cest la prodigieuse quantit de systmes appartenant tous les pays et tous les temps. Puis des caractres, diffrents ou semblables se dgageront comme deux-mmes et rduiront cette multitude infinie de systmes un assez petit nombre de systmes principaux qui comprennent tous les autres. Aprs la classification vient lexplication. Ces grandes familles de systmes viennent de lesprit humain. Voil pourquoi lesprit humain, aussi constant lui-mme que la nature, les reproduit sans cesse. Lhistoire de la philosophie revient donc finalement la psychologie qui, point de dpart de toute saine philosophie, fournit mme lhistoire sa plus sre lumire 1. On domine donc lhistoire en la niant, puisquon remplace le dveloppement des doctrines dans la dure par leur classement. Le second point de vue qui permet dintroduire une unit dans lhistoire de la philosophie est celui dune liaison dynamique entre les systmes, o chacun apparat comme un moment ncessaire dune histoire unique. Lhistoire de la philosophie ne fait ici que reflter les tendances gnrales du dbut du XIXe sicle, qui ont donn naissance aux sciences morales et sociales ; on ne croit plus que lhistoire gnrale soriente vers le succs dune religion particulire ou dun empire ; elle progresse plutt p.23 vers une civilisation collective qui intresse lhumanit entire. De mme lhistoire de la philosophie ne soriente pas au bnfice dune secte ; elle a une loi immanente que lon peut reconnatre par une observation directe. Aucune science ne saurait tre comprise sans sa propre histoire, toujours insparable de lhistoire gnrale de lhumanit 2, il nest nulle remarque qui condense plus nettement les ides dAuguste Comte sur lhistoire intellectuelle : impossibilit de sparer le prsent du pass, de considrer le stade prsent de lintelligence autrement que dans le progrs dynamique o il est n des stades passs ; impossibilit de sparer lhistoire du dveloppement intellectuel de celle de lensemble de la civilisation. Le positivisme affirme la continuit humaine que niaient le catholicisme maudissant lantiquit, le
1 2
Histoire gnrale de la philosophie, 4e dit., Paris, 1867, p. 4. Systme de Politique positive (1851-1854), Paris, Crs, 1921, t. III, p. 2.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
25
protestantisme rprouvant le moyen ge, et le disme niant toute filiation . La pense de Comte se rattache au mouvement gnral que nous avons vu crotre au XVIIIe sicle contre lide dune histoire de la philosophie comme simple numration de sectes incohrentes. La continuit dynamique (p. 27) nous interdit de croire quil y ait jamais dans les opinions humaines des changements radicaux ; elles se sont modifies en vertu de la mme impulsion qui les modifie encore, cest--dire dune impulsion vers une subordination croissante de nos jugements lordre objectif. Chacune de ces tapes a sa place normale et ncessaire. La logique purement subjective (p. 31) du ftichiste qui anime les phnomnes est, lorigine, aussi normale que le sont aujourdhui les meilleures mthodes scientifiques. Cette vision dune marche continue, qui ne peut tre rtrograde, amne Comte transformer entirement la valeur due les historiens du XVIIIe sicle donnaient chaque priode du pass, particulirement la pense grecque et la pense du moyen ge. Il proteste formellement contre les irrationnelles p.24 hypothses de certains rudits sur une prtendue antriorit de ltat positif envers ltat thologique (p. 73), allusion sans doute une objection que lon peut tirer de la science positive des Grecs prcdant la pense mdivale. Ces hypothses, ajoute-t-il, ont t renverses irrvocablement daprs une meilleure rudition . Lunion de la thologie et de la mtaphysique, qui caractrise le moyen ge, union qui, aux yeux des crivains protestants comme Brcker et des encyclopdistes, est un scandale et une alliance monstrueuse, est prcisment ce qui fait la supriorit du moyen ge sur lantiquit, et ce qui prpare lge moderne. La thologie sans mtaphysique, cest ncessairement le polythisme ; il constitue seul le vritable tat thologique, o limagination prvaut librement. Le monothisme rsulte toujours dune thologie essentiellement mtaphysique, qui restreint la fiction par le raisonnement. Comte entend donc moins par philosophie les systmes techniques des spcialistes de la philosophie, quun tat mental diffus travers la socit qui se manifestera aussi bien, sinon mieux, dans des institutions juridiques, dans des uvres littraires ou des uvres dart que dans les systmes des philosophes. Un systme philosophique, nommment dsign, pourra, il est vrai, montrer avec une particulire clart cet tat desprit, parce quil concentre des traits pars ailleurs et les met en pleine lumire 1 ; mais il ne sera jamais tudi qu titre de symbole et de symptme. Ce qui intresse les historiens anims de lesprit positiviste, ce sont les reprsentations collectives , et les vues individuelles nobtiennent leur regard que si elles sont le reflet du collectif. De l un changement de mthode : il se manifeste par le peu de souci que lon a de la partie en quelque sorte technique de la philosophie ;
1
Cf. Politique positive, 4e d., t. III, p. 34, sur la ncessit dune fixation des croyances en un enseignement. Lanarchie moderne a pu seule susciter le rve subversif dune foi sans organe .
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
26
ce qui intresse ce sont les thormes fondamentaux des philosophes, p.25 le contenu de leur opinion, et non leur vrit absolue ; chaque systme dopinion est en relation avec une poque et tire de cette relation la seule justification laquelle il puisse prtendre. Avant Auguste Comte, Hegel eut un gal souci de faire lapologie des systmes, en montrant que leur diversit ne soppose pas lunit de lesprit : Lhistoire de la philosophie, dit-il 1, rend manifeste, dans les diverses philosophies qui apparaissent, quil ny a quune seule philosophie divers degrs de dveloppement, et aussi, que les principes particuliers sur lesquels sappuie un systme ne sont que des branches dun seul et mme ensemble. La philosophie la dernire venue est le rsultat de toutes les philosophies qui prcdent et doit contenir les principes de toutes ces philosophies. Ce nest l ni le sectarisme qui excommunie, ni le scepticisme qui profite des divergences des systmes pour les renvoyer tous ; sectarisme et scepticisme supposent quil y a plusieurs philosophies ; lhistoire pose quil ny en a quune. Pour justifier le mpris de la philosophie, lon admet quil y a des philosophies diffrentes, dont chacune est une philosophie et non pas la philosophie, comme sil y avait des cerises qui ntaient pas aussi du fruit . Lhistoire de la philosophie est le dveloppement dun unique esprit vivant prenant possession de lui-mme ; elle ne fait quexposer dans le temps ce que la philosophie mme, libre des circonstances historiques extrieures, expose ltat pur dans llment de la pense . Unit de lesprit humain et continuit de son dveloppement, telles sont les certitudes a priori qui, simposant lhistorien avant mme quil ait commenc sa recherche, lui mettent en mains le fil qui lui permettra de sorienter. Ce que cette thse suppose, cest lexistence dune sorte da priori historique, a priori qui consiste dans la nature de lesprit et dont la connaissance nest pas du tout justiciable des mthodes historiques. p.26 Lhistoire de la philosophie est lhistoire des manifestations de lesprit ; comme telle, elle est dbarrasse des contingences et des accidents ; lhistorien est sr de trouver un lien dialectique entre les systmes qui se succdent 2. Avec Hegel et Comte, nous sommes lextrme oppos de la situation o la Renaissance avait laiss lhistoire de la philosophie ; le pass ne soppose plus au prsent ; il le conditionne et, justifi par lui, il ne fait que drouler lunit dun plan systmatique et prconu. Toute lvolution de lhistoire de la philosophie jusqu nos jours repose sur une discussion de ce postulat. En effet la connaissance de la loi immanente ce dveloppement nest pas le rsultat de lobservation et de linduction historiques. Lunit de la
1 2
Encyclopdie (1817), Einleitung, 13, 14. De mme, Comte fait reposer finalement (Politique Positive, t. III) sa loi des trois tats non sur une induction historique, mais sur la nature de lesprit humain.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
27
philosophie, chez Hegel, nest pas une constatation, mais bien un postulat. Cest un postulat qui ne peut tre accept quavec la philosophie dont elle fait partie. Est-ce ainsi que lhistoire apparat une vue non prvenue ? Tout homme dun jugement ordinaire quon mettra en prsence du spectacle quoffre lhistoire de la philosophie sen formera demble une ide singulirement diffrente de ce que voudrait le sophisme de la philosophie hglienne. Renouvier, qui formule cette opinion 1, revient en effet, par del lclectisme franais, par del Hegel et Diderot, cette tradition du sectarisme, contre laquelle staient levs le XVIIIe et le XIXe sicles, parce quelle ne rpondait pas au dsir passionn de lunit de lesprit humain. Selon Renouvier, la division des philosophes en sectes opposes, nest point un accident historique, rsultant de prjugs temporaires que feront disparatre les lumires , mais un phnomne normal qui tient la constitution de lesprit humain. Depuis vingt-cinq sicles, en Occident, les plus grandes oppositions se sont maintenues p.27 entre les philosophes. Sans doute, la controverse et le progrs des connaissances positives ont pu liminer certaines questions et supprimer certaines dissidences, mais la plupart et les plus graves de toutes nont fait que reculer ou se transporter ailleurs. Lesprit humain est de nature antinomique ; la controverse dominante est celle qui existe entre la doctrine de la libert et celle du dterminisme ; cette controverse se ramnent, selon Renouvier, toutes les autres, et lon peut classer systmatiquement tous les systmes, en faisant rentrer chacun deux dans lune ou lautre de ces deux doctrines. Or, il nest pas prvoir que jamais un parti puisse convaincre lautre par des raisons contraignantes. Ainsi sexplique et se justifie lexistence des sectes. Le tort de lclectisme et de lhglianisme est davoir vu seulement dans les sectes tantt un produit arbitraire de la fantaisie, tantt un moment ncessaire mais tout provisoire dans le dveloppement de la pense. Du point de vue de Renouvier, lhistoire de la philosophie se fige donc en un dialogue intemporel entre deux thses contradictoires et toujours renaissantes ; dune poque lautre, il ny a pas de diffrences philosophiquement importantes ; les variations de la terminologie, la diversit des rapports sous lesquels peut tre envisag chaque problme et qui permettent de donner une forme et des expressions nouvelles des opinions en ralit anciennes , voil la seule matire qui reste lhistoire comme telle ; elle a en revanche des cadres permanents, ceux mmes qui permettent la classification systmatique des doctrines ; mais ces cadres sont des ncessits de la pense et non pas des faits historiques. La seule initiative qui reste permise lesprit humain, cest non pas la construction des systmes qui sont dans lessentiel prdtermins (tout comme chez de Grando ou Cousin), mais ladoption libre dune des deux seules directions possibles. Loriginalit nest pas, comme on le croyait, dans linvention
1
Esquisse dune classification systmatique des doctrines philosophiques, La Critique religieuse, juillet 1882, p. 184.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
28
intellectuelle dun systme, mais dans lattitude de la volont lgard de systmes prforms. Le point de vue de Renouvier marque dj labandon de la doctrine dune prtendue ncessit historique. Son poque mme et plus encore la ntre, nous donnent le spectacle dune sorte de dsagrgation des grandes synthses historiques ; notre temps a une rpulsion manifeste pour les grandes constructions, quelles soient hgliennes ou positivistes. Les signes extrieurs de cet tat desprit, cest que les uvres marquantes dans lhistoire de la philosophie, ne sont plus des histoires densemble, mais des ouvrages limits une priode comme la Philosophie des Grecs ddouard Zeller, ou une nation, ou un problme, comme le Systme du Monde de Platon Copernic de Duhem, ou bien des recueils philologiques comme les Fragments des Prsocratiques et les Doxographes grecs dH. Diels, ou des monographies comme celles dHamelin sur le Systme dAristote ou le Systme de Descartes. Les histoires gnrales de la philosophie ont elles-mmes une mthode plus analytique que synthtique et visent plus recueillir les rsultats des travaux utiliss dans les monographies qu dcouvrir une loi immanente de dveloppement ; telle sous cet aspect, la Philosophie analytique de lhistoire de Renouvier ; telles lHistoire de la Philosophie europenne de Weber, lHistoire de la philosophie par problmes de Janet et Sailles, et plus manifestement encore la grande Histoire de la philosophie dUeberweg, qui ne vise qu tenir le lecteur au courant des travaux originaux sur chaque question.
p.28
Les causes de cette situation, qui est nouvelle, sont de deux sortes. La premire est limmense labeur philologique, qui, depuis 1850 environ, grce des ditions critiques, des dcouvertes de textes, des recueils de fragments, a, en mme temps quil prcisait et enrichissait notre information, rendu difficiles ou mme impossibles ces vues densemble que se targuaient davoir les historiens dantan. Il doit en tre ainsi si lon songe aux conditions de la mthode philologique : son point de vue, en effet, les priodes de lhistoire se distinguent moins par des vnements positifs qui en marqueraient le dbut et la fin que p.29 par la nature et ltat des sources qui les font connatre ; pour ne prendre quun exemple grossier, combien diffrent est ltat de nos sources relatives la philosophie antique, avec ses rares uvres originales, et ltat des sources de la philosophie mdivale ou moderne, dont labondance effraye limagination. Le travail de critique et dinterprtation des textes doit suivre dans les deux cas des mthodes diffrentes et il implique mme des habitudes desprit assez distinctes pour quon ne puisse se vanter de les possder la fois ; mais il en faudrait dire autant de priodes bien plus courtes ; le stocisme et lpicurisme, par exemple, connus par des lambeaux de textes, ne peuvent tre tudis de la mme manire que le systme dAristote, dont lenseignement est intgralement conserv. Dautre part, les conclusions du philologue, quand il sagit dinterprter une pense et den serrer de prs le sens, sont souvent provisoires et la merci
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
29
dune nouvelle dcouverte ou dun nouveau rapprochement ; les interprtations des systmes anciens comme le platonisme, ou mme des doctrines modernes, comme celles de Descartes ou de Kant, sont innombrables ; comment y trouver un point dappui solide pour une construction synthtique ? Aux exigences de la mthode philologique sajoute une seconde raison peut-tre plus dterminante encore pour nous dtourner de lambition de dcrire lensemble du pass philosophique. Comte et Hegel, et mme Renouvier soccupent de la philosophie et non des philosophes. Quils considrent ces reprsentations de lunivers, quils tudient comme des cadres ternels imposs par la nature mme de la raison, ou comme des sortes de reprsentations collectives, voluant elles-mmes collectivement, et se transformant avec la socit, ils font de la philosophie quelque chose dimpersonnel 1, ou, du moins, p.30 lexpression personnelle que donne un philosophe des penses de son temps nest que laccident ; lessentiel est ailleurs, dans ce dictamen rationnel ou social, sorte de dit, laquelle se soumettent naturellement les consciences individuelles, fussent celles dun Platon ou dun Descartes. Or lhistoire de la philosophie a volu comme lhistoire en gnral ; la minutie apporte la recherche des sources ne sexpliquerait pas sans la volont de lhistorien darriver ce quil y a dindividuel, dirrductible, de personnel dans le pass ; ses recherches seraient tout fait inutiles, sil sagissait, comme autrefois, de dterminer des types ou des lois ; quoi bon un exemplaire nouveau dun type dj connu, si lexemplaire navait son prix en lui-mme et dans ce qui le distingue ? Ce got de lindividuel, qui est peut-tre encore le trait dominant de notre critique littraire, nous fait voir le pass sous une perspective tout fait nouvelle ; ce ne sont plus ni des sectes comme la Renaissance, ni des systmes comme chez Cousin, ni des mentalits collectives que vise atteindre lhistorien ; ce sont des individus, dans toute la richesse nuance de leur esprit ; Platon, Descartes ou Pascal ne sont ni des expressions de leur milieu ni des moments historiques, mais de vritables crateurs. Ce qui frappe premire vue cest la discontinuit de leurs efforts ; il ny a, remarque Windelband, nul progrs continu puisque chacun des grands systmes donne du problme une formule nouvelle et le rsout comme si les autres navaient pas exist. 2 Il faut ajouter que ces deux raisons, exigences de la mthode philologique et recherche de lindividuel, bien que sopposant lune et lautre la synthse historique, ne conduisent pas lesprit dans le mme sens. Le philologue a une
1
En ce qui concerne Renouvier, certes, le choix dune des deux doctrines opposes est personnel et libre ; mais les doctrines entre lesquelles le choix sexerce sont tout fait dtermines. 2 Geschichte der Philosophie, Freiburg, 1892.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
30
tendance chercher la parent des penses et des formules ; cette tendance sexagre parfois, si elle nest pas tempre par le got et par p.31 le sens des penses vivantes, jusqu faire dune doctrine nouvelle une mosaque des doctrines passes, jusqu confondre linventeur avec le compilateur. Par un tour desprit inverse, le critique ne veut rechercher dans les doctrines que leur bigarrure et il fait lhistoire des ides en impressionniste, ayant plus de got pour la varit des esprits que pour lunit profonde quelle peut receler. Aux diversits purement doctrinales de lge antique et mdival, lge moderne en ajoute une autre, cest la diversit des esprits nationaux qui donnent sa nuance particulire chacune des philosophies anglaise, allemande ou franaise. Il faut aussi songer limmense complication de la culture moderne qui est en train de se dissoudre, comme Auguste Comte le prvoyait et le craignait, en une srie de cultures spciales et techniques, dont chacune absorbe la vie et les moyens dun homme. Le philosophe, se limitant une des faces de cette culture, est aujourdhui logicien ou pistmologiste, philosophe des mathmatiques ou philosophe de la religion, sans quil y ait de correspondance bien nette et encore moins dunit entre un point de vue et un autre. On oscille entre une culture gnrale, qui est superficielle, et une culture approfondie, qui est troite. Ne voil-t-il pas bien des diversits doctrinales irrductibles la raison : diversits dues des diffrences de personnalits, de caractre national, de mode et de degr de culture ? Comment lhistorien mettra-t-il sur la mme ligne des doctrines dorigine si diffrente ? Aussi voyons-nous les meilleurs des historiens de notre temps hsiter sur la mthode suivre. Cest par exemple Victor Delbos 1 qui, sans renoncer lide dun enchanement rationnel entre les aspects successifs de la pense philosophique, voit son dsir dunit balanc par la crainte de ntre pas exact et de p.32 laisser chapper la substance mme de lhistoire. Et, de fait, ce vigoureux esprit a laiss une admirable srie de monographies, dont le titre mme 2 marque la difficult, peut-tre insurmontable, quil devait trouver crire une histoire gnrale de la philosophie. Mme hsitation, mais plus dissimule, chez Windelband 3. Le dveloppement de la philosophie, comme il le reconnat dans sa prface, drive de trois facteurs, et, lon pourrait mme dire, de trois histoires juxtaposes : 1 Histoire pragmatique ; cest lvolution interne de la philosophie reposant sur le dsaccord entre les solutions anciennes et les reprsentations nouvelles de la ralit : 2 Histoire dans ses relations lhistoire de la culture ; la philosophie reoit ses problmes des ides qui dominent la civilisation dune poque ; 3 enfin histoire des personnes. Sous
La mthode en histoire de la philosophie, 2e article, Revue de mtaphysique et de morale, 1917, p. 279-289. 2 Figures et doctrines de philosophes, Paris, A. Colin ; La philosophie franaise. 3 Geschichte der Philosophie, Freiburg, 1892, p. 9.
1
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
31
le premier aspect, lhistoire a bien une sorte de loi de dveloppement ; mais quelle est au juste limportance de cet aspect par rapport aux deux autres qui font dpendre de nombreux hasards le cours de la vie spirituelle, cest ce que lauteur ne laisse pas pressentir. Est-ce l ltat dfinitif de lhistoire de la philosophie ? Doit-elle abandonner tout espoir dtre elle-mme philosophique, pour devenir un chapitre de la philologie et de la critique littraire ? Est-elle condamne perptuellement osciller entre la mthode de la mosaque et la mthode impressionniste, incapable de faire mieux que de temprer ces deux mthodes lune par lautre ? Sans doute, et malgr lapparence, il reste quelque chose des ides dun Comte, et dun Hegel. Ils nous ont enseign voir dans les systmes de philosophie du pass mieux que des sectes fermes ou des fantaisies individuelles, des aspects de lesprit humain. Ils ont appris prendre le pass intellectuel tout fait p.33 au srieux et ont compris mieux que dautres la solidarit intellectuelle des gnrations. Pourtant la crise qui atteint lhistoire de la philosophie, on ne peut prtendre remdier en revenant une de ces formules gnrales de dveloppement chres aux positivistes et aux hgliens. Tout ce que lon a tent rcemment en ce sens, est ou bien manqu ou tout au moins prmatur 1. Comme les deux premiers problmes que nous avons poss, ce troisime problme ne peut tre rsolu que dune manire approximative et provisoire, avec toutes les incertitudes que comporte lhistoire. Il faut remarquer, en premier lieu, que lrudition philologique, si elle a, comme nous le remarquions, fait crouler la construction comtiste ou hglienne, nous met sur la voie dune solution positive. A mesure que lon progresse davantage dans la connaissance intime et dtaille du pass, lon voit mieux les nouvelles doctrines prendre leur point dinsertion dans les doctrines du pass, et lon tablit des continuits et des passages, l o lon ne voyait dabord que radicale originalit et absolue opposition. Des formules gnrales comme celles de Comte ou de Hegel, pour qui le dveloppement doit procder par opposition franche et nette, rendaient trs mal compte de la ralit nuance que nous montre lhistoire. En revanche, cette continuit des esprits que rvle la critique historique ne saurait sexprimer par une loi gnrale et doit faire lobjet de mille recherches de dtail. Lide dtudier, dans leur continuit et leur gense, les systmes du monde de Platon Copernic naurait pu venir aux historiens imbus de lide de la radicale opposition entre lantiquit et le moyen ge ; et il a fallu la merveilleuse rudi1
Parmi ces tentatives, une de celles que nous jugeons intressantes quoique prmatures est la Philosophie compare de M. Masson-Oursel (Paris, 1923), qui essaye de dgager une loi de dveloppement en comparant lallure gnrale de la pense philosophique en Europe et dans lExtrme-Orient. Malheureusement, les doctrines quil rapproche ne sont pas toujours comparables. Voyez aussi lingnieuse interprtation de lhistoire par J. de Gaultier, Mercure de France, 1er janvier 1923, p. 11.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
32
tion de Duhem pour retrouver travers ce temps la continuit de deux ou trois thmes de pense. Le p.34 regain de faveur si lgitime qua trouv rcemment lhistoire de la philosophie du moyen ge nest pas fond seulement sur des motifs trangers lintrt de lhistoire, mais aussi sur les vritables dcouvertes qui montrent son union la philosophie moderne. Labandon de la mthode a priori, loin de nuire lide de lunit de la philosophie et de lintelligence, a donc permis de lui donner un sens plus plein et plus concret, bien que plus difficile traduire en formules ; car elle nest point lunit dun plan qui se ralise peu peu, mais une srie defforts originaux et dinventions multiples. En second lieu, labandon de lide de progrs fatal, qui a domin lhistoire de la philosophie, jusque vers 1850, na pas t moins favorable une exacte apprciation du dveloppement philosophique. Lide dune marche incessante et continue est tout fait contraire la ralit historique. Bacon avait vu plus juste que ses disciples du XVIIIe sicle lorsquil mentionnait, ct des priodes de progrs, les priodes de rgression et doubli, suivies de renaissances. La vrit est que la courbe de la vie intellectuelle, si lon peut ainsi parler, est extrmement complique, et que seules des tudes de dtail peuvent donner une ide de ses mandres. Encore est-il quelles peuvent en donner lide, et, l non plus, luvre de la critique philologique nest pas destructrice, tout au contraire. Elle nous montre seulement plusieurs schmes possibles de dveloppement, l o lapriorisme historique nen voyait quun. Il y a tantt marche de la pense vers un plus grand dsaccord, vers une dissipation en une poussire de sectes qui sopposent lune lautre, comme en Grce, dans la priode qui a suivi la mort de Socrate, tantt au contraire marche vers lunit de pense, vers laccord presque complet, comme dans la seconde moiti du XVIIIe sicle o dominait lempirisme anglais. Tantt la pense philosophique se fait mouvante, suggestive, se transforme en une mthode de vie spirituelle, en une direction mentale comme chez Socrate ou chez Platon, tantt elle a la forme p.35 dune doctrine dcisive qui a une rponse prte toutes les questions et prtend limposer par une dialectique irrfutable, comme au temps de la scolastique. Il y a des moments o la pense intellectuelle, comme fatigue, renonce affirmer sa propre valeur et cde le pas des doctrines qui prtendent atteindre la ralit par intuition, sentiment ou rvlation ; par exemple lintellectualisme du XVIIIe sicle, avec sa confiance en la raison, est suivi de bien prs de lorgie romantique ; alternance trs instructive et qui, peut-tre, est une loi gnrale de lhistoire de la pense. On voit par ces exemples comment la critique elle seule, sans le moindre a priori, permettra de classer, dordonner les systmes. Lhistoire permettra mme jusqu un certain point de les juger. En effet la valeur dun systme nest pas indpendante de llan spirituel quil a cr. Les doctrines philosophiques ne sont point en effet des choses mais des penses, des thmes de mditation qui se proposent lavenir et dont la
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
33
fcondit nest jamais puise quen apparence, des directions mentales qui peuvent toujours tre reprises ; les ides dont elles sont faites ne sont pas les inertes matriaux dun difice mental qui pourrait tre dmoli et dont les matriaux pourraient tre tels quels remploys dans dautres constructions ; ce sont des germes qui veulent se dvelopper ; elles prtendent tre un bien capable de se communiquer 1 . Or, la recherche historique doit nous permettre de saisir llan originel et la manire dont il se dveloppe, dont il cesse, dont parfois il reprend : lhistoire nest pas acheve, cest ce que ne doit jamais oublier lhistorien de la pense ; Platon ou Aristote, Descartes ou Spinoza nont pas cess dtre vivants. Un des plus grands services que peut rendre lhistoire est sans doute de montrer de quelle manire une doctrine se transforme ; dune manire bien diffrente selon les cas. Il arrive parfois que la doctrine, en devenant p.36 permanente, se raidisse en un dogme, qui simpose : ainsi, aprs trois sicles dexistence, le stocisme, chez pictte, est une foi qui na plus besoin dtre dmontre. Il arrive aussi quun thme philosophique, en cherchant se fixer en doctrine, se raliser en dogmes, finit par spuiser en une sorte de complication et de manirisme, qui fait songer aux brillantes dcadences des coles artistiques dont la formule sest use. Par exemple, la philosophie ionienne, du temps de Platon, est rduite aux balbutiements des derniers hraclitens qui, de peur de fixer le fleuve mouvant des choses, ne veulent plus utiliser le langage. Ou encore, la description des choses intelligibles, chez les derniers no-platoniciens comme Proclus et Damascius, arrive une si minutieuse prcision quon est forc dy sentir tout lartifice dun technicien professionnel et den voir le manque de sincrit ; et lon pourrait en dire autant des dernires formes des systmes de Fichte ou de Schelling. On voit ainsi natre comme des catgories historiques, mouvantes, modifiables, des thmes gnraux de pense qui doivent remplacer les catgories massives dont usaient autrefois les historiens clectiques ou hgliens. Ces trs brves indications excluent la possibilit de terminer cette introduction en formulant rien qui ressemble une loi de dveloppement de la pense philosophique ; il ne sagit pas de construire, mais seulement de dcrire. Ce que lon ne peut plus faire, cest crire lhistoire en prophte aprs coup ; comme si lon voulait donner limpression que la pense philosophique naissait peu peu et se ralisait progressivement. Nous ne pouvons plus admettre comme Aristote, le pre de lhistoire de la philosophie, que lhistoire est oriente vers une doctrine, quelle contient en puissance. Lhistoire de la philosophie nous enseigne que la pense philosophique nest pas une de ces ralits stables qui, une fois trouves, subsistent comme une invention technique ; cette pense est sans cesse remise en question, sans cesse en danger de se perdre en des formules qui, en la fixant, la trahissent ; la vie spirituelle nest que dans le travail et non dans la possession dune prtendue vrit acquise.
1
SPINOZA, De emendatione intellectus, dbut.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
34
Louvrage prsent, dont parat le premier fascicule, sefforce de donner une esquisse aussi claire et aussi vivante que possible de ce travail ; il a t inspir par le dsir de servir de guide dans cet immense pass de la philosophie, que les recherches historiques de dtail rvlent chaque jour plus complexe et plus nuanc. Aussi a-t-il t jug indispensable de donner au lecteur les moyens de juger de la fidlit de cette esquisse et den prciser les traits : cest pourquoi chaque chapitre est accompagn de renvois aux textes les plus importants et suivi dune bibliographie sommaire, indiquant, avec les ditions des auteurs, les ouvrages et articles qui ont paru essentiels 1.
Bibliographie gnrale
@
1 Nous avons indiqu, dans lIntroduction de cet ouvrage, la ncessit dtudier les doctrines philosophiques de lOrient et de lExtrme-Orient, pour donner une image complte du pass de la philosophie ; nous nous sommes assur, pour traiter ces questions, la collaboration de P. Masson-Oursel, lauteur de lEsquisse dune Histoire de la philosophie indienne (1923), dont on connat la comptence ; nous sommes donc heureux dannoncer que notre Histoire sera complte bref dlai par un fascicule supplmentaire sur la philosophie orientale.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
35
I PRIODE HELLNIQUE
@
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
36
CHAPITRE PREMIER LES PRSOCRATIQUES
@ Dans la premire priode, la priode hellnique qui sachve avec la mort dAlexandre (323), la philosophie sest dveloppe en pays grec et successivement en divers centres : cette succession correspond aux vicissitudes politiques. Elle nat au VIe sicle au pays ionien, dans les villes maritimes alors trs riches et commerantes. A partir de 546, lIonie est soumise par les Perses, et la grande ville de Milet est ruine en 494. Le centre de la vie intellectuelle se dplace ; cest dans lItalie du sud et la Sicile que nous voyons se transporter la philosophie. Enfin, aprs les guerres mdiques, au temps de Pricls (mort en 429), Athnes devient la capitale intellectuelle de la Grce comme celle du nouvel empire maritime, qui devait durer jusqu la guerre du Ploponse. Dans ce dveloppement, les Ioniens jouent le principal rle ; les premiers philosophes de la Grande-Grce sont des migrs ioniens ; et ce sont galement des Ioniens qui sont, Athnes, les premiers propagateurs de la philosophie. Pourtant en chacun de ces centres la pense philosophique prend des caractres diffrents.
I. LA PHYSIQUE MILSIENNE
@ Il est difficile de prciser la signification exacte et la porte du mouvement dides qui a eu lieu Milet au VIe sicle avant notre re. Des trois philosophes milsiens qui se sont succd p.42 dans la cit alors la plus puissante et la plus florissante de lAsie Mineure grecque, le premier 1, Thals, na rien crit, et il est connu par une tradition qui ne remonte pas au del dAristote ; les deux autres, Anaximandre et Anaximne, dont chacun est lauteur dun ouvrage en prose, que lon a plus tard intitul De la Nature, ne nous sont gure connus cependant que par ce quen ont dit Aristote et les crivains de son cole. Or ce quAristote cherchait avant tout dans leur enseignement, ctait une rponse cette question : quelle est la matire dont sont faites les choses ? Cette question, cest Aristote qui la pose, et il la pose dans le langage de sa propre doctrine ; nous navons aucune preuve que les Milsiens eux-mmes se soient proccups du problme dont on cherche chez eux la solution. Aussi si lon nous apprend que, selon Thals, leau est le principe de toutes choses,
1
ARISTOTE, Mtaphysique A. 3, 983b 20.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
37
que, selon Anaximandre, cest linfini, et, selon Anaximne, lair, il faut se garder de voir dans ces formules une rponse au problme de la matire 1. Pour en pntrer le sens, il faut chercher, sil est possible, quels problmes ils agitaient effectivement. Ils sont, semble-t-il, de deux ordres : dabord des problmes de technique scientifique ; cest ainsi quAnaximandre passe pour avoir invent le gnomon et y avoir trac les lignes des solstices et de lquinoxe ; il aurait aussi dessin la premire carte gographique, et dcouvert lobliquit du zodiaque. Mais ce sont avant tout des problmes concernant la nature et la cause des mtores ou phnomnes astronomiques, tremblements de terre, vents, pluies, clairs, clipses et aussi des questions gnrales de gographie sur la forme de la terre et les origines de la vie terrestre. De ces techniques scientifiques, nos Milsiens ne firent sans doute que propager en pays grec ce que les civilisations msopotamienne et gyptienne leur transmettaient. Les Babyloniens taient observateurs du ciel ; de plus, pour leur cadastre, ils p.43 dressaient des plans de villes et de canaux et ils tentrent mme de dessiner la carte du monde 2. Quant aux arts mcaniques, ils prsentent dans tous les pays hellniques, du VIIe au Ve sicle, un dveloppement trs riche et vari 3 dont les philosophes ioniens sont les tmoins plus sans doute que les instigateurs : tmoins trs sympathiques, qui voyaient la supriorit de lhomme dans son activit technique et dont lopinion a trouv sans doute sa plus frappante expression chez un Ionien du Ve sicle, Anaxagore ; selon lui, lhomme est le plus intelligent des animaux parce quil a des mains, la main tant loutil par excellence et le modle de tous les outils 4. Loriginalit des Milsiens parat avoir t le choix des images par lesquelles ils se reprsentaient le ciel et les mtores ; ces images ne gardent rien du fantastique des mythes ; elles sont empruntes soit aux arts, soit lobservation directe : il y a dans toutes les analogies qui constituent leur science, avec une extrme prcision imaginative, qui nadmet, comme le mythe, aucun arrire-plan mystrieux, un grand dsir de comprendre les phnomnes inaccessibles par leur rapport avec les faits les plus familiers. Une de ces observations courantes, ctait pour un Milsien, particulirement proccup de navigation, celle des orages et des temptes ; on voyait se former, dans le calme, des nues paisses et noires, qui sont subitement dchires par un clair, annonciateur de la tourmente de vent qui va suivre. Anaximandre, cherchant les expliquer, enseignait que le vent, enferm dans le nuage, la rompu par sa violence et que lclair et le tonnerre accompagnent cette brusque rupture 5. Or, cest par analogie avec lorage quil
1 2
Ibid. A, 3, 983b 6-11 ; 984a 2-7. DELAPORTE, La Msopotamie, 1923, p. 260-261. 3 ESPINAS, Les Origines de la technologie 1897, p 75 sq. 4 ARISTOTE, Des parties des animaux, IV 10, 687 a 7. 5 ATIUS, Placita, III, 6, 1.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
38
conoit la nature et la formation des astres : il suffit, pour obtenir la conception p.44 quAnaximandre se faisait du ciel, de remplacer la gaine de nuages pais par une gaine opaque dair condens (l air ne dsignant pour lui autre chose que les vapeurs), le vent intrieur par du feu, les dchirures de la gaine par des sortes dvents ou tuyaux de soufflet par lesquels le feu fait irruption. Si lon suppose que ces gaines sont de forme circulaire et disposes autour de la terre comme les jantes des roues autour du moyeu dun char, les astres ne seront pour nous que la partie du feu intrieur qui sort par ces vents : par la fermeture momentane de ces vents sexpliqueront les clipses et les phases de la lune. Anaximandre admettait quil y avait trois de ces gaines circulaires, animes dun mouvement rotatoire ; au plus loin de la terre, celles du soleil et de la lune, qui nont quun vent ; au plus bas, celle des toiles fixes (sans doute la voie lacte) qui a un grand nombre dvents 1. Des assimilations de ce genre permettent de formuler dune manire nouvelle le problme cosmogonique ; la formation du ciel nest pas foncirement diffrente de celle dun orage ; il sagit de savoir comment le feu qui, primitivement, encerclait la terre, comme lcorce fait larbre, sest bris et rparti lintrieur des trois anneaux circulaires. Or, la cause en jeu, pour Anaximandre, semble bien tre celle qui est lorigine des pluies, des orages et des vents. Ce sont les vapeurs qui, produites sur la mer, par lvaporation, brisent cette sphre de feu et lengainent en des anneaux 2. Le phnomne fondamental dans cette physique milsienne est bien lvaporation de leau de la mer, sous linfluence de la chaleur. Or, les produits de cette vaporation (vapeurs, vents, nuages, etc.), sont considrs traditionnellement en Grce comme ayant des proprits vitales 3. Anaximandre ne fait donc que suivre une opinion fort ancienne, lorsquil admet que les tres p.45 vivants naissent dans lhumidit chaude vapore par le soleil. Aussi insiste-t-il sur lantriorit des formes de la vie marine, des poissons, des tres enferms dans une corce pineuse, qui ont d modifier leur genre de vie, lorsque, lcorce clatant, ils ont t placs sur terre 4. Ces vues dAnaximandre nous permettent peut-tre de prciser le sens des affirmations sur la substance primitive quAristote considre comme le centre de leur doctrine. Ces affirmations semblent porter non sur la matire des tres, mais sur la chose do est venu le monde. Thals, en enseignant que cest leau ne fait que reproduire un thme cosmogonique extrmement rpandu ; mais, daprs le dveloppement de la pense milsienne, il faut sans doute entendre par cette eau quelque chose comme ltendue marine avec toute la vie qui sen dgage. Il enseignait dailleurs que la terre est comme un disque
1 2
ATIUS, Placita, II, 13, 7 ; 15, 6 ; 20, 1 ; HIPPOLYTE Rfutations des Hrsies, 1, 6, 4-6. ATIUS, III, 6, 1 (origine du vent), compar ARISTOTE, Mtorologiques, 11, 1, 353 b 5. Cf. BURNET, Laurore de la philosophie grecque, trad. Reymond, 1919, p. 67. 3 PLUTARQUE, Dfaut des oracles, 18 ; ARISTOTE, De lme, A 5, 410 b, 27. 4 AETIUS, V. 19, 1.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
39
plat port sur leau primitive comme un navire sur la mer. Quest-ce qui conduisit Anaximandre remplacer leau de Thals par ce quil appelle lInfini ? Sur le sens de cette expression on saccorde fort peu. Est-ce une forme milsienne du mythe hsiodique du Chaos, antrieur aux dieux, la terre et au ciel, comme la thse de Thals se rfrait une ancienne cosmogonie ? LInfini serait alors la chose qualitativement indtermine do naissent les choses dtermines, feu, eau, etc., ou tout au moins le mlange o sont confondues toutes les choses qui se sparent ensuite pour former le monde. Il semble que lInfini dAnaximandre est bien plutt lillimit en grandeur, ce qui est sans bornes, par opposition au monde qui est contenu dans les bornes du ciel, puisque cet infini contient les mondes 1. Cette interprtation cadre avec la thse de la pluralit des mondes, une des thses dAnaximandre qui sera reprise par p.46 Anaximne ; il admet, en effet, lexistence simultane de plusieurs mondes qui naissent et prissent au sein de linfini ternel et sans vieillesse. De cet infini les mondes naissent, nous est-il dit, par un mouvement ternel , cest--dire par un mouvement de gnration incessamment reproduit qui a pour effet de sparer lun de lautre les contraires, le chaud et le froid ; ces contraires agissant lun sur lautre, produisent, on la vu, tous les phnomnes cosmiques 2. Anaximne en prenant lair comme principe cest--dire comme premier commencement, ne scarte pas dAnaximandre. Le mot air ne fait que prciser la nature de lInfini ; car son principe est un air infini (sans limite), do naissent toutes choses ; il est comme lInfini dAnaximandre, anim dun mouvement ternel. Mais il semble quAnaximne nait pas cru que ce mouvement pouvait rsoudre le problme de lorigine des choses ; un mouvement dagitation comme celui quon imprime un crible peut bien sparer des choses mlanges, mais non pas les produire. A ce mouvement ternel, Anaximne a donc superpos une autre explication de lorigine des choses ; lair, par sa rarfaction, donne naissance au feu, et, par ses condensations successives, au vent, au nuage, leau et finalement la terre et aux pierres. Dans ce dernier ordre de transmutations, il pense sans doute des phnomnes trs concrets et accessibles lobservation : formation des vents dans lair calme et invisible, puis formation des nuages qui se rsolvent en pluies, ces pluies donnant naissance aux fleuves qui dposent des alluvions. Le procs inverse, celui de la rarfaction, est celui qui donne naissance au feu, cest--dire sans doute tous les mtores igns et aux astres 3. La physique des Milsiens est donc une physique de gographes et de mtorologistes, mais leur vision densemble de p.47 lunivers nannonce en
1
THEOPHRASTE, cit par Simplicius (DIELS, Doxographi graeci, 376, 3-6). Cf. BURNET, Aurore de la philosophie grecque, d 61-66. 2 HIPPOLYTE, Rfutations des Hrsies, 1, 6 1-2 compar ARISTOTE, Physique, III, 4, 203 b, 25 (cit par BURNET Aurore, p. 66, n.1). 3 HIPPOLYTE, Rfutations, 1, 4, 1-3.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
40
rien les progrs de lastronomie que verra le sicle suivant ; la terre est pour Thals et Anaximne un disque plat que lun fait flotter sur leau et lautre sur lair ; cest pour Anaximandre une colonne cylindrique dont le diamtre de base est gal au tiers de la hauteur et dont la partie suprieure, que nous habitons, est lgrement renfle ; elle se tient en quilibre, parce quelle est gale distance des confins de lunivers. Anaximne revient mme une image mythique tout fait ancienne, sil est vrai quil croit que le soleil aprs son coucher ne passe pas sous la terre, mais contourne lhorizon o il est cach la vue par de hautes montagnes, pour revenir lOrient. A peine pressent-on dans la dtermination quAnaximne donne des distances des anneaux clestes la terre quelque lueur de ce que sera lastronomie mathmatique 1. Dautre part, cette physique, o ninterviennent que des images sensibles et familires, se superpose un mode dexplication dun genre tout diffrent : la naissance et la destruction des mondes sont rgles selon un certain ordre de justice : Cest dans les choses dont ils sont venus que les tres se dtruisent selon la ncessit ; ils se payent lun lautre le chtiment et la punition de leur injustice, selon lordre du temps. Ici merge lide dun ordre naturel de succession qui est en mme temps un ordre de justice : image sociale dun ordre du monde, trs rpandue dans les civilisations orientales, et qui jouera un rle de premier plan dans la philosophie grecque. A cette notion de la justice se rattache sans doute le caractre divin que les Milsiens donnent au monde et la substance primordiale quAnaximne appelle immortelle et imprissable 2.
II. COSMOGONIES MYTHIQUES
@ A cette sagesse ionienne aux images si claires sopposent les efforts faits sans doute vers cette poque pour donner un regain de faveur aux anciennes cosmogonies mythiques. Onomacrite, qui vivait Athnes auprs de Pisistrate (mort en 527) passe pour avoir rassembl ces antiques lgendes ; ce sont dans doute les dbris de sa compilation ou des compilations de ce genre que nous trouvons dans nos plus anciens documents, qui ne remontent pas plus haut que Platon, Aristote et son disciple Eudme. Chacune de ces cosmogonies, comme chez Hsiode, prsente une srie de formes mythiques issues les unes des autres ; mais leur fantastique dpasse celui dHsiode ; nous avons affaire ici une vritable dcadence ; il ne sagit plus dintroduire un ordre, mais de frapper les imaginations. Chez Platon on voit le Ciel et la
p.48 1
Thals, daprs ARISTOTE, Mtaphysique, A 3, 993 b, 21 ; Anaximne dans HIPPOLYTE, Rfutations, I, 7, 4 et 6 ; Anaximandre dans HIPPOLYTE, I, 6, 3 et PLUTARQUE, Stromata (DIELS Doxographi 579, 19). 2 Thophraste chez Simplicius (DIELS Doxographi graeci, 476, 8-11). Cf. CORNFORD, From Religion to Philosophy, p. 174 et 176.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
41
Terre sunir pour engendrer Ocan et Thtys, do nat le couple de Chronos et de Rha, qui produit son tour Zeus, Hra et leurs frres 1. Chez Aristote, les thologiens prennent la nuit pour principe 2. Nous connaissons par Eudme disciple dAristote 3, tout un lot de cosmogonies analogues : moins rserv que ses matres, il nous montre mieux la grossiret dimagination de ces thologiens ; cest par exemple Hellanicos, selon qui le premier couple, lEau et la Terre, ont engendr Chronos ou Hracls qui est un dragon ail tricphale avec un visage de dieu entre une tte de taureau et une tte de lion ; il sunit Anangk ou Adraste pour engendrer dans ther, rbe et Chaos un neuf do sortira le monde. De ces lucubrations, celle quEudme attribue spcialement lassociation religieuse des orphiques (les rapsodies orphiques), et qui montre Chronos, tre suprme, engendrant lther et le p.49 Chaos do sortent luf du monde et le dieu ail Phans, na rien qui la distingue des autres. Mais, prises dans lensemble, les thogonies dEudme offrent un trait remarquable, cest la place quelles font des formes mythiques telles que Chronos, le Temps, ou Adraste, cest--dire ces formes mi-abstraites qui dsignent une loi ou une rgle ; ce sont elles que nous avons vu intervenir sous le nom de Justice dans les cosmogonies ioniennes. Dautre part, il semble que ces cosmogonies se cantonnent peu peu dans les groupes religieux orphiques et forment corps avec lensemble de leurs croyances sur lorigine et la destine des mes. Cest par Platon lui-mme que nous connaissons ces croyances : lme prisonnire dans le corps comme en un tombeau doit aprs la mort prendre place en un banquet o elle senivre ternellement 4. Lon a dcouvert dans des tombeaux de Grande-Grce, Thurioi, Ptlia, leutherne, des tablettes dor que les initis aux mystres orphiques faisaient placer dans leurs tombeaux, et sur lesquelles sont gravs, comme dans un livre des morts gyptien, des recommandations sur litinraire que doit suivre lme aprs la mort et les formules quelle doit prononcer ; ces tablettes, qui sont du IIe sicle avant notre re, montrent combien cette croyance persista. Cest au cycle de mythes orphiques et au cycle dionysiaque que se rattache la lgende, dge incertain, de lorigine divine de lhomme 5 ; les Titans, ennemis de Zeus, sont pousss par Hra faire prir son fils Dionysos ; Dionysos est dchir par eux, et ils en mangent les membres sanglants, sauf le cur qui est aval par Zeus et do renatra un nouveau Dionysos ; Zeus foudroie alors les Titans ; de leur cendre nat la race humaine o le bien, qui vient de Zeus, est ml au mal, llment titanique. Le pote Pindare, qui fleurit en 478, nous est un tmoin de lextension quont prise de bonne heure, ces croyances orphiques. p.50 Le corps de tous cde la mort toute-puissante, mais, vivante
1 2
Time, 40 e. Mtaphysique, 1071 b 25. 3 Dans DAMASCIUS, Des Principes, chap. 123. 4 Rpublique, 363 c ; Phdon, 62 b, 69 c. 5 Cf. ROHDE, Psyche, vol. II, p. 116.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
42
encore, reste une image de notre tre ; car seule elle vient des dieux 1. Nous allons retrouver ces croyances chez les philosophes ; mais ce sera loin de lIonie.
III. LES PYTHAGORICIENS
@ A partir de 494 (date de la destruction de Milet), avec lcole milsienne, disparat momentanment toute trace de la physique ionienne. La vie intellectuelle stait dj dailleurs transporte dans les florissantes colonies de la Grande-Grce et de la Sicile. Plusieurs des hommes qui sy font connatre, viennent pourtant dIonie. Pythagore est n Samos, Xnophane Colophon. Et ce sont eux qui donnent chacun limpulsion dans les colonies dItalie un mouvement dides important, la philosophie des nombres dune part, llatisme dautre part, qui, lune et lautre, vont dominer tout le dveloppement ultrieur des ides. Le pythagorisme nest pas seulement un mouvement intellectuel, mais un mouvement religieux, moral et politique, aboutissant la formation dune confrrie qui cherche faire de la propagande et semparer du pouvoir dans les cits de la Grande-Grce. De ce mouvement trs complexe, il est difficile de se faire une ide exacte : dabord la vie de Pythagore lui-mme nest connue quau travers de lgendes qui se sont formes ds les premires gnrations ; de plus, lhistoire du pythagorisme est compose de deux priodes trs distinctes, dont la premire a dur depuis la fondation de lcole Crotone (vers 530) jusque vers la mort de Platon (350), et la seconde, celle du no-pythagorisme, a dbut vers le 1er sicle de notre re. Or, mme en admettant que lon puisse faire le dpart entre p.51 les doctrines du premier ge et celles du second (ce qui est difficile puisquon doit souvent utiliser des textes datant du nouveau pythagorisme pour connatre lancien), les doctrines attribues en bloc aux pythagoriciens du premier ge contiennent de si flagrantes contradictions quil est bien impossible de les attribuer au seul Pythagore, et que lon doit se contenter de les classer sans pouvoir dterminer ni leurs liens ni leurs auteurs. Pythagore fonde une association religieuse Crotone vers 530. Il ny a l rien de remarquable ; des associations de ce genre, comme celles des orphiques, existaient en Grce ; la mission quelles se donnaient taient denseigner des mthodes de purification quelles tenaient secrtes pour les initis. Telle tait bien aussi lassociation pythagoricienne ; elle avait des secrets quelle interdisait de rvler aux impurs. Des traditions assez anciennes rattachent lenseignement de Pythagore des promesses de vie heureuses aprs la mort pour les initis. Tel tait aussi lenseignement
1
Thrnes, fragm. 2, d. et trad. Puech, IV, p.196.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
43
orphique. La socit, ouverte aux femmes et aux trangers, dpassait les limites dune religion de la cit 1. Les fameuses interdictions contenues dans le catchisme pythagoricien (ne pas manger de fves, ne pas parler dans lobscurit, ne pas porter sur une bague leffigie dun dieu, ne pas sacrifier de coq blanc, etc.) 2, sont des tabous du genre le plus vulgaire 3 o il ne faut chercher aucun symbolisme moral, comme on le fit plus tard, mais des signes qui doivent suffire distinguer des autres hommes les membres de la secte. La doctrine de la transmigration des mes travers des corps dhommes et danimaux, doctrine quun trs ancien document 4 attribue Pythagore, ne peut non plus passer comme le fruit dune rflexion philosophique : croyance frquente chez les p.52 primitifs qui ne voient en la naissance quune rincarnation 5, elle se rattache ces contes, si frquents dans le folklore, qui montrent lme sortant du corps, et allant rsider dans un animal ou un objet inanim 6 ; elle na nullement tre rattache une origine historique prcise. Enfin, le prcepte dabstinence de la viande, sil a rellement fait partie du catchisme primitif de lcole, se rattache sans doute la mme foi en lunit de tous les vivants, qui a donn naissance la doctrine de la transmigration. Quest-ce qui distingue donc Pythagore des sectes orphiques, si incapables de progrs et si cantonns dans leur rituel et leurs mythes fantastiques ? Hrodote raconte que le Thrace Zamolxis, ayant t lesclave de Pythagore, Samos, apprit de lui la manire de vivre des Ioniens 7 . Il semble bien aussi que Pythagore apporta en Grande-Grce la cosmologie milsienne ; il enseignait, comme Anaximne, que le monde tait plong au sein dun air infini ; de cet infini, il absorbe, par une sorte de respiration, les parties les plus proches, qui, entres en lui, sparent et isolent les choses les unes des autres ; lair illimit, appel aussi obscurit, nuit ou vapeur, produit ainsi dans les choses la multiplicit et le nombre 8. Comme les Milsiens, Ptron, un pythagoricien de la plus ancienne poque, passe pour avoir admis la pluralit des mondes 9, une pluralit dfinie, il est vrai, et des mondes rangs en ordre gomtrique. Entre la physique milsienne de Pythagore, et les rgles pratiques de lordre, il nous est dailleurs impossible de saisir la moindre affinit. Nulle parent visible non plus entre cette cosmologie et la doctrine clbre attribue Pythagore par la tradition : toutes les choses sont des nombres.
1
Cf. dans JAMBLIQUE, Vie de Pythagore, 75-78, lettre de Lysis Hipparque sur le secret pythagoricien. 2 JAMBLIQUE, ibid., 83-84. 3 FRAZER, Le Rameau dOr, tr. fr. t. 1, p. 328. 4 XNOPHANE, fragment 7. 5 LVY-BRUHL Fonctions mentales dans les socits infrieures, p. 398. 6 FRAZER, Le Rameau dOr, trad. fr., tome I. 7 IV, 95. 8 ARISTOTE, Mtaphysique, M. 3, 1091 a, 17. 9 Phanias dErse dans PLUTARQUE, Dfaut des Oracles, chap. XXII et XXIII.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
44
Cette doctrine elle-mme se p.53 prsente nous sous trois aspects diffrents dont le lien napparat aucunement. En premier lieu elle dsigne une certaine relation entre les nombres et les formes gomtriques ; Pythagore reprsentait les nombres non pas par le symbolisme habituel des lettres, mais un peu de la manire dont ils sont reprsents sur nos dominos, chaque nombre tant reprsent par autant de points quil a dunits, et ces points tant rangs selon un ordre gomtrique ; do les nombres triangulaires, cest dire reprsentables par des points disposs en triangle, comme 3, 6, 10, etc., carrs, reprsents par des points disposs en carr, comme 4, 7, etc., oblongs, reprsents par des points disposs en rectangle comme 6, 12, etc. 1. Autre, aspect de la doctrine : les trois accords musicaux, quarte, quinte, octave, sont reprsents par des rapports numriques simples, savoir 2/1, 3/2, 4/3, et de plus on peut dfinir une certaine proportion, dite proportion harmonique, qui les contient tous les trois ; cest la proportion 12 : 8 : 6, o la moyenne est infrieure au plus grand extrme, dun tiers de cet extrme, et suprieure au plus petit, galement dun tiers de lui-mme 8=12-12/3=6+6/3. Enfin, troisime aspect, un symbolisme tout fait primitif, daprs lequel les nombres reprsentent lessence des choses, 7 loccasion, 4 la justice, 3 le mariage selon les plus arbitraires des analogies. En laissant de ct ce dernier aspect, do viendra larithmologie fantastique laquelle les hommes samuseront pendant des sicles, on voit comment Pythagore tait amen mettre en lumire et tudier dune part certaines sries numriques, dautre part certains rapports numriques privilgis. Sil les tudia dabord moins pour eux-mmes que pour les choses quils reprsentaient (attribuant par exemple une valeur singulire au nombre p.54 triangulaire 10, la fameuse ttractys, somme des 4 premiers nombres, par laquelle juraient les membres de la secte), il nen tait pas moins conduit reconnatre toutes sortes de nouvelles proprits arithmtiques 2. Dautre part, la dcouverte du thorme dit de Pythagore lamenait considrer quil y avait entre certaines lignes, ici entre le ct dun carr et sa diagonale un rapport qui ntait pas numriquement exprimable : la science pythagoricienne trouvait donc, ds son dbut, ses bornes. Organisation religieuse, cosmologie ionienne, mathmatisme physique, ces trois traits doivent tre complts par un autre ; cest lactivit politique de lordre. Dans quelles conditions lordre sempara du pouvoir Crotone, et quelles taient les tendances politiques des pythagoriciens, cest ce que nous ignorons compltement ; le fait seul est certain ; ce qui est galement sr, cest quun des personnages les plus nobles et les plus riches de la ville, du nom de Cylon, dirigea contre les nouveaux matres une rvolte qui russit ; on entoura et lon incendia la maison o taient runis les principaux pythagoriciens de
1 2
Cf. BURNET, Aurore de la philosophie grecque, trad. Reymond, p. 112 sq. Harmonie, dans JAMBLIQUE, Vie de Pythagore, 115, Symbolisme daprs ARISTOTE, Mtaphysique, M, 4, 1078 b, 21 ; serment pythagoricien, JAMBLIQUE, ibid., 950.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
45
Crotone ; deux seulement purent schapper ; Archippos et Lysis, qui fut ensuite Thbes le matre dpaminondas. Cest sans doute partir de cette catastrophe qui eut lieu vers le milieu du Ve sicle, que les pythagoriciens essaimrent dans la Grce continentale o nous les retrouverons 1.
IV. HRACLITE DPHSE
@ Hraclite dit lObscur et Xnophane sont les deux premiers penseurs dont nous possdions des fragments quelque peu tendus : ils nous ramnent lun et lautre vers les cits ioniennes. Hraclite tait dphse o il florissait sans doute vers la fin du p.55 VIe sicle : lIonie entire tait soumise aux Perses depuis 546, et lon peut supposer quHraclite fut tmoin de la rvolte des villes ioniennes qui toutes, lexception dphse, se runirent pour combattre la domination perse en 498 et furent trs cruellement chties par Darius ; cest au milieu de ces catastrophes civiles que vcut Hraclite et peut-tre sous ces impressions que sa pense prit cette tournure pessimiste, cet aspect distant et hautain, si caractristique, qui, se traduit en un style bref et brillant, sentencieux, plein dimages somptueuses ou familires. Son uvre, De lUnivers, crite en prose, est la premire o nous voyons nettement une vritable philosophie, cest--dire une conception du sens de la vie humaine ente sur une doctrine rflchie de lunivers. Cest peut-tre lui qui a divis son ouvrage en ces trois parties devenues traditionnelles : physique, thologique et politique 2 ; cest sous ces trois chefs que nous pouvons ranger les cent trente courts fragment qui nous restent. Par beaucoup de ses aspects, la cosmologie dHraclite est dorigine milsienne. On y retrouve ses deux thmes principaux : lexplication des astres (feux brillants) par une sorte dvaporation sche mane de la terre et celle des nuages ou vents par des vapeurs nes de la mer ; lexplication de la transmutation du feu en eau puis en terre et des transmutations inverses par la condensation et la rarfaction comme chez Anaximne 3. On y trouve aussi, nettement dgage, la pense implique par toute la doctrine milsienne, de lautonomie du monde, quaucun des dieux ni des hommes na fait 4. Mais il y ajoute des traits nouveaux, tout au moins pour nous ; cest dabord un ddain de la recherche minutieuse et exacte, de cette polymathie qui dsigne la fois lrudition dun Hsiode et dun Hcate recueillant toutes les traditions, pour
R cit dAristoxne, contemporain dAristote, dans JAMBLIQUE, Vie de Pythagore, 248-251. 2 DIOGNE LARCE, Vie des Philosophes, IX, 5. 3 AETIUS, Placita, II 17, 4 ; THOPHRASTE (DIELS, Doxographi, 475, 15 sq.) ; DIOGNE LAERCE, IX, 9. 4 Fragment 20 (daprs lordre de BYWATER).
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
46
crire p.56 pome ou histoire, et la science naissante dun Pythagore 1. De ce got pour lintuition immdiate ( les yeux tant de meilleurs tmoins que les oreilles ) 2 viennent les images de sa cosmologie qui ne dpassent pas beaucoup le mythe : les astres sont produits par laccumulation des vaporations sches dans des sortes de barques clestes, dont louverture est tourne vers nous ; les clipses ont lieu quand ces barques se retournent ; lclat et la chaleur du soleil sont expliqus par la proximit de la barque solaire avec la terre, bien quelle soit au-dessus de la rgion brumeuse o la lune perd clart et chaleur ; la cration quotidienne dun nouveau soleil, et, peut-tre, la ngation de lhmisphre sud, tout cela indique, plutt que des progrs, un singulier mpris des recherches raisonnes et une rgression vers des formes primitives de pense 3. La mditation personnelle dHraclite se dveloppe sur quatre thmes distincts dont lunit nest pas facile saisir : dabord, la guerre (Polemos) est le pre de toutes choses ; la naissance et la conservation des tres sont dues un conflit de contraires qui sopposent et se maintiennent lun lautre. Souhaiter, avec Homre, voir la discorde steindre entre les dieux et les hommes , cest demander la destruction de lunivers. Ce conflit fcond est en mme temps harmonie, non pas au sens dun rapport numrique simple comme chez les pythagoriciens, mais au sens dun ajustement de forces agissant en sens oppos, comme celles qui maintiennent bande la corde dun arc : ainsi se limitent et sunissent, harmonieux et discordants, le jour et la nuit, lhiver et lt, la vie et la mort. Tout excs dun contraire, qui dpasse la mesure assigne, est chti par la mort et la corruption ; si le soleil dpasse ses mesures et ne se couche pas lheure marque par le destin, son feu brlera toute chose. On le voit, le thme des contraires sapplique la fois aux p.57 contraires simultans qui se limitent dans lespace et aux contraires successifs, suite rgle dexcs et de manque, de satit et de famine, qui se limitent dans le temps. Leur union solidaire est maintenue par Dik, la Justice, au service de qui se trouvent les Erinyes vengeresses ; ainsi, chez Hsiode et Pindare, les Heures, filles de Thmis, taient des desses de la rgle, de la justice et de la paix (Eunomia, Dik, Eirn) 4. Le second thme hracliten, cest lunit de toutes choses ; cest l la vrit par excellence que le vulgaire, incapable de prendre garde aux choses quil rencontre, ne remarque pas lor quon ne trouve quen remuant beaucoup de terre et que la nature aime cacher, comme lApollon de Delphes rvle lavenir tout en le cachant sous des mots nigmatiques ; cest la sagesse qui nest point la vaine rudition dun Hsiode ou dun Pythagore recueillant
1 2
Fragments 16-17. Fragment 15. 3 DIOGNE LARCE, IX, 9 ; AETIUS, Placita, II, 22, 2 ; 29, 3 ; fragment 32 ; BURNET, Aurore, p. 151, note 4. 4 Voyez successivement fragments 44, 43, 45, 36, 59, 29, et H. GOMPERZ, Reihenfolge einiger Bruckstcke des Heraklits, Hermes, 1923, p. 20-56. Sur la Justice, frag. 60-61-62.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
47
toutes les lgendes, mais cette unique chose, spare de tout, qui se fie aux yeux plus quaux oreilles, lintuition plus qu la tradition, et qui consiste reconnatre lunique pense qui dirige toutes choses. Quest donc cette unit ? Est-elle lunit de la substance primordiale, telle quelle est chez les Milsiens ? Oui, en un sens : la substance primordiale est le feu, en lequel peuvent schanger toutes choses, comme toute marchandise schange contre de lor ; tout nat et progresse selon que le feu, ternellement vivant, sallume ou steint avec mesure. Mais le feu nest plus un de ces grands milieux physiques, comme ltendue marine ou latmosphre gnratrice de temptes, qui obsdaient limagination des Milsiens : cest plutt une force incessamment active, un feu toujours vivant . Le choix que fait Hraclite, appelle donc lattention moins sur la substance des choses que sur la rgle, la pense, le logos qui dtermine les mesures exactes de ses transformations 1. Le troisime thme hracliten est celui du perptuel coulement des choses. Tu ne peux pas descendre deux fois dans le mme fleuve ; car de nouvelles eaux coulent toujours sur toi. Ltre est insparable de ce continuel mouvement ; la bire se dcompose si elle nest pas remue ; on ne se repose quen changeant ; le temps dplace les choses, comme un enfant qui joue aux dames ; le jeune devient vieux ; la vie cde la place la mort, la veille au sommeil. Les choses froides deviennent chaudes ; ce qui est humide se sche 2.
p.58
Le quatrime thme est une sorte de vision ironique des contrastes, un renversement qui nous rvle dans les choses loppos de ce que nous y voyions dabord. Pour les porcs, la fange vaut plus que leau limpide, et pour les nes, la paille est suprieure lor ; lhomme le plus sage, vis--vis de Dieu, nest quun singe ; leau de la mer est la plus pure et la plus impure, salutaire aux poissons, funeste aux hommes 3. Ces thmes, certes, sont parents entre eux : les opposs ne peuvent se maintenir que grce lunit qui les enveloppe et les limite lun par lautre. Toutes les intuitions dHraclite tendent vers une doctrine unique et dune singulire profondeur ; tous ses contrastes se retrouvent dans un contraste unique : le permanent ou Un et le changeant ne sont pas exclusifs lun de lautre ; cest tout au contraire dans le changement mme, dans la discorde, mais dans un changement mesur et dans une discorde rgle que se trouvent lUn et le permanent 4. Hraclite a eu lintuition que la sagesse consiste dcouvrir la formule gnrale, le logos de ce changement. Parmi ces rgularits, une des principales concerne les changements priodiques du temps, qui ramne, aprs un cycle toujours pareil, les jours, les mois, les annes ; sinspirant de traditions fort anciennes qui remontent la civilisation
1 2
Cf. successivement frag. 1, 5 11, 16 19, 22, 20, 21. Frag. 41, 84, 83, 79, 78, 39. 3 Frag. 53, 51, 97, 99, 52. 4 Frag. 59.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
48
babylonienne, Hraclite seffora de dterminer p.59 une grande anne qui ft, la vie du monde, ce quune gnration est la vie humaine 1. La fin de cette grande anne tait marque, si lon en croit des documents postrieurs, par une conflagration universelle ou rsorption de toutes choses en feu, aprs laquelle le monde renaissait du feu ; mais peut-tre est-ce l une fausse interprtation dHraclite par les stociens ; sans doute, pour lui, tout se transforme en feu ; mais tout moment cette transformation est quilibre par une transformation inverse du feu dans les autres choses, le chemin du haut , la conflagration, est identique au chemin du bas ou extinction du feu en air ; en mme temps, il se disperse et se rassemble, il avance et se retire 2 . La sagesse dHraclite na pour le vulgaire que mpris : mpris dabord pour la religion populaire, pour la vnration des images et particulirement pour les cultes mystrieux, orphiques ou dionysiaques, avec leurs ignobles purifications par le sang, pour les traficants de mystres qui entretiennent lignorance des hommes sur lau-del ; mpris aussi de ce noble, n dune famille o le titre de roi tait hrditaire, pour lincapacit politique de la foule, qui chassait les meilleurs de la cit. Sans doute son Dieu tait-il la ralit mme du monde, qui ne veut pas et qui veut tre appel du nom de Zeus , qui est jour et nuit, hiver et t, et prend des formes varies. Lunit de Dieu, au dbut de la pense grecque, est comme un reflet de lunit du monde 3. Du succs de lhraclitisme au courant du Ve sicle et au dbut du IVe, il nous reste deux chos : dabord le trait Sur le Rgime, conserv dans la collection des uvres attribues Hippocrate, puis la peinture densemble, si palpitante de vie, que Platon fait des mobilistes de son temps dans le Cratyle et p.60 le Thtte. Le trait mdical applique la thorie de la sant la doctrine cosmologique dHraclite ; cest lharmonie du tout, cest--dire lajustement des deux forces opposes, le feu moteur et leau nourrissante, qui constitue la sant. Nous verrons dailleurs dans la suite quil nest pas une doctrine cosmologique qui ne soit en mme temps mdicale ; lide que lhomme est un microcosme est dans ce temps, une des plus banales et rpandues qui soient. Notre mdecin hracliten accumule, non sans virtuosit de style, tous les paradoxes du matre : Tout est semblable, tant dissemblable ; tout identique, tant diffrent ; tout en relation et sans relation ; tout intelligent et sans intelligence 4. Quant ceux dont nous parle Platon, cest--dire son
1 2
ATIUS, II, 32, 3. Cf. la discussion de BURNET Aurore, p. 180 ; frag. 69-40. 3 Frag., 124 130 ; 60, 110 115 ; DIOGNE LARCE, IX, 6 ; sur les rois dEphse STRABON, Gographie, XIV, 1. Certains interprtes, comme TANNERY (Pour lHistoire de la science hellne, p. 182 sq.) croient voir des croyances orphiques dans le frag. 38 et quelques autres. 4 Lorigine hraclitenne est surtout sensible au livre I, chap. III-XXIV ; Cf. BERNAYS, Gesammelte Abhandlungen I, p. 1 sq.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
49
propre matre Cratyle et ses disciples, ce sont des hraclitens exasprs qui, poussant jusquau bout le mobilisme universel, nient quil y ait rien de stable et se refusent toute discussion et mme toute parole, sous prtexte que discussions et paroles impliquent la subsistance des choses dont on discute. Lhraclitisme, en ses derniers prolongements, est donc hostile la philosophie dialectique que nous verrons se dvelopper au cours du Ve sicle 1.
V. XNOPHANE ET LES LATES
@ Ce furent sans doute les malheurs de lIonie la suite de la conqute des Perses (546) qui forcrent Xnophane de Colophon sexpatrier ; cest alors que les Ioniens, fuyant leur pays, fondrent plusieurs colonies dans la mer Tyrrhnienne, parmi lesquelles le, sur la cte lucanienne ; Xnophane tait de ces migrs quil reprsente dans un pome se rencontrant en terre lointaine et sinterrogeant mutuellement : De quel pays p.61 es-tu... et quel ge avais-tu quand le Mde arriva ? 2 . De ses lgies et de ses Satires, il nous reste assez de vers pour nous faire une ide de ses proccupations. Xnophane garde en un sens lesprit des Milsiens, expliquant les astres et le soleil par des manations ou nuages venus de lvaporation de la mer, voyant dans la terre une sorte de dpt dalluvions de la mer, et tirant une preuve de lexistence des fossiles, admettant enfin les mondes innombrables. Mais il na pas les mmes tendances scientifiques que ses prdcesseurs ; peu lui chaut de savoir la forme du monde et celle de la terre ; il admet que le soleil daujourdhui continuera indfiniment sa course en ligne droite et sera remplac demain par un autre, et que la terre stend infiniment loin sous nos pieds 3. Cest que ses proccupations sont ailleurs : chez lui se prcise une ide, dj explicite chez Hraclite, lincompatibilit de la raison humaine, mrie par la science milsienne et par lexprience, avec les images traditionnelles du mythe. Les dieux dHomre et dHsiode, engendrs comme les hommes et coupables de tous les forfaits, avec des vtements, une voix et une forme humaine sont des inventions des hommes ; un thiopien les imagine noirs ; un Thrace leur donne des yeux bleus ; des bufs ou des chevaux, sils en avaient, leur donneraient la forme de leur espce 4. Contrairement Pindare, Xnophane est non seulement le grand contempteur des mythes, mais il na que paroles de mpris contre le got de ses contemporains pour les jeux
1 2
PLATON, Ththte, 179, 180 c. Frag 22 (ordre de DIELS, Die Vorsokratiker). 3 Frag. 28 30 ; AETIUS, Placita, II, 20, 3 ; HIPPOLYTE, Rfutation, I, 14, 5. 4 Frag. 10 16.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
50
olympiques 1. Mais ces ngations il joint, dune manire prudente il est vrai, et sans prtendre atteindre la certitude, une thorie positive du dieu unique, qui nest point semblable aux hommes, puisqu il voit et pense tout entier, et que, tout entier, il entend , et puisque, compltement immobile, il gouverne toutes choses par la puissance intelligente de sa p.62 pense 2. Il semble bien que cet tre un, intelligent et immobile est une divinisation de la nature ; avec Xnophane et Hraclite, nous sommes au moment o la physique ionienne donne naissance une thologie tout oppose celles des mythes, o Dieu prend quelque chose de limpersonnalit, de limmobilit et de lintelligibilit dune loi naturelle. De bien autre porte est luvre de Parmnide. Citoyen dle, colonie ionienne fonde en Italie, sur la mer Tyrrhnienne vers 540, il florissait dans cette ville vers 475 et il lui donna des lois. Nous connaissons le nom de deux pythagoriciens, Aminias et Diochts, dont il fut le disciple 3. Cest l un tout autre milieu intellectuel que lIonie ; la forme littraire mme est nouvelle ; Parmnide est le premier crire une uvre philosophique en vers ; nous en avons le dbut qui est solennel comme le rcit dune initiation religieuse : le pote se voit conduit sur un char par les filles du Soleil, jusquaux portes du jour, que garde la Justice vengeresse ; la Justice, supplie par ses guides, lui ouvre les portes ; il entre et reoit de la desse les paroles de vrit 4. Rcit probablement imit de quelque livre des morts orphique et bien loign, avec sa machinerie fantastique, de la simplicit de la prose ionienne et aussi des images si ralistes dHraclite. Le peu que nous savons de sa cosmologie trahit aussi un esprit tout nouveau ; sil est vrai quil a enseign la sphricit de la terre et lidentit de ltoile du soir avec ltoile du matin 5, cest une preuve quil possdait du monde une image gomtrique prcise, bien loigne du ciel que les Ioniens imaginaient sur le modle des mtores. De fait, ce sont les thses fondamentales de la cosmologie ionienne, surtout sous la forme que lui avait donne Hraclite, qui sont ruines fond par la doctrine de Parmnide ; elles ne sen relveront pas. La naissance et le devenir des choses, p.63 leur sparation et leur runion alternes, leurs oppositions, leurs divisions, leurs altrations, voil tout ce quHraclite prtendait emprunter lexprience directe, et tout ce que Parmnide nie au nom du raisonnement. A la voie de lopinion, qui, sous la conduite des sens et des habitudes de langage, mne la cosmologie ionienne, il oppose la voie de la vrit, qui conduit une tout autre conception du rel. La nouveaut de la pense de Parmnide est dans cette mthode rationnelle et critique qui est le point de dpart de toute la dialectique philosophique en Grce. Du rel, ds
1 2
Frag. 2. Frag. 35, 23 a 26 3 DIOGNE LARCE, Vie des Philosophes, IX, 23, 21. 4 Frag. 1 (daprs lordre de DIELS, Die Vorsokratiker). 5 DIOGNE LARCE, ibid.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
51
quon y pense, on doit dire : il est, on ne peut dire : il nest pas ; car on ne peut ni connatre, ni exprimer ce qui nest pas. Or, cest ce que font les Ioniens, en admettant une substance primordiale qui, tout la fois, est et nest pas ce qui en drive, est la mme que ses produits sans tre la mme. Cest ce quils font en admettant la naissance des choses, la physis, qui fait crotre les tres ; car de ce qui nest pas ne peut venir ce qui est. Impossible que les choses se dissipent et se divisent ; car ce qui est na pas de degrs et ne peut tre moins en une place quen une autre ; on ne peut les concevoir mobiles, puisquil ny a ni naissance ni corruption ; enfin la substance infinie des Ioniens est absurde, puisque, linfini, il manque tout pour tre pleinement 1. Au monde ionien, Parmnide substitue la seule ralit qui puisse tre pense ; une sphre parfaite et, limite, galement pesante partir du centre dans toutes les directions, satisfait seule aux conditions de ce qui est : elle est incre, indestructible, continue, immobile et finie. Ce qui est nest donc point pour Parmnide une notion abstraite, ce nest pas non plus une image sensible : cest, si lon peut dire, une image gomtrique, ne au contact de la science pythagoricienne. Dautre part, la sphre de Parmnide prend pour elle le caractre divin quavait lordre du monde chez Hraclite ; ces divinits miabstraites, p.64 Justice, Ncessit, Destin qui, chez les Ioniens, dirigeaient le cours rgulier des choses, sont invoques par Parmnide pour garantir la complte immobilit de sa sphre 2. Telle est la voie de la vrit ; est-ce dire que lon ne doit pas suivre la voie de lopinion ? Nullement, condition que lon sache bien quil sagisse dopinions humaines. Aussi sa philosophie, Parmnide a-t-il superpos une cosmologie ; mais elle ne parat pas vouloir faire autre chose que recueillir les opinions traditionnelles sur la naissance et la destruction des choses. Elle est par l desprit diffrent de la cosmologie ionienne ; car elle admet en elle des mythes thogoniques comme ceux dHsiode et des Orphiques ; elle considre, par exemple, lamour comme le premier dieu 3. Dautre part, elle nadmet point au principe une substance primordiale, mais bien un couple de deux termes opposs, le Jour et la Nuit, ou, encore la Lumire et lObscurit 4 ; ces termes rappellent la fantaisie hsiodique plus que le positivisme ionien ; quant au couple dopposs, cest un trait de pense tout fait pythagoricien. Enfin, nouvelle marque de lesprit religieux et traditionnel, le ciel est chez lui, comme il le sera dans certains mythes de Platon, le lieu de passage des mes, o sige la Ncessit, Anangk, qui leur distribue leurs lots 5. Il faut ajouter, il est vrai, que dans lexplication de dtail, Parmnide est tributaire des Ioniens : la structure de son ciel, compos de couronnes
1 2
Frag. 5, 6, 8. Frag. 8. 3 PLATON, Banquet, 195c ; frag. 13. 4 Frag. 8 et 9. 5 ATIUS, Placita, II, 7, 2, (DIELS, Doxographi, 335, 15), condition dadmettre la leon des manuscrits .
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
52
concentriques, au centre desquelles se trouve la terre, rappelle les anneaux dAnaximandre ; il y a une couronne de feu pur ou de lumire ; cest la plus loigne qui touche aux extrmits du monde ; les autres couronnes, intermdiaires, sont mlanges dobscurit et de lumire ; les astres en sont les parties lumineuses 1. Avec Parmnide, nous voyons se dessiner, deux courants p.65 opposs dans la pense grecque : dune part le positivisme ionien, intuitif, exprimental, ignorant la mathmatique physique, ennemi dclar des mythes, des traditions religieuses et des nouveaux cultes dinitiation, pour cette raison peu populaire et peu dispos ltre ; dautre part le rationalisme de Parmnide et de Pythagore, cherchant construire le rel par la pense, tendant vers la dialectique, peu sympathique lexprience directe, et, pour cette raison, ds quil sagit des choses sensibles, ami des mythes, dispos faire une grande place au problme de la destine, naturellement populaire et ayant le got de la propagande. La solidarit intime du rationalisme avec limagination mythique contre le positivisme semble tre le trait saillant de cette priode. De la pense de Parmnide, son disciple Znon dle qui fleurit vers le milieu du Ve sicle dveloppa dabord laspect critique. Aristote fait de lui le fondateur de la dialectique 2, cest--dire de lart de prouver en partant des principes admis par son interlocuteur ; sil na pas crit lui-mme de dialogues, il tait sur la voie qui menait cette nouvelle forme littraire. Platon nous dit quil tablissait la thse de Parmnide, lexistence de lUn immobile, en montrant les absurdits qui rsultaient de la thse contraire 3. Il est remarquer que par la thse contraire, Znon nentend pas du tout les doctrines cosmologiques ioniennes vises par Parmnide, mais bien la thse pythagoricienne que les choses sont nombres, cest--dire faites dunits discrtes, telles que des points. Le contraste chez Znon est entre deux reprsentations qui visent lune et lautre la rationalit, entre la continuit de la sphre parmnidienne et la discontinuit du monde pythagoricien. Cette discontinuit est absurde ; en effet, composer le multiple dunits sans grandeur ou de points, cest le composer de riens ; mais donner chaque unit une grandeur, cest dire quelle nest pas lunit, p.66 puisquelle est alors compose. De plus, comment, si le point, ajout une grandeur, ne la rend pas plus grande, pourrait-il tre le composant de cette grandeur ? Enfin, supposer une grandeur faite de points, il y aura entre deux de ces points une grandeur qui devra tre faite dautres points, et ainsi linfini 4. Ajoutons les clbres arguments par lesquels Znon dmontre limpossibilit du mouvement, dans lhypothse o une grandeur est faite de points : largument du coureur : il est impossible que le coureur arrive au bout du stade puisquil
1 2
ATIUS, ibid. Daprs DIOGNE LARCE, Vie des Philosophes, VIII, 57. 3 Parmnide, 128 a b. 4 Frag. 1 3 (dans DIELS, Die Vorsokratiker).
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
53
doit franchir une infinit de points. Achille et la tortue : Achille poursuivant la tortue ne la rattrape pas, puisquil doit dabord atteindre la place do la tortue est partie, puis en repartir pour atteindre la place o elle est actuellement, et ainsi linfini, sil est vrai que la distance entre lui et la tortue sera toujours compose dune infinit de points. Argument de la flche : chaque moment du temps, la flche qui vole occupe un espace gal elle-mme ; elle est donc chaque instant en repos, si lon suppose que le temps est compos de moments indivisibles. Argument du stade : si deux coureurs se meuvent avec une rapidit gale en sens oppos et se rencontrent en passant devant un objet immobile, ils se mouvront, lun par rapport lautre, deux fois plus vite que par rapport lobjet ; or, supposer que les corps soient composs de points et que lintervalle dun point un autre soit franchi en un instant indivisible, il sensuivra que pour le coureur linstant ncessaire pour passer dun point de lobjet immobile au point suivant sera moiti de linstant ncessaire pour passer dun point de lautre coureur au point suivant 1. En dfinitive, cest donc bien la sphre continue de Parmnide que Znon dfend contre les pythagoriciens., Chez Mlissos de Samos, disciple de Parmnide, dune dizaine dannes plus jeune que Znon, le conflit avec la physique ionienne p.67 revient, au contraire, au premier plan. Vu son origine (Mlissos est le gnral samien qui mit mal la flotte de Pricls en 440) 2 il na d connatre la doctrine late quaprs la philosophie ionienne. Ainsi sexpliquerait que, sil donne au rel les proprits de la sphre parmnidienne, unit, ternit, continuit et plnitude, il garde quelque chose du ionisme en la faisant infinie en grandeur. De plus, il insiste avec beaucoup de force sur linsuffisance de la connaissance sensible ; si, en effet, nous affirmons avec vrit quune chose est chaude, il faudra taxer derreur la sensation qui nous montre une chose chaude devenant froide, cest--dire toutes les observations sur lesquelles se fondait limage du changement dans la physique ionienne 3.
VI. EMPDOCLE dAGRIGENTE
@ Malgr lattitude hostile de Parmnide, la spculation physique reprend avec vigueur au milieu du Ve sicle ; cest lpoque dEmpdocle dAgrigente, dAnaxagore de Clazomnes, des jeunes pythagoriciens, et la fin du sicle, du grand Dmocrite dAbdre.
1 2
ARISTOTE, Physique, VI, 9, 239 b 8 aq. PLUTARQUE, Vie de Pricls, 26. 3 Infinit, frag. 3 6 (daprs lordre de DIELS, Die Vorsokratiker) ; contre la connaissance sensible, frag. 8.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
54
Mais un trait entirement nouveau est commun toutes ces doctrines : il ny a pas de transformation, de naissance vritable 1, car rien ne vient de rien ; il y a seulement des combinaisons diverses dun nombre immense de trs petits corpuscules, dont chacun est immuable et dou de proprits tout fait permanentes. Autant de manires dimaginer ces corpuscules et les modes de leur union et de leur sparation, autant de cosmologies diffrentes. En un pome charg dimages, Empdocle expose la doctrine des quatre, lments ou plutt racines des choses : le feu, p.68 lair, leau et la terre ; ils sont au monde comme les couleurs dont se sert le peintre ou comme leau et la farine avec laquelle on fait la pte ; tout vient de leur runion, de leur sparation, de leurs divers dosages ; mais nul dentre eux nest premier ; galement ternels, ils ne proviennent pas lun de lautre 2. Cette doctrine reconnat pour la premire fois lexistence et lindpendance de lair atmosphrique. Empdocle prouve cette existence par lexprience dune clepsydre que lon plonge dans leau en bouchant lorifice suprieur avec le doigt ; lair contenu dans lappareil rsiste lentre de leau par les orifices infrieurs 3. Tout changement a lieu soit par combinaison, soit par dissociation des lments : donc deux puissances actives, lune qui les runit quand ils sont spars, cest lAmiti, lautre qui les spare quand ils sont runis, cest la Haine. LAmiti et la Haine acquirent alternativement la prpondrance lune sur lautre : si nous partons de ltat o tout est uni par lAmiti, du sphaeros (analogue la sphre de Parmnide), la Haine sintroduit peu peu, chasse graduellement lAmiti jusqu ce que les choses soient dans ltat de complte sparation, o lAmiti a compltement disparu ; puis, par un mouvement inverse, lAmiti rentrant graduellement dans le monde en fait sortir la Haine et ramne au sphaeros do lon tait parti. Il y a donc, ternellement alternants, deux cours du monde inverses lun de lautre : celui qui va du mlange la dispersion, celui qui va de la dispersion au mlange, ordre inluctable, parce que la Haine et lAmiti se sont engages par serment se cder alternativement la prpondrance 4. Notre monde actuel 5 est celui o la Haine progresse ; du sphaeros se sont spars dabord lair qui lentoure comme une atmosphre, puis le feu, qui sest port la plus grande hauteur, puis la terre, et de la terre a jailli leau ; dans un des hmisphres clestes le feu est prpondrant et p.69 il produit la lumire du jour ; dans lhmisphre nocturne, il ny a au milieu dune masse dair obscur que des traces de feu 6. Le soleil et la lune ne sont pas au reste des masses ignes. Empdocle sait que la lune ne fait que reflter la lumire du soleil et il connat la vritable cause des clipses et la nature de la nuit qui nest que lombre de la terre ; la lune,
1 2
EMPDOCLE, frag. 8 (ordre de DIELS, Die Vorsokratiker). Frag. 6, 8, 9, 25, 33, 34, 17. 3 Frag. 100. 4 Frag. 16, 17, 26 ; sur la sphre, 27, 28. 5 Comme le montre BURNET, Aurore, p. 267. 6 ATIUS Placita, II, 6 3 ; PLUTARQUE, Strom. (DIELS, Doxographi, 582).
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
55
masse dair condense, renvoie la lumire comme les miroirs de verre qui commencent se rpandre en Grce au Ve sicle 1. Empdocle applique, dune manire dailleurs obscure, cette thorie spectaculaire au soleil ; le soleil est un reflet de lhmisphre ign sur le ciel 2. La gnration actuelle des animaux par lunion des sexes qui a succd un tat primitif dandrogynie est un autre tmoignage du progrs de la Haine 3. A ce tableau de notre monde, Empdocle oppose une esquisse, dailleurs vague, du monde o progresse lAmour, et de la gnration de cratures nouvelles par lunion ; cette phase se rapporte la description de ces membres solitaires errants qui cherchent sunir, ttes sans cou et bras sans paules, et dont lunion donne dabord naissance aux monstres les plus tranges, bufs face dhommes ou hommes ttes de bufs 4. Le physique dEmpdocle est, par ailleurs, riche en explications physiologiques de dtail ; la doctrine des quatre lments donne naissance une cole mdicale, connue par le nom de Philistion ; les proprits de ces lments, le chaud du feu, le froid de lair, lhumidit de leau, le sec de la terre sont considres comme les forces actives dont une certaine combinaison dans lorganisme produit la sant, le degr dintelligence et les divers tempraments ou caractres 5. Une thorie importante, dont on voit mal le lien avec le reste est celle de la perception p.70 extrieure ; des effluves manent des tres et viennent rencontrer des pores placs dans les organes des sens ; sil y a la correspondance convenable, leffluve y pntre et la perception se produit. La vision (ide que Platon reprendra dans le Time) est produite par la rencontre entre leffluve qui vient de la lumire extrieure et le rayon ign qui mane du feu contenu dans lil 6. Empdocle nest pas seulement un physicien ; il se donne aux Agrigentins comme un prophte inspir qui, couronn de bandelettes, sait les gurir et leur enseigne lorigine et la destine de lme et les purifications ncessaires. Empdocle est de la ligne des orphiques et des pythagoriciens. Il croit la transmigration des mes en des corps danimaux, et fonde sur cette croyance le prcepte de labstinence de la chair. Il sait que lme est un dmon, et que la suite de ses vies mortelles est une expiation qui doit durer trente mille ans, pour un crime, meurtre ou parjure, quelle a commis ; la terre est la caverne, le pays sans joie o sont la mort et la colre 7. On ne voit pas trs bien le lien de cet enseignement religieux avec la cosmologie ; ne doit-on pas remarquer
1 2
Frag. 45 48 ; cf. KAFKA, Zur Physik des Empedokles, Philologus, vol. 78, p. 283. PLUTARQUE, ibid. 3 ATIUS, Placita, V, 19, 5 ; cf. BIGNONE, Empedocle, p. 570. 4 Frag. 35, 61. 5 GALIEN, uvres, d. Kuhn, X, p. 5 ; fragments de Philistion dans WELLMANN Fragmentsammlung der griechischen Aerzte, vol., I, 1901. 6 THOPHRASTE, De sensibus, 12 (DIELS, Dox., 502.) 7 Frag. 112 148 que lon rapporte un pome diffrent du premier et intitul Purifications,
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
56
cependant le rapport quil y a entre le pessimisme dEmpdocle et sa croyance que la phase actuelle de lhistoire du monde est domine par la Haine ?
VII. ANAXAGORE DE CLAZOMNES
@ Avec Anaxagore de Clazomnes nous quittons de nouveau la GrandeGrce, avec ses prophtes et ses initis, pour revenir linspiration positive des Ioniens. vnement capital : cet Ionien, dun pays o staient conserves, nous ignorons comment, les traditions milsiennes, vint rsider Athnes, la florissante Athnes daprs les guerres mdiques, la capitale du p.71 nouvel empire maritime ; il y sjourna trente ans, et il y fut lami de Pricls 1, le matre du jour. Malgr cet appui, le vieil esprit athnien, si bien reprsent par les Nues dAristophane, ne saccommodait pas de ces Ioniens, qui niaient la divinit des choses clestes et enseignaient que le soleil tait une pierre incandescente et la lune une terre. Il fut accus dimpit et chass dAthnes 2. Mais son influence resta vivante, comme en tmoigne Platon. Anaxagore donne une solution nouvelle au conflit de Parmnide avec lesprit ionien. Il reste attach au principe maintenant dominant quil ny a ni gnration ni corruption ; rien ne nat ou nest dtruit, mais il y a mlange et sparation des choses qui sont 3. Mais il sagit dexpliquer le changement, et comment une chose peut venir dune autre. Anaxagore sent trs vivement, comme tous les Ioniens, linfinie diversit des choses ; il y a beaucoup de choses et de toutes sortes : os, chair, etc., dont chacune a des proprits irrductibles ; son point de vue est, au moins implicitement, oppos celui dEmpdocle ; celui-ci expliquait les choses par la combinaison et le dosage de quatre qualits lmentaires ; Anaxagore pense au contraire, que los, la chair, le cheveu sont comme tels des qualits indcomposables. Dautre part, nous voyons les choses venir les unes des autres, le cheveu de ce qui nest pas cheveu, la chair de ce qui nest pas chair. Comment est-ce possible sil ny a pas rellement naissance ? Cest que le produit existait dj dans le producteur. La production nest alors que sparation ; dun tat o les choses sont mlanges et o, cause de ce mlange, on ne peut les distinguer les unes des autres, on passe un tat o elles se sparent. Bien plus qu lart du peintre qui combine, la nature serait comparable lart du mtallurgiste qui extrait le fer du minerai. Mais les transformations p.72 des choses sont infinies, nulle chose ne cesse de donner naissance dautres ; il faut donc que chaque chose contienne, en elle, mlanges et invisibles cause de leur mlange, les semences de toutes choses ; les choses ne sont pas coupes les unes des
1 2
PLATON, Phdre, 270 a. PLATON, Apologie de Socrate, 26 d ; DIOGNE LARCE, II, 12, 14 ; cf. Nues, 364-380 o la thorie dAnaxagore est mise dans la bouche de Socrate. 3 Frag. 17 (daprs lordre de DIELS, Die Vorsokratiker).
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
57
autres avec une hache, ni le chaud du froid, ni le froid du chaud 1 . Les choses sont dnommes daprs la qualit qui prdomine en elles ; mais linfinit des autres qualits y est prsente quoique indistincte ; donc la sparation, qui est en voie de se faire, nest jamais accomplie, et elle est mme toujours aussi loin de ltre ; cest un mouvement qui na pas de terme. Ce sont ces semences de toutes choses dont chacune contient une infinit, quAristote a appeles, dun nom devenu traditionnel, les homomries ou parties homognes 2 ; mais il faut bien remarquer quelles ne sont pas des parties composantes des choses, en nombre limit ; Anaxagore ne peut en effet admettre linfinit du mouvement de division que parce quil admet corrlativement linfinie divisibilit et, avec elle, dans un corps limit, une infinit dhomomries qui laissera indfiniment possible le processus de sparation 3. Ds lors on peut traduire en nouveau langage les vieilles cosmogonies milsiennes. LInfini dAnaximandre devient le mlange infiniment grand o toutes choses sont ensemble et ne peuvent tre distingues cause de leur petitesse 4. La cosmogonie sera lhistoire du processus continu de sparation, par lequel les parties du monde sisolent les unes des autres, dune part le dense et lhumide, le froid et le sombre qui se runissent vers le centre, tandis que le rare et le chaud se portent vers la rgion extrieure 5. Mais Anaxagore sest pos dautres questions : et dabord dans cet infini parfaitement homogne, quelle pouvait tre lorigine du mouvement ? Elle ne peut tre p.73 que dans une ralit extrieure et suprieure au mlange, tout comme, chez Empdocle, elle est extrieure aux lments. Cette cause sans mlange, simple, existant par soi, qui est principe de lordonnance du monde est lIntellingence (Nous). Par quel mcanisme agit le Nous ? Anaxagore, sous limpression des changements produits par les rvolutions clestes, admet que la premire cause qui spare les choses les unes des autres est un mouvement circulaire ou tourbillon ; il imagine donc le Nous anim dabord lui-mme dun mouvement circulaire, puis produisant dans un espace limit un petit tourbillon, qui stend peu peu autour de son centre, se propageant travers lespace infini. La sparation des choses est produite, dune manire difficile saisir, par laction mcanique de ce tourbillon ; les astres par exemple viennent de ce que lther arrache des pierres la terre et les enflamme par la rapidit de son mouvement. Le mme procs peut dailleurs se produire en dinnombrables points de lespace illimit, et il faut accepter, selon lenseignement milsien, une infinit de mondes 6.
1 2
Frag., 8 ; cf. 10, 11. ARISTOTE, De la gnration, I, 1, 314 a 18. 3 Frag. 3 et 7. 4 Frag. 1. 5 Frag. 15. 6 Frag. 12 16 ; Frag. 4 (Cf., BURNET, Aurore, p. 310).
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
58
La biologie dAnaxagore na point de liaison sensible avec sa cosmologie ; il soutenait sans doute que tous les tres vivants, y compris les plantes, avaient en eux un fragment de lintelligence universelle 1. Il enseignait que la sensation se fait par les contraires ; cest dans la pupille, parfaitement obscure, que peut apparatre une image lumineuse ; cest ce qui est plus chaud ou plus froid que nous qui nous rchauffe ou nous refroidit ; et cest pourquoi toute sensation implique peine, parce que la peine est le contact du dissemblable 2.
VIII. LES MDECINS DU Ve SICLE
@ Aprs Anaxagore, au cours du Ve sicle, lesprit ionien gagne du terrain, mais sans avoir de reprsentants remarquables ; p.74 les physiciens sont raills par les comiques, Hippon par Cratinos 3, Diogne dApollonie par Aristophane ; et Platon dans le Cratyle (409 b) parle des anaxagoriens. On voit revivre toutes les vieilles thses milsiennes ; Hippon prend pour principe leau ; Diogne dApollonie lair ; Archlaos dAthnes admettait avec Anaxagore le Nous et le mlange primordial. Mais ces auteurs sintressent en gnral moins la cosmologie qu la physiologie et la mdecine 4. Nous possdons, sous le nom dHippocrate, n Cos en 450, une srie de quarante et un traits mdicaux qui nous montrent limmense importance qua eue la mdecine dans la vie intellectuelle des Grecs vers la fin du Ve sicle. Tous les auteurs sont dtachs des vieilles superstitions, et lon connat le magnifique dbut du trait de lpilepsie. Je pense que lpilepsie, appele aussi maladie sacre, na rien de plus divin et nest pas plus sacre que les autres ; les hommes lui donnrent dabord une origine et des causes divines par ignorance. Pourtant il nat entre eux un important conflit de mthode, concernant les rapports de la mdecine avec la cosmologie philosophique. Les uns, comme lauteur du trait Sur lancienne mdecine craignent avant tout pour leur art le dogmatisme et lincertitude de la physique. ; il ne convient pas davoir recours de vaines hypothses, comme celle du froid et du chaud, du sec et de lhumide comme causes de la maladie et de la sant ; de pareilles suppositions sont bonnes quand on veut traiter des mouvements clestes, dont on ne peut rien dire dassur ; la vritable mdecine est autonome, et elle a dcouvert par lobservation, sans le secours de ces hypothses, une infinit de choses dont elle est sre. A cette mthode empirique sopposent les mdecins physiologistes dont Platon a si parfaitement dfini le point de vue dans un passage de Phdre (270c). Il nest pas possible, pense p.75 Platon, de
1 2
Frag. 11 ; ARISTOTE, De plantis, I, 1. THEOPHRASTE, De sensibus, 27 (DIELS, Doxographi, p. 507). 3 Scholie Nues, 94. 4 HIppon, dans lHIPPOLYTE, Rfutation, I, 16, 1 ; Diogne dans THEOPHRASTE (DIELS, Dorographi, 477, 5) ; Archelas dans lHIPPOLYTE, 1, 9.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
59
comprendre la nature de lme sans celle de lunivers, et, sil faut en croire Hippocrate, lon ne peut mme pas, sans cette mthode, parler du corps ; il faut examiner propos de chaque tre sil est simple ou compos, et, au cas o il est compos, faire le dnombrement de ses parties et examiner propos de chacune delles les actions et passions qui lui appartiennent.
IX. LES PYTHAGORICIENS DU Ve SICLE
@ Les pythagoriciens de la mme poque se partagent aussi : les acousmatiques forment un ordre purement religieux o la pratique et la croyance restent le principal, tandis que les mathmaticiens 1 cherchent seulement le dveloppement scientifique des mathmatiques, de lastronomie, de la musique, cest--dire des sciences qui vont tre considres par Platon comme le point de dpart de la philosophie ; ils forment le groupe trs mal connu dont le chef parat avoir t Philolas, et qui comprend Cbs et Simmias, que Platon nous reprsente dans le Phdon conversant avec Socrate, Archytas de Tarente, chef politique de son pays, qui fut lami de Platon et le roi philosophe selon son got, Time de Locres, par qui Platon fait exposer sa propre physique : de ce milieu intellectuel o sesquissent les dogmes du platonisme, il est bien impossible de faire une histoire prcise. Nous navons pour tout document certain, part les fragments de Philolas dont lauthenticit est conteste 2, que les textes o Aristote expose les doctrines des pythagoriciens, sans prciser davantage. Un trait doit en tre retenu, cest leur mancipation peu prs complte de la cosmogonie ionienne ; dire en effet, comme ils le font, que les choses sont faites de nombres, cela ne peut avoir le mme sens que de p.76 dire quelles sont faites de feu ou dair. De quelque manire quon imagine ces nombres, comme des ranges de points ou comme des grandeurs 3, ils ne sont point comme le feu ou lair, des substances capables de se transformer en dautres, ils supposent un ordre fixe et permanent. Do le caractre de leur cosmologie qui ne comporte point de cosmogonie la manire ionienne, mais, se contentant de dcrire un ordre, un cosmos, tend devenir, au lieu dune physique, une pure astronomie mathmatique. Dans leur systme du monde, le centre est occup par un feu autour duquel gravitent une premire plante appele lantiterre, puis la terre qui passe au rang de plante, puis le soleil, les cinq plantes et les toiles fixes ; de ce systme, rien nindique quils aient cherch lorigine ; bien plus la place quils assignent la terre exclut compltement les ides des Ioniens qui, ayant lesprit plus ou moins hant par lassimilation des phnomnes clestes aux phnomnes mtorologiques, supposent
1 2
JAMBLIQUE, Vie de Pythagore, 81, implique que la scission est postrieure Pythagore. BURNET, Aurore, p. 324. 3 Comparer ARISTOTE, Mtaphysique M. 6, 1080 b 18 et 1083 b 8.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
60
invinciblement par l mme la terre immobile au dessous de la vote nuageuse. Quant limagination de ces ralits astronomiques inaccessibles lobservation, lantiterre et le feu central qui claire lhmisphre terrestre que nous nhabitons pas, lune, le feu central, na aucun caractre cosmogonique, mais est destine donner de la lumire solaire une explication dj rencontre chez Empdocle, lautre, lantiterre, expliquer les clipses par linterposition de ce corps opaque entre le feu central et la lune ou le soleil 1. Ce pythagorisme nouveau parat donc tre, en un sens, une vritable libration de la physique dynamique et qualitative des Ioniens, qui donnait, avec les derniers anaxagorens et hraclitens, des marques dpuisement. Il dut y avoir, vers cette poque, une floraison dhypothses sur lordre et les mouvements des corps clestes, mais il ne nous en reste que des traces ; une dentre elles est peut-tre celle du pythagoricien p.77 Hictas, qui explique le mouvement diurne par la rotation de la terre sur son axe ; nous le connaissons par un passage de Cicron qui, bien des sicles plus tard, frappa lattention de Copernic 2.
X. LEUCIPPE ET DMOCRITE
@ Pourtant, la mme poque, lesprit ionien reprenait une vigueur singulire, mais dans une tout autre direction. Leucippe de Milet, qui reut le lenseignement de Znon, fut linitiateur du mouvement que continua Dmocrite dAbdre, n vers 460 et qui fonda son cole Abdre vers 420. Avec celui-ci, qui est dune dizaine dannes plus jeune que Socrate et qui mourut g, se dveloppe une physique encyclopdique, qui a le got des trs vastes collections dobservations zoologiques et botaniques. Personne, disait-il de lui-mme, na voyag plus que moi, vu plus de pays et de climats, entendu plus de discours dhommes instruits. Lon a conserv les titres dune cinquantaine de traits sur les sujets les plus divers : morale, cosmologie, psychologie, mdecine, botanique, zoologie, mathmatiques, musique, technologie, rien ne lui chapp ; de son uvre vaste comme celle dAristote et qui, par son ambition duniversalit, porte bien le cachet de lpoque des sophistes laquelle elle appartient, il ne reste que quelques fragments 3. Dans son dessin gnral, la cosmogonie de Leucippe quon ne peut distinguer de celle que Dmocrite exposait dans ses deux Diacosmoi ou Systmes du Monde, est fidle au schme milsien : une masse infinie o
1 2
ARISTOTE, Du ciel, II, 13 ; AETIUS, Placita, II, 20, 12. Thophraste dans CICRON, Premiers Acadmiques, 39 ; ajouter les considrations sur lharmonie des sphres, cest--dire des sons produits par les toiles dans leur course ; ARISTOTE, ibid., II, 9. 3 DIOGNE LARCE, Vie des Philosophes, IX, 47.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
61
sera puise la matire de mondes innombrables qui se produisent successivement ou simultanment ; pour quun monde se forme, il suffit quun fragment se dtache de cette masse et quil soit anim dun mouvement p.78 tourbillonnaire ; la distinction et la disposition des parties du monde sont, comme chez Anaxagore, les effets ncessaires du mouvement tourbillonnaire 1. Certains dtails du monde de Dmocrite ont mme, pour la fin du Ve sicle, un caractre franchement archaque tout comme Anaximandre, il donne la terre la forme dun tambourin ou dun disque 2. Mais dans ce moule archaque, il introduit une nouveaut considrable, cest la doctrine des atomes ; la physique dmocritenne est la premire physique corpusculaire bien nette : la masse infinie o se trouvent mlanges les semences de tous les mondes est faite dune infinit de petits corpuscules, invisibles cause de leur petitesse, indivisibles (atomes), compltement pleins, ternels, gardant chacun la mme forme, mais prsentant une infinit de formes diffrentes, qui il donne le nom dides, celui mme que Platon donnera plus tard des essences galement ternelles ; entre les atomes, nulle autre diffrence que leur grandeur et leur forme, ou bien, sils ont mme grandeur et mme forme, que leur position ; entre plusieurs combinaisons des mmes atomes, nulle diffrence que lordre relatif des atomes 3. Dautre part, lorigine dun monde, savoir le dtachement dune portion de la masse infinie, suppose un vide dans lequel tombe cette portion ; sans vide, pas de mouvement ; et par vide il faut entendre lespace entirement priv de solidit, ce qui nest pas par opposition ce qui est ; affirmer le vide, cest donc affirmer la ncessit dexistence de ce qui nest pas, cest contredire le grand principe de Parmnide 4. Lamas datomes est, nous lavons dit, anim dun mouvement tourbillonnaire dont lorigine est dailleurs obscure ; leffet de ce mouvement est de produire de multiples chocs entre les atomes de tout poids. Comme il arrive dans un tourbillon de vent ou deau, les atomes les plus lgers sont repousss vers le vide extrieur, tandis que p.79 les atomes compacts se runissent au centre o ils font un premier groupement sphrique ; dans cette sphre se distingueront peu peu une enveloppe sphrique qui devient de plus en plus mince, et un noyau central qui sagrge en partie les atomes enlevs la membrane ; dans la membrane se forment les corps clestes aux dpens des atomes extrieurs qui touchent le tourbillon et sy agrgent 5. Ainsi, pour la premire fois dans une cosmologie grecque, nul appel nest fait des puissances qualitatives telles que le froid et le chaud ; nul
1 2
Ibid., IX, 31-33. AETIUS, Placita, III, 10, 4-5. 3 ARISTOTE, Mtaphysique A 4, 985 b, 15. 4 THEOPHRASTE (DIELS, Doxograph., 484), 1-3. 5 DIOGNE LARCE, IX, 31.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
62
appel non plus des causes motrices extrieures aux ralits lmentaires telles que lIntelligence, lAmiti ou la Haine. Rien quune mcanique corpusculaire o jouent seules un rle les proprits de figure, dimpntrabilit, de mouvement, de position. La vraie ralit appartient latome et au vide ; les autres proprits que nous donnons aux choses, sueur, chaleur ou couleur, leur appartiennent simplement par convention 1 ; elles sont de simples affections de la sensation, qui naissent dans laltration de lorgane par lobjet, comme dans la doctrine que Platon prte au sophiste Protagoras dAbdre et selon laquelle la qualit perue est le rsultat du concours de deux mouvements ; cest bien ainsi que Dmocrite concevait la vision : lair plac dans lintervalle de lil et de lobjet vu se contracte sous la double influence des effluves qui manent de chacun des deux ; lair est ainsi apte recevoir limpression quil transmet jusqu la pupille o a lieu le reflet de lobjet 2. Ainsi, en mme temps quune physique mcaniste, nat tout naturellement le scepticisme lgard des sens ; la connaissance quils nous donnent est une connaissance btarde ; la connaissance lgitime vient de la raison. La mobilit dpend donc non pas dune puissance qualitative quelconque, mais de la forme ou de la dimension des p.80 atomes ; cest pourquoi la physique corpusculaire contient une thorie de lme ; lme tant mobile et cause de mouvement est faite datomes sphriques comme ceux du feu ou comme les poussires que lon voit voltiger en un rayon de soleil ; ses atomes qui sont en nombre gal ceux du corps et se juxtaposent eux en alternant un un avec eux, sont continuellement rnovs par la respiration 3. De luvre de Dmocrite, nous entrevoyons peine les principes ; il faut pourtant, daprs lensemble de ses traits, comme daprs les tmoignages anciens, le considrer moins comme un thoricien que comme un observateur. Aristote nous fait connatre, non sans intention critique, que Dmocrite se contente de recueillir les faits qui se produisent et de noter, quand il y a lieu, leur constance sans vouloir dterminer plus avant leur principe ; collectionnant et classant les faits naturels avec la mme curiosit et dans le mme esprit que les historiens ioniens du Ve sicle, Hcate de Milet ou Hrodote, recueillent les faits de lhistoire 4. A cette science desprit si positif, Dmocrite ajoutait une morale qui, compltement trangre au sens tragique de la vie et de la destine qui se manifeste chez les potes philosophes de la Grande-Grce, a pour thme principal le calme dune me exempte de crainte et de superstition. Dmocrite
1 2
SEXTUS EMPIRICUS, Contre les mathmaticiens, VII, 135. PLATON, Thtte, 52, compar THEOPHRASTE, Dessens, 63, (RIVAUD, Le Problme du devenir, 1905, p. 160). 3 ARISTOTE, De lme, I, 2, 404 a.5 ; LUCRCE, De la nature, I, 370 [370]. 4 ARISTOTE, Physique, VIII, 1.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
63
admet lexistence des dieux, mais ce sont, au mme titre que les hommes, des combinaisons datomes passagres et soumises la ncessit universelle 1.
XI. LES SOPHISTES
@
Les derniers philosophes dont nous avons parl vivent au milieu de lextraordinaire effervescence spirituelle qui marque p.81 la fin des guerres mdiques (449) ; la Grce est soustraite au danger barbare ; lempire maritime athnien comprend une partie des les de lge et la vieille terre de civilisation quest lIonie : Pricls (mort en 429) introduit Athnes la constitution dmocratique. branlement moral trs profond, qui se traduit sur le thtre : tandis quEschyle (mort en 456) reprsentait sur la scne les dangers de la dmesure et les crimes qui consistent dpasser les limites marques par la justice divine, Euripide (mort vers 411) ne cesse pas de marquer le caractre humain, provisoire, conventionnel des rgles de la justice. Dautre part, la comdie attique, dfendant les vieilles traditions, raille, parce quelle les craint, les ides nouvelles quintroduisent la science ionienne et aussi lenseignement des sophistes. La sophistique, qui caractrise les cinquante dernires annes du Ve sicle, ne dsigne pas une doctrine, mais une manire denseigner. Les sophistes sont des professeurs qui vont de ville en ville chercher leur auditoire et qui, pour un prix convenu, apprennent leurs lves, soit en des leons dapparat, soit en une srie de cours, les mthodes pour faire triompher une thse quelle quelle soit. A la recherche et la publication de la vrit est substitue la recherche du succs, fond sur lart de convaincre, de persuader, de sduire. Cest lpoque o la vie intellectuelle, dont le centre passe en Grce continentale, prend la forme dun concours ou dun jeu, cette forme agonistique, si familire la vie grecque ; il ne sagit que de thses dfendues ou combattues par des concurrents auxquels un juge souverain, qui est souvent le public, dcerne le prix. Tel est le dbat quAristophane nous montre slevant entre la thse juste et la thse injuste. Qui es-tu ? demande le juste. Une thse. Oui, mais infrieure la mienne. Tu prtends mtre suprieur et je tiens la victoire. Quelle habilet as-tu donc ? Jinvente des raisons nouvelles. Tel le dbat sur lidal de vie quEuripide dpeint dans lAntiope entre lami des muses et lhomme politique. Platon nous montre, par p.82 contraste, Socrate se drobant ces concours ; cest, dans le Protagoras, Hippias essayant vainement dinstituer un dbat de ce genre entre Socrate et Protagoras ; cest, dans le Gorgias, Callicls, qui, aprs avoir prononc un discours en faveur de la justice naturelle, se plaint que Socrate contrevienne aux rgles
1
DIOGNE LARCE, IX, 45 ; CICRON ; De la nature des Dieux, I, 2a ; fragments trs contests des ouvrages moraux dans STOBE, Florilge.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
64
du jeu en ne lui rpondant pas par un autre discours 1. Il y a l une proccupation de lauditoire que nous connaissions peine jusquici. Le philosophe ne rvle plus la vrit, il la propose et se soumet davance au verdict de lauditeur. Cest un trait qui devient permanent : la suite de lpoque des sophistes, on prend tche de dfinir le philosophe par rapport lorateur, au politique, au sophiste, cest--dire tous ceux qui sadressent un public 2. Dans ces conditions la principale valeur intellectuelle est lrudition qui met lhomme en possession de toutes les connaissances utiles son objet, et la virtuosit qui lui permet de choisir ses thmes avec propos et de les prsenter dune manire captivante. De l, les deux caractres essentiels des sophistes : dune part ce sont des techniciens qui se vantent de connatre et denseigner tous les arts utiles lhomme ; dautre part, des matres de rhtorique qui enseignent capter la bienveillance de lauditeur. Au premier gard, la sophistique peut passer pour la premire affirmation consciente delle-mme de la supriorit de la vie sociale, fonde sur les techniques, depuis les plus humbles mtiers jusqu lart le plus lev que les sophistes se vantent denseigner, savoir la vertu politique 3. Cest la marque commune de quatre grands sophistes, qui nous sont surtout connus par les portraits quen fit Platon la gnration suivante : Protagoras dAbdre, qui florissait vers 440 et qui scandalisa les Athniens par son indiffrence en matire de religion ; p.83 Gorgias de Lontium, qui fut en 427 ambassadeur de sa cit Athnes et mourut presque centenaire vers 380, et dont les lves athniens ne sont pas des philosophes, mais des crivains comme Isocrate, Thucydide, enfin Prodicus de Cos et Hippias dElis. De cet humanisme, qui attend tout de lart et de la culture, fait foi le fameux dbut du trait de Protagoras : Lhomme est la mesure de toutes choses, de ce quelles sont pour celles qui sont, de ce quelles ne sont pas, pour celles qui ne sont pas. Cest au surplus des seules choses humaines que lhomme doit soccuper. Quant aux dieux, je ne puis savoir ni quils sont, ni quils ne sont pas ; trop dobstacles sy opposent, obscurit du sujet et brivet de la vie 4. Il y a l tout un programme qui aspire une culture humaine et rationnelle ; on cherche lhomme en gnral ; cest Hippias qui, daprs Platon, considre tous les hommes comme des parents, des proches, des concitoyens selon la nature, sinon selon la loi 5 . Cest Protagoras qui, dans un mythe clbre, raconte comment Zeus a sauv
1
ARISTOPHANE, Nues (de lanne 423), v. 887 sq. ; EURIPIDE, fragm. 189, d. Nauck ; DIOGNE LARCE, IX, 52 [timon], attribue Protagoras linstitution des joutes de discours ; PLATON, Protagoras, 338 a [conjure] ; Gorgias, 497 bc. 2 Par exemple chez ARISTOTE, Problmes, 30, 9 et 11. 3 Comparer PLATON, Hippias, II, 368 b-d et Protagoras, 318 d, 319 e [politique]. 4 DIOGNE LARCE, IX, 51 [mesure]. 5 Protagoras, 337 c [XXIV.].
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
65
lhumanit qui allait prir faute de moyens naturels de dfense, en donnant tous les hommes la justice et la pudeur, vertus naturelles et innes, qui leur permettent de fonder des cits et de perptuer leur race en saidant les uns les autres : magnifique loge de la vie sociale 1. Le sophiste est toujours prt dfendre les arts ; tel Hippias se vantant, chez Platon, dtre, grce eux, indpendant, puisquil sait mme fabriquer tous les habits quil porte. Telle surtout lanonyme Apologie de la Mdecine, dans la collection des uvres dHippocrate ; elle montre, contre leurs dtracteurs, lutilit des mdecins et elle dbute par ces mots si caractristiques de lesprit de progrs du temps ; Bien des gens sexercent dcrier les arts... Mais le vrai but dun bon esprit, cest ou de trouver des choses p.84 nouvelles ou de perfectionner celles quon a dj inventes 2. Dans ce milieu, les questions morales devaient se poser : Prodicus de Cos, en particulier, parat tre le moraliste du groupe : sous son nom, Xnophon expose le fameux apologue dHercule, choisissant entre le vice et la vertu, auquel les beaux esprits du temps opposaient, pour le dfendre, Pris prfrant la desse Aphrodite Athn et Hra. Ces thmes moraux, comme le thme pessimiste du caractre passager des biens de la vie humaine, devaient tre le sujet de vritables prdications qui continueront par la suite 3. Mais cest dans la politique que les sophistes affirmaient surtout le pouvoir et lautonomie de lhomme : la loi est une invention humaine, et en une certaine mesure, artificielle et arbitraire ; cest ce que montre par le fait luvre des lgislateurs du temps qui, soit Athnes, soit dans les colonies, reprennent chaque instant pied duvre le travail de la constitution : Protagoras donne des lois Thurioi, comme Parmnide lavait fait le. La loi soppose donc, comme une uvre artificielle, la nature. Il y a bien, il est vrai, des lois non crites, des coutumes traditionnelles qui ont une valeur religieuse ; mais elles ne psent point ct de luvre rflchie du lgislateur. Tel est le pont de vue dAntiphon le sophiste, dont les fragments ont t rcemment dcouverts ; il ne se fait pas faute dopposer la justice artificielle des lois la justice naturelle ; par exemple la loi, en obligeant lhomme tmoigner la vrit devant les tribunaux, nous oblige souvent faire tort qui ne nous en a fait aucun, cest--dire contredire le premier pr-
PLATON, Protagoras, 320 c-323 a [XI.]; cf. larticle de Nasru, Philologues, vol, 70. p. 26-28. 2 Cf. Gonnets, Die Apologie der Heilkunet, 1910. 3 Comparer XENOPHON, Mmorables, II, 1, 21, sq, et pseudo-ARISTOTE, loges dHlne, chap. XX, o est soutenue aussi la supriorit de Thse, le hros athnien sur Hercule GOMPERZ (Les Penseurs de la Grce, t. 1, p. 458) lui attribue la paternit des discours pessimistes de pseudo-PLATON, Axiochos.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
66
cepte de la justice : mais en ce caractre conventionnel des lois, Antiphon semble voir une supriorit 1. Ce mouvement dides, dont on sent toute limportance, a eu une assez triste issue, il aboutit au dbut du IVe sicle, dune part au cynisme politique, dautre part la pure virtuosit. Dune part le cynisme politique des aristocrates athniens, Critias et Alcibiade, qui sexprime si souvent dans lHistoire de la guerre du Ploponse de Thucydide 2, et que Platon a immortalis dans le Callicls du Gorgias : cest la dpravation politique et morale dun Callicls pour qui le pouvoir nest plus quun moyen de satisfaire ses apptits, quaboutit lenseignement de la rhtorique par Gorgias. Lautre issue, cest la pure virtuosit, celle que lon trouvait dj dans le trait de Gorgias sur le non-tre, o se servant des moyens dialectiques de llatisme, il dmontre quil ny a rien, ou que si quelque chose existe, cest inconnaissable, ou que, si cest connaissable, cest impossible transmettre aux autres 3. Virtuosit qui se marque par limportance que lon attribue au bien dire, lenseignement rhtorique de Gorgias, les travaux de grammaire gnrale de Protagoras, les recherches de Prodicus sur les synonymes. Virtuosit qui trouve ses ressources dargumentation dans de petites uvres comme les Doubles discours qui rsument schmatiquement la double thse contraire que lon peut avoir soutenir sur des questions morales ; virtuosit qui a enfin sa dernire manifestation dans lart de dispute ou ristique, dont Platon sest si cruellement moqu dans lEuthydme : lristique a des moyens trs faciles de venir bout de son adversaire par deux ou trois principes fort simples tels que : lerreur est impossible, et : toute rfutation est impossible 4.
p.85
Tels taient, malgr les talents suprieurs des sophistes, les p.86 rsultats dune conception de la vie intellectuelle uniquement dirige par le succs. Pourtant de ce mouvement pas plus que des prcdents, rien de positif nest perdu : naturalisme ionien, rationalisme de la Grande-Grce, esprit religieux dEmpdocle et des Pythagoriciens, humanisme des Sophistes, nous allons voir tous ces traits sunir chez le plus prestigieux de philosophes grecs, chez Platon. Bibliographie
1
Sur la loi non crite, cf. SOPHOCLE, Antigone, v. 450-455 ; fragm. dAntiphon dans Oxyrinchus Papyri, tomes XI et XV. (A. CROISET, Revue des tudes grecques, 1917), 2 En particulier III, 83, 1 ; cf. Gorgias, 482c sq. et les citations dun sophiste anonyme dans JAMBLIQUE, Pratreptique, ch. xx. 3 Sur le trait de Gorgias, cf. pseudo-ARISTOTE, Sur Gorgias, Xnophane et Mlissos, fin ; sur Protagoras, ARISTOTE, Rhtorique, III, 5 ; sur Prodicus, PLATON, Protagoras, 337 bc [XXIII]. 4 Cf. sur les rapports de la sophistique et de lristique, pseudo-ISOCRATE, loge dHlne, introduction.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
67
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
68
CHAPITRE II SOCRATE
@
Le sicle qui a prcd la mort dAlexandre (323) est le grand sicle de la philosophie grecque ; cest en mme temps surtout le sicle dAthnes : avec Socrate et Platon, avec Dmocrite et Aristote, nous atteignons un moment dapoge, o la philosophie, sre delle-mme et de ses mthodes, prtend appuyer sur la raison mme son droit tre luniverselle conductrice des hommes : cest lpoque de la fondation des premiers instituts philosophiques qui sont lAcadmie et le Lyce. Mais dans le mme sicle les sciences mathmatiques et lastronomie prennent aussi une extraordinaire extension. Enfin, le brillant dveloppement des systmes de Platon et dAristote ne doit pas nous dissimuler lexistence dcoles issues de Socrate, trangres ou hostiles au mouvement platonico-aristotlicien ; elles prparent les doctrines qui domineront partir de la mort dAlexandre et qui feront ngliger pour longtemps Platon et Aristote.
p.88
Au mois de fvrier de lanne 399, Socrate, g de 71 ans, mourait, condamn par ses concitoyens ; devant le tribunal dmocratique, il avait t accus dtre un impie qui nhonorait pas les dieux de la cit et introduisait de nouvelles divinits et de corrompre la jeunesse par son enseignement 1. Cet homme extraordinaire ntait pas, comme les sages dont nous avons p.89 parl jusquici, un chef dcole ; les coles qui se rclameront de Socrate sont nombreuses et sur bien des points opposes lune lautre ; elles nont en commun nulle tradition doctrinale. Nous natteignons donc Socrate ni directement puisquil na rien crit, ni par une tradition unique, mais travers des traditions multiples qui nous en donnent autant de portraits diffrents. Ajoutons que ces portraits nont nullement lintention dtre fidles ; le plus ancien de tous, celui des Nues dAristophane (en 423, Socrate a alors 47 ans), o Socrate est mis en scne, est une satire. Puis vient, aprs sa mort, toute la littrature des Discours socratiques, dialogues o des disciples donnent leur matre le premier rle ; ces dialogues constituent un genre littraire qui ne se targue nullement dexactitude : au premier rang, les uvres socratiques de Platon, dabord les dialogues apologtiques, crits sous le coup de lindignation de suite aprs la mort de son matre (Apologie, Criton), puis les portraits idaliss (Phdon, Banquet, Thtte, Parmnide), enfin les uvres o Socrate nest plus que le porte-parole de la doctrine de lAcadmie. Au
1
Sur la date du procs, article de PRAECHTER, Hermes, 1904, p. 473 ; sur les chefs daccusation, PLATON, Apologie, 24bc [24b] ; Euthyphron, 2d-3b [2d] ; XNOPHON, Mmorables, I, 1.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
69
second rang, les Mmorables de Xnophon, crits assez tardivement (vers 370), sorte dapologie, o lauteur, qui nest rien moins que philosophe, sous couleur de reproduire les entretiens du matre, donne une assez plate imitation de discours socratiques antrieurs. Il faut y ajouter les titres et trs minces fragments qui restent des dialogues de Phdon et dEschine, quelques donnes dAristote ; enfin une tradition hostile Socrate qui persiste jusqu la fin de lantiquit, chez Porphyre (IIIe sicle), chez le rhteur Libanius (IVe sicle), se fait jour chez les picuriens et se rat-tache au pamphlet crit par Polycrate en 390 1. Certes, tous saccordent sur ltranget et loriginalit de ce sage ; le fils du tailleur de pierres et de la sage-femme Phnarte, qui, vtu dun manteau grossier, parcourait les rues pieds p.90 nus, qui sabstenait de vin et de toute chre dlicate, dun temprament extraordinairement robuste, lhomme lextrieur vulgaire, au nez camus et la figure de silne 2, ne ressemblait gure aux sophistes richement habills qui attiraient les Athniens ni aux sages dautrefois, qui taient en gnral des hommes importants dans leur cit : type nouveau, et qui va devenir le modle constant dans lavenir dune sagesse toute personnelle qui ne doit rien aux circonstances : non pas homme politique, mais seulement excellent citoyen toujours prt obir aux lois, quil sagisse de tenir son poste au combat de Potide, ou de lutter, dans la magistrature o le sort la appel, contre les fantaisies illgales du tyran Critias, ou enfin de refuser, par respect pour les lois de son pays, lvasion que Criton lui propose pour chapper la mort aprs sa condamnation 3. Ni sophiste, ni politique, il na en effet, dans les conversations de hasard quil tient dans les boutiques du march 4 et dans les stades comme dans les maisons de riches, nulle doctrine, nulle lgislation proposer. Cest quil a, avant tout, la volont nette de faire chapper son enseignement la forme agonistique ; il na pas de thses faire juger, il prtend seulement faire en sorte que chacun devienne son propre juge. Dans les dialogues de Platon, Socrate est presque toujours le trouble fte qui ne veut pas se plier aux rgles du jeu et qui le fait cesser. Choisissez, conseille Callias Socrate et Protagoras qui refusent de discuter plus longtemps, choisissez un arbitre, un pistate, un prytane ; Socrate rpond plaisamment quil serait malsant de choisir un arbitre, puisque ce serait faire injure Protagoras . (338b). Mais la vrit est que son but est dexaminer des thses, de les passer lpreuve et non de les faire triompher. Le scnario de la troisime partie du Gorgias est cet gard caractristique : p.91 le discours de Callicls contre la philosophie est
1
Sur Polycrate, DIOGNE LARCE, II, 38 ; hostilit chez picure (CICRON, Brutus, 85), PORPHYRE, Histoire des Philosophes, Fragm. 8 et 9, d. Nauck, PHILOD., De vitiis. 2 DIOGNE LARCE, II, 18 ; le comique Ameipsias dans Diogne, II, 28 ; ARISTOPHANE, Nues, 410-417 ; PLATON, Banquet, 215a sq., Criton. 3 PLATON, Apologie 28 1 ; 32c ; DIOGNE LARCE, II, 24 ; PLATON. 4 Un dialogue socratique de Phdon porte le nom du cordonnier Simon (Diogne II, 105).
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
70
une sorte de morceau de concours ; Platon la assez fait voir en rappelant plusieurs reprises lAntiope dEuripide, pice dans laquelle deux frres soutenaient alternativement, dans une de ces joutes dont le tragique est coutumier, la supriorit de la vie pratique et celle de la vie consacre aux muses ; comme le second des frres, Socrate aurait d, en rponse Callicls, prononcer une apologie de la philosophie ; rien de pareil ; il nnonce lui-mme aucune opinion, mais force Callicls, par ses questions, sexaminer lui-mme. En dfinitive, la philosophie (et peut-tre est-ce ce qui la rendait suspecte, ou tout au moins trange aux yeux dun Athnien du Ve sicle), cest ce qui ne peut prendre la forme agonistique et ce qui, par consquent, se soustrait au jugement de la foule. Avant denseigner les autres, il a d sduquer lui-mme ; nous ne savons rien de cette formation personnelle ; le Socrate des Nues (423) est un homme dge mr, et il avait dpass la soixantaine quand Platon la connu ; du moins, un prcieux document nous rvle en Socrate un homme de passion violente ; cest le tmoignage de son contemporain Spintharos, dont le fils Aristoxne a rdig les souvenirs sur Socrate : Nul ntait plus persuasif grce sa parole, au caractre qui paraissait sur sa physionomie, et, pour tout dire, tout ce que sa personne avait de particulier, mais seulement tant quil ntait pas en colre ; lorsque cette passion le brlait, sa laideur tait pouvantable ; nul mot, nul acte dont il sabstnt alors. Sa matrise de soi est donc une victoire continuelle sur lui-mme 1. Cette pousse intrieure quil contient est sans doute la raison du pouvoir fascinant quil exerce sur toutes les natures ardentes, sur celle dun Alcibiade 2 comme sur celle de Platon. Le temprament de Socrate est trop riche pour quil se borne une pure rforme intrieure et pour quil naspire pas rpandre p.92 sa sagesse autour de lui ; ce nest pas dans la solitude quil veut vivre, cest avec les hommes et pour les hommes, qui il veut communiquer le bien le plus prcieux quil a acquis, la matrise de soi. Cette force intrieure qui le pousse vers les autres, Socrate la sent comme une mission divine. Il faut insister sur ce caractre religieux : le point de dpart de son activit Athnes nest-il pas la rponse de la Pythie de Delphes son enthousiaste ami Chrphon qui il fut rvl que personne ntait plus sage que Socrate ? Cest Apollon qui lui avait assign pour tche de vivre en philosophant, en se scrutant lui-mme et les autres 3 ; rien dexceptionnel dailleurs, en ce temps, linterprtation que Socrate donne de ses propres tendances ; il ne manquait pas dhommes, comme les Euthyphron dont parle Platon, qui se croyaient en rapport spcial avec le divin 4 ; et Socrate en particulier semble avoir prouv en lui-mme la prsence divine par le
1 2
Daprs PORPHYRE, Histoire des Philosophes, p. 213, d. Nauck. Cf. Banquet, 215. 3 PLATON, Apologie, 21a ; 28 e. 4 PLATON, Euthyphron, 3 bc.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
71
fameux dmon, ou plutt ce signe dmoniaque, cette voix intrieure qui, dans les cas o la sagesse humaine est impuissante prvoir lavenir, lui rvlait les actes dont il faut sabstenir 1. Toutefois, sur cet aspect religieux de la pense de Socrate, il faut bien sentendre : la religion lui donne foi et confiance en lui-mme, mais il nen tire aucune vue doctrinale sur la destine humaine, et il ny a aucune raison de croire quil ait t adepte de lorphisme. Quenseignait-il ? A en croire Xnophon et Aristote, Socrate serait avant tout linventeur de la science morale et linitiateur de la philosophie des concepts. Socrate, dit Aristote, traite des vertus thiques, et leur propos, il cherche dfinir universellement... ; il cherche ce que sont les choses. Cest quil essayait de faire des syllogismes ; et le principe des syllogismes, cest ce que sont les choses... Ce que lon a raison dattribuer p.93 Socrate, cest la fois les raisonnements inductifs et les dfinitions universelles qui sont, les uns et les autres, au dbut de la science. Mais pour Socrate les universaux et les dfinitions ne sont point des tre spars ; ce sont les platoniciens qui les sparrent et ils leur donnrent le nom dides 2 . Donc, selon Aristote, Socrate comprit que les conditions de la science morale taient dans ltablissement mthodique par voie inductive de concepts universels, tels que celui de la justice ou du courage. Cette interprtation dAristote qui na dautre but que de rapporter Socrate linitiative de la doctrine idaliste qui, par Platon, continue jusqu lui, est videmment inexacte ; si son but avait t de dfinir des vertus, il faudrait admettre que, dans les dialogues o Platon montre Socrate cherchant sans aboutir ce quest le courage (Lachs), la pit (Euthyphron) ou la temprance (Charmide), il a pris tche dinsister sur lchec de la mthode de son matre. Est-ce bien ce thoricien des concepts qui dirait de lui-mme quil est attach aux Athniens par la volont des dieux pour les stimuler comme un taon stimulerait un cheval , et quil ne cesse de les exhorter, de les morigner, en les obsdant partout du matin jusquau soir 3 ? Lenseignement de Socrate consiste en effet examiner et prouver non point les concepts, mais les hommes eux-mmes et les amener se rendre compte de ce quils sont : Charmide, par exemple, est, dans lopinion de tous, le modle dun adolescent rserv ; mais il ignore ce que cest que la rserve ou la temprance, et Socrate conduit linterrogatoire de manire lui montrer quil ignore ce quil est lui-mme ; de mme Lachs et Nicias sont deux braves qui ignorent ce quest le courage ; le saint et pieux Euthyphron, interrog de toutes les manires, ne peut arriver dire ce quest la pit. Ainsi toute la mthode de Socrate consiste faire que les hommes se connaissent eux-mmes ; son ironie consiste p.94 leur montrer que la tche est difficile et quils croient tort se connatre eux-mmes ; enfin sa doctrine,
1
PLATON, Euthyphron, 3 b ; Alcibiade, 103 105e ; XNOPHON, Mmorables I, 2-4 (le dmon signe divinatoire). 2 Mtaphysique, M, 4, 1078 b, 17 ; comparer XNOPHON, Mmorables, IV, 6. 3 PLATON, Apologie, 30e.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
72
sil en est une, que cette tche est ncessaire, car nul nest mchant volontairement et tout mal drive dune ignorance de soi qui se prend pour une science. La seule science que revendique Socrate, cest de savoir quil ne sait rien 1. Un pareil entretien transforme lauditeur ; le contact de Socrate est comme celui de la torpille ; il paralyse et dconcerte ; il amne regarder en soimme, donner son attention une direction inhabituelle 2 : les passionns, comme Alcibiade, savent bien quils trouveront auprs de lui tout le bien dont ils sont capables, mais le fuient parce quils craignent cette influence puissante qui les amne se rprimander eux-mmes. Leffet de lexamen que Socrate force son auditeur faire, cest en effet de lui faire perdre sa fausse tranquillit, de le mettre en dsaccord avec lui-mme et de lui proposer comme un bien de retrouver cet accord. Socrate na donc pas dautre art que la maeutique, lart daccoucher de sa mre Phnarte ; il tire des mes ce quelles ont en elles, sans aucune prtention y introduire un bien dont elles ne porteraient pas les germes 3. De ltendue des sujets de ses entretiens nous ne pouvons nullement nous faire une ide ; il ny a aucune raison de croire que Socrate nait pas t un homme cultiv, capable de sintresser aux sciences et aux arts ; vrai dire, tout lui tait bon pour prouver les hommes, depuis les discussions esthtiques sur lexpression dans les arts jusquau choix par le sort des magistrats, loccasion duquel il dmontrait labsurdit du rgime dmocratique dAthnes 4. Il faut faire attention toutefois que, contrairement la critique des sophistes, celle de Socrate ne porte ni sur les lois, ni sur les usages religieux, mais seulement sur p.95 les hommes et sur les qualits humaines ; autant il est conservateur en ses ides politiques, autant il est libre lgard de ceux quil veut rformer et qui il montre leur ignorance. Cest sans doute cette extrme libert qui le perdit ; le gouvernement tyrannique de Critias lui avait dj interdit la parole, ce fut la dmocratie qui lui ta la vie. Bibliographie
@
1 2
PLATON, Apologie 21b [21b], 23b. PLATON, Mnon, 79e sq. 3 PLATON, Thtte, 148e sq. 4 XNOPHON, Mmorables, III, 10.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
73
CHAPITRE III PLATON ET LACADMIE
@ Platon est n Athnes en 427, dune famille aristocratique qui comptait des personnages considrables dans la cit, entre autres le cousin de sa mre, Critias, qui fut un des trente tyrans. Ses annes de jeunesse scoulrent au milieu des troubles politiques les plus graves ; la guerre du Ploponse finit en 404 par lcrasement dAthnes, dont lempire maritime est dtruit pour toujours ; lintrieur de la cit, cest le jeu de bascule entre la dmocratie et une tyrannie oligarchique ; la dmocratie est renverse en mars 411 par loligarchie des Quatre-Cents, qui ne dure que quelques mois ; en 404, les Lacdmoniens forcent les Athniens adopter le gouvernement oligarchique des trente tyrans ; ces tyrans, dont le chef tait Critias, taient systmatiquement hostiles la marine et au commerce athniens ; ils tombrent en septembre 403 pour tre remplacs par le gouvernement dmocratique qui devait condamner Socrate. Luvre de Platon porte la marque de ces vnements : instabilit politique des gouvernements, danger dun imprialisme fond sur le commerce maritime, tels sont les thmes constants de ses uvres politiques ; aussi hostile la tyrannie dun Critias qu la dmocratie de Pricls, il devait chercher ailleurs que dans le milieu athnien la possibilit dun renouveau politique La mort de Socrate dut tre une raison dfinitive du pessimisme politique qui se fait jour dans le Gorgias (515e).
p.96
Cest neuf ans aprs cette mort quil entreprit son premier p.97 grand voyage (390-388), qui le conduisit dabord en gypte, dont il na cess dadmirer la vnrable antiquit et la parfaite stabilit politique, puis Cyrne, o il fit connaissance du gomtre Thodore, enfin en Grande-Grce o il rencontra les pythagoriciens, et en Sicile o il visita pour la premire fois le tyran Denys de Syracuse et se lia damiti avec son neveu Dion. Cest en revenant quil fonda son cole ; il acheta prs du village de Colone un fonds de terre appel Acadmie, sur lequel il tablit un sanctuaire des Muses ; ce fonds devint la proprit collective de lcole ou association religieuse qui clbrait annuellement la fte des Muses ; elle le garda jusqu lpoque de Justinien (529). En quoi consistait lenseignement de Platon ? Cest ce quil est difficile de savoir, parce que la plupart de ses uvres, destines un large public, nen doivent pas tre le reflet ; il faut en excepter pourtant ces sortes dexercices logiques que sont la seconde partie du Parmnide et les dbuts du Thtte et du Sophiste ; si lon fait attention que ces exercices sont destins prouver la vigueur logique de ltudiant, que, en outre, Platon considre linfluence de la parole vivante comme bien suprieure celle de lcrit
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
74
(Phdre), enfin que la parole, tel que lentend un socratique, est moins expos suivi que discussion, nous pouvons sans doute conclure que lexpos doctrinal ne doit pas y avoir eu la place quil a prise chez Aristote. Il fit en Sicile, en 366, sur des instances de Dion, un second voyage ; Dion esprait quil pourrait gagner ses ides Denys le Jeune qui venait de succder Denys lAncien ; mais son arrive, Dion tait disgraci et exil, et Platon fut plutt, durant un an, le prisonnier que lhte du tyran. En 361, sur les instances de Denys, nouveau voyage Syracuse aussi infructueux que les deux premiers : reu magnifiquement, choy comme ami du pythagoricien Archytas, tyran de Tarente, il ne put rconcilier Dion avec son cousin ; les dix dernires annes de sa vie furent assombries par la conspiration de Dion contre Denys p.98 (357) ; la tentative choua, et lami de Platon prit, tragiquement victime dun complot (353). Cest aux lettres de Platon que lon doit quelques renseignements sur ses voyages en Sicile ; aucun document de ce genre ne parle des rapports quil eut sans doute avec les conseillers politiques athniens de son temps, notamment avec Isocrate, qui, lui aussi, prtendait tre un philosophe, qui opposait son Busiris au pamphlet de Polycrats contre Socrate, mais qui critiquait assez violemment certains socratiques, comme le cynique Antisthnes. Or Platon, dans le Phdre (278e-279b), a manifest publiquement sa sympathie pour ce rhteur qui, comme lui, avait t compagnon de Socrate ; il pense quil y a en lui un philosophe ; Isocrate, esprit sage, ami dune dmocratie modre, ennemi de lutopie politique, avait au fond le mme but que Platon, la dfense de lhellnisme contre le danger barbare 1. Platon meurt en 348, pendant la guerre que Philippe avait entreprise contre les Athniens et qui devait aboutir la dcadence politique dfinitive de la cit grecque. Dans sa longue carrire, Platon a publi un trs grand nombre de dialogues, tous conservs, dont la chronologie peut tre ainsi restitue : 1 Dialogues prcdant ou suivant immdiatement la mort de Socrate : Protagoras, Ion, Apologie de Socrate, Criton, Euthyphron, Charmide, Lachs. Lysis, Rpublique, livre I (ou Thrasymaque), Hippias, I et II ; 2 Dialogue prcdant la fondation de lacadmie : Gorgias ; 3 Dialogues-programmes suivant de peu la fondation de lcole : Mnon, Mnexne, Euthydme, Rpublique, livres II X ; 4 Dialogues contenant le portrait idalis de Socrate : Phdon, Banquet, Phdre ; 5 Dialogues introduisant une nouvelle conception de la science et de la dialectique : Cratyle, Thtte, Parmnide, p.99 Sophiste, Politique (Le
G. MATHIEU, Les Ides politiques dIsocrate, Paris, 1925, p.177-181.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
75
Sophiste et le Politique devaient tre suivis du Philosophe, qui est rest en projet) ; 6 Derniers dialogues : Time, Critias (inachev), qui devait tre suivi de lHermocrate, Lois (uvre inacheve publie aprs la mort de Platon, et qui prsente en beaucoup dendroits laspect dun recueil de notes), pinomis. Il faut ajouter les noms des dialogues rejets par la critique moderne : Alcibiade, I et II, Les Rivaux, Thags, Clitophon, Minos. Enfin, les treize Lettres conserves sous le nom de Platon, dont lauthenticit a t attaque, au point quelles ont t considres comme des morceaux dexercice de rhteurs athniens, sont aujourdhui reconnues authentiques pour la plupart, notamment la longue lettre VII, adresse aux amis de Dion et remplie de dtails sur les rapports de Denys et de Platon.
I. PLATON ET LE PLATONISME
@
Ds lpoque qui a suivi immdiatement Platon, il y a eu dsaccord sur la signification de ses dialogues. De lantiquit jusqu nos jours, on voit se rclamer de lui des doctrines divergentes ; lpoque de Cicron, par exemple, les uns rattachaient au nom de Platon un dogmatisme analogue celui des stociens, les autres voyaient en lui un partisan du doute et de la suspension du jugement. Un peu plus tard, partir du 1er sicle, les mystiques et les rnovateurs du pythagorisme semparent du nom et des crits de Platon, et le platonisme devient synonyme dune doctrine irrationaliste qui lve lme au-dessus de la pense et de ltre et lunit un Bien qui est aim et got plutt que connu. En revanche, nous voyons au XIXe sicle se dessiner une tendance, encore trs forte maintenant, faire de Platon un pur rationaliste qui identifie la ralit vritable lobjet de lintelligence et enseigne dterminer cet objet p.100 par une discussion raisonne, dont le type est emprunt aux mathmatiques 1. Une pareille divergence entre les interprtes sexplique non seulement par la richesse exceptionnelle de sa pense, dont il est peut-tre impossible et, en tout cas, trs difficile de saisir densemble tous les aspects, mais par la forme littraire quelle revt. Insistons dabord sur ce second point. Le dialogue platonicien na rien de ces traits didactiques, dont les philosophes ioniens et les mdecins de la collection hippocratique donnaient dj le modle. Dans les uvres de vieillesse seulement, on voit quelque chose de semblable : toutes les considrations physiologiques de la fin du Time et une bonne partie des Lois sont de simples exposs ; mais ce sont des uvres auxquelles Platon na pas donn, sauf en certaines parties, leur forme dfinitive. Sauf ces
1
CICRON, Derniers acadmiques, I, 15-18 ; APULE, Du Dieu de Socrate ; NATORP, Platos Ideenlehre, 1903.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
76
exceptions, les uvres de Platon ont un aspect qui les classe tout fait part ; car, si, dans les coles socratiques, peu prs contemporaines de Platon, on crit des dialogues, cette forme dexposition a t presque compltement abandonne de lantiquit, malgr les quelques exemples sporadiques quon en peut donner, comme ceux de Cicron ou de Plutarque ; il est particulirement significatif que les no-platoniciens de la fin de lantiquit nimitent jamais les procds littraires du matre et sefforcent par tous les moyens de retrouver dans le dialogue la substance dogmatique, et il est dautant plus important de chercher apprcier la forme littraire de la pense platonicienne, dans la mesure o elle intresse linterprtation de sa philosophie.
II. LA FORME LITTRAIRE
@ Le dialogue platonicien offre, mlangs divers degrs, trois aspects : il est un drame, il est la plupart du temps une discussion, il contient quelquefois un expos suivi. Dabord un drame : tantt, le lieu, lpoque et les circonstances sont marqus avec prcision, comme dans le Protagoras (309 a-310 a) ; le dialogue est lui-mme souvent, comme dans le Banquet (172-174), insr dans un rcit ; tantt, au contraire, et cela est plus frquent, mesure que Platon avance, le dialogue dbute ex abrupto 1. Il est des dialogues dont laspect dramatique est particulirement visible par la vie des caractres et par les pripties qui tiennent le lecteur en haleine ; il en est dautres do la vie dramatique a peu prs disparu, bien quil ny en ait aucun, mme les plus arides, le Philbe ou le Sophiste par exemple, qui ne renferme quelques traits dhumour et de satire 2. Les personnages, cest dabord Socrate, puis ceux avec qui Socrate a t en relation, sophistes ou philosophes trangers, jeunes gens des nobles familles dAthnes, hommes politiques de la ville, en tout cas, comme dans les comdies dAristophane, des personnages connus de tous, dont plusieurs sont encore vivants, dont beaucoup ont des liens de parent avec Platon. Cest seulement dans ses dialogues de vieillesse que sintroduisent des personnages fictifs et peu vivants, comme ltranger du Sophiste et des Lois, ou Philbe.
p.101
On sait avec quelle prdilection il a dpeint Socrate, le Socrate du Protagoras, encore jeune et sans autorit au milieu des sophistes riches et rputs, le Socrate ayant pleine conscience de sa mission morale et sociale dans lApologie, celui qui inquite la conscience dAlcibiade (Banquet) et qui, dvoilant Mnon son ignorance, lengourdit comme ferait une torpille,
1 2
Dans le Thtte (143 b), il fait mme la critique du premier procd. Philbe, 15 e sq. ; Sophiste, 241 d.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
77
l accoucheur des esprits du Thtte, enfin le dfenseur de la vie philosophique dans le Gorgias et le Mnon. Puis Socrate disparat, et, avec lui, la vie dramatique du dialogue ; il est peu probable que le jeune Socrate qui, dans le Phdon (97 c sq.), sinstruit en lisant Anaxagore, ou, dans le Parmnide (128e sq.), p.102 soumet la doctrine des ides au vieux philosophe dle, soit autre que Platon lui-mme. Autour de Socrate, cest tout un peuple de sophistes, de rhteurs, dexgtes, de potes, de prophtes, dont, la sagesse est passe lpreuve par le matre ; Platon les parodie plus ou moins cruellement : cest Hippias qui se vante denseigner et de pratiquer tous les arts ; cest Protagoras, qui ne sait terminer une discussion sur la possibilit denseigner la justice quen racontant un mythe ; Gorgias le rhteur, dont lenseignement, qui veut tre purement technique, ne se soucie pas de la justice de sa cause ; Ion, linterprte dHomre, qui nobit qu linspiration, comme le pote ; Euthyphron, le prtendu saint, qui veut viter la souillure religieuse plutt que linjustice. Puis viennent les jeunes gens, depuis Charmide, de naissance noble, cousin de la mre de Platon, type de cette rserve, de cette dcence dans lattitude et les propos, que lon appelle la sophrosyn, jusquau Callicls du Gorgias, lambitieux de basse naissance, intelligent et cultiv, dailleurs, et plein dune volont ardente de simposer aux Athniens. Enfin, les bourgeois et politiques dAthnes, Critias le tyran, parent de Platon, qui dans Charmide, se montre violent et sans gards pour Socrate ; Lachs et Nicias, excellents militaires, tout emptrs dans les discussions stratgiques, alors quon leur demande ce que doit apprendre un jeune homme ; linquitante figure dAnytos, dans le Mnon, le bourgeois conservateur qui craint la libert desprit de Socrate et laccusera devant les juges. Plusieurs dialogues ont une progression dramatique et prsentent des crises la manire des pices de thtre. Tantt le scnario est emprunt la vie courante, comme dans le Banquet, o chacun des convives fait, aprs boire, lloge de lamour, tantt aux vnements dramatiques du procs et de la mort de Socrate ; mais quelquefois le progrs nat du caractre mme des personnages ; ainsi il arrive souvent que le p.103 dialogue soit interrompu par limpatience dun auditeur, qui refuse de se soumettre plus longtemps lexamen de Socrate ; lorsque Socrate a affaire un interlocuteur de caractre emport, comme Callicls du Gorgias, le dialogue menace chaque instant de finir 1. Cest le Gorgias qui, dans son ensemble, nous fournit le plus bel exemple dun mouvement dramatique : trois pisodes parfaitement enchans, les trois conversations de Socrate avec Gorgias, avec Plos et avec Callicls ; Gorgias ne voyant que le ct technique de lapprentissage de lorateur, est
1
Par exemple Gorgias, 497 b ; 505 c. d ; 506 d.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
78
incapable de donner son art une fin morale quelconque ; un Plos nutilisera pas la rhtorique mauvaise fin ; mais cest uniquement parce quil est timide et respectueux des prjugs ; vienne au contraire un violent comme Callicls : il trouvera dans lcole de Gorgias non pas un frein, mais au contraire un instrument pour exercer sa violence. Ce sont ainsi toutes les consquences de lattitude intellectuelle de Gorgias, qui se droulent de manire vivante et dramatique. Devant une telle intensit de vie dramatique, on sest demand si Platon navait pas, sous le couvert dinterlocuteurs de Socrate, pour la plupart morts depuis longtemps, voulu dpeindre des personnes vivantes. Il est certain, dune part, que Platon na pas du tout le souci de la chronologie que lon attendrait sil avait rellement lintention de peindre des personnages de lpoque de la jeunesse ou de la maturit de Socrate. Dautre part, certains de ces personnages, mme dans les dialogues de la premire et deuxime priodes, nous sont inconnus dailleurs, par exemple Callicls, ou bien les sophistes Euthydme et Dionysodore, qui Platon donne les premiers rles dans le dialogue Euthydme. On na nullement le droit pourtant, de faire correspondre chacune de ces figures, connue ou non, des contemporains de Platon. La vrit semble tre que la plupart des portraits de Platon sont styliss ; ils prennent, quoique p.104 palpitants de vie, une valeur universelle et Platon a pu ainsi naturellement introduire chez ces personnages les proccupations de son poque et les siennes propres. Quil sagisse ou non de dialogues, prsentant un intrt dramatique, la partie permanente et substantielle du dialogue est, sauf exception, la discussion. A une question (par exemple : quest-ce que la justice ? la vertu peut-elle senseigner ?), le rpondant rplique par une formule : cest cette formule qui est soumise lpreuve de la discussion, selon lunique rgle indique dans le Mnon (75 d). Du ct du rpondant, la discussion (ou dialectique) consiste non seulement donner des rponses vraies, mais des rponses qui dcoulent de ce quil reconnat savoir . La discussion suppose donc toute une srie de postulats admis ou hypothses avec lesquels on confronte la formule discuter, pour voir si elle est ou non daccord avec eux. La premire formule rfute, le rpondant en propose une seconde, puis une troisime, et ainsi de suite, sans aboutir souvent aucun rsultat dfinitif. Ainsi Charmide, dans le dialogue de ce nom, interrog par Socrate sur la nature de la sophrosyn, rpond quelle consiste agir avec ordre et lenteur (159b), mais comme Charmide reconnat, dautre part, que la sophrosyn est parmi les belles choses, et quil est plus beau dagir rapidement que lentement, il sensuit quil y a dsaccord entre sa formule et ce quil reconnat lui-mme comme vrai. Il doit donc labandonner et en proposer une autre. La discussion ou dialectique nest donc aucun degr comme dans les joutes des sophistes, la confrontation de deux opinions adverses soutenues chacune par un interlocuteur : le rpondant seul exprime des opinions
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
79
positives. Socrate, lui, ne sait rien sinon quil ne sait rien ; il na dautre rle que dexaminer ou de passer lpreuve le rpondant, en lui faisant voir sil est ou non daccord avec lui-mme. En principe, la dialectique platonicienne restera toujours ce quelle a t ds labord dans les dialogues socratiques : p.105 le Thtte examine successivement les diverses opinions de Thtte sur la science, comme lHippias majeur rfute les opinions successives dHippias sur le beau. Pourtant, le cadre extrieur et la signification paraissent bien changer peu peu. Les dialogues socratiques sont, en effet, pour le moins autant un examen des personnes mmes quun examen de leurs opinions ; lintrt porte mme plutt sur le premier que sur le second. Les concepts de temprance, de courage, de pit ne sont pas en eux-mmes et pour eux-mmes lobjet de la recherche ; on cherche avant tout si ceux qui ont ou pensent avoir ces vertus, les connaissent, en un mot sils se connaissent bien eux-mmes. Le bnfice de la discussion, ce sera la connaissance de soi-mme . Il semble bien que, mesure que Platon sloignait de linfluence socratique, son centre dintrt se soit dplac et port des personnes aux ralits elles-mmes. Aussi attache-t-il plus de prix au rsultat quil obtient. Que lon compare par exemple le Protagoras au Mnon ; ils portent sur le mme sujet : la vertu peut-elle senseigner ? Mais dans le premier de ces dialogues, Socrate est content de mettre Protagoras en dsaccord avec luimme, puisquil rpond dabord oui et ensuite non ; cest la prtention de Protagoras, plutt que le sujet mme que lon examine. Dans le Mnon, au contraire, Platon, devenu sans doute ce moment le matre de lacadmie, indique des mthodes positives de recherche et denseignement 1. Bien plus, il arrive, dans les derniers dialogues, que la mthode socratique est entirement oublie : dans le Philbe (11b), par exemple, la dialectique ne consiste plus dans lexamen du rpondant par Socrate ; elle comporte deux thses opposes qui saffrontent, et dont lune est soutenue par Socrate lui-mme. Ainsi, au cours de lactivit littraire de Platon, la dialectique perd peu peu en intrt dramatique et humain, et a une p.106 tendance se transformer en une mthode impersonnelle, qui sintresse aux problmes pour eux-mmes. Le troisime aspect que nous distinguions dans luvre de Platon, cest lexpos suivi. Lexpos suivi, dans les uvres de la premire et de la seconde priode, se prsente sous deux formes qui ont grande affinit lune avec lautre : le discours qui soutient une thse, et le mythe qui raconte. Le discours thse est mis en gnral dans la bouche des interlocuteurs de Socrate, et il a bien souvent le caractre dune parodie ; des sophistes exposent leur opinion en une confrence dapparat, et Platon samuse imiter la manire dun Protagoras, dun Prodicus, dun Gorgias 2 ; quelquefois il sagit
1 2
Comparer Protagoras, 361a-d et Mnon, 86c-87b. Protagoras, 320c-323a ; 337bc ; Hippias, I, 291d ; Gorgias, 482c.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
80
de discours qui, sans tre proprement parler des confrences de sophistes en sont parents ; tels les loges de lamour dans le Banquet, o Platon parodie successivement la manire du rhteur Lysias (discours de Phdre), de Prodicus (Pausanias), dHippias (Eryximaque), de Gorgias (discours dAgathon) 1 ; tel le discours de Callicls dans le Gorgias ; le discours de Lysias dans le Phdre est destin donner un exemple concret des dfauts de la technique des orateurs. Mais, dans tous les cas ces discours suivis sont destins servir en quelque sorte de repoussoir la mthode vritablement scientifique de recherche, qui est la dialectique. Socrate, lui, ne possde pas lart des longs discours (Protagoras 336b), et si ses interlocuteurs, suivant leur pente naturelle, essayent de se drober la discussion en prononant un discours (comme Protagoras), sils sont toujours prts, comme Callicls, abandonner la partie quand Socrate ne les laisse pas parler, Socrate, inversement, se plaint que Protagoras ne veuille pas distinguer entre une discussion entre gens qui se runissent et un discours au peuple (Ibid.). Cest que dans un discours il sagit seulement de persuader p.107 lauditeur en flattant ses prjugs, mais non pas de rechercher la vrit et laccord avec soi-mme. Pourtant Platon, au cours de sa carrire, na pas toujours gard cette attitude hostile lart des discours, et il lui a donn, semble-t-il, une place qui va croissant. Les mthodes de persuasion gardent leur importance et leur valeur, lorsquil sagit dimposer des vues qui nadmettent pas de dmonstration rigoureuse. Que lon compare cet gard les Lois, uvre de vieillesse, et la Rpublique ; dans les Lois, il ny a plus de discussion, mais il y a, en revanche, pour chaque catgorie de lois, de longs prologues, destins entraner la conviction plutt qu prouver ; tel, au livre X, le clbre prologue aux lois concernant la religion 2. Cette manire de Platon a eu une immense influence, et nous avons l plus que lbauche dune prdication morale, qui, plus tard, deviendra la philosophie presque entire. Ds le Phdre (269c sq.), dailleurs, Platon a montr comment une rforme de lloquence tait possible, et comment on pouvait, en lassociant la dialectique, donner au discours un ordre et une consistance. Dans le mme dialogue il a donn lexemple de ce style majestueux et oratoire (245c sq.), qui fait un tel contraste avec la vivacit malicieuse des premiers dialogues. Pour le mythe, il est dabord une parure et un ornement dans un discours ; comme tel, il a sa place chez les sophistes ou orateurs que parodie Platon, le mythe de Promthe chez un Protagoras, par exemple 3, ou celui de la naissance dros dans les discours du Banquet. Mais, de trs bonne heure, ds le Gorgias, Platon met des mythes dans la bouche de Socrate. Ces mythes ont certains caractres prcis qui tranchent sur ceux du mythe pur ornement oratoire. En premier lieu, ils ne sont point des parties dun discours plus
1
Phdre, Pausanias, Eryximaque, Agathon sont des lves de chacun de ces rhteurs ou sophistes. 2 Sur limportance de la persuasion, Lois, 903ab. 3 Protagoras, 320c-323a.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
81
tendu mais ils sont traits pour eux-mmes : tels les mythes de la fin du Gorgias (523a) p.108 et de la Rpublique (X ; 614b) ; dans les deux cas, au moment o commence le mythe, la discussion est puise, et le concept de justice est tir au clair ; ils sajoutent la discussion sans en faire partie. En second lieu ces mythes ne concernent jamais la gnalogie des dieux, mais uniquement la destine de lme, ou, dune manire plus gnrale, lhistoire humaine. Les mythes concernant la vie future sont naturellement lies, ds lOdysse, une gographie fantastique dcrivant le pays des ombres. Cette sorte de gographie prend dans le mythe platonicien, une place de plus en plus importante ; tandis que le Gorgias ne dpasse gure les reprsentations homriques, le Phdon spcule sur les reliefs de la surface terrestre ; surtout, la Rpublique (616c-617b) et le Phdre (247c) relient dune manire intime lhistoire de lme au systme astronomique ; le monde entier est avant tout la scne o voluent les mes des hommes et des dieux. On pourrait presque dire que les spculations astronomiques ne sintroduisent jamais chez Platon qu la faveur du mythe de lme ; le mcanisme des choses est tel (Lois, X, 904b) que lme est attire naturellement vers les lieux o elle doit subir son chtiment ou jouir de sa rcompense. Cest que le monde lui-mme est un grand tre vivant et anim ; le Time, qui a la forme dun rcit ou dun mythe, raconte comment lme du monde a t forme et sest form elle-mme un corps. Cette astronomie religieuse a eu dans la suite une influence considrable. Le mythe soriente aussi parfois, mais bien rarement, vers la lgende forme de rcit historique, comme dans un dialogue de vieillesse inachev, le Critias, o sont dcrites lAthnes prhistorique et lAtlantide. Enfin il faut ajouter que, dans le Time (61c la fin), lexpos continu du mythe est reli sans suture une autre forme dexpos continu qui est celle dun trait physiologique ou mdical ; la fin du dialogue, les sciences exprimentales, telles que les concevaient les Ioniens ou les mdecins, font une fugitive et tardive p.109 apparition et ne trouvent naturellement leur expression en aucune des formes littraires que nous avons cites. De cette extraordinaire complexit de formes, drame et comdie, dialectique, discours suivis et mythes, formes qui, selon les poques, sont diffremment doses et ont de plus chacune leurs modifications propres, il est impossible de faire abstraction pour juger la philosophie de Platon.
III. BUT DE LA PHILOSOPHIE
@ Ce qui fait lunit de toutes ces formes, ce qui, en quelque sorte, les ncessite, cest le dsir dtablir la place du philosophe dans la cit, et sa mission morale et sociale. Dans la Grce dalors, le philosophe ne se dfinit nullement, par rapport aux autres genres de spculations, scientifiques ou
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
82
religieuses, mais bien par son rapport et ses diffrences avec lorateur, le sophiste, le politique. La philosophie est la dcouverte dune nouvelle forme de vie intellectuelle, qui ne peut au reste se sparer de la vie sociale. Les dialogues nous dpeignent cette vie, et, avec elle, tous les drames et comdies qui en sont issus. A certains gards, cette philosophie heurtait des habitudes solidement implantes en Grce cette poque, et il tait invitable quil se produist des conflits dont la mort de Socrate est la consquence tragique. Quest le philosophe ? Il y en a chez Platon des portraits multiples. Il est, dans le Phdon (64e sq. [plaisirs]), lhomme qui sest purifi des souillures du corps, ne vit plus que par lme, et ne craint pas la mort, puisque, ds cette vie, son me est spare du corps. Dans le Thtte (172c-177c [XXIV.]), il est lhomme inhabile et maladroit dans ses rapports avec les hommes, qui ne sera jamais sa place dans la socit humaine et restera sans influence dans la cit. Dans la Rpublique, il est le chef de la cit, et cest bien lui qui, dans les Lois (X, 909a), est devenu cette sorte dinquisiteur qui, voulant le salut de lme des citoyens, p.110 impose aux habitants de la ville la croyance aux dieux de la cit ou la prison perptuelle. Enfin, cest lenthousiaste et linspir du Phdre (244a sq.) et du Banquet (210a). Il y a dans ces portraits successifs deux traits dominants qui semblent se contredire ; dune part, le philosophe doit fuir dici 1, se purifier, vivre en contact avec les ralits quignorent le sophiste ou le politique. Dautre part, il doit construire la cit juste o se refltent, dans les rapports sociaux, les rapports exacts et rigoureux qui sont lobjet de la science. Le philosophe est, dune part, le savant retir du monde et, dautre part, le sage et le juste, le vrai politique qui donne des lois la cit. Platon lui-mme nest-il pas la fois le fondateur de lacadmie, lami des mathmaticiens et des astronomes, et, dautre part, le conseiller de Dion et de Denys le tyran ? De plus si, comme philosophe, il est linventeur, ou le promoteur dune logique rigoureuse, il est aussi linspir dont lesprit resterait strile sans limpulsion dros, et qui ne peut engendrer que dans le beau 2 ; la discussion raisonne se double dune dialectique de lamour qui se traduit par des effusions lyriques et des contemplations mystiques 3. Savant et mystique, philosophe et politique, ce sont des traits ordinairement spars, et que, au cours de cette histoire, nous ne rencontrerons plus unis que chez quelques grands rformateurs du XIXe sicle. Aussi importe-t-il de bien comprendre ce qui fait leur lien.
IV. DIALECTIQUE SOCRATIQUE ET MATHMATIQUES.
@
1 2
Thtte, 176a. Banquet, 203e sq ; 206c. 3 Ibid., 210e.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
83
Et dabord, quest-ce que la science platonicienne ? Elle est caractrise par lunion intime entre lobjet de la connaissance et le procd mthodique par lequel on latteint. Il y a l un p.111 point de premire importance sur lequel on ne peut assez insister. Nous voyons Platon partir de ce que lon appelle ordinairement le concept socratique, mais de ce que, lui, il appelle dj lide (eidos ou idea), le courage, la vertu, la pit, cest--dire, comme il le dit dans lEuthyphron (6d [6d]) le caractre unique par lequel toute chose pieuse est pieuse , et dont on se sert comme dun terme de comparaison pour dclarer que tout ce qui est fait de semblable est pieux . Lide est donc un caractre qui rside dans les choses elles-mmes, mais que lon ne peut dgager que par lexamen socratique. Nous ne sommes srs, en effet, que la formule atteinte par le rpondant exprime vritablement lide, que lorsquelle aura rsist cet examen et sera sortie triomphante de lpreuve. Il ny a ni rvlation ni intuition immdiate qui puisse len dispenser. La mthode est dailleurs, ici, bien plus importante que lobjet ; en fait, Socrate naboutit jamais lide ; en revanche, il discipline lesprit et lui enlve ses illusions. La recherche socratique se bornait aux choses morales. On admet, daprs le tmoignage dAristote 1, que Platon ne fit qutendre la mthode des ides qui ntaient pas de la sphre de laction, et quil spara ces ides, cest--dire leur confra une ralit distincte. Mais de quelle manire sest faite cette transformation ? A-t-elle ce caractre purement arbitraire quAristote lui donne ? Il ne le semble pas : la sparation des ides, qui en fait des ralits suprieures aux choses sensibles, parat concider avec la place que Platon donne aux mathmatiques. Les mathmatiques, tout en employant une mthode rigoureuse, savent, au contraire de Socrate, aboutir des conclusions positives. Comment et pourquoi ? Cest grce un procd que Platon appelle hypothse et quil dfinit trs clairement dans le Mnon (87a) : Quand on demande au gomtre p.112 propos dune surface, par exemple, si tel triangle peut sinscrire dans tel cercle, il rpondra : Je ne sais pas encore si cette surface sy prte ; mais je crois propos, pour le dterminer, de raisonner par hypothse de la manire suivante : si cette surface est telle que le paralllogramme de mme surface appliqu une droite donne soit dfaillant de telle surface, le rsultat sera ceci ; sinon, il sera cela . Cette mthode est lanalyse qui consiste remonter du conditionn la condition, en visant avant tout tablir un rapport de consquence logique entre deux propositions, tout en laissant provisoirement de ct la question de savoir si la condition elle-mme est ralise. Cette condition pourra faire lobjet dune recherche analogue, et tre elle-mme rapporte une condition que lon suppose. A la discussion socratique se substitue donc dans le Mnon lanalyse mathmatique. Or, lexistence et la sparation des ides nous sont prsentes dans le Phdon avec une parfaite clart, comme rsultant de lapplication de la
1
Voir ci dessus, p. 98.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
84
mthode danalyse au problme de lexplication des choses tel quil tait pos par la physique. Platon raconte comment, ayant constat que les physiciens ne pouvaient arriver lexplication des faits plus simples, Socrate a t sduit par un livre dAnaxagore, o on lisait que lintelligence tait lordonnatrice et la cause de toutes choses (97c) ; mais en avanant dans sa lecture, il saperoit que, dans lexplication du dtail des phnomnes, par exemple de la forme de la terre ou des mouvements des astres, lintelligence nintervient nullement, et quAnaxagore a recours lair, lther, leau ; il expliquerait que Socrate est assis dans sa prison, non parce quil a refus de svader, mais parce que son organisme a telle ou telle proprit. Cest alors que Socrate se dcide, pour rsoudre les problmes physiques, laisser entirement de ct les ralits donnes par la vue ou les autres sensations, et tenter, dans une seconde traverse , demployer la mthode, dj indique dans le Mnon, cest--dire de poser par hypothse la formule que je jugerais tre p.113 la plus solide, puis de poser comme vrai ce qui saccordera avec cette formule, comme non vrai ce qui ne saccordera pas avec elle . Dans le problme de lexplication des choses, cette formule est celle qui affirme les ides ; on supposera quil existe un beau en soi, un bon en soi, un grand en soi, et ainsi du reste ; et si une chose est belle sans tre le beau en soi, on lexpliquera en disant quelle participe au beau en soi. Lintention de Platon devient trs claire lorsquil compare son mode dexplication celui des physiciens. Soit expliquer comment deux choses forment un couple ; le physicien nous dit soit que deux choses, primitivement loignes se sont rapproches, soit quune mme chose sest divise en deux ; il nous donne donc deux explications contradictoires du mme fait, ou plutt il ne lexplique pas ; aucune opration physique ne peut expliquer la gense de la dyade ; car la dyade existe en soi, indpendamment de toutes les oprations physiques, comme objet de la mathmatique ; et cest par participation cette dyade en soi que nat tout couple de deux choses 1. On voit comment la thorie des ides est lie la mthode analytique ou mthode de lhypothse. La mthode est bien plus vaste et large que la thorie des ides qui nen est quune application particulire. Cest l tout lesprit du platonisme auquel sopposeront si manifestement les dogmatismes qui vont suivre. Llan de pense reste, pour Platon comme pour Socrate, plus important que la russite.
V. DIALECTIQUE PLATONICIENNE
@ Mais la mthode analytique pose un grave problme, pressenti dans le Phdon et longuement trait dans la Rpublique. Dans cette mthode, en effet, lhypothse, aprs avoir servi la p.114 dmonstration, doit elle-mme tre
1
Phdon, 99 c-100 d ; cf. 101 e.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
85
ramene une hypothse plus haute ; mais dans cette rgression vers les conditions, il faut bien sarrter un terme qui se suffit (Phdon, 101d), qui nest plus lui-mme suppos (Rpublique, 511b [511b]). Or ici les mathmatiques nous abandonnent compltement : pour rsoudre leurs problmes, elles supposent des droites ou des courbes, des nombres pairs ou impairs ; mais ces suppositions restent des suppositions, dont pourra seule rendre raison une science suprieure, une dialectique qui arrive linconditionn. Lorsque Platon dsigne ce terme par les expressions Bien ou ide du Bien (508e), son intention est assez claire ; il veut dire que la seule explication dfinitive que lon puisse donner dune chose, cest quelle est bonne ou quelle participe au Bien. Daprs les dialogues postrieurs, on peut supposer que, ds lpoque o il crivait la Rpublique, il raisonnait de la mme manire que dans le Time ; dans le Time (29e-30a [29e]) les rapports mathmatiques ou les formes gomtriques qui sont supposs par lastronome pour expliquer les mouvements des astres ne sont leur tour expliqus que parce quils ralisent un plan du dmiurge, plan qui drive de sa bont ; la bont est ce que tout prsuppose, sans rien prsupposer du tout. Ce quAristote appellera la cause finale est la cause vritable et absolue, qui donne lexplication dernire ; comme les vertus elles-mmes, la justice et la beaut ne valent rien, si on ne sait par o elles sont bonnes (506a). Le Bien est comme un soleil la lumire duquel les autres choses sont connues dans leur raison dtre, et la chaleur duquel elles existent. Le Bien nest donc pas un tre ; il est au del de ltre en dignit et en puissance (506b). On ne peut esprer comprendre ce passage nigmatique de la Rpublique sur lide du Bien que si lon se rend bien compte du problme quelle est destine rsoudre. Dans le Phdon, Platon avait appel du nom gnral de rflexion (dianoia) la pense qui procde par la dcouverte dhypothses ; mais quoi reconnatre que la condition laquelle on est remont p.115 en allant dhypothse en hypothse nest plus elle-mme une hypothse ? Non assurment au lien logique de dpendance que tout le reste a avec elle, ce qui ne la distinguerait pas dune autre hypothse ; on ne saurait le reconnatre que par une intuition intellectuelle directe (nosis) et une sorte de vision ; elle na se justifier daucune autre manire (Rpublique, 511d). De l dcoule le rgime du philosophe, tel quil est dpeint au VIIe livre de la Rpublique, A la base de sa formation intellectuelle se trouvent les quatre sciences, qui emploient la mthode par hypothse : arithmtique, gomtrie, astronomie, musique ; Platon a le plus grand soin dindiquer quil nadmet ces sciences que dans la mesure o elles emploient cette mthode ; il en lague tout ce qui pourrait sy mler dobservation sensible, tout ce qui nest pas dmonstratif ; larithmtique, par exemple, nest pas lart de compter qui sert au marchand ou au stratge, mais la science qui discerne les nombres en eux-mmes, indpendamment des choses sensibles (525e) ; de la mme manire, la gomtrie nest point larpentage (526d) et Platon en trouve une preuve par le fait dans une partie nouvelle de cette science, laquelle il na
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
86
point cess dattacher de limportance, la stromtrie ou science des solides rguliers, qui nest plus du tout une mesure des surfaces, intermdiaire entre la gomtrie proprement dite et lastronomie (528a). Lastronomie qui nadmet que des combinaisons de mouvements uniformes pour expliquer le mouvement des astres et des plantes est donc fort loin de lobservation des astres, qui ne prsente directement la vue que des mouvements irrguliers (530ad). Enfin le musicien qui accorde son instrument en ttonnant nest point le savant qui dcouvre les rapports numriques simples qui constituent les accords (531ab). Ces quatre sciences donc, en nous forant nous lever des hypothses par la pense seule, en dehors des choses sensibles, nous attirent vers ltre, vers les ralits vraies (533ab). Mais ce nest l quune prparation ; ces sciences se p.116 superpose la dialectique. Le vritable dialecticien est lesprit synoptique , celui qui ne garde pas les sciences ltat dparpillement, mais voit leur parent entre elles et avec ltre (537c) ; cest en un mot celui qui rattache la diversit des hypothses leur racine unique, le Bien, et par la science du Bien, qui est la plus grande de toutes, les claire et en montre la ralit.
VI. LORIGINE DE LA SCIENCE. RMINISCENCE ET MYTHE
@ Il importe au plus haut point, pour bien comprendre le Platon de la maturit, davoir toujours prsents lesprit ces deux plans de la connaissance intellectuelle. A leur distinction se rattache toute une srie de problmes. En premier lieu, le Platon purement socratique, qui se contentait de soumettre lpreuve les formules ou solutions donnes par le rpondant, laissait dans un vague complet lorigine de ces formules elles-mmes ; pourtant, si elles taient pleinement arbitraires, quelle chance avaient-elles de saccorder avec la ralit ? Cest l le sens de la question sophistique pose par Mnon 1 ; la recherche est impossible si on ignore tout de ce que lon recherche ; comme elle est inutile si on le connat. Il faut donc que le rpondant ait dj lesprit orient vers la ralit ; il faut donc quil ait dj connu cette ralit, et que recherche et savoir ne soient quune rminiscence (81d). Si lesprit, par la simple rflexion (guide ou non par les interrogations du matre) peut dcouvrir des vrits, cest quil les possdait dj en lui-mme ; et cest par la simple rflexion que lesclave interrog par Socrate dcouvre que le carr double dun autre est celui qui est construit sur la diagonale (82b-85b) ; or, dcouvrir une vrit que lon possdait dj, cest se ressouvenir. La thorie de la rminiscence nest dailleurs nullement une thorie paresseuse, p.117 mais une thorie stimulante ; cest grce elle que nous devons avoir bon courage
1
Mnon, 80 d.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
87
et nous efforcer de rechercher et de retrouver la mmoire de ce dont nous avons perdu le souvenir (81de-86b). Grce elle, nous devenons meilleurs, plus nergiques, moins paresseux . La rminiscence, cest le premier nom de lautonomie de lesprit dans la recherche. Mais cette thorie implique son tour la grave affirmation de la prexistence de lme (81b). Limmortalit de lme, dont Platon a dout dans ses premiers dialogues 1, devient maintenant une condition de la science. Laffirmation, sche et abstraite, de la prexistence, ne suffit pas. Platon a sans doute pens que cette croyance ne prendrait corps que si elle pouvait se reprsenter en un mythe. Le mythe, qui raconte lexistence de lme en dehors du corps, tait, sous la premire forme quil prit dans le Gorgias (523a), bien indpendant des proccupations du Mnon ; il racontait seulement comment luvre de justice se poursuivait aprs la mort ; dans les dialogues suivants, le mythe garde sans doute, dans sa plus grande partie, le mme caractre et reste le rcit dun jugement divin. Toutefois, une place est faite, et qui dans le Phdre (248ac) est trs grande, la manire dont lme a acquis, avant dentrer dans le corps, la connaissance des ralits dont elle retrouvera le souvenir pendant sa vie terrestre ; en accompagnant les dieux du ciel dans leur course circulaire, elle a vu, dans un lieu qui est au del du ciel , ces ralits sans couleur et sans forme que sont les ides, la justice en soi, la temprance, la science ; aprs tre tombes dans un corps, les mes qui les circonstances auront permis de mieux voir deviendront des mes de philosophes capables de souvenir. Ainsi, les ides deviennent, dans le Phdre, des lments constitutifs du mythe de lme ; elles sont localises au del du monde sensible dans le lieu supracleste quaperoit lme. p.118 Cette tendance une sorte de ralisation mythique et imaginative des ides est peut-tre un cueil de la philosophie de Platon ; mais on voit comment elle dpend de la thorie de la rminiscence qui est elle-mme une condition de la science. Le mythe et la science, si elle veut dpasser les hypothses mathmatiques, sont lis dun lien indissoluble.
VII. SCIENCE ET DIALECTIQUE DE LAMOUR
@ A la rminiscence des ides se rattache trs troitement, dans le Mnon, la possibilit de possder des opinions droites sans tre capable de les justifier, cest--dire sans avoir la science (97c-98c). Ainsi les clbres politiques dAthnes, Aristide ou Pricls, qui ont bien dirig la cit, ne possdaient aucune science politique, cest--dire aucune connaissance mthodique mritant le nom dart ; sans quoi, ils eussent t capables de lenseigner et de la transmettre ; or ils nont pas mme pu faire de leurs propres enfants des
1
Apologie de Socrate, 29 ab.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
88
politiques (93c-94e). Mais, pratiquement, lorsque laction seule est en question, lopinion droite quivaut la science. Comme cette opinion nest pas inne lindividu, et comme elle nest pas non plus acquise par linstruction, il faut quelle drive de linspiration des dieux (99c-100b). Cette inspiration est parmi les faveurs faites par les dieux la cit athnienne. Cest un trait qui ne pouvait tonner aucun auditeur de Platon ; pour un Grec, la cit reste ncessairement sous la protection des dieux qui elle rend un culte. Comme la rminiscence du Mnon se ralise dans le mythe de la prexistence de lme du Phdre, linspiration appelle aussi son complment mythique, qui fera saisir par limagination les influences qui sexercent en lme ; cest le mythe dros dans le Banquet et le Phdre. Platon rattache linspiration philosophique tout un ensemble de faits du mme genre. Elle est elle-mme un aspect de la folie amoureuse ; car la philosophie p.119 est pour Platon ce quelle avait t pour Socrate ; elle est non pas mditation solitaire, mais gnration spirituelle dans lme du disciple ; or on nengendre que dans le beau et sous linfluence de lamour (Banquet, 206c). Lamour tend vers limmortalit, aussi bien lamour des beaux corps qui prolonge la vie dun individu en une autre que lamour des belles mes, qui rveille les puissances dormantes de lintelligence chez le matre comme chez le disciple (206d ; 208b). La vie de lesprit est ainsi comme ente sur la vie du corps ; du dsir instinctif qui pousse ltre vivant engendrer son semblable jusqu la vision subite du beau ternel et imprissable, il y a un progrs continu qui est un progrs en gnralit ; cest un progrs dtre mu non plus par la beaut dun seul corps, mais par toute beaut plastique ; mais au-dessus de la beaut plastique se trouve celle des mes, des occupations et des sciences, et au-dessus encore, la mer immense du Beau dont toutes ces beauts sont issues (209e-212a). Platon insiste longuement sur la nature dmoniaque de lamour ; len croire, les dmons jouent, dans le culte religieux, un rle de premier plan ; ils sont lintermdiaire entre les hommes et les dieux, apportant aux dieux les prires des hommes, et aux hommes les dons des dieux. ros est un de ces dmons, le fils de Poros et de Pnia, qui unit la pauvret de sa mre lingniosit, les fertiles ressources de lesprit de son pre : il est le type, et comme le patron des philosophes ; il symbolise en lui tout ce quil y a en eux dinspiration et dlan ; il est, dans lordre affectif, ce que sont, dans lordre intellectuel, les mathmatiques ; il attire vers le beau, comme les mathmatiques attirent vers ltre (202e-203c). De mme quros personnifi est un dmon parmi les autres, la folie amoureuse est aussi une espce dun genre plus vaste qui comprend toute folie venue des dieux (Phdre, 245b). Platon songe en particulier ici aux croyances et pratiques religieuses qui se rattachent un mode de divination dont p.120 limportance sociale tait immense, la divination de la Pythie delphique qui fait tant de bien la Grce grce sa folie, et qui dans son bon sens, nen fait aucun (244b). La folie du prophte qui vaticine est mise
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
89
en parallle avec la folie du pote possd des Muses, celui dont les uvres instruisent les gnrations futures. Cest ces deux dlires dont tous les Grecs acceptent la valeur que Platon vient comparer le dlire de lamoureux ; il nest pas dune valeur moindre ; puisquil est lagitation dune me qui reconnat, dans les choses sensibles, limage de la beaut ternelle quelle a contemple, lorsquelle vivait, avant sa vie terrestre, en compagnie des dieux ; il est donc le point de dpart de la philosophie, et redonne lme ses ailes (249a-250c) ; il aiguillonne lme, comme Socrate, lamant parfait du Banquet (216a) est, dans lApologie (30e), le taon qui stimule les Athniens. Le thme dros et, dune manire gnrale, celui de linspiration divine met nu le fond affectif de la science platonicienne, La philosophie nest pas pour Platon une mthode purement et troitement intellectuelle. Lorgane par lequel on comprend est comme lil qui est incapable de se tourner vers la lumire, autrement quavec tout le corps ; de mme cest avec lme tout entire quil faut oprer la conversion du devenir ltre... Il y a des mchants qui sont dhabiles gens et dont la petite me a une vision aigu et pntrante... ; mais plus elle a de pntration, plus ils font de mal ! (Rpublique, 518e sq.). Cette vision des mdiocres soppose la vision du Beau, qui procde de lamour et qui est le couronnement de linitiation amoureuse. De plus, le mythe relie la vie philosophique lensemble de la destine humaine et par l lunivers entier, qui en est le thtre. La chute de lme, du ciel sur la terre, ses avatars sur terre, sa conversion, et son retour la vision do elle est partie, voil ce qui fait le fond du mythe du Phdre et de lallgorie de la caverne dans la Rpublique : lme dchue du Phdre p.121 (246e) est le prisonnier qui, plac dans la caverne obscure, le dos tourn au jour, ne contemple que la succession plus ou moins rgulire de vaines ombres sur le fond de la caverne jusqu ce que la dialectique vienne lui donner un mouvement de conversion vers la lumire (Rpublique, 514a-516a).
VIII. RVISION DE LHYPOTHSE DES IDES
@ Revenons maintenant au dveloppement de la philosophie proprement dite. Lon a vu comment la mthode par hypothse utilise le raisonnement discursif qui se contente de saisir, comment des consquences senchanent des hypothses. Mais cette mthode resterait incomplte, si, aprs avoir employ les hypothses, on ne les examinait en elles-mmes pour voir si elles sont justifies ou non. Ainsi, dans le Phdon, Platon a employ les ides et la participation aux ides titre dhypothse, pour rsoudre le problme de la causalit physique et prouver limmortalit de lme. Mais, une fois ces problmes rsolus, il faut prouver la valeur de lhypothse elle-mme.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
90
Cest bien une preuve de ce genre que Platon soumet la thorie des Ides au dbut du Parmnide (130a-135c). Et, en effet, avant de lexaminer, Platon la pose comme une hypothse permettant de rsoudre les difficults que Znon, le disciple de Parmnide, a oppose lexistence du multiple (128e-130a). Si lon pose part dun ct les ides, et de lautre les choses qui y participent, on peut, en effet, aisment concevoir comment une mme chose peut tre une et multiple ; cest que lun et le multiple existent part de la chose, et que la chose participe la fois ces deux ides ; cest ainsi quune mme chose peut tre sans contradiction semblable et dissemblable, grande et petite . Platon nous montre le vieux Parmnide souriant devant lardeur du jeune Socrate, qui expose cette solution ; p.122 Parmnide ne recherche plus si elle rend compte de la difficult de Znon contre le multiple, mais il lexamine en elle-mme. Dabord la participation des choses aux ides est impossible. Car si plusieurs choses participent une mme ide, ou bien lide est tout entire en chacune delle, et alors lide est spare delle-mme, ce qui est absurde ; ou bien, elle ny est quen partie, et alors on devra dire quune ide, telle que celle du petit, est ncessairement plus grande que chacune de ses propres parties, ce qui est absurde (131a-131e). De plus, lintention de la thorie des ides, cest daffirmer une ide une, par exemple, celle du grand, au-dessus de la multiplicit de termes qui sont tous grands ; mais cette unit est impossible ; car, si nous avons le droit de poser une grandeur en soi au-dessus des grandeurs multiples, cause de leur ressemblance, il faudra poser, pour la mme raison, une autre grandeur en soi au-dessus des grandeurs multiples et de la premire grandeur, et ainsi linfini (131e-132b). Dira-t-on, pour rpondre la premire difficult, que la chose qui participe lide est lide non point comme la partie au tout, mais comme un portrait son modle ? Il faudra alors inversement que le modle ressemble au portrait, que lide soit semblable la chose ; or, daprs les principes de la thorie, il ny a ressemblance que l o il y a participation une mme ide ; il faudra donc poser au-dessus de la chose et de lide une autre ide laquelle elle participe toutes deux, et ainsi linfini (132a-133a). Enfin, il y a incompatibilit entre la nature de lide et la fonction laquelle elle est destine ; car elle doit tre objet de science ; or, il est vident quelle ne peut mme pas tre connue de nous ; car si elle existe en elle-mme, elle ne peut tre en nous ; une ralit en soi ne peut tre connue que par une science en soi, laquelle nous navons aucune part. Inversement, attribuer Dieu la science en soi, ou science des ides, cest lui refuser la connaissance des choses extrieures aux ides (133 b-134e). Daprs cette critique, tout chappe de ce qui paraissait faire p.123 la valeur de lhypothse des ides : lide nest pas une explication des choses, puisque
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
91
la participation est impossible 1 ; elle nest pas une unit dans le multiple, puisquelle se dissipe en une infinit dides ; elle nest pas objet de science, puisquelle est radicalement spare de nous. Cest toute lhypothse du Phdon qui est mise en question. Cest sans doute vers la mme poque et par contre-partie que Platon est amen, dans le Thtte, faire une revision densemble des conceptions que les autres philosophes se sont faites de la science. Platon vise dabord ceux qui disent que la sensation est la science (151e). Dans la Rpublique (478 sq.) il avait postul comme une chose vidente de soi, que le sensible, sans cesse vanouissant, en flux perptuel, ne pouvait tre objet de connaissance, parce quil contenait la fois des caractres opposs. Ici, il le dmontre directement, sans faire la moindre allusion sa thorie positive. Cest dailleurs un sensualisme particulier que sattaque ici Platon ; ce nest pas ces hommes durs qui ne croient qu ce quils peuvent saisir avec la main (155e), mais ces philosophes plus subtils qui, suivant les traces dHraclite et de Protagoras, rsolvent toute connaissance certaine dans la conscience immdiate que chaque homme a de sa propre sensation prsente ; ainsi lhomme est, comme la dit Protagoras, la mesure de toutes choses (160c [mesure]), dans un monde perptuellement mouvant, o larrt et la fixit seraient la mort et feraient disparatre la fois ltre et la connaissance. En effet, comme ltincelle jaillit du frottement de deux corps, la qualit sensible et la sensation naissent la fois dune sorte de friction dun agent sur un patient ; elles naissent ensemble et ne sont rien lune sans lautre (156a-157a). Aucune qualit nest une ralit en soi, aucune sensation nest stable ; les unes et les autres emportes dans le mouvement p.124 universel ont chaque instant une vidence entire et totale, mais qui disparat chaque moment pour faire place une autre (179c). Telles sont les consquences auxquelles aboutit le mobilisme universel des vieux physiologues ioniens : et Platon trouve ici des adversaires auprs de qui la discussion socratique na pas de prise (179e-180b) ; car cette discussion implique que lon puisse convenir de certains postulats fixes ; comment serait-ce possible, si, ds quon cherche saisir ses paroles, ladversaire change immdiatement et se drobe ? Platon, qui a un sens si aigu du flux des choses sensibles, fait donc tout pour montrer la force de ses adversaires ; il carte avec ddain les objections vulgaires, par exemple celle-ci que Protagoras na pas le droit denseigner les autres hommes, puisque chacun, tant la mesure des choses, est aussi sage que les autres ; car si sa sagesse ne peut plus consister faire passer de lerreur la vrit, elle a encore un beau rle jouer en cartant les opinions nuisibles et en favorisant les opinions utiles (160e-162de).
Dj le Phdon (100 d) contenait bien des doutes sur la nature de la participation dont il se demande si elle est prsence de lide dans la chose ou communion de la chose avec lide.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
92
Aussi ne prtend-il rfuter cette thse quen entrant en elle, et en la suivant jusquau bout. Si lhomme est la mesure des choses, il faudra tenir compte de lopinion de tous les hommes ; et tous les hommes craignent de se tromper dans les matires o ils se savent incomptents et o ils reconnaissent la comptence de ceux qui ils sadressent. Protagoras, sil reste fidle luimme, est forc de se donner tort ; le fait que les hommes se reconnaissent des matres, des mdecins plus habiles queux sur la maladie craindre, des conseillers politiques capables de prvoir ce qui est utile la cit, rfute assez Protagoras. Cette science porte sans doute sur le futur ; mais il reste que lvidence immdiate de la sensation prsente nest atteinte que par celui qui lprouve. Platon rplique que cette vidence est ineffable ; car noncer ce qui est m, dire ce que lon voit, cest arrter le mouvement ou immobiliser la sensation ; on na donc le droit de dire ni que lon voit ni que lon sait ; avant p.125 que lon puisse le dire, lvidence actuelle est remplace par une autre (169d-172b ; 182d). Savoir, ce nest donc pas sentir ; nest-ce-pas plutt juger, et, plus prcisment, porter des jugements vrais ? (187b). Le jugement ou opinion vraie, dont il est ici question, a bien entendu pour objet les choses sensibles ; mais, dans le jugement sur les choses sensibles, il y a ncessairement quelque chose qui ne peut tre peru par la sensation ; car si nous jugeons que des objets existent, quils sont identiques ou diffrents, semblables ou dissemblables, les qualits mmes de lobjet sont bien perues par les sens ; mais lexistence, le mme et lautre, le semblable et le dissemblable sont des termes gnraux ou communs, des rapports qui ne peuvent tre donns par les sens. Cest donc en rflchissant sur les donnes des sens que lme juge ; si cette rflexion aboutit la vrit, si lon nonce des rapports exacts, on atteint ainsi la science (184b-186d). Mais, pour que cette thse ft soutenable, il faudrait dabord quon pt discerner le jugement vrai du jugement faux ; or (Platon reprend ici la thse connue des ristiques), tout jugement faux ou erreur semble impossible : car lerreur ne peut dabord consister dans une confusion ; on ne peut confondre deux choses, pas plus si on les connat toutes les deux, que si on les ignore toutes deux, ou si lon connat lune en ignorant lautre (188a-189a ; 189a-190e). Elle ne consiste pas davantage juger que ce qui nest pas est, ce qui reviendrait opiner le non-tre, cest--dire au sens o le prend Platon, prendre pour objet de son opinion ce qui na aucun contenu de connaissance, ce qui est pleinement indtermin, cest--dire enfin ne pas opiner du tout. Cette double critique de lerreur (dont la premire est reproduite sous plusieurs formes diffrentes) suppose que Platon rvoque maintenant en doute ce quil avait admis dans la Rpublique, cest--dire un tat intermdiaire entre le savoir et lignorance, correspondant une ralit intermdiaire entre ltre et le non-tre ; car, si lopinion fausse est impossible, p.126 cest parce quon ne peut que savoir ou ignorer, et que, si lon juge, on ne peut juger que ltre. Ce qui fait la force de largumentation du Thtte, cest que lopinion ny est point considre comme intermdiaire entre le savoir et
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
93
lignorance, mais ou bien comme savoir, ou bien comme ignorance. Elle est prsente comme un savoir dans la critique de lerreur, et cest au fond ce qui rend lopinion fausse impossible ; on ne peut opiner que ltre ; ce qui revient dire que, si lopinion est science, toutes les opinions se valent. Au contraire, dans la dernire partie de largumentation (201 a-c), elle est prsente comme ignorance, puisquun orateur habile peut convaincre ses auditeurs de faits quils ne connaissent pas directement, et qui pourtant sont exacts ; ils jugent vrai, sans avoir la science. Il ne suffit donc pas de juger vrai pour possder la science ; mais ne suffirait-il pas dajouter ce jugement vrai lnumration des lments dont se compose la ralit dont on parle et la manire dont ils se groupent (201 d) ? On connat une syllabe, quand on connat les lettres dont elles se composent. Cette conception de la science comme analyse logique du sens des mots semble avoir t celle dAntisthnes ; et la raison par laquelle Platon la rfute est tout fait instructive ; il ny aurait donc en effet science que du compos et non des lments simples ; cest dire que notre science ne serait faite que dignorances associes ; cest dire que, pour Platon, la science ne peut consister dans une pure et simple juxtaposition qui naurait pas sa raison dtre dans la nature des lments juxtaposs (203 a - 204 a). Ainsi, daprs le Thtte, aucune des hypothses que lon fait sur la nature de la science nest tenable. Mais, daprs le Parmnide, lhypothse des ides est aussi pleine de difficults. Aucune des hypothses des dialogues prcdents nest maintenue : avec la thorie des ides tombent toutes les vues sur les intermdiaires entre la connaissance et lerreur, entre ltre et le non-tre ; il nest plus question de demi-savoir, dinspiration, damour.
IX. LEXERCICE DIALECTIQUE DU PARMNIDE
@ Ou plutt une chose est maintenue : cest llan mthodique qui avait donn naissance ces hypothses, et qui, en se continuant, va les renouveler et les rajeunir. Ce nest point le dogme des ides, cest cet lan mthodique qui fait le platonisme. Cest l la signification de lensemble du Parmnide. Une fois ruine la thorie des ides, Parmnide engage le jeune Socrate continuer sexercer dans la mthode des hypothses, celle que Platon apprciait si fort dans le Mnon. Il faut non seulement, lhypothse tant pose, examiner ce qui dcoule de cette position , mais voir ce qui rsulte de la ngative (135 a). Cest un exercice de ce genre que contient la seconde partie du Parmnide. On cherche toutes les consquences de lhypothse faite par les Elates ; lun est, puis les consquences de lhypothse contraire : lun nest pas. Les cadres de cette recherche sont dimportance primordiale, parce quils gardent une valeur tout fait gnrale, indpendante de lhypothse quon examine. Pour chacune des deux hypothses, il faut chercher dabord les consquences
p.127
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
94
quelle a pour lUn, puis les consquences quelle a pour les chose autres que lUn. Rechercher les consquences, cest rechercher les attributs que lon doit donner ou refuser lUn, dans chacune des deux hypothses. Mais pour cela, il est indispensable davoir une liste des attributs les plus gnraux (de ces termes communs dont il nous est parl au Thtte) quon puisse accorder ou refuser un sujet quelconque ; Platon arrive une sorte de liste de catgories, dont chaque terme contient dailleurs deux opposs : le tout et la partie, le commencement, le milieu et la fin, le droit et le circulaire (forme), en autre chose et en soi-mme, en mouvement et immobile, mme et autre, semblable et dissemblable, gal et ingal, plus vieux, plus jeune ou contemporain. Seulement, il est trs important de remarquer que lordre dans lequel nous p.128 les citons nest pour Platon nullement arbitraire, en ce sens que lattribution ou la non-attribution de chacune delle au sujet de la recherche est toujours une consquence logique de lattribution ou de la non-attribution de celle qui prcde. Ainsi, dans la premire hypothse, cest parce que lon a dmontr que lUn na ni parties ni tout, que lon peut dmontrer quil na ni commencement ni fin (144e-145b) ; cest parce quil na ni commencement ni fin quon dmontre quil na pas de forme gomtrique (145b). Ces catgories ne sont donc pas comme des cadres prpars davance, mais naissent pour ainsi dire au fur et mesure de la dmonstration. La notion de lUn senrichit ainsi peu peu la manire dont senrichit la notion dune figure mathmatique dont on dcouvre, par voie de consquence, les proprits. Les rsultats de la recherche sont assez dconcertants pour avoir fait de linterprtation du Parmnide un problme fort difficile. En effet, de lhypothse : lun est, Platon montre que lon peut dduire par le raisonnement une double srie de consquences ; dans une premire srie de consquences, on montre quon doit lui refuser chacun des couples de termes opposs que nous avons cits, que, par consquent, il na ni parties ni tout, ni commencement, ni fin, etc. ; dans une seconde srie, on montre au contraire quon doit lui attribuer chacun de ces couples. De la mme hypothse on conclut au sujet des choses autres que lun, quon doit leur attribuer la fois chacun des opposs. De lhypothse contraire la premire : lUn nest pas, on conclut logiquement quil faut attribuer puis refuser lUn les couples de termes quon en avait ni et affirm dans la premire hypothse, et ensuite attribuer puis refuser les mmes couples aux choses autres que lUn. En un mot, Platon semble prendre tche de dmontrer quune mme hypothse a des consquences contradictoires et que deux hypothses contradictoires ont des consquences identiques. Cest pour lever cette contradiction que les no-platoniciens p.129 ont donn du Parmnide, linterprtation complique que nous verrons plus tard ; ils ont suppos que dans chacune des sries de consquences, le mot un et le mot est navaient pas le mme sens ; on peut alors affirmer de lUn les contraires, parce que ce nest pas sous le mme rapport. Mais rien nautorise une pareille interprtation. La signification de cette trange dialectique parat tre bien
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
95
diffrente. Si lon considre avec attention la critique des ides au dbut du dialogue, on saperoit quelle porte moins sur la thse des Ides, prise en elle-mme, que sur les rapports de participation quil y a entre les choses sensibles et les ides ; cest cause de cette participation que les ides devaient ou se couper en parties, ou se sparer delles-mmes et se multiplier chacune linfini. Il resterait, devant cette difficult, faire abstraction, momentanment du moins, de laspect des ides par o elles sont explicatives des choses sensibles pour les considrer en elles-mmes, bref, instituer cette dialectique, dj si nettement dfinie dans la Rpublique (511 b) qui sans utiliser rien de sensible, ne se sert que des ides pour aller, par des ides, dautres ides, et se terminer des ides . Cest ce programme que commence excuter le Parmnide ; il suppose des rapports entre lun et ltre, et il en dduit toutes les consquences possibles, en restant dans le domaine purement intellectuel, et sans faire la moindre allusion aux choses sensibles dont ces ides peuvent tre les modles. Il ne sagit plus, comme dans le Phdon, dexpliquer les phnomnes par des ides, mais de passer dune rgion o la science nest pas possible, o les hypothses se montrent sans force, une rgion o la science est possible. Ce que montre le Parmnide, cest combien sont fcondes les hypothses sur le rapport entre les ides.
X. LA COMMUNICATION DES IDES
@ Ce que va montrer son tour le Sophiste, cest que lhypothse est absolument ncessaire. Le dialogue a pour objet propre les p.130 difficults souleves par la dfinition du sophiste ; si nous disons en effet quil est celui qui ne possde quune apparence de science (233c), il nous chappera en nous disant que lerreur est impossible, puisquelle consisterait penser le non-tre ; or, nest-il pas vrai que le non-tre nest pas (236e-237a ; 241d) ? Pour rsoudre cette question, Platon fait une rvision critique des opinions des philosophes sur la dfinition de ltre. Mais cette critique amne un rsultat surprenant : cest limpossibilit de dfinir ltre en lui-mme, part de tout autre chose. Voici comment : lorsque les Ioniens et Parmnide cherchent dfinir ltre, ils le dfinissent les uns comme multiple, et lautre comme un ; mais ils lui donnent ainsi des dterminations qui ne lui conviennent pas en tant qutre. En quel sens dabord, ltre des Ioniens est-il un couple deux termes ? Sil nest ni lun ni lautre, en particulier, il y a donc non plus deux termes, mais trois ; sil est lun et lautre la fois, il ny a plus deux termes mais un seul. En quel sens, son tour, Parmnide pose-t-il ltre comme un ? Comme il nest pas identique lunit, il y a un tout, fait de ltre et lun ; ou bien ce tout est, et alors ltre nest plus quune partie de ltre ; ou bien il nest pas, et alors ltre nest pas tout. Les Ioniens et Parmnide
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
96
mlangeaient ltre avec autre chose que lui, en ne le sparant pas de ces dterminations quantitatives (243e-245e). Par contre-partie ces hommes terribles qui ne croient qu lexistence de ce quils touchent et qui identifient ltre au corps et les amis des Ides, qui ne voient dans les choses sensibles que flux et devenir incessant et qui ne trouvent ltre que dans certaines ides intelligibles et incorporelles , ont, les uns et les autres, le tort de trop restreindre le sens de ltre. Peut-on dabord le rduire au corps seul ? Mais on est bien forc dadmettre des ralits telles que la justice qui sont effectivement, puisquelles apparaissent et disparaissent dans lme. Veut-on, comme les amis des ides , restreindre ltre ces ralits fixes et p.131 immobiles que sont les ides ? Mais ils ne pourraient avoir le prtention dy saisir l tre total ; ltre total contient ncessairement lintelligence, et par consquent lme et la vie ; tant intelligent, anim et vivant, il nest pas immobile (246a-249a). Cette double polmique contre les matrialistes et les idalistes sadresse des philosophes contemporains quil est malais de dterminer ; dans le premier on reconnat Antisthnes quon a dj vu paratre au Thtte ; quant aux seconds, lembarras est grand : les seuls amis des ides, que nous connaissions cette poque, cest Platon lui-mme et son cole. Ne peut-on pas croire quil critique une conception des ides qui avait t la sienne propre, celle mme quil examine au dbut du Parmnide, et quil avait aujourdhui dpasse ? A cette multiplicit dides isoles et fixes, telles que nous les vmes apparatre dans le Phdon, il opposerait alors ltre total (248e), ce terme assez mystrieux qui parat comprendre non seulement lide ou lobjet qui est connu, mais le sujet qui le connat, lintelligence, et lme dans laquelle elle rside ; il y a ici une bauche que le Time va bientt prciser. En tout cas, la marche des ides reste nette : aux matrialistes, comme aux amis des ides, il reproche de navoir pas vu dans ltre cette puissance dagir et de ptir, cette vie quil y introduit. Mais ce reproche le fait lui-mme retomber dans la difficult quil avait signale chez Parmnide et les Ioniens. Nest-il pas juste, dit ltranger dle qui mne la discussion, que lon nous pose maintenant les questions que nous posions nous-mmes ceux qui disaient que le tout tait le chaud et le froid ? (250a). Nous oscillons ncessairement dune notion de ltre trop restreinte une notion trop tendue ; ds que nous voulons le borner lui-mme, il est trop pauvre ; et le trouvant trop pauvre, nous lui donnons des attributs, mouvement, vie, intelligence, qui le dpassent. Limpossibilit de penser ltre en lui-mme et sans relation avec dautres termes que lui, nous rvle une ncessit, celle p.132 de la communication et du mlange entre des termes tels que tre, mouvement, repos, etc. Ce que la pense atteint, ce ne sont jamais des lments, isols, ce sont toujours des mixtes. Lobjet de la pense, comme le mot qui est compos de voyelles et de consonnes, comme la musique, compose de sons aigus ou graves, est fait de concepts qui sunissent les uns aux autres. Chercher dfinir les concepts en
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
97
dehors de cette union, cest peut-tre ce qui a t la cause du rsultat toujours ngatif des dialogues de Socrate ; on natteint un concept quavec les relations quil a avec dautres. De l une manire nouvelle denvisager la dialectique ; la dialectique est lart qui donne les rgles du mlange des concepts, comme la musique donne les rgles de lunion des sons (253ad). Cette conception de la dialectique est sans doute proche de ce que sera la logique dAristote ; elle en est toutefois fort distincte. En premier lieu, il ne sagit pas de mlanger des concepts pralablement dfinis ; Platon lindique avec une force singulire : quelque attribut que lon puisse donner une notion, elle le possde, non par elle-mme, mais par participation une autre ide : sparer tout de tout, cest faire compltement disparatre tous les discours ; on ne peut rien formuler que par liaison des ides les unes avec les autres (259 e). La pense passe donc de lindtermin au dtermin ; elle ne se contente pas dexpliciter les rapports de notions dj dtermins. En second lieu, et pour la mme raison, lart de la dialectique procde non pas par lapplication de rgles gnrales des cas particuliers, mais par lexamen direct de chaque notion, qui nous renvoie delle-mme aux notions avec laquelle elle doit sunir : ainsi le repos et le mouvement se mlangent avec ltre, mais ils sont incapables de se mlanger entre eux (254d) ; mais, si le mouvement est tre en tant quil participe ltre, il est non-tre, en tant quil est autre que ltre, cest--dire en tant quil participe lautre (255e). Il semble bien que, dans la connaissance directe et immdiate de ces relations, le rle p.133 primordial est jou par cette intuition intellectuelle que Platon, dans la Rpublique, avait mise au sommet de la hirarchie des connaissances. Car la mthode consiste saisir ce que veut lide que lon examine, obir ce que lon voit dans les notions (252e). Et par l, la dialectique platonicienne diffre autant de la pense discursive que la mthode cartsienne diffre de la logique.
XI. LE PROBLME DES MIXTES. LA DIVISION
@ A partir de ce moment, tout leffort de Platon va porter sur lart de saisir les rgles des mixtes ou mlanges. Effort singulirement divers qui va des exercices scolaires de division, jusqu la majestueuse synthse du Time ; effort qui aboutit plutt dailleurs donner des directions et favoriser llan de la pense qu crer une doctrine. Dans le Phdre dj (265d), il avait dfini la dialectique par deux mouvements successifs ; dabord, on voit les choses disperses en une seule ide ; puis, par un mouvement inverse, on divise, ides par ides, selon les articulations naturelles. Il est remarquer que lanalyse ou division suit ici la synthse et que la synthse, loin dtre le terme de la pense et de suivre lanalyse, est au contraire destine servir de point de dpart la division qui est ainsi lessentiel de la dialectique. Les exercices de division que lon trouve au dbut du Politique (258c-267c) et du
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
98
Sophiste (218d-231c), montrent sans doute comment Platon faisait pratiquer la dialectique par ses lves de lacadmie. La division y est prsente comme le procd qui sert dterminer de plus en plus prcisment un concept ; elle aboutit en somme une dfinition ; par exemple, la politique est une science ; mais les sciences se divisent en sciences qui ont pour but la connaissance et sciences qui ont pour but la pratique ; la politique rentre dans la premire classe ; les sciences de la connaissance se divisent leur tour en sciences p.134 qui prescrivent et sciences qui jugent ; la politique est parmi les premires ; ainsi, de division en division, on arrive dterminer de plus en plus le concept. Il est clair que la division platonicienne nest pas un procd purement mcanique ; sans quoi il nchapperait pas la critique dAristote, selon qui il est tout fait arbitraire de placer le terme sur lequel porte la recherche dans un membre de la division plutt que dans lautre 1. Ce nest pas en effet un procd logique, mais lintuition qui peut guider dans ce cas. De plus, si cest une rgle peu prs gnrale que la division doit tre binaire, la rgle pour oprer cette division est peu prcise et soulve de grandes difficults techniques que Platon connat fort bien, mais quil ne rsout pas. Une des plus grosses est de savoir comment distinguer les divisions arbitraires, telles que celle dhomme en Grecs et Barbares des divisions lgitimes telles que la division en mle et femelle ; dans un cas le premier groupe (Grecs) est seul termin, et le second ne lest que par exclusion du premier ; dans le second, nous avons deux caractres opposs galement positifs (262e ; 263b). Mais quel rapport ont entre elles ces deux conceptions de la dialectique, la dialectique comme art de la composition des mixtes, dans le Sophiste, et la dialectique comme art de la division ? Cette question est rsolue dans le Philbe. Ce dialogue nous montre comment lart de composer les mixtes a pour rsultat le classement et la division en espces. Le rapprochement et lunion des deux aspects de la dialectique, ailleurs spars, en rend la notion bien plus nette. Mais dabord la notion du mixte se prsente sous une forme nouvelle ; tout mixte, digne de ce nom, nest pas une fusion arbitraire, mais une combinaison bien fixe de deux lments : dun lment indtermin ou illimit, et dune limite ou dtermination fixe. Lindtermin est un couple dopposs tel que chacun deux p.135 ne soit dfini quen rapport avec lautre, cest--dire soit en lui-mme tout fait indfini ; tels sont plus grand et plus petit, plus aigu et plus grave, plus chaud et plus froid ; termes purement relatifs et perptuellement fluents, puisque ce qui est plus grand quune chose est en mme temps plus petit quune autre. La limite ou dtermination, cest un rapport numrique fixe, tel que le double ou le triple. Le mixte, on le voit aisment, rsulte donc de lintroduction dun rapport fixe dans le couple dopposs ; ainsi les musiciens dmontrent quun rapport de un deux, introduit dans la dyade illimite de laigu et du grave, cre loctave ; on peut concevoir de mme manire quun rapport fixe du lent et du rapide cre un mouvement rgulier, ou faire sortir les formes dun rapport fixe de grandeur et
1
Premiers Analytiques, I, 31.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
99
de petitesse 1. Cette conception du mixte permet et mme implique la division des concepts : la division part dun illimit tel que la voix avec ses nuances infinies daigu ou de grave ; elle y introduit un certain nombre dintervalles fixes, qui sont les accords, caractriss par des rapports numriques fixes tels que 1/2, 1/3, etc. La science consistera connatre le nombre et la nature de ces rapports fixes (18 b). Cette conception du mixte et de la division nest plus tout fait celle du Sophiste. Dabord, il nest plus question dune division uniformment binaire ; dans le cas le plus parfait tout au moins, celui de la musique, le nombre des termes est dtermin par celui des rapports numriques possibles que sont les accords. Nous en voyons un autre exemple dans le Time (54a sq.), o la division en quatre lments dpend du nombre des solides rguliers possibles. Il y a plus : le mlange dun genre avec un autre dans le Sophiste vient de sa nature mme ; ltre, pour tre ce quil est, doit participer au mme et lautre ; il y a l comme le rudiment dun rapport de ncessit logique. Au contraire, lillimit et la limite ne sappellent pas et ne p.136 simpliquent pas ; il faut pour les joindre un quatrime genre dtre, diffrent deux comme du mlange, cest la cause du mlange (26e). Cest dire que, la liaison logiquement ncessaire vers laquelle inclinait le Sophiste, se substituent maintenant des considrations dharmonie, de convenance, de beaut et de bont. Lide du Bien, qui dominait la dialectique dans la Rpublique et qui stait efface dans les dialogues intermdiaires reprend ici, en mme temps que les mathmatiques, un rle de premier plan. Et, ne pouvant dfinir le Bien dans son unit, il y substitue au moins un quivalent fait de trois termes, la beaut, la symtrie et la vrit (65a). Il ne fait ainsi que poser les trois conditions primordiales auxquelles doit rpondre tout mlange ; ces trois termes expriment chacun, sous un aspect diffrent, ce quil appelait dans la Rpublique linconditionn, le Bien, quoi cesse lexplication.
XII. LE PROBLME COSMOLOGIQUE
@ La notion du mixte qui possde beaut, proportion et vrit fut le vritable stimulant des dernires tudes de Platon ; elle lui permit de revenir au problme de lexplication des choses sensibles par les ides, problme quil avait sans doute abandonn devant les difficults quexpose le Parmnide sur la participation. Cest l lobjet du Time. Mais, pour bien saisir ce retour dintrt vers la physique, il faut bien voir que les choses sensibles ne lui apparaissent plus, comme dans le Thtte, comme un flux sans cesse vanouissant, mais comme des parties dun cosmos qui est lui-mme le plus beau des mixtes sensibles, cest--dire un mlange ordonn selon des rapports
Philbe, : 23 c-29 c ; surtout 23 d ; 26 ad.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
100
fixes 1. Sil en est ainsi, le problme de lexplication du monde physique noffre pas de difficult qui lui soit inhrente ; il nest plus quun p.137 cas particulier du problme dialectique en gnral, qui consiste, daprs le Philbe, dterminer la manire dont se forment les mixtes. Le problme de la participation est donc rsolu. Le monde est n dun passage du dsordre lordre sous laction dun dmiurge (30a). Ltat de dsordre antrieur cette action est essentiellement le domaine de la ncessit , dune ncessit brutale, cause errante, qui nest assujettie aucune considration de fin (47e-48a). Mais ce dsordre et cette ncessit ne signifient nullement une radicale inintelligibilit ; cest une sorte de ncessit mcanique analogue celle quacceptait Dmocrite, mais o Platon introduit, sinon la bont du dmiurge, au moins une certaine part dintelligibilit gomtrique. La doctrine des atomes et la doctrine des lments y paraissent, mais pntres desprit gomtrique ; les lments y sont composs de corpuscules, et les corpuscules dun lment donn sont distincts les uns des autres non point par leurs qualits, mais par leur forme gomtrique ; les corpuscules lmentaires de chaque sorte ont la forme dun des quatre polydres rguliers, cube, icosadre, octadre, ttradre correspondant respectivement la terre, leau, lair et au feu. Lingniosit mathmatique de Platon, guid par les rcentes dcouvertes de Thtte en stromtrie, na nullement de peine dmontrer que les faces du cube peuvent se composer de quatre triangles rectangles et isocles, et que les faces de chaque autre polydre qui sont des triangles quilatraux peuvent toutes se composer de six triangles rectangles, dont lhypotnuse est double du petit ct de langle droit. Les transmutations des lments les uns dans les autres deviennent parfaitement intelligibles (en laissant de ct la terre), quand on aura dmontr quun corpuscule deau contient autant de triangles que deux corpuscules dair, plus un de feu, et quun corpuscule dair en contient autant que deux corpuscules de feu (53c-57c). Voil la raison au sein mme de la ncessit. La ncessit brute apparat dans la disposition de ces corpuscules, qui dpend de la manire dont ils ragissent p.138 aux secousses dsordonnes du rceptacle ou espace dans lesquels ils sont ; ils tendent, comme les substances secoues dans un crible, se runir selon leurs ressemblances et leurs affinits (57bc). La source de la ncessit est donc non pas dans les lments, mais dans cette nature ambigu, ce concept btard, peine croyable du rceptacle (52b). Ce rceptacle parat bien tre un de ces termes indtermins, dont le Philbe nous a fourni des exemples ; dune manire prcise, cest la fois lindtermin gomtrique en ce sens quil na aucune dtermination de grandeur et de petitesse et quil les a toutes (50cd) et lindtermin mcanique, en ce sens que son mouvement, sa lenteur et sa vitesse, nont aucune uniformit (52e). Cest ce rceptacle que les triangles lmentaires dabord, puis les polydres qui en sont issus commencent dterminer en y introduisant des rapports fixes de grandeur et de petitesse
1
26 a ; cf. 30 b, le monde est un vivant dou dme et dintelligence.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
101
(53c). Cest en lui que lintelligence du dmiurge va introduire dautres dterminations, et en particulier des dterminations mcaniques. Car le crateur ou dmiurge est avant tout le crateur de lme du monde (34cd), et lme est principe de mouvement (Phdre, 245c ; Lois, 894d), non pas au sens de force mcanique brutale comme est le rceptacle, mais principe de ce quil y a de rgulier et de fixe dans le mouvement. Lme du monde est antrieure au corps quelle est destine animer et qui est log en elle ; mais elle est elle-mme un mixte o se dessinent en quelque sorte toutes les relations arithmtiques ou gomtriques qui se raliseront dans le monde. Tout mixte est compos dune limite et dun illimit ; il ne se distingue dun autre que par laspect que prsentent les deux termes ; la limite et lillimit dont lme est compose sont lessence indivisible, et lessence divisible dans les corps (35a) ; toute dtermination numrique et gomtrique exige en effet deux termes de ce genre ; nous apprenons par Aristote que, selon lenseignement oral de Platon, les nombres naissent de laction de lUn sur la dyade p.139 indfinie du grand et du petit 1 ; tout nombre, toute forme sont le rsultat dune dtermination de ce qui tait dabord indtermin. Le mixte de ces deux essences une fois produit, le dmiurge y mlange encore le mme et lautre, cest--dire deux termes qui sont aussi entre eux comme la limite et lillimit du Philbe. Platon a soin de nous dire que lautre nentre dans le mlange que par force ; il reste, on va le voir, principe dindtermination. Lme est donc faite de trois choses : un mlange des deux substances, divisible et indivisible, du mme et de lautre : Le mixte est maintenant divis selon certains nombres dtermins comme termes de deux progressions gomtriques 1, 2, 4, 8 ; 1, 3, 9, 27, entre lesquels on insre des moyens proportionnels. Puis il est divis en deux branches qui se croisent angle aigu et se recourbent ensuite en cercle ayant mme centre, un des cercles tant inclin sur lautre, comme lcliptique sur lquateur ; le cercle du mme, anim dun mouvement vers la droite, cest--dire dorient en occident, reste unique ; le cercle de lautre anim dun mouvement vers la gauche, cest-dire doccident en orient, est divis en sept. On voit assez que, sous le nom dme du monde, Platon sefforce de montrer comment on arrive une sorte de construction rationnelle du systme astronomique tel quil le concevait et dont les principes taient quil ny avait que des mouvements circulaires ; que les mouvements taient uniformes, et que lirrgularit apparente du mouvement des sept plantes sexpliquait parce quelles taient animes, outre le mouvement diurne, dun mouvement propre en sens contraire. Lme nest quun dessin schmatique du systme astronomique (35a-36d). Le Time est un rcit, un mythe ; le pythagoricien Time y raconte comment se sont forms les divers mixtes, me du monde, monde, corpuscules lmentaires, sans vouloir atteindre mieux qu des conjectures vraisemblables (29c-e) ; ton dont la modestie, p.140 inspire de Parmnide,
1
Mtaphysique, M. 7, 1081 a l4-15.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
102
tranche avec le dogmatisme ionien. Il est clair, au surplus, que, dans lemploi physique des schmes mathmatiques, il est guid par des considrations dharmonie et de beaut ; la seule raison de la formation du monde, cest que le dmiurge tait bon (29e) ; le Bien reste linconditionn quoi se rattache toute preuve. La forme sphrique du monde, le fait quil est unique, viennent de ce quil sefforce dimiter la perfection du modle (32b ; 31ab). Le temps, divis en priodes rgulires, jours, mois, annes, qui est li lexistence des rvolutions clestes, imite autant que possible lternit du modle par son retour incessant sur lui-mme (37d). Dans le dtail de la physiologie quil nous expose la fin de luvre, Platon est aussi perdument finaliste que le seront les stociens ; le Xe livre des Lois affirme aussi avec force que la providence divine nest pas seulement gnrale, mais pntre jusquaux moindres dtails de la structure de lunivers (903 bc). Cest parce que la thorie du monde est avant tout le rcit de luvre providentielle, quelle garde son caractre arbitraire et intuitif. Lesprit humain ne peut que souponner les intentions du dmiurge, il nen est jamais sr (29e-30a). De plus, le dmiurge en pliant la ncessit lintelligence (47e-48a), en sefforant de la faire obir, rencontre des rsistances qui vont croissant ; si le premier mixte, le corps du monde, est fait si harmonieusement quil est imprissable quoique engendr (41ab), les mixtes partiels, faits par les dieux imitateurs du dmiurge, les corps des animaux, sont sujets la mort (41cd ; 43a) ; la srie des mixtes va en perfection dcroissante, et leur conservation est de moins en moins assure. Par un paradoxe apparent, larbitraire sintroduit dans la science des choses physiques dans la mesure o sy introduisent les mathmatiques : larbitraire, mais en mme temps une libert de regard, qui, dtachant lesprit des illusions de lobservation immdiate, lui permet un jeu dhypothses fcond. Cest par exemple grce cette libert desprit que Pluton a pu peut-tre p.141 indiquer en passant lexplication du mouvement diurne par la rotation de la terre autour de son axe 1.
XIII. LENSEIGNEMENT ORAL DE PLATON
@ Les dialogues ne nous font pas connatre tout Platon. Aristote 2 nous a heureusement conserv quelque chose de son enseignement oral, bien quil soit souvent difficile de dmler la pense de Platon, dans cet expos fait avec une intention critique, et souvent mlang avec les thses des successeurs de Platon lAcadmie. Il en rsulte pourtant que, la fin de sa vie, Platon a
1
Telle tait, ds lantiquit, linterprtation du mot par Plutarque ; (Questions platoniciennes, qu. VIII) ; mais cette interprtation nest pas certaine, et le sens peut saccommoder de limmobilit de la terre. 2 Mtaphysique, M. 7 et 8.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
103
conu les ides comme des nombres, mais comme des nombres diffrents de ceux quemploie le mathmaticien. Que sont les nombres idaux ? Pourquoi Platon les a-t-il substitus ou tout au moins superposs aux ides ? Et dabord, comment se distinguent-t-ils des nombres mathmatiques ? Les nombres mathmatiques sont ceux qui sont forms dunits toutes gales entre elles, et qui rsultent de laddition de ces units. Or, nous voyons, dans le Philbe et dans le Time, que Platon a une prdilection manifeste pour la gnration des nombres qui se fait autrement que par laddition, et, spcialement, pour celle qui se fait par les progressions ou par linsertion des trois espces de moyennes proportionnelles, arithmtique, gomtrique ou harmonique 1 : son attention tend se porter sur les rapports numriques plutt que sur les nombres mmes. La musique pythagoricienne lui fait voir lessence des choses dans des rapports numriques, encore plus que dans les nombres. La thorie des nombres idaux semblent bien tre une tentative pour trouver les types de rapport les plus p.142 gnraux. Ces nombres, nous dit Aristote, ne rsultent pas de laddition, puisque leurs units ne peuvent sadditionner, mais de lunion de deux principes, lUn et la dyade indfinie du grand et du petit 2. Cette dyade nest autre chose que le rapport pleinement indtermin et fluent dont le Philbe (24c-25a) nous donnait des exemples. Quant lUn, on sait, daprs une tradition clbre, que Platon lidentifiait au Bien 3 ; or la fonction du Bien, daprs le Philbe, est dintroduire des rapports fixes entre les choses, ce qui est possible par la mesure. LUn dAristote et le Bien de la leon de Platon paraissent identiques la mesure, que le Politique considre comme le point de dpart de la dialectique. LUn, cest ce qui permet de mesurer, et cest le terme inconditionn au del duquel on ne remonte pas. Cest ainsi, daprs Aristote, que le grand et le petit, dingaux quils sont, peuvent tre galiss par lapplication de lUn, et ainsi on obtiendra la dyade idale, compose des deux termes du rapport, non pas en ajoutant une unit une autre, mais en galant le rapport indtermin lunit. Sans poursuivre le mode compliqu de production des nombres idaux, que Platon suit jusqu la dcade idale, on voit par lexemple de la dyade idale que les nombres idaux sont avant tout des rapports fixes. Il est assez naturel de penser que ces nombres idaux sont principe du modle ternel du monde dont il nous est parl dans le Time (28b), comme lme faite de schmes gomtriques combines selon certains rapports numriques est principe du monde sensible. Le Vivant en soi (30a) parat dsigner la ralit intelligible tout entire qui comprendrait au-dessous des nombres idaux, les espces intelligibles, comme le monde, vivant, anim et intelligent, comprend au-dessous de lme, le corps. Il reste en tout cas certain que Platon orientait ses recherches vers les lois de combinaison des mixtes.
1 2
Time, 31c sq. M. 7, 1081 a, 14 3 Daprs ARISTOXNE (contemporain dAristote), dans ses Elments dHarmonie, II, p. 30, d. Meibom.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
104
XIV. PHILOSOPHIE ET POLITIQUE
@ Cest seulement par abstraction que lon peut sparer la politique de Platon de sa philosophie. Ses plus grandes uvres sont du mme coup des uvres philosophiques et politiques. Le Gorgias, o il montre les dangers dune politique non fonde en raison, la Rpublique, o la philosophie est utilise comme le seul moyen darriver une politique viable. La trilogie Sophiste, Politique et Philosophe 1, dont le dernier dialogue est rest en projet, tendait sans doute montrer les capacits politiques du philosophe. La trilogie Time, Critias, Hermocrate, dont Platon na crit que le premier dialogue et le dbut du deuxime, devait, aprs la formation du monde, dcrite dans le Time, traiter des rvolutions des cits, de leur ruine et de leur rtablissement. Les Lois enfin sont un vritable manuel du lgislateur. Il nest pas plus lgitime de sparer la philosophie de la politique chez Platon que chez un Auguste Comte. Comment oublier que llan vers la philosophie lui vient de Socrate, qui insiste avec une telle force dans lApologie sur sa mission sociale ?
p.143
Platon, comme Socrate, croit fermement la mission sociale du philosophe. Aprs avoir dpeint, dans la Rpublique, le rgime de la cit idale, il se demande quelle condition un rgime approchant pourra passer dans les faits ; il suffirait dun seul changement mais qui nest point petit, ni facile, quoiquil soit possible..., cest que les philosophes soient rois dans les cits, ou que les rois et les dynastes soient de bons philosophes, cest que autorit politique et philosophie concident (473b). Il faut donner cette exigence un sens tout fait pratique ; cest au moment mme o Platon passe de la thorie la pratique, quil fait intervenir lautorit politique du philosophe. Platon ne se lasse pas dinsister sur le rle actif qui p.144 convient au philosophe : il faut le forcer descendre de la contemplation des choses intelligibles pour soccuper des affaires de la cit (519d) ; il faut aussi prparer cette rforme lopinion du vulgaire, port, cause mme des vices du gouvernement, considrer la philosophie comme inutile la cit (500b). La philosophie procdera sur la cit comme le peintre sur la muraille quil orne ; il la nettoiera dabord soigneusement, puis il y dessinera la forme de la cit, en comparant chaque instant son dessin au modle du juste quil est capable de contempler (501a). Comment Platon est-il arriv cette vue clbre, qui parat tre lutopie sociale par excellence ? Do vient cette ide dune reconstruction rationnelle de la cit ? Quelle en est la signification exacte ?
Cf. lindication du plan densemble, Sophiste, 217 a.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
105
XV. LA JUSTICE ET LA TEMPRANCE
@ Avant de se prsenter, dans la Rpublique, comme rformateur de la cit, Platon parat avoir rflchi sur la justice plutt en moraliste, la manire de Socrate, quen rformateur politique. Il a montr que lhomme devait tre juste, cest--dire respectueux des lois, pour tre heureux, avant de prouver que le philosophe pouvait seul concevoir et raliser les justes lois. Il est moraliste avant dtre politique, contrairement aux jeunes ambitieux dAthnes, immortaliss dans le Callicls du Gorgias, qui sadonnent sans prparation la politique. De cette morale platonicienne, les deux ples, pour ainsi dire sont dans le Gorgias qui soutient la justice contre le banditisme politique, et dans le Phdon, pour qui la vie philosophique consiste se purifier du corps. Voyons dabord le premier des deux thmes. Dans le Criton, Socrate tait reprsent comme respectueux des lois jusqu en mourir ; et lon connat la clbre prosopope, o les lois p.145 dAthnes montrent Socrate tout ce quil leur doit (50a) ; Platon a le sentiment trs vif que delles dpendent non seulement la scurit, mais toute culture morale. Mais les lois, objecte Callicls, ne sont-elles pas de simples conventions que les hommes du vulgaire ont faites entre eux pour se dfendre contre lavidit des puissants ? La justice naturelle consiste dans des rapports de force, et le plus fort doit possder lautorit (Gorgias, 482c-484c). Quest-ce donc que cette force, dont parle Callicls ? Est-ce la force physique pure et simple ? Alors elle appartient au peuple, sil a la force dimposer les lois (488be). Cest donc la force, accompagne de sagesse et dhabilet, ou, plus prcisment, de la connaissance raisonne de la politique et du courage pour raliser ses desseins (491ad). Mais le courage, qui donne de lautorit sur les choses, implique cette forme intrieure de courage, cette autorit sur soi-mme, qui est la temprance. Car le bien nest pas identique au plaisir, et, sil faut choisir entre les plaisirs ceux qui sont utiles, bons et sains, on ny arrive que grce la temprance qui introduit un certain ordre dans le corps et dans lme, en laguant les dsirs contraires cet ordre (504c-505b). Ce dveloppement sur la temprance, ou vertu de lordre, parent de lgalit gomtrique, est le point culminant du Gorgias (508a) ; en cette vertu, quil avait dj cherch dfinir dans le Charmide, il trouve ici le fondement de toutes les autres, de la pit, de la justice, du bonheur. La temprance est lactivit rgle par lordre et soppose directement lactivit brutale et sans frein de Callicls. Platon entrevoit ici une vrit, qui fait ainsi le fond de sa philosophie, et quil dveloppera avec force dans sa vieillesse 1, cest que cette activit quon appelle lart, qui choisit et agit selon des rgles, est antrieure cette prtendue nature dsordonne et drgle que veut suivre Callicls. Le primat de lart, au cur mme des choses naturelles et de lordre
1
Lois, X, 889 e.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
106
du monde, est un postulat de p.146 toute la politique comme de toute la philosophie de Platon. Lordre nest pas une conqute humaine sur les forces drgles ; il est plutt le fond du rel, qui nous est rvl par une intuition intellectuelle. Si la temprance, avec la technique qui discerne et ordonne, est la vertu fondamentale, lasctisme du Phdon et le gouvernement des philosophes dans la Rpublique seront deux aspects insparables de cette vertu ; si elle ne parat pas occuper dans ces deux dialogues la place centrale quelle a dans le Gorgias, lide qui linspire, celle de la valeur suprieure et dominatrice de lintelligence, reste le point de dpart. Dans le Phdon (82e sq.) la recherche de la vrit saccompagne de labstinence des plaisirs : lme est fixe au corps par le dsir, et elle est force de regarder travers le corps o elle est comme en prison ; mais la philosophie lui enseigne que la vision et les autres sensations sont pleines derreurs ; elle lui apprend ne croire qu elle-mme et ses penses propres ; ainsi elle dtache lme du corps, et fait quelle sabstient autant que possible des plaisirs, des dsirs et des peines. La vritable vertu consiste saffranchir de toutes les affections ; aussi bien que la temprance, la justice, le courage et la prudence sont des purifications (69a). Mais dautre part, la temprance est aussi une vertu qui prescrit lordre ; elle na pas moins dimportance comme technique positive que comme rgle dasctisme. La conclusion du Gorgias est, cet gard, significative, et elle annonce la Rpublique ; les hommes ne seront amliors que grce une technique scientifique que nont jamais possd ni les illustres politiques dAthnes ni les sophistes qui viennent y instruire la jeunesse (513c-515d). En dfinitive, la justice parat tre maintenant, non plus comme dans le Criton, la simple obissance de lindividu aux lois de son pays, mais bien lexigence dune rforme politique complte, sous la conduite des philosophes.
XVI. LE PROBLME POLITIQUE
@ partir de ce moment que llan est donn la pense politique, qui se subordonne et la morale et la psychologie. Mais elle nest plus dans la situation de la dialectique qui, elle, ne quitte pas le monde des ides ; elle se brise au contraire sans cesse contre les faits. Platon, rptons-le, veut tre non pas un utopiste, mais un rformateur ; comme rformateur, il doit tenir compte de la nature des hommes et de la nature des choses, telles quelles sont donnes. Ce quil y a dtrange chez ce rformateur, cest quil est tout au contraire des sophistes bien loin de croire au progrs. Il a beaucoup mdit sur lhistoire et lvolution des socits, comme sur lhistoire des mes individuelles, mlant dailleurs lobservation psychologique prcise le mythe et la
p.147 Cest
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
107
lgende ; mais lobservation comme le mythe met toujours en lumire cette double conclusion que la part de justice et de vertu quil y a en un individu ou en une socit dpend surtout des conditions extrieures, dune heureuse chance, et que, sil y a des changements dans les socits, le changement a toujours lieu vers le pire ou au mieux selon un rythme cyclique qui fait repasser la socit par les mmes tapes. La lgislation, ft-ce celle dun philosophe, a pour but de se servir le mieux possible des conditions de fait quil trouve devant lui, et aussi, darrter ou dentraver les changements, de donner la socit la plus grande stabilit possible. Jamais, au contraire, on ne voit, chez Platon, lide dune rforme positive, dune vritable invention sociale ; il sagit toujours chez lui de maintenir et de conserver, ou bien dlaguer et de supprimer ; il est bien significatif, le mythe qui raconte que les hommes nont vit la dcadence complte que parce que des dieux leur ont fait connatre le feu, appris les arts, et donn les graines du bl (Politique, 274e) ; linitiative des hommes naurait pu les mener jusque l. Le but de la rforme du philosophe ne peut tre alors que dimiter autant quil est possible ltat de socit le plus parfait, dont il possde lide, de prendre en quelque sorte la socit au niveau o elle existe actuellement pour lempcher de tomber plus bas (Lois, IV, 713e) ; mais jamais il ne sagit de promouvoir un progrs vritable. Si une socit prsente les conditions requises pour que sy appliquent les efforts du philosophe, cest par chance, par une srie de circonstances indpendantes de toute volont humaine, grce, par exemple, la faveur du climat et du sol (704 a sq.), que lon fasse dailleurs de cette chance leffet dun hasard ou de la providence divine.
p.148
De l le caractre positif et raliste, conservateur mme parfois, de la politique platonicienne ; de l, son got, croissant avec lge, pour lhistoire et les antiques traditions 1 ; de l, sa condamnation de toute la politique dexpansion qui avait fait la grandeur dAthnes, mais aussi boulevers les murs 2. Il est rest attach uniquement la forme traditionnelle de la cit grecque. Il est bien entendu, par exemple, que dans la Rpublique, cest une cit grecque quil a administrer (470e). Si plus tard, dans le Politique (262 cd), il a jug ridicule la division de lhumanit en Grecs et Barbares, il nen est pas moins vrai quil veut avant tout fortifier lhellnisme, ramener la paix entre les cits et faire cesser les pratiques de pillage et de rduction lesclavage qui accompagnaient les victoires dune cit sur une autre 3.
XVII. JUSTICE SOCIALE
@
1 2
Prologue du Time et Critias. Gorgias, 508 e-519 b. 3 Rpublique, V, 469 b sq.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
108
Lessentiel de la justice sociale, chez Platon, cest de faire lunit de la socit (Rpublique, IV, 423 d). La justice dans les cits imite, autant quil est possible, les essences idales bien p.149 ranges, gardant toujours le mme rapport, sans se faire mutuellement aucun tort, disposes par ordre et selon la raison (VI, 500c) La cit juste nous donne un de ces exemples de multiplicit bien ordonne ; de ces mixtes, dont cest laffaire du dialecticien de dcouvrir la nature. Cest lorsque lon saura ce quest ce mixte, que lon pourra dterminer ce quest lme juste, la justice dans lme tant une ordonnance de ses parties, en tout analogue lordonnance des parties de la socit, qui constitue la justice sociale. La Rpublique se distingue des crits politiques suivants de Platon, en ce quelle insiste davantage sur les conditions de cette unit. Il prsente sa recherch sous la forme dune histoire de la socit, exactement comme dans le Time, les conditions de la stabilit du monde se dcouvrent dans lhistoire de la formation du monde par un dmiurge ; et il arrive que, dans cette histoire, sa vue stend bien au del de la rforme dune cit grecque, jusquaux conditions fondamentales de tout agrgat humain 1. La cit nat du besoin et de la dcouverte du moyen rationnel pour la satisfaire. Ce moyen, cest la division du travail. Il y a cit, ds quil y a runion de quatre ou cinq personnes qui conviennent de satisfaire chacune un des besoins lmentaires de tous les autres, en nourriture, en vtement et en logement ; le laboureur qui produit la nourriture de tous, aura en revanche son abri et son vtement faits par les autres. Chacun, spcialis dans son mtier, produira plus et mieux. La cit, sous sa forme lmentaire, nest donc pas une runion dtres gaux et semblables, mais au contraire dtres ingaux et dissemblables ; elle le restera sous ses plus hautes formes, et cest ce qui garantira la solidarit de ses parties et son unit (370ab). Les fonctions deviendront plus compliques, mesure que la masse de la cit saccrot et que les besoins se multiplient ; ct du laboureur, par exemple, il y aura un fabricant spcial de p.150 charrues et doutils agricoles (370c) ; ct des producteurs se crera la classe de ceux qui font les changes, des commerants par terre et par mer (371ab). Mais le principe reste toujours le mme. Il reste le mme encore, lorsque, dans la cit arrive son achvement, les fonctions se groupent en un petit nombre de classes, la classe des artisans qui soccupent de satisfaire les besoins matriels, la classe des soldats qui dfendent la cit contre ses voisines (373c), la classe des gardiens qui sont chargs de faire observer les lois. Ces trois classes reprsentent les trois fonctions essentielles de toute cit, production, dfense, administration intrieure (434c). Comment ces fonctions seront-elles le mieux remplies, cest l pour Platon lunique problme social. Il ne peut tre question en effet dutiliser les ressources de la cit pour le bonheur dun individu ou dune classe. Nous
1
369 b, sur la division du travail.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
109
fondons la cit, rpond Socrate Adimante qui lui reproche la vie trop dure quil fait mener aux gardiens , non pour quune classe ait un bonheur suprieur, mais pour que la cit entire soit heureuse. 1 Lindividu qui fait partie de la cit est fait pour accomplir sa fonction sociale, et non pour autre chose. Cest en quoi consiste la justice ; tre juste, cest accomplir sa fonction propre (434c).
XVIII. NATURE ET SOCIT
@ Ici se prsente Platon une question redoutable. Les besoins de la socit idale doivent compter avec la nature. En effet, lexercice de chaque fonction sociale suppose non seulement une ducation acquise, mais encore des aptitudes naturelles. Lamour du gain chez lartisan, la passion gnreuse ncessaire chez le soldat, la prudence et la rflexion chez le gardien de la cit ont pour fond un caractre inn quaucune forme sociale p.151 ne pourrait produire (455b). Il y a plus : les proportions diverses dans lesquelles ces caractres existent, dpendent de la nature du milieu gographique. Une rgion, dira-t-il la fin de sa vie, nest pas propre lgal dune autre rendre les hommes meilleurs ou pires 2. Ltude des nombres qui, chez certains, mne jusqu la philosophie et la dialectique, produira, chez les gyptiens, les Phniciens et chez tant dautres peuples, la fourberie et non la science. Cette nature, Platon y attache une importance extrme : en particulier, lorsquil vient parler des vritables chefs de la cit, des philosophes, il ne se lasse pas de recommander de choisir, selon leurs aptitudes naturelles, ceux qui seront capables de recevoir lenseignement de la dialectique ; et il fait une liste trs dtaille des qualits innes indispensables : amour de la vrit et facilit apprendre, faiblesse des dsirs qui sopposent la connaissance, noblesse dme et courage, enfin, une mmoire prcise et tendue 3 : la runion de ces qualits est trs rare, puisquil y a presque incompatibilit entre les qualits quon leur demande, notamment entre la subtilit dun esprit sans cesse actif et la gravit calme, entre linertie de lhomme insouciant des prils et le regard aigu qui les pntre 4 : la noblesse dun vieil Athnien et la subtilit dun sophiste, voil ce que doit runir la nature philosophique. Or, entre les exigences de la socit idale et ce que lui fournit la nature, il ny a pas ncessairement harmonie. Il y a l tout un ct de la ralit qui chappe aux prises de lart humain ; il nest pas de penseur qui en ait tenu plus grand compte que Platon. Pour expliquer ce donn ultime, cette ralit des caractres, qui rsiste la raison, et qui pourtant nous fixe chacun notre
1 2
419b ; comparer 465e sq. Lois, 747d. 3 Rpublique, 490 e. 4 503 b.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
110
destine, il a fait appel un mode dexplication qui est lui-mme irrationnel ; au mythe du choix des vies. Aprs cette p.152 vie, les mes subissent des chtiments ou profitent de rcompenses, selon la justice dont elles ont fait preuve ; puis elles se runissent pour choisir une nouvelle vie : ce choix est pleinement volontaire, et les dieux nen sont nullement responsables ; mais, une fois fait, il est sanctionn par la ncessit et les Moires, et lme nchappera plus son sort ; elle passe avant de renatre dans leau du Lth qui lui enlve tout souvenir de son choix ; puis sa nouvelle vie se droule conformment ce quelle a voulu. On voit, par la place quil occupe la fin de la Rpublique (617d-622b), quelle proccupation politique trahit ce mythe, bien quil ny soit question que de la destine individuelle. Il y a, jusqu un certain point, conflit entre lexplication mythique qui attribue notre sort un choix volontaire, et lexplication naturaliste qui rend compte du caractre des hommes par le milieu gographique ; et peut-tre est-ce pour unir lune et lautre que Platon, dans la dernire forme quil ait donne au mythe, fait appel laction de la providence et de la Dik universelle qui organise le monde de manire que chaque me soit spontanment attire vers le lieu o elle mrite daller 1. Son intention nen reste pas moins nette : cest de poser le caractre comme une donne ultime. Dautre part, la fixit des caractres est, en une certaine mesure, un garant de fixit sociale, et par consquent de justice. Aussi lart social, sil ne peut les produire sa guise, doit au moins les empcher de saltrer de gnration en gnration. Ici, et pour donner une certaine prise au lgislateur, Platon introduit, outre les explications mythique et naturaliste, une explication par lhrdit, incompatible avec les deux premires ; si lexplication est vraie, les chefs de la cit peuvent, en rglementant habilement les mariages, arriver maintenir ltat de puret les caractres convenables chaque classe sociale, comme les leveurs savent maintenir les races pures p.153 (Rpublique, 459b ; 460de). Et cest la ngligence dans lapplication exacte du rglement des unions qui amnera avec la dcadence de laristocratie philosophique, celle de la cit tout entire (546c). Aucun moyen humain, il faut y insister, nest donn pour rtablir ltat primitif ; chez Platon, les lois ne crent pas ; elles conservent. Il ne compte, pour revenir au point de dpart, que sur le cycle qui gouverne le changement, et qui est celui dun devenir circulaire dont les phases se rptent.
XIX. LUNIT SOCIALE
@ Si le fondateur de la cit a, sa disposition, par chance heureuse ou grce la providence des dieux, les caractres quil faut, il peut alors instituer une cit juste. Il suffit pour cela de rglementer lactivit des citoyens de telle
1
Lois, X, 903 d ; 905 b.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
111
manire que chacun donne ses soins une seule fonction, celle laquelle il est naturellement apte, afin que chacun ayant son occupation propre ne soit pas multiple mais un, et quil puisse natre ainsi une cit une et non multiple (Rpublique, 423d). Cest ainsi, par exemple, quune rglementation de la richesse sera ncessaire pour fixer lartisan son mtier ; un potier devenu riche voudra-t-il encore sadonner son mtier ? videmment non ; il devient alors un mauvais potier (421d). Il ne faut pas davantage quil soit pauvre, au point de ne pas pouvoir se fournir des outils indispensables. De l rsultent aussi les lois si tranges concernant les gardiens de la cit ; tout y est subordonn la ncessit de maintenir entre eux lunion parfaite. Le plus grand malheur pour la cit, cest la division ; or, une des plus grandes causes de division, cest le rgime de la sparation des familles, do il sensuit que chacun a ses peines et ses plaisirs part. La communaut des femmes, des enfants et des biens, cest la p.154 seule manire de lier entre eux les gardiens ; tenus par la rglementation des pouponnires publiques dans lignorance des liens naturels de filiation, tous, selon leur ge, auront lgard de tous, les sentiments dun fils ou dun pre (462a sq. ; 464d). Comme dautre part, la cit tient compte non pas des diffrences entre les personnes, mais seulement des diffrences entre leurs aptitudes, comme on dfinit le citoyen uniquement dans son rapport aux occupations, il sensuit quil ne faudra pas donner la femme dans la cit une place diffrente de celle de lhomme ; au point de vue social, il ny a entre eux nulle diffrence ; il y aura des femmes artisans, dautres qui ont les passions gnreuses du dfenseur de la cit ; dautre la sagesse des gardiens (454b-457b). Enfin, si lon ne considre que les fonctions, et non les sujets qui les accomplissent, la sociologie platonicienne se trouvera tre, par une transformation trs simple, une psychologie et une morale. Autant il y aura de fonctions dans la cit, autant il y aura de facults dans lme individuelle ; la fonction de lartisan correspondent les dsirs lmentaires de nourriture ; celle du soldat, la passion de la colre ; celle du gardien, lintelligence rflchie. Comme chacune de ces fonctions a sa vertu ou son excellence, la temprance pour lartisan, le courage pour le soldat, et la prudence pour le gardien, chaque facult aura la sienne ; et, comme la justice dans la cit consiste pour chacun faire ce qui lui est propre, la classe suprieure ordonnant et la classe infrieure obissant, la justice dans lindividu consiste aussi maintenir chaque partie de lme dans son rle naturel. Ainsi, ltude de la socit nous permet de lire plus facilement dans lme de lindividu (453a ; 443e sq.).
XX. DCADENCE DE LA CIT
@
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
112
Toute la morale, comme toute la politique, consiste donc fixer ces relations naturelles de la manire la plus solide possible. p.155 Mais labsolue fixit est impossible ; car tout ce qui est n est sujet destruction (546a). Une fois drange lharmonie complexe qui faisait lunit et la justice sociales, il y a une dcadence plus ou moins rapide, et, en passant travers une srie rgulire de gouvernements qui naissent les uns des autres, la cit aboutit par degrs du gouvernement le plus juste au gouvernement le plus injuste. Il ny a pas, chez Platon, dautre volution naturelle et spontane que cette dcadence. Les livres VIII et IX de la Rpublique, qui contiennent tant de traits tirs de son exprience politique et psychologique, ne laissent aucun espoir darrter le mouvement, une fois quil est dclench par la ngligence des premiers magistrats de la cit (545d). A ltat dharmonie succde un tat de sparation et de lutte, dont les diverses formes de gouvernement marquent les degrs. Les luttes et dissensions civiles sont dailleurs accompagnes dun tat de trouble et de dsquilibre correspondant dans lme de chaque citoyen ; chaque type de socit correspond un type psychologique. A la constitution la meilleure succde dabord une lutte entre une race dor et dargent qui veut maintenir la vertu et la tradition, et une race de fer et dairain tout asservie la recherche du gain ; cette lutte se termine par une sorte de loi agraire o terres et maisons sont distribues et appropries ; le rgime de la proprit individuelle commence, et, avec lui, lesclavage des laboureurs. La caste dominante devient celle des guerriers, qui songent peu ltude et beaucoup la gymnastique et la guerre, ambitieux et jaloux les uns des autres ; et prenant peu peu le got des richesses (546d-549d). Cest la domination du riche qui caractrise la troisime forme de la cit, que Platon appelle oligarchie. Un certain cens est la condition de laccs aux magistratures. Lunit prcaire du gouvernement prcdent se dfait nouveau ; il y a dans la cit deux cits distinctes, celle des pauvres et celle des riches ; indigence dun ct, luxe de lautre ; et partout la prpondrance p.156 est donne non plus la passion gnreuse, comme dans les prcdents gouvernements, mais aux dsirs infrieurs. Les pauvres que les riches sont obligs darmer pour dfendre la cit, sont dailleurs pour eux un souci constant (550c sq.). Cest le dsir insatiable de richesses qui cause la perte des oligarques ; pour senrichir par lusure, ils favorisent lintemprance de jeunes gens riches et nobles ; ces jeunes gens rduits lindigence, mais gardant toute la fiert de leurs origines, sont les vrais fauteurs de la rvolution qui amne la dmocratie : endurcis par la vie quils mnent, ils nont pas de peine vaincre les riches amollis par le luxe. La dmocratie, cest essentiellement la victoire des pauvres ; son mot dordre est la libert ; chacun y mne le genre de vie qui lui plat ; rien de plus vari, rien de moins unifi quune dmocratie comme celle dAthnes, vrai magasin de constitutions o le politique peut venir chercher des modles ; lhomme dmocratique sintresse tout, mme la
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
113
philosophie. De la libert nat lgalit, entendons cette galit pour les ingaux qui est due labsence dautorit (557-563). Le dsir insatiable de libert cause la perte de la dmocratie, et change cette forme sociale en son contraire, en tyrannie ; ceux qui prsident aux destines de la cit ne peuvent goter au pouvoir sans en vouloir toujours plus, et sans devenir des tyrans. Le tyran est toute lantithse du gardien de la cit idale ; il est, par excellence, lindividu compltement isol, qui rompt tout lien avec la socit, exilant les bons dont il a peur, vivant au milieu de gardes du corps quil sest donn en affranchissant des esclaves. La dissociation de la cit atteint l son terme ; lhomme tyrannique est celui qui lche la bride aux passions les plus sauvages, celles que lhomme bien lev ne connat quen rve ; cest lindividu se prenant comme un absolu, sans amis, toujours despote ou esclave, mais ignorant la vritable libert et la vritable amiti (563e-574d).
XXI. LE MYTHE DU POLITIQUE
@ Le danger constant de dcadence qui menace les cits, est un moyen indirect de prouver la ncessit du gouvernement des philosophes qui les arrte sur la pente. La vue sociale trs pessimiste, qui se dgage de cette sorte de loi de dgradation des cits, nest pas contre-balance chez Platon par la croyance que la technique politique pourrait raliser un progrs en sens inverse. Elle nest quilibre que par une croyance non raisonne, mais tout fait vivante, la forme cyclique du devenir ; le devenir, en revenant sur luimme, ramne ltat primitif. Mais cette croyance, Platon na nullement donn la forme philosophique et scientifique quil donne la description du fait directement constat de la dcadence des gouvernements. Il lui donne la forme dun mythe, celui quil expose dans le Politique, mythe destin sans doute mieux faire saisir la place prcise et limite de lart politique dans une volution dont lensemble chappe pleinement aux prises de lart rationnel. Platon imagine en effet que, dans lge heureux de Cronos, le soleil et les astres allant en sens inverse de leur sens actuel, tout le devenir des tres tait galement de sens inverse, cest--dire quil allait de la mort la naissance au lieu daller de la naissance la mort ; cest dire que la terre produisait spontanment et sans le travail humain tous les fruits utiles lhomme, et, en gnral, que chaque tre arrivait sans effort son point de perfection ; nul travail technique, donc nulle union politique ne sont alors ncessaires. Mais lorsque le soleil change le sens de son cours, lorsque, simultanment, les tres arrivent lentement et difficilement, au milieu dobstacles de toute sorte leur achvement, cest alors que les techniques de tout genre et notamment la technique sociale sont ncessaires ; la plupart des arts sont des dons que les dieux font aux hommes pour les soutenir dans ces difficults (268e-275b [15]).
p.157
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
114
De l, la physionomie, assez particulire et nouvelle, que prend lart social dans le Politique ; tout art humain manipule des choses changeantes, diverses, et ds lors, procde moins par rgles gnrales que par des tours de main qui sadaptent aux circonstances. Il en est de mme de lart politique ; les dissemblances entre les hommes et entre leurs actions, la complte absence dimmobilit dans les choses humaines se refusent toute rgle simple portant sur tous les cas et valables pour tous les temps (294b), aussi bien en matire dart politique que dans les autres arts. Il sensuit que lhomme dtat, le technicien politique est une loi vivante ; et quil est souverain absolu de la cit, comme le ptre de son troupeau. Platon arrive ainsi donner au politique un caractre providentiel et surhumain, germes lointains de la thorie du pouvoir dans lempire romain et dans la papaut. Ici donc encore, on le voit, aucun espoir, fond en raison, de progrs naturel, et le mythe substitu rgulirement la science partout o il est question du retour un tat suprieur au ntre (293-300).
p.158
XXII. LES LOIS
@ Ce sentiment de la relativit et de linstabilit des choses humaines est particulirement vif dans les Lois, luvre inacheve de la vieillesse de Platon ; elle est remplie de prescriptions de dtail, qui indiquent lintention trs nette de raliser sa rforme, peut-tre dans les villes siciliennes qui allaient tre restaures aprs la mort de Denys. Le problme des Lois est, comme celui du Time, un problme du mlange ; on cherche ici quelles proportions rendront la socit le plus stable possible, comme on a dcouvert l-bas celles qui donnaient au cosmos la dure imprissable. Stable et parfait, cest tout un pour Platon : Il importe avant tout que les lois soient stables (797a). Jusquaux jouets des enfants, tout doit rester identique dune p.159 gnration lautre ; tout changement est un trouble, quil sagisse de lorganisme ou de la cit ; les lois ne sont lobjet dun vritable respect que si lon na aucun souvenir dun temps o les choses auraient t autrement que maintenant ; et le lgislateur doit imaginer tous les moyens pour produire cet tat de choses dans la cit . De ces moyens, certains chappent sa volont ; ce sont ceux qui viennent de la nature ; un milieu propice lclosion du caractre, une contre assez isole de la mer et des autres cits pour quelle nait pas de chance dtre contamine par le commerce et par linfluence des autres, telles sont les heureuses chances quon ne doit quaux dieux. En revanche, le lgislateur peut limiter le nombre des citoyens, en choisissant un nombre assez faible, mais tel quil soit multiple du plus dautres nombres possible. Mais surtout, il est matre du mlange qui produira la constitution la plus stable (691c sq.). Lhistoire nous montre lexemple dune constitution qui a
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
115
rsist au temps : cest celle de Sparte, qui a observ les rgles de la mesure, et sest gard de tout excs ; les puissances des deux rois sont tempres lune par lautre ; leur pouvoir est limit par celui du snat o la puissance modratrice des vieillards sallie la force bouillante de la jeunesse ; il est limit galement par le pouvoir des phores. De cette manire, la royaut, mlange comme il fallait dautres lments et recevant deux la mesure, sest conserve elle-mme et a conserv le reste. Au contraire lhistoire montre la dcadence de la constitution perse, cette royaut librale qui se transforme en tyrannie, et celle de la constitution dmocratique dAthnes o la libert amne une anarchie sans frein. Donc il y a deux constitutions antithtiques, despotisme et dmocratie, et mres de toutes les autres ; isoles, elles sont mauvaises ; mais leur mlange bien proportionn produit la bonne constitution (693 d). Quest-ce qui empche la dcadence ? (Car toujours, et ici p.160 encore, il est question de frein qui arrte et non dun progrs positif). Ce qui lempchera, cest lharmonie entre la sensibilit et lintelligence qui juge (689a) ; la cause de la chute, cest que lon prend plaisir ce que lon juge mauvais et injuste, et que lon voit avec peine ce que lon juge juste, cest cause de cette disposition desprit, qui est la pire des ignorances, que la cit nest plus, comme elle doit ltre, amie delle-mme (701d). Platon sent bien que la pure intelligence ne suffit pas ; il y faut encore linclination, et une inclination libre et volontaire. Le lgislateur doit donc obtenir lassentiment non par la violence, mais par la persuasion (887a sq.) ; de l, lusage des prologues dveloppant les motifs dobir aux lois (719c-723b) ; cette sorte de prdication morale tait une nouveaut dans la lgislation. Les rsultats de cette manire dassurer la stabilit sociale par une foi enracine dans les esprits, sont particulirement nets dans le livre X, qui concerne les croyances religieuses. Limpit y est traite avant tout comme un danger social ; lathisme que Platon combat, cest celui des sophistes, qui considraient les dieux comme des inventions humaines (891 b-899 d) ; les ngateurs de la providence quil rfute ne sont point des thoriciens, mais des gens qui laissent libre cours leurs passions parce quils ne croient pas que la justice divine entre dans le dtail des affaires humaines (899d-905 d) ; enfin, la croyance errone que lon sduit Dieu par des prires se rattache toute une srie de pratiques cultuelles et rituelles qui impliquent des associations prives prilleuses pour la vie sociale (905d-907b) 1. Aussi, sil faut dabord essayer de prvenir limpit par des arguments rationnels, comme le fait Platon, il faut prvoir de srieuses pnalits pour ceux qui ne veulent pas se laisser convaincre. Selon les cas, la prison temps ou la prison perptuelle loignent de la cit ces dangereux impies (908a sq.).
Cf. 909 b sur le danger des associations religieuses indpendantes de la cit.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
116
Le dernier mot de Platon politique est cette srnit contemplative du sage qui voit les ressorts cachs qui font agir les hommes. Les choses humaines ne valent pas dtre prises trs au srieux... Lhomme est un jouet de Dieu, une machine pour lui (803b). Le lgislateur est avant tout celui qui connat cette machine et qui sait mener les hommes.
p.161
XXIII. LACADMIE AU IVe SICLE APRS PLATON
@ LAcadmie, aprs Platon, eut successivement pour chefs, Speusippe, le neveu du matre (348-339), Xnocrate (339-315), Polmon (315-269). Lhistoire des doctrines des deux premiers nest gure connue que par quelques allusions dAristote. Elles paraissent avoir t des dveloppements tout fait libres de certaines suggestions du matre ; il nexiste pas ce moment dorthodoxie platonicienne, et cest mme loccasion dun vif reproche que les no-platoniciens firent aux successeurs directs de Platon 1. Aussi le platonisme, min par les divergences dcole, est ruin par lattaque des nouveaux dogmatismes en formation ; Aristote, les Stociens et picure saccordent pour le combattre. Le problme central parat avoir t pour eux, comme pour Platon vieillissant, celui de la formation des mixtes. Comme dans la Philbe, comme dans le Time, il sagit dexpliquer les diverses formes de la ralit par lintroduction dune mesure ou dun rapport fixe dans une ralit primitivement indfinie et sans fixit. Mais ce mode dexplication nest quun schme vague qui nexclut pas les divergences. Dune part, en effet, il vaut avant tout pour expliquer les nombres ; lUn, dterminant le multiple ou dyade indfinie du grand et du petit, lgal dterminant lingal ; mais que dire des autres ralits telles que les p.162 grandeurs mathmatiques ou le monde ? Speusippe a pens que chacune delles impliquait un nouveau couple de principes, diffrent de celui do naissent les nombres ; comme le nombre vient de lunion de lun et du multiple, par exemple, les grandeurs mathmatiques naissent du mlange de lindivisible avec lespace indfini ; les ralits des divers degrs ayant ds lors chacune leurs principes spciaux ne dpendront plus les unes des autres, et lensemble des choses, selon lobjection dAristote, sera comme une mauvaise tragdie, faite dpisodes 2. Pourtant, bien quintroduisant pour chaque degr des couples de principes distincts, Speusippe a d insister sur lanalogie ou similitude quil y avait entre ces couples successifs : par exemple, bien que lintelligence, principe dunion dans lme du monde, ait une nature spciale absolument distincte de lun, principe du monde 3, il y a pourtant entre lun et lintelligence une
1 2
NUMNIUS (IIe sicle ap. J.-C.) dans EUSBE, Prparation vanglique, XIV, 5, 2. ARISTOTE, Mtaphysique, Z, 2, 1028 b 21 ; cf. 1075 b 37 et 1090 b 13. 3 DIELS, Doxograph graeci, p. 303 ; Il soppose en cela Xnocrate.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
117
analogie de rle : ce sont des analogies de ce genre que Speusippe recherchait peut-tre dans son trait sur les Semblables, dont les fragments se rapportent la classification des tres vivants. Il suit galement de la doctrine de Speusippe que les premiers degrs de la ralit ne contiennent en rien la richesse et la plnitude des degrs subsquents. Le Bien ou Perfection nest donc pas au dbut : de mme le germe vivant ne contient nulle des perfections que lon trouve chez lanimal adulte. Aussi cest tort, selon lui, que lon assimile, lUn, qui est principe, au Bien qui est postrieur 1. On voit tout ce que Speusippe a sacrifi de la dialectique platonicienne : en supprimant la continuit qui lie par une chane dductive les formes de la ralit au principe, il a ni lexistence du bien comme principe, celle des nombres idaux, celle mme des ides ; considrant la srie des mixtes, nombres mathmatiques, grandeurs mathmatiques, me, il emploie p.163 le schme platonicien, pour construire chacun deux ; mais il ignore leur liaison. En contraste parfait avec Speusippe, Xnocrate semble avoir voulu insister sur lunit et la continuit de la srie des formes dans ltre ; il identifie les ides aux nombres idaux 2, et il retrouve ces nombres dans la srie des tres qui en dpendent, dans les lignes et les surfaces idales, quil dmontre tre inscables, dans lme quil dfinit un nombre qui se meut et ailleurs une combinaison de lun et du multiple, enfin dans le ciel et toutes les choses sensibles 3. Tandis que Speusippe refuse dassimiler lUn au Bien, parce quil faudrait identifier au mal son contraire qui est le multiple, Xnocrate nhsite pas devant cette conclusion ; do il suit, si tous les tres, sauf lUn, sont des mixtes de lun et du multiple, que tous, ils participent au mal. Sa thorie des lignes inscables est celle qui est le mieux connue grce au trait apocryphe dAristote Sur les lignes inscables 4 ; la ligne idale (et le mme argument sapplique la surface et au corps) doit tre indivisible, parce quelle est antrieure toutes les autres et parce quelle est leur unit de mesure. Xnocrate a cherch nier partout lapparente discontinuit des choses ; Platon avait dj indiqu dans le Time que tout corps sensible devait se composer des quatre lments ; cette unit substantielle des diverses rgions du monde, si contraire la doctrine quAristote allait soutenir, Xnocrate la reprend pour son compte, en considrant la solidit de la rgion terrestre comme imitant celle de la lune et celle du soleil 5.
1 2
ARISTOTE, Mtaphysique, A7, 1072 b 30 ; et. 1075 a 36 ;1092 a 22 ; 1091 a 29. ARISTOTE, Mtaphysique, Z, 1028 b 24. 3 PLUTARQUE, Cration de lAme daprs le Time, ch. II ; CICRON, Songe de Scipion, 1, 14 ; Tusculanes, 1, 20. 4 ARISTOTE, Mtaphysique, N 1091 b 35. 5 PLUTARQUE, Du Visage qui est dans la lune, ch. XXIX.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
118
Les doctrines de Speusippe et de Xnocrate sont donc divergentes ; mais le problme quelles rsolvent est le mme. Aussi les deux disciples se retrouvent-ils daccord, lorsquil sagit p.164 dinterprter le Time 1 ; Platon en dcouvrant la gense de lme et du monde, na pas voulu selon eux dcrire un devenir rel ; le monde est ternel ; cest pour la commodit que Platon suppose quil nat, comme le gomtre fait natre par construction des figures, seulement pour mieux dgager les lments dont elles se composent. La mthode platonicienne se fixe donc, chez ses successeurs, en une doctrine ; la libre fantaisie des mythes aussi va se terminer en dogmes. Cette transformation se relie au got trs vif que le IVe sicle, mme avant lpoque dAlexandre, marque pour lOrient. De ce got tmoignaient dj les titres de certains traits de Dmocrite sur lcriture sacre des Babyloniens et des gyptiens, et son admiration pour la sagesse des Orientaux, dont il a peut-tre traduit les sentences morales 2. Platon lui-mme ou peut-tre un de ses lves immdiats, Philippe dOponte, a crit, comme suite aux Lois, lpinomis, qui contient la premire codification, nous connue, de la thologie astrale chez les Grecs. Les astronomes du IVe sicle, en loignant le ciel de la terre, en distinguant radicalement les choses clestes des mtores, en montrant luniformit du mouvement des plantes, ont donn un cadre nouveau cette thologie issue de lOrient (pinomis 986 e ; 987b) ; lordre qui rgne dans les cieux est la preuve de lintelligence des astres et de la divinit des mes qui les animent (pinomis, 982 b) ; le monde se divise en parties hirarchises dont chacune porte ses vivants ; entre la terre, sjour du dsordre, et le ciel, sjour des dieux visibles (984 d), se trouve lair, o vivent ces tres transparents et invisibles que sont les dmons ; dous dune intelligence merveilleuse, de science et de mmoire, ils aiment les bons et hassent les mchants ; car ils connaissent notre pense ; ils ne sont dailleurs pas impassibles comme les dieux, mais capables de plaisir et p.165 de douleur (984d-985b). Xnocrate admettait une hirarchie thologique tout fait analogue celle de lpinomis : au sommet, les dieux suprmes qui sont lunit et la dyade ; lunit qui est mle, pre, roi du ciel, Zeus, intelligence ; la dyade, divinit fminine, mre des dieux, me de lunivers ; au-dessous le ciel et les astres, qui sont les dieux olympiens ; au-dessous encore les dmons invisibles, sublunaires qui pntrent dans les lments 3. On voit lunion dcisive qui stablit alors entre limage rationnelle du cosmos et les vieilles reprsentations mythiques et thologiques ; les dmons en qui et par qui se ralisent le lien et lunit du monde, occupent naturellement la place centrale dans cette religion cosmique, dont on verra lextraordinaire dveloppement dans le stocisme et le no-platonisme.
1 2
PLUTARQUE, Cration de lAme, ch. III. DiOGHNE LAERCE, Vies, IX, 119 ; CLMENT DALEXANDRIE, Stromates, I, 16, 69 ; Cf. R. EISLER, Arch. fr die Geschichte Philosophie, 1917, p 187. 3 DIELS, Doxographi graeci, f. 304.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
119
Mais Speusippe et Xnocrate semblent stre surtout occups de morale ; neuf des trente-deux ouvrages de Speusippe, dont Diogne (IV, 4) a conserv les titres, et vingt-neuf des soixante ouvrages de Xnocrate (IV, 11) se rfrent expressment la morale ; leur successeur Polmon est surtout connu comme moraliste et son contemporain Crantor crit un petit trait Sur le Deuil, que Pantius le Stocien, deux sicles plus tard, recommandait dapprendre 1. Deux traits caractrisent cette doctrine morale, dailleurs fort mal connue : dabord un certain naturalisme ; il y a des tendances naturelles primitives qui nous portent vers lintgrit du corps, la sant, lactivit intellectuelle ; la fin des biens consiste, selon Speusippe, atteindre la perfection dans les choses conformes la nature, et, selon Polmon, vivre selon la nature, cest--dire jouir des dons naturels primitifs en y joignant la vertu 2 . Le second trait, qui drive de la Rpublique, est la prescription qui commande de rgler et de discipliner les sentiments plutt que de les p.166 supprimer ; cette mtriopathie, conseille par Crantor dans le chagrin dun deuil, contraste avec la sauvage impassibilit prche par les nouvelles sectes dalors 3 ; elle restera le ton de ces crits de circonstances, les Consolations, qui vont devenir si nombreux dans les sicles suivants ; certains thmes (par exemple largument que la mort nest pas craindre, soit quelle soit lanantissement, soit que lme passe aprs dans un lieu meilleur), qui se retrouvent dans tous ces crits, remontent jusqu lApologie de Platon (40 c), do elles durent passer, par Crantor, tous ses imitateurs 4. Sous cet aspect, lAcadmie a un rle non sans importance dans le mouvement de prdication morale, toute humaine et indpendante des doctrines, que nous verrons se dvelopper au IIIe sicle, et qui dominera plus ou moins les divergences des sectes. Bibliographie
@
1 2
CICRON, Premiers Acadmiques, 11, 135. CLMENT DALEXANDRIE, Stromates, 418 d et CICRON, Des Fins, II, 11, 33. 3 Cit par PLUTARQUE, Consolation Apollonius, III.
4
GERCKE, De Consolationibus ; cf. CICRON, Tusculanes, I, 49, 117-118.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
120
CHAPITRE IV ARISTOTE ET LE LYCE
@ Aristote est n en 385 Stagire, ville situe sur la cte septentrionale de lge lest de la Chalcidique. De son pre, qui tait mdecin, il ne put subir linfluence, puisquil tait fort jeune lorsquil le perdit. Il passa de longues annes dans lcole de Platon, o il entra en 367. A la mort du matre, il se trouvait, avec dautres lves de Platon, dont Xnocrate, Assos en olide auprs du tyran Hermias dAtarne. Il y vcut plusieurs annes, non sans doute sans profiter de lexprience politique dHermias, qui avait manuvrer entre les deux puissances du jour, la Macdoine et la Perse. En 343, il se trouve Mitylne dans lle de Lesbos ; cest alors quil fut appel par Philippe, roi de Macdoine, sa cour de Pella, pour se voir confier lducation du jeune Alexandre ; il sacquit parmi les Macdoniens de puissantes amitis dont celle dAntipater ; son propre neveu Callisthnes tait parmi les amis dAlexandre, dont il fut ensuite la victime. Lorsquil retourna, en 335, dans Athnes o le parti national, rduit au silence aprs la dchance politique de la cit, subsistait pourtant encore, ce mtque devait tre connu comme partisan de la Macdoine. Il ne rentra pas lAcadmie, mais fonda au Lyce une nouvelle cole, o il enseigna pendant treize ans. A la mort dAlexandre (323), le parti national athnien que dirigeait encore Dmosthnes lobligea quitter la ville ; il se retira Chalcis, en Eube, dans une proprit hrite de sa mre, o il mourut en 322, 63 ans. Vie bien diffrente de celle de Platon ; ce nest plus p.170 lAthnien de haute naissance, politique jusquau fond de lme, qui ne spare pas la philosophie du gouvernement de la cit ; cest lhomme dtude qui sisole de la cit dans les recherches spculatives, qui fait de la politique elle-mme un objet drudition et dhistoire bien plus quune occasion dagir. De Platon lon ne connat que les crits quil destinait au public, et lon ignore peu prs tout de son enseignement ; dAristote au contraire, il ne reste que dinfimes fragments des ouvrages crits pour un public tendu ; ce que nous avons de lui, ce sont des cours quil rdigea soit pour lenseignement au Lyce, soit peut-tre pour des leons quil fit sans doute Assos, avant dtre prcepteur dAlexandre : notes rdiges par un professeur pour lui-mme, sans aucune recherche de la perfection littraire, parfois simples points de repre pour le dveloppement oral, o ont pu mme, quand ces recueils furent publis aprs sa mort, se glisser des notes dlves.
p.168
Ces ouvrages peuvent se classer ainsi :
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
121
1. Ouvrages de jeunesse destins un large public (quAristote luimme appelle discours exotriques), ceux auxquels pouvait sappliquer lapprciation de Cicron parlant du fleuve dor de son loquence. Ils sont tous perdus. Cest lEudme, dialogue sur limmortalit de lme ; le Protreptique, adress un prince de Chypre, Thmison, auquel rpond peut-tre le discours dun lve dIsocrate, A Dmonakos ; lauteur de ce discours se plaint de ceux qui engagent ltude dsintresse et dtournent de la pratique des affaires ; enfin le trait de la Philosophie, ou Du Bien, qui date de lpoque o Aristote se dgage de lemprise de Platon ; il contenait dj, aprs une histoire de la pense philosophique, une critique de la thorie des ides, et sachevait par une thologie astrale o tait dmontre la divinit des toiles ; 2. Les collections douvrages scientifiques : La collection logique connue sous le nom dOrganon : les Catgories ; De lInterprtation (sur les jugements) ; Topiques (sur les p.170 rgles de la discussion) ; Rfutation des Sophismes ; Premiers Analytiques (sur le syllogisme en gnral) ; Seconds Analytiques (sur la dmonstration) ; on peut y ajouter la Rhtorique et la Potique ; le recueil sur la philosophie premire intitul Les mtaphysiques ; cet ouvrage en douze livres (numrots daprs lalphabet grec), plus un livre supplmentaire () au premier, nest pas dun seul tenant. Il faut considrer part le livre , sorte de prliminaire la physique, qui est de Pasicls, un neveu dEudme ; le livre , vocabulaire indiquant les divers sens des termes philosophiques ; les livres , , , qui forment un trait de la substance, auquel sajoute I et qui est continu par M (chapitres 1 9, 1086 a 20) ; les livres A, B, , E, M (depuis 1086 a 20), N, qui date dune priode antrieure o Aristote se compte encore parmi les platoniciens, bien quil critique la thorie des ides ; le livre K (1-8) parat tre un cahier dlve, se rapportant la mme poque que le groupe prcdent et rsumant les livres de ce groupe ; enfin est un trait thologique, trait densemble qui se suffit lui-mme et qui tranche sur les autres par la magnificence de son style (il faut en excepter le chapitre 8, recherche trs spciale sur le nombre des sphres clestes ncessaire pour expliquer le mouvement des plantes et qui se rfre lastronome Calippe, qui rforma le calendrier attique en 330) ; Les ouvrages sur la nature : la Physique, dont les parties les plus anciennes paraissent tre les livres I, II, VII et VIII ; Du Ciel que sa rfrence au dialogue Sur la Philosophie (I, 9) fait sans doute remonter assez haut ; De la Gnration et de la Corruption ; les Mtores, dont le IVe et dernier livre a t quelquefois suspect ;
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
122
les Mcaniques (dont lauthenticit reste possible daprs Carteron, La Notion de Force dans le Systme dAristote, 1923, p. 265) ; La collection duvres biologiques, trs importante pour lhistoire des sciences : Des Parties des Animaux ; De la Gnration des Animaux, avec les petits traits Sur la Marche des p.171 Animaux, et Sur le mouvement des animaux. A la collection se rattachent le grand trait Sur LAme et les opuscules qui y font suite : Sur la Sensation et le Sensible, Mmoire et Rminiscence, le Sommeil, les Songes, la Divination par les Songes, la Longueur et la Brivet de la Vie, la Jeunesse et la Vieillesse, la Respiration ; La collection duvres morales et politiques : lthique Eudme, la premire, la plus rapproche de Platon ; lthique Nicomaque ; la Politique qui trahit deux inspirations diffrentes : dune part celle des livres H et qui contiennent la thorie dun tat idal, dont A, B, sont lintroduction ; dautre part celle du groupe , E, Z, recherches politiques positives partant dune trs vaste induction historique ; il est de la dernire poque dAristote, de lpoque o il dcrivit les constitutions dune centaine de villes, dont la premire seule, la Constitution dAthnes, a t retrouve. Enfin, il faut ajouter quelques apocryphes qui se sont glisss dans la collection des uvres, dont lun, les Problmes, drive de lcole et a un intrt de premier ordre.
I. LORGANON : LES TOPIQUES
@ Aristote est linventeur de la logique formelle, cest--dire de cette partie de la logique qui donne des rgles de raisonnement indpendantes du contenu des penses sur lesquelles on raisonne. Mais, malgr lapparence, les crits logiques runis sous le nom dOrganon (instrument) ne donnent nullement un expos systmatique de cette logique. En apparence, en effet, ils se rangent selon les titres de chapitres des manuels classiques de logique : 1 Catgories contenant la thorie des termes ; 2 De lInterprtation, ou thorie des propositions ; 3 Premiers Analytiques, ou thorie de syllogisme en gnral ; 4 Seconds Analytiques, ou thorie de la dmonstration, cest--dire du syllogisme dont les prmisses sont ncessaires ; 5 Topiques, ou thorie du p.172 raisonnement dialectique et probable, dont les prmisses ne sont que des opinions gnralement acceptes ; 6 Rhtorique, thorie du raisonnement oratoire ou enthymme, dont les prmisses sont choisies de manire persuader lauditoire. Le syllogisme, dont les deux premiers traits ont montr les lments, est lorgane commun, tudi par le troisime trait, dont usent galement savants, dialecticiens et orateurs, chacun avec des prmisses diffrentes.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
123
La ralit est autre. Aristote a crit les Catgories et la plus grande partie des Topiques (livres II VII) avant davoir dcouvert le syllogisme. Il na dabord mdit sur les rgles du raisonnement quen songeant aux rgles dune saine discussion. Dj, dans le Sophiste et le Parmnide de Platon, lun a vu comment lide des cadres logiques (division et classification des termes, dtermination des genres premiers, relations de lattribut au sujet) naissait des conditions de la discussion ; il sagissait avant tout davoir raison des antilogiques ou ristiques. Cest dans ce milieu de dialecticiens ardents quest ne la logique dAristote. Or le dialecticien na ni les procds du professeur qui expose, ni encore moins ceux du savant qui cre la science ; la dialectique est un dialogue o un interlocuteur, le demandant, soumet un autre, au rpondant, un problme ou une thse ; chaque question, il doit tre rpondu par oui ou par non ; le but de linterrogatoire est en gnral de rfuter le rpondant en lamenant se contredire. On a vu par quelle transposition Platon avait fait de cette dialectique le tout de la philosophie. Aristote a d abandonner de bonne heure pareil espoir ; il abaisse la dialectique ou art de la discussion au rang dun exercice, qui napporte pas une certitude, parce quelle a gard non pas aux choses mmes, mais aux opinions des hommes sur les choses. Ce qui dfinit la dialectique comme telle, cest moins en effet la structure logique du raisonnement que les rapports humains quelle implique ; dans une saine discussion, on doit veiller ne prendre comme points p.173 de dpart que des propositions gnralement acceptes, soit de tous les hommes, soit des hommes comptents, sil sagit dune thse technique ; de plus, les questions poses ne doivent tre ni trop faciles, puisque la rponse est inutile, ni trop difficiles, puisque lon doit y rpondre sur-le-champ 1. De pareils procds ne peuvent amener qu analyser et comparer des jugements pour en montrer laccord ou le dsaccord. Mais cet exercice est indispensable, et cest en lui que nous allons voir natre les cadres dabord de la logique, puis de toute la philosophie dAristote. Son premier souci concerne le vocabulaire : la confusion dans la discussion vient de ce que lon dsigne des choses diffrentes par un mme nom (homonymes) ou une mme chose par des noms diffrents synonymes) ; le prliminaire indispensable est dnumrer les divers sens donns aux mots employs dans la discussion ; presque tout son trait des Catgories, et le livre de la Mtaphysique sont consacrs ces recherches de vocabulaire ; il sagit moins de distinguer les choses mmes que les divers emplois dun mme mot. Mme remarque sur la thorie de la proposition qui est la base de la logique aristotlicienne. En affirmant que toute proposition se compose dun sujet et dun attribut, Aristote a soutenu une thse dune immense porte non seulement logique, mais mtaphysique. Or, cette thse, il lemprunte non pas lanalyse du langage comme on la dit quelquefois (et de fait, il connat des formes verbales, telles que celles du vu, de la prire, quil renvoie la
1
Topiques, 1, 9 et 10.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
124
rhtorique), mais bien lanalyse des problmes dialectiques. En effet, tout problme dialectique consiste demander si un attribut appartient ou non un sujet ; cest en contestant quil ft possible daffirmer un attribut dun sujet que les antilogiques rendaient la dialectique impossible ; ce sont, inversement, les besoins de la dialectique qui ont amen Aristote sa thorie et cest pourquoi il nonce habituellement p.174 les propositions non sous la forme devenue classique : A est B, mais sous celle-ci : B appartient A. Une proposition est une protasis, cest--dire une affirmation quon prsente lapprobation dun interlocuteur. Il en est de mme du classement des propositions ; la division classique en propositions universelles (affirmatives ou ngatives) et particulires (affirmatives ou ngatives) se prsente dabord comme division des problmes ; tout problme consiste en effet se demander si un attribut appartient (ou nappartient pas) au tout (o une partie) dun sujet, ce qui donne la formule des quatre propositions 1. De plus, il importe, pour saisir la porte dun problme dialectique, de connatre le genre de lattribut que lon demande. Lattribut dit-il ce quest le sujet, ou nonce-t-il seulement une proprit du sujet ? nonce-t-il une proprit qui lui appartient ncessairement ou seulement accidentellement ? Autant de cas distinguer pour rendre la discussion possible ; car bien des erreurs viennent de ce que lon se croit en droit de renverser les propositions, cest--dire dadmettre, parce que A appartient tout B, que B appartient tout A. Or, ce renversement nest admissible que si A est un propre de B, cest--dire lui appartient ncessairement et exclusivement. De proccupations de ce genre, on voit natre la fameuse distinction des attributs en cinq classes : genre, espce, diffrence, propre et accident 2. Les trois premiers se rattachent videmment la pratique platonicienne de la division ; la division tait destine montrer ce quest un sujet (ou sa quiddit) en dterminant dabord la classe la plus gnrale dont il faisait partie, puis en divisant cette classe en plusieurs ; la classe la plus ample (animal) devient chez Aristote le genre ; ce qui permet dy sparer des classes subordonnes, ce sont des diffrences (raisonnable) ; la synthse du genre et de la diffrence, cest lespce (homme) ; et chacun de ces trois attributs, chez Aristote comme dans la p.175 division platonicienne, rpond la question quest-ce que ? le genre et la diffrence indiquant, pris chacun part, une partie de lessence de lespce, et pris ensemble, cette essence entire, dont la formule est la dfinition. Le propre et laccident, au contraire, sont des attributs qui ne font pas partie de lessence du sujet, cest--dire ne rpondent pas la question quest-ce que ? Mais le propre est une dpendance ncessaire de lessence du sujet qui il appartient exclusivement comme lgalit des angles deux droits appartient au seul triangle parmi les polygones ; laccident peut, au contraire, ne pas appartenir au sujet.
1 2
Topiques, II, ch. I. Topiques I, 4 ; cf. le commentaire de Porphyre, Introduction sur les cinq voix.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
125
Les Topiques, dans leurs applications pratiques, donnent les moyens dprouver dans laquelle de ces classes rentre un attribut donn ; par exemple un attribut ne sera reconnu comme un genre du sujet que si lon vrifie quil appartient toutes les espces comprises sous le sujet, que tout ce qui appartient au sujet lui appartient aussi (livre IV, chap. premier). Ce sont, on le voit, des rgles permettant de discuter si une attribution admise par le rpondant est valide, si ce quil a pos comme genre nest pas plutt un propre, etc., mais non pas du tout de dcouvrir de pareilles attributions 1. Tel est le caractre des clbres rgles de la dfinition donnes dans les Topiques ; la dialectique est incapable de rpondre la question quest-ce que ? Car les seules questions admises sont celles auxquelles on peut rpondre par oui ou non : incapable dtablir une dfinition, elle peut passer lpreuve une dfinition propose, en cherchant par exemple si la dfinition convient exclusivement au dfini, si on ny a pas subrepticement introduit le propre cot du genre prochain et de la diffrence spcifique, si lon na pas utilis des termes homonymes ou mtaphoriques comme faisaient ceux qui ne dfinissent que par comparaison 2. Cest la pratique de ces discussions qui conduit Aristote p.176 poser trois problmes qui vont dominer sa logique : celui de la conversion des propositions, celui des catgories, celui des opposs. Le premier est amen par lusage spontan quon fait dans la discussion des propositions rciproques de celles que lon a fait admettre par le rpondant ; si, par exemple, on a admis que tout plaisir est un bien, on sera incit considrer comme accord que tout bien est un plaisir. Or une pareille rciprocit nest possible que si lattribut appartient exclusivement au sujet, cest--dire est un de ses propres ou bien la formule de sa dfinition ; mais, dans le cas gnral, comme lattribut peut appartenir des termes qui ne sont pas dans le sujet, luniverselle affirmative se convertit en particulire. En revanche luniverselle ngative et la particulire ngative ne changent pas en se convertissant. Le second problme, celui des catgories, est aussi pos pour les besoins de la discussion 3. Les dix catgories sont les divers sens que peuvent prendre les termes (sujets ou attributs) : ils peuvent indiquer soit une substance (homme, cheval), soit quand, soit o se trouve un tre (adverbes et complments de lieu et de temps), soit la qualit dune chose (adjectifs qualificatifs), soit quoi elle est relative (double, moiti), soit sa situation (il est assis, ou couch), soit sa possession (il a des souliers ou des armes), soit son action (il coupe ou brle), soit sa passion (il est coup ou brl). Bien que ce classement saide de lanalyse du langage, il ne sy rduit pas entirement, puisque, par exemple la forme linguistique substantif blancheur peut dsigner une qualit et non une substance. Ces distinctions sont plutt nes de la
1 2
De Interpretatione, II, 20b 8. Topiques, VI, 2 ; VII, 2. 3 Topiques, I, 7 ; Catgories, 2.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
126
dialectique. Il ne suffit pas, pour que la discussion soit claire, de savoir si un attribut est genre, diffrence, espce, propre ou accident ; il faut encore savoir dans laquelle des dix catgories il rentre ; car si un terme est un genre, et si ce genre est par exemple une qualit (couleur), sa p.177 diffrence et ses espces devront tre aussi des qualits 1. Prcaution dautant plus ncessaire quun mme mot peut avoir plusieurs sens, dont chacun appartient une catgorie diffrente ; le terme bon par exemple, peut entrer dans la catgorie du produire (le remde qui produit la sant), ou de la qualit (vertueux), ou du temps (la bonne occasion), ou de la quantit (la bonne mesure). Cest dans certains cas, grce aux catgories, que le dialecticien pourra conserver la distinction du propre et de laccident ; si je suis seul assis dans une socit, bien que tre assis soit, en lui-mme, un accident, il devient un propre relativement aux assistants et tant que dure leur runion 2. Le problme des oppositions est par excellence celui de la dialectique platonicienne. Pour quune discussion soit mme possible (puisque tout problme consiste demander un oui ou un non), il faut au moins que le non ait un sens par rapport au oui, lerreur par rapport la vrit, lautre par rapport au mme : cest la question de Platon dans le Sophiste. Aristote ayant en vue surtout la pratique de la discussion, cherche dterminer quelles sont les thses qui se commandent et celles qui sexcluent lune lautre. Quand une proposition affirme de tout le sujet ce que lautre nie de tout le sujet (Tout homme est juste, aucun homme nest juste), elles sont dites contraires et ne peuvent tre vraies en mme temps : sont contradictoires deux propositions dont lune affirme ce que lautre nie (Tout homme est blanc ; il nest pas vrai que tout homme est blanc ou : quelque homme nest pas blanc) ; de deux contradictoires, il est ncessaire que lune soit vraie et lautre fausse 3. Il fallait aussi dterminer quels sont les couples dattributs dont lun commande ou exclut lautre ; il y a quatre oppositions de termes ; les relatifs (double et moiti), les contraires (bien et mal), la possession et la privation (clairvoyant et aveugle), la p.178 contradiction (malade et non malade) 4. De ces oppositions, le sens de la premire et de la quatrime est facile saisir ; car deux relatifs simpliquent lun lautre, et deux contradictoires sexcluent, lun des deux devant ncessairement appartenir au sujet. En revanche lemploi des deux autres groupes dopposs demande mille prcautions ; dabord il faut dterminer dans quel genre on prend les contraires. (blanc et noir, dans le genre couleur ; pair et impair dans le nombre) et rapporter la discussion exclusivement ce genre ; puis, il faut distinguer deux cas, celui o les contraires nayant pas de milieu, la position de lun entrane lexclusion de lautre (pair, impair), et le cas inverse (blanc et noir ; le non blanc ntant pas forcment le noir) ; dans ce dernier cas, la dtermination des contraires sera
1 2
Topiques, I, 15, 107a 3. Topiques, I, 5, 102b 11. 3 De lInterprtation, 7. 4 Catgories, 8.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
127
difficile ; si le contraire du blanc est le noir et non pas une autre couleur, cest que dans le genre couleur, le noir est ce quil y a de plus loign du blanc : les termes les plus loigns possible, telle est la dfinition trs peu prcise des contraires laquelle aboutit Aristote. Pour la possession et la privation, il est entendu quils nont de sens que si on les rapporte un sujet qui possde par nature ce dont il peut tre priv ; cest lhomme qui est aveugle et non la pierre ; sinon serait vrai le sophisme qui affirme que lhomme a des cornes parce que lon ne peut dire quand il les a perdues.
II. LORGANON (suite) : LES ANALYTIQUES
@ De ces cadres logiques, si visiblement faits pour la discussion, Aristote a tir toute sa thorie du syllogisme. Il est venu sapercevoir que la ncessit avec laquelle on tirait les consquences des thses poses dabord tait tout fait indpendante du fait que lon discute ; le professeur qui expose, le p.179 dialecticien qui discute, lorateur qui persuade emploient, quelle que soit la diffrence de leurs points de dpart, un raisonnement aussi rigoureux : cest le syllogisme, cest--dire le procd qui fait voir la pense lunion dun attribut un sujet, quand cette union nest pas connue immdiatement. Il est donc loisible dtudier en lui-mme ce raisonnement dans lequel, certaines choses tant poses, une autre en rsulte ncessairement par le seul fait que celles-l sont poses 1 . Cette tude est lobjet des Premiers Analytiques, et elle comprend trois parties : la gense des syllogismes (chap. 1 26), les moyens dinventer les syllogismes (27-30), la rduction de tous les raisonnements valables au syllogisme 2. Cest la division platonicienne qui a pu donner Aristote lide du syllogisme ; car la division est bien une manire de syllogisme ; elle runit en effet un attribut (soit mortel) un sujet (soit homme), une fois admis que ce sujet fait partie dun genre (soit animal), et que ce genre se divise en deux espces, mortel et immortel, dans la premire desquelles rentre lhomme : il y a donc bien l trois termes, logiquement hirarchiss, et, grce cette hirarchie logique, runion de deux dentre eux par le troisime. Mais cest un syllogisme faible , incapable de conclure avec ncessit, puisquil ne donne aucun moyen de dcouvrir dans laquelle des deux espces, mortel ou immortel, il faut placer lhomme, et puisque, dautre part, il fait du moyen animal un genre plus tendu que lattribut mortel 3. Mais gardons lide de cette hirarchie logique, et supposons quil y ait trois termes qui soient les uns aux autres dans un rapport tel que le dernier (mineur) soit dans tout le
1 2
Premiers Analytiques, I, 1, 24b 18. Ibid., I, 32 dbut. 3 Ibid., I, 31 ; Seconds Analytiques, II, 5.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
128
moyen et que le moyen soit dans tout le premier (majeur) 1 . Il en rsultera un syllogisme des extrmes . Si A est affirm de tout B (majeure), et B de tout (ou de quelque) C (mineure), A est p.180 ncessairement affirm de tout (ou de quelque) C. De mme si A est ni de tout B, et B affirm de tout (ou de quelque) C, A est ni de tout (ou de quelque) C. Tel est le syllogisme parfait (premire figure) qui tire immdiatement ses conclusions de linspection de la hirarchie logique entre A, B et C. Remarquons aussi que les concepts hirarchiss ne sont pas assujettis, comme dans la division platonicienne, tre pris dans la quiddit du sujet de la conclusion ; ils peuvent tre aussi des propres et des accidents, pourvu quils satisfassent aux conditions indiques. Entre les trois termes, une autre hirarchie logique que celle qui est indique rendrait-elle possible le syllogisme des extrmes ? Oui, certes ; et il nest pas ncessaire que le moyen soit compris dans le majeur et comprenne le mineur. Si, par exemple, le moyen est affirm de tout le majeur (majeure) et ni de tout le mineur (mineure), il sensuit que le majeur est ni de tout le mineur (deuxime figure). Syllogisme, mais syllogisme imparfait, parce quil ne repose pas sur linspection immdiate de la hirarchie des termes. Il faudra donc le dmontrer, cest--dire le rduite un syllogisme de la premire figure. Cette dmonstration sopre en convertissant la mineure ; tant une ngative universelle (le moyen est ni de tout le mineur), elle se convertit en une ngative universelle (le mineur est ni de tout le moyen), et le syllogisme se trouv ainsi appartenir la premire figure (deuxime mode). Cette dmonstration, qui peut servir dexemple celle des trois autres modes, est videmment commande par le dsir de retrouver au fond de tout syllogisme un mme rapport conceptuel qui place le moyen entre les deux extrmes. Il y a encore syllogisme dans le cas o le majeur et le mineur appartiennent lun et lautre tout le moyen ; car on est en droit de conclure que le mineur appartient quelquefois au majeur (troisime figure). Dans ce cas, la hirarchie est inverse de celle de la figure prcdente, puisque le moyen est plus gnral et que le majeur et que le mineur. Il sera ais de transformer p.181 ce syllogisme imparfait en un syllogisme parfait, en convertissant la majeure qui, tant une affirmative universelle, se convertit en particulire affirmative, et devient : le moyen appartient une partie du majeur. On rtablit ainsi la hirarchie des concepts qui a donn naissance au syllogisme 2. Dans la division platonicienne, comme lattribut exprimait la quiddit du sujet, les propositions taient toujours ncessaires. Ds que lon saffranchit de cette condition, il nest aucune raison de croire quil ny a syllogisme quavec des prmisses ncessaires. Les propositions peuvent tre seulement contingentes et possibles, ou bien noncer une vrit de fait, mais qui nest point ncessaire. Telles sont les trois modalits que peuvent prsenter les
1 2
Premiers Analytiques, I, 4, 25b 32. Prem. Anal. I, 5b et 7.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
129
propositions. Do un nouveau problme : celui de dterminer la modalit de la conclusion dans chacune des trois figures, lorsque la modalit des prmisses est connue. Sauf dans le cas du syllogisme prmisses ncessaires de la premire figure, o lon voit immdiatement que la conclusion est ncessaire, Aristote dmontre la modalit de la conclusion dans tous les cas possibles, en se servant soit de la conversion soit de la rduction labsurde 1. Ce mcanisme compliqu du syllogisme est bien issu de la dialectique : les conclusions sont en effet les problmes rsoudre. Elles sont poses comme questions avant le syllogisme qui doit permettre une rponse. Le syllogisme nat souvent de longues recherches antrieures : une fois pose la question si tel attribut appartient ou non un sujet, il faut trouver le moyen qui la rsoudra ; et cest pourquoi il faut faire deux listes, lune de tous les sujets possibles du majeur, et lautre de tous les attributs possibles du mineur (sans remonter, toutefois, dans les attributs indiquant la quiddit, au del du genre prochain) ; cest dans la partie commune de ces deux listes que lon trouvera ncessairement le moyen 2. recherche ttonnante du moyen fait un contraste complet avec le mcanisme rigide du syllogisme une fois trouv. Ce contraste apparat jusqu lvidence, lorsque Aristote montre comment on peut dduire le vrai du faux ; la vrit de la conclusion nest en aucune manire une garantie de celle des prmisses. Il y montre encore un cas o la dduction est illusoire, malgr la parfaite correction des syllogismes ; cest celui de la preuve circulaire o lon se sert comme prmisse de la conclusion dun syllogisme qui avait lui-mme comme prmisse la conclusion que lon veut actuellement prouver 3. La question est donc maintenant de savoir comment se justifient les prmisses ; lart syllogistique permet bien denchaner ncessairement la conclusion aux prmisses ; il ne donne aucun moyen de poser des prmisses, dans le cas o ces prmisses ne sont pas elles-mmes des conclusions de syllogismes prcdents. Cest ici que trouve place la distinction entre les trois arts qui manient tous trois le syllogisme : lapodictique ou art de la dmonstration, la dialectique et la rhtorique. Cest lapodictique que sont consacrs les Seconds Analytiques. Le syllogisme qui donne la science ou la dmonstration nest pas seulement celui dont la conclusion dcoule ncessairement des prmisses (ce qui est un caractre commun tous les syllogismes), mais celui dont la conclusion est ncessaire. Or la conclusion ne peut tre ncessaire que si les prmisses sont elles-mmes ncessaires ; cest une rgle des syllogismes modaux que, si le moyen appartient ncessairement au majeur, et le mineur ncessairement au moyen, le mineur appartient ncessairement au majeur. Le
1 2 p.182 Cette
Ibid. du chap. VIII au chap. XXI ; cf. HAMELIN, Le Systme dAristote, chap. XII. Seconds Analytiques, II, 13. 3 Premiers Analytiques, II, 2 7.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
130
syllogisme scientifique ou dmonstration est donc caractris par la nature de ses prmisses. Elles doivent tre vraies ; elles doivent tre premires et immdiates et par consquent indmontrables ; car sil fallait les dmontrer elles-mmes et ainsi linfini, la science serait tout jamais p.183 impossible ; elles doivent contenir la cause de la conclusion ; enfin elles doivent tre logiquement antrieures la conclusion et plus faciles connatre quelle (I, 1, 2 et 6). Que sont ces indmontrables ? Il y a dabord les axiomes communs tels que : Il est impossible quun attribut appartienne et nappartienne pas un mme sujet en mme temps et sous le mme rapport . Mais de pareils axiomes sont les conditions universelles ou principes communs de toute science, et ne contiennent la cause de rien en particulier. Les propositions indmontrables qui contiennent la cause, ce sont celles qui enseignent ce quest ltre dont on veut dmontrer un attribut, cest--dire les dfinitions, qui sont les principes propres de la dmonstration 1. Le moyen doit tre emprunt la quiddit de la chose ; il y a une sorte de parit entre le moyen, lessence ou quiddit, la raison et la cause ; ainsi les astronomes ont dcouvert que lessence de lclipse de lune tait linterposition de la terre entre elle et le soleil ; cette interposition est le moyen terme par o lon dmontrera que la lune sclipse ; si tout corps spar ainsi de sa source lumineuse sclipse, et si la lune en est ainsi spar, il sensuit quelle sclipse. Cest toujours parce que le moyen fait partie de lessence du majeur, et parce quil est affirm du mineur, que le majeur peut, lui aussi, saffirmer du mineur. Cest parce quun angle droit est fait de la moiti de deux droits et que langle inscrit dans un demi-cercle est la moiti de deux droits quil est gal un droit. Cest parce quon ne peut attaquer un adversaire sans quil vous attaque son tour que les Athniens qui ont attaqu les Mdes les premiers ont t attaqus leur tour. Cest parce que la promenade entrane une digestion facile, et parce que lhomme en bonne sant a la digestion facile, que cet homme se promne. Le moyen fait donc toujours ressortir lessence ou un aspect de lessence du grand terme ; la mineure peut tre une simple proposition de p.184 fait qui affirme cette essence du petit terme ; la conclusion sera ncessaire 2. Il est certain que, dans la dmonstration, leffet est li analytiquement la cause, puisque leffet (clipse de lune) est la mme chose que la cause (interposition dun corps opaque). Pourtant lexpression liaison analytique est insuffisante pour caractriser la dmonstration ; car la mme liaison a lieu dans tout syllogisme, dmonstratif ou non. Ds que lon pense en effet la liaison propre la dmonstration, on saperoit quil y a entre le moyen et leffet un lien de drivation, de principe consquence qui implique la priorit relle et effective du moyen ; le syllogisme de la cause ou raison va plus loin quun simple jeu de concepts ; il atteint la ralit mme.
1 2
Seconds Analytiques, I, 9 11. Seconds Analytiques, II, 10.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
131
Mais cest prcisment ce point et pour cette raison que la thorie de la science commence ici dborder lOrganon ; en effet, il nest pas possible de dmontrer une dfinition, de faire dune dfinition la conclusion dun syllogisme ; lOrganon est ici incomptent ; tout au plus, peut-il montrer cette impossibilit : toute dmonstration fait voir quune chose est vraie dune autre ; mais la dfinition nonce lessence et naffirme pas une chose dune autre 1 ; dailleurs pour faire cette dmonstration, il faudrait que la cause de lessence ft diffrente de lessence elle-mme, ce qui nest pas, puisquune chose est par elle-mme et immdiatement ce quelle est 2. En revanche, les Analytiques ne peuvent, pas plus que les Topiques, donner de mthode positive pour atteindre les dfinitions. La place de cette mthode est pourtant indique : cest un principe sans exception que nous ne pouvons rien apprendre quen partant de quelque connaissance pralable ; pour tre premire et immdiate, la dfinition nest donc pas sans origine. Cette origine est la perception sensible do elle se tire par induction 3. Linduction est ce p.185 raisonnement dont parle Aristote dans les Topiques et qui consiste, pour attribuer une proprit un genre, faire voir quelle appartient aux espces comprises sous ce genre ; ainsi les anciens montraient que labsence de fiel est, chez un animal, un symptme de longvit en donnant lexemple des solipdes, des cerfs, auxquels des observations plus rcentes pouvaient ajouter le dauphin et le chameau. Pourtant linduction (qui, on le voit, porte non sur les individus mais sur les espces) ne peut, mme si elle est complte, nous faire voir la ncessit de la liaison entre la longvit et labsence de fiel. Cette liaison ne sera saisie intellectuellement que par lanalyse physiologique qui montre le rle du foie dans le maintien de la vie et fait voir dans le fiel une scrtion, de la nature des excrments, qui atteint le foie et par consquent la vie. Linduction ne saurait donc que prparer la connaissance des essences 4. Cette conception de la science dmonstrative ne fait quappliquer lenseignement un procd fait dabord pour la discussion. En effet la science est avant tout lart du professeur qui enseigne, cest--dire qui, excluant toutes les prmisses qui ne sont pas certaines, peut ds lors procder dogmatiquement comme le gomtre, et non pas par interrogation comme le dialecticien. Mais la certitude de ces propositions ne saurait tre elle-mme objet ou matire de science ; car elles devraient tre alors des conclusions de syllogismes, et ainsi linfini, ce qui rendrait la dmonstration impossible. Il faut donc, pour que la science soit possible, des prmisses qui sont elles-mmes indmontrables et qui ne sont pas objets de science. Comment dcouvrir ces prmisses ? Le dialecticien ou le rhteur les demandent, selon les cas, lopinion commune ou claire ; mais ils nobtiennent pas de
1 2
II, 3, 90b 25. II, 7, 93a 4. 3 I, 31, 88 a 4 ; II, 9, 100 b 3. 4 Comparer Premiers Analytiques, II, 25, et Des parties des animaux, IV, 3.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
132
certitude. A qui les demandera le savant ? Cette question donne le cadre de toute la philosophie dAristote, et dabord de sa mtaphysique.
III. LA MTAPHYSlQUE
@ La mtaphysique dAristote tient en effet la place laisse vacante par suite du rejet de la dialectique platonicienne. Elle est la science de ltre en tant qutre, ou des principes et causes de ltre et de ses attributs essentiels 1 . Elle pose ce problme trs concret : quest-ce qui fait quun tre est ce quil est ? Quest-ce qui fait quun cheval est un cheval, quune statue est une statue, quun lit est un lit 2 ? Il sagit de savoir le sens qua le mot est dans la dfinition qui nonce lessence dun tre. La Mtaphysique se trouve tre par consquent, pour sa plus grande partie, un trait de la dfinition : le problme de la dfinition, que Platon avait cru rsoudre par la dialectique, nest en ralit ni du ressort de la dialectique, qui juge simplement de la valeur des dfinitions faites, ni de celui de la science dmonstrative qui en use comme de principes, mais dune science nouvelle et encore inconnue, la philosophie premire, ou science dsire, qui soccupe de ltre en tant qutre.
p.186
Assurment le mot est a dautres sens que celui quil prend dans la dfinition ; il peut servir dsigner lattribut essentiel ou le propre (lhomme est riant), ou encore laccident (lhomme est blanc), laccident pouvant dailleurs tre pris dans une des neuf catgories ; mais ltre du propre comme celui de laccident suppose ltre dune substance ; et si lon peut parler aussi de ltre dune qualit et demander ce quelle est, cest parce quil y a dabord une substance ; tous ces sens dtre sont drivs du premier. Lobjet primitif et essentiel de la mtaphysique est donc de dterminer la nature de ltre en son sens primitif ; mais elle stend tous les sens drivs, puisque tous ces sens se rapportent au sens primitif. Cest pourquoi la mtaphysique a dabord tablir les axiomes p.187 puisque sans eux lon ne saurait parler de ltre en aucun sens ; on ne peut affirmer et nier la fois ; on ne peut dire quune mme chose est et nest pas ; on ne peut dire quun mme attribut appartient et nappartient pas un mme sujet en mme temps et sous le mme rapport. La ngation de ces principes est quivalente la thse du Protagoras du Thtte qui dclarait vrai tout ce qui parat tel. Ltablissement de ces principes indmontrables ne saurait dailleurs tre une dmonstration positive, mais seulement une rfutation de ceux qui les nient : rfutation toute dialectique consistant faire voir ladversaire que, en paraissant les nier, effectivement, il les accepte. Quil ny
1 2
Mtaphysique E 4, 1028 a 2 ; , 1 dbut. Z, 1, 1028 a 12-20.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
133
ait pas de milieu entre laffirmation et la ngation ; cest une condition de la pense ; dire le contraire, cest dire que ce qui est nest pas, que ne qui nest pas est, cest nier quil y ait du vrai et du faux. La rfutation consiste aussi montrer linsuffisance des exemples que ladversaire donne en faveur de sa thse ; notamment la variation des impressions sensibles selon les circonstances ne lui apporte aucune preuve ; car, si le vin, doux pour un homme sain, est amer pour le malade, au moment mme o le vin lui parat amer, il ne lui parat pas doux ; limpression sensible elle-mme vrifie laxiome (, 5 7). Au reste, la tche de la mtaphysique est nouvelle ; il ne sagit plus, ni comme chez les physiciens, darriver par dcomposition aux lments composants des tres, ni comme chez Platon, de slever par une dialectique rgressive jusqu une ralit suprme, objet dune intuition intellectuelle, mais bien de dterminer par gnralisation, les caractres communs de toute ralit. Aussi la mtaphysique nest-elle ni la science du Bien ou cause finale ni celle de la cause motrice, puisque Bien et cause motrice laissent en dehors deux les choses immobiles telles que les tres mathmatiques, mais la science bien plus gnrale de la quiddit qui ne laisse rien en dehors delle 1 ; elle p.188 ntudie pas une une et collectivement toutes les substances mais ce quil y a de commun toutes 2 ; mais, encore une fois ce quil y a de commun, ce nest pas des lments concrets, tels que le feu ou leau, cest que chacune a une quiddit qui permet de la classer dans un genre et de la dterminer par une diffrence 3. A cet gard, il ne faut faire aucune distinction entre les substances sensibles et les substances non sensibles, pas plus quentre les corruptibles et les incorruptibles ; le domaine de la mtaphysique nest pas limit la catgorie de choses non sensibles et incorruptibles ; il est bien plus tendu 4. Non pourtant que le mtaphysicien, tudiant ltre en tant qutre, ait lillusion davoir atteint le genre suprme ; cest l lerreur des platoniciens et des pythagoriciens qui parlant comme dun genre suprme de ltre (ou de lun ; ce qui revient au mme, puisque on peut dire un de tout ce dont on dit est), dterminent ensuite toutes les classes par la mthode de division, au moyen de diffrences de ltre : erreur logique, puisque cest une rgle logique que la diffrence (par exemple bipde) ne doit point contenir dans sa notion le genre (animal) dont elle est la diffrence, tandis que, de chaque prtendue diffrence de ltre, on peut dire quelle est. Ltre, attribut universel, nest donc point pour cela le genre dont les autres tres seraient les espces ; les premiers genres sont les catgories, et ltre, comme lun, est au-dessus delles et commun toutes (I, 2).
1 2
B, 2, 996a 18-b 26. Ib., 997 a 16-25. 3 B, 3, 998 a 20-b 14. 4 B, 4, 1000 a 5.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
134
Pour faire de lun ou de ltre le genre et par consquent le gnrateur de toute ralit, la dialectique platonicienne prenait pour point de dpart moins ltre que des couples dopposs, tre et non tre, un et multiple, fini et infini, par le mlange desquels elle engendrait toutes les formes de la ralit. La mtaphysique ferme encore cette issue la dialectique : les opposs ne sont pas des principes primitifs, mais des manires dtre des p.189 substances ; une chose est substance avant dtre finie ou infinie ; or la substance, cest--dire un homme ou un cheval na pas de contraire ; ce premier principe ne peut donc tre le point de dpart dune dialectique ; la science des opposs nest plus quune partie subordonne de la mtaphysique 1 ; nous verrons quel rle immense elle garde, comme principe de la physique. Si ltre nest ni un genre suprme ni un terme dans un couple dopposs, il nest quun prdicat ; et les seules ralits dont il soit prdicat, quand on le prend en son sens primitif, ce sont des ralits individuelles, Socrate ou ce cheval ( ). Ces ralits sont celles qui sont tudies par la mtaphysique, non pas comme particulires, mais en tant quelles sont quelque chose. Or, ny a-t-il pas l une difficult grave ? Ces choses sensibles, mouvantes, vanouissantes, sont-elles rellement quelque chose ? La science est-elle possible autrement quen atteignant leur modle intelligible et fixe ? De l, le fameux dilemme ; ou un objet est objet de science, et alors il est universel et donc irrel, ou il est rel, donc sensible, sans avoir dtre vritable, donc sans prise pour la science. Car il ny a de science que de luniversel 2 . Cest ce qui a amen Platon superposer aux ralits du devenir, objets dopinion, les ralits stables des ides, objets de science, issue ferme Aristote, dont une des principales proccupations est alors dmontrer les lments stables et permanents impliqus au sein du devenir lui-mme.
IV. CRITIQUE DE LA THORIE DES IDES
@ Cette conception de la mtaphysique reste en un sens fidle lesprit platonicien ; si la science est possible, bien quil ny ait que des ralits individuelles, cest cause des ralits p.190 stables et partant intelligibles que contiennent ces choses particulires. Lillusion de Platon est davoir considr ces ralits stables comme spares des choses sensibles. En sparant les ides, Platon, selon Aristote, na voulu quimaginer une substance qui pt tre lobjet de la science cre par Socrate. Celui-ci avait plac la science dans des inductions amenant des dfinitions ; Platon, tendant la nature entire la mthode que Socrate avait employe en morale, a vu dans les ides des substances correspondant aux quiddits nonces dans les dfinitions, et il a
1 2
N, 1, 1087 a 29-b 4. B, 4, 999 a 24-b 16 ; A, 6, 987 a 34-b 14.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
135
expliqu les choses sensibles par leur participation ces substances 1. La critique dAristote est naturellement toute dialectique ; il sagit moins de dmontrer que les ides nexistent pas que de montrer que la philosophie de Platon nest pas la philosophie premire, cest--dire de montrer quelle a laiss spares les deux choses quelle a cru unir, la science et la substance. Aussi, cette critique, si multiple et varie quelle soit, peut au fond se rduire deux chefs : ou bien les ides sont objets de science, et alors elles ne sont pas des substances ; ou elles sont les substances des choses, et alors elles ne peuvent tre objets de science. Considrons le premier point : on sait les trois arguments par lesquels les platoniciens dmontrent lexistence des ides : lun au-dessus des multiples (une multiplicit dobjets possdant une mme proprit, la beaut par exemple, exige que cette proprit existe au-dessus deux tous) ; les arguments tirs des sciences (puisquune dfinition gomtrique implique lexistence de son objet) ; la reprsentation de la chose qui persiste. une fois la chose disparue, ce qui implique la stabilit dun objet de la science qui nest plus soumis au flux des choses sensibles 2. Or, supposer vrais ces trois arguments, ils prouveraient trop ; car les choses multiples dont on affirme lunit les choses que lon dfinit, celles enfin que lon se reprsente une p.191 fois disparues, peuvent tre bien autre chose que des substances, savoir des quantits, des qualits et des relations. Ces arguments prouvent donc lexistence des ides de qualits ou des relatifs au mme titre que celle des ides de substances 3. Mais comment lide dune chose qui nest pas substance pourrait-elle tre substance ? Car si lide dune qualit est, comme on le veut, ltre mme de cette qualit 4, il sensuit quelle est elle-mme qualit. Il faut aller plus loin : mme lide dune substance ne peut tre, elle aussi, une substance : car toute substance est une ; or, si les ides sont, comme elles doivent ltre dans le platonisme, des objets de dfinition, elles ne peuvent tre unes. Toute dfinition est en effet compose dun genre et dune diffrence : par exemple, lhomme se dfinit un animal bipde ; cette composition ne devrait pas tre un obstacle lunit du dfini, puisque animal bipde dsigne un seul tre ; or, si la thorie des ides est vraie, la composition est incompatible avec lunit ; car les termes animal et bipde dsignent chacun une ide, donc une substance : il y a donc dans lhomme deux substances, et lhomme perd, avec son unit, sa substantialit 5. Mais, bien plus, lunit du genre animal nest pas mieux sauvegarde que celle de lespce ; car, sil tait un, il devrait, pour former les espces, participer la fois et sous le mme rapport des diffrences contraires, par exemple animal
1 2
A, 6, 987 b 1-10. A, 9, 990 b 11-15. 3 Ibid., 16 ; 22-34. 4 Cf. les consquences de la supposition contraire, Z 6, 1031 a 29. 5 M, 4, 1079 b 3-9 ; comparer Z, 12, 1037 b 10-17 ; Z, 13, 1039 a 3-6 ; 1038 b 16.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
136
bipde et multipde 1 : si cest impossible, il faut donc quil soit multiple, et que son unit soit dans notre pense et non plus dans la ralit. Enfin, largumentation de Platon, en pousser les consquences, tablirait pour chaque classe dtre non point une ide comme elle le veut, mais une infinit dides ; car si, chaque multiplicit de choses semblables doit correspondre une ide, la rgle doit sappliquer quand nous envisageons lhomme sensible et lide de lhomme ; ces deux termes, puisquils sont p.192 semblables doit correspondre un troisime homme ; au groupe form par ces trois hommes, doit en correspondre un quatrime, et ainsi linfini 2. La substantialit de lide va ainsi se perdant. Ainsi, si les ides peuvent tre dfinies, elles ne sont pas des substances ; inversement, si les ides sont des substances, elles ne peuvent tre ni objets, ni moyens de science. Dans toute largumentation qui suit, Aristote prte Platon lintention de faire des ides des principes dexplication des choses sensibles ; elles ne sont que la quiddit ralise de ces choses 3 ; et elles prtendent bien rpondre au problme de la mtaphysique ; ce qui fait quun homme (sensible) est un homme, cest quil participe lhomme en soi. Or, cette explication est illusoire : dabord, comme les ides sont des substances fixes, elles doivent tre causes toujours de la mme manire, et elles nexpliquent donc pas le devenir des choses sensibles, le pourquoi de leur naissance et de leur disparition. Lide, tant immobile, peut tre cause dimmobilit mais non de mouvement 4. Comment dailleurs agiraient les ides ? Non pas certes comme la nature qui est immanente aux choses, puisquelles en sont spares. Elles ne peuvent tre non plus des causes motrices. Et en effet aucun abstrait, aucun universel nest capable de produire une chose particulire ; cest toujours une chose particulire actuelle qui engendre une chose particulire ; cest larchitecte qui fait la maison, et cest lhomme qui engendre lhomme 5 . Cette vision concrte et immdiate du devenir ou plutt des devenirs multiples soppose la fiction platonicienne de prtendus modles des choses, qui ne sont en ralit que ces choses mmes auxquelles on ajoute lexpression en soi et qui, loin dexpliquer les choses, ne font que les doubler. Rien dessentiel nest ajout cette critique par largumentation que dirige Aristote contre les doctrines apparentes p.193 celle des ides : dabord contre la doctrine des tres mathmatiques, conus par Platon comme des intermdiaires entre les ides et les choses sensibles, ensuite contre la thorie des nombres mathmatiques rigs en ralits suprmes par Speusippe, enfin contre la thorie des nombres idaux chez Xnocrate. Pourtant il y a un point
1 2
Z, 14, 1039 b 2-6. Z, 13, 1039 a 2. 3 M, 9, 1086 b 9 ; A, 991 b 1-3. 4 A, 7, 988 b 3-4. 5 A, 9, 991 a 8-11 ; Z, 8, 1033 b 26-32 ; 3, 1070 a 27.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
137
nouveau : Aristote ne peut pas dire des essences mathmatiques ce quil disait des ides, quelles ne font que doubler les choses sensibles, puisquelles sont dune autre nature. Mais alors, cette diffrence de nature est prcisment le point de dpart dune critique inverse de celle quil adresse aux ides, savoir le caractre compltement arbitraire (quil signale en particulier chez les partisans des nombres idaux) du rapport entre le nombre et la chose quil a charge dexpliquer 1. Pourtant, pourrait-on dire, des sciences du type de lastronomie qui substitue au ciel visible une construction mathmatique faite de cercles ou de sphres, navancent-elles pas plus prs de la ralit que celles qui en restent la sensation ? Ces sciences taient vraiment le fort des platoniciens : et Aristote lui-mme 2 admet bien que, dans des sciences telles que lharmonique, larithmtique donne la raison ou lessence des accords que les sens font connatre. Sensuit-il que les ralits mathmatiques sont distinctes des sensibles ? Si le ciel des astronomes est une ralit distincte du ciel sensible, il faudra quil y ait un ciel immobile a la place mme o nous voyons le ciel se mouvoir 3. Ltre mathmatique na point cette ralit : il nat dune abstraction qui envisage les formes et les limites en les sparant de leur contenu. Aussi Aristote ne considre pas du tout que les mathmatiques rendent les substances relles intelligibles ; comme les formes et les mouvements rguliers du ciel ont finalement chez lui des raisons physiques, de mme il rejette les constructions mathmatiques p.194 que lon essayait alors de phnomnes comme la vision. Les mathmatiques natteignent que des prdicats des choses, des quantits et nenvisagent point la substance, ltre comme tel ; ce nest pas de leur ct que lon trouvera la mtaphysique.
V. LA THORIE DE LA SUBSTANCE
@ En cartant la doctrine daprs laquelle les quiddits ou essences des choses sont des substances ternelles ralises en dehors des choses dont elles sont les essences, Aristote ne prtend pas nier du tout, bien au contraire, que les quiddits soient ; seulement la quiddit est dans la chose elle-mme ; la quiddit de lhomme est dans Socrate et Callias. Sous un de ses aspects, la mtaphysique est lensemble des rgles qui permettent disoler cette quiddit du reste des attributs. Mais, par la nature du problme, il ny a pas l matire dmonstration, puisquon ne dmontre pas la quiddit ; do en ce domaine, cet appel frquent soit lexprience, soit lopinion, qui est le signe de la mthode dialectique. Dune manire gnrale, si la substance dont il sagit est nous-mme, il est ais dliminer de lessence des attributs comme musicien, vtu de blanc, qui
1 2
M, 8, 1084 a 12-27. Seconds Analytiques, I, 9. 3 B, 2, 997 b, 12-24.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
138
sont acquis et nappartiennent pas nous-mme comme tels ; il reste, comme rsidu, les caractres qui appartiennent la dfinition ; lessence est de toutes les choses dont il y a dfinition ; elle ne contient que ce qui dans la chose nest pas driv mais primitif. Mais encore faut-il distinguer la dfinition qui suppose que le dfini est en autre chose, dfinition qui natteint que les choses drives et non pas les substances, et la dfinition proprement dite qui est celle dune essence qui ne se rapporte pas autre chose ; ainsi pair, qui se dfinit divisible par deux, implique nombre ; camusit, qui signifie courbure dans le nez, implique le nez ; lessence ou quiddit nappartient ces choses que p.195 secondairement et non pas primitivement comme elle appartient la substance 1. Le terrain ainsi dblay, reste la principale difficult : quest-ce qui fait lunit de lessence exprime par la dfinition, unit sans laquelle elle ne peut tre une substance ? Si la dfinition de lhomme est animal bipde, quest-ce qui fait que animal bipde dsigne une essence unique et non une collection de deux termes, tandis que animal blanc est un compos dessence et de qualit 2 ? Question fort grave, puisquil sagit de savoir si, comme les atomistes lont prtendu, on peut obtenir lessence dun tre par simple juxtaposition dlments, ou si lessence a une vritable unit. Pour y rpondre, il faut distinguer entre les parties matrielles dun tre et les parties de sa forme ou de son essence : ainsi les partis matrielles dun cercle, ce sont les segments en lesquels il est divisible ; ses parties formelles, cest le genre (figure plane) et la diffrence qui le dfinissent. Or le cercle ne nat pas de la juxtaposition de ses parties matrielles, auxquelles mme il est antrieur, puisque la notion du demi-cercle implique celle du cercle ; de mme langle aigu, partie matrielle de langle droit, est pourtant logiquement postrieur langle droit, puisquil se dfinit langle plus petit quun droit. De mme la main est postrieure et non pas antrieure lessence du corps vivant, puisquelle ne saurait exister comme main, part de ce corps. Il est vrai quon ne distingue pas toujours clairement les parties essentielles des parties matrielles ; il est difficile par exemple de voir que la chair et les os ne font point partie de lessence de lhomme. Et les platoniciens ont profit de cette difficult pour rduire lessence formelle de toutes choses des nombres, rejetant tout le reste dans les parties matrielles (Z, 11). Mais, la distinction suppose faite, il en rsulte dabord que lunit de ltre ne rsulte point de la conjonction ou p.196 juxtaposition de parties matrielles, puisque ces parties sont postrieures ltre, mais du mode dunion de ses composants logiques, genre et diffrence. Il y a deux manires pour un attribut de sunir un sujet, soit que le sujet participe lattribut (lhomme est blanc) soit que lattribut soit contenu dans le sujet (le nombre deux est pair) ; mais la diffrence ne peut appartenir au genre daucune de ces
1 2
Z, 4, 1030 b, 4-6. Z, 12, 1037 b, 10-18.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
139
deux manires ; comment le genre pourrait-il participer plusieurs diffrences qui sont contraires entre elles ? Comment les diffrences pourraient-elles tre comprises dans le genre sans que tout se rduist lunit dun genre ? Il y a entre le genre et la diffrence un mode dunion tout fait autre et bien plus intime : animal et bipde ne dsignent pas deux tres mais un seul, qui, dabord comme animal, apparat relativement indtermin (cest--dire matire ou tre en puissance), puis comme bipde est relativement dtermin (cest--dire forme et tre en acte) ; la dfinition est donc un nonc un et nonce un tre un, en le dterminant dabord incompltement par le genre (lanimal tant le bipde en puissance), puis compltement par la diffrence bipde 1. Il ny a pas l la moindre juxtaposition de parties trangres lune lautre ; on ne parle pas de deux choses diffrentes en parlant danimal et de bipde, mais dun mme tre dabord indtermin, puis dtermin. Mais il est clair que, pour que la rponse soit valable, la notion complte et actuelle dhomme doit prexister ses composants ; car la notion danimal ne peut tre considre comme indtermine que relativement une notion complte telle que celle de lhomme. Il ne faut donc pas dfinir comme on a lhabitude de faire 2, cest--dire sans doute avec la mthode de division platonicienne qui prtend construire synthtiquement les espces en partant du genre, et va ainsi de ltre en puissance ltre en acte, mais dune autre manire, cest--dire p.197 analytiquement en allant de lacte la puissance. Lunit de lessence se trouve donc achete au prix du renoncement toute mthode gntique et constructrice des concepts : lessence nest pas compose dlments comme la syllabe lest de lettres ; elle est simple et indivisible (lanalyse de la dfinition ntant pas, on la vu, une vritable dcomposition). Or il ny a, pour des termes simples, ni rechercher ni enseigner ; ou du moins la recherche est dun autre genre 3 . Il ny a pas dautre moyen de saisir ces termes indivisibles que cette intuition intellectuelle immdiate quAristote appelle la pense (), et qui est lessence comme la vision est la couleur, ne pouvant pas plus errer sur son objet que chaque sensation sur son sensible propre ; il peut y avoir erreur quand on compose des penses, non quand on pense des termes simples par une sorte de contact immdiat 4. Remarquons, pour prciser, que lintuition intellectuelle nest pas, comme chez Platon, au bout dun long mouvement dialectique qui nous fait dpasser les choses sensibles ; la pense est dans la perception sensible ; elle est immanente la sensation, comme lessence lest la chose 5 ; il y a perception sensible de luniversel, par exemple de lhomme en Callias, non de Callias seulement 6 . La pense, en usant de
1 2
Z, 12, 1037 b, 8-27. H, 4, 1045 a, 20-22. 3 Z, 17, 1041 b, 9. 4 De lme, III, 6, 430 b, 14. 5 , 9, 1051 b, 24-30. 6 Seconds Analytiques, II, 15, 100 a 16.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
140
linduction, produit luniversel. La pense, loin de se sparer du sensible, va donc se tourner vers lui pour connatre les essences ; mais il ny a pas chez Aristote de mthode pour dgager les essences ; et il ne peut y en avoir ; simplement une confiance gnrale dans la pense qui saura les dcouvrir.
VI. MATIRE ET FORME ; PUISSANCE ET ACTE
@ Il reste montrer que lessence () est vritablement ltre en tant qutre, cest--dire ce qui ne se rfre pas un p.198 principe suprieur, ce qui est vraiment principe radical. Pour saisir la porte du problme, il suffit de songer aux rsistances quAristote devait trouver tant prs des Platoniciens pour qui la construction gntique des essences tait le problme fondamental que prs des physiciens ou thologiens qui, leur manire, prtendaient dduire la diversit des tres. En niant la possibilit mme de poser le problme, Aristote eut une influence immense sur la direction de la pense philosophique : ctait mettre fin toutes les tentatives dexplications gntiques que nous avons vu natre dans la pense grecque. Aussi est-il particulirement important de saisir sa doctrine sur ce point. Aristote y emploie, par la nature mme du sujet, qui porte sur des principes indmontrables, une mthode danalogie, dintuition, dinduction qui est sans rigueur dmonstrative : les notions mtaphysiques, qui se rapportent ltre, plac au-dessus des genres de ltre, ne sont pas susceptibles de dfinitions, mais leur sens peut tre seulement suggr par lanalogie 1. Cette argumentation peut se formuler ainsi : si lessence (forme ou quiddit) est un principe premier, cest quelle est un acte et que lacte est toujours antrieur la puissance. Quest-ce que lacte () ? Lacte est la puissance comme lhomme veill au dormeur, celui qui voit celui qui a les yeux ferms, la statue par rapport lairain, lachev par rapport linachev 2. Les seconds termes de chaque couple sont en puissance chacun des premiers ; celui qui a les yeux ferms est voyant en puissance, lairain est statue en puissance, ce qui veut dire que les yeux verront et que lairain deviendra statue, si certaines conditions sont ralises. Le voyant et la statue sont, proprement parler, des tres en acte, dont les actes sont respectivement la vision et la forme de la statue. La vision est un acte, en ce sens quelle reste galement et uniformment vision p.199 pendant tout le temps pendant lequel elle a lieu ; la vie, le bonheur, lintuition intellectuelle sont pour la mme raison des actes, tandis que la marche qui progresse et est chaque instant un stade diffrent
1 2
, 5, 1048 a 36. Ibid., 1048, b, 1.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
141
est non pas un acte, mais une action ou un mouvement. Lacte () est comme luvre ou la fonction () de ltre en acte ; la vision est par exemple la fonction de lil 1 ; lacte est encore entlchie (), cest--dire tat final et achev qui marque les limites de la ralisation possible 2. Il est clair que la notion de puissance na pas de sens en elle-mme et quelle est toute relative ltre en acte ; cest non pas par ce quil est, mais au contraire par ce quil peut devenir, que ltre en puissance est conu comme tel. Lacte est au contraire le centre de rfrence par rapport auquel sont situs et ordonns les tres en puissance. Or, lessence ou forme est un acte 3 et lacte par excellence ; car la quiddit est ce qui appartient un tre donn depuis sa naissance jusqu sa disparition, intgralement, sans progrs ni dficience ; elle nest pas susceptible de plus ou de moins ; lon nest pas plus ou moins homme. Pour exprimer cette permanence inaltrable, Aristote emploie pour lessence lexpression , le fait, pour un tre, de continuer tre ce quil tait. De cette essence ou forme, il ny a pas de devenir ; la forme de la sphre dairain, qui est la forme sphrique, ne nat point lorsque lon fabrique la sphre dairain ; ce qui nat, cest lunion de la forme sphrique et de lairain 4. La naissance ou devenir consiste ainsi dans lunion dune forme avec un tre capable de la recevoir ; cet tre en puissance, devenu tre en acte aprs avoir reu la forme, est proprement ce quAristote appelle matire (). La matire est lensemble des conditions qui doivent tre ralises pour que la forme puisse apparatre ; le coffre en puissance, ou, ce qui revient au mme, la p.200 matire du coffre, cest le bois 5. On le voit, la thse dAristote revient proclamer linexistence de ltre non dfini ; tout tre actuel, cet arbre, cet homme, a, tant quil existe, une essence unique qui en fait un tre en acte ( ) ; ne pas exister, cest, comme le lgendaire bouc-cerf, ntre rien. Maintenant (et cest l, de tous les thormes aristotliciens, le plus important), lacte est antrieur la puissance dans les trois sens du mot antrieur, logiquement, temporellement et substantiellement 6 ; logiquement, puisque, nous lavons vu, la notion de ltre en puissance implique celle de ltre en acte par rapport qui il est dit en puissance ; temporellement, puisque ltre en acte ne provient dun tre en puissance que sous leffet dun autre tre dj en acte ; par exemple le musicien en puissance ne devient musicien en acte que sil est duqu par un musicien en acte ; cest lhomme qui engendre lhomme ; enfin substantiellement, puisque lhomme en puis1 2
, 8, 1050 a, 21-22. , 3, 1047 a, 30. 3 , 8, 1050 b, 2. 4 Z, 8, 1033 b, 5-11. 5 , 7, 1049 a, 18-27. 6 , 8, 1049 b, 19-12.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
142
sance, qui est la semence, tient toute son essence dun homme adulte et en acte. La grosse objection et peut-tre lunique au fond quAristote adresse ses devanciers, cest davoir mconnu la vrit de ce thorme, depuis les thologiens qui faisaient tout natre de la nuit 1, jusqu Platon qui veut faire natre la varit des tres des genres suprmes les plus indtermins. Contre tous ces adversaires, Aristote ne se lasse pas de rpter ce qui en effet peut tre prsent sous diverses formes, mais non pas prouv, savoir que lexistence ne peut tre donne que sous forme de substances actuelles, intgralement dtermines, et que lindtermination ou la matire qui peut exister dans le monde nest nullement une indtermination absolue et en soi, mais seulement relative des formes plus compltes.
VII. PHYSIQUE ; LES CAUSES, LE MOUVEMENT, LE TEMPS, LE LIEU, LE VIDE
@ Lacte, cest--dire la fonction agissante dun tre actuellement existant, tel est donc, en chaque cas, le principe final dexplication ; lil sera expliqu lorsque lon aura montr que ses matriaux sont choisis et disposs pour la vision ; lanimal, lorsque lon aura montr tous les organes combins pour rendre possibles les fonctions vitales ; la cit, lorsque lon aura montr les activits humaines qui en sont les matriaux se combinant en vue dune vie heureuse, facile et bonne. La science aristotlicienne consistera, pour une bonne part, montrer comment des matriaux choisis sorganisent en vue dune certaine fonction : la mtaphysique na fait quen dessiner les cadres ou en indiquer lesprit ; cest lexprience de les remplir, et cest l une uvre collective, encyclopdique, sujette des retouches linfini ; aussi rigides sont les cadres, aussi varie et multiforme la matire qui sy insre.
p.201
Pour avoir un guide dans cette encyclopdie ; il faut se tenir ferme la maxime aristotlicienne suivante : Il faut procder du gnral au particulier 2 , cest--dire de ces ensembles obscurs et confus que sont pour nous les premires connaissances ces connaissances dtailles et distinctes qui, en soi sinon pour nous, sont les premires. La science dAristote a mme rythme que son univers ; elle est un passage de lindtermin au dtermin ; loprateur de ce passage, cest la pense en acte, celle par exemple qui sait actualiser dans une figure gomtrique les lignes qui y sont en puissance et qui serviront dmontrer le thorme. La science dAristote ne progresse pas en profondeur ;elle va plutt stendant et spanouissant.
1 2
A 6, 1071, b, 26-28. Physique, I, 1, 184 a, 23.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
143
Cest que la recherche des fonctions, actes ou essences, est p.202 absolument solidaire des investigations exprimentales sur les conditions matrielles dans lesquelles ces fonctions peuvent se raliser ; ces investigations qui, naturellement, sont illimites, forment la grande partie des travaux dAristote. La physique gnrale sera complte lorsque, ayant dfini les tres naturels en gnral, nous aurons saisi le mcanisme du mouvement qui les ralise. Ltude de ltre vivant sera complte quand, ayant dfini les fonctions vitales en gnral et lme, nous aurons dcrit les mille combinaisons organiques qui lui permettent de se raliser. La forme est toujours ainsi insparable dune matire, ltre en acte de ltre en puissance. Les notions fondamentales de la physique se rfrent cette union. La thorie des causes rpond la question : quest-ce qui fait que tel sujet acquiert telle forme, que le malade gurit ou que lairain devient statue ? Cest la cause matrielle de quoi la chose est faite ; cest ici lairain ou le malade ; la cause formelle, forme, modle ou essence, qui est lide de la sant dans lesprit du mdecin ou lide de la statue dans lesprit du sculpteur ; la cause motrice, qui est le mdecin ou le sculpteur ; la cause finale, cest--dire ltat final ou achev en vue duquel ltre en puissance est devenu tre en acte, la forme de la statue vers laquelle change lairain, celle de la sant vers laquelle change lorganisme (Physique, II, 3). La nature est aussi dfinie non proprement parler comme forme, mais par une certaine relation la matire. En envisageant dune part des produits des arts comme une statue ou un lit, et dautre part des tres naturels comme une pierre ou un homme, on saperoit que les seconds ont en eux-mmes le principe de leur mouvement et de leur repos, tandis que les premiers ont ce principe en un tre tranger eux, le sculpteur ou le charpentier ; dans le cas de la nature, nous avons affaire une force active immanente ( la semence produit une uvre dart ) ; dans le cas de lart, la force active qui est une pense abandonne luvre une fois faite. Ce qui distingue lun de lautre, cest p.203 donc bien le rapport de la forme la matire, intrieur dans lun, extrieur dans lautre 1. Dans la mme notion du rapport de la forme la matire prennent un sens les notions gnralement rpandues de chance et de spontanit auxquelles la critique des physiciens tendait dnier toute valeur : notions populaires et immdiates dsignant non labsence de causes, ainsi que disent les physiciens, mais au contraire des causes agissantes pour notre bonheur ou notre malheur. Lhomme qui, allant lagora, a la chance de trouver un dbiteur qui il ne songeait pas et de recouvrer ainsi sa dette croit avec raison que la chance est une cause parfaitement relle. Elle est en effet relle, mais condition quon la considre comme toute relative, de la mme faon que la matire nest telle que relativement la forme. Ainsi la chance ne peut se dfinir que par rapport aux actes qui sont faits en vue dune fin ; il y a chance, lorsquun acte fait un
1
Physique, II, 1 ; Mtaphysique, Z, 9, 1034 e, 33.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
144
vue dune fin a les mmes consquences que sil avait t fait en vue dune autre fin ; ainsi le crancier recouvre sa dette comme sil tait venu pour cela. La chance nest donc pas une cause premire comme la volont ou lintention ; elle est plutt cause par accident, en ce sens que lacte dont lvnement heureux ou malheureux est leffet na pas t fait pour le produire ; mais encore est-il que cet effet aurait pu tre une fin pour la volont. La chance est par suite un fait rare, tandis que les faits produits par des causes dfinies sont ceux qui se produisent toujours ou au moins la plupart du temps. La spontanit est de mme nature que la chance ; mais son domaine est plus large : elle est, la finalit naturelle, ce que la chance est aux fins intentionnelles de la volont ; si un trpied en tombant se dispose de manire servir de sige, nous disons quil est tomb spontanment. Cest donc une aussi grosse erreur de nier ces causes que den faire des causes premires, antrieures lintelligence et la nature. Enfin, cette liaison commande lide quAristote se fait du mouvement. Il importe de songer que, pour lui, le mot de mouvement voque les changements dtat dtres dtermins. Le mouvement local, par exemple, ce nest nullement un espace parcouru en un temps donn, dfinition telle que tout mouvement ait un rapport prcis avec un autre mouvement, mais cest le mouvement de ltre vivant, saut, marche, reptation ou vol, ou bien le mouvement de la pierre, mouvement vers le centre du monde ; celui de lastre, mouvement circulaire 1 ; ce sont l mouvements despce diffrente (parce quils appartiennent des substances diffrentes) et non pas seulement de quantit diffrente ; ils dpendent en une grande mesure de la nature du sujet qui les possde. Mais il y a bien dautres changements dtats que des mouvements locaux ; il y a par exemple le changement qualitatif ou altration, comme le changement de couleur de la peau dans la passion ou dans la maladie, le changement en quantit, accroissement ou diminution, par exemple lorsque lenfant grandit jusqu ce quil ait atteint sa taille dadulte, ou lorsque le malade maigrit de consomption.
p.204
Tout mouvement est donc limit entre un tat initial et un tat final 2 qui aboutit au repos, lorsque se sont dveloppes tout ou partie des possibilits contenues dans ltat initial. Do la formule clbre : Le mouvement est lacte du possible en tant que possible 3 . Ce nest pas en tant qutre vivant dune telle taille que lenfant grandit, cest en tant quil est enfant, cest--dire quil a la possibilit datteindre la taille adulte ; cette possibilit ralise, le mouvement cesse. Le mouvement na donc de sens que dans le rapport de la forme la matire, de lactuel au virtuel. Le mouvement est en gnral dsign par rfrence ltat final vers lequel il tend ; le noircissement est laltration qui p.205 tend vers le noir ; mais
1 2
De la marche des animaux, chap. III, dbut. Physique, V, 1, 224 b, 35. 3 Physique, III, 1, 201 a, 27-29.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
145
il ne faut pas perdre de vue que le mouvement part dun tat initial qui est le contraire de ltat final, ou intermdiaire entre cet tat et son contraire 1. Si une chose noircit, cest que, au dbut, elle tait blanche ou du moins grise ; si elle grandit, cest quelle tait petite ; si une pierre tombe vers le bas, cest quelle tait en haut. Tout mouvement par consquent a lieu entre des contraires, du haut en bas, du blanc au noir, puisquil ne fait que substituer un contraire lautre ; de plus, ltat initial et ltat final, tant des contraires, sont ncessairement dans le mme genre ; il ny a de mouvement que dune couleur une couleur, dun lieu un lieu. Il y aura donc autant de genres suprmes de mouvement quil y a de genres de ltre qui admettent des contraires ; or parmi les catgories, seules, celles de la qualit, de la quantit et du lieu sont dans ce cas ; do les trois seuls genres de mouvements : altration, augmentation et diminution, mouvement local ; ces trois genres de mouvements sont tout aussi irrductibles un genre commun que les genres de ltre dont ils drivent 2. Dans chacun de ces genres le mouvement a pour point de dpart la privation dune certaine qualit et pour point darrive la possession de cette qualit ; le mouvement va du non-blanc au blanc, du non-musicien au musicien. Dautre part, privation et possession doivent appartenir un sujet qui ne change pas pendant le devenir, un homme par exemple (Physique, I, 7). A ces trois genres, Aristote en ajoutait dabord un quatrime quil a ensuite exclu 3, ; cest la gnration et la corruption, cest--dire la naissance dune substance et sa mort ; ce passage du non-tre ltre et de ltre au non-tre ne doit pas sappeler un mouvement, dabord parce que aucune substance na de contraire , ensuite parce quil est brusque et discontinu. La gnration est sans doute prcde de mouvements de toute p.206 espce qui ont modifi la matire pour la mettre en tat de recevoir la forme ; tel le travail prliminaire du statuaire ; le savant a mme pour principal objet ltude de ces transformations ; par exemple le trait De la gnration des animaux tudie, avant tout, les modifications de la semence qui la rendront capable de recevoir la forme ; mais il ne faut pas confondre cette srie de modifications qui sont de vritables mouvements avec la gnration mme qui concide avec ltat final o amnent ces mouvements dirigs vers elle et qui a lieu en un instant indivisible. Les intentions de cette thorie du mouvement sont aises apercevoir si lon songe au dveloppement antrieur de la philosophie grecque : le mouvement tait par excellence le flux, lindfini, lillimit, cet lment rebelle la pense conceptuelle, que les platoniciens appelaient lautre ou lingal 4. Ce flux universel qui fait natre et emporte des formes sans cesse
1 2
Physique, III, 2, 201 b, 22 sq. Ibid., 1, 200 b, 32-201 a 9. 3 Comparer Physique, III, 1, 200 b 32 et V, 1, 225 a 34. 4 Physique, III, 2, dbut.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
146
changeantes rend impossible toute science et toute connaissance ; il ne restait plus qu fuir dici 1 et chercher la science dans un monde transcendant. A cette image, qui considre comme des ralits absolues des tres en puissance, Aristote substitue la sienne, selon laquelle ltre en puissance est tout relatif ltre en acte. Il ny a point de flux universel : il ny a quune collection de mouvements, dont chacun est limit dune manire prcise par un tat initial et un tat final, Il ny a point de flux des formes substantielles ; la forme substantielle qui, comme cause finale, a dirig la srie des modifications qui ont amen la matire la recevoir, reste stable et identique : la science, avec ses concepts stables, pntre les choses mouvantes elles-mmes. Il reste pourtant des proprits communes tout mouvement, et qui, toutes, tiennent de linfinit : cest le continu, le fait dexister en un temps et en un lieu et peut-tre mme dans le vide. Ces sortes de milieux continus, temps, lieu, vide, p.207 nintroduisent-ils pas des non-tres absolus, indiffrents la forme, non domins par elle ? Telle est bien la manire dont se prsente le problme : comment rendre relatifs la forme ou lessence, ces milieux qui rclament pour eux lindpendance ? ou encore : comment revenir dune thorie mathmatique de lespace et du temps, qui commenait natre, une thorie physique du lieu et de la dure, qui rattache lessence de ltre son lieu et sa dure, comme y sont rattaches sa couleur et sa figure, et qui voit, dans la notion du lieu, non pas lintuition dun milieu universel et indiffrent, mais une notion gnrale ne de la comparaison des lieux occups par les corps ? Dans la reprsentation de linfini, du lieu, du vide, du temps, du continu, il y avait contre la mtaphysique de la substance une mine dobjections : dabord la vieille reprsentation ionienne de cet infiniment grand, o des mondes innombrables et sans cesse renaissants peuvent puiser sans fin la matire de leur renouveau ; puis lide platonicienne plus raffine de linfini qui voyait dans la dyade indfinie du grand et du petit un absolu indpendant qui, en se combinant avec lUn, formait les essences, lide tout fait parente dun espace ou lieu, indpendant des essences ternelles et o ne peuvent apparatre que les images de ces essences ; la ralit indpendante que Dmocrite donnait au vide qui devenait chez lui cette monstruosit dune substance sans essence ; la thorie platonicienne dun temps image de lternit qui forait nier la vritable substantialit de toutes les choses temporelles ; enfin une thorie de la continuit qui aboutissait ne voir dans lunivers quun mouvement unique ; voil tout ce qui parut Aristote incompatible avec sa notion de la substance 2. Aussi sagit-il moins pour lui dtudier ces notions en elles-mmes que de les laborer de manire les
1 2
PLATON, Thtte, 176 a. Cf. surtout Physique, VI, 10.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
147
mettre en accord avec sa thorie de ltre ou de les nier, si laccord est impossible. Cest ainsi que le seul argument quil donne contre la thse platonicienne de linfini comme ralit spare et absolue, cest que toute ralit de ce genre est une substance, que, partant, elle est individuelle ; tandis que linfini ne peut tre que divisible 1. Voil donc linfini ramen ntre que lattribut dune substance. Comment et dans quel sens peut-il tre un attribut de la substance, sans en compromettre lunit et lindivisibilit ; telle est la question qui commande toute la thorie. Dabord il ne peut y avoir de corps sensible infiniment grand ; un corps est, en effet, par dfinition, ce qui est limit par des surfaces ; ce corps ne pourrait dailleurs avoir aucune structure physique imaginable ; sil tait compos, il ne pourrait ltre que dlments eux-mmes infinis ; car, supposer un lment fini, il serait ncessairement absorb par les lments infinis, qui leur grandeur infinie confre une puissance galement infinie ; les lments du corps prtendu sont donc tous infinis ; mais alors ils occupent chacun tout lespace et se pntrent mutuellement, ce qui est absurde. Mais ce corps ne peut davantage tre simple ; car il ny aurait plus de changement, puisque le changement na lieu quentre les contraires. On ne peut dire davantage de lui ni quil est homogne, puisque cette homognit parfaite supprime la distinction des lieux, du haut et du bas, et par consquent les mouvements locaux naturels qui nont dautre raison, comme on va le voir, que la tendance dun corps regagner son lieu propre ; il nest pas non plus htrogne, puisque, on la vu, les lments dont il se compose devraient tre tous infinis, donc occuper tons les lieux ; or, les lments ne peuvent tre htrognes que si chacun a son lieu propre 2.
p.208
Donc pas de corps infiniment grand. Est-ce dire que lon peut nier linfinit ? On ne le saurait sans absurdit ; le temps se prolonge sans fin dans le pass et dans lavenir ; la suite des nombres est illimit (infini par addition), la grandeur p.209 gomtrique est indfiniment divisible (infini par soustraction). Mais en quoi consiste la divisibilit ? Dans le dernier cas, par exemple, en ce quil est toujours possible, ayant pris la moiti dune grandeur, de prendre la moiti de cette moiti ; chaque grandeur que lon prend est toujours une grandeur finie, mais chaque fois diffrente. Il en est de mme de linfini du temps et de la suite des nombres qui consiste non pas arriver effectivement un nombre infini, mais toujours pouvoir prendre un nombre plus grand que celui auquel on sest arrt ; linfini par addition est en un sens le mme que linfini par soustraction, puisquil consiste maintenir la possibilit de toujours prendre une grandeur en dehors de celle que lon a prise. Loin que linfini soit comme on la dit ce en dehors de quoi il ny a rien, cest ce en dehors de quoi il y a toujours quelque chose. Cela revient dire
1 2
Physique, III, 5, dbut. Physique, III, 5, 205 a, 8..
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
148
que linfini nest pas en acte, mais en puissance. Ainsi Aristote libre la philosophie de limagination prsocratique du contenant infini qui serait la source toujours rajeunissante des mondes ; linfini et lillimit sont termes relatifs au fini, lachev dans lesquels ils se trouvent comme une matire et par rapport auxquels ils prennent un sens ; car il est absurde, il est impossible que ce soit linconnaissable et lillimit qui contienne et qui dfinisse (Physique, III, 6). Mais quel prix cette libration ? Et nest-on pas forc de nier du mme coup la fcondit illimite du devenir ? Or, cest ce que ne veut pas Aristote ; en son monde limit, fait de substances dfinies, le devenir est inpuisable et na ni commencement, ni fin. Pareille chose nest possible que si la corruption dun tre est la gnration dun autre . Si en un sens, le devenir va du non-tre ltre et de ltre au non-tre, il va toujours en un sens plus exact de ltre ltre ; un lment ne peut se dtruire quen donnant naissance un autre ; cest en lui-mme et non dans linfini que le devenir trouve les sources de son propre rajeunissement (III, 8 dbut). La thorie du lieu (IV, 1-5) est faite aussi pour protger la p.210 nouvelle mtaphysique substantialiste. Aristote a trs profondment vu que le problme du lieu ne se poserait pas pour lui, sil ny avait pas mouvement local, cest--dire changement de lieu ; dans ce cas, le lieu serait un attribut du corps au mme titre que la couleur. Mais il y a changement de lieu ; l o il y avait de lair, il y a maintenant de leau . Quest donc ce singulier attribut que lair nemporte pas, quil cde leau et qui parat former comme une substance permanente ? En faire, comme le Time, un rceptacle indiffrent des choses, cest affirmer une substantialit tout fait quivoque ; en faire lespace intrieur rempli par le corps, lidentifier aux dimensions du corps, cest dire quil se dplace avec le corps, ce qui est absurde. Le problme paradoxal qui se pose, cest de rattacher le lieu au corps pour faire du lieu un attribut, tout en le laissant pourtant spar. Si nous considrons un corps, nous pouvons envisager la surface qui lui appartient, comme en contact immdiat par tous ses points avec la surface limitante qui appartient son milieu ; cette surface limitante, sorte de vase idal dans lequel est contenu le corps, est le lieu du corps : ainsi le lieu dune sphre cleste est la surface interne de la sphre plus grande en laquelle elle est embote. Le lieu dun corps, tout au moins son lieu particulier, est donc lextrmit du corps qui le contient . Il suit de l que le lieu existe en mme temps que la chose ; car les limites sont avec le limit ; mais il appartient non la chose qui est en lui, mais celle qui contient cette chose : si le lieu est immobile, si les choses changent de lieu, cest quil y a des choses qui sont des contenants immobiles ; le lieu nest rien de spar ; il se rapporte des ralits substantielles ; tout danger pour la mtaphysique est cart. Dangereuse est aussi la notion du vide, dautant que les atomistes la considraient comme indispensable la physique, p.211 mettant le physicien en demeure ou bien dadmettre le vide, ou bien de nier des phnomnes vidents
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
149
comme le mouvement ou la condensation et la rarfaction, qui ne sauraient avoir lieu dans le plein. A quoi Aristote ne se contente pas de riposter ; il attaque ; et, se plaant sur le terrain de ses adversaires, il montre que la structure physique des choses nous connue est incompatible avec lexistence du vide 1. Dabord nous ne connaissons que des mouvements locaux dirigs, mouvements naturels qui sont des mouvements du corps vers son lieu propre, le bas ou le haut, selon que le corps est pesant ou lger, et qui sarrtent une fois ce lieu atteint, ou bien mouvements violents qui le font sortir de son lieu propre et cessent ds que la cause motrice cesse dagir ; ces mouvements sont ncessairement limits entre un tat initial et un tat final. Or, dans le vide, rien de pareil puisquil ny a l ni haut ni bas ; il ny a donc aucune raison pour que le mobile, dans le vide, ou bien ne sarrte pas nimporte o, ou bien ne continue indfiniment se mouvoir. Il est bien instructif de voir comment cette consquence qui, aux yeux dAristote, est absurde est un nonc grossier du principe dinertie qui, son tour, a renvers la science aristotlicienne ; la reconnaissance de sa validit suppose que lon a le droit de considrer le mobile, indpendamment de toutes ses proprits physiques ; or pour Aristote, qui fait du mouvement un aspect ou une consquence de ces proprits, cest l une absurdit ; un corps dans le vide serait un corps sans proprit physique ; et son mouvement ne pourrait tre quarbitraire. Absurdit plus grande encore : un mobile, m dans le vide, devrait tre anim dune vitesse infinie. Pour un moderne, une force donne agissant un instant sur une masse donne correspond une vitesse donne ; si cette vitesse change, cest que dautres forces se sont appliques au mobile, par exemple les forces de rsistance manes du milieu. Aristote est loin p.212 davoir une dynamique aussi prcise : pour lui, la force consiste essentiellement vaincre une rsistance ; cest, par exemple, la force du haleur qui tire un bateau ; la vitesse nest nullement proportionnelle la force, puisque lexprience montre que le bateau, dabord immobile, ne se met brusquement en mouvement que pour un certain degr deffort ; de plus leffort en agissant ne communique au bateau aucune vitesse, puisque le bateau sarrte ds que leffort cesse ; cest donc par lapplication renouvele de la force que le mobile continue se mouvoir ; la vitesse dpend alors de la rsistance vaincre : supposez la rsistance diminuant, la vitesse augmente ; la supposer nulle, elle devient infinie. Ce qui a t dit de la traction peut se rpter de la pousse : un corps qui fait effort pour traverser un milieu a une vitesse qui augmente mesure que la rsistance des milieux quil traverse diminue ; si cette rsistance devient nulle, la vitesse est infinie ; or, cest prcisment le cas du vide. Restent les difficults objectes par les partisans du vide ; pour le mouvement, les partisans du plein sen tiraient par la thorie des mouvements en anneau, dj indique par Platon : chaque mobile fait partie dun cercle dautres mobiles, et toutes les parties du cercle se dplacent la fois, ce qui est possible sans vide ; pour la condensation et la rarfaction, ils admettaient
1
Physique, IV, 6 9.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
150
que, chaque augmentation de volume par changement deau en air par exemple, correspondait une diminution gale par changement dair en eau, de telle manire que le volume total de lunivers reste le mme. Si le temps est essentiellement la succession des jours et des nuits, et en gnral des priodes, il est li aux mouvements rguliers du ciel et nat, comme dit Platon, avec le ciel 1 ; ctait la fois assurer une notion claire du temps, et liminer lantique et vague image cosmogonique dun temps primitif p.213 antrieur au monde. Sur ce dernier point, Aristote saccorde naturellement avec Platon ; sur le premier, il admet bien sans doute que le temps est li au mouvement, quil est quelque chose du mouvement ; et il en donne comme preuve que, ds que nous ne percevons plus le changement, par exemple dans ltat de sommeil et dans les tats o lme ne change pas, nous ne percevons plus le temps ; mais Platon a eu tort de croire quil dpendait seulement du mouvement du ciel. Identifier le temps avec le jour, ses multiples et ses sous-multiples, cest confondre le temps avec lunit de mesure par laquelle nous le mesurons ; cest raliser le temps en dehors des mouvements quil mesure ; cest faire du temps un nombre nombrant, le nombre par lequel nous comptons le temps, nombre qui se rattache effectivement aux mouvements clestes. Mais le temps est en ralit la chose que nous comptons, le nombre nombr ; et il est en chaque mouvement, quel quil soit ; car chaque mouvement a sa dure, comme un attribut qui lui appartient ; cest le nombre du mouvement selon lantrieur et le postrieur , cest--dire ce qu un instant donn, linstant prsent, qui est la fin du pass et le dbut de lavenir, nous pouvons compter comme antrieur et comme postrieur. Nous le comptons au moyen des rvolutions clestes, comme nous comptons une longueur au moyen de la coude, sans que la longueur appartienne moins la chose elle-mme. Ainsi sorientent les efforts dAristote, pour transformer les notions de mouvement, dinfini, de lieu et de temps : en refusant de les concevoir comme spars de la substance, il rejetait tout lesprit des anciens physiciens, et il inaugurait un mouvement de pense dont on verra plus tard les abus et les dangers.
VIII. PHYSIQUE ET ASTRONOMIE : LE MONDE
@ Cest dans le mme esprit quAristote labore limage du monde quil recevait des astronomes gomtres du Ve et du VIe sicle. Pour bien saisir la position dAristote, il faut se rendre compte du contraste quil y avait entre la reprsentation mathmatique de lunivers cre par les astronomes et la reprsentation des physiciens. Ctait un dsaccord
p.214 1
Physique, IV, 10-14.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
151
complet : dune part, un ciel de mme nature que les mtores, engag comme eux dans le devenir incessant des naissances et des corruptions ; un mouvement ternel unique dont ltat actuel de lunivers est seulement un des aspects ; une tendance un mobilisme universel qui ne laisse nulle permanence rien quau mouvement : dautre part, lastronomie de Platon et dEudoxe substitue au ciel sensible un ciel dune structure gomtrique permanente, compos de cercles ou de sphres concentriques animes chacune dun mouvement uniforme ; elle affirme lexistence de mouvements distincts et irrductibles, puisque le systme ne russit que si chacune des sphres est anime dun mouvement propre, indpendant du mouvement des autres ; elle met enfin en lumire lopposition entre lintelligibilit presque parfaite des choses clestes et les changements incessants des choses sublunaires. Mais lastronomie nouvelle ne se prsente pas chez Platon comme une simple hypothse ; elle vise en effet restaurer et justifier rationnellement une trs antique ide religieuse dont la physique tait la ngation et contre laquelle sacharnaient au IVe sicle les derniers reprsentants, des Ioniens ; cest lide dune opposition de valeur religieuse entre le ciel et la terre, le ciel contenant des tres divins et tant lui-mme de nature divine. Lastronomie inclut donc en elle toute la chaleur dune conviction religieuse, et cest sur elle que Platon, dans les Lois, btit la religion quil impose aux citoyens. Lme ou mouvement qui se meut lui-mme, qui a linitiative de tous les autres mouvements, est en effet, ses yeux, une supposition ncessaire du nouveau systme du monde ; cest lme qui, par ses mouvements propres dont les noms sont vouloir, examiner, dlibrer, mne toutes choses au ciel et sur terre 1. Aristote suit ce mouvement dides. mais en le transformant : il accepte lastronomie dEudoxe, mais il en cherche les raisons physiques ; il accepte lunion troite. de lastronomie et de la thologie, et cest vritablement une thologie astrale quil institue ; mais au mouvement qui se meut lui-mme, lme, il substitue un moteur immobile, de la nature de lintelligence.
p.215
Voyons le premier point : Aristote cherche tablir les raisons physiques du caractre primordial du mouvement circulaire, cest--dire du mouvement uniforme dun astre selon le grand cercle dune sphre. Ce mouvement est seul raliser une condition que les physiciens cherchaient vainement dans les autres mouvements, savoir la perptuit. Les physiciens avaient le tort dattribuer cette perptuit un mouvement daltration qualitative, puisque, on la vu, ces mouvements ont ncessairement un tat initial et un tat final, puisquils vont dun contraire un autre, du chaud au froid, par exemple. Dailleurs des mouvements de ce genre sont ncessairement postrieurs au mouvement local ou transport ; il ny a, en effet, altration que lorsquun patient subit leffet dun agent ; par exemple, la nourriture se transforme en
1
Lois, X, 893 c ; 896 a.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
152
chair par assimilation sous linfluence de ltre vivant ; mais, pour que cette influence ait lieu, il faut dabord que le patient soit amen, par un mouvement local, au contact de lagent. Dautre part, la capacit pour un tre de produire un mouvement local est, chez lui, le signe de la perfection : la supriorit de lanimal sur la plante consiste en cette capacit quil ne possde que lorsquil est compltement form et achev ; or le parfait est ncessairement antrieur limparfait. Mais parmi les mouvements locaux tous ne peuvent tre continus. Ces mouvements sont, en effet, de deux sortes : les mouvements rectilignes dont le type est celui du poids qui descend ou du feu qui monte, et les mouvements circulaires. Or, les mouvements rectilignes ne peuvent pas tre continus ; le monde ntant pas infini, ils ont lieu ncessairement entre un tat initial et un tat final, contraires lun p.216 lautre, entre le haut et le bas, la droite et la gauche, lavant et larrire. Dira-t-on que lon peut concevoir un mobile se mouvant sans arrt du haut vers le bas, puis du bas vers le haut, et ainsi de suite linfini ? Mais ce mouvement nest dabord pas un mouvement unique ; puisque le mouvement vers le haut est contraire au mouvement vers le bas, il se compose dautant de mouvements quil y a eu de changements de direction ; de plus, ce nest pas un mouvement sans arrt ; il y a, en ralit un arrt, chaque fois que le mobile change de direction, puisque lon ne peut concevoir que, par exemple, linstant final du mouvement vers le haut soit le mme que linstant initial du mouvement vers le bas. Il en est tout autrement du mouvement circulaire sens unique ; son point initial est aussi le point final vers lequel il se dirige ; ou plutt tout point de son trajet peut tre volont considr comme dbut, fini ou milieu ; cest le seul mouvement qui soit, chaque moment, tout ce quil peut tre. De l cette conclusion qui sonne si trangement des oreilles modernes : le mouvement circulaire est le seul qui soit la fois simple et complet , car si un mouvement rectiligne a une direction simple, par exemple vers le bas, il nest pas complet, puisquil exclut le mouvement de direction inverse ; et sil est complet, il nest plus simple, puisque le mobile doit suivre successivement des directions diffrentes 1. Cette cinmatique, dont la pense moderne aura plus tard tant de peine se dgager, a sa racine dans la conception du mouvement ; Aristote dfinit un mouvement non point par ce quil est chaque instant successif, mais par ce quil ralise globalement dans ltre qui en est le sige ; par exemple le mouvement rectiligne vers le haut, mouvement naturel du lger, est le mouvement par lequel le feu regagnant son lieu propre, ralise ainsi pleinement son essence. Le mouvement nest p.217 pas cette quasi-substance que disait Protagoras ; cest un attribut de la substance, et, lorsquil est naturel ou volontaire, il doit avoir sa raison dans la substance elle-mme : comme le mouvement du coureur du stade a sa raison dans sa volont de gagner le prix, le mouvement du feu a sa raison dans la nature du feu, qui a son lieu naturel
1
Physique, VIII, 7 9, surtout 9, 264, b 9 et 9 dbut.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
153
dans les rgions leves. Ainsi, le mouvement circulaire a sa condition dans la nature de la substance du ciel, cette cinquime essence, diffrente des quatre lments et dont la proprit essentielle est de pouvoir se mouvoir rgulirement. La simplicit du mouvement circulaire vient donc non pas de la simplicit de sa trajectoire, mais bien de lunit dintention quil manifeste ; simplicit veut dire unit de fin, et na pas gard la complexit du mouvement pris en lui-mme. Voil donc en quel sens le mouvement circulaire peut tre un mouvement unique, simple et continuel, seul capable de raliser le mouvement perptuel que cherchaient les anciens physiciens. Or, ce mouvement perptuel est, dautre part, absolument ncessaire ; car il ny a pas de temps sans mouvement, puisque le temps est le nombre du mouvement ; et le temps na pas commenc, cest--dire quil ny a pas dinstant dont on puisse dire quil est linstant initial du temps, puisque tout instant prsent nexiste qu titre de limite entre le pass et lavenir. Le mouvement circulaire du ciel est donc un mouvement perptuel et ncessaire sans commencement ni fin ; ntant pas un mouvement entre des contraires, il na pas de point initial. Il ny a pas de cosmogonie ; il ny a pas dorigine temporelle de lordre des choses clestes ; les schmes de lastronome sont devenus une ralit ; lastronomie mathmatique, fonde sur lobservation et lanalyse, se transforme en une physique dogmatique 1. A cette physique cleste se lie troitement la thologie. La substance du ciel a la puissance de se mouvoir dun mouvement p.218 circulaire ; cette puissance, cest sa matire qui est la matire locale ou topique, cest--dire la simple possibilit de changer de lieu, sans altration ni changement daucune autre sorte 2. Mais cette possibilit qui, on la vu, doit ternellement se raliser, qui la fait passer lacte ? Qui est le moteur ?
IX. LA THOLOGIE
@ De Platon, Aristote garde la notion du contraste entre des mouvements qui paraissent spontans, tels que ceux du feu qui monte, de la pierre qui tombe, de ltre vivant qui se meut et sarrte au gr de son dsir, enfin de la course infatigable du ciel, et des mouvements qui sont dus des pousses ou des tractions. Leur thse commune, cest daffirmer le caractre original et primitif du premier genre de mouvements, le caractre driv du second genre. Ceux-ci ne sont en effet intelligibles que par rapport aux premiers, puisquils consistent sopposer eux, principalement en faisant mouvoir des corps pesants dans une direction autre que leur direction spontane vers le
1
Sur la collaboration personnelle dAristote lastronomie des sphres et les modifications quil y apporta, voir Mtaphysique,, 8. 2 Mtaphysique, , 8, 1069, b 26 ; H, 1, 1042 b, 5-6.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
154
bas ; la mcanique nest proprement que lart de construire des machines telles que le levier, la balance, le coin, pour produire ces mouvements violents et contre nature pour lusage de lhomme. Il sensuit quil est tout fait inintelligible et mme contradictoire de chercher comme les atomistes une explication mcaniste des mouvements du premier genre ; la perception commune, lexprience, donne raison cette thse et soppose pour longtemps au dveloppement de la gniale intuition de Dmocrite, avec laquelle disparatrait toute la thologie dAristote. Ces mouvements primitifs ont donc des moteurs qui ne sont point des corps, et dont laction nest pas mcanique ; ce sont, p.219 pour les platoniciens, des mes, cest--dire des mouvements qui se meuvent eux-mmes ; le platonisme des Lois et celui de lpinomis est une vritable restauration de lanimisme ; cette force spontane quest lme existe non seulement chez lanimal mais pntre lunivers entier dont elle dirige les moindres dtails, depuis le mouvement des cieux jusquaux changements des lments. Contre cette confusion, Aristote proteste ; l o le platonisme cherche unit et continuit, il distingue et hirarchise : le mouvement dun lment qui gagne son lieu propre, celui dun tre vivant, celui des cieux ne sont pas produits par des moteurs de mme espce. Le mouvement de la pierre qui tombe na rien dun mouvement vital ; car il ne commence point et ne finit pas de lui-mme ; mais il est produit par suite dune circonstance extrieure, par la suppression de lobstacle qui lempchait de gagner son lieu propre, et il sarrte lorsque ce lieu est atteint 1. Au contraire, le mouvement local de lanimal a sa source en une reprsentation et un dsir ; il se conforme ce dsir autant que le permettent les conditions mcaniques du mouvement et la constitution organique de lanimal ; il y a donc la fois chez lui, selon son dsir, pouvoir dinitiative et pouvoir darrt, tandis que llment ne pouvait ni se mouvoir ni sarrter de lui-mme. Enfin le mouvement des cieux nest pas comparable celui dun animal. Aristote, dans un ouvrage considr sans doute tort comme apocryphe 2, critique lanalogie que lon sefforait alors dtablir entre eux ; on avait remarqu que ces mouvements supposaient des parties immobiles dans lintrieur de lanimal, les points fixes (articulations) autour desquels peuvent tourner les segments du squelette, et de plus un plan fixe extrieur lanimal, la terre, sur lequel il trouve un point dappui : de mme, dans lunivers, les ples constitueraient les points fixes p.220 autour desquels tourne le ciel, et la terre sur laquelle il roule. Cette comparaison, pousse plus loin que ne le fait Aristote, amnerait conclure que le moteur du ciel est de la mme nature que celui dun tre vivant, cest--dire de la nature dune me. Mais Aristote vite cette conclusion en montrant la faiblesse de lanalogie : en effet ; dans une sphre qui tourne, il est faux quil y ait une partie qui soit immobile ; les ples
1 2
Physique, VIII, 4. Du mouvement des animaux, chap. III et IV.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
155
sont de simples points mathmatiques sans ralit physique ; de plus, si lon assimile le rapport de la terre au ciel avec celui de la terre aux animaux, il faudra dire que la terre est en dehors de lunivers. Contrairement Platon, Aristote ne voit donc dans le ciel rien qui ressemble un organisme vivant. Ainsi moteur naturel de llment, moteur de lanimal et moteur des cieux sont de nature diffrente. Ils ont pourtant un attribut commun, cest dtre eux-mmes immobiles ; Aristote soppose avec force lide platonicienne que le principe du mouvement puisse tre encore un mouvement. Dune manire absolument gnrale, un moteur, en tant que tel, ne peut tre m ; car le moteur est ce qui est en acte ce que le mobile est en puissance ; par exemple cest le chaud en tant quil chauffe ; cest le savant en tant quil instruit ; si le moteur tait m comme le veut Platon, il faudrait quil ft la fois et sous le mme rapport savant et non savant, chaud et non chaud. Si donc il y a un tre qui se meut lui-mme, il nest pas simple, et il se ddouble ncessairement en un moteur immobile et une partie mue par ce moteur (Physique, VIII, 5). Chacune des classes de mouvements (naturel, vital et cleste) nous renvoie une classe distincte de moteurs immobiles : nature, me reprsentative, moteur du ciel. Il y a donc un nombre trs grand de pareils moteurs, autant quil y a de mouvements distincts ou au moins de sries distinctes de mouvements enchans. La notion de moteur immobile concide au fond compltement avec la notion de forme ou dtre en acte ; le moteur, cest ltre en acte en tant quil a rencontr un mobile p.221 capable de passer de la puissance lacte. Le type de laction motrice, cest celle du mdecin qui gurit son malade, du statuaire qui sculpte, cest--dire une action qui ordonne les mouvements de telle faon que la matire devienne susceptible de recevoir une forme existant actuellement dans le moteur ; laction est ordonnatrice en mme temps que motrice. Et cest pourquoi le mouvement cesse ds que le moteur nagit plus, comme une arme est sans ordre ds quelle nest plus commande ; il nest point quelque chose qui pourrait tre communiqu au mobile et persister de lui-mme ; le mobile comme tel na jamais de lui-mme que la possibilit de se mouvoir. Il reste voir quelles sont, parmi ces moteurs immobiles, les particularits du moteur des cieux. Comme le mouvement du ciel est continu et uniforme, il lui faut un moteur ternellement en acte et dont laction soit immuable, donc un moteur indivisible, puisquun moteur divisible puiserait ncessairement son action au bout dun temps fini 1 : De quelle manire Aristote, partant de ces caractres purement formels du moteur des cieux, ternel et indivisible, en a-t-il driv lide que ce moteur tait une intelligence toujours en acte, contemplant sans fin son objet, un vivant ternel et parfait, en dautres termes, tait Dieu 2 ? Lide intermdiaire est celle dtre en acte ; le moteur des cieux est toujours en acte ; or, un tre pleinement en acte, o il ne reste aucune trace
1 2
Physique, VIII, 6. Mtaphysique, , 7, 1072 b, 27-29.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
156
de potentialit, de dveloppement possible, de matire, de privation, ne peut tre quune pense () ; Aristote imagine cet acte pur daprs ltat qui est en nous le plus divin et le plus agrable, cest--dire la contemplation du savant qui, ayant atteint la vrit, en a une connaissance immobile et dfinitive ; si nous supposons permanent et total et dgag de la vie corporelle cet tat qui, chez lhomme, est passager, partiel et li au corps, nous nous reprsentons lacte pur, lacte de lintelligence, qui est la vie p.222 ternelle et parfaite de Dieu, qui est Dieu lui-mme. Il ny a donc en Dieu aucune trace des oprations intellectuelles qui, dans lme humaine, supposent un changement, telles que la sensation, limage, la rflexion qui cherche, la pense discursive, pas plus que des fonctions vgtatives qui se rapportent la vie du corps ; Dieu nest pas une me, un principe vital, mais une pense intellectuelle : Mais une intelligence ne contient-elle pas toujours de la puissance ? Par exemple notre intelligence humaine nest quune simple facult de penser ; pour tre en acte, elle doit subir linfluence de lintelligible, peu prs comme la sensation qui ne peut tre actuelle que sous laction dune chose sensible. A Dieu ; sil est intelligence, serait donc suprieur lintelligible grce quoi il pense. Grave question, puisque nous voyons renatre du coup, au-dessus de moteur des cieux, tout le monde intelligible de Platon, que contemple le demiurge comme un modle au-dessus de lui ; nous voyons compromise lternelle actualit du moteur des cieux, sil peut cesser de penser. Aristote la rsolue ainsi : puisque Dieu est ltre suprieur, il sensuit quil na pas dautre intelligible que lui-mme ; il se pense lui-mme ; il est la pense de la pense 1 ; cest ainsi seulement quil peut se suffire lui-mme. Est-ce l une solution purement verbale ? Aristote sait fort bien que, mme chez lhomme, tout savoir, quel quil soit, sensation, pense ou rflexion, est accompagn de la connaissance de lui-mme ; on ne peut savoir, sans savoir quon sait ; mais lobjet principal du savoir nest pas cette connaissance de soi ; il est un intelligible ou un sensible, distinct de lintelligence et de la sensation. Ce qui en lhomme est laccessoire devient en Dieu le principal ou plutt lunique ; il na plus quter en dehors de lui les objets de sa pense, et cest ainsi seulement que cette pense peut tre acheve et indfectiblement parfaite. Cest vers cet tat dindpendance p.223 que tendent, chez nous, les sciences les plus leves ; en effet, dans les sciences thoriques telles que les mathmatiques, lobjet est identique la pense que lon en a 2 ; la pense puise tout ce quil y a dans lobjet ; elle ne lui est point postrieure, ni davantage antrieure ; elle lui est identique. La thologie dAristote est au sommet de la mtaphysique et de la physique. Elle rsout la fois la question du moteur des cieux et celle de la substance : celle du moteur des cieux ; car la parfaite uniformit de leurs
1 2
, 9, 1074 b, 33. De lme, III, 7, dbut.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
157
mouvements sexplique par limmutabilit divine ; de plus, il est naturel que lintelligence soit motrice, cest--dire que les choses mobiles tendent imiter, autant quil leur est possible, cette immutabilit ; Dieu meut le ciel comme laim meut son amant 1. La condition de ce mouvement uniforme, cest linaltrable quintessence ou ther capable du seul mouvement circulaire ; elle a sa raison dtre en ce mouvement qui est la fin pour laquelle elle existe. Aussi Dieu nest pas le dmiurge du monde, il ne connat mme pas le monde ; il est seulement la fin vers laquelle il aspire. La thologie rsout aussi la question de la substance ; avec Platon, Aristote admet une substance incorporelle spare, cest Dieu ; mais cest en un sens bien diffrent des Ides. La grande diffrence, cest que Dieu nest point, comme les Ides, la substance de toutes choses, pas plus quil nest lobjet de la science. En revanche, il est, si lon peut dire, la substance par excellence, comme il est la science par excellence. Il est la substance par excellence, pour cette raison que ce quil est, son essence, na pas chercher dappui en dehors de lui pour devenir une substance effectivement ralise. Les autres formes substantielles, en effet, ne peuvent devenir effectivement des substances que si elles trouvent en dehors delle, dans une matire, les conditions de leur ralisation ; la statue ne peut p.224 devenir une ralit que grce au marbre, lhomme que grce un corps organis fait dune multitude dlments. Cest pourquoi la forme substantielle qui est lessence dun tre, nest pas encore sa substance ; la substance dsignera plutt le compos de forme et de matire. En Dieu, acte pur, la difficult disparat ; la pense na dautres conditions quelle-mme ; elle est sans matire ; cette substance ternelle, identique son essence, est le type que sefforceront dimiter les substances passagres, nes de la combinaison de la forme et de la matire ; mais elle ne remplace nullement ces substances. Dieu est aussi la science par excellence, mais une science inaccessible lhomme, qui cherche ses objets dans le monde. On voit quel point la place de la thologie dans la doctrine dAristote est diffrente de celle du monde des ides dans celle de Platon. Pour mieux la comprendre, il convient de parler de la crise quelle parat avoir subie au cours du dveloppement de sa pense. Aristote est en gnral extrmement rserv dans le dveloppement de la thologie : Les tres non engendrs et incorruptibles sont sans doute prcieux et divins, mais cest eux que nous connaissons le moins... ; sans doute, avec le prix quils ont, un lger contact avec eux nous est plus agrable que la connaissance des choses qui nous entourent, comme il est meilleur de voir la moindre part dun objet aim que de connatre avec exactitude beaucoup des autres tres ; pourtant la proximit de ces tres, leur parent de nature avec nous, voil des avantages en change de la science des choses divines 2. Paroles caractristiques de lancien platonicien : ce nest plus dans le suprasensible quil va chercher
1 2
Mtaphysique, , 7, 1072 b, 2. Des Parties des animaux, I, 5.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
158
lobjet dune science exacte ; la thologie est au-dessus des prises de lhomme. De l ses hsitations entre le monothisme et le polythisme. Il incline assurment vers le monothisme, parce que lunit dorganisation de lunivers ne saurait tre attribue qu lunit de sa p.225 cause finale, et il termine sa thologie en citant le vers dHomre, qui deviendra le texte perptuel du monothisme paen : Il nest pas bon quil y ait plusieurs matres 1. Mais dautre part Dieu est le moteur des cieux et un moteur immuable ; son effet doit donc tre toujours le mme ; or lastronomie nous rvle lexistence dun grand nombre de sphres concentriques, dont chacune est anime dun mouvement propre, tout fait indpendant de celui des autres ; les principes dAristote exigent ici quil y ait autant de moteurs distincts, et ils conduisent au polythisme 2. De l, la place relle de la thologie dAristote ; la connaissance de Dieu en lui-mme nest nullement son but ; elle na aucun rle en morale ou en politique. Dieu est considr uniquement dans sa fonction cosmique, comme le producteur de lunit du monde, unit qui en permet la connaissance rationnelle. Entre ce moteur immobile et les autres moteurs immobiles, actions passagres et changeantes, que sont les mes, la nature et, en gnral, les formes, il y a une hirarchie ; laction de chacun de ces moteurs infrieurs est dtermine non pas spontanment et son gr, mais selon lordre qui vient du premier moteur et qui se transmet par le mouvement des cieux jusqu la terre. La science des choses naturelles consistera avant tout dmler cette hirarchie, dont chaque terme est la cause finale qui ordonne le terme infrieur, le mouvement du ciel sefforant par sa circularit et son uniformit dimiter limmutabilit divine, de mme que, au-dessous de la lune, le cercle sans fin et retournant toujours sur lui-mme des gnrations et des corruptions imite autant que le permet la matire, le mouvement du ciel. Tous les tres naturels ont ainsi quelque chose de divin 3. La thologie est la garantie quil y a non seulement des causes finales partielles travaillant chacune dans une sphre limite, p.226 mais une cause finale universelle qui en rgle laction ; lhomme engendre lhomme, mais le soleil aussi .
X. LE MONDE
@ Lunivers entier est donc lensemble des conditions auxquelles le mouvement des cieux peut exister. En effet, sil doit y avoir un mouvement circulaire, il faut quil y ait par opposition en son centre un corps qui reste immobile ; cest la terre : le gocentrisme et limmobilit de la terre sont donc dmontrs. De plus, sil y a de la terre, cest--dire un corps pesant qui,
1 2
Mtaphysique, , 10 1076 a, 24 (Iliade, II, 204). Cf. Physique, 258 b, 10 ; 259 a, 3 et Mtaphysique, . 8, 1074 a, 31-38. 3 thique Nicomaque, IX, 14, 1153 b, 32.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
159
dplac du centre, tend y retourner, il faut, par une ncessaire opposition, quil y ait du feu, cest--dire un corps lger qui tend vers le haut ; car si un contraire existe, son contraire ne peut pas ne pas exister. Si lon considre non plus laffinit de llment avec son lieu propre, mais les qualits essentielles par o il manifeste son activit et sa passivit, lon verra que de la mme rgle dcoule lexistence des lments intermdiaires, eau et air ; car la terre dont les attributs sont froid et sec, on voit que soppose non seulement le feu dont les attributs sont chaud et sec, mais leau dont les attributs sont froid et humide ; au feu, chaud et sec, soppose non seulement la terre, mais lair qui est chaud et humide 1. Ainsi se dduisent les quatre lments. On voit quAristote, suivant une conception courante chez les mdecins et les physiciens, reconnat quatre proprits actives fondamentales opposes deux deux : le chaud et le froid, le sec et lhumide ; si lon combine deux deux en un mme sujet ces quatre attributs, en excluant les combinaisons qui uniraient les opposs, il reste quatre combinaisons possibles, sec-froid, froid-humide, humide-chaud, chaud-sec ; chacune de ces combinaisons caractrise un lment, la terre, leau, lair, le p.227 feu ; il est ais de voir que lon passe de chacun au suivant et que lon revient du quatrime au premier en substituant une proprit du couple loppos de cette proprit ; ainsi on passe de la terre leau, en substituant lhumide au sec, dans le couple que forme la terre. Il y a donc possibilit dun passage continu dun lment un autre, dans un ordre dtermin, la terre pouvant se changer en eau, leau en air, lair en feu ; chaque fois la corruption dun lment est la gnration du voisin ; de plus ce devenir est circulaire, puisque le quatrime lment peut, de la mme manire, redonner naissance au premier (lordre pouvant dailleurs tre inverse de celui que lon a choisi) ; de cette manire ce devenir peut tre sans fin. Cet incessant mouvement de transmutation circulaire nest pas seulement possible ; il est rel ; si en effet les lments ne se changeaient pas lun dans lautre, comme ils ont des mouvements limits vers le bas et le haut, chacun sarrterait en son lieu propre et le mouvement cesserait dans la rgion sublunaire : le cercle des transmutations imite sa manire le mouvement circulaire des cieux. Dautre part, pour que ce cercle soit possible, il faut quil y ait dans le ciel plus dun mouvement de translation circulaire ; car un seul mouvement, celui des toiles fixes par exemple, laisserait les lments dans le mme rapport ; il faut donc quil y ait plusieurs sphres concentriques doues chacune dun mouvement propre et dont laxe est inclin sur celui du ciel des fixes ; grce linclinaison de lcliptique se produisent ces effets variables que nous appelons les saisons, dont chacune est caractrise par la prpondrance dune des proprits fondamentales des lments, le chaud ou le froid, Ie sec ou lhumide, qui, selon la place relative du soleil, remporte temporairement la victoire sur son oppos.
Du Ciel, II, 3.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
160
Tel est, en raccourci 1, lunivers dAristote : tous les dtails y sont commands par lensemble. Le cadre de la physique des p.228 choses sublunaires est ainsi dtermin ; elle est ltude des actions et passions rciproques qui ont lieu soit entre les lments, soit entre des corps dj forms et qui produisent tous les mlanges et altrations, grce auxquels de nouveaux corps pourront natre, de nouvelles formes substantielles sinsrer dans la matire. Et il ne faut pas oublier que tous ces changements, bien quils aient leurs conditions matrielles dans les forces lmentaires, ont leur cause finale, leur cause vritable dans la forme vers laquelle ils sont orients ; le remde agit par une suite daltrations de la substance vivante ; mais la cause vritable de ces altrations, cest la sant. Il faut se garder de croire que la production dun corps nouveau est due ces combinaisons ou altrations qui nen sont que les conditions. Encore ces conditions peuvent-elles tre tudies en elles-mmes. Un corps ne subit linfluence dune force que parce quil y a en lui de la matire, cest--dire au fond la possibilit dun changement ; ainsi lorsque lair, sous linfluence du froid, se change en eau, ce nest pas la chaleur de lair qui a pti, puisque la chaleur est une forme ; sans matire, le feu serait impossible ; cest en ralit sa matire 2. On appelle matire premire cette puissance de changement entirement indtermine qui est implique dans la transmutation des lments ; au contraire la matire seconde, par exemple lairain dune statue, est dtermine en elle-mme, bien quelle soit indtermine relativement au changement quelle est encore capable de subir 3. Cest donc grce la matire que lagent peut agir en sassimilant le patient, par exemple le feu en chauffant ; pour quil y ait action, il faut donc que lagent rencontre un patient qui actuellement est diffrent de lui, mais qui lui est semblable en puissance. Un cas spcialement important, cest le mlange, qui se forme par suite dactions et de passions rciproques entre p.229 deux corps ; le mlange nest pas une juxtaposition, comme le prtendent les atomistes, mais une union relle o toute partie, si petite quelle soit, est homogne lensemble : encore ici, nous trouvons cette mme absolue confiance en la sensation brute et non analyse, qui est caractristique de lesprit dAristote. Les diffrences du mlange dpendent la fois des doses et de la nature des corps qui y entrent ; le corps mlang peut disparatre sil est en trop petite quantit, comme une goutte deau dans la mer, ou sil est beaucoup plus passif que lautre ; par exemple dans un alliage dtain et dairain, ltain disparat ne laissant plus quune couleur 4.
Pour une exposition densemble, voyez Du Ciel, II, 3, continu par De la Gnration et de la Corruption, II, 9. 2 De la Gnration et de la Corruption, I, 7, fin. 3 Mtaphysique, , 7, 1049 a, 25. 4 De la Gnration et de la Corruption, I, 6 10.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
161
Une premire application de cette physique est dans les Mtores o Aristote a cherch dterminer les diverses actions qui produisaient cet ensemble de phnomnes irrguliers, voie lacte, comtes, apparitions ignes, qui se produisent au-dessous de la sphre de la lune, et aussi les tats gnraux de latmosphre, vents, tremblements de terre, foudre, tempte. Le IVe et dernier livre est consacr ltude de ce que lon pourrait appeler les divers tats de la matire sous linfluence des deux causes actives par excellence ; du chaud et du froid ; les phnomnes de la cuisson et de la conglation sont spcialement signals ainsi que les tats dus au mlange, comme, le mou, le facile courber, le fragile, le cassable, etc. Toutes ces tudes sont orientes vers le dernier chapitre qui a pour objet ltude des mlanges qui forment les diverses parties de ltre vivant, os, muscle, etc.
XI. LTRE VIVANT : LME
@ Les lments nexistent quen vue de la formation de ces tissus vivants ; ces tissus nexistent quen vue de la formation dorganes tels que lil ou le bras ; ces organes eux-mmes p.230 nexistent quen vue daccomplir certaines fonctions trs compliques, telles que la vue pour les yeux, ou le mouvement pour les bras. Les fonctions vitales en exercice sont donc une des fins principales pour lesquelles la nature agit et opre toutes les combinaisons et mlanges qui rendront possible ltre vivant 1. Mais la vie nest pas le produit de ces combinaisons et de ces mlanges ; le corps organis a seulement la vie en puissance ; il ne sera vivant en acte, cest--dire il ne pourra exercer effectivement les fonctions dun corps vivant, la nutrition, le dveloppement jusqu ltat adulte, la corruption, que lorsquil aura reu cette forme substantielle, qui sappelle lme. Lme est lentlchie premire dun corps naturel qui a la vie en puissance 2 , cest--dire qui est dou dorganes propres accomplir les fonctions vitales. Elle est donc lie ce corps la manire dont le tranchant du fer est li la hache ; elle est la condition immdiate de lactivit du corps, peu prs de la mme manire que la science que possde le savant est la condition immdiate laquelle il contemple la vrit ; de mme que le savant ne la contemple pas toujours, de mme lme nagit pas toujours et a sa priode de sommeil mais elle est toujours immdiatement apte agir..
Des Parties des animaux, II, 1 ; ce que nous appelons les tissus sont les homomres, composs de parties homognes, les organes tant des anhomomres, composs de plusieurs homomres. 2 De lAme, II, 1, 412 a, 27.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
162
Lme est donc avant tout chez Aristote principe de lactivit vitale, moteur immobile de cette activit. La psychologie est lintroduction ltude des tres vivants, comme la thologie est lintroduction ltude de lunivers ; elle na plus dobjet propre et spar comme dans la tradition de Pythagore et de Platon ; lme nest plus la voyageuse qui va de corps en corps accomplir sa destine elle ; elle est lie au corps comme la vue est lie lil 1. Rien ne reste du mythe platonicien, quAristote semble avoir accept dans ses premiers crits ; le problme p.231 de la morale est aussi indpendant de la psychologie quil lest de la thologie ; me et corps naissent et disparaissent ensemble. Il sensuit aussi quil ny a pas, comme la cru Platon, dtude de lme en gnral ; le philosophe tudie lme la manire dont le gomtre tudie les figures : le gomtre ntudie pas la figure en gnral, qui ne dsigne aucune essence, mais le triangle, le polygone, etc., et ainsi une srie de figures, de la plus simple la plus compose, dont chacune implique les prcdentes, mais non les suivantes. De mme, le philosophe tudie la srie des fonctions ou facults ou puissances de lme dont chacune implique les prcdentes mais non les suivantes : fonction nutritive, sensitive, pensante et motrice. Qui possde par exemple la fonction sensitive possde la nutritive ; mais linverse nest pas vrai, et la plante par exemple a seulement la capacit de se nourrir. Ces fonctions ne constituent pas, pour qui en possde plusieurs, autant dmes diffrentes ; elles diffrent logiquement, puisquelles aboutissent un acte diffrent, mais non pas localement ni par leur substance ; chaque vivant a une me unique (De lAme, II, 2). La thorie des fonctions de lme est ne trs videmment de la classification des tres vivants en vgtaux, animaux sans raison et animaux raisonnables. Mais cette classification tranche ne doit pas faire oublier quAristote est essentiellement continuiste et quil voit dans la vie suprieure non une pure et simple addition, mais bien la ralisation de quelque chose qui tait bauch dans la vie infrieure. Chez la plupart des autres animaux, il y a des traces des caractres qui se distinguent avec le plus dvidence chez les hommes : sociabilit et sauvagerie, douceur et duret, courage et lchet, timidit et assurance. Il y a mme chez beaucoup des images de lintelligence rflchie. Cest par le plus et le moins que ces animaux diffrent de lhomme, et que lhomme diffre de beaucoup dentre eux. La nature passe peu peu des tres inanims aux animaux, tel point que la continuit fait que les limites nous chappent et que nous ne savons p.232 qui des deux appartiennent les intermdiaires ; propos de certains tres marins, on peut demander sils sont animaux ou plantes 2 . Ce nest pas quAristote ait la moindre tendance favoriser un volutionnisme comme celui dEmpdocle ; tout au contraire cest pour lui une rgle absolue (quil transporte du domaine de la vie la
1 2
De lAme, II, 1, 412 b, 18. Histoire des Animaux, VIII, 9.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
163
nature entire) quon ne peut pas passer dun genre un autre, et que le semblable produit toujours son semblable ; comme il y a identit spcifique entre la sant du mdecin et celle quil produit chez le malade, il y a toujours identit spcifique entre le gnrateur et lengendr ; les tres vivants se rpartissent en espces fixes incorruptibles dont la forme est transmise dun individu prissable un autre par la gnration ; cest ainsi seulement que le vivant peut imiter le cours ternel des astres et atteindre la perptuit. Ainsi la thse de la fixit des espces se relie aux tendances les plus profondes dAristote, sa recherche de points fixes dans le devenir. La continuit est chez lui tout autre chose que lvolution ; cest non pas lexplication du suprieur par linfrieur, mais tout au contraire de linfrieur par le suprieur, de la plante par lanimal, de lanimal par lhomme : seul le parfait et ladulte nous permet de comprendre limparfait. Cest l lide matresse de ltude des facults de lme, qui peut alors senvisager sous deux aspects : en premier lieu, ltude de chacune des facults est comme lintroduction un chapitre danatomie qui dcrit les tissus et les organes forms de ces tissus qui permettent la facult de sexercer : ainsi la fonction nutritive qui est lassimilation de la nourriture par le corps, telle que le corps saccroisse ltat adulte et sy maintienne, commande tout un mcanisme dactions corporelles sans lesquelles elle ne peut tre connue ; cest dabord la cuisson de laliment ingr par la chaleur intrieure, mane du cur, qui, comme principe du chaud, est engendr le premier dans lanimal ; la nourriture p.233 liqufie ou durcie par le chaud circule dans les veines, et elle filtre travers elle, comme travers un vase dargile cru ; ses parties aqueuses se condensant sous leffet du froid forment la chair ; ses parties terreuses qui contiennent encore un peu dhumidit et de chaleur, les perdent sous laction du froid et deviennent les parties dures telles que les ongles et les cornes ; chaque tre vivant a dailleurs autant de chaleur inne quil convient cet effet 1. De mme la fonction sensitive commande ltude anatomique et physiologique des organes des sens. Dune manire gnrale, ces facults ne sont nullement des explications paresseuses, mais comme des centres de direction dans la recherche exprimentale. Sous un second aspect, ltude de chaque fonction est comme oriente vers ltude de la fonction suprieure, et surtout de celle qui leur est suprieure toutes, savoir la pense intellectuelle. Ce trait se montre surtout dans ltude des facults de connatre ou de discerner le vrai du faux. Ce discernement a lieu soit laide de la sensation soit laide de la pense ; Aristote reste pleinement fidle cette distinction platonicienne et critique fort vivement les physiciens qui rduisent la pense la sensation (De lAme, III, 3) ; mais la signification en est change, parce quAristote accentue moins lopposition que la continuit. Dans la sensation dj, il cherche faire voir ce quil y a de stable, de fixe, de connaissance effective ; la sensation nest pas
1
Comparer Gnration des Animaux, II, 6, et De lAme, II, 4.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
164
une altration purement passive, o lorgane subit laction des qualits sensibles, perptuellement changeantes et mobiles ; certes, cest seulement sous linfluence dun agent sensible sur un organe des sens que la facult de sentir passe lacte ; la sensation nest point pour cela rductible un acte de lagent sensible tout seul ; la plante par exemple subit des altrations par suite de la chaleur, mais elle ne sent pas la chaleur 1 ; il faut donc dire que la sensation est un p.234 acte commun du sentant et du senti, par exemple de la couleur et de la vision, du bruit et de laudition ; et il faut insister sur ce caractre commun et sur limpossibilit dattribuer la sensation lun ou lautre des deux facteurs isolment (De lAme, III, 2). Cet acte a dj quelque chose dune pense ; car comme la pense en ce qui concerne les intelligibles, la sensation, en ce qui concerne les sensibles, affirme avec vrit son objet propre. On appelle en effet objet propre dune sensation la qualit sensible qui fait passer lacte cette sensation, la couleur pour la vue, le son pour loue ; or, sur son objet propre, chaque sensation dit la vrit complte ; la vision ne se trompe pas sur le blanc ; lerreur ne commence que si elle affirme que ce blanc est tel ou tel objet. De ces qualits sensibles, les diverses espces de sensations donnent une connaissance intgrale : nulles qualits sensibles en effet que celles qui agissent par contact, comme les qualits tactiles ou les gots, et celles qui agissent travers un milieu arien ou liquide, comme les couleurs, les sons ou les odeurs (De lAme, III, 1). Sous un autre aspect, cette connaissance sensible est oriente vers la connaissance intellectuelle, puisquelle apprhende les choses sans leur matire ; ce nest pas la pierre elle-mme qui est dans lme lorsquon la peroit, cen est seulement la forme 2 ; bien que cantonne dans la connaissance des choses particulires, la sensation les spare donc de leur matire. De plus, la multiplicit des cinq sens a sa raison en ce quelle facilite la connaissance des qualits communes tous les sensibles, telles que le mouvement, la grandeur ou le nombre ; la perception de ces proprits communes ne serait pas possible avec un seul sens, parce quelle ne se dgagerait pas du sensible propre 3. Enfin, cette multiplicit suppose comme un centre commun, capable dapprhender et de discerner toutes les qualits ; sans quoi les sensations de chaque sens en nous seraient isoles p.235 les unes des autres comme celles dautant de personnes trangres lune lautre ; or, ce centre commun peut saisir les ressemblances et les diffrences et, en gnral, toutes sortes de rapports entre les sensibles 4. La pense au sens le plus large contient tous les actes de connatre indpendants de linfluence actuelle du sensible, cest--dire aussi bien les
1 2
Ibid., II, 12, 424 a, 32. De lAme, III, 8, 431 b, 28. 3 Ibid., III, 1, fin. 4 Ibid., III, 2, 426 b, 17-22.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
165
images de la mmoire que les opinions et les jugements de la science 1. Aristote reconnat aux deux bouts de lchelle de la connaissance une intuition qui ne peut tre que vridique : en bas lintuition du sensible propre par la sensation, en haut lintuition intellectuelle des essences indivisibles 2 : entre les deux stend tout le reste, cest--dire tout ce qui est susceptible dtre vrai ou faux, cest--dire encore toute proposition qui affirme une relation dun attribut un sujet comme passe, prsente ou future. De ces facults intermdiaires Aristote ne fait pas une tude bien systmatique. Il semble bien quil considre chacune dentre elles trois points de vue diffrents, en elle-mme, dans sa relation la facult infrieure et la facult suprieure. Ainsi la reprsentation ou image () : en elle-mme, elle est tout ce qui apparat lme en dehors de la sensation ; elle est gnralement fausse, sans correspondant dans le rel ; mais elle ne saffirme pas comme vraie, car elle nest pas, comme lopinion, accompagne de croyance 3 : ainsi le soleil nous parat avoir un pied de diamtre ; mais nous savons quil est plus grand que la terre. Dans son rapport avec la sensation, elle est limage dune chose sensible passe, une sorte de peinture qui vient de ce que lobjet sensible a laiss son empreinte comme un cachet sur de la cire ; cette image est le souvenir de lobjet et il ny a mmoire que l o il y a image ; on ne se souvient donc pas, contrairement ce qua dit Platon, de vrits purement intellectuelles, on les contemple nouveau, p.236 chaque fois quon y pense 4. Enfin, dans son rapport avec lintelligence, limage est la condition de la pense ; il ny a pas de pense sans image , parce que limage est la matire dans laquelle lintelligence contemple luniversel ; le gomtre, pour dmontrer les proprits du triangle, doit tracer un triangle de dimensions dfinies ; mais il ne pense pas ces dimensions 5. Les traits dAristote ne manquent pas dindications parses sur des faits intellectuels plus complexes, tels que la rminiscence ou le jugement ; la rminiscence est comme lorientation de lme la recherche dun souvenir ; elle part de ltat actuel et par une srie dautres tats lis au premier soit parce quils leur sont semblables, soit parce quils leur sont contraires, soit parce quils en ont t voisins, elle arrive au souvenir cherch ; ce quon a appel plus tard association des ides est ainsi prsent comme un moyen du souvenir 6. A lautre ple de la connaissance est lintelligence dont lacte est la pense individuelle dessences intelligibles elles-mmes indivisibles. Comparable par sa certitude la sensation des sensibles propres, elle en diffre pourtant beaucoup ; entre lintelligible et lintelligence, il y a bien en effet un rapport
1 2
Ibid., III, 3, dbut. Ibid., III, 6, fin. 3 Ibid., III, 3, 428 b, 2. 4 De la Mmoire, chap. I, 450 a, 22. 5 Ibid., 449 b, 30. 6 Ibid., chap. II.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
166
analogue celui qui est entre le sensible et le sentant : lintelligence est bien comme la tablette vide qui contient en puissance tous les intelligibles, et qui ne passe lacte que si elle en subit laction 1 ; mais, tandis que lorgane sentant est dtruit par un sensible trop intense, comme par une lumire blouissante, lintelligence pense au contraire dautant plus que la clart de lintelligible est plus grande 2. De plus, tandis que dans lacte commun de la sensation, le sentant reste toujours distinct du sensible, dans lacte intellectuel de contemplation, lintelligence est compltement identifie lintelligible, et lon ne saurait trouver en elle, quand p.237 elle pense, autre chose que son objet : elle est donc elle-mme intelligible 3. Enfin, tandis que la sensation se rpartit en organes dont chacun nest capable dapprhender quune espce particulire de sensibles, lintelligence est capable de recevoir tous les intelligibles sans exception. Ces trois traits distinctifs reviennent une raison unique : cest que lintelligence peroit les formes ou essences sans matire et dgages de toutes les particularits qui les accompagnent dans le sensible ; par exemple, elle pense non pas le camus, qui est la courbe dun nez, mais le courbe en lui-mme ; par labstraction, elle fait passer lacte les intelligibles qui ntaient quen puissance dans les sensibles ; or la science des choses sans matire est ncessairement identique ces choses ; il ny a rien dans une notion gomtrique ou arithmtique que ce que nous y pensons 4. Pourtant notre intelligence nest quune facult de penser ; elle est tous les intelligibles ; mais elle ne les est quen puissance ; elle ne pense pas toujours ; comment peut-elle passer lacte ? Il est clair que ce nest pas sous linfluence des images sensibles, images sans doute indispensables son opration dabstraction (on ne pense pas sans images), mais do ne sauraient natre spontanment les intelligibles en acte, puisquelles les contiennent seulement en puissance. Conformment la rgle gnrale daprs laquelle un tre ne peut passer de la puissance lacte que sous linfluence dun tre dj en acte, Aristote est donc conduit admettre au-dessus de notre intelligence qui ne pense pas toujours, une intelligence ternellement en acte, intelligence impassible, puisquelle est une pense fixe et indfectible qui ne subit nul changement, productrice de toutes les autres penses, la manire de la lumire qui fait passer lacte les couleurs. Quelle est exactement la place de cette intelligence ? Est-elle, comme lintelligence passive ou en puissance, une partie de lme humaine ? Il ne le semble pas, puisque p.238 Aristote la dclare incorruptible et ternelle, tandis que lintelligence passive est prissable. Si elle est une substance spare de lme humaine, nest-elle pas identique au moteur des sphres, Dieu, qui est pense ternellement actuelle ? Il le semble dautant plus que lintelligence qui est en nous est la part la plus divine de notre tre, dont lactivit nous met au-dessus de la nature humaine et nous
1 2
De lAme, II, 4, 429 b, 31. Ibid., 4, 429 a, 29. 3 Ibid., 4, 430 a, 2. 4 De lAme, II, 7, 431 b, 12.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
167
fait partager la vie des dieux. Mais sur ce point, Aristote ne sexprime pas formellement et laisse ses interprtes dans un embarras dont on verra plus tard les consquences (De lAme, III, 5). Ce qui reste sr, cest la place particulire quil a donne lintelligence dans lme humaine. Si elle peroit les choses sans matire, cest quelle est elle-mme sans matire : cest dire quelle na besoin daucun organe corporel ; si la dfinition gnrique de lme, entlchie dun corps organis, lui convient encore, ce nest pas tout fait dans le mme sens quelle convient la facult nutritive ou sensitive : car nous voyons bien sans doute que le corps organis est une condition sans laquelle lintelligence ne saurait penser ; car elle ne peut penser sans images. Mais, tant en elle-mme indpendante et du fonctionnement dun organe et des images mmes, il faut dire quelle sajoute lme par une sorte dpignse, quelle y entre de lextrieur et par la porte 1. Lme est alors conue dune manire analogue au monde, et, peut-on dire, selon le mme schme : un dveloppement de facults qui, appuy sur le corps organis, soriente vers un terme, lintelligence, qui leur est, certains gards, transcendant. Psychologie et cosmologie, dont les liens staient un peu dtendus chez Platon, grce au mythe de la destine qui crait vraiment lme une individualit, sunissent plus fortement que jamais. Dans cette philosophie, lme nest faite, si lon peut dire, que pour tre une image spirituelle de la ralit. Lme p.239 est en quelque faon tous les tres ; car les tres sont ou bien sensibles ou bien intelligibles ; or la science est en quelque manire le su, et la sensation, le sensible 2 . Dans cette vue synthtique de lme ne sont mis en vidence que les deux ples : sensation et intelligence ; lentre-deux, cest--dire tous les mouvements de pense o nous sommes nous-mmes, rflexion, opinion, imagination, sont absorbs dans leur relation lun ou lautre de ces ples fixes, o lme se fait purement reprsentative et intuitive de la ralit.
XII. MORALE
@ Toute la pense platonicienne reposait sur une union parfaitement intime entre la vie intellectuelle, morale et politique : la philosophie par la science atteint la vertu et la capacit de gouverner la cit. Tout cela se dissocie chez Aristote : le bien moral ou bien pratique, cest--dire celui que lhomme peut atteindre par ses actions, na rien voir avec cette Ide du Bien que la dialectique mettait au sommet des tres 3 ; la morale nest pas une science
1 2
Gnration des animaux, II, 3, 736 b 27. De lAme, III, VIII, dbut 3 thique Nicomaque, I, 6.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
168
exacte comme les mathmatiques, mais un enseignement qui vise rendre les hommes meilleurs, et non seulement leur donner des opinions droites sur les choses rechercher ou fuir, mais les leur faire effectivement rechercher ou fuir. Quand il sagit de vertu, il nest pas suffisant de savoir ; il faut encore la possder et la pratiquer. Sur la porte de cet enseignement, le moraliste ne doit pas se faire trop dillusions : de simples discours ne suffisent pas inspirer la bont ; ils seront fructueux quand ils sadressent des jeunes gens dun caractre noble et libral, mais ils sont bien incapables de conduire le vulgaire la vertu. La morale est donc bien un enseignement, mais un enseignement aristocratique ; ce p.240 nest pas une prdication pour la foule, mais une invite la rflexion pour les mieux dous ; aux autres suffiront lhabitude et la crainte du chtiment 1. Et mme il semble que la vertu ne puisse se dvelopper pleinement que dans les classes aises ; il est impossible ou bien difficile un indigent de faire de belles actions ; car il est bien des choses quon ne fait quen se servant comme instruments, des amis, de la richesse, du pouvoir politique ; un homme trs laid, de basse naissance, solitaire et sans enfants ne saurait atteindre le bonheur parfait. Des vertus aussi prcieuses que le courage, la libralit, la politesse, la justice ne peuvent sexercer qu un certain niveau social ; un pauvre ne peut tre magnifique ; car il na pas de quoi dpenser convenablement ; sil lessaye, cest un sot 2 . Cette thique est celle dune bourgeoisie aise et dcide profiter sagement de ses avantages sociaux ; on ny sent ni le souffle populaire dun veilleur de consciences, comme Socrate, ni la certitude qui animait Platon. Mais elle est en pleine harmonie avec le reste de la philosophie : en thique, comme partout, il sagit de dfinir une fin, puis de dterminer les moyens propres atteindre cette fin. Mais cest une fin pratique et humaine, cest--dire qui doit tre accessible lhomme par des actions ; pour la connatre, il faudra donc se servir de lobservation et de linduction, cest--dire chercher en vue de quoi, en fait, agissent les hommes ; or, il nest pas douteux quils cherchent tous le bonheur ; plaisir, science, richesse ne sont que des moyens pour atteindre cette fin qui ne se subordonne plus aucune autre. La fin est donc le bonheur, mais un bonheur humain, cest--dire qui nous soit accessible par nos actions et qui dure pendant la plus grande partie de la vie. Mais il importe de voir que ce bonheur qui oriente laction comme une fin nest ni une partie ni un rsultat de laction (pas plus que lintuition p.241 intellectuelle nest un rsultat du travail mental puisquelle oriente plutt ce travail) ; le bonheur est dans une autre catgorie que laction : le bonheur est un absolu et un acte, laction est relative une fin 3 ; il nous arrive comme un don des dieux et une rcompense de notre vertu ; principe des biens, il a quelque chose de divin 4. Cest dailleurs lopinion universelle des hommes,
1 2
Ibid., X, 9, 117 9 b, 1 sq. Ibid., IV, 1091 a 31. 3 thique, I, 9, dbut. 4 Ibid., I, 12, fin.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
169
qui considrent le bonheur comme une chose prcieuse entre toutes, mais non point comme une chose louable. On croirait quAristote lutte contre ce type deudmonisme, si diffrent du sien, qui prvalut aprs lui, et qui runit ce quil sefforait par-dessus tout de distinguer : le louable et le prcieux, laction et la fin 1. Cest une rgle universelle quun tre natteint sa fin propre que sil accomplit la fonction qui lui est propre ; lexcellence dans laccomplissement de cette fonction est la vertu de cet tre. La notion de vertu en gnral dpasse donc de beaucoup la sphre de la morale ; on peut parler de la vertu dun tre vivant et mme dun objet inanim ou dun outil fabriqu. Le mot ne suggre pas une qualit spcifiquement morale. De plus, la vertu dun tre est quelque chose dacquis, de surajout lessence ; en effet, il ny a pas de plus ou de moins dans lessence et, l-dessus, Aristote est irrductible ; on est homme ou on ne lest pas ; on ne peut ltre plus ou moins. Mais de lessence dun tre ne se dduisent pas toujours toutes ses qualits avec la mme ncessit que les proprits dun triangle se dduisent de son essence ; il y a des degrs de perfection diffrents pour un tre de mme essence ; il y a des outils de bonne et de mauvaise qualit, bonne ou mauvaise qualit ne faisant pas partie de lessence ; cest donc dans la catgorie de dualit que se prouve la vertu, et plus spcialement dans les qualits acquises (thique, I, 13 ; II, 1). ces principes lhomme : sa fonction propre et distinctive est lactivit conforme la raison ; toute activit humaine, bonne ou mauvaise, est raisonnable ; la vertu humaine consiste dans la perfection ou lexcellence de cette activit. Raliser le sens de cette formule, tel est le but de la thorie des vertus ; or, ce sens est extraordinairement complexe et riche, si lon veut le voir luvre dans tous les dtails particuliers de la vie humaine, et cest bien ce quil faut ; car lthique doit enseigner comment agir, et par consquent descendre tous les cas particuliers ; en matire daction, les notions gnrales sont vides ; et les notions particulires ont plus de vrit parce que les actions portent sur le particulier (III, 7, dbut) , Lthique est donc une sorte de description trs concrte de la manire dont la raison peut pntrer et diriger toute lactivit humaine ; aucun dtail de la vie passionnelle et des relations sociales nest omis ; car cest grce ce dtail que la raison prend un sens. Lthique soriente tout naturellement vers la description des passions, comme, vers la mme poque, la comdie nouvelle de Mnandre (342-290) remplace la violence des diatribes dAristophane par la dlicate analyse des caractres. Ce sont ces analyses qui donnent tout son prix lthique Nicomaque ; il ne sagit point de rgles gnrales mais de rechercher quand il faut agir, dans quel cas, lgard de qui, en vue de quoi et de quelle manire (II, 7) . La vertu est une disposition stable do nat laction vertueuse ; cette disposition nest pas naturelle et inne ; lhomme nat avec des dispositions
1 p.242 Appliquons
Ibid., I, 12.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
170
certaines passions, la colre ou la peur par exemple ; mais ces dispositions ne sont ni vice ni vertu, et il nen est ni lou ni blm. La vertu est une disposition acquise, et acquise par la volont, puisquelle est loue ; elle nexiste rellement que lorsquelle est devenue habitude, cest--dire lorsque, tout acquise quelle est, elle produit les actions avec la mme facilit quune disposition inne ; lhomme nest vraiment juste que sil na aucune peine, sil a mme plaisir p.243 faire une action juste ; cette habitude, ne de la volont, la rend en mme temps plus ferme. Tout ce quil y a de vertu chez lhomme vient donc de son choix volontaire. Mais que doit tre ce choix pour tre raisonnable et vertueux ? Sur ce point capital, Aristote (cest la caractristique de sa mthode en morale) fait appel dune part une analogie, dautre part lopinion commune (II, 6). Dabord lanalogie de lacte vertueux avec les uvres de la nature et de lart : ces uvres visent avant tout viter les excs, le trop ou le trop peu ; les mdecins savent que la sant ou lexcellence du corps est une juste proportion des forces actives contraires, chaud et froid, qui influent sur le corps ; le sculpteur et larchitecte visent aussi certaines proportions justes ; la nature et lart trouvent leur excellence, lorsquils ont atteint ce milieu entre deux excs. La condition matrielle de cet idal est quils oprent sur un de ces continus qui comportent le plus et le moins, un de ces multiples infinis dont Platon parlait dans le Philbe, o saccouplent plus chaud et plus froid, plus grave et plus aigu. Or cette condition est ralise dans la vie morale ; la volont travaille sur des actions et des passions qui comportent le manque et lexcs, le plus et le moins, qui se prsentent par couples, comme crainte et audace, dsir et aversion, o toute augmentation dun des termes est une diminution de lautre ; la vertu consistera atteindre en ces continus le juste milieu. Et cest aussi lopinion commune selon laquelle il y a une seule manire dtre bon et mille dtre mauvais. Mais le problme du milieu se prsente aussi avec des caractres particuliers, dus lobjet de la morale : il ne sagit point en effet, pour trouver lobjet de la vertu, de dfinir dune manire prcise et absolue un milieu, comme on dfinit une moyenne arithmtique entre deux extrmes. La morale ne comporte pas pareille rigueur : elle sadresse en effet des hommes naturellement enclins des passions opposes, de tout degr et de toute nature ; elle a moins donner ces hommes une dfinition thorique de la vertu, qu la produire p.244 en eux ; or il est clair que lon ne produira pas le courage de la mme manire chez le timide quil faut exciter et chez laudacieux quil faut rprimer ; selon les cas, le milieu sera plus prs de lun ou de lautre extrme ; il est milieu par rapport nous et non selon la chose mme. La dtermination du milieu, insparable des moyens pour le produire, est donc une question de tact et de prudence. Ajoutez que, dans une moyenne arithmtique, le milieu est postrieur aux extrmes et dtermin par eux ; dans la vie morale, les extrmes sont, au moins idalement, postrieurs au milieu et ne sont extrmes que relativement lui : limparfait ne se conoit comme tel que par rapport au parfait ; et cest
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
171
en un sens le milieu qui est le vritable extrme, cest--dire le plus haut degr de perfection (II, 6). La vertu est donc, en rsum, une disposition acquise (), de la volont qui consiste en un milieu, milieu relatif nous, dfini en raison, cest--dire tel quun homme de tact peut le dfinir 1. Cadre trs gnral, que viendra remplir lexprience morale ; autant de couples de passions opposs, autant de vertus, et autant de couples de vices opposs entre eux et la vertu. Relativement la crainte et laudace, par exemple, il y a une vertu, qui est le courage, et deux vices qui sont la tmrit et la lchet ; relativement la recherche du plaisir, la vertu est la temprance et les vices opposs sont lintemprance et linsensibilit. De mme, lorsque nous trouvons un couple dactions opposes lune lautre ; relativement au don des richesses par exemple, la vertu est la libralit, les vices opposs sont dune part la mesquinerie, dautre part la prodigalit (II, 7). Ces exemples nous font mieux voir comment la vertu est un milieu tout relatif notre condition humaine, et mme notre condition sociale ; ainsi la libralit, vertu des hommes privs de fortune modeste, est bien diffrente de la magnificence, vertu du riche magistrat bienfaiteur de sa cit : ce qui est gnrosit chez lun sera mesquinerie chez lautre. On le voit : si Aristote dfinit la vertu par une disposition volontaire, il est fort loin dy voir quelque chose comme lintention ; cette disposition nest envisage que comme disposition laction ; les conditions matrielles de laction tant absentes, la vertu na plus aucun sens. Le libral a besoin de richesse pour agir libralement, et le juste dchanges sociaux ; car les intentions sont invisibles, et linjuste se vante lui aussi de sa volont de justice. Aussi sont-ce l vertus humaines insparables du milieu social, vertus politiques, que les dieux par exemple, ne possdent nullement. Comment seraient-ils justes ? Est-ce quon les voit sans rire faire entre eux des contrats et rendre des dpts 2 ? Do son analyse de la volont (III, 1 5) ; elle est considre non pas en elle-mme mais dans ses rapports laction quelle produit. Cest avant tout une question de pdagogie sociale ; il sagit de savoir quelles sont les actions que le lgislateur pourra utilement favoriser par ses loges ou empcher par ses blmes ; une condition, cest quelles soient volontaires. Cette condition concerne leurs diverses causes, cest--dire leur principe originaire, leur fin et leur moyen. Une action est volontaire () au sens le plus gnral, lorsque son point de dpart est intrieur ltre qui laccomplit. Ce qui rend lacte involontaire, cest ou bien une contrainte matrielle, comme si le vent nous emporte, ou bien une contrainte morale, comme celle du tyran (mais ici il ny a aucune rgle prcise pour discerner le point o la menace rend lacte involontaire), ou bien enfin lignorance, non pas lignorance du bien et du
1 2
thique, II, 6, 1106 b 36. X, 8, 1178 a 24 et 1178 b 28.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
172
mal, mais celle des circonstances particulires dont la connaissance aurait modifi notre action. En ce sens gnral, laction volontaire nest nullement propre lhomme : elle se trouve aussi chez lanimal. Lacte proprement humain, cest lacte fait par choix rflchi (), cest--dire par choix prcd dune dlibration (). La dlibration est la recherche qui porte non pas sur la fin de lacte, mais sur les divers moyens possibles datteindre cette fin ; elle na donc lieu que l o il y a de lindtermination et du contingent. Elle est dans le domaine pratique le correspondant de la pense discursive dans le domaine thorique ; elle construit des syllogismes pratiques, dont la majeure implique un prcepte et une fin (les viandes lgres sont salutaires), la mineure, une constatation de fait par la perception sensible (cette viande est lgre), la conclusion, la maxime pratique qui conduit immdiatement laction ou labstention. Une maxime gnrale, sans la connaissance particulire des faits, nentranerait jamais laction ; cest le rle propre de lintelligence pratique de dcouvrir ces faits particuliers exprims dans les mineures (ici la perception sensible est rellement intelligence), tandis que lintelligence thorique connat les principes premiers 1. Mais la dlibration est toujours relative une fin ; la volont de la fin (), fort diffrente de la dlibration qui en dpend, est celle qui vise au bien ou du moins ce qui nous parat tre le bien. Cette analyse de la volont a pour consquence la distinction de deux espces de vertus : les vertus thiques, qui sont en rapport avec le caractre, cest--dire avec nos dispositions naturelles telle ou telle passion pour les rduire leurs justes limites ; les vertus dianotiques ou vertus de la rflexion qui sont qualits de la pense pratique aboutissant laction. Impossible de confondre les premires avec les secondes, cest--dire la force de la volont dominant les passions avec la clart dune intelligence qui recherche la voie droite. Lunit que Socrate parat avoir voulu tablir entre la matrise de soi et la rflexion est dtruite ; la partie irrationnelle de lme reste p.247 comme un lment irrductible que la raison peut gouverner, mais non absorber ; les vertus thiques, courage ou justice, sont en nous presque de naissance ; les vertus dianotiques, comme la prudence, ne sacquirent que par une longue exprience. Impossible aussi de confondre les vertus dianotiques avec la science ou la sagesse ; ces qualits sont la prudence (), qui consiste bien dlibrer, cest--dire viser, en rflchissant, le meilleur moyen possible datteindre une fin et prescrire ce moyen, la pntration (), qui consiste savoir juger correctement les autres dans les choix quils font, le bon sens, facult de juger correctement ce qui convient. Or, tandis que la science ne porte que sur luniversel et le ncessaire, toute la rflexion pratique, on la vu, na affaire qu des circonstances particulires et contingentes ; connaissance complexe des moyens divers datteindre nos fins, elle ne saurait aboutir des vrits universelles (livre VI).
VI, 11, 1148 a 35.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
173
Cette mme tendance sparer ce quunissait la pense dun Socrate et dun Platon se retrouve dans la doctrine de la justice (livre V). Chez Platon, la justice est le soutien de lunit des vertus ; chez Aristote, elle devient une vertu part. Non quil abandonne entirement lide que la justice est la vertu tout entire ; en effet le juste, cest ce qui est prescrit par la loi, et la loi, surtout telle que la conue Platon, contient un trs grand nombre de prescriptions morales, faites pour encourager la vertu ; elle commande la temprance, le courage, la douceur ; mais il convient dajouter que si la lgislation prescrit les actes vertueux, elle vise non la perfection de lindividu, mais celle de la socit ; ainsi donc, sous cette forme trs gnrale, la justice ne contient quun aspect de la vie morale, celui de nos rapports avec autrui (V, 1). Mais elle a une seconde forme bien plus spciale, et qui, elle-mme, se subdivise ; cest la vertu qui prside la distribution des honneurs ou des richesses entre les citoyens : cest celle qui fait respecter les contrats de toute sorte, comme la vente, lachat, le prt ; cest enfin p.248 celle qui dfend les actes darbitraire et de violence. Cest dire quAristote considre comme ayant une place distincte et irrductible le droit sous les trois formes quil trouve en usage : rpartition des biens communs entre les citoyens, droit contractuel, et droit pnal. A ces trois droits, il trouve un seul principe, lgalit ; mais il lentend diffremment dans les trois cas : dans le droit distributif, cest lgalit proportionnelle qui proportionne la part de chacun sa valeur ; le principe du droit contractuel et pnal, cest lgalit arithmtique ; le juge a pour office, par un jeu de compensations et de dommages et intrts, de rtablir lgalit au profit de la personne lse, quil sagisse dune violation de contrat ou dun acte de violence. Dans lchange des marchandises, cette galit est rendue possible par linvention de cette commune mesure, qui est la monnaie. Ainsi Aristote tend crer dans la morale des sphres distinctes, ayant chacune ses principes propres. Ce nest point aussi que toutes les vertus naient des conditions communes ; lorsquAristote crit de si longues pages sur lamiti (VIIIe et IXe livres), cest parce quil la considre comme une condition indispensable la vertu ; mais sa forme la plus leve, lamiti entre hommes libres et gaux, anims chacun de lamour du bien, est seule capable, par la rciprocit de services quelle engendre, de faire atteindre aux hommes toute la perfection possible en se faonnant les uns sur les autres et en se corrigeant les uns par les autres ; il ne sagit pas bien entendu des formes intrieures de lamiti, de cette amiti par intrt que lon trouve chez les vieillards ou de lamiti de plaisir qui lie les jeunes gens. LorsquAristote tudie le plaisir (VII, 11 14 et X, 1 5), cest aussi pour en dterminer la forme la plus leve et faire voir en lui une condition de lexcellence morale ; il est indispensable la vertu que lon se plaise ce quil faut et que lon dteste ce quil ne faut pas faire. Car, en tout cas, il est p.249 impossible de ne pas tendre au plaisir, et ceux qui, comme Speusippe, dclarent que tout plaisir est mauvais sont rfuts par lexprience universelle
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
174
qui nous montre tous les tres sentants le recherchant comme un bien ; ce nest pas par cet asctisme de faade quon loignera les hommes des plaisirs dangereux et quon les amnera aux plaisirs utiles. La vrit, cest que tout acte quel quil soit, quand il sachve, saccompagne du plaisir, de mme que le dveloppement complet dun tre ne va pas sans la beaut : le plaisir sajoute lacte. De plus il achve lacte, en le favorisant ; effet de lacte, il devient cause de la perfection de cet acte. Ds lors, le plaisir nest pas plus susceptible dtre recherch sans condition titre de fin que dtre repouss. Tant vaudra lacte, tant vaudra le plaisir ; cest dire combien est diffrente la valeur des plaisirs ; cest dire aussi que la vertu ne saurait tre parfaite si elle nest pas dveloppe au point de produire le plaisir lorsquelle passe lacte. Amiti et plaisir achvent par consquent chacun sa manire la vertu ; mais ils ne lui donnent pas plus dunit. La vertu reste disperse en formes multiples. Il ne peut sagir de les rduire une ; mais, comme Aristote, dans la thorie de la substance, a dtermin dabord la substance titre de notion gnrale, contenant en son extension une foule de substances diverses, puis est pass de cette notion gnrale celle dune substance individuelle, Dieu, qui est la substance par excellence, en morale, par un rythme trs analogue, il passe de la notion gnrale de vertu considre, comme le titre commun des vertus humaines, thiques et dianotiques, une vertu qui est la vertu par excellence, vertu transcendante aux vertus humaines, vertu divine, qui est la facult de la contemplation intellectuelle (X, 6 8). Tandis que les autres vertus impliquent lunion de lme avec le corps et la vie sociale, lintelligence, dans la contemplation du vrai, est isole et se suffit elle-mme ; tandis que le reste de la vie morale est une vie pleine doccupations incessantes, la vie contemplative est une vie de loisir, et p.250 par consquent bien suprieure, dautant que le loisir est la fin de laction, et non laction celle du loisir. Elle est donc la vie de ce quil y a de vraiment divin dans lhomme, la seule vie que lhomme puisse partager avec les dieux qui sont avant tout des activits pensantes, enfin celle qui produit, en lui, avec le plaisir le plus lev, le bonheur qui peut plus que tout autre se prolonger sans fatigue. Cette morale du contemplatif ou de lhomme dtude, plac bien au-dessus du politique, implique encore une dissociation de ce que Platon avait voulu si fermement unir. Aristote a fortement senti la ncessit de sparer la vie intellectuelle du reste de la vie sociale et den faire une fin en soi. Tous les hommes dsirent naturellement savoir 1 , et le savoir est comme un absolu qui ne se rfre rien autre. On ne peut dire pourtant quil y ait chez Aristote une vritable dualit didal. Car il y a entre les deux vies, pratique et contemplative, une hirarchie et une subordination de la premire la seconde ; la vie sociale dune cit grecque, avec toutes les vertus quelle comporte, est la condition laquelle peut exister le loisir du savant qui con1
Mtaphysique, A, I, dbut.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
175
temple ; ce sont donc l deux vies insparables, la manire dont Dieu et le monde sont insparables.
XIII. LA POLITIQUE
@ Une cit, cest clair, nest pas un simple rassemblement pour viter les torts mutuels et pour changer les services ; ce sont bien l des conditions ncessaires, mais ce nest pas encore une cit ; une cit, cest un rassemblement de maisons et de familles pour bien vivre, cest--dire pour mener une vie parfaite et indpendante 1 . La premire partie de ce passage, vise Platon qui, en dfinissant la cit par la division du travail et par le p.251 troc, a eu le tort dindiquer seulement les conditions matrielles et non la vraie nature, cest--dire la cause finale de la cit. La socit sert non seulement vivre, mais bien vivre, cest--dire quelle est la condition de la vie morale. La science de la politique consistera avant tout dans lexamen des conditions auxquelles cette fin peut tre atteinte ; mais cet examen consiste moins dans des constructions thoriques que dans lusage dobservations et dexpriences quAristote multiplie et tend par des recherches historiques approfondies sur les constitutions des villes ; les sophistes avaient dj fait des rpertoires des lois des cits 2 ; en cela, Aristote continue leur travail et crit lui-mme ou fait crire lhistoire des constitutions diffrentes. Mais cette histoire nest faite que pour prparer une apprciation. La mthode ici est la mme quen biologie : les faits dexprience viennent se grouper en faisceaux selon certaines directions. La fin quil assigne la cit est dailleurs aussi en une certaine mesure le rsultat de son exprience et de sa formation politiques. Il voit, dans lindpendance conomique dune puissance agrarienne, telle que Lacdmone, la condition de sa vitalit morale. Lindpendance dune cit est fonde sur lexclusion des rapports conomiques avec ltranger ; ds quun pays cherche, comme la fait Athnes au Ve sicle, ses ressources dans son commerce avec ltranger, elle dpend des pays qui produisent le bl et de ceux qui achtent ses produits ; do avec le grand commerce, la ncessit du prt intrt et des banques 3. Toute cette civilisation nouvelle qui amne avec elle des guerres, Aristote la condamne ; il voudrait le retour lconomie naturelle. Lunit conomique, cest la famille ; elle a tout ce quil faut pour produire ce qui est ncessaire la consommation de ses membres ; elle nchange que le surplus de cettep.252 consommation. Il ny a donc aucun travailleur libre et salari ; lorganisation de lesclavage avec le pouvoir absolu du matre () sur lesclave est une condition de cette
1 2
Politique, III, 5, 1280 b 29. thique Nicomaque, X, 9. 3 KINKEL, Die socialkonomischen Grundlagen der Staatalehre von Aristoteles, 1911, p. 92.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
176
organisation conomique ; lesclave est loutil vivant qui na dautre volont que celle de son matre et qui ne participe pas la vertu morale ; il deviendra inutile lorsque les navettes marcheront toutes seules (I, 2) . Cette division de lhumanit en matres et esclaves nest ni arbitraire ni violente : la nature, obissant la finalit, cre, dans les climats chauds de lAsie, des hommes desprit ingnieux et subtil mais sans nergie et qui sont faits pour tre esclaves ; seul le climat tempr de la Grce peut produire des hommes la fois intelligents et nergiques, qui sont libres par nature, non par convention. Dans cette thorie qui cadre si bien avec le finalisme dAristote, on sent aussi un cho de la lutte sculaire entre la Grce et les Barbares, et peut-tre un essai pour justifier la gigantesque entreprise de domination universelle de la Grce, alors tente par Alexandre 1. La famille a plus quune fin conomique ; elle permet la direction par le chef de famille de ces mes imparfaites que sont celles des femmes et des enfants ; mes imparfaites, mais non pas mes desclaves ; aussi ne sagit-il plus ici de pouvoir absolu ; le mari commande la femme comme un magistrat ses administrs, le pre aux enfants comme un roi ses sujets (I, 5). La famille contient ainsi toutes les conditions ncessaires pour que la cit ne puisse se composer que de libres et dgaux. Il faut en effet retrancher du nombre des citoyens tous ceux qui exercent les fonctions de production, laboureurs ou artisans ; ce sont l mtiers sans noblesse et qui suppriment le loisir ncessaire pour pratiquer la vertu et soccuper de politique ; il faut y employer des gens dune autre race qui ne songent qu leur travail et non aux rvolutions. La cit proprement dite a avant tout des fonctions militaires et judiciaires, fonctions p.253 qui appartiennent aux mmes hommes des ges diffrents ; il faut y ajouter les fonctions sacerdotales (VII, 7). La diversit des constitutions (IV, 4 et 5) vient des mille manires dont ces fonctions, toujours les mmes, peuvent tre rparties entre les citoyens. Il y a dmocratie lorsque les hommes libres et sans ressource qui forment la majorit sont la tte des affaires ; cest la libert et lgalit qui la caractrisent ; encore faut-il distinguer la dmocratie o cest la loi qui commande et celle o cest la foule avec ses votes changeants. Loligarchie est larrive au pouvoir des riches et des nobles ; elle tend vers la monarchie, mesure que la richesse est plus concentre. La diversit des gouvernements a donc une de ses conditions essentielles dans lquilibre des fortunes. De grandes diffrences de fortune engendrent ncessairement loligarchie. Le but final de la cit, cest dassurer le bonheur et la vertu des citoyens par la domination des lois ; or cette domination est favorise par certaines conditions conomiques, par le dveloppement des classes moyennes : Lorsque la classe des laboureurs et de ceux qui possdent une fortune moyenne est matresse de la cit, cest le rgne de la loi ; ne pouvant vivre quen travaillant et
1
Politique, VII, 6, 1327 b 21-33.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
177
nayant pas de loisir, ils obissent la loi et ne tiennent que les assembles ncessaires . Y a-t-il au contraire beaucoup de citoyens oisifs ? la dmocratie se transforme en dmagogie, et les votes remplacent la loi . On voit la mthode : il sagit non point de fonder une cit mais de trouver, dans les conditions effectivement et historiquement ralises, les moyens infiniment divers et changeants selon les circonstances, dassurer le bien social ; pour trouver la meilleure constitution dans un cas donn, il faut mme aller jusquaux conditions gographiques : Lacropole est oligarchique et monarchique, la plaine est dmocratique (VII, 10). Conditions si nombreuses, et dont certaines sont si sujettes au changement que la constitution ne peut rester stable ; le dsir dgaler ou de primer les autres, le dsir de senrichir et lambition, laccroissement des p.254 fortunes sont les motifs principaux qui produisent les rvolutions (V, 2). Parmi ces conditions, il en est un grand nombre qui viennent de la nature et dont lhomme nest pas matre ; mais il en est aussi qui viennent de la rflexion et de la volont, et de celles-ci lhomme est matre au moyen de lducation, qui doit prparer chez lenfant la vertu civique. Lducation qui fait, les bons citoyens est celle qui se garde de dvelopper une fonction au dtriment des autres et qui sait maintenir la hirarchie de ces fonctions et leur valeur propre : dangereuse par exemple, lducation guerrire de Sparte qui fait de la guerre la fin de la cit tandis que la guerre et le travail ne sont faits que pour la paix et le loisir ; dangereux, labus de la gymnastique qui, chez les Thbains, fait de tout citoyen un athlte, labus de la musique qui fait les virtuoses. Il faut en ralit dvelopper le corps pour lme, la partie infrieure de lme, les passions, pour la partie suprieure, la volont, et enfin la partie suprieure en vue de la raison contemplative et de la raison thorique (VII, 12). Le dveloppement de la contemplation intellectuelle est donc le but final et unique dont tout le reste nest que la condition et la consquence ; dans lme humaine, dans la socit comme dans lunivers, toutes choses tendent vers la pense. La philosophie est peut-tre moins ltude de la pense elle-mme, qui dpasse lhomme, que celle de cette tendance, avec les conditions prodigieusement nombreuses et varies que nous enseigne lexprience. Lunivers mental dAristote est un tableau des divers degrs dapproximation de ces conditions 1. Au plus haut degr, les sciences thoriques, philosophie premire, physique et mathmatiques, tudient les choses qui ne peuvent tre autrement quelles ne sont et dont la perfection consiste dans leur ncessit mme ; plus bas viennent les sciences pratiques et potiques, cest--dire celles dont les objets peuvent p.255 tre autrement quils ne sont et dpendent la fois de conditions naturelles fournies par une heureuse chance et de leffort humain ; les premires, morale et politique, aboutissent des actions ; les secondes, techniques de tout genre, des produits fabriqus par lhomme ;
1
Mtaphysique, E, 1, 1025 b, 18-28.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
178
mais cette classification nempche nullement la parfaite continuit qui fait que laction humaine est, comme le thorme mathmatique, le rsultat dun syllogisme, et que la rhtorique et la posie nont daction, sur les passions que grce la pense rationnelle qui les inspire encore.
XIV. LE PRIPATTISME APRS ARISTOTE
@ Lcole pripatticienne, comme association lgale reconnue par la cit, a t fonde non par Aristote qui tait mtque, mais par Thophraste qui il lgua ses biens dans un testament que lon possde encore. Lcole devient alors une association cultuelle, consacre aux Muses, ayant comme proprit commune et inalinable les maisons et jardins lgus par Aristote, compose de membres plus gs qui lisaient le chef dcole, et de membres plus jeunes chargs dorganiser chaque nouvelle lune les repas communs o lon invitait les personnes trangres lcole. Le travail philosophique est donc collectif. La vie de lcole ne fut dailleurs pas facile ; souponne de macdonisme et peu sympathique aux Athniens, elle fut plusieurs fois menace ; lorsque le macdonien Dmtrius de Phalre dut cder Athnes en 301, commencrent contre les philomacdoniens des reprsailles diriges par Dmochars, le neveu de Dmosthnes ; elles atteignirent dabord les pripatticiens, et Thophraste dut quitter Athnes. A partir de ce moment, les liens entre le pripattisme et Athnes se font plus lches. Les disciples dAristote vont volontiers travailler dans la ville, dont le nom commence faire plir lclat dAthnes : dans Alexandrie 1. Cette affinit des pripatticiens avec la ville de lrudition est bien naturelle. Cest en effet dans le sens des investigations exprimentales que se dirigent les disciples dAristote : botanistes, zoologistes, historiens, ils obissent la puissante impulsion donne par le matre vers les recherches spciales. Cest Eudme, Aristoxne de Tarente et surtout Thophraste drse (372-288), dont le fragment de Mtaphysique commence par laffirmation dun contact intime et dune sorte de communaut entre les ralits intelligibles et les objets de la physique 2 ; les exagrations du finalisme dAristote, auquel il oppose lexprience, paraissent aussi lavoir frapp (320, 12 sq.). Ses collections botaniques, qui sont conserves ; ses nombreuses monographies physiques qui se rapportent aux signes des temptes, au vent, leau et toutes sortes de faits gologiques 3 ; ses clbres Caractres, qui marquent bien la tendance de la morale pripatticienne vers
p.256 1
WILAMOWITZ-MOELLENDORF Antigonos von Karystos, 1881, p. 264 ; ZIEBARTH, Das griechische Vereinswesen, 1896, p. 71 sq. 2 Edit par Brandis, avec la mtaphysique dAristote, Berlin, 1823, p. 308, 8. 3 Fragment de son trait sur leau dcouvert dans The Hibbeh Papyri de Grenfell I, n 16, par Blass.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
179
lobservation de dtail ; son histoire des Opinions physiques qui est devenue une des sources principales des doxographes grecs ; enfin ses recherches historiques de dtail sur les prytanes drse, tout cela marque bien lorientation de lcole. Il ne soccupe de religion qu la manire dun historien et dun anthropologiste ; peu fixe sur la nature de la divinit quil voit tantt dans un Esprit, tantt dans le ciel ou les toiles, il abonde en dtails positifs, par exemple dans la critique quil fait des sacrifices sanglants dont il montre le caractre tardif et quil repousse cause de la parent entre hommes et animaux, non pas postule en dogme, mais tablie par lobservation positive des germes de raison chez les animaux 1. On voit les mmes tendances chez Clarque de Soles qui rassemble, dans un but purement historique, les superstitions sur la vie future 2. Laristotlisme qui fut, bien des sicles aprs, le dogmatisme le plus fig qui soit, tait alors la plus librale des coles. On voit Clarque de Soles abandonner en astronomie la thorie des sphres pour celle des picycles ; et surtout les principes fondamentaux de la physique dAristote 3 sont atteints par la doctrine de Straton de Lampsaque (mort vers 270), qui fut, la cour dgypte, de 300 294, le prcepteur du deuxime Ptolme ; dans une formule exactement inverse de celle dAristote, il enseigne que le hasard prcde la nature ; et de fait, laissant de ct la doctrine des lieux naturels et de la cause finale, il nadmet comme seule force active que la pesanteur : il observe dailleurs avec un soin nouveau le mouvement de chute et dmontre son acclration, en faisant voir que la force avec laquelle le grave rencontre, un obstacle crot avec lespace parcouru. De la seule pesanteur aussi, il dduit la place relative des quatre lments de bas en haut ; llment infrieur, comprim, fait sortir de lui, comme une ponge quon presse, llment suprieur, qui se loge ainsi sa surface ; il ny a bien entendu pas dther, et le ciel est de nature igne. Les diffrences de pesanteur quil y a entre ces corps sont dues aux vides plus ou moins grands quils contiennent, et le vide est encore prouv par la transmission de la lumire et de la chaleur qui ne peut se transmettre que par des milieux non matriels. Ainsi un ordre naturel (sans doute ternellement le mme) peut natre dune simple causalit mcanique : chute, condensation et traction expliquent tout. Il ny a pas dautre dieu que la nature qui, sans aucun sentiment, aucune forme, produit et engendre tous les tres ; la forme na plus limmobilit quelle avait chez Aristote ; le point initial et le point final du mouvement naissent et prissent comme le mouvement luimme.
p.257
Citons encore lhistorien Dicarque, qui dans son histoire abrge du peuple grec 4, reprend, avec une mthode positive, p.258 le vieux rcit
1 2
Extrait par Porphyre dans son trait De lAbstinence. Daprs PROCLUS, Commentaire de la Rpublique, dition Kroll, II, p. 114. 3 PLUTARQUE, De orbe in facie lunae, chap. IV. 4 Connue par PORPHYRE, De lAbstinence, livre IV, chap. II.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
180
hsiodique des origines de lhistoire, distinguant, comme ges successifs, lge dor o les hommes vivent dans le loisir et la paix, lge nomade o, avec la domestication des animaux, dbutent la proprit, les rapines et la guerre, lge agricole, o ces traits saccentuent. Plus tard, Critolas, qui dirige lcole de 190 150, est peine pripatticien ; le dieu suprme devient une raison issue de lther impassible ; lme est aussi un ther raisonnable ; cest lui, semble-t-il, qui, en morale, expose avec prcision la doctrine considre aux sicles suivants comme celle du pripattisme, cest que la vie conforme la nature ne peut saccomplir que par trois genres de biens, les biens de lme, les biens du corps et les biens extrieurs. Spcialisation et tendance un rationalisme implicitement hostile la religion, tels sont donc les traits de laristotlisme vieillissant, philosophie peu populaire et qui cda vite devant luniversel succs des dogmatismes qui naquirent de suite aprs la mort dAlexandre. Ils drivent non de Platon et dAristote, mais des coles dun genre tout diffrent, issues elles aussi du socratisme, et dont il nous faut parler dabord.
Bibliographie @
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
181
II PRIODE HELLNISTIQUE ET ROMAINE
@
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
182
CHAPITRE PREMIER LES SOCRATIQUES
I. CARACTRES GNRAUX
@ Au mme Socrate, dont est issu le mouvement dides de la philosophie du concept, lhistoire rattache un groupe dcoles contemporaines dnommes socratiques ; elles sont toutes en hostilit dcide ce mouvement dides, bien que, dailleurs, elles soient hostiles entre elles. Ce sont lcole mgarique, fonde par Euclide de Mgare, lcole cynique dont le chef est Antisthnes, lcole cyrnaque qui se rattache Aristippe de Cyrne.
p.261
Limportance historique de ces coles est difficile dterminer pour des raisons diverses : dabord leur prestige est diminu par le voisinage de Platon et dAristote ; ensuite il ne reste gure des uvres de leurs adeptes que des collections de titres, quelquefois eux-mmes suspects ; de leurs doctrines que des rsums doxographiques, souvent crits dans le langage des coles postrieures ; sur les personnes que des collections danecdotes ou de chries, destines ldification du lecteur et qui tiennent plus de lhagiographie que de lhistoire ; enfin leur souvenir est clips par celui des grandes coles dogmatiques, picurisme et stocisme, qui se sont fondes aprs la mort dAlexandre. Il faut pourtant reconnatre que ces grandes coles auraient t impossibles sans les petits Socratiques ; lesprit p.262 platonicien, quils ont min sourdement, ne sest pas relev de leurs attaques ; ils ont fait place nette pour les coles qui ont domin la vie intellectuelle de lpoque romaine. De plus, certaines des coles socratiques subsistent plus ou moins longtemps ct des doctrines dpicure et de Znon ; par exemple, le cyrnasme qui garde, en face de lhdonisme dpicure, son originalit propre ; une autre de ces coles, lcole cynique, aprs une clipse (au moins apparente), reparat vers le dbut de notre re et continue exister jusquau VIe sicle, dernire survivante de la philosophie paenne. Entre eux et la philosophie platonico-aristotlicienne, il sagit de quelque chose de plus profond quun conflit doctrinal : ce qui est en question cest la place et le rle de la philosophie. Extrieurement dj la plupart des socratiques conservent un des traits que Platon reprochait le plus durement aux sophistes ; leur enseignement est payant ; rien de semblable, dans ces coles socratiques, simples runions dauditeurs autour dun natre quils payaient, lAcadmie ou au lyce, associations religieuses juridiquement
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
183
reconnues, capables de possder et survivant leur fondateur. Mme contraste dans linspiration de lenseignement : autant Platon exigeait du philosophe une prparation scientifique srieuse, autant un Antisthnes ou un Aristippe dtournaient leurs disciples de lastronomie ou de la musique, considres comme des sciences tout fait inutiles ; quoi bon, dit Aristippe, les mathmatiques, puisquelles ne parlent ni des biens ni des maux 1 ? En mme temps que la mathmatique, on rejetait toute la dialectique, cest--dire lemploi de la discussion dans ltablissement de la vrit. Il ne sagit donc plus denseigner, de discuter, de dmontrer ; on suggre, on persuade au moyen de la rhtorique, on fait appel limpression directe et personnelle. On ne peut prendre p.263 avec plus de nettet le contre-pied de la mthode de Platon. Aussi a-t-on une tendance voir de la convention et de lartifice dans tout ce qui est uvre de pense, uvre labor par la rflexion : telles sont notamment les lois, et, avec les lois, les cits dont elles sont la structure. Do lindiffrence complte pour la politique, qui contraste si fort avec les gots de Platon.
II. LCOLE MGARIQUE
@ Le chef de lcole de Mgare, Euclide, tait pourtant li avec Platon, puisquil reut Mgare Platon et les autres disciples de Socrate au moment o ils quittrent Athnes aprs la mort du matre ; et Platon, en prsentant son Thtte comme un entretien de Socrate, recueilli par Euclide, a voulu sans doute tmoigner des liens damiti qui durrent encore longtemps aprs lvnement tragique 2. Il nen est pas moins vrai que sa doctrine, autant quon peut la deviner travers quelques lignes de Diogne Larce, est aux antipodes de celle de Platon. Pour celui-ci, rappelons-le, toute pense, toute vie intellectuelle tait impossible, moins quon nadmt un systme dides la fois unies entre elles et pourtant distinctes. Or, lorsque Euclide dit que le Bien est une seule chose, quoiquil soit appel de diffrents noms : science, dieu, intelligence ou autres noms encore , lorsquil supprime les opposs du Bien, en affirmant quils nexistent pas, il semble que son intention est de rsister toute tentative pour unir les concepts autrement quen les dclarant identiques, ou pour les distinguer autrement quen les excluant lun de lautre. La science (), le dieu, lintelligence, ce sont prcisment les termes que, dans le Time par exemple, Platon cherche distinguer entre eux et distinguer du Bien suprme, tout en p.264 les unissant et en les hirarchisant. Euclide, en les identifiant et en niant leur oppos, rend impossible toute spculation dialectique du genre de celles du Time ou du Philbe ; la
1
ALEXANDRE DAPHRODISIAS, In metaphysica, d. Hayduck, p. 182, 32 (daprs Aristote). 2 DIOGNE LARCE, Vies des philosophes, II, 106 ; PLATON, Thtte, 142 a - 143 c.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
184
diversit nest que dans les noms et nest plus dans les choses. On sait aussi combien le raisonnement par comparaison est familier et indispensable Platon ; Euclide en nie la possibilit et ne veut pas connatre un semblable qui ne soit ni identique ni diffrent ; ou les termes de comparaison sont semblables aux choses, et alors il vaut mieux se servir des choses ; o ils sont diffrents, et la conclusion ne vaut pas 1. Les fameux sophismes que Diogne Larce attribue au successeur dEuclide, Eubulide de Milet 2, paraissent viser plus spcialement la logique dAristote, et aussi sous la forme o les prsente Cicron dans les Acadmiques, la logique stocienne. Le principe de contradiction nonce quon ne peut dire la fois oui et non sur une mme question ; les sophismes nous montrent des cas o, en vertu de ce principe, on est forc de dire la fois oui et non, o, par consquent, la pense se nie elle-mme. Tel est le sophisme du menteur : Si tu dis que tu mens et si tu dis vrai, tu mens , o lon convient la fois quon ment et quon ne ment pas ; au nom de la logique, le mgarique force son adversaire avouer quil porte des cornes, puisque lon possde ce que lon na pas perdu et que lon na pas perdu de cornes ; il le force reconnatre quil ne connat pas son propre pre, en le lui prsentant sous un voile ; il lui fait convenir qulectre sait et ne sait pas les mmes choses, puisque, lorsquelle le rencontre encore inconnu, elle sait quOreste est son frre, mais elle ne sait pas que celui-ci est Oreste. Il le rduit au silence en lui demandant combien de grains de bl il faut pour faire un tas (sophisme du sorite), ou combien il faut avoir perdu de cheveux pour tre chauve 3. Toutes ces plaisanteries logiques aboutissent bien limpossibilit de choisir entre le oui et le non, donc de discuter laide de concepts dfinis. Elles devaient avoir un grand succs ; Stilpon de Mgare, un contemporain de Thophraste, attirait, dit-on, ses cours les disciples des pripatticiens et ceux des cyrnaques. De son enseignement, nous connaissons assez bien deux parties, qui touchaient au vif la philosophie du concept : dabord la critique des ides 4. La mthode de cette critique cest celle que Diogne Larce indique comme celle dEuclide dans ses rfutations ; il sattaquait aux dmonstrations non en critiquant les prmisses, mais en faisant voir labsurdit de la conclusion ; de mme Stilpon supposant lexistence des ides, en dduit des consquences absurdes : lhomme idal nest pas tel ou tel, par exemple parlant ou non parlant ; par consquent nous navons pas le droit de dire que lhomme qui parle est homme ; il ne rpond pas au concept. Le lgume idal est ternel ; ce que vous me montrez nest donc pas un lgume, puisquil nexistait pas il y a mille ans. Ou bien alors, si vous voulez dire que tel homme individuel rpond bien au concept dhomme, il faudra, si
p.265 1 2
DIOGNE LARCE, Vies des philosophes, II, 106 et 107. II, 108 ; cf. 111. 3 CICRON, Premiers acadmiques, 77, 96 ; DIOGNE LARCE, Vies, VII, 187 ; LUCIEN, Les vies lencan, 22 ; Premiers Acadmiques, II, 92. 4 DIOGNE LARCE, Vies des philosophes, II, 113 ; 114 ; 119.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
185
cet homme est par exemple Mgare, dire quil ny a pas dhomme Athnes, puisque la proprit du concept est dtre unique 1. Quant la porte de cette critique, on voit quelle ne vise pas moins le concept dAristote que lide de Platon ; quon se rappelle seulement les efforts que fit Aristote pour rpondre des critiques du mme genre. Lon connat aussi la position de Stilpon sur un problme voisin, le problme de la prdication, qui avait tant occup Platon dans le Sophiste et o se concentraient tous les efforts de ses adversaires. Au surplus la thse de Stilpon ce sujet nest quun nouvel aspect de celle que nous venons dexaminer. Si lon veut penser, comme Aristote et Platon, par concepts dfinis et stables, ayant chacun leur essence, il est interdit dnoncer une proposition quelconque, sous peine daffirmer lidentit de deux essences distinctes. Affirmer que le cheval court ou que lhomme est bon, cest affirmer que le cheval ou lhomme sont autre chose queux-mmes ; ou bien, si lon rpond que le bon est effectivement la mme chose que lhomme, cest sinterdire le droit daffirmer le bon du remde ou de la nourriture. Il ne faut pas dire sans doute, comme Colots lpicurien, qui nous rapporte cette doctrine de Stilpon dans son trait Contre les philosophes, que cette thse supprime la vie , mais elle supprime linterprtation des jugements, comme relations de concepts, cest--dire tout lidalisme athnien 2. Lon se souvient que, en effet, Aristote navait pu rsoudre de telles difficults quen introduisant, ct des essences fixes et dtermines, des notions de ralits indtermines, telles que celles de puissance, et Platon saccusait plaisamment de parricide en affirmant contre son pre Parmnide que la vie de la pense exigeait quon accordt lexistence au non-tre. Il nest donc pas tonnant que les Mgariques aient t rapprochs de Parmnide et soient considrs comme des rnovateurs de sa pense. Peut-tre cependant la pense de Parmnide ne leur importait pas beaucoup en elle-mme ; ce quils veulent avant tout montrer, cest quun philosophe du concept, nadmettant que des essences fixes, na pas le droit dintroduire ces ralits indtermines, que voulait Aristote : tel parat tre le sens de largument auquel sattache le nom de Diodore Cronos, disciple dEubulide et contemporain du roi Ptolme Ster (306-285) : cet argument que lon appelle le triomphateur atteint en effet les racines mmes de la philosophie dAristote, en montrant que, dans cette philosophie, la notion du possible, et par consquent de puissance indtermine, ne peut avoir aucun sens. Aristote donne (sans dailleurs lattribuer Diodore ni p.267 mme aux mgariques) une forme tout fait simple de largument 3 : ds que vous admettez dune manire gnrale que toute proposition est vraie ou fausse, le principe sapplique aussi bien aux vnements futurs quau prsent ou au
1 2
Id.., VII, 186. PLUTARQUE, Contre Colots, chap. XXII et XXIII. 3 De linterprtation. chap IX.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
186
pass ; toute assertion sur le futur sera ou vraie ou fausse ; il sensuit quil ny a aucune indtermination (ou possibilit dtre ou ne pas tre) pour lvnement futur. Laffirmation du possible est incompatible avec le principe de contradiction. Lauteur de cet argument voulait-il (comme affecte de le croire Aristote qui le rfute par les consquences pratiques de sa thse) dmontrer la ncessit ? Nest-il pas plus conforme ce que nous connaissons des Mgariques de croire quil voulait montrer labsurdit des consquences dune logique fonde sur le principe de contradiction, qui amenait rendre impossible toute volont et toute dlibration sur le futur ? pictte nous donne de largumentation une forme plus complique, mais malheureusement trs obscure 1. Le raisonnement prend pour accord que toute assertion vraie portant sur le pass ne peut devenir fausse ; et que dautre part limpossible ne peut jamais tre un attribut du possible. Puis montrant sans doute ensuite (dans un dveloppement analogue celui que nous a conserv Aristote) que le principe de contradiction doit avoir, selon ladversaire, une porte universelle, cest--dire sappliquer aussi aux assertions relatives lavenir, il en dduit que, dans une alternative (tel vnement arrivera ou narrivera pas), lassertion qui exprime lvnement qui narrivera pas ne se rapporte rien de possible, puisque le possible est ce qui peut tre et ne pas tre, tandis que lvnement en question non seulement nest pas mais ne sera jamais. Dire quil est possible, ce serait donc dire que limpossible est possible. La philosophie du concept ne saurait donc admettre quune ralit rigoureusement et compltement dtermine. Chez tous les Mgariques, on ne voit que des attaques, mais aucune doctrine positive : ils veulent montrer lincohrence de la philosophie du concept ; mais ces ristiques ne paraissent jamais avoir eu lintention, quon leur a parfois prte, de substituer un idalisme propre celui de Platon et dAristote. Le raisonnement a-t-il jamais servi aux penseurs de la Grce, ft-ce Platon, tablir une vrit ? Nest-il pas toujours dialectique, cest--dire destin dduire les consquences dune assertion pose par ladversaire ? Par une transposition gniale, Platon avait fait de cette dialectique un principe de la vie spirituelle ; avec les Mgariques, elle retombe lourdement a terre et reprend son emploi ristique.
p.268
Mais nest-ce pas prcisment pour faire place une vie spirituelle nouvelle, tout autrement dirige que chez Platon ? Il y a dautres moyens dducation que la dialectique. Le rhteur, lui, sait parler de choses utiles et en parle dune manire persuasive ; or cest cette mthode dducation rhtorique, que vante Alexinus dle, un mgarique de la gnration du stocien Znon, dont Hermarque lpicurien a cit un passage du trait Sur lducation 2. On y voit Alexinus, connu dailleurs ainsi que son matre
1 2
Dissertations, II, 19, 1-5. Conserv par PHILODME DE GADARA, au livre B de sa Rhtorique (Volumina rhetorica, dit. Sudhaus ; supplementum, Leipzig, Teubner, 1895, colonne 40, 2-18).
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
187
Eubulide pour avoir crit un livre calomnieux rempli de polmiques personnelles contre Aristote 1, proposer un idal qui scarte beaucoup de la philosophie ; dans le dbat qui a toujours exist, en Grce et mme dans lme grecque, entre la rhtorique et la philosophie, entre lducation formelle qui enseigne des thmes et lducation scientifique qui atteint les choses, il prend parti sans hsitation pour la premire ; et sil reproche aux professeurs de littrature leurs recherches trop pointilleuses en matire de critique de textes, il les loue de traiter de choses utiles en des discours thmes philosophiques, en employant la vraisemblance pour p.269 dcider des questions. Nous avons ici lendroit dont la polmique ntait que lenvers. Nous allons trouve un rythme analogue dans les autres coles socratiques.
III. LES CYNIQUES
@ Un trait commun dans la pense au IVe sicle, trait qui remonte aux sophistes, cest la confiance presque sans bornes dans lducation () pour former et transformer lhomme selon des mthodes rationnelles. Ce trait se retrouve par exemple chez un Xnophon, dont un des principaux ouvrages, la Cyropdie, est destin montrer, par lexemple de Cyrus, quil existe un art de gouverner les hommes et que la connaissance de cet art doit achever lre des rvolutions et mettre fin la crise de lautorit qui tourmente la Grce. Xnophon, dans les Mmorables, comme Isocrate dans le Discours Nicocls, font ressortir les qualits et les vertus que doit possder un roi pour commander 2. Il ne convient pas tant un athlte dexercer son corps qu un roi dexercer son me. De cette ducation du chef, on attend lamlioration de tous. duquer des particuliers, cest servir eux seulement ; engager les puissants la vertu, cest tre utile la fois ceux qui possdent la puissance et leur sujets. Enfin la conception du roi philosophe chez Platon rpond la mme tendance. Nulle part, ce trait nest plus marqu que chez les cyniques, qui se prsentent avant tout comme des conducteurs dhommes. Un cynique du IIIe sicle, Mnippe, raconte, dans sa Vente de Diogne, que Diogne, en vente dans le march aux esclaves, rpondait aux acheteurs qui lui demandaient ce quil savait faire : Commander aux hommes 3. Nulle part, il nest question de cyniques qui se soient borns une rforme intrieure deux-mmes ; sils se rforment, cest pour diriger les autres et soffrir en modles ; ils sont l pour observer et surveiller non pas
p.270 1 2
Daprs EUSBE, Prparation vanglique, XI, 2, 4-5. Cf. MATHIEU, Les ides politiques dIsocrate, Paris, 1925, p. 95 sq. : A la recherche dun chef. 3 DIOGNE LARCE, Vie des philosophes, VI, 9.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
188
eux-mmes, mais les autres, et, au besoin, reprocher aux rois eux-mmes leurs dsirs insatiables. La vertu peut sapprendre , tel est le premier article de la doxographie dAntisthnes 1. Mais cette ducation nest pas purement intellectuelle. Antisthnes est, avec les mgariques, un adversaire dtermin de la formation de lesprit par la dialectique et par les sciences. Aussi Platon et Aristote ne parlentils pas de lui sans lui prodiguer des pithtes ddaigneuses. Vieillard lesprit lent, dit Platon qui a peu prs vingt-cinq ans de moins que lui ; sot et grossier personnage, ajoute Aristote. Contre eux, il employait des arguments analogues ceux des mgariques : Platon veut discuter, rfuter les erreurs et dfinir ; or ni la discussion, ni lerreur, ni la dfinition ne sont possibles, et cela pour la mme raison, parce que dune chose il nest possible dnoncer et de penser quelle-mme. Ds lors la discussion nest pas possible : car ou bien les interlocuteurs pensent la mme chose, et alors ils saccordent ; ou bien ils pensent des choses diffrentes, et la discussion na pas de sens. Lerreur est impossible, car on ne peut penser que ce qui est, et lerreur consisterait penser ce qui nest pas. Enfin la dfinition est impossible, car ou bien il sagit dune essence compose, et alors on peut bien numrer les lments primitifs qui la composent, mais il faut sarrter ces termes indfinissables ; ou bien lessence est simple, et lon peut dire seulement quoi elle ressemble 2. Antisthnes navait pas moins de mpris pour les mathmatiques et lastronomie, le mpris que Xnophon fait exprimer par le Socrate des Mmorables. Sensuit-il que ce premier des cyniques rejetait toute ducation intellectuelle, et faut-il prendre au srieux cette boutade que, si lon tait sage, il ne faudrait pas apprendre lire, pour ne pas tre corrompu par autrui 3 ? En ralit lenseignement quil donnait au Cynosargs ntait pas trs diffrent de celui des sophistes. Isocrate, qui lattaque souvent sans le nommer, par exemple au dbut de lloge dHlne et du Discours contre les Sophistes, dcrit cet enseignement avec assez de prcision : il tait pay quatre ou cinq mines par le disciple ; tout en apprenant un art ristique plein de discussions inutiles, il promettait de faire connatre au disciple le chemin du bonheur ; la fin du Pangyrique, Isocrate lui reproche encore ce contraste entre ces vastes promesses et les mesquines discussions. En fait, il voyait en lui un concurrent, et plusieurs titres de ses livres nous montrent que, dailleurs lve de Gorgias, il enseignait la rhtorique judiciaire, lart de rdiger les plaidoyers, et quil a eu avec Isocrate des polmiques dont tmoignent aussi les passages du rhteur qui viennent dtre indiqus.
p.271 1 2
DIOGNE LARCE, Vie des philosophes, VI, 13. ARISTOTE, Mtaphysique IV 29, 1024 b 32 et Topiques, I, 9, 104 b, 21 rapprocher de PLATON, Euthydme, 283 d, 285 d, et Cratyle, 429 a sq. ; ARISTOTE, Mtaphysique, VII, 3, 1043 b, 24 et PLATON Thtte, 201 d - 202 c. 3 DIOGNE LARCE, VI, 103.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
189
Un des sujets qui devait tenir une grande place dans lcole tait lexplication allgorique dHomre laquelle sont consacrs presque tous les ouvrages de deux des dix volumes en lesquels on t classes les uvres dAntisthnes 1 ; les aventures dUlysse en particulier sont lobjet de plusieurs livres ; lon sait que, dans la littrature allgorique postrieure, les errements dUlysse reprsentent les victoires de lme du sage sur les assauts du monde sensible. Peut-tre faut-il chercher dans Antisthnes lorigine de cette interprtation. En tout cas, il est, sinon le premier, au moins un des premiers, qui ait vu en Homre un moyen ddification ; dj Anaxagore avait affirm que les pomes dHomre taient relatifs la vertu et la justice ; et un passage de Xnophon dans le Banquet p.272 (3, 6) montre bien comment les allgoristes, au nombre desquels est mis Antisthnes, sopposaient aux simples rapsodes, rcitateurs dHomre, et voulaient utiliser pour lducation morale des pomes quil tait de tradition dapprendre par cur. On connat la protestation de Platon qui dans la Rpublique (378 d) trouve cet enseignement dangereux parce que le jeune homme est incapable de distinguer dans le pome ce qui est allgorie de ce qui ne lest pas, et qui, dans lIon, a montr tout larbitraire et le peu de srieux des exgtes dHomre. Pourtant ces allgories morales, qui nous paraissent si enfantines, rpondent au trait le plus important du cynisme. La vertu est dans les actes , tel est le principe dAntisthnes, et elle na besoin ni de nombreux discours, ni de sciences . Mais un acte ne senseigne pas proprement parler ; cest par lexercice et lentranement que lon arrive agir (ascse). Est-ce dire que lducation intellectuelle ny a pas de place ? Nullement : la vertu la plus haute est, pour le cynique, une vertu dordre intellectuel, la prudence () ; elle est le plus sr des remparts ; et cest avec des raisonnements imprenables quil faut se btir ce rempart 2. Pourtant les mots raisonnement ou raison, quil emploie si souvent, ne semblent dsigner aucune suite de penses mthodiques et prouves, comme chez Platon ou Aristote ; de lui nous navons que des aphorismes qui suggrent plus quils nenseignent et font mditer plus quils ne prouvent. Le sage aimera ; car seul le sage sait qui il faut aimer. Si, comme il est probable, Xnophon, en son Banquet (4, 34-45), donne une ide de la manire dAntisthnes dans le discours sur la vraie richesse quil met en sa bouche, nous ny voyons que deux peintures antithtiques, dune part de la richesse apparente, celle de largent, avec tous les maux quelle entrane, dautre part de la richesse relle, celle de la sagesse, avec tous ses avantages. Lducation intellectuelle est donc plutt action massive et immdiate dun aphorisme, mditation sur un thme, que construction raisonne, cette mditation qui prpare laction et contraste si fort avec la pure contemplation du vrai. Mais dans ces mditations, la plus importante est celle des exemples
p.273 1 2
DIOGNE LARCE, VI, 15-18. DIOGNE LARCE, VI, 10-73.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
190
qui nous sont offerts par les hros de la sagesse. Il y avait l une mthode populaire et directe denseignement, propre frapper les esprits imprgns des exploits dHercule ou de Thse ; elle est en effet dun emploi gnral ; dans la lettre, dailleurs mdiocre, de conseils un jeune homme quest le Discours Demonikos, attribu Isocrate, lauteur, qui se donne pour un matre de philosophie, lemploie constamment ; aprs avoir brivement numr les avantages de la vertu, par exemple, il dit : Il est facile de saisir tout cela daprs les travaux dHercule ou les exploits de Thse , ou encore : En te souvenant des actes de ton pre, tu auras un bel exemple de ce que je dis. On comprend quel rle avait lallgorie dHomre, et ce que devaient tre ces ouvrages dAntisthnes dont nous avons les titres, sur Hlne et Pnlope, le Cyclope et Ulysse, Circ, Ulysse et Pnlope et le Chien, o il montrait les hros victorieux dans les tentations 1. Mais le hros cynique par excellence, cest Hercule ; sur lui, Antisthnes crit trois livres. La vie du cynique est une vritable imitation dHercule, le fils aim de Zeus qui la rendu immortel cause de ses vertus ; elle deviendra plus tard une imitation de Diogne. Le cynique veut toujours jouer un rle. se poser comme modle ou faire connatre des modles : limage fameuse du monde considr comme un thtre o chaque homme est acteur dun drame divin, image qui aura une telle place dans la littrature morale populaire, vient peut-tre de lArchelaos dAntisthnes 2. Hercule est le type de la volont indfectible et de la complte libert. Lempereur Julien se demande, dans le discours VII, si le cynisme est une doctrine philosophique ou un genre de vie. Le cynique, en effet, ds lpoque dAntisthnes, a le vtement et la tenue ordinaire des hommes du peuple, manteau (quil replie sur lui-mme pendant lhiver), barbe et cheveux longs, bton la main et besace au dos ; mais, ce vtement et cette tenue, il les garde lorsque, sous linfluence macdonienne, la mode a chang, peu prs comme nos congrgations religieuses ont gard lhabit usuel lpoque de leur fondation ; nul ne peut ds lors ignorer ce passant excentrique avec la vture qui le distingue ; dautant que, pour montrer tous son endurance, il reste nu sous la pluie, marche lhiver les pieds dans la neige, reste lt en plein soleil 3. Ce sage, avec son franc parler qui ne mnage ni les riches ni les rois et quun Aristote aurait sans doute appel effronterie ou grossiret 4, na rien qui le lie aucun groupe social. Plus mal trait que les mendiants de profession, sans cit, sans maison, sans patrie, mendiant errant la recherche de son pain quotidien (comme dit de lui-mme Diogne citant un tragique), il vit dans les lieux publics, sabrite dans les temples et sinvite chez tous. Ainsi seulement il peut remplir sa mission, celle de messager de Zeus,
p.274 1 2
DIOGNE LARCE, VI, 18. DMMLER, Akademika, p. 1-18. 3 DIOGNE LARCE, VI, 13, 23, 41. 4 thique Nicomaque, VI, 6.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
191
charg dobserver les vices et les erreurs des hommes. Cest cette mission que doit faire allusion le titre dAntisthnes Sur lObservateur ; cest elle quaffirme Diogne, disant Philippe quil est lobservateur de ses dsirs insatiables ; cest elle enfin dont le cynique Mndme, contemporain du Philadelphe (285-247), donne tous le spectacle, en se costumant en Erinnye, et en se donnant pour un observateur venu de lHads pour annoncer aux dmons les pchs des hommes 1. Cest sur le clbre Diogne de Sinope (413-327) que la lgende a accumul tous les traits de cette vie cynique. De cette masse p.275 de chries, de bons mots, dapophtegmes recueillis surtout par Diogne Larce et Dion de Pruse, et si connus, de tous, peut-on dgager lauthentique physionomie de Diogne 2 ? On a remarqu avec raison que tous ces documents ne sont pas daccord entre eux et nous donnent, inextricablement mls, deux portraits de Diogne. Il y a le Diogne licencieux, sans frein, dbauch, raillant lasctisme de Platon ; il ressemble tellement aux hdonistes les plus relchs quon lui attribue les bons mots dAristippe ; il est si irrligieux quon lui prte les plaisanteries de Thodore lathe 3. Il y a dautre part, un Diogne plus svre, la volont tendue, lascte qui, vieillard, rpond ceux qui lui conseillent le repos : Et si jtais coureur, au long stade, irais-je me reposer la fin de ma course, naugmenterais-je pas au contraire mon effort ? , le matre qui, comme les directeurs de chants, accentue le ton que les lves doivent prendre, le hros du travail et de leffort (). De ces deux portraits, il semble bien que le second est le vritable Diogne 4. Les plus anciens cyniques, dont le matre Antisthnes proclamait qu il aimerait mieux tre fou que ressentir du plaisir , ne peuvent pas se rapprocher ce point dAristippe. Tout au contraire, nous verrons au chapitre suivant que, chez les cyniques du IIIe sicle, il sopre une sorte de glissement vers lhdonisme ; ce moment nat le cynisme hdoniste, cette sorte de sans-gne brutal, qui, dans lusage actuel et habituel du mot, est le cynisme tout court. Cest peut-tre cet esprit nouveau quest due lintroduction dune masse nouvelle danecdotes dans la vie de Diogne. Le cynisme de Diogne parat donc avoir t une pratique plus quune doctrine ; autant il sloigne des sciences, autant il affecte de rapprocher sa philosophie des arts serviles et manuels. La preuve que la vertu nest pas un don inn ni acquis p.276 par la science, mais quelle est le rsultat dun exercice (), cest que lon voit, dans les arts serviles et les autres, les artisans acqurir par lexercice un savoir-faire peu ordinaire 5 ; tels les athltes et les
1
DIOGNE LARCE, VI, 38, 17, 43, 102 ; EPICTTE, Dissertations, III, 22, 38 ; cf. larticle de Norden, Neue Jahrbcher, 1893. 2 Cf. L. FRANOIS, Essai sur Dion Chrysostome, 1922, p. 119-140 ; Deux Diogniques, Paris, 1922. 3 DIOGNE LARCE, IV, 25-42. 4 DIOGNE LARCE, VI, 34-35. 5 Id., VI, 70.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
192
joueurs de flte. Rien dans la vie ne russit sans lexercice ; avec lui, on peut surmonter toutes choses. Il sagit dailleurs autant de lexercice corporel qui nous donne la vigueur que de la mditation intrieure ; lun complte lautre. Une sorte de confiance entire dans leffort, une confiance fonde sur lexprience forme bien le centre du cynisme de Diogne, condition toutefois que lon entende non pas un effort quelconque, mais un effort raisonn : ce nest pas leffort en lui-mme qui est bon ; il y a des peines inutiles ; et luvre de la philosophie consiste choisir les efforts conformes la nature pour tre heureux ; cest donc par manque de sens quon est malheureux . Do le rle primordial qui reste la raison ; il reste dans le cynisme beaucoup dintellectualisme, puisque lintelligence donne seule le sens du travail faire. Sans ce trait, on ne sexpliquerait pas pourquoi les cyniques pourchassent tellement les prjugs et les opinions fausses ; toute opinion est une fume, , fait dire le comique Mnandre (342-290) au cynique Monimos 1. Dnoncer partout la convention, lui opposer la nature, tel est un des fruits de lenseignement de Diogne. Selon une tradition qui remonte Diocls, Diogne tait le fils dun banquier de Sinope, qui avait t exil de son pays pour avoir fabriqu de la fausse monnaie ; Diogne se vantait den avoir t complice comme si le crime de son pre avait prfigur sa propre mission ; et jouant sur les mots, il voyait dans lacte de fausser la monnaie () le mpris de toutes les valeurs conventionnelles () 2. Il ne sagit point dailleurs du tout, en abolissant les prjugs sociaux, de rformer la socit ; si, par exemple, les cyniques p.277 admettent, comme Platon, la communaut des femmes, ce nest point, comme lui, pour resserrer le lien social, mais pour le relcher et laisser au sage plus de libert. Leur but est si peu la rforme de la socit quils profitent sans vergogne de tous les avantages des riches cits bties par lorgueil ; Diogne disait par raillerie que le portique de Zeus a t bti pour quil y habite. Il sagit donc bien, dans cette mancipation des prjugs, dune rforme intrieure et individuelle. La cit que rvent les cyniques nexclut pas, mais au contraire suppose la cit relle. Cest ce que dit Crats (vers 328), le disciple de Diogne et le matre du stocien Znon, dans un pome qui nous a t conserv : Cest au milieu de la rouge fume de lorgueil quest btie la Besace, la cit du cynique, o aucun parasite naborde, qui ne produit que du thym, des figues et du pain, pour la possession desquels les hommes ne prennent pas les armes les uns contre les autres 3. Dans un esprit diamtralement oppos celui de Platon et mme dAristote, le cynique spare la vie morale du problme social, en mme temps quil rejette les sciences exactes en dehors de la mditation
1 2
Daprs DIOGNE LARCE, VI, 83. DIOGNE LARCE, VI, 20. 3 DIOGNE LARCE, VI, 85.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
193
intellectuelle du sage. Comme il nest pas dhomme plus dnu desprit scientifique, il nen est pas qui soit plus dnu desprit civique. Il ne partage pas la fiert quun Platon ou un Isocrate ont dtre Hellnes et descendants de ces Athniens qui ont repouss lenvahisseur perse ; Antisthnes parat bien avoir dit que la victoire des Grecs sur les Perses ne fut quune affaire de chance. Pourtant, si le cynique se proclame citoyen du monde, si sa politique suit les lois de la vertu plus que celles de la cit , il a une prdilection pour des formes politiques incompatibles avec la cit grecque, tel que lempire perse ou lempire dAlexandre ; trois ouvrages dAntisthnes portent le titre de Cyrus et ont peut-tre inspir cette magnification du Cyrus p.278 type du roi, que lon voit dans la Cyropdie de Xnophon ; et cest une tradition qui se continua chez les cyniques, puisquun disciple de Diogne, Onsicrite, crivit un Alexandre, calqu, nous dit-on, sur la Cyropdie.
IV. ARISTIPPE ET LES CYRNAIQUES
@ Mme dcri des sciences exactes, mme indiffrence. pour lorganisation sociale chez Aristippe de Cyrne et ses disciples ; ils sont cet gard sur la mme ligne (divergente de Platon) que les mgariques et les cyniques. A quoi bon soccuper des sciences mathmatiques ? Ne sont-elles pas infrieures aux arts les plus bas, puisquelles ne soccupent ni des biens ni des maux 1 ? Quant au rle social que le philosophe se rserve, il est, en un sens, diamtralement oppos celui des cyniques, bien quil aboutisse pratiquement la mme indiffrence. En effet (si du moins les paroles que Xnophon met dans sa bouche ne dfigurent pas trop sa pense) 2, Aristippe, prenant le contre-pied des cyniques, dit qu il ne se met pas au rang de ceux qui veulent commander . Seul un insens simposera toutes les peines et toutes les dpenses que doivent assumer ces magistrats dont les cits se servent comme un particulier de ses esclaves . Pour lui, il ne songe qu mener une vie facile et agrable. Aristippe est un contemporain de Platon, attir Athnes par le dsir de suivre lenseignement de Socrate, puis, comme Platon, hte du tyran Denys de Syracuse, qui, daprs les lgendes hostiles rpandues sur son compte, lui aurait fait subir les pires avanies, que son dsir de luxe et de vie lgante lui faisait accepter sans rcriminer. Il est bien difficile de retrouver sa doctrine. Comme documents nous avons, chez Diogne Larce (II, 86-13), une liste de titres douvrages dont beaucoup taient p.279 contests ds lantiquit, une doxographie attribue aux cyrnaques en gnral et qui parat insister surtout
1 2
Daprs ARISTOTE, Mtaphysique, B, 2, 996 a 32 ; M 2, 1078 a 33. Mmorables, II, 1, 8.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
194
sur les points par o lhdonisme cyrnaque se distingue de celui dpicure, enfin un expos de la thorie de la connaissance des Cyrnaques chez le sceptique Sextus Empiricus 1, qui emploie beaucoup des termes techniques propres au stocisme. On a voulu enrichir ce fond par quelques textes de Platon et dAristote, o lon croit voir des allusions Aristippe. Ces textes peuvent se partager en deux catgories : ceux du Philbe, de lthique Nicomaque, de la Rpublique, o lhdonisme est expos ou critiqu, celui du Thtte, o Platon exposerait, sous le nom de Protagoras, la doctrine de la connaissance dAristippe. Les premiers de ces textes concernant lhdonisme posent une question fort obscure. Ils parlent dhdonistes, mais parlent-ils dAristippe ? Srement non pour lun deux. Au chapitre II du Xe livre de lthique Nicomaque, Aristote nomme lhdoniste dont il parle : cest Eudoxe de Cnide (mort en 355), le fameux astronome qui avait frquent lcole de Platon 2. Eudoxe tait-il, proprement parler, un hdoniste ? Homme connu pour son austrit et sa rserve, nous dit Aristote, ce nest point par got du plaisir mais pour rendre tmoignage la vrit quil constate que tout tre recherche le plaisir et fuit la douleur, que le plaisir est dsir pour lui-mme, et enfin que, ajout une chose dj bonne, il en augmente la valeur ; or ce sont l les caractres admis par tous comme tant ceux du Bien et du souverain Bien. Il est intressant de voir que, aprs avoir cit ces arguments dEudoxe en faveur de la thse que le plaisir est le souverain bien, Aristote tudie et critique largumentation du Philbe qui rpond peu prs point par point celle dEudoxe ; il est clair daprs cela que lhdoniste que viserait Platon dans le Philbe pourrait tre Eudoxe et non Aristippe. fait remarquer pourtant que lune des thses que Platon met dans la bouche des amis du plaisir, savoir cette thse que le plaisir est en mouvement, thse qui est absente de lexpos dEudoxe, se trouve attribue Aristippe dans lnumration que Diogne Larce fait de ses opinions. Mais on a fait valoir rcemment, et avec grande raison, que cest tort que lon croit que Platon attribue aux partisans du plaisir cette thse que le plaisir est en mouvement ; en fait, il ne dit rien de pareil, et il nutilise la thse que pour dmontrer que, sil en est ainsi, le plaisir ne peut tre la fin des biens. Et Aristote, dans lthique, reproduisant la thse, la considre uniquement titre dobjection contre les hdonistes et pas du tout comme une de leurs affirmations. A vrai dire, la polmique entre partisans et adversaires du plaisir, telle quelle est prsente dans ce chapitre de lthique, cette mme polmique, qui avait donn occasion Platon dcrire le Philbe, apparat comme une polmique dcole, intrieure lAcadmie, entre Speusippe, qui soutenait que le plaisir est toujours un mal, et Eudoxe, qui pensait quil est toujours un bien. Le caractre un peu artificiel de chacune de ces deux thses
1 2 p.280 Lon
Contre les Mathmaticiens, VII, 190-200. Cf. DIOGNE LARCE, VIII, 36.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
195
(Speusippe soutenant la sienne moins parce quil la croit vraie que pour dtourner les hommes du plaisir) montre quil sagit peut-tre dune discussion dcole. Ces textes, pas plus que celui de la Rpublique (505 b) qui attribue lhdonisme au vulgaire, ne paraissent donc pas viser Aristippe ni pouvoir tendre la connaissance que nous avons de lui ; ils nous montrent en revanche que la question de la valeur du plaisir tait au IVe sicle vivement discute partout. Largumentation dEudoxe (tous cherchent le plaisir, fuient la douleur et sarrtent au plaisir comme une fin) est dailleurs une argumentation fort banale quAristippe a employe aussi pour prouver que le plaisir tait la fin des biens 1. Il p.281 ne peut en tre autrement, si, pour dterminer la fin, on ne fait que constater une vidence. Toute loriginalit du cyrnasme parat tre dans leffort pour sen tenir cette vidence primaire en ny superposant aucune vue rationnelle, et bon nombre des opinions de sa doxographie est destin rpondre aux objections de gens habitus construire rationnellement leur idal de vie plutt qu se fier leurs impressions ou apprciations immdiates. Il est certain par exemple que le caractre fugace et mobile du plaisir ne saccorde nullement avec le bonheur stable et indfectible que rve le sage ; cest pourquoi nous verrons plus tard picure, pour garder le plaisir comme fin, mieux aimer transformer et adultrer la notion du plaisir que de renoncer la stabilit de la sagesse ; il recherchera un plaisir calme et stable, consistant dans labsence de douleur et non pas le plaisir en mouvement des Cyrnaques, si glissant. A quoi Aristippe (ou plutt ses successeurs) rpondaient que ce prtendu plaisir ntait pas diffrent de ltat de sommeil, mais que, dailleurs, le sage ne sinquitait nullement de ce bonheur stable et continu, et que sa fin tait le plaisir du moment ; le bonheur ntait quun rsultat fait de la runion de tous les plaisirs, mais nullement une fin. Cest encore une objection du mme genre que celle qui consiste dire que les plaisirs causs par les actes rprhensibles sont eux-mmes rprhensibles ; cest faire intervenir dans lapprciation du plaisir une reprsentation intellectuelle qui ny a que faire ; le plaisir comme tel, mme en ce cas, pour Aristippe, est un bien. Nous verrons un peu plus loin comment picure a cru pouvoir, en conservant le plaisir comme fin, rendre lhomme matre de son bonheur. Il suffisait que le seul plaisir qui existt ft le plaisir du corps, le plaisir de lesprit ntant que le souvenir ou la prvision de pareils plaisirs ; comme lhomme est matre de diriger son souvenir et sa pense, il peut accumuler les plaisirs. Cest l une construction sans valeur pour le cyrnaque : p.282 dabord lesprit a ses plaisirs et ses peines part, qui nont rien voir avec ceux du corps, par exemple le plaisir de sauver la patrie ; ensuite le temps efface vite le
1
DIOGNE LARCE, II, 86.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
196
souvenir dun plaisir corporel ; enfin les plaisirs du corps surpassent toujours en fait ces plaisirs de lesprit, comme les douleurs corporelles sont bien plus pnibles que les douleurs morales. Dans ces conditions, le cyrnasme ne peut du tout se proposer datteindre cette vie exempte de peine, toute vertueuse impassible, que le cynisme proposait son sage : en fait le sage reste expos la peine, et le mchant ressent parfois des plaisirs. Le sage nest pas non plus exempt de passions ; certes il na aucune des passions qui reposent sur une construction intellectuelle, sur une vaine opinion , mais il ressent fatalement tout ce qui est impression immdiate et certaine ; il est donc sujet la peine et aussi la crainte qui est lapprhension justifie de la peine. Jamais on nest all plus loin pour carter tout ce qui pouvait tre critre du bien et du mal, en dehors du plaisir ou de la peine immdiatement sentis comme mouvement facile ou mouvement rude . Sil y reste encore un peu de raison, cest que, bien que tout plaisir soit dsirable en lui-mme, les agents de certains plaisirs sont souvent pnibles ; aussi la runion des plaisirs qui forment le bonheur est-elle fort difficile . Ainsi, bon gr mal gr, le cyrnaque est amen poser le problme de la combinaison des plaisirs, mais, ds ce moment, la doctrine risque dtre atteinte au cur ; cest ce que nous verrons, dans un prochain chapitre, chez les successeurs dAristippe au IIIe sicle. Sextus Empiricus remarque quil y a parfaite correspondance entre la doctrine morale dAristippe et sa thorie de la connaissance ; la connaissance, comme la conduite, ne trouve de certitude et dappui que dans limpression immdiate laquelle elle doit se tenir pour rester sre ; que nous prouvions limpression de blanc ou de doux, voil ce que nous p.283 pouvons dire sans mentir avec vrit et certitude ; mais que la cause de cette impression est blanche ou douce, voila ce quon ne peut affirmer. Limpression ne doit tre le point de dpart daucune conclusion, la base daucune superstructure intellectuelle. Non seulement la connaissance ne nous fait atteindre aucune ralit en dehors de limpression, mais elle ne permet mme pas un accord entre les hommes, puisquelle est strictement personnelle et que je nai pas le droit de conclure de mon impression celle du voisin ; le langage seul est commun ; mais le mme mot dsigne des impressions diffrentes. Mgarisme, cynisme et cyrnasme forment la contrepartie du platonisme et de laristotlisme ; ils se refusent voir lintrt humain de la culture intellectuelle, et mme de toute civilisation ; ils cherchent lhomme un appui en lui-mme, et en lui seul.
Bibliographie
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
197
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
198
CHAPITRE II LANCIEN STOCISME
@ On appelle ge hellnistique lpoque pendant laquelle la culture grecque est devenue le bien commun de tous les pays mditerranens ; depuis la mort dAlexandre jusqu la conqute romaine, on la voit peu peu simposer, de lgypte et de la Syrie jusqu Rome et lEspagne, dans les milieux juifs clairs comme dans la noblesse romaine. La langue grecque, sous la forme de la ou dialecte commun, est lorgane de cette culture.
p.284
A certains gards, cette priode est une des plus importantes qui soient dans lhistoire de notre civilisation occidentale. De mme que les influences grecques se font sentir jusquen Extrme-Orient, nous voyons inversement, partir des expditions dAlexandre, lOccident grec ouvert aux influences de lOrient et de lExtrme-Orient. Nous y suivons, dans sa maturit et dans son clatant dclin, une philosophie qui, loin des proccupations politiques, aspire dcouvrir les rgles universelles de la conduite humaine et diriger les consciences. Nous assistons, pendant ce dclin, la monte graduelle des religions orientales et du christianisme : puis cest, avec la rue des Barbares, la dislocation de lempire et le long recueillement silencieux qui prpare la culture moderne.
I. LES STOCIENS ET LHELLLNISME
@ Un magnifique lan idaliste qui pntre de pense philosophique la civilisation tout entire, mais qui bientt sarrte p.285 et meurt en dogmes cristalliss, un retour de lhomme sur soi qui renie la culture pour ne chercher appui quen lui-mme, dans sa volont tendue par leffort ou dans la jouissance immdiate de ses impressions, tel est le bilan du IVe sicle, du grand sicle philosophique dAthnes. A partir de ce moment, les sciences expulses de la philosophie vont continuer leur vie autonome, et le IIIe sicle est le sicle dEuclide (330-270), dArchimde (287-212) et dApollonius (260-240), un grand sicle pour les mathmatiques et lastronomie, tandis quau Muse dAlexandrie, dont le bibliothcaire est le gographe ratosthne (275-194), les sciences dobservation et la critique philologique se dveloppent de pair. Quant la philosophie, elle prend une forme tout fait nouvelle et elle ne continue proprement parler dans aucune des directions que nous avons
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
199
dcrites jusquici : les grands dogmatismes que nous voyons natre alors, stocisme et picurisme, ne ressemblent rien de ce qui les a prcds ; si nombreux que puissent tre les points de contact, lesprit est entirement nouveau. Deux traits le caractrisent : le premier cest la croyance quil est impossible lhomme de trouver des rgles de conduite ou datteindre le bonheur sans sappuyer sur une conception de lunivers dtermine par la raison ; les recherches sur la nature des choses nont pas leur but en elles-mmes, dans la satisfaction de la curiosit intellectuelle, elles commandent aussi la pratique. Le second trait, qui dailleurs aboutit plus ou moins, cest une tendance une discipline dcole ; le jeune philosophe na point chercher ce qui a t trouv avant lui ; la raison et le raisonnement ne servent qu consolider en lui les dogmes de lcole et leur donner une assurance inbranlable ; mais il ne sagit de rien moins dans ces coles que dune recherche libre, dsintresse et illimite du vrai ; il faut sassimiler une vrit dj trouve. Par le premier de ces traits, les nouveaux dogmatismes rompaient avec linculture des Socratiques et rintroduisaient p.286 dans la philosophie le souci de la connaissance raisonne ; par le second, ils rompaient avec lesprit platonicien ; ni amateurs de libre recherche comme le Platon socratique, ni autoritaires et inquisiteurs comme lauteur du Xe livre des Lois. Rationalisme, si lon veut, mais rationalisme doctrinaire qui clt les questions, et non, comme chez Platon, rationalisme de mthode, qui les ouvre. Ces deux traits si nouveaux ne furent pas accepts sans rsistance, et nous verrons, au-dessous des grands dogmatismes, se continuer la tradition des Socratiques au IIIe sicle. Pour bien comprendre la porte et la valeur de ces deux traits, il convient de se demander quels taient les hommes qui introduisaient ces nouveauts et de quelle manire ils ont ragi aux circonstances historiques nouvelles cres par lhgmonie macdonienne. Athnes reste le centre de la philosophie ; mais, parmi les nouveaux philosophes, aucun nest un Athnien, ni mme un Grec continental ; tous les Stociens connus de nous, au IIIe sicle, sont des mtques venus de pays qui sont en bordure de lhellnisme, placs en dehors de la grande tradition civique et panhellnique, subissant bien dautres influences que les influences hellniques, et, particulirement celles des peuples tout voisins de race smite. Une cit de Chypre, Cittium, a donn naissance Znon, le fondateur du stocisme, et son disciple Perse ; le second fondateur de lcole, Chrysippe, est n en Cilicie, Tarse ou Soles, et trois de ses disciples, Znon, Antipater et Archdme, sont aussi de Tarse ; de pays proprement smites viennent Hrillus de Carthage, disciple de Znon, et Bothus de Sidon, disciple de Chrysippe : ceux qui sont issus des contres les plus proches sont Clanthe dAssos (sur la cte olienne), et deux autres disciples de Znon, Sphaerus du Bosphore et Denys dHracle, en Bithynie sur le Pont-Euxin ; dans la
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
200
gnration qui a suivi Chrysippe, Diogne de Babylone et Apollodore de Sleucie viennent de la lointaine Chalde. plupart de ces villes navaient pas derrire elles, comme les cits de la Grce continentale, de longues traditions dindpendance nationale ; et, cause des besoins du commerce, leurs habitants taient disposs voyager jusquaux pays les plus lointains ; le pre de Znon de Cittium tait, dit-on, un commerant chypriote qui, venant Athnes pour ses affaires, en rapportait des livres des Socratiques dont la lecture donna son fils le dsir daller entendre ces matres 1. Mais ces demi-barbares restaient bien indiffrents la politique locale des cits grecques. Cest ce que prouve clairement lattitude politique des protagonistes de lcole pendant le sicle qui scoula depuis la mort dAlexandre (323) jusqu lintervention des Romains dans les affaires grecques vers 205. On sait les grands traits de lhistoire politique de la Grce cette poque ; elle est un champ clos o saffrontent les successeurs dAlexandre, particulirement les rois de Macdoine et les Ptolmes. Les villes ou les ligues de villes ne savent que sappuyer sur une des deux puissances pour viter dtre domines par lautre. La constitution des cits change au gr des matres du jour qui, selon les cas, sappuient sur les partis oligarchique ou dmocratique. Athnes en particulier ne fait que subir passivement les rsultats dune conflagration qui stend dans tout lOrient. Aprs une vaine tentative pour recouvrer son indpendance, elle se livre, par la paix de Dmade (322), au Macdonien Antipater qui y tablit le gouvernement aristocratique et se rend matre de toute la Grce. Un moment le rgent de Macdoine qui lui succde, Polysperchon, y rtablit la dmocratie pour sassurer son alliance (319) ; mais Cassandre, le fils dAntipater, chasse Polysperchon, rtablit le gouvernement aristocratique Athnes sous la prsidence de Dmtrius de Phalre, et se maintient en Grce malgr les efforts des autres diadoques, Antigone dAsie et Ptolme, qui p.288 sappuient contre lui sur la ligue des villes toliennes. En 307, nouveau changement. Dmtrius de Phalre est chass dAthnes par le fils dAntigone dAsie, Dmtrius Poliorcte, qui rend Athnes sa libert, enlve au Macdonien la Grce entire et se proclame le librateur de la Grce : les Athniens abandonns par lui sont assez forts pour arrter, avec le concours de la ligue tolienne, Cassandre de Macdoine qui franchit les Thermopyles en 300 et se fait battre late. Quelques annes aprs la mort de Cassandre, Dmtrius Poliorcte prend, en 295, le trne de Macdoine que garderont ses descendants. A partir de ce moment, linfluence macdonienne est Athnes presque sans contrepoids ; en 263 seulement, sous le rgne dAntigone Gonatas, fils de Dmtrius, Ptolme vergte se dclare le protecteur dAthnes et du Ploponse, et Athnes, soutenue par lui et par Lacdmone,
1 p.287 La
DIOGNE LARCE, Vies des philosophes, VII, 31.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
201
fait un dernier et vain effort pour recouvrer son indpendance (guerre de Chrmonide). A partir de ce moment, elle reste comme indiffrente aux vnements : pourtant la rsistance aux Macdoniens est encore trs vive dans le Ploponse, o la Macdoine cherche appuyer son influence sur les tyranneaux des villes ; on sait comment, vers 251, Aratus de Sicyone tablit la dmocratie dans sa patrie, puis, prenant la prsidence de la ligne achenne, chasse les Macdoniens de presque tout le Ploponse et reprend Corinthe. Mais, malgr ses efforts, et bien quil essaye mme de corrompre par largent le gouverneur macdonien de lAttique, il ne peut faire entrer les Athniens dans lalliance, et il sappuie sur Ptolme. On sait la triste fin de ce dernier effort de la Grce vers lindpendance ; Aratus trouve devant lui un ennemi grec, Clomne, roi de Sparte, qui, rnovateur de la vieille constitution spartiate, veut reprendre lhgmonie dans le Ploponse ; contre cet ennemi, Aratus fait appel lalliance des rois de Macdoine, qui, depuis la mort du Poliorcte, taient les ennemis traditionnels des liberts grecques ; Antigone Doson et son successeur Philippe V laident en effet p.289 battre Clomne (221), mais reprennent pied en Grce jusqu Corinthe. Aratus est victime de son protecteur qui le fait empoisonner ainsi que deux orateurs athniens qui plaisaient trop au peuple. Ce sont les Romains qui, en 200, dlivreront Athnes du joug macdonien, mais non point pour la rendre indpendante. Tel est le cadre o se droule lhistoire de lancien stocisme avec ses trois grands scholarques, Znon de Cittium (322-264), Clanthe (264-232) et Chrysippe (232-204). Ce bref rappel tait ncessaire pour bien comprendre leur attitude politique. Cette attitude est nette : entre les villes grecques, qui font un dernier effort pour conserver leurs liberts, et les diadoques qui fondent des tats tendus, ils nhsitent pas ; toute leur sympathie va aux diadoques et particulirement aux rois de Macdoine ; ils continuent la tradition des cyniques admirateurs dAlexandre et de Cyrus. Znon et Clanthe nont jamais demand pour eux le droit de cit athnien, et Znon, nous dit-on, tenait son titre de Cittien 1. Les rois leur prodiguent avances et flatteries ; il semble quils sentent quil y a en ces coles une force morale quon ne peut ngliger. Antigone Gonatas notamment est un grand admirateur de Znon ; il coute ses leons lorsquil va Athnes, ainsi que plus tard celles de Clanthe, et il leur envoie lun et lautre des subsides ; la mort de Znon, cest lui qui prend linitiative de demander la ville dAthnes dlever un tombeau au Cramique en son honneur. Ctait un personnage assez important pour que Ptolme nenvoyt pas dambassadeurs Athnes sans quils lui rendissent visite 2. Antigone aimait sentourer de philosophes ; il avait sa cour Aratus de Sole, auteur dun pome des Phnomnes o se trouve expose lastronomie dEudoxe ; il voulut y faire venir Znon luimme, titre de conseiller et de directeur de conscience ; celui-ci, trop g, refusa, mais il lui envoya deux de ses disciples, p.290 Philonide de Thbes et
1 2
PLUTARQUE, Les Contradictions des Stociens, ch. IV (Arnim, I, n 26). DIOGNE LARCE, Vies des philosophes, VII, 169, 15-24.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
202
Perse, un jeune homme de Cittium qui avait t son serviteur et dont il avait fait lducation philosophique ; Perse devint un homme de cour, dont linfluence tait assez grande pour quil ret lui-mme les flatteries du Stocien Ariston, si lon en croit le pome satirique de Timon. Bien des annes aprs, en 243, nous le trouvons chef de la garnison macdonienne de lAcrocorinthe, au moment o la citadelle est assige par Aratus de Sicyone ; cest, semble-t-il, dans ce sige quil trouva la mort, en dfenseur de la cause macdonienne contre les liberts de la Grce. Nous le voyons intervenir dans les ngociations quun autre philosophe, Mndme dErtrie, un Mgarique celui-l, qui avait un rle politique important en sa ville natale, menait avec Antigone pour dlivrer Ertrie des tyrans et y tablir la dmocratie : or Perse ne fait, semble-t-il, que servir la politique macdonienne, partout appuye sur les tyrans, lorsquil veut empcher Antigone de satisfaire aux demandes de Mndme 1. Comme Znon envoie Perse Antigone, Clanthe envoie Sphaerus Ptolme Evergte. Ce Sphaerus tait le matre stocien qui avait enseign la philosophie Sparte et y avait eu, entre autres lves, Clomne 2. Clomne, qui rtablit Sparte la constitution de Lycurgue, sest peut-tre en ses rformes politiques inspir du stocisme ; mais, vrai dire, il navait, pas plus quaucun Spartiate, cet esprit hellnique qui animait son ennemi, le chef de la ligue achenne, Aratus de Sicyone. Lunivers politique des Stociens est donc bien diffrent de celui dun Platon. Sils tiennent dans la cit dAthnes une place considrable, ce nest plus titre de conseillers politiques ; Diogne Larce (VII, 10) nous a conserv, en les mlangeant, les deux dcrets par lesquels le peuple athnien accordait p.291 Znon une couronne dor et un tombeau au Cramique ; or il y est dit : Znon de Cittium, fils de Mnasas, a enseign la philosophie pendant beaucoup dannes dans notre ville ; ctait un homme de bien ; il invitait la vertu et la temprance les jeunes hommes qui le frquentaient, il les engageait dans la bonne voie, et il offrait en exemple tous sa propre vie, qui tait conforme aux thories quil exposait. Avec la plus grande admiration pour ses qualits morales, il ny a pas trace de son rle politique.
II. COMMENT NOUS CONNAISSONS LANCIEN STOCISME
@ De lenseignement de Znon et de Chrysippe, nous navons quune connaissance indirecte ; des nombreux traits de Znon, des sept cent cinq
1
Index Stocorum herculanensis, col. XIII (Arnim, I, n 441) ; ATHNE, Deipnosophiste, VI, 251 b (Arnim, I, n 342) ; PAUSANIAS, Description de la Grce, II, 8,4 ; DIOGNE LARCE, VII, 143. 2 PLUTARQUE, Vie de Clomne, chap. II.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
203
traits de Chrysippe, il ne reste quune partie des titres conservs par Diogne Larce et dinfimes fragments. Les seuls ouvrages stociens que nous possdions, ceux de Snque, dpictte et de Marc-Aurle datent de lpoque impriale, quatre sicles aprs la fondation du stocisme. Cest en recherchant les traces que lancien stocisme a laisses soit chez eux, soit chez dautres crivains que lon peut reconstituer cet enseignement ; et fort difficilement, car nos principales sources sont dpoque fort postrieure ; ce sont des clectiques comme Cicron, dont les crits philosophiques datent du milieu du Ier sicle avant notre re, et comme Philon dAlexandrie (dbut de notre re) ; ou des adversaires comme Plutarque qui, la fin du Ier sicle, crit ses ouvrages Contre les Stociens et Des Contradictions des Stociens, le sceptique Sextus Empiricus, de la fin du IIe sicle de notre re, le mdecin Galien, qui, la mme poque, crit contre Chrysippe, enfin les pres de lglise, et en particulier Origne, au IIIe sicle. Dans tous ces exposs, tronqus ou malveillants, cest tout au plus si lon doit mettre part une source de premire valeur, p.292 le rsum de la logique stocienne, que Diogne Larce, en son livre VII ( 49-83), a tir de lAbrg des philosophes de Diocls Magns, un cynique ami de Mlagre de Gadara, qui vivait au dbut du Ier sicle avant notre re. Sauf nette exception, toute cette littrature est ne des conflits qui existrent partir du IIe sicle entre le dogmatisme stocien et lAcadmie ou les sceptiques ; cest ainsi, par exemple, que notre principale source sur la doctrine stocienne de la connaissance est dans les Acadmiques de Cicron, crits tout exprs pour la combattre. Cet esprit polmique est dfavorable un compte rendu exact, et Plutarque, notamment, fausse plusieurs fois la pense des Stociens pour mieux les mettre en contradiction avec eux-mmes. De plus, ces crits sont de date tardive, et moins que les auteurs des doctrines ne soient dsigns par leurs noms, il est souvent difficile de faire un dpart entre les opinions des anciens Stociens, ceux du IIIe sicle, et les opinions du moyen stocisme au IIe et au Ier sicle ; dailleurs, mme dans le cours de lancien stocisme, il y a bien des divergences de dtail, malgr laccord en gros. Il ne faut donc pas se dissimuler le caractre quelque peu artificiel dun expos densemble du stocisme, construit avec des donnes aussi pauvres ; partant de la doctrine de Znon, nous indiquons loccasion ce que ses successeurs Clanthe ou Chrysippe en ont modifi ou abandonn.
III. LES ORIGINES DU STOCISME
@ Znon de Cittium fut lve de Crats le cynique, de Stilpon le Mgarique, de Xnocrate et de Polmon, les scholarques de lAcadmie ; il fut en relation frquente avec Diodore Cronos et son lve Philon le dialecticien. Voil dj des influences bien varies ; Znon se vantait en outre de lire les anciens , et sa doctrine est considre certains gards comme une rnovation de
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
204
lhraclitisme. Mais ces influences signales p.293 par les historiens anciens (en particulier Apollonius de Tyr, dans un livre Sur Znon) 1 laisse encore bien nigmatique lclosion du stocisme. Sans doute, il prit chez les Mgariques le got de cette dialectique sche et abstraite qui caractrise lenseignement de lancien stocisme ; en outre celui quil frquenta le plus, Stilpon, passe pour avoir eu le mme ddain de prjugs que les cyniques et avoir mis le souverain bien dans lme impassible 2. Lacadmicien Xnocrate, de son ct, exagrait ce point le rle de la vertu quelle lui paraissait tre la condition du bonheur 3 ; Polmon mettait en valeur, comme les cyniques, la supriorit de lascse sur lducation purement dialectique, et il dfinissait la vie parfaite une vie conforme la nature. Speusippe, dailleurs, ne stait-il pas lev contre le plaisir avec presque autant de violence quAntisthnes ? Ainsi tout ce mouvement rigoriste et naturaliste, gnral dans les coles lpoque dAlexandre, contribuait affirmer et renforcer linfluence du cynique Crats, modre cependant par les doctrines plus douces de lAcadmie. Mais il y a fort loin de ces influences gnrales la doctrine stocienne, qui ne se rduit pas une pdagogie morale, mais est une ample vision de lunivers qui va dominer la pense philosophique et religieuse pendant toute lantiquit et une partie des temps modernes ; il y a l comme un nouveau dpart et non la continuation dcoles socratiques qui se meurent. Devons-nous en chercher lorigine sur le sol grec ? Oui, semble-t-il, du moins en partie. La pense du IVe sicle nest en effet, puise ni par le conceptualisme dAristote et de Platon, ni par lenseignement des Socratiques ; elle est bien plus diverse. Les coles mdicales taient prospres, et elles soccupaient fort des questions gnrales de la nature de lme et de la structure de lunivers ; quon se rappelle les apparitions inattendues p.294 de la mdecine dans le Phdre (cf. ci-dessus, p. 74) et surtout dans le Time de Platon. Dans son livre Contre Julien, le mdecin Galien, une de nos meilleures sources sur lhistoire du stocisme, nous apprend que Znon, Chrysippe et les autres Stociens ont longuement crit sur les maladies, que, au reste, une cole mdicale, lcole mthodique , se rclamait de Znon, et enfin que les thories mdicales des Stociens taient celles mmes dAristote et de Platon. Il les rsume ainsi : il y a dans le corps vivant quatre qualits opposes deux deux ; le chaud et le froid, le sec et lhumide ; ces qualits ont pour support quatre humeurs, la bile et latrabile, le flegme acide et le flegme sal ; la sant est due un heureux mlange de ces quatre qualits, et la maladie (du moins la maladie de rgime) est due lexcs ou au dfaut dune de ces qualits, tandis que dautres maladies viennent dune rupture de continuit des parties
1 2
Connu par DIOGNE LARCE, VII, 2 ; ch. VII, 16. STOBE, Florilge, 108, 33. 3 CICRON, Tusculanes, V, 18, 51.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
205
du corps. Il arrive aussi que telles opinions physiques des Stociens (sur le sige de lme dans le cur, sur la digestion, sur la dure des grossesses) soient cites formellement par Philon dAlexandrie 1 comme des opinions empruntes par les physiciens aux mdecins. On peut prciser la porte de ces emprunts grce aux fragments qui restent de luvre de Diokls de Karystos, un mdecin du IVe sicle, cit par Aristote. Selon la doctrine physiologique que nous venons de voir attribuer aux Stociens, Diokls pensait que tous les phnomnes de la vie des animaux sont gouverns par le chaud et le froid, le sec et lhumide, et quil y a dans chaque corps vivant une chaleur inne qui, en altrant les aliments ingrs, produit les quatre humeurs, le sang, la bile et les deux flegmes, dont les proportions expliquent la sant et la maladie. Mais, dautre part, nous le voyons admettre que lair extrieur, attir vers le cur par le larynx, lsophage et les pores, devient, une fois dans le cur, le souffle psychique p.295 en qui rside lintelligence, qui, en se rpandant dans tout le corps, le tend et le soutient, de qui enfin les mouvements volontaires prennent leur origine. Les corps vivants, dit Diokls, sont ainsi composs de deux choses, ce qui porte et ce qui est port. Ce qui porte cest la puissance, ce qui est port cest le corps. Beaucoup de maladies sont dues lobstruction de cette puissance, identique au souffle et empche de circuler dans les vaisseaux, cause de laccumulation des humeurs. Ce sont l les thories mmes des Stociens sur ltre vivant. Mais lexplication est gnralise ; chez eux, tout corps, anim ou inanim, est conu la manire dun vivant ; il a en lui un souffle (pneuma) dont la tension retient les parties : les divers degrs de cette tension expliquent la duret du fer comme la solidit de la pierre. Lunivers dans son ensemble (comme dans le Time, si imprgn dides mdicales, est aussi un vivant dont lme, souffle ign rpandu travers toutes choses, retient les parties. Des ides mdicales, issues de la physique prsocratique et qui se systmatisent nouveau en une physique et une cosmologie, semblent donc tre lorigine de limage stocienne de lunivers. Ajoutons que les Stociens ne sont sans doute pas les premiers qui, cette poque, institurent, en partant de thories mdicales, une cosmologie vitaliste. Il existait encore, dans la seconde moiti du IVe sicle, des Pythagoriciens ; Aristoxne de Tarente, qui devint disciple dAristote et qui est connu pour avoir soutenu que lme tait lharmonie du corps, les avait frquents, et il nous a laiss les noms de quatre dentre eux 2. Or, Alexandre Polyhistor, un polygraphe du Ier sicle avant J.-C., nous a laiss un rsum dune cosmologie pythagoricienne, tir de Notes pythagoriciennes. Cette cosmologie est trs apparente, dans ses dtails, et avec les opinions des p.296 physiciens ioniens de la dernire priode (Alcmon, Diogne) et avec celles des mdecins du IVe sicle : thorie des deux couples
1 2
Allgories des lois, II, 6 ; Lois spciales, III, ch. II ; Questions sur la Gense, II, ch. XIV. DIOGNE LARCE, VIII, 46.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
206
de forces, chaud et froid, sec et humide, dont lingale distribution produit les diffrences de saisons dans le monde et les maladies dans le corps ; caractre divin de la chaleur, cause de vie, dont les rayons, mans du soleil, produisent la vie des choses ; me, fragment de lther chaud mlang au froid et immortelle comme ltre dont elle mane, nourrie des effluves du sang ; raison do manent les sensations ; autant de traits quil nest pas ncessaire dexpliquer, comme on la fait jusquici, par une influence tardive des Stociens sur des nopythagoriciens du IIe ou du Ier sicle, puisquils se retrouvent tous dans une poque antrieure au stocisme. Certains dailleurs, comme la triple division de lme en raison () intelligence () et cur () ont, par la premire expression dont elle se sert, une couleur trs archaque. Ce pythagorisme, imprgn dides physiques et mdicales, a donc prcd le stocisme. Remarquons dailleurs que la thorie de lme harmonie dAristoxne de Tarente, est en liaison troite avec les ides mdicales ; le caractre musical de la mtaphore disparat presque lorsque cette harmonie est compare la sant du corps et rside dans la part gale que les quatre lments ont la vie du corps 1 ; cest en revanche la thorie mdicale de la vie et la thorie cosmologique des Pythagoriciens dAlexandre Polyhistor. Ainsi se reconstituait le vitalisme mdical, qui diverge si fort du mcanisme mathmatique vers lequel tendait Platon ; et cest bien une tradition ionienne (visible dailleurs jusque dans le monde mathmatis de Platon, considr par le Time comme un tre vivant) que se rattache le monde anim des Stociens. Mais ces influences admises, le principal reste encore inexpliqu. Dans la place que les Stociens donnent Dieu, p.297 dans la manire dont ils conoivent le rapport de Dieu avec lhomme et avec lunivers, il y a des traits nouveaux que nous navons jamais rencontrs chez les Grecs. Le Dieu hellnique, celui du mythe populaire, tout autant que le Bien de Platon ou la Pense dAristote, est un tre qui a pour ainsi dire sa vie part et qui, dans son existence parfaite, ignore les agitations et les maux de lhumanit comme les vicissitudes du monde ; idal de lhomme et de lunivers, il nagit sur eux que par lattrait de sa beaut ; sa volont ny est pour rien, et Platon blme ceux qui croient que lon peut le flchir par des prires ; Platon avait, il est vrai, condamn aussi les vieilles croyances admettant un dieu jaloux de ses prrogatives ; mais la bont quil opposait cette jalousie est une perfection intellectuelle dont lordre du monde est comme le rayonnement, elle na rien dune bont morale. Sans doute aussi, ct de ces Olympiens, les Grecs connaissaient en Dionysos un dieu dont les morts et les renaissances priodiques donnaient un rythme la vie de ses fidles ; le fidle sassocie au drame divin ; prouvant et jouant en quelque sorte la passion du dieu, il sunit lui par lorgie mystique au point de ne plus faire quun avec lui ; dans le culte bachique non plus, le dieu ne descend donc pas jusqu lhomme mais le laisse monter jusqu lui.
LUCRECE, De la Nature des choses, II, 102-3 : 124-5.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
207
Mais le Dieu des Stociens nest ni un Olympien ni un Dionysos ; cest un Dieu qui vit en socit avec les hommes et avec les tres raisonnables et qui dispose toute chose dans lunivers en leur faveur ; sa puissance pntre toutes choses, et sa providence nchappe aucun dtail, si infime quil soit. On conoit dune manire toute nouvelle son rapport lhomme et son rapport lunivers ; il nest plus le solitaire tranger au monde, qui lattire par sa beaut ; il est louvrier mme du monde, dont il a conu le plan dans sa pense ; la vertu du sage nest ni cette assimilation Dieu que rvait Platon, ni cette simple vertu civique et politique que peignait Aristote ; elle est lacceptation de luvre divine et la collaboration p.298 cette uvre grce lintelligence quen prend le sage. Cest l lide smitique du Dieu tout-puissant gouvernant la destine des hommes et des choses, si diffrente de la conception hellnique. Znon le Phnicien va donner le ton lhellnisme. Sans doute ce nest pas une importation brusque dans la pense grecque ; le Dieu de Platon dans le Time est un dmiurge, celui des Lois soccupe de lhomme et dirige lunivers dans tous ses dtails ; et le Dieu du Socrate de Xnophon qui a donn aux hommes leurs sens, leurs inclinations et leur intelligence, les guide encore par les oracles et la divination. Ainsi le thme dmiurgique et providentialiste sannonait dj ; mais avec Znon, il devient la pice matresse de la philosophie. Nous verrons, dans la suite de cette histoire, ces deux conceptions, smite et hellnique, tantt tendre fusionner, tantt saffronter dans la pleine conscience de leur divergence ; et peut-tre trouverons-nous, sous les diverses formes que prend leur conflit jusqu lpoque contemporaine, une des oppositions les plus profondes de la nature humaine.
IV. LE RATIONALISME STOCIEN
@ A ce thme fondamental se subordonne le reste de la doctrine ; Znon est avant tout le prophte du Logos, et la philosophie nest que la conscience que lon prend que rien ne lui rsiste ou plutt que rien nexiste part lui ; cest la science des choses divines et humaines , cest--dire de tout ce quil y a dtres raisonnables, cest--dire de toutes choses, puisque la nature est elle-mme absorbe dans les choses divines. Sa tche est ds lors toute trace, et, quil sagisse de la logique et de la thorie de la connaissance ou de la morale, de physique ou de psychologie, elle consiste dans tous les cas liminer lirrationnel et ne plus voir agir, dans la nature comme dans la conduite, que la pure raison. Mais ce rationalisme du Logos p.299 ne doit pas faire illusion ; il nest en aucune manire le successeur du rationalisme de lintelligence ou intellectualisme de Socrate, Platon et Aristote ; cet intellectualisme avait toute sa ralit dans une mthode dialectique qui permettait de dpasser la donne sensible pour atteindre les formes ou essences parentes de lintelligence. Nul procd mthodique de ce genre dans le
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
208
dogmatisme stocien ; il ne sagit plus dliminer la donne immdiate et sensible, mais tout au contraire de voir la Raison y prendre corps ; nul progrs ne mne du sensible au rationnel, puisquil ny a pas de diffrence de lun lautre ; l o Platon accumule des diffrences pour nous faire sortir de la caverne, le Stocien ne voit que des identits. Comme, dans les mythes grecs, les lgendes des dieux restent extrieures lhistoire des hommes, tandis que, dans la Bible, lhistoire humaine est elle-mme un drame divin, ainsi, dans le platonisme, lintelligible est en dehors du sensible, tandis que, pour le stocisme, cest dans les choses sensibles que la Raison acquiert la plnitude de sa ralit. De l la solidarit ncessaire des trois parties de la philosophie, logique, physique et thique, dans lesquelles, lexemple des Platoniciens, ils distribuent les problmes philosophiques. Bien loin en effet que, chez eux, chacune de ces parties puisse garder, grce la diversit de leur objet, une certaine autonomie (si bien que la morale par exemple, chez Aristote, peut dgnrer en une sorte de description des caractres, indpendante du reste de la philosophie), elles sont au contraire indissolublement lies, puisque cest une seule et mme raison, qui, dans la dialectique, enchane les propositions consquentes aux antcdentes, dans la nature lie ensemble toutes les causes, et dans la conduite tablit entre les actes le parfait accord. Il est impossible que lhomme de bien ne soit pas le physicien et le dialecticien ; il est impossible de raliser la rationalit sparment en ces trois domaines, et, par exemple, de saisir entirement la raison dans la marche des vnements de p.300 lunivers, sans raliser du mme coup la raison en sa propre conduite. Cette sorte de philosophie-bloc, qui impose lhomme de bien une certaine conception de la nature et de la connaissance, sans possibilit de progrs ni damlioration, est une des choses les plus nouvelles qui soient en Grce et qui rappellent les croyances massives des religions orientales. De l aussi la difficult de commencer et lindcision dans lordre des parties, dont on ne peut dcouvrir la hirarchie puisquon les atteint du mme coup ; si lon saccorde commencer par la logique, la physique a tantt le second rang parce quelle contient la conception de la nature do drive la morale, tantt le troisime parce quelle a comme couronnement une thologie qui, selon un texte formel de Chrysippe, est le mystre auquel la philosophie a pour fonction de nous initier 1. On voit donc le stocisme graviter tantt vers la pratique morale, tantt vers la connaissance de Dieu ; hsitation dont on verra mieux plus tard le sens et la porte.
V. LOGIQUE DE LANCIEN STOCISME
@
PLUTARQUE, Des Contradictions, ch. IX (Arnim, II, n 42).
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
209
La thorie de la connaissance consiste prcisment faire rentrer dans le sensible le domaine de la certitude et de la science que Platon en avait soigneusement cart. La vrit et la certitude sont dans les perceptions les plus communes, et elles nexigent aucune qualit qui dpasse celles qui appartiennent tout homme, mme aux plus ignorants ; la science, il est vrai, nappartient quau sage ; mais elle ne sort pas pour cela du sensible, et elle reste attache ces perceptions communes dont elle nest que la systmatisation. La connaissance part en effet de la reprsentation ou image (), qui est limpression que fait dans lme un objet rel, impression analogue, pour Znon, celle dun cachet sur p.301 la cire, ou, pour Chrysippe, laltration que produisent dans lair une couleur ou un son. Cette reprsentation est aussi, si lon veut, comme un premier jugement sur les choses (ceci est blanc ou noir) qui se propose lme et auquel lme peut donner ou refuser volontairement son assentiment (). Si elle le donne tort, elle est dans lerreur et a une opinion fausse : si elle le donne juste titre, elle a alors la comprhension ou perception () de lobjet correspondant la reprsentation ; et il faut bien voir que, dans ce cas, elle ne se contente pas de conclure lobjet de limage, mais elle le saisit immdiatement, et avec une certitude parfaite ; elle saisit non pas les images, mais les choses ; telle est, au sens propre du mot, la sensation, acte de lesprit, trs distinct de limage. Mais pour que lassentiment ne soit pas erron et amne la perception, il faut que limage soit elle-mme fidle ; cette image fidle, qui constitue ds lors le critre ou un des critres de la vrit, est la fameuse reprsentation comprhensive ( ) ; comprhensive, cest--dire non pas capable elle-mme de comprendre ou de percevoir (ce qui naurait aucun sens, puisque la reprsentation est pure passivit, et non pas agissante), mais capable de produire lassentiment vrai et la perception. Le mot comprhensif indique donc la fonction et non la nature de cette image ; et lorsque Znon la dfinit une reprsentation imprime dans lme, partir dun objet rel, conforme cet objet, et telle quelle nexisterait pas si elle ne venait pas dun objet rel , il ne fait que prciser son rle sans dire ce quelle est : la reprsentation comprhensive est celle qui permet la perception vraie et mme qui la produit avec la mme ncessit quun poids fait baisser le plateau dune balance. Mais quest-ce qui la distingue dune image non comprhensive ? Voil une question laquelle, selon les Acadmiciens, les Stociens nauraient jamais rpondu, et, en effet, il est difficile de trouver une rponse. Sans doute faut-il dire, puisque la reprsentation comprhensive nous p.302 permet de ne pas confondre un objet avec un autre, que cest celle o passe la qualit propre et en quelque sorte personnelle qui, selon les Stociens, distingue toujours un objet de tout autre, celle qui, selon Sextus, possde un caractre propre () qui la distingue de tout autre, ou, selon Cicron, celle qui manifeste dune manire particulire les choses quelle reprsente.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
210
La reprsentation comprhensive, commune au sage et lignorant, nous donne ainsi un premier degr de certitude ; la science, propre au sage, nest rien que laccroissement de cette certitude qui ne change pas de domaine, mais devient tout fait solide ; la science, cest la perception solide et stable, inbranlable par la raison 1 . Il semble bien que la solidit de la science est due ce que, chez le sage, les perceptions se confirment et sappuient les unes les autres, de manire quil en puisse voir laccord rationnel ; lart, dj, qui est intermdiaire entre la perception commune et la science, est pour eux, un systme de perceptions rassembles par lexprience, visant une fin particulire utile la vie . On voit ainsi la raison grouper et renforcer les unes par les autres les certitudes isoles et momentanes des perceptions. La science, cest la perception sre parce quelle est totale, ce qui revient dire quelle est systmatique et rationnelle. Znon rsumait dune manire pittoresque toute cette thorie de la certitude. Il montrait sa main ouverte, les doigts tendus, et disait : Telle est la reprsentation ; puis, ayant lgrement pli les doigts : Voici lassentiment , disait-il. Puis, ayant ferm le poing, il disait que ctait l la perception ; enfin, serrant son poing droit ferm dans sa main gauche : Voici, disait-il, la science qui nappartient quau sage 2. Cest dire, si on lit bien ce passage de Cicron, que la reprsentation, comprhensive ou non, ne saisit rien, que lassentiment p.303 prpare la perception, enfin que la perception seule saisit lobjet et plus encore la science. On voit en quel sens, fort restreint, les Stociens peuvent sappeler des sensualistes ; il ny a dautres connaissances que celles des ralits sensibles, cest vrai ; mais cette connaissance est, ds son dbut, pntre de raison et toute prte sassouplir au travail systmatique de la raison. Les notions communes ou innes, telles que celles du bien, du juste, des dieux, notions qui sont formes chez tous les hommes lge de quatorze ans, ne sont nullement drives, malgr lapparence, dune source de connaissance distincte des sens ; toutes ces notions drivent de raisonnements spontans partant de la perception des choses ; la notion du bien, par exemple, vient dune comparaison, par la raison, des choses perues immdiatement comme bonnes 3 ; la notion des dieux vient, par conclusion, du spectacle de la beaut des choses ; seulement ces raisonnements sont spontans et communs tous les hommes. De l, il rsulte que les divers Stociens pouvaient, sans se contredire, choisir des critres de la vrit fort diffrents : la reprsentation comprhensive, comme Chrysippe ; lintelligence, la sensation et la science, comme Bothus : ou encore, comme Chrysippe, la sensation et la prnotion ou notion commune ; tous ces critres, au fond, se correspondent, senchanent et
1 2
PHILON DALEXANDRIE, dans Arnim, II, n 95. CICRON, Premiers Acadmiques, II, 144 (Arnim, I, n 66). 3 CICRON, Des Fins, III, ch. X.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
211
squivalent, puisquil sagit toujours soit de limage qui amne ncessairement la perception, soit de la perception et de sa liaison avec dautres. Lactivit intellectuelle ne peut consister que dans lacte de saisir lobjet sensible ; on ne peut quabstraire, ajouter, composer, transposer, sans jamais sortir des donnes sensibles 1. A ct des choses sensibles, il y a ce quon peut en dire, ce quon peut exprimer par le langage, en un mot, lexprimable p.304 () ; la reprsentation dune chose est produite dans lme par la chose mme ; mais, ce quon peut en dire, cest ce que lme se reprsente loccasion de cette chose, ce nest plus ce que la chose produit en lme 2. Il y a l une distinction dune importance capitale pour comprendre la porte de la dialectique chez les Stociens. Car la dialectique porte non pas sur les choses, mais sur les noncs vrais ou faux relatifs aux choses. Les plus simples de ces noncs vrais ou faux, ou jugements (), sont composs dun sujet exprim par un substantif ou un pronom et dun attribut exprim par un verbe. Lattribut (), lui, seul, est un exprimable incomplet qui demande un sujet comme : se promne. Lensemble du sujet et de lattribut : Socrate se promne, forme un exprimable complet (), ou jugement simple 3. Le type des propositions employes par les Stociens na rien de commun avec celui de la logique platonico-aristotlicienne ; elles nexpriment point de rapport entre des concepts ; leur sujet est toujours singulier, quil soit dailleurs dfini (celui-ci), indfini (quelquun) ou demi dfini (Socrate) ; lattribut est toujours un verbe, cest--dire quelque chose qui arrive au sujet. La logique stocienne chappe ainsi toutes les difficults que soulevaient sophistes et socratiques sur la possibilit daffirmer une chose dune autre, et ignorant, avec la comprhension et lextension des concepts, la convertibilit des propositions, elle laisse tomber le mcanisme compliqu de la syllogistique aristotlicienne. La matire de la dialectique, ce sont des faits noncs de sujets singuliers. Ce nest pas quils ne gardent, eux aussi, le syllogisme ; mais la raison de la conclusion nest plus un rapport dinclusion de concepts exprim par un jugement catgorique, mais un rapport entre des faits dont chacun est exprim par une proposition simple (il fait clair, il fait jour) et dont le rapport p.305 est exprim par un jugement compos ( ), tel que : sil fait clair, il fait jour. Les Stociens connaissent cinq espces de jugements composs : lhypothtique (), exprimant un rapport entre un antcdent et un consquent, tel que celui que nous venons de citer ; le conjonctif qui lie les faits : et il fait jour et il fait clair ; le disjonctif qui les spare de telle manire que lun ou lautre est vrai : ou bien il fait jour ou bien
1
DIOCLS, chez DIOGNE LARCE, VII, 54 (Arnim, II, n 105) ; EPICTTE, Dissertations, I, 6, 10. 2 SEXTUS, Contre les Mathmaticiens, VIII, 409 (Arnim, II, n 85). 3 ARNIM, II, n 181 269 : expos de la logique surtout par Galien et Diocls.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
212
il fait nuit ; le causal qui lie les faits par la conjonction parce que : parce quil fait jour, il fait clair ; le jugement nonant le plus ou le moins, tel que : il fait plus (ou moins) jour quil ne fait nuit. La majeure dun syllogisme est toujours une proposition compose de ce genre, par exemple : sil fait jour il fait clair, la mineure nonce la vrit du consquent : il fait jour, et la conclusion en tire la vrit de lantcdent : donc il fait clair ; cest du moins l le premier des cinq modes ou figures de syllogismes irrductibles ou indmontrables que reconnat Chrysippe, daprs Diocls 1. Le second a comme majeure une hypothtique : sil fait jour, il fait clair, comme mineure loppos du consquent : or il fait nuit, et comme conclusion la ngation de lantcdent : donc il ne fait pas jour. Le troisime a pour majeure la ngation dun jugement conjonctif ; il nest pas vrai que Platon soit mort et quil soit vivant, comme mineure la vrit dun des faits : or Platon est mort, comme conclusion la ngation de lautre : donc Platon nest pas vivant. Le quatrime a pour majeure un disjonctif : ou il fait jour ou il fait nuit, pour mineure laffirmation dun des membres : il fait jour, et pour conclusion loppos de lautre : donc il ne fait pas nuit. Inversement le cinquime, qui part aussi dun disjonctif, nie un des membres dans la mineure : il ne fait pas nuit, et conclut lautre : donc il fait jour : A ces modes indmontrables, sajoutent des modes composs ou thmes (), qui en p.306 drivent, tels que le raisonnement compos : Si A est, B est ; si B est, C est, etc. ; or C est, donc A est. On voit facilement larbitraire de ces deux classements des jugements et des syllogismes, fonds lun et lautre sur le langage ; aussi bien Crinis, un lve de Chrysippe, admet six espces de jugements composs au lieu de cinq ; et si Diocls nous dit que Chrysippe reconnaissait cinq syllogismes indmontrables, Galien ne lui en attribue que trois. A vrai dire lintrt de cette dialectique nest pas dans ce mcanisme ; il est dans la nature de la majeure ; la majeure exprime toujours une liaison de faits, par exemple une liaison entre un antcdent et un consquent. Mais quelles conditions un jugement hypothtique est-il valable ou sain () ? Remarquons que jamais, un pareil jugement nest la conclusion dune dmonstration (la conclusion tant toujours un jugement simple), cest--dire ne peut tre dmontr. Dautre part, laspect extrieur de pareilles propositions : Si tel fait est, tel autre est, leur donne une ressemblance avec ces propositions que les mdecins ou les astrologues, grands observateurs des symptmes et des signes, tablissaient par lexprience pour diagnostiquer les maladies ou prdire la destine. Cest un langage de logiciens inductifs, qui nous renvoie la vision dun monde constitu par des faits enchans lun lautre, si diffrent du monde dAristote. Les Stociens eux-mmes nont vu dans la dmonstration quune espce de signe.
DIOGNE LARCE, VII, 79.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
213
Pourtant, de la forme extrieure de la proposition, il faut sparer la manire dont sa valeur est tablie ; or nous ne trouvons rien dans cette logique qui, de prs ou de loin, ressemble une preuve par induction. Et, en effet, si nous considrons le contenu des jugements quils donnent comme exemples, nous verrons quil nen est pas besoin, puisque le consquent est toujours li dun lien logique avec lantcdent ; la seule justification quils prsentent dun jugement hypothtique : sil fait jour, il fait clair, cest bien en effet que loppos du p.307 consquent, savoir : il ne fait pas clair, contredit lantcdent. Et dans le signe lui-mme, cest--dire dans un jugement tel que : Sil a une cicatrice, cest quil a t bless , les Stociens prtendent retrouver une liaison de mme sorte, puisque le signe lie non pas une ralit prsente une ralit passe, mais deux noncs de fait, qui sont tous deux prsents, et prsents seulement dans lintelligence (), et qui sont au fond logiquement identiques 1. En rsum, si la liaison logique sexprime toujours par une liaison entre des faits constats par les sens et noncs par le langage, cette liaison des faits na de valeur que grce la raison logique qui les unit ; le jugement hypothtique a dautant plus de valeur quil se rapproche davantage de celui o lon passe dun identique un identique : Si lucet, lucet 2. La dialectique stocienne a donc mme idal que la thorie de la connaissance, la pntration complte du fait par la raison, et lon va voir bientt comment la proposition hypothtique, qui en est lorgane, est particulirement apte exprimer leur vision des choses, si bien que la logique nest point chez eux, comme chez Aristote, un simple organe, mais une partie ou espce de la philosophie.
VI. PHYSIQUE DE LANCIEN STOCISME
@ La physique stocienne a pour but de nous amener nous reprsenter par limagination un monde totalement domin par la Raison, sans aucun rsidu irrationnel ; nul domaine pour le hasard, le dsordre, comme chez Aristote et Platon ; tout rentre dans lordre universel. Le mouvement, le changement, le temps ne sont pas lindice de limperfection et de ltre inachev, comme chez le gomtre Platon ou le biologiste p.308 Aristote ; le monde toujours changeant et mouvant a, chaque instant, la plnitude de sa perfection ; le mouvement est 3 chacun de ses instants un acte et non point un passage lacte ; le temps est, comme le lieu, un incorporel sans substance ni ralit, puisque cest seulement parce quil agit ou ptit, grce sa force interne, quun tre change et dure. Aucune disposition par suite, comme Aristote et les successeurs de
1 2
SEXTUS, Contre les Mathmaticiens, VIII, 177. CICRON, Premiers Acadmiques, II, 98. 3 SIMPLICIUS, Commentaire des catgories, 78 b (Arnim, II, n 499).
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
214
Platon, proclamer le monde ternel pour en sauver la perfection ; le monde stocien est un monde qui nat et qui se dissout sans que sa perfection en soit atteinte. La rationalit du monde ne consiste plus dans limage dun ordre immuable qui sy reflte autant que le permet la matire, mais dans lactivit dune raison qui soumet toute chose son pouvoir. Activit de la raison quil faut en mme temps imaginer comme une activit physique et corporelle. Seuls en effet, pour les Stociens comme pour les fils de la terre que Platon rprimandait dans le Sophiste, les corps existent ; car ce qui existe, cest ce qui est capable dagir ou de ptir et seuls les corps ont cette capacit. Les incorporels , quils appelaient aussi intelligibles, sont ou bien des milieux entirement inactifs et impassibles, comme le lieu, lespace ou le vide, ou bien ces exprimables noncs par un verbe, qui sont les vnements ou aspects extrieurs de lactivit dun tre, ou en un mot tout ce que lon pense loccasion des choses, mais non pas des choses. La raison, puisquelle agit, est donc un corps ; et la chose qui subit son action, ou qui ptit est aussi un corps et sappelle la matire 1. Un agent, raison ou dieu, un patient, matire sans qualit qui se prte avec une complte docilit laction divine, cest--dire un corps actif qui agit toujours sans ptir jamais, et une matire qui ptit sans jamais agir, tels sont les deux principes admis par la physique. Lun est cause, et mme lunique cause, laquelle toutes les autres se ramnent, p.309 agissant par sa mobilit, lautre est ce qui reoit sans rsistance laction de cette cause. Cette dynamique qui, par un de ses principes (celui dune action qui sexerce sans raction), reste aristotlicienne, mais qui, par un autre (celui dun premier moteur mobile et dune matire-chose faite dun corps concret), lui est tout fait contraire, ne peut avoir son plein sens que grce un dogme physique des plus tranges et des plus indispensables du stocisme, celui du mlange total ; deux corps peuvent sunir en se mlant par juxtaposition, comme on peut mler des graines despces diffrentes, ou en se confondant en un, comme dans un alliage de mtaux ; mais ils peuvent aussi se mlanger dun mlange total, de faon stendre, sans rien perdre de leur substance et de leurs proprits, lun travers lautre, si bien quon trouve la fois ces deux corps en quelque portion que ce soit de leur espace commun ; cest ainsi que lencens stend travers lair, le vin travers la masse deau laquelle on le mlange, ft-ce celle de la mer entire 2. Or cest de cette manire que le corps agent stend travers le patient, la Raison travers la matire et lme travers le corps. Laction physique ne peut se concevoir que grce la formelle ngation de limpntrabilit ; cest laction dun corps qui en pntre un autre et qui est partout prsent en lui. Cest ce qui donne au matrialisme stocien ce caractre si particulier qui le rapproche du
1 2
DIOGNE LARCE, VII, 139 (Arnim. II, n 300). ALEXANDRE DAPHRODISE, Du Mlange, d. I. Bruns, p. 216 sq. (Arnim, II, n 473).
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
215
spiritualisme. Le souffle matriel () qui traverse la matire pour lanimer est tout prt devenir esprit pur. La cosmologie grecque a toujours t domine par limage dune priode ou grande anne au bout de laquelle les choses reviennent leur point de dpart et recommencent linfini un nouveau cycle : ceci est vrai en particulier des Stociens. Lhistoire du monde est faite de priodes alternes dans lune p.310 desquelles le dieu suprme ou Zeus, identique au feu ou la force active, a absorb et rduit en lui-mme toutes les choses, tandis que, dans lautre, il anime et gouverne un monde ordonn (), Le monde, tel que nous le connaissons., sachve donc par une conflagration qui fait tout rentrer dans la substance divine ; puis il recommence, exactement identique ce quil tait, avec les mmes personnages et les mmes vnements ; retour ternel rigoureux, qui ne laisse place aucune invention 1. La physique ou cosmologie nest que le dtail de cette histoire : du feu primitif (quil faut se figurer non pas comme le feu destructeur que nous utilisons sur la terre, mais plutt comme lclat lumineux du ciel), naissent, par une suite de transmutations tous les quatre lments : une partie du feu se transforme en air, une partie de lair en eau ; une partie de leau en terre ; puis le monde nat ; parce quun souffle ign ou pneuma divin pntre dans lhumide. Dune manire sur laquelle nos textes nous laissent en complte incertitude, procdent de cette action tous les tres individuels lis en un seul monde, chacun avec sa qualit propre ( ), avec une individualit irrductible, qui dure autant que lui ; ces individualits ne sont, semble-t-il, que des fragmentations du pneuma primitif, puisque la gnration de nouveaux tres par la terre ou leau dpend, soit de la portion de pneuma quelle a garde dans la formation des choses, soit peut-tre, dans le cas de lhomme, dune tincelle venue du ciel qui forme son me. De laction concerte de ces individus se forme le systme du monde que nous voyons, limit par la sphre des fixes, avec les plantes circulant dun mouvement volontaire et libre dans lespace, lair peupl dtres vivants invisibles ou dmons, la terre fixe au centre. Mais ce systme gocentrique nest semblable quen apparence ceux que nous connaissons p.311 dj. Dabord les raisons de lunit du monde ne sont pas les mmes : Platon, dit Proclus, tablit lunit du monde sur lunit de son modle ; Aristote sur lunit de la matire et la dtermination des lieux naturels ; les stociens sur lexistence dune force unifiante de la substance corporelle 2. Si le monde est un, cest que le souffle ou me qui le pntre en retient les parties, parce quil possde une tension (), analogue celle que possde en petit tout tre vivant et mme tout tre indpendant quelconque pour empcher la dispersion de ses parties : cest la tension, ce mouvement de va-et-vient du
1
ARNIM, II, n 596 632 ; surtout ALEXANDRE, Comm. des Analytiques, d. Wallies, p. 180, 31. 2 Commentaire du Time, 138 e.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
216
centre la priphrie et de la priphrie au centre, qui fait que ltre existe. Do linutilit de lexemplaire platonicien et du lieu naturel dAristote ; cest par la force qui est en lui-mme, force qui est en mme temps une pense et une raison, que Dieu contient le monde. De l rsulte que le monde peut exister au sein dun vide infini, sans crainte de se dissiper, et que, en revanche, il na en lui-mme aucun vide ; car il ny a aucun lieu naturel que celui que la force se choisit. De plus si le monde est contenu par une me unique, il est ncessaire quil y ait sympathie entre les parties qui le composent ; chaque animal a en effet avec lui-mme une telle sympathie que, daprs les dispositions de certaines de ses parties, lon peut connatre clairement la disposition des autres... Sil en est ainsi, les mouvements peuvent transmettre leur action malgr les distances ; car il y a une vie unique, transporte des agents aux patients 1 . Cette sympathie universelle dun monde o tout conspire distingue radicalement le monde hirarchis dAristote de celui des stociens ; en lui, il y a comme un circulus universel ; la terre et tous ses habitats reoivent les influences clestes qui ne se bornent pas aux effets gnraux des saisons, mais stend jusqu la destine individuelle de chacun, selon lastrologie, dont la diffusion, partir du IIIe sicle, est immense p.312 et qui est compltement accepte par les Stociens. De plus, par une transmutation inverse de celle qui a produit les lments, les manations sches venant de la terre et les manations humides issues des fleuves et des mers produisent les divers mtores et servent de nourriture aux astres. Lastronomie des stociens reoit enfin de l une marque particulire : compltement insoucieux dastronomie mathmatique, ils laissent tomber les sphres ou picycles, imagins pour navoir admettre dans le ciel que des mouvements circulaires ou uniformes ; dsormais chaque plante, faite dun feu condens, suit son cours, libre et indpendante, sous la direction de son me propre, et il est, dans le ciel, des mouvements non uniformes ; leur mouvement circulaire et vari est la preuve mme de leur animation 2 La position de la terre au centre, dautre part, dcoule de raisons dynamiques, de ce que la terre est presse de tout ct par lair, comme un grain de millet plac dans une vessie, et qui reste immobile au centre quand on gonfle la vessie, ou bien de ce que la masse de la terre, pour petite quelle soit, quivaut celle du reste du monde et lquilibre 3 Tel est ce gocentrisme, si diffrent de celui de Platon, tout prt admettre quil nest quune hypothse mathmatique, tandis que celui des stociens est un dogme, li solidement leurs croyances. Clanthe ne pensait-il pas que les Grecs devraient assigner en justice, pour crime dimpit, Aristarque de Samos qui admettait le mouvement de la terre 4? En un mot, le monde est un systme divin dont toutes les parties sont distribues divinement. Il est un
1 2
PROCLUS, Commentaire de la Rpublique, II, p. 258, d. Kroll. ACHILLES, Isagoge 13 (Arnim, II, 686). 3 ARNIM, II, n 555 et 572. 4 PLUTARQUE, Du visage dans la lune, ch. VI.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
217
corps parfait ; mais ses parties ne sont pas parfaites, parce quelles ont une certaine relation au tout et nexistent pas par elles-mmes 1 Tout, dans le monde, est produit du monde. Cet ordre de choses nest pas ternel : contre les pripatticiens qui soutenaient lternit du monde, Znon fait valoir les observations gologiques qui nous montrent le sol se nivelant constamment et la mer se retirant ; si le monde tait ternel, la terre devrait donc tre toute plate et la mer devrait avoir disparu ; nous voyons de plus toutes les parties de lunivers se corrompre, y compris le feu cleste qui a besoin de se restaurer par la nourriture ; comment leur ensemble ne serait-il pas dtruit ? Nous voyons enfin que la race humaine ne peut tre trs ancienne puisque beaucoup des arts qui lui sont indispensables et nont pu natre quen mme temps quelle en sont encore leur dbut 2.
p.313
Nous avons vu ce qutait la naissance du monde ; sa fin, au bout de la grande anne, dtermine par le retour des plantes leurs positions initiales, consiste dans la conflagration universelle ou rsorption de toutes les choses dans le feu. Znon et Chrysippe appellent cette conflagration une purification du monde, laissant ainsi entendre que, la manire des dluges ou des temptes de feu que lon trouve dans les vieux mythes smitiques, il sagissait l dune restitution de ltat parfait. Chrysippe a bien soin de montrer que cette conflagration nest pas la mort du monde ; car la mort est la sparation de lme et du corps ; or ici lme du monde ne se spare pas de son corps, mais sagrandit continuellement ses dpens, jusqu ce quelle ait absorb toute la matire . Cest l un changement conforme la nature et non pas une rvolution violente. Au total, lunivers nest pas la ralisation plus ou moins imparfaite, contingente et instable dun ordre mathmatique ; cest leffet dune cause agissant selon une loi ncessaire, si bien quil est impossible quaucun vnement arrive autrement quil narrive effectivement. Dieu, lme de Zeus, la p.314 raison, la ncessit des choses, la loi divine et enfin le Destin, cest tout un pour Znon 3. La thorie du destin () nest quune claire expression de ce rationalisme intgral que nous voyons chez les stociens. Le destin, qui fut dabord, dans la pense grecque, la force tout fait irrationnelle qui distribue aux hommes leur sort, devient luniverselle raison selon laquelle les vnements passs sont arrivs, les prsents arrivent et les futurs arriveront 4 , raison universelle, intelligence ou volont de Zeus, qui commande aussi bien les faits que nous appelons contre nature, maladies ou mutilations, que les faits que nous appelons conformes la nature, comme la
1 2
PLUTARQUE, Contradictions, ch. XLIV. PHILON DALEXANDRIE, De lincorruptibilit du monde, ch. XXIII et XXIV (Arnim, I, 106). 3 LACTANCE, De la vraie sagesse, ch. IX (Arnim, I, n 160). 4 STOBE, Eclogues (Arnim, II, n 913).
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
218
sant. Tout ce qui arrive est conforme la nature universelle, et nous ne parlons de choses contraires la nature que l o nous envisageons la nature dun tre particulier en le dtachant de lensemble. Il ne faudrait pas confondre ce destin avec notre dterminisme scientifique. Il na rien produit chez les stociens qui ressemble nos sciences de lois, dont on trouve au contraire lide dans des doctrines fort diffrentes, celles des sceptiques. Cest que la ncessit causale, telle que nous la concevons, est celle dune relation, et une relation laisse tout fait indtermin le nombre des phnomnes qui peuvent sy soumettre ; au contraire le destin de lunivers est comme le destin dune personne ; il sapplique un tre individuel, lunivers, qui a un commencement et une fin ; car, comme dit lauteur stocisant dun trait attribu Plutarque 1 : Ni loi, ni raison, ni rien de divin ne sauraient tre infinis. Cette conception appuie de son autorit non seulement des sciences vritables comme lastronomie ou !a mdecine, mais tous les modes de divination de lavenir, astrologie, divination par les songes, etc., dont les stociens taient frus, et sur lesquels Chrysippe et Diogne de p.315 Babylone crivirent de compacts recueils dobservation dont Cicron nous a conserv quelque chose dans son trait Sur la Divination. En un mot le destin nest pas du tout lenchanement des causes et des effets, mais beaucoup plutt la cause unique qui est en mme temps la liaison des causes, en ce sens quil comprend en son unit toutes les raisons sminales dont se dveloppe chaque tre particulier. Ce monde li, fait de logoi ou raisons, constitue une sorte dunivers des forces ou, si lon veut, de penses divines actives qui tient la place du monde platonicien des ides. Les principaux de ces logoi, ceux qui prsident aux phnomnes de la terre ou de la mer, sont les divinits populaires connues par les mythes, Hestia ou Poseidon, et les Stociens se font fort, par une interprtation dont un Stocien de lpoque dAuguste, Cornutus, a conserv la doctrine 2, dexpliquer le moindre dtail des mythes populaires comme une allgorie des faits physiques. Ce fatalisme rencontrait pourtant, lintrieur mme du systme, une difficult, puisquil paraissait nier la croyance la libert humaine. Cicron nous a conserv quelque peu de largumentation pnible par laquelle Chrysippe sefforait de les accorder 3. Comment lacte libre peut-il tre en mme temps dtermin par le destin, telle est la vraie position de la question, puisquil ne sagit en aucun cas de rien soustraire au destin ; Chrysippe sen tire en distinguant plusieurs genres de causes : de mme que le mouvement de rotation dun cylindre sexplique non seulement par une impulsion extrieure, quon appelle cause antcdente, mais par la forme du cylindre qui est la cause parfaite ou principale, de mme un acte libre, comme lassentiment,
1 2
Pseudo PLUTARQUE, Du Destin, ch. III. CORNUTUS, Abrg de Thologie grecque, d. Lang, 1881. 3 CICRON, Du Destin, 39 sq.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
219
sexplique non par la reprsentation comprhensive qui est cause antcdente, mais par linitiative de lesprit qui la reoit. Tout semble donc se passer dans cette p.316 solution, comme si la puissance du destin ne stendait quaux circonstances extrieures ou aux causes occasionnelles de nos actes.
VII. LA THOLOGIE STOCIENNE
@ Le rythme altern du monde est ncessaire pour apprcier la porte de la thologie stocienne. On prononce son gard le nom dimmanence et mme de panthisme, et les crivains chrtiens ne se sont pas fait faute de railler ce Dieu prsent dans les parties les plus infimes de lunivers ; et il est vrai aussi que le monde est fait de la substance de Dieu et sy rsorbe. Mais il ne faut pas abuser dune ide juste ; la vrit est quil y a dans le stocisme les germes dune notion de la transcendance divine, mais aussi que cette transcendance est de nature toute diffrente de celle du Dieu de Platon ou dAristote. Remarquons en effet que la transcendance de Dieu ne va pas, chez Aristote ou les platoniciens, sans laffirmation de lternit du monde ; les platoniciens nous rpteront satit que Dieu ne peut se concevoir sil ne produit le monde de toute ternit ; lexistence actuelle du monde est une des faces ou des conditions de la perfection divine. Il en est tout autrement chez les stociens : grce la conflagration, leur Zeus ou dieu suprme a une vie en une certaine mesure indpendante du monde ; alors, la nature cessant dexister, il repose en lui, livr ses seules penses 1. Dautre part, si Dieu est imagin comme une force intrieure aux choses, comme un feu artiste, procdant mthodiquement la production des choses , ou comme un miel coulant travers les rayons , le stocien sadresse lui dautre part comme un tre providentiel, pre des hommes et qui rgie tout dans le monde au profit de ltre raisonnable, ltre tout-puissant, chef de la nature, qui gouverne toutes choses avec la loi, qui obit tout ce monde qui p.317 tourne autour de la terre, allant o il le mne et se laissant volontairement dominer par lui 2. Les crivains chrtiens ont signal cette espce de conflit interne dans la notion de Dieu chez les stociens : Bien quils disent, dit Origne 3, que ltre providentiel est de mme substance que ltre quil dirige, ils nen disent pas moins pourtant quil est parfait et diffrent de ce quil dirige. Si donc le dieu dAristote et des platoniciens est le dieu transcendant dune thologie savante, celui des stociens est lobjet dune pit plus humaine. Nont-ils pas admis, pour les approuver, toutes les origines que la dvotion populaire donne lide des dieux, la vue des mtores et de lordre du monde, la conscience des forces utiles ou nuisibles lhomme et qui nous
1 2
SENQUE, Lettres Lucilius, 9, 16. CLANTHE, Hymne Zeus (Arnim, I, n 537). 3 Sur lvangile de Jean, XIII, 21.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
220
dpassent, celle des forces intrieures nous qui nous dirigent, comme la passion de lamour ou le dsir de la justice, enfin les mythes des potes et le souvenir des hros bienfaisants ? Leurs preuves de lexistence des dieux qui reposent sur la ncessit dadmettre un architecte du monde, de raison analogue, mais suprieure, celle des hommes, rentrent dans la mme ligne. Toute cette thologie populaire implique des rapports directs et spciaux entre Dieu et les hommes, tandis que la thologie aristotlicienne ou platonicienne ne concerne que le rapport gnral de Dieu lordre du monde, sans rapport particulier lhomme. Le monde est avant tout la demeure des dieux et des hommes et des choses faites en vue des dieux et des hommes 1. Sur ce dernier chapitre, on sait jusqu quel point de ridicule les stociens ont pouss laffirmation dune finalit externe, attribuant par exemple aux puces la fonction de nous rveiller dun sommeil trop long et aux souris lheureux effet de nous forcer veiller au bon ordre de nos affaires. Chrysippe, sur la critique de ses adversaires, ft amen construire une thodice, dailleurs assez faible, pour expliquer la prsence du mal dans lunivers. Deux arguments montrent le mal indispensable la structure de lunivers ; il ny a rien de plus sot, dit Chrysippe, que de croire que des biens auraient pu exister, sil ny avait eu en mme temps des maux ; car le bien est contraire au mal, et il ny a pas de contraire sans son contraire. Selon un deuxime argument, Dieu veut naturellement le bien, et cest l son principal dessein ; mais, pour y arriver, il est amen employer des moyens qui pris en eux mmes ne sont pas sans inconvnient. La minceur des os du crne, ncessaire lorganisme humain, ne va pas sans danger pour son salut. Le mal est alors ncessaire accompagnement () du bien. Enfin, comme le dit dj Clanthe sadressant Zeus : Rien narrive sans toi, except les actes quaccomplissent les mchants dans leur folie. Dans ce troisime argument, le mal moral ou vice est d la libert de lhomme qui slve contre la loi divine, alors que, dans le premier, il tait d la ncessit dun quilibre harmonieux : deux explications contradictoires entre lesquelles les stociens nont jamais su choisir 2.
p.318
VIII. PSYCHOLOGIE DE LANCIEN STOCISME
@ Rationaliste, dynamiste, spiritualiste, telle est, comme la thorie de lme du monde, la thorie de lme individuelle chez les stociens. Ils nient lexistence de lme dans les plantes et ne lattribuent quaux animaux ; et dautre part ils refusent compltement la raison aux btes, en sauvant ainsi
1
Cf. ATIUS, Opinions des Philosophes, I, 6 ; CICRON, De la Nature des Dieux, ch. XXV et XXVI, II, ch. XXVI ; STOBE (Arnim, II, n 527) ; PLUTARQUE, Contradictions ; p. 1044 d. 2 ARNIM, II, n 1069.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
221
lminente dignit de lhomme. En premier lieu, il ny a dme que l o il y a mouvement spontan driv dune inclination mise en branle par une reprsentation. Reprsentation et inclination, telles p.319 sont les deux facults lies ensemble que ne possdent pas les plantes mais seulement les animaux. En revanche les animaux nont encore aucune raison ; les actes instinctifs en apparence intelligents, que recueillent les curieux dobservations (comme on le voit par le trait stocisant Des Animaux de Philon dAlexandrie, et le trait de Plutarque Sur la Subtilit des animaux), ces traits damiti, dhostilit, de politique, ne supposent en eux aucune raison, mais drivent de la raison universelle, partout rpandue dans la nature. La raison, particulire lme humaine, consiste dans lassentiment qui sintroduit entre la reprsentation et la tendance ou inclination ; le caractre propre lme raisonnable, cest en effet que lactivit de la tendance nest pas directement engendre par la reprsentation, mais seulement aprs que lme lui a donn volontairement son adhsion ou assentiment ; tout refus de lme empche laction. Les stociens appellent partie hgmonique o directrice de lme, ou bien encore rflexion, cette partie o se produit la reprsentation, lassentiment et linclination ; et ils se la reprsentent comme un souffle ign localis dans le cur. Delle manent sept souffles igns ; cinq dentre eux stendent. jusquaux organes o ils reoivent les impressions sensibles quils transmettent au centre ; un sixime est le souffle de la voix qui se propage par les organes vocaux ; un septime le souffle gnrateur qui transmet lengendr une parcelle de lme du pre. Ces six facults sont dailleurs moins des parties subordonnes que lme dirigeante elle-mme se propageant travers le corps 1. Au sujet de lorigine de cette me les anciens Stociens ont pens que le souffle ign transmis par le pre ntait pas dabord une me, mais faisait vivre lembryon comme une plante ; p.320 puis au moment de la naissance, le souffle ign refroidi par lair (les stociens supposaient quune partie de lair entr dans les poumons par la respiration tait reue dans le ventricule) se durcissait comme du fer tremp et devenait lme dun animal 2. Les stociens paraissent donc avoir accept cette doctrine quon appela plus tard le traducianisme. Il est difficile de savoir qui faire remonter la doctrine inverse de lorigine de lme conue comme fragment de lther divin, que lon trouve chez les stociens de lpoque impriale, et qui accentue le privilge de lhomme. Lme humaine est en tout cas pure raison, et il sera difficile de voir comment sy introduiront le vice et la draison.
1 2
Sur le conflit ce sujet entre Clanthe et Chrysippe, cf. SENQUE, Lettres, 113. PLUTARQUE, Contradictions, ch. XLI (Arnim, II, 806).
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
222
IX. MORALE DE LANCIEN STOCISME
@ A cette conception du destin, de Dieu et de lme sont lies les rgles de la conduite du sage. Nous suivons, pour exposer cette morale, le plan indiqu par Diogne Larce (VII, 84) comme tant celui de Chrysippe et de ses successeurs jusqu Posidonius. Le moraliste part de lobservation des inclinations () telles quil les constate chez lhomme ds la naissance ou au fur et mesure de leur closion ; ces inclinations, telles quelles sont reues de la nature, ne peuvent tre dpraves. Or la premire inclination nous pousse nous conserver nousmmes, comme si la nature nous avait confis nous-mmes, en nous donnant ds lorigine le sentiment ou la conscience de nous (car cette inclination est insparable de la connaissance de soi et nest pas antrieure elle). Ltre vivant a donc, ds le dbut, le moyen de distinguer ce qui est conforme la nature de ce qui lui est contraire, et lon p.321 appelle premires choses conformes la nature ( ) les objets de ces premires inclinations, sant, bien-tre et tout ce qui peut y servir. Ces objets ne mritent pourtant pas encore le nom de biens ; car le bien est absolu par nature : cest ce qui se suffit soi-mme et peut tre appel lutile. Les stociens ne voudraient pas accepter un bien relatif, comme Aristote qui distinguait le bien du mdecin, de larchitecte, etc. ; les choses conformes la nature dont nous avons parl, tant relatives ltre vivant qui les dsire, ne sont pas des biens. Cest par une laboration rationnelle que lon arrivera concevoir le bien 1. Cest en rflchissant sur la raison commune de notre assentiment spontan nos inclinations, en les comparant entre elles, que nous saisirons la notion du bien. Notre assentiment spontan, laurore de la vie, tait dj un assentiment fond en raison, et mme un assentiment de la raison, puisquil visait conserver un tre produit par la nature, cest--dire le destin ou raison universelle. Mais la notion du bien vient en quelque sorte dune raison au second degr, qui saisit le motif profond de notre attachement nous-mmes, dans la volont que la nature totale, dont nous sommes une partie, a de se conserver. Cest pourquoi ce bien, qui envisage la nature universelle, a une valeur incomparable avec celle des objets primitifs de linclination, qui ne se rapportent qu notre nature particulire ; il ne peut tre obtenu par simple accroissement des fins primitives, comme si, par exemple, il tait la sant, la richesse et les autres fins de ce genre pousses leur maximum ; il est dune autre espce, non dune grandeur suprieure. La preuve cest que lloge ne sadresse ni la sant, ni la richesse, mais quil est rserv au bien. Tout le monde nadmet pas, il est vrai, que le bien est
1
CICRON, Des Fins, III, 72.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
223
digne dloge en lui-mme, et Aristote, par exemple, distingue lacte vertueux, qui seul est louable, du bien ou bonheur, pour lequel il est accompli ; mais, p.322 en vrit, la rflexion nous dit le contraire ; car le bien est objet de la volont ; cet objet est ce en quoi on se complat ; ce en quoi on se complat est louable 1 . Il est vrai quAristote avait raison de dire avec le sens commun que laction honnte et belle, est seule louable ; mais cela revient dire en achevant le raisonnement compos ci-dessus : le louable est lhonnte (, honestum) ; donc seul lhonnte est un bien. Sous cette dialectique si sche, on sent cette modification profonde de la morale, qui consiste nadmettre comme bien que ce qui est ralisable par notre propre volont, en abandonnant comme indiffrent ce qui fait lobjet des inclinations. Vertu et bien sont donc identifis : lun et lautre sont prcieux, louables, utiles et mme indispensables ; le bien ou le bonheur nest plus comme un don divin qui sajoute elle. La vertu na donc aucun objet extrieur vers lequel tendre ; elle sarrte elle-mme ; elle est dsirable pour elle-mme ; elle ne tire pas sa valeur de la fin quelle fait atteindre, puisquelle est elle-mme cette fin. Elle nest pas, comme les autres arts, tourne vers une fin trangre, mais toute entire tourne en elle-mme (in se tota conversa) 2 ; en revanche, elle nest pas, comme les autres arts, susceptible de progrs ; elle est parfaite du premier coup, et complte en toutes ses parties. Cest pourquoi, toute intrieure, elle est une disposition stable et daccord avec soi. Cest cette fermet et cette constance identique la raison, qui est avant tout accord avec soi, que Znon donnait le nom de prudence (). Sil y a dautres vertus, elles ne sont pour lui que des aspects de la vertu fondamentale ; le courage sera la prudence en ce qui est supporter, la temprance, la prudence dans le choix des choses, la justice, la prudence dans lattribution des parts. On voit combien 3 Znon est loin de sparer et de p.323 dissocier les vertus, comme faisait Aristote, distinguant non seulement les vertus de lhomme et de la femme, mais encore celle du riche et celle du pauvre. Nulle distinction de ce genre, ds quon ne voit plus dans la vertu que luniverselle raison. Dieu lui-mme na pas dautre vertu que lhomme. Clanthe insistait peut-tre plus que son matre sur laspect actif de cette raison, lorsquil dfinit la vertu principale une tension (), qui est courage lorsquil sagit de supporter, justice lorsquil sagit de distribuer. Chrysippe revient lintellectualisme de Znon et refuse de voir dans la tension autre chose que laccompagnement des vertus qui en elles-mmes sont des sciences, la prudence tant la science des choses faire ou ne pas faire, le courage, la science des choses supporter ou ne pas supporter, et ainsi de suite ; mais il admet la multiplicit des vertus, en un sens bien autre, il est vrai, que celui dAristote, puisque ces vertus sont indissolublement lies ; qui a une vertu les
1 2
Chrysippe dans PLUTARQUE, Contradictions, ch. XIII (Arnim, III, 29). STOBE, Eclogues (Arnim, III, 208) ; CICRON, Des Fins, III, 32. 3 PLUTARQUE, De la vertu morale, ch. II.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
224
a toutes ; il nen est pas moins vrai que chacune sexerce en une sphre daction distincte et doit sapprendre sparment 1. Le passage de ltat primitif dinnocence, o toutes les inclinations sont droites, ltat o les inclinations sont remplaces par la volont rflchie et la vertu ne se fait pas dune manire aussi aise que le laisserait croire notre expos. Les aspirants la vie vertueuse ne sont pas des innocents, mais des pervertis ; les inclinations primitives nont pas persist, mais en se dformant ou sexagrant, en particulier sous linfluence du milieu social qui dprave lenfant, elles sont devenues des passions, chagrin, peur, dsir ou plaisir, qui troublent lme et font obstacle la vertu et au bonheur 2. Lexistence de la passion offre la psychologie stocienne un problme des plus difficiles rsoudre : si toute la substance de lme est raison, comment peut-il y avoir de lirrationnel en elle ? Car les p.324 passions vont rellement contre la raison, puisquelles nous amnent dsirer comme des biens ou fuir comme des maux ce qui, pour lhomme rflchi, nest en ralit ni bien ni mal. Platon et Aristote navaient pu viter la difficult quen admettant dans lme une ou plusieurs parties irrationnelles ; mais cette thse, outre quelle choque le rationalisme intgral des Stociens, ne rend pas compte de certains lments de la passion, Il faut se rappeler, en effet que, chez un tre raisonnable comme lhomme, linclination nest pas possible sil ne lui donne son assentiment ou adhsion ; ce qui est vrai de linclination en gnral lest de cette inclination exagre et dmesure quest la passion ; il ny a de chagrin par exemple que si lme adhre ce jugement quil y a pour nous un mal prsent ; et toute passion implique ainsi un jugement sur un bien, prsent dans le plaisir, futur dans le dsir, ou sur un mal, prsent dans la peine, futur dans la crainte. Non seulement la gense de la passion dpend de lassentiment, mais aussi son dveloppement ; cest, par exemple, parce que lon croit quil est convenable de se livrer au chagrin que lon gmit et que lon prend le deuil. Or lassentiment est le fait de ltre raisonnable, et de lui seul ; autre chose est de sentir la douleur physique (), autre chose den prouver de la peine (), qui dpend du jugement quelle est un mal. Ce nest donc pas expliquer la passion que de lattribuer une facult dnue de raison 3. La passion est donc une raison, un jugement, comme dit Chrysippe, mais une raison irrationnelle et dsobissante la raison, ce qui est paradoxal et force tout de mme y rechercher un lment irrductible la raison. Chrysippe cherche attribuer cet lment une origine extrieure : ce sont les habitudes donnes aux enfants pour viter le froid, la faim, la douleur qui le persuadent que toute douleur est un mal ; et ce sont les opinions quils entendent exprimer autour deux p.325 pendant toute leur ducation : depuis les
1 2
ARNIM, I, 563, et III, 255-261. ARNIM, III, 228-236. 3 ARNIM, III, 377-420.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
225
nourrices jusquaux potes et aux peintres, ils nentendent quloges du plaisir et des richesses 1. Il faut pourtant bien que ces faux jugements trouvent accs dans lme ; or, lorsque Chrysippe explique lexagration de la tendance par un phnomne analogue llan dun coureur qui ne peut sarrter, puis indique que les augmentations ou diminutions dune passion comme le chagrin sont jusqu un certain point indpendantes du jugement que lon porte sur son objet, puisque le chagrin est plus fort, lorsque le jugement est rcent, cest bien l faire intervenir des facteurs irrationnels tout fait intrieurs lme. Il y en a dautres encore ; la cause initiale de la passion est une faiblesse de lme et la passion est une croyance faible ; de plus elles donnent naissance des faits bien impossibles assimiler des jugements, le resserrement de lme dans la peine et son panouissement dans la joie ; enfin les passions qui sont de nature passagres et instables se transforment en maladies de lme, telles que lambition, la misanthropie qui se fixent et deviennent indracinables 2. Sans nier lexistence de la draison, les Stociens ont insist pourtant sur limportance du jugement pour faire voir combien la passion dpendait de nous ; Chrysippe en particulier a mis en lumire le rle de jugements de convenance, tels que le prjug qui nous fait croire quil est bon et juste de nous livrer au chagrin la mort dun parent. Cest non pas par une rsistance de front la passion dchane, mais par une mditation prventive sur de tels jugements, par des maximes raisonnes, que les stociens esprent nous soustraire aux passions. Lon a vu comment la raison humaine dgage des inclinations spontanes le bien et la vertu. Cest par la mme laboration rationnelle que lhomme dcouvre la fin en vue de laquelle sont faites toutes les actions quil convient de faire. La base de la p.326 vie morale, cest lespce de choix spontan que nos inclinations nous font faire des choses utiles notre conservation ; la fin, cest de vivre en choisissant dun choix rflchi et volontaire les choses conformes la nature universelle 3. Cest sans doute ce qua voulu dire Znon, en dfinissant la fin : vivre daccord, ou vivre avec consquence () 4 ; vivre ainsi, cest vivre selon la raison, qui ne trouve devant elle aucune opposition. Cest srement ce quont voulu dire Clanthe et Chrysippe, en proposant, comme fin, de vivre conformment la nature ( ), cest--dire, commente Chrysippe, en employant la connaissance scientifique des choses qui arrivent par nature. Cette connaissance scientifique, cest celle que nous donne la physique : tout arrive par la raison universelle, la volont de Dieu ou le destin. Ds lors la fin consistera uniquement dans une attitude intrieure de la volont : tout tre
1 2
CHALCIDIUS, Sur le Time, 165-166 (Arnim, III, n 229). CICRON, Tusculanes, IV, 125. 3 CICRON, Des Fins, II, 34 ; III, 14. 4 ARNIM, III n 12.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
226
obit ncessairement au destin ; mais la raison gare essaye dy rsister et dopposer au bien universel le fantme dun bien propre, sant, richesse, honneur ; le sage au contraire accepte avec rflexion les vnements qui rsultent du destin ; l o le mchant est entran par force, il se dirige volontairement ; sil sait que le destin le veut mutil ou pauvre, il accepte cette mutilation ou cette pauvret. Non pareo Deo sed assentior , dit Snque (Lettre 97) ; je nobis pas Dieu, jadhre ce quil a dcid. La rsignation stocienne nest pas un pis aller ; cest une complaisance positive et joyeuse dans le monde tel quil est ; il faut mettre sa volont daccord avec les vnements, de manire que ceux qui surviennent soient notre gr 1. Suivre la nature, suivre la raison, suivre Dieu, ce triple idal que nous verrons se dissocier plus tard ne fait quun pour les Stociens. Il sagit dexpliquer aussi comment cette disposition ne reste p.327 pas intrieure, mais au contraire invite laction. Il y a l un point des plus importants, et nous atteignons lessence mme du stocisme ; la morale stocienne invite laction ; ses fondateurs engageaient par-dessus tout leurs lves accomplir leurs fonctions de citoyen 2 ; beaucoup plus tard, pictte considrait son enseignement comme une prparation vritable aux carrires publiques, et il blmait les jeunes gens qui voulaient rester trop longtemps lombre de lcole : la vie normale de lhomme, cest la vie de lpoux, du citoyen, du magistrat. Nul divorce chez eux entre la vie contemplative et la vie pratique, comme celui qui menaait de stablir et qui sest tabli effectivement, on le verra, comme consquence des doctrines dAristote et de Platon ; la connaissance de la nature est prparation laction. Mais il faut bien voir en quel sens : au premier abord, il semble y avoir dans la morale stocienne une insurmontable difficult qui la force aboutir au quitisme de lhomme parfait, qui, bon gr mal gr, assiste, impassible, tous les vnements. Tous les Stociens sont daccord pour reconnatre que tout est indiffrent, hors cette disposition intrieure quest la sagesse, et quil ny a ni bien ni mal pour nous en ce qui nous arrive : cest dire quil ny a aucune raison de vouloir un contraire plutt que lautre, la richesse plutt que la pauvret, la maladie plutt que la sant. Mais poussons plus loin lanalyse : si nous considrons ltat de lhomme imparfait, sant et richesse ont pour lui plus de prix et de valeur que maladie et pauvret parce quelles sont plus conformes la nature ou satisfont mieux les inclinations. Pour lhomme parfait, sant et maladie ne sont pas de mme ordre que ce quil recherche, savoir la volont droite ou conforme la nature ; cette volont droite est tout fait indpendante de lun ou de lautre, et elle persiste dans les deux ; elle a donc une valeur incomparable. Mais il p.328 ne sensuit pas du tout que, mme pour lhomme parfait, lun nait pas plus de valeur que lautre si on les compare ensemble ; ce qui distingue lhomme parfait, cest quil na pas
1 2
PICTETE, Dissertations, II, 14, 7. SENQUE, Du Loisir, dbut.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
227
dattachement plus grand lun qu lautre, et surtout quil na pas dattachement inconditionnel ; il choisirait la maladie par exemple, sil savait quelle est voulue par le destin ; mais, toutes choses gales dailleurs, il choisira plutt la sant. Dune manire gnrale, sans les vouloir du tout comme il veut le bien, il considre comme prfrables, () les objets conformes la nature, sant, richesses, et comme non prfrables () les choses contraires la nature. Les Stociens peuvent donc ainsi dresser une liste des actions convenables (, officia), qui sont comme les fonctions ou devoirs de ltre raisonnable, capable de sauvegarder sa propre vie et celle de ses semblables : soins du corps, fonction damiti et de bienfaisance, devoirs de famille, fonctions politiques. Laccomplissement de ces fonctions, qui nest ni un bien ni un mal, peut exister chez tous les hommes, et ainsi peut prendre naissance une morale secondaire, une morale des imparfaits qui sadresse tous ; cette morale pratique (morale des conseils ou parntique) a reu plus tard un grand dveloppement et, par elle, le stocisme sest insr dans la vie commune. Le sage et limparfait ont exactement mmes devoirs, tel point que le sage, si parfait et heureux quil soit, devra quitter la vie par le suicide, sil subit en excs des choses contraires sa nature. Pourtant leur conduite nest la mme quen apparence et extrieurement ; l o limparfait accomplit un simple devoir (), le sage accomplit un devoir parfait ( ) ou action droite (), grce son accord conscient avec la nature universelle ; de plus, il sait bien que ce devoir na quune valeur de vraisemblance, et quil y a tels cas o il vaut mieux renoncer ses devoirs de famille ou de magistrat 1. devoir ou fonction na donc jamais une forme catgorique ; de l le dveloppement de toute une littrature de conseils (parntique) qui, laissant de ct les principes abstraits, examine et pse les cas individuels et donne lieu parfois une vraie casuistique. La libert desprit des premiers stociens lgard des devoirs sociaux par exemple tait de fait assez grande pour que lon trouve chez eux des traits qui rappellent le cynisme le plus radical, prnant par exemple la communaut des femmes 2. Telle est la thorie stocienne de laction, si contradictoire dapparence ; il faut bien voir que lindiffrence lgard des choses exprime non pas la faiblesse, mais la vigueur mme de la volont qui consent se manifester par le choix dune action, mais qui ne veut ni sy restreindre ni sy fixer. La morale stocienne ne quitte jamais, ds son principe, la description de lhomme agissant ; elle ne cherche nul bien en dehors de la disposition volontaire ; il sensuit quelle ne peut se raliser entirement que par la description de ltre qui possde la vertu, la description du sage. Le sage est
1 2 p.329 Le
Cf. ARNIM, III, n 493. SEXTUS, Hypotyposes, III, 205.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
228
ltre qui ne garde en son me plus rien qui ne soit entirement raisonnable, tant lui-mme une raison ou un verbe ; donc il ne commettra aucune erreur ; tout ce quil fera, ft-ce laction la plus insignifiante, sera bien fait, et le moindre de ses actes contiendra autant de sagesse que sa conduite tout entire ; il ne connatra ni regret, ni chagrin, ni crainte, ni aucun trouble de ce genre ; il aura le bonheur parfait ; seul il possdera la libert, la vraie richesse, la vraie royaut, la vraie beaut ; seul, il connatra les dieux et sera le prtre vritable ; utile lui-mme, aux autres, il saura seul gouverner une maison ou une cit et avoir des amis. On connat tous ces paradoxes dont on pourrait allonger encore la liste, qui accumulent toutes les perfections sur la personne du sage 1. Pour en comprendre le sens, il faut ajouter p.330 que qui nest pas sage est imparfait, et que, au regard de la sagesse, toutes les imperfections sont gales ; tous les non sages sont galement des fous, des insenss, plongs dans un malheur complet, de vrais exils sans famille ni cit. Quils soient plus ou moins prs de la sagesse, ils nen sont pas moins insenss, puisque la rectitude du sage nadmet ni nuances ni degrs ; ainsi le noy nest pas moins touff, quil soit au fond de leau ou presque la surface, comme larcher ne manque pas moins son but, que la flche en arrive prs ou loin. Il est naturel et conforme ce que nous avons appris du stocisme dadmettre que la sagesse ne puisse tre donne quen bloc ; elle nest, pas plus que la philosophie tout entire, susceptible de progrs. Ce que les stociens anciens ont voulu, ce nest pas prcisment le progrs moral, cest, comme le dit Clment dAlexandrie, une sorte de transmutation intime qui change lhomme tout entier en raison pure 2, le citoyen dune cit en citoyen du monde, transmutation analogue dans lordre de lesprit la transformation politique quAlexandre faisait subir aux peuples. Znon, dit Plutarque 3, a crit une Rpublique trs admire, dont le principe est que les hommes ne doivent pas se sparer en cits et en peuples ayant chacun leurs lois particulires ; car tous les hommes sont des concitoyens, puisquil y a pour eux une seule vie et un seul ordre de choses (cosmos) comme pour un troupeau uni sous la rgle dune loi commune. Ce que Znon a crit comme en rve, Alexandre la ralis ; ... il a runi comme en un cratre tous les peuples du monde entier ; ... il a ordonn que tous considrent la terre comme leur patrie, son arme comme leur acropole, les gens de bien comme des parents et les mchants comme des trangers. On ne peut mieux dire que la morale stocienne est celle des temps nouveaux, o, sur les cits disloques et dsormais incapables dtre une p.331 source de vie morale et un soutien, slvent de grandes monarchies qui aspirent gouverner lhumanit.
1 2
ARNIM, III, 548-656. CLMENT DALEXANDRIE, Stromates, IV, 6. 3 De la Fortune dAlexandre, ch. VI.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
229
La raison, loi universelle ou nature, se fait en quelque sorte monarchique : chez Aristote, elle partit des ralits psychologiques ou sociales de fait, passions, coutumes, lois, quelle essayait simplement, comme den haut, de temprer et dorganiser : ici, elle prend toute la place, et elle expulse tout ce qui nest pas elle-mme ; la vertu est place dans la seule raison 1 .
Bibliographie @
CICRON, Derniers Acadmiques, I, 38.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
230
CHAPITRE III LPICURISME AU IIIe SICLE
I. PICURE ET SES LVES
@ Aprs le systme massif des stociens, cest une dtente de se reposer au jardin o picure philosophe dans le priv avec ses amis, pendant que Znon attirait au portique Pcile la foule du public. Entre ces deux esprits, rien de commun que les traits les plus gnraux de lpoque : un mme dtachement de la cit mais qui, chez picure, na pas comme chez Znon la contre-partie de lattachement aux empires naissants et au cosmopolitisme, et qui reste en somme au niveau de lancienne critique sophistique ; une thorie sensualiste de la connaissance, mais qui nest pas surmonte, comme chez Znon, de toute une dialectique rationnelle ; laffirmation dune liaison troite entre la physique et la morale, mais conue dune manire tout autre, puisque la physique picurienne est prcisment faite pour empcher de rvrer ce qui inspirait Znon un religieux respect ; un grand dsir de propagande morale, mais qui chez picure sexerce par des amis choisis et prouvs ; aussi peu crivains lun que lautre ; mais, tandis que Znon cre des mots nouveaux ou des significations nouvelles, picure, polygraphe comme Chrysippe, se contente dun langage simple et nglig.
p.333
Nous sommes dailleurs, au jardin dAthnes, entre Grecs de bonne souche : picure est dAthnes, quoiquil ait t lev Samos ; et ce sont aussi les ctes ou les voisines de lIonie, do viennent les premiers disciples ; Lampsaque, en Troade, p.334 envoie Mtrodore, Polyaenus, Leonteus, Colots et Idomne ; de Mitylne vient Hermarque, le premier successeur dpicure. Quel accueil devait faire tous ceux qui en taient dignes celui qui se vantait davoir commenc philosopher quatorze ans et qui crivait Mnce : Que le jeune homme nattende pas pour philosopher ; que le vieillard ne se fatigue pas de philosopher ; il nest jamais trop tt ni trop tard pour donner des soins son me. Dire que lheure de philosopher nest pas encore arrive ou quelle est passe, cest dire que lheure de dsirer le bonheur nest pas encore ou quelle nest plus 1. picure, n Athnes en 341, passa sa jeunesse Samos et ne revint Athnes quen 323 ; il y sjourna alors fort peu, et sa retraite Colophon, aprs la mort dAlexandre, parat tre lie lhostilit que lui montrrent les
1
DIOGNE LAERCE, X, 122.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
231
matres macdoniens dAthnes ; il revint Athnes quelques annes aprs et y fonda cole en 306, sous le gouvernement de Dmtrius Poliorcte. On connat le fameux jardin, quil acheta quatre-vingts mines, o, jusqu sa mort, qui eut lieu en 270, il sentretint avec ses amis, trouvant en eux une consolation une cruelle maladie qui, semble-t-il, le tint paralys pendant plusieurs annes. De tout, ce que la sagesse nous prpare pour le bonheur de la vie entire, crivait-il en songeant cette intimit de tous les instants, la possession de lamiti est de beaucoup le plus important 1. Et son testament, que nous a conserv Diogne Larce (X, 16 sq.), nous le montre avant tout proccup de maintenir cette socit dont il tait lme ; ses excuteurs testamentaires ont pour charge de conserver le jardin pour Hermarque et tous ceux qui lui succderont la tte de lcole ; Hermarque et aux philosophes de la socit, il lgue la maison quils doivent habiter en commun ; il prescrit des crmonies commmoratives annuelles en son honneur et en lhonneur de ses disciples dj disparus, Mtrodore et Polyaenus ; il prvoit p.335 le sort de la fille de Mtrodore, et recommande en gnral de pourvoir aux besoins de tous ses disciples. Ds ce moment dailleurs, des centres picuriens commenaient se fonder dans les villes dIonie, Lampsaque, Mitylne et mme en gypte, et ils voulaient attirer le matre vers eux 2. Cest cet essaimage de lcole que nous devons sans doute les seuls documents directs par lesquels nous connaissons picure, trois lettres-programmes contenant un rsum du systme, lune Hrodote sur la nature, lautre Pythocls sur les mtores, la troisime Mnce sur la morale ; de pareilles lettres pouvaient tre crites de concert avec ses principaux disciples, Hermarque et Mtrodore, comme cest le cas de quelques-unes que nous avons perdues 3. Outre ces lettres, nous avons les Penses principales, o, en quarante penses, picure rsume son systme ; il faut y ajouter quatre-vingt une penses dcouvertes en 1888. Tel est lhomme la sant dlicate et au cur exquis, que ses ennemis reprsentent comme un dbauch et qui prchait en ces termes la morale du plaisir : Ce ne sont pas les boissons, la jouissance des femmes ni les tables somptueuses qui font la vie agrable, cest la pense sobre qui dcouvre les causes de tout dsir et de toute aversion et qui chasse les opinions qui troublent les mes 4 . On sait combien il fut vnr de ses premiers disciples, et lon connat les beaux vers dans lesquels, plus de deux cents ans aprs sa mort, Lucrce rend hommage son gnie : Ce fut un dieu, oui un dieu, celui qui le premier dcouvrit cette manire de vivre que lon appelle maintenant la sagesse, celui qui par son art, nous fit
1 2
Principales opinions, XXIII (USENER, Epicurea, 1887, p. 77). Documents dans USENER, p. 135-137. 3 A. VOGLIANO, Nuovi testi epicurei, dans Rivista di filologia, 1926, p. 37. 4 USENER, 64, 12 sq.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
232
chapper de telles temptes et une telle nuit pour placer notre vie en un sjour si calme et si lumineux (V, 7). calme de lme et la lumire de lesprit : deux traits insparables et dont lintime liaison fait loriginalit de lpicurisme. Le calme de lme ne peut tre atteint que par cette thorie gnrale de lunivers quest latomisme et qui, seule, fait disparatre toute cause de crainte et de trouble.
p.336 Le
II. LA CANONIQUE PICURIENNE
@ picure, dit Cicron, a beaucoup de mots trs brillants ; mais il ne se soucie gure de rester daccord avec lui-mme 1. Sa philosophie est en effet une de celles qui procde par des vidences discrtes et spares dont chacune se suffit elle-mme. La premire partie de cette philosophie, la canonique, qui concerne les critres ou canons de la vrit, nest rien danalogue la logique stocienne ; elle est seulement lnumration de diverses sortes dvidence ; la passion ou affection passive (), la sensation, la prnotion (), et un quatrime critre que Diogne attribue seulement aux disciples dpicure, mais que nous voyons en fait souvent employ par le matre lui-mme, le coup dil ou intuition de la rflexion ( ). La premire vidence est celle de la passion, cest--dire du plaisir et de la douleur. Aristippe aussi en avait fait un critre, mais en un sens un peu diffrent ; seul, pour lui, ltat passif est perceptible et lon ne peut en connatre srement la cause ; pour picure au contraire, lvidence porte sur la cause du critre ; le plaisir fait ncessairement connatre une cause de plaisir, qui est agrable, la souffrance, une cause de souffrance, qui est pnible 2. En faisant de la sensation (au sens passif dimpression sensible) un second critre de la vrit, picure veut dire aussi tout autre chose quAristippe : pour lui, chaque p.337 sensation, tat passif, nous renseigne dune manire tout fait sre et certaine sur la cause active qui la produite ; toutes les sensations sont galement vraies, et les objets sont exactement tels quils nous apparaissent ; il ny a aucune raison de suspecter les renseignements quelles nous donnent, condition seulement de nous y tenir, puisque, tant purement passives et irrationnelles, elles ne peuvent rien ajouter linfluence extrieure ou rien en retrancher ; et il ny a aucune raison de douter des unes plutt que des autres ; dire quune sensation est fausse reviendrait dire que rien ne peut tre peru 3. Et, si lon objecte aux picuriens ces contradictions des sens et ces illusions qui devenaient un argument courant des adversaires du dogmatisme,
1 2
Tusculanes V, 26. Comparer SEXTUS, Contre les Mathmaticiens, VII, 203, et VII, 291. 3 CICRON, Premiers Acadmiques, II, 101 (Usener, 185, 11).
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
233
ils montrent comment lerreur est non pas dans la reprsentation mais dans un jugement quy ajoute la raison ; une tour est vue ronde de loin et vue carre de prs ; on ne se trompe pas en disant quon la voit ronde, mais seulement en croyant que lon continuera la voir ronde, si lon sen approche ; la contradiction nest pas entre les reprsentations, mais entre les jugements quon y ajoute. Une confiance dans lvidence immdiate accompagne de mfiance envers tout ce quajoute la raison, telle est la marque de la doctrine de la connaissance dpicure. La tactique constante de ses adversaires a t dessayer de rduire ce dogmatisme un subjectivisme, born aux impressions immdiates ; et les picuriens sen sont toujours dfendus. Cette dfense parat tre le thme du trait de Colots, disciple immdiat dpicure, Quil nest pas possible de vivre selon les dogmes des autres philosophes. Dans ce trait, connu par la rfutation de Plutarque (Contre Colots), lpicurien attaque successivement Dmocrite pour avoir considr la connaissance sensible comme une connaissance btarde, Parmnide pour avoir ni la multiplicit des choses, Empdocle pour avoir ni la p.338 ralit des diffrences de nature entre les choses, Socrate pour avoir hsit sur des notions aussi claires que celle de lhomme, par exemple, dont il cherche la dfinition, Platon pour avoir refus la substantialit aux choses sensibles, Stilpon le Mgarique pour avoir soutenu la vieille thse ristique que rien ne peut se dire de rien, les Cyrnaques et Arcsilas qui nont point admis que nos reprsentations pussent nous conduire des ralits. Et Plutarque na pas dautre manire de rpondre que dassimiler les picuriens ceux quils veulent rfuter, tirant des textes mmes dpicure laveu de la relativit des sensations. Il y a dautres vidences immdiates que la sensation et la passion ; toute question, pour tre pose et comprise, implique que nous possdons davance la notion de la chose demande ; les dieux existent-ils ? Cet animal qui avance est-il un buf, ou un cheval ? Toutes ces questions supposent que nous avons dj la notion des dieux, du buf et du cheval, etc. antrieurement limpression sensible actuelle qui nous amne poser ces questions : prnotions intrieures lme et qui pourtant drivent des sensations prcdentes et ne sont pas du tout, comme les notions communes stociennes, le fruit dune dialectique plus ou moins arbitraire. Cest grce cette origine (origine que lon peut voir mme dans le cas des dieux, par exemple, dont la notion est ne des images trs relles que nous avons eues pendant le sommeil) que la prnotion nest jamais la notion dune chose imaginaire, mais celle dune chose existante ; et cest pourquoi Diogne Larce (X, 33) lappelle perception ou opinion droite : la prnotion implique un jugement dexistence vident ; notre exprience passe, dont elle est en quelque sorte le rsultat, na pas moins de valeur que notre exprience actuelle avec laquelle nous la confrontons. La prnotion nous permet des jugements ou croyances qui dpassent lexprience actuelle : cet homme que je vois l-bas, cest Platon, cet animal
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
234
est un buf, etc... Mais ces p.339 croyances ne seront des jugements solides que si elles sont elles-mmes ramenes des vidences sensibles immdiates, et que sil y a confirmation () alors que je vois lhomme ou lanimal de plus prs. Mais picure, on le sait, prtend arriver non seulement des vidences sur les choses sensibles, mais encore des vidences concernant les choses invisibles (), telles que le vide, les atomes, ou linfinit des mondes. Il est important de songer, si lon veut bien comprendre le canonique dpicure, quil est dune part le moraliste du plaisir, cette fin de la volont qui est saisie dune manire immdiate sans aucune construction rationnelle, et, dautre part, le rnovateur de la physique atomiste, cest--dire dune construction rationnelle de lunivers, fort loigne des impressions immdiates. Ne nous demandons pas encore quel rapport il y a entre les deux motifs, mais seulement par quelle voie (ou par quelle fissure) peut sintroduire une connaissance par pure raison ou pense ? A ct de la confirmation dune croyance par lvidence sensible, picure distingue le cas o, sans tre confirme, elle nest pas infirme. La non-infirmation ( ) est le lien de consquence qui rattache ce qui apparat avec vidence une opinion sur une chose invisible ; par exemple picure affirme quil y a du vide, chose invisible, et le prouve par cette chose vidente quest le mouvement ; car sil ny a pas de vide, il ne doit pas y avoir non plus de mouvement, puisque le corps en mouvement na pas de lieu o se dplacer, si tout est plein 1. Cest aussi par le tmoignage de lexprience immdiate que 1on voit Lucrce prouver lexistence de corps qui sont invisibles cause de leur petitesse : la force des vents que lon ne voit pas, les odeurs et les sons qui impressionnent les sens, lhumidit et le desschement, lusure lente ou laccroissement lent des objets, tous ces faits impliquent lexistence p.340 de pareils corpuscules invisibles 2. En quoi consiste cette consquence ou implication, cest ce que nos textes ne nous disent pas ; mais de lexpression mme non-infirmation, il ressort qupicure se contente dune conception des choses qui ne soit pas contredite par lexprience manifeste. Cet univers nouveau, cet univers datomes forme un tout rationnel et bien li dont les principes peuvent servir dexplication au dtail des phnomnes visibles, tels que les phnomnes clestes ou les phnomnes vitaux. picure recommande ses disciples davoir toujours devant lesprit cette vue densemble qui permet loccasion de dcouvrir le dtail, quand on a bien saisi et que lon garde en sa mmoire le dessin densemble des choses . Cette ncessit dune vue densemble est un des thmes qui revient le plus frquemment dans le pome de Lucrce : cest qu il est bien facile de dcouvrir et de voir de lil de la pense comment se forment les phnomnes
1 2
SEXTUS, Contre les Mathmaticiens, VII, 213. De la Nature, I, 265-328.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
235
mtorologiques de dtail quand on connatra bien ce qui est d aux divers lments . 1 Or cette vue densemble, pour tre assure, ne ncessite-telle pas une source dvidence distincte de celles que nous avons appris connatre ? Car il sagit ici non plus de saisir les choses invisibles dans leur liaison avec les choses manifestes, mais de les saisir en elles-mmes. Si tu penses que les atomes ne peuvent tre saisis par nul coup dil de lesprit (injectus animi = ), tu es dans une grande erreur , ou encore : Cest lesprit qui cherche comprendre ce quil y a dans linfini, hors des murailles du monde, o lintelligence veut tendre sa vue et o senvole librement le regard de lesprit (jactus animi) 2. On comprend alors sinon la nature, du moins le rle du quatrime critre, cit par Diogne, lintuition spirituelle et rflchie qui, voyant densemble lunivers ( ) et p.341 dpassant la simple intuition des sens, nous fait assister au spectacle du mcanisme universel des atomes : vidence dune autre espce que celle de la sensation, mais aussi immdiate quelle, et accompagne dun sentiment de clart et de satisfaction spirituelle que lon sent chaque page de luvre de Lucrce. Ainsi le canonique est bien une numration dvidences de nature distincte et irrductible, mais qui toutes prtendent dpasser les apparences et atteindre la ralit.
III. LA PHYSIQUE PICURIENNE
@ Dans quelles conditions et sous quelle forme picure fut-il amen remettre en honneur la physique de Dmocrite, avec laquelle nous voyons reparatre de vieilles images ioniennes que lon pouvait croire disparues, notamment celles de la pluralit des mondes et de linfini dans lequel ils puisent leur matire ? Il est certain que, avec elles et par elles, nous voyons reparatre aussi le libre esprit ionien, qui fait un tel contraste avec le rationalisme thologique que nous avons vu natre en Sicile (p. 65) et dont les stociens sont maintenant les reprsentants. Lon sait sans doute par quel canal lui arriva le systme de Dmocrite, puisquil fut llve du dmocriten Nausiphane de Tos ; mais, outre quil le dsavoue formellement comme matre et na jamais assez de railleries pour lui non plus que pour Dmocrite, on voit assez combien diffrent tait lesprit qui lanimait : picure est presque totalement tranger aux sciences positives, mathmatiques, astronomie et musique. Aussi la physique navait nullement pour lui son but en elle-mme : Si la crainte des mtores et la peur que la
1 2
DIOGNE LARCE, X, 35 ; cf. X, 83 ; LUCRCE, IV, 532-4. LUCRCE, II, 739-740 ; 1044-1047.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
236
mort ne soit quelque chose pour nous, ainsi que lignorance des limites des douleurs et des dsirs, ne venaient gner notre vie, nous naurions nullement besoin de physique 1. Il ne faut pourtant attribuer picure rien qui ressemble ltat desprit du pragmatisme ; la physique atomiste a son vidence en elle-mme, et la dmonstration de ses thormes est compltement indpendante des rsultats quelle peut avoir dans la vie morale. Une physique comme la stocienne, une dmiurgie comme celle du Time ne pourront subsister sans les croyances morales ou mtaphysiques dont elles ne sont quun aspect ; pareille hypothse na mme pas de sens ; au contraire la physique corpusculaire dpicure, frappe au coin du vers de Lucrce, reste dgage de toute implication morale, et cest elle qui reparatra, chaque fois que lesprit humain sorientera vers une vision de lunivers galement loigne, si lon peut dire, de lanthropocentrisme et du thocentrisme. Dans cette physique dont sloigne le vulgaire (retroque volgus abhorret ab hac) 2 parce quelle ne tient pas compte de ses aspirations, lon a reconnu ce vieux positivisme ionien, si ddaigneux des prjugs, si contraire au rationalisme issu de Grande-Grce toujours prt laisser place toutes les croyances populaires, faire du monde comme un thtre pour lhomme et pour Dieu.
p.342
Aussi peut-on lire en entier la Lettre Hrodote, o picure rsume pour un disciple les points capitaux de la doctrine que lon doit toujours avoir prsents en la mmoire, sans mme souponner quil prend le plaisir comme fin dans sa morale. Insistons-y bien par ce quelle a de ngatif, la physique atomistique conduit nier la plupart des croyances populaires que la physique stocienne essayait au contraire de justifier : la providence des Dieux pour les hommes et avec elle la croyance au destin, la divination et aux prsages, limmortalit de lme avec tous les mythes plus ou moins srieux sur la vie de lme en dehors du corps, qui sy rattachent ; et, tant admis que ces croyances sont pour lhomme des raisons de crainte et de trouble, la physique est capable de supprimer le trouble p.343 de lme. Mais elle ne conduit pas du tout lhdonisme. Il faut dire seulement que, si lataraxie se trouve tre un des lments de la vie de plaisir chez picure, elle contribue cette vie ; et par l se trouve justifie sa place dans les proccupations du moraliste. Mais elle na prcisment cette place que grce sa rationalit intrinsque et la valeur intellectuelle quelle revendique par elle seule. Laxiome de la cosmologie ionienne tait la conservation du tout : rien ne peut natre de rien, rien ne peut retourner au nant ; mais non point la conservation du monde ou cosmos, considr seulement comme une partie ou un aspect momentan du tout. Laxiome de la cosmologie rationaliste
1 2
Principales opinions, XI (USENER, p. 73). LUCRCE, De la Nature, VI, 19.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
237
dAristote et des platoniciens, cest au contraire la conservation du monde, identique avec le tout univers, unit parfaite qui se suffit elle-mme ; et les stociens nadmettent quen apparence la destruction du monde, puisque, dans la conflagration, cest le mme individu qui continue exister. picure part au contraire de laxiome ionien : le tout cest une infinit datomes dans linfinie grandeur du vide ; un monde cest une portion du tout qui se dtache de linfini et garde momentanment un certain ordre. Ds lors il ny a aucune raison pour que le monde possde les caractres que lui confrent les rationalistes : dabord aucune raison pour quil soit unique, puisquil reste une infinit datomes disponibles ; il y a donc une infinit de mondes ; de plus, aucune raison pour quil se suffise lui-mme, puisquil est partie du tout, et les atomes peuvent passer dun monde lautre ; aucune raison pour que les mondes soient dun type unique et quils aient par exemple la mme forme et contiennent les mmes espces dtres vivants ; il en est au contraire de fort diffrents, dus la diversit des semences dont ils sont forms. Autant de thses de cosmologie ionienne reprises par picure, et qui sont, quon le remarque bien, indpendantes de la physique atomistique. Mais la thse particulire de lexistence des atomes est pourtant rattache laxiome gnral ; p.344 cest parce que rien ne peut venir de rien ni revenir rien quil faut admettre que tout corps visible est form datomes, cest--dire de masses inscables, trop petites pour tre visibles, dont se composent les corps et dans lesquels ils se rsolvent ; solides ternels et immuables par leur fonction, puisquils servent de points de dpart fixes la gense et de limite fixe la corruption. Dailleurs des phnomnes, comme la force du vent, les odeurs ou les sons qui se rpandent, lvaporation, lusure ou laccroissement lents tmoignent (par le procd de la non-infirmation) de lexistence de ces corps. La continuit de la matire, en apparence constate par les sens, est une illusion : tel un troupeau de moutons qui, vu de loin, parat tre une tache blanche immobile 1. Pour bien comprendre la nature de latome picurien et surtout pour viter toute confusion avec latomisme moderne il est une remarque quil importe de ne pas perdre de vue : cest que la nature de latome est dtermine par sa fonction, qui est de former les divers composs ; cest un principe sous-jacent la physique picurienne, que lon ne peut faire nimporte quoi avec nimporte quels atomes ; un tre dune espce donne exige des atomes dune espce galement donne ; les atomes ne sont pas des units toutes identiques entre elles de telle sorte que la diversit des composs entre eux ne viendrait que du mode de liaison et de connexion de ces units identiques ; en ralit pour former une me, un dieu, un corps humain, etc., il faut chaque fois des atomes despce diffrente. Une des preuves que Lucrce donne de lexistence des atomes est fort remarquable cet gard (I, 160-175) : la fixit des espces travers le temps, dit-il, est une loi absolue de la nature ; il sensuit que les
1
LUCRCE, De la Nature, II, 308-332.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
238
lments qui servent composer les individus de chaque espce, doivent, eux aussi, tre fixes. Loin que lesprit de latomisme aille, comme il serait naturel de le penser, contre p.345 lide dune classification stable (aristotlicienne) des choses, il en tire au contraire argument ; et la classification des atomes en espces reproduit en miniature celle des choses sensibles. Aussi les atomes sont non seulement les composants, mais les semences des choses (, semina rerum), et cest en effet par la forme des atomes composants plutt que par leur mode de composition que nous verrons sexpliquer les proprits des composs. Et cest pourquoi sans doute latome est dfini non pas comme un minimum (car tous les minima sont gaux et sans forme), mais comme une grandeur inscable quoique non prcisment indivisible. picure, on la vu, ne tire pas argument, pour conclure aux atomes, de limpossibilit de la division linfini. Cette impossibilit picure ladmet aussi, mais elle le fait conclure non pas des atomes, mais des minima tous gaux entre eux. Ces minima rels sont conus par analogie avec les minima visibles, cest--dire avec la dimension la plus petite que puisse voir lil ; comme le champ visuel est compos de ces minima visibles, qui servent dunits de mesure, ainsi la grandeur relle est faite de minima rels, et elle est plus ou moins grande, selon quelle en contient plus ou moins. Cette thorie des minima servait, semble-t-il, picure, rsoudre laporie de Znon dEle sur le mouvement 1 ; le mobile allant dun point un autre na pas parcourir une infinit de positions, mais seulement un nombre fini de minima, par un nombre fini de bonds indivisibles. Latome, lui, tant donn les proprits dont il a rendre compte, doit avoir une grandeur et une forme inaltrables, cest--dire tre compos de minima placs dans une position relative fixe. Cette grandeur ne va jamais dailleurs jusqu rendre latome visible ; quant la diversit des formes, elle est aussi grande mais pas plus grande quil ne faut pour p.346 expliquer les proprits des composs ; aussi, le nombre des espces datomes est impossible saisir), puisque dans notre seul monde nous ne connaissons pas toutes les espces dtres, mais il nest pas infini. Il faut expliquer maintenant la cause du mouvement ternel, sans commencement ni fin, qui, selon lhypothse ionienne, anime linfinit des atomes disperss dans le vide infini. Il ne sagit point ici dun principe transcendant dorganisation, tel que celui des cosmologies rationalistes, pense motrice ou dmiurge, qui, mme lorsque leur action est ternelle, la traduisent par des mouvements priodiques ayant un commencement et une fin, mais dune cause de mouvement immanente et permanente attache la nature de latome. Cette cause est la pesanteur qui produit en tous les atomes, de toute forme et de tout poids, un mouvement de mme direction (de haut en bas) et dgale vitesse. picure recueille comme un cho de lenseignement
1
SIMPLICIUS, in Aristotelis physica, p. 232 a 23 (Usener, 137.9).
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
239
dAristote, lorsquil explique pourquoi tous ces mouvements sont les mmes, si diffrents que soient les atomes : c est que les diffrences de vitesse ne peuvent tre dues qu la diffrence de rsistance des milieux que les mobiles traversent ; le vide offrant une rsistance nulle, toutes les vitesses sont gales. Il faut dailleurs distinguer de cette pesanteur universelle qui emporte uniformment les atomes vers le bas dun mouvement trs rapide, le poids propre de chaque atome qui intervient dans la force plus ou moins grande avec laquelle latome rejaillit sur les autres. Grandeur, forme, pesanteur, telles sont les trois proprits inhrentes chaque masse atomique. Mais ces proprits nexpliquent pas encore pourquoi les atomes se combinent, puisque, tombant paralllement et avec la mme vitesse, ils ne se rencontreront jamais. Cette rencontre, avec tous les chocs, rejaillissements et entrelacements qui sensuivent, ne peut se produire moins que certains dentre eux ne dvient de leur trajectoire ; cette dviation a lieu spontanment un moment p.347 et en un lieu compltement indtermin, puisquelle est sans cause ; et il suffit dailleurs quelle soit extrmement petite. Telle est la clbre dclinaison des atomes (clinamen), qui a tant excit la raillerie des adversaires dpicure ; elle peut tre considre comme le type mme du coup de pouce donn par un physicien gn de ne pas voir les faits cadrer avec sa thorie ; ctait, comme le remarque saint Augustin 1, abandonner tout lhritage de Dmocrite. Gnait-elle ce point les picuriens ? Rappelons-nous le rythme particulier de la pense dpicure, introduisant chacune des grandes thses de sa philosophie avec son vidence propre, distincte, sans se soucier de les driver dune source commune. Or les picuriens ont au moins cherch, sils ny ont pas russi, prsenter la dclinaison comme une vidence de ce genre, non pas une vidence primaire et sensible, puisque lobliquit de la dclinaison est infrieure celle que nos sens peuvent percevoir, mais une de ces vidences qui appartient toute chose invisible que les apparences ninfirment pas. Car nous constatons un phnomne trs certain, cest celui de la volont libre : lon sent directement dans leffort lopposition entre le mouvement naturel du corps et celui qui est cr par lme, et lon a une conscience immdiate du contraste entre le mouvement volontaire ou libre et le mouvement driv dune impulsion extrieure. Or si la dclinaison existe en un compos comme lme, comme lvidence le prouve, il faut quelle existe dans les atomes composants 2. Que pourrait-on opposer aux picuriens sinon le principe de la ncessit de tous les vnements ? mais cest un principe quon leur prte gratuitement. La ncessit, telle quon lentend cette poque, cest le destin des Stociens, cest--dire un ordre dtermin dans les mouvements, ordre dtermin qui fait du cosmos le tmoignage dune pense rationnelle et p.348 divine. Ainsi
1 2
Contre les Acadmiciens, III, 23. LUCRCE, De la Nature, II, 251-293.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
240
entendue, la ncessit est aussi oppose quil est possible la pense dpicure : Il vaudrait mieux encore, dit-il, accepter les fables relatives aux dieux que le destin des physiciens 1 ; cest tout dire, quand on sait la haine quil porte ces fables. On voit donc comment picure pouvait tre amen accepter et voiler la contradiction flagrante quil y a entre laffirmation de la dclinaison et celle de la pesanteur universelle. Lordre actuel des choses que nous appelons le monde est une des mille combinaisons qui se sont produites dans linfinit du temps et de lespace. Les nombreux lments, depuis un temps infini, sous limpulsion des chocs quils reoivent et de leur propre poids, sassemblent de mille manires et essayent toutes les combinaisons quils peuvent former entre eux, si bien que, par lpreuve quils font de tous les genres dunion et de mouvement, ils en arrivent se grouper soudainement en des ensembles qui forment lorigine de ces grandes masses, la terre, la mer, le ciel et les tres vivants 2 . On voit que pour picure, dont Lucrce reproduit ici la pense, il sagit moins de nier lunit et lautonomie du cosmos que de lexpliquer sans avoir recours une origine providentielle. Le cosmos est une russite, aprs mille essais infructueux. Il faut encore montrer ici combien le mcanisme dpicure est loin du mcanisme moderne ; il ne sagit pas de faire voir dans la combinaison actuellement produite un rsultat des lois du mouvement ; mais, tant suppos que tout ce quil faut de matire et datomes pour produire notre monde se trouve par hasard rassembl, il sagit dexpliquer comment les divers tres contenus dans ce chaos seront amens au jour par une volution progressive. Dans cette explication, il ny a dailleurs nulle unit de principe : on peut lire des centaines de vers du livre V de Lucrce, qui y traite de la formation du ciel et de la terre, sans y trouver la moindre allusion la doctrine des p.349 atomes ; limportant pour lui est de recueillir lutile dans les vielles explications que la physique ionienne donnait des phnomnes clestes ou terrestres ; peu importe que lon explique avec Dmocrite le mouvement du soleil sur lcliptique par le fait quil est emport moins vite que les fixes avec le mouvement tourbillonnaire du ciel, ou bien par des courants dair venus des extrmits de laxe du monde et chassant le soleil vers lun ou lautre tropique ; ce quil faut, cest refuser ces masses de feu une me intelligente qui les dirige et par elle mne les choses clestes. Ne le voit-on pas aller jusqu prsenter comme possible lantique supposition quun nouveau soleil se cre chaque matin 3 ! Nous sommes en de de cette astronomie gomtrique, qui nous avait constitu un ciel spar des mtores et de nature diffrente de la terre. On sait le peu dimportance qupicure attachait au dtail de lexplication. Nous avons besoin dun coup dil densemble, dit-il au dbut de la lettre
1 2
DIOGNE LARCE, X, 134. LUCRCE, V, 422-431. 3 De la Nature, V, 660-662.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
241
Hrodote (X, 35), mais non pas autant de vues particulires ; il faut retenir en sa mmoire ce qui donne une vue densemble des choses ; cela permettra de dcouvrir le dtail, pour peu que lon saisisse bien et que lon ait bien en mmoire les ensembles. Et plus loin (79) il fait une opposition des plus instructives entre ceux qui ont tudi tous les dtails de lastronomie, qui connaissent le coucher et le lever des astres, les clipses et choses analogues et pourtant gardent la mme crainte de toutes les choses clestes, parce quils ignorent quelles sont leur nature et leurs causes principales . Il faut laisser de ct tout ce dtail pour aller directement la cause de tous les mtores. Il suffit que la cause les explique ; il nest pas besoin que ce soit la cause relle. Le mme fait peut tre produit par plusieurs causes, et il suffit de dterminer les causes possibles. Lclipse de soleil 1 peut tre produite par linterposition de la lune, mais aussi par p.350 linterposition dun corps dailleurs invisible, ou encore par lextinction momentane du soleil ; nul besoin de choisir entre elles, puisque lune quelconque suffit nous enlever la crainte de lclipse. On voit encore une fois que ces explications ne sont pas toutes lies, tant sen faut, latomisme ; cest toute la physique ionienne qui revient. Cette physique esquissait aussi, on sen souvient, une histoire tout fait positive des animaux, et du dveloppement graduel de la raison humaine, des techniques et des cits ; oppose lhistoire mythique, qui montre lhomme cr et protg par les dieux, elle insiste sur le rle de leffort humain dans le lent passage de lanimalit la vie des cits sans admettre dailleurs quil y ait ni vritable progrs ni supriorit de lune sur lautre. Les picuriens annexent tout naturellement cette histoire positive de lhumanit, qui fait lobjet de la fin du livre V de Lucrce. picure a eu certainement en vue quelque chose de semblable, lorsque, vers la fin de la Lettre Hrodote, il nous dit que ce sont les choses elles-mmes qui ont la plupart du temps instruit et contraint la nature humaine, et que la raison na fait que prciser ensuite ce quelle en avait reu ; le langage par exemple est dabord fait des missions vocales qui accompagnent chez lhomme les passions et les reprsentations ; plus tard chaque peuple convient dutiliser les missions vocales qui lui sont propres pour dsigner les objets. Comme le langage, la justice est aussi dinstitution humaine. Entre les animaux qui nont pu faire de conventions pour ne pas se nuire rciproquement, il ny a ni justice ni injustice ; et il en est de mme des nations qui nont ni pu ni voulu faire de conventions pour le mme objet 2. Le monde dpicure est un des moins systmatiques qui soit ; tandis que les vies individuelles sont chez les Stociens p.351 des aspects ou formes de la vie universelle et que la psychologie est troitement dpendante de la cosmologie, au contraire le monde dpicure qui na point dme ne peut produire lme individuelle, la seule que connaisse picure. Si des mes se trouvent dans le monde, cest par la rencontre fortuite des atomes qui la
1 2
LUCRCE, liv. V, 751-761. Opinions principales, XXXII (USENER, p. 78).
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
242
composent. De l cette singularit qupicure (et Lucrce) traitent de la nature de lme (livre III) avant de parler de la formation du monde et de celle des tres vivants (livre V), et que ltude de la nature humaine se trouve scinde en deux parts distinctes sans aucune relation visible, la psychologie et lhistoire de lhumanit. Le grand intrt de la psychologie pour picure, cest que ltude rationnelle de lme fait vanouir tous les mythes sur la destine, et, avec eux, une des principales causes du malheur et de lagitation des hommes ; forme avec le corps et prissant avec lui, elle na pas songer un avenir qui ne la regarde en rien. A la vie ternelle, Lucrce oppose la mditation de la mort immortelle , de cette infinit de temps pendant lequel nous navons pas t et ne serons plus. La psychologie est expose par picure en des termes un peu vagues et gnraux dans la Lettre Hrodote ; lme est un corps semblable un souffle mlang de chaud, pourtant beaucoup plus subtil que le souffle et le chaud que nous connaissons ; en ce mlange se trouvent toutes les puissances de lme, ses affections, ses mouvements, ses penses, ainsi que sa puissance vitale. Mais pour quil y ait sensation, il faut que lme soit lie au corps ; cest le corps qui fait que lme peut exercer sa facult de sentir, et cest elle en revanche qui rend le corps sensible ; leur agrgat dtruit, lme se dissipe. Cest une question insoluble de savoir si la thorie complexe et dtaille de lme quexpose Lucrce et que Plutarque, dans le Contre Colots, et Atius, dans sa Doxographie, rapportent aux picuriens, remonte picure lui-mme. Il est probable, daprs le texte de Plutarque, quil a t conduit cette thorie plus p.352 ample, cause de limpossibilit dattribuer ce souffle chaud autre chose que des proprits vitales ; jugement, souvenir, amour et haine, tout cela ne peut sattribuer au souffle chaud, et il faut lintervention dune espce particulire datomes. Il sensuit que lme doit tre forme dun groupement de quatre espces diffrentes datomes : atomes de souffle, atomes dair, atomes de chaud, et enfin atomes dune quatrime espce qui na pas de nom, corps dune subtilit et dune mobilit assez grandes pour expliquer la vivacit de la pense. Lintroduction de cette quatrime substance innomme, qui est, selon Plutarque, laveu dune ignorance honteuse , est bien dans la manire dpicure ; chaque phnomne son explication : le corps vivant est un corps chaud qui tantt se meut, tantt sarrte ; chacune de ses particularits vient dune des substances composantes de lme, le mouvement vient du souffle, le repos de lair, la chaleur du chaud ; et la proportion diverse de ces trois substances explique la diversit des tempraments, lardeur du lion et la timidit du cerf. Il faut bien une quatrime substance pour expliquer le phnomne non moins vident de la pense. Il semble que cest une considration du mme genre qui a conduit Lucrce (ou son modle) admettre encore une autre distinction, celle de lesprit (animas) et de lme (anima). Lhomme a des penses, des raisonnements, des volonts, des joies et des haines tout fait part du corps ;
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
243
on ne peut donc attribuer ces phnomnes une substance rpandue travers tout le corps. Il faut les rapporter un esprit (animus) quon localisera dans le cur, puisquon y sent les mouvements de la peur ou de la joie, et que lon distinguera de lme (anima), dissmine dans toutes les parties du corps. Entre cette nouvelle distinction et celle des quatre substances, le rapport nest pas clair, et Lucrce ne lindique nulle part ; il faut en tout cas se garder didentifier, comme on le fait quelquefois, lesprit (animus) la quatrime substance, p.353 linnomme, ce qui donnerait lanimus peu prs le rle que possde la partie principale dans lme selon les stociens ; ce serait accorder lme une sorte dunit par hirarchie, qui est tout ce quil y a de plus contraire lintention dpicure. De plus, ce serait contraire la fonction principale de la substance sans nom qui est de rpandre dans les membres les mouvements sensitifs (III, 245) . Mlangs parmi les veines et la chair, et retenus ainsi par lensemble du corps, les atomes de la quatrime substance produisent cette sorte dbranlement local que Lucrce appelle motus sensifer, grce auquel la partie de lorganisme branle sera sensible aux excitants : car cest un dogme important des picuriens que la sensation se produit au lieu mme o lexcitant est senti, et ils nadmettent pas, comme les Stociens, que lexcitation doit dabord tre transmise la partie hgmonique. Toute la thorie vise, on le voit, parpiller en quelque sorte la substance et les facults de lme, en ne leur crant dautre lien durable que leur prsence dans le corps et en rendant ainsi ncessaire cette dissolution de lme aprs la mort, que Lucrce dmontre par des arguments si varis. Le problme du mode daction des sensibles sur la sensation est li traditionnellement au problme de lme. picure lui donne une place de premier plan dans la Lettre Hrodote (X, 46-5), puisque cest le premier problme quil aborde aprs les thormes gnraux de la physique, et Lucrce lui consacre le quatrime livre entier. Le secret de cet intrt est comme toujours un intrt pratique ; il sagit denlever toute signification redoutable aux visions du rve dont les hommes font des prsages envoys par les dieux ou bien o ils voient les spectres terrifiants des trpasss. A ces terreurs, picure oppose la thorie rationnelle de la vision : de la surface des objets se dtachent sans cesse des simulacres (), sortes de pellicules trs fines, animes dun mouvement rapide, assez subtiles pour trouver passage travers lair en gardant la forme p.354 des objets do elles manent constamment ; ce sont ces simulacres qui, rencontrant lil, produisent la vision. Mais les images du rve ou de limagination ne sont pas dune autre nature ; ce sont aussi des simulacres manant des objets, ils sont seulement encore plus subtils et plus fins que ceux de la vision, et, traversant les organes des sens, ils arrivent directement lesprit ; limagination ne fonctionne donc pas autrement que la vue ; en apparence, il en est autrement, et, puisque nous sommes matres de nous reprsenter une image volont, il semblerait que nous produisons les images ; en ralit, si limage que nous voulons nous apparat, cest que lesprit est sans cesse assailli de milliers de simulacres dont
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
244
seuls limpressionnent ceux sur qui il dirige son attention. Il faut ajouter que ces simulacres, en se dplaant, se dforment, quils susent, perdent des parties ou encore fusionnent entre eux ; cest pourquoi le simulacre dune tour carre nous la fait voir ronde ; cest pourquoi aussi nous voyons en rve des monstres si tranges ; explication naturelle et rassurante des objets qui nous font frmir. Cette thorie de la vision, comme celle de loue et de lodorat, est une thorie de lmission qui contraste fort avec celle des Stociens ; partout o les Stociens parlent de souffles tendus entre lobjet et lorgane des sens, de transmission de forces travers un milieu, picure ne parle que de mouvement et de choc. picure na jamais ni lexistence des dieux ; ce serait nier lvidence : nous voyons en rve et mme pendant la veille les simulacres des dieux ; cest une exprience prolonge et universelle qui suffit prouver leur existence. De ces dieux, nous avons une prnotion ; nous savons quil sagit dtres parfaitement heureux et vivant dans une paix inaltrable. Mais ces prnotions nous ajoutons des opinions ; nous croyons quils soccupent des affaires des hommes, quils manifestent leur volont par des prsages, et notre vie se remplit de superstitions : nous leur immolons des victimes et parfois des p.355 victimes humaines pour leur demander secours ou les apaiser. Or ces croyances sont fausses, puisquelles contredisent notre prnotion ; un tre parfaitement heureux et calme ne peut avoir tous les soucis et les sentiments que nous leur attribuons. La physique tout entire dmontre que ni le monde ni aucune de ses parties ni mme lhistoire de lhumanit ne nous amnent Dieu comme sa cause ; et Lucrce, avec sa vision pessimiste des choses, ajoute quil serait impie dattribuer la volont de ces tres parfaits un monde si plein dimperfections et de misres. Il faut donc refuser aux Dieux comme lme tout rle cosmologique et physique : faits dune matire pure, vivant labri des chocs dans les intervalles des mondes, incorruptibles parce que prservs des causes de destruction, ils mnent une vie parfaitement calme et heureuse, dont la contemplation et la mditation sont la seule pit qui convient au sage sorte de paganisme pur qui nest sans doute pas sans rapport avec le culte des hros.
IV. LA MORALE PICURIENNE
@ Nous navons dautre source importante sur la morale dpicure que la courte Lettre Mnce ; on peut la complter par lexpos du premier livre du trait Des Fins de Cicron qui lemprunte des leons ou des traits des picuriens de son temps, Znon ou Philodme. La Lettre est moins un expos systmatique que lensemble des thmes que doit mditer nuit et jour lpicurien pour vivre en dieu parmi les hommes .
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
245
Il y a dans cette morale, comme deux motifs de pense dont il nest pas ais de voir laccord : dune part, la fin est le plaisir, puisque les animaux comme les hommes recherchent naturellement le plaisir et fuient la douleur, ds la naissance et sans lavoir appris : il y a l une sorte dvidence quil p.356 suffit de faire remarquer et qui se passe de dmonstration : Dautre part le sage est celui qui atteint labsence de trouble (ataraxie), le calme, la paix de lme, que lon obtient en supprimant lagitation des dsirs et des craintes qui assaillent le vulgaire : srnit un peu hautaine dun intellectuel qui a rejet le monde tragique des religions et des mythes, grce la claire vision qui vient des Ioniens : ne craignant plus les dieux, ne craignant plus la mort, et bornant ses dsirs, il atteint le bonheur. Mais cette ataraxie nest nullement prsente comme une fin () ; la seule fin quait jamais admise picure est le plaisir ; lataraxie nest donc estimable quautant quelle se subordonne cette fin, quelle est productrice de plaisir. La relation entre ces deux motifs de pense est bien en effet tout le problme de la morale dpicure ; on sait combien elle est difficile saisir : de trs bonne heure, ses adversaires, de bonne ou de mauvaise foi, prenaient texte du premier de ces motifs pour montrer dans les picuriens des hommes livrs des dsirs sans frein, des dbauchs menant la vie de Sardanapale ; et ils scrutaient la vie intime des amis du jardin pour en dnoncer les scandales. Dautre part, mieux inform, on ne pouvait que reconnatre llvation morale de ses prceptes et lon sait ladmiration queurent pour eux le Stocien Snque, qui en cite un certain nombre, et mme le Noplatonicien Porphyre 1 ; picure dailleurs proteste lui-mme avec force contre ce quil considre comme un malentendu : Lorsque nous disons que le plaisir est la fin, nous ne voulons pas parler du plaisir des dbauchs et des jouisseurs. Si bien que, oblig dadmettre la fois quil tait hdoniste en thorie et sobre et vertueux en pratique, on en arrivait (cest la constante critique de Cicron) laccuser de contradiction et incriminer son intelligence et lacuit de son esprit plus que son caractre et ses murs. est-il bien ainsi et valait-il mieux que sa doctrine ? picure conoit le plaisir tout autrement que les cyrnaques, et il est sur ce point en controverse ouverte avec eux. En premier lieu, picure nadmettait quun seul plaisir, celui que lon sent avec vidence ; le plaisir corporel, quil appelait plaisir de la chair ou plaisir du ventre. Je ne puis concevoir le bien, disait-il, si je supprime les plaisirs du got, ceux de lamour, ceux des sons, ceux des formes visibles 2. Il supprimait les prtendus plaisirs de lesprit quadmettaient les Cyrnaques. Sans doute il y a une joie qui appartient lme ; mais cette joie nest jamais que le souvenir ou lanticipation des plaisirs du corps ; aucune joie ne viendrait de lamiti, par exemple, si lon ne
1 2 p.357 En
Lettres Lucilius, 9, 21, etc. ; PORPHYRE, Lettre Marcella, 27-30. DIOGNE LARCE, X, 6 (USENER, p. 120).
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
246
considrait lami comme une promesse de scurit et une sorte de garantie contre la souffrance ; la joie intellectuelle est celle de latomiste dont la thorie supprime la crainte des souffrances corporelles qui, daprs les fausses croyances, nous attendent aprs la mort. En second lieu, ce plaisir du ventre nest pas tel que limaginent les Cyrnaques, un mouvement et une agitation. Il suffit de considrer que lhomme, au dbut de sa vie et lorsque ses inclinations nont pas t dpraves, ne recherche le plaisir que lorsquil ressent un besoin ou une douleur, faim ou soif ; ds que la douleur a disparu, il ne cherche plus rien. Il sensuit que le plus haut degr du plaisir, tel quil est dtermin par la nature, nest que la suppression de la douleur. Une fois la douleur supprime, le plaisir peut tre vari mais non pas augment ; on peut apaiser sa faim avec des mets trs diffrents, lapaisement de la faim restera toujours le plus haut plaisir que lon puisse atteindre. Entre le plaisir et la douleur il nest pas dtat indiffrent. Tel est le souverain bien picurien que lcrivain chrtien Lactance dclarait tre lidal dun malade qui attend du mdecin sa gurison 1. De fait il est fort probable que cette conception si inattendue p.358 du plaisir corporel est en rapport avec ce que nous savons de la dlicate sant dpicure ; et lorsquil nous dit que le vrai plaisir est un plaisir en repos ( ), il faut entendre sans doute par l cet heureux quilibre du corps ( ), en quoi consistent la sant et lapaisement des besoins naturels satisfaits. Mais cet idal mme nous indique une rgle daction. Tout plaisir, dit picure, est par sa nature propre un bien ; mais tout plaisir nest pas choisi par la volont ; de mme toute souffrance est un mal, mais toute souffrance nest pas volontairement vite 2. Ceci va, et peut-tre avec intention, contre un principe fondamental du stocisme : Le bien est toujours choisi par la volont 3 . Cette notion commune renversait lhdonisme moins quil nadmt cette licence sans frein que lui prtent ses adversaires ; sinon, il fallait nier ce prtendu principe de sens commun. picure suit peut-tre ici les Cyrnaques. il distingue la fin, objet de linclination immdiate. de lobjet, de la volont rflchie, comme, ceux-ci distinguaient la fin ou plaisir, du bonheur, fait de lensemble des plaisirs. Linclination nous porte au plaisir ; la rflexion, aide par lexprience, doit peser les consquences de chaque plaisir ; nous dlaissons alors les plaisirs dont vient un surplus de peines, comme nous supportons des souffrances dont nous tirerons un plus grand plaisir. La pense rflchie intervient encore pour calmer et supprimer les dsirs qui, tant impossibles satisfaire, engendrent de nouvelles douleurs. hachant
1 2
De linstitution divine, III, 8, 10. DIOGNE LARCE, X, 129. 3 PLUTARQUE, Contradictions des Stociens, XIII.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
247
en effet que le plus haut degr du plaisir est la suppression de la douleur, nous pouvons dterminer plusieurs catgories de dsirs, les dsirs naturels et ncessaires, dont la satisfaction est indispensable : tels le dsir de manger ou de boire ; les dsirs naturels et non ncessaires qui se rapportent des objets qui varient seulement la satisfaction p.359 du besoin, par exemple le dsir de manger dun certain mets, dont la satisfaction par hypothse najoute rien au plaisir ; les dsirs qui ne sont ni naturels ni ncessaires, mais vides, tels que le dsir dune couronne ou dune statue. Le sage est celui qui sait que le plus haut degr de plaisir peut tre atteint par la satisfaction du premier genre de dsirs et qui, avec un peu de pain et deau, rivalise de flicit avec Jupiter . Cette pense rend le sage peu prs indpendant des circonstances extrieures, puisque ses besoins sont rduits si peu 1. Le dsir, on le voit, trouve sa rgle et sa borne non dans une volont qui soppose lui, mais dans le plaisir mme, compris comme il doit ltre. Mais lpicurien ne peut mconnatre que la douleur, pure passion, atteint lhomme en dehors de toute prvision et de toute volont. Comment maintenir inaltr le bonheur du sage, o le bien dpend du hasard des impressions successives, sans que nous puissions y opposer aucune volont ? Cest dabord par des aphorismes tels que ceux-ci : Une douleur forte est brve ; une douleur prolonge est faible : Mais cest surtout en quilibrant la douleur actuelle par la reprsentation des plaisirs passs et par lanticipation des plaisirs futurs. La reprsentation dun plaisir pass est elle-mme un plaisir, tel est le postulat picurien qui a t si prement contest par les adversaires ; et Plutarque demande si le souvenir dun plaisir pass naggrave pas notre peine actuelle. Il semble pourtant que cette vie de souvenirs et despoirs a t celle qui a procur le calme picure vieilli et malade : sur le point de mourir il crit Idomne : Je vous cris la fin dun heureux jour de ma vie : mes maladies ne me laissent pas et elles ne peuvent plus augmenter ; tout cela joppose la joie qui est dans mon me au souvenir de nos discussions passes 2. Par cette espce dexercice dimagination auquel nous invite picure, le sage p.360 se cre des joies permanentes parmi lesquelles il faut mettre au premier rang celles de lamiti. Inversement le souvenir des peines et surtout lapprhension des peines ou la crainte sont eux-mmes des peines prsentes. On sait comment picure lutte contre celles de ces craintes qui engendrent les plus grands maux parmi les hommes, la crainte des dieux et la crainte de la mort ; les dieux bienheureux ne sont pas craindre, et la mort non plus, si lme est mortelle ; car alors la mort nest rien pour nous, puisque nous devrions sentir pour en souffrir. Pour bien apprcier cette attitude dpicure, il faut savoir quil avait lutter non seulement contre ceux qui craignaient la mort comme le plus grand des maux, mais contre les pessimistes qui lappelaient de leurs vux et
1 2
DIOGNE LARCE, X, 127 ; ELIEN, Histoires diverses, IV, 13 (UBENER, p. 339). DIOGNE LARCE, X, 22.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
248
trouvaient avec Thognis que le meilleur est de ne pas natre mais au moins, une fois ns, de passer le plus vite possible les portes de lAchron 1 . Le nant ne doit pas tre plus dsir que craint. On voit que la morale dpicure est une srie de recettes ou dexercices qui empchent notre pense de divaguer et de nous emporter notre dtriment au del des bornes fixes par la nature. On voit alors la liaison intime quil y a entre les deux motifs de pense que nous distinguions : si la recherche du plaisir est dfinie comme il faut, elle implique tous ces exercices de pense, mditation sur la borne naturelle des dsirs, calcul des plaisirs, reprsentation des plaisirs passs ou futurs dont le ct ngatif, en quelque sorte, est lataraxie de lme. En cet exercice naissent les vertus qui sont insparables de la vie de plaisir et en particulier la prudence, plus prcieuse que la philosophie elle-mme 2 , la prudence qui nest autre chose que la volont claire que nous avons dcrite. Toutes nos vertus ne sont, comme elle, que des moyens de scurit pour nous garantir des peines : telle est en particulier la p.361 justice dont le plus grand fruit est lataraxie 3 ; elle est faite de conventions positives par lesquelles les hommes sengagent ne pas se nuire rciproquement ; mais il est bien entendu que chacun de nous accepte les lois pour se protger personnellement contre linjustice et quil naura aucun scrupule les violer, sil y a quelque intrt et peut le faire en toute scurit. picure admet donc en somme, dans ses vues sur la socit, tout le conventionalisme des sophistes, sans orienter pourtant le moins du monde vers le cosmopolitisme des stociens. Nous voyons dans Plutarque Colots polmiquer contre les cyniques pour dfendre ltat, mais seulement parce quun gouvernement fort est une garantie pour lindividu. Ce nest pas qu sa manire picure naccepte une espce de droit naturel : Le droit naturel est lexpression de ce qui sert aux hommes ne pas se nuire les uns aux autres 4. Il nen est pas moins vrai que la justice reste relative aux pays. En gnral lpicurien, sil ne se refuse pas compltement participer la vie politique, cherche, moins dexception, vivre cach 5 et rester simple particulier. Bibliographie @
1 2
DIOGNE LARCE, X, 126. DIOGNE LARCE, X, 132 [prudence]. 3 CLMENT DALEXANDRIE, Stromates, VI, 2 (USENER, p. 317). 4 Opinions principales, XXXI (USENER, 78) ; Cf. STOBE, Florilge, 43, 139 (USENER, 320). 5 USENER, p. 328.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
249
CHAPITRE IV PRDICATION MORALE, SCEPTICISME ET NOUVELLE ACADMIE AUX IIIe ET IIe SICLES
I. POLYSTRATE LPICURIEN
@ Il est impossible de mieux saisir les courants dides qui agitaient les esprits vers le milieu du IIIe sicle que dans le petit trait Du Mpris irraisonn de Polystrate 1 qui succda Hermarque la tte de lcole dpicure vers 250. Cest une espce de protreptique, o lauteur engage un jeune homme quitter les autres coles pour entrer dans lcole picurienne.
p.363
On a vu que les picuriens niaient peu prs tout ce que les Stociens considraient comme le fondement assur de la vie morale : providence des dieux, me du monde, unicit du monde et sympathie entre ses parties, destin, divination par les signes, toutes ces affirmations tant lies ensemble par la dialectique. Mais le dogmatisme stocien trouvait en mme temps dautres adversaires, les sceptiques et les nouveaux acadmiciens qui prtendaient garder intact lesprit de Platon contre le dogmatisme envahissant. Polystrate sadresse un jeune homme qui est prs dtre sduit par cet antidogmatisme sceptique ; il y trouve en effet ce que les picuriens lui proposaient, limpassibilit obtenue par la sagesse, capable de supprimer le trouble vain qui p.364 vient des songes, des signes et de tout ce qui nous agite vainement (colonne I a). Mais cette sagesse opre avec une mthode et dans un esprit tout diffrents ; les picuriens motivaient leurs ngations par une physique fonde sur lvidence ; au contraire les adversaires dont parle Polystrate, pour branler ces opinions fausses, critiquent toutes les connaissances et mme les plus certaines. Ils y emploient la mthode qui est la plus odieuse un picurien, la dialectique, qui sert plutt branler lopinion dautrui qu produire en eux-mmes lataraxie dont ils se vantent (colonne XII a). Ils dmontrent, en sappuyant sur la diversit des opinions des hommes, quil ny a ni beau ni laid, ni bien ni mal, ni rien de pareil. Embarrassant notre vie des embarras des autres hommes , ils deviennent incapables de distinguer quelle fin recherche notre nature et de quoi cette fin se compose . On ne peut dfinir dune manire plus prcise la dialectique, qui consiste en effet faire dcouvrir chacun lincertitude de ses propres opinions.
1
dition Teubner dun papyrus dHerculanum.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
250
Quels sont les philosophes viss par Polystrate ? II ne mentionne, dans le texte conserv, que la secte de ceux qui se nomment les impassibles et les cyniques, dont, en effet, on se rappelle le conventionalisme (colonne XII a) ; mais il ajoute quil vient de parler dautres philosophes qui suivent la mme mthode. Nous saisissons donc l tout un courant de pense trs distinct du stocisme et de lpicurisme, daccord avec le stocisme pour employer la dialectique et avec lpicurisme pour nier les croyances stociennes, mais radicalement hostile au dogmatisme de lun et de lautre. Le trait le plus gnral de ce courant de pense, cest lhostilit la physique au sens plein du mot, cest--dire une conception densemble du monde, objet dune foi () certaine et sur laquelle sappuie la vie morale. A ce dogmatisme, tout ce courant philosophique oppose une sorte dhumanisme qui ramne constamment la pense des choses extrieures qui nous sont inaccessibles la p.365 mditation sur les conditions humaines de lactivit intellectuelle et morale. Ce sont les aspects fort divers de ce courant au IIIe et au IIe sicle que nous tudions en ce chapitre.
II. LHDONISME CYNIQUE
@ Une de ses premires manifestations est la continuation, sous diverses formes, des coles socratiques. Le cyrnasme notamment, prend vers le milieu du IIIe sicle des formes tout fait inattendues. Il aboutissait chez Hgsias un pessimisme dcourag qui confine lindiffrence 1. Si le bonheur, comme le veut Aristippe, est la somme des plaisirs, il ne peut tre atteint ; car nous voyons le corps rempli de maux, dont lme est trouble par sympathie ; nous voyons le sort mettre nant nos espoirs. Sil est vrai que le plaisir est notre fin, cest dire quil ny a aucune fin naturelle ; car la raret, la nouveaut et la satit le forment et le font disparatre. Quimporte aussi ltat desclavage ou de libert, de richesse ou de pauvret, de noblesse ou dobscurit, puisquaucun deux ne promet un plaisir sr ? Avec une pareille fin, il ny a pas sirriter contre lgosme qui est sagesse, ni contre les fautes qui rsultent ncessairement des passions ; il ne faut pas har le pcheur, mais lenseigner . Enfin ce dtachement va jusquau suicide, et cest dans un livre intitul lAbstinent (A, celui qui sabstient de nourriture pour mourir de faim) que lon voit Hgsias dvelopper le thme des malheurs de la vie humaine 2. Cette pense forme moins une doctrine quune srie de thmes, parmi lesquels les principaux sont les thmes pessimistes des maux de la vie et des malchances du sort. Il est ais
1 2
DIOGNE LARCE, II, 93. 96. CICRON, Tusculanes, I, 83.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
251
de voir quil nest pas un seul des traits de cet enseignement que ne p.366 vise picure pour y rpondre au nom dun hdonisme rectifi et appuy sur la nature et la physique plus que sur lobservation de la vie humaine, comme celui dHgsias ; on se rappelle notamment sa condamnation dun pessimisme qui conduit au suicide, sa doctrine du libre arbitre, son aversion contre ceux qui font du sort une desse toute-puissante. Annicris 1 aussi essaya des remdes contre ces consquences dcourageantes de lhdonisme, mais en usant de moyens humains ; il donnait une valeur absolue tout ce qui attache lindividu aux autres hommes : amiti, liens de famille et de patrie ; ce sont des conditions de bonheur indispensables. En vritable observateur des hommes, il a plus de confiance dans lhabitude que dans la raison pour rendre lhomme suprieur lopinion publique ; ce sont les mauvaises habitudes de lducation qui nous rendent faibles devant lopinion ; ce sont de bonnes habitudes qui nous librent. Thodore, disciple dAnnicris, qui fut exil dAthnes et, enseigna auprs du roi Ptolme Ier (mort en 283), qui lenvoya en ambassade Lysimaque, roi de Thrace, parat avoir dcidment inclin vers le cynisme 2 : un sage tellement indpendant quil na nul besoin damis, tellement suprieur aux autres quil ne songe nullement se sacrifier pour sa patrie, ce qui reviendrait perdre sa sagesse pour des insenss, tellement au-dessus de lopinion publique quil nhsite pas, loccasion, voler et mme faire des vols sacrilges, tel est le cynique effront dont Thodore nous fait le portrait ; sorte de milieu entre lhdonisme et le cynisme, o le plaisir, bien pour le premier et mal pour le second, et la peine, mal du premier et bien du second, deviennent lun et lautre indiffrents. La prudence et la justice sont les seuls biens, et le monde, la seule cit que reconnat le sage. Mais Thodore, surnomm lathe, est surtout connu pour avoir ni lexistence des dieux et p.367 inspir, dit-on, picure ; nous ne savons rien de son argumentation contre les dieux ; mais le fait suffit pour nous faire voir combien son cosmopolitisme devait tre diffrent du cosmopolitisme religieux des Stociens. Un pareil enseignement, tout fait de thmes populaires, sans appareil technique compliqu, tranger toute culture scientifique, plus dsireux dinfluence immdiate que dune recherche patiente de la vrit, aboutit une forme littraire qui obtiendra le plus grand succs, cest celle du discours philosophique ou diatribe, sorte de sermon o lorateur prsente lauditoire, en un style lgant et fleuri, le fruit de sa sagesse. Nous connaissons assez bien celles dun lve de Thodore, Dion de Borysthnes, dont un auditeur, Tls, rdigea des rsums qui nous ont t conservs par Stobe. Nulle doctrine systmatique prcise dailleurs chez ce Bion, qui avait dabord t
1 2
DIOGNE LARCE, 96-97. DIOGNE LARCE, 97-103.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
252
llve du cynique Crats, puis, aprs lenseignement de Thodore, avait reu celui de Thophraste 1. Par la forme littraire, la diatribe de Bion est le contre-pied des ouvrages didactiques des Stociens, avec leurs raisonnements squelettes et leur terminologie droutante. Elle nest pourtant pas non plus le discours suivi, fait de priodes, la manire des rhteurs et des sophistes ; elle a gard quelque chose de la discussion dont elle est issue (diatribe, chez Platon, dsigne le dialogue socratique) ; elle sadresse directement lauditeur quelle veut convaincre ou rfuter, par des questions courtes et passes. Homme, est cense dire la Pauvret, pourquoi mattaquer ? Tai-je priv dun bien vritable ? De la temprance ? De la justice ? Du courage ? Manques-tu du ncessaire ? Les chemins ne sont-ils pas pleins de fves et les sources pleines deau ? Un interlocuteur fictif prend mme parfois la parole pour faire des objections ; tel celui qui se plaint de son sort : Tu commandes, dit-il, et moi jobis ; p.368 tu uses de beaucoup de choses, et moi de peu. Mais ct de ces passages qui sont comme une discussion stylise, il y en a dautres, plus oratoires, o la pense spand en images : il en est qui sont restes clbres et seront reprises satit : Comme le bon acteur joue bien le rle que le pote lui assigne, lhomme de bien doit jouer comme il faut celui que lui assigne la Fortune. La Fortune est comme un pote qui donne tantt un premier rle et tantt un rle secondaire, tantt celui dun mendiant , ou encore : Comme nous quittons une maison, dont le loueur a enlev la porte et le toit, a bouch le puits, ainsi je quitte ce pauvre corps ; lorsque la nature qui me la prt menlve yeux, oreilles, mains et pieds, je ne le supporte pas, mais, comme je quitte un banquet, sans mirriter, ainsi, je quitte la vie, lorsque lheure est venue. Enfin, Bion emploie lanecdote difiante, la chrie ou lapophtegme, quil emprunte aux hros du cynisme, Diogne et Socrate en particulier. Tout cela runi forme ce genre de discours quratosthne appelait la philosophie en manteau brod , parce quil est fait de tous les genres, discussion, anecdote, discours. La diatribe est faite de mille variations sur un mme thme : la Fortune (Tych) a distribu aux hommes leurs sorts dune manire souveraine et incomprhensible pour eux, sans aucune trace de providence ; le bonheur consiste tre satisfait de son sort () et se plier toutes les circonstances, comme le navigateur obit aux vents : sorte de sagesse rsigne qui aboutit limpassibilit, qui renonce comprendre le secret des choses ou mme admettre quelles aient un secret, qui renonce donc agir sur elles, et qui cherche sen rendre tout fait indpendant grce la disposition intrieure de lme. Cest lpoque du dveloppement du culte de la desse Tych, qui remplaait tout le panthon par une sorte de force capricieuse et impersonnelle ; Bion avait pu lapprendre de son matre pripatticien Thophraste, qui, avant Straton disait en son Callisthne que tout tait rgi par
1
DIOGNE LARCE, IV, 51-52.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
253
le hasard. Vitam regit fortuna p.369 non sapientia, traduit Cicron 1 ; et les Stociens consacraient la rfutation de cette pense dsenchante des traits dont celui de Plutarque Sur la Fortune nous a laiss lcho ; il y montre comment la vertu matresse et caractristique de lhomme, la prudence, implique que tout nest pas rgi par le hasard et que, si, dans les arts infrieurs, tout le monde admet que la prudence est ncessaire, il faudra ladmettre a fortiori dans les questions plus importantes qui se rapportent au bonheur 2. Avec une pareille doctrine, si doctrine il y a, la seule mthode est non pas dapporter des preuves mais de suggrer une attitude ou un tat desprit ; pour montrer par exemple quil ne faut pas se fier au plaisir ni voir en lui une fin, Bion reprendra le thme de Crats et dHgsias : peignant les ges de la vie, il y montrera que les souffrances y dpassent les plaisirs, avec toutes les gnes dans lesquelles vit lenfant, les soucis qui accablent lge mr, les regrets qui consument la vieillesse et la moiti de la vie passe dans linconscience du sommeil 3. Voulant montrer comment les choses ne peuvent nous atteindre, il fera prendre la parole la Pauvret qui dveloppera lidal dune vie frugale saine et heureuse, un repas de figues et deau frache, un lit de feuilles ; la Richesse montrera en revanche tout ce quelle donne lhomme : La terre elle-mme ne produit pas spontanment et sans mon concours ; je donne llan toute chose. Sagit-il de consoler de la mort dun ami : Ton ami est mort, cest quil est n aussi. Oui, mais il ne sera plus. Il y a dix mille ans il ntait pas non plus, ni lpoque de la guerre de Troie, ni au temps de tes grands-parents 4. Cette diatribe, qui concentrait en elle tant de thmes auparavant disperss, eut un succs immense ; elle cre la philosophie un nouveau style qui la rend attrayante comme un dveloppement de rhteur ; par limage de la Tych, elle se p.370 dbarrasse de toute doctrine et devient ainsi populaire. Prte aussi sunir toute doctrine, puisquelle prche en somme la mme impassibilit, le mme dtachement que Stociens et picuriens ne croient pouvoir acqurir quau prix dune physique ou dune thologie, elle donnera naissance tous ces airs de bravoure de philosophie populaire que lon trouve chez le pote Horace ou Lucien, ou bien insrs dans un tissu doctrinal comme chez Lucrce ou chez Philon dAlexandrie, chez les Stociens de lempire, Musonius, Snque et pictte et jusque chez Plotin ; cette dernire fleur du socratisme nest-elle pas traditionnellement considre comme le summum de la sagesse antique ?
1 2
Tusculanes, V, 9, 24. [IX.] DUMMLER Akademika, p. 211. 3 STOBE, Florilge, 98, 72. 4 Ibid., 5, 67.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
254
III. PYRRHON
@ Chez les hommes dont nous venons de parler, nous voyons une attitude morale assez nette et ferme saccompagnant dune indiffrence peu prs complte envers toute espce de dogmes. Cela peut nous aider retrouver la pense de Pyrrhon dle (365-275), peu prs contemporain de Znon et dpicure ; pense difficile atteindre : comme Socrate, il na rien crit ; comme lui, il est le point de dpart dune longue ligne de philosophes, qui, de gnration en gnration, lui attribuent leurs propres dcouvertes ; comme lui enfin, il est devenu un hros lgendaire. Aussi se demande-t-on ce quil faut lui attribuer dans les arguments des sceptiques contre la valeur de la connaissance, et Ve quil faut croire des anecdotes par trop dmonstrative de son indiffrence quAntigone de Caryste raconte dans son ouvrage Sur Pyrrhon. Il semble bien quil ne faut rien lui attribuer de cette argumentation sceptique technique contre la valeur de la connaissance que nous verrons plus tard se dvelopper avec nsidme et Sextus. Si lon sen tient aux donnes de ses disciples immdiats, Nausiphane le Dmocriten, plus tard matre p.371 dpicure, et Timon de Phlionte, il excitait ladmiration plutt par son caractre et sa valeur morale que par sa doctrine. Nausiphane conseille dimiter son genre de vie, mais sans adhrer ses thories ; Timon, son enthousiaste disciple, le dpeint ainsi dans des vers du Python 1 ; Comment, Pyrrhon, as-tu trouv le moyen de te dgager de la vanit des opinions des sophistes et de briser les liens de lerreur ? Ce nest pas toi qui tes souci de chercher quel air entoure la Grce, do viennent les choses et quoi elles arrivent. Il est dailleurs universellement admir, puisquil est nomm grand prtre par ses concitoyens dle et reoit Athnes le droit de cit. Le seul renseignement prcis que nous ayons sur son enseignement est le rsum trs clair quAristocls en a conserv daprs Timon 2. Celui qui veut tre heureux doit considrer dabord ce que sont les choses ; en second lieu quelles dispositions nous devons avoir envers elles ; enfin ce qui rsultera de cette disposition. Pyrrhon dclare que les choses sont gales et sans diffrences. instables et indiscernables, et que par consquent nos sensations et nos opinions ne sont ni vraies ni fausses. Sur le second point, il dit quil ne faut avoir nulle croyance, mais rester sans opinions, sans inclinations, et fermes dans ces formules : nulle chose nest plutt quelle nest pas ; elle est et elle nest pas ; ni elle nest ni elle nest pas : Sur le troisime point Timon dit que de cette disposition rsulteront dabord le silence () et ensuite lataraxie.
1 2
DIOGNE LARCE, IX, 64 [python]. Dans EUSBE, Prparation vanglique, XIV, 18, 2-3.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
255
Lcole de Pyrrhon est, comme toutes celles de ce temps, une cole de bonheur. Son point de dpart nest pas trs diffrent des doctrines que nous venons danalyser ; la plupart des hommes attribuent leur bonheur ou leur malheur aux choses elles-mmes, la pauvret ou la richesse ; or ces choses ne les rendent malheureux que parce quils sy confient comme des choses sres, parce quils ont des croyances. Si lon montre p.372 lhomme quelles sont fuyantes, instables, passant incessamment lune dans lautre, toute foi, toute croyance disparatront et avec elles toute affirmation et toute raison de trouble. Linstabilit dont parle Pyrrhon nest rien que celle de la fortune. Il ny a pas trace ici dune critique de la connaissance, telle que celle que nous allons trouver chez les Acadmiciens ; comment laurait institue celui que Timon, dans les Silles nous prsente comme aussi hostile la dialectique qu la physique 1 ? Ce nest pas notre connaissance qui est incrimine ; cest la nature mme des choses qui exclut la connaissance. Mais la suspension de jugement () qui est la garantie du bonheur trouve une trs forte rsistance chez les hommes eux-mmes : Pyrrhon partage le pessimisme si frquent son poque ; il a le sentiment dune folie universelle qui agite les hommes et qui fait ressembler la foule, selon un vers dHomre quil admirait, des feuilles qui tourbillonnent 2 ; son lve Philon dAthnes, qui nous donne ce renseignement, nous dit aussi quil comparat les hommes des gupes, des fourmis ou des oiseaux, insistant sur tout ce qui fait ressortir leur incertitude, leur vanit et leur enfantillage. Il citait souvent ce passage dHomre : Meurs toi aussi, ami ; pourquoi te plaindre ? Patrocle est bien mort qui valait mieux que toi. Et son disciple Timon invectivait, dans les Silles, les malheureux hommes, objets de honte, semblables des ventres, toujours disputant et gmissant, outres pleines dune vaine enflure 3 . Pyrrhon nest pas du tout un Socrate qui vit dans la cit et qui aime les hommes ; cest un solitaire qui les mprise. Il suit de l que la suspension de jugement et lataraxie qui la suit comme son ombre ne sont pas obtenues par une simple p.373 vue intellectuelle de linstabilit des choses ; il y faut un exercice prolong et une mditation que guident les formules que Timon prte Pyrrhon, et qui font partie ds maintenant de la tradition sceptique. Le discours est pour lui un pis aller ; cest par les actes quil faut dabord combattre contre les choses . Pyrrhon a d insister avec force sur ce caractre pratique de sa doctrine. Il sagissait pour lui, selon une expression dune nergie rare, de dpouiller lhomme , et Timon, qui compare son matre un Dieu, emploie une expression analogue, le dpouillement des opinions 4 .
1 2
DIOGNE LARCE, IX, 65 [python]. Ibid., IX, 67 [Homre] ; Iliade, VI, 147. 3 EUSBE, Prparation vanglique, XIV, 18, 28. 4 DIOGNE LARCE, IX, 66 et 65.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
256
Si Pyrrhon, dans le principe, ne scartait pas beaucoup des brillants auteurs de diatribes, len voil maintenant bien diffrent par le srieux et laustrit de sa manire. On pressent que la contre-partie de sa vision de linstabilit des choses ne devait pas tre, comme pour eux, une vague croyance une incertaine Tych, mais la certitude dune nature trs ferme laquelle se rattache lassurance du sage ; et en effet au dbut de son pome Les Images (I), Timon lui prte ces paroles : Je te dirai ce qui mapparat en prenant comme droite rgle cette parole de vrit, quil existe ternellement une nature du divin et du bien, do drive pour lhomme la vie la plus gale 1. Un accent religieux de ce genre a quelque chose dnigmatique ; le dieu que rvre Pyrrhon nest point une providence du monde ni mme des hommes comme celui des Stociens ; il est seulement comme ltre parfaitement stable devant qui svanouissent les aspects divers et fuyants du rel. Y a-t-il l, comme on la pens, lcho dune sagesse lointaine, de cette sagesse hindoue avec laquelle Pyrrhon fut srement en contact, puisque, accompagnant Alexandre dans ces voyages, il connut ces asctes hindous que les Grecs appelaient les gymnosophistes et dut tre frapp par linsensibilit et lindiffrence dont ils faisaient preuve jusque dans les supplices ? On sait dailleurs que, partir de ce temps, les faits et gestes de ces gymnosophistes ont leur place parmi les contes difiants, dans tout trait de morale populaire, tel que celui de Philon dAlexandrie Sur la Libert du Sage. Les disciples de Pyrrhon furent nombreux, et lun deux a rsum ainsi sur son pitaphe le double enseignement tborique et pratique quil reut de son matre : Cest moi Mncls le Pyrrhonien qui trouve toujours dgale valeur tout ce quon dit, et qui ai tabli chez les mortels la voie de lataraxie.
IV. ARISTON
@ Cest encore un aspect du mme humanisme que lon trouve chez Ariston de Chio, un dissident du stocisme, qui, dailleurs, avant Znon, avait eu pour matre lAcadmicien Polmon ; se rattachant expressment au Socrate du Phdon et celui des Mmorables, il dlaisse la physique et il mprise les inutiles toiles daraigne de la dialectique. Son argumentation contre la physique est triple : elle est incertaine, inutile et impie ; incertaine comme le prouvent les dissentiments des physiciens par exemple sur la grandeur de lunivers et sur lexistence du mouvement ; inutile puisque, mme connue, elle ne nous donne aucune vertu ; impie puisquelle va jusqu nier lexistence des dieux, ou les remplacer par des abstractions comme linfini ou lun 2 : on ne peut imaginer plus grand contraste avec la physique dogmatique des Sto1 2
SEXTUS, Contre les Mathmaticiens, XI, 20. EUSBE, Prparation vanglique, XV, 62, 7.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
257
ciens, tout imprgne de morale et de religion ; cest pourtant bien la physique stocienne quil a lintention de rfuter, et lorsquil dit, daprs Cicron 1, quon ne sait quelle forme ont les dieux, ni mme sils ont le sentiment ou sont des tres p.375 anims, il semble bien quil vise le feu artiste ou les corps igns dont les Stociens faisaient des dieux. Donc Ariston veut se borner aux choses humaines sans mme sinquiter de ce qui viendra aprs la mort. Comme tous les moralistes que nous venons de citer, il prche le dtachement des choses ; et le souverain bien est pour lui labsence mme de cet attachement, lindiffrence () 2. Il suit avec une logique rigoureuse les consquences de ce principe, en faisant ressortir par contraste linconsquence des Stociens. Nous ne connaissons bien sa pense que sur trois points, et sur ces trois points il se pose en critique du stocisme ; cest sa thorie de lunit absolue de la vertu, sa conception de lenseignement moral, qui supprime la parntique, et enfin sa critique de la thorie stocienne des prfrables. Il ny a quune seule vertu, cest la science () des choses bonnes et mauvaises. Quand on nomme des vertus diverses, temprance, prudence, courage, justice, on ne parle en ralit que dune seule et mme vertu, mais qui se fait jour en des circonstances diffrentes, temprance lorsquil sagit de choisir les biens et dviter les maux, prudence lorsquil sagit de faire le bien et de sabstenir du mal, courage, lorsquil sagit doser, justice lorsquil sagit de distribuer chacun selon son mrite. Mais, qui possde la vertu, ces quatre espces de circonstances ne demandent pas chacune une connaissance ou un effort nouveaux. Cest la mme vertu qui agit sous des rapports distincts. La vertu est comme la vue qui, selon les circonstances, est vue des choses blanches ou vue des choses noires, tout en restant une et identique. Quel est le sens exact de cette thorie ? Elle est lie, semble-t-il, dune manire troite aux deux autres points indiques 3. Un heureux hasard a voulu que Snque, dans une de p.376 ses Lettres Lucilius (94) ait indiqu avec dtail les raisons pour lesquelles Ariston ne voulait pas de la parntique, cest--dire de cette morale indfiniment fragmente qui traite successivement des devoirs de lpoux, du pre, du magistrat, etc., en donnant en chaque cas des conseils et des prescriptions. On sait quelle place cette sorte de morale pratique a eue ds le dbut de lcole stocienne ; elle sera, plus tard, certains moments, presque tout le stocisme. En elle, Ariston voit dabord le danger de ce morcellement de la vie morale, danger qui lavait amen affirmer lunit de la vertu ; cest un travail sans limite, puisque les cas despces sont innombrables ; ce ne peut donc tre le fait de la sagesse qui est, par dfinition, acheve et limite ; et Ariston voit
1 2
De la Nature des Dieux, I, 37 [ariston]. CICRON, Premiers Acadmiques, II, 130 [adiaphorie]. 3 GALIEN, De la doctrine dHippocrate et de Platon, VII, 2 ; PLUTARQUE, De la vertu morale, ch. II.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
258
mal le philosophe entrer dans tous les dtails, donner des prescriptions diffrentes celui qui se marie, selon quil pouse une jeune fille, une veuve, une femme sans dot. Une telle pratique est dailleurs inutile ; le disciple qui reoit les conseils est en effet comme un aveugle dont on guide chaque pas ; ne vaut-il pas mieux lui ouvrir les yeux pour quil puisse se guider lui-mme ? Or cest prcisment le rle des principes philosophiques. Les conseils au reste ne pourraient avoir daction efficace que grce ces principes qui les rendent prcisment inutiles ; car un conseil ne sera cout que si lon en donne la raison ; or cette raison est dans un principe philosophique gnral, tel que celui de la justice ; ds que lon est imbu de ce principe gnral, le conseil devient inutile. La pense dAriston met en prsence deux manires trs diffrentes de concevoir la pdagogie morale : sa critique part de ce principe, que les conseils, ne concernant que la manire dagir, sont incapables de transformer lme et de la librer du mal et des opinions fausses ; pareil effet ne peut tre obtenu que par des principes philosophiques agissant pour ainsi dire dun coup. Dune part une morale qui vise guider la conduite, dautre part une morale qui veut modifier la disposition p.377 intrieure ; il est clair que cest de ce ct que vont non seulement la morale dAriston, mais toutes celles que nous venons dexaminer : par plus quAriston, Bion ou Pyrrhon ne donnent de conseils pratiques ; on ne voit plus chez eux de morale pareille celle dAristote qui dcrivait dans leur dtail les diverses manires de vivre des hommes. Mais les Stociens avaient essay de concilier les deux mthodes, et ils avaient laiss la parntique ct de la science des principes. Ariston se montre plus intransigeant. Il faut bien voir la contre-partie de cette intransigeance en mme temps que les raisons profondes de lopportunisme des Stociens. Ce soin exclusif des choses de lme, qui nest pas quilibr par des rgles daction prcises, nest en effet quune des formes de son adiaphorie ; ces rgles daction, les Stociens nont su les trouver quen justifiant lattachement de lhomme pour les objets naturels de ses inclinations : lui-mme, corps et me, et les milieux dont il fait partie, famille, cit ou groupement damis. Cest la thorie des prfrables, et cest sur elle quest fonde toute la parntique ; le conseil ne fait que formuler le parti le plus conforme aux inclinations naturelles. Or Ariston rejette lide des prfrables, cest--dire lide que, sil ne sagit pas de bien ou de mal, une chose puisse tre prfre une autre, la sant la maladie, ou laisance la pauvret. Il est en cela daccord avec les sermonnaires des diatribes, et, lui aussi, on attribue la fameuse comparaison du sage avec le bon acteur 1 jouant comme lui le rle qui lui est chu par le sort. Le sage doit se plier aux circonstances, mais il na aucun motif pour choisir une action plutt quune autre. Il semble dailleurs que largumentation dAriston contre les prfrables, que nous a conserve
1
DIOGNE LARCE, VII, 160.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
259
Sextus 1, soit une sorte dargumentation ad hominem contre les Stociens. On se rappelle en effet que, pour eux, les choses conformes la nature, sant, richesses, etc.. p.378 ne sont prfrables que sous condition et que, daprs Chrysippe, le sage peut choisir la maladie, sil sait que la maladie entre dans la trame des vnements de lunivers. Or, Ariston prtend rfuter le Stociens en leur montrant quil y a telle occasion o le sage doit choisir la maladie, si par exemple on imagine un cas o la maladie nous dlivre de la sujtion dun tyran. Et il na fait, semble-t-il, que gnraliser cette remarque, en admettant que, dans tous les cas, le prtendu prfrable nest choisi ou vit par le sage que selon loccasion. Remarquons que cette attitude est le rsultat ncessaire de labsence de toute physique chez Ariston ; il ny a pas trace en effet chez lui dune thorie des inclinations naturelles, qui seule pourrait justifier la thorie des prfrables ; et la thorie des inclinations, il est ais de le voir, dpend elle-mme dune vue densemble de la nature. Ce nest point par une rgle transcendante, mais par une sorte de dessein immanent la nature que les Stociens peuvent faire concevoir la valeur de certaines inclinations. Cette base disparue, tout le reste scroule, les prfrables, les rgles daction, les devoirs. Le sage ne vise qu atteindre lindiffrence. Or cette consquence mne, comme chez Pyrrhon (dont nos sources rapprochent la plupart du temps Ariston), linaction complte, moins dune hypothse, quil semble bien quAriston ait faite : cette hypothse, cest celle dune certaine facult qua le sage de se donner arbitrairement des motifs daction, sans autre raison que sa propre volont. Cest, semble-t-il, cette thorie que Chrysippe a en vue, lorsquil parle de philosophes qui, voulant affranchir notre volont de la contrainte des causes extrieures, prte lhomme une certaine impulsion ( ), qui est manifeste dans le cas des choses indiffrentes, lorsque, de deux partis gaux et semblables, il est ncessaire den choisir un, sans que nul motif mne lun plus qu lautre puisquils ne prsentent pas de diffrences 2. Ainsi, moins daccepter la physique au sens large du mot, cest--dire moins de chercher dans la nature lorigine, la justification et la mesure de nos tendances, comme le font picure et les Stociens, on est conduit soit la totale inaction, par absence de motifs, soit la libert dindiffrence.
p.379
V. LA NOUVELLE ACADMIE AU IIIe SICLE : ARCSILAS
@
1 2
Contre les Mathmaticiens, IX, 63. PLUTARQUE, Des Contradictions des Stociens, ch. XXIII.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
260
La chane dor des scholarques de lAcadmie, aprs Xnocrate, Polmon et Crats, se continue par Arcsilas de Pitane (en olide) qui dirigea lcole depuis 268 jusquen 241, anne o il mourut g de soixante-quinze ans. De lui part une impulsion nouvelle ; le courant, dides dont il est lauteur restera vivant jusque vers le milieu du Ier sicle avant notre re, poque o nous le verrons se transformer et steindre : cest lpoque de la nouvelle Acadmie. Elle se marque avant tout par une raction trs vive contre les nouveaux dogmatismes, contre ces conceptions densemble de lunivers qui se donnent comme la condition de la sagesse, contre les prtendues certitudes dont ils sont issus. LAcadmicien nest pas, comme ceux dont nous venons de parler, un homme qui se retranche dans une solitude ddaigneuse et dans lindiffrence ; cest un combatif ; il attaque et pourchasse ladversaire ; loin de laisser tomber la dialectique, cest delle quil se sert pour renverser le dogmatisme. Pour bien comprendre leur doctrine, il nous faudrait mieux savoir quel point le milieu de lAcadmie, avec ses traditions restait diffrent des nouvelles coles dogmatiques ; lorsque le jeune Arcsilas, aprs avoir suivi, frais dbarqu Athnes, les cours de Thophraste, entra en contact avec Crats et Polmon, il crut, nous dit-il, voir ces tres divins, le reste de cette ancienne humanit faite dune race dor . Aussi la lutte entre Arcsilas et Znon est-elle une lutte entre deux esprits diffrents. p.380 Du ct dArcsilas, cest lesprit de la culture sophistique et humaine ; instruit en mathmatiques et en musique, faisant dHomre sa lecture quotidienne, familier avec Pindare, il acquit, grce ses heureux dons et cette ducation, une facilit de parole et un art de persuader qui lui attirrent une grande foule dlves 1 ; rien du style lourd et encombr de mots techniques des Stociens ; rien non plus de leur gravit un peu pesante : Arcsilas est un moqueur acerbe et redout. Leur conception de lenseignement devait tre fort diffrente : les Stociens sont dinfatigables polygraphes qui fixent leur dogme en formules crites ; Arcsilas est un infatigable jouteur qui accommode de mille faons la discussion loccasion qui soffre, un improvisateur ; aussi devait-il mettre la parole vivante au-dessus de lcrit muet, et il na rien crit, pas plus que Socrate ou Pyrrhon. Dautre part, au point de vue politique, son attitude est tout autre que celle des grands Stociens ; sil sabstient, comme eux, de politique active dans la cit, il ne montre pas le mme empressement auprs des pouvoirs naissants : personnage considrable dans la ville par sa fortune personnelle comme par son enseignement, il se drobe aux avances que lui fait le protecteur des Stociens, Antigone Gonatas ; il na de relations personnelles quavec Eumne. roi de Pergame : on ne voit nulle trace chez lui du cosmopolitisme stocien. Ces circonstances peuvent servir comprendre les rsistances que trouva chez lui la prtention affiche des Stociens la certitude, prtention qui
1
DIOGNE LARCE, IV, 31-37.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
261
tranche tellement sur lordinaire modestie des philosophes grecs ; cest, en lui, tout lesprit critique et analyste des Grecs qui se rvolte contre la synthse dfinitive que voudraient imposer les Stociens. Non seulement Arcsilas leur oppose le dicton de Socrate (la seule chose que je sais, cest que je ne sais rien), mais il retrouve chez tous les p.381 philosophes la mme hostilit au dogmatisme, chez Empdocle, Anaxagore, Dmocrite, Hraclite, Xnophane, Parmnide et Platon ; ce sont bien l aussi les anctres que lui trouve lpicurien Colots, comme on la vu plus haut ; ses adversaires et lui sont daccord pour dgager dans la pense grecque une tradition antidogmatique 1. Par devant Platon, par derrire Pyrrhon, au milieu Diodore , tel est le portrait composite quAriston donne dArcsilas. Sa manire est la manire libre et enjoue de Platon ; sa conclusion est celle de Pyrrhon, cest que le sage doit suspendre son jugement ; mais sa mthode est celle de Diodore le Mgarique, cest la dialectique. Le rsum trs prcis que Sextus a conserv de sa discussion sur la thorie de la certitude de Znon nous montre en effet lemploi de la dialectique au sens le plus prcis du mot 2. Arcsilas nintroduit aucune affirmation et se sert uniquement de celles qui sont poses par ses adversaires. Cest, insistons-y bien, en se plaant dans lhypothse des Stociens quil les rfute. Les Stociens distinguent entre la science, comprhension inbranlable, qui nappartient quau sage, et lopinion, assentiment faible appartenant au mchant et dont le sage est tout fait exempt. Entre la science et lopinion se trouve la comprhension ou perception, assentiment une reprsentation comprhensive ; cette perception, qui est certaine, appartiendrait la fois au sage ou au mchant. Or daprs les Stociens eux-mmes, cette comprhension ou perception est impossible ; car ou bien elle appartiendra au sage et elle sera science ; ou bien elle appartiendra au mchant, et alors elle sera opinion, puisque le mchant doit toujours se tromper. Dautre part leur dfinition de la perception est en contradiction avec leur dfinition de lassentiment ; car ils dfinissent la perception, lassentiment une reprsentation : or ils disent quon ne p.382 peut donner son assentiment qu un discours et un jugement. Enfin, leur dfinition de la reprsentation comprhensive : une reprsentation vraie telle quelle ne peut devenir fausse, est en contradiction avec de nombreux faits que les Stociens sont les premiers reconnatre et exposer en dtail, et do il rsulte quil ny a nulle reprsentation prtendue vraie laquelle une reprsentation reconnue fausse ne soit tellement semblable quon ne peut les distinguer. Cest sur ce dernier point que se donne carrire largumentation sceptique, qui se transmettra peu prs invariable jusqu la premire Mditation de Descartes ; nous en connaissons le dtail (qui, sans doute, ne remonte pas entirement Arcsilas), par Cicron et saint
1 2
PLUTARQUE, Contre Colots, 26 ; CICRON, Premiers Acadmiques, II, 14. Contre les Mathmaticiens, VII, 150-158 ; Cf. aussi CICRON, ibid., II, 94-98 [arcsilas].
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
262
Augustin 1 ; les erreurs des sens, les songes, livresse, la folie engendrent des reprsentations fausses indiscernables des vraies, pour celui qui les prouve ; mme dans ltat normal, on est forc dadmettre quil y a des reprsentations indiscernables entre elles, comme par exemple celle de deux ufs ; et ctait une plaisanterie habituelle, pour prouver au sage que, lui aussi, il opinait, de lamener confondre deux frres jumeaux 2. Enfin le sorite ou argument du tas est destin montrer quil y a des sries de reprsentations dun mme objet, telles que nous ne puissions indiquer prcisment la limite partir de laquelle une reprsentation nest plus comprhensive 3 ; combien de grains faut-il ajouter un grain de bl pour que ces grains forment un tas ? Dans cet exemple familier Arcsilas semble avoir voulu montrer la continuit parfaite quil y a entre la vrit et lerreur. Concluons donc que le sage stocien est forc dadmettre ou bien quil aura des opinions, ou bien quil suspendra son jugement. Comme lon nadmet pas la premire alternative, comme lerreur, la lgret, la tmrit sont trangres au sage, il ne reste que la seconde. On sait les consquences que Pyrrhon tirait de cette abstention ; cest linactivit complte, dont Ariston ne pouvait sortir que par larbitraire. Or cette consquence forme le fond dune objection que lon fit de bonne heure (comme on le voit par lexemple de Colots) Arcsilas ; la vie pratique devient impossible selon ces principes. Arcsilas, qui nest ni un contemplatif ni un solitaire, rpugne cette consquence, le bonheur nexiste que grce la prudence, et la prudence consiste en des actions droites. Sans doute, daprs Sextus, la fin est pour lui la suspension de jugement ; mais rien nindique quil en fasse la raison positive du bonheur 4. Il y a donc un critre ou une rgle () des actions volontaires, bien quil ny ait pas de critre de la vrit. On sait combien ces deux critres sont insparables pour le dogmatisme, dont cette liaison constitue lessence mme ; cest que, chez cet tre raisonnable quest lhomme, linclination et par consquent laction ne peuvent exister, si lintelligence ny donne pas son assentiment. Arcsilas parat bien avoir admis au contraire que lhomme peut accomplir des actions sans donner son assentiment ; laction habituelle est une action de ce genre, et lon sait combien les sophistes avaient insist sur le rle de la coutume. Mais Arcsilas ne sen tient pas l ; il cherche un critre plus prcis en ce quil appelle le raisonnable () ; laction droite, dit-il, sera celle qui, une fois faite, pourra se dfendre par son caractre raisonnable. Quel est le sens exact de ce mystrieux critre de laction ? Il ne sagit, bien entendu, pas de vraisemblance, puisquil a t dmontr une fois pour toutes que les reprsentations sont toutes dgale valeur. Il est remarquer dautre part que la
p.383 1 2
AUGUSTIN, Contre les Acadmiciens, II, 5, 11. DIOGNE LARCE, VII, 162. 3 SEXTUS, Contre les Mathmaticiens, VII, 411. 4 SEXTUS, Hypotyposes, I, 232.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
263
dfinition de laction droite (celle du sage) est mot pour mot celle que les Stociens donnent de laction convenable, cest--dire de celle que le mchant lui-mme peut accomplir en suivant ses inclinations naturelles ; ils y emploient le mot p.384 que Cicron rend par probabilis 1. Nest-il pas vraisemblable quArcsilas, suivant en cela la tradition des matres de lAcadmie, et surtout de Polmon, a voulu prendre pour critre les inclinations naturelles, auxquelles il est raisonnable de cder ? Nous ne connaissons bien quun aspect de lenseignement dArcsilas ; mais il reste bien des traces de lexamen critique des autres dogmes des Stociens, comme par exemple la consquence absurde quil tirait de leur thorie du mlange total 2. Dautre part, certains textes nous le montrent dispos admettre la thorie des choses indiffrentes ; il soutenait avec eux lindiffrence la douleur et la mort : La mort nest un mal que dans lopinion ; quand elle est l, elle ne fait aucun mal ; elle ne fait du mal quabsente et attendue; Cest sans doute aussi pour montrer que la pauvret ntait en soi ni bonne ni mauvaise quil faisait voir quelle apparaissait tantt comme un mal tantt comme un bien 3. Cet enseignement devait faire, selon la tradition sophistique, une trs grande part la virtuosit ; il critiquait toute thse, quelle quelle ft, et avait coutume en chaque sujet de soutenir le pour et le contre, non pas pour dmontrer la fausset dune thse, mais pour montrer la ncessit de chercher plus avant. Mais la forme littraire qui avait son agrment tait le dialogue ; daprs Cicron, il fut le premier reprendre la tradition du dialogue philosophique qui, par Carnade, persiste jusqu Cicron lui-mme pour tre reprise ensuite par Plutarque. Cest la forme la plus contraire qui soit au nouvel enseignement dogmatique, et elle suffirait pour indiquer la radicale opposition desprit aux enseignements rgnants 4. Dans ces conditions, il ny a aucune raison de croire p.385 quArcsilas rservait ses disciples un enseignement dogmatique secret, quil ne donnait quaux mieux dous, et quil cachait au public, par crainte, dit Diocls de Cnide, des Thodoriens et de Bion le sophiste. Le renseignement tendancieux de ce Diocls, qui est peut-tre un de ses contemporains, a t reproduit satit par des auteurs trs postrieurs, Cicron, Sextus, saint Augustin qui, sans doute. se seraient plu voir lenseignement platonicien maintenu sans dfaillance lAcadmie 5.
VI. LA NOUVELLE ACADMIE AU IIe SICLE :
1 2
CICRON, Des Devoirs, I, 8. PLUTARQUE, Contre les Stociens, ch. XXXVII. 3 CICRON, Des Fins, V, 32 ; PLUTARQUE, Consolation Apollonius, ch. XV ; STOBE, Florilge, 95, 17. 4 CICRON, Acadmiques, fragm. 20 ; Des Fins, II, 2 ; De la Nature des Dieux, I, 5 [arcsilas]. 5 SEXTUS, Hypotyposes, I, 234 ; CREDARO, Lo scetticismo degli Academici, vol. II, p. 189.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
264
CARNADE
@ Tous les philosophes dont nous avons parl jusquici appartiennent au IIIe sicle ; le IIe sicle o eurent lieu tant dvnements importants pour lhistoire de lOccident, la conqute romaine, conqute de la Macdoine (168), conqute de la Grce (146), conqute de lAsie-Mineure (132) ne voit pas natre de philosophes originaux, hors Carnade de Cyrne, qui, aprs le scholarchat de Lacydes (d. 241) et aprs une priode obscure o lcole ne fut dirige que par le collge des anciens 1, prit avant 156 la direction de lAcadmie quil garda jusqu sa mort en 129. Son nom est insparable de celui de Clitomaque de Carthage qui dirigea lcole aprs lui jusquen 110. En effet Carnade na rien crit, et cest Clitomaque qui se fit le prophte de sa philosophie ; cest lui que Cicron a emprunt lexpos quil nous donne de sa thorie de la connaissance. Nous ne connaissons de la vie de Carnade quun vnement rest clbre : le snat romain, devenu larbitre des cits grecques, avait condamn Athnes une amende de cinq cents talents pour la dvastation de la ville dOrope. Le peuple athnien envoya au snat pour dfendre sa cause trois ambassadeurs choisis chacun dans une des trois coles philosophiques : p.386 Diogne le Stocien, Critolas le Pripatticien, et enfin Carnade lAcadmicien : ils allaient Rome, comme, un sicle avant, tant de leurs prdcesseurs taient alls chez les diadoques ; ils y firent sensation par les discussions quils donnrent en public, Carnade par son loquence fougueuse, Critolas par ses phrases arrondies et sentencieuses, Diogne par sa manire sobre et modre (156). Daprs une classification donne par Sextus, Arcsilas et Lacyde formeraient la seconde Acadmie, Carnade et Clitomaque la troisime 2 ; cette division rend en tout cas justice loriginalit de Carnade, qui est un des penseurs les plus profonds et les plus subtils de lpoque hellnistique. Une autre circonstance rend sa pense daccs difficile : Carnade na rien crit, et cest seulement par lintermdiaire de ses disciples que nous arrivons jusqu lui. Ajoutons que les crits de ces disciples ont pri, et que nous ne les connaissons que par les emprunts quy ont faits Sextus Empiricus et Cicron dans ses deux traits intituls Premiers et Seconds Acadmiques ; ces traits eux-mmes ne nous sont parvenus que dune manire incomplte, et notamment la partie ou Cicron exposait pour elle-mme la thorie de la connaissance de Carnade a disparu. Or, sur un point capital de cette thorie, il y a divergence expresse entre deux interprtations de sa pense : Carnade a-t-il ou non abandonn la suspension du jugement comme idal de la sagesse ? Un seul tmoin, mais dimportance, dit quil est rest fidle la
1 2
WILAMOWITZ-MOELLENDORF, Hermes, vol. XLV, p. 406. Hypotyposes, I, 220.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
265
pense dArcsilas ; cest son disciple et successeur Clitomaque ; daprs lexpos quen donne Cicron partir du chapitre 31 des Premiers Acadmiques, aprs avoir indiqu que, daprs Carnade, bien des choses paraissent vraies au sage, il ajoute : Et pourtant le sage ny donne pas son assentiment, parce quil peut toujours exister une chose fausse pareille cette chose vraie. Tout au contraire, un autre disciple de p.387 Carnade, Mtrodore, suivi par les scholarques acadmiciens qui ont succd Clitomaque, Philon et Antiochus 1, tmoigne non sans vivacit que Carnade a t mal compris et quil a abandonn lintransigeance dArcsilas, qui rendait la vie impossible ; la mme interprtation, sans indication de source, se retrouve dans les exposs. de Sextus et du noplatonicien Numnius 2. Malgr labondance des tmoins, nous avons une raison importante de nous mfier de cette seconde interprtation ; nous verrons, en effet, comment lAcadmie aprs Clitomaque, a volu dune manire inattendue vers le dogmatisme stocien : ses chefs avaient le plus grand dsir de montrer quils avaient le grand Carnade pour eux, et ils ont pu altrer sa pense. Il ne faut pas se dissimuler pourtant que, qui accepte linterprtation de Clitomaque, les thses de Carnade sur la connaissance deviennent dune interprtation moins facile. Il y a dabord une partie de ces thses quil soutient en commun avec Arcsilas et celle-ci ne souffre pas de difficult ; la critique des affirmations drivant des sens ou de la coutume, celle de la raison nont peut-tre contenu rien de bien original. Largument de la non-diffrence () entre les reprsentations considres comme vraies et celles qui sont considres comme fausses, largument tir du changement perptuel des apparences, qui interdit dattribuer dune manire fixe une couleur, ou une forme un objet, largument du sorite ou du menteur, les preuves tires de la diversit des coutumes, tout cela est dj, au IIe sicle, de la viande remche 3 . Mais nous voulons parler du critre positif, que Carnade a juxtapos sa critique. Ce critre, quil appelle le vraisemblable ou persuasif () a pour fonction, non seulement de guider la pratique de la vie, comme le raisonnable dArcsilas, p.388 mais, ce qui est tout nouveau, de nous donner une rgle de discussion dans la recherche des tres et de nous faire approcher de la vrit : critre non seulement pratique mais thorique 4. Or, si le vraisemblable est pour lui un critre thorique, il justifie une affirmation concernant la ralit ; et si, par hypothse, cette affirmation ne peut tre certaine, elle est une opinion ; il semble donc que user de ce critre, cest adhrer une opinion incertaine, et, dans ce cas, les adversaires de Clitomaque auraient raison.
1 2
CICRON, ibid., 78-148. Dans EUSBE, Prparation vanglique XIV, 7, 5. 3 SEXTUS, Contre les Mathmaticiens, VII 143, 402 et 412 ; CICRON, Premiers Acadmiques, II, 93-96 ; 87 ; Tusculanes, I, 108. 4 CICRON, ibid., 32 ; SEXTUS, ibid., 436.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
266
Voyons donc de plus prs la nature de ce critre ; daprs lexpos de Sextus 1, la rforme de Carnade consiste essentiellement chercher le critre non dans le rapport de la reprsentation lobjet, mais dans le rapport de la reprsentation au sujet. Sous le premier rapport, notre reprsentation est effectivement vraie ou fausse, mais nous nen pouvons rien savoir, puisquun terme du rapport nous manque ; sous le second rapport, il en est qui nous paraissent vraies et dautres ne nous paraissent pas vraies. Considrant les premires, nous pouvons chercher pourquoi elles ont cette force persuasive ; or nous nous apercevons que cette force a des degrs et varie selon les circonstances ; si un objet est petit ou une grande distance, si notre vue est faible, cette force est petite ; dans les cas contraires, les reprsentations paraissent vraies avec assez de force et elles peuvent nous servir de critre. Une exprience prolonge nous montrera que mme celles-ci peuvent, en des cas fort rares, tre fausses ; quil nous suffise quelles soient vraies en gnral, car cest sur la gnralit que sont rgls nos jugements et nos actions . Voil un langage tout nouveau ; il ne sagit plus dopposer en bloc la certitude absolue lincertitude, mais de se tenir dans lentre-deux et de dterminer toutes les nuances que comportent les intermdiaires : cest le probabilisme de p.389 Carnade, si distinct des ngations tranches dArcsilas. Comme Sextus le rpte deux fois, le critre de Carnade a une largeur 2 , cest--dire quil contient des degrs en plus et en moins. Ds lors le problme de lassentiment se dplace ; sil sagit, comme le veulent les Stociens, davoir une reprsentation qui permette de saisir lobjet lui-mme, le sage suspendra toujours son jugement, et lon ne peut dire quil opinera, cest--dire quil croira faussement saisir un objet ; mais sil sagit non pas datteindre lobjet, mais de comparer les reprsentations entre elles par leurs caractres internes, on pourra avoir, comme le dit Carnade expos par Clitomaque 3, un fort penchant obir ces reprsentations ; sans pourtant croire saisir directement par elles une ralit. On change dopinion et lon arrive dune opinion moins probable une opinion plus probable non pas en percevant une ralit, quon ne saisissait pas dabord, mais en se reprsentant dune faon prcise et dtaille ce quon ne se reprsentait dabord que dune manire confuse ; en voyant par exemple quune corde roule que lon prenait dans la demi-obscurit pour un serpent, ne bouge pas, quelle na pas la couleur dun serpent ; la reprsentation ainsi parcourue dans ses dtails () nous donne plus de scurit. Cette scurit augmente encore, lorsque cette reprsentation nest pas entrave () par une autre reprsentation ; ainsi la reprsentation quAdmte a dAlceste, lorsque Hercule la ramne des enfers, peut tre aussi prcise quon voudra ; Admte ny croit pas parce quil sait quAlceste est
1 2
Ibid., 168-176. Contre les Mathmaticiens, VII, 173 ; 181. 3 SEXTUS, ibid., VII, 230.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
267
morte 1. En un mot ce que Carnade substitue une prtendue perception directe des objets, cest un examen critique des reprsentations, qui repose sur ce fait, si peu remarqu jusque l, qu une reprsentation p.390 nest jamais solitaire, mais que les reprsentations sont suspendues lune lautre la manire des chanons dune chane . Une sorte de mthode danalyse et de synthse est substitue la prtendue vision directe de lvidence. Carnade ne sattaque pas seulement la thorie stocienne de la certitude, mais aussi la physique de lcole ; il ne pouvait supporter ce dogmatisme qui prtend connatre le secret des choses ; la thologie de lcole, avec ses thories de la divination et du destin, fait surtout lobjet de ces critiques. Ces critiques elles-mmes sont du type dialectique, cest en tirant correctement les consquences des opinions admises par les Stociens quil en fait sentir labsurdit. Par exemple sa critique de la notion des dieux : les dieu sont, pour les Stociens, des tres anims, bienheureux et dune vertu parfaite. Considrons chacun de ces points : un tre vivant a des sensations, et un tre aussi parfait quun dieu a au moins autant de sensations que les hommes ; donc il possde le got, avec le got, des sensations du doux et de lamer, avec ces sensations, des tats agrables ou pnibles ; sil a des tats de ce genre, il est susceptible de changement, donc corruptible ; ce nest pas un dieu. Il en est de mme de toutes les sensations. La sensation en gnral nest-elle pas dailleurs un changement par altration ? or tout tre qui subit une altration est corruptible et ne peut tre un dieu. Dieu, disent les Stociens, est un tre parfaitement vertueux, or, daprs eux, qui a une vertu les a toutes ; il faut donc attribuer aux dieux la continence, et avec elle la rsistance au mal ; Dieu ressentant le mal, est capable de changement, donc de corruption ; ce nest pas un dieu. On pourrait en dire autant de toutes les vertus. On trouve galement trace dune autre sorte dargumentation qui sadresse moins directement aux Stociens. Carnade demande au dogmatique si Dieu est fini ou infini, sil est un incorporel ou un corps, sil a la voix ou sil en est priv ; et il prouve successivement limpossibilit de chacune des deux p.391 alternatives. Dieu ne peut tre ni infini, car il serait immobile et sans me, ni fini, car il ferait partie dun tout plus grand qui le dominerait. Il ne peut tre ni un incorporel, car lincorporel (au sens stocien du mot, cest--dire le temps ou le lieu) ne peut agir, ni un corps, car tout corps est corruptible. Il ne peut tre ni priv de voix, ce qui contredirait la notion commune quon en a, ni dou de voix, puisquil ny a pas de raison de lui donner un langage plutt quun autre. Cette critique de la thologie est dimportance ; la notion de dieu est, par elle, rejete dans un impntrable mystre ; si Dieu possde la vie, la pense,
1
Daprs SEXTUS, Hypotyposes, I, 227 : lordre des caractres diffre dans lexpos (fait daprs Antiochus) du Contre les Mathmaticiens, VII, 176 (Cf. MUTSCHMANN dans le le Rheinisches Museum, 1911, p. 190).
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
268
la vertu, la parole, ce ne peut tre au sens humain de ces mots. Carnade prpare indirectement le retour une thologie platonicienne moins anthropomorphique que celle des Stociens 1. Sa critique de la divination est aussi toute dialectique. Ou bien lvnement prdit est fortuit, et alors comment le prvoir ? Ou bien il est ncessaire, et alors il est objet de science et non plus de divination ; de plus la divination qui le fait connatre ne peut servir nous en garantir sil est un mal ; elle est donc nuisible. Pour saisir la vritable porte de cette critique, il faut connatre les sentiments dans lesquels plus tard pictte recommande daborder les devins, non pas avec le dsir de servir nos intrts temporels, mais avec une parfaite confiance en la bont divine. L encore, la critique de Carnade suggre un sentiment religieux plus raffin 2. Cicron, en son trait Sur le Destin nous rapporte enfin la critique de Carnade sur la thse de Chrysippe qui prtendait allier le destin et la libert ; il na pas de peine montrer que, malgr les efforts de Chrysippe, il suit de laffirmation du destin que rien nest en notre pouvoir. En revanche il conteste la ncessit de la liaison que Chrysippe a tablie entre laffirmation du destin et le principe de causalit. De ce que rien narrive p.392 sans cause, il ne suit pas que tout arrive par le destin, cest--dire par une trame de causes lies lune lautre ; il peut y avoir des causes indpendantes qui sinsrent du dehors dans la trame des choses, et la volont libre de lhomme peut tre une de ces causes. La porte de cette critique est au fond la mme que celle des prcdentes ; elle suggre quil existe un ordre de choses qui chappe la comptence du physicien. Carnade, pas plus quArcsilas, nest, comme Pyrrhon, un dsespr ; mais ils ont le sentiment dun univers plus profond et plus complexe que celui que prtendait atteindre dun coup le rationalisme stocien. Carnade enfin prpare aussi le dveloppement de la morale, en montrant que la thorie stocienne des prfrables aboutit des consquences trs voisines des thses que Platoniciens et Pripatticiens saccordent admettre ; car leur principe de choix entre les actions est le mme 3. Le rle de Clitomaque fut surtout de maintenir dans sa puret la pense de Carnade. Stobe a conserv de lui quelques phrases o sexpriment dune manire frappante lincertitude des choses humaines et la part prpondrante que la Fortune a dans les affaires humaines. Cicron lui fait exprimer avec force la thse que nous avons considre comme celle de Carnade : nous
1 2
SEXTUS, Contre les Mathmaticiens, IX 137-199. CICRON, De la Divination, I, 4, 7 [carnade] ; II, 3, 9 ; Dissertations, II, 7. 3 CICRON, Des Fins III, 41.
[carnade]
; PICTTE,
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
269
pouvons suivre ce qui nous parat, et mme approuver les reprsentations qui ne sont entraves par aucun obstacle, pourvu que ce soit sans assentiment 1. Sa critique de la rhtorique, que Sextus 2 nous fait connatre, jette un jour curieux sur un dbat qui commenait poindre, et qui va se continuer pendant les sicles suivants : cest le dbat entre la rhtorique et la philosophie comme moyens de haute culture. Ce dbat navait aucun sens dans un mode dexposer tel que celui des Stociens, qui ne rivalisait daucune p.393 manire avec la rhtorique. Au contraire les Acadmiciens sont des orateurs ; des lves des rhteurs quittaient leur matre pour aller entendre Carnade 3, et Clitomaque prend loffensive contre eux en dniant la rhtorique le droit dexister comme un art de pure forme indpendant de la philosophie. Ds lpoque de Carnade, dailleurs, son contemporain pripatticien, Critolas, critiquait la dfinition stocienne de la rhtorique, lart de bien dire, quil trouvait trop formelle et lui opposait la rhtorique comme art de persuader. On pressent la place que la rhtorique doit prendre comme organe naturel des doctrines complexes et nuances que nous avons exposes dans ce chapitre. Le mode dexposition de la philosophie change dailleurs sous ces influences, partir de la fin du IIe sicle, et nous allons voir les Stociens eux-mmes tre les premiers shumaniser.
Bibliographie @
1 2
Florilge, 98, 67 ; 109, 29 ; Acadmiques, II, 103. Contre les Mathmaticiens, II, 20-43. 3 DIOGNE LARCE, IV, 62.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
270
CHAPITRE V LES COURANTS DIDES AU I SICLE AVANT NOTRE RE
er
I. LE MOYEN STOCISME : PANTIUS
@ Les scholarques qui succdrent Chrysippe au courant du IIe sicle jusqu Pantius, de 204 129, nous font dj assister un certain changement de la pense stocienne et comme une dtente du dogmatisme. Sextus dit, sans dailleurs prciser davantage, que les nouveaux Stociens admettent comme critre non plus la reprsentation comprhensive toute seule, mais la reprsentation comprhensive qui na pas dobstacles ; et ils empruntent aux Acadmiciens eux-mmes des exemples de reprsentations comprhensives, qui pourtant nemportent pas la croyance, telles que celle quAdmte avait dAlceste quand elle fut ramene des enfers. Ctait admettre que ce qui fait la certitude, cest moins la reprsentation elle-mme que son rapport lensemble dont elle fait partie. Ils luttent sans doute contre Carnade, et lon connat largument ad hominem que lui adressait Antipater de Tarse : Carnade devait admettre quil apercevait au moins une chose, savoir que rien ne peut tre peru 1.
p.394
Pourtant on voit tomber des traits essentiels de la conception du monde, notamment la thse de la conflagration universelle : Znon de Tarse et Diogne de Babylone (qui lavait dabord accepte) nosent la nier, mais ils suspendent leur p.395 jugement. Bothus de Sidon, en revanche, emploie contre elle toute une srie darguments qui nous ont t conservs par Philon dAlexandrie 2. Le fond de ces arguments, cest que le caractre divin et parfait du monde nest pas compatible avec sa corruptibilit. En de beaux vers, Lucrce (V, 1215) montre lhomme contemplant les toiles et se demandant si, capables grce aux dieux de se conserver ternellement, elles pourront, dans leur course sans fin travers les ges, mpriser les puissantes attaques dune dure sans bornes. Le sentiment que le monde est cr et doit disparatre, loin dtre pour lHellne une preuve de la puissance de Dieu, est au contraire un signe de son impuissance. Cest bien lide de Bothus : la corruption du monde naurait pas de cause, puisquelle ne peut venir ni de lextrieur, cest--dire du nant, ni de lintrieur du monde qui ne contient
1
SEXTUS, Contre les Mathmaticiens, VII, 253 ; CICRON, Premiers Acadmiques, II, 109 [IX.]. 2 De lIncorruptibilit du monde, ch. XV.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
271
aucun principe de maladie (cest l lenseignement du Time) ; de plus le monde ne se dtruit ni par division, puisquil ne rsulte pas dun assemblage datomes, ni par altration de la qualit, puisque les stociens admettent, on la vu, que son individualit ou qualit propre reste, aprs la conflagration, la mme quavant, ni par confusion ; elle est donc impossible. Enfin, et cest largument suprme, ea dieu, pendant toute la dure qui suit la conflagration, reste inactif ; or un dieu inactif est un dieu mort. Bothus revient, on le voit, une tradition thologique plus ancienne que le stocisme et qui simposera de plus en plus aux tenants de lhellnisme. La morale aussi se modifie. La formule de la fin que donne Diogne de Babylone : User de raison dans le choix des choses conformes la nature et le rejet de choses contraire , ou bien celle dAntipater : vivre en choisissant ce qui est conforme la nature et en rejetant ce qui est contraire , insistent avec beaucoup de force sur la ncessit et les raisons dun choix, videmment contre lindiffrentisme dAriston. Dans la curieuse p.396 discussion entre Diogne et Antipater sur un cas de conscience 1, (un commerant amne Rhodes pendant une famine une cargaison de bl ; suppos quils sachent que dautres vaisseaux vont arriver, doit-il le cacher pour vendre son bl plus cher ?), Diogne soutient quil na rien dire puisquil ne violera ainsi aucune loi tablie ; Antipater soutient que son devoir est de le dire, notre instinct social nous induisant faire tout ce qui est utile aux hommes : opposition entre une sorte de pharisasme dcoulant assez naturellement de la notion des fonctions dans lancien stocisme, et une conception plus large, plus libre, plus humaine, des devoirs qui sera celle du moyen et du nouveau stocisme. Il sagit surtout de rgler la vie commune, et nous voyons Antipater se faire le dfenseur du mariage, ce devoir religieux, forme suprieure de lamiti et de lentraide, dont laffaiblissement est un funeste symptme pour la socit 2. Nous avons vu Bothus introduire le platonisme dans la physique ; nous voyons Antipater rattacher expressment la morale stocienne Platon en cherchant chez lui lorigine de lide que lhonnte est seul un bien 3 ; et cest peut-tre par un retour aux ides de Platon quun disciple dAntipater, Hraclide de Tarse, abandonne le paradoxe que toutes les fautes sont gales . Mais tous ces traits saccusent chez Pantius de Rhodes, un des personnages les plus curieux du IIe sicle finissant. Lamiti qui lia Pantius (ainsi que lhistorien Polybe) des Romains minents de son temps, Scipion milien et Llius, au moment o lordre romain commenait simposer tous et, ralisant le rve dune socit universelle, paraissait consommer lhistoire, est un des symptmes les plus curieux de lesprit du temps. Sa
1 2
CICRON, Des Devoirs, III, 50-55. STOBE, Florilge, 70, 13 ; 73, 25. 3 CLMENT DALEXANDRIE. Stromates, V, 14.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
272
noblesse de caractre et sa gravit le rendaient digne, dit Cicron 1, de cette familiarit : Avant 129, anne p.397 o il prit Athnes la direction de lcole et sans doute depuis 146, il ne quitta gure Scipion, laccompagnant en 142 dans son voyage Alexandrie, faisant partie avec Polybe dun voyage dexploration organis en 146 par Scipion le long de la cte occidentale dAfrique. Pantius voyait en Scipion une sagesse, une rserve, une tenue morale qui faisaient son admiration 2. Scipion, dautre part, devait trouver dans le stocisme un guide moral bien ncessaire avec la croissance rapide de Rome et toutes les ambitions quelle suscitait. Comme on confie, disait-il Pantius, des dompteurs les chevaux capricieux ; il faut, amener les hommes trop confiants en leur toile a la rgle de la raison et de la doctrine, pour quils se rendent compte de la faiblesse des choses humaines et de linconstance de la fortune 3 . La vieille ducation traditionnelle doit donc cder le pas un enseignement rationnel. Les disciples romains de Pantius sont nombreux et influents ; cest Quintus Tubron, le neveu de Scipion, fervent Stocien dans sa conduite, qui crivit un trait Sur lOffice du juge, o il conciliait sans doute ses connaissances juridiques avec la doctrine stocienne 4 ; Mucius Scaevola, augure et juriste ; Rutilius Rufus, proconsul dAsie Mineure ; lius Stilon, un grammairien et historien qui fut matre de lrudit Varron. Aprs ce long sjour Rome, il dirigea lcole Athnes de 129 110. Lunivers de Pantius est bien diffrent de celui de Znon ; il a un grand enthousiasme pour Platon, le divin, le trs sage, le trs saint, lHomre des philosophes 5. Il nattache plus la dialectique broussailleuse la mme importance que les fondateurs de lcole, et son enseignement commence par la physique 6. Mais lunit du cosmos se dtend : la conflagration universelle, qui tait comme le symbole de la toute-puissance p.398 de la raison, est nie ; ce monde, si beau et si parfait, conservera toujours un ordre identique celui que nous contemplons. Avec la conflagration tombe la sympathie universelle ; quelle apparence que, dune distance presque infinie, linfluence des astres puisse stendre jusqu la lune, ou plutt jusqu la terre ? . En mme temps que la sympathie, il rejette la divination, fonde sur elle ; et il est dispos admettre un certain relchement dans le destin 7. Ces modifications touchent au fond des choses : Pantius nest plus un thologien, cest un humaniste ; cest lactivit civilisatrice de lhomme qui
1 2
Des Fins, IV, 33. PLINE, Histoire naturelle, V, 1 ; CICRON. Devoirs, II, 76 (Cf. Rheinisches Museum, LIII, p. 220). 3 Des Devoirs, I, 90. 4 AULU-GELLE, Nuits attiques, I, 22, 7 ; XIV, 2, 30. 5 CICRON, Tusculanes, I, XXXII, 79 [XXXII]. 6 DIOGNE LARCE, VII, 141. 7CICRON, De la Nature des Dieux, II, 115 et 85 ; De la Divination, II, 91 ; I, 3 ; Acadmiques, II, 42 et 107 ; PHILON, De lIncorruptibilit, ch. XV ; DIOGNE LARCE, VII, 147 et 149.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
273
lintresse, la raison humaine en mouvement, cratrice des arts et des sciences, beaucoup plus que la raison divine immanente aux choses. Aussi rejette-t-il pour lme (qui nest pour lui quun souffle enflamm) toute destine en dehors de sa vie dans le corps ; il allait, nous dit-on, jusqu nier lauthenticit du Phdon. Lme doit mourir, dit-il, puisquelle est ne, et la preuve quelle ne prexiste pas la naissance, cest la ressemblance morale des enfants avec leurs parents. Dautre part, elle est corruptible puisquelle est sujette la maladie ; et enfin sa partie thre doit regagner la mort les hauteurs du monde dont elle est issue 1. Il ne faut pas stonner non plus quil traitt la thologie des coles de simple bavardage : il est sans doute lauteur responsable de cette tude positive de la thologie que lon trouve chez son disciple Scaevola qui la transmise Varron 2. Il y a en fait trois thologies : celle des potes, si futile, qui met les dieux au-dessous des hommes de bien, celle des philosophes qui saccorde mal avec les croyances ncessaires aux cits, soit que, avec Evhmre, on pense que les dieux ne sont que des hommes rels que lon a diviniss, soit que lon accepte p.399 des dieux qui nont rien de commun avec les dieux dont on voit les statues dans les cits, puisque le dieu des philosophes na ni sexe, ni ge, ni corps limit. Il y a enfin la thologie civile, celle du culte, institue dans les cits par des sages ; et pour laquelle Scaevola, politique avant tout, ne cache pas sa prdilection. Pantius crivit en 140 un trait Du Devoir, qui, selon Cicron, contient sur le sujet une discussion trs exacte et sans controverse. Cicron ajoute quil a suivi (mais non traduit) ce trait dans les deux premiers livres de son propre ouvrage Des Devoirs, non pourtant sans le corriger quelque peu 3 . Ces deux livres forment notre principale source de renseignements sur Pantius. Son idal parat tre la conduite de lhonnte homme trouvant, dans une socit civilise, les moyens et les occasions de satisfaire et de fortifier les penchants dont la nature la dou. Vivre conformment la nature, cest pour lui vivre selon les inclinations quelle nous a donnes. 4. Cest notre nature individuelle quil faut prendre comme rgle. Sans doute il ne faut rien faire contre la nature universelle, mais, celle-ci respecte, suivons notre propre nature, et, trouvions-nous mieux ailleurs, mesurons pourtant nos volonts en les rglant sur notre propre nature 5. Plus de ces ambitions exagres de sagesse surhumaine. Non pas que Pantius, sous prtexte de naturalisme , permette lhomme de sabandonner toutes ses passions. La conscience que nous avons de notre humanit et de notre dignit dhomme suffit nous arrter. Lide dhumanit est vraiment le centre du trait cicronien. Il est intressant de prciser le sens et les cas o il lemploie. Il y a, par exemple,
1 2
CICRON, Tusculanes, I 42 et 79. piphane dans DIELS, Doxographi graeci, p. 513, 7 ; AUGUSTIN, Cit de Dieu, IV, 27. 3 CICRON, Des Devoirs, III, 7 [pantius] ; II, 60 [pantius]. 4 CLMENT DALEXANDRIE, Stromates, II, 79, 14. 5 Des Devoirs, II, 110.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
274
dit-il, deux espces de combats : le premier est lemploi direct de la force, comme chez les animaux ; le second est particulier lhomme : ce sont les guerres justes, prcdes p.400 de dclaration, impliquant le respect des serments. Ou encore ; il y a deux sortes de socits, les socits animales et les socits proprement humaines dont les deux liens les plus forts sont la raison et le langage (ratio et oratio), inconnus aux btes. Ou enfin : la rsistance au plaisir, qui est inconnue de lanimal, est au contraire digne de lhomme. Cicron dira aussi quil est inhumain de faire servir la perte des hommes de bien lloquence dont le rle naturel est de les sauver ; il dira quil est trs contraire lhumanit de mditer dans un banquet o lon est invit, de chanter sur la place publique 1. En un mot lhumanit, cest tout ce qui transforme en usages civiliss les instincts brutaux de lanimal, depuis la politesse et la tenue quelle exige jusquaux rgles de justice que gardent entre eux les ennemis eux-mmes, sils sont hommes. Lhomme de Pantius, ce nest pas lhomme rudimentaire des Cyniques pour qui la civilisation ne cre que complications inutiles ; car le lien social vient de la nature mme, et cest elle qui nous invite la rserve et au respect de nous-mmes (verecundia). Les arts sont non pas des dons des dieux, comme disent les mythes, mais des rsultats de leffort humain, et cest par eux que la vie humaine civilise est si loin de la manire de vivre des btes. Lhumanit transforme donc linstinct bestial, mais sans se substituer lui ; il y a chez les btes des tendances correspondantes toutes les vertus, un dsir de voir et dentendre et une tendance dsintresse au jeu, correspondant la vertu spculative, un dsir de conservation de soi correspondant au courage et la temprance, des tendances sociales innes. Les vertus humaines ne sont que ces tendances naturelles rgles par la raison 2. Lhomme, contrairement ce que dit le stocisme orthodoxe, est donc et reste double, raison et tenantes irrationnelles. Cette doctrine de Pantius, qui ne nous est parvenue quen p.401 chos assourdis, parat avoir t merveilleusement vivante et vigoureuse. Aprs la gravit un peu pesante ou le pessimisme dsenchant des doctrines des deux sicles qui ont prcd, la pense de Pantius, comme celle de Carnade, est comme un nouveau dpart dans la pense grecque ; lon a limpression dune vie intellectuelle ascendante, en correspondance avec les prodigieuses transformations politiques qui saccomplissaient dans le monde.
II. LE MOYEN STOCISME (SUITE). POSIDONIUS
@ Ce brillant dveloppement du stocisme se continue dans une tout autre voie avec le Syrien Posidonius dApame (135-51). Grand voyageur, et grand
1 2
Des Devoirs, I, 34 [festin] ; I, 50 ; I, 105 ; II, 51 ; I, 144. Des Devoirs, II, ch. IV.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
275
observateur de la nature, il visite toutes les ctes de la Mditerrane, Sicile, ctes de lAdriatique, Gaule Narbonnaise, ctes dEspagne jusqu lAtlantique, o il observe le phnomne des mares. Fix Rhodes aprs 1041, il y est chef dcole, en mme temps quil y occupe limportante fonction politique de prytane. Ses relations avec Rome sont constantes ; pendant la guerre de Mithridate, alors que Rhodes, presque seule en Orient, tait reste du parti romain, il va Rome en ambassade pour demander du secours. Pompe fut son ami personnel et lui rendit plusieurs fois visite Rhodes ; le souvenir de leurs conversations a t gard par Cicron, Pline lAncien et Plutarque ; Pompe ly entendit dfendre la philosophie contre les usurpations du rhteur Hermagoras : le philosophe doit se rserver les thses gnrales et lorateur se contenter des hypothses 1. Il fut aussi lami et le matre de Cicron qui sjourna Rhodes en 77. Comme Pantius, Posidonius a adhr de plein cur au parti romain ; lhistorien Polybe, qui voit dans la domination romaine la p.402 conclusion de lhistoire, fait leur lien ; Pantius est lami de Polybe, et Posidonius a continu son histoire. De ses ouvrages philosophiques pas plus que de ses ouvrages scientifiques, mathmatiques, historiques et gographiques, dune uvre dont lampleur nest comparable qu celle de lencyclopdie dAristote, il ne reste rien. Pour reconstituer sa pense il faut utiliser de Cicron le livre II du trait De la Nature des Dieux, le livre Ier des Tusculanes, le trait Sur la Divination : Galien nous fait connatre sa polmique contre Chrysippe sur la nature des passions ; Snque, dans les Questions naturelles, a utilis un ouvrage mtorologique dAsclpiodote de Nice, dont les ides remontent Posidonius ; Strabon le cite souvent dans sa Gographie, et Clomde, dans sa Thorie du mouvement circulaire sinspire de lui ; ajoutons enfin quelques donnes de Proclus sur sa pense mathmatique dans son Commentaire sur Euclide. Tout cela est bien fragmentaire, et la question si importante du sens et de la porte historique de luvre de Posidonius reste fort controverse, surtout depuis que Heinze, en 1892, dans son ouvrage sur Xnocrate, et Norden, en 1903, dans son Commentaire du VIe livre de lnide, ont cru reconnatre linfluence de Posidonius sur le mythe eschatologique du VIe livre de lnide de Virgile et sur celui qui termine le trait de Plutarque Sur le visage quon voit dans la lune. Ces mythes tout platoniciens, dont le dernier surtout reprsente lme purifie slevant vers les rgions clestes, rapprochs du Songe de Scipion, dans lequel Cicron montre lme, aprs la mort, contemplant lordre du monde, rapprochs aussi de ce fait que Posidonius, beaucoup plus nettement encore que Pantius, est revenu, contre le stocisme, la thorie platonicienne de lme, ont amen voir en Posidonius un penseur surtout religieux, auteur dune synthse entre le stocisme et le platonisme, et
1
CICRON, Tusculanes, II, 26, 61 ; PLINE, Histoire naturelle, VII, 30 ; PLUTARQUE, Vie de Pompe, 42 [posidonios] (cf. ARNIM, Dio von Prusa, p. 93).
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
276
linitiateur vritable du no-platonisme. Partant de cette hypothse, on a voulu voir les traces de la pense de p.403 Posidonius, partout o lon trouve cette sorte dasctisme mystique, qui surabonde la fin de lantiquit et qui suppose une conception de lme et une conception du monde : lme compose de deux lments, lun pur, lautre impur, qui souille le premier et dont le premier doit se librer ; un monde fait, limage de cette me, dune rgion pure (le ciel ou Dieu) o doit atteindre lesprit et dune rgion impure dans laquelle il se trouve ; tels, les nombreux passages asctiques de luvre de Philon dAlexandrie (dont le trait De la Cration du monde viendrait dun Commentaire du Time de Posidonius), ceux de Snque et les conceptions cosmologiques du petit trait Du Monde qui se trouve dans la collection des uvres dAristote. Si lon sen tient ce que lon sait certainement, on se gardera de faire de Posidonius lauteur responsable de ces croyances que nous allons voir sinsinuer sous tant de formes partir de notre re. Limage posidonienne de lunivers ressort avec clart du livre II du trait de Cicron Sur la nature des dieux, ds que lon accepte la belle analyse critique quen a faite Reinhardt. Il a montr, en comparant ce livre avec les passages correspondants de Sextus Empiricus, que Cicron y a utilis deux traits stociens de caractre fort diffrent, le premier, dveloppement dune thorie dcole, fait de syllogismes accumuls et constamment rpts sous plusieurs formes, le second dun style tout diffrent, faisant grande place lintuition et lexprience, sans se servir de syllogismes ; chaque fois que Cicron use de ce trait, on ne trouve plus aucun texte correspondant chez Sextus. Tels sont les chapitres 1,7 22 et 39 60 qui forment un tout, un trait sur la providence ; la providence ny est pas prouve comme corollaire des principes, mais saisie dune vision directe dans lensemble de lchelle ascendante des tres depuis linorganique jusqu lorganique et lhomme, non sans dtails exotiques qui rendent le tableau trs vivant. De mme, aux chapitres 11, 15 et 16, il est ais de voir que le p.404 principe de la providence est dfini moins comme une raison ( la manire de lancien stocisme) que comme un agent physique, la chaleur, qui se manifeste en particulier dans les toiles ; enfin dans les chapitres 32 37 se trouve la mme vue densemble sur la gradation des vivants, passant de la vie particulire des plantes la vie universelle de la terre, do elle est issue. Selon la juste formule de Reinhardt, dans lancien stocisme, la raison est organique ; l lorganique est rationnel ; le feu divin nest plus dabord une raison, cest une force organique (vis vitalis, dit Snque ; ). La physique de Posidonius serait donc avant tout un dynamisme insistant sur lexpansion de la vie et la complication graduelle des tres vivants. On conoit ainsi dans leur sens plein la dfinition du monde que Diogne Larce (VII, 138) attribue Posidonius : un systme fait du ciel, de la terre et des natures qui sont en eux. Dans un pareil systme lunit du monde, se dployant en une souple et riche varit dtres hirarchiquement ordonns est
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
277
le principal. Aussi serions-nous disposs croire au tmoignage de Philon dAlexandrie (malgr un texte contraire du doxographe Atius), qui dit que Posidonius abandonna la conflagration universelle et soutint lternit du monde 1. Le mme trait se retrouve dans sa thologie. L o lancien stocisme identifiait, Posidonius parat avoir voulu distinguer : au dire dAtius 2, il sparait Zeus, la nature et le destin comme trois termes dont chacun est subordonn au prcdent ; Zeus serait la force dans son unit, le destin la mme force envisage sous ses aspects multiples, tandis que la nature pourrait tre comme la puissance mane de Zeus, pour relier les forces multiples du destin. Cette triade ou trinit se retrouve chez Cicron propos de lorigine de la divination dans son trait De la Divination, tout inspir des p.405 cinq livres que Posidonius a crits sur le mme sujet. La divination peut venir soit de Dieu, lorsque Dieu vaticine par la bouche dune prophtesse inspire, soit du destin dans le cas de lastrologie dont les rgles sont fondes sur lobservation, soit de la nature, lorsque par exemple, dans le sommeil, lme, affranchie du corps, a des songes prophtiques. Lme a donc avec Dieu des relations directes par lenthousiasme mystique, tandis que le destin avec tous ses dtails est simple objet dobservation, et que la nature contient le principe de tous les vnements. Dans sa psychologie enfin on retrouve la mme tendance ; contrairement lopinion de Chrysippe, il croit impossible dexpliquer la passion, si lon nadmet pas dans lme la distinction et la hirarchie des facults qui ont t dcouvertes par Platon. Nous avons par Galien le dtail de sa critique de Chrysippe. Do viendrait, demande-t-il dabord, lexagration draisonnable de la tendance, qui constitue la passion, sil ny avait que la raison dans lhomme ? Le plaisir, dit-on, nest que lopinion dun bien; mais alors les sages, connaissant leur bonheur, devraient ressentir le plaisir. Il est vrai quil est, daprs Znon, lopinion rcente dun bien ; sil dpend ainsi de la dure, cest quil a une autre cause que le fait purement intellectuel de lopinion. Chrysippe ne sait rien nous dire de la cause de la passion ; il lattribue une maladie de lme, mais sans dcouvrir la cause de cette maladie ; il dit quil faut pour lprouver, une faiblesse peu commune, ce qui est faux, puisquil y a autant de degrs dans les passions, quil y a des degrs davancement vers la sagesse. Enfin la passion devrait tre la mme, quand lopinion sur le bien et le mal est la mme; or il nen est rien, et lhabitude ou le vice causent, pour une mme opinion, des passions plus fortes. La vritable cause des passions est quil y a en nous deux parties : un dmon qui est de mme nature que Dieu, et une partie mauvaise, bestiale, sans raison, athe. La passion consiste plier la premire partie la seconde ; p.406 contrairement ce que dit Chrysippe, il y a des inclinations qui sont mauvaises en elles-mmes ; notre
1 2
PHILON, De Lincorruptibilit, II, p. 497, d. Mangey ; ATIUS, Placita, II, 9, 3. Placita, p. 324, 4 (DIELS, Doxographi graeci).
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
278
temprament corporel lui-mme nous prdispose telle ou telle passion ; et ce nest pas par des arguments quon adoucit ou que lon combat les passions ; on ne peut agir sur lirrationnel que par des moyens irrationnels ; par exemple certains rythmes musicaux dtendent la colre ou le dsir. Partout, Posidonius semble avoir eu pour but de rechercher les liaisons dynamiques des choses. Le bon gographe, dit-il, doit considrer les choses terrestres en liaison avec les clestes. Sur ce principe, il recherche les causes la manire dAristote sans se soucier du prtendu mystre des choses. Dans lensemble, il essaye de dduire des conditions des zones trouves par lastronomie mathmatique, les conditions climatriques et leur influence sur lorganisme ; cest ainsi que, malgr la gographie purement physique, qui rejette le fait comme un conte, il admet le rcit de Pythas de Marseille qui avait observ un pays o le jour le plus court de lhiver durait quatre heures, et le plus long de lt dix-huit heures. Mme esprit, la fois exprimental et mathmatique, dans sa thorie des mares ; il en observe les variations quotidiennes, mensuelles et annuelles, et, aprs quelques autres, les attribue linfluence de la lune, laquelle il adjoint laction du soleil. Ce got de Posidonius pour les sciences se reporte naturellement aux arts qui font la civilisation et quil considre comme le fruit de la plus haute sagesse de lhumanit. Comment, lui demande Snque en critiquant ses ides sur ce point, peut-on admirer la fois Diogne et Ddale 1 ? Cette question fait voir quel point le niveau de la philosophie de Posidonius, qui prtend embrasser dune seule vue lhomme et la nature, dans toutes leurs manifestations les plus complexes, est au-dessus du mince asctisme des cyniques. Cest travers lhistoire p.407 entire de lhumanit quil suit le rle de la sagesse ; lge dor pass, o les sages taient rois, ils ont d se faire lgislateurs et inventer des lois pour sopposer aux vices croissants des hommes ; puis ils ont invent les arts qui facilitent la vie quotidienne, comme celui de btir ; ils ont dcouvert les mtaux, et leurs usages, les arts agricoles, le moulin bl ; Anacharsis invente la roue du potier ; Dmocrite le four poterie. Snque est un peu scandalis du terre terre de cette sagesse. Pour Posidonius, il est vident que rien nest insparable et que la raison humaine doit tre un gal degr artisane et thorique. Ces grandes dcouvertes se font dailleurs par des emprunts la nature : le feu dune fort a fondu le premier les mtaux ; les dents de lhomme ont commenc moudre le grain de bl ; il ny a pas entre art et nature cette opposition quon se plat signaler. Posidonius applique la mme ide lhistoire de la civilisation ; dans sa suite Polybe, en cinquante-deux livres qui traitent des vnements qui ont eu lieu de 145 86, il apprcie la civilisation romaine comme une continuation des civilisations prcdentes, trusque et grecque ; mais elle leur a donn la perfection et lachvement.
Lettre Lucilius, 90.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
279
Lhistoire comme la gographie, comme la morale et la physique tmoignent, pour Posidonius, dune mme continuit dynamique que lobjet de la philosophie est de partout retrouver.
III. LES PICURIENS DU Ier SICLE
@ Lpicurisme participa, lui aussi, cette sorte de renaissance de la philosophie aprs la conqute romaine ; Apollodore qui meurt en 81 ; Phdre que Cicron entend Athnes en 79, Znon de Sidon qui tait un vieillard en 76, Philodme de Gadara, un ami de Cicron, dont les fouilles dHerculanum ont rvl plusieurs uvres, enfin Lucrce (93-51), voil bien p.408 des noms qui prouvent quel point lpicurisme tait en vue dans le monde romain. Les picuriens ont se dfendre contre les autres coles. Dans son trait Sur les Signes, Philodme fait connatre une discussion entre le Stocien Denys et les picuriens Znon, Bromius et Dmtrius Lacon. On sait lemploi qupicure fait des signes pour passer des phnomnes ces ralits invisibles que sont le vide et les atomes ; le mouvement par exemple est le signe du vide. A quoi Denys objectait quon na pas le droit de passer de phnomnes passagers des ralits dun autre ordre, ternelles et immuables, comme le vide et les atomes ; ou, si lon se fonde sur une analogie avec ce que lon observe, (par exemple en concluant de limmutabilit des espces celle des atomes) on doit ou bien la limiter aux cas identiques, et alors elle est infconde, ou bien on doit indiquer le degr de ressemblance, et on est en plein arbitraire. Znon rpond en dfendant linduction picurienne, le passage du semblable au semblable ; son principe est que linvisible () nest tel pour nous que par sa petitesse ; mais les conditions dexistence sont les mmes en petit que celles que nous observons en grand ; ayant par exemple observ dans tous les mouvements que nous constatons ce caractre commun de ne pouvoir se produire que si les obstacles scartent, nous concluons bon droit quil en est de mme dans les mouvements cachs. Bromius ne fait dailleurs pas de difficult reconnatre quil faut rassembler de nombreux faits ; mais surtout des faits semblables qui soient en mme temps diffrents et permettent de mieux dgager la circonstance qui les accompagne insparablement ( ) , et Dmtrius ajoute, quon ne doit conclure que de cas prouvs de tout ct et qui ne laissent pas laffirmation contraire une lueur de vraisemblance. Cette discussion si intressante, dont nous ne dgageons que deux points essentiels, suppose une sorte de confiance dans une nature inaltrable sur laquelle sappuient les conclusions p.409 inductives ; lpicurien reconnat des concepts stables, des caractres communs immuables ; telle chose, dit-il encore, est le concept propre de telle autre chose ; comme lorsque nous disons
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
280
que le corps, comme tel, a masse et rsistance, et que lhomme, comme tel, est un animal raisonnable 1. Ce mme mlange de rationalisme et dempirisme se voit dans la rponse que Dmtrius Lacon fait aux sceptiques qui prtendaient montrer limpossibilit de la dmonstration parce quelle a toujours besoin elle-mme dtre dmontre. Lon tablit une dmonstration particulire concluante, par exemple celle quil y a des atomes et du vide, et lon montre quelle est sre ; nous aurons alors en elle la preuve de la dmonstration gnrique ; car, l o est lespce dun genre, l on trouve le genre dont elle est lespce 2. Toujours le mme trait qui rend si sympathique lattitude intellectuelle des picuriens : leur dgot du verbalisme et de la dialectique et leur bravoure se jeter in medias res. Le livre de Philodme Sur la Rhtorique donne la rponse picurienne la question la mode, si la rhtorique est un art. Il sagit surtout de savoir si lenseignement quon donnait dans les coles de sophistes pouvait tre pratiquement utilis devant les assembles du peuple et les tribunaux. picure dj disait que sduits par le bruit des priodes gales, opposes et chute semblable, les jeunes gens paient un salaire aux sophistes, mais connaissent bientt quils ont perdu leur argent. Cest donc un art, mais un art inutile au politique. Mais il y avait sur ce point des discussions lintrieur de lcole, et lon voit Philodme blmer svrement deux picuriens de Rhodes qui prtendent trouver dans picure la preuve que la rhtorique nest pas un art. Son trait De la Musique o il discute les opinions du p.410 stocien Diogne de Babylone est aussi dun grand intrt. Le Stocien se montre ici le vritable conservateur et fait valoir en faveur de la musique sa liaison intime avec la civilisation grecque traditionnelle, son rapport avec la pit et le culte des dieux, la manire dont elle apaise les passions et unit les hommes. Lpicurien est au contraire le vritable rationaliste, lesprit libre qui ne sen laisse pas imposer par les usages et les coutumes, contestant par exemple que le Chant najoute rien la gravit des penses dun pome. Son petit trait Sur la Colre, qui utilise Chrysippe dans la description de cette passion, distingue la colre vaine dune colre naturelle, lindignation, que seuls les mchants nprouvent pas et qui est invitable mme chez le sage 3. On a vu dj le mal que se donne Philodme pour dfendre lorthodoxie picurienne contre les htrodoxes de lcole quil appelle les sophistes et contre qui il a crit un trait spcial. Dans un court fragment de ce trait, rcemment tudi, il indique le fameux quadruple remde (tetrapharmakon) picurien contre tous les maux : Dieu nest pas craindre, la mort nest pas
1 2
Cf. surtout dans ldition Teubner du , les colonnes 20, 28, 29 et 34. SEXTUS, Contre les Mathmaticiens, VIII, 348. 3 dit par Wilcke, Teubner, 1914.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
281
redoutable, le bien est dacquisition facile, le danger facile supporter , sorte de formulaire dont picure avait donn le got ses disciples 1. Cest enfin lpoque qui a vu natre ladmirable pome de Lucrce De la Nature qui chante la srnit dun esprit apais par la vision picurienne des choses. Les loges dpicure nous sont une preuve de laccueil enthousiaste que ses ides trouvaient chez les meilleurs esprits de Rome. Il y a l une gravit daccent qui fait contraste avec lagilit dialectique des autres coles grecques, avec cette virtuosit qui devaient tre peu prises Rome. Dans ce vaste pome, tout vient-il dpicure ? Non assurment ; bien des dtails techniques de lexplication des mtores au livre IV reviennent plutt p.411 Posidonius ou Thophraste ; il prend aussi parfois directement Empdocle ; on y trouve des interprtations allgoriques peu habituelles chez les picuriens. De plus, le sentiment mme nest pas tout fait picurien, et la srnit de Lucrce est mlange de pessimisme ; elle ne vient pas dpicure, cette histoire de lhumanit qui se trouve la fin du livre V, et qui montre dans la civilisation une dchance plutt quun progrs ; ce sentiment de la dcadence irrmdiable, mille fois exprim, na pas son modle chez le matre. Quon songe aussi au livre III sur la mortalit de lme : Lucrce a montr par une foule darguments que lme est mortelle ; cela suffirait un picurien ; mais toute la fin sadresse ceux qui gardent des inquitudes, une fois la thse admise ; Lucrce veut encore nous protger contre lhorreur du nant, par la mditation de la mort immortelle . La clbre prosopope de la nature nuse pas darguments picuriens, mais elle insiste sur lternelle monotonie des choses (eadem sunt omnia semper), suggrant ainsi bien plutt le dgot de la vie que lintrpidit devant la mort. Lucrce, ici, utilise, bien plus qupicure, les thmes pessimistes que nous avons rencontrs dans les diatribes.
IV. LA FIN DE LA NOUVELLE ACADMIE
@ La crise qui atteint toutes les coles dans la premire moiti du premier sicle touche aussi lAcadmie : les deux scholarques qui succdent Clitomaque, Philon de Larisse (110-85) et Antiochus dAscalon (85-69), ne sentendirent ni avec leurs prdcesseurs ni entre eux sur la signification donner la doctrine acadmicienne. Nous pouvons nous faire une ide de ce dbat par les Acadmiques de Cicron. Cicron, qui connut Philon Rome entre 88 et 85, qui fut lve dAntiochus Athnes en 79, crivit en 46 un premier trait, les p.412 Premiers Acadmiques, dont le premier livre, perdu, le Catulus, contenait lexpos de la thorie de Carnade, et le second, conserv, le Lucullus, contient prcisment lexpos de la doctrine dAntiochus par Lucullus, suivi de la rfutation quen donne Cicron ; en se conformant
1
VOGLIANO, Rivista di filologia, 1926.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
282
Philon de Larisse. Lanne suivante il crivit une seconde rdaction du mme trait, en quatre livres, les Seconds Acadmiques ; le premier livre, seul conserv, contient un expos de la doctrine dAntiochus, mis dans la bouche de Varron. Pour bien faire comprendre le sujet du dbat, nous devancerons le temps et exposerons dabord le contenu de ce premier livre des Seconds Acadmiques. Varron-Antiochus y expose une thse historique des plus tranges ; les vritables continuateurs de Platon et des Acadmiciens, ce ne sont point Arcsilas et Carnade, ce sont les Stociens ; et cest en reprenant le stocisme bien compris et purg de ses inconsquences que lon renouera la tradition acadmique. Znon de Cittium, qui la reue par Polmon, na fait que changer quelques noms ; en appelant prfrables la richesse et la sant que Platon appelait des biens, il na rien chang aux rgles de la conduite ; tout en rejetant lincorporit de lme, il a gard lessentiel de la physique platonicienne qui est la dualit dun agent et dun patient ; enfin, il admet comme Platon la certitude, tout en la plaant dans les sens. Antiochus est ici le fondateur dun dogmatisme syncrtiste qui efface toutes les nuances ; il collabore, sa manire, ce rapprochement du platonisme et du stocisme que lon constate chez Pantius et Posidonius. Or Cicron raconte que, en 87 avant J.-C., Lucullus, tant proquesteur Alexandrie, avait parmi ses familiers Antiochus et son ami Hraclite de Tyr ; lon avait apport Alexandrie deux livres de Philon ; Antiochus, les ayant lus, sirrita et demanda Hraclite sil avait jamais ou Philon ou un Acadmicien quelconque dire de telles choses ; cest ce moment quil crivit contre son matre un livre intitul le Sosus. Ce qui cause lirritation dAntiochus ne peut tre d, semble-t-il, qu la manire singulire quil a lui-mme dcrire lhistoire ; dans sa rponse Lucullus et Varron, Cicron, qui reprsente Philon, leur oppose une autre vrit historique, celle de la tradition sceptique, qui commence avec les physiciens Anaxagore et Empdocle, continue avec Socrate quAntiochus voudrait sparer de Platon, avec Platon lui-mme et les Cyrnaques 1. Quant Philon, le no-platonicien Numnius raconte quil a chang davis et que, aprs avoir cultiv et exagr les dogmes de Clitomaque, il devint lui-mme dogmatique, retourn par lvidence quil trouvait dans les impressions passives et leur accord entre elles 2 . Philon tait-il donc sur la pente qui menait au dogmatisme dAntiochus ? Dans la mme phrase, daprs Sextus 3, Philon dit que les choses sont incomprhensibles et quelles sont comprhensibles ; Cicron le reprsente la fois ruinant la dfinition znonienne de la reprsentation comprhensive et refusant pourtant
p.413
1 2
Premiers Acadmiques, 72-76 ; Derniers Acadmiques, 43-46. EUSBE, Prparation vanglique, XIV, 712. 3 Hypotyposes, I, 235.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
283
dadmettre que rien ne puisse tre compris 1. Enfin, on le voit admettre la fois des choses videntes (perspicua) qui sont empreintes dans lesprit, tout en naccordant pas que ces choses soient perues. Antiochus, qui le connaissait bien pour avoir t son lve pendant beaucoup plus de temps que personne autre, a-t-il tort de le taxer de contradiction ? La contradiction nest peut-tre quapparente ; Philon a pu admettre des vidences irrsistibles, sans admettre le critre stocien ; et le texte de Sextus ne veut pas dire autre chose : si lon veut user du critre stocien (cest--dire une reprsentation non seulement correspondante lobjet mais capable dtre distingue de tout autre qui ne lest pas), rien nest comprhensible ; en se laissant aller la spontanit de la nature, il y a des choses comprhensibles ; ce sont les perspicua dont parle Cicron. p.414 Philon est donc de ces philosophes dont le sceptique nsidme dit quils dogmatisent sur beaucoup de choses, mais ne veulent pas faire reposer leurs affirmations sur la reprsentation comprhensive. De fait Stobe 2 nous a conserv sous son nom lesquisse dun vritable enseignement moral, dont le dessin nest pas trs diffrent de celui de lenseignement stocien. Telle est lissue de la pense acadmique qui tend se durcir en dogmes.
Bibliographie @
1 2
Premiers Acadmiques, II, 34. Eclogues, II, 40.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
284
CHAPITRE VI LES COURANTS DIDES AUX DEUX PREMIERS SICLES DE NOTRE RE
I. CARACTRES GNRAUX DE LA PRIODE
@ Rien de plus confus que lhistoire de la pense intellectuelle aux deux premiers sicles de notre re ; ces deux sicles voient briller dun dernier clat, avec Snque, pictte et Marc-Aurle, puis disparatre, les grands dogmatismes post-aristotliciens, Inversement, cest la renaissance de lidalisme athnien des Ve et IVe sicles, des systmes de Platon et dAristote. Philon dAlexandrie au dbut de notre re, Plutarque de Chrone (49-120), puis les commentateurs de Platon, en particulier Albinus vers le milieu du IIe sicle, ceux dAristote en sont les tmoins ; en mme temps se cre une littrature pythagoricienne, toute imprgne de platonisme. Mais ct des grandes coles philosophiques, que de motifs nouveaux de penses qui sefforcent de prendre forme et dentrer dans le courant de la civilisation ! Cest la pntration rciproque de lhellnisme et de lOrient ; les juifs dAlexandrie, avec Philon, sy font dabord une place ; puis cest le christianisme : le IIe sicle voit simultanment les apologistes, Justin, Tatien et Irne, et lclosion des grands systmes gnostiques ; plus caches mais non moins actives sont les religions orientales, en particulier celle de Mithra, qui, outre leurs cultes et leurs mystres, ont des conceptions densemble de lunivers et de la destine humaine.
p.415
Ce nest que par abstraction que lon peut tudier isolment ces mouvements de pense ; ils appartiennent une mme civilisation intellectuelle dont il importe de saisir les caractres communs : en premier lieu, la priode cratrice est bien acheve; on ne continue pas les uvres de Platon, dAristote et de Chrysippe, on les commente, et leur lecture assidue donne lieu des exercices sans cesse renouvels. On nprouve pas le besoin de rviser leur conception de lunivers et du cosmos ; cette conception, qui a t chez eux le fruit de lexprience et du raisonnement, est maintenant une image fixe do lon part ; un monde fini et unique, le gocentrisme, lopposition de la terre, lieu du changement et de la corruption, et du ciel incorruptible, avec les rgions intermdiaires de lair, linfluence plus ou moins considrable des astres sur les destines terrestres, voil des dogmes communs presque tous et qui dici longtemps ne seront pas rviss. Nulle curiosit philosophique profonde ; par suite, si lon en excepte les arts
p.416
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
285
pratiques, la mdecine (Galien), les mcaniques (Hron dAlexandrie) et mme lalchimie, nulle curiosit scientifique ; ces arts en effet se vantent le plus souvent dtre de simples pratiques, fruits de lexprience, qui sont tout fait indpendants des sciences thoriques ; si Galien sans doute veut que le mdecin soit philosophe, il entend par l non pas quil doive avoir ses thories personnelles, mais quil doit user pour la physiologie des physiques aristotlicienne ou stocienne ; en revanche Sextus Empiricus et lcole des mdecins dits empiriques, ont grand soin de restreindre la mthode du mdecin la pure observation. Les sciences thoriques, mathmatiques, musique, astronomie ne servent pas plus aux arts pratiques qu la spculation sur lunivers ; on se demande souvent quelle doit tre leur place dans lducation ; on a comme peur de les voir se dvelopper pour elles-mmes, et on ne leur laisse en gnral quun rle subordonn ; il faut en tudier tout ce qui est ncessaire pour comprendre et concevoir le systme du cosmos, p.417 mais sans plus ; ce cycle de lducation librale ( ) est tout au plus lesclave ou lintroducteur de la philosophie ; Thon de Smyrne crit vers 125 un ouvrage sur les connaissances mathmatiques ncessaires pour lire Platon ; larithmtique, chez Philon dAlexandrie, ne sert qu prparer le symbolisme numrique. Ainsi une intelligence fige en images qui simposent, et tout lessor intellectuel arrt, voil un trait gnral de cette priode. Il sensuit que, certains gards, la philosophie ne fournit plus que des thmes, et des thmes si uss que lon ne peut les renouveler que par la virtuosit de la forme. La philosophie tomberait-elle dans la pure rhtorique ? Cest pour elle un constant danger ; combien de fois pictte la-t-il senti, qui reproche constamment ses lves leur absence de sentiments profonds et leur tendance la pure habilet rhtorique ! Combien de fois dj Snque sacrifie-t-il la pense au balancement de la phrase et la dcouverte dingnieuses formules ! Et lon voit un Maxime de Tyr exposer en style lgant le pour et le contre sur les sujets philosophiques les plus graves, la vie pratique et active, le rle des sciences dans la philosophie 1. Si bien que, dans la lutte constante entre les professeurs de rhtorique confrenciers ou sophistes et les philosophes, les sophistes sont prs de triompher ; un lius Aristide (117-177), qui critique passionnment la condamnation de la rhtorique par Platon dans le Gorgias, met lducation formelle du rhteur bien au-dessus de celle du philosophe 2. Cette tournure frivole de la pense, qui ne trouve aucun obstacle dans une activit mthodique de lesprit, a au contraire son contrepoids dans des proccupations morales et religieuses qui sont foncirement les mmes dans toutes les coles. On cherche ce moment, chez le philosophe, un guide, un p.418 consolateur, un directeur de conscience. La philosophie est une cole de paix et de srnit. Si elle prtend rester recherche et connaissance de la
1 2
Dissertations, V et VI, XX et XXI. A. BOULANGER, lius Aristide, 1923.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
286
vrit, cest cause de la valeur que cette connaissance a pour la paix de lme et son bonheur. La philosophie, dit Albinus en son Manuel de philosophie platonicienne, est, en mme temps que le dsir de sagesse, la dlivrance de lme et sa conversion en dehors du corps, qui nous tourne vers les intelligibles et les tres vritables. Ce qui importe dans la connaissance de la vrit, cest datteindre lobjet de la vrit, qui seul produit le bonheur ; ce nest pas la mthode selon laquelle on le recherche. Il sagit moins, on la vu dj propos du stocisme, de dcouvrir une vrit nouvelle que de transformer lesprit et la vision quil a des choses, les jugements quil porte sur elles ; ce rsultat est acquis moins en instruisant lesprit quen le frappant.
II. LE STOCISME A LPOQUE IMPRIALE
@ Aussi, quelles sont les formes littraires que prend la philosophie stocienne ? Des sortes de catchismes moraux comme les discours de Musonius, des sermons thmes philosophiques comme ceux de Dion Chrysostome, des lettres ou des traits de direction spirituelle, comme chez Snque, des causeries qui visent lentranement spirituel chez pictte, lexamen de conscience chez Marc-Aurle. Mais, au-dessous de ces uvres littraires, il faut songer aux innombrables anonymes qui, au milieu des vices croissants de la socit romaine, o les non possdants ne songent qu vivre de la clientle des riches et sur les fonds publics, se donnent pour mission le relvement moral. Quelquefois nous assistons la naissance de ces vocations. cest par exemple le marchand Damasippe qui, aprs une faillite se fait Stocien ; nayant plus daffaires moi, je moccupe de celles des autres , lui fait dire Horace 1 ; cest Dion p.419 Chrysostome, le brillant confrencier mondain qui, ruin par lexil sous Domitien en 83, prend le bton des Cyniques et va de ville en ville prcher la bonne parole. Autour des plus clbres se forment des cercles de jeunes gens, vritable foyer de propagande ; le satirique Perse 2 nous dit lenthousiasme quveillait chez les jeunes gens le Stocien Cornutus, lauteur dune petite thologie stocienne allgorique qui nous est conserve. Lucien nous dit quelle place tenait dans sa ville Dmonax, le Stocien dont la parole apaisante calmait les disputes dans le priv comme dans le publie. On sait combien de jeunes Romains taient envoys chez pictte, sur les rivages lointains de Nicopolis, et combien il avait de mal leur faire quitter lombre de lcole pour la vie publique. Il faut lire lHermotime de Lucien pour voir jusquo allait lengouement pour les philosophes directeurs de consciences chez qui lon trouvait des disciples aux cheveux blanchis et ne se lassant pas dapprendre.
1 2
Satires, livre II, III, 18. Satire, V.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
287
Avec de si multiples ramifications, il est naturel que le stocisme affleure parfois dans la vie politique : le stocisme est suspect, surtout aux mauvais empereurs : parmi les accusations de Tigellinus, laffranchi de Nron, contre Rubellius Plautus, le petit-fils dAuguste, quil voulait faire passer pour un prtendant lempire, se trouve limputation de stocisme ; il suit, dit laccusateur, la secte arrogante des Stociens, fauteurs de troubles et dsireux de dsordre. Rubellius alors en Syrie (en 62) avait auprs de lui comme conseillers moraux les philosophes Coeranus et Musonius ; et, comme on lui envoyait des soldats pour le mettre mort, contre lopinion dun affranchi qui voulait quil rsistt, ils lui conseillrent la place dune vie incertaine et tremblante la fermet dune mort toute prte . Plus tard, en 65, lexil de Musonius et de Cornutus est compris dans les mesures ordonnes par Nron la suite de la conjuration de Pison ; Musonius tait suspect dapprendre la p.420 philosophie aux jeunes gens 1. Opposition muette, on le voit par ces exemples, et non pas rsistance ouverte ; le stocisme nest pas devenu, plus quil ne la jamais t, un parti politique ; le clbre Thrasas ntait pas un politique. Sous Vespasien, nouvel assaut ; le gendre de Thrasas, Helvidius Priscus, alors stratge, est accus de refuser de rendre les honneurs lempereur et de faire de la propagande en faveur de la dmocratie ; en 71, tous les philosophes sont chasss de Rome, sauf Musonius, qui, rappel Rome sous Galba, ne fut pas inquit. Cest vers cette poque que Dion Chrysostome, encore rhteur et non touch par la grce cynique, prononce des discours Contre les Philosophes, ces pestes des cits et des gouvernements . Plus tard, en 85, le souponneux Domitien faisait tuer le sophiste Maternus pour avoir prononc un discours dcole contre les tyrans, Rusticus Arulinus parce quil philosophait et considrait Thrasas comme un saint , Herennius Senecion pour avoir rdig une vie dHelvidius Priscus 2. Le stocisme, si rpandu, a-t-il laiss quelque chose de lui dans le droit romain ? Le caractre historique du droit romain est sans doute son indpendance quasi parfaite de la religion, et de la morale, cest aussi une notion de la souverainet de ltat, vraiment trangre la Grce ; aussi, bien que les traits thoriques comme les Lois de Cicron soient dinspiration stocienne, bien que lon puisse trouver chez Ulpien une dfinition stocienne de la justice, la volont constante et perptuelle dattribuer chacun le sien , le stocisme na jou l quun rle effac ; les historiens du droit ne sont mme pas daccord pour faire remonter au stocisme la notion de droit naturel, et plusieurs lui donnent une origine purement romaine 3. Lenseignement des Stociens se prsente sous plusieurs formes assez diffrentes : il y a dabord, dans lcole, un enseignement technique trs sec et
p.421 1
BOISSIER, LOpposition sous les Csars, chapitre II ; TACITE, Annales, XIV, 57 et 59 [musonius] ; XV, 71 [LXXI]. 2 DION CASSIUS, Histoire romaine 66, 12-19 ; 67, 13. 3 HILDENBRAND, Geschichter und System der Rechts und Staatsphilosophie, I, 600, contre VOIGT, Rmische Rechtsgeschichte, I, 237 sq.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
288
scolastique, fond sur la lecture commente des anciens matres ; de Chrysippe en particulier, celui quAulu-Gelle a connu chez les Stociens dAthnes dans la premire moiti du IIe sicle ; il en indique les divisions, en particulier celles de la dialectique et de la morale, qui ne font que reproduire les divisions traditionnelles. On apprend en particulier mettre en forme les syllogismes 1. Chez Philon dAlexandrie, chez pictte on trouve nombre dallusions des leons dcole de ce genre ; pictte reproche plusieurs fois aux matres de philosophie de sen tenir linterprtation de Chrysippe et dtre de purs philologues. Il est noter que les seuls Stociens quon lit sont de lancien stocisme ; les plus rcents que cite pictte sont Archdme, Antipater et Crinis ; on ignore Pantius et Posidonius, et, avec eux, la direction nouvelle, humaniste et platonicienne quavait prise lcole. pictte est plus prs de Znon que de Pantius 2. Il y avait un enseignement plus vivant et plus agissant. Il employait tous les procds depuis le discours public, la manire du rhteur, adress tous, jusqu la consultation personnelle, adapte chaque cas particulier. Plutarque nous parle de ltonnement des gens qui, habitus entendre les philosophes dans les coles, avec le mme sentiment quils coutent les tragdiens dans les thtres, ou les sophistes dans leur chaire, cest--dire en cherchant en eux la seule virtuosit de parole, sont tout surpris que, le cours une fois fini, ils ne dposent pas leurs ides avec leurs cahiers ; et surtout lorsque le philosophe les prend en particulier et les avertit franchement de leurs fautes, ils le trouvent dplac ; ... ils ignorent que chez les vrais philo,sophes, le srieux et la plaisanterie, le sourire et la svrit, p.422 et surtout les raisonnements quils tiennent chacun en particulier ont la plus utile influence 3 . Entre ces confrences morales dapparat dont les discours de Dion Chrysostome donnent lexemple et ces consultations personnelles, telles que celle que Snque a crite pour son ami Srnus Sur la Tranquillit de lme, il y a toute sorte de procds intermdiaires : en particulier, dans lenceinte de lcole, la diatribe. Le matre (ou un lve) vient de faire une leon technique ; il donne la permission de linterroger, et commence alors une improvisation, libre de toutes formes techniques, dans un style souvent brillant et imag, plein danecdotes, ayant recours lindignation ou lironie ; tel est le procd que le philosophe Taurus employait Athnes, daprs Aulu-Gelle (I, 26) ; tel est celui dpictte dont llve Arrien a rdig les clbres diatribes. Il est mme visible que, dans cette rdaction, est parfois entr le rsum de la leon ou du commentaire technique que venait de faire le disciple, quoi nous devons de trs rares mais prcieuses indications techniques sur lancien stocisme dont le
1 2
AULU-GELLE, Nuits attiques, I, 2 ; II, 8. PHILON, De lAgriculture, 139, d. Cohn ; PICTTE, Dissertations, I, 17, 13 ; III, 2, 13. 3 PLUTARQUE, De la bonne manire dcouter, ch. XII.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
289
ton tranche dune manire remarquable avec les vigoureuses sorties du matre 1.
III. MUSONIUS RUFUS
@ De Musonius Rufus, Stobe en son Florilge, a conserv quelques prdications morales, rdiges par un de ses lves ; par exemple un sermon Sur la nourriture (17, 43), o il fait de labstinence dans le boire et le manger le principe de la temprance et recommande, la manire dun pythagoricien, le vgtarisme ; dans le sermon Sur labri (1, 64) il prescrit la simplicit dans le vtement et dans larchitecture ; ailleurs (19, 16) il crit pour recommander aux philosophes de ne pas p.423 porter plainte contre les insultes qui, effectivement (il suffit de lire pictte), devaient tre nombreuses (56, 20). A ceux qui croient la vocation de philosophe incompatible avec le mariage, il rpond en citant tout une liste de grands philosophes maris, Pythagore, Socrate, Crats, et en faisant lloge du mariage : le dtruire, cest dtruire la famille et la cit ; cest dtruire tout le genre humain (67, 20). Il en indique les devoirs. Il met en garde contre lincontinence. Ailleurs (75, 15), il se montre fort proccup de la diminution du nombre des enfants dans les familles romaines, la chose la plus nuisible qui puisse tre la cit , et slve en particulier contre labominable pratique, toujours vivante, parat-il, de lexposition des enfants. A un jeune homme qui voulait faire de la philosophie, malgr lordre formel de ses parents, et qui lui demandait sil ny avait pas des cas o un fils pouvait dsobir, il rpand en recommandant lobissance complte et stricte aux parents, tout en lui faisant comprendre que ses parents ne peuvent pas et mme ne veulent pas lempcher de philosopher, cest--dire non pas de porter barbe longue et manteau court, mais dtre juste et temprant. Il faut enfin citer sa mditation sur lexil, qui ne nous prive daucun bien vritable 2. On voit la manire : des morceaux courts, de mme inspiration, mais sans appareil technique, sans systmatisation et dont chacun se suffit lui-mme. En une pareille ducation, Musonius a la plus grande confiance ; cest elle qui fait les bons rois comme les bons citoyens ; le matre de morale est indispensable ; il est utile de manger, de boire et de dormir sous la surveillance dun homme de bien (66, 19). De cet ducateur moral, il se fait la plus haute ide ; aussi il a plutt dcourager qu veiller les vocations : Il vaut mieux quils ne sapprochent pas du philosophe, la plupart des jeunes gens qui disent vouloir philosopher ; leur approche est une tache pour la p.424 philosophie. Et il fait voir le contraste entre lauditoire du philosophe mondain, applaudissant et louant, et celui du philosophe vritable qui donne la conscience du pch et
1 2
Par exemple dans II, 1, les 1 7 rsument la leon du jour ; le reste est la diatribe. STOBE, 69, 23 ; 70, 14 ; 75, 15 ; 84, 21.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
290
amne au repentir 1. Il faut ajouter, pour complter ce portrait, que Musonius connat les rebuffades venant, comme dit Tacite, qui raconte lanecdote, dune sagesse intempestive ; envoy par Vitellius, en 69, pour inviter la concorde larme flavienne qui tait aux portes de Rome, il dut subir, en se mlant aux manipules, les brocards et mme les mauvais traitements des soldats 2.
IV. SNQUE
@ Moins candide tait Snque, prcepteur puis ministre de Nron ; n Cordoue, en 4 avant J.-C., dun rhteur dont il reste beaucoup de thmes de discours et dexercices, il reut une ducation soigne dans la maison de sa tante, dont le mari, Vitrasius Pollio, fut prfet dgypte pendant seize ans ; en 41, il fut exil en Corse par Claude la suite dun scandale de cour, et il crivit un ministre tout-puissant, en 43, une Consolation Polybe, que lon trouvera pleine de flatteries ; en 49, il est rappel par Agrippine qui lui confie lducation de Nron ; de 54 61, il est le ministre de Nron ; disgrci, il vit dans la retraite de 62 65, et, sur lordre de Nron, il finit par le suicide. De 41 62, il crivit ses uvres, dix traits moraux ou dialogues (le mot dialogi traduit le grec diatribes et indique tout de suite le genre littraire o il faut les placer) ; vers 59, il crit le trait Des Bienfaits. Cest vers la fin de sa vie, aprs sa retraite, quil crit, en 62, les Questions naturelles, o il nous fait connatre lexplication des mtores, quil emprunte surtout Asclpiodote de Nice, un lve de Posidonius, et les fameuses Lettres Lucilius ; Lucilius, procurateur de Sicile, ny joue quun p.425 rle bien effac ; dans ces cent vingt-quatre lettres, on voit moins une effective direction de conscience que lusage dune forme littraire, quil choisit sous linfluence dun recueil de lettres dpicure, quil venait de lire et quil cite constamment dans les vingt-neuf premires lettres, forme littraire plus commode un homme toujours en peine dordonner ses ides 3. Il se donne comme un stocien trs libre ; les anciens ne sont pas des matres mais des guides ; il ne faut pas les suivre, mais y donner son adhsion ; leurs ides doivent tre traites comme un bien de famille amliorer. Aussi nprouve-t-il aucun scrupule ranger picure parmi les prudentiores, auprs de qui lon prend conseil, et le mettre avec Znon et Socrate parmi ceux dont lexemple et le caractre ont eu une influence plus grande que les paroles et lenseignement 4. Snque se montre donc non seulement fort dtach de la partie systmatique de la philosophie, mais
1 2
AULU-GELLE, Nuits attiques, II, 1 TACITE, Histoires, III, 71. 3 Cf. BOURGERY, Revue de philologie, 1911, p. 40 ; PICHON, Journal des Savants, mai 1912. 4 Lettres Lucilius, 45, 4 ; 80, 1 ; 64, 7 ; 22, 5 ; 6, 6.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
291
encore bien plus confiant dans les influences personnelles que dans linfluence des doctrines. Cest dire quil se mfie du trop de science et de la curiosit inutile : Vouloir savoir plus quil nest suffisant, cest une manire dintemprance. On sinstruira dans les arts libraux, mathmatiques et astronomie, mais seulement aussi longtemps que lesprit ne peut rien produire de plus grand. Et, aprs avoir expos quelques subtilits stociennes, il ajoute : tre sage est une chose moins cache et plus simple 1. On sent ds lors dans quel esprit il soccupera de physique sil sen occupe ; cest que la connaissance du monde et du ciel lve lme et la transporte au niveau des objets quelle traite . Ses recherches physiques, les Questions naturelles, comme sans doute ses livres perdus Sur la situation de lInde, la situation et la religion des gyptiens, sont des compilations, et encore, propos dun fragment dhistoire naturelle sur les p.426 poissons commence-t-il une diatribe contre le luxe de table, comme il blme lusage de la glace, propos de la formation de la neige. Sa thologie nest aussi et ne veut tre que ddification morale. Voulez-vous tre agrable Dieu ? Soyez bon ; lui rendre un culte, cest limiter ; cest non pas user de sacrifices, mais dune volont pieuse et droite. Il a cette dvotion stocienne envers Dieu bienfaisant, Dieu tmoin intrieur de nos actes, Dieu pre, Dieu juge, qui laisse compltement intacte ltude de sa nature et de son rapport au monde : Lorigine divine de lme humaine, parcelle du divin descendue dans le corps, est encore pour lui matire dveloppement difiant ; mais, peu lui importe ce quest lme et o elle est 2. O Snque est vraiment chez lui, cest dans le tableau subtil et mille fois nuanc des vices ou maladies morales qu il veut soigner. Observation aigu et pessimiste, voil ce que nous trouvons chez lui. Cest une runion de btes fauves, dit-il de la socit de son temps ; la diffrence, cest que celles-ci, entre elles, sont douces et sabstiennent de mordre ; les hommes se dchirent entre eux 3 : Le sage ne sirrite pas contre un vice commun tous ; il verra les hommes dun il aussi favorable que le mdecin voit ses malades ; il aura dailleurs comme contre-partie le sentiment de lextrme fragilit des choses humaines, en lesquelles rien nest certain que la mort 4. Aussi Snque dveloppe-t-il avec complaisance toutes les nuances du mal moral, en particulier ce dgot de la vie et de laction qui enlve le calme son ami Srnus : un regret de la chose entreprise, crainte dentreprendre, ballottement de lesprit qui ne trouve pas dissue parce quil ne peut ni commander ses dsirs, ni leur obir. Do lennui et le mcontentement de soi 5 .
1 2
Ibid., 8, 36 ; 106, 11. Voir successivement, Lettres, 117, 19 ; 95, 10 ; Questions naturelles, IV, 13 ; V, 15 ; Lettres, 95 ; 115 ; 44, 49 ; Des Bienfaits, II, 29 ; Lettres, 41, 2 ; 66, 12 ; 31, 11 ; 92, 30 ; Questions, VII, 25. 3 De la Colre, II, 8-10 [froces]. 4 Lettres, 90, 11. 5 De la Tranquillit, ch. II.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
292
V. PICTTE
@ Snque sadresse le plus souvent des hommes faits, que les circonstances ont prouvs et quil veut gurir. pictte est le matre des jeunes gens dont il veut former la volont ; souvent des jeunes gens riches destins aux carrires publiques et quil faut garantir contre les mille dangers du servilisme, de la flatterie, des subits revers de fortune. Sous mille formes. il leur rpte la mme vrit ; le bien et le mal pour lhomme sont uniquement dans ce qui dpend de lui, cest--dire dans le jugement et la volont qui, selon quils seront sains et droits, ou bien dpravs, produiront tout le bonheur ou le malheur dont lhomme est susceptible. La vraie libert, cest laffranchissement des opinions fausses. Lpoque dpictte est celle o lingnu, celui qui na dans ses ascendants que des hommes libres, se fait de plus en plus rare ; les affranchis et leurs familles ont un rle qui va croissant ; pictte lui-mme est un esclave affranchi 1. Cest cette libration de fait de lesclave qupictte transpose dans le sentiment moral : Le dogme philosophique, dit-il, cest ce qui fait relever la tte ceux qui sont abaisss, ce qui permet de regarder les riches et les tyrans droit dans les yeux 2. Cest bien des fois quil exprime lide que le travail manuel ne dshonore pas, et un de ses disciples qui craignait la pauvret, il donne en exemple des mendiants, des esclaves et des travailleurs.
p.427
Cette libert intrieure consiste dans lusage des reprsentations 3. Toute action, aussi bien chez lanimal que chez lhomme, suit une reprsentation ; lanimal comme lhomme use de ses reprsentations pour agir. Mais les btes nont pas conscience de cet usage ; lhomme en a conscience, et cest p.428 pourquoi il peut en user bien ou mal, correctement ou non. Ce qui nest pas moi ce sont mes aeux, mes proches, mes amis, ma rputation, mon sjour, Quest-ce qui est donc toi ? Lusage de mes reprsentations. Personne ne peut me forcer penser ce que je ne pense pas 4. A ce sentiment de libert est li un sentiment religieux trs vif, qui consiste avant tout en une relation spciale de lhomme Dieu ; si lhomme est libre, cest quil est une des parties principales de la nature en vue desquelles toutes les autres choses sont faites ; tant une partie principale, il est non pas comme les autres choses une uvre de Dieu, mais un fragment de
1 2
DENIS, Histoire des ides morales, t. II, p. 80. Dissertations, III, 26, 35. 3 BONHFFER, Die Ethik des Epiktet, p. 73 ; Dissertations, III, 20, 7 ; I, 9, 8 ; I, 16, 12 ; I, 10, 7 ; IV, 4, 4. 4 III, 24, 68.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
293
Dieu ; Dieu la donn lui-mme au lieu de le laisser dpendant 1. Mais il faut bien entendre que cette apothose de lhomme est moins une donne brute quun idal raliser et comme une croyance directrice.
VI. MARC-AURLE
@ Lexamen de conscience quotidien est une pratique morale recommande par Snque, qui la rapporte au Pythagoricien Sextius. Chaque soir, avant le sommeil, il faut se demander : Quel mal ai-je guri aujourdhui ? A quel vice ai-je rsist ? En quoi suis-je meilleur 2 ? Cest srement ces pratiques de mditation intrieure que nous devons les penses que Marc-Aurle sest adresses lui-mme. Il sagit avant tout pour lempereur, au milieu de ses soucis politiques et de ses campagnes contre les Barbares, de se garder contre le dcouragement. On sent chez lui une nergie qui a toujours besoin de se tendre nouveau. Le sentiment de dtresse au rveil, les penses troublantes qui lui viennent, les reproches dautrui p.429 sur ce que lui-mme croit tre le bien, la gne de la cour et de la socit, le sentiment du vide, de la monotonie et de la petitesse, les surprises de la chair, la violence de la colre, lhorreur du nant qui attend lme aprs la mort, voil quelques exemples des dangers contre lesquels il lutte par une assidue mditation. Il ne pense pas grand bien en gnral des remdes que propose la philosophie ; il sait lincertitude de la physique et ne veut pas lier la vie morale telle ou telle notion sur le monde et les dieux ; il connat la vaine ostentation des leons publiques ; il sait tout ce qua dinefficace et dinhumain la mthode de rprimande un peu brutale ; il y a chez lui une politesse qui lexclut 3. Aussi emploie-t-il peu les affirmations trop massives du stocisme ; que la mort soit une chose indiffrente, ce nest pas l son thme ordinaire de consolation ; il songe plutt que par elle lindividu est rendu lunivers et se diffuse dans le tout, quelle est un affranchissement, quelle nous fait chapper au danger de dcrpitude intellectuelle 4. Son thme fondamental, cest en effet partout le rattachement de lindividu lunivers : cest la seule chose qui donne un sens la vie, si instable et passagre en elle-mme. Cette affirmation de la bont radicale du monde est mme quelque chose de plus et de plus profond que la croyance ordinaire en la providence. Mme si les dieux ne soccupent nullement de moi, je sais que je suis un tre raisonnable, que jai deux patries, Rome, en tant que je suis Marc-Aurle, et le monde, en tant que je suis homme, et que le seul bien, cest ce qui est utile ces deux patries. Ainsi, mme en ce cas, laffirmation
1 2
II, 8, 7. De la Colre, III, 3, 6. 3 Ibid., 6, 40 ; 76, 5 ; 5, 6. 4 A lui-mme, 64, 17 ; 75, 21 ; 4, 10.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
294
religieuse fondamentale subsisterait ; lacte moral est comme un panouissement de la nature universelle chez lhomme ; lhomme doit produire, comme un arbre donne ses fruits, sans le savoir 1. Aprs Marc-Aurle, le stocisme trane une existence p.430 obscure : sans doute les philosophes des autres coles le connaissent, lutilisent, lexposent, le critiquent. Lenseignement de Plotin comporte la critique de bien des thories physiques notamment ; les commentateurs dAristote le citent frquemment pour lopposer leur matre. Dautre part, les moralistes de lcole, avec leurs consolations, leurs diatribes, leurs exercices moraux deviennent, avec les uvres semblables des Cyniques, le bien commun de tous ; chrtiens comme paens utilisent ce riche arsenal de rconfort moral. Ce succs clatant et durable a lieu sans les Stociens. On a vu combien les Stociens de lpoque impriale staient eux-mmes dtachs dun dogme technique, auquel pictte ne parat plus consentir que par une sorte de scrupule professionnel : simultanment on voit ce dogme, presque sans vie dj, attaqu par les sceptiques et remplac par un autre, celui des Platoniciens.
VII. LE SCEPTICISME AU Ier ET AU IIe SICLE
@ Lhistoire extrieure du scepticisme est fort mal connue ; entre les deux plus illustres sceptiques, nsidme, qui parat avoir vcu peu avant notre re, et Sextus Empiricus dont luvre date sans doute de la deuxime moiti du IIe sicle, dautres sceptiques, dont Agrippa, ont vcu des dates indtermines. Luvre dnsidme nous est assez bien connue, grce au rsum de ses Discours pyrrhoniens que le Byzantin Photius a conserv dans sa Bibliothque (cod. 212). On y voit nsidme tenant avant tout se sparer des Acadmiciens de son temps (sans doute Philon de Larisse), qui sont Stociens tout en combattant les Stociens et qui dogmatisent sur la vertu et le vice, ltre et le non-tre. Le but du livre est de dmontrer que le sage Pyrrhonien atteint le bonheur en se rendant compte quil ne peroit rien avec certitude ni par la sensation, ni par la pense, et en saffranchissant ainsi des continuels chagrins et p.431 soucis qui atteignent les adeptes des autres sectes. Le scepticisme est donc, lui aussi, une cole de bonheur et dataraxie : Les Discours suivaient dans le dtail les philosophies dogmatiques ; ils recherchaient curieusement les discours contraires relatifs aux principes de la physique (agent et patient, gnration et corruption, mouvement et sensation), la mthode de cette mme physique (cherchant si les phnomnes sont les signes de ralits caches, et si lon peut saisir un lien de causalit) enfin aux principes de la morale (le bien et le mal, les vertus, la fin).
A lui-mme, 16, 18 ; 55, 13-22 ; 71, 4.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
295
Sextus nous a conserv quelques dtails de cette argumentation ; nsidme. disait par exemple que toute gnration est impossible, en parcourant toutes les hypothses possibles : le corps ne peut produire le corps, soit quil reste en lui-mme (car il ne produit alors que lui-mme), soit quil sunisse un autre ; car il ny aurait aucune raison, si un corps uni un second en produit un troisime, pour que celui-ci uni un des deux autres nen produise pas un quatrime, et ainsi linfini. Lincorporel (au sens stocien du mot, comme vide, lieu ou temps) ne peut produire lincorporel ; car il est par dfinition incapable dagir et de ptir. Le corps ne peut produire lincorporel, ni lincorporel le corps, pas plus que dun platane ne vient un cheval. On le voit, la gnration (cest le sous-entendu de toute cette argumentation) est toujours compare la production de ltre vivant 1. Nous connaissons encore ses huit arguments ou tropes contre les causes 2. Les cherche-t-on dans linsivible ? Comment le visible pourrait-il tmoigner (cest le mot du dogmatisme picurien) en faveur dun invisible tout fait diffrent de lui, immuable et ternel alors quil est passager ? De quel droit ramener lunit dune mme substance (comme latome) les causes de phnomnes si multiples ? Comment attribuer p.432 lordre du monde (comme fait lpicurien) des causes agissant au hasard ? Pourquoi concevoir (toujours selon la mthode des picuriens) les actions et passions des choses invisibles sur le modle des choses visibles ? Pourquoi se vanter, comme ils le font, de suivre les impressions communes et reconnues de tous, alors quils ont des hypothses fort spciales sur les lments ? De quel droit restreindre les causes caches, par exemple celles des mtores, celles qui saccordent avec nos hypothses ? Pourquoi contredire la fois les apparences et ses propres hypothses, en admettant des causes telles que la dclinaison ? Toute cette critique vise avec vidence lpicurisme. Contre les signes, nsidme demandait comment il se fait, si, selon la dfinition stocienne, les signes sont des antcdents visibles et connus de tous destins dcouvrir un consquent cach , que les choses signifies ne soient pas aussi semblables pour tous, pourquoi par exemple la rougeur et lhumidit de la peau, la rapidit du pouls sont, pour divers mdecins, des symptmes de choses fort diffrentes 3. Enfin lon connat les dix tropes ou cadres gnraux, o nsidme entassait, contre la connaissance sensible, des arguments qui allrent sans cesse senrichissant. Le premier conclut, de la diffrence des organes entre les animaux et lhomme et des animaux entre eux, que chaque espce doit avoir ses sensations particulires ; Sextus y a peut-tre ajout, de son cru, un dveloppement sur la supriorit de lanimal sur lhomme (62-77), qui atteint le stocisme au point sensible. Le second conclut de la diffrence des hommes,
1 2
Contre les Mathmaticiens, IX, 221-226. SEXTUS, Hypotyposes, I, 180-185. 3 SEXTUS, Contre les Mathmaticiens, VIII, 215.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
296
quant au corps et lme, celle de leurs sensations. Le troisime montre le dsaccord des sensations de diverses espces entre elles, les divers sens jugeant diffremment du mme objet, et les objets pouvant avoir soit plus de qualits, soit moins que nous nen percevons. Le p.433 quatrime montre le dsaccord entre les sensations dune mme espce, selon les circonstances (hallucination de la folie, du rve, ge, passion, etc). Les cinquime, sixime, septime, huitime et neuvime montrent comment un sensible nous apparatra diffrent, selon sa position ou distance, selon quil est ou non mlang dautres, selon sa quantit, selon sa relation celui qui juge ou aux autres sensibles, selon sa raret. Le dixime enfin fait voir combien les lois et les coutumes produisent dapparences diffrentes 1. Les cinq tropes que Sextus attribue des sceptiques plus rcents et Diogne Larce Agrippa ne sont pas du tout de mme nature que ceux dnsidme ; le trope de la discordance, fondant la suspension du jugement sur les divergences des philosophes, entre eux et avec le vulgaire, celui de la rgression linfini exigeant pour une affirmation une preuve, pour cette preuve une nouvelle preuve et ainsi linfini, celui du relatif qui montre notre jugement dpendant non de ce que sont les choses mais des rapports quelles ont soit avec nous, soit entre elles ; celui de lhypothse exigeant, si lon veut chapper la rgression linfini, que lon commence par une hypothse non prouve ; celui du diallle montrant que si lon chappe au deuxime ou au quatrime trope, cest pour tomber dans la dmonstration circulaire, o lon prend comme principe la consquence, tous ces tropes concernent non pas les sens en particulier, mais plutt les problmes et les recherches rationnelles. Il en est de mme des deux tropes que cite ensuite Sextus, donnant au dogmatique le choix de poser au dbut des affirmations, et alors elles manquent de preuves, ou bien de les dduire dautres affirmations, et alors on tombe dans la rgression linfini ou le diallle 2. Aprs une pareille abondance darguments on est fort p.434 surpris dapprendre par Sextus que, pour nsidme, le scepticisme est le chemin qui conduit lhraclitisme ; et sous son nom, Sextus nous expose une physique complte qui prend pour principe lair, assimil au temps et la nuit ; admettant deux sortes de changements, le qualitatif, (comme le changement de couleur) et le local, douant enfin lhomme dune pense qui, par lintermdiaire des sens, apparat vraie. Il y a l un problme qui nest point rsolu, malgr le parent que les sceptiques ont de tout temps reconnue entre leur systme et celui dHraclite. Les Hypotyposes ou Esquisses pyrrhoniennes de Sextus Empiricus et son vaste ouvrage en onze livres, Contre les mathmaticiens, dont les six premiers sont consacrs aux arts libraux, mathmatiques, grammaire, rhtorique,
1
SEXTUS, Hypotyposes, I, 31-163 ; PHILON, De lIvresse, 171 sq. ; d. Cohn ; DIOGNE LARCE, IX, 79-88. 2 SEXTUS, Hypotyposes, I, 166-177 ; 178-179 ; DIOGNE LARCE, IX, 88-89.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
297
gomtrie, arithmtique, musique et les cinq derniers au dogmatisme philosophique, sont une somme du scepticisme et un arsenal o il a runi et class tous ses arguments. Grce au got de lcole pour largument tir de la divergence des philosophes, ces ouvrages renferment les trs abondants et prcieux renseignements historiques que nous avons souvent utiliss. Mais largumentation y est souvent pauvre, monotone, fatigante par son verbalisme et sa scheresse. Sextus, qui nous apprend tant de choses, nous apprendrait donc peu sur sa contribution personnelle au scepticisme, si, ct et comme en dehors de ce flot darguments, nous ne trouvions lide positive dune mthode empirique de connaissance, qui trace les linaments dune vritable logique inductive. Sextus insiste souvent sur le fait que, ds que lon ne prtend pas atteindre la ralit, nos jugements dapparence sont suffisants dans la vie journalire ; les sceptiques ne dtruisent pas les apparences 1 ; et il suffit que le miel nous paraisse nous adoucir le got (sans que lon cherche sil possde ou non la qualit p.435 de douceur) pour que lon sache sil faut ou non en manger. Les sceptiques ont donc eux aussi un critre, cest lobservation quotidienne qui prend une quadruple forme, quon se laisse guider par la nature, ou conduire par la ncessit des passions, ou quon rgle sa conduite sur la tradition des lois et des coutumes, ou enfin quon employe les procds techniques des arts. Dans tous ces cas, lesprit se laisse aller, en ragissant le moins possible, la contrainte des choses. De l la thorie positive du signe qui est essentiellement celle dun mdecin (Sextus est un Mdecin de la secte mthodique) 2 habitu lobservation. Il fait la dclaration suivante : Nous ne combattons pas contre le sens commun et nous ne bouleversons pas la vie, comme on nous en accuse par calomnie ; si nous supprimions toute espce de signes, nous combattrions contre la vie et contre les hommes. Il est en effet deux espces de signes, le signe indicatif employ par les dogmatiques qui prtendent conclure des apparences des choses qui nous sont caches par nature, telles que les dieux, les atomes, et le signe commmoratif qui nous rappelle seulement une autre chose qui a t plusieurs fois observe, avec celle que lon observe actuellement. Dans les choses qui apparaissent, il y a une suite observable daprs laquelle lhomme, se rappelant aprs quelles choses, ou avant quelles choses, ou avec quelles choses est observe telle autre, il se souvient de celles-l en observant celle-ci. En ce sens, la notion de consquence distingue lhomme de la bte 3. Nous voyons ainsi affleurer dans la philosophie quelque chose de ces mthodes techniques, pratiques, positives quemploient les arts tout fait indpendants de la philosophie ; ces arts mancips se justifient par eux-mmes, sans tre dfinis, ainsi que chez les Stociens, comme un degr infrieur dune prtendue science qui na aucun droit lexistence.
1 2
Hypotyposes, I, 19-21. Cf. Contre les Mathmaticiens, I, 260, et Hypotyposes, I, 236. 3 Lettres Lucilius, 92, 25.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
298
VIII. LA RENAISSANCE DU PLATONISME AU IIe SICLE
@ De multiples raisons, partir du IIe sicle, ont fait succomber le stocisme devant le platonisme. Ce changement a dabord un aspect social indniable. Dans la romanesque Vie dApollonius de Tyane, de Philostrate (V, 32-35) nous voyons saffronter devant Vespasien le Stocien Euphrate, ami de la libert et de la dmocratie, conseillant lempereur de se dmettre, et le hros du livre, le Pythagoricien et Platonicien Apollonius de Tyane, conservateur, ami du rgime imprial, o il voit avant tout la garantie de la fortune assise et des liberts locales ; Euphrate, le reprsentant de la philosophie conforme la nature , oppos celui de la philosophie qui se prtend d inspiration divine . Les philosophes noplatoniciens se recrutent dans les classes aises et cultives ; l, nulle vocation qui fasse dun esclave un philosophe ; nul succs populaire, non plus, comme celui quavaient connu les matres du stocisme. Un cercle de gens distingus dans une petite ville, comme celui que nous voyons apparatre dans les uvres de Plutarque de Chrone, un milieu ferm de gens instruits, comme lcole de Plotin Rome au IIIe sicle ; la fin du Ve et au VIe sicle, des paens de bon ton qui se runissent pour maintenir vivante la tradition de lhellnisme, voil les milieux naturels de cette pense. La politesse raffine des Platoniciens que lon voit apparatre chez Lucien fait contraste avec la grossiret quil prte aux autres philosophes 1. Ici la philosophie exige une lente et laborieuse initiation, et, en ses sommets, elle ressemble plutt des confidences que lon cache au vulgaire qu des vrits de sens commun.
p.436
Cest un autre milieu, mais cest aussi un autre univers et une autre conception de la destine. En si peu de temps que p.437 ce soit, dit Snque du sage Stocien, il concentre des biens ternels 2. A cette unit de la vie morale, toute ramasse en elle-mme, correspond la vision dun univers qui est, chaque moment, ncessaire et parfait, et dont les vnements ne font que manifester une ralit toujours gale. Il suffit que la volont se dtende pour que linquitude naisse ; la destine nest pas accomplie chaque moment, mais saccomplit peu peu, graduellement, au cours du temps. Avec cette conception de la destine, la vision de lunivers se transforme, son unit se rompt ; linterdpendance des tres se substitue la hirarchie des formes de ltre, de la plus parfaite la mains parfaite, travers lesquelles passe lme montant dune rgion moins parfaite une rgion plus pure ; ce sont tous les mythes sur lme qui renaissent, et lunivers, destin leur servir de thtre, na plus dautre rle.
1 2
Banquet, ch. XXXVII-XXXIX sur Ion, le Platonicien. Lettres Lucilius, 92, 25.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
299
Le platonisme nest donc plus un humanisme, cest--dire une vision de lunivers o lhomme et laction humaine Se droulant en un milieu social humain forment le centre des proccupations ; le Dieu des Stociens avait avec lhomme un lien particulier, et lhomme avec toute sa nature tait pour eux un but de lunivers. Bien diffrente est une vision des choses, o lordre universel, le monde a une valeur en lui-mme et non parce quil est au service des tres raisonnables ; lhomme, comme tel, perd sa prminence qui passe la pure intelligence en laquelle il essaye de se transformer, cest--dire lintelligence qui contemple lordre universel. Lhomme raisonnable est, certains gards, infrieur aux animaux et aux plantes. Quon ne stonne pas, dit Plutarque,si les btes sans raison suivent la nature mieux que les tres raisonnables ; ce point de vue, les animaux sont mme infrieurs aux plantes, qui la nature na donn ni reprsentation ni penchant capables dune dviation contre nature 1.
IX. PHILON DALEXANDRIE
@ Des formules nettes de ce nouveau platonisme se trouvent dj chez Philon dAlexandrie (40 av. 40 ap. J.-C.). Ctait un membre influent de la communaut juive riche et florissante et, vers la fin de sa vie, il fit partie de lambassade qui alla porter Caligula les dolances des juifs de la ville contre le gouverneur romain dgypte ; dans cette communaut, la culture grecque est depuis longtemps chez elle ; on ny lit plus la Bible que dans la traduction grecque, et les jeunes gens de famille y apprennent toutes les sciences et la philosophie grecque. La lecture et le commentaire de la Bible restent pourtant, comme dans tout le monde juif, le centre de la spculation ; mais on explique la Bible, comme les Grecs expliquaient depuis longtemps Homre, par la mthode allgorique ; tout, ds lors, devient dans la Bible lhistoire dune me qui se rapproche ou sloigne de Dieu en se rapprochant ou en sloignant du corps. Tout le premier chapitre de la Gense, par exemple, raconte selon ces interprtes lhistoire dune intelligence purifie, cre par Dieu et rsidant au milieu de vertus ; puis Dieu faonne, limitation de celle-l, une intelligence plus terrestre (Adam), qui il donne comme secours et soutien ncessaire la sensation (ve) ; par lintermdiaire de cette sensation, lintelligence se laisse entraner et dpraver par le plaisir (le serpent) ; tout le reste de la Gense est lhistoire des diverses manires dont lhomme redevient un esprit pur, et les patriarches notamment signifient les trois modes possibles de ce retour, par lexercice asctique (Jacob), par lenseignement (Abraham), ou, par une grce spontane et naturelle (Isaac). A la faveur de cette mthode, Philon fait entrer dans son commentaire tous les thmes philosophiques de son temps ; et son uvre, considrable, est un vritable muse, o lon trouve ple-mle discours
p.438 1
De lAmour de la progniture, ch. I.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
300
de consolation, diatribes, p.439 questions la stocienne (si le sage peut senivrer), fragments de leons dialectiques ou physiques. De cet amalgame il se dgage pourtant quelques ides : lessentielle est celle dun Dieu transcendant qui ne touche le monde que par des intermdiaires, et que lme natteint aussi que par des intermdiaires. Lintermdiaire, chez Philon, se caractrise moins par sa nature que par sa fonction ; cest en voyant quoi il sert que lon peut dterminer ce quil est. Aussi on comprend pourquoi lintermdiaire se dissocie en une foule dtres plus ou moins distincts ; lintermdiaire cest le Logos ou Verbe, fils de Dieu, dans lequel il voit le modle du monde et par lequel il le cre ; cest aussi toute la srie des puissances, la puissance bienfaisante ou cratrice, et la puissance qui punit et chtie ; cest la sagesse avec laquelle il sunit, dune union mystrieuse, pour produire le monde ; ce sont mme les anges et les dmons igns ou ariens, qui excutent les ordres divins. Tous ces intermdiaires sont aussi ceux par lesquels lme remonte Dieu ; ce retour, qui sopre grce au sentiment de la fragilit et du nant des choses sensibles (que Philon fait voir en utilisant les tropes dnsidme), ne nous mne Dieu que grce aux intermdiaires ; en ce sens, le sage arriv ltat de pur esprit, le monde mme en qui se reflte lordre divin sont pour nous des intermdiaires. En un mot, la mthode philonienne recueille et hirarchise toutes les formes et tous les degrs possibles du culte qui relie lme Dieu ; Abraham, sous le nom dAbram, a t astrologue avant darriver une pit plus pure. Il y a dans la pense de Philon quelque ambigut : on trouve en lui toute la pit dun juif pour qui Dieu est en rapports constants, multiples et particuliers avec lhomme, le soutenant, le secourant, le punissant : cest la pit smite, dont nous avons vu le succs chez les Stociens. Mais il y a aussi lide dun Dieu transcendant qui chappe tout rapport avec lhomme, qui nest atteint que par de purs esprits, p.440 entirement dtachs du monde et deux-mmes, en tat dextase. Donc la fois les deux formes de thologie et de transcendance que nous avons dgages plus haut. Ds maintenant, la grande affaire du philosophe noplatonicien et nopythagoricien, cest, dlaissant compltement le premier point de vue, celui de la dvotion, des rapports de lhomme Dieu, datteindre, en elle-mme, en dehors de tout rapport avec le monde et lhomme, cette ralit transcendante ou, comme on dit, intelligible ; cest sous un aspect, aspect bien troit, il est vrai, du plus pur hellnisme. La thorie stocienne du Logos ou Verbe, du dieu assistant lhomme, qui se retrouvera chez les chrtiens, est presque absente chez les paens.
X. LE NEO-PYTHAGORISME
@
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
301
Le pythagorisme se rveille dans des conditions mal connues : au temps dAuguste vivent les Sextius, dont Snque cite avec loge les rgles morales dexamen de conscience 1 ; une mme inspiration de morale pratique et asctique, se trouve dans le Tableau de Cbs, allgorie morale o domine, comme chez Philon, lide du repentir arrachant lhomme au plaisir ; de mme esprit et trs imprgns de platonisme sont tous les fragments pythagoriciens que Stobe a conservs dans son Florilge : simples rsums de morale platonicienne, crits en dialecte dorien, et dont la pense principale est : Celui qui suit les dieux est heureux, celui qui suit les choses mortelles est malheureux (103, 26). Sur ce fond de morale asctique slve une arithmologie fantastique, destine dterminer la nature de la ralit transcendante par les nombres et leurs proprits. Lun de ces Pythagoriciens, Modratus de Gads, qui est de lpoque de p.441 Plutarque, nous raconte comment la thorie de la matire que Platon expose dans le Time fut dabord celle des Pythagoriciens, qui la transmirent Platon. Ce quil y a de vrai dans ce fantaisiste rcit, cest que larithmologie mtaphysique de Modratus nest quune traduction numrique de la mtaphysique platonicienne 2 : les diverses formes de ralit sont comme les divers degrs de dtente de lUn primitif ; auprs de ce premier Un, qui dpasse ltre ou lessence, un second Un qui est ltre rel ou lintelligible, cest--dire les ides ; puis un troisime Un, lme, qui participe aux ides ; au-dessous de cette trinit dUns, la dyade ou matire, qui ne participe pas aux ides, mais qui est ordonne leur image. Cette vision de lunivers va devenir la vision matresse du noplatonisme. Quant lemploi des nombres Modratus reconnat quil est seulement dun symbolisme commode et natteint pas la nature des choses. Ne pouvant transmettre clairement par le discours les premiers principes, les Pythagoriciens ont recours au nombre pour les exposer. Ils appellent un la raison de lunion, la cause qui fait que tout conspire, deux la raison de laltrit, de la divisibilit, du changement 3. En un mot le Pythagoricien ne connat pas le nombre comme point de dpart dune science autonome, mais comme mthode daccs la ralit non sensible. Tel est le pythagorisme que lon trouve si frquemment dans les uvres de Philon, qui utilise le Time dont Modratus lui-mme a comment le passage sur les proportions numriques dans lme 4. Tel est celui de Nicomaque de Grasa dans sa Thologie arithmtique.
XI. PLUTARQUE DE CHRONE
@
1 2
Lettres Lucilius, 59, 64 et 73. Expos dans SIMPLICIUS, Commentaire de la physique, p. 230, d. Diels. 3 PORPHYRE, Vie de Pythagore, 48-49. 4 PROCLUS, Commentaire du Time, 144 f.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
302
De tout ct, pendant ces deux premiers sicles, nous avons des preuves de la faveur grandissante que trouvent les uvres p.442 de Platon ; on les explique en de nombreux commentaires, en particulier sur le Time. On discute notamment la question de savoir si cest par un simple artifice dexposition que Platon y reprsente le monde engendr et sil le croyait ternel. A ceux qui soutiennent cette interprtation, Philon oppose dj la lettre mme de Platon, qui parle dun Dieu pre, crateur (), dmiurge et aussi linterprtation que donne Aristote 1. Plutarque 2 qui traite plutt de la cration de lme conclut, dans le mme sens, que lme a t cre avant le corps ; sans quoi serait dtruite la valeur de largumentation platonicienne contre les athes, qui repose sur le fait que lme est antrieure au corps. Mais linterprtation contraire, celle de lternit du monde, finit par simposer compltement, sauf aux penseurs chrtiens qui utilisent le Time. On imite aussi beaucoup les mythes de la destine. Plutarque la fait plusieurs fois. Dans un de ces mythes, les mes aprs la mort slvent vers le ciel, traversent dabord un Styx cleste, jusqu la lune, o sjournent celles qui ne sont ni mauvaises ni impures ; l, il y a une deuxime mort, et, comme lme stait spare du corps, lintelligence se spare de lme quelle laisse dans la lune pour monter travers les sphres clestes : schme constant qui revient avec dinfinies variantes 3. LHads souterrain a compltement disparu de ces mythes ; cest le monde entier qui est devenu le thtre de la destine de lme. Le platonisme de Plutarque est li une raction nationale trs forte en faveur des traditions religieuses grecques en mme temps qu une critique assez violente des grands dogmatismes post-aristotliciens ; on trouve chez lui, avec une apologie de loracle delphique, une protestation contre linterprtation rationaliste des dieux, la fois contre celle qui les rduit p.443 des facults et des passions de lme, et contre le stocisme qui en fait des forces naturelles 4. Plutarque est lhomme qui, la fois thologien, prtre et philosophe ne veut rien abandonner de lhritage grec, et veut encore laccrotre de toute la richesse des cultes gyptiens dIsis.
XII. GAIUS, ALBINUS ET APULE. NUMNIUS
@ Plusieurs manuscrits nous ont conserv, sous le nom dAlcinos, une Introduction aux dogmes de Platon ; comme Freudenthal la dmontr, luvre est en ralit dAlbinus, le Platonicien qui fut le matre de Galien
1 2
De lincorruptibilit du monde, ch. IV. De la Production de lme daprs le Time. 3 Du Visage qui est dans la lune, fin. 4 Amatorius, chap. XII.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
303
Smyrne en 152, aprs avoir t Athnes llve de Gaius. Dautre part, M. Sinko a fait voir quApule, qui rsida Athnes vers 140, a rdig son trait Sur le dogme de Platon daprs le mme cours quAlbinus, cest--dire daprs celui de Gaius. On voit, dans ces deux uvres, comment Gaius contraint dentrer les matires de lenseignement platonicien dans le cadre devenu traditionnel, logique, physique et thique ; on y trouve un monde ternel, un dieu transcendant dont la nature est dtermine par de doubles ngations (ni mauvais, ni bon ; ni qualifi, ni sans qualit) la manire de lUn du Parmnide de Platon, et qui est connu soit par la mthode dabstraction, soit par la mthode danalogie. Des fragments qui restent de luvre des Platoniciens de la fin du IIe sicle, Svre, Atticus, Harpocration, Cronius et surtout Numnius, on peut conclure que, dans ses grands traits, la reprsentation noplatonicienne du monde est tout fait fixe. Numnius, lpoque des Antonins, a crit un livre pour rfuter lopinion dAntiochus, qui assimilait Platon aux Stociens et pour revendiquer lautonomie du platonisme que, comme p.444 Philon, il rapprochait de Mose 1. On connat sa thorie des trois dieux : au sommet, lintelligence premire (ou Bien en soi), cratrice des intelligibles ; au-dessous, le dmiurge, crateur du monde sensible ; et enfin le monde, le troisime dieu ; il ny a rien l quune interprtation du Time 2. On connat aussi, par Proclus 3, sa croyance en un Hads cleste au milieu duquel il dcrit lalle et venue des mes.
XIII. RENAISSANCE DE LARISTOTLISME
@ Beaucoup moins populaire que le platonisme, beaucoup moins dispos sunir aux croyances gnrales de lpoque, laristotlisme doit sa renaissance au IIe sicle au got qui portait les esprits vers les anciennes doctrines ; les Pripatticiens, depuis Andronicus qui dita les uvres dAristote vers 50 avant J.-C., inclinent chercher le sens exact des paroles du matre plutt qu dvelopper, selon sa mthode, la connaissance de la nature. De l cette srie de commentaires, dont les premiers, ceux dAdrastus ( lpoque dAdrien), sont perdus ; les plus anciens que nous ayons sont ceux dAlexandre dAphrodise sur la Mtaphysique, sur les Premiers analytiques, les Topiques et les Rfutations des sophistes ; enfin sur La sensation et les Mtores, auxquels il faut joindre des traits Sur lme et Sur le destin ; ils datent environ de la fin du IIe sicle. Plus tard, ltude dAristote et de ses commentateurs devient un exercice obligatoire dans toute cole philosophique ; cest par exemple fort
1
Sur la diffrence des Acadmiciens avec Platon, cit par Eusbe, Prparation vanglique, XIV, 5 sq. 2 Dans louvrage Sur le Bien, connu aussi par les citations dEusbe. 3 Commentaire de la Rpublique, vol. II, p. 96, 11, d. Kroll.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
304
souvent la lecture dun commentaire dAristote qui sert de point de dpart aux traits de Plotin (par exemple Ennade IV, 6) ; si bien que, le pripattisme disparaissant de nouveau comme cole devant le grand succs du platonisme, les p.445 commentaires dAristote continuent jusqu la fin de lantiquit ; la clbre Isagoge de Porphyre, llve de Plotin, quune traduction latine de Boce fit connatre au moyen ge occidental, tait une introduction ltude des Catgories. Les plus connus de ces commentateurs sont Thmistius (2e moiti du IVe sicle) et surtout Simplicius, dont les commentaires sur les Catgories, sur la Physique et sur le trait du Ciel sont dune surprenante richesse dinformation 1. Ces commentaires se relient, sans aucune suture, aux commentaires en syriaque, puis en arabe, et enfin ceux quon crivit en Occident, partir du XIIIe sicle, sans oublier les commentateurs byzantins, qui se rattachent Jean Philopon (dbut du VIe sicle). Une tradition, si constamment suivie, dont nous voyons ici le dbut, a une importance historique que lon peut difficilement exagrer ; par elle se sont transmises et certaines manires de poser des problmes philosophiques, et certaines manires de classer les ides, dont la pense occidentale est toute imprgne. On peut en donner en exemple la discussion qui commence Thophraste et qui se poursuit pendant le moyen ge entier sur la nature des intellects et de la connaissance intellectuelle daprs un obscur chapitre dAristote (p. 238). Daprs Thmistius, Thophraste interprtait ainsi la doctrine du matre : la connaissance intellectuelle est la dcouverte des formes intelligibles, incluses dans les choses sensibles, par un intellect passif qui est amen lactivit par un intellect agent. Et il faisait Aristote les trois objections suivantes : On ne sait si lintellect patient est acquis ou sil est inhrent ; de plus, on ignore la nature de la passion que subit cet intellect ; car si lorigine de la connaissance intellectuelle est dans la sensation, il faut que lintellect subisse laction du corps ; mais comment le pourrait-il sil est incorporel ? Et comment p.446 pourrait-il tre matre de sa pense, puisque rien ne ptit de soimme ? Enfin, si une intelligence nest rien en acte, mais si elle est tout en puissance, en quoi diffre-t-elle de la matire premire ? A propos de lintellect-agent, les difficults ne sont pas moindres ; car on ne peut dire comment il vient en lme, et sil lui est inhrent, pourquoi loubli, lerreur et le mensonge 2 ? Nous connaissons par Alexandre dAphrodise 3 la solution que son matre Aristocls essayait de ces difficults ; on va voir quelle est suggre par le stocisme (et la confusion que lon commit longtemps entre Aristocls et
1
Les commentaires grecs ont t dits par lAcadmie de Berlin : Commentaria in Ariatotelem graeca, edita consilio et auctoritate Acadami regi borussic, 23 volumes et 3 volumes supplmentaires. 2 Daprs THMISTIUS, In de Anima, d. Heinze, p. 117, 310 sq. 3 De Anima liber, d. J. Bruns, p. 110 sq.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
305
Aristotls, et qui fit attribuer Aristote lui-mme les ides de celui-l ne contribua pas peu obscurcir le sujet). Aristocls admet dabord que ce quAristote appelle lintellect matriel ou en puissance est un intellect qui crot naturellement, comme toutes nos autres facults, par le progrs de lge et qui est capable doprer labstraction. Nanmoins cette activit, inhrente lme, nest possible que parce quil y a un intellect venu du dehors, pense pure, intelligence divine partout rpandue dans la matire, comme une substance en une substance, traversant tout et tant en nimporte quel corps. Lorsque cet intellect en acte rencontre un mlange corporel favorable, elle agit par lui comme par un instrument, et lon dit que nous pensons. Notre intelligence matrielle ou en puissance nest donc, comme toutes nos autres facults, quune certaine combinaison organique, qui peut servir dinstrument la pense. Cette doctrine rpond aux objections de Thophraste ; mais Alexandre estime quelle scarte trop de lopinion du matre. Pour lui, il distingue quatre intellects, lintellect en puissance ou hylique, capacit de recevoir les formes, semblable une table rase, ou plutt ce caractre quelle a dtre rase , intellect diffrent de la matire premire, puisquil ne p.447 devient pas telle ou telle chose en particulier et parce quil ne ptit pas comme la matire. En second lieu, lintellect acquis, ou lintellect comme disposition, qui nat lorsque lintelligence a apprhend luniversel, en sparant par abstraction les formes de la matire ; il est lensemble des penses qui sont toujours notre disposition, comme la science est la disposition du savant, bien quil ny pense pas toujours actuellement. Enfin lintellect en acte est la pense actuelle, dans laquelle le sujet est identique son objet. Ces trois intellects dcrivent les trois phases de lactivit intellectuelle, de la puissance la disposition et de la disposition lacte. Le quatrime intellect est lintellect agent, la cause qui fait passer lacte les intelligibles en puissance. Il faut quil soit par consquent lui-mme intelligible en acte, par sa propre nature, spar et sans mlange. Dans cet intellect agent, Alexandre est amen reconnatre non plus une facult de lme, mais lacte pur, la pense de la pense, en un mot le Dieu dAristote. Cest donc Dieu qui est lagent de lopration intellectuelle en nous ; ce nest point une vision en Dieu mais cest, si lon peut dire, une vision par Dieu. Grce Alexandre, chez les Pripatticiens comme chez les Platoniciens, la mditation sur la nature de la connaissance intellectuelle et sur son objet nous amne non pas la science, mais la thologie. Bibliographie @
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
306
CHAPITRE VII DVELOPPEMENT DU NOPLATONISME
I. PLOTIN
@ Le noplatonisme est essentiellement, on la dj vu, une mthode pour accder une ralit intelligible et une constructiqn ou description de cette ralit. La plus grosse erreur que lon pourrait commettre, cest de croire que cette ralit a pour fonction essentielle dexpliquer le sensible ; il sagit avant tout de passer dune rgion o la connaissance et le bonheur sont impossibles une rgion o ils sont possibles ; la ressemblance grce laquelle on peut passer de lun lautre, puisque le sensible est limage de lintelligible, intresse moins parce quelle explique le monde sensible que parce quelle permet de remonter ce qui est en soi sans rapport au monde. La vie des dieux, dans le mythe, est indiffrente au monde des humains ; la ralit intelligible de Plotin ne connat pas non plus le monde et ne sabaisse pas lui ; son tat desprit est, subtilis lextrme, ltat desprit mythologique.
p.449
Le IIIe sicle et les deux suivants marquent, dans le paganisme, une tentative pour saisir la structure et les articulations de cette ralit. La philosophie de ce temps est une manire de description des paysages mtaphysiques o lme se transporte par une sorte dentranement spirituel. Un de ses initiateurs fut Ammonius Saccas, qui enseigna Alexandrie au moins de 232 243 et qui rvla Plotin, dj p.450 g de vingt-huit ans, la philosophie vritable : personnage dailleurs fort mal connu ; il na rien crit ; de ses disciples, nous connaissons, outre Plotin, le philologue Longin, Hrennius, enfin un Origne quil ny a aucune raison dcisive didentifier avec Origne le chrtien, bien quil soit de la mme poque ; mais nous ignorons tout de ce quon enseignait dans lcole dAmmonius. Il faut attendre au Ve sicle avant dentendre parler des ides dAmmonius par Nmsius et par Hirocls, et il ny a aucune raison dcisive de croire que cest bien dAmmonius Sakkas quils parlent. Nous ne pouvons donc saisir le rle de ce matre aim dans la formation desprit de Plotin. Plotin (205-270), lve dAmmonius de 232 243, le quitte pour suivre lempereur Gordien dans son expdition contre les Perses ; en 245 il est Rome, o il reste jusqu sa mort ; il y runit quelques disciples enthousiastes, et parmi eux Porphyre qui fut son secrtaire. Cest sur les instances de ces disciples, semble-t-il, quil se dcide trs tardivement, en 255, crire et publier. Il rdigeait fort vite et sans revoir, confiant Porphyre le soin des
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
307
corrections matrielles ; ainsi sont ns, dans un ordre de succession que nous donne Porphyre, en sa Vie de Plotin, les cinquante-quatre traits dont Porphyre, aprs la mort de Plotin, a donn une dition densemble en les groupant en six Ennades, ou groupes de neuf. Ces traits paraissent reproduire fidlement son enseignement oral ; ils ne donnent pas du tout un expos suivi et progressif de la doctrine, mais plutt une srie de confrences lucidant des points particuliers, la valeur de lastrologie, la manire dont lme descend dans le corps et lui est unie, le problme de la mmoire dans les diverses espces dmes, depuis lme humaine jusqu lme du monde, mais les tudiant en fonction dune vision de lunivers qui est toujours active et prsente. Cette vision de lunivers nest pas particulire Plotin ; nous lavons vu sesquisser chez Posidonius lorsquil distingue et range par ordre ce que lancien stocisme identifiait ; dieu, p.451 destin, nature ; nous lavons vu se prciser chez Modratus, avec sa thorie de la triple unit. Quel en est le principe ? Lon a vu les Stociens (et Plotin reprend formellement leur thse) soutenir que le degr de ralit dun tre dpendait du degr dunion de ses parties, depuis le tas de pierre, aux parties seulement juxtaposes, jusqu ltre vivant dont toutes les parties sont maintenus par la tension de lme, en passant par un corps collectif, tel quun chur ou une arme. On peut concevoir lunion saccroissant au point que les parties se fusionnent et deviennent de plus en plus insparables : ainsi lon ne peut parler dans le mme sens des parties dun corps vivant et des parties dune science ; dans un corps vivant, les parties sont solidaires, mais localement spares ; dans une science, une partie cest un thorme, et chaque thorme contient en puissance tous les autres ; on voit ainsi comment un degr dunification de plus nous fait passer du corporel au spirituel. Mais, toute ralit o lunion des parties nest pas parfaite suppose au-dessus delle une unit plus acheve ; ainsi la sympathie mutuelle des parties dun corps vivant ou des parties du monde suppose au-dessus delle une unit plus parfaite, celle de lme, qui les contient ; lunion des thormes dune science suppose lunit dune intelligence qui les saisit. Sans cette unit suprieure tout sparpille, seffrite et perd son tre. Rien nest que par lUn ; Aristote a eu tort de dire que ltre et lun sont toujours convertibles : en ralit ltre est toujours subordonn lUn ; lUn est le principe de ltre. Mais une condition : cest que cette unit ne soit pas une unit purement formelle et vide, mais contienne toute la ralit qui se dveloppera en son produit : lme dun vivant contient en elle, ltat de raisons sminales insparables les unes des autres, tout le dtail du corps vivant ; rien de rel qui ne vienne delle. A cette condition, on voit la porte du mode dintelligibilit quemploie Plotin, qui consiste faire comprendre une p.452 ralit quelconque en la rapportant une unit plus parfaite 1.
1
Ennade, VI, trait 9.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
308
Pourtant Plotin abandonne entirement la thorie stocienne, dont il a quelquefois suivi les formules ; pour les Stociens, on sen souvient, lunification tait due une activit propre de lagent qui pntrait dans la matire et, par sa tension, en retenait les parties. Pour Plotin, toute unit est toujours plus ou moins du genre de celle dune science ; dans une science lesprit est un parce quil contemple un seul et mme objet ; ce qui introduit lunit dans la ralit infrieure, cest la contemplation du principe suprieur 1. Dire que lun est le principe de ltre revient alors dire que la seule ralit vritable est la contemplation. Non seulement lintelligence est contemplation de son objet, mais la nature est aussi contemplation, contemplation tacite, silencieuse, inconsciente, du modle intelligible quelle sefforce dimiter ; un animal, une plante, un objet quelconque nont leur forme (au sens aristotlicien) que dans la mesure o ils contemplent le modle idal qui se reflte en eux. Le principe suprieur reste donc en soi, en son inaltrable perfection et immobilit ; rien de lui-mme, de son activit ne passe dans la ralit infrieure, puisquil nagit, comme les choses belles, quen emplissant les choses de sa lumire et de son reflet autant quelles sont capables de le recevoir. Toutefois, pour bien le saisir, il faut avoir prsente limage fixe dun cosmos unique, fini et ternel, avec son ordre toujours identique lui-mme, qui obsde lesprit de Plotin comme celui de tous ses contemporains ; cest en fonction de cette image que sa doctrine mtaphysique prend un sens. Le donn, cest lunit du monde sensible, et toutes les ralits intelligibles dont il dpend ne sont que ce mme monde, plus contract et en quelque sorte dmatrialis. Toute la construction mtaphysique de Plotin perd beaucoup de son sens si lon naccepte, p.453 avec lunicit du monde, son unit, la sympathie de ses parties, son ternit et le gocentrisme 2. Ainsi se comprend la thorie plotinienne des principes ou hypostases : le premier principe, cest lUn ou Premier, en qui il ny a encore aucune division ; il nest rien, puisquil ny a en lui rien de distinct ; et il est tout, puisquil est puissance de toutes choses ; il est comme lUn du Parmnide de Platon, dont on peut successivement tout nier et tout affirmer ; de fait, cest ce dialogue que Plotin emprunte le principe de sa thorie de lUn. Mais cest aussi au VIIe livre de la Rpublique ; lUn est en effet aussi le Bien, puisquil donne chaque tre son tre ; et il est lui-mme au-dessus de lessence , puisque tre, rappelons-le, pour Platon, cest ncessairement tre quelque chose. Or le Premier, Bien ou Un, est une hypostase, sans tre une essence ou substance. Le mot hypostase signifie tout sujet existant, que ce sujet soit dtermin ou non ; le mot essence ou substance () dsigne aussi un sujet existant, une hypostase, mais un sujet dtermin par des attributs positifs et ayant une forme. Cest pourquoi il faut faire attention que ces attributs :
1 2
III, 8. II, 1.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
309
Premier, Un ou Bien, ne soient pas pris pour des proprits positives ou des formes de lUn ; ce sont des manires den parler, en envisageant le rle quil jouera par rapport aux hypostases subordonnes; ce nest pas une manire de dire ce quil est puisque, proprement parler, il nest rien, pas mme un, pas mme bien, rien quun nant superessentiel 1. Pourquoi cet Un ne reste-t-il pas lunique ? Pourquoi la ralit ne reste-t-elle pas ternellement contracte en lui ? Cest que toute chose parfaite produit, comme ltre vivant, arriv ltat adulte, produit son semblable ; production inconsciente, involontaire, due une sorte de surabondance, comme celle dune source dont le trop plein scoule, comme celle dune lumire qui se diffuse ; ltre vivant, la source, la p.454 lumire ne perdent rien se rpandre, et gardent en eux-mmes toute ralit ; cest ce que lon a appel, dune mtaphore habituelle, mais qui nest pas tout fait juste, la thorie de lmanation ; il faut dire plutt, avec Plotin, la procession, la production, ou marche en avant de quelque chose qui vient du principe. Mais le produit cherche rester le plus prs possible de son producteur, dont il reoit toute sa ralit ; peine a-t-il procd quil se retourne vers lui pour le contempler. Cest en cet acte de se retourner, ou conversion, que nat (bien entendu dune naissance ternelle et intemporelle) la seconde hypostase, qui est la fois tre, Intelligence et Monde intelligible 2. Il ne faudrait pas exagrer lunit systmatique de la pense plotinienne dans la description de cette seconde hypostase ; elle prsente plusieurs aspects. Cest dabord, sous laspect du monde intelligible, lUn en quelque sorte dtendu et multipli : la ralit, indistincte dans lUn, spand en une multiplicit hirarchise de genres et despces, que lon voit se former par une sorte de dialectique (la division platonicienne) et de mouvement spirituel, partir des genres suprmes ; encore faut-il bien voir que ce mouvement est ternellement achev, que cette hirarchie dintelligibles est ternellement fixe, et que cest seulement notre pense qui se meut en la parcourant 3. Il faut aussi se garder dexagrer le caractre de multiplicit de ce monde : dans une pareille unit systmatique, chaque tre contient tous les autres, tout est dans tout : Plotin nous rappelle que la dialectique platonicienne ne procde pas, comme la logique aristotlicienne, par des additions, ajoutant au genre des diffrences spcifiques pour dterminer lespce ; elle procde par division, cest--dire que le genre est un tout concret que lon spare pour le diviser en espces, comme on peut concevoir le monde divis en ciel p.455 et rgion sublunaire ; le progrs du genre aux espces nest pas un enrichissement, mais un passage du tout aux parties, o les parties garderaient encore la richesse du tout 4.
1 2
VI, 9 ; V, 1, 6, ; VI, 8. V, 1, 6 ; V, 2 ; V, 3, 13 sq. ; V, 4. 3 IV, 4, 1-2. 4 I, 3 ; III, 2, 1-2 ; V, 9.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
310
De l une consquence importante : lintelligible aristotlicien ne dsignait que des genres et des espces ; lindividu, ralis dans le monde sensible, contenait donc tous les caractres de la forme spcifique, augments dautres caractres en nombre indtermin, dus sa ralisation dans la matire et qui constituaient sa vritable individualit ; on peut penser lhomme, on ne peut penser Socrate, dont lindividualit est due aux mille accidents que la forme spcifique de lhomme a rencontrs en se ralisant : le monde sensible serait donc certains gards plus que le monde intelligible ! La vrit est au contraire pour Plotin que lindividu existe dans le monde intelligible, ou quil y a des ides des individus 1 . Plotin nadmet pas dune manire gnrale que la forme, pour se raliser dans le sensible, doive tre accrue de caractres positifs, comme les organes de dfense, par exemple, ou les organes des sens ; ces questions : Quel besoin le lion intelligible a-t-il de griffes, puisquil na pas se dfendre ? Quel besoin ltre vivant intelligible a-t-il dorganes du sens, en une rgion o il ny a nulle chose sensible ? il rpond : Afin que tout soit, afin que le monde intelligible contienne toutes les richesses possibles ; la sensation, dans ltre vivant matriel, est non pas, comme le disent les Stociens, simple impression dune matire sur une autre, mais garde encore quelque chose de spirituel et dimmatriel qui garantit son origine intelligible. Et Plotin refuse dexpliquer la production des organes des sens par rien de tel quun hasard heureux ou une providence attentive ; ils ne sont quune imitation dgrade dune ralit plus haute 2. La deuxime hypostase est donc un vritable monde, p.456 complet, parfait, et non pas un simple schma abstrait du monde sensible. La deuxime hypostase est aussi ltre ou essence ; cest--dire le contenu concret ou positif dune chose qui fait delle un objet de connaissance. La premire hypostase tait au-dessus de ltre, et on devait en nier tout caractre positif ; la seconde est ltre mme, cest--dire tout ce qui fait que la ralit a une forme qui la rend connaissable. Enfin, la seconde hypostase est lintelligence. Plotin introduit sur ce point des nouveauts qui ont frapp ses contemporains, qui ont notamment beaucoup choqu Porphyre son entre dans lcole. Lintelligence est ce qui connat ltre ou essence : or, entre ltre ou intelligible, qui est connu et lintelligence, qui le connat, il faut admettre, semble-t-il, une distinction : ltre est pos dabord comme la ralit en acte puis lintelligence dont les virtualits sactualisent lorsquelle apprhende ltre ; il est mme essentiel au platonisme de poser lintelligible avant lintelligence ; cest Aristote et Anaxagore qui, prenant lintelligence pour principe, ne savent pas la dfinir et suppriment lintelligible. Si un Platonicien acceptait lintelligence comme principe second, cest quil mettait comme principe premier lintelligible, la manire de Platon qui, dans le Time, a dcrit lintelligence du dmiurge
1 2
V, 7. VI, 7, 1-2.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
311
contemplant hors delle-mme et au-dessus delle les modles idaux limitation desquels sont produites les choses. Or Plotin ne suit pas du tout cette tradition : il prend son compte la formule connue dAristote : dans la science, la chose sue est identique au sujet qui connat, et il refuse dadmettre que les intelligibles soient en dehors de lintelligence. Sans doute, il est fidle Platon, lorsquil sagit de mettre au-dessus de lintelligence une ralit dont elle a la vision ; mais cette ralit, qui est lUn, nest plus lintelligible. Pourquoi donc ce changement si profond ? Rappelons dabord que si le Time subordonnait lintelligence dmiurgique aux modles idaux, en revanche la Rpublique p.457 faisait du Bien le principe commun du connaissant et du connu, comme le soleil est le principe commun des choses visibles et de la sensation visuelle ; intelligence et intelligible, connaissant et connu sont ainsi au mme niveau. Ainsi Plotin, lui aussi, se rclamait de Platon. Mais de plus et surtout, la thse contraire lui parat introduire en philosophie toutes les difficults de la thorie de la connaissance des dogmatismes postaristotliciens. Si lintelligible est en dehors de lintelligence, il faudrait se figurer une intelligence sans pense actuelle et dans laquelle viennent simprimer, par rencontre, les intelligibles, la manire des sensibles sur les organes des sens ; cette intelligence serait imparfaite, incapable dapprhender ternellement son objet, incapable datteindre la certitude sur son objet dont elle ne possderait quune image. LIntelligence hypostase doit donc dcouvrir en elle-mme toute la richesse du monde intelligible. La pense de soi-mme lui donne non seulement (comme le cogito augustinien ou cartsien) la certitude formelle de son existence, mais la certitude de son contenu ; sa connaissance sy arrte, comme elle y commence 1. Ici se trouve, semble-t-il, lunit des spculations de Plotin sur la seconde hypostase : lIntelligence est vision de lUn, et par l mme, elle est connaissance de soi et connaissance du monde intelligible ; il ne faut pas se figurer le monde intelligible la faon dun tre inerte qui ne serait pas en mme temps une pense ; rappelons-nous que ltre est contemplation ; la conception la plus profonde que lon puisse avoir du monde intelligible est celle dune socit dintelligences ou, si lon veut, desprits dont chacun, en se pensant, pense tous les autres et qui ne forment donc quune Intelligence ou Esprit unique. Comme lUn produit lIntelligence, lIntelligence produit une troisime hypostase qui est lAme. La thorie plotinienne de lme est encore plus complexe que sa thorie de p.458 lIntelligence. Pour bien en saisir la porte, il faut opposer, comme le fait sans cesse Plotin, ce quAristote pensait de lme ce quen pensaient, non sans une certaine concordance, Platoniciens et Stociens ; nous aurons ici un des motifs de dissentiment qui ont paru les plus graves cette poque entre Aristote et Platon. Aristote a pour ainsi dire ray lme de son image de lunivers ; les moteurs des cieux sont des intelligences ;
1
V, 5, 1-2 ; III, 8, 8.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
312
lme napparat que dans les corps vivants sublunaires, titre de forme du corps, notion tout intellectuelle dun physiologiste qui cherche le principe des fonctions corporelles ; lme, comme sige de la destine, a disparu. Au contraire, dans le Phdre, le Time et les Lois, comme chez les Stociens, il y a une me du monde, rectrice du monde sensible, laquelle les mes individuelles, mes des astres et mes des hommes, sont consubstantielles et dont elles ne sont que des fragments. Ce nest pas l une diffrence de terminologie, mais une opposition profonde dans la conception de lunivers et de la destine ; de lunivers dabord qui est un tre vivant et dans lequel, par consquent, les mouvements gnraux (mouvements circulaires des astres) sont dus non pas la proprit dune quintessence dont la nature est de se mouvoir circulairement, mais linfluence dune me qui domine llment ign qui compose le ciel et lui fait prendre, contrairement sa nature, le mouvement circulaire, ce mouvement de retour sur soi, qui est une imitation du sien propre 1 ; il nest rien qui fasse plus horreur au Platonicien que la quintessence aristotlicienne ; partisan de lunit substantielle du cosmos et de la sympathie de ses parties, il y voit non sans raison la ngation de cette thse. Opposition aussi dans la conception de la destine puisque les mes individuelles ont, dans le dtail du gouvernement des choses, le mme rle que lme du monde a dans lensemble ; leur destine fait donc partie dun plan densemble p.459 et Plotin dveloppe avec prdilection la vieille image des diatribes, le monde, thtre o la providence assigne chacun son rle 2. Sans songer cette vision du monde, cette fonction cosmique des mes, on ne saurait comprendre la nature de la troisime hypostase. Car lme nest que le monde intelligible, mais plus divis, plus dtendu, pas encore tendu pourtant, ou du moins pas encore tendu dune tendue matrielle, puisque lme a pour proprit dtre tout entire la fois dans toutes les parties du corps vivant quelle anime 3, dispose pourtant rpartir son influence dans le lieu et dessinant en elle, comme lme du monde du Time, les divisions du monde. Lme est en un mot lintermdiaire entre le monde intelligible et le monde sensible, touchant au premier parce que, procdant de lui, elle se retourne vers lui pour le contempler ternellement, touchant au second, parce quelle lordonne et lorganise. Encore ne sont-ce l deux fonctions diverses quen apparence : en ralit, elle norganise, nous le verrons, que parce quelle contemple, par une influence qui mane delle sans quelle le veuille ; comme si les figures auxquelles pense un gomtre se dessinaient delles-mmes 4 ; elle na pas une fonction active et providentielle ct de sa fonction contemplative ; purement contemplante, restant en haut, elle agit.
1 2
II, 2 ; II, 1. III, 2 et 3. 3 VI, 4 et 5. 4 Description de laction de la nature, III, 8, 4.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
313
A cette triade dhypostases sarrte la srie des ralits divines o le mal ne pntre pas. Est-ce l une thologie ? Plotin ne prononce jamais le nom de Dieu (sauf dans un texte suspect) propos du premier principe ; ce nom ne revient frquemment dans ses crits qu propos des mes rectrices du monde ou des astres qui, seuls, sont proprement pour lui des dieux et propos desquels il dfend le polythisme hellnique. Dautre part, Plotin a tenu sparer les actes cultuels de la religion p.460 et les spculations sur les principes : longuement, il parle et de la divination astrologique, de la prire et du culte des statues, afin de montrer que lefficace de ces actes cultuels, quil ne nie pas, provient non pas de laction dun dieu sur le monde en rponse cet acte (comme si les astres bienheureux pouvaient soccuper des sottises humaines), mais de la sympathie qui lie lune lautre les parties du monde, tout acte cultuel tant en somme analogue une incantation qui produit ses effets, la seule condition quelle soit bien excute. Entre cette religion qui tend au rite pur et laccs de lme aux ralits intelligibles, il ny a aucun rapport. Remarquons, ce sujet, quel point sa thorie des hypostases est diffrente de la thorie philonienne des intermdiaires, dont on la rapproche si souvent mal propos ; lintermdiaire philonien, le Verbe qui chtie ou rcompense, va en quelque sorte au devant des besoins de lme humaine, et na dautre rle que le souci du bien des hommes ; lhypostase plotinienne na aucune volont de bien, aucune intention de sauver les hommes : cest lopposition, mille fois rencontre, de la dvotion smite et de lintellectualisme hellnique ; chez Plotin, chaque hypostase nest quune contraction, une unification toujours plus haute du monde, jusqu lunit absolue. Toutefois, avec une restriction : en cette ralit ineffable, dnue de caractres positifs, quest lUn, Plotin discerne une infinit et une indtermination qui en font quelque chose dautre que la simple raison abstraite de lunit du monde. Dans le trait quil a crit Sur la libert et la volont de lUn (VI, 8), on voit natre dans le Premier une sorte de vie positive et indpendante ; ce nest point seulement lindpendance () que possdent le monde intelligible ou le monde sensible, cest--dire la facult de se suffire soi-mme sans besoin de lextrieur ; (cela cest lindpendance dune essence, mais encore le monde est-il li sa propre essence quil ne peut quitter) ; lindpendance du Premier est labsolue libert, le fait de pouvoir tre ce quil p.461 veut sans se lier aucune essence ; une sorte de puissance indfinie de mtamorphoses, qui ne sarrte aucune forme. Il y a l quelque chose de nouveau et qui nest pas chez Platon ; Platon avait parl dun principe suprme qui tait limite, mesure et rapport fixe, donc toujours conu relativement lordre dont il tait le principe. LUn infini de Plotin est libert absolue, la ralit qui est ce quelle est par soi, par rapport soi et pour soi 1. Dfinir la ralit la plus profonde, comme indpendante des formes o lesprit fixe les tres, tel est le propre du platonisme ; mais il sensuit quelle
1
VI, 8, 7.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
314
ne pourra tre atteinte que par des mthodes, indpendantes des mthodes intellectuelles, puisque lintelligence na affaire qu de ltre dfini et limit. Au-dessous de la triade des hypostases divines, Plotin admet encore une autre hypostase, qui est la matire. Tandis quAristote dfinit la matire par relation la forme et en fait toujours un relatif, Plotin en fait au contraire une ralit absolue. Tandis quAristote considre la matire (sauf la matire premire) comme indtermine seulement par rapport une forme (lairain par rapport la statue), bien quelle puisse tre dtermine en elle-mme, Plotin nadmet quune matire compltement indtermine, et mme indterminable ; car la faon dont la forme existe dans la matire ne rend pas celle-ci plus dtermine ; la forme, en la quittant, la laisse aussi pauvre de dtermination quelle lavait trouve ; la matire est impassible, elle est labsolue pauvret du mythe du Banquet. Aussi ny a-t-il pas union vritable de la forme et de la matire ; il faut plutt dire que le sensible est un simple reflet passager de la forme dans la matire, et qui naffecte pas plus la matire que la lumire naffecte lair quelle remplit 1. Cette incapacit de recevoir la forme et lordre, de la possder, de la garder, cette impossibilit de dire : moi, davoir un p.462 attribut positif, cest le mal en soi, et cest la racine de tous les maux qui existent dans le monde sensible. Le mal nest pas en effet une simple imperfection puisque, alors, il faudrait dire que lIntelligence est mauvaise parce quelle est infrieure lUn. Vice, faiblesse de lme, tout ce qui parat tre le mal en soi, nest un mal que parce que lme est entre en contact avec la matire, est plonge dans le devenir cause de ce contact ; elle sen purifie non pas en sen rendant matresse, mais en la fuyant. Si cette matire existe pourtant, cest parce quil faut que tout degr de ralit soit puis ; elle nest pas indpendante de lUn ; elle en est seulement comme le dernier reflet, avant lobscurit complte du nant 2. Dans lapprciation de Plotin sur lorigine du mal, nous rencontrons simultanment deux thodices de principes fort diffrents : dans lune, celle dont nous venons dindiquer le principe, le mal cest la matire, et la chose sensible est un reflet dans un reflet ; on y chappera en revenant aux ralits. Lautre, celle quil dveloppe en ses derniers crits, en est bien diffrente : le logos ou raison, principe dharmonie, joue le beau jeu du monde, et chaque tre a dans le monde une place et un rle qui le font convenir avec lharmonie du tout ; il ptit ou subit tout ce qui convient en cette qualit ; la souffrance quil subit (comme celle de la tortue trop lente pour chapper au chur qui savance et la foule aux pieds) peut tre un mal pour lui, si on le considre isolment et dtach de tout ; elle nest pas un mal pour lunivers 3. On voit ici deux thses trangres lune lautre : dune part une thodice pessimiste
1 2
III, 6, 6 sq. ; II, 4, 6 sq. I, 8. 3 III, 2 et 3.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
315
nacceptant comme remde au mal que la fuite hors du monde, dans la ralit suprasensible ; dautre part une thodice progressive et optimiste, admettant le remde stoque de lassentiment volontaire. Mais sont-elles contradictoires ? Laideur du sensible, fuyant, vanouissant, indtermin ; p.463 beaut du cosmos, ordonn, harmonieux, rgl par des lois ternelles, cest lasctisme du Phdon, ct de ladmiration du Time pour lart du dmiurge : deux sentiment distincts, mais non contradictoires, puisquils rpondent la dissociation du monde sensible en ses facteurs rels, abaissant dune part notre vue vers lindtermination de la matire, et llevant dautre part vers lme du monde et la rgion suprasensible. La beaut que nous admirons en une chose, Plotin la dit dans le premier trait quil ait crit, Du beau (I, 6), nest point une simple disposition des parties de cette chose, cest le reflet dune ide suprasensible ; cest donc le monde intelligible que nous admirons effectivement dans le monde sensible et auquel nous sommes renvoys par une dialectique ncessaire qui spare lordre du dsordre. Cette distinction permettra de comprendre la difficile question de la destine des mes individuelles. Rappelons que Plotin admet une sorte dunit de toutes les mes, toutes les mes drivant dune me unique, la manire dont les intelligences drivent de lIntelligence. Lme du monde a prpar pour chacune une demeure correspondante sa nature et quelle doit diriger pendant le temps fix par lordre des choses. Lme dirige le corps, on sen souvient, seulement parce quelle contemple lordre intelligible ; tourne ou convertie vers ce monde et tant par l elle-mme intelligence, elle reste auprs de lintelligence, tandis quun reflet delle-mme va clairer et vivifier le corps. Mais, parce que le lien qui unit les mes est plus dtendu que celui qui unit les intelligences, lme peut se tourner vers son reflet ; alors, au lieu de contempler son modle, elle voit son reflet ; comme Narcisse attir par son image et se noyant pour ltreindre, elle se prcipite vers lui, et elle est dsormais asservie aux changements du monde sensible, sujette aux mille inquitudes relatives son corps et de faux biens qui lui chappent. Telle est la descente de lme ; et sa destine dans la vie future dpend, par une sorte 1 p.464 de justice immanente, du pch quelle a commis ainsi . Le but de lducation philosophique est la restitution de lme dans son tat originaire de contemplation ; mais ici il faut bien entendre une doctrine qui nest pas simple ; on ne pourra la comprendre que par une distinction entre mon me et moi-mme. En ralit lordre du monde implique que lintelligence de lme (ou partie de lme qui contemple lintelligence) reste ternellement convertie vers le monde intelligible, puisque cest de cette contemplation que drive lexistence mme du corps quelle dirige ; cest moi qui, au lieu de rester au niveau de ma propre intelligence, descend vers le reflet que mon me projette ; le moi, cest cette me intermdiaire qui est
1
IV, 9 ; IV, 3, 2-8 ; IV, 8 ; IV, 3, 9-10.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
316
entre lme intellectuelle et son reflet et qui peut aller tantt vers lun, tantt vers lautre, tandis que la partie suprieure de lme reste en haut . Dans un monde, aussi fixe et arrt que celui de Plotin, la destine et lhistoire ne peuvent sintroduire que si on laisse cette ralit, que Plotin appelle souvent lme et que nous appelons le moi, passer dune rgion une autre ; la destine de lme (ou du moi), cest le changement qui sopre en elle, lorsquelle simprgne successivement de tous les paysages mtaphysiques travers lesquels elle passe 1. Autant de niveaux de ralit, autant de manires de vivre possibles pour lme : au bas, la vie dans le monde sensible, quil sagisse de la vie de plaisir o lme est compltement passive, ou de la vie active, dont la rgle est donne par les vertus sociales qui dirigent laction. Plus haut la rflexion, o lme se recueille en elle-mme, jugeant et raisonnant ; cest, par excellence, le niveau intermdiaire o lme est matresse delle-mme. Au-dessus de cette pense discursive, procdant par dmonstration, elle atteint la pense intuitive ou intellectuelle et monte au niveau de lintelligence, cest--dire des essences qui ne supposent rien avant elles et sont des donnes p.465 intuitives. Mais lme peut encore aller parfois plus haut, jusquau Premier ; il ne sagit plus alors dune vision intellectuelle ou dune intuition, puisque lon ne peut saisir que le dtermin ; il sagit plutt dune espce de contact, tout fait ineffable, o lon ne peut mme plus parler dun sujet qui connat et dun objet qui est connu, o cette dualit mme est supprime, o lunification est complte, o il y a moins une connaissance que jouissance de cet tat. De cet tat ne peuvent tmoigner que ceux qui lont prouv ; or ils sont rares et, chez eux-mmes, cet tat est rare ; Plotin affirma, dit-on, Porphyre, ny tre arriv que quatre fois ; de plus ils ne pourront en parler que par souvenir ; car au moment o ils lprouvent, ils ont perdu toute notion deux-mmes ; tel est le plus haut degr o lon puisse atteindre, lextase suprieure lintelligence et la pense 2.
II. NOPLATONISME ET RELIGIONS ORIENTALES
@ Dans les deux sicles et demi qui ont suivi la mort de Plotin, le noplatonisme a une histoire fort complexe non seulement par ses doctrines, souvent divergentes chez les trs nombreux matres qui les enseignent, mais aux points de vue religieux et politique. Au point de vue religieux, le noplatonisme se fait peu peu solidaire des religions paennes, qui finissent au milieu du triomphe croissant du christianisme. Lenseignement de Plotin contenait, on la vu, une doctrine
1 2
IV, 8, 8. PORPHYRE, Vie de Plotin, chap. XXIII ; VI, 7, 33 sq.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
317
religieuse distincte de sa doctrine philosophique ; elle se distingue par deux traits : la divinit des tres clestes, des astres ; un ensemble dactes religieux, prires, vocations des mes, incantations magiques, dont lefficacit dcoule dune manire en quelque sorte mcanique de lobservance exacte des rites prescrits. Ce ne sont pas l, p.465 bien entendu, des dcouvertes de Plotin, mais des ides communes quil agrge sa philosophie. Sous toutes les formes, on voit se rpandre aux IIe et IIIe sicles le culte du soleil, aussi bien dans les mystres de Mithra, dont les adeptes sont aussi nombreux cette poque que dans le culte officiel du Deus Sol 1 quinstitue Aurlien, empereur en 270 ; culte dans lequel il prtendait runir toutes les religions de lempire et auquel pouvaient participer, sans rien sacrifier de leurs prfrences personnelles, les Syriens adorateurs de Baal, les Grecs et les Latins. Prs dun sicle plus tard, en 362, cest aussi autour du culte du Soleil que lempereur Julien, qui est un adepte des mystres de Mithra, veut rorganiser une religion paenne officielle. Et comment comprendre, en effet, cette vnration religieuse que le cosmos inspire aux noplatoniciens sans cette substructure religieuse, dont ils sont moins les auteurs que les tmoins ? Tandis que le philosophe lgitime ce culte par lensemble de ses spculations, on voit des monuments figurs sefforcer de la faire parler limagination, comme cette sphre magique du IIe ou IIIe sicle o saccumulent les symboles des divinits cosmiques 2 : le soleil, personnage assis, entour dune aurole de sept rayons, le triangle, symbole de la gnration et cinq cercles scants indiquant les cinq lments que distingue Aristote ; dtails dont beaucoup se retrouvent dans un hymne au Soleil de Proclus. A ce culte solaire se rattache, dailleurs, dans le mithriacisme, la mme vue de la destine humaine que lon trouve chez Plotin ; dans les bas-reliefs mithriaques, le soleil rayonnant fait continuellement descendre, le long de ces sept rayons, des particules de feu dans le corps quil appelle la vie. Inversement, quand la mort a dissous les lments dont ltre humain est compos, le soleil les lve vers lui 3. La transformation de lme en un tre cleste, aprs la mort, p.467 ou, ds cette vie ; sous linfluence des crmonies des mystres, est la croyance courante des religions des mystres, vers le IIe sicle ; dans les mystres de la Grande-Mre, Apule nous reprsente liniti, appel la renaissance et une vie nouvelle, revtant successivement douze habits au cours des crmonies nocturnes de linitiation, et le matin, revtu de lhabit cleste , honor comme un dieu par toute la communaut 4. Les noplatoniciens cherchent parfois aller la rencontre de ces croyances, en se faisant eux-mmes plus populaires ; de l naissent des crits comme le petit crit de Salluste, Des dieux et du monde, sorte de catchisme
1 2
HOMO, Essai sur le rgne de lempereur Aurlien, p. 270. DELATTE, Bulletin de correspondance hellnique, 1913 p. 253. 3 CUMONT, Astrology and Religion among the Greeks and Romans, 1912, p. 188. 4 APULE, Mtamorphoses, livre VIII ; REITZENSTSIN, Die hellenistische Mysterien p. 26. 30. 31. C
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
318
noplatonicien qui sadresse aux gens du commun, avec la prtention de sappuyer uniquement sur le sens commun et sur les mythes connus de tous, avec un vident souci de clart. Un dogme fondamental de cette religion, et qui loppose aux nouvelles croyances chrtiennes, cest celui de lternit du monde, avec lordre quil possde actuellement ; admettre la cration revient admettre que les astres ne sont pas des tres divins ; et les noplatoniciens, de Porphyre Proclus, ne se lassent pas de rpter contre la cration le mme argument : la production du monde est un rsultat ncessaire et par consquent ternel de la nature de Dieu, quon ne peut supposer inactif quen le supposant imparfait. Un second trait de la religion de Plotin, cest lextraordinaire force attribue au rite, qui transforme au fond tout acte cultuel en un acte magique 1, Cest encore l un trait commun du temps. En nulle poque, on ne trouve plus dincantations magiques crites sur des tablettes, quil sagisse de tablettes dexcration ou de charmes damour ; en nul temps, on na de moyens plus nombreux de prvoir lavenir ; de l un charlatanisme sans frein comme au IIe sicle, celui dAlexandre p.468 dAbonotique, dont Lucien, dans son Alexandre, a dvoil les odieuses machinations. Plotin lui-mme prsente le monde sensible comme un vaste rseau dinfluences magiques et donne la philosophie comme le seul moyen dchapper ces influences. On sait aussi le succs queut le roman de Philostrate (vers 220), o le Pythagoricien Apollonius de Tyane sinitie tous les procds magiques de lOrient. Dans son Alexandre, Lucien nous dit que le charlatan considrait comme ses principaux ennemis les picuriens et les chrtiens . Le fait est que, ds la fin du IIIe sicle, ltat voit dans ces superstitions un danger public ; de nombreuses mesures furent prises contre elles 2 ; ds 296, une loi interdit lastrologie ; sous Constantin, une loi de 319 interdit lart divinatoire priv, et, en 321, prcise les formes lgales dans lesquelles la divination est permise ; une nouvelle loi contre la divination (358), linterdiction des sacrifices (368), un procs contre les magiciens et les philosophes (370), lois encore renforces sous Thodose sans parler de nombreux dits contre le paganisme en gnral, qui continuent jusquau Ve sicle, tout cela nous montre avec quelle ardeur taient poursuivies les ides et les pratiques dont les noplatoniciens avaient rendu leur philosophie compltement solidaire ; les vies de nos philosophes, celle de Plotin par Porphyre, les Vies des Sophistes, dEunape (vers 375), la vie de Proclus, par Marinus (vers 490), celle dIsidore, par Damascius (vers 511), nous montrent en effet des milieux o, de plus en plus, les croyances superstitieuses taient acceptes denthousiasme et o lon cherchait les contes les plus absurdes sur linfluence magique dune pierre noire ou dune statue. Il faut ajouter que ce nest pas pour leur absurdit que les pouvoirs publics veulent rformer ces superstitions ; cest que tout le monde les craint parce que tout le monde, chrtiens comme paens, gens du peuple comme gens
1 2
Ennade, IV, 4, 38 sq. A. MAURY, La Magie et lastrologie, 3e d., 186, p. 94-150.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
319
instruits, croit leur efficacit et en a peur. Les p.469 sceptiques et les picuriens dont parle Lucien se font rares. Il faut se reprsenter cet univers travers dinfluences magiques sympathiques, auxquelles on ne songe pas opposer la connaissance la plus lmentaire des lois de la mcanique. Jamais on na t plus loin qu cette poque dune conception mcaniste de lunivers ; nulle action quune sorte de rayonnement qui ne connat pas lobstacle de la distance ; on veut ignorer ou viter toute transmission mcanique de forces : pour Plotin, le milieu matriel qui est entre lil et lobjet, visible, loin de servir transmettre la lumire, ne peut tre quun obstacle son influence 1 ; et il nadmet pas non plus la transmission mcanique de limpression de lorgane des sens au sige de lme ; il repousse avec force la prtention dassimiler laction naturelle celle dun levier. Comment comprendre la production mcanique dune qualit comme la couleur 2 ? Loin que la magie soit une exception, laction naturelle des choses les unes sur les autres nest quun cas particulier de luniverselle magie. Divinit des astres, ternit du monde, croyance la magie, croyance que les mes, dorigine divine, sont destines retourner aux dieux, tels sont les dogmes dune foi que lon shabitue appeler lhellnisme par opposition au christianisme. Cette croyance a ses livres saints ; ce sont les Oracles chaldens, que lon attribue une antiquit recule et qui datent au moins du IIIe sicle, puisque Porphyre les utilise ; cest, en ralit, un simple expos versifi du platonisme ; Proclus lestime tel point quil avait lhabitude de dire quil verrait sans regret tous les livres dtruits si lon gardait seulement les Oracles et le Time de Platon. Cette croyance a aussi son culte, et il se produit mme une dissidence des plus curieuses, entre les thurges qui veulent rduire lhellnisme une pratique rituelle, en abandonnant toute spculation philosophique, et p.470 les philosophes purs. La thurgie est la connaissance des pratiques ncessaires pour faire agir linfluence divine o et quand on veut ; cest un art qui nest pas sans rapport avec lalchimie, si rpandue cette poque et reposant comme lui sur la croyance lunit des tres, do vient leur sympathie 3. Le point de vue thurgique, uniquement pratique, antispculatif est bien reprsent par le trait Des mystres des gyptiens, attribu Jamblique, o il nest dautre mthode de connaissance que la purification. Les philosophes, qui ne parlent quavec respect de ces thurges, se donnent, eux, pour mission de spculer sur la ralit suprasensible, qui est au-dessus de la magie du monde sensible ; il sagit toujours de dterminer dans leur hirarchie les formes de cette ralit. Cest chez tous le mme problme et, en gras, la mme mthode de procession et de conversion ; mais
1 2
Ennade ; IV, 5. Ennade, IV, 7, 6 ; III, 8, 2, 5. 3 BIDEZ, Liturgie des mystres chez les noplatoniciens. Bulletin de lAcadmie royale de Belgique (classe des lettres), 1919, p. 415.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
320
cependant leur pense prsente des nuances, et il se fonde de vritables coles. Les principales directions de penser sont dues Porphyre, au Syrien Jamblique (mort en 329), puis Proclus (412-484), qui fait briller dun dernier clat lAcadmie dAthnes, enfin Damascius (dbut du VIe sicle), le dernier matre dAlexandrie.
III. PORPHYRE
@ Porphyre de Tyr (233-305), ds quil eut fait la connaissance de Plotin Rome, en 263, se consacra rpandre ses ides, diter ses uvres en les faisant prcder dune vie du matre (298), crire une Introduction aux intelligibles, o il utilise les Ennades pour donner une vue densemble de la nature de lme et du monde intelligible, insistant surtout sur limpassibilit de lme, mme dans la sensation ( 18), et sur son indpendance du corps. Mais il semble que son got p.471 personnel lattirait vers lasctisme nuance pythagoricienne et vers la thologie allgorique ; son trait De lAbstinence des viandes, adress un certain Firmus, qui avait abandonn la pratique du vgtarisme, contient, pour justifier cette pratique, des dtails extraordinairement abondants et prcieux ( cause des auteurs quils nous font connatre, en particulier Thophraste, le successeur dAristote) sur les sacrifices sanglants ; ils ne plaisent quaux dmons mchants qui veulent se faire adorer et qui corrompent les opinions, mme des philosophes, sur les dieux. Sa Lettre Marcella, une veuve mre de sept enfants quil pousa, est dune dvotion toute traditionnelle, avec son dieu lpictte, tmoin et surveillant de toutes nos actions et de toutes nos paroles . Cest surtout la thologie pratique qui domine dans le trait sur la Philosophie daprs les Oracles, compos avant la rencontre avec Plotin et dont les extraits, connus par la Prparation vanglique dEusbe, contiennent les donnes les plus curieuses sur les rgles du culte, et celles de la fabrication des statues, rgles donnes par les oracles. Le trait Des images, extrait aussi par Eusbe, plus Stocien que Platonicien, donne de nombreux dtails sur la signification symbolique des statues, aussi bien de la matire en laquelle elles sont faites que de leurs attitudes, de leurs couleurs, des attributs quon leur ajoute. Lexplication dun passage dHomre, dans lAntre des Nymphes, lui est une occasion dexposer ses vues sur la destine de lme. Enfin on le voit dfendre, contre le noplatonicien Atticus (fin du deuxime sicle), daprs qui la matire est une ralit indpendante du premier principe, la thse plotinienne que cette hypostase dernire est, elle aussi, drive du principe. Tel est le thologien qui crivit Contre les Chrtiens une attaque violente, dont Eusbe a conserv quelques extraits o il proclame nettement que le culte de Jsus est incompatible avec celui dEsculape. Ajoutons que Porphyre fut aussi historien et commentateur ; auteur dune Vie de Pythagore, il crivit une Histoire des p.472 philosophes jusqu Platon,
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
321
conserve par fragments, une Introduction aux Catgories dAristote (Isagoge) dont limportance historique au Moyen ge est grande, un Commentaire des Catgories, conserv en partie, mais dont le commentaire de Boce nest que la traduction 1, une Introduction lapotlesmatique de Ptolme, qui montre quil gotait lastrologie 2.
IV. JAMBLIQUE
@ Cest sous Diocltien et Constantin quenseigna Jamblique de Chalcis, dont la pense domine toute la fin du noplatonisme ; il tait non moins mystagogue que philosophe. La manire dont il voulait quon tudit Platon (selon un ordre peut-tre dj traditionnel) est caractristique ; on devait tudier dix dialogues en ordre systmatique en commenant par Alcibiade I, qui traite de la connaissance de soi, en continuant par le Gorgias, qui traite des vertus politiques, en rservant pour la fin le Parmnide, qui se rapporte au principe suprme. Ainsi les dialogues, lus comme il faut, ne sont quun vaste guide de la vie spirituelle 3. Des spculations de Jamblique sur lme, nous ne connaissons gure que les fragments dun trait, de caractre surtout historique, conservs dans les Eclogues (I, 40, 8 ; 41, 32-33) de Stobe. Ce qui nous intresse, cest quil veut y distinguer la pure tradition historique du platonisme des additions dont elle a t lobjet. Daprs un enseignement, qui ne remonte qu Numnius, lme serait une essence identique celle de la ralit suprieure dont elle drive ; daprs la doctrine vritable de Platon (et aussi dAristote et de Pythagore), lme est une substance distincte de cette ralit et doue de caractres propres. p.473 On voit ici, assez nettement, lopposition dun platonisme inspir du stocisme, celui de Numnius, qui fait des mes de simples fragments de lintelligence divine, et dun platonisme qui multiplie les termes de la hirarchie des ralits, en sefforant de conserver chacun son caractre propre et original. Cette tendance la multiplication des termes de la hirarchie, qui apparat dj cette occasion, est le trait distinctif de cette priode ultime du noplatonisme inaugure par Jamblique ; il donne la mthode et lexemple, dont Proclus sinspirera, si bien que, au lieu de la simple triade plotinienne, la ralit suprasensible se composera dun grand nombre de ternaires, tags les uns au-dessus des autres. Est-ce l, comme on le rpte souvent, la continuation dun mouvement de pense qui dbute chez Plotin ? Plotin aurait intercal, entre le premier principe et le monde, les hypostases de
Cf. BIDEZ, Comptes rendus de lAcadmie des inscriptions, 1er octobre 1922. BOLL, Sphaera, p. 7, note. 3 Daprs Proclus, Commentaire de lAlcibiade, d. Cousin, 297, 11-20.
1 2
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
322
lintelligence et de lme, pour rtablir la continuit, rendue impossible par la transcendance du Principe ; ses successeurs, selon le mme procd, auraient intercal dautres termes comme on intercale des points, pour se rapprocher dune ligne continue. Nous voyons au contraire, dans la direction de Jamblique, une vritable raction contre lesprit plotinien. Lorsque Proclus, qui est tout fait dans lesprit de Jamblique, a montr, en son Commentaire du Time (241 f. sq.), que lternit tait une hypostase intercaler entre le Bien et lAnimal en soi (de mme que le Temps doit tre intercal entre le monde intelligible et le monde sensible), il fait la remarque suivante propos dauteurs quil ne nomme pas et qui doivent tre Plotin et ceux de son cole : Les autres confondent tout ; nadmettant que lIntelligence entre lme et le Bien, ils sont forcs de reconnatre lidentit de lIntelligence et de lternit. Cette critique simpliste revient non pas distinguer l o Plotin confond et identifie, comme on le croirait lire seulement Proclus, mais mconnatre lesprit de Plotin, qui sans confondre du tout lternit et le monde intelligible, retrouve lternit p.474 dans le mouvement de lintelligence qui revient vers lun 1, la recherchant donc dans sa gense et son processus, loin den faire, comme ses successeurs, un terme fig. Cest de la mme manire que, ailleurs, Proclus critique la thorie des dmons que donne Plotin ; Plotin dtruit la notion mme de dmon en faisant, comme les Stociens, du dmon une partie de nous-mme 2 ; encore ici, Proclus nglige la subtile thorie plotinienne de lme, daprs laquelle la partie suprieure de nous-mme (le dmon), la partie contemplative, est nous sans tre nous ; elle est nous-mme quand nous y atteignons : elle cesse dtre nous, lorsque nous descendons un niveau infrieur. La grande affaire de Jamblique (comme de Proclus) est de trouver une mthode qui participe non moins la mthode aristotlicienne, classant les concepts des caractres les plus gnraux aux plus particuliers, qu la dialectique platonicienne ; une mthode aussi qui permette de retrouver, dans le monde intelligible, dduites et bien leur place, les mille formes religieuses que distingue le paganisme, dieux, dmons, hros, etc. Ce vaste classement est vide de la vie spirituelle qui animait les Ennades et qui maintenant dchoit dune part jusqu luvre appliqu du thologien, dautre part jusqu la pratique du thurge. De fait, il ny a rien de si diffrent que la triade plotinienne. (Bien, Intelligence, Ame dont lensemble constitue le monde intelligible) et le fameux ternaire de Jamblique. On va voir dailleurs comment le second sort du premier : rappelons comment Plotin avait imagin la production de lhypostase infrieure par la suprieure ; de celle-ci part un rayonnement qui procde ; cette procession sarrte, et la chose qui a procd, se retournant par
1 2
Ennade, II, 7. Commentaire sur lAlcibiade, p. 382-5, visant Plotin, Ennade, III, 4. 5
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
323
un mouvement de conversion, se fixe en contemplant son origine. Plotin avait ajout, et en particulier propos de la manire dont lme nat de lintelligence, que le p.475 principe de lAme ne procde pas mais reste auprs de son origine. Le ternaire de Jamblique isole cette triple condition de toute production 1 ; toute production a pour principe un ternaire qui comprend ce qui reste ( ), ce qui procde ( ), ce qui fait que, ce qui procde se convertit ( ). Mais, ces conditions de production, Jamblique les ralise en formes fixes : chaque ternaire est comme un monde ou plutt un systme (diacosmos) qui comprend ce qui fait que ce systme est un, ce qui fait quil est divers (procession), ce qui fait que, bien que divers, il reste unifi (conversion). De plus cette triple condition qui, chez Plotin, ne faisait que dessiner la forme gnrale de toute production devient, chez Jamblique, toute la ralit ; il ny a que des systmes ternaires ou diacosmes tags les uns au-dessus des autres, chaque systme infrieur tant comme une forme spcialise du systme suprieur. Ainsi le premier ternaire est compos dun principe didentit, lunit, dun principe de procession ou de distinction, la dyade, enfin dun principe de conversion, la triade. Au-dessous un second ternaire compos de trois ttrades, considres trois points de vue diffrents ; la premire comme carr de deux est une unit subsistante (22) ; la seconde comme produit de deux par la dyade (2 x 2) procde ; la troisime comme contenant implicitement la dcade parfaite (1+2+3+4=10) se convertit. Au-dessous un troisime ternaire dont le premier terme est principe de ressemblance et participe lidentit, un deuxime qui stend travers toutes choses la manire dune me, un troisime qui fait retourner les choses leurs principes. Cee principes transforment considrablement le noplatonisme ; le ternaire de Jamblique ne sajoute pas la triade de Plotin ; il le remplace ; le rythme du ternaire nest plus celui de la triade ; dans la triade, Un, Intelligence, Ame, il y a un progrs continu vers toujours plus de division, plus dexpansion. p.476 Au contraire, dans le ternaire de Jamblique, on voit une unit qui spand, puis qui revient sur elle-mme ; la triade Un, Intelligence, Ame, Jamblique substitue la triade tre, Vie, Intelligence 2. Lintelligence est postrieure la vie et par consquent lme, comme on le voit effectivement dans le devenir visible, o la naissance est suivie du dveloppement de la vie et celui-ci du dveloppement de lintelligence, o lon voit le progrs en complexit de ltre ltre vivant et du vivant lintelligent. Lintelligence correspond au moment de la conversion, cest--dire quelle ne produit rien, mais quelle ordonne et organise ce qui a t produit.
V. PROCLUS
1 2
Daprs PROCLUS, Commentaire du Time, 206 a. PROCLUS, ibid., 252 e.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
324
@ Ces traits vont se prciser chez Proclus de Byzance, un des derniers diadoques de lAcadmie, qui se fait gloire, aprs son prdcesseur Plutarque, denseigner Athnes o il voudrait, mais en vain, concentrer lenseignement. Dune riche famille de magistrats judiciaires et destin dabord lui-mme au barreau, il devient philosophe par vocation : dune dvotion scrupuleuse et varie, clbrant chaque mois les crmonies de la Grande-Mre, observant les jours nfastes des gyptiens, jenant rgulirement le dernier jour de chaque mois, priant chaque jour au lever et au coucher du soleil et midi, recherchant les divinits exotiques qui il adresse des hymnes, pratiquant un art thurgique dont les procds lui avaient t transmis par Asclpignia, la fille de Plutarque, qui les tenait de son pre 1, tel est le dvot personnage qui fut par excellence dans lcole noplatonicienne le grand classificateur, auteur de rsums, de sommes, de commentaires de toute sorte, dont lordre, la clart, la limpidit sont surprenants en matire si abstruse. De grands commentaires inachevs, ou incompltlement parvenus, sur le Time, sur lAlcibiade, sur le mythe du Xe livre de la Rpublique, sur le Parmnide, sur Euclide ; des traits thologiques, une longue Thologie platonicienne, de courts lments de thologie ; une dissertation Sur le mal, conserve dans une traduction latine du Moyen ge, telles sont ses uvres principales. Les lments de thologie, qui donnent une ide complte de la ralit suprasensible, sont remarquables par leur mthode : ils sont composs de thormes dmontrs par la mthode euclidienne ; Proclus affectionne la dmonstration par labsurde qui conclut une hypothse en liminant toutes les autres. Tel est par exemple le thorme fondamental du trait, que lon pourrait appeler thorme de la transcendance : Un terme galement prsent tous les termes dune srie ne peut les clairer tous que sil est non pas en lun deux, ni en eux tous, mais avant tous. Car (ainsi parle la dmonstration), ou bien il est en tous, et, partag en tous, il a besoin dun autre terme qui unisse ses parties ; ou bien il est en lun deux seulement ; mais alors il ne sera pas prsent tous. Donc, etc. Ce thorme si important est la dmonstration du ralisme platonicien ; il veut dire quil ny a pas de choses bonnes sil ny a auparavant la bont ; de choses ternelles sil ny a lternit, etc. Daprs ce thorme, Proclus distingue, propos de chaque srie de choses qui possdent un caractre commun, par exemple la srie des choses bonnes, trois termes : un terme imparticip, cest--dire transcendant, la bont ; un terme particip, cest--dire le caractre commun toutes ces choses, savoir bon, enfin la ou les choses participantes, cest--dire les choses bonnes. On pourrait dire, en termes logiques, que limparticip est la comprhension du concept, le participant son extension, et le particip ce qui relie la comprhension lextension.
Daprs MARINUS, Vie de Proclus.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
325
De l une mthode de classification des termes daprs leur gnralit dcroissante ; lartifice de Proclus, qui fait de cette p.478 classification une mtaphysique, revient considrer chaque terme gnral comme cause des choses comprises en son extension ; ainsi lun ou lunit est cause de toutes les choses dont on peut dire quelles sont unes ; il sensuit que plus un terme est gnral et simple, plus il est lev en dignit ; mais inversement, plus une chose participante est simple, cest--dire participe exclusivement des caractres trs gnraux, moins elle est leve en dignit ; cest ainsi que ltre, comme caractre abstrait, est suprieur la vie (cest--dire a un domaine plus tendu que celui de la vie), et la vie lintelligence ; en revanche, ltre intelligent est suprieur ltre seulement vivant, et ltre vivant ltre tout court, dautant que la prsence dun attribut moins universel dans un sujet y implique celle dattributs plus universels : si une chose est homme, elle est a fortiori animal, et, si elle est animal, elle est tre. Voil donc les sries (une srie, , tant la runion dun imparticip, dun particip et dun participant, par exemple de la vie et des tres qui le possdent) classes en ordre hirarchique suivant le degr de gnralit ou de simplicit de limparticip qui les domine : au principe de tout, lUn ; audessous, la srie des units () ; au-dessous celle de ltre (au-dessous puisque tout tre est un, tandis que tout un, par exemple une privation, nest pas tre) ; au-dessous la srie de la vie, puis la srie de lme. La srie, Proclus le dit positivement (prop. 111), est le genre. Seulement, pour Proclus, le genre est cause, cest--dire que dans son unit, il contient sans distinction toutes les espces. Cest dire que chaque srie est comme un monde (diacosmos) dont chacun contient sa faon toutes les ralits possibles ; ce qui est contenu dans la srie des hnades sous la forme de lhnade est contenu dans la srie de ltre sous forme dtre et ainsi de suite ; donc chaque partie du contenu de lhnade correspond une partie du contenu de ltre, de la vie, de lintelligence ; de lme ; lensemble des parties correspondantes, prises aux tages diffrents, sappelle un p.479 ordre (), pour autant que Proclus lui-mme est fidle sa terminologie. Donc il y a comme une loi de dveloppement ou de distribution de la ralit qui est commune toutes les sries : les tres se divisent comme les units, les tres vivants comme les tres, les intelligences comme les tres vivants, les mes comme les intelligences. Cherchons comprendre ce quest cette loi de distribution. LUn primordial, principe de toutes les choses, a, rappelons-le, par rapport aux tres qui en dpendent, des fonctions diverses : il en fait des tres achevs () ; il retient ensemble les parties de leur essence () ; il protge leur limite contre lenvahissement des autres essences () ; cest grce lUn quil y a un systme dtres dfinis et systmatiss. Or ces diverses fonctions, compltement indivises en lUn, doivent se sparer ; de cette sparation nat la srie des hnades ou dieux, dont chaque terme dfinit un dieu ou une classe de dieux ; il y a les dieux qui achvent, ceux qui con-
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
326
tiennent, ceux qui gardent, et dautres encore si lon trouve dautres proprits de lUn. Cette composition de la srie des hnades ou dieux se retrouve dans claque srie infrieure, ce qui veut dire que chaque srie a, lgard de son infrieure, la fonction dachever, de contenir et de garder ; ltre dterminant ainsi le systme ou srie des intelligences, lintelligence celle des mes, les mes exerant enfin les mmes fonctions dans le monde sensible. Mais il y a plus : chaque srie contient en elle-mme, sous son point de vue propre, les caractres de toutes les autres sries. Rendons compte dabord des caractres des cinq sries subordonnes : des units drivent les essences ou tres fixes et intelligibles ; de ces tres les Vies qui ne sont que ces tres conus comme formant un systme analogue un vivant (lanimal en soi du Time de Platon) ; des Vies, les Intelligences, sujets intellectuels qui apprhendent et contemplent ; des p.480 Intelligences, les mes qui vont animer le monde sensible. Or chaque srie (cest la consquence ncessaire du fait que le genre contient lespce) contient en elle des termes correspondant toute la suite des sries. La structure Un, tre, vie, intelligence, me nest pas seulement celle de la suite des sries, mais celle de chacune des sries. Dans la srie des units il y a, outre lunit en elle-mme, des units ou dieux intelligibles, correspondant ltre, des dieux intelligents correspondant lintelligence, des dieux intra-cosmiques correspondant aux mes. Il en est de mme dans chacune des sries, chacune ayant son sommet une unit correspondant la srie divine, Intelligence une, me une, etc., et contenant sa manire, en tant quintelligence, me, vie ou tre, tout ce que contiennent les sries suprieures ou subordonnes. Ainsi, dans chaque srie, deux thmes de classification juxtaposs mais non unis, lun reposant sur la division de lUn en ses fonctions, lautre sur le principe que tout est dans tout. Cest tout autre chose que la philosophie de Plotin : tout est fait, dans le systme de Proclus, pour que chaque ralit reste sa place, dans une hirarchie fige ; elle a en quelque sorte dans sa srie tout ce quil lui faut ; ainsi les intelligences de la quatrime srie ne contemplent pas les intelligibles de la deuxime ; mais lintrieur mme de la quatrime srie, il y a un terme, les intelligences intelligibles, correspondant la deuxime srie et qui est lobjet des intelligences intelligentes. Dans le plotinisme, toutes les avenues taient comme ouvertes cette voyageuse en pays mtaphysique 1 qutait lme ; rien chez Proclus ne correspond ce moi mobile et spirituel qui se dplace tous les niveaux entre la matire et lun. La notion de vie spirituelle a presque disparu. Proclus cesse didentifier le mal avec la matire. Le mal nest ni dans la forme que veut dominer la matire, ni dans la matire qui dsire lordre ; p.481 il est dans le manque de commune mesure () de la matire la forme 2. Il nexiste donc pas comme hypostase ; mais comme parhypostase , comme tre driv.
1 2
INGE, The Philosophy of Plotinus. Commentaire du Time, 115 e.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
327
Lon ne peut tre plus infidle Plotin. Nul vnement vritable dans cet univers, qui nadmet point la cration, mais reste ternellement lui-mme. Dans quelle intention, dit Proclus sadressant aux chrtiens, aprs une paresse dune infinie dure, Dieu viendra-t-il crer ? Parce quil pense que cest mieux ? Mais auparavant ou il lignorait, ou il le savait ; dire quil lignorait, cest absurde ; et sil le savait, pourquoi na-t-il pas commenc avant 1.
VI. DAMASCIUS
@ Avec Damascius, personnage non moins dvot que Proclus, comme on le voit daprs la Vie dIsidore quil a crite, nous atteignons les derniers cercles intellectuels paens, ceux qui se runissaient Alexandrie pour parler du vieux temps et sur lesquels un papyrus a dernirement donn des dtails si suggestifs 2. Le trs long trait Des Principes, qui nous a t conserv, est un commentaire de la dernire partie du Parmnide ; il prend la plupart du temps le contre-pied de celui de Proclus. Toute la hirarchie fige des ralits, telle que lavait conue lesprit presque juridique de Proclus, est dsorganise pour laisser place une vie spirituelle et mystique intense qui rtablit partout les rapports, les avenues qui mnent aux ralits suprieures. Dtruire les catgories fixes par Proclus, montrer quelles ne trouvent nul point dattache dans le Parmnide, telle est sa grande proccupation. Et dabord il ne faut pas prendre pour premier principe lUn transcendant, avec ses fonctions dfinies dunification du rel. Au-dessus de lUn, il y p.482 a lIneffable, inaccessible tous, sans coordination, spar ce point quil ne possde plus vritablement la sparation ; car ce qui est spar est spar de quelque chose et garde un rapport avec ce dont il est spar 3 . Il faut donc mettre le Principe en dehors et au-dessus de toute hirarchie et se garder dadmettre en lui, mme titre de modle, nul ordre, nulle hirarchie. Est-ce que, pourtant, quelque chose vient de lui aux choses dici ? Comment non, si tout, de quelque faon, vient de lui (17, 13) ? Ce quelque chose, cest ce que toute ralit contient elle-mme dineffable, dimpntrable : plus nous montons, plus nous trouvons dineffable. LUn est plus ineffable que ltre, ltre que la Vie, la Vie que lIntelligence. Pourtant nous sommes sur la mauvaise pente, lorsque nous essayons ainsi de hirarchiser les ineffables ; nous sommes sur le point de rtablir une nouvelle hirarchie, en trouvant un Un ineffable, do dpend une ralit ineffable ; aussi faudra-t-il finalement refuser de dire quil communique rien de lui aux ralits qui viennent de lui. LIneffable, cest ce que pose la premire hypothse du Parmnide, en affirmant quil nest mme
1 2
Ibid., 88 c. J. MASPERO, Les Papyrus Beaug. Horapollon et la fin du paganisme gyptien. Bulletin de lInstitut franais darchologie orientale, tomes X et XI. 3 Edition RUELLE, 1, p. 15, l. 13.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
328
pas un, suivant leffort de lme qui le pose un, puis qui en supprime lUn, cause de sa supriorit qui noffre aucune prise. On voit la manire de Damascius, cet effort vers lintuition quil essaye de faire aboutir en limitant ses affirmations les unes par les autres, par une manire de dialectique vivante bien plus semblable celle de Plotin qu celle de Proclus. LIneffable, cest une sorte dinitiative absolue, comme le Premier de Plotin, dans son trait Sur la volont de lUn. Par contre lUn, tant cause, est dfini par une fonction et une relation. Dune manire gnrale, Damascius est plein de mfiance envers cette manire mcanique de dterminer les principes, qui p.483 triomphe avec Jamblique et Proclus ; elle a le grand tort, ses yeux, demployer lgard des principes les notions qui nont de sens que dans les drivs. Ainsi, voulant montrer comment de lUn radical drive la totalit une qui est comme lensemble uni des ralits intelligibles, on fait de cette totalit unie la synthse de deux principes opposs quon appelle lUn et la Dyade, ou bien la Limite et lIllimit, ou encore le Pre et la Puissance. En vrit, on natteint pas ainsi directement la ralit, mais on procde par image ; habitus expliquer sans difficult par des synthses de ce genre les mixtes que contemplent notre intelligence et notre me (par exemple un accord par un rapport fixe dterminant la dyade indfini du grave et de laigu), nous transportons sans plus des principes de ce genre la ralit suprme ( 45). La preuve quil ny a l quanalogie incertaine, cest la diversit de noms dont on se sert pour dsigner chacun des deux principes opposs, Monade, Limite, Pre, Existence pour le premier, Dyade, Puissance, Chaos pour le second ( 56). Sparation et opposition, procession et retour napparaissent que dans des ralits drives de celle dont on veut rendre compte par lunion de deux principes distincts. La ralit quon veut expliquer, cest lUnion ou lUni, cest--dire celle en laquelle toutes choses sont encore ltat indivis ; comment donc la faire natre de la fusion de deux ralits distingues ? Des principes qui existent avant lUni, donc avant que rien ne soit ltat de distinction, ne sauraient tre distincts. Do, chez Damascius, une conception nouvelle du ternaire primitif o les trois moments, station, procession et retour, sont remplacs par trois termes dont la triplicit naltre pas lunit ; des trois termes, le premier est Un-Tout, un par lui-mme et tout en tant quil produit le second ; le second est Tout-Un, tout par lui-mme, et un par leffet du premier ; le troisime tient du premier, lun, et du second, le tout ; chacun des termes est comme un aspect et une face de la mme ralit. En critiquant ainsi la mthode de Proclus, cest le p.484 noplatonisme luimme que Damascius est bien prs dabandonner ; il faudrait analyser le dtail de son livre immense pour montrer comment, presque chaque explication que Proclus donne du Parmnide, il oppose la sienne, inspire dun esprit diffrent ; il rejette par exemple des explications qui concluraient des
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
329
proprits du monde cr celles de son exemplaire 1 ; et il insiste sur ce fait que le monde sensible nest pas une image de toute la ralit suprasensible en bloc, mais seulement dune petite portion de cette ralit, du monde des Ides 2. Ailleurs il reconnat. et il indique avec force que la procession et la conversion ne peuvent se dire proprement que des natures intellectuelles (Plotin avait-il dit autre chose ?) et ne peuvent servir de moyen gnral pour expliquer toute ralit. Lenseignement de Damascius qui, par certains aspects, est dune profondeur et dune nouveaut admirables, bien que non sans confusion ni bavardage, resta infcond par le malheur des temps. Lorsque Justinien ordonna, en 529, la fermeture des coles philosophiques dAthnes, lUniversit dAthnes, si florissante au temps du sophiste Libanius, lami de Julien et dHimrius, tait tombe faute dlves et peut-tre de professeurs ; Damascius, dans la Vie dIsidore (221-227), nous dit quelle tait la grande infriorit de lenseignement philosophique Athnes son poque, avec le diadoque Hgias, qui prfra finalement les pratiques pieuses la philosophie. Alexandrie ntait pas un sjour sr pour les philosophes, comme le prouvent la perscution que leur fit subir lvque Athanase et le meurtre de la noplatonicienne Hypatie, assassine en 415 par la populace ; la ville tait dailleurs bien dchue de sa splendeur. La nouvelle capitale de lempire tait peu favorable aux tudes philosophiques : le noplatonisme meurt avec toute la philosophie et toute la culture grecques ; le VIe et le VIIe sicle sont des moments de grand silence.
Bibliographie @
1 2
I, 52, 16-53, 17. 156, 31-160, 22.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
330
CHAPITRE VIII HELLNISME ET CHRISTIANISME AUX PREMIERS SICLES DE NOTRE RE
I. CONSIDRATIONS GNRALES
@ christianisme ne soppose pas la philosophie grecque comme une doctrine une autre doctrine. La forme naturelle et spontane du christianisme nest pas lenseignement didactique et par crit. Dans les communauts chrtiennes de lge apostolique, composes dartisans et de petites gens, dominent les proccupations de fraternit et dassistance mutuelle dans lattente dune proche consommation des choses. Rien que des crits de circonstances, ptres, rcits de lhistoire de Jsus, actes des aptres, pour affermir et propager la foi dans le royaume des cieux ; nul expos doctrinal cohrent et raisonn. La philosophie grecque est arrive, vers lpoque de notre re, limage dun univers tout pntr de raison, dnu de mystre, dont le schma est sans cesse rpt par les crits philosophiques comme sous des formes plus populaires (le trait Sur le monde ; les Questions naturelles de Snque, etc.) ; vanoui, dans un pareil univers, le problme de la destine future soit par lide picurienne de la mort immortelle qui ne concerne en rien les vivants, soit par lacceptation stocienne de la mort comme de tous les vnements que tisse luniversel destin ; vanouis les mythes des dieux, ramens soit la proportion dun rcit historique par Evhmre qui veut y p.487 retrouver lhistoire de rois dfunts, soit un symbolisme physique par les Stociens. Toute lattitude pratique du philosophe est commande par ce rationalisme ; dans ses consolations, dans ses conseils, dans sa direction de conscience, cest toujours le mme retrait : quelle raison de se plaindre, de craindre, de se troubler dans un monde o tout vnement arrive sa place et son heure ? Au moment o le philosophe prchait Rome le rationalisme, Jsus enseignait en Galile des gens sans instruction, ignorant tout des sciences grecques et de leur conception du monde, plus aptes saisir les paraboles et les images que les raisonnements dune dialectique serre ; dans cet enseignement, le monde, la nature et la socit ninterviennent pas comme des ralits pntres de raison et se pliant docilement la comprhension du philosophe, mais comme dinpuisables rservoirs dimages pleines de signification spirituelle, le lys des champs, le fils prodigue, la mnagre la
p.486 Le
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
331
recherche de sa drachme perdue, et tant dautres dont la fracheur et le caractre populaire font contraste avec les fleurs attendues et les prcieuses lgances des diatribes. Lui aussi, il apprend comment on atteindra le bonheur ; mais ce nest pas par une sorte dhrosme de la volont qui fait considrer tous les vnements extrieurs comme indiffrents ; la pauvret, les chagrins, les injures, les injustices, les perscutions, ce sont l des maux vritables, mais des maux qui, grce la prdilection de Dieu pour les humbles et les dshrits, nous ouvrent le royaume des cieux. La souffrance et lattente, une sorte de joie dans la souffrance, qui vient de lattente du bonheur, quel tat diffrent, chez le disciple du Christ, de cette srnit du sage qui, chaque moment, voit, accomplie, sa destine tout entire ! Or, propos de cet enseignement du Christ, qui soppose avec vidence lhellnisme par labsence totale de vues thoriques et raisonnes sur lunivers et sur Dieu, lhistorien de la philosophie doit se poser un problme qui nest dailleurs quun aspect p.488 dun problme plus gnral concernant lhistoire de la civilisation : quelle est, au juste limportance, dans lhistoire des spculations philosophiques, du fait que la civilisation occidentale, partir de Constantin, est devenue une civilisation chrtienne ? On connat toute la gamme des rponses qui ont t faites cette question : elle est nulle, disent certains, et cela peut se dire avec deux intentions diffrentes, soit pour sauver la puret du christianisme vanglique qui ne contient rien que le devoir damour et de charit et le salut par le Christ, soit pour garantir lindpendance et lautonomie de la pense rationnelle ; dans la premire intention, lon montre (tel a t le point de vue des premiers historiens protestants de la philosophie) 1 que la dogmatique chrtienne qui se surajoute lvangile et saint Paul pendant les cinq premiers sicles, notamment les spculations sur la nature du Verbe et sur la Trinit, na t quune addition dangereuse de la spculation grecque la tradition primitive. Dans la seconde intention, on montre que les progrs effectifs de lesprit humain au point de vue rationnel se rattachent sans suture aux sciences grecques, sans que le christianisme intervienne dans la marche qui a conduit de la mathmatique grecque au calcul infinitsimal ou de Ptolme Copernic : sorte de dveloppement autonome de la raison que le christianisme a pu parfois entraver, mais quil na jamais aid : tel est le point de vue des thoriciens du progrs dans la seconde moiti du XVIIIe sicle. Daprs dautres, au contraire, le christianisme marquerait une rvolution importante dans notre conception de lunivers. On prsente dailleurs cette nouveaut du christianisme sous deux aspects assez divers, bien que peut-tre complmentaires. En premier lieu, chez les philosophes qui ont une tendance rechercher dans lhistoire une dialectique interne, on fait remarquer que la philosophie grecque donne essentiellement une p.489 reprsentation objective des choses, une image de lunivers qui est un objet pour lesprit qui la
1
Cf. lIntroduction du t. I, p. 16.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
332
contemple ; dans cet objet se trouve en quelque sorte absorb le sujet, lorsque, science parfaite, il devient, comme le dit Aristote, identique lobjet quil connat ; dans le stocisme, le sujet na pas dautre autonomie que ladhsion entire lobjet. Tout linverse, le christianisme connat des sujets vraiment autonomes, indpendants de lunivers des objets, dont toute lactivit ne spuise pas penser lunivers, mais qui ont une vie propre, vie de sentiment et damour intraduisible en termes de reprsentation objective. En somme en ignorant toutes les spculations des Grecs sur le cosmos, le christianisme na fait que mieux affirmer loriginalit de sa collaboration la pense humaine, qui est la dcouverte de ce qui est irrductiblement sujet, le cur, le sentiment, la conscience ; et cest seulement dans une civilisation chrtienne qua pu se dvelopper lidalisme qui fait de la nature intime du sujet le principe de dveloppement de toute ralit 1. De plus, et cest un second aspect de la rvolution mentale due au christianisme, le cosmos des Grecs est un monde pour ainsi dire sans histoire, un ordre ternel, o le temps na aucune efficace, soit quil laisse lordre toujours identique lui-mme, soit quil engendre une suite dvnements qui revient toujours au mme point, selon des changements cycliques qui se rptent indfiniment. Lhistoire mme de lhumanit nest-elle pas, pour un Aristote, un retour perptuel des mmes civilisations ? Lide inverse quil y a dans la ralit des changements radicaux, des initiatives absolues, des inventions vritables, en un mot une histoire et un progrs au sens gnral du terme, une pareille ide a t impossible avant que le christianisme ne vienne bouleverser le cosmos des Hellnes : un monde cr de rien, une destine que lhomme na pas accepter du dehors, mais quil se fait lui-mme par son obissance ou sa p.490 dsobissance la loi divine, une nouvelle et imprvisible initiative divine pour sauver les hommes du pch, le rachat obtenu par la souffrance de lHomme-Dieu, voil une image de lunivers dramatique, o tout est crise et revirement, o lon chercherait vainement un destin, cette raison qui contient toutes les causes, o la nature sefface, o tout dpend de lhistoire intime et spirituelle de lhomme et de ses rapports avec Dieu. Lhomme voit, devant lui un avenir possible dont il sera lauteur ; il est dlivr pour la premire fois du mlancolique sunt eadem omnia semper de Lucrce, du Destin stocien, de lternel schme gomtrique o Platon et Aristote enfermaient la ralit 2. Cest ce trait capital qui a frapp les premiers paens qui se sont occups srieusement des chrtiens. Que reproche Celse aux chrtiens dans le Discours vrai quil a compos contre eux vers la fin du IIe sicle ? cest dadmettre un Dieu qui nest pas immuable, puisquil prend des initiatives et des dcisions nouvelles au gr des circonstances, qui nest pas impassible, puisquil est touch par la piti ; cest de croire une sorte de mythologie, celle du Christ, dont les rcits nadmettent pas dinterprtation
1
Par exemple HEGEL, Philosophie de lHistoire, section III, chap. II, dition. Rclam, p. 413. 2 Cf. L. LABERTHONNIRE, Le Ralisme chrtien et lidalisme grec, 1904, chap. II et III.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
333
allgorique , cest--dire qui se donne comme une histoire relle et ne peut tre rduite un symbole dune loi physique. Cest l, pour un Platonicien comme Celse, un manque de tenue intellectuelle. Ainsi dune part un christianisme pur foncirement indpendant de la spculation philosophique grecque, et une culture intellectuelle autonome, toute grecque dorigine et sans rapport la vie spirituelle du chrtien ; dautre part un christianisme qui apporte une vision de lunivers entirement nouvelle, un univers dramatique o lhomme est autre chose que limmacule connaissance de lordre du monde. A prendre la question dune manire purement historique, en sabstenant de ces grosses oppositions entre paganisme et p.491 christianisme, en utilisant les tudes de dtail poursuivies depuis prs dun sicle sur les origines du christianisme, on sapercevra, croyons-nous, quaucune de ces solutions nest satisfaisante. Examinons-les brivement tour tour : le christianisme pur des historiens protestants nest quune abstraction, parfaitement lgitime au point de vue pratique, mais tout fait illgitime aux yeux de lhistorien ; cest en effet une seule et mme volution qui, dans les cinq premiers sicles, emporte la pense paenne du problme pratique de la conversion intrieure chez un Snque ou un pictte la thologie raffine de Plotin et de Proclus, et la pense chrtienne du christianisme spirituel et intrieur de saint Paul la thologie dogmatique dOrigne et des Cappadociens : il serait difficile de ne pas voir jouer les mmes facteurs dans cette transformation. Comment ne pas se souvenir dailleurs de cette vrit historique de mieux en mieux dmontre que ce qui spare paens et chrtiens, ce nest point une question de mthode intellectuelle et de spculation, mais seulement la soumission aux cultes lgaux et en particulier au culte de lempereur ? Quant au dveloppement autonome de la pense scientifique, le fait parat tout fait exact ; mais il faut remarquer que le christianisme na pas, lgard de lducation scientifique grecque, une situation diffrente de celle de la philosophie grecque elle-mme. Origne, par exemple, distingue avec prcision une triple sagesse : la sagesse de ce monde , ce que Snque appelait les arts libraux et Philon le cycle de lducation, cest--dire la grammaire, la rhtorique, la gomtrie, la musique, quoi on peut ajouter la posie et la mdecine, cest--dire tout ce qui ne contient aucune vue sur la divinit, ni sur la manire dtre du monde, ni sur aucune ralit leve, ni sur linstitution dune vie bonne et heureuse . Puis vient la sagesse des princes de ce monde , cest--dire la philosophie occulte des gyptiens, lastrologie chaldenne, mais surtout lopinion si varie et multiple des Grecs sur la divinit . p.492 Enfin, la sagesse du Christ qui drive de la rvlation 1. Il faut ajouter que, dans la premire espce de sagesse, la sagesse de ce monde,
1
Des Principes, daprs la traduction latine de RUFIN, livre III, chap. III.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
334
pouvaient sans doute entrer des parties plus ou moins considrables de la philosophie, savoir la logique et la dialectique, certaines gnralits de la physique et de lastronomie, enfin toute lducation formelle de lhonnte homme, telle que lavait conue un Musonius par exemple, catchisme moral tout fait gnral. Il est intressant, cet gard, dentendre lopinion dun Platonicien, contemporain de Proclus, Hermias, qui distingue la philosophie humaine de cette initiation spciale que le platonisme rservait ses adeptes. Ce nest pas, dit-il, parler exactement dappeler philosophie la mathmatique, la physique et lthique ; cest un abus de mot ; cette philosophie humaine, il oppose lenthousiasme de liniti, qui contient en lui la thologie, la philosophie entire et la folie amoureuse 1. Cette partie commune de lducation, le christianisme ne la rejette pas du tout en principe ; sans doute les chrtiens sont trs diviss sur sa valeur spirituelle ; il y a parmi eux des personnages cultivs, comme saint Augustin, comme saint Grgoire de Naziance qui sen font les trs ardents dfenseurs, tandis que dautres, tels des latins comme Tertullien ou saint Hilaire, sont partisans de la voie courte et ne sentent nullement la ncessit de cette ducation ou mme la critiquent formellement. Mais la divergence de vue ce sujet nest pas plus grande chez les chrtiens quelle ne la t chez les paens aprs Aristote ; ds qua paru la sagesse cynique ou stocienne, les sciences philosophiques, qui taient pour Platon la seule voie daccs vers la connaissance des ralits vritables, deviennent soit de simples auxiliaires ou servantes de la sagesse, incapables de comprendre par elles-mmes leurs propres principes, soit mme (chez les Cyniques ou les Cyrnaques) des parures inutiles dues lorgueil humain. Ainsi il y a, dans les premiers sicles de notre re, un rgime mental commun tous : le fond en est le sentiment dune coupure entre lducation moyenne, universellement accessible, et la vie religieuse, que lon natteint que par des mthodes fort diffrentes de lexercice normal de la raison, quil sagisse de lducation morale du Stocien, de lintuition plotinienne ou de la foi chrtienne en la rvlation.
p.493
De ce rgime, le christianisme nest nullement lauteur ; il laccepte comme un tat de fait ; nous verrons aussi au cours de cette histoire, quil na jamais ragi contre lui, et que la rvolution intellectuelle qui y a mis fin, au moment de la Renaissance occidentale, provient dune inspiration tout autre que linspiration chrtienne. Il ny a pas en tout cas, pendant les cinq premiers sicles de notre re, de philosophie chrtienne propre impliquant une table des valeurs intellectuelles foncirement originale et diffrente de celle des penseurs du paganisme. Reste voir jusqu quel point lon peut dire que le christianisme a rnov notre vision de lunivers. Il serait dangereux de confondre ici le christianisme
1
HERMIAS, Commentaire du Phdre, d. Couvreur, p. 92, 6.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
335
mme avec linterprtation quon en donne aprs beaucoup de sicles couls. Le christianisme, ses dbuts, nest pas du tout spculatif ; il est un effort dentraide la fois spirituelle et matrielle dans les communauts. Mais, dabord, cette vie spirituelle nest pas du tout particulire au christianisme : le besoin de vie intrieure, de recueillement est ressenti dans tout le monde grec bien avant le triomphe du christianisme ; la conscience du pch et de la faute sexprime en des formules populaires chez les historiens ou les potes 1 ; la pratique de lexamen de conscience, celle de consultations spirituelles qui sont de vritables confessions sont frquentes au dbut de notre re. De plus, il sen faut bien que cette pratique et cette vie spirituelles aient chang p.494 quoi que ce soit limage de lunivers qui rsultait de la science et de la philosophie grecques : monde unique et limit, gocentrisme, opposition de la terre et du ciel, tout cela persistera jusqu lpoque de la Renaissance ; au cosmos grec se juxtapose la vie spirituelle des chrtiens sans que naisse une notion nouvelle des choses ; lintrieur de la vie spirituelle sans doute, sintroduit (et encore nous verrons avec quelle restriction) cette notion de crise imprvisible, dinitiative absolue que la cosmologie grecque avait essay deffacer ; mais ce sentiment de lhistoire et de lvolution ne se ralisera en une conception densemble des choses que grce lexprience infiniment accrue de lhomme dans le temps et dans lespace, grce la refonte mthodique de cette curiosit grecque, que blmaient dj les Stociens. Nous esprons donc montrer, dans ce chapitre et les suivants, que le dveloppement de la pense philosophique na pas t fortement influenc par lavnement du christianisme, et, pour rsumer notre pense en un mot, quil ny a pas de philosophie chrtienne. Nous ne prtendons pas pourtant, dans les lignes qui suivent, faire une histoire mme rsume de la dogmatique chrtienne aux premiers sicles ; des noms importants manqueront dans ce chapitre, parce quil tudie le christianisme, non, pas en lui-mme, mais en son rapport avec la philosophie grecque.
II. SAINT PAUL ET LHELLNISME
@ La pense chrtienne a pass, la fin de lantiquit, par les mmes tapes que la pense paenne. A lenseignement moral de lpoque impriale correspondent (on la souvent remarqu propos de Snque) la prdication et les ptres de saint Paul. A la priode de formation et dclosion du noplatonisme, la fin du Ier et au IIe sicle rpondent le quatrime vangile, p.495 les apologistes et le dveloppement des systmes gnostiques. Au point de maturit du platonisme avec Plotin correspond la formation des vastes
1
POLYBE, Histoires, XVIII, 43, 13.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
336
synthses thologiques de Clment et dOrigne au didascale dAlexandrie. Proclus et Damascius ont pour contre-partie vers la mme poque saint Augustin, les pres de Cappadoce, puis tous ceux quon peut appeler les noplatoniciens chrtiens, comme Nmsius et Denys lAropagite. Mme courbe du mouvement spirituel des deux cts, mme tendance passer dune vie morale et religieuse surtout intrieure, reposant sur la confiance en Dieu, une thologie doctrinale et dogmatique, qui parle de Dieu dans labsolu plutt que des rapports de lhomme avec Dieu. Saint Paul est un hellne dducation et, soit influence directe, soit action diffuse de doctrines partout rpandues. on trouve chez lui nombre dides, de manires de penser, dexpressions familires Snque et surtout pictte. Le christianisme comme le stocisme est cosmopolite ; et il ne connat quune vertu commune tous les tres raisonnables. Point de Juif, ni de Grec, desclave ni dhomme libre, de sexe masculin ou fminin ; tous vous tes un en Jsus-Christ. Comme la diatribe stocienne, saint Paul prche la parfaite indiffrence, au point de vue du salut, de la condition sociale dans laquelle on vit 1. Le sentiment que laptre des Gentils ou mme les vanglistes ont de leur rle et des devoirs qui leur incombent est le mme que chez pictte 2 ; on sait quelle haute ide celui-ci se faisait de sa mission morale sy donnant de toute son me et se considrant comme un soldat, ainsi que saint Paul, bon soldat du Christ . La source de sa force est chez pictte, comme chez saint Paul, la confiance en Dieu ; lun et lautre savent quils peuvent tout grce au Dieu qui leur donne sa puissance. p.496 Cette assurance en la raison qui juge et comprend toute chose vient de ce quelle nous a t donne par Dieu ; cest ainsi que chez saint Paul, lhomme spirituel juge tout et nest jug par personne . Comme le Cynique dont pictte trace le portrait idal, laptre est un envoy de Dieu sur la terre 3. De cette foi en Dieu provient chez lun comme chez lautre le calme en toutes circonstances, puisque tous les vnements rsultent de la bont de Dieu. Comme le prdicateur stocien, lannonciateur de lvangile ne trouvait souvent que raillerie chez les gens du monde. On connat le vieillard aux bagues dor qui, chez pictte, conseille le jeune homme : il faut philosopher, mais il faut aussi avoir de la cervelle ; et ces choses sont folles 4. De mme, saint Paul sait bien que le christianisme est folie aux yeux de lhomme psychique, qui ne peut connatre ce que juge lhomme
1 2
ptre aux Galates, 3, 23 ; aux Corinthiens, I, 7, 17-40. Comparer PICTTE, Dissertations, II, 2, 12 ; III, 24, 31, et SAINT PAUL, Aux Corinthiens, I, 9, 7. 3 COMPARER PICTTE, I, 6, 37 et I, 1, 4 et 7 avec SAINT PAUL, Aux Philippiens ; 4, 13 ; Aux Corinthiens I, 2, 45. 4 PICTTE, I, 22, 18. SAINT PAUL, Aux Corinthiens, I, 1, 27 ; 3, 18.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
337
spirituel. Cest prcisment cette ignorance de leurs propres fautes, cette inconscience dans le pch qui rendent indispensable la tche du prdicateur ; douceur envers ces ignorants, pardon fraternel de linjustice, insouciance du jugement dautrui, telle est lattitude que le philosophe et laptre ont en commun devant le sicle. Tous ces traits communs viennent des conditions analogues dans lesquelles se fait la prdication ; ils rpondent un mme besoin, passionnment senti, de conversion intrieure. Il ne sagit ni dinfluer par la parole la manire des sophistes, ni de faire connatre un dogme ; la thologie paulinienne est aussi peu prcise que le dogme stocien chez pictte ; ce qui importe saint Paul, ce nest pas de dcouvrir la nature de Dieu, mais de sauver lhomme, et cest pourquoi le Christ qui exprime tous les rapports de Dieu avec lhomme est au centre de sa pense. De la mme manire, peu importe pictte la question p.497 de la substance de Dieu ; ce qui est au premier plan, cest la filiation divine de lhomme, exprime avec une nuance de tendresse inconnue de lancien stocisme, do rsulte la fraternit de tous les hommes ; Marc-Aurle, comme pictte, les dsigne par le prochain. Cette filiation, il la symbolise dans le personnage dHercule fils de Zeus, le sauveur qui abandonne les siens et parcourt tous les pays pour rpandre la justice et la vertu 1. Reste, bien entendu, le trait fondamental du christianisme, absent chez pictte, qui na pas connu, comme le dit Pascal, la misre de lhomme et qui fait de lhomme son propre sauveur ; chez saint Paul, le pcheur qui connat le bien ne peut le faire cause de la puissance du pch, contre-balance seulement par la grce du Christ. Il ne sagit plus comme dans le stocisme, comme dans le philonisme mme, de ces puissances mi-abstraites, qui assistent lhomme, verbe divin ou dmon intrieur, mais dun personnage historique dont la mort a sauv lhumanit par une action dune efficacit tout fait mystrieuse et tout fait diffrente de celle du sage paen, qui simplement enseigne ou se donne comme modle.
III. LES APOLOGISTES DU IIe SICLE.
@ Les apologistes de lpoque des Antonins, Justin, dont il reste deux Apologies, lune adresse Antonin le Pieux (138-161) et lautre Marc-Aurle (161-180), Tatien, qui peu aprs lui crit un Discours aux Gentils, Athnagore qui adresse son apologie la fois Marc-Aurle et son fils Commode, ont, sauf Tatien, une vidente proccupation ; cest, pour faire accepter la nouvelle religion, dy signaler ce quelle a de commun avec la pense grecque, ce qui peut en accentuer le caractre universel et humain, ce
1
Dissertations, I, 22, 14 ; II, 12, 7 ; Manuel, 33.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
338
qui peut en un mot la rendre agrable aux p.498 paens. Do lattitude la fois sympathique et rserve dun Justin envers la philosophie grecque, en particulier envers Platon quil dclare suprieur aux Stociens dans la connaissance de Dieu, tandis que les Stociens lui sont suprieurs en morale. En identifiant Jsus au Logos ou au Verbe, en qui Dieu a cr lunivers, lauteur du clbre prologue du Quatrime vangile avait introduit la thologie dans le christianisme : la thologie, cest--dire la proccupation de la ralit divine ou suprasensible prise en elle-mme, et non plus dans son rapport la vie religieuse de lhomme. La prtention de Justin est darriver demble, grce au Christ, au Verbe de Dieu et lintelligible que les philosophes nont fait que pressentir obscurment 1. Mais pour que ces pressentiments soient possibles, il est conduit admettre que Dieu qui sest rvl Mose et dans lvangile, sest aussi rvl partiellement aux philosophes et surtout Socrate et Platon ; il y a un Verbe unique ou Logos de Dieu, dont la rvlation plus ou moins complte produit chez tous les hommes ces notions innes du bien et du mal, cette notion universelle de Dieu, dont la plupart des hommes, tout en les possdant, ne savent pas dailleurs faire usage : raison universelle, rvlation des prophtes, verbe incarn ne sont que les degrs diffrents dune mme rvlation ; la raison nest quune rvlation partielle et disperse ; chaque philosophe, voyant dune parcelle du Verbe divin ce qui lui est apparent, a des formules trs belles 2. Avec cette thse de la rvlation partielle se concilie fort mal une autre thse, que Justin a pu trouver chez les Juifs de lentourage de Philon, et daprs laquelle Platon et les Stociens auraient t les lves de Mose. Ce quil y a de commun ces thses, cest leffort pour retrouver une sorte dunit de lesprit humain, refltant lunit du Verbe. Il faut ajouter dailleurs quil procdait avec les Juifs p.499 comme avec les Grecs, cherchant identifier le Christ au Logos des livres juifs, au Fils, la Sagesse, la Gloire du Seigneur 3. Pareille mthode ntait possible quavec une connaissance fort superficielle de Platon ; sil en connat, comme les moralistes stociens de lEmpire, lApologie, le Criton, le Phdre et le Phdon, il en ignore les dialogues dialectiques et met au premier plan le Time dont il mlange sans cesse le rcit, comme le fit dj Philon dAlexandrie, avec le rcit de la cration dans la Gense ; ce quil apprend du Time, cest que Dieu, par bont, partant dune matire informe, a tout cr dabord pour les hommes , confondant ainsi la philanthropie du Dieu des Juifs et la bont du dmiurge platonicien 4. Le thme du Platon chrtien apparat ainsi dans lhistoire ; il est fort prcis par lExhortation aux Grecs, ouvrage qui, attribu dabord Justin, lui
1 2
HARNACK, Dogmengeschichte, vol. I, p. 467 et 470. Deuxime Apologie, chap. XIII. 3 Dialogue contre Tryphon, 61. 4 DE FAYE, De lInfluence du Time de Platon sur les ides de Justin martyr.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
339
est en ralit postrieur de prs dun sicle : lauteur, beaucoup mieux inform que Justin, ne cache pas les contradictions de Platon soit avec Aristote, soit avec lui-mme sur les objets les plus importants : lternit du monde, limmortalit des mes, le monothisme, etc... Pourtant Platon a eu, selon lui, une opinion exacte sur le Dieu qui est rellement ; ltre chez lui est celui qui est de Mose ; il faut seulement savoir le lire : si lon trouve chez lui des restrictions au monothisme, sil admet une matire non engendre et des dieux engendrs, cest quil craignait, en donnant sa pense telle quelle, de se faire accuser comme Socrate : de l son expos entortill sur les dieux 1. Le Platon chrtien, que lon trouve en lisant le Time la lumire de la Gense, se retrouve chez Tatien, llve de Justin ; mais contrairement son martre, il nadmet aucune connaissance de Dieu par la raison, et il est conduit expliquer la ressemblance de Platon et des Stociens avec Mose par un p.500 plagiat inavou des Grecs. Dune manire gnrale, le rationalisme de Justin parat subir un recul chez Tatien : cest ainsi que lesprit, le pneuma qui reoit la rvlation nexiste que chez les purs et quil nest pas une partie de lme, simple matire pntrante et subtile qui ne se distingue de lme des btes que par la parole articule, mais quil lui est superpos 2. Tout au contraire, le rationalisme de Justin se retrouve accru chez Athnagore ; le monothisme quil trouve chez les potes, chez les Pythagoriciens, chez Platon indique selon lui une inspiration divine commune Mose et aux philosophes ; Platon parvient mme concevoir la trinit. Il reste cependant que Platon, quil connat dailleurs beaucoup mieux que Justin, est un Platon chrtien, que le Bien ou ltre immuable par lequel il dpeint Dieu, na que le nom en commun avec la premire hypostase plotinienne et ressemble beaucoup plus au Dieu des Stociens ; si lon songe avec quelle vigueur le noplatonisme paen exclut la religiosit stocienne, on apprciera mieux la porte de ce platonisme chrtien, o se retrouve toute la thologie des Stociens, avec les arguments (mis en forme syllogistique) fonds sur la providence et la beaut du monde.
IV. LE GNOSTICISME ET LE MANICHISME
@ A lpoque mme des apologistes se dveloppaient dans les milieux chrtiens les systmes dits gnostiques, qui nous sont surtout connus par les rfutations quen ont faites les Pres de lglise de la gnration suivante, en particulier lauteur inconnu des Philosophumena, Irne dans son Contre les Hrtiques, Tertullien dans le Contre Marcion, sans oublier la Pistis Sophia,
1 2
Exhortation aux Grecs, chap. XX-XXII. PUECH, Les Apologistes grecs.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
340
crit gnostique en langue copte datant du IIIe sicle, mais traduisant des crits grecs plus anciens. Daprs une thse des Philosophumena, gnralement accepte jusqu nos jours, les systmes gnostiques rsulteraient dune sorte dinvasion de la philosophie grecque dans la pense chrtienne, et les sectes grecques seraient finalement responsables de ces hrsies chrtiennes qui auraient donc, comme aboutissant de la pense grecque, un intrt direct pour lhistoire de la philosophie. Les travaux contemporains qui ont su dgager la pense gnostique vritable des exposs plus ou moins fantaisistes o la cachent les Pres de lglise laissent au contraire limpression que la philosophie grecque est en elle pour bien peu de chose. Ces systmes nen gardent pas moins un intrt du premier ordre, parce quils donnent, nous allons le voir, comme la contre-preuve dune vrit qui se dgage, croyons-nous, de tout notre expos de la philosophie grecque : lhellnisme est caractris par lternit de lordre quil admet dans les choses ; un principe ternel do dcoulent ternellement les mmes consquences. Or le thme commun des systmes gnostiques, cest la rdemption ou dlivrance du mal qui implique avec elle la destruction, et la destruction dfinitive de lordre dans lequel nous vivons. Pour lHellne le mal disparat par la contemplation de lunivers dont il fait partie ; pour le gnostique il disparat soit par la suppression de cet univers, ou sinon par llvation de lme au-dessus et en dehors de lui.
p.501
Basilide, Valentin et Marcion, tels sont les trois gnostiques les plus connus qui vivaient vers le milieu du second sicle : Mais cest chez Valentin seulement quapparat, semble-t-il, une conception densemble de lunivers des gnostiques. Basilide, lui, est avant tout un moraliste, obsd par le problme du mal et celui de la justification de la providence 1. Tout ce quon voudra, disait-il, plutt que de mettre le mal sur le compte de la Providence ; et, pour expliquer les souffrances des p.502 martyrs, il est prt accepter quils ont pch dans une vie antrieure. Il considre dailleurs le pch comme provenant de la passion, et la passion comme une sorte desprit mauvais qui sajoute lme du dehors et la souille. Ces vues conduisaient une sorte de dualisme moral, dont on trouve lanalogue chez Platon. Mais un homme dun esprit plus mtaphysique que Basilide, Valentin, devait en dduire les consquences les plus contraires au platonisme. Valentin cherche en effet dans lorigine de lhomme lexplication du dualisme qui se rencontre en lui. Ce dualisme entre lesprit et la chair correspond un dualisme plus profond entre le crateur de ce monde, le dmiurge, escort de ses anges, dont il est parl dans la Gense, et le dieu suprme ou dieu bon. Suivant le rcit de la Gense, et, du moins en partie, linterprtation quen donne Philon dAlexandrie, il montre lhomme fabriqu par ces tres mauvais qui sont le dmiurge et les anges, et en qui sintroduisent les passions, qui sont
1
E. DE FAYE, Gnostiques et gnosticisme, p. 24-26.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
341
des esprits immondes. A cette crature, le Dieu suprme, le Dieu bon a ajout une semence de la substance den haut, de lesprit. Toute lhistoire du monde est celle de la lutte contre les anges qui essayent de faire disparatre cette semence, et elle aboutit sa dlivrance. La rdemption ne consiste pas comme chez saint Paul dans lefficace de la mort du Christ, mais elle drive, comme on le voit surtout chez Hraclon, un disciple de Valentin, de la gnose ou rvlation apporte par le Christ. Aprs Valentin, le gnostique le plus connu est Marcion qui parat avoir t surtout lexgte du groupe ; cest en effet par ltude de textes quil cherche montrer que le Dieu de lAncien Testament, rvl par Mose, dieu cruel, vindicatif et belliqueux nest pas le mme que le Dieu rvl par le Christ, Dieu de bont, crateur du monde invisible, tandis que le dieu de Mose a cr le monde visible. Ils sopposent lun et lautre comme la justice et la bont. Aucun effort dailleurs pour p.503 justifier cette thse autrement que par la double rvlation des deux testaments ; limportant est pour lui de dmontrer que la rdempteur, le Christ, qui nous dlivrera du rgime du dmiurge nest en aucune manire le Messie juif prdit par les prophtes ; et il na pas de peine, en prenant les textes au sens littral, montrer quaucun trait du Messie ne se retrouve chez Jsus. Dautre part il ne peut admettre que Christ, lenvoy du dieu suprme, puisse avoir vraiment une nature corporelle, cest--dire participer dune manire quelconque au monde du dmiurge ; il pense donc quil sest rvl brusquement ltat dhomme fait et que son corps nest quapparent. Marcion dduisait de ces vues lasctisme le plus strict, proscrivant le mariage et faisant de la continence la condition du baptme ; ainsi on chappe, au moins de volont, au monde du dmiurge. La pense gnostique, aprs Valentin et Marcion, se dissipe en cette foule de systmes connus par les Philosophumena qui, chacun, avec les variations parfois les plus bizarres, traitent toujours le mme thme, la dlivrance par le Christ de lme dorigine divine enferme dans le monde sensible cr par un mchant dmiurge. Il y a bien chez tous, si lon veut, une sorte de schme de la vie spirituelle, quon retrouve dans le noplatonisme : dans les deux cas, il sagit dune me dorigine divine qui descend dans un corps terrestre o elle contracte une souillure, et do elle doit remonter son origine ; mais ce nest l que banalit ; et il suffit de lire le trait que Plotin a adress aux gnostiques quil a connus Rome vers 260 pour comprendre tout le dgot quun Hellne devait avoir pour des gens qui ne manquaient pas, dailleurs, dutiliser le Phdon et le Phdre. Le point prcis du diffrend est, semble-t-il, le suivant ; lorsque le gnostique ne veut pas se contenter de la pratique religieuse, de lasctisme, lorsquil veut se donner les raisons de son exprience de la rdemption, lorsquil veut savoir lorigine des forces spirituelles p.504 salutaires ou contraires, il est amen superposer la religion une sorte de drame mtaphysique, compltement arbitraire. Citons, comme un exemple parmi
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
342
bien dautres, la manire dont le gnostique Justin, du IIIe sicle, raconte le drame qui aboutit la rdemption : au sommet trois principes, le Dieu bon, puis Elohim ou le pre, du sexe masculin, et Eden, du sexe fminin ; Elohim sunissant Eden produit deux sries de douze anges dont lensemble forme le Paradis; lHomme qui y est cr reoit dElohim le pneuma ou souffle spirituel, et dEden lme ; Elohim qui, jusque l, ignorait le Dieu bon, passe (comme lme du Phdre) aux sommets de la cration et abandonne Eden pour le contempler ; Eden, pour se venger, introduit le pch dans lhomme ; Elohim, voulant sauver lhomme, envoie Baruch, un de ses anges, dabord Mose, puis Hercule, enfin Jsus, le rdempteur final qui, crucifi par un des anges dEden, laisse son corps sur la croix 1. Il suffit de lire cette lucubration, qui fait dpendre le sort de lhomme dune scne de mnage mtaphysique pour saisir quel point la gnration des ons, de ces ralits ternelles provenues de couples divins, telle que la dcrit le gnosticisme, est loin de la gnration plotinienne des hypostases, combien aussi cette rdemption o lme est lenjeu de forces qui se la disputent (reprsentation populaire qui persiste trs tard et se retrouve en bien des lgendes) est loin du salut plotinien (sil faut encore appeler salut ce qui nest que la connaissance rflchie dun ordre rationnel). Ainsi le gnosticisme qui aboutit dune part des contes bleus o il sagit dintroduire toutes les formes religieuses qui hantent le cerveau dun oriental, dautre part des pratiques superstitieuses dont les monuments se dcouvrent dans toute ltendue de lempire romain, na quune relation indirecte avec lhistoire de la philosophie. La conscience de la ralit du mal, comme naissant dune p.505 puissance volontaire radicalement mauvaise, est la substance du gnosticisme ; elle est aussi celle du mouvement dides qui, n au IIIe sicle de linitiative du perse Mni (205-274) et connu sous le nom de manichisme, sest propag dans tout lempire et quon retrouve sous diverses formes dans plusieurs hrsies du Moyen ge. Mni introduit le dualisme perse de la puissance bonne et de la puissance mauvaise, dOrmuzd et dAhriman, dualisme assez diffrent de celui des gnostiques qui restent malgr tout monothistes et o la puissance cratrice reste infrieure et subordonne la ralit suprme. Chez Mni, il sagit de deux puissances cratrices qui luttent ensemble, le Bon opposant une cration nouvelle chaque cration du mauvais, jusqu la destruction complte de son uvre. De l le drame du monde 2 : le Dieu bon qui avait dabord cr cinq puissances ou demeures, Nos, Ennoia, Phronesis, Enthymsis, Logismos (ces cinq demeures sont, on le voit, cinq aspects de la pense divine) laisse ces puissances sans rapport avec le monde, parce quelles sont faites pour la tranquillit et pour la paix ; il produit de lui1 2
E. DE FAYE, Gnostiques et gnosticisme, p. 187 suiv. Daprs le Livre des Scholies de THODORE BAR KHONI, vque de la fin du VIe sicle, analys par CUMOMA, Recherches sur le Manichisme, I, 1908.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
343
mme dautres puissances au fur et mesure des besoins, pour lutter contre le mal, la Mre des Vivants qui voque son tour le Premier Homme, lAmi des Lumires et lEsprit vivant, le Messager qui voque douze Vertus, enfin Jsus, qui sont toutes destines entrer en rapport avec la puissance des tnbres. Cette dualit entre deux sortes de puissances, lune correspondant au Verbe ou lIntelligence des philosophes grecs, lautre un drame religieux o tout parle limagination, est des plus instructives ; le Logos ou Intelligence qui soutient lordre ternel des choses ne suffit plus expliquer un ordre que lon veut temporaire parce quon le considre comme rsultant dune crise anormale. Chez les manichens, la cration du monde sensible nest pas, comme chez les gnostiques, entirement cration dun dmiurge mauvais ; cest ainsi que lHomme p.506 primitif cre son tour cinq lments quil revt comme une armure, lair limpide, le vent rafrachissant, etc., qui sopposent terme terme aux cinq lments du monde des tnbres.
V. CLMENT DALEXANDRIE ET ORIGNE
@ Le didascale que Pantne, Stocien converti au christianisme, cra Alexandrie et qui eut successivement sa tte Clment dAlexandrie (160-215) et Origne (185-254) est le premier essai pouss fond pour donner un enseignement chrtien qui, par son ampleur, pt rivaliser avec celui des coles paennes ; milieu bien loign de celui des gnostiques, o nous trouvons pour la premire fois des hommes trs informs de la philosophie grecque et prenant vis--vis delle une position assez nette. Position complexe pourtant : dans son Protreptique aux Grecs, par exemple, Clment est amen comparer lhellnisme et le christianisme ; il trouve dans lhellnisme ou bien des erreurs compltes ou bien des vrits partielles timidement exprimes que seul le christianisme peut saisir dans leur ensemble. Ainsi la thologie des Grecs, considre dans ses cultes et dans ses mystres, est errone ou scandaleuse (chap. V et VI) ; chez les philosophes, il distingue ceux qui ont pris les lments comme dieux, et ceux dun degr plus haut qui ont attribu la divinit aux astres, au monde ou son me : erreur complte, qui consiste confondre Dieu avec ses uvres ; mais en revanche, il trouve chez le Platon du Time qui parle du pre et du crateur de toutes choses une trace de vrit ; de mme Antisthne et Xnophon ont atteint le monothisme, et Clanthe le Stocien, ainsi que les Pythagoriciens, ont connu les vritables attributs de Dieu. Le christianisme ne ferait alors que consommer lhellnisme, peu prs comme le nouveau testament convainc derreur lancien, tout en tant son accomplissement. en est de mme de la doctrine morale. La sagesse grecque donne des conseils en des cas particuliers propos du mariage, de la vie publique ; la pit chrtienne est un engagement universel et pour la vie entire, tendant
p.507 Il
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
344
en toute occasion, en toute circonstance, la fin essentielle . Elle ralise donc en somme ce que le stocisme et les autres coles prtendaient faire ; car en affectant de limiter la philosophie lart des conseils pratiques de dtail, Clment veut la remplacer comme science des principes (chap. XI). La vrit, cest que le christianisme tout entier est coul par lui dans le moule de lenseignement philosophique grec et particulirement de celui qui, jusquau IIe sicle, fut le seul compltement organis de lenseignement stocien. Ds que le Verbe lui-mme, dit-il, est venu des cieux jusqu nous, il nest plus ncessaire daller lenseignement des hommes 1. Mais lenseignement divin quon y substitue garde mme forme que cet enseignement humain. Lorsque Clment nous dit que la foi (), tant calomnie par les Grecs, est la voie de la sagesse 2, il scarte des Grecs moins quon ne pourrait croire ; il dfinit, la foi, comme les Stociens, un assentiment volontaire, un assentiment un terme fixe et solide, assentiment qui est le prlude de la vie chrtienne, comme il est, chez les Stociens, le prlude de la sagesse. Lobjet vritable de la foi, dit-il encore, cest non pas la philosophie des sectes, mais la gnose, savoir la dmonstration scientifique des choses transmises dans la vraie philosophie, cest--dire dans le christianisme 3. Et, si lon en vient quelques dtails de son enseignement, lon saperoit que le Pdagogue tout entier est construit comme un trait de morale stocienne ; le premier livre contient le critre de laction droite, savoir la droite raison, identique au Verbe ; et il faut y noter le chapitre VIII, o Clment, songeant p.508 videmment aux gnostiques, dmontre par une argumentation de forme toute stocienne que la justice est identique la bont, passant par un raisonnement compos de lamour de Dieu pour les hommes sa justice. Quant aux deuxime et troisime livres, cest une diatribe la Musonius sattachant prescrire aux chrtiens une vie simple et modeste ; tout le stocisme mlang de cynisme que nous connaissons passe l dans lenseignement chrtien ; au paradoxe : seul le sage est riche , il substitue seulement : seul, le chrtien est riche . Sagit-il mme de la mthode dans la connaissance de Dieu, Clment nhsite pas emprunter tout ce quil en dit lenseignemnent pythagoricien ou platonicien dalors, montrant par quelle suite dabstractions on arrive la connaissance de lunit pure, ou encore employant au sujet de Dieu les formules mmes que lon trouve dans le manuel platonicien dAlbinus : Dieu nest ni genre, ni diffrence, ni espce, ni individu, ni nombre, ni accident ni sujet ; il nest pas un tout. Enfin sa notion du Fils ou Logos nest pas fort loin de celle du monde intelligible ; au Pre, qui est indmontrable, soppose le Fils qui est sagesse, science, vrit comportant un dveloppement.
1 2
Protreptique ; chap. IX. Stromates, II, 2. 3 Stromates, liv. II, chap. XI.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
345
Car il est toutes choses ; il est le cercle de toutes les puissances tournant autour dun centre unique 1 . Lattitude dOrigne par rapport lhellnisme se marque nettement dans sa longue rponse au pamphlet de Celse contre les chrtiens. On sait lobjection de Celse, si grave pour un Hellne partisan dun ordre ternel des choses contre lvnement de lincarnation : Si lon change la moindre des chose dici-bas, tout sera boulevers et disparatra , ou encore : Cest donc aprs une ternit que Dieu a song juger les hommes et avant il ne sen souciait pas 2. Or cest prcisment ce caractre mythologique ou, si lon veut, historique du p.509 christianisme quOrigne sefforce dattnuer dans sa rponse : Le seul changement produit par la prsence de Dieu, rpond-il la premire objection, cest un changement dans lme du croyant 3 , tendant ainsi rduire lincarnation un vnement intrieur, et prsentant dailleurs plus loin la descente de Dieu comme une manire de parler (tropologie). A la seconde objection, il rpond que Dieu na jamais cess de soccuper du rachat des hommes ; chaque gnration, la sagesse de Dieu descend en des mes saintes et des prophtes . Et cest dune manire analogue quil rpond ailleurs lobjection que les Hellnes tiraient, contre la cration du monde, de limpossibilit dadmettre un dieu inactif : sans croire au retour ternel des Stociens, il estime que Dieu, avant ce monde, a cr dautres mondes, admettant ainsi la conception cyclique du temps qui est la marque mme de lhellnisme 4. Mme tendance lhellnisme lorsquil considre les modifications du Verbe dans la cration ou lincarnation, non comme des changements du Verbe pris en lui-mme, mais comme des apparences dues la diffrence de capacit des tres qui peuvent le recevoir 5. Nanmoins on voit le mme Origne se mfier de lhellnisme et surtout du platonisme. Tous ceux qui reconnaissent une providence, dit-il, confessent un Dieu inengendr qui a tout cr ; que ce Dieu ait un fils, nous ne sommes pas seuls le proclamer, bien que cela ne paraisse pas croyable aux philosophes grecs ou barbares ; et pourtant quelques-uns dentre eux ont cette opinion, quand ils disent que tout a t cr par le Verbe et la Raison de Dieu. Mais nous, cest selon la foi dune doctrine divinement inspire que nous y croyons... Quant au Saint-Esprit, nul nen a eu le moindre soupon que ceux qui connaissent la Loi et les prophtes, ou bien croient au Christ 6. On voit ici les limites exactes de lhellnisme auquel la foi p.510 chrtienne vient se superposer sans le dtruire. Mais ct de vrits partielles, lhellnisme contient aussi des erreurs soit sur la nature du monde, soit sur celle de lme.
1 2
Stromates, liv. V, chap. XI et XII ; liv. IV, chap. XXV. Cit par ORIGNE, Contre Celse, liv. IV, chap. III ; p. 278, 8 et 279, 8, dit. Ii ; Ktschau. 3 P. 182, 8. 4 Des Principes, liv. II, 3, 4. 5 Contre Celse, liv. IV, chap. XVIII. 6 Des Principes, liv. I, 3, 1.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
346
Le monde sensible nest plus du tout, chez Origne, un ordre imitant un modle intelligible : dabord le monde des ides nexiste que dans la seule fantaisie de lesprit, et lon ne voit ni comment le Sauveur pourrait en provenir, ni les saints y sjourner 1. De plus, Dieu na cr dabord que des tres raisonnables gaux ; mais ces cratures sont doues de libre arbitre et peuvent dchoir ; de l vient la diversit des mes ; cette diversit correspond celle des corps qui nont pas une existence absolue, mais naissent par intervalle en raison des mouvements varis des cratures raisonnables, qui en ont besoin et qui en sont revtus 2. Enfin, Origne ne croit pas quil puisse exister des mes cres compltement prives de corps ; Dieu seul est incorporel ; il faut dire seulement que le corps se modifie en dignit et en perfection, en correspondance constante avec la dignit et la perfection de lme.
VI. LE CHRISTIANISME EN OCCIDENT AU IVe SICLE
@ Des chrtiens moins attachs que Clment et Origne la civilisation hellne appuyaient encore sur limpossibilit daccorder le Christ et la philosophie grecque ; ils sont inconciliables surtout parce quils narrtent pas la divinit au mme point de la hirarchie des tres ; pour Platon et les Stociens, la ralit divine stend jusquaux mes, aux astres et au monde qui sont des tres divins ; les chrtiens la restreignent la seule Trinit. Or, dans un dveloppement contre le caractre divin des mes, Arnobe (converti en 297) sen prend Platon et son hypothse de la rminiscence qui implique que les mes p.511 sont des tres divins dchus, au-dessous des dieux et des dmons. Comment est-ce possible, demande-t-il, puisquil y a des races entires qui sont ignorantes, puisque, dans les sciences, les hommes ont des opinions multiples et opposes, puisque, enfin, le fameux interrogatoire du Mnon ne serait vraiment probant que sil sadressait un tre humain, lev au fond dune caverne close a labri de toute exprience et qui naurait pas, comme lesclave du Mnon, lusage quotidien des nombres ? Si dailleurs elle oublie en entrant dans le corps, cest quelle est susceptible de ptir, par consquent corruptible et prissable 3. Argumentation dont le mdiocre esprit dArnobe na peut-tre pas saisi toute la porte, mais dont il rsulte que le seul empirisme est daccord avec lorthodoxie. Largument que Lactance (mort en 325) invoque contre la divinit des astres est encore plus instructif. Ce que les Stociens font valoir en faveur de la divinit des tres clestes, prouve le contraire ; car sils pensent quils sont des dieux parce quils ont un cours rgulier et rationnel, ils se trompent bien ; et prcisment parce quils ne
1 2
Des Principes, II, 3, 5. Des Principes, II, 9, 5 ; IV, 4, 8. 3 Contre les Gentils, liv. II, chap. XIX.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
347
peuvent sortir des orbites prescrites, il apparat quils ne sont pas des dieux ; sils taient des dieux, on les verrait se transporter et l comme des tres anims sur la terre qui vont o ils veulent parce que leurs volonts sont libres 1. Esprit certainement nouveau, o lordre rgulier seul ne suffit pas prouver la divinit, selon qui, inversement, comme on le voit au livre IV, Dieu se manifeste par des dcisions imprvues en inspirant des prophtes et en envoyant son fils sur la terre. Ce qui est atteint par ces remarques, provenant dhommes moins amis des philosophes que les chrtiens de culture grecque, cest lide dune hirarchie dtres divins naissant les uns des autres et comprenant tout ce quil y a de ralit vritable ; le concile de Nice (325), en affirmant lgalit absolue des personnes et la Trinit dans cette fameuse formule : le Fils est p.512 consubstantiel au Pre, mettait fin toute tentative de trouver une pareille hirarchie lintrieur de la ralit divine et excluait delle toutes les crations spirituelles 2 ; nous indiquerons bientt dans quelles conditions a pu se reformer pourtant un noplatonisme chrtien. Saint Augustin (354-430) est un de ceux qui ont le plus contribu rpandre lestime du nom de Platon parmi les chrtiens ; la lecture des uvres de Plotin dans la traduction latine de Marius Victor a concid peu prs avec sa conversion dfinitive au christianisme (387), et la parent de la spiritualit chrtienne avec celle des Platoniciens la toujours frapp ; seuls, pense-t-il, ils sont des thologiens ; tandis que les autres philosophes ont us leur intelligence rechercher les causes des choses, ils ont, eux, connu Dieu, et ont trouv en lui la cause de lunivers, la lumire de la vrit, la source de la flicit 3. Ce qui leur manque ce nest donc pas lide du but quil faut atteindre, mais celle de la voie par laquelle on y arrive, le Christ. On connat les paroles des Confessions propos de sa lecture des noplatoniciens : Jy ai lu, non pas en ces termes, la vrit, que dans le principe tait le Verbe, et que le Verbe tait auprs de Dieu et que le Verbe tait Dieu, que le Verbe nest issu ni de la chair, ni du sang, ni de la volont dun homme, ni de la volont de la chair, mais de Dieu ; mais je ny ai pas lu que le Verbe sest fait chair et a habit parmi nous..., quil sest luimme abaiss en prenant la forme dun esclave, et quil sest humili en se rendant obissant jusqu la mort et la mort sur la croix 4. Cette opposition du mdiateur platonicien et du Christ revient souvent dans la pense de saint Augustin. Le Christ est mdiateur non pas parce quil est le Verbe ; le Verbe, immortel et suprmement heureux, est bien loin des malheureux mortels ; p.513 il est mdiateur parce quil est homme ; il nest pas, comme chez les philosophes, un principe dexplication physique ; il est celui
1 2
Institution divine, II, chap. V. HARNACK, Dogmengeschichte, vol. II, p 230. 3 La Cit de Dieu. VIII, 10. 4 Confessions, VII, 9.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
348
qui dlivre lhomme en se faisant homme lui-mme ; cette incarnation est un vnement dont le caractre passager fait contraste avec lordre ternel qui fixe ternellement la place de lintermdiaire entre Dieu et lhomme. Et cest pourquoi le mdiateur divin ne peut tre, comme la cru Apule, un dmon ou un ange, puisquil est de leur nature dtre heureux et immortels et surtout puisque, chez lui, lintermdiaire est destin sparer Dieu du monde plus qu ly unir, isoler Dieu de la souillure des choses mortelles plutt qu en sauver lhomme 1. Ces citations suffisent peut-tre montrer combien, malgr sa sympathie pour eux, saint Augustin est loin des Platoniciens. On le voit mieux encore, lorsquil arrive des thses fondamentales dans lhellnisme, lternit des mes et lternit du monde. A propos de la premire, il dit : Pourquoi ne pas croire plutt la divinit en des matires qui chappent aux recherches de lesprit humain ? Contre lternit des rvolutions priodiques de lunivers, il na dautres raisons que des raisons religieuses : Comment est-ce une vraie batitude, celle en lternit de laquelle on ne peut croire, sil y a toujours retour des mmes misres ? Et dautre part, le Christ nest mort quune fois 2. On sent dans ces jugements une sorte dardeur affective qui est, en effet, la marque du saint : comme il a subordonn le prtendu ordre rationnel des choses aux besoins de la vie religieuse, ainsi il a justifi contre les Stociens, toutes les passions de lme humaine ; dsir, crainte, tristesse peuvent venir de lamour du bien et de la charit, et ne sont pas en eux-mmes des vices. Cest la chute du rationalisme moral en mme temps que celle du rationalisme philosophique. Aussi ne peut-on parler quavec beaucoup de prcautions et de p.514 rserves du platonisme de saint Augustin. Aprs ne pas avoir marchand, dans ses premiers crits, les loges aux Platoniciens, au point de dire quils sont les seuls philosophes et que philosophie et religion ont un mme objet, le monde intelligible, qui peut tre dcouvert par deux moyens, soit par la raison soit par la foi 3, il revient sur cet loge dans ses Rtractations : Lloge que jai fait de Platon et des Platoniciens me dplat et non sans raison, surtout parce que la doctrine chrtienne a tre dfendue contre de grandes erreurs de leur part 4. La spiritualit augustinienne est trs loin de celle de Plotin ; que lon compare les fameux passages du trait Sur la Trinit rappels Descartes par ses contradicteurs, o il est parl de la science interne par laquelle nous savons que nous sommes et que nous vivons, aux passages de Plotin sur les hypostases qui se connaissent elles-mmes 5 ; on verra combien cette con1 2
Cit de Dieu, IX, 15. Cit de Dieu, X, 31, et XIII, 13. 3 Contre les Acadmiciens, III, 20, 43 [43.] ; crit en 387. 4 I, 14 [309] ; crit en 426. 5 De la Trinit, X, 13 [13.], et XV, 21 [24. sic] et Ennades, V, 3 dbut.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
349
naissance de soi a un sens diffrent chez les deux auteurs ; chez saint Augustin, elle est une connaissance qui chappe toutes les raisons de douter apportes par les Acadmiciens ; elle est la connaissance dun fait, dune existence, non dune essence. Chez Plotin elle est bien diffrente ; elle est la connaissance de lessence intelligible des choses, identique lessence de lintelligence ; se connatre, cest connatre lunivers ; il sagit non pas de se sentir vivre et exister, mais de connatre des ralits. Comme la connaissance de soi, la manire dont saint Augustin comprend la connaissance intellectuelle le distingue beaucoup de Plotin : le trait qui frappe saint Augustin, ce nest point quelque proprit intrinsque des choses intelligibles, cest lindpendance des vrits que nous concevons par rapport aux esprits individuels ; tous ceux qui raisonnent, chacun avec leur raison et leur esprit, voient donc en commun la mme chose, par exemple la raison et la vrit du 1 p.515 nombre . Tel est le caractre purement extrieur qui dmontre pour lui lexistence dune ralit intelligible ; encore, ici, il sagit de la disposition du sujet lgard des choses, non des choses mmes. Cest encore une forme du rationalisme hellnique que saint Augustin combat chez lhrtique Plage qui affirmait, avec les Stociens, que nos fautes comme nos mrites dpendent entirement de nous. Si le pch dAdam, disait-il, nuit mme ceux qui ne pchent pas, la justice du Christ devrait servir mme ceux qui ne croient pas. Il ajoutait : On ne peut accorder daucune manire que Dieu, qui nous remet nos propres pchs, nous impute ceux dautrui 2. Lerreur importante pour saint Augustin est que cette thse rend inutile la prire et, avec elle, toute vie religieuse ; elle nous carte de Dieu en nous faisant chercher en notre volont quel bien est ntre, et quel bien ne vient pas de Dieu ; en faisant Dieu auteur de notre volont, et en ajoutant que cest nous-mmes qui rendons notre volont bonne, les Plagiens devraient conclure que ce qui vient de nous, la volont bonne, vaut mieux que ce qui vient de Dieu, la volont tout court. Ces quelques exemples suffisent montrer quel accueil rserv trouvait la philosophie grecque dans les milieux latins ; un saint Ambroise (mort en 397), attach la discipline plus qu la doctrine, trouvait plutt son modle dans le trait Des Devoirs de Cicron, quil imite dans le trait de mme titre o il nonce les obligations des clercs ; auparavant Tertullien (160-245), se donnant comme fidle gardien de lorthodoxie, ne concdait de valeur qu la morale stocienne et accordait que Snque est souvent ntre ; mais il tait bien loign de faire une place la machinerie mtaphysique complique du noplatonisme et mme lducation librale grecque.
VII. LE CHRISTIANISME EN ORIENT
1 2
Du libre arbitre, II, chap. VII [16.]. Daprs saint Augustin, A Marcellin, III, 2 [2.].
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
350
AU IVe ET AU Ve SICLE
@ Il en tait tout autrement en Orient, o la thologie rserve au clerg, aux fonctionnaires et la bonne socit, tandis que le peuple vit dun christianisme de second ordre, est tout fait dans la tradition de laristocratisme hellnique 1 . Aussi Eusbe de Csare (265-340), par exemple, dans sa Prparation vanglique, destine montrer comment le christianisme est susceptible dune claire dmonstration et nest pas une foi aveugle, cite de copieux extraits des philosophes grecs, dont beaucoup ne nous sont connus que par lui. Plus tard, on voit Grgoire de Naziance (330-390) dfendre lducation librale des Grecs, cest--dire les sciences, contre des chrtiens qui la jugeaient inutile 2 ; les allusions que lon trouve aux coles philosophiques dans ses loges de Csaire et de Basile prouve sa connaissance familire de la philosophie grecque 3. Pourtant, dans le milieu des Cappadociens, Basile, Grgoire de Nysse (mort en 395), Grgoire de Naziance et aussi de saint Jean Chrysostome, les philosophes grecs restent les sages du dehors dont on se sert loccasion pour commenter lcriture 4.
p.516
Saint Jean Chrysostome ne cache pas quil faudrait que nous neussions pas besoin du secours de lcriture, mais que notre vie soffrt si pure que la grce de lesprit remplat les livres dans nos mes et sinscrivt en nos curs comme lencre sur les livres. Cest pour avoir repouss la grce quil faut employer lcrit qui est une seconde navigation 5. De plus, dans les conflits sur la nature de la Trinit, qui mettent aux prises dune part Arius et ses partisans qui soutiennent que le Fils est une cration du Pre, dautre part les orthodoxes, saint Athanase p.517 et les Cappadociens qui admettent la consubstantialit des personnes, il semble bien que la question pose est tout fait trangre la philosophie : les mots gnration, procession, employs par les chrtiens pour dsigner les rapports du Fils ou de lEsprit au Pre ne gardent en aucune manire le sens prcis quils ont chez Platon et les platoniciens ; ce sens, sil tait conserv, impliquerait une doctrine telle que larianisme, puisque cest un principe absolu du noplatonisme que la ralit qui procde est infrieure celle dont elle procde. Mais la croyance la divinit de Jsus-Christ vient sopposer ce principe et commander un dogme qui na plus la moindre racine dans la spculation philosophique. En dautres milieux, pourtant, lon voit le platonisme avoir un succs beaucoup plus grand ; il surabonde par exemple dans le trait de lvque
1 2
HARNACK, Dogmengeschichte, vol. II, p. 273. Eloge de Basile, chap. XI et XII. 3 Eloge de Csaire, XX, 4 et 5 ; de Basile, XX, 2 ; LX, 4. 4 GRGOIRE DE NYSSE, Patrologie grecque de MIGNE, vol. XLIV, 1336 a. 5 Commentaire sur saint Matthieu, dbut.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
351
dmse, Nmsius (vers 400) Sur la nature de lhomme. Pas trace dinspiration chrtienne en cet ouvrage o cet vque traite avec la libert dun philosophe, la question de lunion de lme et du corps, en se demandant comment deux ralits aussi distinctes peuvent former un seul tre ; toute sa sympathie va une doctrine quil donne comme celle dAmmonius Saccas, matre de Plotin et qui, en tout cas, ressemble beaucoup celle de Plotin luimme ; cette doctrine compare lme une lumire intelligible en laquelle baigne le corps ; on voit assez quelle suppose lorigine divine de lme, cest--dire une des thses qui a le plus loign les chrtiens de lhellnisme 1. Si lon veut connatre les rapports des chrtiens instruits et des philosophes dans les milieux orientaux dgypte et dAsie Mineure, vers le Ve sicle, il faut lire le curieux dialogue dne de Gaza (vers 500), Thophraste, o lon voit un philosophe paen ; Thophraste, qui vient darriver dAthnes Alexandrie, discuter la thse chrtienne de la rsurrection des morts avec p.518 un certain Euxithos de Syrie, un chrtien, qui a t llve du noplatonicien Hirocls et qui se rend Athnes pour tudier auprs des philosophes la question de la survivance de lme. Le point curieux est lemploi de la dialectique philosophique par le chrtien Euxithos pour dfendre la thse dun monde cr et prissable et celle de la rsurrection de la chair. Aux objections habituelles du Grec que nous avons dj rencontres plusieurs fois, il rpond que Dieu, avant le commencement du monde, a t actif dans lternelle procession des personnes, que les Chaldens, Porphyre et Plotin enseignent la cration de la matire, que, suivant Platon, tout tre sensible est cr. De plus le monde doit prir, puisque, selon le Time, il le peut et puisque toute puissance doit passer lacte. Dailleurs, Dieu fait prir le monde pour lordre, parce que lordre exige la production des contraires, donc celle du sensible qui prit en face de lintelligible qui est ternel. Pour la rsurrection de la chair Euxithos essaye den faire un dogme hellnique, non seulement en citant les faits de rsurrection mentionns par les Grecs, mais en sappuyant sur la force de la raison sminale, assez puissante pour rassembler nouveau les lments du corps qui se sont dsunis ; dailleurs lme peut-elle ne pas communiquer au corps son immortalit, comme le soleil communique sa chaleur leau ? Enfin vient Denys lAropagite, ce personnage mystrieux, que lon a pris pendant tout le moyen ge pour le compagnon de saint Paul ; il doit en partie cette confusion lextrme autorit qui sattache ses crits, et lon ne peut dire combien dides noplatoniciennes passrent, sous le couvert de son nom, dans la mystique chrtienne. En ralit, cit pour la premire fois au concile de Constantinople (533), il ne peut avoir crit quaprs Proclus (mort en 485) dont il subit linfluence. Ses crits forment deux groupes : dabord la Hirar-
Patrologie grecque de MIGNE, t. XL, p. 592.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
352
chie cleste 1 et la Hirarchie ecclsiastique, qui tudient toute la srie des cratures capables de recevoir la rvlation divine p.519 depuis les plus hautes, le premier ordre danges qui touche Dieu sans intermdiaire, jusqu la plus basse, le fidle baptis, chaque tre tant considr comme recevant la rvlation du terme suprieur et la donnant au terme infrieur. En second lieu les ouvrages Des noms divins 2 et de la Thologie mystique formaient, avec deux autres ouvrages perdus, les Esquisses thologiques et la Thologie symbolique, un cours complet de thologie dont le plan est donn au chapitre III de la Thologie mystique. Les trois premiers ouvrages, Esquisses, Noms et Thologie symbolique comprenaient la thologie positive, tudiant successivement dans les Esquisses la Trinit qui est au-dessus du monde intelligible, dans les Noms, les dnominations de Dieu empruntes lordre des intelligibles : bien, tre, vie, intelligence, etc., dans la Thologie symbolique, les attributions de Dieu qui sont empruntes au monde sensible, colre, jalousie, serment, etc. Le dernier ouvrage, la Thologie mystique, contient la thologie ngative et montre, en suivant lordre inverse de la thologie positive, quaucune dnomination, emprunte au sensible ou lintelligible, ne convient Dieu. Denys ne dfinit nulle part sa situation par rapport au noplatonisme paen ; dans ses lettres, on le voit se refuser toute polmique avec les paens ; dautre part, il nous fait connatre lopinion dun sophiste paen , Apollophane, au sujet de ses crits : Ce sophiste, dit-il, minjurie et mappelle parricide, parce que jutilise dune faon impie les Grecs contre les Grecs 2. Le voil donc nettement accus, du ct paen, de se servir du noplatonisme au profit du christianisme ; et, de fait, bien quil se vente de tirer toute sa philosophie ou thosophie de lcriture 3, il est vrai que sa pense est toute imprgne des ides de Proclus, particulirement sous les trois aspects suivants : Dieu, tant la cause de tout, contient tout, la manire dont la cause contient leffet, cest--dire quon peut attribuer p.520 Dieu tous les noms de cratures, Vie, Sagesse, etc., condition de prendre ces noms au sens de Cause de vie, Cause de sagesse, etc. ; et cest le principe de la thologie positive ; mais Dieu tant cause de tout sans tre rien de ce dont il est cause, il faut lui enlever toutes ces attributions, et cest le principe de la thologie ngative, qui est suprieure la positive. En second lieu, dans les Noms divins, il suit pour examiner les dnominations de Dieu, lordre des hypostases que les noplatoniciens admettent partir de Jamblique, cest--dire le Bien, puis la triade tre, Vie, Intelligence, allant ainsi de labstrait au concret ; et il explique exactement comme Proclus, comment, bien que ltre soit suprieur
1
[css : disponible sur le site http://docteurangelique.free.fr/ consacr saint Thomas dAquin]. 2 Lettres 6 et 7 ; dition MIGNE, 1080 a et b. 3 dition MIGNE, 588 a.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
353
lIntelligence, les tres intelligents sont suprieurs aux tres purs 1. Cest encore pour des raisons semblables celles de Proclus, raisons qui remontent finalement au Parmnide, quil admet le principe suivant, essentiel dans sa thologie : bien que leffet soit semblable la cause, la cause nest pas pour autant semblable leffet. Et pourtant on trouve des traits qui distinguent profondment sa doctrine de celle de Proclus. En premier lieu, lordre des noms divins ou hypostases ne reprsente nullement en Dieu un ordre de gnration, comme si sa Vie procdait de son tre, et son Intelligence de sa Vie ; tout est identique en Dieu : aussi Denys ne fait-il aucune tentative pour donner les raisons de cet ordre. De plus, et cest l une consquence, Dieu comme Trinit, comme Pre, Fils et Esprit, dont il parle dans les Esquisses, est au-dessus des noms divins. Enfin, du ct des choses, Denys a renonc toute dduction vritable : les trois triades danges de la Hirarchie ne sont pas lies lune lautre par des considrations rationnelles, pas plus que le terme dune triade nest li aux deux autres ; ce sont les cadres numriques du noplatonisme sans le contenu. Il faudrait se garder, malgr lapparence, dattribuer ces p.521 modifications importantes linfluence de lorthodoxie chrtienne, qui repousse effectivement la procession ncessaire des formes de la ralit les unes des autres. La vrit, cest que le noplatonisme chez Denys volue exactement comme chez son contemporain Damascius : celui-ci, on la vu, dclare nettement que la procession des hypostases et la hirarchie du suprieur linfrieur ne sont que des manires de parler bien inadquates, quand il sagit des premiers principes. Comme Denys aussi, il renonce la dduction rationnelle pour faire appel la tradition des Oracles chaldens, lorsquil sagit de dterminer la succession des formes de la ralit. Enfin la thologie ngative de Denys est plus proche de celle de Damascius que de celle de Proclus ; au lieu daccumuler les ngations sur le premier terme de la srie, le Bien ou lUn, ils dfinissent lun et lautre un terme encore suprieur au Bien, que Damascius appelle lIneffable et dont Denys, citant le Parmnide, dit quil ny a ni discours, ni nom, ni connaissance 2. Telle est donc la diversit des courants intellectuels dans le christianisme des premiers sicles ; de lenseignement de saint Paul luvre de Denys lAropagite, il y a la mme distance que des proches de Musonius et dpictte la mtaphysique complique de Damascius : on ne peut dire quil y ait eu en cette priode une philosophie chrtienne. Bibliographie
1 2
dition MIGNE, 818 a. Edition MIGNE, 1043 a.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
354
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
355
III MOYEN ET RENAISSANCE
@
GE
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
356
CHAPITRE PREMIER Les dbuts du moyen ge
I. CONSIDRATIONS GNRALES
@ Vers le Ve sicle, lunit de la civilisation mditerranenne est brise en mme temps que lunit politique. Avec la destruction des villes qui marque linvasion des Barbares dans tout lOccident, les centres traditionnels de culture disparaissent ; avec la civilisation urbaine seffondre cet enseignement sophistique qui avait donn son unit la dernire priode de lantiquit.
p.523
Comment, jusqu lpoque carolingienne, les tudes purent-elles continuer en des conditions aussi dplorables ? Il faut ici rappeler un trait gnral la fin de lpoque romaine : on recherche moins la culture intellectuelle proprement dite que le dveloppement de la vie spirituelle, et cet universel besoin correspondent moins les chaires de sophistique ou les chaires scientifiques la manire du Muse dAlexandrie, que ces conventicules spirituels que deviennent peu peu les coles philosophiques ; on les voit dj natre chez Philon avec les Thrapeutes du lac Marotis, et innombrables, dans le paganisme mme, sont les communauts pythagoriciennes, hermtistes, platoniciennes : ajoutons que si, dans certains milieux comme celui de Plotin, la vie spirituelle reste encore hautement intellectuelle et si le besoin dorganisation rationnelle domine, dans dautres elle tend se transformer en une pure religion mystrieuse, avec ses formules, ses rites et ses sacrements. Ce nest donc pas par une rvolution violente, mais selon une pente naturelle que tout ce qui restait de vie intellectuelle se rfugia dans les communauts chrtiennes et particulirement dans les monastres, lorsque tout lOccident devint chrtien.
p.524
Ainsi saccomplit, presque invisible, un changement prodigieux ; la vie intellectuelle toute subordonne la vie religieuse, les problmes philosophiques se posant en fonction de la destine de lhomme telle que la conoit le christianisme. La priode o dure ce rgime marquera les limites, naturellement un peu indcises, du Moyen Age intellectuel ; lpoque moderne commencera au moment o lintelligence affirmera lautonomie de ses mthodes et de ses problmes : rvolution si profonde que nous en voyons peine aujourdhui toutes les consquences.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
357
II. ORTHODOXIE ET HRSIES AUX IVe ET Ve SICLE
@ Il faut pourtant cet gard, distinguer soigneusement lOccident de lOrient ; dans les grandes controverses religieuses qui marqurent, en Orient, la fin de lantiquit, on sent la mme proccupation mtaphysique, le mme souci de dterminer la structure intelligible des choses que dans le noplatonisme du mme temps ; tous ces dbats peuvent se ramener soit la question trinitaire et au rapport des hypostases entre elles, soit la question christologique, cest--dire au rapport du Verbe comme hypostase divine avec Jsus-Christ comme homme. Et malgr les appels lautorit et lcriture, les divergences entre les thologiens semblent bien tre dordre philosophique. Ce sont dune part les hrtiques : Sabellius et les modalistes qui craignent de tomber dans le polythisme en faisant du Verbe le Fils de Dieu ; Arius qui, dans le mme esprit mais linverse, nadmet le Fils de Dieu comme personne, qu condition de faire de lui une crature de Dieu, la premire de toutes, p.525 mais qui ne soit pas ternelle ou coternelle au Pre ; car Dieu est son principe 1 ; cest toute lcole dAntioche qui refuse de voir en Jsus-Christ autre chose quun homme combl des grces de la divinit et carte les combinaisons mtaphysiques de lhomme-dieu ; ide qui, aprs Nestorius, se rpand dans la chrtient et passe jusquen Extrme-Orient. On voit, travers toutes ces opinions, la marque dune mme inspiration rationaliste, cherchant classer, viter les confusions, distinguer. En face de ces opinions se constitue dautre part le dogme orthodoxe ; il cherche concilier le thocentrisme, qui fait sombrer toute diffrence dans lunit divine, avec les distinctions indispensables lexistence mme du Christianisme : cest la formule quAthanase et le concile de Nice opposent Arius : lunit de substance en Dieu avec la diversit des personnes ; ce sont les formules avec lesquelles Cyrille dAlexandrie et le concile dphse (433) condamnent Nestorius : la dualit des natures, humaine et divine, dans le Christ, nempche pas que Marie soit la theotokos, la mre de Dieu. En Occident, les conflits ne manquent pas la mme poque ; mais ils sont dun autre ordre ; ils visent tous, directement ou indirectement, la ncessit de linstitution de lglise et de sa hirarchie : tel est le donatisme qui, n et presque cantonn en Afrique, datait dun sicle, lorsqueut lieu en 411 le dbat prsid par saint Augustin ; tel le plagianisme que combattit toute sa vie saint Augustin. Lglise, en tant quinstitution ncessaire la dispensation des grces divines, tait incompatible avec lune et lautre de ces hrsies. Les donatistes prtendaient que la valeur dun sacrement avait pour condition la valeur morale du prtre qui la confrait ; ctait nier lglise
1
Cit par HARNACK, Lehrbuch der Dogmengeschichte, II, 3e d., p. 191, n. 2.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
358
comme socit fonde sur des rgles pratiques strictes et objectives ; ctait la livrer tous les hasards dune apprciation subjective de la moralit des prtres ; celui qui confre les sacrements p.526 na pas tre saint en son cur pas plus que le juriste romain qui dit le droit na tre juste : le formalisme est condition de stabilit. Quant au plagianisme, le point de dpart du conflit fut un essai de rforme monastique du moine Plage, qui, pour lutter contre des chrtiens qui sexcusaient, sur la faiblesse de la chair, de ne pas excuter la loi divine, prchait que lhomme a la force de faire le bien sil le veut et montrait les pouvoirs de la nature humaine ; il voulait que lme ne ft pas dautant plus relche et lente la vertu, quelle se croit moins de pouvoir et quelle estime ne pas avoir ce quelle ignore tre en elle 1. Cest linspiration du stocisme, avec sa confiance en la vertu ; mais cest la ngation du pch originel avec sa transmission hrditaire, puisque Dieu ne peut nous imputer le pch dautrui ; cest prsenter luvre du Christ comme celle dun matre ou dun docteur qui nous sert de modle, la manire des saints du cynisme, non pas comme celle dune victime dont les mrites justifient lhomme ; cest enfin dnier toute importance aux moyens de grce, aux sacrements, que lglise tient la disposition des fidles. A ces thories, saint Augustin oppose la fois lexprience personnelle de sa conversion et la ralit efficace de lglise ; si Plage dit vrai, lhomme na ni demander par ses prires dchapper la tentation, ni prier quand il tombe 2 ; les Plagiens travaillent trouver notre bien en ce qui, en nous, nest pas de Dieu ; sils admettent que la bonne volont vient de Dieu, cest au mme titre que lexistence ; et alors Dieu, en ce cas, serait aussi lauteur de la mauvaise volont ; ou bien, si lon admet quil ne produit que la volont, et si cest lhomme lui-mme qui la rend bonne, il sensuit que ce qui vient de nous, le bien, est suprieur ce qui vient de Dieu. On sait avec quelle rigueur saint Augustin suit les consquences de son attitude : tout bien ne peut venir lme, corrompue par le pch p.527 originel, que dune grce spciale ; le salut, qui dpend des mrites ainsi acquis, nappartient qu ceux qui sont prdestins par Dieu de toute ternit ; les enfants morts sans baptme sont justement damns ; les gentils, nayant pas t touchs par la grce du Christ, nont jamais atteint la vertu. Ce double conflit, avec la solution que lui donne saint Augustin, fait comprendre le milieu dans lequel va se drouler la pense occidentale : une glise dsormais assure de dtenir tous les moyens de salut pour les hommes. Luvre du pape Grgoire le Grand sera la consolidation dfinitive du pouvoir spirituel de lglise. Ces conflits touchent plutt la politique ecclsiastique (au sens le plus lev du terme), quau dogme au sens oriental, cest--dire la structure
1 2
Ad Demetrium, cit par HARNACK, Lehrbuch, III, p. 161. AUGUSTIN, Ad Marcellinum, II, chap. II.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
359
mtaphysique de la divinit. La pense de saint Augustin, si ferme lorsquil sagit de la vie religieuse de lme humaine, est indcise ds quil en vient au dogme proprement dit ; cest ainsi que dans la controverse sur lorigine de lme (dont la solution parat pourtant former un indispensable complment mtaphysique sa doctrine de la grce), il hsite, sans conclure, entre le traducianisme qui fait driver notre me de celle de nos parents et le crationisme qui fait de chaque me une crature ex nihilo ; et il slve fort contre ceux qui croient que lhomme peut discuter sur sa propre qualit ou nature tout entire, comme si rien de lui-mme ne lui chappait 1. Ajoutons que, depuis le moment o, avec Grgoire le Grand, ils se saisissent dune manire inconteste du pouvoir jusquau XIIe sicle, les papes ne donnent aucun impulsion propre la spculation thologique ; avant tout politiques et juristes, ils sont plus occups daffirmer et dassurer tous les droits quils veulent tirer de leur pouvoir spirituel sur les mes que de prendre la tte du mouvement intellectuel.
III. LE Ve ET LE VIe SICLE : BOCE
@ Pourtant la tradition philosophique peut appuyer utilement les vrits de la foi : telle est la conviction de Claudien Mamert, un moine provenal qui crit vers 468 un De Statu Animae, o il runit toutes les autorits philosophiques concernant la spiritualit de lme ; il sappuie sur saint Paul pour montrer que les philosophes ne sont pas aussi ignorants de la vrit que leurs contempteurs les en accusent, et il prend partie lindolence intellectuelle de ses confrres. Il se plaint du mpris o est tomb Platon qui, pourtant, une poque o Dieu navait pas encore rvl la vrit aux hommes, tant de sicles avant lIncarnation, a dcouvert le Dieu un, et trois personnes en lui 2. Par Claudien, le haut Moyen ge a pu connatre les vues du Phdre, du Time, du Phdon sur lincorporit de lme ; il y a trouv aussi le modle de cette rudition lamentable, faite de coupures mal raccordes, dernire hritire de ces doxographies, o lantiquit finissante rsumait son pass philosophique ; on y voit paratre, ct des philosophes grecs (pythagoriciens et platoniciens), les philosophes romains (les Sextius et Varron), puis les barbares (Zoroastre, les Brachmanes, Anacharsis), sans oublier le stocien Chrysippe, assez bizarrement appel comme garant de la spiritualit de lme.
p.528
Par Boce (Anicius Manlius Severinus Boetius) le dernier des Romains n en 480, consul en 510, appel par Thodoric de hautes fonctions et excut en 525 sur une accusation de magie, le haut Moyen ge
1 2
De Anima et ejus origine, IV, 2 [2.]. MIGNE, Patrologie latine, LIII, 746 d.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
360
eut, sur la philosophie antique, des notions plus limites, mais plus substantielles. Boce avait entrepris cet immense travail de traduire en latin les uvres de Platon et dAristote et plusieurs de leurs commentateurs. Cette uvre, qui ne fut pas reprise en grand avant le XIIIe p.529 sicle, aurait peut-tre rendu bien diffrentes, si elle avait abouti, les destines de la philosophie mdivale. En ralit, son travail se borna une partie des crits logiques dAristote : une traduction des Catgories avec un commentaire inspir de celui de Porphyre, le de Interpretatione suivi de deux commentaires ; lIsagoge de Porphyre avec un commentaire inspir dAmmonius ; du reste de luvre logique dAristote, aucune traduction, mais des manuels concernant les syllogismes catgorique et hypothtique et les diffrences topiques. Voil les seules notions quelque peu prcises qui restent de lantiquit : une partie de luvre logique dAristote ! Cela est de grande consquence ; comme lindique Boce daprs Porphyre, les catgories dAristote, substance, qualit, quantit, etc., ne se rfrent pas aux choses mmes, mais ne sont pas non plus de simples classes grammaticales ; elle traite des mots en tant quils signifient les choses et des choses en tant quelles sont signifies par des mots. Or, pour lui, non seulement le langage est dinstitution humaine, mais tout nom est dabord un nom propre pour dsigner une chose corporelle particulire ; il sensuivra que les catgories et leur suite, toute la logique sont naturellement adaptes aux choses corporelles et faites pour elles. Cest de l que vient tout le tourment du problme que Porphyre posait en ces termes au dbut de lIsagoge : Quant aux genres et aux espces (dsignes par des mots qui ne signifient plus des choses corporelles concrtes) ont-ils une existence ou ne sont-ils quen nos seules penses ? Sils existent, sont-ils des corps ou des choses incorporelles ? Sils sont des choses incorporelles, sont-ils spars ou nexistent-ils que dans les choses sensibles ? Porphyre pose seulement les questions ; Boce, en le commentant, indique la solution quil en a trouve chez Aristote, mais sans lapprouver : cette solution est manifestement tire de la critique des ides platoniciennes : un genre existe la fois en plusieurs individus ; il est donc manifeste quil ne peut exister en soi ; lunit numrique dun tre en soi p.530 est incompatible avec lparpillement du genre dans les espces ou des espces dans les individus 1. Boce a compos aussi des crits thologiques, fort lus et comments jusquau XIIe sicle ; ils sont lis troitement ses crits dialectiques : ce qui fait le fond de son De Sancta Trinitate 2 par exemple, cest cette question : les rgles de la dialectique sont-elles applicables aux propositions nonces par le thologien ? quelles sont les prcautions prendre, les rgles particulires
1 2
MIGNE, Patrologie latine, LXIV, p. 82 b-86 a. [css : disponible sur le site : http://docteurangelique.free.fr/ consacr saint Thomas dAquin].
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
361
suivre pour se servir du discours en des sujets pour lesquels le discours na pas t fait ? Boce agit enfin par sa clbre Consolation philosophique, quil crivit dans sa prison, aprs sa disgrce : presque nulle trace de christianisme en cet ouvrage, inspir, en sa forme littraire qui mlange le vers et la prose, des modles de la diatribe romaine et, en son fond, de la thodice stocienne et platonicienne. Il sagit pour lui de sexpliquer linjustice dont il est victime ; le cours des choses humaines, si dsordonn quand on le compare lordre parfait de la nature, est-il donc livr une fortune aveugle ? Vieux thme de Platon dans le Gorgias et les Lois, de Plotin dans les Ennades. La gurison de ces doutes et de ce dsespoir se fait en deux temps : ce sont dabord les remdes plus doux : la Fortune, en une diatribe de mme veine que celle de Tls, dmontre Boce quil na pas de se plaindre delle, que la vraie flicit saccommode de tous les hasards, que la mauvaise fortune a mme des avantages. Puis viennent les remdes plus violents : la Philosophie dmontre que le vrai bonheur, qui est indpendance, ne rside quen Dieu, qui est le Bien et lunit parfaite ; Dieu auteur de la nature, ne peut donner aux tres que des impulsions vers le bien ; et le mal, ne pouvant tre produit par lui, nest rien. Il sagit seulement daccommoder cette affirmation de la Providence avec lexprience que lon a du succs des mchants. Succs apparent, p.531 rpond la Philosophie avec le Gorgias et la Rpublique : tous les mchants sont en ralit malheureux. Le destin de chaque tre dpend bien en ralit de la Providence qui confie aux forces naturelles le dtail de lexcution de ses volonts ; et ainsi la justice vritable, bien diffrente de la justice apparente, se ralise. Et, si lon dit que cette vue sur la destine suppose la ngation de la libert, inconciliable, croit-on, avec la prescience divine, Boce rpond dabord avec Cicron que la prescience ne prouve pas la ncessit des vnements, et ensuite que nous avons tort de nous figurer la prescience de Dieu, qui vit et connat dans un ternel prsent, sur le type de nos raisonnements. Livre mouvant, malgr son caractre factice, et qui restera longtemps comme un des seuls tmoins dune vie morale qui puise son inspiration ailleurs que dans les pouvoirs spirituels du jour : un des seuls, disons-nous, car le haut Moyen ge a aussi connu Lucain, Virgile et Cicron. Si lon ajoute ces ouvrages son trait de institutione arithmetica, imit de Nicomaque de Gerasa, et son de musica, on verra quel rle a jou Boce dans la transmission de la culture hellnique au Moyen ge occidental. Aprs Boce qui, sans tre original, avait au moins le mrite daller aux sources et de traiter les questions fond, on ne trouve plus que dhumbles compilateurs, attentifs faire des extraits et des abrgs des anciens livres pour enseigner les clercs. Un de leurs modles est Marcianus Capella, lAfricain, qui, vers la fin du Ve sicle, avait crit, sous le titre de Noces de Mercure et de la Philologie, un manuel dont chaque livre, du IIIe au IXe, est
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
362
consacr aux sept sciences fondamentales. Cet auteur est lui-mme un compilateur qui tient presque toute sa science de Varron. Le quatrime livre (la Dialectique), qui dbute par un loge du fameux rudit latin, fait connatre au Moyen ge les cinq voix , genre, espce, diffrence, propre et accident, les dix catgories, les oppositions, les propositions, les syllogismes ; le sixime contient surtout une longue p.532 description de la terre emprunte Pline lAncien, et de maigres dtails venus des lments dEuclide. Le septime laisse voisiner une fantastique arithmologie symbolique avec quelques thormes positifs. Cassiodore (477-575), un ami de Boce qui passa au monastre de Vivarium une partie de sa longue vie, se donne surtout pour tche de runir et de transmettre cette science disparate ; il crit les Institutiones divinae, encyclopdie thologique, les Saeculares lectiones o il enseigne les arts libraux ; mais, au premier de ces ouvrages, il dclare que la connaissance des arts libraux a son origine dans la Bible et quil faut la ramener au service de la vrit. Il nous donne pour lessentiel la grammaire de Donat, la rhtorique de Cicron commente par Marius Victor et de Quintilien, une dialectique qui ne va plus loin que celle de Marcianus Capella, un rsum de larithmtique de Boce et des lments dEuclide. Son trait de Anima vient de saint Augustin et de Claudien Mamert. Lauteur a conscience de la dualit dinspiration qui, sur la nature de lme, oppose la philosophie et la religion. Les matres des lettres sculires dfinissent lme une substance simple, une forme naturelle, diffrente de la matire de son corps, possdant lusage des organes et la vertu de la vie . Mais, daprs lautorit des docteurs vridiques , elle est cre par Dieu, spirituelle, substance proprement dite, cause de vie pour le corps, raisonnable et immortelle, et capable de se tourner au bien et au mal. De mme il sait distinguer les preuves de limmortalit daprs les lettres sculires (ce sont essentiellement celles du Phdon), et la preuve, bien plus facile, par les autorits vridiques (cest que lme est faite limage de Dieu). Enfin, propos de la connaissance du mal chez les hommes, il fait mention des philosophes qui ne suivent pas la loi du crateur, mais plutt lerreur humaine 1 .
IV. LA RAISON ET LA FOI
@ de pareilles conditions, la question des rapports de la raison et de la foi se pose dune manire qui nest pas simple. Une institution comme lglise nest pas un ensemble de vrits spculatives sur lesquelles la foi ou la raison peuvent tre en accord ou en conflit ; elle simpose dabord au mme
1 p.533 Dans
MIGNE, Patrologie, LXX, p. 1279, surtout chap. I, II et x.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
363
titre quune constitution politique ou que des rgles juridiques : cest une cit spirituelle, que laugustinisme pense tablir dfinitivement. Cette cit implique deux espces de connaissances : les connaissances purement profanes et la science des choses divines ; les connaissances profanes forment lensemble de cette propdeutique ou arts libraux, quun Philon et un Snque plaaient au dbut de la philosophie : le trivium, grammaire, rhtorique, dialectique, qui comprend tous les arts de la parole et du discours, et le quadrivium, compos des quatre sciences dont Platon faisait le point de dpart de la philosophie : arithmtique, gomtrie, astronomie et musique. Pas plus que chez un Philon ou chez un Snque, elles nont leur fin en ellesmmes ; elles ne sont justifies pour le clerc qui les enseigne aux autres clercs quautant quelles peuvent servir la science des choses divines ; le trivium trouve sa justification dans sa ncessit pour la lecture et lexplication de lcriture et des Pres, et pour lenseignement du dogme ; le quadrivium est indispensable la liturgie et au comput ecclsiastique : pour un usage aussi limit, on nprouve pas le besoin daugmenter les connaissances acquises, ni de promouvoir ces sciences pour elles-mmes, mais on se contente, en des encyclopdies plus ou moins vastes, dinventorier lhritage du pass ; ainsi, ces connaissances, dordre purement rationnel pourtant, nont aucune autonomie, puisque lon nen retient que ce qui est acquis et dans la mesure du service quelles peuvent rendre lglise. Do les encyclopdies qui furent crites avant lpoque de p.534 Charlemagne, dans les cantons de lEurope o subsistait encore quelque vie intellectuelle. cest--dire en Espagne et en Irlande. Isidore, vque de Sville (570-636) crit ses tymologies qui traitent de lorigine de certaines choses daprs le souvenir des livres anciens : trois livres sur le trivium et le quadrivium, dont les chapitres sur la dialectique, venus dApule et de Marcianus Capella, contiennent, outre quelques lments de logique, les divisions de la philosophie ; puis dix-sept livres sur tout ce qui peut intresser un clerc en matire de calendrier, dhistoire, dhistoire naturelle, de gographie. Plus tard Bde le Vnrable (672-735) crit au monastre de Jarrow un De natura rerum de mme qualit, o il copie Isidore, mais o il utilise souvent Pline lAncien. Il en est tout autrement de la science des choses divines, qui repose sur lautorit. Lautorit nest point quelque chose de simple ; les hrtiques, eux aussi, veulent sappuyer sur lautorit, et les Ariens citent lcriture en leur faveur. Del des difficults qui font lobjet propre du Commonitorium de Vincent de Lrins ; cet ouvrage, crit en 354, ouvre vritablement la pense du Moyen ge, en formulant les rgles destines discerner la tradition vritable en matire de foi : suivre de prfrence lopinion de la majorit, en se dfiant des opinions prives ; au cas pourtant o lhrsie risque de stendre, sattacher lopinion des anciens ; si lon trouve des erreurs en ces opinions, suivre les dcisions dun concile oecumnique, ou, sil ny a pas eu de concile, questionner et comparer les matres orthodoxes et chercher
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
364
lopinion commune tous. Il y a bien dans la tradition une croissance, mais une croissance organique qui ne procde jamais par addition ou innovation, mais par dveloppement et claircissement. Voil donc, fixes, ds le dbut du Moyen ge, les rgles qui doivent permettre lunit spirituelle de se maintenir, sans aucune intervention de la pense philosophique. Dautre part, la pense mdivale sur les choses divines reoit de saint Augustin la tradition noplatonicienne. Dieu p.535 est lintelligence au sens minent, la source de lintelligible ; et la connaissance ou vision de Dieu est comme la limite suprieure de toute connaissance intellectuelle. Comme Plotin, saint Augustin pense que quand lme se sera recueillie, ordonne et sera devenue harmonieuse et belle, elle osera alors voir Dieu, la source mme do dcoule toute vrit, et le pre mme de toute vrit . Au-dessous de cette vision, rserve au petit nombre, lme intelligente naturellement unie aux intelligibles aperoit les vrits dans une certaine lumire incorporelle de mme nature quelle-mme 1. Entre ces deux thmes, nulle parent : dune part un ensemble de formules, discutes par conciles et synodes, comme on discuterait des formules juridiques ; dautre part, une spiritualit libre, o la connaissance nest pas borne par la foi, mais toujours oriente vers la pleine connaissance de Dieu. Le grand paradoxe du Moyen ge est prcisment den affirmer la solidarit : comprendre la vrit sur Dieu ne saurait tre autre chose que comprendre les vrits de la foi ; la raison, au sens dune intelligence illumine, doit consommer la foi. Lesprit du temps se manifeste en particulier en des uvres sur la manire dinstruire les clercs, telles que le De Institutione Clericorum de Rhaban Maur (776-856), abb du monastre de Fulda en 822. Le IIIe livre de cet ouvrage, qui est une compilation des trois derniers livres de la Doctrine chrtienne de saint Augustin, ramne, directement ou indirectement, toute science la connaissance des vrits de la religion, renferme dans la science des critures. Le fondement et la perfection de la sagesse, crit Rhaban Maur, cest la science des saintes critures. (Livre III, ch. II). Et la production littraire du temps est faite avant tout dinnombrables commentaires portant sur lAncien Testament (surtout luvre des six jours), sur les vangiles et les ptres : commentaires qui ne font dailleurs que rpter p.536 et amplifier ceux des grands docteurs des sicles prcdents, saint Hilaire ou saint Augustin. Les rgles de ce commentaire se rattachent, par lintermdiaire des pres grecs et latins, au commentaire allgorique de Philon : cest dire quil nest aucune connaissance, dordre scientifique ou philosophique dont il ne puisse avoir se servir. Rhaban Maur exige du clerc la connaissance de la pura veritas historiarum et des modi tropicorum locutionum, cest--dire la distinction des cas o le rcit de lcriture doit tre pris la lettre et de ceux
1
Cf. BOYER, De lIde de Vrit chez saint Augustin, p. 190 et 199, Paris, 1920.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
365
o il doit tre interprt allgoriquement ; et il donne lui-mme un long dictionnaire de toutes les interprtations allgoriques des noms des personnages de la Bible, runissant ainsi des matriaux pour les commentaires. Mais cela ne suffit pas ; toutes les disciplines doivent servir cette fin, mme les doctrinae gentilium qui comprennent les arts libraux et la philosophie. De Boce Rhaban Maur, on se rend compte quil y a dans ces doctrines-l une tradition intellectuelle entirement trangre au christianisme et lglise. Limportant pour nous est moins dnumrer tous les dbris de cette culture conservs dans ces vieilles encyclopdies que de bien se rendre compte de lattitude de ces chrtiens vis--vis de cette masse de connaissances qui leur tait transmise sans la clef qui pouvait servir les pntrer vritablement, cest--dire sans les mthodes intellectuelles grce auxquelles elles avaient t inventes. Or cette attitude nest pas sans ambigut : dune part il y a une tendance (certainement drive de saint Augustin) ramener toutes les doctrines des gentils la mme source de vrit do mane la rvlation chrtienne : Les vrits que lon trouve dans les livres des savants du sicle, ne doivent tre attribues qu la Vrit et la Sagesse, parce que ces vrits nont pas t tablies ds labord par ceux dans les livres de qui on les lit ; mais, manant de ltre ternel, elles ont t dcouvertes par eux, dans la mesure o la Vrit et la Sagesse leur p.537 ont permis de la dcouvrir ; et ainsi tout doit tre ramen un seul terme, aussi bien ce que lon trouve dutile dans les livres des gentils que ce quil y a de salutaire dans lcriture. (Chap. II). La mthode de la science nest pas dune autre nature que la mthode philologique du commentaire : il sagit de dcouvrir ce que Dieu a institu dans la nature, comme le commentaire dcouvre ce quil a institu dans le livre. De l un dpart entre les mauvaises sciences, qui sont selon les institutions des hommes , (chap. XVI), cest--dire le culte des idoles et les arts magiques, et les bonnes sciences qui se divisent elles-mmes en deux classes : celles qui se rapportent aux sens corporels, lhistoire qui nous fait connatre le pass, la connaissance du prsent par les sens, et les conjectures sur lavenir, telles que celles de lastronome, qui reposent sur lexprience (experimentum) ; en second lieu les sept arts libraux. Mais ct de cette notion dune source unique de vrit qui tend unir et confondre, agit un principe tout diffrent : daprs ce principe le commentaire de lcriture domine tout ; et les rpertoires des sciences profanes ne doivent, eux aussi, que fournir des matriaux pour lintelligence du sens spirituel de lcriture. La grammaire, par exemple, aux yeux de Rhaban Maur, contient une partie, la mtrique, qui est indispensable lintelligence du psautier ; la dialectique apprendra les rgles des connexions des vrits, qui permettront de savoir ce qui peut se dduire correctement des vrits enseignes par lcriture ; larithmtique, grce la connaissance des
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
366
nombres, nous dcouvrira des sens cachs de lcriture, qui restent ferms aux ignorants ; la gomtrie, dont les proportions ont t observes dans la construction du tabernacle et du temple, nous aidera pntrer le sens spirituel ; lastronomie, enfin, est indispensable au calcul des temps 1. La connaissance de lunivers a le mme usage que celle des arts libraux : on en cherche avant tout une image densemble ; le De Natura Rerum de Bde dcrivait le monde selon lordre des lments : le ciel avec ses plantes et ses toiles ; lair avec ses mtores, comtes, vent, tonnerre, clair, arc-en-ciel ; les eaux, locan avec ses mares, la mer Rouge et la crue du Nil ; la terre avec sa vie intrieure, ses volcans. Dans le De Temporibus, cest un tableau complet de lhistoire avec ses six ges, dont le dernier, qui dure encore, commence avec le dbut de lempire romain. Lusage de ces vastes tableaux densemble, dont aucun trait, peu dexceptions prs, ne vient de lexprience directe et personnelle, o presque tout vient de la tradition (et en particulier de Pline lAncien), se montre en des encyclopdies du genre du De Universo de Rhaban Maur, dont la science est surtout drive dIsidore de Sville : ce qui fait lunit de cette compilation, dans la mesure o elle en une, cest une vaste interprtation allgorique de lunivers entier o tous les dtails du monde ont un sens spirituel ; la pense du suint livre y est perptuellement prsente.
p.538
On voit donc ce que le christianisme absorbe de la culture hellnique : des matriaux pour la grande uvre religieuse du salut de lhomme ; de lesprit qui lanimait, on ne parat pas avoir le plus lger soupon. Il ne sagit pas de la comprendre de lintrieur, mais tout au plus de linventorier et de lutiliser ; dans les cercles instruits, on ne se refuse pas, aprs saint Augustin, agrer les philosophes : Si ceux mme quon appelle les philosophes, les platoniciens surtout, dit Rhaban Maur aprs avoir parl des arts libraux, se trouvent avoir dit des choses vraies et concordantes avec notre foi dans leurs exposs et leurs crits, il ne faut pas craindre ces choses, mais il faut les leur prendre pour notre usage, comme dinjustes possesseurs. (Ibid., chap. XXVI.) Si lon essaye de se reprsenter les moyens quun homme du VIIIe sicle avait pour se reprsenter ce pass philosophique, p.539 voici ce que lon trouve : dune part une srie duvres authentiques, mais de basse poque, dtaches et sans lien, et qui toutes se rattachent la spiritualit noplatonicienne : nous voulons dire le Commentaire de Time de Chalcidius, et la traduction du dbut du mme dialogue par Cicron, le Commentaire du songe de Scipion, par Macrobe, ce qui a pass de Plotin et de Porphyre chez saint Augustin. Une seconde source tait les doxographies trs nombreuses qui donnaient quantit de dtails historiques, dailleurs de plus en plus dforms et inexacts, sur les coles disparues ; or ces doxographies, dont Rhaban Maur nous offre un exemple 2, drivent des Pres, chez qui elles sont une prface la
1 2
MIGNE, Patrologie, CVII, p. 395-398 ; Cf. AUGUST1N, De Ordine, II, 14. De Universo, livre XV, chap. I (MIGNE, CXI).
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
367
dmonstration de lidentit entre les sectes philosophiques paennes et les hrsies chrtiennes. Enfin viennent les traits techniques logiques de Boce, issus dAristote. Ce tableau du pass philosophique, si incomplet, si dform, explique la confiance et la dfiance dun Rhaban Maur ; la philosophie indispensable comme outil logique, et aussi tout illumine des rayons de la vrit chez un Platon, est dangereuse parce quelle nous met sur la pente de lhrsie. Cest une proccupation pdagogique qui domine luvre dAlcuin (730-804), que Charlemagne appela dAngleterre en 781, et dont le nom symbolise presque cette renaissance intellectuelle que voulut le roi des Francs ; il rforme le clerg de lempire franc, tomb un degr de dchance intellectuelle inoue ; il duque les laques pour lesquels fut institue lcole palatine. Ses manuels denseignement, grammaire, rhtorique, dialectique, trait sur lorthographe, najoutent rien aux compilations prcdentes. Comme on le voit par sa correspondance, Alcuin a une grande autorit en ce temps, et il soutient lutilit des tudes profanes pour la thologie. On le voit en son trait De Fide sanctae et individuae trinitatis sappuyer sur saint p.540 Augustin pour affirmer que les rgles de la dialectique sont ncessaires et que les questions les plus profondes sur la sainte Trinit ne peuvent tre lucides que grce la subtilit des catgories.
V. JEAN SCOT ERIGNE
@ Mais luvre de Jean Scot rigne est le meilleur tmoin des proccupations philosophiques qui animent alors les thologiens. Jean est issu de cette glise dIrlande, qui avait manifest plusieurs fois son indpendance lgard de Rome ; Bde, en son Histoire ecclsiastique, cite la lettre o le pape Jean lui reproche non seulement des carts de discipline, mais des carts de doctrine ; elle revenait lhrsie plagienne. On y lisait dailleurs les potes classiques et lon y savait encore le grec 1. Jean, qui naquit en Irlande vers le dbut de IXe sicle, fut un de ces Scots qui allaient enseigner sur le continent. Accueilli la cour de Charles le Chauve, vers 840, il fut capable de traduire en latin les uvres de Denys lAropagite et de son commentateur Maxime le Confesseur ; ces uvres dj envoyes en France par le pape lpoque du roi Ppin, avaient t de nouveau transmises Louis le Dbonnaire, en 827, par les envoys de lempereur Michel le Bgue. La traduction de Jean nest dailleurs pas une traduction vritable au sens que nous donnons ce terme ; cest, comme le seront presque toutes les traductions du Moyen ge, un mot--mot dune fidlit dsolante, qui fait croire que lauteur, comme un mdiocre colier, ne cherchait le sens de la phrase
1
MIGNE, Patrologie latine, XCV, p. 113.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
368
quaprs avoir traduit sparment chaque mot ; Denys ne fut plus traduit de nouveau avant la fin du XIIe sicle. Les uvres de Denys furent une des sources importantes de la conception noplatonicienne des choses que nous trouvons p.541 chez Jean Scot : ce ne fut pas la seule ; et ce qui suffit ltablir, cest que, dans son trait Sur la prdestination, crit en 851, o il ne cite pas encore les uvres de Denys, son noplatonisme apparat nettement. Jean indique assez compltement ses autorits pour que lon puisse dterminer ces sources : dans le De Divisione Naturae, outre Denys et Maxime, cest avant tout saint Augustin, puis Grgoire de Nysse, plus rarement Basile de Csare et Grgoire de Naziance et piphane, trs rarement saint Ambroise, Origne et saint Jrme. A ct des Pres, il a souvent recours aux philosophes ou sages de ce monde : les traits logiques de Boce, par qui il connat Cicron et Aristote, le Time de Platon, parfois Pythagore, plus souvent Pline lAncien, et aussi les potes Ovide et Virgile. Jean nest pas, comme ses prdcesseurs, un simple compilateur ; il a une pense assez ferme et indpendante pour utiliser ses sources sans leur tre asservi. Son systme nest point un mlange, dose diffrente, de Denys et dAugustin ; cest une rponse rflchie une question redoutable qui va dominer toute la pense mdivale. Limage chrtienne et limage noplatonicienne de lunivers ont en commun une sorte de rythme : lune et lautre sont des images thocentriques, qui nous dcrivent le double mouvement des choses, la manire dont les choses scartent de leur premier principe, puis leur retour au principe. Seulement dans limage chrtienne, la suite de ces moments est une srie dvnements, dont chacun part dune libre initiative : cration et chute ; rdemption et vie future dans la batitude. Chez les noplatoniciens, lon voit les moments successifs driver dune ncessit naturelle et ternelle : lcart vis--vis du premier principe consiste en ce que la mme ralit qui, dans le premier principe, tait ltat dunit absolue, est, aux niveaux infrieurs de ltre qui dcoulent de lui et les uns des autres avec ncessit, dans un tat de division de plus en plus grand ; et le retour consiste en ce que cette division fait, par un mouvement inverse, place lunit. Mais lopposition entre ces deux images de lunivers est bien loin dtre aussi nette que nous la prsentons ici : le christianisme hellnique est incontestablement hypnotis par le noplatonisme ; il a une tendance (qui naboutit jamais compltement) interprter la suite des vnements raconts par le mythe chrtien comme une suite de moments ncessits par la nature des choses. Depuis les Stociens, lesprit grec est domin par limage dune vie de lunivers alternant entre la sortie de Dieu et labsorption en Dieu : schme dont il reste ncessairement beaucoup dans limage de la cration, de la chute et de la rdemption.
p.542
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
369
Or cest prcisment ce schme que retrouve Jean Scot ; et sa grande uvre De Divisione naturae est une interprtation densemble du thocentrisme chrtien par le thocentrisme platonicien. Dj dans son opuscule Sur la prdestination, son noplatonisme apparat clairement. Le moine Gottschalk avait soutenu lexistence dune double prdestination, celle des lus et celle des rprouvs ; de mme quune prdestination divine faisait parvenir les lus la justification et la vie ternelle, lautre forait les rprouvs tomber dans limpit et dans les supplices ternels 1. On en dduisait que lorthodoxie et les bonnes uvres taient inutiles et que Dieu forait certains hommes pcher. Rhaban Maur, puis Hincmar, vque de Reims, virent le danger pour lglise ; et Hincmar, non content davoir fait condamner Gottschalk par le synode de Chierzey (849), invita Jean Scot crire contre lui. Jean commena par poser, avec saint Augustin, que la vraie philosophie est la vraie religion 2 et, de fait, cest par des spculations sur lessence divine quil rfute Gottschalk : la double prdestination est avant tout contraire lunit de lessence divine ; une seule et mme cause ne peut produire deux p.543 effets contraires ; et si Dieu, selon Gottschalk, produit en lhomme la justification, il ne peut produire en lui le pch. Dautre part, Dieu, tant la suprme essence, est cause seulement du bien, qui est une ralit, et il ne peut tre cause du pch, qui est un simple nant. On le voit, Jean Scot a retrouv chez saint Augustin deux principes essentiels du noplatonisme, Dieu est identique au Bien, et le mal nest pas une ralit positive. Le De Divisione naturae suit le rythme de la philosophie noplatonicienne 3 ; la procession de Dieu la crature, puis le retour de la crature Dieu : de Dieu principe Dieu fin en passant par la nature. Il est manifeste que cest surtout Maxime le Confesseur qui lui suggre lide de ce rythme : cest linterprte de Denys quil cite pour montrer dans ltat de lhomme aprs le pch la limite extrme de la division et de lcart des choses du premier principe, tandis que la rdemption sera suivie de lunion finale des tres les uns avec les autres et avec Dieu. Ne remarque-t-il pas dailleurs expressment que cette manire de comprendre la rdemption, comme dbut dune rsorption totale en Dieu, a t traite par fort peu et quil ny a chez les Pres que des indications parses ? Ce rythme ne fait que marquer la division de la nature selon toutes les diffrences logiques, comme si le dveloppement de la ralit ntait pas autre chose que la division logique dun genre en ses espces. Il y a dabord la nature qui cre et qui nest pas cre ; cest Dieu comme principe des choses ; puis la nature qui est cre et qui cre ; cest le Verbe issu du principe et qui produit le monde sensible ; ensuite vient la nature qui est cre et qui ne cre
1 2
MIGNE, Patrologie latine, CXXII p. 359 c-360 d. Ibid., p. 358, daprs AUGUSTIN, De vera religione, Chap V [8.]. 3 Cf. le plan densemble, MIGNE, CXXII, p. 528 c d.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
370
pas, cest le monde sensible ; enfin la nature qui nest ni cre ni cratrice, cest Dieu comme fin suprme en qui a son terme le mouvement des choses qui cherchent la perfection. Mais, sous ces diffrences, on reconnat lunit dune p.544 mme nature : selon la vieille formule orphique, que Jean cite sans en connatre lorigine (I. ch. XI), Dieu est la fois principe, milieu et fin. La premire division, Dieu principe, est identique la quatrime, Dieu fin ; la seconde, Verbe crateur, est identique la troisime, monde cr ; et enfin la seconde et la troisime, qui forment lensemble des cratures, se montrent, dans la rdemption, identiques la quatrime. Cest la pense simultane de ces diffrences et de cette identit qui court travers luvre de Jean Scot et, contraignant toujours la pense retrouver le tout dans les parties et les parties dans le tout, donne son style mme cette sorte de tension que lon trouve chez tous les penseurs de mme race depuis Plotin jusqu Hegel et Bradley. Cest bien en effet le Dieu de Plotin quil dcrit, ce Dieu qui en apparence, se meut du principe la fin en parcourant tout le cycle des tres, mais chez qui il ny a pas en ralit dopposition entre mouvement et immutabilit, qui ne se meut pas pour arriver au repos ; car, si lon dit quil se meut, cest parce quil est le principe du mouvement des cratures (livre I) ; cest bien la triade plotinienne des hypostases quil retrouve dans la Trinit, o le Pre na aucune dtermination positive, tandis que le Fils contient les causes primordiales dans toute leur simplicit et leur unit, et que lEsprit les distribue en genres et en espces ; et les images de la Trinit que, saidant de saint Augustin et de Denys, il trouve dans les tres, la triade essentia virtus operatio, la triade intellectus ratio sensus interior ne font aussi que symboliser ce mouvement de procession ou dvolution du simple au multiple, dune part de lessence cache ses manifestations, dautre part de lide son expression, en suggrant lidentit foncire du multiple avec le simple. Entre ces causes primordiales, il ny a, comme le dit Plotin de ses intelligibles, aucune ingalit, aucune diversit vritable : cest lintelligence qui les spare et les isole. Cest pourquoi le monde sensible cr et dvelopp dans le temps ne peut tre non plus spar du p.545 Fils et de lEsprit qui contiennent sa cause ; il nindique quune tape de plus dans la division ; ce qui, dans lternel, tait simultan, se succde et se dveloppe, comme, de lunit o sont ternellement tous les nombres avec toutes leurs proprits, se dveloppe peu peu larithmtique qui les dcouvre progressivement. Aprs cette extrme division commence le retour des choses Dieu (livre IV) : et cest ici et ici seulement quintervient lhomme, dont la cration marque le dbut de ce retour. Lnigme de lhomme cest quil est un tre double : il est un animal avec ses sens, ses passions et sa vie nutritive ; il est au-dessus de lanimal par la raison et lintellect ; selon une antique interprtation de la Gense par Philon, il est la fois ltre faonn de terre et ltre cr limage de Dieu. La solution de cette nigme, cest que Dieu a voulu crer un microcosme en qui fussent jointes nouveau toutes les cratures ; elles sont toutes en lui, au moins en ide et par leurs notions ; lhomme
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
371
primitif, avant le pch, a une connaissance parfaite de lui-mme et de son crateur, des anges et des choses infrieures lui. Il est donc lorgane du retour de toutes choses Dieu : et parce que ce retour a lieu par lui, toute crature est en lui. Mais lhomme tombe, et la chute a pour consquence de le faire sortir du Paradis, cest--dire de lattacher lanimalit qui est en lui et de le faire dpendre delle, sans quil perde en rien cependant lintgrit de son essence. De l, la ncessit de la rdemption : non seulement elle rtablira lhomme dans son tat primitif, mais encore elle sera marque par lanantissement du monde matriel et par la spiritualisation de toute chose. Cet expos marque assez les restrictions quil convient de faire lassimilation du systme de Jean Scot au noplatonisme. Dans la deuxime partie de cette doctrine, dabord, celle qui concerne la nature de lhomme et le retour Dieu, on voit avec quelle fidlit scrupuleuse il suit les Pres : la double nature p.546 de lhomme, son tat avant et aprs le pch, lhomme microcosme, linterprtation du Paradis, toute cela provient du De Paradiso dAmbroise, qui lui-mme a beaucoup emprunt au de Opificio mundi de Philon, au De Imagine de Grgoire de Nysse, et dautres ouvrages. Et, par ces auteurs, il recueille la tradition du vieux mythe dAnthropos, lintermdiaire entre Dieu et les choses, mythe si dvelopp chez Philon et compltement absent de linspiration plotinienne. Par eux, aussi, il accueille lide antihellnique (et quil sait telle) de la fin du monde, la place de lordre ternel de Plotin. Rien, dans ce salut ou retour de la nature Dieu par lhomme, ne rappelle cette conversion plotinienne dans laquelle ltre man se retourne ternellement vers son principe pour en recevoir les effluves et se constituer ainsi en tant qutre. Si nous revenons maintenant la premire partie de luvre, nous verrons quelle nest pas, la rigueur, un vritable systme dmanation, o le principe rayonne ses influences par une ncessit naturelle : sans doute, en Dieu, tre et vouloir, nature et volont sont termes identiques ; il nen reste pas moins que la production est avant tout une thophanie ; le Pre, invisible et inconnu, se manifeste par le Verbe divin, qui nat dans le mme sens que, en nous, lintelligence, dabord invisible et inconnue, se manifeste au contact des choses sensibles ; et la cration des autres choses nest, pour le Verbe, quune occasion ou un moyen de se manifester. Cette thophanie et cette rsorption dans le premier principe sont diffrentes de la procession et de la conversion, en ce que les premires impliquent que la ralit a une histoire et comporte des initiatives, tandis que les dernires dsignent un ordre ternel et immuable. Bibliographie @
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
372
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
373
CHAPITRE II LE Xe ET LE XIe SICLE
I. CARACTRES GNRAUX
@ Il faut attendre la fin du XIe sicle pour saisir, dans lOccident, une relle reprise de lactivit intellectuelle : non que cette priode intermdiaire soit vide ni sans importance. Il se fonde de toute part et dans les monastres et aux clotres des cathdrales, des coles : centres disperss, mais o la culture est la mme. Auxerre, Reims, Paris ont, ds le IXe sicle, des coles auprs de leurs cathdrales ; Aurillac, Saint-Gall, Chartres, les tudes continuent. Il faut nous reprsenter au milieu de quelles difficults matrielles ; aprs la conqute de lOrient par les Arabes, le papyrus et le parchemin deviennent si rares que les bibliothques restent ncessairement fort pauvres ; une des plus riches, celle de Saint-Gall, contenait quatre cents volumes en 860. Le renouveau intellectuel concide, la fin du XIe sicle, avec la cration dordres religieux, qui copient activement les manuscrits ; et au XIIe sicle, la bibliothque de saint Vincent de Laon contenait onze mille volumes 1.
p.549
Lon sait peu prs le contenu de ces bibliothques du haut Moyen ge en ouvrages philosophiques : Saint-Gall, par exemple, possdait au IXe sicle les uvres logiques dApule, des uvres de Cassiodore, dIsidore, de Bde, et dAlcuin, sans compter les Phnomnes dAratus ; il senrichit au Xe sicle de la Consolation de Boce, de la Pharsale de Lucain, du Songe de Scipion p.550 (peut-tre avec le commentaire de Macrobe), au XIe sicle, des traits logiques de Boce. Cette numration nous montre les troites limites de lhorizon intellectuel en un temps o la culture ne reposait que sur les livres, qui taient si rares. Aussi nous ne possdons gure de cette poque que des gloses marginales et des commentaires (la plupart non publis) aux crits de Boce ou de Marcianus Capella. Dans cette ducation, en dehors de la doctrine chrtienne, la dialectique prend peu prs toute la place. ric dAuxerre (mort en 876), Rmy dAuxerre qui enseigne Chartres vers 862, Bovo de Saxe, au dbut du Xe sicle, Gerbert dAurillac devenu pape (999-1003) sous le nom de Silvestre II, Fulbert, son lve qui ouvrt cole Chartres en 990 sont les principaux auteurs de ces commentaires. Un document du XIe sicle nous a conserv dans
1
L. MAITRE, Les coles piscopales et monastiques de lOccident depuis Charlemagne jusqu Philippe Auguste, surtout p. 278 sq., Paris, 1866.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
374
leur ordre les matires de lenseignement de la dialectique Chartres 1. On y tudiait successivement : lIsagoge de Porphyre, les Catgories dAristote, les Catgories de saint Augustin (avec la prface dAlcuin), les Dfinitions de Boce, les Topiques de Cicron, les Perihermeneias dAristote et dApule, les Diffrences topiques de Boce, des compositions anonymes sur la rhtorique, les Divisions de Boce, le trait. de Gerbert de ratione uti et rationali ; enfin les Syllogismes catgoriques et les Syllogismes hypothtiques de Boce. On voit combien une pareille ducation, prolonge pendant des annes, pouvait rompre la discussion. Mais tout autre art que la dialectique semblerait presque oubli, si lon ne pouvait citer la Gomtrie de Gerbert vers 983, qui, dans ses mthodes de mesure, parat trahir linfluence des mathmaticiens arabes 2. Mais la dialectique rgne en matresse, et elle donne lesprit ce got de la discussion, des distinctions et des divisions sans fin, qui va dominer toute la philosophie mdivale.
II. LA CONTROVERSE DE BRENGER DE TOURS.
@ Mais ce qui intresse lhistoire de la philosophie, cest moins la dialectique comme art de la discussion que lusage que lon tente den faire pour arriver une conception du rel. Pour prciser, rappelons que la collection de Boce posait plusieurs problmes, proprement mtaphysiques, dabord le problme de la ralit des universaux dans le clbre texte de Porphyre ; ensuite (ainsi que saint Augustin) le problme, non moins clbre au Moyen ge de la limite dapplications des catgories (cf. p. 529) ; les dix catgories ou genres de ltre ne sappliquent quau monde sensible ; la dialectique, qui nopre quavec des genres et des espces subordonns aux catgories, ne peut, donc, elle non plus, atteindre une ralit suprieure. Mais il sagit alors de savoir comment on pourra parler de cette ralit. Ajoutons enfin que les commentaires de Boce livraient quelques-unes des notions techniques de la philosophie dAristote, par exemple celle de forme et de matire, celle dacte et de puissance.
p.551
Il y a l tout autre chose quun simple art de la discussion. On sen aperoit dj dans lEpistola de nihilo et tenebris, de Frdgise, petit trait dailleurs assez sot et naf , comme le dit Prantl, lhistorien de la logique ; lauteur lve dAlcuin soutient que le nant (nihil) existe ; car dire quil est nant, cela implique quil est.
1 2
Cit par A. CLERVAL, Les coles de Chartres au Moyen ge, p. 117, Paris, 1895. WRSCHMIDT, Geodtische Messinstrumente und Messmethoden bei Gerbert und bei den Arabern, Archiv der Mathematik und Physik, p. 315, 1912.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
375
Le petit trait de Gerbert de Rationali et rationalibus uti est autrement instructif que ce grossier ralisme. Porphyre dit au chapitre VII de lIsagoge : Raisonnable tant la diffrence spcifique, user de la raison se dit de cette diffrence ; et il se dit aussi de toutes les espces dtres subordonnes cette diffrence. On objectait Porphyre la rgle logique qui veut que le prdicat ait une extension suprieure ou au plus gale celle du sujet : rgle qui est ici viole puisque le terme p.552 raisonnable tant une puissance dont user de la raison est lacte, le sujet aurait plus dextension que son prdicat. Gerbert rpond en distinguant les prdicats qui font partie de lessence du sujet comme raisonnable est partie de lessence de lhomme, et les prdicats accidentels, comme user de la raison, quand il se dit de raisonnable : la rgle indique ne vaut que pour les prdicats du premier genre. Cest cette distinction tranche des attributs essentiels et accidentels que permet de poser nettement le problme des universaux : car les universaux, dont on se demande sils sont rels, ce sont uniquement les genres et les espces, animal, homme, qui sont des attributs essentiels dun individu comme Socrate. Sur ce point, les commentateurs de Boce, comme le pseudo Rhaban Maur (dont on saccorde placer le Super Porphyrium dans la premire moiti du XIe sicle), suivaient les indications que lon trouve chez le matre, et qui proviennent dAristote ; ils rptaient ce quavaient dit Boce et aussi Simplicius, que les Catgories, tude des attributs, ne peuvent se rapporter aux choses (puisque res non praedicatur), mais seulement aux mots en tant quils signifient les choses. Do la solution, toute imprgne dAristote, du problme des universaux : le genre et lespce nexistent qu titre de prdicats essentiels lindividu. Individus, espce et genre, cest la mme ralit (eadem res), et les universaux ne sont point, comme on le dit parfois, chose diffrente des individus. Et lon entend comme un cho de la pense dAristote, par lintermdiaire de Boce, dans ces paroles que le genre est lespce, et lespce lindividu, comme une matire une forme. La controverse sur lEucharistie, qui eut lieu au milieu du XIe sicle, met aussi en jeu la porte de la dialectique. Paschase Radbert (mort vers 860) avait enseign que, dans la conscration, par la vertu de lEsprit, de la substance du pain et du vin se font le corps et le sang du Christ . Cette thorie de la transsubstantiation impliquait dabord un Dieu p.553 tout-puissant dont la volont nest tenue par aucune rgle naturelle, en second lieu une radicale indpendance de ce que les yeux peroivent par les sens, et lintelligence par la foi, puisque dans lespce visible est saisi par lintelligence autre chose que ce qui est senti par la vue et par le got . Brenger de Tours ne songe nullement nier que lEucharistie soit un sacrement, au sens que saint Augustin donne ce mot, cest--dire un signe sacr qui nous fait aller au-del de lapparence sensible jusqu une ralit intelligible ; et il faudrait se garder de faire de lui un rationaliste, ngateur de la foi. Mais, imbu de lenseignement dialectique de Fulbert de Chartres, il ne peut arriver penser la transsubstantiation ; elle implique que lon affirme et que lon nie la fois que
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
376
le pain et le vin sont sur lautel aprs la conscration ; or, une affirmation ne peut tre maintenue tout entire, si on en supprime une partie 1 La question est implicitement pose : avons-nous le droit de nous contredire, en formulant les dogmes ? Les nombreuses rfutations que sattira Brenger souffrent toutes de la mme ambigut. Dune part on lui dit que la dialectique ni la philosophie nont rien voir dans ltablissement dun dogme. Mais, dautre part, on sefforce de lui montrer quil ny a pas de relle contradiction affirmer la transsubstantiation. La lettre de son condisciple de Chartres, Adelmann de Lige, est caractristique de la premire manire : elle serait citer tout entire pour son pret contre la philosophie : Certains gentils et nobles philosophes ont eu bien des opinions fausses et mprises bon droit non seulement sur Dieu le crateur, mais sur le monde et ce qui est en lui. Quoi de plus absurde que daffirmer que le ciel et les astres sont immobiles et que la terre tourne sur elle-mme dun mouvement de rotation rapide et que ceux qui croient au mouvement du ciel se trompent comme les marins qui voient sloigner deux les tours p.554 et les arbres avec leurs rivages ? 2 Cette vieille opinion dHraclide, que le XIe sicle connaissait par le Commentaire de Time de Chalcidius, est mise dailleurs par lui sur le mme pied que lopinion de ceux qui croient que le soleil nest pas chaud, et que la neige est noire . A plus forte raison, en matire de dogme, ni les sens ni lintelligence ne peuvent nous permettre de saisir ce que lon ne saisit que par une vertu issue de la grce, par la foi. Alger de Lige, qui crit vers la fin de la controverse, se place, lui aussi, au point de vue de lautorit : la question doit tre rsolue non par la raison humaine, tout fait incomptente, mais par les tmoignages du Christ mme lgard de ses saints . Et il explique le rapport de la raison la foi par la comparaison suivante : notre intellect est, lgard de Dieu, comme nos sens lgard de lintelligence ou comme chaque sens 1"gard de chaque autre, cest--dire incapable de comprendre, mais tenu de croire ce quil ne comprend pas. On ne peut gure affirmer dune manire plus radicale la discontinuit foncire de lesprit. Et pourtant le mme Alger, la fin de son trait, veut montrer quil ny a pas de contradiction dans la transsubstantiation ; ce nest pas sous le mme rapport quon affirme sur lautel la prsence du pain et celle du corps du Christ. Quant lapparence et la forme des lments, cest du pain et du vin ; quant la substance en laquelle se sont changs le pain et le vin, cest vraiment et proprement le corps du Christ 3 . De la mme manire enfin, Lanfranc, abb du Bec, tout en reprochant Brenger davoir abandonn les autorits sacres et recouru la seule dialectique , tout en dclarant quil prfrerait trancher le dbat par la seule
1 2
Expos de Lanfranc, MIGNE, CL, p. 416 d. Dans HEURTEVENT, Durand de Troarn, p. 290. 3 MIGNE, Patrologie latine, CLXXP. 740 r. d. tt 753 d.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
377
autorit et que en traitant des choses divines, il ne dsire ni proposer des questions dialectiques ni rpondre de pareilles questions , nen veut pas moins lui montrer les fautes quil a commises contre les rgles p.555 de la discussion . Et bien quil le blme de mettre la nature avant la puissance divine, comme si Dieu ne pouvait changer la nature de nimporte quoi 1 , il nen est pas moins vrai quil ne peut admettre quil y ait, dans le dogme, rien qui contredise la dialectique. Ainsi, tandis quon rgle la question par la runion de synodes qui disent la foi (synodes de Rome et de Verceil, en 1050, qui condamnent Branger ; synodes de Rome de 1059 et de 1079, ou il est contraint labjuration), on nen cherche pas moins penser effectivement le dogme selon les rgles de la raison commune.
III. CRITIQUE DE LA PHILOSOPHIE A LA FIN DU XIe SICLE
@ Avec la rforme des ordres monastiques et le mouvement vers lasctisme qui caractrisent la fin du XIe sicle (la foi vive aboutit la croisade de 1095), on sentit le besoin de limiter dune manire plus prcise le rle de ces disciplines profanes. Pierre Damien (1007-1072), cardinal archevque dOstie en 1057, qui seffora toujours de fuir les honneurs dans la solitude dun ermitage, est un de ces rformateurs qui proclament la totale incomptence de la dialectique en matire de foi. Il dclare que la dialectique ne doit pas se saisir arrogamment du droit du matre, mais quelle doit tre comme la servante dune matresse (ancilla dominae). A quelle occasion cette condamnation ? Il sagit du fameux argument dialectique (dont les Mgariques sont les auteurs), qui dmontrait le destin et limpossibilit des futurs contingents au moyen du principe de contradiction : ainsi lon voyait la toute-puissance et la libert en Dieu, le fondement mme de la foi, supprimes par une rgle de logique. Pierre Damien rappelle avec un bon sens parfait, que ces rgles ont t inventes pour servir aux p.556 syllogismes, et qu elles ne se rapportent pas lessence et la matire de la ralit, mais lordre dans la discussion 2. Ctait revenir, par un sr instinct, la doctrine dAristote, qui avait dclar prmisses et dfinitions indmontrables (p. 183) ; tant quon navait pas dautre mthode de penser que la syllogistique, il tait bon de la rduire au rang dun simple organon et de ne pas vouloir en faire linstrument de la connaissance du rel. Seulement, ct de la dialectique, quil tait relativement ais de rduire son rle dorganon, les livres profanes et en particulier le Commentaire du Songe de Scipion de Macrobe faisaient connatre des doctrines sur Dieu et sur le monde, qui taient directement opposes la doctrine chrtienne : on y
1 2
MIGNE, CL, p. 419 c. De divina omnipotentia, chap. V (MIGNE, CXLV, p. 604) ; cf. ci-dessus p. 267.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
378
lisait les spculations de Pythagore sur la transmigration des mes, de Platon sur la fabrication de lme du monde, sans compter la discussion entre Platoniciens et Aristotliciens, do il ressortait que limmortalit de lme impliquait sa divinit. On y voyait affirmer quil y avait sur la terre des rgions habites et inaccessibles, do il fallait conclure que Jsus navait pas sauv tous les hommes. Il y avait l tout autre chose que de la dialectique, une conception du monde o le salut par le Christ ne jouait aucun rle ; cest contre ces adversaires que se tourna Manegold de Lautenbach (mort en 1103 dans un monastre dAlsace) ; contre les lecteurs trop assidus de ces philosophes dangereux, il dclare quils sont sous linspiration diabolique 1. En thorie, rien de plus facile quun pareil dpart : en pratique rien de plus difficile. La thologie employait des mots tels que substantia, dont elle tait bien force daller demander la dfinition aux Catgories dAristote : Manegold lui-mme, admettant la parent de certaines doctrines philosophiques avec la foi, acceptait la division plotinienne des vertus en politiques, purifiantes et purifies quil trouvait chez Macrobe. Il y a donc p.557 au total, au XIe sicle, une vritable incapacit et de se passer de la philosophie profane et de dterminer les limites de son usage.
IV. SAINT ANSELME
@ Cest ce qui fait le grand intrt de la pense de saint Anselme dAoste (1033-1109) qui, reprenant la tradition augustinienne, seffora, dans lenseignement dont il fut aprs Lanfranc qui il succda, linspirateur labbaye du Bec, avant de devenir en 1093 archevque de Cantorbery, dinstituer un quilibre plus stable entre la foi et la raison. La pense dAnselme est fort claire : les critures et lglise imposent notre foi des dogmes, comme ceux de lexistence de Dieu et de lincarnation ; lhomme ne peut y accder que par lautorit, et la raison ne peut nous y conduire. Mais quand la foi existe, lhomme a par surcrot une tendance penser les dogmes, en chercher les motifs. Comme le dit Isae (7, 9), si vous ne croyez pas. vous ne comprendrez pas . Mais dautre part, notre foi cherche comprendre (fides quaerens intellectum) : lintelligence que nous pouvons ainsi acqurir des dogmes en procdant par le raisonnement est comme un intermdiaire entre la foi pure et la vision directe que les lus auront de la ralit divine. Lattitude de saint Anselme est elle-mme intermdiaire entre un fidisme qui se refuse tout exercice normal de la raison, et un mysticisme qui introduit ds cette vie la vision batifique. Il est clair que saint Anselme, par la force de son gnie et par sa mditation des uvres de saint Augustin, retrouve ici quelque chose de la
1
Contra Wolfelmum, MIGNE, CLV, p. 147-176.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
379
dialectique platonicienne : le mouvement qui mne de la foi lintelligence et de lintelligence la vision est bien parent de cette dialectique (p. 113) qui mne de la croyance la rflexion discursive et de celle-ci lintuition intellectuelle ; seulement la croyance est devenue la foi, cest--dire une vertu thologale qui ne vient en lhomme que par la grce de Dieu, p.558 et un ensemble de dogmes do dpend le salut de lhomme ; de plus, lintuition intellectuelle est devenue la vision batifique, qui est accorde aux lus par la grce de Dieu. Lhomme est incapable et de prendre linitiative et datteindre la fin : lintellectus reoit du dehors, de la foi, ce quil a comprendre. Mais part ce donn, il nexige autre chose que la subtilit dialectique quAnselme sefforait de faire acqurir ses lves par des exercices tels que ceux du De Grammatico ; mais, spar de la foi, le raisonnement le plus probant natteint pas la certitude ; il dit seulement ce qui me parat . Il faut ajouter que luvre de saint Anselme est domine par un souci pratique, qui convient au prince de lglise ; en montrant par des raisonnements la ncessit de lincarnation par exemple, il veut rpondre aux objections des infidles qui disent que la foi chrtienne rpugne la raison. De l la forme particulire de ses uvres, quil a bien indique lui-mme au dbut du Monologium : rien de ce quil dit ne doit tre fond sur lautorit de lcriture ; il faut crire en style clair, nemployer que des arguments vulgaires, sen tenir une discussion simple, o tout est fond sur la ncessit de la raison et la clart de la vrit . Ctait saffranchir entirement des habitudes littraires de lpoque et de la servitude de commenter lcriture. Et lon voit par l que, avec quelque prcaution quil faille prendre le rationalisme de saint Anselme, il nen est pas moins vrai quil sest efforc de voir ce que la raison pouvait produire par ses propres forces. Bien entendu sur des matires purement thologiques. Le Monologium et le Prosologium, crits dans cet ordre de 1070 1078, traitent, lun de la nature de Dieu, lautre de son existence ; le De Veritate, qui est postrieur, a pour sujet lunit radicale de toutes les vrits en Dieu ; le Cur Deus Homo, achev en 1098, parle des motifs de lincarnation. Il sagit de montrer que la raison peut avoir un bon usage, quelle peut servir au salut et la conversion des infidles ; il ne sagit p.559 en rien du dveloppement autonome et pour soi de la raison. Pourtant sa mthode mme (et tout fait indpendamment du but quil veut attendre) implique, sur la nature de la raison, des conclusions de porte universelle, indpendantes de la matire quil traite. Dans le Monologium dabord, il retrouve la mthode platonicienne qui conclut, pour chaque catgorie de choses semblables perues par les sens et la raison, lexistence dun modle auquel elles participent toutes, en tant que semblables. Toute luvre pourrait porter pour pigraphe le thorme fondamental des Elments de thologie de Proclus (cf. p. 477) : Un terme prsent tous les termes dune srie ne doit tre ni en lun deux ni en eux tous, mais avant eux. De mme saint Anselme voit que les choses bonnes sont telles par une essence
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
380
commune, le bien, qui est bon par lui-mme et qui est donc souverainement bon. On arrive ainsi, pour chaque catgorie de qualits qui comportent dans lexprience des degrs en plus et en moins, un souverainement grand par lequel les choses sont grandes, un tre absolu par lequel elles sont, un souverainement juste par lequel il y a des choses justes. On dmontre que cest la mme ralit qui est dsigne par ces termes, puisquil ne peut y avoir quune seule nature suprme. Ainsi la dialectique mne de la multiplicit imparfaite une ralit unique et parfaite, du per aliud au per se. De plus cet tre par soi, sil existe, existe de lui-mme (ex se) ; car sil avait une cause, il serait infrieur cette cause. Enfin lunivers vient de lui et il la cr ou produit de rien, mais dune manire raisonnable, ce qui serait impossible sil ny avait pas dans sa pense quelque chose comme un exemplaire de la chose faire, ou, comme lon dit mieux, une forme, une ressemblance ou une rgle ; cest le Verbe de Dieu qui lui est identique : toutes les choses cres sont dans le Verbe, comme luvre existe dans lart, non seulement quand elle est produite. mais avant son existence et aprs sa disparition. Il est ais de dmler dans la pense du Monologium deux p.560 lments qui narrivent point se pntrer : dune part la dialectique platonicienne qui est une mthode gnrale consistant procder du sensible lintelligible, de la diversit lunit, du per aliud au per se ; dautre part une transformation de cette mthode en une mtaphysique religieuse, en suite de quoi ltre per se est dfini comme le Dieu crateur ex nihilo de la Gense, et le monde intelligible comme son Verbe. Confusion qui sexplique certes par le Time lui-mme, avec son dmiurge et son exemplaire, et par tous ceux qui, depuis Philon jusqu saint Augustin, lont propage, mais qui ne se justifie en aucune manire. Le Monologium avait dtermin ce que la raison sait de Dieu, sil existe. Le Proslogium (chap. II et III) dmontre son existence par un unique argument, qui a immortalis le nom de saint Anselme. Voici la page : Nous croyons que tu es quelque chose de tel que rien de plus grand ne peut tre pens (quo nihil majus cogitari possit). Est-ce quune telle nature nexiste pas, parce que linsens a dit en son cur : Dieu nest pas ? Mais du moins cet insens, en entendant ce que je dis : quelque chose de tel que rien de plus grand ne peut tre pens, comprend ce quil entend ; et ce quil comprend est dans son intelligence, mme sil ne comprend pas que cette chose existe. Autre chose est tre dans lintelligence, autre chose exister... Et certes ltre qui est tel que rien de plus grand ne peut tre pens ne peut tre dans la seule intelligence ; mme, en effet, sil est dans la seule intelligence, on peut imaginer un tre comme lui qui existe aussi dans la ralit et qui est donc plus grand que lui. Si donc il tait dans la seule intelligence, ltre qui est tel que rien de plus grand ne puisse tre pens serait tel que quelque chose de plus grand pt tre pens .
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
381
Cette preuve, loin de partir de la mditation de la providence visible travers la nature, part de la mditation sur Dieu, telle que saint Augustin en avait donn le modle 1 : Nulle p.561 me, avait-il dit, na jamais pu ni ne pourra jamais penser rien de meilleur que toi... et si tu ntais incorruptible, je pourrais atteindre par la pense quelque chose de meilleur que mon Dieu. Le mouvement de pense est le mme : on peut srement attribuer Dieu ce quon ne peut en nier sans diminuer sa perfection. Dieu et les choses qui sont de Dieu sont en tout le meilleur , avait dj dit Platon 2. Et ctait l le principe de toute spculation rationnelle sur Dieu. Mais nulle part, on navait song faire de lexistence un attribut quon ne peut lui refuser en raison de sa grandeur et de limmensit de sa perfection. Chez les philosophes, lexistence de Dieu tait implicitement admise parce que, seule, elle pouvait en quelque sorte boucler leur image de lunivers : plus de mouvement ternel des cieux, sans le premier moteur dAristote : plus de rationalit parfaite des choses sans un logos qui pntre lunivers chez les Stociens. Dans le christianisme, lexistence de Dieu est suppose par le drame qui doit aboutir au salut de lhomme, et elle est, comme toutes les autres, une vrit rvle. Or saint Anselme qui ne pense point Dieu en fonction dun ordre cosmique qui il est indispensable et qui ne veut pas par hypothse user de la rvlation, na plus quune seule issue : cest de prouver lexistence par la mme mthode de mditation qui lui avait permis de le penser. Ce nest pas, on la dit avec grande raison 3, une preuve ontologique qui va de lessence lexistence : car lessence de Dieu nous est inconnue ; donc la preuve part non pas de lessence de Dieu, mais de la notion de Dieu telle quelle est dans notre entendement, et telle quelle ne se dcouvre qu une mditation assidue ; cest cette notion qui, si loin quelle soit de lessence relle, nous permet de conclure lexistence de son objet. Toutes ces dmarches impliquent quon affirme comme possible une mditation de ce genre, qui consiste prendre une p.562 conscience de plus en plus claire dune notion de Dieu, qui est dans notre entendement : affirmation quil faut prendre la fin du XIe sicle comme dune trs grande hardiesse ; car ctait dire que lon peut mditer sur Dieu, part lenseignement que donne lglise. Largumentation que Gaunilon, le prieur de Marmoutiers, oppose la preuve de saint Anselme au nom de linsens, est toute fonde sur cette apprhension, et cest en vrit toute la mthode thologique de saint Anselme quil attaque : La ralit mme, qui est Dieu, je ne la connais pas, je ne puis mme la conjecturer de rien qui lui soit semblable, et dailleurs vous assurez vous-mme quelle est telle que rien ne peut lui tre semblable. Cest le point de dpart dAnselme, lesse in intellectu de Dieu, que conteste Gaunilo : nayant aucune notion de Dieu, nous ne pouvons lgitimement rien affirmer ni nier de lui. La conclusion implicite, cest quil ny a pas en
1 2
Daprs DRAESKE, Revue de philosophie, p. 639, 1909. Rpublique, 381 b. 3 KOYR, p. 201, note 1.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
382
thologie dautre mthode que lautorit et la rvlation : cest lcroulement du rle de lintellectus, tel que la mthode dAnselme lavait fix entre la foi et la vision des lus. De cette mthode, saint Anselme donne une nouvelle application dans le De Veritate ; comme dans le Monologium, il y dpeint dans un cas particulier le mouvement qui nous porte de la multiplicit lunit. Il part ici de la multiplicit des vrits, qui sont vrits des nonciations, vrits des opinions, vrits de la volont (cest--dire lintention droite), vrits des actions (ou actions droites), vrits des sens, vrits des essences. Cette numration, elle seule, montre comment le problme de la vrit apparat Anselme : le vrai nappartient pas seulement au jugement ; il peut se dire aussi de la volont, des sens et des essences. Le caractre commun de toutes ces vrits, cest la conformit une certaine rgle ou la rectitude : une nonciation verbale est faite pour signifier ce qui est, et elle est vraie lorsquelle signifie effectivement ce quelle est faite pour signifier ; il en est de mme dune opinion ; la volont sera vraie lorsquelle se dirigera dans le sens o elle p.563 le doit ; et de mme les actions, les sens, pris en eux-mmes, seront toujours vrais, parce que le sens fait toujours ce quil doit ; enfin les essences sont vraies, en ce sens que les choses ont toujours lessence que Dieu a voulu quelles aient, et sont ce quelle doivent tre. La notion de vrit se rfre donc, dans tous les cas, une rgle suprme ternellement subsistante, vrit qui nest pas rectitude parce quelle doit tre quelque chose mais parce quelle est, et laquelle se rduisent toutes les autres. Impossible dexprimer plus nettement ce rationalisme thocentrique, que nous avons vu natre avec le stocisme et le noplatonisme, o la raison, transcendante aux vrits particulires, nest point la mthode immanente qui les dcouvre, mais la ralit minente et unique dont elles sont comme les aspects. Il est visible dans ce trait, comme dans toute luvre de saint Anselme, que le contraste entre foi et intellect cest avant tout le contraste entre deux manires de prsenter le thocentrisme, dune part le Dieu chrtien du salut, dautre part le monde intelligible et transcendant du noplatonisme. : lun tout autant que lautre fait tendre la raison humaine vers une rgion o son exercice normal est impossible, et o elle doit se convertir en vision. Mais lon se rappelle la divergence profonde quil y a entre ces deux thocentrismes : dune part le drame divin du christianisme avec son univers discontinu, dont les vnements, cration, pch, rdemption sont dus des initiatives imprvisibles dtre libre ; dautre part, un univers dun seul tenant, sans histoire, dont lordre est ternel et invariable ; divergence en particulier visible dans lincarnation qui lie deux natures, la divine et lhumaine, que le platonisme spare, et qui introduit dans lunivers une loi radicalement nouvelle. Or, dans le Cur Deus homo, saint Anselme applique sa mthode du fides quaerens intellectum au dogme mme de lincarnation ; il veut faire voir le caractre ncessaire et rationnel de la mort du Christ ; ne st-on rien de la mort de Jsus, la raison doit p.564 confesser que les hommes ne peuvent tre
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
383
heureux que si un homme-dieu apparat et meurt pour eux ; car seul un dieu peut donner satisfaction pour un pch qui a offens la majest divine. Certes Anselme, on le voit, ne rduit pas la vrit chrtienne une phase ncessaire dun ordre ternel ; il y introduit cependant, une fois le pch suppos, une sorte de ncessit rationnelle qui loriente vers la vision platonicienne des choses.
V. ROSCELIN DE COMPIGNE
@ Si diffrent quil soit du christianisme, le platonisme dut pourtant paratre Anselme li dune manire ncessaire au dogme de la Trinit, lorsquil vit les consquences de la doctrine de Roscelin de Compigne. Les vues de Roscelin, que lon rsume sous ltiquette de nominalisme, vues qui ne sont connues que par quelques rares extraits de ses contradicteurs (Anselme et Ablard), paraissent tre nes de la logique de Boce. Celui-ci, on sen souvient, soutenait avec Simplicius, que les Catgories dAristote et toute la dialectique qui en est issue avaient affaire non aux choses mais aux mots en tant quils signifient les choses, et lIsagoge ntait que la classification des cinq voix ou termes par lesquels on les exprime. Roscelin na pas dit autre chose : toutes les distinctions quapporte la dialectique entre genre et espce, substance et qualit, ne sont que des distinctions verbales, dues au discours humain ; mais il a ajout que la seule distinction fonde en ralit tait celle des substances individuelles. Cest bien ce quen dit Anselme dans le passage o il rsume en trois articles la doctrine des dialecticiens 1 : Les substances universelles ne sont quun souffle de voix ; la couleur nest autre chose que le corps color ; la sagesse de lhomme nest rien que son me. p.565 Roscelin veut dire que cest seulement par le langage que nous pouvons sparer lhomme de Socrate, le blanc du corps blanc et la sagesse de lme, mais que lhomme dont nous parlons est en ralit Socrate, le blanc est un corps blanc, et la sagesse une me sage. Ce nest pas seulement la division des choses daprs les voix et les catgories, cest mme la division dun corps en parties corporelles, qui daprs Ablard parat Roscelin tout fait arbitraire et conventionnelle ; tout corps, telle une maison, est indivisible : dire quelle est compose en ralit des fondations, des murailles et du toit, cest considrer une de ses parties, le toit, par exemple, la fois comme une partie dun tout, et comme une chose distincte dans une numration de trois choses 2. Roscelin parat donc avoir eu le sentiment (et cest l le sens du nominalisme) que toutes les distinctions faites par le dialecticien nexistaient que dans le langage et non dans les choses. Dautre part lon sait quil a t condamn au concile de Soissons (1092) abjurer son opinion sur la Trinit.
1 2
MIGNE, Patrologie latine, CLVIII, p. 265 a. COUSIN, uvres indites dAblard, p. 471.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
384
Il avait, semble-t-il, tir toutes les consquences de lopinion de Boce daprs qui le mot personne dsigne une substance raisonnable ; il y a ds lors en Dieu autant de substances que de personnes (trithisme) ; le Pre et le Fils, lengendrant et lengendr, sont deux ralits distinctes ; les trois personnes sont spares comme le seraient trois anges, et sil y a unit entre elles, ce nest quune unit de volont et de pouvoir. Entre cette opinion et le nominalisme, quel rapport y a-t-il ? Saint Anselme nous lexplique clairement, quand il parle de ces dialecticiens dont lesprit est si engag dans les images corporelles quil ne peut sen dgager ; si lon ne peut comprendre comment plusieurs personnes sont spcifiquement un seul homme, comment comprendre comment plusieurs personnes sont un seul Dieu ? Si lon ne peut distinguer entre un cheval et sa couleur, p.566 comment distinguer entre Dieu et ses multiples relations ? Si lon ne peut distinguer lhomme individuel de la personne, comment comprendre que lhomme assum par le Christ nest pas une personne ? . Daprs ce texte dcisif, le trithisme ntait quune des erreurs de Roscelin : son nominalisme tait un principe subversif de toute thologie, parce quil distinguait l o il ne fallait pas, et ne distinguait pas l o il fallait ; il voyait dans la Trinit trois substances individuelles distinctes ; en revanche (et cest le second point vis par Anselme), il ne voulait point distinguer les attributs de Dieu (bont, puissance, etc.) de sa substance, pas plus que (cest le troisime point) il ne pouvait distinguer la personne divine incarne en Jsus de son humanit. Il y a, chez ce clerc de Compigne, un besoin de voir clair, qui ne se satisfait pas des rsidus daristotlisme et de platonisme. Cest l, on la dit avec raison, plus quune question dcole ; si les universaux sont des ralits, le thologien na pas seulement affaire aux formules mais aux choses mmes 1. Bibliographie
SEEBERG, cit par GRABMANN, Geschichte der scholastischen Methode, p. 311
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
385
CHAPITRE III LE XIIe SICLE
@ XIIe sicle est un sicle de pense ardente et varie, tumultueuse et confuse aussi : dune part un besoin de systmatisation et dunit qui donne naissance ces sortes dencyclopdies thologiques que sont les livres des Sentences ; dautre part une grande curiosit desprit qui se traduit en certains milieux par un retour lhumanisme antique et par une attention nouvelle aux sciences du quadrivium. Ajoutons que lantiquit se dvoile peu peu par des traductions dauteurs jusque l inconnus et que les bibliothques senrichissent. Il semble que lon peut dmler quatre directions desprit principales, qui se manifestent en des milieux diffrents : les thologiens auteurs de Sentences qui rassemblent et unifient la tradition chrtienne ; les platoniciens de lcole de Chartres, qui sont de vritables humanistes ; les mystiques du clotre de Saint-Victor ; enfin un mouvement panthiste et naturaliste qui ne va pas sans inquiter le pouvoir spirituel. Mais il y a aussi les indpendants qui ne se laissent ranger en aucune catgorie, surtout Ablard, dont lintelligence, complexe et sensible, reflte toutes les passions de son poque.
p.568 Le
I. LES SENTENTIAIRES
@ Le XIIe sicle est lpoque de ces grandes encyclopdies thologiques, o lon essaye de runir en un seul corps comme dit Yves de Chartres tout ce qui a trait la vie chrtienne, p.569 discipline, foi et murs. Nulle proccupation philosophique en tout cela : mais la ncessit pratique, pour que la chrtient garde son unit spirituelle, de runir tant de donnes parses : canons, dcrets et dcrtales, opinions des Pres, rgles de morale pratique et de vie religieuse : tout cela daspect souvent contradictoire et quil sagissait pourtant dunifier. Les besoins auxquels correspondent ces productions sont de mme ordre que ceux auxquels correspondent nos codes, besoin pratique et juridique bien plus que philosophique. Le travail auquel on se livre est donc dordre philologique et critique ; Bernold de Constance indique, en chaque point, les autorits en apparence contradictoires, et, comme autrefois Vincent de Lrins, donne des rgles pour les concilier ou choisir entre elles. Yves de Chartres (mort en 1116) donne, en son Decretum en dix-sept livres, un miroir (speculum) des doctrines de la foi et des rgles des murs. De la mme poque date le Speculum universale de Radulfus Ardens, qui est comme une
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
386
histoire de lhomme chrtien, o lon trouve, ct de lenseignement spcifiquement chrtien, tout ce qui pouvait rester de la morale humaniste de lantiquit : avant la rvlation du salut par le Christ (l. II), il explique les concepts moraux fondamentaux de bien et de vertu (l. I) ; avant dexposer la foi et les sacrements (l. VII et VIII), il dveloppe les penses humaines sur la vertu et le vice (l. VI) ; avant de traiter des vertus thologales, il parle de vertus cardinales : juxtaposition des vrits chrtiennes et dune morale humaniste quil essaye navement dintgrer la foi. trouve-t-il par exemple la classification antique des sciences (transmise par Isidore ou Bde) en thorique, thique, logique, quoi sajoute la mcanique, il sempresse de remarquer pieusement que ces quatre sciences sont quatre moyens contre les quatre dfauts issus du pch originel, ignorance, injustice, erreur, faiblesse corporelle. Cette codification du christianisme a donn lieu une suite douvrages que lon peut suivre tout le long du XIIe sicle : les p.570 Questions ou Sentences dAnselme de Laon (mort en 1117) les Sentences de Guillaume de Champeaux (1070-1121), celles de Robert Pullus (mort en 1150), de Robert de Melun (mort en 1167, et surtout celles de Pierre le Lombard, le Matre des sentences (mort en 1164), qui bientt, aprs sa mort, servaient dj de textes dexplication Pierre Comestor (mort en 1176) et Pierre de Poitiers (mort en 1205) ; leur tude devait tre au sicle suivant le fondement de tout enseignement thologique. Le Sic et non dAblard, qui fut un des matres du Lombard, appartient au mme genre littraire, puisque sur chacun des points de la foi chrtienne, il rassemble les opinions des Pres en les groupant en deux classes, celles qui disent le oui, et celles qui disent le non. Ablard ne voulait certes pas en tirer de conclusion sceptique, mais seulement provoquer les lecteurs sexercer davantage la recherche de la vrit et les rendre plus subtils par cette recherche 1 ; et il commenait dailleurs par donner des rgles pour concilier les opinions. Ces ouvrages supposent naturellement, on le voit, le travail rationnel sans lequel toute codification est impossible : pour le fond des choses, rien que lautorit ; mais pour tablir le sens et la valeur dune autorit, discussion raisonne ; sur chacun des paragraphes dont se composent les distinctions ou chapitres de son livre, Pierre Lombard oppose textes aux textes, le pro et le contra, et il choisit, non point par des citations, mais en discutant. Ainsi stablit la mthode dite scolastique, mthode dialectique qui est faite pour juger ou prouver les opinions, non point pour inventer : lesprit subtil est non pas celui qui dcouvre une nouvelle vrit, mais celui qui saisit une concordance ou une contradiction entre des opinions ; seule mthode intellectuelle possible en un domaine o la vrit est considre comme dj donne.
MIGNE ; Patrologie latine, CLXXVIII, p. 1349 a.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
387
Un autre point important, cest la distribution des matires dans luvre dAblard et du Lombard ; la substructure en est le rcit du drame chrtien : on tudie successivement Dieu et la Trinit, la Cration, les Anges, lhomme et le pch originel, lIncarnation et la Rdemption, les sacrements et leschatologie. Il y a l comme un schme de lunivers qui sest peu peu impos, qui va maintenant dominer et que nous retrouverons chez bien des philosophes, longtemps aprs le Moyen Age expir. Dabord la peinture de la hirarchie des ralits : Dieu, les anges et lhomme ; puis le drame proprement dit : le pch originel, la rdemption et le retour Dieu des lus : double thme qui comporte bien des variations, mais dont les variations limites, en quelque sorte, sont un platonisme la manire de Scot rigne qui fait du mouvement de descente et de retour vers Dieu une ncessit ternelle, et lorthodoxie dun Lombard ou dun saint Thomas, qui mettent au dbut de chaque acte du drame une initiative tout fait libre et contingente.
p.571
II. LCOLE DE CHARTRES AU XIIe SICLE : BERNARD DE CHARTRES
@ Une espce de thologie philosophique se dveloppe par contre dans lcole de Chartres. Rien de plus mouvant que les efforts faits cette poque dans le milieu chartrain pour tendre lhorizon intellectuel au del de Boce, dIsidore et des Pres. Parmi les initiateurs, il faut dabord citer Constantin lAfricain et Adlard de Bath, tmoins prcieux des relations qui commencent stablir entre lOrient et lOccident. Ds la fin du XIe sicle, Constantin, n Carthage, voyage dans tout lOrient ; il traduit, outre des livres mdicaux des Arabes et des Juifs, les Aphorismes dHippocrate avec le Commentaire de Galien, et deux traits de Galien, Cest dans ces p.572 traductions que lon puise, comme nous le verrons bientt, la connaissance de la physique corpusculaire de Dmocrite. Adlard de Bath qui, au dbut du XIIe sicle, voyage en Grce et en pays arabe, en rapporte surtout des traductions douvrages mathmatiques. Il traduit de larabe les lments dEuclide, et fait connatre, outre des ouvrages astronomiques, larithmtique dAlchwarismi. Voil qui augmentait singulirement le quadrivium. En mme temps que mathmaticien, Adlard est platonicien de tendance ; et son platonisme vient non pas de saint Augustin, mais directement du Time, de Chalcidius et de Macrobe. Il a crit son petit trait De Eodem et Diverso pour justifier la philosophie ; lon y voit, selon le poncif de Boce et de Marcianus Capella, Philosophia, accompagne des sept arts, discuter contre Philocalia. Or, la thorie de la connaissance qui y est expose suppose tout le mythe platonicien de la psych : lintelligence, ltat de puret, connat les choses et leurs causes ; dans la prison du corps , cette connaissance est en partie perdue ; alors elle cherche ce quelle a perdu
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
388
et, sa mmoire dfaillant, elle recourt lopinion ; le tumulte des sens (cf. Time, 44 a) qui nous laisse ignorer les choses trs petites et les trs grandes empche la connaissance rationnelle (les minima sont probablement les atomes, dont Adlard acceptait lexistence). Il sensuit quAristote a raison, quand il dit que nous ne pouvons actuellement connatre sans nous aider de limagination ; mais Platon a raison aussi, en affirmant que la connaissance parfaite est la connaissance des formes archtypes des choses, telles quelles sont dans lentendement divin, avant de passer dans les corps ; il y a seulement marche inverse : Platon part des principes, Aristote des choses sensibles et composes. De l sa solution du problme des universaux : la distinction entre genre, espce et individu, par exemple entre animal, homme et Socrate, na de signification que dans les choses sensibles ; ces mots dsignent la mme essence sous un rapport p.573 diffrent. En considrant les espces, on ne supprime pas les formes individuelles, mais on les oublie parce quelles ne sont pas poses par le nom de lespce. Il en est de mme pour le genre par rapport lespce. Mais il faut se garder de confondre ces universaux, dnomms par le langage, avec les formes archtypes telles quelles sont dans lintelligence divine ; les universaux ne sont, selon Aristote, que les choses sensibles mmes, quoique considres avec plus de pntration ; les formes ne sont plus ni les genres ni les espces qui ne peuvent tre conues que dans leur rapport aux individus ; mais elles sont conues et existent en dehors des choses sensibles, dans lesprit divin . Et il ne sagit pas l dune connaissance assimilable la vision batifique, mais bien dune connaissance humaine et normale, puisque la dialectique a pour but de contempler les ides. Bernard de Chartres qui enseigne Chartres de 1114 1124, parat avoir eu lide fort nette, bien caractristique du milieu chartrain, que le but du savoir nest pas de fixer la connaissance du pass, mais de ltendre. Nous sommes comme des nains sur lpaule des gants ; nous pouvons voir plus et plus loin que les anciens, non grce lacuit de notre vue ou la grandeur de notre corps, mais parce que nous sommes soutenus et levs sur eux comme sur des gants 1. Jean de Salisbury lappelle le plus parfait platonicien de notre temps 2 ; il aurait soutenu que les universaux sont identiques aux ides platoniciennes ; est-ce Bernard que revient aussi le court expos du platonisme qui suit ? Jean y accentue lopposition entre limmutabilit des ides et la mutabilit des choses sensibles, en sinspirant de Snque (Ep. 58, 19 et 22) quil cite formellement et du Time (49 de). Il est en tout cas une chose qui parat certaine. Le frre de Bernard, Thierry, a compos un commentaire de la Gense, o il explique le monde par le concours p.574 de quatre causes : Dieu le Pre comme cause efficiente, les quatre lments comme cause matrielle, le Fils comme cause formelle, le Saint Esprit comme
1 2
Jean DE SALISBURY, Metalogicus, III, 4. Ibid, IV, 35.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
389
cause finale ; il est visible quil y a dans ce passage un effort pour appliquer la thorie aristotlicienne des quatre causes la cosmogonie du Time ; et les formules chrtiennes dissimulent mal les quatre notions platoniciennes de dmiurge, de matire, dordre du monde et de bien (dailleurs Thierry identifie formellement ensuite le Saint-Esprit lme du monde du Time) : or cette interprtation du Time se trouve dans la lettre 65 (8-10) de Snque, qui assimile chacun des principes du monde de Platon une des quatre causes dAristote : mme interprtation dailleurs dans la prface de la pseudo Thologie dAristote, une uvre arabe du IXe sicle dont nous parlons plus loin. Cest encore le Time qui inspire Bernard Silvestris, dans son De Mundi universitate sine Megacosmus et Microcosmus ; vers le milieu du sicle. Un lve de Bernard de Chartres, Guillaume de Conches (mort en 1145) crit un Commentaire du Time et une Philosophia qui est pntre de platonisme. Il est remarquer que, contrairement Ablard qui suit aussi Platon, mais qui le subordonne et veut le faire servir lapologtique chrtienne, les platoniciens de Chartres exposent le platonisme comme une philosophie indpendante, sans essayer aucun rapprochement avec le dogme et non sans apporter une certaine fantaisie dhumaniste et un souci du style qui donne toutes les productions chartraines une saveur bien spciale. Cest par exemple la cosmogonie de Bernard Silvestris, sorte de mystre avant la lettre o lon voit Natura tout en larmes se plaindre Noys, cest--dire la Providence, de la confusion qui rgne dans la matire ; Noys cde ses plaintes et spare les lments lun de lautre (comme au premier livre des Mtamorphoses dOvide) ; puis Noys sadresse Natura en lui promettant de former lhomme pour complter son uvre, tandis que Natura formera le corps de lhomme avec les quatre lments p.575 (cest une adaptation du rcit du Time). En apparence cest la Trinit chrtienne sous un vtement platonicien ; le pre identique au Bien (Tagathon), le Fils au Noys, lEsprit lme du monde ou Endelechia qui mane de Noys ; mais lassimilation est illusoire, puisquil sagit de termes hirarchiss et non de personnes gales, puisque lme du monde informe, encore une autre hypostase infrieure elle, la nature, puisque Noys enfin ne ressemble nullement au Verbe incarn ; mais quil est un monde intelligible, renfermant espce, genre et individus, tout ce quengendreront la matire, les lments et le monde..., toute la srie des destins (fatalis series, cest le terme stocien), la disposition des sicles, les larmes des pauvres et les fortunes des rois 1.
III. ALAIN DE LILLE
@
COUSIN, Ouvrages indits dAblard, p. 628.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
390
La nature, lunit de la nature et des lois naturelles, voil bien en effet ce qui fait peut-tre lessentiel du platonisme chartrain. Un des plus beaux penseurs de la fin du sicle, Alain de Lille (mort en 1203), qui, sans dpendre directement des Chartrains, garde beaucoup de leur esprit, nous reprsente la nature comme une jeune vierge portant une couronne orne de pierres qui symbolise les plantes et vtue dun manteau o est brode toute la varit des tres : ce clerc du XIIe sicle retrouve ainsi la vieille image que Phrcyde de Syros, au VIe sicle avant J.-C., empruntait peut-tre aux Babyloniens. Et cette reprsentation de la nature est lie celle de lhomme microcosme, form des mmes parties que la nature, laquelle nest sans doute pas tranger le trait de Nmsius, De la nature de lhomme, traduit dj par Alfanus en 1058 ; mais Alain de Lille use surtout des p.576 images du Time ; la raison est dans lhomme comme le mouvement de la sphre des toiles fixes, et la sensibilit avec ses varits, comme celui des sphres obliques des plantes ; lme est encore comme une cit divine, o la raison, dans la tte, correspond Dieu et au ciel, lardeur dans le cur, aux anges et lair, la partie infrieure dans les reins, lhomme et la terre. Ainsi domine limage dune vie universelle dont toutes les parties se correspondent par des affinits secrtes 1. Un clerc orthodoxe comme Alain ne peut certes diviniser la nature, et il la soumet Dieu : mais la manire dont il conoit les rapports de Dieu la nature est emprunte la Thologie de Proclus, quil connat par le livre des Causes, traduit de larabe vers le milieu du sicle, et cit ailleurs par lui sous le nom dAphorismes sur lessence du souverain Bien 2 ; lorsquil fait dire la nature : Lopration de Dieu est simple et la mienne est multiple , on ne peut que se rappeler les thories platoniciennes qui ne voient entre les divers niveaux de la ralit que la diffrence dune unit enveloppe une unit dveloppe.
IV. GUILLAUME DE CONCHES
@ Cest la conception mme de la philosophie qui tend se transformer dans les milieux chartrains ; nous en avons un tmoignage dans luvre de Guillaume de Conches (1080-1145), un lve de Bernard de Chartres. Ce qui la caractrise, cest la distinction radicale quil fait entre le trivium et le quadrivium, le trivium (grammaire, dialectique, rhtorique) ntant quune tude prliminaire la philosophie, tandis que le quadrivium (mathmatiques et astronomie) est la premire partie de la philosophie dont la seconde est la thologie. Lopposition des sept arts la thologie tend faire place une p.577 opposition des belles-lettres (eloquentia ou trivium) ltude scientifique et
1 2
De planctu naturae, MIGNE, CCX, p. 431-482. Contra Haereses, I, ch. XXV.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
391
philosophique de la nature 1 : ce qui correspond bien dailleurs la situation de fait que dpeint Guillaume, daprs qui beaucoup de matres voudraient borner lenseignegnement lloquence (Prface). Cest une image nouvelle de la nature qui se dessine : Guillaume essaye dintroduire la physique corpusculaire de Constantin lAfricain. Constantin, traitant en physicien des natures des corps a appel lments, au sens de premiers principes, les parties simples et les plus petites de ces corps ; tandis que les philosophes, traitant de la cration du monde et non des natures des corps particuliers, ont parl de leurs quatre lments qui sont visibles. Mais, limage ordinaire des quatre lments est bonne pour ceux qui, comme des paysans, ignorent lexistence de tout ce qui ne peut tre saisi par les sens 2. Voici donc que lintelligence rclame timidement son rle non plus seulement pour connatre les choses divines, mais pour dterminer la substance de la ralit sensible : on oppose les atomes invisibles aux lments visibles, le mlange mcanique la transmutation. Guillaume trouva devant lui beaucoup de rsistance et en particulier dans le milieu chartrain mme. Lhistoire de cette polmique est aise reconstituer si lon compare la Philosophia de Guillaume (p. 49-55) et le fragment de son commentaire du Time avec les ides que soutenait Gilbert de la Porre (mort en 1154), lui aussi lve de Bernard de Chartres et longtemps chancelier de Chartres. Guillaume fait en effet allusion ceux qui, pour le combattre, sappuyaient sur un fameux passage du Time (43 a) qui, cause de la fluidit du sensible, niait que les lments fussent des substances stables. Or Gilbert, nous le savons, croit tre fidle au Time en distinguant dune part les quatre lments sensibles qui se mlangent entre eux dans le rceptacle matriel (celui que p.578 Platon appelle ncessit, mensonge, nourrice, mre) pour produire les divers corps, et dautre part les Ides des quatre lments, substances pures formes de la matire intelligible qui se trouvent, avec les exemplaires, auprs de Dieu. Il refuse donc de voir autre chose que fluence dans le monde sensible, et ne trouve de fixit que dans la ralit divine 3. La physique, dit-il ailleurs, ne soccupe que des formes engages dans la matire et dans cet tat dengagement : elle doit donc se rfrer toujours au monde intelligible. Guillaume semble avoir eu au contraire lide dune physique autonome : par exemple, aprs avoir montr que le firmament ne saurait tre fait deau congele, il ajoute : Mais je sais ce quon dira ; nous ignorons ce quil en est, et nous savons que Dieu peut le faire. Malheureux ! Quy a-t-il de plus misrable que ces paroles ? Dieu peut-il faire une chose sans voir comment elle est, ni avoir de raison pour quelle soit ainsi, ni en manifester lutilit ? Aussi Guillaume nhsite pas chercher une explication proprement naturelle de lorigine des tres et, en ce qui concerne celle de lhomme et
1 2
Philosophia mundi, IV 40 (MIGNE, CLXXII). MIGNE, Patrologie, vol. CLXXII, p. 50 a et 49 e d. 3 MIGNE, Patrologie, LXIV, p. 1265.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
392
des animaux, revenir aux spculations de Lucrce : cest lopration de la nature (natura operans) quil faut attribuer la formation des tres vivants 1. A ceux qui lui opposent quune telle conception droge la puissance divine, il rpond que, tout au contraire, elle la fait clater, puisque cest cette puissance qui a donn aux choses une telle nature et qui ainsi, par lintermdiaire de la nature oprante, a cr le corps humain ; ces critiques viennent dhommes qui ignorent les forces de la nature , tandis que moi, jaffirme quil faut en tout chercher la raison, mais si elle nous manque, nous confier au saint Esprit et la foi . Il nhsite dailleurs pas reconnatre, en suivant peut-tre ici linspiration de Lucrce et du Time (cf. p. 139) que, en ces matires, on ne peut atteindre que le probable. Ce naturalisme mlange dune p.579 faon un peu confuse des thmes dorigines platonicienne, picurienne (et, mme stocienne puisque Guillaume dfinit lme du monde cette force naturelle (vigorem naturalem) insre par Dieu dans les choses et par laquelle certaines vivent, dautres vivent et sentent, dautres vivent, sentent et raisonnent ).
V. LE MYSTICISME DES VICTORINS
@ A ct des graves sententiaires qui codifient le christianisme, des chartrains qui rnovent le platonisme, se dessine, li une rforme profonde des ordres monastiques, un important mouvement mystique, dont les plus grands reprsentants sont saint Bernard (1091-1153) et Hugues de Saint-Victor (1096-1141). Lidal monastique, celui du status religiosus, est une vie de renoncement, o lon obit une rgle commune pour parvenir la perfection, grce la pauvret, la chastet et lobissance. Lhistoire des ordres monastiques nous montre une continuelle alternance entre loubli des rgles primitives, qui aboutit faire pntrer la vie mondaine dans les clotres et les rformes qui imposent nouveau la rgle. Le XIe sicle est domin par la rforme de labbaye de Cluny ; mais lesprit monastique sy affaiblit de nouveau, et il se rveille, au XIIe sicle, avec la rforme de Cteaux, tandis que Bruno de Cologne fonde lordre des Chartreux. Le moine cistercien est un compos de paysan, dartisan et dascte . La vie spirituelle ne consistera donc pour lui que dans une mditation spirituelle des vrits fondamentales du christianisme, grce laquelle il y pliera de mieux en mieux son intelligence et sa volont. Cest de cette mditation, o lentranement imaginatif abolit presque entirement la rflexion critique, que nat le mysticisme monastique du XIIe sicle. Le type en est le trait De diligendo Deo 2 du clbre saint Bernard, dorigine cistercienne et abb de Clairvaux, le prdicateur de la deuxime
1 2
MIGNE, Patrologie, CLXXII, p. 53-56. [css : disponible sur le site http://docteurangelique.free.fr/ consacr saint Thomas dAquin].
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
393
croisade p.580 (1146), le conseiller du pape Eugne III, son ancien religieux, qui il adresse un trait De Consideratione sur les maux de lglise et les devoirs du souverain pontife. Pour cet esprit ardent et passionn, toute la philosophie est la connaissance de Jsus crucifi , ou, ce qui revient au mme, la connaissance de lamour de Dieu pour les hommes, qui amne les hommes aimer Dieu. Cet amour explique tout le drame chrtien ; par amour, Dieu a destin tous les hommes au salut ; mais il leur a donn une volont libre (dfinie par lexpression stocienne dassentiment, consensus) qui a dchu ; la suite de cette faute, lincarnation et le supplice de Jsus ont t pour Dieu un moyen de satisfaire sa justice et sa piti ; le chrtien a dsormais la capacit de se sauver en suivant le Christ ; la vie chrtienne est la description de cette voie qui part de la considration ou recherche (qui est mditation sur nous-mme, sur le monde et sur Dieu) pour aboutir la contemplation, qui est une conception assure et non douteuse de la vrit , et enfin lextase o lme, spare des sens corporels, ne se sentant plus elle-mme est emporte (rapitur) jusqu la jouissance de Dieu, et, devenant trs diffrente delle-mme et trs semblable Dieu, est finalement difie. Il faut bien voir tout ce quil y a de traditionnel dans cette peinture de la vie intrieure dont les traits se reproduisent de sicle en sicle depuis Philon, Plotin et saint Augustin. Il faut pourtant appuyer sur ce fait que, dans les milieux que nous tudions ici, ce mysticisme est religieux et sentimental et nullement spculatif ; il est rgle de vie pour lme et non pas, comme chez Plotin, appui dune conception philosophique de lunivers ; cest la tradition de la mditation intrieure dAugustin, non celle de la mtaphysique noplatonicienne. Mme tendance chez Hugues de Saint-Victor, et ceux qui lui succdent comme matres au clotre Saint-Victor Paris ; ce ne sont plus comme Bernard de grands politiques, mais des matres de thologie qui donnent tous leurs soins linstruction des clercs. p.581 Trs diffrents aussi des chartrains, ils sen tiennent une conception traditionnelle de lducation, et les six livres du Didascalicon de Hugues (avec lEpitome in Philosophiam) sont des manuels la manire dIsidore comprenant les arts libraux et la thologie ; il tient beaucoup des tudes compltes, allant de la grammaire la mcanique en passant par lthique et la philosophie thorique (mathmatiques, physique et thologie), et il proteste contre ceux qui veulent dchirer et lacrer ce corps densemble et qui, par un jugement pervers, choisissent arbitraitrement ce qui leur plat 1. Tradition duniversalisme, trs importante dans lhistoire de la philosophie et qui, au XIIe sicle, commenait tre menace, nous allons voir bientt par qui. Cest donc une instruction intellectuelle fort complte que sadosse la contemplation mystique dont le Victorin dcrit les tapes dans un trs grand nombre duvres. Cest toute la vie intrieure du chrtien qui est dpeinte par exemple dans le De Contemplatione et ejus speciebus, sortes de rgles
1
B. HAURAU, Les uvres de Hugues de Saint-Victor, p. 169-170.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
394
dexercices spirituels de plus en plus difficiles ; la mditation sur la morale et les ordres divins, le soliloque dans lequel lhomme intrieur scrute les secrets de son cur, la circonspection (circumspectio) qui est la dfense contre la sduction des biens sensibles ; enfin lascension qui a elle-mme trois degrs, lascensio in actu, qui consiste confesser ses pchs, distribuer des aumnes et mpriser les richesses ; lascension dans nos sentiments (in affectu) qui consiste dans la parfaite humilit, la charit consomme, la puret de la contemplation ; enfin et au plus haut lascension dans lintelligence (in intellectu) qui consiste connatre les cratures, et ensuite le crateur. La connaissance de Dieu sopre dailleurs selon cinq modes de plus en plus parfaits : en partant de la crature, dont la contemplation conduit lide du crateur ; par la nature de lme, p.582 qui est une image de lessence divine, qui est partout dans le corps comme Dieu dans lunivers ; par lcriture qui nous rvle les attributs de Dieu ; par un rayon de la contemplation qui nous fait monter jusqu lui ; enfin par la vision dont trs peu jouissent prsent, et dans laquelle, ravis par la douceur dun got divin, lon contemple seulement Dieu dans le repos et la paix. Lon voit avec quel soin ce mysticisme reste orthodoxe ; la contemplation, son plus haut degr, nest quune sublimation des vertus chrtiennes fondamentales, foi et charit. Luvre dHugues est continue par Richard de Saint-Victor dont le mysticisme est encore plus pntr, si lon peut dire, de rationalisme et dintellectualisme ; il veut, comme saint Anselme, trouver des raisons ncessaires des dogmes divins ; et son De gratia contemplationis fait une part immense la prparation intellectuelle de lextase.
VI. PIERRE ABLARD
@ Chartrains, sententiaires et Victorins, si diffrents et mme si hostiles quils paraissent, sont pourtant anims dun mme esprit : on ressent chez tous le sentiment dune libration, la joie dune civilisation commenante, une ardeur intellectuelle qui se heurte aux moyens mdiocres dont ils disposaient. Le XIIe sicle est le premier qui se dlivre vritablement des encyclopdies et des commentaires ; les formes littraires se font plus souples et plus personnelles. Pierre Ablard (1079-1142) en est le reprsentant le plus caractristique : pendant de longues annes, il enseigne, avec un succs croissant, la dialectique Melun, Corbeil, puis Paris lcole cathdrale et sur la montagne Sainte-Genevive : les Introductions pour les commenants, les Gloses et les Petites Gloses sur Porphyre, enfin la Dialectique (1121) sont les rsultats de cet enseignement. Mais vers 1112, il commence p.583 sappliquer la thologie avec Anselme de Laon, et lenseignement quil donne Paris en
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
395
1113 lcole cathdrale est tout thologique. On sait quelle catastrophe y mit fin en 1118, la suite de son amour pour Hlose ; cruellement mutil par loncle de celle-ci, le chanoine Fulbert, il se rfugia labbaye de Saint-Denis : Il reprit pourtant son enseignement dabord Nogent-sur-Seine, puis de 1136 1140 au Paraclet : De cette poque de sa vie date linspiration du Sic et non (1121), de la Theologia christiana, de lIntroductio ad Theologiam et de lEthica. De cette poque date aussi cette Histoire de mes malheurs (Historia calamitatum) qui ressemble plus aux Confessions de Rousseau qu celles de saint Augustin, et la clbre correspondance avec Hlose. Lenseignement dAblard est un de ceux qui, au moyen ge, excita avec le plus de force la rprobation des thologiens : condamnes par deux conciles, Soissons en 1121, Sens en 1141, ses opinions thologiques sont considres comme un rsum de toutes les grandes hrsies : arien, plagien et nestorien, daprs une lettre de larchevque de Reims au cardinal Guido de Castello (1141) 1, il aurait ni lgalit des personnes divines, lefficacit de la grce, la divinit du Christ ; et toutes ces ngations auraient une source unique ; limmense orgueil intellectuel que lui reprocha son grand adversaire saint Bernard 2, orgueil qui fait que le gnie humain (humanum ingenium) usurpe tout pour lui, ne rservant rien la foi . ou encore quil sefforce de dnier tout mrite la foi en pensant quil peut comprendre par la raison humaine tout ce quest Dieu , Cest donc tout le rgime de la vie chrtienne quon lui reproche de vouloir changer ; un dogme dont tout mystre est supprim et qui rend inutile la tradition, une morale qui sappuie sur la confiance de lhomme en lui-mme et rend inutile la grce avec les sacrements. Qutait donc, chez Ablard, cette raison ? Une raison forme tout entire par la dialectique quil cultiva avec passion, lexclusion presque complte des sciences du quadrivium ; de lui est issue, nous le verrons, une cole de dialecticiens qui bornaient la philosophie cet art. Sa Dialectique (celle de 1121) est dailleurs uniquement fonde sur les traductions et les travaux de Boce ; elle ignore encore les grands traits logiques dAristote, Analytiques premiers et seconds, Rfutation des Sophistes, Topiques qui ne furent traduits en latin quen 1125. La dialectique reste pour lui ce quelle tait pour Boce commentant les Catgories, une science qui ne porte pas sur les choses mmes, mais sur les mots en tant quils signifient les choses. Elle nentrane donc nullement, fait bien important, notre connaissance directe des choses ; et, si lon voulait chercher la manire dont un Ablard se reprsente lunivers, ce nest pas dans sa dialectique quon le trouverait, mais dans tel passage de lthique, o ce rationaliste parle de laction que les dmons ont sur nous grce leur connaissance des forces naturelles : Car il y a dans
p.584 1 2
MIGNE, Patrologie, CLXXXII, epist. CXCII. Lettre de 1140 ; MIGNE, ibid., p. 331.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
396
les herbes, dans les semences, dans les natures des arbres ou des pierres, bien des forces capables de remuer ou dapaiser nos mes 1. Il ne faut pas oublier ce contraste entre cette connaissance vivante et passionne de la nature et la sche classification dialectique dans les filets de laquelle on ne pouvait gure esprer prendre les choses. Pourtant la dialectique ne peut pas non plus se dsintresser totalement de la connaissance des choses. Le programme de lenseignement dialectique dAblard parat dabord assez simple : il tudie les termes incomplexes (les cinq voix et les catgories), puis les termes complexes, cest--dire la proposition et le syllogisme catgoriques et la proposition et le syllogisme hypothtiques, enfin les dfinitions et la division. Simplicit toute apparente, puisque, loccasion de la proposition p.585 hypothtique, il traite de tout ce quil connat par Boce des Topiques dAristote, et il fait intervenir des questions physiques et mtaphysiques, telle que celle de la matire et de la forme, et de la thorie des causes. Ce caractre quivoque de la dialectique, que nous avons vu natre chez Aristote, dans sa tentative pour faire dune mthode de discussion une mthode universelle (p. 185), est la base de la clbre querelle des universaux : si les mots signifient des choses, on demande quelles choses signifient les mots qui noncent les genres et les espces des substances individuelles. Les genres et les espces (animal ou homme) sont, rappelons-le, des attributs dun sujet individuel (Socrate), mais des attributs qui, la diffrence des accidents (blanc, savant), rentrent dans lessence de ce sujet, cest--dire sont tels que, sans eux, le sujet cesserait dtre ce quil est. On se souvient que Porphyre et, aprs lui, Boce, se demandaient si ces genres et ces espces, ces universaux, existaient dans la nature des choses ou taient le simple produit dune vaine imagination. On a vu sur ce point lopinion de Roscelin ; Guillaume de Champeaux, vque de Chlons (1070-1121), avait une autre doctrine ; il pensait que homme qui est un attribut essentiel de Socrate, de Platon et dautres individus est essentiellement la mme ralit qui est tout entire la fois en chacun de ces individus ; il ajoutait que ces individus ne diffrent pas du tout par leur essence, en tant quhommes, mais par leurs accidents. Cest l dailleurs, nous dit-on, une fort ancienne opinion : le genre (animal) reste identique lui-mme, quand on y ajoute les diffrences (raisonnable, sans raison) qui le spcifient, et lespce identique elle-mme quand on y ajoute les accidents. Ablard nous apprend quil discuta la thse de Guillaume, dont il fut llve, et mme quil la lui fit corriger. Guillaume admit alors que luniversel, dans les divers individus, tait la mme ralit non pas essentiellement mais par absence de p.586 diffrence (non essentialiter sed indifferenter) . Cest le ct ngatif de la mme thse ; impossibilit de
1
COUSIN, uvres, II, p. 608
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
397
distinguer entre lhomme comme tel en Platon et en Socrate. Guillaume a mme t plus loin et il a fini par reconnatre quentre lhumanit de Socrate et celle de Platon, il ny avait ni identit essentielle, ni absence de distinction, mais simplement similitude 1. Il est noter que cette discussion nest pas sur le mme plan que le conflit qui, seize sicles auparavant, avait spar Aristote de Platon au sujet de lexistence des Ides. Le platonisme thologique, qui admet les Ides comme penses de Dieu et exemplaires des choses, est trs conciliable avec le nominalisme, qui admet que les universaux, tels que nous les nommons et les pensons, ne dsignent pas de ralit vritable. On voit quelquefois, chez le platonicien Scot rigne, lorigine du nominalisme parce quil pensait que la dialectique navait affaire qu lexpression linguistique (dictio) 2. Ablard, qui, en thologie, est un raliste platonicien, qui croit avec Macrobe et Platon que lintelligence divine contient les espces originales des choses, appeles Ides avant quelles se manifestent en des corps 3, nadmet pourtant pas le ralisme des universaux de son matre Guillaume. Il fait valoir contre lui la vieille objection de Boce : Res de re non praedicatur. Un universel est un attribut ; or nulle ralit ne peut se dire de plusieurs choses, mais seulement un nom . Donc, tandis que Guillaume considrait le genre et lespce isolment, comme membres dune classification commenant par le genre le plus lev et termine aux espces infimes, Ablard, qui suit Boce, ne veut pas oublier que luniversel est avant tout un prdicat qui implique plusieurs sujets individuels dont il est prdicat. Par l, nous pouvons comprendre la thorie des universaux que lui attribue son lve Jean de Salisbury : p.587 Il voit dans les universaux les discours (sermones) et dtourne en ce sens tout ce qui a t crit sur les universaux ; des discours (sermones), cest--dire que luniversel ne peut exister part des sujets dont il est lattribut (sermo praedicabilis) 4. Il y a, parat-il, une liaison troite entre cette solution, et la thorie aristotlicienne de labstraction, quAblard emprunte aux passages de Boce inspirs du IIIe livre du trait De lme dAristote et dont il parat tre le premier saisir limportance ; il dcrit le processus par lequel, aprs la sensation qui atteint superficiellement la ralit , limagination fixe cette ralit dans lesprit, puis lintellect saisit non plus la ralit mme, mais la nature ou proprit de la ralit ; cette nature ou forme, si par abstraction elle est saisie spare de la matire, nest jamais connue comme une ralit spare : Il ny a pas dintellect sans imagination. A partir dAblard, on ne traite plus des universaux, sans parler en mme temps des conditions de la formation des ides gnrales. Aussi tout le sicle
1 2
Citations dans G. LEFVRE, Les variations de Guillaume de Champeaux. PRANTL, Geschichte der Logik, II, p. 28. 3 dition COUSIN, II, p. 24. 4 Jean DE SALISBURY, Metalogicus.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
398
parat tendre vers une espce de ralisme tempr , qui admet que les mots gnraux ont un sens rel, sans pourtant dsigner des choses relles au mme titre que les choses sensibles. Telle est lattitude de lauteur du trait anonyme De Intellectibus 1 ; il est prcd dune remarquable analyse de la connaissance intellectuelle : une perception intellectuelle (intellectus) dune chose compose, comme trois pierres, peut tre tantt simple, quand on les peroit dune seule intuition (uno intuitu), tantt compose quand on les connat par plus dune impression (pluribus obtulibus) ; mais lintellect, simple ou compos, est toujours un, pourvu que son acte ait lieu avec continuit et par une unique impulsion de lesprit . On le voit, la simplicit et lunit peuvent se trouver dans lintellect qui joint les choses (intellectus conjungens), alors quelles ne sont pas dans les choses mmes. De la mme p.588 manire, dans labstraction, lintellect, en sparant la forme de la matire, divise et spare des choses qui, dans la ralit, ne sont ni divises ni spares. En aucun de ces deux cas, il ne sensuit que lintellect est inutile et vain. Il ne lest pas davantage, lorsque jemploie des termes universels, tels que homme. Le fait que lhomme est toujours, en ralit, tel ou tel, nimplique nullement que je le conoive tel ou tel. Il ny a donc pas simplement le nom gnral et la ralit individuelles, il y a encore le sens du nom qui est lobjet propre de lintellect. Comme le dit un autre fragment anonyme, Socrate, homme et animal sont la mme chose, mais considre dune manire diffrente ; genre quand on y considre la vie et la sensibilit, espce quand on y ajoute la raison, individu lorsquon y considre les accidents 2. Dans toutes ces doctrines, plus trace de nominalisme ; pas trace non plus de ralisme ; le ralisme platonicien, sil est frquemment soutenu, rpond un tout autre problme que celui des universaux ; et lon chercherait vainement une doctrine qui soutienne rigoureusement la ralit des genres et des espces au sein des choses. Lauteur que Jean de Salisbury 3 prsente comme le type du raliste, Gauthier de Mortagne, soutient que les universaux doivent tre unis aux individus. Pierre Lombard, dailleurs, contrairement saint Anselme, dgage le dogme de la Trinit de toute supposition raliste, en prenant soin de distinguer radicalement lunit des trois personnes en Dieu de lunit des espces dans le genre ou de lunit des individus dans lespce 4. Le champ est donc laiss libre une doctrine qui vient dAristote et de Boce, et qui peut se rsumer en deux articles : il y a, dans les choses, des formes universelles qui sont comme des images des Ides divines ; ces formes nexistent pas en soi, mais ne sont saisies spares que par une abstraction de lintellect. Le problme thologique, tel que le pose Ablard, drive du mme tat desprit que le problme des universaux.. Lenseignement dialectique,
p.589 1 2
Dans ldition COUSIN des uvres dAblard, II, p. 733-755. Cf. les fragments anonymes dans Beitrge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, IV, Heft 1, p. 105 et 108. 3 DEHOVE, Temperati realismi antecessores, p. 122. 4 Metalogicus, II, 18.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
399
finit par crer une certaine structure mentale, ou, si lon aime mieux, par imposer une certaine manire de classer la ralit : de toute chose, on se demande dans laquelle des cinq voix de Porphyre ou des dix catgories dAristote elle rentre : de toute chose, et mme de la ralit divine, propos de laquelle les thologiens les plus orthodoxes prononcent les mots de substance, dessence, de propre, de relation, didentique et de divers. Cest la question que lon se pose la suite de Boce, dont le De Trinitate na pas dautre sujet que lapplication des termes de la dialectique la ralit divine. Lon se rappelle la solution de Scot rigne. La question est une de celles qui a passionn le XIIe sicle ; et la Thologie chrtienne dAblard contient sur ce point non seulement son enseignement propre, mais un tableau de celui de ses contemporains. On a vu plus haut que saint Bernard et son parti accusaient Ablard dexagrer le rle de la dialectique dans la connaissance des choses divines. Croirait-on que toute luvre dAblard est prcisment dirige contre des dialecticiens quil accuse de la faute quon lui reproche ! Dans cet opuscule, nous entendons non pas enseigner la vrit, mais la dfendre, et surtout contre les pseudophilosophes qui nous attaquent avec des raisonnements philosophiques 1. Ablard tient donc une position moyenne entre les thologiens radicaux qui, considrant les distinctions dialectiques comme vraies des choses sensibles seules, repoussaient leur application la ralit divine et les hyperdialecticiens qui voulaient appliquer telles quelles les distinctions dialectiques la Trinit. De cette seconde position drivent les hrsies que nous dpeint Ablard : celle dAlbric de Reims qui, de ce que le Pre et le Fils sont un seul Dieu, concluait que Dieu sest p.590 engendr lui-mme ; celle de Gilbert lUniversel qui voulait distinguer en Dieu, outre sa divinit et les trois personnes, les trois essences : paternit, filiation et procession, selon lesquelles se distinguent les personnes ; celle dUlger, coltre dAngers, qui distinguait en Dieu les attributs comme la justice et la misricorde au mme titre que les proprits des personnes ; celle de Joscelin de Vierzy qui enseigne que Dieu peut se tromper, puisque certaines choses arrivent autrement quil ne les a prdites ; enfin celle dont Ablard accuse les Chartrains daprs qui Dieu ne serait pas antrieur au monde 2. On suit facilement dans toutes ces hrsies lapplication des rgles dialectiques : Albric applique la notion de substance ; Gilbert, la rgle qui veut que chaque tre ait une essence distincte ; Ulger ne voit dans les Catgories aucun moyen de distinguer les personnes (Pre, Fils) des autres attributs de Dieu ; Joscelin de Verzy applique aux textes sacrs la notion de la
1 2
dition COUSIN, p. 519. Introductio ad theologiam, d. COUSIN, p. 84-85, comment par ROBERT, les coles, etc., p. 198 sq.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
400
modalit des propositions ; les Chartrains, la rgle que la cause ne peut exister sans leffet. La solution dAblard parat dabord tre tout fait radicale : Dieu ou ce quon dit de lui ne rentrent en aucune catgorie ; on ne peut mme dire quil est substance, puisque la substance selon Aristote est le sujet des accidents et des contraires ; aucun nom ne lui convient ; en lui-mme, Dieu enfreint les rgles des philosophes . Mais ct de cette application brutale de la dialectique, il y a la voie quenseignent Platon et saint Augustin, celle des similitudes. Lon peut dire, par exemple, que le Pre est au Fils comme la cire est limage que lon modle avec elle : cest la mme cire quant lessence (essentialiter) ; pourtant limage vient de la cire, et limage et la cire ont chacune une proprit qui ne convient qu elle. Cest une image du mme genre quAblard cherche et trouve dans le Time et chez Macrobe. Il ne prend pas en effet la p.591 lettre la doctrine de Platon, et il rclame le droit de la soumettre une exgse allgorique. Le langage par nigme est aussi familier aux philosophes quaux prophtes (p. 46). Aussi son exgse du Time, qui, comme celle des Chartrains, retrouve la trinit chrtienne dans la triade Dieu, Intelligence, Ame du monde, est-elle tout entire allgorique, de manire supprimer ce qui, dans la lettre de Platon, serait htrodoxe. Il se donne surtout beaucoup de mal pour identifier lme du monde, cette premire crature du dmiurge qui, par elle, fait du monde un tre vivant, au Saint-Esprit. Si Platon donne cette me un commencement dans le temps, tandis que le Saint-Esprit est ternel, cest quil entend parler de lopration de lEsprit dans le monde, opration qui est temporelle et progressive. Si Platon compose lme du monde de deux essences, indivisible et divisible, cest parce que le Saint-Esprit, simple en soi, est multiple dans ses effets et dans les dons quil fait lme humaine. Sil considre le monde comme un vivant raisonnable, anim par cette me, cest dune manire figure, puisque le monde nest aucun degr un tre vivant ; mais comme notre me confre la vie notre corps, lme du monde ou Saint-Esprit confre la vie spirituelle nos mes. On voit lintention : retrancher de Platon tout ce naturalisme que gotera tant la Renaissance. Ablard se rend bien compte de ce que son procd a de violent , et il crit ces lignes caractristiques : Si lon maccuse dtre un interprte inopportun et violent qui, par une explication impropre, dtourne le texte des philosophes vers notre foi et leur prte des ides quils nont jamais eues, que lon songe cette prophtie que le Saint-Esprit profra par la bouche de Capha, en lui prtant un autre sens que celui qui la prononait (p. 53). On voit ce quest la thologie dAblard : ce nest ni la mthode dialectique dAnselme visant tablir par le raisonnement ce qui est cru par la foi, ni la philosophie des Chartrains, qui est en quelque mesure indpendante du dogme ; cest un p.592 effort pour trouver, dans les notions philosophiques, une image de la ralit divine, de manire la penser au moins par similitude.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
401
VII. LES POLMIQUES CONTRE LA PHILOSOPHIE
@ Ces tendances, ainsi que celles de Guillaume de Conches. paraissaient inquitantes dans des milieux o la rforme monastique, fonde sur une foi trs simple, tait le principal ; Saint-Bernard et ceux qui lentourent en sont dardents adversaires. Leur point de vue est reprsent dans lnigma fidei de Guillaume de Saint-Thierry (mort en 1153) ; il songe avant tout la foi commune qui doit tre celle de tous dans lglise de Dieu, tant des petits que des grands 1 ; il songe la simplicit vanglique et au style propre de lEsprit saint, o lon ne trouve aucune allusion ces questions compliques sur la Trinit que les thologiens ont t obligs de poser pour se dfendre contre les hrsies. Les prdicaments de substance, accident, relatif, genre, espce, etc., sont trangers la nature de la foi ; instruments communs et vulgaires de la raison, ils sont indignes des choses divines (p. 409 a ; 418 b). Cest l le fond de tous les reproches que Guillaume de Saint-Thierry adresse Guillaume de Conches 2. Pour les comprendre, il faut se rappeler que le Time est une cosmogonie qui dcrit, dans les ralits divines, ce qui a rapport la cration du monde ; la thologie trinitaire rvle prtend au contraire atteindre Dieu en dehors de son rapport au monde. Or Guillaume de Conches, sinspirant de Platon (et aussi de saint Augustin), identifie le Pre avec la puissance par laquelle Dieu cre le monde, le Fils avec la Sagesse selon laquelle il le cre, lEsprit avec la volont par laquelle il ladministre. Ds lors, le Pre p.593 est ce quil est, non point par rapport au Fils (comme dans la thologie orthodoxe) mais par rapport la crature, non point par nature mais par manire dtre (338 d). La Trinit ne dcrit plus la vie divine dans son intimit mais des relations la crature, comme sont la charit ou la misricorde. Le reproche fait Ablard est de mme nature : en identifiant la Trinit la triade puissance, sagesse et bont, il transporte en Dieu considr en luimme ce qui nest vrai quen Dieu considr lgard de lhomme et de la crature. Cette assimilation est pourtant classique ; on la trouve chez saint Augustin et ensuite chez Bde et P. Lombard ; mais elle est dangereuse parce quelle fait perdre le sens du mystre. Il lui reproche aussi davoir cherch, avec le Time, le motif de la cration dans la bienveillance de Dieu envers les cratures , ou de dire que le saint Esprit est une me qui stend partout. Voil, dit-il, un thologien qui connat mieux la chair que lesprit et lhomme que Dieu. Il est plus clair que le jour que ces termes : tre m par une affection ou stendre quelque chose, ne conviennent pas au Dieu immuable.
1 2
MIGNE, CLXXX, p. 407 c. MIGNE, CLXXX, p. 333-340.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
402
VIII. GILBERT DE LA PORRE
@ Guillaume de Saint-Thierry est pourtant, lui aussi, forc de reconnatre que la doctrine de la foi ne peut repousser et rejeter compltement les noms qui lui sont apports par les hommes ; il faut simplement les adapter un un ses rgles . Il indiquait ainsi le programme qua suivi Boce, dans son De Trinitate et que reprend Gilbert de la Porre, dans le Commentaire quil en crit. Selon Gilbert, toutes les hrsies proviennent de ce que lon a appliqu aux choses thologiques certaines rgles qui ne conviennent quaux choses naturelles . Malgr toutes les prcautions quil prend cet gard, il sent bien quil est impossible de parler de Dieu si on ne lui p.594 transfre des catgories empruntes aux choses naturelles . Il convient seulement de garder les proportions : tche prilleuse, que Gilbert lui-mme na pas su remplir au gr de saint Bernard, qui le fit condamner aux conciles de Paris (1147) et de Tours (1148). Gilbert, lve des Chartrains, adhre leur platonisme. De plus, il est de ceux qui, cette poque, ont tudi le plus profondment la logique dAristote : il connat les Analytiques, traduits en 1125 ; sous le titre De Sex Principiis, il crit une tude qui restera classique, sur les six dernires catgories, action, passion, o, quand, avoir, situation. Surtout il insiste sur la notion de forme ou dessence, en sappuyant sur un passage de Snque, que nous avons dj vu utilis par les Chartrains 1. Snque y distingue lIde platonicienne de la forme () aristotlicienne, comme le modle qui est en dehors dune uvre de la forme qui est inhrente luvre. Cest prcisment la distinction que fait Gilbert 2 ; et ce que lon appelle son ralisme consiste dire non pas que ces formes subsistent en elles-mmes, mais que les substances individuelles, qui, elles, subsistent par elles-mmes, nont dtre ou dessence que grce ces formes qui leur sont inhrentes ; un homme na dtre ou dessence que parce quil a en lui la forme humanit, elle-mme compose des formes rationalit et corporit. En revanche, ces formes, qui font subsister les substances (elles sont les subsistentiae des subsistentes), ne peuvent subsister par elles-mmes, cest--dire tre des sujets. Or Gilbert trouvait, dans ses considrations sur la forme, une rgle commune aux naturalia et aux theologica : cest, disait-il, une rgle commune aux deux ordres que ltre vient toujours de la forme 3. Il faut donc supposer en Dieu mme, antrieurement aux trois personnes, une forme, la divinit ou p.595 dit, par laquelle ces personnes sont informes. Cest cette distinction mme que saint Bernard attaqua. Lon voit assez par l toutes les
1 2
Lettres Lucilius, 58, 21. Cf. Jean de SALISBURY, Metalogicus, II, 17 (MIGNE, CLXXXIX, p. 875 d). 3 MIGNE, LXIV, p. 1268 sq.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
403
difficults de ce problme critique, o susent les forces intellectuelles du XIIe sicle : Jusqu quel point la ralit divine est-elle sujette aux rgles de la connaissance des choses naturelles ?
IX. LTHIQUE DABLARD
@ Le reproche qui vise la doctrine dAblard sur la Trinit et qui aboutit la condamnation de Soissons (1121) cache peut-tre un reproche plus grave qui le fit condamner de nouveau Sens en 1141. Au XIIe sicle, pas plus quaux sicles antrieurs, on ne peut isoler le dbat spculatif relatif au dogme, de tout un ensemble dides, plus pratiques que thoriques, sur la vie chrtienne. Comme saint Bernard thologien soppose Ablard thologien, et pour les mmes raisons, les rformateurs monastiques, qui veulent retourner la rgle stricte, trouvent devant eux des contradicteurs qui proclament que le mariage entre moines et moniales est licite, ou encore que lon peut tre sauv avant lIncarnation et sans y croire. A ce quon pourrait appeler le naturalisme thologique rpond ce mouvement dmancipation, qui aboutit dclarer inutiles vie monastique, sacrements et mrite de la foi. Cest dans cette atmosphre quAblard crivit son Ethica ou Scito te ipsum. L vritablement, comme la dit saint Bernard, lintelligence humaine garde tout pour elle et ne rserve rien la foi 1 . Ablard, qui y dnonce le scandale de la remise des pnitences prix dargent faite par les prtres, qui conteste aux vques le pouvoir de remettre les pchs, y dfend une morale individualiste, tout fait indpendante de la discipline chrtienne : p.596 la droite volont dtermine seulement par lobissance la conscience et au bien tel quil est conu ; par suite le pch purement personnel et limpossibilit du pch originel et de toute rversibilit des fautes ; la distinction radicale entre la faute morale, purement interne, assentiment ce que lon tient pour mauvais, et la faute lgale ; limpossibilit pour aucun autre homme de connatre lintention qui, seule, constitue la faute ; enfin lide dun salut personnel qui ignore la rversibilit sur nous des mrites du Christ 2 ; au total une intuition profonde, qui ramenait au premier plan la morale grecque et humaine ; voil le nouvel vangile et la nouvelle foi 3 que lon jugea dangereux pour la situation acquise de lglise et que lon fit condamner Sens. Le pape Innocent II, dans le rescrit quil crit ce sujet, rappelle la lettre (dailleurs fausse) de lempereur Marcien qui dit au pape Jean : Que, lavenir, nul clerc, nul militaire, nulle personne dune condition quelconque ne tente de traiter publiquement de la foi chrtienne.
1 2
MIGNE, CLXXXII, p. 331. dition COUSIN, II, p. 637-638. 3 Lettre de saint Bernard Innocent II (1140), CLXXXII, p. 354.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
404
X. LA THOLOGIE DALAIN DE LILLE
@ Ces condamnations narrtaient nullement le mouvement irrsistible qui portait les thologiens rechercher, dans la foi chrtienne, une structure rationnelle, qui en ft un tout bien li. Il y a l une ncessit pratique dont il faut se rendre compte : Ablard la fait plusieurs fois valoir ; la mthode de raisonnement tait la seule possible contre des hrtiques qui nadmettaient point la vrit. Cest aussi ce que dit Alain de Lille dans son De Arte seu articulis catholicae fidei quil crivit vers la fin du sicle. Il y emploie (comme autrefois Proclus dans ses lments de thologie que connat Alain) la forme dEuclide avec ses notions communes, postulats (petitiones) et thormes. Pourtant Alain, pas plus quAblard, ne prtend, par le raisonnement, dpasser la probabilit ; la foi au contraire reste issue de raisons certaines qui ne suffisent pas la science . Aussi y a-t-il chez lui un contraste entre le caractre contingent des vrits chrtiennes, dont la plupart noncent des vnements dpendant dune dcision mystrieuse dun Dieu incomprhensible, et le caractre rationnel de la mthode qui doit prouver ces faits. La puissance insondable de Dieu vient toujours limiter la raison que lon pourrait donner des vrits de la foi ; par exemple, Dieu aurait pu racheter le genre humain dune manire tout autre quil na fait (III, 15) ; il ny a aucune ncessit ce que ce soit le Fils qui sincarne, plutt quune autre personne.
p.597
Tout comme Gilbert de la Porre, il essaye, dans ses Theologicae regulae, de montrer dans quelle mesure les rgles des naturalia peuvent tre transfres aux theologica. Il a un double principe : dabord les rgles communes de lattribution ne sappliquent pas Dieu : Dieu ne peut tre considr comme un sujet logique dont les attributs se rangeraient suivant les catgories quiddit, qualit, quantit, etc. ; car il est impossible de faire rentrer Dieu, qui est un terme singulier, dans un genre et dans une espce, et la diversit de ses attributs ne dsigne jamais quune essence unique. Dautre part, les rgles relatives aux causes sappliquent la fois aux choses naturelles et la ralit divine : si un prdicat est vrai dun sujet, que ce sujet soit Dieu ou un tre de la nature, nous avons toujours le droit de dire quil y a une cause par laquelle ce prdicat lui appartient, et que la cause de lattribution est diffrente de lattribut lui-mme ; sil est vrai que Dieu est juste, il y a une cause qui fait quil est juste, et cette cause est diffrente de lattribut juste qui en nonce les effets par rapport nous. Dans ce second principe, il faut voir une application nouvelle des ides du Monologium de saint Anselme qui consiste remonter la nature de Dieu en se rfrant la varit de ses attributs, ou, comme disait Denys lAropagite, de ses noms.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
405
XI. LES HRSIES AU XIIe SICLE
@ La dernire partie du XIIe sicle et le commencement du XIIIe, occups par le pontificat dInnocent III (1198-1216) et sa lutte contre lEmpire, par le conflit des barons anglais contre les rois de la dynastie angevine, est une poque plus trouble et tumultueuse que jamais, laquelle mettront fin dune part le concile de Latran (1215) qui confirme les doctrines sur la puissance des papes, et, du mme coup, institue les tribunaux dinquisition et autorise la cration des ordres mendiants, et la Grande Charte (1215) qui rgle les liberts anglaises, tandis que, un an auparavant (1214), le pouvoir des Captiens avait t affermi Bouvines.
p.598
Pour comprendre limportance de ces vnements qui, nous le verrons, ont pes dun poids norme sur lhistoire des ides, il faut se reprsenter les mouvements qui agitaient ce XIIe sicle finissant : dune part un vaste mouvement social dmancipation contre lglise qui se manifeste par des hrsies trs populaires et par des doctrines htrodoxes : dautre part, un mouvement humaniste et doctrinaire, dont Jean de Salisbury, llve dAblard et des dialecticiens de France, le conseiller de larchevque Thomas Becket, est le meilleur reprsentant. Dans ces hrsies nombreuses, dans ces associations de Bguines, de Capucis, dHumilis, de Pauvres catholiques, comme chez les Cathares et les Albigeois ou les Vaudois, il est difficile de dterminer o finissent les questions de discipline, o commencent les questions de doctrine. Dj, au milieu du sicle, un lve dAblard, Arnauld de Brescia prchait que les ecclsiastiques ne pouvaient tre sauvs sils possdaient des terres ; il fut assez puissant pour faire chasser le pape de Rome en 1141. Le fond substantiel de ces hrsies parat bien tre toujours le mme : la prdication dun idal de vie religieuse et sainte, par un retour la simplicit vanglique et p.599 un complet affranchissement de lglise et des sacrements. Des illumins se proclament fils de Dieu. Un Pierre de Bruys nie la valeur du baptme et la prsence relle dans lEucharistie, et veut abattre les glises et supprimer le culte extrieur. Vers 1170, le Lyonnais Pierre Walds (fondateur de la secte des Vaudois), usurpant loffice de Pierre , prche la pauvret vanglique ; Alain de Lille nous dit quil nie toute autorit religieuse et mme toute autorit humaine, la valeur du sacrement de lordre, linstitution de labsolution et des indulgences. Le mme Alain de Lille parle, dans son Contra Haereticos, dhrtiques quil ne nomme pas, mais o il est ais de reconnatre les fameux Cathares ou Albigeois, qui dominaient dans le sud de la France ; on y voit comment les opinions doctrinales sont lies cet idal de vie. Lambition dune saintet, route pure et dpouille, ne va pas sans la croyance que notre me est une force cleste dchue, et emprisonne par des forces adverses et mauvaises. Mais cette croyance se transforme chez les Albigeois en une doctrine prcise,
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
406
o nous reconnaissons non pas, comme on la dit quelquefois, le manichisme, mais plutt la doctrine des Gnostiques : le monde a t cr par un mauvais principe, un dmiurge qui est en mme temps lauteur de la loi mosaque ; lme est dorigine cleste ; ange dchu, elle est punie par la vie terrestre ; de cette me, il faut distinguer lme comme simple principe vital, qui, ainsi que lme des animaux, prit avec le corps. Le Christ, venu pour sauver les mes, na pas du tout la nature humaine ; son corps nest quune simple apparence. Il na institu aucun des sacrements, dont la prtendue ncessit pour le salut fait la force de lglise. La vie chrtienne tend seulement un tat de puret o lme, compltement dlivre du pch, incapable de mal faire, nest plus la prisonnire du mal ; les purs ou Cathares sont ceux qui sont arrivs cet tat. Lindpendance religieuse, que les Albigeois rclamaient, cadrait avec lindpendance politique que les matres du Midi p.600 de la France, les comtes de Toulouse, voulaient se donner. On sait comment une croisade, ordonne par Innocent III et marque par des cruauts sans nom (1207-1214) mit fin la fois lhrsie et la puissance des comtes. Parmi les doctrines condamnes au concile de Latran, se trouve celle de Joachim de Flore, abb du monastre de Saint-Jean Fiore en Calabre (1145-1202). Jsus dit, en lvangile de Jean (XIV, 16) : Je prierai mon Pre qui vous donnera un autre Consolateur (Paraclet) afin quil reste ternellement parmi vous. Ce Paraclet est, pour Joachim, le Saint-Esprit ; et ce verset marque les trois priodes de lhistoire du salut ; la loi mosaque, priode du Pre, qui est le pass et prfigure lglise chrtienne ; lglise, qui est le prsent, prfigure le rgne de lEsprit qui est le futur et que Joachim annonce en des visions apocalyptiques, o il reprsente lglise transforme et spiritualise en une re nouvelle qui doit commencer en 1260. Ainsi nat lide dun vangile ternel, qui donne le sens spirituel et dfinitif de lvangile du Christ ; cette ide persistera jusquau XIVe sicle dans les milieux franciscains 1. Entre les ides de Joachim et celles des Vaudois ou des Albigeois, il y a certes une parent, le dsir de faire natre un ordre spirituel nouveau, diffrent de lordre actuel. Mais lopposition est grande : les Joachimites voient dans lvangile ternel la consommation du christianisme, attendue pour lavenir ; ils ont le sens de la continuit historique. Les Cathares nient simplement le rle de lglise, et considrent que lordre spirituel nouveau est ds maintenant ralis par les purs ou parfaits, initis leur origine divine. Progrs dun ct, rvolution brusque de lautre 2. La doctrine dAmaury de Bne, matre en thologie Paris qui mourut en 1207, bien que trs diffrente de celle des p.601 Albigeois, conduit la mme
1 2
Cf. GILSON, Saint Bonaventure, p. 22 sq. Cf. DELACROIX, Le mysticisme spculatif en Allemagne, p. 44.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
407
attitude pratique : les Albigeois retrouvent le drame du salut, tel quil avait t dpeint par les gnostiques, la dlivrance de lme, essence divine prisonnire du mal ; nul drame de ce genre chez Amaury. Il enseignait que chaque homme est un membre du Christ ; daprs les commentaires de ses disciples, il voulait dire que la seule ralit qui existt, ternellement identique elle-mme, ctait Dieu ; et que le salut ne consiste en rien que dans la science ou connaissance que Dieu est toutes choses : rien de semblable la foi et lesprance, qui sont des attentes dun meilleur sort ; rien de la crainte de lEnfer ou des espoirs du Paradis ; nulle croyance que Dieu soit spcialement prsent dans le Christ ou dans lhostie, puisquil est partout et que toutes les cratures lincarnent ; mais, ds labord, une assurance complte que, par la rvlation dAmaury, est n le rgne dfinitif de lEsprit qui doit remplacer lglise. On a reconnu la ligne de pense qui, drive des Stociens, et passant par Plotin et Denys, arrive jusqu Amaury par lintermdiaire de Scot rigne. On voit aussi que, cette poque, cette doctrine thorique de lunit de tout tre en Dieu avait assez de force pour se traduire dans les faits par une opposition tout le systme spirituel de lglise. Lglise sentit le danger, et la doctrine des Amauriciens fut condamne au synode de Paris en 1210 et au concile de Latran (1215) ; en mme temps, lon condamnait le De Divisione naturae dOrigne o lon voyait la source de cette doctrine. Vers la mme poque, elle se manifeste pourtant encore dans les crits de David de Dinant, condamns aussi en 1210 ; nous nen connaissons que le titre, De tomis hoc est de divisionibus, qui fait songer rigne ; mais nous connaissons ses ides par Albert le Grand et saint Thomas. La division dont il sagit est celle des ralits en corps, mes et substances spares ; chacune de ces ralits a son principe indivisible, la matire (Yle) pour les corps, lIntelligence (Noyn vel mentem) p.602 pour les mes, Dieu pour les substances spares. Or cette triade, matire, intelligence et Dieu ne dsigne quune substance unique ; David parat avoir employ, pour tablir cette conclusion, le principe du livre des Causes : si lon y voyait des termes distincts, il faudrait admettre au-dessus deux, un principe simple et indivisible, qui contienne en lui ce quils ont de commun (cest dune manire analogue que raisonnait Avicebron, dont David a pu connatre la Fons vitae) : on est donc renvoy une ralit unique. On reconnat dans cette triade non point la triade noplatonicienne de Macrobe, Un, intelligence et me, mais une triade tire du Time, dmiurge, intelligence ou tre, et matire.
XII JEAN DE SALISBURY
@ Un des personnages les plus curieux de cette poque est Jean de Salisbury (1110-1180) qui reut lenseignement dAblard, de Gilbert de la Porre et de
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
408
Guillaume de Conches, qui fut lami de Thomas Becket et mourut vque de Chartres. Cest un crivain distingu, plein des souvenirs de lantiquit classique, non seulement des potes, comme Ovide et Virgile, mais de Snque et surtout de Cicron qui il a emprunt sa connaissance de la morale stocienne en mme temps que le doute acadmique. Ses deux grands ouvrages, le Metalogicus et le Policraticus, refltent dune manire vivante toutes les proccupations dun grand seigneur ecclsiastique de ce temps. Le Metalogicus nous donne un tableau de toutes les questions que soulevait vers 1160 la diffusion de lenseignement de la dialectique. A ce moment tendait saffaiblir la conception longtemps dominante, selon laquelle la dialectique ntait quun des sept arts libraux qui, dans leur ensemble, taient destins servir dintroduction la thologie : conception hirarchique trs nette que beaucoup de thologiens du XIIe sicle voient, non sans effroi, en danger de disparatre : la dialectique p.603 ne sait plus se subordonner, et elle envahit la thologie. Un saint Bernard voit l avant tout un pch, une honteuse curiosit qui consiste savoir pour savoir, une honteuse vanit qui consiste connatre pour tre connu . Ces plaintes sont continuelles la fin du XIIe sicle, et elles stendent mme aux auteurs des sentences et des sommes, qui lon reproche de ne pas se contenter des Pres ; dans son Contra quatuor labyrinthos Franciae, Gauthier, prieur de Saint-Victor, combat Pierre Lombard et Pierre de Poitiers non moins quAblard et Gilbert de la Porre. Mais on ne redoutait pas simplement cet envahissement de la thologie par la dialectique, qui profanait la science sacre et faisait des dogmes lobjet de disputes publiques ; on voyait aussi, non sans apprhension, natre une culture dialectique trop pousse, culture purement formelle de lart de la discussion, qui finit par tre prise comme fin en soi. Linterdiction, faite aux matres s arts, denseigner la thologie, avait, comme rsultat, un dveloppement presque monstrueux de lart de discuter. Jean de Salisbury nous dpeint ces purs philosophes qui ddaignent tout en dehors de la logique et ignorent grammaire, physique et thique. Ils y passent toute leur vie ; devenus vieux, ce sont des douteurs purils, ils discutent toute syllabe et mme toute lettre des paroles et des crits ; ils hsitent en tout, ils cherchent toujours, et ils ne parviennent jamais la science... Ils compilent les opinions de tous, et la masse des opinions qui sopposent est telle que le propre auteur du livre peut peine les connatre 1. Impossible de mieux sentir le danger de lexercice de la subtilit pour elle-mme qui fait renatre, aux bords de la Seine, chez un Adam du Petit-Pont, le got des sophismes o staient complu certaines coles grecques. Adam avouait ingnument quil aurait eu fort peu dauditeurs sil avait enseign la dialectique avec des formules simples et faciles entendre 2 ; p.604 on aime mieux faire des collections de sophismes, comme celui-ci o revit
1 2
Metalogicus, I, chap. VI et VII. Cf. GRABMANN, Geschichte der scholastischen Methode, II, 112.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
409
tout lesprit de lcole mgarique : Cent est moindre que deux, puisque cent, par rapport deux cents, est moindre que deux par rapport trois. Jean de Salisbury nest nullement un ennemi de la logique, et il lutte contre ceux qui la dclarent inutile, comme lnigmatique personnage quil appelle Cornificius, qui se vantait de sa mthode pour raccourcir les tudes 1. Mais Jean veut que la logique soit un simple instrument pour la pense : la dialectique dAdam, roulant sur elle-mme et approfondissant ses propres secrets, soccupe de sujets qui ne servent ni dans la famille, ni la guerre, ni au tribunal, au clotre, la Cour ou lglise, nulle part sinon dans lcole (ch. VIII). Or la logique nest faite que pour rsoudre des questions dont la matire est emprunte dailleurs. A ce sujet, Jean suit avant tout les Topiques dAristote, le trait qui a sa prdilection parmi les cinq traits de lOrganon, dont la connaissance complte se rpandait alors en Occident. Limportance des Topiques est considrable ; le livre est alors dans toute sa nouveaut, et il est de style beaucoup plus clair que les Analytiques. Avec un sens historique trs sr, Jean voit bien quil constitue un trait complet par lui-mme ; commenant par les fondements de la logique, enseigns au premier livre, avec beaucoup plus de clart que chez Porphyre et Boce, il y joint les questions morales et physiques dont le tableau est donn au livre III, et sachve avec le livre VIII, le plus utile de tous, o sont enseignes les rgles de la discussion et du tournoi dialectique. Parmi les autres traits de lOrganon, les Catgories et le Periermeneias ne sont faits que pour prparer les Topiques ; les Analytiques nen sont que des appendices ; lart de la dmonstration, enseign dans les Derniers analytiques, est sans usage ; car la nature des choses est trop cache pour que lhomme p.605 puisse connatre la modalit des propositions, le possible, limpossible et le ncessaire. Cest pourquoi la mthode de dmonstration vacille la plupart du temps en physique et na son efficacit pleine quen mathmatique (ch. XIII, fin). On voit ici, en traits nets, lidal dune poque : non pas dcouvrir la nature des choses, mais trouver une mthode gnrale dinvention des arguments, applicable dans les circonstances les plus diverses. On sait bien que lon natteindra ainsi que le probable ; saisir la vrit mme, cela nappartient qu la perfection de Dieu ou dun ange (II, ch. X). Aussi bien, Jean sait que au-dessus de la raison, quil dfinit la manire stocienne par la stabilit du jugement, il y a lintelligence (intellectus) qui atteint les causes divines des raisons naturelles, et la sagesse qui est comme la saveur des choses divines. Mais il en isole fortement la sphre o se dbattent des intrts purement humains avec des moyens humains. Ce mme esprit, humanisme surmont dune thologie, se retrouve dans le Policraticus, o la sagesse humaine, morale et politique, est surmonte dune thocratie. Dans sa partie morale, cette uvre est tout entire pntre de stocisme. Il y a, cette poque, une vidente renaissance de cette doctrine,
1
Cf. ROBERT, Les coles, etc., p. 69, note.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
410
qui concide avec le naturalisme dont nous avons trouv tant de manifestations : lon connat et lon discute les arguments stociens relatifs au destin 1 : Jean nous parle dun nostocien (novus stoicus), un certain Louis, un Italien des Pouilles, qui avait comment Virgile, et qui, reprenant la vieille discussion de Diodore sur les futurs contingents, concluait quil tait impossible de savoir si quelquune des actions que lhomme ne fera pas est pourtant une action possible (II, ch. XXXIII). Ailleurs Jean prouve, selon la bonne doctrine stocienne, que la providence de Dieu ne supprime pas la nature des choses, et que la srie des choses (series rerum, qui est la dfinition p.606 mme du destin) naltre pas la providence ; Tout le livre IV, qui est politique, est pntr des ides stociennes du De Legibus de Cicron ; on y trouve que le prince est lesclave de la loi et de lquit, et que la loi (cest la formule de Chrysippe) est matresse de toutes les choses divines et humaines. Ltat, dit-il encore, doit tre ordonn limage de la nature ; et il cite ce propos comme modle, la description de la rpublique des abeilles daprs les Gorgiques (V, 21). Cest une lettre de Plutarque Trajan quil demande au livre V des prceptes pour la conduite du prince. Mme tendance stocienne dans sa morale particulirement au livre VIII, o il traite des passions, en suivant les Tusculanes. Son stocisme est en effet celui dun Cicron, limit par le doute acadmique. Ce naturalisme, pntr de rationalisme stocien sarrange merveilleusement bien dune thocratie, qui soumet le pouvoir temporel au pouvoir spirituel. Si le prince est le ministre des prtres et infrieur eux , cest qu il est constant que le prince, par lautorit de la loi divine, est soumis la loi de la justice (IV, 3 et 4). Le prtre est donc le premier interprte de cette loi divine que le prince doit toujours avoir devant les yeux (IV, 6). Rationalisme, naturalisme et prdominance du pouvoir spirituel vont de pair en des formules comme celles-ci : Ltat est un corps anim grce aux bienfaits de Dieu, dirig par la souveraine quit et rgi par la rgle de la raison (V, 6). Le prince est donc llu de Dieu ; et de l viennent ses privilges, qui le font considrer dans ltat comme une image de la divinit (VI, 25). De mme que lon trouve la loi stocienne ralise dans le pouvoir spirituel tabli par le Christ, lon voit, daprs Jean, la morale stocienne luvre dans les ordres monastiques, particulirement chez les Chartreux (VII, 23). Bibliographie @
V. ch. IV (546 a) cite la dpicure contre la ncessit fatale du Stocisme.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
411
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
412
CHAPITRE IV LA PHILOSOPHIE EN ORIENT
@ Les destins de lOccident pendant le Moyen ge furent en partie dtermins par la conqute arabe qui, tendue de lInde lEspagne et savanant jusquau sud de lItalie et aux les grecques, forme comme un cran entre lEurope et lAsie : on sait comment, en un sicle ( partir de 635), la domination des Arabes se rpandit dune manire foudroyante, ne sarrtant, bout de course, qu Poitiers en 732 et au Turkestan chinois en 751. Ils apportaient avec eux une langue et une religion qui sont restes, ds lors, la langue et la religion dimmenses territoires. Elles simposrent comme delles-mmes en ces pays de vieille culture hellnistique, Syrie, gypte, Perse, o nous voyions encore, au VIe sicle, des philosophes tout occups commenter Platon et Aristote. Un pareil vnement a eu sur le cours de lhistoire des ides une influence que nous cherchons apprcier trs sommairement dans ce chapitre.
p.609
Les historiens nous apprennent combien peu nombreux taient les Arabes dorigine dans ces vastes territoires, quils occupaient militairement, mais en gardant les cadres administratifs et sociaux des pays conquis ; dans la dislocation qui partagea lempire en souverainets indpendantes, les califes de Bagdad par exemple, mirent leur service toute lorganisation financire et politique des anciens souverains persans 1. On observe, p.610 semble-t-il, un fait analogue dans le domaine intellectuel : convertis lislamisme et crivant en arabe, les philosophes arabes, dont la plupart sont dorigine non pas smitique mais aryenne, trouvent leurs thmes de mditation soit dans les uvres grecques, que les Chrtiens nestoriens, qui peuplent lAsie-Mineure et la Perse, traduisent ds le VIe sicle en syriaque et en arabe, soit dans les traditions mazdennes vivantes en Perse et auxquelles se mlange intimement la pense de lInde (mysticisme des Soufis).
I. LES THOLOGIENS MUSULMANS
@ Le Coran nest donc pas leurs inspirateur direct. Il nen a pas moins eu, sa manire, une influence considrable. Le Coran na engendr, on le sait, aucune thologie dogmatique analogue celle qui dominait lEurope. Il y en a plusieurs raisons : dabord la plupart des controverses thologiques naissaient
1
Cf. HALPHEN, Les Barbares, livre I, ch. X et XI, Paris, Alcan, 1926.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
413
de questions que la doctrine du Coran cartait implicitement : les controverses trinitaire et christologique, pas plus que celle de la grce nont aucun sens dans une doctrine qui admet la radicale unit de Dieu et ignore rien de pareil au sacrement ; Dieu et son prophte Mahomet, qui a consomm luvre des deux prophtes Abraham et Jsus, ainsi se rsume la religion de lIslam : sommaire et nette comme un paysage du dsert et nayant pas le got hellnique pour les spculations compliques sur la nature de la ralit divine. Dautre part, il ny a dans lIslam aucun pouvoir spirituel charg de dire le dogme ; le Coran ne se surcharge daucune addition qui ait force contraignante. LIslam connat les prophtes, hommes inspirs de Dieu, mais il nen est aucun qui puisse ajouter la lettre du Coran. Le livre sacr, bien plus pratique et juridique que thorique, ne renferme quun seul dogme, dont Mahomet emprunta lide p.611 au monothisme juif : celui dun Dieu unique, absolument simple de nature, et dont la volont est toute puissante et imprvisible. Ce dogme implique une reprsentation de lunivers, aussi contraire que possible celle du noplatonisme rgnant dans les pays conquis par les Arabes : dun ct, cest larbitraire divin le plus complet, de lautre, cest lide de cet ordre rationnel de dveloppement que la pense grecque a introduit dans le monde. Cest cette opposition qui fut le seul thme de la thologie musulmane proprement dite, celle des Motekallemin et des Motazilites, qui sefforcrent de dresser, contre leurs adversaires, une image cohrente de lunivers selon le Coran. Toute la rflexion se concentre autour de deux questions purement thologiques : ngation de la multiplicit en Dieu, ngation de tout pouvoir autre que celui de Dieu. Sur le premier point, on se demandait comment, si Dieu tait un, on pouvait dire quil tait bon, savant, juste, etc. Les uns vont jusqu nier de Dieu toutes ces proprits : les autres, sans les nier compltement, les considrent comme des modes ou manires dtre sous lesquels apparat lessence divine, mais qui ne lui ajoutent rien ; mais ce ne sont point des qualits, et celui qui affirme une qualit ternelle ct de Dieu affirme deux dieux . Dautres, enfin, les affirment comme des qualits ternelles subsistant par lessence de Dieu. A propos du second point, les thologiens craignent de voir la puissance de Dieu limite dune part par le libre arbitre, dautre part par un dterminisme qui accepterait lide de ncessit naturelle. La ngation du libre arbitre donne naissance, par raction, au dbut du VIIIe sicle, lcole des motazilites (les spars), qui, sous limpulsion de Wasil, fils dAta, accordent lhomme la libert pour sauvegarder la bont de Dieu ; il serait incapable de dcrter laction mauvaise, alors quil ordonne le bien ; cest dans le mme esprit conciliant que Wazil, le fondateur de la secte, admettait, entre le croyant juste et limpie, ltat intermdiaire de croyant pcheur, ide qui rappelle la p.612 solution modre que les moyens stociens donnaient au problme du progrs moral.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
414
Quant au dterminisme naturel, il faut se rendre compte quil est indissolublement li par la tradition grecque limage dun monde ternel volution cyclique et dun dieu agissant la manire dune force naturelle. Par contre, la thse de la cration amne avec elle un indterminisme radical dans la production des choses non seulement au premier moment mais aussi dans la suite des temps. De l latomisme que soutient lcole dAl Aschar (876-935) : la continuit de la substance est impossible ; car il faudrait admettre que Dieu ne ft pas libre de crer une partie sans les autres ; donc les corps sont faits datomes intendus flottant dans le vide. Pas davantage de continuit dans le temps, form dune srie dinstants indivisibles, ni dans le mouvement, fait de bonds spars et indivisibles. Aucune ncessit non plus dans linhrence des proprits latome ; car tous les atomes sont identiques ; et leurs proprits, couleur, vie, sont des accidents surajouts. Aucune ncessit enfin pour que ces accidents, existant dans la substance un moment donn, y existent linstant suivant ; ils sont, chaque instant, leffet dune cration directe de Dieu, et il ny a pas de loi naturelle qui ncessite lexistence ou la non existence de quoi que ce soit. Dans cet atomisme, qui est la gloire dAllah, on chercherait vainement rien qui rappelle le rationalisme dpicure.
II. LINFLUENCE DARISTOTE ET DU NOPLATONISME
@ Linfluence grecque, contraire cette thologie, se rpandit dabord grce aux traductions du grec en syriaque par les chrtiens nestoriens, qui, dabord lcole dEdesse (431-489), puis dans les clotres de Syrie, enfin, au VIIe sicle, Kennesre sur lEuphrate, traduisent, outre lOrganon dAristote, le trait p.613 pseudo-aristotlicien Du monde et les uvres de Galien. Au IXe sicle, aprs la fondation de Bagdad, on traduit beaucoup en arabe soit du syriaque, soit du grec, et le calife lui-mme fonde, en 832, dans sa capitale, une sorte de bureau de traducteurs. Vers la fin du IXe sicle, un Arabe possdait en sa langue luvre presque entire dAristote (sauf la Politique), avec les commentaires dAlexandre, de Porphyre, de Thmistius, dAmmomus, de Jean Philopon ; il pouvait connatre en outre quelques dialogues de Platon comme le Time, la Rpublique, le Sophiste ; la doxographie grecque lui tait accessible, grce la traduction des Opinions des Philosophes de Plutarque sans compter des faux dEmpdocle et de Pythagore ; enfin la mdecine, avec Galien, lastronomie avec lAlmageste de Ptolme, leur taient connues. Comment utilisent-ils ces matriaux ? Leur interprtation dAristote est domine par deux traits qui lui sont faussement attribus. Vers 840, on traduit en arabe, sous le nom de Thologie dAristote un choix dextraits de sept traits des trois dernires Ennades de Plotin ; la traduction est prcde dune prface qui est un expos rsum de la thorie noplatonicienne des
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
415
hypostases ; la triade Dieu, Intelligence et Ame (o chaque terme dcoule du prcdent), il ajoute un quatrime terme, la Nature, qui drive de lme ; et il fait correspondre chacun de ces quatre termes aux quatre causes dAristote, finale, formelle, motrice et matrielle. Parmi les extraits se trouve en entier le deuxime trait de la cinquime Ennade, qui contient en raccourci toute la doctrine de Plotin. Le second trait, faussement attribu Aristote est le trait Des Causes, qui contient des extraits des Elments de thologie de Proclus. Sous ces influences, la philosophie arabe, dans la mesure o elle suit les Grecs, est essentiellement constitue par une interprtation noplatonicienne de luvre entire dAristote o paraissent au premier plan, avec les deux traits que nous venons de rappeler, le livre V de la Mtaphysique et le livre VIII de p.614 la Physique, qui contiennent les spculations dAristote sur lIntelligence motrice des cieux, ainsi que le livre III De lme, qui traite de la nature de la connaissance intellectuelle. Or on ne peut rien concevoir de plus diffrent, certains gards, que lesprit dAristote et celui du noplatonisme : dune part, un empirisme rationaliste, une technique logique, une orientation positive ; dautre part une sorte de mythologie des forces spirituelles o lunivers apparat baign et que lon saisit par intuition.
III. AL KINDI
@ Ce qui caractrise les philosophes arabes, cest laisance avec laquelle ils savent passer dun esprit lautre. Le premier des pripatticiens arabes connus, Al Kindi (mort en 872), est un mathmaticien trs soucieux de connaissance positive : Celui qui veut connatre les dmonstrations logiques, dit-il, doit longtemps sattarder aux dmonstrations gomtriques et en recevoir les rgles, dautant quelles sont plus faciles comprendre, parce quelles se servent dexemples sensibles. La dmonstration est pour lui une sorte de mesure pour laquelle il faut dabord avoir une rgle juste et ensuite la bien appliquer 1 . Elle suppose donc des connaissances antrieures et indmontrables qui sont de trois espces : dabord la connaissance de lexistence de lobjet dont on veut dmontrer les attributs (an sit) ; cette connaissance est donne directement par les sens ; la connaissance des axiomes universels connus par soi tels que les neuf axiomes dEuclide, connaissance commune et qui nexige ni mditation ni rflexion ; enfin la connaissance de la quiddit ou dfinition de lobjet, connaissance qui, au moyen des axiomes, permettra de dmontrer les attributs. On se rappelle toute les difficults quavait engendres chez p.615 Aristote la thorie de la dfinition et de la quiddit : Al Kindi se trouve en prsence des mmes difficults : la quiddit dun tre nest cornue ni par les sens qui
1
Traduction Nagy, p. 46.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
416
natteignent que lexistence, ni par linduction qui natteint que les proprits. Il faut donc, pour dgager la quiddit des donnes sensibles, une opration spciale, qui est dcrite dans le trait De intellectu et intellecto. Conformment au thorme fondamental de la mtaphysique dAristote : un tre ne peut passer de la puissance lacte sinon sous linfluence dun tre dj en acte, il faut quil existe un intellect toujours en acte , qui pense toujours les quiddits ; ainsi sexplique que lintellect en puissance qui est dans lme (cest--dire la capacit de penser les quiddits), puisse devenir lintellect qui passe de la puissance lacte , et aboutisse l intellect acquis (adeptus) , capable de dmonstration. Ainsi la connaissance des quiddits na lieu que dans une me capable de la recevoir, et grce une intelligence premire toujours en acte qui, tant la forme universelle des choses (Dieu) et donnant aux choses leurs quiddits ou formes, accorde aussi ces formes lintelligence en puissance.
IV. AL FARABI
@ Ces vues sur lopration intellectuelle impliquaient donc en germe toute une thologie, celle que nous trouvons dveloppe chez Al Farabi (n la fin du IXe sicle). En elle viennent se croiser linfluence dAristote, et celle de Platon. A Aristote, il emprunte sa thologie astrale, simplifie par lastronomie arabe : un Dieu suprme au-dessus des mondes, les cieux composs de huit sphres concentriques et embotes, celle des fixes et celles qui portent chacune des sept plantes, chacune des sphres ayant son mouvement circulaire propre dirig par une intelligence ; au-dessous enfin la sphre sublunaire. A Plotin (par la pseudo Thologie dAristote), il emprunte limage gnrale de la production des p.616 tres, de cette sorte de loi dvolution qui va de lUn au Multiple, de lternel au Temporel et au Changeant. Au dbut, un principe suprme, Dieu, qui, connaissant son essence, connat par l mme toutes les choses ; il les connat dabord dans leur unit absolue, identique sa propre essence ; et cest l sa premire science ; il les connat ensuite dans linfini dtail de leur multiplicit ; et cest l sa seconde science, rductible au fond la premire. Comment de cette absolue unit drivera la multiplicit ? Quon se rappelle comment chez Plotin, de lUn naissait lIntelligence ; quelque chose dindtermin mane de lUn et, se retournant vers lUn, cette chose devient intelligence en le contemplant et en se connaissant elle-mme. Cest la description mme dAl Farabi : de lUn ternel ne peut venir quun tre unique et ternel qui est un intellect ; tant driv, il est compos ; car il nest par lui-mme que possible. Il faut donc distinguer en lui la connaissance quil a du Principe, comme fondement de son existence ; la connaissance de son existence comme possible, cest--dire de sa matire (la matire ntant que ltre en puissance) ; la connaissance quil a de lui-mme, qui est sa forme ou essence.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
417
De ces trois connaissances naissent trois tres ; de la connaissance quil a du principe nat un second intellect qui sera lui comme il est au Principe ; de sa matire nat la matire de la premire sphre (cette matire topique qui est la simple possibilit du mouvement circulaire) ; de sa forme nat lme motrice de cette sphre. Ainsi commence la procession des intellects et des sphres clestes avec leurs mes, chaque intellect produisant son tour un intellect subordonn, une sphre et une me motrice, jusqu la dernire des sphres, celle de la lune, domine par le dernier des intellects, lintellect actif . Chaque intellect est comme la loi du mouvement de la sphre. Il connat lordre de bien qui mane de lui et, en le connaissant, le produit. Dautre part il imagine aussi le mouvement qui porte sa sphre dun point un autre ; cette image est p.617 son tour cratrice ; elle cre ce quil y a dordre dans la transmutation des lments dans la rgion sublunaire. Les intellects, et en particulier le dernier, lintellect actif, contiennent, indivisiblement, toutes les quiddits ou formes des choses sensibles ; mais ces quiddits se sparent les unes des autres dans la rgion sublunaire, o chaque tre nest quun tre spar des autres. Cest partir de cet tat de sparation que commence la connaissance intellectuelle dans lme humaine. La connaissance est un mouvement de runion qui est exactement linverse du mouvement de division. Lintellect actif voulant runir le plus possible ce qui a t divis cre lintellect acquis dont fait partie la nature humaine. Les divers intellects que distingue Al Farabi dans lme humaine ne seront que les principaux moments dans le passage de la division lunit. Au plus bas degr lintellect en puissance qui est la capacit dabstraire les formes de la matire et de runir ou classer ces formes ; au-dessus lintellect en acte, qui est la ralisation effective de cette capacit ; lintelligible, mlang dabord limage et accompagn de particularits individuelles, est peu peu purifi et dgag en passant du sens au sens commun, et du sens commun limagination, o lintellect en puissance prend la matire de son activit abstractive. Au-dessus de lintellect en acte se trouve lintellect acquis qui saisit, dune vue intuitive, les formes dans lunit de leur principe. Au-dessus enfin lintellect actif, celui de la lune, qui prcde tous les autres et qui a dclench toute leur activit, en faisant passer lacte lintelligence en puissance. Thorie des intellects trs diffrente de celle dAl Kindi, tout imprgne de lesprit de Proclus, hirarchisant les intellects de telle manire que chacun partir de lintellect actif soit celui qui le suit, comme une forme une matire. Il ne faudrait pas croire, au reste, que cette thorie de la connaissance intellectuelle exclut, pour Al Farabi, tout autre mode de liaison de lme humaine avec la ralit suprme. p.618 Comme chez Plotin, Dieu est, tantt le premier terme dune srie dmanations parmi lesquelles lintelligence humaine trouve un rang et une place dtermins ; tantt il est ltre simple, en dehors de toute la srie, dont lme, cartant le monde sensible peut jouir directement. tant au-dessus de tout, il est sans aucun voile ; il na aucun
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
418
accident sous lequel il se cache ; il nest ni prs ni loin ; il ny a aucun intermdiaire entre lui et nous.
V. AVICENNE
@ Avicenne (980-1036) na rien ajout dessentiel la mtaphysique dAl Farabi. Il part, comme lui, dun Dieu pure intelligence qui, en connaissant son essence, connat toutes les choses, mme les choses individuelles, dans leurs raisons foncires et leurs pures quiddits ; il dcrit de la mme manire lmanation des intellects et des mes motrices qui font tourner les sphres dun mouvement uniforme pour imiter autant que possible limmutabilit des intellects do elles drivent. Comme chez Al Farabi, la connaissance est due linfluence que lintellect agent, ou intellect de la sphre de la lune, exerce sur les intellects disposs la subir ; cest lui qui a donn aux choses sensibles leurs formes ou quiddits, autant que la matire est susceptible de les recevoir, et cest lui qui produit dans les intellects la connaissance. Mais Avicenne distingue plusieurs ordres de connaissance : il y a la connaissance des principes premiers ou axiomes, la connaissance des ides abstraites, enfin la connaissance par rvlation, telle que celle de lavenir ; au premier correspond l intellect dispos ou prpar , ainsi appel parce que la puissance y est proche de lacte ; au second, lintellect en acte qui peroit actuellement les formes intelligibles que lintellect matriel ou possible peroit en puissance ; au troisime lintellect man ou intellect infus qui vient du dehors . Avicenne a dcrit avec abondance le mcanisme du second de ces intellects. On arrive, par un lent progrs, dgager la notion abstraite de la chose sensible ; lopration commence avec la sensation qui ne reoit de lobjet que la forme ( ce nest pas la pierre qui est dans lme, mais sa forme ), mais non dpouille encore de ses dpendances matrielles , cest--dire des caractres dus la matire qui en font un individu, ni des accidents qui tombent sous les catgories autres que la substance : quantit, situation, etc. La fantaisie ou formative , place en la cavit gauche du cerveau, garde encore limage son individualit, mais commence la sparer des conditions de lieu ou de temps o elle existait. Puis la cogitative, imaginative ou collective , lassociant dautres images semblables, produit une sorte de notion grossire qui, sans tre encore dbarrasse des caractres individuels, tend vers luniversel. Les images rendent possible l opinion , par laquelle, sans aucune rflexion, la brebis par exemple distingue le loup des autres animaux. Cest dans les images, ainsi prpares, que lme raisonnable, sous linfluence de lintellect agent, dcouvre les formes abstraites, partir desquelles les oprations logiques et rflchies deviennent possibles.
p.619
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
419
Mais Avicenne reconnat les troites limites de cette connaissance intellectuelle chez lhomme ; lhomme ne peut connatre lessence des choses, mais ce qui en est insparable ou en est propre ; par exemple, du corps, il sait non pas ce quil est, mais quil a trois dimensions ; les essences sont seulement conclues des propres 1. Lme peut pourtant arriver un tat plus parfait : dans ltat de sommeil, dpouille du corps, elle est mieux dispose recevoir linfluence de lintellect agent qui, dverse sur la facult imaginative, produit les songes prophtiques ; et aprs la mort, elle atteindra une connaissance plus parfaite encore. Un contemporain dAvicenne est Alhazen (965-1038) dont la Perspective et ltude de loptique ont eu la plus grande influence sur les latins du XIIe sicle : il est lauteur dune analyse de la perception visuelle qui, encore aujourdhui, reste classique et que nous retrouverons chez Witelo.
p.620
VI. AL GAZALI
@ Luvre dAl Gazali (1058-1111), qui enseigna Damas et Jrusalem nous est un tmoignage de linquitude que causait la diffusion du pripattisme dans lIslam : sa Tehfut el Falsifah (Destruction des philosophes) est consacre exposer le pripattisme pour le rfuter ensuite. A la thse de lternit du monde, il rplique quelle blesse la volont dindiffrence que lon doit attribuer Dieu, en lui imposant ternellement le choix dun ordre dtermin ; linfinit du temps pass implique la rgression linfini des causes, qui est impossible, puisque le nombre infini, ntant ni pair ni impair, est contradictoire. Les philosophes nont pu dmontrer non plus ni lunit de Dieu, ni la spiritualit de lme, ni la ncessit du lien causal. Il est dailleurs difficile de dfinir lattitude propre de Gazali : selon Averros, il nappartient aucune secte : il est ascharite avec les ascharites, soufis avec les soufis, philosophe avec le philosophes , et par sa Destruction, il voulut se garantir contre la haine des thologiens, qui ont toujours t les ennemis des philosophes 2 . Quil soit ou non sceptique, on trouve chez lui une sorte de critique sceptique de la connaissance, qui correspond un courant qui parat avoir t assez gnral dans lIslam cette poque : lincertitude des sens qui se contredisent et sont contredits par la raison, lincertitude de la raison dont les principes, de mme quils jugent les sens, peuvent p.621 tre jugs par des principes qui nous restent inconnus, voil la vieille argumentation des sceptiques grecs, que lon retrouve chez dautres penseurs arabes 3.
1 2
Liber Aphorismorum de Anima, trad. ANDRE DE BELLUNE, p. 101-121. Cit par WORMS, dans BAUEMKER, Beitrge zur Philosophie der Mittelalters, III, p. 51. 3 Cf. CARRA DE VAUX, Gazali, p. 115 et 45.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
420
VII. LES ARABES EN ESPAGNE : AVERROS
@ Les philosophes, dont il nous reste parler, appartiennent la florissante Espagne musulmane du XIIe sicle. Avempace (Ibn Badja, mort en 1118) de Saragosse, a cherch dans son Rgime du Solitaire dcrire les divers degrs par lesquels un homme seul, en dehors de toute influence sociale, arrive sidentifier lintellect actif, devenir membre dun tat parfait, o lon ne connat ni la justice ni la mdecine, lots de nos tats imparfaits qui ont lutter contre les maux ; au-dessus des ides abstraites de la matire quont dcrites les philosophes, il lui faut aboutir des formes intelligibles, qui sont spares de la matires par elles-mmes et non plus par lintelligence et qui se rduisent finalement lunit. Abubacer (Ibn Tofal, 1100-1185) de Cadix, en son roman philosophique, Le Vivant Fils du vigilant, imagine ce que pourrait tre le solitaire dAvempace, sil naissait de la terre, en une le inhabite ; alors on le verrait, partant des connaissances sensibles, slever aux formes abstraites des corps, puis leurs causes gnrales, les cieux ternels et leurs moteurs, enfin jusqu Dieu, en se dtachant tout fait des sens. Averros (Ibn Roschd, 1126-1198) de Cordoue se donne surtout pour tche de dterminer le sens vritable dAristote contre les dformations de ses interprtes. Deux points surtout doivent tre mis en lumire : sa thorie de la production des formes substantielles, et sa thorie de lintellect possible. La premire est dirige contre Avicenne : on voit, dans la p.622 gnration spontane, la forme substantielle apparatre, dans la nature, comme une nouveaut absolue qui ntait point contenue dans la matire ; mais il en serait ainsi, selon Avicenne en toute gnration ; la nature par elle-mme ne produit que des combinaisons venant de laction rciproque des quatre qualits premires ou actives, le froid et le chaud, le sec et lhumide ; mais la forme substantielle qui, dune combinaison donne, fait tel ou tel tre, viendrait dun dator formarum qui est une intelligence suprieure et extrieure la nature. Averros reproche Avicenne de faire ainsi de ltre naturel non plus un tre un, mais deux tres accols produits par deux agents distincts ; il est davis, pour sa part, quune nouvelle forme substantielle est introduite en une matire par une autre forme qui existe dj dans une matire (cest la gnration dite univoque : lhomme engendre lhomme), sans quon ait recourir un dator formarum extrieur la matire. Le corps qui possde une forme substantielle est capable dabord, par ses qualits actives, de transformer la matire au point o elle doit ltre pour recevoir la forme, puis dengendrer la forme en la matire ainsi transforme. Sa thorie de lintellect est dirige contre linterprtation dAlexandre dAphrodise (quil semble souvent confondre avec Aristocls). On sait que,
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
421
dans lintellect en acte, lintelligence est identique lintelligible quelle pense : or lintelligible est ternel ; lintelligence est donc ternelle comme lui : mais si le sujet qui pense les intelligibles est ternel, on demande comment nous, qui sommes corruptibles, nous pourrons les penser : Alexandre, faisant de lintellect matriel, qui est nous-mmes, un tre engendr et corruptible, est par l incapable dexpliquer comment nous les pensons. Il faut donc que lintellect matriel, sil est capable de penser, soit inengendr, incorruptible, identique pour tous les hommes. Mais alors la difficult est inverse : comment sexplique notre activit intellectuelle propre qui commence un certain moment du temps ? p.623 La seule solution possible est dadmettre que cet acte intellectuel nest pas une intellection nouvelle, un acte qui nous unit en ce moment lintellect agent ; ce qui vient de nous, et ce qui disparat avec nous, cest cette simple disposition, appele intellect passif, qui consiste en ce que ltat de nos images nous permet de recevoir lternelle manation de lintellect agent. Lon verra bientt le dveloppement de laverrosme chez les latins : quil suffise de dire que, selon lui, cette philosophie nest pas du tout oppose la religion ; religion et philosophie reprsentent deux tapes de la pense ; la religion cache sous un voile, pour les rendre accessibles au profane, les vrits que le philosophe dcouvre et dont la connaissance est le culte mme quil rend Dieu.
VIII. LA PHILOSOPHIE JUIVE JUSQUAU XIIe SICLE
@ Cest dans le monde arabe que se dveloppa, aux mmes sicles, la philosophie des Juifs. La Kabbale dsigne moins une doctrine particulire que la forme juive de la mystique noplatonicienne ; en face du Talmud, commentaire juridique et littral de la Loi, elle reprsente un tat desprit analogue celui que nous avons vu natre chez Philon dAlexandrie : sens mystique des lettres et des nombres, qui sont les signes par lesquels la Sagesse se fait entendre aux hommes ; correspondance mystrieuse de ces lettres avec la composition du monde, les divisions de lanne, la conformation de lhomme ; emploi de la mthode allgorique qui permet de voir en chaque mot de la Loi un sens lev et un mystre sublime, mythologie des puissances et des anges qui multiplie les intermdiaires entre Dieu et les cratures, rien de tout cela ne parat fort nouveau. Isaak Israli, juif dgypte (de 845 940) pense surtout en noplatonicien dsireux, quil parle de la mtaphysique ou de p.624 la thorie de la connaissance, de retrouver une hirarchie o linfrieur procde du suprieur et en est comme lombre : intelligence, me raisonnable, me animale, me vgtative ; dans lintelligence, intelligence en acte, intelligence en puissance, imagination, sens, voil des manires de classer que nous connaissons.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
422
Compilations utiles et non sans importance historique, puisque les latins du XIIIe sicle trouvent en son Livre des Dfinitions, la fameuse dfinition de la vrit : adaequatio rei et intellectus. Saadja (892-942), un autre juif dgypte qui vcut en Babylonie tenta, dans son Livre de la Foi et du Savoir, crit en 932, de dterminer la part de la raison et de la rvlation dans la loi. Des commandements tels que lordre de servir Dieu et linterdiction de le mpriser, linterdiction de se faire tort lun lautre sont rationnels ; il en est dautres dont lobjet, indiffrent en soi, devient loi par la volont de Dieu et qui ne peuvent tre que rvls ; mais ces seconds commandements sont indispensables pour lexcution des premiers qui, trop gnraux, ne dterminent pas les circonstances de leur application. Comment dfendre le vol, si lon ne dfinit pas la proprit ? Cest dans lEspagne et au Maroc que se dveloppe la philosophie juive. Avicebron (Salomon ben Gebirol ; 1020-1070), de Malaga, a crit une Fons Vitae dont limportance historique est grande : elle deviendra, au XIIIe sicle latin, une des sources principales du noplatonisme. Elle renferme, avant tout, une classification hirarchique des ralits : dabord le Dieu lev au-dessus de tout, puis la Volont, puis la Forme, insparable de la Matire quelle dtermine. Lobjet propre de la Fons est ltude de la forme et de la matire : lide gnrale de cette tude est la suivante : Toutes les choses qui manent dune origine sont rassembles quand elles sont prs de lorigine et disperses quand elles en sont loin. Au plus haut niveau la forme universelle qui contient, unies en elle, toutes les formes ; au plus bas degr les choses sensibles qui contiennent aussi p.625 toutes les formes, mais spares les unes des autres et disperses ; entre les deux, des ralits telles que lintelligence qui contient unies mais pourtant distinctes, toutes les formes. Un second principe dAvicebron est quil ny a pas de forme sans matire ; mais chaque niveau de la ralit correspond une matire qui est dautant plus parfaite que le niveau est plus lev : car la perfection dune matire consiste recevoir les formes ltat dunion le plus grand possible. De l lordre de la Fons Vitae, qui commence par le niveau le plus bas, celui des substances corporelles : elle tudie successivement la matire corporelle qui soutient les qualits sensibles, la matire spirituelle qui soutient la forme substantielle du corps, la matire des substances spirituelles intermdiaires (mes), celle des substances simples (intelligences), enfin la matire universelle qui soutient la forme universelle. On voit la place que tient en cette hirarchie la connaissance intellectuelle ; les formes sont dans lintelligence toutes ensemble et unies elle dune union spirituelle essentielle, non pas de cette union accidentelle qui les joint au corps : trait essentiel au noplatonisme qui ne surajoute pas la connaissance la ralit, mais la considre elle-mme comme un des niveaux des ralits qui stagent entre lUn et le multiple. Mose Mamonide, qui naquit Cordoue (1135) et mourut au Caire (1204), est avant tout, dans son Guide des gars, un rabbin qui explique la
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
423
Loi et naborde les sujets philosophiques, questions des intelligences spares, des mouvements des sphres, de la forme et de la matire, que pour mieux comprendre le Livre. La spculation philosophique est autonome (comme le pensera saint Thomas) ; mais elle confirme les vrits de la Loi. Cette position donne la pense de Mamonide quelque ambigut, ou du moins une diversit daspects qui se concilient mal. Sagit-il par exemple de dmontrer philosophiquement lexistence de lunit de Dieu (livre II) ? Mamonide emprunte aux pripatticiens une dmonstration qui repose sur lternit p.626 de lunivers, admise par eux : car cest par la considration du mouvement sans commencement ni fin des sphres clestes quil arrive conclure un moteur infini qui est Dieu. Pourtant il nadmet pas lternit du monde, sinon titre dhypothse et pour que la dmonstration soit possible. Son systme du monde est au total, comme celui de tous les philosophes arabes, le systme des sphres homocentriques issu dAristote ; mais il reste, l aussi, fort sceptique sur lexactitude de cette reprsentation, quil ne juge pas susceptible dtre dmontre. Le centre des proccupations de Mamonide est, semble-t-il, le rle intellectuel et social du prophte 1. La prophtie est une manation de Dieu qui se rpand, par lintermdiaire de lintellect actif, sur la facult rationnelle dabord et ensuite sur la facult imaginative. Rpandue sur la facult rationnelle seule, elle fait les savants spculatifs ; sur la raison et limagination, elle fait les prophtes proprement dits, indispensables pour runir les hommes en une socit parfaite, et pour rgler les actions des individus humains, dont la diversit et par suite les conflits possibles dpassent tout ce que lon voit dans les autres espces.
IX. LA PHILOSOPHIE BYZANTINE
@ La ville de Constantin avait, au Moyen ge, toutes les ressources pour continuer la tradition philosophique grecque ; mais, ville de juristes, dhommes daffaires et de thologiens, elle nen avait pas le got ; le nombre de chaires de philosophie dans lUniversit de Constantinople est infime ct des chaires de sophistique et de jurisprudence 2. Aussi ne voit-on gure que des rudits et des commentateurs, pour qui la seule question p.627 vivante est celle du conflit entre Platon et Aristote. Lrudit Photius (820-897) qui, dans sa Bibliothque, nous a conserv tant dextraits ou de rsums de philosophes grecs, marque une prdilection pour Aristote. Au contraire Psellos (1018-1098) se fait le dfenseur de Platon ; Platon est le vrai thologien ; Aristote, le plus souvent, a touch dune manire trop humaine
1 2
Guide des gars, trad. MUNK, p. 281. Code thodosien, XIV, 9, 3 ; 5 chaires de rhtorique, 20 de grammaire, 2 de sciences juridiques, 1 seule de philosophie.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
424
aux dogmes thologiques. Luvre de Psellos, qui est immense, est le point de dpart de ce courant de philosophie platonicienne, qui, par Plthon et Bessarion, se propagea lItalie de la Renaissance et dans le reste de lOccident. Aussi importe-t-il lhistoire des ides de bien dfinir ce qutait son platonisme. Son inspirateur, cest surtout Proclus, cet homme dune nature suprieure, qui a tout approfondi en philosophie , Je me suis dirig, raconte-t-il encore, vers Plotin, Porphyre et Jamblique, pour marrter ladmirable Proclus comme dans un vaste port. Cest lui qui ma fourni la science et de justes ides 1. Cette doctrine devait plaire plus que tout autre un esprit de formation juridique comme celui de Psellos. Il eut fort faire pour restaurer cette philosophie paenne ; lexemple de saint Jean Damascne, qui dnonait les erreurs sataniques des sages paens , les moines du mont Olympe, qui il voulait faire admirer Platon, traitaient le philosophe athnien de satan hellnique . Mais, comme il le dit en rponse aux reproches de son ami Xiphilin, fait-il autre chose que continuer la tradition des pres cappadociens, en utilisant Platon pour la dfense des dogmes chrtiens ? Les doctrines de Platon sur la justice et limmortalit de lme ne sont-elles pas pour les ntres des points de dpart de doctrines semblables ? 2. Dans luniversit de Byzance restaure par Constantin Monomaque, Psellos sefforce de reprendre la tradition de lenseignement noplatonicien, la base les sciences numres au VIe livre de la Rpublique, que lon p.628 enseigne avec les manuels de Nicomaque, de Grasa, dEuclide et de Diophante pour les mathmatiques, de Ptolme et de Proclus pour lastronomie, dAristoxne pour la musique ; au-dessus, la philosophie qui dbute par la logique dAristote et se termine par les commentaires de Proclus ; au-dessus encore lexplication allgorique des textes inspirs, tels que les pomes dOrphe ou les oracles chaldens. Aucune revendication doriginalit en tout cela : Mon seul mrite, dit-il, consiste en ce que jai recueilli quelques doctrines philosophiques puises une fontaine qui ne coulait plus 3. Il en rsulte un rationalisme trs dcid qui lamne attaquer (comme lavait fait Plotin) les superstitions de son temps et particulirement la croyance aux dmons quil reproche au patriarche Michel Crularius : Psellos entend rester un mtaphysicien spculatif et non pas dvier vers la thurgie. La tradition reprise par lui continue avec ses lves Michel dphse, Jean Italos qui transcrivent inlassablement les commentaires noplatoniciens dAristote ou de Platon. Eustrate, llve dItalos, est un vque de Nice, blm pour enseigner la mme doctrine plotinienne des hypostases quAblard enseigna un peu plus tard Paris. Le noplatonisme de Proclus, si attaqu quil ft par les thologiens (nous avons par exemple une rfutation
1 2
Cf. ZERVOS, Michel Psellos, p. 193, n. 2 et 3. uvres, d. Sathas, p. 444 sq. 3 ZERVOS, Michel Psellos, p. 40.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
425
des lments de thologie de Proclus, au XIIe sicle, par Nicolas de Modon) 1, persiste au XIIe sicle avec Michel Italicos et Nicphore Blemmyds, aux XIIIe et XIVe sicles avec Georges Acropolite, Joseph, Thodore Mtochita, Nicphore Gregoras, au XVe sicle avec Demetrios Kydonis et Gmiste Plthon, qui introduisit le platonisme Florence, la Cour des Mdicis et qui prit souvent la dfense de Platon contre les Pripatticiens. Il semble avoir vu trs srieusement dans le platonisme le point dappui dune religion universelle : Je lui ai entendu dire, p.629 crit Georges de Trbizonde, lorsque nous tions Florence, que, dans peu dannes, tous les hommes, par toute la terre, embrasseraient dun commun consentement et avec un mme esprit, une seule et mme religion... Et sur ce que je lui demandais, si ce serait la religion de Jsus-Christ ou celle de Mahomet : ni lune ni lautre, me rpondit-il, mais une troisime qui ne sera pas diffrente du paganisme 2. Telle est lissue du mouvement inaugur par Psellos. Contre Plthon, Thodore Gaza reprsente au XVe sicle, la vieille tradition de laccord de Platon avec Aristote 3. Les commentaires dAristote se poursuivirent dailleurs Byzance pendant toute cette priode : parmi les disciples mmes de Psellos, Michel dphse commente une partie de lOrganon et le Xe livre de lthique Nicomaque, Jean Italos, le De Interpretatione, Eustrate, lthique Nicomaque et les Seconds Analytiques. Nicphore Blemmyds, Georges Pachymre (1242-1310), Sophonias, Jean Pdiasimos, Lon Magentinos ont, au XIVe sicle, paraphras ou rsum les traits logiques et psychologiques dAristote et ont copi les commentaires de Simplicius et dAmmonius. Enfin il convient dindiquer tout au moins, ct de ces philosophes officiels et universitaires, un courant dides mystiques qui se poursuivit dans les monastres ; il a une de ses premires manifestations dans lchelle du Paradis de saint Jean, dit Climaque, abb du monastre du mont Sina au dbut du VIIe sicle ; cette uvre, qui devint clbre et qui fut connue notamment en Occident par Gerson, a subi des influences dune pense philosophique plus populaire que celle de Platon et dAristote, et lon trouve en elle un cho de la pense stocienne et cynique. Saint Jean indique en effet trente degrs successifs dans son chelle, et le vingt-neuvime est limpassibilit p.630 () ; limpassible est celui qui a rendu sa chair incorruptible, qui a lev sa pense au-dessus de la cration, et qui lui a subordonn toutes ses sensations 4. Saint Jean voyait dans les Pres du dsert, en gypte, dont lHistoire Lausiaque nous raconte la vie, dillustres
1 2
dit par Voemel, Francfort, 1825. Trad. BOIVIN, Mmoires de lAcadmie des Inscriptions, II, 1717, cit par ZERVOS, Michel Psellos, p. 239. 3 Cf. Thodore GAZA, De fato, ed. Taylor, Toronto, 1925. 4 MIGNE, Patrologie grecque, LXXXVIII, p. 1148 b et 1149 a..
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
426
exemples de cette impassibilit ; son uvre forme ainsi un des chanons qui relie la mystique chrtienne aux Pyrrhon et aux Diogne. Le courant de mysticisme spculatif, qui se rattache Denys lAropagite continue aussi dans les monastres grecs, avec Symon (1025-1092) qui soutenait que lintuition mystique tait incompatible avec la vie mondaine et possible seulement chez les moines. Grgoire Palamas et son lve Nicolas Cabasilas, qui furent lun et lautre, vers le milieu du XIVe sicle, archevques de Thessalonique, prennent parti pour les Hsychastes, qui soutiennent quil existe, en dehors de la Trinit, une lumire incre qui mane delle et qui met le mystique en communication avec Dieu, suprme manifestation de lmanatisme noplatonicien au sein du christianisme. Bibliographie @
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
427
CHAPITRE V LE XIIIe SICLE
I. CARACTRES GNRAUX
@ On sait quel magnifique loge Auguste Comte 1 fait du XIIIe sicle : ge organique par excellence qui a ralis lunit spirituelle, la vritable catholicit. Vers ce sicle se tourne le rve de tous ceux qui jugent impossible toute paix sociale sans le fondement dune foi commune qui dirige la pense et laction et se subordonne la philosophie, lart et la morale.
p.633
Assurment, il nexiste peut-tre aucune poque o les cadres de la vie spirituelle aient t plus solides et plus nets. Les circonstances taient alors spcialement favorables ; la renaissance de villes puissantes et commerantes favorisait, comme elle le fait toujours, lactif change des ides ; lUniversit de Paris, qui lon va voir jouer un tel rle dans la vie intellectuelle du XIIIe sicle, est incomprhensible sans le Paris de Philippe-Auguste, la capitale dun royaume qui devient le plus puissant de lEurope et qui attire les trangers de toute nation : nulle trace dexclusivisme national dans cet enseignement donn en une langue qui est la langue liturgique de la chrtient, donn par des matres de tout pays, des Anglais comme Alexandre de Hals, des Italiens comme saint Bonaventure et saint Thomas dAquin, des Allemands comme Albert p.634 le Grand. Cest lUniversit de la chrtient occidentale tout entire, et cest le chef de la chrtient, le vicaire du Christ qui, en lorganisant et en lui donnant des statuts, prtend en faire le centre mme de la vie chrtienne. Cest le mme pape, Innocent III, qui a cr lInquisition, confirm les ordres mendiants, Franciscains et Dominicains, et donn des statuts lUniversit de Paris : trois actes inspirs du mme esprit, du dsir de fortifier lunit chrtienne ; il trouvait dans linquisition un moyen dexpurger les hrsies, dans les ordres mendiants des hommes qui, dtachs de tout intrt temporel, de toute attache leur pays, se mettaient au service exclusif de la pense chrtienne, dans lUniversit, qui runit sous le nom de facult des arts, facult de droit et facult de thologie, des coles dj florissantes mais disperses, un moyen de systmatiser toute la vie intellectuelle de lpoque autour de lenseignement de la thologie. Car seul le pape a la haute main sur lenseignement de lUniversit, laquelle Philippe-Auguste est seulement pri daccorder des privilges
1
Systme de Politique positive, III, p. 488, d. Crs, 1912.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
428
temporels. Cet enseignement, il prtend lorganiser de manire parer au danger qutait devenu pour la thologie le dveloppement outr de la dialectique ; la dialectique doit rester un organon, et il faut empcher les docteurs modernes des arts libraux de soccuper de sujets thologiques ; cest ce que dit Innocent III en 1219 et ce que rpte Grgoire IX en 1228 : Lintelligence thologique doit exercer son pouvoir sur chaque facult comme lesprit sur la chair, et la diriger dans la voie droite pour quelle ne sgare pas. Et il sagit dune thologie qui doit tre expose uniquement selon les traditions prouves des saints et ne pas se servir darmes charnelles ; en 1231, il donne le mot dordre : Que les matres de thologie ne fassent pas ostentation de philosophie . Dans ces conditions, en effet, la philosophie est rduite lart de discuter et de tirer des consquences, en partant des prmisses poses par lautorit divine. De l la forme littraire des p.635 crits de ce temps, qui drive de la mthode employe par Ablard dans le Sic et non, puis par les sententiaires du XIIe sicle ; sur chaque sujet, on argumente coup dautorits ou de raisons dduites de lautorit ; et aprs avoir indiqu le pour et le contre, on donne la solution ; on en vient ignorer ou viter tout expos densemble, toute vue synthtique qui, liant systmatiquement les diverses affirmations du thologien, donnerait la doctrine chrtienne une allure trop rationnelle. Il y a sans doute un ordre inhrent lexpos des vrits de la doctrine chrtienne : Dieu, la cration, la chute, la rdemption et le salut, cest lordre traditionnel, celui qua suivi Pierre le Lombard et qui est sous-jacent aux Sommes de saint Thomas dAquin ; mais il faut remarquer que cest un ordre des vrits rvles o chacune ne dpend pas logiquement de la prcdente ; cration, chute, rdemption, ce sont des actes libres, que lon peut connatre par leurs effets, mais non dduire de principes ncessaires ; il reste donc tudier sparment chacun des articles de foi et des affirmations quil implique ; la raison sert toujours descendre aux consquences, mais non pas remonter aux principes et systmatiser. Mais lintrieur de ces cadres si fixes et si rigides, la pense a-t-elle cette catholicit que les papes rvaient de lui imposer ? Nullement, et malgr la volont des papes, le XIIIe sicle nous donne le spectacle de conflits aigus qui interdisent, mme pour cette poque, de parler dune philosophie scolastique unique ; ils ne sapaiseront que lorsque le Moyen ge aura cess de vivre. Ces conflits ont prcisment leur source dans la prtention de rduire tout le haut enseignement intellectuel la thologie et aux disciplines qui y prparent ; la philosophie purement humaine rclame une place pour elle, et on ne sait laquelle lui donner ; la mettra-t-on lintrieur de la thologie ? Quelle peine on aura alors maintenir lunit dune doctrine qui use la fois de deux mthodes aussi divergentes que lautorit et la mthode rationnelle ! On en verra bientt p.636 dillustres exemples. Lexpulse-t-on au contraire de la thologie ? Elle revendique alors son indpendance. Dans les deux cas, lunit spirituelle que lon voulait tablir est brise ; elle est brise parce que lon a
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
429
cru, pour des motifs essentiellement politiques et religieux, ne pas devoir tenir compte de lautonomie de la raison humaine ; elle naura de chance de se rtablir que lorsque la prtention de la thologie rgenter toutes les tudes sera dfinitivement abandonne. Lhistoire de la philosophie au XIIIe sicle est celle de ces conflits : plus rien de cette renaissance anticipe, de cette libert desprit, de cette pense passionne que nous trouvions au XIIe sicle : une recherche tout prix, mme au prix de la logique et de la cohrence, dune unit, voulue pour des raisons sociales et politiques plutt quintellectuelles.
II. LA DIFFUSION DES UVRES DARISTOTE DANS LOCCIDENT
@ Ces conflits sont encore accentus par la connaissance complte des uvres dAristote qui, traduites en latin, soit de larabe soit du grec, ouvrent la pense philosophique un champ jusquici presque inconnu et donnent pour la premire fois la rvlation directe dune pense paenne, qui na t aucunement modifie par son contact avec la pense chrtienne. Ds le milieu du XIIe sicle, Tolde, un collge de traducteurs, sous limpulsion de lvque Raymond (1126-1151), commence traduire de larabe les Analytiques postrieurs avec le commentaire de Thmistius ainsi que les Topiques et les Rfutations des sophistes ; Grard de Crmone (mort en 1187) traduit les Mtores, Physique, Du ciel, De la gnration et de la corruption, sans compter les apocryphes, la Thologie, le trait Des causes, celui Des causes des proprits des lments. Puis la connaissance du grec se rpand ; on trouve dans des manuscrits du XIIe sicle une traduction de la Mtaphysique p.637 (moins les livres M et N qui ntaient point encore traduits en 1270) et mme un commentaire sur ce livre ; et Guillaume Le Breton, dans sa chronique de lanne 1210, dit quon lisait Paris la Mtaphysique rcemment apporte de Constantinople et traduite du grec en latin . Au cours du XIIIe sicle, Henri de Brabant, Guillaume de Moerbeke (1215-1286), un ami de saint Thomas dAquin, Robert Grosseteste, Bartholome de Messine sont des hellnistes qui traduisent tout ou partie des uvres dAristote, et notamment la Politique, ignore des philosophes arabes. On traduit aussi les uvres des commentateurs arabes ou mme grecs, et des philosophes juifs ; Al Kindi, Al Farabi, Avicenne, Avicebron sont connus ; et au milieu du XIIIe sicle, on possde Paris tous les commentaires dAverros, sauf celui de lOrganon. On peut concevoir leffet foudroyant de ces dcouvertes sur des esprits avides dinstruction livresque, trs mal prpars comprendre et juger Aristote, parce quils manquaient du sens historique ncessaire pour le
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
430
replacer dans son cadre, parce quils ne labordaient que par des traductions qui, suivant lusage de lpoque, taient du mot mot souvent incomprhensible, et, enfin parce quils navaient, pour lutter contre cette influence prestigieuse, le secours daucune doctrine adverse ni surtout daucune mthode opposer la solide construction aristotlicienne. De Platon, on navait traduit au XIIIe sicle, que le Phdon et le Mnon ; on connut dans la deuxime moiti du mme sicle les Hypotyposes de Sextus Empiricus ; rien de tout cela ne faisait quilibre au pripattisme. Or cette doctrine, si forte de la faiblesse des autres, contenait tout autre chose que ce que les thologiens demandaient la philosophie ; la philosophie, toujours servante, devait tre utilise comme prliminaire et auxiliaire ; on ne voulait tenir delle quune mthode de discussion et non pas une affirmation sur la nature des choses. Et voici quAristote apporte une p.638 physique qui, avec la thologie qui lui est lie, suggre une image de lunivers compltement incompatible avec celle quimpliquent la doctrine et mme la vie chrtiennes : un monde ternel et incr, un dieu qui est simplement moteur du ciel des fixes et dont la providence et mme la connaissance ne stendent point aux choses du monde sublunaire ; une me qui est la simple forme du corps organis et qui doit natre et disparatre avec lui, qui na par consquent aucune destine surnaturelle et supprime par suite toute signification au drame du salut : cration, chute, rdemption, vie ternelle, voil tout ce quAristote ignorait et, implicitement, niait. Il ne sagissait plus maintenant de ce platonisme clectique qui, sans doute, offrait un certain danger puisquil aboutissait aux solutions errones de Scot rigne et dAblard, mais qui, du moins, outre quil pouvait, grce saint Augustin et lAropagite, saccommoder assez bien avec le dogme, manifestait la proccupation de la ralit divine et de la vie surnaturelle de lme : laristotlisme, lui, se refusait mme poser les problmes et leur donner un sens quelconque. En dsaccord formel avec la thologie chrtienne, il faut ajouter que le bloc doctrinal, form par la physique dAristote, ne saccordait pas mieux avec la science exprimentale qui fut la seule au Moyen ge mriter vraiment ce nom, cest--dire avec lastronomie ; la connaissance trs certaine que lon avait alors de la variation des distances des plantes par rapport la terre pendant le cours dune de leurs rvolutions, aurait d rendre impossible une thorie des cieux qui enchssait la plante sur une sphre qui avait la terre pour centre et qui tait en recul sur la doctrine de Ptolme (lAlmageste avait t traduit par Grard de Crmone en 1175) ou la doctrine pythagoricienne du mouvement de la terre, connue ds le haut Moyen ge : circonstance qui, ce moment, narrte pas le progrs de laristotlisme mais qui, plus tard, une fois quil et triomph, fut une des causes les plus importantes de sa ruine. Ce qui importait ce moment, cest que laristotlisme, loin de servir la politique universitaire des papes, menaait dtre un gros obstacle. Albert le Grand lui-mme ne dnonait-il pas linfluence de la physique dAristote
p.639
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
431
sur les ides htrodoxes de David de Dinant ? Aussi, ds 1211, le concile de Paris dfend denseigner la physique dAristote, le lgat du pape Robert de Couron, en donnant, en 1215, ses statuts lUniversit de Paris, tout en permettant les livres logiques et thiques dAristote, dfend de lire la Mtaphysique et la Philosophie naturelle. Interdiction vaine sans doute, devant lengouement du public, puisque Grgoire IX se borne commander de fabriquer des ditions dAristote expurges de toute affirmation contraire au dogme. Il nen est pas moins vrai que, en 1255, la Physique et la Mtaphysique taient au programme de la Facult des arts, que, partir de ce moment, lautorit condamne non plus Aristote, mais ceux qui tiraient de ses livres des doctrines contraires lorthodoxie, enfin quAristote devient peu peu une autorit indiscutable : cest lhistoire de cette christianisation dAristote que nous allons maintenant raconter.
III. DOMINIQUE GONDISSALVI
@ La pense dAristote et des noplatoniciens arabes ou juifs fut dabord mise en circulation par des compilateurs tels que Dominique Gondissalvi (mort en 1151), larchidiacre de Sgovie, qui, outre ses traductions, crivit des ouvrages tels que le De Divisione philosophiae, compos daprs Al Farabi et les Dfinitions dIsaac Israli ; il y bouleverse lordre traditionnel du trivium et du quadrivium pour le remplacer par celui de lencyclopdie aristotlicienne : la physique qui tudie les tres mobiles et matriels ; la mathmatique, qui tudie les mmes tres, abstraction faite de leur matire et de leur mouvement ; la thologie qui tudie les tres immobiles tels que Dieu et les p.640 anges. Quant la logique, elle est un instrument qui prcde la philosophie. Il donne le plan de ltude des livres physiques et mtaphysiques dAristote daprs Al Farabi : les premiers allant de la Physique au trait De lme en passant par les traits Sur le ciel et Sur les animaux ; les seconds traitant successivement de lessence et de ses accidents, des principes des dmonstrations, des essences incorporelles, de leur hirarchie et de laction divine. Plan tout fait nouveau en Occident, daprs lequel, quon le remarque bien, la thologie comme tude du moteur immobile est lie intimement la physique, comme tude des corps mobiles, o ltude de lme comme forme du corps organis, est une partie de la physique : image de lunivers antithtique de limage platonico-augustinienne qui considrait au contraire Dieu et lme dans leur vie propre et toute surnaturelle. Mme inspiration dans le De immortalitate animae, o Dominique, critiquant et rejetant formellement les preuves platoniciennes de limmortalit de lme humaine parce quelles sont trop gnrales et parce quelles porteraient aussi bien sur lme des brutes, naccepte que les preuves fondes sur les prmisses aristotliciennes qui contiennent non pas des principes gnraux, mais les caractres propres du sujet tudi : mais le principal de ces
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
432
preuves, cest, comme on le sait, lindpendance de lintellect par rapport au corps, qui amne imaginer une immortalit impersonnelle, bien diffrente de la continuation de la destine individuelle de lme.
IV. GUILLAUME DAUVERGNE
@ Une uvre comme celle de Guillaume dAuvergne, qui professait la thologie Paris en 1228, tmoigne de lespce de malaise produit chez un augustinien traditionnel par lintroduction de ces nouvelles ides. Un des efforts de la philosophie arabe avait t de distinguer, p.641 sans sortir des cadres de la philosophie dAristote, le premier principe des tres drivs de lui ou crs par lui : entreprise difficile, si lon se souvient de la mtaphysique dAristote : cette mtaphysique en effet, par ses spculations sur les mobiles et les moteurs, aboutissait poser une multiplicit de moteurs immobiles, intelligences motrices des cieux, mes des animaux, dont on ne voyait pas clairement comment ils dpendaient dun principe unique. Cela saccordait fort peu avec le monothisme de toutes les religions issues du judasme. On se rappelle comment Al Farabi, puis Avicenne se tirrent de ce mauvais pas : cest par un caractre intrinsque, la ncessit, que le principe suprme se distingue des moteurs qui sont drivs de lui : ltre ncessaire a de soi tout ce quil est ; il est simple et unique. Les moteurs drivs sont au contraire des tres possibles en eux-mmes qui nexistent que sous linfluence de ltre ncessaire qui les fait passer lacte. Aristote ne pouvait devenir monothiste si lon najoutait sa doctrine quelque distinction de ce genre : et Guillaume dAuvergne lintroduit en effet dans la scolastique non sans la rattacher aussi Boce : cest la clbre distinction de lessence et de lexistence : Dieu est ltre (ens) dont lessence est dtre (esse) ; cest--dire que lui-mme et ltre que nous lui attribuons quand nous disons : il est, sont une seule et mme chose. Au contraire la crature est comme faite de lunion de deux choses, ce quelle est (quod est) ou son essence, et ce par quoi elle est (quo est) qui est ncessairement distinct de son essence, puisque cette essence ne peut exister par elle-mme. Toutefois cette distinction, qui servait tablir le monothisme, introduisait, telle quelle tait prsente par Avicenne, un nouveau danger ; en effet, si le rle du principe suprme est de faire passer lacte des tres possibles, il faut bien quils existent comme possibles antrieurement cette action ; le possible est alors une matire indpendante de ltre suprme : cest seulement ainsi quAvicenne peut expliquer la p.642 multiplicit dans les
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
433
cratures. Tout au contraire, pour Guillaume, le possible nest pas une entit distincte de Dieu, mais seulement le pouvoir que Dieu a de lui donner ltre 1. A cette nuance dinterprtation se rattache la critique quil adressait aux pripatticiens qui soutenaient lternit du monde, en sappuyant sur ce principe que nous avons rencontr si souvent : une essence immuable ne peut commencer produire un certain moment. Guillaume rpond quil ne pourrait alors y avoir aucun changement dans le monde qui ne se rduise ce qui prcde, cest--dire aucun vritable changement, le changement tant la production du nouveau. On le voit, les pripatticiens, appuyant lternit du monde sur la simplicit du premier principe ne pouvaient expliquer le multiple et le changeant que grce une matire indpendante ; la ngation de cette matire amenait soit nier ce changement, soit mettre en Dieu un pouvoir crateur, bien diffrent de lacte pur dAristote. Du mme esprit partent les critiques de Guillaume contre les thories arabes de la connaissance qui introduisaient dans lme mme lopposition de matire et de forme, en montrant lintellect en puissance passant lacte sous linfluence dun intellect toujours en acte. Guillaume non seulement refuse daccepter cet intellect agent spar quAvicenne (et selon lui Aristote) plaaient dans la sphre de la lune ; mais il rfute une thorie anonyme des pripatticiens chrtiens qui, faisant de lintellect agent comme de lintellect matriel une facult de lme elle-mme attribuait au premier une action qui consiste faire passer lacte les signes intelligibles qui sont en puissance dans le second ; on attribuerait lme une science toujours actuelle qui, comme la rminiscence de Platon, rendrait inutile toute instruction. Guillaume nadmet en lme quun intellect unique, quil appelle lintellect matriel ; de cet p.643 intellect se dveloppent, comme de la semence ltre adulte, et sous linfluence des sensations et des images, les formes intelligibles dont il est gros. Lon sent quel point cette thorie sloigne de celle qui rduit lintelligence la facult dabstraire ; labstraction nest pas, selon Guillaume, inhrente la connaissance des formes intelligibles ; elle vient de notre imperfection et de la faiblesse de notre vue spirituelle ; le type de la connaissance intellectuelle, cest la connaissance de soi, cest--dire de ses opinions, de ses doutes, donc dun tre particulier.
V. DOMINICAINS ET FRANCISCAINS
@ Des attitudes plus nettes que celle de Guillaume dAuvergne allaient engendrer les conflits qui agitrent les universits de Paris et dOxford pendant toute la seconde moiti du XIIIe sicle. Vers la fin du sicle, en 1284, alors que ces agitations taient presque apaises, le franciscain Jean Peckham,
1
Cf. ROLAND-GOSSELIN dans son dition du De Ente et Essentia de saint Thomas, p. 164.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
434
archevque de Canterbury, crivait la curie romaine : Que la sainte glise romaine daigne considrer que la doctrine des deux ordres (franciscain et dominicain) est actuellement en opposition presque complte sur toutes les questions dont il est permis de disputer ; la doctrine de lun de ces deux ordres, dlaissant et, jusqu un certain point, mprisant les enseignements des pres, se fonde presque exclusivement sur les enseignements des philosophes 1. Et il prcisait en une lettre de 1285 lvque de Lincoln : Vous savez que nous ne rprouvons aucunement les tudes philosophiques pour autant quelles servent aux dogmes thologiques ; mais nous rprouvons ces nouveauts profanes qui, contre la vrit philosophique et au dtriment des Pres, se sont introduites il y a environ vingt ans dans les profondeurs de la thologie, entranant le rejet p.644 et le mpris manifestes de la doctrine des Pres. Quelle est donc la doctrine la plus solide et la plus saine, celle des fils de saint Franois, cest--dire de frre Alexandre de Hals, de frre Bonaventure et de leurs pareils dont les uvres... se fondent la fois sur les pres et sur les philosophes ; ou bien cette doctrine nouvelle qui lui est presque totalement contraire, qui consacre ses forces dtruire et branler tout ce quenseigne saint Augustin sur les rgles ternelles et la lumire immuable, les puissances de lme, les raisons sminales innes dans la matire ? Ainsi deux esprits sopposent : lesprit franciscain, nourri de saint Augustin et reprsent par Bonaventure ; lesprit dominicain, issu dAristote, et reprsent par Albert le Grand et saint Thomas dAquin. Dun ct, une doctrine o la philosophie, mal distingue de la thologie, sefforce, selon le modle noplatonicien, datteindre au moins par image la ralit divine : de lautre, une sparation complte entre la thologie rvle et une philosophie qui, par son point de dpart, lexprience sensible, par sa mthode. toute rationnelle, affirme son autonomie et son indpendance vis--vis de la thologie. Il est pourtant insuffisant dopposer sommairement laugustinisme franciscain au pripattisme dominicain. En premier lieu, saint Bonaventure nhsite pas, sur bien des points, suivre Aristote. En second lieu, au sein mme de leur ordre, Albert et saint Thomas trouvrent bien des adversaires ; et cest un dominicain, Robert Kilwardby qui, tant archevque de Cantorbery, fit condamner en 1277 des propositions thomistes. En troisime lieu, saint Thomas ntait pas moins oppos que saint Bonaventure une certaine manire de comprendre le pripattisme, qui aboutissait des conclusions directement contraires la foi chrtienne ; nous voulons parler de Siger de Brabant et du mouvement que lon a appel laverrosme latin. Enfin les deux ordres se trouvent encore runis sur le terrain pratique : il tait dans les intentions des papes de p.645 confier ces ordres plutt quau clerg sculier lenseignement thologique lUniversit de Paris et, ds 1229, une chaire est
1
Cit par GILSON, tudes de philosophie mdivale, p.120.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
435
rserve chacun des deux ordres mendiants ; de l une polmique ardente des sculiers contre les rguliers ; elle se marque par le De periculis novissimorum temporum (1255) o Guillaume de Saint-Amour contestait aux moines le droit denseigner et qui saint Thomas rpliqua par le Contra impugnantes Dei cultum.
VI. SAINT BONAVENTURE
@ On sait comment saint Bonaventure lui-mme oppose lesprit des deux ordres : Les Prcheurs (dominicains) sadonnent surtout la spculation, de quoi ils ont reu leur nom, et ensuite lonction ; les Mineurs (franciscains) sadonnent principalement lonction et ensuite la spculation . Saint-Franois dAssise, le fondateur de lordre des Mineurs avait donn un lan nouveau la vie spirituelle plus qu la doctrine, et sil recommandait aux frres dtudier, ctait condition dagir avant denseigner 1. Et il y eut parmi les Franciscains un parti, le parti des spirituels, qui rpugnait tout enseignement doctrinal, partisans de Joachim de Flore, dont la pense sur lvangile ternel se rattache aux hrsies sur le rgne de lEsprit. Ses vues taient acceptes par le gnral mme de lordre, Jean de Parme, qui, en 1257, dut donner sa dmission et fut condamn par un tribunal prsid par le nouveau gnral de lordre qui ntait autre que saint Bonaventure. On voit mieux par l le problme qui se pose aux Franciscains doctrinaires et thologiens : concilier lenseignement doctrinal et raisonn avec la libre spiritualit franciscaine, ou plutt faire de la doctrine un lment insparable de cette illumination intrieure en quoi consiste la vie spirituelle. Ds avant p.646 Bonaventure, il y eut des Franciscains doctrinaires, Alexandre de Hals (1170-1245), matre de thologie Paris, dont la Somme construite sur le plan des Sentences du Lombard, tout en nignorant pas laristotlisme, restait fidle la tradition augustinienne ; Jean de la Rochelle (1200-1245) : lun et lautre connaissent et mme admettent, pour le domaine limit de la connaissance naturelle, la doctrine aristotlicienne de la connaissance, cest par linfluence dun intellect agent que lintellect possible peut abstraire des images issues des sens les formes intelligibles ; mais lorsquil sagit dobjets qui dpassent les aptitudes de lhomme, la connaissance devient illuminative et a pour agent Dieu lui-mme. Mais Jean Fidanza de Toscane (1221-1274), qui fut surnomm Bonaventure, le docteur sraphique qui enseigna Paris de 1248 1255, et fut gnral de son ordre 36 ans, est le plus remarquable reprsentant de cet esprit. Tout lenseignement de saint Bonaventure est un itinraire de lme vers Dieu suivant le titre (Itinerarium mentis in Deum) que porte une de ses
1
BONAVENTUPE, in Hexameron, 22, 21, cit par GILSON, Saint Bonaventure, p.3.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
436
dernires uvres : un moment o les Dominicains produisaient tant duvres purement philosophiques, lon en chercherait vainement une dans la liste des siennes : de grands Commentaires sur les Sentences et une foule dopuscules sur des sujets purement thologiques ou mystiques. Mais, dans cet itinraire, il rencontre la raison et la philosophie, et il en assimile tout ce qui peut servir conduire une vie spirituelle suprieure. Mise ainsi sa place dans llan qui nous mne Dieu, la raison philosophique na de signification que dans la mesure o elle est tourne vers Dieu ; elle indique une tape transitoire entre un stade infrieur o nous connaissons moins Dieu et un stade suprieur o nous le connatrons davantage, un des moments o nous passons en allant de ltat de simple croyance la contemplation. On commence par la stabilit de la foi, et lon progresse par la srnit de la raison pour parvenir la p.647 suavit de la contemplation 1. Saint Bonaventure reste tout fait dans la ligne de la philosophie noplatonicienne : la raison conue comme un intermdiaire entre la croyance et une intuition intellectuelle qui saisit demble le principe : nulle ide chez lui dune raison qui, dans la sphre o sappliquent ses rgles, se suffirait elle-mme et qui crerait des sciences autonomes. La raison non moins que la foi dune part et la contemplation de lautre rsulte chez lui dune grce sanctifiante qui se manifeste dabord, par la vertu de la foi (credere), puis par le don de lintelligence de ce que lon croit (intelligere credita), enfin par la batitude de la contemplation (videre intellecta) : cest l le schme des degrs de la connaissance, tel que Platon le traait la fin du VIe livre de la Rpublique : laccent de dvotion qui sy ajoute ne saurait rien changer au fond des choses. Il sensuit que la philosophie ne doit pas tre, pour Bonaventure, le fruit dune curiosit qui veut atteindre les choses en elles-mmes, mais dune tendance religieuse qui nous porte vers Dieu. Les cratures peuvent tre considres ou bien comme des choses ou bien comme des signes 2 ; cest comme signes que les considre Bonaventure ; en tout il cherche des expressions, des images, des vestiges, des ombres de la nature de Dieu : les solutions des questions les plus techniques, o il soppose saint Thomas, sont commandes chez lui par ce vaste symbolisme qui lui fait considrer la nature, lgal de la Bible, comme un livre dont il faut dchiffrer le sens divin. Dieu, la cration, le retour de lme Dieu par la connaissance et lillumination ; ou si lon aime mieux : Dieu cause exemplaire, Dieu cause efficiente, Dieu cause finale, tels sont les trois uniques thmes de la philosophie. Lexistence de Dieu est elle-mme une vidence : vidence pour lme qui, en se connaissant, se connat comme limage de Dieu, et qui, connaissant les p.648 choses imparfaites, composes, mobiles saisit par l mme ltre parfait, simple, immuable dont elles sont les effets. Dieu comme cause
1 2
Cit par GILSON, p. 115. Cit par GILSON, p. 209.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
437
exemplaire est lobjet de la mtaphysique proprement dite : Bonaventure affirme avec force contre Aristote lexistence des ides platoniciennes ; en elles seules, Dieu trouve son expression vritable et complte et sa premire ressemblance ; aussi bien le monde des Ides nest pas une crature, il est Dieu mme comme Verbe ou comme Fils ; il est donc un et simple et il napparat multiple quautant quil donne naissance une multiplicit finie de choses sensibles. Le monde intelligible de Bonaventure nest pas celui de Plotin, dabord parce quil nest pas infrieur son principe, ensuite parce quil nest pas un intermdiaire entre Dieu et le monde sensible et comme une premire cration, toute spirituelle, du monde ; et en ce sens, Bonaventure nest nullement platonicien ; rien ne vient combler le gouffre infini qui spare la crature du crateur ; rien en revanche ne vient faire obstacle au retour de lme Dieu. Cest pourquoi Dieu, comme cause efficiente ou cratrice, doit tre diffrent de Dieu comme cause exemplaire : dans lunit infinie du Verbe qui est le modle dune infinit de mondes possibles, la volont de Dieu choisit un de ces mondes pour des raisons qui nous sont entirement impntrables. Bonaventure refuse en effet dadmettre que la raison du meilleur puisse enchaner la volont de Dieu qui serait astreint crer le meilleur des mondes possibles ; notion qui na mme point de sens puisque, quel que soit le monde choisi, lon peut linfini en concevoir un meilleur. Par ce volontarisme qui ira saccentuant dans les coles franciscaines, Bonaventure soppose encore plus formellement toute tentative pour tablir une continuit entre Dieu et la crature. Aussi, dans sa conception des cratures, tout est fait la fois pour montrer en elles le signe de lactivit immdiate de Dieu et pour empcher toute confusion avec la divinit : deux p.649 exigences qui sont sinon contradictoires, du moins opposes, lune tendant saisir en tout lirradiation divine, lautre proclamer en tout la dficience de la crature. Dficience, la multiplicit des cratures, incapables de recevoir autrement quen se multipliant la communication et leffusion de la perfection divine ; dficience, la ncessit, pour toute crature, dtre compose de forme et de matire, la matire soulignant le ct passif de son tre. Bonaventure na pas hsit soutenir, avec les autres franciscains et contre saint Thomas, quil nexistait aucune forme pure dans la cration, et que les anges eux-mmes, qui sont des intelligences spares, et aussi les mes humaines, qui sont des tres spirituels, sont faits dun couple de forme et de matire ; il suffit en effet quun tre soit changeant, actif et passif, individuel et capable de rentrer dans une espce ou un genre pour quon puisse dire quil contient de la matire, cest--dire de ltre en puissance ou une possibilit dtre autre ; or, cest le cas des mes et mmes des anges qui sont de vritables individus, contrairement ce que croit saint Thomas. Cest encore par le sentiment de cette dficience que saint Bonaventure a accept, contre saint Thomas, la thse de la pluralit des formes : on sait que, pour Aristote, la forme dun tre est ce qui fait quil est
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
438
effectivement ce quil est ; cest grce la prsence en lui de la forme humanit quun homme est homme ; chaque substance, tant une, doit donc avoir une forme substantielle unique ; cette forme dtermine et fixe compltement la nature de la substance. Or cette conclusion nest pas accepte par Bonaventure : considrer la forme comme parachevant et consommant ltre de manire ce que rien de substantiel ne puisse sy ajouter, ce serait admettre que la crature puisse tre parfaite et acheve : en ralit, si la forme donne une perfection la substance, ce nest point pour ly fixer, cest pour la disposer recevoir une autre perfection quelle ne pourrait elle-mme lui donner ; on peut concevoir par exemple que la lumire sajoute un corps dj constitu p.650 pour en stimuler lactivit, comme une forme substantielle nouvelle. Du mme esprit provient la rponse quil donne la question de la production de la forme : on se rappelle un clbre thorme dAristote : un tre en puissance ne peut devenir tre en acte que sous linfluence dun tre dj en acte : cela implique que la forme qui va natre dans ltre en puissance ny est point du tout prsente, mais va en tre comme tire sous linfluence de ltre en acte (duction des formes) ; or cette thorie donnerait ltre en acte une efficace quil ne peut avoir ; cette efficace sera rduite ses justes limites, si lon admet avec saint Augustin que ltre en puissance contient les raisons sminales que linfluence de ltre en acte ne fait que manifester et dvelopper. On voit donc lunit de toutes ces thses dont plusieurs opposent le penseur franciscain saint Thomas : multiplicit, composition hylmorphique universelle, pluralit des formes, raisons sminales, autant de manires de rendre impossible un monde physique qui serait autonome et aurait en lui son principe dexplication. Thses en parfait accord avec la seconde exigence, selon laquelle on doit retrouver dans la crature les traces dirradiation divine : simple analogie dailleurs, comme lgalit quil y a entre deux rapports, et non ressemblance vritable comme celle quil y a entre Dieu et les Ides ; le type de cette analogie, cest limage de la Trinit que saint Augustin retrouvait dans les rapports entre les trois facults de lme humaine ; mais cette analogie a elle-mme des degrs, depuis les ombres ou vestiges des attributs divins que lobservateur trouve dans les choses de la nature jusqu limage vritable qui, dans lme humaine, prend directement conscience de sa propre ressemblance Dieu. Par leffet de la grce surnaturelle, cette image analogique se transformera chez les lus en une similitude vritable, qui est la dification de lme. Cest moins en elle-mme que par rapport cet tat final que saint Bonaventure analyse la connaissance intellectuelle p.651 et interprte les donnes dAristote et des Arabes sur ce sujet. Il accepte la distinction entre lintellect agent et lintellect possible : mais dabord comme Alexandre de Hals et saint Thomas, il fait de lun comme de lautre une facult de lme, et refuse de voir dans lintellect agent une ralit distincte et la dernire des intelligences clestes : la ngation de lintellect agent spar est, chez lui, un
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
439
aspect de ce mme tat desprit qui le dtourne daccepter un intermdiaire quelconque entre Dieu et lme. De plus, lintellect agent nest pas lintellect possible comme un pur agent un pur patient ; lintellect agent aide simplement lintellect possible faire lopration dabstraction ncessaire pour extraire des images de limagination les formes intelligibles ; mais cest lintellect possible qui fait lui-mme lopration et qui livre lintellect agent les espces quil contemple 1. Enfin, labstraction sur le sensible nest pas pour lui le seul type de connaissance intellectuelle : lempirisme dAristote nest juste que dans la connaissance du monde sensible ; quand il sagit des principes, des vertus morales et de Dieu, notre manire de connatre est toute diffrente ; pour la connaissance des principes, tels que celui de contradiction, il y faut bien des espces sensibles ; mais la lumire naturelle qui est en nous permet de les acqurir immdiatement et sans nul raisonnement ; quant aux vertus morales, la connaissance nen est due aucune espce sensible, mais linclination que nous sentons en nous vers le bien et la connaissance immdiate que cette inclination est droite ; enfin Dieu nous est connu par simple rflexion sur nousmmes, puisque nous sommes faits son image. En un mot, sous le nom de connaissance de nous-mme et de Dieu, saint Bonaventure admet une connaissance directe qui ne passe pas par le circuit du sensible. Si lon veut maintenant justifier cette connaissance et voir p.652 en quoi consiste sa vrit, on sera amen la rapporter toute lillumination divine. Bonaventure part ici du vieux principe platonicien (repris par Avicenne), selon lequel il ny a de connaissance que l o lesprit atteint ltre, cest--dire une ralit stable et identique. Or atteindre ltre, ce nest pas prcisment voir Dieu, ni voir les ides et les raisons ternelles en Dieu ; lide de ltre est comme un cadre que nous nous efforons appliquer des ralits qui ne la comportent pas exactement et qui, pour cette raison, ne peuvent tre lobjet dune connaissance certaine et entire ; mais cette ide ne peut exister que grce la prsence et linfluence en nous de ces raisons ternelles que nous ne possdons pas ; et ainsi la connaissance la plus humble se dfinit non pas en elle-mme mais titre dimage efface de la connaissance pleine et certaine que Dieu a de sa propre raison. La philosophie de saint Bonaventure reprsente donc un type de pense dune grande importance historique. Elle est domine par ce quil considre comme la vrit fondamentale : lme a une destine surnaturelle qui nous est connue par la rvlation chrtienne. Dans la recherche des autres vrits, on ne peut procder comme si nous ignorions celles-l, et comme si nous avions une mthode autonome pour dterminer le vrai et le faux : toutes les vrits sordonnent au contraire par rapport celle-l. La nature et lme ne se comprennent que tournes vers Dieu : la nature comme la trace des attributs divins, lme par sa fonction essentielle damour qui nous unit Dieu.
1
GILSON, p. 354.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
440
Il est ais de voir pourtant que, historiquement, le principe de cette philosophie, bien quabsorb par des penseurs chrtiens, ne touche en aucune faon lorthodoxie chrtienne. Nous reconnaissons ici lantique principe noplatonicien, n en dehors de toute influence chrtienne : un tre nest pleinement ce quil est quen vertu de la conversion qui le tourne vers son propre principe dont il reoit les effluves ; doctrine dont les uvres dun successeur de Bonaventure, Matthieu dAquasparta p.653 (1235-1302), matre de thologie Paris, puis gnral de lordre en 1287 devait montrer encore plus nettement lopposition laristotlisme de saint Thomas. Dans ses Quaestiones de cognitione, il relve lempirisme de certains philosophes qui nient quaucune influence spciale de la lumire divine soit indispensable dans la connaissance, et qui attribuent toute connaissance la facult naturelle de lintellect agent, reniant ainsi lautorit du principal docteur saint Augustin. Il affirme linverse que tout ce qui est connu avec certitude dune connaissance intellectuelle est connu dans les raisons ternelles et dans la lumire de la premire vrit . Mme fidlit au platonisme chez le franciscain Jean Peckham (1240-1292), lve de Bonaventure Paris et matre de thologie lUniversit dOxford. La force de ce mouvement platonico-augustinien nous fait comprendre les conditions dans lesquelles sest dvelopp le mouvement inverse, le mouvement aristotlicien, chez Albert le Grand et saint Thomas.
VII. ALBERT LE GRAND
@ Le premier des grands pripatticiens chrtiens est le dominicain Albert le Grand (1206-1280) le docteur universel ; Albert nest pas seulement le matre de thologie qui enseigna Paris de 1245 1248 et fut lecteur Cologne de 1258 1260 et de 1270 sa mort : si, de 1240 1256, il crivit des paraphrases de tous les traits connus dAristote, en y intercalant mme des traits de son cru sur les questions qui rentraient dans le plan dAristote mais avaient t ngliges par lui (comme le De mineralibus) et en y ajoutant le commentaire de lapocryphe De Causis (quil sait ntre pas dAristote et quil considre comme extrait par David le Juif des crits dAristote et dAvicenne), il est aussi lauteur de traits de thologie dogmatique comme le Commentaire des Sentences et la Summa de creaturis et dcrits mystiques comme le commentaire du pseudo p.654 Denys ou le De adhaerendo Deo ; enfin il joue un rle actif comme dfenseur de lordre des Prcheurs contre les attaques de Guillaume de Saint-Amour en 1256, comme lgat du pape et prdicateur de la croisade en Allemagne (1263). Extrme diversit et extrme tendue qui, dans la joie o il est de faire linventaire des richesses contenues dans lencyclopdie dAristote et dajouter mme ces richesses, lui masquent la plupart du temps le peu de cohrence de sa pense. Albert parat en avoir le sentiment, et cest alors quil
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
441
fait des dclarations comme celles-ci : En tous mes livres philosophiques, je nai jamais rien dit de mien, mais jai expos aussi fidlement que je lai pu les opinions des Pripatticiens ;... sil se trouve que jai quelque opinion moi, nous la ferons paratre, sil plat Dieu, dans nos livres thologiques plutt que dans nos traits philosophiques 1. Aussi est-ce un jeu dopposer Albert lui-mme et son augustinisme son pripattisme. Parfois il se contente de juxtaposer. Ainsi dans la Somme de Thologie 2, il avertit quil y a une double notion de lme, la notion aristotlicienne de lme comme forme du corps organis, et la thorie thologique quil tire surtout des crits de saint Augustin : dun ct la description du mcanisme de la vie intellectuelle et volontaire, dun autre ct la description de facults tages les unes au-dessus des autres qui montrent lme slevant progressivement de la connaissance sensible jusqu Dieu : rien de semblable entre la sensation dAristote, acte commun du sentant et du senti, et la sensualit dAugustin qui rattache lme la terre en lui faisant chercher lutile et fuir le nuisible ; rien de pareil, quoiquen pense Albert, entre la distinction augustinienne de la raison suprieure qui nous dirige et de la raison infrieure qui nous fait connatre la loi morale, et la distinction pripatticienne de lintellect agent et de lintellect possible ; enfin p.655 distinction radicale, admise par Albert, entre la volont ( ou lectio) chez Aristote, qui suit le jugement de lentendement, et la notion exclusivement thologique du libre arbitre, facult de la raison et de la volont par laquelle est choisi le bien, si la grce nous assiste, ou le mal, si elle fait dfaut . Rien ne correspond chez Aristote la synteresis, cette tincelle de conscience qui, selon saint Jrme, ne steint pas dans lme dAdam, mme chass du Paradis , facult de connatre les rgles morales suprmes, dont les philosophes ne parlent pas, parce quils divisent les facults de lme daprs leurs objets gnraux, tandis que les thologiens savent distinguer entre le droit divin et le droit humain . Ainsi les vues des saints sur lme considre en dehors de tout rapport avec le monde sensible, compltent les vues du philosophe qui ne connat lme quen rapport avec le corps. Pourtant, dautres gards, la doctrine dAlbert indique des habitudes desprit bien nouvelles par rapport laugustinisme rgnant ; le niveau auquel peut atteindre la raison philosophique est en quelque sorte abaiss : il ne sagit plus, comme chez saint Anselme de trouver par lintellect les raisons des dogmes rvls, incarnation ou trinit : ce sont l des articles qui sont et resteront de pure foi. La raison philosophique ne peut procder que des effets aux causes, et ce qui est premier dans lordre de la connaissance est dernier dans lordre de ltre : cest dire que nous ne pouvons atteindre Dieu que par le monde sensible, par une preuve cosmologique allant de leffet la cause, et
1 2
Cit par SCHNEIDER, Die Psychologie des Alberts, p. 295 sq. Tr. 12, quaest. 73.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
442
non par une preuve ontologique. De la considration du monde, on peut sans doute conclure Dieu, mais on ne peut mme pas savoir avec une entire certitude rationnelle si le monde a ou non commenc dans le temps ; les arguments pour lternit que lon trouve chez Aristote quilibrent presque les arguments contraires et, seule, la rvlation peut trancher la question. Albert a, dune manire gnrale, une tendance sparer p.656 les termes entre lesquels le platonisme augustinien cherche une continuit et une hirarchie. Voici quelques aspects de cette tendance : les augustiniens du XIIIe sicle, sous linfluence plus ou moins proche dAvicebron, avaient admis dans toutes les cratures, aussi bien spirituelles que corporelles, une composition hylmorphique : lange et lme, aussi bien que le corps, sont composs de matire et de forme. Contrairement cette vue et suivant Aristote avec sa thorie de lintelligence motrice qui est un acte pur et de lme qui est une forme, Albert refuse dadmettre une matire comme composant des tres spirituels. Ce refus a pour effet de transformer sa vision de lunivers ; comme la forme (par exemple celle de lhomme) est par elle-mme un universel, comme le principe dindividuation est dans les accidents provenant de la matire qui sajoute la forme, il sensuit que la nature de lhomme individuel, compos dune me et dun corps, na presque plus rien de commun avec celle de lange : les anges, tant des formes pures, doivent par l mme diffrer entre eux comme des espces, non comme des individus ; aucune des facults de mme nom nest la mme chez lange et dans lme humaine, dans lme qui, lie au corps, natteint le rationnel que par une opration dabstraction sur les images sensibles, tandis que lange a une connaissance intuitive, exempte derreur et de recherche ; lintellect agent, intuitif chez lange, est, chez lhomme, une simple clart indistincte qui emprunte aux images sensibles toutes les distinctions des genres et des espces 1. Ainsi lon a partout limpression de profondes cassures dans la continuit universelle : Albert refuse mme dadmettre tout ce qui, dans la thorie de la connaissance intellectuelle chez les pripatticiens arabes, aurait rapproch lhomme de Dieu ; lintellect agent qui, chez Averros, tait lintelligence motrice de la dixime sphre contenant actuellement en elle tous les p.657 intelligibles, qui, par consquent, tait commun tous les hommes, est remplac par un intellect agent qui est une partie de lme humaine ; il y a donc autant dintellects agents quil y a dmes ; il est dailleurs vide de formes et na dautre fonction que dabstraire les formes des images sensibles donnes dailleurs. Si une intelligence spare ou anglique influe sur nous, le rsultat de cette influence est une rvlation, qui est entirement distincte de la connaissance naturelle 2.
1 2
Summa creat., trait VI, d. de 1651, XIX, p. 77-182. Summa de homine, qu. 53, art. 3.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
443
Dans ces conditions, on comprend comment ltude de la nature pour elle-mme a pu intresser Albert, comment, grce ce principe que lexprience seule donne la certitude en des questions de zoologie, de botanique ou de minralogie, ces sciences commencent devenir chez lui autre chose que des bestiaires fantastiques ou des symboliques traditionnelles. Les dominicains allemands qui propagrent Cologne les doctrines dAlbert, Hugues de Strasbourg et Ulrich de Strasbourg, sont encore fort mal connus : il semble pourtant que le second dentre eux se rapproche bien plus que son matre du pripattisme arabe et quil est au dbut du mouvement mystique qui aboutira Matre Eckart.
VIII. SAINT THOMAS DAQUIN
@ Mais cest surtout chez saint Thomas dAquin, le docteur anglique , que saffirme et se prcise le mouvement dides inaugur par Albert. N en 1227 au chteau de Rocca-Secca, de la famille des comtes dAquin, devenu dominicain ds 1243, il est lve dAlbert le Grand Paris de 1243 1248, puis Cologne ; de 1252 1259, nouveau sjour lUniversit de Paris, o il devient matre en 1257 ; de 1259 1268, il habite lItalie, et il entre en relation avec le dominicain hellniste p.658 Guillaume de Moerbeke, par qui il a des traductions dAristote faites directement sur le texte grec ; de 1268 1272, il enseigne Paris, o il a se dfendre la fois contre les ennemis des rguliers, contre Siger de Brabant et les averrostes de la Facult des Arts, contre les augustiniens qui sefforcent de le faire condamner ; il quitte Paris pour Naples en 1272 et meurt en 1274 en se rendant au concile de Lyon. Dans son second sjour Paris (1252-1259), il crit, outre son Commentaire des sentences de Pierre Lombard 1, les trois traits de Ente et Essentia, de Veritate, Contra impugnantes Dei cultum et religionem (au moment des attaques de Guillaume de Saint-Amour contre les ordres). Du sjour en Italie et des relations avec Guillaume de Moerbeke (1259-1268) datent ses commentaires : commentaires dAristote (De interpretatione, Analytiques postrieurs, Physique, Mtaphysique (12 livres), thique, De lme, Mtores, De coelo I III, De generatione, Politique I IV), commentaire du livre Des Causes (dont il dcouvre lidentit avec les lments de thologie de Proclus, que traduit Guillaume de Moerbeke), commentaires des traits thologiques de Boce, des Noms Divins de lAropagite. Dans la mme priode, il crit la Summa contra gentiles (1259-1260), et il commence en 1265 la Summa theologica quil continue, sans lachever, jusquen 1273. En son dernier sjour Paris, il crit des uvres
1
[css : un trs grand nombre duvres de Saint Thomas, sur site ou tlchargeables (Word ou html), sont disponibles sur le site : http://docteurangelique.free.fr/ ]
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
444
polmiques, le De unitate intellectus contra Averroistas, contre Siger de Brabant, le De Perfectione vitae spiritualis et le Contra retrahentes a religioso ingressu, contre les ennemis des ordres mendiants : le De aeternitate mundi contra murmurantes, contre les ennemis du pripattisme. Enfin il crivit en diverses priodes et sur divers sujets des Quaestiones disputatae et des Quaestiones quodlibetales, qui rdigent les discussions effectives quil soutenait oralement sur les sujets quon lui proposait des poques fixes. Malgr la limpidit tranquille et peut-tre sans gale du style de saint Thomas, ses habitudes littraires sont si loignes des p.659 ntres que lon voit difficilement sil existe un systme thomiste et quel il est. Rien chez lui de cette motion et de cette fougue qui, aux XIe et XIIe sicles, donnaient naissance des uvres synthtiques o la pense sexpose en sa continuit ; par exemple dans la Somme thologique, rien quune suite de questions spares en articles ; chaque article salignent les arguments contre la thse, les arguments pour, puis la rponse aux arguments contre ; nul arrt, nulle vue densemble (sauf exception ; par exemple Somme, IA pars, qu. 85, art. 1-3) dans ces discussions o lon dsire seulement lemporter sur ladversaire : la dialectique, entendue comme art de discussion, est devenue la matresse toute-puissante ; on apprend disposer les arguments plutt qu les inventer.
IX. SAINT THOMAS (suite) : LA RAISON ET LA FOI
@ Sil en est ainsi, si le philosophe ou le thologien ne voit pas dinconvnient cette exposition morcele et dchiquete, cest quil considre que son rle nest pas de faire la synthse, puisquelle est dj faite, ni de dcouvrir la vrit, puisquelle est dj trouve. Le travail de saint Thomas suppose deux grandes synthses quil accepte toutes faites comme des prsuppositions de son uvre propre : dune part lorganisation des vrits de la religion, telles quelle se prsentait chez les sententiaires du XIIe sicle, dautre part la synthse philosophique dAristote. Une partie de ses uvres, les Sommes, suit le rythme des Sentences, qui finalement revient au rythme de la philosophie noplatonicienne : ainsi la Somme contre les Gentils traite dabord de Dieu, puis de la hirarchie des cratures qui procdent de lui, puis de la destine de lhomme et de son retour Dieu dans la vie ternelle. Dans une autre partie de ses uvres, il analyse et commente les uvres dAristote. Dautre part, le rapport quil conoit entre ces deux synthses, p.660 la synthse thologique des vrits rvles et la synthse philosophique des vrits accessibles la raison, laisse son esprit beaucoup plus tranquille et satisfait, beaucoup moins avide et passionn de recherche que celui dun saint Anselme ou dun Ablard : tandis que, chez ceux-ci, le rapport entre la raison et la foi tait dfini, si lon ose dire, dune manire dynamique, les vrits de foi tant proposes la raison comme des vrits pntrer par elle dans un
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
445
progrs illimit, il est dfini chez saint Thomas dune manire statique : il y a des vrits de foi qui excdent dfinitivement lintelligence humaine ; il y a des vrits philosophiques qui lui sont accessibles ; mais nul progrs ne peut conduire des unes aux autres. Si lon peut raisonner en matire de foi, cest seulement en tirant les consquences des vrits de foi poses comme prmisses, jamais en dmontrant ces vrits : ainsi lon peut dmontrer la ncessit de la grce divine, par cette raison que, sans elle, la destine surnaturelle de lhomme serait impossible ; mais il faut dabord que lexistence de cette destine surnaturelle nous soit rvle. Cette conception purement statique, il est important de voir que saint Thomas ne lemprunte nullement la tradition thologique, mais quelle rsulte pour lui dune doctrine de la connaissance tout entire emprunte Aristote : Lintellect humain ne peut arriver, par sa vertu naturelle, saisir la substance de Dieu mme, parce que la connaissance de notre intellect, selon le mode de la vie prsente, commence par le sens ; et cest pourquoi ce qui ne tombe pas sous les sens ne peut tre saisi par lintelligence humaine, moins dtre conclu partir des sens. Or les choses sensibles ne peuvent conduire notre intelligence voir en elles ce quest la substance divine, parce que ce sont des effets qui ngalent pas la vertu de la cause 1. Ainsi lempirisme dAristote est rig en sauvegarde contre lindiscrtion dune raison qui voudrait scruter p.661 les mystres ; les choses sensibles ne sont plus, comme chez Bonaventure, des signes interprter pour y voir la prsence divine, mais de simples effets par lesquels nous remontons, au moyen dun pnible raisonnement, jusqu une cause que nous ne saisissons pas en elle-mme, mais en ses relations ses effets. Enfin le principe mme de cette conception des rapports de la raison et de la foi supprime un des moteurs les plus puissants de la pense philosophique dans les sicles prcdents ; nous voulons parler de ces contradictions entre la raison et la foi do rsulte, pour ajuster lune lautre, un effort vers laccord, qui est gnrateur de pense philosophique. Saint Thomas part de ce principe que la vrit ne saurait tre contraire la vrit ; il sensuit que nulle vrit de foi ne saurait infirmer une vrit de raison, ou inversement. Mais, comme la raison humaine est dbile, comme lintelligence du plus grand philosophe, compare lintelligence dun ange, est bien infrieure ce quest lintelligence du paysan le plus simple compare la sienne propre, il sensuit que lorsquune vrit de raison nous parat contredire une vrit de foi, nous pouvons tre srs que la prtendue vrit de raison nest quune erreur et quune discussion plus serre nous en montrera la fausset. La philosophie reste donc servante de la foi, non pas que la foi fasse appel elle comme une auxiliaire pour sclairer ellemme, non pas quelle mle ses affirmations au tissu des argumentations rationnelles (car la philosophie est pleinement autonome, en tant que mode de connaissance), mais parce que la thologie la domine en la dclarant incapable de prouver tout ce qui serait contraire la foi. Une hirarchie de ce genre rend inutile a
1
Summa contra Gentiles, I, 3.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
446
priori tout effort dajustement rciproque ; nulle pntration et mme nul point de friction ne sont possibles dans ce rapport purement extrieur de la foi la raison, pas plus quils ne sont possibles entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel qui, den haut et du dehors, donne au premier ses conditions et les limites de son office.
X. SAINT THOMAS (suite) : LA THORIE DE LA CONNAISSANCE
@ Pourtant il faut bien lentendre : entre la thorie thomiste des rapports de la raison et de la foi et la thorie thomiste de la ralit, il y a sinon une opposition du moins un contraste qui explique le dveloppement de la philosophie. Entre le mode de connatre par raison et le mode de connatre par rvlation, il y a discontinuit complte, et le premier ne nous fera jamais monter ni mme aspirer au second ; en revanche, dans ltre mme, dans la ralit, il y a, comme les noplatoniciens lont toujours enseign et comme saint Thomas le croit aussi, continuit complte, si bien que, en soi, dans le rel, il ny a aucune sparation ni coupure entre les aspects du rel qui nous sont donns par la raison, et la ralit qui nous est connue par la rvlation, ou celle qui est atteinte par la connaissance des anges et par la vision batifique. Or, du moment que la connaissance, si humble quelle soit, atteint demble ltre mme et que ltre est dun seul tenant, il est impossible quil ny ait point une portion commune entre les vrits de raison et les vrits de foi, cest--dire quil ny ait pas certaines vrits (telles que lexistence de Dieu) qui soient rationnellement dmontrables autant que rvles.
p.662
Ces considrations abstraites peuvent sclairer historiquement de la manire suivante : on connat le contraste entre la thologie dAristote et celle des noplatoniciens : Aristote saisit Dieu uniquement comme le premier moteur du monde sensible ; il le saisit dailleurs ainsi par une dmonstration rationnelle, et en employant les principes communs de sa physique et de sa mtaphysique ; la dmonstration de lexistence de Dieu est drive de lapplication du principe directeur de toute sa conception du monde, la priorit de lacte sur la puissance : la connaissance de Dieu comme premier moteur ou acte pur est p.663 donc une connaissance tout aussi rationnelle que nimporte quelle connaissance physique. La thologie noplatonicienne ne part pas du sensible : elle se place dabord en une ralit intelligible quelle prtend saisir par une intuition spciale, donnant dailleurs un nom diffrent cette intuition suivant la hauteur quelle atteint dans la ralit divine. Ainsi Aristote saisit Dieu comme achvement de lexplication rationnelle de lunivers ; cest ce que peut en atteindre une raison qui est assujettie partir des donnes sensibles ; mais elle ne peut aller plus loin.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
447
Encore peut-elle y arriver parce que la connaissance, nous lavons dj dit, atteint ltre. La thorie thomiste de la connaissance peut senvisager un double point de vue. Par un aspect, elle est universelle et, stendant tous les modes de la connaissance quels quils soient, elle indique les conditions de toute connaissance ; par un autre aspect, elle est critique et dtermine les limites et les conditions spciales la connaissance humaine. Sous le premier aspect, elle sinspire dune formule dAristote, que Plotin et Proclus (dans les lments de thologie, identiques au De Causis) avaient dveloppe avec abondance : Lme est en quelque manire toutes choses ; elle est en quelque manire les choses sensibles, quelle peroit par les sens, puisque la sensation, acte commun du sentant et du senti, laisse dans lme la forme des choses, sans leur matire, mais avec tous les accidents qui les individualisent ; dautre part, lintelligence en acte est identique la chose mme quelle comprend ; il ny a pas de diffrence entre la science et la chose sue. Et, quil sagisse de la connaissance sensible ou de la vision batifique, la connaissance est une certaine prsence, impossible analyser, de lobjet connu dans le sujet connaissant. Elle nest donc point, comme on le dit souvent par erreur, une assimilation. Il faut dire seulement (et cest l le second aspect) que, en vertu du principe suivant : Le connu est dans le connaissant selon le mode du connaissant , il peut y avoir p.664 des cas o lassimilation, cest--dire lopration par laquelle le connu est rendu semblable au connaissant, est une condition pralable de la connaissance ; par exemple, quand le sujet et lobjet sont aussi diffrents que lme et la chose sensible, la connaissance intellectuelle ne peut avoir lieu que par une espce , qui est la fois une forme propre de lintellect, et une image ou similitude de la chose comprise ; cest l espce impresse , par laquelle lintellect, comprenant la chose, commence son opration quil termine la dfinition ou espce expresse. Mais nulle opration de ce genre nest utile dans la vision batifique ou dans la connaissance que Dieu a de sa propre essence ; elle ne dfinit donc pas toute connaissance ; la connaissance prise en gnral, est bien une prsence directe de ltre 1.
XI. SAINT THOMAS (suite) : LES PREUVES DE LEXISTENCE DE DIEU
@ Mais il suit des limites de la connaissance humaine que les rgions de ltre que la raison peut atteindre ne dpassent pas les bornes dessines par Aristote, cest--dire le monde physique termin par une thologie envisageant Dieu comme premier moteur : croire que lon peut connatre lexistence de Dieu directement et par vidence, sans passer par le monde
1
Cf. sur ce point spcial, TONQUDEC, Notes dExgse thomiste, Archives de philosophie, I, 1.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
448
sensible, croire quon ne peut latteindre que par la foi, voil deux erreurs inverses lune de lautre, mais qui reposent sur le mme principe : cest ce faux principe quon ne peut parler de lexistence de Dieu que lorsquon a dabord connu ce quil est. Les uns disent (comme saint Anselme) que, le nom de Dieu signifiant ltre tel quon ne puisse pas en concevoir de plus grand, il sensuit que Dieu existe. Ils disent aussi que, ltre p.665 de Dieu tant identique son essence, poser lessence de Dieu cest le poser existant. Mais les autres, se dfiant des forces de la raison, et voyant que la quiddit de Dieu ni mme la signification du nom de Dieu ne peuvent tre atteintes, en concluent que toute dmonstration de son existence est impossible. Les seconds ont raison en ce quils nient : notre raison est trop faible pour saisir dans la perfection et la grandeur de Dieu la raison de son existence ; mais sils concluent que son existence ne peut tre dmontre, cest quils ignorent quil y a deux genres de dmonstrations, la dmonstration quid qui prend la quiddit comme moyen et va de lessence ses proprits, ou de la cause leffet, et la dmonstration quia, qui procde de leffet la cause, et peut dterminer la cause en son rapport leffet 1. Or, non seulement lorsquil sagit de lexistence de Dieu, mais dune manire absolument gnrale, saint Thomas considre la dmonstration quid comme inaccessible lhomme. Lon se rappelle quune des difficults de la thorie dAristote tait limpossibilit de dcouvrir un procd rationnel pour atteindre la quiddit des tres : nul, plus que saint Thomas, ne se rend compte de cette lacune du pripattisme, dont il fait une lacune de la raison humaine : Mme dans les choses sensibles, les diffrences essentielles nous sont inconnues ; et cest pourquoi elles sont dsignes par des diffrences accidentelles qui proviennent des diffrences essentielles, de la mme manire que la cause est signifie par son effet ; par exemple on pose bipde comme diffrence dhomme. Le genre de dmonstration qui va de leffet la cause, de laccident lessence, dmonstration qui nous permet de poser lexistence dune chose sans connatre pralablement la nature de cette chose et sans rien en savoir sinon quelle produit leffet qui nous a amen jusqu elle, cest l le domaine normal de lesprit humain dans toutes ses recherches ; et les p.666 quatre voies qui nous amnent poser lexistence de Dieu ne supposent aucun mode spcial de connaissance, mais ne font quappliquer cette question les procds de raisonnement les plus ordinaires. La premire est emprunte au huitime livre de la Physique dAristote : Tout ce qui est m est m par autre chose ; ce moteur, son tour, ou bien est m ou bien ne lest pas ; sil ne lest pas, nous avons ce que nous cherchions, un premier moteur immobile, et cest ce que nous appelons Dieu ; sil est m, il est m par un autre, et il faut alors ou bien procder linfini (ce qui est impossible) ou bien en venir un moteur immobile.
1
Summa contra Gentiles, I, 12.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
449
La seconde est emprunte la Mtaphysique : Dans toutes les causes efficientes ordonnes, le premier terme est cause du moyen, et le moyen cause du dernier, quil y ait dailleurs un ou plusieurs moyens ; la cause supprime, ce dont elle est la cause est aussi supprim ; donc, le premier terme supprim, le moyen ne pourra tre cause. Mais, si lon procde linfini dans les causes efficientes, nulle cause ne sera la premire : donc toutes les autres, qui sont les termes moyens, seront supprimes, ce qui est manifestement faux ; donc il faut poser une cause premire efficiente qui est Dieu. La troisime voie part de lexprience que nous faisons de la naissance et de la corruption des tres ; de ce quils se corrompent, nous concluons quils sont seulement possibles, cest--dire quil y a un temps o ils ont t amens lexistence par un tre dj existant. Mais si tous les tres taient seulement possibles, il suit quil y aurait un moment ou aucun tre naurait exist ; mais il serait alors impossible quaucun deux comment exister, et il ny aurait rien, ce qui est manifestement faux. Il faut donc poser un tre ncessaire par soi, que lon appelle Dieu. La quatrime voie emploie le second livre de la Mtaphysique. Nous pouvons comparer deux affirmations au point de vue p.667 de leur vrit, et voir quelles sont lune plus fausse, lautre moins fausse : comparaison qui nest possible quen se rfrant un vrai absolu ou un tre absolu qui est Dieu. La cinquime voie est emprunte Jean Damascne et Averros au second livre de la Physique : Il est impossible que des choses contraires et discordantes concordent en un seul ordre, sinon grce au gouvernement dun tre qui attribue tous et chacun sa tendance vers une fin dtermine : or nous voyons dans le monde des choses de nature diverse concorder en un ordre unique et non pas rarement mais le plus souvent ; il faut donc un tre par la providence de qui le monde soit gouvern ; cest lui que nous appelons Dieu 1. Il y a, dans toutes ces preuves, une vidente affectation ne faire intervenir aucun sentiment religieux, aucun lan de lme Dieu, rien de ce qui regarde les rapports particuliers de lhomme Dieu dans sa destine surnaturelle : rien que les notions techniques de la physique aristotlicienne ; aussi, de bonne heure dj, des critiques se sont demand si la valeur de ces preuves ntait pas solidaire de celle de la physique dAristote ; cest peut-tre une critique de ce genre que saint Thomas nous indique dans la Summa contra Gentiles 2 : Deux raisons paraissent infirmer ces preuves, la premire cest quelles procdent de la supposition de lternit du monde, qui, chez les catholiques, est suppose tre fausse... ; la seconde cest quil est suppos, dans ces dmonstrations, que le premier m, savoir le corps cleste, est m de lui-mme : do il suit quil est anim, ce que beaucoup naccordent pas.
1 2
Summa contra Gentiles, I, chap. XIII, et Summa theologica, I, qu. 2, art. 3. Concernant la premire et la seconde, voir I, ch. XIII.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
450
Lternit du monde avec tout ce quelle implique (un monde sans histoire, donc sans rdemption ni consommation du monde), lanimation du ciel avec tous les dangers de lastrologie, est-ce donc au prix de ces erreurs que la raison pouvait arriver tablir lexistence de Dieu ?
XII. SAINT THOMAS (suite) : INTERPRTATION CHRTIENNE DARISTOTE
@
p.668 Cette critique, justifie ou non, est propre nous faire comprendre la situation particulire de saint Thomas aux yeux de ses contemporains et les problmes qui simposaient lui. Il sagissait de faire voir dans la philosophie pripatticienne une philosophie vraiment autonome et indpendante du dogme et qui pourtant saccordt avec lui.
Or lunivers aristotlicien prsentait des traits qui semblent peu aisment conciliables avec la croyance chrtienne : dune part un Dieu qui est seulement le moteur des cieux, qui produit ce mouvement en une matire qui existe indpendamment de lui ; dautre part un Dieu tout-puissant, crateur dun monde qui a commenc dans le temps et qui doit finir. Mme contraste dans la notion des cratures spirituelles, intelligences spares ou mes. Chez Aristote, comment par les Arabes, les intelligences spares sont les moteurs des sphres clestes, et ces intelligences ont mme nature et mme fonction que le Dieu suprme, si bien quon ne peut comprendre leur dpendance son gard : dans lunivers chrtien, les anges sont des cratures capables de dchoir. Les mes, aussi, sont bien diffrentes : chez Aristote, lme est la forme du corps organis, et le principe des fonctions biologiques ; elle na son individualit que par ce rapport avec son corps, qui est sa matire. Dans le drame chrtien, lme est un individu complet par soi-mme dont le rapport avec le corps est passager, et le sujet dune destine surnaturelle. De la conception aristotlicienne de lme comme forme du corps, il semble rsulter quelle est dtruite avec le corps ; il semble aussi que, si elle a une connaissance indpendante des objets sensibles et des organes corporels, telle quest en fait la connaissance intellectuelle, cest par une intelligence qui p.669 na plus aucun rapport avec le corps, qui est au-dessous de lme impassible et appartient en commun tous les hommes. Lternit de cette intelligence impersonnelle est tout autre chose que limmortalit personnelle et rduit nant limage de sa destine surnaturelle. Mme contraste dailleurs dans la morale. Le mrite, chez Aristote, repose sur des vertus qui sont des acquisitions volontaires, qui tirent parti du fonds naturel du caractre et qui saccroissent grce aux offices civils de lhomme et ses rapports politiques ou sociaux avec les membres de la cit. Lidal de la
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
451
mystique chrtienne est au contraire de dpouiller lhomme et de lisoler pour offrir lme toute nue aux effluves de la grce divine. Devant ces contrastes indniables, les adversaires de saint Thomas font ressortir les divergences doctrinales : et toute la tactique de saint Thomas consiste transformer toutes ces divergences de doctrine en une divergence fondamentale et dfinitive, mais acceptable tout fidle, une divergence de mthode. La philosophie humaine considre les cratures en tant quelles sont telles ou telles, do les parties de la philosophie qui correspondent aux genres des choses ; mais la foi chrtienne les considre non en tant quelles sont telles ou telles, par exemple elle considre le feu non pas en tant que feu, mais en tant quil reprsente la hauteur divine et sordonne en quelque manire Dieu lui-mme... Le philosophe considre dans les cratures ce qui leur convient selon leur nature propre, par exemple dans le feu le mouvement vers le haut ; le fidle considre en elles ce qui leur convient en tant quelles sont rapportes Dieu, par exemple quelles sont cres par lui, quelles lui sont soumises, et choses de ce genre 1. Voyons maintenant comment saint Thomas emploie cette tactique dans les quatre problmes que nous avons indiqus. p.670 Dabord du Dieu moteur au Dieu crateur : dune manire gnrale, la physique aristotlicienne comme telle nenvisage que des causes dtermines produisant des effets dtermins : cest pourquoi elle ne connat que des agents capables, par leur action, de tirer dune manire extrieure et antrieure cette action ltre qui y est contenu en puissance ; ces agents produisent uniquement un changement ou mouvement, cest--dire le passage dun tre en puissance, mal dtermin, un tre en acte, bien dtermin ; enfin leur action nest pas instantane, mais doit se drouler dans le temps. Or toutes les voies doivent, dans la pense de saint Thomas, nous amener conclure une cause universelle, cest--dire un agent dont toutes les choses, quelles quelles soient, sont uniformment effets, donc une cause dtre, une cause produisant ex nihilo et agissant instantanment. Cest l un point de toute importance, mais qui suppose une interprtation nouvelle de la pense dAristote : la premire voie , telle quon la trouve dans la Physique, est en effet une solution du problme du mouvement circulaire des sphres clestes ; le moteur immobile reste donc une cause dtermine au sens ci-dessus, cest--dire une cause qui fait passer de la puissance lacte le mouvement circulaire contenu dans la matire des cieux. Or, toute mention des sphres clestes a disparu dans la preuve thomiste ; et saint Thomas la prsente de telle manire que le premier moteur fasse figure de causa essendi ou cause cratrice : les cieux que meut le premier moteur, fait-il remarquer (Contra Gentiles, II, 6), sont cause de gnration pour les choses de la rgion sublunaire, ce qui prouve que le premier moteur est cause dtre. Grce cette considration, saint Thomas peut accepter en toute tranquillit les objections. Cette preuve, dit-on,
1
Summa contra Gentiles, II, 4.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
452
implique lternit du monde ; car le premier moteur toujours en acte doit produire ternellement les mouvements des cieux. Lobjection perd toute sa force si lon saperoit dabord que lternit du monde nimplique pas lindpendance du monde p.671 et la ngation de sa cration ; il suffit, comme la dj fait Avicenne, de concevoir que Dieu a cr le monde ds lternit ; donc, quil soit ternel ou quil ait commenc dans le temps, le monde reste un effet et une crature de Dieu. De plus, les raisons qua donnes Aristote en faveur de lternit du monde ne sont pas, selon saint Thomas, convaincantes ; le fait pour Dieu dtre moteur du monde est une relation quil a aux cratures et qui par consquent nappartient pas ncessairement son tre. En cette matire, la raison ne peut conclure avec certitude ni pour ni contre ; et il reste sen rapporter la foi, qui nous rvle avec certitude que le monde a t cr dans le temps. Dans la seconde voie, il entend cause efficiente, non pas au simple sens de cause motrice, comme cest le cas en gnral chez Aristote, mais au sens de cause qui conduit ses effets ltre ; et cest ainsi que cette voie peut le conduire une cause cratrice. Pour la troisime voie, la spculation sur le ncessaire et le possible, sur lessence et ltre quelle introduit, est tout fait trangre lesprit dAristote, et cest elle qui lui permet, comme nous allons voir, de conclure une cause universelle. Lon ne peut en effet trouver chez Aristote lorigine du problme de la distinction entre ltre et lessence. Sans doute Aristote recommande de rechercher si un tre existe avant de rechercher sa quiddit ; cest que la quiddit dun tre qui nexiste point nest rien ; la quiddit du bouc-cerf nest rien, si cet animal fantastique nexiste pas. Or la manire dont les Arabes, puis ensuite saint Thomas se posent la question des rapports de lessence ltre, loin dtre une suite ou une extension des indications dAristote, en prend juste le contre-pied : il ne sagit pas de chercher si une chose existe avant de dterminer sa quiddit, mais, linverse, de savoir si la quiddit peut avoir un sens dtermin avant toute question sur lexistence, de savoir, pour employer la terminologie de saint Thomas, si lessence est rellement diffrente de ltre. Or cette p.672 question, bien abstraite et technique dapparence, est sous-jacente une proccupation thologique : dire que ltre dune chose est identique son essence, cest dire quelle existe par soi, quelle est ncessaire : cest lui donner un privilge qui nappartient qu Dieu : il appartient toutes les autres natures dtre seulement possibles ; leur tre leur vient dautre chose ; lessence elle-mme nest que possible et peut tre pense sans son tre, sauf sil sagit de ltre unique dont lessence est dexister. Il nest toutefois pas surajout lessence comme un accident ; il est plutt laccomplissement du pouvoir en quoi consiste lessence. Il sagit donc bien daffirmer entre lessence et lexistence un abme bant dont la ngation rendrait Dieu inutile : esprit bien oppos celui dAristote qui Averros a t plus fidle lorsquil a dit quil ny avait entre lessence et lexistence quune diffrence de raison : on peut toujours, dit-il, penser lessence sans la concevoir existante ; mais une essence qui nexisterait pas effectivement est
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
453
chose tout fait imaginaire. En posant inversement comme seul ncessaire ltre dont lessence est dtre, on met la racine des choses la forme la plus universelle qui soit, forme dont toutes les choses qui possderont ltre ne seront que participations et effets. La quatrime voie aboutit au mme rsultat : en effet il est de rgle que chaque chose agisse et produise son effet selon ce quelle est en acte ; or la quatrime voie nous amne un tre qui, tant ltre en acte, doit tre universellement pour toutes les autres choses la cause de leur tre. Enfin la cinquime voie nous conduit exiger une cause qui est diffrente des causes naturelles particulires. On voit par quel dtour le Dieu crateur et transcendant a pris la place du premier moteur, sur linjonction dune foi qui exigeait de la raison quelle trouvt des preuves. Si oiseuse que paraisse la question un lecteur moderne, la thorie des anges se trouvait tre une des pierres dachoppement les plus graves pour laristotlisme thomiste. Pour p.673 saisir le sens de cette question, il faut se rappeler que la preuve du premier moteur que donnait Aristote la fin de la Physique conduisait assez naturellement une multiplicit de moteurs immobiles, autant dintelligences motrices quil y avait dans son systme astronomique de sphres, puisque chacune de ces sphres est suppose anime dun mouvement propre et distinct. Le rapport qui peut exister entre ces intelligences motrices est dailleurs laiss dans lombre par Aristote, et son systme est aussi viable, quon le conoive comme un monothisme o toutes les intelligences dpendent dune seule, ou comme un polythisme o elles agissent de concert, mais indpendamment. Quoi quil en soit, les intelligences spares, que Denys lAropagite, suivant une tradition dj ancienne, assimilait aux anges de la hirarchie cleste, taient dans laristotlisme, comme premiers moteurs dune sphre cleste, les gaux de Dieu mme. On sait dj comment lcole franciscaine, suivant non seulement Avicbron, mais Hugues de Saint-Victor, avait rsolu la question : ces substances spares ne sont pas des formes pures, mais elles sont composes de matire et de forme : partout o il y a indtermination, partout o il y a pluralit et finit, il y a matire ; cest ainsi quil y a une matire commune toute substance qui, selon quelle est dtermine par telle forme ou telle autre, devient esprit ou corps ; et la multiplicit des intelligences prouve quelles ont un fond commun dtermin par des formes diverses. Mais saint Thomas nie compltement cette composition hylmorphique des substances spirituelles. Un de ses arguments atteint la conception gnrale quAvicbron se fait de la matire et de son rapport la forme. Chez lui, la gnration consiste en ce que la forme sajoute la matire comme un accident une substance ; ds lors, il ny a aucune vritable gnration ni aucune vritable unit dans ltre compos ainsi produit ; il est une simple
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
454
somme ou addition. Mais si, avec Aristote, p.674 lon conoit la matire comme un tre en puissance (marbre) qui devient tre en acte (statue) la suite de mouvements ou daltrations diverses, on comprendra comment la composition hylmorphique ne peut appartenir quau corps. Que, au contraire, les intelligences soient des formes pures et sans matire, cest ce que prouvent les caractres de la connaissance intellectuelle, telle que la dcrite Aristote ; en effet, selon lui, dans lacte de comprendre, lintelligence est identique lintelligible quelle comprend : or lintelligible nest nullement reu dans lintelligence comme une forme dans une matire 1. Reue dans une matire, une forme se divise ; elle sindividualise en se liant des accidents ; elle exclut la prsence de la forme contraire ; elle sintroduit dans la matire par suite dun mouvement. Objet de lintellect, la forme est au contraire simple et indivisible, universelle et libre daccidents, mieux connue grce la prsence de son contraire, dautant mieux comprise que lintelligence est moins mobile. Mais si les intelligences spares sont de pures formes, comment viter les inconvnients de la thse ? Cest quun tre peut tre une pure forme sans pour cela galer la simplicit de Dieu. Nous savons dj quil y a en toute crature un mode de composition bien diffrent de celui de la forme et de la matire, celui de lessence et de ltre, deux termes qui, en Dieu seul, sont identiques. Au contraire dans toute chose cre il faut distinguer lessence ou substance, cest--dire ce quest cette chose (quod est), et son tre mme, ou ce par quoi elle mrite le nom dtre (quo est), ou si lon aime mieux, sa puissance et son acte. Cest cette distinction qui, importe dans laristotlisme, servira, comme chez Albert le Grand, sparer lange de Dieu : distinction qui nest que lnonc abstrait de ce que lon veut prouver ; car dire que lange est une crature, dire que son essence na pas delle-mme la puissance dtre, p.675 dire que ce quil est est distinct de ce par quoi il est, ce sont formules identiques. Cette composition, pourtant, nen fait pas un vritable individu, puisque, on le verra, lindividualit nappartient qu une forme engage dans la matire ; les anges, pures formes, diffrent entre eux comme des espces et non comme des individus, et cest la consquence mme que tirait Aristote 2. La troisime difficult est dans le rapport particulier que laristotlisme affirme entre lme et le corps : Lindividualit de lme, dit un interprte rcent, doit tre explique de manire sauvegarder la fois son immortalit personnelle et sa fonction de forme substantielle 3. Voil bien, en effet, le problme : pour saint Thomas, qui suit Aristote, lme est la forme du corps organis ; lme et le corps ne sont pas deux substances indpendantes ; mais de lunion des deux se forme lhomme, qui est un tre unique : union naturelle sans laquelle lme ne peut se saisir : lme
1 2
Contra Gentiles, II, 50. Mtaphysique, A, 8, 1074 a, 36. 3 ROLAND-GOSSELIN, dans son dition du De Ente, p. 117.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
455
ne peut en effet se connatre par elle-mme, et ce que saint Augustin a pu dclarer sur ce point, en disant que lme a par elle-mme des notions de choses incorporelles , revient dire que lme peroit quelle est parce quelle peroit ses propres actions (Contra Gentiles, III, 46). Sil en est ainsi, le problme de lindividualit de lhomme se rsout selon la rgle gnrale qui sapplique lindividuation des tres composs de forme et de matire. On sait que la forme, en elle-mme, est spcifique, et que, pour une mme espce dtre, cest une forme spcifiquement identique qui est dans tous les individus de lespce : ce qui spare les individus les uns des autres, cest donc la matire laquelle sunit la forme. Pour bien comprendre comment la matire est principe dindividuation, il faut pourtant distinguer : ce nest pas le fait dtre uni la matire en gnral qui fait p.676 lindividualit ; lhomme, comme espce, renferme dj la matire puisquon le dfinit un compos dme et de corps, sans tre pour cela individu : ce qui fait lindividu, cest la matire dsigne (materia signata), cest--dire celle qui est considre sous des dimensions dtermines ; cest elle qui individualise la forme et qui produit la diversit numrique dans une mme espce, non seulement parce quelle donne la forme une position exclusive de toute autre dans le temps et dans lespace, mais encore parce que, en raison de sa dbilit, elle ne peut recevoir la forme que dune manire dficiente et imparfaite. Devenir un individu pour une forme engage dans la matire, cest donc de toute manire une limitation, un affaiblissement, une diminution. Lme humaine, comme forme du corps, est soumise ces conditions et nacquiert lindividualit qu raison du corps dont elle est la forme et qui a avec elle une parfaite correspondance. Il semblerait quil faut en conclure que cette individualit doit suivre la destine du corps et disparatre avec lui. Or tel nest pas lenseignement de saint Thomas : Lme humaine, dit-il, est une forme qui selon son tre, ne dpend pas de la matire. Do il suit que les mes sont bien multiplies selon que sont multiplis les corps, mais que pourtant la multiplication des corps nest pas cause de la multiplication des mes : et cest pourquoi il nest pas ncessaire que, les corps une fois dtruits, la pluralit des mes cesse. (Contra Gentiles, II, 81.) Lon voit ici comment la foi chrtienne vient, comme du dehors, limiter le biologisme aristotlicien. Mais il convient de voir de plus prs comment procde saint Thomas pour encadrer dans le pripattisme cette doctrine de lindividualit permanente de lme. Il na, pour accepter la permanence de lindividualit de lme humaine en dehors de son corps, quune seule raison philosophique, cest quil existe dans lme humaine, outre les oprations qui exigent des organes corporels, une p.677 intelligence qui connat ses objets sans lintermdiaire ni lassistance de la matire : Lme intelligente nest donc pas totalement saisie par la matire ou immerge en elle, comme les autres formes matrielles. (Contra Gentiles, II, 68 fin.)
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
456
Mais cette solution amne une autre difficult et fort grave ; cest celle qui concerne les rapports de lintelligence avec le reste de lme humaine. Lon connat dj toute la suite des interprtations que les commentateurs grecs et arabes avaient donnes de la pense dAristote sur ce point, leur accord quasi unanime voir dans lindpendance de lopration intellectuelle vis--vis des organes du corps la preuve que lintellect ntait pas compris dans la dfinition de lme comme forme du corps ; par ailleurs lintelligence, quand elle pense actuellement, est identique son objet ; or cet objet, ce sont les universaux on formes spcifiques ; lintelligence ne peut par suite tre quune forme universelle, indpendante de la matire ; elle nest donc pas susceptible dindividuation ; identique chez tous les hommes, elle nest pas quelque chose de lme. Cest autour de ce problme que se joue la destine de laristotlisme thomiste dans sa rivalit avec le pripattisme arabe : Albert le Grand en avait dj vu toute limportance et, vrai dire, sous des formes techniquement diffrentes, il ne cessera de proccuper lhomme occidental. Chez tous les pripatticiens, chrtiens ou arabes, il y a un point de dpart commun, cest la manire dont ils se reprsentent lopration intellectuelle : cest une opration dabstraction par laquelle les formes spcifiques, comprises en puissance dans les donnes sensibles et dans les images plus ou moins labores de ces donnes, sont tires de ces images ou phantasmes. Saint Thomas rduit deux le nombre des intellects ncessaires cette opration : lintellect agent et lintellect possible : lintellect agent tire les formes spcifiques des phantasmes ; lintellect qui est comme une table rase et qui est apte tout devenir reoit les formes ainsi abstraites. Ces intellects p.678 ne fonctionnent donc jamais que dans leur rapport avec des oprations qui ont elles-mmes besoin dorganes corporels ; ils ne donnent point par eux-mmes de connaissances. La difficult, cest, une fois ces oprations dcrites, de savoir quel en est le sujet ; ces intellects sont-ils spars ou bien lun deux seulement, lintellect agent, tandis que lintellect possible est une partie de lme, ou enfin les deux intellects appartiennent-ils lme ? Le premier parti est celui dAverros, le second celui dAvicenne, le troisime celui de saint Thomas ; mais la thse dAvicenne est en elle-mme illogique ; car il y a un tel rapport et une telle proportion entre lacte de lintellect agent et la puissance de lintellect possible, que le premier doit appartenir au mme sujet que le dernier. Le vritable adversaire est donc Averros, qui avait dailleurs tant de partisans lUniversit de Paris. (Contra Gentiles, II, 76.) Il suffisait contre lui de dmontrer quune substance intellectuelle peut tre la forme dun corps ; saint Thomas ne trouve chez Aristote, nul secours pour cette dmonstration ; tout au plus 1 peut-il donner en exemple les mes des
1
Contra Gentiles, II, 76.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
457
sphres clestes, qui meuvent leur sphre par le dsir quelles ont du bien. Il a donc affirm, bien plus quil ne la dmontr, qu une substance intellectuelle peut tre un principe formel dtre pour une matire. (Contra Gentiles, II, 58.) Mais, cela suppos dmontr, il faut encore prouver que ladjonction de lintelligence aux autres puissances de lme ne compromet pas son tour lunit et lindivisibilit de lme : la puissance intellectuelle nest-elle pas ce point diffrente de la puissance nutritive et sensitive que chacune parat former une me part ? Cest ici quintervient le problme technique de la pluralit des formes : les Augustiniens, en accord sur ce point avec Avicbron, soutenaient que, dans un compos matriel, la matire est informe par plusieurs formes ; p.679 mesure quon slve dtres moins parfaits des tres plus parfaits, une forme vient sajouter une forme suprieure ; le corps est dtermin par la simple forme de la corporit ; dans llment sajoute la forme de llment ; dans le mixte des lments, la forme du mixte ; dans la plante, lme nutritive ; dans lanimal, lme sensitive et ainsi de suite, la forme suprieure ne faisant que sajouter la forme infrieure. Les formes infrieures sont embrasses dans les formes suprieures, jusqu ce que toutes soient ramenes la premire forme universelle, qui unit en elle toutes les formes 1. Cette thse dj critique par Avicenne, parat inacceptable saint Thomas : la pluralit des formes en un tre, est incompatible avec son unit ; une pluralit de formes ne peut crer une vraie substance ; car si un compos dou dune seule forme, comme un corps, est dj une substance, une forme nouvelle ne pourra que sajouter une substance dj existante, titre dattribut accidentel. Il est ais de voir, dans cette discussion, le conflit entre limage dun univers fait dune suite de formes hirarchises, dont chacune est pour ainsi dire avide de celle qui viendra la complter (lunit ntant en effet jamais dans lindividu, mais seulement dans le tout), et limage pripatticienne dun univers fait dindividus ayant chacun en soi le principe de ses oprations. A cette seconde inspiration se rattache la thse de lunit de la forme en chaque individu. Mais grce cette thse aussi, le danger qui menaait lunit de lindividu humain est tout fait cart ; car non seulement lintelligence est la forme du corps organis, mais encore elle est la seule et unique forme de ce corps, et cest delle que dcoulent toutes les facults, sensitive ou vgtative, dont les oprations sont excutes par les organes du corps. De cette manire la forme du corps humain est tout entire une me intelligente qui tire son p.680 individualit de sa relation au corps et son indpendance du caractre immatriel de ses oprations de connaissance. Toutefois il reste un argument trs fort contre cette individualisation de lintelligence : lintelligence en acte tant identique son objet, et son objet tant une forme universelle, lintelligence ne peut tre multiplie en individus
1
AVICEBRON, Fons Vitae, ed. Bauemker, p. 143, 13.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
458
divers. Cest par un vrai coup de force thologique que rpond saint Thomas 1. On argumente fort grossirement, dit-il, pour montrer que Dieu ne peut faire quil y ait plusieurs intellects de mme espce, parce que, croit-on, cela implique contradiction. Mais mme en admettant quil ne ft pas de la nature de lintellect dtre multipli, il ne sensuivrait pas ncessairement que cette multiplication impliqut contradiction. Rien nempche quune chose nait pas dans sa nature la cause dun caractre quelle possde pourtant en vertu dune autre cause ; ainsi par nature, le grave na pas ce caractre dtre en haut, et pourtant il peut tre en haut, sans que cela implique contradiction. De mme si lintellect de tous tait unique parce quil ne contient pas de cause naturelle de multiplication, il pourrait pourtant admettre la multiplication sans contradiction, en vertu dune cause surnaturelle. Soit dit non tant pour notre actuel propos que pour que cette manire dargumenter ne stende pas dautres sujets ; car ainsi on pourrait conclure que Dieu ne peut faire que des morts ressuscitent et que des aveugles recouvrent la vue. Lon voit, par ce texte si expressif, que saint Thomas nhsite pas enjoindre la raison de plier, cest--dire dargumenter dans le sens de la foi ou de se taire. Comme il y a une physique rationnelle du monde sensible qui permet de remonter par raisonnement jusqu Dieu comme la cause du monde, et une thologie rvle qui excde les forces de la raison, il y a, pour diriger la conduite humaine, une morale naturelle appuye sur la direction spontane de la p.681 volont vers le bien et le bonheur, et une destine surnaturelle dans laquelle lhomme nest conduit que par une grce sanctifiante qui nappartient pas delle-mme la volont claire par la raison. Les ides fondamentales de la morale naturelle sont empruntes par saint Thomas Aristote. De lthique Nicomaque vient lide que notre volont se dirige naturellement et spontanment vers le bien qui est sa fin, que notre libre arbitre consiste non pas choisir notre fin, qui nest pas libre, mais choisir, par dlibration raisonne, les moyens qui nous conduisent cette fin. Il faut donc quil y ait une lumire naturelle qui nous donne les prmisses de nos raisonnements pratiques ; cette lumire naturelle se manifeste par la syntrsis qui est, pour saint Thomas, un habitus (tat stable) naturel et immuable, qui se divise en prceptes particuliers ; delle vient la rectitude de la volont. Les vertus sont des habitudes acquises, venant de ce que, grce notre libre arbitre, nous sommes capables de choisir les moyens les meilleurs. Cette vue suppose que les lois de la morale et du droit sont fondes sur la raison de Dieu, laquelle se soumet sa propre volont. La loi ternelle nest que la raison de la sagesse divine ; la volont divine, tant raisonnable, est soumise cette raison et par consquent la loi ternelle. Cette immutabilit du droit en raison, contre quoi protesteront plus tard les occamistes, restera pourtant la base de toute une partie des thories modernes du droit ; et cest
De unitate intellectus contra Averroistas, ch, VII.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
459
de saint Thomas que la reoit au XVIIe sicle Grotius, par lintermdiaire du scolastique Vasquez (mort en 1506) 1. Mais cette lumire naturelle ne donne aucun moyen de passer aux vertus suprieures, la charit et la batitude des lus qui consiste en une connaissance de Dieu, impossible en cette vie, et qui, seule, est capable de satisfaire tous les dsirs humains. On a reconnu linauthenticit du grand crit politique De regimine principum, autrefois attribu saint Thomas ; crit, au moins en sa dernire partie, par Ptolme de Lucques, vers 1301, il reprsente admirablement, en matire politique, lesprit thomiste tel que nous le voyons se dgager de sa philosophie : un pouvoir civil, qui recherche le bien de la cit, avec la mme autonomie que la raison recherche la vrit en matire spculative ; mais en mme temps la certitude absolue que, si ce pouvoir civil vient sopposer dune manire quelconque aux buts du pouvoir spirituel qui a reu de Dieu la mission de conduire lhomme au salut, il est dans lerreur et doit tre redress. De l rsulte le caractre tout rationnel, presque raliste, de cette politique dinspiration thomiste en matire temporelle. Le royaume nest pas fait pour le roi, mais le roi pour le royaume. Le roi na dautre raison dtre de son pouvoir que la recherche du bien de tous ; et, sil sacrifie le bien de ses sujets son bien propre, ceux-ci sont dgags de toute obligation son gard et ont le droit de le dclarer dchu de son pouvoir, Mais, dautre part, il est entendu que cet tat rationnel ne peut tre quun tat chrtien. Car cest la loi divine qui marque le vrai bien, et son enseignement appartient au ministre de lglise 2 : et cest pourquoi lglise a le droit dexcommunier et de dposer les rois. Cette sorte de thocratie tempre qui laisse au pouvoir temporel une autonomie correspondante celle que la thologie laisse la philosophie rationnelle fait contraste avec le De regimine Christiano crit vers la mme poque (1301-1302) par Jacques de Viterbe, un ermite augustin qui, dans lesprit augustinien, soutient une thocratie bien plus stricte contre les prtentions croissantes des royauts nationales.
p.682
XIII. LAVERROISME LATIN : SIGER DE BRABANT
@ Il nest pas douteux que lintroduction du pripattisme lUniversit de Paris eut pour effet de rompre lunit de la culture mdivale telle quon lavait rve jusquau XIIe sicle : dune part ltude des sept arts, destins donner toutes les connaissances lmentaires ncessaires au commentateur, dautre part une thologie, faite avant tout des commentaires de lcriture et des Pres ; interdiction dailleurs dun empitement, puisque la Facult des
p.683 1 2
GURVITCH, La Philosophie du droit de H. Grotius, Revue de Mtaphysique, p. 369, 1927. De regimine principum, I, 13.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
460
Arts devait exclure de son programme toute matire thologique. Mais o la philosophie dAristote pouvait-elle trouver place ? A la Facult des Arts, puisquil ne pouvait tre question de faire dAristote une autorit thologique, et, de fait, vers le milieu du sicle, le programme de la facult comprend ltude de toute lencyclopdie dAristote, en commenant par lOrganon, en continuant par lthique, la Physique et la Mtaphysique, etc. 1. Ctait introduire la Facult des Arts beaucoup de questions extrieures aux sept arts et touchant la thologie. Situation prilleuse : car la Facult des Arts, lon avait commenter purement et simplement la philosophie dAristote, sans soccuper en aucune manire de la discorde possible de ses doctrines avec la foi. Nous cherchons ici, dit Siger de Brabant, en exposant contre Albert et saint Thomas son interprtation des textes dAristote sur lintellect, lintention des philosophes et principalement dAristote, quoique peut-tre le philosophe ait eu une opinion qui nest pas conforme la vrit ; et que la rvlation nous donne sur lme des enseignements qui ne peuvent tre conclus par la raison naturelle ; mais nous navons rien faire maintenant des miracles divins, puisque nous discutons en physicien des choses p.684 naturelles 2. La synthse thomiste donnait sans doute un principe daccord : ce que la raison nous enseigne ne peut tre contraire ce que la foi nous rvle, et, sil y a une apparente contradiction, cest que la raison a t mal conduite. Les matres s arts soumettaient ce principe une preuve exprimentale : la raison y tait interroge indpendamment de la foi, et ctait une simple question de fait de savoir si ses conclusions saccordaient ou non avec la foi. Or la chose nest pas douteuse pour Siger de Brabant, le clbre matre s arts, qui, de 1266 1277, enseigna lUniversit de Paris linterprtation averroste dAristote et qui fut linitiateur de ce mouvement que lon a appel laverrosme latin : les thses dAristote contredisent les doctrines rvles. Cest l pour lui, semble-t-il, une simple constatation de fait, dont il ne dduit pas du tout, comme on la dit, quil y a une double vrit , une vrit pour les philosophes et une vrit pour les thologiens ; il nhsite pas affirmer que cest la foi qui dit vrai ; et pourtant quelques philosophes ont eu une opinion contraire . Lidentit de lintellect chez tous les hommes, la ncessit des vnements, lternit du monde, la destruction de lme avec le corps, la ngation de la connaissance des choses singulires en Dieu, la ngation de la providence divine dans la rgion sublunaire, tels sont les principaux articles, par o laverrosme de Siger soppose la foi chrtienne, et que Gilles de Lessines recueillait en 1270 dans lenseignement de Siger pour les soumettre Albert le Grand 3.
1 2
Cartulaire de lUniversit, cit par E. GILSON, tudes, p. 56. d. Mandonnet, II, p. 153-154. 3 Cf. La demande de consultation et La rponse dAlbert, publis par Mandonnet, II, p. 29.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
461
On y a reconnu peu prs toutes les thses quAverros prtait Aristote et que niait saint Thomas. Un trait comme le De Anima intellectiva (p. 152) de Siger contient dailleurs la discussion de linterprtation dAlbert le Grand et de saint Thomas, dsigns par leurs noms, sur les textes dAristote p.685 relatifs lintellect. Il est faux, selon Aristote, que les facults vgtative et sensitive appartiennent au mme sujet que la facult intellectuelle ; sans doute lintelligence est unie au corps dans son opration, parce quelle ne peut rien saisir que dans limage qui implique lorgane corporel de limagination ; mais cest elle seule qui comprend, et lorsque lon dit que lhomme comprend, on ne veut pas parler de lhomme comme compos dme et de corps, mais de son intellect seul. Mme avec les prcautions quemployait Siger, cet enseignement fut jug dangereux par lautorit ecclsiastique ; en 1270 lvque de Paris, tienne Tempier, condamna treize propositions de lenseignement averroste sur la connaissance de Dieu, lternit du monde, lidentit des intellects humains, la fatalit, celles mme que Gilles de Lessines avait soumises Albert ; en 1277, sur linvitation du pape Jean XXI, lvque de Paris ouvre une enqute, et porte une nouvelle condamnation de 219 propositions ; la condamnation dbute en attribuant aux averrostes la doctrine de la double vrit ; ils disent que ces choses sont vraies selon la philosophie, mais non selon la foi catholique, comme sil y avait deux vrits contraires et comme sil y avait, dans les paroles de gentils qui sont damns, une vrit contraire la vrit de la Sainte criture 1. Siger, oblig de quitter lUniversit, fut cit devant linquisiteur de France, et en appela au Saint-Sige ; condamn linternement perptuel, il mourut tragiquement vers 1282, poignard par le clerc qui lui servait de secrtaire. Le mouvement averroste, qui, ds lors, tait men non pas seulement par Siger, mais par Boce de Dacie et Bernier de Nivelles, condamns avec lui, continua malgr ces mesures. Jean de Jandun matre s arts Paris vers 1325, et mort en 1328, fut excommuni en 1327 par le pape Jean XXII. Mme protestation pourtant chez lui dattachement la foi : p.686 Il est certain que lautorit divine doit faire foi plus que nimporte quelle raison dinvention humaine 2. Il veut soutenir des opinions de foi contraires la raison, en accordant comme possible auprs de Dieu ce que tous nos raisonnements nous conduisent dclarer impossible . Il est donc amen logiquement une sorte de fidisme. Jaffirme la vrit de tous ces dogmes, dit-il en parlant des dogmes contredits par Aristote, mais je ne sais pas les dmontrer ; tant mieux pour ceux qui le savent ; mais je les tiens et les confesse par la foi seule. Nous retrouverons plus tard laverrosme qui jouera un grand rle la Renaissance.
1 2
Mandonnet, II, p. 175. Cit par GILSON, tudes, p. 71.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
462
XIV. POLMIQUES RELATIVES AU THOMISME
@ La condamnation porte par Tempier en 1277 marquait une grande inquitude cause non seulement par laverrosme, mais par le pripattisme en gnral. Saint Thomas, sans doute, compris de son propre point de vue, tait ladversaire des averrostes ; toute sa thorie de lintellect nest quune longue rponse laverrosme, et le De Unitate intellectus contra Averroistas a peut-tre t crit en 1270 pour rfuter Siger. Mais, vue de lextrieur, sa philosophie tait pripatticienne, et il tait bien difficile de voir exactement o sarrtait le danger de laristotlisme import lUniversit de Paris. Aussi certaines des 219 propositions condamnes visent non pas Siger lui-mme, mais bien les innovations du thomisme : impossibilit de la pluralit des mondes (27), individuation par la seule matire (42-43), ncessit, pour la volont, de poursuivre ce qui est jug bon par lintellect (163), voil quelques unes des thses thomistes qui paraissaient suspectes. Saint Thomas rencontrait des contradicteurs dans son ordre mme : les p.687 dominicains qui lavaient prcd lUniversit de Paris, Roland de Crmone et Hugues de Saint-Cher, taient augustiniens. Un de ses plus ardents adversaires fut le dominicain Robert Kilwardby qui, matre de thologie lUniversit dOxford de 1248 1261 et archevque de Canterbury en 1272, enseignait les ides de saint Bonaventure sur la matire et la forme ; il soutenait que la matire contient les raisons sminales qui expliquent la production des choses ; et contrairement la thse de lunit de la forme, il enseignait que lme ntait pas simple mais compose des parties vgtative, sensitive et intellectuelle. Aussi fit-il condamner Oxford en 1277 la thse de lunit de la forme : condamnation qui fut rpte plusieurs reprises par son successeur au sige de Canterbury, le franciscain Jean Peckhm. Celui-ci condamne en bloc toute la philosophie nouvelle, dans une lettre de 1285 o il rprouve les nouveauts profanes du vocabulaire, introduites depuis vingt ans dans les profondeurs de la thologie contrairement la vrit philosophique, et en injure aux saints . Et il cite notamment labandon de la doctrine augustinienne des rgles ternelles et de la lumire immuable, des puissances de lme, des raisons sminales insres dans la matire et quantit dautres . Le passage vise videmment les thses correspondantes du thomisme : lintellect agent, lunit des formes, la thorie de lduction des formes.
XV. HENRI DE GAND
@ Sous ces sches formules, il faut bien saisir les deux visions de lunivers qui sopposent : dune part lunivers augustinien o la raison est dj une illumination, o ltre dj inform aspire de nouvelles formes, o la matire est grosse des dterminations que va engendrer la forme : dautre part
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
463
lunivers pripatticien o toute connaissance intellectuelle est p.688 abstraction, o lindividu est complet par lui-mme, o la matire attend passivement la forme. Laugustinisme antithomiste est particulirement reprsent Paris par le matre sculier Henri de Gand, le doctor solemnis, matre de thologie Paris en 1277 et mort en 1293. Contrairement ce principe pripatticien : la forme donne ltre la matire, il admet que la matire existe par soi et subsiste en acte ; acte imparfait sans doute et qui la laisse capable de recevoir la forme qui lachve et laccomplit. Cest que, pour lui, contrairement au principe thomiste, lessence nest pas rellement distincte de ltre ; chez saint Thomas, chaque essence attendait, on se le rappelle, de ltre universel son actualisation et, pure puissance, ny avait aucun droit par elle-mme : pour Henri, lessence a par elle-mme son tre et, des essences diverses correspondent autant dtres divers ; principe qui laisse en chaque essence quelque chose du pouvoir de Dieu. Sa thorie de lindividuation est galement antithomiste ; lindividuation est due non pas la matire mais la ngation ; lindividu est ltre qui, terme infrieur de la division, devient incapable de se diviser son tour, et qui est galement incapable de sidentifier et de communier avec les autres individus. Cette thorie des essences et des individus devait lamener, semble-t-il, placer en Dieu lui-mme les objets de notre intelligence, du moins leur niveau le plus lev ; aussi est-il davis que lhomme ne peut atteindre, en partant des choses naturelles, les rgles de la lumire ternelle que Dieu offre qui il veut et enlve qui il veut . Nulle thorie o lon voit mieux lopposition lesprit thomiste : continuit dans ltre, mais discontinuit dans la connaissance, telle pourrait tre la somme de la sagesse thomiste, qui dessine dune manire prcise les limites de la raison ; continuit dans ltre, donc continuit dans la connaissance, telle est la somme de la sagesse augustinienne pour qui la raison se continue en illumination. De cette opposition dcoulent deux conceptions bien diffrentes de p.689 la vie spirituelle ; pour Henri de Gand, la fin de cette vie nest pas, comme chez saint Thomas, la connaissance de Dieu, mais lunion avec Dieu ou lamour ; la volont qui est la facult de dsirer ou daimer a donc une fin qui est suprieure celle de lintelligence et qui seule vaut par elle-mme ; ce nest donc point, comme le veut saint Thomas, lintelligence qui impose la volont la fin quelle poursuit.
XVI. GILLES DE LESSINES
@ Pourtant le thomisme, aprs la condamnation de 1277, trouvait dardents dfenseurs ; au Correctorium fratris Thomae que Guillaume de la Mare crit en 1278 rpondent de nombreuses rfutations : on publie notamment de nombreuses dissertations destines montrer la cohrence intime du thomisme. Le dominicain Gilles de Lessines, mort en 1304, est un de ceux qui publient un trait de Unitate formae (1278), dans lequel il expose sous tous les
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
464
aspects possibles le mme argument : Bien que les formes abstraites par lentendement (par exemple la ligne dans la surface, la surface dans le corps) soient vraiment plusieurs et diffrentes en tant que formes, pourtant dans lunique sujet dont elles sont des parties ayant chacune leur rle, elles nont quun tre unique qui provient de cette forme dont elles ont leur tre physique et do dcoulent leurs fonctions, comme les actes seconds dcoulent de lacte premier 1. De plus, on voit un sculier, Godefroy de Fontaine, mort en 1308, lve dHenri de Gand qui, sur quelques points du moins, prend contre son matre la dfense des thses thomistes. Il admet contre saint Thomas, que ltre ne diffre pas de lessence. Dieu est aussi bien cause de lessence dune chose que de son existence ; avant que la chose soit cre, elles sont lune et p.690 lautre en puissance ; aprs que la chose est cre elles sont lune et lautre en acte ; mais il est manifestement faux que lessence soit en puissance par rapport son existence 2. Godefroy est contraire aussi la thorie thomiste de lindividuation, qui, selon lui, ne permettrait dadmettre entre les individus que des diffrences accidentelles ce qui est un inconvnient manifeste . En revanche il dfend, contre lilluminisme, la thorie de la connaissance intellectuelle par abstraction, et contre le volontarisme, la thse thomiste selon laquelle la volont est soumise lentendement. Enfin il y a, au dbut du XIVe sicle, une diffusion du thomisme en des ordres influents ; Gilles de Rome, des ermites augustins, mort en 1316, prend la dfense de la thse de lunit des formes ; Humbert introduit le thomisme chez les Cisterciens, Grard de Bologne chez les Carmlites. Frre Thomas fut canonis en 1323 par le pape Jean XXII, et lon sait la place que Dante (1265-1321) lui a rserv dans la Divine Comdie : au quatrime ciel, Dante rencontre les thologiens philosophes, dont le plus grand est saint Thomas. On sait aussi que saint Thomas a, sa gauche, Siger de Brabant et que le pote fait prononcer par le saint des vers logieux pour laverroste : passage qui a bien embarrass les commentateurs et qui signifie peut-tre que, pour les amis comme pour les ennemis de saint Thomas, la pense thomiste prsente au fond une tendance identique celle de Siger : lalliance dAristote et du Christ, contre lancienne tradition thologique.
XVII. LES MATRES DOXFORD
Augustinisme et pripattisme ne sont point les seuls courants de pense qui traversent le XIIIe sicle. Il est plus p.691 difficile de dfinir le troisime courant dont nous allons maintenant parler. A certains gards, il continue la
1 2
dition DE WULF, p. 57. d. DE WULF et PELZER, p. 305-306.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
465
pense du XIIe sicle plus que les mouvements que nous venons dtudier, et il annonce la philosophie moderne dune manire plus nette ; lesprit chartrain qui unissait au got des sciences positives, mathmatiques et sciences exprimentales, lrudition classique et la recherche de lintuition mtaphysique de la nature considre comme un tout, intuition qui trouvait sa satisfaction dans lattachement au platonisme, cet esprit la fois positif, naturaliste et hant du dsir dintuition universelle, se retrouve chez les penseurs dont nous allons parler et auxquels la brivet de cette Histoire ne nous permet pas de donner la place qui leur serait due. Dabord le groupe des oxfordiens : leur esprit sannonce chez Alexandre Neckham, mort en 1217, qui connat le De Coelo et le De Anima dAristote, plus nettement chez son contemporain Alfred lAnglais (ou Alfred de Sereshal) qui voyage en Espagne o il apprend larabe ; il traduit de larabe en latin le De Vegetabilibus de pseudo-Aristote, et un Liber de congelatis, qui est un supplment aux Mtores ; il crit un De motu cordis ; il connat les Aphorismes dHippocrate et lArt mdical de Galien. Michel Scot, mort vers 1235, est celui qui traduisit de larabe la Sphre des astronomes dAl Petragius, des ouvrages dAverros et dAvicenne, et lHistoire des Animaux dAristote, quil ddie lempereur Frdric II ; cest cet astronome et cet alchimiste que Dante a plongs dans lenfer. Cet esprit spanouit enfin chez Robert Grosseteste, chancelier de lUniversit dOxford, vque de Lincoln depuis 1235 et qui mourut en 1253. Les vingt-neuf traits de lui qua dits Baur comprennent surtout des crits scientifiques, en particulier des traits doptique (De la lumire ou de lbauche des formes, De larc-en-ciel ou De larc-en-ciel et du miroir, De la couleur, Du mouvement corporel et de la lumire), mais aussi des traits dacoustique, dastronomie, de mtorologie, et en outre p.692 des crits mtaphysiques sur lhomme microcosme, sur les intelligences, sur lordre dmanation des choses causes partir de Dieu. En somme, une conception de lunivers physique dont le centre est ltude de la lumire, une conception de lunivers mtaphysique dont le centre est lide dmanation des formes partir de lunit, et une liaison intime et profonde entre cette physique, qui nous dcrit les lois de la diffusion de la lumire et cette mtaphysique, qui dcrit lmanation des tres. La lumire joue un rle analogue, par quelques cts, celui que jouait le feu dans la cosmogonie stocienne. Premire forme corporelle , elle explique, par son expansion, sa condensation, sa rarfaction tous les corps de lunivers. Elle a cette proprit dtre immdiatement prsente en tout lieu ; elle se propage en effet de tout ct, de telle sorte que dun point lumineux, sengendre immdiatement une sphre de lumire aussi grande quon le veut, moins que lombre ny fasse obstacle ; propagation sphrique et vitesse infinie arrte dans son expansion par lobscurit, Robert ne demande pas autre chose pour lexplication du cosmos et de ses sphres. Tout est un, issu
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
466
de la perfection dune lumire unique, et les choses multiples ne sont multiples que grce la multiplication de la lumire mme. Mais il faut saisir le noyau positif que contiennent ces aventureuses recherches : cest en effet au sein de cette mtaphysique de la lumire que prend naissance la physique mathmatique de la nature : loptique est insparable de la considration des lignes, des angles et des figures qui se ralisent en quelque sorte dans la propagation de la lumire ; et cette bauche de physique mathmatique aboutit affirmer lexistence dun ordre rigoureux et rigoureusement concevable par lesprit dans la nature : Toute opration de la nature saccomplit de la manire la plus dtermine (modo finitissimo), la plus ordonne, la plus brve et la plus parfaite possible 1. De lcole de Robert Grosseteste sort une Summa philosophiae qui comprend 19 traits dont les sujets vont de lhistoire de la philosophie la minralogie. Malgr le fantastique de cette histoire o, avec Isidore, Brose, Josphe et saint Augustin, lauteur voit les premiers philosophes en Abraham, Atlas et Mercure, il fait pourtant preuve desprit critique en relevant la manire dont les traducteurs arabes en ont pris leur aise avec le texte dAristote, lui faisant citer Ptolme dans le De Coelo, ou le montrant dans les Mtores sadressant lempereur Hadrien. Il nous dit aussi que, en matire de choses naturelles indiffrentes au salut, les thologiens ont pu se tromper. Dans les questions mtaphysiques, la Somme est dfavorable au thomisme ; il refuse, avec presque tous les augustiniens, dadmettre lexistence de ces espces intelligibles que saint Thomas dclarait indispensables la connaissance intellectuelle (p. 298) ; lessence de la chose sunit lintellect sans aucun intermdiaire ; sans quoi ce ne seraient pas les essences mmes, mais leurs images qui mettraient lintellect en mouvement, et ce seraient plutt leurs images (idola) que les formes mmes qui seraient comprises . Il maintient aussi la tradition augustinienne dans la question de la connaissance de lintellect par lui-mme : Lme, en se comprenant, ne reoit pas sa propre espce, mais a plutt lintuition (contueri) delle-mme (p. 463). Comme au caractre intuitif de la connaissance intellectuelle des essences des choses ou de nous-mmes, il est attach lide que lme intellectuelle est individuelle par elle-mme, mme sans relation au corps.
p.693
XVIII. ROGER BACON
@ Mais le plus remarquable des Oxfordiens est Roger Bacon, le doctor mirabilis, chez qui lon voit un esprit fougueux, ardent, indomptable, qui se traduit dans sa vie comme dans p.694 ses crits ; nul moins que lui na mnag lignorance et la fatuit des philosophes parisiens , et en particulier leur
1
dit. BAUR, De luce, p. 75.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
467
ngligence en matire dtudes du langage, des mathmatiques et des sciences de la nature. N entre 1210 et 1214, il avait dabord t Oxford llve de Robert Grosseteste qui il tmoigna toujours la plus vive admiration ; il sjourna Paris de 1244 1252 ; entr dans lordre des Franciscains et revenu Oxford, il composa de 1266 1268 lOpus majus, divis en sept parties se rapportant aux causes de lignorance humaine, aux rapports de la philosophie et de la thologie, la science des langues, lutilit des mathmatiques dans la physique, lastronomie, la rforme du calendrier et la gographie ; loptique, la science exprimentale et la philosophie morale. Cet ouvrage, crit sur une demande faite par le pape Clment IV en 1268, fut compos en mme temps que deux autres ouvrages qui contenaient des travaux prliminaires : lOpus minus et lOpus tertium. En 1278, Roger Bacon crivit dans le Speculum astronomi (faussement attribu Albert le Grand) une dfense de lastrologie judiciaire ; il y mettait en question la condamnation de lastrologie, prononce dans la 170e des propositions condamns en 1277 par lvque Tempier : On peut connatre par des signes les intentions des hommes et les changements de ces intentions. Cet crit fut sans doute sa perte : le gnral des Franciscains qui, depuis 1277, suivait la politique qui avait abouti une paix complte avec les dominicains le condamna en 1278 la peine de lincarcration. Cest bien en effet lesprit thomiste qui est atteint au fond par toute luvre de Roger, cet esprit de prudent cloisonnement qui prescrit chacun les limites dont il ne doit pas sortir. Roger est, par excellence, le partisan de lunit de la sagesse ; il ny a quune seule sagesse contenue tout entire dans les critures. La philosophie et le droit canonique ne font que prsenter sur la paume de la main (velut in palmam) ce que p.695 la sagesse divine concentre comme dans le poing (velut in pugnum). Roger rappelle cette ancienne manire de concevoir lunit spirituelle que tout le Moyen ge avait emprunte saint Augustin et Bde : les arts libraux mis au service de linterprtation de lcriture, la philosophie paenne servant la rfutation des erreurs des gentils : cest au point que la philosophie, considre en elle-mme , part de cette uvre totale, nest daucune utilit . Aristote lui-mme, interprt par les Arabes, est appel en garant de cette unit ; il admet que la connaissance intellectuelle nous est impossible sans laide dun intellect agent qui contient toutes les formes ; cest dire quil sait tout, mais sil sait tout, cela ne convient ni une me, ni un ange, mais Dieu seul. Et si Bacon ne va pas jusqu dire, comme certains Franciscains, que nous voyons immdiatement les essences en Dieu, il affirme du moins que nous ne connaissons intellectuellement que sous linfluence immdiate dun intellect agent qui est identique au Verbe, auteur de notre salut. Aussi les philosophes chrtiens, loin de limiter et de rtrcir le domaine de leurs recherches doivent rassembler dans leurs traits toutes les paroles des philosophes au sujet des vrits divines, et mme aller bien au del sans devenir pour autant des thologiens . Lunit de lesprit est prouve, on le voit, par un recours son origine divine : origine dmontre aussi, selon les vues de Bacon, par la
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
468
fantastique histoire de la philosophie, quil emprunte aux Pres de lglise : la philosophie, rvle aux patriarches, a t transmise par divers intermdiaires aux philosophes paens, et elle est, de l, revenue aux chrtiens. Et lcriture est aussi la somme de cette sagesse, lcriture o se trouve toute crature en soi ou dans son image, dans son type universel ou dans sa singularit, du haut des cieux leurs confins, de telle sorte que, comme Dieu a fait les cratures et lcriture, il a voulu mettre les cratures dans lcriture, quon la comprenne tant au sens littral quau sens spirituel . conception de la sagesse aboutit, pratiquement, la thocratie la moins modre ; car par la lumire de la sagesse est ordonne lglise de Dieu et dispose lglise des fidles. Comme elle rgit le monde, nulle autre science nest requise pour lutilit du genre humain . La cit baconienne rappelle la cit platonicienne : au sommet les clercs, au-dessous les savants, au-dessous encore les militaires, en dernier lieu les artisans ; un droit ecclsiastique, uniquement fond sur les critures, qui domine le droit civil ; les papes et les princes prenant pour conseiller les sages qui, dtenant le savoir, doivent seuls dtenir le pouvoir ; enfin lunit religieuse du monde obtenue par un apostolat fond sur ce savoir. Il y a un contraste des plus tranges entre ces caractres de la pense baconienne et les traits de sa doctrine que lon est habitu mettre au premier plan et o lon voit sa principale signification historique. Roger Bacon est celui qui, dans les sciences, a prn lexprience comme la seule mthode possible : Nous avons, dit-il, trois moyens de connatre, lautorit, lexprience et le raisonnement ; mais lautorit ne nous fait pas savoir si elle ne nous donne pas la raison de ce quelle affirme... ; le raisonnement de son ct ne peut distinguer le sophisme de la dmonstration moins dtre vrifi dans ses conclusions par les uvres certificatrices de lexprience. Il se trouve pourtant que personne de nos jours na cure de cette mthode..., cest pourquoi tous les secrets ou peu sen faut, et les plus grands de la science, sont ignors de la foule de ceux qui sadonnent au savoir. Partisan de la mthode exprimentale, il a en mme temps lide de la physique mathmatique qui en est insparable, physique lie comme chez Robert Grosseteste loptique de Ptolme connue par larabe Alhazen, aux constructions gomtriques de loptique dans la rflexion, la rfraction et la thorie de larc-en-ciel ; la construction mathmatique du point de combustion derrire une lentille convexe claire par le soleil parat Bacon donner la cause p.697 propre et ncessaire du phnomne . En mme temps qu lexprience et aux mathmatiques, Bacon sattache aux problmes techniques, tant la technique des ingnieurs que lui fait imaginer des machines automotrices ou des machines volantes qu la technique sociale, comme le problme de lorganisation du travail et de lassistance publique. Cet esprit exprimental, mathmatique et technique, na certes jamais t absent chez les ingnieurs, les architectes ou les artisans du Moyen ge ; mais transport dans le domaine spculatif, il parat faire de Bacon le vritable
p.696 Cette
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
469
anctre de la philosophie moderne. Il ne faut pourtant pas oublier en lui le thocrate illumin, celui qui voyait en Clment IV le pape prdit par les astres pour la conversion de la terre au catholicisme. Illuminisme et exprience, ce sont les deux traits dont lunion fait la physionomie de Bacon. Union inexplicable, sil sagissait de la mthode exprimentale telle quon la comprend aujourdhui. Mais, en fait, ce nest pas delle quil sagit ; on ne rencontre chez lui aucune mthode prcise ni pour instituer des expriences ni pour en tirer des lois. Le mot experimentum est intimement li, pour un homme du XIIIe sicle, des ides quil ne nous suggre plus. Lexpert, chez Bacon, est essentiellement celui qui sait dgager et utiliser des forces occultes qui sont inconnues au reste des hommes ; cest lalchimiste qui cre llixir de vie et la pierre philosophale ; cest lastrologue qui connat les pouvoirs des astres ; cest le magicien qui connat les formules qui dominent la volont des hommes. Limage de lunivers que donne lexprience est bien diffrente de celle que donne la physique du philosophe : celle-ci dduit les phnomnes naturels des proprits des quatre lments ; celle-l connat par ses procds, des forces caches irrductibles celles des lments, telles que celle que Pierre de Mariscourt mettait en uvre dans ses recherches sur laimant. Lorsque Bacon parle de la science exprimentale, il songe donc une science secrte et traditionnelle, consistant p.698 dans linvestigation des forces occultes et dans la domination que leur connaissance assure lexpert. Lunivers de ces experts, cest essentiellement lunivers tel que Plotin le dcrivait, un ensemble de forces qui sentrecroisent, fascination, paroles magiques, forces manes des astres et auxquelles on est soumis sans le savoir ; le type et le modle de cette diffusion de chacune de ces forces partir de leur point dorigine, Bacon le prend dans la perspective, si tudie de son temps, qui donne, dans la diffusion de la lumire, un exemple de la multiplication des espces . Cette multiplication est comme la loi gnrale des forces qui senchevtrent dans lespace. Partant de l, Bacon attache bien moins dimportance au contrle des faits, qu la dcouverte des secrets ou des faits tonnants que les experts se transmettent dune gnration lautre. Il accueille avec une incroyable crdulit (la credulitas est pour lui la premire vertu de lexpert) les racontars de Pline lAncien sur le diamant attaqu par le sang de bouc (Pline 20, 1 ; 37, 15), sur lemploi des glandes de castor en mdecine (Pline 32, 13) et tant dautres faits controuvs quil emprunte lexprience des rustres et des vieilles femmes. A lexprience de la nature ainsi comprise correspond lexprience intrieure en matire de choses spirituelles, les illuminations reues par les patriarches et les prophtes ; elle aussi, son plus haut degr, elle est tout fait secrte : audessus des vertus, des dons du Saint-Esprit et de la paix du seigneur, il y a les ravissements et leurs diverses espces, qui, chacune sa manire, font voir bien des choses quil nest pas permis lhomme de dire .
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
470
Celui qui dtient ces secrets spirituels possde dailleurs par l mme les sciences humaines. La doctrine de Bacon, avec tous ses dfauts et par ses dfauts mmes, est un admirable tmoin de limpatience avec laquelle certains hommes du XIIIe sicle supportaient les cadres dans lesquels la philosophie des Parisiens voulait enfermer lhomme et lunivers. Ils ont le sentiment que la ralit vritable est p.699 en dehors de ces cadres, dans un abme de puissances merveilleuses, o quelques hommes rares, illumins dune sagesse suprieure, savent seuls se guider.
XIX. WITELO ET LES PERSPECTIVISTES
@ Dun esprit analogue viennent les travaux de Witelo, n en Pologne entre 1220 et 1230 et qui, rsidant en Italie, fut, en mme temps que saint Thomas, lami de lhellniste Guillaume de Moerbeke ; cest sur la demande de celui-ci quil crivit une Perspectiva, simple compilation des travaux dEuclide, dApollonius de Perge, et de lOptique de Ptolme, traduite en latin ds le XIIe sicle, mais surtout de lOptique de larabe Alhazen dont il traduit les remarquables considrations sur les perceptions visuelles acquises, base de toute la psychologie moderne de la perception. Il a de plus crit un trait De Intelligentiis o, suivant le livre Des causes, il tudie les trois hypostases noplatoniciennes ; la Cause premire ou lUn, lIntelligence et lme. Entre la mtaphysique noplatonicienne et la perspective, il y a chez lui la mme affinit que chez Robert Grosseteste. Le symbolisme lumineux pour marquer laction de lUn est sans doute appuy sur saint Augustin et lptre aux Romains ; mais il le dveloppe par des considrations de perspectiviste : la lumire est la fois un corps simple et par l mme capable de se multiplier ; au corps le plus simple est due la plus grande extension ; leau est due une plus grande extension qu la terre, lair quil nen est d leau, au feu qu lair . La lumire, qui est le plus subtil des corps, a donc la plus grande extension ; elle loge en elle les corps ; elle permet aux modles de se reflter dans la matire et elle est ainsi le principe de la connaissance. A cette mtaphysique noplatonicienne correspond un trait dj remarqu plusieurs fois qui loppose au p.700 thomisme : cest la prpondrance de lamour sur la connaissance : Dans le mme tre, lamour prcde naturellement la connaissance... ; et lamour est achev par la connaissance, non pas que la connaissance soit le complment de lamour, mais parce que, du fait de la connaissance, il se multiplie et vit en lui-mme... La connaissance nest pas la perfection de lamour ; mais plutt, tout au contraire, la connaissance sordonne par rapport la dlectation et lamour. Nous trouvons enfin en Dietrich de Freiberg, n vers 1250, matre de thologie Paris en 1297, et qui mourut aprs 1310, cette mme union des
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
471
tudes exprimentales, surtout de loptique, et de la mtaphysique noplatonicienne. Auteur dune thorie mathmatique de larc-en-ciel o il explique le phnomne par une double rfraction suivie dune rflexion sur les gouttes de pluie, il adhre, quoique appartenant lordre des Prcheurs, une philosophie augustinienne et noplatonicienne bien diffrente de la doctrine officielle de lordre. Suivant les lments de thologie de Proclus et la doctrine des trois hypostases, il accepte les images de la production des choses par manation et de leur conversion, bien quil les concilie avec la cration. Sil emprunte dautre part Aristote la notion de lintellect agent, cest pour lidentifier la partie cache de lesprit (abditum mentis), la profondeur de la mmoire (profunditas memoriae nostrae), image de Dieu, laquelle sont immdiatement prsentes sans recherche les rgles ternelles et limmuable vrit, tandis que labstraction relve seulement de la facult cogitative.
XX. RAYMOND LULLE
@ Luvre immense et encore incompltement tudie de R. Lulle est un tmoignage des proccupations qui dominent le XIIIe sicle finissant. Ses ouvrages, crits en catalan, mais p.701 traduits la plupart en latin, sont tous au service du mme but pratique, quil visa aussi par ses actes et par une propagande inlassable : tablir sur la terre entire la catholicit, considre comme identique la raison. N Majorque en 1235, il quitte en 1265 femme et enfants pour se donner tout sa mission : pendant neuf ans, il apprend Majorque la langue et la science des Arabes ; vers 1288, il propose aux papes un plan de croisade et de mission dans les pays des infidles. En 1298 et plus tard en 1310 et en 1311, il est Paris o il crit un grand nombre de traits (encore manuscrits) contre les averrostes. En 1311, il assiste au concile de Vienne et y demande que lon cre des enseignements de langues arabe et hbraque Rome et dans plusieurs universits pour prparer les missionnaires. Lui-mme partit Tunis pour convertir les infidles et il y mourut en 1315. Cet homme si ardemment dvou sa tche pratique, ce mystique dont lactivit eut pour point de dpart une vision et qui crivit des Dialogues et cantiques damour entre lami et laim, est lauteur de ce fameux Grand Art, qui a, conformment au dessein gnral de sa vie, un caractre pratique bien plus que thorique. Comme tous ceux qui, au Moyen ge, voulurent combattre les infidles ou les hrtiques, et selon la tradition du XIIe sicle tout entier, R. Lulle entend prouver les articles de foi par des raisons ncessaires . Cest au service de ce but quil met son Ars generalis ou ars magna, art de raisonner qui doit, dans son intention, tre assez populaire et facile daccs pour donner, mme aux gens du commun, les moyens de dfendre la foi : une religion universelle, appuye sur une mthode de penser galement universelle, voil lide que Lulle se fait de la catholicit.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
472
En quoi consiste ce grand art ? On se rappelle que la logique dAristote sachoppait deux problmes, qui taient lun et lautre des problmes techniques : en premier lieu la dcouverte de prmisses ncessaires ou principes qui pussent donner la p.702 conclusion du syllogisme un caractre dmonstratif et scientifique ; en second lieu, tant donn les termes extrmes, la dcouverte du moyen terme qui les unira. Ce sont ces deux problmes que le Grand Art se vante de rsoudre ; cet art nest pas proprement parler un art de raisonner mais un art de la dcouverte. Le titre mme de quelques-uns de ses traits le dit : De venatione medii inter subjectum et praedicatum, Ars compendiosa inveniendi veritatem, seu ars magna et major, ars inveniendi particularia in universalibus, quaestiones per artem demonstrativam seu inventivam solubiles, Ars inventiva veritatum. Chaque science a ses principes propres et diffrents des principes des autres sciences ; aussi lentendement requiert quil y ait une science gnrale avec des principes gnraux dans lesquels soient impliqus et contenus les principes des autres sciences particulires comme le particulier dans luniversel , tels sont les premiers mots de lArs magna generalis et ultima. Rappelons-nous la mthode quAristote avait indique pour dcouvrir le moyen terme permettant de rsoudre une question, cest--dire de savoir si un prdicat tait ou non vrai dun sujet donn : en cherchant, pour un sujet donn tous les prdicats possibles, pour un prdicat donn tous les sujets possibles, on arrivait ncessairement dcouvrir entre ce sujet et ce prdicat tous les moyens possibles. Le Grand Art est une gnralisation de ce procd. Lulle pense dabord dcouvrir tous les prdicats possibles dun sujet quelconque en numrant les attributs suivants : bonitas, magnitudo, aetertas ; potestas, sapientia, voluntas ; virtus, veritas, gloria ; diffrentia, concordia, contrarietas ; principium, medium finis ; majoritas, aequalitas, minoritas , dont les neuf premiers dsignent des attributs divins, et les neuf derniers des relations ; tout prdicat est, selon lui, rductible soit un de ces attributs, soit une combinaison de ces attributs, combinaison qui se fait selon certaines rgles. Dautre part, propos dun sujet, on p.703 peut se poser dix questions : sil est, ce quil est, de quoi il est fait, pourquoi il est, combien grand (quantum), quel (quale) il est, quand il est, o il est, avec quoi il est. Ces prliminaires suffisent pour montrer que le Grand Art ne pouvait parvenir dpasser le cercle de la logique dAristote : ce prtendu art dinvention nest quun art de classer et de combiner des concepts donns, non pas du tout de les dcouvrir. Il semble parfois que Lulle confond lordre avec linvention : il donne par exemple lartiste qui traite de la physique, le conseil dappliquer successivement le concept sur lequel il est en doute (celui de la nature) aux dix rgles , cest--dire de se poser son propos les dix questions ci-dessus, et il ajoute (fol. 78 b) : Comme un cristal plac en une couleur rouge se dispose relativement cette couleur et de mme dans une couleur verte, ainsi, quand un terme inconnu est promen (discurritur) travers les rgles et les espces des rgles, ce terme inconnu est color ou
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
473
clairci par les rgles dans lesquelles on le place , claircissement, on le voit, purement formel, qui consiste savoir ce que lon doit demander dune chose, qui permet de chercher la chose sous divers aspects, mais qui ne sera jamais suffisant pour dcouvrir les rponses. Tels sont les courants de la pense au XIIIe sicle. On aura remarqu un trait commun ces penses si diverses : ce nest pas en vain que la priode que nous tudions a t inaugure par Innocent III, qui dfendit, plus quaucun pape, la primaut du spirituel, et que les rguliers, dpendant immdiatement du pape, ont pris dans les universits une place considrable. Partout on rve dorganisation hirarchique et dunit spirituelle : les systmes que nous avons dcrits, viennent du mme esprit qui a produit les croisades : tendre partout la catholicit. On projette dans la ralit mtaphysique cette unit spirituelle, et tout le monde, sans exception, accepte que la mtaphysique noplatonicienne (facilement conciliable avec lide de la cration), avec son unit et sa hirarchie, p.704 reprsente exactement cette ralit. On construit une politique idale o le pouvoir temporel est ou bien absorb par le pouvoir spirituel, ou bien subordonn ce pouvoir ; si, pour certains, la raison et la cit terrestre sont autonomes, cest de la manire dont on peut appeler autonome une fonction dont les limites ont t prcisment marques par un pouvoir suprieur. Or, cette aspiration lunit aboutit un complet chec : au XIVe sicle, tandis que, dans les affres de la guerre de Cent Ans, nat lide de nationalit qui va carter pour toujours lide dune unit politique de la chrtient, la reprsentation de lunivers se disloque. Nest-il pas vrai dailleurs que les lments que les penseurs dit XIIIe sicle avaient reus dans leur construction travaillaient sourdement la miner ? Platonisme, aristotlisme, exprience, mathmatiques, traditions antiques, toutes ces forces qui nous ont apparu momentanment participant la construction dun systme de pense chrtienne vont se faire voir maintenant sous leur vritable jour comme des forces compltement indpendantes de la croyance chrtienne une destine surnaturelle. Bibliographie @
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
474
CHAPITRE VI LE XIVe SICLE
I. DUNS SCOT
@ Le premier symptme de cette dsagrgation se trouve dans le mouvement dides inaugur par Duns Scot, le docteur subtil. Il eut une carrire fort courte : n en Angleterre avant 1270, il reut lenseignement dOxford, dont il recueillit le got traditionnel pour les mathmatiques, considres comme donnant le type de la certitude ; il enseigna Paris partir de 1305 et y mourut en 1308. Il crivit en Angleterre ses commentaires sur Aristote et des Questions sur les sentences de P. Lombard (linauthenticit du De Rerum principio, quon attribuait cette priode parat prouve), Paris les Reportata parisiensia et les Collationes : il dmontra la supriorit religieuse des moines mendiants sur les rguliers dans le De perfectione statuum.
p.708
Duns Scot ne rentre dans aucun des courants que nous avons suivis : ceux qui en font un augustinien, lon doit objecter la critique trs vive quil fait des thories les plus chres lcole : celle de la connaissance intellectuelle comme illumination, celle des raisons sminales contenues dans la matire et des connaissances innes contenues dans lme. Mais il est encore moins thomiste : ses doctrines les plus clbres, lexistence actuelle de la matire, lindividuation par la forme (haeccit), la priorit de la volont, sont en opposition consciente et voulue avec celles de saint Thomas. Un des traits essentiels qui le distingue et lisole, cest laffirmation sans rticence de ce que lon pourrait appeler le caractre historique de la vision chrtienne de lunivers : cration, incarnation, imputation des mrites du Christ, ce sont, de la part de Dieu, des actes libres au sens le plus plein du mot, cest--dire qui auraient pu ne pas avoir lieu et qui dpendent dune initiative de Dieu qui na dautre raison que sa propre volont. Le credo ut intelligam de saint Anselme, leffort pour scruter les motifs de Dieu sont loppos direct de ce nouvel esprit. Et cest pourquoi il a singulirement allong la liste des purs objets de foi, des credibilia, qui sont dautant plus certains pour les catholiques quils ne sappuient pas sur notre entendement aveugle et souvent vacillant, mais trouvent un soutien ferme dans la plus solide des vrits : toute-puissance, incommensurabilit, infinit, vie, volont, toute prsence, vrit, justice, providence, cest--dire presque tous les attributs divins que saint Thomas dduisait de la notion de Dieu comme
p.709
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
475
cause du monde, sont pour Duns Scot des objets de foi. Il admet sans doute pourtant une preuve rationnelle de lexistence de Dieu, la preuve a contingentia mundi qui nous force passer de ltre changeant dont nous avons lexprience ltre ncessaire qui a en lui sa raison dtre. Cette preuve ne saurait partir, comme le veut saint Anselme, de la notion de ltre le plus grand que lon puisse penser ; car cette notion qui nest point une ide simple et inne a t forme par nous en partant des tres finis, et il faudrait dabord montrer quelle nest pas contradictoire. On pourrait rsumer ces vues en disant que toute trace de lesprit noplatonicien, cest--dire daffirmation de la continuit et de la hirarchie entre les formes du rel, a presque disparu chez Duns Scot. Si laugustinisme affirmait continuit dans ltre donc continuit dans la connaissance, et le thomisme continuit dans ltre mais discontinuit dans la connaissance, le scotisme pourrait avoir pour formule : discontinuit dans p.710 ltre et discontinuit dans la connaissance 1. Duns Scot emploie en effet tous les concepts que nous avons vu simposer au XIIIe sicle : intellect possible et intellect agent, matire et forme, universel et individuel, volont et entendement ; mais tandis que, chez les penseurs prcdents, ces concepts sappelaient, se liaient, se hirarchisaient, sorganisaient, le but de Duns Scot parat tre dy faire voir des termes indpendants dont chacun part a une ralit pleine et suffisante, qui sajoutent sans doute, mais sans sexiger. Duns Scot parat dailleurs abandonner le principe danalogie universelle qui, chez Bonaventure et mme chez saint Thomas, tait le grand moteur de la continuit. En dclarant que ltre a un sens univoque et non pas quivoque au regard de Dieu et des cratures (cest--dire quil signifie la mme chose), il enlve tout fondement au rapport danalogie qui permet de passer dun terme (la crature), tre au sens driv, un autre, Dieu qui est tre en un plus noble sens ; car la crature et Dieu se rapportent au mme titre et de la mme faon la notion dtre, qui ne donne ainsi aucun moyen de les distinguer en les rapprochant. Ce discontinuisme se marque dabord par la thorie de la matire : elle est hostile la fois laugustinisme et au thomisme ; laugustinisme parce que Duns Scot nie lexistence dune raison sminale au sein de la matire ; au thomisme parce quil nie le principe pripatticien quil ny a aucune puissance qui puisse faire que la matire existe sans la forme ; il nie en un mot ce quil y a de commun deux thories par ailleurs si opposes, savoir le lien entre matire et forme qui fait que, dans la premire, la matire contient un principe interne qui la fait aspirer la forme et que, dans la seconde, la matire na dexistence que relative la forme qui lactualise 2. p.711 Duns Scot pense (comme Henri de Gand) que la matire, puisquelle a une ide distincte,
1
On ne trouve laffirmation de la continuit des formes que dans le De Rerum principio, dont lauthenticit est douteuse. 2 In II Sententiarum, dist. XII, d. Wadding, VI, p. 664-699.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
476
est quelque chose dactuel par soi ; il nest pas arrt par cette objection dAristote que, sil en est ainsi, le compos de matire et de forme est fait de deux tres en acte qui sajoutent et quil na plus dunit. La thorie de lhaeccit de Duns Scot rsout le problme de lindividuation dans un sens videmment contraire au thomisme ; mais elle nest pas moins dfavorable laugustinisme. On sait que, le tableau des genres et des espces tant trac jusquaux espces infrieures ou spcialissimes, le pripattisme refusait de trouver quoi que ce soit dintelligible dans les individus o se distribuait la forme spcifique, attribuant cette division purement numrique la matire, ladjonction des accidents la forme spcifique. On se rappelle dautre part que laugustinisme, voyant dans lme individuelle le sujet de la destine surnaturelle, confrant dailleurs lme une connaissance de soi par soi qui la rend, quoique singulire, intelligible elle-mme, rpudiait, au nom de la foi, la thorie de lindividuation par la matire. Et il reste bien, chez le franciscain Duns Scot, quelque chose de cet esprit augustinien : admettre la thse thomiste, croire que la nature ou forme spcifique reste la mme dans tous les individus dune mme espce, cest en revenir au maudit Averros 1 ; cest croire que la nature humaine, delle-mme indivise, se divise seulement par la quantit comme de leau homogne quon distribuerait en diffrents vases. Mais la doctrine de Duns Scot vise un rsultat bien plus gnral : il veut donner lindividu comme tel une intelligibilit analogue celle que le pripattisme donne lespce, cest--dire une dtermination par des caractres positifs et essentiels et non plus par des caractres ngatifs et accidentels ; la socratit est quelque chose de positif, mme avant lexistence de Socrate dans la matire, et elle persiste, p.712 quels que puissent tre les changements de quantit et daccidents dans le Socrate rel. Cest lunit de lindividu, unit admise par tous qui, pour Duns Scot, exige une entit dtermine qui est lhaeccit : la forme spcifique (quinit) ninclut pas cette entit, la matire laquelle elle se lie (la structure corporelle commune tous les corps de chevaux) non plus ; il faut donc la chercher en dehors de la forme, de la matire et par consquent de leur compos, dans une ralit ultime. Mais il faut faire attention que le passage de lespce aux individus ne sopre pas comme celui du genre aux espces 2 : dans le passage du genre aux espces, le genre est la diffrence comme un tre en puissance est une forme qui le dtermine, et cest pourquoi genre et diffrence sunissent en une ralit unique. Lespce spcialissime au contraire est entirement dfinie : elle nexige point, pour se complter, lindividualit ; il sensuit que dans un seul et mme tre individuel (ce cheval) lentit singulire (haeccit de ce cheval) et lentit spcifique restent des ralits formellement distinctes . Cest dire que lindividualit sajoute simplement en fait lespce, sans quil y ait aucun lien de continuit intelligible de lun lautre. Trait important qui
1 2
Tome VI, p. 405. Tome VI, p. 413.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
477
se manifeste dans la critique que Duns Scot fait de la connaissance anglique daprs saint Thomas ; celui-ci pense, selon la tradition noplatonicienne, que les anges connaissent les choses singulires non pas comme nous, mais parce quils possdent un intellect, suprieur au ntre, o la connaissance des singuliers est contenue en celle des universaux : continuit tout jamais impossible pour Duns Scot. Comme il fait de la matire une ralit actuelle mme sans la forme, de lindividu une ralit positive distincte de lespce, Duns Scot donne lintellect possible une activit qui est, en une certaine mesure, autonome, vis--vis de lintellect agent : p.713 le rle propre de lintellect agent est de sparer la forme spcifique de limage sensible o elle est en puissance ; mais celui de lintellect possible est lacte de comprendre, et de cet acte il est cause totale ; lespce intelligible, produit de labstraction, est requise non pour produire lacte de comprendre, qui drive de lintellect possible seul, mais pour dterminer cet acte tel ou tel objet 1. Encore croit-il que la distinction des actes est seulement rendue manifeste par celle des objets, bien que, en elle-mme, elle dcoule de la puissance intellectuelle toute seule. On voit aussi quel point cette thorie carte Duns Scot de lilluminisme augustinien ; la thse dHenri de Gand, que les objets sensibles ne peuvent clairer lme et quil y faut un rayon divin, il rplique en citant la certitude des premiers principes qui sont apprhends avec vidence, ds que les termes le sont, la certitude par exprience, enfin la certitude intrieure des faits de conscience, autant dexemples de certitudes directes et autonomes. Cest dans le mme esprit quil affirme dune manire si contraire au thomisme le primat de la volont sur lentendement. Bien loin que la volont suive le bien connu par lentendement, elle commande lentendement , en le dirigeant la considration de tel ou tel objet ; lentendement, sil est cause de la volition, est donc une cause asservie la volont . Ce que vise Duns Scot, ce nest pas de substituer au thomisme la vue augustinienne qui fait de lamour plutt que de la connaissance le but final des choses, cest daffranchir la volont de lentendement, comme il a affranchi la matire de la forme, lindividu de lespce, lintellect de lillumination divine : car ces considrations aboutissent avant tout dclarer que la volont est entirement libre : Rien autre que la volont nest cause totale de la volition dans la volont. Ce sont ces vues psychologiques que Duns Scot transporte p.714 dans la thologie. Nul asservissement, chez Dieu non plus, de sa volont un bien conu par son entendement. Sans doute, les possibles que Dieu conoit par son entendement ne sont nullement des crations de sa volont, et on ne peut trouver chez Duns Scot une thorie du primat de la volont et de la cration des vrits ternelles. La volont ne peut vouloir limpossible et le contradictoire. Seulement les possibles quil conoit par son entendement ne
1
Tome III, p. 362 et 365.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
478
donnent aucune rgle sa volont cratrice : De ce que sa volont a voulu telle chose, il ny a aucune cause sinon que la volont est la volont. Aussi la volont ne dpend pas de la rgle du bien ; mais inversement la volont est la premire rgle, et nulle rgle nest droite sinon en tant quelle est accepte par la volont divine . Thse qui a des consquences importantes sur lesprit de la morale scotiste. Les prceptes moraux qui nous font connatre le bien, dpendent dune loi divine ; mais ce bien vient seulement de ce quils ont t voulus par Dieu ; et, comme cette volont est arbitraire, on peut concevoir que Dieu et pu donner des commandements autres que ceux qui sont au Dcalogue. Cet arbitraire, cette discontinuit radicale que Duns Scot introduit jusque dans la ralit divine, commandent sa conception de la politique : mlange intime datomisme social et dautoritarisme sans frein qui reflte dans la socit la vision de lunivers que nous venons dexposer : les hommes sont dabord tous gaux ; mais ils ont, de plein gr, sacrifi leur indpendance une autorit quils se sont donne eux-mmes pour limiter les dangers que leur gosme leur faisait courir lun lautre ; cette autorit est ds lors toute-puissante et sans contrepoids ; le chef institue, distribue et rvoque son gr les proprits ; il ny a dautres lois que les lois positives institues par lui ; il na dautres devoirs que les devoirs envers Dieu, et, parmi ces devoirs, la conversion par force des Juifs (que Duns Scot voit perscuts et bannis autour de lui, au dbut du XIIIe sicle, p.715 par cette monarchie captienne qui rclamait pour elle cet imperium que lui accorde la thorie du Franciscain) 1. Ce volontarisme de Duns Scot trouve son expression la plus complte chez un oxfordien du XIVe sicle, Thomas Bradwardine qui, n avant 1290, mourut archevque de Canterbury en 1349. Mathmaticien et gotant comme tel la preuve anselmienne de lexistence de Dieu quil veut seulement complter en dmontrant que le concept de ltre souverainement parfait nimplique pas contradiction, il fut surtout lantiplagien qui en arrivait presque nier toute autre causalit que la causalit divine ; non seulement il ny a pas pour lui de raison ni de loi ncessaire en Dieu antrieurement sa volont , mais encore la volont divine est la cause efficiente de toute chose quelle quelle soit, cause motrice de tout mouvement , et lacte le plus libre que lhomme puisse faire, cest Dieu qui le ncessite. Cette thorie du serf arbitre, si sche, si loigne du mysticisme, puisque, loin dunir lhomme Dieu par la mditation et lamour, il len fait dpendre dune dpendance extrieure comme un serf dpend de son matre ( Lhomme est serf de Dieu, serf spontan, dis-je et non contraint ), se rpandit au XIVe sicle ; elle est reprsente luniversit de Paris par le cistercien Jean de Mirecourt qui vit, en 1347, condamner quarante de ses thses, parmi lesquelles celles qui disaient que Dieu veut que quelquun
1
Cf. B. LANDRY, Duns Scot, p. 233-245.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
479
pche et quil soit pcheur, quil veut, en voulant son bien, quil soit pcheur, quil est cause du pch comme pch, du mal de coulpe comme mal de coulpe, auteur du pch comme pch. Dterminisme thologique qui, par langlais Jean de Wiclef, influa sur Luther. Le scotisme qui, au XIVe sicle et au XVe sicle, compta tant de commentateurs et mme de chaires destines lenseigner dans les principales universits de lEurope, est donc un des gnrateurs de lesprit nouveau.
II. LES UNIVEIISITS AUX XIVe ET XVe SICLES
@ Il est difficile dexagrer le rle social des Universits au XIVe et au dbut du XVe sicle ; au XVe sicle, la pragmatique sanction, confirme encore par une ordonnance de Louis XII en 1499, rservait aux gradus des Universits de grands avantages dans la collation des bnfices ; de longues tudes universitaires (trois annes de thologie et de droit canon), taient une condition indispensable pour tre nomm cur dans les paroisses des villes. Nul milieu plus libre dailleurs que ces Universits : Oracle de lesprit et guide de lopinion europenne, puissance la plus redoutable rige en face des pouvoirs lgaux. Aucun corps na t plus libre, aucune organisation plus dmocratique. Des Assembles de compagnies, facults ou nations, et des assembles gnrales ; le droit de statuer sur toutes les affaires, administration, enseignement, justice ; dans quelques-unes mme... une reprsentation accorde aux tudiants... ; des matres se recrutant eux-mmes ; des pouvoirs lus, et pour un temps court (recteur et procureur pour trois, quatre ou six mois, un an tout au plus)... ; contre lingrence du pouvoir central ou des pouvoirs locaux, larmure solide de privilges incontests ; exemption fiscale, droit dtre jug par ses pairs, et, pour rendre ces garanties efficaces, le pouvoir de suspendre ses cours..., telle est la charte que la faveur des papes et des rois a reconnue et consacre. 1
p.716
Cette floraison des universits stend jusquau milieu du XVe sicle, o diverses circonstances leur enlvent force et influence au profit du pouvoir central, o la spculation est abandonne, o la prparation aux grades devient lunique affaire : alors les universits cessent pour longtemps dtre les centres actifs quelles taient, et nous verrons la vie spirituelle continuer dans des conditions nouvelles. Mais aux XIVe et XVe sicles, cette indpendance se manifeste p.717 par des spculations hardies et nouvelles qui se rattachent, bien plutt qu la tradition du XIIIe sicle, celle du XIIe sicle. Toute lpoque est domine par le conflit des antiqui et des moderni. Or les anciens, ce sont en ralit les novateurs du XIIIe sicle, tout emptrs dans les discussions qui sont nes des
1
IMBART DE LA TOUR, Les Origines de la Rforme, I, p. 347, p. 527 sq.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
480
concepts venus dAristote et de ses commentateurs arabes, forme et matire, principe dindividuation, intellect agent et intellect possible, espces intelligibles et sensibles, intelligences motrices des cieux ; les modernes ce sont ceux qui, loin de donner une solution pour ou contre ces questions, les rejettent comme des non-sens ; ils en reviennent, en revanche, la vision de lunivers, libre et dgage, que nous avions vu sbaucher aux XIe et XIIe sicles : nominalisme de Roscelin et dAblard, atomisme de Guillaume de Conches. On ne cherche plus ni rationaliser la foi, comme saint Anselme, ni illuminer la raison, comme saint Bonaventure, ni lui prescrire les limites de son domaine, comme saint Thomas : la spculation philosophique se droule, autonome et libre. Au milieu de quelles agitations, on le sait : rien ne tient plus dans la vieille chrtient : le pouvoir de lEmpereur ananti par la dissociation de lempire en plus de trois cents principauts qui minent le pouvoir central : Comme les princes dvorent lEmpire, le peuple dvorera les princes , prdisait en 1433 Nicolas de Cuse 1. Le pouvoir des papes ny gagne pas ; il est dchir par le grand schisme (1348), qui a pour issue le Concile de Constance (1414-1418) et le Concile de Ble (1433) qui ne font lun et lautre que rendre plus aigu le conflit entre les conciliaires, partisans de la suprmatie du Concile sur le pape, considrant le pape comme un administrateur de lglise, et les ultramontains affirmant la puissance illimite du pape. Dans cette dcadence des pouvoirs traditionnels, les royauts nationales prennent une vigueur incomparable. A ces conflits, qui mettent en jeu tant dintrts pratiques et qui forcent rflchir sur tant de conceptions juridiques, les matres du XIVe et du XVe sicles prennent une part active, et ils sont presque tous des juristes et des politiques en mme temps que des philosophes. Le grand initiateur du nominalisme, Guillaume dOccam, est aussi un opposant au pape Jean XXII ; excommuni en 1328, il est reu la cour de lempereur Louis de Bavire, o il trouva dj Jean de Jandun, un autre ennemi du pape, qui avait soutenu en son Defensor Pacis que seule, luniversalit des citoyens tait le lgislateur humain et qui avait t excommuni en 1327 ; Guillaume y crivit pendant plus de vingt ans des pamphlets contre le pape, tels que le Compendium errorum papae Johannis XXII, et un vaste ouvrage de politique, le Dialogus inter magistrum et discipulum de imperatorum et pontificum potestate. Un autre nominaliste, Durand de Saint Pourain, est lauteur dun De jurisdictione ecclesiastica et de legibus. Le grand schisme est loccasion, de la part du mathmaticien et de lastronome Henri de Hainbuch, de nombreux ouvrages sur les conditions de la paix dans lglise, crits aprs 1378 ; mais le mme est lauteur dcrits conomiques et politiques. Au XVe sicle, on voit le cardinal Pierre dAilly soutenir au concile de Ble le parti des conciliaires, tandis que, au concile de Constance, Nicolas de Cuse passe au parti du pape et, devenu cardinal, prend une part prpondrante toutes les affaires
p.718 1
Cit par VANSTEENBERGHE, Nicolas de Cuse, p. 47.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
481
ecclsiastiques de son temps, la rforme intrieure du clerg en Allemagne, la prdication contre les Hussites, la prparation dune croisade contre les Turcs en 1454.
III. LES DBUTS DU NOMINALISME
@ Nous avons donc devant nous, aux XIVe et XVe sicles, une gnration dhommes lesprit froid et sobre, qui ont perdu lenthousiasme religieux qui animait les gnrations des grandes p.719 croisades, et qui ont acquis, dans la diplomatie complique quexige cette poque la moindre affaire, cet esprit net et positif qui caractrise leur doctrine. Car nous voyons alors tomber, sous les coups des nominalistes, toute cette machinerie mtaphysique que nous avons vu slever au XIIIe sicle. Le nominalisme de cette poque est tout autre chose quune solution particulire du problme spcial des universaux : cest un esprit nouveau qui dclare fictives toutes ces ralits mtaphysiques que croyaient avoir dcouvertes les pripatticiens et les platoniciens, qui se tient aussi prs que possible de lexprience et qui rejette dans le domaine de la foi pure, inaccessible toute communication avec la raison, les affirmations de la religion. Le premier des nominalistes, le dominicain Durand de Saint-Pourain (en Auvergne) mort en 1334 vque de Meaux, naccepte lautorit daucun docteur si clbre ou solennel quil soit . Et il dclare fictives les espces sensibles et intelligibles, que saint Thomas disait ncessaires, mais que personne na jamais vues ; fiction, lintellect agent, dont lopration dabstraction, bien comprise, ne ncessite nullement lexistence ; il est ncessaire sans doute lorsque lon prend luniversel pour la forme spcifique, qui est la ralit foncire des choses ; cette ralit, ntant pas donne dans les images sensibles, doit tre saisie par une opration suprieure ; il en est tout autrement si luniversel ne nat que dune certaine manire de considrer limage sensible en ne tenant pas compte de ce quil y a dindividuel en elle ; luniversel ne prexiste pas cette considration, il diffre de lindividu comme lindtermin du dtermin. Faux problme par consquent, le problme de lindividuation qui suppose que lespce existe avant lindividu, puisque lon demande ce qui lindividualise ; or rien nexiste que lindividuel, qui est le premier objet de notre connaissance. De mme le franciscain Pierre Auriol qui, aprs avoir t p.720 matre de thologie Paris en 1318 mourut Avignon, en 1322, la cour du pape Jean XXII, dont il tait le protg, montre un nominalisme dcid dans son Commentaire sur les sentences. La connaissance de luniversel ne va pas plus profondment que celle de lindividuel ; au contraire il est plus noble de connatre une ralit individuelle et dsigne (demonstratam) que de la
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
482
connatre de manire abstraite et universelle 1. On comprendra mieux cette formule en suivant lanalyse de la connaissance que tente Pierre Auriol : les choses produisent dans lintellect des impressions qui peuvent tre diffrentes en force et en prcision ; en suite de quoi il se produit dans lintellect une apparence que Pierre appelle aussi un tre intentionnel (esse intentionale), un reflet (forma specularis), un concept ou une conception, une apparence objective, tous mots synonymes qui dsignent, non pas comme la species du thomisme, lintermdiaire travers lequel lme connat la chose, mais lobjet propre de la connaissance ; ajoutons mme que cette apparence nest pas du tout pour lui comme une image de la chose ayant une ralit distincte de ce quelle reprsente ; cest la chose elle-mme, prsente en lesprit, mais en ce quelle a dactuellement visible par lui. Ds lors, on dit quil y a connaissance du genre, lorsque la conception est tout fait imparfaite et indistincte, connaissance de lespce lorsquelle devient plus parfaite et plus distincte. Le progrs de la connaissance va donc de luniversel au singulier, ce qui veut dire du confus au clair et au distinct.
IV. GUILLAUME DOCCAM
@ Le plus grand des nominalistes, celui qui dduisit toutes les consquences de la thorie, est le franciscain anglais Guillaume p.721 dOccam, qui fut tudiant Oxford (1300-1347). Il tait nomm aux XIVe et XVe sicles le vnrable initiateur (venerabilis inceptor) du nominalisme, le monarque ou porte-tendard (antesignanus) des nominaux, et lon appelait indiffremment ses partisans nominaux (nominales), terministes ou conceptistes. Les arguments de Guillaume contre lexistence des universaux ne sont pas nouveaux ; ce sont ceux, qui dj employs aux XIe et XIIe sicles, remontent par Boce la discussion que fit Aristote des ides de Platon : luniversel tant suppos existant en soi, il sera un individu, ce qui est contradictoire : dautre part, poser luniversel pour expliquer le singulier, cest non pas expliquer mais doubler les tres (application du clbre principe dconomie quemployait dj Pierre Auriol et que Guillaume nonce ainsi : nunquam ponenda est pluralitas sine necessitate) ; enfin, mettre luniversel dans les choses singulires, do lesprit le tirerait par abstraction, cest aussi le rendre individuel. Pourtant Guillaume, en cela encore trs fidle Boce et tous les commentateurs antiques des Catgories, ne place pas plus les universaux dans les mots eux-mmes que dans les choses, mais soit dans les significations dun mot (intentio anim, conceptus anim, passio anim) soit dans les mots en tant quils signifient quelque chose : au second sens, ils sont conventionnels
1
Tome I, 816 b.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
483
puisque les mots sont dinstitution humaine ; mais au premier sens, ce sont des universaux naturels (universalia naturalia). En dsignant les universaux comme des signes ou significations, Guillaume, comme dailleurs Ablard lavait fait, a transpos la question de la nature des universaux en celle de leur usage dans la connaissance ; cet usage, qui fait tout leur tre, est de remplacer dans la proposition les choses mmes quils dsignent (supponere pro ipsis rebus) : loin dtre une fiction, comme une chimre, ce sont des images qui p.722 reprsenteront indiffremment lune quelconque des choses singulires contenues dans leur extension, et pourront les remplacer comme le signe remplace la chose signifie. Il faut seulement ne jamais perdre de vue cette rfrence aux choses ; il faut se rappeler que luniversel nest jamais quun prdicat qui peut se dire de plusieurs choses, quil nest donc pas une chose, en vertu de laxiome : res de re non praedicatur. La connaissance primitive est donc pour Guillaume lintuition des choses singulires, acte apprhensif qui, la manire de la comprhension stocienne, inclut toujours un jugement dexistence ; cette intuition est ou bien extrieure, et elle atteint les choses sensibles, ou bien intrieure, et alors notre intellect connat en particulier et intuitivement certains intelligibles qui ne tombent aucunement sous le sens, tels que les intellections, lacte de volont, la joie, la tristesse et choses de ce genre que lhomme peut exprimenter tre en lui 1. Lopposition du sensible lintelligible persiste donc pour ce nominaliste ; mais elle nest plus du tout celle du concret labstrait, ni celle des donnes des sens aux ralits mtaphysiques qui en sont lorigine ou le modle ; elle est lopposition de deux expriences, lexprience externe et lexprience interne. Il sensuit quelle ne donne plus aucun motif pour complter les donnes de lexprience par une ralit mtaphysique laquelle elles auraient se rapporter ; cest ainsi que nous ignorons entirement par la raison et par lexprience si notre me est une forme incorruptible et immatrielle, si lacte de comprendre implique une telle forme, si lme ainsi comprise est la forme du corps 2. Au contraire lopposition de la sensibilit la raison porterait Occam, contrairement saint Thomas, sparer, comme la fait Aristote, lintellect de lme sensible, et leur ajouter une troisime forme, la forma corporeitatis. Dieu et ses attributs ne sont pas davantage p.723 connus ; comme Dieu ne nous est pas connu intuitivement, nous nous efforons den composer une ide ; mais ce nest pas avec cette ide, faite de traits emprunts aux choses de notre exprience, que nous pourrons, comme le voulait saint Anselme, passer son existence ; ce nest pas, non plus, comme saint Thomas, en remontant des effets la cause ; le principe de cette dmonstration : Tout ce qui est m est m par autre chose , nest lui-mme ni vident ni dmontr (et nous verrons bientt
1 2
In Sententias, Prolegomena, qu. 1. Quodlibet I, quaest. 10.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
484
quelles attaques il a subies de la part des occamistes) ; lautre principe, quil faut sarrter en remontant dans la srie des causes, une cause premire, est probable, mais ne peut tre strictement prouv. A plus forte raison, lunit de Dieu, son infinit, la trinit des personnes sont de purs articles de foi. Une foi aussi compltement extrieure et impermable la raison, amne considrer comme arbitraires autant quobligatoires les prceptes moraux qui viennent de Dieu : les commandements du Dcalogue sont de purs actes de la volont de Dieu, qui nous devons obissance sans avoir dautres raisons que cette volont. Dieu nest oblig aucun acte ; cest donc ce quil veut quil est juste de faire.
V. LES NOMINALISTES PARISIENS DU XIVe SICLE : LA CRITIQUE DU PRIPATTISME
@ Les thories dOccam furent interdites la facult des arts de lUniversit de Paris en 1339 et en 1340 ; plus dun sicle aprs, en 1473, un dit du roi Louis XI interdit nouveau loccamisme, et les matres doivent sengager par serment enseigner le ralisme. Entre ces deux dates, tandis que la science dOxford languit, il sest produit lUniversit de Paris ce mouvement nominaliste, si important pour lhistoire des sciences et de la philosophie, que P. Duhem est le premier p.724 avoir bien tudi et avoir estim sa juste valeur. Le pape Clment VI, en 1346, ne voyait pas sans inquitude les matres s arts se tourner vers ces doctrines sophistiques 1. On sait dj quil condamna lanne suivante les thses du cistercien Jean de Mirecourt qui, inspir par Duns Scot, dclarait que Dieu est la seule cause et, avec Occam, que la haine du prochain nest dmritoire que parce quelle est dfendue par Dieu. En 1346, il condamna les thses dun autre matre, un matre s arts, Nicolas dAutrecourt, qui dut les abjurer publiquement lanne suivante devant lUniversit rassemble. Une physique corpusculaire o tout changement se rduit un mouvement local, un monde o la seule cause efficace est Dieu et o lon nie toute causalit naturelle, telle est limage simple de lunivers que Nicolas proposait pour remplacer la physique et la mtaphysique aristotliciennes qui, son avis, ne contenaient pas une seule dmonstration et que lon devrait bien abandonner pour tudier son thique et sa Politique. Et cette ngation, il la dmontre en attaquant les deux grandes notions quutilisent la physique et la mtaphysique, savoir celle de causalit et celle de substance. La mthode de ces critiques, quon a compares celles de Hume, mais quon doit rapprocher surtout des tropes sur les causes de Sextus
1
Chartularium Universitatis parisiensis, II, 1, p. 588.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
485
Empiricus, dont les Hypotyposes taient connues depuis la traduction de Guillaume de Moerbeke, consiste essentiellement appliquer comme critre de vrit le principe de contradiction, tel quil se trouve nonc dans la mtaphysique. Ds lors, il montrera aisment que de ce quune chose est connue comme existence, il ne peut tre infr avec vidence (dune vidence rductible au premier principe ou la certitude du premier principe) quune autre chose existe . De ce que la flamme sapproche de ltoupe, on ne peut en conclure avec vidence p.725 quelle sera brle. Je puis conclure seulement avec probabilit, de ce que ma main sest rchauffe en lapprochant du feu, quelle se rchauffera dans les mmes conditions. Une pareille critique tait leffondrement de la physique pripatticienne, qui tenait le lien de causalit comme parent du lien didentit (toute causalit tant en principe la production du semblable par le semblable) et qui assurait ainsi lunit du devenir, lunit du monde et par elle le monothisme, tandis que, chez Nicolas, le devenir devient une succession de moments sans liaison. La mme critique sexerce sur la notion de substance ; la substance quAristote pose comme sujet des apparences donnes par les sens nest connue ni intuitivement (puisque tous la connatraient) ni par raisonnement discursif puisque les apparences sont une chose et la substance une autre chose, et quil nest pas permis de conclure dune chose une autre chose. Il suit de l que je ne suis certain avec vidence que des objets (objectis) de mes sens et que de mes actes . Parmi les Impossibilia dont Siger de Brabant offrait, par jeu logique, de fournir la dmonstration, se trouvait la proposition suivante : Tout ce qui nous apparat nest que simulacre et songe, si bien que nous ne sommes certains de lexistence daucune chose 1. Et Siger sappuyait sur largument suivant : ce sont pas les sens, qui nous donnent les apparences, mais cest une autre facult qui peut seule juger si ces apparences sont vraies. Nicolas ne fait que complter largument en montrant que le principe de contradiction ne peut servir passer des apparences la ralit. Et il sattaque de mme la notion de facults de lme, affirmant que lon na pas le droit de conclure de lacte de volont lexistence de la volont.
VI. LES NOMINALISTES PARISIENS ET LA DYNAMIQUE DARISTOTE
@ Voil donc le monde dAristote mis en pices : il restait attaquer ce qui fait le fond mme de son systme, savoir sa dynamique. Le principe de cette dynamique, rappelons-le, tait : Tout ce qui est m est m par autre chose ; il faut entendre ce principe en ce sens que, non seulement son moment initial, mais chacun de ses moments successifs, le mouvement est
p.726 1
dition Mandonnet, II, p. 77.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
486
produit par un moteur qui contient en acte ce qui, dans le mobile, est en train de se raliser. De l deux thories des plus singulires que nous avons prcdemment exposes : celle du mouvement des projectiles qui ne peut se continuer que grce une pousse incessamment renouvele, celle du mouvement des cieux qui nest possible que grce des intelligences motrices ternellement existantes. Or cette thorie des intelligences motrices des cieux avait t lie par les Arabes et par les philosophes du XIIIe une conception thologique de lunivers laquelle elle offrait un appui indispensable : la hirarchie anglique de Denys lAropagite se ralisait en ces intelligences spares sur la nature desquelles on spculait tant. Ajoutons que ce principe dynamique servait aussi de soutien au thomisme, puisquil tait la majeure de sa premire preuve de lexistence de Dieu. On voit donc quels puissants intrts sattachaient ce principe ; or cest lui qui est attaqu par les nominalistes parisiens qui font ainsi place nette pour le dveloppement de la physique moderne, fondent la mcanique, remplacent la mythologie des intelligences motrices par une mcanique cleste qui a des principes identiques ceux de la mcanique terrestre, et en mme temps rompent le lien de continuit que lancienne dynamique tablissait entre la thorie physique des choses et la structure mtaphysique de lunivers. Cest dabord Jean Buridan, n Bthune vers lanne 1300, qui fut recteur de lUniversit de Paris vers 1348 et mourut peu aprs 1358. Il introduit la notion dimpetus (lan), quil faut comprendre comme loppos mme du principe de la physique dAristote. Lide en est emprunte ce mouvement des projectiles qui tait la croix de la physique dAristote : si lon jette une pierre en lair, le moteur communique au mobile une certaine puissance qui le rend capable de continuer se mouvoir de lui-mme dans la mme direction ; cet lan (impetus) est dautant plus puissant que la vitesse avec laquelle la pierre est mue est plus grande ; et le mouvement durerait indfiniment sil ntait affaibli par la rsistance de lair et la pesanteur. Mais, si nous supposons des circonstances dans lesquelles cet affaiblissement nait pas lieu, le mouvement ne cesserait pas. Tel est, peut-on imaginer, le cas des cieux ; Dieu, au dbut des choses, a anim les cieux dun mouvement uniforme et rgulier qui se continue sans fin : thse qui rend inutile les intelligences motrices et mme tout concours spcial de Dieu, qui assimile les mouvements des cieux au mouvement des projectiles, qui, avec le principe dinertie, fonde lunit de la mcanique et relgue dans le pass la thorie des lieux naturels et, avec elle, comme nous le verrons bientt, la finit du monde et le gocentrisme. Mais ce principe na pas droul dun coup toute la richesse de ses consquences, et Buridan lui-mme lappliquait incorrectement lorsquil considrait le mouvement circulaire et uniforme dune sphre comme pouvant se continuer, autant que le mouvement rectiligne, en vertu dune premire impulsion.
p.727
Cest la mme erreur que commet Albert de Saxe, recteur de lUniversit de Paris, en 1353 et mort vque dHalberstadt en 1390. Mais en mme temps,
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
487
il nonce une hypothse qui posait dune manire toute nouvelle le problme de la mcanique cleste. La terre se meut et le ciel est en repos. Ds lors en effet que limmobilit de la terre na plus, comme chez p.728 Aristote, de raison physique, il ne sagit plus que de savoir si la nouvelle hypothse sauvera les phnomnes . Ainsi renat la vieille vision pythagoricienne de limmobilit des cieux, qui na jamais t inconnue du Moyen ge, puisque certains interprtes la trouvaient dans le Time de Platon, que Scot rigne et Albert le Grand la mentionnaient, que le scotiste Franois de Meyronnes, vers 1320, lui donnait la prfrence, mais qui trouve cette fois les notions de mcanique gnrale propres lui donner son plein sens. Dautre part, et dans le mme esprit, Albert de Saxe entreprend des recherches sur la pesanteur, en dehors de toute hypothse sur les lieux naturels ; et il donne une dtermination, dailleurs encore inexacte, des rapports entre la vitesse, le temps et lespace parcouru dans la chute des corps. Nicolas Oresme, qui tudiait la thologie Paris en 1348 et mourut en 1382 vque de Lisieux, fut un de ceux qui propagrent la nouvelle mcanique cleste. Dans son Commentaire aux livres du Ciel et du monde (quil crivit en langue vulgaire ainsi que nombre de ses autres uvres), il montre que nulle exprience et nulle raison ne prouvent le mouvement du ciel et il indique plusieurs belles persuasions montrer que la terre est mue de mouvement journal et le ciel non ; et il noublie pas de conclure que telles considrations sont profitables pour la dfense de notre Foy. Cest le mme Nicolas Oresme qui invente, avant Descartes, lemploi des coordonns du gomtre ; cest lui qui, avant Galile, trouve lexacte formule de lespace parcouru par un corps dans une chute en mouvement uniformment acclr. En Marsile dInghem, qui mourut en 1396, en Henri de Hainbuch, qui fut recteur de lUniversit de Vienne en 1393, et mourut en 1397, et dont les crits astronomiques et physiques sont encore indits, ces ides trouvrent des propagateurs. Cependant, chez le cardinal Pierre dAilly qui, n en 1350, fut chancelier de lUniversit de Paris en 1389 et mourut en 1420, p.729 lgat du pape Avignon, lesprit occamiste continuait. Comme Nicolas dAutrecourt, il est convaincu que lexistence du monde extrieur ne peut tre prouve puisque toute chose sensible extrieure tant dtruite, Dieu pourrait conserver en nos mes les mmes sensations . Lexistence de Dieu nest dailleurs pas plus dmontrable ; lune et lautre existence restent simplement probables. Comme Guillaume dOccam, il affirme que la volont divine nagit nullement sous la raison du bien, mais que lordre naturel et lordre moral quil a voulus drivent dune volont qui na aucune raison pour laquelle elle est dtermine vouloir . Dieu nest pas juste parce quil aime la justice, mais, inversement, une chose est juste parce que Dieu laime, cest--dire parce quelle lui agre.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
488
VII. OCCAMISME, SCOTISME ET THOMISME
@ Lhistoire des universits du XVe sicle est surtout lhistoire de la lutte des anciens et des modernes. Loccamisme se rpand en particulier en Allemagne o il trouva un vulgarisateur sans originalit mais fidle en la personne de Gabriel Biel qui enseigna en 1484 lUniversit de Tbingen et mourut en 1495 ; ce furent des lves de Biel, des Gabrielistes, Staupitz et Nathin, qui, au couvent des Augustins, initirent Luther cette thologie nominaliste, dont le Dieu ressemble plutt un Jhovah capricieux et arbitraire qu un Dieu qui soumet sa volont la loi de lordre et du bien conue par son entendement. Les anciens restaient sans doute reprsents dans les Universits : ce sont surtout des commentateurs : Jean Capreolus (1380-1444), Paris et Toulouse ; Antonin (1389-1459) Florence ; Cologne, en particulier, reste une universit purement thomiste, do sort Denys le Chartreux (1402-1471). Au dbut du XVIe sicle, Cajetan, de 1505 1522, et Franois Silvestre de Ferrare, en 1516, commentent lun la p.730 Somme thologique, lautre la Somme contre les Gentils. Des scotistes sans originalit non plus, dfendent le ralisme de Duns Scot contre le nominalisme dOccam.
VIII. LE MYSTICISME ALLEMAND AU XIVe SICLE : ECKHART
@ La contre-partie du mouvement nominaliste que nous venons danalyser est le mouvement mystique qui se droule vers la mme poque, et surtout en Allemagne. Vers la fin du XIVe sicle, Gerson dfinissait la thologie mystique lintelligence claire et savoureuse des choses qui sont crues daprs lvangile 1. Cette thologie doit tre acquise par la pnitence plutt que par linvestigation humaine et lon peut se demander si Dieu nest pas mieux connu par un sentiment de pnitence que par lentendement qui recherche. On voit chez ce mystique franais, ami de Pierre dAilly, linfluence des Victorins pour qui le mysticisme est avant tout une mthode de mditation lie lavancement spirituel. La thologie scolastique prouve et dmontre, et elle aboutit un systme dides bien classes ; la thologie mystique voit et savoure, et elle aboutit une ineffable union avec Dieu. Le milieu et les conditions dans lesquels se dveloppe le mysticisme, les formes littraires quil revt, tout cela le distingue trs profondment de la philosophie des universits. Il est insparable de la vie conventuelle, avec tout lentranement la mditation spirituelle que comporte lorganisation
1
Contra vanam curiositatem, d. Dulin, 1706, vol. I, p. 106.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
489
monastique, des prdications en langue vulgaire qui sadressent au sentiment plus qu lintellect, enfin dun mouvement gnral des esprits qui stend jusquaux gens du peuple et qui se manifeste surtout par la croyance millnariste, dont nous avons p.731 vu tant dexemples au XIIe sicle ; elle aboutit au XIVe sicle une extraordinaire closion de prophtes et de prophtesses qui annoncent que les temps sont rvolus et que lAntchrist va paratre. Le mysticisme 1, mme lorsquil est doctrinal, garde beaucoup de ces traits qui lapparentent au peuple ; les mystiques allemands du XIVe sicle usent de prfrence du langage vulgaire ; ils exposent par affirmation, par vision, sans jamais discuter ni prouver ; leur but est toujours, comme le dit Eckhart, le plus spculatif dentre eux, de conduire lme se sparer et sinformer en Dieu, se convaincre de sa noblesse et de la puret de la nature divine 2. Ce nest pas autrement que parle Plotin, avec qui la pense dEckhart a tant daffinit, bien quelle nen dpende pas directement ; le dominicain Jean Eckhart, n en 1260, tait lUniversit de Paris en 1300 ; mais de 1304 jusqu sa mort en 1327, sauf un sjour Paris en 1311, il rsida en Allemagne, o, vicaire gnral de son ordre, depuis 1307, il acquit une haute rputation, enseignant, prchant, rformant les couvents dominicains de son ordre en Bohme ; les deux dernires annes de sa vie furent assombries par les attaques des Franciscains qui, en 1329, firent condamner Rome vingt-huit de ses thses. Il serait donc difficile de comprendre comment ce dominicain, qui fut sa manire un homme daction, est arriv des spculations mtaphysiques, o lon voit, non sans raison, lorigine de la philosophie allemande, si lon nindique dabord comment il concevait la vie chrtienne. Cest, semble-t-il, par tout un systme dinterprtation spirituelle des prceptes vangliques et des rgles monastiques qui en sont issues : pauvret, amour, humilit, bonnes uvres, prires, toutes ces rgles, destines dtourner lhomme de lui-mme et du p.732 monde et le rapprocher de Dieu, Eckhart les interprte en un sens purement spirituel : la pauvret, cest ltat de lhomme qui ne sait rien, qui ne veut rien et qui na rien ; compltement spar de lui-mme et de toutes les cratures, le vrai pauvre na mme plus la volont daccomplir la volont de Dieu ; il est dans un tat de passivit complte, o il laisse Dieu accomplir en lui son uvre, aussi prt souffrir les tourments de lenfer qu participer aux joies de la batitude. Lamour est une union aussi complte que possible qui na son but quen lui-mme ; conformment un trait permanent du mysticisme il ne sagit plus de lamour, toujours dficient, que dcrit Platon, mais dune plnitude, qui est identique Dieu lui-mme ; laction de lme amoureuse na donc plus rien de dficient, et elle nest asservie aucune fin ;
1
PASTOR, Histoire des Papes, I, 166, cit par VANSTEEBERGHE, Le cardinal Nicolas de Cuse, Lille, p. 33, 1920. 2 dition Pfeiffer, p. 191 ; comparer PLOTIN, Ennades, IV, 3. 1.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
490
lamour et les vertus qui toutes sensuivent, loin dtre des acquisitions de lme, sont donc (comme Eckhart le dit aprs Plotin) ltre mme de lme ; ils sont cette unit profonde o fusionnent indissolublement unies, toutes les vertus, accomplies ds lors sans effort, et mme sans volont ni conscience, et qui ne comportent aucun degr ; les bonnes uvres, aumnes ou jenes, sont sans valeur, si on ne considre la volont do elles partent : la volont, insoucieuse de toute russite extrieure, suprieure par l mme toute circonstance, au temps et lespace, ne pouvant donc jamais tre empche, est luvre vritable, luvre interne qui, seule, rapproche de Dieu. La vritable prire nest pas davantage la prire extrieure, limite un but dtermin et momentan, cest le constant abandon la volont de Dieu. On voit ici reparatre dans toute sa force une manire de comprendre la vie intrieure qui, depuis Plotin, navait jamais trouv une formule aussi nette et complte : le but de la vie spirituelle, consistant dans lamour, toutes les vertus comprises en une seule, la complte libert atteinte en replaant lme en son propre fond, cest--dire en de des tats o elle a une p.733 activit limite, et dtermine, Cest bien l la tradition plotinienne que nous avons vue maintes fois sopposer une autre tradition, daprs laquelle la vertu, au lieu dtre retrait sur soi et retour soi, est une acquisition volontaire dpendant de contacts multiples et rpts avec les milieux extrieur et social. Pourtant il est remarquer que la doctrine dEckhart, pas plus que le plotinisme, nengendre cette abstention dactivit extrieure, que lon appela au XVIIe sicle le quitisme. Les activits infrieures de lme, celles qui aboutissent laction, volont, raison, entendement, sens externes, ne soit pas supprimes par le retrait de lme en soi ; elles sont au contraire ordonnes et diriges. Le problme, qui a si fort tourment le stocisme, est ici rsolu : quand on possde le droit principe, les actions droites en rsultent delles-mmes. Cest cette conception de la vie spirituelle dont le rythme domine la thologie et la mtaphysique dEckhart. Ce rythme, nous le connaissons depuis longtemps : unit originaire des tres, division, retour lunit, il nest pas, depuis lpoque des Stociens, une seule vision de lunivers, dont ce schme, plus ou moins dform par suite de proccupations diverses, ne fournisse le dessin gnral : que lon conoive le passage de lun au divers comme une manation ou une cration, la conception densemble des choses reste toujours domine par lide que la consommation de choses est un retour lunit avec Dieu, une vritable dification. Le point de vue propre dEckhart, cest que ce retour lunit serait tout fait impossible, quil naurait mme pas de sens, si lon concevait les cratures finies et individuelles, poses en dehors de Dieu, comme doues dune ralit vritable, au mme sens que la ralit divine. Toute la mtaphysique dEckhart est donc dans cette ngation : Lindividualit est un pur accident, un nant ; supprime ce nant, toutes les cratures sont unes. Il sagit donc pour lui de montrer que cette unification avec Dieu, qui consomme la
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
491
destine, nous p.734 dcouvre en mme temps la ralit des choses ; cest en ce sens que le mysticisme dEckhart est un mysticisme spculatif ; sa doctrine de la destine est en mme temps une doctrine de ltre. Lunit de Dieu ne se perd point, ds que lon conoit toute la diversit des choses comme la manifestation ou rvlation dune unit plus profonde ; si une parole exprime une pense intrieure, cette parole ne fait quun avec la pense quelle exprime ; et il suffit que le divers nous apparaisse ainsi pour tre immdiatement ni comme divers, comme tre indpendant, et pour revenir Dieu dont il est issu ; ainsi ds l-mme que je conois les choses comme rvlations de Dieu, je connais quelles reviennent Dieu. Cette mthode, Eckhart lapplique ce quil y a de divers en Dieu, la Trinit : bien des vues augustiniennes sur la Trinit prtaient cette application : le Fils nest-il pas le Verbe, la Parole ou lIntelligence par o sexprime le Pre, et lEsprit le lien damour qui unit le Fils au Pre ? Mais, lexemple des triades dont les lments de thologie de Proclus, traduits par Guillaume de Moerbecke, lui fournissaient le modle, il conoit dabord au-dessus de la Trinit, la divinit (Gottheit) comme une unit imparticipe, une nature non nature , qui reste en elle-mme, tandis que, au-dessous, les trois personnes forment la nature nature ; la premire, le Pre, correspond lunit participe de Proclus ; il est lunit absolue o sidentifie connu et connaissant ; le Fils exprime la pense du Pre et lEsprit les unit. La cration du monde, ou procession des choses cres en dehors de Dieu, nest pas strictement diffrente en nature de la gnration du Fils par le Pre ; car le monde cr nest point autre chose quune expression de Dieu. Chaque chose a en Dieu son tre ternel, compris dans le Verbe : la cration est cet acte intemporel par lequel Dieu sest exprim en son Fils. Et cest pourquoi, puisque Eckhart naccepte dautre causalit p.735 divine que cette causalit immanente, il nest pas permis de concevoir lexistence individuelle de chaque crature, en un temps et en un espace dtermins, comme le rsultat dun acte positif de Dieu ; cest une improprit de dire que Dieu a cr un certain moment le ciel et la terre ; cette existence finie des choses hors de Dieu, cette diversit qui les spare ne peut se concevoir que comme un nant et une privation ; et cest dire avec quelle force Eckhart adhre la thorie plotine-augustienne du mal, qui fait du mal une simple privation et un dfaut, lis cette diversit. Or cest par la connaissance mme de cette unit originaire des cratures que le monde revient son origine. Lme na dautres fonctions que cette connaissance. On voit avec quelle complaisance Eckhart doit admettre ces affirmations aristotliciennes que lme est en quelque manire toutes choses , que, dans lintelligence en acte, lobjet est identique au sujet, accepter aussi cette thse noplatonicienne que chaque hypostase, me et intelligence, comprend toutes choses sa manire. Cest l la vritable base de sa thorie de lme, qui ne peut tre considre ainsi quon le fait quelquefois,
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
492
comme un point de dpart de sa doctrine, mais tout au contraire, ainsi que chez Plotin, comme un dnouement : le fond de lme, ce quil appelle ltincelle (Funke) ou la synteresis, est comme le lieu o toute crature retrouve son unit. La connaissance au sens le plus haut (qui est connaissance suprarationnelle de cette unit ou foi) nest donc point comme la reprsentation de choses qui lui seraient et lui resteraient extrieures ; elle est une transmutation des choses mmes dans leur retour Dieu ; elle est, pourrait-on dire, comme laspect spirituel de cette conflagration universelle, o certains stociens dj voyaient plutt une purification quun incendie matriel. Dans le christianisme dEckhart, le Christ, incarn en Jsus, agit moins comme rdempteur du pch dAdam que comme modle, comme lhomme chez qui se trouve consomm tout p.736 ce que lme humaine recherche, lunion parfaite de Dieu et de la crature. Laspect historique et juridique, sacramentel, de la doctrine chrtienne disparat presque chez lui ; lincarnation du Christ, qui aurait eu lieu mme sans le pch dAdam, na nullement pour raison dtre principale de donner satisfaction Dieu pour ce pch ; le Christ est plutt le guide des mes par qui lunivers retourne Dieu. De la pense dEckhart, les mystiques allemands. du XIVe sicle recueillent moins la thorie mtaphysique quune rgle intrieure de vie : Jean Tauler (1300-1361), Henri Suso (1300-1365) sont surtout des prdicateurs ; le Flamand Jean Ruysbroeck (1293-1381), prieur du couvent de Grnthal prs de Bruxelles, par son got pour linterprtation allgorique de lcriture, fait songer la pit de Philon beaucoup plus quau don spculatif de Plotin : Il faut, dit-il dans lOrnement des noces spirituelles, que lme comprenne Dieu par Dieu ; mais ceux qui voudraient savoir ce que Dieu est et ltudier, quils sachent que cest dfendu. Ils deviendraient fous. Toute lumire cre doit faillir ici ; cette quiddit le Dieu dpasse toutes les cratures ; on croira les articles de foi et on ne tentera pas de les pntrer..., voil la sobrit 1. Texte intressant qui nous rend tmoins de la profonde scission des esprits en cette fin du XIVe sicle ; plus rien de cet univers o le monde conduit Dieu, et o la raison sachve par la foi. Ou bien le nominalisme, o la raison dirige par lexprience, commence connatre les lois naturelles des choses, et o la foi ne peut se surajouter la raison que par un dcret arbitraire, ni faire connatre en Dieu quune puissance absolue et sans motif ; ou bien le mysticisme qui va directement Dieu sans passer par la nature, et ne retrouve ensuite la nature que toute pntre de Dieu et en quelque sorte rsorbe en lui. Ce qui est plus grave peut-tre, cest que cette scission rpond p.737 la sparation de deux milieux intellectuels : dune part les Universits, o se cre ce moment une vritable aristocratie intellectuelle, et, o slaborent les mthodes de la science, dautre part les couvents dont la vie spirituelle, beaucoup plus lie celle des masses, comporte, ct des spculations de
1
Traduction Hello, p. 61.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
493
profonds mystiques, des mouvements populaires trs tendus, plus sociaux quintellectuels. Bibliographie @
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
494
CHAPITRE VII LA RENAISSANCE
I. CARACTRES GNRAUX
@ Dans les milieux humanistes du XVe sicle, si diffrents des Universits, sous la protection des princes ou des papes, se runissent indiffremment laques et ecclsiastiques, lAcadmie platonicienne dans la Florence de Laurent le Magnifique, comme lAcadmie aldine Venise. En ces milieux nouveaux, il nest aucune considration pratique qui puisse prvaloir sur le dsir du savoir comme tel ; lesprit, tout fait libr, nest plus asservi, comme dans les Universits, la ncessit dun enseignement qui forme des clercs. Au sicle suivant est fond le Collge de France qui, distinct de lUniversit, est fait non pour classer le savoir acquis et traditionnel, mais pour promouvoir les connaissances nouvelles.
p.739
Cette libert produit un pullulement de doctrines et de penses, que nous voyions poindre pendant tout le Moyen ge, mais qui, jusque-l, avaient pu tre refoules ; ce mlange confus, que lon peut appeler naturalisme, parce que, dune manire gnrale, il ne soumet lunivers ni la conduite aucune rgle transcendante, mais en recherche seulement les lois immanentes, contient, ct des penses les plus viables et les plus fcondes, les pires monstruosits ; avant tout, on affecte de tourner le dos tout ce qui sest fait jusquici : Laurent Valla (crit le p.740 Pogge aussi humaniste et picurien que ltait son ami) blme la physique dAristote, il trouve barbare le latin de Boce, il dtruit la religion, professe des ides hrtiques, mprise la Bible... Et na-t-il pas profess que la religion chrtienne ne repose point sur des preuves, mais sur la croyance, qui serait suprieure toute preuve ! 1. Or le Pogge est un fonctionnaire de la Curie romaine ; quant Laurent Valla, le cardinal de Cuse, en 1450, le recommandait au pape et voulait ly faire entrer. Ce dsir intense dune vie autre, nouvelle et dangereuse, est provoqu ou du moins accentu par lnorme accroissement de lexprience et des techniques qui, en un sicle, change les conditions de la vie matrielle et intellectuelle de lEurope. Accroissement de lexprience dans le pass, grce aux humanistes qui lisaient les textes grecs, et qui, au XVIe sicle, sinitirent aux langues orientales ; limportant est moins encore la dcouverte de nouveaux textes que la manire dont on les lit ; cest le mme De officiis de
1
Cit par H. BUSSON, Les Sources et le dveloppement du rationalisme, p. 55.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
495
Cicron que connaissent saint Ambroise et rasme ; saint Ambroise y cherche des rgles pour ses clercs ; rasme y trouve une morale autonome et indpendante du christianisme ; il ne sagit plus maintenant daccommoder ces textes lexplication des critures, mais de les comprendre en eux-mmes. Accroissement de lexprience dans lespace, lorsque, dpassant les bornes de l, o la chrtient, aprs lantiquit, avait trac les limites de la terre habitable, lon dcouvre non seulement de nouvelles terres, qui dtournent les regards du bassin de la Mditerrane, mais de nouveaux types dhumanit dont la religion et les murs sont inconnues. Accroissement des techniques, non seulement par la boussole, la poudre canon et limprimerie, mais par des inventions industrielles ou mcaniques dont plusieurs sont dues des artistes italiens qui taient en mme temps p.741 des artisans. Les hommes de cette poque, mme attachs la tradition, ont limpression que la vie, longtemps suspendue, reprend, que la destine de lhumanit recommence : Nous voyons partout, crit le Cardinal de Cuse vers 1433, les esprits des hommes les plus adonns ltude des arts libraux et mcaniques, retourner lantiquit, et avec une extrme avidit, comme si lon sattendait voir saccomplir bientt le cercle entier dune rvolution 1. Les esprits taient naturellement ports confronter avec cette exprience accrue les conceptions traditionnelles de lhomme et de la vie, fondes sur une exprience bien plus restreinte. Malgr toutes les divergences et toutes les diversits, il ny a eu, durant le Moyen ge tout entier, quune seule image ou, si lon veut, un seul schme dans lequel viennent naturellement sencadrer toutes les images possibles de lunivers : cest ce que nous avons appel le thocentrisme : de Dieu comme principe Dieu comme fin et consommation, en passant par les tres finis, voil une formule qui peut convenir la plus orthodoxe des Sommes comme la plus htrodoxe des mystiques, tant lordre de la nature et lordre de la conduite humaine viennent se placer avec une sorte de ncessit entre ce principe et cette fin. Une pareille synthse ntait possible que grce une doctrine qui concevait toutes les choses de lunivers par rfrence cette origine ou cette fin, tous les tres finis comme des cratures ou des manifestations de Dieu, tous les esprits finis comme en train de sapprocher ou de sloigner de Dieu. Or cest cette rfrence qui, de plus en plus, devient impossible : dj, au XIIe sicle, nous avons vu comment sbauchait un naturalisme humaniste qui tudiait en elles-mmes la structure et les forces de la nature et de la socit ; plus encore, au XIVe sicle, laissant dlibrment tout ce qui regarde p.742 lorigine et la fin des choses, dmontrant mme que cest par erreur quon a cru saisir dans lopposition du ciel immuable et de la rgion sublunaire quelque chose du plan divin, les occasions tudient la nature en et pour elle-mme. Mais, aux deux sicles suivants, que de raisons nouvelles de scarter du thocentrisme ! Les tranges et mystrieuses profondeurs que lon
1
Cit par VANSTEEBERGHE, Le cardinal Nicolas de Cuse, p. 17.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
496
souponnait peine dans lhistoire et dans la nature commencent apparatre ; la philologie, dune part, la physique exprimentale, dautre part, donnent sur lhomme et sur les choses des enseignements nouveaux ; le drame chrtien, avec ses moments historiques, cration, pch, rdemption ne peut dcidment servir de cadre une nature dont les lois lui sont tout fait indiffrentes, une humanit dont une partie lignore compltement, une poque o les peuples chrtiens eux-mmes, se rendant indpendants du pouvoir spirituel, font prvaloir dans leur politique des buts tout fait trangers aux fins surnaturelles de la vie chrtienne, ou mme dlibrment contraires lide de lunit de la chrtient. Un changement si vital a une infinit de rpercussions. La plus importante pour nous est de mettre au premier plan les hommes de pratique, hommes daction, artistes et artisans, techniciens en tout genre aux dpens des mditatifs et des spculatifs ; la conception nouvelle de lhomme et de la nature est une conception que lon ralise plutt quon ne la pense ; les noms des philosophes proprement dits, de Nicolas de Cuse Campanella ont alors bien peu dclat ct de ceux des grands capitaines et des grands artistes ; tout ce qui compte est alors technicien en quelque sens que ce soit ; le type achev est Lonard de Vinci, la fois peintre, ingnieur, mathmaticien et physicien ; mais il nest gure de philosophe qui ne soit en mme temps mdecin, ou tout au moins astrologue et occultiste ; la politique de Machiavel est une technique destine aux princes italiens ; les humanistes, avant dtre des penseurs, sont des praticiens de la philologie, soucieux des p.743 mthodes qui leur permettront de restituer les formes et les penses des anciens. Pourtant, et cest peut-tre l le grand paradoxe de lpoque, les philosophes de la Renaissance, depuis Nicolas de Cuse jusqu Campanella, sefforcent dorganiser leur pense autour de lancien schme de lunivers ; le retour au platonisme, tel quon le constate chez beaucoup dentre eux, loin de les conduire des ides neuves, ne fait que les persuader davantage que la grande tche de la philosophie est dordonner les choses et les esprits entre Dieu comme principe et Dieu comme fin. Le contraste entre ce schme vieilli et la nouvelle philosophie de la nature quils intgrent en leur systme fait, nous le verrons, la grosse difficult de leur doctrine.
II. LES DIVERS COURANTS DE PENSE
@ Ces rflexions nous permettront de sparer en cette priode si confuse, plusieurs courants dides relativement distincts : il y a dabord le courant platonicien. On se souvient que le platonisme avait t, ds les premiers sicles chrtiens, bien accueilli par la nouvelle religion ; les humanistes platoniciens du XVe sicle, comme Marsile Ficin, gardent encore un trs srieux espoir de trouver dans le platonisme une synthse philosophique favorable au
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
497
christianisme : ils continuent, tout en lignorant, la tradition des Chartrains et dAblard. Le second courant est celui des averrostes de lUniversit de Padoue ; ceux-l suivent une tradition qui, depuis Siger de Brabant, est ininterrompue et se transmet Padoue mme, au dbut du XIVe sicle, par Pietro dAbano : elle repose sur une interprtation dAristote, oppose celle du pripattisme chrtien, o lon voit un Aristote naturaliste, ngateur de la providence et de limmortalit de lme, affirmant en revanche un rigoureux dterminisme : tradition o il faudrait se garder de voir p.744 laurore de la science moderne ; car les padouans sont des ractionnaires qui ont maintenu lesprit de la physique dAristote. Le troisime courant est celui des savants vritables pour qui le modle nest ni Platon ni Aristote, mais Archimde, cest--dire lhomme qui a su le premier unir la mathmatique lexprience : Archimde, compltement ignor du Moyen ge, amne dun bond un tat de la science beaucoup plus avanc que tout ce que pouvait enseigner la tradition. Un quatrime courant non moins original que le troisime, et qui naboutit aucune formule fixe et dtermine est celui des moralistes qui, de mme que le savant cherche ce quest la nature indpendamment de son origine et de sa fin, se propose de dcrire lhomme de la nature, abstraction faite de sa destine surnaturelle ; en cette description de la nature humaine, les morales antiques, et en particulier la stocienne, sont vritablement les initiatrices. Il semble que, sous rserve du premier courant, loccamisme a nonc, ds le XIVe sicle, la supposition implicite en toutes ces doctrines : rien, dans la nature, ne peut nous amener aux objets de la foi ; la foi est un domaine ferm, rserv, incommunicable sinon par un don gracieux de Dieu. Mais nest-ce pas aussi lide fondamentale de la Rforme ? Notre intelligence ni notre volont ne peuvent tre en rien disposes la foi par des moyens naturels. La Rforme soppose autant la thologie scolastique qu lhumanisme ; elle nie la thologie scolastique, parce quelle nie avec Occam que nos facults rationnelles puissent nous conduire de la nature Dieu ; elle renie lhumanisme moins pour ses erreurs que pour ses dangers, puisque les forces naturelles ne peuvent communiquer aucun sens religieux. En revanche la Rforme est aussi hostile que lhumanisme la conception thocentrique de lunivers et toutes les thses morales et politiques qui y sont lies ; lun et lautre veulent ignorer cette synthse du naturel et du divin, du monde p.745 sensible et de son principe, avec toutes les consquences quavait rves le XIIIe sicle. Ainsi cest de deux manires, opposes lune lautre, que lon essaye de retrouver lunit mentale perdue par la scission, que lon sent dfinitive, entre la connaissance de la nature et la ralit divine : ou bien en sefforant dorganiser une vie morale autonome qui prend comme rgle la nature, ou bien en enlevant lhomme toute possibilit de se justifier autrement que par la grce.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
498
III. LE PLATONISME : NICOLAS DE CUSE
@ La lutte intestine entre lancien schme thocentrique de lunivers et la mthode humaniste se marque dune manire prcise chez le plus grand des penseurs du XVe sicle, le cardinal Nicolas de Cuse (1401-1464). Il y a chez lui un mlange des plus curieux entre loccamisme dont il a reu la tradition de ses matres de Heidelberg et le noplatonisme quil connat fond non seulement par la lecture de Denys lAropagite, mais surtout par celle des grandes uvres de Proclus, lments de thologie, Commentaire sur le Parmnide et Thologie platonicienne. Ce recours direct et large aux sources du noplatonisme est de toute importance. Tout autre chose est le noplatonisme des Arabes et mme celui de Denys lAropagite ; autre chose celui de Plotin et de Proclus. Le premier est avant tout soucieux de dcrire la hirarchie des tres, depuis les anges ou intelligences jusquaux esprits infrieurs pour dterminer en quelque sorte la position mtaphysique de chacun deux ; le second, beaucoup plus voisin de Platon, malgr les diffrences, veut montrer comment chaque degr de la hirarchie contient toute la ralit possible, mais sous un aspect diffrent : lUn contient toutes les choses, lIntelligence aussi, lAme galement ainsi que le monde sensible, mais chaque p.746 hypostase sa manire ; dans lUn, elles sont indistinctes ; dans lIntelligence, elles se pntrent grce une vision intuitive qui voit toutes en chacune ; dans lAme, elles ne sont plus lies que par les liens de la raison discursive ; dans le monde, elles restent extrieures les unes aux autres ; la diffrence quil y a de lune lautre peut donc sexprimer en termes de connaissance plutt quen termes dtre. Le noplatonicien se reprsente le passage dune hypostase la suprieure moins comme le passage dune ralit une autre que comme la vision de plus en plus approfondie, de plus en plus une dun mme univers. Or cest cette ide noplatonicienne qui, exprime de mille faons dans le De doctes ignorantia (1440) et les autres uvres du cardinal, forme vritablement le fond de sa pense : il cherche une mthode qui lui permettra de passer un plan de vision de lunivers suprieur celui de la raison et celui des sens : voir toutes choses intellectualiter et non pas rationaliter, tel est son but. Donnons-en un exemple caractristique dans sa manire denvisager les mathmatiques ; sans avoir eu de rsultats fconds en ce domaine, sa pense nous intresse du moins par son orientation. Rappelons dabord dun mot ce quont t les mathmatiques pour Aristote : pour lui, on le sait, les caractristiques gomtriques dun tre de la nature, comme la stature de lhomme ou la configuration physique du ciel, dpendent de lessence de cet tre ; ds lors la gomtrie, tude de ces configurations, ne saurait tre quune science de ralits abstraites qui nont point en elles-mmes leurs raisons ; le rai-
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
499
sonnement mathmatique enchane, lune lautre, les proprits de ces formes, qui sont statiquement donnes dans la dfinition : cest la gomtrie qui a occup longtemps cette position infrieure que bien des penseurs de la Renaissance sont disposs lui laisser ; Fracastor, par exemple, remarque que les mathmatiques, bien que certaines, ont des objets trop humbles p.747 et trop bas, et cette rflexion a mme encore son cho dans le Discours de la mthode. Or Nicolas de Cuse, ct de la mathmatique sensible qui est lart de larpenteur, de la mathmatique rationnelle qui est celle dEuclide voudrait voir instituer une mathmatique intellectuelle ; cest ce quil appelle dun titre expressif lart des transmutations gomtriques (1450) qui traite les problmes que les mathmaticiens modernes appellent problmes de limite, des cas o concident lune avec lautre des formes que le gomtre considre comme distinctes : ainsi lon voit par intuition quun arc de cercle concide avec la corde, lorsque larc est minimum. Cette concidence de larc et de la corde nest quune application du principe gnral de la concidence des opposs qui est le principe de la connaissance intellectuelle des choses, tandis que le principe de contradiction est celui de la connaissance rationnelle. Lintelligence voit runis des contraires que la raison oppose et dclare exclusifs. La connaissance tend donc vers lirrationnel, cest--dire vers lintellectuel comme vers une limite ; la docte ignorance est ltat desprit de celui qui, non satisfait de la connaissance rationnelle, sait combien il est loign de la connaissance intellectuelle et essaye de sen rapprocher. La concidence des contraires, ainsi comprise, nest quun aspect de cet tat dunit de toutes choses o les platoniciens voyaient le principe de ltre et de la connaissance ; mais, par cet aspect, elle peut donner prise une multiplicit de problmes, autant de problmes concrets quil y a de couples de contraires : ainsi la courbe concide avec la droite ; le repos concidera avec le mouvement ; le mouvement nest quun repos ordonn en srie (quies seriatim ordinata) 1. Ce sont toutes les grandes oppositions sur lesquelles reposait la physique aristotlicienne qui sont condamnes. Nous pouvons tre brefs sur la mtaphysique cusienne qui ne fait que projeter dans le rel ces divers tats dunits. Ce que les platoniciens appelaient tat dunion, il lappelle complicatio, et explicatio ce quils appelaient tat de dispersion. Dieu est toutes choses ltat de complicatio ; le monde est toutes choses ltat dexplicatio ; Dieu et lunivers sont lun et lautre un maximum contenant tout ltre possible ; mais Dieu est le maximum absolu, le possest o tout pouvoir (posse) est dj arriv ltre (est) ; le maximum ne signifie pas dailleurs ici le plus grand des tres, ce qui supposerait quon le compare des tres finis : et il faut dire, pour concevoir cet excs qui le met hors de toute proportion avec les choses, quil est aussi le minimum, cest--dire quil dpasse toute opposition. Lunivers est
1
De docta ignorantia, II, 3.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
500
le maximum contract, cest--dire concret, o la ralit, compose et successive, passe de la puissance lacte ; ou encore : Dieu est la quiddit absolue du monde ; lunivers en est la quiddit contracte. Dans ce maximum contract quest lunivers, Nicolas montre lexplicatio en train de se faire bien plutt quacheve ; en effet sa physique, comme celle de Plotin, cherche montrer que tout est encore en tout ; ainsi les quatre lments nexistent pas ltat de puret, comme chez Aristote ; ce sont des mixtes, et le feu lui-mme contient, runis en lui, les trois autres lments. La connaissance est le mouvement inverse de lexplicatio, par lequel, dans lme, la diversit se rduit lunit. Dans cette thorie de la connaissance se trouve une confusion fondamentale, remarque par plusieurs historiens et qui est fort instructive. Chez Nicolas, comme chez Aristote, lme est, sa manire, toutes choses ltat de complication, et la connaissance quelle produit peu peu est lexplication de ce qui est en elle ; comme lexplicatio est un tat de dtente et de multiplicit, elle est, en principe, infrieure la complicatio. Mais inversement, la connaissance, actuation des puissances de lme, est en fait un enrichissement ; il semble bien que Nicolas de Cuse ait peru dune manire assez vague que la p.749 connaissance se fait par deux mouvements inverses lun de lautre, lun danalyse, lautre de synthse, mais quil les nomme lun et lautre explicatio. Comment le dogme sarrange-t-il de ce platonisme ? Lesprit de Nicolas de Cuse parat sans cesse partag entre le principe occamiste qui met les vrits de la foi au-dessus de toute prise humaine, et les thses platoniciennes qui dcrivent la ralit divine elle-mme. Reconnatra-t-on, par exemple, la cration, acte positif et libre de la volont divine, en cette formule : Puisque la crature a t cre par ltre du maximum, et puisque, dans le maximum, cest une mme chose dtre, de faire et de crer, crer ne veut pas dire autre chose, sinon que Dieu est tout ? 1. A vrai dire pourtant, Nicolas de Cuse nadmet pas, comme Plotin, quil y ait aucun principe ncessaire qui force la multiple sortir de lun : il est jamais impossible de comprendre comment une forme infinie unique est participe de manire diverse en des cratures diverses 2, et lespoir de toute mtaphysique manatiste est abandonne. Lon voit encore ici par o Nicolas de Cuse est un moderne, essayant dextraire du noplatonisme moins une mtaphysique expliquant en gros lunivers quune mthode et un esprit, aboutissant des problmes concrets et limits.
IV. LE PLATONISME (suite)
@
1 2
De docta ignorantia, II, 2, p. 24. Ibid., p. 25.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
501
Le platonisme de Nicolas de Cuse, par bien des points, dpasse de beaucoup celui que nous allons maintenant exposer : le cardinal, accabl daffaires, ne pouvait donner que peu dinstants la mditation philosophique, et ses ides restent souvent vagues ; mais il a fait plus quentrevoir quil y a une mthode dans le platonisme. Au contraire, les platoniciens, p.750 depuis Marsile Ficin, veulent surtout accentuer le fonds religieux ou potique quil y a dans les doctrines du matre ; et ils y cherchent non seulement laccord avec le christianisme, qui, contre les averrostes padouans, doit montrer que la philosophie, elle aussi, est chrtienne, mais encore lunit dune religion commune toute lhumanit, que lon rencontre plus ou moins obscurment dans les traditions de tous les peuples et dont le christianisme nest peut-tre quun aspect momentan : ide qui mettra les platoniciens humanistes en conflit avec la Rforme, mais aussi finalement avec la Contre Rforme. On voit par l le sens de la lutte entre aristotliciens et platoniciens quouvrit Plthon, Florence, en 1440, avec son pamphlet contre Aristote ; pour lui, comme pour le cardinal Bessarion et ses partisans, il sagissait demployer Platon se dfendre contre le fatalisme et la ngation de limmortalit de lme. Cest aussi le sens des travaux de Marsile Ficin, qui traduisit Plotin en 1492 et commenta Platon dans sa Theologia platonica de immortalitate animorum ; il voit dans ses recherches philosophiques un complment ncessaire la prdication religieuse, qui est impuissante dtruire limpit dAverros. Il y faut une religion philosophique que les philosophes couteront avec plaisir, et qui, peut-tre, les persuadera. Avec quelques changements, les platoniciens seraient chrtiens 1 . Ficin trouvait chez Platon un Dieu crateur, des mes doues dexistence personnelle, de libert et dimmortalit ; penseur peu original, mais habile traducteur et commentateur dont les livres (dits plusieurs fois Paris au XVIe sicle) restent, pour toute la Renaissance, la source de la connaissance de Platon et de Plotin. On trouve un tat desprit analogue, avec une plus chaude imagination, chez Jean Pic de la Mirandole (1463-1494) qui p.751 recommence aprs tant dautres dans son Heptaplus linterprtation allgorique de la gense mosaque, o il retrouve la mtaphysique blouissante et complique de la Cabale et du Zohar ; il ny a rien l que nous ne connaissions depuis Philon dAlexandrie ; mais il faut signaler nouveau cette union de lallgorie avec lide dune religion universelle. Toute la fantasmagorie de la Cabale reparat, au XVIe sicle, dans les constructions mtaphysiques des mystiques allemands. Dans leur monde, comme dans celui de Plotin, tout est symbole, tout est dans tout, et la science consiste marquer les degrs daffinit par la connaissance desquels on saura galement comment les choses agissent les unes sur les autres. Tel est le but du mdecin Paracelse (1493-1541) dont toutes les uvres ne sont que la
1
Theologi platonic prmium, p. IV ; cit par BUSSON, Sources, etc., p. 174.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
502
dcouverte de prtendus correspondances de ce genre entre les choses de la nature. Nous nous contentons de signaler ces trangets, en marquant leur diffusion dans les pays de langue allemande. Non sans protestation de la part de lorthodoxie luthrienne, Paracelse et matre Eckhart, tous les deux crivains de langue allemande, deviennent les guides de ces socits mystiques, o fermentent les ides qui se sont traduites finalement dans les uvres, toute- populaires, de Valentin Weigel (1533-1588), puis de Jacob Boehme (1575-1624), ces initis qui, dpassant la lettre de lcriture, atteignent les mystres de la vie divine. Nous retrouverons plus tard les aboutissants de ce mouvement. Nous verrons, la fin de ce chapitre comment le spiritualisme platonicien a produit de vritables systmes philosophiques. Indiquons ici brivement combien, sous une forme diffuse et non systmatique, il sest li aux croyances chrtiennes. Le christianisme de Platon devient alors une thse favorite des humanistes. rasme, dans lloge de la Folie (1511), qui parut Paris et qui eut un succs immense, est tout heureux de constater laccord des doctrines des chrtiens et des platoniciens sur lme humaine enchane au corps et empche par p.752 la matire de contempler la vrit, puis lidentit des sages qui dplorent la folie de ceux qui prennent des ombres pour des ralits , et des pieux qui se portent tout entiers la contemplation des choses invisibles (chap. XLVI). Cet clectisme se dveloppe en France pendant tout le XVIe sicle : Amaury Bouchard, maistre des requestes ordinaires de lhostel du roi, crit vers 1530 un trait, De lexcellence et immortalit de lme, extrait non seulement du Time de Platon, mais aussi de plusieurs aultres grecz et latins philosophes tant de la pythagorique que platonique famille , cest--dire des citations de Pythagore, Linus et Orphe quil emprunte la Theologia platonica de Ficin 1. LEncyclie des secrets de lternit, de Fvre de la Boderie, un pome en huit chants crit en 1570, est le type de cette apologtique du christianisme, adresse aux libertins et dvoyez , lie au platonisme : lme immortelle du Phdre, lme spare du corps du Phdon avec ses ides innes, la preuve de lexistence de Dieu par le fait que lme atteint lternit : Et puisquelle attaint bien jusqu lternit, Il te faut confesser une Divinit : Car sil nen estoit point, ton me tant isnelle Ne pourroit concevoir une Essence ternelle, ce sont l les lments dun platonisme chrtien, les mmes que Descartes devait utiliser soixante-dix ans plus tard 2.
1 2
BUSSON, ibid., p. 1744-176. BUSSON, ibid., p. 600-601.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
503
Un aspect particulier de cette influence de Platon doit attirer notre attention : cest la diffusion dans les milieux littraires et philosophiques des ides du Phdre et du Banquet sur lamour : lamour platonique () est fort diffrent de lamour de Dieu (caritas) que lvangile met au sommet des vertus ; celui-ci, quil soit considr par les thomistes comme foncirement p.753 identique lamour de soi ou par les Victorins et les Franciscains comme amour pur et dsintress, libre de toute attache avec les impulsions naturelles, est en tout cas une fin 1 ; lamour platonique, fils de la Ressource et de la Pauvret, est toujours dficient, dsir qui nest jamais satisfait et qui manque toujours de la beaut dont il est en qute, inquitude sans repos. Cette doctrine du Banquet se trouve en des ouvrages trs rpandus vers le milieu du XVIe sicle ; Balthazar Castiglione, dans le Parfait Courtisan (1540), dcrit tout le progrs par lequel lamour monte des beauts infrieures aux suprieures. Mais surtout Lon lHbreu, en ses Dialoghi di Amore (1535) soutient que lamour et le dsir concident souvent, que lamour sexprime dj dans le monde sublunaire par le dsir de gnration, quoiquil ne soit quune image affaiblie de lamour qui rgne dans le monde des intelligences 2. Pontus de Tyard, qui traduit Lon lHbreu en franais, fait en mme temps connatre dans le Solitaire premier (1552) la thorie de la folie amoureuse du Phdre, o la folie de lamour, cest--dire le fervent dsir que lme a de jouir de la divine et ternelle beaut est mise en parallle avec linspiration prophtique et linspiration potique ; et Ronsard, en ses Odes (I, X), suit Pontus de Tyard et dclare que les vers viennent de Dieu, non de lhumaine puissance . Lamour devient ainsi non plus le but dune vie suprieure, mais son point de dpart et son moteur 3.
V. LES PADOUANS : POMPONAZZI
@ Luniversit de Padoue, qui depuis 1405 dpendait de la srnissime rpublique de Venise, qui y nommait et y congdiait les matres sans intervention du pouvoir religieux, resta, p.754 au XVe et au XVIe sicle, un centre de libert ; lInquisition mme et plus tard les Jsuites qui y fondrent un collge voyaient leur puissance annule par le Snat vnitien : ltat laque se faisait ici le protecteur des philosophes 4. Le plus clbre de ses matres fut Pomponazzi (1462-1525), qui se pose la question suivante : supposer que nous ne possdions aucune rvlation divine, quelle ide devons-nous nous faire de lhomme et de sa place dans
1 2
Cf. ROUSSELOT, dans Beitrge der Geschichte der Philosophie der Mittelalters, VI. Cf. H. PFLAUM, Die Idee der Liebe Leone Ebreo, 1926, qui montre pourtant dans le dtail (p. 112 et 113), linfluence de saint Bonaventure. 3 BUSSON, ibid., p. 391-00. 4 Cf. R. CHARBONNEL, La pense italienne au XtlO sicle, p. 258-259.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
504
lunivers ? Question laquelle il trouvait une rponse chez Aristote et ses commentateurs. En son De immortalitate animae (1516) non seulement il dmontre que lme intellectuelle, insparable de lme sensitive (puisquelle ne peut penser sans images) doit tre mortelle comme le corps, mais il en tire les consquences pratiques (chap. XIII XVI) : lhomme, qui na aucune fin surnaturelle, doit prendre comme fin lhumanit mme et ses devoirs quotidiens ; il doit trouver dans lamour de la vertu et la honte du mal un suffisant motif daction ; il doit savoir que cest le lgislateur qui, connaissant le penchant de lhomme au mal et ayant gard au bien commun, a dcid que lme tait immortelle, non par souci de la vrit, mais de lhonntet, et pour amener les hommes la vertu. Voil ce que nous ne trouvions pas chez Siger de Brabant : une conception positive de la vie humaine sans rfrence la destine surnaturelle : on en voit tout de suite laccent stocien. Or cest la mme inspiration stocienne que nous trouvons dans le De Fato, libero arbitrio et de praedestinatione, crits en 1520 : ce quil y attaque surtout, cest la prtendue conciliation que lon a tent dtablir entre libre arbitre, destin et providence : Si lon pose la providence, lon pose le destin et lon dtruit le libre arbitre ; si lon pose le libre arbitre, on dtruit la providence et le destin. En cette affirmation de lidentit de la providence et du destin, on reconnat lesprit p.755 stocien ; et cest encore toute la thodice stocienne (qui est aussi celle de Plotin) que nous trouvons la fin du livre : tous les maux justifis parce quils rentrent dans le plan de lunivers, le mal insparable du bien, le cercle de la fortune qui fait distribuer aux hommes les sorts les plus divers, voil une conception du destin qui nannonce en rien celle du dterminisme scientifique o les faits dterminent les faits, mais qui reste celle du stocisme, o les parties sont dtermines par leur rapport au tout. De cette conception naturaliste, Pomponazzi tira les consquences en son De naturalium effectuum admirandorum causis seu de incantationibus liber, paru en 1556. La thorie du miracle quil y donne procde certainement plus de la doctrine stocienne et plotinienne de lunivers que dun sentiment du vritable dterminisme scientifique ; il ne lui suffit pas dopposer aux miracles le postulat du dterminisme scientifique ; il avoue (comme le fait Plotin) que les faits miraculeux sont des faits exceptionnels qui accompagnent par exemple ltablissement des religions et ne sont pas conformes au cours commun de la nature ; ils sont pourtant des faits naturels ; mais pour les expliquer, il faut aller, dans la connaissance de la nature, jusqu une profondeur que lon natteint pas dordinaire ; il faut connatre les forces occultes des herbes, des pierres et des minraux, telles que Pline lAncien les a dcrites ; il faut voir la sympathie qui lie lhomme microcosme aux diverses parties du monde et lui fait subir des influences distance 1 ; il faut enfin
Comparer PLOTIN, Ennade, IV, 4, 36-42.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
505
connatre la force de limagination, capable, par la suggestion, de produire des gurisons. Tout en se proclamant fidle croyant, Pomponazzi habituait donc les esprits une conception de lhomme et de lunivers indpendante du dogme ; il est pourtant remarquer que cette conception est fort loin de lexprience et des sciences p.756 positives, se rfrant seulement des conceptions de lunivers fort vieillies. Les aristotliciens de Padoue sont en revanche tout fait en dehors du courant qui mne de Buridan Kpler, Galile et Descartes : pendant tout le cours du XVIe sicle, le pripattisme italien oppose la nouvelle dynamique labsurde thorie dAristote sur le mouvement des projectiles 1. On le voit, le Padouan admet un univers stocien et mme plotinien, plus encore quaristotlicien. Les fameuses discussions quil y eut entre alexandristes et averrostes, cest--dire entre ceux qui prtendaient suivre Alexandre dAphrodisias ou Averros dans linterprtation de la thorie Aristotlicienne de lintelligence, ne touchent pas au fond des choses. Lalexandriste (comme Pomponazzi) admettait que lme tait mortelle, parce que lintellect possible sur quoi agit lintellect agent ntait rien autre chose quune disposition des organdi de lhomme, favorable cette action ; laverroste, admettant que lintellect possible est, comme lintellect agent, ternel mais aussi impersonnel, confrait lme humaine, en tant quelle participe la connaissance intellectuelle, une immortalit impersonnelle. Un des plus clbres averrostes est Nifo, dont le De Immortalitate (1518) combat Pomponazzi et que Lon X encourage dans sa lutte contre lalexandrisme 2 jug plus dangereux encore que laverrosme. Remarquons que ce prtendu alexandrisme reproduit lenseignement dAristocls, un des matres dAlexandre, qui tait tout imbu de la doctrine stocienne : cest donc encore le stocisme que nous retrouvons en cette interprtation dAristote : mais remarquons aussi que ce dbat implique que lon on tait rest une conception du mcanisme de la connaissance intellectuelle, depuis longtemps abandonne par les occamistes.
VI. LE DVELOPPEMENT DE LAVERROISME
@ Jrme Cardan (1501-1576), qui tudia Pavie, puis Padoue, jusquen 1525, et qui fut clbre comme mdecin, reprsente assez bien ce naturalisme padouan, cest--dire une conception stoco-plotinienne du monde (la thorie du monde de Plotin, isole de sa thorie des hypostases, est fort prs du stocisme) trs favorable loccultisme et lastrologie. Ce bohme
p.757 1 2
Cf. DUHEM, Bulletin italien, 1909. CHARBONNEL, ibid., p. 229.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
506
incorrigible dont Leibniz dit qu il tait effectivement un grand homme avec tous ses dfauts et aurait t incomparable sans ses dfauts 1, a laiss des Confessions (De vita propria) o il se dclare, entre autres choses dtracteur de la religion, vindicatif, envieux, mlancolique, dissimul, perfide, magicien . Il y a en effet chez lui une singulire histoire des religions ; considrant la grandeur et la dcadence des religions et leur distribution dans les divers climats, il les rapporte linfluence de conjonctions dastres et fait correspondre leur histoire aux grandes priodes cosmiques ; il tire lhoroscope du Christ n sous la conjonction de Jupiter et du Soleil, tandis que la loi judaque vient de Saturne 2. Dans son monde anim par une me unique dont lorgane est la chaleur, et qui renferme toutes les mes individuelles, dans ce monde, o tous les tres, mme en apparence insensibles, sont vivants, les influences magiques se propagent volont pour qui sait les capter. Cette conception de lme, appele parfois un esprit universel, dispose Cardan accepter laverrosme et rejeter limmortalit. Le mouvement padouan aboutit en Italie Cremonini (1550-1631), qui, professeur Padoue, fut en 1611 et en 1613 lobjet dune enqute en cour de Rome ; les points de doctrine quon lui reprochait davoir soutenus en son De Clo sont caractristiques de laristotlisme padouan : ternit et ncessit p.758 du ciel qui lamnent nier la cration, liaison intime de lme au corps qui lui fait nier limmortalit, action de Dieu comme dune simple cause finale, ce qui ne saccorde point avec la personnalit et la providence divine. Cest surtout le danger de ces propositions pour les croyances qui frappait les contemporains ; nous devons ajouter que, au moment o Copernic, Kpler et Galile avaient dj paru, le ciel dAristote avec son ternelle circulation et sa finalit ntaient plus que des vieilleries encombrantes : les platoniciens, nous le verrons, taient, bien autrement que les Padouans, attentifs au progrs scientifique. Il faut donc distinguer, dans la pense padouane, les constructions dogmatiques, si mdiocres et vieillies, de la critique morale et religieuse dont linfluence fut immense, surtout en France, et qui inaugure cette pense libre et indpendante qui, ne se traduisant en aucune doctrine philosophique arrte, se glissant de mille manires dans la littrature et la posie, devient habituelle chez ceux que lon a appels les libertins. Nombreux furent, vers 1540, les rapports intellectuels entre la France et lItalie 3. Calvin connat bien les Italiens et se mfie deux ; ce sont eux, crit-il en 1539, qui ont dit que la religion a est anciennement controuve par lastuce et finesse de peu de gens : fin de contenir par ce moyen le simple populaire en modestie 4. De 1542 1567, Vicomercato, appel par Franois Ier, enseigne laverrosme au
1 2
THODICE, 251. Cf. BAYLE, Dictionnaire, art. Cardan, Remarque P. 3 BUSSON, ibid., 1e partie, liv. I, ch. IV et V. 4 Initiation chrtienne, I, p. 5, d. Lefranc
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
507
Collge de France. Il a en France des lves comme Jean Fernel, qui, dans le De abditis rerum causis (1548), dpeint sous le nom de Brutus, un alexandriste convaincu.
VII. LE MOUVEMENT SCIENTIFIQUE : Lonard de Vinci
@ Le mensonge est si vil, crit Lonard de Vinci (1452-1519), que, mme sil parlait bien des choses de Dieu, il ferait perdre sa grce au divin ; la vrit est dune telle excellence quelle prte p.759 sa noblesse aux moindres choses quelle loue. La vrit, mme si elle traite dune chose petite et infrieure, dpasse infiniment les opinions incertaines sur les problmes les plus sublimes et les plus levs... Mais toi qui vis de songes, tu trouves ton plaisir plutt aux sophismes dans les choses releves et incertaines quaux conclusions sres et naturelles qui ne slvent pas cette hauteur. Cest l une opinion toute contraire celle des padouans ; et Pomponazzi dclarait que la noblesse dune science vient de la noblesse de son objet plutt que de la certitude de la dmonstration. Voyons bien tout ce quelle implique : dans les sicles dont nous venons dcrire lhistoire, on identifie le vrai avec Dieu mme ; le moyen datteindre le vrai est alors ou bien la rvlation de Dieu par son verbe, ou bien le raisonnement ; mais le vrai lui-mme est toujours au-dessus des moyens dont dispose lesprit humain. Si, au contraire, le vrai est dfini par les conclusions sres et naturelles, il est par l mme proportionn aux forces de lesprit humain et dfini sans nulle rfrence une ralit transcendante et extrieure lesprit. Mais aussi et par l mme, le vrai ne sexpose pas sous la forme dune vision systmatique et totale de lunivers (que cette vision soit due la rvlation, la raison ou aux deux ensembles), mais se dmembre en quelque sorte en une multitude de propositions, dont le lien ensemble consiste non pas exprimer un unique vrai mais dans la manire dent leur certitude a t acquise. Lonard, comme savant, sans accepter les rsultats de la dynamique des occamistes, est pourtant de ceux qui en ont propag lesprit ; critiquant les toiles daraigne du syllogisme, traitant les alchimistes et les astrologues de charlatans ou de fous , il est de ceux qui, comme Tartaglia, comme Galile, mettent au-dessus de tout les uvres dArchimde, reprenant les questions de dynamique au point o il les a laisses. Mais, dautre part, en Italien de la Renaissance, Lonard est un dynamiste qui, dans le mouvement, cherche le moteur spirituel, p.760 dans le corps humain, luvre de lme qui a ralis en lui son ide de la forme humaine ; et lesprit est dsir qui, avec une impatience joyeuse, toujours attend le printemps nouveau, toujours le nouvel t , et ce mme dsir est la quintessence insparable de la nature . On voit pourtant quelle diffrence il y a entre ce dsir, production jaillissante des formes toujours nouvelles, et lantique forme aristotlicienne qui impose aux choses un ordre statique et, autant que le permet la matire, ternel.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
508
VIII. LE PYRRHONISME : MONTAIGNE
@ Lon ne saurait attribuer trop dimportance ces penseurs qui, ddaigneux de tout systme, hommes parlant des hommes et non des matres enseignant des disciples, ont donn, dans ltude de lesprit humain, les mmes exemples de sincrit quun Lonard de Vinci dans ltude de la nature. Sans doute il y a les purs ngateurs, les libertins proprement dits tels que Bonaventure des Priers, qui, en son Cymbalum mundi (1537), crit dans la manire de Lucien, se moque de lvangile et de ses miracles. On trouve aussi, tout au long du XVIe sicle, un courant pyrrhonien et sceptique qui porte non pas contre la religion, qui mme est souvent daccord avec elle, mais qui est dirig contre la philosophie et la science proprement dite. Agrippa de Nettesheim, dans son trait Sur lincertitude et la vanit des sciences et des arts (1527) rappelle les vieilles diatribes du haut Moyen ge contre la dialectique : les sciences (et par l il entend aussi bien les mathmatiques que les arts de la divination ou lquitation) sont incertaines et inutiles, puisque la religion nous enseigne, elle seule, le chemin de la flicit. Omer Talon, lauteur de lAcademia (1548), dclare quAristote est le pre des athes et des fanatiques 1 , et il combat en lui la philosophie p.761 des paens et des gentils . Ainsi le pyrrhonisme, dont Rabelais donne, en raillant, des formules empruntes Sextus Empiricus, nest nullement antichrtien 2. Omer Talon y voit non pas une critique de la foi, mais la vraie philosophie qui est libre dans lapprciation et le jugement quelle porte sur les choses et non enchane une opinion ou un auteur . Son livre suit dailleurs, dans lessentiel, les Acadmiques de Cicron. Luvre de Rabelais et celle de Montaigne dpassent de haut ces crits de circonstances. Chez eux se crent ces formes littraires incomparables o la pense, libre de luniforme dialectique, va droit aux choses et aux hommes ; chez ces moralistes qui nont que peu de contact avec le mouvement scientifique du temps nat pourtant une conscience intellectuelle scrupuleuse, qui ne se laisse point facilement surprendre. La raillerie lucide de Rabelais ne mnage pas plus les disputeurs des Universits que les faiseurs de miracles ou de fausses dcrtales. Montaigne, loin de toute construction thorique, sefforce de trouver en lui-mme et chez les autres lhomme tel quil est, dans sa nudit intellectuelle et morale, sans les faux semblants que lui ajoutent les prtentieuses doctrines qui le dfinissent par sa relation lunivers et Dieu. On connat la page de l Apologie de Raymond sebond (Essais, II, XII) (1580) o Montaigne a dress une espce de bilan de la science de son sicle :
1 2
Cit par BUSSON, ibid., p. 237. Tiers livre de Pantagruel (1546), ch. XXIX.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
509
Le ciel et les estoilles ont branl trois mille ans ; tout le monde lavoit ainsi creu, jusques ce quil y a environ dix-huit cens ans que quelquun savisa de maintenir que cestoit la terre qui se mouvoit ; et, de nostre temps, Copernicus a si bien fond cette doctrine quil sen sert trs-reglement toutes les consequences astrologiennes... Avant que les principes quAristote a introduicts de Matire, Forme et Privation, fussent en credit, dautres principes contentoient la raison humaine... Quelles lettres ont ceux-cy, quel p.762 privilge particulier que le cours de nostre invention sarreste eux ?... Combien y a-t-il que la mdecine est au monde ? On dit quun nouveau venu, quon nomme Paracelse, change et renverse tout lordre des rgles anciennes... Et ma lon dit quen la geometrie (qui pense avoir gaign le haut point de certitude parmy les sciences) il se trouve des demonstrations inevitables subvertissans la vrit de lexprience : comme Jaques Peletier me disoit chez moi quil avoit trouv deux lignes sacheminant lune vers lautre pour se joindre, quil vrifioit toutefois ne pouvoir jamois jusques linfinit, arriver se toucher... Ceust t pyrrhoniser, il y a mille ans, que de mettre en doute la science de la cosmographie, et les opinions qui en estoient receus dun chacun ; cestoit heresie davouer des antipodes. Voil de nostre sicle une grandeur infinie de terre ferme... qui vient destre descouverte. Nul passage nindique mieux comment les esprits rflchis, la fin du XVIe sicle, prenaient conscience de la fragilit de la vision de lunivers au Moyen ge : ruine du gocentrisme, critique des principes dAristote, innovations mdicales, dcouverte des asymptotes, dcouverte du continent amricain, autant de faits qui montre que la raison natteint point, comme on lavait cru, des principes fixes et immuables sur lesquels se fonderait une science dfinitive : mathmatiques, astronomie, mdecine, philosophie, tout est ce moment en voie de changement. Est-ce pour substituer la vaine science une autre science qui, elle, sera dfinitive ? Montaigne est loin de le croire : Qui sait, dit-il en parlant de Ptolme et de Copernic, quune tierce opinion, dicy mille ans, ne renverse les deux prcdentes ? Et, malgr la dcouverte de Colomb, les gographes de ce temps ont tort dasseurer que meshuy tout est trouv et que tout est veu . Ce changement nest pas un tat provisoire ; cest ltat continuel de lesprit humain. Mais aussi le pyrrhonisme nest donc pas indiffrence et inertie ; cest le dogmatisme qui est inerte ; le scepticisme est une p.763 recherche, une enqute infinie dun esprit exigeant et difficile satisfaire. Montaigne nest pas, comme Omer Talon, un acadmicien ; il ne partage pas cette opinion moyenne et douce, introduicte par gens de composition , que nostre suffisance nous peut conduire jusques la cognoissance daucunes choses, et quelle a certaines mesures de puissance, outre lesquelles cest tmrit de lemployer. Son scepticisme ne saccommode pas des bornes fixes ainsi prescrites lesprit humain ; il est malais de donner des bornes nostre esprit ; il est curieux et avide... Ayant essay par experience... que les sciences et les arts ne se jettent pas en moule,
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
510
ains se forment et figurent peu peu en les maniant et pollissant plusieurs fois. ce que ma force ne peut descouvrir, je ne laisse pas de le sonder et essayer ; et en retastant et petrissant cette nouvelle matire, jouvre celuy qui me suit quelque facilit pour en jouyr plus son ayse ;... autant en fera le second au tiers, qui faict que la difficulte ne me doit pas desesperer, ny aussi peu mon impuissance, car ce nest que la mienne. La science dont il ne veut pas, cest celle qui prtend partir de principes fixes : de cette science il dit : Si (lhomme) advou lignorance des causes premires et des principes, quil me quitte hardiment tout le reste de sa science : si le fondement lui faut, son discours est par terre. Le critique de Montaigne ne porte donc pas sur les rsultats positifs des sciences, mais sur leurs prtendus principes et sur lassurance de ceux qui procdent dune troigne trop imprieusement magistrale (III, 8). Cest que lunivers de Montaigne, si lon peut ainsi parler, est aussi divers et vari que limage traditionnelle du monde, lgue par lantiquit, tait une et monotone : plus rien de cette analogie universelle qui dominait la conception des choses. Le monde nest que varit et dissemblance (II, 2). Il nest aucune qualit si universelle en cette image des choses que la diversit et varit... La ressemblance ne faict pas tant un, p.764 comme la diffrence faict autre (III, 13). Encore ne faut-il pas affirmer trop absolument cette diversit : lexprience nous fait voir aux nouvelles Indes, chez des nations nayant jamais ouy nouvelle de nous des usages et des croyances trangement semblables ceux des nations chrtiennes (II, 12). Y a-t-il donc un fonds naturel commun ? Que non pas ! Car il sagit de croyances qui par aucun biais ne semblent tenir nostre naturel discours . Ces ressemblances tonnent plus quelles ne rassurent : Cest un grand ouvrier de miracles que lesprit humain. Nulle nature unique et permanente au fond des choses. La nature humaine que les Stociens recommandent de suivre, nest rien quon puisse connatre ; sans doute il est croyable quil y a quelques lois naturelles, comme il se voit s autres cratures ; mais en nous, elles sont perdues, cette belle raison humaine singrant par tout de maistriser et commander, brouillant et confondant le visage des choses selon sa vanit et inconstance (II, 12). Dans ces conditions, le savoir doctrinal des savants de profession tire sa fixit non pas de la connaissance de la nature, mais de ceux qui veulent en establir leur fondamental suffisance et valeur . Cela nempche que en son vray usage, il est le plus noble et puissant acquist des hommes... chose de tres-noble et tres-pretieux usage, qui ne se laisse pas possder vil prix (III, 8). Et voil peut-tre la vritable dcouverte de Montaigne : la science par elle-mme ne fait pas pntrer lhomme dans une rgion divine et suprieure lhumanit ; elle tire sa valeur non de son objet, mais de son usage ; peu importe la vantardise dun chirurgien qui raconte ses gurisons sil ne sait de cet usage tirer de quoy former son jugement . La valeur de la science vient
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
511
de la valeur de lhomme qui la domine et qui lemploie. Et cest pourquoi Montaigne a comme perptuel sujet dtude lhomme, non pas la nature humaine universelle qui se drobe, non pas lhomme sauv par p.765 la grce de Dieu, mais lhomme tel quil le trouve en lui sans secours estranger, arm seulement de ses armes et desgarny de la grace et cognoissance divine (II, 12). De l lentreprise des Essais, dont le caractre mthodique se prcise mesure quil les crit : Jose non seulement parler de moy, mais parler seulement de moy (III, 8). Cest une espineuse entreprise, et plus quil ne semble, de suyvre une alleure si vagabonde que celle de nostre esprit, de penetrer les profondeurs opaques de ses replis internes, de choisir et arrester tant de memes airs de ses agitations... Il y a plusieurs annes que je nay que moy pour vises mes penses, que je ne contrerolle et nestudie que moy ; et si jestudie autre chose, cest pour soudain le coucher sur moy, ou en moy, pour mieux dire... Il nest description pareille en difficult la description de soy-mesure, ny certes en utilit (II, 6). Il ne sagit pas plus de se raidir contre lexprience, avec de prtendus principes rationnel, que de se laisser aller au gr du changement universel ; l aussi, il faut choisir et arrester , et cest luvre non pas dune raison qui nous fait prendre pied en un monde divin, mais dune rflexion sur soi, sincre, attentive et prolonge. Ce mme scepticisme actif a t soutenu, avec moins dclat, par le mdecin Franois Sanchez, dans son Quod nihil scitur (1581). Ce brviaire du scepticisme o il accumule les arguments contre lexistence dune science parfaite et complte (les choses sont tellement enchanes que la connaissance complte de lune delle impliquerait la connaissance du tout, qui nous est inaccessible) contient en revanche des conseils positifs pour atteindre ce que lhomme peut savoir des choses : il ne faut pas se tourner vers les hommes et leurs crits, ce qui est abandonner la nature, mais avant tout, se mettre par lexprience au contact avec les choses 1.
IX. MORALISTES ET POLITIQUES
@
p.766 Les XVIe sicle
conditions du dveloppement de la vie intellectuelle amenrent au une renaissance du stocisme : les auteurs anciens que lon lisait avec le plus de passion, Cicron, Snque et mme Plutarque, taient pntrs de ce stocisme populaire qui vise plus la direction de conscience qu lexpos dune doctrine philosophique raisonne. Pourtant, on peut peine dire quil sagit alors dune renaissance, puisquun fond dides stociennes, plus ou moins mconnues, navait jamais disparu pendant toute la priode mdivale : faut-il rappeler le stocisme de saint Ambroise, qui a conserv, comme fin des biens, laccord avec la nature et laccord avec soi 2 ; et
1 2
Cit par SORTAIS, La philosophie moderne, p. 40. De officiis, I, 135 ; I 85.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
512
combien les manuels de morale, tels que ceux dAlcuin 1, dHildebert de Lavardin 2 et tant dautres ont suivi Snque et Cicron dans leurs dfinitions des vertus et des vices et dans leur conception de lhonnte. La morale de Roger Bacon nest-elle pas dun bout lautre inspire de Snque ? La morale stocienne a pu se juxtaposer la vie proprement chrtienne ; mais le christianisme na jamais pu ni labsorber, ni la remplacer ; cest cette indpendance dont les Stociens de la Renaissance prennent conscience, sans aucune hostilit au christianisme dailleurs ; et au contraire, ce nostocisme sefforce daccorder la doctrine stocienne avec la vie chrtienne. Ce ntait pas sans protestation de la part dun Calvin qui, au contraire, dfend ardemment la doctrine chrtienne contre le reproche de stocisme ; il voit avec horreur la confusion que commettent malicieusement ses ennemis entre la prdestination et le fatum des stoques, cest--dire une ncessit laquelle soit contenue en nature par une conjonction p.767 perptuelle de toutes choses ; et il y a grande diffrence entre le chrtien qui porte la croix et le sage stoque qui semble tre du tout stupide et ne sentir douleur aucune 3. Il nen est pas moins vrai que, dans la seconde partie du XVIe sicle surtout, beaucoup desprits font leur nourriture des uvres morales de Cicron, de Marc Aurle et beaucoup plus encore de Snque et dpictte ; tous leurs livres sont traduits en franais, mdits, comments, imits. Ces ouvrages, procdant par images et par prceptes, qui simpriment dans lme par une sorte de ncessit immdiate et sans dmonstrations, qui correspondent au besoin de rconfort ou de consolation, ont un succs sans prcdent. Ils habituent lesprit faire comme un dpart entre la fin surnaturelle de nos actions que la rvlation seule peut faire connatre et la direction effective de notre conduite. Combien quiceluy M. T. Cicron et tous les autres Philosophes paens aient err par la dconnaissance de la fin dicelles bonnes uvres, nanmoins les chrtiens y peuvent apprendre et recueillir des doctrines profitables 4. Mais cest la doctrine stocienne tout entire, avec sa mtaphysique, que lrudit de Louvain Juste Lipse sefforce de faire connatre. Les excellents petits livres, o il a runi et class ce que lon pouvait savoir de son temps sur les Stociens (Manuductio ad Stoicam philosophiam, 1603, et Physiologia Stoicorum) principalement par Snque, sont prcds dune prface o lauteur a soin de nous avertir : Que personne avec les Stociens, ne place la fin des biens ou le bonheur dans la nature moins dentendre par la nature Dieu lui-mme. On peut dire que cest grce linspiration de Snque quil a pu nier dans le stocisme tout ce quil pouvait avoir de choquant pour la
1 2
MIGNE Patrologie latine, CI, p. 613 sq. Ibid., CLXXI, p. 1007. 3 Institution chrtienne, liv. I, ch. XVI, VIII ; liv. III, ch. VIII, IX. 4 Prface de Les Offices de M. T. Cicron, traduit par BELLEFOREST, 1583 ; cit par :alla Mlle ZANTA, La Renaissance du stocisme au XVIe sicle, p. 131 (sur les traductions, cf. tout le chap. III de la 2e partie).
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
513
conscience chrtienne : Snque lui dira par exemple que le destin p.768 nest que la volont de Dieu lui-mme et que Dieu est libre puisquil est lui-mme sa propre ncessit . On voit toute la porte pratique de ce nostocisme dans la vie et les uvres de Guillaume Du Vair (1556-1621) ; dune famille de magistrats, aprs avoir t fort suspect la Ligue, il devint avec lavnement de Henri IV matre des requtes au Parlement de Paris, puis premier prsident du parlement dAix. Son stocisme nest point, comme il semble lavoir t souvent cette poque, celui dun rsign qui puise seulement dans ses lectures la force de se soumettre linvitable ; il est (et cest l le vritable stocisme, celui dpictte) tout tendu vers laction ; son Trait de la Constance et Consolation s Calamitez publiques, crit en 1590, pendant le sige de Paris par le Barnais, alors quil soutenait, au pril de sa vie, la cause du roi lgitime, est tout anim du dsir de servir la patrie , de gurir la France de tous ses maux, le luxe de la noblesse, la simonie de lglise, la perversion de la justice. Ce nostocisme qui nat du dsir dune direction de conscience, est fort diffrent (et il y a l une sorte de paradoxe de lHistoire) de ce naturalisme stocien qui alimente lesprit des libres penseurs comme les Padouans ou les platoniciens de la fin de la Renaissance. Le sentiment de spiritualit, qui anime les stociens dont nous venons de parler, reste indpendant de telle ou telle conception de lunivers ; il concerne uniquement le for intrieur de lhomme, et, dtach de toute vision panthiste du monde, il est au contraire tout prt se lier avec la spiritualit platonicienne, dont nous avons dj indiqu la place. Il est intressant de voir que la Constance de du Vair se termine par les paroles du prsident de Thou son lit de mort, au sujet de la connaissance de soi : Il faut des discours, dit-il, pour connatre les choses dont les formes sont noyes en la matire : ... mais vouloir comprendre la nature de notre me de cette faon, cest ne la pas vouloir connoistre. Car estant simple comme elle est, il faut quelle entre toute nue en notre p.769 entendement, ayant remplir toute la place ; tout ce qui laccornpagneroit, lempescheroit... Et pour ce, le vray moyen de connoistre la nature de nostre me, cest de llever par dessus le corps et la retirer toute soy ; afin que rflchie en soy-mesme, elle se connoisse par soy-mesme 1. Ce stocisme, affirmation de lindpendance du moi, glisse vers le spiritualisme, affirmation de lautonomie de lesprit dans la connaissance quil a de lui-mme. Du stocisme, il reste, mme chez les moralistes qui ne sont pas proprement parler des stociens, une tendance trouver la source de nos maux dans un jugement mal rgl et quil dpend de nous de rformer. Cette ide dpictte, que lon trouve si parfaitement exprime chez Du Vair ( car notre volont a la force de disposer nostre opinion tellement quelle ne preste consentement qu ce quelle doit..., quelle adhre aux choses videmment
1
dition Flach, p. 621
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
514
vraies, quelle se retienne et suspende s douteuses, quelle rejette les fausses 1 fait aussi le fond de la Sagesse, de Pierre Charron (1603), si forte dailleurs que soit en ce livre linfluence de Montaigne. Si Charron se garde de donner au mot sagesse le sens hautain et enfl des thologiens et philosophes qui prennent plaisir descrire et faire peinture des choses qui nont pas encore est veues, et les relever telle perfection que la nature humaine ne sen trouve capable que par imagination (prface), il nen est pas moins vrai quil exige comme conditions de la sagesse, laffranchissement des erreurs et vices du monde et des passions , et la pleine libert desprit tant en jugement quen volont 2, ce qui est du pur pictte. Ajoutons que cette libert saccompagne du prcepte dobir et observer les lois, coutumes et crmonies du pays . Le moraliste est ainsi amen tudier lhomme tel quil est au lieu de chercher sa conduite quelque principe transcendant ; p.770 la connaissance de soi, cest--dire des faiblesses humaines, est, selon Charron, un lment important de la sagesse, et laffaire du moraliste est ds lors de peindre les passions et leurs causes. Dans le mme temps que ces morales humanistes, naissait une politique raliste qui ignorait tout du droit divin des princes ou dun contrat entre les princes et les peuples, qui ne voulait voir dans la socit que le jeu des forces humaines et le conflit des passions. Le type en est le clbre Prince de Nicolas Machiavel (1469-1527) qui acquiert, dans ses fonctions dagent diplomatique de la rpublique florentine, une exprience dont il nous donne les fruits. La plbe, sa nature est de se rjouir du mal..., une multitude sans chef nest aucune dutilit 3, voil les aphorismes qui justifient les moyens par lesquels le prince assure son autorit. Quil soit prince par la volont du peuple qui veut se servir de lui contre les grands, ou bien par la faveur des grands, il doit tout faire plier ; le prince nest pas un lgislateur, cest un guerrier ; la guerre, ses institutions et sa discipline sont le seul objet auquel un prince doive donner ses penses et son application et dont il doive faire mtier ; car cest l le vrai mtier de quiconque gouverne 4. Aussi bien un prince ne doit-il pas se mettre en peine du reproche de cruaut, lorsquil sagit de maintenir ses sujets dans lobissance. La vraie clmence ne consiste-t-elle pas faire quelques exemples de rigueur au lieu de laisser slever des dsordres qui bouleverseront la socit entire ? Le prince nest pas davantage oblig de tenir sa parole, si cette fidlit tournait son dtriment. Tout dpend ici des circonstances : un prince doit savoir agir propos, en bte et en homme ; il agit en homme quand il combat avec les lois ; mais cette manire
1 2
La Philosophie morale des Stoques, cite par ZANTA, p. 293. Livre II chap. I et II. 3 Histoire, II, 34 ; Discours, I, 44. 4 Prince, ch. XIV, traduit dans F. FRANZONI, La Pense de N. Machiavel, p. 173.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
515
de combattre ne suffit point, et il doit souvent agir en bte , cest--dire employer la violence. Ce sont bien des leons de ralisme que son poque trouva chez Machiavel, et un sicle plus tard, Franois Bacon pouvait crire : Il faut remercier Machiavel et les crivains de ce genre qui disent ouvertement et sans dissimulation ce que les hommes ont coutume de faire, non ce quils doivent faire 1.
p.771
Cest le problme du prince que Machiavel pose en Italie au dbut du sicle ; cest celui du tyran qutienne de la Botie (1530-1563) pose dans le Discours de la servitude volontaire, quil crivit, dit son ami Montaigne, nayant pas encore atteint le dix-huitiesme an de son ge, lhonneur de la libert contre les tyrans. Comment un nombre infini de personnes peut-il se laisser tyranniser par un seul, cest le problme de Machiavel, vu cette fois non du ct du prince, mais du ct des peuples. Le tyran ne pourrait rien, sil ne rencontrait de la part du peuple la volont dtre esclave : Cest le peuple qui sasservit, qui se coupe la gorge, qui, ayant le choix ou dtre serf ou dtre libre, quitte la franchise et prend le joug, qui consent son mal, ou plutt le pourchasse 2. Si le peuple cesse ainsi duser de son droit naturel , cest que les semences de bien que la nature met en nous sont si menues et glissantes quelles ne peuvent endurer le moindre heurt de la nourriture contraire ; elles ne sentretiennent pas si aisment comme elles sabtardissent, se fondent et viennent rien 3. Ainsi il y a, dans la pense de la Botie un sentiment du droit des peuples, un idalisme juridique qui lopposent en tout Machiavel.
X. UN ADVERSAIRE DARISTOTE : PIERRE DE LA RAME
@ Un lecteur moderne sera quelque peu tonn, en lisant les lgantes productions de Ramus (1515-1572), de la clbrit de son nom, des temptes quont souleves ses livres, des p.772 pisodes tragiques quils ont suscits. Cest quil faut voir en lui moins un philosophe spculatif quun homme de mtier qui smeut de la strilit de lenseignement dans les coles parisiennes, qui voudrait y porter remde, et qui se heurte toutes les rsistances de la routine. On connat ses tribulations : issu dune trs pauvre famille du Vermandois, il conquiert, en 1536, son grade de matre s arts en soutenant la thse suivante : Tout ce qua dit Aristote est fiction (commenticia).
1 2
De dignitate et augmentis scientiarum, liv. VII, ch. II, 10. Edition Paul Bonnefon, p. 56, 1922. 3 Ibid., p. 69.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
516
En 1543, il publie des Aristotelicae animadversiones ; les pripatticiens le poursuivent devant le Parlement ; laffaire est voque devant le roi ; Franois Ier, dans ses solicitudes pour accroistre et enrichir son royaulme de toutes bonnes lettres et sciences 1, interdit Ramus denseigner et de publier aucun livre ; car, dit larrt, parce quen son livre des Animaduersions il reprenoit Aristote, estoit videmment cogneue et manifestee son ignorance, voire quil avoit mauvaise voulente, de tant quil blasmoit plusieurs choses qui sont bonnes et vritables . Linterdiction fut leve par Henri II en 1551 et, pendant dix ans, Ramus enseigna avec clat au Collge de France, sans sortir du vieux cadre du trivium et quadrivium, puisque ses leons portrent sur la grammaire, la rhtorique, la dialectique, larithmtique et la gomtrie. Converti au calvinisme en 1562, il quitta Paris pendant les guerres civiles ; il trouva un accueil empress en Allemagne et en Suisse, o il professa de 1568 1570 ; rentr en 1570, il fut assassin deux jours aprs la Saint-Barthlmy, le 26 aot 1572 ; son collgue et implacable ennemi Charpentier est accus de ce meurtre. Professeur avant tout, il cherche apporter en toutes les matires quil enseigne une simplicit, une clart que lon ne connaissait plus. Il est, comme la dit Bacon, non sans ironie, le pre des Abrgs . Ses Animadversiones de 1543 vont p.773 rejoindre sa brve Dialectique de 1555, crite en franais, et ses Advertissements sur la rformalion de lUniversit de Paris au Roy, de 1562, o il proteste contre la complication de lenseignement. Son reproche essentiel Aristote tient sans doute en ses lignes : Il a voulu faire deux logiques, lune pour la science, lautre pour lopinion 2 ; Aristote a voulu sparer la discussion vivante, celle que pratiquent naturellement les potes, orateurs, philosophes et bref tous excellents hommes , dun certain amas chaotique de rgles qui sont de nul usage et qui encombrent lesprit. Tout Ramus est l : la logique ou dialectique est un art pratique, fond sur la nature. On commence par la doctrine, on croit connatre la logique pour savoir caqueter en lcole des rgles dicelle 3. Il faut linverse commencer par la nature et pratiquer longtemps potes, orateurs et philosophes. La dialectique de Ramus, comme on la not avec beaucoup de raison 4, est calque sur la rhtorique de Cicron et de Quintilien ; les deux parties quil y distingue, sont linvention, qui consiste trouver les arguments, et la disposition, qui consiste les mettre en ordre ; or ce sont l les deux premires parties de la rhtorique. Linvention est lancienne topique, qui indique les classes gnrales darguments : les causes, les effets ; etc. La disposition concerne la mise en forme de ses arguments ; la dernire partie de la
1 2
Arrt cit par WADDINGTON, Ramus, p.50. La Dialectique, p. 3. 3 La Dialectique, dition de 1576, p. 65. 4 G. SORTAIS, La philosophie moderne, p. 24, note 3, p. 39.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
517
disposition est la mthode, qui consiste grouper les arguments, une fois trouvs, dans lordre le plus clair possible. Il est donc noter que, chez Ramus, lordre reste entirement spar de la dcouverte des arguments. La mthode ou ordre na qu rsoudre des problmes de ce genre : les prceptes de grammaire tant mis chacun sur un carr de papier, puis, tous les carrs tant brouills, comment les ordonner ? Et Ramus de remarquer : Premirement, il p.774 ne sera pas besoing des lieux dinvention, car tout est j trouv. Il na donc pas le moindre pressentiment de cette intime liaison entre lordre et linvention que Descartes dcouvrit non pas chez les orateurs et les potes, mais dans les mathmatiques. Lon trouve dans certains traits contemporains un pressentiment plus net de la mthode. Acontio publie en 1558 un De methodo qui dfinit la mthode un procd correct qui, permet, en de de lexamen de la vrit (citra veritatis examen) de poursuivre la connaissance dune chose et denseigner convenablement la manire dont on la acquise 1. Cette dfinition contient donc deux parties : mthode dinvestigation et mthode dexposition. Cette mthode dinvestigation consiste aller du plus connu au moins connu, et le plus connu, cest pour Acontio non seulement des ides gnrales, mais des notions innes qui sont telles que, si on les profre, personne ne peut ne pas donner son assentiment, comme : le tout est plus grand que la partie . Pourtant la mthode reste un simple auxiliaire qui ne dispensera pas de lexamen de la thse laquelle elle amne. Malgr ces relles faiblesses, le ramisme a exerc, jusquau milieu du XVIIe sicle, un grand attrait, surtout en Allemagne. Ramus a parfaitement senti et not lexigence de clart qui caractrise son poque et qui lamne sortir des coles et crire en langue vulgaire : Quand je retourne des escholes grecques et latines, et desire lexemple et imitation des bons escholiers rendre ma leon la patrie... et lui declairer en sa langue et intelligence vulgaire le fruict de mon estude, japperoy plusieurs choses repugnantes ces principes, lesquelles je navoye peu appercevoir en leschole par tant de disputes 2. Ajoutons que, ennemi de laristotlisme, Ramus trouva sur sa route tous les lves des Padouans ; il attaquait Aristote non seulement comme logicien, mais comme libre penseur, comme p.775 auteur dune thologie qui nie la providence et la cration, et dune morale indpendante de la religion. Il eut donc contre lui tous les libertins du temps. Galland, lami du peripatticien padouan Vicomercato, dans sa rponse Ramus (Pro schola parisiensi contra novam Academiam P. Rami, 1551) lui oppose aussi le caractre indispensable dune morale indpendante, celle qui a appris aux paens les devoirs de la vie domestique, publique et civile, qui nous apprend refrner nos dsirs et
1 2
Cit par G. SORTAIS, La philosophie moderne de Bacon Leibniz, p. 46. Prface de la Dialectique, cit par WADDINGTON, Ramus, p. 405.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
518
nos passions ; quon recommande les devoirs envers Dieu, et la pit en passant sous silence les vertus civiques, aucun prix, je ne le supporterai 1 .
XI. LE PLATONISME : POSTEL ET BODIN
@ Lesprit platonicien a une exigence dunit qui fait dfaut tous les autres. Ce sont des tentatives dunit qui caractrisent les grands systmes qui closent lre de la Renaissance. Dabord leffort, de caractre pratique autant que thorique, de Guillaume Postel qui veut utiliser sa connaissance des langues orientales pour raliser lunit religieuse de la terre (de orbis terme concordia, 1542) et qui pense que cet accord est possible grce au caractre rationnel des vrits religieuses : hostile aux protestants qui rompent lunit chrtienne non moins quau catholicisme autoritaire qutablit le concile de Trente, il ne voit de salut que dans le retour lorigine oublie de toutes les religions, qui est la raison : il sagit avant tout pour lui de dmontrer contre les Padouans la cration ex nihilo et limmortalit personnelle ; et cest Platon quil leur oppose : Car, dit-il, pour contredire les Ides de Platon, les substances spares et, en gnral, la sagesse cre tout entire, ils en sont venus nier Dieu en le reprsentant comme contraint agir 2. Il faut ajouter que la religion rationnelle de Postel reste celle p.776 dun homme de la Renaissance, celle dun rudit qui, comme Marsile Ficin et Pic de la Mirandole, essaye de la rattacher une tradition dont il trouve les chos chez Platon, mais aussi dans la rvlation des Sibylles, dans la Kabbale juive, et chez les trusques, qui il consacre un livre : tradition qui vient de la Raison, conue cette fois non plus comme simple facult de raisonner, mais comme le Verbe, le Logos, lme du monde qui anime tous les tres et qui inspire les prophtes. Le juriste Jean Bodin est lauteur dune Rpublique (1577) o il oppose Platon Machiavel, en dclarant que lautorit de ltat reste soumise au droit naturel, quelle ne peut, par exemple, supprimer la proprit individuelle et que ltat na dautre fin que le souverain bien humain. Lide fondamentale de son Heptaplomeres est la mme que celle de Postel : dgager de toutes les religions existantes un contenu commun qui puisse devenir la religion universelle qui nest pas autre chose que le regard dun esprit pur vers le vrai Dieu ; mais sa religion est encore plus simplifie que celle de Postel, puisquelle ne contient gure que laffirmation du Dieu unique et de son culte par lexercice des vertus morales ; et, dans la pratique, il arrive une tolrance qui lui fait reconnatre toutes les religions afin de nestre pas accus
1 2
Cit par BUSSON, ibid., p. 225. Cit par BUSSON, p. 297.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
519
dathisme ou destre un sditieux capable de troubler la tranquillit de la Rpublique 1.
XII. LE PLATONISME ITALIEN : TELESIO
@ Des proccupations sociales dominent la pense de Postel et de Bodin : bien diffrents sont les spculatifs italiens dont nous allons parler : tous soutiennent cet animisme universel, cette thorie de lunivers vivant que nous avons dj rencontre p.777 chez les Padouans. Ce qui les en distingue, cest dabord quils sont hostiles Aristote, cest ensuite quils donnent leur doctrine comme une vision totale de la ralit qui se suffit et nest pas simplement juxtapose la foi. Cest dabord Telesio (1509-1518), qui, au dire de Franois Bacon, est le premier des modernes (novorum hominem primum). Il fait revivre lanimisme stocien, qui pouvait lui tre connu par Diogne Larce, Snque et Cicron : il admet le dynamisme avec ses deux principes : une force active et une matire tout fait inerte et passive ; seulement cette force motrice se ddouble en force expansive ou chaleur et force de contraction ou froid : expansion et contraction expliquent, par leurs divers degrs, toutes les diffrences qualitatives des tres. Cette force active est un corps, et lme du vivant, qui en est une partie, est galement un corps, un souffle ou pneuma, rpandu travers les cavits crbrales et les nerfs. Cette conception de lme, qui sera vulgarise dans la thorie courante des esprits animaux, implique, sur la nature de la connaissance, une thse analogue celle des Stociens : la sensation est un contact o lobjet modifie le souffle ou esprit, qui ragit par une activit propre de conservation ; cette activit de conservation (Telesio suit ici le livre III du De Finibus de Cicron) donne naissance la morale, grce la connaissance que lhomme prend de la solidarit de sa conservation avec celle dautrui ; et la principale vertu sociale, comme au De officiis de Cicron, est lhumanit, tandis que la vertu intrieure est la sublimit qui fait trouver le bonheur dans la vertu. Quant la connaissance intellectuelle, mmoire et pense, elle consiste en une conservation des sensations, capable de suppler aux sens, quand ils nous manquent. La sensation et la conscience se trouvent dailleurs non pas seulement chez les hommes et les animaux, mais en tous les tres de la nature dont le tout sympathique forme lanimal univers. Telesio soutient bien aussi la thse dune me immatrielle p.778 qui sajoute lautre et qui est en rapport avec notre destine surnaturelle ; mais il est difficile de voir dans cette addition autre chose quune mesure de prudence lgard des puissances de lglise.
1
Cit par BUSSON, p. 163.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
520
XIII. LE PLATONISME ITALIEN (suite) : GIORDANO BRUNO
@ G. Bruno (1548-1600) cite souvent parmi ses matres italiens Franois Patrizzi (1529-1597), le professeur de Ferrare et de Padoue qui contribua en effet beaucoup rpandre ce platonisme sotrique, qui mlange les ides des dialogues avec la mystique des livres hermtiques, et les oracles des Chaldens ; syncrtisme que nous allons retrouver chez Bruno. Il est dun cerveau ambitieux et prsomptueux, crit G. Bruno, de vouloir persuader aux autres quil ny a quune seule voie pour arriver la connaissance de la nature... Bien que la voie la plus constante et la plus ferme, la plus contemplative et la plus distincte et le mode de considrer le plus lev doivent toujours tre prfrs, ce nest pas une raison pour blmer un autre mode qui a de bons fruits, bien quils ne soient pas du mme arbre. Les picuriens ont dit beaucoup de bonnes choses, bien quils ne slvent pas au-dessus des qualits de la matire. Hraclite a bien des choses excellentes, bien quil ne dpasse pas lme. On tire profit dAnaxagore qui place au-dessus delle un intellect, le mme que Socrate, Platon, Trismgiste et nos thologiens ont appel Dieu 1. Nul passage ne peut mieux exprimer lclectisme de Bruno et son ambition dune philosophie totale ; il na quun ennemi, cest Aristote, lhomme injurieux et ambitieux, qui a voulu dprcier les opinions de tous les autres philosophes avec leurs manire de philosopher . richesse ou plutt cette profusion de penses chez un philosophe qui, comme plus tard Leibniz, ne veut rien perdre des spculations du pass, a toujours dconcert ceux qui ont voulu tenter un expos systmatique de la doctrine de Bruno. Une hirarchie dhypostases : Dieu, Intelligence, Ame du monde et matire, comme chez Plotin ; lhliocentrisme de Copernic avec linfinit des mondes qui lui est li ; lIdentit de Parmnide ; latomisme de Dmocrite avec une physique corpusculaire, voil les principales thses de Bruno, qui navaient gure accoutum de se trouver ensemble : nous avons vu le plotinisme intimement li au gocentrisme, qui seul peut lui fournir une image sensible de lunit, et Plotin condamne latomisme qui remplacerait la continuit de la vie par la composition mcanique. Verrons-nous donc chez Bruno, une suite de systmes successifs, ce qui parat bien impossible, dans les ouvrages quil a composs en une priode de dix ans de 1582 1592, de 34 44 ans ? Aimerons-nous mieux voir un tissu de contradictions dans ces livres que Bruno, qui avait abandonn son couvent de dominicains en 1576, crivit pendant une vie agite, suspect tous, aux luthriens comme aux
1 p.779 Cette
Della Causa, d. Gentile, I, p. 170.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
521
calvinistes, puis enferm huit ans dans les prisons du Saint-Office, do il ne sortit en 1600 que pour le bcher ? Certes il y a chez lui bien des inconsquences et mme des absurdits, comme son singulier atomisme mathmatique qui, composant des lignes de points, semble dater dun temps antrieur Platon, o les irrationnelles navaient pas encore t dcouvertes. Mais, pour le reste, Bruno a su au contraire dgager le platonisme de solidarits compromettantes : rappelons en effet que le platonisme, lorigine, nest nullement li, comme le systme dAristote, au gocentrisme, que Scot rigne, comme Nicolas de Cuse, deux grands platoniciens, matres particulirement aims de Bruno, ont t favorables lhliocentrisme des Pythagoriciens, que Platon lui-mme dans le Time aprs avoir parl du monde comme dun vivant et de son me, expose un atomisme qui p.780 constitue le monde de corpuscules, solides rguliers inscriptibles en des sphres : or cest cet atomisme de Platon (et non celui de Dmocrite) que Bruno se rfre dans le texte suivant : Pour Pythagore les premiers principes sont les monades et les nombres, pour Platon les atomes, les lignes et les surfaites 1 ; cest lui, et non picure, qui lui suggre lide de donner tous les atomes la figure sphrique. Bruno, en vritable intuitif, a rompu ainsi de sculaires associations dides ; les platoniciens vulgaires en restaient la contemplatio ordinis, la connaissance de lordre hirarchique des choses ; or elle nest que le quatrime degr dune chelle qui en comporte neuf, dont les deux derniers sont la transformation de soi-mme en la chose, et la transformation de la chose en soi-mme 2. Entre tous les moments de la connaissance, Bruno voit dailleurs une parfaite pntration : On peut dmontrer, crit-il, que sil y a dans le sens participation de lintelligence, le sens sera lintelligence elle-mme. Texte significatif o disparat cette opposition des sens lintellect qui est une des plus chres au platonisme vulgaire, et qui montre bien la tendance constante de Bruno : celle qui consiste glisser toujours de la participation lidentit, quil sagisse du sens et de lintellect, ou bien du sensible et de lintelligible. Cest ce qui explique les principaux traits de sa vision du monde : chez lui, toutes les hypostases, Dieu, Intelligence, Ame du monde, Matire se rduisent une seule, qui est la vie la fois une et multiple de lunivers, lanimal saint, sacr et vnrable 3 ; il ne peut, en particulier, admettre une matire qui ne soit quun non tre et qui ne contienne dj toutes les raisons sminales ; en quoi il scarte de Plotin moins quon ne le croit dhabitude, puisque, sous le nom de matire intelligible, celui-l a prcisment conu une ralit vritable et p.781 divine. Tous les individus ne peuvent tre pour lui que des modes de la substance unique, qui sont la substance comme les nombres
1 2
De Minimo, I, ch. X. Sigillus sigivorum, I, 34. 3 De Immenso, cit par CHARBONNEL, La Pense italienne, p. 455, n. 2.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
522
lunit, ou plutt comme les units composantes des nombres lunit primitive qui en est la condition ; Dieu est la monade des monades, lentit des tres, la substance des substances ou, comme le dit le De Immenso : ... Rerum facies dum tantum fluctuat extra, Intimius cunctis quam sint sibi quaeque, vigens est Entis principium, cunctarum fons specierum, Mens, Deus, Ens, Unum, Verum, Fatum, Oratio, Ordo 1. Tandis que la surface des choses reste flottante, il est plus intime toutes choses quelles ne le sont elles-mmes, principe vivant de ltre, source de toutes les formes, Esprit, Dieu, tre, Un, Vrai, Destin, Verbe, Ordre . Dans certains exposs, cet Esprit se dcompose en ralits de degrs diffrents : Esprit suprieur tout ou Dieu, Esprit insr en toutes choses ou Nature, Esprit qui traverse toutes choses ou Raison 2 ; en dautres, il ne sagit que dune ralit unique ; peu importent ces diffrences ; elles nont de prix que pour ceux qui veulent chercher si Bruno est partisan de la transcendance ou de limmanence, ce qui na de sens que lorsquon fait de Dieu et de la nature des ralits statiques et juxtaposes, ce qui nen a aucun lorsquon accepte le dynamisme de Bruno qui considre la force vivante et mouvante. Ainsi sexplique la thse de linfinit de lunivers, puisque linfini divin ne peut sexprimer que dans un univers galement infini. Ainsi sexplique, malgr le paradoxe apparent, mme latomisme (que lon pourrait appeler plus proprement la monadologie). Bruno, en effet, fait, comme plus tard Leibniz, de la simplicit la caractristique de la substance : p.782 Compositum porro nullum substantia vera est 3. Si, pour cette raison, il accepte les atomes, ce ne sont pas les lments impies 4 de Dmocrite ; la physique de Bruno nest point du tout mcaniste : en dehors des atomes, il y a lther rgion immense dans laquelle se meut et vit le monde 5, milieu remplissant lespace, corps de lme du monde par lequel les atomes se composent et se combinent, et, en chaque individu une me qui est comme le centre autour duquel se rassemblent et sordonnent les atomes : de telle sorte que Bruno garde simultanment la conception plotinienne de lindividu comme image du tout et microcosme et de lindivisible dmocriten comme unit composante. De son systme Bruno espre, comme Ficin du platonisme, la vritable unit religieuse, quil oppose celle des Rformateurs, ces esprits misanthropes semant partout la discorde, celle du catholicisme, fanatique, pessimiste et ennemi de la nature, celle du judasme avec son dieu jaloux et
1 2
De Immenso, VIII, 10, 1. De Minimo, dbut. 3 De Minimo, I, III, 29. 4 De Immenso, V, 8, 36. 5 De Minimo, I, 2, 10.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
523
sanguinaire 1 ; unit quil rattache la religion gyptienne , cest--dire au platonisme religieux dHerms Trismgiste. Cette religion est une gnose ; cest la connaissance pour lhomme que Dieu est voisin de lui, avec lui et plus intrieur lui que lui-mme il ne peut ltre 2). La pense de L. Vanini (1585-1619) est fort loin davoir la rigueur et lampleur de celle de Bruno ; cherchant partout asile contre ses perscuteurs et finalement victime de lInquisition, qui le fit brler Toulouse comme hrtique, il est surtout le propagateur et le vulgarisateur des thses des Padouans.
XIV. LE PLATONISME ITALIEN (suite) : CAMPANELLA
@ Laboutissant de ce courant animiste est le systme de Campanella qui, malgr son poque (1568-1639), reste bien un homme de la Renaissance : Son ouvrage le plus important, De Sensu rerum et magia, rdig en 1604 et publi en 1620, se donne dans le sous-titre comme une partie admirable de la philosophie occulte o il est dmontr que le monde est la statue de Dieu vivante et connaissante, que toutes ses parties et les parties de ses parties sont doues de sens, plus ou moins clair ou obscur, mais autant quil suffit pour sa conservation et celle du tout . Lon a reconnu le panpsychisme de Bruno et de Telesio : deux de ses principaux arguments pour dmontrer que le monde est un tre sentant, sont dorigine stocienne : il est sentant parce que certaines de ses parties sentent et ce qui est dans les parties est a fortiori dans le tout : argument de Chrysippe au De natura deorum de Cicron ; toutes ses parties sentent parce que, toutes, elles ont des instincts ou impulsions qui impliquent la sensation : argument qui emploie la thorie du De Finibus, mais en tendant tous les tres de la nature, comme Plotin lavait fait, ce que les Stociens disent seulement de lanimal. Campanella ne reconnat plus la hirarchie dAristote et des stociens entre lanimal, la plante et ltre inanim ; il ne voit plus l, comme Platon et Plotin, que des degrs : la facult nutritive suppose dj la facult sentante ; lintellect est identique au sens ; la bte pense dj et a une sorte de raison discursive (discursus universalis). A cette conception du monde se rattache la magie naturelle, conue la manire dont la concevait Plotin la IVe Ennade comme un art positif demployer les forces occultes qui manent des astres ou de la simple tension de la volont 3 ; cette action magique, qui est le type de laction p.784 naturelle, est tout loppos du mcanisme dont le triomphe tait si proche.
p.783 1 2
Cf. les textes dans CHARBONNEL, La pense italienne, p. 488-490. Cit par BLANCHET, Campanella, p. 452. 3 Cf. BLANCHET, Campanella, p. 217.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
524
Sur ce naturalisme sdifie une mtaphysique, qui dveloppe le principe du systme de Plotin : ce qui est sympathie dans le monde sensible est, dans la ralit intelligible, union intime et identit. La connaissance sensible nest quun contact de lobjet avec le sujet ; elle ne nous rvle de lobjet que laspect par o le sentant peut sidentifier au senti ; mais la connaissance intellectuelle a pour type la connaissance de lme par soi ; or toute connaissance est insparable de cette connaissance de soi ; en connaissant les choses, lme se connat parce quelle est ce quelle est : elle est les autres choses. au moment o elle se sent change en elles. Pourtant ce changement nest pas le savoir, mais la cause ou loccasion du savoir . Selon le mme principe les proprits communes et similitudes qui relient les choses donnent loccasion lme de contempler les Ides ; lassimilation du connu au connaissant, imparfaitement ralise dans nos concepts gnraux, lest parfaitement dans lIde. Lme et la nature conduisent Campanella jusqu un Dieu qui contient, en ses primalits , Puissance, Sagesse et Amour le modle de notre me et de toutes choses : lanalogie universelle permet ce sensualiste de slever du sensible lintelligible 1. En 1599, Campanella complota en Calabre o, se prsentant comme un nouveau Messie, il semble, daprs les pices du procs qui lui fut intent, avoir voulu raliser une rpublique thocratique analogue celle quil exposa plus tard dans la Cit du Soleil, compose en 1602 et parue en 1623. Lide centrale de cette utopie est celle dune renaissance de lhumanit grce une organisation plus productive. Il a un grand souci des ralits conomiques : On compte, dit-il, soixante-dix mille mes Naples, et cest peine sil y a dix ou quinze mille travailleurs p.785 dans le nombre. Aussi ceux-l spuisent et se tuent pour un travail au-dessus de leurs forces. Dans la cit du Soleil, les travaux tant galement distribus, chacun ne travaille pas plus de quatre heures par jour. Pourtant le rsultat conomique nest pas le principal : Quelques hommes slancent la dcouverte du nouveau monde, guids par lappt des richesses ; mais Dieu les y pousse dans un but bien plus lev. Cette ide dune humanit devenue une, qui atteindra une religion naturelle, foncirement identique dailleurs avec le Christianisme, est lide fondamentale de ceux qui, la Renaissance, ont fait revivre le platonisme.
XV. LE MYSTICISME ESPAGNOL
@ De mme que la mthode exprimentale de Lonard abandonne la construction mtaphysique de lunivers et voit dans les choses des quilibres momentans et changeants de forces, et non plus la ralisation dun plan idal, de mme la mystique espagnole qui en est contemporaine, abandonne les
1
GILSON, Le raisonnement par analogie chez T. Campanella, dans tudes de philosophie mdivale, p. 125.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
525
spculations sur la structure de la ralit divine. Les mystiques du XVIe sicle pratiquent lhumilit intellectuelle : Dieu, dit saint Jean de la Croix (mort en 1591) ne veut pas que nous leur ( nos rvlations intimes et personnelles) donnions entire crance, tant quelles nont point pass par ce canal humain quest la bouche de lhomme 1. La soumission lglise est complte. Le mme Jean de la Croix rpugne lide quil y ait un procd rationnel qui puisse mener lesprit du monde sensible Dieu : Aucune chose cre ni pense ne peut offrir lentendement un moyen convenable pour sunir Dieu. Tout ce que lentendement peut atteindre lui est plutt obstacle que moyen de sy attacher 2. Donc, on cherche dans lunion Dieu non point p.786 la rvlation de lessence des choses, ni en gnral une rponse une question, mais avant tout une libert intrieure, qui affranchisse de toute contrainte, une science immdiate qui soit indpendante de toute mditation et de tout raisonnement. Au tmoignage de sainte Thrse (1515-1582), les paroles divines intrieures, que le mystique ne peut pas ne pas entendre, qui transforment son me et qui ont une telle force que rien ne les peut effacer, se produisent pourtant dans lme des moments o elle est incapable de les comprendre et ne rpondent aucun dsir de les entendre 3. Le mystique cherche la perfection intrieure de son me, et non plus, comme Scot rigne ou Eckhart, la rvlation des principes de lunivers. Le contact entre la vie religieuse et lhistoire de la pense intellectuelle, qui durait depuis des sicles, change daspect dans un pareil mysticisme. Bibliographie @
1 2
M. DE UNAMUNO, LEssence de lEspagne, p. 215. Cf. J. BARUZI, Saint-Jean de la Croix, p. 412-413. 3 Vie de Sainte-Thrse, traduct. BOUIX, chap. XXV, p. 323.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
526
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
527
BIBLIOGRAPHIE
Gnrale - Priode hellnique - Priode hellnistique et romaine - Moyen ge et Renaissance @
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
528
BIBLIOGRAPHIE GNRALE
@
I. OUVRAGES GNRAUX UEBERWEG, Grundriss der Geschichte der Philosophie, 4 vol. : vol. 1, Das Altertum, par Praechter. 12e dit., 1926 ; vol. II, Die patristiche und scholastische Zeit, par Bauingartner, 11e dit., 1926 ; vol. III, Die Neuzeit bis zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts, par Frischeisen-Koehler et Moog, 12e dit., 1923 ; vol. IV, Die deutsche Philosophie im 19. Jahrhundert und die Gegenwart 12e dit., 1924) ; vol. V, Die Philosophie des Auslandes im 19. Jahrhundert und die Gegenwart, 12e d., 1924. Louis CAZAMIAN, Lvolution psychologique et la littrature en Angleterre, Paris, 1920. WEBER, Histoire de la philosophie occidentale, dernire dition Paris, 1925. RENOUVIER, Philosophie analytique de lhistoire, 4 vol., 1896-1897. DELBOS, Figures et doctrines de philosophes, 1918. BRUNSCHWICG, Les tapes de la philosophie mathmatique, 1912. BRUNSCHWICG, LExprience humaine et la causalit physique, 1922. BRUNSCHWICG, Le progrs de la conscience dans la philosophie occidentale, 2 vol., Paris, 1927. REVUES. Revue philosophique (depuis 1876), de mtaphysique et de morale (depuis 1893), des sciences philosophiques et thologiques (depuis 1911), de philosophie (depuis 1900) : Archiv fr die Geschichte der Philosophie (depuis 1886) ; Archives de philosophie (depuis 1923) ; Mind (depuis 1876) ; Revue dHistoire de la philosophie (1927-1929). FRANCK, Dictionnaire des sciences philosophiques, 1885.
II. ANTIQUIT. RITTER et PRELLER, Historia philosophiae graecae (Recueil de textes), 9e dit., par Wellmann, 1913. ZELLER, Die Philosophie der Griechen (Partie I, Die vorsokratische Philosophie, 6e dit., par Lortzing et Nestle, 1919-1920, traduit par Boutroux sur la 4e dit., 2 vol., 1877-1882 ; Partie II, section 1, Sokrates-Plato, 4e dit., 1888, trad. par Belot, 1884 ; section 2, Aristoteles, 3e dit., 1879 ; Partie III, section 1, (4e dit., 1909) et 2 (4e dit., 1903), Die nacharistotelische Philosophie. GOMPERZ, Les Penseurs de la Grce (traduit de lallemand par Reymond), 3 vol., 1908-1909 (jusquaux premiers pripatticiens). BURNET, Greek Philosophy, part. I : Thales to Platon, 1914. ROBIN, La Pense grecque et les Origines de lEsprit scientifique, 1923. A. et M. CROISET, Histoire de la littrature grecque.
III. - MOYEN AGE
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
529
Beitrge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters (Texte und Untersuchungen), par Bumker et Hertling (depuis 1891). HAURAU, Histoire de la philosophie scolastique, 3 vol., 1872-1880. DE WULF, Histoire de la philosophie mdivale, 4e dit., 1912, 5e dit., tome I, 1924. GILSON, La Philosophie au moyen ge, 2 vol., 1922.
IV. TEMPS MODERNES HFFDING, Histoire de la philosophie moderne (traduit par Bordier), 2 vol., 1906 ; Les Philosophes contemporains, (traduit par Tremesaygues), 1908. KUNO FISCHER, Geschichte der neuern philosophie, 10 vol., 38 h 5e dit., 1904-1921. DELBOS, La Philosophie franaise, 1919. SORLEY, A History of english Philosophy, 1920. ZELLER, Geschichte der deutschen Philosophie, 2e dit., 1873.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
530
I. PRIODE HELLNIQUE
@ CHAPITRE PREMIER. Les prsocratiques.
TEXTES DIELS, Die Fragmente der Vorsokratiker ; griechisch und deutsch, Berlin, 1903, ; 3e dit., 2 vol., 1912. DIELS, Doxographi graeci, Berlin, 1879.
TUDES DENSEMBLE BURNET, Early Greek Philosophy, Londres, 1892, 3e dit., 1920, (traduct. par Reymond : lAurore de la philosophie grecque, Paris, 1919). CORNFORD, From Religion to Philosophy ; a study in the origins of western speculation, Londres, 1912. DIS, Le Cycle mystique : la divinit, origine et fin des existences individuelles dans la philosophie antsocratique, Paris, 1909. DIS, Le problme de lUn et du Multiple avant Platon, Revue dHistoire de la philosophie, I, 1927. RIVAUD, Le Problme du devenir et la notion de la matire dans la philosophie grecque depuis les origines jusqu Thophraste, Paris, 1905. TANNERY, Pour lhistoire de la science hellne : de Thals Empdocle, Paris, 1887.
TUDES SPCIALES 1. Articles de DRFLER sur Thals dans Archiv fr Geschichte der Philosophie, XXV, 1912, p. 305 ; de TANNERY et de DIELS sur Anaximandre (ibid., VIII, 1895, p. 443 ; X, 1897, p. 228). II ABEL, Orphica. O. KERN, Orphica, 1922 ; de Orphaei Epimenidis Pherecydis theogoniis. MISS HARRISON, Prolegomena, p. 574. III. A. DELATTE, tudes sur la littrature pythagoricienne (dans : Bibliothque de lcole des Hautes Etudes, sciences historiques), Paris, 1915 ; La Vie de Pythagore de Diogne Larce, dition critique, Bruxelles, 1922 ; La Politique pythagoricienne (Bibliothque de la facult de philosophie et lettres de luniversit de Lige), Lige-Paris, 1922. G. MAUTIS, Recherches sur le pythagorisme. (Recueil de travaux de la facult des lettres de Neuchtel), 1922. IV. Max WUNDT, Die Philosophie des Heraklits. Archiv fr Geschichte der Philosophie, XXIX, p. 431. V. MACHIORO, Eraclito, Bari, 1922.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
531
V. M. LEVI, Senofane e la sua filosofia, Turin, 1904. H. DIELS, Parmenides Lehrgedicht, grechisch und deutsch, Berlin, 1897. BROCHARD, Sur Znon dle, tudes de philosophie ancienne et moderne, 1912, p. 3-22. CHIAPEI.LI, Sui fragmenti e sulle dottrine di Melisso di Samo (Rendiconti della Academia delli Lincei), 1890. VI. J. BIDEZ, La biographie dEmpdocle (Travaux de luniversit de Gand), 1894. BIGNONE, Empedocle, Studio critico, Turin, 1916. VII. J. GEFFCKEN, Die Asebeia von Anaxagoras, Hermes, XLII, n 1. VIII. uvres dHippocrate, texte et traduction par Littr, 10 vol., Paris, 1839-1861. DIS, Les uvres dHippocrate, Revue de philosophie, XXI, 1912, p. 56 et 663. IX. E. FRANCK, Plato und die sogenannten Pythagoreer, Halle, 1923. X. A. DYROFF, Demokritstudien, Munich, 1899. XI. H. GOMPERZ, Sophistik und Rhetorik, Leipzig, 1912. W. NESTLE, Die Schrift des Gorgias uber die Natur, Hermes, LVII, 1922, p. 51. BODRERO, Protagoras, Rivista di filologia, XXXI, p. 558.
CHAPITRE II. Socrate.
A. TAYLOR, Varia Socratica, Oxford, 1911. H. MAIER, Sokrates. Sein Werk und seine geschichtliche Stellung, Tbingen, 1913. L. ROBIN, Les Mmorables de Xnophon et notre connaissance de la philosophie de Socrate, Anne philosophique, 1910. E. HORNEFFER, Der junge Platon, 1922. L. ROBIN, Sur une hypothse rcente relative Socrate, Revue des tudes grecques, XXIX, 1916, p. 129.
CHAPITRE III. Platon.
UVRES Texte : Ed. J. Burnet, dans Scriptorum classicorum Bibliotheca Oxoniensis, 5 volumes. Traduction : uvres compltes par V. Cousin (12 vol. 122-1840), Saisset et Chauvet (10 vol., 1869). Texte et traduction : Time, par Th.-H. Martin, 2 vol., 1841. uvres compltes. (en cours de publication) dans la collection Guillaume Bud ; ont paru tomes I, II, III et VIII.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
532
TUDES GNRALES A. FOUILLE, La Philosophie de Platon, Paris, 1869 ; 2e dit., 1888-89. H. RAEDER, Platons philosophische Entwickelung, Leipzig, 1905. WILAMOWITZ-MOELLENDORF, Platon, 2 vol., Berlin, 1919. P.-E. MORE, Platonism, Princeton, 1917. W. PATER, Platon and Platonism, Londres, 1909 (Traduction franaise, Paris, 1923). C. PLAT, Platon, Paris, 1907. A. E. TAYLOR, Plato : The man and his work, New-York, 1927. C. RITTER, Platon, Mnchen, 1909. C. RITTER, Plato, sein Leben, seine Schriften, seine Lehre, vol. I, Munich, 1910. DIS, Platon, Paris, 1930. TUDES SPCIALES Ch. HUIT, La Vie et luvre de Platon, Paris. 1893. J. CHEVALIER, La Notion du ncessaire chez Aristote, Lyon, 1914, (p. 191-222 ; rsum des travaux sur la chronologie des dialogues de Platon). A. RIVAUD, ludes Platoniciennes : I. LAstronomie platonicienne, Revue dhistoire de la philosophie, II, 1928. I. et II. V. BROCHARD, Les Mythes de Platon. (tudes de philosophie ancienne et moderne, 1912, p. 46). P. FRUTIGER, Les Mythes de Platon, Paris, 1930. DIS, La Transposition platonicienne. (Annales de lInstitut de Louvain, II, 1913, p. 267.) IV. MILHAUD, Philosophes gomtres de la Grce, Paris, 1906. RODIER, Mathmatique et Dialectique dans le systme de Platon. (Archiv fr die Geschichte der Philosophie, 1902.) V. RODIER, volution de la dialectique de Platon, Anne philosophique, 1905. VI. L. ROBIN, Sur la doctrine de la Rminiscence, Revue des tudes grecques, XXXII, 1919, p. 451. VII. L. ROBIN, La Thorie platonicienne de lamour, Paris, 1908. VIII et. IX. V. BROCHARD, La Thorie platonicienne de la participation daprs le Parmnide et le Sophiste. (tudes, p. 113.) X. A. DIS, La Dfinition de ltre et la nature des ides dans le Sophiste, Paris, 1909. XI. J. SOUILH, La Notion platonicienne dintermdiaire dans la philosophie des dialogues, Paris, 1919. XII. L. ROBIN, La Physique de Platon, Paris, 1919. A. BRMOND, De lAme et de Dieu, dans la philosophie de Platon, Archives, de philosophie, II, cahier 3, 1924, p. 24.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
533
XIII. L. ROBIN, La Thorie platonicienne des ides et des nombres daprs Aristote, Paris, 1908. XV. V. BROCHARD, La Morale de Platon. (tudes, p. 169.) XVI-XXII. L. ROBIN, Platon et la science sociale, Revue de mtaphysique, 1913. A. ESPIANAS, Origines et Principes de la politique platonicienne. (Introduction ldition du livre VI de la Rpublique, Paris, 1886.) XXIII. P. LANG, De Speusippi Academici scriptis, Bonn, 1911. R. HEINZE, Xenokrates. Eine Darstellung der Lehre und Sammlung der Fragmente, Leipzig, 1892.
CHAPITRE IV. Aristote.
UVRES dition de lAcadmie de Berlin, par Bekker (t. I et II, 1831 ; tome III, traductions latines ; tome V, 1870 : Index aristotelicus, de Bonitz, et Fragments, par V. Rose). ditions partielles : Mtaphysique, d. Bonitz, Berlin, 1848-9 ; dit. Ross, Oxford, 1924 ; Organon, dit. Waitz, 1844-6 ; De lme, dit. Trendelenburg, 1833 ; thique Nicomaque, dit. Burnet, 1900 ; Politique, dit. Newman, 1887-92 ; Mtorologiques, dit. Ideler, 1834-36, dit. Fobes, 1919. Traductions franaises : uvres compltes, par Barthlmy Saint-Hilaire ; Mtaphysique, I-III, par Colle, 1912-1922 ; De lme, par Rodier, 1900 ; Physique, II, par Hamelin, 1900 ; Physique, IV, 1-5, par Carteron, 1923 ; Politique, par Thurot ; Constitution dAthnes, par Haussoulier, 1892 : thique nichomachenne, liv. I. et II, par Souilh ct Cruchon, Archives de philosophie 1929 ; Physique, liv. I IV, par Carteron, 1926. TUDES GNRALES Hamelin, Le systme dAristote, publi par Robin, 1910. WERNER, Aristote et lidalisme platonicien, Paris, 1910. PIAT, Aristote, 1903. LALO, Aristote, 1923. ROSS, Aristote, Londres, 1923 ; trad. fr., Paris, 1930. JAEGER, Studien zur Enstehunsgeschichte der Metaphysik des Aristoteles, Berlin, 1892. JAEGER, Aristoteles, Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung, 1923. TUDES SPCIALES I et II. H. MAIER, Die Syllogistik des Arisloteles, Tbingen, 1896-1900. C. THUROT, tudes sur Aristote, 1861. M. ROLAND-GOSSELIN, Les Mthodes de la dfinition daprs Aristote. (Revue des sciences philosophiques et thologiques, 1912.)
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
534
BRUNSCHWICG, Qua ratione Aristoteles metaphysicam vim syllogismo inesse demonstraverit, 1897. ROBIN, Sur la conception aristotlicienne de la causalit, Archiv fur die Geschichte der Philosophie, 1909. III IV. IX. RAVAISSON, Essai sur la mtaphysique dAristote, 1er vol., 1836 (rimprim en 1920). ROBIN, La Thorie platonicienne des Ides et des Nombres daprs Aristote, 1908. VII et VII. X. CARTERON, La Notion de Force dans le Systme dAristote, 1923. DUHEM, Le Systme du monde de Platon Copernic, tome I, p. 130-214, 1913. XI. POUCHET, La Biologie aristotlique, 1885. XII et XIII. OLL-LAPRUNE, La Morale dAristote, 1881. DEFOURNY, Aristote. Thorie conomique et socit, Louvain, 1914 ; Aristote et lducation, 1919 ; Aristote et lvolution sociale, 1924. XIV. THEOPHRASTE, Caractres, dit. Navarre, collection. G. Bud, 1921 ; Fragments, dit. Teubner. BERNAYS, Theophrastos Schrift uber die Frommigkeit, 1866. RODIER, La Physique de Straton de Lampsaque, 1891.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
535
II. PRIODE HELLNISTIQUE ET ROMAINE
@ CHAPITRE I. Les Socratiques.
II. C. M. GILLESPIE, On the Megarians, dans Archiv fr die Geschichte der Philosophie, 1911, tome XXIV, p. 218. ZELLER, Ueber den Kurieuon des Megarikers Diodorus dans Sitzungs-berichte der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, anne 1882, p. 151-159. III. F. DMMLER, Antisthenica, Berlin, 1882. J. GEFFCKEN, Kynika und Verwandtes, Heidelberg, 1909. G. RODIER, Conjecture sur le sens de la morale dAntisthne : Note sur la politique dAntisthne, dans tudes de philosophie grecque, Paris, 1926, p. 25-36, 303. IV. A. MAUESBERGER, Plato und Aristippus, Hermes, vol. LXI, 1926, p. 208-230 ; p. 363. Lorenzo COLOSIO, Aristippo di Cirene, Turin, 1925.
CHAPITRE II. Lancien stocisme.
I. P. H. ELMER MORE, Hellenistic philosophies, Princeton, 1923. KAERST, Geschichte des hellenistischen Zeitalters, 1901. WILAMOWITZ-MOFLLENDORF, Hellenistische Dichtung in der Zeit des Callimachos, Berlin, 1924, 1er volume, chapitre I. III. DYROFF, Lorigine de la morale stocienne (Archiv fr die Geschichte der Philosophie, tome XII). WELLMANN, Die Fragmente der sikelischen Aertze, Berlin, 1901. VELLMANN, Eine pythagoreische Urkunde des IV Jahrhunderts vor Christ, Hermes, 1919, p. 225. IV. Stoicorum Veterum fragmenta, coll. J. ab. Arnim. 3 vol., Leipzig, 1905, 1903 ; un quatrime vol. contient les Indices, 1914. OGEREAU, Essai sur le systme philosophique des stociens, 1885. F. RAVAISSON, La mtaphysique dAristote, tome II, Paris, 2e d., 1920. G. RODIER, Histoire extrieure et intrieure du stocisme. (tudes de philosophie grecque, 1926, p. 219-269.) BARTH, Die Stoa, Leipzig, 1908 ; 2e d., 1924. E. BRHIER, Chrysippe, 1910. R. HIRZEL, Untersuchungen ber Ciceros philosophische Schriften, 1883, 2e partie, 1e division : Le dveloppement de la philosophie stocienne. I. BEVAN, Stociens et Sceptiques, tr. fr. Paris, 1927.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
536
V. V. BROCHARD, De Assensione Stoici quid senserint, 1879. HEINZE, Zur Erkenntnisslehre der Stoa, 1886. A. LEVI, Sulla psicologia gnoseologica degli Stoici (Athenum, juillet et octobre 1925). V. BROCHARD, La logique des stociens. (tudes de philosophie ancienne, 1912, p. 221-251.) HAMELIN, Sur la logique des stociens. (Anne philosophique, 1902). E. BRHIER, La thorie des incorporels dans lancien stocisme, 1908. VI, VII, VIII. CAPELLE, Zur antiken Theodicee, Archiv fr die Geschichte der Philosophie, 1903. BONHOEFFER, Zur stoischen Psychologie, Philologus, vol. LIV, 1895. GANTER, Die stoische System der , Philologus, vol. LIII ; zur Psychologie der Stoa, ibid. vol. LIV. STEIN, Psychologie der Stoa, Berlin, 1886. IX. CICRON, Des Fins, livres III et IV. DENIS, Histoire des ides et des thories morales dans lantiquit, Paris, 1856. RODIER, La cohrence de la morale stocienne. (tudes, p. 270-308.) DYROFF, Die Ethik der alten Stoa, 1890. A. BONHOEFFER, Epiktet und die Sioa, 1890.
CHAPITRE III. Lpicurisme au IIIe sicle.
TEXTES Epicurea, dit. HERMANN USENER, Leipzig, 1887 (collection des fragments dpicure). Epicureae tres litterae et ratae sententiae, edit. VON DER MHLL (collection Teubner), 1922. (Cf. aussi Wiener Studien, 1888, tome X, p. 191.) Trois lettres, traduites par HAMELIN. (Revue de Mtaphysique, 1910, tome XVIII, p. 397.) Doctrines et maximes, traduites par M. SOLOVINE, Paris, 1925. Lettres et penses matresses, traduites par ERNOUT dans Le Commentaire de Lucrce, Paris (collection Bud), 1er volume, 1925. LUCRCE, De la Nature, texte et traduction par ERNOUT, 2 vol. de la collection Bud, 1920 ; Commentaire, par L. ROBIN, 2 vol. de la mme collection, 1925 et 1926. C. BAILEY, Epicurus, the extant remains, with short critical apparatus, translation and notes, Oxford, 1926. TUDES E. JOYAU, picure, 1910.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
537
GASSENDI, Syntagma philosophiae epicureae, dans Opera omnia, tome III, 1658. II. F. THOMAS, De Epicuri canonica, 1889. F. MERBACH, De Epicuri canonica, dissertation, Weida, 1909. III. LANGE, Histoire du Matrialisme, traduction, Paris, Schleicher, 1910, tome I, p. 84-150. IV. M. GUYAU, La Morale dpicure, 2e dit., 1881. V. BROCHABD, La Morale dpicure (dans tudes de philosophie ancienne et moderne, 1912, p. 294).
CHAPITRE IV. IIe et IIIe sicles : Scepticisme, nouvelle Acadmie.
I. POLYSTRATE, Du mpris irrationnel ou contre ceux qui slvent sans raison contre les opinions du vulgaire (dit. Wilke, Teubner, 1905) cf. PHILIPPSON, Neue Jahrbcher fr das Klassische Altertum, 1909, p. 487). II. WENDLAND. Philo und die kynisch-stosche Diatribe, Berlin, 1895. Teletis reliquiae, edit. Otto Hense, Freiburg, 1889. A. OLTRAMARE, Les origines de la diatribe romaine, Lausanne, 1926. III. BROCHARD, Les Sceptiques grecs, 2e d., Paris, 1923. GOEDECKEMAYER, Die Geschichte des griechischen Skepticismus, Leipzig, 1905. VI. HENSE, Aristo bei Plutarch, Rheinisches Museum, XLV, 1890. V et VI. Mmes ouvrages quau n III. CREDARO, Lo Scetticismo degli Academici, 2 vol., Milan 1889, 1893. R. HIRZEL, Untersuchungen ber Ciceros, philosophischen Schriften, IIIer Theil, 1883. P. COUISSIN, Lorigine et dvolution de lE, Revue des tudes grecques, 1929, XL, p. 373.
CHAPITRE V. Courants dides au Ier sicle avant notre re.
I. A. SCHMEKEL, Die Philosophie der mittleren Stoa in ihrem geschichtlichen Zusammenhange, Berlin, 1892. A. BESANON, Les adversaires de lHellnisme Rome, Paris, 1910, chap. V. Panaetii et Hecatonis fragmenta, d. Fowler, dissert., Bonn, 1885. II. J. BAKE, Posidonii Rhodii reliquiae doctrinae, Leyde, 1810. K. REINHARDT, Poseidonios, Munich, 1921. J. HEINEMANN, Poseidonios. Metaphysische Schriften, I, Breslau, 1921. W. JAEGER, Nemesios von Emesa (Quellenforschungen zum Neuplatonismus und seinen Anfngen bei Poseidonios), Berlin, 1914.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
538
POHLENZ, De Posidonii (Jahrbcher fr class. Philologie. Supplement band XXIV, 1898). W. CAPELLE, Die Schrift von der Welt, Neue Jahrbcher f. d, kl. A., XV, 1905, p. 55. W. CAPELLE, Die griechische Erdkunde und Poseidonios. Ibid., XXXIII, 1920, p. 305. III. Editions des fragments de Philodme dans la bibliothque Teubner ; en outre le est dit par Diels, Preuss. Akademie der Wissenschaften, 1916, n 4 et 6. (Cf. Philippson, Hernies, LIII, p. 358, et LIV, p. 216.) V. DE FALCO, Lepicureo Demetrio Lacone, Naples, 1923. C. GIUSSANI, Studi lucreziani, Turin, 1906. LUCRECE De la Nature, dition et traduction Ernout, coll. Guillaume Bud, 2 vol., 1920 ; Commentaire de L. Robin, ibid., 2 vol., 1925 et 1926. MARTHA. Le Pome de Lucrce.
CHAPITRE VI. Courants dides aux deux premiers sicles de notre re.
I. ROBIOU, De lInfluence du stocisme lpoque des Flaviens et des Antonins, 1852. G. BOISSIER, La Fin du paganisme. DENIS, Histoire des thories et des ides morales dans lantiquit, 1856. III. Musonii Rufi fragmenta, ostendit O. HENSE, coll. Teubner, 1905. IV. MARTHA, Les Moralistes sous lEmpire romain, Paris ; tudes morales sur lantiquit ; lexamen de conscience. R. WALTZ, La Vie politique de Snque, 1909. E. ALBERTINI, La Composition dans les ouvrages philosophiques de Snque, 1923. V. L. WEBER, La Morale dpictte et les besoins prsents de lenseignement moral, Revue de Mtaphysique, 1905. A. BONHDEFFER, Epiktet und die Stoa, 1890. A. BONHDEFFER, Die Ethik des Stokers Epiktet, 1894. A. BONHDEFFER, Epictet und das neue Testament, Giessen, 1911. J. BRUNS, De schola Epicteti, Kiel, 1897. T. COLLARDEAU, tude sur pictte, 1903. Les Entretiens dpictte, traduction par Courdaveaux, 1908. VI. RENAN, Marc-Aurle. Penses de Marc-Aurle, trad. Couat, Bordeaux, 1904 ; dition et traduction, par Trannoy, dans la collection G. Bud, 1925. VII. BROCHARD, Les Sceptiques grecs, 1887, 2e dit., 1921. GOEDECKEMEYER, Die Geschichte des griechischen Skepticismus, Leipzig, 1905.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
539
IX. PHILON, Allgories des Saintes Lois, dit. et trad. par . Brhier, Paris, 1908. . BRHIER, Les Ides philosophiques et religieuses de Philon dAlexandrie, 1907, 2e dit., 1924. XI. B. LATZARUS, Les Ides religieuses de Plutarque, Paris, 1920. VOLKMANN, Leben, Schriften und Philosophie des Plutarch von Chrona, Berlin, 1869, 1873. O. GRARD, De la Morale de Plutarque, 1865. E. GUIMET, Plutarque et lgypte, 1898. XII. FREUDENTHAL, Hellenistische Studien, 1879, III, p. 322. T. SINKO, De Apulaei et Albini doctrin platonic adumbratione (Dissertat. philol. Acad. litt. Cracov., t. XLI, p. 129), Cracovie, 1905. P. VALLETTE, LApologie dApule, Paris, 1908. P. MONCEAUX, Apule ; roman et magie, 1888 ; Les Africains. tude sur la littrature latine dAfrique. Les Paens, 1894.
CHAPITRE VII. Le Noplatonisme.
I. E. VACHEROT, Histoire critique de lcole dAlexandrie, 3 vol., 1846. J. SIMON, Histoire de lcole dAlexandrie, 2 vol., 1843-1845. T. WHITTAKER, The Neoplatonists, 1901 ; 2e dit., 1918. W. R. INGE, The Philosophy of Plotinus, Londres, 1918. HEINEMANN, Plotin, 1921. R. ARNOU, Le dsir de Dieu dans la philosophie de Plotin, Paris, 1921. E. BRHIER, La philosophie de Plotin, dans Revue des cours et confrences, 1922. PLOTIN, Ennades (avec PORPHYRE, Vie de Plotin), dit. et trad. par E. BRHIER, coll. G. Bud ; tomes I et II, 1924 ; tome III, 1925 ; tome IV, 1927 ; tome V, 1931. H. F. MLLER, Ist die Metaphysik des Plotinos ein Emanationssystem, Hermes, XLVIII, 1913, p. 409. II. CUMONT, Les Religions orientales dans le paganisme romain, 1928. COCHEZ, Les Religions de lEmpire dans la philosophie de Plotin, 1913. III. J. BIDEZ, Vie de Porphyre, Gand, 1913. IV. J. BIDEZ, Jamblique et son cole, Revue des tudes grecques, 1919, p. 29-40. (Cf. Bulletin de lAcadmie royale de Belgique, 1904, p. 499.) Jamblichi Theologumena Arithmetic, dit. de Falco, coll. Teubner, 1922. (Cf. Rivista indo-greco-italica VI, 1922, p. 49.) V. Proclus, Commentaire du Parmnide, trad. CHAIGNET, 1900-1902. dition dans la collection Teubner des Commentaires Sur la Rpublique (2 vol., Kroll,1899-1901), Sur le Time (2 vol., Diels, 1900-1904), Sur le Parmnide
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
540
(Pasquali 1908), Esquisse des thses astronomiques (Manitius, 1907), Institution physique (Ritzenfeld, 1912), Sur Euclide (Friedlein, 1873). dition Cousin de la traduction latine par G. DE MORBEEKE des opuscules sur la providence, la libert et le mal, du commentaire sur Alcibiade, 1864. VI. C. E. RUELLE, Le Philosophe Damascius. tudes sur sa vie et ses crits, 1861. DAMASCIUS, De Principiis, d. Ruelle, 2 vol., Paris 1889-1891. DAMASCIUS, Des principes, traduit par CHAIGNET, 1898.
CHAPITRE VIII. Hllnisme, Christianisme.
I. A. HARNACK, Lehrbuch der Dogmengeschichte, 3e dition, 3 volumes, Freiburg et Leipzig, 1894-1897. J. TIXERONT, Histoire des dogmes dans lantiquit chrtienne, 8e, 6e et 4e ditions, Paris, 1921, 1919, 1915. CORBIRE, Le Christianisme et la fin de la philosophie antique, 1921. II. E. RENAN, Saint Paul (3e vol. de lHistoire des origines du christianisme). TOUSSAINT, LHellnisme et laptre Paul, 1921. A. BONHFFER, Epictet und das neue Testament, Giessen, 1911. III. A. PUECH, Les Apologistes grecs du IIe sicle de notre re, Paris, 1912. JUSTIN, Apologies, texte grec et traduction par L. PAUTIGNY, 1904 ; Dialogue avec Tryphon, texte grec et traduction par G. ARCHAMBAULT, 1909 (dans la collection des textes et documents dHemmer et Lejay, Paris, A. Picard). IV. E. DE FAYE, Introduction lhistoire du gnosticisme, 1903 ; Gnostiques et gnosticisme, tude critique des documents du gnosticisme chrtien aux IIe et IIIe sicles, 1913. BOUSSET, Die Hauptprobleme der Gnosis, 1907. F. CUMONT, Recherches sur le manichisme, I. La Cosmogonie manichenne daprs Thodore Bar Khni, Bruxelles, 1908. V. E. DE FAYE, Clment dAlexandrie, 1898, 2e d., 1903. E. DE FAYE, Origne, vol. I. Sa biographie et ses crits, 1923. DENIS, La Philosophie dOrigne. C. BIGG, The Christian Platonisits of Alexandria, Oxford, 1913. VI. P. DE LABRIOLLE, Histoire de la littrature latine chrtienne, 1920, 2e d., 1923. Ch. GUIGNEBERT, Tertullien, 1901. L. GRANDGEORGE, Saint Augustin et le noplatonisme, 1896. J. MARTIN. Saint Augustin, 1.301. P. ALFARIC, Lvolution intellectuelle de saint Augustin, 1918. Ch. BOYER, LIde de vrit dans la philosophie de saint Augustin, 1920. THAMIN, Saint Ambroise et la morale chrtienne au IVe sicle, 1895.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
541
VII. Cf. les manuels dHARNACK et de TIXERONT, cits au 1. C. GRONAU De Basilo, Gregorio Nazianzeno Nyssenoque Platonis imitatoribus, Gottingae, 1908. J. DURANTEL, Saint Thomas et le pseudo-Denis (Introduction : La question du pseudo-Denis), 1919.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
542
III. MOYEN GE ET RENAISSANCE
@ CHAPITRE I. Les dbuts du Moyen ge 1.
I. B. HAURAU, Histoire de la philosophie scolastique, t. I (jusqu la fin du XIIe sicle), 1872 ; t. II (en 2 parties), 1880. B. HAURAU, Notices et extraits de quelques manuscrits latins de la Bibliothque nationale, 6 vol., Paris, 1890-1893. M. DE WULF, Histoire de la philosophie mdivale, 3 vol., Paris. et Louvain, 5e d., 1924-1926. A. VACANT, Dictionnaire de thologie catholique, 1839-1919. M. GRABMANN, Die Geschichte der scolastischen Methode, Freiburg, 2 vol., 1909-1911. P. DUHEM, Le systme du monde, histoire des doctrines cosmologiques de Platon Copernic, t. II, 1914 (Astronomie chez les Arabes et chez les Pres de lglise) ; t. III, 1915 (Astronomie latine au Moyen ge) ; t. IV, 1916 (Astronomie latine au Moyen ge, noplatonisme arabe) ; t. V, 1917 (La crue de laristotlisme). F. PICAVET, Esquisse dune histoire gnrale et compare des philosophies mdivales, 2e d., 1907. . GILSON, La Philosophie au Moyen ge, t. I, de Scot rigne S. Bonaventure ; t. II, de S. Thomas dAquin G. dOccam, Collection Payot, Paris, 1922 (Cf. les chroniques de GILSON sur lhistoire des philosophies mdivales dans la Revue philosophique, p. 454, 1924 ; p. 289, 1925 ; p. 295, 1927). . GILSON, Le Sens du rationalisme chrtien, dans tudes de philosophie mdivale, Strasbourg, p. 1-29, 1921. J. A. ENDRES, Geschichte der mittelalterlichen Philosophie im christlichen Abendland, Kempten und Mnchen, 1908. A. DUFOURCQ, Histoire ancienne de lglise, t. IV (Le Christianisme et lEmpire), t. V (Le Christianisme et les Barbares) ; Histoire moderne de lglise, t. VI (1049-1300) ; t. VII (1294-1527), Paris, 1925. Parmi les revues spciales, mentionnons (en dehors des revues cites la fin de lIntroduction) : Revue noscolastique, Rivista neoscolastica, Archives dhistoire doctrinale et littraire du Moyen ge, diriges par GILSON et THRY (depuis 1926) ; Revue thomiste, Revue dhistoire franciscaine (depuis 1924), Gregorianum. II. A. HARNACK, Lehrbuch der Dogmengeschichte, 3e d., t. II et III, 1894. TIXERONT, Prcis de lhistoire des dogmes, t. II, 6e d., 1921 ; t. III, 4e d., 1919. III. EBERT, Histoire de la littrature latine chrtienne, trad. fr., p. 516 sq. P. DE LABRIOLLE, Histoire de la littrature chrtienne, livre V, chapitre II. uvres de BOCE, MIGNE. Patrologie latine, t. LXIII et LXIV.
1
Nous indiquons ici les ouvrages fondamentaux qui doivent tre toujours sous la main de ceux qui tudient la pense du moyen ge ; nous nous dispenserons dy renvoyer dans la bibliographie de dtail des chapitres.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
543
uvres de CLAUDIEN MAMERT, MIGNE, Patrologie, t. LIII. uvres de MARCIANUS CAPELLA, Teubner, Leipzig, 1866. uvres de CASSIODORE, MIGNE, t. LXIX et LXX. R. DE LA BROISE Mamerti Claudiani vita ejusqua doctrina de anima hominis ; Paris, 1890. H.-F. STEWART, Boethius, Edinburgh, 1891. T. VENUTI DE DOMINICIS, Boezio, Grotta ferrata, 1911. M. GRABMANN, Die Geschichte der scholastischen Methode, t. I, Freiburg, p. 148 sq., 1909. IV. ISIDORE DE SVILLE, Etymologiarum libri XX, MIGNE, Patrologie, t. LXXXII. BDE LE VNRABLE, De natura rerum ; MIGNE, t. XC ; Historia ecclesiastica, MIGNE, t. XCV ; de Temporibus, t. XC. VINCENT DE LRINS, Commonitorium ; MIGNE, t. L. RHABAN MAUR, De institutione clericorum, MIGNE, t. CVII ; De Universo, t. CXI. ALCUIN, uvres, MIGNE, t. C, et CI. LA FORT, Histoire dAlcuin, Paris, 1898. V. JEAN SCOT RIGNE, De praedestinatione, MIGNE, Patrologie latine, t. CXXII, p. 355-439 ; De divisione natur, ibid., p. 442-1022. J. DRSEKE, Johannes Scotus Erigena und dessen Gewhrsmnner in seinem Werke de divisione naturae (Studien zur Geschichte der Theologe und Kirche, de Bonwetsch et Seeberg, t. IX, 1902) ; Cf. Zeitschrift fr wissenschaftliche Theologie, 1903 et 1904. M. JACQUIN, Revue des sciences philosophiques et thologiques, p. 674, 1907, et p. 104 et 747, 1908. H. BETT, Johannes Scotus Erigena, a study in mediaeval philosophy, Cambridge, 1925 (Cf. KOYR, Revue dHistoire de la philosophie, p. 241, 1927).
CHAPITRE II. Le Xe et le XIe sicle.
I. - FRDGISE, Epistola de nihilo et tenebris, MIGNE, Patrologie latine, t. CV. GERBERT, De rationali et rationalibus uti, MIGNE, t. CXXXIX, p. 159-168. Ps.-RHABAN MAUR, Super Porphyrium (dans COUSIN, uvres indites dAblard), p. XVI et LXXVI. PASCHASE. RADBERT De corpore et sanguine domini. MIGNE, t. CXX, p. 1263-1350. Sur la controverse de BRENGER, Cf. les crits de HUGUES DE LANGRES (MIGNE, t. CXLII, p. 1325), dADELMANN DE LIGE (MIGNE, t. CXLIII, p. 1289 et HEURTEVENT, Durand de Troarn. p. 287-303), dALGER DE LIGE (MIGNE, t. CLXXXIX, p. 740 sq.), de LANFRANC (MIGNE, t. CL, p. 410-442), de DURAND DE TROARN (MIGNE, t. CXLIX, p 1375).
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
544
J. ENDRES, Fredegisus und Candidus, Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, Philosophisches Jahrbuch, p. 439-446, 1906. AD. FRANCK, Gerbert (dans : Moralistes et philosophes), Paris, 1872. GERBERT, uvres, dition Olleris, Clermont-Ferrand, 1867. EBERSOLT, Essai sur Brenger de Tours et la controverse sacramentaire au XIe sicle, Paris, 1903. R. HEURTEVENT, Durand de Troarn et les origines de lhrsie brangarienne, Paris, 1912. III. - PIERRE DAMIEN, uvres, MIGNE, t. CXLIV-CXLV. J. ENDRES, Die Dialektiker und ihre Gegner in XI Jahrhunderte, Philosophisches Jahrbuch, 1906. J. ENDRES. Petrus Damiani und die weltliche Wissenschaft, Beitrge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, t. VIII, Mnster, 1910. IV. - SAINT-ANSELME, uvres, MIGNE, Patrologie latine, t. CLVIII et CLIX, Proslogion, dit. et trad. KOYR, Paris, 1930. A. DANIELS, Quellenbeitrge und ntersuchungen zur Geschichte der Gottesbeweise im XIIIe Jahrhunderte (Beitrge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, t. VIII, 1909). Publie le texte de PROSLOGION, ch. I, II et III, et celui de GAUNILO, Liber pro insipiente. CHARLES DE REMUSAT, Anselme de Cantorbry, Paris, 1854. Revue de philosophie, dcembre 1909 (numro consacr Saint Anselme : articles de DUFOURCQ, DOMET DE VORGES, PORE, DRAESEKE, LEPIDI, GEYSER, ADLOCH, BEURLIER, BAINVEL, MARCHAUX). A. KOYR, LIde de Dieu dans la philosophie de Saint Anselme, Paris, 1923. V. - ROSCELIN, Lettre Ablard, MIGNE, Patrologie, t. CLXVIII, p. 357 (Edition nouvelle de REINERS dans Beitrge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, t. VIII, 1910). F. PICAVET, Roscelin, philosophe et thologien daprs la lgende et daprs lhistoire, Paris, 1911.
CHAPITRE III. Le XIIe sicle.
CH. H. HASKINS, The Renaissance of the twelfth Century, Cambridge, 1927. I. BERNOLD DE CONSTANCE, uvres, MIGNE, Patrologie latine, t. CXLVIII, p. 1061. RADULFUS ARDENS, Speculum universale, indit analys par GRABMANN, Geschichte der scholastischen Methode, p. 246. YVES DE CHARTRES, Decretum, MIGNE, t. CLXI. ANSELME DE LAON, Extraits indits des Sentences, publis par G. LEFVRE, 1894. GUILLAUME DE CHAMPEAUX, Sentences, publies par G. LEFVRE dans Les variations de G. de Champeaux et la question des universaux, Lille, 1898.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
545
ROBERT PULLUS, Sentences, MIGNE, t. CLXXXVI, p. 639. ROBERT DE MELUN, Extrait des Sentences dans MIGNE, t. CLXXXVI, p. 1015 et 1053. PIERRE LE LOMBARD, uvres, MIGNE, t. CXCI et CXCII. PIERRE COMESTOR, uvres, MIGNE, t. CXCVIII, p. 1049-1844. PIERRE DE POITIERS, Sententiae, MIGNE, t. CCXI, p. 783. PIERRE ABLARD, Sic et non, MIGNE, t. CLXXVIII. G. ROBERT, Les coles et lenseignement de la thologie pendant la premire moiti du XIIe sicle, Paris, 1909. F. PROTOIS, Pierre Lombard, son poque, sa vie, ses crits, son influence, Paris, 1881. J. DE GHELLINCK, Les Citations de Jean Damascne chez Gandulph et Pierre Lombard, Bulletin de littrature ecclsiastique, p. 278, 1910 ;1912. J. N. EPENSBERGER, Die Philosophie des Petrus Lombardus und ihre Stellung im XII Jahrhunderte (Beitrge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, t. III, 1901). II. - CONSTANTINUS AFER, uvres, Ble, 1536. ADLARD DE BATH, De eodem et diverso, dit par Hans WILLNER, Beitrge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, t. IV, 1903, p. 3-34. BERNARD SILVESTRIS, De mundi universitate, dans Bibliotheca philosophorum mediae aetatis de BARACH, t. I, Innsbruck, 1876 (cf. t. GILSON, La cosmogonie de B. Silv., Arch. dHist. litt. et doctrinale du M. A., 1928, p. 5-24). GUILLAUME DE CONCHES, Extraits du commentaire du Time dans COUSIN, Ouvrages indits dAblard, p. 648-657 et MIGNE, t. CLXXII, p. 245-252 ; Philosophia mundi (sous le nom dHonorius dAutun), MIGNE, t. CLXXII, p. 39. CH. HUIT, Le platonisme au Moyen ge, Annales de philosophie chrtienne, t. XX et XXI. A. CLERVAL, Les coles de Chartres au moyen ge, Paris, 1895. CH. H. HASKINS, Adelard of Bath, The english Review, 1911. IV. K. WERNER, Die Kosmologie und Naturlehre des scholastischen Mittelalters mit spezieller Beziehung auf Wilhelm von Conches (Sitzungberichte der kaiserl. Akad. der Wissenschaften, t. LXXIV, 1873). V. SAINT-BERNARD, uvres, MIGNE, Patrologie latine, t. CLXXXII CLXXXV. HUGUES DE SAINT-VICTOR, uvres, MIGNE, t. CLXXV CLXXVII. B. HAURAU, Les uvres de Hugues de Saint-Victor, Paris, 1886. J. DE GHELLINCK, Revue noscolastique, p. 226, 1913. P. ROUSSELOT, Pour lhistoire du problme de lamour au Moyen ge (Beitrge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, t. VI, 1908). J. RIES, Das geistliche Leben in seinen Entwicklungsstufen nach der Lehre des heiligen Bernhards, Freiburg-i.-B., 1906. G.-B. GRASSI BERTAZZI, La filosofia di Hugo da Santo Vittore, Albrighi, 1912.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
546
VI. ABLARD, uvres thologiques, MIGNE, t. CLXXVIII. COUSIN, uvres indites dAblard, Paris, 1836. PETRI ABELARDI, Opera, d. Cousin, t. I, 1849 ; t. II, 1859. ABLARD, Glossae super Porphyrium, ed. GEYER, Beitrge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, t. XXI, 1919. Ch. DE RMUSAT, Ablard, 2 vol., Paris, 1845. VACANDARD, Pierre Ablard et sa lutte avec saint Bernard, sa doctrine, sa mthode, Paris, 1881. P. LASSERRE, Un conflit religieux au XIIe sicle, Ablard contre S. Bernard, Paris. 1930. DEHOVE, Qui praecipui fuerint labente XII saeculo temperati reaslismi antecessores, Lille, 1908. MICHAUD, Guillaume de Champeaux et les coles de Paris au XIIe sicle, Paris, 1867. G. LEFVRE, Les variations de Guillaume de Champeaux et la question des universaux, Lille, 1898. VII. GUILLAUME DE SAINT-THIEERY, Disputatio adversus Abaelardum, MIGNE, t. CLXXXII, p. 531-532 ; nigma fidei, ibid., t. CLXXX, p. 397-440. W. MEYER, Die Anklagestze des heiligen Bernard gegen Ablard (Nachrichten der kn. Ges. d. Wissensch. zu Gttingen, p. 397 468, 1898). VIII. GILBERT DE LA PORRE, Commentaire aux traits thologiques de Boce, MIGNE, t. LXIV p. 1255 ; De Sex Principiis, MIGNE, t.. CLXXXVIII, p. 1257 (cf. dition HEYSE, Mnster, Aschendorf, 1929). A. BERTHAUD, Gilbert de la Porre et sa philosophie, Poitiers, 1892. IX. J. SCHILLER, Ablards Ethik im Vergleich zur Ethik seiner Zeit, Mnchen, 1906. X. ALAIN DE LILLE, uvres, MIGNE, t. CCX. M. BAUMGARTNER, Die Philosophie des Alanus ab Insulis, Beitrge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, t. II, 1896. P. BRAUN, Essai sur la philosophie dAlain de Lille, Revue des Sciences ecclsiastiques, 1897-1899. XI. P. ALPHANDRY, Les Ides morales chez les htrodoxes latins au dbut du XIIIe sicle (collection de lcole des Hautes tudes : sciences religieuses, t. XVI, Paris, 1903). CH. JOURDAIN, Mmoire sur les sources philosophiques des hrsies dAmaury de Chartres et de David et Dinant (Acadmie des Inscriptions, t. XXVI, p. 467, 1870). P. FOURNIER, tude sur Joachim de Flore, Paris, 1909. A. PRIER, Yahya ben Adi, un philosophe chrtien au Xe sicle, Paris, 1920 (traduction des petits traits apologtiques par le mme). t. GILSON, Les sources grcoarabes de lAugustinisme avicennisant, avec une dition et une traduction du De intelleclu dAlfarabi (cf. MASSIGNON, Notes sur le texte arabe du De intellectu), Arch. dHist. doctr. du M. A., 1929.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
547
A. SCHNEIDER, Die Psychologie Alberts des Grossen (Beitrge zur Geschichte der Philosophie der Mittelalters, IV, p. 401-412, sur David de Dinant). XII. - JEAN DE SALISBURY, uvres, MIGNE, t. CXCIX. JEAN DE SALISBURY, Policraticus, ed. C. WEBB, 2 vol. Oxford, 1909 (Sur la doctrine, cf. les Prolegomena de WEBB).
CHAPITRE IV. La philosophie en Orient.
Encyclopdie de lIslam, Paris et Leyde, 1907, etc. ; en 1927, 4 vol. (de A K, et dbut de S). SCHMLDERS, Essai sur les coles philosophiques chez les Arabes, Paris, 1842. J. POLLAK, Entwicklung der arabischen and jdischen Philosophie im Mittelalter (Archiv fr die Geschichte der Philosophie, vol. XVII, 1904.. M. HORTEN, Die Philosophie des Islam, Mnchen, 1923 (Cf. ses revues gnrales dans Archiv fr die Geschichte der Philosophie, vol. XIX, 1906 ; XX, 1907 ; XXII, 1909). S. MUNK, Mlanges de philosophie juive et arabe, Paris, 1859, rimprim en 1927 (S. MUNK est auteur des notices sur Kindi, Farabi, Gazali, Ibn Badja, Ibn Roschd, dans le Dictionnaire des Sciences philosophiques, Paris, 1852) CARRA DE VAUX, Les Penseurs de lIslam. I. M. GUTTMANN, Das religionsphilosophische System der Mutakallimn nach dem Berichte des Maimonides, Leipzig, 1885. S. HOROWITZ, Ueber den Einfluss der griechischen Philosophie auf die Entwicklung des Kalam, Breslau, 1909. II. E. RENAN, De peripatetica philosophia apud Syros, Paris, 1852. C. SAUTER, Die peripatetische Philosophie bei den Syrern und den Arabern (Archiv fr die Geschichte der Philosophie, XVII, 1904). A. PRIER, Yahya ben Adi, un philosophie chrtien au Xe sicle, Paris, 1920 (traduction des petits traits apologtiques par le mme). F. DIETERICI, La Thologie dAristote, trad. allemande et remarques, Leipzig, 1883. III. T. J. DE BOER, Zu Kindi und seiner Schule, Archiv fr die Geschichte der Philosophie, t. XIII, 1900. ALKINDI, Die philosophischen Abhandlungen, d A. NAGY, Beitrge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, II, 1897. IV. Cf., outre les tudes densemble sur la philosophie arabe, CARRA DE VAUX, Avicenne, Paris, p. 91 116, 1900. DIIEETERICI, Alfarabis philosophische Abhandlungen, Leyde, 1890. DIETERICI, Alfarabis Abhandlung ber die Harmonie zwischen Platon und Aristoteles (texte et traduction), Leyde, 1890-1892. M. HORTEN, Das Buch der Ringsteine Farabis (traduction), Beitrge, etc., V, 1905.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
548
V. CARRA DE VAUX, Avicenne, Paris, 1900. C. SAUTER, Avicennas Bearbeitung der aristotelischen Metaphysik, Freiburg, 1912. AVICENNAE opera in lucem redacta, ab ANDREA BELLUNENSI, Venise, 1495, 1598, 1546. D. SALIRA, tude sur la mtaphysique dAvicenne, Paris, 1926. M. HORTEN, Das Buch der Genesung der Seele (Die Metaphysik Avicennas), traduction, Halle, 1907-1909. ALHAZEN, Perspectiva (traduction latine de RISNER dans Opticae thesaurus, Basile, 1572) ; Ueber das Licht (texte et traduction allemande de BAARMAN dans Zeitschrift der deutschen morgnlndischen Gesellschaft, t. XXXVI, 1882. VI. CARRA DE VAUX, Gazali, Paris, 1903. GAZALI, Destruction des philosophes, trad. CARRA DE VAUX, Louvain, Museion, 1903 sq. VII. AVEMPACE, Le Rgime du Solitaire, analyse de MUNK, Mlanges, p. 349-409. L. GAUTHIER, Hajj ben Yadahn, roman philosophique dIbn Tofal, texte et traduction, Alger, 1900. L. GAUTHIER, Ibn Tofal, sa vie et ses uvres, Paris, 1909. AVERROS, trad. lat. de ses uvres, Venise, nombreuses ditions de 1472 1553 ; La mtaphysique, trad. M. HORTEN, Halle, 1912 ; Accord de la religion et de la philosophie, trad. L. GAUTHIER, Alger, 1905. E. RENAN, Averros et laverrosme, Paris, 1852. L. GAUTHIER, La thorie dIbn Roschd sur les rapports de la religion et de la raison, Paris, 1909. P. DONCUR, La Religion et les matres de laverrosme, Revue des sciences philosophiques et thologiques, 1911. VIII. Artis cabbalisticae scriptores, Ble, 1587 ; Opera omnia Ysaac, Lugduni, 1515. SAADJA, Vom Glauben und Wissen, trad. P. BLOCH, Mnchen, 1879. AVENCEBROLIS, Fons Vitae (traduction latine de JEAN DESPAGNE et DOMINIQE GONDISSALVI, dite par BAMKER, Beitrge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, t. I, 1892-1895 (Index prcieux pour le vocabulaire de la scolastique). MAIMONIDE, Le Guide des Egars, tract. S. MUNK, 3 vol., Paris, 1856, 1861, 1866 ; A. BONILLA Y SAN MARTIN, Historia de la filosofia espaola, t. II, Madrid, 1911. S. KARPPE, tudes sur les origines et la nature du Zohar prcdes dune lude sur lhistoire de la Kabbale, Paris, 1901. P. VULLIAUD, La Kabbale juive, Paris, 1922. I. HUSIK, Geschichte der jdischen Philosophie, New-Yorlc, 1816. J. GUTTMANN, Die philosophischen Lehren des Isaak ben Salomon Israeli, Mnster, 1911.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
549
ENGELKEMPER, Die religionsphilosophische Lehre Saadja Gaons ber die heilige Schrift, dans Beitrge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, IV, 1903. J. GUTTMANN, Die Philosophie des Salomons Ibn Gebirol, Gttingen, 1889. G. FOCK, Moses ben Maimon, sein Leben, seine Werke und sein Einfluss, Leipzig, 1908. L. LVY, Mamonide, Paris, 1912. IX. K. KRUMBACHER, Geschichte der byzantinischen Literatur, 2e d., Mnchen, 1897, Erste Abteilung, 3. Ch. ZERVOS, Un philosophe noplatonicien du XIe sicle, Michel Psellos, Paris, 1919 (p. 35 : indication des ditions de Psellos). PHOTIUS, Opera ; MIGNE, Patrologie grecque, t. CI CIV. PSELLOS, Opera ; MIGNE, t. CXXII, p. 477 sq ; N. SATHAS, vol. IV et V de la M , Paris, 1874 et 1875. MICHEL DEPHSE et EUSTRATE, Commentaires aux t. XX et XXI de ldition des Commentateurs dAristote de Berlin. SOPHONIAS, ibid., t. XXIII. NICPHORE BLEMMYDES, MIGNE, t. CXLII, p. 527 sq. MICHEL ITALICOS, Correspondance dans Cramer, Anecdota graeca oxonensia III, p. 158-203, 1836. GEORGES ACROPOLITE, Opera, d. Heisemberg, Leipzig (Teubner), 1903. THODORE METOCHITA, Miscellanea philosophica et historica, ed. Mller, Leipzig, 1821 ; in Aristolelis physica, Ble, 1559. NICPRORE GRGORAS, MIGNE, t. CXLIX, p. 520. DEMTRIOS KYDONIS, Sur la crainte de la mort, Leipzig, Teubner, 1901. PLTHON, Lois, d. Alexandre, Paris, 1858 ; De platonicae atque aristotelicae philosophi diffenrentia, Ble, 1574. JEAN PDIASIMOS, In Ariatotelis analytica, ed. de Falco, Naples, 1926. SY7dEON, Opera, MIGNE, t. CXX, p. 321 sq. GRGOIRE PALAMAS, ibid., t. CL, p. 909 sq. NICOLAS CABASILAS, ibid., t. CL, p. 491 sq.
CHAPITRE V. Le XIIIe sicle.
I. B. LANDRY, Lide de chrtient chez les Scolastiques du XIIIe sicle, Paris, 1929. H. DENIFLE et A. CHATELAIN, Cartularium universitatis parisiensis, t. I (1200-1286), Paris, 1889. GILSON, La Servante de la thologie, dans tudes de philosophie mdivale, Strasbourg, p. 30-50, 1921. II. A. JOURDAIN, Recherches critiques sur lge et lorigine des traductions latines dAristote, 2e d., Paris, 1843.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
550
M. GRABMANN, Forschungen ber die lateinischen Aristotelesbersetzungen des XIII Jahrhundert (Beitrge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, t. XVII, 1916). FROMENT, La prohibition des livres dAristote au XIIIe sicle, Revue augustinienne, avril 1908. III. DOMINICUS GUNDISSALINUS, De Divisione philosophiae (ed. BAUR, Beitrge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, t. IV, 1903) ; De Immortalite animae (d. Blow, Beitrge, etc., t. II, 1897) ; De unitate (ed. Correns, Beitrge, t. I, 1891) ; De anima, ed. Lwenthal, Berlin, 1890. J. A. ENDRES, Die Nachwirkung von Gundissalinus de immortalitate animae, Philosophisches Jahrbuch, 1890. IV. GUILLAUME DAUVERGNE, uvres, Nuremberg 1496, Venise 1591, Orlans 1694 ; De immortalilate animae (Beitrge, etc., t. II, 1897). M. BAUMGARTNER, Die Erkenntnisslehre des Wilhelms von Auvergne (Beitrge, etc., t. II, 1893). A. MASNOVO, Gugliemo dAuvergne, Rivista di filosofia neoscolastica, t. XIX, 1927. VI. SAINT BONAVENTURE, Opera omnia, 10 vol., Ad Claras Aquas, 1882-1902. F. PALHORIES, Saint Bonaventure, Paris 1913 (du mme, des articles dans Revue noscolastique, 1912 ; Revue des sciences philosophiques et thologiques, 1912 ; Rivista di filosofia neoscolastica. 1912). E. GILSON, La philosophie de saint Bonaventure, 1924. ALEXANDRE DE HALS, Summa Universae theologiae, dite Venise en 1475 et 1576, Nremberg en 1482 et 1502, Cologne en 1522. MATHIEU DAQUASPARTA, Quaestiones disputatae, dites dans : De humanae cognitionis ratione anecdota quaedam s. Bonaventurae et nonnullorum ipsius discipulorum, ad Claras Aquas, 1883, et dans : Bibliotheca franciscana scolastica medii aevi, t. I, ibid., 1903. VII. ALBERT LE GRAND, uvres dites Lyon, 21 vol., 1651, et Paris, par BORGNET, 38 vol., 1890-1899. TH. HEITZ, La philosophie et la foi chez Albert le Grand, Revue des sciences philosophiques et thologiques, II, 1908. A. SCHNEIDER, Die Psychologie Alberts des Grossen (Beitrge, etc., t. IV, 1903 et 1906). M. GRABMANN, Studien ber Ulrich de Strassburg, Zeitschr. fr katholische Theologie, t. XXIX, 1905. VIII, IX, X, XI, XII. SAINT THOMAS, uvres ; d. de Rome 1570-1571 ; d. Frett et Mar, Paris, 34 vol., 1872-1880 ; d. de Rome, 1882, sq. contenant du t. IV au t. XII la Somme thologique, avec le Commentaire de Cajetan. SAINT-THOMAS, Opusculum de Ente et Essentia, ed. Roland-Gosselin, 1926. SERTILLANGES, S. Thomas dAquin, 2 vol., Paris, 1910. P. ROUSSELOT, Lintellectualisme de saint Thomas, Paris, 1908 ; 2e d.,1924. E. GILSON, Le thomisme, 2e d., Paris, 1923 ; Saint Thomas dAquin (Les moralistes chrtiens, Paris, 1925).
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
551
M. GRABMANN, Thomas von Aquin, eine Einfhrung, in seine Personlichkeit und Gedankenwelt, Mnchen 1912. J. DURANTEL, Le Retour Dieu dans la philosophie de saint Thomas, Paris, 1918. J. ZEILLER, LIde de ltat chez saint Thomas dAquin, Paris, 1910. M. ASIN Y PALACIO, El averroismo teologico de santo Tomas de Aquino, Zaragoza, 1904 (Cf. DONCUR, La religion et les matres de laverrosme, Revue des sciences philosophiques et thologiques, 1911). P. MANDONNET, Les premires disputes sur la distinction relle entre lessence et lexistence, Revue thomiste, XVIII, 1910. JACQUES DE VITERBE, De regimine christiano (1301-1302), dition ARQUILLIRE. Paris, 1926. XIII. P. MANDONNET, Siger de Brabant et laverrosme latin au XIIIe sicle ; I. tude critique ; II. Textes indits (t. VI et VII des Philosophes belges, Louvain, 1911 et 1908). P. ALPHANDRY, Y a-t-il eu un averrosme populaire au XIIIe et au XIVe sicle, Revue de lhistoire des religions, t. XLV, Paris, 1902. E. GILSON, La doctrine de la double vrit, dans tudes de philosophie mdivale, Paris 1921, p. 51-75 (contient des textes de JEAN DE JANDUN). Les Quaestiones de JEAN DE JANDUN sur les crits dAristote ont t souvent imprimes au XVe et au XVIe sicles. RENAN, Averros et laverrosme, 2e d., Paris, 1861. XIV. ROBERT KILWARDBY, Rplique Pierre de Confleto, dite par EHRLE, Archiv fr Literatur und Kirchengeschichte des Mittelalters. t. V, 1889. JEAN PECKHAM, Sept lettres relatives au conflit entre le pripattisme et Saint Augustin, dites par EHRLE, Zeitschrift fur katholische Theologie, XIII, 1889. GUILLAUME DE LA MARE, Correctorium fratris Thomae, avec une introduction de P. GLORIEUX sur Les premires polmiques thomistes, Bibliothque thomiste, t. IX, Le Saulchoir, 1927. XV. HENRI DE GAND, Tripartitio doctrinarum et rationum, Bologne, 1701. G. HAGEMANN, De Henrici Gandavensis quem vocant ontologismo, Munster, 1898. XVI. GILLES DE LESSINES, De unitate form, Louvain, 1902 (t. I des philosophes du Moyen ge). M. DE WULF et PELZER, Les quatre premiers quodlibets de Godefroi de Fontaines, Louvain, 1904. (T. I des philosophes belges) ; M. DE WULF et HOFFMANS, Les quodlibets V-VII (T. III des philosophes belges). M. DE WULF, Un thologien philosophe du XIIIe sicle, tudes sur la vie, les uvres et linfluence de Godefroid de Fontaines, Mmoires de lAcadmie royale de Belgique, Bruxelles, 1904. XVII. ALEXANDRE NECKHAM, De naturis rerum, ed. Th. Wright, London, 1863. ALFRED LANGLAIS, De motu cordis, au t. II de la Biblitoth. philosophorum mediae aetatis de Barach, Innsbruck, 1878.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
552
L. BAUR, Die philosophische Werke des Robert Grosseteste, Beitrge, etc., t. IX, 1912 (contenant la fin la Summa philosophica, faussement attribue Robert). XVIII. The Opus majus of R. Bacon, by JOHN H. BRIDGES, 2 vol., Oxford, 1897 (un volume supplmentaire de corrections et de notes, Oxford, 1900). F. ROGERI BACONI, Opera hactenus inedita, by Brewer, London 1859 (contient lOpus tertium et lOpus minus). P. DUHEM, Un fragment indit de lOpus tertium de Bacon, ad Claras Aquas, 1909. Opera hactenus inedita R. Baconis, ed. R. STEELE, Oxonii, 1911. P. MANDONNET, La composition des trois Opus, Revue noscolastique, 1913, p. 51. E. CHARLES, Roger Bacon, sa vie, ses ouvrages, sa doctrine, Paris, 1861. A. G. LITTLE, Roger Bacon, Essays, contributed by various writers, Oxford, 1914. CARTON, Lexprience mystique de lillumination intrieure chez R. Bacon ; La synthse doctrinale de R. Bacon ; Lexprience physique chez R. Bacon, 3 vol. 1924. XIX. C. BAUEMKER, Witelo, ein Philosoph und Naturforscher des XIII Jahrhunderts (Beitrge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, t. III, 1908). Contient une dition du De Intelligentiis et des extraits de la Perspectiva, dite Nuremberg en 1535. E. KREBS, Meister Dietrich, sein Leben, seine Wissenschaft (Beitrge, etc., t. V, 1906) contient le de intellectu et intelligibili, et le de habitibus (Krebs edite le De esse et essentia, Revue scolastique, p. 516, 1911 ; Wrschmidt le De iride, Beitrge, etc., t. XII, 1914). XX. BEATI RAYMUNDI LULLI, Opera omnia, Mainz, 1721-1742 (dition incomplte). (Cf. RAYMOND LULLE, Dialogue et cantique damour entre lami et lamie, traduit du catalan par A. MARIUS, Bruxelles, 1912). A. GOTTRON, Neue Literatur zu Ramon Lull, Franciskanische Studien, p. 250, 1914.
CHAPITRE VI. Le XIVe sicle.
A. DUFOURCQ, Histoire moderne de lglise, t. VII : Le Christianisme, et la dsorganisation individualiste, 4e d., 1924. I. DUNSII SCOTI, Opera omnia, d. Wadding, Lyon, 1639, 12 vol. A. VnenNZ La philosophie de Duns Scot compare celle de s. Thomas, Annales de philosophie chrtienne, 1887-1889. E. PLUZANSKI, Essai sur la philosophie de Dun Scot, Paris, 1887. B. LANDRY, Duns Scot, Paris, 1922. E. LONGPR, La philosophie du b. Duns Scot, Paris, 1924. E. GILSON, Avicenne et le point de dpart de Duns Scot, Archives dhistoire doctrinale et littraire du moyen ge, II, 1927. THOMAS BRADWARDINE, De causa Dei adversus Pelagium et de virtute causarum, Londres, 1618.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
553
JEAN DU MIRECOURT, Propositions condamnes, dans DENIFLE, Cartularium universitatis parisiensis, 1891, p. 610-614. III. DURAND DE SAINT-POURAIN, In Sententias commentariorum libri quatuor ; 15 ditions au XVIe sicle ; Quaestio de natura cogitationis, d. Koch, Mnster, 1929. PIERRE AURIOL, Commentaire sur les Sentences, t. I, Rome, 1596 ; t. II, 1605. R. DREILING, Der Konceptualismus in der Universalienlehre des Petrus Aureoli (Beitrge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, t. XI, 1913). B. LANDRY, Pierre Auriol : sa doctrine et son rle, Revue dHistoire de la Philosophie. t. II, 1928. IV. GUILLAUME DOCCAM, Super quatuor libros sententiarum subtilissima quaestiones, Lyon, 1495 ; Quodlibeta septem, 1487 et 1491. Fr. BRUCKMLLER, Die Gotteslehre Wilhelms von Occam, Mnchen, 1911. L. KUGLER, Der Begriff der Erkenntniss bei Wilhelm von Occam, Breslau, 1913. E. HOCHSTETTER, Studien zur Metaphysik und Erkenntnisslehre Wilhelms von Ockam, Berlin, 1927. V. J. LAPPE, Nicolaus von Autrecourt. Sein Leben, seine Philosophie, seine Schriften (Beitrge, etc., t. VI, 1908) (accompagn des textes de NICOLAS dAUTRECOURT). VI. JEAN BURIDAN, Quaestiones super octo physicorurn libros, Paris, 1509 et 1516. ALBERT DE SAXE, Quaestiones super octo physicorurn libros, Padoue, 1493 ; Venise, 1504, 1516 ; in libros de Coelo et Mundo, Pavie, 1481 ; Venise, 1520. NICOLAS ORESME, Commentaire aux livres du Ciel et du monde (indit ; cf. DUHEM Archives franciscaines, p. 23, 1913) ; De difformitate qualitatum (indit, cf. DUHEM, tudes sur Lonard de Vinci, 3e srie, p. 373, 1913). PIERRE DAILLY, Quaestiones super primum, tertium et quartum Sententliarum, 1478, 1490, 1500. P. DUHEM, tudes sur Lonard de Vinci, 2e srie, Paris, 1904, p. 379-441 ; 3e srie, p. 1-492, 1913. VIII. MEISTER ECKHART, uvres dans Deutsche Mystiker des XIV Jahrhunderts, t. II, Leipzig, 1857. G. THRY, Le commentaire de Matre Eckhart sur le Livre de la Sagesse, Arch. dHist. doctrinale du M. A., 1928 et 1929. H. DELACROIX, Le mysticisme spculatif en Allemagne au XIVe sicle, Paris, 1900. JEAN RUYSBROECK, Ornement des noces spirituelles, d. Macterlinck, Bruxelles, 1891 ; uvres choisies, trad. Hello. A. WAUTIER DAYGALLIERS, Ruysbroeck lAdmirable, Paris, 1923.
CHAPITRE VII. La Renaissance
I et II. BURCKHARDT, La civilisation en Italie au temps de la Renaissance, traduction Schmidt Paris, 1885.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
554
H. HAUSER, tudes sur la rforme franaise, 1909. E. GEBHARDT, La Renaissance italienne et la philosophie de lhistoire, 1887. J.-R. CHARBONNEL, La pense italienne au XVIe sicle et le courant libertin, 1917. BUSSON, Les Sources et le dveloppement du rationalisme dans la littrature franaise de la Renaissance (1533-1601), Paris, 1922. B. PINEAU. rasme et sa pense religieuse, Paris, 1923. III. E. VANSTEENBERGHE, Le Cardinal Nicolas de Cuse, 1922. NICOLAI DE CUSA, Opera, Ble 1565. IV. A. LEFRANC, Le platonisme et le plotinisme sous la Renaissance (1500-1550), Revue dHistoire littraire, 1895. V. FIORENTINO, P. Pomponazzi, Vrone, 1869. POMPONATII, Opera, Ble, 1567. P. POMPONAZZ1, Les causes des merveilles de la nature ou les enchantements, tr. fr. avec introduction, par H. BUSSON, Rieder, Paris, 1930. PTRARQUE, Sur ma propre ignorance, trad. JULIETTE BERTRAND, Paris, 1927. VI. VIDARI, G. Cardano, Rivista italiana di filosofia, t. VIII, 1893. L. MABILLEAU, Cesare Cremonini, la philosophie de la Renaissance en Italie, 1881. VI. P. DUHEM, tudes sur Lonard de Vinci. G. SAILLES, Lonard de Vinci, 4e d., 1912. VII. PROST, Corneille Agrippa, 1881-1882 : P. VILLEY, Les sources et lvolution des Essais de Montaigne, 1908. F. STROWSKI, Montaigne, 1906. VIII. L. ZANTA, La Renaissance du stocisme au XVIe sicle, 1914. P. MESNARD, Du Vair et le nostocisme, Revue de la Philosophie, II, 1928. VILLARI, Nic. Machiavelli e suo tempo, Florence, 1881. J. BARRIRE, tienne de la Botie contre Machiavel, 1908. LA BOTIE, Discours de la servitude volontaire, dition P. Bonnefon, 1922. IX. WADDINGTON, Ramus et ses crits, 1856. G. SORTAIS, La philosophie moderne depuis Bacon jusqu Leibniz, t. I, p. 12-33, 1920. XI. CHAUVIR, Bodin auteur de la Rpublique, 1917. A. LEFRANC, Communication sur Jean Bodin, Acadmie des Inscriptions, sance du 6 janvier 1928. G. POSTEL, De orbis concordia libri. IV. Ble 1544. J. BODIN, Les six livres de la Rpublique, Lyon, 1579.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
555
XII. FIORENTINO, Telesio, studii storici sull idea della natura nel risorgimento italiano, Naples, 1872-1874. XIII. E. TROILO, La filosofia di Giordano Bruno, Turin, 1907. E. NAMER, Les Aspects de Dieu dans la philosophie de G. Bruno, 1926. E. NAMER. E. TROILO, Il problema della materia in G. Bruno e linter pretazione di F. Tocco. dans Bilychnis, XVI, 1927. G. BRUNO, Opera italiane, ed G. GENTILE, 3 vol. Bari, 1907-1909 ; Opera latine conscripta, Naples, 3 vol. 1879-1891. XIV. L. BLANCHET, Campanella, 1920. CAMPANELLA, Opera, tomes I, II et IV, Paris 1637. XV. J. BARUZI, Saint-Jean de la Croix et le problme de lexprience mystique, 1924.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
556
INDEX
DES
NOMS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
A @
ABAUZIT (F.), II, 969, 1044. ABEL, I, 86. ABLARD, I, 564, 565, 568, 570, 571, 574, 582-592, 593, 595-596, 597, 598, 602, 603, 607, 608, 628, 634, 638, 660, 717, 721, 743, 934. ABUBACER, I, 621. ACHILLES, I, 312. ACONTIO, I, 774. ACROPOLITE (Georges), I, 628, 632. ADAM (Ch.), II, 45, 126, 597, 652, 667. ADAM DU PETIT-PONT, I, 603, 604. ADAMSON, II, 1105. ADDISON, II, 486. ADLARD DE BATH, I, 571, 572, 607. ADELMANN DE LIGE, I, 553, 566. ADICKES, II, 571. ADIMANTE, I, 150. ADLOCH, I, 567. ADRASTUS, I, 444. AELIUS ARISTIDE, I, 417. AELIUS STILON, I, 397. ATIUS, I, 43, 44, 45, 55, 56, 59, 61, 64, 68, 76, 78, 397, 351, 404. AGASSIZ, II, 1040. AGATHON, I, 106. AGRIPPA, I, 430, 433. AGRIPPA DE NETTESHEIM, I, 760. AHRENS, II, 804. AILLY (Pierre d), 9, 718, 729, 730, 738. ALAIN DE LILLE, I, 575-576, 596-597, 599, 608. AL ASCHARI, I, 612. ALBEE (Ernest), II, 295. ALBRIC DE REIMS, I, 589, 590. ALBERT DE SAXE, I, 727, 728, 738. ALBERT LE GRAND, I, 601, 633, 639, 644, 653-657, 674, 677, 683, 684, 685, 694, 705, 728. ALBERTINI, I, 448. ALBINUS, I, 415, 418, 443-444, 508. ALBRICH, II, 271. ALCHWARISMI, I, 572. ALCIBIADE, I, 85, 91, 92, 93, 101. ALCINOS, I, 443. ALCMON, I, 296. ALCUIN, I, 539, 548, 549, 550, 551, 766. ALEMBERT (d), II, 317, 319, 382, 432-438, 453, 467, 848, 875.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
557
ALEXANDER (S.), II, 1103-1105. ALEXANDRE I, 468. ALEXANDRE DAPHRODISIAS, I, 262, 309, 310, 444, 446, 447, 613, 622, 756. ALEXANDRE DE HALS, I, 633, 644, 646, 651, 705. ALEXANDRE POLYIIISTOR, I, 295, 296. ALEXINUS DELE, I, 268. ALFARIC, I, 522. II, 599, 649, 667. ALIPANUS, I, 575. ALGER DE LIGE, I, 554, 566. AL FARABI, I, 615-618, 637, 639, 640, 641. ALFRED LANGLAIS, I, 691, 706. AL GAZALI, I, 620-621, 631. ALHAZEN, I, 620, 631, 696, 699. ALHAIZA, II, 847. AL KINDI, I, 614-615, 617, 631, 637. AL PETRAGIUS, I, 691. ALPHANDRY, I, 608, 706. AMAURY BOUCHARD, I, 752. AMAURY DE BNE, I, 600, 601. AMBROISE (St), I, 10, 515, 541, 546, 740, 766. ANZINIAS, I, 62. AMMONIUS SACCAS, I, 449, 450, 517, 529, 613, 629. AMPRE (A. M.), II, 615, 636-643, 630, 631, 633. AMPRE (J. J.), II, 646. ANACHARSIS, I, 407, 528. ANASTASE (St), I, 516. ANAXAGORE, I, 43, 67, 70-73, 74, 78, 87, 101, 112, 271, 381, 413, 456, 778. II, 13. ANAXIMANDRE, I, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 64, 72, 78, 86. ANAXIMNE, I, 42, 46, 47, 52, 55. ANCILLON, II, 643, 644. ANDLER, II, 570, 785, 1022. ANDR (Pre), II, 226, 227. ANDRONICUS, I, 414. ANNICRIS, I, 366. ANSELME DE LAON, I, 570, 583, 607. ANSELME (St), I, 557-564, 565, 566, 567, 582, 588, 591, 597, 655, 660, 664, 709, 717, 723, 833. ANTHONY (R.), II, 156. ANTIGONE DASIE, I, 287, 289, 290. ANTIGONE DE CARYSTE, I, 370. ANTIGONE GONATAS, I, 288. ANTIOCHUS I, 387, 380, 411, 412, 413, 443. ANTIPATER, I, 168, 286, 287, 394, 395, 421. ANTIPHON, I, 84. ANTISTHNES, I, 98, 126, 131, 261, 262, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 293, 506. ANTONIN, I, 729. ANYTOS, I, 102. APELT (E. F.), II, 813. APOLLODORE, I, 286, 407. APOLLONIUS DE PERGE, I, 285, 699. II, 16, 212. APOLLONIUS DE TYANE, I, 436, 468. APOLLONIUS DE TYR, I, 293. APOLLOPHANE, I, 519. APPUHN, II, 198.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
558
APULE, I, 100, 443-444, 467, 513, 534, 549, 550. ARAGO, II, 506. ARATUS DE SICYONE, I, 288, 289, 290, 549. ARBOUSSE-BASTIDE, II, 893. ARCSILAS, I, 338, 379-385, 386, 387, 389, 392, 412. ARCHAMBAULT, I, 522, 381, 570. ARCHELAOS DATHNES, I, 74. ARCHDME, I, 286, 421. ARCHIMDE, I, 285, 744, 759. II, 16, 212, 868. ARCHIPPOS, I, 54. ARCHYTAE DE TARENTE, I, 75, 97. ARDIGO (Robert), II, 934. ARGENTAL (d), II, 461. ARISTARQUE DE SAMOS, I, 312. ARISTIPPE DE CYRNE, I, 261, 262, 275, 278-283, 336, 365. ARISTOCLS, I, 371, 446, 622, 756. ARISTON, I, 290, 374-379, 381, 383, 395, 396. ARISTOPHANE, I, 71, 74, 81, 82, 89, 90, 101, 242. ARISTOTE, I, 2, 3, 12, 28, 29, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 54, 65, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 85, 88, 89, 92, 93, 97, 111, 114, 132, 134, 138, 141, 142, 161, 162, 163, 167, 168-259, 261, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 272, 277, 278, 279, 280, 293, 294, 297, 299, 306, 307, 308, 310, 316, 317, 321, 322, 323, 324, 327, 331, 343, 346, 377, 402, 403, 406, 415, 416, 430, 442, 444, 445, 446, 447, 451, 456, 458, 461, 466, 471, 472, 489, 490, 492, 499, 528, 529, 539, 541, 550, 551, 552, 556, 561, 564, 572, 573, 574, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 594, 604, 609, 612, 613, 614, 615, 621, 627, 628, 629, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 644, 648, 649, 650, 651, 653, 654, 655, 656, 658, 659, 660, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 677, 678, 681, 683, 684, 685, 686, 690, 691, 693, 695, 700, 702, 703, 708, 711, 717, 721, 722, 725, 726, 727, 728, 740, 743, 744, 746, 748, 750, 754, 756, 758, 761, 762, 771, 772, 773, 774, 777, 778, 779. II, 12, 13, 15, 24, 25, 28, 30, 33, 34, 37, 38, 46, 50, 51, 53, 57, 60, 76, 78, 85, 88, 99, 100, 114, 115, 116, 117, 120, 123, 202, 213, 214, 226, 234, 235, 237, 238, 239, 241, 247, 249, 261, 285, 301, 340, 367, 407, 414, 440, 470, 521, 523, 567, 720, 744, 750, 836, 838, 863, 870, 917, 944, 951, 972, 973, 1002, 1004, 101.1, 1030, 1077, 1109, 1116. ARISTOXNE, I, 54, 91, 142, 256, 295, 296, 628. ARIUS, I, 516, 524, 525. ARMINIUS, II, 7. ARNAULT DE BRESCIA, I, 598. ARNAULD, II, 9, 49, 64, 72, 83, 114, 200, 201, 202, 204, 218, 219, 223, 228, 233, 234, 249, 250, 258, 262, 268. ARNIM, I, 304, 310, 312, 318, 322, 323, 324, 325, 326, 328, 329, 332, 401. ARNOBE, I, 510, 511. ARNSBERGER, II, 365. ARRIEN, I, 422. ASCLPIGNIA, I, 476. ASCLPIODOTE DE NICE, I, 402, 424. ASIN (M.), I, 705. ASSZAT, II, 453. ATHANASE (St), I, 484, 525. ATHNAGORE, I, 497, 500. ATTICUS, I, 443, 471. AUBFRT DE VERS, II, 197. AUG (L.), II, 838. AUGUSTIN (St), I, 10, 16, 347, 382, 385, 398, 492, 512, 513, 514, 515, 525, 526, 527, 532, 534, 535, 536, 537, 539, 541, 542, 543, 544, 550, 551, 553, 557, 560, 572, 580, 583, 590, 592,
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
559
593, 638, 644, 650, 654, 675, 693, 695, 699. II, 72, 73, 114, 120, 202, 227, 259, 299, 367, 460, 461, 773, 833, 834, 838, 968. AULU-GELLE, I, 397, 421, 422, 424. AURIOL (Pierre), I, 719, 720, 721, 737. AUSONE, II, 47. AUSTIN (John), II, 679. AUTRECOURT (Nicolas d), I, 724, 725, 729, 738. AVEMPACE, I, 621, 631. AVENARIUS, II, 945-950. AVERROS, I, 620, 621-623, 631, 637, 656, 667, 672, 678, 684, 691, 711, 750, 756. AVICEBRON, I, 602, 624, 625, 632, 637, 656, 673, 678, 679. AVICENNE, I, 618-620, 621, 622, 631, 637, 641, 642, 652, 653, 671, 678, 679, 691.
B @
BAADER, II, 713, 731, 732. BAARMAN, I, 631. BABEUF, II, 866. BACHELARD, II, 870. BACON (Franois), I, 13, 14, 21, 34, 771, 772, 777. II, 17, 18, 20-45, 53, 96, 163, 307, 369, 394, 581, 627, 660, 674, 915, 1067. BACON (Roger), I, 693-699, 706, 766. BAENSCH, II, 199. BAGUENAULT DE PUCHESNE, II, 401. BAILEY, I, 362. BAILLET, II, 126. BAILLIS, II, 1055. BAIN (A.), II, 682, 940. BAINVEL, I, 567. BAKE, I, 414. BALDENSPERGER, II, 483. BALDWIN (Mark), II, 1138. BALFOUR, II, 1057. BALLANCHE, II, 576, 636, 825-828, 838, 858, 961. BALTHAZAR CASTIGLIONE, I, 753. BALZ, II, 157. BARACH, I, 607. BARCHOU DE PENHON, II, 711. BARCKHAUSEN, II, 381. BARDILI, II, 566, 568, 569. BARNI, II, 570. BARRIRE (J.) I, 787. BARROW, II, 306. BARTH (Karl), II, 831. BARTH (Paul), I, 331. BARRS, II, 654, 1024. BARTHLEMY SAINT-HILAIRE, I, 259, 646, 667. BARTHEZ, II, 632. BARTHOLOME DE MESSINE, I, 637. BARTHOLMS, II, 218, 335. BARUZI (J.), I, 785, 787, 270, 1004, 1005. BARZELOTTI, II, 1088.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
560
BASCH (V.), II, 486, 572, 785, 794, 800. BASILE (St), I, 516, 541. BASILIDE, I, 501, 502. BASSET, II, 319. BASSON, II, 11, 12, 13. BASTIAT, II, 896. BASTIDE (Ch.), II, 276, 294. BASTIEN, II, 455. BAUCH, II, 1083. BAUEMKER, I, 38, 620, 632, 706, 1122. BAUER (Bruno), II, 787, 789, 790, 791, 794, 795, 797, 798. BAUMGARTNER, I, 608, 705. BAUR, I, 691, 692, 705, 706. II, 790. BAUSSET (de), II, 599. BAUTAIN, II, 834, 835. BAYET, II, 1134. BAYLE, I, 757. II, 18, 197, 234, 296-305, 309. BAZARD, II, 854. BEATTIE, II, 498. BEAULAVON, II, 358, 483. BEAUMONT (Christophe de), II, 433. BEAUNE (Florimond de), II, 51. BECCARIA, II, 675. BECK (J.-S.), II, 568. BECKET (Thomas), I, 598, 602. BDE LE VNRABLE, I, 534, 538, 540, 548, 549, 569, 593, 695. BEECKMAN, II, 46, 53, 87. BEKKER, I, 258 . II, 115. BELIDSKIJ, II, 797. BELIN (J.-V.), II, 400. BELLUNE (Andr de), I, 619, 631. BELOT (G.), II, 1135. BENEKE, II, 813. BENRUBI, II, 483. BENTHAM, II, 502, 503, 668, 674-676, 677, 678, 679, 682. BRENGER DE TOURS, I, 551-555, 566. BERG (Conrad), II, 119. BERGIER (Nicolas), II, 447. BERGMANN, II, 365, 711. BERGSON, II, 946, 1003, 1023-1033, 1048, 1068, 1069, 1070, 1072, 1075, 1079, 1107, 1123, 1138. BRIGARD I, 14, 11, 13. BERKELEY, II, 282, 288, 311, 336-358, 363, 394, 396, 403, 405. II, 406, 409, 415, 488, 497, 531, 669, 670, 695, 823, 1026. BERNARD (Saint), I, 579, 580, 583, 589, 592, 594, 603, 607. BERNARD DE CHARTRES, I, 571-575, 576, 577. BERNARD SILVESTRIS, I, 607. BERNAYS, I, 60, 259. BERNIER DE NIVELLES, I, 6. BERNOLD DE CONSTANCE, I, 569, 607. BERNOULLI, II, 874, 875. BROSE, I, 693. BERR (H.), II, 1074. BERSOT (E.), II, 465, 667.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
561
BERTHAUD, I, 608. BERTHET (J.), II, 127. BERTHELOT (Ren), II, 494, 500, 801, 802, 870, 921, 935, 953. BERTHIER, II, 128. BERTHOLLET, II, 757, 878, BERTRAND (A.), II, 646. BERTRAND (J.), II, 454. BRULLE (de), II, 47, 64. BERZLIUS, II, 757, 879. BESANON, I, 414. BESSARION, I, 627, 750. BETT, I, 548. BEURLIER, I, 567. BICHAT, II, 609, 614, 632, 757, 872, 879, 880. RIDEZ, I, 87, 470, 472, 485. BIEDERMANN, II, 799. RIEL (Gabriel), I, 729, 301, 498. BIGG, I, 522. BIGNONE, I, 69, 87. BILLINGER, II, 363, 441. BILIENA (G. de), II, 486. BINET (Alfred), II, 1139. BION DE BORYSTHNES, I, 367, 368, 369, 377, 385. BIOT, II, 757. BLACKSTONE, II, 674. BLAINVILLE, II, 861, 879, 880. BLAIZE, II, 598. BLAMPIGNON, II, 201, 228. BLANCHET, I, 782, 783, 787. II, 127, 142. BLANQUIS (Genevive), II, 1021. BLASS, I, 256. BLEMMYDS (Nicphore), I, 628, 629, 632. BLIGNRES (Clestin de), II, 867. BLOCH (Lon), II, 315, 320. BLOCH (P.), I, 631. BLONDEL (Charles), II, 1138. BLONDEL (Maurice), II, 127, 228, 271, 1034-1038. BLOOD, II, 1042. BODIN, I, 775-776, 787. BODRERO, I, 87. BOCE, I, 445, 472, 528-532, 536, 539, 541, 547, 549, 550, 551, 552, 564, 565, 571, 572, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 593, 603, 641, 658, 685, 721, 740. BORCI (J. de), II, 805. BOER (T.-J. de), I, 631. BOEHME (Jacob), I, 751. II, 229-232, 270, 291, 487, 490, 696, 713, 723, 724, 727, 731, 732. BOETHUS, I, 286, 303, 395, 396. BOTIE (tienne de la), I, 771, 787. BOILEAU, II, 114, 939. BOINR, BOURG (BARON de), II, 253. BOIS-LIEYMOND (du), II, 271, 454. BOISSIER, I, 420, 447. BOIVIN, I, 629. BOLINBROKE, II, 322.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
562
ROLL, I, 472. BOLZANO, II, 813. BONALD (de), II, 490, 573), 579, 581, 584-591, 598, 599, 630, 826, 833, 834, 837, 864, 865, 1130. BONAVENTURE DES PRIERS, I, 760. BONAVENTURE (St), I, 633, 644, 645-653, 687, 705, 710, 717. II, 203. BONHOEFFER, I, 332, 427, 448, 522. BONIFAS, II, 199. BONITZ, I, 258. II, 812. BONNET (Charles), II, 398-399, 401, 450, 451, 962. BONNETTY, II, 834, 835. BONNEVILLE, II, 490. BOOLE, II, 673, 913, 1110. BORDAS-DEMOULIN, II, 837, 838. BORDEU, II, 437, 632. BOREL (A.), II, 431. BORGNET, I, 705. BORREL (PH.), II, 199. BORRELLI, II, 612. BORRIES (K.), II, 572. BOSANQUET, II, 483, 984 ; 2, 1050-1058. BOSCOVICH, II, 452-453, 510. BOSSERT, II, 500. BOSSES (DES), II, 262, 268. BOSSUET, II, 3, 5, 64, 151, 200, 201, 202, 204, 269, 367, 460, 461, 773, 909, 939. BOSTRM, II, 823. BOTTINELLI, II, 992. BOUASSE (H.), II, 1066. BOUGL, II, 483, 857, 860, 897, 898, 1133. BOUILLET (M.-N.), II, 45. BOUILLIER, II, 128, 196, 228, 1001. BOUIX, I, 786. BOULAI NVILLIERS (COMTE de), II, 198, 370. BOULAN (E.), II, 500. BOULANGER, I, 417. BOURDIN, II, 50. BOURGERY, I, 425. BOURGIN (H.), II, 847. BOURSIER, II, 201. BOUSSET, I, 522. BOUTROUX (E.), II, 127, 128, 142, 228, 270, 483, 571, 969, 1003-1012, 1023, 1025, 1035, 1064. BOUTROUX (Pierre), II, 88. BOUVIER (B.), II, 483. BOVO de SAXE, I, 550. BOYER, I, 522, 535. BOYLE, II, 43, 44, 45, 1.45, 233, 281, 292, 312, 348, 351, 414. BRADLEY, I, 544, 435. II, 1043, 1050-1058, 1108. BRADWARDINE (Thomas), I, 715, 737. BRAGA (G.-C.), II, 401, 613. BRAMHALL, II, 145. BRANDES, II, 465. BRANDIS, I, 256. BRANDT, II, 147, 157.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
563
BRAUN, I, 608, 732. BREDENBURG (Jean), I, 160, 198. BRHIER (E.), I, 331, 448, 485. II, 732. BRMONT (A.), I, 167. BRENTANO, II, 1109, 1110, 1111. BRIDGES (John-H.), I, 706. BRINON (Mme de), II, 269. BROCHARD, I, 87, 167, 339., 362, 393, 448, 115, 128, 199, 910, 981. BROISE (de la), I, 548. BROMIUS, I, 408. BROUSSAIS, II, 879. BROWN (Thomas), II, 669-670, 682, 813, 1026. BRCKER, I, 16, 18, 24. BRUCKMLLER, I, 737. BRUS (G. de), I, 15. BRUNEAU, II, 854. BRUNETIRE, II, 1024. BRUNO de COLOGNE, I, 579. BRUNO (Giordano), I, 778-782, 703, 787. II, 10, 25, 160, 247, 720, 751, 900, 1060. BRUNS (J.), I, 448. BRUNSCHWICG, I, 37, 259. II, 73, 126, 142, 198, 571, 953, 1093-1095, 1099, 1102. BRUYS (Pierre de), I, 599. BUCHEZ (Philippe) II, 833-83 4. BCHNER, II, 1009. BUFFIER, II, 319 ; 320, 331-335, 498, 591. BUFFON, II, 382, 448-452, 454, 488, 616. BUHL, II, 791. BURCKARDT, I, 786, 909. BURDEAU, II, 824. BURDIN, II, 848, 886. BUREAU (PAUL), II, 1126. BURKE, II, 486. BURIDAN (Jean), I, 727, 738, 756. BURLAMAQUI, II, 486. BURLAEUS, I, 13. BURLOUD, II, 1139. BURNET (John), I, 38, 44, 45, 46, 53, 56, 59, 68, 73, 75, 86, 166, 258. BURNET, II, 323. BURIOT (H.), II, 784. BUSCO, II, 97, 314, 315. BUSSON (H.), I, 740, 750, 752, 753, 758, 760, 775, 776, 786. BUTLER (William), II, 326, 327. BUYS (L.), II, 803. BYWATER, I, 55.
C
@ CABANIS, II, 599, 603, 607-610, 612, 613, 615, 849. CABASILAS (Nicolas), I, 630, 632. CABET, II, 595. CAGLIOSTRO, II, 487. CAHEN (A.), II, 483. CAHEN (L.), II, 506. CAJETAN, I, 729.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
564
CALDERON, II, 721. CALIPPE, I, 170. CALLIAS, I, 90, 194, 197. CALLICLS, I, 82, 85, 91, 102, 103, 106, 144, 145. CALLISTHNES, I, 168. CALVIN, I, 766, 7, 260, 478. CAMPANELLA, I, 742, 743, 783-785, 787. II, 10, 900. CAMPBELL FRAZER, II, 294. CAMPER, II, 494. CANGUILHEM, II, 1011. CANTACUZNE, II, 824. CANTECOR, II, 126, 127, 571. CANTONI, II, 1088. CANTOR, II, 1064. CAPELLE, I, 332, 414. CAPREOLUS (Jean), I, 729. CARDAN (Jrme), I, 757. CARCASSONNE (L.), II, 381, 502. CARLILE (W.-W.), II, 425. CARLINI, II, 295. CARLYLE, II, 668, 679-682, 731, 831, 832, 912, 941, 955, 1019, 1041. CARNADE, I, 384, 385-393, 394, 401, 412. II, 266. CARNOT, II, 854, 855, 874, 875, 1075. CARO (F.), II, 1002. CARR (WILDON), II, 1100. CARRA de VAUX, I, 121, 631. CARRAU, II, 335. CARR, II, 224. CARTERON, I, 170, 259. II, 128. CARTON, I, 706. CARUS (K.-G.), II, 731. CASSANDRE, I, 287, 288. CASSIODORE, I, 532, 547, 549. CASSIRER, I, 5. II, 270, 358, 571, 1080. CATERUS, II, 49. CAUCHY, II, 971. CAULLERY (M.), II, 448. CAVALIERI, II, 16, 87, 133 ; (2, 239. CAVENDISH, II, 98. CAZAMIAN, II, 578. CELSE, I, 490. CRULARIUS (Michel), I, 628. CERVANTS, II, 721. CSAIRE, I, 516. CHABOT, II, 613. CHAIGNET, I, 485, 1001. CHALCIDIUS, I, 325, 539, 554, 572. CHAMBRE (Franois de la), II, 328. CHANUT, II, 103. CHARBONNEL, I, 754, 756, 780, 782, 786. CHARLES (F.), I, 706. CHARLTY (S.), II, 860. CHARMIDE, I, 93, 102, 104. CHARPENTIER, I, 772.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
565
CHARRON (Pierre), I, 769, 770. II, 103, 300. CHARTIER (Alain), II, 1093. CHASDA CRESCAS, II, 159. CHATEAUBRIAND, II, 579, 581, 599, 600, 903, 934. CHATELAIN (A.), I, 704. CHATELET (Mme du), II, 455. CHAUVET, I, 166. CHAUVIR, I, 787. CHAVANNES, II, 570. CHNIER (Andr), II, 488. CHERBURY (Herbert de), II, 4, 14. CHRPHON, I, 92. CHERFILS (CH.), II, 838. CHESELDEN, II, 394, 395. CHEVALIER (J.), I, 167. II, 126, 142, 1033. CHEVALIER (M.), II, 506. CHEVRILLON (A.), II, 954. CHEVREUL, II, 871, 878. CHEVREUSE (Duc de), II, 200. CHIAPELLI, I, 87. II, 1088. CHIDE (M.-A.), II, 1036. CHILLINGWORTH, II, 4. CHINARD, II, 612, 613. CHRYSIPPE, I, 286, 289, 291, 292, 294, 300, 301, 303, 305, 306, 313, 314, 315, 318, 319, 320, 322, 323, 324, 325, 326, 333, 378, 391, 394, 402, 405, 406, 410, 416, 421, 528, 606, 783. CHUBB (Thomas), II, 324. CICRON, I, 77, 80, 89 ; 1, 99, 100, 163, 165, 166, 169, 264, 291, 292, 293, 302, 303, 307, 315, 317, 321, 322, 325, 326, 331, 332, 336, 337, 355, 356, 365, 369, 374, 375, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 388, 391, 392, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 407, 411, 412, 413, 420, 515, 531, 532, 539, 541, 550, 602, 606, 740, 765, 767, 773, 777, 783, . II, 266, 618. CLAIRAUX, II, 875. CLAPARDE, II, 401, 483. CLARKE, II, 245, 266, 291, 292, 293, 324, 325, 327, 328, 338, 374, 414, 416, 417, 420, 457. CLAUBERG, II, 115, 118-119, 128. CLAVIUS (P.), II, 46. CLANTHES DASSOS, I, 286, 289, 290, 292, 312, 317, 318, 319, 323, 326, 506. CLARQUE de SOLES, I, 256, 257. CLEMENCEAU, II, 893. CLMENT DALEXANDRIE, I, 12, 16, 165, 330, 361, 396, 399, 495, 506-510. CLOMDE, I, 402. CLOMNE, I, 288, 289, 290. CLERSELIER, II, 99. CLERVAL (A.), I, 550, 607. CLIFFORD (W.-K.), II, 930. CLITOMAQUE de CARTHAGE, I, 385, 386, 387, 388, 389, I, 392, 411, 413. COCHERY, II, 372. COCHEZ, I, 485. CRANUS, I, 419. COGORDAN, II, 598. COHEN (Hermann), II, 1077. COHEN (G.), II, 126, 1078, 1079, 1080. COLERIDGE, II, 668, 679-682, 912, 955. COLERUS, II, 199.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
566
COLLARDEAU, I, 448. COLLE, I, 259. COLLIER (Arthur), II, 357, 363. COLLIGNON (A.), II, 453. COLLINS, II, 291, 293, 336, 439. COLONNA DISTRIA, II, 198, 613, 646. COLOTS, I, 266, 334, 337, 351, 361, 381, 383. COMENIUS, II, 16. COMMODE, I, 497. COMPAYR, II, 425. COMTE, I, 5, 8, 12, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 143, 633. II, 311, 367, 506, 573, 576, 579, 580, 591, 608, 614, 654, 685, 756, 762, 767, 774, 784, 788, 840, 848, 849, 854, 856, 861-893, 896, 897, 907, 909, 910, 929, 931, 932, 933, 934, 944, 945, 961, 970, 972, 976, 977, 986, 989, 993, 1003, 1010, 1067, 1074, 1126. CONDILLAC, I, 17, II, 57, 327, 364, 380, 382-401, 404, 407, 427, 430, 431, 437, 439, 481, 482, 499, 573, 588, 589, 590, 602, 603, 606, 607, 608, 610, 611, 612, 613, 620, 621, 625, 631, 638, 645, 648, 649, 650, 659, 660, 669, 758, 881, 910, 937, 958, 1069, 1131. CONDORCET (MME de), II, 423, 425. CONDORCET, I, 19. II, 367, 493, 503, 504, 505, 506. CONFUCIUS, II, 360. CONRING, II, 266. CONSIDRANT (V.), II, 845, 846, 847. CONSTANT (Benjamin), II, 591-592. CONSTANTIN LAFRICAIN, I, 571, 577. CONSTANTINESCU-BAGDAT, II, 310. CONSTANTINUS AFER, I, 607. COPERNIC, I, 33, 77, 388, 758, 761, 762, 779. II, 12, 13, 640, 922. CORBIRE, I, 521. CORDEMOY, I, 115. CORNELIUS (H.), II, 571, 813. CORNET, II, 7. CORNFORD, I, 5, 47, 86. CORNUTUS, I, 315, 419. COSTE, II, 274, 319. COUAILHAC, II, 646. COUCHOUD, II, 198. COURDAVEAUX, I, 448. COURNOT, II, 273, 909, 910, 911, 986-992, 1019. COUSIN (V.), I, 22, 27, 30, 166, 565, 566, 575, 584, 586, 587, 589, 590, 607. II, 204, 228, 379, 597, 648, 651, 654, 655, 656-667, 685, 834, 835, 846, 881, 899, 1000. COUTURAT (L.), II, 270, 271, 571, 1102. CRANTOR, I, 165, 166. CRATS, I, 277, 292, 293, 367, 369, 379, 423. CRATINOS, I, 74. CRATYLE, I, 60. CREDARO, I, 385, 393. CREMONINI, I, 757. CRESSON, II, 271, 571, 1024. CREUZ, II, 513. CREUZER, II, 726, 727, 827. CRINIS, I, 306, 421. CRITIAS, I, 85, 90, 95, 96, 102. CRITOLAS, I, 258, 386, 393. CRITON, I, 90.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
567
CROCE, II, 372, 784, 1050, 1058, 1059, 1060. CROISET (A. ET M.), I, 38. CROMUS, I, 443. CUDWORTH, II, 273, 276, 277, 291, 355, 356, 423. CUMONT, I, 466, 485, 5115, 522. CUSE (NICOLAS de), I, 717, 718, 740, 741, 742, 743, 745, 749, 779, 786. II, 229. CUSHING (M.-P.), II, 454. CUVIER, II, 637, 642, 757, 844, 870, 879, 880. CYRILLE DALEXANDRIE, I, 525. CYRUS, I, 269, 289.
D
@ DAMASCNE (Jean), I, 627, 667. DAMASCIUS, I, 36, 48, 468, 470, 481-484, 485, 495, 521. II, 903. DAMASIPPE, I, 418. DAMIEN (Pierre), I, 555, 567. DAMIRON, II, 597, 613, 667. DEMOLINS, II, 1126, 1127. DANIEL (P.), II, 114. DANIELS, I, 567. DANTE, I, 690, 691, 721. DANTON, II, 866. DANZEL, II, 500. DARBON, II, 992, 1062, 1068. DARWIN (Erasme), II, 670, 678. DARWIN (Charles), II, 911, 920-924, 928, 966, 1018, 1025, 1033. DAUBE, II, 604. DAUBENTON, II, 449, 879. DAUDIN, II, 449, 451, 454. DAUNOU, II, 643, 665. DAURIAC (L.), II, 500, 981, 991. DAVID (M.), II, 358, 407, 425. DAVID de DINANT, I, 601, 602, 639. DAVID LE JUIF, I, 653. DAVILL, II, 270. DAVY (G.), II, 1126, 1128, 1132, 1135. DCIUS, II, 331. DEDIEU (J.), II, 381. DEFOURNY, I, 259. II, 905. DEGRANDO, II, 591, 645. DEHOVE, I, 588, 608. DELACROIX (RL.), I, 600, 738. II, 646, 733, 839, 947, 1138. DELAPORTE, I, 3, 43. DELATTE, I, 86, 466. DELATTRE, II, 1044. DELBOS (V.), I, 31, 37, 38. II, 126, 198, 228, 309, 310, 381, 465, 483, 570, 571, 572, 646, 733. DELFICO, II, 612. DELVOLV, II, 309. DMTRIUS KYDONIS, I, 628, 632. DMTRIUS LACON, I, 108, 409. DMTRIUS de PHALRE, I, 255, 287, 288. DMTRIUS POLIORCTE, I, 288, 334.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
568
DEMOCHARS, I, 255. DMOCRITE DABDRE, I, 67, 77-80, 88, 137, 164, 207, 218, 337, 341, 347, 349, 381, 407, 579, 779, 780, 782. II, 11, 12, 13, 85, 88, 94, 217. DMOSTHNES, I, 168, 255. DENIFLE, I, 704. DENIS, I, 332, 427, 447, 522. DENYS de SYRACUSE, I, 97, 99, 110, 1.58, 278. DENYS LAROPAGITE, I, 4-195, 518, 519, 520, 521, 540, 541, 543, 544, 597, 600, 630, 638, 654, 658, 673, 726, 745, 225. DENYS DHRACLE, I, 286, 408. DENYS LE CHARTREUX, I, 729. DERMENGHEM, II, 488, 598. DESCARTES, I, 1, 8, 10, 15, 20, 28, 29, 30, 35, 382, 514, 728, 752, 756, 774. II, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 31, 38, 39, 44, 46-128, 129, 133, 134, 135, 138, 147, 148, 149, 161, 163, 165, 166, 167, 170, 171, 174, 177, 178, 179, 186, 189, 190, 197, 200, 203, 205, 211, 213, 215, 216, 218, 220, 221, 222, 229, 234, 235, 236, 237, 241, 242, 243, 245, 247, 251, 252, 258, 259, 264, 265, 280, 281, 286, 300, 302, 306, 307, 312, 313, 315, 317, 320, 321, 332, 340, 346, 348, 353, 360, 361, 366, 385, 386, 389, 390, 403, 405, 414, 428, 436, 440, 458, 459, 497, 499, 531, 535, 593, 626, 627, 634, 635, 638, 639, 640, 644, 645, 649, 650, 651, 836, 837, 848, 862, 863, 874, 875, 876, 887, 902, 944, 967, 1003, 1030, 1068, 1106, 1114, 1115, 1118, 1119, 1122. DESJARDINS (Paul), II, 1093. DESLANDES, I, 18. DESNOIRESTERRES, II, 465. DESTUTT de TRACY, II, 399, 503, 599, 600-606, 611, 613, 615, 643, 645. DEVAUX (Philippe), II, 1104. DEWAULE, II, 401. DEWEY (J.), II, 157, 295, 1046, 1047, 1048. DICARQUE, I, 257. DICKINSON, II, 1100. DIDEROT, I, 18, 26. II, 330, 363, 382, 384, 395, 396, 432-438, 448, 449, 450, 453, 466, 473, 489, 504, 578, 579, 581, 961. DIDIER (J.), II, 401, 425. DIELS (H.), I, 28, 47, 61, 62, 64, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 78, 86, 87, 162, 165, 398, 404, 414, 441, 485. DIS, I, 86, 87, 167. DIETERICI, I, 631. DIETRICH de FREIBERG, I, 700. DIGBY, II, 119-120. DILLMANN, II, 271. DILTHEY, II, 500, 572, 733, 784, 824, 1000. DIOCHTS, I, 62. DIOCLS, I, 276, 292, 303, 304, 305, 306. DIOCLS de CNIDE, I, 385. DIOCLS de KARYSTOS, I, 294, 295. DIODORE CRONOS, I, 266, 292, 381, 605. DIOGNE DAPOLLONIE, I, 74, 385, 386. DIOGNE de BABYLONE, I, 286, 314, 394, 395, 396, 410. DIOGNE de SINOPE, I, 274, 275, 276, 277, 278, 368, 406, 630, 421. DIOGNE LARCE, I, 3, 12, 55, 56, 59, 62, 65, 71, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 87, 89, 90, 162, 164, 165, 263, 264, 265, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 273, 279, 280, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 296, 303, 305, 308, 320, 334, 336, 338, 340, 348, 357, 358, 359, 360, 365, 366, 367, 371, 372, 373, 377, 380, 382, 393, 397, 398, 404, 433, 777. DION CASSIUS, I, 420.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
569
DION de PRUSE, I, 97, 99, 110, 275, 418, 420, 422. DIONYSODORE, I, 103. DRONYSOS, I, 297. DIOPHANTE, I, 628. DODWELL, II, 293. DRFLER, I, 86. DOMET de VORGES, I, 567. DOMINIQUE GONDISSALVI, I, 639-640, 705. DONAT, I, 532. DONCUR, I, 631. DOUDAN, II, 652, 667. DRAESEKE, I, 548, 560, 567. DREBBEL, II, 35, 41. DREILING, I, 737. DREWS, II, 1000. DREYFUS-BRISAC, II, 483. DRIESCH (H.), II, 1025. DROBISCH, II, 812. DUBOS, II, 380, 486. DUCLOS, II, 434, 485. DUCROS (L.), II, 453. DUFOUR (TH.), II, 483. DUFOURCQ, I, 547, 567, 737. DUGALD STEWART, II, 498, 499, 654, 668-669, 679, 682. DUGAS, II, 966, 969 DUGUIT (LON), II, 1135. DUHEM, I, 28, 33, 259, 547, 706, 723, 738, 756, 787. II, 228, 1065, 1067, 1073. DHRING, II, 945. DUMAS (G.), II, 860, 893, 1136, 1137. DMMLER, I, 273, 369. DUNAN, II, 270, 1091. DUNIN-BORKOWSKI, II, 199. DUNS SCOT, I, 708-715, 724, 730, 737, 1037. DNTZER, II, 500. DUPRAT, II, 1050. DUPROIX (J.), II, 966. DUPUIS, II, 600. DURAND de SAINT-POURAIN, I, 718, 719, 737. DURAND de TROARN, I, 566. DURANTEL, I, 522, 705. DURKHEIM, II, 484, 884, 984, 1068, 1126, 1128-1134. DUTOIT-MEMBRINI, II, 489. DWELSHAUVERS, II, 483. DYROFF, I, 87, 331, 332. II, 199.
E
@ EBERHARD, II, 514. EBERSOLT, I, 567. EBERT, I, 547. ECKART, I, 657, 730-737, 738, 751, 786, 229, 696, 723. ECKSTEIN (D), II, 595, 827. EDDINGTON, (A.-S.), II, 1073. EDELMANN, II, 514.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
570
EDWARDS (Jonathan), II, 337. EHRENBERG, II, 784. EHRLE, I, 706, 1122. EINSTEIN, II, 1072, 1076, 1080. ELKIN, II, 425. ELIEN, I, 359. ELLIS, II, 45. ELSENHANS, II, 824. EMERSON, I, 1. II, 831-832, 839, 1019, 1039, 1041. EMPDOCLE DAGRIGENTE, I, 67-70, 71, 73, 76, 86, 87, 232, 337, 381, 411, 413. ENDRES (J.-A.), I, 547, 566, 567, 705. NE de GAZA, I, 517. ENSIDME, I, 370, 414, 430, 431, 432, 433, 434, 439. ENFANTIN, II, 854, 855, 859, 961. ENGELKEMPER, I, 632. ENGELS (Frdric), II, 786, 791. PAMINONDAS, I, 54. EPENSBERGER, I, 607. PICTTE, I, 36, 267, 274, 291, 303, 326, 327, 370, 391, 415, 417, 418, 419, 421, 422, 423, 427-428, 430, 471, 491, 495, 496, 497, 521, 767, 768, 769. II, 16, 30, 138, 619. PICURE, I, 14, 89, 161, 262, 271, 281, 333-362, 363, 366, 367, 370, 373, 408, 409, 410, 411, 425, 780 II, 11, 13, 14, 15, 85, 458, 972. PIPHANE, I, 541. RASME, I, 740, 751. RATOSTHNE, I, 285. ERDMANN, II, 358, 571, 799, 1109. RIC DAUXERRE, I, 550. ERNOUT, I, 362. RYXIMAQUE, I, 106. ESCHENMAYER, II, 723. ESCHYLE, I, 81. ESCULAPE, I, 471. ESPINAS, I, 43, 167. II, 128, 335, 483, 1127, 1128. ESSERTIER, II, 1135. ESTVE, II, 729. ESTIENNE (H.), I, 15. EUBOULIDE de MILET, I, 264, 266, 268. EUCKEN, II, 1062 EUCLIDE de MGARE, I, 261, 263, 264, 265. EUCLIDE (Le mathmaticien), I, 285, 532, 572, 596, 614, 628, 699, 747. II, 73, 135, 144, 212, 235, 502. EUDME, I, 48, 49, 79, 256. EUDOXE, I, 214, 215, 279, 280, 289. EULER, II, 238, 874. EUMNE, I, 380. EUNAPE, I, 468. EUPHRATE, I, 436. EURIPIDE, I, 81, 82, 91. EUSBE de CSARE, I, 161, 268, 371, 372, 374, 387, 413, 444, 471, 516. II, 28. EUSTRATE, I, 628, 629, 632. EUTHYDME, I, 103. EUTHYPHRON, I, 93, 102. EUXITHOS de SYRIE, I, 598. EVELLIN (F.), II, 454, 571, 981.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
571
EVHMRE, I, 396, 486.
F
@ FABRE DOLIVET, II, 489. FAGUET (E.), II, 230, 483. FAIRBROTHER, II, 992. FALCO (de), I, 414. FARDELLA, II, 115, 227. FAUCONNET (A.), II, 824. FAUCONNET (P.), II, 1132. FAULHABER, II, 47. FAYE (de), I, 499, 501, 504, 522. FAYE, II, 314. FECHNER, II, 993-994, 996. FLIX-FAURE (Lucie), II, 969. FNELON, II, 125, 197, 200, 204, 322. FERMAT, II, 16, 51, 238, 306. FERNEL (JEAN), I, 758. FERRARE (Franois-Sylvestre de), I, 729. FERRAZ, II, 597, 834, 839. FERRI (E. de), II, 732, 934. FESSLER, II, 489. FEUERBACH, II, 787, 788, 789, 791, 793, 795, 908, 945, 982. FVRE de LA BODERIE, I, 752. FICHTE, I, 36. II, 489, 568, 569, 573, 645, 650, 679, 680, 683-711, 713, 715, 716, 717, 718, 719, 721, 723, 727, 728, 729, 734, 735, 736, 737, 760, 761, 766, 802, 803, 808, 810, 823, 969, 1068, 1077, 1133. FIORENTINO, I, 786, 787. FIRMUS, I, 471. FISCHER (K.), I, 38, 198, 270, 571, 732, 784, 799, 824. FISKE (JOHN), II, 931. FITTBOGEN (G.), II, 500. FLORIAN, II, 18, 45. FLUDD (ROBERT), II, 24, 32, 39. FOBES, I, 258. FOCK, I, 632. FONTANES, II, 599. FONTENELLE, II, 225, 305-310, 313, 384, 419, 506. FORGE (DE LA), II, 115, 120-121, 122, 200. FORGUES, II, 598. FORMEY, II, 486. FOUCHER (L.), II, 991. FOUILLE (A.), I, 166, 126, 1090. FOURIER (CH.), II, 573, 576, 579, 677, 840-847, 858. FOURIER (Joseph), II, 870, 874, 875, 876, 945. FOURNEL, II, 854. FOURNIER (P.), I, 608. FOX BOURNE, II, 294. FRANCK (A.), I, 37, 87, 567. II, 500, 1001. FRANCKE, II, 359. FRANOIS (L.), I, 275. FRANOIS (St), I, 644, 645, 646. FRANZONI, I, 770.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
572
FRASCATOR, I, 746. FRASER (A.-C.), II, 358, 343, 500. FRASSDORF, II, 484. FRAYSSINOUS, II, 648, 651. FRAZER (James), I, 51, 52. FRDGISE, I, 551, 566. FRRON, II, 433. FREUD, II, 1088, 1140. FREUDENTHAL, I, 443, 448. II, 199. FREUND, II, 6. FRIEDBERG, II, 847. FRIEDLEIN, I, 485. FRIES, II, 812-813. FROMENT, I, 705. FRUTIGER, I, 167. FULBERT, I, 550, 553, 583. FULLEBORN, I, 20.
G
@ GAIUS, I, 443-444. GALIEN, I, 69, 291, 294, 304, 306, 375, 402, 405, 416, 443, 571, 613, 691. GALILE, I, 728, 756, 755, 759. II, 10-15, 18, 19, 23, 36, 48, 54, 87, 88, 95, 97, 129, 144, 148, 242, 244, 316, 387, 753, 868, 899, 900. GALL, II, 880, 881. GALLAND, I, 775. GALLOWAY, II, 1056. GALUPPI, II, 899. GANTER, I, 332. GAONACH, II, 228. GARAT, II, 599. GARNIER (A.), II, 667. GARRIGOU-LAGRANGE, II, 1123. GASSENDI, I, 14, 362. II, 10-15, 17, 39, 49, 69, 83, 119, 135, 302, 498, 634. GASTINEL, II, 453. GASTRELL, II, 323, 324. GAULTIER (de), I, 33, 1063. GAUNILON, I, 562. GAUTHIER (L.), I, 631. GAUTHIER de MORTAGNE, I, 588. GAUTHIER de SAINT-VICTOR, I, 603. GEBHART, I, 786, 199. GEFFCKEN, I, 87, 283. GELPCKE, II, 711. GEMELLI, II, 1132. GENTILE, II, 372, 1058, 1060. GEORGES de TRBIZONDE, I, 629. GERANDO (de), I, 21, 22, 27. GRARD de BOLOGNE, I, 690. GRARD de CRMONE, I, 636, 638. GRAUD de CORDEMOY, II, 121-123. GERBERT DAURILLAC, I, 550, 551, 552, 566. GERBET, II, 594. GERCKE, I, 166.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
573
GERDIL, II, 227, 588, 589, 901. GERSON, I, 629, 730. GEULINCX, II, 114, 116-118, 120, 128. GEYSER, I, 567, 1122. GHELLINCK (J. de), I, 607. GIBELIN, II, 570. GIBERT, II, 41. GIBIEUF, II, 50, 67. GIBSON, II, 127, 295. GIESE, II, 785. GILBERT, II, 96. GILBERT LUNIVERSEL, I, 590. GILBERT de LA PORE, I, 577, 593-595, 597, 602, 603, 608. GILLESPIE, I, 283. GILLES de LESSINE, I, 684, 685, 689-690, 706. GILLES de ROME, I, 690. GILSON, I, 38, 547, 600, 643, 645, 647, 651, 683, 686, 704, 705, 706, 737, 784. II, 126, 127, 128, 198, 1122. GIOBERTI, II, 899, 901-903, 904, 905. GIOIA, II, 612, 613. GIRAUD (V.), II, 142, 954. GIUSSANI, I, 414. GLANVILL, II, 43. GOBINEAU, II, 941-942, 1024. GOBLOT (Edmond), II, 1096. GOCLENIUS, I, 17. GOEDECKEMAYER, I, 393, 448. GODEFROY de FONTAINE, I, 689, 690. GODFERNAUX, II, 199. GODWIN, II, 676, 679. GOETHE, II, 446, 491, 494, 496, 578, 579, 721, 739, 742, 755, 801-802, 807, 813, 816, 832, 1084. GOEZE, II, 491. GOHIN, II, 454. GOMAR, II, 7. GOMPERZ, I, 38, 57, 84, 87. GONDISSALVI (Dominique), I, 632. GONZALES, I, 632. GORE (W.-C.), II, 425. GORGIAS, I, 82, 85, 102, 103, 106. GOTTRON, I, 767. GOTTSCHALK, I, 542, 543. GOUHIER (H.), II, 127, 203, 228, 860, 893. GOURD (Jean-Jacques), II, 981. GOYAU, II, 598. GRABMANN, I, 38, 547, 548, 566, 603, 607, 704, 705. II, 1122. GRANDGEORGE, I, 522. GRASSY-BERTAZZI, I, 608. GRATRY, II, 834, 836, 837. GRARD, I, 448. GREEN, II, 984, 985, 986, 1050. GRGOIRE LE GRAND, I, 527. GRGOIRE de NAZIANCE (ST), I, 492, 516, 541. GRGOIRE de NYSSE (ST), I, 516, 541, 546.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
574
GREGORAS (Nicphore), I, 628, 632. GREGORY (James), II, 312. GRIGNAN (Mme de), II, 224. GRIMM, II, 434. GRIN (E.), II, 969. GRISEBACH, II, 824. GROETHUYSEN, II, 787. GRONAU, I, 522. GROSSETESTE (Robert), I, 637, 691, 692, 693, 694, 696, 699. GROTIUS (Hugo), II, 3, 4, 19. GUEROULT, II, 567, 709, 711, 785. GUHRAUER, II, 500. GUIDO de CASTELLO, I, 583. GUIGNEBERT, I, 522. GUILLAUME de CHAMPEAUX, I, 570, 585, 586, 607. GUILLAUME de CONCHES, I, 574-579, 592, 602, 607, 717. GUILLAUME de SAINT-THIERRY, I, 592, 593, 608. GUILLAUME LE BRETON, I, 637. GUILLAUME de MOERBECKE, I, 485, 637, 658, 699, 724, 734. GUILLAUME DAUVERGNE, I, 640-643, 705. GUILLAUME de SAINT-AMOUR, I, 645, 654. GUILLAUME de LA MARE, I, 689. GUILLAUME DOCCAM, I, 718, 720-723, 724, 729, 730, 737, 744. GUIMET, I, 448. GUINGUEN, II, 599. GUIZOT, II, 795, 846, 861. GURVITCH, I, 681, 704, 711, 804, 898, 1121. GUTBERLET, II, 1122. GUTTMANN, I, 631, 632. GUYAU, I, 362, 1021-1022. GUY-GRAND, II, 894, 895, 896, 898. GUYON (Mme), II, 2, 487.
H
@ HCKEL, II, 934, 942-943. HAGEMANN (G.), I, 706. HALBWACHS, II, 270, 1132. HALVY (lie), II, 502, 503, 669, 676, 682, 857, 860. HALPHEN, I, 609, 704. HAMEL (J.-B. du), I, 18. HAMELIN, I, 28, 181, 259, 331, 361. II, 126, 969, 991, 1050, 1052-1062, 1098. HAMILTON, II, 498, 670-673, 682, 925. HANNEQUIN, II, 127, 270, 1067, 1068. HANSEN, II, 500. HARMEL, II, 898. HARNACK, I, 498, 512, 516, 521, 522, 525, 526, 547. II, 270. HARPOCRATION, I, 443. HARRINGTON (James), II, 5. HARRISON (Miss), I, 86. HARTENSTEIN (G.), II, 271, 570, 812, 824. HARTLEY (David), II, 399, 499, 678. HARTMANN (N.), II, 784, 785, 1121. HARTMANN (Ed. von), II, 732, 738, 998-1000.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
575
HARVEY, II, 16, 41, 99, 100. HASKINS, I, 607. HASSE (H.), II, 425. HASSELBLATT, II, 824. HATZFELD (AD.), II, 142. HAURAU, I, 38, 547, 581, 607, 1001. HAUSER, I, 786. HAUSSOULIER, I, 259. HAYM (J.), II, 500, 733, 784. HEATH, II, 45. HCATE, I, 55, 80. HEEREBORD (Adrien), II, 114. HEGEL, I, 12, 25, 26, 29, 32, 33, 489, 544. II, 311, 492, 573, 574, 576, 656, 655, 704, 727, 734-785, 786, 787, 791, 796, 797, 798, 799, 801, 803, 806, 807, 808, 823, 835, 836, 847, 907, 908, 909, 910, 926, 927, 935, 937, 938, 944, 984, 993, 994, 997, 998, 1011, 1013, 1046, 1053, 1054, 1058, 1061, 1062, 1193. HGSIAS, I, 365, 366. HGIAS, I, 484. HEIDEGGER, II, 831, 1119. HEIM, II, 757. HEIMANN, II, 784. HEINEMANN, I, 414, 485, 808. HEINZE, I, 167, 331, 402, 446. HEITZ, I, 705. HELLER, II, 769. HELMHOLTZ, II, 270, 950, 982, 983. HLOSE, I, 583. HELVTIUS, II, 432, 434, 438-448, 454, 481, 607, 618, 620, 675, 881. HELVTIUS (Mme), II, 599, 615. HELVIDIUS PRISCUS, I, 420. HEMSTERHUIS, II, 494-497, 500. HENDEL (Ch.-W.), II, 425. HENNEQUIN (V.), II, 846. HENRI de BRABANT, I, 637. HENRI de GAND, I, 687-669, 706, 711, 713. HENRI de HAINBUCH, I, 718, 728. HENRY (Ch.), II, 453. HENSE, I, 393, 447. HRACLON, I, 502. HRACLITE DPHSE, I, 54-60, 61, 62, 63, 123, 381, 434, 778. II, 809, 896, 927, 1078. HRACLIDE de TARSE, I, 396, 551. HRACLITE de TYR, I, 412. HERBART, II, 808-812, 824. HERDER, II, 367, 487, 491-494, 496, 500, 504, 508, 569, 570, 663, 801, 935. HERENNIUS SENECION, I, 420, 448, 450. HERILLUS de CARTHAGE, I, 286. HERMAND, II, 453. HERMARQUE, I, 268, 334, 335, 363. HERMS TRISMGISTE, I, 778, 782. HERMIAS DATARNE, I, 168, 492. HERMINIER (L), II, 301. HRODOTE, I, 52, 80, 335, 342, 349, 350, 351, 353. HRON DALEXANDRIE, I, 416. II, 16.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
576
HERSHELL, II, 913, 916. HERTLING, I, 38, 295. HERZ (MARCUS), II, 517. HERZEN (A.), II, 796, 797. HSIODE, I, 48, 55, 57, 61, 64, 308. HESS (moses), II, 787, 790. HEURTEVENT, I, 554, 566, 567. HEYBERGER, II, 16. HICTAS, I, 77. HIROCLS, I, 450, 518. HILAIRE (St), I, 492, 536. HILDEBERT DE LAVARDIN, I, 766. HILDEBRAND, I, 420. HINCMAR, I, 542. HINTON, II, 1057. HIPPIAS, I, 82, 83, 102, 105, 106. HIPPOCRATE, I, 5 9, 74, 75, 83, 87, 375, 571, 691. HIPPOLYTE, I, 44, 46, 47, 61, 74. HIPPON, I, 74. HIRZEL, I, 331, 393. HOBBES, I, 15. II, 5, 11, 15, 17, 19, 49, 50, 68, 69, 144-157, 995, 196, 241, 275, 276, 282, 292, 329, 331, 370, 380, 435, 469, 478, 626, 863, 885, 959. HOCHSTETTER, I, 737. HOCKING, II, 1056. HODGSON, II, 1105. HOEFFDING, I, 38, 483, 1033, 1088-1089. HORFMANN, II, 127. HOLBACH (D), II, 432, 434, 438-448, 482, 486, 489. HLDERLIN, II, 727, 728, 729. HOLLAND, II, 313, 447, 448. HOMRE, I, 56, 61, 102, 225, 271, 272, 273, 372, 380, 397, 438, 471. II, 308, 369, 371, 721. HOMO, I, 466. HONIGSWALD (R.), II, 157. HOOKE, II, 44. HOOKER, II, 150. HOPITAL (Marquis de L), II, 225. HORACE, I, 370, 418. HORN (G.), I, 14, 15, 17. HORNEFFER, I, 95. HOROWITZ, I, 631. HORTEN, I, 630, 631. HOWISON, II, 1055. HUAN, II, 199, 998. HUBBART (G.), II, 860. HUBER (Marie), II, 327, 328. HUBERT (Henri), II, 1132. HUBERT (Ren), II, 228, 454, 473, 483. HUET, II, 123-126, 128. HUGUES de SAINT-CHER, I, 687. HUGUES de SAINT-VICTOR, I, 579, 580, 581, 582, 607, 673. HUGUES de STRASBOURG, I, 657. HUIT (CH.), I, 167, 607, 838. HUMBERT, I, 690.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
577
HUMBOLDT (A. de), II, 995. HUMBOLDT (Guillaume de), II, 807-808. HUME, I, 724. II, 122, 288, 311, 382, 400, 402-425, 427, 430, 439., 447, 467, 482, 497, 513, 518, 519, 566, 568, 627, 628, 669, 670, 675, 914, 915, 927, 985, 997, 1051, 1089, 1111, 1112, 1130. HUSIK, I, 632. HUSSERL, II, 1108-1122. HUTCHESON, II, 330, 335, 421, 422, 423, 448, 486. HUXLEY (Thomas), II, 929. HUYGHENS, II, 50, 98, 124, 244. HYDE, II, 145. HYPATIE, I, 484.
I
@ IBSEN, II, 1024. IDELER, I, 258. IDOMNE, I, 334, 359. IMBART de LA TOUR, I, 716. INGE, I, 480, 485. ION, I, 102. IRNE, I, 415, 500. ISAAK ISARLI, I, 623, 639. ISELIN, II, 493. ISIDORE, I, 468. ISIDORE de SVILLE, I, 534, 538, 548, 549, 569, 571, 693. ISOCRATE, I, 83, 84, 85, 98, 169, 269, 271, 273, 277.
J
@ JACOBI, II, 491, 494-497, 500, 566, 664, 723, 736, 805, 806, 963. JAEGER, I, 259, 414. JACKSON, II, 295. JACQUIN, I, 548. JAKOB (L.-H.), II, 565. JAMBLIQUE, I, 51, 54, 75, 85, 470, 472-476, 483, 520, 627. JAMES (H.), II, 832, 1039, 1040. JAMES (W.), II, 432, 654, 832, 969, 994, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1055, 1070, 1107. JANET (Paul), I, 28. II, 45, 465, 598, 667, 1002. JANET (Pierre), II, 1136. JANKLVITCH (V.), II, 372, 733, 1033, 1086. JANSNIUS, II, 7, 8. JAQUELOT, II, 124. JAURS, II, 483. JEAN CLIMAQUE (St), I, 629, 630. JEAN CHRYSOSTOME (St), I, 516. JEAN DESPAGNE, I, 632. JEAN ITALOS, I, 628, 629. JEAN de PARME, I, 645. JEAN de LA ROCHELLE, I, 646. JEAN de JANDUN, I, 685, 706, 718. JEAN de LA CROIX (St), I, 785.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
578
JEFFERSON, II, 611. JROME (St), I, 541. JRUSALEM, II, 1109. JOACHIM, II, 1055. JOACHIM de FLORE, I, 600, 645. JODL, II, 945. JOHNSTON (G.-A.), II, 358. JOLIVET (A.), II, 143. JONSIUS, I, 13. JORET, II, 500. JORNANDS, II, 379. JOSCELIN de VIERZY, I, 590. JOSPHE, I, 693, 28. JOUFFROY, II, 499, 500, 649, 652-656, 667, 682, 958. JOURDAIN, I, 608, 704. JOUSSAIN (A.), II, 358. JOVY (E.), II, 143. JOYAU, I, 362, 613. JURIEU, II, 3, 296, 297, 298, 303, 585, 586, 590. JUSSIEU, II, 642. JUSTE LIPSE, I, 767. JUSTIN, I, 415, 497, 498, 499, 500, 504, 522.
K
@ KAERST, I, 331. KAFKA, I, 69. KANNES (J.-A.), II, 745. KANT, I, 8, 9, 29. II, 311, 315, 360, 453, 458, 483, 487, 489, 491, 496, 507-572, 573, 580, 640, 642-645, 648, 660, 670, 671, 672, 679, 680, 685, 688, 691, 692, 693, 694, 699, 700, 702, 703, 706, 717, 736, 760, 761, 766, 772, 801, 805, 808, 810, 811, 812, 816, 817, 823, 834, 850, 897, 910, 913, 934, 944, 966, 972, 979, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 994, 997, 1005, 1006, 1011, 1051, 1058, 1064, 1071, 1072, 1077, 1081, 1082, 1083, 1084, 1088, 1111, 1116, 1117, 1122, 1123, 1124. KARPPE, I, 632. II, 199. KEIM (A.), II, 454. KPLER, I, 756, 758. II, 54, 87, 88, 95, 754, 875, 876, 987. KERN (O.), I, 86. KERNER (J.), II, 731, KIDD (B.), II, 931. KILWARDBY (ROBERT), I, 644, 687, 706. KING, II, 294. KINKEL, I, 251, 824. KINKER, II, 643. KIREEVSKI, II, 798. KIRKEGAARD, II, 830-831, 832, 838. KLAGES (L.), II, 1087. KNUTZEN (Martin), II, 507. KPPEN (F.), II, 790. KORTEWEG, II, 127. KORBER, II, 732. KOTARBINSKI, II, 45. KOYR, I, 548, 561, 567. II, 229, 270, 784, 798. KRAUSE, II, 802-805.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
579
KREBS, 9, 707. KROLL, I, 485. KRONER, II, 1063. KRUG, II, 757. KRUMBACHER, I, 632. KUGLER, I, 737. KUNZ, II, 454.
L
@ LAAS (ERNST), II, 944, 945. LABERTHONNIRE, I, 490. II, 127, 1036. LABOULAYE (douard), II, 1000. LABRIOLLE (de), I, 522, 547. LA BRUYRE, II, 329. LABRY (R.), II, 797. LACHELIER, II, 570, 1003-1012, 1023, 1025, 1064, 1092, 1093, 1095. LACHS, I, 93, 102. LACORDAIRE, II, 594. LACTANCE, I, 314, 357, 511. LACYDE, I, 386. LADD, II, 1056. LAFFITTE (Pierre), II, 933 LA FORT, I, 548. LAGNEAU, II, 198, 1092, 1093. LAGRANGE, II, 874. LAHORGUE, II, 143. LALANDE, II, 38, 45, 320, 1095-1098, 1138. LALLY, II, 456. LALO, I, 259, 1132. LAMARCK, II, 438, 818, 880, 920-924. LAMENNAIS, II, 490, 592-597, 662, 775, 790, 833, 837, 846, 885, 934. LA METTRIE, II, 432, 438-448, 454, 486. LAMI, II, 667. LAMPRECHT, II, 295. LAMY (Bernard), II, 226. LAMY (Franois), II, 197, 226. LAND, II, 128, 198. LANDRY (B.), I, 715, 737. II, 157. LANFRANC, I, 554, 557, 566. LANFREY, II, 400. LANG, I, 167. LANGE, I, 362. II, 359, 439, 454, 789, 983, 1070. LANGEVIN, II, 1076. LANGRES (Hugues de), I, 566. LANSON, II, 128, 320, 334, 465. LANTOINE, II, 295. LAPIE (PAUL), II, 1097. LAPLACE, II, 315, 458, 868, 870, 875, 876, 926. LAPORTE, II, 9, 127, 142. LAPPE (J.), I, 738. LA ROCHEFOUCAULD, II, 1, 9, 424, 439, 1015. LAROMIGUIRE, II, 599, 647-648, 657. LASBAX, II, 199.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
580
LASSERRE (P.), I, 608, 934, 953. LASSON (G.), II, 784, 785. LATOUR (R. de), II, 483. LATZARUS, I, 448. LAUNOIS, I, 13. LAURENT de LARDCHE, II, 856. LAURENT VALLA, I, 739, 740. LAURIE (H.), II, 682, 1053. LA VALETTE-MONBRUN (de), II, 616, 646. LAVATER, II, 489. LAVEILLE, II, 598. LAVOISIER, II, 868, 872. LAZARUS, II, 812. LE BRETON (A.), II, 431. LE BRETON (Maurice), II, 1040, 1044. LECANUET, II, 1035. LECHARTIER, II, 4255. LECHEVALIER, II, 845. LE CLERC, II, 274, 319. LE CONTE, II, 931. LE DANTEC, II, 932, 953, 1075. LEFVRE (A.), II, 335. LEFVRE (G.), I, 586, 607, 608. LEFORT de MORINIRE, II, 226. LEFRANC, I, 786, 787. LE GRAND (Antoine), II, 115. LE GRAS (Joseph), II, 433, 453. LEIBNITZ, I, 757, 779, 781. II, 17, 18, 26, 107, 115, 122, 132, 149, 196, 197, 204, 213, 215, 216, 229-271, 291, 292, 294, 297, 298, 306, 311, 314, 321, 355, 359, 360, 363, 364, 383, 389, 436, 458, 492, 495, 510, 513, 514, 515, 516, 518, 576, 626, 752, 823, 874, 913, 926, 927, 944, 952, 962, 979, 1011, 1051, 1109. LELEVEL, II, 226. LLIUS, I, 396. LELONG (P.), II, 201. LEMAITRE (J.), II, 483. LEMOINE (A.), II, 401. LE MONNIER, II, 435. LENOIR, II, 310, 401, 431. LON (A.), II, 199. LON (Xavier), II, 489, 572, 685, 687, 688, 689, 711, 1076. LON LHBREU, I, 753. II, 164. LONARD de VINCI, I, 742, 758-760, 785. LEONHARDI, II, 804, 824. LONTEUS, I, 334. LEOPARDI, II, 615. LEPIDI, I, 567. LEQUIER (Jules), II, 966-969, 970, 973. LEROUX (P.), II, 845, 957-961, 970. LEROUX (Emmanuel), II, 1039, 1040, 1044, 1045, 1046. LEROY (Andr), II, 425. LEROY (Maxime), II, 127, 860. LE ROY (douard), II, 1037, 1067, 1076. LE SENNE (Ren), II, 1098. LESSING, II, 487, 491-494, 496, 504.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
581
LEUCIPPE, I, 77-80, 809. LEUWENHOECK, II, 261, 718, 721, 746, 748. LE VERRIER, II, 916, 1067. LEVI (AD.), II, 45, 157. LVI (M.) I, 87, 331. LEVINAS, II, 1115, 1121. LVY (Albert), II, 800. LVY (Heinrich), II, 1063. LVY (M.), I, 632. LVY-BRUHL, I, 5, 52. II, 310, 425, 483, 500, 893, 1133, 1134, 1140. LEWES, II, 929. LIARD, II, 126. LIBANIUS, I, 89, 484. LICHTENBERG, II, 757. LICHTENBERGER, II, 733, 1022. LIEB (F.), II, 713. LIEBERT, II, 1080. LIEBIG, II, 35, 45. LIEBMANN, II, 982. LIGNAC (de), II, 227. LIMBOURG (Philippe de), II, 160, 161. LINN, II, 437, 448. LIONNE (M. de), II, 201. LIPSE (Juste), I, 14, 16, 18. LIPSTORP (Daniel), II, , 114. LITTLE, I, 706. LITTR, II, 893, 909, 932-934. LITZMANN (C.), II, 733. LOCKE, I, 10 II, 5, 16, 17, 75, 225, 226, 227, 234, 263, 272-295, 311, 312, 318, 319-320, 331, 332, 334, 340, 343, 344, 346, 347, 370, 380, 385, 388, 390, 394, 395, 396, 400, 403, 405, 407, 408, 409, 414, 422, 432, 437, 439, 447, 452, 455, 456, 457, 476, 487, 491, 494, 497, 581, 604, 638, 644, 645, 658, 668, 674, 758, 809, 849, 917, 1111. LOISY, I, 485. LOMBROSO, II, 934. LONGIN, I, 450. LONGPR, I, 737. LORENZ (P.), II, 500. LORENZ VON STEIN, II, 790. LORENZO COLOSIO, I, 283. LOSSIUS, II, 514. LOSSKI, II, 1025. LOTZE, II, 995-996. LOUIS, I, 603. LOUVILLE, II, 459. LWE, II, 711. LUC (de), II, 757. LUCAIN, I, 531, 549. LUCAS, II, 199. LUCIEN, I, 264, 370, 419, 436, 468, 469, 760. LUCRCE, I, 80, 296, 335, 339, 340, 341, 342, 344, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 355, 362, 370, 395, 407, 410, 411, 414, 490, 578, 13, 909. LUCULLUS, I, 412, 413. LUDOVICI (K.-G.), II, 365. LULLE (Raymond), I, 700-704, 707.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
582
LUTHER, II, 301, 555, 585, 777. LYCURGUE, I, 290 LYON (G.), II, 156, 295, 335, 358. LYSIAS, I, 106. LYSIS, I, 54.
M
@ MABILLEAU, I, 787. MABLY, II, 371. MACAULAY, II, 678. MACH, II, 945-950, 1065, 1068, 1074, 1112. MACHIAVEL, I, 742, 770, 771, 776. II, 3, 5, 17, 30. MACHIORO, I, 87. MACKINTOSH (J.), II, 335, 679. MC TAGGART, II, 984, 1055. MACROBE, I, 539, 550, 556, 572, 586, 590. MAGENTINOS (Lon), I, 629. MAGNENUS, I, 14. MAGNIEN, II, 13. MAHEU, II, 358. MAHNKE (D.), II, 270. MATER, I, 95, 259. MAMON (Salomon), II, 566, 567. MAIMONIDE, I, 625, 626, 632, 159. MAINE de BIRAN, II, 399, 573, 575, 579, 599, 603, 608, 609, 613, 614-636, 638, 640, 642, 646, 647, 660, 662, 1005, 1043, 1094. MAIRAN, II, 223. MAIRE (Albert), II, 142. MAISTRE (J. de), II, 45, 487, 488, 4.91, 573, 57 5, 576, 579, 581-584, 598, 858, 864, 885. MAITRE (L.), I, 549. MALEBRANCHE, II, 16, 17, 26, 64, 107, 114, 116, 117, 123, 124, 197, 200-228, 229, 234, 247, 258, 279, 287, 311, 320, 321, 339, 343, 346, 348, 350, 357, 371, 374, 383, 389, 390, 403, 407, 409, 460, 469, 478, 514, 546, 583, 588, 589, 626, 627, 628, 900, 939. MALESHERBES, II, 433, 485. MALLARM, II, 910. MALPIGHI, II, 261. MALTHUS, II, 676-678, 922. MALUS, II, 757. MALVY, II, 143. MAMERT (claudien), I, 528, 532, 547, MANDEVILLE, II, 329, 339, 430. MANDONNET, I, 684, 705, 706, 725. MANEGOLD de LAUTENBACH, I, 556. MANI, I, 505. MANITIUS, I, 485. MANSEL, II, 673, 925. MARC-AURLE, I, 291, 415, 418, 428-430, 497, 767, 635. MARCELLA, I, 336. MARCIANUS CAPELLA, I, 531, 532, 534, 547, 550, 572. MARCION, I, 501, 502, 503. MARCK (S.), II, 1063. MARCHAL (Christian), II, 598. MARCHAL (Le Pre), II, 1123, 1124.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
583
MARCHAUX, I, 567. MARET, II, 835, 836. MIARGERIE (de), II, 598. MARIANO, II, 905. MARILLIEN, II, 646. MARINUS, I, 468, 476. MARION, II, 294. MARISCOURT (Pierre de), I, 697. MARITAIN, II, 1123. MARIUS (A.), I, 707. MARIUS VICTOR, I, 512, 532. MARMONTEL, II, 426, 434. MARRAST (A.), II, 567, 658, 663. MARSILE FICIN, I, 14, 743, 750, 776, 782, 118, 120, 355. MARSILE DINGHEM, I, 728. MARTHA, I, 414, 417. MARTIN (Andr) (Ambrosius-Victor), II, 202, 228. MARTIN (B.), II, 824. MARTIN (J.), I, 522. MARTIN (TH.-H.), I, 166, 1001. MARTINO (P.), II, 360. MARVIN, II, 1106. MARX, II, 678, 790, 791, 792, 793, 794, 797, 895, 89T ;, 908. MASLAM (Lady), II, 273. MASNOVO, I, 705. MASPERO, I, 481. MASSON (P.-M.), II, 483, 486. MASSON (F.), II, 45. MASSON-OURSEL, I, 7, 33. MATERNUS, I, 420. MATHIEU (G.), I, 98, 269. MATTHIEU DAQUASPARTA, 1, 652, 705. MATTIA DORIA, II, 227. MAUDUIT, II, 826, 838. MAUESBERGER, I, 283. MAUGAIN, II, 18, 366. MAUPERTUIS, II, 312, 455, 486. MAURICE (F.-D.), II, 957. MAUNY, I, 468, 17. MAUSS (Marcel), II, 1132. MAUVEAUX, II, 453. MAUXION, II, 824. MAXIME de TYR, I, 417. MAXIME LE CONFESSEUR, I, 540, 541, 543. MAXIMILIEN de BAVIRE, II, 47. MAYER, II, 945. MAYJONADE, II, 646. MAZZINI, II, 595, 596, 902, 903-905. MCOSH (James), II, 682. MAUTIS (G.), I, 87. MEDICUS, II, 711. MEIJER (W.), II, 299. MEINARDUS, II, 425. MEINONG, II, 425, 1110.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
584
MEINSMA, II, 199. MLANCHTON, II, 2. MLAGRE de GADARA, I, 292. MLISSOS de SAMOS, I, 66, 67, 85. MNANDRE, I, 242, 276. MNAND (Louis), II, 977. MNCE, I, 334, 335, 355. MNCLS LE PYRRHONIEN, I, 374. MENDELSSOHN, II, 494, 496, 514, 565. MNDME, I, 274, 290. MNIPPE, I, 269, MENNICKEN, II, 228. MNON, I, 101, 116. MENTR (F.), II, 992. MENZEL, II, 199. MERBACH, I, 362. MERCATOR, II, 306. MERCIER, II, 1122. MR, II, 132. MERLANT (J.), II, 431. MERSENNE, II, 17, 48, 49, 50, 62, 64, 65, 98, 99, 144. MESMER, II, 488. MESNARD (P.), I, 787. MESSER, II, 571. MTOCHITA (Thodore), I, 628, 632. MTRODORE, I, 334, 335, 387. METZ (R.), II, 425. METZGER (W.), II, 732. MEYER (Eduard), II, 791. MEYER (Louis), II, 194. MEYER (W.), I, 608, 500. MEYERSON (E.), II, 785, 1074, 1075, 1095. MICHAUD (R.), I, 1, 608. II, 832, 839. MICHEL DEPHSE, I, 628, 629, 632. MICHEL ITALICOS, I, 628, 632. MICHELET, II, 367, 576. MICICIEVICZ, II, 595, 828, 829. MIELISCH, II, 199. MIGNE, I, 516, 517, 519, 520, 521, 528, 530, 532, 537, 539, 540, 542, 543, 547, 548, 553, 554, 555, 556, 564, 566, 567, 570, 577, 578, 583, 592, 594, 595, 607, 608, 630, 632, 766. MILHAUD (G.), I, 4, 167, 126, 127, 571, 1065-1067. MILL (James), II, 674, 676, 677, 678-679, 912. MILL (J. ST.), II, 682, 893, 910, 911, 912-919, 925, 932, 937, 938, 940, 997, 1040, 1055, 1067, 1094, 1096. MILTON, II, 5. MIRABEAU, II, 426, 430. MIRECOURT (Jean de), I, 715, 724, 737. MIRON, II, 226. MNASAS, I, 291. MODERATUS de GADES, I, 440, 441, 451. MODON (Nicolas de), I, 628. MOLESWORTH (W.), II, 156. MOLIRE, II, 428. MOLITOR, II, 711.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
585
MOLYNEUX, II, 394, 395. MONGE, II, 875. MONCEAUX, I, 448. MONGLOND, II, 500. MONINIOS, I, 276. MONTAIGNE, I, 760-767, 769, 771. II, 17, 103, 135, 138, 139, 140, 298, 300, 368, 373, 460, 619, 832. MONTALEMBERT, II, 594, 597, 903. MONTESQUIEU, II, 225, 373-381, 382, 463, 478, 502, 601, 619, 686, 863. MONTMOR, II, 17. MOORE, II, 1102, 1105. MORE (P.-E.), I, 166, 331, 291. MOREL, II, 484. MORGAN, (Auguste), II, 913. MORGAN (Thomas), II, 324, 673. MORIN, II, 50, 90. MORLEY, II, 454. MORNET, II, 320, 483. MORVONNAIS (Hippolyte de la), II, 846. LA MOTHE LE VAYER, II, 9, 15. MOULTOU, II, 479. MOUY (P.), II, 228, 991. MOYSSET, II, 898. MUCIUS SCAEVOLA, I, 397, 398, 399. MHL (von der), I, 361. MUIRHEAD, II, 1055. MUIRON, II, 845. MLLER (Hermann), II, 128. MLLER (H. F.), I, 485. MLLER (Max), II, 573, 909. MULLER (Maurice), II, 454. MUNK, I, 626, 630, 632. MNSTERBERG, II, 1083. MUSONIUS, I, 370, 418, 419, 420, 422-424, 492, 508, 521. MUSSET (A. de), II, 573. MUSSET-PATHEY, II, 483. MUTSCHMANN, I, 389.
N
@ NAGY, I, 631. NAIGEON, II, 453. NAMER, I, 787. NASSAU (Maurice de), II, 46, 47. NATHAN, II, 271. NATHIN, I, 729. NATORP, I, 100, 127, 572, 1078, 1079. NAUSIPHANE de TOS, I, 341, 370, 371. NAVILLE, II, 646. NECKHAM (Alexandre), I, 691, 706. NEDELKOVITCH, II, 453, 454. NEEDHAM, II, 459. NEF (W.), II, 954. NELSON, II, 813.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
586
NEMESIUS, I, 450, 495, 517, 575. NESTLE, I, 83, 87. NESTORIUS, I, 525. NEUMANN, II, 746. NEW MAN, I, 258, 832, 955-957, 1035, 1039. NEWTON, II, 43, 44, 92, 98, 129, 225, 233, 242 ; 2244, 245, 292, 306, 311-319, 336, 348, 352, 353, 364, 390, 400, 404, 447, 452, 455, 456, 458, 459, 491, 494, 510, 519, 539, 559, 576, 583, 753, 757, 841, 845, 849, 868, 869, 870, 874, 887, 1065. NICIAS, I, 93, 102. NICOLAS, II, 711. NICOLAI, II, 489, NICOLE, II, 1, 8, 9, 114, 304. NICOMAQUE, I, 441, 531, 628. NIETHAMMER, II, 711. NIETZSCHE, II, 156, 731, 743, 787, 820, 910, 942, 944, 945, 1013-1022, 1030, 1068. NIFO, I, 756. NOACK, II, 799. NOL (G.), II, 785. NIHUSIUS, II, 304. NORL, II, 784. NORDEN, I, 402. NORRIS (John), II, 227, 357. NOVALIS, II, 489, 579, 714, 727, 729, 801. NOVARO (M.), II, 228. NUMNIUS, I, 161, 387, 413, 443, 444, 472, 473.
O
@ OCONNOR, II, 506. OGEREAU, I, 331. OKEN (L.), II, 750. OLDENBURG, II, 162, 170, 233. OLL-LAPRUNE, I, 259, 228, 667, 1034-1038. OLLION (H.), II, 294. OLLIVIER (M), II, 786. OLTRAMARE, I, 7, 393. OMER TALON, I, 760, 763. ONSICRITE, I, 278. ONOMACRITE, I, 48. ORESME (Nicolas), I, 728, 738. ORESTE, I, 264. ORIGNE, I, 291, 317, 491, 495, 506-510, 541 : ORIGNE LE NOPLATONICIEN, I, 450. ORPHE, I, 628. OSTWALD (W.), II, 571, 948, 1073. OUALID, II, 898. OVIDE, I, 541, 574, 602.
P
@ PACAUD, II, 570. PACHYMRE (Georges), I, 629. PAGET (Amde), II, 845.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
587
PALACIO, I, 705. PALAMAS (Grgoire), I, 630, 632. PALOLOGUE, II, 431. PALHORIS, I, 705, 901, 902, 903, 905. PALISSOT, II, 433. PALISSY (Bernard), II, 16. PALLAS, 451. PANTIUS, I, 165, 394-401, 402, 412, 421. PANTNE, I, 506. PAPPUS, II, 55. PARACELSE, I, 751. II, 25, 41, 231, 714. PAR (Ambroise), II, 16. PARKER, II, 115. PARMNIDE, I, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 78, 84, 121, 127, 130, 131, 140, 266, 337, 381, 779. II, 70, 997, 1078. PARODI, II, 358, 483, 992, 1097. PASCAL, I, 30, 497. II, 17, 51, 52, 73, 97, 98, 129-143, 233, 239, 242, 306, 373, 421, 427, 428, 460, 461, 495, 619, 836, 956, 1015, 1017, 1037. PASCHASE RADBUT, I, 552, 566. PASICLS, I, 170. PASQUALI, I, 485. PASTOR, I, 731. PATER (W.), I, 167. PATRIZZI, I, 778. PATRU, II, 303. PATTISON (marck), II, 957. PAUL (St), I, 491, 494-497, 502, 518, 521, 528, 936, 957, 968. PAULHAN (F.), II, 598, 1136. PAUSANIAS, I, 106, 290. PAUTIGNY, I, 522. PAYNE, II, 676. PECKHAM (Jean), I, 643, 653, 687, 706. PDIASIMOS, I, 629, 632. PEIRCE, II, 1038, 1042. PLAGE, I, 515, 525. PELETIER (Jacques), I, 762. PELLARIN, II, 845, 847. PELLETAN (Eugne), II, 846. PELLISSIER (G.), II, 465. PELZER, I, 690. PENJON, II, 721, 358. PRIER (A.), I, 631. PERRIN, II, 1076. PERROT DABLANCOURT, II, 303. PERRY, II, 1105. PERSE, I, 419. PERSE, I, 290. PESTALOZZI, II, 808. PETERS, II, 271. PETRON, I, 52. PEYRE (A.), II, 977. PFLAUM, I, 753, 164. PHDRE, I, 106. PHDRE (Lpicurien), I, 407.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
588
PHNARTE, I, 89, 94. PHRCYDE de SYROS, I, 575. PHILIPPSON, I, 393. PHILODME, I, 89, 268, 355, 407, 408, 409, 410. PHILOLAS, I, 75. PHILON DALEXANDRIE, I, 291, 292, 294, 302, 313, 319, 370, 374, 395, 398, 403, 404, 415, 417, 421, 433, 438-440, 441, 442, 444, 448, 491, 498, 499, 501, 523, 533, 545, 560, 580, 623, 736, 751, 193, 773. PHILON DATHNES, I, 372. PHILON de LARISSE, I, 387, 411, 412, 413, 414, 430. PHILONIDE de THBES, I, 290. PHILOPON (Jean), I, 445, 613. PHILOSTRATE, I, 436, 468. PHOTIUS, I, 430, 627, 632. PIAGET (Jean), II, 1140. PIAT, I, 167, 259. PIC de LA MIRANDOLE (Jean), I, 750, 776. PICAVET, I, 547, 567, 453, 570, 711. PICHLER, II, 365, 613. PICHON, I, 425. PICOT, II, 50. PIERRE COMESTOR, I, 570, 607. PIERRE LE LOMBARD, I, 570, 571, 588, 593, 603, 607, 634, 646, 708. PIERRE de POITIERS, I, 570, 603, 607. PIETRO DABANO, I, 743. PIRON (H.), II, 1137. PILLON, II, 228, 309, 425, 971, 980. PINDARE, I, 49, 57, 61, 380. PINEAU, I, 786. PIROU, II, 898. PISITRATE, I, 48. PLAN, II, 483. PLATON, I, 5, 11, 14, 17, 30, 33, 34, 35, 36, 48, 49, 50, 59, 60, 64, 65, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96-167, 9.68, 1.69, 171, 172, 177, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 197, 200, 206, 212, 213, 214, 218, 220, 222, 223, 224, 230, 231, 235, 238, 240, 243, 247, 250, 258, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 270, 272, 275, 277, 278, 279, 280, 286, 290, 293, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 305, 307, 308, 310, 312, 316, 327, 338, 363, 367, 375, 381, 396, 397, 405, 412, 413, 415, 416, 417, 441, 442, 443, 444, 453, 457, 458, 461, 469, 470, 479, 490, 492, 498, 499, 500, 502, 506, 510, 512, 514, 518, 528, 530, 533, 539, 541, 556, 561, 572, 574, 578, 585, 586, 590, 591, 592, 609, 615, 627, 628, 629, 637, 642, 647, 721, 728, 732, 744, 745, 750, 751, 752, 775, 776, 778, 779, 780, 783. II, 15, 16, 32, 33, 69, 70, 74, 76, 99, 118, 119, 203, 225, 235, 259, 340, 355, 356, 367, 407, 440, 469, 551, 558, 650, 706, 719, 767, 818, 832, 836, 838, 844, 862, 900, 944, 986, 996, 1018, 1045, 1061, 1076, 1077. LE PLAY, II, 1126. PLECHANOW (G.), II, 454. PLTHON, I, 627, 628, 629, 632, 750. PLINE, I, 397, 401, 532, 534, 538, 541, 698, 755. II, 25, 27, 42. PLITT, II, 732. PLOTIN, I, 11, 14, 370, 430, 436, 444, 445, 449-465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 473, 474, 475, 480, 481, 482, 484, 485, 491, 495, 503, 512, 514, 517, 518, 523, 530, 535, 539, 544, 546, 580, 601, 613, 615, 616, 618, 627, 628, 648, 663, 698, 731, 732, 735, 736, 745, 748, 749, 750, 751, 755, 757, 779, 780, 783, 784. II, 15, 70, 71, 118, 169, 225, 247, 253, 255, 261, 291,
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
589
337, 355, 469, 680, 706, 707, 719, 723, 746, 763, 830, 838, 903, 927, 963, 993, 994, 1008, 1028, 1029, 1032, 1053, 1057, 1079, 1092. PLOUCQUET, II, 514. PLUTARQUE de CHRONE, I, 12, 44, 47, 52, 67, 69, 100, 141, 163, 164, 166, 257, 267, 289, 290, 291, 292, 300, 312, 314, 317, 319, 320, 322, 330, 337, 338, 351, 352, 358, 359, 361, 369, 375, 378, 381, 384, 401, 402, 415, 421, 422, 436, 437, 441-443, 606, 613, 766. II, 426. PLUTARQUE DATHNES, I, 476. PLUZANSKI, I, 737. POGGE (LE), I, 740. POHL, II, 757. POHLENS, I, 414. POINCAR (Henri), II, 1064, 1065-1067, 1069, 1070. POINSOT, II, 861. POIRET, II, 197. POLMON, I, 161, 165, 292, 293, 379, 384, 412. POLIGNAC, II, 227. POLLACK, I, 630. POLLOCK, II, 198, 953. POLYAENUS, I, 334. POLYBE, I, 401, 402, 407, 493. POLYCRATE, I, 89, 98. POLYSPERCHON, I, 287. POLYSTRATE L picurien, I, 363-365, 393. POMMEREL, II, 454. POMMIER (J.), II, 667, 936, 954. POMPONAZZI, I, 753-756, 759, 786, 302. PONTUS de TYARD, I, 743. PORE, I, 567. POUCHET, I, 259. PORPHYRE, I, 89, 91, 174, 256, 257, 356, 441, 445, 450, 456, 465, 467, 468, 469, 470-482, 485, 518, 529, 539, 550, 551, 582, 585, 589, 604, 613 ; 1 ; 627. POSIDONIUS, I, 320, 401-407, 411, 412, 421, 424, 450. POSTEL, I, 775-776, 787. POWELL, II, 957. POWICKE (Frdric J.), II, 295. PRADES (Abb de), II, 433. PRAECHTER, I, 88. PRANTL, I, 551, 586. II, 799. PRAT, II, 971, 980. PRELLER, I, 38. PRIESTLEY, II, 502, 506. PROAL (L.), II, 483. PROCLUS, I, 36, 256, 311, 402, 441, 444, 466, 467, 468, 469, 470, 472, 473, 474, 475, 476-481, 482, 483, 484, 485, 491, 492, 495, 518, 519, 520, 521, 559, 576, 596, 613, 617, 627, 628, 658, 663, 700, 734, 745. II, 225, 247, 337, 355, 488. PRODICUS de COS, I, 83, 84, 85, 106. PROMTHE, 107. PROST, I, 787, 128, 228. PROTAGORAS DABDRE, I, 79, 82, 83, 84, 85, 90, 102, 105, 106, 107, 123, 124, 217. II, 83, 1045. PROTOIS, I, 607. PROUDHON, II, 796, 797, 804, 837, 840, 894-898. PROTOIS, I, 607.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
590
PRZYWARA (Erich), II, 1122, 1123. PSELLOS, I, 627, 628, 629, 632. PTOLME, I, 613, 628, 638, 696, 699, 762. II, 640. PTOLME de LUCQUES, I, 682. PUAUX, II, 309. PUECH (A.), I, 500, 522. PUECH (J. L.), II, 898. PUECH (H. CH.), II, 1062. PUSEY, II, 955. PYRRHON, I, 370-374, 377, 378, 380, 381, 383, 392, 630. PYTHAGORE, I, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 65, 75, 87, 230, 423, 472, 541, 556, 613, 780, 336, 369, 1076. PYTHAS de MARSEILLE, I, 406. PYTHOCLS, I, 335.
Q
@ QUAST (O), II, 425. QUPRAT, II, 454. QUESNAY, II, 501, 502. QUINET, II, 576, 652. QUINTILIEN, I, 532. QUINTUS TUBRON, I, 397.
R
@ RABELAIS, I, 761. RACINE, II, 428. RADULFUS ARDENS, I, 569, 607. RAEDER (II.), I, 166. RAEY (JEAN de), II, 114. RAME (Pierre de La), I, 771-775. II, 54. RAMSAY, II, 433. RASMUSSEN, II, 682. RAUH (Frdric), II, 142, 195, 199, 1098. RAVAISSON, I, 259, 331, 142, 614, 1003-1012, 1028, 1092, 1095. RAWIDOWICZ, II, 800. RAWLEY, II, 41. RAY (JEAN), II, 486. RAYMOND, I, 636. READ, II, 1057. READE (W. W.), II, 931. RE (Paul), II, 923. RGIS (Sylvain), 115, 123-126, 128, 197, 218, 219, 223, 226. RGIUS, II, 51, 82, 84. RGNAULT, II, 877. REHMKE, II, 1108-1122. REID, II, 312, 332, 403, 497-499, 500, 594, 668, 669, 670, 671, 958 : REIMARUS, II, 491. REINERS, I, 567. REINHARDT, I, 403, 404, 414. II, 571. REINHOLD, I, 20, 21. II, 565. REITZENSTEIN, I, 467.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
591
RMUSAT (Charles de), 1 ; 567, 608. II, 775, 1001. RMY DAUXERRE, I, 550. RENAN, I, 448, 522, 631, 706. II, 573, 654, 789, 806, 807, 828, 834, 836, 909, 931, 1002, 1025. RENAUD DELISSAGARAY, II, 225. RENAUD (H.), II, 845. RENOUVIER, I, 26, 27, 28, 29, 37. II, 358, 425, 454, 573, 908, 955, 966, 968, 969, 970982, 1009, 1034, 1060, 1061. RESTIF de LA BRETONNE, II, 488. REVERDIN (H.), II, 1043. REVIUS, II, 51. REY (Abel), II, 1073. REYMOND, I, 86. REYNAUD (Jean), II, 854, 961-962, 993. RHABAN MAUR, I, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 548, 552, 566. RIBOT, II, 824. RICARDO, II, 676-678. RICHARD de SAINT-VICTOR, I, 582. RICHARD (G.), II, 792, 1133. RICKERT, II, 1081, 1082. RIGNANO, 1074. RIEHL, II, 571, 984, 992. RIES, I, 608. RISNER, I, 631. BITTER, I, 38. BITTER (Constantin), I, 167. BITTER (Le Physicien), II, 715. BITTER (J.-H.), II, 500. RITZENFELD, I, 485. RIVAUD, I, 79, 86. II, 199. ROBERT GROSSETESTE, I, 590, 604, 607. ROBERT de MELUN, I, 570, 607. ROBERT PULLUS, I, 570, 607. ROBERT de COURON, I, 639. ROBERTSON (G. C.), II, 156. ROBERVAL, II, 17, 51, 98, 244. ROBESPIERRE, II, 866. ROBIN, I, 38, 95, 167, 259, 362. ROBINET (J.-B.), II, 450. ROBIOU, I, 447. ROCHE, II, 226. ROCQUES (P.), II, 784. RODIEN, I, 167, 259, 283, 331, 332, 271. RODRIGUES (OLINde), II, 854, 855. ROEMER, II, 91. ROGERS, II, 682, 969, 1050. ROHAULT, II, 115, 204, 312. ROHDE, I, 49, 1013. ROLAND de CRMONE, I, 687. ROLAND-GOSSELIN, I, 259, 642, 675. ROMAGNOSI, II, 612. ROMANES, II, 931, 953. ROMEYER (B.), II, 143. RONSARD, I, 753.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
592
ROSCA, II, 954. ROSCELIN de COMPIGNE, I, 564-566, 567, 585, 717. ROSE (V.), I, 258. ROSENBERGER, II, 320. ROSENKRANZ, II, 453, 570, 799, 800. ROSMINI, II, 899-901, 902, 904, 905. ROSS, I, 258, 259. ROSTAN, II, 646. ROUSSEAU, I, 583, 225, 226, 358 ; 382, 384, 403, 424, 434, 438, 445, 466-484, 485, 513, 546, 548, 549, 554, 575, 579, 586, 587, 592, 616, 618, 621, 631, 686, 768, 769, 828, 841, 842, 853, 866, 897, 960, 1016. ROUSSELOT, I, 608, 705, 753. ROUSTAN (D.), II, 227. ROUSTAN (M.), II, 400. ROUVRE (de), II, 893. ROYCE, II, 739, 785, 984, 1050-1058. ROYER-COLLARD, II, 647, 649-652, 654, 656, 899. ROZENZWEIG (F.), II, 785. RDIGER (Andras), II, 364. RUELLE, I, 485. RUFIN, I, 492. RUGE (Arnold), II, 791, 798. RULF, II, 271. RUMFORD, II, 757. RUSSELL, II, 270, 1064, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106. RUSTICUS ARULINUS, I, 420. RUTILIUS RUFUS, I, 397. RUYER (R.), II, 992. RUYSBROECK (Jean), I, 736, 738. RUYSSEN (TH.), II, 571, 824. II, 1038.
S
@ SAADJA, I, 624, 632. SABELLIUS, I, 524. SAIGEY (.), II, 465. SAINT-CYRAN, II, 7. SAINT-MARTIN, II, 485-491, 713, 714, 718, 727, 731, 745. SAINT-SIMON, II, 576, 665, 677, 685, 835, 840, 841, 848-860, 885, 886, 1126. SAINT-PIERRE (Abb de), II, 850. SAINTE-BEUVE, II, 666, 838, 921. SALIBA, I, 631. SALISBURY (Jean de), 1 ; 573, 586, 587, 588, 594, 598, 602-606, 608. SALLUSTE, I, 467. SALOMON (M.), II, 667. SANCHEZ (Franois), I, 765. SAND (George), II, 855. SANTAYANA, II, 1105. SAPHARY, II, 665, 666. SATHAS, I, 632. SAURAT, II, 5. SAUTER, I, 631. LE SAVOUREUX, II, 991. SAY (J.-B.), II, 506.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
593
SAYOUS, II, 400. SCHAD (J.-B.), II, 711. SCHELER (MAX), II, 1116, 1117, 1118. SCHELLING, I, 36. II, 311, 573, 576, 644, 645, 656, 708, 711, 712-733, 734, 736, 737, 738, 766, 798, 802, 803, 806, 808, 823, 832, 835, 944, 965, 998, 999, 1003, 1004. SCHERER, II, 836. SCHILLER (J.), I, 608. SCHILLER (J. F. C.), II, 689, 742, 807. SCHILLER (F. C. S.), II, 1044, 1045, 1046. SCHINZ, II, 483. SCHLEGEL (A. W.), II, 489, 690, 721, 722, 726, 727, 775. SCHLEGEL (F.), II, 683, 721, 730, 805. SCHLEIERMACHER, II, 683, 805-807, 824, 955. SCHMEKEL, I, 414. SCHMID (CH. E.), II, 565. SCHMOLDERS, I, 630. SCHNEIDER (A.), I, 608, 654, 705. SCHNEIDER (J.), II, 500. SCHOLZ, II, 495, 500. SCHOOT, II, 51. SCHOPENHAUER, II, 548, 743, 798, 801, 813-823, 824, 851, 907, 945, 998, 999, 1013, 1014, 1015, 1019. SCHUBERT (G. H.), II, 731. SCHUBERT-SOLDEN, II, 350. SCHULTZ (albert), II, 507. SCHULZE (Albert), II, 567, 568. SCHUPPE, II, 949, 950. SCHWARZ, II, 127. SCOT ERIGNE (Jean), I, 540-546, 548, 571, 586, 589, 601, 638, 728, 779, 786. SCOT (Michel), I, 691. SCOTT (W. R.), II, 335. SAILLES, I, 28, 787, 1.28, 969, 991, 994, 1005, 1008, 1091. SECRTAN, II, 908, 962-966, 971. SE (H.), II, 381. SEEBERG, I, 566. SEELEY, II, 957. SEGOND, II, 899, 905, 1032. SEILLIRE (Ernest), II, 1087. SENANCOUR, II, 577, 633. SNQUE, I, 291, 316, 319, 326, 327, 356, 370, 375, 402, 403, 406, 407, 415, 417, 422, 424-426, 427, 428, 437, 440, 486, 491, 494, 495, 515, 533, 573, 574, 594, 602, 766, 767. II, 16, 426, 619. SENTROUL (C.), II, 571. SERENUS, I, 422, 426. SERTILLANGES, I, 705. II, 1123. SETH PRINGLE-PATTISON, II, 1056. SVERAC, II, 454, 506. SEVRE, I, 443. SEXTIUS, I, 428, 440, 528. SEXTUS EMPIRICUS, I, 12, 15, 79, 279, 282, 291, 302, 304, 307, 329, 336, 339, 370, 373, 377, 381, 382, 383, 385, 386, 387, 388, 389, 391, 392, 394, 403, 409, 413, 416, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 637, 724 SEYFARTH (H.), II, 128. SHADWORTH, II, 1105.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
594
SHAFTESBURY (Comte de), II, 273. SHAFTESBURY (Comte A. de), II, 293, 294, 329, 330, 432, 437, 813. SHAKESPEARE, II, 721, 941. SHARP, II, 425. SHELLE (G.), II, 506. SHERLOCK, II, 324, 325. SIEBECK, II, 24. SIEYS, II, 599. SIGER de BRABANT, I, 644, 658, 683-686, 690, 725, 743, 754. II, 113. SIGWART, II, 1097, 1108. SIMMEL, II, 1084-1088. SIMMIAS, I, 75. SIMON (J.), I, 485, 667, 1000, 1001. SIMON (RICHARD), II, 194. SIMPLICIUS, I, 308, 345, 441, 445, 552, 564, 629. SINKO, I, 443, 448. SIRVEN (J.), II, 126, 456. SLOWACKI, II, 829. SMITH (J.), II, 291. SMITH (Adam), II, 331, 382, 422-425, 501, 502, 503. SOCRATE, I, 10, 19, 34, 75, 77, 82, 88-95, 96, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112, I, 113, 117, 119, 120, 121, 132, 143, 144, 145, 150, 189, 190, 194, 240, 246, 263, 270, 278, 298, 299, 304, 338, 368, 370, 372, 374, 380, 413, 423, 425, 455, 498, 499, 552, 565, 572, 586, 588, 711, 712, 778. II, 324, 356, 685, 1018, 1094. SOLGER, II, 732. SOLOVINE, I, 361. SOMMER, II, 125. SOPHOCLE, I, 84. SOPHONIAS, I, 629, 632. SOREL (Albert), II, 381. SOREL (G.), II, 800, 1048-1049. SORLEY, I, 38. II, 682, 1057. SORTAIS, I, 765, 773, 774, 787. II, 45, 126, 128, 157. SOUILH (J.), I, 167. II, 143. SOURIAU (Paul), II, 1092. SOZZINI (Fauste), II, 6. SPAVENTA, II, 1058. SPEDDING, II, 45. SPENCER, II, 673, 731, 911, 923, 924-929, 931, 934, 966, 980, 1009, 1033, 1037, 1045, 1047, 1064, 1067, 1090, 1091, 1095, 1126, 1130, 1138. SPENER, II, 507. SPENGLER, II, 1087. SPENL, II, 733. SPEUSIPPE, I, 161, 1.62, 163, 165, 193, 249, 280, 293. SPHAERUS, I, 286, 290. SPINOZA, I, 10, 33. II, 17, 26, 84, 107, 149, 158-199, 204, 216, 223, 233, 234, 238, 251, 279, 292, 298, 311, 322, 362, 383, 389, 415, 495, 496, 514, 698, 699, 720, 731, 751, 775, 897, 937, 938, 993, 1001, 1053, 1092. SPINTHAROS, I, 91. SPIR, II, 996-998. SPRAT, II, 45. SPULLER, II, 598. STAL (Mme de), II, 591, 643, 645. STAHL, II, 632, 1003.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
595
STAMMLER, II, 483, 1080. STANLEY JEVONS, II, 1058. STAUPITZ, I, 719. STANYAN, II, 432. STEELE, I, 706. STEFFENS, II, 731. STEIN, I, 332, 270. STENDHAL, II, 600, 609-610, 814. STNON, II, 101. STEWART (H. F.), I, 548. STILPON de MGARE, I 265, 266, 292, 293, 338. STIRLING, II, 984. STIRNFR (MAX), II, 793, 794, 795, 796, 797, 830, 832, 1096. STOBE, I, 12, 80, 293, 314, 317, 322, 361, 367, 369, 384, 392, 396, 414, 422, 423, 440, 472. STOUT (G. F.), II, 1100. STRABON, I, 59, 368, 402. STRATON de LAMPSAQUE, I, 257. STRAUSS (David), II, 787, 789, 806, 936, 1013. STRECKEISEN-MOULTOU, II, 483. STROWSKI, I, 787. II, 142. STUMPF, II, 1108. STURM, I, 18. SUAREZ, II, 1. SUSO (Henri), I, 736. SWAMMERDAM, II, 261. SWEDENBORG, II, 487, 512, 832. SYDENHAM, II, 273. SYMON, I, 630, 632.
T
@ TACITE, I, 420, 424. II, 307. TAINE, II, 573, 667, 682, 908, 910, 937-941, 954, 966, 993, 1002, 1023, 1033, 1064, 1067. TALBOT, II, 20. TALLEYRAND, II, 649. TANNERY, I, 59, 86. II, 126, 127, 571. TARDE (G.), II, 1126, 1127. TARTAGLIA, I, 759. TATIEN, I, 415, 497, 499, 500. TAULER (Jean), I, 736. TAURUS, I, 422. TAYLOR, I, 95, 167. II, 157, 425. TLS, I, 367, 530. TELESIO, I, 776, 778, 783. TELLKAMP (A.), II, 295. TENNYSON, II, 1057. TERRASSON, II, 227. TERTULLIEN, I, 492, 500, 515. TETENS, II, 514. THALS, I, 3, 6, 42, 45, 47, 86. THAMIN (R.), I, 522. II, 228. THTTE, I, 105, 137. THMISON, I, 169.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
596
THMISTIUS, I, 445, 446, 613, 636. THODORE (Le Gomtre), I, 97. THODORE LATHE, I, 275, 366, 367. THODORE BAR KHONI, I, 505. THODORE de GALA, I, 629. THOGNIS, I, 360. THON de SMYRNE, I, 417. THOPHRASTF, I, 45, 70, 74, 77, 78, 79, 86, 255, 256, 259, 265, .367, 368, 411, 445, 446, 471, 517. II, 30. THRY (G.), I, 547, 608. THIERRY (augustin), II, 848. THIERRY de CHARTRES, I, 573, 574. THIERSCH, II, 500. THOMAS (F.), I, 362. THOMAS (P. F.), II, 969. THOMAS (ST.), I, 571, 601, 625, 633, 635, 644, 645, 647, 649, 650, 641, 653, 657-682, 683, 684, 686, 688, 689, 690, 699, 705, 708, 709, 710, 717, 719, 722, 723, II, 25, 113, 833, 836. THOMASIUS, II, 235. THOMASSIN, II, 225, 291. THRASAS, I, 420. THUCYDIDE, I, 83, 85. II, 144. THUREAU-DANGIN, II, 969. THUROT, I, 259. II, 648. TIBERGHIEN, II, 804, 805. TIECK, II, 683, 727, 801. TIME de LOCRES, I, 75. TIMON, I, 290, 371, 372, 373. TINDAL (Matthew), II, 325. TISSERAND, II, 635, 646. TISSOT, II, 570. TITTEL, II, 565. TIXERONT, F, 521, 522, 547. TOCQUEVILLE (Alexis de), II, 1000. TOLAND, II, 291, 292, 324, 439, 443, 491. TNNIES (F.), II, 156, 157, 800. TONQUDEC, I, 664. TOURNEUR, II, 905. TOURVILLE (H. de), II, 1126. TOUSSAINT, I, 522. TOWIANSKI, II, 829. TRANSON (Abel), II, 845. TREMBLEY (J.), II, 401. TREMESAYGUES, II, 570. TRENDELENBURG, I, 258. TROETSCHL, II, 571, 1082. TROLO, I, 787. TUMARKIN (Anna), II, 572. TYRREL (G.), II, 1035. TYRRELL (James), II, 273.
U
@ UBAGHS, II, 835. UEBERWEG, I, 28, 37. II, 1022.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
597
ULGER, I, 590. ULPIEN, I, 420. ULRICH de STRASBOURG, I, 657. UNAMUNO (de), I, 785. URIEL DA COSTA, II, 158. URTIN, II, 1035. USENER, I, 334, 335, 337, 341, 345, 350, 357, 359, 361.
V
@ VACANDARD, I, 608. VACANT, I, 547, 737. VACHEROT, I, 485, 836, 837, 1001, 1002. VAIHINGER (H.), II, 571, 1068, 1069, 1070, 1112. VAILLY (Mlle de), II, 224. VAIR (Guillaume du), I, 768, 769, 103. VALENTIN, I, 501, 502, 503. VALRY (Paul), II, 910, 1139. VALLETTE, I, 448. VALLIER, II, 271. VALLOIS, II, 643, 646. VAN BIEMA, II, 228, 271. VAN DALE, II, 306, 309. VAN DEN ENDE, II, 159. VAN DEN KODDE, II, 160. VAN DER HAEGHEN, II, 128. VAN DER LINDEN, II, 199. VAN HATTEM, II, 196. VAN HOMRIGH, II, 337. VAN LEENHOF, II, 196. VAN VLOTEN, II, 198. VANINI (L.), I, 782. VANSTEENBERGHE, I, 717, 731, 741, 786. VARILLON, II, 431. VARRON, I, 397, 398, 412, 413, 528, 531. VASQUEZ, I, 681. VAUCANSON, II, 440. VAUGHAN (C. E.), II, 372, 381, 425, 483, 686, 711, 905. VAUVENARGUES, II, 426-431, 445. VAUX (CLOTILDE de), II, 862, 884, 893. VENUTI de DOMINICIS, I, 548. VERMEIL (E.), II, 785. VERRI, II, 613. VIAL, II, 483. VIATTE (A.), II, 487, 500, 598, 838. VICO (Jean-Baptiste), II, 366-372, 381, 403, 827. VICOMERCATO, I, 758, 775. VIDGRAIN, II, 228. VIDARI, I, 787. VIGIER, II, 127. VIGNY (A. de), II, 577, 633. VILLARI, I, 787. VILLE (de la) (P. Valois), II, 114. VILLEY, I, 787.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
598
VILLERMOZ, II, 488, 489. VILLERS, II, 643. VINCENT de LRINS, I, 534, 548, 569, 833. VINET (A.), II, 142. VIRGILE, I, 402, 531, 541, 602, 605. VISCHER (F. T.), II, 799. VITELIUS, I, 424. VITERBE (Jacques de), I, 682, 706. VITRASIUS POLLIO, I, 424. VOTIUS, II, 51. VOGLIANO, I, 335, 410. VOIGT, I, 420. VOITURE, II, 305. VOLDER (DI, ), II, 249. VOLKELT (J.), II, 824, 1084-1088. VOLKMANN, I, 448. VOLNEY, II, 505, 506, 599. VOLP, II, 271. VOLTAIRE, I, 8, 17. II, 43, 252, 308, 312, 315, 318, 320, 331, 355, 363, 371, 382, 384, 394, 416, 426, 431, 434, 455-465, 468, 470, 487, 491, 503, 578, 579, 581, 582, 590, 897. VRIES (Simon de), II, 160, 162. VULLIAUD, I, 632. VUY (J.), II, 483.
W
@ WADDINGTON, I, 772, 774, 787. WAGNER (Richard), II, 907, 1014, 1015, 1020. WAHL (Jean), II, 83, 127, 742, 784, 839, 1040, 1041, 1042, 1053, 1100, 1107. WAITZ, I, 258. WALDS (Pierre), I, 599. WALLAS (May), II, 431. WALLIS, II, 145. WALLNER, II, 711 WALT WHITMAN, II, 1041. WALTZ (R.), I, 447. WARBURTON (William), II, 325. WARD, II, 571, 956, 1057. WAUTIER DAYGALLIERS (A.), I, 738. WAZIL, I, 611. WEBB, I, 608. II, 143, 571. WEBER, I, 28, 37. WEBER (E. H.), II, 994. WEBER (E. A.), II, 732. WEBER (Louis), I, 448. WEIGEL (Erhard), II, 232, 235. WEIGEL (Valentin), I, 751. II, 229, 230. WEILL (G.), II, 860. WEILLER, II, 500. WEIRTHEMER, II, 1139. WEISHAUPT, II, 565. WELLMANN, I, 69, 331. WENDLAND, I, 393. WENKE (H.), II, 785.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
599
WERCKMEISTER, II, 271. WERENFELS, II, 125. WERNER, I, 607. II, 484. WEULERSSE (G.), II, 506. WHATELY, II, 913. WHEWELL, II, 913, 915. WHITEHEAD, II, 1064, 1103, 1106, 1107. WHITTAKER, I, 485. WICLEF (Jean de), I, 715. WIEGERSHAUSEN, II, 572. WILAMOWITZ-MOLLENDORF (von) I, 166, 255, 331, 385. WILBOIS, II, 1067. WILL, II, 832, 839. WINCKELMANN, II, 1014. WINDELBAND, I, 30, 32, 1081, 1082, 1117. WINHOLD, 271. WITELO, I, 699-700. WITT (de), II, 161, 196. WITTICH, II, 114, 197. WHLER, II, 879. WOLF (Christian), II, 359-365, 495, 507, 510, 511, 513, 515, 518, 535. WOLLASTON, II, 325. WOLLSTON, II, 325. WORDSWORTH, II, 679, 912. WORMS, I, 620. WRONSKI (Hon), II, 828-829, 838. WULF (de), I, 38, 547, 689, 690, 706. WUNDT (Max), I, 87. WUNDT (Wilhelm), II, 950-953, 1000. WRSCHMIDT, I, 550. WYNNE, II, 319.
X
@ XNOCRATE, I, 161, 163 ; 1 165, 168, 193, 292, 293, 379, 401. XNOPHANE, I, 50, 51, 54, 60-67, 85, 381. XNOPHON, I, 84, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 269, 270, 271, 272, 278, 298, 406. XIPHILIN, I, 627.
Y
@ YVES de CHARTRES, I, 568, 569, 607.
Z
@ ZAMOLXIS (T.), I, 52. ZANTA (Mlle), I, 767, 769, 787. ZELLER (E.), I, 28, 38, 283. II, 365, 799, 800, 909, 1011. ZEILLER (J.), I, 705. ZNON DELE, I, 65, I, 66, 77, 87, 121, 122, 345.
mile BRHIER Histoire de la philosophie. I. LAntiquit et le Moyen ge
600
ZNON de CITTIUM, I, 262, 268, 277, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 298, 300, 301, 302, 313, 314, 322, 323, 326, 330, 333, 370, 374, 379, 380, 397, 405, 412, 421, 425. II, 838. ZNON LPICURIEN, I, 355, 407, 408. ZNON de TARSE, I, 394. ZERVOS, I, 627, 628-, 629, 632. ZIEBARTH, I, 255. ZIEGLER (TH.), II, 800, 945, 1000. ZIEHEN, II, 949. ZIELER (G.), II, 431. ZOROASTRE, I, 528. ZYMALKOWSKI, II, 271. ZYNDA (von), II, 572.
Nom du document : brephi_1_pdf.doc Dossier : C:\CSS\Brehier Modle : C:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Modles\Normal.dot Titre : Histoire de la philosophie. Tome I, L'Antiquit et le Moyen ge. I. Priode hellnique Sujet : Histoire de la philosophie Auteur : mile Brhier, 1876-1952 Mots cls : Philosophie, Histoire, Prsocratiques, cosmogonies, pythagoriciens, Hraclite, Xnophane, Elates, Empdocle, Anaxagore, Leucippe, Dmocrite, sophistes, Socrate, Platon, Time, Lois, Rpublique, Gorgias, Phdon, Mnon, Banquet, Phdre, Acadmie, Aristote, Commentaires : http://www.uqac.ca/Classiques_des_sciences_sociales/ Date de cration : 12/12/05 13:36 N de rvision : 5 Dernier enregistr. le : 12/12/05 14:34 Dernier enregistrement par : Pierre Palpant Temps total d'dition :28 Minutes Dernire impression sur : 12/12/05 16:57 Tel qu' la dernire impression Nombre de pages : 600 Nombre de mots : 236 846 (approx.) Nombre de caractres : 1 350 023 (approx.)
Vous aimerez peut-être aussi
- HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE, Tome 2Document805 pagesHISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE, Tome 2feuille1115100% (6)
- Brephi 1Document615 pagesBrephi 1quatenus2100% (1)
- Brehier Chryssipe PDFDocument316 pagesBrehier Chryssipe PDFdrfitti1978Pas encore d'évaluation
- Philosophie MédiévaleDocument382 pagesPhilosophie Médiévalesantsetesh100% (1)
- Principes de la philosophie morale: ou Essai sur le mérite et la vertuD'EverandPrincipes de la philosophie morale: ou Essai sur le mérite et la vertuPas encore d'évaluation
- Méditations métaphysiques de René Descartes: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandMéditations métaphysiques de René Descartes: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Plotin (Fiche philosophe): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandPlotin (Fiche philosophe): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frPas encore d'évaluation
- La Destination de l'homme de Johann Gottlieb Fichte: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLa Destination de l'homme de Johann Gottlieb Fichte: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Éthique de Spinoza - L'origine et la nature des sentiments (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandÉthique de Spinoza - L'origine et la nature des sentiments (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frPas encore d'évaluation
- Éloge de la folie d'Érasme (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvreD'EverandÉloge de la folie d'Érasme (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Kierkegaard (Fiche philosophe): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandKierkegaard (Fiche philosophe): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frPas encore d'évaluation
- Actes Enseigner Philosophie 121456Document261 pagesActes Enseigner Philosophie 121456Mamadou Moustapha SarrPas encore d'évaluation
- De l'âme d'Aristote: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandDe l'âme d'Aristote: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Être et Temps de Heidegger - Nécessité, structure et primauté de la question de l'être (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandÊtre et Temps de Heidegger - Nécessité, structure et primauté de la question de l'être (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frPas encore d'évaluation
- Le vivant (Fiche notion): LePetitPhilosophe.fr - Comprendre la philosophieD'EverandLe vivant (Fiche notion): LePetitPhilosophe.fr - Comprendre la philosophieÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Lire Platon avec Hannah Arendt: Pensée, politique, totalitarismeD'EverandLire Platon avec Hannah Arendt: Pensée, politique, totalitarismePas encore d'évaluation
- La matière et l'esprit (Fiche notion): LePetitPhilosophe.fr - Comprendre la philosophieD'EverandLa matière et l'esprit (Fiche notion): LePetitPhilosophe.fr - Comprendre la philosophieÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- (Clavier Paul) Premieres Lecons Sur Critique de La (B-Ok - CC) PDFDocument129 pages(Clavier Paul) Premieres Lecons Sur Critique de La (B-Ok - CC) PDFkhalidePas encore d'évaluation
- Claude Bruaire LOGIQUE ET RELIGION CHRETIENNE DANS LA PHILOSOPHIE DE HEGEL Paris 1964Document192 pagesClaude Bruaire LOGIQUE ET RELIGION CHRETIENNE DANS LA PHILOSOPHIE DE HEGEL Paris 1964francis batt100% (4)
- (Pierre Hadot) Qu'est-Ce Que La Philosophie Antiqu PDFDocument464 pages(Pierre Hadot) Qu'est-Ce Que La Philosophie Antiqu PDFcheby92100% (5)
- L'Idée Des Artistes Panofsky, Cassirer, Zuccaro Et La Théorie de L'art - TrotteinSDocument8 pagesL'Idée Des Artistes Panofsky, Cassirer, Zuccaro Et La Théorie de L'art - TrotteinSAhmed Kabil100% (1)
- Cogitatio PhilosophusDocument59 pagesCogitatio PhilosophusIsmael OuedraogoPas encore d'évaluation
- Chap 1 - L'héritage de La Pensée GrecqueDocument6 pagesChap 1 - L'héritage de La Pensée GrecqueLouis BergPas encore d'évaluation
- Philos Tle - CoursDocument70 pagesPhilos Tle - CoursMamadou Moustapha SarrPas encore d'évaluation
- Analyses, Commentaires, Paraphrases, Résumés Et Tableaux Pour Aider À Lire La Critique de La Raison Pure Et La Critique de La Faculté de JugerDocument236 pagesAnalyses, Commentaires, Paraphrases, Résumés Et Tableaux Pour Aider À Lire La Critique de La Raison Pure Et La Critique de La Faculté de JugerDavo Lo SchiavoPas encore d'évaluation
- Programme de Philosophie Classe de PremiereDocument5 pagesProgramme de Philosophie Classe de PremiereJuanito RASAMOELPas encore d'évaluation
- Alain de Libera = Averrأ²es, le trouble-fأھteDocument17 pagesAlain de Libera = Averrأ²es, le trouble-fأھteMadjid PhiloPas encore d'évaluation
- (Philosophie 15) André Tosel, Pierre-François Moreau, Jean Salem (eds.)-SPINOZA AU XIXe SIÈCLE. Actes des journées d’études organisées à la Sorbonne (9 et 16 mars, 23 et 30 novembre 1997)-Publications.pdfDocument494 pages(Philosophie 15) André Tosel, Pierre-François Moreau, Jean Salem (eds.)-SPINOZA AU XIXe SIÈCLE. Actes des journées d’études organisées à la Sorbonne (9 et 16 mars, 23 et 30 novembre 1997)-Publications.pdfErcilio Herrera100% (1)
- Sophiste (Monique Dixsaut)Document58 pagesSophiste (Monique Dixsaut)xfgcb qdljrkfgle100% (1)
- Cours Philosophie Langage ArtDocument48 pagesCours Philosophie Langage ArtAdeimantosPas encore d'évaluation
- L'Utilité de La Philosophie-1Document4 pagesL'Utilité de La Philosophie-1diallohaliloullahPas encore d'évaluation
- L'Être Et La Personne Selon Le B. Jean Duns Scot.Document18 pagesL'Être Et La Personne Selon Le B. Jean Duns Scot.Karl EinsamPas encore d'évaluation
- GILSON. Etienne - Introduction À L'etude de Saint Augustin (1949, Librarie Philosophique J. Vrin) PDFDocument400 pagesGILSON. Etienne - Introduction À L'etude de Saint Augustin (1949, Librarie Philosophique J. Vrin) PDFAndré DiasPas encore d'évaluation
- Histoire de La Philosophie - Temps ModernesDocument61 pagesHistoire de La Philosophie - Temps Moderneseris_lashtamPas encore d'évaluation
- Leçon 2Document4 pagesLeçon 2Aminata ThiamPas encore d'évaluation
- Passage Du Mythe À La Raison Et de La Def de La PhiloDocument6 pagesPassage Du Mythe À La Raison Et de La Def de La Philohyppolitesergot86100% (1)
- Emmanuel Kant. Avant Apres PDFDocument127 pagesEmmanuel Kant. Avant Apres PDFsimon669Pas encore d'évaluation
- P. Duhem - Sauver Les Apparences - Essai Sur La Théorie Physique de Platon À GaliléeDocument148 pagesP. Duhem - Sauver Les Apparences - Essai Sur La Théorie Physique de Platon À GaliléeArnOmkarPas encore d'évaluation
- Eric Weil - Problèmes Kantiens (Vrin, 1970) PDFDocument86 pagesEric Weil - Problèmes Kantiens (Vrin, 1970) PDFsimon669Pas encore d'évaluation
- TA Et TS en Philosophie Continue Tome 2Document48 pagesTA Et TS en Philosophie Continue Tome 2Keudeu Tao DimanchePas encore d'évaluation
- Introduction A La PhilosophieDocument186 pagesIntroduction A La PhilosophieKhouloud AdouliPas encore d'évaluation
- La Philosophie Au Moyen Age - GilsonDocument326 pagesLa Philosophie Au Moyen Age - Gilsonagustina190% (1)
- Russell Philosophie ExplicationDocument3 pagesRussell Philosophie ExplicationLadji Mamoudou KabaPas encore d'évaluation
- Werner, Charles, Aristote Et L'idéalisme Platonicien (1909)Document394 pagesWerner, Charles, Aristote Et L'idéalisme Platonicien (1909)Horacio Gianneschi100% (1)
- Arendt 2conditionhommemoderne FicheDocument15 pagesArendt 2conditionhommemoderne Ficheeforgues564Pas encore d'évaluation
- Philo OrigineDocument20 pagesPhilo OriginefassarjeaninemalackPas encore d'évaluation
- Cours Sur La PhilosophieDocument3 pagesCours Sur La PhilosophieMamadou Moustapha Sarr100% (1)
- GONTIER, Thierry - Les Grandes Oeuvres de La Philosophie Ancienne PDFDocument66 pagesGONTIER, Thierry - Les Grandes Oeuvres de La Philosophie Ancienne PDFCătălin-Mihai Ștefan100% (1)
- Discours de La PhilosophieDocument163 pagesDiscours de La Philosophieazrak samawiPas encore d'évaluation
- Andre Cresson Et Rene Serreau HEGEL SA VIE SON OEUVRE SA PHILOSOPHIE Paris Puf 1949Document144 pagesAndre Cresson Et Rene Serreau HEGEL SA VIE SON OEUVRE SA PHILOSOPHIE Paris Puf 1949francis batt50% (2)
- Cours1 OPEMTleSTDocument11 pagesCours1 OPEMTleSTHonoré Kokou SodogaPas encore d'évaluation
- Alain de Libera La Querelle Des Universaux de Platon A La Fin Du Moyen AgeDocument246 pagesAlain de Libera La Querelle Des Universaux de Platon A La Fin Du Moyen AgeLeandro AntonelliPas encore d'évaluation
- Textes de Sall Domaine 1Document27 pagesTextes de Sall Domaine 1diarraPas encore d'évaluation
- Brochard, La Morale de Platon - 1905Document47 pagesBrochard, La Morale de Platon - 1905Philppe_GuerandePas encore d'évaluation
- Pierre Aubenque - La Métaphysique Dans La Culture Grecque ClassiqueDocument7 pagesPierre Aubenque - La Métaphysique Dans La Culture Grecque ClassiqueAnonymous 1mMZ4s100% (1)
- Lecon Introductive 2023Document8 pagesLecon Introductive 2023Zied AyadiPas encore d'évaluation
- Essai D'une Définition de La Notion de Baroque LittéraireDocument25 pagesEssai D'une Définition de La Notion de Baroque LittéraireabelPas encore d'évaluation
- Httpspapyrus Bib Umontreal Caxmluibitstreamhandle18666825these Pdfsequence 1&isallowed yDocument428 pagesHttpspapyrus Bib Umontreal Caxmluibitstreamhandle18666825these Pdfsequence 1&isallowed yjenesuismoitemuPas encore d'évaluation
- SoufismeDocument107 pagesSoufismeSalma JeddaPas encore d'évaluation
- The Strange World of Human SacrificeDocument4 pagesThe Strange World of Human SacrificeTiffany BrooksPas encore d'évaluation
- Liste BenedictionsDocument5 pagesListe Benedictionsok pugPas encore d'évaluation
- Les 7 Péchés CapitauxDocument2 pagesLes 7 Péchés CapitauxJean-Joël AllouanPas encore d'évaluation
- Rene Basset - Histoire de La Conquete de L'abyssinieDocument524 pagesRene Basset - Histoire de La Conquete de L'abyssinieKassa MekonnenPas encore d'évaluation
- LL 15 Le MalDocument8 pagesLL 15 Le Malghalia.mesfiouiPas encore d'évaluation
- Cheikh Adboul-Lâhi Dieye - La ReponseDocument49 pagesCheikh Adboul-Lâhi Dieye - La ReponseSidy Al-Mukhtar Diongue100% (2)
- Réformes Religieuses Ressources Cours PDFDocument7 pagesRéformes Religieuses Ressources Cours PDFsbruyerePas encore d'évaluation
- TRAITE DE LA FRATERNITE (Vingt-Deuxième Lettre) Fransızca UhuvvetDocument64 pagesTRAITE DE LA FRATERNITE (Vingt-Deuxième Lettre) Fransızca UhuvvetNurgentr Nur100% (2)
- La Tradition Des Indiens de L Amérique Du Nord (V)Document3 pagesLa Tradition Des Indiens de L Amérique Du Nord (V)BelhamissiPas encore d'évaluation
- Cours 4 - Kitab TawhidDocument5 pagesCours 4 - Kitab TawhidelevesPas encore d'évaluation
- 2page 2013 06 LivretDocument64 pages2page 2013 06 Livretparoissesmegalithes1077Pas encore d'évaluation
- EAN 2001 LectOblig4 S1Document9 pagesEAN 2001 LectOblig4 S1Julien SiinoPas encore d'évaluation
- Edouard Dubus Du Journaliste Bonapartiste Au Poete AnarchisantDocument329 pagesEdouard Dubus Du Journaliste Bonapartiste Au Poete AnarchisantGilles PicqPas encore d'évaluation
- Commentaire de La Logique D'aristote (Complet)Document113 pagesCommentaire de La Logique D'aristote (Complet)MediaetasPas encore d'évaluation
- Conférences Données À Ojai, U.S.A., 1944, Par J. KrishnamurtiDocument27 pagesConférences Données À Ojai, U.S.A., 1944, Par J. KrishnamurtiJoop-le-philosophe100% (1)
- La Clef Des Grands Mystères: Suivant Hénoch, Abraham, Hermès Trismégiste Et SalomonDocument524 pagesLa Clef Des Grands Mystères: Suivant Hénoch, Abraham, Hermès Trismégiste Et Salomonclebretonfr100% (1)
- Programme Mariage EgliseDocument16 pagesProgramme Mariage EglisemouperPas encore d'évaluation
- Introduction Livre IcônesmelkitesDocument6 pagesIntroduction Livre IcônesmelkitesAgnès-mariam de la CroixPas encore d'évaluation
- Anthologie Poc3a9tique Sur La Mort AmyDocument14 pagesAnthologie Poc3a9tique Sur La Mort AmyLe DessinateurPas encore d'évaluation
- Mini Encyclopédie Des Proverbe Et Dictons de FranceDocument31 pagesMini Encyclopédie Des Proverbe Et Dictons de FrancefenoremielPas encore d'évaluation
- Jorge Manrique, Guy Debord-Stances Sur La Mort de Son Père-Le Temps Qu'il Fait (1995)Document49 pagesJorge Manrique, Guy Debord-Stances Sur La Mort de Son Père-Le Temps Qu'il Fait (1995)Blaise Marchandeau100% (1)
- Buttet, Nicolas, L'Eucharistie À L'ecole Des Saints (2000)Document382 pagesButtet, Nicolas, L'Eucharistie À L'ecole Des Saints (2000)MillenaPas encore d'évaluation
- Anthologie Du FantastiqueDocument22 pagesAnthologie Du FantastiqueGretel Lopez50% (2)
- Identite: Direction Des Affaires Academiques Et de La Scolarite (Daas)Document2 pagesIdentite: Direction Des Affaires Academiques Et de La Scolarite (Daas)Joséphine AGBOYIBOPas encore d'évaluation
- Etude Biblique Pique Nique-1Document2 pagesEtude Biblique Pique Nique-1Exaucé Guylaure BOUNKOULOUPas encore d'évaluation
- Jéthro-Yousroûn - WikipédiaDocument5 pagesJéthro-Yousroûn - Wikipédiaalicemonika001Pas encore d'évaluation
- Tableau Des 6 Principes Et Des 6 Niveaux de Consciences de LDocument5 pagesTableau Des 6 Principes Et Des 6 Niveaux de Consciences de LNataPas encore d'évaluation