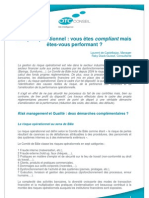Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Bale II Gestion Du Risque Operationnel
Bale II Gestion Du Risque Operationnel
Transféré par
Oussama Abdel-IlahTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Bale II Gestion Du Risque Operationnel
Bale II Gestion Du Risque Operationnel
Transféré par
Oussama Abdel-IlahDroits d'auteur :
Formats disponibles
BALE II & GESTION DU
RISQUE OPERATIONNEL
- Cas du Groupe Banque Populaires -
Prpar par :
NOUA!T! CHAR!FA
;ant Propos
Problmatique traiter
- Quel processus la banque doit-elle mettre en place
afin de mesurer et de reporter le risque oprationnel et
ce en conformit avec les directives publies par Bank
Almaghrib en la matire ?
Et quel est l'tat des lieux de l'adoption des mthodes
avances par le groupe banque populaire du Maroc ?
Chapitre prliminaire :
Section 1 : Le groupe banque
populaire du Maroc ( prsentation
rapide)
Section 2 : Les risques bancaires
Chapitre 1 : Nouvel accord de Ble
Section 1 : Pourquoi le ratio Cooke (Ble I) ?
Section 2 : Rforme de l'accord Ble I ;
Nouveau ratio de solvabilit Mc Donough
Section 3 : Transposition de Ble II au Maroc
Chapitre 2 : Le risque oprationnel,
vue d'ensemble
Section 1 : Gnralits sur le risque
oprationnel
Section 3 : Approches de mesure du risque
oprationnel
Chapitre 3 : La gestion du risque oprationnel
au sein du G.B.P
Section 1 : Implmentation d'une gestion de
risques oprationnels dans un tablissement de
crdit : cas le crdit populaire du Maroc CPM.
Section 2 : Formalisation de la procdure de
gestion des risques oprationnels la BP.
Section 3 : Le passage de l'approche de base
l'approche avance par la BP
Prsentation rapide du groupe banque
populaire
Le secteur bancaire marocain, vue d'ensemble :
majoritairement contrl par le secteur priv le secteur
Bancaire marocain se caractrise par :
Prsence marque des banques trangres de
l'actionnariat trangre 22% du total des actifs
bancaires en 2007.
La tendance la concentration s'est encore
renforce en 2005, le total bilan des trois
premires banques (CRDIT POPULAIRE DU
MAROC, ATTIJARIWAFA BANK et la BMCE)
reprsentant 64% de l'ensemble.
Prsentation rapide du groupe banque
populaire
La bancarisation est encore faible au Maroc. On
compte une agence bancaire pour 15 000 habitants
et selon les estimations seules 24% de la population
marocaine utilisent les services d'une banque.
Les banques sont toujours sous contrle des
autorits :
o BAM: Les Banques sont tenues de fournir BAM des
tats financiers mensuels, trimestriels, semestriels
et annuels ainsi que des tats financiers consolids
semestriels et annuels. BAM a en outre le pouvoir de
mener des inspections dans les tablissements de
crdit. Ces inspections ne sont pas menes selon un
calendrier prcis ou intervalles rguliers.
Prsentation rapide du groupe banque
populaire
o Ministre des finances :
Le Ministre des Finances est charg de
rglementer et super;iser le systme bancaire en
collaboration a;ec BM. Il octroie et retire les
licences bancaires. Il autorise les fusions et
acquisitions au sein du secteur bancaire
o Conseil National de la Monnaie et de lEpargne
Le CNME prsid par le Ministre des Finances a un
rle consultatif en matire de politique montaire
et de crdit.
Prsentation rapide du groupe banque
populaire
Comit des Etablissements de Crdit
Le CEC prsid par le gou;erneur de Bank l Maghrib a
un rle consultatif en matire doctroi ou de retrait de
licences bancaires de fixation du capital minimum des
banques derglementation comptable prudentielle de
prises de participation au capital dentreprises et de
fusions entre banque
II- Prsentation du Groupe Banques
populaires GBP ou CPM
Le Crdit populaire du Maroc, appel galement
groupe Banques Populaires est un groupement de
banque constitu par la banque Centrale populaire
(CPM) , et les banques rgionales, et le comit directeur
.Il s'agit donc d'une institution 3 dimensions :
Le comit directeur du Crdit populaire ;
La Banque Centrale Populaire ;
Les Banques populaires rgionales.
LES BANQUES POPULAIRES REGIONALES :
sont organises sous la forme cooprative capital variable
directoire et conseil de surveillance .
Les banques populaires rgionales (PBR), banque de
proximit, actuellement au nombre de 11 constituent le
socle du crdit populaire du Maroc.
tablissement de crdit habilit effectuer toutes les
oprations de banque dans leurs circonscriptions
territoriales respectives. contribuer au dveloppement de
leur rgion par la diversit des produits qu'elles offrent. Le
financement de l'investissement, la bancarisation de
l'conomie.
II- Prsentation du Groupe Banques
populaires GBP ou CPM
Organigramme Type de BPR
Prsident du directoire
Dpartement planification
et contrle de gestion
Dpartement
1uridique
Direction ressources humaines Direction Audit Interne
Gestion
Administrative et
sociale
Dept
Iormation et
G.P.E.C
Depart Audit Interne Dept Contrle
Documents
Direction
dveloppement et
rseau
Direction risque
engagement
Direction
administrative
financire
Dpt Etude Crdit E/ses
Dpt Etude Crdit Part et Imm.
Dpt Marketing com.
Dpartement Animation Rseau
Dpartement recouvrement
amiable
Dpartement risque priori
Dpartement contrle
Gestion
Engagement
Dpartement Contentieux
Dpartement Production
Bancaire
Dpartement
Comptabilit&Finance
Dpt Moyens Gnraux
Dpt Organisation
Informatique
Section 2 : Les risques bancaires
un Risque
=
incertitude sur la ;aleur future dune
donne actuelle
Section 2 : Les risques bancaires
Le risque de crdit ou de contrepartie
Le risque de crdit peut se dfinir comme le risque
de pertes conscutives un vnement de crdit,
c'est dire au dfaut d'un emprunteur sur un
engagement de remboursement de dettes qu'il a
contractes ( risque de dfaillance de l
emprunteur).
Section 2 : Les risques bancaires
Les risques de march
Ces risques sont dfinis comme les risques de pertes
lis aux variations des prix de march. Ils
couvrent:
Risque de taux
Risque de change
Risque de prix
Risques d'illiquidit de march
Section 2 : Les risques bancaires
o Risque de taux d'intrt
Exprime les risques de perte ou de manque gagner
qui sont lis aux volutions des diffrents taux
d'intrt, autrement dit c'est le risque qu'une hausse
des taux diminue les valeurs des actifs financiers
d'une banque ou renchrisse le cot de ses actifs (en
cas de baisse des taux).
Section 2 : Les risques bancaires
Risque de change :
Peut tre dfini comme perte entrane par la ;ariation du
cours des crances ou des dettes libelles en de;ise par
rapport la monnaie de rfrence de la banque. Le
risque apparat ds lors quun tablissement achte
dautres de;ises et quil reste en position ou;erte.
Section 2 : Les risques bancaires
Risque d'illiquidit :
ai bon produit.mais...
....je ne trou;e pas la personne intresse!
Section 2 : Les risques bancaires
le Risque Oprationnel
Risque rsultant de linsuffisance de conception dorganisation
relati;e au traitement
dministratif e comptable des oprations est qualifi
galement de risque de procdure de traitement ou risque de
Back-office .
il sagit de risque quotidien sans caractre exceptionnel.
Exemple ; omission dun code mau;aise imputation de
compte...
Tout simplement on fait mal son tra;ail .
Chapitre 1 :
Nouvel accord de Ble II
CH1 : Nouvel accord de Ble
Section 1 : Pourquoi le ratio Cooke (Ble I) ?
Rappel Historique :
n de la con;ention de Ble de 1988 cette dernire fixait pour
les banques ;ocation internationale des normes de fonds
propres qui taient fondes sur un nombre limit de catgories
de risques. Il a;ait deux objectifs : premirement promou;oir
des conditions de concurrence loyale dun pays lautre pour
les banques ;ocation internationale et deuximement
renforcer lassise financire de ces banques
CH1 : Nouvel accord de Ble
4rces du rati4 C44e :
Le principe de ce ratio est dexiger un ni;eau de fonds propres
proportionnel au risque de crdit auquel la banque est
expose. Plus la banque prend de risque plus elle doit
constituer de fonds propres. Ces derniers doi;ent permettre
damortir des pertes sur des oprations bancaires et ainsi
;iter la faillite de la banque. Le ratio Cooke incite donc la
banque limiter ses risques.
CH1 : Nouvel accord de Ble
Il prsente un autre avantage :
il constitue en effet une information du premier ordre pour les
cranciers de la banque dposants dtenteurs de titre
obligataires et contreparties sur les marchs interbancaires).
CH1 : Nouvel accord de Ble
Faiblesses du ratio Cooke :
Malgr des amliorations successi;es qua connues le ratio
Cooke ce dernier prsente de nombreuses limites :
CH1 : Nouvel accord de Ble
imites lies au statut de lemprunteur
iffrents taux de pondration sont appliqus pour dterminer la
charge de capital. Le ratio Cooke a donc une logique forfaitaire.
Il nintroduit aucune distinction fonde sur le risque de crdit
de lemprunteur mais uniquement sur son statut - entreprise
banque collecti;it locale ou Etat- ne tenant donc pas compte
de la ;aleur et du risque intrinsque de lentreprise.
CH1 : Nouvel accord de Ble
Nature Pondrations
$ou;erains 0%
Banques 20%
Entreprises 100%
consquence:
Le contenu informationnel du ratio se trouve biais,
puisqu'un prt un emprunteur risqu est pris en compte
dans la mme proportion qu'un prt un emprunteur
prsentant peu de risque.
CH1 : Nouvel accord de Ble :
Exemple illustratif :
&ne banque peut faire un prt de 100MC soit une $ocit
cote ou une socit cote c
- $elon laccord de 1988 Ratio de sol;abilit ou ratio
Cooke) :
La banque doit dtenir 8M de Fonds Propres pour pou;oir
emprunter 10M
FP/ Engagement * coefficient de pondration doit tre
suprieur 8%. )
CH1 : Nouvel accord de Ble
Le taux dintrt appliqu la $ocit =6%
Le taux dintrt appliqu la $ocit C=7% prsente un risque
le;)
Le cot de financement est de 5%
Le Rendement est donc :
Pour la Socit A :
Le rendement est de : 100*6%)- 92*5%) = 1.4
Taux de rendement compar lexigence de Fonds Propres = 1.4/8
=175%.
Pour la socit C :
Le rendement est de : 100*7%)- 92*5%) = 24
Taux de rendement compar lexigence de Fonds Propres = 24/8
= 30%
CH1 : Nouvel accord de Ble
Conclusion :
Mau;aise prise en compte du profil de risque rel de
chaque banque dans la dtermination des ni;eaux de
fonds propres.
Prsentation du nouveau Ratio Mc Donough
Ble II :
Pour pallier aux insuffisances de Ratio Cooke le comit
de Ble a propos un nou;el accord sur les fonds propres
qui de;ra remplacer le ratio Cooke compter du 1er
jan;ier 2007.
Le nouveau dispositif est destiner :
Prsentation du nouveau Ratio Mc Donough
Ble II :
Mieux aligner les exigences de fonds propres sur les
risques sous-jacents et fournir aux banques et leurs
autorits de contrle plusieurs options pour ;aluer
ladquation de leurs fonds propres.
Prise en compte du risque optionnel
Prsentation du nouveau Ratio Mc Donough
Ble II :
La Structure du nouvel accord BleII
Le nou;el accord Ble II repose sur trois piliers qui se
renforcent mutuellement :
Pilier 1 :
Exigence minimale de fonds propre
Pilier 2 :
Processus de $ur;eillance prudentielle
Pilier 3 :
iscipline de march
Pilier 1 : l'exigence minimale de fonds
propres :
ux termes du nou;el accord la dfinition des
fonds propres rglementaires na pas chang et
le Ratio minimal requis reste maintenue 8%.
Le rel changement concerne les mthodes
utilises pour mesurer le risque encouru par
la banque.
Pilier 1 : l'exigence minimale de fonds
propres :
la prise en compte du risque oprationnel fait partie des
nou;eauts de la rforme du ratio de sol;abilit
trois options de calcul pour le risque oprationnel :
Lapproche indicateur de base
Lapproche standard
Lapproche de mesure complexe.
Pilier 2 : le processus de surveillance
prudentielle :
le comit considre la sur;eillance prudentielle comme
un complment essentiel des exigences de fonds
propres et de la discipline de march.
Lobjectif du deuxime piler de ce nou;eau dispositif
est de sassurer que les banques appliquent des
procdures internes saines pour dterminer
l'adquation de leur fonds propres sur la base
d'une valuation approfondie des risque encourus
Pilier 3 : la discipline du march et la
communication financire :
le comit a dterminer des lments qui lui
apparaissent les plus importants en termes de
transparence financire et a demand tous
les tablissements bancaires de publier ces
informations.
Les banques tenues de publier des informations trs
compltes sur la nature le ;olume et les mthodes de
gestion de leurs risques ainsi que sur ladquation de
leurs fonds propres. des reporting)
Le calendrier de mise en application :
2006 2006
Nouveau cycle
de consultaton
2me verson
Rato Mc 0onouyh
2005 2005 2004 2004 2003 2003 2002 2002 2001 2001 2000 2000 1999 1999 1988 1988
Rato Cooke
1re verson de
l'accord de le ll
VersIon fInaIe Ie II
26l06l2004
2007 2007
Abandon du Abandon du
ratio Cooke et ratio Cooke et
D D claration Mc Donough claration Mc Donough
W C0E
W Moyen rent
W Maroc
W Tunse
W Eyyte.
!ase de mIse nIveau:
W DrganIsatIons
W !ratIques
W Systmes d'InformatIon
!ase de mIse en oeuvre:
W Tests et sImuIatIons
W VaIIdatIon des modIes
Vous aimerez peut-être aussi
- Gestion Des Risques Bancaires 2004Document402 pagesGestion Des Risques Bancaires 2004Pilgreem100% (5)
- Optimiser le coût du risque crédit - sous Bâle 3, IFRS 9 et la BCE - exemple en banque de détailD'EverandOptimiser le coût du risque crédit - sous Bâle 3, IFRS 9 et la BCE - exemple en banque de détailPas encore d'évaluation
- Risque OpérationnelDocument14 pagesRisque OpérationnelAkram Ait Beni IfitPas encore d'évaluation
- L - Évaluation de La Gestion Des Risques Opérationnels Au Sein Du Groupe Banque Populaire PDFDocument75 pagesL - Évaluation de La Gestion Des Risques Opérationnels Au Sein Du Groupe Banque Populaire PDFsamah744100% (5)
- Gestion Des Risque BancaireDocument57 pagesGestion Des Risque BancaireFranck Eliezer Yazi100% (8)
- LE RISQUE DE CREDIT - IDENTIFICATION Et EvaluationDocument11 pagesLE RISQUE DE CREDIT - IDENTIFICATION Et EvaluationCJPas encore d'évaluation
- Assurance - Banque - Gestion de patrimoine - Tome 2a: 6 cas de management stratégique - énoncésD'EverandAssurance - Banque - Gestion de patrimoine - Tome 2a: 6 cas de management stratégique - énoncésPas encore d'évaluation
- Impôt Sur Les SociétésDocument30 pagesImpôt Sur Les SociétésredecosadmanPas encore d'évaluation
- Etapes de Gestion de Risque de CreditDocument9 pagesEtapes de Gestion de Risque de CreditCharly Elysée AdahiPas encore d'évaluation
- TP Solaire PhotovoltaiqueDocument21 pagesTP Solaire PhotovoltaiqueOthmane Elmouatamid100% (2)
- WORD La Gestion Des Risques BancairesDocument9 pagesWORD La Gestion Des Risques BancairesHajar ElKhalbi100% (1)
- Traité de gestion de portefeuille, 5e édition actualisée: Titres à revenu fixe et produits structurés - Avec applications Excel (Visual Basic)D'EverandTraité de gestion de portefeuille, 5e édition actualisée: Titres à revenu fixe et produits structurés - Avec applications Excel (Visual Basic)Pas encore d'évaluation
- Manuel Risques Opérationnels BancairesDocument57 pagesManuel Risques Opérationnels Bancairesyab100% (1)
- Reglementation Pridentielle BancaireDocument3 pagesReglementation Pridentielle BancaireSaif ChtiouiPas encore d'évaluation
- La Règlementation BancaireDocument23 pagesLa Règlementation BancaireAtikaPas encore d'évaluation
- Courbe Des Taux Et Techniques de ValorisationDocument52 pagesCourbe Des Taux Et Techniques de ValorisationEl HassanePas encore d'évaluation
- La Structure MixteDocument5 pagesLa Structure MixteYao Albert Kouakou67% (3)
- Memoire Online Gestion Des RisquesDocument53 pagesMemoire Online Gestion Des RisquesClaudette ZagréPas encore d'évaluation
- Risque OpérationnelDocument48 pagesRisque OpérationnelAbdessamiaa Fettal83% (6)
- Modélisation Du Risque de CréditDocument106 pagesModélisation Du Risque de CréditTheonlyone01100% (2)
- Les Enjeux de Bale IIDocument37 pagesLes Enjeux de Bale IIYaim Inicay0% (1)
- La Gestion Des RisquesDocument6 pagesLa Gestion Des RisquesRabiadz SoufPas encore d'évaluation
- Maitrise Des Risques BancaireDocument21 pagesMaitrise Des Risques BancaireToufik ZeroukPas encore d'évaluation
- Risque IperationnelDocument117 pagesRisque Iperationnelsellaoui100% (1)
- Risques BancairesDocument29 pagesRisques BancairesrajaahadiPas encore d'évaluation
- 1 La Gestion Des Risques Du Crédit RevueDocument138 pages1 La Gestion Des Risques Du Crédit RevueAmine0% (1)
- La Gestion Des Risques BancairesDocument54 pagesLa Gestion Des Risques Bancaireskkhelil100% (4)
- L'Audit Bancaire) Les Types Et L'Importance (Document18 pagesL'Audit Bancaire) Les Types Et L'Importance (Esc studentPas encore d'évaluation
- La Cartographie Des Risques BancairesDocument4 pagesLa Cartographie Des Risques BancairesIlyess ElOmari86% (7)
- Le Controle Interne Et La Gestion Des Risques BancDocument22 pagesLe Controle Interne Et La Gestion Des Risques BancMeryem Imourig100% (1)
- La Notation Interne Peut Être Un Outil Efficace de Mesure Du Risque de CréditDocument9 pagesLa Notation Interne Peut Être Un Outil Efficace de Mesure Du Risque de CréditMeryemPas encore d'évaluation
- Risques OpérationnelsDocument39 pagesRisques Opérationnelsstudio linePas encore d'évaluation
- La Gestion Du Risque OpérationnelDocument28 pagesLa Gestion Du Risque OpérationnelHouda Ait AhmedPas encore d'évaluation
- Risques Financier VdefDocument32 pagesRisques Financier VdefNesrine BelkhoujaPas encore d'évaluation
- Bale IIDocument135 pagesBale IISiguerdjidjene SpringPas encore d'évaluation
- Risque Opérationnel Risque de Liquidité Et Risque de ModèleDocument33 pagesRisque Opérationnel Risque de Liquidité Et Risque de ModèleReda OuzzinePas encore d'évaluation
- OFDMDocument76 pagesOFDMmohamed balPas encore d'évaluation
- Gestion 20de 20risques 20operationnelsDocument41 pagesGestion 20de 20risques 20operationnelsmilou88Pas encore d'évaluation
- Gestion Des Risques OpérationnelsDocument11 pagesGestion Des Risques OpérationnelsaljahPas encore d'évaluation
- Polycopié Du Module Stratégie Financière Et Gouvernance Bancaire, Master FB, S3Document27 pagesPolycopié Du Module Stratégie Financière Et Gouvernance Bancaire, Master FB, S3Amine100% (1)
- Gestion Prudentielle Des Risques BancairesDocument33 pagesGestion Prudentielle Des Risques BancairesReda Ouzzine100% (2)
- Definition Et Sources de Risque Du Credit-1Document11 pagesDefinition Et Sources de Risque Du Credit-1molab2001100% (3)
- Chapitre 1 Gestion Des RisquesDocument20 pagesChapitre 1 Gestion Des Risquesinsaf arfaPas encore d'évaluation
- CH4 Les Risques BncairesDocument3 pagesCH4 Les Risques BncairesRafik AmeuroudPas encore d'évaluation
- Risque OperationnelDocument13 pagesRisque OperationnelRodagom Mog100% (1)
- Le Risque Opérationnel Bancaire - CairnDocument16 pagesLe Risque Opérationnel Bancaire - CairnMohamed Zoubair100% (1)
- Chapitre II Risque de CréditDocument2 pagesChapitre II Risque de CréditChaiMae TourBiPas encore d'évaluation
- Risque Opérationnel (Revu Soukaina)Document13 pagesRisque Opérationnel (Revu Soukaina)Khadija100% (1)
- Gestion Du Risque Bancaire: Définition, Mesures, Gestion, Déterminants Et Impact Sur La PerformanceDocument46 pagesGestion Du Risque Bancaire: Définition, Mesures, Gestion, Déterminants Et Impact Sur La PerformancebabasPas encore d'évaluation
- Memoire (Réparé) 22222Document103 pagesMemoire (Réparé) 22222Ould Hamahoullah100% (1)
- Gestion Des Risques Financier Au MarocDocument3 pagesGestion Des Risques Financier Au Marocfranque lebonPas encore d'évaluation
- ANALYSE D'UNE Démarche de Cartographie Du RisqueDocument174 pagesANALYSE D'UNE Démarche de Cartographie Du RisqueSouad TouchliftPas encore d'évaluation
- Gestion Des RisquesDocument3 pagesGestion Des RisquesHouriaPas encore d'évaluation
- QuestionnaireDocument10 pagesQuestionnaireMaryem BaddoujPas encore d'évaluation
- Gestion Des Risques BancairesDocument3 pagesGestion Des Risques BancairesYassine MalkiPas encore d'évaluation
- La Réglementation Prudentielle en Algérie Et Son Niveau de Conformité Avec Les Standards de Bâle 1 Et Bâle 2Document141 pagesLa Réglementation Prudentielle en Algérie Et Son Niveau de Conformité Avec Les Standards de Bâle 1 Et Bâle 2Jiji LotmaniPas encore d'évaluation
- Exposé Sur La Gestion de Risques BancairesDocument22 pagesExposé Sur La Gestion de Risques BancairesCharly Elysée Adahi33% (3)
- Analyse Des Risques Bancaires - Bale IIDocument107 pagesAnalyse Des Risques Bancaires - Bale IISaad ZanifiPas encore d'évaluation
- Risque Operationnel La Mise en Place de Tableaux D IndicateursDocument3 pagesRisque Operationnel La Mise en Place de Tableaux D IndicateursAnonymadine Mya0% (1)
- Ahrouch - CopieDocument40 pagesAhrouch - CopieMeryem100% (2)
- Dsto GD 0103Document5 299 pagesDsto GD 0103Harry SyafriandiPas encore d'évaluation
- LCI Business Model Canvas Français WordDocument1 pageLCI Business Model Canvas Français Wordkouakou eliezer gnakanPas encore d'évaluation
- Le Controle de GestioDocument62 pagesLe Controle de GestioFeraoun Feraoun Mohand0% (1)
- DPV V4.19 (Standard) FrEsDocument61 pagesDPV V4.19 (Standard) FrEsPedro DiasPas encore d'évaluation
- Activite 2 5e Semaine 1Document2 pagesActivite 2 5e Semaine 1Aboubacar KountaPas encore d'évaluation
- Design-AMES - Liban2022-2023 - CAIDocument54 pagesDesign-AMES - Liban2022-2023 - CAISomar S. SemaanPas encore d'évaluation
- Jazzaround "Marc Moulin" N°29 - 2001Document38 pagesJazzaround "Marc Moulin" N°29 - 2001JazzaroundPas encore d'évaluation
- 31 01 10les SectionsDocument5 pages31 01 10les SectionstaheniiPas encore d'évaluation
- Loi Ordinaire L2019012AN Du 09 Mai 2019 Portant Code Maritime de La Republique de Guinee. CopierDocument38 pagesLoi Ordinaire L2019012AN Du 09 Mai 2019 Portant Code Maritime de La Republique de Guinee. CopierHassPas encore d'évaluation
- kp-132-3 - Varispeed Transcritical CO2 Compressores ECOLINEDocument12 pageskp-132-3 - Varispeed Transcritical CO2 Compressores ECOLINECristian Alfredo Tapia CabelloPas encore d'évaluation
- Série Circuit LCDocument4 pagesSérie Circuit LCChokri JaballiPas encore d'évaluation
- Vosach: Présentation de ProjetsDocument15 pagesVosach: Présentation de Projetsapi-525151253Pas encore d'évaluation
- Dissertation HGGSPDocument2 pagesDissertation HGGSPLili BrissaudPas encore d'évaluation
- MIF 214 Ingestion de Produits CaustiquesDocument6 pagesMIF 214 Ingestion de Produits CaustiquesFouad RyukPas encore d'évaluation
- Syndrome Catastrophique Des AntiphospholipidesDocument11 pagesSyndrome Catastrophique Des AntiphospholipidesHenry TraoréPas encore d'évaluation
- La Maison White ODocument7 pagesLa Maison White OSarah SalmiPas encore d'évaluation
- ADORAMA RO - Mobalpa PDFDocument101 pagesADORAMA RO - Mobalpa PDFCristina TarcatuPas encore d'évaluation
- Centrifugal CompressorDocument10 pagesCentrifugal CompressorJudith SmithPas encore d'évaluation
- Pcu125 HDDocument100 pagesPcu125 HDhadrien.perrotPas encore d'évaluation
- CB - CG4 - Chapitre 1 - Structures en Bois - BisDocument33 pagesCB - CG4 - Chapitre 1 - Structures en Bois - BisNick Jordan KEMBOU WOUNTSAPas encore d'évaluation
- Devoirs Maths Cm2 Mhm-3-2Document16 pagesDevoirs Maths Cm2 Mhm-3-2alicia.cretalPas encore d'évaluation
- BOUREGAB 1 1697642965187 Séismes - CoursDocument3 pagesBOUREGAB 1 1697642965187 Séismes - Coursmajdoulaymen1234Pas encore d'évaluation
- Attaques Sur WebsitesDocument10 pagesAttaques Sur WebsitesSîmø MJPas encore d'évaluation
- MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAlDocument13 pagesMODIFICATION DU CAPITAL SOCIAlbajjiloubna6Pas encore d'évaluation
- Rapport de StageDocument8 pagesRapport de StageBelkadi FamilyPas encore d'évaluation