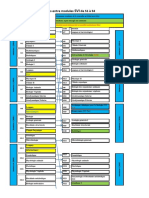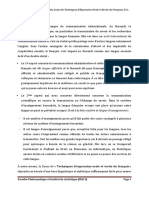Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Couchot
Couchot
Transféré par
vviandanteCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Couchot
Couchot
Transféré par
vviandanteDroits d'auteur :
Formats disponibles
U
N
P
O
I
N
T
D
A
C
T
U
UN POINT DACTU
112L'ART NUMRIQUE
U
n
p
o
i
n
t
d
a
c
t
u
e
n dcembre dernier, nous avons abord la question
de l'criture hypertextuelle avec celle de la
publication en ligne ; nous traitons dans ce Point
d'actu du thme de l'art numrique au-del de
l'image du mme nom.
Dans un domaine o les artistes travaillent autant les
modes de communication et d'interactivit que les
contenus et les formes, il faut donner quelques moyens
pratiques de dcouvrir les uvres, les sites web, et
proposer quelques repres qui en facilitent
l'appropriation ; dcrire les dispositifs et en commenter
les intentions.
Prise en compte des formes antrieures de l'image,
interrogation de son statut dans un contexte
interactif : ces deux dmarches aident dpasser les
navets et les vertiges de l'hypertechnologie.
L
image numrique est la dernire tape dune
volution technique longue et discontinue qui a
dbut il y a environ trente mille ans. Produite
lorigine avec la main, prolonge par quelques outils rela-
tivement simples, limage est maintenant engendre
par des procds entirement automatiques. Cette
automatisation dont on relve dj les prmices dans
les techniques fort anciennes du tissage, de la tapisse-
rie et de la mosaque, sacclre la Renaissance avec
la mise au point de la perspective et de ses machines
optiques, franchit une tape suprieure avec la photo-
graphie, le cinma et la tlvision, et atteint sa forme
actuelle au cours des annes soixante-dix qui voient
natre et se rpandre limage numrique en deux et
trois dimensions, fixe ou anime. Mais limage num-
rique, tout en sinscrivant dans le mme mouvement
dautomatisation, introduit une rupture radicale avec
les processus qui la prcdent. Elle est dote de pro-
prits techniques sans prcdent.
De la trace au calcul
Limage numrique peut tre :
1. le produit dun traitement entirement automa-
tique de linformation visuelle ;
2. loccasion dentretenir une sorte de dialogue avec
celui qui la cre ou qui la reoit.
Elle est calcule et interactive. Ces deux qualits la
distinguent fondamentalement des images tradition-
nelles. Alors que ces dernires sont toujours obtenues
par lenregistrement dune trace trace matrielle (pig-
ments, encres, etc.) dans le dessin, la peinture, limpri-
merie, trace optique-chimique dans la photographie,
lholographie et le cinma ou trace optique-lectro-
nique dans la vido-tlvision , limage numrique
l'art numrique
LIMAGE NUM
De quelles ruptures avec l'image
traditionnelle le statut de
l'image numrique est-il le
rsultat, notamment dans le
domaine de l'art ?
Edmond Couchot
PROFESSEUR MRITE DES UNIVERSITS
L'ART NUMRIQUE113
U
n
p
o
i
n
t
d
a
c
t
u
nest plus une empreinte laisse par un objet ou un
rayonnement nergtique sur un support, elle est le
rsultat dun calcul programm effectu par un ordina-
teur. Ses processus de fabrication ne sont plus phy-
siques (matriels ou nergtiques) mais computation-
nels et langagiers. Toutefois, limage numrique ne
saurait tre rduite une pure virtualit, car elle sac-
tualise sur des supports bien rels (cran, papier, film,
etc.). Elle est paradoxalement virtuelle et relle.
Les images numriques diffrent encore des autres
images par la faon dont elles sont distribues , au
sens large, cest--dire donnes voir, reproduites,
conserves, mises en circulation en fin de compte
socialises. Leur mode de rception est dit conversa-
tionnel ou, plus couramment, interactif . On parle
aussi de mode dialogique dans une acception plus
thorique pour insister sur la prsence dun logos (une
raison non plus graphique mais informationnelle) tra-
vers laquelle stablissent les changes entre le regar-
deur et limage. Le mode dialogique offre la possibilit
dagir sur limage sans interrompre les processus de
calcul grce de multiples interfaces, telles que le cla-
vier, la souris et lcran, ou dautres dispositifs mettant
en jeu des processus physiques ou corporels com-
plexes. On dit alors que le dialogue a lieu en temps
rel ; le regardeur a limpression que limage rpond
instantanment son action, le temps du calcul
restant non perceptible. Les rponses de lordi-
nateur peuvent tre plus ou moins complexes
selon les calculs effectus, de mme que les
informations transmises lordinateur par les inter-
faces.
Un changement de statut
Ces deux caractristiques entranent une srie de cons-
quences importantes, sans prcdent dans lhistoire,
qui transforment le statut symbolique, conomique,
social et politique de limage, ainsi que sa place dans
les arts visuels.
1. Pour la premire fois, en effet, les modes de pro-
duction et les modes de rception de limage sont
rgls par la mme technologie. Crer une image num-
rique et la donner voir empruntent la mme machine:
lordinateur et ses priphriques, notamment les rseaux
numriques. Crateurs, crations, mdiateurs et publics
RIQUE
AU-DEL DES PARADOXES
vivent dornavant lheure du numrique.
2. Les matriaux et les outils numriques, utiliss
aussi bien pour produire que pour distribuer ces images,
sont ceux de la programmation : des langages forma-
liss , labors partir de modles logiques et
mathmatiques issus des sciences les plus
diverses. Limage numrique, en tant que tech-
nique, salimente un fonds commun scienti-
fique comme jamais aucune image ne la fait
auparavant.
Cela implique encore deux consquences capi-
tales.
Premire consquence : un changement de rgime
figuratif. Les modles emprunts la science sont des
modles de simulation. Si la photo dune pomme ren-
voie par enregistrement optique la prsence dune
pomme relle saisie par lappareil un moment prcis,
limage dune pomme numrique (quand elle est tota-
lement calcule ou dite de synthse) ne renvoie
aucune pomme relle ; elle nest que lactualisation
dun programme sans lien direct (indiciaire) avec le
rel. La photo de la pomme est une re-prsentation,
limage numrique de la pomme est une simulation. Le
rgime figuratif du numrique nest plus celui de la
reprsentation, mais celui de la simulation. Ce qui en
Pour la premire fois,
les modes de production
et les modes de rception
de limage sont rgls par
la mme technologie.
114L'ART NUMRIQUE
U
n
p
o
i
n
t
d
a
c
t
u
avec lappareillage classique de la photographie. Cet
usage est maintenant courant dans toutes les pra-
tiques graphiques, o une multitude dapplications
informatiques permettant les effets les plus clas-
siques, en mme temps que les plus indits,
sont la disposition des artistes. Il en va de
mme dans le cinma et la vido.
ou mta-outil ?
loppos, dautres artistes cherchent explorer les
possibilits techniques et artistiques qui nexistaient
pas auparavant, tout particulirement le mode dialo-
gique, la simulation de mondes virtuels enveloppants,
les rseaux numriques, des interfaages originaux. Un
art nouveau, sappuyant sur des esthtiques innovantes,
est n et continue de se dvelopper notons-le en
marge de lart dit contemporain fortement institu.
Selon le point de vue dont on considre les images
numriques, on constate donc que les unes sinscri-
vent dans une continuit quasi linaire avec des pra-
tiques artistiques prcdentes, longuement prouves,
et les prolongent, tandis que les autres rompent radi-
calement avec celles-ci et proposent dautres esth-
tiques. Il faut noter encore quentre ces deux ples
stend le vaste domaine du multimdia o se croisent
la fois les techniques traditionnelles de limage (des-
sin, peinture, photo, images animes), du texte et du
son, et les techniques interactives de rception (hors
ligne, avec le CD-Rom, ou en ligne, avec les rseaux)
propres au numrique. Cest cet aspect paradoxal de
limage numrique et du numrique en gnral qui
a rendu difficile la comprhension du phnomne.
De nouvelles conditions pour la cration
Notons encore au passage, sans vouloir trop largir
notre rflexion aux autres pratiques artistiques, que ces
caractristiques et ces paradoxes propres limage le
sont tout aussi bien au son (de la voix et de la musique)
et dans une certaine mesure au texte, avec les possi-
bilits de simulation introduites par la technologie hyper-
textuelle. La transversalit du numrique donne
limage numrique un caractre hybride extrmement
marqu. Rduite de pures entits informationnelles
(les pixels), elle peut hybrider les formes, les couleurs,
les textures, les mouvements les plus divers ; mais tout
autant, limage traditionnelle, sitt quelle est numrise
(cest--dire rduite des pixels et soustraite ses sup-
ports dorigine), est susceptible de shybrider toute
autre image, ou des images de synthse. Et toutes ces
images hybrides sont encore capables de shybrider
avec toutes sortes de sons et de textes.
En outre, comme on la constat, limage numrique
est aussi le rsultat dune hybridation trs singulire :
celle quelle entretient avec la technoscience puisque
celle-ci pntre dsormais au cur de limage. Limage
et lart ont toujours entretenu des liens, parfois trs
troits, avec la science. Sinspirant des modles issus de
soi est une rvolution dans les rapports de limage au
monde. Mais le propre de la simulation tant de simu-
ler, limage numrique est ainsi capable de simuler
les images traditionnelles obtenues par les proc-
ds optiques, chimiques et lectroniques. La simu-
lation simule trs souvent la reprsentation.
Seconde consquence: une implication accrue
de limage dans la mondialisation de la culture.
Cette consquence dcoule de la premire ; la
technoscience jouant un rle moins visible, mais
aussi dcisif que lconomie dans la mondialisation,
limage numrique tend imposer, sans quon en ait
une conscience claire, une vision du monde totalisante,
au-del des philosophies, des religions et des arts.
Chaque image, indpendamment de son contenu
(informationnel ou esthtique), participe au systme
technoscientifique mondial dune manire incompara-
blement plus intense que ne le faisaient les techniques
pourtant dj universellement rpandues de la photo,
du cinma et mme de la tlvision.
Image et art numriques
Curieusement, les bouleversements apports par
limage numrique dans la sphre de lart nont gure
t ressentis comme vidents, du moins lors de ses pre-
mires apparitions dans les pratiques artistiques. Les
nouvelles images des annes quatre-vingt ont t
souvent critiques pour leur manque de nouveaut
esthtique. Certes, ces critiques liminaient de leur
champ danalyse les images qui prsentaient une relle
innovation esthtique (il y en avait pourtant, comme en
tmoigne lhistoire de lart numrique) et sattardaient
sur celles qui sefforaient, en qute de critres pr-
tendument objectifs , de se rapprocher de lultrara-
lisme cinphotographique. Les premires essayaient
dexplorer les nouvelles spcificits de limage calcule
ouvertes par la programmation et le mode dialogique,
les autres mettaient profit certaines capacits de simu-
lation du numrique : simuler les autres images, les
images non numriques. Do les questions. Les images
numriques sont-elles radicalement nouvelles, en rup-
ture complte avec la tradition figurative, ou au contraire
en totale continuit avec la longue technicisation des
pratiques artistiques de limage ? Simple outil ou mta-
outil ?
Simple outil
Limage numrique est paradoxalement lun et lautre.
Capable de simuler la plupart des techniques tradi-
tionnelles, elle peut sintgrer dans les esthtiques
propres ces pratiques et composer avec elles, voire sy
fondre. On cherche dans ce cas et rien ninterdit de
le faire affirmer une continuit avec la tradition,
tout en la renouvelant. Certains photographes, par
exemple, utilisent la puissance du numrique pour crer
des photos qui ont lair de vraies photos, mais qui nau-
raient pas t ralisables, ni sans doute imaginables,
limage
numrique tend
imposer, sans quon en ait
une conscience claire,
une vision du monde
totalisante
L'ART NUMRIQUE115
U
n
p
o
i
n
t
d
a
c
t
u
ces sciences rcentes, qui depuis ces dernires annes
sorientent vers la comprhension des phnomnes
mentaux (intelligence et vie artificielles, connexion-
nisme, neurobiologie, etc.), limage est en train dac-
qurir des comportements dits autonomes , cest--
dire capables dinventer des stratgies cognitives
relativement complexes, quon croyait jusqu prsent
le propre exclusif de lhomme. Limage numrique na
pas fini de nous surprendre et de nous mettre en ques-
tion.
Toutes ces caractristiques modifient en profondeur
les conditions de la cration artistique. Plus de technique
insistons sur ce point pour dsamorcer les critiques
habituelles nengendre pas automatiquement plus
dart. Ces nouvelles conditions ouvrent aux artistes des
champs de possibilits fantastiques, mais elles leur ten-
dent en mme temps de redoutables piges. Car, pour
ne pas se laisser vassaliser par cette hypertechnologie,
il faut en comprendre la logique et en anticiper les
effets, en user tout en lui rsistant, la soumettre tout en
sen servant, ngocier, ruser avec elle et lapprcier
laune de sa puissance inoue. Soumis une obsoles-
cence permanente de la technologie, lart numrique
doit crer ses propres mthodes de rgulation, sil ne
veut pas se confondre avec la technique elle-mme.
Port de par sa spcificit vers lexprimentation, il voit
aussi changer les conditions de la recherche artistique :
jusquo peut-on exprimenter ? quand y a-t-il uvre ?
o commence, o finit luvre ?
Mais ce sont les conditions de la critique artistique
qui changent, critique remise en cause par des uvres
qui nexistent que dans la mesure o le regardeur inter-
agit avec elles. Le rle de la critique est-il encore de
mettre lheure juste lhorloge du public qui, selon
Baudelaire, retarderait sur celle du gnie: Le public est,
relativement au gnie, une horloge qui retarde ?
Ce sont encore les conditions de la diffusion, de la
conservation, de la fonction des muses et des institu-
tions, du rapport de lart au march international qui
changent. Ce sont les conditions de lenseignement,
lcole et luniversit, dans les arts et dans les lettres.
Enfin mais peut-on dire enfin ? , pour revenir
la mondialisation, ce sont les conditions du rapport
entre lexpansion plantaire de la technoscience et la
singularit vivante et autonome de lart.
cela il faut ajouter que, si importantes que soient
les images numriques, elles ne constituent quune
partie dun phnomne technologique aux cons-
quences culturelles sans exemple dans lhistoire par
son ampleur qui traverse et bouleverse lensemble des
activits humaines, puisquil nen est gure qui ne soient
un jour ou lautre affectes par le numrique. Penser
limage aujourdhui cest--dire lavenir de toute image
puisque toute image a un devenir numrique possible
, cest forcment penser au-del de limage, au-del
de ses paradoxes, en relation avec le nouveau milieu
technologique informationnel scrt par nos propres
socits. G
Bibliographie
Bureaud Annick et Magnan Nathalie, Connexions. Art,
rseaux, mdias, cole nationale des beaux-arts, 2002,
Paris.
Couchot Edmond, La Technologie dans lart. De la photo-
graphie la ralit virtuelle, J. Chambon, 1998, Paris.
Lart numrique. Comment la technologie vient au monde
de lart, en collaboration avec Norbert Hillaire, Flammarion,
2003, Paris.
Domingues Diana, sous la direction de, Arte e vida no scu-
lo XXI. Tecnologia, cincia y criatividade, UNESP, 2003, So
Paulo.
Lovejoy Margot, Postmodern Currents. Art and Artists in
the Age of Electronic Media, 2nd ed., Prentice Hall, 1997.
Popper Frank, LArt lge lectronique, Hazan, 1993.
Lauteur
Professeur mrite des universits, Edmond Couchot a
dirig le dpartement Arts et Technologies de l'image
l'universit Paris-VIII pendant une vingtaine d'annes et
continue de participer aux recherches du centre Images
numriques et Ralit virtuelle. Il s'intresse, en tant que
thoricien, aux relations de l'art et de la technologie.
Il a notamment publi :
Images. De l'optique au numrique, Herms, 1988 ;
La Technologie dans l'art, J. Chambon, 1998 ;
LArt numrique, en collaboration avec N. Hillaire,
Flammarion, 2003.
La Funambule (voir page prc-
dente) et Danse avec moi sont deux
dispositifs interactifs raliss par
Michel Bret et Marie-Hlne Tramus,
de luniversit Paris-VIII. La
premire pice donne au spectateur
loccasion dinteragir avec une
fildefriste virtuelle qui a appris
marcher sur un fil et la seconde lui
offre lopportunit desquisser des
pas de danse en duo avec une
ballerine virtuelle. Le spectateur est
dans les deux cas muni dun
capteur de mouvements et les
personnages de synthse ragissent
ses gestes en inventant des
rponses appropries (soit des
gestes de rquilibration pour la
funambule, soit des pas de danse
pour la danseuse) qui ne sont pas
programmes. Dotes de rseaux
de neurones virtuels, ces cratures
ont la capacit dlaborer de
vritables stratgies cognitives.
Une manire de rintroduire de la
corporit dans lart numrique et
dinciter le spectateur explorer les
limites de son propre corps.
Vous aimerez peut-être aussi
- Susan Sontag, Sur La PhotographieDocument4 pagesSusan Sontag, Sur La PhotographieNemiye Pérez Mardini100% (1)
- 1988 - Le Masculin Entre Sexualité Et SociétéDocument15 pages1988 - Le Masculin Entre Sexualité Et SociétéLuciano Alvarenga MontalvãoPas encore d'évaluation
- L'art NumeriqueDocument8 pagesL'art NumeriqueDe CruzPas encore d'évaluation
- Gare À La Maitresse Texte CompletDocument2 pagesGare À La Maitresse Texte CompletadnenePas encore d'évaluation
- Petite Histoire D'une Idée Bizarre - Les Courbes Et Les Surfaces de Bézier PDFDocument10 pagesPetite Histoire D'une Idée Bizarre - Les Courbes Et Les Surfaces de Bézier PDFArnaud Jammet100% (1)
- 20220602M - Le Virtuel Comme Espace AutreDocument113 pages20220602M - Le Virtuel Comme Espace AutreTurtlePas encore d'évaluation
- Logiciel de Creation Co3Document19 pagesLogiciel de Creation Co3Hack - TpMPas encore d'évaluation
- La Photomodélisation ArchitecturaleDocument5 pagesLa Photomodélisation ArchitecturaleEcho Utis0% (1)
- Livret IA PDFDocument35 pagesLivret IA PDFoboumouPas encore d'évaluation
- jvhs05 Nintendo64Document124 pagesjvhs05 Nintendo64bebou1312Pas encore d'évaluation
- Le Jeu MedecinDocument5 pagesLe Jeu MedecinCaroline SimondsPas encore d'évaluation
- Les 9 NotionsDocument5 pagesLes 9 NotionsYathis DelicatPas encore d'évaluation
- L'addiction Aux Réseaux Sociaux, Le Mal ModerneDocument3 pagesL'addiction Aux Réseaux Sociaux, Le Mal Modernesalma aitoubrahimPas encore d'évaluation
- L'atelier D'écriture Théâtrale: Des Modèles À Leur Nécessaire DétournementDocument9 pagesL'atelier D'écriture Théâtrale: Des Modèles À Leur Nécessaire DétournementGilberto Schmütz de GoumaPas encore d'évaluation
- La Menagerie de Papier - Ken LiuDocument366 pagesLa Menagerie de Papier - Ken LiuAlexandre GUEZPas encore d'évaluation
- Livre Blanc - IA & Ingénierie PédagogiqueDocument36 pagesLivre Blanc - IA & Ingénierie Pédagogiquedododream7780Pas encore d'évaluation
- 05 Cours MethodoUX MDulot ProductionDocument72 pages05 Cours MethodoUX MDulot ProductionHHM HHMPas encore d'évaluation
- Politis - 1692 - 10-16 FévDocument32 pagesPolitis - 1692 - 10-16 FévOre TarkoPas encore d'évaluation
- Devoirs de Français 03 - Artbook de MontataireDocument52 pagesDevoirs de Français 03 - Artbook de Montataireattano1789Pas encore d'évaluation
- Simplification JDR Contemporain CocDocument28 pagesSimplification JDR Contemporain CocMatéo ROBINPas encore d'évaluation
- Comment Analyser Un ReportageDocument3 pagesComment Analyser Un ReportageFanny Silene Plata DuranPas encore d'évaluation
- Livre SW BetaDocument69 pagesLivre SW Betayo goloPas encore d'évaluation
- La Lettre de La FFJDR n.3 (Nouvelle Formule) - Octobre 2000Document16 pagesLa Lettre de La FFJDR n.3 (Nouvelle Formule) - Octobre 2000vil_farfadetPas encore d'évaluation
- Note 4 Approche Systemique PDFDocument5 pagesNote 4 Approche Systemique PDFsoukainaPas encore d'évaluation
- Root Underworld Learn To Play - TRAD FRDocument8 pagesRoot Underworld Learn To Play - TRAD FRAlexandre BertolinoPas encore d'évaluation
- GC Grand Livre Du JV WebDocument412 pagesGC Grand Livre Du JV Webydelon6Pas encore d'évaluation
- Le - Cadrage Au CinemaDocument7 pagesLe - Cadrage Au CinemaKamal TalebPas encore d'évaluation
- Remue MeningesDocument3 pagesRemue MeningeshattabsatPas encore d'évaluation
- Progr C3 ArtsPlastiques 2016 PDFDocument4 pagesProgr C3 ArtsPlastiques 2016 PDFhabibaPas encore d'évaluation
- Creation Personnage Cyberpunk 1.3.1Document67 pagesCreation Personnage Cyberpunk 1.3.1franckflo3871Pas encore d'évaluation
- METZ, C. - Au-Delà de L'analogie, L'imageDocument11 pagesMETZ, C. - Au-Delà de L'analogie, L'imagesimpla-1Pas encore d'évaluation
- Carnet de Bord Chef D'oeuvreDocument16 pagesCarnet de Bord Chef D'oeuvresegalPas encore d'évaluation
- Fiche Technique N 3 Stréotypes, Biais Cognitifs Et DiscriminationDocument7 pagesFiche Technique N 3 Stréotypes, Biais Cognitifs Et DiscriminationBenAhmed AbdennaceurPas encore d'évaluation
- Haiku KiraDocument19 pagesHaiku KiraScrbdPas encore d'évaluation
- Expose Les Representations SocialesDocument15 pagesExpose Les Representations SocialesNesrine TrabelsiPas encore d'évaluation
- Analyse D Oeuvre CorrigeDocument2 pagesAnalyse D Oeuvre CorrigeGeorgiana GattinaPas encore d'évaluation
- Rallye Romans Policiers1Document44 pagesRallye Romans Policiers1Angel KissPas encore d'évaluation
- Root Base Law of Root - TRAD FRDocument18 pagesRoot Base Law of Root - TRAD FRAlexandre BertolinoPas encore d'évaluation
- Présences À DistanceDocument218 pagesPrésences À Distancecorrinne1702Pas encore d'évaluation
- Le Régime de Vérité NumériqueDocument28 pagesLe Régime de Vérité NumériqueAntoinette RouvroyPas encore d'évaluation
- Precis Delectro AcoustiqueDocument155 pagesPrecis Delectro AcoustiqueAnas HasniPas encore d'évaluation
- MAO Catherine 2014 TheseDocument436 pagesMAO Catherine 2014 TheseM CPas encore d'évaluation
- Gand Jeu Histoire Dont Vous Êtes Le HérosDocument41 pagesGand Jeu Histoire Dont Vous Êtes Le HérosOceane GodardPas encore d'évaluation
- Chateau JeuDocument7 pagesChateau JeuArnaud De BatselierPas encore d'évaluation
- Cours 5Document33 pagesCours 5Salima BoucennaPas encore d'évaluation
- Charte Graphique CY Gastronomie WebDocument12 pagesCharte Graphique CY Gastronomie WebS.A.R.L stengifPas encore d'évaluation
- DCC Fiche Clerc v2Document1 pageDCC Fiche Clerc v2X82100% (1)
- jvhs04 100jeuxDocument93 pagesjvhs04 100jeuxbebou1312Pas encore d'évaluation
- Guide Et Sous-Genre de L'imaginaire - ApophisDocument169 pagesGuide Et Sous-Genre de L'imaginaire - ApophisDFPas encore d'évaluation
- Une Brève Histoire de La PsychogéographieDocument17 pagesUne Brève Histoire de La PsychogéographieGilles MalatrayPas encore d'évaluation
- Cartes de Sort ShadowrunDocument26 pagesCartes de Sort ShadowrunRyu Osaki100% (1)
- La Créativité 2023Document10 pagesLa Créativité 2023amalbenchouchenePas encore d'évaluation
- Les PlansDocument4 pagesLes PlansValérie PalaciosPas encore d'évaluation
- Memoire FlouDocument69 pagesMemoire FlouMaïder Fortuné100% (1)
- Atelier Cinema Le CadrageDocument10 pagesAtelier Cinema Le CadrageAmiraPas encore d'évaluation
- Cours de LudothèqueDocument11 pagesCours de LudothèquetomanubisPas encore d'évaluation
- POLITIQUE de L'INFORMATIQUE ET de L'INFORMATION Les Pionniers de La Nouvelle Frontière ÉlectroniqueDocument586 pagesPOLITIQUE de L'INFORMATIQUE ET de L'INFORMATION Les Pionniers de La Nouvelle Frontière ÉlectroniqueIntinionPas encore d'évaluation
- GN Guide DebutantDocument11 pagesGN Guide DebutantArthanis Archimage d'EtherPas encore d'évaluation
- La Méta-Analyse: Méthodes Et Applications en Sciences SocialesDocument60 pagesLa Méta-Analyse: Méthodes Et Applications en Sciences SocialesGaston BadesirePas encore d'évaluation
- C. Paul, Art Numerique, Probl 23-25Document3 pagesC. Paul, Art Numerique, Probl 23-25Eve BeamanPas encore d'évaluation
- Halmaoui Ia PDFDocument18 pagesHalmaoui Ia PDFlucry choumelePas encore d'évaluation
- Lyotard, Jean François - La Logique Qu'il Nous FautDocument57 pagesLyotard, Jean François - La Logique Qu'il Nous FautWalterBenjamin100% (1)
- Benjamin-1931-Petite Histoire de La PhotographieDocument32 pagesBenjamin-1931-Petite Histoire de La PhotographieAtopiakPas encore d'évaluation
- Bougnoux - Mediologie Et MediasDocument11 pagesBougnoux - Mediologie Et Mediascorrinne1702Pas encore d'évaluation
- Esthetiques Ordinaires Du Cinema Et de L'AudiovisuelDocument199 pagesEsthetiques Ordinaires Du Cinema Et de L'Audiovisuelcorrinne1702Pas encore d'évaluation
- Présences À DistanceDocument218 pagesPrésences À Distancecorrinne1702Pas encore d'évaluation
- Pronoms Relatifs Simples1Document6 pagesPronoms Relatifs Simples16qt7dxkjstPas encore d'évaluation
- C 212 DocDocument1 pageC 212 Docmed AminePas encore d'évaluation
- Histoire Du Tribunal Révolutionnaire T6Document520 pagesHistoire Du Tribunal Révolutionnaire T6yveslunnPas encore d'évaluation
- Echantillonnage Partie 2Document26 pagesEchantillonnage Partie 2Amine SlaouiPas encore d'évaluation
- Contrôle 3e Année Eval 3 1er Semestre Passerelle Hanane ELMONTASSIRDocument2 pagesContrôle 3e Année Eval 3 1er Semestre Passerelle Hanane ELMONTASSIRahmed oubasPas encore d'évaluation
- Collectif - Un Ange Passe - Les Anges de La Littérature (2004) PDFDocument100 pagesCollectif - Un Ange Passe - Les Anges de La Littérature (2004) PDFmatrixleblancPas encore d'évaluation
- Page 42 of 551Document1 pagePage 42 of 551Mohammed ASPas encore d'évaluation
- SVI Correspondance Modules14 15Document2 pagesSVI Correspondance Modules14 15Don YaPas encore d'évaluation
- RegsinmoDocument3 pagesRegsinmogamalPas encore d'évaluation
- Mémoir Master 2 (1) Horch 2Document76 pagesMémoir Master 2 (1) Horch 2Rö ŠæPas encore d'évaluation
- Goldmann L., Pour Une Sociologie Du Roman.Document3 pagesGoldmann L., Pour Une Sociologie Du Roman.DonQuichottePas encore d'évaluation
- Cours de FrancaisDocument53 pagesCours de FrancaisIratabara LouangePas encore d'évaluation
- Le Chemin de Maitre Livres 1-3Document157 pagesLe Chemin de Maitre Livres 1-3timotheePas encore d'évaluation
- đề 2Document8 pagesđề 2Hoàng Phúc Đào100% (1)
- Autrui Sujet CorrigeDocument2 pagesAutrui Sujet CorrigeRblhPas encore d'évaluation
- Hélène Montardre - Pégase L IndomptableDocument44 pagesHélène Montardre - Pégase L IndomptableعبداللهبنزنوPas encore d'évaluation
- Conseil CBDocument9 pagesConseil CBabdoul7Pas encore d'évaluation
- Livre de La SagesseDocument24 pagesLivre de La Sagessecheikh oumar baPas encore d'évaluation
- Boala Parkinson. Practicarea ExercitilorDocument38 pagesBoala Parkinson. Practicarea ExercitilorDia ZahaPas encore d'évaluation
- Dix Regles Dans Al-IstiqamahDocument37 pagesDix Regles Dans Al-IstiqamahAlpha BakPas encore d'évaluation
- Cahier Histoire 1Document75 pagesCahier Histoire 1Mamadou Moustapha Sarr100% (2)
- Depistage Neonatal DrepanocytoseDocument4 pagesDepistage Neonatal Drepanocytosefdesouche2Pas encore d'évaluation
- LES ADVERBES EN - MentDocument3 pagesLES ADVERBES EN - MentSimge AtalarPas encore d'évaluation
- La Sorciere de La Boutique de Livres - TapuscritDocument2 pagesLa Sorciere de La Boutique de Livres - Tapuscritjdj7dvy4vbPas encore d'évaluation
- Tout Le Magnétisme Et Plus EncoreDocument31 pagesTout Le Magnétisme Et Plus EncoreSabrina katia DEVARIEUXPas encore d'évaluation
- Bracelet FleurDocument2 pagesBracelet FleurCarinePas encore d'évaluation
- Les Parametres Vitaux Et BiologiquesDocument146 pagesLes Parametres Vitaux Et BiologiquesNabi ZoulkaranaïniPas encore d'évaluation