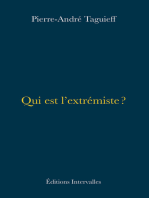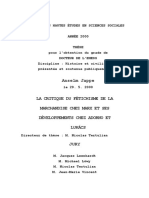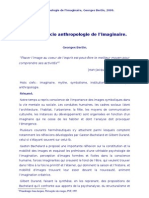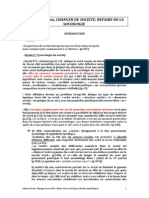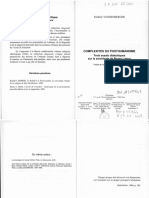Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
0862
0862
Transféré par
NgườiSàiGònCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
0862
0862
Transféré par
NgườiSàiGònDroits d'auteur :
Formats disponibles
MARX
PENSEUR DU POSSIBLE
Collection L'Ouverture Philosophique
dirige par Bruno Pquignot
et Dominique Chateau
Une collection d'ouvrages qui se propose d'accueillir des travaux
originaux sans exclusive d'coles ou de thmatiques.
Il s'agit de favoriser la confrontation de recherches et des rflexions qu'
elles soient le fait de philosophes "professionnels" ou non. On n'y con-
fondra donc pas la philosophie avec une discipline acadmique; elle est
rpute tre le fait de tous ceux qu'habite la passion de penser, qu'ils
soient professeurs de philosophie, spcialistes des sciences humaines,
sociales ou naturelles, ou
'"
polisseurs de verres de lunettes
astronomiques.
Dernires parutions
Alain DOUCHEVSKY, Mdiation & singularit. Au seuil d'une
ontologie avec Pascal et Kierkegaard, 1997.
Joachim WILKE, Les chemins de la raison, 1997.
Philippe RIVIALE, Tocqueville ou l'intranquillit, 1997.
Grald HESS, Le langage de l'intuition. Pour une pistmologie du
singulier, 1997.
Collectif, Services publics, solidarit et citoyennet, 1997.
Philippe SOUAL, Miklos VETO, Chemins de Descartes, 1997.
Sylvie COIRAULT-NEUBURGER, Exprience esthtique et religion
naturelle, 1997.
Agemir BAVARESCO, La thorie hglienne de l'opinion publique,
1998.
Michle ANSART-DOURLEN, L'action politique des personnalits et
l'idologie jacobine, 1998.
Philippe CONSTANTINEAU, La doctrine classique de la politique
trangre. La cit des autres, 1998.
Genevive EVEN-GRANBOULAN, Ethique et conomie, 1998.
Bernard GUELTON, L'exposition, 1998.
Itzhak GOLDBERG, Jawlensky ou le visage promis, 1998.
Maryse DENNES, Husserl - Heidegger. Influence de leur oeuvre en
Russie, 1998.
Jean BARDY, Bergson professeur, 1998.
Franois NOUDELMANN, Image et absence. Essai sur le regard, 1998.
Michel V ADE
MARX
PENSEUR
DU POSSIBLE
Prface du Professeur Jacques D'HoNDT
ditions L'Harmattan
5-7, rue de l'cole-Polytechnique
75005 Paris
L'Harmattan Inc.
55, rue Saint-Jacques
Montral (Qc)
- CANADA H2Y IK9
DU MME AUTEUR
Livres
L'idologie, Paris, P.U.F., 1973, colI. Logos, 96 p. (Textes choisis et introduction).
Trad. portugaise: Lisbonne, 1977; trad. arabe: Beyrouth, 1982.
Gaston Bachelard ou le nouvel idalisme pistmologique, Paris, ditions sociales, 1975,
304 p. (Trad. allemande: Berlin, 1979).
Contributions des ouvrages collectifs
La critique de l'abstraction par Marx.., in La logique de Marx (sous la dir. de
J. D'Hondt), Paris, P.U.F., 1974, pp. 61-89. (Trad. portugaise: Lisbonne, 1978).
La conception de la thorie chez Marx.., in Science et dialectique chez Hegel et Marx,
ditions du C.N.R.S., 1980, pp. 41-56.
Bachelard et le matrialisme philosophique , in Gaston Bachelard, Profils pistmolo-
giques (dir.: Guy Lafrance), Presses de l'Universit d'Ottawa, Philosophica, 1987,
pp.57-77.
Epistemologie , in Enzyklopiidie zur brgerlichen Philosophie im 19. und 20. Jahrhun-
dert (Manfred BUHR hrsg.), VEB Bibliographisches Institut, Leipzig, 1988,
pp. 439-453 (trad. franaise, 1981, in La Pense,
n
220).
La vie et la mort, Actes duXXIV' Congrs de l'Association des Socits de Philosophie
de Langue Franaise (ASPLF) tenu Poitiers les 27-30 aot 1992, (sous la dir. de M.
Vade), Poitiers, Socit Poitevine de Philosophie, 1996, 468 p. (Index et
iconographies).
Les chemins de la raison: XX, sicle, la France la recherche de sa pense, (dit par J.
Wilke, J.-M. Gabaude, M. Vade), Paris, L'Harmattan, 1997, 332 p.
etc.
Premire parution: ditions Mridiens Klincksieck, 1992
@
L'Harmattan, 1998
ISBN: 2-7384-6615-X
PRFACE
Ce livre apporte du nouveau.
La thse fondamentale qu'il soutient avait certes t suggre plus ou
moins discrtement et l. Elle est dveloppe ici plus compltement, plus
mthodiquement, plus fortement que jamais: Marx est un adepte de la libert
individuelle et collective.
Michel Vade intervient dans une querelle thorique actuellement trs
vive, attise par le spectacle d'vnements mondiaux rvlateurs. Quel rapport
se noue entre la pense authentique de Marx et les consquences pratiques,
diverses et douteuses, que l'on a prtendu en tirer? Il s'agit d'tablir ou de
rtablir, dans un dbat confus, ce que Marx a vraiment dit. L'tude d'un
problme particulier - en jargon philosophique, celui de la modalit -
induit une interprtation globale de l'uvre de Marx. Le jeu de cette catgorie
de la modalit dans les recherches thoriques de Marx restait jusqu'
maintenant mconnu ou nglig.
Que l'on aime ou que l'on dteste Marx, que l'on souhaite confirmer son
actualit ou dnoncer sa premption, la premire tche est d'essayer de le
connatre: l'auteur s'applique donc redresser les erreurs les plus rpandues
aussi bien parmi les partisans que parmi les adversaires, et il le fait en se
rfrant constamment aux textes originaux dont l'accs demeure trs difficile,
en particulier pour des lecteurs franais tributaires de traductions souvent
dfectueuses. Les traducteurs de Marx reoivent parfois sans critique des
reprsentations du marxisme qui leur ont t inculques avant toute lecture.
Mais, pour expliquer certains errements, il convient sans doute d'incriminer
aussi l'embarras et les variations de Marx lui-mme, ses obscurits ou ses
contradictions apparentes.
Le propos de Vade prend un tour polmique lorsqu'il examine des
interprtations errones ou frauduleuses. Il rcuse des versions trop objecti-
vistes ses yeux, ou trop subjectivistes. Dgage de la gangue des
commentaires dformants, la philosophie de Marx s'offre alors comme une
philosophie de la libert parce qu'elle a su reconnatre d'abord l'existence et la
8 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
varit des possibles, des situations et des actions possibles dans la vie sociale
et dans les rapports de l'homme avec la nature.
Le livre procde donc, comme il convient, une fine analyse des divers
types de possibilit que Marx discerne, ainsi que de leurs relations avec les
catgories principales de la vie et de la philosophie: ncessit, causalit,
dterminisme, etc.
Un des aspects les plus frappants de ce recours la notion de possibilit
se trouve dans la mise en vidence de l'influence d'Aristote et d'picure sur le
mode marxien de pense. L'appel ces philosophes antiques permet de
compenser en quelque sorte l'excs de ncessitarisme et d'idalisme de Hegel,
dont l'ascendant sur Marx ne se voit toutefois pas contest.
Si le possible ou l'en soi joue dans la conception marxienne du monde
et de l'homme le rle minent que Vade lui assigne, alors on comprend mieux
l'moi et le dsarroi des matrialistes traditionnels devant une telle doctrine.
Mrite-t-elle encore son nom de matrialisme, et quelles conditions? Vade
ne mconnat ni la gravit ni l'urgence d'une telle question. Son livre la pose
implicitement et explicitement avec vigueur et insistance. En proposant de
nouvelles rponses, il suscite de nouvelles recherches.
Ainsi se trouvent veilles et stimules l'inquitude et l'intelligence du
lecteur devant une uvre qui n'a pas encore livr toutes ses significations, et
dont on lui ouvre ici l'une des entres les plus prometteuses.
J. D'Hondt
Jeannie,
et la mmoire de Bourobou
Bourobou.
*
Etudiant en philosophie Poitiers, dcd accidentellement
",
au cours de l't 1985, dans
son pays, le Cameroun, alors qu'il entreprenait de prparer un mmoire de Matrise sur L'ide
de mthode critique dans la Contribution de Marx, qu'il m'avait demand de diriger.
Grave est la nuit
Mais l'homme a dispos ses signes
fraternels
La lumire vint malgr les poi-
gnards
Pablo NERUDA
~
AVANT-PROPOS
La vitalit d'une pense se mesure au nombre des dbats et des combats
qu'elle provoque. A cette aune, celle du marxisme est enviable. Le rsultat est
aujourd'hui un certain clatement de la pense de Marx qui disparat dans la
multiplication des interprtations.
A l'encontre de cette dispersion comme du dogmatisme, nous tentons
dans le prsent ouvrage un exercice de <<lecture approche de l'uvre
thorique de Marx.
Nous avons donc d appuyer nos analyses sur de nombreuses citations, et
entrer parfois dans certaines minuties. Nous esprons que les lecteurs en
tireront profit et que, au bout du compte, l'intelligence de la pense de Marx
y gagnera.
Nombre de travaux consacrs au marxisme ont fait trop bon march du
recours aux textes originaux. Les traductions - mme celles des dernires
annes, pourtant meilleures que les anciennes bien des gards - laissent
encore dsirer. Nous adressant avant tout un public franais, nous avons
utilis les traductions existantes, palliant leurs dfauts en modifiant par
endroits le texte qu'elles proposent, ce que nous avons mentionn.
Nous donnons partout les rfrences l'dition Dietz des Marx-Engels
Werke (uvres de Marx et d'Engels) parce qu'elle est seule peu prs
exhaustive et plus accessible que la nouvelle Marx-Engels Gesamtausgabe
(dition complte de Marx et d'Engels) en cours de publication, laquelle
nous avons aussi eu recours l'occasion.
Nous n'avons pas voulu alourdir nos notes en donnant le texte original de
Marx, nous contentant de signaler les termes allemands entre crochets carrs
chaque fois que cela nous a paru indispensable.
A quelques exceptions prs, nous mentionnons les uvres de Marx et
d'Engels -
y compris quelques uvres choisies -
par une abrviation de leur
titre, en faisant en sorte qu'elle reste lisible: le lecteur trouvera ces abrviations
dans la Bibliographie qui figure en fin d'ouvrage.
14 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Les sigles utiliss dans les notes ont donc t limits un trs petit
nombre:
MEW signifie Marx-Engels Werke
MEW EB signifie Marx-Engels Werke, Erganzungsband
Gr. signifie Grundrisse der Kritik der politischen Oekonomie
MEGA 1 signifie Marx-Engels Gesamtausgabe (dite Ire MEGA)
MEGA signifie Marx-Engels Gesamtausgabe (dite 2e MEGA)
MEGA, App. signifie (tome d'Apparat critique de la MEGA)
Le sigle est suivi directement du n du tome; ainsi, MEW 1 renvoie
Marx-Engels Werke, 1. 1", et MEGA IllS, Marx-Engels Gesamtausgabe,
2e Section, t. 5 .
Les autres sigles employs (uniquement dans les notes) sont les suivants:
AIT signifie: Association Internationale des Travailleurs
bit. signifie: dition bilingue
ES signifie: ditions sociales
L. signifie: Lettre (ou Lettres)
O. C. signifie: uvres compltes
Les autres abrviations utilises sont d'usage courant.
Nous avons adopt quelques conventions pour les rfrences simultanes,
dans une mme note, plusieurs ditions d'un mme texte:
-
nous donnons en premier les rfrences aux ditions franaises;
- le texte de la citation est celui de la premire dition mentionne;
-
enfin, quand plusieurs sources sont cites dans des notes qui se
suivent, nous gardons l'ordre des rfrences sans rpter le titre.
Les caractres gras, soit dans les citations, soit dans notre texte, sont
rservs aux mots trangers (sauf pour les titres d'ouvrages). Ainsi, quand
Marx insre des termes en franais dans son texte, ils apparatront en gras dans
la citation (sauf pour Misre de la philosophie, et quelques autres cas de textes
crits en franais par Marx).
Les mots entre crochets carrs dans les citations sont ajouts par nous.
Le lecteur trouvera en fin de volume 1) une Bibliographie raisonne
comportant les uvres de Marx et d'Engels, les instruments de la recherche,
une slection de la littrature marxienne, les uvres d'Aristote et de Hegel
utilises, des ouvrages gnraux (dictionnaires, encyclopdies), 2) un Index des
noms de personnes 3) un Index des concepts 4) un Index des termes allemands.
Faisons ds maintenant, et une fois pour toutes, une remarque sur la
traduction du mot allemand Prozess .
Les traducteurs franais, suivant l'exemple de Marx l, ont gnralement
traduit ce terme par procs . Dans nos citations de traductions franaises
d'uvres de Marx et d'Engels, ou de commentateurs, nous avons substitu
partout processus procs.
Deux raisons motivent cette dcision. D'une part, procs au sens de
processus est savant et inusit dans la langue courante2. D'autre part,
AVANT-PROPOS
15
l'usage du mot processus prvaut chez les traducteurs des uvres de Hegel
pour rendre Prozess. Or, l'on sait l'attachement de Marx la terminologie
hglienne et les rapports troits de son mode de penser avec celui du
philosophe de Berlin.
Que M. Jacques D'Hondt trouve ici l'expression de notre gratitude pour
ses enseignements savants, ses conseils judicieux et son soutien amical,
auxquels cet ouvrage doit beaucoup. Toute notre reconnaissance va galement
Jeannie Vade, ainsi qu' Mme Fiorinda Li Vigni et M. Jean-Claude
Bourdin, pour l'aide qu'ils nous ont apporte en relisant le manuscrit qui leur
doit de nombreuses amliorations.
Nous adressons nos remerciements aux directeurs successifs du Centre de
Recherche et de Documentation sur Hegel et sur Marx de Poitiers, qui nous
ont permis d'utiliser ses nombreuses ressources.
Nous tenons aussi remercier MM. Manfred Buhr et Vincent von Wro-
blewsky, de l'Institut Central de Philosophie de l'Acadmie des Sciences de la
Rpublique Dmocratique Allemande, qui, en 1980, nous ont amicalement
donn accs l'important fichier des matires des uvres de Marx et d'Engels
de l'Institut Central pour les Sciences du Langage auprs de cette Acadmie
Berlin, source qui a considrablement enrichi nos recherches documentaires.
Enfin, ayant bnfici d'un semestre de Cong de Recherches en 1985-
1986, grce aux mesures gouvernementales d'alors, nous sommes redevable au
Directeur de la Facult des Sciences Humaines et au Conseil Scientifique de
l'Universit de Poitiers, qui ont accueilli favorablement notre demande.
NOTES
1. l.:e capital, t. l, p. 181, n. 1; trad. Lefebvre, p. 200, n. O.
2. Emile LITTRsignale processus,. comme rare de son temps dans le sens de dveloppe-
ment, progrs", et procs,., dans ce mme sens, comme appartenant l'ancienne langue,.
(Dictionnaire de la langue franaise, Paris, Gallimard/Hachette, 1962, vol. 6, pp. 455 et 457). Cet
emploi de processus" est devenu la rgle aujourd'hui, procs" tant rserv la langue
judiciaire, bien qu'il conserve son usage en anatomie. Mais les traducteurs franais gardent, par
un respect exagr pour Marx qui ne connaissait qu'imparfaitement notre langue, cet emploi
surann de procs pour signifier marche, dveloppement, progrs.
INTRODUCTION
Ni lu ni compris?
Aux meilleurs esprits
Que d'erreurs promises!
Paul VALRY
1. Pour une connaissance approche de Marx
Aprs l'poque du dogmatisme marxiste triomphant et de ses critiques
radicales, aprs celle des interprtations libres, qui caractrisent une seconde
priode dans l'histoire du marxisme, sommes-nous en passe d'entrer dans une
nouvelle re de la connaissance de Marx?
Marx nous est devenu familier et lointain la fois. Toujours trs
combattu, est-il encore lu? Quand il l'est, est-il compris? L'uvre de Marx
devrait tre mieux connue. Du moins, elle est connaissable: disposant de
bonnes ditions des uvres originales, on peut peu prs l'embrasser en
totalit. De plus, le marxisme appartient la culture contemporaine I : parfois
il est omniprsent, voire seul prsent, par partis et pouvoirs interposs. D'une
certaine faon donc, la pense de Marx est bien connue: elle est ancre dans
le monde.
Nanmoins, n'est-ce pas le lieu de dire avec Hegel: <<lebien-connu en
gnral est justement, parce qu'il est bien connu, inconnu 2? Car, dans le
temps mme o il devenait enfin connaissable, Marx nous devenait tranger.
Il s'loigne de nous: quel sens peut bien dlivrer aujourd'hui une uvre
enracine dans les savoirs et les ralits d'un autre temps?
Les crits de Marx ne sont pas de lecture facile. Ils supposent la
connaissance d'un contexte qui a gnralement disparu: l'Allemagne, l'Angle-
terre et la France d'il y a cent trente ou cent cinquante ans! Autant dire un
.
pass rvolu. Or, comme l'crivait un certain jeune homme de 18ans, en 1835,
les lointains illusionnent 3.
Pour tre surmonts, les obstacles la lecture de Marx rclament un
18 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
exercice de lecture approche au sens o Bachelard parlait de connaissance
approche, d'approximation fine.
Les choses sont complexes. Outre l'loignement historique, il y a l'obsta-
cle de la langue. Et malheureusement les traductions ne se sont gure
amliores. Mais cela n'excuse pas tout: les obstacles une bonne comprhen-
sion sont loin d'tre seulement de nature pistmologique . Gaston Bache-
lard remarquait malicieusement que la connaissance du rel est une lumire
qui projette toujours quelque part des ombres , qu' elle n'est jamais imm-
diate et pleine
",
que <<lesrvlations du rel sont toujours rcurrentes . En
effet, ajoutait-il: <<lerel n'est jamais ce qu'on pourrait croire, mais il est
toujours ce qu'on aurait d penser4.
Ne pourrait-on appliquer ce propos la connaissance de la pense de
Marx? Le marxisme n'est-il pas ce qu'on aurait d penser, non ce qu'on
pourrait croire? Les multiples images que nous en donnent d'innombrables
commentaires ou rfutations ne projettent-elles pas toujours quelque part des
ombres? La connaissance d'une uvre, reste longtemps indite, ou non
traduite, comme celle de Marx, n'est-elle pas rcurrente?
Les conditions dans lesquelles elle fut labore -, et tenue sous le
boisseau! -, interdirent, et, dans une certaine mesure, interdisent encore, que
sa connaissance soit immdiate et pleine. Malgr l'abondance des exposs,
et des travaux thoriques et historiques qui leur ont t consacrs, nous le
verrons, les uvres de Marx reclent toujours des nigmes et rservent des
surpnses.
Nous n'avons pas cherch donner une nouvelle <<lecture de Marx. A
quoi bon ajouter une interprtation celles dont on dispose? Leur nombre est
suffisant pour satisfaire tous les esprits. Cependant, nous n'avons pas hsit
nous carter des commentaires consacrs, sans trop nous proccuper, inverse-
ment, des exgses hasardes par des thoriciens originaux et audacieux, mais
peu respectueux des textes. Nous avons prfr revenir ces textes mmes
pour les explorer hors de tout a priori. Si notre lecture est nouvelle, ce sera par
surcrot. Car comprendre la pense d'un chercheur et d'un lutteur tel que
Marx, ce n'est pas dfendre sa cohrence systmatique ou sa vrit indfecti-
ble, ce qui suffit au dogmatisme ordinaire. Ce n'est pas davantage la soumettre
une critique acrimonieuse au nom d'une prtendue supriorit que procure-
raient la simple postrit ou la survenue d'vnements inous.
Aussi, par-del les exposs populaires fournis nagure par de fidles
disciples ou par des adversaires dclars, par-del les partis-pris des partis et
des partisans qui se rclamrent aveuglment de lui, par-del les annexions et
dformations o se sont illustrs ceux qui dcouprent habilement les crits
marxiens pour s'en faire un costume au got du jour ou s'y loger en bernard
l'ermite y important leurs philosophies trangres, il nous a paru utile de la
soumettre un nouvel examen, pourvu qu'il ft clairant sur son sens.
La catgorie du possible se prtait cet objectif. Marx fut un penseur du
possible autant qu'un penseur du ncessaire. Pour lui, la ncessit d'une
INTRODUCTION
19
prochaine, voire imminente, rvolution sociale, qui serait la dernire grande
rvolution historique, ne faisait qu'un avec sa possibilit. Il crut que la
possibilit relle d'un dpassement dfinitif de toute socit de classes se
prsentait, ds le milieu du dix-neuvime sicle, avec l'apparition et le
dveloppement rapide de la classe sociale qui le raliserait: la classe ouvrire
ou proltariat. Il pensa que cette rvolution, possible et ncessaire la
fois, consisterait dans l'abolition de toute exploitation de l'homme par
l'homme et de tout asservissement politique, grce la disparition de la
proprit prive des moyens de production. Il affirma que cette rvolution
conduirait l'instauration, puis l'panouissement, d'un rgne de la
libert. Il en rsulte que la pense marxienne de la ncessit historique tait,
en mme temps, une pense de la possibilit historique.
Marx fondait ses affirmations sur une vaste culture, une somme immense
de connaissances de tous ordres, dont il a tir une synthse puissante et
originale qui est la fois un bilan et un programme. Il tait de ceux qui pensent
qu'un programme d'action rvolutionnaire rclame un bilan rigoureux,
scientifique, une connaissance thorique, qui lui serve de base. Rciproque-
ment, si le bilan est srieux et exact, s'il donne la comprhension rationnelle
du processus rel qui se droule sous nos yeux, il dbouche sur un programme
qu'il appelle; il fait voir l'avenir: il s'ouvre sur le possible.
On nous objectera que Marx a affirm haut et fort que l'histoire suit un
dveloppement ncessaire. De l, on a gnralement conclu qu'il affirmait
la prdictibilit en histoire; il aurait entendu le cours du monde d'une manire
dterministe. Bref, peut-on penser le matrialisme historique sans le ramener
un dterminisme historique, une sorte de fatalisme conomique 5?
Nous ne nierons pas que Marx s'est plu utiliser le langage du fatalisme;
mais est-ce son dernier mot? est-ce le sens de son message? Une analyse de sa
pense cartera cette interprtation. La pense de Marx est tout autant une
pense de l'action rvolutionnaire par laquelle les hommes se librent de toute
ncessit trangre, qu'un fatalisme born et obscur. Quant lui, Marx
proclamait: Les hommes font l'histoire! Jusqu'ici, expliquait-il, ils l'ont
faite inconsciemment, soumis des forces conomiques et sociales qu'ils ne
comprenaient pas, mais ils peuvent dsormais la faire consciemment: telle
est la thse marxienne!
Il est d'ailleurs ais de remarquer que la catgorie de ncessit est rien
moins qu'univoque: On pourrait discuter longtemps sur l'usage que fait
Marx de la catgorie modale de la ncessit dans sa conception du passage du
systme bourgeois au communisme. C'est probablement un usage encore
fortement influenc par la science du XIXesicle et qui, par surcrot, a t
souvent interprt, pour des raisons de propagande, d'une faon mtaphysi-
que sinon thologisante et providentialiste. Cette catgorie de la ncessit doit
tre amene aujourd'hui une problmatique beaucoup plus complexe6.
Nous montrerons qu'il y a toutes sortes de ncessits, que la ncessit
conomique se prsente elle-mme sous plusieurs formes: la ncessit absolue
20 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
n'est pas la ncessit relative7. Celle-ci se prsente sous la forme des besoins,
des tendances, de la probabilit, etc. Peut-on assimiler la ncessit du passage
de la socit de classes une socit sans classes la ncessit aveugle d'une
loi de la nature? Ncessit naturelle, ncessit conomique, ncessit histori-
que, ne sont nullement identiques en tous points. Elles prsentent des traits
communs, mais aussi des diffrences. Par suite, la catgorie du possible n'est
pas moins fondamentale dans la pense marxienne que celle du ncessaire.
En contestant que chez Marx, la ncessit historique - ou mme
conomique - ait le sens dterministe auquel la ramenrent de nombreux
interprtes, nous heurtons de front une ide reue, qui dcoule de simplifica-
tions dogmatiques qu'on a fait subir au marxisme pour des raisons politiques,
en le couchant dans le lit de Procuste d'une idologie courte vue.
L' interprtation dterministe a incontestablement rendu de grands services
ceux qui embrassrent le marxisme, comme ceux qui le rejetrent: pour les
premiers, elle justifiait leur volontarisme politique obstin, pour les autres son
refus vhment.
La conception matrialiste marxienne est indissolublement une pense
des conditions matrielles de l'action et de l'activit transformatrice par
laquelle les hommes se librent progressivement de leur sujtion la nature et
des ingalits de classes que perptue la domination politique. La nouvelle
classe sociale universelle, la classe ouvrire, peut et doit remplir cette
mission et instaurer un rgime o tous jouiraient d'une vritable libert: voil,
pour Marx, la possibilit par excellence.
Mais nos contradicteurs ne dsarmeront pas: Marx ne ramenait-il pas la
libert la comprhension de la ncessit, comme l'avaient fait Spinoza et
Hegel, dont il se proclamait volontiers le disciple? Toutefois, peut-on faire de
Marx un spinoziste ou un hglien orthodoxe , lui qui s'est toujours insurg
contre toute allgeance et toute orthodoxie? N'opposa-t-il pas le rgne de la
libert au domaine de la ncessit, la libert n'existant qu'au-del de la
ncessi t?
Comme ses deux illustres devanciers, il concevait la libert comme
affirmation et ralisation de soi, comme libration de toute contrainte de
classe, comme libre panouissement de chacun grce la matrise collective de
toutes les conditions extrieures converties en leviers de cette ralisation. Mais
le but est le libre panouissement des individus, non leur absorption dans un
tout. C'est en tant que rvolutionnaire, mettant le communisme au service de
l'individu, que Marx pensait ces questions.
Nous soutiendrons, enfin, qu'on ne peut comprendre la libert telle que
Marx la concevait, si l'on oublie sa premire uvre, sa Dissertation doctorale,
o il interprtait la philosophie de la nature d'picure comme l'expression
d'une philosophie de la libert. Vers vingt ans, le jeune philosophe s'tait dj
engag dans un combat pour la libert qu'il n'a jamais cess de mener.
Cette premire philosophie de la libert n'aurait-elle laiss aucune trace
dans la pense ultrieure de Marx? Gnralement, il n'abandonnait pas ce
INTRODUCTION
21
pour quoi il s'tait passionn: Marx n'est pas l'homme des reniements. La
pense de la libert est la constante profonde de toute son uvre et de toute
son action. S'il pense une libert qui ne se ramne pas purement et simplement
la comprhension de la ncessit, sa pense est ncessairement une pense du
possible.
Telles sont les questions qui fondent notre recherche. Apprendre voir en
Marx un penseur du possible nous a paru susceptible de l'clairer d'un jour
nouveau, de contribuer en fournir une comprhension plus pntrante et
plus quilibre, plus ouverte et plus juste, que celles qui ont t imposes ou
proposes jusqu'ici.
Notre propos contestera l'interprtation dominante du matrialisme
historique comme dterminisme. Nous interrogerons ce qui, dans l'uvre de
Marx, peut bien tayer une telle lecture. Nous nous arrterons sur les concepts
de loi conomique , de ncessit historique.) et de science de l'histoire .
On ne l'a pas assez remarqu, certaines expressions ne se trouvent gure
sous la plume de Marx: <<loide l'histoire, par exemple, ne fait pas partie de
son vocabulaire. Par contre, il est des catgories que l'on rencontre beaucoup,
comme celles de causes, de force ou d'activit) auxquelles, curieuse-
ment, les analystes s-marxisme se sont peu intresss.
De mme, nous devrons faire toute leur place des notions trs courantes
chez lui comme celles de moyennes et de tendances . Certains thmes, la
probabilit, la technologie (thorie de la machine), n'ont gure t tudis.
Nous comblerons ces lacunes.
Nous tracerons des coupes transversales dans les uvres de Marx, en
analysant des catgories trs courantes, malaisment dfinissables, parfois
dlaisses par des commentateurs presss d'arriver aux enseignements politi-
ques immdiats. Cet exercice de lecture approche est seul capable d'branler
l'image courante, nave et dogmatique, du marxisme ordinaire, de dranger
nombre d'exposs lmentaires comme bien des lectures savantes: histori-
cistes, pragmatiques, thoricistes, subjectivistes, etc.
Nous dnoncerons la confusion, entretenue par une longue tradition,
entre la critique de l'conomie politique et la conception gnrale de l'histoire.
Le passage de l'une l'autre est un vritable saut que l'on fait aisment sans
se demander quelle distance il faut franchir pour cela, quels concepts et quelles
ides sont alors mobiliss. Pourtant, il est notoire que dans ses ouvrages
historiographiques ou les chapitres historiques du Capital, Marx ne dduit
pas l'histoire de l'conomie!
Enfin, les influences croises de trois philosophes auxguels il s'est, tout
jeune, intress plus qu' tous les autres: Hegel, Aristote et Epicure, n'ont pas
reu toute l'attention qu'il faudrait dans la littrature spcialise sur les
origines de sa pense. A notre avis, ce jeu crois est primordial. Habituelle-
ment, on ne considre gure que l'influence hglienne, moins qu'on ne
prtende mme une rupture radicale de Marx avec tous ses devanciers. Or, les
philosophies d'picure, d'Aristote et de Hegel jouent toutes les trois un rle
22 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
capital dans la formation de sa pense. Il faut en tenir compte si l'on veut
dterminer le sens du marxisme de Marx.
Finalement, nous douterons de tout, afin d'viter les certitudes conforta-
bles et les accomodements partisans, les facilits du simplisme et les dmem-
brements thoriques intempestifs, les dcoupages chronologiques l'emporte-
pice et les dpassements ontologiques illusoires.
2. Le concept de possibilit chez Marx et ses origines
A premire vue, le concept de possibilit ne semble pas tenir une grande
place dans l'uvre de Marx. Il n'apparat au premier plan que dans la thorie
des crises conomiques.
Ceux qui se sont penchs sur cette catgorie chez Marx se limitent donc
aux textes o il distingue crise possible et crise effective8. Ce faisant, ils
semblent penser que ce concept n'intervient que l o le terme apparat
explicitement 9.
Double erreur, car les termes exprimant la possibilit apparaissent trs
souvent dans les uvres de Marx et quels que soient les sujets abords.
Si l'on relevait les occurrences du mot possibilit [Moglichkeit], on
obtiendrait une liste importante. Il faudrait y ajouter toutes les apparitions de
l'adjectif possible , et des expressions ou termes synonymes, tels que
virtuel, en puissance [der Moglichkeit nach], potentiellement, "poten-
tialiter , ,dn posse , ,datent , etc.
En voici quelques exemples. A propos de la force de travail, Marx parle
de 1'efficace de cette puissance [de travail] [Wirksamkeit dieses Vermo-
gens]1o, du travail in esse oppos au travail in posse 11,d'une possibilit
qui est en soi, en tant que puissance [an sich, ais Vermogen, ou an sich,
der Moglichkeit nach]12, du capital qui est lui-mme tout moment du
processus la possibilit de passage d'une de ses phases dans la suivante, et o
chacun des moments apparat potentiellement [potentialiter] comme du
capita113. Il oppose l'appropriation virtuelle l'appropriation relle du
travail vivant par le capital14.
Au fil des textes, on [mit par noter que Marx emploie, avec une insistance
non dissimule, une terminologie venant d'Aristote et de Hegel. Il existe de
multiples exemples de ce genre. Dans certains cas, nous le verrons, Marx
emploie directement le mot grec 86vaJ.ll. Il y a plus: en dehors des
occurrences du terme, c'est dans toutes ses analyses fondamentales que Marx
utilise cette catgorie de la pense: toutes les fois o il est question de
ralisation, de dveloppement, de processus, ou de changement. Elle est
partout prsente: c'est une conception gnrale des rapports entre possibilit
et ralit que l'on a affaire.
Marx se rattache une tradition qui confre la notion de possibilit un
certain sens: il reconnat sa dette profonde l'gard de Hegel et plus
INTRODUCTION
23
lointainement d'Aristote. Hegel traitait explicitement de la possibilit, la
prenant, dans son systme, au sens de possibilit relle . Marx, lui, utilise
cette notion, mais il n'en refait nulle part l'analyse thorique dtaille
laquelle la soumettait Hegell5.
Or, sous le nom de possibilit relle, Hegel empruntait Aristote le
concept d'tre en puissance. Marx fait de mme. C'est la tradition aristotli-
cienne qu'il se rfre. Ainsi, soit directement, soit par l'intermdiaire de Hegel,
sa conception du possible s'enracine chez Aristote, quoi qu'en disent ceux
pour qui Marx aurait rompu dfinitivement, aprs 1845, avec toute la
philosophie antrieure. On voudrait que la pense de Marx n'ait plus rien
voir avec la ci-devant philosophie! Mais il s'avre difficile de nier l'in-
fluence profonde et durable que des philosophes comme Hegel et Aristote ont
exerce sur Marx, y compris dans Le capital.
Cette notion d' tre en puissance est applique par Marx l'analyse des
rapports entre valeur d'usage et valeur d'change: un objet dont on n'a pas
l'usage immdiat est, de ce fait, valeur d'change en puissance 16; ou encore:
en tant que mesure de valeur, l'or ne peut servir que parce qu'il est lui-mme
produit du travail, dont une valeur variable en puissance [der Moglichkeit
nach] 17.
Si tels sont le sens majeur et l'origine de la catgorie de possibilit chez
Marx, il convient de dire brivement comment Aristote tait parvenu son
concept de possibilit en tant qu'tre en puissance.
Communment, on pense le possible en fonction d'une double rfrence,
d'une part au rel, d'autre part l'irrel. Le possible, dit-on, n'est pas un rel,
car il lui manque quelque chose pour avoir la plnitude ontologique que
prsente la ralit. Mais il n'est pas non plus un irrel au sens du pur non-tre
ou de l'impossible, car son accession l'tre n'est pas exclue comme pour les
tres imaginaires. Le possible a donc le statut d'un intermdiaire, d'une
mdit , entre l'tre et le non-tre: il met alors la pense commune dans
l'embarras. Qui n'a jamais prouv cet embarras?
Les penseurs anciens ont beaucoup discut pour savoir s'il fallait accorder
au possible un statut ontologique. Sans entrer ici dans une histoire de ce
concept qui est fort intressante et complexe, il nous suffira de dire quelques
mots ce sujet 18.
Aristote admit l'existence du possible telle que la conoit le sens commun,
en argument~nt de la manire suivante: Nous avons sous les yeux de
nombreux cas"de ce genre. Par exemple, le vtement que voici peut tre coup
en deux, et pourtant ne pas l'tre en fait, mais s'user auparavant; de mme il
peut n'tre pas coup, car il ne pourrait plus tre us auparavant s'il n'avait
pas la possibilit de n'tre pas coup. [...] On a affaire une vritable
indtermination. 19Ce possible est en quelque sorte suspendu entre l'tre et le
non-tre, quidistance de l'un et de l'autre.
Telle est apparue sa situation pour la premire rflexion philosophique, celle
des Grecs anciens, qui l'ont tenu pour un concept hybride et embarrassant.
24 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
L'entendement oscille en effet de son sens d'tre son sens de non-tre, allant
de l'affirmation du possible sa ngation: le possible a-t-il q~elque existence
ou bien n'est-il que non-tre tant qu'il n'est pas venu l'tre 20? Tous
cherchrent d'une faon ou d'une autre sortir de cette aporie.
Ce caractre de mdit du possible est la raison pour laquelle son
existence avait t nie par les penseurs qui, au nom de l'absoluit de l'tre,
excluaient tout mlange entre l'tre et le non-tre: ce fut la position implicite
des lates pour qui tre et ncessit se rciproquent. Les atomistes, Leucippe
et Dmocrite, ont maintenu ferme cette diffrence ontologique entre tre et
non-tre dans celle des atomes-lments et du vide.
On sait comment Platon, dans un parricide contre Parmnide, a d
faire place cette mdit. Il chercha sortir de ce dilemme en concevant l'tre
(le monde des ides) la manire late, tout en acceptant cependant
l'existence du possible dans le monde du devenir qu'il concevait en termes
hraclitens.
Mais l'admission du devenir et du possible n'allait pas de soi pour les
penseurs grecs en gnral. Si la ngation du possible n'tait encore qu'implicite
chez les lates, elle devint tout fait explicite dans l'cole mgarique de
tendance latisante. Diodore Cronos s'est acquis un titre de gloire par son
fameux argument: Le dominateur . Il y nie l'existence d'un possible qui ne
se raliserait pas, faisant observer qu'un possible qui ne deviendrait jamais
rel, serait, contradictoirement, impossib1e21.
C'est ce problme qu'Aristote apporta une rponse originale et clbre.
En sa qualit de plus grand penseur ancien du devenir, du changement et de
ses formes, c'est lui qui fit faire un pas dcisif la pense philosophique
concernant le possible. A la diffrence de tous ses prdcesseurs, il distingua
deux aspects d'un tel concept en inventant 1'tre en puissance et en
l'opposant soigneusement, quant au sens, 1'tre contingent ou indter-
min qu'illustre l'exemple du vtement: l'tre contingent s'oppose l'tre
ncessaire, alors que l'tre en puissance s'oppose l'tre en acte.
L'tre en puissance est la capacit positive recevoir une forme donne:
un bloc de marbre est statue en puissance. Mieux, la puissance [UvaJ.w;], c'est
la capacit concrte, le pouvoir , de raliser cette forme dans une matire.
C'est une possibilit oriente vers l'tre. Dans les tres naturels, elle est
inhrente un tre qui est lui-mme en acte: l'enfant est homme en
puissance; il a la capacit de devenir un adulte; c'est son devenir naturel,
normal; il Y tend. Ainsi se trouve dfinie la UvaJ.lt, potentia ou puis-
sance 22.
Du possible, au sens d'tre en puissance, se distingue l'autre sorte de
possibilit, l'tre contingent, qui est pur pouvoir-tre indtermin, sans aucune
prfrence pour ce qui en sortira: le vtement est pure indtermination quant
au fait d'tre us ou d'tre coup, sans qu'il y ait davantage de raisons en lui
pour que tel de ces deux accidents lui survienne plutt que l'autre. Ce
possible contingent est ce qui n'est pas dtermin dans un sens ou dans l'autre.
INTRODUCTION
25
Il possde une gale indiffrence pour les divers tats qui lui choient dans le
cour du devenir. Aucune raison essentielle ne l'oriente vers l'un ou vers
l'autre23.
Il n'en est pas de mme de l'tre en puissance. Pourtant, celui-ci ne se
ralise pas toujours, ni mme ncessairement le plus souvent. Des causes
varies peuvent empcher sa ralisation. Combien de graines ne germent
jamais et ne deviennent jamais la plante qu'elles sont pourtant en puis-
sance? Il n'en reste pas moins que l'tre en puissance diffre essentiellement
de l'tre contingent.
Soulignons encore que, chez Aristote, la perfection n'est pas vue dans la
puissance, mais dans l'acte. C'est seulement dans l'tre en acte que l'tre en
puissance est parvenu la plnitude de l'tre: en celle-ci, il disparat. Ainsi, la
perfection suprme du divin est l'acte pur exempt de toute puissance, un acte
que ne trouble nulle trace d'tre en puissance24.
Parmi les Anciens, picure ne retint que le possible au sens de contingent
qui tient une grande place dans sa philosophie. Inversement, les Stociens,
disciples des Mgariques, rsorbrent le possible dans le rel.
Hegel entendait le possible au sens aristotlicien d'tre en puissance,
quoique dans une philosophie trs diffrente, une philosophie de l'Esprit, d'o
sa terminologie propre: il l'appelle l'tre-en-soi, ou l'en-soi; au dbut, l'Esprit
n'est qu'en-soi, inconscient de soi, non dvelopp. Parfois, Hegel indique cette
origine aritotlicienne:
L'Esprit commence par son infinie possibilit, simple possibilit il est
vrai, mais qui enferme son contenu absolu comme l'En-soi et pose la fin et le
but que l'Esprit n'atteindra que dans son rsultat - rsultat qui sera alors sa
seule ralit. Dans l'existence, la succession apparat ainsi comme une
progression de l'imparfait vers le plus parfait, et l'imparfait ne doit pas tre
saisi abstraitement comme seulement imparfait, mais comme ce qui contient
galement en soi, comme germe et comme tendance [Trieb], le contraire de soi-
mme, savoir ce qu'on nomme le parfait. La possibilit indique, tout au
moins par rflexion, quelque chose qui doit se raliser, et la dynamis d'Aristote
est aussi potentia, force et puissance 25.
Hegel oppose cette possibilit relle la possibilit formelle. Il voue ses
sarcasmes ceux pour qui ne serait possible que ce qui serait non-contradic-
toire au sens logique du terme.
Est-il besoin de dire que Marx adopte la mme position? Le possible est
pour lui un rel dont sort la ralit future qu'il contient en germe: ainsi la
force de travail ou tout autre force productive. Marx ne cache pas cette
filiation philosophique de la notion de possibilit relle, au sens d' tre en
puissance: il nOInme parfois Aristote, ou bien il se contente d'y faire
clairement allusion en employant le mot MV<Xllt. Le plus souvent, il s'en
dispense; on peut alors hsiter sur le sens donner possibilit.
Analysant la sparation, dans le mode de production capitaliste, entre
l'ouvrier et les conditions objectives de son travail, il oppose la simple
26 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
possibilit du travail [blosse Moglichkeit] et sa ralit effective [Wirklich-
keit] :
[Le] processus de ralisation du travail est tout autant son processus de
dralisation. Il [le travail] se pose objectivement, mais il pose son objectivit
comme son propre non-tre ou comme l'tre de son non-tre: du capital. Il
retourne en lui-mme en tant que simple possibilit de poser de la valeur, que
possibilit de valorisation: car toute la richesse effective, le monde de la valeur
effective, et, en mme temps, les conditions relles de sa propre effectuation
sont poss en face d'elle comme des existences autonomes. Ce sont les
possibilits reposant au sein mme du travail vivant qui, la suite du processus
de production, existent effectivement en dehors de lui - mais comme des
ralits effectives qui lui sont trangres, qui constituent la richesse par
opposition lui-mme26.
Il semble bien que la simple possibilit dont il est question ici, c'est la
possibilit relle au sens de Hegel, ou le possible au sens aristotlicien de
puissance. C'est la possibilit de travailler que possde l'ouvrier en dehors de
tout processus de travail effectif, par opposition au capital qui est devenu
autonome en face de lui. En effet, ds que la sparation entre l'ouvrier et les
conditions de travail est historiquement ralise, celles-ci ne dpendent plus de
lui. Elles lui sont devenues extrieures, trangres. Elles rsident dans le
capital qui lui fait face, c'est--dire dans des choses: marchandises, moyens
de production, valeurs, qui sont la discrtion de leur propritaire. Ces choses
ont t cres par l'ouvrier qui n'en a jamais la libre disposition. Alors, le
capital apparat, par opposition au travailleur, comme la ralit effective
[Wirklichkeit] au sens propre du terme: il est l'agent dont repart le mouve-
ment27. Pour l'ouvrier, le travail est devenu une simple possibilit. La
ralisation de cette possibilit est livre la contingence. Elle dpend de ceux
qui sont en possession du capital, c'est--dire des moyens de production et de
la richesse en gnral. Le travailleur peut aussi bien tre mis au travail que ne
pas l'tre.
Ne pourrait-on interprter cette simple possibilit comme le possible
contingent au sens d'Aristote? Cela serait discutable, car l'ouvrier garde la
possibilit de crer des valeurs. Il est la possibilit de valorisation. Bien
que rduit l'tat de simple possibilit de la valeur, le travailleur est
cependant la seule source de celle-ci, et donc la seule source du capital. Il est
la valeur en puissance. Simplement, les conditions relles de cette valorisa-
tion sont passes dans son autre: le capital.
Il s'agit en fait d'une dialectique entre le capital et le travail: chacun
d'eux passe dans son contraire. L'ouvrier aprs le travail (<< la suite du
processus de travail, dit Marx) n'est plus que simple possibilit et le capital
accapare la ralit effective, l'efficace, le pouvoir d'agir. Comme les conditions
objectives de ralisation du travail en puissance qu'est l'ouvrier sont de l'autre
ct, du ct du capital, celui-ci semble tre devenu, lui seul, la possibilit
relle du renouvellement du processus. Mais le travail de l'ouvrier reste
INTRODUCTION
27
indispensable. Chacun, capital et travail, passe donc de l'tat de possibilit
celui de ralit effective. Ils sont des moments certes diffrents, mais lis
dans un mme processus d'ensemble. Ainsi, la notion de possibilit renvoie
aux rapports entre acte et puissance tels qu'Aristote les dcrivait et que les
reprenait Hegel; ce dernier les comprend d'une manire dialectique o chaque
contraire devient son autre; Marx aussi.
Prenons un autre exemple. Examinant les contradictions entre surtravail
[Mehrarbeit] d'un ct, et richesse, oisivet, non-travail, de l'autre, Marx fait
remarquer, incidemment, que deux points de vue s'opposent:
Du point de vue de la ralit, le dveloppement des richesses n'existe que
dans ces contradictions; du point de vue de la possibilit, son dveloppement
est prcisment la possibilit d'abolir [auflteben] ces contr.adictions28. Il ne
s'agit plus de deux moments coexistants d'une dialectique qui oppose deux
aspects d'un mme processus et d'une mme ralit, mais de l'opposition entre
une ralit et une ralit future qui n'existe pas encore. L'intressant ici, c'est
que le point de vue de la possibilit est plus essentiel que celui de la ralit
prsente. L'tat de choses actuel, c'est l'opposition entre le travail et la
richesse, leurs contradictions. Le rgime social actuel repose sur l'existence de
ces contradictions: il spare la richesse et le travail. Mais le dveloppement de
la richesse (valeurs d'usage, biens) ouvre une possibilit , celle de dpasser
les contradictions actuelles entre pauvret et richesse, entre travail des uns et
oisivet des autres. Cette possibilit, Marx l'appelle parfois, selon la termino-
logie hglienne, une possibilit devenue ou pose [gesetzt]. Non seule-
ment, elle est lie une ralit contradictoire, mais aussi un dveloppement
dans le temps: c'est une possibilit historique .
De simples possibilits, la possibilit au sens de contingence (hasard
ou fortuit), la possibilit au sens d' tre en puissance , des possibilits
historiques , voil divers modes du possible. Peut-on ordonner ces modes,
distinguer diverses varits du possible chez Marx? C'est ce que nous allons
chercher maintenant.
3. Les modalits du possible
De fait, dans les uvres de Marx, il est question de toutes sortes de
possibilits, qualifies de multiples faons: elles sont relles , naturelles ,
historiques , gnrales , thoriques , formelles , abstraites . Il y a
des possibilits devenues , poses , abolies , de simples possibilits ,
etc.
Remarquons qu'en gnral, il ne s'agit pas du possible au sens logique du
terme, c'est--dire ce qui n'implique pas contradiction. Quand M. Gnter
Krber crit que le spectre des possibilits qui sont prsentes dans la ralit
objective s'tend de l'impossibilit la ralit en passant par la possibilit
28 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
formelle et abstraite et la possibilit relle (concrte) ,,29, il voque bien la
varit des possibilits que l'on trouve chez Marx.
Par contre, lorsqu'il ajoute: une chose est impossible aussi bien si elle
contredit les lois de la pense (si donc elle est logiquement contradictoire) que
si elle est en contradiction avec les lois de la nature et de l'histoire29 , cette
formulation pose problme dans un ouvrage qui se donne pour marxiste :
elle exclut qu'il puisse y avoir des contradictions dans la ralit! Or, Marx, en
vrai disciple de Hegel, soutient que la contradiction est relle et que toute
chose est contradictoire!
N'allons pourtant pas croire qu'il s'agit toujours chez Marx de la
possibilit relle au sens de puissance . Il considre aussi des possibilits
abstraites . Quel est le rapport de ces possibilits abstraites la possibilit
relle? A ce sujet, dans l'article de M. Kr6ber que nous venons de citer, nous
lisons ceci:
Marx dcrit dans les Thories sur la plus-value, sur l'exemple du
dveloppement des crises dans le capitalisme, un cas classique de transforma-
tion d'une possibilit abstraite en une possibilit relle et en une ralit 30.
Ici aussi il faut mettre en garde contre une quivoque. M. Kr6ber suggre
que, pour Marx, le possible abstrait se transformerait de lui-mme en possible
rel. Or Marx nie expressment que la possibilit abstraite d'une crise puisse
engendrer la crise relle, au sens o elle en serait la cause! Il insiste longuement
sur ce point, comme nous le verrons, et souligne, prcisment propos des
crises, qu'il convient de bien distinguer la possibilit abstraite de la possibilit
relle.
A titre de fil conducteur, nous proposerons de regrouper les diverses
occurences du concept de possibilit chez Marx sous trois chefs principaux: la
possibilit abstraite, la possibilit concrte, la possibilit relle. Justifions
brivement cette tripartition.
Les possibilits abstraites se rencontrent dans l'analyse scientifique. On
les trouve tout au long du Capital. Ce sont les possibilits thoriques ", que
Marx appelle aussi possibilits gnrales: sa terminologie n'est pas fige et
fixe. tant donn qu'il s'agit de possibilits qui sont penses, qu'elles se
fondent sur les catgories et les lois gnrales auxquelles parvient la connais-
sance scientifique, elles semblent n'tre que des possibilits purement logiques.
Toutefois, ce serait une erreur de les ramener celles-ci. Marx est fort
svre pour les abstractions pures qu'il pourchasse chez les idalistes, les
utopistes, ou les idologues. Il demande que les possibilits envisages dans la
thorie, en conomie comme dans les autres sciences, expriment des aspects de
la ralit, et qu'elles expliquent les faits.
Ces possibilits thoriques se distinguent parfois difficilement des possibi-
lits concrtes et historiques ou de la simple [blosse] possibilit. En voici un
exemple:
Si le capital [d'une entreprise] circule quatre fois par an, il est possible
que le sur-gain [Mehrgewinn] se rajoute son tour au capital lors de la seconde
INTRODUCTION
29
rotation et effectue une rotation avec lui [...] [d'o un intrt accru rapport
par ce capital]. Mais cette diffrence n'est pas du tout implique par
l'hypothse. Il n'en existe que la possibilit abstraite31.
Cette possibilit, comme les hypothses dont elle dpend, n'est ici que
thorique. Marx laisse pourtant entendre que, dans la ralit, c'est plutt ainsi
que les choses se passent. Cependant, la possibilit thorique n'est pas la
possibilit concrte. Elle a le caractre de la possibilit simple rencontre ci-
dessus: il est contingent qu'elle soit ralise; cela dpend des circonstances,
c'est--dire de conditions particulires donnes.
Les possibilits thoriques ont donc une sorte de statut intermdiaire
entre les pures possibilits logiques, et les possibilits concrtes ou relles. Cela
apparat clairement lorsque Marx discute le cas de la possibilit de la rente
foncire absolue, point sur lequel il marque son dsaccord complet avec
Ricardo:
Quant la thorie de la rente [...], le seul fait que j'aie dmontrer
thoriquement, c'est la possibilit de la rente absolue, sans que soit viole la loi
de la valeur. C'est l le point central autour duquel se livre la bataille thorique
depuis les physiocrates. Ric[ardo] nie cette possibilit; moi, je l'affirme.
J'affirme en mme temps que sa ngation repose sur un dogme faux
thoriquement et repris d'A. Smith - il s'agit de l'identit suppose entre les
prix de revient et les valeurs des marchandises32.
Que la possibilit thorique doive garder, en filigrane, le sens d'une
possibilit relle, cela ressort de ce que Marx ajoute: En ce qui concerne
l'existence de la rente absolue, ce serait une question rsoudre au moyen de
statistiques, dans chaque pays. Mais l'importance de la solution purement
thorique dans le seul domaine thorique apparat quand on voit les statisti-
ciens et les praticiens en gnral affirmer depuis 35 ans l'existence de la rente
foncire absolue, tandis que les thoriciens (de l'cole de Ricardo) cherchent,
par des abstractions trs forces et thoriquement faibles, en dmontrer'
l'impossibilit 33.
Cette dernire indication montre bien que, dans son esprit, la possibilit
de la rente foncire absolue n'est pas une abstraction pure et force comme
celles sur lesquelles spculent les conomistes vulgaires.
L'opposition entre possibilit abstraite et possibilit relle tait utilise
par Marx dans sa Thse de Doctorat en 1841. Le jeune philosophe observait
que la manire de concevoir le possible est une des diffrences majeures qui
oppose les philosophies de Dmocrite et d'picure, ce dernier se contentant de
la possibilit abstraite pour expliquer les phnomnes physiques:
Le hasard [pour picure] est une ralit qui n'a que la valeur de la
possibilit, mais la possibilit abstraite est justement l'antipode de la possibilit
relle. Cette dernire est enferme dans les limites rigoureuses de l'entende-
ment; la premire est illimite comme l'imagination. [...] L'objet doit seule-
ment tre possible, pensable34.
A l'vidence, cette opposition renvoie la distinction hglienne dj
30 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
mentionne. picure se servait de la possibilit abstraite comme forme
d'explication des phnomnes, d'o sa doctrine des hypothses multiples.
Remarquons ds maintenant que Marx n'adoptait pas ce point de vue. Cela
signifie-t-il que l'on pourrait comparer sa dmarche scientifique ultrieure,
celle de Dmocrite? En tout cas, comme Aristote et comme Hegel, il fait
largement place au hasard [Zufall] et la fortuit [Zuffiiligkeit]. Il faut
justifier le hasard, dit-iP5; c'est une forme de possibilit concrte; le hasard
existe objectivement.
On le voit, si, dans de nombreux textes de Marx, la possibilit relle a le
sens de la MvaJ.u d'Aristote, il est bien d'autres cas o le concept de
possibilit a un sens diffrent. Ainsi la possibilit historique , qui apparat
lorsqu'il y a une certaine contingence: concours de divers facteurs, combinai-
son de causes varies, rencontre de circonstances plus ou moins acciden-
telles. Avec ces notions, l'on a affaire l'tre contingent au sens d'Aristote36.
Une possibilit historique ne se ralise pas ncessairement. Certaines
possibilits ont exist qui ont, pour ainsi dire, avort et sont restes sans suite.
Marx admet cette forme de possibilit, par exemple, lorsqu'il fait remarquer
que la formation de capital ne part pas de la proprit foncire [...], ni de la
corporation (bien qu'il existe sur ce point une possibilit)37 . Il veut dire que
si cela a eu lieu, cette production de capital est reste trs secondaire par
rapport au processus principal de gense historique du capital qui a eu pour
cause le dveloppement du grand commerce et de l'argent.
De mme, la possibilit qu'un capital continue fonctionner comme tel
dpend de certaines conditions matrielles qui peuvent se rencontrer ou non:
La possibilit pour le capital de continuer son processus de valorisation
dpend ici d'une accumulation pralable du capital (considr sous l'angle de
sa subsistance matrielle)38.
Marx considre des causes possibles de perturbations, conomiques ou
naturelles, dans la circulation du capital39. Il considre des possibilits d'carts
entre prix et valeurs. A ce propos, il explique que le rapport d'change peut
exprimer ou la valeur mme de la marchandise, ou le plus ou le moins que son
alination, dans des circonstances donnes, rapporte accidentellement. Il est
donc possible qu'il y ait un cart, une diffrence quantitative entre le prix d'une
marchandise et sa grandeur de valeur 40.
Il va plus loin encore: La forme prix n'admet pas seulement la
possibilit d'une divergence quantitative entre le prix et la grandeur de valeur
[...], mais encore elle peut cacher une contradiction qualitative, de sorte que le
prix cesse tout fait d'exprimer de la valeur [...]. Des choses qui, par elles-
mmes [an und fr sich], ne sont point des marchandises, telles que par
exemple l'honneur, la conscience, etc., peuvent devenir vnales. Une chose
peut donc avoir un prix formellement sans avoir une valeur. Le prix devient ici
une expression imaginaire comme certaines grandeurs en mathmatiques41.
Lorsque Marx envisage des formes possibles de socits et de systmes
conomiques, en quel sens faut-il prendre possible? On sera embarrass
INTRODUCTION
31
pour rpondre. Est-ce une possibilit thorique ou une possibilit historique et
concrte? Le rapport entre mode de travail et proprit de la terre, lorsque
celle-ci est pur instrument de production, peut prendre plusieurs formes,
rpte Marx dans un texte appel par certains diteurs: Formes antrieures
la production capitaliste 42.
Cette forme [...] , dit-il, peut se raliser de manire trs diffrente43 .
La premire forme du rapport d'une communaut humaine la terre est celle
de la communaut purement naturelle (tribale). Puis Marx en considre
d'autres: celles de la Grce, de Rome, de la Germanie, qu'il compare. Ce qui
dcide de la forme ralise, ce sont des causes diverses. Ces possibilits sont
envisages sur un plan thorique, nanmoins ce sont aussi des possibilits
concrtes: elles sont attestes historiquement, et c'est des formes de socits
ayant exist que Marx ne cesse de se rfrer. Elles ont un-certain caractre
contingent: certaines circonstances particulires (gographiques, climatiques,
politiques, etc.) ont prsid leur apparition et leurs dveloppements.
Rsumons-nous: des formes de socit historiquement possibles, le
hasard de circonstances contingentes, des possibilits abstraites ou thoriques,
voil des varits de possibilits. Hormis les cas o possible signifie en
puissance (Mv<lj.u), le mot possible a une pluralit de sens que Marx met
abondamment en uvre. De ce rapide aperu, il ressort que l'ventail va des
possibilits abstraites la possibilit la plus concrte: la possibilit relle. Non
que Marx ignore la possibilit au sens purement logique; mais son emploi en
ce sens n'a gure de place dans sa pense concrte qui s'assigne comme tche
de dcouvrir et d'analyser les vritables causes du processus historique.
Schmatiquement, trois espces de possibilits se prsentent: la possibilit
abstraite, la possibilit concrte, la possibilit relle, sans qu'il y ait de limites
tranches entre elles. Elles dtermineront la progression de notre recherche.
Sous le nom de possibilits abstraites, nous envisagerons d'abord les
possibilits dont il est question dans la thorie, essentiellement la thorie
conomique, puisque ce fut l'objet majeur des travaux de Marx. Les formes de
possibilit qui s'y rencontrent sont lies la nature des lois et des causes dans
le mode de production capitaliste. Cela pose la question du dterminisme.
Nous envisagerons cette question en premier, parce qu'elle a donn matire
des interprtations divergentes, et aux critiques des adversaires de Marx. Elle
provoqua mme de vives polmiques entre marxistes. Nous consacrerons donc
notre premire partie l'examen de la question du dterminisme, et aux
notions de loi et de cause chez Marx.
Dans une deuxime partie, nous proposerons de comprendre les notions
de moyenne, de tendance, d'histoire et de force, comme des formes de la
possibilit concrte. Marx fait largement place ces concepts. Parler de loi
tendancielle, n'est-ce pas introduire le hasard? Mais en quel sens? Quelle
place tient exactement la probabilit dans la pense de Marx? Fut-il proba-
biliste et qu'en rsulte-t-il pour la conception matrialiste de l'histoire?
Enfin, comment concevait-il la notion de force? Quelle est l'origine de ce
32 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
concept central? Quel est son sens? Car - ne l'oublions pas - le moteur de
l'histoire ce sont des forces: les forces productives!
Comme les analyses prcdentes auront rvl que Marx pense dans les
catgories d'tre en puissance et d'tre en acte, nous montrerons dans
notre troisime partie que Marx doit beaucoup Aristote. Mais quoi
prcisment? Nous dcouvrirons qu'il a eu un intrt particulier pour ce
philosophe et penseur encyclopdique. Nous serons conduit poser une
question difficile, mais cruciale: celle des influences respectives de Hegel et
d'Aristote sur le jeune Marx. Or ces influences se prolongent chez le Marx de
la maturit. Nous avancerons l'hypothse selon laquelle, lorsque Marx critique
la pense spculative hglienne, il s'inspire de la critique qu'Aristote avait su
faire de la dialectique spculative de Platon.
Cependant, Marx reste avant tout un penseur de son temps. Il analyse
l'activit concrte: le travail et la production industrielle dans le monde
moderne. Quelle est la place de la rvolution technique dans le processus
historique? En quoi consiste cette rvolution technique? Elle a forcment des
rpercussions sur la structure des classes sociales. Elle conduit des crises,
des situations rvolutionnaires. Ce qui devient alors possible, selon Marx, c'est
une libration de l'exploitation conomique, l'ouverture sur une re de libert
au sens de libration des alinations sociales et politiques. Les notions
d'activit, de technique, de crise et de libert, et leurs articulations, feront
l'objet de la dernire partie de cet ouvrage. Nous verrons que pour Marx les
hommes font tout autant les circonstances que les circonstances font les
hommes . Dans cette formule tient tout le marxisme.
Dans sa conception de la libert comme libration relle, c'est--dire
troitement lie ses bases matrielles, les conditions (objectives) et l'action
humaine (subjective) sont des prsuppositions insparables. D'o le fait que le
possible par excellence, c'est une ouverture de l'histoire humaine sur un
monde de libert. Dans cette mesure, Marx apparatra tout autant comme un
penseur de la possibilit historique que de la ncessit historique.
Nous distinguerons donc trois formes essentielles de possibilit chez
Marx: la possibilit abstraite ou thorique, la possibilit concrte ou histori-
que, la possibilit relle ou libert (en un sens matrialiste, c'est--dire
pratique). Nous organiserons notre enqute en observant que la premire
concerne la critique de l'conomie politique, la seconde la conception de
l'histoire, la troisime, la philosophie de Marx, son humanisme, ce qu'il
appelait lui-mme un matrialisme pratique
".
INTRODUCTION
33
NOTES
1. Jean-Paul SARTRE le qualifia de seule philosophie vivante: Loin d'tre puis, le
marxisme est tout jeune encore, presque en enfance: c'est peine s'il a commenc se dvelopper.
II reste donc la philosophie de notre temps: il est indpassable parce que les circonstances qui l'ont
engendr ne sont pas encore dpasses. (Critique de la raison dialectique, Paris, Gallimard, 1960,
p.29).
2. Phnomnologie de l'esprit, Prface, t. l, p. 28; d. bil., pp. 74-77. - Hegel ajoutait: C'est
la faon la plus commune de se faire illusion, et de faire illusion aux autres que de prsupposer
dans la connaissance quelque chose comme bien connu et de s'en satisfaire. (Termes souligns
par Hegel.
-
Dans les citations, sauf mention contraire, nous ne soulignerons que les termes
souligns par les auteurs eux-mmes).
3. Die Ferne tascht: cette phrase figure dans la composition allemande de Marx pour
l'examen terminal de ses tudes au lyce de Trves, quivalent au Baccalaurat (cf. uvres (d.
Rubel), t. III, p. 1362; MEW EBl, p. 592).
4. Gaston BACHELARD, Laformation de l'esprit scientifique, Paris, Vrin, 1960, p. 13.
5. Cf., entre autres, Isaiah BERLIN, Historical Inevitability (L'invitabilit historique),
Londres, 1957.
6. Cesare LUPORINI, Problmes philosophiques et pistmologiques, in Marx et la pense
scientifique contemporaine, Paris/La Haye, Mouton, 1969, p. 176.
7. Marx suit d'ailleurs Hegel qui distinguait ces deux sortes de ncessit en disant de la
ncessit relative qu'elle se dtermine elle-mme en tant que contingence (Science de la logique,
trad. Janklvitch, t. 3, p. 209; trad. Labarrire et Jarczyk, t. 2, p. 261). Or Marx, en conomie
et en histoire, ne recourt qu' la ncessit relative qui n'est autre, toujours selon Hegel (ibid.), que
la possibilit relle.
8. II s'agit de quelques pages des Thories sur la plus-value (t. II, pp. 595-623; MEW 26.2,
pp. 499-524). Nous traitons de la possibilit des crises ci-dessous, chapitre 9.
9. Ainsi, M. Lucien Sve donne des rfrences qui, pour l'essentiel, se limitent cette
question des crises. II crit: Chez Marx, on peut suivre l'laboration d'une rflexion capitale sur
la possibilit et la ralit des crises conomiques dans le mode de production capitaliste (<<Sur la
catgorie de possibilit: Notes pour une recherche,La Pense, dco 1978,
n
202, p. 139). M. SEVE
estime cette analyse catgorielle d'une formidable nouveaut (ibid., p. 141). Cependant, ajoute-
t-iI, elle est en partie dj indique dans la Logique de Hegel, mais en partie seulement
(ibid.). II ne signale pas la prsence de l'ide de possibilit dans un concept aussi central que celui
de force de travail, qui est du travail possible ou en puissance .
10. Manuscrits de 1857-1858, t. II, p. 84, I. 27; Gr., p. 488, I. 13-14.
Il. Ibid., p. 85,1. Il; Gr., p. 488,1. 37.
12. Thories, t.lII, p. 576, I. 2 et 14; MEW26.3, p. 479, I. 15 et 25.
13. Manuscrits de 1857-1858, t. 2, p. 129, I. 7-10; Gr., p. 531, I. 16-20.
14. Thories, t. I, p. 475-476; MEW 26.1, p. 382, I. 10-13.
15. HEGEL, Science dda logique, Livre II, Section III, et Encyclopdie, ~~142-159.
16. Le capital, d. Lefebvre, p. 100, I. 3; MEW23, p. 102,1. 14-15. Le texte franais de J. Roy
(ES, t. 1, p. 98, I. 9) ne traduit pas l'expression der Moglichkeit nach qui signifie en puissance
(littralement: selon la possibilit).
-
Dans cette mme phrase, M. Lefebvre commet une
bvue: il parle de valeur d'usage en puissance au lieu de valeur d'change: les ditions
allemandes portent Tauschwert, non seulement la quatrime dition suivie par les Marx-Engels
Werke, mais aussi la premire dition (cf. MEGA 2,11/5, p. 54, I. 16-17). Cette phrase ne fut pas
modifie par Marx ou Engels dans les rditions de 1872, 1883 et 1895.
17. Le capital, d. Lefebvre, p. 111, I. 25; MEW23, p. 113, I. 15. Trad. modifie, M. Lefebvre
ayant traduit <<ilpeut tre une valeur variable . Il est vrai que l'dition J. Roy disait encore plus
simplement que
l'or est une valeur variable (ES, t. l, p. 108, I. I).
18. Pour un aperu historique, nous renvoyons l'excellent article PossibiIit de
M. Guido CALOGEROdans l'Enciclopedia Italiana, article remarquable de richesse et de concision.
Nous lui empruntons ici beaucoup. Ernst BLOCH, dans un commentaire magistral, semble avoir
utilis cet article, sans le dire (Le principe esprance, Paris, Gallimard, 1959, p. 270 et suiv.). Cf.
galement Bruce AUNE, Possibility, Encyclopedia of Philosophy, New York/London, Macmillan,
1972.
19. De l'interprtation, ch. 9, 19a 12-18 (Organon, d. Tricot, t. l, p. 101).
-
Bien que les
34 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Stociens soient considrs comme des tenants d'un ncessitarisme absolu, on notera que l'un des
plus grands, Chrysippe, semble avoir soutenu, comme Aristote, l'existence du possible l'aide
d'un exemple analogue: Toi [Chrysippe], tu dis: Des vnements qui n'auront pas lieu sont
possibles; par exemple, il est possible que cette pierre prcieuse soit brise, mme si eIle ne doit
jamais l'tre (CICRON, De Fato, VII, 13, Trad. E. Brhier, revue par P. Aubenque, in Les
Stociens, Paris, Gallimard, Bibliothque de la Plade, 1962, p. 478).
20. Cette osciIlation de l'entendement face au possible est trs manifeste, beaucoup plus tard,
chez Leibniz dans sa thorie des mondes possibles existant dans l'entendement divin, mais
qui n'ont jamais exist ni n'existeront jamais reIlemen1. De mme, on la retrouve chez Kant, dans
la thorie des postulats de la pense empirique. Kant admet des choses formeIlement ou
logiquement possibles, qui restent des possibilits d'entendement.
21. Dans une trs savante tude (Ncessit ou contingence: L'aporie de Diodore et les systmes
philosophiques, Paris, d. de Minuit, 1984,447 p.), M. Jules VUlLLEMINexamine cet argument de
faon magistrale. Il situe les coles philosophiques anciennes et modernes d'aprs leurs positions
sur les trois thses qui constituent le Dominateur . Ces coles vitent les consquences
ncessitaristes de cet argument en interprtant telle ou teIle de ses thses de manire ingnieuse,
parfois fort subtile. Pour ce faire, M. VuilJemin s'appuie sur la trs vaste lit~rature contemporaine
consacre aux modalits, du fait de la floraison des tudes logiques techniques des systmes
modaux. Nous ne pouvons y faire que cette brve aIlusion, car il n'y est pas question de Marx.
22. Cf. ARISTOTE,Mtaphysique, Livre 9, chap. 1 9 (d. Tricot, t. Il, pp. 481 et sui v.).
23. Ces gales possibilits, Aristote les nomme 'ta voEX6IlEva<>:les [choses] qui peuvent
tre ou ne pas tre. (Sur la traduction de cette notion par contingence , cf. ci-dessous, pp. 157-
158, n. 95, et p. 368, n. 160.)
24. La pense chrtienne bouleversa l'quilibre aristotlicien. Le dogme de la cration ex
nihilo obligea en effet faire de la puissance un attribut essentiel de Dieu. ElIe introduisit ainsi la
possibilit dans l'tre divin, ce qui ne
l'a
pas empche de se rclamer du Stagirite: on en dbattit
beaucoup au Moyen Age. Sur ces transformations et leur suite dans la mtaphysique moderne
chez Descartes, Spinoza, Leibniz et Kant, voir l'article de l'Enciclopedia Italiana mentionn (cf. ci-
dessus p. 23, note 18). De nombreux auteurs allemands ont trait de l'histoire des doctrines de la
possibilit (cf. A. Faust, Der Moglichkeitsgedanke: Systemgeschichtliche Untersuchungen [La
pense de la modalit: Recherches d'histoire des systmes], Heidelberg, 1931-1932, 2 vol.;
A. BECKER-FREYSENG, Die Vorgeschichte des philosophischen Terminus contingens: die Bedeu-
tungen von CONTINGEREbei Boethius und ihr Verhaltnis zu den Aristotelischen Moglichkeits-
begriffen [La prhistoire du terme philosophique contingent <>:les significations de CONTIN-
GERE<>chez Boce et son rapport aux concepts aristotliciens de la possibilit], Heidelberg,
Bilabel, 1938, 79 p.; W. Brocker, Das Modalitatsproblem [Le problme de la modalit],
Zeitschrift fr Philosophische Forschung, 1946,
n
l, pp. 35-46; G. SCHNEEBERGER,Kants
Konzeption der ModalbegrifJe [La thorie kantienne des concepts modaux], Ble, Verlag fr Recht
und Gesellschaft Ag., 1952, III p.); I. Pape, Tradition und transformation der Modalitat:
le, Bd,
Moglichkeit-Unmoglichkeit [Tradition et transformation de la modalit: le' vol.: Possibilit-
Impossibilit], Hambourg, Meiner, 266 p.).
25. La raison dans l'histoire, pp. 186-187.
-
Pour dynamis, nous avons respect
l'orthographe de la traduction de M. Papaioannou.
26. Manuscrits de 1857-1858, t. l, p. 393; Gr., p. 358.
27. Marx emploie Wirklichkeit, mot de la langue courante, qui est form sur le verbe wirken:
agir. Le mot ralit , en franais, laisse compltement chapper cette signification active. C'est
pourquoi nous traduisons, comme beaucoup de traducteurs rcents, par ralit effective,
expression gnralement prfre ralit<> qui ne contient pas l'ide d'activit. Avant Marx,
Hegel avait exploit ce sens actif de Wirklichkeit. Il y consacre un chapitre particulier de sa Science
de la logique: Livre II, Section III. Voir aussi Encyclopdie des sciences philosophiques en abrg,
99142-159.
28. Manuscrits de 1857-1858, t. l, p. 340; Gr., p. 305, note.
-
Aufbehen et Aufbebung posent
des problmes insurmontables aux traducteurs. Dans la dialectique hglienne, ces termes
dsignent un processus qui, la fois, abolit et conserve.
-
Gnralement, nous indiquerons ces
termes entre crochets dans nos citations pour souligner ce double sens.
29. Philosophisches Worterbuch, art. Moglichkeit, t. 2, p. 819, col. A. (Trad. par nous)
30. Ibid., col. B. (Traduit par nous)
31. Manuscrits de 1857-1858,1. 2, p. 135; Gr., p. 537.
32. L. Engels du 9 aot 1862, Correspondance, 1. VII, pp. 75-76; MEW 30, pp. 274-275.
33. Ibid.
INTRODUCTION
35
34. Diffrence, p. 231 ; MEW EB 1, p. 276; MEGA 2, Ill, p. 30. - Cette Thse fut prsente
devant la Facult de Philosophie de l'Universit de Ina, qui n'tait pas, comme celle de Berlin,
sous l'influence directe du gouvernement prussien. Elle tait plus librale et plus kantienne que
celle-ci. (Sur les conditions dans lesquelles Marx obtint le titre de Docteur en Philosophie, cf.
Johannes IRMscHER, Karl Marx studiert Altertumswissenschaft [Karl Marx tudie la science de
l'antiquit], Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl Marx-Universitiit, Leipzig, 3. Jahrgang, Gesell-
schafts - und Sprachwissenschaftliche Reihe, Heft 2/3, p. 214).
35. Introduction de 1857, Contribution, p. 173, I. 32; MEW 13, p. 640, I. 24-25.
36. Cf. Mtaphysique, Livre 6, chap. 3 (d. Tricot, t. l, pp. 341-343).
37. Manuscrits de 1857-1858, t. I, p. 443, I. 4-7; Gr., p. 404, I. 26-30.
38. Ibid., p. 324; p. 290.
39. La circulation du capital implique des possibilits de perturbation. (Thories, t. II, 634;
MEW 26.2, p. 533).
40. Le capital, t. l, p. 111: MEW 23, p. 117. - Mots souligns par nous.
41. Ibid., p. 112; p. 117. Trad. modifie.
42. Manuscrits de 1857-1858, t. I, p. 410 sq.; Gr., p. 375 sq.
43. Ibid., p. 412, I. 23-25; p. 376, I. 31-33.
PREMIRE PARTIE
,
LA POSSIBILITE ABSTRAITE
OU
LA CRITIQUE
DE L'CONOMIE POLITIQUE
Chapitre premier
LE DTERMINISME
Il faut arriver dissoudre cet
norme bloc du Dterminisme
mtaphysique qui pse sur la pen-
se scientifique.
Gaston BACHELARD
Un spectre hante le marxisme depuis son origine: le spectre du
dterminisme I. De fait, on a souvent compris le matrialisme historique tel
qu'il fut conu par Marx et Engels, comme une nouvelle sorte de dterminisme
historique, li un matrialisme quasiment mcaniste.
Mais, dans leur explication des vnements historiques, ramnent-ils les
causes des causes efficientes et matrielles au sens mcaniste du terme?
Mme s'en tenir l'conomie, nous verrons que, pour Marx, les causes sont
d'espces diverses et irrductibles, que la finalit n'en est pas exclue; loin de l.
L'histoire prend un sens: les hommes se librent de toute ncessit alinante,
en matrisant la nature et en supprimant toute forme d'exploitation.
Le matrialisme marxien est trs original: il n'a rien de commun avec le
dterminisme laplacien par exemple. En consquence, ne conviendrait-il pas
de parler de causalisme plutt que de dterminisme2? Il est vrai, Marx a rpt
que les conditions de vie conomiques dterminent les structures sociales, le
rgime politique et les formes de la conscience sociale (idologies).
Toutefois, Engels a bien insist sur le fait qu'il ne s'agissait que d'une
dtermination en dernire instance . Aurait-il mal compris et dform la
pense de son ami? Certains lui attribuent en effet une version forte du
dterminisme conomique.
Voil les questions que nous allons aborder dans ce chapitre. En
particulier, nous montrerons qu'Engels n'allait ni plus loin, ni moins loin que
Marx dans l'affirmation de la ncessit historique, que celle-ci n'implique pas
40 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
un dterminisme au sens ordinaire du terme, car c'est d'auto-dtermination
qu'il s'agit. En fin de compte, nous soutiendrons que les conceptions
marxiennes de la nature et de l'histoire ne se ramnent aucune des formes de
dterminismes qu'on rencontre avant ou aprs eux. Pourtant, innomlxables
sont ceux qui ont fait l'amalgame, et qui ont parl de dterminisme leur
sujet.
1. Le marxisme considr comme dterminisme
Le premier caractriser la conception de l'histoire de Marx comme un
dterminisme historique fut sans doute son gendre, Paul ~afargue 3. Peu de
temps aprs, Georges Sorel, alors ralli au marxisme, disait de Paul Lacombe
dont l'ouvrage venait de paratre4: Il traite des questions du dterminisme
historique d'une manire remarquable et il n'a connu Marx qu'aprs avoir
crit son livre. 5 Ainsi, parler du matrialisme historique comme d'un
dterminisme lui paraissait tout naturel.
Dans cette premire poque de diffusion du marxisme, il est arriv
Antonio Labriola, qui tait tout sauf dogmatique, de parler du dterminisme
historique, o [...] on commence par des motifs religieux, politiques, esthti-
ques, passionns, etc., mais o il faut ensuite dcouvrir les causes de ces motifs
dans les conditions de fait sous-jacentes 6.
L'emploi de ce vocable souleva les objections de Croce, et bientt de Sorel
lui-mme. S'ouvrait en effet, parmi les marxistes, ce que l'on peut appeler la
querelle du dterminisme qui ne resta pas confine des cercles intellectuels.
Des divergences clatrent au grand jour, au dbut du xxe sicle, dans le parti
social-dmocrate allemand. La controverse opposa les deux principaux dpo-
sitaires du legs thorique de Marx et d'Engels, Bernstein et Kautsky. Ce
dernier, au dire de Sorel, aurait proclam: Il faut d'abord poser le dtermi-
nisme7. Il n'importe gure que cette dclaration soit vraie ou fausse; ce qui
est significatif, c'est que Sorel ait formul l'enjeu du dbat sous la forme d'un
tel impratif. .
Nous ne pouvons retracer ici l'essor de l'interprtation scientiste du
marxisme sous l'gide de Plkhanov et de Kautsky qui eurent une audience
immense l'poque stalinienne, Staline l'ayant reprise en l'aggravant8. Pour
des raisons idologiques, la fois politiques (pratiques) et thoriques (scien-
tistes), on procda alors l'absolutisation de l'ide de ncessit, et le marxisme
fut compris comme un fatalisme historique. Depuis lors, l'pithte dtermi-
niste colla la peau du marxisme.
Le philosophe le plus clbre qui ait vu dans le marxisme un vritable
dterminisme fut Jean-Paul Sartre. S'en prenant l'autorit de Staline, alors
indiscute chez les marxistes franais, Sartre dnonait cette drive scientiste
des marxistes dans leurs tentatives [...]pour tudier les superstructures qui
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
41
sont pour eux les" reflets" du mode de production 9, et laissait tomber son
verdict comme un couperet: Nous sommes sur le terrain du dterminisme 10.
Se rfrant aux ouvrages de marxistes alors en vue, MM. Naville et
Garaudy, Sartre estimait que leurs tudes concrtes se limitent la plupart du
temps aux vieilles explications tainiennes par le dterminisme du milieu et du
moment II . Il concdait: Simplement le milieu est plus prcisment dfini
chez eux par le mode de vie matrielle 12, et il accusait Engels d'avoir amorc
cette dviation 13.
Comme beaucoup d'autres, Sartre fut victime du mirage dterministe
travers lequel on percevait la pense de Marx et d'Engels: il ne voyait dans leur
explication de l'idologie qu'une reprise du vieux matrialisme d'Helvtius et
de D'Holbach 14,analysant la pense des marxistes comme l'alliance btarde
de deux composantes, l'une mtaphysique: une foi matrialiste consistant
dans un ralisme naf, l'autre scientiste: une croyance positiviste l'image du
monde que donne la physique.
Mme si l'on accordait que sa critique de Naville et Garaudy ft
pertinente, il resterait que Sartre faisait un faux-procs, d'une part aux
sciences physiques, qu'il imaginait en tre restes au mcanisme classique 15,
d'autre part au matrialisme historique de Marx et d'Engels qu'il caricaturait.
Le faisait-il en toute bonne foi?
Un pre jsuite, M. Jean-Yves Calvez, la fin d'un ouvrage considrable,
portait un jugement semblable sur le matrialisme historique: il s'agit d'une
doctrine qui considre la socit comme un "piphnomne", ou d'un
matrialisme social (la socit" forme de la matire "), qui se combine avec un
dterminisme historique saisissable en des lois. Celles-ci semblent devoir tre
conues suivant le mode des lois de la nature. [...] Une telle doctrine [est une]
combinaison d'une conception matrialiste du rel et d'une conception la
fois matrialiste et dterministe de la socit 16.
Pourtant, M. Calvez avait judicieusement remarqu que, bien consid-
rer la porte de la critique de Marx l'encontre du matrialisme causaliste et
dterministe, on doit se garder de concevoir le "matrialisme historique"
comme un pur dterminisme conomique ou social1? . Mais, au moment de
conclure, il s'empresse d' oublier cette recommandation!
Plus laconique, un autre catholique, conomiste, M. Piettre, donnait,
quelques annes plus tard, une dfinition similaire du marxisme: Le matria-
lisme historique, c'est, comme son nom l'indique, la volont d'expliquer
l'histoire par des facteurs matriels, essentiellement par les facteurs conomi-
ques et techniques. C'est donc, dans son principe mme - un dterminisme
conomique 18.
Ainsi le mot dterminisme revient comme un leitmotiv. Karl Popper y
recourt volontiers, et sans nuances. Marx aurait confondu la prvision
scientifique telle qu'elle existe en physique ou en astronomie par exemple, et la
prdiction historique 19.
Comme Sartre ou M. Calvez, M. Popper estime que Marx fut conduit
42 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
la conviction errone qu'une mthode scientifique rigoureuse doit reposer sur
un dterminisme strict, conviction d'o proviendrait sa croyance aux lois
inexorables de la nature et de l'histoire2o)). L encore) on attribue Marx un
dterminisme de type laplacien, ce qui permet Karl Popper une critique
facile de la conception marxienne de l'histoire.
Ces adversaires du marxisme professent des philosophies bien diffrentes.
Cependant, ils s'accordent dans une interprtation dterministe de la pense
de Marx.
Certes, les marxistes leur ont ouvert la voie: trs souvent, la suite de
Kautsky et de Plkhanov, ils parlrent de dterminisme pour caractriser le
matrialisme historique, et cela le plus naturellement du monde.
M. Henri Lefebvre a longtemps soutenu que la pense de Marx et
d'Engels tait un dterminisme social , ce qu'il condensait dans une formule
lapidaire: le dterminisme social, c'est la nature dans l'homme; Le
dterminisme social permet en effet l'activit spcifiquement humaine, il la
conditionne - et cependant il la limite. Le dterminisme social permet la
libert de l'homme, et cependant il s'oppose elle21.
Le marxisme officiel d'Europe de l'Est soutint que la doctrine de Marx
tait un dterminisme, quoique d'une espce dialectique . Ainsi, pour
M. Gnter Kr6ber: Avec la formation du matrialisme historique et
dialectique, taient [...]donnes pour la premire fois toutes les prsupposi-
tions pour remplacer le dterminisme mcanique par une nouvelle conception
du dterminisme. [...] Cette conception du dterminisme fonde sur la
philosophie marxiste est le dterminisme dialectique22, qui se dfinit comme
la doctrine philosophique de l'interdpendance objective et du rapport de
conditionalit rciproque de tous les objets, processus, etc., sur la base de lois
objectives 23.
Cependant, le caractre dialectique de l'interdpendance et de l'action
rciproque invoques ici tend s'effacer devant des relations entre des
choses et des lois de caractre purement objectif, sur lequel on met
unilatralement l'accent. Marx, lui, n'omettait pas de souligner l'activit
subjective par laquelle les hommes matrisent la nature, font leur histoire et y
ralisent leurs buts.
Tous les marxistes n'ont cependant pas tenus Marx pour dterministe. En
prsentant sa pense comme une philosophie de la praxis , Gramsci rcusait
cette interprtation. De mme, Sydney Hook, qui fut longtemps marxiste,
considrait que les doctrines de Hegel, de Spencer, et des marxistes ortho-
doxes taient des formes de dterminisme social , auquel il opposait... la
conception de Marx, qui lui paraissait plutt tre un pragmatisme socia)24.
D'autre part, Sartre nuanait son jugement en ce qui concerne Marx25.
Henri Lefebvre en vint aussi, tardivement, protester contre l'assimilation du
marxisme un dterminisme. Rvisant ses opinions antrieures, il dnia
finalement toute base srieuse une telle interprtation: Bien qu'on ait voulu
souvent attribuer [une] attitude brutalement" dterministe" Marx et aux
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
43
marxistes, il n'existe pas dans l'uvre de Marx de textes qui justifient cette
interprtation 26.
Que d'avis divergents! Que d'avis changeants! Dans ces conditions,
parler de dterminisme, n'est-ce pas crer des quivoques? Surtout, une
question se pose: Marx avait-il pens que sa conception de l'histoire pourrait
tre considre comme dterministe? Il a bien soutenu qu'une ncessit"
s'exerce en histoire, que l'on peut comparer celle que l'on dcouvre dans les
processus naturels. Mais, reconnatre une ncessit, est-ce affirmer un dtermi-
nisme? S'il s'agit de processus dialectiques et rvolutionnaires, la ncessit
prend un sens tout diffrent: la ncessit du nouveau!
Contester l'interprtation dterministe du marxisme ne va cependant pas
de soi. Elle a une longue tradition pour elle: celle de l'conomisme. En quoi
consiste donc le dterminisme conomique qu'on trouve chez Marx?
2. L'quivoque du dterminisme conomique chez Marx
A la question de savoir si la conception marxienne de l'histoire est
dterministe, on pourrait rpondre ngativement, du fait que Marx et Engels
ne se sont jamais dclars tels27. Toutefois, ils pourraient avoir t dtermi-
nistes sans employer le mot: celui-ci n'tait pas encore en usage au temps o
ils laborrent leur conception 28.
Nanmoins, il ne convient pas de parler de dterminisme pour qualifier
leur doctrine. Nous soutenons qu'il y a l une quivoque, car la suite de
Hegel, ils conoivent le devenir historique comme un processus dialectique, ce
qui exclut tout point de vue unilatral, et donc aussi le rductionnisme
conomiste29.
Cette quivoque vient de ce que l'on suppose que le matrialisme
implique le dterminisme. En passant sur des positions matrialistes partir
de 1845, Marx et Engels auraient-ils t amens adopter aussi un point de
vue dterministe? C'est oublier qu'ils prsentent leur philosophie comme un
matrialisme nouveau", qu'ils prennent soin de distinguer des formes
antrieures de matrialisme. Ils se prononcrent clairement sur ce point.
Tout le monde sait qu'ils prirent expressment leur distance par rapport
Bchner, Vogt et Moleschott, qui eurent une certaine vogue de leurs temps,
mais aussi par rapport Diderot et D'Holbach, et mme par rapport
Feuerbach: c'est tout le sens de L'idologie allemande. Ils affichrent un franc
ddain pour les matrialistes allemands de leur temps. Engels, dans ses
principaux ouvrages: l'Anti-Dhring et la Dialectique de la nature, en plein
accord avec Marx30, dveloppe une critique en rgle du matrialisme mca-
niste et de toute forme d'explication qui s'en tient la causalit externe. Cela
est bien connu et devrait suffire tablir notre thse.
De fait, le matrialisme historique marxien ne se contente pas de recourir
la causalit efficiente externe. Mme le facteur conomique, nous le verrons,
44 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
ne s'impose pas d'une manire mcanique et extrieure . Marx et Engels
parlent constamment d'action rciproque, d'interdpendance, de dveloppe-
ment organique, d'auto-diffrenciation interne et d'auto-mouvement (proces-
sus). Dans ces conditions pourquoi donc beaucoup de leurs disciples, et
quasiment tous les critiques, virent dans le dterminisme un trait fondamental
du marxisme? C'est que l'on commet encore une autre erreur.
Ds la publication du premier livre du Capital et de ses traductions
franaise et russe, Marx et Engels eux-mmes durent se dfendre contre
l'assimilation de leur conception l'volutionnisme (par exemple, celui de
Spencer), ou au darwinisme social . Leur raction contre l'volutionnisme
naturaliste et mcaniste de Haeckel est typique. Les gnralisations philoso-
phiques de ce savant trs clbre et influent aprs 1870 s'tendaient tous les
domaines: biologiques, historiques et sociaux. Il prnait .un matrialisme
purement mcaniste:
Il y a dans la nature un vaste processus de dveloppement universel
ternel. Tous les phnomnes naturels sans exception, depuis le mouvement
des corps clestes et la chute de la pierre qui roule jusqu' la croissance des
plantes et la conscience de l'homme sont soumis la mme grande loi de
causalit; ils doivent, en fin de compte, tre rduits la ncessit atomique,
conception mcanique ou mcaniste, unitaire ou moniste, ou d'un seul mot
monisme31.
Qu'y a-t-il de commun entre ce mcanisme mtaphysique et le matria-
lisme nouveau , dialectique , qui voit toujours en mme temps le ct
subjectif , esquiss par Marx dans les Thses sur Feuerbach32? Engels,
comme Marx, a constamment refus le mcanisme. A Haeckel qui soutenait
que: Selon la conception matrialiste du monde, la matire ou substance
prcde le mouvement ou force vive, la matire a cr la force)" Engels
objectait: Il serait tout aussi faux de dire que la force a cr la matire,
puisque force et matire sont insparables , s'exclamant: O celui-l va-t-il
chercher son matrialisme 33?
A l'vidence, Marx et Engels n'ont jamais profess de telles conceptions:
chaque occasion, ils polmiqurent contre elles sans mnagement. C'est une
profonde mprise de leur attribuer des conceptions dterministes. A la rigueur,
on peut comprendre qu'une telle mprise ait t faite du vivant de Marx: ses
uvres taient peu connues. D'une manire gnrale, les conceptions volu-
tionnistes et historiques nouvelles se fondaient sur une tradition matrialiste
mcaniste, et sur un positivisme dterministe. On a mis Marx dans le lot, la
Prface du Capital pouvant prter quivoque34.
Plus surprenant est le fait que cette interprtation de Marx se soit
largement rpandue au xx. sicle et qu'elle ait ralli beaucoup d'esprits comme
nous l'avons montr ci-dessus.
C'est que les textes marxiens eux-mmes, par un certain nombre d'as-
pects, donnent lieu une telle interprtation continuellement renaissante. Si,
chaque pas, le marxisme a rencontr la question du dterminisme, si on la
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
45
voit ressurgir tout instant, on doit en chercher l'origine et les raisons dans les
termes mmes dans lesquels Marx a expos ses ides.
Effectivement, il dit souvent des vnements et processus historiques,
conomiques, sociaux, politiques ou idologiques, qu'ils sont dtermins
[bestimmten], soumis des lois ncessaires [notwendigen Gesetzen], produits
ou engendrs par des causes dterminantes [bestimmenden].
Nanmoins, il les dit aussi bien, et indiffremment, conditionns
[bedingten]. Il analyse leurs conditions [Bedingungen]: situations, tats des
forces politiques et sociales, forces conomiques. Parmi ces conditions, les
conditions matrielles sont essentielles: elles conditionnent [bedingen]
tout le reste, les rapports sociaux, les murs, les institutions, les ides.
Remarquons surtout que Marx se contente d'affirmer que les conditions
matrielles furent dterminantes jusqu' aujourd'hui, mais il ajoute qu'il
n'en sera pas toujours ainsi. Et cette dtermination est globale: les
conditions matrielles de la vie sociale dcidrent, parmi toutes sortes d'autres
causes, et en gros, de la division des socits en divers castes, ordres ou classes.
Ces mmes conditions matrielles d'existence de la socit rgissent donc, mais
plus ou moins indirectement, les diverses sphres de l'activit et de la pense
humaines 35. Ces conditions matrielles changent historiquement: elles sont
fonction d'un contexte socio-conomique donn. Leur ncessit est historique:
elles n'ont rien d'immuable.
Cette affirmation que la vie sociale, politique et idelle, est conditionne
par des ncessits d'ordre vital n'tait pas nouvelle. Des matrialistes l'avaient
soutenue, pensant surtout aux besoins vitaux individuels. Marx largit et
relativise ce qu'il faut entendre par besoins matriels : ce sont des besoins
socio-historiques qui varient d'une classe l'autre et selon les poques.
Marx dplace l'analyse sur le plan social. Il existe une liaison troite,
ncessaire, une interdpendance, entre des besoins sociaux dtermins et
des rapports sociaux dtermins36 (division du travail, rapports de pro-
prit, etc.). Un type de rapports sociaux dfinit un mode de production .
Pendant toute une priode, ces rapports sont dominants: ils dfinissent des
classes, mais prsentent nanmoins une grande variabilit historique et
individuelle.
Simultanment, Marx soutient que les pratiques et les principes juridiques
et politiques, ceux de la morale, de l'art et de l'ducation, les ides philosophi-
ques et religieuses, sont lis ces besoins et intrts matriels: ils les expriment,
travers toutes sortes de dformations et d'idalisations plus ou moins
trompeuses. Les ides et reprsentations collectives prennent la forme semi-
consciente de vritables systmes de justification d'intrts particuliers: ce sont
alors des idologies 37.
La ncessit conomique n'est donc rien d'autre que celle des besoins
et des intrts sociaux gnraux. Les premiers de tous et les plus imprieux
sont matriels , en particulier quand des masses d'hommes sont aux limites
de la survie. Il ne s'agit pas d'une ncessit extrieure: c'est au contraire la
46 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
pression interne de besoins vitaux. Cette ncessit n'est pas tant mcanique
que vitale: elle est de l'ordre de l'existence. Elle fait agir les classes exploites
et opprimes, comme les classes dominantes: celles-ci, pour se maintenir au
pouvoir, sont dans la ncessit de reproduire les rapports sociaux (rapports
d'exploitation, de proprit, etc.) sur lesquels elles reposent. D'o ces luttes de
classes qui jalonnent l'histoire, tantt latentes et sourdes, tantt clatant en
crises et rvolutions quand les groupes sociaux les plus menacs n'ont d'autre
ressource que de recourir la violence.
Ces ides, par leur force et leur grande gnralit, font figure de principes:
Marx les qualifie de prsupposs tirs de l'tude de l'histoire et de
l'conomie38. Marx et Engels dtenaient ainsi la cl d'une explication histori-
que globale: l'histoire n'est pas abandonne au hasard; elle n'est pas non plus
rgie par une ncessit prdtermine et inflexible. Dans son ensemble, en
gros dit Marx, l'histoire suit un certain cours, un dveloppement gnral,
dans lequel la conscience et la volont des individus n'ont qu'une part
relativement modeste, du moins jusqu'ici.
Le processus fondamental, finalement dcisif, est le dveloppement des
forces productives matrielles et sociales. Il s'effectue par tapes, travers
toutes sortes de dtours et de complications. Les grandes priodes historiques
se succdent selon un ordre que l'on peut comprendre, car elles se prparent
l'une l'autre, quoique non intentionnellement. Les forces productives impli-
quent certains rapports sociaux. Elles dcident des diverses catgories de
mtiers et donc des classes. En changeant, elles provoquent le changement
historique.
La forme de la socit en rsulte. Les forces productives ne peuvent
tre mises en uvre qu' l'intrieur de certains rapports de production qui leur
sont adquats: rapports entre des matres et des esclaves, ou des seigneurs et
des serfs, ou encore des capitalistes et des ouvriers. Forces et rapports sociaux
de production forment ce que Marx appelle la base conomique, les
rapports sociaux constituant .la structure proprement dite 39.
L'ide fondamentale de Marx et d'Engels n'est pas seulement qu'il y a un
cours ordonn de l'histoire. Cette ide, bien d'autres l'avaient soutenue. La
conception proprement marxienne consiste en ceci: un certain degr de
dveloppement des forces productives implique des rapports sociaux qui lui
correspondent. A ceux-ci, toutes les institutions (rapports de proprit, droit,
rapports politiques, formes de gouvernement, idologies) doivent s'adapter,
selon des interdpendances complexes. La base conomique de la socit a un
caractre matriel en un sens large: c'est aussi bien le territoire gographi-
que et ses ressources naturelles que tous les amnagements, instruments et
moyens labors par les hommes; elle prexiste, avec les superstructures
correspondantes, comme un donn, un matriau, que les nouvelles
gnrations trouvent dj l.
La thse qui a soulev le plus d'objections et de critiques est celle selon
laquelle les formes de conscience dpendent, plus ou moins directement, de
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
47
cette base matrielle. Le fait que notre pense serait conditionne par autre
chose qu'elle-mme n'est pas facilement admise depuis la Renaissance. Pour
Marx, comme pour Hegel d'ailleurs, la conscience et la volont n'ont pu jouer
qu'un rle second dans les grands changements historiques. La conscience est
partielle et tardive par dfinition, elle s'aveugle, freine le mouvement ou au
contraire le prcipite trop. La conscience rvolutionnaire elle-mme se fait des
illusions sur les possibilits et les impossibilits, sur le but poursuivi et sur ce
qui est rellement atteint et ralis.
Ces ides, Marx les expose de manire concise et frappante dans un texte
clbre. On nous permettra de le citer, bien qu'il figure dans toutes les
anthologies, car c'est sur la base de telles pages qu'on attribue Marx un
conomisme intgral:
Dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent en des
rapports dtermins [bestimmt], ncessaires [notwendig], indpendants de leur
volont, rapports de production qui correspondent un degr de dveloppe-
ment dtermin [bestimmt] de leurs forces productives matrielles. L'ensemble
de ces rapports de production constitue la structure conomique de la socit,
la base concrte [reale Basis] sur laquelle s'lve une superstructure juridique
et politique et laquelle correspondent des formes de conscience sociales
dtermines [bestimmt]. Le mode de production de la vie matrielle condi-
tionne [bedingt] le processus de vie social, politique et intellectuel en gnral.
Ce n'est pas la conscience des hommes qui dtermine [bestimmt] leur tre; c'est
inversement leur tre social qui dtermine leur conscience40.
Presque tous les commentateurs trouvent ici la formule d'un dtermi-
nisme: ils en tirent l'ide que, pour Marx, l'histoire serait rgie par quelques
lois gnrales du mme genre que celles de la physique: le principe d'inertie
ou la loi de la gravitation universelle. Il n'y aurait pas de diffrence essentielle
entre la ncessit conomique et celle des lois de la nature. Marx aurait
conu une sorte de mcanique de l'histoire en abolissant toute frontire
entre les sciences sociales et politiques et les sciences naturelles.
Mais, il y a l une interprtation qui force les choses. N'allons pas
accentuer la ncessit historique plus que Marx ne l'a fait. Dans la Prface que
nous venons de citer, Marx se borne des indications schmatiques, de
caractre surtout structurel. Il esquisse une sorte d'anatomie gnrale des
socits, laissant entendre qu'il y a une dynamique de l'histoire: pourtant il
n'en nonce aucune <<loi. C'est ailleurs qu'il s'exprime sur des lois d'volu-
tion concernant le processus historique. Quand il le fait, ce sont des lois
complexes, et qui ont des caractres contradictoires.
Il ne faut pas oublier que, pour Marx, si les hommes se trouvent engags
dans des rapports qu'ils n'ont pas voulus consciemment, ce sont tout de
mme eux qui produisent leur existence volontairement. Ils poursuivent un
but et le ralisent, mais en atteignent aussi un autre: par exemple, ils crent des
rapports sociaux auxquels ils n'avaient pas pens! Une gnration nouvelle les
trouve tablis: ils existent avant elle, et elle en prend conscience aprs coup. En
48 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
ce sens, ils sont indpendants de la volont . Marx ne veut pourtant pas dire
que les hommes ne peuvent agir pour les transformer, ni que des hommes,
dans un pass plus ou moins recul, n'ont pas contribu les produire. Au
contraire, il affirme que ce sont les hommes qui ont fait l'histoire. C'est
pourquoi ils peuvent agir rvolutionnairement sur les conditions sociales de
leur existence.
Marx soutient donc seulement que, jusqu'ici, les rapports sociaux se sont
imposs plus qu'ils n'ont t choisis41. D'autre part, il ne dit pas 'que les
hommes ne furent pour rien dans l'histoire passe. C'est en poursuivant
certaines fins - subvenir leurs besoins en dveloppant leurs moyens
d'existence et amliorer leurs conditions de vie matrielles - qu'ils ont
galement produit des structures sociales compltement imprvues et
inimaginables.
Encore ne doit-on dire cela qu'avec prudence; car l'inconscience n'est pas
gale chez tous; elle est relative; surtout, elle ne dure pas ternellement. Peu
peu, individus et classes prennent conscience de ces rapports, et se donnent
pour mission de les changer, ou de les perptuer, selon leurs intrts plus ou
moins bien compris.
Un texte aussi lapidaire que la Prface la Contribution ne montre pas
toute la pense de Marx. Il faut, pour cela, se reporter L'idologie allemande
o Marx et Engels, en 1845-1846, dveloppaient leurs ides.
On y lit que la faon dont les hommes produisent leurs moyens
d'existence dpend [abhiingt] d'abord de la nature des moyens d'existence dj
donns et qu'il leur faut reproduire42, que la faon dont les individus
extriorisent [assern] leur vie, c'est l leur tre. Ce qu'ils sont concide
[zusammenfiillt] donc avec leur production, aussi bien avec ce qu'ils produisent
qu'avec la faon dont ils le produisent. Ce que sont les individus dpend
[abhiingt] donc des conditions matrielles de leur production43.
Ainsi, la relation entre rapports sociaux et forces productives n'est pas
unilatrale. Il n'y a pas extriorit des termes, mais unit dialectique! Les
conditions et le conditionn doivent tre entendus comme interdpendants
dans une totalit en dveloppement. Sinon, la pense de Marx est corsete
dans une interprtation a priori rductrice. Entre les conditions matrielles
d'existence, les conditions de production et <d'tre mme de l'homme, il est
impossible de tracer des limites. Parler d' extriorisation" de la vie, comme le
fait Marx, c'est rcuser la simple dtermination de celle-ci par des facteurs qui
lui seraient extrieurs . L'extriorisation exclut l'extriorit!
Marx pense l'unit dialectique entre les conditions d'existence des
hommes et leur tre
", entre conditions objectives et conditions subjectives
qui s'impliquent rciproquement et s'interpntrent, comme dans le cas de
l'tre vivant et de ses conditions de vie. Il lie indissolublement ce qui est
produit et la manire de produire. Or, ce qui est produit ici, ce sont aussi bien
les rapports sociaux que les objets d'usage.
Toutefois, il faut le reconnatre: Marx parle parfois le langage du
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
49
dterminisme, ce qui trompe le lecteur courant. N'a-t-il pas flirt" avec le
mode d'expression de la physique mcaniste, ou des volutionnistes les plus
dterministes, lorsque, dans la Prface du Capital, il crit que les lois
naturelles de la production capitaliste [... sont des] tendances qui agissent et
s'imposent avec une ncessit de fer44,,?
Marx se laisse ici entraner par sa passion polmique. Cette Prface
prsente son grand ouvrage comme une bombe lance la tte de la
bourgeoisie
".
Il accentue avec un malin plaisir la ncessit" de la chute du
capitalisme pour signifier la bourgeoisie qu'elle ne saurait rgner indfini-
ment: certes, le dveloppement conomique lui-mme lui sera fatal, mais dire
quand, o et comment, c'est une autre affaire, dans laquelle Marx a refus de
s'engager45.
A prendre ces dclarations la lettre, sorties de leur -contexte, on verse
dans l'interprtation dterministe. On cite souvent en ce sens un passage
fameux de Misre de la philosophie, o, contre Proudhon, Marx use d'une
analogie qui a quelque chose de mcanique . Le conditionnement des
institutions socio-politiques et des rapports sociaux par les moyens de
production est dcrit dans un raccourci saisissant: Le moulin bras vous
donner!- la socit avec le suzerain; le moulin vapeur, la socit avec le
capitaliste industriel46.
On ne cite gnralement que cette formule lapidaire. Il faut la replacer
dans son contexte: Les rapports sociaux sont intimement lis aux forces
productives. En acqurant de nouvelles forces productives, les hommes
changent leur mode de production, et en changeant le mode de production, la
manire de gagner leur vie, ils changent tous leurs rapports sociaux. Le moulin
bras vous donnera la socit avec le suzerain; le moulin vapeur, la socit
avec le capitaliste industrieI47.
Le raccourci final n'a pas le sens unilatral qu'on veut lui donner comme
base d'une mcanique de l'histoire. Marx n'entend pas nier toutes les
mdiations. Il dit bien que l'action humaine est l'origine du changement:
les hommes changent leur mode de production . Dans quelle mesure ce
changement dpend-il d'eux, il est difficile de le dire, mais en tout cas il est en
partie voulu. L'acquisition de nouvelles forces productives est plutt donn ici
comme volontaire. Comme dans le cas prcdent (Prface de la Contribution),
ce sont les rapports sociaux qu'elles engendrent qui ne sont pas voulus
consciemment.
.
Ce qui reste obscur, c'est la faon dont se fait l'acquisition de nouvelles
forces productives . Cette acquisition implique action consciente et volont,
au moins d'un certain nombre d'individus, sinon de classes entires de la
socit.
Certains raccourcis marxiens ont pris valeur d'aphorismes. Celui du
moulin bras et du moulin vapeur induit l'ide d'une dpendance directe,
unilatrale, mcanique, alors que Marx veut seulement souligner ce que la
plupart des sociologues ou historiens niaient: que les classes sociales sont
50 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
historiquement et matriellement conditionnes, plus qu'elles ne le sont
spirituellement. De tels raccourcis oblitrent la complexit des rapports. Ils
masquent le fait qu'on a affaire des totalits (des socits) o tout est
interdpendant et o l'action humaine joue son rle, ce que Marx montre si
bien dans ses ouvrages historiques.
Son ide fondamentale est que l'activit et la vie sont troitement lies aux
conditions objectives dans lesquelles elles se dploient: elles dpendent
dialectiquement de ces conditions qui sont leur base au sens de moyen. Il faut
faire intervenir ici l'ide d'une dialectique des moyens et des fins. Les moyens
imposent leurs propres conditions aux fins qu'ils permettent, mais qui ne s'y
rduisent pas: la vie et l'activit poursuivent leurs propres fins travers les
moyens qu'elles utilisent.
D'ailleurs, il arrive que l'ide de dterminisme soit suggre par une
traduction qui emploie malencontreusement le verbe dterminer , l o
l'allemand n'y songe pas. Dans le texte franais traditionnel du Manifeste du
parti communiste, on peut lire, dans un passage o Marx et Engels apostro-
phent ceux qui dfendent les ides courantes des classes dominantes de leur
temps:
Vos ides rsultent elles-mmes [selbst sind Erzeugnisse] des rapports
bourgeois de proprit et de production, comme votre droit n'est que la
volont de votre classe rige en loi, volont dont le contenu est dtermin
[dessen InhaIt gegeben ist] par les conditions matrielles d'existence de votre
classe 48.
Le mot dtermin suggre un rapport unilatral et une passivit de la
volont, ce que n'implique pas l'allemand gegeben qui signifie seulement
donn . Il en tait de mme dans l'exemple prcdent: ce sont les hommes
qui changent leur manire de produire en changeant leurs instruments de
production; le contenu (ou l'objet) de ce changement est donn (ou fourni)
par la situation et les possibilits objectives. Mais il ne s'impose pas de faon
automatique. Il y faut la dcision et la lutte pour le changement, l'activit et
l'intervention pratique des hommes.
Ajoutons que matriel , adjectif trs frquent chez Marx, a le sens de
contenu en gnral. Il s'oppose formel qui renvoie forme sociale
(c'est--dire aux rapports sociaux), et non spirituel. Matriel renforce
l'import du mot dterminer, et achve de donner, surtout en franais,
l'impression que Marx pense un dterminisme externe, alors qu'il l'entend au
sens de conditionner, et d'une manire dialectique: les conditions dtermi-
nantes sont des prsuppositions (Voraussetzungen). Une lecture fine , une
lecture dialectique , vite les quivoques et les interprtations unilatrales.
Or, une telle lecture est souvent conteste et carte, bien que seule, elle
accorde tous les textes et les diverses parties de la doctrine marxienne. Elle
permet de comprendre que, pour Marx, les hommes puissent reprendre en
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
51
main ce qui leur a chapp, puisque, en fait, ce qui les dtermine a t cr
par eux: il s'y alinent!
.
Arrtons-nous encore un instant sur la terminologie. Dtermin" a
plusieurs sens et traduit divers termes allemands. Quand il est question chez
Marx et Engels d'individus dtermins ", de conditions dtermines
", de
contenu dtermin", ce qualificatif signifie donn", spcifi", caract-
ris de telle ou telle manire,,; voici un passage de L'idologie allemande o il
a ce sens large:
Voici donc les faits: des individus dtermins qui ont une activit
productive selon un mode dtermin entrent en des rapports sociaux et
politiques dtermins. [...] La strucutre sociale et l'tat rsultent constam-
ment du processus vital d'individus dtermins49."
Par cette rptition insistante du mot dtermin ", Marx veut simple-
ment dire qu'il faut considrer des hommes et des situations concrtes: ce n'est
pas 1'homme en gnral" qui agit, mais des individus singuliers ayant des
statuts sociaux singuliers, placs dans des conditions et ayant des moyens
galement particuliers.
Si Marx affirme que l'influence de l'activit productive matrielle, et des
rapports sociaux qu'elle implique, est prpondrante par rapport aux autres
modes d'activit et aux autres relations humaines, son ide fondamentale est
que les deux cts, l'action et ses conditions, sont toujours prsents. L'action
humaine permet de dpasser le dterminisme au sens strict du terme; les
hommes qui ont t les agents en partie inconscients de leur histoire, peuvent
en devenir les agents conscients: jusqu'ici ils ont plutt subi les conditions
objectives, les rapports sociaux qui se sont imposs eux, qu'ils ne les ont
domines. Mais cette ncessit n'est pas ternelle.
Si l'on rapproche tous les textes de Marx, force est d'avouer que s'y
exprime toujours la mme conception: sans droger son point de vue
matrialiste, il soutient que si une ncessit a rgn en histoire, cette ncessit
est trs particulire. Il s'agit d'une alination ", d'une ncessit qui mane des
hommes eux-mmes: des puissances sociales s'imposent eux malgr eux bien
qu'ils en soient les auteurs et les agents. Il s'agit toujours d'une dialectique de
l'action et de ses conditions. Mettre l'accent sur celles-ci au dtriment de celle-
l ne peut conduire qu' la mprise d'un dterminisme mcaniste indpassable
et d'un matrialisme mtaphysique. L gt le quiproquo. Cette ncessit
contient la possibilit de son propre dpassement dialectique, parce qu'il est
impossible de dissocier les conditions matrielles ( la fois naturelles et
sociales) de l'activit humaine et cette activit elle-mme, pas plus qu'on ne
peut dissocier la matire et la force. Telles sont les ides de Marx. En fait de
dterminisme historique, il ne dit pas davantage.
Le matrialisme historique, que Marx et Engels dveloppent partir de
1845, se prsente dans des termes sensiblement diffrents selon les textes et les
52 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
circonstances. Ces variations proviennent de la diversit des doctrines vises:
Marx s'exprime plus ou moins brutalement en durcissant ses propos et ses
formules s'il vise les jeunes idologues allemands ou les socialistes rvolution-
naires franais, Proudhon et Lassalle ou les conomistes anglais, Dhring et
Haeckel ou Feuerbach et Hegel.
En tout cas, une chose est claire; les deux mots d'ordre les plus clbres
de Marx: Les philosophes n'ont fait qu'interprter diversement le monde, ce
qui importe, c'est de le changer 50
", et Proltaires de tous les pays, unissez-
vous 51, dmentent catgoriquement qu'il ait pu professer un dterminisme au
sens strict du terme. Il n'entendait pas nier la part active que les hommes ont
dans la production sociale de leur existence, ni rduire leur capacit d'interve-
nir efficacement dans leur histoire. Il insiste au contraire sur cette possibi-
lit qui s'ouvre devant eux.
3. La dtermination en dernire instance selon Engels
Non seulement les affirmations de principe que l'on trouvait dans les
ouvrages publis par Marx et Engels semblaient dterministes 52,>, mais dans
les annes soixante-dix, la question d'un dterminisme historique s'est
pose directement eux sous la forme du darwinisme social. Or; ils s'oppos-
rent cette doctrine. Rappelons qu'elle consistait transposer [les] lois des
socits animales purement et simplement dans celles des hommes 53, comme
si les phnomnes sociaux (la production et la lutte des classes) suivaient les
mme lois que le mtabolisme physiologique ou l'volution biologique des
espces 54.
Et, plusieurs annes aprs la mort de son ami, le vieil Engels dut rpondre
aux questions que des disciples plus ou moins avertis lui posrent sur
l' conomisme de Marx. Press par plusieurs correspondants, il fit les mises
au point ncessaires 55.Ils lui demandaient si Marx pensait rellement pouvoir
rendre compte de tous les phnomnes de la vie sociale: murs, langues,
croyances, religion, littrature, art, etc., par le seul facteur conomique .
Celui-ci suffisait-il mme expliquer les vnements proprement politiques?
Engels rpondit nettement en protestant qu'ils n'avaient jamais t
partisans d'un rductionnisme conomiste; il s'leva contre la tendance de
certains disciples ramener la conception matrialiste de l'histoire, qui portait
maintenant le nom de Marx, un matrialisme vulgaire et une nouvelle
forme de dterminisme (le dterminisme conomique), rpudiant les sch-
matisations htives et dogmatiques.
A ses correspondants qui pensaient sans doute son rcent Ludwig
Feuerbach, paru en 1886 et 1888, il rappelait d'abord la thse gnrale qu'il
soutenait avec Marx depuis L'idologie allemande 56: le facteur conomique est
le plus dterminant. Toutefois, s'empressait-il d'ajouter, il s'agit seulement
d'une dtermination en dernire instance .
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
53
Il crit Joseph Bloch: D'aprs la conception matrialiste de l'histoire,
le facteur qui est dterminant dans l'histoire est, en dernire instance [das in
letzter Instanz bestimmende Moment] la production et la reproduction de la vie
relle 57, ajoutant: Ni Marx, ni moi n'avons jamais affirm davantage. Si,
ensuite, quelqu'un torture cette proposition pour lui faire dire que le facteur
[Moment] conomique est le seul dterminant [einzig bestimmende], il la
transforme en une phrase vide, abstraite, absurde. La situation conomique
est la base, mais les divers lments [Momente] de la superstructure - les
formes politiques de la lutte de classe et ses rsultats, - les Constitutions
tablies [...], les formes juridiques, et mme les reflets de toutes ces luttes
relles dans le cerveau des participants [...] exercent galement leur action sur
le cours des luttes historiques et, dans beaucoup de cas, en dterminent de
faon prpondrante la forme 58.
Cette rponse carte l'conomisme stricto sensu. Le processus historique
implique une causalit rciproque de multiples facteurs: Il y a, explique
Engels, action et raction de tous ces facteurs [Momente] au sein desquels le
mouvement conomique finit par se frayer son chemin comme une ncessit
travers la foule infinie de hasards 59.
L'intention est claire. Ce qu'Engels fait remarquer Joseph Bloch, sans
prononcer le mot, c'est le caractre dialectique de leur conception: le mode
d'action du facteur conomique doit tre replac au sein d'une totalit o
il y a toujours interdpendance de multiples facteurs jouant tous leur rle et
s'influenant mutuellement. Engels exclut expressment que le facteur cono-
mique serait seul actif. Par l, il semble attnuer le tranchant des affirmations
les plus catgoriques de Marx.
Pourtant, Marx aussi avait mis en avant l'ide de totalit60, mme si elle
n'apparat gure dans les textes que nous avons discuts jusqu'ici. Il semble
qu'Engels ait t amen y insister plus que lui 61.Impossible, dit-il, de trouver
l'origine de chaque vnement ou de chaque production idologique une
situation conomique qui suffirait les expliquer. On tomberait dans un
matrialisme mcaniste.
S'adressant en 1894 un tudiant, Walther Borgius, il dplore que l'on ait
compris la dpendance entre base et superstructures comme si celles-ci
n'taient que 1'effet automatique de celle-l 62.
Cette lettre est, tout entire, une protestation encore plus nette que les
prcdentes contre une interprtation rductrice et unilatrale des ides de
Marx:
Le dveloppement politique, juridique, philosophique, religieux, litt-
raire, artistique, etc., repose sur le dveloppement conomique. Mais ils
ragissent tous galement [auch] les uns sur les autres, ainsi que sur la base
conomique. Il n'en est pas ainsi parce que la situation conomique est la
cause, qu'elle est la seule active et que tout le reste n'est qu'action passive. Il
y a, au contraire, action rciproque, sur la bas~ de la ncessit conomique
qui l'emporte toujours en dernire instance. L'Etat, par exemple, agit par le
54 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
protectionnisme, le libre-change, par une bonne ou une mauvaise fiscalit
[..,] 63.
Le facteur conomique n'est pas seul dterminant; il ne l'emporte qu'en
fin de compte . Pour faire comprendre cela Joseph Bloch, Engels, dans sa
lettre, recourt l'image d' une ncessit qui se fraye son chemin travers une
infinit de hasards
".
Engels nous claire-t-il par l? Bien sr, tout le monde comprend que les
eaux de pluie finissent par arriver la mer, quels que soient les hasards"
qu'elles rencontrent sur leur chemin. Mais, comment une ncessit peut-elle
merger si les hasards sont en nombre infini? C'est ce que l'on ne peut
comprendre l'aide de cette simple comparaison. Si les multiples causes sous-
entendues ici taient totalement disparates en nature, nombre et grandeur,
jamais une ncessit quelconque n'en rsulterait. Engels s'explique mieux
quand il dcrit l'apparition de la ncessit historique" partir d'une
multiplicit de causes individuelles:
L'histoire ", dit-il, se fait de telle faon que le rsultat final se dgage
toujours des conflits d'un grand nombre de volonts individuelles, dont
chacune son tour est faite telle qu'elle est par une foule de conditions
particulires d'existence; il y a donc l d'innombrables forces qui se contrecar-
rent mutuellement, un groupe infini de paralllogrammes de forces, d'o
ressort une rsultante -l'vnement historique - qui peut tre regarde elle-
mme, son tour, comme le produit d'une force agissant comme un tout, de
faon inconsciente et aveugle 64,,?
Comparaison n'est pas raison. L'mergence d'une ncessit au sein d'un
grand nombre d'vnements singuliers implique des prsupposs. En bonne
logique, d'vnements se produisant au hasard" ne rsulte une ncessit que
si des facteurs constants figurent dans les vnements alatoires lmentaires.
En l'occurrence, ce qui est suppos relativement constant, ce sont les
besoins lmentaires des nombreux individus d'une socit, d'o des changes
rguliers et rpts des milliers de fois dans des conditions similaires. La
causalit conomique, reporte l'chelle de l'individu, est suppose dtermi-
nante en dernire instance ce niveau individuel.
L'ide sur laquelle repose cet expos d'Engels, c'est que, malgr l'infinie
varit des motivations et causes individuelles, dans l'ensemble, les mobiles les
plus frquents l'emportent. Les autres motifs et mobiles se contrecarrant
mutuellement
", l'intrt conomique merge comme un rsultat qui ne se
manifeste qu'au niveau global et dans le long terme.
Ainsi, Engels parat assouplir les affirmations marxiennes les plus
premptoires qui, prises d'une manire laconique, posent un dterminisme
beaucoup plus troit. En fait, nous le verrons, Marx invoquait, tout autant
qu'Engels plus tard, des causes multiples et contingentes. Comme lui, il
s'appuyait, lui aussi, sur le fait qu'une ncessit ressort au niveau global quand
on a affaire un grand nombre d'vnements individuels65.
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
55
Il reste que si, au niveau lmentaire, les causes non conomiques taient
aussi nombreuses et de mme poids que les causes conomiques, que pourrait-
il en rsulter d'autre qu'une histoire vnementielle, une succession dsordon-
ne? D'autre part, si l'on admet des causes biologiques, ou psychologiques,
voire spirituelles, plus nombreuses ou plus fortes que les causes conomiques,
ce sont elles qui l'emporteraient en dernire instance". N'est-ce pas ce
qu'impliqent plus ou moins les autres thories de l'histoire, de Hegel
Nietzsche ou Toynbee?
Pour l'emporter au niveau global, il faut bien que les causes conomiques,
au moins la longue", soient, au niveau individuel lui-mme, plus fortes que
les autres. Pour Marx et Engels, c'est l un fait incontestable, vrifiable
empiriquement ou historiquement: les besoins matriels sont finalement les
plus forts; ce sont ceux qui meuvent les classes les plus nombreuses. Pour eux,
cela n'a mme pas besoin d'tre tabli 66.
Parlant des socits de classes, Engels explique Borgius:
Les hommes font leur histoire eux-mmes, mais jusqu'ici ils ne se
conforment pas une volont collective, selon un plan d'ensemble [...]. Leurs
efforts se contrecarrent, et c'est prcisment la raison pour laquelle rgne,
dans toutes les socits de ce genre, la ncessit dont l'accomplissement et la
forme d'apparition est le hasard. La ncessit qui s'y impose par le hasard est
son tour, en fin de compte [schliesslich], la ncessit conomique67.
Ainsi, le facteur conomique ne rside pas au-del de l'infinie multi-
tude des volonts individuelles. La causalit conomique n'est pas ext-
rieure" aux individus ou la socit, comme les dtracteurs du marxisme
l'entendent quand ils disent que l'individu est soumis une ncessit tran-
gre", qui serait entirement objective . Ce qui commande la volont, ce
sont les divers motifs et mobiles des individus sociaux, dont les motifs et
mobiles matriels, qui au total sont plus puissants que les autres.
Engels crivait dans son Ludwig Feuerbach:
Dans la nature, et, jusqu' prsent, en majeure partie galement dans
l'histoire humaine, elles [les lois] ne se fraient leur chemin que d'une faon
inconsciente, sous la forme de la ncessit extrieure, au sein d'une srie
infinie de hasards apparents 68.
La ncessit n'est extrieure qu'en apparence, dans sa forme". En fait,
c'est une ncessit interne, immanente.
Outre le facteur conomique, Engels voque divers autres facteurs,
gographiques, raciaux, politiques, qui peuvent l'emporter pendant un certain
temps. Quelle est leur importance relative? Il est justement impossible de le
dire d'une manire gnrale. On ne peut que procder l'tude particulire des
situations concrtes. Selon les poques et les peuples, selon les conditions
naturelles aussi, les contraintes conomiques ont un trs grand poids ou au
56 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
contraire ne sont qu'un facteur parmi une foule d'autres qui peuvent dominer
plus ou moins longtemps.
Ainsi, il y a toutes sortes de possibilits. Mais, ce niveau de notre analyse
de la conception marxienne, telle qu'elle apparat avec les claircissements
d'Engels sur la dtermination en dernire instance , ce ne sont que des
possibilits abstraites; la ncessit conomique, qui prvaut toujours eh fin de
compte au sein de la causalit rciproque de nombreux facteurs, semble tre
une ncessit qui s'impose de l'extrieur aux individus parce que, dans les
socits de classes, elle agit sous forme de contrainte .
4. Un paradoxe: Marx plus dterministe qu'Engels
Aprs cet examen des explications d'Engels, une question se pose: Engels
tait-il fidle Marx? Certains ont en effet prtendu qu'en vulgarisant la
pense de son ami, il l'avait dforme. Sur la question laquelle nous nous
intressons ici, peut-on mettre en vidence une telle divergence?
En fait, dans les passages o Marx rsume ses ides, il soutient fermement
des positions qui, paradoxalement, peuvent le faire passer pour plus dtermi-
niste que ne le sera le vieil Engels. Considrons les arguments qui plaident en
faveur de cette hypothse, avant que nous ne la rfutions.
Engels tait convaincu, pour l'essentiel, de l'identit de vues complte
entre lui et son ami. Il parle en leur nom tous deux, disant: notre
conception , ou bien, ni Marx, ni moi, n'avons jamais affirm davantage .
Pourtant, si l'on rapproche les lettres d'Engels des annes 1890-1895 et les
textes de Marx que nous avons cits ci-dessus69, il semble qu'une certaine
diffrence se dgage: Engels aurait attnu l'accent mis par Marx sur le facteur
conomique. Jusqu'ici, nous n'avons gure vu Marx parler d'une action en
retour des superstructures ou de l'idologie sur la base conomique.
Serait-ce sous la pression de la critique, et du fait des questions de ses
interlocuteurs, qu'Engels aurait accord aux facteurs non conomiques un rle
plus grand que celui que Marx aurait t prt admettre? N'a-t-il pas t
amen, tardivement, leur reconnatre un rle actif qui avait plutt t
minimis par Marx?
Marx tait plus radical. Dans les textes cits de L'idologie allemande, de
Misre de la philosophie, du Manifeste, et des Prfaces la Contribution et au
Capital, toute autonomie relative des facteurs non conomiques semble abolie,
ce qu'Engels accorde au contraire ses correspondants
Certes, dans la Prface de la Contribution de 1859, Marx mentionne la
conscience comme un des facteurs qui participe toute rvolution sociale:
Lorsqu'on considre [ces] bouleversements, il faut toujours distinguer
entre le bouleversement matriel [...] des conditions de production conomi-
ques et les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques ou philoso-
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
57
phiques, bref, les formes idologiques sous lesquelles les hommes prennent
conscience de ce conflit et Lemnent jusqu'au bout 70.
"
Mais, il ajoute aussitt:
Pas plus qu'on ne juge un individu sur l'ide qu'il se fait de lui-mme,
on ne saurait juger une telle poque de bouleversement sur sa conscience de
soi; il faut, au contraire, expliquer cette conscience par les contradictions de
la vie matrielle, par le conflit qui existe entre les forces productives sociales
et les rapports de production 71."
N'tait-ce pas minimiser le rle de la prise de conscience et de la volont
dans l'action et dans les luttes, et rduire presque rien le rle du facteur
politique dans le processus de l'histoire? Cela s'accorderait mal avec
l'nergie dploye par Marx pour organiser le proltariat et le faire intervenir
consciemment dans les situations de crises rvolutionnaires.
Si, d'aprs les textes invoqus ici, les individus participent bien au
processus historique, cela ne semble pas, selon Marx, pouvoir modifier
fondamentalement le cours du monde. Les hommes ne feraient qu'accomplir
une mission qui s'impose eux comme une ncessit extrieure: ils sont
contraints de suivre les lois conomiques d'volution de la socit o ils vivent,
mme s'ils parviennent les connatre.
Marx parat rester fidle aux vues hgliennes sur la Raison dans
l'histoire, Raison qui, par une sorte de ruse, utilise les fins humaines pour
accomplir ses propres buts. Une telle Raison, chez Hegel, restait assez
mystrieuse dans ses procds et ses fins, quoique le philosophe spculatif
ait affirm tre en mesure de la saisir et de la comprendre conceptuellement.
Lui aussi, sa faon, Marx enlve toute responsabilit aux individus dans le
processus historique et considre la marche de la socit comme soumise un
destin:
Lors mme qu'une socit est arrive dcouvrir la piste de la loi
naturelle qui prside son mouvement, [...J elle ne peut ni dpasser d'un saut
ni abolir par des dcrets les phases de son dveloppement naturel. [...J Mon
point de vue, d'aprs lequel le dveloppement de la formation conomique de
la socit est assimilable la marche de la nature et son histoire, peut moins
que tout autre rendre l'individu responsable de rapports dont il reste
socialement la crature, quoi qu'il puisse faire pour s'en dgager 72.
Cinq ans plus tard, il ne baisse pas la garde. Au contraire, il rcidive!
Dans la Postface la deuxime dition allemande du Capital, il approuve le
compte-rendu de son ouvrage par un critique russe, 1. I. Kaufman 73, qui
crivait:
Marx ne s'inquite que d'une chose: dmontrer par une recherche
rigoureusement scientifique, la ncessit d'ordres dtermins de rapports
58
MARX PENSEUR DU POSSIBLE
sociaux [...]. Pour cela, il suffit qu'il dmontre, en mme temps que la
ncessit de l'organisation actuelle, la ncessit d'une autre organisation dans
laquelle la premire doit invitablement passer, que l'humanit y croie ou
non, qu'elle en ait conscience ou non. Il envisage le mouvement social comme
un enchanement naturel de phnomnes historiques, enchanement soumis
des lois qui, non seulement sont indpendantes de la volont, de la conscience
et des desseins de l'homme, mais qui, au contraire, dterminent sa volont, sa
conscience et ses desseins 74.
C'est sur de telles pages que se fondent disciples et critiques qui parlent du
dterminisme historique", et du dterminisme conomique de Marx.
Engels aurait donc assoupli ce dterminisme", en soulignant que le facteur
conomique n'est dterminant qu'en dernire instance.
Si c'tait le cas, nous aurions la situation suivante: un Marx qui, dans ses
ouvrages thoriques, comme dans ses crits polmiques, aurait t le plus loin
dans l'affirmation dterministe; un Engels, qui, sur le tard, aurait fait marche
arrire. Cela tiendrait-il au temprament de Marx? Il ne mnageait pas ses
adversaires. D'autre part, tant donn l'volution des luttes de classes, Engels,
sur la fin de sa vie, a modifi ses ides sur les chances d'un mouvement
rvolutionnaire violent et arm, adaptant la thorie la ralit. D'aprs les
textes que nous venons de citer, Marx semble tre rest plus doctrinaire" que
ne le sera le vieil Engels. Les formules d'un dterminisme existent bien chez
Marx. Engels aurait cherch les temprer ultrieurement.
Ne pourrait-on pas alors parler de deux versions de la thorie marxienne:
une version forte", le dterminisme conomique stricot sensu, qu'on trouve-
rait chez Marx depuis Misre de la philosophie, jusqu' la Postface au Capital
en 1872, et une version faible", celle admise par le vieil Engels, qui, sans
renier formellement la version prcdente, la temprerait75? En effet, Engels
parat en rabattre quand il s'agit d'appliquer leur doctrine gnrale des cas
historiques particuliers. Il fait ainsi observer Joseph Bloch:
Ce sont des causes historiques et, en dernire instance, conomiques,
qui ont form [...] l'tat prussien et qui ont continu le dvelopper. Mais
on pourra difficilement prtendre sans pdanterie que, parmi les nombreux
petits tats de l'Allemagne du Nord, c'tait prcisment le Brandebourg qui
tait destin par la ncessit conomique et non par d'autres facteurs
[Momente] encore [...] devenir la grande puissance o s'est incarne la
diffrence dans l'conomie, dans la langue et aussi, depuis la Rforme, dans
la religion entre le Nord et le Sud. On parviendra difficilement expliquer
conomiquement, sans se rendre ridicule, l'existence de chaque petit Etat
allemand du pass et du prsent ou encore l'origine de la mutation
consonantique du haut-allemand [...]16.
Combien cela semble en retrait sur les impratifs poss par Marx lorsqu'il
assignait ses tches un matrialisme historique en possession de ses
principes! Dans Le capital, il fixait ce matrialisme un programme autre-
ment ambitieux: c'est dans la technologie, disait-il, qu'il faut chercher la cl
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
59
dcisive pour expliquer, non seulement l'histoire matrielle de la socit, mais
aussi celle des ides, en particulier des religions:
La technologie met nu le mode d'action de l'homme vis--vis de la
nature, le processus de production immdiat de sa vie matrielle, et par
consquent, l'origine des rapports sociaux et des ides et conceptions
intellectuelles qui en dcoulent. L'histoire de la religion elle-mme, si l'on fait
abstraction dOecette base matrielle, manque de critrium. Il est, en effet, bien
plus facile de trouver par l'analyse le contenu, le noyau terrestre des
conceptions nuageuses des religions, que de faire voir par une voie inverse
comment les conditions relles de la vie revtent peu peu une forme thre.
Cette dernire est la seule mthode qui soit matrialiste, et par suite
scientifique 77.
En distinguant ainsi deux mthodes rigoureusement inverses l'une de
l'autre, Marx dfinit celle qu'il tient pour la seule authentiquement matria-
liste: elle fait voir comment les conditions relles (matrielles) revtent des
formes idologiques thres.
A quelle autre mthode s'oppose-t-elle? Trs certainement, Marx songe
celle que suivaient de nombreux philosophes de la religion: Feuerbach, Bruno
Bauer, David Strauss, et, avant eux, Hegel et Spinoza, et sans doute d'autres
crivains encore comme Benjamin Constant ou Charles de Brosses78.
Tous tentaient de trouver par l'analyse des conceptions religieuses, leur
contenu, leur noyau terrestre. Marx, lui, l'inverse, montait l'assaut du
ciel. Il l'avait dit en propres termes dans L'idologie allemande: A l'encontre
de la philosophie allemande qui descend du ciel sur la terre, c'est de la terre au
ciel que l'on monte ici, proclamait-iP9.
Selon Marx, pour accder la vritable explication scientifique, la seule
qui soit matrialiste, il faut analyser la base conomique des formations
sociales pour y dcouvrir les causes d'o dcoulent ncessairement leurs
institutions et leurs idologies.
Que fait-il d'autre dans le troisime Livre du Capital lorsqu'il dduit
ainsi, par l'analyse des conditions concrtes de la production capitaliste prise
dans les diffrenciations internes de son processus d'ensemble, les diverses
reprsentations que l'entrepreneur capitaliste, le banquier, le propritaire
foncier, le commerant, le travailleur salari, le rentier, se font sur la nature et
la source de leurs revenus respectifs?
Conformment la note du Livre premier du Capital sur la mthode
scientifique, Marx montre comment les conditions de la vie conomique
revtent une forme thre dans les ides des divers protagonistes sociaux.
En dvoilant le ftichisme gnralis de la marchandise dans tout systme
d'change marchand, il tablit que les ides du rentier, du commerant, du
salari ou du capitaliste ne sont pas moins trompeuses, voire fantastiques, que
les croyances religieuses en gnral ou que celles des philosophes et
idologues Bauer, Stirner ou Proudhon. Toutes s'expliquent matriellement
60 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
partir d'une analyse des conditions de vie des classes sociales et de leurs
luttes.
Face aux questions de ses correspondants, Engels semble n'avoir pas pu
maintenir le programme que Marx avait trac, mais n'avait ralis que dans le
seul domaine des doctrines conomiques. Pour son application aux domaines
religieux, moraux, littraires ou philosophiques, Marx n'a donn que des
indications pisodiques, jamais d'applications proprement dites.
Les exigences qu'il avait poses, cette dmarche matrialiste qui part des
conditions de vie et que Lafargue a suivie pour expliquer quelques ides
morales et religieuses assez gnrales 80, apparaissent maximalistes: elles ne
peuvent tre satisfaites si aisment! Et Engels renvoie ses correspondants en
qute d'exemples d'applications concrtes pertinentes aux ouvrages historio-
graphiques de Marx lui-mme81.
5. Dissolution du paradoxe: des varits possibles de socits
Parce qu'Engels s'est charg de vulgariser le matrialisme historique,
parce qu'il s'est occup des sciences de la nature et qu'il n'avait pas le gnie de
Marx, on le considre comme plus positiviste que son ami. Il aurait ouvert la
voie la transformation du marxisme en doctrine, prparant la sclrose
dogmatique qui interviendra sous la direction de Staline.
La plupart de ceux qui rendent Engels responsable de cette catchisation
du marxisme ajoutent qu'il l'aurait fait involontairement dans ses exposs
populaires, en particulier l'Anti-Dhring, en simplifiant l'excs la pense de
Marx pour les besoins du parti ouvrier82. Certains le rendent responsable
d'une vritable trahison volontaire des ides de Marx 83.
En scrutant les moindres diffrences entre Engels et Marx, ces critiques
d'Engels veulent persuader que Marx aurait peine t matrialiste. Dans ce
but, il est commode de faire d'Engels un bouc missaire.
A s'en tenir la question du dterminisme, curieusement, nous voyons
surgir un paradoxe, car nous venons de constater au contraire qu'Engels a
plutt agi dans le sens de la modration, non d'un durcissement des ides de
Marx.
D'ailleurs, les thses des dtracteurs d'Engels sont peu vraisemblables.
Marx tait parfaitement au courant de la rdaction de l'Anti-Dhring. Il a
approuv l'ouvrage sans rserves: il en a mme rdig un chapitre. En outre,
en ce qui concerne les lettres du vieil Engels, il n'y aurait rien d'tonnant ce
qu'un penseur, qui a contribu l'laboration d'une thorie nouvelle, nuance
plus tard les premiers exposs qui en furent donns. C'est plutt la rgle chez
ceux qui ont dcouvert et dvelopp de grandes doctrines.
Engels n'a jamais eu l'intention ni l'impression de modifier en quoi que ce
soit la pense de Marx. Au contraire: il dit expressment qu'il partage
compltement le point de vue de son ami. Comment aurait-il pu se livrer, sans
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
61
s'en apercevoir, une dformation aussi importante qu'on le prtend, alors
qu'il a si troitement collabor avec Marx en toutes circonstances84? Enfin, il
tait trs scrupuleux sur le chapitre de l'honntet intellectuelle et littraire85.
Mais venons-en aux arguments internes. Au sujet de la dtermination en
dernire instance", Engels se borne en fait exposer, sans y apporter la
moindre modification, des ides que Marx professait aussi, et depuis long-
temps, car elles taient au cur de leurs conceptions ds le dbut de leur
collaboration, mme si cela n'apparat pas tellement dans les textes marxiens
canoniques 86".
Marx exprime souvent, et dans les mmes termes qu'Engels, l'ide de
dtermination en dernire instance. A propos de la gense du capital, il
demande: Les prix tant rgls par le prix moyen, c'est--dire en dernire
instance par la valeur de la marchandise, comment le capital peut-il natre 87?
"
Et Marx d'ajouter: Je dis" en dernire instance" parce que les prix moyens
ne concident pas directement avec les grandeurs de valeur comme le croient
A. Smith, Ricardo, etc. 88"
La mme ide se retrouve tout au long du Capital: Ce que la concur-
rence ne montre pas, c'est la dtermination de la valeur qui domine le
mouvement de la production, ce sont les valeurs qui se dissimulent derrire les
prix de production et, en dernire instance, les dterminent89."
Il emploie galement cette expression pour caractriser un processus
historique global: C'est un niveau dtermin de l'volution des forces
productives des sujets qui travaillent - niveau auquel correspondent des
rapports dtermins de ces sujets entre eux et avec la nature - que s'effectue
en dernire instance la dissolution tant de leur communaut que de la
proprit base sur celle-ci 90.
"
Nous croyons pouvoir tablir d'une manire incontestable la convergence
de vue complte entre Engels et Marx en choisissant une page du livre III du
Capital91. A propos du mode de production asiatique, Marx crit:
Cette forme [Form] conomique spcifique, dans laquelle du surtravail
non pay est extorqu aux producteurs directs, dtermine [bestimmt] le
rapport de dpendance tel qu'il dcoule directement de la production elle-
mme, et ragit son tour de faon dterminante [bestimmend] sur celle-ci.
C'est la base de la formation entire de la communaut conomique [Hierauf
aber grndet sich die ganze Gestaltung...] issue directement des rapports de
production et en mme temps la base de sa forme [Gestalt] politique
spcifique. C'est toujours dans le rapport immdiat entre le propritaire des
moyens de production et le producteur direct (rapport dont les diffrents
aspects correspondent naturellement un degr dfini du dveloppement des
mthodes de travail, donc un certain degr de force productive sociale), que
nous trouvons le secret le plus profond, le fondement [Grundlage] cach de
toute la construction [Konstruktion] sociale et par consquent de la forme
[Form] politique que prend le rapport de souverainet et de dpendance, bref,
le fondement [Grundlage] de la forme spcifique de l'tat dans chaque cas.
Cela n'empche pas qu'une mme base [Basis] conomique (la mme quant
62 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
ses conditions principales), sous l'influence [durch] d'innombrables circons-
tances [Umstande] empiriques diffrentes, de conditions naturelles, de rap-
ports raciaux, d'influences historiques extrieures, etc., peut prsenter des
variations et des nuances infinies qui ne sont comprises [begreifen] que par
une analyse de ces circonstances empiriques donnes 92.
Toutes les ides que le vieil Engels avance pour rpondre aux questions de
ses correspondants se retrouvent ici. Examinons cette page de plus prs.
Par formes politiques , Marx entend des types d'tat politiquement
diffrents: les tats orientaux ancestraux (la structure sociale et politique
millnaire de l'Inde), les cits grecques, les tats fodaux du Moyen-Age, les
monarchies absolues du XVIIesicle, les nations rpublicaines modernes, etc.
Chacun de ces types d'tat admet son tour des varits <<infinies. La
relation entre la forme politique et ses incarnations conrtes est celle de
l'espce aux individus.
Tout d'abord, Marx affirme que la base conomique dtermine la forme
gnrale des rapports de dpendance sociale et politique. C'est la dtermina-
tion principale , le secret le plus profond, le fondement cach de toute la
construction sociale93. De son ct, dans ses lettres prcites, Engels rappelle
toujours que la base (ou le moment) conomique, est dterminante
",
dcisive , dominante: c'est sa ncessit qui s'impose en fin de compte .
Deuximement, Marx mentionne en bonne place qu'il y a une action en
retour de la forme politique sur la base dont elle dpend. Cette forme et sa
base interagissent, comme il le disait des rapports sociaux et des forces
productives dans Misre de la philosophie94. Il y a action rciproque de tous les
moments du tout social les uns sur les autres. Caractristique est le fait que
l'action de la forme politique , c'est--dire du gouvernement et de ceux qui
exercent le pouvoir, soit qualifie de dterminante [bestimmend] par Marx.
Troisime ide sur laquelle insiste Marx dans cette page: il est possible que
des institutions et structures politiques different, bien qu'elles s'lvent sur une
mme base conomique, ce qui montre qu'il ne tient pas celle-ci pour seule
dterminante . A l'intrieur d'un mme mode gnral de production, il y a
place pour diverses formes politiques possibles (Athnes ou Sparte dans
l'Antiquit; tats-Unis d'Amrique, Angleterre et France au XIXesicle).
Ce que Marx dit ici a une importance considrable pour notre propos.
Nous rencontrons une forme de possibilit, la possibilit de diffrentes varits
d'tats l'intrieur d'une mme forme conomique gnrale.
D'o proviennent les variations et la diversification? De causes particu-
lires, voire de circonstances purement contingentes, rpond Marx dans la
page que nous analysons.
L'infinie diversit possible provient, dit-il, de conditions naturelles
(allusion des conditions gographiques, climatiques, orographiques, aux
ressources naturelles, etc.), de rapports raciaux (allusion des diffrences
raciales ou des traditions constitutives du caractre d'un peuple), enfin
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
63
d'influences historiques extrieures (allusion sans doute aux rapports
d'change, d'interpntration ou de conflits et de guerre entre peuples:
invasions trangres, colonisation, etc.). Non seulement Marx souligne la
multiplicit de ces conditions, mais aussi leur htrognit.
Comment ne pas tre frapp de la convergence manifeste entre le contenu
de cette page du Capital et celui des lettres du vieil Engels95? Il n'est pas
jusqu'aux diverses espces de causes empiriques que Marx numre ici qu'on
ne retrouve chez Engels. De mme que Marx invoque les conditions naturelles,
de mme, Engels renvoie au milieu extrieur , par exemple
- crit-il
l'tudiant Borgius - la base gographique sur laquelle se droulent les
rapports conomiques96. Marx mentionnait les influences raciales; Engels
aussi: La race est elle-mme un facteur [Faktor] conomique 97.
Ainsi, lorsqu'Engels explique: notre conception de l'histoire est, avant
tout, une directive pour l'tude [...]. Il faut rtudier toute l'histoire, il faut
soumettre une investigation dtaille les conditions d'existence des diverses
, formations sociales avant d'essayer d'en dduire les modes de conception
politiques, juridiques, esthtiques, philosophiques, religieux, etc., qui leur
correspondent. Sur ce point, on n'a fait jusqu' prsent que peu de choses
[...)98 , ces lignes auraient pu tre signes de Marx. On retrouve ce qu'il disait
de la mthode matrialiste scientifique 99.
Si Marx a consacr une bonne partie de sa vie approfondir ses tudes
conomiques avant d'laborer Le capital, s'il a tudi dans le dtail l'histoire
des doctrines conomiques et toute l'histoire moderne 100,Engels en fit autant
avec ses recherches sur l'histoire militaire, l'poque franque, les langues
germaniques, l'origine de la famille, de la proprit prive et de l'tat, ou
encore le christianisme primitifl01.
La ncessit d'investigations dtailles s'exprime dans la rgle de l'analyse
concrte de la situation concrte, dicte par Marx et Engels, et reprise comme
un leitmotiv dans toute la tradition marxiste.
Nous sommes donc en prsence d'un accord complet entre les rponses
d'Engels dans ses lettres des annes quatre-vingt dix et les ides exprimes par
Marx dans cette page concise du Capital. Il suffit de remarquer que celle-ci,
appartenant au Livre III, fut crite dans les annes 1863-1864, quand Marx
prparait conjointement le premier et le troisime livres, et qu'Engels, dans les
annes o se situent les lettres en question, tait prcisment en train de
dchiffrer et de transcrire les manuscrits de ce troisime livre. La conclusion
s'impose: la convergence est si complte qu'elle tablit la totale fidlit
d'Engels la pense de Marx.
Plusieurs consquences en dcoulent. D'une part, cela suffit pour couper
court aux multiples interrogations sur une dformation involontaire et
inconsciente, dans un sens ou dans un autre, qu'Engels aurait fait subir la
pense marxienne: il a les manuscrits sous les yeux et est en train de les publier.
La fable d'un Engels figeant la pense de Marx en un conomisme rducteur
est renvoye sa propre inconsistance.
64 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Le paradoxe d'un Marx plus dterministe qu'Engels se dissipe lui aussi,
devant une connaissance prcise de leurs uvres.
Quant leurs exposs qui prsentaient brivement leur conception en
faisant croire un dterminisme, Engels s'en est expliqu lui-mme en
invoquant leur caractre justement polmique:
C'est Marx et moi-mme, partiellement, qui devons porter la responsa-
bilit du fait que, parfois, les jeunes donnent plus de poids qu'il ne lui est d
au ct [Seite] conomique. Face nos adversaires, il nous fallait souligner
le principe essentiel ni par eux, et alors nous ne trouvions pas toujours le
temps, le lieu, ni l'occasion de donner toute leur place aux autres facteurs
[Momente] qui participent l'action rciproque 102.
Nous venons de voir Marx faire galement remarquer que, dans tout
travail historique, il faut tenir le plus grand compte des circonstances
particulires que des conditions conomiques gnrales ne suffisent pas
expliquer. Engels renvoie ses correspondants aux uvres o Marx avait ralis
des tudes historiques concrtes, car ce sont des modles du genre 103. Il
convient d'y ajouter les chapitres du Capital qui dcrivent la gense historique
de certaines institutions, de certaines lois, de certains types sociaux (gnrale-
ment en Angleterre): gense du fermier capitaliste aux XVIeet XVIIesicles,
histoire des lois limitant la dure de la journe de travail, histoire de la loi sur
les fabriques, histoire des lois protectionnistes sur les crales (le bl), au XIXe
sicle.
Ces textes prouvent que Marx savait ne pas tomber dans le rduction-
nisme conomiste troit qu'on lui prte, et qu'il tait loin de tout expliquer par
l'conomie. Quand il crivait l'histoire, il s'est au contraire, bien gard de ce
ridicule.
Hlas, certains de ses disciples n'ont pas su viter cet cueil. Engels s'en
plaint: Malheureusement, il n'arrive que trop frquemment que l'on croit
avoir parfaitement compris une nouvelle thorie et pouvoir la manier sans
difficult, ds qu'on s'en est appropri les principes essentiels, et cela n'est pas
toujours exact. Je ne puis tenir quitte de ce reproche plus d'un de nos rcents
" marxistes", et il faut dire qu'on a fait des choses singulires 104.
Quels rcents marxistes? Quelle choses singulires ? Il est difficile de
le dire. Paul Lafargue est-il du nombre? Marx avait formul d'expresses
rserves contre la manire dont son gendre avait compris ses ides: Lafargue
avait aussi mal assimil le matrialisme historique, que, jadis, Proudhon la
dialectique!
Engels songe peut-tre des cas plus singuliers encore, par exemple
Achille Loria qui, en 1883, avait dnatur la conception marxienne de
l'histoire, et, en 1886, l'avait arrange sa faon et prsente comme sa propre
dcouverte 105.
Le matrialisme historique, pour tre appliqu, doit reposer sur de
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
65
srieuses connaissances dans les sciences, en conomie, en histoire, et en
philosophie! Il y faut en outre un sens dvelopp de la dialectique 106,sous
peine de tomber dans des interprtations unilatrales.
6. Les formes de dterminisme en histoire et le matrialisme historique
Marx et Engels ne se disent pas dterministes . Auraient-ils accept que
ce vocable leur soit appliqu s'ils avaient connu l'acception restreinte que
Claude Bernard lui donna en 1864 pour un usage scientifique, en opposant au
dterminisme mtaphysique de Leibniz ou de Laplace le dterminisme scien-
tifique en tant qu'hypothse mthodologique et heuristique ncessaire au
travail du savant?
Claude Bernard obligeait ainsi distinguer diverses formes de dtermi-
nismes et la question se pose donc de savoir si le matrialisme historique ne
rentrerait pas sous l'une de ces formes. C'est ce qu'il faut examiner mainte-
nant. Nous y ajouterons quelques considrations sur l'apparition du mot
dterminisme qui sera pleine d'enseignements et clairera notre propos.
Trois formes principales de dterminisme se laissent distinguerlO7, bien
qu'elles soient plus ou moins lies et parfois mles l'une l'autre: le
dterminisme religieux ou populaire, le dterminisme philosophique ou mta-
physique et le dterminisme savant ou scientifique. Le premier serait sans
doute mieux appel fatalisme et le second ncessitarisme; au troisime
seul, il conviendrait de rserver le nom de dterminisme . Chacune de ces
trois formes principales du dterminisme a son application en histoire.
La premire forme est la plus ancienne. Elle affirme que tous les
vnements qui, d'une manire ou d'une autre, touchent l'homme, se produi-
sent parce qu'ils sont voulus par des puissances ou agents surnaturels, parfois
personnifis. Leur mode d'action chappe aux processus ordinaires de la
nature. On prte ces agents des intentions plus ou moins caches et
enveloppes de mystres. Leurs interventions, quoique occultes, sont conues
de manire anthropomorphique. La dtermination des vnements apparat
comme transcendante. Cependant on cherche la pntrer et l'interprter.
La croyance populaire imagine, avec surabondance, les raisons d'agir de ces
puissances surnaturelles, qu'entourent toujours un halo d'irrationalit.
On trouve cette forme de dterminisme dans la plupart des conceptions
religieuses, par exemple dans les doctrines thologiques (providentialisme,
prdestination, etc.), laborations savantes du fatalisme vulgaire: en effet,
pour elles, l'homme est le jouet d'une puissance surnaturelle aux desseins
insondables.
Bien que sa conception de l'histoire n'ait rien voir avec de telles
croyances ou de telles doctrines, Marx flirte parfois avec leur manire de
s'exprimer. Il lui arrive de dire que certains vnements se produiront
fatalement . Il qualifie la rvolution qui provoquera la chute du capitalisme
66 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
d' invitable et la dcrit comme une fatalit . De mme, il n'hsite pas
utiliser la notion de destin. Il l'applique aux vnements historiques impor-
tants. Il dit que les classes sociales ont une destine en quelque sorte trace
l'avance. Elles semblent ainsi n'tre que des instruments au service d'une
ncessit qui les dpasse.
Est-ce, de sa part, une simple manire de parler? Rien n'est plus loign
en effet de la conception marxienne de la ncessit historique que l'ide d'une
fatalit au sens de l'intervention arbitraire et aveugle d'une puissance transcen-
dante la socit ou la nature. La fatalit historique est analogue celle
des cataclysmes naturels. De plus, quand Marx affirme qu'une rvolution
sociale et politique se produira que les hommes le veuillent ou non , il ne
l'entend pas au sens du fatalisme ordinaire: cette rvolution ne saurait se
produire quoi que les hommes fassent. Il est bien vident.qu'elle ne saurait
survenir si personne ne se rvolte! Il y faut le concours volontaire et conscient
de nombreux individus, de classes sociales entires, agissant gnralement avec
conscience d'un but et d'une manire concerte, mme si cette conscience est
fausse et s'illusionne.
Pourquoi Marx a-t-il affectionn le langage du fataliste? C'est qu'il y a
bien une sorte de fatalit: la crise est fatale pour certains individus ou
certaines classes. Sa fatalit est bien relle pour ceux qui ptissent de son
dchanement. Parfois, il en est qui en sont victimes du fait mme de leur
attitude ngative! Mais beaucoup craignent sans raison qu'elle leur soit fatale:
combien de personnes redoutent, pour des motifs divers, tout changement
social, surtout une rvolution! Lorsque Marx parle de fatalit, c'est ceux-l
qu'il s'adresse.
Le langage fataliste est destin branler le conservatisme courte vue,
stigmatiser l'gosme et l'inconscience. Ce n'est pas seulement un discours ad
hominem: c'est le discours adquat pour parler de l'inadquation entre l'ancien
et le nouveau, entre le prim qui doit mourir et disparatre, et ce qui vient
l'existence port par des forces neuves. Il dcoule d'une comprhension vraie
du processus historique. Il est indissolublement d'ordre rhtorique et d'ordre
thorique.
La deuxime espce de dterminisme est le dterminisme philosophique;
il prend une forme mtaphysique ou spculative. Appliqu l'histoire, il se
trouve dvelopp dans des doctrines riches et varies. Leur trait commun
consiste affirmer que le cours de l'histoire est orient dans une direction
dtermine en vertu d'une cause ou d'une raison gnrale, ou encore en vertu
d'une loi fondamentale, qui rgiraient les vnements singuliers et les explique-
raient. Par exemple, on soutient qu'il existerait une loi d'volution universelle
orientant toute l'histoire vers une certaine fm.
On a affaire une lacisation de la conception prcdente, car cette cause
ou raison, cette loi ou fin, sont gnralement conues comme immanentes la
nature et l'histoire, quoique diffrentes des fins humaines individuelles et
particulires. La ncessit de cette loi ou de cette fin s'impose aux individus,
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
67
aux classes, aux peuples et l'humanit elle-mme. Elle reste trangre et
suprieure aux hommes, quoiqu'elle ne soit pas insondable. Au contraire,
elle est gnralement donne comme minemment comprhensible et ration-
nelle . Cette loi gnrale est dcrite comme une Raison , une rationalit, qui
gouvernerait aussi bien les tre finis que les vnements singuliers.
Dans cette conception, le cours de l'histoire est ou cyclique, ou linaire,
ou encore prend la forme d'une spirale. Chez les Anciens, dominait l'ide de
cycles rptitifs (thme de la grande anne). Pour Vico, l'histoire passe par des
priodes de dveloppements, de rgressions et de nouveaux dparts; chacun de
ces cycles est analogue au prcdent. Selon Hegel, l'histoire est l'accomplisse-
ment de l'Esprit, travers un processus d'objectivation-alination de soi que
l'Esprit doit surmonter pour se retrouver auprs de soi; cela se ralise par la
succession de peuples historiques dans lesquels l'Esprit s'incarne sous des
formes particulires.
Au nombre de ces conceptions philosophiques, il faut mettre celle de
Comte (loi des trois tats de Pesprit humain) et l'volutionnisme de Spencer
(loi universelle de diffrenciation et de spcification). Elles ont un caractre
nettement mtaphysique du fait qu'elles donnent une loi gnrale susceptible
d'expliquer la totalit de l'histoire dans sa forme et dans son contenu. Comme
le fatalisme ou le providentialisme, ces doctrines sont presque toujours
conduites affirmer la ncessit de tous les vnements singuliers et tenter
d'en donner une justification en les rattachant directement la cause ou la
loi gnrale, comme de simples cas particuliers de celles-ci.
Indiquons ds maintenant ce qui spare le marxisme des conceptions de
Hegel, de Comte ou de Spencer, malgr la parent et la ressemblance qui le
lient elles. L'ide d'une volution historique gnrale est reprise par Marx,
qui la dcrit lui aussi comme un dveloppement qui procde par tapes
progressives se succdant dans un certain ordre d'engendrement ncessaire. En
gros, il se forge donc une conception analogue celles de Vico, des
philosophes des Lumires, de Hegel, et des positivistes ou volutionnistes.
Cependant, quand il s'agit d'tudier l'histoire effective, il est plus
circonspect que ses devanciers ou contemporains. Il critique l'ide d'un
progrs qui s'effectuerait partout et toujours selon un ordre unique 108.S'il
adopte nombre de vues concrtes de Hegel sur l'histoire et son processus
dialectique, il rejette l'ide hglienne d'Esprit qui raliserait sous la forme
d'un dveloppement temporel sa fin spirituelle , dfinie d'une manire
hautement spculative. Tout en soulignant que les hommes ont t jusqu'ici
individuellement subordonns des fins qui s'accomplissaient leur insu et
s'imposaient eux d'une manire aveugle, Marx conteste que l'histoire
poursuive une fin propre, distincte de celle que les hommes individuels
peuvent vouloir. Cette fin (se librer de toute alination) ne se ralise pas sans
la participation consciente et volontaire des individus qui, s'ils prennent leur
destin collectivement en main, pourront en mme temps accomplir leurs buts
individuels .
68 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Pour Marx, l'histoire n'est rien d'autre que le processus par lequel les
hommes se librent par eux-mmes des contraintes naturelles et sociales; elle
est, pour tous, la fois ralisation de soi et ouverture sur un dveloppement
au contenu infini, plutt que clture sur une fin au contenu dtermin . Dire
qu'il y a pour Marx une loi de l'histoire conduit des quivoques. C'est par
sa conception de la fin (la libert) et des moyens de l'atteindre (le dveloppe-
ment des forces productives et la lutte de classes) que le marxisme se
diffrencie des doctrines voques l'instant.
La troisime forme de dterminisme est le dterminisme scientifique .
La forme prcdente tait spculative ou mtaphysique, la fois par sa
manire de concevoir la fin de l'histoire et par le caractre gnral de la loi
ou de la Raison dont elle discernait l'accomplissement dans le cours du
monde. Dans la troisime forme de dterminisme, on s'intresse moins une
loi gnrale qu'aux causes particulires qui provoquent les vnements
historiques, des causes efficientes spcifiques. Tout arrive conformment des
causes dtermines, partir de situations donnes; l'explication procde
comme le fait la science moderne l'gard des phnomnes naturels.
Cette forme de dterminisme causal exclut toute ncessit transcendante
et toute causalit finale. Ce qui caractrise un dterminisme scientifique, c'est
qu'il ne fait appel qu' des causes efficientes et des conditions donnes dans
l'exprience. Il prend alors la forme de la thorie dite des facteurs . Par
exemple, on donne le climat et les autres conditions naturelles comme causes
des traits caractristiques des diverses socits humaines (Montesquieu).
D'une manire gnrale, c'est la conception des Lumires, ou de l'volution-
nisme d'inspiration darwinienne. L'on s'en tient des facteurs objectifs
empiriques et matriels.
L encore, diverses formes de dterminisme se prsentent: on fait
dpendre tous les vnements historiques d'un facteur unique, ou bien d'un
facteur prdominant, ou bien ils rsulteraient de la combinaison et du jeu de
divers facteurs, largement, voire compltement, indpendants. On a ainsi
cherch la ncessit qui se manifeste en histoire dans les facteurs gographi-
ques, climatiques, biologiques (races), ethniques (caractres des peuples), etc.
Presque aucune de ces conceptions n'affirme la ncessit des vnements
historiques singuliers. La ncessit n'est gnralement affirme qu'au niveau
global, et l'on admet une large contingence (accumulation des petites causes,
hasard, concours de circonstances, etc.).
La conception de Marx et d'Engels est proche de ces thories; cependant,
elle en diffre. Ceux qui la disent dterministe la ramnent gnralement une
thorie des facteurs. Ils attribuent Marx l'ide que ces facteurs sont des
causes efficientes excluant toute finalit, et s'imposant aux individus de
l'extrieur. De fait, Marx recourt l'explication causale, mais ce n'est pas de
la seule causalit efficiente externe qu'il s'agit. Nous montrerons que, parmi les
divers facteurs historiques, les causes humaines (besoins dfinis de faon
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
69
historique et sociale) sont essentiels. A la causalit des facteurs externes se
superpose celle qu'introduit l'homme en poursuivant ses fins propres.
Avant de conclure un dterminisme historique chez Marx, il faudrait
examiner de quelle nature sont les lois et les causes conomiques pour lui.
Nous savons dj que le facteur conomique n'impose sa loi que grce la
mdiation de tous les autres facteurs sociaux et humains qui sont autant de
conditions. D'autre part, ce facteur conomique se partage lui-mme en
deux composantes de genre diffrent: les forces productives et les rapports
sociaux. Les hommes et les classes participent l'action du facteur conomi-
que . Les crises qui secouent l'histoire ne sont surmontes que grce l'action
consciente et organise des classes sociales.
Enfin, si l'activit des hommes, vritables agents de l'histoire, conduit la
ralisation de la libert, peut-on encore parler de dterminIsme , en quelque
sens qu'on prenne le terme, puisqu'il arrive un moment o la ncessit
historique concide avec la possibilit pour les hommes de matriser les
causes extrieures et de choisir leurs fins? La thse de Marx est que, par les
rvolutions politiques et sociales, les individus et classes interviennent de plus
en plus consciemment et volontairement dans le cours de l'histoire, et
parviennent l'orienter en fonction de leurs buts. C'est pourquoi, si dtermi-
nisme il y a, celui-ci est trs paradoxal!
Par bien des aspects, le matrialisme historique de Marx et d'Engels
s'apparente au dterminisme scientifique. Nanmoins, leur conception ne se
laisse ramener aucune des formes de dterminisme qui furent appliques en
histoire et avances dj avant eux. Appliquer le mot dterminisme au
marxisme laisse chapper un aspect essentiel de la pense de Marx. Ce n'est
encore l qu'une prsomption. Celle-ci paratra plus forte aprs que nous
aurons jet un coup d'il sur l'histoire de l'apparition du mot "dtermi-
nisme . Ce bref historique nous aidera prciser son sens.
La question n'est pas de savoir s'il y aurait anachronisme l'appliquer au
matrialisme historique. Un terme peut tre forg tardivement pour dsigner
une conception qui a vu le jour longtemps avant qu'il n'apparaisse. Or,
l'introduction du mot dterminisme dans la philosophie et dans la science
va nous clairer sur les doctrines auxquelles il convient de l'appliquer.
En lecteur trs averti, Marx n'ignorait pas l'existence de ce vocable
rcent; et, s'il ne l'utilisa presque jamais, il l'entendait dj dans le sens qu'il
a pour nous. Or, il l'employa plus de vingt ans avant Claude Bernard.
Celui-ci clarifia son sens et le fixa pour un emploi scientifique , le
faisant ainsi passer dans l'usage courant en franais. Le mettant au centre de
sa rflexion mthodologique.et heuristique, donc se plaant dans une optique
pratique, Claude Bernard faisait consciemment uvre de philosophie des
sciences; il dclarait tre le premier l'introduire dans la science.
L'histoire antrieure du mot dterminisme offre quelques curiosits. Il
tait nouveau l'poque de Marx: il ne commena se rpandre en
70 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
philosophie que vers 1840. Dans son acception actuelle, on ne le trouve pas l
o on l'aurait attendu, chez Laplace ou Comte, Ampre ou Taine 109.
Le premier emploi attest se trouve chez Kant, mais en un sens tout
diffrent de celui que le mot aura bien plus tard pour dsigner la conception
laplacienne du monde ou mcanisme universel (Laplace, rptons-le, n'em-
ploie pas le terme). Au sens bernardien, il dsignera plus modestement le
dterminisme exprimental ou conditionalisme 110.
Par dterminisme, Kant dsignait <da dtermination du libre-arbitre
par de suffisantes raisons intrieures 111. Il l'opposait au prdterminisme
d'aprs lequel des actes volontaires en tant qu'vnements ont leurs raisons
dterminantes dans le temps antrieur qui, ainsi que ce qu'il contient, n'est plus
en notre pouvoir 112.
Ainsi, Kant faisait rentrer ce que nous appellerions dterminisme
dans le prdterminisme , et il entendait par dterminisme tout autre
chose: un mode de dtermination rationnel de la volont. C'est donc dans le
domaine de la philosophie pratique que le terme fait son apparition, alors
qu'on l'aurait attendu dans celui des sciences de la nature.
Curieusement, il semble que ce soit Hegel qui l'ait introduit le premier en
philosophie des sciences dans son sens actuel. En effet, dans un passage de sa
Science de la logique, il explique que le dterminisme [Determinismus] est le
point de vue auquel se tient le connatre , quand on indique, pour chaque
dtermination de l'objet la dtermination d'un autre , savoir ses conditions
ou encore l'tat de choses antrieur. Le dterminisme progresse ainsi
l'infini . Hegel conclut: n'est par consquent prsent nulle part un principe
d'autodtermination 113.
Cette dernire observation est trs remarquable. Elle dit l'essentiel:
dterminisme et autodtermination s'opposent. Hegel fournit ainsi la pierre de
touche qui permet de discriminer le caractre dterministe ou non-dtermi-
niste d'une thorie. D'aprs ce critre, il faut refuser de considrer la
conception marxienne de l'histoire comme dterministe, puisque, pour
Marx, l'histoire est non seulement un processus d'auto-dveloppement, mais
finalement et essentiellement un processus d'auto-cration de l'homme.
A partir des annes quarante du XIX. sicle, le mot dterminisme est
reu comme une vieille connaissance, affirme M. Brunelle. Lalande signale
qu'il figure dans l'Encyclopdie de Ersch et Grber parue en 1832.
Tout porte croire que c'est Hegel que Marx l'emprunte quand il crit
dans sa Thse en 1841: La ncessit apparat, en effet, dans la nature finie
comme ncessit relative, comme dterminisme. [...] Ce qui veut dire que c'est
un enchanement de conditions, de causes, de raisons, etc., qui mdiatise cette
ncessit 114.
Selon M. Brunelle
-
qui ne mentionne pas Marx dans cette histoire -,
Claude Bernard donne au mot dterminisme une acception nouvelle, en
particulier par rapport la dfinition de Bouillet: il aurait dlimit le sens du
concept en circonscrivant les conditions de son usage. Avant lui, le mot
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
71
dsignait la ncessit cosmique; aprs lui, il signifie: [..,] la condition ou
l'ensemble des conditions qui dterminent la production d'un phnomne,
sans lesquelles le phnomne ne se produirait pas, avec lesquelles le phno-
mne se produit ncessairement 115.
Ainsi, le mot dterminisme a chang d'acception avec Claude Bernard,
qui le fait passer du ncessitarisme mtaphysique leibnizien ou du mcanisme
laplacien au conditionalisme, le dterminisme en biologie dsignant pour lui
l'ensemble des conditions physico-chimiques (externes ou internes) ncessaires
pour qu'un phnomne se produise. Nous ne voyons aucune diffrence
essentielle entre cette dfinition et celle que lui donnaient Hegel en 1816, et
Marx en 1841. Or, ainsi dfini, il ne dsigne jamais l'autodtermination, ce qui
expliquerait pourquoi Marx n'a jamais pens avoir t dterministe .
Claude Bernard ignorait la Science de la logique, non traduite de son
temps. S'il l'et connue, et qu'il et galement remarqu les quelques lignes o
apparaissait le mot (,dterminisme, il n'aurait rien eu changer sa
dfinition. Marx, lui, connaissait parfaitement les uvres de Hegel et la
littrature allemande. Il pouvait donc trouver toute naturelle l'mergence du
terme son poque, et tout aussi naturellement se sentir tranger au
dterminisme au sens propre du terme; il professait une conception dialectique
du devenir et des processus historiques, o l'ide d'auto-dveloppement est
absolument fondamentale.
Ainsi s'explique sans doute le fait que le terme ne soit jamais utilis par
lui pour qualifier ses propres conceptions. Pourtant,
- ironie de l'histoire! -
de nombreux disciples et interprtes de Marx considreront ultrieurement la
conception marxienne de l'histoire comme l'expression d'un authentique
dterminisme qualifi d'historique ou d'conomique!
Pouvons-nous tirer de cette discussion une conclusion suffisamment
solide pour rsister toute objection et toute rfutation? Ce n'est pas sr
tant que nous n'aurons pas pouss davantage l'analyse des catgories fonda-
mentales de la pense de Marx. Nous pouvons seulement avancer titre
d'hypothse que la conception matrialiste de l'histoire, bien comprise, ne peut
tre identifie sans restriction un dterminisme, et que cette appellation lui
est inadquate.
Cette hypothse de travail permet de ne pas rduire d'emble la possibilit
chez Marx celle qu'admet une conception dterministe, o les possibilits
restent abstraites, car dfinies par des lois gnrales et une causalit externe.
Chez Marx, la catgorie du possible a un sens plus profond et plus essentiel.
Mais voil! Cette hypothse se heurte un obstacle majeur: dans Le
capital, Marx accorde une trs grande place aux lois conomiques , et qui
plus est des lois causales. Si, comme le soutient Karl Popper, les lois des
phnomnes conomiques sont, comme les lois des sciences de la nature, des
lois absolument ncessaires, sur lesquelles se fonde notre capacit de prvision
(et Marx cherche prvoir), ne serait-on pas reconduit subrepticement l o
72
MARX PENSEUR DU POSSIBLE
l'on ne veut pas aller? Toute dcouverte de lois conforte en effet un
d.terminisme.
Il nous faut donc considrer la manire dont Marx conoit les lois en
conomie, pour comprendre quelle sorte de possibilit elles donnent lieu
pour lui. Ces lois ne restreignent-elles pas le champ du possible historique
en le soumettant un ncessitarisme conomique fondamental?
NOTES
1. A titre prliminaire, nous retenons la dfinition suivante, et reue, du dterminisme:
Doctrine philosophique suivant laquelle tous les vnements de l'univers, et en particulier les
actions humaines, sont lis d'une faon telle que les choses tant ce qu'elles sont un moment
quelconque du temps, il n'y ait pour chacun des moment antrieurs ou ultrieurs, qu'un tat et un
seul qui soit compatible avec le premier. (LALANDE, Vocabulaire..., p. 222, col. A, sens C). Cette
dfinition convient des conceptions du monde et de la nature comme celles de Spinoza, Leibniz,
Newton, D'Holbach, Kant ou Laplace.
2. La causalit et le dterminisme ne sont point absolument synonymes , faisait pertinem-
ment remarquer BACHELARD (Le nouvel esprit scientifique, Paris, Presses Universitaires de France,
1971, p. 114) et un prcdent clbre vient l'esprit: Aristote!
3. Le matrialisme conomique de Karl Marx, Paris, H. Oriol, 1984, et Le dterminisme
conomique: La mthode historique: Recherches sur l'origine et l'volution des ides de justice. de
bien. de l'me et de Dieu, Paris, Giard et Brire, 1909.
4. De l'histoire considre comme science, Paris, Hachette, 1894. Cet ouvrage fit poque; il a
t longtemps pris des historiens qui, parfois, le recommandent encore.
5. Les polmiques pour l'interprtation du marxisme: Berstein et Kautsky, Paris, Giard et
Brire, p. 12, n. 3.
6. Essais sur la conception matrialiste de l'histoire (paru en italien en 1896; Ire d. fr., trad.
A. Bonnet, 1902), Paris-Londres-New York, Gordon & Breach, rimpr., 1970, p. 119.
7. Georges SOREL donne cette phrase pour une citation textuelle (Karl Kautsky, Le marxisme
et son critique Eduard Bernstein, trad. Martin-Leray, Paris, Stock, 1900) sans rfrence de page.
Nous ne l'avons pas trouve dans cet ouvrage.
8. Joseph STALINE qualifiait un vnement politique, comme une rvolution, de phnomne
absolument naturel, invitable (Matrialisme dialectique et matrialisme historique, Paris, d.
soc., 1956, p. 9). Selon lui, le matrialisme appliqu l'tude de l'histoire revient parler de <dois
ncessaires du dveloppement social. Il insistait beaucoup sur ce concept de lois ncessaires
(ibid., p. 13). (Des extraits significatifs de cet opuscule de Staline figurent dans le Vocabulaire de
la philosophie de LALANDE (Appendice, pp. 1269-1271). Cependant, le mot dterminisme ne s'y
trouve pas, pas plus que dans les articles de Lnine sur Marx (Textes philosophiques, trad. Pelta-
Sve, Paris, d. soc., 1978, pp. 213-233). Mais l'ide n'y est-elle pas partout au premier plan?
9. Matrialisme et rvolution , Situations III, Paris, Gallimard, 1949, p. 157.
ID. Ibid., p. 158. Vraisemblablement, Sartre n'avait pas connaissance de la formule que Sorel
attribuait Kautsky.
.
Il. Ibid., p. 160.
12. Ibid., note 1.
13. Ibid., pp. 141, 147 et suiv.
-
Sartre citait Ludwig Feuerbach et Anti-Dhring. Mais il
passait la mesure: dans ces ouvrages, on reconnatra difficilement les vues de Taine!
14. Ibid., pp. 141-144.
15. Qu'il s'agisse de Newton ou d'Archimde, de Laplace ou d'Einstein, le savant n'tudie
pas la totalit concrte, mais les conditions gnrales et abstraites de l'univers (ibid., p. 152).
Sartre va jusqu' prtendre que, mme selon la science du xxe sicle, un corps reoit toujours son
nergie du dehors (ibid., pp. 166-167, note).
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
73
16. La pense de Karl Marx, Paris, $d. du Seuil, 1956, p. 585.
17. Ibid., p. 143. Cette remarque est faite propos du commentaire des Thses sur Feuerbach.
18. Marx et marxisme, Paris, Presses Universitaires de France, 1962, p. 26.
19. La socit ouverte et ses ennemis, t. 2, Hegel et Marx, trad. Bernard-Monod, Paris, d. du
Seuil, 1979, p. 62.
- K. Popper parle aussi bien du dterminisme sociologique de Marx.., que
de son dterminisme historique.. et de son dterminisme scientifique.. (ibid., pp. 72-73).
20. Ibid., p. 61.
-
Karl POPPER assimile carrme.nt le marxisme une doctrine fataliste de
l'histoire: S'il peut y avoir une science sociale et, partant, une prophtie histori'que, le cours
gnral de l'histoire est prdtermin et il n'y a rien faire l contre.. (ibid., p. 62), comme si Marx
n'avait pas voulu changer ce cours des. choses qu'on ne ferait que subir!
21. Pour connatre la pense de Karl Marx, Paris, Bordas, 1940, p. 144.
22. Cf. l'article Determinismus.., in Philosophisches Worterbuch, p. 266, col. A. (Traduit par
nous.) .
23. Ibid., p. 263, col. A. (Traduit par nous.)
24. The Hero in History: A study in limitation and possibility, New York, J. Day, 1943, chap.
IV et V; et From Hegel to Marx, Studies in the Intellectual Development of Karl Marx, London,
1936, pp.
90-98 (signal par H. Lefebvre, op. cit., p. 45). Les marxistes orthodoxes, ce sont Engels,
Plkhanov, Kautsky, Lnine, Trosky et Boukharine.
25. Il prcisa qu'il visait plutt Engels que Marx, [...] et surtout les marxistes franais.. (Op.
cit.., p. 32). En 1949, il se dfendait dj d'avoir accus Marx de dterminisme: comme on m'a
reproch sans bonne foi de ne pas citer Marx dans cet article, je prcise que mes attaques ne
s'adressent pas lui mais la scolastique marxiste de 1949... (Ibid., p. 135, n. 1).
26. Op. cit., pp. 46-47.
27. Des interprtes plus rcents, comme Louis Althusser ou M. Michel Henry, vitent cette
question. On chercherait en vain chez eux des dclarations comme celles que Sartre, Calvez ou
Popper mettent tellement en avant.
28. Sur l'histoire du mot dterminisme.. et son apparition, cf. ci-dessous, pp. 69 sq.
29. C'est seulement aprs avoir recherch ce qui motive l'attribution Marx et Engels d'un
dterminisme conomique que nous comparerons leur conception aux principales formes de
dterminisme en histoire.
30. Marx suivit de prs la rdaction et la publication de l'Anti-Dhring: il y participa! Il
connaissait bien aussi le projet de Dialectique des sciences de la nature d'Engels.
31. ln Freie Wissenschaft undfreie Lehre (Science libre et enseignement libre, cit in MALON,
Histoire du socialisme depuis les temps les plus reculs jusqu' nos jours, Lyon, H. Albert, 1892,
t. 2, p. 54). Marx et Engels parlent de Haeckel dans leurs lettres (cf. Correspondance, t. IX,
p. 365: MEW 32, p. 206; 33, p. 120; L. sur les sciences, pp. 67 et 80.)
32. Le principal dfaut de tout le matrialisme jusqu'ici [...] est que l'objet extrieur, la
ralit, le sensible ne sont saisis que sous la forme d'Objet [...]... (L'idologie (1968) p. 31; (1976)
p. 1; d. bil., pp. 25-26; MEW 3, p. 533.)
33. Dialectique, p. 209; MEW20, p. 478; d. Kedrov, p. 85.
34. Marx annonait son but: .. dcouvrir la loi naturelle du mouvement de la socit
moderne... Il Y parlait du caractre naturel.. des lois de la production, et des phases de son
dveloppement naturel... (Le capital, t. l, pp. 18 et 19; trad. Lefebvre, pp. 5-6; MEW 23, pp. 12
et 15-16). On trouve des formules identiques dans la Postface la deuxime dition allemande de
1872 (ibid., pp. 24 et 27-28; pp. II et 15-16; pp. 20 et 25-27). Nous analyserons la notion de loi
naturelle.., telle que Marx l'emploie en conomie, dans le prochain chapitre (cf. ci-dessous,
pp. 84 et suiv.).
35. Dans L'idologie allemande, o se trouvent dveloppes pour la premire fois ces ides,
Marx et Engels se fondent sur le fait, tabli par les historiens, que les intrts matriels des classes
sociales sont plus puissants que les idologies et les passions.
36. Dtermin.. a ici le sens de prcis.., ou spcifi... C'est l aussi une des sources de
l'quivoque; nous allons
y
revenir.
37. Marx illustre cette thse par de nombreux exemples, non seulement ceux des idologues
allemands de Kant Stirner, mais aussi celui de l'utilitarisme du XVIIl< et du XIX< sicles qui joue
en France et en Angleterre un rle analogue (cf. L'idologie (1968) pp. 449-455; (1976) pp. 412-
418; MEW 3, pp. 393-399).
38. Ibid., p. 51; (1976) p. 21; d. bil., p. 75; MEW 3, p. 27.
39. Beaucoup confondent base.. et structure.., en particulier en parlant
d'.<infrastructure... Nous aurons l'occasion d'y revenir.
40. Contribution (Prface), pp. 4-5; MEW 13, pp. 8-9.
74 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
41. Lors de la Rvolution de 1789, par exemple, la majorit des Franais pensait que
l'abolition des ordres sociaux d'Ancien Rgime instaurerait l'galit, alors qu'elle a engendr de
nouvelles classes en gnralisant le salariat, c'est--dire de nouveaux rapports d'exploitation de
l'homme par l'homme.
42. L'idologie (1968) pp. 45-46; (1976) p. 15; d. bil., pp. 56-57; MEW 3, p. 21. (Rappelons
que les termes souligns le sont par Marx).
43. Ibid.
44. Le capital (trad. Lefebvre), p. 5; MEW23, p. 12. Traduction de J. Roy: Il ne s'agit point
ici du dveloppement plus ou moins complet des antagonismes sociaux qu'engendrent les lois
naturelles de la production capitaliste, mais de ces lois elles-mmes, des tendances qui se
manifestent et se ralisent avec une ncessit de fer. (Le capital, t. l, p. 18)
-
On relvera le
paradoxe qu'il
y a parler d'une ncessit absolument inflexible propos de tendances!
45. Cela a tromp Karl Popper qui croit que Marx a voulu jouer le rle de prophte".
L'ide que la ncessit des lois conomiques est assimilable celle des lois de la nature demande
un examen dtaill sur lequel nous ne pouvons anticiper: il viendra dans notre prochain chapitre.
46. Misre, p. 119; MEW 4, p. 130; Textes sur la mthode, p. 69.
47. Ibid.
48. Manifeste, pp. 76-77; MEW 4, p. 477. Il faudrait peut-tre traduire par: volont dont
l'objet est fourni (ou procur) par les conditions [...] .
49. L'idologie (1968) pp. 49-50; (1976) p. 19; d. bil., pp. 68-69; MEW 3, p. 25.
50. Thses, in L'idologie, p. 34; (1976) p. 4; d. bil., pp. 32-33; MEW 3, p. 7.
51. Manifeste, pp. 118-119; MEW 4, p. 493.
52. Les uvres de Marx et d'Engels publies avant 1867 taient peu nombreuses, et souvent
anciennes. Il ne faut pas oublier que deux livres du Capital sur les trois, les Thories sur la plus-
value, L'idologie allemande, les Manuscrits de 1844, et les Grundrisse taient inconnus du public
et des disciples, voire d'Engels lui-mme. Marx laissait une uvre manuscrite considrable; de
surcrot, son criture est fort difficile dchiffrer. Mais, peu peu, des ditions et traductions en
taient faites, au premier rang, celles qu'assurait Engels, qui en outre s'efforait de rditer la
plupart de leurs uvres anciennes.
53. L. d'Engels Lavrov, 12-17 novo 1875, L. sur les sciences, p. 85; MEW 34, p. 170. Parmi
les darwinistes sociaux figuraient des socialistes de l'Association Internationale des Travailleurs:
Lange, Lavrov, etc.
54. Ainsi, on tendit l'histoire un modle explicatif emprunt aux sciences naturelles alors
en plein essort. Cf. G. Molina, Darwinisme, Dictionnaire critique du marxisme, p. 281.
55. Nul n'tait mieux plac que lui pour fournir ces explications. Non seulement il avait
collabor constamment avec Marx pendant plus de quarante ans, mais il avait t le premier
concevoir les ides de base de la nouvelle thorie de l'histoire. Il connaissait la plupart des crits
non publis ou oublis de Marx (articles de revues et de journaux, et fascicules divers), ainsi
qu'une grande partie de sa correspondance. Beaucoup de manuscrits de Marx taient en sa
possession. Il tait en train de transcrire les plus importants, ceux des livres II et III du Capital,
qu'il put faire paratre en 1885 et 1895. Les rponses d'Engels ses correspondants sont donc des
plus prcieuses.
56. Avant d'envoyer ces lignes l'impression, j'ai ressorti et regard encore une fois le vieux
manuscrit de 1845-1846. Le chapitre sur Feuerbach n'est pas termin. La partie rdige consiste
en un expos de la conception matrialiste de l'histoire, qui prouve seulement combien nos
connaissances d'alors en hi;;toire conomique taient encore incompltes. (Ludwig Feuerbach,
pp. 2-3; MEW 21, p. 274). Evidemment, dans Le capital, et les Thories sur la plus-value, Marx a
normment progress dans cette voie. Mais, cela signifie-t-il que l'conomisme
y
serait plus
prononc? Engels ne le pense pas: leur concepti09 de l'histoire n'a pas vari, dit-il.
57. L. Joseph Bloch, 21 septembre 1890 (Etudes, p. 238; MEW 37, p. 463). Moment est
le terme hglien, couramment employ par Marx et Engels, pour dsigner un aspect d'une totalit
concrte, aspect qui n'en est pas sparable. Nous traduirons Moment par facteur, malgr les
inconvnients de ce terme, pour suivre l'usage; mais parfois, nous opterons pour moment.
58. Ibid.
-
Entre 1890 et 1895, dans ses lettres Conrad Schmidt, Franz Mehring, et
d'autres, Engels s'exprime dans les mmes termes.
59. Ibid.
60. Le rsultat auquel nous arrivons n'est pas que la production, la distribution, l'change,
la consommation sont identiques, mais qu'ils sont tous membres [Glieder] d'une totalit, des
diffrences l'intrieur d'une unit. (Introduction gnrale, Contribution, pp. 163-164; MEW 13,
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
75
pp. 630-631; Mthode, pp. 154-155. Trad. modifie. - Ce texte n'a t publi qu'en 1939, en tte
des Grundrisse).
, 61. En ajoutant que la production dborde [bergreift] aussi bien son propre cadre dans la
dtermination antithtique d'elle-mme que les autres moments [Momenle ], et que c'est partir
d'elle que recommence sans cesse nouveau le processus (ibid.), Marx ne parlait pas de
dtermination en dernire instance et n'cartait pas l'interprtation conomiste.
62. Il n'y a donc pas, comme on veut se l'imaginer, et l, par simple commodit, un effet
automatique [automatische Wirkung] de la situation conomique, ce sont au contraire les hommes
qui font leur histoire, mais dans un milieu donn qui la conditionne [...]. (L. du 25 janv. 1894;
Etudes, p. 254; MEW 39, p. 206).
-
Wirkung signifie: effet, rsultat, consquence.
63. Ibid., p. 253; p. 206.
64. L. J. Bloch, 21 sept. 1890 (Ibid., pp. 239-240; MEW 37, p. 464).
65. Au XIX. sicle, l'application du calcul des probabilits en physique, en sociologie, en
conomie, montrait qu'on pouvait dgager des lois gnrales pour les phnomnes de foules. Les
facteurs constants et les facteurs variables alatoires se laissent distinguer grce quelques
hypothses simples, tires, soit de considrations sur des proprits telles que la symtrie, la
rptition et la frquence relative des cas possibles, soit de l'observation empirique. Les enqutes
statistiques fournissaient de telles constantes ou permettaient du moins' de les supposer par
approximation ou extrapolation. Quand nous tudierons la notion de moyenne, nous verrons que
Marx avait une claire conscience des difficults thoriques intrinsques cette notion lorsque
l'on
passe de son application en conomie son application en histoire.
'
66. Sauf quand on veut le prouver dans tel cas concret: il y faut alors les recherches
empiriques et historiques correspondantes.
67. L. Borgius, 25 janvier 1894, tudes, p. 254; MEW 39, p. 206. Trad. modifie. La
traduction des ditions sociales dit: ncessit complte et manifeste par le hasard [die
Notwendigkeit, deren Erganzung und Erscheinungsform die Zufiilligkeit ist].
- D'autre part, notons
bien qu'Engels lie cette vue sur les rapports entre hasard et ncessit aux socits de classes. Cela
laisse entendre que, dans des socits sans classes, le facteur conomique ne serait plus prvalent,
que les rapports entre ncessit et hasard seraient alors changs, dpasss, que la ncessit ne se
manifesterait plus sous la forme du hasard. .
68. Cf. Ludwig Feuerbach (d. bi!.), pp. 82-83; Etudes, p. 210; MEW 21, p. 293 (soulign par
nous).
-
Dans la mme page, on lit: Finalement, malgr tous les hasards apparents et tous les
retours momentans en arrire, un dveloppement progressif finit par se faire jour. (Ibid., pp.
84-
8~; p. 211; p. 293. Trad. modifie.) Quelques lignes plus bas, les ditions franaises antrieures
(Etudes, p. 217; MEW 21, p. 298) commettaient un vritable contresens, introduisant le quiproquo
dterministe, en traduisant bewegenden Ursachen par causes dterminantes, et bewegende
Machle par puissances dterminantes, alors que l'original allemand dit littralement: causes
motrices et puissances motrices (celles qui mettent en mouvement).
69. Dans le deuxime paragraphe de ce chapitre (supra pp. 43-52).
70. Contribution, pp. 4-5; MEW 13, p. 9.
-
De mme, dans Le capital, il soulignait que
l'galit et la libert juridiques <en droit) jouaient un rle adjuvant, ou mieux un rle intgrant,
dans l'conomie capitaliste.
71. Ibid., p. 5; p. 9.
72. Le capital, t. l, pp. 19-20; MEW 23, pp. 15-16. Quoi que puisse faire l'individu;
l'affirmation est forte: c'est la formule du fataliste! Dans le texte allemand, Marx disait d'une
manire assez diffrente: quand bien mme il [l'individu] parviendrait s'lever, subjectivement,
au-dessus de ceux-ci [les rapports sociaux]. (Trad. Lefebvre, p. 6; MEGA, II/5, p. 14,!. 11-12;
texte inchang dans les ditions ultrieures de Marx ou d'Engels). Qui a introduit en franais
l'expression favorite du fataliste, Marx ou Joseph Roy? Comme Marx a parfois utilis ce genre de
formule ailleurs, on peut penser qu'elle figure ici avec son accord.
73. Marx fait l'loge de Kaufmann qu'il cite longuement: En dfinissant ce qu'il appelle ma
mthode d'investigation avec tant de justesse, et, en ce qui concerne l'application que j'en ai faite,
tant de bienveillance, qu'est-ce donc que l'auteur a dfini, si ce n'est la mthode dialectique? (Le
capital, t. 1, pp. 28-29; MEW 23, p. 17; trad. Lefebvre, p. 27.)
74. Ibid., p. 27; p. 16; pp. 25-26. Trad. modifie. Nous n'hsitons pas nous fonder sur cette
prsentation des ides de Marx par Kaufmann, tant donn que Marx l'avalise sans rserve.
75. Sous une forme plus prononce, c'est ce que confirme le diffrend qui opposa les
marxistes au tournant du xx. sicle (opposition dj voque ci-dessus, p. 40).
76. tudes, p. 239; MEW 37, pp. 463-464.
77. Le capital, t. 2, p. 59, n. 2; MEW23, p. 393. Trad. modifie. - La mthode matrialiste,
76 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
voie inverse de la voie ordinaire, est difficile. Marx ne cesse de rpter que les chemins de la
science sont difficiles: Il n'y a pas de route royale pour la science et ceux-l seulement ont chance
d'arriver ses sommets lumineux qui ne craignent paS de se fatiguer gravir ses sentiers
escarps. (L. Maurice Lachtre, 18 mars 1872; ibid., t. 1, p. 44; Lettres sur Le capital, p. 266;
MEW 33, p. 464). De mme, il prvient ses lecteurs: Dans toutes les sciences le commencement
est ardu. (Le capital, t. 1, p. 17; MEW 23, p. Il).
78. Marx lut De la religion, de B. Constant, et Du culte des dieux ftiches, de De Brosses, en
1842. (Cf. ses extraits de lectures, MEGA, IV/l, pp. 342-367, et 320-329).
79. L'idologie (1968) p. 51; (1976) p. 20; d. bil., pp. 72-73; MEW 3, p. 26.
80. Le dterminisme conomique de Karl Marx, de Paul LAFARGUE (op. cit.) avait pour sous-
titre: Recherches sur l'origine et l'volution des ides de justice, du bien, de l'me et de Dieu".
Mme l'essai de Lassalle dans le domaine du droit (Das System der erworbenen Rechts. Eine
Versohnung des positiven Rechts und der Rechtsphilosophie [Le systme du droit acquis: Concilia-
tion du droit positif et de la philosophie du droit], Leipzig, 1861, in-8) ne trouve pas grce aux
yeux de Marx (Cf. Lettres Lassalle, Il juin et 22 juillet 1861, Correspondance, t. VI, pp. 337, 362-
364; MEW 30, pp. 607, 613-615). Mais, il n'y a pas chez Marx, sauf remarques incidentes et
fragmentaires, d'exemple de ce qu'il aurait fallu faire.
8!. Ce sont les ouvrages clbres sur: Les luttes de classes en France, 1848-1850; Le dix-huit
brumaire de Louis Bonaparte, et La guerre civile en France, 1871.
82. On a vu Sartre opposer ainsi Engels Marx. Georg Lukacs (Qu'est-ce que le marxisme
orthodoxe, in Histoire et conscience de classe, Trad. par K. Axelos et J. Bois, Paris, d. de Minuit,
pp.
20-21 et passim) l'avait prcd en mettant particulirement en cause la Dialectique de la
Nature.
83. M. Colletti, renchrissant sur Lukacs et Sartre, voit un abme entre la rigueur et la
complexit qui caractrisent toute page de Marx, et la vulgarisation populaire, voire par moments
le dilettantisme des uvres d'Engels. (Il marxismo e Hegel [Le marxisme et Hegel], Bari, 1969,
p. 97). En 1974, revenant sur ce jugement pour le nuancer, il le maintient en substance, invoquant
d'anciennes remarques de Gramsci qui faisaient dj porter Engels une lourde responsabilit
dans la transformation de la pense de Marx en un systme: L'origine de nombreuses
propositions discutables contenues dans le Manuel (de Boukharine) doit tre recherche dans
l'Anti-Dhring et dans la tentative trop extrieure et formelle pour en tirer un systme de concepts
autour du noyau originaire de la philosophie de la praxis, qui satisfasse au besoin scolastique de
compltude. (Cit par Colletti, Politique et philosophie, Paris, d. Galile, 1975, p. 29, n. 3.) Nous
ne pouvons qu'voquer ce procs fait Engels; son examen sort du cadre de notre travail. Le
Manuel en question est La thorie du matrialisme historique: Manuel populaire de sociologie
marxiste (Ire d., Moscou, 1921; tr. fr., Paris, Anthropos, 1967,358 p.).
84. Ils ont prpar tous leurs ouvrages en commun; en particulier, Marx a envoy son ami
les preuves d'imprimerie du Capital. Engels lui exprimait son sentiment et lui donnait des
conseils. De 1844 1870, ils ont discut de tous les vnements, de leurs lectures, de leurs activits,
et de leurs projets dans un change pistolaire ininterrompu, et, au besoin, ils se rencontraient.
Aprs l'installation d'Engels Londres, le 20 septembre 1870, leurs rencontres devinrent presque
quotidiennes. Ils se sont toujours partag les tches dans une vritable division du travail.
85. Engels s'est expliqu d'une faon prcise et dtaille sur son travail d'dition des
manuscrits de Marx (cf. Le capital, t. 6, Prface, pp. 8-13; MEW25, pp. 8-15). M. Rubel est svre:
Nous devons souligner le dfaut majeur de son entreprise: il donne l'apparence d'uvres
acheves des pages souvent informes et mal rdiges, matriau d'un travail dont Marx lui-mme
disait qu'il fallait encore le complter, voire l'crire. Malgr cette accusation, M. Rubel, sans
remarquer qu'il dtruit ainsi ses propres arguments, crit plus loin: Nous n'aurons garde de lui
reprocher aucune infidlit dans l'tablissement des textes (MARX, uvres, d. Rubel, t. 2,
p. XI).
86. Nous appelons ainsi les pages les plus clbres, habituellement cites par les commenta-
teurs et qui figurent dans les ditions d'uvres choisies de Marx et d'Engels.
87. Le capital (trad. Lefebvre), p. 187, n. 37 in fine; MEW 23, pp. 180-181; ES, t. l, p. 169,
note.
-
Nous rencontrons ici la question de la possibilit du capital! C'est une des grandes
questions laquelle Marx apporte une rponse neuve en conomie.
88. Ibid.
89. Ibid., t. 6, p. 222; MEW 25, p. 219. Ailleurs, il demande dans quel sens tendent en
dernire instance les fluctuations [...] (ibid., p. 185; p. 178).
90. Manuscrits de 1857-1858, t. I, p. 432-433; Gr., p. 395. L'expression in der letzter Instanz
fait partie de la langue courante en allemand, au sens de finalement . Marx l'emploie aussi en
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
77
ce sens: au sujet de la composition du capital social d'un pays, il annonce que c'est de celle-ci
exclusivement, en dernire instance, qu'il sera maintenant question. (Le capital, trad. Lefebvre,
p. 687; ES, t. 3, p. 55; MEW23, p. 641.)
91. L'on excusera la longueur de la citation vu son importance pour trancher la question
d'une prtendue divergence du vieil Engels par rapport Marx.
92. Le capital, t. 8, p. 172; MEW 25, pp. 799-800. (Traduction que nous avons modifie sur
plusieurs points, car celle des traducteurs - Mme Cohen-SalaI et M. Badia - change parfois
assez sensiblement le sens du texte allemand.)
-
Cette page est un morceau d'anthologie. Elle
montre une pense plus souple et nuance qu'on ne pense gnralement.
93. Mme Cohen-Solal et M. Badia (ibid.) ont traduit Hauptbedingungen par conditions
fondamentales au lieu de conditions principales , qui nous parat plus exact pour rendre la
pense de Marx. Fondamental>. risque d'tre entendu dans le sens d'une interprtation
fondamentaliste, c'est--dire ici du rductionnisme conomiste.
94. Cf. ci-dessus, pp. 49-50. Mme chose dans l'Introduction de 1857 (cf. ci-dessus, p. 53,
n.60).
95. Dans le dtail de ses dveloppements, Marx s'attarde souvent sur les causes de cette
diversit des formes politiques et sociales dans le cadre d'un mme mode de production. Dans la
page que nous venons d'analyser, ces causes se trouvent regroupes et rsumes: c'est pourquoi
elle peut ~uffire notre dmonstration.
96. Etudes, pp. 252-253; MEW 39, p. 205.
97. Ibid., p. 253; p. 206. Cette mention de la race parmi les facteurs qui conditionnent la
diversit peut tonner chez des socialistes internationalistes. On doit la replacer dans le contexte
de l'poque. C'est une question dlicate de savoir si Marx et Engels ont partag l'ethnocentrisme
gnral de leur temps, et mme, en partie, l'antismitisme rpandu dans tous les milieux, y compris
socialistes, au XIX. sicle. Cependant Engels dnonce l'antismitisme de Dhring, et Marx et lui
sont fort loigns des thses de Gobineau. Ils n'attribuent pas aux caractres raciaux une influence
dterminante dans l'explication hi~torique. Engels ne les mentionne pas dans L'origine de la
famille, de la proprit prive et de l'Etat, et lorsque Marx caractrise les peuples, c'est par leur type
d'activit dominante (peuples commerants, nomades, agriculteurs, marins, etc.). II reste qu'ils
mentionnent la race parmi les facteurs historiques.
98. L. C. Schmidt, 5 aot 1890. Ibid., p. 236; MEW 37, pp. 436-437.
99. Cf. la note du chapitre XV du Capital dj analyse (ci-dessus, pp. 59-60, n. 77 80).
100. Ses lectures historiques taient considrables. Elles portaient sur les sujets les plus
divers, de la Rvolution franaise aux histoires du commerce ou des mtiers, de la monnaie ou de
la diplomatie, etc. II connat les historiens les plus anciens comme les plus actuels.
101. ENGELS, Contribution l'histoire du christianisme primitif, in Sur la religion, pp. 310-
338; M.:W 22, pp. 445-473. Ses autres travaux figurent dans L'origine de la famille, de la proprit
et de l'Etat,
pp. 171-285.
102. L. J. Bloch, 21 septembre 1890, tudes, p. 240; MEW 37, p. 465.
103. Cf. ci-dessus, p. 60, n. 81.
104. tudes, p. 241; MEW37, p. 465.
105. Engels a dmasqu Loria deux reprises, en 1883, dans le
n
21 du journal Der Social-
demokrat (Le social-dmocrate) (cf. MEW 19, pp. 346-347), et en 1895, nouveau, dans la Prface
au Livre III du Capital (t. 6, pp. 20-23; MEW 25, pp. 25-28). Dans une lettre Plkhanov (26 fv.
1895), il voque ,d'illustre Loria (L. sur Le capital, p. 415; MEW 39, p. 417).
106. LNINE, tudiant Hegel en 1914, le note: On ne peut pas comprendre totalement ,de
Capital de Marx et en particulier son chapitre premier sans avoir beaucoup tudi et sans avoir
compris toute la Logique de Hegel. Donc pas un marxiste n'a compris Marx un demi-sicle aprs
lui! (op. cit., p. 250, ou Cahiers philosophiques, t. 38 des uvres, Paris-Moscou, d. du progrs,
1971, p. 170).
107. Ici, nous sommes redevables l'excellent article: Determinism in History (Le dtermi-
nisme en histoire) de W. H. Dray, in Encyclopedia of Philosophy, vol. l, pp. 373-376. La
conception de Marx et Engels y est mentionne parmi beaucoup d'autres; W. H. Dray ne s'y
arrte pas particulirement. Ce sera au contraire notre objet de confronter le matrialisme
historique aux trois formes de dterminisme que cet auteur distingue comme suit: 1) Destin et
providence, 2) Invitabilit historique, 3) Dterminisme scientifique.
108. On le verra quand nous examinerons le concept d'histoire (cf. ci-dessous, chap. 5).
109. Aujourd'hui encore, l'histoire de l'apparition de ce terme dans le sens qu'il a
actuellement est assez mal connue. Les premiers lements de cette histoire figurent dans les
Observations sur Dterminisme du Vocabulaire philosophique de Lalande (pp. 221-224).
78 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
M. Lucien Brunelle en fournit beaucoup d'autres, dans sa Thse de Doctorat de Troisime Cycle
(Universit de Paris-Nanterre, non publie): L'invention et l'application du concept de dterminisme
par Claude Bernard (Introduction et Premire partie). M. Brunelle a compil et compar de
nombreuses sources, particulirement les Dictionnaires franais, allemands et anglais, ainsi que
les philosophes franais du XIX. sicle, en liaison avec l'origine du concept de dterminisme chez
Claude Bernard. Nous lui empruntons de nombreuses donnes.
110. Ce terme serait seul convenable, selon Claude Bernard, qui ne le retient cependant pas,
car, estime-t-il, ce nologisme savant ne serait pas accept par l'esprit de la langue franaise (cf.
Principes de mdecine exprimentale, Paris, Presses Universitaires de France, 1947, p. 265).
111. La religion dans les limites de la simple raison, Ire division ad fiDem. Il s'agit d'une
addition une note, faite lors de la deuxime dition en 1794. Kant donne le mot comme
fabriqu par d'autres, sans doute les wolffiens. - Cet ouvrage ne fut traduit en franais qu'en
1841 et 1842. M. Brunelle (op. cit., p. 32 et suiv.) donne la liste chronologique des ditions des
uvres de Kant et de leurs traductions. En 1840, dterminisme apparat, sous sa forme
franaise, dans la table alphabtique de l'dition des uvres de Leibniz publies par Johannes
Erdmann. On le trouve, deux ans plus tard, dans le Dictionnaire franais-allemand de Mozin,
Guizot, et al. (dition de 1842), au sens d'influence ncessaire et irrsistible des motifs. Enfin,
il apparat, naturalis en franais, dans le Dictionnaire philosophique de Bouillet (1854) qui le
dfinit: Systme philosophique qui explique tout par l'enchanement des causes et des effets,
admettant ainsi que tout y est dtermin l'avance: ce n'est qu'un autre nom du fatalisme (cit
par M. Brunelle, op. cU., pp. 2, 8, etc.). On voit que Bouillet confondait dterminisme, mcanisme
et fatalisme, pour les envelopper dans la mme rprobation, procd auquel ressemble beaucoup
celui des critiques de Marx que nous avons cits au dbut de ce chapitre. M. Brunelle tablit d'une
manire convaincante que l'objet principal de Claude Bernard tait prcisment de combattre
cette dfinition de Bouillet.
112. KANT, loc. cit.
113. Science de la logique, t. 2, p. 220. - Hegel l'oppose au finalisme, comme les causes
efficientes aux causes finales. III'identife au mcanisme, et le fait aussi synonyme de fatalisme
(ibid., p. 247)! R. Eucken le signalait chez Hegel sans donner de rfrence (cf. LALANDE,op. cit.,
p. 222, Observ.). De mme, Hegel crit: <<l'instinct n'a pas d'autre direction que son propre
dterminisme (Philos. du Droit, 9 17).
-
Les uvres Compltes de Hegel parurent partir de
1834; la traduction franaise de la Science de la logique attendra 1947-1949.
114. Diffrence, p. 231; MEWEB I, p. 276. Marx peut aussi avoir rencontr dterminisme
dans Rvision des principes et des concepts fondamentaux du droit pnal positif de P. J. A.
Feuerbach (1799). Dans une lettre son pre, le 10 novembre 1837, il dit avoir tudi cette uvre.
Par contre, il est peu probable qu'il l'ait relev dans l'dition des uvres de Leibniz par Erdmann
(1840), d'une part cause de la date de parution de celle-ci, d'autre part du fait que, dans sa Thse
et ses Cahiers prparatoires, comme dans les notes de lecture qu'il rdige en tudiant les uvres
de Leibniz Ganv.-mars 1841), il utilise l'dition Dutens (Genve, 1768). (MEW EB l, Index
bibliogr., p. 681, et MEGA 2, III, App., p. 1292, et IV/l, App., pp. 571 et 977). Les termes
dterminisme et dterministe apparaissent diverses reprises dans les Cahiers prparatoires
ou dans la Thse de Marx (Diffrence, p. 118, 170, 241, 244; MEW EB I, pp. 42 [das absolut
Deterministisch], 166 [Determinismus], 280 [das deterministische Sich-Treffen der Atome], 282
[Determinismus]). Signalons que dterminisme apparat aussi chez Bolzano
(Wissenschaftslehre und Religionswissenschaft [Thorie de la science et science religieuse], Sulz-
bach, 1837), ce qui montre que ce nologisme faisait peu peu son apparition dans la littrature
scientifique allemande.
.
115. DECHAMBRE,Dterminisme, in Dictionnaire encyclopdiques des sciences mdicales, sous
la dir. de A. Dechambre, tome 28, 1883 (cit par BRUNELLE, op. cU., p. 8).
Chapitre 2
LES LOIS
L'esprit des lois, c'est la proprit.
Simon LINGUET
Les possibilits dpendent bien videmment de l'existence de lois, et de la
nature de celles-ci. Or, dans Le capital il est beaucoup question de certaines
lois, les lois conomiques. C'est un ouvrage de thorie. Les lois qui y sont
envisages prsentent les caractres qu'on trouve dans toute thorie scientifi-
que: elles sont abstraites, thoriques, gnrales. Marx est le premier le
souligner. Nanmoins, bien qu'elles soient abstraites, il les dit aussi naturelles;
bien qu'elles soient thoriques, il les dit aussi objectives; bien qu'elles soient
gnrales, il les dit aussi historiques. Voil trois aspects contradictoires des lois
chez Marx.
Aprs quelques considrations gnrales concernant la problmatique des
lois, nous nous poserons donc les questions suivantes. En premier lieu, nous
nous demanderons en quel sens les lois conomiques sont dites naturelles
par Marx. Que faut-il entendre par nature quand il s'agit de phnomnes
conomiques ?
Deuximement, si les lois conomiques tudies dans Le capital sont
thoriques, sont-elles purement idelles? Nagure, M. Louis Althusser l'a
soutenu 1. Or, nous verrons que Marx les tenait pour inhrentes aux processus
conomiques eux-mmes. Illes dit alors naturelles en un autre sens que les lois
de la nature extrieure. La nature d'une chose, c'est son essence. N'est-ce pas
plutt ce que signifierait le mot nature dans lois naturelles de l'cono-
mie?
En troisime lieu, Marx soutient que les lois conomiques varient avec les
socits et les poques. Or, il parle parfois de lois conomiques absolument
gnrales, indpendantes des poques et des lieux. Dans une conception
historique, peut-il y avoir de telles lois gnrales?
Enfin et surtout, il parle aussi de soi-disant lois naturelles propos du
mode de production capitaliste, ce qui semble remettre en cause la notion
mme de lois naturelles de l'conomie, et fera apparatre la possibilit de
leur changement.
80 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
1. La problmatique des lois
Dcouvrir des lois universelles et ncessaires en conomie politique,
reconnatre l'tendue et l'empire de telles lois, tout comme on avait reconnu
l'existence de lois universelles et ncessaires dans la nature, c'est ce que les
conomistes modernes avaient fait avant Marx.
Comme les physiciens, les conomistes pensaient que de telles lois
devaient tre immuables et ternelles. Or, pour Marx, les lois conomiques
sont variables: elles changent historiquement. Cela n'empche pas qu'elles
s'imposent aux hommes malgr eux. Des ncessits conomiques sont la base
de l'histoire humaine. En rsulte-t-il que le cours de l'histoire soit ncessaire?
S'il y a un jeu des possibles dans l'volution biologique2, n'yen a-t-il pas un
dans l'volution historique? Marx se dit proche de Darwin. Tient-il la
possibilit historique pour une simple apparence subjective? Faudrait-il
concevoir le comportement des hommes l'image de celui que s'imagine avoir
le rveur ou de celui que nous voyons chez le somnambule3? L'action
consciente et finalise des pratiques humaines n'a-t-elle pas son rle en
histoire ?
Marx parle beaucoup des lois conomiques qu'il assimile aux lois
naturelles4. Il met ainsi l'accent sur la ncessit conomique et le caractre
gnral des lois. Il n'y aurait donc place que pour une sorte de possibilit: la
possibilit abstraite, que dtermine la forme de ces lois.
L'un des mrites incontests de Marx est d'avoir repris l'examen appro-
fondi des lois dgages par ses prdcesseurs en conomie politique. Il a aussi
dcouvert de nouvelles lois conomiques et en a poursuivi l'tude d'une
manire trs dtaille avec une grande pntration. Surtout, il a entrepris
d'expliquer et d'exposer toutes ces lois dans le cadre d'un vaste systme
thorique et critique qui fait encore poque de nos jours 5.
L'ide de loi est celle d'une relation ncessaire et constante, du moins
suffisamment permanente pour qu'on la considre, dans certaines limites de
temps et certaines conditions dtermines, comme une relation constante. Or,
c'est une opinion gnrale que toute dcouverte de lois dans un domaine
quelconque y introduit ou y conforte un dterminisme, ft-il partiel.
Aussi, ce que Marx dit des lois en conomie est-il capital pour notre
propos. Les conoit-il, comme beaucoup l'ont soutenu, de la manire qu'on
vient de rappeler, issue des sciences de la nature, plus prcisment de la
physique?
Si c'tait le cas, le type de ncessit que la science moderne avait
dcouvert dans les phnomnes naturels s'tendrait aux processus conomi-
ques et de l au processus historique. Mais, de la nature l'conomie et de
celle-ci l'histoire la consquence est-elle bonne? C'est dans la nature des lois
conomiques qu'il faut chercher la rponse cette question.
y
a-t-il une dfinition de la loi conomique chez Marx, ou mme de la loi
LA POSSIBILIT ABSTRAITE 81
en tant que telle? Hormis dans une Introduction gnrale6, il nous laisse sur
notre faim. Il n'a pas crit sa Logique , bien qu'il en ait exprim l'intention:
Si jamais j'ai un jour de nouveau du temps pour ce genre de travail, j'aurais
grande envie, en deux ou trois placards d'imprimerie, de rendre accessible aux
hommes de bon sens, lefond rationnel de la mthode que H[egel] a dcouverte,
mais en mme temps mystifie 7.
Ce projet ne vit pas le jour. Toutefois, Marx dit s'tre servi de la
dialectique hglienne dans Le capital8. Mais, gardons-nous de l'appliquer
mcaniquement, de l'extrieur, au dtriment du contenu concret qu'il faut au
contraire avoir tudi fond pour se le rendre familier9.
Ne cherchons pas une dfinition formelle des lois chez Marx: A
proprement parler, on ne trouvera pas de dfinition de la loi conomique dans
Le capitallO , avoue un commentateur, M. Georges Dumnil.
Cependant, M. Dumnil pense trouver une dfinition incidemment, au
dtour d'une page du Livre III du Capital, o, propos du mot loi, Marx
remarque en passant: Je veux parler de cette connexion [Zusammenhang]
interne et ncessaire entre deux choses qui se contredisent dans les phno-
mnes apparents II.
Prenant la contradiction pour apparente, M. Dumnil interprte ainsi:
La loi est identifie une connexion - autrement dit un rapport -
qualifie de ncessaire. Marx dfinirait donc ici la loi en tant que rapport
ncessaire , une formule en elle-mme assez banale 12.
Si c'tait tout ce que Marx avait voulu dire ici, ce serait en effet trs
commun. Mais la loi dont il s'agit, elle, n'est pas banale! Ce n'est pas une loi
conomique quelconque, mais la loi de la baisse tendancielle du taux de profit
qui prside au destin de tout le systme social capitaliste 13.
De quoi s'agit-il dans cette page du Capital? Marx explique que la mme
cause (la mise en uvre d'un capital accru) peut produire deux effets opposs:
l'augmentation de la masse du profit et la baisse de son taux, ce qui conduit
finalement au dveloppement de certaines contradictions. L'accumulation du
capital engendre deux consquences contraires. Les capitalistes et beaucoup
d'conomistes voyaient l une impossibilit, une mme cause ne pouvant
avoir, selon eux, des effets opposs et contradictoires.
Au contraire, ce rapport ncessaire entre deux aspects du mme processus
est, pour Marx, un rapport interne, une interdpendance: un Zusammen-
hang, c'est--dire l'action rciproque des moments d'un tout. Marx utilise ici
des termes et des ides qui viennent tout droit de Hegel. Or, M. Dumnil
ramne cette conception dialectique une dfinition formelle, affectant
d'ignorer son origine et son sens philosophiques.
D'autre part, la loi en question est complexe: elle laisse place de
multiples possibilits que Marx envisage. Si le mobile du capital est la
recherche du profit, et d'un profit toujours plus grand, s'il s'accrot ainsi
continuellement, on peut constater qu' il est tout aussi possible que le capital
augmente sans que s'accroisse la masse du profit et [...] il peut mme
82 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
augmenter encore alors qu'elle baisse 14. Il en va de mme pour le taux du
profit. Toutes ces variations thoriquement possibles se constatent
empiriquement. La loi, dans son nonc gnral, reste une loi abstraite, et
toutes ces possibilits sont aussi des possibilits abstraites, tant que l'on ne
considre pas un pays dtermin, une priode dtermine, un capital dter-
min, bref une histoire concrte.
Mais est-ce le cas de toutes les lois? La dfinition retenue par M. Dumnil
ne s'appliquerait-elle pas mieux des lois conomiques plus simples? Avant
d'aborder une loi comme celle-l - la loi fondamentale du systme de
production capitalste, la loi de son mouvement d'ensemble qui est un
processus contradictoire -, il nous faudrait comprendre quelle sorte de
ncessit caractrise les lois conomiques en gnral pour Marx.
Or, grande est la varit des lois que l'on trouve dans son uvre.
Certaines sont fort clbres, au moins par leurs noms: loi de la valeur, loi de
la valorisation (plus communment dsigne comme loi de la plus-value,
absolue ou relative), loi de la baisse tendantielle du taux de profit.
D'autres sont moins familires, et il y en a de toutes sortes: lois de
l'change, lois du cours de la monnaie, loi de la baisse de valeur des objets
d'utilit, loi de l'accumulation capitaliste, lois des cycles (cycles des marchan-
dises, cycles de l'argent, cycles du capital), lois de dveloppement propres
chaque formation socio-conomique.
Enfin, il existe, selon Marx, des lois absolument universelles et nces-
saires, indpendantes des formes de socits envisages: les lois de la produc-
tion en gnral1s.
C'est presque chaque page du Capital que Marx parle de lois. En tenter
une numration exhaustive est une tche difficile 16.Elle ne prsente d'ailleurs
d'intrt qu' condition d'y mettre un certain ordre. Mais lequel? Ces lois sont
extrmement varies. Ces varit nous plonge dans l'embarras: sont-elles
toutes de mme nature? Comment les classer?
Selon M. Dumnil, il y aurait essentiellement deux sortes de lois pour
Marx, des lois conceptuelles internes et des lois de champs pluriconcep-
tuelS. Les premires dfiniraient des rapports absolument ncessaires au sein
d'un certain champ thorique circonscrit par un concept, par exemple le
concept de valeur. Elles constitueraient des dterminations ncessaires.
Les secondes, au contraire, feraient intervenir des causes externes par
rapport ce champ thorique. La dtermination serait alors seulement
contingente. Par exemple, explique M. Dumnil, la longueur de la journe de
travail ne prsente aucun caractre de ncessit. Elle dpend de causes externes
la loi de la valeur et aux lois de la plus-value absolue et relative. Elle rsulte
de l'issue variable de la lutte entre les ouvriers et les propritaires des moyens
de production, de la concurrence des premiers entre eux et des seconds entre
eux, et de quantit d'autres facteurs infiniment varis 17.
M. Dumnil aboutit la conclusion suivante: L'action d'une loi
conceptuelle exprime ce qu'il y a de ncessaire dans le processus, et l'influence
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
83
des causes extrieures multiples et varies, indpendantes les unes des autres,
rend compte de ce qu'il y a de contingentIB.
Cette distinction est intressante. Elle rompt avec le dogmatisme cono-
mique. S'appuyant sur de nombreux passages du Capital? M. Dumnil montre
que la vie conomique n'est pas le domaine d'une ncessit absolue: y
intervient une large part de contingence. Nous le suivrons sur ce point.
Cependant, sa distinction entre ncessit conceptuelle et contingence
historique ne saisit pas la vritable pense de Marx, qui n'en reste pas de
simples dichotomies, mais dcle des contradictions dialectiques.
Par sa dmarche analytique, M. Dumnil ne prend gure celles-ci en
compte. La lecture du Capital qu'il propose ne dpasse pas l'opposition entre
une ncessit thorique et une contingence empirique. Dans sa terminologie
particulire, il dit du champ pluriconceptuel: Un tel 'champ runit les
ncessits internes d'une totalit conceptuelle structure [...] une dtermina-
tion emprunte une autre totalit logique. Le rapport externe prend ainsi
force de loi, mais chacun ressent aisment ici que la ncessit" de la liaison
ne cesse de s'amenuiser au fil de ces extensions 19.
En consquence, la contingence rgnerait dans l'histoire qui rsulterait
d'un concours de causes disparates2o. Que devient alors la ncessit conomi-
que qui s'impose aussi aux individus, par exemple dans la concurrence?
En fait, pour Marx, les rapports entre ncessit et contingence sont ceux
de deux contraires qui passent l'un dans l'autre et qui s'engendrent mutuelle-
ment. C'est ce que montrera l'tude des moyennes et des phnomnes de
compensation.
Il ne suffit donc pas de classer les lois conomiques en deux grands genres,
et de les subdiviser en espces et sous-espces. En procdant ainsi, on pourrait
rpartir les lois conomiques en fonction de leur plus ou moins grande
gnralit, selon qu'elles valent pour des priodes plus ou moins tendues, et
pour des sphres plus ou moins particulires de la vie conomique.
De cette manire, on trouverait d'abord les lois de la production en
gnral, en second lieu les lois caractrisant la formation socio-conomique
capitaliste, puis celles des principales branches de la production, ou celles qui
rgissent les diverses formes du capital, et ainsi de suite. On descendrait ainsi
de la plus grande gnralit, laquelle s'identifierait la ncessit la plus forte,
vers le plus particulier qui serait en mme temps le plus contingent.
Or, bien d'autres classifications sont galement nvisageables. Par exem-
ple, certaines lois sont des lois de structure, ainsi les lois de correspondance qui
lient forces productives et rapports de production, ou base et superstructures;
d'autres sont des lois de changement et d'volution: lois d'apparition, de
dveloppement et de disparition. On peut aussi distinguer entre les lois
relationnelles et les lois causales. Cette opposition cOncide-t-elle avec la
prcdente? On peut encore les classer en lois rgulatrices et en lois
tendantielles , types de lois galement frquents dans Le capital. Autre
84 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
opposition: il y a pour Marx des lois ternelles et des lois historiques et
transitoires.
Laquelle de ces classifications doit-on tenir pour la plus fondamentale?
Celle de M. Dumnil n'est que l'une de celles qui sont permises.
En fait, Marx ne se pose pas ce genre de problme formel, qu'il dpasse
d'emble: c'est une pluralit d'oppositions que l'on a affaire, une extrme
varit de lois, non seulement quant leur contenu, mais quant leur type
logique. Cette multiplicit dfie toute classification fixe, pour deux raisons:
premirement, ces lois forment des ensembles o elles sont interdpendantes;
deuximement, elles sont historiquement variables.
Finalement, la tentative de M. Dumnil se rvle insatisfaisante parce
qu'il ne retient que le caractre thorique, conceptuel, des lois21. Marx
parle parfois de concepts, par exemple du concept de capital. Mais, tout son
effort fut de comprendre et expliquer les lois relles des phnomnes.
Son but tait de comprendre la ncessit relle qui se manifeste sous la
forme phnomnale de la fortuit.
Les lois conceptuelles sur lesquelles M. Dumnil met l'accent sont
plutt les lois structurelles que les lois de dveloppement. Or, aux yeux de
Marx, ces dernires sont les plus essentielles. M. Dumnil part du postulat
inverse. D'ailleurs, notre connaissance, l'expression (dois conceptuelles ne
se trouve pas dans l'uvre marxienne. Par contre, Marx dit volontiers que les
lois conomiques sont naturelles22 .
S'il pense dialectiquement, il n'abolit pourtant pas les distinctions
plaisir. L'une des plus classiques est celle que l'on fait ordinairement entre les
lois de la nature qui sont totalement indpendantes de la volont humaine, et
les lois institues explicitement comme telles par les hommes (codes juridiques,
constitutions politiques, etc.).
Auquel de ces deux genres appartiennent les lois conomiques? En quoi
sont-elles naturelles , et en quoi relvent-elles des hommes et de leur action?
Rpondre cette question est fondamental, si, comme Marx, on s'assigne
comme but de changer le monde .
2. L'analogie entre lois conomiques et lois naturelles
Dans la Prface du Capital, Max parle des lois naturelles de la
production capitaliste23 . Dans le mme texte, pour dfinir sa manire de voir,
il compare les lois conomiques des lois naturelles: mon point de vue , dit-
il, est celui d'aprs lequel le dveloppement de la formation conomique de la
socit est assimilable la marche de la nature et son histoire24.
De mme, toujours dans cette Prface, il parle de la loi naturelle qui
prside au mouvement de la socit25 , par o il faut entendre que chaque
socit a sa propre loi de dveloppement, une loi qui lui est spcifique. Pour
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
85
la socit capitaliste, c'est la loi de la baisse tendancielle du taux de profit, celle
qui l'achemine sa perte et son dpassement dans une socit sans classes.
Ce ne sont pas seulement les lois de la socit capitaliste moderne que
Marx qualifie de naturelles . Dcrivant la structure sociale de l'Inde, il crit:
La loi qui prside la division du travail de la commune fonctionne ici [en
Inde] avec l'autorit irrfragable d'une loi naturelle [...]26.
D'une part, une loi d'volution historique, celle qui rgit la socit
capitaliste et la conduit vers son destin: une rvolution sociale radicale qui
abolira dfinitivement le salariat et l'exploitation de l'homme par l'homme.
De l'autre, une loi structurelle qui rgit pendant des millnaires une socit
fige dans ses divisions sociales hrditaires; malgr les rvolutions politiques
qui agitent sa surface, l'Inde reproduit inlassablement des castes immuables.
Voil deux types de socits socialement et conomiquement trs diff-
rentes. Nanmoins, dans les deux cas, celui de la socit moderne aux
changements incessants et rapides, et celui d'une socit asiatique marque par
une immobilit quasiment ternelle, la loi fondamentale qui caractrise
chacune d'elles est dite naturelle .
Doit-on prendre cette qualification la lettre? Il convient en effet de faire
remarquer que Marx ne qualifie pas les lois conomiques de naturelles aussi
souvent qu'on le croit. Il ne le fait mme qu'assez rarement, mais dans des
occasions importantes, d'o l'impression qu'il le ferait constamment.
L'inventaire des occurrences du mot loi dans Le capital que
M. Dumnil a dress permet de corriger cette impression27. A le parcourir, on
s'aperoit que l'expression loi naturelle n'a souvent qu'un sens analogique.
Dans certains cas, elle est mme purement ironique. L'identification des lois
conomiques des lois naturelles n'intervient que dans des textes qui, comme
la Prface du Capital sont frappants. En effet, si Marx utilise trs souvent le
terme nature , et plus encore l'adjectif naturel , la signification de ces
vocables varie en fonction des contextes.
On sait le rle central que joue la loi de la valeur dans l'conomie
politique anglaise classique; dans sa thorie du mode de production capita-
liste, Marx la reprend d'une manire critique . Dans Le capital, cette loi, dite
loi de la valeur-travail par les conomistes28, est compare une loi
naturelle bien connue: la loi de la pesanteur. En quel sens Marx soutient-il que
cette loi soit naturelle?
Il se demande comment, dans une conomie o les produits s'changent
librement sur un march, les travaux privs, excuts indpendamment les
uns des autres [...] sont ramens leur mesure sociale proporitionnelle. Il
rpond: parce que dans les rapports d'change accidentels et toujours
variables [des] produits, le temps de travail social ncessaire leur production
s'impose par la force [gewaltsam] comme loi naturelle rgulatrice [ais regelndes
Naturgesetz], au mme titre que la loi de la pesanteur se fait sentir n'importe
qui lorsque sa maison s'croule sur sa tte29.
On remarquera, ici, que l'assimilation d'une loi conomique une loi
86 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
naturelle concerne son mode d'action. La manire dont elle s'impose, voil ce
qui l'apparente aux lois de la nature. Les agents conomiques, c'est--dire les
vendeurs et les acheteurs (au stade lmentaire de son analyse, Marx suppose
que les uns et les autres sont la fois producteurs et consommateurs), n'ont
pas pos cette loi volontairement par une convention ou un dcret dlibr. En
gnral, ils ne sont pas mme conscients de son existence! Mais ils en subissent
les effets, bons ou mauvais pour eux. La loi elle-mme reste inaperue et
insouponne. Aux yeux des protagonistes, la valeur des marchandises parat
provenir des proprits objectives des choses: Il semble qu'il rside dans ces
choses une proprit de s'changer en proportions dtermines comme les
substances chimiques se combinent en proportions fixes 30.
De nouveau, la loi de la valeur est compare une loi naturelle, qui, cette
fois, est emprunte au domaine de la chimie: la loi des proportions multiples,
dcouverte et nonce par Dalton au dbut du XIX. sicle31. Cette deuxime
comparaison concerne le contenu de la loi, savoir une composition substan-
tielle selon certains rapports prcis, soit entre des choses matrielles (les
atomes des substances chimiques), soit entre des valeurs (quantits de travail
reprsentes par des prix eux-mmes exprims dans les units conventionnelles
d'une monnaie). De mme que la loi des proportions multiples nonce que les
substances chimiques rsultent de la combinaison d'lments simples dont les
quantits sont en rapport arithmtique, la loi de la valeur nonce que les
changes de produits se font dans des proportions quantitatives dtermines,
l'unit de mesure tant l'heure de travail, un travail suppos de qualit et
d'intensit normales (moyennes).
Dans la comparaison prcdente, les agents conomiques n'taient pas
conscients de la loi; de mme ici ils n'ont pas conscience de ce qui dtermine
ces proportions, pas plus que nous ne percevons le nombre d'atomes des
substances chimiques lmentaires qui se combinent dans les molcules d'un
compos. Si on les interrogeait sur la valeur de leurs marchandises, les
changistes fourniraient les rponses les plus diverses. Ainsi, non seulement la
nature de la loi de la valeur, mais la manire dont elle agit et son existence
mme, chappent la conscience et par consquent la volont des agents
conomiques. C'est ce qui l'apparente aux lois de la nature.
Cela ne signifie cependant pas que les producteurs changistes n'y soient
pour rien. C'est l une diffrence essentielle par rapport aux lois de la nature.
La valeur est engendre par l'activit de travail. La loi de la valeur dcoule de
la manire de produire et d'changer, bien qu'elle ne soit pas elle-mme le but
conscient et voulu de l'activit. Mais l'activit des hommes a un but: ils ont
produit pour changer.
Ce qui est dit de cette loi telle qu'elle se prsente dans toute conomie
marchande, doit-il tre dit de toutes les lois conomiques, dans tous les
rgimes et en tout temps? Non, car cette loi suppose certaines conditions
particulires sans lesquelles elle n'existerait pas. Elle implique des producteurs
privs indpendants, petits producteurs individuels ou entrepreneurs nom-
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
87
breux proposant les mmes produits sur un march libre. La loi est alors une
consquence ncessaire de l'activit de producteurs privs et du mode
d'change qui s'ensuit. Les buts que ceux-ci poursuivent en changeant leurs
produits peuvent tre trs varis, et mme tout fait disparates. Pourtant la loi
en rsulte; mieux, elle rgit le march, mais de manire aveugle; telle est sa
similitude avec les lois naturelles, lesquelles s'imposent indpendamment des
dsirs ou de la volont des hommes, et sans qu'ils en aient forcment
conSCience.
La diffrence est que les lois de la nature existent sans le concours des
actions humaines, ce qu'on ne saurait dire des lois conomiques qui ne
peuvent donc tre identifies des lois naturelles: il y a seulement analogie.
Nanmoins, cette analogie est bien fonde. Elle autorise Marx assimiler la
marche de la socit celle de la nature! Le rapport de l'homme la nature
et celui de l'individu la socit sont homologues. Ds lors, le cours de
l'histoire ressemble celui des phnomnes naturels. Toutefois, cette compa-
raison prsente des caractres singuliers. Non seulement, Marx choisit des
conditions particulires: des petits producteurs indpendants, mais aussi des
circonstances remarquables: un accident! Qu'est-ce dire? Si la loi physique
de chute des corps existe, les hommes n'y sont pour rien. Mais, lorsqu'il s'agit
d'un accident, le rapport de l'homme la nature est particulirement
important. Le parallle entre loi de la valeur et loi de la pesanteur prend alors
tout son sens. En effet, l'accident provoque une prise de conscience. C'est
dessein que Marx choisit un exemple o la loi de la pesanteur agit directement
sur l'homme qui en subit les effets! Cette circonstance force cet homme
prendre conscience de la loi elle-mme: parce qu'il en est victime! Si une
maison s'croule sur son occupant, celui-ci va soudain s'apercevoir de son
poids, de sa vtust, etc., ce dont, jusque-l, il ne s'tait jamais souci. Il ne
saisit pourtant pas pour autant les voies par lesquelles a pu se produire ce
fcheux vnement.
L rside la pertinence de l'analogie. Le petit producteur indpendant qui
veut changer ses produits se trouve dans une situation identique" celle de la
victime d'une loi naturelle. Ses pertes surviennent d'une faon inattendue et
incomprhensible pour lui. Un jour comme les autres, sans savoir comment ni
pourquoi, il se dcouvre ruin. Sur le march o il vient d'habitude, la valeur
de ce qu'il fabrique a soudain chut alors que rien ne le laissait prsager: il
a travaill dans les mmes conditions, produit les mmes choses, de la mme
manire, en y consacrant le mme temps, les mmes forces et les mmes
ingrdients. Mais voil des circonstances singulires: un effondrement du
march.
L'exemple de la maison qui s'abat inopinment sur son occupant est une
parabole. Que l'accident soit naturel ou social, il force celui qui le subit
prendre conscience de l'existence d'une loi qu'il ignorait. Notre homme est
amen par la force des choses s'interroger sur les causes de l'accident, et
dcouvrir l'existence et la nature de la loi.
88 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Pour que les protagonistes et les conomistes eux-mmes finissent par
dcouvrir une loi conomique cache comme la loi de la valeur, il.a fallu que
des accidents se soient produits: des crises conomiques! Si aucun accident
n'tait possible, ni n'tait survenu, aurait-on dcouvert, tudi et analys la
loi? La science est fille de l'tonnement a dit un sage32. Marx complte cet
aphorisme: l'tonnement est lui-mme fils de la pratique.
La prise de conscience d'une loi ne provient pas d'une facult d'tonne-
ment dsintresse et gratuite. Ce sont les ncessits et les consquences
pratiques qui obligent l'homme rflchir sur les causes des vnements qui le
touchent. Marx rejette la thorie idaliste classique selon laquelle la connais-
sance aurait pour origine une curiosit tout intellectuelle, ou un besoin inn
de l'esprit humain 33. C'est parce que les hommes sont confronts des
tches pratiques que la science fait son apparition. L'analogie entre loi de la
valeur et loi de la pesanteur renvoie des tches d'ordre vital: reconstruire une
habitation plus solide, s'assurer de meilleurs moyens d'existence en changeant
les rapports socio-conomiques.
Dans les deux cas, la pression de la ncessit amne prendre conscience
des lois objectives. La loi de la valeur, que Marx analyse au dbut du Capital,
possde un caractre de ncessit objective comme les lois de la nature. Elle
s'impose, qu'on en ait conscience ou non, qu'on le veuille ou non, tant que les
conditions de production sont celles d'une conomie marchande et qu'il y a
une pluralit de petits producteurs pour chaque marchandise.
Toutefois, ce n'est qu'une analogie, qui, comme toute analogie a ses
limites. Les analogies sont sources d'illusions et d'erreurs. Marx les dnonce
souvent:
On a donn le nom de capital du travailleur sa puissance de travail
[...J. Si l'on s'en tenait cette dfinition, tout fonds constitu des processus
rpts d'un seul et mme sujet serait du capital; ainsi, par ex.: la substance
de l'il serait le capital de la vision, etc. Ce genre de littrature, qui range
tout sous n'importe quoi en fonction d'une quelconque analogie, peut mme
paraitre spirituel lorsqu'on l'entend pour la premire fois et ce, d'autant plus,
qu'il ramne l'identit les ralits les plus disparates. Rptes et, qui plus
est, rptes de faon autosatisfaite comme des noncs valeur scientifique,
ces grandes phrases sont tout bonnement des niaiseries 34.
Voici deux analogies particulirement superficielles:
Comparer l'argent au sang - c'est le terme de circulation qui en a
fourni l'occasion ...:- est peu prs aussi juste que l'apologue de Menenius
Agrippa comparant les patriciens l'estomac. Comparer l'argent au langage
n'est pas moins faux. [...J Les ides n'existent pas spares du langage. Des
ides qu'il faut commencer par traduire de leur langue naturelle en une
langue trangre pour qu'elles aient cours, pour qu'elles soient changeables,
prsentent dj plus d'analogie [avec les pris des marchandises]; mais alors
l'analogie rside dans leur tranget, pas dans la langue35.
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
89
Souvent, dans une analogie, la diffrence n'est pas moins importante que
l'identit: ce peut tre une diffrence d'essence! Malgr les nombreuses
analogies et les rapports qui existent entre la division du travail dans la socit
et la division du travail dans l'atelier, il y a cependant entre elles une diffrence
non pas de degr, mais d'essence36.
De mme, Marx relve le vice cach des analogies historiques:
(d'espre que cet ouvrage [Le dix-huit brumaire de Louis Bonaparte]
contribuera carter le terme couramment employ aujourd'hui, particuli-
rement en Allemagne, de csarisme. Dans cette analogie historique superfi-
cielle on oublie le principal, savoir que, dans l'ancienne Rome, la lutte de
classes ne se droulait qu' l'intrieur d'une minorit privilgie, entre les
libres citoyens riches et les libres citoyens pauvres [...]. tant donn la
diffrence complte entre les conditions matrielles, conomiques de la lutte
des classes dans l'antiquit et dans les temps modernes, les formes politiques
qui en dcoulent ne peuvent pas avoir plus de ressemblance entre elles que
l'archevque de Canterbury avec le grand prtre SamueI37."
Quand nous voyons Marx user son tour d'analogies, il faut en
dterminer le sens exact. Or, dans le cas de la loi de la valeur, il critique
justement le ftichisme de la marchandise38 . Le capital n'est pas une
chose, rpte Marx, mais un rapport social: il en est de mme de la valeur.
Qualifier la loi de la valeur de loi naturelle doit donc tre relativis.
Elle n'apparat comme telle que dans le cadre de certaines conditions socio-
conomiques. Dans d'autres conditions: communauts primitives, branches
de production o existe un monopole, production concerte par branches
(corporations, coopratives de production), ou conomie planifie d'une
socit socialiste, la loi de la valeur ne s'impose plus comme une loi
naturelle , c'est--dire aveuglment. Le contexte indique donc les limites de
l'analogie.
En ce qui concerne la loi de la valeur comme loi naturelle , ce qui
importe selon Marx, c'est le phnomne essentiel de rification de la valeur
dans un systme o les producteurs privs individuels produisent indpendam-
ment les uns des autres. Alors, l'galit des travaux humains revt la forme
chosifie [sachliche Form] de valeur objectivement gale des produits du
travail39.
Cette galit entre des travaux qualitativement divers est tablie d'une
manire force, extrieure aux individus. Marx dit des grandeurs de valeur des
produits qu'elles changent constamment, indpendamment de la volont, des
prvisions et des actions des changistes. Leur propre mouvement social
possde aux yeux de ces derniers la forme d'un mouvement des choses qui les
contrlent au lieu d'tre contrles par eux4o. C'est par l'intermdiaire du
march que la loi de la valeur agit et s'impose comme" une loi naturelle
rgulatrice .
90 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Une autre donne du contexte montre qu'il ne faut pas prendre l'analogie
.
entre lois conomiques et lois naturelles la lettre. Marx renvoie Engels qui
avait parl, avant lui, de loi naturelle au sujet d'une autre loi conomique
fameuse: la loi de l'offre et de la demande. Dans un article publi en 1844, le
jeune Engels faisait remarquer que l'offre et la demande ne se recouvraient
jamais, bien qu'une certaine compensation s'tablt travers leurs oscillations
sur le march.
Cette <<loi" tait prsente par beaucoup d'conomistes comme natu-
relle", c'est--dire ncessaire, ternelle. Engels soutenait qu'elle ne conduisait
nullement un quilibre harmonieux, comme ils le prtendaient. Bien au
contraire, c'tait un passage continuel de l'excitation l'abaissement", des
oscillations perptuelles". La plupart des conomistes croyaient que cette loi,
livre son cours naturel", devait empcher les crises qu'avait connues
l'Ancien Rgime. Les faits montraient l'inverse: des crises de surproduction, la
misre dans l'abondance!
En ralit, dit Engels, cette loi suppose amener 1'harmonie" ne rgne
qu'au moyen des crises", qu'elle n'empchait pas d'clater, malgr les efforts
des hommes politiques et des industriels. La rptitions de ces crises, surtout
depuis 1817, avait frapp les thoriciens41. Peu d'entre eux russissait les
expliquer 42.
tant donn l'essor de la production grande chelle, une telle loi aurait
d tout rguler pour le mieux dans le meilleur des mondes. Engels se
demandait quel genre de loi c'tait, puisque les crises n'en survenaient pas
moins priodiquement. Il rpondait qu'elle agissait justement en tant que loi
naturelle
43.
Cette loi, avec sa compensation permanente o ce qui est perdu ici est
regagn l-bas, l'conomiste la trouve admirable [...]. Et pourtant il est
manifeste que cette loi est une pure loi naturelle et non pas une loi de l'esprit.
Une loi qui engendre la rvolution. L'conomiste vient avec sa belle thorie
de l'offre et de la demande, il vous dmontre qu'on ne peut jamais trop
produire et la pratique [Praxis] rpond avec les crises commerciales qui
reviennent aussi rgulirement que les comtes et telles qu'en moyenne nous
en avons une tous les cinq sept ans. Ces crises commerciales se sont
produites depuis quatre-vingts ans avec la mme rgularit que les grandes
pidmies de jadis, et elles ont amen plus de misre, plus d'immoralit que
celles-ci. [...] Naturellement, ces rvolutions commerciales confirment la loi,
elles la confirment au plus haut point mais d'une autre manire que
l'conomiste voudrait nous le faire croire44.
Et Engels de conclure:
Que doit-on penser d'une loi qui ne peut s'tablir qu'au moyen de
rvolutions priodiques? C'est justement une loi naturelle qui repose sur
[aufberuht] l'inconscience des intresss 45.
LA POSSIBILIT ABSTRAITE 91
A-t-on jamais dit d'une loi naturelle qu'elle reposait sur l'inconscience
des hommes? Or, c'est bien ce qu'Engels dit littralement de la loi de l'offre et
de la demande.
Malgr son tranget, cette affirmation se justifie. Engels expliquait, en
effet, que la loi s'impose prcisment [eben] comme <<loinaturelle , parce
que les producteurs isols restent inconscients de l'tat des besoins des
consommateurs et des produits offerts par leurs concurrents: L'offre suit
toujours immdiatement la demande mais ne parvient jamais la couvrir
exactement, [...] elle ne correspond jamais la demande parce que dans cet
tat d'inconscience de l'humanit personne ne sait le volume de celle-ci ou de
celle-l 46.
Engels accusait l'anarchie de la production, qui fait loi dans un systme
conomique concurrentiel constitu de petits producteurs indpendants:
Si les producteurs comme tels savaient de combien les consommateurs
ont besoin, s'ils organisaient la production, s'ils la rpartissaient entre eux,
les oscillations de la concurrence et sa tendance la crise seraient impossi-
bles47.
Au fond, Engels disait dj que les lois conomiques rsultent de certains
rapports sociaux. Elles apparaissent aux individus indpendants comme des
lois fondes dans la nature des choses . Ainsi que le dira Marx ds que la
proportion dans laquelle les produits s'changent entre eux a acquis une
certaine fixit habituelle, elle [la valeur] leur parat provenir de la nature mme
des produits du travail48 .
La loi de la valeur, qui est fondamentale dans toute conomie de march,
s'impose d'autant mieux comme une loi naturelle qu'elle reste inconsciente et
mconnue.
Pourtant, les lois conomiques ne peuvent tre dites naturelles que cum
grano salis. Elles prsupposent un systme conomique dtermin o rgnent
certains rapports sociaux: des producteurs assez nombreux et indpendants,
c'est--dire la proprit prive et un march libre. L, les lois conomiques
s'imposent comme les lois de la nature. Ainsi, elles sont identiques celles-
ci, puisqu'elles sont contraignantes et agissent aveuglment; et pourtant, elles
ne leur sont pas identiques, puisqu'elles rsultent de rapports sociaux qui ne
sont pas naturels!
En tant qu'elles s'imposent comme de l'extrieur par la concurrence de
producteurs-consommateurs indpendants, les lois conomiques dans la
socit capitalisate n'manent pas de l'intelligence et de la volont. Voil ce
que beaucoup ne purent admettre. Gabriel Tarde s'insurgeait contre le
prjug la mode selon lequel les faits gnraux de la vie sociale seraient
rgis non par des volonts et des intelligences humaines, mais par des mythes
appels lois naturelles49 . Les rapports sociaux et les rapports de proprit
seraient-ils mythiques?
92 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
3. Nature au sens d'essence
Marx dnonce les dfauts du mode de production capitaliste qu'il
considre comme l'un des plus contre-nature qui soit. La volont d'accro-
tre la plus-value par tous les moyens, rendue ncessaire par la concurrence,
renverse toutes les barrires. Tout devient vnal. L'argent y acquiert un
pouvoir dmesur. Le ftichisme de la valeur se dploie sous toutes sortes de
formes. Tous les rapports humains sont soumis l'intrt goste 50.
Dans ces conditions, parler des lois naturelles de la production
capitaliste n'est plus qu'une mtaphore 51. Nature et naturel ne peuvent
plus tre pris au sens qu'ils ont dans les sciences de la nature, mme si Marx
emprunte les termes de ses comparaisons celles-ci.
Quand on lit au dbut du chapitre V du Capital, que la forme de
circulation par laquelle l'argent se mtamorphose en capital, contredit toutes
les lois dveloppes jusqu'ici concernant la nature [ber die Natur] de la
marchandise, de la valeur, de l'argent et de la circulation elle-mme52, le mot
nature est employ en un autre sens: celui d'essence.
Marx explique, propos de la loi de la valeur: Bien que l'conomie
classique n'ait jamais formul cette loi, elle y tient instinctivement, parce
qu'elle dcoule de la nature mme de la valeur 53.
Il en va ainsi pour toutes les lois qui dcoulent de l'essence d'une socit
donne: elles lui sont spcifiques, elles appartiennent sa nature .
Lorsqu'il s'agit des lois naturelles de la production, cela peut donc
s'entendre en deux sens. Par suite, l'expression: <dois naturelles de la
production capitaliste donne lieu toutes sortes de quiproquo que Marx
dnonce.
Nature a le sens d' essence partout o il est question de lois rgissant
une formation socio-conomique donne: ce sont ses lois internes, (<imma-
nentes . Marx parle ainsi frquemment des <dois immanentes la circula-
tion 54, des <dois immanentes de la production capitaliste 55, des <dois
internes de la production capitaliste 56, etc.
Naturel en ce sens d' essentiel n'est pas dit des lois conomiques
pour les mmes raisons que dans l'analogie avec les lois de la nature.
Cependant, ces deux sens sont parfois prsents simultanment. C'est le cas
dans les formules les plus connues de Marx, celles de la Prface du Capital par
exemple.
L'assimilation des lois conomiques aux lois de la nature, ainsi que la
dfinition que Marx donne de son point de vue , donnent la fausse
impression que, pour lui et Engels, l'histoire obirait un dterminisme
rigoureux, identique celui qu'enseignait la physique classique. En effet, Marx
et Engels ont soutenu qu'il tait possible, et ncessaire, de modifier les lois soi-
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
93
disant naturelles du mode de production capitaliste en abolissant ce mode
de production lui-mme.
Confondre les deux sens du mot nature conduit l'ide qu'il y a des lois
inexorables de l'histoire comme dit Karl Popper 57. Or, pour Marx, les lois
d'un mode de production sont tout sauf ternelles et inexorables . Certes,
dans certaines conditions sociales, la ncessit conomique s'impose aveugl-
ment, comme de l'extrieur. Mais, les conditions changent parce que les
hommes changent leurs moyens d'existence: ils sont l'origine de ce change-
ment 58; il ne leur est pas extrieur! En parlant d'inexorabilit, Popper limine
de la conception de Marx l'ide que les hommes participent aux changements,
qu'ils les ont souhaits et voulus, mme si en rsultent aussi des consquences
d'abord inaperues.
Gnralement, les critiques du marxisme ne distinguent pas les divers sens
des mots nature et naturel chez Marx. Si, comme Sartre ou Karl Popper,
on les confond, si l'on ne tient pas compte des diffrences qui subsistent par
del l'assimilation des lois de la production capitaliste des lois naturelles ,
alors on gauchit la pense de Marx; on lui attribue un fatalisme historique
naf; on transforme la ncessit relative en ncessit absolue; on supprime la
diversit des acceptions, parfois fort loignes les unes des autres, du mot
naturel .
Frquemment, naturel signifie donc interne , immanent , appar-
tenant l'essence d'une socit donne. Dans d'autres cas, il signifie
aveugle , extrieur. L'expression <<loinaturelle est tantt une abrvia-
tion de: <<loisqui s'imposent comme les lois de la nature , tantt de: <<loisqui
dcoulent de l'essence d'une formation socio-conomique donne , qui
appartient par nature son mode de production. On en conclut que, pour
Marx, le capitalisme serait un mode de production naturel . Or, Marx se
mfiait de telles analogies et des assimilations indues qu'elles entranent.
Le quiproquo provient de ce que, dans les textes les plus gnraux de
Marx, les deux sens du mot nature sont prsents la fois. Nous allons voir
que la loi de la valeur peut tre dite naturelle dans les deux sens du mot. Or,
nous n'avons encore rencontr qu'une formulation particulire de cette loi. Il
convient d'insister sur la ncessit de distinguer ces deux acceptions sur le plan
thorique. L'analyse critique que Marx fait du capitalisme revient prcisment
les distinguer. Si Marx indique les ressemblances entre lois de la nature et lois
conomiques, il n'en a pas moins insist aussi sur les diffrences. Assimiler
n'est pas identifier.
Le quiproquo que nous dnonons ici a cependant encore une autre
source. Il arrive que les deux acceptions du mot naturel appliqu aux lois
conomiques ont un noyau de sens commun, qui est au fondement de leur
identification. C'est le cas lorsque Marx reconnat que certaines lois conomi-
ques valent quelles que soient les conditions sociales particulires o elles
s'exercent, lois universelles et ncessaires parce que lois de la production en
gnral .
94 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Bien qu'il n'y ait pas de production gnrale , explique Marx, le concept
de production en gnral n'est pas irrationne}59. Toute production est
production concrte de certains produits, dans certaines conditions, une
certaine poque. Par suite, il semble qu'il ne devrait y avoir que des lois
conomiques particulires, variant d'un mode de production l'autre, des lois
historiquement dtermines, caractrisant telle ou telle socit telle ou telle
poque.
Pourtant, Marx fait remarquer qu'il existe bel et bien des lois gnrales de
l'conomie qui appartiennent tout mode de production. En voici deux
exemples: toute production est appropriation de la nature par l'individu
dans le cadre et par l'intermdiaire d'une forme de socit dtermine
,,60; la
production est immdiatement consommation, la consommation immdiate-
ment production 61.
Ces lois ne sont-elles pas des lois naturelles de la production, aux deux
sens du mot naturel? Elles s'imposent aux individus, et mme toutes les
socits possibles, d'une faon contraignante comme les lois de la nature, et
elles dcoulent de l'essence de la production sociale. Ces lois conomiques sont
indpendantes des formes de socits. L'activit productive est soumise
certaines conditions gnrales qui s'imposent toute formation socio-cono-
mique quelle que soit sa forme spcifique.
Les savants du XVIIesicle ont dcouvert des lois gnrales de la nature,
nonces dans la mcanique classique, en particulier dans la dynamique
newtonienne. Elles s'appliquent toutes les formes de mouvements des corps
matriels, aussi diffrents phnomnologiquement que le dplacement sur
terre, la chute libre dans l'air ou le vide, et le mouvement des astres dans
l'espace. De mme, les conomistes classiques recherchaient des lois conomi-
ques gnrales, soit dans la production, soit dans la circulation, mais qui
fussent les mmes travers toutes les poques quelles que soient les socits.
Nous trouvons que Marx reconnaissait, lui aussi, de telles lois conomiques
absolument universelles et ncessaires. Surgit donc la question suivante:
comment Marx peut-il admettre des lois gnrales dans une conception
pour laquelle tout est historique?
En effet, il professe une philosophie selon laquelle tout change et tout
passe: individus, classes sociales, modes de production, socits, peuples,
n'ont qu'une existence transitoire; ils sont apparus et ils disparatront. Dans
une philosophie du devenir universel, admettre des lois gnrales, n'est-ce pas
une inconsquence? S'il y a de telles lois gnrales, ne limitent-elles pas le
champ du possible?
4. Des lois gnrales et leurs formes possibles
Marx affirme donc qu'il existe des lois gnrales de la production, ce qui
ne l'empche pas de soutenir qu'il est possible de changer la base de la socit
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
95
actuelle et ainsi de transformer toutes ses superstructures62. Nous sommes
alors en prsence d'un dilemme. Des lois universelles et ncessaires, valables
pour toute socit possible, ne constituent-elles pas, en effet, des conditions de
possibilits universelles de l'histoire, par consquent une sorte d'ordre trans-
cendant qui limite a priori les possibilits historiques63?
Inversement, pour certains, le marxisme serait un historicisme, pour
lequel il n'y aurait pas de lois gnrales. De fait, Marx critique avec vigueur
toute ternisation des rapports de production capitalistes64. De grands
penseurs, Rousseau, Smith, Ricardo, Proudhon, ont procd cette ternisa-
tion, explique Marx. Ils ont prennis les rapports sociaux actuels en
supposant que le producteur individuel autonome de la socit bourgeoise
moderne aurait exist de tout temps: leurs explications conomiques reposent
sur des robinsonnades . D'une faon gnrale, Marx s'en prend toutes les
abstractions, aux catgories riges en catgories gnrales transcendant
toutes les poques65. Pour viter ces robinsonnades, il n'est qu'un remde:
se placer sur le terrain historique 66.
En admettant des lois de la production en gnral", Marx ne fait-il pas
prcisment ce qu'il reproche aux auteurs de robinsonnades? Parfois, ses
propos sont dconcertants: il qualifie certaines lois particulires
d' ternelles! Ainsi, l'ouvrier en vendant sa force de travail au capitaliste se
conforme aux lois ternelles de l'change67 , alors qu'ailleurs Marx insiste sur
le fait que toutes les socits n'ont pas pratiqu cette forme d'change entre
propritaires individuels. Ne tombe-t-il pas dans une flagrante contradiction?
Il faut carter ce reproche, car, dans le cas prsent, Marx use d'une figure de
style; il va de soi que ces lois ternelles n'existent qu'autant que se
pratiquent les changes; c'est une ternit limite!
La vraie difficult est l'admission de lois absolument gnrales, qui
apparaissent comme des lois rellement ternelles, alors que Marx a bien
montr la spcificit de tout mode de production et de ses lois conomiques.
Rappelons-nous la loi de la valeur. Elle nous est apparue ci-dessus comme
spcifique et relative une socit de petits producteurs indpendants, donc
lie des conditions particulires, spatialement et temporellement.
On pourrait objecter que Marx n'envisage gure de telles lois universelles
que dans l'Introduction de 1857, qui est reste l'tat de manuscrit; mais s'il
abandonne cette manire de commencer la critique de l'conomie politique en
considrant des lois aussi gnrales, ce n'est pas qu'il ait chang d'avis. En
voici la raison: <de supprime , dit-il, une introduction gnrale que j'avais
bauche parce que, rflexion faite, il me parat qu'anticiper sur des rsultats
qu'il faut d'abord dmontrer ne peut tre que fcheux68 . En quoi tait-ce
fcheux? Marx lui-mme, prsentant la dmarche adopte dans la Contribu-
tion de 1859, estime que <de lecteur qui voudra bien [le] suivre devra se dcider
s'lever du singulier au gnral69 , ordre inverse de celui de l'Introduction
gnrale.
.
Or, peut-on dire que Le capital s'lve du singulier au gnral? Il procde
96 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
plutt de l'abstrait au concret, de la marchandise en gnral la production
capitaliste, de celle-ci aux subdivisions du capital dans ses formes principales
et leur articulation interne dans le processus d'ensemble de la production
capitaliste. Cette dmarche est prcisment celle que prconise le paragraphe
mthodologique de l'Introduction de 18577.
Marx n'a donc pas cart cette Introduction pour son contenu, mais pour
des raisons d'efficacit thoriques et pratiques: quel est le meilleur angle
d'attaque pour effectuer la critique de l'conomie politique du capitalisme?
Cela ne remet pas en cause l'affirmation selon laquelle il y a des lois
absolument gnrales de la production 71.Cette thse, fermement soutenue par
Marx, exclut l'historicisme absolu qu'on lui attribue parfois.
Il a donc pens qu'il y a des lois gnrales de l'conomie, sans se dpartir
de sa conception historique, ni de sa philosophie du changement et du devenir.
Grce aux explications qu'il donne par lettres, un an aprs la publication
du Capital, son ami de Hanovre, Ludwig Kugelmann, on peut comprendre
comment il articulait lois gnrales et lois particulires72. A Kugelmann, il
nonce une loi qu'il qualifie de naturelle" et d' indpassable :
N'importe quel enfant sait que [...] les masses de produits correspondant
aux diverses masses de besoins exigent des masses diffrentes et quantitative-
ment dtermines de la totalit du travail social. [...] Des lois naturelles ne
peuvent absolument pas tre dpasses [aufgehoben]13."
Voil une loi conomique qui est naturelle" et absolument gnrale. Ici,
Marx ne parle pas mtaphoriquement: cette loi, dit-il, est absolument
ncessaire,,! Elle exprime des conditions sine qua non de toute production
sociale. Elle vaut universellement, pour toute socit passe, prsente ou
future, de quelque nature qu'elle soit. Elle est naturelle" au second sens que
nous avons distingu ci-dessus: elle dcoule de l'essence de la vie en socit.
Pourtant, contrairement aux lois de la nature, elle est vidente", si facile
connatre qu'elle est la porte d'un enfant! Nul besoin, son sujet, d'une
recherche longue et ardue.
Or, dans ses explications Kugelmann, Marx prcise que cette loi, n'est
autre que... la loi de la valeur, ajoutant: La science consiste prcisment
dvelopper [entwickeln] lafaon dont la loi de la valeur se fraye un chemin [sich
durchsetzt] 74.
"
N'entretient-il pas la confusion? Nous avons vu que la loi de la valeur
supposait certaines conditions spcifiques: des travaux privs indpendants;
d'o le fait qu'elle chappait la conscience des agents conomiques. Marx
nous dit maintenant que cette loi est valable pour tous les modes de
production et qu'elle est trs facile connatre 75!
Dvoilant Kugelmann le fond de sa pense, Marx lui dit que la loi de la
valeur se prsente sous diverses formes
". D'une part, elle a une forme
gnrale: la ncessit de la rpartition ", en proportions dtermines ", de la
masse du travail social dans une socit quelconque. D'autre part, elle prend
des formes spcifiques selon les conditions sociales particulires dans les-
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
97
quelles elle se ralise. Dans une socit o domine la petite production prive,
elle s'impose, par une contrainte externe, aux agents qui, habituellement, n'en
ont pas conscience.
Mais, la forme que prend la loi peut tre change: Il est self-evident [il va
de soi] que la forme dtermine de la production sociale ne supprime nullement
cette ncessit de la rpartition du travail social en proportions dtermines:
c'est la faon dont elle se manifeste [ihre Erscheinungsweise] qui peut seule tre
modifie [andern kann]76.
Arrtons-nous un instant sur ce point, car il ouvre des perspectives
importantes sur la pense de la possibilit. Marx affirme ici la possibilit de
transformation historique d'une loi qui, sous sa forme actuelle, s'impose d'une
manire contraignante. Ainsi, la forme gnrale de la loi n'empche pas une
transformation possible qui dpend de certaines causes, en particulier d'agents
capables de raliser ce changement de forme. En ralit, les limites imposes
par une loi gnrale sont mouvantes: dans le cas de la loi de la valeur, elles
sont relatives aux besoins humains. Nous n'avons donc ici que des possibilits
abstraites, celles que permet une loi gnrale:
Ce qui peut tre transform, dans des situations historiques diffrentes,
c'est uniquement la forme sous laquelle ces lois se frayent un chemin 77. Et
Marx de prciser que, dans le cas de la loi de la valeur, seule sa forme change:
dans une conomie d'change priv des produits individuels du travail, sa
forme est prcisment la valeur d'change de ces produits78.
Ces prcisions donnes Kugelmann permettent de saisir ce que nous
appelons la premire forme du possible chez Marx. En effet, il est question ici
de ce qui peut tre transform, et de ce qui ne peut pas l'tre. Ce que
nous apprennent ces claircissements sur la loi de la valeur et ses formes
possibles, c'est que ce qui peut tre ainsi ou autrement, c'est uniquement une
forme. Ce qui est possible, c'est la transformation d'uneforme.
Possibilit et forme sont troitement lies. Un mme contenu, la rparti-
tion des masses de travail proportionnellement aux besoins, peut prendre
diffrentes formes suivant les conditions conomiques et sociales dans les-
quelles il se ralise: la forme, ce sont les rapports sociaux.
Cette manire de considrer la possibilit remonte Aristote qui fait
reposer les possibles en puissance sur la distinction de la forme et de la
matire, une mme matire tant apte recevoir ou prendre diffrentes
formes qui dpendent de l'action d'un agent, rationnel ou irrationnel,
immanent ou extrieur. Chez Marx, dans le cas de la loi de la valeur, la
matire est le travail en tant que substance de la valeur.
A propos du rapport entre valeur d'usage et valeur d'change, Marx pose
une question: En soi et pour soi, la valeur en tant que telle est-elle l'universel,
face la valeur d'usage et la valeur d'change qui en seraient les formes
particulires79?. Mais il repousse cette manire de voir, car, dans la forme de
production capitaliste, la valeur d'change est la dtermination prdomi-
nante80. Toutefois, il est vident que l'usage ne cesse pas d'tre du fait qu'il
98 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
n'est dtermin que par l'change; bien qu'il en reoive son orientation
mme 81.
Valeur d'usage et valeur d'change ne sont pas deux espces diffrentes
dans un mme genre. Il n'y a pas d'universe!>, qui les transcenderait. La
valeur d'change (la forme) est toujours lie une certaine valeur d'usage qui
lui sert de support
".
Pour le capitaliste, la nature de ce support est
parfaitement indiffrente, mais non pour l'acheteur et le consommateur
ordinaires.
Une dialectique s'tablit entre les deux sortes de valeur, une relation de
forme contenu o elles s'entre-dterminent. C'est bien la catgorie de
contenu que Marx utilise pour dsigner la valeur d'usage: dans le rapport
entre capital et travail, la valeur d'usage, c'est--dire le contenu, bref la
particularit naturelle de la marchandise en tant que telle, n'a pas d'existence
en tant que dtermination formelle conomique82.
En effet, Marx explique que la production capitaliste n'a pas pour but et
pour moteur immanent, les valeurs d'usage en tant que telles: Sa dtermina-
tion formelle est, au contraire, la valeur d'change. En dehors de cette forme,
le contenu est indiffrent; il n'est pas contenu du rapport en tant que rapport
sociaI83. Le rapport salari s'applique n'importe quelle sorte de travail.
Pourtant, Marx pose la question de savoir si, dans le mode de production
capitaliste, la forme conomique de la production ne serait pas dtermine,
d'une certaine faon, par le contenu, c'est--dire par les besoins humains, par
la nature, ou par d'autres circonstances matrielles.
Mais est-ce que ce contenu en tant que tel ne se dveloppe pas dans un
systme de besoins et de production? Est-ce que la valeur d'usage en tant que
telle n'entre pas dans la forme elle-mme, ne dtermine pas la forme
conomique elle-mme, p. ex. dans le rapport entre capital et travail? dans les
diffrentes formes de travail? agriculture, industrie, etc. rente foncire? -
influence des saisons sur les prix des produits bruts?, etc.
84.,)
Il est clair que, pour Marx, il reste toujours un rapport ncessaire entre
forme et contenu. La forme conomique capitaliste n'est pas totalement
dominante ou libre par rapport son contenu, mais seulement prdomi-
nante .
Tout ce que l'on peut conclure de la lettre Kugelmann, et de cette note
des Grundrisse, c'est qu'i! y a diverses formes possibles pour un mme contenu,
que le contenu ne dtermine pas totalement la forme, mais peut tre domin
par elle: le matrialisme de Marx n'est pas d'espce banale!
Pour penser ces rapports, il faut une conception dialectique:
Le rapport entre les marchandises doit [...] tre la fois un rapport o
elles apparaissent en tant que grandeurs essentiellement semblables, ne
diffrant que quantitativement; il doit s'exprimer par une mise en quation
o elles apparaissent comme matrialisation du temps de travail gnral, et
il doit en mme temps tre leur rapport en tant qu'objets qualitativement
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
99
diffrents, que valeurs d'usage particulires rpondant des besoins particu-
liers, bref un rapport qui distingue les marchandises en tant que valeurs
d'usage relles. Or cette mise en quation et cette diffrenciation s'excluent
rciproquement. Ainsi s'tablit [...] un ensemble d'exigences contradictoires,
la ralisation de l'une des conditions tant directement lie la ralisation de
son contraire.
-
Le processus d'change des marchandises doit tre la fois
le dveloppement et la solution de ces contradictions85.
Ainsi, nous dcouvrons chez Marx une premire forme de possibilit qui
est lie l'existence de lois gnrales, quoique, comme tout universel, une loi
gnrale n'existe jamais que sous des formes particulires86.
La possibilit concerne un changement de forme d'un contenu substantiel
qui reste qualitativement identique lui-mme travers ce changement. Cette
possibilit de changement de forme d'une loi gnralelelle que la loi de
la valeur, renvoie au changement historique: elle se ralise dans le processus de
devenir de l'histoire. La question devient: le changement historique est-il lui-
mme dtermin par des lois? Des formes gnrales, ou des lois comme la loi
de la valeur, ne suffIsent pas rendre compte du changement des formes
particulires. Nous n'avons donc que l'ide abstraite de possibilit, la possibi-
lit du changement des formes socio-conomiques. Les lois de la production
en gnral sont incapables de nous livrer la cl de la possibilit historique
relle.
Autre consquence: du fait que ces lois gnrales ne peuvent pas tre
dpasses , le matrialisme historique n'est ni un relativisme, ni un histori-
cisme absolus. Mais, par leur activit, les hommes peuvent changer radicale-
ment la forme dans laquelle de telles lois se ralisent.
Pour illustrer ces rapports entre lois universelles et formes particulires
tels que Marx les entend, rapportons une mtaphore trs significative, qu'il
choisit l'occasion d'une Prface: La socit )', dit-il, ne trouvera pas son
quilibre tant qu'elle ne tournera pas autour de son spleil, le travaiI87.
Lorsque cela sera ralis, les formes marchandes particulires de la loi de
la valeur seront dpasses . Marx avait pleine conscience de la rvolution
copernicienne qu'il oprait dans la thorie sociale et historique. Considrer le
travail comme soleil de la socit, c'tait y dcouvrir son centre de gravit
naturel , sa base , son fondement matriel, mieux encore, sa substance,
qui pourvoit tout et rend tout possible. Ce qui s'exprime dans cette loquente
mtaphore, c'est l'esprit du matrialisme marxien.
5. Les soi-disant lois naturelles du capitalisme
L'ide que les lois conomiques sont naturelles tait trs rpandue avant
Marx. La plupart des conomistes pensaient que le systme de production et
d'change moderne tait dans l'ordre des choses. On connat le matre mot du
libralisme classique: laissez faire, laissez passer . Le XIxe sicle a rpt
100 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
satit qu'il suffisait de laisser jouer la libre concurrence, que la loi de l'offre
et de la demande rglerait le march, que l'quilibre conomique et la justice
sociale devaient en rsulter d'eux-mmes. Cette loi serait conforme au droit
rationnel, justement appel droit naturel.
Si l'on pense que les lois conomiques (loi de l'change, loi de l'offre et de
la demande) sont naturelles, le dessein de changer l'ordre social parat
aberrant, et, la volont de le faire, utopique, puisque tout changement autre
que naturel serait impossible et toute entreprise humaine non conforme
ces lois naturelles de l'conomie voue l'chec.
Il est clair que Marx ne disait pas les lois conomiques du march
naturelles en ce sens. Le capital n'est qu'une critique systmatique et
dtaille des prjugs du libralisme conomique dont les. robinsonnades
camouflent les faiblesses thoriques et les erreurs historiques. La loi de l'offre
et de la demande n'est que prtendument naturelle. Marx qualifie rguli-
rement ces lois-l de naturelles par drision. Ces soi-disant lois naturelles
peuvent prcisment tre changes et abolies. Mieux: elles doivent l'tre !
L'tude de l'histoire passe montre que la forme des lois conomiques a
chang: elle fonde la critique dire que les lois du capitalisme ne sont que de
soi-disant lois naturelles de l'conomie. Se fondant sur l'histoire, Marx est
donc en mesure d'affirmer qu'un changement de forme de la socit est
possible, qui consistera dans un changement de ses rapports sociaux.
Cette critique des lois prtendument naturelles de l'conomie n'est pas
trs apparente dans les premiers chapitres du Capital, ou dans les Prfaces ou
l'Introduction de 1857. Elle ne vient au premier plan qu'avec la loi de
l'accumulation capitaliste, loi gnrale des socits dveloppes du temps de
Marx, parce que ce systme est oblig d'accrotre continuellement la valeur
sous forme de valeur d'change. Discutant la question de savoir si le
dveloppement du capital peut amliorer la condition ouvrire, Marx crit:
Dans toutes les controverses sur ce sujet, on a souvent nglig le
principal, la differentia specifica de la production capitaliste. On n'y achte pas
la force de travail pour que son service ou son produit satisfasse les besoins
personnels de l'acheteur [le capitaliste]. Le but de celui-ci est la valorisation de
son capital, la production de marchandises qui contiennent plus de travail
qu'il n'en paie, qui contiennent donc une portion de valeur qui ne lui cote
rien et qui sera nanmoins ralise par la vente des marchandises. Produire de
la plus-value, faire du plus et du plus, telle est la loi absolue de ce mode de
production 88.
Cette loi, certains conomistes la donnaient pour conforme la nature
des choses. A son sujet, Marx dnonce une mystification, voire une falsifica-
tion dlibre et cynique de certains conomistes: la loi de l'accumulation
[est] mystifie en loi naturelle, s'exclame-t-iI89. En fait, il accuse ici particu-
lirement Malthus de prter main-forte aux capitalistes avec son fameux
principe de population que Marx nomme <doi de population.
Le clbre pasteur anglican, se basant sur des donnes dmographiques
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
101
(entre autres, celles des tats du Nord de l'Amrique depuis le milieu du XVIIe
sicle), disait: Nous pouvons tre certains que lorsque la population n'est
arrte par aucun obstacle, elle double tous les vingt-cinq ans, et crot ainsi de
priode en priode selon une progression gomtrique90.
D'autre part, Malthus prtendait dmontrer que les moyens de subsis-
tance ne pouvaient, au mieux, que doubler dans la mme priode91. Il estimait
la pauvret des classes laborieuses justifie, du fait de leur trop grande
fcondit. Aussi prconisait-il, parmi diverses mesures telles que le veuvage et
l'abstinence sexuelle, l'abolition graduelle des lois prises, en Angleterre, en
faveur des pauvres, victimes de l'industrialisation forcene92. Quel renfort
idologique pour les partisans de la libre concurrence et de la baisse des
salaires! Malthus fournissait une explication naturelle de la misre
ouvrire: non seulement celle-ci tait dans l'ordre des choses, mais elle avait
valeur de sanction morale.
Beaucoup d'conomistes pensaient que la pauprisation de la classe
ouvrire tait invitable pour assurer l'accumulation capitaliste initiale .
Malthus allait plus loin: il la donnait pour une loi providentielle de la
nature, les pauvres n'ayant qu' s'en prendre eux-mmes.
Il est vident que pour accrotre la production, il faut augmenter
l'accumulation du capital. Selon un prjug rpandu, cela impliquerait une
rduction des salaires. Marx dmontre au contraire que la hausse des salaires
est tout fait possible: la composition du capital restant la mme, le progrs
de l'accumulation tend faire montrer le taux des salaires 93.
Aussi, il fustige les conomistes, particulirement ceux de l'cole de
Malthus, qui justifiaient les pires consquences de la course au profit et
l'accumulation. Ils lgitimaient la loi fondamentale du mode de production
capitaliste en en faisant une loi invitable, naturelle et ternelle. Ils
donnaient bonne conscience l'exploitation la plus honte.
Marx renverse cette explication qui se dit scientifique . A l'inverse des
malthusiens, il crit que c'est la loi de la production capitaliste qui est la
base de ce qu'on appelle prtendument la "loi naturelle de la population "94.
Cette phrase connut diverses versions au fil des ditions et traductions du
Capital95. La traduction franaise de Joseph Roy, revue par Marx, dit que <<la
loi de la production capitaliste [est] mtamorphose en prtendue [angeblich]
loi naturelle de la population96. La premire dition allemande parlait d'une
vritable mystification 97.
Le qualificatif prtendue qui ne figurait pas en allemand, apparat dans
la version franaise, et se retrouve dans les ditions allemandes ultrieures. Or,
dans son relev des occurrences du terme loi dans Le capital, M. Dumnil
tronque cette phrase en parlant seulement de la loi de la production
capitaliste ainsi mtamorphose en loi naturelle (...)98 . Le mot prtendu a
disparu, et les points de suspension de M. Dumnil sont particulirement
malheureux. Le fait qu'il s'agisse du principe de population de Malthus
chappe au lecteur99. Le texte est compltement dulcor 100.
102 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Marx conclut: la mystification qui transforme la loi de l'accumulation
capitaliste en celle, prtendument naturelle , de Malthus, n'exprime donc
en fait que ceci: que la nature de l'accumulation exclut toute diminution du
taux d'exploitation du travail ou toute augmentation du prix du travail qui
pourrait mettre srieusement en pril la reproduction permanente du rapport
capitaliste et sa reproduction une chelle toujours largie lOI.
Cela dit, l'accumulation capitaliste n'exclut pas une augmentation rela-
tive et priodique des salaires. Au contraire, leur hausse est possible ! Ils
montent ou descendent indpendamment des variations soi-disant natu-
relles de la population. C'est le mode de production qui dicte sa loi aux
mouvements de la population, et chaque formation socio-conomique a ainsi
sa propre loi de population, qui n'est rien moins que naturelle .
Mais ce n'est pas seulement le principe de population que des
conomistes renomms rigeaient en loi naturelle . Toutes les lois de la
production capitaliste (loi de l'change, loi de l'offre et de la demande, etc.),
dit Marx en de nombreuses occasions, sont mtamorphoses, d'une faon ou
d'une autre, en lois naturelles . Sarcastiquement, il les qualifie de lois
ternelles ou sacres . Il tourne en drision les conomistes qui se
faisaient toutes sortes d'illusions ce sujet.
Pour J. Torrens, le capital serait aussi vieux que l'homme: dans la
premire pierre que le sauvage lance sur le gibier qu'il poursuit, dans le
premier bton qu'il saisit pour abattre le fruit qu'il ne peut atteindre avec la
main, nous voyons l'appropriation d'un article dans le but d'en acqurir un
autre, et nous dcouvrons ainsi - l'origine du capital
]02
.
Cette dfinition du capital en fait une chose naturelle! Rien de plus
facile que d'en conclure que les autres proprits du systme capitaliste serait
tout aussi naturelles, donc ncessaires et indpassables .
Les capitalistes qui doivent affronter l'action revendicative des ouvriers
invoquent aussi le caractre naturel, donc ncessaire, des lois de la
concurrence: Marx se gausse de la faiblesse de leurs arguments. Pour marquer
le caractre non-naturel des lois invoques, il emploie les guillemets. Les mots
naturel et ternel , ainsi souligns, dnoncent la supercherie consciente et
dlibre, le mensonge et l'hypocrisie:
Ds qu'afin d'affaiblir l'effet funeste de cette loi" naturelle" de l'accu-
mulation capitaliste, ils [les travailleurs] s'unissent pour organiser l'entente et
l'action commune entre les occups et les non-occups, aussitt le capital et
son sycophante l'conomiste de crier au sacrilge, la violation de la loi
"ternelle" de l'offre et de la demandelO3,
Baptisant la loi de l'offre et de la demande sainte loil04, Marx ironise.
Les dfenseurs de l'ordre tabli sanctifient tout ce qui sert leurs intrts. Au
fond, ils pensent comme le rvrend J. Townsend qui faisait, avant Malthus,
l'apologie de la pauvret:
Il semble qu'une loi de la nature veuille que les pauvres soient quelque
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
103
peu imprvoyants, si bien qu'il s'en trouvera toujours pour remplir les
fonctions les plus serviles, les plus sales et les plus abjectes de la communaut.
Le fonds du bonheur humain s'en trouve considrablement accru, les plus
dlicats sont librs de ces corves et peuvent s'adonner des mtiers plus
nobles, etc., sans tre drangs... La Loi sur les pauvres tend dtruire
l'harmonie et la beaut, l'ordre et la symtrie de ce systme que Dieu et la
nature ont instaur en ce monde 105.
Les mmes, qui clament la loi de l'offre et de la demande naturelle et
sacre", rvlent qu'ils la tiennent pour peu naturelle et peu sacre lorsqu'ils
la violent allgre ment et en appellent la force pour la contrecarrer l o elle
ne tourne pas leur avantage:
Ailleurs) dans les colonies, par exemple, o la formation d'une rserve
industrielle rencontre des obstacles importuns, les capitalistes et leurs avocats
ne se gnent pas pour sommer l'tat d'arrter les tendances dangereuses de
cette loi" sacre" 106.
"
Finalement, y regarder de prs, on s'apercevrait que Marx use davan-
tage de l'adjectif naturel" de manire parodique qu'il ne le reprend son
compte en lui donnant son sens propre. Il le retourne contre ceux qui
l'emploient tout propos et hors de propos.
Les malthusiens et les conomistes vulgaires n'taient pas les seuls
transfigurer les lois conomiques particulires notre poque en soi-disant"
lois naturelles, gnrales, partant absolument ncessaires". Des socialistes
comme Gray et Proudhon recherchaient aussi les lois naturelles" ternelles
de la production 107.
Ils pensaient les trouver dans l' change galitaire) que violerait la
grande proprit immobilire et le capital financierlO8. Or) objecte Marx)
l'change gal" fut la base de l'conomie marchande dont est sorti le
capitalisme! Le projet des bons de travail ou celui du crdit gratuit sont
d'aimables, mais vaines utopies. Proudhon croyait possible de revenir une
conomie soi-disant naturelle . Pour Marx, c'est une impossibilit.
Tous, selon Marx, sont mystifis par l'ide qu'il y aurait des lois
conomiques naturelles" simples, comme les lois de l'change et de l'offre et
de la demande. L'objet du Capital est de montrer que ce sont l des illusions
engendres par la concurrence. Celle-ci transforme les lois immanentes de la
production capitaliste en lois coercitives externes. Agissant alors comme des
lois naturelles", elles apparaissent aux protagonistes immdiats aussi nces-
saires que les lois de la nature elles-mmes:
Les lois immanentes de la production capitaliste se rflchissent dans le
mouvement externe des capitaux, se font valoir comme lois coercitives de la
concurrence et, par cela mme, parviennent la conscience des capitalistes
individuels en tant que motifs qui les poussent 109.
104 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Les agents conomiques sont abuss par les apparences; les conomistes
aussi, alors que la science devrait dbusquer la ralit cache derrire ce qui
apparat la surface des choses. Ainsi, un conomiste bourgeois du
XVIIIesicle, Edmond Burke, affirmait sans vergogne: les lois du commerce
[...]sont les lois de la nature et consquemment de Dieu 110. Les conomistes
vulgaires, plus prosaques, se contentrent de faire des lois de la concurrence
des lois immuables de la nature, ce qui ne valait gure mieux.
La pense de Marx est que les lois spcifiques du mode de production
capitaliste prsentent un double aspect: naturelles et ncessaires ~n un sens, du
fait de leur ressemblance des lois de la nature par la manire dont elles
s'imposent, mais, en un autre sens, qui n'est pas moins essentiel, non naturelles
et non ncessaires, parce qu'historiques et transitoires.
Vingt ans avant Le capital, l'poque de L'idologie allemande, il
reprochait Karl Heinzen, socialiste utopique, de ne pas voir que la
suprmatie politique de la bourgeoisie [...] a sa source dans ces conditions
modernes de la production que les conomistes bourgeois proclament des lois
ncessaires, ternelles Ill.
En 1865, Engels expliquera de mme F. A. Lange: Pour nous, ce qu'on
appelle les" lois conomiques" [die sogenannten "okonomischen Gesetze"] ne
sont pas des lois ternelles de la nature, mais des lois historiques, qui naissent
et disparaissent, [...]. La loi dite "de Ricardo" [das sog. Ricardosche Gesetz]
[...] n'est valable ni pour le servage, ni pour l'esclavage antique 112.
Bien qu'il n'ait pas connu, semble-t-il, l'Introduction de 1857, Engels
exprimait trs exactement et trs clairement la pense de Marx, remarquant
comme lui que les conomistes procdaient d'une manire anhistorique. Dans
la lettre que nous citons, il poursuit: On [les conomistes] prsuppose
l'ensemble du systme bourgeois, et l'on dmontre ensuite que chaque partie
isole en est une partie ncessaire, ergo [donc] une" loi ternelle" 113.
La socit bourgeoise se targue de droit naturel . Ses apologistes
soutiennent que la libre concurrence est une loi naturelle . Marx les
brocarde, car cette loi contient une violence cache. L'ouvrier libre est
contraint sous la pression de ses propres besoins naturels de se vendre contre
un salaire, aussi faible soit celui-ci: dans le cours ordinaire des choses le
travailleur peut tre abandonn l'action des" lois naturelles" de la socit ,
c'est--dire la dpendance du capital, engendre, garantie et perptue par
les conditions mmes de la production 114.
Mais les classes dominantes ont toujours la possibilit de recourir la
force et la violence quand cette contrainte naturelle ne suffit plus. Dans
Le capital, Marx dnonce la violence sous toutes ses formes, aussi bien
indirecte que directe, la violence indirecte tant implique dans la manire
bourgeoise de comprendre les lois conomiques comme si elles taient
vraiment naturelles , et par suite invitables et impossibles changer.
Or, il ne faut pas mettre sur un mme plan les <<loisternelles de <<la
production en gnral d'une part, et les soi-disant lois ternelles de la
LA POSSIBILIT ABSTRAITE 105
proprit, de la concurrence et de l'accumulation capitalistes. Ce que Marx
soutenait dans sa critique de la Philosophie de la misre de Proudhon, est une
thse partout prsente dans Le capital:
A mesure qu'elle [la production] se mtamorphose en production
capitaliste [selon ses propres lois immanentes] ses lois de proprit se
changent en lois de l'appropriation capitaliste. Quelle illusion donc que celle
de certaines coles socialistes qui s'imaginent pouvoir briser le rgime du
capital en lui appliquant les lois ternelles de la production marchande 115!
Qui est vis ici? Ce n'tait pas seulement les conomistes bourgeois qui
s'illusionnaient; des penseurs socialistes aussi, au premier rang, les proudho-
niens. Mais aprs 1871, Marx semble avoir voulu attnuer sa virulente
polmique contre Proudhon. En effet, dans la premire dition allemande du
Capital, il le prenait nommment partie: Qu'on admire donc l'astuce de
Proudhon, qui veut en finir avec la proprit capitaliste, en faisant valoir les
lois ternelles de la proprit, fondes sur la production des marchandises 116.
Il en est des lois ternelles de la proprit au sens de Proudhon comme
de la prtendue loi naturelle de la population de Malthus. Ces soi-
disant lois naturelles et ternelles sont le rsultat d'une histoire antrieure.
Elles n'ont pas toujours exist! Nes un jour, elles disparatront.
De plus, leur naissance n'a pas t naturelle. On a un peu forc
l'accouchement du mode de production capitaliste et de ses lois. tudiant la
gense du capitaliste industriel, Marx numre les diffrentes mthodes
d'accumulation primitive qui ont rendu possibles les lois actuellement
tablies qui s'exercent maintenant comme des lois naturelles; ces mthodes,
ce furent le rgime colonial, le crdit public, la finance moderne et le systme
protectionniste. Quelques-unes de ces mthodes reposent sur l'emploi de la
force brutale 117.
Les conomistes oublient que les lois de la production actuelle ne sont pas
tombes du ciel, qu'elles ont d'abord repos sur la traite des ngres, par
exemple: En somme, il fallait pour pidestal l'esclavage dissimul des
salaris en Europe, l'esclavage sans phrase dans le nouveau monde. [...] Voil
ce qu'il en a cot pour dgager les "lois ternelles et naturelles" de la
production capitaliste, pour consommer le divorce du travailleur d'avec les
conditions du travaillI8. Marx va jusqu' dire: La violence est l'accou-
cheuse de toute vieille socit grosse d'une socit nouvelle. Elle est elle-mme
une puissance [Potenz] conomique 119."
On mesure la diffrence avec la saintet des lois du commerce pour un
Burke! La ncessit des lois naturelles de la production capitaliste n'est
qu'une ncessit historique. Ces lois ne sont que transitoires et peuvent tre
dpasses". Pour cela, il faut que certaines conditions soient runies, c'est-
-dire qu'existent les causes capables de mettre leur abolition l'ordre du jour.
Certaines causes, en effet, ont rendu les lois de la production capitaliste
106 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
possibles et ncessaires dans le pass et jusqu' aujourd'hui. D'autres causes
peuvent rendre leur dpassement lui aussi possible et ncessaire.
NOTES
I. Par l, M. Louis Althusser et ses disciples rejoignent les conomistes qui soulignent que
Marx, dans Le capital, aurait construit un modle abstrait et gnral, valable pour un
capitalisme pur qui ne se rencontre jamais dans la ralit.
2. Au sens o M. Franois Jacob dcrit la formation d1un nouvel individu (une nouvelle
combinaison gntique possible) comme rassortiment de deux programmes diffrents (les deux
parents) par la reproduction sexue, ce qui ouvre l'volution biologique un champ pratiquement
infini de possibles (Le jeu des possibles, Paris, Fayard, 1981, p. 23).
3. SPINOZAsoutenait que la conduite humaine tait dtermine par des causes ncessaires. Sa
doctrine est clbre: L'exprience elle-mme n'enseigne [...] pas moins clairement que la Raison
que les hommes se croient libres pour la seule raison qu'ils sont conscients de leurs actions et
ignorants des causes par lesquelles ils sont dtermins (Ethique, Ille Partie, prop. 2, Scolie, in
uvres, Paris, Gallimard, Encyc!. de la Plade, p. 418). Les exemples du rve et du somnambu-
lisme sont de Spinoza (ibid., pp. 416-417).
4. L'assimilation des lois conomiques aux lois de la mcanique est assez frquente chez lui
et chez Engels. Toutefois, ils sont loin de penser comme Spinoza que l'apptit et la dtermination
du corps [...] se dduisent des lois du mouvement et du repos (Ioc. cit.).
5. Les travaux sur les thories conomiques de Marx furent trs nombreux depuis un sicle.
Parmi les plus rcents, signalons celui de M. MAAREK(Introduction au Capital de Marx: Un essai
de formalisation, Paris, CaImann-Lvy, 1975), qui renvoie d'autres. Sur la place de Marx dans
l'histoire des doctrines conomiques, voir Joseph SCHUMPETER, Histoire de l'analyse conomique,
Paris, Gallimard, 1. 2, 1983; Henri DENIS, Histoire de la pense conomique, Paris, Presses
Universitaires de France, 1971 ; A. ANIKINE,La jeunesse d'une science: La pense conomique avant
Marx, Moscou, d. du Progrs, 1975; et Marx lui-mme (Thories, MEW 26).
6. Manuscrit inachev, aussi appel Introduction de 1857, que l'on trouvera dans: Contribu-
tion; Mthode; uvres (d. Rubel), 1. 1. Il est surtout connu par son quatrime paragraphe intitul
.da mthode de l'conomie politique (reproduit in tudes). M. Louis Althusser s'appuya surtout
sur le dbut de ce paragraphe pour fonder son interprtation de la pense de Marx.
7. Lettre Engels, 16 janvier 1858, in Correspondance, t. V, pp. 116-117; MEW 29, p. 260;
Lettres sur Le capital, p. 83.
8. Cf. Postface la deuxime dition allemande du Capital. Marx explique: La mystifica-
tion que la dialectique subit entre les mains de Hegel n'empche aucunement qu'il ait t le
premier en exposer les formes gnrales de mouvement de faon complte et consciente. Chez
lui elle se tient sur la tte. Il faut la retourner pour dcouvrir le noyau rationnel sous l'enveloppe
mystique. (Le capital t. 1, p. 29; MEW 23, p. 27; trad. modifie. Voir aussi: trad. Lefebvre,
pp. 17-18.)
9. A propos de la thorie de l'argent, dans une lettre Engels du 25 fvrier 1859, Marx juge
svrement Lassalle qui, avec quelques phrases abstraites, comme" unit abstraite" et autres
formules de la mme veine, a la prtention de porter des jugements sur des choses empiriques qu'il
faut tudier, et pendant longtemps into the bargain [par-dessus le march] pour pouvoir en
parler." (Correspondance, t. V, p. 279; MEW 29, p. 404.)
10. Le concept de loi conomique dans le Capital, Paris, Maspro, 1978, p. 31.
Il. Le capital, t. 6, p. 238; MEW 25, p. 235. Trad. modifie.
12. Op. cit., p. 32.
-
M. Dumnil s'interrogeant sur ce lien interne dont parle Marx le
trouve surprenant. N'arrivant pas croire que Marx ait pu tre raliste, il affirme, comme
M. Althusser, que cet intrieur est celui d'un objet contruit par la pense et qui n'a rien de
commun avec le rel! (Ibid., pp. 32-33). M. Dumnil craint de verser dans l'empirisme.
13. Le contexte est clairant. Voici la phrase complte de Marx, dont M. Dumnil ne retient
LA POSSIBILIT ABSTRAITE 107
que l'incidente finale: De mme que tous les phnomnes se prsentent l'envers dans la
concurrence et donc dans la conscience des agents qui y participent, de mme cette loi
-
je veux
parler de cette interdpendance [Zusammenhang] entre deux choses qui se contredisent dans les
phnomnes apparents. (Loc. cit.
-
Cf. ci-dessus. p. 81, n. 11 - Trad. modifie.)
14. Ibid., p. 237; p. 234. Mots souligns par nous.
15. Marx s'exprime sur la production en gnral et ses lois, mais aussi plus largement sur
les catgories gnrales, dans l'Introduction gnrale de 1857 dont c'est l'objet.
16. M. Dumnil fournit, en annexe son ouvrage, un relev intitul: Les emplois explicites
du terme "loi" dans Le capital (op. cit., pp. 401-429). Mais ce relev n'est pas complet: nous le
verrons bientt.
17. Ibid., p. 138 et suiv.
18. Ibid., p. 49.
19. Ibid., p. 172.
20. M. Dumnil ne s'occupe pas de la conception de l'histoire de Marx. Or, des notions
fondamentales comme celle de loi doivent tre apprcies dans le cadre de cette conception.
21. Cet a priori thoriciste , qui gouverne son ouvrage, est emprunt M. Louis Althusser.
M. Dumnil fait constamment usage des ides et de la terminologie de (;e dernier, mais c'est
seulement dans la conclusion de son livre (op. cit., p. 376), prfac par M. Althusser, que l'auteur
renvoie nommment celui-ci, comme source de son interprtation.
22. Marx tait objectiviste: il pensait que, malgr leur nature abstraite, toutes les lois des
sciences sont objectives . Beaucoup de savants le pensent aussi, par exemple Einstein et Louis
de Broglie. Pierre Duhem lui-mme exprimait finalement sa conviction que la thorie physique
n'est point un systme artificiel, aujourd'hui commode et demain sans usage: elle est une
classification de plus en plus naturelle, un reflet de plus en plus clair des ralits [...] (La thorie
physique: son objet, sa structure, Paris, Vrin, 1981, p. 411).
23. Le capital, t. l, p. 18; trad. Lefebvre, p. 5; MEW 23, p. 12.
24. Ibid., p. 20; p. 6; p. 16. Soulign par Marx.
25. Ibid., p. 19; p. 6; p. 15.
26. Le capital, trad. Lefebvre, p. 403; MEW 23, p. 379. Voici la traduction de J. Roy: La
loi qui rgle la division du travail de la communaut agit ici avec l'autorit inviolable d'une loi
physique (ES, t. 2, pp. 47-48).
27. Le relev de M. Dumnil repose sur la traduction franaise de J. Roy faite sur la premire
dition allemande. Il en reproduit les imperfections. Il arrive que le mot loi soit choisi par
J. Roy pour traduire Regel [rgle] et non Gesetz [loi], ce qui chappe parfois M. Dumnil. En
outre, ce dernier ne pouvait se rfrer, pour le texte allemand, qu' celui de la quatrime dition
du Capital suivie par les diteurs des Marx-Engels Werke. La premire dition allemande, que
Marx a remanie par la suite, n'a t rdite qu'en 1983 (cf. MEGA, t. 11/5). Le Sachregister
(Index des matires) de laMEW, quoiqu'il ne soit pas non plus sans dfauts, permet de reprer des
occurrences du terme Gesezt (loi) dans Le capital, non releves par M. Dumnil. Mais cet Index
n'est pas exhaustif non plus!
28. Elle nonce que la valeur d'change d'une chose est la quantit de travail social moyen
ncessaire sa production dans des conditions donnes une poque donne (cf. Adam SMITH,
Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Paris, Gallimard, 1976, p. 61; David
RICARDO, Des principes de l'conomie politique et de l'impt, Paris, Flammarion, pp. 25-32; Le
capital, t. l, pp. 51-56; trad. Lefebvre, pp. 39-46; MEW 23, pp. 49-55).
29. Le capital, t. l, p. 87; trad. Lefebvre, p. 86; MEW 23, p. 89. Trad. modifie.
30. Ibid.
31. Cette loi a jou un rle dcisif dans l'histoire de la chimie: elle est l'origine de la thorie
atomique fonde sur l'hypothse selon laquelle les molcules des substances sont composes de
nombres dfinis d'atomes de corps lmentaires simples.
32. Cet aphorisme est attribu Platon qui rapporte qu'Iris, la science, est engendre de
Thaumas, l'tonnement (Thtte, trad. Dis, Paris, Les Belles Letttes, 1963, p. 177 (155 d.
33. On reprit trs souvent cette thse. Ainsi, pour Auguste Comte, spculer, ou thoriser, est
un besoin fondamental de l'esprit humain qui cherche expliquer toutes les anomalies
apparentes de l'univers qui le frappent (Cours de philosophie positive, 1re Leon, in uvres
choisies, Paris, Aubier, 1952, p. 60). Mais il s'agit d'un tonnement thorique, ce qu'indique la
notion d'anomalie. Comte empruntait cette explication de l'origine des sciences Adam Smith
(<<De l'origine de la philosophie, Essais philosophiques, figure en Appendice dans les
Recherches..., op. cit., pp. 437-442). On la trouve aussi chez Hume. Dans un essai sur les origines
de la philosophie grecque, Smith crivait: C'est donc l'tonnement, et non l'attente d'aucun
108 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
avantage attach de nouvelles dcouvertes, qui est le premier principe de l'tude de la
philosophie, de cette science qui se propose de mettre dcouvert les liaisons secrtes qui unissent
les apparences si varies de la nature. C'est pour satisfaire ce sentiment que les hommes
poursuivent cette recherche; ils
y
trouvent un plaisir ou un avantage primitif, et dont la jouissance
les flatte, sans songer mme ses effets, et aux nouveaux moyens qu'il leur prpare pour se
procurer d'autres plaisirs. (Ibid., p. 440.)
34. Manuscrits de 1857-1858, t. l, pp. 231-232; Gr., p. 200.
35. Ibid., p. 99; p. 80.
-
Marx veut dire que, si les ides sont insparables du langage, par
contre, l'argent, lui, est sparable de toutes les autres marchandises!
36. Le capital, t. 2, p. 44; trad. Lefebvre, p. 398; MEW 23, p. 375.
37. Le dix-huit brumaire, p. 10; MEW 8, p. 560. (Prf. la 2e d. de 1869.)
38. Marx emploie l'analogie comme moyen heuristique et explicatif, mais en mme temps il
en fait la critique et retourne le procd analogique contre lui-mme: C'est seulement le rapport
social dtermin des hommes eux-mmes qui prend ici pour eux la forme phantasmagorique d'un
rapport entre choses. Si bien que pour trouver une analogie, nous devons nous chapper vers les
zones nbuleuses du monde religieux. [...] J'appelle cela le ftichisme. (Le capital, trad. Lefebvre,
p. 83; ES, 1. l, p. 85; MEW23, pp. 86-87.) Ainsi le ftichisme est dvoil, ,c'est--dire expliqu et
critiqu la fois.
39. Le capital, trad. Lefebvre (modifie), p. 82; ES, t. l, p. 84; MEW23, p. 86. La traduction
de Jules Roy supprime les difficults: Le caractre d'galit des travaux humains acquiert la
forme de valeur des produits du travail. M. Lefebvre propose de lire: L'identit des travaux
humains prend la forme matrielle de l'objectivit de valeur identique des produits du travail , ce
qui n'est gure mieux. Il est vrai que le texte allemand est difficilement traduisible sans gaucherie
ou bizarrerie en franais: Die Gleichheit der menschlichen Arbeiten erhiilt die sachliche Form der
gleichen Wertgegenstiindlichkeit der Arbeitsprodukte. Cette phrase ne se trouve pas dans la
premire dition de 1867. Elle apparat dans la traduction franaise de J. Roy. Dans cette
traduction qu'il a revue , Marx remanie son expos et introduit ici plusieurs alinas (cf. MEGA,
1. II/S, pp. 46-47).
-
A Versachlichung, que l'on peut traduire par chosification ou
rification ,
l'Index des matires de cette dition renvoie cette page, o ne figure pas ce mot
lui-mme, mais des expressions approchantes: enveloppe chosifie, forme-chose, forme
chosifie , etc. (Ibid., ou MEW, 23, p. 86).
40. Le capital, trad. Lefebvre (modifie), p. 86; ES, t. l, p. 87; MEW23, p. 89.
41. Beaucoup faisaient de la loi de l'offre et de la demande la plus fondamentale de toutes les
lois conomiques, et ils l'estimaient juste, quitable, conforme aux exigences du droit rationnel
appel droit naturel . C'tait la thse de Bastiat dans ses Harmonies conomiques.
42. Il
y
a en effet l'exception remarquable de Sismondi (cf. H. DENIS, op. cil., pp. 374-377).
En gnral les conomistes taient drouts par le caractre nouveau des crises de surproduction.
43. Nous citons cette page d'Engels malgr sa longueur, car Marx faisait grand cas de cet
crit du jeune Engels. Fortement impressionn par cet opuscule, Marx se lana, partir de 1844,
dans l'tude de l'conomie politique.
44. Esquisse, trad. Chambre (modifie), pp. 76-77; trad. Papaioannou, p. 49; MEW l,
pp. 514-515; d. Fischer, p. 27.
45. Ibid. - Ce sont prcisment ces deux phrases que Marx cite lorsqu'il met en parallle la
loi de la valeur et la loi de la pesanteur (cf. Le capital, 1. 1, p. 87, n. 1; trad. Lefebvre, p. 86, n. 28;
MEW 23, p. 89, n. 28), rendant ainsi publiquement hommage son ami qui l'avait prcd dans
la critique de l'conomie politique anglaise.
46. Esquisse, trad. Chambre, pp. 74-77; trad. Papaioannou, p. 49; MEW l, p. 514; d.
Fischer, p. 27.
47. Ibid., pp. 76-79; p. 49; p. 515; p. 27.
-
Notons qu'il s'agit ici de ce qui est possible et de
ce qui ne l'est pas.
48. Le capital, t. l, p. 87; trad. Lefebvre, p. 85; MEW 23, p. 89. Trad. modifie.
49. La logique sociale, Paris, Alcan, 1895, p. 134.
50. Partout o elle a conquis le pouvoir, elle [la bourgeoisie] a dtruit les relations fodales,
patriarcales et idylliques. Tous les liens varis qui unissent l'homme fodal ses suprieurs
naturels, elle les a briss sans piti pour ne laisser subsister d'autre lien, entre l'homme et l'homme,
que le froid intrt, les dures exigences du paiement au comptant . Elle a noy les frissons de
l'extase religieuse, de l'enthousiasme chevaleresque, de la sentimentalit petite-bourgeoise dans les
eaux glaces du calcul goste (Manifeste, pp. 38-39; MEW 4, pp. 464-465).
51. Marx use volontiers des mtaphores avec une conscience aigu de leur pouvoir, et de
leurs limites. S. S. PRAWER (Karl Marx and World Literature, Oxford, Univ. Press., 1976, chap. Il)
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
109
donne une ide de l'tendue et de la varit de cet usage. Cet ouvrage trs document montre
l'immense culture de Marx. Il signale de nombreuses allusions littraires dont Marx maillait ses
crits. Les diteurs des uvres de Marx sont loin de les signaler toutes. Cet ouvrage de M. Prawer
mriterait une traduction en franais. Cf. notre Compte rendu in Erasmus, 1978, vol. 30,
n
21-22,
pp. 871-874).
52. Le capital, 1. l, p. 160; trad. Lefebvre, p. 175; MEW 23, p. 170. Trad. modifie.
53. Ibid., p. 30 I ; p. 345; p. 325.
-
Bien que le mot nature" ne figure pas dans le texte
allemand (cf. MEGA II/S, p. 245), nous nous appuyons sur la version franaise que Marx a revue.
54. Ibid., t. l, p. 134,161,168; pp. 144,177,186; pp. 142,172,180.
55. Ibid.,t. l, p. 265; 1. 3, pp. 32, 204; trad. Lefebvre, pp. 302, 664, 856; MEW 23, pp. 286,
618,790. Ou encore, ES, 1. 6, p. 239; MEW 25, p. 235.
56. Ibid.,t. 7, p. 23; MEW25, p. 368.
57. Exposant le dterminisme sociologique de Marx", Popper crit que Marx a t un
prcurseur de la doctrine pragmatiste selon laquelle le rle principal de la science n'est pas de
connatre les vnements passs, mais de prdire l'avenir. - Malheureusement, cette ide l'a
entran sur une fausse route. En effet, l'argument plausible d'aprs lequel la science ne peut
prdire l'avenir que si celui-ci est prdtermin, contenu en quelque sorte dans le pass, l'a conduit
la conviction errone qu'une mthode scientifique rigoureuse doit repostr sur un dterminisme
strict. L'influence de Laplace et des matrialistes franais apparat dans sa croyance aux" lois
inexorables de la nature et de l'histoire"".
(Op. cit., p. 61.)
58. Cf. le passage de Misre de la philosophie, cit ci-dessus p. 49.
59. Quand donc nous parlons de production, c'est toujours de la production un stade
dtermin du dveloppement social qu'il s'agit - de la production d'individus vivant en socit.
[...] Mais toutes les poques de la production ont certains caractres communs, certaines
dterminations communes. La production en gnral est une abstraction, mais une abstraction
rationnelle, dans la mesure o, soulignant et prcisant bien les traits communs, elle nous vite la
rption. (Introduction gnrale, Contribution, pp. 150-151; Mthode (bil.), pp. 118-119; MEW
13, pp. 616-617; Manuscrits de 1857-1858, t. I, p. 19; Gr., pp. 6-7.)
60. Ibid., p. 153; p. 21; pp. 122-123; p. 619; p. 9.
61. Ibid., p. 156; p. 25; pp. 132-133; p. 622; p. 12.
62. Mot mal construit, mais Consacr par l'usage , note M. Jacques D'HoNDT (Hegel,
Philosophe de l'histoire vivante, Paris, P.D.F., 1966, p. 191).
63. Cette ide est trangre Marx. Pourtant, dans cette voie, certains interprtes dcouvrent
chez lui une philosophie <<transcendantale. Ainsi, M. Henry a soutenu que le matrialisme
historique est une thorie transcendantale de l'histoire (Karl Marx, Paris, Gallimard, 1976,
t. l, pp. 179 et suiv.).
64. L'Introduction gnrale s'ouvre sur cette critique (cf. Contribution, pp. 149-153; Mthode,
pp. 110-125; MEW 13, pp. 615-620).
65. Marx s'exprime l-dessus dans de nombreuses circonstances, entre autres dans le !i 3 de
l'Introduction gnrale. (a. Ibid., pp. 164-172; pp. 156-181; pp. 631-639; et Michel VAD:E,La
critique de l'abstraction par Marx, in La logique de Marx, pp. 61-89).
66. Marx fait l'loge de J. D. Steuart parce qu'il se tient davantage sur le terrain historique
que les autres conomistes. Il n'a pas imagin le producteur individuel l'origine de l'histoire; il
a chapp cette illusion nave (cf. Introduction gnrale, Contribution, p. 149; Mthode,
pp. 112-113; MEW 13, pp. 615-6).
67. Le capital, t. l, p. 194; trad. Lefebvre, p. 217; MEW 23, p. 208.
68. Contribution, p. 3; MEW 13, p. 7.
69. Ibid.
70. Marx y pose la question de savoir quel doit tre le point de dpart de la thorie
conomique: l'abstrait ou le concret? La dmarche d'exposition empirique y est critique et
rejete. Aussi certains interprtes ont-ils vu dans ce texte la preuve d'un changement de point de
vue radical de Marx, sur le plan mthodologique, par rapport L'idologie allemande o, contre
les ides spculatives des Jeunes Hgliens en matire historique, il insistait sur la ncessit d'en
venir l'histoire empirique, et de s'y tenir d'abord. Y a-t-il changement chez Marx? En 1857,
notons qu'il s'agit, non d'histoire, mais de la critique des abstractions des thories conomiques:
les grands conomistes, dans leurs thories, supposant les rapports capitalistes valables indiff-
remment pour toutes les poques, faisaient tout autant fi de l'histoire que les Jeunes Hgliens. Si
l'on doit partir de catgories abstraites en conomie politique, encore faut-il qu'il s'agisse
d'abstractions dtermines . C'est le cas du travail abstrait" et de la marchandise comme
valeur d'change, catgories dont part Le capital.
110 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
71. Marx a parfois modifi ses conceptions conomiques. Travaillant au livre III du Capital,
il remanie compltement son explication de la rente foncire. Il confie Engels: (de donne
maintenant un grand coup de collier [...]. J'allonge un peu ce tome [le livre 1er] [...]. Par
parenthse, j'y vois enfin clair dans la question embtante de la rente foncire (mais laquelle je
m'interdis de faire ne serait-ce qu'une allusion dans cette partie de l'ouvrage). J'avais depuis
longtemps des misgivings [doutes] quant l'absolue exactitude de la thorie de la rente de
R[icardo] et j'ai enfin dcouvert la supercherie. Mais galement dans d'autres questions qui font
partie de ce tome, j'ai fait quelques dcouvertes intressantes et surprenantes, depuis notre
dernire rnecontre. (Correspondance, t. VII, p. 51; MEW 30, pp. 248-249; Lettres sur Le
capital, p. 119. Trad. modifie.)
-
Certains commentateurs, arguant de ces modifications,
soutiennent qu'il
y aurait eu une volution philosophique, pistmologique , de Marx; aprs
M. L. Althusser, c'est ce que pensent MM. DENIS (L'conomie de Marx: Histoire
d'un
chec,
Paris, P.U.F., 215 p.) et BIDET (Que faire du ",Capital, Matriaux pour une refondation, Paris,
Klincksieck, 283 p.). Ces changements n'affectent en fait que certaines questions de thorie
conomique. Les vues gnrales de Marx et ses ides mthodologiques sont, au contraire,
remarquablement stables.
72. Le docteur L. Kugelmann a fait beaucoup pour diffuser Le capital ep Allemagne. Marx
avait sjourn chez lui. De leur correspondance, les lettres de Marx ont t traduites en franais.
A notre connaissance, celles de Kugelmann Marx ne sont pas dites.
73. L. Kugelmann du 11 juill. 1868 (Correspondance, t. IX, p. 263; MEW 32, p. 553; L.
Kugelmann, p. 103; L. sur ",Le capital, p. 230). Nous avons modifi la traduction sur plusieurs
points, en particulier pour auCgehoben, terme cl de la dialectique chez Hegel et Marx pour
dsigner un processus qui est la fois suppression et conservation. Bien qu'une certaine mode
veuille, depuis quelque temps, modifier les usages du franais, nous avons conserv la traduction
traditionnelle de ce terme par dpass, quoique le terme allemand signifie aussi bien
conserv . A des termes sophistiqus, savants et abstraits, comme sursum , nous prfrerions
surmont: ne dit-on pas qu'un obstacle a t surmont? Mais le franais n'a pas de substantif
correspondant, alors que dpassement remplit cette fonction pour rendre Aufhebung.
-
La
traduction de M. Gilbert Badia: Des lois naturelles ne peuvent pas tre supprimes absolument
(L. Kugelmann,p. 103)prte contre-sens: la place du mot absolument et le mot supprim
sont particulirement malheureux. M. Badia laisse entendre que ces lois peuvent tre suppri-
mes jusqu' un certain point, alors que Marx veut dire au contraire que la rpartition sociale
du travail en proportions dtermines est une ncessit absolue. Sur le passage de cette lettre
discut ici, M. Andr Tosel fait d'excellentes remarques (Praxis, Vers une refondation en
philosophie marxiste, Paris, d. soc., p. 159).
74. Correspondance, t. IX, p. 264; MEW 32, p. 553; L. Kugelmann, p. 103. Trad. modifie.
Texte de M. Badia: Le rle de la science c'est prcisment d'expliquer comment agit cette loi de
la valeur. (Cf. aussi, L. sur Le capital, p. 230). Sich durchsetzen pose un problme de
traduction: c'est se frayer un chemin travers des obstacles et par le moyen de ces obstacles
mmes. La traduction habituelle par s'imposer convient mal.
75. On pourrait songer rsoudre cette difficult en invoquant une volution de la pense de
Marx concernant la valeur, thse soutenue par M. J. BIDET (op. cit.). De son ct, M. H. DENIS
(op. cit.) a conclu l'chec de 1'conomie de Marx en supposant qu'il est impossible de
concilier une thorie hglienne du capital (celle des Grundrisse) et une thorie ricardienne de
la valeur (celle du Capital). Ce n'est pas l'avis d'conomistes comme MM. Henri JACOT
( Substance, grandeur et forme de la valeur dans" Le capital" , Analyse, pitmologie, Histoire,
Lyon, Cahier
n
4, novo 1984), Pierre DocKs (La thorie de la valeur d'Adam Smith, ibid.) ou
J. M. SERVET ( Les figures du troc du XVIe au XIXe sicle: lectures de textes conomiques, ibid.,
Cahier
n
12, oct. 1977).
76. L. Kugelmann, p. 103; Correspondance, t. IX, p. 263; MEW 32, p. 553.
77. Was sich in historisch verschiednen Zustanden iindern kann, ist nur die Form, worin jene
Gesetze sich durchsetzen. [...] (Ibid.) Sur la traduction de sich durchsetzen, voir ci-dessus, note 74,
in fine.
78. Ibid.
-
Dans l'dition franaise du Capital, modifiant la prsentation du premier
chapitre sur le conseil d'Engels, Marx introduira un paragraphe intitul: forme de la valeur. Le
contexte montre qu'il s'agit de la forme spcifique de la valeur dans un monde d'changes de
marchandises. Ne comprenant pas cette dialectique de la loi gnrale et de ses formes
particulires, M. BIDET (op. cit., pp. 40-70, et 200-233) estime que le concept de valeur ne serait
pas un concept conomique, mais un concept essentiellement socio-politique: aussi voit-il des
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
111
paralogismes insurmonts dans la thorie marxienne de la valeur. Il n'utilise d'ailleurs pas cette
lettre Kugelmann, ni, d'une manire gnrale, la correspondance.
79. Manuscrits de 1857-1858, t. I, p. 207; Gr., p. 178, note. Trad. modifie.
-
Certains
interprtes allguent cette note pour soutenir que le concept de valeur (sans spcification) serait
pris comme concept gnrique par Marx (cf. M. Denis, op. cit., pp. 93-97, qui propose une
traduction non exempte d'erreurs; il en va de mme pour celle des ditions sociales). Ils le
transforment en un concept spculatif, aux dpens de la dialectique de l'universel et du
particulier, et de celle de la forme et du contenu, qui sont manifestes ici.
80. Ibid., p. 208; p. 179, note.
8!. Ibid.
82. Ibid., p. 207; p. 178, note.
83. Ibid.
-
Chez Marx, formel dsigne la forme d'une socit, c'est--dire le type des
rapports sociaux qui y
sont dominants, ceux qui lui sont spcifiques. Marx souligne ici ce qui fait
la spcificit du mode de production capitaliste.
84. Marx pose le problme clairement: <. Si seule la valeur d'change en tant que telle jouait
un rle dans l'conomie, comment des lments qui ne se rapportent qu' la valeur d'usage
pourraient-ils y entrer par la suite, comme, p. ex., dans le capital en tant que matire premire,
etc. (Ibid., p. 208; p. 178). C'est ce problme qu'il reproche l'conomie politique classique
anglaise de n'avoir pas .su rsoudre: Comment se fait-il que, chez Ricardo, la constitution
physique de la terre tombe subitement des nues *1, etc. (Ibid.
-
Ici, M. Denis commet un contre-
sens complet en traduisant: Comment chez Ricardo la qualit physique de la terre disparat-elle
soudain? (op. cit., p. 94).) Le verbe allemand employ par Marx est hereinschneien, qui signifie
pntrer dans..., comme la neige [Schnee] s'infiltre dans un local. L'ide de Marx est que la
valeur d'usage s'infiltre, pour ainsi dire, dans la valeur d'change.
85. Contribution, p. 22; MEW 13, p. 30. Ces exigences contradictoires sont assumes par une
marchandise particulire: l'argent. Elles se trouvent ralises en elle.
86. Cette dialectique de l'universel et du particulier que l'on trouve dans l'Introduction de
1857, est partout prsente, dans le Manifeste ou Le capital, dans les lettres Kugelmann, et dans
la Postface au Capital de 1872. Marx explique Engels qu'il a t influenc par une relecture de
La science de la logique de Hegel, car, au dbut de 1858, Freiligrath lui en avait fait parvenir un
exemplaire qui avait appartenu Bakounine: Dans la mthode d'laboration du sujet, quelque
chose m'a rendu grand service: by mere accident [par pur hasard], j'avais refeuillet la Logique de
Hegel [...] (L. Engels du 16 janv. 1858, Correspondance, t. V, p. 116; MEW 29, p. 260). Cette
lecture a inflchi le style de l'expos, mais ne fait pas revenir Marx un mode de penser qu'il
aurait abandonn! Il pense toujours dialectiquement: l'Introduction de 1857 et la moiti des
cahiers des Grundrisse, qui sont antrieures au hasard de cette relecture, le prouvent.
87. Rvlations sur le procs des Communistes Cologne, MEW 18, p. 570. (Cit par
Laura Lafargue dans sa traduction de Rvolution et contre-rvolution en Allemagne, Paris, Giard
et Brire, 1900, p. 233,note. Sur l'histoire de cette brochure crite en 1852, parue en 1853 Ble
et Boston, puis en 1875 Leipzig, cf. MEW 18, p. 759, n. 411).
- Voici la phrase en allemand:
Der Gesellschaft findet nun einll1al nicht ihr Gleichgewicht, bis sie sich um die Sonne der Arbeit
dreht, o Marx dit littralement: autour du soleil du travail.
88. Le capital, trad. Lefebvre, p. 693; ES, t. 3, p. 59; MEW 23, pp. 646-647.
89. Ibid., trad. Lefebvre, pp. 695-696; MEW23, p. 649.
90. Essai sur le principe de population, trad. Theil, Paris, Gonthier, 1963, p. 20.
9!. Nous sommes donc en tat d'affirmer, en partant de l'tat actuel de la terre habitable,
que les moyens de subsistance, dans les circonstances les plus favorables la production, ne
peuvent jamais augmenter un rythme plus rapide que celui qui rsulte d'une progression
arithmtique. (Ibid., p. 22) Malthus rsume son raisonnement comme suit: La race humaine
crotra selon la progression 1,2,4,8, 16,32,64, 128,256... tandis que les moyens de subsistance
crotront selon la progression 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Au bout de deux sicles, population et moyens
de subsistance seront dans le rapport de 256 9. (Ibid., p. 23) Comme c'est videmment
impossible, des millions d'hommes seront ainsi condamns mourir de faim (ibid.).
92. Ibid., chap. 20, pp. 175 et suiv.
93. Titre du premier paragraphe du chap. XXV (cf. Le capital, t. 3, p. 54; trad. Lefebvre,
p. 686; MEW 23, p. 640).
*
David RICARDO, On the Principles..., pp. 55-75. (Note de Marx). (Cf. Ricardo, op. cit.,
pp.57-75.
112 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
94. Ibid., trad. Lefebvre, pp. 695-696; MEW 23, p. 648.
-
Cette phrase ne figure pas dans
l'dition Roy, le texte ayant t remani en cet endroit par Marx.
95. M. J.-P. Lefebvre suit la quatrime dition allemande (1895), texte dfinitif tabli par
Engels partir des annotations crites et d'indications orales de Marx lui-mme.
96. Le capital, t. 3, p. 61; MEW 23, p. 649. C'est la phrase dont nous sommes parti.
-
Prtendu" traduit correctement angeblich. Souvent, les traducteurs rendent ce mot en franais
par soi-disant
",
utilis aussi pour traduire sogenannt, mot qui signifie littralement: ainsi
nomm", dit", comme dans Charles dit le Tmraire". Sogenannt a donc deux sens, l'un
neutre, l'autre critique, sur lesquels Marx joue.
97. Das so in ein Naturgesetz mystificirte Gesetz der kapitalistischen Accumulation
["']'"
(MEGA, t. IllS, p. 500, 1. 17-18.)
98. Op. cit., p. 410.
99. Loi naturelle de la population" figure pourtant bien dans le texte de Jules Roy. Mais,
celui-ci omet les guillemets qui indiquaient de quelle loi il s'agissait!
100. Cette accumulation de ngligences au fil des traductions et citations est fcheuse. On
voit combien le recours aux textes des diverses ditions allemandes du Capital est indispensable,
mais aussi combien il peut tre dlicat, Marx ayant lui-mme remani son texte. Dans la page en
question, une vingtaine de lignes ajoutes explicitent sa critique de Malthus.
101. Le capital, trad. Lefebvre, p. 696; MEW 23, p. 649. Cette phrase figure dans la premire
dition (cf. MEGA, t. II/S, p. 500, 1. 18-22), mais non dans la traduction de Roy.
- Le
soulignement de ihre Natur [sa nature] dans la premire dition n'est pas reproduit par les diteurs
des MEW, ni dans la traduction de M. J.-P. Lefebvre! Par l, Marx rappelait la spcificit du mode
de production capitaliste, comme il l'avait fait une page plus haut.
102. Cit par Marx (ibid., p. 207, n. 9; ES, t. l, p. 186, n. 1; MEW23, p. 199, n. 9).
103. Ibid., t. 3, p. 83. - Texte lgrement diffrent dans la quatrime dition: Ds qu'ils
essaient d'organiser, par des trade-unions par exemple, une action planifie commune aux
travailleurs occups et aux travailleurs inoccups, pour briser ou affaiblir les consquences
funestes sur leur classe de cette loi naturelle de la production capitaliste, aussitt le capitaliste et
son sycophante de l'conomie politique crient la violation de la loi ternelle" et en quelque
sorte sacre" de l'offre et de la demande" (trad. Lefebvre, pp. 718-719; MEW 23, pp. 669-670).
104. Ibid., p. 79. (Figure seulement dans l'd. Roy; cf. MEW 23, p. 666, n. 83, in fine).
105. Cit in Le capital, trad. Lefebvre, p. 726; ES, t. 3, p. 89; MEW 23, p. 676. - Marx
observe que Malthus a souvent recopi par pages entires l'essai" de Townsend (ibid., n. 2; n. 90,
et MEGA, t. II/S, p. 522).
106. Ibid., p. 83-; p. 670; p. 719.
107. Proudhon pensait qu'il
y
a des <dois ternelles de la proprit", fonde dans le droit de
tout travailleur la totalit du produit de son travail. Sa clbre apostrophe: <da proprit, c'est
le vol" ne visait pas la petite proprit, fruit naturel du travail
".
108. D'o l'ide de ces socialistes (Proudhon, Gray, etc.) de chercher le remde aux maux de
la socit actuelle dans un systme conomique et social nouveau o l'on donnerait chacun
l'exact quivalent de sa quantit de travail par un systme de bons de travail
".
Selon l'ide
d'change gal, Proudhon a voulu prouver qu'il tait possible d'introduire le crdit gratuit. Il cra
une banque cet effet; mais elle sombra rapidement.
109. Le capital, t. 2, p. 10; trad. Lefebvre, p. 356; MEW 23, p. 335. Trad. modifie.
1l0. Cit par Marx (ibid., t. 3, p. 201, n. 4; p. 853, n. 248; p. 788, n. 248).
lll. Cf. La critique moralisante et la morale critique", in Karl Marx, Textes (1842-1847),
p. 101; MEW 4, p. 338; uvres, d. Rubel, t. 3, p. 754; uvres philosophiques, trad. Molitor, rd.
Anthropos, t. l, p. 322. Marx numre ces conditions de la production moderne,,: la moderne
division du travail
",
la forme moderne de l'change
",
la concurrence
",
la concentration
",
etc.
112. L. F. A. Lange, 29 mai 1865, Correspondance, t. VIII, pp. 106-107; MEW 31, pp.
466-
468. Trad. modifie. Tradlre par la prtendue loi de Ricardo" comme le font les traducteurs des
Editions sociales est un contre-sens.
113. Ibid., p. 108; p. 467.
114. Le capital, t. 3, p. 178; trad. Lefebvre, p. 829; MEW 23, p. 765. Trad. modifie et mot
soulign par nous.
115. Ibid., p. 27; p. 658; p. 613.
-
Dans les ditions allemandes, la deuxime phrase de cette
citation figure en note (cf. MEGA, t. IllS, p. 472, n. 23).
116. Ibid.,p. 27, n. 2;p. 658, n. 24; p. 613, n. 24. -Ou bien cette modification est due Joseph
Roy, ou bien Marx qui, peut-tre, aura voulu mnager les proudhoniens aprs la sanglante
rpression de la Commune de Paris o ils taient en majorit.
LA POSSIBILIT ABSTRAITE 113
117. Ibid., p. 193; p. 843; p. 779.
118. Ibid., p. 201; p. 787.
119. Le capital, t. 3, p. 193; trad. Lefebvre, pp. 843-844; MEW23, p. 789. Trad. modifie. Trad.
de J. Roy: La force est un agent conomique.
Chapitre 3
LES CA USES
S'il Y a entre la nature d'une
cause et la nature d'un effet une
diffrence essentielle, n'y a-t-il
pas incompatibilit? et impossibi-
lit que l'effet soit le produit de la
cause qu'on lui donne? Qu'est-ce
que la possibilit? Qu'appelle-t-on
impossible?
DIDEROT
Empiristes et positivistes contestent que les sciences puissent dcouvrir les
causes des phnomnes. Quelle prtention de dire les causes, surtout les causes
ultimes et dernires! La science retomberait dans la mtaphysique, voire dans
la thologie 1. Ils lui enjoignent donc de se borner tablir et classer des lois.
Leur hantise est que la mtaphysique ne s'immisce dans les sciences. Avant
tout, que celles-ci vitent de donner prise aux controverses ontologiques
auxquelles conduit la recherche des causes2.
Le fait est que, aujourd'hui, les savants, influencs ou non par ces
interdictions, adoptent gnralement des positions philosophiques prudentes:
ils sont positivistes. Marx, lui, tait plus hardi: toute sa pense est causale! A
la diffrence de beaucoup d'conomistes, d'historiens et de sociologues, il n'en
est pas rest la recherche des lois des phnomnes socio-conomiques. Il en
a cherch les causes; le but des sciences socio-historiques, pense-t-il, est
prcisment de les trouver.
D'aiHeurs, aucune science ne consiste dans un catalogue de faits, dans une
simple classification des lois trouves de manire purement empirique. On fait
toujours intervenir des ides thoriques . De plus, certaines lois sont,
intrinsquement, des lois causales. C'est le cas de la dynamique classique qui,
assignant des forces l'origine des mouvements, explique ces mouvements
causalement3. Il en est ainsi de la plupart des grandes thories scientifiques qui
ont fait poque. En outre, il est remarquer qu'elles rduisent rarement les
causes un seul et mme genre.
Nous montrerons d'abord que Marx procde l'explication par les
116 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
causes. Ce sera le plus facile. Ensuite, nous chercherons quelle est pour lui la
nature des causes en conomie politique. Comme elles ne se ramnent pas
une seule et unique espce, cela donnera lieu un jeu des possibles, que Marx
conoit d'une manire souple et ouverte.
1. L'explication par les causes
La conception matrialiste de l'histoire est, par excellence, une thorie
explicative. Elle s'assigne la tche de rendre compte de l'ensemble du devenir
des socits humaines dans leurs aspects principaux, l'aide de causes
conomiques: besoins matriels, moyens de production, forces sociales et
intrts des classes en prsence.
L'analyse conomique ne peut se faire dans un vide thorique. Les grands
courants de la pense conomique se divisent justement sur les hypothses
explicatives4. Les savants avancent toujours quelque vue sur les causes des
variations des prix, des cots de production, des valeurs, du capital, de
l'investissement, des revenus, de la monnaie, sur les causes des cycles et des
crises, sur les conditions de la croissance conomique, etc.
Marx appelle lui-mme sa conception une conception matrialiste de
l'histoire , parce qu'elle explique l'histoire par des causes matrielles (cette
dsignation doit tre prise en un sens large claircir). Dans une telle
conception, le principe de causalit a une importance fondamentale: une
validit universelle. Pourtant, des interprtations rcentes, structuraliste
comme celle de M. Louis Althusser, ou subjectiviste comme celle de Michel
Henry, tendent masquer cet aspect essentiel: ils ne font pas l'explication
causale matrielle la place qu'elle a chez Marx.
L'tude des lois est une chose; Marx ne la nglige pas, on vient de s'en
rendre compte. Mais l'tude des causes est encore plus dcisive, car derrire les
lois se tiennent les causes. Au-del du comment , Marx cherche le pour-
quoi. S'il pense que les lois sont objectives, c'est justement parce que, en elles,
ce sont les causes relles qui se traduisent et se manifestent. Son uvre en
conomie a consist essentiellement en une recherche des causes de tous ces
phnomnes que sont la valeur, le salaire, la plus-value, le profit, la rente
foncire, l'intrt, etc.
A frquenter les uvres de Marx, on est frapp de constater qu'il
demande continuellement quelle est l'origine des faits et des lois conomiques,
quelle fut leur gense historique et quelles ont t les conditions de leur
apparition. S'il scrute le dveloppement pass et prsent du capitalisme, c'est
pour dceler les forces qui l'animent, les tendances qui le poussent, qui
dessinent son devenir et annoncent son destin.
Partout, Marx dcouvre des causes matrielles qui dcident des
moyens de produire, des rapports sociaux et des formes des institutions. Les
LA POSSIBILIT ABSTRAITE 117
grands vnements politiques, guerres, rvolutions, ont pour origine des luttes
de classes qui sont des luttes pour des intrts trs matriels".
L'explication marxienne des reprsentations idologiques est clbre;
c'est une explication causale: elle assigne des vnements spirituels des
causes matrielles,,!
Dans Le capital, la premire question aborde ne semble pas tre une
question causale: il s'agit de dterminer la nature de la valeur d'un produit qui
est objet d'change. Nanmoins, la recherche de la substance" de la valeur
est fondamentalement la recherche de sa cause. La valeur est engendre par le
travail. C'est pourquoi tous les objets d'utilit que l'on ne trouve pas tout prts
dans la nature ont une valeur. Ils rclament des oprations particulires qui
transforment les choses naturelles pour les rendre propres satisfaire des
besoins humains dtermins. Ce sont des produits". "Or, un produit"
renvoie une cause productrice" qui en est l'origine:
L'activit de l'homme provoque [...], grce au moyen de travail, une
modification de l'objet de travail qui ds le dpart tait le rsultat vis. Le
processus [Prozess] s'teint dans son produit. Ce produit est une valeur
d'usage, une matire naturelle approprie des besoins humains par une
modification de sa forme. Le travail s'est combin avec son objet. Il a t
objectiv, tandis que l'objet a t travaill. Ce qui apparaissait du ct du
travailleur sous la forme de la mobilit [Unruhe] apparat maintenant du ct
du produit comme une proprit au repos [ruhende], dans la forme de l'tre.
Le travailleur a fil et le produit est un fil5.
Maintenant, si l'on cherche la proprit des choses qui fait qu'elles sont
changeables et ont" une valeur d'change6, on ne peut la trouver qu'en ceci
qu'elles sont des produits du travail", mais, explique Marx, des produits du
travail abstrait" ou quantits de travail qui leur ont t consacres, indpen-
damment de la nature particulire de ce travail. Seul compte le temps de
travail7.
La marchandise se prsente sous deux formes: valeur d'usage et valeur
d'change. C'est donc, conclut Marx, que chacune a sa propre cause. Or, pour
les deux, la cause est le travail. Marx en dduit immdiatement le caractre
double du travail, ide absolument centrale dans ses analyses.
Cette dcouverte, qui ne lui est pas propre, devient pourtant rvolution-
naire entre ses mains parce qu'il la dveloppa d'une manire critique. Elle est
la cl des problmes sur lesquels achoppait l'conomie politique classique. Il
les rsout dans Le capital:
[...] le travail contenu dans la marchandise a aussi un caractre double.
Ce point, que j'ai dvelopp le premier de manire critique, est le pivot
autour duquel tourne la comprhension de l'conomie politique8.
Ainsi, le travail concret est la cause de la valeur d'usage des marchan-
118 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
dises 9, le travail-abstrait , ou quantit ou dure du travail, la cause de leur
valeur d'change.
Adam Smith et Ricardo l'avaient vu, mais n'en avaient pas reconnu toute
la porte: ils n'en avaient tir aucune critique de l'conomie capitaliste! Ce que
Marx reproche Ricardo au sujet de la plus-value, c'est qu'il ne s'est pas
intress sa cause, mais seulement la mesure de sa grandeur:
Ricardo ne s'occupe jamais de l'origine [Ursprung] de la plus-value. Il
la traite comme une chose inhrente la production capitaliste, qui pour lui
est la forme naturelle de la production sociale. Aussi, quand il parle de la
productivit du travail, il ne prtend pas y trouver la cause [Ursache] de
l'existence de la plus-value, mais seulement la cause [Ursache] qui en
dtermine la grandeur 10,
La gageure de Marx, ce fut, tout en respectant la loi de la valeur (change
d'quivalents), d'arriver expliquer l'existence d'une plus-value, ce que
l'conomie politique anglaise n'avait pas russi faire.
Pourtant, Marx ne mnage pas ses loges Ricardo quand celui-ci
explique la grandeur de la valeur d'une marchandise par la quantit de travail
ncessaire pour la produire.
Mais, comment se fait-il qu'une valeur nouvelle soit cre si l'on
n'change que des quivalents, y compris pour payer l'ouvrier?
Marx dcouvre que cette plus-value a son origine dans la diffrence entre
la valeur d'change des choses produites et la valeur d'change des choses
consommes dans la production. Si une valeur plus grande apparat (est
produite !), c'est que la valeur d'change de la force de travail, c'est--dire
la valeur des choses ncessaires l'ouvrier pour vivre, est moindre que la
valeur de ce qu'il produit. C'est cette diffrence que met profit, dans des
conditions historiques et sociales donnes, l'entrepreneur capitaliste qui achte
la force de travail des ouvriers.
Cette explication est clbre. On peut y faire toutes sortes d'objections, en
particulier contester la thorie de la valeur-travail sur laquelle elle repose 11.
Mais il est clair que c'est une explication causale.
Bien d'autres exemples montrent que la recherche des causes est absolu-
ment essentielle chez Marx. L'une des distinctions importantes du Capital est
celle qui oppose plus-value relative et plus-value absolue. Elle parat obscure
au premier abord. La plus-value absolue semble mal dsigne, car elle est tout
aussi relative que la plus-value relative: elle varie avec la dure du travail et sa
qualification, avec les saisons, les pays et les poques; elle n'est pas la mme
d'une entreprise l'autre, d'une branche de production l'autre, etc.
Cependant, cette distinction devient lumineuse lorsqu'on s'aperoit qu'il
s'agit d'une diffrence d'origine. C'est par leurs causes originaires que ces deux
formes essentielles de plus-value diffrent. La plus-value que Marx appelle
LA POSSIBILIT ABSTRAITE 119
absolue a son origine dans la portion de la journe o l'ouvrier continue de
travailler alors qu'il a dj reproduit la valeur de sa propre force de travail12.
Quant la plus-value relative, elle est d'origine toute diffrente: elle
provient de la productivit du travail, laquelle dpend de la coopration, de la
division du travail et des moyens techniques mis en uvre 13.A partir de la fin
du XVIIIesicle, l'introduction du systme de machines (fabrique mcanise)
fut le grand moyen pour accrotre la productivit du travail dans certaines
branches, et crer ainsi davantage de plus-value relative.
L'on a deux causes de nature absolument diffrentes. Il est clair que des
causes diffrentes procurent des possibilits diffrentes. Marx indique les
divers effets possibles de la coopration: elle peut concentrer la force productive
collective en un endroit de l'espace 14.Elle peut l'tendre spatialement, comme
lorsque l'on construit une ligne de chemin de fer en de multiples endroits la
fois. Elle peut aussi la concentrer sur un moment du temps. Enfin, elle peut
combiner ces diverses possibilits entre elles.
Marx rechercha les causes qui provoqurent le grand essor de la socit
bourgeoise moderne. Ces causes sont complexes: c'est plutt un ensemble de
causes diverses, plus ou moins lies et interdpendantes. L'idologie allemande
insistait surtout sur la division du travail comme cause de ce remarquable
dveloppement: la suite des conomistes anglais, Marx et Engels en firent
alors un principe explicatif gnral, qui sera dsormais la base de leurs
conceptions. Marx les a prcises dans Le capital, justement par ses distinc-
tions des formes de la plus-value des formes de coopration, des formes du
profit, etc.
L'apparition de la socit bourgeoise fut le rsultat d'un concours et d'un
enchanement de causes multiples. Sa gense a t rendue possible par une
nouvelle division du travail, qui dpendait elle-mme de causes nombreuses;
d'une part, des causes subjectives: le progrs technique est impuls ou
retard par les forces sociales en prsence; d'autre part, des causes objec-
tives: les moyens de production qui forment eux-mmes un vaste ensemble
li des possibilits matrielles et naturelles. L'introduction de nouveaux
outils ou machines suppose des matriaux et d'autres machines: les machines
de mtal ne furent possibles que du fait de l'invention du tour de Maudsley 15,
ce qui assura la suprmatie de la machine vapeur. Une technique nouvelle
suppose tout un systme technique.
Ces causes peuvent avoir de multiples effets. La division du travail va de
pair avec les modifications des moyens de production: le progrs dans les
moyens de production engendre de nouveaux rapports de production.
Mthodes et mtiers sont bouleverss. Une nouvelle division sociale gnrale
s'en suit, de nouveaux rapports sociaux. Beaucoup de choses possibles
apparaissent, par consquent de nouveaux statuts sociaux, un droit nouveau,
des partis politiques nouveaux, des ides nouvelles, une littrature nouvelle.
Une rvolution technique a donc de nombreuses consquences possibles
sur les plans matriels, moraux et intellectuels. Le nouveau machinisme a
120 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
engendr les villes industrielles, et leur cortge d'effets souvent dsastreux sur
la sant et le mode de vie des couches les plus pauvre~. Par leurs liens trs
troits avec les artisans et ouvriers migrs, Marx et Engels s'intressrent
particulirement ces consquences dramatiques: ils cherchrent compren-
dre leurs causes profondes pour y porter remde 16.
L'introduction d'une machine apparemment secondaire peut cependant
a.voir des rpercussions importantes au point de vue social: La machine
rsolument rvolutionnaire qui prend pied uniformment dans la totalit des
innombrables branches de cette sphre de production, confection, cordonne-
rie, couture, chapellerie, modistes, etc., c'est la machine coudre 17. Par o
l'on voit que Marx n'a pas pris modle exclusivement sur les grandes filatures
et manufactures de tissage mcanises et qu'il ne ngligeait pas les multiples
aspects et secteurs de la production, ni toutes les possibilits que cette diversit
engendre.
La grande industrie ne rvolutionne pas seulement son propre secteur, ni
seulement les classes qui y participent directement: C'est dans la sphre de
l'agriculture que la grande industrie a l'effet [wirken] le plus rvolutionnaire,
dans la mesure o elle anantit ce bastion de l'ancienne socit qu'est le
"paysan" et lui substitue l'ouvrier salari 18.
Par son caractre rvolutionnaire, le mode de production capitaliste
ouvre donc l'ventail des possibilits historiques: comme dit Marx, il
consomme la rupture du lien de parent qui unissait initialement l'agriculture
et la manufacture au stade infantile et non dvelopp de l'un et de l'autre. Mais
cette rupture cre en mme temps les prsupposs matriels d'une nouvelle
synthse un niveau suprieur, de l'association de l'agriculture et de l'indus-
trie [...] 19.
L'impact de l'industrie sur l'agriculture montre que tout est li: le jeu des
possibles techniques, celui des possibles sociaux et des possibles idologiques.
La conscience sociale participe aux bouleversements: Le mode d'exploita-
tion le plus routinier et le plus irrationnel est remplac par l'application
consciente de la science 20.
Ainsi, la recherche des causes ne concerne pas seulement les phnomnes
conomiques, mais aussi les ides conomiques. L'un des principaux objectifs
de Marx dans Le capital fut de rendre les ouvriers conscients des causes qui
dterminent le salaire et des ides fausses qu'ils se font ce sujet.
Il examine les diverses rponses apportes cette question: le salaire est-
il l'objet d'un libre contrat, d'une convention? Ou bien y a-t-il un prix
naturel du travail comme l'avait soutenu A. Smith? Celui-ci confondait
valeur d'change et valeur d'usage. Il supposait en outre que la valeur d'usage
des biens de consommation courants et les besoins ne variaient quasiment pas
tout au long de l'histoire humaine.
Autre possibilit: la variation des salaires serait-elle lie au mouvement
naturel de la population? Cette conclusion dcoule de la fameuse thorie de
Malthus. Marx s'exclame: Ce serait une belle loi 21! En effet, les mouve-
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
121
ments gnraux du salaire sont en gros exclusivement rguls par les phrases
d'expansion et de contraction de l'arme industrielle de rserve, qui
correspondent aux changements de priodes du cycle industriel. Ils ne sont
donc pas dtermins [bestimmt] par les volutions de l'effectif absolu de la
population ouvrire22.
Marx critique galement l'explication du salaire par la loi de l'offre et de
la demande. Bien que communment invoque dans ce but, cette loi ne peut
rendre compte, tout au plus, que du phnomne secondaire, savoir que les
salaires oscillent autour d'une moyenne laquelle ils se ramnent. L'offre et la
demande rgulent ces fluctuations, mais ne peuvent expliquer le niveau auquel
s'tablit cette moyenne.
L' explication apporte par cette loi est vide, fait constamment remar-
quer Marx. Elle ne fournit aucune cause qui explique ce niveau moyen. La
mme objection vaut pour l'explication des prix en gnral: la stabilit des prix
sur une certaine priode ne peut trouver sa raison d'tre que dans des causes
gnrales constantes sur la priode considre 23.
Pourquoi les ides courantes sur le salaire sont-elles errones? Il faut en
chercher la raison, c'est--dire la cause, dans le mode de production capitaliste
lui-mme et dans le mode d'change qui lui correspond. Quand on change des
produits sur un march, le phnomne principal est l'change d'quivalents:
on croit donc tout naturellement que le capitaliste paie rellement le travail
sa valeur. L'on identifie le travail que l'on effectue et le travail pay.
Cette explication causale, tant des faits conomiques que des ides qu'on
se fait sur eux, occupe tout Le capital. Ce mode d'explication vient de loin: il
est dj caractristique du jeune Marx.
Dans L'idologie allemande, Marx et Engels expliquent que les formes et
les contenus de la conscience sociale ont pour origine des causes extrieures
la conscience elle-mme, des causes matrielles, plus prcisment les condi-
tions d'existence gnrale des diverses classes sociales. Les ides sont lies la
profession qui implique que l'on n'a qu'un point de vue partiel sur la socit.
Ils expliquaient ainsi les ides de l'cole allemande de la critique religieuse
(Strauss, Feuerbach, Bauer, Stirner), par la situation gnrale (conomique,
politique et sociale) de la socit allemande, attribuant les limites et les
insuffisances de cette critique au retard historique de l'Allemagne sur la
France et l'Angleterre, dans les domaines conomique, social, politique et
intellectuel.
Trs tt, Marx dnonait chez Feuerbach un manque de sens social et
politique, ce qui l'empchait de comprendre la spcificit du contenu concret,
socialement et historiquement dtermin, des croyances et reprsentations
religieuses: Les aphorismes de Feuerbach n'ont qu'un tort mes yeux: il
[Feuerbach] renvoie trop la nature et trop peu la politique, crit-il un
ami, ds 184324. Le comble est atteint par Stirner qui, se piquant d'histoire,
n'arrive qu' une philosophie de l'histoire spculative , pompeuse et
ronflante , trois catgories rebattues25 .
122 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Feuerbach, Bauer et Stirner avaient pens expliquer les ides reli-
gieuses (en fait, le christianisme) d'une manire critique . Marx montre
qu'ils se font encore de profondes illusions sur l'origine des ides. Mme
Feuerbach, qui dmasquait l'alination religieuse dans son Essence du christia-
nisme, en restait une explication encore trs idaliste: c'tait pour lui un
phnomne d'alination de la pense de l'homme en gnra!. De mme
pour Bruno Bauer qui revenait la conscience de soi au sens de Fichte.
En fait, dit Marx, ils ne font appel qu' des concepts gnraux, comme le
concept de conscience de soi ou le concept d'homme en tant qu'tre
gnrique ou genre, dans lesquels ils croient trouver l'origine des croyances et
reprsentations religieuses, alors que celles-ci, rtorque-t-il, ont, suivant les
priodes et les socits, des causes particulires, sociales et matrielles bien
dtermines dcouvrir par une tude historique.
Le vrai point de dpart, ce sont des individus appartenant des classes
aux intrts dtermins, entretenant des relations sociales donnes: esclaves ou
hommes libres, plbiens ou patriciens, serfs ou seigneurs, compagnons ou
matre de jurande, etc.26. Ni Feuerbach, ni Bauer, ni Stirner n'entrent dans ces
dtails . Aussi Marx peut-il ironiser:
Dans cette conception [histoire d'esprits], on s'en tient sans problme
la religion, dont on fait une causa sui [cause de soi] (car" la Conscience de
soi" et "l'Homme" sont encore, eux aussi, de nature religieuse), au lieu de
l'expliquer partir des conditions empiriques [...]. Si Stirner avait examin
un peu l'histoire relle du moyen ge [...] il aurait pu dcouvrir qu'il n'existe
pas la moindre histoire" du christianisme" et que les diverses formes que sa
conception prit diffrentes poques, loin d'tre autant
d'''autodterminations'' et de "dveloppements" "de l'esprit religieux",
eurent pour origine des causes [Ursachen] tout fait empiriques, chappant
toute influence de l'esprit religieux27,
Marx n'a pas seulement retenu la leon historique et dialectique de Hegel,
il s'est instruit auprs des historiens franais (Augustin Thierry, Mignet,
Guizot): ils avaient un tout autre sens social du mouvement historique rel
que les Idologues allemands; ils n'expliquaient pas l'histoire de la France ou
celle de l'Angleterre par un mouvement des ides religieuses!
Mais, chercher les causes spcifiques des idologies et des institutions
dans les conditions empiriques, sociales et historiques, de l'poque considre,
apparat trs tt chez Marx. Ds ses premiers crits, sa pense est dj oriente
en ce sens, ce qu'il devait Hegel, videmment.
Un ditorialiste de la Gazette de Cologne, qui devait ignorer Montesquieu
et Hegel autant que Guizot et Augustin Thierry, attribuait le dclin des
socits grecque et romaine de l'Antiquit l'affaiblissement de leur religion:
Chez les nations qui ont atteint une importance historique suprieure,
l'apoge de leur vie politique concide avec l'panouissement suprme de leur
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
123
sens religieux, la dcadence de leur grandeur et de leur puissance avec la
dcadence de leur culture religieuse28.
Marx dnonce ici l'inversion de la cause et de l'effet:
C'est en retournant exactement l'affirmation de l'auteur qu'on obtient
la vrit; il a mis l'histoire la tte en bas. [...] Si la chute des tats de
l'antiquit entrane la disparition des religions de ces tats, il n'est pas besoin
d'aller chercher d'autre explication, car la
':
vraie religion" des Anciens tait
le culte de "leur nationalit", de leur "Etat". Ce n'est pas la ruine des
religions a~tiques qui a entran la chute des tats de l'antiquit, mais la
chute des Etats de l'antiquit qui a entran la ruine des religions anti-
ques29.
lev dans l'esprit des Lumires, Marx n'a jamais eu aucune illusion sur
les causes de la religion ou de la philosophie. Il est persuad de leurs origines
terrestres. Dans le mme article de juillet 1842, se trouvent ces lignes souvent
cites et qui ne seraient pas dplaces dans Le capital:
Seulement les philosophes ne poussent pas comme les champignons, ils
sont les fruits de leur poque, de leur peuple, dont les humeurs les plus
subtiles, les plus prcieuses et les moins visibles circulent dans les ides
philosophiques. C'est le mme esprit qui difie les systmes philosophiques
dans le cerveau des philosophes et qui construit les chemins de fer avec les
mains des ouvriers. La philosophie n'est pas hors du monde, pas plus que le
cerveau n'est extrieur l'homme mme s'il n'est pas dans son estomac 30.
S'il n'y est pas question des classes, mais du peuple, si, cette poque, ni
rapports sociaux ", ni idologie ne font partie du vocabulaire de Marx,
l'explication gnrale concernant l'origine et la gense des ides voque dj
celle qu'on trouvera dans L'idologie allemande et dans Le capital. L' esprit
qui est la cause des ides philosophiques, c'est celui qui pense et ralise les
inventions techniques3l !
Donnons encore une preuve
- s'il en est besoin -
que le point de vue
causal est central chez le jeune Marx. L'une des ides de base de sa critique de
la philosophie du droit de Hegel, en 1843, est que c'est la socit civile qui
dtermine l'tat, et non l'inverse: Quelle est [...] la puissance de l'tat
politique sur la proprit prive? La propre puissance de la proprit prive [...].
Que reste-t-il l'tat politique [...]? L'illusion que c'est lui qui dtermine, alors
. que c'est lui qui est dtermin [bestimmtJ32.
L'on trouve dj l la future dtermination de la superstructure
(l'tat) par sa base (la socit civile). Il est vrai qu' cette poque Marx ne
donne pas encore cette dernire comme dtermine son tour par la
production matrielle, en particulier la production des moyens de production.
Mais il est clair que pour lui l'explication socio-historique consiste rendre
compte des structures sociales et idologiques d'une manire causale. Le
124 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
causalisme est une constante de sa pense. Et cette explication est quasi-
matrialiste, car il cherche trs tt les causes du ct des conditions d'existence
matrielles des hommes vivant en socit.
2. La notion de cause et ses divers sens
Rappelons notre hypothse de travail: Marx est causaliste, mais non
dterministe. Examinons donc les termes qui expriment l'ide de cause.
L'abondance et la varit des expressions qu'il mobilise, l'absence de
rigueur des traductions, provoquent toutes sortes de quiproquo et de msinter-
prtations ce sujet. Peut-tre Marx en est-il le premier responsable. N'a-t-il
pas fait preuve d'un grand laxisme, en mettant contribution toutes les
ressources de la langue?
En effet, on trouve: produire ", engendrer , crer , faire natre ,
tre la source de , amener , provoquer , susciter , entranr ,
conditionner , dterminer , tie produit , tre engendr , natre de ,
avoir pour source, avoir pour origine, avoir pour fondement, avoir
pour condition , dpendre de , rsulter de , tre issu de , s'en suivre
de, dcouler de, tre conditionn par, tre dtermin par, etc.
Parmi les substantifs, outre cause, signalons: condition, prsuppo-
sition , origine , source , gense , production , activit , proces-
sus, dveloppement, cration 33,
On le voit, la causalit est exprime sous des formes extrmement
diverses. En outre, il convient de mentionner d'autres types de rapports
voisins, impliquant plus ou moins l'ide de causalit. Ils sont galement
exprims de manire trs varie: apparatre , se raliser , s'objectiver ,
se manifester, se prsenter sous la forme de, avoir pour forme
d'existence, etc.
Vouloir dresser, comme pour le terme loi , une liste exhaustive des
occurrences des termes exprimant l'ide de cause, mme limite au Capital,
serait impraticable et drisoire: c'est chaque page, presque dans chaque
phrase, que l'on rencontre ces termes34, Malgr ces obstacles, tentons une
brve analyse du vocabulaire de la causalit chez Marx, afin de mieux cerner
sa pense causale.
Reprenons la clbre parole de L'idologie allemande: Ce n'est pas la
conscience qui dtermine [bestimmt] la vie, mais la vie qui dtermine la
conscience 35, rpte, presque mot pour mot, dans la Prface la Contribu-
tion: Ce n'est pas la conscience des hommes qui dtermine leur tre; c'est
inversement leur tre social qui dtermine leur conscience36.
Chaque fois, est employ le verbe bestimmen [dterminer]. De mme,
quand il s'agit des rapports entre base et superstructures, entre la socit civile
(l'organisme conomique) et la forme de l'tat, c'est--dire sa structure
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
125
juridique et politique, Marx affirme qu'il y a une certaine relation causale
globale entre la premire et la seconde.
Or, dans les mmes textes, pour expliquer ce qu'il veut dire, Marx emploie
aussi bedingen qui signifie conditionner: Le mode de production de la vie
matrielle conditionne [bedingt] le processus de vie social, politique et
intellectuel [geistig] en gnral37.
Conditionner et dterminer ne signifient pas la mme chose!
Ramener le premier au second, ou faire l'inverse, peut changer du tout au tout
l'interprtation. Marx ne se soucie gure de faire des distinctions formelles,
bien qu'il diffrencie souvent nettement entre cause et condition .
C'est le mot dterminer et ses drivs qui focalisent les difficults. Pour
faire la clart sur ce point, il faut carter les cas o dtermin [bestimmt] est
adjectif. Quand il est question des individus dtermins d'une poque
dtermine, produisant dans des conditions dtermines, etc., dter-
min a le sens de prcis, particulier ou spcifique. Il correspond
donn en mathmatiques. Il n'en est pas de mme du verbe dterminer
conjugu la voix active ou passive. Dans les citations que nous venons de
rappeler, il exprime la relation entre une cause productrice et l'effet qu'elle
engendre.
Quant au substantif dtermination [Bestimmung], il a trois sens
distincts: il signifie tout d'abord proprit , qualit ou caractre d'une
chose, d'un processus ou d'une personne; il n'a alors qu'un sens descriptif. En
second lieu, il exprime une relation fonctionnelle comme dans la plupart des
lois en science38. Enfin, il signifie une vritable relation causale. Il faut
remarquer que l'ide de dterminisme peut s'attacher l'un aussi bien qu'
l'autre de ces deux derniers sens39.
Si, dans les formules ci-dessus, Marx emploie sans autre prcision et
indiffremment bestimmen et bedingen, il faut tout de mme noter qu'ailleurs
d'autres termes sont mis en uvre qui font mieux comprendre sa pense. Ils la
compltent et la nuancent. Ainsi, L'idologie allemande explique que la
production des ides est d'abord immdiatement mle [verflochten]
l'activit matrielle des hommes, qu'elle apparat en tant qu'manation
[Ausfluss] directe de leur comportement matriel40 .
Ainsi, que la conscience dpende de la vie concrte, cela ne veut pas dire
qu'il n'y a que passivit de la conscience. Il y a bien une dpendance causale,
mais l'ide d'manation montre qu'il ne s'agit pas de la causalit telle que
l'entend un dterminisme extrinsque et un matrialisme mcaniste, mais
d'une interdpendance, d'une intrication, d'une symbiose indissoluble. En
outre, Marx l'admet sans difficult, quoique nes dans la vie immdiate, les
ides se dtachent de cette troite liaison initiale; alors leur rapport la vie
devient indirect et mdiat. Les ides des idologues sont moins intimement
lies la vie immdiate que celles du peuple et des hommes de la pratique.
Quand Marx parle de conditions , vite-t-il les quivoques de mots
comme dterminer et dtermination? Nous ne le pensons pas, car la
126 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
notion de condition exprime tout autant la causalit efficiente ds lors qu'il
s'agit justement de conditions externes . L'eau est la condition de
l'apparition d'tres vivants. En ce sens, elle en est la cause extrinsque. Mais
il est vident que l'eau ne suffit pas expliquer l'apparition de la vie. Est-ce
ainsi que la vie conditionne la conscience pour Marx?
Il aurait sembl de saine mthode de distinguer entre la cause au sens
d'origine et la cause au sens de simple condition, entre la cause productrice (ce
qui agit, l'agent) et la cause en tant que simple condition de possibilit parmi
d'autres. Conditionner signifie moins que causer; notre exemple de l'eau
et de la vie le montre.
Cette distinction ne nous avancerait cependant gure, car il est un autre
terme que Marx emploie volontiers comme synonyme de condition et qui
explicite ce qu'il veut dire: c'est prsupposition , terme courant en allemand,
auquel Hegel a donn un sens thorique prcis dans sa logique. Prsupposi-
tion [Voraussetzung] renvoie position [Setzung], c'est--dire poser
[setzen], en tant qu'activit ou action de faire apparatre et tre quelque chose.
En ce sens, la chose est pose41.
Les relations entre poser et prsupposer sont dialectiques. Pas de position
sans prsupposition. Inversement, toute prsupposition est relative une
position, une activit posante , la causalit immanente d'un agent ou
du sujet d'un acte ou d'une action42. En ce sens, tout matriau (c'est le cas de
la base conomique d'une socit donne) est prsuppos par l'activit qui
s'en empare et l'lit en fonction de ses propres buts. Au besoin, elle lui donne
forme. C'est ainsi qu'il faut comprendre la relation de dpendance entre la vie
et ses conditions matrielles: ainsi s'tablit, ds le dbut, une intime liaison et
une fusion entre elles. Il en est de mme pour les relations entre la conscience
et la vie sociale.
La relation entre le capital et le travail est galement de ce type: c'est une
dialectique de la position et de la prsupposition o l'un des opposs devient
son contraire dans un change sans fin 43.Ils sont cause et effet l'un de l'autre:
c'est une causalit rciproque.
Si condition a ce sens prsupposition, il faut revenir sur le rapport
entre base et structure , et entre infrastructure et superstructure, car
l aussi c'est de la relation entre un pos et une prsupposition qu'il s'agit.
Le mot base peut signifier deux choses. Il peut avoir un sens passif ou
un sens actif. Dans le sens passif, il a simplement le sens de sol [Grundlage],
mot frquemment utilis par Marx. Base signifie alors matriau nces-
saire, ou simple assise , pour le dveloppement d'une ralit qui a une
autonomie relative par rapport cette base. La base, en ce sens, c'est la
condition ncessaire, mais non suffisante, c'est la condition matrielle de la
superstructure, au sens de cause matrielle chez Aristote; elle est condition
de possibilit passive. Dans l'autre sens, la base est conue comme la cause
agente, ou encore comme la cause pleine et entire au sens de Leibniz. Elle est
ncessaire et suffisante, et engendre la superstructure.
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
127
Les interprtes mettent en avant tantt l'un, tantt l'autre de ces deux
sens. Le premier est plutt voqu par le mot condition et le second par
celui de dtermination . Malheureusement, - rptons-le -, Marx dit
indiffremment que la base conditionne toute la socit, ou qu'elle la
dtermine. La seule conclusion est que pour lui la base est la fois
condition et cause, mais la superstructure galement dans une causalit
rciproque. C'est finalement ce que recouvre l'ide de correspondance entre
base et superstructure. Celle-ci n'est pas un simple piphnomne de celle-
l, comme le disent certains critiques comme M. Calvez.
Marx tenait donc garder les deux aspects de cette alternative, au risque
d'une redoutable quivoque qui a aliment les polmiques sur l'interprtation
du marxisme, et les divergences des commentateurs.
Dveloppons un peu ce point, car il est difficile de croire qu'un penseur
comme Marx ait pu maintenir un tel dilemme au cur de ses doctrines. La
seule manire de sortir de ce dilemme consiste admettre que la base n'est pas
cause au sens mcanique du terme: il n'y a pas extriorit entre elle et la
superstructure. On a vu qu'une base socio-conomique caractrise d'une
manire gnrale ne suffit pas expliquer la forme singulire d'un tat donn.
Toutes sortes de causes rendent compte des diffrences des institutions d'un
peuple l'autre, d'une rgion l'autre, d'un moment historique l'autre, bien
que l'on soit en prsence d'un mme mode de production 44.
Marx donne en exemple la France, l'Angleterre et les tats-Unis d'Am-
rique, pays o le mode de production dominant est capitaliste et o les
bourgeoisies ont la suprmatie politique depuis qu'elles y ont renvers par une
rvolution ou une guerre, les structures socio-politiques fodales ou colo-
niales. Cependant, les constitutions politiques de ces pays prsentent des
diffrences considrables. La base ne dtermine donc pas de manire
automatique la forme particulire de l'tat.
Faut-il pour autant en con dure que la base soit une simple assise
indiffrente la forme des institutions qu'elle supporte? Non pas. La base
socio-conomique prsente aussi des diffrences d'un pays l'autre, ce qui
n'apparat gure dans Le capital. Par contre, dans Le dix-huit Brumaire, Marx
montre que la forme prise par l'tat franais sous le Second Empire plonge ses
racines dans la structure de classe singulire de la France, que caractrise le
morcellement de la proprit foncire; la condition conomique des petits
paysans propritaires y joue un rle dcisif:
Le pouvoir d'tat ne plane pas dans les airs. Bonaparte reprsente une
classe bien dtermine, et mme la classe la plus nombreuse de la socit
franaise, savoir les paysans parcellaires45.
La base conomique et sociale d'un pays donn a ses traits particuliers.
Ce qu'affirme Marx, c'est la fois une dpendance46 et une correspon-
dance. D'une part, la structure tatique dpend de la structure sociale, et celle-
128 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
ci de la structure conomique; d'autre part, base et superstructure se
correspondent, de mme que les forces productives et les rapports de
production qui forment la base proprement dite.
A l'intrieur de cette correspondance et de cette dpendance gnrales, il
y a place pour des variations et pour toutes sortes de possibilits, car des
causes diverses jouent leur rle.
Qu'il y ait une latitude et un jeu de diverses causes, cela apparat ds
qu'on analyse les rapports entre base et forme politique dans des cas
historiques donns. Alors, il faut procder l'analyse concrte, et ce sont
toutes sortes de facteurs: historiques, gographiques, etc., qui interviennent et
s'entre-mlent.
Cependant, dans une correspondance globale, une relation de dpen-
dance causale existe puisque les changements importants, parfois spectacu-
laires, des formes politiques suivent les changements moins perceptibles que
l'on peut constater dans le domaine socio-conomique.
On ne saurait aller plus loin tant que l'on reste sur un plan gnral.
Correspondance et dpendance admettent toutes sortes de degrs l'intrieur
des limites qu'elles imposent. Parfois, Marx souligne la dpendance d'une
manire presque caricaturale pour bien la faire ressortir, ainsi dans l'exemple
emblmatique de Misre de la philosophie o, deux manires de produire (ici
deux manires de moudre le bl), reprsentes par le moulin bras et le
moulin vapeur, il fait correspondre deux types de personnages sociaux
et politiques, le seigneur fodal et le capitaliste industriel moderne. Il est clair
que ces types sociaux dpendent des moyens de production. Par l, Marx
semble poser un dterminisme conomique rigoureux.
Pourtant, dans ce schme historique prsent en un dyptique contrast,
rien n'indique les causes qui ont engendr le moulin bras et le seigneur fodal
d'une part, la machine vapeur et l'entrepreneur capitaliste d'autre part.
Surtout, rien ne fait comprendre le passage des premiers aux seconds, sauf
faire remarquer que Don Quichotte fut terrass par le moulin vent. On n'a
ainsi que l'ide d'~ne ncessit aveugle. Mais l'histoire relle ne se rsume pas
au rcit romanesque de Cervants qui syncope la srie des causes.
D'ailleurs, l'histoire relle ne prsente pas toujours et partout des cas nets
de correspondance et de dpendance. On peut mme allguer et trouver toutes
sortes de cas contraires. Marx le sait pertinemment: il leur fait place! Il ne
soutient pas que la correspondance soit parfaite et harmonieuse. Au contraire,
aime-t-il dire, s'il y a histoire, c'est justement parce que se dveloppent toutes
sortes de discordances47. Et quelles discordances: des contradictions! Quelles
discordes: des guerres!
La correspondance n'exclut donc pas les oppositions et les conflits.
L'histoire est faite de tensions et de luttes, o se manifestent les contradic-
tions internes la socit. Une priode calme cache des conflits latents ou
venir. Tout volue et change: ce qui s'accordait finit par se dsaccorder.
C'est pourquoi, chez Marx, on trouve aussi l'ide que des formes d'tat
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
129
ne correspondent pas la base socio-conomique sur laquelle pourtant elles
reposent. Un tat dj bourgeois peut tre greff sur une structure juridico-
conomique ancienne qui persiste. Ainsi, l'tat monarchique franais du
XVIIesicle est cet hybride o un quilibre prcaire s'tablit entre des classes
sociales conomiquement opposes: la fodalit et la bourgeoisie. Il y a
avance de certaines superstructures sur la base conomique! La bourgeoisie
a obtenu une certaine prpondrance politique, sans avoir russi modifier
des rapports sociaux fodaux. Il y faudra la Rvolution de 1789!
La causalit conomique et historique n'est donc pas simple. Marx n'avait
pas une conception troite, unilatrale, des rapports de dpendance entre base
et superstructures. Car, inversement, on le voit s'interroger sur la permanence
de formes idologiques ou juridiques qui ne correspondent plus une base
matrielle et sociale qui a compltement disparu, parfois depuis longtemps.
C'est un vritable contre-exemple de la thse fondamentale du matrialisme
historique que celui de certaines formes d'art trs anciennes dont la vitalit
persiste ou qui refleurissent dans la priode .moderne ou contemporaine.
Pourquoi, demande Marx, les exploits d'Achille, ou l'odysse d'Ulysse,
nous meuvent-ils encore, alors que toutes les conditions d'existence, les ides
sur le monde et les croyances ont radicalement chang depuis la lointaine
poque d'Homre48? Que devient la thse selon laquelle chaque forme de
socit a ses formes idologiques correspondantes? La vie ne dtermine-
rait-elle pas toujours la conscience ?
La rponse que Marx tente d'apporter cette question est que les formes
d'art et leurs productions peuvent avoir une signification humaine qui
dpassent leur poque de naissance. Que l'art et l'pope grecs procurent
encore une jouissance esthtique ", cela ne peut s'expliquer que par la
psychologie humaine: l'humanit, comme l'individu, dit Marx, prend
plaisir [...] revivre son propre caractre dans sa vrit naturelle 49, celle de
son enfance. Cette explic~tion montre que l'application des principes du
matrialisme historique aux productions idologiques peut prsenter quel-
que difficult!
Autre contre-exemple crucial, celui du droit romain. Ce droit persiste ou
rapparat en plein dveloppement capitaliste au sein de rapports sociaux
bourgeoisso. Marx soulve cette objection sa thorie dans l'Introduction
gnrale, aprs avoir nonc l'axiome fondamental de sa conception de
l'histoire, savoir, que toute forme de production engendre [erzeugt] ses
propres rapports juridiques, sa propre forme de gouvernement, etc. SI.
Parmi les points principaux dvelopper, il note le rapport ingal entre
le dveloppement de la production matrielle et celui de la production
artistique (problme pour lequel il esquisse l'explication voque l'instant);
puis, il poursuit: cette disproportion est loin d'tre aussi importante, ni aussi
difficile saisir qu' l'intrieur des rapports sociaux pratiques. [...] Le point
vraiment difficile discuter ici est celui-ci: comment les rapports de produc-
tion, en tant que rapports juridiques, suivent un dveloppement ingal. Ainsi
130 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
par exemple le rapport entre le droit priv romain (pour le droit criminel et le
droit public c'est moins le cas) et la production moderne52.
Les lments de la rponse proprement marxienne cette question, que
Marx qualifie lui-mme de difficile , figurent dans quelques lignes des
Manuscrits de 1857-1858, crits quelques mois aprs l'Introduction gnrale.
Nous ne pouvons entrer ici dans les dtails. Seules nous intressent les lignes
suivantes:
Ce droit, bien qu'il corresponde [entspricht] une situation sociale
dans laquelle l'change n'tait nullement dvelopp, a pu pourtant dvelop-
per [...] les dterminations de la personne juridique, prcisment celles de
l'individu de l'change, et ainsi anticiper [antizipieren] (du point de vue des
dterminations fondamentales) le droit de la socit industrielle 53.
Cette rponse est trs remarquable: l'anticipation et non pas la rptition
historique 54! Marx indique dans cette page des Grundrisse que le systme
socio-juridique du moyen-ge diffrait essentiellement du droit priv romain,
et que la reprise de celui-ci et son dveloppement par la socit industrielle
moderne enjambe donc toute l're du mode de production foda}55.
Que constatons-nous: des formes d'tat mixtes, en avance sur les formes
de proprit encore dominantes; persistance, par del plusieurs modes de
production successifs, de formes d'art venues de la Grce archaque; rsur-
gence et panouissement, aprs mille ans de fodalit, d'une forme de droit ne
il y a dix-huit sicles et qui a anticip d'autant la socit bourgeoise moderne.
Voil des aspects de 1'histoire peu conformes au schma rigide des stades
monolithiques qu'on prte habituellement Marx.
Ce sont l des faits importants, contraires aux thses de base forcment
schmatiques de la thorie gnrale. Ils montrent que Marx restait trs
conscient de la difficult d'expliquer toute l'histoire l'aide de quelques
principes gnraux. Il serait bon d'tre aussi prudent que lui quand on cherche
appliquer le matrialisme historique aux domaines juridiques, politiques et
idologiques.
Nous disions que la causalit tait complexe. Les exemples prcdents en
sont la preuve. Les principes gnraux ne permettent aucune dduction
historique. Pourquoi fait-on moins de cas de l'art grec et du droit romain, que
du moulin bras et du moulin vapeur? Pourquoi appliquer deux poids et
deux mesures aux crits de Marx?
Il en rsulte que la conception de l'histoire de Marx est ouverte sur des
possibles. Elle prsente plus de possibilits qu'on ne s'y attendait. Cette
ouverture sur les possibles est bannie par l'interprtation dterministe domi-
nante de la pense de Marx. Parler de causalisme est plus appropri. Un
causalisme n'implique pas l'homognit et l'unicit des causes. Il admet
toutes les formes de causalit, que nous trouvons justement, d'aprs Marx,
dans l'histoire concrte: dpendance, interdpendance, causalit rciproque,
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
131
influence en retour, persistance de formes anciennes, anticipations de formes
futures, rptitions, etc.
En histoire, on a affaire des touts organiques, des ensembles
complexes de causes qui interfrent, se conjuguent ou s'entravent. Le mouve-
ment gnral qui se dgage sur de longues priodes manifeste l'action
prdominante de l'un des moments sur les autres. Dans le tout social, en
dernire instance , c'est l'activit de production qui prdomine. On a une
dpendance dans une interdpendance. L'une n'exclut pas l'autre, mais
l'inclut.
D'ailleurs, si l'on analyse la base
", celle-ci est elle-mme une totalit de
moments: production, distribution, change, consommation, o, ce qui dcide
finalement du mouvement gnral, c'est le processus de production. Mais
son tour, l'analyse de la production rvle une compositio'n organique: des
branches de production interdpendantes, une unit entre forces productives
et rapports de production travers des connexions complexes. Partout, une
unit de diffrences.
A chaque fois, il s'agit d'une dialectique entre moments interdpendants
d'un tout. Car, celui-ci et chacun de ses moments sont en devenir, et sont eux-
mmes des rsultats historiques. Ils ont une origine, c'est--dire des causes, que
l'tude de l'histoire peut seule faire dcouvrir.
L'enqute causale se divise donc. Sur des touts en devenir, il ya en effet
deux points de vue possibles: le point de vue organique, et le point de vue
historique, bien que dans la ralit les deux soient toujours prsents ensem-
ble56. Dmler ces deux aspects en conomie fut l'un des objets majeurs de
Marx dans Le capital.
Du point de vue historique il s'intresse la gense, l'origine du mode
de production capitaliste. Mais il ne prend pas toujours origine [Usprung] au
sens de naissance ou de commencement historique. Quand il reproche
Ricardo de ne pas s'tre suffisamment intress l'origine de la plus-value,
origine signifie cause actuelle . Dans la recherche des causes, on peut
vouloir saisir la premire apparition d'une chose dans le temps, ce qui l'a
amene l'existence. Mais, dans Le capital, lorsque Marx trouve l'origine de
la valeur, et ainsi celle de la plus-value et du capital, dans le travail abstrait,
il ne s'agit pas de retracer sa gense historique, de chercher les conditions qui
ont prsid sa naissance, quoique cette connaissance historique puisse aider
la thorie. C'est plutt l'inverse: clarifier thoriquement la formation de la
valeur permet ensuite de faire l'histoire de son dveloppement rel.
Ainsi, dans les analyses thoriques du Capital, origine n'a pas souvent
le sens de gense au sens historique. Il a celui de cause essentielle
permanente dans des conditions donnes, valables tant que durent ces
conditions.
Il y a donc deux sortes de conditions de possibilit, les conditions
organiques et les conditions historiques. D'o deux sortes de possibilits:
la possibilit organique et la possibilit historique. La premire est celle que
132 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
nous avons appele abstraite: c'est l'analyse thorique, scientifique, qui
la fait dcouvrir et comprendre. La seconde seule est vraiment concrte: on
y accde en tudiant l'histoire.
Que Marx prenne plutt pour objet, dans son grand ouvrage, la possibi-
lit organique (thorique) et recherche les origines au sens de causes
actuelles , ne signifie videmment pas qu'il se dsintresse des origines au
sens historique. Il parle alors de gense . Ainsi, parfois, entreprend-il
d'exposer la gense historique du systme conomique capitaliste 57.
Distinguer ces deux sens d' origine est de premire importance pour
l'intelligence du Capital, et pour celle de l'histoire elle-mme. Si l'on ne
s'occupait. que de rapporter les vnements dans leur succession purement
temporelle, on n'aurait que des chroniques o tout s'entremlerait confus-
ment. L'histoire semblerait n'tre que bruit et fureuf.
.
Inversement, si l'on se bornait, dans la thorie conomique pure du mode
de production, chercher l'origine au sens de cause essentielle, on tomberait
dans des robinsonnades en prenant les conditions thoriques pour des donnes
historiques relles. On en ferait des conditions permanentes, des donnes
naturelles et ternelles.
Ainsi, dans un chapitre de la fin du Livre premier du Capital, Marx
critique une robinsonnade de Smith: l'explication de la gense historique
du capital par l'accumulation dite [sogenannte] originaire58. Pour l'cono-
miste anglais, le capital serait le fruit peu peu grossi du travail effectu dans
le pass par un petit nombre de gens laborieux, intelligents et conomes. Marx
estime que cette explication de l'origine historique du capital ne vaut pas
mieux que celle que la thologie chrtienne donne de la condition humaine
avec son mythique pch originel pris pour un vnement historique initial.
Il objecte que les causes de la gense concrte du capital furent trs diffrentes
de celles que Smith imaginait:
Comme on le sait, dans l'histoire relle [widUch] le premier rle est
tenu par la conqute, l'asservissement, l'assassinat suivi de vol, en un mot,
par la force [Gewalt]. Dans la suave conomie politique, c'est l'idylle qui a
toujours rgn. Droit et "travail" auraient t de tout temps les uniques
moyens d'enrichissement, en faisant exception chaque fois, naturellement, de
cette anne. En ralit, les mthodes de l'accumulation originaire sont tout ce
qu'on voudra, sauf idylliques59.
Que Marx ait eu pour but de comprendre et d'exposer le processus du
capital peut faire croire que trouver les causes originaires au sens historique
suffirait. Mais dcouvrir la gense historique concrte ne suffit pas. Il faut
surtout rendre compte de la reproduction continuelle, au sein d'un mode de
production donn, de toutes ses conditions vitales essentielles.
Marx a confi un jour un correspondant: Je dteste les explications qui
rsolvent les problmes en les transportant dans un domaine inconnu 60.
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
133
N'est-ce pas ce qui arrive si l'on remonte trop haut dans l'histoire pour y
trouver l'origine, et ainsi, croit-on, l'explication, des vnements actuels?
3. Analyse de la causalit conomique
La nature. conomique de la causalit historique tait nie ou minimise
par de nombreux historiens et philosophes de l'histoire, en particulier en
Allemagne. Marx et Engels insistrent d'autant plus sur elle: ils affirmrent
que la division du travail, intimement lie l'tat des forces productives, est
l'origine des grands changements sociaux et politiques.
D'aprs L'idologie allemande, c'est elle qui engendre la division sociale
en castes, ordres, ou classes:
Les divers stades de dveloppement de la division du travail reprsen-
tent autant de formes diffrentes de la proprit; autrement dit, chaque
nouveau stade de la division du travail dtermine [bestimmt] galement les
rapports des individus entre eux pour ce qui est de la matire, des instruments
et des produits du travail61.
Les rapports de proprit drivent immdiatement des conditions de la
production, c'est--dire des forces productives qui sont elles-mmes troite-
ment lies la division du travail62.
Marx et Engels admettent donc avec Smith et Ricardo, mais aussi avec les
Saint-Simoniens, l'extrme importance du dveloppement technique. Longue-
ment dveloppes par L'idologie allemande, ces ides se retrouvent dans les
autres uvres de Marx et d'Engels. En 1845, l'accent tait mis d'une manire
quasi exclusive sur le rle de la division du travail: elle paraissait tre la cause
sui generis de tous les processus conomiques et sociaux63.
Pourtant, la division du travail est son tour un effet et un rsultat;
elle a son origine dans les possibilits techniques, lesquelles dpendent de la
dcouverte de nouvelles ressources naturelles, des inventions, des connais-
sances, de la volont des individus et groupes qui dtiennent les biens et le
pouvoir: l'introduction de nouvelles pratiques, impliques par les nouveaux
instruments, se heurte au conservatisme des habitudes et des mentalits
(croyances religieuses, etc.).
Dans Le capital, au contraire, la causalit parat tre plus conomique
que purement technique >'. Les analyses de la technologie y sont menes au
sein d'une analyse conomique globale. Mais que signifie conomique
chez Marx? Si la division du travail dpendait exclusivement de la nature des
moyens matriels de la production, le processus de l'histoire se ramnerait aux
progrs des techniques. Le matrialisme historique ne serait qu'un technolo-
gisme .
En gnralisant rapidement l'emploi de machines nouvelles, beaucoup
134 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
plus nombreuses et puissantes, dans plusieurs secteurs importants de la
production matrielle, le systme de la fabrique tendait se substituer partout
o elle le pouvait ceux de la manufacture et de l'atelier artisanal. Les effets
du nouveau systme technique sur la vie sociale, intellectuelle et morale
frappaient les esprits. Ce fut un bouleversement trs brutal, souvent dcrit;
dont les consquences furent fortement dnonces64.
Or, Marx ne rduit nullement toutes les causes aux seules causes
techniques. En tant qu'explication causale, l'analyse conomique marxienne a
pour objet de discerner les diffrentes causes et la manire dont elles s'exercent
dans la production, et de l dans les autres sphres de l'conomie et dans toute
la socit. Prenons donc un exemple de causalit conomique.
On peut constater, crit Marx, qu'au XIXesicle, sous s.a forme-machine
[...J, le moyen de travail devient immdiatement le concurrent du travail-
leur65 . Il s'agit d'une possibilit qui se ralise, d'une lutte qui se droule sous
nos yeux. Quelles sont les causes de cette lutte entre la machine et l'ouvrier?
Qu'y a-t-il de spcifique cette lutte au XIXesicle? C'est qu'elle est devenue
immdiate . Qu'est-ce que cela signifie?
Marx en voit la cause dans la "forme-machine de l'instrument de travail,
et il prsente cela comme un vnement historique nouveau. Mais, que la
machine concurrence le travailleur, voil une vrit qui semble de tous les
temps: il a exist des machines depuis des millnaires. La machine n' a-t-elle
pas toujours t la concurrente du travailleur? Ne le sera-t-elle pas toujours?
N'est-ce pas un fait inhrent 1'<, essence ternelle des instruments de travail
en tant que tels66?
Qu'est-ce que prsuppose une concurrence entre l'ouvrier et la machine?
Un mode d'change gnralis, c'est--dire un march, donc une conomie
marchande, et pour que la concurrence concerne aussi l'ouvrier, il faut qu'il
s'agisse d'un march tendu, non seulement aux produits de consommation
courante, mais aussi aux travailleurs et aux machines en tant qu'ils sont
rduits les uns et les autres l'tat de marchandises.
En outre, pourquoi immdiatet de la concurrence? Cela veut dire que
rien ne s'interpose entre l'ouvrier et la machine sur ce march gnral: plus
d'ordres sociaux d'Ancien rgime, plus de corporations, plus de familles
patriarcales, plus de possession par l'individu de moyens d'existence ou de
production personnels. Cela suppose donc l'existence du travailleur libre,
qui est lui-mme le rsultat d'un long processus historique antrieur.
Il est libre au sens o il ne possde plus rien, sauf son propre corps. Il
est libr de toute servitude (servage). Ainsi rduit lui-mme, il ne peut
soutenir la concurrence avec la machine moderne. C'est un jeu de possibilits
et d'impossibilits. Il peut se vendre, en droit, qui bon lui semble, mais doit
accepter le salaire fix par le jeu de la concurrence capitaliste. Dans ces
conditions de concurrence immdiate, la machine dplace les ouvriers:
elle peut mme les remplacer, donc les rejeter hors de la production. Ds lors,
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
135
l'ouvrier salari, exclu par la machine, devient une bouche de trop au
banquet de la vie67.
Ce que Marx dit de l'poque moderne, caractrise par l'introduction des
machines-outils mues par une machine vapeur centrale, doit se dire, mutatis
mutandis, de toutes les grandes poques de mutations technologiques. La
concurrence faite au travailleur par la machine n'est pas devenue relle
seulement rcemment. Les nouveaux outils ont toujours concurrenc le
travailleur partir du moment o ils prsentaient des avantages conomi-
ques .
Or, ces avantages n'existent que pour ceux qui peuvent possder les
instruments, c'est--dire pour certaines classes sociales. Il n'y a pas d'avan-
tages conomiques in abstracto. Ce sont des avantages pour des individus
dtermins, par exemple les entrepreneurs bourgeois suffisamment riches pour
acheter machines et travailleurs.
Il faut donc dire, la manire froidement scientifique de Ricardo, et
la manire critique de Marx, que cet nonc: la machine devient le
concurrent immdiat de l'ouvrier, n'est pas une vrit intemporelle. Il n'a de
sens que si l'on indique les conditions sociales dans lesquelles se ralise cette
possibilit qui, sans cela, reste purement abstraite. Si l'on oubliait ces
conditions, on pourrait envisager toutes sortes de remdes parfaitement
utopiques. Ces conditions sociales consistent elles-mmes en possibilits
matrielles et intellectuelles (biens, argent, pouvoir, savoir).
Dire que <<lamachine devient le concurrent immdiat de l'ouvrier, c'est
dire que ce devenir est une possibilit relative aux conditions matrielles et
sociales de la production capitaliste. L'nonc complet, scientifique et
critique , sera donc le suivant: dans les conditions de la production
capitaliste moderne concurrentielle, la machine devient le concurrent imm-
diat de l'ouvrier.
Cet nonc de causalit conomique ne vaut que si des conditions
dtermines sont runies. Ce sont elles qu'il faut voir sous les termes de
concurrence immdiate. Qui dit machine ici, dit capital et ouvriers: il y a
engendrement rciproque entre eux. Quand cette nouvelle alliance se ralise, il
est devenu possible que la nouvelle forme de machine vince immdiate-
ment l'ouvrier. Une nouvelle lutte s'ouvre qui oppose les ouvriers au capital
parce que le capital oppose les machines aux ouvriers: c'est la nouvelle forme
de lutte des classes, o le rapport la machine met en jeu les rapports de
classes. La mise en chmage technique d'un grand nombre d'ouvriers rend
l'abolition des rapports sociaux dominants possible: il met l'ordre du jour la
rvolution sociale, et la prise du pouvoir par la classe des travailleurs.
Quelles consquences tirer de cette analyse? Premirement, c'est bien une
analyse de causalit . La causalit conomique s'analyse en facteurs
techniques (ou technologiques) et en facteurs sociaux. Ces facteurs ne sont pas
de mme nature. Ils ne doivent pas tre mis sur le mme plan, bien qu'ils soient
galement ncessaires: ils se conditionnent mutuellement.
136 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Pourquoi parler de causes conomiques , si les facteurs essentiels sont,
d'une part techniques (matriels), d'autre part sociaux (des rapports entre
individus dtermins: ouvrier <dibres, capitalistes industriels, propritaires
fonciers, etc.)? C'est que facteurs matriels et facteurs sociaux sont subordon-
ns une finalit qui est conomique . On recherche une conomie dans
la dpense en moyens de production, en forces productives .
La dpense peut s'entendre en deux sens, donc conomie s'entend
en deux sens: ou bien en termes matriels (valeurs d'usage), ou bien en
termes de valeurs d'change. L'conomie matrielle peut porter soit sur les
moyens objectifs (forces naturelles, matires premires, instruments fabriqus,
etc.), soit sur les moyens subjectifs (la force de travail, sa qualit, sa quantit,
etc.). L'conomie en valeur peut porter sur tous ces lments considrs en
tant qu'ils ont une valeur68.
Par suite, <d'conomie s'apprcie de manire trs variable. Valeurs
d'usage et valeurs d'change sont extrmement diverses. Elles prsentent
quantit d'aspects, naturels et humains, historiques et sociaux.
L'conomie de moyens, apprcie en termes de valeurs d'usage, a
toujours t poursuivie, quels que fussent les modes de production. Toutefois,
cette conomie est fonction des besoins historiquement dtermins des indivi-
dus et des classes. C'est lorsqu'il devient possible de rvolutionner les moyens
technologiques que cette conomie se manifeste aux yeux de tous.
L'autre forme, l'conomie en termes de valeur d'change, c'est--dire en
temps de travail, s'est dveloppe paralllement depuis longtemps. Masque
par l'existence de l'esclavage et du servage et par la faible productivit
agricole, elle a nanmoins pris pied peu peu dans des domaines divers de la
production surtout depuis le xe sicle69.
A l'poque moderne, domine par le mode de production capitaliste, cette
conomie relative est continuellement recherche, travers la combinaison
conomique de la valeur d'usage et de la valeur d'change. En effet, si le
capitalisme poursuit essentiellement la production de la valeur d'change, la
valeur d'usage continue de faire valoir ses droits. Les moyens de production se
modifient plus rapidement; les innovations techniques et les changements
dans les mtiers, et par suite dans les statuts sociaux et les classes, se succdent
sans rpit 70.
Dans les conditions capitalistes de la production, c'est l'conomie en
termes de valeur d'change qui devient l'essentiel, puisque le but du capitaliste
est d'accrotre la plus-value, but qui lui est impos par la concurrence. D'aprs
le mode de formation de la valeur - plus-value obtenue partir de l'achat de
la force de travail sa valeur marchande et de son emploi en tant que valeur
d'usage susceptible d'engendrer plus de choses que sa reproduction n'en exige
-, l'conomie est value en termes de temps de travail. Le machinisme ne
prsente un avantage conomique que s'il rduit le temps de travail relatif,
voire le temps de travail absolu 71.
A toutes les poques, l'conomie relative n'a pu tre obtenue que grce
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
137
certaines innovations, qui ne sont pas toutes matrielles au sens troit du
terme: elle ne provient pas seulement des inventions techniques, ou de la
dcouverte de nouvelles ressources naturelles, mais aussi, d'une manire plus
ou moins lie celles-l, des modifications dans les mthodes de travail, et de
la meilleure utilisation des moyens et ressources connus72.
Cependant, tous ces facteurs ne suffisent pas eux seuls entraner une
rvolution conomique". Ils n'en offrent que la possibilit matrielle, qui
certes peut peser d'un grand poids. Il faut aussi qu'ils aillent dans le sens des
intrts des classes dominantes. Sinon, celles-ci s'y opposent; elles empchent
l'application des moyens techniques nouveaux qui les menacent. Au besoin,
elles les dtruisent. Inversement, si elles ont un intrt majeur les dvelopper,
elles peuvent les imposer par la force et la violence: nous avons vu Marx
rappeler par quels moyens brutaux l'accumulation originaire du capital fut
ralise en Angleterre aux XVIeet XVIIesicles.
Afin de comprendre la causalit conomique dans le mode de production
capitaliste, il est essentiel de distinguer, nous dit Marx, la composition-
technique et la composition-valeur du capital, c'est--dire, d'une part, la
manire dont le capital se rpartit en moyens matriels de diverses sortes
(matires premires, matires instrumentales, machines, sources d'nergie
naturelle, forces de travail), d'autre part en lments valeurs constitutifs du
capital (rapport entre les valeurs des diverses composantes matrielles).
La composition technique dpend de conditions naturelles et physiques.
La composition-valeur reflte les rapports sociaux de production, puisqu'elle
se divise en salaires, ou capital variable ", et valeurs des moyens matriels de
la production que Marx appelle le capital constant.
On est ici au cur de la question de la liaison des facteurs causaux. Marx
nomme composition organique d'un capital donn, la relation entre sa
composition technique et sa composition valeur. Cette notion de composition
organique est extrmement importante. Lisons le texte o Marx la prsente:
La composition du capital doit tre prise en un double sens. Du ct de
la valeur, elle se dtermine [bestimmt sie sich] par la proportion selon laquelle
il se divise en capital constant, ou valeur des moyens de production, et capital
variable, ou valeur de la force de travail, somme globale des salaires. Du ct
de la matire [Stoff], telle qu'elle fonctionne dans le processus de production,
tout capital se divise en moyens de production et force de travail vivante.
Cette composition se dtermine [bestimmt sich] par le rapport entre la masse
des moyens de production employs, d'un ct, et la quantit de travail
requise pour employer ceux-ci, de l'autre. La premire composition, je
l'appelle comppsition-valeur du capital, la seconde, composition technique
du capital. Il existe entre les deux une troite corrlation [enge Wechselbezie-
hung]. Pour l'exprimer, je donne la composition-valeur du capital, dans la
mesure o elle est dtermine [bestimmt] par sa composition technique et
reflte [Widerspiegelt] les modifications [Anderungen] de cette dernire, le
nom de; composition organique du capitaP3.
138 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Sur chacun des deux plans, celui de la valeur ou celui de la matire,
tous les facteurs sont dans une dpendance rciproque. La composition
technique dfinit la productivit matrielle du travail, la composition-valeur sa
productivit en valeur d'change que mesure le taux de la plus-value ou encore
celui du profit. Il y a une liaison ncessaire entre ces deux plans, bien qu'elle
admette une relative flexibilit, que Marx dit troite parce que toutes sortes
de contraintes les lient. Nanmoins toutes sortes de fluctuations possibles se
prsentent, qui proviennent des changements dans chacun des facteurs. Il y a
des adaptations ncessaires, des besoins de nouveaux matriaux, etc. Compo-
sition technique et composition-valeur doivent s'accompagner, et se dvelop-
per de concert. Mais retards et blocages dus un dveloppement ingal
peuvent apparatre.
Ce qui caractrise ces rapports complexes entre les' deux sortes de
composition du capital, c'est une correspondance et une dpendance la fois.
D'une part, la composition-valeur reflte la composition technique; d'autre
part, elle en dpend, elle est conditionne et dtermine par elle.
Disons quelques mots sur les possibilits thoriques que cette analyse
permet d'envisager. Pour lever le taux de plus-value et obtenir plus de valeur
(de profit), le capitaliste peut chercher augmenter la part relative des moyens
matriels utiliss (en abaissant d'autant la valeur des salaires) afin d'avoir plus
de produits vendre avec le mme capital. Ce faisant, il obtient plus de valeur
que ses concurrents dans l'change, ou par rapport aux moyens et mthodes de
production antrieurs (modes de production ant-capitalistes). C'est pourquoi
le capitalisme impulse les dveloppements techniques qui, justement, rendent
cette possibilit relle: il joue sur la plus-value relative.
En quoi la composition-valeur dpend-elle de la composition technique?
La composition-valeur se prsente toujours comme un rapport quantitatif,
parce qu'elle concerne des grandeurs homognes, mesurables dans une mme
unit. Il n'en va pas de mme de la composition technique: les quantits des
divers matriaux (matires premires, etc.), la quantit d'instruments et
machines ncessaires, la quantit d'ouvriers, ne peuvent se mesurer dans une
quelconque unit de mesure commune. A fortiori, cela est impossible pour la
combinaison de ces deux compositions entre elles 74. On peut seulement
parler d'une dpendance qualitative.
D'un point de vue thorique, toutes les possibilits existent: l'une des deux
compositions peut varier sans que l'autre change, elles peuvent varier toutes
les deux, soit dans un mme sens, soit dans des sens opposs. Ce que Marx
veut dire en parlant de reflet, c'est que, ncessairement, si l'une varie, cela se
rpercute dans l'autre. Rien de mcanique ici 75. En rgle gnrale, l'augmen-
tation de la quantit des matires premires et des machines - choses qui vont
le plus souvent de pair! -, relativement au nombre d'ouvriers, signifie un
accroissement du capital constant. Mais, ce dernier peut s'lever faiblement ou
d'une manire considrable. Cela dpend du genre de production, de la nature
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
139
des matriaux, de celle des machines, de la nature du travail requis, etc. et des
valeurs respectives de ces divers lments.
Ainsi, plusieurs sortes de causes essentielles interviennent en conomie:
les proprits naturelles des matriaux, la nature des instruments et objets
techniques, les mthodes de travail, les rapports sociaux (la proprit des
moyens de production par certaines classes). D'autres facteurs extra-conomi-
ques jouent galement leur rle: l'utilisation de la force par un pouvoir
(conservateur ou rvolutionnaire), l'application de la science, le frein constitu
par le poids des croyances ou mentalits (religion, traditions) etc. C'est une
riche multiplicit et varit de causes qui intervient.
4. Pluralit et multiplicit des causes
De l'analyse prcdente se dgage une nette pluralit causale. Ni dans
ses thories conomiques, ni dans sa conception de l'histoire, Marx ne ramne
les causes un type unique et homogne. Elles sont multiples et coordonnes;
leurs effets se combinent et s'entrelacent.
En conomie, la causalit se dcompose en quelques causes en nombre
restreint et de nature essentiellement diffrente: une composante matrielle
stricto sensu (naturelle), une composante proprement conomique ou
combinaison de facteurs techniques et sociaux o le critre est la dpense en
valeur (aux deux sens du terme valeup, enfin une composante sociale
renvoyant aux conditions sociales dans lesquelles s'exerce l'activit conomi-
que (relations de proprit, relations entre classes, etc.).
C'est sur cette analyse causale que repose la critique marxienne de
l'conomie politique classique. En effet, le capitaliste cherche prioritairement
produire de la valeur d'change, au dtriment des autres facteurs naturels et
humains: le travailleur et la nature sont traits comme des moyens de faire de
la plus-value, c'est--dire de l'argent.
Cette analyse critique concerne toutes les sciences socio-historiques:
histoire, politique, sociologie, histoire des ides, du droit, des religions, de la
philosophie, de la littrature, de l'ducation, de l'art et des sciences, etc.
Il importe d'avoir constamment prsente l'esprit cette articulation
interne essentielle de la causalit conomique pour apprcier toute interprta-
tion de la pense de Marx. L'analyse de Marx s'oppose toute rduction de
l'histoire un dterminisme simplificateur, comme celui que l'on trouve chez
les classiques, ou chez Kant ou Laplace 76.
Il y a toujours, en histoire comme en conomie, un concours de plusieurs
sortes de causes (naturelles, techniques, sociales, etc.) combines et articules
en un tout organique en dveloppement, faisant lui-mme partie d'un devenir
plus vaste. C'est d'une interdpendance des causes qu'il s'agit.
Cette pluralit des causes ouvre largement le champ des possibles. Marx
souligne volontiers que la production capitaliste dispose d'une grande diver-
140 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
sit de moyens pour parvenir son but spcifique, accrotre la productivit
pour accrotre la plus-value:
Toutes les mthodes qui visent lever la force productive sociale du
travail et qui grandissent sur cette base [Grundlage] sont en mme temps des
mthodes de production accrue de plus-value ou de sur-produit, qui st de
son ct l'lment constitutif de l'accumulation. Ce sont donc en mme
temps des mthodes de production de capital par du capital, des mthodes
d'accumulation acclre de celui-ci 77.
Le capitalisme tend accrotre la valeur (la plus-value) aussi bien que les
produits. Il vise l'une ou l'autre, dit Marx. Ce ou a le sens d~une
quivalence, car dans les deux cas on a le mme rsultat: l'lvation de la force
productive. Marx en conclut qu'il faut distinguer plusieurs facteurs conomi-
ques, qui appartiennent deux catgories essentielles:
Si un certain degr d'accumulation du capital apparat ainsi comme
condition [Bedingung] du mode de production spcifiquement capitaliste,
celui-ci provoque en retour [rckschlagend verursacht) une accumulation
acclre du capital. Si un certain degr d'accumulation du capital apparat
ainsi comme condition du mode de production spcifiquement capitaliste,
celui-ci provoque en retour une accumulation acclre du capital. Ces deux
facteurs [Faktoren] conomiques crent [erzeugen], selon le rapport compos
de l'impulsion qu'ils se donnent rciproquement, le changement dans la
composition [Zusammensetzung] technique du capital, qui fait que la compo-
sante [Bestandteil) variable du capital devient de plus en plus petite compare
sa partie constante 78.
Objectera-t-on que Marx parle ici de deux facteurs conomiques, et
non de deux facteurs de nature diffrente? En fait, c'est une confirmation
que le point de vue conomique prsente deux aspects essentiellement
diffrents. Le capital, ou valeur accumule, ne peut s'accrotre si l'on n'lve
pas la productivit, c'est--dire la quantit des valeurs d'usage produite avec
un certain capital.
Il y a l deux facteurs: d'un ct, des mthodes comme la coopration,
la division technique du travail, l'emploi de machines ou d'un travail qualifi
(science), de l'autre, produire, en consommant une certaine valeur existante,
une nouvelle valeur plus grande.
Ces deux facteurs s'impulsent l'un l'autre; dans le mode de production
capitaliste, ils sont dans un rapport compos qui rsulte de l'action
rciproque entre facteurs techniques (conomiques au sens matriel) et
facteurs conomiques (au sens d'conomie en valeur).
On remarquera, en outre, une condition historique: pour qu'il y ait
capital, dit Marx, un certain seuil d'accumulation doit tre atteint. Alors, la
causalit prend la forme de la causalit rciproque: le processus rsultant se
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
141
prsente comme une interaction entre deux sortes de causes spcifiques, lies
les unes aux autres.
En fin de compte, ces deux facteurs conomiques , ce sont les moyens
de production matriels, et les moyens de production formels (valeurs). Le
capital se prsente, alternativement ou simultanment, sous ces deux formes,
ce qui rsulte de ce qu'il est valeur se mettant en valeur; c'est son essence et sa
fin. Il ne peut se raliser qu'en combinant les deux facteurs conomiques
qui s'engendrent rciproquement79.
Certains interprtes de Marx tendent sparer ces deux aspects, en
prenant conomique soit au sens matriel, soit au sens formel de valeur ,
alors que les deux forment une totalit indissoluble. Ils dissocient complte-
ment valeur d'usage et valeur d'change dans le processus conomique
capitaliste. Au contraire, Marx, lui, insistait sur leur intiII!e combinaison et
impulsion rciproque dans une totalit qu'il appellait justement organique:
la composition organique du capital!
C'est sur la base de cette analyse qu'il faut envisager ce qui est possible
pour l'conomie capitaliste. Son existence et sa survie sont suspendues la
possibilit pour le capital de se mettre en valeur. Marx nie que cette mise en
valeur puisse se poursuivre indfiniment dans les conditions capitalistes.
Parvenu un certain degr de dveloppement, l'un des facteurs entre en
contradiction avec l'autre. La mise en valeur de la valeur existante ne serait
pas possible, s'il n'y avait des mthodes techniques accroissant les forces
productives (et donc les produits), qui servent de base [Grundlage] cette
valorisation. C'est l'augmentation des valeurs d'usage qui rend possible la
mise en valeur.
Rciproquement, l'accumulation de la valeur permet son tour d'amlio-
rer les mthodes techniques et de multiplier les moyens matriels et humains.
L'une est condition de possibilit, ou prsupposition, de l'autre. Dans ce
couplage, toutes les formes de l'action rciproque se manifestent et entrent en
jeu: action en retour de l'effet sur sa cause ou raction, conditionnement
rciproque, engendrement et dveloppement mutuels.
Soit un autre exemple de causes multiples interagissantes, celui des trois
formes du capital du point de vue de la circulation: la forme marchandise ,
la forme argent , et la forme moyens de production (instruments, matire
premires et forces de travail). Le capital parcourt ces formes dans un cycle de
transformations qui lient sphre de la production et sphre de la circulation.
Voici comment se prsentent ces mtamorphoses:
Considr comme un tout, le capital occupe [...] ses phases diffrentes
simultanment, par juxtaposition dans l'espace. Mais, sans arrt, chaque
fraction passe successivement d'une phase, d'une forme fonctionnelle,
l'autre, fonctionnant ainsi successivement dans chacune d'elles. Les formes
sont donc des formes fluides, et leur simultanit est
/'
uvre de leur succession.
Chaque forme suit l'autre et la prcde, en sorte que le retour de telle fraction
du capital une certaine forme est conditionn [bedingt ist] par le retour de
142 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
telle autre une autre forme. [...]
- C'est seulement dans l'unit des trois
cycles que se ralise la continuit du processus-total [...]. Le capital social
total comporte toujours cette continuit, et son processus comporte toujours
l'unit des trois cycles80.
Ces trois cycles sont les cycles respectifs du capital sous chacune de ses
trois formes au cours d'une certaine priode. Chacune se transforme dans les
deux autres pour revenir soi sous sa forme initiale. Les capitaux, sous ces
trois formes, sont consomms, et remplacs ou reproduits au terme d'un
cycle81.
Chaque forme du capital est cause des deux autres, cause ayant ici le
double sens de condition antcdente et d'origine essentielle. La causalit
prend la forme d'un enchanement circulaire qui revient sur lui-mme et se
rpte, soit avec reproduction simple de la valeur initiale, soit avec
reproduction largie".
L'achat de nouvelles matires premires, par exemple, suppose comme
condition ncessaire, qu'une certaine masse d'argent soit disponible, ce qui
suppose qu'une masse correspondante de marchandises ait t vendue et leur
valeur ralise en argent. Cela implique son tour que ces marchandises aient
t produites, processus au cours duquel certaines quantits de forces de
travail, de matires premires et d'instruments, auront t consommes.
Prise abstraitement, sur le plan thorique gnral, la circulation du capital
est un cas d'enchanement linaire de causes et d'effets, qui se referme sur lui-
mme comme un cercle qui reste identique lui-mme ou qui s'largit en
spirale. Du point de vue temporel, elle prsente des phases qui se rptent dans
un mme ordre au cours de cycles semblables.
Mais, derrire cette structure simple pour la rflexion immdiate, Marx
signale, dans l'extrait cit l'instant, quelque chose d'autre: une dpendance
causale. En effet, dans la ralit, les trois cycles se chevauchent, et c'est la
succession, dit-il, qui engendre la simultanit. Qu'est-ce que cela signifie?
On comprend aisment que le capital social total se fractionne en trois
parties donc chacune passe successivement par ces trois formes. Dans le cas
d'un capital individuel, on trouve en effet simultanment des moyens de
production, des marchandises, et des moyens de paiement, c'est--dire l'actif
du bilan des immobilisations, des stocks et des liquidits.
Or, un capitaliste individuel peut trs bien mettre tout son capital sous
une seule des trois formes: il peut tout raliser sous forme d'argent par
exemple. Mais rester dans cet tat contrevient la nature" du capital. Il lui
faut aller recommencer ailleurs et produire autre chose. Il ne peut subsister
sans se transformer! Il doit ncessairement passer de l'une l'autre sans arrt.
Mais quelle ncessit le pousse prendre ces trois formes simultanment?
En fait, en mode de production capitaliste, la continuit de la production
prime; elle est un impratif conomique:
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
143
C'est la continuit qui est le trait caractristique de la production
capitaliste; elle est conditionne [bedingt] par sa base technique, bien qu'elle
ne soit pas toujours absolument ralisable
g2.
Il ne faut pas s'tonner que Marx invoque ici la base technique. Alors que
les chevaux doivent se reposer, les machines peuvent fonctionner vingt quatre
heures sur vingt quatre. La mobilit du capital dpend des possibilits de la
base technique. Or, la continuit de la production ne peut tre absolue: il faut
bien arrter les machines pour les entretenir ou les rparer.
L'ensemble du capital social, mais aussi le capital individuel, doit viter
les interruptions de la production, les temps morts qui limitent d'autant la
cration de valeur nouvelle. Le capital doit s'arrter le moins de temps possible
dans chacune de ses formes . Il n'est dans l'une que pour passer aussitt
dans l'autre. Par nature, il fluidifie les formes dans lesquelles il est pourtant
bien oblig d'tre: On ne peut le comprendre que comme mouvement, et non
pas comme une chose au reposg3. C'est justement ce que permet <<labase
technique nouvelle, le machinisme, qui convient merveille au capital.
Les trois cycles ne sont donc pas indpendants. Les trois formes du
capital ne se succdent pas comme des ralits indiffrentes l'une l'autre.
Elles forment un tout, une unit , o chacune dpend des deux autres. Cette
unit se prsente la fois dans l'instant et dans la dure.
D'o cette formule trs curieuse au premier abord: La simultanit [des
trois cycles] est l'uvre de leur succession. Il n'est pas ais de comprendre
que la succession des formes du capital engendre leur simultanit.
Marx veut dire que la simultanit est le moyen pour que la succession
soit la plus rapide possible. On vite ainsi toute interruption. Si le capital tait
entirement sous forme de marchandises, ou d'argent, ou de moyens de
production, pendant un certain laps de temps, il ne fonctionnerait plus comme
capital. Il lui faut prendre les trois formes simultanment. C'est sa nature qui
le veut: pas de stocks immobiliss, pas d'argent qui dort, pas de machines au
repos. C'est videmment au niveau du capital social total que la continuit du
processus se ralise le mieux.
Le systme conomique se prsente comme un enchevtrement complexe
de toutes sortes de formes diversifies. Malgr tout, s'il existe une unit et une
continuit, cela tient une cause originaire gnrale qui rside dans la nature
du capital: faire toujours plus de plus-value, et pour cela passer continuelle-
ment et aussi rapidement que possible par ses trois formes.
L'interdpendance des formes et des cycles rvle, son origine, une
cause conomique qui les lie ensemble et impulse le mouvement du tout. C'est
un processus complexe, m par une ncessit qu'impose une fin immanente:
accrotre la valeur ou succomber dans la concurrence.
Nous avons vu que cette cause s'analyse en une pluralit de facteurs ou
moments essentiels (naturels, techniques, sociaux). Maintenant, si l'on analyse
144 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
chaque facteur, nous allons voir les causes se multiplier et se diversifier: c'est
d'une multiplicit concrte qu'il s'agit en ralit.
Examinant ce qui peut lever ou abaisser la rente foncire diffrentielle -
celle que rapportent diverses terres -, Marx observe qu'elle dpend de la
diffrence dans les quantits de produits obtenus sur diffrentes terres de
mme superficie bien qu'on y emploie des capitaux gaux. Elle ne peut
provenir que des diffrences dans les conditions naturelles. Celles-ci dcident
des diverses possibilits :
Les deux causes gnrales, indpendantes du capital, de l'ingalit de
ces rsultats sont: 1. lafertilit [...]; 2. la situation topographique des terres.
Ce point est d'une importance dcisive dans le cas des colonies et, de faon
gnrale, pour l'ordre dans lequel des terrains peuvent ~re successivement
cultivs. De plus, il est clair que ces deux causes diffrentes de la rente
diffrentielle, la fertilit et la situation, peuvent agir en sens oppos. Un
terrain peut tre trs bien situ et en mme temps trs peu fertile et
inversement. Ce fait est important, car il explique pourquoi, en dfrichant le
sol d'un pays, on peut tout aussi bien aller des meilleures terres aux moins
bonnes qu'inversement 84.
L'tonnant est que Marx traite ici de conditions naturelles comme de
causes qui dterminent la valeur d'un revenu, la rente foncire. D'aprs la
thorie de la valeur-travail, les causes naturelles qui lvent ou abaissent la
quantit des produits ne devraient pas avoir d'influence sur la valeur, car, dans
cette tude de la rente diffrentielle, Marx a suppos des quantits gales de
travail et de moyens de production, des capitaux gaux. C'est que la rente est
value et exige par les propritaires fonciers en fonction des produits
attendus de la terre et, donc, des facteurs naturels; en ralit, sa vritable
origine est ailleurs: elle provient d'un partage, entre capitalistes et propri-
taires fonciers, de la plus-value sociale totale qui, elle, provient de la
productivit du travail gnral85.
Du seul fait qu'il y a deux causes naturelles variables auxquelles le
propritaire rattache le calcul de la rente, c'est tout un ventail de possibilits
qui apparat. Si les causes sont multiples, les possibilits qui se prsenteront
seront d'autant plus nombreuses. Du moins dans l'abstrait, car beaucoup de
ces possibilits restent thoriques. Marx l'indique en parlant de causes
gnrales . Dans la ralit, d'autres facteurs interviennent. Par exemple,
pour coloniser des terres, il faut non seulement des capitaux, mais une main
d'uvre locale ou immigre; il faut que celle-ci soit assez docile ou qu'on
puisse la contraindre, etc.
Toujours au sujet de la rente foncire, Marx se rapproche de la ralit
concrte quand il numre des causes de dtermination plus particulires. Elles
sont de nature trs diverse:
Parmi ces causes, il ne faut pas seulement compter les causes gnrales
LA POSSIBILIT ABSTRAITE 145
(fertilit et situation), mais aussi: 1. la rpartition des impts qui peut avoir
un effet uniforme ou non [...]; 2. les ingalits provenant d'un dveloppement
diffrent de l'agriculture dans les diverses parties d'un pays [...]; et
3. l'ingalit qui prside la rpartition du capital entre les fermiers 86...
Voil bien des causes qui limitent les possibilits gnrales.
Passons la division du travail; Marx souligne qu'elle aussi a une base
naturelle. La manire dont il en parle montre bien qu'il pense, l encore,
une multiplicit de causes extrmement varies:
Des communauts diffrentes trouvent dans leur environnement natu-
rel des moyens de production diffrents et des moyens de subsistance
diffrents. Leur mode de production, leur mode de vie I(t leurs produits sont
donc aussi diffrents. C'est cette diffrence naturelle qui, quand il y a contact
entre des communauts, [entrane...] la division sociale du travail [...]87...
Dans ce cas galement, Marx attire l'attention sur les possibilits offertes
par les conditions naturelles, du fait du polymorPhisme des fins: des commu-
nauts diffrentes peuvent utiliser un mme milieu naturel de manire
diffrente 88.
Il est clair que le milieu naturel conditionne les activits possibles: il a ses
particularits gographiques, orologiques, climatiques, une flore et une faune
dtermines, certaines ressources du sous-sol, etc. Cet ensemble de conditions
naturelles donnes constitue la fois un cadre de contraintes relatives et un
ventail de possibilits, ce que Marx exprime en disant que la nature est pour
l'homme un magasin de vivres et un arsenal de moyens de travail89. Bref,
c'est une base pour de multiples modes de vie ventuels et des dveloppements
conomiques diffrents.
On pourrait multiplier les exemples montrant que Marx prend en
considration des possibilits nombreuses.
La matire premire peut former la substance principale d'un produit
ou n'y entrer que sous forme de matire auxiliaire. [...] Comme toute chose
possde des proprits diverses et prte, par cela mme plus d'une
application, le mme produit est susceptible de former la matire premire de
diffrentes oprations. [...] Dans la mme opration, le mme produit peut
servir et de moyen de travail et de matire premire 90...
Ces proprits naturelles des choses, sources d'usages possibles innom-
brables, restent gnralement inconnues jusqu' ce qu'une nouvelle pratique
ou les progrs de la science les dcouvre:
Au lieu de chercher les vritables causes naturelles de l'puisement du
sol (d'ailleurs tous les conomistes qui ont crit sur la rente diffrentielle les
ont ignores, les connaissances en chimie agricole tant leur poque
146 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
insuffisantes), on a eu recours la thorie superficielle qu'i! tait impossible
d'investir n'importe quelle masse de capital sur une surface dlimite91.
La gense des manufactures offre galement un bon exemple de cette prise
en considration d'une multiplicit de causes diverses, qui forment autant de
conditions historiques:
Il Yeut d'autres circonstances encore qui concoururent simultanment
au dveloppement de l'industrie manufacturire: l'augmentation des mar-
chandises mises en circulation ds que le commerce pntra aux Indes
orientales par la voie du cap de Bonne-Esprance, le rgime colonial, le
dveloppement du commerce maritime.
Un autre point qu'on n'a pas encore assez apprci dans l'histoire de
l'industrie manufacturire, c'est le licenciement des nombreuses suites des
seigneurs fodaux, dont les membres subalternes devinrent des vagabonds
avant d'entrer dans l'atelier. [...]
L'agrandissement du march, l'accumulation des capitaux, les modifica-
tions survenues dans la position sociale des classes, une foule de personnes se
trouvant prives de leurs sources de revenu, voil autant de conditions
historiques pour la formation de la manufacture92.
N'y a-t-il pas toujours une pluralit~, une multiplicit de causes de nature
et d'espces diffrentes? Non seulement les causes naturelles, mais aussi les
causes conomiques, sociales, politiques, varient et ont toutes un caractre
historique.
Derrire les gnralits de la thorie conomique, n'est-ce pas la contin-
gence qui se prsente au plan concret? Comme Hegel, Marx ne fait-il pas droit
la contingence, au sens de hasard ou fortuit?
5. La contingence des causes: le hasard oufortuit
Nous venons d'tablir que, mme si l'on ne considre que la sphre
conomique, les causes y sont diverses. Nous avons appel essentielles les
causes principales. Marx en distingue les causes accidentelles ou contin-
gentes . Il parie en effet parfois de la contingence des causes, qui rgne la
surface de la socit , rpte-t-il.
Or, aucune frontire infranchissable ne spare la ncessit de la contin-
gence. L'enqute historique ou l'analyse thorique permettent de distinguer,
selon les cas, entre les causes essentielles et les causes accidentelles. La
contingence caractrise les vnements et les tres singuliers, l'infinie varit
des choses concrtes.
Toutefois, il s'agit de la contingence au sens de hasard ou de
fortuit. Par l, Marx est disciple de Hegel, qui insistait sur la puissance du
hasard [Zufniligkeit]:
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
147
Si nous disons [...] que la Raison universelle se ralise dans le monde,
nous ne nous rfrons certainement pas tel ou tel individu empirique: celui-
ci peut se trouver bien ou mal du fait que dans ce domaine, les hasards et la
particularit ont reu du concept le pouvoir d'exercer leur droit formida-
ble93.
Les sciences exactes, ds qu'elles s'appliquent des tres concrets,
tiennent compte des singularits et des caractres accidentels: elles parlent
couramment de perturbations ou du rle d'lments impondrables, et cela
dans tous les ordres de phnomnes. Les lois universelles et les causes
essentielles parviennent rarement expliquer ne serait-ce qu'un seul fait ou
tre individuel, comme la forme de la terre, la disposition des plantes dans le
systme solaire ou l'existence de tel ou tel individu d'une espce vivante.
Tout tre et tout vnement est singulier: cela se retrouve partout dans la
nature94. Il n'est pourtant pas assur que le nombre des causes soit plus lev,
ni leurs combinaisons plus complexes en sociologie et en histoire qu'en
astronomie ou en physique: les atomes sont bien plus nombreux que les tres
humains, et les composs chimiques que les groupes sociaux, les langues ou les
peuples.
De mme, pour Marx, il n'y a pas de fait ni de processus conomique ou
social particulier qui n'ait ses causes accidentelles, qui avec les causes
essentielles concourent le produire. L'histoire est le rsultat d'une multipli-
cit de causes singulires qui s'entrelacent d'une manire varie et mouvante.
Toutes sortes d'influences, de circonstances, de modifications nombreuses,
interviennent des degrs divers. Cet aspect des choses, Marx le nomme la
contingence: die Zuffaligkeit, c'est--dire la fortuit 95.
Il ne la reconnat pas seulement pour les faits et individus singuliers, mais
remarque qu'elle se manifeste aussi largement au plan socio-conomique.
Pour lui, il y a une contingence sociale qui joue un rle majeur dans certains
phnomnes conomiques importants. A propos des lois gnrales de l'cono-
mie, il crit: La production est dtermine par des lois naturelles gnrales,
la distribution par la contingence [Zufall] sociale96.
L'exemple typique de fortuit, chez Marx, est celui de la rpartition de
la plus-value sociale totale. Une fois dfalques les dpenses gnrales de la
socit (administration, police, arme, etc.), cette rpartition s'effectue pour
l'essentiel entre deux grandes catgories sociales: les propritaires fonciers et
les entrepreneurs capitalistes. Ce partage du surproduit social entre les
diverses classes en prsence, que ce soit sous sa forme de valeurs d'usage ou
sous celle de valeurs d'change, ne dpend pas de lois gnrales, mais d'un
rapport variable et fortuit qui relve des circonstances, en particulier des
forces respectives des classes sociales. Ce rapport de forces est issu d'une
histoire antrieure et n'est donc pas sans cause, mais il est contingent par
rapport aux lois immanentes de la production capitaliste (lois de la valeur, de
la plus-value, etc.).
148 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Pourtant, cette rpartition n'est pas purement arbitraire: elle est lie des
situations historiques particulires, nationales ou locales. Aucune loi conomi-
que n'y prside, alors qu'une loi dtermine la valeur des produits. Nous
l'avons vu, la rente foncire n'a pas de rapport, en systme capitaliste, avec la
valeur des produits agricoles. Si on la lie la valeur de la terre , cette liaison
est contingente, la terre n'ayant en soi aucune valeur, chose que Marx
tablit par ailleurs.
Dans ces conditions, le partage de la plus-value n'est pas fix par les lois
fondamentales du mode de production capitaliste. Ce sont donc certaines
circonstances qui en dcident, les conventions antrieures et les coutumes.
En cas de litige, c'est la lutte sociale qui tranche. Il n'en va pas de mme de la
rpartition des deux parts respectives de plus-value, l'intrieur de chacune
des classes qui en bnficient. Des causes dtermines y prsident: la grandeur
relative du capital engag, la fertilit des terres et leur situation, etc.
Marx ne recourt donc pas la contingence au sens mtaphysique du
terme: ce qui aurait pu ne pas tre97. Nulle part il n'y a pour lui de contingence
absolue, nulle part une absence totale de causes.
Prenons nouveau l'exemple de la division du travail. Dans l'atelier, la
manufacture ou la fabrique, elle est troitement soumise aux ncessits
matrielles du processus de production immdiat: elle est ncessaire car
dtermine par la nature mme des instruments et mthodes de travail.
Au contraire, aucune ncessit ne rgle la division du travail dans la
socit civile bourgeoise o rgnent les droits naturels des individus; elle
n'est pas organise selon un plan rationnel tabli l'avance, ou selon
quelque autre ncessit. Elle n'obit aucune loi: les individus s'orientent vers
le mtier qui leur plat, ou fuient toute activit. Ici rgne la volont
individuelle; chacun poursuit des fins personnelles, voire des lubies. Comme
disent Marx et Engels, c'est <<l'anarchie qui rgne sur le plan social; il y a
absence de toute organisation concerte.
Ainsi, d'un niveau l'autre, la division du travail est soumise un
principe diffrent:
Au lieu que dans la manufacture la loi d'airain du rapport quantitatif
ou de la proportionnalit soumet des nombres dtermins d'ouvriers des
fonctions dtermines, le hasard et l'arbitraire [Zufall und Willkr] jouent
leur jeu bariol dans la rpartition des producteurs de marchandises et de
leurs moyens de production entre les diverses branches du travail sociaI98.
Dans de pareils cas, Marx invoque une contingence sociale ou
individuelle, historique ou naturelle: il s'agit toujours de la fortuit , du
hasard rsultant des circonstances, jamais d'une contingence au sens d'une
indtermination absolue, hasard aveugle des picuriens, ou libert d'indiff-
rence des mtaphysiciens spiritualistes.
Si le partage social de la plus-value n'est pas dtermin par une loi
LA POSSIBILIT ABSTRAITE 149
immanente au mode de production, si la rpartition du travail l'chelle
sociale globale n'obit aucun principe ncessaire, cela ne veut pas dire qu'ils
se feraient sans causes! Ils ne sont pas non plus livrs un hasard pur au sens
mathmatique, comme la sortie des numros d'une loterie!
Le partage du produit social global ne peut varier qu'entre deux bornes
extrmes: sa masse est donne. L'une des parties peut ne recevoir que la
portion congrue
"
; des causes extra-conomiques en dcident. Apriori, toutes
les rpartitions sont possibles. Entre ces bornes extrmes, se dploie tout
l'ventail des possibilits. Dans le domaine socio-historique, Marx fait large-
ment place la fortuit, au sens de concours de causes indpendantes.
L'interprtation dterministe du marxisme, qui cherche tout expliquer
dogmatiquement par la ncessit conomique et les lois de la production,
occulte le rle du hasard objectif dans lequel s'insre la volont humaine
individuelle 99.
Mais certains tendent interprter cette fortuit comme si elle chappait
au domaine de l'explication causale. C'est ce que faisait Lucien Goldmann
lorsqu'il s'interrogeait sur la notion de classe sociale chez Marx; ce sujet, il
parlait de la distinction [ faire] entre les facteurs qui ont une valeur causale
et les facteurs accidentels et contingentsIOO. Cette formulation est malheu-
reuse, car les facteurs accidentels et contingents ne sont pas moins des facteurs
causaux que les autres!
De mme, lorsque M. Dumnil partage les causes en causes essentielles,
ncessaires et internes, et en causes accidentelles, excternes et contingentes lOI,
notre sens, il faudrait prciser qu'il ne s'agit que d'une extriorit relative.
Les causes qui dcident du partage de la plus-value font encore partie d'une
totalit.
Dans une socit dtermine, la population se rpartit en classes qui sont
interdpendantes conomiquement comme le montre bien le Tableau cono-
mique de Quesnay que Marx reprend dans sa thorie de la reproduction 102.
Malgr la multiplicit des causes qui s'y manifeste, l'histoire selon Marx,
n'est pas livre la contingence, c'est--dire au hasard. Nanmoins, il dcrit la
gense d'un nouveau mode de production comme rsultant du concours de
facteurs provenant de la dcomposition du mode de production prcdent en
lments divers: les ouvriers libres, le capital commercial, la dcouverte du
Nouveau Monde, etc., qui constituent autant de causes indpendantes.
Ainsi, des causes essentielles jouissent d'une indpendance qui, pour tre
relative, n'en est pas moins relle.
Lucidement, certains marxistes ont insist sur cette contingence tous les
niveaux de la ralit ds qu'on l'aborde concrtement. Critiquant l'abus que
l'on faisait de la mtaphore de 1'organisme social, Labriola osait dire: cette
mtaphore n'a pas plus de porte [que celle des facteurs]; et la recherche
particulire, critique et circonstancie des faits historiques est la seule source
de ce savoir concret et positif qui est ncessaire au dveloppement complet du
matrialisme conomique 103.
150 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Des critiques vigilants le lui ont reproch: il y aurait pril mtaphysi-
que 104,> souligner la contingence des causes. Soulignant le rle des contin-
gences varies du dveloppement conomique et de la situation politique qui
en dcoule 105, Labriola fut pris partie par Gentile, qui l'accusa d'avoir fait
du matrialisme historique une mtaphysique du contingent 106.
Ce mot appliqu au marxisme est inattendu et, pour le moins, inhabituel.
Or, Labriola a compris Marx mieux que beaucoup d'autres, et ses crits
gardent leur valeur aujourd'hui encore. Il avait su viter le simplisme et le
dogmatisme. C'est ce que Croce rtorqua en le dfendant malgr tout:
Les propositions et formules qui [semblent] critiquables dans les
ouvrages de M. Labriola, [...] sont simplement des excroissances d'une
pense ralistiquement saine. [...] Ses observations, [...1 parfois lgrement
contradictoires, toujours heureuses, nous ramnent sur le terrain raliste. [...]
Il a, un degr minent, le respect de l'histoire 107."
Bel hommage, que mrite tout autant Marx. Mais, avec l'ide
d'indpendance des causes, ce qu'impliquait dj leur multiplicit, n'attri-
buons-nous pas Marx la thorie du hasard de... Cournot?
Pour Marx, comme pour Cournot, le hasard qui se dploie dans les
vnements singuliers engendre une forme de ncessit: celle qui rsulte du
concours d'un grand nombre de causes ou vnements lmentaires. Cette
ncessit n'exclut pas le hasard, elle le suppose! Inversement, le hasard
n'exclut pas la ncessit, il y conduit 108!
Les explications et les exemples de Marx concernant cette liaison du
hasard et de la ncessit, qui est la ncessit mergeant du grand nombre, ont
en effet un air de ressemblance avec la fameuse conception de Cournot qui
proposa de dfinir le hasard par le concours de sries causales indpen-
dantes , du moins assez indpendantes pratiquement pour tre considres
thoriquement comme telles: en effet, l'indpendance absolue de sries qui
remonteraient l'infmi est toujours contestable 109.
Ce que Marx dit du concours de causes gnrales comme la fertilit et la
situations des terres, ou de la runion de conditions historiques d'origines
diverses, rpond tout fait cette dfinition. De plus, comme Cournot, pour
parler du hasard, Marx se place sur un plan historique et critique.
Toutefois, pour Marx, la combinaison des facteurs causaux essentiels
qui sont lis par une correspondance ncessaire n'entre pas dans cette
dfinition, puisque, dans ce cas, les causes diffrentes doivent convenir et
s'ajuster entre elles. On ne peut donc parler d'indpendance! La correspon-
dance est une forme de dpendance!
La contingence, pour Marx comme pour Cournot, est donc la forme que
prend le cours des choses quand concourent des causes diverses, sans rapport
direct, sauf assez lointain, entre elles.
S'il en restait l, peu de choses, du point de vue logique, le diffrencierait
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
151
de Cournot. Par exemple, Marx crit: il n'y a pas de relation causale [keine
ursachliche Verbindung] entre la formation d'un capital argent additionnel et la
masse de mtal prcieux se trouvant dans le pays 110.
Voil un cas d'indpendance de deux sries causales au sens de Cournot,
et on pourrait en trouver ainsi beaucoup d'autres sous la plume de Marx, ds
qu'il en vient des choses ou situations particulires. Comme Cournot, Marx
accorde que, aurait-on une connaissance prcise des sries en jeu, on n'limi-
nerait pas ce genre de contingence ou hasard: pour tous deux, le hasard, en
ce sens, est objectifll1.
Ils n'affirment cependant ni l'un ni l'autre une contingence absolue 112.Ils
pensent qu'il y a une certaine rationalit de l'histoire qui n'est pas qu'une
succession kalidoscopique dsordonne.
Cela dit, leurs conceptions de l'histoire, ainsi que leurs philosophies
respectives, diffrent considrablement!
Pour Marx, toutes les sries causales (les facteurs causaux ou moments
sociaux) manent d'un monde dont elles ne sont que des aspects; si elles
jouissent d'une indpendance, celle-ci est relative. D'autre part, il pense un
monde en devenir; il y a une histoire parce qu'il y a une certaine volution qui
est un dveloppement. Cournot, lui, critique les conceptions volutionnistes.
C'est pourquoi, Marx n'accorde pas autant que Cournot la linarit des
chanes causales simples: ce n'est l pour lui qu'une vue abstraite des choses.
Pour Cournot, au contraire, tout se passe comme si la ralit se composait de
telles sries causales linaires, o les vnements se droulent paralllement.
Par sa philosophie gnrale, Marx pense que rien n'est absolument
indpendant, que l'indpendance n'est que relative; mais d'un autre ct, dans
les cas conomiques et historiques concrets, il admet que l'indpendance des
causes est pratiquement ralise.
Jusqu'o va-t-il dans l'admission de la fortuit? Si, pour lui, la contin-
gence, au sens de fortuit, joue un rle important et constant en histoire, il
n'en conclut pas que tout soit contingent, car la contingence la plus grande, la
multiplicit mme des causes individuelles les plus nombreuses, ramne la
ncessit par le jeu des moyennes. Un renversement dialectique s'opre. Tous
les coups de ds dont l'histoire est faite n'abolissent pas la ncessit. Cette
ncessit sans cesser d'tre conomique devient historique.
Comme l'avait fait remarquer Hegel, la dpendance de l'vnement
fortuit l'gard de conditions transforme sa ncessit: Cette ncessit est en
mme temps relative. - Elle a en effet une prsupposition partir de laquelle
elle commence, elle a son point de dpart dans le contingent. L'effectif rel
comme tel est en effet l'effectif dtermin, et a d'abord sa dterminit comme
tre immdiat dans le fait qu'il a une pluralit de circonstances existantes;
mais cet tre immdiat, comme dterminit, est aussi le ngatif de soi, est tre-
en-soi ou possibilit 113.
Celle-ci apparat chez Marx comme possibilit historique concrte.
152 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
NOTES
1. Cette thse, soutenue par les empiristes anglais, puis Auguste Comte et les no-positivistes,
visait, l'origine, l'usage du principe de causalit en thologie, et dans la mtaphysique
rationaliste classique; mais elle fut tendue de plus en plus aux sciences, tendant en exclure toute
explication de type causal.
2. Le grand souci des positivistes est d'arriver sparer la science et la philosophie en traant
une ligne de dmarcation infranchissable et dfinitive entre elles. Leur idal de purifier les sciences
de toute trace de mtaphysique, serait atteint - pensent-ils
-
si l'on pouvait abolir la philosophie
au bnfice de connaissances uniquement et strictement positives
",
en particulier en en banissant
l'explication par des causes. La phnomnologie d'inspiration husserlienne, 'elle aussi, conteste les
explications causales" en philosophie. Rcemment, pour des motivations scientistes (thori-
cistes), certains interprtes de Marx ont minimis l'importance de sa recherche des causes. C'est
pourquoi il importe, au contraire, de la faire apparatre en pleine lumire.
3. Nanmoins, toutes les .dois" de la mcanique classique ne sont pas des lois causales
",
comme on le croit communment: le fameux principe d'inertie n'est pas causal,,; il n'assigne
aucune cause au mouvement (cf. Mario BUNGE, Causality: The Place of the Causal Principle in
Modern Science, Cambridge (Mass.), Harvard Univ. Press, 1959, pp. 108-111). .
4. Cf. J. A. SCHUMPETER, op. cil.; Andr MARCHAL, Systmes et structures conomiques,
Paris, Presses Universitaires de France, coll. Thmis, 1959: H. Denis, Histoire... ; A. Anikin, op.
cit.
5. Le capital (trad. Lefevbre), p. 203; ES, t. 1, p. 183; MEW23, p. 195.
6. Marx prcise: dans la forme de socit que nous avons considrer, elles [les valeurs
d'usage] constituent en mme temps les porteurs matriels de... la valeur d'change." (Le capital,
t. l, p. 52; trad. Lefebvre, pp. 40-41; MEW 23, p. 50. - Trad. modifie.)
7. Marx suit Adam Smith et David Ricardo. Ce dernier ouvrait son trait (op. cil., p. 25) par
l'nonc suivant: La valeur d'une marchandise, ou la quantit de toute autre marchandise contre
laquelle elle s'change, dpend de la quantit relative de travail ncessaire pour la produire, et non
de la rmunration plus ou moins forte accorde l'ouvrier." Adam Smith (op. cit., p. 61) en avait
donn une dfinition voisine: La valeur d'une denre quelconque pour celui qui la possde, et
qui n'entend pas en user ou la consommer lui-mme, mais qui a l'intention de l'changer pour
autre chose, est gale la quantit de travail que cette denre le met en tat d'acheter ou de
commander. Le travail est donc la mesure relle de la valeur changeable de toute marchandise."
8. Le capital, t. l, p. 57; MEW 23, p. 56. - Trad. modifie; la traduction de Roy donne
depuis plus d'un sicle: .d'ai, le premier, mis en relief ce double caractre du travail reprsent
dans la marchandise. Comme l'conomie politique pivote autour de ce point, il nous faut ici entrer
dans de plus amples dtails." M. Lefebvre traduit: J'ai t le premier mettre le doigt, de
manire critique, sur cette nature bifide [sic] du travail contenu dans la marchandise. Comme c'est
autour de ce point que tourne la comprhension de l'conomie politique, il convient de l'clairer
un peu plus
ici" (Ioc. cit., p. 47).
La traduction de Joseph Roy supprime l'expression: de manire critique,,! Elle gratifie
Marx de l'honneur qui revient Adam Smith, que Marx flicite ailleurs pour avoir dcouvert le
travail abstrait" et l'avoir mis au centre de l'conomie politique: Un norme progrs fut fait
par Ad. Smith quand il rejeta toute dtermination particulire de l'activit cratrice de richesse
pour ne considrer que le travail tout court [...]." (Introduction, in Contribution, p. 168; MEW 13,
p. 635). Dans Le capital, Marx dit seulement qu'i! est le premier avoir dvelopp une critique de
l'conomie politique du capitalisme en se fondant sur ce caractre double du travail. Dans la
premire dition, on lit: Dieser Punkt, der von mir merst kritisch entwickeln wrde [...] (MEGA,
t. Il/5, p. 22), dans la quatrime: Diese zwieschligtige Natur [...] ist zuerst von mir kritisch
nachggewiesen worden" (MEW 23, p. 56), chaque fois avec, en note, une rfrence la Contribution
parue en 1859.
9. Pour tre tout fait exact, il faudrait dire l'une des causes
",
la nature elle-mme tant
l'autre.
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
153
10. Le capital, t. 2, p. 189; trad. Lefebvre, p. 578; MEW 23, p. 539.
Il. Auparavant, on avait attribu la cration de la valeur la fcondit de la nature (les
Physiocrates), ou aux vertus du commerce (les mercantilistes).
12. D'o le chapitre du Capital consacr la longueur de la journe de travail, en particulier
toutes les luttes autour de la loi des dix heures en Angleterre au milieu du XIXesicle.
13. D'o les chapitres du Capital sur la coopration, les manufactures, le machinisme et la
grande industrie.
14. L'effet de la coopration simple se manifeste de faon colossale dans les ouvrages
gigantesques des anciens peuples asiatiques, gyptien, trusque, etc. (Ibid., p. 26; p. 375; p. 353.
Trad. modifie)
-
La coopration simple runit des hommes qui accomplissent les mmes gestes
dans une tche commune. Dans la coopration complexe intervient la division du travail; ainsi, la
manufacture runit des mtiers diffrents (cf. le clbre exemple de la manufacture d'pingles
analys par Adam SMITH(op. cit., L. 1er,ch. 1er,pp. 38 et suiv.).
15. Marx connait cet ingnieur (cf. Le capital, t. 2, p. 70; trad. Lefebvre, p. 546; MEW 23,
p. 510), qui mit au point en 1797 le premier tour fileter entirement en mtal. Par contre, il
semble avoir ignor Wilkinson, inventeur du tour alser les cylindres (1772) qui joua un rle
dcisif pour assurer le succs de la machine vapeur de Watt(Cf. Histoire. des techniques, Paris,
Gallimard, Encyclopdie de la Pliade, pp. 693 et 705).
16. C'est ce que fait dj Marx dans les Manuscrits de 1844 avec ses analyses du travail alin,
et Engels dans La situation des classes laborieuses en Anglete"e, puis Marx nouveau tout au long
du premier livre du Capital.
17. Le capital, trad. Lefebvre, p. 530; ES, t. 2, p. 151; MEW23, pp. 495-497.
18. Ibid., p. 565; p. 180; p. 528.
-
De mme, la colonisation agricole de certaines rgions du
monde au XIXesicle fut possible grce la rvolution industrielle, par exemple la production de
la laine en Australie. (Ibid., p. 507; pp. 131-132; p. 475). L'essor des tats-Unis est lui-mme le
produit de la grande industrie europenne, plus prcisment anglaise (Ibid., p. 507; pp. 132-133;
pp. 475-476).
19. Ibid., p. 565; p. 180; p. 528.
20. Ibid. La grande industrie a cr cette science toute moderne qu'est la technologie.
(Ibid., p. 546; p. 164; p. 510). L aussi, il s'agit d'une relation causale. Remarquons ici un bel
exemple de l'unit de la thorie et de la pratique, car l'essor de la technologie comme discipline
scientifique contribue celui de la grande industrie: il
y
a interaction.
21. Ibid., p. 714; ES, t. 3, p. 80; p. 666.
22. Ibid., p. 715; p. 80; p. 666.
23. Sur l'incapacit de la loi de l'offre et de la demande rendre compte du niveau moyen
des salaires et de celui des prix en gnral, cf. Le capital, t. 2, pp. 208-209; trad. Lefebvre, pp. 601-
602; MEW23, pp. 559-560.
24. L. Arnold Ruge, 13 mars [1843]. (Correspondance, t. I, pp. 289-290; MEW 27, p. 417.
Trad. modifie.)
25. Selon une vue dialectique aussi simple que nave, Stimer divisait l'histoire de l'humanit
en trois priodes; son enfance correspondent le Ngre et le ralisme, son adolescence le
Mongol et l'idalisme), son ge adulte le Caucasien et l'unit ngative du ralisme et de
l'idalisme. (Cf. L'idologie (1968), pp. 153 et 187-195; (1976), pp. 119 et 152-160; MEW 3,
pp. 115, 147-153).
26. numration du dbut du Manifeste du parti communiste (pp. 30-31; MEW 4, p. 462),
reprise de Saint-Simon.
27. L'idologie (1968) p. 177; (1976) pp. 142-143; MEW 3, p. 137.
28. Cit par Marx dans L'ditorial du
n
179 de la "Gazette de Cologne", Sur la religion,
p. 22; MEW l, p. 91.
29. Ibid. - Dans Le capital, Marx dvoile partout la mme inversion. Il montre d'o
procdent les illusions imaginatives du cur Chalmers: selon lui, plus serait faible la masse du
produit annuel que les capitalistes dpensent comme capital, plus seraient grands les profits qu'ils
ingurgiteraient , et ajoute: Notre cur confond cause et effet. (Le capital, t. 6, p. 259; MEW 25,
p. 256.)
30. Sur la religion, p. 30; MEW l, p. 97.
31. Est-ce l'esprit objectif au sens de Hegel et de Montesquieu, ou bien (faisons un pas de
plus) est-ce l'esprit au sens d'Helvtius ou de D'Holbach, de Diderot ou de Cabanis? Il est sans
doute difficile de le prciser. En tout cas, le jeune Marx conoit l'esprit d'une manire plus
concrte que Feuerbach la Conscience du Genre.., ou Bauer la Conscience de soi... Le jeune
Marx connaissait bien les thses des marrialistes franais. Sans doute, savait-il que Cabanis avait
154 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
profess que le cerveau tait l'organe destin produire la pense (cf. sur ce point, Histoire de la
Philosophie, Paris, Gallimard, t. III, pp. 111-112). Mais, vraisemblablement, il ignorait que
Diderot, dans sa Rfutation suivie de l'ouvrage d'Helvtius intitul L'Homme, lui objectait
d'avoir mconnu les fonctions du cerveau dans ses explications sur l'origine des ides et des
facults intellectuelles humaines. Cet crit de Diderot ne fut publi qu'en 1873 (cf. DIDEROT,
uvres philosophiques, Paris, Garnier, 1961, pp. 583-585).
32. Droit politique, p. 159; MEW 1, pp. 304-305. - Dans la mme page, Marx crit qu' (dl
[Hegel] fait de la cause l'effet et de l'effet la cause, du dterminant le dtermin et du dtermin
le dterminant (ibid.).
33. Des recherches lexicographiques et critiques sur tous ces termes seraient mener. Elles
excdent les moyens actuels, vu que les instruments de la recherche sur Marx: ditions critiques
et Index des matires de ses uvres, manquent, ou sont trs insuffisants, rptons-le.
34. Est-ce ce qui a dissuad les auteurs d'Index de distinguer ou de retenir dans leurs listes
des termes comme cause, causalit, condition, prsupposition, dtermination,
cration , et les verbes correspondants? Pendant longtemps, il n'y eut, en fait d'index, que ceux
dresss par les diteurs ou traducteurs que pour quelques uvres de Marx. De plus, ils sont trs
pauvres en ce qui concerne le vocabulaire philosophique. Ils sont remarquablement discrets, voire
muets, pour des entres comme cause, gense, dveloppement, cration, etc. La
traduction du Livre Premier du Capital par J.-P. Lefebvre offre un Index des matires plus
complet que celui des ditions prcdentes. Cependant, il ne mentionne ni cause , ni ses drivs;
par contre, on y trouvera bouteilles , boutiquier et calches! Le rcent Sachregister zu
Marx-Engels Werke (Index des matires des uvres de Marx et Engels) remdie cet tat de
choses, quoique les notions conomiques et politiques s'y taillent la part du lion. Sous Kausalitat,
il donne environ cinq cent cinquante rfrences rparties dans les quarante volumes de la MEW.
Comme les termes Ursache [cause]. BedinglBlg [condition] et Bestimmung [dtermination] n'y
figurent pas, leurs occurrences ventuelles figurent sous Kausalitat. De fait, les mots Ursache et
Kausalitat ne figurent pas toujours dans les pages mentionnes.
35. L'idologie (1968), p. 51; MEW 3, p. 27.
36. Contribution, p. 4; MEW 13, p. 3.
37. Ibid.
38. Par exemple, dans la loi de chute des corps: e =: 1/2 gt2, l'espace et le temps entretiennent
une relation dtermine, mais aucun des deux, ni l'espace, ni le temps, n'est cause de la chute: cette
loi n'est pas une loi causale! Cependant, l'on dit que l'une des variables est dpendante et
l'autre indpendante: l'espace parcouru dpend du temps. Le temps dtermine l'espace,
mais pas au sens causal du terme!
39. M. Mario Bunge distingue ainsi plusieurs espces de dterminismes. Toutefois, il fait du
dterminisme un genre dont la causalit ne serait qu'une espce (op. cit., passim). A notre avis,
entre dterminisme et causalit, il n'y a pas une relation d'espce genre: la causalit peut aussi
tre considre comme une catgorie plus large que le dterminisme. Sur ce point, nous suivons
Bachelard (Le nouvel esprit scientifique, pp. 114-115; cf. supra, p. 72, n. 2).
40. L'idologie (1968), p. 50, MEW 3, p. 26. Dans cette page, Marx explique justement le sens
dans lequel il faut entendre la formule: (<lavie dtermine la conscience.
41. Les traductions franaises masquent souvent l'emploi de prsupposition [Vorausset-
zung], car les traducteurs le rendent par condition qui traduit aussi Bedingung. Prsupposi-
tion est technique et peu courant en franais. Mais de ce fait, on affadit le texte: les rsonances
dialectiques disparaissent.
42. Sur cette dialectique, cf. Hegel, Science de la logique, trad. Janklvitch, t. 2, p. 93, et
passim.
43. Nous avons dj rencontr cette relation dialectique entre capital et travail dans notre
introduction (cf. ci-dessus pp. 26-27).
44. Nous renvoyons la page du Capital (t. 8, p. 172, MEW 25, pp. 798-800) dj commente
ci-dessus (cf. supra, pp. 61-63).
45. Le dix-huit brumaire, p. 104; MEW, t. 8, p. 198.
46. Marx emploie aussi bien le verbe dpendre [abhangen] que le verbe dterminer.
47. En allemand, se correspondre [sich entsprechen] et se contredire [sich widerspre-
chen] s'opposent directement. Rien de tel en franais, d'o notre emploi de discordance pour
rendre sensible ce qui est immdiatement peru en allemand. Correspondance peut se dire aussi
Ubereinstimmung, qui a la mme racine que Bestimmung [dtermination], stimmen signifiant
s'accorder aux divers sens du terme. Ces correspondances sont intraduisibles! Le rseau des
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
155
affinits smantiques de l'allemand est dtruit dans n'importe quelle traduction franaise qui en
introduit d'autres.
48. Introduction, in Contribution, pp. 173-175; MEW 13, pp. 640-642.
49. Ibid.
.
50. Cette question constitue encore aujourd'hui un problme pour les historiens et les
analystes du droit. (Cf. M. J. Gaudemet,
(,
Droit romain, 9 3: Survie et persistance du droit
romain, in Encyclopaedia Universalis, vol. 14, pp. 313-314.)
51. Loc. cit., p. 153; pp. 619-620; Mthode, pp. 124-125. On notera le verbe "engendrer
employ ici par Marx.
52. Ibid., p. 173; p. 640; p. 183. Trad. modifie.
53. Manuscrits de 1857-1858, t. l, pp. 185-186; Grundr., p. 157. Deux mots: "pu et
anticiper, souligns par nous, les autres par Marx.
54. A la suite de Hegel, Marx aimait fait observer que souvent l'histoire se rpte, que ce qui
s'est pass sous forme de tragdie, se rpte sous forme de farce. Ce thme important a t tudi
par M. Assoun (La rptition historique, Paris, Presses Universitaires de France, 1978). Il est
intressant de mettre en contraste les "anticipations historiques, qui constituent une tout autre
forme de rptition .
55. En outre, il souligne que dans la Rome ancienne, les esclaves ne bnficiaient pas de ce
droit priv, le droit d'changer (Manuscrits de 1857-1858, t. I, pp. 185-186; Grundr., p. 157).
56. Marx refuse de poser dans l'abstrait la question (,mtaphysique et scolastique de la
primaut ou de l'antriorit de l'une de ces deux formes essentielles de la causalit sur l'autre. Et
propos des catgories gnrales, il fait remarquer qu'il faudra tudier le rapport existant entre
l'expos scientifique et le mouvement rel. (Introduction gnrale, Contribution, p. 151; MEW
13, p. 618; Mthode, pp. 118-119).
57. Cf. le chapitre du Capital sur l'accumulation capitaliste originaire, et les deux chapitres
consacrs ,da gense [Genesis] du fermier capitaliste et (da gense du capitaliste industriel
(t. 3, pp. 184 et 192; trad. Lefebvre, pp. 834 et 842; MEW 23, pp. 770 et 777). Les mots gense
et "origine ne figurent pas dans les Index, sauf une trs timide apparition de
(,
gense dans
l'index de la traduction du Capital de M. Lefebvre, avec la mention de trois occurences! Dans le
Sachregister zu Marx-Engels Werke, ne figurent ni Urspmng, ni Genesis, ni Entstebung [naissance,
commencement, formation].
58. En anglais: previous accumulation, c'est--dire "accumulation antrieure, ou "prala-
ble. Traduire, avec M. J.-P. Lefebvre, sogenannte par ('prtendue est un contresens. Il y a bien
une accumulation originaire pour Marx, sauf qu'il ne l'explique pas par les mmes causes que
Smith! (Sur la traduction de ursprnglich par "originaire, cf. J. D'Hondt, L'idologie de la
rupture, Paris, Presses Universitaires de France, 1978, pp. 73-77, o l'on trouvera des citations et
des arguments trs convaincants).
59. Le capital, trad. Lefebvre, p. 804; MEW 23, p. 742. Trad. modifie. Texte allemand
identique de la premire la quatrime dition. (Cf. MEGA, t. 11/5, p. 575, 1.10-15, et Le capital,
t. 3, p. 154).
60. L. P. L. Lavrov, 18 juin 1875. MEW 34, p. 145. (Traduit par nous).
61. L'idologie (1976) p. 16; (1968) p. 47; MEW 3, p. 22.
62.
L'on reconnat de la faon la plus manifeste le degr de dveloppement qu'ont atteint
les forces productives d'une nation au degr de dveloppement qu'a atteint la division du travail.
Dans la mesure o elle n'est pas une simple extension quantitative des forces productives dj
connues jusqu'alors (dfrichement de terres par exemple), toute force de production nouvelle a
pour consquence un nouveau dveloppement de la division du travail. (Ibid., p. 16; p. 46;
pp. 21-22.) Forces productives et division du travail sont interdpendantes. Il y
a action
rciproque entre elles.
63. Non seulement les rapports d'une nation avec les autres, mais aussi toute la structure
interne de cette nation elle-mme, dpendent [abhangen] du niveau de dveloppement de sa
production et de ses relations intrieures et extrieures. (L'idologie (1976) p. 16; (1968) p. 46;
MEW 3, p. 21.)
64. Suite aux enqutes de Villerm et d'autres (dont Engels), des crivains clbres (Carlyle,
Victor Hugo) s'taient alarms des graves mfaits de tous ordres engendrs par la premire
rvolution industrielle. Un sicle aprs, Lewis MUMFOR9 en dresse encore le sombre tableau
(Technique et civilisation, trad. par D. Moutonnier, Paris, Ed, du Seuil, pp. 141-194).
65. Le capital, t. 2, p. 112; MEW 23, p. 454. Autre traduction: En tant que machine, le
moyen de travail devient immdiatement le concurrent de l'ouvrier lui-mme. (Trad. Lefebvre,
p. 482). Marx cite RICARDO: La machinerie et le travail sont en concurrence constante.
156 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
(Principes, p. 479). Une traduction franaise contemporaine dit: Les forces mcaniques et les
forces humaines sont en concurrence perptuelle (Des Principes..., p. 350).
66. Les inventions du collier d'paules et du moulin eau eurent des effets similaires sur les
petits agriculteurs libres du Moyen Age (Cf. GILLE B., Technique et civilisation, le Moyen Age,
in Histoire des techniques, Paris, Gallimard, Encycl. de la Pliade, 1978, pp. 524 et suiv.; FURIAD.
et SERREP.-Ch., Techniques et socits: liaisons et volutions, Paris, A. Colin, 1970, pp. 80-88 et
102-112). II faut se garder de toute vue idyllique sur les poques passes: l'histoire de la diffusion
du moulin eau aux xe et XIe sicles fut ponctue de luttes sociales intenses: les techniques
nouvelles, rvolutionnaires par essence, ne s'imposent pas paisiblement. (Cf. entre autres, BLOCH
M., Avnement et conqutes du moulin eau , Annales d'histoire conomique et sociale, 1935,
pp. 538-563; PARRAINCh., Rapports de production et dveloppement des forces productives:
l'exemple du moulin eau, La Pense,
n
119, fv. 1963, pp. 55-70; KLEMMFr., Histoire des
techniques, Paris, Payot, 1966, 234 p.; DOCKESP., Changements techniques et rapports sociaux
dans l'histoire des socits rurales ouest-europennes, Un rexamen de la transition de l'esclavage
au servage , Analyse, pitmologie, Histoire, Lyon, Cahier
n
Il, sept. 1977, pp. 79-172).
67. L'viction brutale de nombreux travailleurs hors de la production se multipliait dans
toutes sortes de branches d'industrie. Les rvoltes des tisserands (canuts .de Lyon en 1833, ou
tisseurs de lin de Breslau (Silsie) en 1844) ne furent que les plus tristement clbres (cf. E.J.
HOBSBAWN, L're des rvolutions, trad. de l'anglais, Paris, Fayard, 1969, pp. 258 et suiv.).
68. Dans les deux cas, elle est relative. C'est toujours une conomie faite par rapport
d'autres moyens, d'autres manires de travailler, employes par des concurrents actuels ou
potentiels, dans le mme pays ou dans d'autres pays.
69. Des changements techniques dcisifs ont boulevers l'agriculture autour de l'an mille.
Aussi, certains historiens
y voient une des plus grandes rvolutions sociales de tous les temps avec
le dveloppement subsquent du commerce, des changes, des villes, de l'art, etc. (cf. FURIA et
SERRE, op. cit.).
70. Marx insiste sur cet aspect rvolutionnaire permanent du mode de production
capitaliste (cf. Manifeste, pp. 40-45; MEW 4, p. 465-467).
71. Dans toutes les socits de classes, il
y
a exploitation de l'homme par l'homme, quoique
ses formes soient bien diffrentes: le systme escalvagiste de l'Antiquit, le servage du Moyen Age,
sont aussi des modes d'extorsion d'un surplus par les classes dominantes. La diffrence est que ce
surplus tait essentiellement valu en termes de valeurs d'usage.
72. A ct de l'conomie ralise grce aux amliorations rvolutionnaires des moyens
techniques (instruments, outils, machines, quipements techniques, transports, etc.), il
y
a celle qui
rsulte de l'organisation du travail: coopration et division du travail, dqualification du travail
(travail des enfants, etc.). Plusieurs chapitres du Capital tudient l'conomie dans les conditions
de travail aux dpens des ouvriers, <d'conomie d'nergie ou de btiments, <d'utilisation des
rsidus, les conomies rsultant des inventions (cf. Le capital> t. 6, pp. 106-122; MEW 25,
pp.
98- 114).
73. Le capital, trad. Lefebvre, p. 686; ES, t. 3, p. 54; MEW 23, p. 640.
74. II ne s'agit pas d'un rapport quantitativement mesurable. C'est une relation sui generis,
dont les termes sont incommensurables, irrationnels comme dit Marx parfois. Pour compren-
dre cela, il faut se reporter la dfinition hglienne de la mesure comme unit de la quantit
et de la qualit. (Cf. HEGEL, Science de la logique, L. l, Ille Section.)
75. On le voit, cette corrlation ncessaire n'est pas exclusive de toutes sortes de
possibilits, au contraire.
76. Dans son clbre Essai philosophique sur les probabilits, qui sert d'Introduction la
seconde dition de sa Thorie analytique des probabilits en 1814, Laplace propose un apologue
clbre: il imagine qu'une intelligence capable d'embrasser toutes les forces dont la nature est
anime et la situation respective des tres qui la composent et assez vaste pour soumettre ces
donnes l'analyse [mathmatique], embrasserait dans la mme formule les mouvements des plus
grands corps de l'univers et ceux du plus lger atome. Rien ne serait incertain pour elle et l'avenir
comme le pass serait prsent ses yeux. (LAPLACE,uvres, Paris, Gauthier-Villars, 1886, vol.
VII, L. l, pp. VI-VII).
77. Le capital, trad. Lefebvre, p. 700; ES, t. 3, p. 66; MEW 23, pp. 652-653. Trad. modifie.
- M. Lefebvre traduit Mehrwert par survaleur, alors que plus-value est le terme franais
consacr par l'usage. Nous le substituerons donc survaleur en citant cette traduction.
78. Ibid. - De l la concentration du capital, dont il faut distinguer la centralisation
qui porte sur des capitaux dj existants. (Ibid., p. suiv.)
79. Ici, l'on voit que les causes des processus conomiques sont des causes finales. Ce sont
LA POSSIBILIT ABSTRAITE 157
des forces ou causes motrices, orientes vers un but: l'accroissement de la productivit. Que
celui-ci soit conscient ou non, voulu ou non, il est immanent au processus conomique global.
80. Le capital, t. 4, p. 97; MEW 24, p. 108 (mots souligns par nous).
- Le deuxime livre
du Capital a pour titre: Le processus de circulation du capital . Le premier est intitul: Le
processus de production du capital , alors que le titre franais (trad. J. Roy cautionne par Marx)
est: Le dveloppement de la production capitaliste, ce qui peut crer quelque quivoque avec
le titre du troisime livre: Le processus d'ensemble de la production capitaliste.
81. Dans le Livre II du Capital, l'analyse de la causalit inclut la circulation des marchan-
dises (matriaux, machines, forces de travail), car Marx y tudie la reproduction du Capital.
82. Le capital, t. 4, p. 95; MEW 24, p. 106. Mme E. Cogniot traduit: elle est ncessite par
sa base technique. Or, la base technique ne fait que rendre possible une plus grande continuit
de la production: elle la conditionne , mais ce n'est pas elle qui la rend directement ncessaire
comme il est affirm par cette traduction fautive. J. Roy ne peut tre mis en cause: il s'agit du
livre II du Capital, publi par les soins d'Engels en 1885.
83. Ibid.
84. Le capital, t. 8, p. 41 ; MEW 25, pp. 663-664. Peut et peuvent souligns par nous.
85. Nous n'aborderons pas davantage la thorie marxienne de la rente.: elle nous entranerait
dans des considrations conomiques complexes qui n'entrent pas dans notre sujet.
86. Le capital, 1. 8, p. 41; MEW 25, p. 663.
87. Le capital (trad. Lefebvre), p. 396; ES, t. 2, p. 42; MEW 23, pp. 372-373.
88. Marx critique ceux pour qui la nature serait partout semblable elle-mme. Ainsi,
quoique matrialiste, Feuerbach la conoit d'une faon abstraite: Feuerbach ne voit, par
exemple Manchester, que fabriques et machines l o il
y avait seulement, il y
a un sicle, des
rouets et des mtiers tisser, et il ne dcouvre que pturages et marcages dans la campagne
romaine, l o il n'aurait trouv, du temps d'Auguste, que des vignobles et des villas de
capitalistes romains. (L'idologie (1968), p. 56; (1976), p. 25; bil., pp. 84-85; MEW 3, p. 44).
89. Comme la terre est [le] magasin de vivres primitif[de l'homme], elle est aussi l'arsenal
primitif de ses moyens de travail. (Le capital, 1. 1, p. 182; trad. Lefebvre, p. 201; MEW 23,
p. 194).
90. Ibid., p. 184; pp. 204-205; pp. 196-197. Mots souligns par nous.
91. Ibid.,1. 8, p. 163; MEW 25, p. 789. Marx s'intressait de prs l'agronomie et la chimie
organique naissante (cf. les travaux de Liebig; on commenait alors dcouvrir et analyser les
constituants des substances organiques les plus simples). Il connaissait la thorie molculaire
ayant entendu [les cours d'] Hofmann sur ce sujet. (L. Engels, 22 juin 1867, Correspondance,
t. VIII, p. 390; MEW 31, p. 306. Trad. modifie.)
-
En 1863, Marx assista des cours populaires
sur la mcanique et la thorie des machines l'Institut de Gologie de Londres (cf. L. Engels,
28 janv. 1863; ibid., 1. VII, p. 127; MEW 30, p. 320). Les cours d'Hofmann faisaient-ils partie
des cycles de confrences donnes dans ce cadre? Dans Le capital, Marx se rfre aux
connaissances les plus rcents en chimie: il connat les traits de Laurent, Gerhardt et Wurtz,
fondateurs de la thorie molculaire. Il se liera d'amiti avec un chimiste allemand de grande
notorit: Schorlemmer, dont Engels avait fait la connaissance Manchester dans le cadre de
l'Institut Schiller.
92. Misre, p. 144; MEW 4, p. 152.
93. La raison dans l'histoire, p. 99.
-
Pour Hegel, ce droit formidable s'exerce aussi dans
la nature: il en voulait pour preuve le riche et libre dploiement des tres et des espces (cf.
Encyclopdie, add. au 9145; trad. B. Bourgeois, p. 578).
94. M. Mario Bunge expose trs bien ce point: Aucun physicien sens ne pense plus
maintenant qu'il existe dans le monde rel (contrairement aux schmes thoriques) deux particules
de matire (doues de masse ou non) qui soient exactement dans le mme tat et qui interagissent
exactement avec les mmes champs. [...] Si une telle spcificit, une telle unicit et une telle non-
rptabilit des vnements dans le monde de la matire ne rendent pas impossibles les sciences
physico-chimiques, pourquoi rendraient-elles impossibles les sciences sociales? Assurment, les
vnements socio-historiques sont beaucoup plus riches que ceux de niveau infrieur, ce qui leur
confre un plus haut degr de spcificit et d'individualit. Mais cela ne signifie pas que les
vnements socio-historiques soient uniques [einmalig] (c'est--dire n'arrivent qu'une fois)
tous gards (cf. BUNGEM., Causality..., pp. 266-267, trad. par nous).
95. Les mots contingent et contingence traduisent zufillig et Zufalligkeit. Mais ces
traductions sont quivoques. Der Zufall, c'est le hasard, la fortune, le sort (bon ou mauvais), le cas
imprvu, l'accident. L'adjectif zufalIig veut donc dire: par hasard, accidentel, fortuit, occasion-
nel, par rencontre... Or, en franais, le mot contingence.. a deux sens trs diffrents. Dans la
158 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
langue courante, ,<les contingences , ce sont les obstacles ou difficults imprvus que l'on
rencontre dans la ralisation d'un projet ou dans l'application d'une dcision, ce qui n'a rien voir
avec <<lacontingence au sens mtaphysique d'indtermination par absence de toute espce de
cause. Cette contingence mtaphysique est celle que certains philosophes supposent comme
condition de possibilit de la libert humaine, dfinie comme un libre-arbitre pouvant se
dterminer quels que soient les motifs ou les mobiles. Cette conception connut un regain de
faveur, depuis qu'en 1930, les physiciens de l'cole de Copenhague l'ont adopte en interprtant
certains principes de la microphysique comme une preuve d'indtermination physique.
- Il serait
donc prfrable de traduire ZuffaUigkeit chez Marx par fortuit, ou d aux circonstances.
Marx n'affirmait pas plus la contingence mtaphysique que le ncessitarisme absolu (cf. ci-
dessous, p. 368, note 159).
96. Contribution, p. 154; MEW 13, p. 621.
97. Sur les sens trs diffrents de contingent et de contingence , cf. B. SAINT-SERNIN,
Contingence , Encyclopaedia Universalis, vol. 4, pp. 953-955.
98. Le capital, t. 2, p. 46; trad. Lefebvre, p. 400; MEW23, p. 377.
99. Dans L'idologie allemande, Marx met autant l'accent sur les dtermination individuelles
que sur les dterminations sociales, comme l'a bien montr M. Jacques 'TEXIER(<< La thorie
matrialiste de l'individualit dans L'idologie allemande, La Pense, mars-avr. 1981,
n
219,
pp.62-81).
100. Lucien GOLDMANN, Sciences humaines et phosophie, Paris, Gonthier, 1966, p. 124.
101. G. DUMENIL, op. cit., p. 137 et suiv.
-
Le mme auteur parle de la contingence de
l'clatement de la crise (ibid., p. 201 et suiv.), ce que contredit leur retour priodique!
102. Cf. le livre II du Capital, passim (par ex., t. 4, pp. 92, 121, 175 et suiv.; MEW24, pp. 103,
133,189 et suiv.)
-
Sur le rapport de Marx Quesnay, cf. Jean BENARD, Marx et Quesnay, in
Franois Quesnay et la Physiocratie, Paris, Institut National d'tudes Dmographiques, vol. l,
1958, pp. 105-130.
103. Antonio LABRIOLA, Essais, op. cit., p. 171.
104. L'expression est de Benedetto Croce qui, pensant entre autres Labriola, craint que
dans la littrature marxiste, c'est--dire parmi les disciples et les interprtes de la pense de Marx,
il
y ait vraiment un pril mtaphysique, contre lequel il faut se mettre en garde. (Matrialisme
historique et conomie marxiste: Essais critiques, 1899, trad. Bonnet, Paris, 1901; rimpression
Genve/Paris, Slatkine, 1981, p. 139.)
105. Loc. cit., p. 54.
106. G. GENTILE, Une critica dei materialismo storico [une critique du matrialisme
historique], Studi Storici, vol. VI, 1897, p. 421 (cit par CROCE,loc. cit., p. 139).
107. Loc. cit., pp. 139-140.
108. Cette relation sera aborde dans notre prochain chapitre consacr aux moyennes.
109. Le HASARD![...] Cette ide est celle de l'indpendance actuelle et de la rencontre
accidentelle de diverses chanes ou sries de causes: soit que l'on puisse trouver, en remontant plus
haut, l'anneau commun o elles se rattachent et partir duquel elles se sparent; soit qu'on
suppose (car ce ne peut tre qu'une hypothse) qu'elles conserveraient leur mutuelle indpen-
dance, si haut que l'on remontt). (Antoine-Augustin COURNOT, Matrialisme, Vitalisme,
Rationalisme: tude sur l'emploi des donnes de la science en philosophie, in uvres compltes, t. V,
d. par CI. Salomon-Bayet, Paris, Vrin, 1979, pp. 174-175.)
110. Le capital, t. 5, p. 144; MEW 24, p. 493.
-
Marx veut dire que la masse mtallique de
la monnaie peut rester la mme dans un pays donn et pourtant le capital y crotre, doubler,
tripler, ou, inversement, diminuer dans des proportions quelconques.
Ill. A Laplace, pour qui le nom de hasard nous servirait dguiser l'ignorance o nous
serions des vritables causes, Cournot rpond: Non, le mot de hasard n'est pas sans relation
avec la ralit extrieure; il exprime une ide qui a sa manifestation dans des phnomnes
observables. (Op. cit., p. 175) Cournot donne des exemples dans lesquels la connaissance des
causes n'empche pas qu'i!
y ait hasard; en ce sens, le hasard existe mme dans le domaine
purement rationnel des mathmatiques, o l'on connat les raisons (pour des exemples simples, cf.
ibid., pp. 177-179. Aristote aussi soutint qu'il
y a des vnements ou causes accidentels", qui
ne drogent nullement la causalit, mais qui constituent comme des ruptures si l'on remonte
quelque peu la srie des causes (cf. Mtaphysique, livre E, chap. 4).
112. Insistons-y, Cournot se limite l'indpendance actuelle des causes secondes (op. cit.,
p. 180 et passim). Marx et Cournot n'ont exerc aucune influence l'un sur l'autre. Marx cite
cependant Cournot, mais trs tardivement, et seulement son premier ouvrage conomique de
1838: Recherches sur les principes mathmatiques de la thorie des richesses (cf. Notes de lecture sur
LA POSSIBILIT ABSTRAITE
159
le Trait d'conomie politique.. d'Adolphe Wagner (1879-1880), MEW 19, p. 383). M. Rubel, (in
Marx, uvres (d. Rubel), t. II, pp. 1531-1551) ne donne que des extraits de ces Notes..: le
passage sur Cournot n'y figure pas.
-
D'autre part, quoique Cournot ait t galement un lecteur
assez averti, et ait fait allusion, sans dfaveur, aux thses socialistes, il est trs improbable qu'il ait
lu Marx: l'dition franaise du Capital ne fut diffuse qu' 500 exemplaires et par fascicules,
partir de 1872. La parent de leurs ides sur le hasard, que nous relevons ici, vient du fait qu' leur
poque la science prit en considration les phnomnes lis aux grands nombres en introduisant
le calcul des probabilits dans les domaines sociaux et conomiques. Marx labora sa conception
gnrale de l'histoire en tenant compte de ces aspects probabilistes rcemment venus au premier
plan de la connaissance scientifique. Pour sa part, Cournot est justement connu pour avoir abord
les problmes logiques et pistmologiques que cela pose la philosophie qu'il considre comme
une critique de la connaissance.
113. Science de la logique, trad. Labarrire-Jarczyk, t. II, p. 260.
DEUXIME PARTIE
LA POSSIBILIT CONCRTE
OU
LA CONCEPTION DE L'HISTOIRE
Chapitre 4
LES MOYENNES
Pour bien des personnes, les
choses ne sont gure probables
que d'une seule m anire: si la
probabilit d'un vnem ent est
trs grande, elles la prennent pour
la certitude,. si elle est trs faible
au contraire, elles estim ent
/'
v-
nem ent im possible.
Adolphe QUTELET
Le sens historique et raliste caractrise la dmarche de Marx qui ne perd
jamais de vue que les individus et les socits sont des individus sociaux
dtermins, des socits dtermines, etc. Dans Le capital, les rfrences la
situation historique concrte de toutes sortes d'tats et de nations, de
l'Angleterre l'Inde, de l'Irlande l'Australie, des tats-Unis d'Amrique la
Russie, sont nombreuses. Parfois elles viennent au premier plan et envahissent
le champ de l'analyse. Derrire les considrations thoriques les plus abs-
traites, l'analyse concrte de la situation concrte reste un souci constant.
Cependant, Marx n'utilise pas seulement des donnes historiques: il
prend en considration des moyennes, concept qui tient une trs grande place
dans Le capital. Apparemment, considrer des moyennes, c'est s'en tenir un
point de vue abstrait. En fait, c'est une manire de tenir compte des variations
individuelles possibles; c'est introduire au niveau thorique un certain esprit
probabiliste. Avec les moyennes, la contingence apparue par le truchement de
la multiplicit des causes est surmonte. Le hasard mne son libre jeu sans que
la ncessit soit abolie. Celle-ci revt seulement une forme nouvelle: celle de la
probabilit, dans laquelle se conjuguent le ncessaire et le contingent. Avec la
probabilit, nous avons un premier type de la possibilit concrte .
164 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
L'omniprsence de la notion de moyenne dans Le capital et le recours de
Marx aux considrations statistiques soulvent des problmes gnralement
passs sous silence par les commentateurs. Dans l'usage abondant qu'il fait de
la notion de moyenne, se fonde-t-il sur la loi des grands nombres? Ses analyses
semblent impliquer qu'il admet la validit de cette loi.
Dans quelle mesure le matrialisme historique accueille-t-ille probabi-
lisme qui gagnait les sciences sociales? Bien plus, on peut se demander si Marx
n'aurait pas subrepticement adopt les vues de Qutelet en matire d'anthro-
pologie et de physique sociale. Quel est le rapport exact de Marx Qutelet?
Rpondre ces questions n'est nullement vident.
En effet, la conception gnrale que Marx se fait du dveloppement
historique ne conduit-elle pas rejeter les hypothses sur lesquelles repose la
loi des grands nombres? N'enveloppe-t-elle pas une critique de la notion de
moyenne?
Nous allons montrer que la possibilit historique , au sens o Marx
l'entend, suppose bien un large usage des notions de moyenne et de probabilit
statistiques, mais un usage critique. Il s'agit d'une critique dialectique qui
intgre ces notions en les dpassant.
1. Compensation et loi des grands nombres
Marx utilise beaucoup la notion de moyenne. Lorsqu'il tudie la valeur et
la plus-value, le capital et le profit, le salaire et les prix, il s'agit de la valeur et
de la plus-value moyennes, du capital et du profit moyens, du salaire et des
prix moyens. De mme pour la force de travail, la dure ou l'intensit du
travail, et les phnomnes conomiques en gnral. Ce sont toujours des
moyennes qui rsultent d'un processus de compensation concret: la concur-
rence.
Le livre premier du Capital part de la prsupposition selon laquelle l'effet
de la concurrence est galisateur:
Les oscillations continuelles des prix du march, leur baisse et leur
hausse se compensent et s'annulent [sich aufbeben] rciproquement et se
rduisent d'elles-mmes au prix moyen [Durchschnittspreis] comme leur
rgle intime
'.
De mme, le niveau moyen du salaire du travail simple , celui des
ouvriers non qualifis des fabriques mcanises modernes, se ralise par la
concurrence:
Les frais de production du travail simple se montent [belaufen sich] aux
frais d'existence et de reproduction du travailleur. Le prix de ces frais [...]
constitue le salaire [... qui] ainsi dtermin s'appelle le minimum de salaire. Ce
minimum de salaire, tout comme la dtermination du prix des marchandises
LA POSSIBILIT CONCRTE 165
par les frais de production en gnral, joue pour l'espce et non pour
l'individu pris isolment. Il y a des ouvriers, qui, par millions, ne reoivent pas
assez pour pouvoir exister et se reproduire; mais le salaire de la classe
ouvrire tout entire est, dans les limites de ses oscillations, gal ce
minimum2."
Considrer des moyennes n'a de sens que si l'on a affaire des
vnements qui se reproduisent un trs grand nombre de fois et qui sont
soumis individuellement des variations accidentelles, considres comme des
fluctuations s'effectuant au hasard". Alors les carts se compensent. C'est
l un fait que Marx admet partout comme base d'analyse.
Pour lui, ces moyennes sont relles , et non pas seulement des moyennes
arithmtiques" abstraites3. Le prix moyen d'une marchandise s'tablit sur
le march, o sont prsents de multiples vendeurs et acheteurs, quelles que
soient les conditions de production - gnralement diffrentes - de cette
marchandise:
La marchandise est vendue son prix de march gnral, qui est le
rsultat de l'action galisatrice exerce par la concurrence sur les prix
individuels 4. Ainsi, l'tablissement de la valeur de march que nous avons
prsent ici dans l'abstrait est ralis sur le march rel par la concurrence
entre les acheteurs [...] 5".
Cette explication est permanente dans Le capital. Marx n'entend pas
rester sur un plan thorique abstrait: les moyennes dont il parle ne sont pas
purement arithmtiques et sans correspondant dans la ralit. La valeur
moyenne est une ralit effective au mme titre que la hauteur d'un difice
dans l'exemple de Qutelet. C'est une ralit qui s'impose pratiquement aux
agents conomiques et sur laquelle ils se guident.
Lorsqu'il s'agit de concurrence entre capitaux, Marx parle d'une galisa-
tion ou prquation [Ausgleichung], par laquelle il explique la diffrence entre
prix de production et prix de march; selon cette thorie, ce n'est pas le profit
rel fait par chaque entrepreneur qui s'ajoute au prix de production dans son
entreprise, mais le profit moyen ralis l'chelle sociale totale, que Marx
dfinit ainsi:
Les taux de profit tablis dans diverses branches de production
diffrent beaucoup l'origine. Ces divers taux de profit, sous l'effet de la
concurrence, s'uniformisent en un taux gnral de profit qui est la moyenne
[der Durchschnitt] de tous ces taux de profit diffrents. On appelle profit
moyen le profit qui, conformment ce taux gnral de profit, choit un
capital de grandeur donne, quelle que soit sa composition organique6."
Marx insiste beaucoup sur ce processus de prquation des taux de profit:
en effet, il apportait ainsi une rponse neuve et originale au problme que
166 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
posait l'conomie politique classique les diffrences constates entre les
valeurs thoriques et les prix rels.
La concurrence rpartit le capital social entre les diffrentes sphres de
production de telle manire que les prix de production dans chaque sphre
sont constitus sur le modle de ceux existant dans les sphres de composi-
tion moyenne 7.
Implicitement, Marx admet donc que la loi des grands nombres rgit les
phnomnes conomiques, condition qu'il y ait libre concurrence; il fait
remarquer que la multiplicit des causes est la condition ncessaire pour que
s'tablisse un taux de profit moyen:
tant donn le grand nombre de causes diverses qui font monter ou
baisser le taux de profit [...J, on pourrait croire que le taux gnral de profit
se modifie tous les jours. Mais le mouvement se produisant dans l'une des
sphres de production neutralise celui qui se produit dans une autre, les
influences s'entrecroisent et se paralysent rciproquement 8.
Si Marx ne parle nulle part expressment de la loi des grands nombres, il
n'est pourtant gure douteux qu'il pensait la rpartition de la frquence des
carts la moyenne selon la loi de Gauss. Pouvait-il l'ignorer, connaissant les
ouvrages de Qutelet?
Les conditions d'application de la loi des grands nombres sont impliques
par la manire dont il prsente le processus de compensation. Il dclare qu'il
faut considrer les choses sur une longue dure: pour des priodes assez
longues les prix de march moyens galent les prix de production 9. Il suppose
toujours un trs grand nombre de ventes et d'achats d'un mme produit, qui
annule l'effet des causes accidentelles telles que les variations saisonnires,
les diversits locales, les diffrences individuelles, etc.
Toutes les lois conomiques qu'il analyse prsupposent les conditions de
la compensation et de l'galisation des valeurs ou des prix: de nombreux
individus, d'innombrables actes d'changes, et la longue dure. En se basant
sur l'tablissement des moyennes comme sur un fait universel, il admettait la
validit de la loi des grands nombres en conomie 10. Cependant, fait
singulier, il ne la nomme jamais! Pourtant, n'est-ce pas elle que font penser
des lignes comme celles-ci:
Dans la ralit, cette sphre [celle de la circulation] est celle de la
concurrence; considrer chaque cas isolment, on voit que c'est le hasard qui
y rgne; la loi interne qui se fraye un chemin au sein de ces accidents fortuits
et les rgularise ne devient visible que lorsque ces accidents fortuits sont
groups par grandes masses 11.
Cela explique que (da loi reste [...] invisible et incomprhensible pour
chaque agent individuel de la production elle-mme 12.
Ds ses premires lectures conomiques, Marx remarquait que cette loi
LA POSSIBILIT CONCRTE
167
tait une vritable contradiction inhrente au systme capitaliste: Dans
l'conomie politique, la loi est dtermine par son contraire, savoir l'absence
de lois. La loi de l'conomie politique, c'est le hasard 13.
Cette formule paradoxale -la loi est l'absence de loi -pourrait aussi
se trouver dans Le capital o Marx souligne toujours l'anarchie sociale de la
production. Dans le capitalisme libral, tout est livr la concurrence; c'est le
hasard qui rgne et fait loi... la surface visible de la socit. Cette <doi du
hasard n'est-elle pas justement celle des grands nombres, la concurrence
tant le moyen pratique par lequel elle s'applique en conomie.
Or, cette loi repose sur l'hypothse de l'indpendance des causes lmen-
taires, condition pour que les vnements soient alatoires . La rfrence
continuelle de Marx aux moyennes suppose donc l'indpendance des indivi-
dus: indpendance des capitalistes entre eux et des salaris entre eux, et
finalement d'eux tous.
Il arrive que Marx formule quasiment cette hypothse. Par exemple, aprs
avoir crit que les capitaux ont toujours tendance oprer, par la concur-
rence, cette galisation [Ausgleichung) dans la rpartition de la plus-value que
le capital total a produite et surmonter tous les obstacles qui s'y oppo-
sentI4, et que cette galisation [Ausgleichung] repose sur la rpartition
proportionnelle, toujours changeante, du capital social total, entre les diverses
sphres de production; sur le va-et-vient perptuel des capitaux; sur leur
transfrabilit d'une sphre l'autre, bref sur leur libre mouvement entre les
diverses sphres de la production [...J, il ajoute: nous admettons ici
qu'aucune entrave (tout au plus une entrave occasionnelle et temporaire)
n'empche la concurrence des capitaux de ramener la valeur au prix de
production 15.
Ces suppositions, le libre mouvement des capitaux individuels, l'absence
complte d'entraves, c'est l'hypothse de l'indpendance des vnements, au
sens du calcul des probabilits. Comme les statisticiens et les probabilistes,
Marx admet le caractre conjectural de cette hypothse lorsqu'on l'applique
des situations relles. Les conomistes disent ce sujet, dans une intention
critique, qu'il prsuppose un rgime de concurrence parfaite , qu'il n'aurait
donc raisonn que sur un modle purement idal .
Or, Marx est le premier reconnatre que les conclusions tires de
suppositions thoriques gnrales ne sont qu'approches: si, dans la thorie,
dit-il, nous considrons le problme dans toute sa rigueur, [...) dans la ralit
il ne se pose, bien entendu, que de faon approximative et avec mille
modifications 16. Dans toute application concrte, il faut chercher les raisons
particulires des divergences observes.
Dans les cas o, dans certaines branches, il y a monopole, protection-
nisme ou subvention de l'tat, la transfrabilit des capitaux ne s'exerce plus
et le taux de profit moyen ne s'tablit pas, du moins dans ces branches-l.
Les lois thoriques dveloppes dans Le capital supposent donc l'indpen-
dance des capitaux individuels et, d'une faon gnrale, des individus,
168 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
acheteurs ou vendeurs, consommateurs ou producteurs. Marx raisonne dans le
cadre d'une conomie de march o les changes sont suffisamment libres
pour que la concurrence joue pleinement son rle et que s'tablissent des
moyennes.
Cela n'est-il pas en contradiction avec sa philosophie de la totalit
affirme par ailleurs? Cournot limitait l'indpendance aux causes secondes
ou prochaines, et ne se prononait pas sur l'unit dernire du monde,
hypothse de philosophie transcendante qui, pour lui, n'avait pas sa place
dans la science, mais que celle-ci n'infirmait pas non plus. Marx ne professe
pas un tel criticisme philosophique: il affirme l'unit du monde, et, au niveau
conomique, l'interdpendance de tous les processus et facteurs constituant
une socit. L'indpendance des individus n'est que relative; bien qu'ils soient
librs des entraves et rglements des anciennes corporations, les producteurs
conomiques ne sont pas absolument libres et indpendants les uns des
autres, mme en rgime de libre concurrence. Ils produisent pour le march.
Une totale libert individuelle est la condition des changes, mais de ceux-
ci merge une ncessit au niveau global, la ncessit stochastique.
Cette libert ou indpendance relative est une forme de possibilit
concrte: la socit bourgeoise laisse les individus produire ce qu'ils veulent et
autant qu'ils le veulent. Ils peuvent dvelopper leurs qualits et facults
personnelles: c'est une possibilit concrte qui leur est donne avec les moyens
que leur confre leur statut social17.
Pour savoir si Marx admet, sur un plan strictement scientifique, les
hypothses impliques par la loi des grands nombres, l'examen de l'usage qu'il
fait de la notion de moyenne n'est pas suffisant. Il faudra examiner son
attitude l'gard des statistiques et son rapport au probabilisme.
Durant l'poque qui prcde celle o Marx entreprend ses tudes
conomiques, les savants avaient dcouvert que la ncessit, qui ressortait de
la loi des grands nombres et des observations statistiques, soutenait la
comparaison avec celle qu'on tait accoutum admettre dans les sciences
physiques. Les lois de la nature n'taient vrifies qu'avec une certaine
approximation du fait des invitables erreurs d'observation ou d'expri-
mentation. On dcouvrit qu'une prcision parfaite des mesures est impossible.
D'o la prise en compte des seuls chiffres significatifs au-del desquels toute
prcision est illusoire: bref, on admit la relativit essentielle des mesures.
Or, les moyennes que les grandes enqutes statistiques du XIXe sicle
rvlaient dans les phnomnes sociaux, prsentaient souvent une aussi bonne
prcision que bien des observations et des mesures en astronomie, en
mcanique, en optique, etc.
Il apparut que la ncessit stochastique ne le cdait en rien celle des lois
de la nature. On devait mme appliquer au domaine des sciences physiques et
naturelles les mthodes de calcul des moyennes mises au point par la thorie
mathmatique des probabilits: d'o la thorie et le calcul des erreurs
d'observation.
LA POSSIBILIT CONCRTE 169
L'admission de la probabilit, comme nouveau type de ncessit dans
plusieurs domaines des sciences, conduisait une rvision des ides qu'on se
faisait sur la ncessit dans la nature. Marx labora ses conceptions alors que
se dveloppait ce nouveau courant de pense probabiliste. Vu le large usage du
concept de moyenne dans Le capital, on peut dire que Marx, comme tous les
conomistes de son temps, a intgr ce nouveau probabilisme dans ses
conceptions. Avec la probabilit, c'est une nouvelle forme de possibilit qui
apparat chez Marx.
Nous avons rencontr jusqu'ici trois formes de la possibilit que nous
avons appeles abstraites. Ce fut tout d'abord la diversit des formes
possibles" d'tats sur une mme base conomique
", diversit que l'on
trouvait galement dans les formes particulires possibles d'une mme loi
conomique gnrale (exemple de la loi de la valeur). Ensuite, nous avons
dcouvert les possibilits offertes par la combinaison des causes essentielles
dans la causalit conomique, possibilits limites toutefois par leur ncessaire
ajustement rciproque en un tout (loi de correspondance). Enfin, nous avons
reconnu l'existence chez Marx d'une multiplicit de causes: conditions natu-
relles, raciales, historiques, politiques, etc. Ces causes multiples peuvent
seulement tre tudies de manire empirique dans chaque cas particulier.
D'elles rsultent toutes les liaisons circonstancielles, les rencontres fortuites,
qui donnent l'histoire son aspect chaotique. Cette fortuit est fonction du
nombre et de l'indpendance de ces causes.
Avec les vnements qui se rptent un trs grand nombre de fois, nous
abordons une nouvelle dimension de la ralit, une multiplicit qui dfie toute
description. Nous nous trouvons devant une telle multitude d'vnements
lmentaires que, pratiquement et thoriquement 18,on a affaire une infinit
de causes et de conditions. Les tudier tous est impossible: on ne peut mme
songer les numrer. Il en rsulte pourtant une forme de ncessit et de
possibilit spcifique, la probabilit.
Cette ncessit n'est contraignante que pour les individus pris dans leur
ensemble: elle a un caractre collectif. Elle est paradoxalement fonde sur un
large ventail de possibilits concrtes, que dans la thorie des probabilits
l'on appelle les cas possibles . La probabilit est un mixte de ncessits et de
possibilits, o la ncessit rsultante n'est que globale, et o les possibilits
concrtes sont nombreuses et s'ouvrent devant tous les individus singuliers.
Hasard et ncessit se mlent, passent l'un en l'autre; ils forment couple et
changent leurs caractres.
En se fondant sur ces faits de probabilit devenus incontestables dans
tous les domaines de la ralit sociale, Marx pose, comme tous les savants de
son temps, une distinction entre causes constantes et causes accidentelles, les
premires tant l'origine des vnements les plus frquents qui finissent par
ressortir et prdominer, les autres l'origine des plus rares qui manifestent des
carts notables par rapport aux prcdents.
C'est cette forme particulire de ncessit relative, propre aux moyennes,
170 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
que vise Marx en qualifiant les lois conomiques de lois rgulatrices ,
seulement rgulatrices, car elles admettent toutes sortes d'irrgularits, de
distorsions et d'exceptions, mais qui se compensent.
Marx entend la compensation et la rgulation d'une manire dynamique.
Ce sont, dit-il, des processus. Processus dsigns de manire trs varie:
compensation, galisation, neutralisation, annulation, prquation, etc.
D'ailleurs, Marx sous-estime la difficult thorique qui se prsente ici, car
il serait logique de ne pas donner le mme sens une compensation due un
grand nombre d'vnements et la prquation des taux de profit entre
branches de production, puisque ces branches sont en nombre assez restreint.
Cependant, Marx les assimile: il parIe de moyennes dans tous les cas, parce
qu'il s'agit, pour lui, dans ces divers processus conomiques, d'une action
galisatrice de la concurrence et de sa tendance ramenr les prix ou les
valeurs une moyenne, par un mcanisme quelconque de rduction des
carts, qui assure finalement leur neutralisation.
C'est sur la base de ce prsuppos thorique gnral d'une compensation,
quelles qu'en soient les modalits, que Marx pose le problme qu'il estime non
rsolu par les conomistes classiques: dans le cadre d'un capitalisme concur-
rentiel, comment le capital peut-il se former s'il y a une relle galisation des
valeurs?
La formation de capital doit ncessairement tre possible mme quand
le prix des marchandises est gal la valeur des marchandises. Elle ne peut
tre explique par un cart entre les prix des marchandises et leur valeur.
Quand les prix s'cartent vraiment des valeurs, il faut d'abord les ramener
ces dernires, c'est--dire faire abstraction de cette circonstance (Umstand)
comme de quelque chose d'accidentel (zufiillig), pour avoir sous les yeux,
dans toute sa puret, le phnomne de la formation de capital sur la base de
l'change des marchandises, et ne pas tre troubl au cours de l'observation
par des circonstances accessoires [Nebenumstiinde) gnantes et trangres au
droulement proprement dit du processus 19.
Or, nous le savons, Marx admettra, plus loin dans Le capital, des
diffrences entre prix et valeurs, qu'il explique par le taux de profit moyen qui
s'ajoute aux prix de production pour donner les prix de march. En outre, au
Livre III du Capital, l'galisation des valeurs se rvle plus complexe encore:
concrtement, elle ne consiste pas en une simple compensation d'carts qui se
rpartiraient rgulirement autour d'une moyenne centrale. Nous dcouvri-
rons au contraire une critique de cette conception trop simple.
Malgr cela, Marx pense, avec son sicle, qu'il faut partir du phnomne
universel de la compensation. L'conomie n'tait pas la seule concerne. Dans
toutes les disciplines sociales et anthropologiques, on dcouvrait des lois
stochastiques. Acquis rcent, mais dsormais solide, de la science. En se
basant sur l'observation de la rpartition normale >', autour de valeurs
centrales, des grandeurs physiques, sociales, intellectuelles, morales mme,
LA POSSIBILIT CONCRTE
171
mesures dans l'ensemble d'une population donne, Adolphe Qutelet et
d'autres savants avaient prcis et gnralis ce qu'on savait dj auparavant
pour des faits sociaux comme les naissances, les mariages ou les dcs.
Qutelet en avait tir son ide d' homme moyen laquelle il confrait une
porte explicative gnrale. Il avait tendu ses observations et ses analyses
statistiques toutes sortes de domaines, de la mtorologie l'anthropom-
trie, et mme aux comportements humains comme les crimes ou les suicides
que l'on croyait les moins susceptibles d'tre soumis des lois objectives
indpendantes de la volont individuelle.
Or, cette manire de concevoir les actions individuelles comme soumises
des lois et des causes objectives inaperues, c'est aussi celle de Marx quand
il affirme que les processus conomiques l'chelle d'un pays et les rapports
sociaux sont indpendants de la libre volont des individus, et que ceux-ci ne
peuvent en tre tenus pour responsables. Ce type d'explication est appliqu
par Marx, non seulement en conomie politique, mais aussi dans les divers
domaines de la sociologie et de l'idologie. Malgr tout ce qui les oppose l'un
l'autre, finalement, Marx ne concevait-il pas le rapport de l'individu la
socit de la mme faon que Qutelet?
Certes, la diffrence est grande entre Marx, philosophe de l'histoire
rvolutionnaire, critique dialecticien de l'conomie politique classique, et celui
qui voulut dmontrer l'existence de 1'homme moyen en soumettant les
donnes des enqutes statistiques et des recensements une analyse purement
mathmatique. Pourtant, Marx ne doit-il pas quelque chose Qutelet? Quel
jugement portait-il sur sa thorie de l'homme social?
Avant d'aborder ces questions, il sera bon d'examiner ce que Marx
pensait des statistiques en gnral, car il les a beaucoup pratiques: il s'en
servait volontiers.
2. Marx et les statistiques
Au XIxe sicle, les statistiques connurent un dveloppement considrable
qui fit faire un pas important toutes les sciences sociales. Elles ont contribu
rvler des lois sociologiques que ne montraient pas les faits immdiats. Leur
rle en ce domaine est comparable celui que des instruments comme la
lunette astronomique, le microscope, le chronomtre, le thermomtre, etc.,
jourent dans l'essor de l'tude de la nature aux XVIIeet XVIIIesicles.
Marx insiste souvent sur la diffrence essentielle entre la surface visible de
la socit et ses lois internes caches analogues des lois naturelles. En cela,
il suivait les thoriciens de la physique sociale 20" qui se fondrent sur le
progrs dcisif des statistiques pour promouvoir leur discipline au rang de
science rigoureuse et exacte. Ce sont les statistiques qui ont le plus fait pour
assimiler les lois sociologiques aux lois de la nature. Elles furent en effet
<d'instrument permettant de dcouvrir les lois qui rgissent les phnomnes
172 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
sociaux, et servirent vrifier les hypothses thoriques avances pour
expliquer ces phnomnes.
Les conomistes classiques avaient d'ailleurs prcd les sociologues et les
physiciens sociaux dans cette voie. Mais partir du XIxe sicle, grce au
perfectionnement du calcul des probabilits, beaucoup de savants pensrent
que recueillir et dpouiller consciencieusement les matriaux statistiques
suffirait rvler les causes caches des phnomnes sociaux. Qutelet joua un
rle essentiel dans ce mouvement d'ides. Il montra que la connaissance de
certains faits sociaux pouvait devenir objective grce aux recensements et
l'emploi de mthodes statistiques.
Quand Marx prend constamment en considration des moyennes pour
tudier les faits conomiques (valeur, prix, plus-value, profit, etc.), il procde
tout simplement comme faisaient ses prdcesseurs et ses contemporains en
conomie et sciences sociales. Toutefois, il ne se fie pas aveuglment l'usage
empirique des statistiques auquel, son avis, ils se sont trop borns. Se servant
des statistiques, il reste trs critique leur gard. Mais cette position n'est pas
immdiatement apparente.
Premier constat, Marx n'a pas ddaign leur apport et leurs enseigne-
ments. Il les utilise mme beaucoup. En 1851, il signalait un ami,
J. Weydermeyer, une srie d'ouvrages et de travaux statistiques, en les lui
commentant brivement21. Plus tard, il confie L. Kugelmann: Durant mon
indisposition, je n'ai pu crire, mais j'ai aval une masse norme de
"matriaux" statistiques et autres 22.
"
Certains chapitres du Capital sont truffs de tableaux ou de donnes
numriques 23,et, aprs la mort de Marx, on trouva une masse considrable de
documents statistiques dans ses papiers24.
Pour bien comprendre le contexte intellectuel dans lequel se place la
rflexion de Marx sur les statistiques, il est bon d'voquer en quelques mots
leur histoire et le sens de leur dveloppement au XIX. sicle25.
La documentation statistique se dveloppa partir du XVIesicle. Les
prmisses de ce dveloppement taient dj lointaines: le calcul des probabi-
lits reut sa premire impulsion des besoins des compagnies commerciales et
des compagnies d'assurances du XIVe au XVIIe sicle. L'tablissement des
impts et des taxes sous l'Ancien rgime fut galement un facteur dterminant
de l'usage des Statistiques. Condorcet en tendit l'application aux domaines
politiques et juridiques en tudiant l'aide de mthodes statistiques les
jugements des tribunaux et les votes dans les jurys et les assembles parlemen-
taires.
Mais les Statistiques connurent leur progrs dcisif dans les annes 1820-
1830. On se met organiser de manire systmatique les recensements de la
population, et on collecte alors avec soin toutes sortes de matriaux statisti-
ques dont l'tude mathmatique s'affine. Une vritable coopration scientifi-
que s'instaure entre pays pour harmoniser les enqutes, diffuser les informa-
tions, et permettre les comparaisons des fins pratiques diverses:
LA POSSIBILIT CONCRTE
173
gouvernementales, administratives, commerciales, industrielles. C'est l'poque
o l'on fonde les Associations nationales et les premiers Congrs internatio-
naux de Statistiques.
Paralllement, au dbut du XIX. sicle, la thorie mathmatique des
probabilits s'approfondit, ce qui permet d'exploiter l'norme quantit d'in-
formations contenue dans les tables statistiques. Grce cet instrument
mathmatique, on dgage une reprsentation simplifie et claire des princi-
paux phnomnes que reclent ces informations. Qutelet et d'autres perfec-
tionnent les tables de mortalit, posent les fondements d'une discipline
nouvelle,l'anthropomtrie26.
La multiplication des enqutes statistiques des fins de toutes sortes:
politiques, sociales, mdicales, etc., appelle et justifie ce nouveau dveloppe-
ment du calcul des probabilits, qui trouve aussi des applications scientifiques,
non seulement dans la thorie des erreurs d'observations, mais bientt dans la
thermodynamique et la thorie cintique des gaz.
Pour toutes ces raisons, le calcul des probabilits accde la dignit d'une
science mathmatique de premier plan. L'exploitation des enqutes statisti-
ques en bnficie. Celles-ci deviennent l'indispensable instrument d'observa-
tion sociale qu'elles ne cesseront plus d'tre.
Elles introduisaient la mesure objective dans la connaissance socio-
historique. Sans elles, toute thorie sociale courait dsormais le risque de
tomber dans la spculation, ce qui arriva Auguste Comte qui les a
ddaignes et a rejet le calcul des probabilits.
Marx au contraire fait grand cas des donnes statistiques. Nous en avons
la preuve lorsqu'il dit du bouleversement matriel de la base conomique
qu'on peut [le] constater d'une manire scientifiquement rigoureuse27 . Sans
qu'il soit question des statistiques dans ce passage, on peut supposer qu'il y
pensait. Avec les statistiques, on atteignait l'impartialit de l'observation
dans des domaines o elle est particulirement difficile. videmment, Marx
recourt surtout aux statistiques conomiques, y puisant, comme ses devan-
ciers, la matire empirique de sa rflexion thorique: en ce sens, elles sont au
commencement de la science.
Marx survient donc juste au moment o vient de s'oprer une rvolution
de l'esprit scientifique en matire sociale. Il participe de ce que les historiens
des sciences appellent l'esprit probabiliste . Les tudes de Qutelet sur le
crime avait fait sensation 28. Elles imposaient cette ide rvolutionnaire que le
crime tait un fait socia!. Leur retentissement contribua rvler
l'opinion publique l'utilit et la porte de l'tude des matriaux statistiques.
Marx appartient, de naissance, ce courant d'ides nouvelles dans lequel il a
certainement baign ds ses premires annes de formation au lyce de
Trves29.
Comment se situe-t-il dans ce mouvement en faisant la thorie du capital?
Peu de commentateurs et interprtes de Marx se sont pos cette question 30.S'il
174 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
est facile de voir qu'il s'est beaucoup servi des statistiques, il l'est moins de
prciser ce qu'il pensait exactement de leur rle et de leur porte thoriques.
Il a formul sur elles des apprciations varies, apparemment divergentes.
Jeune, il a eu des propos trs durs leur gard, ce qui pourrait faire croire qu'il
n'en avait qu'une pitre opinion:
On sait que compter est la premire activit thorique de l'esprit qui
oscille encore entre la sensibilit et la pense. Compter est le premier acte
d'intelligence, libre et thorique, de l'enfant. Mettons-nous compter, crie la
Preussische Staats-Zeitung [Gazette de l'tat prussien] ses surs. La
statistique est la premire science politique! Je connais la tte d'un homme,
si je sais combien de cheveux elle produit 31.
Il ne faudrait pas prendre cela pour l'expression d'uri jugement ddai-
gneux sur les statistiques. Marx donne libre cours sa verve critique aux
dpens de l'organe de l'absolutisme prussien. Il se moque, non des statistiques
elles-mmes, mais de leur usage partisan des fins de propagande gouverne-
mentale:
La Staats-Zeitung [...] n'est pas seulement comparable Pythagore,
statisticien de l'univers! Elle montre qu'elle est influence par le grand
philosophe naturaliste contemporain qui voulut un jour reprsenter par des
sries de nombres les diffrences entre les animaux [...]32."
Partout ailleurs, d'une manire gnrale, Marx est beaucoup plus favora-
ble aux recherches statistiques qu'il ne brocarde plus jamais ce point. Le
jeune et courageux rdacteur de la Gazette Rhnane, sr de son fait, dnonait
les airs scientifiques que se donnait le journal du gouvernement sur qui il
dversait sarcasmes sur sarcasmes.
Cependant, toute sa vie durant, Marx resta trs vigilant sur ce chapitre;
il jugea svrement ceux qui recouraient aux statistiques sans esprit critique.
Entre autres, l'conomiste amricain H. Carey eut droit ses foudres:
Dans son Essai sur le taux du salaire, un de ses premiers crits
conomiques, M. H. Carey cherche dmontrer que les diffrents salaires
nationaux sont entre eux comme les degrs de productivit du travail
national. La conclusion qu'il veut tirer de ce rapport international, c'est
qu'en gnral la rtribution du travailleur suit la mme proportion que la
productivit de son travail. Notre analyse de la production de la plus-value
prouverait la fausset de cette conclusion, lors mme que M. Carey en et
prouv les prmisses, au lieu d'entasser, selon son habitude, sans rime ni
raison, des matriaux statistiques qui n'ont pas pass au crible de la
critique 33.
Ici, l'attitude de Marx l'gard des statistiques commence de nous
apparatre: il les pense utiles, et mme indispensables, tout en mettant de
LA POSSIBILIT CONCRTE 175
srieuses rserves sur leur emploi. Il sait que des nombres bruts n'ont gure de
sens:
C'est seulement si l'on comprend d'abord les conditions qui crent le
taux de profit que l'on pourra ensuite, grce la statistique, tablir des
analyses relles du taux du salaire diffrentes poques et dans divers
pays 34."
Entre les mains des conomistes vulgaires et de tous les positivistes, les
donnes statistiques ont toutes chances d'tre trompeuses, et parfois parfaite-
ment dnues de sens. Leur usage, naf et superficiel, ou sciemment perverti,
sert justifier les robinsonnades apologtiques de toutes sortes de demi-
savants et d'idologues.
Il ne s'agit pourtant pas, pour Marx, de condamner les statistiques. Il a au
contraire tout fait conscience du rle non seulement important, mais crucial,
qu'elles peuvent et doivent jouer en conomie et dans toutes les sciences socio-
historiques. Elles rvlent des faits et des lois qu'on ne saurait tablir sans
elles. Elles permettent de dceler des tendances caches et d'en rechercher les
causes. Encore faut-il qu'elles soient bien faites, et que les hypothses ou
conclusions qu'on en tire soient passes au crible de la critique thorique.
Dans les Thories sur la plus-value, discutant la thse ricardienne de la
hausse permanente du prix des crales, Marx fait remarquer qu'il ne faut pas
seulement envisager les prix mais les quantits produites:
Pour les comparaisons des prix du bl, etc. durant diffrentes priodes
d'annes, il est en mme temps important de comparer les masses produites
tant et tant par qr. [= quarters, ou quintaux), car c'est justement comme a
qu'on voit dans quelle mesure la fabrication de bl additional [additionnelle)
influe sur le price [prixJ35...
Marx porte donc une apprciation circonstancie sur l'usage des statisti-
ques: il proclame leur ncessit, rclame leur perfectionnement, souligne que
certaines statistiques sont inutilisables ou inexistantes; dans ses lettres
Engels, il se plaint de la difficult de trouver la documentation requise 36. Il
dplore spcialement le retard de l'Allemagne dans ce domaine: Compare
la statistique anglaise, la statistique sociale de l'Allemagne et du reste du
continent europen est rellement misrable37."
Il apprcie de manire d'autant plus logieuse les rapports des inspecteurs
de fabriques anglais dont les enqutes lui ont tellement servi nourrir Le
capital de faits concrets et de donnes chiffres38.
Dans les quations arithmtiques qui abondent dans Le capital, les
nombres paraissent tout fait arbitraires. Ils le sont souvent: c'est le caractre
abstrait de la thorie qui le veut. Ces chiffres ne reprsentent que des
possibilits tout thoriques". Toutefois, certains viennent tout droit de
176 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
l'entreprise d'Ermen et Engels de Manchester39. L'abstrait est ici le dcal-
que (le reflet)! du concret. La thorie pouse la ralit concrte.
Dans ces conditions, l'on comprend que Marx ait profess une vive et trs
profonde admiration pour William Petty, conomiste anglais du XVIIesicle,
qui fut l'un des premiers penser les questions politiques en termes conomi-
ques partir de considrations statistiques. En 1876, il rabroue le socialiste
allemand Eugen Dhring qui malmenait l'uvre de William Petty:
M. Dhring se comporte envers la fondation par Petty de
"l'Arithmtique politique", vulgairement appele" statistique", comme
envers les travaux conomiques proprement dits de Petty. On [Dhring]
hausse les paules avec hargne sur la singularit des mthodes appliques par
Petty! En prsence des mthodes grotesques que Lavoisier lui-mme appli-
quait encore cent ans plus tard dans ce domaine, en prsence de la distance
norme qui spare encore la statistique d'aujourd'hui du but que Petty lui
avait magistralement assign, cette prtention prsomptueuse la supriorit,
deux sicles post festum, apparat dans sa niaiserie toute nue 40.
Consquemment, Marx a rclam l'tablissement de statistiques ouvrires
dont il ressentait cruellemenf le manque. A ce sujet, il fit adopter une
rsolution au Congrs de Genve de l'Association Internationale des Travail-
leurs en 1866.
Dans sa correspondance et dans les Rapports qu'il rdige pour l'Associa-
tion entre 1866 et 1872, il y revient par une srie de rappels, afin qu'on
applique cette rsolution, et il approuve la Section de Berlin qui fut l'une des
premires uvrer en ce sens41.
Les documents statistiques sont pour Marx un instrument de vrification
et de dcouverte: les matriaux statistiques qu'il a amasss, tous ceux qu'il a
consults au British Museum, ont certainement fait beaucoup pour le guider
dans ses rflexions et ses dcouvertes en conomie. Ils sont utiliss pour
accompagner et corroborer des dveloppements et des conclusions thoriques.
Mais qu'est-ce que ceux-ci leur doivent exactement? Il est difficile de le dire en
l'absence de travaux de spcialistes en conomie et statistiques tudiant
techniquement cette question.
Dans Le capital, les donnes statistiques servent plutt d'illustration.
Marx semble les avoir apprcies et employes surtout pour leur valeur
dnonciatrice. Il les slectionne en ce sens: elles apparaissent peu prs
exclusivement dans les chapitres qui dnoncent les conditions inhumaines
d'exploitation des travailleurs par le capital lors de la premire vague de
l'industrialisation en Angleterre.
Il est remarquer, en effet, qu'il ne s'intresse pas proprement parler
aux problmes spcifiques de l'tablissement des statistiques, ni aux techni-
ques proprement mathmatiques de leur exploitation. Pourtant, ni la com-
plexit des questions souleves, ni les limites de cet instrument mathmati-
que 42ne lui chappaient.
On peut seulement induire cette conclusion de son attitude gnrale, car
LA POSSIBILIT CONCRTE 177
il ne s'exprime pas directement sur ces matires. L'conomtrie n'existait pas
encore. Comment Marx l'aurait-il accueillie? Il a toujours nourri une certaine
mfiance l'gard des statistiques pures et des calculs qui s'loignent trop du
concret. Cette rserve va nous apparatre clairement aprs un examen du
jugement que Marx a port sur l'uvre et les thories de Qutelet et sur l'esprit
probabiliste.
3. Marx a-t-il repris le concept d:homme moyen de Qutelet?
N'hsitons pas le rpter: dans Le capital, Marx a constamment fait
usage de la notion de moyenne, ce qui conduit se demander si, dans ses
analyses thoriques, il n'aurait pas, plus ou moins volontairement et indirec-
tement, repris le concept d'homme moyen que Qutelet a rendu clbre.
Marx a tudi les ouvrages du savant belge. Ses Cahiers conservent des
notes de lecture, en 1851, de deux livres de Qutelet: A Treatise on Man and
the Development of his Faculties43 , et Du systme social ou des lois qui le
rgissent44 . Ces titres sont trs significatifs. Ils pourraient presque convenir
pour une prsentation des conceptions de Marx.
Marx cite et nomme de trs nombreux savants et crivains de toutes
sortes. Or, le nom de Qutelet apparat rarement dans ses uvres. Il n'est
mentionn que deux fois dans les trois Livres du Capital, qui ne contiennent
aucune citation du savant belge: c'est maigre !
Toutefois, Qutelet est cit dans des articles, et Marx parle aussi de lui
dans quelques lettres. Malgr leur caractre occasionnel, ces quelques men-
tions et citations sont prcieuses pour dterminer le rapport de Marx
Qutelet, ainsi que son rapport l'esprit probabiliste du XIXe sicle. Elles
permettent de se faire une ide assez prcise de ce que Marx pensait de la
thorie de l'homme moyen.
Les diteurs des Marx-Engels Werke qualifient cette thorie de Qutelet de
non scientifique45 , donnant cette apprciation comme si elle manait de
Marx lui-mme. Or, lorsque Marx mentionne Qutelet dans le premier livre du
Capital, son opinion semble plutt contraire. Il est vrai qu'il est trs laconique.
A la fin d'une note, on trouve seulement ceci: (Consulter Qutelet sur
l'homme moyen.)46 C'est tout!
Le contexte montre que Marx considre alors le travail social moyen, ou
travail de. qualit moyenne. Il voque les carts individuels qu'on observe en
ralit par rapport ce travail moyen , et l'auteur anglais dj rencontr ci-
dessus, Burke, qui avait expliqu que, sur cinq valets de ferme, un possdera
toutes les qualits d'un bon ouvrier, un autre, d'un mauvais, et les trois autres
ne seront ni bons ni mauvais, mais entre les deux47 .
Marx laisse entendre que cela est douteux et ne vaut que si l'on prend un
nombre d'ouvriers plus lev: Que cette observation soit exacte ou non, la
178 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
journe d'un assez grand nombre d'ouvriers exploits simultanment constitue
une journe de travail social, c'est--dire moyen48.
Il donne alors lui-mme un exemple numrique qui porte sur douze
ouvriers nombre qui ne diffre gure de celui de Burke:
Supposons que le travail quotidien dure douze heures. Douze ouvriers
travailleront alors 144 heures par jour, et quoique chacun d'eux s'carte plus
ou moins de la moyenne et exige par consquent plus ou moins de temps pour
la mme opration, leur journe collective comptant 144 heures possde la
qualit sociale moyenne49.
Le nombre 144 lui a paru un grand nombre, suffisant pour qu'une
compensation ait effectivement lieu et que le travail considr soit incontesta-
blement un travail moyen, correspondant une moyenne relle . C'est alors
que Marx renvoie sans autre commentaire, ni rfrence, au concept d'homme
moyen de Qutelet. Ainsi, il le suppose connu et le reprend son compte, en
le restreignant ici une facult physique: la force de travail humaine.
Cela confirme que Marx admet la loi des grands nombres pour la
dtermination des capacits physiques moyennes des hommes qui cooprent
dans un collectif de travail. Toutefois, il note la ncessit d'un minimum
d'habilet chez tous les membres de ce collectif. Sinon, les douze ouvriers
pourraient former un groupe compltement disparate. Pour que la considra-
tion de la moyenne ait un sens, il faut que le groupe prsente une certaine
homognit 50, ce qui montre que Marx ne s'en tient pas un point de vue
purement quantitatif, la seule dure du travail, mais qu'il considre aussi sa
qualit: un travail qualifi d'une certaine sorte.
Poursuivant ses rflexions critiques partir de l'exemple de Burke, Marx
suppose les mmes douze ouvriers rpartis entre six petits patrons:
Ce serait pur hasard si chaque patron tirait de sa paire [d'ouvriers] la
mme valeur et ralisait par consquent le taux gnral de la plus-value. Il y
aurait des divergences. [...] Les diffrences se compenseront pour la socit,
mais non pour le petit patron. Les lois de la production de la valeur ne se
ralisent donc compltement que pour le capitaliste qui exploite collective-
ment beaucoup d'ouvriers et met ainsi en mouvement du travail social
moyen5!.
Dans ce contexte, le renvoi Qutelet est minemment positif. Marx
adopte bien un concept quivalent celui d'homme moyen, celui de travail-
leur moyen . Cependant, - nous l'tablirons bientt - Marx critique ailleurs
la thorie gnrale de Qutelet. Il fallait nanmoins insister auparavant sur
cette transposition du concept d'homme moyen dans celui d'ouvrier
moyen. De plus, ce n'est pas seulement en matire conomique que Marx
accepte ce concept: ne le retrouve-t-on pas dans 1'individu social caractris
par des facults ou qualits moyennes, celles que partagent tous les
membres d'une mme communaut.
Il est vrai que Marx ne lui donne pas une aussi grande gnralit: il le
LA POSSIBILIT CONCRTE
179
borne des groupes limits, en particulier des classes h.istoriquement
dtermines. Il n'tend pas ce concept d' individu social tout le genre
humain. Il critique au contraire l'emploi du concept intemporel et anhistori-
que de nature humaine sous les formes que lui donnaient Rousseau,
Feuerbach, Bauer, Stirner, et les conomistes. Le concept d' individu social,
historiquement et sociologiquement caractris, est plus concret que celui
d'homme moyen de Qutelet.
Dans le troisime livre du Capital, le jugement que Marx porte sur les
travaux de Qutelet est tout aussi favorable, confirmant la note du Livre
premier. Dans l'tude de la conversion des valeurs en prix, Qutelet est nomm
de manire trs logieuse:
La conversion des valeurs en prix de production n;abolit (aufhebt] pas
les limites du profit, mais modifie seulement sa distribution entre les
diffrents capitaux particuliers, dont se compose le capital social; la rparti-
tion se fait de faon uniforme proportionnellement aux fractions de valeur du
capital total que chaque capital particulier reprsente. Les prix de march
sont tantt suprieurs tantt infrieurs ces prix rgulateurs de production,
mais ces fluctuations s'annulent (sich aufheben] rciproquement. Qu'on
examine des barmes de prix sur une priode assez longue. En cartant les cas
o la valeur relle des marchandises a chang (veriindert] par suite d'un
changement dans la force productive du travail, ainsi qe ceux o le
processus de la production a t perturb par des accidents naturels ou
sociaux, on sera tonn de voir combien l'amplitude des carts est relative-
ment restreinte, avec quelle rgularit ceux-ci se compensent. On trouvera
qu'ici aussi s'imposent les moyennes rgulatrices semblables celles que
Qutelet a dmontres pour les phnomnes sociaux 52.
Ainsi, c'est d'une manire tout fait explicite et positive que Marx
accueille les travaux de Qutelet comme une relle contribution scientifique
aux sciences sociales. Il accepte le concept d'homme moyen en parlant du
travailleur moyen 53 ou des individus sociaux; mais nous pouvons
pousser ce rapprochement: la notion d'idologie n'est-elle pas l'quivalent
marxien des facults intellectuelles et morales moyennes dans lesquelles
Qutelet cherchait aussi les caractristiques de son homme moyen? Toute-
fois, une diffrence importante spare Marx de Qutelet: celui-ci considre des
facults, Marx des contenus de conscience particuliers: des ides et reprsen-
tations dtermines; l aussi, il est plus concret.
Dans L'idologie allemande, Marx a montr les insuffisances de la thorie
de l'alination religieuse de Feuerbach fonde sur l'ide d'essence humaine, de
<d'homme comme genre. Marx lui opposait le fait que le genre humain
volue historiquement, qu'il se divise en socits et en classes antagonistes. Il
substitue l'essence gnrique humaine de Feuerbach les concepts de travail-
leur moyen et d'homme moyen d'une classe sociale, expliquant les
alinations idologiques (religions) par l'alination conomique gnrale, en
180 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
particulier, pour le monde moderne occidental, par le ftichisme de la
marchandise dans une conomie de march capitaliste.
Marx retient les importantes dcouvertes de Qutelet et de Feuerbach,
concernant les faits sociaux et leur dmystification. Mais les ides fausses des
idologues, les robinsonnades pseudo-scientifiques des conomistes, se com-
prennent partir du processus d'alination des producteurs et de la socit en
gnral. Les mmes processus qui engendrent les moyennes objectives (valeur
moyenne, plus-value moyenne, salaire moyen) engendrent le ftichisme de la
marchandise et les alinations de la conscience sociale. Que les faits sociaux
obissent aux lois de rpartition statistiques, Marx s'accorde l-dessus avec
Qutelet, comme il tombe d'accord avec Feuerbach sur l'existence des
alinations de la conscience. Mais il se spare d'eux quand il s'agit d'interpr-
ter ces faits 54.
Les autres mentions de Qutelet dans l'uvre de Marx55 permettent de
prciser l'opinion qu'il s'est forme de lui: Qutelet , crit-il son ami
Kugelman, est maintenant trop vieux pour qu'on tente encore quelque
exprience avec lui. Il a rendu de grands services dans le pass, en montrant
que mme les phnomnes de la vie sociale, fortuits en apparence, sont soumis
une ncessit interne qui se manifeste par leur rcurrence priodique et leurs
moyennes priodiques. Mais il n'a jamais russi interprter cette ncessit. Il
n'a pas non plus fait de progrs et a seulement rassembl davantage de
matriaux pour ses observations et ses calculs. Il n'est pas plus avanc
aujourd'hui qu'avant 183056.
Marx estime donc l'apport scientifique de Qutelet en se plaant deux
points de vue. En ce qui concerne la dcouverte des faits et des lois, il flicite
le grand statisticien qui a dmontr qu'il existe un type de ncessit
caractristique des phnomnes sociaux. Mais, il pense que cet apport,
minemment positif en lui-mme, n'a pas port tous ses fruits sur le plan
thorique. Les ides de Qutelet en sociologie ont tourn court: elles n'ont
dbouch sur aucune explication solide et durable.
Cette critique ressemble celle que Marx adresse aux conomistes en
gnral: eux aussi ont dcouvert et dmontr des lois gnrales, objectives,
des ncessits caches; toutefois, ils n'ont pas russi les expliquer; ils n'ont
pu dcouvrir les causes vritables des phnomnes. De mme Qutelet: il n'a
pas trouv les causes susceptibles de rendre compte des moyennes qui
ressortent des mesures anthropologiques. Il fut remarquable dans la dcou-
verte de ces moyennes, mais l'interprtation thorique qu'il en a donne tait
d'une insigne faiblesse.
Le jugement de Marx sur Qutelet comporte donc deux volets. Les
diteurs des Marx-Engels Werke laissent entendre qu'aux yeux de Marx rien ne
serait scientifiquement valable dans l'uvre du mathmaticien belge. Marx
n'est pas si dogmatique. Dans un premier temps, il se range lui-mme aux
cts des physiciens sociaux et de Qutelet, prt dire avec le mathmati-
cien franais Poisson:
LA POSSIBILIT CONCRTE 181
Les choses de toute nature sont soumises une loi universelle qu'on
peut appeler la loi des grands nombres et, de ces exemples de toute nature, il
rsulte que la loi universelle des grands nombres est dj pour nous un fait
gnral et incontestable, rsultant d'expriences qui ne se dmentent
jamais 57.
Chez beaucoup de thoriciens, Qutelet le premier, l'application des
nouvelles mthodes statistiques dans le domaine socio-conomique ne se
faisait pas sur la base d'une conception aussi vaste et profonde que celle de
Marx. A l'inverse du savant belge, Marx fit porter tout son effort sur la thorie
explicative qu'il dveloppa pour elle-mme sans la faire dpendre troitement
de donnes statistiques pralables. Il a sans cesse approfondi ses recherches
thoriques. Mais, il n'a rien fait dans le domaine des techniques d'observation
quantitative des faits conomiques. Ce sera le rle de l'conomtrie.
Dans le champ des sciences sociales, Marx et Qutelet forment deux
figures de savants diamtralement opposes, Qutelet n'ayant rien pu expli-
quer par son concept d'homme moyen qui est rest une gnralisation
empirique. Toute sa vie, il resta attach ce concept qui sera fortement
critiqu par les sociologues ultrieurs 58. Par contre, il n'a cess de perfection-
ner les mthodes d'enqutes statistiques et d'en promouvoir l'application.
L'extension des ides probabilistes aux domaines de la gntique et de la
thorie de l'volution des espces la fin du XIX. sicle, fait dire G. Darmois:
Ainsi furent provoqus de nouveaux et trs puissants dveloppements
des mthodes analytiques, capables de manier et de dominer les conceptions
d'volution alatoire qui doivent normalement complter et enrichir les
anciennes conceptions plus dterministes 59.
On sait que, partir de 1860, les ides d'volution et de processus
alatoire effectuent leur jonction dans L'origine des espces de Darwin. Or,
Marx et Engels dveloppaient, eux aussi, une thorie synthtique prenant en
compte la fois les moyennes stochastiques caractristiques des phnomnes
de foule et les processus d'volution historique. Dans ces conditions, serait-il
permis de parler d'volution alatoire au sujet de la conception matrialiste
de l'histoire?
Cette ligne de pense ouvre la voie une comprhension nuance et assez
riche de la pense de Marx 60.Le fait que la loi des grands nombres rgisse tous
les phnomnes sociaux n'empche nullement, selon Marx, que les socits
changent historiquement et suivent leur propre volution.
Cette ide d'une volution travers les phnomnes stochastiques n'est-
elle pas prsente dans celle des lois tendancielles, qui caractrisent le devenir
de tout systme conomique et social? Or, les processus qui donnent naissance
aux tendances sont diffrents de ceux qui, par la compensation, prsident
seulement l'tablissement de moyennes comme chez Qutelet.
182 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
L'histoire des ides nous apprend que le nouvel esprit scientifique du
XIXe sicle s'est pntr progressivement du probabilisme qu'imposait le
dveloppement des statistiques, lui-mme impuls par une forte demande
sociale.
Cet esprit probabiliste modifiait la conception classique de la nature qui
prenait son modle dans les lois de la mcanique. Mais, il renouvela surtout les
sciences sociales. Dans quelle mesure la pense de Marx appartient-elle ce
mouvement? Abordons cette question, que, gnralement, on ne pose pas.
4. Marx et le nouvel esprit probabiliste
Aux alentours de 1830, Qutelet tablissait dfinitivement que, si on les
prenait en grand nombre, les faits humains se produisaient avec un rgularit
tonnante, mme ceux qui semblaient ne relever que de la seule libert
individuelle: ils pouvaient tre prdits avec une excellente approximation!
On a longtemps cru que les actions qui dpendent d'un choix volontaire,
tant libres, taient imprvisibles. Or, voil que prises par centaines ou par
milliers, elles se rvlaient prvisibles. Il fallait donc qu'elles soient dtermi-
nes par des causes indpendantes de la volont et de la conscience indivi-
duelles, des causes qu'il n'tait pas au pouvoir des individus de changer, et qui
restaient dcouvrir. L'exemple le plus frappant tait celui des crimes.
Telles taient les conclusions qu'imposaient les travaux de Qutelet,
conjointement ceux de plusieurs autres savants. C'est sur ces rsultats,
rcemment entrs dans la science, que Marx pouvait se fonder sans avoir les
dmontrer. Il en tint le plus grand compte, non seulement en conomie
politique, mais, plus largement, pour tous les phnomnes sociaux. En 1853,
dans un article sur la peine de mort, il citait le savant belge:
Si donc les crimes, ds qu'on les considre en grands nombres,
montrent, dans leur frquence et leurs espces, la rgularit des phnomnes
naturels, si, pour parler comme Qutelet, il serait difficile de dcider" dans
lequel des deux domaines" (le monde physique ou la vie sociale) "les causes
efficientes [die effektive Ursachen] entranent leurs effets aprs soi avec une
plus grande rgularit ", n'y a-t-il pas ncessit
-
au lieu de magnifier le
bourreau, qui ne supprime une partie des criminels que pour faire une place
pour d'autres -, rflchir srieusement sur le changement du systme qui
nourrit de tels crimes
61
1"
Avant de tirer cette consquence politique et morale, Marx rappelle un
passage clbre de la Physique sociale:
Il est un budget qu'on paye avec une effrayante rgularit, c'est celui
des prisons, des bagnes et des chafauds [...]. Nous pouvons numrer
d'avance combien d'individus souilleront leurs mains du sang de leurs
semblables, combien seront faussaires, combien seront empoisonneurs; peu
LA POSSIBILIT CONCRTE
183
prs comme on peut numrer d'avance les naissances et les dcs qui doivent
se succder62.
Gnralisant les rsultats de ses premires tudes, Qutelet tenta d'labo-
rer une conception sociologique gnrale: pouvait-il en tirer des conclusions
sociales pratiques? Les possibilits concrtes d'intervenir utilement dpendent
de la nature des lois sociologiques. Les recensements et autres enqutes
statistiques ont une finalit pratique, que Marx rappelle dans l'article que nous
venons de citer. Pour remplir leur rle, ils doivent d'abord avoir une valeur
scientifiquement objective. La conception de l'homme social de Qutelet tait-
elle au niveau de ses rsultats empiriques? En quoi Marx se diffrenciait-il des
physiciens sociaux? Partageait-il la mme idologie sociologique que
Qutelet? Peut-on comparer la philosophie sociale de Qutelet celle de
Marx? Autant de questions examiner.
En 1835, Qutelet exposa sa philosophie sociale gnrale: on
commenait souponner qu'en perdant de vue les individus, on peut
dmler, travers les phnomnes sociaux qui dominent les masses, des lois
qu'on dtermine de la manire la plus prcise. Ce qui arrta d'abord, ce fut
la conviction du libre-arbitre de l'homme: l'on savait que sa volont est une
cause insaisissable, place en dehors de toute loi [...). Mais l'on perdait de vue
que cette volont n'a plus d'action au-del de certaines limites o commence
la science, et que les effets, si grands en apparence, comme ceux qu'on a
toujours cru voir la naissance des choses, pouvaient tre estims comme
sensiblement nuls, s'ils sont considrs' d'une manire collective. L'exp-
rience, en effet, prouva bientt aux plus clairvoyants que les volonts
individuelles se neutralisent au milieu des volonts gnrales 63.
Il en tirait une ide directrice pour la science sociale qu'il voulait
construire:
Nous serions conduits admettre comme principe fondamental dans
les recherches de cette nature, que plus le nombre des individus que l'on
observe est grand, plus les particularits individuelles, soit physiques, soit
morales, soit intellectuelles, s'effacent et laissent prdominer la srie des faits
gnraux en vertu desquels la socit existe et se conserve64.
L'objectif de Qutelet tait donc de dcouvrir les lois fondamentales de la
socit, de faire de la sociologie une science exacte, en gnralisant sur les
plans psychiques, intellectuels et moraux, les faits qui ressortaient de l'tude
des sries de mesures physiques anthropomtriques (taille, poids, etc.). D'o
sa conviction que l'homme moyen est un tre rel. Il pensa que la confiance
qu'on peut avoir dans ce concept crot avec l'tendue de la population sur
laquelle on fonde les mesures de ses caractristiques. Mais son ide d'homme
moyen relevait plus de la conjecture philosophique que de la science65.
Nanmoins, il apparat comme le reprsentant d'un courant d'ides, dont
184 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Marx a subi profondment l'influence et auquel il a sacrifi, du moins jusqu'
un certain point.
Pensant dtenir les mthodes qui permettaient de dterminer 1'homme
moyen
", Qutelet se mouvait sur un terrain nouveau: il y intervint en
pionnier, fondateur d'une science ambitieuse qu'il nomma physique sociale.
En fait, cette ide de physique sociale reposait, chez lui, sur des analogies
empruntes la mcanique. Ds son premier Mmoire sur les Statistiques, il
croyait que la rgularit que l'on constate dans les phnomnes sociaux taient
l'expression de lois naturelles ", en tout point semblables celles du monde
inorganique et du monde organique:
- En suivant attentivement la marche rgulire de la nature dans le
dveloppement des plantes et des animaux, l'analogie nous autorise croire
que l'influence de ses lois doit s'tendre jusque dans l'espce humaine 66.
Il affirma que les forces morales peuvent se composer et admettre des
rsultantes comme les forces physiques. La plupart mme des lois de la
mcanique trouvent leurs analogues quand on passe du monde physique au
monde moral ".
67
D'o le nom de physique donn la nouvelle science.
Qutelet pensait qu'il est une loi qui domine notre univers et qui semble
destine y rpandre la vie 68", loi qu'il a cru devoir nommer loi des causes
accidentelles, parce qu'elle indique comment se distribuent la longue une
srie d'vnements domins par des causes constantes, mais dont des causes
accidentelles troublent les effets. Ces causes accidentelles finissent par se
paralyser et il ne reste en dfinitive que le rsultat qui se serait invitablement
reproduit chaque fois, si les causes constantes seules avaient exerc leur
action 69
".
En consquence, l'homme pris individuellement est impuissant: Le
partage des forces humaines et des forces matrielles qui agissent dans les
phnomnes est trs difficile dterminer [...] Ce qu'il est facile de voir, ds
prsent, c'est que les lois du monde matriel changent infiniment plus par les
forces de la nature que par l'intervention de l'homme en gnral, et que, de
plus, l'action individuelle de l'homme peut tre considre comme sensible-
ment nulle 70.
"
Tout cela rappelle fortement le point de vue" de Marx qui consiste
assimiler les processus sociaux aux processus naturels. C'est ce point de vue
qui s'exprimait dj chez Qutelet et que Marx reprend en des termes peu
prs identiques. Qutelet n'est d'ailleurs ici que l'un des multiples reprsen-
tants d'un vaste courant de pense. L'ide selon laquelle les phnomnes
sociaux obissent des lois qui les rendent aptes tre tudis objectivement
prenait de plus en plus pied dans la science et dans la philosophie du XIXe
sicle. Si elle se rencontrait au sicle pass chez les philosophes des Lumires,
les matrialistes et les Idologues franais, Qutelet eut le mrite de la prciser
LA POSSIBILIT CONCRTE
185
et de la populariser mieux que d'autres. Surtout elle portait sur des phno-
mnes dsormais mesurables !
En premire approche, nous pouvons dire que c'est une mme conception
des rapports entre l'individu et la socit qui s'exprime chez Qutelet, puis
chez Marx. En fait, c'tait un courant de pense vigoureux qui s'appuyait sur
une base scientifique. Il marquait tous les esprits et Marx en subit l'influence
par son milieu familial et ses professeurs de lyce 71. Il faut se reporter cette
poque, o l'on dcouvrait que l'individu n'a qu'une action sensiblement
nulle , comme dit Qutelet, sur le monde social. Cela se retrouve chez Marx,
en particulier lorsqu'il affirme que dans la production sociale de leur
existence, les hommes entrent en des rapports dtermins, ncessaires, ind-
pendants de leur volont72, car il s'agit videmment ici, comme pour
Qutelet, des hommes pris individuellement . Quand Marx rpte avec
insistance que ,des conditions de vie dterminent la conscience, ce propos
est-il si loign de cet autre qui proclame, comme une dcouverte rvolution-
naire, que le criminel n'est que le produit de la socit?
Des diffrences essentielles sparent les conceptions de Marx et celles d'un
savant comme Qutelet. Marx est matrialiste, alors que Qutelet ne l'est
pas; pour Marx, tout est soumis au devenir alors que Qutelet cherche
dcouvrir des lois universelles et gnrales et un homme moyen quasiment
immuable. Cela n'empche pas qu'ils aient des ides communes en matire de
science sociale. Essayons donc de prciser le rapport de Marx Qutelet.
Le nouvel esprit probabiliste qui anime Qutelet reste dans le cadre d'une
conception gnrale du monde, formule par Descartes et reprsente au XIX.
sicle par Laplace. La physique sociale se prsentait comme une extension
de la conception mcaniste du monde au monde social. Qutelet le dit assez
navement:
Quelle main soulvera le voile pais jet sur les mystres de notre
systme social et sur les principes ternels qui en rglent les destines et en
assurent la conservation? Quel sera l'autre Newton qui exposera les lois de
cette autre mcanique cleste 73?
A l'objection d'un gomtre, M. Bienaim, qui lui avait fait remarquer
que la loi des causes accidentelles tait mal nomme, que les fluctuations
qu'on remarque n'ont rellement plus rien d'accidentel quand on les prend en
nombre suffisant 74, Qutelet rpond:
"Je conviens en effet qu'il n'existe mme pas une seule cause accidentelle
au monde, et que chaque cause a son origine ncessaire, quelque faible
qu'elle soit; j'ai voulu me conformer seulement au langage ordinaire,
esprant bien que je serais compris de mes lecteurs75.
Malgr le nouvel esprit probabiliste qu'il a si puissamment contribu
introduire en science sociale, Qutelet en reste philosophiquement une
186 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
conception mcaniste du monde 76, alors que la conception philosophique
gnrale de Marx est foncirement diffrente.
Si Le capital admet partout l'existence des moyennes, et de fluctuations
autour d'une valeur centrale dues des causes accidentelles, si Marx fait ainsi
les mmes constatations que Qutelet et les statisticiens en gnral, s'il les suit
lorsqu'il s'agit du rsultat qui, par le jeu des compensations, ramne un
ensemble de faits une moyenne gnrale, par contre, pour ce qui est
d'expliquer cette moyenne elle-mme, il ne fournit pas du tout la mme
explication qu'eux.
L'accord entre Marx et les partisans de la physique sociale sur certains
faits gnraux n'empche pas qu'ils divergent, non seulement sur un plan
philosophique, mais mme sur un plan strictement scientif}que, car, sur la
thorie explicative des moyennes elles-mmes, Marx se spare d'eux, comme il
se spare des conomistes.
Dans son article sur la peine de mort, aprs avoir cit Qutelet et rappel
cette dcouverte qu'une ncessit gouverne le nombre et le genre des crimes
qui seront commis, Marx ajoute que cela n'est pas tant engendr par la
direction politique particulire d'un pays que bien plutt par les conditions
fondamentales de la socit bourgeoise moderne dans son ensemble 77.
Comme preuve, il extrait de la Physique sociale de Qutelet un tableau
comparatif des crimes par tranches d'ge commis Philadelphie et en France
de 1822 1824. Le statisticien belge attribuait, lui aussi, les constances
observes, exprimes en pourcentages, des causes sociales:
La socit renferme en elle les germes de tous les crimes qui vont se
commettre. C'est elle, en quelque sorte, qui les prpare, et le coupable n'est
que l'instrument qui les excute. Tout tat social suppose donc un certain
nombre et un certain ordre de crimes qui rsultent, comme consquence
ncessaire, de son organisation 78."
La rgularit des divers types de crimes dans deux pays aussi diffrents
qu'un jeune tat du Nouveau-Monde et un vieux pays du continent europen
provient, dit Marx, des mmes conditions sociales fondamentales [die
grundlegenden Bedingungen], celles qui rgnent dans la socit de classes
bourgeoise moderne. Qutelet l'attribuait aussi l'organisation de la
socit, l'tat social, qu'il ne caractrise pas aussi nettement que Marx
par sa nature bourgeoise-moderne . Mais Marx n'est gure plus prcis que
Qutelet qui accuse, mots peine couverts, <d'tat social .
Est-il possible de remdier aux crimes en tant que maux sociaux? Du
diagnostic dcoule le traitement. Qu'est-ce que prconise Qutelet? Il reste trs
timor dans ce domaine. On trouve fort peu de choses dans ses ouvrages sur
les remdes apporter ce qu'il considre pourtant comme des maux dont il
faudrait se dfaire.
LA POSSIBILIT CONCRTE
187
Aprs avoir dress pour son lecteur, qu'il veut alarmer, un constat
effrayant des crimes, Qutelet poursuit dans ce morceau d'loquence:
Gardons-nous cependant de croire, s'il n'est pas en notre pouvoir
d'arrter brusquement le mal, qu'il soit impossible d'y. remdier entirement.
La justice de prvention peut tre surtout d'un puissant secours, d'un secours
plus efficace peut-tre que la justice de rpression, qui est comme une faible
digue pour arrter un torrent toujours prt dborder, c'est la source qu'il
faut remonter pour donner au cours une drivation utile... Vouloir que le
torrent rgularise lui-mme sa marche par ce seul motif qu'on lui a donn une
digue, ou qu'il s'tablisse subitement un nouvel ordre de choses, en laissant
subsister les mmes causes, c'est attendre un prodige qui ne se ralisera
pas 79.
C'est videmment sur la possibilit d'apporter un remde aux maux
sociaux que le penseur rvolutionnaire diverge le plus du sociologue positi-
viste; ils ne conoivent pas les causes profondes des moyennes sociales de la
mme faon. Bien qu'il voque comme ncessaire un nouvel ordre de
choses , Qutelet ne semble pas avoir exprim de sympathie particulire pour
les doctrines socialistes et pour la rvolution sociale. Ses propos laissent
toutefois penser qu'il tait partisan de rformes claires 80.
Mais il ne va pas jusqu' rclamer une rvolution; au contraire, il ne croit
pas aux changements brusques .
Ainsi, ce n'est pas propos du diagnostic gnral que la divergence de
Marx d'avec Qutelet clate. Elle porte sur le remde que Marx voit dans une
rvolution radicale, qui changerait les rapports de production et le rgime de
la proprit actuels, mme si cela suppose une maturation pralable. A coup
sr, il ne comptait pas plus que Qutelet sur des prodiges. Le moins que l'on
puisse dire est qu'il ne les attendait pas! Il mit tout en uvre pour hter la
venue de cette rvolution sociale et de la socit communiste.
La divergence d'avec Qutelet n'est donc pas d'ordre pistmologique.
C'est un mme esprit scientifique, une mme philosophie de la science,
qui les anime: l'esprit objectiviste et probabiliste appliqu aux sciences
sociales. C'est pourquoi Marx ne qualifie pas brutalement Qutelet de non
scientifique>}, mme au sujet du concept d'homme moyen. Toutefois, il
n'aurait pas repris son compte, pour exprimer son point de vue , la phrase
de Laplace que Qutelet choisit comme exergue pour sa Physique sociale:
Appliquons aux sciences politiques et morales la mthode fonde sur
l'observation et le calcul, mthode qui nous a si bien russi dans les sciences
naturelles 81.
Pourtant, Marx a parfois exprim des vues trs proches. Il ne ddaignait
pas l'application des mathmatiques et du calcul aux questions conomiques
et sociales. Il usa beaucoup de formules arithmtiques que l'on peut mettre
188 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
sous forme d'quations82. Il envisagea mme d'tudier les crises conomiques
grce une formulation algbrique des lois du capital83.
Cependant, les rapports sociaux ne se mettent pas en formules, et, devant
les barrires qui sparent les classes sociales, le concept d'homme moyen se
rvle inefficace, et devient idologique .
C'est l qu'achoppe Qutelet. Il s'est tromp en recherchant, derrire tous
les hommes empiriques, un homme moyen qu'il conut, sinon comme
effectivement ralis dans un individu rel84, du moins comme une vritable
norme a priori que la nature chercherait raliser dans chaque individu qu'elle
fait natre.
En effet, Qutelet interprtait cet homme moyen comme un modle
auquel tendait rellement la nature agissant comme un tre intentionnel. Il
pensa obtenir ce modle en runissant les moyennes prises aux diffrents
points de vue: physique, moral, et intellectuel.
C'est ce qui est pouss la caricature dans la tentative du savant belge de
dterminer un type d'homme aux proportions physiquement parfaites, qui
serait le modle de la beaut dans le genre humain, et auquel les artistes
n'auraient plus qu' se conformer pour raliser des chefs d'uvre. Il crut
qu'on pouvait obtenir cet Apollon en le composant des moyennes obtenues en
mesurant les diffrentes parties du corps dans toutes les populations consti-
tuant le genre humain.
Qutelet interprtait donc les moyennes comme des normes vises par une
nature providentielle, les carts tant compris comme des erreurs accidentelles
dans la ralisation de ces intentions, tout comme les erreurs d'observation ou
de mesure s'expliquent par les conditions imparfaites dans lesquelles opre le
savant, mme s'il rpte ses oprations.
Les moyennes dans l'ordre humain et social ne pouvaient se comprendre,
selon Qutelet, que si la nature y oprait intentionnellement en prenant pour
but de telles normes idales. Pour rendre compte de cette finalit de la nature
dans la poursuite d'un modle humain parfait, il ne trouva d'autre ressource
que de recourir une intention divine85. Marx pouvait estimer que Qutelet
tournait le dos une saine comprhension scientifique et philosophique des
constances et rgularits observes.
Rapidement, la thorie de l'homme moyen de Qutelet apparut comme
une <<idologie scientifique dans le sens o l'entend M. Canguilhem 86. Le
savant belge n'a abouti qu' une sociologie prsomptive: sa physique
sociale ne s'est pas mue en une science au sens thorique du terme. Marx
avait parfaitement raison: sur le plan thorique, Qutelet ne fut effectivement
pas plus avanc en 1870 qu'en 183087, bien qu'il ait donn l'impulsion dcisive
une plade de disciplines nouvelles comme la dmographie, la criminologie,
l'anthropomtrie, dont les mthodes se rpandront en biologie, en gntique
des populations, en conomtrie et en sociologie gnrale.
Alors que pour Qutelet les variations historiques des moyennes sont
assez faibles et insignifiantes 88, pour Marx les caractristiques moyennes
LA POSSIBILIT CONCRTE 189
peuvent varier beaucoup d'une poque l'autre. De plus, pour une mme
priode, elles diffrent considrablement selon les conditions de vie
conomiques des diverses classes sociales.
Comme Qutelet, derrire les moyennes, Marx voit des normes 89. Mais il
les prend en un sens relatif. Il a une conception historique des normes, qui
contraste avec celle qu'en a Qutelet, pour qui c'est la stabilit qui l'emporte.
L'quilibre, selon Marx, n'est jamais que transitoire.
Si l'esprit probabiliste tient une large place dans sa pense, puisqu'il
insiste sur les processus de compensation et sur le caractre rgulateur de toute
loi, Marx n'en reste pas l; il entre dans une analyse des composantes internes
aux moyennes; il les prend dans des domaines dtermins. En outre, sur de
longues priodes, les moyennes changent; se rvlent des tendances histori-
ques et des volutions. Comme les lois, les moyennes sont soumises aux
devenir historique.
A premire vue, les moyennes ne font apparatre la possibilit que sous la
forme des variations individuelles et des causes accidentelles. En ralit, une
norme se substitue historiquement une autre, une moyenne une autre.
Toute norme nouvelle qui fait son apparition n'est d'abord qu'une exception
ct de la norme actuelle, dont elle va prendre la place. Elle se prsente sous
forme de tendance . Aussi, bien que Marx fasse grand usage de la notion de
moyenne, on doit en trouver quelque part chez lui la critique.
5. Critique des thories de la compensation
Bien qu'il admette la ralit et l'universalit des processus de compensa-
tion, Marx critique les thories de la compensation . Il dsigne par l les
thories conoiques qui en appellent la concurrence comme cause ultime
pour expliquer le niveau auquel s'tablissent les valeurs, les prix (prix de
production et prix de march) et les revenus (salaires, profit, rente, intrt).
Selon Marx, la concurrence joue bien un rle rgulateur, mais elle ne rend
compte que d'un aspect des choses, le plus superficiel. Elle ne peut expliquer
les lois conomiques les plus importantes et les plus profondes.
Nombreux taient les thoriciens qui faisaient de la concurrence, en
particulier de la loi de l'offre et de la demande, un mcanisme suffisant
expliquer les principaux phnomnes socio-conomiques, ceux de la produc-
tion comme ceux de la circulation. Un chapitre du Capital est spcialement
consacr montrer la vanit de leurs thories 90. La loi de l'offre et de la
demande, de l'avis de Marx, ne peut rendre compte que de la tendance
ramener les valeurs ou prix une valeur ou un prix moyens: elle ne peut pas
dterminer cette moyenne elle-mme. La concurrence ne concerne que les
fluctuations accidentelles, mais ne peut en rien influer sur le fait que la
moyenne s'tablit un certain niveau plutt qu' un autre.
190 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Marx attire l'attention sur ce problme thorique important, par exemple
lorsqu'il s'agit d'expliquer le niveau moyen des salaires:
Pour le prix du travail comme pour celui de n'importe quelle autre
marchandise, le changement dans le rapport de l'offre et de la demande
n'explique rien d'autre que son changement [celui du prix du travail], c'est-
-dire les oscillations des prix de march au-dessous ou au-dessus d'une
certaine grandeur. L'offre et la demande concident-elles? alors, dans des
circonstances par ailleurs gales, l'oscillation des prix cesse. Mais alors l'offre
et la demande cessent aussi d'expliquer quoi que ce soit. [...] On [les
conomistes] prit une assez longue priode des oscillations du march, par
exemple un an, et l'on trouva alors que leurs hauts et leurs bas s'galisent en
une grandeur moyenne intermdiaire, une grandeur constante. Cette gran-
deur devait donc naturellement tre dtermine autrement que les carts par
rapport elle-mme, qui se compensent91."
La concurrence est un mcanisme essentiel du rgime de production
capitaliste et de toute production marchande en gnral. Mais elle ne joue
qu'un rle rgulateur. Elle ne peut tre l'origine d'un mouvement gnral des
prix, ni mme expliquer leur stabilit sur une certaine priode. Elle est une
condition, mais non la cause de la fixation des prix.
Si cette analogie est permise, nous dirons qu'elle n'est pas plus la cause du
niveau des prix dans le mode de production capitaliste, que le rgulateur d'une
machine vapeur n'est la cause du mouvement de cette machine. Pourtant, le
rgulateur stabilise la vitesse de fonctionnement de la machine autour d'un
rgime moyen.
Cette critique des thories de la compensation court travers Le capital
comme un fil rouge. Elle est dveloppe explicitement dans le Livre III. Marx
y revient plusieurs reprises propos de la dtermination du salaire ouvrier,
ou prix de march de la force de travail. Il dnonce l'indigence thorique de
toutes les explicaitons par la concurrence, qui tombent dans une ptition de
prmClpe.
Pour expliquer le salaire, il ne nous servirait rien ", crit-il, de faire
intervenir la concurrence. [...] Supposons que l'offre et la demande de travail
s'quilibrent. Par quoi sera alors dtermin le salaire? Par la concurrence.
Mais nous venons de supposer qu'elle eesse d'tre dterminante et que
l'quilibre de ses deux forees contraires annule [authebt] ses effets. Ce que nous
nous proposons de trouver est prcisment le prix naturel du salaire, c'est--
dire le prix du travail qui n'est pas rgl par la concurrence, mais, au contraire,
la rgularise92".
Ce raisonnement rduit nant les prtentions des thories de la
compensation. Il s'applique galement toutes les formes de revenu: profit,
rente foncire, etc. Marx ne prend pas la peine de le rpter pour la rente, mais
il le fait pour le profit:
La concurrence galise les taux de profit des diffrentes sphres de
LA POSSIBILIT CONCRTE
191
production pour en faire le taux moyen de profit. [...] Mais ce que la
concurrence ne montre pas, c'est la dtermination de la valeur qui domine le
mouvement de la production, ce sont les valeurs qui se dissimulent derrire
les prix de production et, en dernire instance, les dterminent93."
Marx conteste donc radicalement le pouvoir explicatif de la concurrence,
quoique ce soit par elle que toute moyenne s'tablisse. Mais le phnomne
apparent, les fluctuations, ne peut rendre compte de la norme elle-mme:
les fluctuations de l'offre et de la demande n'expliquent rien d'autre
que les carts des prix de march par rapport aux prix de production [...]94".
Il insiste longuement sur ce point, disant qu'il s'agit de savoir ce que peut
et ce que ne peut pas la concurrence: c'est en effet une question de possibilit.
Peut-elle dterminer le profit moyen? Marx le nie vigoureusement l'aide
d'arguments trs simples:
La concurrence peut seulement supprimer les ingalits d'un taux de
profit95. Car, pour qu'elle joue, [...], il faut que le profit [...] existe dj. Ce
n'est pas la concurrence qui le cre. Elle l'augmente ou le diminue, mais elle ne
cre pas le niveau qui s'tablit comme rsultat de la prquation. Quand nous
parlons d'un taux ncessaire du profit, nous voulons prcisment connatre le
taux de profit qui ne dpende pas des mouvements de la concurrence, mais la
normalise 96.
Ironiquement, Marx fait remarquer que la concurrence doit se charger
d'expliquer tout ce que les conomistes ne comprennent pas alors que ceux-ci
auraient inversement pour mission de nous expliquer la concurrence97 .
La concurrence joue son rle dans le processus de ralisation de la valeur.
Le produit issu du processus de production doit tre vendu: c'est seulement
lorsque la vente a eu lieu que la plus-value qu'il contenait en puissance se
trouve rellement dans les mains du capitaliste.
Ralisation ici ne veut pas dire cration. La valeur nouvelle est cre
dans le processus de production lui-mme.. Il est impossible d'expliquer cette
cration par la concurrence. On ne peut pas non plus soutenir srieusement
que la valeur nouvelle aurait son origine dans le commerce; c'est pourtant une
croyance tenace et rpandue que la plus-value serait le bnfice qu'il
suffirait au commerant de prlever en sus du prix auquel il a achet la
marchandise. Si la plus-value, objecte Marx, tait ainsi extorque aux consom-
mateurs, d'o ceux-ci la tireraient-ils? Il faut bien en revenir ce qui se passe
dans le processus de production.
N'expliquant que les oscillations autour d'une moyenne et la compensa-
tion qui en rsulte, la concurrence n'expliquera pas davantage une volution
historique, un changement notable dans la longue dure. C'est elle qui,
inversement, a besoin d'tre explique: elle est plutt effet que cause. D'o
provient-elle? Marx le dit: c'est la baisse du taux de profit qui suscite la
192 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
concurrence entre les capitaux et non 1'inverse98 . C'est donc un changement
de nature historique qui engendre la concurrence. Elle a son origine dans la
tendance l'accumulation, la tendance agrandir le capital et produire de
la plus-value sur une chelle largie >', car c'est l, pour la production
capitaliste, une loi, rsultant des constantes rvolutions dans les mthodes de
la production elles-mmes, de la dprciation du capital existant que ces
rvolutions entranent continuellement, de la lutte gnrale de la concurrence
et de la ncessit de perfectionner la production et d'en tendre l'chelle,
simplement pour se maintenir et sous peine de disparatre99.
Il semblerait que la concurrence soit cause et effet dans un systme
d'actions rciproques. Mais, chaque fois qu'il en a l'occasion, Marx fait
observer que la concurrence n'est pas la cause mais l'effet, mme quand il
s'exprime au conditionnel irrel:
"
Il est clair que [la] dprciation effective de l'ancien capital ne pourrait
avoir lieu sans lutte [...]. Le taux de profit ne baisserait pas cause d'une
concurrence qui proviendrait de la surproduction de capital. C'est l'inverse,
c'est parce que les mmes circonstances font diminuer le taux de profit et
provoquent la surproduction de capital que s'engagerait maintenant la lutte
concurrentielle 100.
Ainsi l'opinion commune se fait une ide tout fait fausse du rle de la
concurrence. On pense que le prix d'une marchandise rsulte de la runion de
trois lments prexistants: le salaire, le profit et la rente, et que chacun de
ceux-ci serait dtermin indpendamment des deux autres et fix par la
concurrence que se feraient les salaris entre eux, les capitalistes entre eux et
les propritaires fonciers entre eux, comme si, sur ces trois terrains, les acteurs
conomiques taient isols les uns des autres.
Marx soutient une thse contraire: la valeur de la marchandise prexiste;
elle se dcompose seulement ensuite entre les classes sociales. Il y a rpartition
et non pas runion accidentelle d'lments disparates. C'est ici que se
produisent les illusions:
Les reprsentations d'un commerant, d'un spculateur en bourse,
d'un banquier, sont ncessairement tout fait inverses [verkehrt]. Celles des
fabricants sont fausses par les actes de circulation auxquels leur capital est
soumis et par l'galisation du taux gnral de profit. La concurrence joue
aussi ncessairement dans ces ttes un rle tout fait invers lOI.
Marx rsume ses ides dans une page trs caractristique. Il y considre la
forme spcifique de la production capitaliste o l'ensemble de la production
est rgi par la production de la valeur (cration de la plus-value). Cette
manire de produire contient une contradiction essentielle que la concurrence
masque; celle-ci cache la loi vritable tout en la ralisant. D'une faon
LA POSSIBILIT CONCRTE
193
gnrale, elle est le moyen par lequel s'impose la loi de la valeur, mais elle ne
dtermine pas la valeur . Voici cette page:
D'un ct, sous cette forme tout fait spcifique de la valeur, le travail
vaut uniquement en tant que travail social; d'un autre ct, la rpartition de
ce travail social, l'ajustement [Erganzung] et l'change rciproques de ses
produits, sa soumission au mcanisme social et son insertion dans ce
mcanisme, sont abandonns aux agissements fortuits et qui s'annulent
rciproquement [sich wechselseitig auOlebenden] des producteurs capitalistes
individuels. Comme ceux-ci se rencontrent seulement en tant que propri-
taires de marchandises, chacun essayant de vendre la sienne aussi cher que
possible (et n'est guid apparemment dans la rgulation de la production elle-
mme que par son libre-arbitre [Willkr]), la loi interne ne s'affirme que par
l'intermdiaire de leur concurrence, que par les pressions rciproques des uns
sur les autres, de sorte que les carts s'annulent [auOleben] rciproquement.
La loi de la valeur agit ici uniquement comme loi interne, et, vis--vis des
agents individuels, comme une loi naturelle aveugle, qui ralise l'quilibre
social de la production au milieu des fluctuations accidentelles de celle-
cP02.
Ne pourrait-on pas objecter Marx de tomber lui aussi dans un cercle
vicieux? D'une part, la loi de la valeur agit comme une loi interne cache qui
doit finalement expliquer la concurrence. D'autre part, la valeur dont il s'agit
dans cette loi est elle-mme une valeur moyenne", que mesure le temps social
moyen ncessaire. Ce genre de cercle, il le reproche prcisment aux
thories de l'explication par la concurrence.
Revenons donc la dtermination de la valeur comme valeur moyenne. Si
Marx la prsuppose effectivement au point de dpart de ses analyses, c'est--
dire au dbut du Capital, il sait qu'elle reste une notion abstraite. Quand il
parle des choses concrtement, il use d'une dmarche qui lui est coutumire:
il distingue divers cas. Nous allons voir que c'est l que se trouve la vraie
critique marxienne de la notion de moyenne.
Concrtisant son propos, Marx en vient envisager trois cas de figure
pour la dtermination de la valeur d'une certaine sorte de produits:
Premier cas, celui o
<da grande masse [des] marchandises est produite peu prs dans les
mmes conditions sociales normales, de sorte que cette valeur soit en mme
temps la valeur individuelle des marchandises isoles qui forment cette
masse. Si une partie relativement petite est produite au-dessus de ces
conditions, une autre au-dessous, de sorte que la valeur individuelle de l'une
est plus grande, celle de l'autre plus petite que la valeur mdiane [mittlere] de
la plus grande partie des marchandises, ces deux extrmes se compensent de
sorte que la valeur moyenne [Durchschnittswert] de leurs marchandises est
gale la valeur des marchandises appartenant la masse intermdiaire [der
mittlern Masse], et alors la valeur de march est dtermine [bestimmt] par la
valeur des marchandises produites dans les conditions intermdiaires [nnter
mittlern Bedingungen] 103
".
194 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Malgr leur lourdeur, ces explications sont claires: Marx veut dire que
dans ce cas, la valeur moyenne est une valeur relle 104pour la plus grande
partie des produits d'une mme espce 105.Elle rgle donc les valeurs des
quantits de ce produit qui seraient fabriques dans des conditions diffrentes:
une faible quantit produite dans de bonnes conditions (s'il y a une nouvelle
machine dans une entreprise particulire), et une autre faible quantit produite
dans d~ mauvaises conditions. La valeur moyenne gnrale et celle de la
grande masse des produits obtenus dans les conditions intermdiaires conci-
dent, bien qu'il y ait trois sortes de conditions diffrentes, les bonnes, les
moyennes, et les mauvaises, et donc, concrtement, trois sortes de valeurs.
Deuxime cas:
Admettons que [...] la valeur des marchandises produites dans les
conditions les plus mauvaises ne compense pas [sich nicht ausgleichen mit]
celle des marchandises produites dans les conditions les meilleures, de sorte
que la partie des marchandjses produites dans les conditions les plus
mauvaises forment une partie relativement importante aussi bien par rapport
la masse intermdiaire [mittlere) que par rapport l'autre extrme, c'est la
masse produite dans les plus mauvaises conditions qui rgle [regelt) alors la
valeur de march ou valeur sociale 106.
Le troisime cas tant le symtrique du deuxime, nous ne nous y
arrterons pas, la conclusion tant videmment inverse.
Il n'y a donc que dans le premier cas que la valeur sociale moyenne
[DurchschniUswert] et la valeur individuelle de la majeure partie des produits
d'une branche de production concident 107.Dans les deux autres cas, il n'en va
pas de mme. Est-ce une manire de faire la diffrence entre moyenne et
mdiane au sens technique de ces termes en statistiques? Cette interprtation
est tentante et semblerait clairer les choses, bien que Marx ne s'occupe pas de
dfinitions mathmatiques et abstraites rigoureuses. Si, dans le second cas, la
masse des produits obtenus dans de mauvaises conditions (faible productivit)
dcide de la valeur de march de l'ensemble, c'est qu'il y a un besoin social de
ces produits, et que les quantits produites dans les conditions moyennes ou
bonnes ne suffisent pas. Dans ce cas, il y a un impratif: les producteurs
travaillant dans les mauvaises conditions doivent bien vendre leurs produits
leur valeur pour subsister (cas de mise en culture de mauvaises terres si le
besoin social l'impose). La valeur des autres produits s'aligne sur celle-l.
Voil une dtermination de la valeur qui n'est pas une moyenne au sens
statistique du terme, celui qui prvaut partout chez Qutelet.
En ralit, il ne s'agit pas non plus d'une distinction abstraite entre
moyenne et mdiane au sens de l'arithmtique pure, mais plutt de conditions
d'existence de certaines catgories sociales et de besoins sociaux. Les trois cas
diffrents que Marx compare illustrent donc une varit concrte, celle qui se
prsente entre les diverses conditions de production d'un mme produit.
LA POSSIBILIT CONCRTE
195
Surtout, cette explication permet de comprendre que valeur et prix de
march puissent diverger.
En fait, ce quoi Marx a ainsi procd, c'est une critique de la notion
de moyenne. Car, la mme valeur de march, qui cache des cas diffrents (des
valeurs diffrentes), s'impose des marchandises qui, produites dans des
conditions diffrentes, ont en ralit une valeur suprieure ou I11oindre. La
compensation au sens propre du terme ne s'effectue que dans le premier cas.
Mme si Marx continue de prsupposer, l'intrieur mme des trois situations
envisages, une application de la notion de moyenne statistique, l'esprit de ces
exemples est de dpasser celle-ci.
La notion de moyenne, qui convenait dans le cadre des hypothses
thoriques simplifies du Livre premier, ne suffit plus ici. Marx dnonce
l'insuffisance de la notion purement arithmtique de moyenne et les illusions
qui l'accompagnent. Quoiqu'indispensable et correspondant une certaine
ralit (la concurrence), elle est frappe d'une relativit essentielle: elle est
encore abstraite. Le vritable concret, ce sont les cas d'espces et leurs
conditions particulires.
Le dbut du Livre premier du Capita/Ie confirme pour peu que l'on soit
attentif la manire dont Marx commente la notion de moyenne aprs avoir
dfini la substance de la valeur comme dpense d'une certaine quantit de
force de travail humaine, indiffrente la forme dans laquelle elle a t
dpense 108.
Cette dfinition, qu'on trouve dj chez Adam Smith, tombe sous le coup
de l'objection que l'on n'a pas manqu de lui faire et que Marx rapporte: Il
pourrait sembler que [...] plus un homme sera fainant ou malhabile, plus sa
marchandise aura de valeur J09. A cela, il faut rpondre:
Mais en ralit, le travail qui constitue la substance des valeurs est du
travail humain identique, dpense de la mme force de travail humaine. La
force de travail globale de la socit, qui se manifeste dans les valeurs du
monde des marchandises, compte ici comme une seule et mme force de
travail humaine, bien qu'elle consiste en d'innombrables forces de travail
individuelles. Chacune de ces forces de travail individuelles est une force de
travail humaine identique aux autres, dans la mesure o elle a le caractre
d'une force de travail social moyenne [Durchschnitts-Arbeitskraft], agit en
tant que telle et ne requiert donc dans la production d'une marchandise que
le temps de travail ncessaire en moyenne [im Durchschnitt] ou temps de
travail socialement ncessaire
1JO.
Et Marx de prciser:
Le temps de travail socialement ncessaire est le temps de travail qu'il
faut pour faire apparatre une valeur d'usage quelconque dans les conditions
de production normales d'une socit donne et avec le degr social moyen
d'habilet et d'intensit du travai11 11.>>
196 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
On nous opposera que Marx se fonde ici sur la notion de moyenne! Mais
lisons la suite du texte. Elle fait ressortir que ce temps social moyen ncessaire
est minemment variable. Non seulement il comporte en son sein une infinie
varit, mais ce temps de travail social moyen change:
Aprs l'introduction du mtier tisser la vapeur, en Angleterre, il ne
fallait plus peut-tre que la moiti du travail qu'il fallait auparavant pour
transformer une quantit de fil donne en tissu. En fait, le tisserand anglais
avait toujours besoin du mme temps de travail qu'avant pour effectuer cette
transformation, mais le produit de son heure de travail individuelle ne
reprsentait plus dsormais qu'une demi-heure de travail social et tombait du
mme coup la moiti de sa valeur antrieure 112.
Une mme marchandise peut donc rsulter de conditions de production
diffrentes. C'est le cas dans l'exemple choisi ici par Marx; les conditions
normales, sociales, moyennes1I3, changent, parfois mme brusque-
ment: la valeur peut tomber 114. Quand il ne faut plus, avec de nouveaux
moyens de production, que la moiti du temps qui tait ncessaire auparavant,
et que l'artisan ou tisserand traditionnel a toujours besoin du mme temps de
travail qu'avant , que faut-il entendre par temps de travail ncessaire?
L'apparition de nouvelles manires de produire plus conomes en temps
signifie que, pendant une certaine priode, il va y avoir deux temps de
travail ncessaires , dont l'un consiste justement dans cette nouvelle possi-
bilit de produire.
Une poque de conflits s'ouvre. La concurrence avive se transforme en
lutte de deux sortes de producteurs qui mettent en uvre deux moyens de
production diffrents. Il ne s'agit plus de la concurrence d'un grand nombre de
producteurs produisant dans des conditions peu prs semblables, mais de
deux groupes qui peuvent tre numriquement et socialement tout fait
dissemblables.
Cette situation d'affrontement conomique potentiel est indique, en
germe, dans la dfinition de la valeur, ce que Marx prcise en crivant que les
marchandises qui contiennent des quantits de travail gales, ou qui peuvent
tre fabriques dans le mme temps de travail, ont donc la mme grandeur de
valeur
115.
Le temps ncessaire , qui dtermine la grandeur et la substance de la
valeur, n'est pas forcment celui qui est rellement dpens: c'est aussi bien
celui dans lequel les choses peuvent tre produites. La ncessit se dfinit ici
par une possibilit . Le temps ncessaire est celui d'une production
possible , tant entendu qu'il s'agit d'une possibilit concrte , dj
partiellement, localement, ralise: une petite fraction des produits est dj
obtenue dans ce nouveau temps minimum.
Reprenons les trois cas distingus par Marx et rapports ci-dessus.
Lorsque le mtier tisser m la vapeur survient et supplante le mtier
manuel, il y a un passage, plus ou moins rapide et brutal, du cas II au cas III,
LA POSSIBILIT CONCRTE
197
le cas I reprsentant la situation antrieure, mais aussi la situation future o les
nouvelles normes domineront dans le secteur considr. La production de
tissus l'aide de mtiers manuels sera devenue minime ou tout fait
insignifiante, et la production selon les nouvelles normes sera devenue la rgle
gnrale.
La possibilit dont Marx parle ici est une possibilit concrte: on a la
possibilit effective de produire sur des bases nouvelles, avec des moyens
nouveaux, par exemple des machines automatiques mues par un moteur
central au lieu de mtiers et d'outils manuels. Cette possibilit existe: non
seulement l'invention technique est faite, mais elle est avantageuse au point de
vue conomique.
Ce qui caractrise cette possibilit concrte, c'est qu'elle fait apparatre
une ncessit, mais une ncessit spcifique. Le changement technique
devient ncessaire du fait qu'il est concrtement possible, que des forces
productives et sociales nouvelles sont apparues: elles existent de manire
potentielle. Le type de ncessit qui accompagne cette possibilit est une
ncessit historique. Ce qui est remarquable, c'est que ncessit et possibilit ne
sont aucunement exclusives l'une de l'autre: sous forme de forces potentielles,
elles signifient la mme chose et s'identifient.
Au dbut du Capital, Marx pose donc une vritable quivalence des
concepts de ncessit et de possibilit dans les priodes de transition histori-
que: le temps de travail moyen socialement ncessaire" est dfini par une
possibilit concrte , celle que donnent les capacits productives. Quand
cette possibilit nouvellement apparue devient ralit, cela se traduit par une
modification des valeurs qui se manifeste d'une manire plus ou moins brutale
pour les divers protagonistes sociaux. Cette modification devient un enjeu
historique; elle met aux prises les partenaires sociaux de la veille qu'elle
transforme en antagonistes.
La chute des valeurs peut tre retarde; l'invention faite, son application
effective l'chelle sociale (c'est--dire l'innovation technique), quoique
possible, peut aussi bien tre refuse, les moyens nouveaux restant volontaire-
ment inemploys. Concrtement, la possibilit historique apparat donc
d'abord seulement sous forme de tendance .
NOTES
1. Le capital, t. I, pp. 168-169, n. 2; MEW 23, p. 180, n. 37. L'emploi de sich autlteben est
remarquable: les fluctuations sont.. la fois conserves et supprimes.
2. Travail salari, p. 34; MEW 6, p. 407. Trad. modifie.
-
Dans cet opuscule publi en 1849
et reprenant des confrences prononces Bruxelles en 1847, Marx pariait du prix du travail
198 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
et non du prix de la force de travail". En 1891, Engels mit le texte jour sur ce point. Marx ne
distingua travail et force de travail qu' partir des annes 1857-1858.
3. Il existe en effet deux sortes de moyennes, dont Qutelet donnait des exemples simples:
dans une srie de mesures d'un objet, par exemple la hauteur d'un difice, on cherche
dterminer un nombre qui existe vritablement: la moyenne des mesures peut tre considre
comme la plus approche de la hauteur relle. Au contraire, si l'on parle de la hauteur moyenne
des maisons d'une rue, on a une moyenne abstraite, simple opration de calcul entre des
quantits qui n'ont pas de relations essentielles (Sur le dveloppement de l'homme et de ses
facults ou Essai de Physique sociale, Paris, Bachelier, 2 vol., 1935, t. 1, Appendice, pp. 487-488).
-
(Nous abrgerons nos rfrences cet ouvrage en Physique sociale,,).
4. Le capital, t. 8, p. 34; MEW 25, p. 655.
5. Ibid.,1. 6, p. 200; MEW 25, p. 194.
6. Ibid., p. 174; MEW 25, p. 167. Cf. le chapitre du troisime Livre intitul: galisation
[Ausgleichung] du taux de profit par la concurrence (ibid., p. 189; MEW 25, p. 182).
7. Ibid., p. 189; MEW 25, p. 182.
8. Ibid., p. 185; MEW25,p. 178.
9. Ibid.,1. 7, p. 24; MEW25, p. 368. Mots souligns par nous. .
10. C'est seulement en 1837 que Poisson lui donna ce nom. Selon toute vraisemblance, Marx
ne connaissait pas les mmoires de ce mathmaticien. Mais cette loi tait dj ancienne de son
temps. Elle fut dmontre par De Moivre en 1711 et par Jacques BERNOUILLI en 1713 (cf. Histoire
Gnrale des Sciences, t. 3,1" partie, p. 80). Marcel Boll en donne une ide claire en disant qu'elle
consiste dans <d'identification progressive de la probabilit mathmatique dfinie a priori, et de la
probabilit statistique constate a postriori en effectuant les expriences de contrle" (Les
certitudes du hasard, Paris, Presses Universitaires de France, 1962, p. 109). Cette loi est aussi
connue sous le nom de loi de Laplace-Gauss: Laplace l'avait utilise pour fonder la thorie des
erreurs d'observation. Par la suite, les mathmaticiens ont t amens distinguer diverses sortes
de lois des grands nombres (cf. Histoire Gnrale des Sciences, op. cit., pp. 77-92)!
11. Le capital, t. 8, p. 206; MEW 25, p. 836. Trad. modifie. Remarquons l'accord entre les
explications d'Engels et celles de Marx. Lorsqu'Engels parle, en crivant J. Bloch, d'une foule
de hasards", des conflits d'un grand nombre de volonts individuelles , d'une foule de
conditions particulires , d' innombrables forces , toutes ces expressions voquent galement
cette loi des grands nombres qu'il ne nomme pas non plus. La Dialectique de la nature ne
mentionne ni cette loi, ni le calcul des probabilits, ce qui ne constitue pas une preuve qu'Engels
les ignorait! Marx
y
fait une fois une allusion assez explicite en disant des carts individuels qu'on
les nomme mathmatiquement erreurs (Le capital, 1. 2, p. 16; MEW 23, p. 342).
12. Le capital, t. 8, p. 206; MEW 25, p. 836.
13. Notes de lecture des lments d'conomie politique de James Mill (cf. MEW EB 1,
p. 445; MEGA, IV/3, pp. 520-521; MEGA l, vol. 3, p. 531; cit et traduit par M. Rubel [1959, p.
52]).
14. Le capital, t. 8, p. 145; MEW 25, p. 769-770.
15. Ibid.
-
Nous adoptons la rectification propose par M. Rubel (in Marx, uvres, 1. 2,
p. 1373, n. 1), qui lit Ausgleichung au lieu de Voraussetzung (texte d'Engels).
16. Le capital, 1. 6, p. 199; MEW 25, p. 193.
17. La consquence immdiate, c'est la concurrence dans tous les domaines, le bellum
omnium contra omnes (la guerre de tous contre tous) de Hobbes.
18. La loi des grands nombres a ce double aspect thorique et pratique (cf. ci-dessus, n. 10,
sa dfinition par Marcel Boll).
19. Le capital, t. l, pp. 168-169, n. 2; trad. Lefebvre, pp. 186-187, n. 37; MEW 23, p. 180,
n. 37. Trad modifie.
20. Nom d'abord donn la discipline qui deviendra la sociologie. Marx ne retient ni
physique sociale , ni sociologie , mais continue de parler de sciences sociales ou de
sciences sociales et historiques".
21. Tu me demandes un manuel de statistique. Je te recommande
-
parce qu'il contient en
mme temps des explications d'ordre conomique
-
le Commercial Dictionary de Mac Culloch,
1845. Il Ya des choses plus rcentes, par exemple de Mac Grgor, dont les statistiques sont peut-
tre les meilleures de toute l'Europe. (L. du 16 oct. 1851, Correspondance, t. II, p. 349; MEW 27,
p. 582.)
-
Marx continue en numrant d'autres ouvrages pour l'Amrique, l'Allemagne, et la
France. En particulier, il signale l'importante History ofprices (Histoire des prix, en trois volumes)
de Thomas Tooke.
22. L. Kugelmann du 6 mars 1868, Correspondance, t. IX, p. 179; MEW 32, p. 539.
LA POSSIBILIT CONCRTE 199
23. Les sujets sur lesquels portent ces tableaux, que Marx donne l'appui de ses analyses,
sont trs varis (nous suivons l'ordre o ils apparaissent en nous limitant au premier Livre du
Capital; il s'agit de l'Angleterre; C2, 81 renvoie la p. 81 du tome 2, C3 au tome 3):
mortalit des enfants par districts (C2, 81); quantits de fils produits (coton, etc.) et valeurs (C2,
100-1); nombre defabriques de coton (C2, 115-6); statistiques des grains de 1831 1866 (C2, 132-
133); statistique des marchs du coton (C2, 135); mortalit compare des agriculteurs, tailleurs et
imprimeurs (Londres) (C2, 145); nombre moyen de broches par fabrique (C2, 232), par tte (C2,
232); accroissement de la population en Angleterre et au Pays de Galles (C3, 91); revenus (C3, 92,
93); alimentation chez les ouvriers selon les catgories (C3, 98); nombre de personnes par
chambre (ouvriers de Bradford) (C3, 105); villages, salaires, et loyer (C3, 116-7); consommation
(C3, 120-1); maisons Langtoft (C3, 130); l'accumulation capitaliste en Irlande (cinq tableaux)
(C3, 137 et suiv.); moyennes hebdomadaires des frais d'entretien par tte (C3, 144); nombre et
tendue des fermes en Irlande (C3, 149).
- Il faut
y ajouter les donnes numriques maillant le
texte du Capital: gestes la mule-jenny (C2, 95); nombres de chevaux-vapeur, de broches, de
fabriques, de mtiers tisser, d'ouvriers de fabrique, et leur volution rcente (cf. C2, 97-8, 124-
7, entre autres).
24. Selon Engels, les documents statistiques figurant dans les papiers de Marx constituaient
un volume respectable: quelques mtres cubes.
25. Selon Frank H. HANKINS(Adolph Qutelet as Statistician [Adolphe Qutelet, Statisti-
cien], New York [1908], AMS Press, 1968, chap. II), deux sortes de travaux ont conduit aux
statistiques du XIXesicle: 1) ceux dont l'objet tait la vie et l'organisation de l'tat: Mnster
(1536 et 1544), Conring (1660-1668), Achenwall, ,de pre de la science statistique (1748); 2) ceux
des fondateurs de la politique arithmtique: Graunt (1662), Petty (1681, 1699), Derham (1699),
Sssmilch (1742). Ces deux courants se rassemblent prcisment chez Qutelet. On trouvera des
donnes succinctes, surtout sur l'histoire de la statistique dmographique, in Histoire des sciences,
op. cit., pp. 1607, 1609, 1616.
26. Le premier, Qutelet reconnut que les mesures anthropomtriques obissaient au
binme de Newton, loi d'aprs laquelle une valeur est d'autant moins frquente qu'elle s'carte
davantage de la valeur moyenne. (Cf. Paul Lester, L'anthropologie , Histoire de la science, loc.
cil., p. 1388).
27. Contribution, p. 4; MEW 13, p. 9.
28. G. DARMOIS,brossant l'histoire du calcul des probabilits au XIXesicle, crit: On ne
saurait passer sous silence, au sujet des phnomnes collectifs alatoires, l'uvre du savant belge
Adolphe Qutelet (1796-1874). Venu Paris, en 1823, pour se documenter sur l'astronomie, il
connut Fourier, Poisson, Lacroix et la pense de Laplace. Nous reviendrons sur ce qu'on a appel
la loi des grands nombres, dont Poisson dveloppait volontiers le caractre gnral. Qutelet
revint enthousiaste du Calcul des probabilits et des lois qu'il pressentait dans le monde social. Il
n'est pas douteux que cet espoir tait parfaitement valable dans l'ensemble. [...] Qutelet eut une
prodigieuse influence et une extrme efficacit dans la constitution des socits nationales et
internationales de statistiques. Il avait en outre un grand talent littraire, sans doute beaucoup de
charme, avec une grande puissance de travail au service d'une curiosit scientifique trs tendue.
Il russit parfois un peu trop bien dans l'introduction de certaines notions comme le "penchant
au suicide". Il tenait beaucoup cette sorte de molcule conventionnelle du monde social qu'il
appelait "l'homme moyen". (G. DARMOIS, La probabilit, Histoire Gnrale des Sciences,
loco cil., p. 79.)
29. Cf. ci-dessous, p. 185 et p. 202 note 71.
30. A notre connaissance, il n'existe aucune tude sur le rapport de Marx aux statistiques ou
l'esprit probabiliste du XIXesicle.
31. Les dlibrations de la sixime Dite rhnane, 1er article, Dbats sur la libert de la
presse, Gazette Rhnane, 5 mai 1842, in uvres (d. Rubel), 1. 3, p. 140; MEW l, pp. 29-30.
32. Ibid.
-
La dernire phrase est une allusion Lorenz Oken, fondateur de l'ostologie
philosophique et proche de Schelling. S'inspirant de la philosophie de l'identit de Schelling, Oken
considrait que tous les phnomnes naturels taient des nombres en mouvement. (Ces prcisions
sont fournies par M. Rubel (ibid., p. 1525, note 3 de la p. 140).
33. Le capital, 1. 2, p. 233; trad. Lefebvre, p. 631; MEW 23, p. 587.
34. Ibid.,t. 6, p. 252; MEW 25, p. 250.
-
Dans ce passage, Marx discute l'ide selon laquelle
la chute du taux de profit s'expliquerait par une hausse du taux du salaire: Il n'est pas de plus
grande niaiserie dit-il, bien qu'exceptionnellement le cas puisse se produire". En effet, la chute
tendancielle du taux de profit s'allie une hausse tendancielle du taux de la plus-value [...] Le taux
200 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
de profit ne baisse pas parce que le travail devient moins productif, mais parce qu'il le devient
plus (ibid.).
35. Thories, t. 2, p. 144; MEW 26-2, p. 127. - Les priodes d'annes,) considres par
Marx taient des priodes de dix et de cinquante ans qui couvraient plus de deux sicles, de 1641
1859. Il indique qu'on doit carter les chiffres des annes o il y eut une dvaluation de la
monnaie ou bien une scheresse exceptionnelle (ibid.).
36. Ce qui est intressant dans la pratique et ncessaire pour la thorie ne concide pas du
tout en conomie politique, voil la calamit, si bien qu'on n'y trouve mme pas, comme dans
d'autres sciences, la documentation requise (L. Engels du 16 mai 1868, Correspondance, t. IX,
p. 234; MEW 32, p. 88).
- A diverses reprises, dans ses lettres des annes soixante, Marx demande
Engels des donnes prcises sur la rotation du capital circulant dans l'entreprise o travaillait
son ami.
37. Le capital, (Prface de la 1red.), t. l, p. 19; trad. Lefebvre, p. 5; MEW 23, p. 15.
38. Cf. L. Engels du 16 mai 1868, Correspondance, t. IX, p. 233; MEW 32, p. 88.
39. Le 7 mai 1868, Marx demande Engels de nouveaux renseignements sur la rpartition du
capital dans l'usine de G. Ermen, pour que je puisse, dit-il, utiliser les donnes de la page 186
sur votre fabrique -
qui suffisaient amplement pour illustrer le taux de la plus-value - pour le
taux de profit (Correspondance, t. IX, p. 228; MEW 32, p. 82). La rfrence p. 186 , renvoie
au chapitre du Capital sur le taux de la plus-value (ES, t. l, p. 210; trad. Lefebvre, p. 237; MEW
23, p. 226). Dans les ditions ultrieures, Marx actualisa ses chiffres en remplaant ceux de 1860
fournis par Engels, par ceux de 1871, procurs eux aussi par Engels.
40. Anti-Dhring,
PI'.
267-268; MEW 20, p. 218. Trad. modifie, celle de M. Bottigelli tant
trs maladroite dans ce passage; elle ne permet pas de bien saisir ce que Marx dit exactement de
W. Petty. Soulignons que Marx a crit le chapitre de l'Anti-Dring intitul: Sur "L'Histoire
critique" (ibid.,
PI'.
261 et suiv.;
PI'.
21 I et suiv.).
41.
(c
Le Conseil Gnral remercie la section de Berlind'avoir dj constitu une commission
de la statistique (L. F. Jozewicz du 24 fvr. 1872, MEW 33, p. 409. Trad. par nous.)
42. Les grands dveloppements thoriques sur ce point n'interviendront qu'au tournant des
XIXeet xx. sicles. G. DARMOIS(op. cit., p. 76) crit qu'il a fallu [...] attendre jusqu'en 1888-1889
pour que Galton voie clairement et dise ce qu'est la corrlation , c'est--dire la liaison de
probabilit, ou liaison stochastique. Marx, comme Qutelet et tous les savants de son temps, ne
pouvait se fonder en matire d'interprtation statistique que sur la conception laplacienne et
gaussienne de la probabilit.
43. dit dimbourg en 1842, cet ouvrage tait la traduction anglaise du premier grand
livre publi par Qutelet en franais: Sur l'homme et le dveloppement de ses facults, (op. cit.:
Physique sociale). C'est Louis Villerm, statisticien connu pour ses enqutes sociales dans le Nord
de la France, qui en avait surveill l'impression Paris.
44. Paru Paris, chez Guillaumin en 1848 (abrg en Systme social. Selon M. RUBEL
(Marx, uvres, t. l, p. 1662, n. 1 de la p. 861), Marx l'aurait relu en 1865. Seule la lecture du
premier de ces deux ouvrages est signale par Franz NEUBAUER(Marx-Engels Bibliographie, p. 82,
sous X/XI, in fine).
45. CLI'Index des noms de personnes, in MEWt. 23, p. 909, col. A: Qutelet. L'Index des
ditions sociales (Le capital, t. 3, p. 286, col. 2) ne reproduit pas cette apprciation.
46. Le capital, t. 2, p. 17, note 1; MEW 23, p. 342. Les parenthses sont de Marx. Le
soulignement n'est pas reproduit par les MEW (cf. MEGA, t. II/S, p. 261).
47. Ibid.
48. Ibid.
49. Ibid.
50. Une moyenne n'existe qu'entre grandeurs de mme dnomination (ibid., p. 16; p. 342).
51. Ibid., p. 17; p. 342.
52. Le capital, t. 8, p. 236; MEW 25, p. 868. (Trad. modifie. Mme Cohen-Solal et M. Badia
traduisent veriindern par altrer . Cette traduction est un contre-sens: en franais, altrer la
productivit veut dire la diminuer, alors qu'il s'agit au contraire de son augmentation, de son
amlioration. Remarquons en outre que, dans cette page, les mmes traducteurs rendent
Produktivkraft [littralement, force productive] par productivit).
53. Il convient de distinguer le travailleur collectif du travailleur moyen . Dans le
travailleur collectif se produit un effet qualitatif qui dpasse la simple runion arithmtique des
forces ou qualits des travailleurs individuels. Ce que nous disons ici du travailleur moyen ne
pourrait donc s'appliquer sans prcaution aux notions de force ouvrire collective ou de
LA POSSIBILIT CONCRTE
201
capital collectif par lesquels, prcisment, Marx dpasse le strict point de vue quantitatif
impliqu dans la notion d'homme moyen.
54. Ce qu'il critique chez Qutelet n'apparat pas dans Le capital, o Marx semble plutt
prendre soin de ne pas critiquer publiquement le savant belge.
55. Trois de ces mentions sont pisodiques, dont une humoristique (cf. L. Lassalle du
Il mars 1858, Correspondance, t. V, p. 158; MEW29, p. 553, et L. Engels du 21 aot 1875, MEW
34, p. 6). La Neue Oder-Zeitung (Nouvelle Gazette de l'Oder) publia le 8 fvr. 1855 un article o
Marx, voquant la dure moyenne des crises ministrielles anglaises, renvoie au clbre ouvrage
sur" Les facults de l'homme" de Qutelet (cf. MEW I l, p. 44).
56. L. Kugelmann du 3 mars 1869, Correspondance, t. X, p. 42; MEW 32, p. 596. - Selon
toute vraisemblance, la proposition faite par Kugelmann de s'adresser Qutelet devait
concerner l'enqute statistique ouvrire que Marx rclamait aux Sections de l'A.I.T. - Marx avait
probablement raison de penser irralisable une collaboration de Qutelet, qui tait vieux et
diminu depuis un accident de sant survenu en 1855. En outre, Marx souhaitait que des
conclusions thoriques, et certainement aussi politiques, soient tires de telles enqutes, de faon
qu'elles ne s'achvent pas dans la publication de simples tables statistiques. II estimait que
Qutelet, vu ses ouvrages antrieurs et leurs rditions sans changements majeurs, n'aurait pu, sur
le plan thorique, raliser cette partie du programme.
- En 1866, pour qu'on labore des
statistiques ouvrires, Marx avait propos un questionnaire soumis au Congrs de Genve de
l'A.I.T. En 1880, il rdigera un nouveau questionnaire, beaucoup plus dtaiII. Ce programme
d'une Enqute ouvrire fut publi par Benot Malon dans le
n
4 de La revue socialiste, le 20
avril 1880 (cf. MEW 19, pp. 230-237, et uvres (d. Rubel), t. I, pp. 1527-1536).
57. Simon-Denis POISSON,Recherches sur la probabilit des jugements en matire criminelle
et en matire civile, Paris, Bachelier, 1838, p. 12 et pp. 246 sq. (cit dans Histoire gnrale des
sciences, t. 3, 1repartie, p. 80).
58. Cf. HANKINS, op. cit., et Maurice HALBWACHS, La thorie de l'homme moyen, Essai sur
Qutelet et la statistique morale, Paris, 1912.
-
Cependant, M. G. Darmois, propos du concept
d'homme moyen crit: <,Joseph Bertrand s'en est moqu, et mme de faon spirituelle, mais on
pourrait aussi plaisanter Bertrand de n'avoir pas vu qu'il
y avait quelque chose de trs important
dans l'<<homme moyen. On peut aussi sourire quand on entend Qutelet nous dire: L'urne que
nous interrogeons, c'est la nature , mais comme l'a remarqu Keynes, on serait amen rflchir
assez profondment si l'on nous prsentait cette remarque: La nature que nous interrogeons,
c'est une urne (Histoire Gnrale des Sciences, loc. cit., p. 79.)
59. Ibid. p. 77.
60. Dans cette perspective, il faut rappeler que Marx s'est senti si proche des conceptions de
Darwin qu'il a pu crire au sujet de L'origine des espces: [...] c'est l le livre qui contient, sur
le plan de l'histoire naturelle, le fondement [Grundlage] de notre conception (L. Engels du
19 dco 1860, Correspondance, t. VI, p. 248; MEW 30, p. 131.)
61. La peine de mort [...], New York Daily Tribune,
n
3695, 18 fv. 1853; MEW8, p. 509;
trad. par nous.
-
La phrase que Marx attribue Qutelet ne se trouve pas littralement dans la
Physique sociale o on lit: Les phnomnes moraux, quand on les observe en masses,
rentreraient en quelque sorte dans l'ordre des phnomnes physiques (Physique sociale, 1869,
t. 1, p. 98). Qutelet a remani son ouvrage. Mais, pour cette phrase, le texte est identique dans
la Ire d. (cf. Physique sociale, 1835, pp. 96-97). Marx cite-t-il de mmoire ou d'aprs des notes de
lecture approximatives? Utilise-t-il d'autres sources? Qutelet a publi de trs nombreux
Mmoires et divers crits que Marx pouvait connatre.
62. Ces phrases clbres furent cites bien des fois, ainsi par Henri de Brouckre la
Chambre belge des reprsentants le 4 juillet 1832, lors d'une intervention en faveur de l'abolition
de la peine de mort (Moniteur belge, 2e anne,
n
188, 6 juill. 1832). C'est sur eUes que se terminait
l'un des premiers Mmoires o Qutelet laborait son systme sociologique: Recherches sur le
penchant au crime aux diffrents ges (Bruxelles, 1831). II
y reprenait des ides dj avances en
1828 dans ses Recherches statistiques sur le Royaume des Pays-Bas: Ce qui frappe le plus au
milieu de tous ces rsultats, c'est l'effrayante exactitude avec laqueUe les crimes se reproduisent...
Ainsi l'on passe d'une anne l'autre, avec la triste perspective de 'loir les mmes crimes se
reproduire dans le mme ordre et attirer les mmes peines dans les mmes proportions. Triste
condition de l'espce humaine! La part des prisons, des fers et de l'chafaud semble fixe pour eUe
avec autant de probabilit que les revenus de l'tat. Nous pouvons numrer d'avance combien
d'individus souilleront leurs mains du sang de leurs semblables, combien seront faussaires,
combien empoisonneurs, peu prs comme on peut numrer d'avance les naissances et les dcs
qui doivent avoir lieu (cit in Adolphe Qutelet 1796-1874, Mmorial Adolphe Qutelet, publi
202 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
l'occasion du Centime Anniversaire de sa mort, Bruxelles, Duculot, 1974. (Nous abrgerons ce
titre en Mmorial A. Qutelet.)
63. Physique sociale, t. l, p. 98.
64. Ibid.
65. Prcisons que c'est seulement en 1845 que Qutelet entreprit un traitement rellement
mathmatique des statistiques et qu'il mentionna la distribution normale, ou distribution
binomiale.
66. Mmoire sur les lois des naissances et de la mortalit Bruxelles , Nouveaux Mmoires
de l'Acadmie Royale des Sciences et Belles Lettres de Bruxelles, t. III, 1826, p. 496.
67. Du systme social ou des lois qui le rgissent, Paris, Guillaumin, 1848, Prface, p. xi.
68. Ibid., p. 15.
69. Note sur la loi des causes accidentelles . Ibid., p. 305.
70. Physique sociale (1869), p. 108.
71. Il faudrait pouvoir dterminer avec prcision le contenu des enseignements qu'il reut au
lyce de Trves dans les annes 1830-1836. Dans sa biographie monumentale, Auguste Cornu dit
peu de choses (cf. Karl M arx et Friedrich Engels, t. 1er,Les annes d'enfance et de jeunesse, La
gauche hglienne, 1818/1820: 1844, Paris, Presses Universitaires de Franc, 1855, p. 61). On sait
que le professeur de sciences naturelles faisait tudier des sries d'observations mtorologiques
faites avec les lves (cf. MEGA Ill, App., p. 1201). Or, Qutelet avait appliqu les mthodes
statistiques l'examen de certains phnomnes mtorologiques. La grande renomme de
Qutelet dans les annes trente, et l'orientation gnrale des tudes Trves, o bien des
professeurs avaient des ides avances, ont d donner trs tt Marx une orientation de pense
scientifique, et ce got pour les sciences concrtes qu'il manifesta tout au long de sa vie.
n. Contribution, p. 4; MEW 13, p. 8. (Dj cit supra, p. 47).
73. Physique sociale, p. 301 (cit in Mmorial A. Qutelet, p. 99).
74. Ibid., p. 306.
75. Ibid.
-
Nous avons rencontr la mme position chez Cournot.
76. Il se dfendit pourtant de porter atteinte au libre-arbitre individuel, en particulier dans
son mmoire de 1846 sur la Statistique morale. De mme, Herschel dfendra la Physique sociale
contre les lecteurs superficiels et les penseurs qui prirent les rsultats des statistiques sur la vie,
l'accident, le crime, etc., comme des indications sur l'absence de libre-arbitre chez les tres
humains (cit in Mmorial A. Qutelet, p. 165).
77. La peine de mort, New York Daily Tribune,
n
3695, 18 fvr. 1853; MEW 8, p. 508.
Trad. par nous.
78. Physique sociale, t. l, p. 97. - Ce passage suit immdiatement la citation de Qutelet faite
par Marx.
79. Recherches statistiques... (op. cit., cit in Mmorial A. Qutelet, pp. 86-87).
80. Ses liens avec le pouvoir royal et les princes, qui il enseigna les fondements et les
applications du calcul des probabilits, l'ont-ils contraint la prudence? Pourtant, dans de tels
passages, il semble avoir dit le fond de sa pense.
81. Cette phrase est tire de l'Essai philosophique sur les probabilits (op. cit.).
82. Marx chercha recourir au calcul infinitsimal auquel il s'est beaucoup intress, non
seulement pour ses applications, mais aussi d'un strict point de vue thorique. M. Alcouffe le
montre trs bien dans son dition des Manuscrits Mathmatiques de Marx, dont il donne une
excellente prsentation. Les ditions Sociales avaient dj fourni un aperu de ces travaux de
Marx sur l'histoire des Mathmatiques en traduisant des extraits de l'dition russe de 1968
(cf. Lettres sur les sciences de la nature, pp. 129-151).
83. J'ai tent, diffrentes reprises, de calculer - pour analyser les crises -
ces ups and
downs [hauts et bas] [dans les tableaux de prix] comme on analyse des courbes irrgulires, et j'ai
cru possible (et je crois encore que c'est possible, l'aide d'une documentation choisie avec soin)
de dterminer mathmatiquement, partir de l, les lois essentielles des crises (L. Engels, 31
mai 1873, in Lettres sur Le capital, p. 272; MEW 33, p. 82). Marx avait tent d'intresser un ami
vers en mathmatiques, Samuel Moore, cette mathmatisation de l'conomie (cf. ibid.).
84. Qutelet le qualifie d'tre fictif, bien que les moyennes qui le dcrivent restent relles:
La considration de l'homme moyen est tellement importante dans les sciences [...] qu'il est
presque impossible de juger de l'tat d'un individu sans le rapporter celui d'un autre tre fictif
qu'on regarde comme tant normal et qui n'est au fond que celui que nous considrons (Physique
sociale, cit in Mmorial A. Qutelet, p. x).
85. Du systme social, p. 30 et suiv.
-
En 1871, Qutelet crit: La principale ide pour moi
est de faire prvaloir la vrit et de montrer combien l'homme est soumis son insu aux lois
LA POSSIBILIT CONCRTE 203
divines et avec queUe rgularit il les accomplit" (Anthropomtrie ou mesure des diffrentes facults
de l'homme, BruxeUes/Leipzig/Gand, C. Mucquardt, p. 21). M. G. Canguilhem, qui cite ce
passage, fait remarquer que s'il peut paratre discutable de remonter jusqu' la volont de Dieu
pour rendre compte du module de la taille humaine, cela n'entrane pas pour autant qu'aucune
norme ne transparaisse dans cette moyenne (Essai sur quelques problmes concernant le normal et
le pathologique, Paris, Presses Universitaires de France,
4'
d., 1979, p. 101.)
86. Les idologies scientifiques seraient [...] des idologies de philosophes, des discours
prtention scientifique tenus par des hommes qui ne sont encore, en la matire, que des
scientifiques prsomptifs ou prsomptueux (Idologie et rationalit dans l'histoire des sciences de
la vie, Paris, Vrin, 1977, p. 44). M. Canguilhem donne comme exemples l'atomisme du XIX' sicle,
et l'volutionnisme de Spencer. La thorie de l'homme moyen de Qutelet, discours prtention
scientifique, serait peut-tre un exemple d'idologie scientifique.
-
On ne doit pas les
confondre selon M. Canguilhem, avec des idologies de scientifiques, c'est--dire des idologies
que les savants engendrent par les discours qu'ils tiennent pour thmatiser leurs mthodes de
recherche et de mise en rapport avec l'objet, par les discours qu'ils tiennent sur la place que la
science occupe, dans la culture, relativement aux autres formes de culture. Les idologies de
scientifiques sont des idologies philosophiques (ibid., pp. 43-44).
87. Si eUes ont connu plusieurs ditions de son vivant, les uvres de Qutelet ne furent pas
rdites depuis sa mort.
88. Discutant des irrgularits dans la croissance l'adolescence, il estime qu'eUes sont
produites par les modes de vie qui drangent le cours rgulier de la croissance natureUe , que <<la
nature ne procde pas par mouvements brusques. De mme, s'il admet des variations des
moyennes au cours des sicles, eUes sont minimes devant le fait majeur, la constance, et devant la
marche rgulire de la nature (cf. Du systme social, pp. 23-27).
89. L'intrt de la conception de Qutelet est en ceci qu'il identifie dans sa notion de
moyenne vritable les notions de frquence statistique et de norme (Essai, op. cit., p. 101).
90. Le capital, chapitre L: L'illusion de la concurrence, t. 8, p. 229 et suiv.; MEW 25,
p. 860 et suiv.
91. Ibid., t. 2, pp. 208-209; trad. Lefebvre, p. 602; MEW 23, p. 560. Trad. modifie.
92. Ibid., t. 8, p. 240; MEW 25, p. 871.
-
Marx parle encore ici de prix du travail, alors
qu'il faut comprendre prix de la force de travail .
93. Ibid., t. 6, p. 222; p. 219.
94. Ibid., t. 7, p. 23; p. 368.
95. Ibid., t. 8, pp. 240-241; pp. 872-873. Mot soulign par nous.
96. Ibid.
-
Le texte peut paratre quivoque par son laconisme: il faut comprendre que la
concurrence augmente ou diminue le profit... pour un capitaliste pris en particulier! En effet, pour
lui, les circonstances peuvent faire qu'il soit favoris ou dfavoris.
97. Ibid., p. 241; p. 873.
-
Marx voque souvent la thorie de la concurrence. Elle est
prsuppose partout dans Le capital; dans le livre III, il dit: L'tude de la concurrence [...] n'est
pas traite dans le prsent ouvrage (ibid., t. 6, p. 248; p. 245). II envisageait sans doute d'en
traiter quelque part dans sa vaste entreprise de critique de l'conomie politique, dont les trois
livres du Capital ne formaient qu'une premire partie! En aurait-il trait propos du commerce
extrieur et du march mondial (cf. le plan esquiss in Contribution, dbut de la Prface, p. 3;
MEW 13, p. 7)7
98. Le capital, t. 6, p. 269; MEW 25, p. 267.
99. Ibid., pp. 257-258; pp. 254-255. Trad. modifie.
100. Ibid., p. 265; pp. 262-263. Trad. modifie et mot soulign par nous. La concurrence (la
lutte) est une condition sine qua non pour le capital. II faut se reporter au contexte pour
comprendre: il s'agit des contradictions internes de la loi de la baisse tendancieUe du taux de
profit , diverses situations tant envisages successivement par Marx (ibid.).
101. Ibid., t. 6, p. 322; p. 325. Trad. modifie.
102. Ibid., t. 8, p. 255; p. 887. Trad. modifie, ceUe des ditions sociales tant particulire-
ment dfectueuse ici (cf. aussi uvres (d. Rubel), t. 2, pp. 1478-1479, o le texte aUemand est
traduit de manire plus littrale).
103. Le capital, t. 6, p. 198; MEW25, p. 192. Trad. modifie.
104. Le fait que la valeur individuelle de la marchandise correspond sa valeur sociale est
maintenant plus rel et mieux dfini [...]. (Ibid.)
105. Pour exposer la chose de la faon la plus facile, nous considrons d'abord que toute
la masse de marchandises est issue d'une seule branche de production, qu'elle reprsente une seule
204 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
marchandis.e et que la somme des prix de la multitude de marchandises identiques est condense
en un seul prix. (Ibid., t. 6, p. 198; pp. 191-192. Trad. modifie.)
106. Ibid. Trad. modifie. Mme Cohen-Solal et M. Badia n'ont pas distingu entre moyen
et (<intermdiaire , diffrence qui est pourtant fort nette en allemand; ils traduisent les deux
termes allemands par moyen, de sorte que le texte franais occulte le sens de cette page du
Capital.
107. Marx parle indiffremment de la valeur intermdiaire [mittlere Wert], ou de la masse
intermdiaire [mittlere Mass], ce qui ne facilite pas la comprhension.
108. Le capital, trad. Lefevbre, p. 43; ES, t. 1, p. 54; MEW 23, p. 52.
109. Ibid., p. 43; p. 54; p. 53. Trad. modifie.
110. Ibid., p. 44; pp. 54--55; p. 53. Trad. modifie.
-
On remarquera que l'on a ici l'identit
de choses diffrentes: la valeur est justement cette (<identit .
111. Ibid. Soulign par nous.
112. Ibid.
113. Moyen, social, normal, ncessaire, sont des termes synonymes.
114. C'est prcisment la formule que Marx emploie dans le troisime des cas distingus il y
a un instant: Si, dans le cas III, la quantit des marchandises produites d,ansles conditions les
plus favorables occupe une assez grande place, non seulement par rapport l'autre extrme, mais
par rapport aux conditions mdianes, la valeur de march tombe au-dessous de la valeur mdiane"
(ibid., t. 6, p. 200; MEW 25, p. 194. Trad. modifie et soulign par nous). Au dbut du Capital,
Marx prend justement un exemple historique concret de ce cas
n
III.
115. Le capital, trad. Lefebvre, pp. 44-45; ES, t. 1, p. 55; MEW 23, p. 54 (soulign par nous).
Chapitre 5
L'HISTOIRE
Le progrs ne se tient pas au-
dessus du cours des choses
humaines comme un destin ou un
fatum, ou comme une prescription
lgale.
Antonio LABRIOLA
L'histoire fait son apparition dans la thorie conomique elle-mme avec
la notion de tendance, car une tendance a un caractre historique. Ce sont
donc les lois tendancielles qui retiendront d'abord notre attention.
Les lois ou les causes, mme multiples et diverses, ne fournissaient que des
possibilits abstraites. La possibilit concrte s'est manifeste avec les
moyennes. Celles-ci, en effet, supposent qu'on admette l'infinie varit
possible des comportements individuels.
Avec les tendances, il s'agit d'une nouvelle forme de possibilit concrte:
la possibilit historique. Dans une tendance, la ncessit n'exclut pas la
possibilit, mais au contraire l'inclut. Une tendance" exprime une ncessit
qui n'est encore qu' l'tat de possibilit.
La notion de tendance historique conduit d'autres catgories, en
particulier celle de dveloppement historique". Dans un dveloppement
historique, on a affaire la fois une ncessit et une possibilit, qui
deviennent des catgories synonyms. Nous examinerons donc les notions de
dveloppement et de ncessit historiques.
Nous nous demanderons ensuite en quel sens Marx parlait de science"
propos de l'histoire. Nous avons fait remarquer qu'il n'use gure de
l'expression lois de l'histoire". De mme, plutt que de science de l'his-
toire", il parle de sa conception matrialiste de l'histoire".
Enfin, parler de tendance et de dveloppement historiques, n'est-ce pas
206 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
admettre qu'une finalit se manifeste en histoire? Comment Marx la conce-
vait-il dans le cadre de son matrialisme? Si le matrialisme historique est une
conception finaliste de l'histoire, de quelle nature est cette finalit? De quelles
fins matrielles est-il alors question?
1. Les tendances
Toutes les lois conomiques sont historiques . Mais certaines, les lois
tendancielles, le sont tout particulirement; surtout l'une d'entre elles, la plus
clbre, la loi de la baisse tendancielle du taux de profit.
Notre objet n'est pas d'tablir que cette loi dcoule bien des thories de la
valeur et de la plus-value (c'est--dire de la thorie de l'exploitation et de celle
de l'accumulation capitalistes). Cette dduction marxienne fut trs controver-
se. Elle a fait couler beaucoup d'encre et divise toujours les conomistes '.
Nous nous limiterons l'examen du sens gnral, pistmologique et
philosophique, de cette loi tendancielle dans la conception historique de Marx,
dans la mesure o notre but est de chercher dgager les rapports entre
ncessit et possibilit tels qu'ils apparaissent dans des lois de ce genre.
Pour Marx, comprendre cette loi, c'est comprendre l'volution historique
du mode de production capitaliste. Elle est prcisment la loi de dveloppe-
ment" qui prside la marche de l'histoire de la socit bourgeoise
moderne", dit la prface du Capital. Elle rsulte de son histoire passe et
dcide de son destin futur.
La baisse du taux de profit dcoule directement de la formule du taux de
profit: t =~, et des conditions gnrales de la production en rgime
c+v
capitaliste2. L'accroissement du capital constant par rapport au capital
variable est ncessit par la concurrence que se font les capitalistes entre eux.
Pour subsister, chaque capitaliste individuel doit accrotre la productivit
des moyens de production qu'il contrle. Cet accroissement peut s'obtenir
principalement par l'emploi de nouvelles forces naturelles plus puissantes,
grce des machines par exemple. C'est pourquoi le capital constant,
reprsent par
c"
dans la formule ci-dessus, subit ncessairement une hausse,
ce qui diminue justement le taux de profiP.
Mais, pourquoi cette loi se manifeste-t-elle essentiellement sous forme de
tendance? Parce que toutes sortes de causes contraires s'en mlent. Pour
empcher la chute du taux de profit, le capitaliste profite de l'accroissement de
la productivit pour hausser la plus-value (le numrateur de la formule): il
intensifie l'exploitation. Il y a l de larges possibilits:
La hausse du taux de la plus-value [...] est un des facteurs qui
dterminent la masse de la plus-value et, partant, le taux de profit galeJ;I1ent.
Ce facteur ne supprime pas la loi gnrale. Mais il fait en sorte qu'elle agit
LA POSSIBILIT CONCRTE 207
plutt comme une tendance [aIs Tendanz], c'est--dire comme une loi dont la
ralisation absolue est arrte, ralentie, affaiblie par des circonstances qui la
contrecarrent4.
Une loi exprime toujours une ncessit; mais c'est une ncessit relative
puisqu'une loi conomique ne s'exerce que dans des conditions donnes: elle
implique certains rapports de production. Si elle n'agit que de faon tendan-
cielle, cette ncessit est, pour ainsi dire, doublement relative. Il y a toute une
srie de causes qui peuvent agir en sens contraire. Mais ces causes contraires
ont aussi leurs limites. Elles sont autant de possibilits concrtes qui s'offrent
pour retarder l'effet de la loi ou l'annuler.
Si le capitaliste accrot le degr d'exploitation de la force de travail, c'est-
-dire prlve davantage de plus-value (le numrateur de la formule ci-dessus)
en baissant la part qu'il consacre aux salaires, il se heurte la rsistance de la
classe ouvrire ou des limites naturelles: la longueur de la journe de travail
n'est pas indfiniment extensible.
Il est possible aussi de rduire le salaire au-dessous de sa valeur par
l'inflation ou en diminuant le cot de production des biens de consommation
courants des travailleurs, ou par d'autres expdients. Marx indique laconique-
ment: c'est une des causes les plus importantes qui contrecarrent la tendance
la baisse du taux de profitS
".
n existe encore beaucoup d'autres possibilits et facteurs qui font obstacle
la loi: la baisse du prix des lments du capital constant (grce la baisse de
la valeur des objets d'utilit du fait de l'accroissement gnral de la producti-
vit), la surpopulation relative (qui exerce une pression sur les salaires), le
commerce extrieur accru, la transformation du capital en capital par actions,
etc.6. videmment, ces possibilits peuvent se combiner; la volont et
l'arbitraire individuels se donnent libre cours: chacun cherche dfendre sa
situation, et, la plupart s'efforcent d'en tirer le maximum d'avantages.
Du fait de toutes ces causes contraires, la loi ne s'impose qu' travers
toutes sortes de dtours:
Thoriquement, lorsque, par suite de l'augmentation de la producti-
vit, [...] le prix des marchandises baisse, le taux de profit pourrait rester le
mme. [... Il] pourrait mme s'lever [...]. Mais en ralit, la longue, il
baissera 7.
La loi ne se rvle aux conomistes ou aux producteurs que dans le long
terme. Elle n'apparat clairement aux yeux de tous qu' certains moments qui,
pour cette raison, semblent exceptionnels. Cette loi ne prsente donc pas les
caractres habituels auxquels on reconnat gnralement les lois: constance,
simplicit, rgularit, permanence. Les circonstances dans lesquelles elle
devient visible sont singulires, historiques: ce sont les priodes de crises.
208 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
La loi n'agit que sous forme de tendance [nur ais Tendanz] dont l'action
[Wirkung] n'apparat de faon frappante que dans des circonstances dtermi-
nes et sur de longues priodes de temps8.
En temps ordinaire, la loi n'apparat pas, mais plutt son contraire: la
hausse du taux de profit! Devant toutes les possibilits de retarder et
contrecarrer l'action de la loi, sa ncessit semble disparatre.
Une tendance, objectent certains9, est-ce encore une loi? Marx rpondait
par avance que si la loi ne se manifeste que comme une simple tendance ,
c'est qu'elle recouvre une contradiction, non pas une contradiction subjec-
tive" et purement apparente, ni non plus une contradiction individuelle 10,
mais une contradiction spcifique, la contradiction essentielle du mode de
production capitaliste.
.
C'est de cette loi que Marx dit qu'elle est la connexion interne et
ncessaire entre deux choses qui se contredisent dans les phnomnes appa-
rents 11. Chaque palliatif, explique-t-il, n'a qu'une action temporaire et finit
par avoir des effets contraires ceux qui taient viss. La contradiction
principale se dveloppe en multiples contradictions: il y a discordance et non
plus correspondance 12.
Ces contradictions internes de la loi 13proviennent du fait que la mme
cause, l'accroissement du capital constant, engendre des effets opposs.
L'origine en est la disproportion [Missverhaltnis] qui a sa source dans
l'exploitation capitaliste du travail, disproportion entre l'accroissement du
capital et la diminution relative du besoin qu'il a d'une population en
augmentation 14. Avec plus de moyens matriels de production, il faut,
relativement, moins de travailleurs!
Le capitaliste individuel est pris entre deux impratifs opposs, d'o les
tendances antagonistes qui s'exercent sur lui:
D'une part, sur une quantit de travail donne, en transformer le plus
possible en plus-value, d'autre part, utiliser somme toute le moins de travail
possible par rapport au capital avanc, de sorte que les mmes raisons qui
permettent d'augmenter le degr d'exploitation du travail interdisent d'ex-
ploiter autant de travail qu'auparavant avec le mme capital total. Voil les
tendances antagonistes [...] 15.
Finalement, la cause de la contradiction et du caractre tcndanciel de la
loi, c'est le dveloppement de la productivit impuls par le capitaliste qui doit
dfendre son capital dans la concurrence et maintenir les conditions capita-
listes de la production. Le mouvement qu'il est contraint de donner la
production impose cependant une barrire son dveloppement:
Voici en quoi consiste la contradiction: le mode de production
capitaliste implique une tendance un dveloppement absolu des forces
productives, sans tenir compte de la valeur [...], tandis que, par ailleurs, le
LA POSSIBILIT CONCRTE
209
systme a pour but la conservation de la valeur-capital existante et sa mise en
valeur au degr maximum 16.
Si la loi de la baisse tendancielle du taux de profit ne se manifeste que
comme une tendance, cela ne semble pas tre le cas des autres lois: loi de la
valeur, lois de l'change, etc.
Pourtant, la pense profonde de Marx est que ce caractre tendanciel
affecte toute les lois. Il arrive Marx de le dire en termes exprs dans une
remarque incidente: Si nous avons admis l'existence d'un taux gnral de la
plus-value qui, comme toute loi conomique, n'est en fait qu'une tendance,
c'tait pour simplifier l'tude thorique 17.
Mais s'agit-il toujours du mme genre de tendances? Nous allons nous
arrter sur ce point qui est riche d'enseignements.
La loi de la baisse tendancielle du taux de profit exprime la contradiction
essentielle du mode de production capitaliste; or, nous venons de le voir, elle
ne se manifeste que dans le long terme.
Par contre, l'existence d'un taux gnral de plus-value a un caractre
permanent. La tendance, ici, s'exerce dans le court terme: les innombrables
fluctuations et compensations quotidiennes font que le taux de la plus-value
s'tablit rapidement son niveau moyen 18.
C'est une tendance qui ralise un
quilibre gnral peu prs rgulier et non une baisse irrgulire!
Le concept de tendance prend donc un sens diffrent selon les phno-
mnes concerns. Dans certains processus, c'est la tendance l'quilibre qui
l'emporte, dans d'autres c'est la tendance au dsquilibre. Dans le premier cas,
ce sont les compensations qui prvalent: dans le second, ce sont les carts}}
qui vont s'aggravant.
Il convient par consquent de bien distinguer ces deux types de tendances.
Dans lequel de ces deux types rangera-t-on alors l'tablissement du taux de
profit moyen que Marx dcrit aussi l'aide du concept de tendance?
Somme toute, dans l'ensemble de la production capitaliste, c'est
toujours seulement d'une manire trs complexe et approche que la loi
gnrale se fraye un chemin [durchsetzt] comme la tendance dominante [aIs
die beherrschende Tendanz], comme moyenne de fluctuations ternelles
impossibles fixer fermement [festzustellen].
-
Puisque le taux gnral de
profit est constitu par la moyenne [durch den Durchschnitt] des divers taux
de profit correspondant chaque fraction de 100 du capital avanc pour un
laps de temps dtermin, disons un an, l'cart provenant de la diffrence des
temps de rotation pour des capitaux divers s'y trouve galement effac
[ausgeloscht] 19.
La compensation dont il s'agit dans l'tablissement du profit moyen n'est
pas une compensation au sens statistique du terme: c'est une rpartition au
prorata de la grandeur de chacun des capitaux et au prorata du temps pendant
lequel ils sont investis dans la production et la circulation. La frquence des
210 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
carts ne vrifie pas la distribution normale ou courbe de Gauss. Or, il ne
s'agit pas non plus d'carts qui vont en s'amplifiant irrgulirement, comme
dans le cas de la baisse tendancielle du taux de profit.
Examinons de plus prs les rsultats obtenus. Les lois les plus simples
comme la loi de la valeur, les lois de l'change (marchand ou capitaliste),
agissent en tant que tendances l'quilibre:
L'change ou la vente des marchandises leur valeur est rationnel;
c'est la loi naturelle de son quilibre et c'est partir de cette loi qu'il faut
expliquer les carts et non inversement expliquer la loi elle-mme partir des
carts 20.
"
Avec la loi de la baisse tendancielle du taux de profit, on n'a pas du tout
le mme genre de phnomne, mais un changement progressif s'effectuant
d'une faon heurte, avec des -coups et des retours en arrire. En considrant
les choses sur le long terme, on peut certes encore comparer cette volution
aux fluctuations au hasard autour d'une moyenne. Mais alors que la moyenne
en priode normale est une moyenne relle pour la grande masse des produits,
ici le bas taux de profit vers lequel on tend est une ralit qui n'apparat que
dans des moments exceptionnels.
Mieux encore, c'est une ralit future! La baisse ressort d'une courbe
complique, une courbe en dents de scie >>, trs irrgulire. On ne conclut la
baisse que par extrapolation, et anticipation. D'une ligne imaginaire reliant les
points bas de cette courbe pris sur une longue dure, de l'ordre du sicle21, on
dduit l'existence profonde d'un mouvement historique .
Marx distingue bien ces diverses sortes de tendances quoiqu'il ne les thorise
pas d'une manire aussi explicite. C'est seulement en passant qu'il affirme que
les lois n'agissent que sous forme de tendances. Il n'en vient mettre l'accent
sur leur caractre tendanciel que lorsqu'il s'agit de phnomnes volutifs
irrguliers dont on ne peut dgager qu'une allure globale: c'est ici que
tendance prend son sens le plus concret, et que le mot est parfaitement
adquat.
Si l'on doit comprendre les lois de la valeur, de l'change, de la plus-value,
du taux moyen de profit, etc., comme des applications de la loi des grands
nombres en conomie politique, on ne le peut plus de la mme faon pour cette
loi de baisse tendancielle. Les priodes de crises o se manifeste cette baisse
sont trop peu nombreuses pour pouvoir la faire rentrer sous la loi des grands
nombres , mme l'chelle sculaire. Cependant, on constate que se dgage
une rgularit tendancielle22". Il s'agit d'une tendance historique , dont
Marx, avec les conomistes classiques, cherche les causes dans les conditions
fondamentales du rgime de production 23.
La tendance la baisse du taux de profit est une tendance au dsquilibre
et la rupture de tout le systme productif et social. Comment parler alors de
LA POSSIBILIT CONCRTE 211
simples fluctuations autour d'une moyenne , puisque c'est d'une volution
et d'une histoire qu'il s'agit?
La notion de loi en sort largie, conserve et dpasse. Nous avons vu que
toute loi n'est qu'une abstraction, qu'elle est plus ou moins approche. Mais,
la loi de la baisse tendancielIe du taux de profit est encore plus approximative
que les autres lois; plus concrte, elle est moins prcise. Elle comporte
nanmoins son propre type de ncessit. Malgr le caractre incertain du
niveau auquel s'tablira le taux de profit dans les priodes venir, cette loi
rsulte des conditions contradictoires immanentes au systme capitaliste; elle
exprime une ncessit qui est une ncessit historique incluant en elle
diverses possibilits temporelles.
Cette loi concerne tous les facteurs essentiels du tout social. A l'inverse
des lois plus immdiates et plus simples, elle est globale !:t complexe: elle
embrasse l'ensemble d'un systme socio-conomique dans son devenir, et les
tendances antagonistes qui le caractrisent donnent aux divers processus
sociaux l'allure d'une histoire .
La tendance gnrale est historique en un double sens: elle l'est par sa
forme, comme toute loi, car c'est la loi d'un systme donn historiquement. En
outre, elle l'est par son contenu: c'est elle qui dtermine ce que deviendra le
systme long terme.
Il y a donc tendance et tendance. Les tendances au dsquilibre sont bien
diffrentes des tendances l'quilibre. En consquence, il y a ncessit et
ncessit. Dans les deux cas, la ncessit s'impose travers les hasards de
fluctuations qui se suivent dans le dsordre, qui se compensent dans un cas, ne
se compensent pas dans un autre.
Dans un cas, les carts s'annulent rciproquement dans leur ensemble, et
dans un bref laps de temps: la journe, la semaine, le mois ou l'anne. Dans
l'autre cas, les carts se creusent si l'on prend de longues priodes de temps:
la dcennie, le demi-sicle ou le sicle. Des crises clatent, bloquant les circuits
financiers, engorgeant la sphre du commerce, dprimant l'appareil productif,
branlant, de proche en proche, tout le systme politique et social. Dans un
cas, les processus de compensation et le grand nombre assurent une stabilit et
un quilibre relatifs qui sont le trait dominant. Dans l'autre, la compensation
ne se ralise plus; la place, ce sont, tout coup, des oscillations amples et
dsordonnes travers lesquelles se profile un changement. Le fait saillant est
le dsquilibre qui grandit et s'aggrave.
Ce tableau doit tre complt, car il y a un autre type de phnomnes
tendanciels qui ne se ramne aucun des deux prcdents: les phnomnes
priodiques, lorsque les valeurs moyennes (prix, profits, etc.) passent alterna-
tivement par un maximum et un minimum: ce sont les cycles conomiques.
Ceux-ci prsentent des phases qui se suivent dans un ordre rgulier: dvelop-
pement , expansion, crise, dpression, contraction, et redmarrage. Dans un
cycle priodique, les carts ne se suivent pas au hasard . Ils se prsentent
dans un enchanement successif qui se rpte chaque retour du cycle.
212 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Les phnomnes cycliques sont eux-mmes de deux sortes selon que
l'amplitude des priodes est constante (cycles saisonniers, cycles de la repro-
duction simple24) ou selon qu'elle va en augmentant (reproduction largie),
auquel cas on a une sorte de mouvement en spirale. Compar aux deux types
de tendances dcrits ci-dessus, un cycle se caractrise par le fait que la
tendance l'quilibre et la tendance au dsquilibre s'y composent et, si l'on
peut dire, l'emportent alternativement et se dpassent .
.
Dans un processus comme la tendance la baisse du taux de profit, on n'a
ni cette rgularit des phases successives, ni des carts d'autant plus faibles que
leur frquence est plus grande. Ce n'est pas non plus l'accroissement rgulier
des minima et des maxima de la reproduction largie. Ce sont au contraire des
crises irrgulires et dsordonnes. Plus de maxima ni de minima par lesquels
passe rgulirement le systme. L'irrgularit n'est plus -l'exception; elle
devient la rgle!
Le taux gnral de profit n'a de sens que sur une priode peu tendue.
tudiant ce taux moyen, Marx dit que, la longue, il ne se maintient pas.
A court terme, les influences s'entrecroisent et se paralysent rciproquement.
Nous tudierons plus loin dans quel sens tendent en dernire instance les
fluctuations. Mais , ajoute-t-il, elles sont lentes 25.
En effet, il faut du temps pour que le capital social total modifie sa
rpartition dans les diffrentes branches de la production: Comme le taux
gnral de profit n'est pas seulement dtermin par le taux de profit moyen
dans chaque sphre, mais aussi par la rpartition du capital total entre les
diverses sphres particulires - rpartition qui se modifie sans cesse -, il en
rsulte une cause permanente de changements dans le taux gnral de
profit26.
C'est un caractre propre la production capitaliste de reposer sur ce
changement permanent et incessant, et de susciter ainsi une tendance histori-
que. Marx souligne la lenteur du changement: cette cause, son tour, se
neutralise elle-mme en grande partie dit-il, en raison du caractre perma-
nent et universel de ce mouvement 27.
Le capital ralentit sa chute par le jeu des rpartitions incessantes qu'il
opre entre les diverses sphres o il s'investit. La loi tendancielle la plus
profonde est contrecarre: elle ne se manifeste avec force qu'pisodiquement,
dans les moments o s'accumulent les difficults de conversion du capital.
Alors, se produisent dsordres, crises et luttes.
C'est donc par des vnements spectaculaires, dans des moment histori-
ques , que la ncessit inhrente la loi se manifeste: des crises conomiques!
Celles-ci peuvent servir de dtonateurs des rvolutions sociales plus ou
moins violentes. Elles sont inhrentes au systme capitaliste. Puisqu'il rvolu-
tionne constamment la production, il porte en lui une tendance permanente au
dsquilibre.
Du fait de ses aspects contradictoires, cette loi fondamentale a donn
lieu des apprciations diverses de la part des commentateurs. Marx, tantt
LA POSSIBILIT CONCRTE
213
souligne la lenteur avec laquelle se manifeste cette tendance, ce qui laisse
ouverte la possibilit d'une longvit prolonge du systme, tantt annonce
l'imminence de la chute fatale. M. Rubelle suspecte d'incohrence, opposant
certains passages du troisime Livre du Capital la Prface au premier Livre
date du 25 juillet 1867:
Les lois gnrales du capitalisme ne sont que des" tendances domi-
nantes", s'exprimant dans des" moyennes" purement fictives!" dit
M. Rubel. Mais poursuit-il: Plus ambitieusement, Marx reparlera, dans la
Prface du Capital; de "lois naturelles de la production capitaliste" et de
"tendances qui se manifestent et se ralisent avec une ncessit de fer" 28.
"
Autrement dit, Marx a tenu deux langages diffrents. ,Or, constater une
certaine lenteur dans le dveloppement historique pass d'une tendance
sculaire, et envisager la probabilit d'une imminente rvolution sociale du fait
qu'une crise conomique se profile, n'est nullement incohrent29.
L'analyse historique et thorique montre que la ncessit implique dans
la tendance gnrale ne s'impose qu'avec le temps, puisqu'il y a toutes sortes
de moyens pour tenter de retarder l'chance.
D'ailleurs, M. Rubel attache au mot naturel dans loi naturelle un
sens manifestement trop absolu 30. La tendance et son aboutissement invita-
ble n'excluent pas, mais incluent au contraire des possibilits concrtes
nombreuses et diverses: par leurs actions conomiques et politiques les classes
et les individus interviennent dans le cours des choses.
Marx ayant sous les yeux les rvolutions politiques qui secouaient la
France, et plusieurs autres pays alentour, depuis 178931, la chute du systme
capitaliste tait une possibilit subjective: que l'on ft en priode de crise ou en
priode d'accalmie, elle tait dsormais l'horizon. Elle tait aussi un possible
objectif: c'est la conclusion historique et logique que Marx tirait, aprs
Sismondi et les conomistes socialistes de I>cole de Ricardo, de l'clatement
priodique rapproch des crises de surproduction.
La lenteur de la baisse sculaire du taux gnral de profit n'empche
aucunement la possibilit d'une chute plus grave et soudaine dans une crise
singulire, ni n'empche la ncessit d'une crise finale (quelque tournure
qu'elle prenne) du mode de production existant. Le propre d'une tendance est,
tantt de se manifester imprativement, tantt de sembler avoir disparu: dans
ce deuxime cas, en elle, la ncessit n'est qu' l'tat de virtualit.
.
Marx dcrit cette situation conomique temporaire o tout peut voluer
dans un sens ou dans l'autre. Ce sont les moments o s'accumulent difficults
et contradictions, o les moyens de parer la crise, la fois chappent
certains agents de la production> et sont ressaisis par d'autres qui en profitent.
C'est durant ces priodes que les individus et les classes sociales rassemblent
leurs forces pour chapper aux consquences de la crise et la surmonter...
d'une manire ou d'une autre!
214 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Dans Le capital, cette situation conflictuelle est longuement dcrite, ses
divers aspects envisags. Par exemple, Marx crit:
Il faut que le march s'agrandisse sans cesse, si bien que ses connexions
[Zusammenhiinge] internes et les conditions qui le rglent prennent de plus en
plus l'allure de lois de la nature indpendantes des producteurs et chappent
de plus en plus leur contrle. Cette contradiction interne cherche une
solution dans l'extension du champ extrieur de la production. Mais plus la
force productive se dveloppe, plus elle entre en conflit a~ec la base troite
sur laquelle sont fonds les rapports de consommation. Etant donn cette
base pleine de contradictions, il n'est nullement contradictoire qu'un excs de
capital s'y allie une surpopulation croissante. Car s'il est vrai que le
couplage de ces deux facteurs accrotrait la masse de la plus-value produite,
par l mme s'accrot prcisment la contradiction entre les conditions dans
lesquelles cette plus-value est produite et celle o elle est ralise 32.
Les pripties du taux de profit sont alors celles de l'histoire, et la loi,
compare au mouvement rel , n'est qu'un nonc abstrait33. Selon Karl
Popper, en parlant de loi tendancielle , Marx aurait commis une faute
insigne contre <da logique scientifique", Une loi, soutient Popper, ne peut tre
que gnrale, alors qu'une tendance est un fait34.
Nous pensons que Marx n'aurait fait aucune difficult accorder qu'une
tendance est de l'ordre du fait. Car toute loi, malgr son caractre abstrait
exprime quelque chose d'objectif; ainsi, une tendance conomique recouvre
un conflit entre des classes qui s'opposent et s'affrontent. Popper nierait-il
qu'une mme cause puisse tre l'origine d'effets qui se contrarient? Cela
dpasse-t-ill'entendement de dire avec Marx:
On ne produit pas trop de richesse. Mais on produit priodiquement
trop de richesse sous ses formes capitalistes, contradictoires 35?
Marx peut parler de contradiction, car la limite du mode de production
capitaliste ressort [...J de ce que le dveloppement de la force productive du
travail engendre, dans la baisse du taux de profit, une loi qui, un certain
moment, entre en opposition absolue avec le propre dveloppement de cette
productivit, et doit tre constamment surmonte par des crises 36".
Les consquences se tirent facilement: ce sont, du point de vue de la
production capitaliste elle-mme, les limites de celle-ci, sa relativit; on voit
qu'elle n'est pas un mode de production absolu, mais un simple mode
historique de production correspondant une certaine poque de dveloppe-
ment restreint des conditions matrielles de production 37.
Les tendances historiques expriment la ralit concrte beaucoup mieux
que ne le font des lois plus gnrales. Il en va ici, comme le dit M. Georges
Canguilhem propos du rapport des tres vivants leur milieu:
Certes, ce milieu que la science dfinit est fait de lois, mais ces lois ce
LA POSSIBILIT CONCRTE
215
sont des abstractions thoriques. Le vivant ne vit pas parmi des lois, mais
parmi des tres et des vnements qui diversifient ces lois 38.
La loi de la baisse tendancielle du taux de profit est une loi spcifique,
la loi d'volution des socits capitalistes. Ce qui est concret, ce sont les
hommes, les classes et les forces productives existantes, qui reclent des
tendances et orientent une volution: Le mode de production capitaliste a
constamment tendance [die bestandige Tendenz] - c'est la loi de son volution
[Entwickelungsgesetz] - sparer toujours davantage moyens de production
et travail [...] 39. C'est dans cette tendance et dans cette volution que consiste
la possibilit concrte du devenir historique.
2. Le dveloppement historique
Une tendance historique exprime une possibilit qui est aussi une
ncessit, soit d'un dveloppement, soit d'une gense. Il convient en effet de ne
pas confondre le dveloppement proprement dit [Entwicklung] et la gense
[Entstehung]. Marx parle du dveloppement d'une formation socio-conomi-
que donne. Dire qu'elle se dveloppe, c'est dire qu'elle assure elle-mme sa
propre croissance, ce qui suppose qu'elle existe dj. Par contre, sa gense,
c'est sa naissance, son apparition. On peut donc entendre volution histori-
que en deux sens diffrents, que Marx, gnralement, prend soin de
distinguer. Nous avons l deux formes de possibilits historiques, car nous
n'avons pas affaire des processus du mme genre.
En outre, Marx ne rserve pas la notion de dveloppement [Entwicklung]
l'histoire humaine, ce que faisait Hegel4o. Le cours de la nature est pour
Marx un vaste processus ayant le caractre d'une volution gnrale, un
ensemble de changements et de transformations incessants, antrieurs
l'homme, dont l'homme est issu et dans lequel il finit par jouer le rle d'agent
conscient.
L'homme dpend de la nature dans la mesure o il en fait partie: il n'y
jouit que d'une autonomie relative. L'histoire des hommes ne peut donc
jamais rompre avec celle de la nature: ils ont eux-mmes t produits par la
nature; leur existence repose sur elle et la prolonge.
En consquence, Marx insiste d'abord plutt sur l'troite liaison entre
l'histoire des hommes et l'histoire de la nature que sur leur diffrence.
S'insurgeant contre Bruno Bauer qui opposait radicalement la nature et
l'histoire, il soutient que la nature est elle-mme historique:
Comme s'il y avait l deux" choses" disjointes , s'exclame-t-il,
comme si l'homme ne se trouvait pas toujours en face d'une nature qui est
historique et d'une histoire qui est naturelle41 .
Mais il proteste galement si l'on ramne l'histoire humaine celle de la
nature. Contre la philosophie de Feuerbach, trop exclusivement naturaliste
216 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
son got, il proclamait: Nous ne connaissons qu'une seule science, celle de
l'histoire42.
Cette apostrophe est clairante: l'histoire est pour Marx la science par
excellence, la science premire , au sens o Aristote parlait de philosophie
premire. Parler de science de l'histoire ne va d'ailleurs pas sans poser
quelques problmes 43.
Marx part donc de l'unit de l'histoire humaine et de l'histoire naturelle,
ce qui implique une certaine identit entre elles. Aprs l'identit, la diffrence:
L'histoire peut tre examine sous deux aspects. On peut la scinder en
histoire de la nature et histoire des hommes. Les deux aspects cependant ne
sont pas sparables; aussi longtemps qu'existent des hommes, leur histoire et
celle de la nature se conditionnent rciproquement 44.
Cette diffrence est relative: c'est une diffrence dans l'identit. En
quoi consiste la diffrence entre l'histoire historique des hommes et
l'histoire naturelle de la nature? La question est d'importance. Nous la
rencontrons constamment chez Marx, qui reprend une parole clbre:
Comme le dit Vico, l'histoire de l'homme se distingue de l'histoire de la
nature en ce que nous avons fait celle-l et non celle-ci45.
Cette ide est absolument fondamentale chez Marx. S'il semble parfois
accorder beaucoup aux conditions naturelles en histoire, il critique ceux qui,
comme Feuerbach, vont trop loin en ce sens. Certes, la nature joue un rle
primaire dans l'histoire des hommes. Toutefois, elle est loin de tout expliquer.
Les conditions naturelles sont rarement la cl qui permet de comprendre un
dveloppement historique ou une gense historique.
Marx n'est pas le premier prendre largement en considration l'in-
fluence des conditions naturelles sur les socits humaines: Aristote, Montes-
quieu, Hegel mme, l'avaient prcd46. Pour lui comme pour eux, ces
conditions sont autant de prsupposs constants de l'histoire:
Ce n'est pas l'unit des hommes vivants et actifs avec les conditions
naturelles, inorganiques, de leur change de substance avec la nature, ni, par
consquent, leur appropriation de la nature, qui demande tre explique ou
qui est le rsultat d'un processus historique [...]47.
Toutefois, Marx ajoute l'enseignement d'Aristote et de Montesquieu
celui de Hegel: si l'histoire de l'homme ne cesse de dpendre des conditions
extrieures que fournit la nature, elle dpend surtout des conditions que lgue
et qu'impose l'histoire antrieure.
Or, le champ des conditions naturelles en histoire n'est pas facile
dlimiter, car la nature elle-mme n'est pas immuable mais en devenir, et elle
offre l'homme toutes sortes de possibilits. Dans ses Grundrisse, Marx
analyse plus profondment qu'ailleurs cette unit de l'homme avec les
LA POSSIBILIT CONCRTE 217
conditions naturelles telle qu'elle se prsente dans les formes [de socit] qui
ont prcd la production capitaliste48.
Dans cette partie du manuscrit, il s'interroge sur la gense historique [die
historische Entstehung] des socits bourgeoises modernes, c'est--dire des
conditions de la production capitaliste, du capital et du travail, de l'ouvrier
libre dnu de tout moyen et instruments de production (terre, outils), sauf
de la disposition de son corps. n trouve plaisant que Proudhon parle ce sujet
de gense [Entstehung] extra-conomique: Dire que l'histoire pr-bour-
geoise et chacune de ses phases a aussi son conomie et une base conomique de
mouvement n'est au fond qu'une pure tautologie49.
Mais cette histoire pr-bourgeoise est une sorte d'histoire economico-
naturelle , ou, comme dit Marx, une prhistoire de l'conomie bour-
geoise 50.
'
Dveloppant les conceptions esquisses avec Engels dans L'idologie
allemande, il s'attache comparer trois types de socits, antrieures aux
socits capitalistes modernes, types qui rsultent de trois possibilits diff-
rentes concernant la proprit commune du sol: la communaut villageoise
asiatique lment d'un empire despotique, la cit grecque ou romaine de
l'Antiquit [nol], la communaut germanique du Haut Moyen Age. Voil
trois formes fondamentales possibles , et chacune peut se raliser de
manire trs diffrente , prcise-t-il diverses reprises 51.
n procde une analyse comparative pour dgager les caractristiques
essentielles de ces trois formes possibles du rapport de la communaut au
sol, ce rapport dpendant troitement des conditions naturelles de la
production. Manrsemble donc faire jouer tous les facteurs gographiques et
naturels: climat, orographie, gologie, etc., un rle prminent pour expliquer
les diffrents types de socits prcapitalistes.
Cependant, l'ide est plutt que, tant donn l'tat rudimentaire des
instruments et des mthodes de travail de ces communauts anciennes, les
rapports sociaux sont encore trs toitement lis aux conditions naturelles. Le
milieu naturel semble donc jouer le rle principal dans la dtermination des
formes de la proprit dans ces priodes de l'Antiquit et du Haut Moyen Age,
au moins aux dbuts de toute cette prhistoire .
Bien que Marx parte de la considration des formes de proprit du
sol, et semble donc au premier abord faire prvaloir la forme d'appropriation
sociale sur les conditions naturelles (gographiques, etc.), au fur et mesure
que son analyse avance le rapport se renverse, et c'est la nature qui parat, en
dernire instance , jouer le rle vritablement dterminant. Cela amne
poser la question de savoir ce qu'il faut entendre par dveloppement
historique chez Marx.
Parfois, il met des rserves sur cette notion:
Ce qu'on appelle dveloppement historique [die sogennante historische
EntwkkJung) repose somme toute sur le fait que la dernire forme [sociale)
218 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
considre les formes passes comme des tapes menant son propre degr de
dveloppement 5lbis."
Aussi est-il intressant de regarder de prs ce qu'il dit de l'histoire pr-
bourgeoise: les
diffrentes formes de rapport des membres de la commune ou de la
tribu au terroir de la tribu - la terre o elle s'est tablie
-
dpendent pour
une part des dispositions naturelles de la tribu, pour une part des conditions
conomiques dans lesquelles elle se rapporte dsormais rellement, en qualit
de propritaire, au terroir, c'est--dire s'approprie les fruits de la terre par le
travail, et cela son tour dpendra du climat, de la nature physique du
terroir, du mode physiquement conditionn [bOOingt]de son exploitation, du
rapport aux tribus ennemies ou aux tribus voisines et des modifications
apportes par les migrations, les expriences [Erlebnissen] historiques vcues,
etc. 52.
Les conditions physiques du terroir semblent avoir, soit directe-
ment, soit mdiatement, le rle prdominant dans la formation de la socit.
Elles ne sont cependant pas les seules invoques. Dans l'numration, sont
aussi mentionnes d'autres conditions: les dispositions naturelles de la
tribu. Cela reste vague. Marx pense sans doute aux qualits raciales; mais il est
difficile de prciser davantage, puisqu'il ne l'a pas fait lui-mme.
A ces conditions premires s'en ajoutent d'autres, en particulier la
ncessit de protger le territoire contre les tribus voisines:
C'est pourquoi [dans la n6t antique] la guerre est la grande tche
d'ensemble, [...]. La commune est d'abord organise sur des bases guer-
rires 53.
Cette dernire affirmation ne laisse pas de surprendre: prise la lettre,
elle renverserait la thse qui donne l'conomie le rle principal. Est-ce que
Marx changerait de principes pour les priodes anciennes? Certainement pas.
Il faut comprendre que l'organisation guerrire ne devient une tche sociale
d'importance vitale que si elle concourt avec les conditions conomiques
assurer l'existence de la socit! Les deux vont de pair et se conditionnent
mutuellement.
De la mme faon, Marx peut dire que les conditions naturelles (le genre
de sol, le climat, etc.) ont une importance primordiale au sens tymologique du
mot: elles conditionnent en premier le mode physique de la production
(culture, levage, etc., et les instruments appropris). Simultanment, la forme
sociale d'appropriation de la nature dpend aussi des dispositions natu-
relies de la tribu.
Les conditions naturelles externes n'abolissent pas les autres conditions
(l'organisation militaire, les traditions et habitudes hrites du pass ou
apportes par des peuples colonisateurs, acculturation) qui peuvent avoir
LA POSSIBILIT CONCRTE 219
une importance tout aussi essentielle. La vritable pense de Marx est que
toutes ces conditions forment une totalit, o les circonstances socio-histori-
ques et les conditions naturelles concrtes dpendent les unes des autres.
S'il insiste tellement sur les conditions naturelles d'existence des
socits prcapitalistes, c'est que ces conditions y ont jou un rle plus
important que dans les socits capitalistes qui, tout en dpendant toujours de
la nature, lui sont cependant moins assujetties. C'est pourquoi Marx qualifie
ces socits antrieures de naturelles .
Malgr tout, dans ces socits, il ne faudrait pas tenir pour accessoire le
rle de la forme sociale. D'une part, le terroir n'est pas un milieu
gographique purement objectif et extrieur: un peuple amnage son milieu et
y prlve ce qui lui convient; un autre peuple dans le mme milieu ferait
autrement. D'autre part, Marx prcise que ces conditionso naturelles d'exis-
tence, auxquelles il [le producteur] se rapporte comme un corps inorganique
qui lui appartient lui-mme [sic], sont elles-mmes doubles et de nature
1) subjective, 2) objective54.
Les conditions subjectives , ce sont les conditions sociales dans les-
quelles l'individu existe et sans lesquelles il ne serait pas ce qu'il est. Le sujet
de la production est un individu socialement dtermin. Ds lors qu'il a un
droit socialement reconnu sur certaines choses, ses propres caractres sociaux
lui apparaissent comme des caractres naturels (ainsi, le droit du citoyen
romain, en vertu de sa qualit de citoyen, sur l'ager publicus [le champ
communal]). II est membre naturel d'une communaut ou d'un groupe social
tout simplement parce qu'il en fait partie de naissance:
Il [le producteur] se trouve en prsence de lui-mme en tant que
membre d'une famille, d'un clan, d'une tribu, etc. [...] Comme membre
naturel [ais natrliches Glied] de la communaut, il a sa part de la proprit
collective et la possession d'une part particulire de celle-ci. [...] Sa proprit,
c'est--dire la relation aux prsupposs naturels de sa production en tant
qu'ils lui appartiennent, qu'ils sont les siens, est mdiatise [vermitteIt] par le
fait qu'il est lui-mme membre naturel d'une communaut 55.
Les conditions sociales paraissent donc tre aussi des conditions
naturelles. C'est pourquoi Marx peut baptiser naturelles des dterminations
subjectives . Quand il dit que cette liaison naturelle n'a pas tre
explique, comprenons bien: elle est le point de dpart de la gense de la
socit bourgeoise; c'est en tant que point de dpart originaire donn et
prsuppos d'un processus ultrieur qu'elle n'a pas besoin d'explication.
Au contraire, la dissociation, gnralise par la socit bourgeoise, des
conditions objectives et des conditions subjectives doit tre explique. Elle ne
peut l'tre que comme rsultat d'un processus historique se droulant au sein
des socits prcapitalistes du fait de leur unit antrieure avec la nature.
Ainsi, le processus historique part d'une totalit qui apparat comme
naturelle par la manire mme dont les individus de ces socits se
220 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
rapportaient la nature extrieure comme un prsuppos inorganique, y
compris les conditions subjectives naturelles . L'histoire est donc le
processus de dissociation de cette liaison naturelle , ou du moins paraissant
naturelle du point de vue de la socit bourgeoise moderne qui a boulevers
tous ces liens antrieurs.
Bien plus, il y a des conditions originaires de la production [... qui] ne
peuvent pas, l'origine, tre elles-mmes produites
- tre des rsultats de la
production 56.
Mais les socits pr-bourgeoises leur en ajoutent d'autres qui paraissent
tout aussi naturelles parce qu' une partie de la socit y est traite par l'autre
en simple condition inorganique et naturelle de sa propre reproduction 57.
Les statuts sociaux de certaines classes (esclaves, serfs) sont mettre au
nombre des donnes naturelles au mme titre que le milieu physique
environnant: Le travai/lui-mme, tant sous la forme de l'esclave que du serf,
est plac au rang des autres tres naturels en tant que condition inorganique de
la production, ct du btail ou comme appendice de la terre 58.
Au milieu physique, il faut ajouter la condition sociale de l'individu,
laquelle il se rapporte comme son corps inorganique , et qui joue ainsi
le rle d'une condition naturelle. D'o les formules de Marx:
Les conditions originaires de la production apparaissent comme des
prsupposs naturels, comme des conditions naturelles d'existence du produc-
teur, de la mme faon que son corps vivant, bien qu'il le reproduise et le
dveloppe, n'est pas l'origine pos par lui-mme, mais apparat comme le
prsuppos de sa propre personne 59.
Naturel veut donc dire donn , prsuppos: c'est l'ensemble des
conditions qu'on trouve l, comme la nature, bien que ce soit dj le rsultat
d'une gense historique antrieure, ce que les individus ne savent pas en
gnral. Ce donn socio-naturel sert de base l'activit. Parmi les conditions
naturelles , figure donc la propre nature sociale des individus pour autant
qu'elle est donne.
L'ensemble des conditions objectives et subjectives ne fait qu'un avec les
formes de proprit, les rapports sociaux de production, les rapports commu-
nautaires (rapports entre ville et campagne, entre proprit commune et
proprit individuelle, type d'assembles, etc.).
L'explication semble circulaire: n'est-on pas renvoy des conditions
naturelles aux conditions sociales? En fait, il s'agit des moments interdpen-
dants de la formation socio-conomique dont il importe de saisir le caractre
spcifique. En somme, par essence, les socits pr-capitalistes taient natu-
relles . Le dveloppement historique de ces socits se fait au sein de cet
ensemble de conditions naturelles , y compris les dterminations sociales-
naturelles. Marx qualifie d'ailleurs ce type de communaut de socit
naturelle [naturwchtige Gesellschaft]60.
LA POSSIBILIT CONCRTE 221
Non seulement les conditions subjectives font partie des conditions
naturelles de la production, mais ces conditions naturelles, en tant que
conditions de production, ont tout autant un caractre conomique essen-
tiel que dans le mode de production capitaliste. Simplement, on a affaire une
forme d'conomie naturelle o la production a pour but de procurer des
valeurs d'usage, des biens de consommation.
Comme dans la socit capitaliste, le but est en mme temps de reproduire
la communaut, avec ses diffrents types socio-naturels, une certaine sorte de
citoyen par exemple, d'o une finalit qui apparat aussi comme plus
naturelle que dans la socit bourgeoise moderne:
Chez les Anciens, nous ne trouvons jamais la moindre tude cherchant
savoir quelle forme de proprit foncire est la plus productive, cre la plus
grande richesse. La richesse n'apparat pas comme le but de la production.
[...] La richesse n'apparat pas comme fin en soi [Selbstzweck] [...] C'est ainsi
que l'opinion ancienne selon laquelle l'homme apparat toujours comme la
finalit de la production, quel que soit le caractre born de ses dtermina-
tions nationales, religieuses, politiques, semble d'une grande lvation au
regard du monde moderne, o c'est la production qui apparat comme la
finalit de l'homme, et la richesse comme finalit de la production 61.
Dans la forme de communaut asiatique, le cycle de la production est
self-sustaining [en auto-subsistance] 62. Pour cette raison, dit Marx, elle se
maintient plus longuement et plus opinitrement que les autres formes de
socits prcapitalistes. Nanmoins, le but poursuivi par toutes ces commu-
nauts est la conservation [ErhaItung] 63. Au contraire, les socits bour-
geoises ne cessent d'accumuler les richesses sous la forme de marchandises, de
valeurs d'change; elles accroissent la production, augmentent la productivit,
tendent les marchs, bref impulsent le dveloppement. Leur finalit imma-
nente est l'augmentation des valeurs, non sous forme de trsor, mais de
capital, de valeur faire fructifier.
Marx soutient conjointement deux ides qui passent ordinairement pour
inconciliables. D'une part, ce sont les conditions matrielles, naturelles qui,
en premire instance, dterminent les formes sociales. D'autre part, et en fin de
compte, toutes les conditions, aussi bien sociales (rapports sociaux) qu'cono-
miques (mode de travail), que raciales, mme l'histoire passe, en tant
qu' exprience historique , et les conditions physiques (la nature), concour-
rent toutes la gense historique et interagissent.
Il fournit une explication dialectique d'esprit la fois naturaliste et
sociologique dans la mesure o il s'agit toujours de touts sociaux en rapport
troit avec un environnement naturel donn et de leur dveloppement
organique. Les conditions sociales mdiatisent toujours l'action des causes
naturelles dont dpend pourtant la socit. Conditions naturelles et conditions
sociales s'interpntrent dans la gense, l'existence et le dveloppement de
toute socit. Marx opre visiblement une synthse de l'explication par les
222 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
conditions naturelles (c'est la thse matrialiste) et de l'ide d'interdpendance
entre conditions naturelles et conditions sociales, qui se mdiatisent
rciproquement (c'est la thse dialectique):
Une condition naturelle de production pour l'individu vivant est qu'il
soit l'lment d'une socit naturelle, tribu, etc. [...]. Sa propre existence
productive n'est qu' cette condition. Son existence subjective en tant que telle
est conditionne par cela, tout comme elle l'est par le rapport la terre en tant
que celle-ci est, au sens propre, son laboratoire , prcise-t-iI64.
Dans les formes pr-capitalistes de socits, le rapport au milieu naturel
est mdiatis par des conditions sociales dtermines: l'appropriation collec-
tive de la terre est le fait originaire. Mme lorsque le sol est rparti entre les
individus, ils n'en sont propritaires qu'en tant que membres de la collectivit.
Cela ne veut pas dire que la structure sociale serait premire. Une
communaut de forme spcifique ne peut s'tablir et durer sur n'importe
quelle terre: le systme social asiatique ne pouvait natre en Grce ou dans les
forts germaniques! Le terroir impose ses conditions au mode de vie et la
manire de produire, c'est--dire aux rapports sociaux: pour autant, ceux-ci ne
sont pas inactifs: ils exercent une action en retour sur le mode d'appropria-
tion du terroir! voquant des temps plus anciens encore que ceux o
s'panouirent les formations prcapitalistes, Marx souligne le caractre tribal
et grgaire de l'existence des hommes ds cette origine:
Comme nous pouvons admettre que l'tat pastoral et le nomadisme
sont la premire forme de mode d'existence [...], la collectivit tribale, la
communaut naturelle; n'apparat pas comme rsultat, mais comme prsup-
pos de l'appropriation (temporaire) et de l'utilisation collectives du sol. S'ils
[les hommes en tribus] finissent par s'tablir [sdentarisation], cela dpendra
de diffrentes conditions extrieures, climatiques, gographiques, physiques,
etc., aussi bien que de leurs dispositions naturelles particulires, etc.,
-
de
leur caractre tribal - et de la manire dont cette collectivit originaire est
plus ou moins modifie65."
Pourquoi avons-nous fait tout ce dtour qui, apparemment, nous a
loign de la notion de dveloppement historique? En effet, remonter par la
gense historique des socits antrieures, nous ne trouvons que des
formes d'existence humaine toujours dj sociales. L'homme existe ds ses
origines en communaut: il est un tre naturellement social. La socit est
d'abord un fait naturel. Si les premires formes de socit sont des formes
de socits naturelles , quand y a-t-il donc histoire?
Dans le manuscrit sur les Formes prcapitalistes que nous avons suivi
jusqu'ici, les propos de Marx sur les rapports entre socit et nature paraissent
parfois confus, voire parfaitement contradictoires66. Toutefois, nous allons
voir s'en dgager une ide fondamentale concernant le dveloppement
historique: c'est au sein de communauts naturelles, pralablement
existantes, qu'une gense a lieu et qu'apparat un processus proprement
LA POSSIBILIT CONCRTE 223
historique . La gense, partant d'un tat de choses d'abord socia-nature!
comme nous avons dit, devient une gense historique, et celle-ci un
dveloppement historique au sens propre du terme. Certaines remarques
incidentes de Marx confirment cette interprtation.
Le processus historique, nous dit-il, apparat lorsque ces communauts
naturelles, voluent d'elles-mmes et se modifient elles-mmes. Les conditions
naturelles qui les caractrisent changent:
Il est en mme temps vident que ces conditions se modifient [sich
andern]. [HO] Aprs que la ville de Rome et t difie et la marche
environnante cultive par ses citoyens, les conditions de la communaut se
trouvrent changes [andre geworden] 67.
Dans son Introduction gnrale. Marx indiquait que ce processus a sa
racine dans la production et qu'il aboutit ceci qu'il transforme justement
les conditions naturelles en conditions historiques !
La production a effectivement ses propres conditions et prsupposi-
tions, qui en constituent des moments. Ces derniers peuvent apparatre au
tout dbut comme des donnes naturelles. Le processus mme de la
production les transforme de naturels en historiques, et s'ils apparaissent pour
une priode comme prsupposition naturelle de la production, pour une
autre priode ils ont t son rsultat historique68.
Autrement dit, conditions naturelles et conditions historiques sont rela-
tives . Au sujet de la clbre dcouverte de Smith selon laquelle le travail
moderne est du travail gnral ou abstrait, Marx fait une remarque
incidente qui prend tout son sens ici:
On pourrait dire que ce qui apparat aux tats-Unis comme produit
historique
-
cette indiffrence l'gard du travail dtermin - apparat
chez les Russes par exemple comme une disposition naturelle69.
La plupart du temps, les conditions internes un mode de production
semblent tre des conditions naturelles puisqu'elles sont dj acquises et
apparaissent comme des donnes. Cependant, elles sont gnralement le
rsultat d'un processus historique antrieur. Ainsi, toutes les formes [sont]
plus ou moins naturelles, mais aussi toutes sont le rsultat d'un processus
historique [... po.
Les formes pr-capitalistes, et celles qui sont encore plus anciennes, sont
issues d'une gense qui les a amenes l'existence. Au sein de ces socits se
prpare une autre gense. Un processus historique a lieu qui les transforme et
les fait voluer dialectiquement:
Par exemple [dans la Rome ancienne] si l'on veut que chaque individu
possde un nombre donn d'arpents de terre, le simple accroissement de la
224 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
population constitue dj un obstacle [ la prennit de la socit]. Pour le
franchir, il faut recourir la colonisation et celle-ci rend ncessaire la guerre
de conqute. D'o les esclaves, etc. [...] Ainsi le maintien de la communaut
ancienne implique la destruction des conditions sur lesquelles elle repose, et
elle se change en son contraire 71.
Marx insiste sur cette dissolution de l'ancien qui conduit l'apparition du
nouveau. La possibilit concrte du capitalisme n'apparat que lorsque les
liens de l'homme et de la terre sont dj dtruits. Cette destruction des formes
anciennes s'est dj opre l'intrieur mme de ces socits antrieures sous
l'influence de leur propre dveloppement immanent. Elle ne peut s'expliquer
par des causes qui ne verront le jour que plus tard.
Comment sont apparus le capital et le travailleur libre, d~mande Marx:
Il s'agit pour nous d'abord de ceci: le comportement du travail par
rapport au capital ou aux conditions objectives du travail en tant que capital
prsuppose un processus historique qui dissout les diffrentes formes dans
lesquelles le travailleur est propritaire, ou le propritaire, travailleur. Donc,
avant tout, 1) dissolution du rapport la terre
-
terroir. [...] 2) Dissolution
des rapports o l'homme apparat comme propritaire de l'instrument. [...] 4)
Dissolution, d'autre part, des rapports l'intrieur desquels les travail/eurs
eux-mmes, les puissances de travail vivantes [die lebendigen Arbeitsvermogen],
appartiennent encore immdiatement aux conditions objectives de production
et font en tant que tels l'objet d'une appropriation
-
donc esclaves et
serfs 72.
Pour comprendre le cours de l'histoire, il ne faut donc pas projeter dans
le pass les conditions actuelles. La notion de dveloppement historique est
ambigu. C'est une notion difficile et qui donne lieu des illusions, car tout
dveloppement a deux aspects, et ces deux aspects sont contradictoires. Le
dveloppement [Entwickung) suppose une dissolution [Auflosung). C'est une
relation typiquement dialectique:
Le dveloppement des forces productives dissout ces formes
[antrieures], et leur dissolution elle-mme est un dveloppement des forces
productives humaines 73.
En fin de compte, qu'est-ce qui caractrise l'histoire historique des
hommes, par opposition l'histoire naturelle de la nature? L'histoire possde
bien un trait spcifique qui la diffrencie de la nature. C'est la transformation
de conditions naturelles (y compris les conditions socio-naturelles) en
conditions qui sont elles-mmes un rsultat produit par une activit sociale.
Les conditions externes donnes, trouves l, sont modifes et changes en
conditions internes produites et reproduites.
La socit se renouvelle et reproduit ses conditions, y compris ses
conditions socio-naturelles, qui, au dbut, lui sont imposes, mais qu'en mme
LA POSSIBILIT CONCRTE 225
temps elle modifie. Pour expliquer cela, Marx use d'une analogie 74: il compare
ce processus de dveloppement historique de la socit celui du travailleur
individuel qui, l'origine, ne pose pas lui-mme son corps vivant , mais qui
le fait par la suite quand il produit les subsistances qui lui sont ncessaires
pour VIvre.
Le processus historique prsuppose donc des conditions (naturelles ou
rsultant d'une gense antrieure) qu'il transforme. Il est la fois continuit et
changement, tant du point de vue substantiel ou matriel, que du point de vue
subjectif (activit d'auto-engendrement):
L'histoire n'est pas autre chose que la succession des diffrentes
gnrations dont chacune exploite les matriaux, les capitaux, les forces
productives qui lui ont t transmises par toutes les gnrations prcdentes;
de ce fait, chaque gnration continue donc, d'une part, le mode d'activit qui
lui est transmis, mais dans des circonstances radicalement transformes, et,
d'autre part, elle modifie les anciennes circonstances en se livrant une activit
radicalement diffrente; ces faits on arrive les dnaturer par la spculation en
faisant de l'histoire rcente le but de l'histoire antrieure75.
L'histoire dpend donc de conditions naturelles, mais seule l'activit
concrte peut les transformer en conditions historiques, en rsultats produits et
reproduits. Les mmes choses qui sont naturelles peuvent devenir historiques.
Parmi ces conditions figure la division du travail, qui peut tre soi naturelle
ou mme dj un rsultat historique 76crit Marx, c'est--dire reproduite par
l'homme, donc produite historiquement, ce qui la fait entrer dans un processus
qui la modifie.
3. La ncessit historique
On voit, d'aprs ce qui prcde, que Marx s'interroge sur ce qu'il faut
entendre par dveloppement historique . Il met en garde contre la reprsen-
tation de l'histoire que l'on trouve chez les philosophes des Lumires, chez
Condorcet par exemple, qui se reprsentent l'histoire comme en progrs
continu, linaire et essentiellement cumulatif: progrs des lumires ou de
1'esprit humain (ainsi Auguste Comte avec sa loi des trois tats ).
Il rejette cette conception: il proteste contre la soi-disant volution
gnrale de l'esprit humain 77. S'il y a une volution, elle ne consiste pas
fondamentalement dans un progrs de l'esprit, mais dans celui des forces
productives matrielles, condition et cause de tout autre dveloppement .
C'est sur cette base que, pour Marx, l'histoire est un processus ouvert, dans
lequel des possibilits divergentes apparaissent, des dtours, des impasses, des
dveloppements qui avortent, des rsurgences, etc. 78.
On attribue souvent Marx une conception trique et pour ainsi dire
mcaniste de la ncessit historique, alors qu'il recherche lui-mme pourquoi
on se fait des reprsentations simplistes de l'histoire, expliquant ce simplisme
226 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
par l'illusion que toute socit se fait sur l'ensemble du pass, une illusion de
rtrospection 79.
Marx suspecte en effet le finalisme de ceux qui s'imaginent que tout le
pass aurait eu pour but et pour fin consciente la socit actuelle!
Pourtant, il parle, lui aussi, d'un dveloppement progressif et de ses
degrs: celui des forces productives. Il affirme frquemment que ce
dveloppement procde par stades. Son schma historique ne diffre donc gure
de celui de la plupart des grands penseurs et philosophes de l'histoire: c'est l'ide
d'une succession de quelques types de civilisations en nombre restreint qui, par
un enchanement ncessaire , ralisent un progrs gnral de l'humanit.
Toutefois, il avertit que ce schma ne donne qu'une reprsentation
globale de l'histoire: c'est seulement grands traits, [que] les modes de
production asiatique, antique, fodal et bourgeois moderne peuvent tre
qualifis d'poques progressives [...]80 . Cette reprsentation linaire simplifie
beaucoup l'enchanement historique complexe des modes de production, et
elle a servi comme un dogme chez les marxistes. Pourtant, l'on remarquera les
prcautions prises par Marx dans cette prudente formulation.
Il y a deux raisons ces rserves de Marx: d'une part, dans l'histoire, il
y a des stagnations, des destructions ou des rgressions parfois considrables.
D'autre part, dans le concret, la belle succession linaire de stades tranchs est
difficile montrer: divers modes de production coexistent dans la mme
socit et se mlent, d'o les rsurgences possibles d'anciennes pratiques (traite
des ngres, formes modernes d'esclavage, etc.). D'o la critique marxienne
d'une reprsentation tlologique grossire de l'histoire. Ce que Marx entend
par ncessit historique est aussi loign d'un mcanisme automatique
que d'un finalisme providentiel .
Ncessit historique a un sens large. Sans droger la ncessit ou
dpendance l'gard de conditions extrieures (l'homme dpend toujours de
la nature), l'activit humaine la transforme en une ncessit interne .
L'histoire est le processus de matrise des conditions objectives et subjectives
donnes: matrise de la nature et matrise des conditions sociales hrites du
pass. L'histoire ne s'accomplit pas en vertu d'une contrainte extrieure aux
hommes: dans le processus historique les conditions naturelles (externes)
sont transformes en conditions historiques (internes)8I.
La notion de ncessit historique provoque souvent un grave quipro-
quo. Certes, Marx tenait tout dveloppement historique pour ncessaire .
Mais de quelle ncessit s'agit-il?
On pense spontanment une contrainte extrieure qui s'opposerait la
ralisation de nos fins. Comme le remarque Labriola 82, la ncessit histori-
que est alors entendue comme une sorte de destin, de fatum, ou d'injonction
morale. Pour justifier cette manire de comprendre Marx, on se contente
gnralement d'invoquer l'analogie qu'il tablit entre les lois conomiques et
les lois de la nature.
Aristote enseignait que ncessit s'entend en plusieurs sens. Au
LA POSSIBILIT CONCRTE
227
premier sens, ncessaire se dit de ce sans quoi, pris comme condition, il n'est
pas possible de vivre 83. C'est la ncessit au sens de besoin et plus
prcisment de besoins eu gard une fin: la vie.
La ncessit que Marx relve partout en conomie et en histoire n'a-
t-elle pas justement le rapport le plus troit avec les besoins et avec la vie?
Quand une nouvelle manire de produire est ncessaire , n'est-ce pas en ce
sens? Or, cette ncessit n'a elle-mme de ralit que lorsque la possibilit du
nouveau existe concrtement. Devient historiquement ncessaire ce qui est
historiquement possible.
En second lieu, nous enseigne encore Aristote, le ncessaire est aussi le
contraint et le forc, c'est--dire ce qui, contre l'impulsion et le choix dlibr,
fait obstacle et empchement84.
La ncessit en ce second sens se rencontre videmment dans l'histoire
concrte: la contrainte et la violence y exercent leur droit formidable (pour
reprendre le mot de Hegel sur la contingence). L'emploi de la force est l'un des
moyens auquel recourent les classes sociales, violence qui prend toutes sortes
de formes, de la pression morale l'emploi lgal de la force et la guerre 85.
Les deux sens de ncessaire paraissent parfois confondus chez Marx.
Seule, une analyse les distingue. Sans tre soumis une contrainte physique
exerce directement sur lui par le capitaliste en personne, l'ouvrier qui doit
vendre sa force de travail sous la pression de ses propres besoins vitaux subit
une violence indirecte; les exploiteurs trouvent un alli naturel dans le
premier des besoins: la faim. Dans ce cas, chacune des deux sortes de ncessit
est prsente des degrs divers.
Ncessaire au premier sens n'indique pas une ncessit externe, mais
interne. Lorsque Marx qualifie les rapports sociaux de ncessaires , il s'agit
autant de leur ncessit immanente relativement un degr de dveloppement
des forces productives, c'est--dire certains besoins sociaux historiquement
dtermins86, que de la contrainte qu'ils constituent pour telle ou telle
catgorie d'hommes.
Du fait que chaque gnration trouve ces rapports dj tablis, ils sont
indpendants de la volont de cette gnration, a fortiori de la volont des
individus isols. Ils agissent sur eux comme une ncessit extrieure.
Seraient-ils survenus autrefois sans que les acteurs historiques (les classes
sociales dominantes) les aient voulus? videmment non: les classes conomi-
quement fortes ont recouru la violence pour les imposer. Ces rapports
n'taient pas contraignants pour elles, mais ncessaires au premier sens.
La ncessit des rapports sociaux existants a sa cause dernire dans une
ncessit immanente: les besoins sociaux une poque et dans une socit
donnes.
Dans la fameuse partition de la journe de travail en temps de travail
ncessaire et temps de travail non-ncessaire (ou surtravail), nces-
saire revt prcisment le premier sens que mentionne Aristote: c'est la
quantit de travail qui est ncessaire pour vivre! Ce temps est celui qu'il
228 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
faut pour produire les choses ncessaires l'existence, qu'on l'entende
l'chelle de l'individu moyen ou celle de la socit.
Cette ncessit n'est rien d'autre que celle des besoins satisfaire, qui sont
trs variables historiquement et socialement. Ce sont des besoins socilux ,
ceux qui sont normaux dans une socit donne87. Remarquons bien que
besoins sociaux et intrts de classe ne sont qu'une seule et mme chose pour
les individus d'une classe donne.
Quant la partie du travail non-ncessaire , elle est contrainte et
force dans les socits de classes. Il s'agit alors de la ncessit au second sens
d'Aristote pour ceux qui y sont soumis, au premier sens pour ceux qui en tirent
profit. Car la ncessit est relative aux points de vue des classes, et fonction de
l'tat des forces dont elles disposent. Elle est foncirement historique: elle
ne dcoule pas de ncessits purement naturelles
88.
Ainsi, d'un ct, le surtravail est naturellement non-ncessaire; de
l'autre, il est ncessaire en tant que contraint et forc, historiquement
impos par les classes et le mode de production dominants. Non-ncessaire
en soi (au sens premier d'Aristote) pour les travailleurs qui y sont contraints
par une violence indirecte, le surtravail est ncessaire (au premier sens
d'Aristote) pour les classes dominantes, car il fait partie de leurs intrts ou
besoins sociaux: sans lui, elles disparatraient!
La ncessit historique est toujours une ncessit relative, condition-
nelle. Non qu'il n'y ait, pour Marx, des ncessits absolues: ce sont les
ncessits naturelles. L'existence sociale est subordonne aux exigences mini-
males de la vie des individus qui la composent. S'arrterait-on de produire, ne
serait-ce que quelques semaines, l'chelle de la socit entire, que cette
ncessit ferait sentir rapidement son aiguillon 89. Que dire si toute activit
productive des hommes s'arrtait durant un an 90? Mais dussions-nous cho-
quer certains marxistes , nous devons dire que, pour Marx, produire n'est
pas une ncessit historique au sens propre du terme, mais une ncessit
naturelle qui s'impose toutes les formes de socit, et toutes les poques.
C'est la production dans des conditions matrielles et sociales dtermines qui
est une ncessit historique . C'est un mode de production particulier qui est
historiquement ncessaire . Une ncessit historique est une ncessit deve-
nue: elle a t engendre une certaine poque par un processus qui l'a
prcde. Pas n'importe quel processus: un processus immanent l'activit
humaine.
Le quiproquo que nous dnonons provient de l'quivocit du mot
condition . Quelles sont les conditions des phnomnes conomiques?
Quelles sont les conditions de l'histoire? Selon Marx, la rponse est double, car
conditions naturelles et conditions historiques sont troitement imbriques
l'une dans l'autre, tisses l'une avec l'autre.
On commet un contresens en prenant toutes les conditions de l'histoire
pour des ncessits historiques . De nombreux lecteurs franais des pages de
L'idologie allemande o Marx passe n revue ces conditions de l'histoire
LA POSSIBILIT CONCRTE
229
tombent dans ce contresens. Ce que Marx appelle les conditions premires de
l'histoire, ce sont des ncessits vitales auxquelles, bien entendu, aucune
socit ne peut droger:
Force nous est , dit-il, de dbuter par la constatation de la prsuppo-
sition premire de toute existence humaine, partant de toute histoire, savoir
que les hommes doivent tre mme de vivre pour pouvoir" faire l'histoire".
Mais, pour vivre, il faut avant tout boire, manger, se loger, s'habiller et
quelques autres choses encore 91.
De ces conditions de l'histoire, il faut bien distinguer ce que Marx
appelle la premire action historique". Il ne dsigne pas du tout les conditions
(ou prsuppositions) ncessaires de l'histoire comme tant elles-mmes des
actions historiques. Il dit seulement ceci: la prsupposition premire de toute
histoire humaine est naturellement l'existence d'tres humains vivants92".
La premir~ condition pour qu'il y ait histoire, c'est l'existence et la
reproduction des tres humains qui, par nature, ont certains besoins. Les
conditions naturelles sont donc reprises l'intrieur du processus proprement
historique en tant que ce sont des prsuppositions de ce processus lui-mme.
Pour faire l'histoire, il faut d'abord vivre; produire la vie devient" une
ncessit historique, mais elle ne l'est pas initialement, si l'on peut dire:
La premire action [Tat] historique est donc la production [Erzeugung]
des moyens permettant de satisfaire ces besoins [boire, manger, etc.], la
production de la vie matrielle elle-mme 93. >.
A la faveur de cette premire action historique qui dcoule d'une ncessit
naturelle vitale, apparaissent de nouveaux besoins qui sont eux-mmes un
rsultat. Ces nouveaux besoins, en tant que tels, rclament leur tour leur
satisfaction:
Le premier besoin lui-mme une fois satisfait, l'action [Aktion] de la
satisfaire et l'instrument dj acquis de cette satisfaction conduisent [fhrt]
de nouveaux besoins - et cette production [Erzeugung] de nouveaux besoins
est la premire action [Tat] historique 94.
"
Marx qualifie donc de premire action historique" deux choses qui
paraissent diffrentes. En fait, elles n'en font qu'une, car, produire des moyens
de production et, ce faisant, fait natre le besoin de ces moyens, c'est une seule
et mme action, un seul et mme processus.
Tel est le processus historique originaire pour Marx: c'est en produisant
de nouveaux besoins que l'homme entre" dans une histoire qui est le
processus d'auto-engendrement de l'homme par lui-mme. Cette dialectique
des moyens de production et de leurs fins (les besoins satisfaire) se poursuit
tout au long de l'histoire.
Les nouveaux besoins concernent aussi bien les moyens de production
230 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
que les objets de consommation, que ceux-ci soient matriels ou spirituels:
c'est le besoin de tabac, de la Bible ou de posie, aussi bien que le besoin de
manger. Marx ne comprend pas les besoins d'une manire trique. Les
besoins deviendraient-ils majoritairement des besoins spirituels que ce qu'il dit
du caractre social variable des besoins et de la dialectique des moyens et des
fins continuerait de valoir.
Les besoins sont historiquement variables. Ils se multiplient avec le
dveloppement des moyens. Ils admettent toutes sortes de degrs de satisfac-
tion. Un besoin peut se satisfaire de multiples faons. Une mme chose peut
tre objet de besoins varis. Ils sont trs diffrentes selon les individus, les
classes, les pays et les poques.
La ncessit d'une rvolution sociale n'est pas sans rapport avec le
dveloppement historique des besoins, et sa possibilit avec le dveloppement
des moyens. Lorsque la satisfaction des besoins lmentaires de classes
sociales nombreuses est entrave alors qu'en existent les moyens, cette
rvolution apparat possible et ncessaire dans ce sens-l. Comme nous l'avons
dj plusieurs fois remarqu, ici possibilit et ncessit se rpondent.
La dtermination d'un besoin dpend de critres objectifs et subjectifs.
Possibilit et ncessit y sont lies: un besoin implique la ncessit de sa
satisfaction, mais aussi la possibilit qu'il soit plus ou moins bien satisfait95. Il
ne saurait exister et durer quelque temps sans les moyens de le satisfaire. Dans
une conomie de march, ne comptent que les besoins solvables96 qui sont
relatifs et varient entre des limites plus ou moins tendues. Mais les possibilits
sont nombreuses 97: certains besoins peuvent tre comprims; misre ou
famine peuvent durer et tre endmiques. La possibilit historique d'une
rvolution des moyens de production et des rapports sociaux peut exister sans
se raliser, dans la mesure o d'autres moyens sont employs: rpression,
colonisation, destruction d'hommes ou de moyens matriels ou des deux.
Si la ncessit historique a le sens de besoin, et qui plus est, de besoin
social, elle prend un tout autre sens que celui d'une ncessit purement
extrieure (le contraint et forc au sens d'Aristote).
Du fait que les intrts matriels des classes - besoins sociaux par
excellence - sont le premier moteur de l'histoire passe et prsente98, il y a
une finalit en histoire, car, par essence, le besoin finalise l'activit. Si la
premire action historique est la cration de nouveaux besoins par la cration
de moyens de production, alors le processus historique est essentiellement
ouverture sur des possibilits.
Ce serait donc une erreur de croire que lorsque Marx parle de ncessit
historique, c'est au dtriment de la possibilit historique. L'une enveloppe
l'autre. La ncessit historique se renverse en son contraire: elle cre la
possibilit historique. Le surtravail salari toujours accru, ncessaire pour la
production capitaliste, dveloppe les forces productives, et ainsi dbouche sur
une possibilit historique, celle du dpassement de ce mode de production.
A partir du moment o des moyens de production nouveaux apparaissent
LA POSSIBILIT CONCRTE
231
et se multiplient, c'est le changement des rapports sociaux qui est historique-
ment possible et ncessaire. Aussi, la ncessit historique prsente un
double aspect: elle est dure et fatale pour les uns, libratrice et vitale pour les
autres. Elle prend la forme de mission historique pour les classes montantes.
Ce que les uns ne peuvent pas viter, c'est justement ce qui est possible
pour les autres; ou plutt, pour ce second groupe de protagonistes, la mme
chose apparat la fois possible et ncessaire.
C'est pourquoi le langage de la fatalit accompagne celui de l'activit
rvolutionnaire. L'un est l'envers de l'autre.
Avec la naissance de la grande industrie, [la] juste proportion [entre
l'offre et la demande] dut cesser, et la production fatalement contrainte
passer, dans une succession perptuelle, par les vicissitudes de prosprit, de
dpression, de crise, de stagnation, de nouvelle prosprit et ainsi de suite 99.
Inversement, lorsqu'elle concernce ce qui n'est pas encore, quoique les
moyens soient prsents, la ncessit historique a le sens d'une possibilit
historique :
Ce n'est pas
1'''
galisation des classes", logiquement impossible [Iogisch
unmoglich], mais 1'" abolition des classes", historiquement ncessaire [histo-
risch notwendig], qui est Ie but des efforts [StrebzieI] de l'Association
Internationale des Travailleurs 100, proclame Marx.
Ce qui est historiquement ncessaire, c'est l'action consciente et volon-
taire, collectivement concerte, d'abolir les anciens rapports sociaux 101.Elle
est ncessaire parce que possible, grce aux forces productives existantes: les
ouvriers et les capacits de la grande industrie. Transformer le monde
matriellement et socialement, c'est ce que peut et doit faire le proltariat 102.
Le fatalement de Misre de la philosophie, et l'historiquement nces-
saire comme but d'un programme d'action rvolutionnaire ne sont aucune-
ment antinomiques. On dvoierait la pense de Marx si l'on prenait de telles
affirmations pour la preuve d'une contradiction insoutenable, alors qu'elles
dsignent les deux aspects d'un seul et mme processus historique o les
conditions ncessaires de l'action et l'action possible sont intimement lies.
Le contresens est de comprendre la ncessit historique comme une
ncessit externe et aveugle. Quand Marx dit que les bouleversements histori-
ques s'accomplissent que les hommes le veuillent ou non , il faut prendre ce
propos dans son intgralit: certains ne le veulent pas, mais d'autres le veulent.
Il ne faut pas retenir seulement le second membre de l'alternative en
oubliant le premier. C'est bien par l'action de certaines classes contre
d'autres classes que l'histoire se fait: mission ncessaire pour les uns, elle est
destin fatal pour les autres: Le bouleversement matriel [...]des conditions
de production conomiques ne va pas sans les formes idologiques sous
lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le mnent jusqu'au
bout 103.
232 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Il est bon de rappeler aussi la conclusion marxienne trs connue selon
laquelle <<l'humanit ne se propose jamais que des problmes [Aufgaben]
qu'elle peut rsoudre [kann losen] 104,en vitant un autre contresens. Marx ne
va pas jusqu' professer un historicisme .
A cela, deux raisons s'opposent. Tout d'abord, il maintient fermement
l'existence de lois gnrales, ternelles, celles de la production en gnral, qui
reposent sur les ncessits naturelles de l'existence.
D'autre part, pour Marx, il existe une finalit en histoire. Celle-ci est
oriente vers une fin, un rgne de la libert ", dont elle est la ralisation
progresSIve.
Si Marx a dvelopp un certain relativisme historique, ce n'tait pas un
relativisme absolu.
Lorsqu'il dit qu'il dmontre la "ncessit" historique de la production
capitaliste et fustige le grand propritaire terrien aristocrate qui ne sait que
consommer 105
", le mot ncessit,) est profondment modifi par l'adjectif
historique . Ce n'est pas la ncessit immuable d'une loi ternelle, c'est la
ncessit transitoire d'un tat de choses existant, ce qui laisse augurer la
possibilit de son abolition future.
Une ncessit est historique par opposition une ncessit naturelle.
Autrement dit, elle est transitoire et peut tre change par les hommes. Marx
pense, comme Lucrce qu'il cite, que tout est en devenir continuel: mors
immortalis 106.
C'est pourquoi nous le voyons mettre la ncessit au rang du phnomne
[Erscheinung]. Opposant <<l' histoire relle (que saisit la nouvelle conception
matrialiste) l'histoire idaliste telle qu'on l'a critejusqu'ici, il note parmi
les ides fondamentales dvelopper: Cette conception apparat comme
[erscheint ais) un dveloppement ncessaire. Mais justification du hasard. [...)
(De la libert, etc., aussi.) 107.
La ncessit qui caractrise le dveloppement historique n'exclut pas mais
inclut qu'elle ne se ralise concrtement que par le biais du hasard. Cette
ralisation est livre aux circonstances, la singularit des situations et des
individus. La ncessit historique au sens matrialiste (dveloppement des
besoins et des moyens de les satisfaire) est celle d'un processus o le hasard a
sa part.
D'autre part, elle conduit au dveloppement de la libert, les besoins
vitaux pouvant tre satisfaits avec un temps de travail ncessaire de plus en
plus rduit. Cela dfinit positivement la libert comme possibilit d'une
dlivrance de la contrainte et de ce qui est forc, ce qui va l'encontre de toute
interprtation mcaniste ou dterministe de la ncessit historique.
Dans une lettre Vra Zassoulitch, membre d'un groupe socialiste russe,
Marx a expressment mis en garde contre l'application mcanique d'un
schma gnral d'volution toute l'histoire.
Vra Zassoulitch lui demandait s'il fallait appliquer la Russie <da loi
conomique du mouvement de la socit moderne dont parlait la Prface au
LA POSSIBILIT CONCRTE
233
Capital, tant donn que Marx, en 1867, avait ajout: elle [cette socit
moderne] ne peut ni dpasser d'un saut ni abolir par des dcrets les phases de
son dveloppement naturelI08".
Vra Zassoulitch lui posait clairement la question:
Vous comprendrez [...], citoyen, quel point votre opinion sur cette
question nous intresse et quel grand service vous nous auriez rendu en
exposant vos ides sur la destine possible de la commune rurale [russe] et sur
la thorie de la ncessit historique pour tous les pays du monde de passer
par toutes les phases de la production capitaliste 109.
"
Marx protestait d'avoir jamais soutenu dogmatiquement une thorie
ncessitariste: Quelques lignes suffiront de ne vous laisser aucun doute sur le
malentendu l'gard de ma soi-disant thorie 110.
"
.
Il renvoie sa correspondante au Capital o, au sujet des stades parcourus
par la socit capitaliste, il limitait son propos l'Europe occidentale:
Au fond du systme capitaliste, il y a [...] la sparation radicale du
producteur d'avec les moyens de production... La base de toute cette
volution, c'est l'expropriation des cultivateurs. Elle ne s'est encore accomplie
d'une manire radicale qu'en Angleterre... Mais tous les autres pays de
l'Europe occidentale parcourent le mme mouvement Ill."
La rponse Vra Zassoulitch souligne cette limitation:
La" fatalit historique" de ce mouvement est donc expressment
restreinte aux pays de l'Europe occidentale 112.
"
Dans Le capital, Marx expliquait que la base de tout ce processus est
l'expropriation du paysan, propritaire priv, qui devient le salari d'un autre
type de propritaire priv, le capitaliste, et que cette transformation d'une
forme de proprit prive en une autre forme de proprit prive se ralise de
manire diffrente dans des pays diffrents: Selon le milieu, il [ce mouve-
ment] change de couleur locale, ou se resserre dans un cercle plus troit, ou
prsente un caractre moins fortement prononc, ou suit un ordre de
succession diffrent 113.
"
Sa forme la plus classique" se prsente en Angleterre. Marx rappelle
Vra Zassouliteh que, dans Le capital, il donnait l'exemple de l'Italie o les
choses s'taient passes autrement. Dans ce pays, il se produisit [mme] un
mouvement en sens contraire. Les ouvriers des villes furent en masse refouls
dans les campagnesI14.
Il y a donc diverses possibilits de dveloppement historique. Aux
socialistes russes, Marx fait remarquer les conditions spcifiques leur pays.
S'il devait y avoir un dveloppement capitaliste, chez les paysans russes, on
aurait au contraire transformer leur proprit commune en proprit pri-
234 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
ve 115. Mais rien n'oblige un dveloppement analogue celui qu'a connu
l'Europe occidentale:
L'analyse donne dans Le Capital n'offre donc de raisons ni pour ni
contre la vitalit de la commune rurale [...]. Cette commune est le point
d'appui de la rgnration sociale en Russie, mais, afin qu'elle puisse
fonctionner comme tel, il faudrait d'abord liminer les influences dltres
qui l'assaillent de tous cts et ensuite lui assurer les conditions normales
d'un dveloppement spontan 116.
Texte combien important pour saisir sur le vif la vritable pense de Marx
comme pense de la possibilit. Ici, il s'agit de la possibilit concrte pour une
socit donne d'voluer dans une direction ou une autre. La ncessit
historique est alors subordonne des interventions subjectives: actions
politiques, mesures conomiques, etc.
On a beau faire l'tude concrte de la vritable situation historique, il
reste difficile de dcouvrir les possibilits concrtes d'agir sur l'avenir. Car, les
diverses causes historiques, qu'elles soient objectives ou subjectives se mdia-
tisent et donnent lieu diverses volutions possibles qui dpendent aussi, en
partie, de l'engagement des hommes et de leur volont. C'est ce que signifie
cette rponse de Marx Vra Zassoulitch: on peut tenter de s'appuyer sur la
commune russe, liminer certaines influences, et en dvelopper d'autres. Cela
renvoie un programme d'action politique, sociale et conomique, devant
favoriser le mode de production collectif encore prsent dans cette forme de
communaut et dans son rapport la terre.
Il reste qu'on ne peut engager une action historique avec la certitude du
rsultat. Les actions (concurrence conomique, luttes politiques, guerres) se
font dans une relative incertitude, l'valuation des probabilits est approxima-
tive, et l'action est risque. C'est l'action mme qui montrera les possibilits de
russites ou d'checs. Telle est la pense de Marx.
Chaque fois qu'il dcrit une gense concrte, l'action historique des
hommes y occupe une bonne place et y exerce ses droits. Il va mme parfois
jusqu' lui donner le premier rang. Il n'estime pas contradictoire d'affirmer la
primaut du facteur conomique, et, quand il se fait historien, de s'crier, en
rappelant les moyens utiliss pour instaurer le capitalisme en Angleterre au
XVIeet au XVIIesicles:
Dans les annales de l'histoire relle, c'est la conqute, l'asservissement,
la rapine main arme, le rgne de la force brutale, qui
l'a toujours
emport 117.
La ncessit historique chez Marx doit tre entendue cum grano salis:
ce qu'on appelle la ncessit historique, c'est aussi bien la possibilit..
historique, celle de nouveaux rapports sociaux de production et d'une
rvolution qui se ralise grce une action historique exigeant gnralement
l'emploi de la force, voire de la violence.
LA POSSIBILIT CONCRTE
235
4. Science et histoire
Marx qualifie souvent sa conception de l'histoire et toute son entreprise
de scientifiques par opposition aux doctrines qu'il considre comme
idologiques et spculatives. Il parat donc logique, comme le font la plupart
des marxistes, d'en conclure que Marx a accd la science de l'histoire .
Mais cette appellation est sujette discussion.
Les adversaires du marxisme lui ont oppos le fait que la prdiction ne
serait pas possible en histoire. La date et la nature d'un vnement physique
comme une clipse ou une mare sont prdictibles, mais non celles d'une
rvolution politique ou d'une crise conomique. Trop de variables et d'incon-
nues entrent en jeu: l'action des individus et des groupes sociaux, la fortune
militaire, etc. On a bbject que Marx lui-mme s'tait tromp dans ses
prdictions de l'imminente catastrophe du rgime capitaliste.
Marx parle-t-il de science de l'histoire ? Certes, il pensait possible et
ncessaire l'tude scientifique des modes de production, particulirement
du capitalisme. La comprhension de l'tape actuelle du dveloppement
conomique donne une certaine connaissance de son volution prochaine.
Or, une prvision scientifique repose sur des lois. Si chaque formation sociale
suit sa propre <<loide dveloppement, est-il pour autant permis de dire que,
pour Marx, il y a des lois de l'histoire? Nous venons de voir ce qu'il disait
au sujet de la Russie: les lois de l'histoire paraissent trs alatoires. Inverse-
ment, s'il n'y a pas de <<lois de l'histoire , de quoi est donc faite la
connaissance scientifique revendique par Marx?
On dira qu'il y a pour lui une loi gnrale, celle du dveloppement
progressif des forces productives travers la succession des formations socio-
conomiques 118.Mais sa manire matrialiste de considrer l'histoire ne peut
tre qualifie de science qu'en un sens trs spcial.
En quel sens Marx parlait-il de science? En 1860, il a rvl que les
communistes de Belgique (lui-mme et une poigne d'amis) se prparaient en
1846 soumettre une critique impitoyable le mlange de socialisme ou de
communisme franco-anglais et de philosophie allemande qui constituait alors
tout le secret de la thorie de la Ligue des Justes et proposer sa place une
connaissance scientifique de la structure de la socit bourgeoise titre de seule
base thorique ferme, qui permettrait aux ouvriers une participation
consciente au processus historique de bouleversement de la socit qui se
produit sous [leurs] yeux 119.
Engels emploiera indiffremment les expressions thorie de l'histoire
[Geschichtstheorie] et science de l'histoire [Geschichtswissenschaft], prci-
sant, comme le faisait Marx, qu'ils se mirent y travailler en commun
Bruxelles au printemps 1845, parce qu'elle avait une importance directe pour
236 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
le mouvement ouvrier de l'poque, pour son combat historiquement
ncessaire contre la classe dominante, la bourgeoisie 120.
Cependant, il est remarquable que Marx parle plutt de son point de
vue [Anschauung] matrialiste en histoire, que de <<lascience de l'histoire.
N'est-ce pas dans le seul domaine de l'conomie politique qu'il convient de
parler de science? Quand Marx dit avoir gravi les sentiers escarps de la
science , c'est du Capital, donc de la thorie conomique, qu'il s'agitI21.
Les grandes dcouvertes scientifiques marxiennes sont au nombre de
deux: l'explication de la formation de la plus-value sans que soit viole la loi
de la valeur ou loi de l'change d'quivalents, et l'explication du fait qu'un
capital donn rapporte un profit proportionnel sa grandeur quelle que soit
sa composition organique. C'est sur ces deux difficults qu'avait chou la
thorie ricardienne. Arm d'une solution thorique ces deux problmes
conomiques; il entreprit une rvision de toute l'conomie politique 122.
Par contre, en histoire, les dcouvertes propres Marx sont trs limites.
Il n'a pas dcouvert l'existence des classes, ni leurs luttes historiques! Il
l'avoue honntement:
Ce n'est pas moi que revient le mrite d'avoir dcouvert l'existence
des classes dans la socit moderne, pas plus que la lutte qu'elles s'y livrent.
Des historiens bourgeois avaient expos bien avant moi l'volution histori-
que de cette lutte des classes et des conomistes bourgeois en avaient dcrit
l'anatomie conomique. Mon originalit a consist: 1. dmontrer que
l'existence des classes n'est lie qu' des phases historiques dtermines du
dveloppement de la production; 2. que la lutte des classes mne ncessaire-
ment la dictature du proltariat; 3. que cette dictature elle-mme ne
reprsente qu'une phase de transition vers l'abolition de toutes les classes et
vers une socit sans classes. Des sots ignorants [...] ne nient pas seulement la
lutte des classes, mais l'existence mme de celles-ci. [...] Ils tiennent les
conditions sociales dans lesquelles la bourgeoisie assure sa domination pour
le rsultat ultime, pour le nec plus ultra de l'histoire; ils prouvent qu'ils [... ne]
comprennent [pas] la grandeur et la ncessit passagre de ce rgime
bourgeois lui-mme 123.
Mme si, en conomie, il n'a pas non plus dcouvert la plus-value, ni la
baisse du taux de profit, Marx peut s'enorgueillir d'avoir gravi les sentiers
escarps de la science du mode de production capitaliste.
Cette connaissance scientifique retentit ncessairement sur l'tude et la
comprhension de l'histoire. Toutefois, l'originalit et l'apport personnel de
Marx sont ici beaucoup moins vidents: de Vico Hegel, de Voltaire
Auguste Comte en passant par Rousseau et Condorcet, les philosophes de
l'histoire l'avaient prcd; les historiens bourgeois et les socialistes franais
avaient reconnu dans la lutte des classes le moteur de l'histoire.
Ce que Marx revendique, sans parler de <<lois de l'histoire , c'est de
mieux dmontrer que ne l'avaient fait ces derniers la liaison ncessaire des
classes des phases de la production. Mais, que les classes luttent pour
LA POSSIBILIT CONCRTE
237
dfendre leurs intrts conomiques, cela avait dj t compris et expos par
les historiens de la Restauration: Augustin Thierry, Guizot, etc. Marx insista
sur l'historicit des classes, sur le fait que leur ncessit est seulement
historique . En particulier, il conclut la possibilit historique de la
disparition de la bourgeoisie capitaliste du fait du dveloppement des forces
productives.
Or, celui-ci se fait selon le type de ncessit et de possibilit prsent dans
la loi de la baisse tendancielle du taux de profit, c'est--dire qu'il est une
tendance dont la ralisation est soumise toutes sortes de conditions, de
circonstances et d'alas: on l'a vu, les forces productives peuvent subir des
rgressions importantes, stagner, etc.
Devant cette ralit de l'histoire concrte, Marx avance une conception
dialectique gnrale plutt qu'une science au sens po~itif du terme. Elle
consiste en ides directrices permettant de saisir rationnellement 124la
gense, le dveloppement et la disparition des modes de production. Ce qui est
objet de science , ce sont des formes de socits et leurs lois immanentes.
Parler d'une science de l'histoire en gnral est quivoque.
Dans l'tude d'une socit particulire, l'exactitude et la rigueur ne sont
de mise que dans l'analyse de sa structure conomique matrielle. Marx dit
bien qu'il faut toujours distinguer entre le bouleversement matriel- qu'on
peut constater de faon rigoureuse - la manire des sciences de la nature
[naturwissenschaftIich] - des conditions de production conomiques et les
formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques ou philosophiques
[...] 125.
Certes, le propos marxien est que l'histoire des arts, des religions ou des
philosophies n'est pas autonome 126.Mais, il ne faut pas le rabaisser celui du
matrialisme vulgaire. Dans ces domaines, on ne peut dgager des lois
quantitatives vrifiables avec l'exactitude dont sont susceptibles les observa-
tions dans les sciences physiques les plus simples et les plus abstraites. La
constatation y est ncessairement plus subjective. Mme pour les structures
juridiques et politiques qui sont troitement lies la base conomique, la
connaissance ne peut atteindre la rigueur et la prcision de l'tude des faits
et processus conomiques 127.
En dehors de l'histoire conomique stricto sensu, la connaissance consiste
moins dgager des lois, qu' dcouvrir des causes permettant de compren-
dre: cette comprhension doit tre rationnelle , c'est--dire saisir la raison
d'tre particulire. Dans l'histoire concrte, le hasard et l'arbitraire (individuel
ou social) interviennent partout. Les dcisions de l'action se fondent sur une
connaissance qui prend la forme de la probabilit, non pas la probabilit
mathmatique, mais la probabibilit philosophique . C'est l'historiogra-
phie de s'occuper de dcouvrir les causes singulires de l'action historique des
classes et des individus 128.
Quand Marx se targue de faire une dmonstration avec une exactitude
mathmatique [den mathematisch exakten Nachweis] 129,il s'agit d'un point de
238 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
thorie et d'un cas limite: dmontrer qu'un capitaliste particulier qui n'em-
ploierait aucun ouvrier aurait nanmoins intrt, pour tirer un profit de son
capital, l'lvation de la productivit du capital social. Mais le cours de
l'histoire n'obit pas une telle exactitude mathmatique .
Lorsque l'expression science de l'histoire figure dans L'idologie
allemande, Marx dsigne par l une histoire scientifique , ce qui n'est
possible que d'un point de vue matrialiste nouveau 130.Quant la science du
rel, remarque-t-il dans le mme ouvrage, elle consiste dans la connaissance
empirique et concrte la plus exhaustive possible de son objet particulier.
Les quelques chantillons d'histoire qu'il ait donns occupent une place
limite dans ses uvres compltes, compars ses recherches en conomie
politique. Il esquisse plusieurs fois l'histoire ou la gense de la socit
bourgeoise moderne 131.En 1844, il avait envisag d'crire une histoire de la
Convention, projet qui n'eut pas de suite. Il y a videmment ses crits clbres
et trs remarquables, mais restreints, consacrs de trs brves priodes de
l'histoire franaise rcente, la Seconde Rpublique et l'phmre Commune de
Paris 132.Cela mis part, Marx n'a pas fait uvre d'historien au sens propre
du terme 133,quoiqu'il ait toujours beaucoup tudi les historiens et toutes
sortes d'ouvrages historiques sur les sujets les plus varis, du commerce la
diplomatie, de la monnaie aux mtiers, des religions aux techniques. Il n'a pas
entrepris d'crire une Histoire universelle . Il n'a pas mme cherch en
donner une fresque comparable celles qu'on trouve chez Condorcet ou
Hegel. Pourtant ses crits abondent en indications et ides qui rivalisent
aisment avec celles de ses devanciers. De toutes ses uvres, on ne peut
extraire tout au plus qu'un vague schma pour une telle histoire universelle: il
est peine bauch, sorte de vaste esquisse dont seuls quelques linaments et
fragments sont donns ici ou l. En outre, ils concernent seulement certains
aspects de l'histoire moderne de l'Europe occidentale. Marx, le prince des
historiens du XIXesicle, n'a pas crit d' Histoire!
Pour faire uvre scientifique en histoire, pour viter les mirages de
l'idologie et les envoles de la spculation philosophique, il prconise la
connaissance empirique tendue du sujet, et l'analyse conomique de la socit
considre. Aux Jeunes hgliens obnubils par la philosophie idaliste
allemande et victimes de leur horizon born, il recommandait de se mettre
l'cole de la science socio-historique franaise et de la science politico-
conomique anglaise, sciences qui tudiaient la vie relle . De l, ses
admonestations mthodologiques et ses exigences draconiennes:
C'est l o cesse la spculation, c'est dans la vie relle que commence
donc la science relle, positive, l'expos de l'activit pratique, du processus de
dveloppement pratique des hommes. [...] Ds lors qu'est expose la ralit, la
philosophie cesse d'avoir un milieu o elle existe de faon autonome. A sa
place, on pourra tout au plus mettre une synthse des rsultats les plus
gnraux qu'il est possible d'abstraire de l'tude du dveloppement historique
des hommes. Ces abstractions, prises en soi, dtaches de l'histoire relle,
LA POSSIBILIT CONCRTE
239
n'ont absolument aucune valeur. Elles peuvent tout au plus servir classer
plus aisment la matire historique, indiquer la succession de ses
stratifications particulires. Mais elles ne donnent en aucune faon, comme la
philosophie, une recette, un schma selon lequel on peut accommoder les
poques historiques 134.
Marx se dfend de vouloir remplacer la philosophie idaliste allemande
par une science matrialiste tout aussi systmatique et absolue qui procure-
rait une connaissance aise de l'histoire. Ce serait verser dans la spculation,
dit-il. Inversement, les rappels insistants de L'idologie allemande sur la
ncessit de la connaissance empirique ne signifient pas un ralliement de Marx
quelque empirisme 135.
Estimant qu'on est loin d'avoir cette connaissance, Marx prfre parler de
son point de vue historique matrialiste plutt de sa scie,nce de l'histoire .
Mieux que les autres thoriciens, surtout les Allemands, il s'est rendu compte
que l'histoire tait encore dans son enfance, surtout l'histoire matrielle (celle
des techniques, des formes conomiques, des formes de communaut, des
rapports des socits la nature, etc.).
En particulier, il soulve un problme considrable: y a-t-il enchanement
ou seulement succession des priodes historiques? Lorsqu'il crit: L'anato-
mie de l'homme est une cl pour l'anatomie du singe 136, il met en doute l'ide
commune d'enchanement historique. Pour comprendre la succession comme
un enchanement, il faudrait avoir compris la nature des systmes socio-
conomiques qui se succdent. Sinon, la priodisation historique reste empiri-
que, ce que les philosophes allemands ont pens viter en recourant des
schmas qui se rvlent spculatifs, car btis partir de pauvrets idali-
ses: 1'Homme pour Feuerbach, la Conscience de soi pour Bruno Bauer,
l'Unique pour Stirner. Ils n'ont fait qu'interprter le monde!
Hritant de Hegel et remettant sa conception sur les pieds , conscient de
l'ampleur et des difficults de la tche, Marx dnonce les retours des
interprtations positivistes ou idologiques, finalement toutes entaches
d'idalisme. Nanmoins, la nouvelle conception matrialiste s'appuie sur
quelques prsupposs gnraux. Si Marx rejette rsolument la plupart des
catgories gnrales avances par les idalistes allemands, il ne peut se
passer de certaines catgories traites comme des prsupposs; mais, elles
ont leur limites 137.
Les catgories gnrales ne sont donc pas toutes mises au rebut. Il garde
d'abord des catgories qui concernent la vie matrielle humaine: besoins,
travail, production, forces productives, change, distribution, consommation.
D'autres concernent l'histoire: dveloppement, degrs de dveloppement,
classes, rapports sociaux, domination, idologie, alination, lutte de classes,
crise et conflit. Enfin, il y a celles qui conviennent toute la ralit, au monde
en gnral: tre et devenir, apparition et disparition, processus et contradic-
tion, essence et phnomne, forme et contenu, moyens et fins. Marx prescrivait
aux idologues allemands une mdication drastique, non une dite intgrale,
240 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
toutes les catgories gnrales devant passer au crible de la critique historique
et thorique, certaines tre rejetes, d'autres transformes, car elles restent plus
ou moins abstraites.
Les prsupposs gnraux dont nous entretient L'idologie allemande, ce
sont les rapports premiers de l'homme et de la nature: pour pouvoir faire
l'histoire, les hommes doivent d'abord vivre et se reproduire; pour cela, ils
doivent produire et reproduire leurs moyens de production, etc. Ces catgories
ne fournissent aucune science de l'histoire proprement parler: elles en
rsultent plutt. L'histoire rclame l'tude des socits concrtes. De mme
qu'il n'y a pas de production en gnral, de mme il n'y a pas de science de
l'histoire en gnra!. Dvelopper la thorie scientifique d'un mode de
production (ce que fait Le capital), ce n'est pas encore crire son histoire qui
est concrte et singulire. La thorie du capital est ncessaire pour comprendre
cette histoire. Mais on ne peut dire que Le capital soit la science de l'histoire
du capitalisme . Inversement, sans l'apparition et le dveloppement histori-
ques du capital, impossible d'en faire la thorie. La science est seconde et
garde un caractr abstrait, alors que l'histoire est concrte et premire.
Usant du pluriel, Marx parle d'ailleurs aussi bien des sciences histori-
ques que d' une science de l'histoire, et il ne sparait pas sciences sociales
et sciences historiques , comme se mettaient le faire les positivistes. Elles
sont indissolublement sociales et historiques 138.
Les difficults comprendre l'ide d'une science de l'histoire chez
Marx viennent du fait qu'en franais, science a un sens assez diffrent de
Wissenschaft en allemand, lequel servait dsigner toutes les disciplines, mme
la critique littraire, la critique de l'art, la critique religieuse, etc.139. Faut-il
rappeler que deux ouvrages fondamentaux de Hegel portaient le titre de
science , l'Encyclopdie des sciences philosophiques et la Science de la
logique? Dans les cercles clairs et en particulier chez les hgliens, ce vocable
dsignait la philosophie ou critique rationnelle de la religion par opposition
la thologie qui se baptisait elle-mme science 140. Wissenschaftlich a le
sens de rationnel ou de critique . C'est en ce sens que Marx l'emploie.
Quand il parle de la science de l'histoire, il s'agit de la connaissance
claire de l'histoire, c'est--dire dbarrasse des multiples illusions idolo-
giques qui l'encombrent et la dvoient.
Marx est exigeant pour la connaissance quelle qu'elle soit. L'objet de la
connaissance est le rel. Mais celui-ci n'est pas l'immdiat. Il faut pourtant
retrouver celui-ci au terme de l'explication.
La connaissance du rel n'est pas aise, mme en conomie, sinon il n'y
aurait pas besoin de science, c'est--dire des efforts de nombreux savants. Mais
les conomistes et historiens vulgaires en restent aux apparences phnom-
nales. Humoristique, Marx remarque:
L'conomiste vulgaire [...] se targue de son attachement l'apparence
qu'il considre comme la vrit dernire. Alors, quoi bon une science 141?
LA POSSIBILIT CONCRTE
241
La science vritable est pourtant l'expression et le reflet de la ralit:
Ce n'est qu'en remplaant les conflicting dogmas [conflits de dogmes]
par les conflicting facts [conflits de faits] et les antagonismes rels qui en
constituent l'arrire-plan cach qu'on peut transformer l'conomie politique
en une science relle 142."
Le mrite de Ricardo est d'avoir t scientifique
", c'est--dire objectif,
respectant les faits et cherchant leur explication vritable quelles qu'en fussent
les consquences. Marx ne lui mnage pas ses loges:
Les manires tranchantes de Ricardo taient non ,seulement scientifi-
quement honntes, mais aussi scientiquement ncessaires pour son point de
vue 143."
Le mrite exceptionnel du savant conomiste anglais consistait en ceci:
Il lui est absolument indiffrent que le dveloppement des forces
productives tue de la proprit foncire ou tue des travailleurs. Si ce progrs
dvalorise le capital de la bourgeoisie, alors ce rsultat est pour lui le
bienvenu. Si le dveloppement de la force productive du travail dvalorise de
moiti le capital fixe existant, qu'est-ce que cela peut faire, dit Ricardo. La
productivit du travail humain a doubl. C'est donc de l'honntet scientifi-
que 144."
Marx fait de mme en histoire: il y pourchasse les mythes, en particulier
toutes les conceptions providentialistes , idalistes et volontaristes qui
expliquent le cours du monde par un dessein divin, ou comme un dveloppe-
ment dtermin a priori d'une manire rationnelle et idelle. L'histoire, disait
plaisamment Engels, n'est pas une personne:
L'histoire ne fait rien, elle "ne possde pas de richesse norme", elle
"ne livre pas de combats"! C'est au contraire l'homme, l'homme rel et
vivant qui fait tout cela, possde tout cela et livre tous ces combats; ce n'est
pas, soyez-en certains, l'" histoire
"
qui se sert de l'homme, comme un moyen
pour raliser - comme si c'tait une personne part
-
ses fins elle; elle
n'est que l'activit de l'homme qui poursuit ses fins lui 145,
Marx aussi marquait bien la diffrence sparant sa conception de
l'histoire de celle de Hegel pour qui, la Raison, mue par son propre dessein
idel immanent, s'accomplit travers le dveloppement historique des peu-
ples:
La philosophie de l'histoire de Hegel est la dernire expression
consquente, pousse sa "plus pure expression" de toute cette faon qu'ont
242 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
les Allemands d'crire l'histoire et dans laquelle il ne s'agit pas d'intrts
rels, pas mme d'intrts politiques, mais d'ides pures 146,
Il ne faut pas s'en laisser conter: les hommes agissent en fonction de leurs
intrts qui sont rien moins que nobles; en 1869, dcrivant les remous
politiques en France et les coups que se portaient les partis, Marx commente:
c'est ainsi que bout le chaudron de sorcire de l'histoire 147.
Il restait trs modeste sur le pouvoir de prdire que serait sense procurer
la science de l'histoire. Il ne la transformait pas en un dogme ayant cette pr-
tention. Marx et Engels faisaient bien la diffrence entre les principes et leur
application. D'une manire nullement dsabuse, Engels tira la leon des
modifications intervenues dans les conditions de la lutte des classes entre 1848
et 1895:
L'histoire nous a donn tort nous aussi, elle a rvl que notre point
de vue d'alors [de l'automne 1850] tait une illusion. Elle est encore alle plus
loin: elle n'a pas seulement dissip notre erreur d'alors, elle a galement
boulevers totalement les conditions dans lesquelles le proltariat doit
combattre. Le mode de lutte de 1848 est prim aujourd'hui sous tous les
rapports. 148
Cette honntet scientifique d'Engels, que Marx n'aurait pas ds-
avoue, devrait dmythifier l'ide de ,<ncessit historique ainsi que celle
d'une science de l'histoire .
5. Matrialisme et tlologie en histoire
L'une des originalits du marxisme est de rcuser toute interprtation
mcaniste de l'histoire. A l'inverse des matrialistes antrieurs, Marx et Engels
font place la finalit et l'explication tlologique. Que leur matrialisme ft
nouveau, Engelsle dit avecnettet: Le matrialisme du siclepasstait surtout
mcaniste , mais, dj dans le domaine des sciences de la nature, avec toute
dcouverte faisant poque, il doit invitablement modifier sa forme; et depuis
que l'histoire elle-mme est soumise un traitement [Behandlung] matrialiste,
s'ouvre galement ici une nouvelle voie de dveloppement 149.
Une connaissance concrte de l'histoire et une matrise des hommes sur
leur destin conduisent, selon Marx, un matrialisme philosophique qui
dcouvre que les causes motrices principales en histoire ce sont les besoins des
individus sociaux et, en particulier, les intrts de classe.
Avec les besoins et les intrts, s'introduit la finalit. L, ncessit et
possibilit se rciproquent: des moyens sont ncessaires pour une fin qui n'est
possible que si les moyens existent; des moyens ouvrent sur des fins possibles,
et le pouvoir s'tend aussi loin que les moyens d'action existants. Si les mobiles
qui mettent en mouvement des masses d'individus et des classes entires sont
essentiellement des besoins et intrts d'ordre matriel , une finalit en
LA POSSIBILIT CONCRTE
243
histoire est concevable au sein d'un matrialisme philosophique: voil l'ide
centrale de Marx et d'Engels dans leur matrialisme 150.
S'ils se sont proclams matrialistes, ils ont toujours insist sur le fait que
leur matrialisme devait tre distingu de celui de leurs prdcesseurs, de celui
de Feuerbach ou de celui de D'Holbach, mais surtout de celui qui refleurissait
de leur temps en Allemagne, avec Ludwig Bchner, J. Moleschott, K. Vogt,
F.-A. Lange, E. Haeckel, etc. Pourtant, le matrialisme marxien comporte des
thses communes toutes les philosophies matrialistes: rejet de tout dualisme
ontologique, des ides de cration et de transcendance absolues, affirmation
de l'unit de la nature, de l'inhrence du mouvement la matire, affirmation
que la conscience et la pense sont des processus immanents la matire,
affirmation de la prvalence des besoins et intrts vitaux sur les idaux, etc.
Cela dit, il prsente plusieurs diffrences originales remarquables par
rapport aux doctrines matrialistes antrieures. Deux d'entre elles concernent
directement notre propos: la critique de la thorie des circonstances >', et
l'admission d'un certain type de finalit en histoire.
En ce qui concerne les phnomnes sociaux, Marx critique en effet la
clbre thorie des matrialistes franais du XVIIIe sicle, qu'il appelle la
thorie des circonstances . C'est l'objet de la lIe Thse sur Feuerbach qui s'en
prend la doctrine [Lehre] matrialiste qui veut que les hommes soient le
produit des circonstances et de l'ducation, que par consquent des hommes
transforms soient des produits d'autres circonstances et d'une ducation
modifie [...] 151.
Pourtant, n'est-ce pas cette doctrine que lui et Engels auraient soutenue
en fait
- comme le font si souvent remarquer certains adversaires du
marxisme - puisqu'ils rptent que les individus sont assujettis leur classe,
et celle-ci aux conditions d'existence dans lesquelles elle est place?
Il y aurait un fond holbachien dans leur matrialisme 152qui se rvle rait
dans les ouvrages d'Engels postrieurs 1870, quand il prsente leurs
conceptions philosophiques essentielles (antriorit de la nature sur l'homme
et de l'tre sur la pense, etc.), et qu'il qualifie la vie, la socit et la pense de
formes de mouvement et d'organisation de la matire 153.
Il est arriv Marx d'aller aussi loin qu'Engels dans ce sens et de tendre
soutenir la thorie des circonstances , c'est--dire d'en revenir un
matrialisme proche de celui des Franais du XVIIIe sicle. C'est ce que
montrent les loges qu'il dcerna un livre de Pierre Trmaux 154.Il estima que
Trmaux ralisait un progrs trs important par rapport Darwin , en
trouvant dans la formation gologique [de la terre] [die Erdformation] [...]
une cause de diffrenciation (non pas la seule, mais la base principale) 155des
espces animales, ainsi que des races humaines et des divers peuples.
Marx avanait que le progrs, qui chez Darwin est purement accidentel,
est prsent ici comme ncessaire sur la base des priodes de l'volution du
corps terrestre 156 pensant que pour son application en politique et en
histoire, c'est beaucoup plus important et plus riche que Darwin. Pour
244 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
certaines questions comme la nationalit, etc., c'est seulement ici qu'est
trouve une base naturelle 157.
Malgr le jugement ngatif qu'Engels porta immdiatement sur cet
ouvrage cause de la faiblesse de ses exemples gologiques et linguistiques
(deux domaines dont Engels tait grand connaisseur), Marx persista penser
que 1'ide de Trmaux tait juste quant au fond, de mme que la
philosophie de la nature allemande, rappelle-t-il Engels, avait eu raison
contre Cuvier, bien que celui-ci ft un naturaliste de tout premier ordre.
Ce qui tonne Marx, c'est qu'Engels mette en avant des arguments
semblables ceux de Cuvier qui avait nanmoins eu tort de s'tre oppos au
principe de la variabilit des espces. A l'inverse de Cuvier, lui objecte-t-il, les
philosophes allemands annonaient intgralement l'ide fondamentale de
Darwin, sans pouvoir le moins du monde la prouver 158.
Il en irait de mme ici:
l'ide fondamentale de Trmaux sur l'influence du sol (mme s'il ne fait
pas entrer en ligne de compte d'ventuelles modifications historiques de cette
influence [...]), cette ide mon avis, il suffit de l'noncer pour qu'elle
acquire une fois pour toutes droit de cit dans la science 159.
Aprs une nouvelle rponse d'Engels qui dmolit les thses de Trmaux,
Marx n'y revient plus. L'affaire semble entendue. Elle est nanmoins trs
significative: on y voit Marx l'afft de toute hypothse thorique qui, dans
les sciences, pouvait corroborer son option philosophique matrialiste.
Toutefois, cette raison philosophique gnrale ne suffit pas rendre
compte du brusque engouement de Marx pour un ouvrage aussi faible 160.
Dans le cas particulier, on peut avancer des raisons prcises. Lorsque Trmaux
crit que les facults productrices du sol ayant une limite, les espces les
moins bien appropries l'poque et aux conditions de vie doivent naturelle-
ment s'teindre devant celles qui le sont le mieux 161
", Marx semble avoir t
aussitt convaincu de la vrit de cette hypothse explicative parce qu'elle est
analogue celle qu'il met lui-mme en avant dans ses analyses conomiques:
c'est une explication causale dans laquelle le terrain joue le rle de base au
sens de possibilit matrielle 162.
Marx fait des moyens de production matriels les conditions auxquelles
les rapports sociaux et toutes les superstructures doivent s'adapter (c'est la
correspondance). Les systmes socio-conomiques les moins aptes" doi-
vent cder la place. L'puisement de la productivit du sol pour Trmaux,
l'apparition de moyens de production suprieurs (c'est--dire l'puisement de
la productivit relative des moyens prcdents) pour Marx, entranent la
disparition des espces antrieures d'tres vivants pour le premier, des formes
de socits anciennes pour le second, et leur remplacement par d'autres mieux
adaptes aux nouvelles conditions.
Est-ce dire que Marx aurait eu un certain penchant pour les thories qui
LA POSSIBILIT CONCRTE
245
font du milieu naturelle facteur dterminant en dernire instance? On ne
saurait tirer cette conclusion 163.En effet, les circonstances matrielles lies
aux besoins conomiques sont socio-historiques : ce sont les moyens de
production (Ie milieu artificiel ), et, conjointement, les forces productives,
dont l'activit humaine subjective, la force de travail qualifie.
D'un ct, nous voyons Marx et Engels accueillir avec enthousiasme la
thorie volutionniste de Darwin en biologie au moment o eux-mmes
dveloppaient une conception matrialiste de l'histoire: ces deux doctrines
chassaient de leurs domaines toute tlologie externe et transcendante. Mais
simultanment, le marxisme exclut la vieille thorie des circonstances que des
matrialistes vulgaires ou mcanistes s'efforaient d'appliquer en histoire et en
sociologie. Insistons sur ce point,
Selon Marx et Engels, on ne peut pas dire, purement et simplement, que
(des hommes sont les produits des circonstances. Marx critique sans aucune
quivoque l'unilatralit d'une telle affirmation dans ses Thses sur Feuerbach:
cette thorie , applique au processus de dveloppement de l'espce
humaine, oublie qu'il faut les hommes pour transformer les circonstances et
que l'ducateur a lui-mme besoin d'tre duqu 164,
N'avoir pas saisi l'activit humaine , (d'importance de l'activit
"rvolutionnaire", de l'activit" pratiquement-critique" , c'est le principal
dfaut de tout matrialisme jusqu'ici 165. Aux matrialistes traditionnels qui
cherchaient expliquer les phnomnes sociaux et historiques uniquement par
des circonstances matrielles externes (l'utilit, etc.), Marx oppose (da
concidence [das Zusammenfallen] du changement des circonstances et de
l'activit humaine ou auto-changement [Selbstveranderung] 166,
Les idalistes concevaient cette activit comme une activit de l'esprit ,
Ce faisant, ils ne liaient pas l'activit ses conditions matrielles 167, Les
matrialistes attribuaient toute la causalit aux circonstances et au milieu, les
idalistes un sujet jouissant d'une autonomie qui l'affranchirait du milieu et
de toutes les conditions objectives. Marx renvoie les uns et les autres dos dos.
Les Jeunes Hgliens tant encore trs idalistes sur ce point crucial,
Marx et Engels ont d'autant plus insist, contre eux, sur le rle des conditions
et des circonstances matrielles (c'est--dire les moyens de production et les
forces productives) dans le cours de l'histoire. D'o les rappels ritrs de la
base relle qui font la trame de L'idologie allemande:
(<Jusqu'ici, toute conception historique a, ou bien laiss compltement
de ct cette base relle de l'histoire, ou l'a considre comme une chose
accessoire, n'ayant aucun lien avec la marche de l'histoire
168.
Cela s'adresse essentiellement aux jeunes philosophes Allemands de
l'poque, quoique les grands idalistes: Kant, Fichte et Hegel, soient aussi
viss.
Lorsque Marx crit: les circonstancesfont tout autant les hommes que les
246 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
hommes font les circonstances 169, il s'oppose la fois aux uns et aux autres,
mais aussi aux mules de D'Holbach ou de Cabanis 170!
Il semblerait qu'en soutenant cette thse, Marx n'ait adopt qu'une
solution de juste milieu, laborant un compromis qui nous renvoie sans fin des
hommes aux circonstances et des circonstances aux hommes!
En fait, cette formule est des plus remarquables. On y trouve l'ide
centrale de Marx, o s'exprime sa conception de la ncessit et de la
possibilit. Si cette formulation commence par rappeler le rle des circons-
tances, c'est parce que, l'encontre des philosophes allemands, il s'agit de
demeurer sur le sol rel de l'histoire , de saisir sa base concrte . Le
processus historique (ainsi qu'il a t dit) consiste dans l'interaction de
l'activit pratique des hommes et des conditions matrielles de cette activit:
on agit toujours dans des conditions dtermines, qui, autant que des
contraintes, sont des matriaux (une base) pour cette pratique:
Cette somme de forces de production, de capitaux, de formes de
relations sociales, que chaque individu et chaque gnration trouvent comme
des donnes existantes, est la base concrte de ce que les philosophes se sont
reprsent comme "substance" et "essence de l'homme", de ce qu'ils ont
port aux nues ou qu'ils ont combattu, base concrte dont les effets et
l'influence sur le dveloppement des hommes ne sont nullement affects
parce que ces philosophes se rvoltent contre elle en qualit de "Conscience
de soi" et d'''Uniques''
171.
Les hommes sont les agents de leur propre changement. Ils ne se
partagent pas en deux catgories, les ducateurs et les duqus , puisque
les ducateurs doivent eux-mmes tre duqus 172.
C'est dans le mme
mouvement que les hommes sont leurs propres ducateurs et se transforment.
Il s'agit d'une ducation pratique , d'une praxis. C'est pourquoi, la
vritable solution pratique de cette phrasologie [la Conscience de soi, le
Genre, l'Unique], l'limination de ces reprsentations dans la conscience des
hommes, ne sera ralise, rptons-le, que par un changement des circons-
tances et non par des dductions thoriques 173.
Le changement des circonstances ne fait qu'un avec l'activit pratique
humaine elle-mme: il se poursuit depuis les temps prhistoriques les plus
reculs. Jusqu'ici, il n'a pas t conscient dans son ensemble: c'est seulement
de nos jours que les hommes peuvent arriver matriser l'ensemble des
circonstances. Cette possibilit, soutient Marx, ne deviendra ralit que par
une rvolution communiste, ce que permet et rclame l'accumulation actuelle
des forces productives. Mais il faut qu'existe aussi une masse ou classe
rvolutionnaire capable de s'emparer de ces moyens et de les transformer.
Le communisme se distingue de tous les mouvements qui l'ont prcd
jusqu'ici en ce qu'il bouleverse la base de tous les rapports de production et
d'changes antrieurs et que, pour la premire fois, il traite consciemment
LA POSSIBILIT CONCRTE
247
toutes les conditions naturelles pralables comme des crations des hommes
qui nous ont prcds jusqu'ici, qu'il dpouille celles-ci de leur caractre
naturel et les soumet la puissance des individus unis 174.
L'ide de Marx est que la thse selon laquelle les circonstances font tout
autant les hommes que les hommes font les ci'rconstances se renverse partir
du moment o les hommes font tout autant les circonstances que les circons-
tancesfont les hommes. Non seulement, cette thse a une valeur critique contre
les diverses coles philosophiques matrialistes et idalistes, mais elle ne
s'applique pas indiffremment toutes les poques historiques. Il faut la
comprendre comme s'appliquant notre poque qui est celle d'un tournant
historique mondial. Du moins, Marx le pensait-il.
Telle est l'expression et l'essence du matrialisme marxien. Si l'on a bien
saisi cela, on a compris que le marxisme carte la fois les thories mcanistes
de l'volution historique inspires par le paradigme des sciences physiques
pour qui le milieu serait le facteur dterminant 175,et les vues idalistes qui font
dpendre les faits politiques, juridiques, sociaux et idologiques, de la volont
et de la conscience humaines supposse libres l'gard des circonstances, selon
le paradigme des doctrines rationalistes et volontaristes, soit thologiques, soit
mtaphysiques.
La doctrine de Marx met autant l'accent sur l'activit propre des hommes
en tant qu'tres sociaux que sur les conditions extrieures d'exercice de cette
activit. Elle est anti-rductionniste. Les hommes sont dous de pouvoirs et de
moyens d'agir qui leur permettent de transformer les circonstances. Celles-ci
doivent tre comprises concrtement en fonction de chaque poque et de
chaque pays; car, hommes et moyens varient avec le temps. De son ct, le
milieu dans lequel les hommes mnent leurs. activits est non seulement
physique, mais aussi socio-historique, rsultat d'un dveloppement pratique
antrieur. C'est d'une dialectique historique entre cet ensemble de conditions
et l'activit qu'il s'agit:
A chaque stade se trouvent donns un rsultat matriel, une somme de
forces productives, un rapport avec la nature et entre les individus, crs
historiquement et transmis chaque gnration par celle qui la prcde, une
masse de forces de production, de capitaux et de circonstances, qui, d'une
part, sont bien modifis par la nouvelle gnration, mais qui, d'autre part, lui
dictent ses propres conditions d'existence et lui impriment un dveloppement
dtermin, un caractre spcifique 176,
Les conditions dessinent les contours des p.ossibilits d'agir. Si Marx
rappelle les Idologues allemands de son temps la ralit historique concrte
et aux conditions matrielles d'existence, il ajoute toujours: ces conditions
sont une base, et beaucoup d'entre elles sont dj des rsultats historiques.
Elles sont un hritage dont une gnration dpend, mais qui donne les moyens
partir desquels et grce auxquels elle existe et poursuit ses propres buts.
248 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Jamais Marx ne rduit l'homme n'tre qu'un rsultat passif des
circonstances, quoique ce puisse tre le cas des hommes individuels et des
classes les plus dmunis de moyens d'existence et d'action. Mme alors, ils ont
pourtant un dernier recours: la lutte, voire la rvolte dsespre, ultime
possibilit (et ncessit!) o ils sont parfois acculs.
Si les circonstances imposent des limites aux possibilits d'action et s'il
convient de s'y adapter, ce sont aussi des moyens dont on peut user et sur
lesquels on peut prendre appui. En outre, les circonstances voluent: la
situation historique change! En ce sens, en 1872, Marx et Engels font
remarquer que l'application des principes dpendra partout et toujours de
circonstances historiques donnes 177.
Tournons-nous vers le fait que leur matrialisme, tant pratique , inclut
une finalit. Celle-ci est prsente dans toute activit humaine, et, par suite, se
retrouve sous de multiples formes partout en histoire. Elle se manifeste aux
divers niveaux de la ralit concrte.
De nombreux interprtres ont considr l'affirmation d'une finalit
comme incompatible avec le matrialisme 178:elle serait contradictoire avec
le caractre scientifique auquel accde le marxisme 179.
Effectivement, Marx critiqua les explications tlologiques.
Que faut-il entendre par finalit historique? Celle-ci serait-elle seulement
une apparence subjective, au sens o l'est, pour Spinoza, la finalit dans la
nature 180?
Marx s'en prend aux explications providentialistes, mme lacises.
Proudhon avait dit de la concurrence qu'elle tait un dcret de la destine,
une ncessit de l'me humaine 181! Marx n'a pas de peine lui objecter
qu'elle a t tablie en France au XVIIIesicle, comme consquence de besoins
historiques , et qu'elle pourrait tre dtruite au XIxe sicle, cause d'autres
besoins historiques 182.
Voil donc Marx recourant un mode d'explication finaliste. Des besoins
impliquent une fin: leur satisfaction, et exigent donc les moyens ncessaires. Il
recourt mme trs souvent la finalit: le travail est l'activit finalise par
excellence, et on lit presqu' chaque page du Capital que le but,) du capital
est de faire du profit. Telle est la nature de la finalit conomique du capital
pour Marx. Expliquer tlologiquement est donc admissible en conomie.
Bien mieux, c'est invitable! Une pratique comme la concurrence ne se
comprend que comme moyen qui remplit une fin: raliser la valeur
contenue en puissance dans la marchandise et par l raliser le profit du
capital. Le mode de production capitaliste est m par une finalit immanente:
faire de la valeur, et toujours plus de valeur.
Chaque formation socio-conomique a sa propre finalit. La dter-
mination des rapports de production par les forces productives, souligne
M. A. W. Wood, ne peut s'entendre que d'une manire tlologique: Marx
explique les relations sociales qui prvalent dans une socit en montrant
comment elles contribuent sa tendance rendre efficace l'emploi de ses
LA POSSIBILIT CONCRTE
249
forces productives. [...] Les forces productives "dterminent" les rapports de
production dans le sens o ces rapports existent afin d'assurer un usage
efficace des forces productives et parce qu'ils l'assurent 183.
Rapports sociaux, structures politiques et idologiques, sont des moyens
adapts certaines fins: ils remplissent une certaine fonction. Cela est
caractristique des systmes, qui, entre autres fonctions, sont orients vers un
but: se maintenir malgr les perturbations et les influences extrerieures;
l'tude de la vie en donne de nombreux exemples.
Admettre une finalit organique immanente chaque socit ne permet
nullement de conclure un but de l'histoire . Comme Hegel, Marx ne se
contente pas de la finalit au sens fonctionnel ou organique 184.Il tient le
processus historique, dans son ensemble, pour un dveloppement progressif
qui procde par tapes, et va donc vers une fin. Mais il nie que cette fin soit la
ralisation d'une Ide en soi de quelque faon qu'on la conoive; a fortiori, il
nie toute fin providentielle.
Une interprtation fonctionnelle, aux yeux de Marx, ne suffit pas pour
comprendre le dveloppement historique gnral qui ne consiste pas dans
une succession disparate de diverses sortes de socits se suivant au hasard:
en gros , l'histoire va de formes infrieures des formes suprieures .
Un point de vue strictement structural ou fonctionnel ne peut rendre compte
d'un dveloppement temporel par degrs.
Marx soutient simultanment que chaque socit a sa fin immanente, et
que les modes de production s'enchanent historiquement. De l'histoire se
dgage une fin qui lui donne sens 185.La marche de l'histoire, comme celle de
la nature, comporte une sorte de dynamique interne qui la finalise. De quelle
finalit s'agit-il donc 186?La position de Marx sur ce problme de la tlologie
historique est subtile, critique et dialectique, en particulier par rapport aux
Lumires et par rapport Hegel.
Marx crit Engels qu'on ne peut pas comprendre la simple volution
[Entwicklung] historique de la machine, si l'on n'a pas compris l'interdpen-
dance [Zusammenhang] qui existe entre les rapports sociaux humains et le
dveloppement [Entwicklung] de ces modes de production matriels 187, ce qui
veut dire que pour comprendre le progrs, mme d'une chose matrielle
(objets artificiels), il faut considrer l'ensemble social, y compris les rapports
sociaux, car ce qui se dveloppe ce sont les modes de production. Marx est
raliste; il constate que, dans leur grande diversit, les socits ne se prsentent
pas dans un ordre chronologique de succession linaire; il y a des lignes
divergentes, toutes sortes de complications. Cependant, un dveloppement
finit par merger de toutes les volutions partielles. L'histoire procde de
sources multiples et varies, qui ont pu rester longtemps indpendantes. Marx
attire souvent l'attention sur le fait qu'une formation sociale [s'difie] avec
les dbris et lments de socits disparues 188. Une globalisation s'effectue:
l'exemple marxien privilgi est celui de la bourgeoisie qui depuis le XVIesicle
250 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
ralise une universalisation de l'histoire du fait qu'elle a cr le march
mondial.
Chaque mode de production nouveau rsulte des prcdents, mais d'une
manire complexe, prcisment parce qu'il y a des nouveauts; toutefois, une
certaine continuit s'instaure entre les poques principales. Marx crit: il
apparat que c'est un dveloppement [Entwicklung] qui a lieu 189. Une certaine
connexion s'tablit qui fait que l'histoire n'est pas succession pure, mais un
processus de dveloppement qui prsente une continuit.
Quelle continuit? Et de quoi y-a-til continuit? C'est une continuit
matrielle, ou de ralits spirituelles matrialises d'une faon ou d'une autre.
Voyons comment Marx la conoit. Stirner, comme Rousseau, se reprsentait
la socit comme la runion d'individus indpendants, prexistants et partant
d'eux-mmes . Marx proteste: -
Les individus sont toujours et en toutes circonstances" partis d'eux-
mmes", mais ils n'taient pas uniques au sens qu'ils ne pouvaient se passer
d'avoir des relations entre eux; au contraire, leurs besoins, leur nature par
consquent, et la manire de les satisfaire les rendaient dpendants les uns des
autres (rapport des sexes, changes, division du travail): aussi tait-il invita-
ble que des rapports s'tablissent entre eux 190.
Or, poursuit-il, de mme que chaque individu dpend de tous les autres,
soit dans la tribu primitive, soit dans la cit antique, soit dans la nation
moderne, de mme la gnration actuelle dpend de toutes les prcdentes:
Le dveloppement d'un individu est conditionn par le dveloppement
de tous les autres, avec qui il se trouve en relation directe ou indirecte; de
mme, les diffrentes gnrations d'individus, entre lesquelles des rapports se
sont tablis, ont ceci de commun que les gnrations postrieures sont
conditionnes dans leur existence physique par celles qui les ont prcdes,
reoivent d'elles les forces productives que celles-ci ont accumules et leurs
formes d'changes, ce qui conditionne les rapport mutuels qui s'tablissent
entre les gnrations actuelles 191.
La continuit 192historique est tablie par cette transmission de forces
productives matrielles et de rapports sociaux (rapports de production, de
proprit, d'changes). Cet hritage cre un lien historique qui s'tend
travers les temps. Il en rsulte que l'histoire apparat comme ralisant une
certaine finalit 193.
Il serait faux d'en conclure que, pour Marx, le cours de l'histoire serait
prdtermin. C'est une totalisation qui s'effectue, avec des alas et des
irrgularits de toutes sortes. A ce sujet, il ne faut pas se mprendre sur une
formule condense d'Engels qui parat paradoxale au premier abord, et o
l'on pourrait voir un finalisme outrancier: Sans esclavage antique, crit-il,
pas de socialisme moderne
194.
Il ne veut pas dire que l'esclavage a t instaur en vue du socialisme
moderne. Tout fait comme Marx, Engels protesterait contre toute compr-
LA POSSIBILIT CONCRTE 251
hension finaliste pour laquelle une tape historique se serait dveloppe en
vue de l'tape suivante. Relisons encore une fois ces lignes o Marx expose
cette continuit qui instaure une finalit rtrospective en histoire, et o il
prcise bien la restriction apporter ici:
L'histoire n'est pas autre chose que la succession des diffrentes
gnrations dont chacune exploite les matriaux, les capitaux, les forces
productives qui lui sont transmis par toutes les gnrations prcdentes; de
ce fait, chaque gnration continue donc, d'une part, le mode d'activit qui lui
est transmis, mais dans des circonstances radicalement changes, et, d'autre
part, elle modifie les anciennes circonstances en se livrant une activit
radicalement diffrente 195.
Marx ajoute ceci:
Ces faits on arrive les dnaturer par la spculation en faisant de
l'histoire rcente le but de l'histoire antrieure; c'est ainsi par exemple qu'on
prte la dcouverte de l'Amrique cette fin: aider la Rvolution franaise
clater 196.
Il ne nie videmment pas par l que la dcouverte du Nouveau Monde
n'ait eu des consquences sur les vnements qui marqurent ultrieurement la
marche des pays capitalistes d'Europe occidentale. Quant A. W. Wood fait
remarquer que Marx n'explique pas tlologiquement le capitalisme en
disant qu'il rend la socit communiste possible (bien que Marx soutienne
qu'en fait le capitalisme rend le communisme possible) 197, il exprime bien la
vraie pense de Marx.
Toujours propos des vues de Stirner qui mettait la libert de l'individu
singulier l'origine de la socit et du mouvement historique, Marx est amen
souligner que l'volution est une succession qui prsente une certaine
cohrence du fait que l'individu ne peut manifester son pouvoir d'agir que s'il
tient compte de conditions qui s'imposent d'abord lui:
Ces diffrentes conditions, qui apparaissent d'abord comme conditions
de la manifestation de soi, et plus tard comme entraves de celle-ci, forment
dans toute l'volution historique une srie cohrente de formes d'change,
dont le lien [Zusammenhang] consiste dans le fait qu'on remplace la forme
d'changes antrieure, devenue une entrave, par une nouvelle forme, qui
correspond aux forces productives plus dveloppes, [...] forme qui son tour
devient une entrave et se trouve alors remplace par une autre 198.
Tout ce mouvement a son origine dans une diversit de points de dpart,
tout comme il y a une diversit d'individus dans une socit. Peu peu les
communauts humaines et les nations entrent en des relations qui n'ont pas t
initialement voulues, et une finalit consciente merge ds lors que l'histoire
devient mondiale:
252 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Ce dveloppement se produisant naturellement [naturwchsig],c'est--
dire n'tant pas subordonn un plan d'ensemble tabli par des individus
associs librement, il part de localits diffrentes, de tribus, de nations, de
branches de travail diffrentes, etc., dont chacune se dveloppe d'abord
indpendamment des autres et n'entre que peu peu en liaison [in Verbin-
dung] avec les autres 199."
Ce mode de dveloppement, que Marx appelle le processus historique,
caractrise toute l'histoire jusqu'ici, qui est ainsi plutt une prhistoire. La
finalit mergente devient une finalit consciente l'poque actuelle, avec le
dveloppement du march mondial par la bourgeoisie, avec la lutte de la classe
ouvrire contre la bourgeoisie capitaliste, et avec la socialisation de la
production et la possibilit de rvolutionner les rapports sociaux.
Marx prcise qu'il ne faut pas interprter la finalit qui se dgage en
histoire d'une manire anthropomorphique: ce n'est pas une finalit consciem-
ment prmdite et voulue en tant que telle; en cela, il pense comme Spinoza
et... Dmocrite ou picure. Mais, il y a une finalit: l, sa conception diffre
profondment des leurs!
Pratiquement, les communistes traitent donc les conditions cres par
la production et le commerce avant eux comme des facteurs inorganiques,
mais ils ne s'imaginent pas pour autant que le plan ou la raison d'tre des
gnrations antrieures ont t de leur fournir des matriaux, et ils ne croient
pas davantage que ces conditions aient t inorganiques pour ceux qui les
craient 200.
Il Ya finalit et finalit. L'histoire se laisse donc saisir aprs coup comme
finalise. S'offre ainsi une possibilit concrte: poursuivre ce processus,
supprimer les causes des maux sociaux (exploitation du travail, domination
politique de certaines classes et misre sociale) en dveloppant collectivement
les forces productives. Alors seulement s'instaure une finalit consciente
l'chelle sociale, ce qui n'est rellement possible que par le passage une
socit sans classes .
Nous avons rencontr de plus en plus frquemment le concept de forces
productives. Quelles sont ces forces susceptibles de faire passer l'histoire
d'une finalit inconsciente et involontaire une finalit consciente et voulue?
NOTES
1. Ainsi, M. Grard MAAREK(op. cit., p. 251 et suiv.) pense qu'elle n'est pas logiquement
implique par les autres thories conomiques de Marx. Admettant la thorie de la valeur-travail
LA POSSIBILIT CONCRTE 253
et celle de l'accumulation capitaliste, M. Maarek montre, l'aide de modles mathmatiques, que
l'on ne peut pas en dduire une baisse tendancielle du taux de profit. Par contre, J. Schumpeter
(OP. CIT., t. 2, pp. 368-369), qui fait autorit en histoire de la pense conomique, y
voit une
consquence logique de ces deux propositions: que la valeur du capital constant augmente plus
vite que celle du capital variable, et que seul le capital variable produit de la plus-value. Il estime
que Marx et ses disciples peuvent en tirer une fiert lgitime".
2. Dans cette formule, pv" dsigne la plus-value, v" le capital variable (salaires), et c"
le capital constant (machines, locaux, matires premires, matires instrumentales, etc.). Avec
cette notation, le taux de plus-value est le rapport pv/v", le rapport c/v" reprsentant la
composition organique du capital.
3. Cela suppose le taux de la plus-value et les salaires constants. Marx examine les diverses
causes de variations possibles des facteurs de cette formule (cf. Le capital, t. 6, p. 225 et suiv.;
MEW25, p. 221 et suiv.). On trouvera un expos lmentaire par Henri LEFEBVRE(op. cit., p. 249),
ou d'autres ouvrages prsentant la pense conomique de Marx. Dans Le capital, l'analyse de la
loi de la baisse tendancielle du taux de profit est complexe et obscure, parce que Marx considre
les choses simultanment du point de vue substantiel (valeurs d'usage) et du point de vue formel
(valeurs d'change). Ce qui rend cette loi difficile tablir, c'est que, conformment la dfinition
de la composition organique du capital,
1'accroissement du volume de valeur du capital constant
[...] ne traduit que trs approximativement l'accroissement de la masse relle des valeurs d'usage
qui, matriellement, constituent ce capital" (Le capital, t. 6, p. 226; MEW 25, p. 222).
4. Ibid., p. 247; p. 244. Trad. modifie.
5. Ibid., t. 6, p. 248; p. 245.
6. Ibid., pp. 248-253; pp. 245-250.
7. Ibid., p. 243; pp. 239-240. (Soulign par nous.)
8. Ibid., p. 251; p. 249.
9. M. Maarek pense que Marx, embarrass, aurait baptis une telle loi tendancielle" par
commodit: Marx a choisi prudemment d'accoler le qualificatif" tendancielle" au terme de
"baisse" du taux de profit. La marge est troite et bien subjective entre une Loi de Baisse
Tendancielle et une Loi de Hausse Tendancielle..." (op. cit., p. 256).
_
10. La contradiction qui nat des conditions d'existence sociale des individus n'est pas une
contradiction individuelle" (cf. Contribution, p. 5; MEW 13, p. 9), par o il faut entendre, sans
doute, l'antagonisme des individus (par exemple l'intrieur d'une mme classe sociale). Tout
autre est la contradiction interne une socit prise dans son ensemble.
11. Le capital, t. 6, p. 238; MEW 25, p. 235. Trad. modifie. (Dj cit ci-dessus, p. 81, n. 1I
et suiv.).
-
La contradiction n'est pas seulement apparente" (au sens d'une illusion subjective):
les phnomnes apparaissant la surface de la socit se contredisent effectivement; ils s'opposent
et s'excluent les uns les autres; la contradiction est relle".
12. En allemand, widersprechen (contredire) et entsprechen (correspondre), ayant la mme
racine, sprechen, sont l'vidence des antonymes, ce que la langue franaise est impuissante
traduire: discordance" et condordance" rendraient cette opposition immdiate plus sensible,
mais au prix d'une perte de sens (cf. ci-dessus, p. 128, n. 47). Il faut donc se souvenir que la
contradiction est la non-correspondance, et la correspondance la non-contradiction.
13. Un chapitre du Capital a pour objet: Le dveloppement des contradictions internes de
la loi" (ibid., pp. 254-278; pp. 251-277).
14. Ibid., p. 235; p. 232. Trad. modifie.
15. Ibid., p. 246; p. 243.
16. Ibid., p. 262; p. 259. - Il ne faut pas confondre le dveloppement des forces productives
en gnral avec celui des forces productives du travail. Cette distinction affleure certains endroits
dans ces pages du Capital (ibid., p. 261; p. 258). Nous y reviendrons.
17. Ibid., p. 191; p. 184. Soulign par nous. - Faute de mieux, nous avons gard la
traduction de Mme Cohen-Solal et M. Badia. Marx crit, littralement: Un tel taux de la plus-
value
-
selon la tendance [der Tendanz nach], comme toute loi conomique [wie aile iikonomischen
Gesetze]
-
est prsuppos par nous en tant que simplification thorique."
18. Le fait que des capitaux qui mettent en mouvement des quantits ingales de travail
vivant produisent des quantits ingales de plus-value prsuppose, du moins jusqu' un certain
point, que le degr d'exploitation du travail ou le taux de la plus-value soit le mme, ou encore que
les diffrences existant ici sont senses [gelten ais] tre galises par des causes [Grnden] relles
ou imaginaires (conventionnelles) de compensation. Cela prsuppose la concurrence entre les
ouvriers et une galisation grce leur migration continuelle d'une sphre de la production une
autre (ibid.
- Trad. modifie).
254 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
19. Ibid., p. 178; p. 171. Trad. modifie. Sur la traduction de sich durchsetzen, cf. ci-dessus,
p. 110, note 74, in fine. Autre traduction par M. Jacot (op. ci1., p. 51), avec un commentaire
clairant sur les enjeux de ces thses de Marx pour la thorie conomique.
-
On trouve ici une
confirmation de ce que nous soutenions au chapitre prcdent, savoir que Marx critique la
notion de moyenne: elle est impossible fixer avec rigueur!
20. Le capital, 1. 6, p. 203;MEW25, p. 197.
21. L'un des grands problmes des conomistes classiques anglais (Smith, Ricardo) avait t
de trouver une explication cette baisse sculaire du profit, en particulier la baisse sculaire des
taux d'intrt (cf. SCHUMPETER, op. cit., t. II, p. 368).
22. Les rgularits tendancielles, qui ne s'appliquent qu' l'chelle macro-sociologique [...],
sont des acheminements des ensembles dans certaines directions plus ou moins prcises, mais
incertaines quant leur aboutissement (Georges Gurvitch, Trait de sociologie gnrale, 3e d.,
Paris, Presses Universitaires de France, 1. I, p. 244).
23. Marx ne doutait pas de leur aboutissement, l'inverse des sociologues comme
M. Gurwitch qui crit: Si la causalit fait dfaut, il importe de faire appel [...] des "rgularits
tendancielles" (ibid.). Selon Marx, comment une tendance aussi fondamentale pourrait-elle tre
sans causes? Et pourquoi ne pourrait-on dcouvrir ces causes?
24. L'tude des cycles conomiques est l'objet du Livre II du Capital.
25. Le capital, t. 6, p. 185; MEW 25, p. 178.
26. Ibid., p. 185; p. 179.
27. Ibid.
28. Cf. MARX, uvres (d. Rubel), t. 2, p. 1754 (note 1 de la page 953).
29. Sur la probabilit des vnements singuliers, cf. l'exergue de notre chapitre 4 (ci-dessus,
p. 163).
30. Nous avons analys le sens de telles dclarations dans nos chapitres 1 et 2, en particulier
quand Marx manie le langage fataliste (cf. ci-dessus, pp. 65-66 et 99-106).
31. Certains historiens appellent la priode qui va de 1789 1871 l're des rvolutions (cf.
HOBSBAWN, op. ci1.).
32. Le capital, 1. 6, p. 258; MEW 25, p. 255.
33. Cf. le dbut du Livre III du Capital (Ibid., p. 47; p. 33).
34. Cf. POPPER,op. cit., 1. 2, passim, et plus particulirement p. 174 et suiv.
-
Popper prne
un dualisme des faits et des normes (ibid., pp. 186 et 203).
35. Le capital, 1. 6, p. 270; MEW 25, p. 268.
36. Ibid.
37. Ibid., p. 272; p. 270. Trad. modifie.
38. G. CANGUILHEM, Essai sur quelques problmes..., p. 131.
39. Le capital, 1. 8, p. 259; MEW 25, p. 892.
40. Hegel ni tout dveloppement historique et dialectique de la nature; celle-ci ne prsente
ses yeux aucun progrs, mais seulement des processus rptitifs: Dans la nature, les
changements quelle qu'en soit la diversit infinie, montrent un cycle qui toujours se rpte: rien
de nouveau sous le solei!. [...] Il ne se produit du nouveau que dans les changements qui ont lieu
dans le domaine spirituel (La raison dans l'histoire, p. 177; d. Lasson, p. 149).
41. L'idologie (1968) p. 55; (1976) p. 25; d. bi!., pp. 86-87; MEW 3, p. 43.
42. Ibid., p. 45, n. I; p. 14, n. 3; pp. 54-55, n. 1; p. 18, n. *.
43. Cf. ci-dessous notre paragraphe Science et histoire (pp. 235 et suiv.).
44. Ibid.
-
cette dernire affirmation peut tonner. En fait, Marx pense aux modifications
que l'homme apporte son milieu environnant, ide encore trs neuve l'poque, mais laquelle
il donne, pour sa part, une grande porte. On la rencontre souvent chez lui. Signalons, l encore,
l'enseignement qu'il reut au lyce de Trves; l'exercice de thme franais de l'examen de fin
d'tudes ne portait-il pas sur un texte au titre-programme: Exemples qui servent prouver que
l'homme peut modifier les influences du climat qu'il habite , compos par Schwendler, professeur
de franais, qui aurait utilis des sources anglaises que connaissait le professeur de sciences
naturelles, Steininger (cf. MEGA 1/1, pp. 458-459 et Apparat, p. 1201; l'dition MEW ne donne
pas le thme de franais de Marx; il ne se trouve pas non plus dans les ditions des uvres de
Marx par M. Rubel, ou par J. Molitor).
45. Le capital, 1. 2, p. 59, n. 2; trad. Lefebvre, p. 418, n. 89; MEW23, pp. 392-393, n. 89.
46. Hegel traite des conditions naturelles de l'histoire dans La raison dans l'histoire, p. 216 et
suiv.
47. Manuscrits de 1857-1858, 1. I, p. 426; Gr., p. 389.
48. Il s'agit d'une partie des Grundrisse consacre l'tude des Formes antrieures la
LA POSSIBILIT CONCRTE
255
production capitaliste (ibid., pp. 410-452; pp. 375-413). Elle a t traduite et dite en franais
sparment, avec d'autres textes de Marx et d'Engels sur le mme sujet, par M. Maurice Godelier,
avec une prface de 130 pages, sous le titre: Sur les socits prcapitalistes).
49. Manuscrits de 1857-1858, t. l, p. 425; Gr., p. 388.
50. Ibid., p. 447; p. 408.
51. Ibid., pp. 411, 412, 414, 416, 437; pp. 375, 376, 378, 380, 399.
51bis. Ibid., p. 40; p. 26 (cf. aussi Contribution, p. 170; MEW 13, p. 636).
52. Ibid., p. 423; pp. 385-386. Trad. modifie.
53. Ibid., p. 414; p. 378.
54. Ibid., p. 426; p. 389.
55. Ibid., p. 427; pp. 389-390.
56. Ibid., p. 426; pp. 388-389.
-
Nous traduisons ursprnglich par originaire. La
traduction franaise cite traduit par originelle (cf. ci-dessus, p. 155, n. 58 de la page 132).
57. Ibid.
58. Ibid.
59. Ibid.
60. Ibid., p. 429; p. 391.
61. Ibid., p. 424; p. 387.
62. Ibid., p. 423; p. 386. (Cf. aussi pp. 413 et 416; pp. 377 et 380).
63. Ibid., p. 431; p. 393.
64. Ibid., p. 429; p. 391.
-
Nous avons vu que production et distribution sont interdpen-
dantes, et que dans ce tout l'un des deux moments est prdominant . La correspondance de tous
les moments n'exclut pas que l'un d'eux conditionne les autres, plus que les autres ne le
conditionnent: le moment prdominant, c'est la production (Contribution, pp. 159-163; MEW 13,
pp. 626-630). De mme ici, ce sont les conditions naturelles de la production qui prdominent:
elles conditionnent le type de rapports sociaux de la communaut, mais dans une dialectique o
ces dernires jouent leur rle. D'o les diverses formes possibles de communauts prbour-
geoises naturelles (Manuscrits de 1857-1858, t. l, p. 411 et suiv.; Gr., p. 375 et suiv.).
65. Ibid., pp. 411-412; pp. 375-376. Trad. modifie.
66. Rappelons qu'il s'agit d'un manuscrit de premier jet, o la pense marxienne se cherche
elle-mme. Ces pages montrent un bouillonnement d'ides qui est l'antipode d'un dogmatisme
simplificateur, crit trs justement M. Maurice Godelier ce propos (cf. Marx/Engels/Lnine,
Sur les socits prcapitalistes, Prface, p. 16).
67. Ibid., p. 431; p. 393.
68. Introduction, in Mthode, pp. 148-149; Contribution, p. 161; Manuscrits de 1857-1858,
t. l, p. 31; MEW 13, p. 628; Gr., p. 18. Soulign par nous.
-
De mme, Marx crit: on ne
commence travailler qu' partir d'une certaine base [Grundlage]
-
d'abord naturelle
-
mais qui
devient ensuite une donne historique (Manuscrits de 1857-1858, t. l, p. 434; Gr., p. 396).
69. Introduction, in Mthode, pp. 170-171; Contribution, p. 169; Manuscrits de 1857-1858,
t. I, p. 39; MEW 13, p. 636; Gr., p. 25.
70. Manuscrits de 1857-1858, t. l, p. 434; Gr., p. 396.
71. Ibid., p. 431 ; p. 393.
72. Ibid., p. 434-435; p. 396-397.
73. Ibid., p. 434; p. 396.
74. Cf. ci-dessus, p. 220, la citation rfrence en note 60 dans ce chapitre.
75. L'idologie (1968) p. 65; (1976) pp. 34-35; (d. bi!.) pp. 114-115; MEW 3, p. 45.
76. Introduction, in Contribution, p. 163; Mthode, pp. 154-155; Manuscrits de 1857-1858,
t. I, p. 33; MEW 13, p. 630; Gr., p. 13.
77. Contribution (Prface), p. 4; MEW 13, p. 8. En allemand: die sogenannte allgemeine
Entwicklung des menschlischen Geistes. On peut aussi traduire sogennant par ce qu'on appelle.
78. Marx cite la disparition de peuples et de civilisations aprs des floraisons remarquables:
socits amrindiennes (cf. Introduction, Ibid., p. 167; p. 634; ou Manuscrits de 1857-1858, t. l,
p. 37; Mthode, pp. 164-165; Gr., p. 23), Phniciens, Empire romain, Gaule, Empire d'Orient (cf.
L'idologie (1976), p. 52 et 68; (1968) p. 84 et 99; (d. bil) pp. 168-171 et 216-217; MEW 3, p. 54
et 23). Il existe des renaissances, et de nouveaux dparts zro. La plupart de ces exemples sont
d'ailleurs aussi chez Hegel.
79. Citons nouveau cette dclaration capitale (cf. p. 255, n. 52 de la page 217-218): Ce que
l'on
appelle dveloppement historique repose sur le fait que la forme dernire considre les formes
passes comme des tapes conduisant elle-mme (Introduction, Contribution, p. 170; Mthode,
pp. 172-173; MEW 13, p. 636; Manuscrits de 1857-1858, t. I, p. 40; Gr., p. 26).
256 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
80. Contribution (Prface), p. 5; MEW 13, p. 9. Soulign par nous.
81. Combien peu marxienne l'affirmation de M. Henri Denis qui, longtemps marxiste, est
nanmoins emport par sa critique au point d'crire ceci: Il [Marx] professe que l'histoire est un
mouvement engendr par la croissance d'un lment extrieur l'homme, les "forces produc-
tives"" (L'conomie de Marx, op. cit., p. 49, soulign par nous). Cela soulve la question de
savoir ce qu'il faut entendre par forces productives . Nous y viendrons dans notre prochain
chapitre.
82. Op. cit., p. 148.
-
Cf. l'exergue au prsent chapite (ci-dessus, p. 205).
83. Mtaphysique, 1015 a 20-21 (d. Tricot, 1. I, p. 258). De ce sens doit tre rapproch cet
autre: c'est ce sans quoi le Bien est impossible (ibid., 1072 b 13; t. II, p. 680). C'est la ncessit
selon la fin, ce qui est ncessaire pour cette fin. Il nous semble quivoque de dire ncessit de la
fin comme le fait M. Le Blond (cf. Aristote, Trait sur les parties des animaux, note
n
20 du
commentateur, pp. 134-136).
84. Mtaphysique, 1015 a 25-27 (t. I, p. 258). Mme dfinition en 1072 b 11 (1. Il, p. 680): il
y a la ncessit qui rsulte de la contrainte, en ce qu'elle force notre inclination naturelle . C'est
la ncessit selon la matire , qui contrarie les intentions et empche la facilit et la perfection.
85. Marx et Engels rfutent l'ide des plus courantes selon laquelle ..<ils'est agi jusqu'ici
dans l'histoire uniquement de prises de possession (L'idologie (1976) p. 69; (1968) p. 100; (bi!.)
pp. 218-219; MEW 3, p. 64).
- Ce qu'il faut relever ici, c'est le mot uniquement. (Mme
rfutation, ibid., p. 68; p. 99; p. 217; p. 23.)
86. Dans la tribu, l'esclavage latent dans la famille ne se dveloppe que peu peu avec
l'accroissement de la population et des besoins (L'idologie (1968) p. 47; (1976) p. 17; (hil.) pp.
60-61; MEW 3, p. 22). Les besoins accrus engendrent de nouveaux rapports sociaux et [...]
l'accroissement de la population engendre de nouveaux besoins (ibid., p. 58; p. 27; pp. 92-93; p.
29). Marx parle, dans le mme sens, des besoins dont le degr de dveloppement [est] dtermin,
dans chaque cas, par le niveau de civilisation [Kulturstufe] (ibid., p. 83; p. 52; pp. 168-169; p. 53).
87. Il est significatif que Marx soit trs critique sur les besoins dits ncessaires ou
prtendus naturels des travaiHeurs (cf. Le capital, t. l, p. 174; MEW 23, p. 185).
88. Dans tous les cas, il
y
a une chose bien claire: la nature ne produit pas d'un ct des
possesseurs d'argent ou de marchandises et de l'autre des possesseurs de leurs propres forces de
travail. Un tel rapport n'a aucun fondement naturel, et ce n'est pas non plus un rapport social
commun toutes les priodes de l'histoire. Il est videmment le rsultat d'un dveloppement
historique prliminaire, le produit d'un grand nombre de rvolutions [Umwiilzungen] conomi-
ques, issu de la destruction de toute une srie de vieilles formes de production sociale (Le capital,
t. 1, p. 172; MEW23, p. 183).
89. Cf. Lettres Kugelmann, p. 103; MEW 23, p. 552.
90. Marx interpelle Feuerbach: Cette activit, ce travail, cette cration matrielle incessante
des hommes, cette production en un mot, est la base de tout le monde sensible tel qu'il existe de
nos jours, telle enseigne que, si on l'interrompait, ne ft-ce qu'une anne, non seulement
Feuerbach trouverait un norme changement dans le monde naturel, mais dplorerait trs vite
aussi la perte de tout le monde humain et de sa propre facult de contemplation, voire celle de sa
propre existence (L'idologie (1968) p. 56; (1976) p. 25; (bil.) pp. 86-87; MEW 3, p. 44.)
91. Ibid., p. 57; p. 26; pp. 88-91; p. 28. Trad. modifie.
92. Ibid., p. 45; p. 15; pp. 54-57; p. 20. Trad. modifie. - Nous voyons apparatre la
dialectique fondamentale de l'activit et de ses conditions (ou prsuppositions).
93. Ibid., p. 57; p. 26; pp. 90-91; p. 28. Nous avons modifi la traduction sur un point
essentiel qui demande quelques mots d'explication: M. Badia et son quipe de traducteurs rendent
par fait.. historique ce que Marx et Engels appellent, en allemand, une action.. historique. Le
mot Tat a un sens actif et n'a rien voir avec le fait.. constat de l'extrieur par un observateur,
ou le fait tabli post festum par un historien. Il serait parfaitement absurde de traduire le mot
de Goethe: Am Anfang war die Tat, par Au commencement tait Ie fait! La traduction de
M. Rubel: Le premier acte historique (MARX, uvres, 1. III, p. 1059) est plus heureuse, mais
voque trop l'acte volontaire qui a lieu un moment du temps.
94. Ibid., pp. 57-58; p. 27; pp. 90-91; p. 28. Trad. modifie.
95. Examinant la demande ouvrire en moyens de subsistance, Marx crit: la dtermination
quantitative de ce besoin est minemment lastique et fluctuante. Sa fixit n'est qu'apparente. Si
les moyens de subsistance taient meilleur march ou le salaire-argent plus lev, les ouvriers
achteraient davantage et le "besoin social" de telle marchandise se rvlerait plus grand (Le
capital,t. 6, p. 204; MEW25, p. 199).
96. Si la valeur de march baisse, le besoin social s'largit gnralement (il s'agit toujours
LA POSSIBILIT CONCRTE
257
ici du besoin" solvable "). Il peut alors, dans certaines limites, absorber des masses plus grandes
de marchandises (ibid., pp. 196-197; p. 190).
97. Marx numre diffrentes possibilits et ventualits dans les rapports de l'offre et
de la demande (ibid., pp. 205-206; p. 200), insistant sur le fait qu'il s'agit du besoin social effectif
[wirklich] (ibid., p. 204; p. 198).
98. Cf. la clbre phrase d'ouverture du Manifeste du parti communiste: L'histoire de toute
socit jusqu' nos jours est l'histoire de luttes de classes (Manifeste, pp. 30-31 ; MEW 4, p. 462).
La prcision jusqu' nos jours [bisherige] est des plus importantes. L'histoire venir peut et
doit prendre une autre forme. En effet, toute l'histoire passe n'est qu'une prhistoire: Avec
cette formation sociale [la socit bour,geoise], s'achve donc toute la prhistoire de la socit
humaine (Contribution, Prface, p. 5; Etudes, p. 122; MEW 13, p. 9).
99. Misre, p. 78; MEW 4, p. 96. Soulign par nous. Dans l'dition allemande de 1885, Engels
traduisit fatalement par: mit Naturnotwendigkeit [selon une ncessit naturelle].
100. L. Engels, 5 mars 1869, Correspondance, t. X, p. 47; MEW 32, p. 274. - Marx critique
un point du programme de l'Alliance de la Dmocratie Socialiste, fonde par Bakounine, qui
rclamait avant tout l'galisation politique, conomique et sociale des classes . Marx
y
voit une
priphrase pour
l'"
harmonie du capital et du travail" prche par les socialistes bourgeois (ibid.).
101. On a en mmoire la XIe Thse sur Feuerbach: Les philosophes n'ont fait qu'interprter
le monde, ce qui importe, c'est de le changer [veriindern] (L'idologie (1968), p. 34; (1976) p. 4;
(bil.) pp. 32-33; MEW 3, p. 7).
102. Cette identit de la ncessit et de la possibilit tait depuis longtemps au cur de la
pense de Marx. Dans La Sainte Famille, il exposait la tche historique des ouvriers: Dans le
proltariat pleinement dvelopp se trouve pratiquement acheve l'abstraction de toute humanit,
mme de l'apparence d'humanit; dans les conditions de vie du proltariat se trouvent condenses
toutes les conditions de vie de la socit actuelle dans ce qu'elles peuvent avoir d'inhumain. [...]
La misre qu'il ne peut plus viter ni farder, la misre [Not] qui s'impose lui inluctablement
[gebieterisch]
-
expression pratique de la ncessit (Notwendigkeit) -, le contraint directement
se rvolter contre pareille inhumanit; c'est pourquoi le proltariat peut et doit ncessairement
[kann und muss] se librer lui-mme [sich selbst befreien] (La Sainte Famille, p. 47; MEW2, p. 38).
103. Contribution, pp. 4-5; MEW 13, p. 9.
104. Ibid., p. 5; p. 9. - Les problmes dont il s'agit sont des tches pratiques .
105. L. Engels, 7 dco 1867, Correspondance, t. IX, p. 113; MEW 31, p. 404.
106. Cet aphorisme, tir d'un vers de Lucrce: Mortalem vitam mors cum immortalis ademit,
<puisque cette vie mortelle, la mort immortelle l'a dtruite , De la nature, trad. Ernout, Paris,
Les Belles Lettres, 1959, L. III, v. 869) est cit dans Misre de la philosophie (p. 119; MEW 4,
p. 130).
107. Introduction, Contribution, p. 173; Mthode, pp. 180-183; Manuscrits de 1857-1858, t. I,
p. 44; MEW 13, p. 640; Gr., pp. 29-30.
108. Le capital, t. 1, p. 19; MEW 23, pp. 15-16. Soulign par nous. (Cit ci-dessus, p. 57.)
109. L. du 8 mars 1881, Lettres sur le capital, p. 305, n. 3; uvres (d. Rubel), t. 2, p. 1557;
MEW 35, p. 494, n. 211.
110. Ibid., p. 305; p. 1557; p. 166. - Cette lettre fut crite en franais, d'o des gaucheries
de style. Les brouillons en sont publis in Sur les socits prcapitalistes, pp. 318-342. Cf. aussi
uvres (d. Rubel), t. II, pp. 1558-1573, et MEW 19, pp. 384-406.
111. L. sur Le capital, p. 305; uvres (d. Rubel), t. II, p. 1558; MEW 35, p. 242. Marx
renvoie la version franaise de son ouvrage: cf. Le capital, t. 3, pp. 154-156; MEGA II/5, p. 575,
et p. 576; MEW 23, pp. 742-744.
112. L. sur Le capital, p. 305; uvres (d. Rubel), t. II, p. 1558; MEW 35, p. 242. - Le
mot fatalit employ par Marx en franais est traduit dans l'dition allemande de sa
correspondance par Unvermeidlichkeit (littralement: invitabilit) (cf. MEW 35, p. 242).
113. Le capital, t. 3, p. 156; MEGA II/5, p. 576; MEW 23, p. 744. Soulign par nous.
114. Ibid., p. 156, n. 1; p. 576, n. 189; p. 744, n. 190. Le texte de cette note a t complt
au fil des ditions (cf. Le capital (trad. Lefebvre), p. 806, n. 189).
115. L. sur Le capital, p. 306; uvres (d. Rubel), t. II, p. 1558; MEW 35, p. 243.
116. Ibid. - Soulign par nous.
117. Le capital, t. 3, p. 154; trad. Lefebvre, p. 804; MEW 23, p. 742.
118. A ce sujet, il se gausse de Lange: Monsieur Lange a fait une grande dcouverte. Toute
l'histoire doit tre subordonne une seule grande loi naturelle. Cette loi de la nature, c'est la
formule (l'expression de Darwin ainsi employe devient une simple formule) struggle for life [lutte
258 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
pour la vie] (L. Kugelamnn du 27 juin 1870, Correspondance, t. X, p. 411; MEW 32, p. 685).
-
A cela, Marx oppose la mthode hglienne dont il fait l'loge (ibid.).
119. Herr VOGT(MEW 14, p. 439). Cit sans rfrence par M. Bert Andras (cf. La ligue des
Communistes (1847). Documents constitutifs, pp. 26-27). Dans l'Introduction cet ouvrage,
M. Andras retrace l'histoire de la Ligue des Justes , organisation secrte, dmocratique et
rpublicaine, fonde en 1838 par les artisans migrs allemands. Elle se transforma en Ligue des
Communistes en 1847 sus l'influence d'Engels et de Marx.
120. ENGELS,Sur l'histoire de la Ligue des communistes (MEW 21, p. 212). Trad. par nous.
121. Rappelons qu'il crit Maurice La Chtre, diteur du Capital en franais: II n'y a pas
de route royale pour la science et ceux-l seulement ont chance d'arriver ses sommets lumineux
qui ne craignent pas de se fatiguer gravir ses sentiers escarps. (L. du 18 mars 1872; cf. Le
capital, t. 1, p. 44; MEW 23, pp. 29-31; MEW 33, p. 434).
122. Il perfectionna la thorie de la monnaie, celle du salaire, celle des prix, celle des cycles
du capital, et enfin bouleversa la thorie de la rente foncire de Ricardo.
123. L. Weidermeyer du 5 mars 1852, Correspondance, t. III, pp. 79-80; MEW 28, pp. 507-
508. Les deux derniers mots souligns le sont par nous.
124. Rationnel est le terme de Marx dans la VIlle Thse sur Feuerbach: tous les mystres
qui portent la thorie vers le mysticisme trouvent leur solution rationnelle dans la pratique
humaine et dans la comprhension [das Begreifen] de cette pratique (L'idologie (1968), p. 33;
(1976) p. 3; (bi!.) pp. 30-31; MEW 3, p. 535). De mme, dans la Ille Thse, on lit que l'auto-
transformation de l'homme ne peut tre saisie et comprise rationnellement qu'en tant que
pratique rvolutionnaire. (Ibid., p. 32; p. 2; pp. 28-29; p. 534).
125. Contribution (Prface), pp. 4-5; MEW 13, p. 9.
126. Selon Marx, l'histoire de la philosophie, contrairement ce que soutint Hegel, ne peut
se comprendre comme un dveloppement autonome de l'ide (philosophique) d'Esprit Absolu.
127. Plus encore que l'exemple de l'art grec, il faut garder prsent l'esprit ici celui du droit
priv romain (cf. pp. 129-130, ci-dessus).
128. Si les lois du capitalisme, y compris sa loi d'volution gnrale, sont thoriquement
toujours et partout les mmes, que de diffrences entre ses formes historiques en Italie ou aux
Pays-Bas, en France, en Angleterre ou en Allemagne, en Amrique du Nord ou en Russie!
129. Le capital, t. 6, p. 212; MEW 25, p. 208.
130. Ce matrialisme affleurait dans la pense de Marx depuis sa Thse de doctorat.
131. Dans L'idologie allemande, dans Le manifeste du parti communiste, dans les Formes
antrieures la production capitaliste (Grundrisse), enfin dans plusieurs chapitres du Capital.
132. Ce sont: Les lut/es de classes en France. 1848-1850. Le dix-huit brumaire de Louis
Bonaparte. La guerre civile en France, 1871.
133. On ne peut gure considrer comme un ouvrage historique son copieux manuscrit
(1800 pages): Les thories sur la plus-value, que Kautsky, suivi par Molitor, ont dit comme
Histoire des doctrines conomiques. Conu initialement comme annexe l'analyse du processus de
production capitaliste (Livre 1er du Capital), il deviendra, dans l'esprit de Marx, un vritable
ouvrage qu'on dsigne aussi parfois comme quatrime livre du Capital. C'est un travail historico-
critique extrmement fouill passant en revue les thories de la plupart des conomistes du
XVIIIesicle et de la premire moiti du XIXesicle. Le plan en est plus thorique qu'historique.
C'est pourquoi le premier titre indiqu convient mieux: c'est celui qu'ont retenu les diteurs
rcents des Marx-Engels Werke (d. Dietz) et des uvres (d. sociales).
134. L'idologie (1968) pp. 51-52; (1976) p. 21; (bi!.) pp. 74-75; MEW 3, p. 27. - Il faut se
souvenir que Marx dirige sa critique contre des philosophes et crivains radicaux allemands
qui, dans leur exposition de l'histoire, se souciaient fort peu de la vie relle, de l'conomie, de
la production, de l'industrie et du commerce. Mme un penseur matrialiste comme Feuerbach
ngligeait l'tude du dveloppement pratique des hommes . Quoique Marx critique galement
la philosophie hglienne de l'histoire pour son caractre spculatif (cf. ibid., d. de 1968, pp.
40 (n. 2), 71, 78 et passim), il souligne nanmoins que Hegel avait cherch analyser l'acte de
production, qu'il faisait place au systme des besoins et qu'il avait considr le travail comme
un moment crucial de l'auto-dveloppement de l'homme (cf. ibid., p. 40, n. 2 et p. 57, n. 3). En
1844, il notait: Hegel se place du point de vue de l'conomie politique moderne. Il apprhende
le travail comme l'essence, comme l'essence avre de l'homme (Manuscrits de 1844, pp. 133-134;
MEW EB I, p. 574).
135. Il ne faut confondre comme le fait M. Pierre METHAIS(Remarques sur L'idologie
allemande et le point de vue empirique, in Hegel & Marx, La politique et le rel, Travaux du
Centre de Recherche et de Documentation sur Hegel et sur Marx, Poitiers, Publications de la
LA POSSIBILIT CONCRTE
259
Facult des Lettres, Anne 1969-1970, pp. 75-94, hors commerce), l'empirisme scientifique, partie
ncessaire de toute science, et l'empirisme comme doctrine philosophique. Marx n'est pas
empiriste en ce deuxime sens: il n'a cess de rpter que la science doit dcouvrir les rapports
essentiels cachs derrire les formes phnomnales (cf., par exemple, Le capital, t. 2, p. 213;
MEW 23, p. 564).
136. Introduction, Contribution, p. 169 (trad. modifie); Mthode, pp. 170-171; Manuscrits de
1857-1858, t. I, p. 40; MEW 13, p. 636; Gr., p. 26.
137. Mme la mthode dialectique a ses limites. Montrant que l'existence du capital
prsuppose un <dong processus historique, Marx remarque: On voit, ce point, de faon
prcise, combien la forme dialectique de l'expos n'est juste que lorsqu'elle connat ses limites ,
limites qu'impose l'histoire! (Fragment de la version primitive, Contribution, p. 253; MEW 13,
p. 945.)
138. Cf. Contribution, p. 170; MEW 13, p. 637. Le texte allemand dit: beijeder historischen,
sozialen Wissenschaft, ce que MM. Husson et Badia ont traduit dans toute science historique
ou sociale. Ce ou est quivoque: il laisse supposer qu'il
y
aurait pour Marx des sciences
sociales distinctes des sciences historiques, alors qu'il ne sparait pas social et historique .
Une telle distinction lui tait absolument trangre; il n'aurait pas compris une sociologie non
historique, ni une histoire non sociale!
139. A Lassalle, Marx crit: L'conomie comme science au sens allemand est encore
faire (L. du 12 novo 1858, Correspondance, t. V, p. 232; MEW 29, p. 567). Plkhanov (La
conception moniste de l'histoire, inuvres philosophiques, Moscou, d. du Progrs, s.d., t. l, p. 577)
l'a remarqu: Les Franais continuent d'appeler les disciplines traitant des socits humaines
sciences morales et politiques pour les distinguer des sciences tout court, qu'ils tiennent toujours
pour les seules exactes. Cette observation reste valable aujourd'hui!
140. En Allemagne, le titre de critique scientifique tait l'objet d'un enjeu philosophique
et politique aux environs de 1840. Les revues ou socits consacres aux belles-lettres se disaient
scientifiques.. au sens de science critique de la religion. Altenstein, Strauss, Bauer, etc., taient
les principaux reprsentants de ce courant de critique scientifique.. laquelle souscrivait bien
videmment la gauche jeune hglienne, contre l'orthodoxie thologique d'Eichhorn et du parti
religieux. Altenstein, ministre de l'Instruction publique et des Cultes fut le protecteur de Bruno
Bauer qu'il nomma Bonn. En 1841, le nouveau roi choisit comme ministre Eichhorn, lequel
rvoqua B. Bauer. Sur ce combat de la science contre la thologie dans l'Allemagne des annes
1830-1840, cf. Franz MEHRING,Karl Marx, Histoire de sa vie, [1918], trad. J. Mortier, Paris, d.
soc., pp. 44-45, ou trad. et commentaires de Grard Bloch, Paris, d. Pie; 1984, pp. 164-165, ainsi
que A. CORNU(op. cit., chap. IV, p. 230 sq., et sur la rvocation de B. Bauer, pp. 264-265).
141. L. Kugelmann, p. 104; MEW 32, p. 553. - Mme rflexion dans une lettre Engels:
La faon de voir du bourgeois et de l'conomiste vulgaire [..,] provient, de ce que, dans leur
cervelle, ce n'est jamais que laforme phnomnale immdiate de rapports qui se reflte et non leur
cohrence interne. D'ailleurs, si tel tait le cas, qu'aurait-on encore besoin en gnral d'une
science? (L. Engels du 27 juin 1867, Correspondance, t. VIII, p. 397; MEW31, p. 313).
142. L. Engels du 10 oct. 1868, Correspondance, t. IX, p. 332; MEW 32, p. 181.
143. Thories, t. II, p. 126; MEW 26.2, p. Ill. Trad. modifie.
144. Ibid. - Marx poursuit: Si la conception de Ricardo va dans le sens de l'intrt de la
bourgeoisie industrielle, c'est uniquement parce que, et dans la mesure o, l'intrt de cette dernire
concide avec celui de la production ou avec le dveloppement productif du travail humain. L o
elle s'oppose cet intrt, il est tout aussi brutal l'encontre de la bourgeoisie qu'il l'est par
ailleurs vis--vis du proltariat et de l'aristocratie (ibid.).
145. La Sainte Famille, p. 116; MEW 2, p. 98. - M. Grard Bloch (in MEHRING, Vie de Karl
Marx, Paris, d. Pie, 1984, p. 402, n. 15) attribue faussement ces lignes Marx. Dans ce premier
ouvrage que Marx et Engels ont publi en commun, les divers chapitres et paragraphes sont crits
tantt par l'un, tantt par l'autre, ce que signale la table des matires.
146. L'idologie (1968) p. 71; (1976) p. 40; (bi!.) pp. 132-133; MEW 3, p. 39.
147. L. Kugelmann du 3 mars 1869, Correspondance, t. X, p. 44; MEW 32, p. 597.
148. Les luttes de classes, Introduction d'Engels du 6 mars 1895, p. 16; MEW7, p. 514.
-
Au
cours de son analyse, Engels explique: L'histoire nous a donn tort nous et tous ceux qui
pensaient de faon analogue. Elle a montr clairement que l'tat de dveloppement conomique
sur le continent tait alors bien loin encore d'tre mr pour la suppression de la production
capitaliste.. (ibid., p. 19; p. 516).
149. Ludwig Feuerbach, (bil.) pp. 42-43; (1966) p. 33; MEW 21, p. 278.
150. Avant eux, la finalit en histoire restait mystrieuse: on devait recourir quelque
260 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
finalit consciente et rationnelle, ou une finalit transcendante et mythique (mythes de cration,
de chute, etc.). Toutes deux s'accordaient mal avec les faits.
151. Thses sur Feuerbach, in L'idologie (1968) p. 32; (1976) p. 2; (bi!.), pp. 26-27; MEW 3,
p. 533. Engels a explicit le manuscrit de Marx qui renvoie seulement de manire lapidaire la
doctrine matrialiste de la modification des circonstances et de l'ducation .
-
Il est aussi
question de cette thorie matrialiste des circonstances [Umstandstbeorie] dans la critique de
L'unique et sa proprit de Stirner (ibid., p. 463; p. 426; MEW 3, p. 406). Mais, daDs ce dernier
passage, Marx ne la rejette pas explicitement.
152. Sur le matrialisme, on se reportera utilement au petit ouvrage de synthse de
M. Olivier Bloch: Le matrialisme, Paris, Presses Universitaires de France, Que Sais-Je?, 1985.
153. Cf. Anti-Dhring, passim, et Dialectique, pp. 75 et suiv.; MEW20, pp. 354 et suiv.
154. Origine et transformation de l'homme et des autres tres, Paris, 1865. Pierre Trmaux
tait un naturaliste franais, chaud partisan du darwinisme.
155. L. Engels du 7 aot 1866, Correspondance, t. VIII, p. 304; Lettres sur les sciences,
p. 48; MEW 31, p. 248.
156. Ibid.
-
Ce qui impressionne Marx, c'est la possibilit de trouver chez Trmaux la
rponse aux difficults que ne rsolvait pas Darwin. Il en numre toute une srie (ibid.).
157. Ibid.
158. L. Engels du 3 oct. 1866, ibid., p. 320; pp. 51-52; pp. 257-258.
159. Ibid.
160. Le livre de Trmaux tomba rapidement dans l'oubli.
161 Op. cit., t. l, p. 50.
162. Selon Mme Yvette CONRY, on peut se demander si ce n'est pas cette causalit par le
terrain qui a sduit Marx (L'introduction du darwinisme en France au XIX< sicle, Paris, Vrin,
p. 220, n. 38). Certes, condition de ne pas comprendre cette dtermination d'une faon
unilatrale: on l'a vu, le terrain n'est qu'un facteur parmi d'autres.
163. Nous avons dit que Sartre en a convenu (cf. ci-dessus, p. 42, n. 25 et p. 60, n. 82).
164. Troisime thse sur Feuerbach (L'idologie (1968) p. 32; (1976) p. 2; (bi!.) pp. 26-27;
MEW 3, p. 533).
165. Premire thse sur Feuerbach (ibid., p. 31; p. I; pp. 24-25; p. 533).
166. Troisime thse sur Feuerbach (ibid., p. 32; p. 2; pp. 26-27; p. 534).
167. Cette objection, dj faite l'idalisme hglien dans les Manuscrits de 1844 (pp. 132-
133, MEW EB I, p. 574), est rpte contre les Jeunes hgliens tout au long de l'idologie
allemande, en particulier contre Stirner qui parlait de (da concidence du possible et du rel
1968) p. 463; (1976) p. 426); MEW 3, p. 406), affirmant que (de malentendu le plus lourd de
consquences au cours des millnaires s'est cach derrire le mot "possible" . Stirner soutenait
que l'homme possdait des forces natives, et qu'i! suffisait d'une impulsion de la volont
individuelle (un ordre) pour les manifester, que les circonstances pouvaient tout au plus jouer un
rle dfavorable: elles empchaient un pote-n [...] de crer de grands chefs-d'uvre [...]; mais
il crira, c'est sr>' (cit par Marx, ibid., pp. 463-466; pp. 427-430; pp. 406-409). Marx tourne en
ridicule cette ide absurde de potes, musiciens et philosophes-ns et cette thorie des
circonstances dfavorables (ibid.).
168. Ibid., p. 70; p. 39; (bi!.), pp. 130-131; MEW 3, p. 39.
169. Ibid., p. 70; p. 39; pp. 128-129; p. 38. Soulign par nous.
170. Malgr le sous-titre de L'idologie allemande, il ne s'agissait pas seulement d'une
critique de la philosophie allemande la plus rcente dans la personne de ses reprsentants:
Feuerbach, B. Bauer et Stimer .
171. Ibid.
-
La Conscience de soi , le Genre (ou Essence de l'homme) et
1'
Unique,
taient respectivement les concepts-cl de Bruno Bauer, de Feuerbach et de Stirner.
172. C'est l'argument de la Troisime Thse sur Feuerbach (cf. n. 165 de la p. prcd.).
173. L'idologie (1968) p. 72; (1976) p. 41; (bi!.) pp. 134-135; MEW 3, p. 40. Trad. modifie.
174. Ibid., p. 97; p. 65; pp. 208-209; p. 70.
- D'o la dfinition des communistes comme
matrialistes pratiques . Il conviendra donc de dire du matrialisme de Marx que c'est un
matrialisme pratique: [...] pour le matrialiste pratique, c'est--dire pour le communiste, il s'agit
de rvolutionner le monde existant, de saisir [angreifen] et changer [verandern] pratiquement l'tat
de choses qu'il a trouv (ibid., p. 54; p. 24; pp. 80-81; p. 42. Trad. modifie). Cette dfinition du
matrialisme ressort galement des Thses sur Feuerbach.
175. On songe ici la clbre thorie de Taine, qui considrait la conjonction de trois
facteurs: le milieu, la race et le moment. Mais, ces trois facteurs , sauf peut-tre le moment
LA POSSIBILIT CONCRTE
261
(que Taine ne dfinissait pas avec prcision), rentrent dans les circonstances" au sens de Marx,
c'et--dire ramnent aux conceptions des matrialistes franais du XVIIIesicle.
176. Ibid., p. 70; p. 39; pp. 128-129; p. 38.
177. Manifeste, pp. 124-125: MEW 4, p. 573. -II s'agit de la Prface la seconde dition
allemande, date du 24 juin 1872, qui introduit des modifications par rapport la premire
dition: le programme rvolutionnaire de 1848 avait vieilli!
178. Beaucoup de marxistes franais ont eu, depuis deux ou trois dcennies, une forte
rticence admettre que le concept de finalit puisse avoir un sens dans un matrialisme, en
premier lieu, Louis ALTHUSSER[cf. Remarques sur une catgorie: Procs sans Sujet ni Fin(s)",
Rponse John Lewis, Paris, Maspro, 1973, pp. 69 et suiv.] - Cf. aussi l'article Tlologie" d
M. Jean-Pierre COTTEN,dans le Dictionnaire critique du marxisme, pp. 1131-1132.
179. Pour Karl Popper, Marx a fait croire que la prophtie historique est une mthode
scientifique permettant de traiter les problmes sociaux,,; il a t un prcurseur de la doctrine
pragmatiste selon laquelle le rle principal de la science n'est pas de connatre les vnements
passs, mais de prdire l'avenir" (op. cit., pp. 60, 61 et passim)
- Nanmoins, des conceptions
matrialistes et des thories scientifiques admettent sans difficult des formes de finalit et
recourent au mode d'explication tlologique. Le darwinisme en est l'exemple le plus clbre et le
plus convaincant, ce que Popper ne dnie pas: il tente de l'appliquer pour lendre compte de
l'histoire des sciences (Cf La connaissance objective, trad. Bastyns, Bruxelles, Editions complexe,
1972, ~16: Esquisse d'une pistmologie volutionnaire).
180. Selon Spinoza, la finalit naturelle" est une illusion anthropomorphique. Cependant,
Spinoza ne niait pas que l'action humaine ft finalise: Tous les prjugs que j'entreprends de
signaler [...] dpendent d'un seul: les hommes supposent communment que toutes les choses
naturelles agissent, comme eux-mmes, en vue d'une fin"
(Op. cit., L. I, Appendice, p. 347).
181. Pour justifier l'uvre de la Rvolution franaise en matire conomique, Proudhon
crivait: Pourquoi donc, si la concurrence n'et t un principe de l'conomie sociale, un dcret
de la destine, une ncessit de l'me humaine, pourquoi, au lieu d'abolir corporations, matrises et
jurandes, ne songeait-on plutt rparer le tout? (cit par Marx in Misre, p. 154; MEW 4,
p. 160).
182. Ibid.
183. Karl Marx, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1981, p. 105 (trad. par nous).
- C'est l
que se trouve, selon cet interprte, la spcificit du matrialisme historique, ce type d'explication
se retrouvant tous les niveaux dans une socit: Marx explique (tlologique ment) les rapports
sociaux en termes de forces [powers] productives, ou les phnomnes politiques et idologiques, ou
la lutte de classes, en termes de structure conomique de la socit" (ibid., p. 110; trad. par nous).
Il prcise que cela n'exclut pas (mais au contraire inclut positivement) que certains aspects des
rapports sociaux figurent dans les explications causales de l'tat et du dveloppement des forces
productives" (ibid.). On trouve une interprtation identique chez G. A. COHEN (Karl Marx's
Theory of History, 2e d., Oxford, Clarendon Press, 1979, chap. IX et X), qui s'arrte longuement
sur 1'explication fonctionnaliste" en gnral et chez Marx en particulier.
184. Kant avait analys cette finalit immanente aux tres vivants. Hegel et Marx l'ont
reprise avec la catgorie d'action rciproque. De ce fait, il est possible de ranger Marx parmi les
organicistes", les fonctionnalistes", et mme les rcents structuralistes". Mais sa pense ne se
rsume pas cela!
185. L'histoire a-t-elle un sens?" demande Karl Popper (La socit..., p. 179), qui rpond
sans la moindre explication: A mon avis elle n'en a pas." Sa crainte de verser dans quelque
philosophie de l'histoire est telle qu'il va jusqu' dire que, la question: ne peut-il vraiment
pas y avoir une histoire de l'humanit?", tout humaniste et tout chrtien doit [...] rpondre par
la ngative" (ibid., p. 180). Bizarre humanisme, trange christianisme!
186. En tout cas,' Marx rejette tout providentialisme, ainsi que les diverses conceptions
classiques des causes finales (par exemple celles de Platon ou de Leibniz). Il n'en fait pas la critique
systmatique, mais procde plutt par des remarques incidentes contre ces doctrines finalistes. Il
faut scruter ces remarques avant de dire qu'il rejette toute tlologie en histoire, ce qui est faux.
187. L. du 28 janv. 1863, Correspondance, t. VII, p. 129; L. sur Le capital", p. 134; MEW
30, p. 321. Trad. modifie.
188. Introduction, Contribution, p. 169; Mthode, pp. 170-171; MEW 13, p. 636.
-
Une des
images concrtes possibles pour se reprsenter ce processus d'volution historique par combinai-
son d'lments de sources diverses serait celle d'un arbre gnalogique qui remonte d'un individu
ses anctres.
189. L'idologie (1968) p. 481; (1976) p. 444; MEW 3, p. 423. Trad. modifie.
262 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
190. Ibid.
191. Ibid. Trad. modifie.
-
On notera l'analogie entre les rapports de gnrations et les
rapports des individus dans une communaut.
192. Marx emploie le mot Zusammenhang, que certains traduisent par connexion
".
Notons
bien que ce n'est pas une interdpendance proprement parier: les gnrations d'une poque
donne ne dpendent pas des gnrations postrieures!
193. La lettre Annenkov du 28 dco 1846 le dit trs bien: Par ce simple fait que toute
gnration postrieure trouve des forces productives acquises par la gnration antrieure, qui
servent elle comme matire premire de nouvelle production, il se forme une connexit dans
l'histoire des hommes, il se forme une histoire de l'humanit (Correspondance, t. I, p. 448; Lettres
sur Le capital, p. 27; MEW27, p. 452.
-
Cette lettre fut rdige en notre langue: Marx s'excuse
de son mauvais franais. Les diteurs allemands ont traduit le mot conl;exit par
Zusammenhang. Est connexe ce qui a des rapports intimes avec d'autres choses, dit Emile Littr
dans son Dictionnaire de la langue franaise).
194. Anti-Dhring, p. 213; MEW 20, p. 168.
195. L'idologie (1968) p. 65; (1976) p. 35; (bi!.) pp. 116-117; MEW 3, p. 45. Soulign par
nous. (Voir ci-dessus, p. 225). Trad. modifie.
196. Ibid., pp. 65-66; p. 35; pp. 116-117; p. 45.
197. Op. cit., p. 109. Trad. par nous.
198. L'idologie (1968) p. 98; (1976) p. 67; (bil.) pp. 212-213; MEW 3, p. 72.
199. Ibid., p. 98; p. 67; pp. 214-215; p. 72.
200. Ibid., p. 97; p. 66; pp. 210-211; p. 71. Soulign par nous.
-
Cela confirme ce que nous
avancions propos du rapport de Marx aux diverses formes de dterminisme en histoire; il n'y a
ni Raison suprieure et transcendante, ni loi gnrale au contenu dtermin l'avance. Le
matrialisme historique n'est pas un dterminisme finaliste, qui affirmerait une finalit prexis-
tante s'imposant aux hommes de l'extrieur.
Chapitre 6
LES FORCES
La force vive est ce qui se
paie.
MONGOLFIER
Le concept de force tient une place importante dans les conceptions de
Marx. Mais il n'a pas le culte de la force pour la force. Ce sont essentiellement
les forces productives qui retiennent son attention, car, c'est leur dvelop-
pement qui rend possible toute civilisation humaine.
Il pensait que l'histoire n'est pas la manifestation de forces sauvages et
aveugles, mais de forces matrielles et sociales destines satisfaire des besoins
humains; elles ne se dveloppent que grce l'action des hommes, qui
sont conscients au moins de leurs buts immdiats.
Par ces deux aspects qui pour lui caractrisent les forces, Marx se
distingue de ceux pour qui ce sont des forces obscures et irrationnelles qui
prsideraient au cours de l'histoire. Il en rsulte que l'histoire est un
dveloppement sens, non une succession sans rime ni raison; elle est
progrs , non bruit et fureur .
Toute socit humaine volue et change. Du point de vue quantitatif, c'est
une croissance; du point de vue qualitatif, c'est une progression, car tout
accroissement quantitatif, au-del d'un certain degr, implique des change-
ments qualitatifs. L'accroissement des forces productives rend possible et
ncessaire un changement des conditions d'existence sociales, et par voie de
consquence un changement des activits humaines spirituelles: science,
art, religion, philosophie.
L'homme se civilise. Le dveloppement des forces productives est la
condition de possibilit sine qua non de cette humanisation. Il est la condition
pour que le processus historique soit matris et dirig, pour qu'il devienne
conforme un but humain conscient et voulu.
264 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Nous avons dit que les tendances, par leur aspect historique, taient une
des formes de la possibilit concrte. Il en est de mme des forces productives.
Comme elles sont fondamentales pour Marx, le concept de possibilit est
profondment inscrit dans sa conception du monde et de l'histoire.
Comment entendait-il le concept de force en gnral? Qu'est-ce qui
caractrise la force de travail? Quel rle jouent exactement les forces naturelles
dans sa conception matrialiste de l'histoire?
Parmi les forces, les forces productives humaines semblent avoir, au
premier abord, un rle primordial, qu'il s'agisse des forces individuelles ou des
forces collectives. Mais le concept de forces recouvre aussi les forces naturelles.
Nous tablirons que Marx leur fait une large place, et que la possibilit
historique dpend partout et toujours des possibilits naturelles elles-
mmes.
J. Le concept de force matrielle
Le concept de force a bien des acceptions. Cette notion a exerc la
sagacit des savants et suscit la critique des philosophes. L'existence de forces
dans la nature, leur essence, leur origine, leur liaison la matire, autant de
questions qui ont t beaucoup dbattues par les sciences et la philosophie.
Les forces, pour Marx, qu'il s'agisse des forces de l'homme ou de celles
d'tres ou d'agents quels qu'ils soient, sont d'abord et fondamentalement,
matrielles, lies indissolublement la matire, inhrentes la matire.
Les forces de l'homme, ce sont ses capacits corporelles et spirituelles
(geistig). Marx semble en emprunter la notion aux sciences naturelles, la
physique et la physiologie. IlIa prend en un sens objectif: mme lorsqu'elles
appartiennent l'agent humain qui, en tant que sujet de l'action, possde et
met en uvre des facults spcifiques, ce sont des forces matrielles.
Marx considre toutes les activits comme des formes ou des manifestations de
forces de nature matrielle. Qu
' est-ce dire?
Matriel ici ne signifie pas qu'il rduise la force la matire dfinie par
des proprits exclusivement mcaniques (l'inertie, la rsistance, l'impntra-
bilit, etc.), comme le faisaient les philosophes matrialistes atomistes ou
cartsiens. Une force est un principe d'action 1.
Cependant, Marx ne se plaait-il pas ainsi au point de vue des physiciens
modernes? Selon mile Littr, la force est la proprit qui fait que le corps
d'un homme ou d'un animal a une certaine puissance d'action2, ce qui rentre
dans l'acception plus large et plus gnrale de la force en tant que puissance
d'action et d'impulsion des agents physiques3.
Ces puissances des agents physiques, ce sont les diverses sortes
d'actions exerces par les corps matriels les uns sur les autres, telles que la
gravitation, la chaleur, l'lectricit, le magntisme, l'affinit chimique, etc.
Quand Marx voque les forces en gnral, c'est en ce sens qu'il l'entend.
LA POSSIBILIT CONCRTE
265
Mais lorsqu'il parle des forces productives de l'homme, il dit qu'elles
prsentent des qualits propres qui s'ajoutent leur qualit gnrique d'tre
des forces matrielles ", c'est--dire naturelles. Chez l'homme, les forces sont
qualifies , ce sont des forces dveloppes, riches d'un certain contenu qui
est acquis ou hrit, qui, surtout, est transmis: il convient, en effet, de faire
entrer en ligne de compte les savoirs-faire et toutes les connaissances particu-
lires qui sont incluses dans les pratiques, et non de considrer la seule mise en
uvre de la force physique nue.
Pourtant, la force productive de l'homme peut se trouver rduite sa
simple force vitale: c'est ce qui arrive l'ouvrier avec la mcanisation des
moyens de production, et avec la captation de sources d'nergies naturelles
utilises dans des moteurs, deux choses qui, runies, rduisent le travailleur
n'tre que l'appendice d'un systme de machines.
Donc, ce que recouvre le concept de force chez Marx est tout fait
variable. Or, en physique galement, on nomme d'un seul mot diffrentes
sortes de forces. Il y a celles qui sont des causes motrices inpuisables et
permanentes: leur action s'exerce toujours; c'est le cas de la force d'attraction
ou pesanteur. On dsigne aussi par force ce qui se dpense dans l'action et
s'puise, tels les combustibles qui doivent tre renouvels. Ces divers types de
forces sont appels nergie par la physique, en particulier dans le fameux
principe de conservation de l'nergie4.
En outre, la mme force ou nergie se prsente sous des formes diffrentes
et des aspects contradictoires. Elle est ce qui agit et aussi ce qui est en attente
d'agir: la physique parle de forces au repos, d'nergie emmagasine , comme
on parle de choses . Une force, au sens d'nergie, ne s'extriorise pas
toujours ncessairement. Elle doit tre sollicite et peut tre entrave: la
poudre ou l'eau d'un barrage peuvent ne jamais dpenser l'nergie qu'elles
contiennent, cette nergie pouvant se trouver dtruite ou disparatre. La
poudre peut mouiller, la rserve d'eau s'vaporer ou s'infiltrer dans le sol.
Hegel avait insist sur cette dialectique de la force et de son extriorisa-
tion qui fait que la force est l'unit intrieure d'une diversit phnomnale:
d'une part, <<laforce a pour seul tre de s'extrioriser , mais, d'autre part, <<les
extriorisations singulires d'une force se prsentent tout d'abord nous dans
une multiplicit varie indtermine [...], nous rduisons ensuite cette multipli-
cit varie son unit intrieure, que nous dsignons comme force 5.
Pour Marx aussi, la force a un ct actif et un ct passif. Il fait partie de
ces philosophes qui, comme Leiniz et Hegel chez les modernes, Aristote et
Hraclite chez les Anciens, ont rejet la conception mcaniste de la nature.
Comme eux, Marx a une conception dynamiste.
Ce caractre dynamique se retrouve videmment dans l'activit produc-
tive humaine: le travail est qualifi chez Marx de travail vivant et de feu
qui lche son objet de ses flammes. Le travail est l'activit d'un vivant, et
cette activit consume les forces de l'individu, son nergie et son corps. En
distinguant la force de travail du travail proprement dit, Marx recourt l'ide
266 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
que la force peut tre au repos, en attente: elle est l'tat d'nergie
potentielle", au sens de la statique et de la dynamique.
La notion de force matrielle" chez Marx voque la dfinition de
l'nergie mcanique d'un systme physique comme somme de l'nergie
cintique et de l'nergie potentielle des corps de ce systme. On pourrait
assimiler le travail vivant, ou travail en acte, l'nergie cintique (l'nergie du
corps en mouvement) et la force de travail l'nergie potentielle (la rserve
nergtique du corps au repos). Si Marx n'a jamais fait explicitement ce
rapprochement, cette analogie est pourtant constamment suggre par les
caractristiques qu'il attribue au travail et la force de travail.
Il n'ignore pas que le concept de force, tout comme le concept de cause,
a suscit soupons et critiques de la part des nominalistes, des sceptiques, des
empiristes et des positivistes. La notion de cause tant couramment utilise par
les thologiens et mtaphysiciens dans l'argument ontologique pour prou-
ver l'existence d'un Dieu crateur, leurs adversaires ont dnonc le caractre
anthropomorphique des concepts de cause et de force.
Si Marx n'est pas entr dans ces dbats mtaphysiques, il a nanmoins
rejet les solutions spculatives donnes ces problmes. Il partit simple-
ment du fait que des forces entrent en jeu dans la production matrielle
humaine. A la manire des physiciens, il pense que seules des forces peuvent
tre dites causes au sens propre du terme: c'est ce titre qu'elles apparaissent
dans les principes fondamentaux de la dynamique6.
A son sens, les questions de l'origine premire et de la cration du monde
telles qu'on les formule d'ordinaire en mtaphysique sont mal poses:
Qui a engendr le premier homme et la nature en gnral [demandes-
tu]? Je ne peux que te rpondre: ta question est elle-mme un produit de
l'abstraction. Demande-toi comment tu en arrives cette question [...J. Si tu
poses la question de la cration de la nature et de l'homme, tu fais donc
abstraction de l'homme et de la nature. Tu les poses comme n'existant pas et
tu veux pourtant que je te dmontre qu'ils existent. Je te dis alors: abandonne
ton abstraction et tu abandonneras aussi ta question 7.
Pour ses analyses conomiques et historiques, Marx recourut aux ensei-
gnements les plus rcents de son temps en physique, en chimie, en physiologie,
sciences pour lesquelles les forces inhrentes la matire sous les formes o on
les a numres ci-dessus, sont les causes des phnomnes; il est vain de leur
chercher quelque autre cause transcendante. Car, le doute sceptique, les
ngations des empiristes, et la critique positiviste ne sont pas concluants pour
Marx. Ils sont infirms par les milliers d'expriences qui montrent journelle-
ment que, dans la nature et dans l'activit humaine, des forces dtermines
entrent en jeu: elles meuvent les individus et les corps matriels, elles animent
les lments, le vent, l'eau, etc.
Marx dfinit souvent la force de travail par la dpense productive du
cerveau, des muscles, des nerfs, de la main de l'homme8 . Cela ne signifie
LA POSSIBILIT CONCRTE
267
pourtant pas qu'il soit mcaniste, ou rductionniste. Il ne se contente ni des
concepts de la mcanique, ni mme de ceux de la physiologie pour dcrire la
force de travail propre l'homme. Lorsqu'il crit: tout travail est d'un ct
dpense, dans le sens physiologique, de force humaine , il ajoute: de l'autre
ct, tout travail est dpense de la force humaine sous telle ou telle forme
productive, dtermine par un but particulier9.
Les critiques du marxisme ne tiennent pas compte de cette importante
adjonction, en particulier de la finalit de l'activit qui est bien souligne ici.
Ils ne retiennent gnralement que ,de ct physiologique pos en premier:
le travail est dpense de nerfs, de muscles, de cerveau, c'est--dire de choses ,
se htent-ils de traduire. Ainsi, l'insistance de Marx dire les forces mat-
rielles a servi de cible aux critiques de tous bords.
Ceux-ci commettent un contresens. Sartre. nous fournit un excellent
exemple de cette interprtation rductrice qui fait violence au matrialisme
dynamiste de Marx. Dans sa critique du matrialisme marxien, il carte
dlibrment la spcificit de la force de travail humaine. Il ne prend mme
pas en considration le fait que Marx et Engels mettent les forces inhrentes
la matire la base de leur conception de la nature.
Revenons un instant la critique sartrienne qui a valeur exemplaire par
le sort qu'elle rserve la notion de force. Tous les efforts de Sartre dans son
analyse du matrialisme marxiste de 1949 allaient liminer les forces. Il
s'appuyait sur un prtendu enseignement des sciences contemporaines.
On l'a vu, Sartre comprit d'abord le marxisme comme si celui-ci avait
soutenu la dtermination unilatrale de l'homme par les circonstances et le
milieu. Son raisonnement tait trs simple. La dmarche de tout matria-
liste, dit Sartre en substance, est de ramener les mouvements de l'esprit
ceux de la matire, et ainsi d' liminer la subjectivit en rduisant le monde,
avec l'homme dedans, un systme d'objets relis entre eux par des rapports
universels 10. Or, Marx et Engels sont matrialistes, donc... (concluez vous-
mme)! Ainsi, Marx et Engels seraient mcanistes! C'est le plus beau
contresens que l'on pouvait faire sur leur conception philosophique gnrale.
Sartre faisait comme si, pour Marx, le monde tait un monde d'objets!
Il n'y a aucune phrase dans l'uvre de Marx et d'Engels qui dise cela, mais
qu'importe. Sartre reprenait en effet la caricature de la science que donnaient
la phnomnologie contemporaine et le positivisme, voire le spiritualisme
franais du XIX. sicle!
Il invoque la science bourgeoise qui a fait ses preuves, une science pour
qui, dans le monde, il n'y aurait que des rsultantes passives, des tats,
rpte-t-illl. Il soutient qu'un objet matriel , pour la science, est anim du
dehors, [...], soumis des forces qui viennent toujours d'ailleurs 12! Sartre
affecte de ne pas connatre la clbre quation d'Einstein et la rvolution
relativiste 13. Dans le mme esprit, il dclare la notion d' histoire naturelle
absurde et s'en prend au darwinisme, sans entrer dans aucun dbat
srieux 14.
268 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Pour Sartre donc, tout se passe comme si la science en tait reste au vieux
mcanisme cartsien, perfectionn par Laplace et auquel Bergson opposait
l'lan vital et la conscience. C'est pour Descartes, en effet, et pour les
spiritualistes, que le mouvement survient aux choses" de l'extrieur
".
Marx
ne dfinissait pas la matire par l'inertie, ni ne rduisait les forces des forces
mcaniques. Dans cette critique du matrialisme philosophique de Marx,
Sartre ne considre jamais les forces productives ", ni leur rapport aux
forces naturelles . Pour Sartre, la nature est sans force, sans dynamisme,
sans mouvement et sans devenir intrinsques: elle n'existe pas!
Tous les critiques du matrialisme de Marx ne sont pas aussi radicaux
dans l'exclusion du concept de force
".
Mais, beaucoup le laissent dans
l'ombre. M. J.-Y. Calvez glisse discrtement sur les analyses marxiennes du
processus de travail et sur la conception de la nature et de l'tre vivant qui lui
sert de base. S'il s'occupe des rapports entre conscience sociale et infrastruc-
tures, il ne s'intresse gure aux rpercussions sociales du machinisme et de la
technique en gnral, ni aux forces naturelles, comme si ces choses n'taient
pas essentielles pour comprendre la pense de Marx 15.
Karl Popper procde peu prs de mme 16.D'autres interprtes rcents
parlent galement fort peu des forces, y compris des forces productives: c'est
le cas de M. Michel Henry, sauf sur un point, la division du travail. M. Louis
Althusser, lui non plus, ne s'interroge pas sur la nature des diffrentes forces
dans les analyses conomiques marxiennes.
Le concept de force est emprunt par Marx, avec celui de force produc-
tive, l'conomie politique et, au-del, aux sciences physiques en gnral, sans
que la force de travail, ou tout autre force, soit rduite ", pour cette raison,
l'nergie mcanique, car Marx ne pense pas que l'quivalence des formes de
l'nergie signifie leur rduction" sa forme mcanique.
Comme beaucoup d'autres concepts qui passent pour spcifiquement
marxiens , celui de force productive n'a pas du tout t dcouvert et
introduit par Marx. Il n'en change pas non plus le sens, contrairement ce que
l'on croit souvent. Cette croyance vient du fait qu'il a compltement renouvel
l'explication de l'origine de la plus-value en la fondant sur la distinction entre
force de travail et travail. Mais, force productive" tait courant: on le
rencontre chez les conomistes classiques et toutes sortes d'crivains s'en
servaient 17.
Marx ne donne pas de dfinition a priori des forces productives, sinon
qu'elles sont matrielles: toute force naturelle peut, d'une faon ou d'une
autre, tre productive. Les forces sont une donne de la nature. C'est une de
ces prsuppositions gnrales dont il faut partir dans l'analyse conomique et
dans la conception de l'histoire.
Comme les lois conomiques, les forces productives matrielles ont un
caractre historique, puisqu'elles sont dcouvertes et utilises certaines
poques et dans certaines conditions sociales. Leur changement est l'origine
du mouvement historique.
LA POSSIBILIT CONCRTE 269
Dans les rapports des hommes la nature, lorsque des forces nouvelles
(nouvelles sources d'nergie par exemple) sont dcouvertes, cela entrane,
travers des circonstances, des mdiations et des tapes diverses, des boulever-
sements dans les capacits productives, dans les manires d'tre et d'agir tous
les niveaux. Tt ou tard, c'est tout l'ensemble socio-conomique de la
communaut humaine qui est transform, mtamorphos. L'histoire
dpend donc aussi des forces naturelles et pas seulement des forces productives
humaines.
2. La spcificit de laforce de travail
Parmi toutes les forces productives, celle dont il est principalement
question dans Le capital, parce qu'elle est l'origine de la plus-value
capitaliste, c'est la force de travaiP8. Avec la loi de la baisse tendancielle du
taux de profit, nous avons vu que, d'un ct, le capitalisme tend dvelopper
cette force le plus possible pour accrotre la quantit de la plus-value cre, et
que, de l'autre, il tend rduire le plus possible son emploi pour lever le taux
de la plus-value (principal moyen d'lever le taux de profit dans la concur-
rence). L'aspect absolu ou quantitatif (la masse de plus-value) et l'aspect relatif
(le taux de plus-value) entrent en opposition. Dans le processus capitaliste de
production de plus-value, ils se contrarient, et des contradictions apparaissent.
L'accroissement de la force de travail est ainsi l'une des conditions de
possibilit du dveloppement capitaliste. Cette foree, engendre par le capita-
lisme qui ne peut l'utiliser compltement, recle la possibilit de son dpasse-
ment, celui-ci devenant un moment donn une ncessit historique .
Dans la force de travail, nous trouvons donc la forme minente de la
possibilit historique concrte. Si elle n'en est pas le seul facteur, du moins est-
elle l'un de ses facteurs essentiels.
Cette force consiste dans les capacits physiques et intellectuelles de
l'individu productif: le travailleur. Elle existe concrtement en lui. Dans la
socit moderne, elle s'identifie lui, car le capital prsuppose que l'ouvrier ait
t rduit sa force de travail et soit reproduit continuellement sous cette
forme.
Pour autant, la force de travail n'est pas toujours sollicite et dpense.
Mises part les priodes de repos ncessaires au point de vue vital, elle peut
ne pas tre consomme dans un processus productif effectif, ce qui arrive
lorsqu'il y a chmage, partiel ou total, des classes laborieuses. Cela justifie la
distinction entre force de travail et travail.
Marx a fait davantage: il a montr que eette distinction est tout fait
essentielle pour la thorie conomique du mode de production capitaliste. Elle
est une des cls permettant de comprendre la possibilit du profit d'entre-
prise et donc du mode de production capitaliste lui-mme. Elle claire les
causes de son apparition et de son dveloppement historique.
270 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Cette distinction est cruciale pour dterminer l'volution en cours de la
socit capitaliste et fonder sur cette connaissance une action politique efficace
parce qu'adapte.
Qu'est-ce que la force de travail? Le concept en parat clair. Nous allons
voir qu'il n'en est rien. Nous l'avons dj dit, on peut la penser par analogie
avec l'nergie potentielle en mcanique. De mme qu'un poids (p. e. une masse
d'eau), lev et maintenu d'une manire quelconque une certaine hauteur,
possde une nergie potentielle, de mme les capacits de travail qui existent
chez l'ouvrier y sont l'tat potentiel tant qu'elles ne sont pas consom-
mes dans un travail effectif.
Le travail lui-mme consiste dans le processus concret et singulier de
ralisation d'un tche (transformation d'un matriau, etc.) qui implique la
vise d'un but, la tension de la volont et la continuit de l'effort et de
l'attention 19.
Marx qualifie le travail en acte de travail vivant , de mme que Leibniz
appela la force physiquement agissante une force vive. C'est le travail qui
anime les instruments et tout l'appareil productif. Surtout, le travail est dit
vivant parce qu'il plonge lui-mme ses racines dans la vie de l'homme.
L'tre humain qui travaille use les forces dont il dispose au dbut du
processus. Lorsqu'elles sont puises, il lui faut les reconstituer, ce qui est
possible grce au processus vital de l'assimilation.
Par opposition au travail, matires premires et instruments (machines,
outils), qui, livrs eux-mmes, resteraient inertes, sont dits morts, et le
capital qu'ils reprsentent, obtenu par du travail vivant pass, est qualifi de
travail mort .
Marx parle donc tout naturellement de travail en puissance pour
dsigner la force de travail et de travail en acte pour dsigner le travail
effectif. Ces notions aristotliciennes ne sont pas trs frquentes dans Le
capital o prdomine le vocabulaire de la physique et de la physiologie.
Le concept de force de travail renvoie, chez Marx et les conomistes en
gnral, celui de force ou d'nergie au sens des sciences physiques, et il est
normal que Marx, voyant dans l'conomie politique la science naturelle des
socits, emploie le concept de force dans le mme sens que les naturalistes et
que les physiciens.
Cependant, il ne rduit pas la force de travail son aspect purement
mcanique. Il ne la prend pas d'une faon simplement quantitative, comme le
font les physiciens pour expliquer les mouvements mcaniques. La physique
elle-mme ne peut s'en tenir au seul aspect quantitatif des phnomnes: les
forces qu'elle tudie sont des forces de gravitation , ou de l'nergie
cintique , ou des forces lectro-magntiques , etc.
Dans la force de travail, c'est d'une disposition de l'individu vivant
humain qu'il s'agit 20, c'est--dire qu'il faut la prendre en mme temps sous sa
forme qualitativement dfinie. Marx ne manque pas de le rappeler: l'homme
se distingue des animaux par sa conformation spcifique; il n'a pas seulement
LA POSSIBILIT CONCRTE 271
des nerfs et des muscles, mais il est dou par nature de mains et d'un
cerveau , c'est--dire d'organes propres des usages spcifiques, qui
modifient tout son comportement. Sur le plan biologique, l'homme a en effet
une configuration naturelle21 tout fait singulire .
Mais Marx va plus loin encore. Aprs avoir dfini la force de travail en
tant que capacit de l'homme de se raliser par une manifestation extrieure
grce une certaine dpense des muscles, des nerfs, du cerveau , il ajoute:
la diffrence des autres marchandises, la dtermination de valeur de la force
de travail contient [...] un lment historique et moraJ22.
En effet, explique-t-il, cette valeur dpend en grande partie [grossenteils]
du degr de culture [Kulturstufe] du pays, [...] des conditions dans lesquelles la
classe des travailleurs libres s'est forme, et par consquent de ses habitudes et
de ses exigences propres 23. Bien sr, elle dpend aussi. des besoins dits
ncessaires qui varient avec les conditions climatiques, et les autres
particularits physiques du pays24.
On voit que la force de travail n'est pas une dpense de force naturelle que
l'on puisse mettre, tous gards, sur le mme plan que les autres forces de la
nature. On ne saurait la rduire celles-ci. Bien des lments (physiologi-
ques, biologiques, historiques et sociaux) entrent en elle. Elle possde des
qualits originales lies l'histoire de la formation sociale laquelle
l'individu appartient.
En tant qu'individu social, tout homme est un produit historique: ses
capacits et facults, ses possibilits , sont issues d'une histoire individuelle
et collective singulire. Ses sens, comme l'oue et la vue, sont eux-mmes
l'objet d'une formation, d'une ducation [Bildung]25. Il en va ainsi de
toutes les facults de l'homme qui entrent dans sa force de travail .
Ce qui est tonnant, c'est que Marx fasse entrer ces lments histori-
ques dans la dtermination de valeur [Wertbestimmung] de la force de
travail, car, on l'a vu, quand il ne prcise pas, c'est de la valeur d'change qu'il
s'agit. Il est ais de comprendre que la valeur d'usage de la force de travail
varie selon les coutumes, les pays, les poques et les civilisations. Il l'est moins
de comprendre que cela se rpercute dans la valeur d'change. Cependant,
tant une certaine quantit de travail moyen, celle-ci implique les aspects
socio-historiques qualitatifs moyens de la force de travaiJ26. Il faut donc
admettre que la dfinition de la valeur d'change comme pure quantit
<temps de travail indiffrenci) est abstraite, et que sa dtermination
concrte, un moment donn et dans un pays donn, fait indirectement entrer
en ligne de compte ces lments historiques et moraux dans l'tablissement
de la valeur moyenne.
A la rigueur, c'est pour les travaux les plus simples que la force de travail
consiste en qualit physiques dnues de qualification historique et morale, et
qu'elle se rduit des capacits quasiment animales et physiques. Dans cette
forme la plus simple, la force de travail peut tre gale chez un homme, une
femme ou un enfant. Mais mme alors, outre les proprits physiques de la
272 MARX PENSEUR DU POSSrBLE
force de travail, intervient un minimum de caractristiques psycho-physi-
ques.
Certes, l'homme peut tre remplac dans certaines tches par des agents
ou tres physiques, par certains animaux, ou par des forces naturelles
lmentaires, qui le concurrencent dans des fonctions devenues mcaniques.
C'est l le cas limite, la borne infrieure en-dessous de laquelle on ne saurait
descendre et o la force de travail touche la force nue", au travail muet",
et s'identifie aux forces aveugles de la nature, quoique cette limite soit
lastique et qu'elle varie avec les modes de production, la dcouverte de
nouvelles lois" de la nature et les inventions techniques. Pourtant, cette
possibilit-limite est terriblement relle: la mcanisation des tches et le mode
de production capitaliste concurrentiel ont donn une ralit cette rduction
l'identit entre la force de travail humaine et les forces simples requises chez
l'homme pour faire fonctionner les machines: avec l'asservissement de l'ou-
vrier la machine dans les conditions qu'imposa le systme socio-conomique
bourgeois, on assista une dgradation des qualits humaines du travail.
Pourtant, ds qu'une certaine qualit" du travail autre que la pure force
musculaire ou nerveuse est requise, s'agirait-il seulement de savoir compter
(par exemple pour faire un tissu de tant de fils sur un mtier ou une machine),
il faut un minimum de qualification intellectuelle,,: pour dnombrer, il faut
faire un minimum de calculs. Aucun animal ne peut alors remplacer l'homme,
mme si, par son caractre rptitif, et mcanique", le travail humain est
rabaiss au niveau de tches quasiment animales".
Quand Marx parle du travail comme dpense de force musculaire,
nerveuse, etc., ce serait commettre un contresens que de l'entendre d'une
manire rductrice. S'il se place, dans l'tude du processus de production, un
point de vue objectiviste comme on le fait dans toutes les sciences naturelles,
s'il emploie leur langage, cela ne veut pas dire qu'il rduise la force de
travail" l'nergie au sens purement mcanique du terme.
Un crivain socialiste, S. A. Podolinski, proposa d'valuer la force de
travail" moyenne de l'homme en units caloriques27". Engels, dans une
lettre Marx28, discute cette tentative et conclut son absurdit conomique,
en montrant que le travail humain n'est pas rductible au travail" au sens des
physiciens.
Dans une activit productive aussi lmentaire que la chasse ou la pche,
l'homme tire de la nature plus d'nergie <quantum de protines et de corps
gras", explique Engels dans cette lettre) qu'il n'en dpense en pratiquant cette
extraction. Engels souligne que ces deux quantits sont indpendantes"
l'une de l'autre.
L'ide de mesurer la force de travail en units physiques avait pour but de
permettre cette comparaison quantitative de l'nergie dpense et du produit
obtenu. Or, cela suppose qu'il n'y aurait ici qu'une transformation d'une
forme d'nergie en une autre, comme en tudient les nergticiens. Si la force
de travail est bien dpense sous forme d'une dpense de calories, cela
LA POSSIBILIT CONCRTE
273
n'empche pas que le travailleur puisse tirer plus d'nergie de la nature qu'il
n'en dpense lui-mme dans cette opration. Cette remarque suffit rduire
nant l'hypothse de Podolinski que le travail humain est capable de retenir
et prolonger l'action du soleil la surface terrestre au-del de ce qu'elle
durerait sans ce travail29 . Car, ce que Podolinski a totalement oubli, c'est
que l'homme qui travaille n'est pas seulement un fixateur de chaleur solaire
actuelle, mais qu'il est un bien plus grand dpenseur de chaleur solaire
passe30 .
Engels consacre quelque temps examiner cette question. Bien qu'un tel
calcul n'ait pas grand sens pour les modes de vie les plus primitifs limits la
cueillette, la chasse ou la pche, il admet qu'il serait faisable. Pour
l'agriculture, les calculs seraient extrmement compliqus. Mais, avec la
production mcanique moderne, Engels devient tout fait catgorique:
Dans l'industrie toute sorte de calcul cesse irrmdiablement. [...] La
mesure de la valeur nergtique d'un marteau, d'une vis ou d'une aiguille
coudre, d'aprs les cots de production, est une impossibilit pure. - A mon
avis, il est absolument impossible de vouloir exprimer des rapports conomi-
ques dans des units de mesure de la physique3l.
Marx partageait cette conclusion. Bien que la force de travail se caract-
rise comme une rserve de force physiologique, il n'a jamais song mesurer
la valeur de la force de travail en units physiques. Une interprtation
physiciste des ides de Marx sur la force de travail, mme quant sa valeur
d'usage, reviendrait lui attribuer un matrialisme vulgaire qui lui est
tranger: comment songer une mesure purement physique des besoins
humains, ds lors qu'il y entre une composante sociale et historique32?
Le rappel frquent de la spcificit du travail humain dans l'uvre de
Marx devrait carter toute tentation de ce genre. Marx n'abandonne pas, pour
autant, le point de vue matrialiste. Que la force de travail soit qualitativement
dtermine, n'empche pas qu'elle soit - ainsi que toute autre force -
matrielle ou naturelle, c'est--dire qu'elle n'est pas transcendante ou
surnaturelle .
Si le travail humain diffre de celui que fournit l'animal du seul fait que
l'homme a une conformation propre, nanmoins, dans certaines conditions,
les corves des serfs, les travaux des esclaves ou des ouvriers, tendent tre
ravals aux tches des animaux domestiques, ou aux oprations des machines.
L'homme est alors utilis comme simple force naturelle33.
Que se passe-t-il en effet avec la production moderne? Celle-ci ne
consiste-t-elle pas justement rduire le plus possible la force de travail sa
seule ralit physique? Depuis que se dveloppe le mode de production
capitaliste, la force de travail prsente de plus en plus cette particularit d'tre
employe des tches indiffrencies: c'est l'emploi d'une main-d'uvre
nombreuse dans de grandes entreprises mcaniques, o la majeure partie des
tches consiste en oprations machinales simples. D'o la rduction du travail
au travail abstrait , au travail gnral.
274 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Ainsi que d'autres conomistes ou observateurs, en gnral socialistes,
Marx a dnonc cette dshumanisation du travail. Ce n'est pas n'importe quel
travail qui est productif dans la socit moderne. Le moins qualifi devient le
plus productif, puisque, grce la grande industrie, la valeur d'change de la
force de travail diminue quand augmente relativement celle des produits qu'on
peut obtenir par sa mise en exploitation. Les instruments de travail accomplis-
sent les oprations compliques, et le travailleur se voit relgu aux oprations
et fonctions simples ne demandant que peu de formation et de qualification.
Malgr cela, ou plutt cause de cela, la productivit du travail s'accrot
constamment. Ces deux processus, dqualification du travail et lvation de sa
productivit, se sont trouvs runis dans la production mcanise des fabri-
ques modernes o la plus grande part du travail est du travail manuel non
spcialis.
Ce phnomne venait au premier plan qui frappait tous les esprits: la
force de travail ouvrire n'tait pas prdestine un emploi particulier. Le
travail accomplir ne demandait aucune qualit spcifique, hormis une
intensit et une dure sans cesse accrues. Dans la plupart des fabriques et pour
la majorit des travailleurs qui y taient employs, le travail se trouva rduit
sa plus simple expression. Ni l'habilet, ni le savoir-faire, ni le jugement, ni
mme la force , ne furent plus des qualits ncessaires. Le travail tomba la
porte des femmes et des enfants; les tres les plus chtifs purent remplacer les
travailleurs manuels eux-mmes. Alors, la force de travail, comme pure
quantit de muscles, de nerfs, de cerveau , devint la possibilit la plus
concrte, la fois la plus gnrale (la plus rpandue) et la plus universelle
(chacun pouvait tout faire). C'tait la possibilit d'accomplir n'importe quelle
tche dans le travail la chane, avec des machines aux commandes simples,
quelles que soient par ailleurs les oprations qu'elles effectuent. Cette possibi-
lit existe chez tous les tres humains, ce pour quoi Marx la qualifie de simple
possibilit ou de possibilit pure .
En conclure que la force de travail perd toute spcificit humaine serait
faux. D'une part, elle a encore quelque qualit particulire l'homme: les
mains, le coups d'il, etc. L'homme, ou l'enfant, devient surveillant autant
qu'appendice pourvoyeur de la machine. D'autre part, la forme sociale de la
force de travail change. Elle est employe dans des modes de travail
dtermins - coopration et division du travail -, qui sont fonction du
dveloppement des instruments et du processus technique de la production.
Le cheval avait pu animer certains mcanismes anciens (faire tourner un
pressoir, etc.); mais, il ne pouvait subsister dans la machinerie industrielle o
les oprations sont ncessairement surveilles par l'homme. Ce fait prouve que
la force de travail humaine, autant rduite qu'on voudra des qualits
physiques simples", y exerce ses proprits spcifiques. voluant elle-mme
au rythme des changements technologiques, la force de travail voit ses
possibilits dcuples.
Pour que la force de travail moderne devienne une possibilit
LA POSSIBILIT CONCRTE 275
simple, il a fallu que le travailleur soit spar des moyens de travail,
conditions objectives de toute ralisation. Elle est alors une possibilit
devenue, ralise historiquement en tant que cette pure possibilit
matrialise dans l'ouvrier dmuni de tout moyen d'existence et de produc-
tion.
Ainsi, la force de travail apparat comme la possibilit concrte, ralise
- en tant que possibilit du travail en gnral - dans le corps de l'ouvrier.
Elle est la source de toute ralisation, de celle des valeurs d'usage comme de
celle des valeurs d'change, de la richesse matrielle comme de la richesse
formelle (argent), et finalement de toute ralisation humaine.
Cela signifie que l'ouvrier n'est plus que la simple possibilit du travail;
il n'en possde plus les moyens objectifs, ni les instruments, ni les capitaux.
C'est l'homme qui n'a que sa force de travail proposer sur le march. Cet
homme-l est le produit typique du monde moderne. Le producteur se trouve
alors dans la situation d'un tre rduit son seul tre en puissance, qui,
spar de ses moyens de ralisation, est identiquement une impuissance.
La distinction marxienne entre force de travail et travail exprime la
sparation historique effective qui a d tre consomme pour que l'conomie
capitaliste prenne son essor. La naissance de cette force de travail nue,
l'ouvrier <<libre, c'est--dire <<libr de toute attache et de tout bien, fut le
rsultat historique du dclin et de l~ dissolution des modes de production
antrieurs. Le secret profond de cette histoire est le dveloppement des
forces productives.
Dans cet tat, la force de travail est objet sur le march. Elle n'est
qu'un tre en puissance qui ne peut pas, de lui-mme, se muer en tre en
acte. Pourtant, dans le processus de la production, mise en contact avec les
moyens objectifs du travail, elle devient 1'tre en acte par excellence qui
anime tout et donne vie au capital lui-mme.
Outre les termes emprunts aux sciences physiques et naturelles, Marx
emploie la terminologie aristotlicienne: la notion d' tre en puissance est
celle qui convient pour dsigner la force de travail. L'utilisation par Marx
d'une nouvelle terminologie plus scientifique n'indique pas forcment qu'il
forge un concept original ou une thorie nouvelle. Si, chez lui, il y a
incontestablement nouveaut sur le plan de l'explication thorique en cono-
mie et en histoire, cette nouveaut n'empche pas qu'il recourt des concepts
emprunts une tradition philosophique prcise, celle d'Aristote.
Mais certains interprtes objectent que Marx ne peut pas avoir t
matrialiste et avoir gard un vieux concept philosophique comme celui d'tre
en puissance. Nous devons donc tablir qu'il a sciemment et explicitement
conu la force de travail comme puissance au sens aristotlicien. Si nous
pouvons le faire, cela fera bien apparatre que la pense de Marx est une
pense de la possibilit, car, incontestablement, la force de travail est la
chose la plus courante que produise le monde contemporain.
276 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
3. La force de travail en tant qu'tre en puissance
Nous soutenons que derrire la description de la force de travail ep. termes
de forces naturelles selon le langage de rigueur dans les sciences modernes de
la nature, plus profond et plus significatif est le recours de Marx la
terminologie philosophique classique de la puissance et de l'acte, dont
l'origine remonte Platon et Aristote34.
Sous sa plume, apparat parfois le mot grec 8r5vaJ.1El, qui signifie en
puissance par opposition tVEpyEigqui signifie en acte. Le passage le plus
remarquable cet gard se trouve dans les Manuscrits de 1857-1858, lorsqu'il
analyse la transition des socits prcapitalistes la formation socio-conomi-
que capitaliste. Il retrace alors la gense historique du travailleur salari
typique du monde moderne.
Quand il y met en vidence le fait que la force de travail a d tre amene
son tat de pure possibilit , il emploie les concepts aristotliciens: On
prsuppose des processus historiques qui ont plac une masse d'individus
d'une mme nation, etc., d'abord dans la situation sinon de travailleurs
rellement libres, du moins de travailleurs qui le sont MVUJlEt,dont la seule
proprit est leur puissance [Vermogen] de travail et la possibilit de l'changer
contre des valeurs existantes35.
Si la force de travail n'apparat plus que comme une possibilit, mais une
possibilit concrte, existant en tant que telle dans le corps de l'ouvrier, c'est
que ce dernier est spar des instruments de son travail. Auparavant, dans les
corporations, les compagnons et artisans possdaient leurs outils: les serfs
taient lis la terre; les esclaves taient directement runis aux moyens de
production matriels et possds au mme titre qu'un cheptel. L'ouvrier
industriel ou agricole n'est plus en possession des moyens de production; il
n'en dispose plus ni n'est immdiatement unis eux. Il est devenu pure
possibilit de travail dtache de ses conditions de ralisation. Sous cette
forme, la force de travail est une simple possibilit, nanmoins une possibilit
pose , car, en tant que rsultat historique, elle implique ses propres
prsupposs. C'est ce que nous appelons une possibilit concrte .
Dans le mme texte, Marx insiste sur cette potentialit de la force de
travail. Quelques lignes plus loin, il parle des travailleurs salaris qui sont
MVUJlEt libres 36, des travailleurs libres existants MVUJlEt37, ainsi que du
capital existant seulement MVUJlEt38. On le voit par cette rptition, il
n'hsite pas souligner qu'il se rfre la terminologie d'origine aristotli-
cienne. Il crit encore:
Ce mme processus, qui a spar une quantit d'individus de leurs
relations antrieures -
d'une manire ou d'une autre
-
[...] et qui a ainsi
transform ces individus en travailleurs libres, a, MVUJlEt,libr ces conditions
objectives du travail - terroir, matriaux bruts, moyens de subsistance,
LA POSSIBILIT CONCRTE 277
instruments de travail, argent ou tout cela la fois - du lien qui les rattachait
antrieurement aux individus dsormais dtachs d'eux39.
Le terme grec MvaJ.u, chez Marx, ne dsigne pas seulement la force de
travail , mais aussi les moyens de production ou les objets de consommation:
Le produit ne connat son ultime accomplissement que dans la
consommation. Un chemin de fer sur lequel on ne roule pas, qui donc ne
s'use pas, n'est pas consomm, n'est un chemin de fer que 86v!XJ.lEt et non en
ralit [der Wirklichkeit nach]40.
Par analogie, Marx compare mme la force de travail au vin, utilisant le
mme terme grec qui, l'vidence, lui vient spontanment:
A considrer l'change capital-travail, tel qu'il existe en tant que simple
rapport de circulation - il ne s'agit pas d'change entre de l'argent et du
travail, mais entre de l'argent et de la capacit de travail vivante. Valeur
d'usage, la capacit de travail ne se ralise que dans l'activit laborieuse elle-
mme, mais tout fait de la mme manire qu'une bouteille de vin, qu'on
achte, ne ralise sa valeur d'usage que quand on boit ce vin. Le travail lui-
mme n'entre [CiilIt]pas plus dans le processus de circulation simple que le
boire. En tant que virtualit, MVUJ.lEt [en puissance], le vin est quelque chose
de potable et l'achat de vin est l'appropriation d'une boisson. De mme,
l'achat de la capacit de travail, c'est la possibilit de disposer du travail
d'autrui41.
Il arrive que Marx indique expressment qu'il emprunte le mot ouvaJ.lt
Aristote: de mme que la convertibilit de la monnaie implique la possibilit
de sa non-convertibilit, de mme la hausse des prix implique leur baisse
OUVaJ.lEt, comme dirait Aristote42.
Parfois, tre en puissance >, est associ tendance comme terme
synonyme, par exemple, propos des limites que le systme capitaliste impose
au dveloppement des forces productives:
La limite du capital, c'est que tout ce dveloppement s'opre d'une
faon contradictoire et que l'laboratilD des forces productives, de la
richesse gnrale, etc., du savoir, etc., se manifeste de telle sorte que
l'individu s'aline lui-mme. [...] Rsultat: le dveloppement tendancielle-
ment et MVUJ.lEt[potentiellement] universel des forces productives - de la
richesse en gnral -, en tant que base, et pareillement de l'universalit du
commerce, et donc du march mondial. Base qui constitue la possibilit du
dveloppement universel de l'individu [...]43.
Marx parle mme une fois de 1'entlchie du capital:
Cet achat [de la puissance de travail] incorpore au capital l'use
[l'usage] de la puissance de travail pour un temps dtermin, elle fait d'un
278 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
quantum dtermin de travail vivant l'un des modes d'existence du capital lui-
mme, son entlchie, pour ainsi dire44."
A propos de la force de travail, certains commentateurs ont rcemment
soutenu que, lorsqu'il rdigea le texte dfinitif du premier livre du Capital,
Marx aurait cart la terminologie philosophique" qu'il employait dans ses
manuscrits prparatoires, au profit d'une autre qui serait plus scientifique .
Ils prtendent que, pour dsigner la force de travail, Marx aurait abandonn
le mot puissance [Vermogen] employ auparavant, optant pour celui de
force [Kraft]45.
On peut leur opposer que la catgorie aristotlicienne de puissance
(Uva,..n)est utilise dans Le capital lors de la dfinition de la force de travail.
Au dbut du chapitre V du livre premier (chapitre VII dans la traduction
franaise), on peut lire, aussi bien dans la premire dition allemande que dans
les suivantes:
L'acheteur de la force de travailla consomme en faisant travailler son
vendeur. Celui-ci devient ainsi actu [en acte] une force de travail agissante
[betiitigende], un travailleur, ce qu'il n'tait auparavant que potentia [en
puissance] 46.
"
Au dbut de ce chapitre du Capital, on rencontre beaucoup de termes
exprimant l'ide de puissance":
Il [l'homme] se prsente face la matire naturelle comme tant lui-
mme une puissance [Macht] naturelle47."
Quelques lignes plus loin, le terme Potenz (directement transcrit du latin
potentia, lequel traduit le grec Uva,..n)est associ la mtaphore du sommeil:
En agissant sur la nature extrieure et en la modifiant par ce
mouvement, il [l'homme] modifie aussi sa propre nature. Il dveloppe les
puissances qui sommeillent en elle [la nature] [in ihr schlummernden Poten-
zen], et soumet son propre empire le jeu de ses forces [ihrer Kriifte]48.
Il est hors de doute que, dans cette page du Capital, Marx ne fait pas de
diffrence entre puissance et force: il utilise indiffremment tous les
termes susceptibles d'exprimer l'ide d' tre en puissance , de mme que dans
ses manuscrits antrieurs il utilisait Uvaf.upour dcrire la force de travail. Il
ne songe pas signaler, sur ce point, un changement quelconque par rapport
ses analyses des Manuscrits de 1857-1858.
L'ide d'tre en puissance est exprime l'aide des tournures les plus
diverses. En soi (an sich), <datent , virtuel , potentiel , en puissance ,
sont pris comme des synonymes. Marx varie les expressions: der Moglichkeit
nach, ais Vermogen, potentiell, potentialiter (adverbe latin), latent, sont les plus
LA POSSIBILIT CONCRTE
279
courantes. Il les groupe parfois ensemble, comme pour leur donner plus de
relief par cette juxtaposition, ce qui prouve bien qu'il ne fait pas de diffrence
entre toutes ces expressions:
La force de travail [...] n'affirme sa force cratrice de valeur que si elle
s'active, se ralise dans le processus de travail; cela n'exclut pourtant pas
qu'elle est en soi, potentiellement, en puissance [an sich, potentiell, aIs
Vermogen], l'activit cratrice de valeur qui, comme telle, ne rsulte pas du
processus, mais en est plutt la condition pralable49.
Non seulement, la catgorie aristotlicienne d'tre en puissance figure en
bonne place, mais aussi celle d'tre en soi emprunte Hegel:
On l'achte [la force de travail] comme tant capable de crer de la
valeur [aIs Fiihigkeit, Wert zu schaffen]. Mais on peut l'acheter aussi sans la
faire travailler productivement: des fins purement personnelles, par
exemple service domestique, etc. Il en est de mme avec le capital. C'est
l'affaire de l'emprunteur de l'employer comme capital, c'est--dire de mettre
effectivement en action sa qualit inhrente de produire de la plus-value.
Dans les deux cas, ce qu'il paie, c'est la plus-value contenue en soi [an sich],
virtuellement [der Moglichkeit nach], dans la marchandise-capital 50.
Or, Hegel signalait que sa distinction entre tre-en-soi et tre-pour-
soi tait d'origine aristotlicienne 51.
Marx dcrit les formes dans lesquelles se ralise le capital, par exemple
l'argent, l'aide de cette catgorie hglienne d' en-soi : L'argent, et
pareillement la marchandise, sont du capital en soi, potentiel [an sich,
potentiell Kapital], tout comme la force de travail est potentiellement [poten-
tiell] du capita152.
Curieusement, il arrive que Joseph Roy, dans sa traduction, introduise un
en puissance qui ne figurait pas en allemand, ce qui correspond tout fait
l'esprit de la pense marxienne; d'ailleurs peut-tre est-ce Marx lui-mme,
qui, en retouchant le franais de Roy, aura gliss cette expression ici:
Il [le salari] ne possde rien que sa force personnelle, le travail l'tat
de puissance, tandis que toutes les autres conditions extrieures requises pour
donner corps cette puissance, la matire et les instruments ncessaires
l'exercice utile du travail, le pouvoir de disposer des subsistances indispensa-
bles au maintien de la force ouvrire et sa conversion en mouvement
productif, tout cela se trouve de l'autre ct [c.--d. du ct du capital] 53.
Visiblement, Marx n'a jamais envisag de se dfaire des catgories
philosophiques hgliennes ou aristotliciennes comme celles que nous exami-
nons prsentement. Tout au contraire! C'est sans doute que la catgorie de
puissance est plus riche que la catgorie de force de la physique moderne.
280 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Si Marx en appelle la Mvu~lt d'Aristote, c'est qu'elle exprime quelque chose
que la notion de force mcanique ne contient pas; mais quoi?
La notion de puissance est troitement corrlative de celle d'acte et toutes
deux renvoient, chez Aristote, l'analyse du mouvement et du changement en
termes de devenir 54.La puissance est un moment, ou un aspect, du devenir,
qu'il s'agisse du mouvement local (translation), du changement qualitatif
(altration) ou quantitatif (croissance ou dcroissance), ou de la gnration.
Le sens premier de puissance pour Aristote est celui de principe de
changement dans un autre tre, ou dans le mme tre en tant qu'autre 55.
D'autre part, elle implique une matire, laquelle s'applique ce
mouvement, ou dans laquelle s'effectue ce changement, ou encore qui est Ie
sujet, au sens de lieu ou support, de cette gense. On trouve ces diverses
caractristiques dans la force de travail telle que Marx l'analyse: nous venons
de voir qu'elle est la puissance active dans le processus de production. tant
alors en acte, elle modifie ce quoi elle s'applique, et se modifie elle-mme
dans ce processus.
D'une part, elle s'exerce sur une matire qui est extrieure au travail-
leur: c'est l'objet de travail, c'est--dire les matriaux, matires premires ou
matires dj ouvres. D'autre part, elle implique un agent en acte. La notion
d' acte (VEPYEtU)caractrise un sujet qui se transforme, se change lui-
mme, lorsque, de puissance, il devient ce qu'il tait destin tre par essence.
Or, Marx souligne que l'homme se modifie par sa propre activit
productive: il acquiert savoir-faire, habilet, pouvoir sur les choses. Il sort
transform du processus qu'il a lui-mme engag et men terme. Il a fait
apparatre de nouveaux besoins, s'est cr de nouvelles habitudes, s'est
form . Dans le travail, l'homme s'engendre lui-mme. Bref, il acquiert une
nouvelle nature.
C'est prcisment cela que ne contient pas la notion de force mcani-
que . Celle-ci ne se transforme pas elle-mme, ni d'elle-mme. Par contre,
c'est ce que contient l'tre-en-puissance aristotlicien, ou ouvuJ.lt: l'enfant qui
devient homme, l'homme qui devient grammairien ou architecte, se trans-
forment; ils deviennent autres grce leur propre activit.
Cet acte d'auto-engendrement prsuppose que le nouvel tre qu'ils sont
devenus, ils l'taient en puissance . Commentant Aristote, M. Aubenque
explique que l'acte n'est pas une notion qui se suffirait elle-mme, mais elle
reste corrlative de celle de la puissance, et ne peut tre pense qu' travers
elle; l'acte n'advient, ne se rvle dans son accomplissement que par la
puissance, le pouvoir d'un agent 56.
C'est exactement ce que Marx dit du travail et de la force de travail. La
puissance, ou pouvoir, appartient un tre existant en acte.
En raliste, Aristote soutenait l'antriorit de l'acte sur la puissance: c'est
l'homme en acte, disait-il, qui engendre l'enfant, lequel est homme en
puissance 57. Dans ce cycle, l'espce se reproduit identique elle-mme.
Marx, lui aussi, insiste sur le fait que la force de travail en tant qu'tre en
LA POSSIBILIT CONCRTE
281
puissance prsuppose un tre en acte qui l'ait produite. Tout tre en puissance
dpend de conditions pralables qui l'ont engendr. L'ouvrier libre doit lui-
mme avoir t produit sous la forme o il apparat maintenant. Toutefois,
la diffrence d'Aristote, Marx ajoute que le cycle de la reproduction ne se
rpte pas ternellement identique lui-mme: chaque forme d'tre (travail-
leurs, capital, etc.) a eu une gense historique, et subira des transformations;
elle est prise dans le devenir universel.
Le terme allemand pour exprimer la puissance aristotlicienne est
Vermogen. Ce mot a deux sens principaux: il dsigne la capacit, la
facult , le pouvoir d'un tre, mais aussi les biens qu'on possde, la
fortune . Le sens des phrases o ce terme apparat peut donc tre ambigu.
Marx fait ressortir cette double signification quand, par parabole, il met dans
la bouche de l'ouvrier qui vient de vendre sa force de travail au capitaliste les
propos suivants:
Je veux, en administrateur sage et intelligent conomiser mon unique
fortune [Vermogen], ma force de travail [Arbeitskraft], et m'abstenir de toute
folle prodigalit 58.
Ce n'est donc pas seulement dans ses manuscrits prparatoires, mais aussi
dans Le capital que les connotations varies de Vermogen sont exploites.
Marx ne se prive pas plus des ressources conceptuelles de la philosophie
classique, que de celles des catgories hgliennes.
Cela est tout fait essentiel pour notre thse: non seulement dans ses
diffrents manuscrits, mais dans Le capital lui-mme, Marx met la catgorie de
possibilit, au sens de la ouvaJ.u d'Aristote, au cur de sa conception de
l'histoire, puisque l'histoire consiste dans le dveloppement des forces produc-
tives :
La puissance de travail elle aussi ne fait la preuve de son pouvoir de
crer de la valeur [seine Kraft, Wert zu schaffen] que lorsqu'elle est active,
ralise dans un processus, en tant que travail. Cela n'exclut pas pourtant
qu'elle soit en soi [an sich], en tant que puissance [ais Vermogen], l'activit
cratrice de valeur qui, comme telle, ne rsulte pas du processus, mais en est
plutt la condition pralable. [...] Ce qu'il [l'acheteur] paie, [...] c'est la plus-
value incluse en soi [an sich], virtuellement [der Moglichkeit nach], selon la
nature de la marchandise achete, dans la puissance de travail [...] 59,
Ce qui caractrise la force de travail, c'est prcisment qu'elle est
productive en puissance, potentiellement cratrice. Ce serait une erreur
profonde de croire, sous prtexte que Marx est matrialiste, que le concept de
cration aurait disparu de son discours et serait banni de sa pense.
La force de travail est valeur en puissance , au double sens de valeur:
elle a la facult de crer les valeurs d'usage non fournies telles quelles par la
282 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
nature et, par l mme, en rgime capitaliste, elle est la facult de crer toute
valeur d'change nouvelle.
Marx exprime cela sous les formes les plus varies: la force de travail, dit-
il, ce sont les capacits , dispositions , possibilits ", potentialits ,
facults, inhrentes l'homme en tant que travailleur. Tous ces termes
visent dire la mme chose, la mme proprit essentielle de la force de travail
d'tre la possibilit concrtement existante, ce qu'elle confirme quand elle est
jete dans la production. Dans l'avance de capital, la force de travail compte
comme valeur, mais dans le processus de production, elle agit en tant que
cratrice de valeur60.
Toutefois, tant qu'elle est spare de ses conditions objectives, elle reste
l'tat de virtualit, et sa conservation mme pose problme:
"tant donn que la puissance de travail n'est prsente que comme
capacit, disposition, potentialit incluse dans la corporit vivante de
l'ouvrier, la conserver ne signifie rien d'autre que maintenir l'ouvrier lui-
mme dans le degr de force, de sant, de capacit vitale en gnral,
ncessaire l'exercice de sa puissance de travail61.
Aussi concrte soit-elle, la force de travail n'est que possibilit. Existant
en tant que telle dans un tre concret, il n'est pas sr qu'elle ralise
effectivement ses potentialit; sa sparation d'avec ses conditions objectives de
ralisation fait qu'elle garde un caractre abstrait . Elle est donc la fois
concrte et abstraite. Elle ressemble l'argent, ou plutt, c'est l'argent qui lui
ressemble62. Marx la qualifie de "possibilit vivante: c'est l'ouvrier au
moment o il se prsente sur le march du travail.
L'une des conditions historiques du capital, crit Marx, est l'existence de
la puissance de travail vivante comme existence seulement subjective, spare
des moments de sa ralit objective, et, de ce fait, spare tout aussi bien des
conditions du travail vivant que des moyens d'existence, moyens de subsistance,
moyens d'auto-conservation, de la puissance de travail vivante; [c'est] donc
[...] la possibilit vivante du travail dans cette abstraction totale63 .
Condition pour qu'appart le capital, la force de travail ouvrire est
maintenant son rsultat, et en tant que telle, dsormais, source de toute
possibilit historique.
4. L'nigme d'un changement terminologique
La distinction entre la force de travail et le travail lui-mme
affleurait dans toute l'conomie politique classique anglaise. Qu'elle ft
absolument cruciale, Marx en avait probablement pris conscience avant de
rdiger ses premiers grands manuscrits en 1857-1858 o elle se trouve
LA POSSIBILIT CONCRTE 283
explicite pour la premire fois. C'est dans ces manuscrits que l'on peut suivre
pas pas cette dcouverte que Le capital fera connatre dix ans plus tard.
Pour dsigner la force de travail , Marx utilisa longtemps dans ses
manuscrits le mot compos: Arbeitsvermogen. Or, fait surprenant, dans Le
capital, il opta pour Arbeitskraft, terme qu'il n'employait presque jamais
auparavant64. Les traductions franaises rcentes des manuscrits de Marx des
annes 1857-1865, tiennent compte de ces variations: M. Lefebvre traduit
littralement Arbeitsvermogen par puissance de travail , rservant force de
travail>, pour Arbeitskraft 65; il souligne que les traductions franaises ant-
rieures faisaient preuve de laxisme en ne distinguant pas "puissance et
force .
M. Jacques Bidet a soutenu que ce changement terminologique s'expli-
querait par l'impossibilit de Marx d'arriver exposer .le passage de la
marchandise et de l'argent au capital comme un processus dialectique: dans
son effort de constituer une critique dialectique de l'conomie politique, Marx
se serait embarrass dans des paradoxes et des contradictions, ce qui explique-
rait les variations terminologiques des manuscrits et l'inachvement mme du
Capital66.
Selon cet interprte, la substitution systmatique de Kraft Vermogen
dans Arbeitsvermogen ne serait qu'un symptme parmi d'autres de la rupture
interminable de Marx avec la philosophie. Malgr lui et presque incons-
ciemment, Marx aurait t conduit se dfaire de la dialectique hglienne.
Prtendant que des termes comme sujet, subjectivit , subjectiva-
tion et objectivation auraient disparu au fil des rdactions successives qui
ont abouti au premier livre du Capital, M. Bidet conclut un retrait de la
terminologie philosophique67. La notion de puissance, avec son arrire-
fond philosophique (Mva~lt)6g , ferait partie du lot des notions vinces.
Or, nous venons de voir que Marx n'a aucunement renonc cette
catgorie philosophique . Il reste que, dans Le capital, la substitution de
Kraft Vermogen, sans explication de la part de Marx, constitue une sorte
d'nigme que nous devons rsoudre, puisque nous soutenons, l'inverse de
M. Bidet, que la notion de force de travail a le sens de la Mva~lt
aristotlicienne. Une telle modification, si elle avait le sens que lui donne M.
Bidet, infirmerait notre thse selon laquelle Marx s'est servi de la catgorie
aristotlicienne de puissance, y compris dans Le capital, prcisment pour dire
ce que la notion de force au sens de la physique moderne tait impuissante
exprimer.
Pour dterminer le sens de la susbstitution de Kraft Vermogen dans
Arbeitsvermogen (puissance de travail), il faut rpondre plusieurs questions:
quand cette substitution est-elle survenue? Quand Vermogen est-il apparu lui-
mme et avec quel sens thorique? Enfin, la substitution fut-elle aussi
systmatique que le prtend M. Bidet? La rponse ces questions peut seule
fournir une base pour discuter les raisons qui ont conduit Marx ses choix
successifs.
284 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Une terminologie rsulte d'un besoin thorique: elle a un sens conceptuel.
A suivre l'interprtation de M. Bidet, l'abandon de Vermogen et l'adoption de
Kraft signifieraient que le concept de force doit tre entendu au sens d'nergie
ou de force mcanique. Marx aurait donc volu d'une philosophie dialectique
vers un certain positivisme et un certain scientisme. Nous avons vu que des
philosophes fort diffrents, appartenant toutes sortes d'coles, ont justement
compris le matrialisme de Marx et d'Engels de cette faon69.
Le concept de possibilit change compltement de sens dans une philoso-
phie du devenir, ou dans un matrialisme classique. Dans ce dernier cas, on est
renvoy la conception de la nature issue de Galile, Descartes et Newton,
base sur la mcanique rationnelle. Par sa manire matrialiste de compren-
dre la production, les besoins et la force de travail, Marx se serait-il ralli une
telle conception?
L'enjeu de ce dbat est philosophique. Une pense pour laquelle le
devenir est fondamental se fait une tout autre conception de la nature. Y
prennent place la vie et la finalit, notions que la science moderne bannissait,
mais qui se trouvent au premier plan dans la pense de Marx, comme dans
celle de Hegel, dans lesquelles se conserve la notion de q>u<Jtdes Anciens7o.
Celle-ci, avec la notion de croissance, contient les ides de changement et de
fin naturelle immanente.
Si l'ide de 8Uva~Hest essentielle celle de force de travail, la substitution
de Kraft Vermogen dans puissance de travail signifie-t-elle qu'un change-
ment conceptuel serait intervenu dans la manire dont Marx pense cette force?
Rptons-le, Marx n'a jamais signal un changement quelconque dans
l'analyse qu'il a faite de la sparation entre la force de travail et les moyens de
production correspondants, ni dans l'explication corrlative de l'origine de la
plus-value, qui est dfmitivement clarifie et matrise partir de 1857.
Ceux qui soutiennent que la pense marxienne aurait subi une modifica-
tion profonde entre la priode des Grundrisse et celle o parat le premier livre
du Capital, doivent admettre, ou bien que Marx ne s'en serait pas aperu, ce
qui n'est pas vraisemblable, ou bien qu'il n'aurait pas voulu le reconnatre, ce
qui serait contraire toutes ses habitudes intellectuelles7!.
C'est plutt l'unit profonde et l'identit des analyses marxiennes qui
frappent des Manuscrits de 1857-1858 au Capital.
Cela ne veut pas dire qu'il n'ait pas eu de motifs rels de choisir un terme
nouveau qu'il jugeait sans doute mieux appropri. Mais en quoi? Avant de
rechercher ces motifs, il convient d'tablir quels sont le moment, les circons-
tances, et la nature exacte de ce changement terminologique.
Quand donc intervient le remplacement de Arbeitsvermgen par Arbeits-
kraft? Ici, les recherches ncessaires n'ont pas t faites. A premire vue, il
semble qu'Arbeitskraft ne se trouve pas chez Marx avant Le capital.
On le signale parfois dans le texte d'une confrence sur Salaire, prix et
profit, prononce en juin 1865 lors de deux sances du Conseil Gnral de
l'Association Internationale des Travailleurs:
LA POSSIBILIT CONCRTE
285
Je vais tre oblig de susciter [...] votre tonnement par un paradoxe
apparent. Vous tes tous absolument persuads que ce que vous vendez
journellement, c'est votre travail, que, par consquent, le travail a un prix.
[...] Et pourtant il n'existe rien du genre de la valeur du travail au sens
ordinaire du mot. [...] Ce que l'ouvrier vend, ce n'est pas directement son
travail, mais sa force de travail dont il cde au capitaliste la disposition
momentane 72.
L'explication marxienne de la plus-value grce la distinction entre force
de travail et travail est ainsi rendue publique pour la premire fois.
Cette confrence fut prononce en anglais et le texte n'en fut publi par la
fille de Marx, Eleanor Aveling, en anglais, qu'en 1898; la traduction alle-
mande, tant postrieure, ne donne pas la preuve que Marx ait utilis ou pens
utiliser Arbeitskraft pour dire force de travail en juin 186573.
La rdaction du premier livre du Capital remonte 1863 et se poursuit en
janvier et octobre 1866. Dans tous les autres manuscrits de 1861 1863, le
terme employ est Arbeisvermogen. Il semble donc que Marx aura opt pour
Arbeiskraft entre 1863 et 1865, peut-tre seulement en 1866, en tout cas
certainement avant l'anne 1867.
Le mot apparat ds les premires pages du Capital, mais l'dition
franaise de J. Roy dit force humaine , ou simplement travail humain l
o en allemand die menschliche Arbeiskraft apparat ct de menschliche
Arbeit, mais plus frquemment que ce dernier74. Ainsi, dans la premire
dition allemande, celle de 1867, il est employ couramment ds le premier
chapitre, et, dans tout l'ouvrage, Marx en fait un usage constant et uniforme,
au lieu de Arbeitsvermogen, une ou deux exceptions prs.
Cela semble donc confirmer l'observation de M. Bidet. Mais voici qui
ruine l'interprtation qu'il en donne: au chapitre VI du Capital lui-mme, ds
que Marx en vient dfinir la force de travail, il donne les deux termes pour
synonymes - comme nous l'avons dj dit -, puisqu'il crit deux reprises:
das Arbeitsvermogen oder die Arbeitskraft 75! Quelques lignes plus loin figure
encore une fois Arbeitsvermogen76.
Cette quivalence, tablie par Marx lui-mme, suffit pour carter l'hypo-
thse d'une variation du concept de force de travail sur la base de ce simple
changement terminologique. Mme si l'on admettait qu'Arbeitskraft n'existe
pas avant 1865, il serait faux de dire qu'on ne rencontre plus Arbeitsvermogen
aprs cette date et, surtout, que Marx ferait dsormais une diffrence entre les
deux termes.
En fait, il n'y a jamais eu de distinction tranche entre Vermogen et Kraft.
Ils sont gnralement pris comme synonymes par Marx, de mme que certains
de leurs sens le sont dans la langue courante.
Dans les Manuscrits de 1861-1863, il parle de la puissance de travail:
Arbeitsvermogen, en tant que simple force: blosse Kraft77.
Dans les Thories sur la plus-value, crites entre 1861 et 1864, lorsque
286 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Marx analyse la force de travail, Kraft explicite Arbeitsvermogen: La
puissance de travail elle aussi ne fait la preuve de son pouvoir [Kraft] de crer
de la valeur que lorsqu'elle est active 78.
Kraft est un terme trs courant chez Marx depuis longtemps, en particu-
lier dans force productive. On trouve frquemment force productive du
travail", o Kraft voisine avec Arbeit [travail] ds L'idologie allemande.
C'est dans les Grundrisse que Marx labore sa clbre explication de la
possibilit de la plus-value capitaliste. Dans ce manuscrit, on peut reprer avec
prcision le moment o surgit la distinction entre travail et force de
travail et o est forg le substantif Arbeitsvermogen 79.
Suivons le cheminement du manuscrit pour y surprendre l'apparition de
ce nologisme forg par Marx, mais naturel en allemand. Marx note d'abord
que:
La valeur d'usage que peut offrir le travailleur [...] n'est pas matriali-
se dans un produit, n'existe pas, tout simplement, en dehors de lui, n'existe
donc pas rellement, mais seulement potentiellement, comme facult 80."
Puis il cherche prciser ce qui est objet d'change entre le travailleur et
le capitaliste:
I) le travailleur change sa marchandise, le travail, qui a une valeur
d'usage, [...] 2) le capitaliste obtient en change le travail mme, le travail en
tant qu'activit qui pose de la valeur [Wertsetzende Tiitigkeit], en tant que
travail productif; c.--d., il reoit en change la force productive [Produktiv-
kraft] qui conserve et multiplie le capital, et devient par l-mme la force
productive et la force reproductrice du capital, force [Kraft] qui appartient au
capital lui-mme81.
Ici, Marx dit encore que la chose change est le travaiI82! C'est
prcisment cette formulation qui va bientt tre carte. Toutefois, la
distinction entre le travail comme marchandise et le travail comme activit est
dj l, parfaitement claire dans l'esprit de Marx: ce que l'ouvrier change,
c'est sa force productive, sa capacit de produire.
Poursuivons la lecture:
Ce que le capitaliste obtient dans cet change simple est une valeur
d'usage: la disposition du travail d'autrui. [Quant au] travailleur, [...] ce qu'il
vend, c'est la disposition de son travail, qui est un travail dtermin, une
comptence technique dtermine, etc. 83.
Marx ne parle toujours que du travail et du fit que le capitaliste dispose
du travail de l'ouvrier:
Si le capitaliste se contentait de la simple facult de disposer [du
travail] sans faire travailler effectivement le travailleur [...], l'change n'en
LA POSSIBILIT CONCRTE
287
aurait pas moins eu lieu. [Par suite, ...] d'un point de vue gnral, la valeur
d'change de sa marchandise ne peut tre dtermine par l'usage que fait
l'acheteur de la marchandise, mais uniquement par la quantit de travail
objectiv qu'eUe recle; donc, ici, par la quantit de travail objectiv qu'il
faut dpenser pour produire le travailleur lui-mme 84.
Jusqu'ici rien de fondamentalement nouveau par rapport Smith ou
Ricardo, et par rapport ce que Marx disait dans les Manuscrits de 1844 sur
le travail alin, ou dans Travail salari et capital85. Dans ces textes, au plan
conomique, grosso modo, il suivait les conomistes anglais.
Cependant, nous arrivons au moment prcis o il va forger l'expression
qui lui servira dsormais pour dsigner la puissance de travail: La valeur
d'usage qu'il [le travailleur] offre sur le march n'existe que comme aptitude
[Fahigkeit], comme capacit de son tre physique [Vermogtm seiner Leiblich-
keit]; elle n'a aucune existence en dehors de ce dernier86."
Survient alors l'expression puissance de travail" dans une phrase qui
exige des claircissements:
Le travail objectiv qui est ncessaire pour maintenir en vie la
substance gnrale dans laquelle existe sa puissance de travail [Arbeitsvermo-
gen], donc pour le [ihn, l'ouvrier] maintenir [en vie] lui-mme, aussi bien que
pour modifier cette substance gnrale en vue de dvelopper cette puissance
[Vermogen] particulire, c'est le travail objectiv dans cette substance gn-
rale [in ihr]87.
"
Le travail objectiv" dont il s'agit, ce sont les moyens de subsistance
ncessaires l'ouvrier. La substance gnrale dans laquelle existe la puis-
sance du travail ", c'est son tre physique, son corps, sa corporit vivante.
Marx veut dire que la puissance de travail ne fait qu'un avec l'ouvrier, et que
ses moyens de subsistance doivent tre reproduits par son propre travail. D'o
le caractre circulaire du processus de production de la puissance de travail,
processus qui repose finalement sur le cercle de la reproduction de la vie elle-
mme. La puissance de travail" est une proprit vitale: elle trouve elle-
mme sa source dans la vie toujours renouvele de l'individu en tant qu'tre
vivant, ce qui prsuppose que celui-ci puisse se procurer les moyens de
subsistance ncessaires. Marx l'explique clairement dans les lignes qui suivent
nos citations prcdentes:
Dans la circulation, quand j'change une marchandise contre de l'argent
en change duquel j'achte une [autre] marchandise [qui] satisfait mon besoin,
l'acte est termin. C'est le cas pour le travailleur. Mais il a la possibilit [er hat
die Moglichkeit] de le reprendre son dbut parce que sa nature d'tre vivant
[seine Lebendigkeit] est la source laquelle sa propre valeur d'usage ne cesse
de se ranimer88.
A partir de l, pour dsigner la puissance de travail ainsi dtermine,
Marx dit aussi bien capacit, facult [Fahigkeit] que puissance ou
288 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
pouvoir>, [Vermogen], en particulier ds le dbut du troisime cahier89. La
puissance de travail est dfinie comme valeur d'usage incorpore l'ouvrier.
Elle se confond avec lui. C'est cette notion que Marx conservera dsormais.
Au point de vue thorique, il n'y aura plus aucune modification conceptuelle
dans l'analyse de ce qui s'change entre l'ouvrier qui est vendeur de cette
capacit, puissance ou force de travail, et le capitaliste qui en est acheteur.
Quant au vocable utilis, il restera celui d'Arbeitsvermogen au moins jusqu'en
1863-1864.
Mais alors, comment se justifie le fait que le changement terminologique,
qui est si frappant dans la version dfinitive du Capital, intervienne si tard?
Car il est surprenant que Marx ne s'en soit pas avis plus tt! Quels motifs
peuvent donc l'avoir empch d'adopter ArbeistkraCt avant Le capital?
Le premier de tous, pensons-nous, ce sont les connotations de Vermogen
qui voque plus que Kraft le pouvoir au sens de potentialit, d'tre en
puissance, et qui traduit directement en allemand le latin potentia, et le grec
8Uva~.lt.Un second motif peut-tre tout aussi dcisif est le fait que, dans les
ouvrages des conomistes et dans la littrature en gnral, Marx trouvait
continuellement, chez les auteurs anglais, le terme power, et chez les auteurs
franais, facult ou puissance de travail. L'anglais dit labour power pour
capacit de travail et n'emploie pas le mot force qui existe aussi, mais
dsigne les forces en physique. Or Marx pratiquait beaucoup les conomistes
franais et anglais.
Inversement, ce qui a pu jouer en faveur du choix final de Kraft au
dtriment de Vermogen, c'est que les conomistes vulgaires considraient la
capacit de travail de l'ouvrier comme son bien
", sa fortune, sa
richesse", ce qui se dit Vermogen en allemand. Certains soutenaient mme
que c'tait son capital
".
Or Marx dnonce cette manire de voir errone de
l'conomie vulgaire. D'o la ncessit, qui a pu s'imposer progressivement
son esprit, d'viter une telle quivoque dans un terme aussi essentiel.
Par suite, la question se renverse: nous constatons que Marx est
longtemps rest attach Arbeitsvermogen malgr ce risque d'quivoque!
Celui-ci, trs rel en allemand, n'existe pas en franais: puissance de travail"
ou pouvoir de travail" ne peut signifier bien de travail ou fortune de
travail ", expressions dnues de sens.
Marx a pu choisir Arbeitskraft pour d'autres motifs encore, en particulier
parce que l'expression sonne d'une manire plus incisive que Arbeitsvermogen;
elle admet un pluriel; enfin elle rend l'ensemble du vocabulaire plus homo-
gne: le voisinage avec force productive l'implique.
A tout cela, s'ajoute un dernier motif, qui, curieusement, n'est pas
invoqu par M. Bidet, bien qu'il aille tout fait dans le sens de sa thse. Le
concept de force devenait d'usage courant dans toutes sortes de sciences. C'est
justement dans les annes soixante que Marx multiplie ses lectures dans le
domaine des sciences de la nature. Parmi les divers ouvrages de physique qu'il
tudie, il remarque La corrlation des forces physiques de W. R. Grove90,
LA POSSIBILIT CONCRTE
289
L'influence des sciences de la nature semble donc s'ajouter aux raIsons
prcdentes et faire pencher la balance en faveur de Kraft.
Il est probable que l'emploi du mot force pour dsigner toutes les
formes d'nergies en physique a jou un rle important dans le choix de Marx.
Toutefois, si cette influence n'est pas niable, peut-on, sans plus de preuves, en
faire le motif essentiel? Cela nous parat difficile pour plusieurs raisons. En
effet, il existe quelques textes marxiens antrieurs 1857 o se rencontre dj
incidemment Arheitskraft91.
En 1850, ce terme apparat la fin d'un article sign d'Eccarius, qui
collaborait avec Marx92. Cet article est publi dans la Nouvelle Gazette
Rhnane, revue politico-conomique, que Marx s'efforce de faire vivre au dbut
de son exil londonien. Or Marx retouchait les textes d'Eccarius93. Les diteurs
de la Marx-Engels Gesamtausgabe y voient la marque de son style, prcisment
dans l'alina terminal o on lit: La manire de produire de la petite-
bourgeoisie dvore trop de forces de travail [Arbeitskriifte J, trop de capital94.
D'aprs le Sachregister zu Marx-Engels Werke, on pourrait croire qu'une
autre occurrence de Arbeitskraft se trouve dans un article d'Engels de la mme
priode. Cet article, paru dans The Democratie Review [La revue dmocrati-
que J en mars 1850, tait en anglais. Engels crivait:
Dans le systme social actuel, [...] le capital est entre les mains du petit
nombre qui la multitude est oblige de vendre son travail [to whom the many
are obliged to sell their labour] 95.
Ainsi, c'est la traduction allemande tardive qui interpole ici force de travail
la place de travaiI96,)!
Il Y a nanmoins un problme qui aurait d tre envisag par ceux qui
fondent une interprtation htive et tendancieuse sur des constatations mal
tayes. En fait, c'est Engels qui, trs tt, et, semble-t-il, le premier, a employ
Arbeitskraft, puisqu'on trouve le mot chez lui ds son Esquisse de 184497!
Dans l'espace de deux trois pages, on en relve six occurrences98.
Or, Marx connaissait bien ce texte: il s'y reporte en prparant le premier
livre du Capital, puisqu'il en cite quelques lignes propos des lois conomiques
qui agissent l'insu des agents conomiques et se manifestent sous forme de
crises cycliques. Il l'aura peut-tre relu. On sait qu'il fut influenc par cette
uvre suggestive du jeune Engels qui, dans son texte, transposait la termino-
logie des conomistes anglais comme Adam Smith. Il reste qu'Engels n'avait
pas song la ncessit de distinguer force de travail et travail pour comprendre
et rsoudre les contradictions o s'enfermait l'conomie politique classique.
Quoi qu'il en soit, le fait qu'Engels employait le mot Arbeiskraft en 1844 montre
qu'il traduisait sans problme en allemand la notion de force (puissance ou
pouvoir) de travail prsente chez les conomistes sur lesquels il s'appuyait. C'est
pourquoi le mot pouvait venir spontanment sous la plume d'Engels ou de
Marx. Deux occurrences de Arbeitskraft se trouvent aussi dans les discours
290 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
prononcs par Engels en fvrier 1845 Elberfeld 99.Par contre, le mot ne semble
figurer ni dans les Manuscrits de 1844, ni dans La Sainte Famille.
Mais, il apparat une fois dans L'idologie allemande:
L'esclavage, certes encore trs rudimentaire et latent dans la famil1e,
est la premire forme de proprit, qui d'ail1eurs correspond dj parfaite-
ment ici la dfinition des conomistes modernes d'aprs laquelle il est la
libre disposition de la force de travail [Arbeitskraft] d'autrui 100.
Dans les annes 1865-1867, une des sources du terme, pour Marx,
pourrait donc tre Engels, celui-ci ayant lui-mme tout simplement traduit
l'expression de Smith: puissance productive du travaipol
".
Le mot Kraft est
li, chez Marx et Engels, ds 1844, des qualificatifs varis: ce sont les forces
essentielles" de l'homme, ses forces vivantes
", ses forces physiques" et
intellectuelles ", ou les forces naturelles" en gnral.
Quant la distinction entre force de travail" et travail ", c'est
proprement une distinction conceptuelle labore et dfinitivement acquise
par Marx partir du moment o il rdige les Cahiers II et III des Grundrisse,
et qu'il analyse l'change entre capital et travail, c'est--dire en novembre-
dcembre 1857.
Rptons que de temps autre, le principe de cette distinction commen-
ait merger chez les conomistes anglais. Engels, en 1844, n'allait pas au-
del; tout ce qu'il avait vu, c'est que <da force de travail excdentaire va
constamment de pair avec un excdent de richesse, de capital, de proprit
foncire 102
".
Enfin, pour complter cette revue, il convient de faire remarquer que
Arbeitskraft apparat de temps autre, sous la plume de Marx, en 1857, dans
le manuscrit mme des Grundrisse 103!
Au terme de cette enqute, il faut conclure que le choix terminologique
dfinitif de Marx dans Le Capital, qui diffre de l'usage qu'il avait gnrale-
ment suivi dans ses manuscrits prparatoires, n'implique aucun changement
conceptuel. En particulier, nous pouvons affirmer que ce choix ne rsulte pas
d'un abandon quelconque des catgories de puissance et d'acte, auxquelles
Marx continue de se rfrer, y compris sous leur forme grecque: les expres-
sions travail en puissance" et travail en acte" dsignent tout autant la
distinction conceptuelle fondamentale entre force de travail" et travail"
que Arbeitskraft et Arbeit.
Marx n'hsite pas recourir au besoin aux termes aristotliciens (MvuJ..lt
et VPYEIU), ou hgliens (an sich, fr sich), dans ses explications, notre
prcdent paragraphe
l'a abondamment prouv. Nous ne voyons pas que
Marx ait cherch s'en dfaire. Cela confirme qu'il voyait dans la force de
travail une forme minente de la possibilit concrte au sens de MvuJ..lt ou
d'tre en puissance.
Marx crit quelque part dans Le capital: Qui dit puissance de travail, ne
LA POSSIBILIT CONCRTE 291
dit pas travail, pas plus que celui qui dit puissance de digestion ne dit
digestion. Ce dernier processus, c'est connu, ncessite autre chose qu'un bon
estomacJ04.
Il utilise ici dessein Arbeitsvermogen, et Vermogen pour le pouvoir
de digrer. Il cite et discute alors un propos de l'conomiste Rossi, prenant
soin de marquer que Arbeitsvermogen rend l'expression franaise puissance
de travail qu'il donne entre parenthsesl05. Ce n'est pas sur une ventuelle
diffrence faire entre Vermogen et Kraft que porte le litige: Marx reproche
Rossi de supposer que l'existence mme de la puissance de travail implique,
ipso facto, l'existence des moyens de subsistance, c'est--dire de supposer que
les conditions de la vente de la puissance de travail sont toujours ralises, ce
qui est absurde, l'exprience et l'observation immdiate montrant le
contraire.
A l'issue de cette recherche sur le concept de force de travail et sur les
termes employs par Marx pour l'exprimer, nous retirons certains rsultats. Il
ne s'agit pas pour lui de garder ou d'abandonner des catgories philosophi-
ques . Qu'il continue dans Le capital utiliser les termes hgliens ou
aristotliciens, c'est indiscutable pour des notions comme celles de forme et de
contenu, de substance, de quantit, de qualit, de moments et de processus: de
mme, en ce qui concerne puissance et acte.
Pour lui, la difficult n'est pas essentiellement de nature terminologique.
C'est de saisir, concevoir et expliquer les phnomnes. La difficult est d'ordre
conceptuel et thorique: elle est de comprendre les contradictions qui se
manifestent dans la ralit, et d'en dcouvrir les vritables causes. Ainsi, avec
la puissance de travail, la difficult est de saisir comment elle a pu et d se
diffrencier concrtement du travail effectif, comment elle a pu tre spare de
celui-ci.
En tudiant ses origines historiques, ses conditions d'apparition, on
dcouvre comment la force de travail a t rduite la simple possibilit de
travail qu'est l'ouvrier libre , exploit par le capital. Mais, le travailleur est
la source de toute possibilit relle, qui rside dans la runion de ces capacits
et des moyens de production existants dans l'activit productive elle-mme.
5. Les forces naturelles sont-elles productives?
On pourrait croire que la possibilit historique relve uniquement de
l'homme, c'est--dire des forces productives humaines, au premier rang, de la
force de travail, et que les forces productives se rduisent celle-ci et aux
moyens de production mis en uvre par les hommes. Or, le concept de forces
productives a une extension bien plus grande: Marx y englobe les forces
naturelles. La possibilit historique reposerait-elle donc aussi sur les possibili-
ts de la nature?
A cette question: y a-t-il pour Marx, d'autres forces productives que la
292 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
force de travail humaine?, l'on hsite rpondre par l'affirmative. Des
interprtes du marxisme disent hardiment: non!
Personne ne met en doute que la force de travail soit, par excellence, une
force productive. Par contre, dans les dfinitions que l'on donne ordinaire-
ment des forces productives, souvent les forces naturelles sont omises.
Au mot production", le Dictionnaire Gnral des Sciences Humaines
prsente la dfinition suivante: On entend par forces productives le rsultat
de la combinaison des travailleurs directs et des travailleurs indirects avec les
moyens de production dans des rapports techniques (une division technique
du travail) dtermins 106.
Les auteurs de cette dfinition omettent deux choses: non seulement
sont oublis" les rapports sociaux de production, mais aussi les forces
naturelles. L'accent est mis unilatralement sur la division technique du
travail. A la dcharge des auteurs de cet ouvrage, reconnaissons qu'ils ne
prtendent pas exposer les vues de Marx.
On trouvera sans doute mieux dans le Dictionnaire critique du marxisme.
Dans l'article sur les forces productives, rdig par M. J.-P. Lefebvre, cet
ouvrage propose de distinguer trois sens: 1) Productivit (du travail social);
2) (toujours au pluriel en ce sens) Capacits de production d'une formation
sociale, ensemble des forces de travail et des moyens de production d'un pays
ou d'une poque donne; 3) Systme interactif des forces de travail et des
moyens de production dans lequel s'exprime le rapport de l'homme aux objets
et aux forces naturelles 107.
Si cette dfinition fait allusion aux forces naturelles, on voit qu'elle ne les
considre pas vraiment comme des forces productives". Seraient-elle incluses
dans les moyens de production,,? On ne sait.
De mme, on cherche en vain une mention des forces naturelles dans
l'article Marx et marxisme" de MM. tienne Balibar et Pierre Macherey de
l'Encyclopaedia Universalis: ils prsentent la productivit du travail" comme
dpendant uniquement des progrs des instruments et techniques de produc-
tion 108", et parlant des forces productives matrielles", ils ne disent pas en
quoi elles consistent, tenant seulement souligner qu'elles incluent la force
de travail humaine 109.Du rapprochement de ces deux indications, il rsulte
que les forces productives matrielles sont a) la force de travail, et b) les
moyens de production (instruments et techniques).
Dans le Philosophisches Worterbuch de MM. Buhr et Klaus, les forces
productives sont dfmies comme le systme de l'action rciproque des
moyens de production et du travail humain HO". A l'appui de sa dfinition,
M. Gunter Heyden, auteur de l'article sur les forces productives, cite Le
capital: Quelles que soient les formes sociales de la production, les travail-
leurs et les moyens de production en restent constamment les facteurs 111.
Ainsi, l'admission des forces naturelles parmi les forces productives se
heurte de srieuses rsistances. D'o vient que des marxistes commettent
cet oubli" quand il s'agit de dfinir les forces productives? Toutefois,
LA POSSIBILIT CONCRTE 293
reconnaissons-le, M. Heyden ajoute que, ainsi dfinies, elles expriment le
rapport de l'homme aux objets et forces de la nature et que l'homme agit
sur la nature et utilise ses proprits 112.
En soutenant que les forces naturelles sont productives '>, n'allons-nous
pas verser dans une interprtation tendancieuse, et faire endosser Marx la
thse des Physiocrates, qui considraient que seule la nature tait productive,
l'origine de toute richesse se trouvant ainsi dans l'agriculture?
Avec la thorie de la valeur-travail, Marx n'a-t-il pas adopt les vues
gnrales de l'conomie politique anglaise, qui impliquaient un rejet des ides
physiocratiques? La productivit du travail ne provient-elle pas uniquement
des procds et agencements que l'homme ajoute la nature? Celle-ci ne
parat pas participer l'acte productif, au processus de travail.
Pour Marx, comme pour les conomistes anglais, l'homme est la source
de la plus-value: son travail est la seule source de la valeur, rpte-t-il. Les
besoins et les buts de la production sont les siens; les moyens aussi: la nature
ne procure que des matires brutes et des formes d'nergies qui n'ont pas de
valeur marchande en elles-mmes. Marx conteste que les outils et instruments
soient productifs de valeur; a fortiori, la nature. n polmique contre ceux qui
soutiennent que la terre aurait une valeur .
Pourtant, il faut mettre les forces naturelles au nombre des forces
productives. Cela dcoule incontestablement du fait qu'il considre la terre
comme l'une des sources de la richesse matrielle, sous forme de valeurs
d'usage:
L'homme ne peut point procder autrement que la nature elle-mme,
c'est--dire qu'il ne fait que changer la forme des matires. Bien plus, dans
cette uvre de simple transformation, il est encore constamment soutenu par
des forces naturelles. Le travail n'est donc pas l'unique source des valeurs
d'usage qu'il produit, de la richesse matrielle. Il en est le pre, et la terre, la
mre, comme dit William Petty 113.
En 1875, Marx insiste sur ce point de doctrine fondamental:
Le travail n'est pas la source de toute richesse. La nature est tout autant
la source des valeurs d'usage (qui sont bien, tout de mme, la richesse relle 1)
que le travail, qui n'est lui-mme que l'extriorisation [Ausserung] d'une force
naturelle, la force de travail de l'homme
114.
Or, Marx le prcise souvent: lorsqu'il dfinit la productivit du travail, il
soutient qu'elle dpend, non seulement des qualits du travail humain, mais
aussi des conditions naturelles , par exemple de la faveur des saisons, ou de
l'abondance des mines 115.
n ne s'agit nullement d'une remarque isole, ni d'une formulation htive
qui lui aurait chapp par quelque ngligence. Dans Le capital, cette ide est
rpte de la manire la plus expresse:
294 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Abstraction faite du mode social de la production, la productivit du
travail dpend des conditions naturelles au milieu desquelles il s'accomplit.
Ces conditions peuvent toutes se ramener soit la nature de l'homme lui-
mme, sa race, etc., soit la nature qui l'entoure. Les conditions naturelles
externes se dcomposent au point de vue conomique en deux grandes
classes: richesses naturelles en moyens de subsistance, c'est--dire fertilit du
sol, eaux poissonneuses, etc., et richesses naturelles en moyens de travail, tels
que chutes d'eau vive, rivires navigables, bois, mtaux, charbon et ainsi de
suite 116.
Marx ajoute mme qu' aux origines de la civilisation c'est la premire
classe de richesses naturelles qui l'emporte; plus tard, dans une socit plus
avance, c'est la seconde 117.
Pour lui, il y a donc une influence des forces naturelles et de la nature en
gnral sur la productivit du travail humain. Peut-on prciser davantage cette
influence? Comment la conoit-il? Ses propos ce sujet ne sont pas toujours
sans crer quelque confusion.
Dans le troisime livre du Capital, il dveloppe une comparaison entre
l'emploi de chutes d'eau naturelles et celui de machines vapeur comme
sources d'nergie 118. Contre toute attente, il dclare que le surprofit est
moindre dans le second cas! Pourquoi alors, se demande-t-on, le capitalisme
aurait-il dvelopp grande chelle la production fonde sur la machine
vapeur, lui dont le mobile est de chercher le plus grand profit possible? Marx
semble en pleine contradiction.
Quelles sont les raisons qu'il avance pour dire que le surprofit est plus
grand dans le cas de l'usage de la chute d'eau? Cela est d tout d'abord une
force naturelle, la force motrice de la chute d'eau existant naturellement; elle
ne cote rien, contrairement au charbon qui transforme l'eau en vapeur et qui
est lui-mme un produit du travail, et donc possde une valeur pour laquelle
il faut payer un quivalent 119.
Rsoudre les difficults qui se prsentent ici n'est pas chose aise. D'une
part, le capitaliste cherche tout autant utiliser la chute d'eau naturelle que la
machine vapeur si, tous comptes faits, il peut produire plus avec la mme
dpense. D'autre part, il est clair que les forces naturelles qui ne supposent
aucun transport, ni aucun travail pralable, sont dites productives bien qu'on
ne les paie pas: dans le travail de cueillette ou d'extraction, l'on n'change pas
ce qu'on obtient directement de la nature contre de l'argent. On paie le travail
de l'ouvrier agricole, mais on ne paie pas la nature elle-mme pour la
multiplication des grains qui rsulte des proprits des plantes et de la
vgtation naturelle.
Dans la comparaison de la machine vapeur la chute d'eau, Marx
oppose les cots de l'extraction et du transport d'un combustible la gratuit
de la libre disposition de la chute d'eau naturelle. Mais on ne saurait maintenir
cette supposition sans restriction: il faudrait comparer les cots respectifs des
LA POSSIBILIT CONCRTE
295
installations et des instruments ou machines; mme dans le cas limite et idal
o la chute d'eau ne demanderait aucun amnagement du sol, il faut au moins
une roue et quelque mcanisme rudimentaire. Ce que Marx compare, c'est la
contribution des forces naturelles elles-mmes en tant qu'nergie la produc-
tion, indpendamment de la part qu'y prennent les moyens. C'est une
premire raison de l'obscurit de son propos.
.
Il y a une autre raison d'ambigut: Marx mle et semble confondre la
production de valeurs d'usage et celle de la valeur d'change. Son argument est
que les forces naturelles, en elles-mmes, sont gratuites: c'est un don de la
nature. Or, dans le cas de la machine vapeur, la nature contribue galement
la productivit du travail:
Le fabricant qui utilise la machine vapeur se seri, lui aussi, de forces
naturelles qui ne lui cotent rien, mais rendent le travail plus productif. [...]
Il ne paie pas le pouvoir que posde l'eau de changer d'tat physique et de
devenir vapeur, ni l'lasticit de la vapeur, etc.l2o.,)
Venant d'affirmer que le fabricant doit son surprofit d'abord une force
naturelle , Marx ajoute que les forces naturelles rendent le travail plus
productif . On comprend qu'il soit productif au sens de production des
valeurs d'usage, et que la productivit du travail dpende du concours que
les forces naturelles lui apportent. C'est pourquoi, en rgime de production
capitaliste, c'est le capitaliste ou du moins la classe capitaliste qui profite de
cette productivit naturelle.
Mais, on ne peut en rester l: pourquoi Marx dit-il que les forces
naturelles rendent le travail plus ou moins productif , sans prciser s'il s'agit
de la valeur d'change ou de la valeur d'usage? En ralit, cela ne se comprend
qu'en admettant qu'il considre les choses sous les deux points de vue la fois:
un certain rapport entre valeur d'usage et valeur d'change s'tablit, bien que
ce rapport ne soit pas quantifiable. Marx rpte que ce sont des choses
incommensurables.
.
Une chose est claire: les forces naturelles sont productives en ce qui
concerne les valeurs d'usage. Dans l'esprit de Marx, cela entrane qu'elles
soient indirectement productives en ce qui concerne la valeur d'change, car
d'elles dpend la productivit du travail, c'est--dire la proportion entre les
produits ncessaires la vie d'un ouvrier et ceux qu'il ralise (proportion qui
peut galement s'exprimer en temps ou valeur).
Dans ces conditions, d'o vient qu'en gnral les commentateurs tendent
passer sous silence les forces naturelles quand ils dfinissent les forces
productives?
Si certains mentionnent les matriaux ou matires premires tirs de
la nature, quand ce ne sont pas simplement des moyens de susbsistances ou
objets de consommation tout prts, ils omettent presque toujours les forces
naturelles 121.
296 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Dans sa discussion sur ce qu'il convient d'inclure dans la liste des forces
productives, G. A. Cohen, analyste pourtant minutieux et rigoureux, com-
met lui aussi cet oubli: il ne compte parmi les moyens de production que les
espaces (la gographie et le climat) et les matriaux bruts, mais pas les
forces de la nature 122!
Les interprtes, mettant en avant l'ide que la force de travail dans le
mode de production capitaliste est la force productive par excellence
", en
concluent subrepticement que, pour Marx, elle serait la seule! Cette compr-
hension de la pense marxienne est unilatrale et, partant, fallacieuse: les
forces productives, ou la force productive globale 123,
d'une socit, c'est un
ensemble o la force productive du travail, les moyens de production, les
forces et matires naturelles sont intimement lis en un tout absolument
indissociable.
En ralit, cette omission est grave: ne pas considrer les forces naturelles
comme productives" dforme la pense marxienne et obre toute compr-
hension profonde du processus historique. Les interprtes, allant plus loin que
Marx lui-mme, focalisent leur attention sur l'exploitation de la force ouvrire
dans le systme capitaliste. Pour le capitaliste, la force de travail est la seule
source de plus-value; par suite, il ne s'intresse qu' la valeur124 comme
quantit de travail moyen socialement ncessaire.
Pourtant, cela ne signifie pas que les forces naturelles ne soient pas
productrices: elles sont productrices de valeurs d'usage! De ce fait, elles
dterminent des possibilits concrtes, et la possibilit historique dpend des
possibilits inhrentes la nature, en particulier de celles qui rsident dans les
forces naturelles que l'homme dcouvre et utilise. La possibilit ne rside donc
pas seulement dans la force de travail, mais aussi dans les forces naturelles, qui
conditionnent la productivit du travail.
L'erreur o certains sont ainsi conduits a ses racines dans le systme
capitaliste lui-mme. Dans tout mode de production o apparat l'change li
un march (donc dans la production marchande en gnral), la force de
travail est seule cratrice de valeur d'change. Le mode de production
capitaliste exploite cette facult et la dveloppe pour en tirer la plus-value.
Ni le capital accumul, ni les moyens de production existants (capital
constant) ne produisent de valeur nouvelle, en entendant valeur au sens de
valeur d'change, mais Marx ne dit pas qu'ils ne produisent .pas de valeurs
d'usage, au contraire. La nature n'est pas productive au sens o elle produirait
des valeurs d'change, mais elle l'est dans l'autre sens! Marx le dit de la
manire la plus formelle:
Le capital, de mme que toutes les conditions de travail) y compris les
forces de la nature, qu'on ne rtribue pas, a une action productive dans le
processus de travail, dans la cration de valeurs d'usage, mais il ne devient
jamais source de valeur 125.
"
LA POSSIBILIT CONCRTE
297
On remarquera que le capital lui-mme est dit avoir une action
productive! Ici, il y a une difficult pour ceux qui n'admettraient pas le rle
des forces naturelles dans la production. Car, comment comprendre que le
capital agisse comme la nature elle-mme dans le processus de travail, si l'on
n'a pas vu que celle-ci a son propre rle dans la production des valeurs
d'usage?
Lorsque Marx parle de l'utilisation des forces naturelles et de nom-
breuses autres forces productives 126,cette affirmation implique que les forces
de la nature font partie des forces productives. Or, l'une des grandes victoires
du capitalisme, sa supriorit sur les modes de production prcdents, c'est de
s'tre empar de certaines forces naturelles nouvelles, de la force expansive de
la vapeur par exemple (grce la machine vapeur) qui, comme toutes les
forces naturelles, ne cote rien 127.
Si l'on s'y trompe, c'est que se produit ici une illusion spcifique au
capitalisme. A propos du rle de la science, dans la forme dveloppe du mode
de production capitaliste, Marx explique que les forces naturelles galement
se prsentent comme forces productives du capitaI128.
Ainsi, on confond la productivit sociale et la productivit naturelle du
travail. Cette confusion est son comble dans le capitalisme dvelopp, car le
capital engendre une illusion: dveloppant les moyens de production matriels
et, par l, accroissant la production des valeurs d'usage, c'est--dire la
satisfaction d'une plus grande quantit de besoins sociaux, il parat jouer le
mme rle que la dcouverte de nouvelles forces naturelles.
C'est parce que le capital peut faire fonctionner les forces naturelles son
profit, comme il le fait avec la force de travail, que se produit l'illusion: il
semble que le capital soit lui-mme productif. Mais sa productivit est
d'emprunt. La productivit naturelle du travail et des forces de la nature
passent pour la sienne propre, parce que, dans les conditions sociales de son
existence, il peut seul les mettre en uvre.
En fait, la nature cre toutes sortes de valeurs d'usage sans aucun
concours du capital, ni aucun travail: Une chose peut tre une valeur d'usage
sans tre une valeur. [...] Tels sont l'air, des prairies naturelles, un sol vierge,
etc. 124.
Soutenir que la nature n'est pas productive, que la productivit du travail
ne dpend pas des capacits productives qui sommeillent dans les matriaux et
sources d'nergie naturels, c'est trahir la pense de Marx.
Que seul le travail soit source de richesse, c'tait, entre autre, la thse de
Destutt de Tracy 130.
Le terme production est l'occasion d'une double quivoque. La
premire est celle que nous venons d'indiquer: elle concerne la caractre
apparemment non productif de la nature. Il semble que celle-ci ne soit pas
productive, parce qu'elle n'est pas l'origine de la valeur en tant que valeur
d'change.
D'autre part, si l'on n'a pas perc jour le mystre de la production de la
298 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
plus-value tout en respectant la loi de l'change d'quivalents, et bien qu'on ait
dcouvert que le travail est l'origine de la valeur (cas des conomistes anglais),
c'est alors le capital, acheteur de la foree de travail qui apparat comme
productif de toute valeur, y compris de la valeur d'usage! Ce fait engendre une
seconde quivoque, inverse de la prcdente; c'est lui, le capital, qui se
prsente comme crateur des nouvelles valeurs d'usage qui croissent sous son
impulsion. Mme celles que la nature fournit gratuitement semblent dcouler
de lui! Alors, le renversement est complet: l'quivoque redouble rend la
mystification totale Bi.
La premire face de l'quivoque (que la nature n'est pas productive) est
d'autant mieux ancre dans la conscience commune que le mode de produc-
tion capitaliste fait croire que le travail n'est pas la source de la productivit
en valeur, puisque le travail ne peut rien sans le capital.
Or, Marx distingue deux sortes de productivit: la productivit naturelle
du travail et sa productivit sociale. En s'emparant de celle-ci, le capital fait
penser que la productivit naturelle dcoule de lui comme si c'tait sa
proprit intrinsque et spcifique. Marx souligne bien l'quivocit du mot
productif" lorsqu'il prcise que, dans le sens capitaliste du terme produc-
tif", ce vocable signifie productif de plus-value" 132.
Mais il y a le sens naturel" du mot. En fait, la ralit est la suivante: c'est
la force de travail et toutes les autres forces naturelles qui crent les valeurs
d'usage.
L'accroissement de la force productive du travail ne consiste pas seule-
ment dans l'intensification du travail, dans l'allongement de sa dure, dans son
perfectionnement (coopration, division du travail, etc.), mais aussi et simul-
tanment dans l'exploitation des ressources de la terre et de la nature en
gnral. C'est ce qui permet de comprendre que les sciences deviennent de plus
en plus une force productive directe, car c'est par elles que l'on acquiert la
connaissance des possibilits" naturelles 133.
La nature est donc, en elle-mme, une rserve de possibilits. Des forces
y sommeillent que l'homme n'a pu, jusqu'ici, dcouvrir et faire agir son
profit. Elle constitue une source de possibilits concrtes pour le dveloppe-
ment humain, qui passe par celui des moyens de production, c'est--dire des
techniques. Cela se ralise grce l'exploitation des forces naturelles (sources
d'nergie, etc.). La puissance productive de ces forces, mise en uvre par
l'homme, les fait passer de l'tat de possibilit concrte celui de possibilit
relle et de ralit.
Cela est d'une importance philosophique fondamentale: il est tout
diffrent de penser que l'homme est la seule source de la possibilit, et de
penser que la nature est galement l'origine de toute possibilit. Le
dveloppement de toutes les forces productives est ce qui rend l'histoire
possible, ou mieux, c'est la possibilit historique elle-mme. Ce dveloppement
dpend au moins autant des rserves potentielles de la nature que des facteurs
propres la force productive du travail. C'est pourquoi, traitant de la
LA POSSIBILIT CONCRTE
299
productivit du travail, Marx ajoute cette prcision: si les conditions
naturelles sont favorables 134.
C'est une des raisons majeures pour lesquelles il est impossible de se
prononcer sur le contenu et le cours de l'histoire venir. Pour le faire, il
faudrait connatre toutes les possibilits qui existent au sein de la nature 135.
Ceux qui pensent que, pour Marx, seule la force de travail serait cratrice,
sont victimes de l'amphibologie du concept de valeur que Marx a dnonce.
Cela rejaillit sur le concept de production: ils prennent le concept de
production au sens capitaliste! Ce quiproquo dsastreux touche galement le
concept de productivit. On peut parler de la productivit ou bien en utilits
ou bien en valeur, quoique les deux soient toujours lies. Dans tout mode de
production marchande, elles sont lies polairement: Les marchandises ne
sont marchandises que parce qu'elles sont deux choses la fois, objet d'utilit
et porte-valeur 136.
L'histoire montre, et la thorie du Capital dmontre, que le capitalisme a
considrablement accru les valeurs d'usage en quantit et en qualit par
rapport aux poques antrieures. Il a pouss au dveloppement de la
population, donc celui de la force de travail, et par consquent celui des
possibilits relles. Il est contraint, par nature, de chercher crer toujours
plus de valeur, du fait de la concurrence entre capitalistes. Surtout, il a
dvelopp le machinisme. Or celui-ci vince les hommes. Ainsi, se meut-il au
sein d'une contradiction.
Dans ces conditions, comment est-il possible d'accrotre la plus-value, si
seule la force de travail est cratrice de valeur? La solution rside dans
l'accroissement de la productivit du travail: celle-ci dpend son tour de bien
des facteurs, en particulier de l'utilisation des ressources naturelles. Parmi ces
ressources, les forces naturelles occupent une place de plus en plus importante,
indique Marx. On ne peut les mettre en uvre que grce au dveloppement des
moyens techniques en gnral.
Pour lui comme pour William Petty, la terre (la nature) est <da mre des
richesses . Marx n'a pas rejet les thses physiocratiques autant qu'on le
pense. Elles restent valables en ce qui concerne la production des valeurs
d'usage; toutefois, elles ne le sont qu'en partie, car, dans la production, c'est
d'un concours de l'homme et de la nature qu'il s'agit, c'est--dire d'une unit
des forces humaines et des autres forces naturelles.
Si le capitalisme a pu, et, dans une certaine mesure, peut encore, se
dvelopper malgr sa contradiction interne, c'est qu'il exploite les forces
naturelles sur une chelle beaucoup plus large que dans les rgimes socio-
conomiques antrieurs: il le fait sans vergogne, pouss par les impratifs de
la lutte concurrentielle. Les forces naturelles sont productives de valeurs
d'usage qui servent de support la valeur d'change. Le capitalisme ne peut
raliser la valeur que grce ces forces: le capital s'empare de la productivit
naturelle pour la faire fonctionner son profit. Marx souligne que l'emploi
toujours plus pouss de moyens techniques nouveaux et plus perfectionns est
300 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
une des sources essentielles de la multiplication inoue de la force productive
du travail.
Toutefois, ce progrs a des limites la fois matrielles et sociales, limites
trs variables selon les branches, les pays et les circonstances. Mme lorsqu'elle
est techniquement et matriellement possible, l'utilisation des forces naturelles
(nouvelles techniques et matrise de nouveaux pouvoirs de la nature) rencontre
des rsistances sociales et politiques: le maintien et la reproduction des
rapports sociaux est une ncessit pour les classes sociales dominantes. Mais
ces impratifs se heurtent aux crises conomiques, o les forces productives
entrent en contradiction avec les rapports de production.
La force de travail tant qu'elle n'est pas mise au contact des moyens de
production n'est productive qu'en puissance. Il en va de mme des forces
naturelles qui ne deviennent utilisables que dans des conditions concrtes,
matrielles et sociales, dtermines: il y faut le truchement d'outils, d'appareils
et d'instruments, d'une force de travail et de rapports sociaux appropris. Le
travail, ou force de travail en acte, et les forces naturelles, sont les manifesta-
tions d'agents naturels. Les possibilits qu'ils reclent ne deviennent relles
que dans l'activit productive.
NOTES
1. Selon mile Littr, force , au sens mtaphysique , dsigne <des forces, les substances
qui sont causes , c'est--dire ce qui est la fois substance et cause des phnomnes
(Dictionnaire de la langue franaise, sub. Vo Force, sens
n
17). C'est en ce sens que Marx le
prend, sauf s'il ne l'aurait pas dit mtaphysique!.
2. Sens
n
I de Littr, ibid.
3. Sens
n 13 de Littr, ibid.
4. Quoique Kraft signifie plutt force , ce principe est dsign en allemand comme Prinzip
des Erhaltung der Kraft. Il fut dcouvert et pos la base de la thermodynamique dans les annes
quarante du XIX. sicle. Helmholtz avait prsent son trait Uber die Erhaltung der Kraft [Sur la
conservation de l'nergie] la Socit de Physique de Berlin le 23 juillet 1847. Marx a d avoir
connaissance de ce principe avant d'tudier des ouvrages de physique, ce qu'il fit surtout dans les
annes soixante. Le 14 juillet 1858, Engels lui crivait: Un [...]rsultat, qui aurait rjoui le vieux
Hegel, est, en physique, la corrlation des forces [die Korrelation der Krafte], autrement dit la loi
selon laquelle, dans des conditions donnes, le mouvement mcanique, donc la force mcanique
(par frottement, p. ex.) se transforme en chaleur, la chaleur en lumire, la lumire en affinit
chimique, l'affinit chimique (dans la pile de Volta p. ex.) en lectricit, et celle-ci en magntisme
(Correspondance, 1. V, p. 203; MEW 29, p. 338; Lettres sur les sciences, p. 17; trad. modifie). -
En 1864, Marx tudia l'ouvrage de W. R. Grove, Correlation of physical forces. Il trouve que
Groce est <de plus philosophique de tous les savants anglais (et mme allemands!)>> (ibid., 1. VII,
p. 255: MEW 30, p. 424).
-
En 1858, Engels lui disait qu'un anglais avait prouv que ces forces
passent l'une en l'autre selon des rapports quantitatifs trs prcis. Il s'agissait de James Prescott
Joule.
5. Encyclopdie, g 136, Addition (trad. Bourgeois, p. 569).
6. Cette discipline est justement dfinie comme l'tude des mouvements et des changements
LA POSSIBILIT CONCRTE
301
en fonction de leurs causes. Rappelons que les physiciens divisent la mcanique en dynamique et
cinmatique, cette dernire tudiant les formes des mouvements indpendamment de leurs causes.
7. Manuscrits de 1844, p. 98; MEWEB I, p. 545. On trouve des remarques identiques dans
un fragment de l'poque de la Dissertation doctorale, o Marx oppose au vieux Schelling ce que
celui-ci avait crit dans sa premire priode (cf. Diffrence, pp. 285-286; MEWEB I, pp. 369-370;
uvres (d. Rubel), t. III, pp. 99-100, n. 9). Toutefois, Marx ne bannit pas la catgorie de cration
mais seulement celle de cration ex nihilo qui suppose un crateur. Nous le vrifierons plus
d'une fois.
8. Le capital, t. I, p. 59; trad. Lefebvre, p. 50; MEW 23, pp. 58-59.
9. Ibid., p. 61; p. 53; p. 61.
10. Matrialisme et rvolution , op. dt., p. 138.
II. Ibid., p. 147.
12. Ibid., p. 154.
-
On trouve une rduction semblable chez Heidegger pour qui <<l'essence
du matrialisme ne consiste pas dans l'affirmation que tout est matire, mais bien plutt dans une
dtermination mtaphysique, selon laquelle tout tant apparat comme la matire d'un travail
(Lettre sur l'humanisme, bil., trad. et prsent. de R. Munier, Paris, Aubier/Montaigne, p. 103).
Comme si le fait que des choses soient matire d'un travail relevait de quelque dcision
mtaphysique !
.
13. Op. dt., p. 148. La physique contemporaine montre qu'il est impossible de dissocier
l'nergie et la matire; c'est ce que dit, depuis 1905, la fameuse quation de la thorie de la
relativit restreinte: e = mc2,qui renverse la physique classique.
14. Se rangeant politiquement aux cts du parti de la rvolution, Sartre rejette nanmoins
avec la dernire nergie la philosophie de Marx et d'Engels pour cause de matrialisme mcaniste:
<<il
y
a un dcalage entre l'action du rvolutionnaire et son idologie (ibid., p. 138), et
qu'arrivera-t-il un jour si le matrialisme touffe le projet rvolutionnaire? (ibid., p. 225).
15. Op. dt., pp. 421-423, 429-430.
-
Dans son Index analytique, M. Calvez mentionne les
forces productives sous production .
16. La socit ouverte..., p. 70-76. Popper discutant <<l'historicisme conomique de Marx
n'aborde que des ides assez gnrales et ne s'arrte pas sur Je concept de force.
17. Il est employ par Charles DUNOYER(De la libert du travail: ou simple expos des
conditions dans lesquelles les forces humaines s'exercent avec le plus de puissance, Paris, 2 t., 1845),
Pellegrino ROSSI (Cours d'conomie politique
-
Anne 1836-1837 -, Bruxelles, 1843), Constantin
PECQUEUR(Thorie nouvelle d'conomie sociale et politique, ou tude sur l'organisation des socits,
Paris, Capelle, 1840), Andrew URE (La philosophie des mamifactures, Paris, Mathias, 1835), Ernest
JONES (An Essay on the Distribution of Wealth and on the Sources of Taxation, Londres, 1831),
Charles DUPIN (Les forces productives et commerciales de la France, Paris, 1827), William
THOMPSON(An Inquiry into the Principles of the Distribution of Wealth most conducive to Human
Hapiness, Londres, 1824). Adam SMITHparlait de l'accroissement de la puissance productive du
travail, auquel donne lieu la division du travail (Richesse..., pp. 40, 41, etc.). Marx connaissait la
plupart de ces ouvrages qu'il avait lus et tudis: il analysa longuement les textes de Jones qui
insistaient sur les forces productives (cf. Thories, t. l, p. 36, et t. 3, p. 511 et suiv.; MEW 26-1,
p. 18, et 26.3, p. 425 et suiv.). De tous ces ouvrages, le seul qu'il semble ne pas avoir connu est celui
de Ch. Dupin, dont le titre ne manque pas d'tonner aujourd'hui (Honor de Balzac a connu cet
ouvrage trs tt).
18. Certains interprtes de Marx ont soutenu que la force de travail serait, pour lui, la seule
force productive vritable, ce qui est faux. Que, dans l'tude du capitalisme, Marx mette d'abord
l'accent sur l'exploitation de la force de travail (ou extorsion de la plus-value absolue) ne signifie
pas qu'il oublie les autres forces productives; en particulier, elles interviennent dans la thorie de
la plus-value relative! Nous le montrerons propos des forces naturelles la fin du prsent
chapitre, et plus loin dans le huitime chapitre.
19. Cf. Le capital, t. l, pp. 180-181; trad. Lefebvre, p. 200; MEW 23, pp. 192-193.
20. La force de travail existe uniquement comme une disposition [Anlage] de l'individu
vivant (Le capital, trad. Lefebvre, p. 192; MEW23, p. 185). Le texte n'est pas tout fait identique
dans la traduction de J. Roy: Mais elle n'existe en fait que comme puissance ou facult de
l'individu vivant (Le capital, t. l, p. 174).
21. Ibid., p. 201; MEW23, p. 194. Le texte traditionnel commet ici une bvue (typographique
ou due J. Roy)? en parlant de la nature naturelle de l'homme! (Cf. Le capital, t. l, p. 182;
MEW 23, p. 194). Cette bvue est releve et commente par M. Jacques d'Hondt < La traduction
tendancieuse du "Capital" par Joseph Roy, in L'uvre de Marx, un sicle aprs, Paris, Presses
Universitaires de France, 1985, p. 132).
302 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
22. Le capital, t. l, p. 174; trad. Lefebvre, pp. 192-193; MEW 23, p. 185. Trad. modifie
d'aprs le texte de la premire dition allemande (cf. MEGA, 11/5, pp. 123-124).
23. Le capital, t. l, p. 174; trad. Lefebvre, pp. 192-193; MEW 23, p. 185.
24. Ibid.
25. Ce mot allemand sigIfie formation , apprentissage , culture (sur la formation
historico-sociale des sens humains, cf. Manuscrits de 1844, pp. 92-94; MEW EH I, pp. 541-542).
26. Pour modifier la nature humaine de manire lui faire acqurir aptitude, prcision et
clbrit dans un genre de travail dtermin~, c'est--dire pour en faire une force de travail
dveloppe dans un sens spcial, il faut une certaine ducation qui cote elle-mme une somme
plus ou moins grande d'quivalents en marchandises. Cette somme varie selon le caractre plus ou
moins complexe de la force de travail. Les frais d'ducation, trs minimes d'ailleurs pour la force
de travail simple, rentrent dans le total des marchandises ncessaires sa production. (Le capital,
t. l, pp. 174-175; trad. Lefebvre, p. 193; MEW 23, p. 186)
-
On voit ici que la dtermination du
travail simple est rien moins que simple , et qu'il convient de faire intervenir ces nouvelles
considrations dans la critique sur les moyennes et les thories de la compensation que Marx
dveloppe ailleurs (cf. ci-dessus, chap. 4,
~
5, p. 189 et suiv.).
27. Darwinien ukrainien, propagateur du marxisme, Pololinski avait publi un article sur
Le socialisme et l'unit des forces physiques dans le journal italien La Plb en 1881.
28. Engels analyse l'article de Podolinski dans sa lettre Marx du 19 dcembre 1882 (Lettres
sur les sciences, pp. 110-111; MEW 35, p. 134).
29. Ibid., p. 109; p. 133.
30. Ibid., p. 111; p. 134.
31. Ibid.,pp. 111-1l2;p.134.
32. Discutant cette question, Marx conclut: II arrive toujours un point o [...] le prix de la
force de travail et son degr d'exploitation cessent d'tre des grandeurs commensurables entre
elles (Le capital, t. 2, p. 198; trad. Lefebvre, p. 590; MEW 23, p. 549).
33. Par exemple, l'esclave attach des dizaines d'annes une noria (cas cit par Marx). Dj
Aristote distinguait bien l'esclave de l'animal et de l'automate en le dfinissant un objet de
proprit anim [!!'Vu'Xov].Il divisait les objets de proprit en instruments d'action [opyava
1tpaKnKu] et instruments de production proprement dits [opyava 1tOT]nKu] (cf. La politique,
L. l, IV,
9~ 2-4,1253 b 33 et 1254 a 2; trad. Aubonnet, p. 17). Ainsi, pour Aristote, l'esclave tait,
comme tout serviteur, un instrument d'action anim, comparable la vigie au service du pilote
sur la proue du navire. Il appartient la vie qui est action et non pas production (ibid.,
1254 a 7; p. 18). .
34. Pour PLATON, cf. Le Sophiste et J. SOUILL, Etude sur le terme DUNAMIS dans les dialogues
de Platon, Paris, 1919. Pour ARISTOTE, cf. Mtaphysique, L. 9, et L. 12, ch. 5.
35. Manuscrits de 1857-1858, t. I, p. 439; Gr., p. 401. Trad. modifie, celle de M. Lefebvre
omettant le mot sinon .
36. Ibid., p. 440; p. 402. - La traduction littrale: des travailleurs salaris ouva!!Ellibres,
est curieuse en franais. Marx veut dire qu' l'poque dont il s'agit, la fin du Moyen Age, ces
hommes ne sont des travailleurs libres qu'en puissance, puisqu'ils conservent la marque de leur
origine sociale, appartiennent des ordres sociaux dtermins: ils sont serfs, manants ou
bourgeois, roturiers ou nobles, ans ou cadets, etc.
37. Ibid., p. 441; p. 403.
38. Ibid.
39. Ibid.
40. Introduction, Contribution, p. 156; Mthode, pp. 132-133; Manuscrits de 1857-1858, t. l,
p. 25; MEW 13, p. 623; Gr., p. 12. Trad. modifie.
41. Contribution, Fragment de la version primitive, p. 254; Gr, p. 946. Trad. modifie.
-
Des
remarques incidentes de cette nature apparaissent souvent chez Marx (cf., entre autres, Manuscrits
de 1861-1863, t. l, p. 142, p. 145; MEGA, II/3.1, p. 119, p.122).
42. Manuscrits de 1857-1858, t. I, p. 69; Gr., p. 53. Trad. modifie.
43. Ibid., p. 34; p. 440.
-
Le style syncop du texte vient du fait qu'il s'agit, ne l'oublions pas,
de manuscrits de premier jet.
44. Thories, t. I, p. 462; MEW 26.1, p. 370.
-
Chez Aristote, entlchie dsigne la forme
ou raison qui dtermine l'actualisation d'une puissance. C'est la forme finale ou perfection vers
laquelle tend un tre (cf., par exemple, Mtaphysique, L. IX, ch. 8, 1050 a).
45. C'est ce qu'a soutenu rcemment M. Jacques Bidet (op. cit., pp. 144-146 et passim). Nous
reviendrons sur ce changement terminologique et son interprtation dans notre prochain
paragraphe (cf. ci-dessous pp. 282 et suiv.).
LA POSSIBILIT CONCRTE
303
46. Le capital (trad. Lefebvre), p. 199 (trad. modifie); MEW23, p. 192; MEGA, II/5, p. 129
(texte allemand identique). La traduction de J. Roy (Le capital, t. l, p. 180) est approximative. Elle
contracte le texte allemand, omettant la deuxime phrase: dans l'affaire, actu et potentia ont
disparu! M. J.-P. Lefebvre les fait disparatre aussi sous leur forme latine, volontairement adopte
par Marx. Comme M. Bidet, M. Lefebvre ne veut pas que Marx soit aristotlicien.
47. Ibid.
48. Ibid.
49. Le capital, t. 7, p. 46; MEW 25, pp. 394-395. Trad. modifie. - Ces lignes sont reprises
de Thories (t. III, pp. 575-576; MEW 26.3, p. 479).
50. Ibid.
51. L'Esprit commence par son infinie possibilit, simple possibilit il est vrai, mais qui
enferme son contenu absolu comme l'En-soi [...]. La possibilit indique quelque chose qui doit se
raliser, et la OUVaj.lld'Aristote est aussi potentia, force et puissance" (La raison dans l'histoire,
pp. 186-187; dj cit ci-dessus, p. 25).
52. Le capital, t. 7, p. 23; MEW25, p. 368. Trad. modifie.
53. Ibid:, t. 3, p. 154. Soulign par nous. - Dans cette page, la traduction franaise de Roy
ne suit pas le texte allemand (cf. MEW 23, p. 742 et trad. Lefebvre, p. 804), qui resta pourtant le
mme dans les diverses ditions (cf. MEGA, II/5, p. 575). En l'absence du manuscrit de J. Roy (et
des preuves), on ne sait si Marx a retouch ici ce que Roy proposait.
54. La notion de puissance (ouVaj.ll) implique la rfrence un pouvoir, et plus
prcisment un pouvoir-devenir-autre, les deux termes qu'emploie Aristote l o la tradition
parle uniformment d'acte (vEpyEia et VtE.XEla) se rfrent plus concrtement encore
l'exprience du mouvement", crit M. Pierre Aubenque (Le problme de l'tre chez Aristote),
4
d., Paris, Presses Universitaires de France, 1977, p. 440).
55. Mtaphysique, L. 9, ch. l, 1046 a 10-11 (trad. Tricot, t. 2, p. 483).
56. Op. cit., p. 441.
57. Mtaphysique, Livre 9, ch. 8, 1049 b 5 (op. cit., p. 507).
- A propos de cette thse,
Aristote prcise sa dfinition de la puissance pour l'appliquer la nature: La nature aussi rentre
dans le mme genre que la puissance, car elle est un principe producteur de mouvement, tout en
n'tant pas dans un autre tre, mais dans le mme tre en tant que mme" (ibid., l 049 b 9-10). On
peut dire que, sur ce point, Marx le suit aussi; nous y reviendrons.
58. Le capital, t. l, p. 230; trad. Lefebvre, p. 260; MEW 23, p. 248.
-
On pourrait aussi bien
traduire: ,de veux conomiser mon unique capacit [ou pouvoir], ma force de travail."
59. Thories, t. III, pp. 575-576; MEW 26-3, p. 479. Trad. modifie. - Marx
y reprend, en
nov.-dc. 1862 (cf. ibid., p. 535, n. 2) un passage des Grundrisse, crit cinq ans plus tt, sur lequel
nous reviendrons (cf. Manuscrits de 1857-1858, t. I, p. 224; Gr., p. 193).
60. Le capital, t. 6, p. 50; MEW 25, p. 38.
61. Manuscrits de 1861-1863, p. 58; MEGA, t. II/3.1, p. 45.
-
Ces manuscrits, qui
constituent une tape de rdaction intermdiaire entre les Grundrisse et Le capital, n'ont t dits
que rcemment dans la nouvelle MEGA.
62. L'argent qui provient de la valorisation d'un capital pralable apparat non plus comme
argent qui est simplement la forme abstraite de la richesse universelle, mais comme assignation sur
la possibilit relle de la richesse universelle
-
la puissance de travail -, en l'occurrence, la
puissance de travail en devenir. [...] Il n'y a pas d'quivalent pour la valeur nouvelle cre; sa seule
possibilit est dans du travail nouveau" (Manuscrits de 1857-1858, t. I, p. 307; Gr., p. 273). La
cration d'argent'> quant la forme, est dj capital (dj possibilit pose du capital)" (ibid.).
Il en est de mme de la force de travail (ibid., p. 439; Gr., p. 401).
63. Ibid., t. I, p. 402; Gr., p. 367.
64. Il
y
a en effet des exceptions remarquables que nous examinerons ci-dessous.
65. Cf. Manuscrits de 1857-1858, t. I, p. XIII, Introduction du traducteur, Remarque sur
Arbeitsvermiigen, et p. 231 (note 70 de M. J.-P. Lefebvre).
66. M. Bidet (op. cit.) centre son analyse sur la thorie de la valeur, estimant que Marx
y
aurait rencontr des difficults insurmontables. Il se fonde sur l'existence de certaines modifica-
tions terminologiques chez Marx (remplacement de formation" par forme", etc.) au fil des
annes. Il soutient que Marx aurait finalement opt pour une pistmologie non-dialectique
",
pour un non-hglianisme", et ne serait dbarrass peu peu des catgories philosophiques
",
sans
y parvenir compltement, puisque - accorde M. Bidet - ces dmls de Marx avec des
concepts philosophiques" se seraient poursuivis, avec des fortunes diverses, jusque dans ses
derniers crits.
67. Ibid., p. 144 (titre du troisime paragraphe).
304 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
68. Ibid., pp. 145-146.
69. Ce n'est pas la conclusion que M. Bidet tire des changements qu'il repre dans la
terminologie marxienne. Pour lui, les concepts fondamentaux de Marx ont un sens socio-
politique . A notre avis, en niant que la pense de Marx repose sur une philosophie
d'inspiration non seulement hglienne, mais aussi, sur certains points importants, aristotli-
cienne, M. Bidet verse dans un positivisme. C'est pourquoi il dnie au concept de force de
travail le sens de OUVal!l.
70. Les historiens de la philosophie antique ont tabli que, chez les grecs et chez Aristote en
particulier, Duvall/(; est synonyme de qJucn (cf. A. FAUST, op. ci1.; W. SESEMAN,Logik und
Ontologie der M6glichkeit, Bliitter fr deutsche Philosophie, 1936, Bd. JO, 2, pp. 161 et suiv.; A.
Becker-Freyseng, op. cit.).
71. Quand Marx s'oppose certaines ides des philosophes, des conomistes, ou des
socialistes, ou quand il varie lui-mme sur quelque point de doctrine, il ne manque jamais de le
faire savoir d'une faon ou d'une autre, soit dans ses ouvrages eux-mmes, soit dans ses changes
pistolaires avec Engels. En ce qui concerne le mode d'exposition dialectique en gnral, la
Postface la deuxime dition allemande du Capital s'inscrit en faux contre la thse de M. Bidet
-
et de quelques autres. Sur le point prcis qui nous occupe, on ne peut trouver la moindre chose
chez Marx qui indique qu'il ait dlibrment opr un changement conceptul.
72. Salaire, p. 44; MEW 16, pp. 129-130. - Marx ajoute que Hobbes, avait dj, d'instinct,
dans son Lviathan, signal ce point qui a chapp tous ses successeurs, en disant: "La valeur
d'un homme est, comme pour toutes les autres choses, son prix: c'est--dire exactement ce qu'on
donne pour l'usage de saforce" (ibid.); citation reprise dans Le capital (t. 1, p. 173, n. 2; trad.
Lefebvre, p. 191; MEW 23, p. 184, n. 42). Voici le texte de Hobbes: The value or worth of a man,
is as of all other things his price
-
that is to say, so much as would be given for the use of his power
(Works, d. Molesworth, Londres, 1839-1844, v. VIII, p. 76; cf. Capital, d. anglaise de Moore-
Aveling (1887), p. 167, n. 2).
73. Cf. MEW 16, p. 623, n. 98. - Les diteurs ne signalent pas la premire dition allemande
de 1898 due Bernstein, et parue dans le journal socialiste Neue Zeit.
-
M. Rubel retrace
l'histoire des ditions du texte (cf. Marx, uvres, d. Rubel, 1. I, pp. 476-477).
74. MEGA, 11/5, p. 24, lignes 25 et suiv.
-
Le texte franais de J. Roy (Le capital, 1. 1, p. 59)
parle ici de dpense de force humaine, alors que
l'on a en allemand: die Verausgabung
menschlicher Arbeitskraft (cf. Le capital (trad. Lefebvre), pp. 50-51; MEW23, p. 53).
-
Quand on
rencontre force de travail en franais, quelques pages plus haut (ibid., 1. 1, p. 4), ce passage ne
figure pas dans la premire dition allemande (cf. MEGA II/5, pp. 20-21), mais a t ajout par
Marx et introduit dans les ditions allemandes ultrieures, ce qui complique les comparaisons.
Toutefois, cela ne change rien l'emploi gnral de Arbeitskraft dans Le capital.
-
A ce propos,
notons que le Dictionnairefranais-allemand de Sachs et Villate, dit Berlin en 1884, mentionne
Arbeitskraft, dans les composs de Arbeit, avec le sens de force active au singulier et le sens de
bras ou d'ouvriers (Arbeiter) au pluriel. Le mme ouvrage indique les sens suivants pour
Vermogen: pouvoir (das Konnen), puissance (physische Fiihigkeit), facult (geistige Fiihigkeit),
forces (kriifte), moyens (Mittel)>>, puis dans un deuxime groupe: fortune (Hab' und Gut), (du)
bien.
75. Le capital, 1. I, p. 170,1. 27-28; trad. Lefebvre, p. 188,1. 8; MEW 23, p. 181,1. 24-
M. Bidet (op. ci1., p. 145) pense que c'est substituer une dfinition nouvelle de la force de travail
une dfinition prcdente. Sans doute le terme est nouveau
-
et encore: nous verrons qu'il ne
l'est pas tout fait. Mais, coup sr, la dfinition n'est pas nouvelle!
76. Le capital, t. 1, p. 171,1. 9; trad. Lefebvre, p. 188,1. 23; MEW23, p. 182,1. 6.
77. Manuscrits de 1861-1863, p. 60; MEGA, 1. II/3.!, p. 46, 1. 35.
78. Thories, t. III, p. 575; MEW 26.3, p. 479; MEGA, 11/3.4, p. 1489, l. 4-6. (Dj cit ci-
dessus p. 281.)
-
Si
l'on
voulait traduire d'une manire uniforme, on devrait dire force de crer
de la valeur et non pouvoir! Ce passage est textuellement repris dans le Livre III du Capital
(1. 7, p. 46; MEW 25, p. 394).
79. En allemand, la formation de substantifs composs est normale et trs courante.
80. Manuscrits de 1857-1858, 1. I, p. 207; Gr., p. 178,1. 8-12.
81. Ibid., p. 215; p. 185.
82. Plus tard, Marx s'excusera de suivre parfois ]a manire de parler usuelle: Lorsque
j'emploierai, par la suite, l'expression valeur du travail, je ne ferai que prendre la tournure
populaire pour' valeur de la force de travail>, (Salaire, p. 5 I; MEW 16, p. 135).
83. Loc. ci1., p. 223, 1. 30-38; p. 193,1. 1-9.
84. Ibid., p. 224; p. 193,1. 21-27 et 37-41.
LA POSSIBILIT CONCRTE
305
85. Confrences prononces Bruxelles en dcembre 1847 et publies en 1849 dans la
Nouvelle gazette rhnane (cf. Travail salari, pp. 5-7, et l'Introduction d'Engels, pp.
9- 19; MEW 6,
pp. 397 et suiv.).
86. Manuscrits de 1857-1858, 1. l, p. 224; Gr., p. 193, I. 40-42. Soulignons ici encore la
difficult de traduire. Dans le texte de M. Lefebvre qui a insist sur la rigueur onomastique"
ncessaire (cf. son Introduction au Capital, trad. de la 4c d. allem., p. XVIII), quelques lignes
d'intervalle, Vermogen est traduit, tantt par capacit , tantt par puissance . D'autre part,
M. Lefebvre traduit Leiblichkeit par tre physique ce qui n'est pas trs heureux: Leib voque
le corps et la vie [Leben], ce que ne rend pas tre physique. Ailleurs, M. Lefebvre traduit
Leilichkeit par corporit vivante .
87. Ibid., p. 224; pp. 193-194. Trad. modifie.
-
La difficult de traduire tient deux choses.
D'une part, Marx crit rapidement: 730 pages (les sept cahiers des Grundrisse) d'octobre 1857
mars 1858. D'autre part, le franais ne dispose pas du jeu de dclinaisons, ni des articles et
pronoms neutres de l'allemand et ne peut donc rendre la densit du texte sans lourdeur; celle-ci
est invitable si l'on veut carter toute ambigut ou contresens.
88. Ibid.
89. Ibid., pp. 231-232; pp. 200-201.
-
En tte de ce troisime Cahi,er figure une date: 29-
30 novembre 1857.
90. J'ai eu rcemment entre les mains un ouvrage scientifique trs important: Correlation
of Physical Forces [La corrlation des forces physiques] de Grove. Celui-ci dmontre que la force
mcanique, la chaleur, la lumire, l'lectricit, le magntisme et la chemical affinity [l'affinit
chimique] ne sont tous, proprement parler, que des modifications de la mme force, qui
s'engendrent mutuellement, se remplacent, se transforment l'une en l'autre, etc. Il limine trs
habilement ces monstrueuses chimres mtaphysico-physiques que sont la chaleur latente
(laquelle n'est gure pire que la <<lumire invisible), le fluide lectrique et autres pis-aller de la
mme eau qui ne servent qu' placer des mots au moment propice, l o les ides font dfaut
(Lettre de Marx L. Philips du 17 aot 1864, Correspondance, 1. VII, p. 253; Lettres sur les
sciences, p. 32; MEW 30, p. 670). Nous avons mentionn ci-dessus (p. 300, n. 4) la lettre Engels
du 31 aot 1864 o il parle aussi de cet ouvrage et de son importance philosophique.
91. Des recherches plus approfondies permettraient peut-tre d'en dcouvrir d'autres que
celles que nous allons examiner.
92. Die schneiderei in London (Les tailleurs de Londres) (MEGA, t. 1/10, p. 604).
93. Ille dit lui-mme son ami Weydemeyer propos d'un autre article d'Eccarius (Lettre
du 30 janv. 1852, Correspondance, t. III, p. 36; MEW28, p. 486).
94. MEGA, t. 1/10, p. 604, et Apparat, p. 1115, note de la p. 604, I. 10-12. - Cet alina est
du plus pur marxisme.
95. Ibid., p. 226, I. 31-32. Traduit et mots souligns par nous.
96. Alors que ArbeitskraCt n'apparat qu'une vingtaine de fois avant 1867, l'Index des MEW
en signale des centaines d'occurrences! Malgr son utilit, on ne peut donc se fier compltement
cet Index des MEW. Comme cela ressort des entres rpertories et classes sous Arbeitskraft,
quand les rfrences renvoient des textes antrieurs 1865, il s'agit d'ditions (ou rditions ou
traductions) ultrieures modifies, parfois par Marx et Engels eux-mmes, plus souvent par les
diteurs de leurs uvres. Le cas de Travail salari et capital est bien connu: en effet, Engels
s'explique sur les corrections qu'il a apportes lors de son dition de 1891. Il en est de mme pour
toutes les traductions en allemand d'uvres, articles, ou lettres, crits en franais ou en anglais,
o ArbeitskraCt a remplac Arbeit le cas chant. C'est dire le manque d'une dition critique des
uvres de Marx et d'Engels. La nouvelle MEGA, en cours d'dition, apporte enfin l'apparat
critique ncessaire.
-
Quant Arbeitsvermogen, ce terme n'est pas retenu dans l'Index des MEW.
-
En outre, cet Index, comme bien d'autres, ne relve gure les termes philosophiques chez
Marx.
97. Esquisse d'une critique de l'conomie politique. Esquisse gniale, selon Marx, qui en
faisait grand cas: il souhaitait sa rdition. Cet article d'Engels, paru dans les Annales franco-
allemandes en janvier 1844, avait vivement frapp Marx, qui se dcida alors se lancer dans des
lectures et tudes conomiques qui ne cesseront plus. Il est l'origine des Manuscrits de 1844 et
de la collaboration de Marx et d'Engels.
98. Esquisse (d. biI.), pp. 84-85, 88-89, 90-91, 94-95, 102-103, 104-105; MEW l, p. 517, I. 15;
p. 519, I. 12 et 24; p. 521, I. 15; p. 523, I. 37; p. 524, I. 18-19. - ArbeitskraCt figure parmi une srie
d'expressions apparentes: force productive de la terre [ProduktionskraCt der Erde] (p. 519, I. 2;
p. 520, I. 27), force productive en gnral [ProduktionskraCt berhaupt] (p. 516, I. 3,7, Il,26,
35; p. 517, I. 9; p. 519, I. 30), force productive de l'humanit [ProduktionskraCt der Menschheit]
306 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
(p. 520,1. 27-28), force des machines" [Maschinenkraft] (p. 519, 1. 28), capacit de production"
[Produktionsfahigkeit] (p. 511, 1. II, 14; p. 517,1. 17), force naturelle" [Naturkfraft] (p. 517,1. 16),
forces [Krafte] du travailleur tendues l'extrme"
(p. 516, 1. 28).
99. MEW 2, p. 539, I. 32, et p. 548, I. 4.
-
Le texte de ces discours a paru, en 1845, dans le
premier volume des Rheinische lahrbcher zur gesellschaftlichen Reform (Annales rhnanes pour
la rforme sociale).
100. L'idologie (1968), p. 61; (1976), p. 31; (bil.) pp. 102-103; MEW 3, p. 32.
-
L'Index des
matires des Marx-Engels Werke signale tort le terme dans le livre qu'Engels publia en 1845: La
situation de la classe laborieuse en Angleterre. Il ne se trouve pas dans les pages mentionnes, mais
seulement arbeitsfahig (apte au travail), Krafte der Arbveiter (forces des travailleurs) et Elementar-
krafte (forces lmentaires, c'est--dire les forces des lments de la nature) (cf. La situation,
pp. 120, 124; MEW 2, pp. 308, 311).
101. Cf. A. SMITH, Recherches..., pp. 87,88,89.
102. ENGELS, Esquisse, p. 89; MEW I, p. 519. Trad. modifie.
103. Dix occurrences sont signales par MEGA, II/l, Apparat, p. 1145. On se reportera
Manuscrits de 1857-1858, t. I, p. 285, I. 3; p. 447, I. 21; p. 449, I. 36-37; t. II, p. 39, I. 33-34; p. 76,
I. I et 9; p. 189, I. 2; p. 190, I. 6, Il; p. 262, I. 25;
-
Grundrisse, p. 251, I. 7; p. 408, I. 19-20; p.
410, I. 35-36; p. 445, I. 32; p. 479, I. 40;, p. 480, !. 3; p. 588, I. 31; p. 589, I. 32-33, 38; p. 660, !.
3-4.
-
MEGA II, III, p. 259,!. 7; II,112, p. 411, I. 19; p. 413,!. 24; p. 444, I. 32; p. 477, I. 6,13;
p. 577, !. 35; p. 578, I. 33, 38; p. 644, !. 28.
-
Toutes ces occurrences voisinent avec
Arbeitsvermiigen, et tantt au singulier tantt au pluriel, ce qui invalide l'hypothse de M. J.-P.
Lefebvre selon qui la notion de puissance explosera [...] en deux sens: celui de force (Kraft) et
celui de potentialit (Potenz)" [Dictionnaire critique du marxisme, p. 469, sub V Force(s)
productive(s)]. M. J.-P. Lefebvre (ibid.) tente galement de montrer qu'il faudrait distinguer, chez
Marx, le sens singulier de force" et le sens pluriel. Ces interprtations paraissent vaines au regard
des textes de Marx!
104. Le capital (trad. Lefebvre), p. 195; ES, t. I, p. 176; MEW23, p. 187; MEGA II/5, p. 125,
I. 33 et suiv.
-
Dans cet alina, Marx emploie le mot Arbeitsvermiigen, comme il le fait pour
traduire l'expression puissance de travail" de Sismondi, respectant les connotations du terme en
franais. En effet, l'affirmation de Rossi, il oppose celle de Sismondi: La puissance de travail
[...] n'est rien si elle n'est pas vendue" (ibid.). Comprenons: elle n'est rien d'autre qu'tre en
puissance.
105. Ibid.
106. Ce Dictionnaire, d M. Georges Thins et Mlle Agns Lempereur, a paru aux ditions
universitaires en 1972. L'article auquel nous nous rfrons se trouve p. 762, co!. A.
107. Op. cil., p. 466.
108. Encyclopaedia Universalis, vo!. 10, p. 579, co!. A.
109. Ibid., p. 579, col. A et col. B.
110. Philosophisches Worterbuch, t. 2, p. 978, co!. A.
III. Le capital, t. 4, p. 38; MEW 24, p. 42.
-
Marx poursuit: Mais les uns et les autres ne
le sont qu' l'tat virtuel [nur der Miiglichkeit nach] tant qu'ils se trouvent spars. Pour une
production quelconque, il faut leur combinaison. C'est la manire spciale d'oprer cette
combinaison qui distingue les diffrentes poques conomiques par lesquelles la structure sociale
est passe" (ibid.).
112. Op. cil., p. 579, col. B.
113. Le capital, t. I, p. 84; trad. Lefebvre, p. 49; MEW 23, pp. 57-58.
114. Gloses marginales au programme du parti ouvrier allemand", in Critique des
programmes de Gotha et d'Erfurt, p. 22, MEW 19, p. 15. Trad. modifie. (La note 2, p. 22 de
l'dition franaise, est introduite par l'diteur, M. Bottigelli. Elle renvoie aux lignes du Capital
cites dans la note prcdente).
115. Le capital, t. I, p. 55; trad. Lefebvre, p. 45; MEW 23, p. 54.
116. Le capital, t. 2, p. 186; trad. Lefebvre, p. 574; MEW 23, p. 535.
117. Ibid.
118. Ibid., t. 8, pp. 35 et suiv.; MEW 25, pp. 656 et suiv.
119. Ibid., p. 35, p. 656.
120. Ibid.
121. M. Henri Lefebvre n'a pas commis cette bvue... La mention de la nature vient en tte
de son numration: Les forces productives comprennent: la nature, la technique du travail et les
instruments, l'organisation et la division du travail" (Pour connatre la pense de Karl Marx, Paris,
Bordas, 1966, p. 137).
LA POSSIBILIT CONCRTE
307
122. Op. cit., pp. 37-38,55,96-97.
123. L'usage du singulier ou du pluriel ne modifie en rien l'analyse. M. J.-P. Lefebvre lui
attribue cependant une importance majeure; il y voit le signe d'une certaine ambigut et de
variations chez Marx (Les deux sens de forces productives, La Pense,
n
207,1979, pp. 126 et
suiv.; et Force(s) productive(s), Dictionnaire critique du marxisme, pp. 446 et suiv.)
124. Marx prvient, ds le dbut de la premire dition du Capital: Quand nous
emploierons par la suite le mot valeur>' sans autre prcision, il s'agira toujours de la valeur
d'change (MEGA II/5, p. 19, n. 9.
-
Cette note ne figure ni dans l'dition de J. Roy, ni dans
la quatrime dition allemande).
125. Thories, t. I, p. 92; MEW 26-1, pp. 64-65.
126. MEW 3, p. 29, note.
-
Ces lignes se trouvent reportes un tout autre endroit, par les
diverses traductions franaises [cf. L'idologie (1968), pp. 91-92; (bi!.) pp. 192-195; (1976), p. 60].
127. Cf. Le capital, t. 8, pp. 34-39; MEW25, pp. 656-661.
-
Ou encore: Dans l'agriculture
(comme dans l'industrie extractive) n'intervient pas uniquement la productivit sociale [du
travail], la productivit naturelle du travail intervient aussi qui dpend des conditions naturelles.
[Mais] il est possible que l'accroissement de la productivit sociale en agriculture compense
peine ou ne compense mme pas la diminution de la force naturelle [...] (.cause de l'puisement
du sol, par exemple) (ibid., p. 150; p. 775).
128. Thories, t. I, p. 457; MEW 26-1, p. 366.
129. Le capital, t. I, p. 56; trad. Lefebvre, p. 46; MEW 23, p. 55.
130. Le travail est la source de toute richesse. Nos facults sont notre seule richesse
originaire, notre travail produit toutes les autres, et tout travail bien dirig est productif
(Destutt de Tracy, 1826, p. 242 et 243, cit in Thories, t. I, p. 318; MEW 26.1, p. 251). Or, on
retrouve cette thse en tte du programme du parti ouvrier allemand de 1875: Le travail est la
source de toute richesse et de toute culture (cit in Critique du programme de Gotha et d'Erfurt,
p. 22; MEW 19, p. 15.
-
On se souvient que Marx critique vivement cette ide, cf. ci-dessus,
p. 293, n. 114).
131. Ainsi, Destutt de Tracy soutenait que ceux qui vivent de profits [les capitalistes
industrieux] alimentent tous les autres et seuls augmentent !a fortune publique et crent tous les
moyens de jouissance. [...] Eux seuls donnent une direction utile au travail actuel, en faisant usage
utile du travail accumul" (Thories, t. I, p. 318; MEW 26.1, p. 251).
132. Thories, t. II, p. 1l7; MEW 26-2, p. 104.
133. Cette ide est dveloppe, en particulier dans les Manuscrits de 1857-1858: C'est par ce
moyen seulement [l'action du capital] que l'application de la science et le plein dveloppement de
la force productive deviennent possibles (t. I, p. 218; Gr., p. 188. Soulign par nous). Ce n'est
ni le travail immdiat effectu par l'homme lui-mme, ni son temps de travail, mais l'appropria-
tion de sa force productive gnrale, sa comprhension et sa domination de la nature [...] qui
apparat comme le grand pilier fondamental de la production et de la richesse; une page plus
loin, Marx conclut: <de savoir social gnral, knowledge [connaissance], est devenu force
productive immdiate (ibid., t. II, pp. 193-194; pp. 593-594).
134. Un chapitre du Capital est spcialement consacr cette question: Nouvelles
recherches sur la production de la plus-value (Le capital, t. 2, pp. .183 et suiv.; trad. Lefebvre,
pp. 569 et suiv.; MEW 23, pp. 531 et suiv.), o Marx se demande s'il n'y a pas [...] une base
naturelle de la plus-value (ibid., p. 185; p. 573; p. 534). Il rpond que la grandeur du surtravail
variera, toutes autres circonstances restant les mmes, selon les conditions naturelles du travail, et,
surtout, selon la fertilit du sol (ibid., p. 187; p. 575; p. 536), mais que <da faveur des
circonstances naturelles fournit, si l'on veut, la possibilit, mais jamais la ralit du surtravail, ni,
consquemment, du produit net ou de la plus-value (ibid., p. 188; p. 576; p. 537). Par exemple,
la faveur de la nature , dans certaines les du Pacifique, peut limiter le travail ncessaire une
journe par semaine (ibid., pp. 188-189; p. 577; p. 538)!
135. Comme Sartre, M. Michel HENRYparle, son tour, des lois impassibles de la nature
(Karl Marx, Paris, Gallimard, 1976, t. II, p. 295). Le moins que
l'on
puisse dire est que Marx ne
dclare pas la nature impassible. Au contraire, elle est, pour lui, dans un devenir incessant.
M. Henry ne s'arrte gure sur le rle que Marx attribue aux forces naturelles dans la production
et, consquemment, dans l'histoire. Aprs avoir rappel qu'il ne fallait pas confondre les plans de
la valeur d'usage et de la valeur d'change, il crit que Marx est gnial pour avoir dit que la
production de valeur s'accomplit totalement, parfaitement, en l'absence du capital constant (ibid.,
soulign par nous). A notre avis, c'est l un contresens total: M. Henry dtourne de son sens la
remarque de Marx selon laquelle, dans l'tude de la production de la valeur, on peut poser le
capital constant comme = O. Cela ne saurait signifier qu'on pourrait produire sans moyens de
308 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
production! Ce contresens explique qu'a fortiori M. Henry fasse bon march des forces natu-
relles.
136. Le capital, t. 1, p. 62; trad. Lefebvre, pp. 53-54; MEW 23, p. 62. "L'habit est porte-
valeur (ibid., p. 66; p. 59; p. 66).
TROISIME PARTIE
LA POSSIBILIT RELLE
OU
LE MATRIALISME PRATIQUE
Chapitre 7
L'ACTIVIT
Au commencement tait l'action.
GOETHE
Tendances et dveloppement historiques reposent sur le progrs des
forces productives . Des forces ne font la preuve de leur ralit que par leur
extriorisation, dans une manifestation effective, c'est--dire dans des activits
et, chez l'homme, dans des pratiques . Le concept d'activit est central chez
Marx. Il est prsent dans celui de production, ou activit productive mat-
rielle, qui est la base de l'histoire humaine. Il est prsent galement dans celui
de pratique en gnral, ou de praxis I .
A l'encontre de lean-Paul Sartre et des marxistes, M. Claude Lvi-Strauss
s'effora de distinguer entre pratiques et praxis: <des pratiques, [...]ralits
discrtes, localises dans le temps et l'espace et distinctives de genres de vie et
de formes de civilisation, ne se confondent pas avec la praxis qui constitue
pour les sciences de l'homme une totalit fondamentale2. Par la fin de cette
remarque, M. Lvi-Strauss se rclamait malgr tout, quoique partiellement, du
point de vue de Marx qui, lui, ne distinguait pas entre pratique et praxis.
Pour la grande majorit des hommes, l'activit de production matrielle
a t, jusqu' notre poque, une contrainte: elle est de l'ordre de la ncessit
objective. Marx pensait qu'elle pouvait et devait de plus en plus laisser place
des activits libres , au riche dploiement de toutes les capacits humaines,
ce qui ne peut arriver qu'avec l'avnement d'un prochain rgne de la libert .
Il convient d'appeler cet avnement la possibilit relle par excellence. En tant
que pense de l'avnement de la libert pour tous les hommes, le marxisme est
fondamentalement une philosophie de la possibilit.
Par ce concept d'activit (production, pratiques en gnral, ou libre
dploiement de puissances naturelles), Marx se rattache autant Aristote qu'
Hegel ou Spinoza. Le rapport de Marx Aristote, par-del Hegel, nous
312 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
retiendra tout particulirement dans ce chapitre3, car il passe inaperu et a t
beaucoup sous-estim. C'est un point sensible pour apprcier les vritables
positions philosophiques de Marx.
L'activit humaine consciente n'a jou qu'un rle indirect dans le pass.
Dans le rgne de la libert , elle sera appele jouer un rle de premier plan.
Ce rgne de la libert reposera sur l'activit de production matrielle sans s'y
rduire: la libert, explique Marx, commence au-del du temps consacr la
production matrielle ncessaire.
La production matrielle est videmment une condition pralable, un pr-
suppos, pour la ralisation de la libert. Cette fin ne peut tre atteinte que
grce l'activit technique par laquelle l'homme renverse sa dpendance
l'gard de la nature en matrise de celle-ci.
L'panouissement des facults et de toutes les potentialits humaines n'est
possible que sur la base du dveloppement de toutes les forces productives. Or,
celui-ci a lieu dans des conditions sociales donnes qui constituent une barrire
ce dveloppement mme.
L'existence des classes est l'obstacle majeur qui s'oppose l'avnement du
rgne de la libert, car jusqu'ici seuls certains hommes ou certaines classes
furent libres. La division de la socit en classes antagonistes d'une part, le
dveloppement des techniques productives d'autre part, provoquent des crises
qui ne trouvent gnralement leur solution que dans des rvolutions plus ou
moins violentes.
La libert pour tous les hommes ne se ralise que comme mouvement de
libration des classes exploites et opprimes, dans des luttes et, au besoin, des
mouvements rvolutionnaires dirigs contre les classes dominantes.
C'est de la conception marxienne de l'activit pratique, des techniques
productives, des crises rvolutionnaires et de l'accomplissement de la libert,
qu'il sera question dans cette troisime partie.
1. Le marxisme en tant que philosophie de r activit
Activit, production, praxis: laquelle de ces trois catgories est la plus
fondamentale? Laquelle sert de matrice aux deux autres?
Les marxistes italiens, Gramsci en tte, ont propos de considrer la
pense de Marx comme une philosophie de la praxis 4. Depuis une dcennie,
des commentateurs ont insist sur l'importance de la catgorie d'activit chez
Marx et dcouvrent chez lui une philosophie de l'activit5 .
Il est vrai que cette catgorie est omniprsente dans les uvres de Marx.
La nature et l'homme sont essentiellement actifs. Tous les agents naturels
manifestent un pouvoir de transformations continuel: partout des tres et des
forces naissent, se dveloppent, et s'affrontent en des mtamorphoses et des
cycles toujours renouvels. La nature offre le spectacle d'un mouvement
LA POSSIBILIT RELLE
313
perptuel d'apparitions et de disparitions. L'histoire, faite par les hommes,
prsente le mme tableau. Le changement est incessant.
Les diverses sciences s'appliquent connatre et comprendre ce devenir et
ses modalits. Elles dpassent beaucoup ce que peuvent en saisir la perception
immdiate ou la connaissance commune. Dans sa thorie de la connaissance,
Marx lie nanmoins la thorie la pratique, car c'est dans la pratique que
l'homme a faire la preuve de la vrit, c'est--dire de la ralit [Wirklichkeit]
et de la puissance [Macht] de sa pense6.
L'activit humaine se distingue de l'activit gnrale de la nature. Elle se
partage en divers type de pratiques: pratiques productives (matrielles) ou
thoriques, artistiques ou politiques, scientifiques ou religieuses, qui s'autono~
misent, mais s'influencent aussi les unes les autres. L'activit productive se
scinde elle-mme et revt diverses formes selon les branches.de la production.
Marx subsume-t-il toutes les activits humaines sous le concept de
praxis ou de pratique? Le terme de praxis n'est-il pas trop limit? Ne
convient-il pas seulement pour caractriser les activits humaines . Inverse-
ment, tant plus gnral puisqu'il s'applique aux agents naturels, le concept
d' activit n'a-t-il pas le dfaut d'tre plus abstrait et plus indtermin?
Quel est le type d'activit qui sert de modle pour penser les autres? Doit-
on penser l'activit en gnral partir de la pratique de production matrielle,
ou, au contraire, doit-on penser la production partir du concept gnral
d'activit? Marx ne voit-il pas dans le travail, non seulement une activit vitale,
mais dans la force de travail en acte, dans l'acte de production, des mta-
morphoses penses sur le modle du mtabolisme des tres vivants? Or celui-
ci renvoie aux processus chimiques et l'nergie des lments naturels. Si Marx
pense toute nergie potentielle l'aide du concept aristotlicien de ouval-U, ne
pense-t-il pas toute activit l'aide du concept aristotlicien d'vEPYEta?
Reprochant aux matrialistes de n'avoir pas fait de l'activit le concept
central de leur philosophie, reprend-il simplement ce concept aux grands
idalistes allemands qui y voyaient essentiellement une activit de la
conscience et de la pense, ou bien n'est-ce pas plutt au grand raliste de
l'Antiquit, Aristote, qu'il l'emprunte? Nous sommes ainsi amen nous
poser la question des rapports de Marx Aristote.
Marx s'tant essentiellement consacr l'tude des processus conomi-
ques et de l'activit de production matrielle, il semblerait plus simple de s'en
tenir au concept de production ou d'activit productive. Mais, Marx ne
part-il pas des concepts d'activit naturelle et de vie? C'est l'un de ces
prsupposs philosophiques gnraux qui sont ncessaires pour faire
l'analyse du travail en tant qu'activit productive. Le travail est activit ",
vie , cration ", souligne-t-il constamment.
Cela dcoule d'ailleurs du fait que le concept de force productive est plus
large que celui de force productive humaine, puisqu'il englobe les forces
naturelles. Marx n'isole pas l'homme de la nature: l'homme est d'abord un
tre naturel vivant. Pour lui, les racines de toute activit humaine se trouvent
314 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
dans la vie: la production prsuppose des tres vivants; l'existence d'tres
humains vivants est la premire prsupposition de toute histoire.
Il faut donc ranger les catgories de l'activit dans l'ordre suivant: tout
d'abord l'activit en gnral en tant que telle, c'est--dire la nature avec son
devenir. La vie vient en second lieu, forme de cette activit naturelle, qui
apparat dans des tres organiss. Des rapports des tres vivants entre eux et
avec leur milieu rsultent l'volution des espces et l'apparition de l'homme.
Vient, en troisime lieu, la pratique humaine au sens le plus large. Parmi ses
diverses formes, la plus caractristique est le travail, activit spcifique de
production matrielle, dcisive pour l'avnement humain dans le pass et qui
le restera pour l'avenir.
On nous objectera que Marx ne s'attarde pas examiner des questions
aussi scolastiques: tantt le concept d' activit lui servirait de prsupposi-
tion gnrale pour penser le travail productif, tantt c'est celui de produc-
tion ou de travail humain qui lui servirait pour penser tous les types
d'activit 7.
Nous pouvons pourtant faire remarquer qu'il ne se contente pas d'analy-
ser l'acte de production matrielle, mais exprime des vues philosophiques
gnrales qui impliquent une philosophie de la nature et de l'tre. Dans cette
mesure, la dfinition du marxisme comme philosophie de la praxis 8 ne
rsoud pas le problme que nous discutons: elle conduit plutt le poser.
Cette dnomination de philosophie de la praxis , choisie cause de ses
connotations dialectiques et historiques concrtes 9, convient mieux, certains
gards, que matrialisme dialectique ou que matrialisme historique .
Mais il n'est pas facile de baptiser la pense de Marx d'un mot.
Cependant, il a une philosophie qu'il ne cache pas: le matrialisme, et une
mthode: la dialectique, qu'il conoit, dans sa thorie raliste de la connais-
sance, comme reflet et expression d'une dialectique relle et objective. La
difficult vient de ce qu'il n'a pas fait uvre de philosophe 10.Mais, au sujet de
son matrialisme , il avertit: c'est un matrialisme nouveau , un matria-
lisme pratique , c'est--dire un matrialisme pour lequel l'activit est un
concept essentiel. En dialecticien consomm ayant parfaitement assimil la
magistrale leon de Hegel, Marx a constamment critiqu ceux qui lvent une
notion quelconque au rang de catgorie gnrale, dont ils veulent tirer les
catgories particulires et parfois mme la ralit empirique. Toutefois, se
passer de catgories gnrales est impossible, ainsi, de celle de pratique (ou
praxis ).
Pourtant, notre avis, cette notion gnrale ne convient pas pour
caractriser la ralit dans sa totalit. On ne saurait parler d'une praxis de la
nature! L'expression philosophie de la praxis prsente cet inconvnient
majeur de ne pas permettre de penser la philosophie naturelle de Marx. Or,
nous l'avons vu, l'histoire renvoie la nature, repose sur elle, se noue et renoue
elle. C'est pourquoi, parler, un moment ou un autre, du marxisme
comme d'une philosophie de l'activit est invitable.
LA POSSIBILIT RELLE 315
Que dit Marx de l'activit? Il ne la dissocie pas de l'tre dont elle est
l'activit. De plus, si toute activit implique un agent qui l'exerce, elle suppose
aussi un objet. Alors qu'il procde l'analyse du travail en tant qu'activit
productive matrielle, Marx note, dans une remarque lapidaire: L'activit qui
n'a pas d'objet n'est rien Il.
Toute activit implique donc, non seulement un agent, mais aussi un objet
auquel elle s'applique ou qu'elle prend pour fin, ft-ce l'agent lui-mme. Dans
les Manuscrits de 1844, Marx soulignait que seul un tre lui-mme rel,
objectif, donc objet, peut avoir une action sur des choses relles:
L'homme est immdiatement tre de la nature. En qualit d'tre
naturel, et d'tre naturel vivant, il est d'une part pourvu deforees naturelles,
deforees vitales; il est un tre naturel actif. [...] Dire que l'homme est un tre
en chair et en os, dou de forces naturelles, vivant, rel, sensible, objectif,
c'est dire qu'il a pour objet de son tre, de la manifestation de sa vie, des
objets rels, sensibles, et qu'il ne peut manifester sa vie qu' l'aide d'objets
rels, sensibles. Etre objectif, naturel, sensible, c'est la mme chose qu'avoir
en dehors de soi objet, nature, sens ou qu'tre soi-mme objet, nature, sens
pour un tiers. [...J
-
Un tre qui n'a pas sa nature en dehors de lui n'est pas
un tre naturel, il ne participe pas l'tre de la nature. Un tre qui n'a aucun
objet en dehors de lui n'est pas un tre objectif. Un tre qui n'est pas lui-
mme objet pour un troisime tre n'a aucun tre pour objet, c'est--dire ne
se comporte pas de manire objective, son tre n'est pas objectif. - Un tre
non-objectif est un non-tre 12.
Il est clair qu'il s'agit, pour Marx, d'une dialectique o activit et tre
s'impliquent et passent l'un en l'autre. L'activit ne peut exister que dans un
tre, appartenir un tre, et tout tre rel est actif.
Si la page cite l'instant insiste sur le caractre objectif et naturel de
l'tre, c'est que Marx y critique la dialectique hglienne de la conscience de
soi, rsume au dbut du dernier chapitre de la Phnomnologie de l'esprit 13.
Selon Hegel, c'est la conscience de soi qui pose l'objet par son processus
d'auto-alination. Marx lui oppose un naturalisme. Toutefois, il n'en-
tend pas abandonner la catgorie d'activit, ni la dialectique de l'tre et de
l'activit. Cela est capital dans sa philosophie gnrale: cette dialectique se
retrouve partout chez lui.
Ds lors, certains ne retiennent plus que le moment de la subjectivit.
Nagure, M. Michel Henry a donn du concept d'activit une interprtation
subjectiviste toute personnelle 14.Voici comment il a propos de compren-
dre cette notion chez Marx:
Il ne faut pas dire seulement que nous pouvons agir sans avoir
l'intuition de ce que nous faisons, mais que notre action est ncessairement
trangre toute intuition, qu'elle n'est possible que pour autant qu'elle n'est
pas l'intuition, qu'elle n'est ni l'intuition d'elle-mme, ni l'intuition d'un
objet quelconque. Ds qu'elle serait intuition en effet, l'action serait regard,
voir, contemplation, elle ne serait plus l'action. Ainsi nous sommes apport
316 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
devant [sic] l'exclusion rciproque de l'essence de la theoria et de l'essence de
la praxis 15.
La prmisse de ce raisonnement - l'homme agit sans voir ce qu'il fait
- fait violence la pense marxienne. M. Henry pensait justifier cette
affirmation en se rfrant la thorie marxienne de l'idologie comme
fausse conscience. Mais une conscience fausse ou trompe n'est pas une
absence de conscience. Marx n'a jamais imagin qu'on puisse avancer une telle
thse: il soutient tout simplement qu'il y a des illusions de la conscience, et non
pas que pour agir il ne faudrait aucune intuition, aucun voir !
La praxis pure, exclusive de tout voir, se trouve peut-tre dans les
habitudes, les instincts, les rflexes et comportements du mme genre; nous
pourrions voquer nouveau ici le somnambulisme. Assurment, Marx ne
. tenait pas ce genre de pratiques pour caractristiques de l'activit humaine!
L'inconscience avec laquelle l'homme participe au processus historique est
tout autre: ce n'est qu'une demi-inconscience, une inconscience relative, une
alination de la conscience 16!
L'action telle que la dcrit M. Henry est coupe de toute conscience, de
toute fin poursuivie avec quelque ide ou reprsentation d'un but. Mme
l'activit des organes des sens semble exclue de l'activit pure au sens de
M. Henry. En excluant brutalement l'intuition et l'action l'une de l'autre,
M. Henry retrouve le procd favori de la mtaphysique qui spare et oppose
des ralits inconciliables ses yeux.
Ce ne sont l, ni la dmarche, ni les ides de Marx, qui un tel dualisme
est tout fait tranger. Certes, il critique l'idalisme hglien, mais, comme
Hegel, il lie tre et activit: il n'instaure pas entre eux de sparation
absolue! La manire dont il dfinit l'homme comme tre de la nature
montre qu'il repousse tout dualisme mtaphysique. Le primat de la pratique
n'est pas exclusif de la thorie: Le dbat sur la ralit ou l'irralit de la
pense - d'une pense [qui serait) isole de la pratique - est une question
purement scolastique 17.
Marx dveloppe donc une philosophie o le concept d'activit joue un
rle minent. C'est ce que montre pertinemment l'tude de M. C. C. Gould qui
prsente la pense de Marx sous l'angle d'une ontologie du travail d'aprs
laquelle l'homme se cre librement lui-mme grce son activit labo-
rieuse 18.
En 1857, dans les Grundrisse, la conception dialectique de l'tre et de
l'activit est au premier plan de toutes les analyses conomiques et fonde la
critique de l'conomie politique. Il faudrait citer toutes les analyses des
rapports du travail et du capital, du travail et des moyens de travail, de la
marchandise et de l'argent. Donnons un exemple o Marx dcrit l'acte de
production en tant que consommation productive:
Le travail n'est pas seulement consomm, mais il passe en mme temps
LA POSSIBILIT RELLE
317
de la forme [Form] d'activit celle d'objet, de repos, o il est fix,
matrialis [materialisiert]; en tant que changement [Veriinderung] de l'objet,
il change sa propre configuration [Gestalt] et, d'activit, devient tre [wird
aus Tiitigkeit Sein]. Le terme du processus est le produit, o la matire
premire apparat combine [verbunden] au travail, et o l'instrument de
travail, de simple virtualit [Moglichkeit] s'est transpos pareillement en
ralit [Wirklichkeit], du fait qu'il est devenu le conducteur rel [wirklichen
Leiter] du travail 19.
La thse des Manuscrits de 1844 selon laquelle l'activit devient tre se
retrouve intgralement ici.
Dix ans plus tard, dans Le capital, c'est la mme dialectique qui est
prsente dans l'analyse du rapport du travail au produit (exemple du tissu).
Elle sous-tend la conception des rapports entre l'homme et la nature:
Il [l'homme] se prsente face la matire naturelle [Naturstoff] comme
une puissance naturelle [Naturmacht] lui-mme. Il met en mouvement les
forces naturelles de sa personne physique, ses bras et ses jambes, sa tte et ses
mains pour s'approprier la matire naturelle sous une forme utile sa propre
vie. Mais en agissant sur la nature extrieure et en la changeant [veriindern]
par ce mouvement, il change aussi sa propre nature 20.
Cette dialectique de l'objectivation du sujet humain dans des produits o
il ne se reconnat pas provoque des phnomnes d'alination, en particulier la
ftichisation des marchandises dans le mode de production capitaliste et la
rification du capital qui, fondamentalement, n'est qu'un rapport social. Cette
rification consiste prendre les rapports sociaux pour des choses. Le
capital devient objet. Mais, en ralit, il n'est rien en soi; il n'est que
l'objectivation du travail, sa matrialisation, sa cristallisation (termes
employs par Marx). L'activit, c'est--dire le travail vivant, concret, rel,
devient tre, c'est--dire un produit, une chose inerte. Marx dit qu'elle
s'teint dans son rsultat21.
Bien plus, l'homme lui-mme, considr comme pure existence [Dasein]
de force de travail, est un objet naturel, une chose, certes vivante et consciente
de soi, mais une chose, et le travail lui-mme est l'extriorisation rifie
[dingliche Ausserung] de cette force [Kraft]22.
On a propos les appellations les plus diverses pour dsigner au mieux la
doctrine de Marx: matrialisme dialectique, philosophie de la praxis,
science de l'histoire, ontologie de l'activit, etc., furent longuement,
voire prement, discuts.
Quant lui, Marx ne privilgiait pas plus activit [Tiitigkeit], que
action,> [Tat], ou pratique [Praxis], ni davantage tre [Sein], que
chose [Ding] ou objet [Gegenstand, Objekt]. Il n'avait pas la religion du
mot. Dans les Thses sur Feuerbach, Tiitigkeit et Praxis sont pratiquement
synonymes 23.
Bien que l'activit productive matrielle soit l'objet quasi-exclusif des
318 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
analyses de Marx; elle n'est pas, pour lui, le seul type d'activit. Qui
soutiendrait qu'il tenait l'activit politique pour secondaire? Quand il met
le travail productif au centre de ses analyses, il ne veut en aucune faon
minimiser les autres modes d'activit humaine, les activit thoriques
(science), artistiques, religieuses, etc., ni non plus les activits animales ou les
modes d'activit cosmique de tous les tres ou lments naturels (activit
volcanique, lectrique, chimique, solaire, etc.).
Concentrant sa rflexion sur l'histoire des hommes, il prend nanmoins
en considration toutes les formes d'activit; il souligne leurs caractres
spcifiques; mais, il est parfois difficile de comprendre ce qu'il veut dire
exactement, tant ses indications sont laconiques. A quoi pense-t-il, par
exemple, lorsqu'il ajoute, aprs avoir affirm qu'une activit qui n'a pas
d'objet n'est rien: ou [elle] n'est tout au plus qu'une activit mentale; or ici
il n'est pas question de celle-ci 24? S'agit-il de l'activit thorique de connais-
sance par opposition l'activit pratique, ou bien de l'activit de la conscience
en gnral, c'est--dire de la facult de se reprsenter toutes sortes de choses
imaginaires, fantastiques, utopiques ou illusoires (uvres littraires, reprsen-
tations religieuses, etc.)? Il faut vraisemblablement l'entendre en ce sens large.
Cela dit, comment Marx conoit-il la pratique humaine en gnral?
Est-ce la production matrielle qui lui servirait de modle? Celle-ci, dans Le
capital est dcrite comme une fabrication, un faire, o le sujet imprime, de
l'extrieur, une forme un objet. Aurait-il abandonn la dialectique de
l'objectivation d'un sujet et de la subjectivation de la chose qu'on trouve au
premier plan des uvres dites de jeunesse, comme les Manuscrits de 1844, et
les Thses sur Feuerbach, dialectique qui exerce toujours une influence
profonde dans les Grundrisse?
Dans les Thses sur Feuerbach, Marx se plaint que le matrialisme
jusqu'ici n'ait pas saisi <d'objet extrieur, la ralit, le sensible, [...] en tant
qu'activit [Tatigkeit] humaine sensible, en tant que pratique [Praxis], de faon
subjective. C'est pourquoi [...] le ct actif [die tatige Seite] fut dvelopp de
faon abstraite par l'idalisme, qui, naturellement, ne connat pas l'activit
relle, sensible, comme telle25 .
Comment comprendre ces affirmations denses et nigmatiques? Peut-on
les accorder avec celles du Capital o la caractristique essentielle de l'activit
humaine est sa finalit consciente? Dans le travail, le processus de fabrication
est adapt un but prconu. L'homme se fait l'avance une reprsentation
du produit ouvrag obtenir26.
Il semble plus facile de runir dans un mme genre l'activit de produc-
tion matrielle et l'action politique (celle-ci poursuivant galement une fin
consciente pralablement pense et voulue), que de ramener le travail et
1'activit relle sensible, dont nous entretient la premire Thse sur Feuer-
bach, sous une seule et mme catgorie.
L'action politique se propose un but, par exemple une socit sans classes.
La conscience de ce but implique celle des moyens mettre en uvre. En ce
LA POSSIBILIT RELLE 319
sens, la pratique humaine est finalise d'une manire consciente. Pourtant elle
s'illusionne souvent sur les causes et sur les rsultats effectivement atteints, qui
diffrent gnralement de ceux qui taient viss, ce qui, selon Marx, a t la
rgle dans l'histoire jusqu'ici.
De mme, le travail, change entre l'homme et la nature, a pour caractre
propre d'tre une opration prmdite:
Le rsultat auquel aboutit le processus de travail tait au commence-
ment dj reprsent dans la conscience du travailleur, donc dj prsent
idelle ment. Non qu'il [le travail] effectue simplement une modification dans
la forme [eine Forrnveranderung] de la ralit naturelle: il y ralise [verwir-
kJicht] en mme temps son propre but, qu'il connat [...] 27.
Est-ce dire qu'au commencement serait, non pas <d'action [die Tat],
ou l'activit [Tiitigkeit], mais... l'ide? A cette interprtation idaliste des
rapports de la conscience et de l'action 28,il faut opposer que ce qui pousse au
travail, ce sont des besoins, et que, d'autre part, l'ide finale prsuppose au
dbut du travail ne modifie pas la nature de l'activit de travail qui reste un
changement [Anderung]. La ralit naturelle est change en ralit humani-
se: l'homme humanise la nature. Mais ce faisant, il modifie sa propre nature,
car il se change, se transforme lui-mme plus ou moins volontairement par
sa propre activit29.
C'est la mme objectivation, et la mme auto-transformation, que Marx
dcrit dans le sensible en tant qu'activit relle sensible de la premire Thse
sur Feuerbach. L'activit de perception de la chose sensible labore l'objet
des sens, qui, de plus, est gnralement une chose travaille (le paysage a t
model par l'homme, etc.); le sujet percevant s'duque lui-mme dans cette
activit de perception30. Cette transformation du sujet est le rsultat d'une
activit humaine, le produit d'une histoire.
Qu'il s'agisse de l'activit matrielle finalise, ou de l'acte de perception
sensible, dans les deux cas, c'est un processus dialectique de transformation
rciproque qui touche autant le sujet que l'objet.
Cela caractrise non seulement toute activit humaine , mais aussi
toute activit en gnral. Car, selon Marx, dans la nature aussi les
changements sont des processus o les choses, en interagissant les unes sur les
autres, se modifient mutuellement. En un certain sens, on peut donc dire que,
dans ces processus, la nature se change elle-mme.
Malgr la diffrence essentielle entre le travail ou activit productive
matrielle et les autres pratiques humaines en gnral (idelles ou sensibles), il
s'agit toujours de processus o tre et activit, activit et objet, sont
dialectiquement unis, ce qui justifie l'usage du terme grec de praxis (npl)
pour dsigner toute activit humaine, les mots Tiitigkeit, wirken (agir) et
Wirklichkeit (ralit effective) convenant, plus largement, pour la vie en
gnral, et pour tout processus naturel.
320 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Le terme de praxis (rcpt) vient des Grecs, en particulier d'Aristote qui
le faisait synonyme de vie31, dsignant par l avant tout l'activit humaine
thique et politique. Mais, d'Aristote Hegel puis Marx, le concept de
praxis n'a-t-il pas compltement chang de sens?
En effet, Aristote distinguait deux espces d'activit: la rcpt et la
rcoillcrt (posis):
On observe, en fait, une certaine diffrence entre les fins: les unes
consistent dans des activits, et les autres dans certaines uvres, distinctes
des activits elles-mmes 32.
Ainsi, la vision est une rcpt; par contre la fabrication d'un bateau est
une rcoillcrt. Dans la praxis, la fin et l'acte s'identifient, ce qui, selon le
philosophe grec, est le propre de l'action thique et politique du citoyen ou
homme libre , au sens grec du terme.
Cette distinction classique s'efface compltement dans le concept marxien
de la praxis qui dsigne l'activit humaine fabricatrice d'un objet extrieur au
travailleur. Alors qu'Aristote nommait rcoillcrt la fabrication - activit o
agent et produit diffrent -, Marx l'appelle praxis. Il y voit mme une forme
fondamentale de la praxis, celle dont toutes les autres dpendent et auxquelles
elle imprime son cachet.
Ainsi, la pratique au sens de Marx recouvre et la praxis et la posis
aristotliciennes, comme dj chez Hegel qui est l'intermdiaire entre Aristote
et Marx.
Dans l'activit pratique par laquelle le travailleur transforme l'objet, il y
a bien davantage, pour Marx; que la fabrication artificielle. L'homme
s'extriorise dans ses productions, il s'y objective. Comme pour Hegel,
l'objectivation est en mme temps affirmation de soi. Le sujet, en s'extriori-
sant dans l'objet, y dcouvre ses pouvoirs. L'objet lui rvle ce qu'il est. C'est
pourquoi, toutes les fois o l'objet (le produit) lui chappe, il ne s'y reconnat
pas: cette objectivation est une alination .
Chez Hegel, puis chez Marx, la pratique n'a pas seulement le sens de la
rcoillcrt aristotlicienne33. Tout produit de l'activit humaine est la ralisa-
tion ou la ralit de l'homme .
Comme le dit Marx, l'homme ne se perd pas dans son objet la seule
condition que celui-ci devienne pour lui objet humain ou homme objectif. Cela
n'est possible que lorsque l'objet devient pour lui un objet social, que s'il
devient lui-mme pour soi un tre social, comme la socit devient pour lui
tre dans cet objet34 .
Ds lors, d'Aristote Marx, le renversement du sens de posis en celui de
praxis est plus apparent que rel. Marx, comme Hegel, conserve la praxis
aristotlicienne dans la dialectique du sujet et de l'objet. Cette dialectique
caractrise l'activit productive ainsi que toute activit pratique. Hegel avait
dj opr la synthse de ce que le philosophe grec dissociait en posis et
LA POSSIBILIT RELLE 321
praxis: il l'avait dcrite comme le propre de l'Esprit devenant conscient de soi
aprs s'tre objectiv, c'est--dire alin. Or, pour Marx, toute objectivation
n'est pas alination: c'est seulement dans certaines conditions sociales que
celle-ci envahit le champ des pratiques humaines, commencer par le
travaiP5.
Dans leur activit sociale et politique, un individu ou une classe donns se
prennent eux-mmes pour but final . C'est pourquoi Marx les appelle
parfois l'individu ou la classe pour soi>,. Le but de l'action de la classe
ouvrire, c'est de se librer des alinations sociales et de toute servitude
naturelle; ce qu'elle vise et poursuit, c'est sa libert.
Dans tous les domaines de son activit, l'homme non-alin se prend lui-
mme pour fin. Marx parle alors de <<libreactivit des travailleurs associs .
Son ide matresse est que lorsque les hommes auront la matrise de leur
ation, leur activit et leur but ne feront plus qu'un, ce qui ne peut se raliser
que dans une socit sans classes o les travailleurs ne produiront plus en vue
d'un but fix par d'autres qu'eux-mmes.
Marx conserve donc aux pratiques humaines, malgr les alinations
socio-historiques qui les ont greves jusqu'ici, le sens qu'Aristote donnait la
praxis: la praxis vritable, c'est l'panouissement de toutes les facults
humaines, o, comme pour Aristote, l'activit et le but ne diffrent plus.
Toute l'histoire, pour Marx, est le processus de l'auto-production de
l'homme partir de conditions donnes, ces conditions tant elles-mmes
progressivement transformes de naturelles en historiques.
Tant que le travail est alin (esclavage, servage, salariat), pour les
hommes exploits, le but personnel de leur activit est dissoci du produit
objectif de cette activit. C'est dans certaines conditions sociales, c'est--dire
dans des rapports sociaux donns, que le travail est rduit n'tre qu'une
posis (et une posis dont le producteur immdiat n'a pas la matrise), alors
qu'il devrait tre, en mme temps, une praxis:
La manifestation de la force de travail, le travail, est l'activit vitale
propre l'ouvrier, sa faon lui de manifester sa vie. Et c'est cette activit
vitale qu'il vend un tiers pour s'assurer les moyens de subsistance nces-
saires. Il travaille pour vivre. Pour lui-mme le travail n'est pas une partie de
sa vie, il est plutt un sacrifice de sa vie. C'est une marchandise qu'il a
adjuge un tiers. C'est pourquoi le produit de son activit n'est pas le but
de son activit. Ce qu'il produit pour lui-mme ce n'est pas la soie qu'il tisse,
ce n'est pas l'or qu'il extrait de la mine, ce n'est pas le palais qu'il btit. Ce
qu'il produit pour lui-mme, c'est le salaire [...] La vie commence pour lui o
cesse cette activit 36.
Ce qui est ainsi dcrit, c'est l'activit aline. L'activit productive qui ne
serait pas aline, Marx l'entend au sens de praxis en grec37, car, pour le
citoyen libre de la cit antique, la praxis tait la ralisation de soi, ce
qu'expriment les philosophies de Platon, puis d'Aristote.
322 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Le but de la praxis pour les hommes libres au sens d'Aristote est
comparable ce qu'il est chez Marx. En effet, le travailleur d'une socit sans
classes a pour but la ralisation de soi en tant qu'individu, le libre panouis-
sement de ses facults humaines par la matrise collective de la nature et des
rapports sociaux. L'objectif des citoyens libres, au sens athnien, c'est--dire
dcidant dmocratiquement en assemble politique des affaires de la cit, est
analogue celui des travailleurs librement associs dcidant de la production
collective dans la socit sans classes38. Dans une telle socit, les individus
libres, non alins, ce sont tous les travailleurs dcidant, en connaissance de
cause, de l'organisation sociale de la production matrielle.
Malgr la diffrence des contextes dans lesquels le concept de praxis est
employ par Aristote et par Marx, on voit que son sens aristotlicien est
prserv. Si l'on ne peut pas dire que Marx, dans l'analyse dialectique de
l'activit productive matrielle, reprenne purement et simplement le concept
de pratique aux anciens, par contre, tout comme chez Hegel, s'agissant de la
pratique en gnral, son origine aristotlicienne est patente.
S'il y a une certaine modration dans l'emploi des catgories philosophi-
ques hgliennes dans Le capital, modration d'ailleurs trs relative, ne
serait-ce pas que Marx use davantage que Hegel d'un fond philosophique de
cartgories et de thses gnrales venant directement d'Aristote?
Ainsi s'expliquerait le fait que Marx pensait la dialectique de l'activit et
de son objet plutt l'aide des concepts aristotliciens de puissance et d'acte,
qu' l'aide de la dialectique spculative de l'Ide et de l'objectivation de la
conscience de soi de Hegel. La question se fait insistante. En effet, quand Marx
donne une rfrence philosophique, outre les catgories hgliennes, ce sont
celles d'Aristote qui lui viennent! N'est-ce pas conscient et voulu?
Si, propos de la possibilit, en particulier dans la manire de concevoir
les forces productives et les possibilits historiques qu'elles ouvrent, il se fonde
continuellement sur la fameuse doctrine aristotlicienne de l'acte et de la
puissance, doctrine qui est un moyen conceptuel de penser le devenir et le
changement en gnral, n'est-ce pas parce que sa pense emprunte dlibr-
ment au grand philosophe grec des thses qu'il transpose presque sans
modification et qu'il intgre sa propre philosophie matrialiste? Tout nous
pousse donc tudier pour lui-mme le rapport de Marx Aristote, seul
moyen qui permette de fonder une rponse cette question.
2. L'apprciation d'Aristote par Marx
Marx ne recourt pas seulement aux deux catgories de puissance pour
dsigner les forces productives, et d' acte pour dsigner l'activit, il use de
nombreuses autres catgories aristotliciennes: contenu (ou matire) et forme,
substance et accident, universel et singulier, essence et diffrence spcifique,
ncessit et contingence, etc. 39.
LA POSSIBILIT RELLE
323
L'hritage hglien de Marx a t souvent soulign, juste titre. Il fut
aussi parfois vivement contest. En tout cas, il a t beaucoup tudi. Par
contre, l'hritage aristotlicien est rest dans l'ombre et est gnralement
mconnu. Les commentateurs l'ont souvent nglig, les historiens de la pense
de Marx l'estimant insignifiant et sans importance vritable: lorsqu'on
numre les sources du marxisme, on ne songe pas mentionner Aristote!
Le faire peut paratre bizarre et mme incongru.
Ce qui complique la recherche - et cela a sans doute empch longtemps
de l'entreprendre -, c'est que Hegel avait intgr de nombreuses vues
philosophiques importantes du Stagirite dans son systme. Il est donc difficile
de dmler la part de l'influence indirecte et celle de l'influence directe de la
philosophie aristotlicienne sur Marx. Une bonne part de notre dmonstration
sera d'abord consacre tablir que Marx a eu un contact troit avec la pense
du Stagirite dans de nombreux domaines.
Nous nous demanderons si l'influence de Hegel sur Marx n'a pas eu une
rivale dans celle d'Aristote: malgr l'tendue de l'hritage hglien recueilli
par Marx, certaines de ses options philosophiques fondamentales ne
devraient-elles pas plus Aristote qu' Hegellui-rnme? Ainsi, lorsqu'il dirige
sa critique contre les philosophes spculatifs en gnral et contre Hegel en
particulier, Marx ne s'inspire-t-il pas de la critique anti-platonicienne d'Aris-
tote?
Pour le dire d'un mot, notre thse sera que, l'encontre de l'idalisme en
gnral, y compris l'idalisme absolu de Hegel, Marx adopte un ralisme et
une dmarche critique dont Aristote lui fournissait les modles. Or, pour les
raisons dites l'instant, il est difficile de le prouver directement. Nous
effectuerons donc un long dtour avant d'en arriver des arguments plus
dcisifs lors de notre examen de la critique marxienne du chapitre terminal de
la Phnomnologie de l'esprit.
Les liens qui rattachent la pense marxienne l'aristotlisme authenti-
que40 sont plus profonds et plus difficiles saisir que de simples emprunts
terminologiques. Cette question n'a gure t aborde; elle ne l'a t que
rcemment, et, de plus, dans des perspectives soit trs gnrales, soit, au
contraire, trs particulires et spcialises41.
C'est un fait que l'inventaire des emprunts de Marx Aristote, ou mme
simplement des mentions d'Aristote dans l'uvre de Marx, n'a pas t
vritablement fait. Nous commencerons par l, pour en venir ensuite aux
questions essentielles qui prendront appui sur ce qui ce sera dgag de cette
enqute pralable, car le rapport de Marx Aristote est lucider.
Nous distinguerons: a) le jugement que Marx porte sur Aristote, sur sa
place chez les Anciens et dans l'histoire de la pense en gnral; b) l'utilisation
de l'uvre d'Aristote par Marx: ce qu'il en retient et la manire dont il le fait;
c) le sens de la philosophie d'Aristote pour Marx.
Nous constaterons qu'tant tudiant, Marx s'est intress Aristote avec
prdilection. En cherchant d'o provient cet intrt du jeune Marx, nous
324 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
dcouvrirons un aspect peu connu du dveloppement de la pense philosophi-
que allemande aprs la mort de Hegel. L'interprtation d'Aristote tait alors
devenue un enjeu capital o le jeune Marx s'apprtait jouer un rle: mais il
dut rapidement abandonner tout espoir de jamais faire une .carrire philoso-
phique, et mme, bientt, de pouvoir s'exprimer d'une manire que1conque en
Allemagne. Son orientation premire vers la philosophie antique jette une vive
lumire sur bien des aspects de sa pense ultrieure. En retour, l'Aristote que
nous dcouvrirons travers Marx reste d'une tonnante vigueur; c'est un
rajeunissement de la figure du Stagirite qui sortira de cette confrontation. On
comprendra alors quel point l'influence d'Aristote sur Marx fut profonde,
durable et trs importante.
Abordons notre premier point. Le jugement que Marx porte sur Aristote
est plus que positif: c'est un jugement trs logieux, qui dpasse de loin les
apprciations qu'il dcerne d'autres, hormis Hegel. Marx a toujours profess
pour lui une grande et relle estime. Ille qualifie de gant de la pense 42, de
plus grand penseur de l'Antiquit43.
Cette apprciation n'est pas unique, ni exceptionnelle. Il ne variera pas l-
dessus. En 1858, Lasalle lui avait envoy son ouvrage: Hraclite l'obscur, en lui
disant qu'il tenait Hraclite pour le plus grand dialecticien parmi les philo-
sophes grecs. Dans sa rponse, Marx tempre cet engouement: Mes remercie-
ments pour" Hraclite". J'ai toujours eu une grande affection pour ce
philosophe auquel je ne prfre qu'Aristote parmi les Anciens44.
Ds sa Thse de doctorat, Marx a profondment apprci Aristote. Ce
fait est masqu parce que Marx y prenait pour objet la philosophie d'picure
et qu'il avait des accents enthousiastes lorsqu'il exaltait en elle une philosophie
de la conscience de soi, affirmant la libert absolue de l'homme face aux dieux
des religions populaires et face aux thologies spculatives.
Mais, dans ses Cahiers prparatoires, quand il dsigne trois philosophes
intensifs , ce sont: Aristote, Spinoza, et Hegel4S.
La philosophie d'picure n'est pour Marx que l'un des trois principaux
courants dans lesquels se divisa la pense grecque aprs la mort d'Aristote.
Lorsqu'il s'agit de prsenter le dveloppement de l'ensemble de la philosophie
grecque, Aristote en est l'acm, le point culminant, de mme que la philoso-
phie hglienne est le point culminant de la philosophie classique allemande et
ainsi de toute la pense moderne.
Dans L'idologie allemande, Marx critique vertement Stirner pour la
manire dont il prsentait l'histoire des ides chez les Anciens. Stirner passait,
sans faon, de Socrate aux... Sceptiques! Marx s'lve contre cette prsenta-
tion cavalire de la part de Stirner:
La philosophie positive des Grecs, qui succde prcisment aux
Sophistes et Socrate et notamment la science encyclopdique d'Aristote,
n'existe donc absolument pas pour [lui] 46.
LA POSSIBILIT RELLE
325
Plusieurs pages de L'idologie allemande sont consacres la philosophie
des Anciens. En dehors de la Dissertation Doctorale et des Cahiers prpara-
toires cette dissertation, c'est un des rares passages o Marx s'exprime avec
quelque dtail sur les philosophes anciens. Ces pages confirment la Disserta-
tion doctorale, et donnent une trs bonne ide de la manire dont il utilise ses
travaux de jeunesse des annes plus tard.
Il apprcie beaucoup les philosophies encyclopdiques et systmatiques47.
Un socialiste, Hermann Semming, avait affirm: Tous les systmes sont de
nature dogmatique et dictatoriale. Marx lui rtorque:
En faisant connatre son opinion sur les systmes en gnral le
socialiste vrai s'est pargn la peine, videmment, d'tudier les systmes
communistes eux-mmes. D'un seul coup, il a dpass non seulement l'Icarie,
mais aussi tous les systmes philosophiques d'Aristote Hegel, le Systme de
la nature [de D'Holbach], la classification des plantes de Linn, et de Jussieu
et mme le systme solaire48.
Plus tard, il ne ragira pas autrement l'gard de Ludwig Bchner, qui lui
envoya ses Six leons sur la thorie de Darwin. S'estimant grand naturaliste,
Bchner portait un jugement ddaigneux sur Aristote. A ce propos, Marx
crivit Engels: son chapter [chapitre] sur la philosophie matrialiste est
recopi sur Lange. Et le mme Bchner jette un regard plein de piti sur
Aristote qu'il ne connat manifestement que par ou-dire49 . Marx, lui - nous
le constaterons -, connaissait Aristote de premire main!
Quand Engels, dans l'Anti-Dhring qualifie Aristote de tte la plus
universelle d'entre eux [les anciens Grecs]50 et le tient pour le meilleur
dialecticien de l'Antiquit, il exprime la pense de Marx. D'ailleurs, Engels
mentionne Aristote aux cts de Hegel, lequel professait une admiration non
dissimule pour Aristote dans ses Leons sur l'histoire de la philosophie, et l'on
sait qu'il clt son Encyclopdie par une longue citation extraite de la
Mtaphysique.
Dans son projet d'Introduction pour ce mme Anti-Dhring, Engels
magnifiait Aristote comme tant <<leHegel du monde antique 51. Se doutait-
il, en crivant cela, qu'il faisait cho la dclaration liminaire de la
Dissertation doctorale du jeune Marx qui couronnait Aristote du titre
d' Alexandre macdonien de la philosophie grecque 52?
Dans sa Thse, Marx partait de l'ide que la philosophie d'Aristote jouait
le mme rle, dans l'Antiquit, que celle de Hegel au XIXesicle. Il mettait en
parallle ces deux systmes encyclopdiques, philosophies qui s'tendent
jusqu' la totalit, disait-iJ53. La philosophie grecque a atteint sa fleur la
plus haute avec Aristote54, de mme que la philosophie moderne avec Hegel.
Ce parallle se prolonge dans leur destin historique: leurs auteurs disparus,
chacun de ces systmes se scinde en ses propres moments constitutifs, que les
successeurs et pigones dveloppent de faon unilatrale 55.
326 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Marx prend souvent la dfense de Hegel, tout en rejetant son idalisme.
Si l'on dressait un bilan, peut-tre dcouvrirait-on qu'il prend aussi souvent la
dfense du Stagirite que celle du grand dialecticien moderne.
3. Le <<trsord'Aristote. Son utilisation par Marx
Marx apprcie donc en Aristote le savant encyclopdique qui a embrass
et enrichi l'ensemble du savoir d'une poque, mais aussi le puissant penseur
. qui, analysant les systmes philosophiques antrieurs, a ralis un examen
critique des catgories de la pense. D'o son apprciation d'Aristote comme
dialecticien.
Les modernes avaient t trs svres envers le grand savant et philosophe
grec; ils avaient rejet sa philosophie et ses conceptions en bloc.
Hegel tentait au contraire de les rhabiliter et il entreprit une rappropria-
tion de son uvre. Il ne voyait pas uniquement ni essentiellement en lui le
mtaphysicien et le logicien que prsentait la tradition scolastique. Il estimait
que <de trsor d'Aristote est depuis des sicles pour ainsi dire inconnu 56? Ces
propos sont sybillins. De quel trsor s'agit-il? Perdu depuis combien de
sicles? Hegel parle mots couverts. Aujourd'hui encore, il faut chercher ce
trsor 57,qui n'avait pas plus chapp Marx qu' Hegel.
D'ailleurs, est-ce le mme trsor pour tous deux? Les rfrences et
emprunts de Marx Aristote vont se rvler plus nombreux qu'on ne pense.
Ils sont dissmins dans des uvres diverses, mais sont toujours trs significa-
tifs, jamais accidentels ou de pure forme. Ils relvent d'une srie de domaines
que l'on peut classer comme suit, en s'levant partir des plus apparents et des
plus connus jusqu'aux plus spculatifs:
a) dans l'ordre socio-politique: la conception de l'homme comme animal
politique, celle des rapports sociaux et de proprit, celle du rapport entre
hommes libres et esclaves;
b) dans l'ordre conomique: les thories de la valeur et de l'argent, le rle
conomique de l'argent accumul (trsor) et son influence sociale, les formes
du capital dans l'antiquit;
c) dans l'ordre historique: Aristote comme historien de la philosophie et
comme source pour l'histoire de la pense antrieure lui;
d) dans l'ordre philosophique, Aristote comme penseur critique de la
religion, de la thologie et de la spculation, comme naturaliste enthousiaste
l'gard de l'tude des tres vivants; comme psychologue: thorie des fonctions
psychiques; comme pistmologue : thorie de la connaissance, conception des
formes de conscience et de connaissance et des rapports entre la thorie et la
pratique; enfin, couronnant le tout, Aristote comme thoricien critique des
catgories les plus gnrales de l'tre et de la pense: acte et puissance, matire
et forme, substance et accident, ncessit et possibilit, causalit et hasard, etc.
LA POSSIBILIT RELLE
327
De ce point de vue, il est apprci en tant que dialecticien par Marx, comme
il l'avait t par Hegel.
a) La thorie socio-politique
Si Marx rappelle volontiers la clbre conception aristotlicienne de
l'homme comme animal politique 58, c'est pour faire ressortir le caractre
plus politique que social de cette dfinition chez Aristote. Pourtant
Aristote part bien de l'ide que l'homme vit en socit, qu'il n'est rien en
dehors de la communaut laquelle il appartient par son origine, par son
ducation, par sa culture. Mais lorsqu'il caractrise l'homme comme animal
politique, c'est d'une communaut de citoyens qu'il s'agit.
Traduire animal politique par animal social , comme le font souvent
les commentateurs, c'est commettre un certain contresens qe Marx fait voir
en mettant immdiatement l'accent sur le contexte socio-politique dans lequel
cette dfinition d'Aristote prend son sens: il ne s'agit pas seulement du fait que
l'homme ne peut vivre isol de ses congnres, mais du fait que le citoyen doit
ses forces, son temps, et mme sa vie, la communaut (service guerrier) et
que la ville (la cit), non la campagne, est le lieu de sjour de l'homme libre 59.
Par l, Marx souligne la spcificit de la Ttot(polis) grecque.
A propos de l'mulation dans le travail en commun, s'il invoque la
dfinition d'Aristote, c'est pour souligner la distance qui spare la socit
bourgeoise moderne de la socit grecque antique: Cela [l'mulation dans le
travail] vient de ce que l'homme est par nature, sinon un animal politique
[politisch], suivant l'opinion d'Aristote, mais dans tous les cas un animal social
[geseIlschaftIich]. Il explique en note: La dfinition d'Aristote est
proprement parler celle-ci, que l'homme est par nature citoyen, c'est--dire
habitant d'une ville. Elle caractrise l'antiquit classique tout aussi bien que la
dfinition de Franklin: "l'homme est naturellement un fabricant d'outils",
caractrise le Yankee60.
Cette distinction entre animal social et animal politique n'est pas tard
venue chez Marx. En mai 1843, il faisait cette remarque, ce qui montre quel
point elle est essentiellepour lui: L'Aristote allemand qui voudrait crire une
" Politique" partir de la ralit allemande devrait inscrire en tte ces mots:
"l'homme est un animal sociable [gesellig], mais totalement apolitique
[unpolitisch]" 61. Si Marx fait rfrence la formule d'Aristote, c'est pour lui
restituer son sens dans le contexte sa cio-politique du monde grec ancien. Il a
donc dj un sens trs aigu des diffrences socio-politiques qui sparent les
ides propres aux grandes priodes historiques et aux diffrents types de
socits.
Nanmoins, il arrive qu'il prenne cette formule en s'en tenant au sens
large o politique signifie social . Dans l'Introduction de 185762, il
s'appuie sur la dfinition aristotlicienne dans un contexte thorique plus
gnral: il veut souligner la profondeur de vue du philosophe grec, pour qui
l'homme ne se dfinit pas seulement par des caractres naturels (biologiques),
328 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
mais par une fin: la vie dans une communaut humaine, une socit, qui lui
permet de bien vivre. L'homme qui vivrait seul, dit Aristote, serait un sous-
homme; il n'aurait plus qu'une vie animale, et ne pourrait subsister et se
dfendre: il serait comme un pion isol au jeu de dames 63, ou bien il serait
un dieu, ajoutait le philosophe grec. L'homme ne peut se raliser en tant
qu'homme, explique La politique, que dans une communaut. Son plein
accomplissement humain n'est possible que dans une cit qui, elle, peut vivre
en autarcie.
Marx juge cette conception suprieure celle des modernes qui, en
justifiant l'atomisme de la socit-civile bourgeoise, prnent l'individualisme.
En somme, Aristote en tait presque arriv la thse selon laquelle, l'essence
humaine, dans sa ralit, c'est l'ensemble des rapports sociaux 64". L'individu
isol est un rsultat historique rcent, ce dont n'ont pas conscience les penseurs
modernes: ils nous prsentent l'individu singulier, autonome et indpendant,
qu'ils voient dans la socit de leur temps, comme ayant toujours exist. En le
prenant pour point de dpart de leurs thories, les conomistes (Smith,
Ricardo) tombaient dans des robinsonnades . Rousseau prsuppose un
individu apolitique et asocial avant l'instauration du contrat social . Par sa
dfinition: l'homme est par nature un vivant destin vivre en cit", Aristote
est beaucoup plus raliste. Il l'emporte donc sur les modernes. Pour Marx,
l'analyse qui ouvre La politique mrite d'tre rappele et retenue face au
principe du monde bourgeois.
Ce ralisme de la conception aristotlicienne des rapports entre individu
et socit ressort dj d'un article de 1842 o Marx souligne que d'abord
Machiavel, Campanella, puis plus tard Hobbes, Spinoza, Hugo Grotius,
jusqu' Rousseau, Fichte et Hegel [...] se mirent considrer l'tat avec des
yeux humains, et dduire ses lois naturelles de la raison et de l'exprience, et
non de la thologie", travail qu'Hraclite et Aristote dj avaient entre-
pris 65".
Ce que Marx apprcie ainsi, c'est l'tude compare d'un trs grand
nombre de constitutions politiques effectue par Aristote dans un esprit
scientifique et comparatiste peu commun son poque66.
Lie l'ide de l'homme animal politique, l'ide d'une gense historique
concrte des rapports sociaux apparat ds le dbut de La politique. Marx n'a
pas manqu de relever ces vues esquisses par Aristote. Quand il souligne que
le processus d'change des marchandises, l'origine, n'apparat pas au sein
mme des communauts primitives67, il indique en note: Aristote fait la
mme remarque au sujet de la famille prive considre [par lui] comme la
communaut primitive [...] , et il cite La politique:
Dans la communaut primitive, il n'existait manifestement aucune
espce de ncessit pour celui-ci [pour l'change]68."
On voit que Marx fut un lecteur attentif d'Aristote. Il l'apprcie haute-
ment pour avoir eu une conception historique du dveloppement des
changes, ainsi que des rapports sociaux constitutifs des socits, mme si
LA POSSIBILIT RELLE
329
Aristote se trompait en prenant la famille prive pour la forme originaire de la
communaut.
Allons plus loin et avanons une hypothse. Selon Aristote, il y a un
rapport troit entre le genre de nourriture, le genre de vie, et le genre
d'acquisition 69.A notre connaissance, il n'y a pas de mention dans l'uvre de
Marx de cette thse d'Aristote. Nanmoins, on peut assurer qu'il la connais-
sait, car, dans Le capital, propos de l'change, il cite la fin du chapitre de La
politique o se trouvent exposes ces ides. De mme, dans ses analyses des
formes de socits antrieures au capitalisme moderne, quand il part du fait
que l'homme se comporte en propritaire des conditions objectives de son
travail productif, et qu'une unit naturelle s'tablit entre la communaut
humaine et ses conditions matrielles de production (terroir, etc.), on peut
supposer qu'il pensait aussi Aristote chez qui se trouvaient dj ces
rflexions 70. Aristote en faisait un principe gnral, qui s'appliquait au mode
de vie des animaux.
En 1853, dans un article politique, Marx observe: Depuis l'poque
d'Aristote, le monde est [...] submerg de dissertations sur le thme: Qui doit
tre la force dominante 71? C'est une claire allusion La politique o Aristote
soutient, dans le premier Livre, le droit de certains hommes tre matres
par nature et dominer les autres. Aristote partait d'un constat: de la plus
petite communaut (le couple) la plus grande (la cit ou l'empire), il y a un
matre , individu ou groupe social72.
Au sujet de la matrise et de la servitude, nous retrouverons la mme
acuit de lecture de Marx et la mme pertinence dans son utilisation des textes
du philosophe grec: il rel~ve en effet que, selon Aristote, la libert n'est pas,
pour le matre, l'antithse de la ncessit, alors que pour l'esclave libert et
ncessit sont totalement opposes.
b) Les conceptions conomiques
Les rfrences marxiennes aux thories conomiques d'Aristote sont aussi
importantes, sinon aussi connues, que les prcdentes. Marx attribue
Aristote deux dcouvertes essentielles que bien des conomistes modernes
ignorent ou ont oublies.
Dans la Contribution, le chapitre sur la marchandise s'ouvre sur un renvoi
Aristote dont le mrite fut d'avoir distingu valeur d'usage et valeur
d'change et d'avoir analys leurs rapports. Marx cite un paragraphe du De
Republica (La politique, appele aussi parfois De la Rpublique):
Tout bien peut servir deux usages... L'un est propre la chose en tant
que telle, mais pas l'autre; ainsi une sandale peut servir de chaussure, mais
aussi d'objet d'change 73.
Dans Le capital, cette citation n'est pas faite ds le dbut74. Elle est
reporte au chapitre II qui traite des changes, lorsque Marx introduit l'ide
330 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
que, pour l'changiste, la seule valeur utile de la chose qu'il possde c'est d'tre
un instrument d'change: il renvoie alors cette mme remarque
fondamentale d'Aristote 75.
Eugne Dhring avait entrepris et publi une Histoire critique de l'cono-
mie politique76. Il y exprimait navement l'opinion suivante: En ce qui
concerne la thorie de la science conomique, nous n'aurions proprement
parler rien du tout de positif relever dans l'antiquit 77, ce que Marx ne peut
laisser dire: Dans la mesure o les Grecs, crit-il, ont fait ['00] des
incursions dans ce domaine, ils y montrent le mme gnie, la mme originalit
que dans tous les autres78. Il pense, non seulement Aristote, mais aussi
Platon ou Xnophon 79.
Quant la deuxime dcouverte d'Aristote en conomie, il s'agit des deux
formes sous lesquelles se prsente l'argent, d'une part, simple moyen de
circulation (monnaie), d'autre part, capital-argent (trsor). Ce que Marx
rappelle ce sujet dans l'Anti-Dhring80, est dj dit dans la Contribution:
Aristote dans le chapitre IX, Livre 1
er de La rpublique, expose les deux
mouvements opposs de la circulation M-A-M et A-M-A sous les noms de
"conomique" et "Chrmatistique" 81.
"
Marx signale qu'Aristote blmait la poursuite de la richesse sous sa
seconde forme, ce qui montre que le Stagirite avait distingu les deux formes
spcifiques de l'argent, celle o il sert seulement en tant que moyen d'change,
et celle o on le thsaurise, o l'on cherche en lui la richesse pour la richesse.
L'Antiquit avait gnralement condamn l'usure (prt intrt). Dans les
Grundrisse et dans les Annexes aux Thories sur la plus-value, Marx note ce
sujet: Dans la thorie (comme chez Aristote), point de vue qu'elle est
mauvaise en soi [an und fr sichJ82.
Aristote a galement fait preuve de gnie, selon Marx, dans sa dfinition
de l'argent en tant que mesure de valeur83, allusion la proposition essentielle
selon laquelle 1'argent est moyen d'change par convention , dfinition qui
soulve la question, si dcisive pour la thorie de la monnaie, de la nature de
l'instrument de mesure.
On lit chez Aristote que la monnaie est devenue une sorte de substitut du
besoin et cela par convention 84, qu'il est une sorte de gage, donnant
l'assurance que l'change sera possible si jamais le besoin s'en fait sentir85;
ainsi, la marchandise qui sert de mesure (<<talon dit encore Aristote) prend
la forme d'un quivalent universel86.
Bref, pour remplir cette fonction, qui drive des ncessits de l'change,
l'argent, chose parmi les autres choses, et qui a une valeur d'usage en tant qu'il
est un mtal apte d'autres emplois ventuels, doit tre choisi et faire l'objet
d'une convention pratique.
Selon Marx, Aristote a parfaitement expos les choses, car il a vu la
difficult qui surgit ici; il y a en effet dans tout change, insistait Aristote,
incommensurabilit de fait entre les choses changes, mais commensurabilit
de convention impose par la pratique: Si
[00']' en toute rigueur, il n'est pas
LA POSSIBILIT RELLE
331
possible de rendre les choses par trop diffrentes commensurables entre elles,
du moins, pour nos besoins courants, peut-on y parvenir d'une faon
suffisante87.
C'est une vritable contradiction dialectique, immanente l'argent en
tant qu'instrument de mesure, et qu'Aristote voit et expose; il n'a pas recul
devant sa mise en vidence. Marx y insiste bien en disant de l'or et de l'argent:
Leur nature de marchandise particulire entre ici en conflit avec leur fonction
de monnaie. Toutefois, comme le remarque dj Aristote, leur grandeur de
valeur est plus constante que celle de la moyenne des autres marchandises88.
Ces analyses pntrantes de la monnaie dans l'thique Nicomaque
fournissent Marx l'occasion de critiquer Michel Chevalier, professeur
d'conomie politique au Collge de France, qui cite ce passage pour prouver
que, d'aprs Aristote, le moyen de circulation est ncessairement constitu par
une substance ayant une valeur intrinsque89 .
Marx met les choses au point: il renvoie d'abord Platon pour qui La
monnaie est un symbole d'change90 , mais il prcise qu'Aristote a eu de la
monnaie une conception incomparablement plus large et profonde que
Platon 91. Car, Aristote explique comment les caractres contradictoires de la
monnaie rsultent du dveloppement des changes.
M. Chevalier ne comprend pas que, pour Aristote, le moyen de circula-
tion, la monnaie, puisse avoir une valeur intrinsque et tre, en mme temps,
mesure par convention , que la monnaie n'a qu'une grandeur convention-
nelle bien qu'elle ait une valeur intrinsque! Pour Aristote, c'est contradictoire,
mais c'est ainsi: la valeur intrinsque et la valeur conventionnelle n'ont aucun
rapport ncessaire et fixe! Selon M. Chevalier, Aristote soutiendrait le
contraire, ce qui est une incomprhension totale, fait remarquer Marx. Sur cet
exemple, on comprend clairement pourquoi, aux yeux de Marx, Aristote tait
dialecticien, alors que M. Chevalier ne l'tait pas!
La limite de l'analyse aristotlicienne de l'argent se manifeste ailleurs,
estime Marx. Si sa comprhension de l'argent dans sa fonction de mesure de
la valeur est tout fait exceptionnelle parmi les Anciens, Aristote n'a
cependant pas dcouvert la vritable substance de la valeur d'change: le
travail abstrait, la quantit de travail mesure par le temps. En sa qualit de
Grec de l'Antiquit, il ne pouvait pas faire cette dcouverte, car la pratique de
l'esclavage dominait l'conomie. Que l'argent ait une grandeur de valeur plus
constante que les autres marchandises, il l'a vu, mais il ne pouvait pas le
comprendre. Aristote s'en tient la convention. En profond observateur des
formes conomiques et de leur fonction sociale, il a discern le fait. C'est son
titre de gloire dans la science conomique. Mais il ne pouvait aller plus loin.
Cette limitation est flagrante dans sa conception du travail: il pense que
l'esclavage est ncessaire. En raliste, il en analyse les fonctions conomiques
et sociales, tout en voyant bien les problmes que cela pose une thique et
une politique humanistes. Comment concevait-il le travail et que dit Marx ce
sujet?
332 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Aristote dfinit le travail comme l'activit cratrice des valeurs d'usage et
en reste donc essentiellement au travail concret (au sens de Marx). Aussi,
considre-t-il les tches remplies par les esclaves sous l'angle du service.
L'esclave est conu comme un serviteur particulier. Aristote n'a pas vu dans
l'esclavage une forme d'exploitation de l'homme par l'homme: il tente de le
justifier comme fond en nature, et prne un traitement humain de l'esclave
par le matre. De l dcoule son incapacit de dcouvrir la nature de la valeur
d'change. Cette manire de concevoir le travail tait sans doute invitable de
son temps.
L'estime que Marx porte Aristote n'en est pas diminue: Quand un
gant de la pense comme Aristote a pu se tromper dans son apprciation du
travail esclave, pourquoi un nain comme Bastiat serait-il infaillible dans son
apprciation du travail salari?92
Dans Le capital, Marx s'arrte sur le paradoxe conomique 93 de la
machine dans le monde moderne. A cette occasion, il cite le fameux texte
aristotlicien:
"Si", rvait Aristote [...], "si chaque outil pouvait, sur ordre ou bien
par pressentiment, excuter le travail qui lui choit, comme les chefs-d'uvre
de Ddale qui se mouvaient d'eux-mmes, ou comme les trpieds d'Hphastos
qui se mettaient spontanment leur travail sacr; si donc les navettes des
tisserands se mettaient d'elles-mmes tisser, le contrematre n'aurait pas
besoin d'aides, ni le matre d'esclaves 94.
Ces lignes de La politique ne sont pas d'interprtation aise. M. Pierre-
Maxime Schuhl a-t-il raison de n'y voir aucune prvision de l'industrie
moderne , c'est--dire des machines tisser automatiques? Il emploie le
mme mot que Marx: c'est un rve d'Aristote, et des anciens en gnral.
Cela pose problme: devons-nous suivre M. Schuhllorsqu'il ajoute que ce rve
se situe pour lui [Aristote] dans le domaine de la mythologie, presque dans
celui de la magie. [...] Nous sommes dans le domaine de la fable95? Est-ce
ainsi que l'entendait Marx? Il y a rve et rve. Quel sens donner au rve
d'Aristote?
Que voulait dire au juste le philosophe grec? Il faut examiner de plus prs
le contexte de La politique o il analyse la diversit des fonctions conomiques
et techniques lies la diversit des moyens mis en uvre. Or, toute tche
[i:pyov]96, dit Aristote, ncessite des instruments [opyava]: parmi ceux-ci, les
uns sont inanims, les autres anims97 . L'esclave est dfini partir de l
comme instrument anim; mais Aristote prcise: objet de proprit
anim, et il justifie la proprit d'une chose par l'usage qui en est fait, par son
propritaire, pour vivre. Dans ces conditions, tout serviteur est comme un
instrument prcdant les autres instruments , comme la vigie sur la proue du
navire98.
Aristote ne dit pas que les instruments et machines soient impossibles ou
inutiles. Son ide, semble-t-il, est que, aussi perfectionn que soit l'instrument
mcanique, il a encore besoin de quelqu'un qui l'emploie, s'en serve et le
LA POSSIBILIT RELLE
333
dirige: il ne peut excuter sa tche de lui-mme avec l'intelligence et le
comportement d'un tre vivant comprenant ce qu'on lui demande. C'est l
qu'Aristote voit la diffrence entre l'instrument ou la machine et l'tre
humain. Il en dduit la ncessit de serviteurs: vigie, manuvres, ou esclaves,
sous les ordres d'un chef ou d'un matre. La proprit d'esclaves se justifie,
pour lui, comme celle de tous les autres instruments et objets utiles, mais ilIa
limite expressment aux besoins de la vie du matre: c'est le sens de son
opposition entre conomie et chrmatistique (recherche de la richesse pour la
richesse).
Aristote a-t-il pressenti que si le machinisme pouvait tre pouss jusqu'
l'automatisation, alors on pourrait abolir l'esclavage? L'automatisation com-
plte des instruments lui paraissant impossible, l'abolition de l'esclavage aussi.
Cette abolition impliquerait des machines capables, non seulement de remplir
des fonctions complexes dvolues la vie et l'tre humain, mais aussi
d'excuter des ordres verbaux. Entre une pense de la magie et une pense
du machinisme, Aristote se situe mi-chemin: il est dans une pense de
l'instrument. Or l'instrument est l'organe de la vie, qui est praxis: La vie est
action et non pas production; aussi l'esclave est-il serviteur dans l'ordre de
l'action 99."
Voil o gt la limite de l'analyse du travail chez Aristote. Le grand
penseur grec n'a pas vu dans le travail de l'esclave une forme d'exploitation de
l'homme par l'homme, mais une ncessit d'ordre technique et naturel.
Nanmoins, Marx souligne la pertinence de son analyse de la division du
travail, et des fonctions des moyens de production, analyse dans laquelle
Aristote considre l'homme lui-mme (l'esclave) comme un moyen en vue
d'une fin: la vie du matre; mais ce moyen est anim,).
Aprs ces lignes clbres d'Aristote voquant des navettes automati-
ques
", Marx cite les vers d'un pote du premier sicle avant notre re, qui
s'merveillait des progrs du machinisme: ce pote chantait la possibilit de
supprimer la peine des hommes et des femmes, asservis la dure ncessit qui
les rivait des tches physiques machinales 100.Marx n'oppose pas la pense
d'Aristote et celle du pote contemporain de Cicron: il leur trouve au
contraire un air commun.
Selon Marx, dans cette ide d'hypothtiques mcanismes automati-
ques, Aristote aurait rellement pens que de tels instruments, s'ils pouvaient
exister, remplaceraient le travail, ce qui marque sa supriorit d'Ancien sur
bien des conomistes modernes qui justifient l'exploitation des salaris par le
capital malgr les possibilits dcuples que nous offrent aujourd'hui les
machines avec leurs moteurs et leurs automatismes.
Marx lisait donc ce passage d'Aristote d'une manire positive, comme si
le philosophe grec s'tait lev au concept d'une possible libration relative des
hommes du travail physique le plus pnible, possibilit qui apparat du temps
de Cicron avec le moulin eau 101.Il lit Aristote en prcurseur d'Antiphilos,
334 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
comme le gant de la pense qui voque hardiment des ralisations peut-tre
pas impossibles en principe.
Rien ne permet de dire qu'Aristote exclut toute possibilit de raliser des
automates mcaniques: il constate seulement que de son temps les navettes ne
marchent pas toutes seules! S'il emprunte un exemple un rcit mythique, et
si son vocation prend l'allure d'une fable, ce n'est pas pour condamner
l'usage d'instruments ou leur perfectionnement.
La pense du grand philosophe grec reste donc prudente et sans doute
timore. Cela provient, selon Marx, des conditions conomiques et des
capacits encore trs limites des techniques du monde grec. En effet, dans un
contexte o le degr de dveloppement des forces productives est restreint, les
mtiers de service, auxquels sont astreints les esclaves, se justifient, - estime
un penseur comme Aristote -, comme une ncessit fonde' en nature, ces
occupations n'tant pas dignes de l'homme libre 102.
L'avantage que le pote grec tardif, Antiphilos, a sur Aristote, c'est qu'il
voit de ses propre yeux le machinisme remporter des succs, ce sur quoi
Aristote pouvait seulement rver , incapable d'en imaginer la possibilit
relle, mme future. D'o le conditionnel irrel de La politique: si les navettes
des tisserands pouvaient se mouvoir d'elles-mmes, le contrematre n'aurait
pas besoin d'aides . Que les choses agissent pour nous sur ordre, voil l'utopie
pour Aristote; mais que certains instruments deviennent automatiques, voil
un rve moins incertain, une anticipation imaginative . Qui en fixera le
sens dans l'esprit d'Aristote? La question ne peut que rester pose, le texte
tant laconique.
Pour Marx) Aristote exprime l'ide d'une libration complte, mais
impossible, des tches matrielles: c'est un rve , une sorte d'idal utopique.
M. Schuhl prend le mot rve pour purement mythique. Marx l'interprte
d'une manire plus favorable Aristote 103. L'automaticit totale est une
impossibilit pour celui-ci, mais tenait-il une automatisation relative pour
impossible? Excluait-il le perfectionnement des machines existantes?
Le point crucial, selon Marx, est que les Anciens en imaginant une
hypothtique automatisation des tches en concluaient une libration des
travailleurs manuels: il n'y aurait plus besoin d'aides et d'esclaves , c'est-
-dire que tous les esclaves deviendraient des hommes libres , ce que chante
Antiphilos d'une manire idyllique.
Trois sicles avant, Aristote, plus raliste, pensait que mme si des
machines rduisaient la pnibilit du travail, il resterait toujours des tches
serviles . Toute activit dans laquelle l'homme n'a qu'une relation physique
la matire, tant utilitaire, est sans valeur et sans fin proprement humaine .
Pour lui, une diffrence essentielle spare les fonctions du pilote et de la vigie.
De mme que le cerveau et la main sont spcifiquement diffrents, de mme le
matre et le serviteur, l'esclave tant une espce de serviteur. Pour Aristote, un
progrs du machinisme ne peut changer fondamentalement le rapport de
LA POSSIBILIT RELLE
335
l'homme la matire. D'o sa justification de l'esclavage comme un mal
ncessaire que l'on peut seulement adoucir et allger.
L'conomiste A. Wagner s'en prenait aux thories conomiques de Marx.
Il rclamait la dmonstration pralable - absente jusqu' prsent - de la
parfaite possibilit d'un processus de production sans l'intermdiaire des
capitalistes privs dont l'activit cre et utilise du capital104 .
Pourtant partisan du socialisme d'tat, A. Wagner ne pouvait pas
concevoir comment se passer de capitalistes dans la production, tombant ainsi
dans la mme erreur qu'" Aristote [... qui], lui, se trompait quand il considrait
l'conomie esclavagiste comme non transitoire 105.
Si un penseur de la taille d'Aristote se trompait en jugeant ncessaires et
fonds en nature les rapports sociaux esclavagistes, a fortiori un Wagner
quand il estime ncessaires et, par consquent ternels;, les rapports de
production capitalistes.
c) Aristote historien de la pense
Il est un autre domaine o, compar aux autres philosophes, Aristote s'est
montr original: en abordant une question, il fait prcder son examen d'un
historique. Il numre les opinions de ses prdcesseurs avant de les discuter,
et, souvent, prend soin de les citer. Il est ainsi le premier historien de la
philosophie , et son uvre est une source prcieuse pour l'tude de la pense
philosophique grecque.
Lors de ses recherches sur les doctrines des atomistes pour sa Thse de
Doctorat, Marx a pu apprcier les mrites d'Aristote cet gard 106.Il s'en
souviendra jusqu' la fin de sa vie. Donnons-en un exemple significatif.
Alors qu'Engels travaille la Dialectique de la nature, Marx lui procure
quelques citations extraites de l'ouvrage de Diogne Larce: Vie et doctrines
des philosophes illustres, concernant la conception des atomes chez les
matrialistes anciens 107.Il Yajoute un court extrait de la Mtaphysique, qui est
nigmatique dans ce voisinage. Il rapporte la clbre thse aristotlicienne
selon laquelle l'Un n'est pas un genre. Rien n'indique pourquoi Marx joint
cette citation aux autres. Tentons de comprendre.
La chimie du XIxe sicle ranimait l'intrt pour les thses des atomistes
grecs. Elle les mettait de plus en plus l'honneur, mais souvent, on les
invoquait d'une manire trs superficielle. Engels voulait critiquer les erreurs
que certains savants, parfois renomms, commettaient sur les doctrines
atomistes par ignorance ou lgret 108.Il polmique ainsi contre Kkul qui
attribuait Dmocrite ce qui revenait Leucippe, et qui affirmait que Dalton,
le chimiste anglais du dbut du XIxe sicle, tait le premier admettre des
atomes diffrencis qualitativement et quantitativement. Engels rappelle que
les Anciens donnaient leurs atomes des formes et des grandeurs, voire des
poids diffrents.
C'est certainement pour l'aider dans cette circonstance que Marx lui
336 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
fournit des matriaux tirs des textes grecs anCIens. Voici la citation de la
Mtaphysique releve par Marx:
Que l'Un soit, dans chaque genre, une nature dfinie, et que jamais la
nature de l'Un ne soit l'Un en soi, c'est ce qui est vident 109.
"
Cette thse est bien connue. On sait en effet qu'Aristote n'admettait pas
d'unit relle suprieure l'unit gnrique. Entre les genres, il n'y a
qu'analogie. Aristote refuse l'ide de Platon de l'Un-Bien, spar et transcen-
dant. L'tre, soutient Aristote, n'est pas un genre.
Mais quel peut tre le rapport de cette thse avec l'atomisme? La coutume
n'est pas d'effectuer un rapprochement quelconque entre Dmocrite et
Aristote ce propos! C'est pourtant un tel rapprochement qlJ'impliquent ces
diverses citations groupes ensemble.
Hasardons une hypothse: Marx voulait-il suggrer que cette thse
aristotlicienne est similaire celle des atomistes pour qui les atomes sont des
uns" lmentaires et qu'ainsi certaines vues d'Aristote (pluralit des genres)
pourraient venir au secours de celles des atomistes, de Dmocrite en particu-
lier (pluralit des genres d'atomes)? Les atomes diffrent les uns des autres.
Chaque genre d'atomes a une nature dfinie ", savoir une grandeur et une
forme particulires, auxquelles picure ajouta un poids dfini.
Marx songeait-il interprter la thse d'Aristote dans un sens matria-
liste , ou seulement clairer deux points de doctrine l'un par l'autre en leur
trouvant un trait fondamental commun? Ces deux conjectures sont permises.
Le passage de la conception de l'tre des lates celles des atomistes par
fractionnement de l'Un est bien connu. Mais qu'ainsi la doctrine atomiste et
celle d'Aristote sur les rapports de l'Un et de l'tre puissent s'clairer
mutuellement, voil qui est moins banal. Nous laisserons cette hypothse en
l'tat: les preuves manquent pour dterminer ce que Marx avait en vue en
transmettant cette citation de la Mtaphysique Engels.
Quoi qu'il en soit, ce que montrent ces extraits, c'est que Marx gardait un
rel intrt pour les thses des philosophes grecs, et pour celles d'Aristote en
particulier, mme lorsqu'elles avaient un caractre mtaphysique comme
cette question des rapports de l'Un et du genre. Il avait donc toujours ses
tudes philosophiques de jeunesse trs prsentes l'esprit. Il ne faut pas
oublier que Marx a tudi de nombreux ouvrages d'Aristote qu'il lisait dans le
grec. Nous allons voir qu'il a fait plus, puisqu'il il avait traduit en allemand,
pour lui-mme, certaines uvres d'Aristote!
Ses travaux prparatoires sa Thse l'ont convaincu qu'Aristote est une
source inestimable pour comprendre la philosophie antique. Il a eu une grande
confiance en lui comme historien des ides. A son avis, les affirmations d'un
Plutarque, ou d'un Augustin, quand il s'agit des atomistes, sont faibles devant
celles d'Aristote. Il ironise:
LA POSSIBILIT RELLE
337
Bayle, sur l'autorit d'Augustin )', assure que Dmocrite a attribu
aux atomes un principe" spirituel". Marx objecte qu'Augustin est une
autorit compltement dnue d'importance, vu son hostilit Aristote et
aux autres anciens
110.
Dans la Diffrence, Marx relve que deux thses contradictoires de
Dmocrite sur la vrit de la connaissance humaine sont rapportes par
Aristote dans deux endroits diffrents, d'une part dans sa psychologie (dans
son trait De anima [De l'Arne]: Pour lui [Dmocrite] le phnomne est le
vrai ), d'autre part dans la Mtaphysique (<< Dmocrite affirme que rien n'est
vrai, ou que le vrai est cach). Marx se fait fort de montrer que ces deux
thses ne se contredisent qu'en apparence.
Ce point tait d'importance. Un historien de la philo~ophie, spcialiste
d'Aristote, traducteur du De anima, Adolf Trendelenburg, soutenait, dans le
commentaire qui accompagnait cette traduction rcente, qu'Aristote ignorait
cette contradiction de Dmocrite. Marx prouve au passage, sur cet exemple
prcis, que la science des aristotliciens, qui refleurissaient aprs 1830 en
Allemagne, n'tait pas de premier ordre"!. Il explique cette contradiction
apparente grce aux catgories de la rflexion au sens de Hegel, ce qui est plus
convaincant que la simple ngation du problme par Trendelenburg.
Cyril Bailey, le grand historien de l'atomisme ancien, salue le mrite du
jeune Marx qui russit runir les sources disperses de la philosophie
matrialiste grecque d'une manire remarquable pour son temps, et les
interprter magistralement en rsolvant le difficile problme que constituait la
diffrence des philosophies de la nature de Dmocrite et d'picure, problme
qu'aucun historien de la philosophie n'avait mme remarqu avant lui: En
jetant aujourd'hui un regard rtrospectif sur cette uvre [la Dissertation de
Marx], il est proprement tonnant, en considrant le matriau alors disponi-
ble, de voir combien Marx est all loin 112.
Nous avons fait le tour des emprunts explicites de Marx Aristote. Quelle
conclusion ressort de cet inventaire? Il est indniable que Marx connaissait
son uvre de premire main. Il l'avait comprise d'une manire trs profonde,
gardant certaines de ses thses avec un rare sens historique et philosophique,
tout en faisant preuve d'esprit critique leur gard.
Mais bien des traces de cette influence aristotlicienne restent implicites et
sont plus difficiles discerner dans ses crits: il pense souvent l'aide de
catgories aristotliciennes, qui forment, avec celles qu'il prend surtout chez
Hegel, la trame de sa pense. Certains soutiennent que Marx, dans Le capital,
raisonnait selon une <<logique aristotlicienne 113.
4. D'o vient l'importance d'Aristote pour Marx?
Des constatations prcdentes il rsulte que, parmi les philosophes priss
338 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
par Marx, c'est Aristote qui occupe, aprs Hegel, la position privilgie.
L'origine de cette orientation est sans aucun doute Hegel lui-mme. C'est
son exemple que, son tour, Marx a apprci et utilis l'uvre d'Aristote.
Pourtant, cette origine ne suffit pas expliquer compltement qu'il se soit tant
inspir du grand penseur raliste grec.
A premire vue, on pourrait penser qu'il se borne prendre chez Hegel ce
qu'il dit d'Aristote, par exemple lorsqu'il prend en-soi" et en puissance"
comme synonymes 114?
En effet, certaines citations d'Aristote chez Marx sortent tout droit des
uvres de Hegel. Il parat incontestable que les rfrences de L'idologie
allemande des thses aristotliciennes prcises sont empruntes au chapitre
que Hegel consacrait Aristote dans ses Leons sur l'histoire de la philosophie.
Lorsque Marx critique le rsum que Stimer faisait de l'histoire de la pense
des Anciens, il s'insurge contre l'absence d'Aristote dans ce rsum et crit, en
condensant le texte hglien 115:
On rencontre, chez lui [Aristote], les notions de pense en soi pour soi,
(Tj VOl1<HTj Kae' a'tllv), de raison se pensant elle-mme (A.ov o vOEL
vou), de pense se pensant elle-mme (ij vOl1<n .fi voi]crEffi)
", ajoutant:
D'une faon gnrale ni sa mtaphysique [celle d'Aristote], ni le troisime
livre de sa psychologie [id.] n'ont droit l'existence [pour Stirner] 116."C'tait
justement la mtaphysique et la psychologie que Hegel prisait par-dessus
tout dans l'uvre d'Aristote!
A l'inverse des penseurs modernes, Hegel avait la plus grande admiration
pour la pense du philosophe du Lyce, en particulier pour sa psychologie de
l'intelligence, tout en l'interprtant, travers ses catgories et son idalisme
absolu. Il insiste particulirement sur la profondeur spculative des concep-
tions psychologiques d'Aristote, dj en ce qui concerne sa thorie de la
sensation, mais surtout devant sa thorie de l'intellect agent:
Le vo se pense seulement lui-mme, parce qu'il est le plus excellent.
Il est la pense de la pense, il est le penser de la pense; en une telle
affirmation s'exprime l'unit du subjectif et de l'objectif, et c'est l ce qui est
excellent au plus haut point. [...]
-
Tel est donc le point culminant de la
mtaphysique aristotlicienne. C'est ce qu'il peut y avoir de plus spcula-
tiPl7.
Quel plus grand loge pourrait esprer un philosophe de la part de Hegel?
En 1845-1846, si Marx invoque aussi cette grande thse d'Aristote, c'est peu
prs dans les mmes termes que Hegel. Pourtant, cette date, Marx ne saurait
tre considr comme encore hglien! Il n'entend certainement pas cette
thse d'Aristote sur la pense au sens spculatif o l'interprtait Hegel. Mais
en dialecticien, il y voit, comme lui, l'unit du subjectif et de l'objectif ", c'est-
-dire entre un objet peru ou conu et l'activit du sujet qui saisit cet objet par
la pense 118.
LA POSSIBILIT RELLE
339
Il ne fait pas de doute que ce sont les textes de Hegel qui attirrent
l'attention de Marx sur l'importance des thses philosophiques originales du
Stagirite. Nanmoins, Marx ne procde pas en fidle disciple de Hegel. Il
n'accepte pas ses jugements sans examen critique. Trs tt, il prenait soin
d'aller directement aux textes, comme s'il avait voulu retrouver par lui-mme,
et par-del Hegel, la pense vritable du philosophe grec, comme s'il avait
aussi voulu vrifier le jugement de Hegel sur Aristote, et saisir le moment o
Hegel l'interprte dans son propre systme de pense. Pour l'instant, ce n'est
qu'une hypothse: nous allons la voir prendre consistance.
Tout montre qu'Aristote a exerc sur Marx un influence plus grande qu'il
ne semble. Nous avanons une hypothse: cette influence s'oppose dans sa
pense celle de Hegel, car elle entre en conflit avec celle-ci sur des points
d'importance primordiale.
Marx a une connaissance directe et intime d'Aristote; mais, cela ne suffit
pas, soi seul, pour dire en quoi consiste son importance pour lui. Or, il est
permis de penser que Marx a trouv en Aristote le grand philosophe raliste
qui lui a permis de s'opposer la puissance de l'idalisme hglien, sans
revenir Fichte ou Kant. On peut prsumer qu'il s'est inspir de l'exemple
d'Aristote en intgrant dans son matrialisme un ralisme proche de celui du
Stagirite. Marx est, en effet, le disciple dialecticien de Hegel chez qui le
ralisme fait pice l'idalisme sans sacrifier l'activit du sujet. En cela, il
trouvait un prcdent et un modle chez Aristote, qui s'tait de mme oppos
l'idalisme objectif et spculatif de Platon.
Ce ne sont donc pas seulement des catgories gnrales, comme celles
d'acte et de puissance, de forme et de matire (ou de contenu), de substance et
d'accident, d'universel et de singulier, d'abstrait et de concret, qu'on trouve
reprises Aristote, identiquement, par Hegel et par son illustre critique: en
fait, elles reoivent chez l'un et chez l'autre des sens diffrents, parce que
situes au sein de philosophies diamtralement opposes.
Il nous faut dmontrer cette influence du ralisme d'Aristote sur Marx en
la prcisant. Existe-t-il des preuves que Marx ait apprci en Aristote le grand
philosophe raliste de l'Antiquit?
Auparavant, cartons un ventuel malentendu. Nous ne voulons pas
soutenir que Marx fut aristotlicien: une telle thse n'aurait pas de sens; elle
resterait prisonnire d'une dmarche comparative formelle et externe, comme
celle laquelle s'est livr Nicolas Hartmann quand il fait de Hegel un
aristotlicien
", en estompant les diffrences qui sparent Hegel d'Aristote 119.
Pas davantage nous ne soutenons que Marx ft plus aristotlicien
qu'hglien, ce qui serait impertinent, vu la nature dialectique de sa pense,
sans parler de sa conception matrialiste et historique, ni de ses doctrines
politiques communistes. Nous adoptons une position toute diffrente; il s'agit
d'valuer un hritage, ou plutt deux hritages: Marx utilise la fois Hegel et
Aristote. On peut certes dire qu'il subit leur influence, mais c'est bien plutt de
l'exploitation de deux hritages qu'il s'agit.
340 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Ds lors, la question prend la forme suivante: comment comprendre la
faon dont ces deux sources, celle de Hegel et celle d'Aristote, ont concouru
dans la formation de la pense de Marx? A l'hritage hglien s'ajoute
l'hritage aristotlicien, hritages que Marx met en uvre d'une manire
historique et critique.
a) Aristote, critique de la religion et de la philosophie spculative
Que l'influence du Stagirite sur Marx ait contrebalanc celle du philo-
sophe de Berlin, cela apparat en pleine lumire quand on compare les
positions prises par Hegel et par Aristote l'gard des religions, et de la
thologie spculative de leur temps. Comme Hegel, Marx dtermine le sens
d'une philosophie d'aprs sa position l'gard des idologies de l'poque, en
particulier l'gard des religions, qu'ils conoivent comme des rponses aux
problmes sociaux et politiques. Or, les loges de Marx vont alors au
philosophe grec. Aristote est en effet apprci par Marx comme l'un des plus
grands critiques de la religion, de la thologie et de la spculation dans
l'Antiquit. Sa Thse sur picure et Dmocrite a masqu ce fait. Mais on peut
dgager les indications que ses manuscrits fournissent sur Aristote ce sujet.
Hegel est la fois lou et blm par le jeune Marx pour son interprtation de
l'histoire de la philosophie post-aristotlicienne, bien qu'elle prsente des traits
de gnie; tant spculative , elle a empch Hegel de comprendre l'origina-
lit du systme picurien, la manire dont picure dtermine les proprits de
l'atome. Parlant des trois grands courants philosophiques qui se sont opposs
et affronts aprs Aristote, l'picurisme, le stocisme et le scepticisme, Marx
dclare:
Hegel, il est vrai, a dtermin dans l'ensemble avec exactitude l'lment
gnral de ces systmes, mais le plan admirable de grandeur et de hardiesse de
son histoire de la philosophie, date de naissance proprement dite de l'histoire
de la philosophie, l'empchait d'entrer dans le dtail; d'autre part, l'ide qu'il
se faisait de ce qu'il appelait spculatif par excellence empchait ce penseur
gigantesque de reconnatre dans ces systmes la haute importance qu'ils ont
pour l'histoire de la philosophie grecque et pour l'esprit grec en gnral. Ces
systmes sont la clef de la vritable histoire de la philosophie grecque 120.
Ils en sont la cl, car ils rsultent de l'clatement du systme d'Aristote, et
rvlent donc ses composantes, comme l'avait vu Hegel. Surtout, pour Marx,
picure marque le progrs des Lumires, le combat de la science et de la
philosophie claire contre les idologies religieuses et spculatives. Tel est le
sens de la philosophie matrialiste grecque. Or, avant Epicure, Aristote prit
une position critique l'gard de la thologie spculative des Pythagoriciens et
de Platon, comme l'gard des reprsentations religieuse de la foule 121.Cette
critique se dveloppe chez picure face aux spculations thologiques qui
renouent, chez les Sociens, avec les cultes populaires d'origine orientale.
Quelques remarques incidentes faites par Marx, diverses poques, nous
indiquent qu'Aristote est, pour lui, le hraut d'un courant rationaliste qui
LA POSSIBILIT RELLE
341
critique, non seulement les croyances populaires, mais aussi les doctrines des
thologues 122.
Le dveloppement de la vie politique dans la cit grecque avait pour
consquence le dclin de la religion, d'o les ides quelque peu hrtiques et
rvolutionnaires de la psychologie et de la thologie aristotliciennes; le
procs de Socrate avait dj rvl ce caractre critique de la philosophie, ce
que Marx sait rappeler l'occasion:
L'apoge de la Grce l'intrieur a lieu l'poque de Pricls,
l'extrieur l'poque d'Alexandre. A l'poque de Pricls, les sophistes,
Socrate (que l'on peut appeler l'incarnation de la philosophie), l'art et la
rhtorique ont vinc la religion. L'poque d'Alexandre fut celle d'Aristote,
qui rejeta l'ide de l'ternit de l'esprit" individuel" et le dieu des religions
positives 123.
Cette remarque de Marx est capitale. Elle montre en Aristote le philo-
sophe qui, avant picure, avait t le plus loin dans la critique rationaliste de
la religion et de la spculation, puisqu'il fut le plus grand critique de la thorie
spculative des Ides de Platon. C'est dans ce contexte, qu'Aristote dvelop-
pait une psychologie raliste lie son hylmorphisme gnral. Il ne fait pas
dpendre sa conception de l'me ('l'UXl1)de quelque doctrine religieuse ou
mythique, serait-ce le mythe philosophique platonicien (mythe d'Er le Pam-
philien), transposition idelle des conceptions pythagoriciennes.
La thologie aristotlicienne est une sorte de thologie naturelle en un
sens qu'il nous est difficile de saisir aujourd'hui. Marx avait fort justement
observ en quoi consistait cette thologie lacise puisque, dit-il, mme un
Aristote prend les toiles pour des dieux, ou du moins les place en conjonction
immdiate avec la plus haute activit [=Energie]124, celle du premier
moteur.
L'expression utilise <mme un Aristote) est trs significative; elle doit
tre comprise par comparaison avec la thologie d'picure, dont les dieux
n'ont plus aucun rapport avec le monde, c'est--dire avec l'activit ou le
mouvement. Pour tout ce qui concerne le monde sublunaire, la philosophie,
selon Aristote, se passe de toute considration thologique. Cela est bien
connu en ce qui concerne l'tude des animaux: elle n'a nul besoin de
l'hypothse d'une origine ou d'une nature divine 125.De mme, dans le sixime
des Cahiers prparatoires sa Thse, Marx note <d'enthousiasme d'Aristote
pour la 86ropia (contemplation)
",
quand il admire la raison dans la
nature
126
.
L'esprit raliste dans la philosophie naturelle, c'est le sens de l'observa-
tion, l'indpendance et la libert de la pense. On retrouve ces traits
caractristiques d'Aristote dans sa philosophie sociale et politique, ce que
Marx ne manque pas non plus de signaler, pour ceux qui l'ont oubli et qui
rabaissent la pense des Anciens. Rappelons-le: il range le Stagirite dans la
342 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
srie des penseurs qui se mirent considrer l'tat avec des yeux humains, et
dduire ses lois naturelles de la raison et de l'exprience, et non de la
thologie; cet gard, la philosophie moderne n'a fait que continuer un
travail qu'Hraclite et Aristote dj avaient entrepris 127".
Quoique dissmines et enfouies dans des crits divers, cahiers de lecture
ou articles de presse peu connus, ces quelques notations fugitives de Marx,
jointes toutes les citations d'Aristote dans la Contribution ou Le capital, sont
trs prcieuses pour restituer l'image qu'il pouvait se faire d'Aristote, celle
d'un rationaliste clair et critique, d'un philosophe des Lumires , qu'il est
difficile de retrouver par-del le mlange de christianisme et d'aristotlisme
que confectionna Thomas d'Aquin, et que propagea la Scolastique 128.
Ce qui rend difficile la perception de cet Aristote authentique, que Marx,
ainsi que la critique historique contemporaine, nous aident retrouver, c'est
le fait que Descartes 129,et les Lumires sa suite, ont rabaiss Aristote et les
Anciens en gnral. Longtemps l'accent fut mis sur les uvres mtaphysiques
et logiques, ce qui a cach la figure du penseur raliste et naturaliste
qu'apprcie Marx.
Il faut replacer la critique systmatique qu'Aristote dirige contre la
thorie des ides de Platon dans le cadre de celle, plus large, de la thologie
spculative des thologues". Marx relve un passage de la Mtaphysique o
Aristote qualifie de discours vide [KEVOOYEtV] le recours de Platon des
mythes pour exposer cette thorie 130.
Sur tous ces points importants, Marx fait l'loge des conceptions d'Aris-
tote, alors qu'il critique la philosophie de l'Esprit et l'idalisme absolu de
Hegel, ce qui n'empche pas Marx de penser que ce dernier surpasse les
Anciens et les Modernes par sa philosophie de l'histoire et sa dialectique.
Marx vante donc Aristote pour son ralisme philosophique qui va
l'encontre de toutes les formes d'idalisme. L'on peut dire que Marx a trouv
dans Aristote l'antidote de l'idalisme hglien. Cet idalisme hglien l'attira
quand, tudiant, il l'eut dcouvert13I. Ce qu'il retint surtout de Hegel, c'est la
mthode dialectique applique aux questions historiques, conomiques et
sociales. Or, avec Hegel, il voit justement en Aristote un des plus grands
dialecticiens de tous les temps.
Marx redonne un sens raliste aux concepts que Hegel avait analyss et
mis au cur de son systme: devenir, processus, dveloppement, opposition,
contradiction, ngation de la ngation. Le renversement de l'idalisme abolu,
la dnonciation du caractre spculatif de la philosophie hglienne, ce que
Marx appelle, en retournant une mtaphore clbre remettre la dialectique
sur les pieds , se fait chez lui la manire dont Aristote avait remis sur ses
pieds la thorie des ides de Platon. Aristote est tir vers l'idalisme par Hegel;
Marx le ramne vers le matrialisme en tenant en haute estime son naturalisme
et son ralisme ainsi que l'ampleur de son savoir et de sa philosophie. De
Hegel, il retient de grandes ides en philosophie de l'histoire, mais non son
principe: l'idalisme.
LA POSSIBILIT RELLE
343
Or, ce n'est pas seulement pour des raisons thoriques et philosophiques
que Marx s'intresse Aristote. Ce fut aussi, et surtout, pour des raisons
pratiques: politiques et idologiques. Nous allons les dcouvrir en examinant
un pisode peu connu de l'histoire de la philosophie dans l'Allemagne des
annes dix-huit cent trente et dix-huit cent quarante.
b) Aristote, enjeu d'une bataille idologique en Allemagne aprs Hegel
Sans conteste, c'est Hegel que Marx doit le plus. Cela dit, parmi tous les
autres philosophes, c'est Aristote qu'en second lieu Marx s'est le plus
intress. Si l'on cherche prciser l'origine de cet intrt et les circonstances
dans lesquelles Marx prit connaissan<~e de l'uvre d'Aristote, on doit remonter
l'poque o il fit ses tudes Berlin de 1837 1841.
Dans cette priode Marx a traduit, au moins partiellement, deux uvres
d'Aristote. Ce fait est unique chez lui 132.Aristote a donc occup le jeune
tudiant d'une manire tout fait exceptionnelle. C'est tout d'abord la
Rhtorique que Marx dit son pre avoir traduite en partiel33. Quatre ans
plus tard, il s'attaque au trait De l'me [ITEpi ,!,uxfi] 134.Marx traducteur
d'Aristote est encore un inconnu: ce Marx-l mriterait une tude.
Pourquoi faire une telle traduction du trait De l'me? Cet ouvrage avait
t rcemment dit en latin par Adolf Trendelenburg 135.En outre, Marx lisait
le grec livre ouvert. Pour comprendre, il faut se reporter au contexte
philosophique allemand de l'poque.
Les annes pendant lesquelles Marx fut tudiant et o il prpara sa Thse
de Doctorat sont celles o se dvelopprent la critique historique du christia-
nisme et plus gnralement la critique antireligieuse en Allemagne. Des
divergences sur le sens donner la philosophie de la religion de Hegel
apparurent parmi les disciples du philosophe qui se sparaient, grosso modo,
en hgliens de droite et hgliens de gauche , ces divergences recouvrant
en effet gnralement des clivages politiques entre conservateurs et partisans
de rformes plus ou moins radicales, alors que l'hglianisme dominait encore
l'Universit de Berlin 136.
.
Simultanment, l'aristotlisme tait l'objet d'un enjeu important depuis le
dbut des annes dix-huit cent trente: des historiens de la philosophie
influents 137rejetrent l'interprtation que Hegel donnait de la succession des
systmes philosophiques grecs dans ses Leons sur l'histoire de la philosophie,
publies en 1833 par l'auditeur et disciple de Hegel, Karl Ludwig Michelet, et
tentrent de contester Hegel le titre d'historien de la philosophie. Pour faire
pice la dialectique de Hegel et son systme, ils revinrent l'interprtation
traditionnelle d'Aristote donne par la Scolastique depuis le XIIIesicle. Dans
la dcade de 1830 1840, de nombreux philosophes allemands ranimrent
cette mtaphysique et la logique formelle que Hegel avait si profondment
critiques et mises au rancart. Opposer les catgories d'entendement et la
logique aristotlicienne classique la Science de la logique de Hegel fut
l'objectif ouvertement proclam de Trendelenburg dans ses Logische Untersu-
344 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
chungen [Recherches logiques], dont les deux tomes parurent au printemps de
1840.
Bruno Bauer, en relations d'amiti trs troites avec Marx et d'une
dizaine d'annes son an, Privat Dozent Bonn, lui crit le 31 mars 1841 en
l'encourageant dans ses travaux sur la philosophie grecque; Trendelenburg
sera naturellement une des premires victimes que tu offrirais la philosophie
offense 138. Un autre ami intime du jeune Marx, Karl-Friedrich Koppen,
l'exhortait de mme, deux mois plus tard: A l'occasion de Trendelenburg, il
faut que tu te souviennes aussi du sieur Schopenhauerl39."
Comme ces lettres n'en disent pas davantage sur Trendelenburg, on se
perd en conjectures sur les vritables projets de Marx au printemps de 1841.
S'agissait-il de donner un prolongement sa Dissertation doctorale dans le
cadre du tryptique qu'il annonait dans son Avant-Propos, ou
-
plus
vraisemblablement - d'un autre projet? On ne sait. En tout cas, ces allusions
de ses correspondants les plus proches prouvent qu'il avait l'intention
d'intervenir contre ce retour l'interprtation scolastique d'Aristote, et d'en
dfendre une autre inspire de Hegel. Nous en donnerons bientt une preuve
plus directe.
Dans ses Recherches logiques 140,Trendelenburg, se fondant sur la logique
aristotlicienne comprise comme logique formelle au sens traditionnel, dve-
loppait une critique en rgle de la dialectique de Hegel. Pour rfuter la logique
hglienne, il s'appuyait sur les sciences naturelles de l'poque. Il considrait
que le dveloppement de l'Ide que prsentait la Science de la logique ne
pouvait se faire selon une dialectique purement conceptuelle, un engendre-
ment de dterminations de pense pures, comme le prtendait Hegel, sans
emprunter son contenu aux sciences empiriques et l'observation. Il proposait
un retour la classification, l'induction et la gnralisation au sens
d'Aristote. C'tait la construction et le sens de la Science de la logique et du
systme hglien que Trendelenburg remettait en cause; indirectement, toute
sa philosophie de la religion, de l'histoire, du droit, tait attaque.
Dans ce contexte, on comprend l'intrt particulier que Marx a port
Aristote. Ses motivations s'clairent. Mais pourquoi choisit-il de traduire
prcisment le IIt:pi \/fuXfi, et pourquoi le fait-il en commenant par le
troisime livre?
Nous pensons pouvoir avancer l'hypothse suivante: il s'agissait, pour
lui, de juger de la pertinence de l'interprtation hglienne de la philosophie
d'Aristote en gnral et de vrifier sa supriorit sur les commentaires des
aristotlisants traditionnels, rcents ou non. En outre, Marx a certainement
voulu prouver la solidit du jugement de Hegel sur la place minente de la
psychologie dans le systme d'Aristote et en particulier de sa psychologie de
l'intelligence et de sa thorie de la connaissance.
Hegel laissait entendre que, l, Aristote tait tout proche de sa propre
conception de l'Esprit. Il insistait sur la porte spculative, profondment
dialectique, des vues aristotliciennes: De la sensation, Aristote passe au
LA POSSIBILIT RELLE 345
penser; et l il devient essentiellement spculatif 141. Quelques pages plus loin,
Hegel insistait: Tel est le point culminant de la mtaphysique aristotli-
cienne. C'est ce qu'il peut y avoir de plus spculatif. C'est seulement en
apparence qu'on y parle du penser ct d'autre chose. [...] ce qu'il dit du
penser est, pris en lui-mme, le spculatif absolu 142.
Pour corroborer cette hypothse, il convient de remarquer que Marx
rpte cette dmarche chaque fois qu'il s'affronte Hegel: en 1843, quand il
critique la philosophie du droit, c'est la doctrine de l'tat qu'il analyse en
dtail, c'est--dire la partie terminale des Principes de la philosophie du droit, le
couronnement de l'uvre devant en dlivrer le vritable sens. Dans les
Manuscrits de 1844, il s'attaque la Phnomnologie de l'Esprit: l encore, c'est
le chapitre terminal, Le savoir absolu , qui est choisi. En 1847, dans Misre
de la philosophie, propos de la mthode dialectique , c'tst dans le dernier
chapitre de la Science de la logique qu'il va chercher ses citations sur la
mthode absolue de Hegel.
En ce qui concerne Aristote, on l'a
vu143, Marx avait des raisons de
suspecter le commentaire de Trendelenburg. L'dition que celui-ci avait
donne du trait De l'me ne devait pas davantage le satisfaire. Il n'est donc
pas exclu que, outre son projet d'tudier tout le cycle des philosophies post-
aristotliciennes, le jeune Marx ait song faire uvre de traducteur, voire de
commentateur, d'Aristote, pour s'opposer aux aristotliciens anti-hgliens. A
cette poque, il s'orientait vers la carrire universitaire. Sa Thse fut entreprise
et crite dans ce dessein. Visiblement, il se prparait intervenir en spcialiste
de la philosophie antique 144.
On a donc toutes les raisons de croire que Marx, qui avait 23 ans 145,
s'apprtait srieusement intervenir dans la bataille pour l'interprtation et
l'appropriation d'Aristote, en dfendant vigoureusement la manire historico-
philosophique de Hegel, grce la dmarche dialectique. Cela ne veut
videmment pas dire qu'il aurait pris fait et cause pour la philosophie
spculative et qu'il aurait dfendu le systme hglien. Il s'agissait plutt pour
lui d'illustrer la manire de penser hglienne. Sa Dissertation sur picure
et Dmocrite montre parfaitement la faon dont, cette poque, il entendait
user de toutes les ressources de cette dialectique pour interprter des systmes
philosophiques, sans faire acte d'allgeance la philosophie spculative elle-
mme. Bien qu'il ne ft pas encore sur de franches positions matrialistes, il
tait dj trs critique envers l'idalisme hglien qu'il rejetait expressment. Il
ne changera pas d'attitude sur ce point: toute sa vie il prendra la dfense du
grand philosophe d'une manire identique, se disant mme, au besoin, son
disciple !
Une preuve positive que Marx, en 1841, entendait critiquer Trendelen-
burg nous est fournie par un fragment manuscrit de quelques pages qui date
de cette poque 146.La fin en est trs nigmatique il est vrai, et on ne sait quoi
il tait destin. Les diteurs, mme trs verss dans l'histoire de la pense de
Marx, sont plutt avares d'claircissements. Ce texte se termine par un alina
346 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
vengeur o l'on se demande qui est vis. Aristote tant nomm, cela met sur
la voie. Aprs avoir distingu deux tendances philosophiques opposes qui,
son avis, caractrisent la philosophie allemande en 1841, il conclut:
II va de soi qu'il surgit en outre toute une foule de figures subalternes,
grincheuses, sans individualit, qui, ou bien s'abritent derrire une gigantes-
que figure philosophique du pass - mais on dcouvre bientt l'ne sous la
peau du lion, la voix larmoyante d'un mannequin d'aujourd'hui et d'hier
perce, en un contraste comique, sous la puissante voix qui traverse les sicles,
celle d'Aristote par exemple, de qui elle s'est faite mal propos l'organe; c'est
comme si un muet voulait se procurer de la voix au moyen d'un norme
porte-voix,
-
ou bien, arm de doubles lunettes, quelque lilliputien, install
dans le petit coin du postrieur du gant, annonce tout merveill au monde
quelle nouvelle perspective tonnante se dcouvre de SOn punctum visus
[point de vue], et fait des efforts risibles pour expliquer que ce n'est pas dans
le cur palpitant, mais dans la rgion ferme et solide o il est post, que se
trouve le point d'Archimde, TCO(HW [l o je suis fix], o le monde est
suspendu des gonds. C'est ainsi que naissent des philosophes-cheveux, des
philosophes-ongles, des philosophes-orteils, des philosophes-excrments,
etc., qui, dans l'homme-monde mystique de Swedenborg, occuperaient un
poste plus bas encore 147.
L'numration parodique de la dernire phrase est en fait une allusion
Trendelenburg qui, dans ses Recherches se faisait le dfenseur d'une concep-
tion finaliste de la nature dans le cadre d'un thisme qu'il appelait conception
organique . Il prtendait trouver cette conception chez Aristote, qui, comme
les thomistes, il attribuait un finalisme transcendant 148,et il l'opposait la
conception historico-dialectique et l'immanentisme de Hegel que rfutaient,
son avis, les thories rcentes des sciences naturelles (celles de Cuvier) 149.
C'est contre cette entreprise anti-hglienne de Trendelenburg, qui interprtait
les vues naturalistes contemporaines l'aide d'un aristotlisme frelat, que
Marx dirige ses sarcasmes. Pour Marx, Aristote est dj le gant incompris des
contemporains: Bastiat et Wagner ne le jugeront pas mieux que Trendelen-
burg.
A la fin de ce mme fragment, le jeune Marx annonait un projet
philosophique:
Mais conformment leur essence, tous ces mollusques tombent,
comme dans leur lment, dans les deux tendances ci-dessus indiques.
Quant ces deux tendances elles-mmes, je donnerai ailleurs une explication
complte de leurs relations soit entre elles, soit avec la philosophie hg-
lienne, ainsi que des divers moments historiques dans lesquels se prsente ce
dveloppement 150.
Cette dclaration programmatique montre qu'il envisageait un vaste
travail philosophique que les circonstances ne lui permettront pas mme
d'baucher 151.Nanmoins, sa propre relation la philosophie hglienne est
LA POSSIBILIT RELLE 347
dj nettement caractrise: ses critiques pisodiques de Hegel, mles celles
qu'il adresse aux Idologues allemands dans ses manuscrits ultrieurs, se
dvelopperont conformment aux indications esquisses ici.
On pourrait encore trouver quelques autres preuves que Marx, comme
Hegel, apprcia en Aristote un penseur dialecticien. Dans sa traduction du
trait De l'me, il insre quelques remarques. Par exemple:
Aristote a raison quand il dit que la synthse est la cause de toutes les
erreurs. La pense sous la forme de reprsentation et de rflexion est
constitue par une synthse de la pense et de l'tre, du gnral et du
particulier, de l'apparence et de l'essence. La pense fausse, la conception
fausse, naissent de la synthse de dterminations qui sont trangres l'une
l'autre, de rapports non pas immanents, mais purement extrieurs, de
dterminations objectives et subjectives 152.
Ainsi, ce n'est pas n'importe quelle synthse qui provoque l'erreur. Celle-
d provient de la runion arbitraire d'lments quelconques. La vrit aussi est
synthse 153.Or la synthse vraie repose sur une unit fondamentale: l'unit de
diffrents, mais de diffrents qui ne sont pas trangers l'un l'autre et sans
rapports. Cette unit rend le jugement vrai, expliquait Aristote 154.Hegel, puis
Marx, le suivent l-dessus.
Cette remarque montre que, pour Marx, Aristote est un philosophe de la
synthse, d'une synthse dialectique , car c'est une synthse de contraires,
tels que matire et forme, ou puissance et acte, qui sont indissolublement lis
dans la substance concrte, c'est--dire dans l'individu concret. C'est cet
Aristote-l - celui du Lyce, non celui des commentateurs 155-, avec son
encyclopdisme, son naturalisme, son ralisme et sa dialectique, qui recle un
trsor inestimable. C'est cet Aristote-l qui, chez Marx, transparat partout
o il apparat.
5. Le sujet de l'activit: rapport de Marx Hegel
Le dtour prcdent nous a rvl la nature exacte du rapport de Marx
Aristote, et permet de revenir sur son rapport Hegel. Il nous a montr que,
lorsque Marx se sert d'une catgorie aristotlicienne, il ne le fait pas par hasard
ou d'une manire convenue, Hegel l'ayant prcd dans cet usage. Nous
l'avons constat pour la catgorie de puissance (Mval.U) qui dsigne la force
de travail, ou toute autre force productive (moyens matriels ou capital). De
mme, lorsqu'il s'agit de l'activit, il faut l'entendre au sens de l'nergie
(vpYEta) chez Aristote.
tant donn le recours de Marx ces catgories, sa conception de la
possibilit est au fond celle d'Aristote, bien que, premire vue, la pense de
Marx semble dpendre davantage des conceptions de Hegel et de sa dialecti-
que que de celles du Stagirite. En ralit, s'il reprend expressment la notion
348 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
de possibilit relle de Hegel, il faut ajouter aussitt que Hegel la devait lui-
mme Aristote.
Il s'opposait en effet Kant qui tenait la possibilit pour une modalit de
la connaissance sans fondement ontologique. Au contraire, dans la Science de
la logique, Hegel insistait, comme Aristote, sur l'objectivit de la possibilit
relle, que ne suffit pas dfinir la simple non-contradiction logique (possibi-
lit formelle). La possibilit relle, disait-il, c'est l'tre-en-soi de l'effectivit
relle. [...] Dans la mesure o l'on s'engage dans les dterminations, circons-
tances, conditions d'une Chose pour connatre de l sa possibilit, l'on n'en
reste plus la [possibilit] formelle, mais [on] considre sa possibilit relle.
[...] Ainsi la possibilit relle constitue-t-elle le tout des conditions. [...] Lorsque
toutes les conditions d'une Chose sont intgralement prsentes, elle entre dans
[l']effectivit 156.Sur l'indigence de la possibilit formelle, Marx est en plein
accord avec Hegel. C'est la possibilit relle qui ne cesse de l'occuper et qui,
seule, l'intresse.
Pourtant, malgr la force du lien qui le rattache sur ce point, comme
souvent, Hegel, Marx a une sensibilit plus profonde que celui-ci la
possibilit. Il exploite toute la gamme des possibles qu'Aristote, conform-
ment sa doctrine des acceptions multiples, distingua et analysa au point de
vue ontologique et au point de vue logique: outre la puissance et l'indtermi-
nation, il yale frquent ou probable, le fortuit ou accidentel, soit fortune, soit
hasard (a(rr6~(1'tov, ou spontanit). Aristote est justement clbre pour avoir
refus d'abolir la possibilit d'vnements futurs, mme s'ils ne doivent pas se
produire. Il s'est dress contre les Mgariques 157,qui, attachs l'argument
logique pur, avaient soutenu le ncessitarisme absolu 158. On fait gloire
Aristote de sa doctrine des vnements futurs , en particulier lorsqu'il s'agit
d'vnements dpendant d'actions rationnelles (dlibres) qui comportent
un enjeu politique, social, ou thique. Ce qui est remarquer dans le clbre
exemple de la bataille navale 159,c'est qu'il s'agit justement d'un vnement
historique qui relve d'une dcision rflchie et calcule.
Aristote faisait une trs large place la pluralit des causes, la
probabilit (ce qui arrive <de plus souvent) et la fortuit (ce qui arrive
rarement), au point que, parfois, on a fait de lui le pre des doctrines de la
contingence au sens d'absence de causes, parce qu'il aurait soutenu
l'indtermination des futurs, dits futurs contingents 160.
Une fois carte l'quivoque contingence au sens d'indtermination, il
est lgitime de dire que Marx fait reposer sa conception de l'histoire sur l'ide
de futurs possibles, qui, comme pour Aristote, dpendent d'une dcision
pratique . Surtout, pour Marx, ils dpendent de l'action ralisant ces
possibles en fonction de conditions matrielles donnes, alors que Hegel,
rationaliste systmatique, accorde finalement tout au concept, allant jusqu'
l'idalisme absolu:
Le concept, qui est tout d'abord seulement subjectif, en vient, sans
LA POSSIBILIT RELLE
349
avoir besoin pour cela d'un matriau et d'une matire extrieurs, en vertu de
son activit propre, s'objectiver 161.
Aussi convient-il de se demander si Marx ne serait pas plus proche
d'Aristote que de Hegel en ce qui concerne sa conception de la ralisation du
possible, bien qu'il n'y ait pas de philosophie de l'histoire proprement parler
chez le Stagirite. On retrouve effectivement chez Marx l'ventail aristotlicien
des possibles ordonns la 8UvaJ.u dans son sens de matire. Le dveloppe-
ment des forces productives est ouvert sur un avenir actuellement indter-
min, alors que, d'aprs Hegel, la succession des figures subjectives et des
formes objectives de l'esprit se clt sur elle-mme quand l'Esprit parvient enfin
au savoir absolu de soi.
Certes, on peut soutenir que le proltariat est la classe pour soi (au sens
hglien) o l'humanit prend conscience de son pouvoir, et se sait la force
absolue de l'histoire venir: en ce sens, le marxisme est le savoir de soi
absolu de la classe ouvrire 162.Effectivement, pour Marx, c'est l l'essence' du
proltariat; cependant, il pensait aussi que le drame n'est pas jou d'avance,
parce que toute action s'ouvre sur des possibles.
Cette ouverture sur les possibles apparat dans la conception marxienne
du sujet de l'action. Selon Marx, l'action politique de notre temps, par ses
objectifs conomiques et sociaux, vise une rvolution radicale qui est encore
accomplir, ce que Hegel envisageait peine. Cette diffrence d'attitude est
connue. Quelques mots nous suffiront.
Hegel approuvait les grands accomplissements de la Rvolution de 1789.
Il en prvoyait des prolongements (en Allemagne, en Angleterre); il les
appelait de ses vux. Mais il ne prsageait pas une rvolution future aussi
radicale que celle-l (l'aurait-il souhaite?). Les Principes de la philosophie du
droit prconisent une monarchie constitutionnelle avec division du pouvoir et
des classes. Au contraire, Marx uvre pour une Rvolution encore plus hardie
et plus profonde encore que la Rvolution Franaise, une rvolution indite et
inoue, allant la racine des choses, dbouchant sur un monde sans exploita-
tion conomique, et par suite sans asservissement politique et sans alination
sociale, grce l'abolition complte, possible et ncessaire, de toute espce de
classe, et au dprissement de l'tat.
Des diffrences de temprament et de pense sparent le thoricien de la
rvolution communiste du philosophe de Berlin, bien qu'Hegel ait entr'aperu
la monte du proltariat ouvrier, classe historique toute rcente. Ces diff-
rences se traduisent au plan philosophique par la critique marxienne de la
conception encore trop idaliste que Hegel se faisait de l'action, et du sujet
de l'activit. Dans l'histoire passe, il y a bien eu une sorte de ruse pour Marx,
mais non de la raison hglienne qui reste toujours quelque peu divine 163,
bien que les ides thologiques de Hegel ne soient gure orthodoxes. Pour
Marx, l'tat n'est en rien l'incarnation de Dieu: il doit disparatre! Et l'Esprit
mondial se rvle tre... le march mondial164 .
350 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Alors que, pour Hegel, la nature est enferme dans un cycle rptitif, pour
Marx, elle est une rserve de possibilits. Ds lors, l'avenir est ouvert, et
l'histoire est loin d'tre termine: au contraire, elle commence 165!Malgr son
opposition aux rductions mcanistes, le systme hglien s'apparente, du
point de vue de sa forme extrieure, un modle thorique formalisable 166.
Toute action implique un agent, en termes philosophiques, un sujet .
Des puissances" (le capital, les classes, l'tat ou le march mondial,,)
disputent l'individu singulier son rle d'agent. Or, Marx ne retient pas
seulement de Hegel la mthode dialectique, mais aussi une thse philosophi-
que fondamentale: la substance est sujet 167". Un sujet est dfini par son
activit, et en tant que tel il occupe une place minente chez Marx comme chez
Hegel, puisque la ralit [Wirklichkeit] inclut l'action [Wirkung] 168.
Ce qui caractrise le sujet, explique Hegel, c'est le mouvement de se-
poser-soi-mme 169", propre l'Esprit, ce qui le dfinit comme absolu. Pour
Marx, l'absolu, c'est la nature; mais en parle-t-il comme d'un sujet,,?
Les termes sujet" et subjectivit" ne conviennent-ils pas seulement
l'homme? Avec les matrialistes, Marx rejette toute cration ex nihilo qui
suppose un tre" crateur prexistant !Pourtant, dans le cadre de son
matrialisme, il maintient que la substance est sujet, puisque la nature est
processus, devenir incessant et ainsi mdiation entre son devenir-autre et soi-
mme , comme dit Hegel de l'Esprit. Aussi la nature est-elle, pour Marx,
mouvement de se poser soi-mme; elle est active
".
Tout comme le travail est vivant ", la nature est vie
".
Aussi est-il
essentiel que Marx reprenne la catgorie aristotlicienne d'acte (vpycw, ou
activit). Aristote incluait l'activit dans sa conception de la nature 170.Hegel,
lui, la plaait dans l'Esprit. Pour autant qu'il reconnt une activit la nature,
ce n'tait qu'une activit d'emprunt, une activit dgrade, l'alination"
d'une activit plus haute, essentiellement diffrente.
On le sait, Marx ne le suit pas sur ce point. La nature, dans son
renouvellement continu, montre une gense, une histoire: elle est active et
source de toute activit; elle est puissance absolue, cause de soi (causa sui),
comme le deus sive natura de Spinoza. Dans son naturalisme, Marx reprend
la philosophie classique allemande l'ide qu'il n'y a pas d'tre qui ne manifeste
quelque activit, qu'un tre qui n'agit pas n'est pas un tre.
Cependant, de mme que Marx recueille l'orientation raliste et natura-
liste de la pense aristotlicienne, il recueille tout autant la dialectique du sujet
et de l'objet de Hegel. Il n'a pas dvelopp ses vues sur la dialectique de la
nature; mais il approuva Engels quand celui-ci se chargea, en leur nom,
d'interprter les apports des sciences de la nature de leur temps au sein de leur
propre philosophie dialectique.
La dialectique de l'histoire, laquelle Marx a consacr ses recherches, est
une dialectique subjective-objective. L'histoire est faite par les hommes, plus
ou moins leur insu, et elle s'impose eux qu'ils en aient conscience ou non,
et qu'ils le veuillent ou non. L'homme, tre naturel et partie de la nature, est
LA POSSIBILIT RELLE
351
la fois agent et patient de cette dialectique historique. Dans la production
incessante des hommes par eux-mmes, facteurs subjectifs et objectifs se
mtamorphosent continuellement les uns dans les autres. Le sujet
- les
hommes en socit 171
- est un tre objectif, et les objets produits, de quelque
nature qu'ils soient - marchandises, rapports sociaux ou institutions - sont
le rsultat d'une activit subjective. Partout, il y a relation dialectique entre
aspects substantiels et aspects subjectifs, entre la nature et l'homme.
Les moments subjectifs et objectifs sont les moments d'une dialectique
universelle, qui caractrise toute activit, toute pratique. Les mtamorphoses,
transformations, renversements, inversions, que Marx analyse en conomie,
en histoire, en sociologie, ou dans l'idologie, sont des manifestations d'un
devenir o substance et sujet sont insparables.
Dans le travail, activit spcifique de l'homme par laquelle il se produit
lui-mme parce qu'il produit les moyens de production de son existence, on
trouve le double processus de subjectivation de la chose, ou humanisation de
la nature, et de ralisation ou objectivation de soi dans des tres objectifs:
produits, instruments, moyens de production, rapports sociaux, institutions,
produits culturels, idologies. Cette dialectique se retrouve sous diverses
formes dans toutes les activits humaines.
A diverses reprises, Marx fait remarquer que, dans sa philosophie
spculative, Hegel renversait les rapports rels: le philosophe de Berlin faisait
sortir la nature de l'esprit par un processus mystrieux: une dcision de
l'Ide, disait-il172. En matrialiste, Marx objecte que c'est l'esprit qui provient
de la nature, du fait que le dveloppement de la pense et de toute production
spirituelle dpend de celui du cerveau, et du langage, lment de la pense. Les
sciences montrent que l'homme qui pense la nature est lui-mme d'abord
produit par la nature.
Marx se spare donc de Hegel lorsqu'il s'agit de dterminer le sujet de
l'acte ou de l'activit, qui est un sujet naturel. L'idalisme hglien renversait
les rapports rels. Il s'agissait de renverser ce renversement: il parle de la
mystification que la dialectique subit entre les mains de Hegel [...]. Chez lui
elle est sur la tte. Il faut la retourner pour dcouvrir le noyau rationnel sous
l'enveloppe mystique 173.
Mme ceux qui critiquaient la spculation de Hegel n'avaient pas
vraiment ralis ce renversement, estime Marx. Chez les jeunes hgliens
comme Bruno Bauer et Max Stirner, la mystification idaliste, dit-il, se
poursuit sous de nouvelles formes. Ils n'ont pas vu que le moteur de l'histoire,
c'tait les luttes de classes, classes lies au dveloppement des forces produc-
tives, et jusqu'ici trs largement indpendantes de la volont et de la
conscience individuelle, en particulier de celle des philosophes. Pourtant, cette
mystification de la dialectique par Hegel n'empche aucunement qu'il ait t
le premier en exposer les formes gnrales de mouvement de faon globale
et consciente 174.
En quoi consiste ce mouvement dialectique que Marx conserve, sinon
352 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
dans l'auto-production et l'auto-dveloppement de la nature et de l'homme
dans un processus historique? C'est l'activit par laquelle un tre se cre lui-
mme, ce que Hegel dsignait comme acte de se poser soi-mme , auquel se
reconnat un sujet. Pour Marx, l'auto-position, ou plutt l'auto-produc-
tion, continue d'tre le principe de toute ralit, nature ou histoire, individu ou
socit, travail ou capital. On ne saurait sparer qu'abstraitement matire et
processus, chose et mouvement, passivit et activit, produit et producteur,
objet et sujet. Parfois, mme la nature est dite devenir sujet !
De fait, Marx n'hsite pas appliquer la catgorie de sujet des
choses, dans la mesure o elles ont acquis une capacit d'agir, un
pouvoir et une autonomie par rapport leur origine: le capital et l'argent
deviennent ainsi, dans une large mesure, des sujets opposs aux travailleurs
et mme aux capitalistes individuels! Il sont dous d'auto-activit, de Selbsta-
tigkeit. Ils ont la puissance de se poser, de s'affirmer, de se raliser, ce qui est
le caractre spcifique d'un sujet. Pourtant, ils sont les produits de l'activit
sociale des hommes; leur pouvoir provient de ce que, dans certaines condi-
tions sociales, ces produits chppent leurs crateurs; ils les dominent,
provoquant l'alination des producteurs et de tous les individus sociaux.
Ainsi, l'argent en tant qu'instrument de la circulation, en tant que
moyen d'change, devient sujet, et la matire naturelle dans laquelle il se
prsente apparat comme tant un accident dont l'importance s'vanouit dans
l'acte d'change lui-mme 175.
Balzac savait et proclamait que le vritable roi des Franais tait sa
Majest la pice de cent sous 176.De mme, pour Marx, l'argent quitte la
livre de valet, sous laquelle il apparat en tant que simple moyen de
circulation, pour devenir soudain le souverain et le dieu du monde des
marchandises 177.
D'une manire semblable, le capital, un certain degr de dveloppe-
ment, est dou de toutes les qualits d'un sujet. Il devient un tre-pour-soi
[fr sich seiender]. Le capital en gnral est pos comme valeur existant pour
sOI, pour ainsi dire comme valeur goque [selbstisch] (ce quoi l'argent ne
faisait que tendre) 178.
Critiquant les souhaits, son avis illusoires, des socialistes de son temps,
Marx explique: Comme tre pour soi, le capital, c'est le capitaliste. Bien sr
certains socialistes disent: nous avons besoin du capital, mais pas du
capitaliste 179.Le capital apparat alors comme une pure chose, et non comme
un rapport de production, qui, rflchi en soi, est prcisment le capitaliste.
Certes, je peux sparer le capital de tel capitaliste singulier, le capital peut
passer un autre capitaliste. Mais, en perdant le capital, il perd sa qualit de
capitaliste. Par consquent, le capital est sparable d'un capitaliste singulier,
non du capitaliste qui en tant que tel fait face au travailleur. De mme, le
travailleur singulier peut aussi cesser d'tre l'tre pour soi du travail; il peut
hriter de l'argent, voler, etc. Mais il cesse alors d'tre travailleur. Comme
travailleur il n'est que l'tre pour soi du travail 180.
LA POSSIBILIT RELLE
353
Le capital devient autonome, indpendant de tel ou tel individu singulier.
Il dicte sa loi, devient un Selbst (un soi), un vritable sujet qui commande
ses soi-disant propritaires. C'eSt lui qui possde ses possesseurs. Il capte
les possibilits relles qui chappent aux individus. Comme l'argent qui fait
fraterniser les impossibilits 181, c'est lui qui se met vouloir:
Si [...] on considre [...] le capital comme un des cts qui, comme
matire ou simple moyen de travail, font face au travail, alors on a raison de
dire que le capital n'est pas productif parce qu'on ne le considre alors
prcisment que comme l'objet qui fait face au travail, comme matire; on le
considre comme simplement passif. Mais la vrit est qu'il n'apparat pas
comme un des cts, ou comme diffrence d'un des cts pris en soi, ni
comme simple rsultat (produit), mais comme le processus de production
simple lui-mme; et que celui-ci apparat maintenant comme le contenu du
capital dou d'un mouvement autonome 182."
Marx ne se fait donc pas scrupule d'employer le concept philosophique de
sujet (agent autonome) dans une dialectique qui s'inspire profondment de
celle de Hegel, et qui, par-del ce dernier, renvoie aussi la dialectique
aristotlicienne des rapports entre acte et puissance.
Lorsque le concept de sujet se prsente chez Marx, celui de substance n'est
pas bien loin. Pas d'activit sans un sujet substantiel, mme si le sujet en
question n'est qu'un simple porteur (Trager): lorsqu'un individu est rduit
au rle de support d'une activit qui lui est trangre, il manifeste encore ce
minimum d'activit qui consiste portep>. Il contribue par son activit
contrainte et force raliser l'activit et la fin d'un autre. Le but de son action
est choisi et dfini par cet autre.
Dj, dans l'analyse du travail alin qu'il entreprit en 1844, Marx
dfinissait l'ouvrier comme la marchandise doue de conscience de soi et
d'activit propre [selbstisch] 183. Il critiquait pourtant avec virulence l'usage
des catgories philosophiques comme celle de sujet, en particulier chez les
Jeunes Hgliens, car ceux-ci faisaient du sujet le matre de ses conditions
historiques. Dans L'idologie allemande, il faisait remarquer que les diff-
rents stades de dveloppement [de la philosophie allemande] ont conduit ces
absurdits: la Substance, le Sujet, la Conscience de soi et la Critique pure, tout
comme ils ont produit l'absurdit religieuse et thologique 184.
Grce ces catgories, les Jeunes Hgliens se livraient des dveloppe-
ments d'ides , qui restaient des pauvrets idalises et inefficaces 185. Ainsi,
Bruno Bauer, pensant renouer avec la source originelle de la philosophie
hglienne, dveloppait une philosophie de la conscience de soi 186.
Marx a-t-il, lui aussi, privilgi le sujet (ou activit) au dtriment de la
substance (ou matire)? La question est parfois controverse. Pourtant comme
Aristote et Hegel, il soutient que tout tre concret, toute ralit effective
comporte ces deux aspects ou moments.
Dans les Thses sur Feuerbach, Marx lie les deux trs troitement en
354 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
dnonant le principal dfaut du matrialisme, disant que, jusqu'ici, les
matrialistes n'ont jamais saisi l'objet de faon subjective 187.
Tout jeune, il salua avec enthousiasme la philosophie de Feuerbach
comme critique dcisive de la philosophie spculative hglienne. Cependant,
il prenait dj ses distances l'gard des thories qui faisaient de la socit, de
l'tat ou de l'Homme en tant que genre , le sujet du processus social,
politique ou historique en gnral. Bien avant L'idologie allemande, ds 1843,
il dsignait les individus rels, agissant et vivant dans des conditions concrtes
donnes, comme les seuls sujets vritables:
Hegel saisit socit, famille, etc., en gnral la personne morale non pas
comme la ralisation de la personne relle, empirique, mais au contraire
comme personne relle. [...] Cette inversion du subjectif d~ns l'objectif et de
l'objectif dans le subjectif [...] provient de ce que Hegel veut crire l'histoire
de la vie de la substance abstraite, de l'Ide, de ce que partant l'activit
humaine, etc., doit ncessairement apparatre comme activit et rsultat
d'un autre, de ce que Hegel veut faire agir l'essence de l'homme pour soi,
en tant que singularit imaginaire plutt que dans son existence relle,
humaine [...] 188.
Hegel concevait l'tat comme l'incarnation de la Raison, ralisation de
Dieu ou Esprit Absolu sur terre. Il faisait de la socit civile ou du systme des
besoins, <d'objet, et de l'tat, le sujet du processus d'ensemble. Marx
soutient que le rapport est inverse: c'est la socit civile qui est le sujet rel de
l'tat. Plus exactement encore, ce sont les hommes concrets, rels, empiriques,
qui sont les vrais sujets. A la substance abstraite de l'Ide, il oppose la
substance concrte , c'est--dire la socit relle avec ses diverses catgories
sociales, et, la base de celles-ci, les hommes individuels avec leurs statuts
sociaux et leurs mtiers particuliers, etc.:
Si H~gel avait procd partir des sujets rels en tant qu'ils sont les
bases de l'Etat, il ne se serait pas trouv dans l'obligation de faire en sorte,
de faon mystique, que l'tat se subjectivise ainsi. "Or", dit Hegel, "la
subjectivit n'est en sa vrit que si elle est sujet, la personnalit que si elle est
personne. "189 Cela aussi est une mystification. La subjectivit est une
dtermination du sujet, la personnalit une dtermination de la personne. Or
au lieu de les saisir comme des prdicats de leurs sujets, Hegel ralise la
subsistance autonome des prdicats et les fait, aprs coup, sur un mode
mystique, se mtamorphoser en leurs sujets [...J. Alors que ce qu'il faut c'est
partir du sujet rel, et considrer son objectivation. [...] C'est prcisment
parce que Hegel part des prdicats de la dtermination universelle au lieu de
partir de l'ens (\J1tOKEtIlVOV, sujet) rel et qu'il faut bien cependant qu'un
porteur soit l pour cette dtermination, que l'Ide mystique devient ce
porteur. C'est cela le dualisme: que Hegel ne considre pas l'universel comme
l'essence relle du rel-fmi, [...) ou qu'il ne considre pas l'ens rel comme le
sujet vrai de l'infini
190.
Cette ide se retrouve dans les Manuscrits parisiens: Il faut surtout viter
LA POSSIBILIT RELLE
355
de fixer de nouveau la "socit" comme une abstraction en face de l'indi-
vidu 191.Dans La Sainte Famille, on lit que l'humanisme rel ne spare pas
l'humanit de l'homme individuel, personnell92 . L'ide est toujours la mme:
l'tat, la proprit prive, la socit, etc., sont des prdicats, des productions
des hommes individuels concrets.
L'idologie allemande y revient longuement et avec insistance. Polmi-
quant contre Stirner, Marx veut marquer qu'il ne retourne pas quelque
feuerbachisme, l'affirmation d'une priorit du Genre sur l'individu. Dans
tous ces rappels de Marx, les individus singuliers sont considrs comme les
seuls sujets rels concrets. Comment ne pas y voir une reprise de la vieille
doctrine d'Aristote selon laquelle la substance concrte, premire, est l'tre
singulier, l'individu, l'espce n'tantqu'une substance seconde 193?
Il est bien connu que Marx s'est oppos la thse de Feuerbach qui faisait
de l'essence humain, du genre, le principe de dtermination des individus en
tant qu' hommes , ceux-ci devant trouver leurs prdicats dans ceux qui sont
caractristiques du Genre humain en gnral, genre qu'ils prennent pour
objet auquel ils s'identifient. Marx vit rapidement l une forme de spculation
philosophique, un humanisme abstrait . Malgr son immense intrt pour la
critique religieuse, cette thorie de Feuerbach reposait encore sur une inver-
sion entre sujet et prdicats qu'il avait pourtant trs bien vue chez Hegel 194.
Feuerbach tait trs loign de l'ide de l'auto-production de l'homme par le
travail. Il n'avait pas tenu compte du fait que la nature humaine change
avec les formes historiques des classes et de la production.
La fin du troisime des Manuscrits parisiens offre un magnifique exemple
de la critique marxienne de la conception hglienne du sujetI95. Marx
examine la manire dont Hegel tablit sa thse selon laquelle le sujet consiste
dans l'<<acte>>.
Aux yeux de Marx, Hegel a le grand mrite d'avoir conu la production
de l'homme par lui-mme [Selbsterzeugung] comme un processus [...], comme
rsultat de son propre travail196. Mais si Hegel apprhende le travail comme
l'essence [...] de l'homme , il n'a pas vu que, dans notre socit bourgeoise
moderne, le travail est le devenir pour soi de
l'
homme l'intrieur de
l'alination, c'est--dire en tant qu'homme alin. Le seul travail que connaisse
et reconnaisse Hegel est le travail spirituel abstrait 197.
Dans la dialectique du matre et du serviteur, l'accent est mis sur la
formation de la conscience de celui qui travaille. Mais, la fin de la
Phnomnologie, l'ensemble du dveloppement apparat comme celui de la
conscience philosophique qui parvient au savoir absolu de soi. Hegel dcrivait
cet acte comme un se poser soi-mme [sich setzen], une activit de l'esprit.
Il expliquait alors le fait que la ralit nous apparaisse comme chose en
disant que c'est l'alination de la consciencl< de soi [qui] pose la chosit 198.
C'est sur ce point que Marx intervient. Il considre le rapport tabli par Hegel
entre la conscience de soi de l'esprit et son autre , la ralit qui apparat
356 MARX' PENSEUR DU POSSIBLE
comme chose" et dont le caractre de chose serait le rsultat d'un acte de
l'esprit.
Marx objecte que, chez Hegel, le pos au lieu de s'affirmer lui-mme,
n'est qu'une affirmation de l'acte de poser qui cristallise pour un instant son
nergie (Energie] sous la forme du produit et qui en apparence (...] lui confre
le rle d'un tre indpendant (selbstandig], rel (wirklich]I99.
Selon Marx, non seulement le sujet, mais aussi l'objet ou la chose
s'affirment eux-mmes. Ce que Hegel obtient n'est pas la chose relle, la
nature200, mais l'abstraction, la chosit . Dans le monde rel, les choses ont
un caractre dynamique spontan; leur tre est effectif et indpendant.
C'est dans l'activit productive matrielle que l'on trouve l'objectivation
relle, car c'est l que le sujet (l'homme) pose des choses relles. Mais ce
n'est pas cette activit-l que Hegel envisage dans sa Phnomnologie. L'objec-
tivation reste idelle pour lui. En fait, il ya bien une objectivation relle, car,
dans le travail, l'homme ralise ses buts dans des choses (des produits) o il
s'objective: cela suppose la fois des sujets rels, les hommes individuels, et
des choses relles, c'est--dire une nature objective qui leur fait face, et qu'ils
n'ont pas pose.
Plus tard, dans les Manuscrits de 1857-1858 et dans Le capital, c'est
toujours de cette dialectique objective et relle qu'il s'agit lorsque Marx
analyse les rapports entre le travail vivant, travail d'un sujet en acte, et les
moyens de production, y compris la nature. Les produits du travail sont
appels travail cristallis, objectiv> matrialis. Cette dialectique par
laquelle le sujet (l'homme) s'objective dans l'objet de son travail, Hegel n'a fait
que la transposer en une activit de la seule conscience de soi, en activit de
<d'esprit,).
La dialectique objective du travail prsente une double diffrence par
rapport la dialectique hglienne de l'alination de l'esprit. En premier lieu,
en tant qu'activit subjective, le travail prsuppose un sujet (l'ouvrier, ou plus
gnralement le travailleur) qui soit lui-mme un tre substantiellement (c'est-
-dire matriellement) et socialement dfini. Le travail ne peut tre lui-mme
que l'acte d'un tre naturel objectif, qui a des forces, des aptitudes et un statut
social dtermins. En second lieu, l'acte du travail prsuppose hors de lui des
choses, les matriaux et les moyens de travail, c'est--dire quelque chose sur
quoi il s'applique.
Contre Hegel, pour qui c'est l'activit de la conscience qui est position
(acte de poser ou engendrement) de la chosit, Marx s'insurge:
Quand l'homme rel, en chair et en os [leibliche], camp sur "la terre
solide et bien ronde",
l'
homme qui aspire et expire toutes les forces de la
nature, pose ses forces essentielles objectives, relles, par son alination
comme des objets trangers, ce n'est pas le [fait de] poser qui est sujet; c'est
la subjectivit de forces essentielles objectives, dont l'action doit donc tre
aussi une action objective201.
LA POSSIBILIT RELLE
357
Ainsi, nous dit Marx ici, ce n'est pas le fait de poser et de s'aliner qui est
sujet. L'alination survient dans un mouvement d'objectivation qui l'enve-
loppe, et l'objectivation ne se rsume pas une alination: celle-ci n'est qu'un
avatar historique de celle-l et rclame son dpassement ds lors possible.
Certes, l'acte de poser (l'objectivation) prsuppose un sujet. Si l'on se souvient
des formules marxiennes qui rappellent la ncessit d'un tre C"onscient
[bewusst Sein] l'origine de toute conscience [Bewusstsein], on peut encore le
dire de la manire suivante: le fait de poser est l'acte d'un tre rel. Mais l'acte
n'est plus, lui seul, le sujet. Or, c'est prcisment ce qu'affirmait Hegel!
Marx rend aux individus concrets rels leur consistance: ce sont eux les
sujets; c'est en eux que rside la possibilit relle, celle d'agir et de se
comporter en sujets. La subjectivit de leurs forces n'empche pas que ces
forces soient objectives , que les sujets soient eux-mmes objectifs:
L'tre objectif agit [wirkt] d'une manire objective et il n'agirait pas
objectivement si l'objectivit n'tait pas incluse dans la dtermination de son
tre [Wesen]. Il ne cre, il ne pose des objets que parce qu'il est pos par des
objets, parce qu' l'origine [von Haus] il est nature. Donc, dans l'acte de
poser, il ne tombe pas de son" activit pure" dans une cration de l'objet,
mais son produit objectif ne fait que confirmer son activit objective, son
activit en tant qu'activit d'un tre naturel objectif202.
L'homme a une nature objective; cela veut dire qu'il dpend d'une nature
extrieure: il en est issu; il a besoin d'elle pour exister. Tout tre naturel
manifeste une activit qui lui est immanente, qui fait partie intgrante de son
essence en tant qu'tre objectif naturel. Le sujet est aussi objet et ce n'est pas
lui qui produit originairement cette nature objective qui est la sienne.
Cela ne signifie pas que Marx embrasse un matrialisme mtaphysique
comme celui des philosophes franais du XVIIIesicle. S'il rejette la notion
d'objet au sens des matrialistes qui n'y incluaient pas l'activit subjective, il
rejette tout autant la notion d'activit autonome absolue en tant qu'acte d'une
conscience. Ainsi, Fichte affirmait: Le moi se pose lui-mme [...] et
inversement, le moi est, et il pose son tre [...]. Le moi est la fois l'agissant
et le produit de l'action
203.
Estimant que Fichte aboutissait une pense ne regardant nulle part au-
dehors dans la ralit204, et que Hegel tendait au mme rsultat, Marx dfinit
l'homme comme tre de la nature: tre naturel vivant, il est d'une part
pourvu deforees naturelles [naturlichen Kraften], de forces vitales, il est un tre
naturel agissant [tatiges]; ces forces [Krafte] existent en lui en tant que
dispositions, capacits, en tant que tendances [Triebe]. D'autre part, en tant
qu'tre naturel, vivant, sensible, objectif, il est, comme les plantes et les
animaux, un tre passif, conditionn et limit; c'est--dire que les objets de ses
tendances existent en dehors de lui, en tant qu'objets indpendants de lui
[...]205.
358 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
D'un ct, l'homme est le sujet de son activit, de l'autre c'est la nature
qui est sujet. Les facults naturelles ou acquises de l'homme, et les pouvoir
inhrents la nature, telles sont les sources relles de toute possibilit.
Mais, nous sommes loin de l'poque o l'homme se dgageait peine de
la nature animale. Un long dveloppement et des modifications ont eu lieu et
les rapports de l'homme la nature passent par la mdiation d'instruments
techniques et de processus sociaux. Les possibilits relles ne rsident donc pas
seulement dans l'activit de l'homme, dans ses forces naturelles, mais dpen-
dent aussi de ces moyens de production et des forces dont il s'est rendu matre,
ou plutt qu'il a domestiques.
L'homme, facteur subjectif de l'activit, se dfinit, non seulement par son
activit objective, mais galement par les moyens ou facteurs objectifs
existants et qui servent de mdiateurs cette activit. La technique est donc le
fidle miroir et le lieu des possibilits humaines relles, ou ralises. Comme
l'crit M. Gilbert Simondon:
Le monde technique offre une disponibilit indfinie de groupements
et de connexions, car il se produit une libration de la ralit humaine
cristallise en objet technique; construire un objet technique est prparer une
disponibilit206.
N'est-ce pas ce que Marx disait?
NOTES
1. Ce mot est pass du grec la langue allemande commune et philosophique.
2. La pense sauvage, Paris, Plon, 1962, p. 173.
3. Quant au rapport de Marx picure, nous en traiterons dans notre dernier chapitre au
sujet de la conception de la libert: le jeune Marx interprta la philosophie d'picure comme une
philosophie de la conscience de soi" et de la libert.
4. Bien qu'il ne fasse pas partie du franais courant, le terme de praxis est consacr en
philosophie; nous suivrons cet usage.
5. Nous pensons aux travaux de MM. M. HENRY (op. cit.), C. C. GOULD (Marx's Social
Ontology: Individuality and Community in Marx's Theory of Social Reality, CamJ:>ridge
(Mass.)/Londres, MIT Press, 1978), G. HAARSCHER(L'ontologie de Marx, Bruxelles, Ed. de
l'Universit, 1980.)
6. Cf. Deuxime Thse sur Feuerbach, L'idologie (1968) pp. 31-32; (1976) p. 1; (bi!.) pp. 26-
27;MEW3,p.S.
7. Dj, les activits techniques humaines avaient servi Aristote pour dfinir l'activit
[vEpyEia]. Ses commentateurs l'ont bien montr: J.-M. LE BLONDsouligne le rle des schmes
de mtiers et des schmes artificialistes dans son uvre (Logique et mthode chez Aristote, 3e d.,
Paris, Vrin, 1939, pp. 326 et suiv.).
8. C'est l'expression dont se servait Antonio Gramsci, lorsqu'il tait emprisonn par le
fascisme mussolinien. Les diteurs franais avertissent que l'expression permettait de ne pas
alerter les censeurs de la prison qui eussent t arrts par le mot marxisme (Cf. Gramsci dans le
Texte, Recueil de textes, Paris,d. sociales, 1975, p. 142, n. 9). Certains interprtes de Marx
LA POSSIBILIT RELLE
359
prennent la notion de praxis ou d'activit en un sens unilatral et absolu: M. G. Haarscher ramne
la philosophie de Marx une ('ontologie de l'activit (op. cit.). D'une manire quelque peu
analogue, mais avant M. Haarscher, M. M. Henry
y
a vu une ontologie de la subjectivit (op. cit.).
Mme S. MERCIER-JOSA a soumis l'argumentation de M. Haarscher une analyse critique en se
fondant sur les Manuscrits de Kreuznach de Marx (plus connus comme Manuscrits de 1844)
(Retour sur le jeune Marx, Paris, Mridiens Klincksieck, 1985).
9. M. Andr TOSEL pense aussi que le marxisme est une philosophie de la praxis . Cf. son
ouvrage: Praxis, Vers une refondation en philosophie marxiste, Paris, d. Soc., 1984.
JO. Aucun de ses crits n'expose ni ne dveloppe spcialement sa philosophie, ce qui ne
signifie pas qu'il n'en ait pas une, malgr ce qu'a tent de soutenir M. Georges Labica, aprs
M. Althusser: Parler d'une philosophie marxiste serait illgitime , crit-il (J. statut marxiste de
la philosophie, Bruxelles, ditions Complexes, 1976, p. 364.)
11. Manuscrits de 1857-1858, t. I, p. 207; Gr., p. 178. Soulign par nous.
12. Manuscrits de 1844, pp. 136-137; MEWEB I, p. 578. - Une telle conception des rapports
entre tre et activit voque la clbre thse de L'idologie allemande concernant les rapports
de l'tre et de la conscience: La conscience ne peut jamais tre autre chose que l'tre-conscient
et l'tre des hommes est leur processus de vie relle (cit ci-dessus, p. 56, n. I).
-
Dans les deux
cas, il s'agit d'une dialectique qui s'inspire fortement de Hegel.
13. Nous reviendrons la fin de ce chapitre sur cette critique marxienne de la thorie du sujet
de Hegel (cf. ci-dessous, pp. 347 et suiv.).
14. M. Henry parle de la subjectivit comme naturant du capital", de la thorie subjective
de la valeur et de la mtaphysique de l'individu de Marx (op. cil., t. II, pp. 407, 408, 445).
15. Le concept de l'tre comme production", Revue philosophique de Louvain, t. 73,
n
17,
fvr. 1975, p. 98. - Nous avions critiqu cette interprtation (cf. M. VADEE, La conception de
la thorie chez Marx , Science et Dialectique chez Hegel et chez Marx, Paris, ditions du C.N.R.S.,
1980, pp. 5 I -53).
16. Dans son ouvrage sur la philosophie de Marx, M. Henry a longuement dvelopp cette
interprtation d'aprs laquelle Marx aurait oppos radicalement l'essence de la praxis
l'essence de la theoria ou intuition: En analysant l'intuition, c'est--dire l'apparition d'un
objet, on ne peut y trouver l'action, mais seulement son contraire, le voir, la contemplation. De
la mme manire en analysant l'action on ne peut y trouver l'intuition puisque si l'intuition tait
prsente en elle, elle n'agirait pas (op. cil., t. I, p. 324; cf. tout le dveloppement des pp. 314-367).
17. Deuxime thse sur Feuerbach, L'idologie (1968) p. 32; (1976) p. I; (bil.) pp. 26-27;
MEW 3, p. 5. Trad. modifie.
18. Op. cil., p. xiv; pp. 40 et suiv.
-
De mme, M. Piotr HOFFMANN,en ce qui concerne la
thorie de la connaissance, souligne le rle majeur qu'y joue la notion d'activit (The Anatomy of
Idealism: Passivity and Activity in Kant, Hegel and Marx, La Haye/Boston/Londres, Nijhoff,
1982).
19. Manuscrits de 1857-1858, t. l, p. 239; Gr., p. 208. Trad. modifie. - Certaines formules
favorites de Marx, comme passer de la forme d'activit la forme d'objet ou d'activit,
devenir tre, dnotent la profonde influence de Hegel. M. Roman ROSDOLSKYa montr d'une
manire magistrale tout le parti que Marx tire de la dialectique hglienne tout au long des
Grundrisse, grand texte prparant Le capital (La gense du Capital chez Karl Marx, trad. de
l'ail., Paris, Maspro, 1976.)
20. Le capital, trad. Lefebvre, pp. 199-200; ES, t. l, p. 180; MEW 23, p. 192. Trad. modifie.
21. Notons que die Arbeit (le travail) est un nom fminin en allemand; en franais, il faudrait
traduire par ,d'occupation , la besogne , la tche , pour rendre plus sensible l'affinit,
continuelle chez Marx, entre le travail et l'activit de la vie, ou vitalit.
22. Ibid., p. 227; p. 202; p. 217. Trad. modifie.
-
Soulignons qu'une simple prcision
donne ici par Marx en passant , savoir que l'homme .est une chose doue de conscience de
soi [selbstbewusste Ding] s'inscrit en faux contre l'exclusion rciproque absolue de l'intuition et
de la pratique, que M. Henry attribue Marx.
23. Dans ces thses, Tatigkeit ou tatig (actif) figurent neuf fois, Praxis ou praktisch quatorze
fois, parfois en apposition, parfois en composition l'un avec l'autre dans die praktische Tatigkeit.
24. Manuscrits de 1857-1858, t. I, p. 207; Gr., p. 178.
25. Thses, L'idologie (1968) p. 31; (1976) p. I; (bil.) pp. 25-26; MEW 3, p. 5.
26. Les moments simples qui constituent le processus de travail sont: l'activit finalise [die
zweckmassige Tatigkeit] ou le travail lui-mme, son objet et son moyen (Le capital, trad.
Lefebvre, p. 200; ES, t. l, p. 181; MEW 23, p. 193. Trad. modifie).
27. Ibid.
360 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
28. Certains interprtes s'appuient sur cette dfinition du travail pour soutenir que Marx
aurait repris les conceptions idalistes des philosophes classiques allemands, en particulier de
Kant (cf. par exemple, M. P. LIVET, Temps de travail, acte rflexif et forces productives,
Compte rendu dans Recherches Hgliennes, Bulletin du Centre de Recherche et de Documenta-
tion sur Hegel et Marx, Poitiers,
n
15, sept. 1980, pp. 3-4; hors commerce).
29. Rappelons ici la phrase dj cite (cf. ci-dessus, p. 317, citation rfrence note 20): En
agissant [wirken] sur la nature extrieure et en la changeant par ce mouvement, il change
[veriindert] en mme temps sa propre nature" (Le capital, t. l, p. 180; trad. Lefebvre, pp. 199-200;
MEW23, p. 192.)
30. Pour comprendre la premire Thse sur Feuerbach, il faut se reporter aux Manuscrits de
1844 (pp. 93-94; MEW EB l, pp. 541-542), o Marx crit: C'est d'abord la musique qui veille
le sens musical de l'homme. [...] Les sens de l'homme social sont autres que ceux de l'homme non-
social. La formation des cinq sens est la formation de toute l'histoire passe (ibid.). En outre,
prcise-t-il, il faut prendre <,sens ici de la manire la plus large: ce sont <,non seulement les cinq
sens, mais aussi les sens dits spirituels, les sens pratiques (volont, amour, etc.), ,<en un mot les
sens humains (ibid.).
31. La vie est action [praxis], et non pas production [posis] (Politique, L. J, ch. IV,
9
5,
1254 a 7; trad. Aubonnet, p. 18).
32. thique Nicomaque, J, l, 1094 a 4-5 (trad. Tricot, p. 32).
33. Cette question a t tudie de manire approfondie par Mme Solange MERCIER-JasA,
dans son article: ,<Aprs Aristote et Adam Smith, que dit Hegel de l'agir? , Les tudes
Philosophiques, 1976,
n
3, pp. 331-350. Elle y montre ce que deviennent les catgories de praxis
et de posis dans les analyses hgliennes du travail et dans la dialectique du matre et du
serviteur. Elle conclut un dpassement de cette dichotomie dans l'objectivation du sujet et la
subjectivation de l'objet qui n'est possible, selon Hegel, que par la constitution d'un vouloir libre,
ou vouloir de l'universel, ce qui advient par le service. Mme Mercier-Josa indique que Marx
reprend le problme hglien, en repensant, dans L'idologie allemande, la manire dont, aux
rapports naturels entre les hommes se substituent des rapports rationnels, ce passage tant li
l'histoire de la division du travail.
34. Manuscrits de 1844, p. 92; MEWEB J, p. 54l.
35. C'est dans le premier des Manuscrits de 1844 qu'est expose pour la premire fois cette
distinction entre objectivation et alination (ibid., pp. 55 et suiv.; pp. 510 et suiv.). On la retrouve
dans Le capital, en particulier dans la thorie du ftichisme.
36. Travail salari, pp. 25-26; MEW6, p. 400.
37. Dans le Dictionnaire Grec-Franais de Bailly, aucun des exemples donns ne concerne les
activits productives , qu'elles soient artisanales, industrielles, ou techniques en gnral.
38. Marx proclame parfois son admiration pour l'humanisme antique, ce qui contraste avec
son loge du caractre civilisateur (du point de vue matriel) du capitalisme moderne:
L'opinion ancienne selon laquelle l'homme apparat toujours comme la finalit de la production
[...] semble d'une grande lvation en regard du monde moderne, o c'est la production qui
apparat comme la finalit de l'homme (Manuscrits de 1857-1858, 1. l, p. 424; Gr., p. 387).
39. L'tude de tous ces emprunts sont du cadre de notre recherche, qui n'a pas pour objet
l'tude comparative et exhaustive de deux systmes de pense aussi vastes que ceux de Marx et
d'Aristote. L'tude partielle que nous allons effectuer ne fera que poser des jalons pour une telle
entreprise.
40. De grands commentateurs, tels que David Ross ou M. Pierre Aubenque, ont insist sur
les dformations subies par la pense d'Aristote au cours de deux millnaires. Mais notre objet ne
sera pas d'entrer dans les problmes pineux dbattus entre historiens de la philosophie grecque.
En tout cas, Marx savait dj pertinemment que la pense d'Aristote avait t dforme.
41. Certains chercheurs ont pris en considration le rapport de Marx Aristote; leurs
travaux nous ont grandement aid. Signalons ceux de MM. R. SANNWALD(Marx und die Antike
[Marx et l'Antiquit], Zurich, 1957), M. HOFER(<<Bermerkungen zur Dialektik bei Aristoteles und
Marx [Remarques sur la dialectique chez Aristote et Marx], Aristoteles: Anliisslich seines 2300.
Todestages [Aristote: A l'occasion du 2300' anniversaire de sa mort], Halle, Martin Luther
Universitat, 1978), D. PASEMANN(Gedanken zu Aristoteles-Rezeption im historischen Materialis-
mus [Rflexions sur la rception d'Aristote dans le matrialisme historique), ibid., H. SEIDEL(Das
Verhiiltnis von Karl Marx zu Aristoteles [Le rapport de Karl Marx Aristote], Deutsche
Zeitschrift fr Philosophie,
27' anne,
n
6, pp. 661-672). M. Seidel surtout a pris conscience de
l'ampleur de la question et l'aborde de front, mais il n'a pas dgag les vraies raisons de l'intrt
de Marx pour Aristote. Mis part ces travaux o le rapport de Marx Aristote est au premier
LA POSSIBILIT RELLE 361
plan, il existe quelques tudes particulires o ce rapport est voqu. C'est le cas de celles qui
s'occupent de Marx tudiant: J. IRMSCHER<Karl Marx studiert Altertumswissenschaft [Karl
Marx tudie la science de l'Antiquit], Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl Marx Universitiit,
Leipzig, 3. Jahgang, Gesellschafts-und Sprach-wissenschaftliche Reihe, Heft 2/3, pp. 207-215) et
E. KRGER<Ueber die Doktor-Dissertation von Karl Marx [Sur la Dissertation doctorale de
Karl Marx], Wissenschaftliche Zeilschrift der Humboldt-Universitiit, Berlin, Gesellschafts-und
Sprachwissenschaftliche Reihe, Heft 2, pp. 101-109). Ils apportent beaucoup d'lments sur
l'histoire de la formation intellectuelle du jeune Marx, mais, de ce fait, ne s'intressent pas aux
traces de ces tudes dans l'uvre de la maturit. D'autres portent sur des sujets particuliers, ainsi
celle de Th. EHLEITER (Die Kategorie des BONUMCOMMUNEbe; Karl Marx: in Beziehung zu
Aristoteles und Thomas von Aquin [La catgorie du bien commun chez Karl Marx en relation
avec Aristote et Thomas d'Aquin], Berlin (Ouest), Dissertation doctorale, 1974), ou bien Aristote
ne s'y trouve impliqu que d'une manire trs indirecte et superficielle, par le truchement de
Thomas d'Aquin par exemple: M. REDING(Thomas von Aquin und Karl Marx [Thomas d'Aquin
et Karl Marx], Gratz, Akademische Druck-und Verlaganstalt, 1953, 23 p.). Nous ne pouvons
passer ces travaux en revue. Ils prjugent souvent de l'issue de la recherche en partant d'a priori
philosophiques ou idologiques.
42. Le capital, 1. l, p. 92, n. 1; trad. Lefebvre, p. 93, n. 33; MEW 23, p: 96, n. 33.
43. Ibid.,1. 2, p. 91; p. 458; MEW 23, p. 430.
44. L. Lassalle, 21 dco 1857, Correspondance, t. V, p. 90; MEW 29, p. 547.
45. Diffrence, p. 183; MEWEB I, pp. 224-225; MEGA, t. lVII, p. 104,1.16.
46. L'idologie (1968) p. 161; (1976) p. 126; MEW 3, p. 121.
47. Dmocrite fut chez les Grecs le premier cerveau encyclopdique (ibid., p. 163; p. 129;
p. 124).
-
Dans ces pages, deux contresens ont t commis par les traducteurs franais dans
l'dition de 1968, o on lit: Les Stociens furent, selon Aristote, les principaux fondateurs de la
logique formelle (ibid., p. 162; MEW 3, p. 123); il faut lire: aprs Aristote [nach Aristoteles).
On trouve une autre affirmation tout aussi tonnante: <da source vritable de la philosophie de
Dmocrite [a] t Aristote [...] (ibid., p. 163: MEW 3, p. 124), alors qu'il faut comprendre: La
source vritable pour connatre la philosophie de Dmocrite est Aristote. Ces erreurs sont
corriges dans l'dition de 1976 (pp. 128 et 129).
48. Ibid. (1968) p. 507-508; (1976) p. 469; MEW 3, pp. 448. - Certains idologues allemands
s'inspirant de Moses Hess, de Feuerbach et faisant des emprunts de seconde main aux socialistes
franais, dveloppaient alors avec quelque succs des vues utopistes et s'appelaient eux-mmes
socialistes vrais (cf. CORNU,op. cit., p. 268 et suiv.).
-
Au sujet des systmes, Marx ajoute: Le
contenu vritable de tous les systmes qui ont fait poque, ce sont les besoins de la priode o ils
ont fait leur apparition. A la base de chacun d'eux, il
y a toute l'volution antrieure [...]
(L'idologie (1968) p. 508; (1976) p. 470; MEW 3, p. 449).
49. L. Engels du 14 novo 1868 (cf. Lettres sur les Sciences, p. 66; Correspondance, 1. IX,
p. 361; MEW 32, p. 203). Trois semaines plus tard, crivant L. Kugelmann, il ne mche pas non
plus ses mots: La faon dont un avorton comme lui [Bchner] expdie Aristote par exemple
-
qui tait un tout autre naturaliste que B[chner]
-
est vraiment tonnante (L. du 5 dco 1868;
ibid., p. 69; p. 378; p. 579).
50. Anti-Dhring, p. 52; MEW 20, p. 19.
-
M. Bottigelli a traduit par: l'esprit le plus
encyclopdique d'entre eux.
51. Ibid., p. 391. Il s'agit d'un fragment qui ne se trouve pas dans le tome 20 des Marx-Engels
Werke.
52. Diffrence, p. 217; MEW EB I, p. 266. Engels connaissait-il cette Dissertation reste
manuscrite (qui d'ailleurs ne nous est pas parvenue tout fait complte: il manque au moins un
chapitre)?
53. Ibid., p. 219; p. 267.
-
Dans ce passage, il s'agit des philosophies de Platon et d'Aristote.
Mais, Marx aurait dit la mme chose de la philosophie hglienne.
54. Ibid., p. 218; p. 267.
55. De 1839 1841, cette ide sert de fil conducteur Marx pour son interprtation de
l'picurisme, du stocisme et du scepticisme antique.
56. Leons sur l'histoire de la philosophie, 1. III, p. 563.
57. M. Aubenque, dont l'objet n'est pas le savoir positif d'Aristote, le confirme indirecte-
ment: Nous ne prtendons pas apporter du nouveau sur Aristote, mais au contraire tenter de
dsapprendre tout ce que la tradition a ajout l'aristotlisme primitif (op. cil., p. 3).
58. Cf. ARISTOTE,Politique, L. I, ch. 2, 1253 a 2-9 (trad. Aubonnet, 1. l, pp. 14-15).
-
La
mention par Marx de cette dfinition aristotlicienne apparat dans l'Introduction de 1857
362 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
(cf. Contribution, p. ISO; MEW 13, p. 616), dans les Manuscrits de 1857-1858 (t. I, pp. 18 et 433;
Gr., pp. 6 et 395-396), enfin dans Le capital (t. 2, p. 19; MEW 23, p. 346).
59. Manuscrits de 1857-1858, t. I, p. 414; Gr., p. 378,1. 8-9.
60. Le capital, t. 2, p. 19 et n. 4; trad. Lefebvre, p. 367 et n. 13; MEW 23, p. 346 et n. 13.
61. L. Ruge de mai 1843, Correspondance, t. I, p. 292; MEW l, p. 339.
62. Cf. note 58 ci-dessus.
63. La politique, L. I, ch. II, ~
10, 1253 a 7 (trad. Aubonnet, p. 15).
64. Sixime thse sur Feuerbach, L'idologie (1968) p. 33; (1976) p. 3; (bil.) pp. 28-29; MEW
3, p. 6.
65. L'ditorial du
n
179 de la Gazette de Cologne", Sur la religion, p. 39; MEW l, p. 103.
66. Sur ce point, on consultera l'intressante Introduction" de J. Aubonnet La politique
d'Aristote (d. Les Belle Lettres, t. I). En particulier, sur Aristote historien du droit constitution-
nel et du droit politique, cf. ibid., pp. XLIV-XLVIII, LlX-LXI, LXXXII-LXXXVII.
67. Contribution, p. 28; MEW 13, p. 36.
68. Marx renvoie De Republica, Opera, Bekkeri Oxonii, 1837, vol. X, p. 14.
-
On lit dans
la traduction de La politique par Aubonnet (L. I, chap. IX,
~
5, 1257 b 20; t. l, p. 27): Dans la
premire forme de communaut, la famille, il est clair que l'change est inutile; sa ncessit
n'apparat qu'avec l'extension de la communaut."
.
69. Ibid., L. I, ch. 8,
~ 4 et suiv. (trad. Aubonnet, pp. 24 et suiv.).
70. Les diteurs des Grundrisse le suggrent, puisqu'ils renvoient en note ce chapitre de La
politique (cf. Grundrisse, p. 1014, note pour les pages 375-376). Ce renvoi est repris dans la
traduction de M. Dangeville (Fondements, t. I, p. 511, note 197). La traduction du texte aux
ditions sociales est bien meilleure; malheureusement, elle ne reproduit pas le prcieux appareil
de notes des diteurs allemands, que donne par contre M. Dangeville!
71. Article sur la politique coloniale anglaise aux Indes, paru le 20 juillet 1853 dans le New
York Daily Tribune (Tribune quotidienne de New-York) (MEW, t. 9, p. 180. Trad. par nous).
72. La politique, L. I, ch. 4 7 (trad. Aubonnet, p. 17 et suiv.). Il s'agissait pour Aristote de
comprendre l'esclavage, en lui trouvant un fondement nature!.
73. Ibid., 1257 a 5-22 (trad. Aubonnet, p. 27). Cit in Contribution, p. 7, n. I; MEW 13, p. IS,
note.
74. Les deux premiers chapitres du Capital reprennent en substance La contribution.
75. Marx la cite plusieurs fois, preuve qu'il tenait marquer la perspicacit d'Aristote sur ce
point fondamental de la thorie conomique: Contribution, pp. 7 et 20; MEW 13, pp. 15 et 28. Le
capital, t. I, p. 96, n. I; trad. Lefebvre, p. 97, n. 39; MEW 3, p. 100, n. 39 et 20; MEW 13, pp. 15
et 28. Le capital, t. I>
p. 96, n. I; trad. Lefebvre, p. 97, n. 39; MEW 23, p. 100, n. 39.
76. Kritische Geschichte der NationalOkonomie und des Socialismus, Berlin, 1871 et 1875.
77. Cit in Anti-Dhring, p. 262 (chap. crit par Marx); MEW 20, pp. 213-214.
78. Ibid., p. 262; MEW 20, p. 213.
79. En particulier, Marx a tudi les conceptions de la division du travail dans la cit
dveloppes par Xnophon et par Platon. Ce qui le frappe, c'est que, pour les Grecs, la division
du travail est justifie dans la mesure o elle permet de fournir des produits de meilleure qualit.
Marx souligne que Xnophon fut le seul thoricien grec qui ait anticip sur les analyses modernes
en faisant ressortir le gain de temps qu'elle permet de raliser (cf. Manuscrits de 1861-1863, (Cahier
IV), pp. 293-300; MEGA 11/3.1, pp. 255-259).
80. Anti-Dhring, p. 264; MEW 20, p. 215.
-
E. Dhring y est vertement fustig pour avoir
crit: Mais que savait de ce rle [du capital-argent] un Aristote?" (cit par Marx, ibid.).
81. Contribution, p. lOI, n. I in fine; MEW 13, p. IlS.
-
Repris dans Le capital, t. I, p. 156,
n. I et p. 167; trad. Lefebvre, p. 172, n. 6, et p. 185; MEW 23, pp. 167, n. 6, et p. 179.
-
Dans
les formules A-M-A" et M-A-M", A" figure l'argent et M" la marchandise. Chrmatisti-
que" vient de <<TXPrlIlU'W"
qui signifie <<les biens, les richesses, l'avoir."
82. Thories, t. III, p. 626; MEW 26.3, p. 522.
-
Cela se retrouve plus loin (ibid., p. 629;
p. 524), dans des extraits de lecture de Luther par Marx, Luther mentionnant cette opinion
d'Aristote.
83. Anti-Dhring, p. 264; MEW 20, p. 215.
-
Allusion l'thique Nicomaque, L. V, ch. 8,
1133 b 17: La monnaie, ds lors, jouant le rle de mesure [...]" (trad. Tricot, p. 244).
-
Les
cahiers de lecture de Marx contiennent des extraits de l'thique Nicomaque, relevs en fvrier et
mars 1858.
84. thique Nicomaque, 1133 a 28-29 (trad. Tricot, p. 242).
85. Ibid., 1133 b 12-13 (trad. Tricot, p. 244).
86. Il est donc indispensable que tous les biens soient mesurs au moyen d'un unique talon
LA POSSIBILIT RELLE 363
[...]. Cet talon, n'est autre, en ralit, que le besoin, qui est le lien universel>, (ibid., 1133 a 25-26
(trad. Tricot, p. 242. Ces pages d'Aristote donnent lieu plusieurs citations de Marx
(cf. Contribution, p. 42, n. 1; MEW 13, p. 52, note).
- Sur l'argent en tant que gage social",
cf. galement, Manuscrits de 1857-1858, t. l, p. 96, n. 66; Gr., p. 78, I. 14; et Le capital, t. 1, p. 73;
MEW 23,
J'p.
73-74.
87. Ethique Nicomilque, 1133 b 19-20 (trad. Tricot, pp. 244-245).
88. Cf. Fragment de la version primitive de la Contribution la critique de l'conomie
politi5lue", Contribution, p. 209; Gr., p. 900. - Marx ne donne pas de rfrence. Il s'agit toujours
de l'Ethique Nicomaque: La monnaie il est vrai, est soumise aux mmes fluctuations que les
autres marchandises (car elle n'a pas toujours un gal pouvoir d'achat); elle tend toutefois une
plus grande stabilit. De l vient que toutes les marchandises doivent tre pralablement estimes
en argent, car de cette faon il y aura toujours possibilit d'change." (L. 5, chf. 8;
9
14, 1113 b
12-15; trad. Tricot, p. 244.)
89. Contribution, p. 84, n. 3; MEW t. 13, pp. 96-97.
90. Marx (ibid., n. 2) cite Platon (cf. La rpublique, L. II, ch. XII, 371 b 9, in uvres, trad.
Chambry, t. VI, p. 69. M. Chambry a traduit en disant que la monnaie est signe de la valeur des
objets changs ,,). Marx indique: Voir aussi le livre V de ses Lois.
"
91. Contribution, p. 84, n. 3; MEW 13, p. 96.
92. Le capital, t. 1, pp. 92-93, n. 1; trad. Lefebvre, p. 93, n. 33; MEW 23, p. 96, n. 33.
93. L'expression est de lui (ibid., t. 2, p. 91; p. 458; p. 430). Il dsigne par l le fait que la
machine, dans les conditions capitalistes de la premire rvolution industrielle, conduisit
allonger la journe de travail, et non l'abrger. D'un autre ct, l'introduction des machines
engendre une population ouvrire surnumraire que Marx qualifie d'arme industrielle de
rserve", laquelle est improductive et pse sur le niveau des salaires.
94. Nous citons d'aprs Le capital (trad. Lefebvre modifie, p. 458; ES, t. 2, p. 91; MEW 23,
p. 430).
-
Le texte diffre sensiblement de celui d'Aristote (cf. La politique, I. l, ch. IV, 1253 b 33
- 1254 a I; trad. Aubonnet, p. 17).
-
Le mot 1tpoatcrE>avoJlat (pressentiment) pourrait se
traduire aussi par prvision,,; il signifie: pressentir, comprendre ou tre inform d'avance, avoir
vent de.
-
Curieusement, Marx renvoie, non pas La politique, mais Die philosophie des
Aristoteles [La philosophie d'Aristote) de F. Biese (Berlin, 1842, t. II, p. 408). Cela est surprenant.
Habituellement, il cite directement Aristote, donnant parfois le texte grec. Partout ailleurs, dans
Le capital, nous l'avons vu, il renvoie La politique. Quel texte Biese donnait-il ici? Nous ne le
savons pas, n'ayant pas pu consulter cet ouvrage inconnu en France et certainement difficile
trouver. Dans son Apparat, la MEGA [II/5, p. 828] ne l'indique pas.
95. Machinisme et philosophie, 3e d., Paris, Presses Universitaires de France, 1969, p. 43 et
p. 110.
-
M. P.-M. SCHUHLse rfre l'dition Costes du Capital en franais (trad. Molitor).
96. En grec ancien, il n'y avait pas de terme correspondant notre mot travail" [sur cette
question, on consultera l'tude de M. Jean-Pierre Vernant (<< Le travail et la pense technique",
Mythe et pense chez les Grecs, t. II, Paris, Maspro, 1965, pp. 5-64).
97. La politique, 1253 b 28-29 (trad. Aubonnet, p. 17).
98. Ibid., 1253 b 29-32 (p. 17).
99. Ibi4., 1254 a 7-8 (p. 18).
100. Epargnez le bras qui fait tourner la meule, meunires, et dormez
Doucement! Que le coq s'poumonne vous avertir qu'il fait jour!
Do a impos aux nymphes le travail des filles,
Et les voil qui sautillent, lgres, sur les roues,
Et que les essieux branls tournent avec leurs rais,
Et que tourne le poids de la pierre roulante.
Vivons la vie de nos aeux et jouissons de l'oisivet
Des dons que la desse nous accorde.
"
Marx attribue, par erreur, ce pome Antipatros. En fait, il est d'Antiphilos de Byzance
(cf. MAGALAES- VILHENA, Essor scientifique et technique et obstacles sociaux la fin de
l'Antiquit", Les Cahiers du Centre de Recherches Marxistes, Paris, 1965, p. 31, n. 2, ronot, hors
commerce; cf. galement, P.-M. SCHUHL,op. cit., p. 44). S. S. PRAWERrvle que cette citation fut
procure Marx par Freiligrath, mais ne donne pas la source de cette information (sans doute la
correspondance de Freiligrath) (op. cit., p. 333). Il ne rectifie pas l'attribution de ces vers
Antipatros; la MEGA non plus (cf. II/5, App., p. 830).
101. L'tude des automates ne se dveloppe que chez Ctsibios, Philon de Byzance, Hron,
mcaniciens grecs de l'cole d'Alexandrie au me sicle avant notre re (cf. Bertrand Gille, Les
mcaniciens grecs, Paris, d. du Seuil, 1980, et Albert de Rochas, La science des philosophes et l'art
364 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
des thaumaturges dans ['Antiquit, Paris, Dorbon, s. d.; cet ouvrage contient les Penumatiques de
Hron d'Alexandrie, et d'autres textes de mcaniciens grecs).
- L'apparition du moulin eau
et ses premires conqutes se situeraient [...] dans le dernier sicle avant notre re et son berceau
dans l'Orient mditerranen (E. GILLE, Histoire des techniques, op. cit., p. 400).
102. D'ailleurs, toutes les formes d'esclavage ne trouvent pas grce aux yeux d'Aristote.
103. Marx dnonce les effets de <da machine entre les mains du capital: en mettant en
disponibilit les ouvriers qu'elle dplace, elle produit une population ouvrire surabondante qui
est force de se laisser dicter la loi. De l ce phnomne merveilleux dans l'histoire de l'industrie
moderne, que la machine renverse toutes les limites morales et naturelles de la journe de travail
[en l'allongeant dmesurment] (Le capital, t. 2, pp. 90-91; trad. Lefebvre, pp. 457-458; MEW23,
p. 430). C'est dans ce contexte que Marx cite le rve d'Aristote qui devient ralit chez
Antiphilos: Ah ces paens! s'exclame-t-il, ils ne comprenaient point [...] qu'il n'y a rien
comme la machine pour faire prolonger la journe de travaiL Ils excusaient l'esclavage des uns
parce qu'il tait la condition du dveloppement intgral des autres (ibid.).
104. MARX, Notes critiques sur le Trait d'conomie politique d'Adolph Wagner (1880)
",
in
uvres (d. Rubel), t. 2, p. 1534; MEW 19, p. 359). Ces notes datent de la seconde moiti de 1880.
Marx cite la page 45 de la 2c d. du Trait de A. Wagner paru en 1879.
105. Ibid.
106. Les rfrences aux uvres d'Aristote sont trs nombreuses dans la Dissertation doctorale
de Marx, ainsi que dans ses Cahiers prparatoires.
107. Cf. Engels, Dialectique, pp. 189-191; MEW 20, pp. 461~462.
-
Il s'agit de trois grands
feuillets, de la main de Marx, avec citations en grec, tires de Diogne Larce et de la Mtaphysique
(d. Tauschnitz). Ces feuillets font partie des Notes et Fragments. Ils sont classs dans la
section: lments d'histoire de la science. Comme les Penses de Pascal, les matriaux pour la
Dialectique de la nature sont rests dans un tat d'laboration trs fragmentaire. Une reconstruc-
tion de l'uvre projete, enrichie de quelques autres textes pris dans l'uvre de Marx et d'Engels,
a t donne par M. B. M. Kedrov: Friedrich Engels ber die Dialektik der Naturwissenschaft
[Frdric Engels sur la dialectique de la science de la nature], Berlin, 1979 (d. originale russe,
Moscou, 1973). Cette dition chrestomatique mriterait d'tre traduite en franais.
108. Cf. Dialectique, p. 50; MEW 20, p. 331; d; Kedrov, p. 57. - Il s'agit d'un texte d'Engels
connu sous le nom d'Ancenne prface de l'Anti-Dhring sur la dialectique.
109. Mtaphysique, L. IX, ch. 2, 1054 a 9-11 (d. Tricot, p. 540). Nous avons suivi la
traduction de Tricot, plutt que celle de E. Bottigelli, faite sur l'allemand et que voici: Donc il
est clair que dans tout genre [de choses] ['un reprsente par lui-mme une nature dtermine et que
pour toute chose cet un lui-mme est la nature de celle-ci (Dialectique, p. 191; MEW 20, p. 462;
d. Kedrov, p. 47). Cette traduction, omettant le mot ou1)Eva, laisse tomber la tournure ngative
de l'affirmation d'Aristote. Les mots entre crochets carrs sont un ajout de l'diteur franais.
110. Diffrence, pp. 244-245; MEW EB l, p. 282. Trad. modifie.
Ill. Ibid., p. 223; p. 270.
112. Karl Marx on Greek Atomism , Classical Quartely, voL XXII, 1928, p. 205; trad. par
nous. - En effet, l'on ne disposait pas encore des grands travaux d9xographiques de Diels sur les
Fragments des Prsocratiques et d'Uesener sur les textes picuriens. Evidemment, dit Bailey, il faut
faire la part du vocabulaire hglien et de la manire hglienne adopts par le jeune Marx dans
son interprtation de !'atomistique antique, ce qui ne retirait rien son mrite: Marx avait ralis
l un vritable exploit. - C'est au Lyce et surtout l'poque de ses travaux philosophiques
d'tudiant, que Marx a pris l'habitude de pratiquer les Apciens dans le texte. Mais, il continuera
de le faire, parfois dans des moments difficiles de sa vie. Epuis et malade, il dit relire Thucydide,
par dlassement: Pour mettre fin la grande contrarit que j'prouve au sujet de ma situation
incertaine tous gards, je lis Thucydide. Ces Anciens au moins restent toujours modernes (L.
Lassalle du 29 mai 1861, Correspondance, t. VI, p. 335; MEW 30, p. 606.). Dans ses notes de
lecture et ses citations de Platon, d'Aristote, de Thycydide, de Xnophon, d'Hraclite ou
d'Homre, les extraits sont souvent en grec dans son texte (cf. par exemple, Le capital, t. I, pp. 73,
114, 156; trad. Lefebvre, pp. 67-68, ( sa p. 119, M. Lefebvre ne donne pas le texte grec de la
citation), p. 172; MEW 23, pp. 73-74,120, 167; Manuscrits de 1861-1863, Cahiers I V, pp. 292-
298; MEGA 11/3.1, pp. 254-258; etc.).
113. Cf. Franois Rrccr, Structure logique du paragraphe I du Capita! , in La logique de
Marx, ouvr. collectif, sous la dir. de J. D'Hondt, Paris, Presses Universitaires de France, 1974,
pp. 105-133.
114. La MvaJ.tt est, chez Aristote, la disposition [Anlage], l'en-soi, l'lment objectif. [...]
L'essence est seulement en soi, seulement possibilit. (Hegel, Leons..., p. 519) - L'en-soi,
LA POSSIBILIT RELLE
365
l'objet est seulement la OiJVI.Il, le possible. (Ibid., p. 531. Nous avons dj renvoy aussi La
raison dans l'histoire: cf. ci-dessus, p. 25, n. 25, et p. 279, n. 51).
IlS. Il avait les uvres de Hegel sous les yeux. Dans L'idologie allemande (et ailleurs !), il
renvoie souvent aux uvres de Hegel, avec rfrences l'appui; il1>e servait de l'dition dite des
amis du dfunt", parue en 19 tomes de 1832 1837.
116. L'idologie (1968) p. 165; (1976) p. 131; MEW 3, p. 126.
117. Leons sur l'histoire dR la philosophie, t. 3, p. 583. L'examen de la psychologie d'Aristote
par Hegel s'tend sur une vingtaine de pages (cf. ibid., pp. 564-584).
118. La comparaison des interprtations respectives par Hegel et par Marx de cette ide
aristotlicienne de pense se pensant elle-mme serait des plus intressantes. Elle sort de notre
sujet. De plus, en ce qui concerne Marx, on en est malheureusement rduit des indications
allusives, sommaires et disperses sur Aristote. Mais la thorie raliste de la connaissance de Marx
est bien connue: la conscience, les reprsentations et les ides (la pense) sont dfinies comme
reflets et expressions du rel. Sa conception gnrale des rapports entre thorie et pratique devrait
servir de base l'tude d'un tel rapprochement. Nous ne pouvons qu'effleurer cette question ici.
Cette tude spcialise reste faire. Marx se rvlerait sans doute beaucoup plus proche d'Aristote
que de Hegel en matire de thorie de la connaissance. Les pages qui suivent donnent les raisons
du bien fond de cette hypothse.
119. Depuis la fin du Moyen Age, il n'y eut que deux grands aristotliciens, Leibniz et
Hegel" (Nikola Hartmann, Aristoteles und Hegel, Die Philosophie des deutschen Idealismus,
2e d., Berlin/Leipzig, De Gruyter, 1929, p. 216; trad. par nous).
120. Diffrence, pp. 207-208; MEW EB I, p. 262.
121. M. Pierre Aubenque (op. cit., p. 335 et suiv.) expose le caractre original et neuf de la
thologie aristotlicienne qui est une thologie savante, la thologie astrale [...], seule fondement
possible d'une thologie scientifique , qui se confond avec l'astronomie.
122. M. Aubenque explique qu'Aristote ne manque pas une occasion de prendre ses
distances l'gard des anciens" thologiens" (ibid., p. 337, n. 4). Par opposition la thologie
archasante de ceux qu'Aristote appelle avec une nuance de mpris, les thologues", qui ne fait
rien d'autre que d'habiller de dehors tragiques et solennels une cosmogonie balbutiante, la
thologie astrale apparat incontestablement comme la doctrine du jour, le nouveau cours
imprim la spculation thologique" (ibid., pp. 336-337, avec rfrence aux Mtorologiques (II,
1,353 b 2) o Aristote distingue thologiens, qui a pour lui un sens pjoratif, et thologi-
Cens. M. Aubenque donne aussi des rfrences dans la Mtaphysique).
123. L'ditorial du na 179 de la "Gazette de Cologne"", in Sur la religion, p. 22; MEW l,
p. 91.
-
Cet article parut dans la Rheinische Zeitung [Gazette rhnane] le 10 juillet 1842.
124. Diffrence, p. 132, 2e cahier prparatoire; MEW EB l, p. 74.
-
L'dition MEGA
(t. IV/l, Apparat, p. 707), contrairement son habitude, ne donne aucune note ni rfrence
Aristote ce sujet.
-
M. Aubenque souligne que .des astres-dieux prennent, chez lui [Aristote],
la place des Ides platoniciennes , indiquant que ce point a t bien mis en lumire par
Festugire (op. cit., p. 337). Longtemps avant Festugire, Marx l'avait bien vu.
125. Qui ne se souviendra [...] du passage plein d'enthousiasme d'Aristote, le plus grand des
philosophes antiques, dans son trait Ilspi 'fij qllJusOJOJIICfj:' [Sur la nature des animaux] [...]
qui rend un tout autre son que la monotonie dgrise d'Epicure! (Diffrence, 2e cahier
prparatoire, p. 123; MEWEB l, p. 60.
-
On ne connat pas de trait d'Aristote portant ce titre.
Marx fait erreur. Il s'agit du Trait sur les parties des animaux (le passage cit est en 645 a 5-6; trad.
Le Blond, p. 119. Rectification de titre d'aprs MEW EB l, p. 662, n. 11, et MEGA IV/l, App.,
p. 705, note de la page 30, ligne 7).
126. Diffrence, p. 183; MEW EB I, p. 224; MEGA IV/I, p. 104,1. 20. Trad. modifie.
-
(Avec indication par Marx du mme titre erron de Trait aristotlicien que dans la note
prcdente. )
127. L'ditorial du
n
179 de la "Gazette de Cologne"", in Sur la religion, p. 39; MEW l,
p. 103. (Passage dj cit ci-dessus, p. 328, n. 65.)
- Pour laborer ses conceptions politi51ues,
Aristote tudia cent cinquante-huit constitutions (cf. AUBENQuE,op. cit., p. 629). D'aprs Emile
Brhier, il procdait moins par constructions thoriques" que par multiplication des observa-
tions et des enqutes historiques approfondies" (Histoire de la philosophie, Paris, Presses
Universitaires de France, 1951, t. 1, fasc. l, p. 251).
128. Si Marx avait connu le mot de Pic de La Mirandole: Sans Thomas, Aristote serait
muet" (cit par M. Aubenque, op. ciL, Exergue, p. I), il en aurait pris le contrepied.
129. On pourrait reprendre ici une formule de Marx selon laquelle: Descartes fit prir la
philosophie grecque dans le doute universe)" (Diffrence, p. 123; MEW EB l, p. 58).
366 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
130. Diffrence, p. 185; MEW EB l, p. 226.
-
La traduction franaise de la Dissertation
laisse encore plus dsirer que celle des autres uvres de Marx! C'est le cas ici, o M. Ponnier
traduit: Aristote dit que crer des mythes, c'est crer des sentences [Aristoteles nennt daher das
Mythologisieren Kenologisieren]. Voici la phrase complte de la Mtaphysique o figure ce mot
d'Aristote: Quant dire que les Ides sont des paradigmes et que les autres choses participent
d'elles, c'est se payer de mots vides de sens et faire des mtaphores potiques (Mtaphysique, A,
9,991 a 20-22; trad. Tricot, pp. 87-88; mme texte en M, 5, 1079 b 24-26; trad. Tricot, pp. 739-
740). M. Rubel se tire d'affaire par un nologisme: Aristote appelle l'art de mythologiser:
"knologiser" [uvres (d. Rubel), t. III, p. 850].
-
Hegel avait relev cette critique acre de
Platon par Aristote (Leons..., t. 3, pp. 520-521).
131. L'idalisme hglien lui fit d'abord l'effet d'un grotesque chant de sirnes (1. de
Marx son pre, 10 novo 1837; Correspondance, 1. l, p. 35; MEWEB l, p. 8).
132. Lors de ses lectures, qui furent toujours trs nombreuses, Marx prenait des notes,
souvent abondantes. Mais ces extraits relevs au fil de la plume, plus ou moins truffs de
remarques et commentaires critiques, qui se dveloppaient parfois pour eux-mmes, n'allaient
jamais jusqu' constituer, sauf dans le cas de deux uvres d'Aristote, une traduction du texte
tudi.
133. Lettre du 10 novo 1837, Correspondance, t. l, p. 36; MEW EB l, p. 9.
-
Quant cette
traduction de la Rhtorique, on ne peut rien en dire faute d'une trace quelconque dans ce qui nous
est parvenu des travaux et essais littraires du jeune Marx. Auguste CORNU(op. cit., 1. l, pp. 92-
102) analyse cette lettre, mais ne mentionne pas cette traduction de la Rhtorique.
134. De l'me est le titre consacr: ce trait a pour objet les fonctions psychiques. La
traduction de Marx est justalinaire; dense, rapidement faite, semble-t-il. Quelques rares
remarques y sont insres. Cette traduction couvre le Livre III, et le dbut du livre I. Un cahier
d'extraits du Livre 2 est perdu. Marx utilisa vraisemblablement l'dition d'Isaac Casaubon
(Genve, 1604) avec traduction latine en regard.
-
Cette traduction partielle, par Marx, du trait
De l'me en allemand est accessible depuis 1976 dans un volume de la nouvelle MEGA (t. IV/l,
pp. 155-182, et Apparat, pp. 733-750). Elle fut faite dans le cadre de la prparation de l'examen
que Marx s'attendait devoir subir lors de sa soutenance de Thse. Bruno Bauer lui avait crit
qu'il fallait travailler Aristote, Spinoza et Leibniz. On possde aussi les extraits des lectures de
Spinoza et Leibniz que fit Marx cette occasion. Le jury de la Facult de Philosophie d'Ina lui
dcerna le titre de docteur trs vite, sans qu'il ft prsent, au vu de sa seule Dissertation doctorale.
(Sur les conditions dans lesquelles Marx fut amen soumettre sa Dissertation l'Universit de
Ina et non celle de Berlin, cf. IRMSCHER,op. cit., et nos brves indications, ci-dessus, pp. 29,
n. 34, et pp. 360-361, n. 41.)
135. Cette dition grco-latine tait accompagne d'un commentaire.
136. Marx fit ses tudes universitaires Bonn en 1836-1837, puis Berlin de 1837 1841, o
il put suivre des cours d'Eduart Gans, le disciple saint-simonien de Hegel, que Hegel lui-mme
considra comme celui qui l'avait le mieux compris. Pour un tableau du contexte politique et des
polmiques philosophiques et religieuses cette poque, nous renvoyons l'uvre monumentale
inacheve d'Auguste CORNU(op. cit., 4 volumes parus). Toute biographie de Marx en donne
galement des lments (cf., entre autres, Mehring, op. cit.; Boris NIKOLAEVSKYet Otto
MAENSCHEN,Karl Marx, Paris, Gallimard, nouv. d. augm., 1970; P. FDossEv et alii, Karl
Marx. sa vie, son uvre, Moscou, d. du progrs, 1973.
137. Ainsi, Christian August BRANDIS(Handbuch der Geschichte der Griechisch-Romischen
Philosophie [Manuel d'histoire de la philosophie grecque et romaine], Berlin, Reimer, 3 t. en
5 vol.), et Heinrich RITTER(Geschichte der Philosophie alter Zeit, I. Teil [Histoire de la philosophie
ancienne, 1repartie], Hambourg, 1829), comme l'indiquent les diteurs de la MEGA (t. 1/1, App.,
p. 934). Marx se servit de l'Histoire... de Ritter pour sa Thse. Signalons qu' la mme poque (
partir de 1831) paraissait la grande dition des uvres d'Aristote par I. Bekker, qui est la rfrence
des aristotlisants jusqu' aujourd'hui (cf. P. AUBENQUE, op. cit.). C'est celle qu'utilisa Marx pour
ses citations de l'Ethique Nicomaque, et du De republica [La politique], parues dans les t. IX et
X en 1837.
138. MEGA, III/l, p. 354. Trad. par nous.
-
Cette dition procure les lettres des
correspondants de Marx et Engels, ce qui est une nouveaut trs apprciable dans l'dition de leur
correspondance.
139. Ibid., p. 361.
-
Marx rend hommage son ami et jeune hglien, Koppen, en le citant
trs logieusement dans l'Avant-Propos rdig en vue de la publication de sa Thse. Koppen avait
un grand talent d'historien: il venait de se faire connatre par un essai sur Frdric le Grand.
140. Ce livre de Trendelenburg figurait dans la bibliothque de Marx, dont il nous est
LA POSSIBILIT RELLE 367
parvenu un catalogue tabli dans les annes 1850 par son ami Roland Daniels (cf. Ex Libris, Karl
Marx, Friedrich Engels).
141. Hegel, Leons..., t. III, p. 577.
142. Ibid., p. 583.
143. Cf. ci-dessus, p. 337.
144. Avec le titre de Docteur en philosophie, il obtenait le droit d'enseigner et esprait
rapidement rejoindre Bruno Bauer l'Universit de Bonn comme Privat Dozent. Mais l'exclusion
de Bauer de l'Universit sur intervention du nouveau Ministre de l'ducation et des Cultes, en mai
1840, mit rapidement fin tout espoir de Marx de ce ct.
145. Moses Hess crivit en 1841 un ami, que Marx joint l'esprit le plus profond et le plus
srieux l'ironie la plus mordante; reprsente-toi Rousseau, Voltaire, Holbach, Lessing, Heine et
Hegel, je ne dis pas rassembl, mais confondus dans une seule personne . (Cit par FDossEV et
al., op. cit., p. 26).
146. Les diteurs le placent dans la Dissertation doctorale, comme faisant partie des notes
d'un chapitre perdu; ainsi la MEW et la MEGA le donnent comme note 2 du chapitre IV de la
premire partie. M. Ponnier suit les MEW, alors que J. Molitor (uvres philosophiques, vol. l,
pp. 51-54) le donne en Annexe sous le titre Fragments, ce qui semble plus logique.
147. Diffrence, pp. 236-237; MEW EB l, p. 330. Trad. modifie. (Cf. galement, MARX,
uvres philosophiques, 1. I, pp. 53-54.) Aucune de ces ditions ne donne de notes explicatives.
M. Rubel pense que le dbut de ce passage vise l'cole de pense [...] de la philosophie naturel1e
de Schelling dont les doctrines sotriques, voire occultistes, se couvraient de l'autorit
d'Aristote (MARX, uvres (d. Rubel), t. III, p. 1516, n. 1 de p. 87, in fine). M. Rubel (ibid.)
donne aussi quelques claircissements, emprunts la MEGA [to Ill, Apparat, p. 951], sur
l'allusion l'homo maximus, incarnation de l'univers des esprits, du mystique sudois Sweden-
borg.
148. Les commentateurs d'Aristote s'interrogent toujours sur la question de savoir s'il
y
a
pour lui une transcendance, en particulier en ce qui concerne l'intel1ect agent et le Premier moteur
(sur ce dernier point, cf. P. Aubenque, op. cit., pp. 335 et suiv.).
149. Les diteurs de la nouvelle MEGA (t. 1/1, pp. 69-70; App., pp. 950-951, n. 69.28-704,
avec rfrence aux Recherches logiques, vol. 1/2, pp. 8-10) expliquent que Trendelenburg prnait
un retour aux vues finalistes d'Aristote en se fondant sur la correspondance entre fin et moyen
dans les organes des animaux. Trendelenburg prenait comme exemple les formes des parties du
pied des carnivores: doigts, ongles, ligaments, muscles, etc.
150. Diffrence, pp. 236-237; MEW EB I, p. 330.
151. Il entrera dans la bataille politique, en devenant journaliste. Sur le plan philosophique,
outre Hegel, c'est avec Feuerbach, Bauer, Stirner et Proudhon qu'il polmiquera. C'est l qu'il
faut chercher la suite de ce projet de 1841, bien qu'en dehors de travaux journalistiques
alimentaires il se soit essentiel1ement consacr l'conomie politique, la politique et l'histoire.
152. MEGA, t. IV/I, p. 164,1. 32-38. Trad. par nous.
153. La doctrine de la vrit compositio (composition) fut trs importante dans toute la
philosophie scolastique. Remarquons que compositio est la traduction latine du grec cruvEh:cn
(synthse), et que la proposition spculative hglienne s'inspire d la thse qu'Aristote dveloppe
la suite de Platon (Le sophiste, 261d et suiv.) selon laquel1e le jugement consiste en une synthse
de dterminations opposes.
154. La vrit ou l'erreur dpend, du ct des objets, de leur union ou de leur sparation,
de sorte que tre dans le vrai, c'est penser que ce qui est spar est spar et que ce qui est uni est
uni [...]. (Mtaphysique, IX, 10, 1051 b 3-4; trad. Tricot modifie, p. 522. .:...-Cf. aussi Organon,
L. I, Les catgories, et L. II, De l'interprtation, passim).
155. Cette opposition entre deux Aristote est souligne par M. Aubenque qui crit: On ne
s'est pas suffisamment interrog sur le fait [n.] que le Lyce, hritier de la pense du Matre, ne
crut pas lui tre infidle en versant dans le probabilisme et le scepticisme qui taient les siens
l'poque de Cicron, et qui conclut: L'opposition de l'Aristote du Lyce et de l'Aristote du
commentaire laisse l'interprte, et lui seul, la responsabilit de redcouvrir l'Aristote effectif
(op. cit., p. 16). Marx, sans doute mieux encore que Hegel, n'avait-il pas redcouvert cet Aristote
effectif? Redcouverte reste ignore et inaperue, Marx n'ayant pu faire uvre de philosophe,
ni d'historien de la philosophie, puisque les jeunes hgliens et l'hglianisme en gnral furent
bannis des Universits al1emandes aprs 1841.
156. Science de la logique, trad. Labarrire-Jarczyk, t. II, pp. 256-258.
157. Mtaphysique, IX, 3 (trad. Tricot, p. 488 et suiv.).
158. Chez Hegel aussi, il ya tendance la systmaticit logique. Marx ragit contre elle.
368 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
158. De l'interprtation, ch. 9, 18 b 24-25 (trad. Tricot, p. 99).
159. Nous l'avons dj soulign, contingence est un terme ambigu. En philosophie, il
voque l'absence de cause, ce qu'Aristote ne dit pas du tout, mme des accidents. A. RIVAUD
l'affirme pourtant: l'accident est ce qui apparat et disparat absolument sans cause (le
problme du devenir et la notion de matire dans la philosophie grecque, depuis les origines jusqu'
Thophraste, Paris, 1906, p. 417). Le texte cit l'appui n'est pas convaincant. Contre cette
interprtation, cf., entre autres, R. SORAHJI,Necessity, Cause and Blame: Perspectives on Aristotle's
Theory [Ncessit, cause et responsabilit: Perspectives sur la thorie d'Aristote, Londres,
Duckworth, 1980]. Le terme contingence vient des plus anciennes traductions et commentaires
latins (surtout de Boce, utilisant lui-mme la traduction du Pri Hermnias par Victorin us).
A. BECKER-FREYSENG, dans une tude historico-philologique trs fouille, a montr que tre
contingent (contingere) traduit, dans les mmes pages, tantt VoXECTBal (tre possible), tantt
CTvjJ{3aivElv(arriver): cela trouble tout et [le texte] devient extravagant (op. cit., p. 16, n. 26).
Le verbe latin contingere, dans son vieux sens de accidere, evenire, convient parfaitement pour
rendre crUI!~aivElv. Mais VXEcrBalet crUI!~aiVElvdsignent, d'une manire gnrale, tre
possible et possible dans leurs diffrents sens. Chez Aristote, la thorie des modes, et en
particulier des modes de la possibilit, est trs complexe. M. G.-G. GRANGERY a consacr une
tude trs intressante (La thorie aristotlicienne de la science, Paris, Aubier, 1976, p. 179 et
suiv.): il met en uvre la smantique logique contemporaine, qui tente d'introduire quelque clart
dans les textes aristotliciens. Quant Becker-Freyseng, il rapporte les avatars des termes
d'Aristote qui, traduits en latin, conduisent des confusions inextricables. Chez Aristote lui-
mme, VXEcrE>al revtait plusieurs sens (doctrine des acceptions multiples). Au sens large, le
possible comprend le ncessaire (Premiers analytiques, 1,3,25 a 38 et 25 b 4); au sens troit (non
quivoque), et que Becker-Freyseng appelle la possibilit bilatrale ou symtrique , il
comprend tout ce qui n'est ni ncessaire, ni impossible. Becker-Freyseng tablit que c'est
seulement pour la thorie du syllogisme qu'Aristote retient ce sens troit: dans tous les autres
contextes, VXEcrE>al, comme uva'[ov, a le sens large de possible (op. cit., p. 69). C'est le sens
dans lequel il apparat dans ses trois occurrences du chapitre 9 du De l'interprtation, et de mme
au chapitre 13. Contingent signifiant couramment en franais, comme le contingens latin, ce
qui arrive de faon accidentelle (au sens tymologique d' accident>,) ne convient pas pour
traduire le mot VEX0I!EVOV, ce que font pourtant traditionnellement les traductions. Tournant
la difficult, certains commentateurs disent que VEX0I!EVOV signifie le possible <<logique,
l'opposant uva'[ov qui serait le possible ontologique (H. BONITZ, Index Aristotelicum, in
Aristotelis Opera, d. de l'Acad. de Berlin, dited. Bekker, vol. V, 1870; GRANGER,op. cit., p. 216
et suiv.). M. Tricot, s'autorisant d'Hamelin et de Ross, s'lve contre cette tentative: il n'y a, en
ralit, aucune distinction entre ces deux notions (cf. ARISTOTE,Mtaphysique, p. 287, n. 4;
rpt dans les Premiers analytiques, p. 10, n. 5). Le dsaccord des commentateurs montre que
rgne ici la plus grande confusion. A notre avis, il conviendrait, si l'usage cOI)~\lcrne s'y opposait,
de parler des futurs possibles plutt que des futurs contingents . Il est hors de doute
qu'Aristote n'a pas voulu soutenir que la bataille navale arrivera accidentellement. Lorsqu'il
crit que, dans l'un des sens du mot: les choses sont dites possibles (VXEcrE>at) parce qu'elles
arrivent le plus souvent et de faon naturelle ('[0 7tEqJuKvat)>> (Premiers analytiques, 25 b 14),
parler de contingence dans ce cas (cf. trad. Tricot, p. 11), quelle que soit la dfinition nominale
qu'on en donne, est particulirement fcheux, car c'est exactement la dfinition de uva'[ov (en
puissance) !
161. Encyclopdie,
9
194, Addition l, trad. Bourgeois, p. 609.
-
Ce passage est relev par
Marx (cf. Le capital, 1re d. ail., MEGA II/S, p. 31, n. 196; cette note a disparu des ditions
ultrieures, Marx ayant remani tout le 1erchap. du Capital).
162. Ce fut la thse soutenue par Georg Lukacs en 1922, en particulier dans le texte intitul:
La conscience de classe.. (op. cit., pp. 67-107).
163. Hegel avoue lui-mme, la fin de la Philosophie de l'histoire, qu'il "examine la seule
progression du Concept", et qu'il a expos dans l'histoire la "vritable thodice" , fait observer
Marx (L'idologie (1968) p. 78; (1976) p. 47; (hil.) pp. 152-153; MEW 3, pp. 48-49).
164. A vrai dire, dans l'histoire passe, c'est aussi un fait parfaitement empirique qu'avec
l'extension de l'activit au plan de l'histoire universelle, les individus ont t de plus en plus
asservis une puissance qui leur est trangre
-
oppression qu'ils prenaient pour une tracasserie
de ce qu'on appelle l'Esprit du monde -, une puissance qui est devenue de plus en plus massive
et se rvle en dernire instant tre le march mondial. (Ibid. (1968) p. 66-67; (1976) pp. 35-36;
(bil.) pp. 118-119; MEW3, p. 37.)
165. Risquons une analogie que suggre rtrospectivement l'histoire des ides scientifiques:
LA POSSIBILIT RELLE
369
entre le systme ferm (fermeture logique) du Concept (Begriff) hglien et le systme ouvert de
la praxis marxienne, il
y
a la mme diffrence qu'entre la dynamique classique et la thermo-
dynamique des structures dissipatives de Prigogine: des dveloppements nouveaux, loin du pass
et du connu, sont possibles (cf. I. PRIGOGINE et I. STENGERS, La nouvelle alliance, Paris,
Gallimard, 1979).
166. On a pu se proposer de formaliser les oprations de la dialectique hglienne (cf.
M. KOSOK, The formalization of Hegel's Dialectical Logic (La formalisation de la logique
dialectique de Hegel), International Philosophical Quartely, vol. 6,
n
4, 1966; Y. GAUTHIER,
Logique hglienne et formalisation, Dialogue, vol. 6,
n
2, 1967; D. DUBARLEet A. Doz, Logique
et dialectique, Paris, Larousse, 1972).
-
Marx avait raill ce penchant de Hegel appliquer une
structure logique a uriori (ft-elle dialectique) aux objets de sa rflexion: il le montre propos de
la constitution de l'Etat, de la ncessit et de la nature du monarque, etc. (cf. Droit politique, p. 44;
MEW l, p. 210, et passim).
167. Phnomnologie (Prface), d. bil., pp. 47 et suiv. .
168. En allemand, on ne peut penser .ralit [Wirklichkeit] sans penser activit ou action
[Wirkung], Wirklichkeit contenant la racine wirken (agir). Le substantifWirkung signifie aussi bien
action qu' effet .
169. Phnomnologie, pp. 48-49.
170. UVClllla finalement un sens peu prs quivalent celui du mot <pUCIl [nature],
selon A. Faust (cit par Sesemann [op. cit. p. 164], trad. par nous); on en rapprochera ce que dit
M. Aubenque du concept de nature chez Aristote [op. cit, p. 422 et suiv.].
171. . Dans la mthode thorique il faut que le sujet, la socit, reste constamment prsent
l'esprit en tant que prsupposition. (Introduction, in Mthode, pp. 160-161; Contribution, p. 166;
tudes philosophiques, p. 104; MEW 13, p. 633; Gr., p. 122; soulign par nous.)
172. La libert absolue de l'Ide consiste en ce qu'elle [...] se rsout [einschliesst] laisser
librement aller hors d'elle-mme le moment de sa particularit [...]comme nature. (Encyclopdie,
~ 244, trad. Bourgeois, p. 463). - D'une autre faon que Marx, M. Bourgeois crit, propos de
cette manire spculative d'engendrer la nature partir de l'ide: . La tentation d'expliciter la
catgorie (rationnelle) de concept par la catgorie abstraite (relevant de l'entendement) de
fondement, que nous avons aperue chez Hegel lorsqu'il parle essentiellement du concept,
exprime peut-tre la difficult, sinon l'impossibilit, de saisir comme concept le rapport du logique
et du rel, de la pense et de l'tre. Nous touchons ici [...] un problme majeur
- le problme
peut-tre - pos par le hglianisme." (Ibid., Prsentation, p. 109) Cette difficult tait bien
connue des disciples et critiques de Hegel. Marx tente de fournir une explication sense des
formules nigmatiques dans lesquelles Hegel expose son idalisme absolu: .Toute cette Ide qui
se comporte d'une faon si trange et si baroque et propos de laquelle les hgliens se sont
terriblement cass la tte, n'est absolument rien d'autre que l'abstraction (c'est--dire le penseur
abstrait), [Ide qui] instruite par l'exprience et claire sur sa propre vrit, dcide [...] de
renoncer elle-mme, et se rsoud poser, la place de son [...] nant, de sa gnralit et de son
indtermination, son tre-autre, le particulier et le dtermin, laisser aller librement la nature hors
d'elle-mme, [...J contempler une bonne fois cette nature qu'elle a affranchi (Manuscrits de
1844, p. 146; MEWEB l, pp. 585-586; uvres (d. Rubel), 1.11, p. 139; Trad. modifie). Schelling
avait aussi attaqu ce point de la doctrine hglienne (cf. la citation ci-dessus, pp. 348-349,
rfrence n. 161).
173. Le capital, Postface la 20ded., Trad. Lefebvre, pp. 17-18; MEW23, p. 27.
174. Ibid.
175. Manuscrits de 1857-1858, 1. 1, p. 151; Gr., p. 125,1. 7-10. (Trad. modifie; deux mots
souligns par nous; accident est en franais (ou anglais?) dans le texte.)
176. .Vous vous abusez [...] si vous croyez que c'est le roi Louis-Philippe qui rgne, et il ne
s'abuse pas l-dessus. Il sait comme nous tous, qu'au-dessus de la Charte, il
y
a la sainte, la
vnre, la solide, l'aimable', la gracieuse, la belle, la noble, la jeune, la toute-puissante pice de
cent sous (La cousine Bette, in La comdie humaine, Genve, Ed. Rencontre, s. d., t. IX, p. 813.
- Ces propos sont placs dans la bouche de Crevel, maire de Paris).
177. Manuscrits de 1857-1858, 1. l, p. 160; Gr., p. 133. (Trad. modifie.)
178. Ibid., p. 242; p. 210.
-
Le lecteur peut vrifier ici que si .en soi signifie. en puissance
(OUVClIlEl), . pour soi signifie en acte [vP'YEtaJ.
179. Entre autres: John Francis Bray: Labour's wrongs and labour's remedy; or, the age of
might and the age of right, Leeds, 1839, p. 59. (Note de Marx) [Les maux du travail et leurs
rem.Nes, ou l're de la force et l're du droit. - Sur Bray et sa thorie de l'galit d'change, cf.
Misre, pp. 79-89; MEW 4, p. 98-105; ou Thories, t. III, p. 373 et suiv.J.
370 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
180. Ibid.; Gr., p. 211.
181. Manuscrits de 1844, p. 121-122; MEW EB I, p. 565.
-
Dans ce passage, Marx cite
Goethe (Faust) et Shakespeare (Timon d'Athnes). Il reprend cette dernire citation dans Le capital
(1. l, pp. 137-138, n. 4; trad. Lefebvre, p. 149, n. 91; MEW 23, p. 146, n. 91), ce qui montre que
sa conception de l'autonomisation de l'argent et de son devenir-sujet, n'a pas chang depuis 1844.
S. S. Prawer (op. cit. pp. 78 et suiv.) compare l'usage lgrement diffrent que Marx fait de ce
passage de Shakespeare dans ces deux ouvrages.
182. Manuscrits de 1857-1858, t. l, p. 243; Gr., pp. 212-213.
183. Manuscrits de 1844, pp. 72-73; MEW EBl, p. 524.
184. L'idologie (1968) p. 53; (1976) pp. 22-23; bi!., pp. 78-79. Trad. modifie. Ces lignes
figurent dans un passage retrouv en 1962, et que ne donne pas le troisime tome des Marx-Engels
Werke. Mais, on le trouve dans la MEGA, Editionsgrundsiitze und Probestcke, Berlin, Dietz, 1972,
p. 47. Ce Probeband (Volume-Essai) de la nouvelle MEGA, contient, entre autres, l'dition critique
de la
1"
Partie de L'idologie allemande (pp. 31-119, et apparat critique pp. 399-507). Destin une
diffusion prospective restreinte, il fut tir un trs petit nombre d'exemplaires. Grce l'amabilit
de M. Lucien Sve, nous avons pu le consulter.
185. Ibid.
186. Bauer pensait que le jeune Hegel avait t fichten. (Sur ce point, cf. J. ZELENY, Die
Wissenschaftlogik bei Marx und das Kapital [La logique de la science selon Marx et Le
capital], Berlin, Akademie Verlag, 1968, trad. all. de Bollhagen, pp. 242-244.)
187. C'est la premire des Thses sur Feuerbach (L'idologie (1968) p. 31; (1976) p. 1; d.
bil., pp. 24-25; MEW 3, p. 533).
188. Droit politique, p. 81; MEW l, pp. 240-241.
189. HEGEL, Principes de la philosophie du droit, 9 279, p. 310. (Note introduite par nous.)
190. Droit politique, p. 60; MEW l, p. 24.
191. Manuscrits de 1844, p. 90; MEW EB I, p. 539. Il ajoute: L'individu est l'tre social.
192. La Sainte Famille, p. 31; MEW 2, p. 22.
193. Cette ide est aussi au cur de la philosophie hglienne.
194. Il est noter que, mis part dans L'idologie allemande qui ne put tre publie par eux,
Marx et Engels ne critiqueront jamais publiquement la philosophie de Feuerbach. L'ouvrage
tardif d'Engels est autant un hommage au philosophe matrialiste qu'une critique, car c'est une
critique dialectique , que
l'on
peut comparer celle qu'ils ont faite de Hegel.
195. Avec la Critique du droit politique, c'est l'un des rares textes o Marx soumet la
dialectique spculative hglienne un examen dtaill. Il choisit les premires lignes du chapitre
terminal de la Phnomnologie de l'esprit: Le savoir absolu , qui contient un aperu abrg de
tout le dveloppement de l'ouvrage. La critique marxienne serait intressante analyser. Cela
dborde notre propos. Nous considrerons le seul point qui nous intresse ici. Parmi les
innombrables travaux sur les rapports de Marx Hegel, signalons: 1. ALTHUSSER, Pour Marx,
Paris, Maspro, 1966; 1. ALTHUSSER et al., Lire le Capital, Paris, Maspro, 2 1., 1966;
E. BOTTIGELLI, Gense du socialisme scientifique, Paris, d. soc., 1962; J.-Y. CALVEZ, op. cil.;
A. CORNU, op. cit.; J. D'HoNDT, De Hegel Marx, Paris, Presses Universitaires de France, 1972;
J. HYPPOLITE, tudes sur Marx et Hegel, Paris, Rivire, 2e d., 1965; S. MERCIER-JosA, Pour lire
Hegel et Marx, Paris, d. so., 1980; M. M. ROSENTHAL, Les problmes de la dialectique dans Le
capital de Marx, Moscou, Ed. en langues trangres, Paris, Ed. soc., 1959; J. ZELENY, op. cit.
196. Manuscrits de 1844, p. 132; MEWEB I, p. 574.
197. Ibid., pp. 132-133; ibid.
198. HEGEL, Phnomnologie, trad. Hyppolite, t. 2, p. 293.
-
M. Bernard Rousset traduit:
Ce sera l'extriorisation de la conscience de soi qui posera la chosit (cf. Hegel, Le savoir
absolu, p. 91).
199. Manuscrits de 1844, p. 136; MEWEB l, p. 577. (Trad. modifie.)
200. Une page plus haut, Marx a fait remarquer que pour Hegel, ce n'est pas l'homme rel
en tant que tel, que ce n'est donc pas la nature non plus qui devient sujet [...J, mais seulement
l'abstraction de l'homme, la conscience de soi [...] (ibid., p. 135; ibid.)
201. Ibid., p. 136; p. 577. Trad. modifie.
-
Nous avons mis l'expression <da terre solide et
bien ronde entre guillemets, car Marx fait allusion ici un pome de Goethe: Grenzen der
Menschheit [Les limites de l'homme]. Les diteurs des Marx Engels Werke ne signalent pas cette
allusion. S. S. PRAWER (op. cit., p. 76) relve le fait que Marx dforme la citation.
.
202. Manuscrits de 1844, p. 136; MEW EB I, p. 577. (Trad. modifie).
203. J. G. FICHTE, La thorie de la science, Expos de 1804, Paris, Aubier, 1967, pp. 80-81.
-
Il s'agit du premier principe, absolu, inconditionn, de la science humaine. Fichte poursuit:
LA POSSIBILIT RELLE 371
"Ce
qui agit et ce qui est produit par cette activit; l'agir [Handlung] et le faire [fat] sont une seule
et mme chose, et par suite le" Je suis" est l'expression d'une action [Tathandlung]...
204. Manuscrits de 1844, p. 147; MEW EB I, p. 587.
-
Ces mots sont rapprocher d'une
pigramme du jeune Marx jointe aux posies offertes son pre en 1837:
Kant und Fichte zurn Aether schweifen, Kant et Fichte errent volontiers dans l'ther
Suchten dort ein fernes Land, Y cherchent un pays lointain
Doch ich such' nur tchtig zu begreifen, Quant moi, je ne cherche qu' saisir pleinement
Was ich - auf der Strasse fand! Ce que
j'ai trouv - dans la rue!
MARX, Posies, in MEGA, Ill, p. 644. (Traduit par nous.)
205. Manuscrits de 1844, p. 136; MEW EB r, p. 578.
206. G. SIMONDON, Du mode d'existence des objets techniques, Paris, Aubier, 1969, p. 246.
Chapitre 8
LA TECHNIQUE
Quand le globe se retournera
comme un malade qui rve, et que
les mers deviendront des conti-
nents, les Franais de ce temps-l
trouveront au fond de notre ocan
actuel une machine vapeur, un
canon, un journal et une charte,
envelopps dans un bloc de corail.
BALZAC
L'homme, facteur subjectif de l'activit, ne serait rien sans les moyens et
facteurs objectifs de cette activit. C'est dans l'activit technique que les
possibilits qui sommeillent chez l'homme et dans la nature deviennent relles.
Car, la possibilit relle ne rside pas seulement dans l'activit des hommes,
c'est--dire dans leurs forces, ou capacits, naturelles ou acquises, mais aussi
dans tous les moyens qu'ils ont labors et dans les forces de la nature captes
et contrles par eux.
Les procds et moyens techniques ont ceci de spcifique qu'ils multi-
plient les possibilits. Ils leur ouvrent un champ largi. Depuis la premire
rvolution industrielle, les techniques sont nombreuses, raffines et souvent
trs complexes.
Marx fut l'un de ceux qui en eurent le plus conscience. Aussi a-t-il orient
ses recherches vers la technologie pour comprendre cette ouverture et ce qui,
dans la rvolution technique moderne, la fois dterminait et ouvrait
l'histoire. Son originalit, c'est d'avoir examin les liens qui unissaient
technique et conomie.
Ainsi, il s'est demand quel tait le vritable point de dpart du
machinisme. En effet, une invention locale, apparemment mineure, est
374 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
susceptible d'entraner de proche en proche une modification de tout le
systme technique et social. Une innovation technique simple peut tre la
source de possibilits historiques nouvelles. Marx a soutenu que la possibilit
du dpassement du capitalisme et de la socit de classes tait lie, non
seulement aux progrs du machinisme, mais aussi ceux de l'lectricit, de la
chimie, etc.
Les objets techniques constituent dont le fidle miroir des possibilits
relles. Ils sont ces possibilits ralises. M. Gilbert Simondon l'a bien
soulign:
L'objet technique devenu dtachable peut tre group avec d'autres
objets techniques selon tel ou tel montage I.
C'est ce qui fait du monde technique une disponibilit indfinie .
Dans les techniques, les conditions objectives et subjectives de la possibi-
lit refte se trouvent runies: les conditions subjectives, puisque les tres
techniques2 sont le fait de l'homme, crs par lui en vue de ses propres fins,
et mis en mouvement par son activit; les conditions objectives, puisque les
tres techniques ont une existence matrielle, et que par eux les hommes
s'approprient les forces et les matriaux de la nature. Dans une activit
technique complexe, l'homme poursuit son alliance originaire avec la nature
en largissant et en resserrant la fois le lien natif qu'il entretient avec elle.
L'homme et la nature sont toujours lis et forment une unit. Que devient
pourtant cette unit, quand les possibilits et virtualits qui sommeillent, tant
du ct des choses que de l'homme, viennent l'existence par des tres aussi
artificiels que les machines et les grandes fabriques industrielles modernes?
Quel est le rle exact des machines? Qu'apportent-elles de nouveau dans la
liaison de l'homme la nature? Le machinisme ne dtruit-il pas les capacits
humaines au lieu de les dvelopper? Quel service rend-il au capital ? Voil les
questions qu'abordait Marx par ses recherches sur la technologie et sur" son
impact conomique et humain.
En tudiant l'influence des techniques, Marx montre que leur progrs
conduit des crises, mais aussi la possible abolition de l'exploitation du
travail: c'est la possibilit relle vritable. Grce leur dveloppement, elles
ouvrent l'histoire sur un infini, sur un monde libr des alinations qu'impo-
sent les rapports sociaux de classe, un monde o les hommes seront libres.
1. L'unit de l'homme et de la nature
Selon Marx, l'unit de l'homme et de la nature ne se ralise pas tant dans
la consommation, mais plutt dans la production. C'est surtout l que
l'homme use de moyens interposs entre lui et l'objet auquel s'applique son
action. Ce sont des choses, outils, instruments, appareils, dispositifs, installa-
LA POSSIBILIT RELLE 375
tions, constructions, etc., distincts de son propre corps et objets d'une
prparation. C'est par l, nous dit Marx dans L'idologie allemande, que les
hommes se sont concrtement diffrencis des animaux:
On peut distinguer les hommes des animaux par la conscience, par la
religion, par ce qu'on voudra. Ils commencent se diffrencier eux-mmes des
animaux ds qu'ils commencent produire leurs moyens d'existence, pas en
avant qui dpend de leur organisation corporelle3.
Ces moyens sont gnralement conservs en vue d'un usage ritr pour
une production de choses utiles. Dj Aristote distinguait nettement deux
sortes d'usages: Les instruments proprement dits sont des instruments de
production [opyava notT]LtK]; l'objet de proprit, au contraire est un
instrument d'action [npaKLtKOVopyavov]. En effet, la navette produit quelque
chose de plus que son usage propre, mais d'un vtement et d'un lit on ne tire
que leur seul usage4.
Dans Le capital, .l'activit productive humaine est analyse sous un autre
angle que dans L'idologie allemande. Rappelons sa dfinition. Marx y
distingue trois cts: Les moments simples du processus de travail sont
l'activit finalise [die zweckmiissige Tiitigkeit] ou le travail lui-mme, son
objet et son moyen 5.
Cette analyse est tout fait gnrale: elle s'applique la production
humaine indpendamment de toute forme sociale dtermine6.
Au premier abord, ces deux prsentations de l'activit humaine produc-
tive paraissent beaucoup diffrer: dans L'idologie, l'accent est mis sur les
causes et les conditions qui ont engendr la diffrenciation de l'homme partir
de l'animal. Ce qui importe alors, c'est la constitution organique de l'homme
qui est l'origine de l'apparition de moyens de production extrieurs et
spars de son corps.
Dans Le capital, c'est une autre caractristique de l'activit humaine qui
est considre: sa finalit. Ce n'est plus la conformation biologique de
l'homme qui semble essentielle, mais le rle de la conscience, et donc la vise
d'une fin et tout ce qu'elle implique, continuit de l'effort, tension de la
volont oriente vers le but, imagination anticipative et intelligence concep-
tuelle abstraite.
Pourtant, les deux analyses ne s'excluent nullement; elles s'accordent en
ce qu'elles font du moyen interpos le fait essentiel: dans l'une, Marx se
place du point de vue des causes originaires, et analyse les conditions de
possibilit organiques et physiques du dveloppement historique des moyens
de production; dans l'autre, il se place au point de vue de l'essence de l'activit
qui en rsulte: une activit finalise 7.
Dans l'une, c'est l'organe qui est dsign (la main ou le cerveau); dans
l'autre, c'est la fonction (la pense et la reprsentation anticipe d'un but). La
fonction ne va videmment pas sans l'organe qu'elle prsuppose et qui la rend
possible. Marx enracine le technique dans le biologique.
Essayons de prciser la conception que Marx se fait des moyens de
376 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
production, et du rle de la technique. Les moyens de production sont
doublement dtermins puisque s'y composent les fins que l'homme vise et les
proprits des choses de la nature auxquelles s'appliquent les instruments
servant d'intermdiaires l'action humaine. Ces instruments sont choisis et
fabriqus en fonction de ces choses naturelles: la forme du filet est condition-
ne par celle des poissons qu'il est destin attraper, la forme du soc et celle
de la charrue sont conditionnes par la nature du sol qu'ils doivent fouiller et
retourner.
Il faut l'entendre au sens le plus large: parmi ces proprits figurent les
forces, et l'on peut dire que, ds les outils et instruments les plus primitifs, les
forces de l'homme se composent avec celles de la nature. L'homme se sert des
proprits mcaniques, physiques, chimiques de certaines choses pour les faire
agir comme forces sur d'autres choses, conformment son bt 8.
Par les moyens de production, l'homme entre en des rapports dtermins
avec la nature. Il se soumet elle, et en mme temps il se la soumet. Il use des
tres et objets naturels comme de matriaux, et il domestique les forces de
la nature.
Selon Marx, nous devons considrer la nature non seulement comme la
base de l'existence de l'homme da terre est son magasin de vivres originel
dit-iI9), mais aussi comme l'arsenal de ses moyens de production, et comme
un rservoir de forces.
A ces divers points de vue, ce sont toutes sortes de possibilits qui se
prsentent. Ces possibilits ne surgissent pas seulement du fait de l'homme,
mais aussi et avant tout du fait de la nature. Elles ne deviennent et ne sont des
possibilits relles que dans le mtabolisme qui s'tablit entre lui et la nature.
En tant que telles, elles sont fonction des besoins de l'homme, c'est--dire des
fins auxquelles il destine tres, objets et forces naturels. Elles sont aussi
fonction des moyens dont il dispose, soit par nature et originairement, soit en
les ayant labors.
Les usages possibles des choses et des processus naturels sont innombra-
bles. Ils ne sont pas fixs une fois pour toutes, de toute ternit. Ce qui est
matriau d'un point de vue et dans certaines circonstances, est moyen d'un
autre point de vue et dans d'autres circonstances:
Comme chaque chose possde des proprits de toutes sortes [vielerlei]
et elle prte [fiihig ist] par cela mme, plus d'une application, le mme
produit est susceptible [kann] de former la matire premire de diffrentes
oprations. [Inversement,...] dans le mme processus de travail, le mme
produit peut [mag] servir de moyen de travail et de matire premire JO.
Marx n'omet pas de souligner que les besoins sont aussi divers. Ils sont
socialement et historiquement variables; besoin de pain, de tabac, de Bible ou
de posie Il. De leur ct, les moyens pour obtenir une mme fin peuvent tre
trs diffrents galement. Marx fait ainsi observer que le got du froment
LA POSSIBILIT RELLE
377
n'indique pas qui l'a cultiv, serf russe, paysan parcellaire franais, ou
capitaliste [farmer] anglais 12. Il y a la mme varit possible dans les
instruments que dans les producteurs, sans que puisse s'tablir une rigoureuse
correspondance.
L'activit productive, par-del les conditions sociales et techniques
auxquelles elle est astreinte, se prsente concrtement sous une infinie varit
de formes. La liste de ces formes possibles ne saurait tre dresse: elle
supposerait une numration exhaustive des capacits inhrentes aux hommes
et la nature, capacits qui, en outre, ne deviennent relles que si les moyens
matriels qu'elles requirent sont dcouverts et mis en uvre. L'histoire est
pleine des efforts pour obtenir des moyens de production suprieurs aux
prcdents et des luttes qui se livrent pour leur possession, ou leur destruction:
car il arrive que les moyens existants ou connus soient dtruits, ou leur usage
entrav et empch!
Marx ne pensait pas que l'interposition de moyens, aussi complexes
soient-ils, rompe l'unit de l'homme et de la nature. Bruno Bauer cherchait
comprendre cette unit en posant l'homme comme pure Conscience de
soi , et la nature comme pure Substance , c'est--dire commt deux tres
ou ralits antinomiques et originairement spars. D'o son embarras
thorique devant les contradictions dans la nature et dans l'histoire , et sa
recherche d'une unit problmatique de l'homme et de la naturel3.
Partant, au contraire, de l'unit essentielle de l'homme et de la nature
comme du fait originaire, Marx qbjecte Bruno Bauer:
N'importe quel problme philosophique profond se rsout tout bonne-
ment [...] en un fait empirique. [...] Prenons par exemple la question
importante des rapport de l'homme et de la nature [...]. Cette question [...] se
rduit d'elle-mme la comprhension du fait que la si clbre" unit de
l'homme et de la nature" a exist de tout temps dans l'industrie, et s'est
prsente de faon diffrente, chaque poque, selon le dveloppement plus
ou moins grand de l'industrie; et il en est de mme de la "lutte" de l'homme
contre la nature, jusqu' ce que les forces productives de ce dernier se soient
dveloppes sur une base adquate 14.
Selon Marx, le vritable problme est l'inverse de celui de Bruno Bauer:
il faut chercher pourquoi le dveloppement historique a conduit une
sparation des conditions objectives et des conditions subjectives de ralisation
des possibilits relles, et, ainsi, une sparation entre possibilit et ncessit.
Pourquoi l'unit essentielle de l'homme et de la nature a-t-elle disparu dans le
monde moderne? Pourquoi cette plainte et ce sentiment de plus en plus
rpandus que l'homme a t arrach de la nature, comme de son milieu natif
et de son lment 15?
Les idologues s'imaginent que cette sparation est originaire, alors que
c'est un signe des temps nouveaux. On tait dans une priode de mutations, o
les changements dans le mode de production et le mode de vie se multipliaient.
378 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Le grand responsable, c'est la rvolution industrielle et ses consquences: en
particulier, l'urbanisation faisait ressentir la rupture avec la nature comme la
perte d'une unit qu'il faudrait retrouver. D'o la nostalgie et la qute d'une
unit perdue; d'o le dveloppement des utopies d'un retour une unit
idyllique antrieure o l'homme aurait entretenu un rapport immdiat et
harmonieux avec la nature. En termes abstraits, dans la philosophie classique
allemande, c'tait le problme de la rconciliation du sujet et de l'objet 16.
La rapide division de la socit en nouvelles classes, malgr les rves et les
promesses de fraternisation et d'galisation de la Rvolution franaise,
apparaissait de plus en plus clairement comme la source de toutes les
alinations et scissions, et comme le problme politique majeur.
Au plan conomique, les penseurs socialistes dnonaient l'exploitation
des travailleurs salaris, et dvoilaient la contradiction entr les possibilits
objectives de la production (la surproduction) et l'impossibilit de satisfaire les
besoins des masses laborieuses qui taient touches par la pauprisation et
sombraient priodiquement dans la misre.
Malgr la gravit de ces faits, Marx n'en maintenait pas moins que l'unit
de l'homme et de la nature ne pouvait tre rompue. Dans quelque socit et
quelque mode de production que ce soit, cette unit continue de se faire valoir.
Par contre, c'est l'unit sociale qui fait problme. Quand Marx lance son
clbre mot d'ordre: ce qui importe, c'est de changer le monde 17, c'est du
monde social, des rapports sociaux qu'il s'agit. Les communistes proclament
publiquement que 'leurs buts ne peuvent tre atteints que par le renversement
par la force de tout l'ordre social antrieur 18. Cependant, la scission de la
socit en classes antagonistes a ses racines dans la nature des moyens de
production et donc indirectement dans les rapports la nature et dans son
mode d'appropriation.
L'unit de l'homme et de la nature n'est donc pas primordialement en
cause, mme si Marx sait dj que l'exploitation de la nature rencontre des
limites et entrane des consquences ngatives, par exemple l'rosion du sol
par suite du dboisement, ou le dclin de certaines rgions autrefois prospres,
maintenant pauvres, voire dsertiques: il le rappelle Feuerbach.
Nanmoins, l'homme et la nature forment une unit, une identit
dialectique, un tout, dans lequel les moyens de production jouent le rle de
mdiateurs. Cette unit prend des formes variables. Marx considre que
l'histoire des organes productifs de l'homme social, base matrielle de toute
organisation sociale [...] serait digne de recherches semblables celles de
Darwin sur la formation des organes des plantes et des animaux considrs
comme moyens de production pour leur vie 19.
Il existe une volution des formes de socits par diversification de leurs
moyens de production et apparition de nouveaux moyens. Pour comprendre
l'unit concrte de l'homme et de la nature une poque donne et dans un
type de socit donn, il faut tudier les moyens de production qui lui
confrent sa forme spcifique.
LA POSSIBILIT RELLE
379
S'il y a toujours unit de l'homme et de la nature, c'est que l'homme
appartient la nature et ne saurait se placer hors d'elle. Ses propres forces et
facults, qu'eUes soient matrielles ou spirituelles, ne sont ni trangres, ni
transcendantes la nature, mais au contraire toujours ncessairement en
rapport avec les choses et processus naturels extrieurs.
C'tait l'ide de Marx dans les Manuscrits de 1844. Ilia maintient sans
changements dans L'idologie allemande, puis, vingt ans aprs, dans Le
capital: l'industrie, et l'activit productive matrielle en gnral, ralisent
l'unit de l'homme et de la nature. Mais c'est une unit dont la forme est
changeante, une unit mouvante, en dveloppement: celui-ci implique des
changements rciproques de chacun de ses ples. L'homme s'appropriant les
forces de la nature ne le fait que par l'intermdiaire de moyens adapts, les
organes productifs qu'il a lui-mme crs; c'est l, la fois, sa participation
la cration et son auto-cration. Dans la mesure de ses forces, il manifeste la
puissance de la nature, et dveloppe sa nature.
Si nous laissons de ct la prise de possession de subsistances toutes
trouves - la cueillette des fruits par exemple, o ce sont les organes de
l'homme qui lui servent d'instrument - nous voyons que le travailleur
s'empare immdiatement non pas de l'objet, mais du moyen de son travail. Il
convertit ainsi des choses extrieures en organes de sa propre activit, organes
qu'il ajoute aux siens de manire allonger, en dpit de la Bible, sa
conformation naturelle 20.
2. L'analyse de la machine: la machine de travail
La nouveaut rvolutionnaire qui, au XIXesicle, a modifi le rapport de
l'homme la nature, c'est le dveloppement considrable du machinisme et
l'apparition des fabriques et de la grande industrie. Parmi leurs causes, on cite
en premier la transformation de la machine feu en machine vapeur. On
rend couramment ceUe-ci responsable du bouleversement gnral de tout le
rgime de la production, du fait qu'elle supplanta dans de nombreux secteurs
les sources d'nergie utilises auparavant: l'homme, les animaux, l'eau ou le
vent, en les remplaant par l'nergie de la vapeur et, par consquent, par celle
du feu. Or, avec le rgime de la production, tout le rgime des rapports sociaux
s'est trouv entran dans le sillage de la rvolution industrieUe. De l, la
puissance historique qu'on dvolue la machine vapeur: elle aurait chass
une poque et fait pl~ce une autre. Au muse, en littrature, mme en
musique, la locomotive charbon symbolise cette nouvelle re2I.
Le dveloppement de la machinerie moderne semble avoir t provoqu
et dtermin par celui de la machine vapeur. Beaucoup de machines ne sont
apparues qu'aprs elle, comme sa consquence directe ou indirecte. Est-ce
vraiment et principalement d'eUe que dcoula l'accroissement considrable des
possibilits de production du systme technique de la fabrique?
380 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Marx soutint une thse contraire cette ide courante, une thse
paradoxale, selon laquelle la rvolution industrielle n'a pas tenu essentielle-
ment au brusque accroissement quantitatif de la puissance nergtique
dveloppe par la machine vapeur et ses perfectionnements successifs, mais
une rvolution qualitative dans le machinisme lui-mme, plus profonde et
plus radicale que l'invention de la machine vapeur. La source d'o
dcoulrent les merveilleuses possibilits du machinisme industriel moderne ne
serait pas l o elle parat tre.
Les historiens ont tenu, et tiennent encore, l'histoire de la technologie,
pour une discipline tout au plus auxiliaire. Souvent, elle leur est mme
compltement trangre. Ils en ignorent tout. La technologie semble devoir
concerner davantage l'conomiste. Or, ces derniers s'en sont aussi peu
intresss. Mme les marxistes croient avoir assez fait lorsqu'ils ont expliqu
les concepts conomiques gnraux de valeur et de plus-value, de profit et
d'intrt. Il leur suffit de dmontrer l'exploitation de l'homme par
l'homme, ce pour quoi des donnes empiriques assez sommaires suffisent.
Parlant des forces productives, ils restent trs discrets sur ce qu'il faut entendre
par l, presss d'en venir aux rapports sociaux et la politique.
Rien de tel chez Marx. Pour lui, la technologie tait de la plus grande
importance. Car, comprendre les vnements technologiques, c'est compren-
dre les possibilits et les impossibilits relles, au plan social et politique. De
toutes les sciences ncessaires pour saisir les causes des processus et vne-
ments historiques, l'conomie politique proprement dite mise part, il n'en est
pas qu'il tnt pour plus fondamentale. Marx a pris soin d'tudier la technolo-
gie, qui tait pour lui tout fait insparable de l'conomie politique, comme
le prouve l'analyse du machinisme qui occupe des chapitres trs importants du
Capital. L'essor du capital et celui du machinisme ont en effet partie lie: le
machinisme s'est avr le moyen le plus puissant pour lever la plus-value:
Le dveloppement de la force productive du travail, au sein de la
production capitaliste, vise raccourcir la partie de la journe de travail o
le travailleur doit travailler pour lui-mme, mais c'est prcisment pour
allonger l'autre partie de la journe de travail, celle o il peut travailler
gratuitement pour le capitaliste. Dans quelle mesure on peut atteindre aussi
ce rsultat sans baisser le prix des marchandises, voil ce que nous allons voir
maintenant en examinant les mthodes particulires de production de la plus-
value relative 22.
Ces mthodes particulires, ce sont justement la nouvelle divison techni-
que du travail et la forme de coopration que l'on trouve dans les fabriques et
la grande industrie. Marx entreprend donc d'analyser le rle de la machine
sous ses formes modernes et leur faon de contribuer raliser cette possibilit
qui est aussi une ncessit pour le capitalisme: augmenter sur une grande
chelle la plus-value relative.
Comment les machines permettent-elles cette transformation qualitative
LA POSSIBILIT RELLE
381
de la plus-value? Pour le comprendre, il faut d'abord saisir la diffrence
spcifique qui spare deux poques: d'une part l'outillage et les mtiers du
systme technique classique23, d'autre part, les machines du systme
industriel moderne .
Dans le domaine technologique, Marx utilise les travaux existant de son
temps. Des Allemands avaient, les premiers, cultiv cette discipline24. Mais ce
furent surtout les rcents travaux anglais de Charles Babbage et Andrew Ure
qui servirent de base aux grands chapitres du Capital sur l'usage capitaliste des
machines et de la machinerie25.
Le traducteur franais du Trait sur l'conomie des machines et des
manufactures de Babbage prsentait l'ouvrage comme compos de deux
parties:
La premire est un abrg de Mcanique pratique, qui offre le rsum
le plus complet et le plus exact des diverses applications des machines aux
Arts et aux Manufactures; la deuxime est un trait d'conomie politique,
consacr l'exposition des effets gnraux de l'industrie manufacturire, et
spcialement des avantages qui rsultent de l'emploi illimit des machines
comme moyen de production 26.
"
Aprs avoir soulign que Babbage effectuait un rapprochement conti-
nuel de la thorie et de la pratique , il indiquait le but de son Trait:
Faire connatre les avantages de l'industrie manufacturire, et mieux
apprcier la forme vritable sous laquelle les considrations d'conomie
politique doivent tre dsormais prsentes, pour faire sortir cette science
imparfaite du vague des aperus thoriques, et la constituer en science exacte
et positive27."
En ce qui concerne la division du travail, Babbage n'allait gure plus loin
que Smith. Seul, le concept d'opration28 tait nouveau:
.
En divisant l'ouvrage en plusieurs oprations distinctes dont chacune
demande diffrents degrs d'adresse et de force, le matre fabricant peut se
procurer exactement la quantit prcise d'adresse et de force ncessaire pour
chaque opration; tandis que si l'ouvrage tout entier devait tre excut par
un seul ouvrier, cet ouvrier devrait avoir la fois assez d'adresse pour
excuter les oprations les plus dlicates, et assez de force pour excuter les
oprations les plus pnibles 29.
Sur le terrain de l'analyse technologique, Ure se rvlait suprieur
Babbage: il rendait clairement compte des effets du machinisme sur la division
technique du travail. Marx tira le plus grand parti de Ure; nanmoins, il
empruntait tous les deux, car, son avis, ils ont leurs mrites respectifs:
Le docteur Ure, dans son apothose de la grande industrie, fait bien
382 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
mieux ressortir les caractres particuliers de la manufacture que les cono-
mistes ses devanciers, [...] et mme que ses contemporains, par exemple,
Babbage, qui lui est de beaucoup suprieur comme mathmaticien et
mcanicien, mais ne comprend cependant la grande industrie qu'au point de
vue manufacturier 30.
La dfinition de la machine par Babbage est frappante de concision et de
prcision: Quand, par la division du travail, chaque opration particulire a
t rduite l'emploi d'un instrument simple, la runion de tous ces
instruments, mis en action par un seul moteur, constitue - une.machine31."
La machine sous sa forme spcifiquement moderne suppose le perfection-
nement pralable des outils, ce qui eut lieu durant la priode de la manufacture
et dans les conditions de la division manufacturire du travail. Dans Le
capital, discutant de la distinction entre la machine et l'outil, Marx compare
les analyses et dfinitions de Babbage et de Ure. Il propose une dfinition qui
s'inspire troitement de celle de Babbage32:
La machine-outil est [...] un mcanisme qui, ayant reu le mouvement
convenable, excute avec ses instruments les mmes oprations que le
travailleur excutait auparavant avec des instruments pareils 33.
Alors seulement il devenait possible d'appliquer de nouvelles forces
motrices des machines qui portaient les outils au lieu qu'ils soient manis par
l'homme. Ces outils taient issus de la priode prcdente, et cela, sans que
l'emploi de la force de la vapeur y ait t pour quelque chose.
Dans le domaine des techniques comme dans l'histoire en gnral, il s'agit
d'un concours de dveloppements diffrents; en matire technologique, la
diversification des outils et instruments rpondent leur runion et leur
coordination dans un ensemble mcanique:
Une fois les outils transforms d'instruments manuels de l'homme en
instruments de l'appareil mcanique, le moteur acquiert de son ct une
forme indpendante, compltement mancipe des bornes de la force
humaine34.
Autrement dit, Marx voit que ce qui est dcisif dans la diffrenciation de
la machine par rapport l'outil, c'est que le changement essentiel n'est pas
tant dans la nature et la force du moteur (par exemple, la machine vapeur),
que dans la machine de travail" [Arbeitsmachine]:
Ds que l'instrument, sorti de la main de l'homme, est mani par un
mcanisme, la machine-outil a pris la place du simple outil. Une rvolution
s'est accomplie alors mme que l'homme reste le moteur35.
C'tait heurter de front la dfinition de la machine adopte par la
majorit des mcaniciens anglais (la machine serait un outil complexe), ainsi
LA POSSIBILIT RELLE 383
que celle des technologues et conomistes anglais (la machine serait mue par
une force motrice naturelle; la rvolution industrielle partirait donc de la
machine vapeur).
A contre-courant de ces ides dominantes, encore trs rpandues actuel-
lement, Marx allait jusqu' dire:
La machine vapeur elle-mme [...J n'amena aucune rvolution dans
l'industrie. Ce fut au contraire la cration des machines-outils qui rendit
ncessaire la machine vapeur rvolutionne 36.
"
Cela est tout fait remarquable. tant donn que le nombre d'outils
avec lesquels l'homme peut oprer en mme temps est limit par le nombre de
ses organes 37", et qu'on pourra les runir ou les multiplier dans un complexe
machinique mu par un seul moteur, Marx distingue deux formes typiques de
machines industrielles: le systme de machines o les oprations sont htro-
gnes, ou celles qui prsentent une multitude d'organes identiques.
Dans le deuxime cas, la machine, d'o sort la rvolution industrielle,
remplace l'ouvrier qui manie un outil singulier [einzeln], par un mcanisme qui
opre en une fois avec un grand nombre de tels outils ou d'outils semblables,
et qui est mis en mouvement par une seule force motrice, quelle qu'en soit la
forme38 . On a ainsi la coopration de plusieurs machines homognes, une
foule de mtiers tisser mcaniques par exemple, mis en mouvement par
l'impulsion d'un moteur commun39.
C'est sur cette rvolution dans la machine de travail>, que repose la
possibilit de l'accroissement inou de la plus-value relative, car le dvelppe-
ment du machinisme signifie la diminution de la part relative du travail
ncessaire dans la journe de travail.
Il est frappant de constater que Marx n'arrive cette vue originale et
profonde sur le vrai point de dpart de la rvolution industrielle qu'assez
lentement et tardivement. Dans les annes soixante, prparant Le capital, il
reprend et approfondit ses connaissances technologiques en liaison avec des
questions fondamentales de thorie conomique40.
C'est seulement en 1863 qu'il arrive l'ide que le changement dcisif a eu
lieu d'abord dans la machine de travail", c'est--dire dans la partie du
mcanisme qui se substitue la main et aux gestes complexes de l'artisan,
mcanisme qui ralise ses oprations avec une finesse, une prcision, une
rgularit ou une rapidit, suprieures celles dont seraient capables les
meilleurs ouvriers. C'est l, dira-t-il dans Le capital, qu' une diffrence
essentielle se manifeste immdiatement. [...] Le principe subjectif de la division
du travail n'existe plus dans la production mcanique. Il devient objectif, c'est-
-dire spar des facults individuelles de l'ouvrier41
".
Marx rappelle Engels la conception courante: Les technologues
anglais, qui tiennent un peu plus compte de l'conomie [que les Allemands],
font la distinction suivante (et leur suite beaucoup d'autres, presque tous les
384 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
conomistes anglais): dans un cas le motive power [force motrice] provient de
l'homme, dans l'autre d'une natural force [force naturelle]42.
Mais il ne la fait pas sienne, et prsente alors l'ide qui sera centrale dans
son analyse du machinisme dans Le capital:
Or, [...] en examinant la machine dans sa forme lmentaire, nous
constatons que la rvolution industrielle ne part pas de la/oree motrice, mais
de cette partie de la machine que les Anglais appellent la working machine
[machine effectuant le travail], donc elle ne part pas, par exemple, de l'emploi
de l'eau ou de la vapeur se substituant au pied pour actionner le rouet, mais
de la transformation du processus immdiat du filage lui-mme et de
l'viction de cette partie du travail humain qui n'est pas simple exertion of
power [dpense de force] (comme l'action de presser la pdale du rouet), mais
le processus de travail affectant immdiatement la matire transformer43.
En d'autres termes, Marx fait une analyse fonctionnelle et structurale la
fois. Mais c'est surtout dans la dtermination des fonctions assumes par les
machines (fonction nergtique ou fonction de travail proprement dite) que
Marx apporte du nouveau.
Pour lui, la rvolution dans la machine de travail entrane son
merveilleux pouvoir de production. C'est de l que proviennent toutes ses
possibilits aussi nombreuses que varies, et toutes ses consquences sociales
et historiques. Sa lettre Engels insiste sur l'importance technologique de la
machine de travail; celle-ci matrialise de nouvelles forces productives:
D'autre part, il est tout aussi vident que, ds l'instant o il ne s'agit
plus de l'volution historique de la machine, mais de la machine sur la base
[auf Basis der] du mode de production actuel, la machine de travail (par
exemple, dans la machine coudre), est la seule partie dcisive
[entscheidende], tant donn que, ds que ce processus a t mcanis, tout le
monde sait de nos jours qu'on peut l'actionner [bewegen kann], selon sa
dimension, la main, grce l'eau ou grce la machine vapeur44.
Toujours dans cette mme lettre Engels, Marx indique la porte capitale
pour le matrialisme historique d'une analyse correcte de la rvolution
technique :
Pour les mathmaticiens purs, ces questions sont indiffrentes, mais
elles prennent beaucoup d'importance ds qu'il s'agit de dmontrer l'interd-
pendance [Zusammenhaug] des rapports sociaux humains et de l'volution
de ces modes de production matriels45.
Mais peut-on dire que la machine travaille? L'expression machine de
travail n'est-il pas mtaphorique? Pourtant, force est de reconnatre qu'elle
assume des fonctions dont l'homme avait toujours eu l'apanage jusque-l:
adresse, finesse d'excution, complexit des oprations, et cela dans quantit
de domaines (mtallurgie, filage, tissage, couture, etc.). Bref, son nom n'est
LA POSSIBILIT RELLE 385
pas usurp: en un certain sens, il faut donc dire avec Marx que la machine
travaille >'.
De plus, contrairement ce que l'on croit, Marx ne fut nullement
obnubil par le dveloppement des machines motrices et par le dploiement de
force des machines cyclopennes modernes. En ralit, nous dit-il, l'aspect
spectaculaire de la machine vapeur masque, plus qu'il ne la rvle, une autre
rvolution, moins visible, plus silencieuse, et qui s'est droule avant son
apparition.
La force de travail humaine ne remplit pas seulement une fonction
motrice; dans ses autres fonctions, elle avait dj t remplace par des
mcanismes avant que n'intervnt cette machine insolite, la machine vapeur
qui a rempli le monde de son bruit et de son rythme endiabl; les btes de trait
et le moulin eau avaient dj supplant la force humaine en tant que
source motrice ou moteur.
La rvolution industrielle commence ds que les machines sont
employes l o, de tout temps, le rsultat final exigeait un travail humain,
[...] l o l'homme, tant donn la nature des choses, ne fait pas fonction ds
l'abord de simple power [force motrice]46.
Cette annexion soudaine, par les machines, de fonctions jusque-l
rserves I'homme, entrana des bouleversements sans nombre dans la
division du travail. La nouvelle partition des fonctions technologiques rvolu-
tionna les mtiers. Elle modifia radicalement les rapports entre les hommes
dans la production. Non seulement, cette rvolution a rendu possible le
dveloppement spectaculaire des forces productives du travail sur lequel
repose le mode de production capitaliste, mais, grce l'accroissement de la
productivit du travail, elle rendit possible de nouveaux modes d'exploitation
de la force de travail, et donna naissance de nouvelles classes sociales
inconnues dans le pass.
Dire que les machines travaillent n'est donc pas purement mtaphori-
que; grce aux forces naturelles qu'elles canalisent, captent ou domestiquent,
il en est d'elles comme de toutes les autres forces naturelles ou animales que
l'homme met son service: elles contribuent la cration de la richesse en
crant de nouvelles valeurs d'usage. Une rvolution technologique n'largit
pas seulement le cercle des possibilits matrielles, c'est--dire des valeurs
d'usage possibles. Elle tend et ralise des possibilits rserves aux hommes.
Par le truchement d'une nouvelle division du travail, elle rend aussi de
nouveaux rapports sociaux possibles.
3. La division du travail: ses deux formes principales
Adam Smith avait dcouvert dans la division du travailla cause qui est
386 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
l'origine des possibilits du dveloppement technologique de la productivit.
De mme, Marx et Engels, dans L'idologie allemande, font jouer la division
du travail un rle essentiel. Ils insistent particulirement sur le partage entre
travail manuel (ou productif) et travail intellectuel (ou improductif). Cepen-
dant, ds ses premires tudes conomiques47, Marx allait plus loin que Smith
en replaant la division du travail dans une perspective historique, et, dans Le
capital, la division du travail semble plutt tre la consquence que la cause du
progrs de la productivit, puisque c'est l'introduction des machines qui
entrane une division nouvelle des tches.
Dans sa polmique contre Proudhon, Marx reproche celui-ci de faire de
la division du travail une catgorie gnrale et une cause originaire qui
expliquerait tout: La division du travail est, d'aprs M. Proudhon, une loi
ternelle, une catgorie simple et abstraite. Il faut donc aussi que l'abstraction,
l'ide, le mot lui suffise pour expliquer la division du travail aux diffrentes
poques de l'histoire. Les castes, les corporations, le rgime manufacturier, la
grande industrie doivent s'expliquer par le seul mot diviser48.
Marx oppose Proudhon que l'on a besoin d'tudier les nombreuses
influences qui donnent la division du travail un caractre dtermin chaque
poque49 pour expliquer ses diffrentes formes spcifiques.
Ds Misre de la philosophie, il s'appuie pour cela sur les analyses alors
rcentes d'Andrew Ure et de Charles Babbage que Proudhon ignore 50. Elles
sont nettement suprieures celle de Smith, pour la simple raison - indique
par Marx - que la grande fabrique mcanise n'existait pas encore l'poque
de Smith5!.
Rappelons que, dans ses analyses technologiques du Capital, Marx
n'aurait t, selon M. Gury, qu'un mauvais lve d'Andrew Ure52. L'un des
principaux arguments de M. Gury est le suivant: en soutenant que la division
du travail dans la manufacture se reproduisait dans la fabrique moderne,
Marx serait revenu en de des analyses de Ure. M. Gury y voit une
inconsquence! De quoi s'agit-il? Dans Le capital et ailleurs, Marx note
qu'une nouvelle gnration part de conditions de travail hrites de la
gnration prcdente, et par consquent d'une certaine division des mtiers
existante.
La mme observation de Marx se trouvait dj, vingt ans avant Le capital,
dans Misre de la philosophie. Les choses y sont plus claires. Cette observation
historique portait alors, non sur la transformation de la manufacture en
fabrique, comme dans Le capital, mais sur la transition, historiquement
antrieure, des corporations et des mtiers du Moyen Age la division du
travail dans la manufacture.
Cette constatation est intressante pour saisir sur un exemple prcis
comment Marx conoit la possibilit historique. En l'occurrence, il s'agit du
rle de la division du travail dans le processus du dveloppement socio-
historique. Marx fait remarquer que la division du travail au sens de Smith (la
LA POSSIBILIT RELLE 387
seule que connaisse Proudhon!) n'est pas l'origine de l'atelier. Au contraire,
l'atelier l'a prcde:
Le dveloppement de la division du travail suppose la runion des
travailleurs dans un atelier. Il n'y a mme pas un seul exemple, ni au XVIe,ni
au XVIIe sicle, que les diverses branches d'un mme mtier aient t
exploites sparment au point qu'il aurait suffi de les runir dans un seul
endroit pour obtenir l'atelier tout fait 53.
C'est pourtant ce qu'affirmait Proudhon. Marx ajoute: Mais une fois les
hommes et les instruments runis, la division du travail telle qu'elle existait
sous la forme des corporations se reproduisait, se refltait ncessairement dans
l'intrieur de l'atelier54.
Dans ce dbat, il ne s'agit de rien de moins que de l'uri des principes de
base du matrialisme historique, celui qui fait dpendre les rapports de
production des forces productives. Par voie de consquence, c'est de la
dpendance des rapports sociaux l'gard des rapports de production
matriels, technologiques, dont il est question ici.
Ce que veut dire Marx, c'est qu'il ne faut pas inverser le rapport de cause
effet. Les forces productives matrielles (les instruments, etc.) se dveloppent
avant les rapports de production qu'ils entranent. Mais un tel dveloppe-
ment de nouveaux moyens de production a ncessairement lieu au sein de
l'ancienne socit, donc partir de ses rapports sociaux de production, de ses
mtiers, etc. Ainsi, la division sociale du travail a prcd la division technique
du travail au sens de Smith. En effet, selon Le capital, il faut distinguer entre
division du travail dans la socit et division du travail dans l'unit de
production lmentaire (atelier, manufacture, fabrique, usine):
La division manufacturire du travail ne prend racine que l o sa
division sociale est dj parvenue un certain degr de dveloppement,
division que par contre-coup elle dveloppe et multiplie. A mesure que se
diffrencient les instruments de travail, leur fabrication va en se divisant en
diffrents mtiers 55.
Ainsi naissent de nouveaux types de mtiers. Cette division manufactu-
rire , c'est celle dcrite par Smith dans son fameux exemple de la manufac-
ture d'pingles 56. Toutefois, ce n'est pas la manufacture sous ses premires
formes historiques 57.
La division sociale du travail dans la socit est de beaucoup antrieure
celle qui est intervenue dans la manufacture. La preuve en est, dit Marx, que
presque partout il y eut une lutte acharne entre la manufacture et les
mtiers 58.
La manufacture est un rsultat historique. Il y fallut une pluralit de
circonstances indispensables qui concoururent simultanment au dvelop-
pement de l'industrie manufacturire 59. En les numrant, Marx insiste
388 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
ostensiblement sur le fait qu'elles sont trs diverses: l'accumulation de
capitaux qui suivit la dcouverte de l'Amrique, l'extension du commerce aux
Indes (rgime colonial), le licenciement de nombreuses suites seigneuriales
transformes en une masse de vagabonds, qui devinrent une rserve de main-
d'uvre pour les entrepreneurs des manufactures: autant de conditions
historiques pour la formation de la manufacture60 .
Il serait erron de prendre la division du travail comme historiquement
originaire, d'en faire une catgorie conomique simple, primitive, et de croire
que cette division, irait en s'accroissant et s'approfondissant toujours, comme
si elle se divisait elle-mme, et comme si elle tait la cause originelle de tout
le mouvement historique depuis les dbuts de la prhistoire jusqu' nous.
Pour Marx, il est essentiel de voir que la division du travail se prsente
sous deux formes majeures: dans la socit elle est bien antrieure celle que
l'on trouve dans l'atelier. La premire est antdiluvienne . Elle est la
prsupposition de la seconde:
Sous le rgime patriarcal, sous le rgime des castes, sous le rgime
fodal et corporatif, il y avait division du travail dans la socit tout entire
selon des rgles fixes. Ces rgles ont-elles t tablies par un lgislateur? Non.
Nes primitivement des conditions de la production matrielle, elles n'ont t
riges en lois que bien plus tard. C'est ainsi que ces diverses formes de la
division du travail devinrent autant de bases d'organisation sociale. Quant
la division du travail dans l'atelier, elle tait trs peu dveloppe dans toutes
ces formes de socit61.
Cette distinction n'est pas une dcouverte originale de Marx. Elle avait
dj t faite par des conomistes qu'il cite dans Le capital: Storch, Skar-
beck62. Or, en 1847, Marx a dj lu les ouvrages de Skarbeck et de Storch,
quoiqu'il ne les nomme pas63: Nous ne donnerons, dit-il, que quelques
points sommaires, pour faire voir qu'avec des formules on ne peut pas faire de
l'histoire64. Ds avant cette date, il savait l'importance conomique et
historique de la division du travail sous ses formes sociales et sous ses formes
techniques.
La comprhension du mouvement historique d'une socit implique celle
de sa base technologique. Mais on ne doit pas procder partir de catgories
gnrales, serait-ce celle de la division du travail. Pour Marx, on ne saurait
simplifier l'histoire en la soumettant ou en la rduisant l'volution d'un
facteur unique; ici, le facteur technique.
A suivre M. Gury, c'est pourtant une telle conception qu'on lui
attribuerait: on voudrait alors que Marx ait t Ure, lequel ne voyait que par
la division technique du travail et qui tombait dans une description idyllique
de la fabrique moderne. Ce serait perdre le sens des conditions historiques de
la possibilit du dveloppement de la fabrique, qui sont aussi des conditions
sociales, et qui renvoient une division pralable de la socit en classes.
Faire prvaloir une ncessit purement technique comme celle de la
LA POSSIBILIT RELLE
389
division du travail, c'est ce que font ceux qui attribuent Marx un dtermi-
nisme technologique. Mais, Marx n'est pas Smith; il est encore moins Dre:
Il ne faut pas perdre de vue que les nouvelles forces productives et les
nouveaux rapports sociaux de production ne se dveloppent pas partir du
nant, ne tombent pas du ciel ni ne sortent du ventre de l'Ide qui se pose elle-
mme; mais ils se forment l'intrieur d'un dveloppement existant de la
production et de rapports de proprit hrits et traditionnels, et en
contradiction avec eux65.)}
Marx n'a pas vari sur ce point. Il a toujours eu une conception
profondment dialectique, contradictoire, de la possibilit du dveloppement
technique. On en a la preuve lorsqu'en 1867, dans Le capital, il crit:
Si l'anarchie dans la division sociale et le despotisme dans la division
manufacturire du travail caractrisent la socit bourgeoise, des socits
plus anciennes, o la sparation des mtiers s'est dveloppe spontanment,
puis s'est cristallise et enfin a t sanctionne lgalement, nous offrent par
contre l'image d'une organisation sociale du travail rgulire et autoritaire,
tandis que la division manufacturire y est compltement exclue, ou ne se
prsente que sur une chelle minime, ou ne se dveloppe que sporadiquement
et accidentellement
66.)}
En note, il cite son propre ouvrage vieux de vingt ans, crit et publi en
franais: Misre de la Philosophie67.
Dans cet exemple de la division du travail, Marx suit une dmarche qui lui
est familire, celle qu'il explicite dans l'Introduction de 1857 en prenant comme
exemple une autre catgorie gnrale , celle de travail. Il ne faut pas
entendre la division du travail de manire formelle, comme un concept
gnral, applicable toutes les poques, et toutes les formations socio-
conomiques. Comme tout autre phnomne conomique, la division du
travail doit tre entendue relativement une poque donne, autrement dit
dans un ensemble de conditions donnes. A l're du machinisme, et mme si
des machines ont exist bien avant68, on a une nouvelle forme de division du
travail, et par suite de nouveaux rapports sociaux de production. Ainsi, toutes
sortes de mtiers disparaissent et d'autres apparaissent avec l'introduction et
la diversification des machines: machines de travail, machines motrices et
mcanismes de transmission. L'ensemble d'organes mcaniques qui se combi-
nent et se ramifient dans la fabrique, assigne aux travailleurs de multiples
fonctions diffrentes et nouvelles, mme si elles sont parcellarises et souvent
dshumanises l'extrme.
Proudhon soutenait aussi une autre ide, inverse de la prcdente: pour
lui, l'avnement de la machine signifiait la disparition de la division du
travail69. Pas du tout, proteste Marx! L encore, quelle erreur: c'est une de ces
contre-vrits historiques que Marx relve chaque pas chez Proudhon. En
ralit, c'est le contraire; avec les machines, la division du travail fait des
390 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
progrs spectaculaires, et prend de nouvelles formes auxquelles Proudhon
demeure compltement aveugle:
Nous n'avons pas besoin de rappeler que les grands progrs de la
division du travail ont commenc en Angleterre aprs l'invention des
machines. [...] Le tisserand et le fileur, runis nagure dans une seule famille,
furent spars par la machine. Grce la machine, le fileur peut [kann]
habiter l'Angleterre en mme temps que le tisserand sjourne aux Indes
~ffiW~~
.
Cette division proprement internationale du travail est une possibilit que
l'introduction des machines dans la production et dans les transports ralise en
grand, une possibilit relle absolument impensable cette chelle dans tous
les modes de production antrieurs:
Grce l'application des machines et de la vapeur, la division du
travail a pu prendre de telles dimensions que la grande industrie, dtache du
sol national, dpend uniquement du march de l'univers, des changes
internationaux, d'une division de travail internationale 71.
Non seulement la fabrique cre et dveloppe une nouvelle division du
travail en son sein, mais elle en entrane galement une au niveau internatio-
nal, modifiant tout le systme mondial de la production, des changes et de la
consommation. Dsonnais, le ryot (ou paysan) indien dpend de la bonne
marche des fabriques et du capital anglais, et le travailleur salari anglais de la
lutte des classes aux Indes.
Comment parler du but providentiel et philanthropique que M. Prou-
dhon dcouvre dans l'invention et l'application primitive des machines 72
",
alors que leurs consquences, dans le mode de production capitaliste, se
rvlent tre tout le contraire? Le travailleur, supplant par les machines, se
retrouve au chmage; le travail se trouve mcanis, parcellaris, miett ,
loin que soit restaure la synthse des mtiers que l'atelier et la manufacture
avaient spars, synthse que se plat imaginer Proudhon d'une manire
utopique. Consquences ngatives par rapport la ralisation de l'homme
total, pleinement et harmonieusement dvelopp.
4. La machine est une force productive
Nous venons d'voquer les consquences ngatives de la nouvelle division
du travail due au dveloppement soudain et considrable du machinisme
moderne: viction hors du systme productif des ouvriers surnumraires, et
dshumanisation du travail dans la production. Ces consquences prouvent,
s'il en tait besoin, que les machines peuvent remplacer effectivement les
hommes dans une partie du processus productif et dans certains secteurs.
LA POSSIBILIT RELLE
391
Si les machines remplissent des fonctions jusque-l tenues pour
spcifiquement humaines, des fonctions dont l'homme s'enorgueillissait
(adresse, habilet, dextrit, etc.), si en quelque sorte elles travaillent , on
doit dire qu'elles font partie des forces productives. Mais, n'est-ce pas un abus
de langage, et, chez les dfenseurs du capitalisme, un prtexte pour dnier aux
travailleurs le rle d'agents premiers de la production?
Nous avons vu que, seules, la force de travail et les forces naturelles sont
vritablement des forces; les hommes, les animaux et les lments sont des
agents manifestant une activit propre, spontane, vitale ou naturelle.
Outils et instruments, appareils et dispositifs, ustensiles et installations, ne
sont pas par eux-mmes des forces . N'en est-il pas de mme des machines
qui demandent tre mises en mouvement par une source d'nergie qui leur
est extrieure?
Cependant, du fait que les machines motrices et les machines de travail
accomplissent des fonctions propres l'homme, la question se pose. Nous
allons voir que Marx range les machines dans les forces productives. En effet,
il est incontestable que les machines, en tant que telles, matrialisent et
ralisent des possibilits productives nouvelles. Est-ce seulement en jouant sur
le sens des mots que Marx les dit productives ?
Repartons de l'analyse de l'activit productive matrielle donne dans Le
capital, selon laquelle: (des moments simples du processus de travail sont
l'activit finalise ou le travail lui-mme, son objet et son moyen 73.
Marx distingue ainsi expressment l'activit et les choses: d'une part, il y
a le travail, ou force de travail en acte, d'autre part les matriaux auxquels
cette force s'applique et les diffrents moyens (outils, etc.), qui sont eux-mmes
des choses matrielles.
Cela n'empche cependant pas Marx d'englober tous les moyens de
production sous le concept gnral de forces productives . Ce fait est bien
connu. Ne faut-il pas avouer que le concept de force reoit dans cet usage un
sens dtourn, et qu'il devient mtaphorique?
Marx prte le flanc l'accusation d'incohrence ou de laxisme. Nous
avions dj discern des flottements dans l'usage du terme de force, mais cette
fois, Marx tomberait dans une vritable contradiction in adjecto.
La question est importante. La notion de force, dans forces produc-
tives , pourrait bien tre quivoque. En tendant son emploi, Marx lui
donnerait en fait deux sens totalement distincts: tantt le terme dsigne
l'nergie dont sont capables certains agents comme l'homme, les tres vivants
et les autres tres naturels dous de spontanit, tantt il dsigne les moyens
ou choses mises en mouvement et en action par cette nergie.
Qu'est-ce qui autorise Marx passer de l'un des sens l'autre sans
rencontrer des contradictions insurmontables? N'est-ce pas le fait qu'une
certaine forme dtermine d'nergie (la force du travail ou tout autre force
naturelle) requiert, pour se raliser en tant que telle, les moyens appropris?
392 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Dans cette optique, seul le couple compos de la force et des moyens
correspondants peut lgitimement tre appel une force productive.
En ce sens, notre thse sera que ce n'est pas dans la force seule mais dans
cet ensemble que rside la possibilit relle . N'est-ce pas ce qui arrive
manifestement avec les machines de travail? Nous avons vu Marx conclure,
avec d'autres technologues, que les machines travaillent dans la mesure o,
ds que la machine motrice et la machine-outil sont combines (automates, ou
machines automatiques), elles deviennent capables d'effectuer par elles-mmes
la chane des oprations matrielles que seul l'homme pouvait accomplir
auparavant.
S'il est normal de compter les machines au nombre des forces produc-
tives, il faut dire aussi qu'elles travaillent. Marx n'assume-t-il pas cette
conclusion 74?Si l'on tient parler ici de mtaphore, il faudra convenir que
la mtaphore n'est dans la langage que parce qu'elle est dans la ralit, qu'elle
est relle. Les machines de travail ralisent effectivement, matrielle-
ment, cette mtaphore. Il y a transfert effectif du travail de l'homme la
machine. Le travail est dplac; celui de l'homme devient autre: l'on a un
nouveau mode de travail.
N'est-ce pas pour cela que le marxisme est souvent tenu pour une
conception technologique, soit pour l'en fliciter, soit, au contraire, pour le
dplorer et lui en faire grie[75?
Englober les moyens de production dans les forces productives ne doit
pas conduire abolir toute distinction entre les forces et les choses auxquelles
elle s'appliquent, entre l'activit (Ie travail ou l'action de forces naturelles), et
l'objet ou matire qui subit l'action transformatrice.
D'autres commentateurs de Marx rcusent une interprtation purement
technologique. Il ne suffit pas d'examiner les formes techniques prises par le
processus concret de production dans le systme de la fabrique, il faut aussi
prendre en considration les rapports sociaux et l'action de l'homme social76.
Marx distingue toujours entre le caractre matriel des processus et leurs
aspects formels (sociaux).
Lorsqu'il critique les ides conomiques de Proudhon, il lui reproche de
confondre les rapports conomiques (rapports sociaux de production) et les
rapports matriels. Il affirme alors explicitement que la machine est une
force productive:
Les machines ne sont pas plus une catgorie conomique que ne saurait
l'tre le buf qui trane la charrue. Les machines ne sont qu'une force
productive. [Au contraire], l'atelier moderne, qui repose sur l'application des
machines, est un rapport social de production, une catgorie conomique 77.
Ainsi, les moyens de production, en tant qu'ils sont des objets matriels,
ne font pas partie de la structure conomique de la socit, bien qu'ils soient
dits forces productives . La structure conomique, c'est l'ensemble des
LA POSSIBILIT RELLE
393
rapports sociaux de production. Souvent on confond structure et base ,
ce qui arrive lorsqu'on parle de 1'infrastructure 78.
La distinction entre base matrielle et structure formelle est plus
fondamentale aux yeux de Marx que celle entre forces productives et moyens
de production. Tous les moyens de travail, depuis les outils les plus simples
jusqu'aux engins et usines les plus complexes, sont des choses ou des
ensembles de choses, des objets physiques entretenant des rapports mat-
riels entre eux, ainsi qu'avec l'homme et la nature. Bien qu'ils ne fassent pas
partie de la structure socio-conomique, ils en sont nanmoins la cause. Les
rapports sociaux, ou structures , dpendent des rapports matriellement
impliqus dans le processus technique de production, mais ne s'y rduisent
pas.
Cela prcis, revenons notre question: pourquoi Marx considre-t-illes
machines comme des forces productives? Que nous indique la comparaison
de la machine l'animal de trait? Il semble que cette comparaison soit limite
aux machines motrices. Mais il serait difficile de maintenir fermement cette
restriction. Lorsque Marx pose que tout mcanisme dvelopp se compose de
trois parties essentiellement diffrentes: moteur, transmission et machine
d'opration 79, on constate qu'il met au nombre des moteurs, des organes
comme la roue hydraulique et l'aile du moulin vent bien qu'ils n'aient pas en
eux-mmes la force de se mouvoir, comme l'animal 80. Or, celui-ci aussi a
besoin d'un apport d'nergie extrieur.
L'on utilise l'animal en fonction de ses qualits: le buf est l'exemple
mme de l'animal qu'on emploie pour sa force purement physique. De
l'analogie entre la machine et l'animal, on conclut que ce sont des forces
productives. De proche en proche, toute chose qui intervient un titre
quelconque dans le processus de production rentre dims la catgorie des
forces productives, quoique Marx pense surtout aux tres techniques issus
de la premire rvolution industrielle: Les machines proprement dites datent
de la fin du XVIIIesicle8l.
Dans un passage dj cit, o Marx dit que l'histoire n'est rien d'autre
que la succession de gnrations dont chacune exploite les matriaux, les
capitaux, les forces productives qui lui sont transmis par toutes les gnrations
prcdentes 82, forces productives rsume une numration peine bau-
che. Elle ramasse et condense tout ce qui devrait faire l'objet d'un examen et
d'un inventaire.
Mais, dira-t-on, lorsque Marx, dans Le capital, dveloppe son analyse de
la production des valeurs utiles, il ne considre pas que ces forces
comprennent les moyens de production. Ces moyens se divisent en condi-
tions naturelles (la terre et ses ressources), et en conditions artificielles (outils,
instruments et machines):
Si l'on considre l'ensemble de ce mouvement [le processus de travail]
394 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
au point de vue de son rsultat, du produit, alors tous les deux, moyens et
objet de travail, se prsentent comme moyens de production 83.
Ces moyens de production (si l'on met les moteurs proprement dits
part) possdent des proprits, des capacits ou pouvoirs incorpors en
eux. Ils ne sont pas des forces au sens propre du terme, mais ils transmettent
les forces ou les modifient, les emmagasinent, etc. On peut donc les considrer
comme des formes d'tre en puissance au sens large, comme on l'a vu pour
la force de travail. Toutefois, ils ne sont mis An mouvement que par des forces
ou des moteurs extrieurs: l'homme ou des forces naturelles.
Dans des machines automatises, les forces sont incorpores: le moteur
en fait partie. Elles prsentent certains traits essentiels quoi l'on reconnat les
vritables forces productives comme la force de travail, les- animaux et les
formes d'nergie naturelle. Quand elles sont mises et maintenues en mouve-
ment, elles contribuent la cration de valeurs d'usage. Elles accroissent la
productivit du travail. Elles contiennent du travail pass objectivit tout
comme la force de travail qui a d tre produite elle aussi. Enfin, les
machines ont la possibilit relle de remplacer l'ouvrier dans une partie plus ou
moins grande de ses fonctions - c'est l leur caractristique essentielle -, ou
bien d'accomplir les tches assures jusque-l par les nombreux animaux
auxquels on devait recourir. Sous tous les aspects, elles contribuent la
production des objets d'utilit: comment ne pas les dire productives?
Des analyses mcanistes, ou des physiciens rigoureux, pourraient nan-
moins protester que Marx entretient un grave quiproquo: en appelant les
moyens de production des forces , il perptuerait la confusion entre
objets et forces, choses et mouvements, tats et actions.
Mais l'analyse marxienne du processus de production et de ses conditions
souligne justement l'impossibilit de maintenir ces distinctions initiales. A
propos du travail productif de valeurs d'usage, dans une note apparemment
anodine, Marx prcise que cette dfinition du travail productif, telle qu'il se
prsente du point de vue du processus de travail simple, ne suffit pas du tout
dans le cas du processus de production capitaliste84.
Dans ce passage du Capital, l'analyse est donc expressment restreinte
l'activit du travailleur individuel. Relativement au travailleur simple qui
manie des outils inertes par eux-mmes (artisan, paysan, ouvrier individuels),
les autres facteurs qui contribuent au processus sont qualifis de moyens .
Dans le travail simple, l'activit est toute du ct. de l'homme:
Dans le processus de travail, l'activit de l'homme effectue donc,
l'aide du moyen de travail, un changement de l'objet de travail, changement
qui tait vis l'avance85.
Ainsi nat l'impression que seule la force de travail est une force
productive proprement parler. Cela n'est plus vrai dans le travail
LA POSSIBILIT RELLE 395
complexe. Marx insiste donc ici sur le caractre de choses des moyens de
travail:
Le moyen de travail est une chose [eiDDing] ou un complexe de choses
que le travailleur [Arbeiter] glisse [schiebt] entre lui et l'objet de son travail,
et qui lui sert en tant que conducteur de son activit sur cet objet 86.
Dans ce cas simple, la chose transmet seulement le mouvement que
l'homme lui donne. C'est de ce point de vue que la nature peut tre dcrite
comme un magasin de vivres et un arsenal d'outils possibles, toutes
choses qui, de ce point de vue, sont inertes.
Or - on l'a vu avec la question de savoir si les forces naturelles taient
productives -, l'ide que seul l'homme serait actif et producteur de valeurs
d'usage est unilatrale et fausse. Elle ne convient que pour le travail simple o
la force de travail est la seule force en jeu; l'exemple pris par Marx pour
illustrer cette analyse est celui du tisserand individuel qui utilise un mtier
tisser manuel.
La question est de savoir ce qui est productif . Marx ne dit pas que la
seule force productive soit le travail! La coopration est un pouvoir
productif87 . Le capital lui-mme est productif, mme au sens de productif de
valeurs d'usage, du fait qu'il met en uvre des moyens accrus et qualitative-
ment nouveaux, en particulier 1'atelier automatique , la machinerie, etc.
Mme dans le travail simple, la force de travail, si elle a une certaine
existence en tant que puissance en dehors de son exercice, n'a nanmoins sa
pleine effectivit que mise en prsence des instruments appropris, avec
lesquels elle doit entrer en contact direct. C'est l'ensemble; force de travail et
moyens de travail, qui est seul rellement productif .
Il en est de mme de la machiI}e de travail, et de tout dispositif
machinique, qui doivent tre mus par les forces convenables. Ce qui est
productif, c'est l'ensemble constitu par le moteur, la machine de transmis-
sion, la machine d'opration, et ceux qui les manient.
L'incorporation du moteur dans un systme mcanique dont il n'est
qu'une partie, la coopration de trs nombreux ouvriers, et l'application de la
science, voil ce qui est caractristique du processus de production capita-
liste . C'est tout cela que la note cite ci~dessus voque sans l'expliciter. La
machine est productive dans le systme capitaliste; car celui-ci la lie au
travailleur collectif et la fait fonctionner grce la domestication de forces
naturelles puissantes.
Cette vue dialectique qui considre la totalit du mode de production
dvelopp, qui prend donc l'acte productif avec ses conditions spcifiques
d'effectuation, est seule susceptible de rompre le cercle o se meut une
interprtation purement positiviste des moyens de production. Elle est confir-
me par les remarques dont Marx parsme Le capital:
396 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
En gnral, ds qu'il est tant soit peu dvelopp, le processus de travail
ne saurait se passer de moyens dj travaills88.
Quand Marx explique plus prcisment les rapports de l'homme l'objet
de travail, on voit apparatre l'ide que les moyens de production ne se
bornent pas transfrer une force qui leur est trangre ou extrieure, mais
que leurs proprits, y compris des proprits actives, entrent en jeu et se
joignent aux actions que l'homme exerce89.
Non seulement, il faut inclure dans les moyens de production les forces
naturelles au sens strict du mot force , mais aussi toutes les proprits
inhrentes aux choses. Les machines sont par excellence une combinaison de
diverses parties actives et passives 90; elles combinent les proprits actives et
passives des matires, qui sont slectionnes, prpares. runies, canalises,
diriges. Les matriaux manifestent leurs qualits de rsistance, d'lasti-
cit, etc., qui sont de vritables forces actives ou passives. La machines
apparaissent alors comme jouant un rle actif et productif, tout comme les
forces de la nature ou celles de l'homme, puisqu'elles concourrent la
production de valeurs d'usage. Grce elles, l'homme fait agir les choses sa
place selon la manire qui lui convient. Dans la production l'aide de
machines, la force de travail, les moyens de production et les forces naturelles
fusionnent. C'est l'ensemble, li en un seul tout, qui constitue une force
productive :
De mme que l'homme a besoin d'un poumon pour respirer, de mme
il a besoin d'organes faonns par son industrie pour consommer producti-
vement les forces physiques. Il faut une roue hydraulique pour exploiter la
force motrice de l'eau, une machine vapeur pour exploiter l'lasticit de la
vapeur91.
Il nous faut tirer la conclusion de ces considrations. Nous ferons
remarquer que Marx se place deux points de vue qu'on peut assez bien
distinguer. Du premier point de vue, il analyse le travail en acte; il parle alors
des moyens du travail et les met tous au rang de matriaux et d'instruments
considrs comme autant de choses que le producteur traite comme ses
objets ou du moins comme des objets. La nature elle-mme (y compris les
forces naturelles) est objet en ce sens. Elle est un pur moyen relativement la
fin vise par l'homme. En d'autres termes, tout est vu ici du point de vue
subjectif de l'homme qui agit, poursuit une fin et agence les choses en
consquence: tous les moyens sont objets pour lui.
Quand il s'agit de considrer les capacits productives, on se place un
autre point de vue, celui o l'on se dresse, en quelque sorte, le bilan objectif
des possibilits de production. On se place alors au point de vue du produit
comme dit Marx, ou encore (si l'on prend les choses de plus haut et qu'on
veuille appliquer ces conclusions tout le systme socio-conomique) du point
LA POSSIBILIT RELLE
397
de vue du rsultat historique. Alors, le concept de force productive a son
sens le plus large; il prend le pas sur le sens prcdent, o la force se rduisait
et s'identifiait au travail en tant qu'effectuation de la force de travail humaine.
Ce nouveau concept de force , ainsi gnralis, englobe, avec les forces
proprement dites, tous les moyens disponibles, qu'ils soient en eux-mmes
actifs ou inertes, qu'ils soient actuellement en service ou non, du moment
qu'ils peuvent tre mis en mouvement ou utiliss et consomms productive-
ment. Ils sont susceptibles, comme dit Marx, d'tre rveills d'entre les
morts :
Une machine qui ne sert pas au travail est inutile. [...] Le travail vivant
doit ressaisir ces objets, les ressusciter des morts et les convertir d'utilits
seulement possibles en utilits effectives [wirkliche, relles], agissantes [wir-
kende] 92.
Ainsi, la machine n'est productive que lorsqu'elle est elle-mme en
acte .
On a donc deux points de vue: celui de l'activit relle ou effective et celui
de la possibilit relle. Il s'agit toujours de la bipolarit entre acte et puissance.
Dans le premier cas, celui du travail simple, c'est le langage de l'activit
subjective humaine qui l'emporte: il s'agit des forces productives effectivement
en acte, et sous cet angle subjectif tous les moyens et forces extrieurs
l'homme et au travail sont comme de pures choses. La nature et les forces de
la nature elles-mmes sont la chose de l'homme: elles rentrent dans la
catgorie des moyens objectifs .
Dans le second cas, on a le langage de la possibilit. Tous les moyens ne
sont pas ncessairement mis en uvre, mais pourraient l'tre. Tout devient
force productive . Ce concept couvre tout ce qui est potentiellement contenu
dans les moyens existants: les terres dfricher, les ressources naturelles
extraire, les forces naturelles capter, les machines inventer et faire
fonctionner, etc. De ce point de vue, la machine est une force productive, tout
autant que le buf, ou le sol.
Ainsi, la difficult qu'on pourrait soulever contre Marx se rsoud: c'est la
difficult de comprendre pourquoi ces choses - les machines - sont dites des
forces , alors qu'elles ne sont mises en mouvement que par des forces
naturelles extrieures (animaux, chutes d'eau, combustibles, force expansive
de la vapeur, etc.) ou par l'homme. Cela ne peut tre compris que dans le cadre
d'une double dialectique: celle du sujet et de l'objet d'une part, et celle de la
puissance et de l'acte qu'on trouve dans chacun d'eux, d'autre part.
L'objet (la machine) devient sujet, le sujet (la science) devient objet en se
matrialisant dans la machinerie industrielle:
Il est vident au premier coup d'il que la grande industrie doit, par
l'incorporation des forces immenses de la nature et des sciences de la nature
398 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
dans le processus de production, augmenter extraordinairement la producti-
vit du travail93 .
Le mot important ici est le verbe incorporer. La machine est le corps
de l'homme tendu dans des proportions gigantesques:
C'est comme systme articul de machines de travail qui ne reoivent
leur mouvement que d'un automate central par l'entremise de la machinerie
de transmission que l'exploitation mcanise a sa configuration la plus
dveloppe. La machine isole y a fait place un monstre mcanique dont le
corps emplit des corps de btiment entiers de la fabrique, et dont la force
dmoniaque, dissimule d'abord par le mouvement cadenc et presque
solennel de ses normes membres, clate dans la danse fivreuse et vertigi-
neuse de ses innombrables organes d'opration 94.
Forces et moyens sont deux catgories diffrentes pour l'entende-
ment commun. En ralit, les choses ne sont pas si simples. Dans le travail qui
n'est plus du travail simple, en particulier dans la production capitaliste
dveloppe (machinisme industriel), les forces productives sont des moyens et
les moyens de production sont des forces: il y a identit dialectique. Forces et
moyens passent l'un en l'autre. Il est vain de vouloir maintenir leur distinction
absolue, comme on le voit immdiatement sur les tableaux synoptiques o l'on
range les diverses espces de forces et de moyens de production, o se lisent les
ambiguts, et o apparaissent des bizarreries ou des lacunes surprenantes.
Soit celui auquel aboutit G. A. Cohen95:
Forces
productives
{
Moyens de
production
Force de travail.
{
Instruments de production
(outils, machines, locaux
et matires instrumentales)
Matires premires
Espaces [spaces]
On remarquera que ce tableau met les moyens de production parmi les
forces, ce qui est classique, mais qu'il omet les forces naturelles96. Cet oubli
est des plus tonnant chez un matrialiste, alors que Cohen argumente pour
soutenir que les espaces, faisant partie des .moyens de production,
doivent tre considrs comme des forces productives, ce qui, tout prendre,
est une gageure et un paradoxe plus fort que dans le cas des machines 97
!
Marx qualifie lui-mme de force productive toutes sortes de choses qui
sont loin d'tre des objets matriels au sens habituel. Ainsi, les classes
sociales sont elles-mmes qualifies de forces productives:
Pour que la classe opprime puisse s'affranchir, il faut que les pouvoirs
productifs dj acquis et les rapports sociaux existants ne puissent plus
exister les uns ct des autres. De tous les instruments de production, le
plus grand pouvoir productif, c'est la classe rvolutionnaire elle-mme98.
LA POSSIBILIT RELLE
399
A ce sujet, curieusement, les diteurs des Marx-Engels Werke dnoncent
une erreur de Marx, qui confondrait alors instrument et agent. Ils tentent de
le disculper, mettant cette erreur au compte de l'immaturit et de
1'inscientificit des connaissances de Marx en 1847:
Ici Marx - la diffrence de ses crits ultrieurs - ne distingue pas
encore nettement entre les concepts" instruments de production" et "forces
productives "99.
Faudrait-il enlever tous les moyens de production du tableau des
forces productives prsent l'instant? Dans Le capital, Marx n'crit-il pas
que l'tendue productive de la machinerie [est] plus grande que celle de
l'outil, et que c'est seulement dans la grande industrie que l'homme
apprend faire fonctionner pour rien, sur une grande chelle, comme uneforce
de la nature, le produit de son travail pass, dj objectivlOo?
Faire fonctionner les outils et instruments grce la machinerie, comme
une force, cela dpasse l'entendement ordinaire qui veut sparer les choses et
les forces 101.Marx n'avait pas l'entendement ordinaire!
5. Le service du machinisme et ses limites capitalistes
Dans un paragraphe traitant de la valeur transmise par le machinisme
au produit, Marx parle du service que la machine rend au capitaliste:
plus elle est productive et plus le service qu'elle rend se rapproche de celui des
forces naturelles 102.
Les forces naturelles sont gratuites; de mme que le capitaliste s'empare
de celles-ci, de mme il fait fonctionner les machines son service. Le
machinisme est justement le grand moyen pour lever la plus-value relative:
Ds qu'il s'agit de gagner de la plus-value par la transformation du
travail ncessaire en surtravail, il ne suffit plus que le capital, tout en laissant
intacts les procds traditionnels du travail, se contente d'en prolonger
simplement la dure. Alors, il lui faut, au contraire, transformer les
conditions techniques et sociales, c'est--dire le mode de la production 103.
lever la plus-value relative est en effet chose impossible sans que le
travail ne gagne en force productive 104. L'augmentation de la force produc-
tive du travail, autrement dit, de sa productivit, consiste abrger le temps
socialement ncessaire la production d'une marchandise, de telle sorte
qu'une quantit moindre de travail acquire la force de produire plus de
valeurs d'usage 105.
La possibilit relle de cet accroissement de productivit est fournie
principalement par l'invention et l'usage des machines qui, comparativement
aux diffrents instruments et procds antrieurs, produisent beaucoup plus
400 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
avec autant ou moins de travail humain. Mais soutenir que, grce aux
machines, la plus-value relative est accrue, n'est-ce pas admettre que les
machines auraient pour effet une cration de plus-value et donc de valeur? Or,
l'on connat la thse de Marx: seul le travail cre la valeur. Marx ne rtablit-
il pas ainsi subrepticement un rapport quantitatif entre valeur d'change et
valeur d'usage, ce qui serait en contradiction avec la loi de la valeur?
Ce qui est sr, c'est que Marx affirme que le machinisme rend bel et bien
un service au capital. Mais en quoi consiste exactement ce service? Alors
que jusqu'ici, dans ce chapitre, nous considrions les choses du point de vue de
la valeur d'usage, maintenant entre en ligne de compte la valeur d'change.
S'il est bien clair que les machines accroissent la production des valeurs
d'usage, et qu'en ce sens elles sont des forces productives , par contre le fait
qu'elles permettent d'accrotre la plus-value relative l'est beaucoup moins. La
chose parat mme tout fait contestable sur la base de la thorie de la valeur-
travail et de la thorie de la plus-value qui en dcoule: l'origine de la plus-
value ne peut tre que le travail, ce qui vaut videmment aussi bien pour la
plus-value relative que pour la plus-value absolue.
Or, Marx est catgorique: le machinisme est le grand moyen d'accrotre
la plus-value relative. La difficult qui se prsente ici vient de ce que Marx
soutient, en mme temps, que les machines ne crent pas de valeur. Ces deux
affirmations paraissent tout fait inconciliables. Comment surmonter cette
difficult?
Marx parle en effet d'une manire manifestement ambigu du service
que le machinisme rend au capital, parce que c'est un service gratuit ,
comme nous allons le voir. En quoi peut bien consister ce service? Et parler de
service gratuit, comment est-ce possible et qu'est-ce que cela signifie, tant
donn que les machines cotent ?
Historiquement, le dveloppement du machinisme va de pair avec celui
du capitalisme. Ils s'influencent rciproquement. Le capital a rendu possible la
rvolution industrielle moderne. En retour, celle-ci a permis d'accrotre
continuellement l'accumulation du capital dans des proportions inconnues
auparavant.
Indiquons tout de suite un autre aspect de cette liaison rciproque du
machinisme et du capitalisme: les possibilits de dveloppement du machi-
nisme nous sont apparues comme infinies, sans autres limites que celles de la
nature elle-mme. Par contre, il n'en va pas de mme du mode de production
capitaliste qui comporte ses propres limites intrinsques tant donn qu'il
repose sur l'exploitation de la classe ouvrire, qu'il tend simultanment
dvelopper et chasser de la production selon les alas des hausses et des
baisses du profit.
Ce qui est en question dans le service rendu par les machines au
capital, dans la possibilit relle qu'elles lui offrent d'accrotre la plus-value
relative, c'est la contribution des machines aux possibilits de dveloppement
du capitalisme. Si, d'un ct, les machines rendent un service au capital, d'un
LA POSSIBILIT RELLE 401
autre ct, celui-ci limite leur emploi. Ce sont ces diffrents aspects du
machinisme dans ses rapports avec le capitalisme qui vont nous occuper
maintenant.
Nous avons dsormais une vue complte des forces productives. La
possibilit relle consiste dans le degr de leur dveloppement. La productivit
de travail humain repose sur le dveloppement historique des moyens de
production. Mais ce dveloppement dpend de conditions subjectives
(sociales) autant que de conditions objectives (naturelles et techniques). Le
machinisme, entre les mains des capitalistes, a ralis un accroissement sans
prcdent des forces productives et de la productivit du travail. Avec le
systme des machines qui joue un rle prpondrant dans cet accroissement,
de nouveaux modes de coopration du travail, donc d'organisation sociale de
la production, sont devenus possibles. Cependant le capitalisme les limite
l'intrieur de la fabrique. A l'extrieur, rgnent la concurrence et l'anarchie de
la production. Les classes sociales sont ainsi autant des forces destructrices ou
limitantes que des forces productives.
C'est un fait que le capital tend s'emparer des forces productives quelles
qu'elles soient: en dtenant la proprit des moyens de production, il a rduit
la force de travail sa merci, et, de proche en proche, il a tendu son empire
sur la proprit foncire, sur la terre et les forces naturelles, condition que
toutes ces choses prsentent un pouvoir productif pour lui, c'est--dire
condition qu'elles permettent d'obtenir une plus-value ou un profit accrus:
telle est en effet la loi du capital.
La machine moderne, impliquant une dpense initiale plus importante
que les moyens de production prcdents, ncessita le capital. Inversement, le
dveloppement du capitalisme pousa celui du machinisme, condition
toutefois que celui-ci se rvle tre une source de plus-value et de profit.
Dterminer la nature exacte du service que les machines rendent au
capital doit faire comprendre la fois comment le dveloppement du capital
fut possible, et quel est l'avenir qu'il a devant lui. Comment le capitaliste peut-
il toujours trouver intrt au dveloppement des machines, si elles conomi-
sent la force de travail humaine en la rduisant de plus en plus? La plus-value
ayant en effet son origine dans le travail, si le machinisme rduit la quantit de
travail, d'o peut alors provenir l'accroissement continuel de la plus-value que
le capitaliste en retire, et ne rencontre-t-il pas ncessairement une limite dans
ce dveloppement?
Les choses sont claires tant que l'on reste sur le plan de la production de
valeurs d'usage. Le couplage de la force de travail humaine avec les forces
naturelles et son remplacement graduel par le travail des machines rend
compte du fait que la force productrice du travail est dcuple par ces
nouveaux moyens de production:
La richesse des socits dans lesquelles rgne le mode de production
402 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
capitaliste apparat comme [erscheint ais] une" gigantesque accumulation de
marchandises" 106.
Or, cette production de richesses doit en mme temps assurer l'accroisse-
ment de la plus-value. Comment cela est-il possible? Quel service le
machinisme, une fois cr et instaur grce au capital, continue-t-il de rendre
au capitalisme? Pour le comprendre, considrons d'abord le capitaliste
individuel.
De mme que Marx tient compte du rle des forces naturelles dans la
production des valeurs d'usage 107, de mme il souligne les possibilits du
machinisme qui met contribution, par l'intermdiaire de la science, les
proprits des matriaux et les diverses ressources offertes gratuitement par
la nature:
Les forces productives rsultant de la coopration et de la division du
travail ne cotent rien au capital. Ce sont les forces naturelles du travail
social. Les forces physiques appropries la production, telles que l'eau, la
vapeur, etc., ne cotent rien non plus. [...] Et il en est de la science comme des
forces naturelles. La loi de dviation de l'aiguille aimante dans le cercle
d'action du courant lectrique, ou bien celle de la production du magntisme
dans le fer autour duquel circule un courant lectrique, une fois dcouvertes,
ne cotent pas un liard 108.
La consquence est triviale:
[...] Il est vident au premier coup d'il que l'industrie mcanique, en
s'incorporant des forces immenses de la nature et de la science de la nature,
doit augmenter d'une manire extraordinaire la productivit du tra-
vail [...] 109.
Le capitaliste individuel qui introduit une nouvelle machine performante
profite donc tous points de vue de la mcanisation du processus productif.
Celle-ci lui permet de faire davantage de profit en levant sa part de plus-value
et par consquent son capital. Plus son capital est important, plus il est en
mesure de faire du profit. Cela est assez vident, et Marx peut passer de
l'individu la classe capitaliste:
Le capitaliste qui emploie le mode de production perfectionn s'appro-
prie, par consquent, sous forme de surtravail, une plus grande partie de la
journe de travail de l'ouvrier que ses concurrents. Il fait pour son propre
compte particulier ce que le capital fait en grand et en gnral dans la
production de la plus-value relative 110.
La liaison historique entre machinisme et capital est indniable. L'essor
de l'industrie a t li l'existence pralable de capitaux, mais la rciproque est
encore plus vraie: le sort du capital est li sa capacit de mettre en uvre des
LA POSSIBILIT RELLE
403
procds toujours plus productifs. Toute nouvelle machine qui accrot la
productivit du travail tend le pouvoir et le rgne du capital.
Cependant> la machine ne cre aucune valeur nouvelle. Pas plus que
n'importe quel outil:
Comme tout autre lment du capital constant, la machine ne produit
pas de valeur, mais transmet simplement la sienne l'article qu'elle sert
fabriquer \11.
Dans l'emploi des machines, il faut videmment tenir compte de la
dpense de travail ncessaire pour les produire. Si elles rclamaient autant de
travail pour tre fabriques que les outils et les hommes qu'elle est destine
remplacer, le capitaliste n'y trouverait aucun intrt, sauf s'il veut faire
intervenir des motifs extra-conomiques. Il se heurte aussi la rsistance des
ouvriers qu'il peut remplacer. L'histoire garde les traces des luttes des ouvriers
contre l'introduction des machines: Marx le rappelle.
Si la machine demande davantage de travail qu'elle n'en remplace, alors
le capitaliste est perdant. Le fait que certains s'y essaient reste une exception
qui ne peut tre gnralise. De nombreux inventeurs se ruinent, et le nombre
d'inventions restant lettre morte pour des raisons conomiques ne se compte
pas.
Pour dterminer le service apport par la machine au capital, il faut
considrer le rapport entre la valeur des machines et celles des forces
productives qu'elles remplacent (essentiellement la force de travail). Mais y
intervient galement, d'une manire indirecte qui n'est pas souvent bien
aperue, la valeur des choses que ces machines contribuent produire,
condition qu'il s'agisse des produits entrant dans la consommation courante
de la classe ouvrire, car c'est la valeur de ces produits qui dtermine la valeur
de la force de travail, que dplacent justement des machines.
Si les machines sont coteuses, leur cot se rpartit cependant sur le
grand nombre des marchandises qu'elles fabriquent. Il y a une grande
diffrence entre la valeur de la machine et la portion de valeur qu'elle transmet
priodiquement son produit 112.Comme leur effet est de multiplier norm-
ment les produits par rapport aux procds employs auparavant - Marx en
donne des exemples frappants -, la part de valeur des machines qui entre
dans les marchandises diminue d'autant. Dans chacune, il n'yen a qu'une
infime fraction.
Remarquons que dans tout ceci la machine ne cre aucune valeur: elle se
borne la transmettre au produit. Ainsi, Marx maintient sa ngation de tout
rapport direct entre la machine et la production de la valeur!
Il est clair que la machine ne transmet au produit que la valeur qu'elle a
cot. Il est clair galement que le capitaliste ne s'empare que des machines qui
remplacent la force de travail en conomisant le cot de la production. C'est
ici que la machine moderne est merveilleuse pour lui, car elle incorpore,
404 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
combine et multiplie les oprations difficiles qui demandent des qualits
particulires: habilet, finesse, rapidit, talent, et mme savoir et science. En
consquence, elle rduit l'ouvrier au rle de servant mcanique et de surveil.
lant.
Pourtant, Marx affirme galement que le machinisme contribue d'une
manire essentielle la production de la plus-value relative, c'est--dire sa
cration. Les mots production et cration sont alors l'objet d'une
quivoque que Marx n'a pas toujours pris soin d'viter. Par exemple, il crit:
Il n'y a une grande diffrence entre la machine en tant qu'lment
crant la valeur [ais wertbiIdendem Element] et en tant qu'lment crant le
produit [ais produktbildendem Element] ll3.
Cette affirmation: la machine est un lment crateur de valeur est fort
surprenante. Elle introduit la confusion, et on pourrait accuser Marx de
contradiction, puisqu'il mle les deux plans de la valeur d'usage et de la valeur
d'change. Quand, dans le mme temps, il insiste sur le fait que, tout comme
les forces naturelles, les machines rendent un service gratuit au capitaliste,
l'quivoque est son comble:
Dduction faite des frais quotidiens de la machine et de l'outil, [...] leur
aide ne cote rien. Mais ce service gratuit de l'une et de l'autre est
proportionn leur importance respective 114.
Il faut tenir fermement les thses fondamentales de Marx travers ces
diverses dclarations, et dmler ce dont il est question. D'une part, la valeur
de la machine se retrouve dans le produit total. Quant au service gratuit ,
c'est celui que la machine fournit dans la production des valeurs d'usage.
L' importance de la machine, compare l'outil, ne peut tre que sa
puissance , sa capacit de production, en quoi, de nombreux gards, elle a
une supriorit dcisive sur l'outil manuel:
La raison en est que la machine, construite avec des matriaux plus
durables, vit par cela mme plus longtemps, que son emploi est rgl par des
lois scientifiques prcises, et qu'enfin son champ de production est incompa-
rablement plus large que celui de l'outilll5.
Dans tout cela, il s'agit bien de production des valeurs d'usage. A ce point
de vue, le service de la machinerie est gratuit et proportionnel sa
puissance matrielle, et l'on peut comparer les machines aux outils ou
tout autre force productive, aux animaux et l'homme. On ne peut donc dire
que leur aide ne cote rien [so wirken sie umsonst], et que leur service est
gratuit [unentgeltlieh], qu'en les considrant sous l'angle o elles sont des
forces productives comparables aux forces naturelles.
Du point de vue de la valeur, tout le monde sachant que les machines
LA POSSIBILIT RELLE
405
cotent gnralement plus chers que les moyens antrieurs, elles ne rendent
service au capitaliste que si elles abaissent la valeur des objets de
consommation des masses ouvrires dans une proportion plus grande qu'elles
ne lui cotent l'achat et pour leur fonctionnement rgulier.
L'quation est donc complexe. Le service des machines est absolu en ce
qui concerne la production des valeurs d'usage et relatif en ce qui concerne la
plus-value relative que le capitaliste ralise grce elles, car cette plus-value
rsulte indirectement de l'accroissement de la productivit du travail et de ses
effets sur la valeur des objets de consommation courants.
Au sujet du service rendu par les machines sur le plan des valeurs
d'usage, Marx reproche Ricardo d'avoir parfois port son attention si
exclusivement sur cet effet des machines (dont il ne se rend d'ailleurs pas plus
compte que de la diffrence gnrale entre le processus de travail et le
processus de formation de la plus value) qu'il oublie la portion de valeur
transmise par les machines au produit, et les met sur le mme pied que les
forces naturelles 116."
Or, les machines ne sont pas un don de la nature. Elles ne peuvent donc
pas tre compltement assimiles aux forces naturelles, comme le faisait
Ricardo. Parler de la gratuit de leur service est pourtant invitable, car
elles rendcnt bicn un rel service au capitaliste, puisqu'elles sont pour lui le
moyen d'augmenter la plus-value relative. Pourtant elles ne sont pas absolu-
ment gratuites: il les paie, tout comme la force de travail!
Les machines sont le produit d'un travail pass. Comme le dit trs bien
Marx, c'est ce travail pass qui fonctionne maintenant comme une force
naturelle 117.Elles ont rclam une dpense de forces, de temps, etc. Le service
des machines est donc de conserver ce travail pass, non pas seulement du
point de vue de la valeur, mais du point de vue de l'usage. C'est cette proprit
dont le capitaliste bnficie. Il en bnficie mme doublement car cet effet est
multipli et lev une puissance suprieure quand on se met produire les
machines et leurs outils l'aide de machines 118.
Avec la runion des machines dans un systme (fabrique), les vertus de la
coopration du travail s'appliquent la coopratIon des machines: conomie
au point de vue de la valeur (frais regroups et rpartis entre les diverses
parties de la machinerie), mais aussi accroissement corrlatif sur le plan de
l'usage: les capacits incorpores en elles par le travail pass se combinent et
accroissent leur puissance productive .
Cela ne signifie pas que les machines crent de la valeur. Il en est ici
comme de la fertilit d'un sol, ou de la puissance d'une chute d'eau que
l'cxploitant capitaliste ne paie pas, mais qui contribuent aux rendements
matriels. Les deux processus, celui de la production matrielle, celui de la
valorisation, restent htrognes, mais ils sont nanmoins continuellement
jumels et enchevtrs dans la ralit. C'est l'analyse qui les spare.
Ainsi resurgit continuellement la mme question: les machines crent-
elles la plus-value relative ou non? Il faut rpondre: non; c'est l une illusion,
406 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
semblable beaucoup d'autres en conomie politique. Tout ce qu'elles font,
c'est augmenter la productivit du travail. Qu'en rsulte-t-il, en ralit? Que la
valeur des produits de fabrication industrielle baisse. En effet, le mme produit
contient beaucoup moins de travail au total (mme compte tenu de la part de
valeur transmise par la machine), que s'il tait fabriqu de manire artisanale
ou manufacturire.
Quand on introduit la machine dans le processus de production, il y a
substitution, dans le travail incorpor au produit, d'un travail pass, celui qui
a rclam la fabrication de la machine (ou plutt sa part aliquote), une partie
du travail vivant; le produit demande relativement plus de travail pass, mais
moins en quantit absolue:
Une analyse compare du prix des marchandises produites mcanique-
ment et de celles produites par le mtier ou la manufacture, dmontre qu'en
gnral cette portion de valeur que le produit drive du moyen de travail,
crot dans l'industrie mcanique relativement, tout en dcroissant absolu-
mentI19.
Cette dcroissance absolue se traduit dans la baisse de la valeur des
produits. Il faut en effet moins de temps pour en produire autant. Ce n'est
qu'une autre manire de dire que la productivit du travail a augment. Le
phnomne dans son ensemble est alors le suivant: la valeur d'un mtre de fil
par exemple va contenir plus de valeur venant de la filature mcanise (cot de
la machine filer automatique) que du rouet, mettons dix ou cent fois plus.
Mais, d'un autre ct, cette valeur aura beaucoup diminu puisque la filature
produira mille ou dix mille fois plus dans le mme temps (on peut supposer
que l'on emploie une force de travail de valeur gale).
C'est en cela que consiste la production (cration) de la plus-value
relative. En effet, l'introduction de machines ne prsente d'intrt du point de
vue strictement capitaliste que si elle permet de raliser plus de valeur avec la
mme valeur. La diminution de la valeur relative de la force de travail joue
galement un rle majeur, comme nous l'avons dj dit.
Tout est soumis des changements continuels; tout est donc relatif: la
population crot, les besoins s'tendent, les valeurs des produits baissent.
L'emploi des machines dans le secteur de la production des biens de
consommation courants (ou des moyens servant produire ces biens) abaisse
la valeur de la force de travail, et par l la part relative du temps de travail
ncessaire dans la journe de travail. C'est ce qui modifie la grandeur relative
du temps consacr reproduire la force de travail. Mais la machine ne cre pas
plus de valeur ou de plus-value que n'importe quel autre instrument. La plus-
value provient toujours du surtravail ou travail effectu au-del du temps de
travail ncessaire. L'accroissement des grandeurs relatives masque l'abaisse-
ment des grandeurs absolues. La traduction montaire des valeurs en prix
contribue ce masquage.
LA POSSIBILIT RELLE
407
Une critique inverse de celle faite Ricardo est adresse par Marx
J.-B. Say qui se figure que les machines rendent le "service" de crer une
valeur qui forme une part du profit du capitaliste 120.
Cela confirme nos conclusions prcdentes. Cependant, vu la complexit
du phnomne conomique examin ici, Marx semble parfois s'exprimer de la
mme manire que J.-B. Say, par exemple quand il crit de manire lapidaire:
Moins elle [la machine] contient de travail, moins elle ajoute de valeur
au produit. Moins elle transmet de valeur, plus elle est productive et plus le
service qu'elle rend se rapproche de celui des forces naturelles 121.
Il conviendrait peut-tre de parler de la fertilit du travail pass
incorpor dans les machines. C'est l leur service gratuit . Cette fertilit
ne cote rien. Mais, de mme que le sol s'puise, la machine s'use.
Il suffira de peu de mots maintenant pour comprendre les limites que le
capitalisme impose l'emploi des machines. Rappelons cette vidence: le
capitaliste n'introduit une machine que si elle prsente un intrt de son point
de vue, c'est--dire si elle lui permet de raliser un profit suprieur celui de
ses concurrents.
En soi, le machinisme qui rend service au capital ne lui est pas li pour
l'ternit. En effet, le mode de production capitaliste rencontre ses propres
limites qui font qu' partir d'un certain degr il est amen restreindre
l'emploi des machines: il ne peut en dvelopper toutes les possibilits. Nous
avons dj relev ces limites intrinsques au systme capitaliste, quand il se
heurte la baisse tendancielle du taux de profit, justement provoque par le
dveloppement des forces productives mcanises.
On a vu que le capitaliste individuel qui introduit une machine perfection-
ne accrot sa part de plus-value relative, mais, d'autre part, cette plus-value
extra disparat ds que le nouveau mode de production se gnralise . Tout est
refaire pour lui; il doit nouveau chercher lever la productivit du travail.
Du fait de la concurrence, le capitaliste est entran dans un cercle infini.
Dans l'absolu, lorsqu'une machine exige plus de temps pour tre fabri-
que que le travail qu'elle remplace, son emploi gnralis n'est pas possible.
C'est l une limite pour toute innovation technique, quel que soit le rgime
social. Mais le mode de production capitaliste y ajoute d'autres limites qui lui
sont propres: il s'oppose parfois l'emploi de machines.
Du fait qu'elle remplace certaines oprations de l'homme par des
oprations mcaniques, une machine rejette certaines catgories d'ouvriers
hors de la production en les mettant au chmage, ce qui pse sur le niveau des
salaires et limite la consommation. Mais la mcanisation a entran des crises
spcifiques, les crises de surproduction.
Inversement, le capitaliste n'introduit pas la machine l o la main-
d'uvre est bon march. Par l, s'explique le fait que des machines peuvent
tre mises en uvre dans un pays et non dans un autre. De mme, une fois
408
MARX PENSEUR DU POSSIBLE
invente, une machine peut attendre longtemps avant d'tre rellement
employe, o que ce soit dans le monde.
Ainsi, en tout pays d'ancienne civilisation, l'emploi des machines dans
quelques branches d'industrie produit dans d'autres une telle surabondance de
travail (redundancy of labour, dit Ricardo), que la baisse du salaire au-dessous
de la valeur de la force de travail, met ici obstacle leur usage et le rend
superflu, souvent mme impossible au point de vue du capital, dont le gain
provient en effet de la diminution, non du travail qu'il emploie, mais du travail
qu'il paye 122.
Dans tous les cas, c'est la concurrence qui dtermine les capitalistes
employer ou non les machines, voire les inventer eux-mmes ou pousser
l'invention quand elles peuvent conomiser de la force de travail et faire
crotre le profit 123. .
Avec les machines, ce sont donc la fois des possibilits nouvelles qui
s'offrent, et des limites, des impossibilits, qui apparaissent. C'est alors que les
rapports sociaux et la lutte des classes jouent leur rle.
D'une part, la bourgeoisie s'est empare de toutes les forces productives
de l'industrie mcanique qui taient son avantage. Elle les a puissamment
impulses et fait fructifier. C'est son ct civilisateur 124.
Cependant, elle les limite selon les contraintes internes du capital. La
diffrence entre le prix d'une machine et celui de la force de travail peut varier
beaucoup, lors mme que la diffrence entre le travail ncessaire la
production de la machine et la somme de travail qu'elle remplace reste
constante 125.
C'est la premire diffrence (diffrence de valeur) qui dcide de l'emploi
des machines dans le systme de production capitaliste, lors mme que la
seconde diffrence serait matriellement" avantageuse et permettrait une
diminution sociale du temps de travail total. Le capitaliste considre la
machine uniquement comme moyen de rendre le produit meilleur mar-
ch 126". Il ne s'occupe pas des besoins matriels et de leur qualit.
Mais, les machines et, plus gnralement, les techniques, pourraient tre
considres tout autrement: comme diminuant et pargnant la peine des
hommes. Pour qu'elles prsentent cet intrt, il suffit que le temps ncessaire
leur production soit moindre que le temps de travail qu'elles remplacent, et
que les conditions dans lesquelles elles sont produites soient humaines:
C'est pourquoi, dans une socit communiste, l'emploi des machines
aurait une tout autre tendue que dans la socit bourgeoise 127.
Ses limites, le mode de production capitaliste les prouvent dans les crises.
LA POSSIBILIT RELLE
409
NOTES
1. Op. ciL, p. 246.
-
Dans le mme ordre d'ides, citons la formule significative de Hegel:
Le moyen est quelque chose de suprieur aux buts finis de la finalit extrieure. (Science de la
logique, trad. Janklvitch, t. II, p. 452; trad. Labarrire, t. II, p. 263). Sur cette question, cf.
J. D'HoNDT, Tlologie et praxis dans la "Logique" de Hegel, Hegel et la pense moderne,
Paris, Presses Universitaires de France, 1970, pp. 1-26.
2. Nous l'entendons ici au sens de M. Simondon qui englobe sous cette dnomination les
objets et les ensembles techniques. Il peut tre utile de prciser que, selon cet auteur, il faut
dfinir l'objet technique [...], par le processus de concrtisation et de surdtermination
fonctionnelle qui lui donne sa consistance au terme d'une volution, prouvant qu'il ne saurait tre
considr comme un pur ustensile (op. ciL, p. 15).
3. L'idologie (1968) p. 45; (1976) p. 15; bi!., pp. 56-57; MEW 3,21.
-
Plus tard, propos
des rapports sociaux, Marx dira que c'est l'instrument qui est dcisif (<<Subordination formelle
et subordination relle du travail au capital , cf. uvres (d. Rubel), t. 2, p. 374).
4. La politique, L. I, ch. IV, 9
4, 1254 a 1-5 (d. Aubonnet, p. 17).
5. Le capital (trad. Lefebvre), p. 200; ES, t. l, p. 181; MEW23, p. 193. (Dj cit, cf. ci-dessus
p. 366).
-
La traduction de Roy omet le mot finalis, et dit activit personnelle de l'homme.
Le texte allemand n'a cependant pas vari (cf. MEGA, t. II/S, p. 130).
6. Ibid., p. 199; p. 192.
7. En cela, Marx s'est trs visiblement inspir des ides de Hegel (J. D'HoNDT, L'idologie
de la rupture, Paris, P.U.F., p. 205). Marx renvoie expressment l'Encyclopdie qu'il cite ce
propos dans Le capital [to l, p. 182, n. I; MEW 23, p. 194, n. 2]: La raison est aussi ruse que
puissante. La ruse consiste en gnral dans l'activit mdiatisante qui, en laissant les objets,
conformment leur nature propre, agir les uns sur les autres et s'user au contact les uns des
autres, sans s'immiscer immdiatement dans ce processus ne fait pourtant qu'accomplir son but
(HEGEL, Encyclopdie,
9
9, Addition, trad. Bourgeois, p. 614).
8. Le capital, t. 1, pp. 181-182; trad. Lefebvre, p. 201; MEW 23, p. 194.
--
Cela se trouve
presque littralement chez Hegel (cf. note prcdente) ceci prs que Hegel parle de <<laisser les
choses agir" et Marx de se servir d'elles" pour les faire agir les unes sur les autres.
9. Ibid., p. 182; p. 201; p. 194. (Trad. modifie)
10. Ibid., p. 184; pp. 204-205; p. 197.
-
Marx emploie parfois konnen qui indique la
possibilit matrielle objective, le pouvoir physique de faire: La matire premire peut [kann]
former la substance principale d'un produit ou n'y entrer que sous la forme de matire auxiliaire
(ibid.). Mais, il emploie aussi bien mogen qui a un sens subjectif, renvoyant un choix ou un
dsir, ou encore qui exprime une incertitude objectivement fonde, au sens de: <dl peut se faire
que
",
il peut arriver que .
11. Cf. Ibid., p. 51 ; p. 39; p. 49; et Contribution, p. 8; MEW 13, p. 16.
12. Cf. Contribution, ibid. - Mme observation dans Le capital, t. I, p. 186; trad. Lefebvre,
p. 207; MEW 23, p. 199.
13. L'idologie (1986) p. 55; (1976) p. 25; d. bi!. pp. 85; MEW 3, p. 43.
14. Ibid.
15. Cette exprience et ce sentiment d'arrachement et de perte taient la base du
Romantisme, dont les manifestations ont t souvent dcrites et les racines sociales analyses.
16. Sur l'importance et le sens de ce thme dans le gense de la philosophie hglienne,
cf. Charles TAYLOR, Hegel, Cambridge/Londres/New York/Melbourne, Cambridge Univ. Press,
rd., 1978, ch. 1 et 3.
17. Onzime Thse sur Feuerbach, L'idologie (1968), p. 34; (1976) p. 4; d. bi!., pp. 32-33;
MEW 3, p. 535. Trad. modifie.
18. Manifeste, pp. 118-119; MEW 4, p. 493. Trad. modifie.
19. Le capital, t. 2, p. 59, n. 2; trad. Lefebvre, pp. 417-418, n. 89; MEW 23, pp. 392-393, n. 89.
20. Le capital, t. l, p. 182; trad. Lefebvre,.p. 201; MEW 23, p. 194. Trad. modifie..- Marx
pense vraisemblablement un chapitre de l'Evangile de Matthieu (VI, 27), qui dclare vaine
l'accumulation des moyens d'existence artificiels: Qui de vous peut, force de sO).lcis, prolonger
une coude la longueur de sa vie?"
(La Sainte Bible, Braine-le-Comte (Belgique), Ed. Zech, 1952,
p. 1146).
.
21. Sans parler de tableaux clbres, nous pensons La bte humaine d'Emile Zola et la
pice musicale Pacific 231 d'Arthur Honneger.
410 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
22. Le capital, t. 2, p. 15; (d. Lefebvre) p. 361; MEW 23, p. 340. Trad. modifie.
23. Selon M. Bertrand Gille, il s'agit d'une priode qui couvre la Renaissance, le XVII' et la
premire moiti du XVIII' sicle (cf. GILLE, op. cit., pp. 580-675).
24. En novembre 1851, Marx tudie les ouvrages de Johann BECKMANN (Beitrage zur
Geschichte der Erfindungen [Contribution l'histoire des inventions), Leipzig/G6ttingen, 1782-
1805,5 t. en 2 vol.) et de Johann H. M. POPPE (Geschichte der Technologie seit der Wiederherstel-
lung der Wissenschaften bis an das Ende des achtzehnten lahrhunderts [Histoire de la technologie
depuis la renaissance des sciences jusqu' la fin du XVIII' sicle], Leipzig/G6ttingen, 1807-1811,
5 vol.; et Lehrbuch der allgemeinen Technologie [Manuel de technologie gnrale], Cotta, 1821). A
son habitude, il en relve des extraits dans ses cahiers.
25. Marx a tudi Ch. BABBAGE (On the Economy of Machinery and Manufactures, London,
1832) et A. URE (The Philosophy of Manufactures: or, an exposition of the scientific, moral and
commercial Economy of the Factory System of Great Britain, London, 1835). Il s'est d'abord servi
des traductions franaises de ces ouvrages. Dans Le capital, il citera l'dition anglaise de celui de
Babbage.
26. Op. cit., t. l, p. i.
27. Ibid., p. iij. .
28. Ce concept est introduit par Beckmann dans son Entwurf der allgemeinen Technologie
(Projet de technologie gnrale) (cf. Thals, 1968, pp. 43-45). Marx ne semble pas avoir connu cet
ouvrage tardif de Beckmann.
29. Op. ciL, t. 1, p. 232.
30. Le capital, t. 2, p.' 40, n. 3; trad. Lefebvre, p. 393, n. 48; MEW 23, p. 370, n. 48. -
Babbage a laiss son nom dans l'histoire des techniques: il fut le premier dgager tous les
concepts de base d'un calculateur automatique , et est ainsi l'origine des ordinateurs actuels
(cf. Histoire des techniques, pp. 916-918). Il fit aussi partie de la commission statistique
internationale mise sur pied par Qutelet.
31. Cette dfinition, dj cite dans Misre de la philosophie (p. 145; MEW 4, p. 153) sans
indication de page, est reprise dans Le capital (t. 2, p. 62, n. I; p. 421, n. 95; p. 396, n. 95). Marx
ne donne pas la rfrence. Dans Babbage (op. ciL), cette dfinition est p. 230. L'diteur franais
du Capital renvoie la premire dition anglaise de 1832, p. 136.
32. Selon M. Franois GURY< La division dl! travail entre Ure et Marx ( propos de Michel
Henry)>>, Revue philosophique de la France et de l'Etranger, 1977,
n
4, pp. 423-444), Marx serait
pass ct de ce qu'il
y
avait de plus neuf chez Ute. Celui-ci avait propos de considrer que le
principe du systme automatique est [...] de substituer l'art mcanique la main-d'uvre, et de
remplacer la division du travail entre les artisans par l'analyse d'un procd dans ses principes
constituants (Philosophie des Manufactures, p. 30, et p. 32). L'anglais dit to substitute
mechanical science for handskill, and the partition of a process into its essential continents for the
division or gradation of labour among artisans.
- M. Gury parle d'une bvue de Marx qui serait
due partiellement la traduction franaise utilise par Marx. Mais il incrimine galement les
propres traductions en allemand d'extraits de Ure faites par Marx. - Dans Le capital, Marx
procde une analyse gnalogique (historique) du machinisme: ce qui lui importe, c'est la faon
dont on est pass des outils et instruments dans la manufacture aux systmes de machines dans la
fabrique industrielle de son poque. Il cite Ure et retient sa dfinition de la fabrique et du systme
automatique, en les mettant leur place: au terme de l'volution (cf. Le capital, t. 2, pp. 65-66;
trad. Lefebvre, p. 426; MEW 23, p. 401).
33. Le capital, t. 2, p. 60; trad. Lefebvre, p. 419; MEW 23, p. 394.
34. Ibid., p. 64; p. 424; p. 398.
35. Ibid., p. 60; p. 419; p. 394.
36. Ibid., pp. 61-62; p. 421; p. 396.
-
On ne peut manquer d'tre frapp de la perspicacit
de Marx sur ce sujet , dit M. G. CANGUILHEM (<<Les commencements de la technologie , Thals,
1968, p. 23).
37. Le capital, t. 2, p. 60; trad. Lefebvre, p. 419; MEW 23, p. 394.
-
La notion d'opration
renvoie davantage Ure, qui serait ici suprieur Marx, pense M. Gury, par son esprit
rationaliste, car il procde une analyse plus abstraite du travail: sa dmarche est analytique.
38. Ibid., p. 62; p. 421; p. 396. (Trad. modifie).
-
Cette sorte de machine de travail se
prsentait l'poque dans les filatures et fabriques de tissage mcaniques, o un grand nombre de
machines de travail disposes en srie taient actionnes par une seule machine motrice. Marx
ajoute que cette machine est seulement l'lment simple de la production mcanique [maschinen-
massigen Produktion]" (Ibid.).
39. Ibid., p. 65; p. 425; p. 400.
LA POSSIBILIT RELLE
411
40. L-dessus, il n'y a rien dans les Manuscrits de 1857-1858 (cf. t. II, pp. 181 et suiv.; Gr.,
pp. 581 et suiv.), o Marx se borne rappeler Babbage et Ure, restant sur un plan conomique,
et n'entrant pas dans l'analyse proprement technologique, ce qu'il fera dans Le capital. C'est dans
des lettres Engels qu'on le voit aborder ces questions: .. Dans ma dernire lettre, je
t'ai interrog
sur les selfactors [machines filer automatiques]. [...] De quelle manire avant cette invention
intervenait l'ouvrier qu'on appelle le spinner [fileur]? Je comprends ce qu'est le selfactor, mais pas
la situation qui l'a prcd.
- J'insre certaines choses dans la section sur le machinisme. Il y a
quelques questions curieuses que j'ignorais lors de ma premire laboration. Pour y voir plus clair
sur ce point,
j'ai relu entirement mes cahiers [d'extraits] sur la technologie; je suis de mme un
cours de travaux pratiques [...]. (L. du 28 janv., Correspondance, t. VII, pp. 127-128; Lettres sur
Le capital, p. 133; MEW 30, pp. 320-321. Trad. modifie).
41. Le capital, t. 2, pp. 65-66; trad. Lefebvre, p. 426; MEW 23, p. 401.
- C'est l que Marx
retient l'ide essentielle de Ure: Le processus total est considr en lui-mme, analys dans ses
principes constituants et ses diffrentes phases, et le problme qui consiste excuter chaque
processus partiel et relier les divers processus partiels entre eux, est rsolu au moyen de la
mcanique, de la chimie, etc. Marx ajoute ce complment significatif: ce qui n'empche pas
naturellement que la conception thorique ne doive tre perfectionne par une exprience pratique
accumule sur une grande chelle (ibid.). Cela va l'encontre de la thse de M. Gury faisant de
Ure un prcurseur du rationalisme appliqu , que Marx n'aurait pas compris. M. Gury n'a pas
pris en considration un tel passage, o Marx rend hommage Ure et tient compte de son analyse,
en liant troitement la thorie la pratique.
42. L. Engels du 28 janv. 1863, Correspondance, t. VII, p. 128; Lettres sur Le capital,
p. 133; MEW 30, p. 321.
43. Ibid.
44. Ibid. (Trad. modifie). - Malgr de tels passages, M. Gury, estimant que Marx n'a pas
compris Ure, se pose le problme psychologique et pdagogique d'expliquer ce qui se passe dans
l'esprit du mauvais lve qu'est Marx. Ce dernier se serait livr un bricolage douteux des
textes sa disposition (cf. F. GURY, op. cir., p. 431). Nous reviendrons ci-dessous, dans notre
prochain paragraphe sur la division du travail, sur un point de l'article de M. Gury qui, propos
de la technologie, demande: Marx fait-il autorit en la matire? (ibid., p. 425). Marx ayant
soulign que la rvolution technique du machinisme avait lieu dans certaines fonctions de travail
propres l'homme, son analyse ne nous parat pas infrieure celle de Ure, d'autant plus qu'il la
reprend!
45. L. Engels du 28 janv. 1863, Correspondance, t. VII, p. 128; Lettres sur Le Capital,
p. 134; MEW 3D, p. 321. Trad. modifie.
46. Ibid., p. 130. p. 135; p. 322.
47. Rappelons que c'est en 1844 que Marx se familiarisa avec l'conomie politique. Ses
lectures portrent sur de nombreux ouvrages. M. Cornu (op. cit., t. 1, p. 89) en signale treize,
indiquant que sa liste est incomplte (cf. MEGA IV/2, pp. 301-553; Marx-Engels Bibliographie,
pp.21-34).
48. Misre, p. 135; MEW 4, p. 144-145.
49. Ibid.
50. Babbage, disent les historiens de la technologie, fut .d'initiateur [d'une] nouvelle manire
de poser les problmes de l'conomie, d'intgrer thorie du machinisme et thorie de l'conomie .
(Thals, 1966, p. 83.
-
En note, on
y lit que Babbage fut un innovateur dans de nombreux
domaines: machines calculer, thorie de la reprsentation des systmes mcaniques, thorie de
la politique de la science, et qu'en fait la mme inspiration l'anime, il s'agit toujours des
conditions de la puissance historique . On comprend l'intrt que lui porte Marx.)
51. Misre, p. 148; MEW 4, p. 155..
52. M. Gury n'examine pas pour eUe-mme la conception de la division du travail chez
Marx; il examine avant tout les citations de l'ouvrage de Ure dans Le capital, et leurs sources.
53. Misre, p. 145; MEW 4, p. 152-153.
-
Dans l'alina suivant, Marx prcise qu'il s'agit de
.da division du travail dans le sens d'A. Smith.
54. Ibid.
55. Le capital, t. 2, p. 43; MEW 23, p. 374.
-
Mme ide dans Misre de la philosophie:
l'accumulation et la concentration d'instruments et de travailleurs prcda le dveloppement de
la division du travail dans l'intrieur de l'atelier. Une manufacture consistait beaucoup plus dans
la runion de beaucoup de travailleurs et de beaucoup de mtiers dans un seul endroit, dans une
salle sous le commandement d'un capital, que dans l'analyse des travaux et dans l'adaptation d'un
ouvrier spcial une tche trs simple. [...] Pour M. Proudhon, qui voit les choses l'envers, si
412 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
toutefois il les voit, la division du travail dans le sens d'Adam Smith, prcde l'atelier, qui en est
une conditon d'existence (Misre, pp. 144-145; MEW 4, pp. 152-153).
56. Recherches..., L. lcr, pp. 38-46.
57. Misre, p. 144; MEW 4, p. 152.
58. Ibid.
59. Ibid.
60. Ibid.
61. Ibid., p. 143; p. 151.
62. Le capital, t. 2, p. 41, n. 1; MEW23, pp. 371-372, n. 50. -. Marx
y
cite la triple distinction
de Skarbeck: division gnrale du travail par grands scctcurs d'activit, division principale par
branches, et division spciale que l'on devrait qualifier du titre de division de besogne ou dc
travail proprement dite .
63. Cf. ses Extraits de lecture, in MEGA IV12, pp. 328-331, et IV/3: la lecture de la Thorie
des richesses sociales de Skarbeck a lieu fin 1843 .dbut 1844, et celle du Cours d'conomie politique,
et des Considrations sur la nature du revenu national de Storch, entre fvrier et juin 1845
(cf. Marx-Engels Bibliographie, p. 28, et CORNU,op. cil., t. III, Marx Paris, 1962, p. 89, n. 3).
64. Misre, p. 143; MEW 4, p. 151.
65. Manuscrits de 1857-1858, t. l, p. 219; GR., p. 189.
66. Le capital, t. 2, p. 46; trad. Lefebvre, p. 401; MEW 23, pp. 377-378.
67. Cet ouvrage tait inconnu en allemand. Il ne sera traduit qu'en 1884, aprs la mort de
Marx, et il tait sans doute difficile de le trouver en 1867! Cela n'empche pas Marx de rappeler
son analyse ancienne, qu'il estime toujours valable. -.. La citation donne en note par Le capital
l'tait en franais: On... peut tablir cn rgle gnrale, que moins l'autorit prside la division
du travail dans l'intrieur de la socit, plus la division du travail se dveloppe dans l'intrieur de
l'atelier, et plus elle y est soumise l'autorit d'un seul. Ainsi, l'autorit dans l'atelier et celle dans
la socit, par rapport la division du travail, sont en raison inverse l'une de l'autre (Misre,
p. 143; MEW 4, p. 151; MEGA, II/S, p. 291, note 59). Signalons que ces pages de Misre de la
philosophie sont utilises dans les Manuscrits de 1861-1863 (t. I, Cahiers l V, p. 310; MEGA,
II/3.1, pp. 267-268).
68. Avec la manufacture se dveloppa aussi et l l'usage des machines. [...] L'Empire
romain avait transmis avec le moulin eau la forme lmentaire de toute machinerie [ou
mcanique] [Maschinerie] (Le capital, t. 2, pp. 38-39; trad. Lefebvre, pp. 391-392; MEW 23,
p. 368. Trad. modifie). Les deux bases matrielles sur lesquelles, dans le cadre de la
manufacture, se fonde le travail prparatoire l'industrie mcanique, sont la montre [l'horloge]
et le moulin (d'abord le moulin grains sous la forme du moulin eau), tous deux lgus par
l'Antiquit. (Le moulin eau, originaire d'Asie mineure, introduit Rome l'poque de Jules
Csar)>>(Lettre Engels du 28 janv. 1863, Correspondance, t. VII, pp. 128-129; MEW 30, p. 321).
69. Proudhon crivait ce sujet: Dans la socit, l'apparition incessante des machines est
l'antithse, la formule inverse du travail; c'est la protestation du gnie industriel contre le travail
parcellaire et homicide. [...] Les machines, se posant dans l'conomie politique contradictoirement
la division du travail, reprsentent la synthse, s'opposant dans l'esprit humain l'analyse
(PROUDHON,Philosophie de la misre, t. l, pp. 135, 136, 161 et 164. Cit in Misre, p. 141; MEW
4, p. 149).
70. Misre, p. 146; MEW 4, p. 154.
71. Ibid.
72. Ibid., p. 147; p. 154.
73. Le capital, t. I, p. 181; trad. Lefebvre, p. 200; MEW 23, p. 193. Trad. modifie.
74. Ceux qui veulent rserver le caractre productif au seul travail humain sont logique-
ment amens s'lever contre cette extension du concept de forces productives; c'est le cas de
certains disciples de M. Louis Althusser (cf. MACHEREY,Marx et l'idologie bourgeoise du travail,
d'aprs le premier paragraphe de la Critique du Programme de Gotha (Communication un
Colloque du C.R.D.H.M., Poitiers, non publie, Compte Rendu in Recherches Hgliennes,
n
15,
sept. 1980, pp. 6-7).
75. M. G. A. COHENpropose une <<lecture technologique (tecbnological reading) de Marx
(op. cit., p. 31).
76. A. W. WOOD (op. cit., p. 70) s'interroge: La thorie de l'histoire [de Marx] est-elle
technologique? (A <<technological tbeory of history?). Il rpond par la ngative.
77. Misre, pp. 140-141; MEW 4, p. 149.
78. Infrastructure dsigne, la fois et indistinctement, la base matrielle de la socit et les
rapports sociaux qui lui sont ncessairement et intimement lis. Cependant, ce sont deux
LA POSSIBILIT RELLE 413
catgor'ies htrognes comme matire et forme chez Aristote. A propos des confusions qui
naissent de l, G. A. COHEN(op. cit., pp. 28-37) fait des remarques trs pertinentes.
79. Le capital, 1. 2, p. 59; trad. Lefebvre, p. 419; MEW 23, p. 393.
80. Le moteur donne l'impulsion tout le mcanisme. Il enfante sa propre force de
mouvement comme la machine vapeur, la machine lectro-magntique, la machine calorique,
etc., ou bien reoit l'impulsion d'une force naturellc externe, comme la roue hydraulique d'une
chute d'eau, l'aile d'un moulin vent des courants d'air>' (ibid.). Une machine peut mme tre me
par la force humaine, comme le circular loom [mtier tisser circulaire] de Claussen, qui sous la
main d'un seul ouvrier, excutc 96000 mailles par minute (ibid., p. 59; p. 418; p. 392).
81. Misre,p. 145;MEW4,p. 153.
82. L'idologie (1968) p. 65; (1976) p. 34; bil., pp. 114-115; MEW 3, p. 45.
83. Le capital, t. l, p. 183; trad. Lefebvre, p. 203; MEW 23, p. 196.
-
Marx soutient le
paradoxe de nommer moyen <de poisson qui n'a pas encore t pris, car on n'a pas encore
invent l'art d'attraper des poissons dans des eaux o il n'yen a pas (ibid., n. I; n. 6).
84. Ibid., p. 183, n. 2; p. 203, n. 7 (o l'on relve une coquille: finition au lieu de
dfinition !); p. 196, n. 7; MEGA, t. II/5, p. 132. (Trad. refaite; deux mots souligns par Marx;
cf. MEGA II/5, qui donne le texte de la premire dition allemande.)
85. Ibid., p. 183; p. 203; p. 195. (Trad. modifie)
86. Ibid., p. 181; p. 201; p. 194. (Trad. modifie. Nous suivons littralement le texte
allemand, au risque d'une certaine lourdeur.)
87. Un mode de production ou un stade industriel dtermins sont constamment lis un
mode de coopration ou un stade social dtermins, et [...] ce mode de coopration est lui-mme
une "force productive" (L'idologie (1968) p. 58; (1976) p. 28; (d. bil.) pp. 94-95; MEW 3,
p. 30).
-
Le chapitre du Capital sur la coopration (t. 2, pp. 16-27; pp. 362-377; pp. 341-355)
dveloppe la mme ide.
88. Le capital, t. 1, p. 182; trad. Lefebvre, p. 202; MEW 23, p. 194. Trad. modifie.
89. Rappelons ici des lignes dj cites (cf. ci-dessus, p. 376, citation rfrence note 8): Il
[le travailleur] profite des proprits mcaniques, physiques, chimiques de certaines choses pour
les faire agir en tant que moyens d'action [ais Machtmittel) sur d'autres choses, conformment
son but (ibid., pp. 181-182; p. 201; p. 194.
-
Trad. modifie).
90. Fr. REULEAUXa thoris le rle de ces diverses forces et des contraintes qu'on leur
impose dans les mcanismes, attirant particulirement l'attention sur les cltures de force,
forme sous laquelle s'est conserv, dans le systme machinal, un reste de libert cosmique
(Cinmatique: Principes fondamentaux d'une science des machines, trad. Debize, Paris, Libr. F.
Savy, 1877, p. 257). Reuleaux observait en effet qu',<I existe dans la nature, des mouvements
d'une trs grande varit , et que quant des mouvements rigoureusement relis les uns aux
autres et drivant rgulirement les uns des autres, comme ceux que nous obligeons les machines
produire, on n'en rencontre jamais dans la nature (ibid., p. 256).
91. Le capital, t. 2, p. 71; trad. Lefebvre, pp. 433-434; MEW 23, p. 407.
92. Ibid., t. I, p. 185; p. 206; p. 198. Trad. modifie.
93. Ibid., trad. Lefebvre, p. 434; E.S., 1. 2, p. 72; MEW 23, p. 408.
94. Ibid., p. 428; p. 67; p. 402.
95. Op. cit., p. 55. Trad. par nous.
-
Ce tableau en remplace un autre, plus sommaire,
prsent quelques pages plus haut par Cohen afin de le discuter (ibid., p. 32).
96. M. G. HEYDEN(Philosophisches Worterbuch, p. 978) omet aussi les forces naturelles en
dfinissant les forces productives, ce que nous avons dj signal (cf. ci-dessus p. 292, n. 110).
97. Op. cit., pp. 50-52.
98. Misre, p. 178; MEW4, p. 181.
99. MEW 4, p. 626, note 79. Trad. par nous.
-
Sans doute l'ide que Marx ait pu qualifier
la classe ouvrire d' instrument soulve-t-elle quelque rticence! Dans leur note, les diteurs
renvoient aux remarques d'Engels sur les modifications termina logiques qu'il a apportes lors de
la rdition de Travail salari et capital, substituant force de travail travail o cela
s'imposait: Marx n'a introduit cette distinction qu'une dizaine d'annes plus tard, comme on l'a
vu. Mais Engels ne fait allusion aucune autre modification terminologique, disant au contraire
qu'elles tournent toutes autour de ce point. Est-il donc si difficile de penser dialectiquement les
deux notions de force de production et d'instrument de production? La classe ouvrire, domine,
exploite et rprime, ne devient-elle pas un instrument de la production capitaliste? Et son
tour ne se transforme-t-elle pas en instrument et force de la rvolution technologique, puis de la
rvolution sociale et politique? Qui distinguera ici la force de l'instrument?
100. Le capital, trad. Lefebre, p. 434; ES, t. 2, p. 72; MEW 23, p. 409. Soulign par nous.
414 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
101. Tenter de distinguer, comme M. J.-P. Lefebvre (Dictionnaire critique du marxisme,
p. 467), entre la force productive et les forces de production ne nous aurait t d'aucun
secours dans la question dbattue ici. En ralit, Marx emploie, dans les mmes textes, l'une ou
l'autre de ces expressions (produktivkriifte, Produktionskriifte), et au singulier ou au pluriel. Voir,
par exemple, L'idologie allemande (cf. MEW 3, o l'on trouve ces deux expressions respective-
ment pp. 21, 22, 24, 26,30,35,38, etc., et 32,34,35,36,38, etc.); Forces de production , selon
M. Lefebvre est toujours au pluriel dans L'idologie allemande et a un sens subtantiel qui
rgresserait tendanciellement , dit-il (ibid., pp. 468-469). Mais on vrifiera qu'il n'en est rien:
dans les mmes pages, Marx use aussi du singulier! videmment, dans Le capital, il sera davantage
question de la productivit et de ,<la force productive du travail (au singulier), tant donn le
caractre thorique de l'ouvrage.
102. Le capital, t. 2, p. 74; trad. Lefebvre, p. 438; MEW23, p. 411. (Nous laissons de ct
pour l'instant le dbut de cette phrase qui dit que moins elle [la machine] transmet de valeur, plus
elle est productive. Cela soulve des problmes que nous allons examiner dans un instant.).
103. Ibid., p. 9; p. 354; p. 334.
104. Ibid., p. 9; p. 353; p. 333. Soulign par nous.
105. Ibid., p. 9; p. 354; p. 333.
106. C'est la phrase sur laquelle s'ouvre Le capital (t. l, p. 51; trad. Lefebvre, p. 39; MEW
23, p. 49; trad. modifie). Mme chose au dbut de1a Contribution (p. 7; MEW 13, p. 15).
107. Marx clt la section sur le machinisme et la grande industrie en indiquant que ,<les deux
sources d'o jaillit toute richesse [sont]: La terre et le travailleur" (Le capital, t. 2, p. 182; trad.
Lefebvre, p. 567; MEW 23, p. 530). -.Termes souligns dans l'dition de Roy; ainsi que dans la
1red. allemande (cf. MEGA, t. II/S, p. 413), mais non dans les autres.
108. Ibid., p. 71; trad. Lefebvre, p. 433-434; p. 408. (Trad. modifie) - Marx fait ici allusion
l'invention des moteurs lectriques (machine de Gramme) dans les annes soixante du sicle
dernier.
.
109. Ibid., p. 72; trad. Lefebvre, p. 434; p. 408. (Trad. modifie) - Citation dj faite, mais
pour un autre de ses aspects (cf. ci-dessus, pp. 397-398, n. 93).
110. Ibid., p. 12, p. 358; p. 337.
111. Ibid., p. 72; p. 434; p. 408.
112. Ibid.
113. Ibid. Trad. modifie
-
Ces deux phrases sont condenses en une seule par Roy.
114. Ibid., p. 72; trad. Lefebvre, p. 435; p. 409.
-
Voici la traduction propose par
M. Lefebvre: Si nous dduisons de la machinerie et de l'outilleurs cots moyens quotidiens, [...)
alors ils travaillent [wirken] pour rien, comme des forces de la nature disponibles sans
l'intervention du travail humain. Dans la mesure mme o l'tendue productive [der produktive
Wirkungsumfang] de la machinerie sera plus grande que celle de l'outil, plus grande sera l'tendue
de son service gratuit [ibres unentgeltlichen Dienstes], compar celui de l'outil .
115. Ibid.
116. Ibid., pp. 72-73, n. 1; pp. 435-436, n. 109; p. 409, n. 109.
117. Ce n'est que dans l'industrie mcanique que l'homme arrive faire fonctionner sur une
grande chelle les produits de son travail pass comme forces naturelles, c'est--dire gratuite-
ment (ibid., p. 72; p. 435; p. 409).
-
Cit ci-dessus p. 464, n. 1, dans la traduction de
M. Lefebvre.
118. La production de machines au moyen de machines diminue videmment leur valeur,
proportionnellement leur extension et leur efficacit (ibid., p. 74; p. 438; p. 411).
119. Ibid.
120. Ibid., pp. 72-73, n. l, in fine; p. 436, n. 109; p. 409, n. 109.
121. Ibid., p. 74; pp. 437-438; p. 411.
-
Nous avions signal la difficult de bien comprendre
ces affirmations de Marx (cf. ci-dessus, p. 399, n. 102).
122. Ibid., p. 77; p. 441; p. 415.
-
Aussi voit-on aujourd'hui des machines inventes en
Angleterre qui ne trouvent leur emploi que dans l'Amrique du Nord. Pour la mme raison,
l'Allemagne, aux XVIe et XVIIe sicles, inventait des machines dont la Hollande seule se servait; et
mainte invention franaise du XVIIIe sicle n'tait exploite que par l'Angleterre (ibid., p. 77;
p. 441; pp. 414-415).
123. De tout cela, Marx donne des exemples (cf. ibid., pp. 77-78; pp. 441-442; pp. 415-416).
124. Cf. Manifeste, pp. 40-41; MEW 4, pp. 466-467.
125. Le capital, t. 2, p. 77; trad. Lefebvre, p. 441; MEW 23, p. 414.
-
Dans le dbut de la
phrase, il s'agit de la valeur d'change des forces productives, dans la deuxime partie de leur
valeur d'usage. Marx veut dire qu'il n'y a pas de proportion ncessaire entre elles: une machine
LA POSSIBILIT RELLE 415
peut coter moins, autant ou plus, que cent ouvriers, tout en produisant deux fois plus de
marchandises qu'eux, par exemple.
126. Ibid., p. 76; pp. 440-441; p. 414.
127. Ibid., p. 77, n. 1; p. 441, n. 116a; p. 141, n. 116a. (Note ajoute dans la 2- d. allem.).
-
Marx veut dire ici que la machine remplace le travail, mais non le salaire. Or, du point de vue
de la valeur, dont le mode de production capitaliste est prisonnier, on est contraint de mettre la
machine en concurrence avec le salaire. D'o des limites plus troites que celles qui seraient
objectivement ncessaires. Cependant, cela ne veut pas dire que toutes les limites au remplacement
de la force de travail par des machines seraient supprimes par une socialisation complte des
moyens de production: il faut que leur production conomise du travail.
Chapitre 9
LES CRISES
Nous approchons de l'tat de
crise et du sicle des rvolutions.
J.-J. ROUSSEAU
La possibilit historique rsulte du progrs des forces productives et s'y
identifie. Les possibles sont multiplis par les innovations techniques o se
ralise l'accroissement de la matrise sur la nature. L'avnement et les
ralisations de l'industrie mcanise le dmontrrent. Cette mcanisation de
certaines des oprations de l'activit humaine ne fut elle-mme possible que
grce au capital, dont elle a en retour impuls l'essor. Cette liaison de
l'industrie et du capital est dialectique.
Le triomphe de l'industrie assura au capital son emprise sociale, et la
bourgeoisie sa domination politique. Mais il comportait sa face ngative: il
engendra des crises spcifiques, inconnues auparavant, des crises paradoxales:
la richesse dans la pauvret, la surproduction sociale et la pauprisation des
classes laborieuses!
Comment interprter ces phnomnes? Les crises taient-elles passagres,
locales et surmontables, ou ncessaires, gnrales et fatales? Les opinions
divergrent. Certains nirent la possibilit d'une crise gnrale; Marx l'af-
firma. Nous avons cit ses phrases clbres o il compare les catastrophes
conomiques et les rvolutions sociales et politiques aux cataclysmes naturels,
du fait de leur caractre invitable . C'est dans les crises du mode de
production capitaliste que se manifestent les rapports entre possibilit, ralit
et ncessit.
Marx ne cherche pas tellement distinguer entre diffrents types de
crises; elles sont financires et commerciales, industrielles et sociales, politi-
ques, internationales, tous ces aspects se mlant d'une manire complexe, mais
non inextricable. Il s'agit pour lui d'en dcouvrir et d'en dmler les causes
418 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
profondes: toutes ont un fondement conomique. Pour saisir ce qui rend une
crise gnrale possible, il faut discerner les causes qui provoquent les crises
relles . On ne peut dlimiter la future crise possible qu' partir d'une
analyse du rel, prsent et pass.
Il s'agit pour Marx de comprendre la fois la possibilit et la ncessit des
crises gnrales. Sa thse est qu'une crise gnrale du mode de production
capitaliste est non seulement possible, mais ncessaire. Toutefois, la possibilit
n'entrane pas la ralit: aussi prend-il soin de distinguer la possibilit de la
crise gnrale de sa ralit . Analysant les crises gnrales du capitalisme, il
distingue entre possibilit formelle et possibilit relle . En effet, il ne
suffit pas d'admettre la simple possibilit formelle des crises, comme le
faisaient certains conomistes et crivains politiques qui disaient que ces crises
avaient des causes accidentelles et que la crise gnrale pouvait ne pas se
produire.
Se plaant dans une perspective historique, Marx estima, au contraire,
que les socits capitalistes ne sauraient faire exception parmi les socits de
classes: comme pour leurs prdcesseurs, leur destin est de disparatre dans
des bouleversements et une rvolution qu'elles ne peuvent carter. Les crises
qui secouent les socits capitalistes montrent que ce mode de production est
essentiellement contradictoire, et que la crise possible est destine devenir
relle. Mais, il faut d'abord tablir que la crise gnrale du mode de
production capitaliste est possible, ce qui montrera que cette possibilit est une
possibilit relle.
1. La possibilit des crises
Lorsqu'il tudie la possibilit des crises, Marx ne se place pas un simple
point de vue empirique. Il ne se contente pas de dire: les crises sont possibles
du fait qu'on les constate.
On avait effectivement observ un retour priodique des crises, selon un
cycle prsentant une nette rgularit. Il s'agissait de dvoiler les causes de cette
rapparition rgulire des secousses conomiques et sociales qui, branlant les
socits les plus avances, rpercutaient leurs effets sur les autres nations par
le truchement du march mondial.
Ce retour priodique, Marx en recherche les causes. On l'a vu, ce sont
celles qui sont la base de la loi de la baisse tendancielle du taux de profit.
Cette loi permet de prdire une aggravation des crises. D'o l'invitabilit
d'une crise gnrale que le capitalisme ne sera pas en mesure de surmonter: il
sera ou dtruit ou transform en un autre systme de production.
Les vnements du XIXesicle, durant la priode que l'historien Hobs-
bawn nomme ,<l're des rvolutions 1, montraient, la fois, la rptition de
crises conomiques plus ou moins graves, et leur rsolution sans modification
essentielle du mode de production.
LA POSSIBILIT RELLE 419
Il nous semble que Marx tienne compte de ce double phnomne,
lorsqu'il dit que la possibilit de la crise gnrale doit tre soigneusement
distingue de sa ralit. Les dterminations qui expliquent [erkliiren] la
possibilit de la crise n'expliquent pas, il s'en faut, sa ralit ,,2.
Les causes de sa possibilit et celles de sa ralisation ne sont pas les
mmes. La possibilit de la crise n'entrane pas la crise. Ainsi, Marx ne parle
tout d'abord que de simple possibilit: la crise en puissance" (potentia) doit
tre oppose la crise en acte (actu)3. Il faut que la crise existe l'tat
potentiel, pour devenir relle. D'o l'importance de bien distinguer la crise
potentielle de la crise effective.
Ce faisant, Marx lutte contre deux thses diffrentes et opposes, d'une
part contre celle selon laquelle une crise gnrale n'est pas possible, d'autre
part contre celle qui veut qu'une crise survienne du fait de sa "simple possibilit.
Commenons par cette deuxime thse.
[Des] conomistes, tels que J[ohn] St[uart] Mill par exemple) [...]
veulent expliquer les crises par [de] simples possibilits de crise impliques
dans la mtamorphose de la marchandise - comme la sparation de l'achat et
de la vente -
[...]4. Ils pensent expliquer la crise partir de cette forme
lmentaire5
".
Cela quivaut
",
dit Marx, expliquer la crise en exprimant son
existence sous la forme la plus abstraite qui soit, c'est--dire expliquer la
crise par la crise 6
".
)Ce serait en rester la simple possibilit abstraite, et, comme John Stuart
Mill, tenter d'expliquer la ralit partir de la possibilit. Certes, cette
possibilit formelle" est dj elle-mme prsente dans la ralit: il y a
effectivement sparation de l'achat et de la vente, cette sparation se manifes-
tant sous diverses formes <formes" de la monnaie).
Marx remarque que ces conomistes se satisfont en affirmant que dans
ces formes existe la possibilit que des crises surviennent, que c'est donc un
hasard si elles ne se produisent pas et que, par consquent, leur clatement lui-
mme apparat comme un simple hasard7
".
La question que Marx pose ces thoriciens est la suivante: comment
expliquent-ils le passage de la possibilit d'une crise sa ralit? En appeler
aux diverses formes que peuvent prendre les marchandises dans l'achat et la
vente grce l'argent, comme le font John Stuart Mill et d'autres conomistes,
ne saurait suffire pour expliquer cette transformation. La simple possibilit n'a
jamais t cause de la ralit.
Ce que Marx conteste donc, c'est l'explication selon laquelle la crise
possible deviendrait une crise relle par hasard, c'est--dire du fait de
circonstances accidentelles, extrieures et contingentes. En effet, le hasard ne
saurait rendre compte du caractre cyclique des crises. Non que le hasard ne
joue son rle l comme ailleurs: il y a des vnements dus au hasard. Marx ne
le nie pas du tout, au contraire. Mais quand il s'agit d'un vnement majeur
420 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
comme une crise gnrale, sa ralisation dpend de bien autre chose que
du simple hasard.
Expliquer la ralit par la possibilit, c'est ce que faisaient les philosophes
comme Leibniz qui imaginait une pluralit infinie de mondes possibles, ou
comme les atomistes picuriens qui avaient introduit le hasard aveugle
l'origine de la formation des mondes. On trouve l'analogue du hasard chez
les thologiens qui recourent un fiat arbitraire pour expliquer la
cration.
Chercher les causes d'un fait ou d'un vnement dans des conditions de
possibilits gnrales, c'est en rester la possibilit formelle logique. Beaucoup
d'conomistes se contentaient d'tablir la possibilit des crises, et pensaient
ainsi les avoir suffisamment expliques.
Pourtant, Marx est d'accord avec eux sur un point. Il
y"
a effectivement
possibilit de crise partir du moment o il y a sparation entre les deux actes
d'achat et de vente. Mais, malgr le fait de cette sparation, la crise reste une
simple possibilit tant que rien n'empche les changes: en effet, cette
sparation a lieu dans la sphre de l'change, c'est--dire de la circulation des
valeurs (marchandises et argent). Or les causes des crises du systme capitaliste
ne se trouvent pas dans les processus d'change, puisque ceux-ci procdent
ncessairement selon la loi de l'galit des changes: si un individu perd dans
un change singulier (change ingal), celui qui lui a achet gagne autant, et,
au total, la loi est respecte.
Les causes des crises du systme capitaliste se trouvent ailleurs: dans le
mouvement d'ensemble de la production capitaliste. On connat la rponse
marxienne: les crises proviennent de l'apparition de nouvelles forces produc-
tives qui ne trouvent pas d'emploi du fait des rapports de production
dominants. Les forces productives entrent en contradiction avec les rapports
sociaux. Les capacits productives ne peuvent se dployer du fait d'une
restriction des capacits de consommation des classes les plus nombreuses. La
crise prend la forme de crise de surproduction. La concurrence capitaliste cre
la fois la surproduction et la sous-consommation.
Cette contradiction est interne au mode de production capitaliste. Elle
tient son essence. C'est elle qui provoque les crises. Or, les conomistes
classiques anglais avaient justement contest la possibilit de crises de
surproduction. Aussi tonnant que cela puisse paratre, c'tait en particulier le
cas de Ricardo.
Plus exactement, Ricardo niait la possibilit de toute crise gnrale,
admettant seulement celle de crises locales ou sectorielles limites. Il pensait
que l'accumulation capitaliste pouvait se poursuivre indfiniment: Il ne
saurait y avoir dans un pays de capital accumul, quel qu'en soit le montant,
qui ne puisse tre employ productivement8 , affirmait-il.
En d'autres termes, il y aurait toujours des dbouchs pour un capital de
quelque grandeur qu'il soit. Il ne serait pas possible que l'on produise trop.
LA POSSIBILIT RELLE 421
Comme Ricardo ne niait pas qu'il y et, ou qu'il puisse y avoir, des c.rises
conomiques, comment accordait-il ces deux affirmations?
Il admettait qu'il peut tre produit une trop grande quantit d'une
certaine denre et [qu'Jil peut en rsulter une surabondance telle dans le
march, qu'on ne puisse en retirer ce qu'elle a cot9". Cependant, ce trop
plein ne saurait avoir lieu pour toutes les denres 10,
En substance, l'explication de Ricardo est la suivante: les besoins vitaux
lmentaires sont faciles satisfaire dans toute socit; ils ne rclament qu'une
quantit limite de travail et de produits, alors que les autres besoins potentiels
sont indfinis et illimits Il, Bien que la productivit du travail augmente avec
l'amlioration des conditions de production, les objets rpondant cette
seconde catgorie de besoins demandent une quantit de travail que rien ne
borne a priori. Par suite, il n'y aurait pas de limite assignable au dveloppe-
ment du capital et les forces productives qu'il met en uvre seraient
susceptibles de crotre autant que l'on voudrait.
Relevant ces propos, Marx fait observer que les Anciens non plus ne
parlaient pas de crise de surproduction: la consommation de luxe des classes
riches absorbait le surplus. Dans l'Antiquit, souligne-t-il, l'activit tait
essentiellement consacre produire des biens de consommation. L n'est plus
l'objet premier de la production moderne qui doit avant tout crer de la plus-
value, et toujours plus de plus-value, chaque capitaliste individuel y tant
contraint par la concurrence. Ricardo raisonne comme un Ancien: il assigne
au m6de de production capitaliste la mme finalit qu'au mode de production
de l'antiquit. D'o l'impossibilit de trop produire: certaines classes pour-
raient toujours augmenter leur consommation volont.
C'est sur cette ngation ricardienne de la possibilit de toute crise gnrale
du rgime capitaliste que porte la critique marxienne. Avant Marx, des
conomistes avaient dj rompu avec la thorie de Ricardo sur ce point, car les
crises de surproduction gnrales taient devenues un fait qui se rptait. Elles
ne pouvaient plus tre nies.
Cette erreur de Ricardo s'explique; Marx lui trouve quelque excuse:
Ric[ardoJ en ce qui le concerne, ne savait au fond rien des crises, des crises
du march mondial rsultant du processus de production lui-mme
12,,,
Il avait labor sa doctrine avant que les crises gnrales ne se soient
manifestes avec une ampleur inaccoutume: la premire grande crise de
surproduction survint en 1817. Il n'ignorait pas les hausses et les baisses des
prix. Mais il ne pensait pas qu'elles pourraient jamais constituer une menace
pour le rgime de production capitaliste.
Les conceptions de Ricardo sur les crises doivent donc tre rapportes aux
vnements conomiques dont il tait le tmoin:
Il pouvait expliquer les crises de 1800-1815, par le renchrissement des
grains la suite des mauvaises rcoltes, de la dprciation du papier-
422 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
monnaie, de la dprciation des articles coloniaux [...] la suite du blocus
continental!3.
Autrement dit, Ricardo rendait compte des crises par diverses causes
extrieures au processus de production, par des raisons politiques et non
conomiques , prcise Marx. Quant aux crises d'aprs 1815, il se les expliquait
en partie par une mauvaise anne, [en l'occurrence] par une pnurie du bl ",
et en partie par les changements soudains des circuits commerciaux du fait
du passage de l'tat de guerre la paix 14.
Aprs Ricardo, on ne pouvait plus penser de mme:
Les phnomnes historiques postrieurs, en particulier, la priodicit
presque rgulire des crises du march mondial, ne permettaient plus aux
successeurs de Ricardo de nier les faits ou de les interprter comme des faits
accidentels !5.
Ces quelques lments d'histoire conomique clairent la rponse des
conomistes la question de la possibilit des crises gnrales. Ces donnes
sont indispensables pour comprendre que la question se posait avec de plus en
plus d'acuit du temps de Marx et qu'elle ait pris une importance cruciale dans
sa conception de la possibilit historique. D'o l'intrt de l'analyse marxienne
de la possibilit des crises.
Comme Ricardo, Marx se place sur un plan thorique. Du fait que les
crises se reproduisent avec une certaine rgularit, les explications de Ricardo
ne suffisent pas. C'est dans l'analyse du processus de production, et du
mouvement d'ensemble de l'conomie capitaliste qu'on doit trouver en quoi
les crises sont possibles, et en quoi elles sont ncessaires; car il faut bien
distinguer les causes qui rendent une crise gnrale possible de celles qui la
rendent ncessaire.
La rponse cette question se trouve dans la thorie de l'accumulation.
L'accumulation capitaliste rencontre des limites que Ricardo n'a pas vues: il
pense que cette accumulation peut se poursuivre autant que l'on voudra. Or
elle est limite par la possibilit de ralisation de la plus-value.
L'accroissement des forces productives impuls par le capital engendre la
surproduction, qui n'est toutefois qu'une surproduction relative . Ce mode
de production veut que la grande masse des travailleurs ait son revenu limit
un minimum, puisque la lutte concurrentielle entre les capitalistes les
contraint abaisser le cot de la force de travail comme tous les autres cots.
D'o une contradiction interne invitable: en effet, partir d'un certain point,
les marchandises produites ne peuvent plus tre achetes; la plus-value, et
donc le profit, qui sont le nerf de la guerre concurrentielle, ne peuvent plus tre
raliss . C'est la crise. Le systme rencontre ses limites.
Ricardo, dont on a souvent reconnu les qualits de logicien, niait, par un
raisonnement trs simple, qu'une surproduction gnrale ft possible:
LA POSSIBILIT RELLE 423
Personne ne produit que dans l'intention de consommer ou de vendre
la chose produite, et on ne vend jamais que pour acheter quelque autre
produit qui puisse tre d'une utilit immdiate, ou contribuer la production
future. Le producteur devient donc consommateur de ses propres produits,
ou acheteur et consommateur des produits de quelque autre personne. Il
n'est pas prsumable qu'il reste longtemps mal inform sur ce qu'il lui est le
plus avantageux de produire pour atteindre le but qu'il se propose, c'est-
-dire pour acqurir d'autres produits. Il n'est donc pas vraisemblable qu'il
continue produire des choses pour lesquelles il n'y aurait pas de
demande 16.
C'est dire que la crise ne serait que sectorielle et momentane. Historique-
ment, on voyait effectivement les crises se rsorber, et le mouvement de
production repartir de plus belle. Cependant, Ricardo n;avait pas pris la
mesure des grandes crises de surproduction.
Marx montre aisment la faiblesse des arguments du grand conomiste
anglais: Ce sont l les bavardages purils d'un Say qui ne sont pas dignes de
Ricardo 17. Il suffit en effet de remarquer qu' aucun capitaliste ne produit
pour consommer son produit. [...] Plus haut on avait oubli que le produit est
marchandise. Maintenant on oublie mme la division sociale du travail. Dans
des rgimes o les hommes produisent pour eux~mmes, il n'y a pas de crises,
mais il n'y a pas non plus de production capitaliste18.
L'erreur de Ricardo provient de ce qu'il ne fait pas de diffrence entre les
divers modes de production; il ne prend pas en considration les conditions
particulires au mode de production capitaliste;
Ici [chez Ricardo] les crises sont donc vacues par un raisonnement
qui oublie ou nie les premires prsuppositions de la production capitaliste,
l'existence du produit comme marchandise, le ddoublement de la marchan-
dise en marchandise et argent, les moments de la sparation qui en rsultent
dans l'change des marchandises et enfin la relation de l'argent ou de la
marchandise au travail salari 19.
Ricardo reprenait la thse de Say: On n'achte des produits qu'avec des
produits, et le numraire n'est que l'agent au moyen duquel l'change
s'effectue 20. Que l'argent rende l'change possible n'entrane pas que
l'change puisse toujours s'effectuer rellement. Que les produits soient
toujours achets par des produits, certes, condition de pouvoir les
acheter! Ricardo part d'une loi gnrale abstraite (les produits sont toujours
achets par des produits) pour en tirer la conclusion que les produits peuvent
toujours tre achets. Faute insigne chez un logicien comme lui! Il devait
seulement affirmer; les produits, quand il sont achets, le sont toujours par
d'autres produits. Marx attribue cela au fait que Ricardo se place au point de
vue du capitaliste.
L'objection marxienne est des plus simples. C'est une question de
424 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
possibilit relle! Peut-on toujours vendre ce qu'on a produit? Poser la
question, c'est y rpondre: beaucoup de gens ont des besoins, mais ils ne sont
pas solvables! Par sa nature, le rgime de production capitaliste multiplie
normment le nombre des produits grce l'emploi des machines. Cette
production massive prsente un intrt particulirement dans les branches qui
produisent les biens de consommation courante: en abaissant leur prix, elle
abaisse en effet celui de la force de travail ouvrire, ce qui s'impose du fait de
la concurrence entre capitalistes.
Ainsi, la contradiction, dj rencontre, du point de vue de la valeur, dans
la loi de la baisse tendancielle du taux de profit, se retrouve ici sur le plan
matriel (ou substantiel): la capacit de production dpasse la capacit de
consommation (besoins solvables); la production relle dpasse la consomma-
tion possible. D'o une surproduction relle de nature telle que la consomma-
tion de luxe, le superflu ou le gaspillage, ne peuvent l'absorber, car il s'agit de
la surproduction de produits de base: du bl, du coton, des tissus, etc. C'est
dans une thse errone, reprise de Say, que Ricardo fonde sa ngation de la
possibilit de toute crise gnrale fatale: il croit que, avec un peu de temps, le
capital peut se dplacer volont dans d'autres domaines de production.
Marx a beau jeu d'objecter qu'un homme qui a produit n'a pas le choix
entre vouloir vendre et ne le vouloir pas. Il lui faut vendre. Et justement dans
les crises il arrive ce fait qu'il ne peut pas vendre ou qu'il ne le peut qu'au-
dessous du cot de production 21.
Quand la crise est l, le capital ne peut plus se dplacer, car il ne peut plus
se raliser. Il doit se dvaloriser. Non seulement cela arrive , mais Marx
soutient que la crise gnrale du rgime de production capitaliste est nces-
saire.
Toutefois, c'est une ncessit conditionnelle: une crise gnrale n'inter-
vient que parce qu'elle a d'abord t rendue possible du fait de la sparation de
la vente et de l'achat. Cette possibilit devient ralit parce que des causes
internes au processus d'ensemble de la production capitaliste portent cette
sparation au paroxysme en l'accroissant et en la prolongeant dans le temps.
Mais mme le capitaliste le plus riche ne peut maintenir cette sparation
indfiniment. Ne pouvant raliser>' la valeur qui existe potentiellement dans
les marchandises produites, il ne peut continuer la production: La crise est
prcisment le moment de la perturbation et de l'interruption du processus de
reproduction 22.
Ce dont il s'agit, ce n'est pas seulement de la possibilit et de l'existence
des crises, mais de leur nature: aprs 1820, de l'avis gnral, ce sont des crises
de surproduction. Face au texte de Ricardo disant que tout capital peut
toujours s'employer productivement , Marx s'exclame:
A quoi bon tout ce discours? Dans les moments de surproduction, une
grande partie de la nation (spcialement la classe ouvrire) est plus que
LA POSSIBILIT RELLE 425
jamais dpourvue de bl, de chaussures, etc., pour ne pas parler de vin et de
furniture [meubles]23.
Les besoins donc existent. Bien mieux, ce sont les ouvriers, ceux qui ont
produit, qui ne peuvent pas racheter leur produit. Ce qui encombre le march
est prcisment ce dont ils ont le plus besoin24.
Par consquent, il ne suffit pas de constater que des crises clatent; il ne
suffit pas non plus d'indiquer que leur possibilit rside dans la sparation de
l'achat et de la vente. Il faut comprendre pourquoi, de possibles, elles
deviennent relles. On ne peut pas dire que la possibilit se transforme en
ralit.
Les crises ont deux sortes de causes: celles qui les rendent possibles et
celles qui les rendent relles. Il s'agit de montrer qu'elles ne sont pas
accidentelles.
2. La possibilit formelle des crises. Ses deux formes
Marx a observ les crises25. Mais il ne pense pas que cela suffise pour les
comprendre. Sa dmarche n'est pas empiriste: en analysant les crises en mode
de production capitaliste, il est amen, sur un plan thorique, distinguer
deux formes de possibilit, qu'il appelle des possibilits formelles , parce
qu'elles sont lies aux formes de la valeur dans les changes.
La possibilit des crises provient de l'existence des formes de la marchan-
dise: forces de travail, produits de toutes sortes et monnaie, celle-ci se
prsentant aussi galement sous diverses formes. Elle rside dans leur spara-
tion, qui est la disjonction des deux actes de la vente et de l'achat.
Il n'y a videmment pas d'achat sans vente, ni de vente sans achat: tout
acheteur suppose un vendeur et rciproquement. Cependant, la sparation de
l'achat et de la vente devient effective lorsque le paiement est diffr et renvoy
terme, c'est--dire, historiquement, lorsque s'introduisirent le paiement par
traites et l'escompte dans le grand commerce. Avec ces moyens financiers, un
marchand peut avoir achet et en cas de mvente ne plus tre en mesure
d'honorer ses engagements. De mme pour le capitaliste qui, ayant achet
force de travail, instruments (machines, etc.) et matriaux (matires premi-
res, etc.), se trouve ne pas pouvoir vendre les produits qu'il a fait faire en
runissant ces diverses forces productives .
Les passages des produits d'une de leurs formes l'autre ne sont que des
mtamorphoses matrielles qui semblent toujours possibles. Mais ces
mtamorphoses continuelles supposent un rgime d'change des produits en
tant que marchandises , et non un rgime de troc, ou d'changes rgls
socialement (corporations, planification sociale avec abolition du march).
Cependant, la crise consiste dans l'arrt de cet incessant changement de formes
l'une de ses phases; la mtamorphose ne peut plus s'accomplir:
426 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Void comment se prsente la possibilit de la crise dans la mtamor-
phose de la marchandise.
-
Premirement, il faut que la marchandise qui, en
tant que valeur d'usage, existe rellement et en tant que valeur d'change,
dans le prix, existe idalement, soit transforme en argent. M-A. Si cette
difficult, la vente, est rsolue, il n'y a plus de difficult pour l'achat: A-M,
car l'argent est immdiatement changeable contre tout. [...] La possibilit de
la crise, pour autant qu'elle apparat dans la forme simple de la mtamor-
phose, rsulte donc uniquement de ceci: les formes diffrentes
-
les phases
-
que la marchandise parcourt dans son mouvement, d'une part sont des
formes et des phases qui se compltent ncessairement, mais par ailleurs,
malgr cette cohrence [Zusammengehorigkeit] interne ncessaire, ce sont des
parties et des formes du processus indpendantes, qui peuvent tre et qui sont
spares, qui ne concident pas dans le temps ni dans l'espace. La possibilit
de la crise rside donc uniquement dans la sparation de la vente et de
l'achat26."
.
Il pourrait sembler curieux que Marx l'appelle possibilit formelle ", car
elle n'a rien voir avec la possibilit formelle au sens de la logique, pour qui
une chose est possible lorsqu'elle n'est pas contradictoire. Ici, le qualificatif
formel" signifie qu'un moment critique apparat qui rsulte de la forme de
l'change" 27: nous disons que la forme simple de la mtamorphose inclut la
possibilit de la crise 28".
Cette possibilit apparat du fait qu'un produit passe d'une forme dans
une autre: la possibilit de la crise est lie l'existence de ces transformations
successives d'une mme valeur dans les mains de son propritaire. Elle se
prsente ds qu'il y a une circulation marchande simple, et une transformation
de la marchandise en argent. Cela suffit: si l'acheteur ventuel, qui en a le
besoin, n'est pas solvable, la mtamorphose ne peut se faire. Alors la vente est
diffre. Ds ce moment, la mtamorphose est entrave, voire srieusement
compromise. Si achat et vente concidaient, la possibilit de la crise [...J
disparatrait 29.
"
Cette possibilit formelle n'apparat pas dans le systme du troc. Elle
nat et se dveloppe avec la monnaie, plus encore avec la monnaie de crdit.
Pour cette raison, Marx la nomme encore une possibilit gnrale ", ou
abstraite":
La possibilit gnrale abstraite de la crise ne signifie rien d'autre que
la forme la plus abstraite de la crise, sans contenu, sans motif impliquant ce
contenu. La vente et l'achat peuvent tre disjoints. Ils sont donc crise potentia
[en puissance] et leur conjonction demeure toujours un moment critique
pour la marchandise 30.
Cette possibilit, Marx la dit formelle ", car il n'y a rien, dans les formes
mmes de la marchandise, qui indique quelles causes peuvent entraver
rellement la vente effective. Ces causes proviennent d'ailleurs:
LA POSSIBILIT RELLE 427
Ce qui transforme cette possibilit de la crise en crise n'est pas contenu
dans cette forme elle-mme: ce qu'elle contient uniquement c'est qu'est
prsente l la forme pour une crise3!."
Cette thse figure, dans les mmes termes, dans Le capital. Ds que l'on
a une circulation marchande simple, une monnaie faisant fonction de moyen
d'change, l gt la possibilit de crises futures:
Dans le commerce du troc, personne ne peut aliner son produit sans
que simultanment une autre personne aline le sien. L'identit immdiate de
ces deux actes, la circulation la scinde en y introduisant l'antithse de la vente
et de l'achat. Aprs avoir vendu, je ne suis forc d'acheter ni au mme lieu ni
au mme temps, ni de la mme personne laquelle j'ai vendu. [...] Si la
sparation des deux phases complmentaires l'une de l'a,utre de la mtamor-
phose des marchandises se prolonge, si la scission entre la vente et l'achat
s'accentue, leur liaison intime s'affirme -
par une crise32."
Cette scission est aggrave dans le mode de production capitaliste du fait
que les circuits d'change se complexifie nt. Toutes sortes d'oppositions
apparaissent qui se dveloppent en contradictions:
Les contradictions que recle la marchandise, de valeur usuelle et
valeur changeable, de travail priv qui doit la fois se reprsenter comme
travail social, de travail concret qui ne vaut que comme travail abstrait; ces
contradictions immanentes la nature de la marchandise acquirent dans la
circulation leurs formes de mouvement. Ces formes impliquent la possibilit,
mais aussi seulement la possibilit des crises. Pour que cette possibilit
devienne ralit, il faut tout un ensemble de circonstances qui, au point de
vue de la circulation simple des marchandises, n'existent pas encore33."
C'est l qu'en restaient des conomistes comme James Mill. Pour rendre
compte des crises qui, dj leur poque, branlaient le mode de production
capitaliste, ils se contentaient de cette possibilit formelle et gnrale , de
cette simple possibilit qui tient la forme de l'change - quand ils ne
l'assimilaient pas purement et simplement l'change immdiat de pro-
duits
34.
Non seulement Marx demande qu'on n'explique pas l'clatement d'une
crise par des circonstances accidentelles, ce qu'il reproche Ricardo de faire,
comme nous l'avons vu, mais il ne suffit pas non plus de reconnatre que les
crises sont possibles, comme l'ont fait ses successeurs, en particulier J. S. Mill.
Car il y a possibilit et possibilit. Marx distingue deux sortes de possibilits:
outre la simple possibilit formelle, il y a une forme de possibilit formelle plus
concrte que Marx prsente ainsi:
Sous sa premire forme la crise est la mtamorphose de la marchandise
elle-mme, la disjonction de l'achat et de la vente.
-
Sous sa seconde forme,
la crise est la fonction de l'argent comme moyen de paiement, o l'argent
428 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
figure dans deux moments spars dans le temps, dans deux fonctions
diffrentes 35.
"
La spcificit des crises de la production capitaliste tient ces deux
formes diffrentes de possibilit. lucidons ce point. Marx revient lui-mme
dans son manuscrit sur ces deux formes de possibilit pour prciser les choses.
Dans le passage cit l'instant, il a seulement nonc le principe de leur
diffrence. La deuxime forme de possibilit, indique-t-il, c'est la forme
spcifique des crises montaires 36
".
D'ailleurs, l'expos de la question est complexe. D'une part, Marx a
affirm que ces deux formes [de crises] sont encore tout fait abstraites, bien
que la seconde soit plus concrte que la premire37. Plus loin, il dit: quand
on tudie pourquoi la possibilit gnrale de la crise se transforme en ralit,
quand on tudie les conditions de la crise, il est [...] totalement superflu de
s'occuper de la forme des crises qui rsultent du dveloppement de l'argent
comme moyen de paiement38", c'est--dire de la forme montaire des crises.
Pourtant, celles-ci sont plus concrtes! Or, on pourrait croire que le plus
concret nous rapproche des causes relles!
Comme pour ajouter la difficult, Marx fait suivre cette dernire
affirmation d'une remarque surprenante: C'est justement pourquoi les
conomistes aiment faire passer cette forme vidente pour la cause des
crises 39.
On se serait plutt attendu ce que les conomistes soient critiqus pour
en tre rests la premire forme, la plus abstraite! La dialectique n'est-elle
pas, sur le plan thorique, la reproduction schmatique d'une volution
historique, c'est--dire d'un dveloppement du plus simple et du plus primitif
au plus complexe, et en mme temps n'est-elle pas le passage du plus abstrait
au plus concret? De ces deux formes de possibilit de crise, la plus abstraite est
la plus ancienne: elle est aussi vieille que l'change et la monnaie. La forme
plus concrte est spcifique du capitalisme40.
En quoi consiste cette deuxime forme de possibilit de crise que Marx
distingue de la premire? Elle tient, nous dit-il, l'une des fonctions de
l'argent, celle o il sert de moyen de paiement. En effet, l'argent remplit trois
fonctions. Premirement, il sert d'instrument de mesure des valeurs, monnaie
idale, monnaie de compte. Pour cela, il suffit de dfinir une unit
montaire, ses divisions (dcimales ou autres) et une nomenclature correspon-
dante, quelle que soit la nature de la chose qui matrialise cette monnaie.
Deuximement, l'argent est moyen de circulation. Troisimement, il est moyen
de paiement. En outre, on sait qu'il peut tre reprsent dans ces diverses
fonctions, surtout dans la dernire, par des symboles (monnaie de papier, par
exemple, ou monnaie fiduciaire: traites, etc.).
Pour illustrer son propos, Marx donne un exemple de crise possible:
supposons que les moyens de paiement soient des traites chance. Soit un
marchand de tissu (commerant) qui a rgl le fabricant du tissu par une traite.
LA POSSIBILIT RELLE
429
Ce dernier a fait de mme avec le filateur auquel il s'est approvisionn. Et ainsi
de suite, le filateur, les marchands de machine, de lin, de charbon, etc., se sont
tous pays les uns les autres par des traites chance. Tous dpendent de la
vente du tissu par le marchand. Mais que celui-ci ne puisse pas honorer sa
traite au fabricant de tissu, ainsi nat une crise gnrale41 . Les produits finis
sont l, les moyens de production ont t consomms, mais c'est l'argent qui
ne circule plus. On a une crise sous cette forme particulire de crise montaire.
Toutefois, la crise ne provient pas de cette forme de l'argent. Ce n'est que
sa forme de manifestation. Sa cause, c'est l'arrt de l'change sous sa forme
simple. Dans la crise, (d'achat et la vente se figent42 . Comme cet vnment
se produit dans le commerce, il semble que la cause rside dans la circulation,
non dans la production. Mais c'est une illusion. La cause, c'est le fait que l'on
a produit plus qu'il n'y a de besoins solvables: il n'y a pas d'achteurs en
rapport avec la quantit de produits. La chose ne peut se manifester que dans
le processus de circulation43.
Sous la premire forme, la possibilit de crise semble devoir rester trs
limite: elle ne concerne que l'acte d'change simple (achat et vente) qui a lieu
entre un capital et un autre capital. La disjonction de l'achat et de la
vente ne se produit que de manire sporadique. Elle ne concerne que des
capitaux diffrents , et n'arrive que d'une manire contingente, explique
Marx44. L'argent est seulement moyen de circulation: le capital n'apparat
alors que sous sa forme marchandise .
Cependant, du fait que les fonctions de l'argent se dveloppent sous le
capitalisme et que la seconde forme de possibilit intervient, cela va donner
une soudaine importance la premire forme de possibilit de crise.
Sous sa seconde forme, la possibilit de la crise nat de l'argent comme
moyen de paiement. Dans ce cas, le capital prsente une base beaucoup plus
relle pour la ralisation de la premire possibilit. Pourquoi? Les choses
s'clairent compltement lorsque Marx revient sur ce point, quelques pages
plus loin, dans son manuscrit:
La possibilit gnrale des crises est donne dans le processus mme de
mtamorphose du capital et cela doublement: dans la mesure o l'argent
fonctionne comme moyen de circulation - par la non concidence de l'achat
et de la vente. Dans la mesure o l'argent fonctionne comme moyen de
paiement: il agit alors dans deux moments diffrents - comme mesure des
valeurs et comme ralisation de la valeur [i.e. comme moyen de paiement).
Ces deux moments ne concident pas. Si la valeur a chang dans l'intervalle,
si la marchandise ne vaut plus, au moment de sa vente, ce qu'elle valait au
moment o l'argent fonctionnait comme mesure des valeurs, et partant [au
moment] des obligations rciproques, le montant de la vente de la marchandise
ne permet pas de remplir l'obligation45.
Or, voil justement ce qui devient invitable dans le mouvement de
dveloppement acclr que le capital donne la production. D'un ct, il
430 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
implique une extension de la masse montaire et du crdit. D'autre part, il
tend par tous les moyens accrotre sans cesse la productivit du travail et de
toutes les forces productives pour l'emporter dans la concurrence. Il modifie
donc trs rapidement les moyens de production et leur valeur, abaisse les
cots, c'est--dire la valeur des produits. Aussi, la valeur des marchandises au
moment o ont t tires les traites n'est-elle plus la mme au moment o elles
viennent chance. Au moment o ces traites ont t tablies, elles taient
mesure de la valeur, au moment o elles sont honores elles sont moyens de
paiement. Mais, dans l'intervalle la valeur a chang . L est le fait capital,
essentiel, invitable, qui se concrtise dans les crises commerciales, financires,
dans les faillites et le krach qui gagne l'ensemble du systme socio-cono-
mlque.
Finalement, si l'on rsume les ides de Marx, il faut dire que, mme sans
changement de la valeur, le simple fait qu'il y ait paiement chance cre dj
une possibilit d'apparition de difficults, une possibilit de crise. C'est une
possibilit toute formelle. Cependant, dans tous les cas, cette premire forme
de possibilit (sparation entre vente et achat) est toujours implique46. Avec
la deuxime forme de possibilit, qui est la plus concrte, toutes les
contradictions de la production bourgeoise clatent collectivement dans les
crises gnrales du march mondial47 .
Ainsi, a-t-on analys en quoi consistent les lments contradictoires qui
clatent au cours de la catastrophe48 . Marx souligne que cela ne se trouve pas
chez les conomistes. Au contraire! En apologistes du mode de production
capitaliste, ils se contentent de nier la catastrophe elle-mme ,,49. L'apologie
consiste alors falsifier les faits conomiques les plus simples et particulire-
ment s'en tenir l'affirmation de l'unit face la contradiction 50.
A l'inverse, Marx tient les crises pour le moment o l'unit se fait valoir,
et justement par la violence. L'achat et la vente, explique-t-il, sont deux
moments cohrents. S'ils deviennent indpendants et s'autonomisent, alors,
c'est justement dans la crise que leur unit se manifeste, l'unit des diffrents
lments. L'autonomie qu'acquirent l'un vis--vis de l'autre les deux
moments qui vont ensemble et qui se compltent, [...] est violemment anantie.
[...] Il n'y aurait pas de crise sans cette unit interne d'lments en apparence
indiffrents les uns par rapport aux autres. Mais pas du tout, dit l'conomiste
apologtique. tant donn qu'il ya unit, il ne peut pas y avoir de crise
51
'.
3. La ralisation de la possibilit des crises
Le caractre abstrait de la possibilit des crises est fortement soulign par
Marx. Toutefois, cette abstraction, comme dans le cas du travail abstrait ",
est une abstraction en un sens relatif, une abstraction objective ", car la
possibilit des crises existe . Elle rside dans la forme des moyens ou
instruments d'change. Elle est donc contenue en puissance en eux. Elle a sa
LA POSSIBILIT RELLE
431
ralit matrielle dans l'argent et ses diverses formes (mtaux prcieux, ou
signes de valeurs: monnaie fiduciaire, monnaie de crdit).
Il ne s'agit pas de la possibilit au sens logique d'absence de contradictions.
La possibilit formelle des crises rside au contraire dans une chose qui
contient une contradiction immanente: l'argent, marchandise dans laquelle
existe la contradiction de la valeur d'usage et de la valeur d'change 52.
Instrument de mesure des valeurs, moyen de circulation des marchandises et
moyen de paiement, l'argent est plus fondamentalement encore deux choses
contraires qu'il incarne conjointement: il est la fois valeur d'change et valeur
d'usage. Il est une valeur d'usage faisant fonction de valeur d'change, une
valeur d'usage devant se rsumer n'tre que valeur d'change. Sous l'une de
ces deux formes, il nie l'autre. Son essence est contradictoire!
En tant que chose contradictoire assumant des fonctions diffrentes, il
remplit son rle dans l'clatement et la manifestation des crIses. Les contradic-
tions de la production capitaliste semblent rsider dans l'essence de cette
marchandise particulire qu'est l'argent. Mais c'est qu'il les rsume de par sa
place, ses formes et ses fonctions dans le processus d'ensemble de ce type de
systme productif. Avec le dveloppement de l'argent, forme la plus abstraite
des produits du travail, achat et vente peuvent tre spars.
Cependant, la possibilit formelle de la crise contenue dans l'argent ds
son origine n'est pas en elle-mme une possibilit relle. La ralisation de la
crise est passage de la crise potentielle la crise relle: La crise relle ne peut
tre expose qu' partir du mouvement rel de la production capitaliste, de la
concurrence et du crdit 53. On a vu que Marx cherche pourquoi la
possibilit gnrale de la crise se transforme en ralit54. Comment la crise
se ralise -t-elle?
Dans le paragraphe prcdent, nous avons dcouvert que les formes de
l'argent et les fonctions qu'il doit remplir (en particulier comme monnaie de
crdit), jouent un rle crucial dans le mouvement d'ensemble de la production
capitaliste. Analysant les transformations que ce mode de production fait subir
l'argent et les formes spcifiques qu'il lui donne, Marx montre que l'argent
y perd l'existence autonome dont il jouit tant que
l'on se contente de l'employer
comme pur moyen de circulation ou de l'amasser pour le thsauriser.
Or, le capitaliste, par le traitement qu'il fait subir l'argent, est l'exacte
antithse de l'avare: il s'empresse de rejeter l'argent dans la circulation. Le
capital se dveloppe pour lui-mme:
L'existence autonome, illusoire, de l'argent est abolie [aufgehoben]; il
n'existe plus que .pour se valoriser; c.--d. pour devenir capital. [...] L'argent,
pour autant qu'il existe ds maintenant en soi, comme capital, n'est par
consquent qu'une assignation sur du travail futur (nouveau). [...] Ici le
capital n'entre plus seulement en rapport avec le travail prsent, mais dj
avec le travail futur. Il n'apparat plus non plus comme s'tant rsolu en ses
lments simples du processus de production, mais en son lment d'argent;
mais non plus comme argent qui est simplement la forme abstraite de la
432 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
richesse universelle, mais comme assignation sur la possibilit relle de la
richesse universelle -la puissance de travail-, en l'occurrence, la puissance
de travail en devenir 55.
En d'autres termes, l'argent, en tant qu'il est en soi du capital, est destin
acheter la force de travail et les moyens de production correspondants pour
renouveler le cycle du capital. Marx parle alors de l'argent comme d'une forme
de possibilit du capital, face laquelle la puissance de travail est qualifie de
possibilit relle . Cette forme, c'est le capital qui la lui donne. L'argent, tel
qu'il apparat et fonctionne dans le rgime de production capitaliste, est issu
d'un processus de production prcdent, et est vou le renouveler. Il devient
un point de dpart du processus du capital engendr par le capital. C'est
pourquoi il est qualifi de possibilit pose du capital:
Par un temps de surtravail absolu - le fait de travailler 8 heures au lieu
de 4 - [il
Y
a] cration d'une nouvelle valeur, [disons] de 20 thalers [ou
francs], cration d'argent, et d'argent qui, quant la forme, est dj capital
(dj possibilit pose du capital [...]); nouvelle valeur ajoute aux valeurs
anciennes, l'univers existant des richesses 56.
Cette diffrence entre la possibilit relle du capital (c'est--dire les forces
productives matrielles) et sa possibilit pose (c'est--dire le capital sous
forme d'argent) devient une diffrence relle (objectivement ralise) dans et
par la production capitaliste. Celle-ci runit et spare la fois le capital-argent
et la force de travail qui sont tous deux la possibilit du capital futur, et ainsi
de l'avenir de la socit capitaliste.
La possibilit relle, c'est essentiellement la force de travail existante, bien
qu'il y faille le concours de certaines conditions objectives (forces de la nature,
matires premires et moyens techniques) pour qu'elle ralise effectivement le
capital qu'elle est potentiellement. L'argent, sous sa forme capitaliste (capital
en soi) acquiert une puissance quivalente la force de travail. Il cherche
donc acheter et mettre en uvre la force de travailla plus productive pour
lui (loi de la concurrence). Il est ainsi puissance sur le futur, parce qu'il achte
ce qui est le plus dcisif pour le futur: la force de travail et ses moyens
d'exercice.
Il n'est donc pas une simple possibilit qui signifierait qu'il n'a pas de
pouvoir! Mais il n'a de pouvoir que s'il fonctionne sous cette forme, que s'il
a en vue sa retransformation en un capital accru. Il doit acheter ce qui est
susceptible de l'accrotre. Il est anim par la finalit propre au capital. Son tre
n'est plus tant dans sa forme de monnaie mtallique qui continue pourtant
lui servir de base et de truchement; il est plutt dans des formes nouvelles,
titres de crdit et autres signes de valeur:
De mme que le crancier de l'tat, tout capitaliste possde dans la
valeur nouvelle qu'il a acquise une assignation sur du travail futur, qu'il s'est
LA POSSIBILIT RELLE 433
appropri en mme temps qu'il s'appropriait le travail prsent. (Dvelopper
[...] ce ct du capital. On voit dj sa proprit de subsister comme valeur
spare de sa substance. La base du crdit y est dj instaure.) L'amasse-
ment du capital sous la forme de l'argent n'est donc en aucune manire
amassement matriel des conditions matrielles du travail. Mais amassement
des titres de proprit sur du travail. Le fait de poser du travail futur comme
travail salari, comme valeur d'usage du capital. Il n'y a pas d'quivalent pour
la valeur nouvelle cre; sa seule possibilit est dans du travail nouveau 57.
Il ne suffit pas que cette possibilit de travail nouveau soit pose dans
l'argent, qui matrialise la plus-value prcdemment cre, pour qu'elle
devienne effective. Pour Marx, comme pour Hegel et Aristote, le passage de la
possibilit la ralit implique une ralit elle-mme en acte. La ralisation
d'une possibilit exige que ses conditions relles soient run.ies: par exemple,
il est possible que le capital et la puissance de travail vivant librs par
l'accroissement des forces productives doivent tous deux rester en friche, parce
qu'ils n'existent pas dans les proportions ncessaires la production fonde
sur le dveloppement des nouvelles forces productives 58.
Des obstacles la ralisation de ces possibilits surgissent au point
d'engendrer des crises. La puissance de travail que rprsente l'ouvrier est la
possibilit relle par excellence. Mais, elle ne confirme cette possibilit que si
elle est mise en prsence de ses conditions d'exercice:
La valeur d'usage que peut offrir le travailleur face au capital [...] n'est
pas matrialise dans un produit, n'existe pas, tout simplement, en dehors de
lui, n'existe donc pas rellement, mais seulement potentiellement, comme
facult. Elle ne devient ralit effective [Wirklichkeit) qu' partir du moment
o elle est sollicite, mise en mouvement par le capital 59.
Cette sollicitation vient de causes qui lui sont extrieures , puisque dans
les conditions de production capitalistes, ce qui caractrise la force de travail,
ou mieux, le travailleur ", c'est qu'il est spar de toutes les conditions
objectives du travail. Il ne peut rien offrir hormis lui-mme, car il n'est en
possession que de lui-mme.
Il en est exactement de mme pour la transformation de la crise possible
en crise relle. Les causes relles des crises sont extrieures l'argent, et la
sphre de la circulation en gnral. Dans un systme o il est dj crdit,
assignation sur du travail futur , l'argent est lui aussi spar de ses
conditions de ralisation, exactement comme le travailleur est spar de tout
titre de proprit sur des choses. L'argent issu d'un processus de production
capitaliste antrieur, mais spar de sa ralit, cherche raliser la plus-
value qu'il est en soi. Par sa forme, il est assignation sur du travail salari
futur. Il ne peut raliser ce qu'il est en soi qu'en trouvant un secteur o il
pourra nouveau fonctionner comme capital. D'o les mouvements de
capitaux, o se trouvent tous les lments des crises.
L'argent reprsentant dsormais du travail futur, cette traite grossit
434 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
sans cesse. Pourra-t-elle toujours tre honore par le capital? videmment
non. Pourtant, Marx ne voit aucune fatalit dans l'clatement d'une crise, et il
reste trs prudent dans l'analyse thorique: Si l'argent en tant que moyen de
paiement fonctionne de telle sorte que les crances s'abolissent et que donc la
contradiction qu'il recle dans cette fonction ne se ralise pas, [si] donc les
deux formes abstraites de la crise ne se manifestent pas comme telles realiter
[dans la ralit], il n'y a pas de crise 60.
Autrement dit, la sparation de l'achat et de la vente avec le dveloppe-
ment du crdit est une condition ncessaire, mais non suffisante pour qu'il y
ait crise. De mme pour l'argent fonctionnant comme moyen de paiement: les
rajustements ncessaires se font par dvalorisation d'une partie du capital
(faillites ou ventes perte dans certains secteurs ou pour certaines entreprises);
la crise gnrale est ainsi carte ou recule.
Ce n'est pas par sa forme que le capital-argent rencontre ses limites et
qu'clate la crise gnrale fatale pour le mode de production capitaliste, mais
par son contenu. Car, la catgorie de forme renvoie celle de contenu. La
possibilit de la crise tient la forme de l'argent, sa ralit son contenu
capitaliste. Prsentant les deux formes de possibilit des crises, Marx dit:
L'existence de la crise apparat en elles sous ses formes les plus simples et
dans son contenu le plus simple, pour autant que cette forme est elle-mme son
contenu le plus simple. Mais )', ajoute-t-il, ce contenu n'a pas encore de
fondement [Aber es ist kein begrndete Inhalt]61.
En d'autres termes, la transformation de la possibilit en ralit a son
origine ailleurs que dans la forme du capital-argent:
La circulation montaire simple et mme la circulation de l'argent en
tant que moyen de paiement - et toutes les deux apparaissent bien avant la
production capitaliste sans qu'il se produise des crises
-
sont possibles et
relles sans crises. On ne peut donc pas expliquer partir de ces formes
seules, [...] pourquoi la contradiction qu'elles reclent potentia [en puissance]
apparat actu [en acte] en tant que telle 62.
Marx demande donc un contenu fond , c'est--dire un fondement rel,
une cause matrielle. Des formes, aussi pleines de contenu soient-elles, ne
constituent pas un fondement suffisant. Seule une cause matrielle effective
pourra expliquer qu'une possibilit de crise se transforme en crise relle.
Quelle cause est-elle susceptible de provoquer une crise? Ce ne peut tre un
vnement contingent, qui ne peut jamais tre qu'une cause dclenchante63. Il
y faut une cause essentielle, qu'il faut chercher dans l'essence mme de la
formation socio-conomique capitaliste. Bien que les crises se manifestent
d'abord dans la sphre de la circulation et se dveloppent en conflits o toutes
les contradictions internes du systme apparaissent, leur cause n'est pas dans
la circulation.
tant donn que la sphre de la production est le moment le plus
LA POSSIBILIT RELLE 435
dterminant, l'origine de la crise devrait donc se trouver dans le processus de
production. Or, dans les pages o il analyse la possibilit des crises, Marx
soutient que la crise ne proviendrait pas non plus de la sphre de la production!
Le simple processus de production, le processus (immdiat) du capital
ne peut en soi ajouter ici rien de nouveau. [...J Voil pourquoi dans la
premire section sur le capital - sur le processus immdiat de production -
il ne vient pas s'ajouter aux autres de nouvel lment de crise64.
L encore, on pourrait accuser Marx d'inconsquence. O trouver ce
nouvel lment qui transforme la crise possible en crise relle, s'il n'est ni
dans la circulation ni dans la production? Se hter de crier l'incohrence
serait une erreur. En effet, Marx explique dans un passage analyser que ce
nouvel lment de crise en soi, est contenu [dans la production], puisque le
processus de production est appropriation - et, partant, production
- de
plus-value. Mais, dans le processus de production lui-mme, cela ne peut pas
apparatre, puisqu'il n'y est pas question de la ralisation de la valeur qui est
seulement reproduite) mais de celle de la plus-value. - La chose ne peut se
manifester que dans le processus de circulation, qui en soi est en mme temps
processus de reproduction 65.
Reproduction de la valeur et ralisation de la plus-value sont deux choses
diffrentes. La valeur est reproduite dans le processus de production. C'est
l'objet du premier livre du Capital de montrer que les salaires et le capital
constant sont reproduits lors du temps de travail ncessaire.
Par contre, le problme de la ralisation se pose pour la plus-value. C'est
la plus-value nouvellement cre, incorpore dans les produits, que le capita-
liste doit trouver sous forme d'argent dans la vente effective de ces produits.
Cette valeur nouvelle (argent cr) doit se raliser en retournant dans le
processus de production par une consommation productive largie. Cela
prsuppose la vente des produits aux valeurs escomptes. Les difficults
apparaissent donc dans la sphre de la circulation, mais les causes profondes
de l'impossibilit de la ralisation se trouvent dans l'largissement de la
production, car celle-ci ne peut toujours se faire.
Il faut donc considrer le processus d'ensemble de la production capita-
liste, car circulation et production y sont interdpendantes: elles se prsuppo-
sent et se mdiatisent l'une l'autre:
Le processus de circulation ou le processus de reproduction du capital
dans son ensemble, c'est l'unit de sa phase de production et de sa phase de
circulation, processus qui se poursuit dans les deux phases qui constituent les
deux processus 66.
La cause des crises gnrales, ce nouvel lment seul capable de leur
donner un contenu fond, doit tre cherch dans le processus d'ensemble.
436 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Le mouvement rel part du capital existant. Le mouvement rel c'est
celui qui s'opre sur la base de la production capitaliste dveloppe, qui part
d'elle-mme, se prsuppose elle-mme67.
Dans ses explications sur les rapports entre possibilit et ralit des crises,
Marx dit, d'une part, que leur ralit provient d'un tat de choses (Ie mode de
production capitaliste) qui contient en lui-mme (en soi) la possibilit de cette
ralit, et d'autre part, que les crises ne dcoulent pas de leur simple possibilit
formelle:
La non-concidence spatiale et temporelle de l'achat et de la vente [...]
n'est pas la cause de la crise. [...] On ne peut pas dire que la forme abstraite
de la crise est la cause de la crise68.
C'est dans le capital dvelopp que se trouve le contenu recherch, la
vraie cause qui est au fondement des crises. C'est lui qui transforme la
possibilit de la crise en crise relle. La cause de la crise, c'est le processus de
reproduction, car, <despossibilits de crise [...] sont plus dveloppes dans le
processus 69. La crise, c'est l'impossibilit o se trouve le capitalisme dve-
lopp de raliser la plus-value contenue en soi dans les produits qu'il a t
contraint de produire en masse.
Le processus d'ensemble du capital runit des exigences contradictoires.
Ce sont les contradictions entre production et consommation dans les
conditions du capitalisme 70. Marx fait remarquer que la fameuse identit
entre vente et achat (entre vendeurs et acheteurs), mise en avant par les
conomistes comme Say et Ricardo pour en tirer l'identit entre production et
consommation, en reste au simple processus de production immdiat.
Ces identits, qui leur servent de principes, les conduisent nier la
possibilit des crises de surproduction. Elles deviennent ridicules si on les
applique aux ouvriers: en effet, qui ne voit que les ouvriers sont producteurs
de choses qu'ils ne consomment pas, et consommateurs (dans le processus de
production) de choses qu'ils n'achtent pas? Ce que les ouvriers produisent
en fait, c'est la plus-value 71, qu'ils ne consomment pas!
Le simple rapport entre travailleur salari et capitaliste implique:
1. Que la majeure partie des producteurs (les ouvriers) ne sont pas
consommateurs (pas acheteurs) d'une trs grande portion de leur produit: les
moyens et la matire de travail;
2. Que la majeure partie des producteurs, les ouvriers, ne peuvent
consommer un quivalent pour leur produit. [...] Il leur faut constamment
tre des surproducteurs, produire au-del de leurs besoins pour pouvoir tre
consommateurs ou acheteurs l'intrieur des limites de leurs besoins 72.
Ainsi, les conomistes ne font-ils que nier imaginairement des opposi-
tions et contradictions qui existent bel et bien dans la ralit. La force de
travail existante, dont la productivit est dtermine par les moyens de
LA POSSIBILIT RELLE 437
production et les forces naturelles, est la possibilit relle de toutes les richesses
produites, mais aussi de toutes celles qu'elle pourrait produire si elle tait
entirement et pleinement employe. Mais elle ne l'est qu' un certain degr:
le plein emploi est rarement ralis. D'une part, il y a toujours quelques
fractions de la classe ouvrire qui sont mises un certain temps au chomge, les
rvolutions techniques tant incessantes et le capital mobile. D'autre part, ce
dernier, dans sa course au profit, est conduit produire au-del des besoins
solvables. Il y a un retard du march, de la demande, sur une production en
augmentation 73. De l rsulte la contradiction entre le dveloppement
irrsistible des forces productives et la limitation de la consommation en tant
que base de la surproduction 74.
La cause de la crise est la structure de la socit en classes. Du point de
vue capitaliste, les forces productives ne sont rien d'autre qu~ de la plus-value
en puissance . Or, cette possibilit se mue en impossibilit dans les conditions
du capitalisme dvelopp. Les rapports sociaux dominants empchent l'appro-
priation sociale des produits. Ces rapports, trop troits pour les possibilits
objectives (matrielles) de production, imposent leurs limites la consomma-
tion et donc la ralisation de la plus-value. L'impossibilit de raliser la plus-
value produite fait passer la crise possible l'tat de crise relle. Il y a la fois
unit et sparation des deux phases du processus d'ensemble, celle de la
circulation qui doit tre aussi celle de la reproduction du capital et celle de la
production:
Aussi les conomistes qui nient la crise s'en tiennent-ils uniquement
l'unit des deux phases. Si elles taient uniquement spares sans tre unes,
c'est alors prcisment qu'il n'y aurait pas de possibilit d'tablir de force
leur unit, pas de possibilit de crise. Si elles taient uniquement unes, sans
tre spares, il n'y aurait pas de possibilit de les sparer de force, ce qui est
encore la crise. La crise, c'est l'tablissement par la force de l'unit entre des
moments promus l'autonomie et l'autonomisation par la force de moments
qui sont essentiellement uns 75.
4. Crise du capital et rvolution
La crise provient du fait qu'on ne peut pas raliser la valeur en vue de
laquelle les marchandises ont t produites, valeur qu'elles sont en puissance
puisque la quantit de travail et les moyens de production ncessaires ont t
dpenss pour les produire. Reportons-nous l'expos du capital achev
(capital et profit), c'est--dire au livre III du Capital, o Marx explique cette
impossibilit par le conflit entre l'extension de la production et la valorisa-
tion [Verwertung]16.
Dans cette explication, plusieurs difficults attendent le lecteur. Marx
envisage indiffremment les masses , c'est--dire des grandeurs absolues, et
les taux , c'est--dire des rapports. D'o une premire difficult suivre son
438 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
raisonnement. S'y ajoute une seconde difficult, puisque le texte donne
l'impression que l'on peut considrer aussi bien les grandeurs ou rapports
physiques (valeurs d'usage) que les grandeurs ou rapports de valeur (valeur
d'change). Bien que Marx souligne souvent que ces deux sortes de grandeurs
ne sont pas commensurables et qu'elles peuvent varier indpendamment
l'une de l'autre, il laisse parfois penser qu'elles vont de pair, comme si le
dveloppement de l'une entranait celui de l'autre, contrairement ce qu'il
soutient gnralement.
Ainsi, on peut lire que le dveloppement de la productivit sociale du
travail se manifeste de deux manires: primo, dans la grandeur des forces
productives dj cres, dans le volume des conditions de production, qu'il
s'agisse de leur valeur ou de leur quantit -, dans lesquelles a' lieu la
production nouvelle et dans la grandeur absolue du capital productif dj
accumul; secondo, dans la petitesse relative, par rapport au capital total, de
la fraction du capital dbours en salaire, c'est--dire dans la quantit
relativement minime de travail vivant requis pour reproduire et valoriser un
capital donn en vue d'une production de masse77 .
Une chose est sre: tout rapport quantitatif dtermin, ncessaire, a t
exclu par l'opposition fondamentale, pose au point de dpart du Capital:
valeur d'usage et valeur d'change sont radicalement htrognes. Malgr cela,
sans doute faut-il admettre que si un rapport quantitatif est imaginaire, il y
a du moins une certaine interdpendance et une correspondance entre elles.
Considrons de plus prs l'explication marxienne des rapports entre
valeur d'usage et valeur d'change dans les crises. Les crises trouvent leur
contenu, ou mieux leur fondement, dans le dveloppement du capital, la fois
en tant qu'accumulation de valeur et en tant qu'accumulation de forces et de
moyens de production. Le capitalisme consiste dans l'accaparement priv des
forces productives naturelles et des forces productives sociales du travail en
vue de produire toujours plus de valeur. Mais les propos de Marx ne sont pas
toujours parfaitement clairs:
Le dveloppement de la force productive du travail contribue indirec-
tement augmenter la valeur-capital existante en multipliant la masse et la
diversit des valeurs d'usage qui reprsentent la mme valeur d'change et
constituent le substrat matriel du capital, ses lments concrets, les objets
matriels qui composent directement le capital constant [".]18.
En quoi consiste cette contribution indirecte , puisque Marx affirme ici
que pour la mme valeur d'change il y a davantage de valeurs d'usage, et que
cependant la valeur-capital augmente, ce qui suppose non seulement que la
valeur d'usage reprsente la valeur d'change, mais que son accroissement
entrane indirectement celui du capital (valeur).
Cela veut dire que l'accroissement des moyens de production matriels
permettent un capital donn qui les possde ou qui les achte, d'en tirer un
LA POSSIBILIT RELLE 439
capital accru. C'est l la contribution des valeurs d'usage l'augmentation
du capital. En multipliant la quantit des richesses matrielles, l'accroissement
de la force productive contribue augmenter la valeur-capital. De plus en
plus de temps de travail social est accapar par le capital. Tel est le rapport qui
s'tablit entre les deux sortes de valeurs. Cela permet de comprendre que le
capital sera conduit des crises.
Souvent, on ne prend pas garde que Marx affirme une dpendance
indirecte de la valeur d'change l'gard de la valeur d'usage. On sait qu'au
dbut du Capital il pose leur diffrence comme essentielle: de l, on conclut
qu'il les penserait comme parfaitement indiffrentes l'une l'autre et n'entre-
tenant que des rapports extrieurs ou fortuits, accidentels. En fait, c'est se
placer du point de vue capitaliste lui-mme. C'est le capitaliste qui affiche une
parfaite indiffrence l'gard de la valeur d'usage. Peu lui importe ce qui est
produit; seule compte pour lui la cration d'une nouvelle valeur qui, ajoute
celle qu'il a jete dans le feu de la production, lui assurera un capital accru.
Tout ce que dit Marx, c'est que valeur d'usage et valeur d'change ne sont
pas commensurables. Elles peuvent varier dans le mme sens, ou en sens
inverse l'une de l'autre, ou encore l'une peut changer sans qu'aucune
modification ne s'en suive dans l'autre. Si l'on prend les choses abstraitement,
elles admettent donc toutes les proportions (ou disproportions) possibles.
Mais dans le processus rel, la mise en valeur du capital, c'est--dire sa
reproduction avec production d'un surplus de valeur, rencontre des limites qui
sont, soit de nature matrielle, soit de nature sociale.
Du ct matriel, la masse de travail que le capital peut commander ne
dpend pas de sa propre valeur, mais de la masse des matires premires et
auxiliaires, de l'outillage mcanique et autres lments du capital fixe, des
subsistances qui le composent, quelle que soit la valeur de ces composantes 79.
Marx rappelle ici que la reproduction n'est possible que si les lments
matriels existent en quantit suffisante, et que cela ne dpend pas de leur
valeur, mais des capacits des sources d'approvisonnement qui ne suivent
gnralement pas le mme rythme de dveloppement que la demande des
produits finis ou semi-finis, et ne le peuvent pas.
Du ct social, la mise en valeur rencontre la limite de l'exploitation de la
force de travail qui dpend du degr de la lutte des classes, et de l'issue des
conflits sociaux et politiques. Interviennent donc aussi le rapport de force des
classes sociales en prsence, la puissance des classes dominantes et la capacit
de rsistance des classes exploites.
Le dveloppement des forces productives ne contribue celui de la valeur
que si le capitaliste ralise la valeur nouvellement cre, ce qui ne peut se faire
que dans certaines proportions tant donnes la structure sociale et la
rpartition des richesses, moyens de consommation et instruments de produc-
tion. A partir d'un certain point, il y a contradiction entre l'accroissement des
richesses matrielles et celui des valeurs accumules par la classe des capita-
440 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
listes. Cette contradiction est justement dans la nature mme des choses en
mode de production capitaliste.
N'oublions pas que Marx est raliste, et qu'il effectue une critique de
l'conomie politique classique, qui justement tendait ne considrer les choses
que du point de vue de la valeur. Certes, les deux sortes de valeurs ne sont pas
commensurables. Mais en posant qu'elles n'ont pas de rapport direct, Marx
n'en soutient pas moins qu'elles ont tout de mme un certain rapport, un
rapport indirect , mais non moins ncessaire, qui conduit le capitalisme sa
perte. On ne peut comprendre Marx sans la dialectique!
Nier tout rapport commensurable n'entrane pas une indpendance
absolue. C'est au contraire une telle dpendance qui se manifeste dans les
crises! Que montrent-elles, sinon que les marchandises dont on s'attend
raliser la valeur d'change (qu'elles sont dj en soi)
D'e trouvent pas
d'acheteurs, et donc pas d'usage. Elles ne peuvent tre vendues; a fortiori, elles
ne peuvent tre consommes. Avec leur non-usage, c'est leur valeur d'change
qui disparat aussi: celle-ci ne se ralise pas.
D'ailleurs, ce par quoi commence le Capital, c'est que dans une marchan-
dise quelconque, les deux sortes de valeurs sont toujours prsentes ensemble.
La marchandise se dfinit par l: elle est leur unit! La valeur d'change ne
peut aller sans la valeur d'usage. Ainsi, on ne peut produire de la valeur (plus-
value), que sur la base de la production de certaines valeurs d'usage.
Les deux sortes de valeur ont donc un lien. Si ce lien se rompt, des
produits (richesses ou biens quelconques) sont dtruits: des valeurs d'usage
disparaissent d'une faon ou d'une autre sans tre consommes. Alors
disparat aussi la valeur d'change qu'elles sont en puissance. Cette destruc-
tion force et dlibre est la preuve que ce lien est bien rel.
Au niveau social global, dans les crises, on constate concrtement des
dprciations priodiques du capital existant: il y a destruction partielle ou
une mise en sommeil d'une partie du capital. Cette destruction s'opre par le
conflit des facteurs antagoniques qui se font jour dans des crises 80. Des
capitalistes individuels ne parviennent pas raliser la valeur des marchan-
dises qu'ils ont produites. L'issue du conflit se traduit ncessairement par une
dvalorisation, une perte de valeur:
Cette perte ne se rpartit nullement de manire uniforme entre les
capitaux particuliers: c'est la concurrence qui opre la rpartition. Et dans
cette lutte, la perte se rpartit fort ingalement et sous les formes les plus
diverses [...]: ainsi un capital sera en sommeil, un autre compltement
dtruit, un troisime ne subira qu'une perte relative ou ne connatra qu'une
dprciation passagre, etc. Mais dans tous les cas, l'quilibre se rtablirait
par mise en sommeil et mme destruction de capital: ces phnomnes
pouvant revtir une ampleur plus ou moins grande. Ils s'tendraient mme en
partie la substance matrielle du capital8l.
S'il Y a crise, c'est justement parce qu'il y a un rapport entre les deux
LA POSSIBILIT RELLE 441
sortes de valeurs: l'impossibilit de raliser la valeur d'change rsulte de
l'impossibilit de la vente qui a des causes sociales. C'est la limitation des
revenus de certaines classes sociales, non l'absence des besoins, qui empche
l'achat de marchandises produites, ce qui contraint une disparition ou
destruction de valeur:
L'augmentation de la force productive [...] va toujours de pair avec une
dprciation du capital existant (...] 82.
Cette contradiction dialectique entre le dveloppement des forces
productives et celui du capital conduit la baisse de valeur des produits et
la dvalorisation du capital. Marx mettait fortement l'accent sur cette
dialectique dans la Contribution de 1859: elle est prsente in nuce dans la
marchandise83. Valeur d'usage et valeur d'change forment toujours une
unit: la marchandise est cette unit dialectique de deux contraires.
Par l'analyse du processus d'ensemble du capital, on est conduit
dcouvrir l'unit contradictoire qui se rvle dans les crises:
Les crises ne sont jamais que des solutions violentes et momentanes
des contradictions existantes, de violentes ruptions qui rtablissent un
instant l'quilibre [Gleichgewicht] rompu 84.
C'est justement cette unit qui s'affirme dans et par les crises: la valeur
d'change cre n'est ralise que si les produits qui portent cette valeur
sont consomms effectivement. Sinon, elle est dtruite. Or, le mode de
production capitaliste tend sparer les deux moments de cette unit entre
valeur d'change et valeur d'usage, car le capitaliste ayant produit des valeurs
d'usage veut y retrouver la valeur d'change qu'il en escompte sur la base de
la mesure antrieure des valeurs. Il est anim par deux tendances antagonistes
qui refltent son niveau l'tat de crise:
Voici en quoi consiste la contradiction: le mode de production capita-
liste implique une tendance au dveloppement absolu des forces productives,
sans tenir compte de la valeur et de la plus-value que cette dernire recle, ni
non plus des rapports sociaux dans le cadre desquels a lieu la production
capitaliste, tandis que, par ailleurs, le systme a pour but la conservation de la
valeur-capital existante et sa mise en valeur au degr maximum (c'est--dire un
accroissement sans cesse acclr de cette valeur85.
Ainsi s'opposent le moyen employ par le capital et son but. Son but est
de reproduire et de mettre en valeur la valeur existante. Son moyen, c'est la
multiplication des forces productives, multipliant par l mme les quantits
produites. Comme il ne tient pas compte des capacits de consommation, le
but et le moyen finissent par s'opposer, car la capacit de consommation est
limite par les rapports sociaux. Les forces productives entrent en contradic-
tion avec les rapports sociaux. Les crises conomiques divisent les classes
442 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
l'intrieur d'elles-mmes; elles se traduisent en conflits sociaux et dbouchent
sur les rvolutions ou les restaurations politiques.
Le capital est donc anim par deux tendances antagonistes qui le poussent
hors de lui-mme. Il doit maintenir et reproduire continuellement les mmes
rapports sociaux: la classe des capitalistes et celle des ouvriers, car ainsi
seulement il s'assure l'appropriation prive des produits et celle de la plus-
value (ou plutt de la part laquelle il peut prtendre aprs partage avec les
autres classes dominantes). D'autre part, pour crer toujours plus de valeur, il
dveloppe la force productive sociale du travail. D'o la forme de la
contradiction propre au capital dvelopp: l'appropriation prive des moyens
de production est contradictoire avec le caractre social du travail et des forces
productives.
Ainsi s'expliquent les conflits de classes qui, sous le rgne du capital sont
essentiellement ceux qui opposent ouvriers et capitalistes, proltariat et
bourgeoisie, et leurs fractions internes. Les luttes sociales ont pour enjeu la
proprit des moyens de production. La rvolution susceptible de dpasser les
contradictions de la formation socio-conomique capitaliste a pour objectif
fondamental l'abolition de cette forme de proprit prive.
Cependant, il existe des solutions internes au mode de production
capitaliste. Elles consistent limiter ou dtruire, volontairement ou involon-
tairement, des forces productives. Le systme capitaliste y procde conti-
nuellement par le jeu de la concurrence, de la politique et des crises.
Pour Marx, la vritable rsolution de cette contradiction fondamentale
est la rvolution sociale par des moyens politiques: la dictature du
proltariat, dans laquelle la classe ouvrire exerce le pouvoir politique.
Cependant, il ne suffit pas d'une action politique qui abolisse formellement les
classes sociales. Le problme rsoudre est fondamentalement conomique.
La seule solution dfinitive possible est l'abolition du systme d'change
concurrentiel. Marx ne s'est gure arrt dcrire le systme de production
socialiste, encore moins un futur communisme. Il le conoit comme un
systme conomique o il n'y aurait plus ni march libre, ni argent. Marx
voque mme parfois un systme de bons de travail dans une production
socialise (sans parler d'change gal !), c'est--dire un systme o l'appropria-
tion et la distribution seraient sociales et non plus prives.
Le mode de production capitaliste poursuit un objectif contradictoire.
D'un ct, il tend la production, multiplie les produits pour raliser la plus-
value; ce faisant, il accrot les valeurs d'usage: c'est son ct civilisateur. De
l'autre, il limite la consommation d'une grande partie de la population;
priodiquement, il est contraint, de gr ou de force, de dtruire ce qui
apparat dans ce systme comme une surproduction 86; la production est
trop grande pour les capacits d'absorption des acheteurs ventuels: il y a
des besoins ou des capacits de consommation, mais du fait du caractre
priv de l'appropriation de la plus-value, le capitalisme restreint les besoins
LA POSSIBILIT RELLE
443
solvables. Il se meut dans un cercle constamment renouvel et constamment
interrompu.
Le passage de la possibilit de la crise du capital sa ralit s'effectue
dans les priodes o l'opposition s'accentue entre les capacits de production
et l'impossibilit du march d'absorber cette mme production tant donnes
les conditions de l'appropriation, c'est--dire les rapports sociaux, qu'impli-
que la production capitaliste8?
Les crises conomiques gnrales crent une situation de rvolution
sociale et politique. Selon Marx, elles supposent un capitalisme dvelopp ;
il pensait en effet que les progrs de la rvolution industrielle qui avaient lieu
sous ses yeux provoqueraient tt ou tard l'effondrement du mode de produc-
tion capitaliste du fait qu'ils craient la classe historique qui pouvait seule
succder la bourgeoisie. La crise gnrale qui devait emporter le capitalisme
tait possible, du fait de la complte anarchie de la production, les entreprises
et les branches de production tant indpendantes. Chaque capitaliste agit
pour son compte personnel; nanmoins, dans les crises ils font front commun
sur le plan politique: le pouvoir et le gouvernement agissent en tant que
reprsentants des classes dominantes. De mme, tous les ouvriers, ayant des
intrts communs, sont contraints s'organiser en une classe unie dans un
mouvement politique, ou parti au sens large, qui dirige son action contre les
conditions de l'exploitation conomique du travail par le capital. C'est cette
condition - Marx y a insist constamment - qu'ils peuvent mener le combat
contre la bourgeoisie.
Dans des conditions de concurrence conomique, plus les forces produc-
tives croissent et plus il y a possibilit de crise. Ce dveloppement ne peut
dboucher que sur une rvolution fatale aux rapports sociaux dominants,
c'est--dire la proprit prive des moyens de production et au pouvoir
politique dtenu par les classes dominantes (propritaires et industriels).
L'accroissement de la classe ouvrire, la rptition des crises conomiques
de surproduction et les luttes politiques (rvolutions en France et en Europe
au long du XIX. sicle) ont fait penser Marx que la fin du capitalisme dans
les pays les plus dvelopps tait proche, voire imminente. La Commune de
Paris, malgr ses insuffisances politiques, lui sembla le prototype et l'annonce
de l'avnement historique du socialisme.
Marx pense la rvolution partir de l'exemple des rvolutions qui
jalonnent l'histoire du peuple franais de 1789 1871. La succession des crises
conomiques est due au fait qu'il faut procder au renouvellement du capital
constant, c'est--dire des moyens de production industriels. Le dveloppement
imptueux de la puissance du capital se poursuit travers ses dprciations
priodiques. Ces faits constituent la base objective des luttes sociales et des
rvolutions politiques. Les causes qui transforment une rvolution possible en
rvolution relle sont autant subjectives qu'objectives. Tout dpend de la
composition des classes sociales et de leurs expriences historiques, de leur
444 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
niveau de conscience et de leur volont, qui sont elles-mmes en grande partie
fonction des conditions objectives:
Ce sont galement [les] conditions de vie, que trouvent prtes les
diverses gnrations, qui dterminent [entscheiden] si la secousse rvolution-
naire, qui se reproduit priodiquement dans l'histoire, sera assez forte pour
renverser la base de tout ce qui existe; les lments matriels d'un boulever-
sement total sont, d'une part, les forces productives existantes et, d'autre
part, la formation d'une masse rvolutionnaire qui fasse la rvolution, non
seulement contre des conditions particulires de la socit passe, mais contre
la production de la vie antrieure elle-mme, contre 1'ensemble de
l'activit qui en est le fondement; si ces conditions n'existent pas, il est tout
fait indiffrent, pour le dveloppement pratique, que l'Ide de ce boulever-
sement ait dj t exprime mille fois... comme le prouve l'histoire du
communisme 88.
.
Marx n'exclut pas que l'clatement d'une crise gnrale - qui se prsente
toujours avec ses aspects conomiques, sociaux et politiques - soit provoqu
par des circonstances accidentelles. Mme des circonstances naturelles peuvent
servir de cause occasionnelle. L'conomie continue de dpendre des alas des
saisons et d'autres causes naturelles. Certains pourraient trouver curieux que
Marx les fasse entrer en ligne de compte. Pourtant, une saison exceptionnelle,
par exemple une scheresse qui provoque la pnurie de certaines matires
premires, peut tre responsable d'une crise. Cela ne contrevient pas au fait
que la causse essentielle de la crise rside dans le processus d'ensemble du
mode de production capitaliste, et que ses agents soient les hommes, les classes
sociales. L'vnement extrieur doit toucher une matire premire qui joue un
rle important, ainsi le bl ou le coton aux XVIIIeet XIXesicles 89.
Nous retrouvons ici une constante de la pense marxienne: il y a un
ensemble de causes, subjectives et objectives, qui ne sont pas toutes de mme
nature, qui n'agissent pas de la mme manire, ni au mme degr les unes et
les autres, tout en entrant dans une interdpendance relative.
Cependant, la priodicit des crises indique une prdominance des causes
intrinsques au systme conomique et social. La causalit extrinsque
n'explique donc que partiellement le passage de la possibilit la ralit. A la
causalit naturelle, qui fait toujours valoir ses droits, se superpose la causalit
propre au mode de production lui-mme. Le capitalisme dvelopp, avec sa
matrise de plus en plus importante des forces naturelles, arrive un point o
il se subordonne la causalit extrinsque (naturelle), bien que celle-ci continue
jouer un rle comme cause matrielle,,: la nature reste le substrat et la
condition de toute socit.
Marx pensa que la rvolution technologique en cours sous ses yeux aprs
les annes soixante du XIXesicle (dveloppement des applications industrielles
de la chimie et de l'lectricit, compltant celles de la mcanisation des tches)
permettrait un accroissement tel des forces productives que le passage au
LA POSSIBILIT RELLE 445
communisme et la rvolution qui l'instaure devenaient historiquement nces-
saIres.
Dans l'analyse des conditions de la crise finale du capitalisme donne
dans Le capital, Marx soutient deux choses: la priodicit des crises gnrales,
et leur aggravation. La runion de ces deux ides conduit l'affirmation d'une
catastrophe finale invitable pour la formation socio-conomique bourgeoise
moderne. Toutefois, Marx ne se prononce pas sur le degr d'aggravation des
crises qui provoquerait cette rvolution. Ainsi, il n'est pas question de dire
partir de quelle limite l'abaissement du taux de profit serait susceptible de
dclencher la rvolution! Cela dpend aussi de l'initiative des hommes, de
l'alliance des classes exploites, etc. Marx se gausse de ceux qui proposent des
recettes pour les marmites de l'avenir 90. L'abaissement du taux de profit
indique seulement une orientation gnrale.
Or, le capitalisme socialise les forces productives. Il prpare donc une
certaine volution, dont on peut deviner le but final, car le dveloppement des
forces productives permet de l'envisager. Ce but, c'est la libration des classes
laborieuses de l'exploitation du travail qui se fait actuellement au bnfice et
sous la direction des classes dominantes. Le but, c'est l'abolition de toute
espce de classe sociale, et une situation, ou plutt un devenir, que Marx
qualifie de rgne de la libert .
L'aboutissement des analyses du Capital est le suivant:
Nous avons vu que l'accumulation croissante du capital implique
l'accroissement de sa concentration. C'est ainsi que s'accrot la puissance [die
Macht] du capital, celle des conditions sociales de production qui s'autono-
misent, personnifies par les capitalistes [die im Kapitalisten personifizierte
Verselbstandigung], vis--vis des producteurs rels. Le capital apparat de
plus en plus comme un pouvoir social dont le capitaliste est l'agent
[Funktionar]. Il semble qu'il n'y ait plus de rapport possible entre lui et ce que
peut crer le travail d'un individu isol; le capital apparat comme un
pouvoir social alin, devenu autonome, une chose qui s'oppose la socit
et qui l'affronte aussi en tant que pouvoir du capitaliste rsultant de cette
chose. La contradiction entre le pouvoir social gnral, dont le capital prend
la forme, et le pouvoir priv des capitalistes individuels sur ces conditions
sociales de production devient de plus en plus criante et implique la
suppression [Auflosung] de ce rapport en incluant en mme temps la
transformation [Herausarbeitung] de ces conditions de production en condi-
tions de production sociales, collectives, gnrales. Cette transformation est
implique par le dveloppement des forces productives en production
capitaliste et par la manire dont s'accomplit ce dveloppement 91.
Marx dcrit ainsi la seule possibilit historique relle qui est donc en
mme temps une ncessit historique. Ce que peut le capital et ce que peut le
travail sont opposs: ils s'affrontent. La seule issue est une rvolution la fois
conomique et politique dbouchant sur un mode de production socialis
directement issu du mode de production capitaliste dvelopp. La seule issue
est la libert en tant que libration conomique, sociale et politique.
446 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
NOTES
I. Titre retenu par cet historien anglais pour
l'un de ses ouvrages, comme nous l'avons dj
vue (cf. supra, p. 156, n. 67).
2. Thories, t. II, p. 599; MEW 26.2, p. 502.
3. Ibid., pp. 608,611; pp. 510, 513. - Dans ces pages, Marx parle deux reprises de crise
potentia" .
4. Ibid., p. 599; p. 503.
5. Ibid.
6. Ibid.
7. Ibid., p. 611; p. 513.
8. Principes..., op. ciL, p. 254. (Cit par MARX, Thories, 1. II, p. 593; MEW 26.2, p. 497.)
Nous citons la traduction franaise de Ricardo, plutt que le texte donn par Marx en allemand,
retraduit en franais par l'diteur des Thories.
9. Op. cit., p. 255.
10. Ibid.
Il. Quoique une socit, ou partie de socit, puisse avoir autant de bl et autant de
chapeaux et de souliers qu'elle peut ou qu'elle veut en consommer, on ne saurait en dire autant
de tout produit de la nature ou de ['art. Bien des personnes consommeraient plus de vin, si elles
avaient le moyen de s'en procurer. D'autres, ayant assez de vin pour leur consommation,
voudraient augmenter la quantit de leurs meubles ou en avoir de plus beaux. D'autres pourraient
vouloir embellir leurs campagnes, ou donner plus de splendeur leurs maisons. Le dsir de ces
jouissances est inn dans l'homme; il ne faut qu'en avoir les moyens; et un accroissement de
production peut, seul, fournir ces moyens" (ibid., p. 256).
12. Thories, t. II, p. 593; MEW 26.2, p. 498.
13. Ibid.
14. Ibid., pp. 593-594; p. 498.
15. Ibid., p. 594; p. 498.
16. Op. ciL, p. 254 (cit par MARX, Thories, t. II, p. 599; MEW 26.2, p. 503). Comme
prcdemment, nous citons d'aprs la traduction franaise rcente des Principes de Ricardo, ce
que nous continuons de faire dans les pages suivantes.
17. Thories, t. II, p. 599; MEW 26.2, p. 503.
18. Ibid., pp. 599-600; p. 503.
19. Ibid., pp. 598-599; p. 502.
20. Op. cit., p. 255 (cit par MARX, Thories, t. II, p. 598; MEW 26.2, p. 501).
-
Ricardo
critique Adam Smith qui attribuait la baisse des profits l'accumulation des capitaux, et une
hausse conscutive des salaires. Par contre, il flicite Say: M. Say a prouv de la manire la plus
satisfaisante, qu'il n'y a point de capital, quelque considrable qu'il soit, qui ne puisse tre
employ dans un pays, parce que la demande des produits n'est borne que par la production"
(op. cit., p. 254).
21. Thories, t. II, p. 600; MEW 26.2, p. 503.
22. Ibid., p. 600; p. 504.
23. Ibid., p. 604; p. 507.
24. Ce qui est encore plus trange en cas de surproduction, c'est que les vritables
producteurs des marchandises mmes qui encombrent le march
-
les ouvriers - en manquent.
Ici, on ne peut pas dire qu'ils devraient produire ces choses pour les obtenir puisqu'ils les ont bel
et bien produites et ne les ont pour autant pas" (ibid., p. 605; pp. 507-508).
-
Marx ajoute: On
ne peut pas dire non plus que la marchandise dont il s'agit gluts the market [encombre le march]
parce qu'il n'existe pas de besoin de l'avoir." (Trad. modifie).
25. Marx tudia les crises qui clataient de son temps. Il suivit de prs les vnements
conomiques et politiques dans de nombreux pays. Son uvre journalistique, non traduite en
franais (sauf les articles de la Nouvelle Gazette Rhnane de 1848-1849), est importante: il a
collabor rgulirement par des ditoriaux de politique gnrale et de politique conomique au
New York Daily Tribune [Tribune quotidienne de New York] entre 1851 et 1856, puis irrgulire-
ment jusqu'au 15 fvrier 1862. Sa correspondance porte galement tmoignage du fait qu'il suivait
de prs l'volution des grandes crises commerciales. Dans ces priodes, il s'en entretenait avec
Engels, qui travaillait dans les bureaux de l'entreprise de filature Ermen et Engels Manchester.
Par exemple de novembre 1857 janvier 1858, tous deux suivirent l'volution de la crise de trs
LA POSSIBILIT RELLE 447
prs (remarquons que c'est la priode o Marx rdigea les Gnmdrisse; cf. Corresponda/'lce, t. V,
pp. 57-121; MEW 29, pp. 204-265); de nombreuses lettres montrent un change d'informations
suivies au jour le jour.
26. Thories, t. II, p. 606; MEW 26.2, pp. 508-509.
27. Ibid., p. 607; p. 509.
28. Ibid..
29. Ibid., p. 606; p. 509.
30. Ibid., p. 608; pp. 510-511.
31. Ibid..
32. Le capital, t. 1, pp. 121-122; trad. Lefebvre, pp. 128-129; MEW 23, pp. 127-128.
33. Ibid., p. 122; p. 129; p. 128.
34. Ils effaaient ainsi les diffrences entre les divers modes de production et d'change, ce
qui permettait de nier les contradictions de la production capitaliste, comme Marx l'explique
dans une note (ibid., p. 122, note 1; p. 129, n. 73; p. 128, n. 73), o il reprend les ides dveloppes
dans les pages des Thories sur la plus-value que nous analysons ici. Il avait critiqu James Mill en
1859 (Contribution, pp. 138 et suiv.; MEW 13, p. 153 et suiv.).
35. Thories, t. II, p. 608; MEW 26.2, p. 511.
36. Ibid., p. 613; p. 515.
37. Ibid., p. 608; p. 511.
38. Ibid., p. 613; p. 515.
39. Ibid.
40. On se souvient que dans un paragraphe consacr la mthode de l'conomie politique,
Marx conteste que la ralit se dveloppe toujours en allant du plus simple au plus complexe: a
dpend! dit-il (Cf. Introduction de 1857, Contribution, pp. 164 et suiv.; MEW 13, p. 631 et suiv.)
41. Thories, t. 2, p. 610; MEW26.2, p. 512.
42. Ibid.
43. Ibid., p. 611; p. 513.
44. Ibid., p. 609; p. 511.
45. Ibid., pp. 612-613; p. 514.
46. Ibid., p. 613; p. 515.
47. Ibid., p. 636; p. 535.
48. Ibid., p. 597; p. 500.
49. Ibid.
50. Ibid.
51. Ibid.
52. Ibid., p. 598; p. 501.
-
Comme J.-B. Say, Ricardo affirmait: l'argent n'est que
l'intermdiaire qui rend l'change possible. Marx objecte que Ricardo transforme ainsi l'argent
en simple produit (valeur d'usage) , et transforme par consquent l'change de marchandises,
en simple troc de produits (ibid.). Ainsi, selon Ricardo, il n'y aurait pas de contradiction la base
de l'change, et par suite
-
nous l'avons vu -, pas de possibilit de crise gnrale.
53. Ibid., p. 611; p. 513.
54. Cf. ci-dessus, p. 428, citation rfrence note 38.
55. Manuscrits de 1857-1858, t. I, pp. 306-307; Gr., p. 272.
56. Ibid., p. 307; p. 273.
57. Ibid.
58. Ibid., p. 383; p. 348.
59. Ibid., p. 207; p. 178.
60. Thories, t. 2, p. 610; MEW 26.2, p. 512.
61. Ibid., p. 611; p. 513.
62. Ibid.
63. Par exemple, explique Marx, la proportion dans laquelle les instruments de production
sont multiplis est plus rapide que l'augmentation des matires premires qu'on peut se procurer
pour le laps de temps donn (p.e. le coton). C'est pourquoi le climat (le temps) [...] joue un si
grand rle dans l'industrie [...]. La reconversion de l'argent en marchandises peut donc se heurter
des difficults et faire natre des possibilits de crise. [...] (Il existe encore des quantits de
moments, de conditions, de possibilits de crise qu'on ne pourra analyser qu'en abordant l'tude
de la situation concrte, notamment de la concurrence des capitaux et du crdit)>> (ibid., p. 635;
pp. 533-534).
64. Ibid., p. 611; p. 513.
448 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
65. Ibid.
-
Ce passage n'est pas dnu d'ambigut. Nous avons suivi la traduction de
M. Badia, bien qu'elle omette de traduire nicht dans des nicht nur reproduzierten Werts.
66. Ibid., p. 612; p. 514.
67. Ibid.
-
Marx ajoute: Aussi le processus de reproduction et les possibilits de crise qui
sont plus dveloppes dans ce processus ne sont-ils eux-mmes qu'incompltement exposs dans
ce chapitre, et ils devront tre complts dans le chapitre" Capital et profit"
",
ce qui sera fait au
Livre III du Capital.
68. Ibid., p. 614; p. 515.
69. Ibid., p. 612; p. 545.
70. Ibid., p. 616; p. 518. Titre donn au paragraphe 12 de cette partie des Thories.
71. Ibid., p. 618; p. 519.
72. Ibid., p. 619; p. 520.
73. Ibid., p. 624; p. 524.
74. Ibid., p. 628; p. 528.
75. Ibid., p. 612; p. 514.
76. (Le capital, t. 6, p. 259 et suiv.; MEW 25, p. 257 et suiv.) Il s'agit d'un paragraphe du
chapitre sur les contradictions internes de la loi de la baisse du taux de profi.t.
77. Ibid., pp. 259-260; p. 257.
78. Ibid., p. 261; p. 258.
79. Ibid.
80. Ibid., p. 262; p. 259.
81. Ibid., p. 266; p. 264.
-
On relvera le souci de Marx d'envisager toutes les ventualits
possibles.
82. Ibid., p. 261; p. 258.
83. Rappelons l'expos de la Contribution: Le rapport entre les marchandises doit [...] tre
la fois un rapport o elles apparaissent en tant que grandeurs essentiellement semblables, ne
diffrant que quantitativement; il doit s'exprimer par une mise en quation o elles apparaissent
comme matrialisation du temps de travail gnral, et il doit en mme temps tre leur rapport en
tant qu'objets qualitativement diffrents, que valeurs d'usages particulires rpondant des
besoins particuliers, bref un rapport qui distingue les marchandises en tant que valeurs d'usage
relles. Or cette mise en quation et cette diffrenciation s'excluent rciproquement. Ainsi s'tablit
non seulement un cercle vicieux, la solution de l'un des problmes supposant l'aure rsolu, mais
un ensemble d'exigences contradictoires, la ralisation de l'une des conditions tant directement
lie la ralisation de son contraire" (Contribution, p. 22; MEW 13, p. 30.) (Nous avons dj cit
ces lignes capitales, cf. ci-dessus, pp. 98-99.)
84. Le capital, t. 6, p. 262; MEW 25, p. 259.
85. Ibid. (Partiellement cit; cf. ci-dessus, pp. 208-209.)
86. Marx fait remarquer que le nom donn aux crises de surproduction ne leur convient
pas: Le terme overproduction [surproduction] en soi induit en erreur. Tant que les besoins les
plus pressants d'une grande partie de la socit ne sont pas satisfaits ou tant que ne sont satisfaits
que ses besoins les plus immdiats, on ne peut naturellement pas parler absolument d'une
surproduction de produits
-
en entendant par l que la masse des produits serait excdentaire par
rapport aux besoins de ces produits. A l'inverse, il faut dire que, en ce sens, sur la base de la
production capitaliste, il
y
a constamment sous-production. La limite de la production, c'est le
profit du capitaliste, nullement le besoin du producteur. Mais surproduction de produits et
surproduction de marchandises sont deux choses totalement diffrentes" (Thories, t. 2, pp. 628-
629; MEW 26.2, p. 528).
87. Marx aurait certainement modifi son analyse conomique en fonction des changements
intervenus depuis un sicle dans les socits les plus industrialises, sous l'effet mme des luttes
ouvrires. Mais aurait-il pour cela modifi sa conception de l'histoire et des rvolutions? C'est peu
probable.
88. L'idologie (1968) p. 70; (1976) p. 39; (bi!.) pp. 128-131; MEW 3, pp. 38-39.
89. Ainsi,la hausse des valeurs des matires premires est une cause importante de crise pour
Marx. Car, nous l'avons vu, ,<la productivit du travail est aussi lie des conditions naturelles"
(Le capital, t. 6, p. 272; p. 270).
90. Cf. Le capital, Postface la 20 d. allem., t. l, p. 26, trad. Lefebvre, p. 15; MEW 23, p. 25.
- Marx parle des recettes comtistes
",
visant les doctrines sociales d'Auguste Comte et de ses
disciples.
91. Ibid., t. 6; p. 276; MEW 25, p. 274. Trad. modifies.
Chapitre 10
LA LIBERT
La libert est un mot qui
comporte une infinit de significa-
tions. [...] En fait, elle est elle-
mme la fin qu'elle ralise. [...]
HEGEL
Toute la pense de Marx est oriente par l'ide de la libert. C'est, dans
son essence mme, une pense et une philosophie de la libert. Pour Marx, il
s'agit de la libert en tant que libration, par elles-mmes, des classes
domines, asservies ou exploites.
La pense de Marx culmihe dans l'ide que l'tape prochaine de l'histoire
consiste dans l'mancipation de la classe ouvrire par elle-mme, processus
dj en cours et qui sera en mme temps la ralisation de la fin dernire de
toute l'volution historique: le rgne de la libert . Celui-ci est la possibilit
relle ultime. C'est ce qui donne son unit et son sens la pense marxienne,
ce qui en fait un humanisme.
Comment Marx concevait-il cette libration et cette re de libert qu'elle
ouvrirait et qui est le possible par excellence?
Il s'agit d'une libert concrte, d'une libert ralise dans l'action, par
l'intervention pratique des hommes dans l'histoire. Cette libert est une fin
consciente et conquise, non un attribut, une proprit ou une chose, qui
seraient dj l chez l'homme au point de dpart. C'est une libert conqurir,
plutt qu' reconnatre ou retrouver. C'est un rsultat, non un prsuppos.
Seule une action historique peut la raliser travers des luttes diriges contre
les diverses sortes d'alination qui s'enracinent dans l'exploitation du travail et
l'existence des classes.
Nous examinerons d'abord la notion d'alination. Puis, nous tenterons de
prciser ce que Marx entend par ce rgne de la libert conu comme un but
450 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
final de l'histoire. Si l'tre de l'homme consiste dans son activit, particulire-
ment dans le travail, qu'est-ce que Marx peut bien entendre par libert?
Celle-ci n'apparat-elle pas au-del du travail? Enfin, nous n'oublierons pas
que la premire philosophie de Marx fut une philosophie de la libert qui
s'exprima dans sa Thse sur picure et Dmocrite. Quel fut le rapport de Marx
picure? N'en reste-t-il pas des traces dans la pense marxienne de la
maturit? Marx ne continua-t-il pas tout au long de sa vie de s'inspirer de ses
premiers engagements philosophiques? Ne doit-il pas quelque chose picure
dans sa conception d'un rgne de la libert ?
1. Alination et objectivation
La dialectique de l'alination et de la libration est centrale dans la
conception marxienne de l'histoire. Si l'homme a le pouvoir de se librer par
sa propre action des alinations qu'il subit, c'est parce qu'elles sont survenues
historiquement du fait de sa propre activit. Les alinations prennent des
formes diffrentes selon les formes de socit et d'activit. Sous ses formes
capitalistes, l'alination la valeur d'change, l'argent et au profit, tend
devenir universelle. C'est la raison pour laquelle Marx pense que la rvolution
socialiste et l'avnement du communisme apporteront une libration qui ne
peut tre galement qu'universelle.
Il convient de distinguer d'emble alination et objectivation. Cette
distinction se fait jour ds les Manuscrits de 1844. Hegel enseignait que toute
objectivation tait alination 1, ide reprises par Bauer et Stirner. Pour Marx,
il n'y a alination que lorsque des individus ou des classes sont asservis des
puissances sociales (classes, rapports de proprit, tat, institutions, reli-
gion, etc.) qui les dominent, quoiqu'ils les aient cres.
Leur rapport la nature est d'une tout autre sorte. Ils y affirment leur
propre nature et leurs fins. La nature est traite en objet, mme si l'on doit dire
que l'homme est et reste toujours sous la dpendance de la nature dont il est
une partie. Il lui est subordonn ", mais il ne lui est pas alin . Le
dveloppement des forces productives le rend de plus en plus libre l'gard de
la nature; cependant, bien entendu, le primat de la nature extrieure n'en
subsiste pas moins2. Dans ce rapport la nature, l'homme s'objective, et
cela, dans toutes les formes de socit. Aussi toute objectivation n'est-elle
pas alination. L'alination est sociale.
Selon Marx, les individus et les gnrations se dcouvrent dans une
situation o, en gnral, ils ne sont pas socialement ou conomiquement
libres, mais contraints. L'esclave antique, le serf du Moyen Age, l'ouvrier
salari moderne, se trouvent assujettis d'autres hommes qui, directement ou
indirectement, les exploitent ou les traitent comme des choses ou des serviteurs
dont ils disposent pour leurs fins. Mais les capitalistes eux-mmes en tant
qu'individus sont asservis et alins au capital, qu'ils ne dominent pas!
LA POSSIBILIT RELLE 451
Ces formes d'asservissement social ne furent pas institues volontaire-
ment. Elles sont apparues comme des ncessits inhrentes aux conditions de
vie impliques par le mode de la production matrielle3. Les rapports sociaux
s'imposent subrepticement sans que personne les ait clairement voulus: quand
on les dcouvre, ils existent dj depuis un certain temps. Pour l'homme
asservi ou exploit, l'ensemble de sa vie est aline; elle ne lui appartient
pas, mais est la proprit et la chose d'un autre. Son activit force lui apparat
comme trangre: il ralise les fins d'un autre. Ce qu'il produit lui chappe; il
ne se reconnat pas dans ce qu'il fait. Mais, le capitaliste ne domine pas non
plus le produit social.
La matrise de la nature est la condition pour que les hommes asservis se
librent des alinations conomiques, sociales, politiques, et idologiques dont
ils sont victimes. Cette dialectique de l'alination et de la libration sous-tend
toute l'histoire humaine. Le mode de production le plus volu au XIX. sicle,
le capitalisme concurrentiel et industriel, prpare les conditions matrielles et
sociales de la libration de la classe ouvrire en parvenant un degr de
matrise de la nature antrieurement inconcevable.
Rappelons que, pour Marx, les rapports de l'homme la nature sont des
rapports dialectiques. Marx se range aux cts des matrialistes grecs, de
Spinoza, des matrialistes franais, des Idologues et de Feuerbach: pour eux
tous l'homme est de part en part un tre naturel, un produit de la nature. Mais,
pour Marx dialecticien, cela signifie que la nature se ralise dans l'homme.
L'homme est l'tre o la nature se manifeste elle-mme, devient consciente
d'elle-mme. En ce sens, l'objectivation fait partie d'une dialectique natu-
relle englobante.
En fait, nature a deux sens. Au sens restreint et relatif, c'est la nature
extrieure telle qu'elle apparat face l'homme, la fois comme un objet
pratique, milieu de son existence et objet de ses besoins, et comme un objet
thorique, un objet de la connaissance: elle est la fois la base de son
existence, le champ et la matire >.de ses activits, la rserve o il puise les
matriaux pour ses outils et instruments, l'objet de ses conceptions, enfin le
lieu de son action finaliste.
Mais en un sens large, la nature est la totalit du rel, qui n'est ni une
ralit immuable, anhistorique et intemporelle, ni une ralit qui serait
extrieure et transcendante l'homme, une chose intuitionner et
contempler. Dire que la nature agit en l'homme serait insuffisant, car l'homme
agit en retour sur la nature et la modifie. Les rapports de l'homme la nature
ne sont pas des rapports de pure subordination, ce qu'ils seraient s'il y avait
extriorit de la nature par rapport l'homme.
L'homme est pourvu de forces propres, de capacits et potentialits, qui
lui sont essentielles, et la nature est tout autant sa nature. Elle est ainsi dfinie
comme champ de possibilits. Il largit les potentialits de la nature en captant
les forces naturelles. Ce champ du possible n'a d'autres limites que celles de la
nature elle-mme. Devant ces potentialits naturelles, les alinations apparais-
452 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
sent pour ce qu'elles sont: des alinations historiques et sociales, qui tiennent
aux rapports sociaux qui divisent les hommes en classes diffrentes et
opposes.
Marx ne manque pas de souligner le caractre progressiste du capitalisme.
Celui-ci a fait faire l'humanit un pas en avant considrable par rapport
tous les modes de production antrieurs. Toutefois, il n'a pas supprim les
alinations sociales. Illes a accentues en intensifiant l'exploitation du travail,
en aggravant la pauprisation des classes laborieuses, en dgradant les
conditions de vie des couches pauvres et dmunies du proltariat.
-
Les alinations s'accumulent, dchance physique et avilissement moral
allant de pair. Elles touchent toute la socit du fait du rle que jouent la
valeur sous toutes ses formes: il y a un ftichisme gnralis de la
marchandise. Tout rapport humain disparat devant <<lefroid intrt , les
dures exigences du paiement au comptant , noyant tous les sentiments
dans les eaux glaces du calcul goste4.
L'alination s'universalise: elle n'pargne personne5. Le capitaliste en est
victime le premier: lui ne peut pas se librer. C'est l'esclave le librateur, non
le matre! L'alination a de multiples aspects, lis ce que Marx appelle la
subsomption du travail au capital. Cette subsomption se prsente sous deux
formes qui, en gros, se sont succdes dans le temps.
Le capital, engendr historiquement, reproduit et transforme lui-mme le
mode de production sur lequel il repose. D'o deux formes historiques
majeures du capital. Le capital s'est d'abord appropri la plus-value absolue,
et seulement en un second temps la plus-value relative.
Dans la premire forme, le capital s'empare de la partie non ncessaire du
travail, d'o il tire la possibilit de sa premire croissance. Il apparat et se
dveloppe sans rien changer au processus concret du travail. Si l'achat du
travailleur comme force de travail modifie les rapports sociaux, par exemple
les rglements et statuts corporatifs du Moyen Age, malgr tout, ces
changements n'ont pas en soi modifi essentiellement le mode rel du
processus du travail et de la production. Au contraire, il est dans la nature des
choses que la subordination du processus du travail au capital s'opre sur une
base antrieure cette subordination et diffrente des anciens modes de
production. Ds lors le capital s'empare d'un processus de travail prexistant,
par exemple du travail artisanal ou du mode d'agriculture de la petite
conomie paysanne autonome6 .
Marx appelle cette forme de subordination la subsomption formelle du
travail au capital? Dans un premier temps, la subordination du travail au
capital est donc indpendante du processus concret du travail. Il n'y a alors
que la contrainte au surtravail en gnral. Ce type de subordination est celui
de la priode o le capital s'est form historiquement, en gros, du Moyen Age
au XVIIesicle.
Dans le second type de subordination, la subsomption relle, le capital
s'approprie non seulement le surtravail, mais la force productive du travail
LA POSSIBILIT RELLE 453
social. Il organise lui-mme le processus de travail, la coopration, le travail
collectif (manufactures, fabriques), et s'approprie les forces productives
sociales gnrales (machinerie, science), pour accrotre sans cesse la plus-value
relative. Le processus concret du travail est mis ainsi lui-mme sous la
dpendance du capital. Les formes de ce processus apparaissent comme
formes de dveloppement du capital. Les forces productives du travail,
dveloppes partir de ces formes du travail social, se prsentent comme si
elles taient la force exclusive du capital lui-mme.
Au cours de cette transformation, les forces productives s'autonomisent:
elles constituent des puissances objectives qui font face au travailleur, des
puissances qu'il trouve dj l, existant avant lui. Capital, fabriques, machine-
rie, argent, tout cela fait face au travail comme autant de forces qui lui dictent
leurs conditions. Mais, il en va de mme pour le capitaliste individuel: il se
trouve face au capital social qui constitue une puissance qui se dresse contre
lui. Le capital, matrialis dans des choses extrieures, a une ralit
substantielle doue d'un pouvoir, et anime d'un auto-mouvement, qui
chappe compltement aux individus particuliers. La subsomption du travail
et de tous les processus sociaux au capital est devenue relle .
Le travailleur libre tait la condition du dveloppement historique du
capital dans sa premire phase, celle o le capital ne se subordonne le travail
que formellement. Ille reste dans la seconde phase, mais Ie travailleur libre est
alors reproduit lui-mme comme les autres lments objectifs du processus de
travail. L'homme individuel, parcellaire, devient un simple porteur des
fonctions que lui assigne le capital. L'action du capital prend une forme et une
existence de plus en plus relles. D'une part, le travailleur apparat comme
subordonn aux, conditions objectives du travail. D'autre part, il apparat
comme subsum sous les conditions subjectives du travail, c'est--dire les
formes du processus de travail: coopration, etc. Ce n'est pas lui qui les utilise;
ce sont elles qui l'utilisent.
Le rsultat historique de tout le dveloppement capitaliste est une
soumission de plus en plus gnrale des travailleurs au capital dont l'unique
mobile est la recherche du profit, ce qui aline conomiquement de plus en
plus les individus sociaux. La ncessit de faire le plus grand profit possible se
subordonne directement la substance de leur vie, qu'ils soient ouvriers ou
entrepreneurs capitalistes. Toutes les autres formes d'alination drivent de
celle-l. La soumission la loi du profit, l'argent, au prt intrt et au
crdit, est gnrale.
Cette distinction de deux formes de subordination est souvent absente
dans les exposs du marxisme. Elle est pourtant capitale. On y trouve la source
des deux grandes formes d'alinations, c'est--dire des deux obstacles trs
diffrents l'un de l'autre que le capital oppose la libration relle des
individus producteurs: d'une part, l'allongement de la journe de travail,
d'autre part, l'intensification de l'exploitation du travail (cadences, producti-
vit, nouvelles formes de division du travail, etc.).
454 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
On runit souvent indistinctement ces deux formes de l'exploitation
capitaliste, en particulier quand on parle de lutte pour l'amlioration des
conditions du travail, parce que le capital a lui-mme intrt ce que l'on
confonde les deux. Alors que l'une, la soumission relle du processus concret
de travail aux conditions techniques objectives de la production, subsistera,
quoique modifie et humanise, dans le socialisme, l'autre, le raccourcisse-
ment de la dure du travail, est justement le grand moyen de libration des
hommes. La diminution de la journe de travail est le levier de la lutte contre
les alinations: la misre conomique, la dpendance sociale, la subordination
politique et la pauvret intellectuelle8. Elle est rendue possible par l'accroisse-
ment de la productivit du travail.
C'est galement dans les formes de la subsomption que l'on trouve
l'explication des rapports variables qui s'tablissent entre les diverses classes et
entre les individus et la classe dont ils sont membres. L'idologie allemande
prsente ces rapports comme suit: ce sont d'abord les individus qui crent la
classe. Une nouvelle classe n'apparat d'abord que sous la forme d'individus
indpendants, dissmins et l au sein des classes de l'ancienne socit.
Cette classe nouvelle ne se subordonne pas encore les individus, ou seulement
formellement: elle est en cours de formation. Il ne s'agit que d'individus qui
mnent des conditions de vie semblables. Comme dit Marx, il n'y a pas encore
de classe pour soi, mais seulement une classe en soi, en puissance. Dans
cet tat de choses, c'est la classe qui dpend des individus plus que les individus
ne dpendent de la classe. Ce processus, que Marx dcrit pour la constitution
de la bourgeoisie au cours du Moyen Age, est le mme pour toute nouvelle
classe en gestation.
Puis, dans une deuxime temps, la classe se constitue et s'autonomise: des
organes communs et rguliers se forment. Les individus sont alors socialement
soumis la classe qui les dtermine, ainsi que leur idologie. Une fois
constitue, la classe reproduit les individus conformes sa nature. Elle devient
un sujet dou d'auto-activit ayant ses propres institutions. Elle se subordonne
les individus sociaux qui sont ses membres:
Ce n'est que trs lentement que la classe bourgeoise se forma partir
des nombreuses bourgeoisies locales des diverses villes. [...] Les individus
isols ne forment une classe que pour autant qu'ils doivent mener une lutte
commune contre une autre classe. [Puis, ...] la classe devient son tour
indpendante l'gard des individus, de sorte que ces derniers trouvent leurs
conditions de vie tablies d'avance, reoivent de leur classe, toute trace, leur
position dans la vie et du mme coup leur dveloppement personnel; ils sont
subordonns leur classe 9.
Le moment de la subordination de l'individu la classe, c'est aussi celui
de la subordination des classes domines aux classes dominantes et de celles-
ci leurs conditions objectives d'existence, en l'occurrence au capital. Ainsi
naissent et s'panouissent les formes modernes d'alination. Les produits
LA POSSIBILIT RELLE 455
des hommes (marchandises, argent, rapports sociaux bourgeois, tat) se
dressent face aux individus comme des forces qui leur sopt devenues tran-
gres, et qui le sont tous gards lorsqu'il s'agit des ouvriers libres qui n'ont
que leur force de travail vendre pour vivre. Les forces sociales du travail,
appropries et animes par le capital, semblent doues d'auto-activit [Selbst-
Hitigkeit]. Elles semblent se mouvoir d'elles-mmes, avoir leur propre volont,
poursuivre leur but immanent, qui apparat insens. Le capital, bien que
produit et constamment reproduit par le travail, devient lui-mme un sujet
qui cre et renouvelle ses conditions objectives et subjectives. Le capital n'a
plus qu'un seul but: crotre. Il impulse une production fivreusement accl-
re: il a le diable au corps .
Toutes les puissances sociales manent pourtant des individus. Or,
mme si elles sont proprit de certains individus (les possesseurs des moyens
de production), elles sont transformes en puissances objectives. Contre Bauer
et Stirner, Marx souligne que cette alination objective ne saurait tre dpasse
par une action individuelle, encore moins par un acte intellectuel. Pour cela, il
faut au contraire une action objective et collective:
La transformation par la division du travail des puissances person-
nelles (rapports) en puissances objectives ne peut pas tre abolie du fait que
l'on s'extirpe du crne cette reprsentation gnrale, mais uniquement si les
individus soumettent nouveau ces puissances objectives et abolissent la
division du travail. Ceci n'est pas possible sans la communaut 10.
L'mancipation des individus l'gard des puissances objectives (les
puissances du capital, de l'tat, etc.) est possible, parce qu'ils sont eux-mmes
l'origine de tous les processus d'alination. C'est eux qui, par leurs activits
et leurs fins, crent indireCtement ces puissances qui les dominent comme si
elles leur taient trangres . Celles-ci sont en fait leurs propres pouvoirs
alins , du fait des rapports de production et des rapports de proprit qui
les en sparent aussitt qu'ils les ont produits. Ils leurs sont ravis en mme
temps que la plus-value.
Pourtant, comme les travailleurs sont les vritables et ultimes crateurs de
toutes ces puissances , ils peuvent se les r-approprier: c'est l'objet de la
rvolution sociale par laquelle la classe ouvrire s'mancipera elle-mme, en
abolissant les rapports sociaux existants, c'est--dire la proprit prive des
grands moyens de production.
Les individus sociaux, seuls agents concrets et rels, sont l'origine de
toute action historique et sociale possible: ils sont les producteurs effectifs de
la richesse qui, dans les mains d'autrui, les domine. Ils sont la force productive
par excellence et tous les moyens de production sont leur uvre, objectivation
de leurs potentialits et virtualits ou, quand il s'agit des forces naturelles,
objet de leur activit.
De plus, 1'individu se dveloppe en mme temps que les forces
456 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
productives sociales et objectives. Dans L'idologie allemande, Marx souligne
que ce dveloppement de l'individualit s'effectue surtout dans la formation
socio-conomique bourgeoise qui largit de plus en plus la libert individuelle,
ou du moins sa possibilit, car elle continue de partager la socit en classes.
L'existence de l'individu a pour base la communaut, explique-t-il:
"C'est seulement dans la communaut [avec d'autres que chaque]
individu a les moyens de dvelopper ses facuIts dans tous les sens: c'est
seulement dans la communaut que la libert personnelle est possible Il. Il
Individu et socit sont toujours en rapport dialectique: ils se correspon-
dent. La libert est conue comme libert individuelle; ce n'est pas une libert
mtaphysique (libre-arbitre ou pouvoir de la pense pure, pouvoir de l'esprit),
mais une libert consistant dans ses moyens matriels et sociaux. C'est
pourquoi, c'est seulement dans une socit sans classes que la libert vritable
sera une possibilit relle et ainsi une ralit pour tous les hommes. Cela
implique la suppression des alinations survenues historiquement dans le
pass sous la forme des rapports sociaux.
De l, la conception de l'histoire comme processus de ralisation de la
libert, comme libration de tous les individus l'gard des puissances qui les
asservissent. Avec le dveloppement des forces productives, la destruction de
ces puissances est rellement possible, ou plutt leur dpassement dans un
nouveau rgime socialis de la production et une nouvelle forme de socit,
une socit sans classes.
C'est ce que Marx pense comme <<lapossibilit relle, celle du passage
un rgne de la libert. A l'poque o, en commun avec Engels, il labore la
conception matrialiste de l'histoire, il dfinit la tche des communistes, ces
matrialistes pratiques , comme la praxis rvolutionnaire , qui implique la
comprhension rationnelle de la pratique humaine
12}}.
Pour raliser cette possibilit, la classe rvolutionnaire doit mener bien
cette double tche. Sa mission est d'tablir le rgne de la libert}}. Mais en
quoi consiste-t-il exactement?
2. Le rgne de la libert
L'histoire est, au sens strict, le processus de cration de l'homme par lui-
mme. Engels le fait bien ressortir: L'existence normale des animaux est
donne dans les conditions simultanes leur existence, dans lesquelles ils
vivent et auxquelles ils s'adaptent; celles de l'existence de l'homme, ds qu'il
se diffrencie de l'animal au sens troit du terme, sont absolument indites;
elles doivent d'abord tre labores par le dveloppement historique qui suit.
L'homme est le seul animal qui puisse sortir par le travail de l'tat purement
LA POSSIBILIT RELLE
457
animal; son tat normal est celui qui correspond la conscience et qu'il doit
lui-mme crer13.
Nous avons vu Marx dvelopper cette ide, qui est fondamentale aussi
pour lui. C'est en crant les conditions de leur existence, c'est--dire, avant
tout, les moyens de production eux-mmes, par leur activit productive ou
travail, que les hommes font leur propre histoire qui n'est autre chose
qu'une auto-transformation, et donc un auto-engendrement de l'homme.
Pourtant, cela ne serait pas suffisant pour faire de la pense de Marx une
pense de la libert. En effet, il faut ajouter l'ide d'une auto-cration de
l'homme par le travail, l'ide d'une libration des contraintes de la nature
grce cette activit elle-mme. Si le travail, quels qu'en fussent les formes et
les moyens, devait toujours absorber la majeure partie du temps pour la
plupart des hommes, sans aucune possibilit de dpasser cet tat de chose, la
libert resterait l'apanage du petit nombre, et le rgne de la libert serait
utopique et illusoire. La libert comme possibilit relle pour tous les hommes
implique quelque chose de plus que l'auto-cration humaine, savoir un
accroissement de la matrise de la nature tel, que la diminution conscutive du
travail ncessaire bouleverse le caractre et le contenu des activits
humaines. C'est seulement si cette deuxime possibilit est une possibilit
relle que l'accs un rgne de libert vritable est lui-mme rellement
possible 14.
Selon Marx, le dveloppement des forces productives remplit cette
deuxime condition. Il est la condition de possibilit de la libert. Marx
estimait que les conditions objectives et subjectives de ralisation de la libert
pour tous les hommes commenaient tre runies. D'une part, les conditions
objectives du fait de la premire rvolution industrielle qui accroissait la
matrise de la nature d'une manire spectaculaire; d'autre part, les conditions
subjectives du fait de la croissance rapide de la classe ouvrire et de son
importance dcisive dans le processus de production moderne, la coopration
runissant les ouvriers salaris en grand nombre sur les lieux de production,
d'o leur force et la possibilit de leur action. Ces deux processus s'engendrant
l'un l'autre, Marx en concluait que seules deux classes principales resteraient
en prsence. A la suite des socialistes de son temps, il dnona la division de
la socit en classes opposes, en dominants et domins, comme ce qui entrave
l'accs la libert pour la masse des hommes exploits.
Nombreux sont ceux qui le constatrent: le mode de production capita-
liste et la socit civile moderne n'avaient pas supprim les ingalits et les
antagonismes de classes, malgr les idaux proclams et poursuivis par les
Rvolutions bourgeoises anglaise, amricaine et franaise. Le nouveau rgime
restait conomiquement fond sur l'exploitation de l'homme par l'homme.
Sous la forme nouvelle du salariat ouvrier, il perptuait les alinations, les
oppressions de toute sorte et la rpression politique. L'abolition du salariat,
c'est--dire de l'achat et de la vente de la force de travail selon un contrat soi-
458 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
disant <<libre entre l'ouvrier individuel et le capitaliste, tait donc le but
logique de la rvolution sociale.
Dans les socits du XIXe sicle, la libert relle n'existait que pour
certaines classes et certains hommes. Pour l'ouvrier de cette poque brutale-
ment mis au chomge sans aucun recours, comme pour celui d'aujourd'hui qui
arrive en fin de droits, la libert est drisoire; proclame en droit, elle est
nie en fait. Pour que la libert acquire quelque ralit pour eux, il est
ncessaire d'utiliser plein les forces productives existantes, ce qui n'est pas le
cas avec les crises et dprciations ou destructions priodiques de biens ou de
valeurs. Il est ncessaire de transformer les rapports sociaux dominants,
d'abolir le rapport social ingal entre les dtenteurs du capital ou de la terre et
les dtenteurs de la force de travail. Il faut supprimer l'appropriation
capitaliste prive. Sans ce changement rvolutionnaire, le travailleur libre
restera priv de libert relle, parce que priv des moyens matriels de cette
libert 15.
Marx souligne que les fameux droits de l'homme, bien que proclams
depuis 1789, se rvlent inexistants pour le plus grand nombre; ils n'emp-
chent pas l'exploitation de l'homme par l'homme, mais servent l'assurer
<<lgalement: Avant tout nous constatons que les droits dits de l'homme, les
droits de l'homme, par opposition aux droits du citoyen, ne sont rien d'autre
que les droits du membre de la socit bourgeoise, c'est--dire de l'homme
goste, de l'homme spar de l'homme et de la collectivit 16.
QueUe est la signification du droit humain la libert de la Dclaration
des droits de l'homme de 1791, comme de la Constitution de 1793? Ce droit,
rpond Marx, n'est pas fond sur la relation de l'homme l'homme, mais au
contraire sur la sparation de l'homme d'avec l'homme. Il est le droit cette
sparation, le droit de l'individu limit, limit lui-mme. - L'application
pratique du droit la libert est le droit humain la proprit prive, c'est-
-dire le droit de jouir et de disposer de sa fortune arbitrairement ( son gr),
sans se rapporter d'autres hommes, indpendamment de la socit, c'est le
droit l'gosme
17.
Ces droits s'accommodent des alinations socio-conomiques et de ceUes
qui leur font cortge sur les plans social, politique, culturel et idologique en
gnral.
Toutefois, la ralit historique montre un dveloppement humain
contrast et contradictoire. Du point de vue matriel, il y a un dveloppement
des richesses, et peu peu, travers toutes sorte de pripties, de luttes, de
conflits et de rvoltes, c'est aussi une extension des liberts relles que l'on
assiste: libert de conscience, liberts politiques (suffrage universel), certains
droits conomiques (journe de 10 heures).
Cela ne fut possible que grce au dveloppement de la bourgeoisie, la
rvolution industrielle qui accrut les forces productives et les biens un
rythme rapide. Or, comme les forces productives ne cessent de crotre, les
inventions de se multiplier, la science de s'tendre, un nouvel largissement des
LA POSSIBILIT RELLE
459
liberts est rellement possible, que le capitalisme ne peut plus contenir et
auquel il fait politiquement obstacle, au besoin par la force.
Les tendances historiques du mouvement social (lutte des classes) du
temps de Marx taient de deux sortes: tendance l'abolition de l'esclavage et
du servage dans de nombreux pays o ils existaient encore (tats-Unis, Russie
et colonies), et tendance similaire, dans les pays conomiquement les plus
dvelopps, l'accession des classes ouvrires aux droits politiques (suffrage
universel, constitution de partis), aux droits syndicaux (droit d'association,
droit du travail, droit de grve), aux droits sociaux (droit l'ducation, au
logement, la sant, aux loisirs, etc.).
L'abolition de l'asservissement conomique (exploitation de la force de
travail) ne peut se raliser que par l'mancipation de la classe ouvrire qui est
la fois possible et ncessaire, ce que montrent les luttes politiques du
XIX. sicle en Europe. Le dveloppement des possibilits de production que
rvlent les crises de surproduction, un dveloppement sans exemple de
l'industrie [... et] un accroissement inou du commerce 18, est tel qu'il permet
d'envisager la possibilit relle d'une rvolution sociale. Cette ide, Marx la
partage avec la plupart des socialistes du XIX. sicle.
Telles sont les conditions de la libert; mais qu'est-elle positivement?
Marx est parmi les plus radicaux: le but de la rvolution est l'abolition des
classes. Plus que les socialistes franais, Marx cherche en prciser les
conditions et les contours. Sur la base de ses analyses critiques de l'conomie
politique, il dcrit le passage un rgime de proprit socialise comme la
condition ncessaire de l'abolition des classes. Il pense que ce nouveau rgime
conduira un dprissement de l'tat en tant qu'instrument aux mains des
classes actuellement dominantes, et au remplacement du gouvernement des
hommes par une administration des choses, selon la formule que lui et
Engels reprennent aux Saint-Simoniens.
De la libert, Hegel disait: en fait, elle est elle-mme la fin qu'elle
ralise 19. Marx va un peu plus loin et s'efforce de prciser davantage son
contenu possible . C'est dterminer ce contenu, selon l'esquisse fugitive
qu'en donnent des remarques dissmines dans l'uvre de Marx, que nous
allons nous attacher.
Les conditions de la ralisation de ce que Marx appelle le rgne de la
libert sont dcrites d'une manire condense dans une page clbre du
troisime livre du Capital, o domine son souci de fonder son propos sur une
base conomique raliste. Rapportons cette page pour l'analyser:
En fait, le royaume de la libert commence seulement l o l'on cesse
de travailler par ncessit et opportunit impose de l'extrieur; il se situe donc,
par nature, au-del de la sphre de production matrielle proprement dite. De
mme que le sauvage [Wilde] doit lutter contre la nature pour pourvoir ses
besoins, se maintenir en vie et se reproduire, l'homme civilis est forc, lui aussi,
de le faire et de le faire quels que soient la structure de la socit et le mode
de la production. Avec son dveloppement s'tend galement le domaine de
460 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
la ncessit naturelle, parce que les besoins s'largissent [sich erweitern]; mais
en mme temps s'largissent les forces productives pour les satisfaire. En ce
domaine, la seule libert possible est que l'homme social, les producteurs
associs rglent rationnellement leurs changes avec la nature, qu'ils la
contrlent ensemble au lieu d'tre domins par sa puissance aveugle et qu'ils
accomplissent ces changes en dpensant le minimum de forces et dans les
conditions les plus dignes, les plus conformes leur nature humaine. Mais cette
activit constituera toujours le royaume de la ncessit. C'est au-del que
commence le dveloppement des forces humaines comme fin en soi, le vritable
royaume de la libert qui ne peut s'panouir qu'en se fondant sur l'autre
royaume, sur l'autre base, celle de la ncessit. La condition essentielle de cet
panouissement est la rduction de la journe de travail 20.
"
Ainsi, le possible par excellence, c'est cette libert se dveloppant dans
une forme de socit o la production destine satisfaire les besoins
ncessaires est socialement organise, o la concurrence et la volont arbi-
traire des individus ne font plus loi en ce qui concerne ce domaine de la
ncessit, mais o s'exercent librement" les activits <<individuelles" en
dehors du temps de travail ncessaire21.
La libert dont il est question ici ne peut se ramener <d'intellection de la
ncessit ", la ncessit comprise
", et la dtermination du choix fonde
sur la connaissance aussi bien des lois de la nature extrieure que de celles qui
rgissent l'existence physique et psychique de l'homme lui-mme, comme
l'explique Engels quand il dit se placer dans le cadre de la conception
hglienne des rapports entre ncessit et libert22.
La manire dont Marx pose la libert dans la socit communiste, en
l'opposant au domaine de la ncessit" implique davantage: dans une socit
sans classes, la libert se prsente plutt comme ouverture d'un champ de
possibilits pour toutes sortes d'activits indites, affranchies de toute nces-
sit, que ce soit l'invitable ou l'indispensable.
Toutefois, parvenir cette forme de socit est impossible sans la
connaissance de la ncessit des lois naturelles impliques dans les techniques,
et sans celle de la ncessit des processus socio-conomiques impliqus dans la
transformation rvolutionnaire de la socit de classes actuelle en une socit
sans classes.
C'est ici que se pose la question de savoir quel est le contenu de la libert
pour Marx. Selon les textes, ce contenu semble entendu de deux manires
notablement diffrentes: tantt, comme dans la page du Capital cite
l'instant, la libert est la sphre des activits individuelles laisses l'arbitraire
et au choix individuels au-del du travail ncessaire, tantt Marx la fait
consister dans le travail lui-mme, mais d'un travail tel que l'homme s'y ralise
pleinement, ce qui suppose un dpassement - que l'on entend parfois comme
une disparition totale - de la division du travail.
C'est ce qui ressort d'une autre page clbre, crite en 1845-1846, qui
illustre concrtement ce quoi Marx peut penser aussi la fin du Capital:
LA POSSIBILIT RELLE
461
Dans la socit communiste, o chacun n'a pas une sphre d'activit
exclusive, mais peut se perfectionner dans la branche qui lui plat, la socit
rglemente la production gnrale, ce qui cre pour moi la possibilit de faire
aujourd'hui telle chose, demain telle autre, de chasser le matin, de pcher
l'aprs-midi, de pratiquer l'levage le soir, de faire de la critique aprs le
repas, selon mon bon plaisir, sans jamais devenir chasseur, pcheur, berger
ou critique23.
Ces activits libres de nombreux individus ne concourent-elles pas, au
moins en partie, la production matrielle? Elles rentreraient donc dans la
part de travail dite ncessaire . O fixer les limites? Pourtant, la page du
Capital que nous interrogeons ici, parle bien de deux parts , dont l'une de
travail ncessaire . L'activit libre est un concept difficile prciser. Marx
l' a-t-il dlibrment laiss dans l'indtermination? L'on peut se demander, ici
plus que jamais, si Marx est cohrent ou s'il n'aurait pas vari. Ce qui frappe
habituellement, c'est plutt la constance de ses ides philosophiques gnrales.
Ses conceptions de l'homme et de la socit restent fondamentalement les
mmes de L'idologie allemande au Capital!
Ce qui est sr, c'est que, lorsqu'il est question de libert chez Marx, ce
n'est pas d'une libert absolue du vouloir, au sens du libre-arbitre des
mtaphysiciens ou de la raison des moralistes rigoristes, mais de celle de
l'activit rationnelle dlibre que couronne le plaisir de l'acte au sens
d'Aristote, voire au sens des matrialistes et des hdonistes. Marx rappelle que
deux conceptions philosophiques de la libert s'affrontent:
<dusqu'ici la libert a t dfinie par les philosophes sous un double
aspect: d'un ct par tous les matrialistes, comme puissance, comme
matrise des circonstances de la vie d'un individu -, d'autre part, par tous les
idalistes, les Allemands en particulier, comme autodtermination, dtache-
ment du monde rel, comme libert purement imaginaire de l'esprit 24.
Tout en adoptant la conception matrialiste, lorsqu'il dcrit le rgne de
la libert , Marx semble dpasser cette opposition, quoique la possibilit de
cette libert repose sur la matrise des circonstances , celles de la
production matrielle (rapport la nature) et celles des rapports sociaux dans
une socit communiste.
La libert est toujours lie des moyens objectifs, sans lesquels elle n'est
qu'illusoire. Elle s'tend autant que ces moyens le permettent, sans s'identifier
eux. Les hommes sont libres proportion des moyens matriels dont ils
disposent;
Il n'est pas possible de raliser une libration relle, ailleurs que dans
le monde rel et autrement que par des moyens rels; [...] l'on ne peut abolir
l'esclavage sans la machine vapeur et la mule-jenny, ni abolir le servage sans
amliorer l'agriculture25.
462 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Cela reste vrai de toute sphre de libert future, qu'il faut donc concevoir
sur la base de ses moyens ncessaires. Marx n'identifie pas non plus la libert
future la seule conscience de la ncessit )', comme tendaient le faire
Spinoza et Hegel. La libert de chasser, de pcher ou de faire de la critique
littraire, selon mon bon plaisir", ne peut se rattacher aucune ncessit.
Marx dveloppe ici une thorie de l'individualit o les potentialits de
l'individu s'largissent en possibilits libres . Doit-on dire que cette libert
implique un choix motiv, fond sur des dterminations rationnelles? C'est
plutt une spontanit, un libre panouissement", une invention, une
cration, une explosion des possibilits: cette libert-l (redisons-le) est elle-
mme sa propre fin". Aucune autre dtermination ne lui convient. Nan-
moins, elle reste lie des besoins et elle est fonction des aptitudes et facults
individuelles, pouvoirs" ou potentialits". La ralisation de ces potentiali-
ts qui sommeillent dans les hommes dpend du dveloppement des forces
productives:
En ralit les choses se sont naturellement prsentes ainsi: les hommes
ont chaque fois atteint le degr d'mancipation que leur prescrivaient et
permettaient, non pas leur idal de l'homme, mais les forces productives
existantes. Toutefois, toutes les mancipations ont eu lieu jusqu'ici sur la
base de forces productives limites, dont la production, incapable de
satisfaire la socit entire, ne permettait le progrs que si les uns satisfai-
saient leurs besoins aux dpens des autres, ce qui donnait aux uns - la
minorit - le monopole du progrs, tandis que les autres - la majorit -
en raison de leur lutte continuelle pour la satisfaction des besoins les plus
lmentaires taient, en attendant (c'est-cdire jusqu' la cration de nou-
velles forces productives de caractre rvolutionnaire), exclus de tout pro-
grs. Ainsi la socit a toujours volu dans le cadre d'un antagonisme26.
Le dveloppement historique est une volution qui a un sens: il consiste
dans l'mancipation progressive l'gard des contraintes naturelles et sociales
qui sont successivement surmontes ou abolies. Marx n'est pas le premier
parler de dveloppement des forces productives comme base des progrs de la
libert humaine. Il ne cache pas ce qu'il doit au socialisme franais et aux
Lumires, aux matrialistes comme D'Holbach ou Feuerbach, et Hegel.
Mais deux choses distinguent Marx: d'une part, l'mancipation et les
progrs de la libert n'ont pas pour cause essentielle exclusive le progrs
intellectuel (thse des Lumires); d'autre part, bien que fond sur une base
ncessairement matrielle, le dveloppement des forces productives et des
richesses n'est pas entendu par Marx en un sens quantitatif.
Nous ne nous attarderons pas sur le premier point tant nous en avons dj
parl. Par contre, le second est souvent mconnu, voire ni avec beaucoup de
mauvaise foi 27.On s'acharne mal comprendre Marx: sa pense est carrment
dforme et caricature. Il ne faut pas se mprendre sur le sens du marxisme
et croire que Marx considre tout accroissement de la quantit des biens
matriels comme signe d'un progrs humain . En effet, dans la page du
LA POSSIBILIT RELLE
463
Capital cite ci-dessus, on notera que le dveloppement des richesses doit se
produire dans des conditions dignes de l'homme. M. Maximilien Rubel a
donc raison de souligner l'aspect thique ainsi compt par Marx au nombre
des besoins ncessaires28. Les conditions de vie et de travail influent en effet
sur la qualit de la force productive du travail.
Pour Marx, l'aspect qualitatif du progrs est essentiel, bien qu'il repose
sur un progrs quantitatif. Par une ncessit dialectique, partir d'un
certain degr, le changement quantitatif provoque un changement qualitatif.
Lorsque Marx dit que <des besoins s'largissent, sous l'apparence d'un
langage de la quantit, en ralit il s'agit tout autant de la diversit et de la
qualit des besoins. Il dnonce justement la rduction du progrs son
caractre quantitatif dans la socit bourgeoise. Voir le progrs sous cet angle
exclusif, c'est le fait du systme social dans leque1la valeur d'change est le
mobile fondamental et le critre ultime. Pour Marx, il faut restaurer les valeurs
d'usage dans leur rle de dterminant essentiel. Ici, il faut soigneusement
distinguer le point de vue matrialiste d'un point de vue quantitativiste.
C'est la socit bourgeoise qui est moralement matrialiste. Par contre, la
socit communiste, avec sa sphre de libert, ne l'est pas!
Cette distinction est importante pour comprendre les conditions dans
lesquelles s'effectue le passage au rgne de la libert: Marx voque un
minimum de dpense en forces humaines; c'est un minimum en quantit, mais
non en qualit. Ce minimum ne doit pas tre atteint n'importe quel prix.
Marx met les plus expresses rserves sur ce point: le travail ncessaire doit
tre conforme la dignit de la nature humaine 29 !
Comme dans les analyses du travail alin des Manuscrits de 1844, une
ide affleure dans cette remarque incidente du Capital, savoir que le travail,
quand mme on en rduirait la dure, pourrait encore s'effectuer dans des
conditions alinantes. L'industrie moderne procde la dshumanisation du
travail, non seulement lorsqu'elle allonge sa dure, mais surtout en transfor-
mant radicalement son contenu: travail machinal, rptitif, intensifi, abrutis-
sant, etc. Aussi, le gain de temps libre ralis par les progrs de la productivit
du travail et des moyens de travail peut se faire en rduisant le travail une
activit non seulement vide de tout intrt et de tout sens, mais physiquement
et intellectuellement dgradante.
Ce qui se prsente donc dans le travail qui subsiste sous le rgne de la
libert, c'est un minimum et un maximum relatifs au double point de vue
quantitatif et qualitatif. Le fond de la pense de Marx pourrait tre restitu
ainsi: les facults humaines doivent tre prserves pour qu'on puisse parler
d'un dveloppement des forces productives. C'est bien le superlatif relatif qui
est employ: le plus dignes , le plus conformes la dignit humaine. Cette
dignit est aussi un besoin .
Cela montre que Marx ne conoit pas les besoins humains la manire
d'un matrialisme grossier et vulgaire, ni la manire d'un Bentham contre
lequel il dirige des critiques acerbes. Marx est plus hdoniste qu'il n'est
464 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
utilitariste. En tout cas, la dignit du travailleur dans le travail, la qualit
humaine de sa tche, voil aussi une des conditions de la vritable libert.
Le point de vue matrialiste dans l'explication du processus de l'histoire
humaine ne revient pas sacrifier la qualit la quantit.
3. Surtravail et temps libre. Travail et libert
Comme la libert suppose le raccourcissement de la journe de travail,
examinons ce qui se passe, pour Marx, au-del du temps de travail ncessaire
lorsque le mode de production capitaliste dveloppe le surtravail, soit
absolument, soit relativement.
Bien que les progrs de la productivit permettent la diminution de la
longueur de la journe de travail, le mode de production capitaliste rpugne
cette diminution. Les capitalistes y rsistent, car le surtravail est la seule
origine de la plus-value, et donc du profit.
Ici une question se pose: le passage au rgne de la libert n'entranera-
t-il pas la disparition du surtravail, c'est--dire du travail non-ncessaire , du
fait qu'il n'y aura plus d'exploitation? Dans les quelques lignes o Marx
dfinit le rgne de la libert, il n'est question que du travail ncessaire, et
l'opposition est entre ncessit et libert, partition o le surtravail semble avoir
disparu. Faut-il donc penser que l'mancipation des travailleurs et la fin de
l'exploitation consisteraient, pour Marx, dans l'abolition du surtravail? On
peut se reprsenter concrtement les choses comme suit: ds maintenant, si
l'on faisait disparatre le profit et avec lui la classe des capitalistes, la classe
ouvrire ne serait plus astreinte qu'au seul travail ncessaire, et le temps libre
serait gagn sur le surtravail. Le chapitre de la fin du Capital auquel nous nous
rfrons semble autoriser une telle lecture.
En effet, dans ce chapitre 30, Marx rappelle que la plus-value accapare
par une fraction de la socit lui permet, entre autre choses, de vivre dans
l'oisivet. Cependant, l'encontre de l'interprtation prcdente, il prcise
aussi que le surtravail, pour autant qu'il est un travail excdant le niveau des
besoins donns, devra toujours exister , parce qu'il faut s'assurer contre les
hasards de la production, assurer (<l'extension progressive du processus de
reproduction qu'entranent inluctablement le dveloppement des besoins et
l'accroissement de la population 31.
Or, le capitalisme fut lui-mme le plus puissant agent qui ait pouss
cette extension et cet accroissement. C'est une de ses consquences,
justement parce qu'il maintient ou augmente la part relative du surtravail:
Suivant que la force productive du travail est plus ou moins dvelop-
pe, le surtravail peut tre important pour une courte journe de travail
totale ou relativement faible pour une longue journe de travail totale 32.
LA POSSIBILIT RELLE 465
Par exemple, explique Marx, le surtravail tant de trois heures, sur une
journe de douze heures de travail il reprsentera le quart; mais si la journe
de travail n'est que de six heures, il en reprsente la moiti. Le taux
d'exploitation n'est que de 33 113 % dans le premier cas, de 100 % dans le
second. Cela est possible, mme si l'on suppose que la quantit des richesses
produites est la mme, pourvu que la productivit ait doubl, puisqu'on
suppose ici qu'on produise autant en un temps deux fois moindre.
Passer effectivement du premier cas au second dpend cependant de
beaucoup de facteurs minemment variables. Cela dpend des inventions
techniques, des dcouvertes scientifiques, de l'action et de la conscience des
hommes, de l'issue de leurs luttes pour diminuer la journe de travail ou
s'opposer aux nouvelles conditions du travail, de l'action politique des classes
au pouvoir, des rapports entre les nations sur le march mondial, bref de tous
les facteurs socio-historiques qui se commandent les uns les autres, s'entrecroi-
sent de faon complexe, concourent parfois, mais se contrecarrent aussi.
Par l'exemple ci-dessus, Marx tablit que, non seulement raccourcir la
journe de travail est possible ds lors que la productivit crot, mais qu'avec
une dure moiti moindre le capitaliste peut encore accrotre son profit. La
dure du trvail tant la mme, c'est la productivit qui importe seule, ce que
Marx dit d'une manire si abrupte que, sorti du contexte, son propos semble
nier tout rle la dure du surtravail:
La richesse vritable de la socit et la possibilit d'un largissement
ininterrompu de son processus de reproduction ne dpendent [...J pas de la
dure du surtravail, mais de sa productivit et des conditions plus ou moins
fcondes [reichhaltigen] dans lesquelles il s'accomplit33...
D'une manire gnrale, il conviendrait plutt de dire que la quantit de
valeurs d'usage produite dans un temps donn, donc aussi pour un temps
donn de surtravail, dpend galement de la productivit du travail34 , et pas
seulement, ni essentiellement, de sa dure.
Marx veut montrer par l que la condition de possibilit de la libert, sa
condition de ralisation effective, c'est primordialement la productivit du
travail: elle est le grand moyen qui permet de diminuer d'une manire dcisive
la dure absolue de la journe de travail, alors que dans la perspective
capitaliste, c'est la proportion du surtravail qui compte. Le capitaliste est la
recherche du meilleur rapport; aussi attache-t-il beaucoup d'imp.ortance la
dure du surtravail qu'il veut maintenir ou mme accrotre35.
L'accumulation capitaliste du produit du surtravail joue ainsi un rle
historique considrable: le capital conduit si objectivement ce rsultat qu'il
dveloppe les besoins au-del des besoins vitaux lmentaires. La consquence
n'est rien de moins que la gestation d'une nouvelle forme de socit:
Cela permet, d'une part, d'atteindre une tape o disparaissent la
466 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
contrainte et la monopolisation, par une fraction de la socit au dtriment
de l'autre, du progrs social (y compris ses avantages matriels et intellec-
tuels). D'autre part, le surtravail cre les moyens matriels et le germe de
rapports [Verhaltnissen] qui, dans une forme plus leve de la socit,
permettraient d'unir ce travail une limitation plus grande du temps
consacr au travail matriel36.
En somme, Marx dit ici que pour couvrir tous les besoins que le
capitalisme a heureusement dvelopps, le temps de surtravail sera incorpor
au temps de travail ncessaire dans la socit socialiste. Non seulement
disparat la monopolisation, mais aussi la contrainte: le travail en sera plus du
travail forc comme dans les conditions du contrat de travail capitaliste;
puisque le capitaliste reoit sans quivalent ce surtravail, qui reste essentiel-
lement du travail forc, autant celui-ci puisse-t-il sembler rsulter d'une
convention contractuelle librement consentie 37.
Il reste pourtant que, dans des conditions socio-conomiques diffrentes
de celles du capitalisme, le travail ne perdra pas son caractre ncessaire.
Les travailleurs associs organiseront rationnellement leur temps de travail
ncessaire: c'est <<laseule libert qu'ils auront, dit-il. Dans ce domaine, la
libert est effectivement la ncessit comprise. Mais il y a une deuxime sorte
de libert, la libert vritable , celle qui apparat au-del de ce domaine.
Tout ce que nous pouvons dire d'aprs cette page du Capital, c'est que le
temps libr grce la journe de travail rduite rend possible le libre
dveloppement des forces humaines [die menschIiche Kraftentwicklung]3S, qui
deviennent fin en soi. Est-ce encore un travail? Marx n'emploie pas le
mot. Nous avons dj pos la question qui ressort d'une analyse intrinsque du
texte: est-ce une activit productive ou une activit improductive?
On peut parler de temps libre , mais c'est du temps libre pour un
travail libre. L'vocation d'un royaume de la libert prte diverses
interprtations. Marx pense sans doute une transformation qualitative du
travail dans son ensemble, mme de celui qui est marqu du sceau de la
ncessit . Collectivement organis et rationnellement compris, ce travail
n'est plus alin . Dans son ensemble, il tend perdre son caractre pnible
du fait qu'il aura une dure moins longue; il ne sera plus dnu de sens, du fait
qu'il ne sera pas impos de l'extrieur.
Mais on doit parler de trois parties dans la journe active et non plus de
deux: celle qui est consacre au travail destin satisfaire les besoins vitaux
lmentaires (reproduction de la force de travail); celle qui est consacre au
surtravail, et qui reste ncessaire en un autre sens, puisque, unie la
prcdente, elle permet d'tendre la reproduction et de rpondre au dvelop-
pement des besoins et de la population; enfin, celle que dgage la rduction de
la journe de travail, et qui, dans l'esprit de Marx, devient la part essentielle,
et surtout celle o l'homme ralise sa finalit vritable.
Non seulement la rduction de la journe de travail ncessaire est une
LA POSSIBILIT RELLE
467
transformation quantitative qui a des consquences sur le plan qualitatif, mais
le but de la production se transforme: il devient autre.
Dans le mode de production capitaliste, le surtravail est dvelopp dans
un but bien dtermin: crer un surplus de valeur d'change. Concrtement,
c'est la recherche du profit individuel sous l'aiguillon de la concurrence qui est
le motif dterminant. Ct ngatif, inhumain de ce mode de production:
l'homme y est subordonn la production et non la production l'homme39.
Si l'on objectait que ce mode de production peut s'adapter, largir le
cercle des classes qui s'emparent du profit, voire le partager avec l'ensemble de
la socit, alors on aurait prcisment la prparation d'un mode de production
suprieur qui procure l'usage de tous les produits tous ceux qui participent
la production, ainsi qu' l'ensemble de la socit. Ce serait un pas vers <de
rgne de la libert. Marx n'exclut pas une telle tape transitoire menant une
socit communiste. Il n'a pas cherch la dfinir plus prcisment, se
contentant d'noncer des mesures conomiques et politiques pouvant prparer
l'avnement de la socit sans classes40.
Il y a deux contresens viter concernant le rgne de la libert: il ne
faut pas le comprendre comme suppression du surtravail et maintien du seul
travail ncessaire.
Il ne faut pas non plus le comprendre comme suppression du travail
ncessaire lui-mme. Sur ce point, Marx est trs explicite. Il pense utopique
une libration absolue qui abolirait toute contrainte au sens de ncessit de
travailler. Une part de l'activit humaine restera toujours du travail nces-
saire. Certes, elle peut diminuer toujours plus, mais il serait faux de croire
qu'elle pourrait devenir nulle.
Or, des commentateurs prtent cette ide Marx: Librs des
contraintes du travail ncessaire (qui est transfr, selon Marx, la production
automatise), les individus sont alors libres de raliser les projets qu'ils veulent
quels qu'ils soient41. Cette interprtation force le texte du Capital, bien que
Marx aille presque jusqu' cette ide en d'autres endroits42.
Quant au premier contresens, nous l'avons vu, il consiste penser que
l'mancipation du travail pourrait se raliser par la suppression de toute forme
de surtravail. Voyons-en brivement les implications. Quoique cela ne soit pas
en principe une impossibilit, Marx ne s'attarde pas sur cette hypothse qu'il
ne croit pas raliste: il n'imagine pas, dans l'tat de choses actuel, que la
reproduction largie doive cesser, et qu'une socit pourrait se contenter de sa
reproduction pure et simple. L'ide qu'on pourrait ainsi arrter le dveloppe-
ment est aux antipodes de la pense de Marx. La mission du proltariat n'est
pas d'abolir le surtravail en supprimant le profit capitaliste, et par la
rvolution d'arrter le progrs, mais de raliser une forme suprieure de
socit o le progrs, socialement matris, sera poursuivi: loin de s'immobi-
liser, le temps de l'histoire vritable commencera. Le temps sera domin:
Dans la socit bourgeoise, c'est le pass qui rgne sur le prsent, dans la
socit communiste c'est le prsent qui rgne sur le pass43. De l'une de ces
468 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
socits l'autre, c'est un renversement qui s'opre entre moyen et fin, ainsi
qu'entre les parts respectives de travail ncessaire et de travail libre.
Dans le mode de production capitaliste, comme dans ceux qui l'ont
prcd, le temps libre existe pour une fraction de la socit, pour des classes
et des individus qui vivent dans une oisivet partielle ou complte.
Qu'est donc finalement la libert? Du temps libre que remplira le plein
dveloppement des individus pour eux-mmes, sans aucune contrainte ni
soumission une quelconque ncessit extrieure et incomprise. Ainsi, ce que
Marx entend par rgne de la libert est dtermin dans son essence comme
ouverture sur les possibles. Mais, de ceux-ci, peut-on dire davantage?
Le temps libre gagn par la rduction du temps de travail ncessaire, tait-
il, pour Marx, un temps de loisir au sens o on l'entend aujourd'hui, ou
bien une complte inactivit, comme le suggre l'oisivet des classes riches que
Marx dnonce dans la mesure o elle repose sur l'exploitation d'autres
hommes? Il y a l un risque de mcomprhension.
Quelques pages des Manuscrits de 1857-1858 nous clairent davantage sur
toutes ces questions. Elles compltent trs utilement la fin du troisime livre du
Capital. L'analyse du temps de loisir - tel est bien le sens du vocable anglais
leisure employ par Marx - dgag par l'accroissement de la productivit du
travail s'oppose la thorie qui explique le profit par <d'abstinence du
capitaliste (thorie dite upon alienation: profit par alination , autrement dit
frugalit, pargne, etc.). A cela, Marx oppose que <d'conomie relle -
l'pargne - consiste en pargne de temps de travail; [minimum (et rduction
un minimum) de cots de production]; or, cette pargne est identique au
dveloppement de la force productive44 ,
Par son insistance sur le ncessaire dveloppement des forces productives,
Marx ne propose aucunement de redoubler d'esprit d'abstinence. Le but de la
socit sans classes n'est pas un accroissement indfini du surtravail, et la
recherche de la puissance pour la puissance, bref un productivisme .
Toutefois, n'est-ce pas le moyen d'y parvenir? On a pu le croire. Cette
interprtation doit pourtant tre carte aussi, car, pour Marx, cette conomie
de temps a un but humain. Aprs les lignes que nous venons de citer, il ajoute:
Donc aucunement renonciation la jouissance, mais dveloppement de
puissance, de capacits de production et donc aussi bien des capacits que des
moyens de jouissance. La capacit de jouissance est la condition de cette
dernire, donc son premier moyen, et cette capacit est dveloppement d'une
disposition individuelle, est force productive.
Marx n'a aucune estime pour
1'oisivet; la libert telle qu'il l'envisage
n'exclut pas le repos et le farniente, mais ne saurait s'y rsumer: Le temps
libre [...] est aussi bien temps de loisir que temps destin une activit
suprieure45.
La libert ne s'accomplit que dans l'activit: l'tre en acte est la ralit
fondamentale. D'aprs L'idologie allemande, cette activit peut se diversifier,
LA POSSIBILIT RELLE
469
voire se disperser, mais elle vise toujours quelque fin, qui est jouissance,
satisfaction d'un besoin, d'un intrt, ou d'une passion individuels. En ce sens,
elle contribue dvelopper les facults humaines.
Les penseurs grecs anciens se fixaient comme but suprme l'ataraxie ou la
contemplation pure, la thorie (theria): Marx prendrait plutt le contre-
pied de cet idal, en dfinissant la libert par l'activit (praxis). Mais le point
commun de Marx et des Anciens est qu'il s'agit d'une activit libre de toute
contrainte externe.
Le <doisir que procure le temps disponible , n'est donc pas l'inaction
totale. Aussi, il peut et doit tre considr comme consistant en un certain
travail. L'pargne de temps de travail gale augmentation de temps libre,
c.--d. de temps pour le plein dveloppement de l'individu, dveloppement qui
agit lui-mme son tour, comme la plus grande des forces productives, sur la
force productive du travaiI46. L'activit occupant le temps libre n'est donc
pas du travail improductif . En ralit, pour Marx, ces catgories deviennent
inadquates: elles passent dialectiquement l'une en l'autre; il y a identit des
contraires; il devient difficile, voire impossible, de les discerner. L'essentiel
pour lui, c'est que ce temps libre n'est pas un temps d'inactivit, mais celui qui
substitue l'activit contrainte (travail forc ou travail ncessaire) une activit
libre , c'est--dire sans finalit impose de l'extrieur47 .
Il convient de rapprocher cette distinction de celle que faisait Aristote
entre l'activit libre et rationnelle du matre oppose l'activit contingente et
contrainte de l'esclave48. Le matre se dtermine lui-mme: le but de son
activit ne lui est pas impos par un autre. Au contraire, l'esclave ne choisit ni
le but ni les modalits de sa tche. C'est la mme opposition que Marx
applique ici. Comme il le disait dans les Manuscrits de 1844: est libre l'activit
qui n'a pas d'autre but qu'elle-mme; est libre l'tre qui se prend pour but de
lui-mme49.
Cette conception de la libert, comme spontanit, auto-activit, auto-
dtermination, absence de toutes sujtion un autre, est tout fait explicite
aussi dans Le capital, quand Marx dit que le rgne de la libert concide avec
<de dveloppement des forces humaines comme fin en soi 50.
C'est dans le mme esprit qu'il faut comprendre la fameuse remarque
selon laquelle dans une phase suprieure de la socit communiste, quand
auront disparu l'asservissante subordination des individus la division du
travail, et, avec elle, l'opposition entre le travail intellectuel et le travail
manuel; [...] le travail ne sera pas seulement un moyen de vivre, mais
deviendra lui-mme le premier besoin vital 51.
Un commentateur, M. A. A. Wood, le dit trs bien:
<da distinction entre rgne de la ncessit et rgne de la libert [...] n'est pas
une distinction entre travail et loisir (temps libre), mais entre travail consacr
aux besoins ncessaires, et travail devenu lui-mme le premier besoin de la
vie 52".
470 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Si, pour Marx, le travail est destin devenir le premier de tous les
besoins, c'est qu'il sera alors sa propre fin en tant qu'activit o l'individu
humain dveloppe toutes ses potentialits, ce qu'il n'est pas actuellement pour
la plupart des travailleurs astreints satisfaire les besoins ncessaires sous la
contrainte des classes dominantes qui profitent de leur situation prcaire.
Ainsi Marx ne fait pas du travail l'antithse de la libert, comme le faisait
Adam Smith, qui restait idologiquement prisonnier de la conception chr-
tienne biblique du travail comme sacrifice: en travaillant, crivait Smith,
l'homme qui est dans son tat normal de sant, de force et d'activit, et
d'aprs le degr habituel d'adresse et d'habilit qu'il peut possder, [...] doit
toujours cder [une] portion de son repos, de sa libert et de son bonheur 53.
Marx commente:
Tu travailleras la sueur de ton front! C'est la maldiction dont
Jhovah a gratifi Adam en le chassant. Et c'est ainsi qu'A. Smith conoit le
travail: comme une maldiction. Le "repos" apparat ds lors comme l'tat
adquat, synonyme de "libert" et de" bonheur". Que l'individu se trouvant
"dans un tat normal de sant, de force, d'activit, d'adresse et d'habilet"
puisse prouver quand mme le besoin d'effectuer une part normale de
travail et de suspension de son repos semble peu intresser A. Smith 54.
Voil qui rvle bien les ides de Marx sur le travail. Il ne faut pas se
laisser obnubiler par l'tat de dgradation physique et morale auquell'exploi-
tation ravale les travailleurs, par ncessit sociale , dans toutes les
socits de classes. Ces conditions alinantes ne tiennent nullement au travail
par nature:
A. Smith semble tout aussi peu avoir ide que surmonter des obstacles
puisse tre en soi une activit de la libert [...], tre donc l'auto-effectuation,
l'objectivation du sujet, et, par l mme, la libert relle dont l'action est
prcisment le travai155.
Marx critique tout autant la conception diamtralement oppose celle
de Smith, et selon laquelle tout travail devrait tre une activit aussi
attractive qu'un jeu, un pur plaisir, [un] pur amusement comme le pense
Fourier avec ses conceptions naves et ses visions de grisette56.
La conception marxienne du travail comme premier besoin de l'homme
prend ses distances l'gard de ces deux conceptions. A Smith, Marx oppose
que tout travail est une activit productive, qui n'a pas son but dans la valeur
d'change qu'elle engendre, mais dans la manifestation de soi de l'homme
qu'elle implique: l'individu s'exprime et se ralise dans les valeurs d'usage,
matrielles ou autres, qu'il cre par cette activit.
A Fourier, il oppose que le travail en tant qu'activit objective produisant
quelque chose d'objectif ne peut tre un pur plaisir sans but extrieur soi et
LA POSSIBILIT RELLE 471
sans effort, un assouvissement papillonnant des passions que le grand utopiste
franais s'est complu rpertorier et classer. Le travail vritable comporte
des caractristiques qui ne se trouvent pas dans l'activit ludique et gratuite:
conscience du but, interaction des moyens et des fins, changes avec la nature,
attention, volont, continuit des efforts, etc. Bref, le travail ne peut pas
devenir jeu, comme le veut Fourier [...] 57.
Marx donne parfois en exemple des activits sur le modle desquelles il
conoit ce que sera le travail vraiment libre au-del du travail ncessaire dans
une socit dbarrasse de l'exploitation; ce sont les activits intellectuelles et
spirituelles!
C'est le libre dveloppement des individualits, o l'on ne rduit donc
pas le temps de travail ncessaire pour poser du surtravail, mais o l'on
rduit le travail ncessaire de la socit jusqu' un minimum, quoi
correspond la formation artistique, scientifique, etc., des individus grce au
temps libr et aux moyens crs pour eux tous 58.
"
C'est d'un exemple du mme genre qu'il tire argument contre Fourier:
Des travaux, effectivement libres, la composition d'une uvre musicale
par exemple, requirent justement l'effort la fois le plus intense et le plus
diablement srieux59."
Pour atteindre ce type d'activit, le travail de la production matrielle
rclame de profondes modifications qui vont de pair avec le dveloppement
des facults humaines. Marx songe la transformation du travail parcellaris,
machinal, rptitif, en des tches intelligentes, comprises, organises collecti-
vement, ce qui suppose paralllement l'accession de tous une ducation et
une formation intellectuelle, technologique et culturelle, c'est--dire un dve-
loppement tant de l'individu que de la socit tout entire6o".
Toutes ces ides sont dj contenues dans le clbre passage de L'idologie
allemande, o l'individu peut tre berger le matin, pcheur la ligne l'aprs-
midi, critique littraire le soir ", passage si souvent cit et tir du ct des vues
utopistes du fouririsme ou de l'Icarie de Cabet. A l'heure de la Commune de
Paris, ou la critique du Programme de Gotha, Marx n'avait rien y changer,
et nous ne pouvons aller plus loin dans la dtermination du contenu de
l'activit libre qui sera nanmoins un travail authentique.
L'ide que le mme individu peut tre, tour tour et le mme jour, berger,
pcheur et critique, sans jamais devenir ni l'un ni l'autre, a une signification
philosophique profonde. Elle rvle le sens de la pense de Marx en tant
qu'humanisme. L'ultime finalit du dveloppement des forces productives et
de la rvolution sociale communiste est la libration des individus de toute
alination, oppression et spoliation. Le but de l'action politique est d'instaurer
une communaut humaine o chacun pourra vivre et s'panouir librement
472 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
aprs un minimum consacr aux tches ncessaires: de chacun selon ses
capacits, chacun selon ses besoins61".
Ce rgne de la libert est la possibilit historique relle. Cette ide de
la libert, la fois individuelle et sociale, matrielle et spirituelle, a toujours t
au cur de la pense de Marx. Sa premire uvre philosophique, qui considre
picure comme un penseur de la libert, en tmoigne. Le marxisme devrait-il
quelque chose picure sur ce point essentiel?
4. Ce que Marx doit picure dans sa conception de la libert
On accordera sans difficult M. Andr Calvez que: la question de la
libert a [...] occup une place importante dans [la] pense" de Marx62.
Combien cette formulation parat mesure, compare celle d'un Toynbee qui
s'crie: Chez Marx, la desse" ncessit historique" est une divinit toute
puissante qui remplace Jhovah et substitue au Judasme le proltariat du
monde occidental, tandis que le royaume messianique est reprsent par la
dictature du proltariat63.
Pourtant, M. Calvez trouve que la question de la libert a recul avec
le temps chez Marx. D'aprs lui, cela s'est produit sans doute en raison de
l'interprtation historique dterministe qui s'est de plus en plus impose
Marx64 . Cette dclaration, malgr sa diffrence de ton par rapport celle de
Toynbee, la rejoint: la pense de Marx serait devenue une pense de la
ncessit.
M. Calvez n'est pas le seul penser ainsi: beaucoup estiment que la
question de la libert aurait chang de nature chez Marx. Celui-ci, en fixant
avec Engels les traits fondamentaux de sa conception matrialiste" de
l'histoire ds 1845-1846, serait pass d'une philosophie de la libert une autre
philosophie, une philosophie de la ncessit qui ne laisse plus qu'une place
seconde la libert; comme la conscience qui, au dire de M. Calvez, ne serait
pour le marxisme qu'une sorte d'piphnomne65, la libert serait plus
apparente que relle.
Or, il est faux que la question de la libert ait recul chez Marx. Une
telle affirmation ne tient pas devant ce que Marx dit du rgne de la libert
comme but final de l'histoire et de son dveloppement.
Certes entre 1841 et 1846, la pense du jeune Marx a bien volu, et de
manire importante! Du point de vue philosophique, elle passe d'un certain
mlange d'idalisme et de matrialisme un matrialisme nouveau , un
matrialisme pratique
",
et, du point de vue politique, d'un libralisme
rpublicain assez avanc, un communisme intgral66.
En philosophie, il mit en effet progressivement au centre de ses concep-
tions, au plan ontologique l'activit", au plan conomique et socio-histori-
que, la praxis, les pratiques des individus sociaux et des classes. Cependant, il
mit tout autant en avant les catgories de causes matrielles et de conditions
LA POSSIBILIT RELLE
473
extrieures que celles d'activit et d'action; ces notions interdpendantes
dfinissent le matrialisme historique.
Les biographes de Marx assurent un peu vite qu'il adhra d'abord une
sorte d'idalisme: avouons-le, cet idalisme est malais dfinir avec quelque
prcision. C'tait une philosophie de la conscience de soi . Certains estiment
qu'elle ressemblait comme un frre jumeau celle de Bruno Bauer. Celui-ci
pensait revenir au point de vue du jeune Hegel qu'il croyait fichten . Ainsi,
MM. Garaudy et Althusser ont parl, chacun de leur ct, d'un moment
fichten chez le jeune Marx 67.
En ralit, l'idalisme qu'affiche le tout jeune Marx est un idalisme
inspir la fois de Hegel et de la philosophie des Lumires. Pourtant,
M. Bottigelli crit que, dans sa Dissertation, Marx se plaait encore du point
de vue de l'idalisme68. Par exemple, dans la ddicace de sa Thse Ludwig
von Westphalen, son futur beau-pre, le jeune auteur qui voulait faire publier
son travail affirmait que l'idalisme n'est pas une fiction, mais une vrit 69.
Le contexte de cette ddicace laisse deviner un idalisme objectif plein de la
philosophie des Lumires franaise et allemande: Marx qualifie l'esprit et la
nature de grands mdecins magiques 70.
Par consquent, M. Calvez n'a pas tout fait tort de dire de Marx que le
matrialisme [..,] s'est peu peu impos son esprit71 . En fait, dj avant
1840, le jeune Marx n'tait pas sur des positions franchement idalistes. Ds le
10 novembre 1837, le jeune tudiant crivait en s'ouvrant son pre de ses
dbats intrieurs:
Partant de l'idalisme que, soit dit en passant, j'ai confront et nourri
avec ce que me fournissaient Kant et Fichte, j'en suis arriv chercher l'ide
dans le rel lui-mme. [...] Je voulais une fois encore plonger dans la mer [la
philosophie de Hegel], mais avec le dessein bien arrt de trouver la nature
.
spirituelle aussi ncessaire, aussi concrte et ferme de contours que la nature
physique 72.
On ne peut gure caractriser d'un mot la vritable position philosophi-
que du jeune Marx. En effet, dans sa Thse, il dploie dj une grande
virtuosit dialectique; il use abondamment du vocabulaire et de la manire de
Hegel, mais d'une faon trs libre: il a une approche concrte et sociale des
problmes d'histoire de la philosophie. En mme temps, il s'engage aux cts
des Jeunes hgliens dans leur combat qui, sous la bannire philosophique et
littraire, est en fait politique. Il donne une orientation trs offensive son
travail thorique. C'est ce que proclame l'Avant-Propos, qui est une vritable
dclaration de guerre idologique.
Marx est pass d'un idalisme incertain un matrialisme certain.
Mais, il n'en rsulte nullement qu'il aurait galement volu entre 1840 et 1845
vers un dterminisme dont il aurait t aux antipodes auparavant. Beau-
coup prsentent pourtant les choses ainsi. Ils laissent entendre qu'il aurait
474 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
d'abord eu une conception idaliste de la libert, une philosophie de la
conscience inspire de Hegel, avec de fortes rminiscences de Kant et de
Fichte, vers lesquelles tendaient ses amis du Doktorklub73.
Ici, les interprtes font jouer un rle capital son premier crit de
jeunesse, sa Dissertation doctorale intitule: Diffrence de la philosophie de la
nature chez Dmocrite et picure74, car on y trouve en filigrane ses premires
positions philosophiques, en particulier ses ides sur la libert. Ultrieurement,
dans le cadre du matrialisme historique, dveloppe-t-il une seconde"
philosophie de la libert?
y
a-t-il eu changement ou au contraire continuit? La conception des
rapports entre ncessit et libert a-t-elle vari et en quoi?
Nous poserons la question sous la forme suivante: la conception que
Marx se fait de la libert au terme du troisime livre du Capital et dans les
autres crits que nous avons analyss ci-dessus, garde-t-elle des lments
essentiels de sa premire philosophie, ou bien s'en diffrencie-t-elle?
L'interprtation que le jeune tudiant donnait de la philosophie d'picure
a-t-elle influenc sa pense ultrieure? Mieux: l'inspirerait-elle secrtement, en
tant que pense de la libration l'gard de toute puissance" extrieure?
Pour rpondre, cherchons quel fut le rapport de Marx picure.
D'ailleurs, n'y a-t-il pas un certain picurisme penser que, dans la
socit sans classes, chacun, libr des dures contraintes qu'ont imposes
jusqu'ici des moyens de production limits, aura la possibilit de se livrer un
libre exercice de ses facults dans une nature sans transcendance?
Selon Marx, chaque tre humain trouvera son panouissement et son
plaisir dans cet exercice d'une libert sans entraves, une fois satisfaits les
besoins ncessaires, ce qui sera facile avec un minimum d'efforts et de temps.
Il retient donc quelques traits importants de l'idal picurien.
N'aurait-il pu transposer les paroles d'picure: C'est un malheur de
vivre dans la ncessit, mais vivre dans la ncessit n'est pas une ncessit 75?"
Le philosophe grec poursuivait: partout s'ouvrent les chemins vers la libert,
nombreux, courts et faciles 76: ce propos ne convient-il pas la socit
communiste? Marx invite penser que le mot d'picure: il est permis de
dompter la ncessit elle-mme 77, y prendra son plein sens.
Des diffrences majeures et videntes sparent les doctrines de Marx et
d'picure de nombreux gards: anthropologique, social, politique, thi-
que, etc. Il va de soi que l'idal marxien de la socit sans classes et de son
rgne de la libert, compar l'thique svre et quasi-asctique d'picure, ne
peut tre qualifi d' picurien qu'en un sens tout relatif.
Malgr tout, l'interprtation marxienne du principe de la philosophie
picurienne prsente un intrt majeur pour la comprhension en profondeur
du marxisme: nous devons nous demander si le principe de cette philosophie
d'picure n'a pas exerc une influence dterminante sur la manire dont Marx
envisagea la libert dans une socit o les hommes se seront mancips de
toute alination sociale.
LA POSSIBILIT RELLE 475
De 1838 1841, le jeune tudiant fut saisi d'un vritable enthousiasme
pour picure qui reprsentait dans la pense antique et dans l'histoire des
ides une philosophie de la libration. Surtout, picure avait radicalis la
critique des illusions de la perception, des reprsentations religieuses com-
munes et de la pense spculative. C'tait la condition pour parvenir
l'autonomie et la tranquillit parfaite, le moyen de dompter mme la
ncessit
),
!
Marx interprte la philosophi.e d'picure dans le contexte de son propre
combat. La Prusse semi-fodale de 1840 voulait dicter sa loi ractionnaire
toute l'Allemagne. Il brandit le drapeau de la libert en philosophie, avec des
buts politiques; il ne cessera plus. Il prne une libert rvolutionnaire,
agissante et conqurante, attitude contraire celle d'picure. Mais reste ce
point commun: de mme qu'picure avait rejet en son temps la croyance en
un destin aveugle ou en une soi-disant volont des dieux, de mme Marx
refusait la soumission de l'individu toute autorit trangre (tat et religion),
toute idologie, spculation ou utopie.
Ce fut toujours une dmarche typique de Marx que de se servir d'une
pense critique et mancipatrice comme d'une arme dans un combat philoso-
phique, idologique et politique. Ds ses premiers travaux thoriques, il se
montra matre dans cet art, mme contre Hegel, et justement propos
d'picure 78.
Celui-ci est pour lui, parmi les philosophes anciens et modernes, le hros
ponyme de la libert, car il avait banni toute transcendance, et dnonc toute
forme d'assujettissement idologique et social. Aussi avait-il ni l'existence
d'une nature mystrieuse et la ncessit extrieure.
Dans la Thse, on relve les formules les plus laudatives pour lui: ainsi
picure est [...], des Grecs, le plus grand philosophe des "lumires"79.
Avant tout, le jeune Marx apprcie le fait qu'picure ralisa dans
l'Antiquit la critique la plus radicale qui ft de la pense thologique et
spculative. Il en faisait l'emblme de son combat et de celui des Jeunes
Hgliens, comparant les courants philosophiques post-hgliens en Alle-
magne, Berlin, aux coles philosophiques grecques, Athnes, aprs
Aristote. Dans ce parallle, picure est le hros de la philosophie et de la
pense libre contre l'entendement thologisant: La philosophie ne s'en
cache pas. Elle fait sienne la profession de foi de Promthe: "En un mot, j'ai
de la haine pour tous les dieux. "79bisCette profession de foi est sa propre
devise qu'elle oppose tous les dieux du ciel et de la terre qui ne reconnaissent
pas comme divinit suprme la conscience de soi humaine 80.
L, la pense de Marx s'exprime avec les accents polmiques et combatifs
qui le caractriseront dsormais. Htrodoxe comme tous les Jeunes Hg-
liens, Marx entreprenait d'interprter picure en entrant en dissidence par
rapport au matre: implicitement, il oppose cette conscience de soi humane
l'Esprit et la Raison qui gardaient chez Hegel des attributs thologiques.
Il reste pourtant fidle Hegel: plaant picure trs haut, il n'adopte pas
476 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
pour autant sa conception de la <dibert >', ni son principe tel qu'il
l'interprte. On s'y trompe souvent; il ne faut pas oublier que toute la
Dissertation repose sur une opposition: dans ce dyptique, il ne msestime pas
l'apport de Dmocrite autant qu'on le croirait.
L'examen des ides d'picure et de Dmocrite est plac sur le terrain de
la philosophie de la nature, qui est a priori le moins favorable pour dvelopper
une pense de la libert comme libration. Mais c'est l qu'picure apparat
original, et que se rvle la cl de sa philosophie.
Marx soutint qu'une diffrence systmatique opposait picure Dmo-
crite. Il entreprenait de le prouver dans le dtail sur le terrain de leurs
conceptions de la physique et des sciences de la nature8l. Son ide directrice
tait que Dmocrite et picure reprsentaient deux points de vue divergents au
sein d'une mme cole philosophique: celui de la ncessit naturelle et celui de
la libert humaine82.
La philosophie d'picure aurait pour principe la conscience de soi
singulire
".
Elle pose que l'individu a la possibilit de se librer de toute
alination et de toute ncessit contraignante non-naturelle. Non seulement
picure se dressait contre les conceptions du destin et de la fatalit des
Stociens, mais il s'opposait aussi aux doctrines physiques et cosmologiques
d'Aristote et de Dmocrite, qui faisaient la part belle la ncessit essentielle
fonde dans la nature des tres: la libert de l'individu tait limite chez eux
par des contraintes extrieures dont il n'aurait pas la possibilit de s'affran-
chir. picure y oppose le hasard et le libre-arbitre.
Cette interprtation en termes de conscience de soi ne signifiait pas, pour
Marx, quelque approbation de la philosophie de la nature d'picure. L'ana-
lyse dtaille des diffrences que Marx dcouvrait entre l'atomistique picu-
rienne et l'atomistique dmocritenne tait magistrale83. Il y voyait l'expres-
sion, d'un ct, d'une philosophie de la singularit et de la conscience de soi,
de l'autre, d'une philosophie de l'universalit et de l'objectivit (une philoso-
phie de la chose en soi)84. C'est sur cette base qu'il interprte les caractres
nouveaux attribus l'atome par picure. Pour Marx, l'atome, avec son
clinamen [dclinaison], devient chez picure l'image de l'autonomie de la
conscience de soi singulire.
Toutefois, la manire mme dont Marx caractrise ce principe picu-
rien est grosse de rserves. Recourant la terminologie logique hglienne,
Marx souligne qu'picure est le philosophe de la possibilit abstraite . Le
principe de son thique - la conscience de soi singulire, essence secrte de sa
philosophie de la nature - est seulement une conscience de soi abstraite .
Dmocrite, au contraire - fait remarquer Marx -, avait adopt en philoso-
phie et en science le point de vue de la possibilit relle!
En soulignant ainsi le ct abstrait du principe picurien, le jeune Marx
montrait qu'il ne faisait pas une lecture purement apologtique d'picure85.
Certes, il l'approuvait chaudement d'avoir dvelopp une critique radicale de
la doctrine stocienne de la ncessit cosmique, et d'avoir non seulement rejet
LA POSSIBILIT RELLE
477
les dieux de la foule, mais aussi ceux des philosophes. Marx apprciait cette
critique qui s'attaquait aux spculations savantes comine aux croyances et
reprsentations, la thologie astrale et scientifique d'Aristote comme la
thologie spculative de Platon. Le jeune Marx exaltait cet athisme critique
militant.
On ne saurait dire pour autant qu'il ait adopt une philosophie de la
conscience de soi abstraite ou quelque idalisme subjectif, et qu'il n'avait que
mpris pour le point de vue objectiviste, universaliste et scientifique repr-
sent, dans l'cole des matrialistes grecs, par Dmocrite. L'loge qu'il faisait
d'picure s'adresse au critique de l'alination de la conscience religieuse; il ne
signifie pas que sur le terrain de la philosophie de la nature et de la thorie de
la connaissance le point de vue dmocriten ne garde pas, pour Marx, sa
supriorit sur celui d'picure.
>
Ici, nous heurtons de front un prjug rpandu sur le sens de la Thse de
Marx. Franz Mehring, gnralement bon juge, crit: Ce qui, au premier coup
d'il, surprend le plus le lecteur d'aujourd'hui, c'est le jugement dfavorable
qu'il [Marx] porte sur Dmocrite. Selon Marx, Dmocrite n'a fait que poser
une hypothse [...]86. C'est une allusion trs claire la conclusion de la
Dissertation, Mehring mettant ainsi le doigt sur un point crucial. Lisons cette
conclusion de la Thse de Marx:
La diffrence entre les philosophies de la nature de Dmocrite et
d'picure, que nous avons poses la fin de la partie gnrale, s'est trouve
dveloppe et confirme dans toutes les sphres de la nature. Chez picure,
l'atomistique avec toutes ses contradictions, est donc, en tant que science
naturelle de la conscience de soi (laquelle est elle-mme sous la forme de la
singularit abstraite, un principe absolu), dveloppe et acheve jusqu' son
extrme consquence, qui est la dissolution de cette atomistique, et son
opposition consciente l'universe1. Pour Dmocrite, au contraire, l'atome
n'est que l'expression universellement objective de l'tude empirique de la
nature en gnral. L'atome reste donc pour lui une catgorie pure et abstraite,
une hypothse qui est le rsultat de l'exprience et non pas son principe actif
[energische Prinzip], et qui reste donc sans ralisation, tout comme elle ne
dtermine pas davantage l'tude relle de la nature87."
Pourquoi Mehring pense-t-il que cela soit un jugement dfavorable pour
Dmocrite? Marx fait tout autant ressortir l'unilatralit de la position
d'picure que celle de la position de Dmocrite! Le point de vue d'picure,
dit-il, ne conduit rien moins qu' la disparition de l'atomistique physique
"
comme science . En effet, pour picure, les sciences de la nature doivent se
contenter d'avancer et de multiplier des conjectures vraisemblables pour
expliquer les phnomnes. Sa thorie des explications multiples a scanda-
lis: c'est sa nonchalance .
Aux yeux de Marx, Dmocrite l'emportait de loin sur picure en ce qui
concerne l'tude empirique des tres naturels et l'explication des phnomnes:
478 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
il avait parcouru le monde et se posait en rival d'Aristote par sa connaissance
encyclopdique de la nature 88.
Contrairement Mehring, nous ne pensons pas que dans sa Thse Marx
juge" Dmocrite: il constate et expose, analysant deux doctrines dans leurs
traits essentiels pour les comprendre. A cause de l'objectivisme de principe de
Dmocrite, l'atome reste chez celui-ci une chose inerte, qui n'a qu'une
proprit physique de rsistance (impntrabilit); il n'a pas le sens d'un
principe actif; il n'est pas une cause agissante, source d'une activit imma-
nente.
Ce caractre actif de l'atome, c'est picure qui
l'a
pos au fondement
de sa philosophie naturelle avec la fameuse dclinaison que Marx comprend
comme l'expression du principe d'autonomie dans l'atoII1e. Selon cette
interprtation, le mrite relatif d'picure est d'apporter ici le principe
actif qui manquait auparvant la physique atomistique 89.C'est ce principe
actif qui intresse Marx. Mehring claire bien ce point essentiel:
Marx, cette poque, confondait encore ce point la philosophie ou,
plus exactement la philosophie du concept avec la science, qu'il pouvait
aboutir une conception que nous ne parviendrions plus sans doute
comprendre aujourd'hui, si nous n'y voyions se rvler l'essence de son tre.
-
Pour Marx, vivre signifia toujours travailler, et travailler signifia toujours
combattre90.
),
Parlant du jeune Marx, Mehring est-il tout fait fond conclure: Ce
qui l'loignait de Dmocrite, c'tait l'absence d'un "principe moteur91"?"
Avec beaucoup d' propos, il rapproche cela de ce que Marx dit du
matrialisme dans la premire Thse sur Feuerbach: ce qui a manqu jusqu'ici
tout matrialisme, c'tait de n'avoir pas saisi l'objet extrieur, la ralit, le
sensible en tant qu'activit humaine sensible, de faon subjective92. Or, selon
le jeune Marx, c'est ce qu'avait signifi aussi, en vertu de son principe, la
philosophie de la connaissance d'picure.
En revanche, nous ne suivons pas Mehring lorsqu'il juge que Marx s'est
loign de Dmocrite. Marx vit trs bien que si quelqu'un revenait en de
de Dmocrite dans l'art d'expliquer les phnomnes naturels, c'tait picure.
Cela indique, d'une faon certes encore indirecte, qu'il n'tait ni plus ni moins
dterministe en 1841 qu'il ne le sera plus tard.
En effet, la Thse de doctorat de Marx est tout aussi logieuse l'gard
de la philosophie objectiviste de la nature et de la connaissance de Dmocrite
qu'elle l'est en ce qui concerne le sens de la philosophie picurienne en tant que
philosophie de la conscience de soi et de la libert individuelle93.
En effet, que dit prcisment la Dissertation des catgories de ncessit et
de possibilit <hasard d'picure) auxquelles Marx consacre quelques pages
o il est justement question du dterminisme? Qu'elles se trouvent respec-
LA POSSIBILIT RELLE 479
tivement chez Dmocrite et chez picure. Il rappelle-cette opposition bien
connue par laquelle picure se distinguait de son devancier94:
Un ~)Qint est [...] historiquement certain: Dmocrite se sert de la
ncessit, Epicure du hasard; et chacun d'eux rejette le point de vue oppos
avec l'pret de la polmique95.
Pour ce qui est des catgories de la rflexion, dit Marx, l'opposition des
deux grands atomistes grecs se manifeste p,rcisment en ceci que l'un explique
les choses par la ncessit et l'autre par le hasard: Dmocrite emploie comme
forme de rflexion de la ralit effective la ncessit96.
Diamtralement oppose cette forme d'explication, celle d'picure qui
prne le hasard:
Par contre, picure [c'est Marx qui cite]: "La ncessit, qui est
mentionne par certains comme la matresse absolue, n'est pas; bien au
contraire, certaines choses sont fortuites, les autres dpendent de notre libre-
arbitre. La ncessit est impossible convaincre, le hasard au contraire est
instable. [...] Mieux vaut suivre le mythe sur les dieux qu'tre asservi la
d~a.p~vll [au destin] des physiciens. Car ce mythe laisse esprer la
misricorde l'homme qui a honor les dieux, alors que le destin le livre
l'inexorable ncessit. Mais ce n'est nullement dieu, comme la foule le croit,
c'est le hasard qu'il faut admettre "97." *
Le jeune Marx exprimait-il cette occasion une prfrence pour le
hasard d'picure? Il serait vain de le soutenir, car la possibilit laquelle
en appelle picure, dcIare-t-il, reste tout fait abstraite et relve de
l' <<imaginaire. Sur ce point, il ne mnage pas particulirement picure:
Le hasard est une ralit qui n'a d'autre valeur que la possibilit. Or la
possibilit abstraite est prcisment l'antipode de la possibilit relle. Celle-ci
est enferme, comme l'entendement, dans des limites prcises; celle-l, telle
l'imagination, ne connat pas de limite. La possibilit relle cherche
dmontrer la ncessit et la ralit de son objet; la possibilit abstraite ne se
soucie gure de l'objet qui demande explication, mais du sujet qui explique.
Il suffit que l'objet soit possible, concevable. Ce qui est possible abstraite-
ment, ce qui peut tre pens, ne constitue, pour le sujet pensant, ni obstacle,
ni limite, ni pierre d'achoppement. Peu importe alors que cette possibilit soit
d'ailleurs relle, car l'intrt ne s'tend pas ici l'objet en tant que teI98.
Ici, quelle surprise!, c'est picure qui est abstrait99et Dmocrite concret!
Marx souligne en effet l'insouciance et la dsinvolture d'picure l'gard de
l'explication des phnomnes physiques. Cela implique une approbation
*
Diogne Larce, X, 133. (Note de Marx). Cf. PICURE, Doctrines et Maximes, op. cit., p. 80
(Lettre Mnce, in fine).
480 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
peine voile du mode d'explication dmocriten. Or, de quelle sorte de
ncessit s'agissait-il chez Dmocrite? Marx le prcise:
La ncessit apparat, en effet, dans la nature finie, comme ncessit
relative, comme dterminisme. La ncessit relative ne peut qu'tre dduite de
la possibilit relle, ce qui veut dire que c'est un enchanement de conditions,
de causes, de raisons, etc., qui mdiatise cette ncessit. La possibilit relle
est l'explication de la ncessit relative. Et nous la trouvons employe par
Dmocrite 100.
Cette ncessit relative identique la possibilit relle dont elle dcoule,
nous l'avons rencontre partout chez Marx: c'est la ncessit ou possibilit
qu'on trouve derrire les lois et les causes conomiques, dans les tendances
historiques et les forces productives, dans l'activit et ses conditions, et elle
fonde l'explication des idologies et de la conscience.
En 1841, le point de vue dterministe n'est aucunement rcus, quitte
prciser qu'il ne saisit que le ct objectif de la ralit. Marx souligne au
contraire que <<J'enthousiasme et le srieux avec lesquels Dmocrite applique
ce mode d'explication l'tude de la nature, l'importance qu'il attache la
tendance donner des causes [Begrndungstendenz] s'expriment navement
dans cette profession de foi: Je prfre dcouvrir une nouvelle" tiologie
plutt que d'obtenir la couronne du roi de Perse!" *
101
Le point de vue d'picure n'est donc pas jug suprieuf: au lieu de
comprendre les phnomnes naturels, il conduit l'abstraction; il suffit
picure de sauver les phnomnes d'une manire absolument quel-
conque,
En fait, c'est seulement dans la conclusion de sa thse que Marx exprimait
une prfrence pour le type de rflexion qu'picure appliquait la nature 102.
Le philosophe du Jardin poussait aussi loin que possible la critique de
l'objectivisme: il dniait toute consistance aux objets naturels, librant la
conscience de toutes les fausses reprsentations de la ncessit et du destin,
posant en principe le rgne du hasard pur, le libre-arbitre, l'autonomie absolue
du choix individuel. La contrepartie de cette position, c'tait l'abandon de la
science de la nature: avec lui, l'atomistique tombait victime de ses propres
contradictions; celles-ci se rvlent surtout chez Lucrce.
Marx a toujours gard, la base de sa philosophie matrialiste ce fervent
rvolutionnaire de la libert au sens qu'elle avait dans son interprtation du
hasard et du clinamen d'picure, sans adopter pour cela une doctrine du
hasard ou contingence pure, ni du libre-arbitre. Comme Dmocrite, il fit
largement sa place la connaissance scientifique des phnomnes qui rvle
l'existence et l'action de lois objectives; mais la ncessit des lois, sauf celle de
quelques lois gnrales, n'est ni absolue, ni anhistorique.
*
EUSBE, Praepar. evang., XIV, p. 781 (Note de Marx).
LA POSSIBILIT RELLE 481
Ds sa premire uvre thorique, ce qui s'exprime chez Marx, c'est dj
la fois une pense de la ncessit et de la libert. C'est ce qui ressort des
explications qu'il fournit des catgories de la rflexion employe par chacun
des deux grands matrialistes grecs.
.
Rsumons-nous: le rsultat essentiel de cette enqute limite sur le
rapport de Marx picure, est l'ide d'une libration de tout asservissement
et de toute soumission une ncessit extrieure et transcendante. C'est cette
ide interprte d'une manire profondment rvolutionnaire que Marx a vu
chez picure.
Or, Marx est rest fidle son interprtation du sens pratique, idologi-
que et philosophique de l'picurisme. Mais picure n'a videmment pas connu
le vritable principe nergique , l'activit productive, le travail dont le
pouvoir librateur ne s'est rvl qu'avec le monde moderne, ce que Marx lui-
mme ne dcouvrit que dans les annes suivantes. Son combat politique
comme rdacteur de la Gazette rhnane le conduisit l'analyse du travail
alin de l'ouvrier salari exploit par le capital, et de l la critique thorique
de la base conomique de la socit civile bourgeoise.
Pourtant, ds l'poque de sa Thse de doctorat, Marx pensait que la
libert est dans l'action par laquelle les hommes se librent des ingalits
sociales et politiques, et que cette libration est relative aux moyens qu'ils ont
de la raliser. Si le matrialisme historique fut effectivement une dcouverte
progressive de Marx et d'Engels de 1843 1846, par contre l'ide de la libert
comme libration de toute alination et accomplissement de soi, est une
grande constante, une ide fondamentale de toute l'uvre de Marx, et ce, ds
sa prime jeunesse.
Sur ce point, Marx n'a pas vari: libert et ncessit ne sont pas
antinomiques, mais dialectiquement lies, la libert reposant sur la ncessit;
car, il n'y a de libert vritable que dans l'activit et l'action, mais celles-ci
dpendent des moyens ou conditions. Dans toute activit, la ncessit d'abord
extrieure est finalement dialectiquement dpasse, la fois conserve et
dpasse.
Faisant remarquer dans L'idologie allemande que Feuerbach ne fait pas
la critique des conditions actuelles ", Marx ajoute: Il retombe par consquent
dans l'idalisme, prcisment l o le matrialiste communiste voit la fois la
ncessit et la condition d'une transformation radicale tant de l'industrie que
de la structure sociale 103.
"
L'volution de Marx vers un plus grand dterminisme est une illusion
de rtrospection. Ceux qui affirment une telle volution projettent chez le
jeune Marx, pour les besoins de leur cause, une conception de la libert
abstraite (hasard et libre-arbitre d'picure), ou quelqu'<<dalisme ad hoc.
Ils dtournent aussi le matrialisme historique de son sens, ceux qui,
l'inverse, n'y voient qu'une doctrine de la ncessit, interprte, comme le font
Toynbee ou Popper, dans le sens d'un dterminisme. Le dterminisme, li
par naissance au ncessitarisme, la prdestination, ou encore au mcanisme
482 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
et l'objectivisme naturaliste, fait le lit de formes nouvelles de fatalisme, un lit
de Procuste dans lequel on couche le marxisme.
Georges Sorel crivait:
L'ancien matrialisme concluait l'inutilit des efforts; ds qu'il
voulait tre logique, il aboutissait une forme spciale du dterminisme,
ressemblant pas mal au fatalisme. On a singulirement abus de l'adoration
du rel, [...] proclamant la soumission aux dcrets du destin. D'un autre ct
les spiritualistes n'ont jamais pu expliquer ce qu'est le mystrieux libre-
arbitre, dont ils parlent tant et qui, d'aprs eux, est la base de tout ordre
social. -
[...] C'est l'existence du milieu artificiel qui est la condition
fondamentale de notre libert 104.
Il cernait ainsi la vritable pense de Marx comme ~ne pense pour
laquelle la possibilit relle, explication de la ncessit relative , est la libert.
Toute l'uvre de Marx expose une philosophie de l'activit, qui lie indissolu-
blement l'acte et ses conditions matrielles, comme elle lie la pense (la
thorie) et la pratique (l'action). A l'poque de sa Dissertation doctorale, le
jeune Marx proclamait cette relation dialectique:
La philosophie en tant que volont se tourne contre le monde
phnomnal. [...] Il en rsulte la consquence que le devenir-philosophie du
monde est en mme temps un devenir-mondial [WeItlich-Werden] de la
philosophie, que la ralisation [Verwirklichung] de la philosophie est en
mme temps sa dperdition [Verlust] 105.
NOTES
1. L'alination s'identifie en fin de compte chez Hegel avec l'objectivit , crit M. mile
Bottigelli (cf. Manuscrits de 1844, Prsentation, p. LV), qui ajoute qu'en consquence sa
suppression ou sa reprise est [...] une suppression de l'objectivit (ibid., p. LVI). Marx emploie
aussi bien Entfremdung (alination) que Verasserung qui signifie alination d'un bien, vente.
l! parle trs couramment du travail ou du produit d'autrui (fremd), et parfois de la forme aline
[entfremdete] de la production capitaliste (Le capital, 1. 2, p. 113; MEW 23, p. 455. Trad.
modifie), ou du travail dj alin [entfremdet] de l'ouvrier entrant dans le processus de
production (ibid., t. 3, p. 13; p. 596).
- Cela doit tre prcis contre ceux qui l'ont ni (en
particulier, Louis Althusser, et d'autres aprs lui).
2. L'idologie (1968) p. 56; (1976) p. 25; d. bi!., pp. 86-87; MEW 3, p. 44.
3. Cf. les causes du dveloppement de l'esclavage dans la Rome antique voques par Marx
dans les Manuscrits de 1857-1858 (ci-dessus, pp. 223-224).
4. Manifeste, pp. 38-39; MEW 4, pp. 464-465.
5. Certains commentateurs ont bien raison de mettre la catgorie d'alination au centre de la
pense de Marx; ainsi, M. Calvez qui organise ses analyses en fonction de cette notion (op. cit.).
l! montre que Marx est pass d'une critique de l'alination religieuse et idologique une critique
de l'alination politique et sociale, et enfin conomique. Bien que cela schmatise un peu trop
l'volution de Marx, elle la dfigure moins que celle de Louis Althusser, pour qui, partir de
L'idologie allemande, Marx aurait rejet cette catgorie fondamentale juge hglienne,
subjective, anthropocentrique et humaniste (M. Althusser a soutenu qu'il
y avait chez Marx un
LA POSSIBILIT RELLE 483
anti-humanisme thorique , cf. Pour Marx, Paris, Maspro, 1965, et Lire le capital, Paris,
Maspro, 1966.)
6. uvres, d. Rubel, t. 2, pp. 366-367. Un chapitre indit du Capital, p. 194.
7. Cf. Thories, t. I, p. 455, n. 3; MEW 26.1, p. 365; et Le capital (trad. Lefebvre), p. 571;
MEW 23, p. 533.
-
La traduction de Roy rsume beaucoup le texte allemand, laissant cette
distinction dans l'ombre (cf. Le capital, t. 2, pp. 184-185). Cette question de la nature de la
domination du capital sur le travail dans sa premire forme historique est traite dans le chapitre
sur l'accumulation primitive, o on lit: <<lemode de production technique ne possdant encore
aucun caractre spcifiquement capitaliste, la subordination du travail au capital n'tait que dans
la forme (Le capital, t. 3, p. 179; trad. Lefebvre, p. 829; MEW 23, p. 766).
8. Cf. Statuts de l'Association Internationale des Travailleurs, 3e considrant, uvres (d.
Rubel), t. I, p. 469; MEW 16, p. 14.
9. L'idologie (1968) pp. 92-93; (1976) pp. 61-62; d. bi!., pp. 196-199; MEW 3, pp. 53-54.
10. Ibid., pp. 93-94; p. 62; pp. 200-201; p. 74.
II. Ibid., p. 94; p. 62; pp. 200-20 I ; p. 74. Phrase souligne par nous.
12. Thses sur Feuerbach, Thses IV et VIII, L'idologie (1968) pp. 32-33; (1976) pp. 2-3; d.
bi!., pp. 28-31; MEW 3, pp. 6-7.
13. Fragment pour la Dialectique de la nature, Sur la religion, p. 189; Dialectique, p. 195;
MEW 20, p. 466; d. Kedrov, p. 355.
14. Prcisons que nous cherchons saisir ce que Marx pensait, non s'il avait raison pour son
temps, ni si toutes ses ides essentielles conservent leur part de vrit aujourd'hui.
15. Nous pouvons nous demander aujourd'hui si les conditions de cette abolition taient bien
runies dans les rgimes communistes en U.R.S.S. depuis 1917, en Europe de l'Est depuis 1945, ou
en Chine depuis 1949, puisqu'elle n'a pas abouti aux consquences prvues, ou du moins espres;
mais la rvolution sociale des rapports de production n'a peut-tre pas dit son dernier mot.
16. La question juive, pp. 102-103; MEW l, p. 363.
17. Ibid., pp. 104-107; pp. 364-365.
18. Adresse inaugurale de l'Association Internationale des Travailleurs, uvres (d. Rubel),
t. I, p. 460; MEW 16, p. 5.
19. HEGEL, La raison dans l'histoire, trad. Papaioannou, p. 85.
20. Le capital, t. 8, pp. 198-199; MEW 25, p. 828. Trad. modifie.
21. Que cela soulve toutes sortes de problmes, voire d'objections, c'est certain. Mais Marx
a pens que ce serait l'affaire des gnrations futures elles-mmes d'y rpondre.
22. Anti-Dhring, p. 146; MEW 20, p. 106.
23. L'idologie (1968) p. 63; (1976) p. 32; d. bi!., pp. 106-109; MEW 3, p. 33. Il faut
comprendre la dernire phrase comme rejetant une spcialisation vie et qui serait impose
l'individu l'encontre de ses propres tendances et prfrences. Nous ne discuterons pas la part
d'utopie qui entre sans doute dans les vues de Marx, malgr toutes les rserves qu'il mettait lui-
mme ce sujet. Nous cherchons seulement dgager ses ides, telles qu'eUes apparaissent
travers ses divers textes.
24. Ibid., p. 331-332 (note); p. 296 (note); MEW 3, p. 282 (note).
25. Ibid., pp. 52-53; p. 22; (bi!.) pp. 76-79. - Cette citation appartient un fragment
retrouv en 1962, et qui ne figure pas dans l'dition Dietz des Marx-Engels Werke. Le texte
allemand donn dans l'dition bilingue est celui de la Deutsche Zeitschrift jr Philosophie, 1966,
10-14 Jahrgang.
- On le trouvera dans le Probeband de la seconde MEGA, p. 47,!. 8-14. - La
mule-jenny de Crompton (1777) fut la premire machine filer automatique (cf. Histoire des
techniques, p. 718).
26. Ibid., p. 474; p. 437; MEW 3, p. 417.
27. Cela dcoule, par exemple, du procs intent par Sartre au matrialisme marxiste (cf. ci-
dessus, pp. 40-41 et 267-268).
28. D'ailleurs, M. RUBELpense qu' il est peu prs impossible de faire, dans les crits
comme dans ce que nous savons du comportement de Marx, la part de la motivation thique et
du jugement scientifique (Karl Marx, Essai de biographie intellectuelle, Nouv. d., Paris, Rivire,
1971, p. 429).
29. La rfrence la qualit morale du travail ne relve pas ici de considrations tactiques
comme dans les Statuts de l'Association internationale des travailleurs au sujet desquels Marx
crivit Engels: Je fus simplement tenu d'insrer dans le prambule des statuts deux phrases sur
le duty [devoir] et le right [droit], de mme que truth, morality and justice [vrit, moralit et
justice], mais le tout plac de telle manire que a ne peut tirer consquence. (L. du 4 novo 1864,
Correspondance, t. VII, p. 282; MEW 31, p. 15. - Passage cit sans rfrence ni date, et traduit
484 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
autrement par M. RUBEL.Cf. uvres, t. l, p. 1623, note 1 de la page 470) - On peut lire en effet
dans ces Statuts que l'Association dclare que toutes les socits et individus y adhrant
reconnatront comme base de leur conduite envers tous les hommes, sans distinction de couleur,
de croyance et de nationalit, la Vrit, la Justice et la Morale.. (Statuts de l'Association
internationale des travailleurs, uvres (d. Rubel), t. I, p. 470; MEW 16, p. 15).
30. Le capital, 1. 8, pp. 197-198; MEW 25, p. 827-828.
31. Ibid., p. 198; p. 827.
32. Ibid. Trad. modifie.
33. Ibid. p. 198; p. 828. Trad. modifie.
34. Ibid.
35. C'est ce qu'illustrait la thse de W. Senior pour qui tout le profit net provient de la
dernire heure.., thse qu'il dveloppa en 1837 pour s'opposer la loi des dix heures et que Marx
critique dans Le capital (t. l, p. 221; trad. Lefebvre, p. 250; MEW 23, p. 238).
36. Le capital, t. 8, p. 198; MEW 25, p. 827. Trad. modifie.
37. Ibid., p. 197; p. 827. Trad. modifie.
38. On remarquera l'emploi du mot Kraft.
39. Cf. ci-dessus (p. 221) ce que Marx dit des Anciens ce sujet, citation rfrence n. 62.
40. On trouve ces mesures dans le Manifeste (pp. 86-87; MEW 4, pp. 481-482), dans les
propositions aux Congrs de l' A.!. T., et dans les Gloses marginales au programme de Gotha (1875).
41. Cf. Carol C. GOULD, op. cit., p. 126. (Trad. par nous.)
42. Le grand ct historique du capital est de crer ce surtravail, travail superflu du point
de vue de la simple valeur d'usage, de la simple subsistance, et sa dtermination et destination
historique est accomplie ds lors que, d'un ct, les besoins sont dvelopps au point que le
surtravail au-del de ce qui est ncessaire est lui-mme besoin universel, rsulte des besoins
individuels eux-mmes -
que, d'un autre ct, l'ardeur universelle au travail, du fait de la svre
discipline du capital par laquelle sont passes les gnrations successives, s'est dvelopp comme
acquis universel de la nouvelle gnration
-
ds lors, enfin que ce surtravail, grce au
dveloppement des forces productives du travail que le capital pousse sans cesse en avant dans son
avidit sans bornes s'enrichir, dans les conditions o il peut seulement la satisfaire, s'est accru
jusqu'au point o la possession et la conservation de la richesse universelle, d'une part, n'exige
qu'un temps de travail minime pour la socit tout entire et o, d'autre part, la socit qui
travaille adopte une attitude scientifique vis--vis du processus de sa reproduction sans cesse en
progrs, de sa reproduction en une abondance toujours plus grande; qu'a cess donc le travail o
l'homme fait ce qu'il peut laisser faire sa place par des choses. [...J En aspirant sans trve la
forme universelle de la richesse, le capital pousse le travail au-del des frontires de ses besoins
naturels et cre ainsi les lments matriels du dveloppement de cette riche individualit qui est
aussi polyvalente dans sa production que dans sa consommation et dont le travail, par
consquent, n'apparat plus non plus comme travail, mais comme plein dveloppement de
l'activit elle-mme, o la ncessit naturelle a disparu sous sa forme immdiate; parce qu'un
besoin produit par l'histoire est venu remplacer le besoin naturel" (Manuscrits de 1857-1858, 1. l,
pp. 263-264; Grundr., pp. 230-231.) Cette page ne parle pas explicitement d'un rgne de la
libert.., mais c'est bien de lui qu'il est question, comme dj dans L'idologie allemande (cf. ci-
dessus, p. 461).
43. Manifeste, pp. 72-73; MEW 4, p. 476. - Cette formule significative s'explique si l'on a
prsent l'esprit la phrase qui prcde: Dans la socit bourgeoise, le travail vivant n'est qu'un
moyen d'accrotre le travail accumul. Dans la socit communiste, le travail accumul n'est
qu'un moyen d'largir, d'enrichir et de faire progresser l'existence des travailleurs."
44. Manuscrits de 1857-1858, t. II, p. 199; Grundr., p. 599.
45. Ibid., p. 200; p. 599.
46. Ibid., p. 199; p. 599.
47. La traduction du passage du Capital o Marx dfinit le rgne de la libert contient un
contresens caractris: elle parle d'opportunit impose de l'extrieur.. alors qu'il s'agit du
travail dtermin par une ncessit et une finalit externe.. (cf. ci-dessus, p. 529). - D'aprs le
contexte, il s'agit videmment, de la finalit impose par le mode de production capitaliste, ou par
un autre mode d'exploitation du travail, en particulier le systme esclavagiste, galement nomm
et pris en exemple dans la mme page (Le capital, t. 8, p. 198; MEW25, p. 828.)
48. Cf. ARISTOTE,Mtaphysique, L. 12, ch. 10,1075 a 18-22 (trad. Tricot, p. 707). Marx relve
prcisment ce passage dans ses Cahiers prparatoires sa Thse: Aristote [...] dans la
Mtaphysique enseigne que chez les hommes libres la ncessit domine plus que chez les esclaves,>
LA POSSIBILIT RELLE 485
(MEW EBI, p. lOI, et MEGA IV/l, p. 54, I. 8-9. - M. Ponnier ne le signale pas (cf. Diffrence,
p. 146, n. 34). Par contre, M. Rubelle fait (uvres, t. III, p. 827, n. a.)
49. Cette ide domine toute l'analyse du travail alin dans le premier des Manuscrits de
1844: L'animal est dans une unit immdiate avec son activit vitale. Il ne s'en diffrencie pas.
Il est cette activit. L'homme fait de son activit vitale elle-mme l'objet de sa volont et de sa
conscience. Il a une activit vitale consciente. [...] C'est pour cela seulement que son activit est
une activit libre. Le travail alin renverse le rapport de telle faon que l'homme, du fait qu'il est
un tre conscient, ne fait prcisment de son activit vitale, de son essence qu'un moyen de son
existence [... L'animal] ne produit que sous l'emprise du besoin physique immdiat, tandis que
l'homme produit mme libr du besoin physique et ne produit vraiment que lorsqu'il en est
libr (Manuscrits de 1844, p. 63-64; MEWEB I, pp. 516-517.
-
Trad. modifie.)
50. Le capital, t. 8, p. 199; MEW 25, p. 828.
51. Critique des programmes de Gotha et d'Erfurt, p. 32; MEW 19, p. 21.
52. Karl Marx, op. cit., p. 243, n. 20 (trad. par nous).
-
Dans cette note, M. Wood s'oppose
la thse de Plamenatz selon laquelle, dans L'idologie allemande, Marx niait toute distinction
entre travail et loisir, mais l'aurait sagement rintroduite ultrieurement. La formule selon
laquelle le travail devient le premier besoin, ainsi que les autres textes,que nous allons citer,
donnent raison M. Wood.
53. Cit par Marx (Manuscrits de 1857-1858, t. II, p. 101; Grundr., p. 504.) Cf. A. SMITH,
Recherches..., T. I, pp. 64-66.
54. Ibid., p. 101; pp. 504-505.
55. Ibid., p. 101; p. 505.
56. Ibid., p. 102; p. 505.
57. Ibid., p. 199; p. 599. Nanmoins, ajoute Marx, le grand mrite [de Fourier] est d'avoir
nonc comme objectif ultime, non pas l'abolition du mode de distribution, mais celle du mode de
production lui-mme et son dpassement en une forme suprieure (ibid., pp. 199-200; p. 599).
58. Ibid., pp. 193-194; p. 593.
59. Ibid., p. 102; p. 50S.
60. Cette expression, Marx la tire d'un crit anonyme: The source and remedy of the national
difficulties, deduced from principles of political economy, in a letter to Lord John Russell [Source et
remde aux difficults nationales, dduits des principes de l'conomie politique, dans une lettre
Lord John Russell] (cf. Ibid., p. 194; p. 594).
- Voici le passage relev par Marx: Une nation
est vritablement riche si, au lieu de 12 heures, on n'en travaille que 6. La richesse n'est pas le
commandement exerc sur du temps de surtravail" (richesse relle), mais le temps disponible, en
plus du temps ncessit dans la production immdiate, pour chaque individu et la socit entire .
L'auteur de cet crit appartient l'cole des ricardiens socialistes. On voit quelles sources ont
fcond le marxisme, et combien Marx avait parfois peu de choses ajouter.
61. Critique des programmes de Gotha et d'Erfurt, p. 32; MEW 19, p. 21.
62. Force et fragilit de l'ide de libert chez Marx, in Droit et libert selon Marx, sous la dir.
de M. Plant y-Bonjour, Paris, Presses Universitaires de France, 1986, p. 125.
63. Cit par K. POPPER(La socit ouverte..., t. 2, p. 170).
-
Toynbee poursuit: Malgr cela,
les traits distinctifs de l'apocalypse juive traditionnelle apparaissent derrire le dguisement
transparent, et c'est en fait le judasme prrabbinique que notre philosophe impresario prsente en
accoutrement occidental [...] (ibid.). Ces propos sont discuts par Karl Popper qui dnonce leur
exagration (ibid., pp. 170-173).
64. Op. cit., p. 137.
65. La pense de Karl Marx, p. 585. (Cf. supra p. 41, citation rfrence note 16).
66. Nous ne pouvons entrer dans le dtail de l'histoire complexe et souvent tudie, de
l'volution de la pense du jeune Marx et des multiples influences qu'il a sllbies. Nous n'en
retiendrons que ce qui concerne la philosophie de la libert dans son rapport Epicure.
67. Cf. Roger GARAUDY,Karl Marx, Paris, Seghers, rd. 1969, p. 39 (ide dveloppe sur
plusieurs pages); L. ALTHUSSER, Pour Marx, op. ci!.,)'. 27.
68. La gense du socialisme scientifique, Paris, Ed. sociales, 1967, p. 66.
-
Le mme auteur
dit que l'activit de journaliste de Marx, en 1842, va le conduire abandonner son idalisme
philosophique (ibid., p. 74), mais qu'il y faudra du temps: Marx est encore ici tout fait
idaliste (ibid., p. 79); cette affirmation nous parat exagre. M. BottigelIi dit aussi qu'en 1843,
dans sa Critique du droit politique hglien, Marx reste encore un idaliste par sa conception
mme de l'tat'" mais que dj sont donns dans sa pense des lments du dpassement de
l'idalisme (ibid., p. 82). Des formules aussi faibles ou vagues figurent chez Auguste Cornu (op.
486 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
cit., passim). S'agit-il d'un idalisme objectif ou d'un idalisme subjectif? Ces auteurs ne le disent
pas.
69. Diffrence, p. 206; MEWEB l, p. 260.
70. Ibid., note 2. - Cette note donne le texte d'une premire rdaction.
71. Force et fragilit de l'ide de libert chez Marx, op. cit., p. 144.
72. Correspondance, t. l, p. 35; MEW EB I, p. 8.
-
Il exprimait clairement son dsespoir d'y
parvenir: l'exaspration d'avoir faire mon idole d'une conception que je dtestais [...] me rendit
malade" (ibid., p. 37; p. 10).
- La manire dont il mentionne Kant et Fichte laisse penser qu'il
s'agit d'une concession son pre qui prisait Voltaire, Rousseau et la philosophie claire du
XVIII"sicle en gnral.
73. Bruno Bauer prendra de plus en plus parti pour une philosophie de la conscience de
soi
",
marquant un net retour de Hegel Fichte.
-
Le Doktorklub tait un cercle d'universitaires
et de jeunes crivains hgliens, constitu autour des frres Bruno et Edgar Bauer et de Friedrich
Koppen. Marx y participa activement lorsqu'il devint tudiant Berlin en octobre 1836.
74. C'est le premier ouvrage thorique de Marx qui nous soit parvenu, contrairement
l'affirmation de M. Henry (Karl Marx, t. I, p. 35) qui fait jouer ce rle la Critique du droit
politique hglien de 1843, qu'il qualifie de premier grand travail thorique de Marx,,!
75. Propos d'picure, d'aprs Snque, Lettre XII (cit par Marx in DiffJrence, p. 229; MEW
EB l, p. 274; MEGA Ill, p. 65, n. 40). Cf. PICURE,Doctrines et maximes, p. 97, trad. Maurice
Solovine,
2"
d., Paris, Hermann, 1938, p. 97, Parole
n
9.
76. Id., ibid.
77. Id., ibid.
78. Cf. Michel VADE,Une diffrence entre Hegel et Marx: le cas d'picure
",
communica-
tion paratre dans les Actes du XXIII" Congrs de l'Association des Socits de Philosophie de
Langue Franaise de Tunis-Hammamet sur Critique et Diffrence (2-4 sept. 1990). Nous y
examinons pour elles-mmes les interprtations de l'picurisme par Hegel et par le jeune Marx, en
les comparant.
79. Diffrence, p. 283; MEW EB I, p. 305; MEGA, 1. Ill, p. 57, I. 35.
-
Marx crit de mme,
en 1845-1846: Quant picure, il fut [...], dans l'antiquit le seul adepte radical des Lumires:
il attaque ouvertement la religion antique" [L'idologie (1968) p. 164; (1976) p. 130; MEW 3,
p. 125].
-
Marx connaissait certainement la remarque de Hegel sur la philosophie d'picure: sa
physique est clbre pour avoir banni ces superstitions qui sont l'astrologie, la crainte des dieux:
elle a inaugur le succs des lumires, en ce qui concerne le domaine physique" (Leons sur
l'histoire de la philosophie, 1. IV, p. 716).
79bis. ESCHYLE,Promthe enchan, v. 966. (Note de Marx.)
80. Diffrence, p. 209; MEW EB I, p. 262 (Avant-Propos, dat de mars 1841).
~1. Hegel lui-mme n'avait pas aperu cette diffrence fondamentale. En effet, Hegel ne croit
pas Epicure quand celui-ci assurait qu'il tait autodidacte,,: Cela ne signifie pas qu'il n'a pas
appris des autres philosophes et qu'il n'a pas tudi les crits des autres. Il ne faut pas entendre
non plus par l qu'il a t tout fait original dans sa philosophie, quant son contenu; car,
comme on l'observera par la suite, sa philosophie physique en particulier est celle de Leucippe et
de Dmocrite" (Leons sur l'histoire de la philosophie, t. 4, trad. Garniron, p. 688). Plus loin, Hegel
dit de sa mtaphysique
",
que ce sont des mots creux (ibid., pp. 707-718)! En particulier, il insiste
sur le fait qu'picure procdait dj comme notre moderne science procde encore,,: ce sont les
mmes principes empiriques, des analogies sensibles, etc. Quelle diffrence quand on ouvre la
Thse du jeune Marx qui trouve, au contraire, le plus haut intrt la philosophie de la nature
picurienne pour l'originalit et la signification philosophique profonde de son principe. Notons
que Marx n'estime pas du tout que l'explication empirique picurienne des phnomnes soit
encore celle de notre science moderne: car, dit-il, picure procde avec une nonchalance sans
borne dans l'explication des phnomnes physiques,,! (Diffrence, p. 232; MEW EB l, p. 276),
chose que Marx ne dit jamais de la science des Modernes.
82. Malgr les diffrences qui sparent la Grce d'aprs Alexandre le Grand et l'Allemagne
du XIX"sicle, le mme affrontement doctrinal entre ncessit naturelle et libert humaine tait au
cur des grands dbats de la philosophie classique allemande: il se prolonge chez Marx.
83. Nous n'entrerons pas dans tous ses dveloppements ici; nous}mporte seulement ce qu'il
dit en particulier de la possibilit et de la ncessit chez Dmocrite et Epicure.
84. Il existe peu de travaux spcialiss sur la Thse de Marx, qui a souffert encore plus que
la plupart de ses autres uvres de n'avoir pu tre publie de son vivant. On n'en possde d'ailleurs
qu'une copie incomplte, prpare en vue d'une dition que le jeune Marx esprait rapide. La
difficult d'accs aux ditions critiques (Premire et deuxime MEGA), le fait que, pendant
LA POSSIBILIT RELLE 487
longtemps, il n'y a pas eu de traduction franaise fiable, et bien d'autres causes idologiques et
partisanes, ont conduit minimiser l'intrt qu'elle prsente pour comprendre la pense
marxienne ultrieure. M. Calvez en fait peine mention: au premier abord, il n'en donne mme
pas le titre (cf. La pense de Karl Marx, p. 24)! Il ne dit rien du rapport de Marx picure; il ne
signale que les dclarations d'athisme du jeune Marx, tirant deux citations de la Dissertation
cette occasion (ibid., pp. 56-57). M. Bottigelli en dit davantage bien que sa prsentation soit trs
rapide, son ide la plus intressante tant que Marx tentait dj de dpasser l'hg~lianisme (op.
cit., pp. 66-70).
-
Par contre, M. Jacques PaNNIER (in Marx, Diffrence, Introduction, pp. 9-103,
et Complments sur Hegel, Marx et l'picurisme, pp. 291-364) donne un commentaire dtaill,
quoique dpass sur quelques points dans la mesure o il s'appuie sur un chapitre de La sainte
famille, M. Olivier BLOCH(cf. Marx, Renouvier et l'histoire du matrialisme, La Pense,
n
191,
fvr. 1977, pp. 3-42) ayant dcouvert que Marx emprunte largement la substance de son chapitre
d'histoire du matrialisme moderne un livre de Charles Renouvier sur le destin du cartsianisme.
- Ce que dit Franz Mehring n'est pas toujours trs exact, ainsi lorsqu'il assure que Marx fait
d'picure le fondateur de la science atomiste (op. cit., trad. J. Mortier, p. 53; trad. G. Bloch,
p. 174), ce qui conviendrait bien mieux Leucippe et Dmocrite, ~)Umme Lucrce; - Quant
au travail de Mme Francine MARKOVITS(Marx dans le Jardin d'Epicure, Paris, Les Editions de
Minuit, 1974), il part d'hypothses hermneutiques singulires. - Pour des tudes historiographi-
ques et philosophiques plus compltes, il n'existe gure que l'examen critiql!e document de
M. Jean-Marx GABAUDE(Le jeune Marx et le matrialisme antique, Toulouse, Ed. Privat, 1970),
ou des ouvrages trangers non traduits: R. SANNWALD(Marx und die Antike, dj mention),
Johannes MATHWITCH,Karl Marx, Schriften zur epickureischen, stoschen u. skeptischen Philoso-
phie, Hist.-Krit. Ausgabe, Berlin, Dissert. doctorale dactylographie), et des articles, par ex. Ernst
BLOCH(<<Epikurund Karl Marx oder ein subjektiv Faktor im Fall der Atome, Uber Karl Marx,
Frankfurt am Main, Suhkamp, 4e d., 1973; trad. angl.: On Karl Marx, New York, Herder and
Herder, 1971). Signalons encore que le grand historien de l'atomisme grec, Cyril Bailey avait port
sur la Thse de Marx, lors de sa publication dans la premire MEGA, un jugement exemplaire
dans la concision d'une note critique de deux pages (cf. supra, p. 337, n. 112).
85. M. Pannier le fait bien ressortir (op. cit., pp. 42-54), ainsi que M. Gabaude (op. cit., pp. 68
et suiv.).
86. Op. cit., trad. J. Mortier, p. 174; trad. G. Bloch, p. 53.
87. Diffrence, p. 284; uvres (d. Rubel), t. III, p. 64; MEWEB l, p. 305. - Nous suivons
la traduction de M. Pannier, qui diffre peu de celle, plus ancienne, de Molitor (d. Costes), ou
de celle, plus rcente et plus lgante, de M. Rube!. Nous l'avons prfre cette dernire qui
respecte moins la terminologie hglienne si caractristique de Marx dans ce travail de jeunesse.
Aucune dition franaise ne donne le texte original (grec ou latin) des nombreuses citations des
Anciens faites par Marx. L'dition Anthropos des uvres philosophiques, qui reprend l'ancienne
dition Costes, ne donne mme pas les rfrences, que l'on trouve par contre chez M. Ponnier, non
sans ngligences! Sur ce point, on lui prfrera l'dition de M. Rubel o les rfrences et les
citations traduites sont au contraires trs soignes. Tout travail srieux qui voudrait examiner
dans le dtail l'interprtation marxienne des philosophes anciens doit recourir au texte original de
ces citations que Marx faisait, lui, en grec et latin. L'dition de M. Rubel donne le texte franais
des citations marxiennes. Les Marx-Engels Werke les procurent seulement depuis 1973, mais la
premire MEGA les auvait publies ds 1927.
88. Ibid., pp. 225-228; pp. 26-28: pp. 272-274.
-
L'on sait que Marx ne mprisa jamais les
sciences de la nature et le savoir empirique en gnra!. Il faut en juger d'aprs ses travaux
conomiques et historiques.
89. Cette analyse jette une vive lumire sur certains des points les plus obscurs de la
philosophie de la nature d'picure qui intriguaient dj tellement dans l'antiquit, ou paraissaient
tre des expdients ou des extravagances.
90. Op. cit. trad. J. Mortier, p. 174; trad. G. Bloch, p. 53. - Cette observation est trs
remarquable.
91. Ibid.
92. L'idologie (1968) p. 31; (1976) p. 1; d. bi!., pp. 24-25; MEW 3, p. 5. - Marx ne pensait
sans doute plus alors picure, mais plutt aux modernes, aux matrialistes franais du XVIIIe
sicle et Feuerbach.
93. Nous ne cherchons pas savoir si cette interprtation est historiquement soutenable.
M. Gabaude le conteste; Cyril Bailey est un peu moins catgorique.
94. On n'en concluait pas avant Marx, ou mme aprs lui, qu'picure rompait compltement
488 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
avec Dmocrite. - On nous permettra de citer largement, afin de faire ressortir la position de
Marx, ds l'poque de sa Thse, sur l'opposition entre ncessit et hasard.
95. Diffrence, p. 230; uvres (d. Rubel), t. III, p. 30; MEW EB I, p. 275.
96. Ibid., p. 228; p. 28; p. 274. - Marx cite une srie de sources attestant que cette thse est
centrale chez Dmocrite: Aristote dit de lui [Dmocrite] qu'il ramne tout la ncessit.
Diogne Larce rapporte que le tourbillon des atomes, d'o toute chose nat, est la ncessit de
Dmocrite. Des explications plus satisfaisantes nous sont fournies sur ce point par [le Pseudo-
Plutarque]: la ncessit serait pour Dmocrite le destin et le droit, la providence et la cratrice du
monde. Mais la substance de cette ncessit serait l'antitypie, le mouvement, l'impulsion de la
matire. [... Chez] Stobe, se trouve conserve la sentence suivante de Dmocrite [...]: les hommes
se sont imagin le fantme du hasard
-
une manifestation de leur propre embarras; car une
pense forte doit tre l'ennemie du hasard. De mme Simplicus rapporte Dmocrite un passage
o Aristote parle de la vieille doctrine qui supprime le hasard" (ibid.)
- Antitypie" est un vieux
mot signifiant" rsistance
",
au sens de qui repousse" comme l'enclume fait rebondir le marteau.
97. Ibid., p. 229; p. 29; pp. 274-275.
-
Marx signale galement un texte de Cicron o
l'picurien Velleius dit la mme chose [...] au sujet de la philosophie stocienne: Que doit-on
penser d'une philosophie, pour laquelle, comme pour les vieilles commres ignorantes, tout
semble se produire par le fatum?... Epicure nous a dlivr, et nous a install dans la libert." *..
98. Ibid., pp. 231-232; pp. 30-31; p. 276. Trad. modifie. - Curieusement, Marx recourt ici
une opposition entre entendement et imagination qui fait penser la doctrine kantienne des
facults (libert de l'imagination et limitations qu'imposent les conditions de l'entendement), alors
que, partout ailleurs dans la Thse, les catgories utilises sont celles de la Science de la logique et
de la Phnomnologie de l'esprit. Bien qu'il ne relve pas le caractre kantien de cette opposition,
M. GABAUDE(op. cit., p. 67, n. 114) signale nanmoins que Kant avait demand de "ne pas
conclure [...] de la possibilit logique des concepts la possibilit relle des choses"" (Cf. KANT,
Critique de la raison pure, Paris, Presses Universitaires de France, 1950, p. 428, n.).
99. C'est le lieu de rappeler que Marx, quelques annes aprs sa Thse, verra la mme
unilatralit et la mme abstraction dans la conscience de soi.. de Bruno Bauer, ou dans
L'unique.. de Stiner (cf. Michel VADE, La critique de l'abstraction par Marx, in La logique de
Marx, op. cit., pp. 61-89). A force d'individualisme, estime Marx, Bruno Bauer et Stirner sont
devenus des idalistes abstraits.
100. Diffrence, p. 231; (d. Rubel), t. III, p. 30; MEW EB I, pp. 275-276. - Selon Marx,
c'est le vritable point de vue de Dmocrite attest par les Anciens: En voici quelques exemples
tirs de Simplicius. Qu'un homme soit altr, qu'il boive et retrouve la sant, ce n'est pas le hasard
que Dmocrite donnera comme cause, mais la soif. Mme si, en effet, il a sembl, propos de la
cration du monde, faire intervenir le hasard, il affirme cependant que dans les cas particuliers
celui-ci n'est la cause de rien, mais il renvoie d'autres causes. Ainsi, par exemple, la cause de la
dcouverte d'un trsor est le fait de creuser le sol ou de planter un olivier
**"
(ibid., trad.
modifie, et note restitue selon MEW (ibid.) et MEGA III, p. 30).
101. Ibid. - Le jeune Marx qualifie cet aphorisme de Dmocrite de naf", sans doute parce
qu'il juge que cela marquait un dsintrt pour l'action, et qu'ainsi Dmocrite diffrait des
penseurs" intensifs" (Aristote, Spinoza, Hegel) que lui, Marx, prisait particulirement et qui
tablissaient un lien troit entre la pense (la philosophie) et l'action (la politique et la vie sociale).
102. Marx prsentait sa Thse devant une facult de philosophie dont on sait qu'elle tait
plus kantienne qu'hglienne :il
y
a donc sans doute de sa part quelque tactique dans la conclusion
de la Dissertation. ,
103. L'idologie (1968) p. 57; (1976) p. 26; (bi!.) pp. 88-89; MEW 3, p. 45.
104. L'ancienne et la nouvelle mtaphysique, D'Aristote Marx, Paris, Rivire, 1935, pp. 263-
264, n. 8.
105. Diffrence, p. 235; uvres, (d. Rube!), t. III, p. 85; MEW EB l, p. 329.
-
Cet
aphorisme figure dans un fragment, plac par les diteurs dans les notes du chapitre IV
(manquant) de la premire partie de la Thse de Marx.
-
Il faut prciser, en replaant cette parole
dans son contexte, que <<la"philosophie dont il est question ici, c'est le systme hglien tel qu'il
se prsente face la "ralit" allemande de 1841. Cela ne veut pas dire que toute pense et toute
philosophie" ait fini son usage.
*
SNQUE, Epist., XII, p. 42. (Note de Marx.)
**
SIMPLICIUS, in Scol. ad Arist. (coll. Brandis), p. 488.
CONCLUSION
Je suis all au communisme
comme on va la fontaine.
Pablo PICASSO
1. Les trois moments de la pense de Marx
Devant l'uvre de Marx, tant thorique que pratique, et son destin
mouvement, devant son interprtation controverse, l'on s'interroge: A
quoi tient l'intrt pour le marxisme? [...]Comment entendre, dans la diversit
mme de ses produits, l'exceptionnelle fcondit de la pense issue de Marx et,
dans le bruit et la fureur, de l'adhsion enthousiaste au dni passionn, sa
vivace vitalit? Et les pralables: un ou des marxismes pousss sur ce fertile
terreau? Ressortissant quel statut, celui de la science, celui de la philosophie,
celui de l'idologie, ou de plusieurs la fois, moins que ne soient, par cet
avnement, repousses et dnonces comme son en de les divisions du savoir
elles-mmes qui s'offriraient la cerner? La considration de l'histoire ne se
donne-t-elle pas, ici plus qu'ailleurs encore, pour le premier pralable I?
A ce type de question, Lnine avait propos une rponse qui prenait en
compte la gense historique de la pense de Marx: il parlait des trois sources
et [des] trois parties constitutives du marxisme2.
D'une manire diffrente, nous dirions que la pense de Marx tire sa force
du fait qu'elle instaure en permanence une unit entre sa dimension scientifi-
que, son orientation pratique, et son sens philosophique. C'est l)un des rsultats
auxquels nous a conduit notre enqute. Il y a l comme trois axes auxquels il
faut rfrer chaque proposition marxienne. Ce sont trois moments (au sens
hglien du terme), toujours troitement lis.
Plus qu'on ne l'avait jamais fait avant lui, Marx a donn l'histoire et aux
disciplines sociales une dimension scientifique en les fondant sur une
analyse critique de l'conomie politique ainsi que sur des sciences annexes,
toutes considres historiquement. Il a infatigablement poursuivi ses
recherches empiriques et s'est efforc de rsoudre les questions thoriques de
490 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
l'conomie politique, se concentrant presque exclusivement sur le mode de
production capitaliste et la socit civile-bourgeoise, sur leur naissance, leur
dveloppement et leur volution prvisible.
Les analyses conomiques de Marx donnent sa conception de l'histoire
sa dimension et sa teneur scientifiques. C'est seulement dans cette mesure que
l'on peut parler de l'histoire comme science. Son ide la plus dcisive est sans
doute la distinction entre ce qui est d'ores et dj prim et ce qui est acquis
et doit se dvelopper; ce qui est destin disparatre, ce sont les rapports
sociaux actuels entre classes bourgeoises dominantes et possdantes et classes
ouvrires domines et exploites; ce qui doit subsister et crotre, ce sont les
forces productives matrielles et spirituelles (science).
Rtrospectivement, la connaissance scientifique du mode de production
capitaliste dominant permet d'clairer la gense historique du capital et toute
l'histoire de l'poque moderne et de l'poque contemporaine. Pour remplir ce
programme de connaissance historique empirique et d'explication thorique,
Marx a clairement compris la ncessit d'tendre ses recherches aux sciences
auxiliaires de l'conomie politique: statistiques, technologie, agronomie, et
sciences naturelles en gnral. Selon une ide de jeunesse qu'il poursuivit dans
l'ge mr, il chercha toujours les liens rciproques qui unissent les sciences
socio-historiques aux sciences de la nature3. Voil pour la dimension scienti-
fique du marxisme, que bien peu de marxistes ont su ou pu conserver en
gardant cette ouverture d'esprit encyclopdique de Marx, et en prolongeant
son effort.
Contrairement la manire ordinaire de comprendre la science, cela ne le
conduisit pas une conception purement positiviste ou scientiste de l'histoire,
mais plutt une conception causaliste singulire qui prsente partout l'ide
que les hommes sont, collectivement, les agents principaux de l'histoire, et
qu'ils prennent une part grandissante dans le processus historique: celui-ci
devient peu peu conscient et volontaire.
Dcouvrir des lois et des causes matrielles la base du processus
historique ne mena nullement Marx la conclusion qu'il y aurait des lois
conomiques ternelles (sauf quelques lois trs gnrales), ou quelque loi
transcendantale de l'histoire. Les lois qui rgissent le mode de production
capitaliste comme celles qui rgissaient les modes de production antrieurs
sont transitoires: elles reposent sur des rapports de classe et un degr de
dveloppement dtermin des forces productives matrielles, et l'on ne peut
rien dire des futures forces productives.
Marx ne soutint pas non plus que l'histoire se raliserait toujours malgr
ses protagonistes, classes et individus sociaux, et contre leur volont. Pour lui,
les hommes sont en train de prendre conscience du processus historique et
doivent le faire toujours plus. Dans cette mesure, ils peuvent hter la solution
des conflits ds lors qu'ils en comprennent de mieux en mieux les vrais ressorts
dans le pass et dans le prsent.
Parce que l'action est relle et rellement la base de l'histoire, l'action
CONCLUSION
491
historique est une possibilit relle pour les agents historiques que nous
sommes dj de par notre existence et notre tre mme.
Ici se manifeste la seconde composante essentielle de la pense de Marx,
son deuxime axe, son orientation pratique. La philosophie de Marx est la
fois une pense de l'activit et une doctrine de l'action. Ayant inlassablement
dnonc les incohrences qu'il dcouvrait chez les autres, il fait preuve de
beaucoup de consquence. L'histoire rsultant de l'activit des hommes et de
la lutte des classes sociales, son secret le plus profond se rvle en analysant les
activits essentielles qui conditionnent les classes elles-mmes, en premier lieu,
la plus fondamentale de toutes, l'activit de production matrielle qui a t
jusqu'ici une ncessit contraignante et qui restera toujours la base de
l'existence humaine.
A travers cette activit matrielle et individuelle consciente, certains
rapports sociaux se sont imposs aux hommes, car nos rapports avec la
socit ont commenc, dans une certaine mesure, avant que nous puissions les
dterminer4, crivait dj le lycen de 17 ans que Marx tait en 1835.
Mais l'action historique collective devient graduellement consciente,
s'enrichit de la comprhension thorique des modes de production et de leurs
limites. La science dvoile la vrit derrire les apparences; elle perce le
mystre des alinations qui paraissent fondes dans la nature soi-disant
ternelle des choses; elle dcouvre la source de l'exploitation de l'homme par
l'homme. L'action collective volontaire et consciente devient possible et
ncessaire, lorsque l'ensemble du mouvement historique pass devient lui-
mme enfin l'objet d'une comprhension rationnelle. Marx a toujours pens,
comme Hegel, que l'histoire n'est pas aussi irrationnelle qu'elle le paratS. La
doctrine de Marx est donc aussi une doctrine rationnelle de l'action: analysant
les classes sociales et leurs luttes, elle montre la possibilit et la ncessit de la
constitution de la classe ouvrire en parti politique qui doit tendre la
dmocratie6, et dont l'action rvolutionnaire a pour but d'abolir les diff-
rences de classes en dveloppant les forces productives et de raliser le socia-
lisme. Le marxisme a donc une orientation pratique, conomique et politique
la fois, qui lui est tout aussi essentielle que sa dimension scientifique.
Les rvolutions franaises, depuis la grande rvolution de 1789 jusqu' la
Commune de Paris, sont, pour Marx, des tapes successives dans la constitu-
tion du proltariat en parti politique et en force vivante de l'avenir. Elles
indiquent ce que pourrait tre un gouvernement de la socit par la classe
ouvrire, car elles ont rvl cette classe elle-mme travers sa lutte contre
la bourgeoisie, ou avec elle contre la noblesse. Les rvolutions bourgeoises ont
permis les tentatives du proltariat ouvrier urbain de se librer politiquement
de la bourgeoisie et conomiquement de l'exploitation du travail salari. En ce
sens, elles ont montr l'avenir possible.
Marx ne songeait pas faire prvaloir la connaissance sur l'action ou
l'action sur la connaissance. Il tait intimement persuad que l'action politique
de la classe ouvrire ne pouvait russir que si elle se fondait sur une
492 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
connaissance adquate de la situation et des possibilits objectives, et,
inversement, que la connaissance ne pouvait atteindre une pleine vrit
historique qu'en tudiant les derniers dveloppements de la pratique politique
et les capacits et potentialits conomiques inhrentes aux progrs techniques
et aux bouleversements sociaux les plus rcents.
Le but des efforts de Marx fut de faire concider la conscience de la classe
ouvrire (sa connaissance scientifique de l'histoire), et sa pratique des luttes
conomiques et sociales concrtes. Ainsi seulement, cette classe pourrait
raliser la prochaine tape historique du dveloppement de l'humanit, qu'elle
est seule est en mesure d'assumer, vu son rle conomique. Du moins, c'est
ainsi que Marx voyait les choses: qu'il ait eu raison ou non est une autre
affaire. L'activisme ou le pragmatisme ne l'emportaient pas chez lui sur la
ncessit de parvenir une connaissance objective rationnelle.-
L'unit de la dimension scientifique et de l'orientation pratique du
marxisme s'effectue au sein d'une conception gnrale. Le marxisme a un sens
philosophique; il est une philosophie: un humanisme , parce que l'homme
- c'est--dire chaque individu singulier - est le but et la fin en soi, la fin
dernire [Endzweck]. Marx comprend l'histoire comme ayant un sens
humain , cette fin ultime tant le libre dveloppement des facults et
potentialits de chacun des individus sociaux que nous sommes. Ainsi, le
matrialisme pratique n'empche pas que la pense de Marx ne soit une
pense de la possibilit, parce qu'elle est essentiellement une philosophie de la
libration et de la libert.
Continuellement a surgi devant nous le paradoxe d'une pense de la
ncessit qui est en mme temps un pense de la libert, paradoxe apparent qui
se dissipe ds que l'on admet avec Marx que le devenir historique rsulte de
l'activit de transformation pratique par les hommes des conditions matrielles
et sociales de leur existence, c'est--dire d'un processus de dveloppement o
les contradictions se rsolvent dialectiquement: l'histoire procde selon des
phases, des tapes que ponctuent des renversements rvolutionnaires.
Ainsi la catgorie de possibilit est l o il est question de devenir et de
dveloppement, d'activit et d'action, de ralisation et d'accomplissement.
Elle affleure donc partout.
2. L'homme en tant qu'tre des possibles
De quel possible s'agit-il finalement chez Marx? Il nous est apparu que
les concepts qui sont la base de la critique marxienne de l'conomie
politique, que ceux qui sont constitutifs du matrialisme historique , que
ceux qui, enfin, dfinissent le matrialisme pratique de Marx en tant que
philosophie de l'activit libre, contiennent tous quelque degr l'ide du
possible, parfois de faon minente.
Bergson dnona dans le possible la fois un mirage et un fantme, c'est-
CONCLUSION
493
-dire la fois une perception fausse et un produit de l'imagination: Le
possible est [...]le mirage du prsent dans le pass; [...] le possible aurait t
l de tout temps, fantme qui attend son heure. 7 Il concluait: Il faut en
prendre son parti; c'est le rel qui se fait possible, et non pas le possible qui
devient rel8.
Marx aurait-il acquiesc cette conclusion et aux arguments avancs par
le spiritualiste franais pour l'tayer? Beaucoup de possibles imagins et rvs
par la conscience commune ou par les idologues et les utopistes ne sont pour
Marx aussi que mirages et fantmes: n'a-t-il pas lutt contre les idalisa-
tions et les fantasmagories de la conscience? Il n'en reste pas moins que,
avant Bergson et l'inverse de lui, il tint certains possibles pour des possibles
rels .
Quant la conclusion de Bergson, il faudrait la moq.ifier passablement
pour l'adapter l'esprit du marxisme. Pour autant que nous puissions le faire
parler, Marx aurait plutt dit ceci: Il faut prendre parti; c'est nous qui,
historiquement, faisons devenir rel ce qui est possible; les causes qui font que
"le rel se fait possible", c'est le travailleur et la nature.
Les hommes ne font-ils pas l'histoire en dveloppant et transformant
leurs rapports la nature? L'histoire est l'auto-dveloppement et l'auto-
cration de l'homme en tant qu'tre naturel sur la base de la nature. Le rel est
ralisation, et l'histoire ralisation de toutes les capacits et virtualits que
reclent les hommes en eux, ralisation qui se fait toujours en liaison avec
quelque possibilit naturelle sous-jacente.
Les possibles dont parle Marx ont la signification de puissances au sens
aristotlicien du terme. En ce sens, le possible est un rel, mais on ne saurait
dire qu' il attende son heure! En ralit, il tend sa propre ralisation. Ce
concept de tendance est absent de l'analyse bergsonienne des rapports du rel
et du possible. Pour Marx, ces tendances sont spcifies; ce sont des besoins
historiques et sociaux qui poussent ncessairement les hommes l'action.
Contrairement Marx, Bergson n'a rien d'un rvolutionnaire.
Aussi, pour Marx, les possibles en tant que possibles rels, effectifs, sont-
ils des pouvoirs , des capacits, non de pures virtualits. Ils consistent
dans cette forme de ralit qui est prsente dans les forces et qui donne lieu
un dveloppement. Ces forces sont les causes motrices de l'histoire comme il
y a des forces motrices dans la nature et des forces en acte derrire les
phnomnes naturels.
Mais nous avons dcouvert davantage. Diverses formes de possibilit se
laissent assez bien discerner chez Marx: ce n'est pas tout fait des mmes
sortes de possibilits qu'il s'agit dans la ralit concrte et historique et dans
la thorie. Nous l'avons montr, la catgorie de possibilit se prsente sous de
multiples aspects, depuis les diffrentes formes possibles de socits et d'tats,
jusqu'aux forces productives, en passant par le concours de circonstances et la
contingence (hasard ou fortuit).
Surtout, le possible est pens et affirm dans l'ide d'ouverture de
494 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
l'histoire sur un avenir qui dpend des luttes de classes et de l'action politique.
Omniprsente, et condition d'en bien voir les figures varies, la catgorie de
possibilit tient une place gale celle de ncessit, parce que la pense de
Marx est essentiellement autant une pense du devenir, du changement et de
l'activit que de leurs conditions ncessaires. Dans le devenir historique ou
naturel, le possibie et le ncessaire sont corrlatifs; ils changent leurs rles:
un nouveau mode de production, de nouveaux rapports sociaux, de nouvelles
institutions, deviennent ncessaires ds lors que leur possibilit existe concr-
tement et qu'ils manifestent une supriorit quelconque sur l'ancien.
Selon la conception de l'histoire de Marx, nous sommes soumis des
conditions que nous trouvons l, auxquelles nous devons nous plier, mais ces
conditions servent aussi de base notre action: c'est nous qui faisons notre
histoire partir de conditions hrites. Des lois conomiques s'imposent
nous comme de l'extrieur, parce que nous poursuivons nos buts individuelle-
ment, dans une anarchie sociale plus ou moins complte. Les consquences
involontaires de nos actions volontaires sont devenues des puissances qui nous
dominent et nous oppriment.
Cet tat de choses antdiluvien peut tre modifi et chang collectivement
par les classes socialement exploites, car les causes essentielles dans l'histoire,
finalement, ou bien se trouvent en nous-mmes, ou bien sont des puissances
naturelles dont nous pouvons nous assurer graduellement la matrise. En
analysant ces rapports d'impuissance et de puissance, Marx s'attache
concevoir les conditions de possibilit de la transformation d'une histoire,
jusqu'ici largement subie, en une histoire voulue.
Ainsi compris, le matrialisme historique est aux antipodes d'une doc-
trine du destin ou d'une fatalit trangre auxquels les individus seraient
irrmdiablement et ternellement asservis. Il montre au contraire les voies
d'une libration des alinations et asservissements survenus historiquement et
involontairement. Parmi la diversit des causes qui concourent au dveloppe-
ment historique, l'agent causal qui devient le plus important, c'est l'homme
lui-mme, le travailleur et la classe ouvrire tout entire.
En consquence, parler d'un dterminisme strict et rigoureux propos
des conceptions de Marx est un contresens. Il serait plus judicieux de parler de
causalisme que de dterminisme9. L'ide de dterminisme historique n'ex-
prime qu'un ct de la ralit historique: elle omet l'autre ct, l'activit, et
par suite la libert comme libration. Elle rduit nant le rle de l'homme
dans le processus historique. Est causaliste, par contre, toute doctrine pour
laquelle le principe de causalit a une validit universelle. Pour Marx rien ne
se produit sans cause et la recherche des causes anime sa pense. Mais, de ce
que rien ne soit sans cause, il ne dcoule pas que toutes les causes soient de
mme nature, ni qu'elles soient toutes des causes externes.
Dj dans l'analyse marxienne des concepts de lois et de causes conomi-
ques se profile le champ des possibles. Celui-ci apparat concrtement dans les
concepts de tendance et de dveloppement historiques. La source vritable des
CONCLUSION 495
possibles rels, ce sont les forces productives et les moyens de production
existants. Ces possibles se ralisent par l'activit pratique des hommes,
travers crises et rvolutions.
L'action de l'homme (du travailleur) en tant qu'tre conscient et poursui-
vant des fins immanentes (ses besoins) ne peut tre ramene la causalit des
agents naturels aveugles et sans conscience. L'on vient de rappeler que comme
Aristote, Marx fait trs largement place aux diverses modalit.s de la causalit:
ce qui arrive selon la dcision dlibre d'tre rationnels, ce qui se produit
toujours et ncessairement, ou le plus souvent, ou encore rarement et par
hasard ou fortune; et il fait une grande place aux circonstances. Pas plus qu'on
ne tient Aristote pour dterministe, pas davantage on ne saurait le dire de
Marx, mme si jusqu'ici l'histoire s'est faite plutt aveuglment et sans avoir
t vraiment voulue. .
Comme Hegel, Marx pense les processus socio-historiques l'aide de la
catgorie d'action rciproque: tous les moments d'une totalit exercent
constamment leur action les uns sur les autres.
Toutefois, l'admission de ces divers modes de causalit ne suffirait pas
faire de Marx un penseur du possible. Seules y parviennent vraiment l'ide
d'activit, l'ide de la libration historique des sujtions de classe pr-
existantes, et l'ide de rgne de la libert, rgne rellement car matriellement
possible. Le contenu de cette libert est ouvert sur tous les possibles humains
futurs.
Ici, ce qui distingue Marx des utopistes, c'est qu'il ne dissocie pas ces
possibles de leurs conditions matrielles et actuelles de ralisation, en s'en
tenant au plus prs de l'histoire relle. Dans cette mesure, le marxisme vite la
drive utopique. II met l'activit humaine transformatrice et ses conditions
matrielles et naturelles au centre de sa conception de l'histoire. Cette activit
est un processus dialectique: modifiant ses conditions d'existence, l'homme
modifie du mme coup ses forces, ses facults, ses rapports tant la nature
qu' la socit: il modifie son tre.
C'est pourquoi, pris avec ses liens la nature et aux puissances naturelles
et sociales matrises, l'homme est l'tre des possibles.
3. Socit communiste et individu libre
La pense de Marx - nous avons galement tent d'tablir ce rsultat-
garde quelque chose de son inspiration initiale puise dans l'picurisme
comme philosophie de la libert, entendue comme libration de toute alina-
tion et de toute ncessit son naturelle.
Mais il n'y a pas, pour Marx, d'opposition absolue entre la ncessit et la
possibilit. Si l'on analyse n'importe quelle ncessit historique ou naturelle,
on y trouve la possibilit. Mieux, les ides de possibilit et de ncessit finissent
par se renverser en histoire. II y a un moment o l'une bascule dans l'autre. La
496 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
ncessit change alors de sens. Finalement, la pense de Marx est autant une
philosophie de la libert qu'une philosophie de la ncessit..
Cette libert ne consiste pas seulement dans la connaissance de la
ncessit: certes elle repose sur elle, mais nous l'avons vu, la libert l'emporte
peu peu sur la ncessit elle-mme: elle gagne de plus en plus sur le domaine
de celle-ci qui reste nanmoins sa base.
L'histoire s'ouvrant sur un avenir de liberts et de possibilits de plus en
plus nombreuses et diverses pour tous les individus, il est impossible de rduire
la conception de Marx un ncessitarisme sous quelque forme qu'on la
prenne. La part de ncessit que Marx reconnat dans l'histoire passe est
certes considrable; cependant, cette ncessit est graduellement englobe
dans l'activit humaine mesure que celle-ci tend son champ d'action et sa
matrise sur les lments extrieurs. L'activit de l'homme, s'appuyant sur la
ncessit naturelle, la tourne son avantage et la soumet ses fins.
Il semblerait que la ncessit se scinde, d'une part, en ncessit naturelle,
d'autre part, en ncessit sociale. En fait, celle-ci est lie celle-l, dans la
mesure o la ncessit sociale, c'est--dire la contrainte des rapports sociaux
existants, correspond au degr de matrise de la nature et en rsulte. Ainsi, les
contraintes qui s'imposent aux hommes viennent et de la nature et des formes
sociales hrites et tablies.
L'on ne s'affranchit pas proprement parler de la ncessit naturelle:
l'homme peut seulement la matriser; c'est l'enjeu de l'activit matrielle
pratique (techniques). Marx pensait que cette matrise devenait telle de son
temps qu'elle permettait d'ores et dj l'abolition de l'exploitation du travail
et l'amorce d'une socit sans classes, c'est--dire du rgne de la libert.
S'affranchir des contraintes sociales qui tiennent aux rapports sociaux, tel
est l'enjeu de l'action politique et de la lutte des classes qui dpendent aussi du
dveloppement des possibilits objectives. D'o l'importance primordiale,
d'aprs le marxisme, de la dialectique des forces productives et des rapports
sociaux de production et de proprit. Les rapports sociaux existants canali-
sent les forces productives: s'ils sont assez larges, ils permettent et impulsent
leur dveloppement; lorsqu'ils deviennent trop troits, ils l'entravent et
deviennent caducs. Les forces productives nouvelles, cumules avec les forces
productives existantes, exercent leur pression sur les deux plans: pression
objective sur le plan matriel, et pression du rapport de force des classes
antagonistes.
Les ncessits conomiques, matrielles et formelles (sociales), qui ont
pes et psent encore sur les hommes, du moins sur la grande majorit d'entre
eux, peuvent tre domptes. Elles se sont imposes jusqu'ici d'une faon
contraignante; elles ont entran la dpendance et l'asservissement du plus
grand nombre, parce que les individus et les masses aveugles ignorent quel sera
le rsultat de leur comportement. Les hommes accdent difficilement la
conscience que leurs buts individuels entrent en contradiction avec les
rapports de proprit, les rapports de classe et les institutions tablies (tat,
CONCLUSION
497
religion, etc.). De cette manire, jusqu'ici, dans l'histoire, s'est gnralement
ralis tout autre chose que ce qu'ils pensaient et poursuivaient.
Pourtant, ce processus historique inconscient n'est pas une fatalit
ternelle et immuable; se dveloppent les moyens pour les classes domines et
exploites de se librer des contraintes sociales qu'elles n'ont pas voulues, et
d'abolir les classes par une rvolution politique et conomique. Apparue par
l'action historique des hommes dans le pass, la ncessit de la division de la
socit en classes sociales peut disparatre par une autre action historique dans
l'avenir, une rvolution sociale radicalelO.
Si la ncessit conomique matrielle joue un rle essentiel et finalement
dcisif, paradoxalement, pour un matrialisme comme celui de Marx, cette
ncessit en se dveloppant engendre elle-mme la possibilit relle pour les
hommes de s'affranchir de ces contraintes donnes au point de dpart et de
limiter progressivement le domaine de la ncessit: le capitalisme engendre le
socialisme en crant en son sein ses conditions matrielles et la force subjective
qui le ralisera, la classe ouvrire II.
La conception marxienne de l'histoire donne penser, en mme temps, la
ncessit historique de l'tat de choses prsent, et la possibilit galement
historique de son dpassement dans un monde de liberts relles pour tous,
partir du moment o les conditions en sont cres: cette rvolution consiste
pour tous les travailleurs associs s'manciper de l'exploitation capitaliste et
rduire le temps de travail, tout en largissant la sphre des besoins qu'il est
effectivement possible de satisfaire. Par son action libratrice rvolutionnaire,
la classe ouvrire fait passer l'humanit de ce qui n'tait qu'une prhistoire
une histoire vritable. Tout le pass antrieur n'est plus qu'une prsupposi-
tion dialectiquement surmonte, conserve et dpasse.
Marx envisage, d'une manire peut-tre encore utopique, un avenir aux
possibilits illimites. A partir de la rvolution communiste qui abolit les
classes sociales, le temps de l'histoire irifinie commence 12. Marx laisse ouvert
l'avenir qui s'annonce. Il ne le dcrit, ni ne l'imagine d'aucune faon, sauf par
la parabole de l'individu tour tour, et selon son bon plaisir, berger, pcheur
et critique. Il n'en donne que l'ide, en parlant du <<libre dploiement de tous
les possibles humains futurs, impossibles dfinir autrement. Cette ide
infinie prsuppose les conditions de la ralisation des possibles. La condition
sine qua non de la libration de tous de toute exploitation conomique, de tout
asservissement social, et de toute subordination politique de classe, est le
dveloppement des forces productives.
Ce qui empche cette <<ided'tre une ide pure, c'est l'immersion de la
thorie dans la pratique, le fait que cette ide exprime le mouvement historique
rel qui se droule sous nos yeux, et auquel nous participons d'une faon ou
d'une autre.
La libert individuelle au plein sens du terme, c'est--dire sans aucune
alination sociale, ne peut se raliser que collectivement dans une socit
communiste, parce que la libert ne peut devenir relle pour tous que dans une
498 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
telle socit sans classes. Nous rencontrons, l encore, un de ces paradoxes
soutenus par Marx et qu'accepte si mal l'entendement commun.
L'histoire, telle que la prsentent la plupart des disciples proclams de
Marx, apparat comme poursuivant une fin: la socialisation des moyens de
production et la ralisation de la socit communiste quel qu'en soit le prix
pour les liberts et la conscience individuelles. C'est un thme politique bien
connu, qui a justifi ou cach des pratiques totalitaires maintenant gnrale-
ment et presqu'unanimement rprouves sinon refuses 13.
Certes, l'ide de Marx tait que la libert ne pouvait devenir relle pour
chacun que dans une socit o l'abolition des classes serait accomplie. La
libert est cette condition, ce qui, dans l'esprit de Marx, signifiait une socit
o les rapports auront un caractre humain, c'est--dire o chaque individu
participera aux choix et les inflchira.
Cela ne veut pas dire que, dans une telle socit communiste, il n'y aura
plus de diffrences entre les individus! Paradoxalement, Marx et Engels sont
la fois individualistes et universalistes (internationalistes)! C'est Marx qui a
crit (citons un texte de 1844):
Le communisme est le moment rel de l'mancipation et de la reprise de
soi [Wiedergewinnung] de l'homme, le moment ncessaire pour le dveloppe-
ment venir de l'histoire. Le communisme est la forme ncessaire et le principe
nergtique du futur prochain.}) 14Mais ", prcisait-il aussitt, il n'est pas en
tant que telle but du dveloppement humain.
})
15
Cette ngation ajoute l'affirmation qui la prcde est fort tonnante.
Cela rappelle les critiques que Marx a adresses ultrieurement aux concep-
tions providentialistes ou finaliste ordinaires de l'histoire 16: ces critiques
confirment qu'en niant que le communisme soit le but, il ne s'agit pas pour
Marx d'un simple propos lanc en l'air et qu'il aurait abandonn par la suite.
Que veut-il donc dire quand il nie expressment que la fin de l'histoire serait
la ralisation de la socit sans classes, alors qu'on lui attribue universellement
cette ide d'une tlologie historique oriente prcisment vers ce but?
Nous l'avons dit: il tait pass au communisme justement au moment o
il rdigeait les Manuscrits de 1844. L'affirmation que <<lecom~unisme n'est
pas le but du dveloppement humain}) se comprend et s'explique pourtant
assez bien:
La seule fin en soi", nous l'avons vu dans le dernier chapitre, c'est le
dveloppement de chaque individu pour lui-mme, le libre" exercice de ses
propres facults, le libre" dveloppement de ses potentialits. La fin de
l'activit et de la vie de l'homme individuel, c'est sa propre libert. Selon Marx,
le but du dveloppement humain ne peut tre que le dveloppement des seuls
tres rels qu'il connaisse, les individus concrets et singuliers: ainsi, le
communisme n'est que le moyen de la ralisation de ce but.
Bien entendu, il n'y a jamais que des individus sociaux". autrement dit,
ce quoi Marx pense en crivant que le communisme n'est pas la fin du
CONCLUSION 499
dveloppement humain, c'est l'interdpendance entre individu et socit,
entre l'homme totalement libre et la socit sans classes.
Le Manifeste du parti communiste le confirme:
A la place de l'ancienne socit bourgeoise, avec ses classes et ses
antagonismes de classes, surgit une association dans laquelle le libre dvelop-
pement de chacun est la condition du libre dveloppement de tous. 17
Cette ide que la libert individuelle, personnelle, est le but ultime, et
qu'elle est possible, a toujours habit la pense de Marx, qui savait lorsqu'il
travaillait sa Thse de Doctorat que notre libert est dans l'action par
laquelle nous ralisons notre propre libration, et qu'elle est toujours relative
aux moyens rels que nous avons de le faire.
Toute la vie de Marx fut un combat pour comprendre, saisir et accrotre
les moyens de cette libration possible de tous les individus de toute sujtion
trangre, afin de parvenir un jour ce que tous ensemble nous soyons libres.
Il le disait potiquement en dfinissant son entreprise de critique politique
radicale comme complment pratique de la critique thorique de la religion
acheve par Feuerbach:
La critique a dpouill les chanes des fleurs imaginaires qui les
recouvraient, non pour que l'homme porte des chanes sans illusion, dsesp-
rantes, mais pour qu'il rejette les chanes et cueille la fleur vivante. 18
Marx est matrialiste, mais il faut souligner que c'est dans le domaine de
la critique politique et pratique qu'il se diffrencie radicalement de tous les
matrialistes qui l'ont prcd. Il y aurait eu un manque de logique de sa part
si, dans sa philosophie matrialiste, il avait repris la thorie des circons-
tances dfendue par la grande majorit des matrialistes antrieurs. Pour
Marx, l'homme est un tre actif. Or, l'activit humaine est telle que, bien
qu'elle dpende de conditions matrielles pralables (naturelles et sociales),
elle les modifie en retour: l'homme a donc prise sur la ncessit, parce qu'il a
prise sur ses propres conditions d'existence. Pour l'homme agissant et se
ralisant, la ncessit est le tremplin de la possibilit.
Que Marx analyse l'activit de production matrielle pour y dcrypter les
secrets de l'histoire, qu'il fasse l'loge des ralisations historiques de la
bourgeoisie capitaliste moderne, qu'il exalte l'action hroque des classes qui
se librent de leur joug social ou politique, enfin, qu'il prdise 19un rgne o
sera possible, parce que relle, une pleine libert pour chacun, la catgorie de
possibilit joue un rle capital chez lui. L'ide qu'il y a du possible est toujours
prsente et illumine tout.
Un penseur marxiste original et profond a parfaitement exprim ce fond
de l'uvre de Marx comme penseur du possible:
Le levier dans l'histoire humaine, c'est celui qui la produit
- l'homme
qui travaille, qui enfin n'est plus extrioris, qui n'est plus alin, ni rifi, ni
500 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
asservi au profit de ceux qui l'exploitent. Marx est le matre ralis de cette
abolition du proltariat, de cette mdiation possible, et en train de se raliser,
des hommes avec eux-mmes et avec leur bonheur moral. [...] Marx est le
matre essentiel de cette mdiation qui nous rapproche incessamment du
foyer de la production de l'ensemble de l'vnement du monde [Weltgescbe--
hen], de ce que Engels appelle la mtamorphose de la prtendue chose en soi
en chose pour nous dans la mesure d'une humanisation possible de la nature.
Un peuple libre, sur un fondement libre, tel est, saisi ainsi de faon
paradoxale, le symbole final de la ralisation du ralisant, c'est--dire du
contenu-limite le plus radical dans le possible objectivement rel en gn-
ral. 20
NOTES
1. Georges LABlcA, Le marxisme
d' aujourd'hui, Paris, Presses Universitaires de France, 1973,
p.5.
2. La doctrine de Marx est toute-puissante, parce qu'elle est juste. Elle est complte et
harmonieuse, donnant aux hommes une conception cohrente du monde, inconciliable avec toute
superstition, toute raction, toute dfense de l'oppression bourgeoise. Elle est le successeur
lgitime de tout ce que l'humanit a cr de meilleur au XIX' sicle: la philosophie allemande,
l'conomie politique anglaise, le socialisme franais (uvres, 1. 19, p. 13; Karl Marx et sa
doctrine, Paris, d. sociales, 1971, p. 70; Textes philosophiques, op. cit., p. 214).
- Les trois
sources mises en avant, juste titre, par Lnine, ne sont cependant que des sources majeures. Il
faut leur en ajouter quelques autres. A la philosophie classique allemande, mme prolonge
jusqu' Feuerbach, il convient d'adjoindre les philosophes franais du XVIII' sicle, l'conomie
politique anglaise, cole physiocratique franaise, et, aux socialistes franais, les socialistes anglais
(Owen en particulier). Sur le plan philosophique, nous avons vu le rle que jourent des penseurs
comme picure et Aristote.
3. L'histoire elle-mme est une partie relle de l'histoire de la nature, du devenir de la nature
en homme (des Werdens der Natur zurn Menschen). Les sciences de la nature comprendront plus
tard aussi bien la science de l'homme, que la science de l'homme sera subsume sous la science de
la nature: il y aura une (eine) science (Manuscrits de 1844, p. 96; MEW EB I, p. 544. Trad.
modifie.)
4. Cette phrase figure dans sa Composition allemande pour le Baccalaurat [cf. uvres (d.
Rubel), t. III, p. 1363; MEW EB I, p. 592).
5. La raison a toujours exist, seulement pas toujours sous forme rationnelle [vernnftig)>>
a crit Marx (L. Arnold Ruge, septembre 1843, Correspondance, 1. 1., p. 299; MEW 1, p. 345.
Trad. modifie.). - Dans cette lettre, Marx dveloppe ses ides critiques sur la ralit politique
allemande, en prenant pour canevas
-
sans le dire, tant elle tait connue
-
la clbre thse de
Hegel: Ce qui est rationnel est rel et ce qui est rel et rationnel (Hegel, Principes de la
philosophie du droit, trad. Kaan, p. 41). Cette remarque de Marx, replace dans son contexte,
signifie que dans la ralit politique existante se trouve, sous forme inconsciente, une vrit
sociale qu'il faut y dcouvrir, pour comprendre et exposer les exigences socialistes (que)
renferme [00') toutes les formes modernes [de l'tat)>> (L. Ruge, loco cit.). (Au sujet de la
pratique rationnellement comprise , nous renvoyons aux Thses III et VIII sur Feuerbach,
cites ci-dessus p. 258, n. 125).
6. Marx ne s'est gure prononc sur les conditions de la dmocratie, mais il a lutt pour la
libert de la presse, men des batailles critiques contre les lois et la bureaucratie prussiennes, salu
avec enthousiasme l'introduction du suffrage universel, et acquiesc aux mesures de la Commune
qui visaient empcher la fonctionnarisation de la vie politique.; on peut dire que sa conception
de la dmocratie et du parti tait aux antipodes des rgimes totalitaires qui se sont dvelopps au
CONCLUSION
501
xxe sicle. On ne sait ce qu'il aurait pens de la doctrine lniniste du parti, de l'existence du parti
unique, de la candidature unique, et du rgime qui s'est dvelopp en U.R.S.S. sous l'impulsion de
Staline.
7. La pense et le mouvant, Paris, Presses Universitaires de France, 1960, p. Ill.
8. Ibid., p. 115.
9. Le principe de causalit se subordonne ce que la pense objective exige et [...]en cela
il peut bien tre dit encore la catgorie fondamentale de la pense objective. En effet, [...] l'ide de
cause s'est constitue sans s'astreindre aux dfinitions ultra-prcises que nous rclamions pour
fonder le Dterminisme. De la cause l'effet, il
y a une liaison qui, jusqu' un certain point,
subsiste en dpit des dfigurations partielles de la cause et de l'effel. La causalit est donc plus
gnrale que le dterminisme (BACHELARD, Le nouvel esprit scientifique, p. 115). M. Mario Bunge
a soutenu, au contraire, avec une argumentation trs dveloppe, fonde sur la science
contemporaine, que la causalit n'tait qu'une espce dans un genre plus vaste: le dterminisme
(Causality, op. cit., ch. 1er).Mais il renverse le sens des mots en introduisant dans sa dfinition du
dterminisme ce qu'il appelle <<leprincipe gntique (ibid., pp. 24-25) qui est proprement la
causalit!
10. Remmorons-nous l'une des formules typiques de Marx dans L'idologie allemande: <<le
matrialiste communiste voit la fois la ncessit et la condition d'une transformation radicale
tant de l'industrie que de la structure sociale (cf. ci-dessus p. 481, citation rfrence note 104).
11. Le monopole du capital devient une entrave pour le mode de production qui a grandi
et prospr avec lui et sous ses auspices. La socialisation du travail et la centralisation de ses
ressorts matriels arrivent un point o elles ne peuvent plus tenir dans leur enveloppe capitaliste.
Cette enveloppe se brise en clats. L'heure de la proprit capitaliste a sonn. Les expropriateurs
sont leur tour expropris.
- L'appropriation capitaliste, conforme au mode de production
capitaliste, constitue la premire ngation de cette proprit prive qui n'est que le corrollaire du
travail indpendant et individuel. Mais la production capitaliste engendre elle-mme sa propre
ngation avec la fatalit qui prside aux mtamorphoses de la nature. C'est la ngation de la
ngation (Le capital, I. 3, p. 205; trad. Lefebvre, p. 856; MEW23, p. 791. Mots souligns par
nous).
12. Nous nous permettons de renverser le mot de Valry: Le temps du monde fini
commence" (Regards sur le monde actuel et autres essais, Paris, Gallimard, 1945, p. 23), pour
exprimer ce que Marx pouvait penser.
13. Nous crivions ces lignes avant la chute du mur de Berlin (cf. notre Thse dactylogra-
phie, p. 575; elle fut soutenue le 29 juin 1989).
14. Manuscrits de 1844, p. 99; MEWEB l, p. 546.
15. Ibid.
16. Marx rejette l'explication courante de la finalit historique par l'intervention d'une
conscience soit humaine, soit supra-humaine. Cette critique marxienne de la finalit rationnelle
(au sens classique du terme) en histoire a conduit certains interprtes soutenir que Marx niait
toute espce de tlologie historique, alors qu'il ne rejette que ses reprsentations grossires et les
conceptions idalistes de la finalit dans la nature et en histoire (cf. ci-dessus, pp. 248-252).
17. Manifeste, pp. 88-89; MEW 4, p. 482. - Le but n'a pas chang par rapport 1844: La
critique de la religion dtruit les illusions de l'homme pour qu'il pense, agisse, faonne sa ralit
comme un homme dsillusionn parvenu l'ge de la raison, pour qu'il gravite autour de lui-
mme, c'est--dire de son soleil rel (Critique du droit politique hglien, Introduction, p. 198;
MEW I, p. 379). Aujourd'hui, on peut estimer que les chemins pour y parvenir sont parsems de
plus de difficults qu'il ne pouvait le penser. Tout ce que nous prtendons est que c'est bien ce que
Marx a rellement pens et soutenu toute sa vie.
18. Critique du droit politique hglien, Introduction, p. 198; MEW l, p. 379.
19. M. Jacques D'Hondt a fait remarquer qu'il arrive que l'on assimile tort l'affirmation
de la ncessit d'un avenir nouveau [...] et la prdtermination ou la prvision de cette nouveaut
(HEGEL, philosophe de l'histoire vivante, op. cil., p. 152, n. I). De mme que <<la mtaphore
[hglienne] de la "chouette de Minerve" laisse l'avenir ouvert (ibid.), de mme, dirons-nous, la
conception historique matrialiste de Marx: Si construire l'avenir et dresser des plans dfinitifs
pour l'ternit n'est pas notre affaire, ce que nous avons raliser dans le prsent n'en est que plus
vident; je veux dire la critique radicale de tout l'ordre existant, radicale en ce sens qu'elle n'a pas
peur de ses propres rsultats, pas plus que des conflits avec les puissances tablies (L. Arnold
Ruge, septembre 1843; Correspondance, t. l, p. 298; MEW l, p. 344).
20. Ernst BLOCH, Le principe esprance, trad. de l'allemand, Paris, Gallimard, 1976, t. I,
p.300.
BIBLIOGRAPHIE
Cette bibliographie se limite aux principaux ouvrages mentionns dans ce
travail et utiliss au cours des recherches qui l'ont prcd. Ils sont rpartis en
quatre rubriques:
I. uvres de Marx et d'Engels.
II. Instruments de la recherche sur Marx et Engels.
III. Introductions au marxisme; commentateurs et interprtes de Marx.
IV. uvres d'Aristote et de Hegel.
V. Revues, encyclopdies et dictionnaires.
Des subdivisions ont t introduites par souci de clart et de commodit
pour les lecteurs. Les quelques rgles adoptes sont indiques en tte de
chaque division.
I. uvres de Marx et d'Engels
L'histoire des textes marxiens et engelsiens est trs complexe: nous en avons
parfois donn un aperu dans nos notes quand le contexte le demandait. Nous nous
dispensons d'y revenir, car cela exigerait davantage de place pour tre convenablement
abord. Les indications ce sujet sont donc rduites ici au strict mininum.
Les ditions et traductions des uvres de Marx et d'Engels sont nombreuses. Pour
les mmes raisons, nous ne retenons que celles que nous avons utilises ou qui se
trouvent mentionnes dans des citations ou des notes. On trouvera des bibliographies
plus ou moins tendues des uvres et crits divers de Marx et d'Engels dans les
ouvrages, rpertoris dans la rubrique Instruments de la recherche ci-dessous, sous
les noms de CALVEZ,EUBANKS, NEUBAUER,RUBEL,SEVE,ainsi que dans MEW, MEGA,
et uvres de Marx-Engels (d. soc., ou d. Rubel). Il convient d'y ajouter le Catalogue
raisonn du Centre de Recherche et de Documentation sur Hegel et Marx (CNRS). La
Bibliographie de Neubauer est de loin la plus complte et la plus dtaille.
Dans le texte et les notes de notre travail, des abrviations de titres ont t adoptes
pour les uvres et recueils d'crits de Marx et d'Engels. On trouvera ces abrviations
sur une premire ligne, le titre complet ne venant qu'en second lieu.
504 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
A. UVRES cOMPLTESou dites comme telles, par ordre chronologique du
dbut de la parution
MEGA 1
MARX-ENGELS GESAMTAUSGABE (dite Premire MEGA), sous la dir.
de D. Riazanov. Berlin/Moscou/Frankfort, ditions Marx-Engels. Seuls,
sept volumes ont parus de 1927 1935. Elle comporte des index des noms
et des matires tendus et dtaills.
uvres (d. Costes)
Marx, uvres, trad. fran. de J. Molitor, Paris, Costes, 39 vol., parus partir
de 1933. (Sept autres volumes sont consacrs aux uvres d'Engels).
MEW
MARX-ENGELS WERKE, Berlin, Dietz, 39 volumes. - Parution partir de
1956. Tous les volumes contiennent des notes, un index bibliographique, et
des index des uvres cites et des noms mentionns. Seuls, les vol. 20, 23,
24,25,26 et 39 comportent un index des matires.
uvres (d. Rubel)
Marx, uvres, trad. fran. de M. Rubel, L. vrard et J. Janover, Paris,
Gallimard, Encyclopdie de la Pliade, 3 volumes parus (1963, 1968, 1982).
MEW EE
MARX-ENGELS WERKE, Ergiinzungsbiinde (2 volumes supplmentaires,
compltant les MEW), Berlin, Dietz, 1973 (1re d. 1968).
MEGA Probeband
Karl MARX, Friedrich ENGELS GESAMTA USGABE (MEGA), Editionsgrund-
siitze und Probestcke, Berlin, Dietz, 1972,68* + 724 p.
- Volume d'essai
ditorial, prliminaire la parution de la seconde MEGA. Contient une
diversit d'uvres de Marx et d'Engels, dont L'idologie allemande (1re
Partie), La guerre civile en France, quelques Lettres et des Extraits des
Cahiers de notes de lecture de Marx; suivent les apparats critiques corres-
pondants.
- Ce volume est presque introuvable en France.
MEGA (ou MEGA 2)
MARX-ENGELS GESAMTAUSGABE(dite Seconde MEGA ), Berlin, Dietz,
100 vol. prvus, paraissant depuis 1975. En cours de publication. Chaque
vol. omporte deux tomes, le second regroupant l'apparat critique (notices
ditoriales, variantes, notes, index, etc.). Depuis la chute du mur de Berlin,
serait reprise par l'Institut international d'histoire sociale d'Amsterdam.
Correspondance
Marx-Engels, Correspondance, sous la dir. de G. Badia et J. Mortier, trad.
BIBLIOGRAPHIE
505
Auger, G. Badia, et alii, Paris, d. soc., 12 vol. parus, couvrant la priode
allant de novo 1835 juin 1872.
B. UVRESSPARESle plus frquemment cites, mentionnant l'abrviation des
titres, et classes selon l'ordre alphabtique du premier nom des titres abrgs
Distinguer entre les uvres de Marx et celles d'Engels est une question dlicate;
parfois il est impossible de le faire. Souvent il y a eu collaboration, mme lorsqu'elle fut
minime et rduite une consultation, comme dans le cas du Capital. Aprs le titre
abrg, nous indiquons le nom de l'auteur principal de l'uvre, ou les deux noms quand
il s'agit d'une publication ou rdaction en commun. Cette mention est suivie de la date
de la publication par Marx ou Engels, ou celle de la rdaction pour des uvres restes
indites de leur vivant ou des manuscrits, sauf lorsque cette date figure dans
l'abrviation elle-mme.
Les ditions d'uvres spares contiennent souvent d'autres textes, outre celui ou
ceux qu'annonce le titre. D'autre part, il existe des mmes uvres de multiples ditions,
par les mmes diteurs ou par d'autres, parfois avec des modifications et amliorations.
Les dates mentionnes dans les indications bibliographiques qui suivent le titre complet
sont celles de l'dition dont nous nous sommes servis.
tant frquente, la mention des ditions sociales), a t abrge en d. soc. .-
En fin de ligne, on trouvera le renvoi au tome des Marx-Engels Werke (MEW), ou
d'autres ditions o se trouve le texte allemand de l'uvre concerne. Quand il s'agit
d'un texte dont l'original tait dans une autre langue, nous mettons ce renvoi entre
crochets carrs.
Anti-Dhring. Engels
- 1877-1878
Anti-Dhring: M. E. Dhring bouleverse la science, trad. mile Bottigelli, 2e d.
revue, Paris, d. soc., 1963,511 p. MEW20
Le dix-huit. Brumaire. Marx - 1852
Le dix-huit Brumaire de Louis Bonaparte, traducteur non indiqu, Paris, d.
soc., 1963, 132 p. MEW 8
Le capital, t. 1 3. Marx - 1867
Le capital, 1erLivre. (Reproduction de la trad. de Joseph Roy, revue par Marx,
parue de 1872 1875 chez Maurice Lachtre). Paris, d. soc., 3 tomes, 1957,
1967,1968, resp. 317,245 et 383 p. MEGA 11/5
Le capital (trad. Lefebvre). Marx-Engels - 1890
Le capital, L. 1er, trad. de Jean-Pierre Lefebvre sur le texte de la 4e d. aHem.
d'Engels, Paris, d. soc., 1983, 940 p. MEW 23
Le capital, t. 4 et 5. Marx-Engels - 1885
Le capital, L. II, d. par Engels, trad. Erna Cogniot, Paris, d. soc., 1960,
1953, resp. 326 et 271 p. MEW24
506 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Le capital, t. 6 8. Marx-Engels - 1894
Le capital, L. III, d. par Engels, trad. C. Cohen-SalaI et Gilbert Badia, Paris,
d. soc., 1957, 1959, 1960, resp. 349, 274 et 322 p. MEW 25
Contribution. Marx - 1859
Contribution la critique de l'conomie politique, trad. Maurice Husson et
G. Badia, Paris, d. soc., 1957,309 p. MEW 13
Dialectique. Engels
- 1872-1882
Dialectique de la nature, trad. mile Bottigelli, Paris, d. soc., 1952, 367 p.
MEW 20
- Autre dition: Ueber die Dialektik der Naturwissenschaft, [Sur la dialecti-
que de la science de la nature].
Textes rassembls et dits par B. M. Kedrov, Trad. allem. de l'd. russe (Moscou,
Nauka, 1973),sous la dir. de M. Buhr et G. Krober, Berlin, Dietz, 1979.
- Il s'agit
d'une reconstitution de l'ouvrage projet par Engels sur ce sujet, l'aide des textes
constituant la Dialectiquede la nature et d'extraits prlevs dans d'autres uvres de
Marx et d'Engels. MEW 20
Diffrence. Marx - 1841
Diffrence de la philosophie de la nature chez Dmocrite et picure, trad. introd.
et notes par Jacques Ponnier, Bordeaux, Ducros, 1970,369 p.
- Contient
les Cahiers Prparatoires de Marx (sauf les citations des textes anciens).
MEW EB l
Droit politique. Marx - 1843
Critique du droit politique hglien, trad. et introd. Albert Baraquin, Paris, d.
soc., 1975,223 p. MEW 1
Esquisse. Engels - 1844
Esquisse d'une critique de l'conomie politique, bilingue, introd. de H. Cham-
bre, trad. de H. A. Baatsch, Paris, Aubier Montaigne, 1974,191 p.
MEW1
- Autre trad. par K. Papaioannou, in Marx, Critique de l'conomie politique,
pp. 29-64. (Cf. ci-dessus dans Recueils et choix de textes .)
Grundrisse ou Grundr. ou Gr. Marx - 1857-1858
Grundrisse der Kritik der politischen Oekonomie (Rohentwurf) [Esquisse de la
critique de l'conomie politique (bauche)] 1857-1858. Berlin, Dietz, 1974
(Ire d., 1953).
Ce volumineux manuscrit est la premire bauche du Capita/. On le dsigne, selon un
usage consacr, sous le nom de Grundrisse[bauche], ou sous celui de Manuscrits de
1857-1858.(Pour la traduction franaise, cf. ce titre ci-dessous).
-
Il ne fait pas
partie des tomes des MEW.
BIBLIOGRAPHIE 507
La guerre civile. Marx - 1871
La guerre civile en France, 1871, texte bas sur une traduction franaise de
1871, revue par Marx en 1872; d. mile Bottigelli et alii, Paris, d. soc.,
1968. MEW 17
L'idologie (1968). Marx-Engels - 1845-1846
L'idologie allemande: Critique de la philosophie allemande la plus rcente
dans la personne de ses reprsentants Feuerbach, B. Bauer et Stirner, et du
socialisme allemand dans celle de ses diffrents prophtes, prs. et annot.
par Gilbert Badia, trad. Augier, Badia, Baudrillard, Cartelle; Paris, d.
soc., 1968, 632 p. MEW 3
L'idologie (1976)
(Autre d. du mme texte, rvise sur MEGA 2), mmes traducteurs, Paris, d.
soc., 1976, 621 p. MEW 3
L'idologie (bil.)
L'idologie allemande: Premire partie, bilingue, introd. de J. Milhau, d. par
M. KUntz, Paris, d. soc., 1972,267 p. MEW 3
Introduction. Marx - 1857
Introduction gnrale la critique de l'conomie politique (dite aussi Introduc-
tion gnrale ou encore Introduction de 1857), in Contribution, p. 147-175. Il
est reproduit dans Textes sur la mthode, Manuscrits de 1857-1858, uvres
(d. Rubel) t. J, et en partie dans les tudes philosophiques.
Grundrisse et MEW 13
Ludwig Feuerbach. Engels - 1886-1888
Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande, bilingue,
introd. de J.-P. Cotten, trad. Bottigelli, Paris, d. soc., 1979,213 p.
MEW21
Les luttes de classes. Marx - 1850
Les luttes de classes en France, 1848'-1850, traducteur non mentionn, Paris,
d. soc., 1967,219 p. MEW7
Manifeste. Marx-Engels - 1848
Manifeste du parti communiste, bilingue, trad. Laura Laffargue, revue par Jean
Bruhat et Michle Kiintz, Paris, d. soc., 1972, 269 p.
-
Contient les
prfaces successives de Marx et Engels, et d'autres textes. MEW 4
- Autre d., prsent. et commentaire par F. Chtelet, Paris, d. Pdagogie
moderne, 1981, 190 p.
Manuscrits de 1844. Marx
Manuscrits de 1844: conomie politique et philosophie, trad. E. Bottigelli,
Paris, d. soc., 1962, 177 p. M EW EB I
508 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
- Autre traduction, avec une prsentation par K. Papaioannou, in Marx,
Critique de l'conomie politique, pp. 65-301.
Manuscrits de 1857-1858. Marx
Manuscrits de 1857-1858, trad. sous la dir. de J.-P. Lefebvre, t. I et II, Paris,
d. soc., 1980,454 et 457 p.
-
Il s'agit du texte des Grundrisse, dont on trouvera une autre trad. de R. DangeviIle,
sous te titre: Fondementsde la critiquede l'conomiepolitique, 2 t., Paris, Anthropos,
1968,519 et 562p. Elle contient les notes des diteurs allemands qui manquent dans
la traduction aux ditions sociales. Grundrisse
Misre. Marx - 1847
Misre de la philosophie: Rponse la Philosophie de la misre de M. Proudhon.
(Publi en franais par Marx.) d. par Henri Mougin, Paris; d. soc., 1968,
220 p. [MEW 4]
La Sainte Famille. Marx-Engels - 1845
La Sainte Famille, trad. Erna Cogniot, Prs. et annat. par N. Meunier et
G. Badia, Paris, d. soc., 1969,256 p. MEW 2
Salaire. Marx - 1865
Salaire, prix et profit (Confrences), 1red. (anglaise) en 1898 par Eleanor et
Edward Aveling, 1red. aHem. par Eduard Berstein en 1898; traducteur non
indiqu, Paris, d. soc., 1966,94 p. MEW 16
Socialisme. Engels
- 1880
Socialisme utopique et socialisme scientifique. (Cet opuscule reprend des
chapitres de l'Anti-Dhring.) Trad. Laura Laffargue, Paris, d. soc., 1962,
104 p. MEW 19
Textes sur la mthode. Marx-Engels
Textes sur la mthode de la science conomique: Introduction de 1857 ,
Postface au Capital, et quatre autres textes, bilingue, Introd. de L. Sve,
trad. revue par J.-P. Lefebvre, Paris, d. soc., 1974,240 p.
Thories. Marx - 1861-1863
Thories sur la plus-value (Livre IV du Capital), 3 tomes, trad. dirige par
G. Badia, Paris, d. soc., 1974, 1975,1976, resp. 510,727 et 697 p.
MEW 26.1,26.2,26.3
Thses. Marx - 1845
Thses sur Feuerbach, in L'idologie (1968), p.
pp. 24-33.
31-34; (1976) pp. 1-4; (bil.)
MEW3
Travail salari. Marx - 1849
Travail salari et capital, trad. sur l'd. dfinitive d'Engels de 1891, Paris, d.
soc., 1972,93 p. MEW 6
BIBLIOGRAPHIE 509
C. AUTRES UVRESdont le titre n'a pas donn lieu abrviation (ordre
alphabtique)
1) Livres, fascicules, brochures, articles, manuscrits (fragments), etc.:
MARX. 1864
Adresse inaugurale de l'Association Internationale des Travailleurs, in uvres
(d. Rubel), t. I, pp. 259-268. MEW 1
MARX. 1863-1866
Un chapitre indit du Capital, trad. et prs. par R. Dangeville, Paris, Union
Gnrale d'dition (10/18), 319 p.
MARX. 1858
Contribution la critique de l'conomie politique: Fragment de la version
primitive, in Contribution, pp. 177-255. Grundrisse
MARX-ENGELS.1875-1891
Critique des programmes de Gotha et d'Erfurt, trad. rvise, sans nom de
traducteur, sous la dir. de E. Bottigelli, Paris, d. soc., 1966, 158 p.
MEW 19
MARX. 1842
Les dlibrations de la sixime Dite rhnane, 1erarticle, Dbat sur la libert
de la presse, La Gazette Rhnane, 5 mai 1842. ln uvres (d. Rubel), t. III,
pp. 138-198. MEW 1
MARX. 1842
L'ditorial du n 179 de la Gazette de Cologne, La Gazette Rhnane, 10-14
juill. 1842, in Sur la Religion, pp. 15-40. MEW 1
MARX. 1852
Enthllungen ber den Kommunisten-Prozess zu Koln [Rvlations sur le procs
des communistes Cologne], 1852; nouv. d. Leipzig, 1875. [Non traduit
notre connaissance.] MEW 18
ENGELS. 1885
Zur Geschichte des Bundes des Kommunisten [Sur l'histoire de la Ligue des
communistes). [crit comme introduction la rdition des Rvlations... de
Marx en 1885; cf. ci-dessus: Enthllungen... . Non traduit notre
connaissance.) MEW 21
MARX. 1861
Herr Vogt [Monsieur Vogt), trad. J. Molitor, Paris, Costes (t. 24, 25 et 26 des
uvres). MEW 14
510 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
MARX-ENGELS
La ligue des Communistes (1847), Documents constitutifs, rassembls par Bert
Andras, d. bilingue, Paris, Aubier, Connaissance de Marx, 1972,205 p.
MARX. 1861-1863
Manuscrits de 1861-1863: Cahiers l V, contribution la critique de
l'conomie politique; Trad. sous la dir. de J.-P. Lefebvre, Paris, d. soc.,
1979. [Ces manuscrits constituent une tape de rdaction intermdiaire
entre les Grundrisse et Le capital] MEGA II/3
MARX. 1881
Les Manuscrits Mathmatiques de Marx: tude et prsentation par
A. AIcouffe, Paris, Economica, 1985, pp. 351. [Il s'agit de manuscrits dont
on ne sait la destination que Marx leur rservait. Cette dition savante ne
mentionne pas le nom du traducteur.]
MARX. 1845
La question juive [ Zur Judenfrage , in Annales Franco-Allemandes, fvr.
1844], bilingue, trad. Marianna Simon, introd. de Franois Chtelet, Paris,
Aubier Montaigne, 1971, 157 p. MEW 1
ENGELS. 1845
La situation de la classe laborieuse en Angleterre, d'aprs les observations de
l'auteur et des sources authentiques, Trad. et notes de G. Badia et
J. Frdric, Avant-propos de E. J. Hobsbawn, Paris, d. soc., 1960,413 p.
MEW2
MARX. 1864
Statuts de l'Association Internationale des Travailleurs, prcds du Pram-
bule, in Critique des programmes de Gotha et d'Erfurt, pp. 141-144; uvres
(d. Rubel), t. I, pp. 469-472. MEW 16
2) Recueils et choix de textes de divers diteurs (ordre alphabtique):
MARX. 1844
Cri#que de /'conomie politique, comprenant l'Esquisse d'Engels et les Manus-
crits de 1844 de Marx, trad. et prsent. par K. Papaioannou, Paris, Union
Gnrale d'ditions (10/18), 1972, 320 p. MEW 1 et EB l
MARX-ENGELS
tudes philosophiques [Textes choisis], nouv. d. revue et augmente, introd. de
Guy Besse, Paris, d. soc., 1974.
MARX
uvres philosophiques, trad. de l'aIl. par J. Molitor, nouv. d. revue et augm.
par J.-J. Raspaud, Paris, Champ libre, 1981,2 vo1., 649 et 583 p.
BIBLIOGRAPHIE
511
MARX-ENGELS
Sur la religion, Textes choisis, trad. et ann.
E..
Bottigelli, Paris, d. soc., 1960, 358 p.
MARX. 1857
Sur les socits prcapitalistes, Textes choisis de Marx, Engels, Lnine, prf. de
Maurice Godelier, Paris, d. soc., 1978, 415 p. Contient la trad. d'un
passage des Manuscrits de 1857-1858 [G rundrisse] connu aussi sous le nom
de Formes antrieures la production capitaliste.
par G. Badia, P. Bage et
MARX-ENGELS
Studienausgabe II, Politische Oekonomie, Frankort/Main, Fischer 1966,288 p.
Contient: Esquisse, Manuscrits de 1844, et un choix de tex~es sur l'conomie
politique des annes 1857-1867, des Grundrisse au Capital.
MARX
Textes 1842-1847: Textes choisis, Cahiers Spartacus n 33 (Dir. R. Lefeuvre),
avril-mai 1970, 126 p.
D. CORRESPONDANCE(lettres choisies)
La correspondance de Marx et d'Engels, qu'il s'agisse de lettres entre eux ou des
tiers, occupe les volumes 27 39 des Marx-Engels Werke, auxquels il convient d'ajouter
quelques lettres publies dans les volumes complmentaires (MEWEB I et 2). L'dition
de la deuxime MEGA y consacre une section, et donne les lettres des correspondants
de Marx et d'Engels en annexe.
Outre la Correspondance (cf. ci-dessus dans uvres compltes), nous avons
recouru quelques recueils de lettres choisies:
MARX-ENGELS
Lettres sur Le capita!, prs. et annotes par G. Badia, trad. par G. Badia,
J. Chabbert et Paul Meier, Paris, d. soc., 1964,456 p.
Karl MARX, Jenny MARX, ENGELS
Lettres Kugelmann, trad., prsent. et notes de G. Badia, Paris, d. soc., 1971,
269 p.
MARX-ENGELS
Lettres sur les sciences de la nature (et les mathmatiques), trad. et introd. de J.-
P. Lefebvre, Paris, d. soc., 1973, 158 p.
II. Instruments de la recherche sur Marx et Engels
Il existe des instruments indispensables pour la recherche sur l'uvre, crite de
Marx et d'Engels. Ils sont malheureusement peu connus en France, et rarement
512 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
signals. Voici ceux auxquels nous nous sommes rfrs pour notre documentation et
nos recherches:
Catalogue raisonn des Ouvrages et Documents de la Bibliothque du
C.R.D.H.M.
[Centre de Recherche et de Documentation sur Hegel et sur Marx, quipe de
Recherche Associe du C.N.R.S.], Poitiers, juin 1976 (reproduction offset, hors
commerce). Rpertorie 1200 ouvrages et 200 Documents, avec des Indications
Bibliographiques dtailles, et un Index exhaustif des noms de personnes mention-
ns (auteurs, diteurs, prfaciers, traducteurs). tabli par M. VADEet alii.
CORNU, Auguste, Karl Marx et Friedrich Engels, Paris, Presses Universitaires
de France:
-
tome 1er: Les annes d'enfance et de jeunesse, La gache hglienne,
1818/1820-1844,1955,315 p.;
- tome II: Du libralisme dmocratique au communisme, La Gazette Rh-
nane, Les Annalesfranco-allemandes, 1842-1844, 1958,367 p.;
- tome III: Marx Paris, 1962, 272 p.;
- tome IV: Laformation du matrialisme historique (1845-1846), 1970,318 p.
DRAHN, Ernst
Marx-Bibliographie: Ein Lebensbild Karl Marx's in biographisch-bibliogra-
phischen Daten.
[Bibliographie de Marx: Un portrait de la vie de Karl Marx travers une chronique
biographique et bibliographique], Charlottenburg, Deutsche Verlagsgesellschaftfr
Politik und Geschichte, 1920, in-8, 60 p. (2000. revue et augmente, 1923). -
La
bibliographie proprement dite se trouve aux pp. 15 49.
EUBANKS, Cecil L.
Karl Marx and Friedrich Engels: an analytical Bibliography [Karl Marx et
Friedrich Engels: Une bibliographie analytique], New York/Londres,
Garland, 1977, LVII-163 p.
Ex-libris Marx-Friedrich Engels, Schicksal und Verzeichnis eine Bibliothek [Ex-
libris Marx-Engels, Destin et catalogue d'une bibliothque], d. par
B. Kaiser et I. Werchau, Berlin, Dietz, 1967, in-8o, 230 p.
Cet ouvrage retrace l'histoire de la Bibliothque de Marx avant 1851, en se basant
sur des lettres et la liste tablie par le Dr Roland Daniels, ami de Marx, qui a recueilli
cette bibliothque lors de l'exil de Marx Londres partir de 1850, pour la lui faire
parvenir. (La liste de Daniels est donne in fine.) L'ouvrage commente l'tat des
livres, leur contenu, et donne un aperu des traces d'utilisation par Marx (notes
marginales, soulignements, etc.).
Inhaltsvergleichnisregister der Marx-Engels Gesamtausgaben [Index comparatif
des uvres compltes de Marx-Engels], tabli par G. Hertel, Berlin,
Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1957, XX-295 p.
Tables de correspondance entre les uvres compltes de Marx-Engels, en langue
BIBLIOGRAPHIE
513
russe (29 vol. parus Moscou de 1928 1947), la 1re MEGA, et 86 ouvrages
contenant des uvres et choix de textes de Marx-Engels parus en allemand de 1902
1955.
Karl Marx, Chronik seines Lebens in Einzeldaten [Karl Marx, Chronique de sa
vie au fil des dates], prpare par D. Riazanov, tablie par l'Institut Marx-
Engels-Lnine, Moscou, Marx-Engels Verlag, 1934, in-8, 464 p. (Base
d'une bonne bibliographie des uvres de Marx et d'Engels.)
The Karl Marx Library [La bibliothque de Karl Marx, trad. anglaise de l'Ex-
libris... de Kaiser et Warchau], d. et trad. par Saul K. Padover; New-
York/St-Louis/San Francisco, MacGraw Hill, 1972, LIII-298 p.
Marx-Engels Verzeichnis [Catalogue Marx-Engels], tabJi par M. Kliem,
H. Merbach et R. Sperl; Berlin, Dietz, 1966,2 tomes:
- 1. I: Werke, Schriften, Artikel [uvres, crits, Articles], 360 p.;
- 1. II: Briefe, Postkarten, Telegramme [Lettres, Cartes postales, Tl-
grammes], 819 p.
Ces deux tomes sont des tables de correspondance entre l'dition MEWet toutes
les ditions allemandes d'uvres particulires de Marx et d'Engels, ainsi que de
textes choisis et recueils, parus de 1945 1966 Berlin chez Dietz.
-
Ils sont
complts par des index auxiliaires (index des articles en langues trangres, liste des
crits publis dans des livres, brochures ou priodiques, index alphabtique des
titres, index des destinataires et expditeurs des lettres, etc.).
NEUBAUER, Franz, Marx-Engels Bibliographie, (en allemand), Boppard am
Rhein, Harald Boldt, 1979,417 p.
Cette bibliographie tout fait exceptionnelle fait un point complet, pouss au
dtail des mois et des jours, des crits de Marx et d'Engels. Elle rpertorie pour
chaque crit les principales sources (allemandes en gnral) o on peut les trouver.
RUBEL, Maximilien
Bibliographie des uvresde Karl Marx, avec en Appendice un Rpertoire des
uvres de Friedrich Engels; Paris, Rivire, 1956, 274 p.
Supplment la bibliographie des uvres de Karl Marx, Paris, Rivire, 1960,
78 p.
Sachregister zu Marx-Engels Werke (MEW) [Index des matires des uvres de
Marx-Engels (MEW)], sous la dir. de H. Herferth, Berlin, Acadmie des
sciences sociales, 1980, 3 fascicules dactylographis, 918 p. en tout (pagina-
tion continue, non commercialis).
Muni d'une prface imprime, de Hans Jorg Sandkhler, cet Index a donn lieu
une dition photocopique en un volume reli: Cologne, Pahl-Rugenstein, 1983,
LXIV-918 p.
-
Trs utile, fort tendu sur les matires conomiques et politiques, il
contient comparativement assez peu d'entres philosophiques, historiques et litt-
raires. Lorsqu'elles existent, elles ne sont gure diversifies.
514 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
III. Introductions au marxisme; commentateurs et interprtes de Marx
Nous retenons quelques uvres marquantes et des introductions lmentaires qui
permettent de se faire une ide de la rception de la pense de Marx et de l'ventail des
interprtations que le marxisme a suscites depuis plus d'un sicle.
A. Littrature marxienne franaise
ALTHUSSER,Louis, Pour Marx, Paris, Maspro, 1965,261 p.
ALTHUSSERet alii, Lire <<Lecapital, Paris, Maspro, 1965,2 tomes, 260 et 404
p.
ANDRANI,Tony, De la socit l'histoire, 2 t., Paris, Mridiens Klincksieck,
1986, 752 et 596 p.
BOTTIGELLI,mile, Gense du socialisme scientifique, Paris, d. soc., 1967,
264 p.
CALVEZ,Jean-Yves, La pense de Karl Marx, Paris, d. du Seuil, 1956, 664 p.
D'HoNDT, Jacques, De Hegel Marx, Paris, Presses Universitaires de France,
1972,232 p.
D'HoNDT, L'idologie de la rupture, Paris, Presses Universitaires de France,
1978, 192 p.
DOMMANGET,Maurice, L'introduction du marxisme en France, Lausanne, d.
Rencontre, 1969.
FAVREPierre et FAVREMonique, Les marxismes aprs Marx, Paris, Presses
Universitaires de France, 1970, 128 p.
GABAUDE,Jean-Marc, Lejeune Marx et le matrialisme antique, Toulouse, d.
Privat, 1970, 277 p.
GARAUDY,Roger, Karl Marx, Paris, Seghers, 1969,314 p.
HENRY, Michel, Karl Marx, Paris, Gallimard, 1976,2 t., 481 p. et 486 p.
HYPPOLITE,Jean, tudes sur Hegel et sur Marx, Paris, Rivire, 1965,208 p.
LABICA,Georges, Le marxisme d'aujourd'hui, Paris, Presses Universitaires de
France, 1973, 96 p.
LABICA,Le statut marxiste de la philosophie, Bruxelles, d. Complexe, 391 p.
LEFEBVRE,Henri, Pour connatre la pense de Karl Marx, Paris, Bordas, 1977,
286 p.
LEFEBVRE,Henri, Le matrialisme dialectique, Paris, Presses Universitaires de
France, 1971, 167 p.
Marx et la pense scientifique contemporaine, Contributions prsentes un
BIBLIOGRAPHIE
515
Symposium sous l'gide de l'U.N.E.S.C.O. (Paris, 8-10 mai 1968), Paris/La
Haye, Mouton, 1969,612 p.
MERCIER-JOSA,Solange, Pour lire Hegel et Marx, Paris, d. soc., 1980,207 p.
MERLEAU-PONTY,Maurice, Les aventures de la dialectique, Paris, Gallimard,
1955,313 p.
RUBEL, Maximilien, Karl Marx, Essai de biographie intellectuelle, Paris,
Rivire, 1971,460 p.
SARTRE,Jean-Paul, Critique de la raison dialectique, Paris, Gallimard, 1960,
757 p.
SEVE, Lucien, Une introduction la philosophie marxiste, Paris, d. soc., 1980,
716 p.
- Contient une Bibliographie (pp. 645-657) et un Vocabulaire
philosophique (pp. 659-716).
TOSEL,Andr, Le dveloppement du marxisme en Europe occidentale depuis
1917, Histoire de la Philosophie, Paris, Gallimard, Encycl. de la Plade,
1974, t. III, pp. 902-1045.
TOSEL, Praxis. Vers une refondation en philosophie marxiste, Paris, d. soc.,
1974,313 p.
VADE, Michel, L'idologie, Paris, Presses Universitaires de France, 1973,
96 p.
B. Littrature marxienne trangre
Nous ne renvoyons videmment ici qu' une infime partie de la production
littraire mondiale sur Marx, Engels, et le marxisme. Le choix est forcment limit et
indicatif: nous avons retenu les ouvrages les plus importants pour le genre de recherche
que nous avons faite. On en trouvera bien d'autres dans nos notes.
BLOCH, Ernst, Das Prinzip Hoffnung [Le principe esprance], [1959], trad.
fran., Paris, Gallimard, 1959.
COHEN, G. A., Karl Marx's Theory of History, A Defence [La thorie de
l'histoire de Karl Marx, Une dfense], Oxford, Clarendon Press, 1979,
396 p.
Gramsci dans le texte, Recueil sous la diT. de F. Ricci, trad. J. Bramant et al.,
Paris, d. soc., 1975, 797 p.
KAPP, Yvonne, Eleanor [MARX], Chronique familiale des Marx, trad. de
l'anglais par O. Meier, Paris, d. soc., 1980,377 p.
LNINE, Vladimir Ilitch, Karl Marx et sa doctrine, Paris, d. soc, 1971,218 p.
516 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
LNINE, uvres, t. 38: Cahiersphilosophiques, Paris/Moscou, d. soc./d. du
Progrs, 1971,607 p.
LNINE,Textes philosophiques, Introd. B. Henry, trad. S. Pelta, Fr. Sve, Paris,
d. soc., 1978,351 p.
LUKACS,Georg, Histoire et conscience de classe, trad. K. Axelos et J. Bois,
Paris, d. de Minuit, 1960, 383 p.
LUKACS,Ontologie de l'tre social, trad. fr., Paris.
Marx, sa vie, son uvre, par P. Fdosev et al., Prsentation de Victor
Kousiakov, Traducteur non indiqu, Moscou, d. du Progrs, 1973,
670 p.
NICOLAIEVSKY, Boris, MAENSCHEN-HELFEN, Otto, Karl Marx, trad., Paris,
Gallimard, nouv. d. augm., 1970 (Biographie de Karl Marx).
MEHRING, Franz, Karl Marx, Histoire de sa vie, trad. et Avant-Propos,
J. Mortier, Paris, d. soc. 1983,600 p.
MEHRING,F., Vie de Karl Marx: Mai I8I8-Fvrier 1848, trad., notes et Avant-
Propos de G. Bloch, Paris, d. Pie, 687 p.
-
Chaque chapitre de cette trad. du texte de Mehring est suivi de notes rudites trs
dveloppes et documentes, souvent de toute premire importance.
-
Ce premier
volume doit tre suivi d'un second couvrant la priode 1848-1883de la vie de Marx.
PRAWER,S. S., Karl Marx and World Literature [Karl Marx et la littrature
universelle], Oxford, University Press, 1976,446 p.
ROSDOLSKY,Roman, Zur Entstehungsgeschichte des Marschen Kapital,
Frankfurt, Europasche Verlagansta1t, 1968,2 t.; trad. fr. du t. I: La gense
du Capital de Karl Marx, par J.-M. Brahm et C. Colliot- Th1ne, Paris,
Maspro, 1976, 398 p.
ROSENTHAL,Mark, M., Les problmes de la dialectirJue dans Le capital de
Marx, Moscou, Ed. en langues trangres; Paris, Ed. soc., 1959,485 p.
WOOD, Allen W., Karl Marx [en anglais], London, Routledge and Kegan Paul,
1981,282 p.
ZELENY, Jindrich, Die Wissenschaftslogik bei Marx und das Kapital [La
logique de la science chez Marx et Le capital], traduit du tchque en
allemand par P. Bollhagen, Berlin, Akademie Verlag, 1968,333 p.
IV. uvres d'Aristote et de Hegel
A. ARISTOTE
De l'Ame, trad. nouv. et notes par J. Tricot, Paris, Vrin, 1947,236 p.
BIBLIOGRAPHIE
517
thique Nicomaque, nouv. trad. avec introd., index et notes, par J. Tricot,
Paris, Vrin, 1959,540 p.
De l'Interprtation, in Organon, 1er voL, nouv. trad. et notes par J. Tricot,
Paris, Vrin, pp. 77-155.
La Mtaphysique, nouv. d. revue, avec commentaire par J. Tricot, Paris, Vrin,
2 t., 878 p.
Les Mtorologiques, nouv. trad. et notes par J. Tricot, Paris, Vrin, 300 p.
La Politique, L I et II, texte tabli et trad. par J. Aubonnet, 2e d. rev. et
corrige, Paris, Les Belles Lettres, 1968, (1re d. 1960], 177 p. [texte grec en
regard, 95 p.]
Les Premiers Analytiques, in Organon (Ille Liv.), vol. 2, nouv. trad. et notes par
J. Tricot, Paris, Vrin, 1947,335 p.
La Rhtorique, texte et trad., par J. Voilquin et J. Capelle, Paris, Garnier, s. d.
Trait sur les Parties des Animaux, Liv. 1er, Texte et trad., avec Introd. et
commentaire par J.-M. Le Blond, Paris, Aubier (Montaigne), 1945,205 p.
B. HEGEL, Georg W. F.
1807. La phnomnologie de l'esprit, trad. de J. Hyppolite, 2 tomes, Paris,
Aubier Montaigne, 1939,358 et 359 p. (Abrg en Phnomnologie).
1807. La phnomnologie de l'esprit, Prface, bilingue, trad., introd. et notes
par J. Hyppolite, Paris, Aubier Montaigne, 1966,224 p.
1807. Le savoir absolu (chap terminal de la Phnomnologie], bilingue, introd.,
trad. et commentaire par B. Rousset, Paris, Aubier Montaigne, 1977,252 p.
1812. Science de la logique, 1er tome en 2 livres, trad. prsent. et notes par
P.-J. Labarrire et G. Jarczyk, Paris, Aubier Montaigne, 1972 et 1976, resp.
414 et 355 p.
1816. Science de la logique, 2e tome, mme traducteurs, mme diteur, 1981,
464p.
1817-1827-1830. Encyclopdie des sciences philosophiques, 1, La science de la
logique, Texte intgral prsent, traduit et annot par Bernard Bourgeois
(texte des d. successives de 1817, 1827 et 1830, avec les Additions), Paris,
Vrin, 646 p. Abrg en Encyclopdie (trad. Bourgeois)>>.
1819-1830. Leons sur l'histoire de la philosophie, trad. et notes par P.
Garniron, Paris, Gallimard; La philosophie grecque, t. 3, 1972, pp. 383-619,
et t. 4, 1975, pp. 623-978. (Titre abrg en Leons.)
1821. Principes de la philosophie du droit, trad. par Andr Kaan, prf. par
J. Hyppolite, Paris, Gallimard (Ides), 1940,380 p.
1822. La raison dans l'histoire [Introduction aux Leons sur la philosophie de
l'histoire], trad. nouv., introd. et notes par K. Papaioannou, Paris, Union
Gnrale d'ditions (10/18), 1965,311 p. .
1830. Prcis de l'encyclopdie des sciences philosophiques, trad. par J. Gibelin,
Paris, Vrin, 1967,320 p.
1830. Encyclopdie des sciences philosophiques en abrg, trad. par M. de
518 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Gandillac sur le texte tabli par F. Nicolin et O. P6ggeler (d. Meiner, 1959),
Paris, Gallimard, 1970,550 p. (Titre abrg en Encyclopdie.)
1832. Science de la logique, trad. intgrale par S. Janklvitch, Paris, Aubier
Montaigne, 2e d., 1969; t. 1, 194 p.; t. 2, pp. 195-438; t. 3, 238 p.; t. 4,
pp. 239-573.
V. Revues, encyclopdies, dictionnaires
Nous mentionnons les principaux ouvrages gnraux et revues auquels nous nous
sommes rfrs dans notre texte et nos notes.
Dictionnaire critique du marxisme, sous la dir. de Georges Labica et Grard
Bensussan, 2e d. refondue et augmente, Paris, Presses Universitaires de
France, 1985 (1re d., 1982).
Dictionnaire gnral des sciences humaines de Georges Thins et Agns
Lempereur, Paris, ditions universitaires, 1972.
.
Enciclopedia Italiana, Roma, Di Scienze, Lettere ed Arti, 1949.
Encyclopedia of Philosophy [Encyclopdie de la philosophie], d. par Paul
Edwards, New York/Londres, Macmillan, vol. 1-6, 1972.
Encyclopiidisches Worterbuch der franzosichen und deutschen Sprache, de Sachs
et Villatte, Hand and Schule Ausgabe, Berlin, Langenscheidt'sche Verlags-
Buchhandlung, 1884.
Histoire de la philosophie, par Henri Brhier, Paris, Presses Universitaires de
France, 1red. 1937,2 tomes en 7 fascicules.
Histoire de la philosophie, Paris, Gallimard, Encyclopdie de la Plade:
vol. 1: Orient-Antiquit-Moyen Age, sous la dir. de Brice Parain, 1969.
vol. 3: Du XIXesicle nos jours, sous la dir. d'Yvon Belaval, 1974.
Histoire de la science, sous la dir. de Maurice Daumas, Paris, Gallimard,
Encyclopdie de la Plade, 1957.
Histoire des sciences, sous la dir. de Ren Taton, Paris, Presses Universitaires
de France, t. 3, 1ervol.: Le XIXesicle, par F. Abelis et alii, 1961.
Histoire des techniques, sous la dir. de Bertrand Gille, Paris, Gallimard,
Encyclopdie de la P1ade, 1978.
La pense, Revue du rationalisme moderne (Sciences, Arts, Philosophie),
Paris, SEPIRM (distribution Messidor - S.O.D.1.S.).
Philosophisches Worterbuch, sous la dir. de Georg Klaus et Manfred Buhr,
BIBLIOGRAPHIE 519
We d. revue et augmente, Leipzig, VEB Bibliographisches Institut, 1974,
en 2 tomes.
Recherches Hgliennes, Bulletin du Centre de Recherche et de Documentation
sur Hegel et sur Marx, Universit de Poitiers, C.N.R.S. (17 numros depuis
1970; non priodique, non commercialis).
Thals, Recueil des travaux de l'Institut d'Histoire des Sciences de l'Universit
de Paris, Paris, Presses Universitaires de France.
Vocabulaire technique et critique de la philosophie, sous la dir. de Andr
Lalande, 7e d., Paris, Presses Universitaires de France, 1950.
INDEX DES NOMS DE PERSONNES
Outre les noms de personnes, sont mentionns les noms d'coles et de
courants philosophiques. Les noms de personnes imaginaires ou mythiques
sont distingus par une typographie diffrente. d. signifie diteur,
trad." traducteur",
n." notes
".
A
ACHENWALL,199 (n. 25).
Achille, 129.
Adam, 470.
AGRIPPA, Menenius, 88.
ALCOUFFE,202 (n. 82).
ALEXANDRE le Grand, 325, 341, 486
(n. 82).
Alexandrie (cole d'-), 363 (n. 101).
ALTENSTEIN,259 (n. 140).
ALTHUSSER,43, 73 (n. 27), 79,106 (n. 1,6,
12), 107 (n. 21), HO (n. 71), H6, 261
(n. 178), 268, 359 (n. 10), 370
(n. 195), 412 (n. 74), 473, 482 (n. l,
5), 485 (n. 67).
ALTHUSSER et alii, 370 (n. 195), 412
(n. 74).
AMPRE, 70.
ANDREAS, 258 (n. 119).
ANIKINE, 106 (n. 5).
ANNENKOV, 262 (n. 193),262 (n. 194).
ANTIPATROS, 363 (n. 100).
ANTIPHlLOS, 333-335, 363 (n. 100), 364
(n. 103).
Apollon, 188.
ARCHIMDE, 346.
ARISTOTE,8, 21, 23-26, 30, 32, 34 (n. 19,
22, 23), 126, 158 (n. Ill), 216, 226-
228, 230, 256 (n. 83), 264, 275-277,
280-281, 302 (n. 33, 34, 44), 303
(n. 51, 54, 57), 304 (n. 70), 311, 313,
320-350, 360 (n. 33, 39-41), 361
(n. 41, 47, 49, 53, 57, 58), 362 (n. 66,
72, 75, 80), 363 (n. 86, 94), 364
(n. 102, 103, 106, 109, 112, 114), 365
(n. ll7, ll8, 122, 124, 125, 127, 128),
366 (n. 130, 132-134), 367 (n. 147-
149, 153, 155), 368 (n. 159), 375,412
(n. 78), 433, 461, 469, 475-478, 484
(n. 48), 488 (n. 96, 101, 104),495,500
(n. 2), 503.
AssouN, 155 (n. 54).
AUBENQUE,280, 303 (n. 54), 360 (n. 40),
361 (n. 57), 365 (n. 122, 124, 127,
128), 366 (n. 137), 367 (n. 148), 369
(n. 170).
AUBONNET,362 (n. 66,68).
AUGUSTE,157 (n. 88).
AUGUSTIN(Saint -),336-337.
AUNE, 33 (n. 18).
AVEUNGEleanor (fille de Marx), 285.
B
BABBAGE,381, 382, 386, 410 (n. 30, 31),
4H (n. 40, 50).
522 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
BACHELARD, 18, 33 (n. 4), 39, 72 (n. 2),
154 (n. 39), 501 (n. 9).
BADIA (trad.), 110 (n. 73, 74).
BADIA et alii, 256 (n. 93), 448 (n. 65).
-
(Cf. aussi COHEN-SOLAL et BADIA, et
HUSSON et BADIA.
BAILEY, 337, 364 (n. 112),487 (n. 84,93).
BAILLY (trad.), 360 (n. 37).
BAKOUNINE, 111 (n. 86), 257 (n. 100).
BALIBAR, 292.
BALZAC, 301 (n. 17),352,373.
BASTIAT, 108 (n. 41), 332, 346.
BAUER, Bruno, 59,121-122,179,215,239,
259 (n. 140),260 (n. 170, 171),344,
351, 353, 366 (n. 134), 367 (n. 144,
151),367 (n. 151), 370 (n. 186), 377,
450,455,473,486 (n. 73), 488 (n. 99).
BAUER, Edgar, 486 (n. 73).
BAYLE, 337.
BECKER-FREYSENG, 34 (n. 24), 304
(n. 70), 368 (n. 159).
BECKMANN, 410 (n. 28).
BEKKER, 366 (n. 137).
BENARD, 158 (n. 102).
BENTHAM, 463.
BERGSON, 268, 492-493.
BERLIN, 33 (n. 5).
BERNARDClaude, 65, 69-70, 78 (n. 109-
Ill).
BERNOUILLI Jacques, 198 (n. 10).
BERNSTEIN, 40, 304 (n. 73).
BERTRAND,201 (n. 58).
BIDET, 110 (n. 71, 75, 78), 283, 284, 285,
288, 302 (n. 45), 303 (n. 46, 66, 67),
304 (n. 71,75).
BIENAIM, 185.
BIESE, 363 (n. 94).
Bible (La -),379,409 (n. 20).
BLOCH Ernst, 33 (n. 18), 487 (n. 84), 501
(n. 20).
BLOCH Grard, 259 (n. 140, 145), 487
(n. 84).
BLOCH Joseph, 53-4, 58, 74 (n. 57), 75
(n. 64), 198 (n. Il).
BLOCH Marc, 156 (n. 66).
BLOCH Olivier, 260 (n. 152),487 (n. 84).
BOCE, 34 (n. 24).
BOLL, 198 (n. 10).
BOLZANO, 78 (n. 114).
BONITZ, 368 (n. 159).
BORGlUS, 53, 55, 75 (n. 67).
BOTTIGELLI, 370 (n. 195), 473, 482 (n. 1),
485 (n. 68), 487 (n. 84); (trad.), 200
(n. 40), 306 (n. 114), 364 (n. 109).
BOUILLET, 70, 78 (n. Ill).
BOUKHARINE, 73 (n. 24), 67 (n. 83).
BOURDIN, 15.
BOURGEOIS, 369 (n. 172).
BRANDIS, 366 (n. 136).
BRAY, 369 (n. 179).
BREHIER, 365 (n. 127).
BROCKER, 34 (n. 24).
BROGLIE, Louis de -, 107 (n. 22).
BROSSES Charles (de -), 59, 76 (n. 78).
BROUCKERE (de -), 201 (n. 62).
BRUNELLE, 70, 78 (n. 109, Ill, 115).
BCHNER Ludwig, 43, 243, 325, 361
(n. 49).
BUHR, 15.
BUHR et KLAUS (d.), 292.
BUNGE, 152 (n. 3), 154 (n. 39), 157 (n. 94),
501 (n. 9).
BURKE, 104-105, 177-178.
C
CABANIS, 153 (n. 31), 246.
CABET,471.
CALOGERO, 33 (n. 18).
CALVEZ, 41, 73 (n. 27), 127, 268, 301
(n. 15), 370 (n. 195), 472, 473, 482
(n. 5), 487 (n. 84), 503.
CAMPANELLA, 328.
CANGUILHEM, 188, 203 (n. 85), 214, 254
(n. 38),410 (n. 36).
CAREY, 174.
CARLYLE, 155 (n. 64).
CASAUBON (d.), 366 (n. 134).
CERVANTES, 128.
CESAR (Jules
-
), 412 (n. 68).
CHALMERS, 153 (n. 29).
CHAMBRY (trad.), 363 (n. 90).
CHEVALIER,331.
CHRYSIPPE, 34 (n. 19).
ClCERON, 34 (n. 19),333,367 (n. 155),488
(n. 97).
CLAUSSEN, 413 (n. 80).
COGNIOT (trad.), 157 (n. 82).
COHEN G. A., 261 (n. 183), 296, 398, 412
(n. 75),413 (n. 78).
COHEN-SOLAL et BADIA (trad.), 77 (n. 92-
93), 200 (n. 52), 204 (n. 106), 253
(n. 17).
COLETTI, 76 (n. 83).
INDEX DES NOMS DE PERSONNES 523
COMTE(Auguste -), 67, 70, 107 (n. 33),
152 (n. 1), 173,225,236,448 (n. 90).
CONDORCET,172, 225, 236, 238.
CONRING, 199 (n. 25).
CONRY,260 (n. 162).
CONSTANT,59, 76 (n. 78).
Copenhage (cole de -), 158 (n. 95).
CORNU, 202 (n. 71), 259 (n. 140), 361
(n. 48), 366 (n. 133, 136), 370
(n. 195),411 (n. 47), 412 (n. 63),485
(n. 68).
COTTEN,261 (n. 178).
COURNOT, 150, 151, 158 (n. 109, 111,
112), 202 (n. 75).
Crevel, 369 (n. 176).
CROCE, 40, 150, 158 (n. 104, 106).
CROMPTON,483 (n. 25).
CTESIBIOS,363 (n. 101).
CUVIER, 244, 346.
D
DALTON, 86, 335.
DANGEVILLE(trad.), 362 (n. 70).
DANIELS,367 (n. 140).
DARMOlS, 180, 199 (n. 28), 200 (n. 42),
201 (n. 58).
DARWIN, 180, 201 (n. 60), 243-245, 257
(n. 118),260 (n. 156), 325, 378.
DECHAMBRE,78 (n. 115).
Ddale, 332.
DEMOCRITE,24, 29-30, 252, 335-337, 340,
345, 361 (n. 47), 450, 474, 476-480,
486 (n. 81, 83), 487 (n. 84, 95, 97),
488 (n. 94,96, 100, 101).
DENIS, 106 (n. 5), 110 (n. 71, 75), 111
(n. 79, 84), 152 (n. 4), 256 (n. 81).
DERHAM, 199 (n. 25).
DESCARTES,34 (n. 24), 185,268,284,342,
365 (n. 129).
DESTTUT de TRACY, 297, 307 (n. 130,
131).
D'HoNDT, 8, 15, 109 (n. 62), 155 (n. 58),
301 (n. 21), 364 (n. 113),370 (n. 195),
409 (n. 2,7),501 (n. 19).
DIDEROT,43, 115, 153 (n. 31),154 (n. 31).
DIELS (d.), 364 (n. 112).
DIODORE CRONOS, 24, 34 (n. 21).
DIOGENE LARCE, 335, 364 (n. 107),
479 *, 487 (n. 96).
DOCKES, 110 (n. 75), 156 (n. 66).
Don Quichotte, 128.
Doz (cf. DUBARLE et Doz).
DRAY, 77 (n. 107).
DUBARLE et Doz, 369 (n. 166).
DUHEM, 107 (n. 22).
DHRING, 52, 77 (n. 97), 176, 330, 362
(n. 80).
DUMENIL, 81-85, 101, 106 (n. 12-13), 107
(n. 16,20,21,27), 149, 158 (n. 101).
DUNOYER, 301 (n. 17).
DUPIN Charles, 301 (n. 17).
DUTENS (d.), 78 (n. 114).
E
J;:CCARIUS, 289, 305 (n. 93).
Ecole de Copenhague (voir Copenhage).
~co1e d'Alexandrie (voir Alexandrie).
Editeurs des Grundrisse, 362 (n. 70).
diteurs des Marx-Engels Werke, 177,
180, 258 (n. 133), 367 (n. 146), 370
(n. 201), 399,487 (n. 88).
diteurs de la MEGA. (Marx-Engels
Gesamtausgahe), 289, 366 (n. 137),
367 (n. 146), 487 (n. 88).
diteurs du Sachregister zU MEW
(Index), 155 (n. 57), 306 (n. 100).
EHLEITER,361 (n. 41).
EICHHORN,259 (n. 140).
EINSTEIN,107 (n. 22), 267.
Elates (Les -), 24, 336.
ENGELS, 13-14,39-41,43-44,46,48,50-6,
58,60-5, 73 (n. 24-25,29, 31, 35), 74
(n. 52, 55-58), 75 (n. 67, 72), 76
(n. 82-86), 77 (n. 91, 97, 101, 105,
107),90-92, 104, 106 (n. 4, 7,9), 108
(n. 43-47), 110 (n. 71, 78), III
(n. 86), 112 (n. 95), 119-121, 133,
148, 153 (n. 15), 155 (n. 64), 157
(n. 82, 91), 175, 180, 198 (n. 2, Il,
15),199 (n. 24), 200 (n. 39),217,235,
241-245, 248-250, 255 (n. 48), 256
(n. 85, 93), 257 (n. 99), 258 (n. 119,
120), 259 (n. 141, 145, 148), 260
(n. 151),267,272-273,284,289,290,
301 (n. 4), 304 (n. 71), 305 (n. 85,90,
97, 98), 306 (n. 100, 102, 103), 325,
335, 336, 350, 361 (n. 52), 364
(n. 108, 109), 366 (n. 138), 370
(n. 194), 383, 384, 410 (n. 40), 413
(n. 99), 446 (n. 25), 456, 459, 460,
472,481,483 (n. 29),498,500,503.
EPICURE, 8, 21, 25, 29-30, 252, 324, 337,
340,341,345,358 (n. 3), 365 (n. 125),
450, 472, 474-481, 485 (n. 66), 486
524 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
(n. 75, 78, 79, 81, 83), 487 (n. 84, 89,
92, 94), 500 (n. 2).
picuriens (Les -), 148.
Er (mythe d'-le Pamphilien), 341.
ERDMANN Johannes (d.), 78 (n. Ill,
114).
ERMEN et ENGELS (Entreprise -), 200
(n. 39), 446 (n. 25).
ERSCH et GRBER, 70.
ESCHYLE, 476 (n. 79 bis).
EUBANKS, 503.
EUCKEN, 78 (n. 112).
EUSEBE,480*.
F
FAUST, 34 (n. 24), 304 (n. 70), 369
(n. 170).
FEDOSSEEVet alii, 366 (n. 136), 367
(n. 145).
FESTUGIERE,365 (n. 124).
FEUERBACHLudwig, 43, 52, 65, 121-122,
153 (n. 31),157 (n. 88),179,180,215,
216, 239, 243, 256 (n. 90), 258
(n. 134), 260 (n. 170, 171), 354, 355,
361 (n. 48), 367 (n. 151),370 (n. 194),
378,451,462,499,500 (n. 2).
FEUERBACHP. J. A., 78 (n. 114).
FICHTE, 122, 245, 328, 339, 357, 370
(n. 186,203), 371 (n. 204), 474, 486
(n. 72, 73).
FOURIER,Charles, 470-471, 485 (n. 57).
FOURIER, Joseph (mathmaticien), 199
(n. 28).
FRANKLIN, 327.
FREDERIC Ie Grand, 366 (n. 139).
FREILIGRATH, III (n. 86), 363 (n. 100).
FURIA et P.-Ch. SERRE, 156 (n. 66, 69).
G
GABAUDE, 487 (n. 84, 85, 93), 488 (n. 98).
GALILEE, 284.
GALTON, 200 (n. 42).
GANS, 366 (n. 134).
GARAUDY, 41, 473, 485 (n. 67).
GAUDEMET, 155 (n. 50).
GAUSS, 166, 198 (n. 10).
GAUTHIER, 369 (n. 166).
GENTILE, 150, 158 (n. 106).
GEHRARDT, 157 (n. 91).
GILLE, 156 (n. 66), 363 (n. 101), 364
(n. 101),410 (n. 23).
GOBINEAU, 77 (n. 97).
GODELIER, 255 (n. 48, 66).
GOETHE, 256 (n. 93), 311, 370 (n. 181,
201).
GOLDMANN, 149, 158 (n. 100).
GOULD, 316, 358 (n. 5),483 (n. 41).
GRAMSCI, 42,311,358 (n. 8).
GRANGER, 368 (n. 159).
GRAUNT, 199 (n. 25).
GRAY, 103, 112 (n. 108).
GROTIUS, 328.
GROVE, 288, 305 (n. 90).
GRBER (cf. ERSCH et GRUBER).
GUERY, 386, 388, 410 (n. 32, 37), 411
(n. 41, 43,52).
GUIZOT, 78 (n. Hl), 122,236.
GURWITCH, 254 (n. 22).
H
HAARSCHER,358 (n. 5), 359 (n. 8).
HAECKEL,44, 52, 73 (n. 31), 243.
HALBWACHS, 201 (n. 58).
HAMELIN,368 (n. 159).
HANKINS, 199 (n. 25),201 (n. 58).
HARTMANN,339, 365 (n. 119).
HEGEL, 8, 17,20-23,25-26,33 (n. 2, 7), 34
(n. 27), 42-43, 47, 52, 55, 57, 59, 67,
70-71, 76 (n. 83), 77 (n. 106), 78
(n. 113), 81, 106 (n. 8), 110 (n. 73),
111 (n. 86), 122, 123, 126, 146, 151,
153 (n. 31), 154 (n. 32, 42), 155
(n. 54), 156 (n. 74), 157 (n. 93), 215,
216,227,236,238-241,245,249,254
(n. 40, 46), 255 (n. 78), 258 (n. 126,
134), 259 (n. 135), 261 (n. 184), 264,
279, 284, 300 (n. 4), 311, 314-316,
320, 322-328, 337-340, 342-357, 359
(n. 12, 19), 364 (n. 114), 365 (n. H5,
118, 119),366 (n. 130, 131, 136),367
(n. 145, 151, 155, 158), 368 (n. 163),
369 (n. 166, 172), 370 (n. 186, 189,
194, 195, 198, 200), 409 (n. l, 7, 8,
16),433,449,450,459,462,473-475,
482 (n. 1),483 (n. 19),486 (n. 78, 79,
81), 487 (n. 84), 488 (n. 101), 491,
495, 500 (n. 5),501 (n. 19), 503.
Hgliens (Les Jeunes -), 109 (n. 70),
238, 245, 259 (n. 140), 260 (n. 167),
353, 367 (n. 155),475,486 (n. 73).
HEIDEGGER, 301 (n. 12).
HEINE, 367 (n. 145).
HEINZEN, 104.
INDEX DES NOMS DE PERSONNES 525
HELMHOLTZ,300 (n. 4).
HELvETruS, 41, 153 (n. 31).
HENRY, 109 (n. 63), 116,268,307 (n. 135),
308 (n. 135),315,316,358 (n. 5), 359
(n. 8, 14, 16, 22), 410 (n. 32), 486
(n. 74).
Hphastos, 332.
HERACLITE, 264, 324, 328, 342, 364
(n. 112).
HERON d'Alexandrie, 363 (n. 101), 364
(n. 101).
HERSCHEL,202 (n. 76).
HESS, 361 (n. 48), 367 (n. 145).
HEYDEN, 292, 293, 413 (n. 96).
HOBBES, 198 (n. 17),304 (n. 72), 328.
HOBSBAWN,156 (n. 67),254 (n. 31),418.
HOFMANN, 157 (n. 91).
HOFFMANN,Piotr, 359 (n. 18).
HOFFER, 360 (n. 41).
.
HOLBACH (le Baron d'-), 41, 43, 72
(n. 1), 153 (n. 31),243,246, 325, 367
(n. 145), 462.
HOMERE, 129, 364 (n. 112).
HONNEGER,409 (n. 21).
HOOK, 42.
HUGO (Victor -),155 (n. 64).
HUME, 107 (n. 33).
HUSSERL, 152 (n. 2).
HUSSONet BADIA(trad.), 259 (n. 138).
HYPPOLITE,370 (n. 195).
I
Idologues (Les), 184,451.
Iris, 107 (n. 32).
IRMSCHER, 35 (n. 34), 361
(n. 134).
(n. 41), 366
J
JACOB, Franois, 106 (n. 2).
JACOT, 110 (n. 75), 254 (n. 19).
Jhovah, 470, 472.
JONES, 301 (n. 17).
JOULE, 300 (n. 4).
JOZEWICZ, 200 (n. 41).
JUSSIEU, 325.
K
KANT, 34 (n. 20, 24),.70, 72 (n. 1), 73
(n. 37), 78 (n. 111-112), 139,245,261
(n. 184), 339, 348, 360 (n. 28), 371
(n. 204), 474, 486 (n. 72), 488 (n. 98).
KAUFMANN, 57,75 (n. 73,74).
KAUTSKY, 40, 42, 73 (n. 24), 258 (n. 133).
KEDROV, 364 (n. 107), 483 (n. 13).
KEKULE, 335.
KEYNES, 201 (n. 58).
KLAUSS (cf. BUHR et -).
KLEMM, 156 (n. 66).
KOPPEN, 344, 366 (n. 139), 486 (n. 73).
KOSOK, 369 (n. 166).
KROBER, 27-28, 42.
KRGER, 361 (n. 41).
KUGELMANN, 96-98, 110 (n. 72-73), 111
(n. 78), 172, 180, 201 (n. 56), 361
(n. 49).
L
LABICA, 359 (n. 10), 500 (n. I).
LABRIOLA,40, 149, ISO, 158 (n. 103, 104),
205, 226.
LA CHTRE, 76 (n. 77),258 (n. 121).
LACOMBE, 40.
LACROIX, 199 (n. 28).
LAFARGUELaura (trad.), III (n. 87).
LAFARGUEPaul, 40, 60, 64, 76 (n. 80), III
(n. 87).
LALANDE, 72 (n. 1), 77 (n. 109), 78
(n. 113).
LANGE, 74 (n. 53), 104,243,257 (n. 118).
LAPLACE,70, 72 (n. I), 109 (n. 57), 139,
156 (n. 76), 158 (n. Ill), 185, 187,
198 (n. 10), 199 (n. 28), 268.
LASSALLE,52, 76 (n. 80), 259 (n. 139),
324.
LAURENT,157 (n. 91).
LAVOISIER, 176.
LAVROV,74 (n. 53).
LE BLOND,256 (n. 83), 358 (n. 7).
LEFEBVREJean-Pierre, 292, 305 (n. 86),
307 (n. 123),414 (n. 101);
-
(trad.):
33 (n. 16, 17), 108 (n. 39), 112 (n. 95,
101), 152 (n. 8), 154 (n. 43), 155
(n. 57, 58), 156 (n. 77), 283, 302
(n. 35),303 (n. 46),414 (n. 114).
LEFEBVRE Henri, 42, 253 (n. 3), 306
(n. 121).
LEIBNIZ, 34 (n. 20, 24), 65, 72 (n. 1), 78
(n. Ill, 114), 126, 261 (n. 186), 265,
270,365 (n. 119), 366 (n. 134).
LEMPEREUR(cf. THINESet -).
526 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
LENINE, 73 (n. 24), 77 (n. 106), 489, 500
(n.2).
LESSING, 367 (n. 145).
LESTER, 199 (n. 26).
LEUCIPPE, 24, 335, 486 (n. 81),487 (n. 84).
LEVI-STRAUSS, 311.
LIEBIG, 157 (n. 91).
LINGUET,79.
LINNE, 325.
LITTRE, 15 (n. 2), 262 (n. 193), 264, 300
(n. 1).
LIVET, 360 (n. 28).
LI VIGNI, 15.
LORIA, 64, 77 (n. 105).
LOUIS-PHILIPPE, 369 (n. 176).
LUCRECE, 232, 257 (n. 106), 480, 487
(n. 84).
LUKACS,76 (n. 82,83), 368 (n. 162).
Lumires (Les - dans l'Antiquit), 340,
475, 486 (n. 79).
Lumires (Les - au XVIIIeS.), 67-68, 123,
184,225,249,342,357,462,473,486
(n. 72), 500 (n. 2).
LUPORINI,33 (n. 6).
LUTHER,362 (n. 82).
M
MAAREK, 106 (n. 5), 252 (n. 1), 253 (n. l,
9).
MAC CULLOCH, 198 (n. 21).
MAC GREGOR, 198 (n. 21).
MACHEREY, 292, 412 (n. 74).
MACHIAVEL, 328.
MANSCHEN (cf. NIKOLAIEVSKY et -).
MAGALHAS-VILHENA, 363 (n. 100).
MALON, 73 (n. 31),201 (n. 56).
MALTHUS, 100-102, 105, III (n. 91), 112
(n. 100, 105), 120.
Malthusiens (les -), 103.
MARCHAL, 152 (n. 4).
MARKOVITS, 487 (n. 84).
Matrialistes grecs (Les -),451,477,481.
Matrialistes franais (Les -), 109
(n. 57), 184, 261 (n. 175), 451, 487
(n. 92).
MATTHIEU (vangliste), 409 (n. 20).
MATTWITCH, 487 (n. 84).
MAUDSLEY, 119.
Mgariques (les -), 24-25, 348.
MEHRING, 74 (n. 58), 259 (n. 140, 145),
477-478, 487 (n. 84).
MENECEE,479.
Mercantilistes (Les -), 153 (n. Il).
MERCIER-JOSA, 359 (n. 8), 360 (n. 33),370
(n. 195).
METHAIS, 258 (n. 135).
MICHELET Karl, 343.
MIGNET, 122.
MILL James, 198 (n. 13),427,447 (n. 34).
MILL John Stuart, 419, 427.
MOIVRE(de -), 198 (n. 10).
MOLES CHOTT, 43, 243.
MOLINA, 74 (n. 54).
MOLITOR(d., trad.), 258 (n. 133), 367
(n. 146), 487 (n. 87)
MONGOLFIER, 263.
MONTESQUIEu,68, 122, 153 (n. 31), 216.
MOORE Samuel (trad.), 202 (n. 83).
MOZIN, 78 (n. Ill).
MUMFORD, 155 (n. 64).
MNSTER, 199 (n. 25).
N
NAVILLE,41.
Nopositivistes (Les -), 152 (n. 1).
NERUDA, Il.
NEUBAUER, 200 (n. 44), 503.
NEWTON, 72 (n. 1), 185, 199 (n. 26),284.
NIETZSCHE, 55.
NIKOLAIEVSKY et MAENSCHEN, 366
(n. 136).
o
OKEN, 199 (n. 32).
OWEN, 500 (n. 2).
P
PAPAIOANNOU (trad.), 34 (n. 25).
PAPE, 34 (n. 24).
P ARMENIDE, 24.
PARAIN, 156 (n. 66).
PASCAL, 364 (n. 107).
PASEMANN, 360 (n. 41).
PECQUEUR, 301 (n. 17).
PERICLES, 341.
PETTY, 176, 199 (n. 25),200 (n. 40), 293,
299.
PHILIPS, 305 (n. 90).
PHILONde Byzance, 363 (n. 101).
Physiocrates (les -), 153 (n. Il),293.
PIC de la Mirandole, 365 (n. 128).
PICASSO, 489.
INDEX DES NOMS DE PERSONNES 527
PIETTRE, 41.
PLAMENATZ, 485 (n. 52).
PLANTy-BoNJOUR,485 (n. 62).
PLATON,24, 32, 107 (n. 32), 261 (n. 186),
276, 302 (n. 34), 321, 330, 331, 339,
340-342, 361 (n. 53),362 (n. 79), 363
(n. 90), 364 (n. 112), 367 (n. 153),
477.
PLEKHANOV, 40, 42, 73 (n. 24), 77
(n. 105), 259 (n. 139).
.
PLUTARQUE, 336.
PODOLINSKI,272, 273, 302 (n. 27, 28).
POISSON,180, 198 (n. 10), 199 (n. 28),201
(n. 57).
PONNIER(d.), 486 (n. 85,86); (trad.), 365
(n. 130), 367 (n. 146),485 (n. 48), 487
(n. 84, 85, 87).
POPPE, 410 (n. 24).
POPPER, 42, 71, 73 (n. 19, 20, 27), 74
(n. 45), 93, 109 (n. 57), 214, 254
(n. 34), 261 (n. 179, 185), 268, 301
(n. 16),481,485 (n. 63).
Positivistes (Les -),152 (n. 2),175.
PRAWER, 108 (n. 51), 363 (n. 100), 370
(n. 181,201).
PRIGOGINE et STENGERS, 369 (n. 165).
Procuste, 482.
Promthe, 475.
PROUDHON,49, 52, 59, 64, 95, 103, 105,
112 (n. 107, 108), 217, 248, 261
(n. 181),367, (n. 151),386,387,389-
390,392,411 (n. 55), 412 (n. 69).
Proudoniens (les -),112 (n. 116).
Pseudo-PLUTARQUE, (le), 487 (n. 96).
PYTHAGORE, 174, 340.
Pythagoriciens (les -), 340.
Q
QUESNAY,149, 158 (n. 102).
QUETELET, 163-166, 171, 173, 177-189,
194, 198 (n. 3), 199 (n. 25, 26, 28),
201 (n. 54-56, 58, 61-62), 202 (n. 65-
71,73-81,84-85),410 (n. 30).
R
REDING, 361 (n. 41).
REULEAUX, 413 (n. 80).
RENOUVIER, 487 (n. 84).
RICARDO, 29, 61, 95, 107 (n. 28), 110
(n. 71),111 (n. 84), 112 (n. 112), 118,
131, 133, 135, 152 (n. 7), 155 (n. 65),
241, 258 (n. 122), 259 (n. 144), 287,
328,405,407-408,420-424,427,436,
447 (n. 52).
RICARDO (cole de -), 213, 254 (n. 21).
RICCI, 364 (n. 113).
RITTER, 366 (n. 137).
RIVAUD, 368 (n. 159).
ROCHAS (Albert de -), 363 (n. 101).
ROSDOLSKY, 359 (n. 19).
ROSENTHAL, 370 (n. 195).
Ross, 360 (n. 40), 368 (n. 159).
ROSSI, 291, 301 (n. 17),306 (n. 104).
ROUSSEAU,95, 179, 236, 250, 328, 367
(n. 145),417,486 (n. 72).
ROUSSET(trad.), 370 (n. 198).
Roy (trad.), 33 (n. 16, 17),75 (n. 72), 101,
107 (n. 27, 39), III (n. 94), 112
(n. 99, 101, 116), 113, (n. 119), 152
(n. 8), 157 (n. 80, 82), 198 (n. 15),
279,285, 301 (n. 20, 21), 303 (n. 46),
304 (n. 74), 307, (n. 124),409 (n. 5),
414 (n. 113),446 (n. 8, 16),483 (n. 7).
RUBEL, 76 (n. 85), 200 (n. 44), 213, 304
(n. 73), 366 (n. 130), 367 (n. 147),
463, 483 (n. 28), 484 (n. 29), 485
(n. 48);
- et alii (d., trad.), 158
(n. 88), 256 (n. 93), 487 (n. 87), 503.
RUSSELL(Lord John -), 485 (n. 60).
s
SACHS et VILLATTE, 304 (n. 74).
SAINT-SERNIN, 158 (n. 97).
SAINT-SIMON, 153 (n. 26).
Saint-Simoniens (les -), 133, 366
(n. 136), 459.
SANNWALD, 360 (n. 41), 487 (n. 84).
SARTRE, 33 (n. 1), 40-42, 72 (n. 13), 73
(n. 27), 76 (n. 82-83), 260 (n. 163),
267, 268, 301 (n. 141), 307 (n. 135),
311,483 (n. 27).
SAY, 407, 423-424, 436, 446 (n. 20), 447
(n. 52).
Sceptiques (les -), 324, 340.
SCHELLING, 199 (n. 32), 301 (n. 7), 367
(n. 147),369 (n. 172).
SCHILLER, 157 (n. 91).
SCHMIDT, Conrad, 74 (n. 58).
SCHNEEBERGER, 34 (n. 24).
SCHOPENHAUER, 344.
SCHORLEMMER, 157 (n. 91).
SCHUHL, 332, 334, 363 (n. 95, 100).
528 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
SCHUMPETER,106 (n. 5), 152 (n. 4), 253
(n. 1),254 (n. 21).
SCHWENDLER, 254 (n. 44).
Scolastiques (les), 342,343.
SEIDEL, 360 (n. 41).
SEMMING, 325.
SENEQUE,486 (n. 75), 488 (n. *).
SENIOR,484 (n. 35).
SERREP.-Ch. (cf. FURIAet SERRE).
SERVET, 110 (n. 75).
SESEMANN, 304 (n. 70), 369 (n. 170).
SEVE,33 (n. 9), 370 (n. 184), 503.
SHAKESPEARE, 370 (n. 181).
SIMONDON,358, 371 (n. 206), 374, 409
(n.2).
SIMPLICIUS, 488 (n. 96, 100, et **).
SISMONDI,108 (n. 42), 213, 306 (n. 104).
SKARBEK, 388, 412 (n. 62,63).
SMITH,29, 61, 95,107 (n. 28), 107 (n. 33),
110 (n. 75), 118, 120, 132, 133, 152
(n. 7, 8), 153 (n. 14), 223, 254 (n. 21),
287, 289, 290, 301 (n. 17), 306
(n. 101), 328, 381, 385-387, 389,411
(n. 53), 412 (n. 55), 446 (n. 20), 470,
485 (n. 53).
Socialistes franais, 361 (n. 48).
Socialistes ricardiens, 213.
SOCRATE, 324, 341.
Sophistes (Les -), 341.
SORABJI, 368 (n. 159).
SOREL, 40, 482.
SOUILLE, 302 (n. 34).
SPENCER, 42, 44, 67.
SPINOZA, 20, 34 (n. 24),65, 72 (n. 1), 106
(n. 3,4),252,261 (n. 180),311,328,
350, 366 (n. 134), 451, 462, 488
(n. 101).
STALINE, 40, 60, 501 (n. 6).
STEININGER, 254 (n. 44).
STENGERS (cf. PRIGOGINE et -).
STEUART, 109 (n. 66).
STIRNER, 59, 73 (n. 37), 121-122, 153
(n. 25), 179, 239, 250, 251, 260
(n. 151, 167, 170, 171), 324, 351,
355, 367 (n. 151), 450, 455, 488
(n. 99).
STOBEE,487 (n. 96).
Stociens (les -), 25, 34 (n. 19), 340, 361
(n. 47), 476.
STORCH,388, 412 (n. 63).
STRAUSS, 65, 121,259 (n. 140).
SSSMILCH, 199 (n. 25).
SWEDENBORG, 346, 367 (n. 147).
T
TAINE, 70, 260-261 (n. 175).
TARDE,91.
TAYLOR, 409 (n. 16).
TEX 1ER, 158 (n. 99).
THIERRY, Augustin, 122,236.
THINES et LEMPEREUR, 306 (n. 106).
THOMASd'Aquin, 342, 361 (n. 41), 365
(n. 128).
THOMPSON, 301 (n. 17).
THUCYDIDE, 364 (n. 112).
TOOKE, 198 (n. 21).
TORRENS, 102..
TOSEL, 110 (n. 73), 359 (n. 9).
TOWNSEND, 102, 112 (n. 105).
TOYNBEE, 55, 472, 481, 485 (n. 63).
TREMAUX, 243-244, 260 (n. 154, 156,
160).
TRENDELENBURG, 337, 343-346, 366
(n. 140), 367 (n. 149).
TRICOT (trad.), 364 (n. 109),368 (n. 159).
TROTSKY, 73 (n. 24).
U
Ulysse, 129.
URE, 301 (n. 17),381,382,386,388-389,
410 (n; 32, 37),411 (n. 40, 41, 44,52).
UESENER(Ed.), 364 (n. 112).
V
VADEE, Michel, 109 (n. 51, 65), 359
(n. 15), 486 (n. 78), 488 (n. 99).
VADEE, Jeannie, 15.
VALERY, 17,501 (n. 12).
VELLEIUS, 488 (n. 97).
VERNANT, 363 (n. 96).
VICO, 67, 216, 236.
VICTORINUS, 368 (n. 159).
VILLATTE (cf. SACHS et -).
VILLERME, 155 (n. 64), 200 (n. 43).
VOGT, 43, 243.
VOLTAIRE, 236, 367 (n. 145),486 (n. 72).
VUlLLEMIN, 34 (n. 21).
w
WAGNER Adolphe, 159 (n. 112), 335, 346,
364 (n. 104).
WATT, 153 (n. 15).
529 INDEX DES NOMS DE PERSONNES
WESTPHALEN,Ludwig von -, 473.
WEYDEMEYER,172,305 (n. 93).
WILKINSON,153 (n. 15).
Wo1ffiens, (les -), 78 (n. 111).,
WOOD, 248, 251, 412 (n. 76), 469, 485
(n. 52).
WROBLEWSKI, IS.
WURTZ, 157 (n. 91).
x
XENOPHON, 330, 362 (n. 79), 364 (n. 112).
Z
ZASSOULlTCH, 232-234.
ZELENY, 370 (n. 186, 195).
ZOLA, 409 (n. 21).
-.
INDEX DES CONCEPTS
A
Abstraction, abstrait (cf. Concret, Conscience de soi, Rel): 27-29, 79, 80, 94-96, 1I8,
138,238-239,282,355-356; - objective: 430.
Accident: 87-88, 147-15l.
Accumulation:
-
de la valeur: 438,
-
de forces et moyens de production: 438; -
capitaliste (thorie): 422; - illimite (Ricardo): 422-424.
Achat (cf. changes).
Acte: 126:
-
de se poser soi-mme: 355-358 (cf. Position); tre en acte: 276, 280.
Action (cf. Conditions): 126, 229-231, 234, 31I, 350, 481; - historique: 49, 229, 256
(n. 93),490-491;
-
et intuition (= voir): 315-316;
-
politique: 234, 318;
-
rciproque: 44, 64, 81,141; - en retour: raction: 56,131; - rvolutionnaire:
19.
Activit: 21,49-51,69,225, 31I-322; 347-358, 478, 481; - aline: 321;
-
animale:
318;
-
et choses: 391, 396-399; - cosmique: 318; - et tre: 315-317;
-
finalise: 248, 375;
-
humaine: 313;
-
humaine sensible: 318; - intellectuelles:
471; - libre: 311, 320-321, 461-462, 464-472;
-
politique: 318, 481;
-
rvolutionnante: 245; -subjective: 318;
-
vitale: 313; facteurs objectifs de
1'-
: 373; philosophie de 1'-: 312.
Administration (cf. Gouvernement).
Affirmation de soi (cf. Auto-production, Homme, Sujet): 320, 356.
Agent: 315, 347-358;
-
historiques: 491;
-
physiques: 264.
Alination (cf. Objectivation): 50-51, 316, 317, 320-321, 352, 355-357,450-456,458;-
religieuse: 122.
Analogies: 87; - conomico-naturelles: 84-91, 270;
-
bio-sociologiques: 88, 225; -
historiques: 89; - mtaphysique: 336.
Analyse concrte: 63, 128.
Anarchie de la production ca.pitaliste: 91, 401.
Animal (Buf, Cheval, Cf. Energie): diffrence entre l'homme et 1'-: 375.
Antagonismes: 241.
Anticipations historiques: 130.
Antagonisme (cf. Classes, Contradiction, Lutte): 462.
Apparence: 61.
Argent:
- =
mesure de valeur: 330; - = moyen de circulation: 330; - = trsor: 330;
rle de l'argent dans les crises: 427, 430.
Aristotlisme: 343-347.
532 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Arithmtique: - politique: 176; formules, quations -: 175, 187-188.
Art grec: 129.
Asservissement (cf. Alination).
Atelier (cf. Division du travail, Manufacture): 387.
Atomisme antique: 335, 337, 476-477, 480;
-
moderne (en chimie): 335.
Auto-activit: 352,455,469; auto-alination 51,315; auto-changement: 245,280; auto-
cration de l'homme: 457; auto-dveloppement: 332; auto-diffrenciation: 44;
auto-mouvement (cf. Processus): 44; auto-production de l'homme: 321, 352, 355;
auto-subsistance: 221.
Autonomie relative: 56.
B
Barrire: 208.
Base (cf. Forme, Structure, Superstructure): 61, 123, 126-127, 141, 392-393;
-
concrte: 47;
-
conditionnante: 127-128;
-
dterminante: 127-1'28; - conomi-
que: 46-47, 61;
-
naturelle: 243-244;
-
technique; 143.
Besoins: 376;
-
potentiellement infinis: 421 ;
-
sociaux: 45-46;
-
solvables: 424,437;
-
historiquement variables: 230; diversit des -: 376; largissement des -
(cL Humanisation): 463; production des -: 228-231; travail =
premier besoin
vital: 469.
Bourgeoisie: 408, 417, 442-445, 454.
But, buts: 126, 248.
C
Capacit:
-
de production: 424;
-
de consommation: 424.
Capital: le
- =
sujet: 353, 455; - = assignation sur du travail futur: 431-432; loi du
-,401,421; dvalorisation du
-
(cf. Destruction).
Capitalisme: 251; but du -: 140,248,251,453; ct civilisateur du -: 408, 442, 452;
ct inhumain du -: 134-135,263,390,463,467.
Capitaliste: le -, antithse de l'avare: 431; le
-
industriel: 49, 128; le point de vue
capitaliste: 439.
Catgories gnrales (cf. Prsupposs): 239-240,389;
-
du marxisme: 21, 239,339;-
de Proudhon (cf. Atelier, Manufacture): 386-387, (cf. Division du travail) 389;-
aristotliciennes: 22-23,275-281, 290, 322, 337-339, 347; - hgliennes: 22-23,
279,290,323-324,338-339,476;
-
philosophiques
=
pauvrets idalises: 353.
Causalit:
-
conomique: 133-137, 392;
-
efficiente: 126;
-
immanente: 126;
-
rciproque: 53,126,130-131,138-140; termes exprimant la -: 124, 154 (n. 34).
Causalisme: 39,130,494.
Cause: 21; au sens de condition, au sens d'origine: 126; - productrice: 126; inversion
de la cause et de l'effet: 123.
Causes: 45, 68;
- accidentelles: 147-151;-
accidentelles des crises: 422; - actuelles:
131-132;
-
contraires: 207;
-
dterminantes: 45;
-
conomiques: 55, 69;
-
efficientes: 68;
-
essentielles: 136-137, 139, 149; - naturelles: 444;
-
de la
religion, de la philosophie, de l'tat: 123;
-
multiples: 139-146; concours de-
: 149-151; recherche des -: 480.
Cerveau: 266, 271, 274.
Changement (cf. Processus): 22, 49, 212, 280, 317; - historique: 99.
Christianisme, (cf. Critique religieuse, Religion).
Chose (cf. Forces, Objet): 393-399.
Chosit: 356-357.
Circonstances (cf. Concours des causes): 30, 62-64, 83, 87, 148-151, 207, 376;
-
INDEX DES CONCEPTS 533
singulires: 87; matrise des -: 461 ; rapport entre les - et les hommes: 245-246;
thorie matrialiste des -; 243-248.
Classe ouvrire: 451, 457, 497-500.
Classe rvolutionnaire: 398, 443-445.
Classes sociales (cf. Rapports sociaux), - sont des forces productives: 398; abolition
des -: 231; division des
-
(cf. Division du travail): 378, 388; existence des-:
236; luttes des -: 89-90, 231, 236-237, 312, 351, 439, 442-445.
Communisme: 246-247,251,442-445,467,472,489,495-500;
- n'est pas but, mais
moyen: 498-499; Ide et histoire du -: 444.
Communistes, matrialistes pratiques: 252, 260 (n. 174),378.
Composition organique du capital: 137-138, 141.
Comprhension rationnelle: 236-242.
Concret (cf. Abstrait, Analyse, Situation, Thorie, Rel): 28-32, 63, 128, 163,205, 234,
237.
Concurrence: 134-135,401,407,421.
Conditionn: 45; conditionner: 125; conditionalisme: 71.
Conditions (cf. Prsuppositions): 45, 62, 68,126; - artificielles (cf. Instruments, Outils,
Machines): 393; - de l'action et action: 231, 246; - et activit: 51; - de
l'histoire: 228; - historiques: 131, 140; - naturelles: 144,393; - naturelles de
l'histoire: 216-225; - ncessaires, mais non suffisantes: 434; - objectives: 282;
-
organiques: 131, 252; - de possibilit de l'histoire: 95; - subjectives
(sociales): 219-225; - socio-conomiques: 89.,
Connaissance exacte, rigoureuse: 237-238.
Conscience:
-
sociale: 120;
-
de soi: 246,473,475;
-
de soi singulire abstraite: 476-
482; dialectique de la
-
de soi (Hegel): 315, 474; prise de - (sociale): 87-88,443-
444, 496-500.
Conservation du pass (cf. Continuit, Succession, Travail pass): 405.
Contenu: 50,211; dialectique du - et de la forme: 98; (cf. Forme).
Contingence, contingent: 23-27, 34 (n. 21, 24), 82-83, 146-151, 157-158 (n. 95), 368
(n. 159);
-
des causes: 150;
-
sociale: 148.
Continuit (cf. Gnration, Succession); - historique: 250.
Contradiction: 27, 81, 128,208,213-214,224,253 (n. 12),389;
-
du capitalisme: 269,
420,436,441; - individuelle: 208; - interne: 208,420; -logique: 27-28;-
dialectique: 83,208,331; - de la valeur d'usage et de la valeur d'change: 431.
Contradictions (incohrences, laxisme) de Marx: 177, 180,213,214,222,234,248,283,
391,394,399,400,404,435.
Coopration (cf.: Division du travail): 380; - de machines: 405; possibilits de la-
: 119.
Correspondance: 127-129, 138; -, versus contradiction: 208, 253 (n. 12).
Cration (cf. Auto-cration, Production): 266,313,350,357; - de valeur, 191,281,
394, 404, 432.
Crise: 90, 210, 213-214, 312, 417;
-
du capital: 437-445;
-
gnrale, possible et
ncessaire: 417-419, 423-424, 442-445; - priodique: 90-91, 418;
-
possible
(potentielle),
-
effective (relle): 22, 419;
-
de surproduction, 407,421,423,436,
459; causes des -: 419, 425-430, 434; ngation de la possibilit d'une crise
gnrale; 424; possibilit des - (cf. changes); deux formes de possibilit des -
: 425-430; ralisation de la possibilit des -: 420.
Critique: 240, 259 (n. 140); analyse
-
du capitalisme: 93, 240; - de la dialectique:
344; - des conomistes: 139; - rationnelle (cf. Science): 240; - religieuse: 121-
123,340; mthode, manire -: 117, 118, 139.
Culture, formation ducation: 243-245, 271.
Cycle: 90-91,121,141-143,211-212; histoire cyclique: 67.
534 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
D
Darwinisme: 68,181,267; - social: 44, 52.
Degr (cf. Dveloppement).
Dpassement (dialectique): 27, 34 (n. 28), 51, 211.
Dpendance (cf. Correspondance): 61,127-130,138.
Destin: 205, 321.
Destruction: 401;
-
de valeur, de capital: 440-441.
Dtermination: 125, 127; - en dernire instance: 39, 52-56, 61, 131,212.
Dtermin (cf.: Contenu, Donn): 45, 61,125; sens du mot dtermin: 50, 51, 124-
125; dterminer (hestimmen): 124-125.
Dterminisme: 39, 473, 494; dfinition du -: 72 (n. 1);
-
dialectique: 42;
-
conomique: 43-48, 58;
-
historique: 40-42, 58; - laplacien: 39, 42, 139;
-
mtaphysique: 65, 66-67;
-
scientifique: 65,68-69;
-
social: 42; - technologi-
que: 389; emploi du mot
-
par Marx: 78 (n. 114),478,480,488 (n. 101); les
formes du -: 65-71; volution de Marx vers un -: 472-474, 480-481; historique
du mot: 69-72, 77-78 (n. 109, 111); le langage du -; 48-49, 65-66;
(cf.: Interprtation dterministe).
Dvalorisation (cf. Destruction de valeur).
Dveloppement (cf. Continuit, Gnrations): 22, 215, 249;
-
des forces productives:
457, 462; - historique: 205, 215, 217-218, 223, 225, 233-234, 250-252;
-
historique naturel: 252; - ingal: 129;
-
organique: 44;
-
de la socit: 57, 84;
-
technique: 133; degr de -: 46; plein
- des individus; 468.
Devenir (changement): 24-25, 322; philosophie du -: 96.
Dialectique: 26, 50, 53,221,237,283,315,319,395,397,440; - de l'acte et de la
puissance: 322,397; - de l'action et de ses conditions: 51,231,246-247;
-
de
l'alination et de la libration: 450-456;
-
du contenu et de la forme: 98; - de
l'tre et de l'activit: 315-316;
-
de la force et de son extriorisation: 265; - des
formes de la valeur: 97-99;
-
de l'homme et de la nature: 315, 317;
-
du matre
et du serviteur (Hegel): 355; - des moyens et des fins: 50, 248; - du ncessaire
et du possible: 494; - de la position et de la prsupposition: 126;
-
de l'universel
et du particulier: 97-98;
-
du sujet et de l'objet: 318-320, 397;
-
hglienne: 343,
347-358; - marxienne: 345-358; double -: 397; remettre la - sur ses pieds: 342;
unit -: 48 ; (cf. Contradiction, Dpassement, Matrialisme -).
Dictature du proltariat (cf. Domination politique): 472.
Dieux, dieu (cf. Thologie): 34 (n. 24), 340-342, 350, 475; le
-
du monde des
marchandises: 352.
Dignit humaine (cf. thique, Humanisation).
Disproportion, non-correspondance: 208.
Dissolution (cf. Destruction): 223-225.
Division sociale: 133.
Division du travail: 119, 133, 145, 148,381;
- d'Adam Smith: 385-386; -
subjective,
-
objective: 383; consquences de la -: 390; rle socio-historique de la -: 386,
387;
-
internationale du travail: 390; - sociale du travail: 388; - technique du
travail: 380.
Domestication: 376, 395.
Dominateur (Ie -, ou matre-argument de Diodore Cronos): 24, 34 (n. 21).
Domination politique, 417;
-
de la classe ouvrire: 442-445;
-
sociale du capital: 450.
Donn: 50.
Droit priv romain: 129; droits: 458.
Dualisme mtaphysique: 316.
Dynamique: 47; conception dynamiste: 265.
INDEX DES CONCEPTS
535
E
changes: sparation de l'achat et de la vente: 419; son rle dans les crises: 427-430.
conomie: 136, 141; double sens: 136; - anglaise: 52.
conomisme: 52, 64; (cf. Dterminisme conomique, Facteur conomique, Rduction-
nisme).
manation: 125.
mancipation (cf. Abolition, Domination, Libration, Matrise).
Empirique, empirisme: 239, 258-259 (n. 135),418.
picurisme: 340; Marx et 1'-: 474-482,486 (n. 82, 85), 495.
nergie physique (cf. Force, Force de travail): 265-266, 268, 379; - animale: 143,272,
274,379,392-393; - naturelles: 269, 393, 396.
En soi, tre en-soi (an-sick) (Hegel) (cf. tre en puissance): 22, 23, 25,151,278-279.
Entlchie (Aristote): 277.
Entendement: - ordinaire: 399.
Esclavage: 105,276,459;
-
antique: 250; thorie de 1'- chez Aristote: 332-334.
Esprit = march mondial: 349; - absolu (Hegel): 25, 349-350.
tat: 123,342,349: dprissement de 1'-: 459; formes d'-: 128.
ternisation (cf. Robinsonnades):
-
des lois: 95.
thique: 463.
tonnement: 88 (cf.: Science, Prise de conscience).
tre:
-
de la nature: 315;
-
social (cf. Vie): 47-48; - objectif: 256-358.
tre en puissance (au sens d'Aristote): 23, dfinition: 24-25, 276-282, 290, 394. (Cf. En
soi, tre-en-soi, Force de travail).
volution:
-
biologique: 80;
-
historique 67, 80, 223; - de la terre: 243-244; schma
gnral d'- historique: 232; la soi-disant
-
de l'esprit humain: 225.
volutionnisme: 44, 49, 67-68, 243-244; (cf.: Darwinisme, Dveloppement).
Exploitation (cf. Classes, Plus-value, Socits de classes): 378, 400, 451;
-
de la nature:
378.
Extriorisation: 48, 265, 320.
Extriorit: 48.
F
Fabrique: 134,379,405.
Facteur: 55-56, 136, 143;
-
conomique: 43, 136, 141;
-
technique: 388; autres
facteurs: 55-56; thorie des -: 143, 149.
Fatalisme, fatalit historique: 65, 93, 231 ; langage du fatalisme: 66, 231, 482.
Ftichisme (social): 59, 89, 317, 452 (cf. Mthode matrialiste).
Fins, fins (cf.: Activit, Dialectique, Libert, Moyens, Vie): 50,284; - en soi: 466;
polymorphisme des fins: 145;
-
de l'histoire: 249.
Finalisme: 226, 250-252.
Finalit (cf. Fonction, Instrument, Organe, Travail): 319; - mergente: 252; -
externe, - interne: 469; - en histoire: 232, 242, 248-252;
-
rtrospective: 250-
252.
Fonction (cf. Finalit, Organe): 126,249,375; - nergtique: 384; - de travail: 384;
analyse fonctionnelle: 384.
Fondement: 61.
Force (cf. nergie, Puissance): 21, 31-32, 44, 115,132,263-300,391; sens du concept de
force: 264-266, 391-399;
- =
cause: 266.
Forces (cf. Agent): - essentielles: 290;
-
naturelles: 268,290,291-300,376,391,397-
398;
-
vitale,
-
vivantes: 265, 290, 356-357;
-
vive (Leibniz): 270; limination
536 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
des -; 267; extriorisation de la -: 265; oubli des -: 268,292; gratuit des
-
naturelles: 399-402,405; rapport de -: 147,439.
Forces productives: 32, 263, 268, 291, 391-399; dfinitions des -: 292-293, 396-399;
-
naturelles: 291-300; lever la -: 140; tableau des -: 398; transmission des-:
250-252.
Force de travail: 265, 266-267, 269-275, 391;
-
simple, nue (cf. Ouvrier libre): 272-
275; - = tre en puissance: 275-282; mesure de la -: 272-273; sparation d'avec
les moyens de travail: 274-275,282,377; spcificit de la -: 271, 273; termes de
Marx pour force dans force de travail: 281-291.
Formation socio-conomique: 46-48, 61-62, 84.
Formes (cf.: Contenu):
- d'art: 129; -
de conscience sociales: 47 (cf.: Ides,
Idologie); - conomique (cf. Formation socio-conomique);
- d'tat: 128;
- idologiques (cf. Ides, Idologie): 59; -
des instruments: 376; - politique:
61-62;
-
possibles: 30-31, 62, 97-98; - de proprit: 217-224;
-
sociale: 50;
transformation de la -: 97.
Formel (oppos Matriel): 50.
Fortuit, fortuit, (cf. Hasard).
Futur (cf. Capital, Travail-): futurs possibles (<<contingents): 348.
G
Gense: 131-132, 146;
-
et dveloppement: 215, 223; - de la socit bourgeoise: 238.
Genre, unit gnrique: 336.
Gnrations: 250-252.
Gouvernement des hommes, administration des choses: 459.
Grand nombre: 150,178.
Guerre: 218.
H
Hasard, fortuit: 29-30, 146-15 l, 348;
-
et ncessit: 54-55, 150-151; justification du
-: 232; rle du
-
dans les crises: 419-420, 444; le
-
d'picure: 478-480; thorie
du
-
de Cournot: 150-151, 158-159 (n. 109, Ill, 112).
Hdonisme (cf. Utilitarisme): 463.
Histoire (cf. Processus, Universalisation): 215-225;
-
des hommes, - de la nature:
215-216;
-
et prhistoire, 467, 497; universelle: 238; - voulue, consciente: 494;
conditions de 1'-: 229; crire 1'-: 240; faire 1'-: 48; marche de l'histoire: 57-58;
. philosophie de 1'-: 121; point de vue historique: 131; reprsentations simplistes
de 1'-: 225-226.
Historicisme: 95, 96, 99, 232.
Historiographie: 60, 64, 240.
Homme: 315, 317;
-
alin,
-
rels: 355-358;
- =
tre de la nature: 356-358; l'-
comme genre (Feuerbach): 246; -, fabricant d'outils: 327; les - font l'histoire:
47-50,457,490-491; les -, individus concrets, dtermins: 355; -libre: 322, 334;
-, animal politique, social: 327; auto-production de ]'-:321, 355; conformation
biologique de 1'-: 270-271, 375; essence de
1'-
(Hegel): 354; 1'-, tre des
possibles: 492-495.
Humanisation, dshumanisation: 263, 462-464, 467.
Humanisme:
-
abstrait,
-
rel: 355,463-464,492.
INDEX DES CONCEPTS
537
I
Idalisme (cf. Ralisme): 241, 318, 461, 473; - absolu (Hegel): 323, 338, 342, 348-349,
354;
-
historique: 232,241-242;
-
subjectif: 477.
Ides, Idologie: 45, 46-48, 56, 59, 353; la lutte idologique autour d'Aristote en
Allemagne en 1830-1840: 343-347.
Identit dialectique (cf. Dialectique): 398,469.
Idologie:
-
allemande: 52; - franaise: 52;
-
religieuses: 340.
Illusions (cf. Ftichisme, Robinsonnades): 88, 226; - du capitalisme: 297, 405-406.
Inconscience: 316;
-
sociale: 48;
-
des lois: 86-87, 90-91 ; (cf. Ncessit inconsciente,
Prise de conscience).
Indtermination (indiffrence, possibilit bilatrale): 23-24, 148,348 (cf. Contingence).
Individualit: dveloppement de 1'-: 456,471.
Individus sociaux, - et classes (leurs rapports): 454, 471 ;
- =
but et fin dernire: 492,
498-499.
Influences historiques: 63.
Infrastructure, (cf. Base, Structure).
Instruments: 376;
-
d'action (Aristote): 302 (n. 33),332-334;
-
de production et-
d'action (Aristote): 375 (cf. Moyens de production, Outils, Machine).
Interaction: 141, 221.
Interdpendance: 44, 53, 81, 130, 139, 143,222.
Intrts (cf. Besoins sociaux): 137.
Interprtation:
-
d'Aristote: 324, 328-347;
-
d'picure: 474-482;
-
de Hegel
(cf. Catgories, Dialectique, Idalisme): 347-358.
Interprtations du marxisme;
-
dterministe: 20, 40,130,472; - historiciste: 21;-
pragmatique: 21;
-
scientiste: 40-41;
-
subjectiviste: 21;
-
thoriciste: 21
(cf. Ontologie du travail, Philosophie de la praxis).
Intuition (= voir) et action: 315-316.
Inventions: 403.
Inversion du sujet et du prdicat: 354-355.
Irrel: 23.
J
Journe de travail: diminution de la -: 454, 464-472.
L
Latent (cf. Puissance, En puissance, Virtuel).
Libralisme politique: 472.
Libration: 32,334,445,449,451,462,471,481-482.
Libert: 32,69,312,449; - = comprhension de la ncessit: 20, 460; la -l'emporte
peu peu sur la ncessit: 496; -
est sa propre fin: 449, 459;
=
libration: 449-
464,481;
- d'indiffrence: 148, 232; -
relle: 458;
-
et temps libre: 464-472;
-
vritable: 466; conception de la -: 472; conception idaliste de la -: 474;
conception de la
-
d'picure: 474-482; contenu de la -: 460-472; dfinitions
(matrialiste, idaliste) de la -: 461; justification de la -: 232; philosophie de la
-: 20,449,472,480-482; rgne de la -: 32, 312, 456-464, 464-472.
Limites:
-
naturelles: 378,400;
-
du capitalisme: 400,422;
-
de l'exploitation: 439;
-
du progrs: 300; - des rapports sociaux capitalistes: 437.
Logique:
-
aristotlicienne: 337, 343; - Marx: 81.
Loi, notion de loi: 45, 79-84,115; dfinition des
-:-:
80-81, 84; classification des -: 83-
84; varits des -: 82;
538 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
-
types de loi: -
abstraites, thoriques, gnrales: 79,94-96;
-
causales: 71;
-
de
champs pluriconceptuels: 82; - coercitives: 103; - conceptuelles internes: 82;
-
de dveloppement: 84; - conomiques: 69, 71, 79; - conomiques histori-
ques, transitoires: 104, 206; - conomiques naturelles: 79, 85-86, 91, 99;
-
ternelles, absolument ncessaires: 90, 102-105;
-
ternelles de la proprit, du
commerce, etc.: 104, 105; - d'volution historique: 85; - d'volution de
l'histoire: 21, 42, 67, 93,205,235;
-
internes, immanentes: 92, 103; - naturelles,
objectives: 84-87, 342;
-
de la production en gnral: 95;
-
providentielles
(<<divines, sacres, ect.): 101-105 (cf. Mystification);
-
rgulatrices: 83, 85,
89; - structurelles: 85; - tendancielles: 83,85,206-208;
-
lois conomiques gnrales:
-
de l'accumulation capitaliste: 100-101;
-
de bais&e
tendancielle du taux de profit: 81, 85, 210, 215, 418; - de population (- de
Malthus): 100-101;
-
de la valeur: 85-87, 96-97,118; son mode d'action: 85-86,
son contenu: 86, ses fonnes: 96-97; les soit-disant
-
naturelles de l'conomie
capitaliste: 79, 85-87,99-105;
-
autres lois:
-
des causes accidentelles: 184; - des grands nombres (Gauss-
Laplace): 164-171, 178;
-
de la pesanteur: 85-87;
-
des proportions multiples:
86; -
des trois tats (A. Comte): 225.
Loisir (cf. Libert: Rgne de la -, Temps libre): 464, 468-471.
Lumires: 340, 342, 475.
Lutte: 19-20, 134,230,233-234,351,377,439,458,481,491.
M
Machine (cf. Instrument, Outil): 21, 119-120, 133-134, 143,332-334; la
- n'est pas une
catgorie conomique: 392; la - ne cre aucune valeur, 403; la
-
tend le corps
de l'homme: 398; cot des -: 400, 403-406; dfinitions de la -: 382-384;
distinction entre la - et l'outil: 382-384; volution historique de la -: 249; lutte
des ouvriers contre la -: 403; paradoxe conomique de la -: 322; rle de la-
moderne: 380; valeur des -: 403.
Machines:
-
coudre: 120;
-
feu: 379;
-
vapeur: 119,294,373,379-380,396;-
automatiques: 332; fonnes de la - industrielle: 383; machine-outil: 135,382-383;
machine de travail: 379-385; moulin bras, moulin vapeur: 49, 128, 130; moulin
eau: 333, 385; moulin vent: 393; mule-jenny: 461, 483 (n. 25); roue
hydraulique: 393, 396; tour de Maudsley: 119.
Machinisme: 119,299,373,379-385; analyse du -: 380,389; effets du
-
sur la division
du travail: 381; liaison historique du - et du capital: 402; le service du -: 399-
408.
Main (cf. Outil): 266, 270-273, 382-384.
Matrise (cf. Domination, Exploitation, Nature, Travail): 321,451,461,469,496.
Manufacture: 146, 387-388;
-
d'pingles (Smith): 387.
Marxisme (cf. Catgories, Interprtation, Philosophie): les trois sources du -: 489-
490; dimension scientifique du -: 489-490; orientation pratique du -: 490-491 ;
sens philosophique du -: 491-492.
Matrialisme (cf. Mthode matrialiste): 41, 242-252, 313-314, 342, 353-354;
-
antrieur Marx: 318, 478; - dialectique: 314; - conomique: 149;
-
historique (difficults du -): 129-130 (cf. art grec, droit romain); - mcaniste
(cf. dterminisme): 39, 243-244, 267-268; nouveau -: 32,99,242,313; point de
vue <conception) matrialiste de l'histoire: 205, 233-234, 236, 238, 481 ;le
-
pratique marxien: 32, 99, 472, 492.
Matriel: 50, 264 (cf. Contenu, Formel, Vie).
Matire (cf. Dterminisme mcaniste, Force, Objet): 44, 264, 280.
Mathmatique (cf. Arithmtique); 237-238.
INDEX DES CONCEPTS 539
Mcanismes (cf. Machine, analyse de la -): 389, 393.
Mdiation (cf. Dialectique, Instrument, Moyens): 221, 350.
Mtabolisme: 313,376.
Mtamorphose:
-
de la marchandise: 425.
Mtaphore:
-
relle: 392.
Mtaphysique: 316, 343.
Mthode:
-
dialectique: 81; - matrialiste: 59-60; - = s'lever de l'abstrait au
concret: 96;
- = s'lever du singulier au gnral: 95.
Milieu (cf. Vie):
-
extrieur: 63, 243-246.
Mode de production: 47-49, 59, 61-62, 240; - capitaliste, ses apologistes: 430; son
processus d'ensemble: 420; sa spcificit (cf. Capital): 423;
-
matriel: 249;
-
de
la vie matrielle: 47.
Moi (Fichte): 357.
Moment: 53,81,143.
Monnaie: fonnes de la
-
(cf. Argent).
Mort (cf. Travail mort): rsurrection d'entre les -,397.
Moteur (cf. nergie, Machines): 382, 385.
Mouvement: 44.
Moyen, moyens (cf. Fin): 50, 242, 374-376;
-
d'existence,
-
de subsistance: 282, 294,
-
de production (cf.: Outil, Machine): 49-50, 61, 244, 376.
Moyenne: 21,121,163-171,182-197.
Multiplicit: 144.
Mutations technologiques: 135.
Mystification: 101-105,354.
Mythe, fable ou rve: 332-334.
N
Naturalisme: 243-246, 315.
Nature: 79,121,145,312,350-358; - (double sens): 93,104,451; - au sens d'essence:
92; - au sens grec ancien (<<phusis):284; Dieu
= -
(Spinoza): 350; la -
est
sujet: 356-358; activit de la -: 312-313; don de la -: 294-295, 405; matrise de
la -: 444; marche de la -: 57; primat de la -: 450; rle dans la production: 293-
300.
Naturel (cf.: Lois naturelles, Lois soi-disant naturelles, Socit naturelle): 213,220-222.
Naturalisme, philosophie naturaliste: 44, 121, 325, 341.
Naturalistes: 346.
Ncessaire: 18; -, non-ncessaire: 228.
Ncessitarisme: 33 (n. 19),34 (n. 21), 65,233,348,472,481.
Ncessit: 18-21,33 (n. 19),34 (n. 21), 226-227;
-
absolue,
-
relative: 19-20,93,228;
-
de fer: 213;
-
devenue: 228;
-
et hasard: 54-55, 150-151,478-480;
-
de
l'histoire: 57-58;
-
historique: 19, 21, 32, 105, 225-234;
-
inconsciente et
aveugle: 54; - interne,
-
externe: 55;
-
et libert (picure): 474-482; -
objective: 88;
-
potentielle, virtuelle: 213; - relative = possibilit relle: 480,
482; domaine de la -: 460; mergence d'une -: 54; philosophie de la -: 472,
480; prise sur la -: 499.
o
Objectif, objectivit: - en conomie politique: 56-57, 173;
-
dans les sciences socio-
historiques: 171-173, 182-183, 186-188,237-241.
Objectivation (cf. Alination): 316-322, 354-358, 450-456.
Objectivisme: 477-478.
540 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Objet (cf. Sujet, Dialectique, Inversion): 267, 315, 317, 354, 397.
Ontologie: - du travail: 316.
Originaire: 132.
Origine: 116; double sens (naissance historique, cause actuelle): 13I.
Organe (cf. Fonction): 375.
Organisme: 131;
-
social (mtaphore): 149; point de vue organique: 13I.
Outils (cf. Machine, Machine-outil): 119,381; - complexes: 382.
Ouvrier libre" (cf. Travailleur): 134,269,272-275,291;
-
et machine (cf. Machine);
1'- produit la plus-value: 436; rle de 1'-: 404.
P
Parti:
-
ouvrier: 60, 442-445.
Pass: le - rgne sur le prsent: 467.
Pauprisation: 378,417.
Pense (cf. Thorie): 313.
Philosophie: 52;
-
de l'activit: 312-322;
-
de la conscience de soi singulire: 476;-
de l'histoire: 18-20,43-44,65-69,225,241-242;
-
des Lumires: 340,475; - de
la praxis: 42, 312-314; terminologie philosophique (cf. Catgories): 283, 290-291.
Physique mcaniste: 49.
Plaisir (cf. Travail =pur plaisir).
Pluralit: 139-143,348.
Plus-value: 118, 285, 297-298.
Politique: 121.
Position (Setzung) (cf. Sujet): 126,356.
Positivisme: 60, 115, 152 (n. 2),284,395.
Possibilit (cf.: Formes possibles, Force de travail, Utilits): 22-32, 33 (n. 9, 18), 34
(n. 24),348;
-
abstraite, gnrale, thorique: 27-29, 80, 138,476;
-
bilatrale,
gale
-
(cf. indtermination); - de changement de forme: 98-99;
-
concrte: 28,
30-32,264,269,276;
- devenue", pose": 27, 275-276; - formelle des crises:
418; ses deux formes: 425-430;
-
formelle (cf. contradiction logique): 25, 27-28,
348;
-
historique, concrte: 19,27,31,131-132,151,230-231;
- indtermine
(cf. indtermination);
- matrielle: 137; -
multiple: 138, 144;
- naturelles: 27,
296;
-
objective: 213;
-
organique: 131-132;
-
productive: 391; - relle,
effective: 23, 25, 28, 31-32, 348, 392,476,480,482; - relle des crises: 418;-
relle des richesses: 437; - subjective: 213; - vivante: 282; la - se mue en
impossibilit: 437; langage de la -: 397; ngation de la - (cf. Le dominateur);
rapport entre -
et ralit dans les crises: 418-437; simple -: 26-28, 274-275.
Possible: formes du -: 27-32,493; champ du -: 451,494; les
-
humains futurs: 497;
lejeu des -: 80; le
- =
mirage (Bergson): 492-493; logiquement impossible: 231.
Potentialit, potentiel: 22.
Pouvoir (cf. Domination): - du capital: 432.
Pragmatisme social: 42.
Pratique, pratiques: 311, 348;
-
et thorie: 313,381.
Praxis: 246, 311-312, 316, 318, 320;
-
et po'isis: 320-321; activit pratiquement
critique: 245; philosophie de la -: 42, 312.
Prdtermin, Prdterminisme: 46, 70 (cf.: Destin, Dterminisme, Fatalisme, Ncessi-
taris me).
Prdietibilit, prvision: 19,41,235,299.
Prdiction historique: 41; erreur de -: 242.
Prhistoire: 217,252.
Prsent: le
-
rgne sur le pass: 467.
Prsupposs: 239-240.
INDEX DES CONCEPTS 541
Prsupposition (cf., Condition, Pos): 50, 126,220,229.
Probabilit: 21, 348; distribution normale: 210.
Procs d'Engels: 60-61, 76 (n. 83).
Processus: 14-15, 22;
-
de circulation capitaliste: 429, 435; - d'ensemble de la
production capitaliste: 435; - historique: 57, 219-225, 229, 252; - de production
capitaliste: 394-395, 435; - de production matrielle: 405; - de reproduction
capitaliste: 435; - de valorisation: 405.
Productif (cf. Travail -): capital -,395.
Production (cf. Mode de -): 312-313; - gnrale: 94; concept gnral de -: 94
(cf.: Lois gnrales).
.
Productivit (naturelle, sociale): 298, 300, 399-408.
Produit: 317.
Profit (cf. Capitalisme, Plus-value):
-
par abstinence du capitaliste: 468.
Progrs: 205,225; - par tapes, par stades: 226; - intellectuel (cf. Lumires): 462;
limites du -: 300.
Proltariat (cf. Classe ouvrire, Communisme, Libert, Rvolution, Salariat): 52,442-
445; abolition du -: 500.
Proprit (qualits, caractres): 376; - en tant que forces: 376,396 (cf. Formes de-
, Lois de la -).
Providentialisme: 65, 104-105, 188,241,248.
Psychologie (d'Aristote): 337, 344.
Puissance (= en puissance, tre en puissance,,) (cf. Force de travail; Forces
productives, Possibilit): 22-27, 348, 493;
-
objectives: 453;
-
de travail: 287-
291;
-
de travail = possibilit relle de la richesse universelle: 432; termes
signifiant -: 278,288.
Puissances objectives, - objectives: 455.
R
Raison: 67; la
-
selon Hegel: 57,475; activit rationnelle (Aristote): 469.
Rapports (cf.: Base, Forces productives, Structure); - de production: 47-51, 61-62,
248,335;
-
sociaux: 46-50, 136,249,393,437,458; - sociaux esclavagistes: 335;
oubli" des -
sociaux: 292; - sociaux nouveaux: 119; transmission des -
sociaux: 250.
Rationalisme, critique rationaliste: 340-342.
Ralisation: 22, 282, 432-433; - de la libert: 456; - de la plus-value: 422, 435;
-
de
soi: 321-322; obstacles la
-
de la valeur: 433.
Ralisme (cf. Idalisme): 323, 339, 341-342, 440.
Ralit effective (Wirklichkeit): 26, 34 (n. 28), 350.
Rconciliation du sujet et de l'objet: 378.
Rductionnisme conomiste: 52.
Rel (cf. Ralit, Ralisation): 23; le - se fait possible: 493.
Reflet (cf. Ides, Idologie): 138,241.
Rification (cf. Ftichisme): 317.
Relativisme historique: 99, 232.
Religion:
-
dans l'Antiquit: 122-123; critique de la -: 59, 121; histoire de la -: 59;
philosophie de la -: 59.
Renversement de l'idalisme: 342, 350-358;
-
de la dialectique (cf. Dialectique): 351.
Rptitions historiques: 130
Reprsentations (cf. Ides, Interprtations, Reflet).
Rsultat: 317.
Rvolution (Cf. Crise du capital): 19,349,385,417,437,442-445,491;
-
coperni-
cienne: 9; - industrielle: 373,378,379-380,444-445;
-
communiste: 471, 497;
542 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
-
technique: 32, 373, 385; - = renversement de l'ordre social: 378; re des-:
417-418.
Robinsonnades: 95, 100 (cf.: ternisation).
Routine (cf. Science).
Rupture (cf. Crise).
Ruse: 349; - de la Raison: 57.
S
Sacrifice (cf. Travail = sacrifice).
Salariat: abolition du -: 457.
Scepticisme: 340.
Science: 19,88,115,120, 147,235,240,397; - auxiliaires: 490; - de l'histoire: 21,
205, 216, 235-242;- de la nature: 237, 264-268, 272-273, 288-289, 397; -
naturelles: 346;
-
relle, positive: 238;
-
sociales, - historiques: 240; rle de la
-
dans la production (= force productive): 297-298, 395, 402.
Scientisme: 284.
Seigneur fodal: 49, 128.
Srie causales indpendantes: 150-151.
Servage: 276, 459.
Simultanit: 141-143.
Singularits: 147.
Situation:
-
concrte: 63;
-
historique: 148,
-
rvolutionnaire: 443.
Socialisme moderne: 250; systme socialiste: 442.
.
Socit (cf. Classes):
-
bourgeoise: 408, 467;
-
civile: 123;
-
de classes: 55,437,457;
-
sans classes: 252, 322, 460, 468; - communiste: 408, 461, 467;
-
pr-
capitalistes: 221-224;
-
socialiste: 466.
Sol:
- =
base: 126;
- =
terre, terroir: 144-145,217-224.
Soleil: 99 (cf.: Travail).
Sous-consommation: 417, 420; - relative: 422, 442-443.
Spculation, philosophie spculative, 32, 121,225,238-239,338-340,344-345,354.
Spirituel: 50, 264.
Stocisme: 340.
Structure (cf.: Rapports sociaux, Mode de production): 46-47, 126, 392-393; infra-
structure (cf. Base): 126, 393; superstructure: 47, 53, 56, 123, 126; - juridique et
politique: 47.
Structurel (cf. Dynamique): analyse, point de vue structurels: 47.
Subjectivit (cf. Objet): 267, 315.
Subordination (cf. alination):
-
du travail au capital: 452-454.
Subsomption (cf. Subordination).
Substance, substantiel: 350-358.
Succession: 141-143.
Sujet (cf. Dialectique du -
et de l'objet): 126, 349-358, 397; - et activit: 352;
-
naturel: 351;
-
et substance: 350; changement, transformation du -: 319.
Superstructure (cf. Structure).
Surproduction (cf. Besoins solvables, Crises).
Surtravail (travail non-ncessaire): 228, 464-472; abolition du -: 464.
Suzerain: (cf. Moulin bras, moulin vapeur, capitaliste industriel).
Synthse: 238, 347.
Systmes: 325, 344; - techniques: 381.
INDEX DES CONCEPTS 543
T
Techniques (cf. Rvolution -, Systme -): 119, 134-136,373; - = organes productifs
de l'homme social: 378; tres -: 374; objet -: 358, 374; innovation -: 374,407;
monde -: 358, 374.
Technologie: 21, 58-59; histoire de la -: 380, 383-384; conception technologique de
l'histoire: 392.
Technologisme: 133, 392.
Tlologie: 242,249.
Temps libre (cf. Libert et -).
Tendance: 21, 31,205-215,357; diverses espces de -: 209-212; loi tendancielle: 31,
81 ;
-
et tre en puissance: 277.
Terre (cf. Physiocratie, Sol): 293, 376; -, mre des richesses: 299.
Terminologie (cf. Catgories).
Thisme: 346.
Thologie: 132, 349;
-
naturelle: 341;
-
spculative: 340.
Thologues: 341.
Thorie (cf. Pratique et -): 115-116,313; - de la connaissance: 344; ma soi-disant
- (Marx): 233, 236;
-
de l'histoire: 235.
Totalit, tout: 53, 81; touts organiques: 131.
Traducteur, Marx -: 343.
Transformation:
-
de la forme d'une loi: 96-99.
Travail (cf. Force de travail, Journe): dfinition du -: 248, 269-282, 285, 316-317,
319,375;
-
abstrait (catgorie gnrale): 118, 389; - alin: 321; - =premier
besoin vital: 469-471;
-
de l'esclave: 332-334;
-
concret: 117;
-
forc: 466;
-
futur (cf. Capital); -libre: 461;
-
et libert: 464-472;
- d'une machine: 384;
-
manuel, intellectuel: 386; - ncessaire: 451; - nouveau: 433; - pass =-
mort 270, 397, 405; - = pur plaisir (Fourier): 470; -
potentiel (en puissance)
(cf. Force de travail); - productif, improductif: 386, 394; - et temps libre: 464-
472;
- =
sacrifice (Smith): 470; -
simple, 394;
-'
serait la seule source des
richesses: 297-298, 394-395;
-
seule source des valeurs: 400; - spirituel abstrait
(Hegel): 355; -
et vie: 350; - vivant (en acte): 265, 270; auto-production de
l'homme dans le -: 355-358; ontologie du travail: 316; sparation du -
et de ses
conditions (cf. Force de Travail); le -, soleil de la vie sociale: 99.
Travailleur Jibre: 276,453; - associs: 466.
U
Un, Unit gnrique (cf. Genre): 336.
Unit (cf. Dialectique): de l'homme et de la nature: 374-379;
-
du subjectif et de
l'objectif: 338; 1'- se fait valoir dans les crises: 430.
Universalisation de l'histoire: 250.
Usages possibles: 376.
Utilitarisme: 463-4.
Utilits: - possibles: 397;
-
effectives, agissantes: 397.
v
Valeur:
-
d'usage,
-
d'change, leur lien ncessaire: 97-98, 295, 438-440; valeur-
travail: 85-87, 96-97, 117-118,136-138,152 (n. 2),293;
-
chez Aristote: 329-330;
- des machines,403; baissede la - des objets d'utilit: 406; changement de la
-
et crises: 429-430; cration de
-
(cf. Cration).
Valeur-travail (cf. Loi de la valeur).
544 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Vente (cf. changes).
Vrit: 347; contre-vrits historiques (de Proudhon): 389-390.
Vie (cf. Besoins, Fin, Travail): 50, 284, 313; tres vivants: 214, 225;
processus de vie social, politique et intellectuel: 47-48..
Violence: 104-105,234.
Virtualit, virtuel: 22, 276-282, 317.
tre social,
INDEX LEXICAL
DES TERMES ET EXPRESSIONS ALLEMANDS
Ce lexique recense la plupart des termes et expressions allemands de cet
ouvrage, laissant de ct des termes sans consquence sur le sens. Il en donne
la traduction, et les numros de pages et de notes o ils apparaissent. Le
lecteur pourra les retrouver dans leur contexte (le plus souvent une citation),
et consulter nos commentaires concernant leur traduction et, ventuellement,
les divergences des traducteurs.
A
abhangen (dpendre): 48, 154 (n. 46), 155 (n. 63).
an sick (en soi): 22, 278-279, 281, 290.
an undfir sick (en et pour soi): 30, 330.
iindern (changer): 97; sick - (se changer, se transformer): 223, nderung (changement,
rendre autre): 137,319; andre geworden (devenues autres): 223.
angeblick (prtendu, soi-disant): lOI, Il2 (n. 96).
angreifen (prendre, saisir): 260 (n. 174).
Anlage (disposition, aptitude): 364 (n. 114).
Anschauung (manire de voir, conception): 236.
Arbeit (travail): 285, 286, 304 (n. 74), 305 (n. 96), 359 (n. 21); Arbeiter (ouvriers): 304
(n. 74), 395; Arbeitskraft (force de travail): 281, 283-285, 288-290, 304 (n. 74), 305
(n. 96, 98); Arbeitsmachine (machine de travail): 382; Arbeitsvermogen (puissance
de travail): 283-288, 305 (n. 96), 306 (n. 103, 104); lebendigen Arbeitsvermogen
(puissances de travail vivantes): 224.
Aufgabe (tche; problme): 232.
auj1teben (dpasser, abolir et conserver la fois): 27, 34 (n. 28), 179, 190, 193; sich
auj1teben (se compenser, s'annuler): 164, 179, 197 (n. 1); sick wechselseitig
auj1tebenden (qui s'annulent rciproquement): 193; Auj1tebung (dpassement): 34
(n. 27), IlO (n. 73); aufgehohen (dpass): 96, 110 (n. 73), 431.
Aujlosung (dcomposition, dissolution): 224,445.
Ausjluss (manation): 125.
Ausgleickung (galisation, prquation): 165, 167.
ausloscken (teindre; effacer): 209.
546 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
af3ern (extrioriser): 48; Af3erung (manifestation, extriorisation): 293, 317.
B
Basis (base): 47,384; reale Basis (base concrte): 47.
bedingen (conditionner): 45, 125; bedingt (conditionn): 45, 141, 143, 218; Bedingung
(condition): 45; grundlegenden Bedingungen (causes fondamentales): 186.
befreien (sich selbst -) (se librer soi-mme): 257 (n. 103).
begreifen (saisir, comprendre): 62; das Begreifen (la comprhension): 258 (n. 124);
Begriff(concept, notion, ide): 369 (n. 165).
begrnden (fonder solidement - cf. Grund): 434; Begrndungstendanz (tendance
donner des causes): 480.
Bestandteil (lment, constituant, composant): 140; bestimmen (dterminer): 45, 124-
125; sich bestimmen (se dterminer soi-mme): 137; bestimmt (dtermin): 47, 121,
123-124, 133, 193; Bestimmung (dtermination): 125, 154 (n. 34,47).
bewegen (mouvoir, remuer): 384; bewegend (mouvant, qui meut): 75 (n. 68).
bewuf3t (conscient): 357; Bewuf3tsein (conscience): 357.
Bildung (formation, culture intellectuelle, lumires): 271.
bisherige Gusqu' prsent, jusqu' ce jour): 257 (n. 98).
D
Dasein (existence): 317.
Determinismus (dterminisme): 70,78 (n. 114).
Dienst (service): 414 (n. 101).
Ding (chose): 317, 395; dinglich (qui a le caractre de chose, chosifi, rifi): 317.
Durchschnitts-Arbeiskraft (force de travail moyenne): 195; Durchschnittswert (valeur
moyenne): 193,194.
durchsetzen (sich) (se faire une place, se frayer un chemin travers): 96,209,254 (n. 19).
E
einzel (singulier, individuel): 383; einzig (unique): 53.
Endzweck (fin dernire): 492.
Energie (nergie, activit): 341, 356; energische Prinzip (principe actif): 477.
entfremdet (alin): 482 (n. 1); Entfremdung (alination, cf. fremd): 482 (n. 1).
entscheiden (dcider, dterminer): 384,444.
entsprechen (tre conforme , correspondre): 154 (n. 47),253 (n. 12).
Enstehung (naissance, origine, commencement): 155 (n. 57), 215, 217; historische
Entstehung (gense historique): 217.
entwickeln (dvelopper): 96; Entwicklung (dveloppement; volution): 215, 224, 249,
250, 255 (n. 77); Entwicklungsgesetz (loi d'volution): 215; sogenannte historische
Entwickung (ce qu'on appelle dveloppement historique): 217 (cf. sogennant).
Erdformation (formation de la terre): 243.
Erhaltung (conservation, maintien): 221; Erhaltung der Kraft (conservation de l'ner-
gie): 300 (n. 4).
erscheinen ais (apparatre comme): 232; Erscheinung (apparition, manifestation, ph-
nomne): 75 (n. 67),232; Erscheinungsweise (manire d'apparatre, de se manifes-
ter): 97.
erzeugen (engendrer, former, produire): 129; Erzeugung (production): 229; Erzeugnis
(produit, rsultat): 50.
INDEX LEXICAL DES TERMES ET EXPRESSIONS ALLEMANDS
547
F
fiihig (capable): 376; Fahigkeit (capacit, aptitude): 279,287,304 (n. 74).
Faktor (facteur): 63.
Form (forme): 61, 317; Formveranderung (changement de forme): 319.
fremd (tranger): 482 (n. 1).
fir sich (pour soi): 290;fir sich seiend (tant-pour-soi): 352.
G
gebieterisch (imprieux, impratif): 257 (n. 102).
gegeben (donn): 50.
Gegenstand (objet): 317; Gegenstand/ichkeit (objectivit, caractre d'tre objectif): 108
(n. 39).
Geist (esprit): 255 (n. 77), geistig (intellectuel, de l'esprit, spiritue.1): 264; menschliche
Geist (esprit humain): 255 (n. 77).
Genesis (gense, formation): 155 (n. 57).
Geschichtstheorie (thorie de l'histoire): 235; Geschichtswissenschaft (science de l'his-
toire); 235.
gesellig (sociable): 327; Gesellschaft (socit): III (n. 87); naturwchsige Gesellschaft
(socit naturelle): 220;gesellschaftlich (social): 327.
gesetz (pos): 27; Gesetz (loi): 45.
Gestalt (forme, figure): 61, 317; Gestaltung (formation): 61.
Gewalt (force): 132; gewaltsam (par la force): 85
Gleichheit (galit): 108 (n. 39); Gleichgewicht (quilibre): 441.
Glied (ais natrliches -) (en tant que membre naturel): 219.
Grund (fond; sol, terrain; fondement, base, fondation): 253 (n. 18); grnden (fonder):
61; Grund/age (fondement): 61, 126, 140, 141, 201 (n. 60), 255 (n. 68).
H
Hab'und Gut (du bien, de la fortune): 304 (n. 74).
Herausarbeitung (obtenir force de travail, faire sortir, dgager): 445.
Hauptbedingung (condition principale): 77 (n. 93).
historisch notwendig (historiquement ncessaire): 231 (cf. Enstehung).
I
Inhalt (contenu): 50,434.
Instanz (instance): 53,76-77 (n. 90).
K
konnen (pouvoir physiquement, objectivement): 376, 384,409 (n. 10).
Kraft (force, pouvoir, efficacit): 278, 281, 283-286, 288-291, 304 (n. 74), 306 (n. 100,
103), 317, 357, 484 (n. 38).
Kraftentwicklung (dveloppement de la force): 466.
Kulturstufe (niveau de culture): 256 (n. 86),271,281.
L
Leben (vie): 305 (n. 86); Lebendigkeit (vitalit, proprit de ce qui est vivant): 287.
Lehre (enseignement, doctrine, discipline; systme): 243.
548 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
leiblich (corporel, du corps): 356; Leiblichkeit (qui est corporel, du corps, corporit):
287, 305 (n. 86).
Leiter (conducteur, guide): 317.
M
Macht (puissance, autorit, empire): 75 (n. 68), 278, 313, 445; Machtmittel (moyen de
pouvoir, d'action): 413 (n. 89).
maschinenmiifJig (mcanique, fait la machine): 410 (n. 38).
mathematisch exakten Nachweis (dmonstration d'une exactitude mathmatique): 237.
Mehrarheit (surtravail): 27; Mehrgewinn (sur-gain): 28; Mehrwert (plus-value): 155
(n. 77).
Mif3verhiiltnis (disproportion): 208.
Mittel (moyen): 304 (n. 74).
mittler (situ au milieu, moyen): 193, 194, 204 (n. 107).
miigen (pouvoir, au sens subjectif): 409; logisch unmiiglich (logiquement impossible):
231.
Miiglichkeit (possibilit): 22, 278-279, 281, 287, 304 (n. 70), 306 (n. Ill), 317;
Miiglichkeit (blofJe -) (simple possibilit) 26.
Moment (facteur, moment, ct): 53, 74 (n. 57).
N
Naturgesetz (loi naturelle): 85; Naturmacht (puissance naturelle, puissance de la
nature): 317; Naturnotwendigdkeit (mit -) (selon une ncessit naturelle): 257
(n. 99); Naturstoff (matire naturelle, matriau naturel): 317; naturwissen-
schaftlich ( la manire des sciences de la nature): 237; naturwchsig (naturel, de
manire naturelle): 252.
Not (ncessit, urgence, besoin; dtresse, indigence, misre): 257 (n. 102); notwendig
(ncessaire): 45; Notwendigkeit (ncessit): 75 (n. 67), 257 (n. 102).
o
Ohjekt (objet): 317.
p
potentiell(potentiel, potentiellement): 278; Potenz (puissance): 105,278,306 (n. 103).
Praxis (pratique, exercice): 311, 317, 318, 320-322, 359 (n. 23).
Produktionskraft (force de production): 414 (n. 101); produktivbildend (crant un
produit): 404; Produktivkraft (force productive): 200 (n. 52),414 (n. 101).
Prozess (processus): 14.
R
regeln (rgler, rgulariser, mettre en ordre): 194; regelnd (rgulant, rgulateur): 85.
reichhaltig (qui contient beaucoup, riche, fcond): 465.
Rckschlag (choc en retour, raction, contrecoup): 140.
Ruhe (repos, immobilit): II7.
s
schaffen (crer, produire, tirer du nant): 279.
INDEX LEXICAL DES TERMES ET EXPRESSIONS ALLEMANDS
549
schieben (pousser, couler, glisser): 395.
schlief3lich (finalement): 55.
schlummern (sommeiller, se reposer): 278.
Sein (tre): 317.
Seite (ct): 64.
Selbst (soi): 353; selbstandig (qui subsiste par soi-mme, indpendant): 356; selbst-
bewufJt (dou de conscience de soi): 359 (n. 22); Selbsterzeugung (production de
soi, auto-production): 355; Selbsttiitigkeit (spontanit, auto-activit): 352, 455;
selbstisch (goste): 352, 353; Selbstveriinderung (changement de soi-mme, auto-
changement): 245; Selbstzweck (fin en soi): 221.
setzen (poser, placer, mettre): 126; sich setzen (se poser): 355; Setzung (position, action
de poser): 126.
sogennant (<<dit", appel, nomm; soi-disant): 104, 112 (n. 96),132,217,255 (n. 77).
Stoff (matire, substance, matriau): 137.
Strebziel (but de l'effort): 231.
T
Tat, ou That (action, acte): 229, 256 (n. 93), 317, 319, 371 (n. 203); Tathandlung (acte
externe, violence): 371 (n. 203); tiitig (actif, agissant, effectif): 357, 359 (n. 23);
Tiitigkeit (activit): 286,317-319,359 (n. 23, 26).
Tauschwert (valeur d'change): 33 (n. 16).
Tendanz (ais beherrschende -) (en tant que tendance dominante): 209; bestiindige
Tendanz (tendance constante): 215; nur ais Tendanz (seulement en tant que
tendance): 208.
Triiger(porteur): 353.
Trieb (force d'impulsion, tendance, penchant, inclination): 357.
u
umsonst (pour rien, gratuitement): 404.
Umstiind (circonstance): 62, 170; Umstandstheorie (thorie des circonstances): 260
(n. 152).
Umwiiltzung (rvolution): 256 (n. 88).
unentgeltlich (gratuit, gratis): 404,414 (n. 101).
Unruhe (agitation, mobilit): 117.
Unvermeidlichkeit (invitabilit): 257 (n. 112).
Ursache (cause): 75 (n. 68), 122, 154 (n. 34); effektiven Ursachen (causes efficientes):
182.
Ursprung (origine, naissance, provenance): 118, 131, 154 (n. 57, 58); ursprnglich
(primitif, originaire, dans l'origine, primitivement): 255 (n. 56).
v
veriindern (changer, modifier, transformer): 179, 200 (n. 52), 257 (n. 101),260 (n. 174),
317; Veriinderung (changement, transformation): 317.
Verausgabung (dpense): 304 (n. 74).
VerafJerung (alination, vente): 482 (n. 1).
verbinden (lier ensemble, relier, joindre): 317; Verbindung (liaison, union, combinaison,
connexion): 151,152.
verflochten (entrelac, enchevtr): 125.
Verhiiltnis (rapport): 466.
verkehrt (invers, l'envers): 192.
550 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Vermogen (puissance, pouvoir, biens): 22, 276, 278, 279, 281, 283-285, 287, 288, 304 (n.
74), 305 (n. 86).
vernnftig (rationnel, sous forme rationnelle): 500 (n. 5).
Versachlichung (chosification, rification): 108 (n. 39).
Verselbstiindigung (autonomisation, mancipation): 445.
verursachen (causer, occasionner, produire, provoquer): 140.
verwirklichen (raliser): 319; Verwirk/ichung (ralisation): 482.
Vorau{3etzung (prsupposition): 50, 126,154 (n. 41).
w
Wechselbeziehung (rapports mutuels, corrlation): 137.
Weltgeschehen (vnement du monde): 500; weltlich-werden (devenir mondial): 482.
werden (devenir): 500 (n. 3).
Wertbestimmung (dtermination de la valeur): 271; wertbildend (crant, produisant, de
la valeur): 404; wertsetzend (posant de la valeur): 286.
.
Wesen (tre, nature relle, ralit, essence): 357.
widerspiegeln (reflter, rflchir): 137.
widersprechen (contredire, tre en contradiction): 154 (n. 47), 253 (n. Il).
wiedergewinnen (regagner, recouvrer, reprise): 498.
Willkr(arbitraire, bon plaisir, volont despotique): 148,193.
wirken (agir): 34 (n. 28),319,357,369 (n. 168),404,414, (n. 1I4); wirkend (agissant, qui
opre, efficace): 397.
wirklich (vrai, rel, effectif, authentique): 132, 3 17, 397; Wirklichkeit (ralit effective):
26,34 (n. 27), 313, 317, 319, 350, 369 (n. 168),433.
Wirksamkeit (efficacit): 22.
Wirkung (effet, rsultat): 75 (n. 62), 208,350,369 (n. 168),414 (n. 101).
Wissenschaft (science: savoir, doctrine, rudition; connaissance): 240; historische,
soziale -(science, historique, sociale): 259 (n. 138); wissenschaftlich (scientifique,
mthodique, raisonn): 240.
z
zwezckmiif3ig (conforme au but, finalis): 359 (n. 26), 375.
Zufall (hasard): 30, 147-148, 157-8 (n. 95); zufiillig (par hasard, fortuit): 170;
Zufiilligkeit (fortuit): 30, 146-147, 157-8 (n. 95).
zusammenfallen (concider, convenir): 48; das Zusammenfallen (la concidence): 245.
Zusammengehorigkeit (homognit, cohrence): 426.
Zusammenhang (connexion, interdpendance, lien): 81,214,249,251,262 (n. 192, 193),
384.
TABLE DES MATIRES
Prface. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avant-propos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Pour une connaissance approche de Marx. . . . . . . . . . . . . . .
2. Le concept de possibilit chez Marx et ses origines. . . . .". . . . . .
3. Les modalits du possible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Premire partie.
- La possibilit abstraite ou la critique de l'conomie poli-
tique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre premier. Le dterminisme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Le marxisme considr comme dterminisme. . . . . . . . . . . . . . .
2. L'quivoque du dterminisme conomique chez Marx. . . . . . . .
3. La dtermination en dernire instance selon Engels. . . . . . . .
4. Un paradoxe: Marx plus dterministe qu'Engels. ... ..
5. Dissolution du paradoxe; des varits possibles de socits.. . .
6. Les formes du dterminisme en histoire et le matrialisme histo-
rique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 2. Les lois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. La problmatique des lois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. L'analogie entre lois conomiques et lois naturelles. . . . . . . . . .
3. Nature au sens d'essence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Des lois gnrales et leurs formes possibles. . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Les soi-disant lois naturelles du capitalisme. . . . . . . . . . . . . .
Notes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 3. Les causes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. L'explication par les causes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. La notion de cause et ses divers sens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Analyse de la causalit conomique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Pluralit et multiplicit des causes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. La c1tingence des causes: le hasard ou fortuit .............
Notes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
13
17
17
22
27
33
37
39
40
43
52
56
60
65
72
79
80
84
92
94
99
106
115
116
124
133
139
146
152
552 MARX PENSEUR DU POSSIBLE
Deuxime partie. - La possibilit concrte ou la conception de l'histoire.
Chapitre 4. Les moyennes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Compensation et loi des grands nombres. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Marx et les statistiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Marx a-t-il repris le concept d'homme moyen de Qutelet? ....
4. Marx et le nouvel esprit probabiliste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Critique des thories de la compensation. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 5. L' histoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Les tendances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Le dveloppement historique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. . . . . . .
3. La ncessit historique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Science et histoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Matrialisme et tlologie en histoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 6. Les forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Le concept de force matrielle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. La spcificit de la force de travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. La force de travail en tant qu'tre en puissance. . . . . . . . . . . . . .
4. L'nigme d'un changement terminologique .................
5. Les forces naturelles sont-elles productives? ................
Notes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Troisime partie. - La possibilit relle ou le matrialisme pratique. . . .
Chapitre 7. L'activit..........................................
1. Le marxisme en tant que philosophie de l'activit. . . . . . . . . . . .
2. L'apprciation d'Aristote par Marx.. . . . . .. . .. . . .
3. Le trsor d'Aristote. Son utilisation par Marx. . . . . . . . . . . .
4. D'o vient l'importance d'Aristote pour Marx? .............
5. Le sujet de l'activit: le rapport de Marx Hegel. . .. .. . . . . . .
Notes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre 8. La technique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. L'unit de l'homme et de la nature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. L'analyse de la machine: la machine de travail ............
3. La division du travail: ses deux formes principales. . . . . . . . . . .
4. La machine est une force productive ....................
5. Le service du machinisme et ses limites capitalistes. . . . . . . .
161
163
164
171
177
182
189
197
205
206
215
225
235
242
252
263
264
269
276
282
291
300
309
311
312
322
326
337
347
358
373
374
379
385
390
399
TABLE DES MATIRES
Notes .
Chapitre 9. Les crises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. La possibilit des crises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. La possibilit formelle des crises: ses deux formes. . . . . . . . .
3. La ralisation de la possibilit des crises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Crise du capital et rvolution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre JO. La libert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Alination et objectivation ...............................
2. Le rgne de la libert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Surtravail et temps libre: travail et libert. . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Ce que Marx doit picure dans sa conception de la libert. . .
Notes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conclusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Les trois moments de la pense de Marx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. L'homme en tant qu'tre des possibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Socit communiste et individu libre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bibliographie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Index des noms de personnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Index des concepts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Index lexical des termes et expressions allemands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
553
409
417
418
425
430
437
446
449
450
456
464
472
482
489
489
492
495
500
503
521
531
545
ERRATA DE LA PREMIRE DITION
page ligne au lieu de lire
.,~
18 dont donc
-.)
58 25
strictot stricto
78 note 115, ligne I
encyclopdiques ellcyclopedique
1]2
note 97, ligne 1
mysticirte mystifierte
135 12 ill abstracto in abstracto
149 23 excternes
externes
156 note 66, ligne 9 PARRAIN PARAIN
189 28
conoiques cono!Tques
190 31
explicaitons explications
194 17 forment forme
199 note 32, ligne 4
140). 140.
229 30
deja de le
37
fait faire
230 10 diffrentes diffrents
231 16
concernee concerne
247 18
supposse supposes
248 16
interprtres interprtes
251 23
Quant Quand
253 note 12, ligne 3 condordance concordance
note 17, ligne 3
Tendanz Tendenz
254 note 40 ni
nie
note 44 cette
Cette
261 note 178, ligne 4
Maspro Maspero
note 179
(Cf.Ia (Cf. Ia
265 37 Leiniz Leibniz
286 24
Wertsetzende wertsetzende
302 note 26, ligne 2
clbrit clrit
304 note 74, ligne] 2
(krUte) (Krifte)
305 note 86, ligne 7
Leilicbkeit Leiblichkeit
306
note 100,ligne4 der Arbveiter der Arbeiter
322 20
cartgories catgories
358 note 8, ligne 4
Texte, texte,
360 note 39, ligne 1
sont
sort
361 note 41, ligne 4
Jahgang Jahrgang
394 16
objectivit objectiv
404 JO TIn'y a
Ilya
412 note 63, ligne 4
p.28,
pp. 21 et 28,
448 note 83, ligne 8 l'aure l'autre
472 12 Andr Calvez; Jean-Yves Calvez;
483 note S, ligne 1
Maspro Maspero
485 note 68, ligne 7 l'idalisme l'idalisme"
487 note 87, ligne J3
auvait avait
492 10
est seule est seule est
495 40
son natureUe non natureUe
498 42
autrement Autrement
SOS 30 dix-huit Brumaire dix-huit Brumaire
507 31
Laffargue Lafargue
514 9 et 10
Maspro Maspero
5]8
46
SEPIRM [...] S.O.DJ.S) (Revue de J'lnstitut de
Recherches marxistes, depuis J98 J).
538 1
types de loi: types de lois:
542
]9 Srie causales Sries causales
546 43
Entwkkung Entwicklung
549 23 et 24 (3 fois)
Tendanz Tendenz
Collection L'Ouverture Philosophique
dirige par Bruno Pquignot
et Dominique Chateau
Dj parus
Franois NOUDELMANN, Sartre: l'incarnation imaginaire, 1996.
Jacques SCHLANGER, Un art, des ides, 1996.
Ami BOUGANIM, La rime et le rite. Essai sur le prche
philosophique, 1996.
Denis COLLIN, La thorie de la connaissance chez Marx, 1996.
Frdric GUERRIN, Pierre MONTEBELLO, L'art, une thologie
moderne, 1997.
Rgine PIETRA, Lesfemmes philosophes de l'Antiquit grco-romaine,
1997.
Franoise D'EAUBONNE, Fminin et philosophie (une allergie histo-
rique), 1997.
M. LEFEUVRE, Les chelons de l'tre. De la molcule l'esprit, 1997.
Muhammad GHAZZLI, De la peifection, 1997.
Francis IMBERT, Contradiction et altration chez J.-J. Rousseau, 1997.
Jacques GLEYSE, L'instrumentalisation du corps. Une archologie de
la rationalisation instrumentale du corps, de l'ge classique l'poque
hypermoderne, 1997.
Ephrem-Isa YOUSIF, Les philosophes et traducteurs syriaques, 1997.
Collectif, publi avec le concour de l'Universit de Paris X, Objet des
sciences sociales et normes de scientificit, 1997.
Vronique FABBRI et Jean-Louis VIEILLARD-BARON (sous la
direction de), L'Esthtique de Hegel, 1997.
Eftichios BITSAKIS, Le nouveau ralisme scientifique. Recherche
Philosophiques en Microphysique, 1997.
Vincent TEIXEIRA, Georges Bataille, la part de l'art. La peinture du
non-savoir, 1997.
Tony ANDRANI, Menahem ROSEN (sous la direction de), Structure,
systme, champ et thories du sujet, 1997.
Denis COLLIN, La fin du travail et la mondialisation. Idologie et
ralit sociale, 1997.
Collection La Philosophie en commun
dirige par S. Douailler, J. Poulain,
P. Vermeren
Dj parus
Renzo RAGGHIANTI, Alain. Apprentissage philosophique et gense de la
Revue de Mtaphysique et de Morale.
Philippe DESPOIX,Ethiques du dsenchantement
Frances NETHERCOTT, Une rencontre philosophique, Bergson en Russie
( 1907-1917).
Jean-Marie LARDlC,L'infini et sa logique. Etude sur Hegel.
Patrice VERMEREN, Victor COUSIN.Le jeu de la philosophie et de l'Etat.
Jean-Ernest Joos, Kant et la question de l'autorit.
Stanislas BRETON,Vers l'originel.
Hlne VANCAMP,En deuil de Kafka.
Franois ROUGER,Existence-Monde-Origine.
Collectif, Jean BORRElL,La raison de l'autre.
Christian MIQUEL,Philosophie de l'exil.
Christian MIQUEL,La Qute de l'exil.
Ruy FAUSTO,Sur le concept de capital. Ide d'une logique dialectique.
Augusto PONZIO,Sujet et altrit sur Emmanuel Lvinas.
Anne STAQUET, Introduction la pense faible de Vattimo et Rouatti.
Hlne VAN CAMP, Chemin faisant avec Jacques Derrida.
Danielle COHEN-LEVINAS, Des notations musicales. Frontires et singu-
larits.
Alessandro PANDOLFI, Gnalogie et dialectique de la raison mercanti
listes
Slavoj ZIZEK, Essai sur Schelling. Le reste qui n'clt jamais.
Humberto GIANNINI,Pierre-Franois MOREAU,Patrice VERMEREN(Sous
la direction de), Spinoza et la politique.
Rada IVEKOVIC, Le sexe de la philosophie
Ernesto Mayz V ALLENILLA, Fondements de la mta-technique
Juan Diego BLANCO,Initiation la pense de Franois Laruelle.
Monica M. JARAMILLO-MAHUT, E. HUSSERLet M. PROUSTA la recherche
du moi perdu.
Rada IVEKOVIC, Jacques POULAIN(resp.), Gurir de la guerre et juger la
paix.
Collection La Philosophie en commun
dirige par S. Douailler, J. Poulain,
P. Vermeren
Dernires parutions
Juliette SIMONT,Essai sur la quantit, la qualit, la relation chez Kant,
Hegel, Deleuze. Les "Fleurs noires" de la logique philosophique.
Serge VALDINOCI, La science premire, une pense pour le prsent et
l'avenir.
Hubert VINCENT, Education et scepticisme chez Montaigne, ou
Pdantisme et exercice du jugement.
Brigitte LEROY-VIMON,L'altrit fondatrice.
Ccilia SANCHEZ,Une discipline de la distance, l'institutionnalisation
universitaire des tudes philosophiques au Chili.
Vronique FABBRI,La valeur de l'uvre d'art.
Franois ROUGER,L'vnement de monde.
Roman INGARDEN,De la responsabilit. Ses fondements ontiques
(traduction franaise et prsentation par Philippe Secrtan).
Michel SERVIRE, Le sujet de l'art prcd de Comme s'il y avait un art
de la signature de Jacques DERRIDA.
l vaylo DITCHEv,Donner sans perdre. L'change dans l'imaginaire de la
modernit.
Juan MONTALVO, Oeuvres choisies.
Janine CHNE,Edith & Daniel ABERDAM(textes recueillis par), Comment
devient-on dreyfusard?
J. H. LAMBRET,Photomtrie ou de la mesure et de la gradation de la
lumire, des couleurs et de l'ombre 1760. Trad. du latin: J. Baye, J.
Couty, M. SaiIIard.
Muhamedin KULLASHl, Humanisme et Haine.
Marie-Jos KARDOS,Lieux et lumire de Rome chez Cicron.
Jacques POULAIN, Penser, Au prsent.
Charles RAMOND,Spinoza et la pense moderne.
Wolfgang KAMPFER, Le temps partag.
Alberto GUALANDI, La rupture et l'vnement.
Marie CRISTINAFRANCOFERRAZ,Nietzsche, le bouffon des dieux.
Jacques POULAIN, La condition dmocratique.
Achev d'imprimer le 25 mai 1998
sur les presses de Dominique Ouniot,
imprimeur Langres - Saints-Oeosmes
Dpt lgal: juin 1998 - N d'imprimeur: 3272
Vous aimerez peut-être aussi
- (Points Histoire) Jacques Le Goff - Les Intellectuels Au Moyen Âge-Points (2010)Document285 pages(Points Histoire) Jacques Le Goff - Les Intellectuels Au Moyen Âge-Points (2010)Cristian Macedo100% (4)
- Louis Althusser - Étienne Balibar (Av. Prop.) - Pour Marx-La Découverte, Poche (2007) PDFDocument291 pagesLouis Althusser - Étienne Balibar (Av. Prop.) - Pour Marx-La Découverte, Poche (2007) PDFIvan Dureve100% (2)
- Cahiers Du Cinema No. 63Document68 pagesCahiers Du Cinema No. 63Nicq HalePas encore d'évaluation
- Clastres, Introduction Au Discours de La Servitude VolontaireDocument5 pagesClastres, Introduction Au Discours de La Servitude VolontairejulienboyerPas encore d'évaluation
- Georges Politzer, Le Concret Et Sa Signification by Giuseppe BiancoDocument262 pagesGeorges Politzer, Le Concret Et Sa Signification by Giuseppe BiancotrofouPas encore d'évaluation
- Actuel Marx 2012-N°52 - Deleuze GuattariDocument224 pagesActuel Marx 2012-N°52 - Deleuze GuattariHugo VezzettiPas encore d'évaluation
- Louis Janover - Préface Au Livre de M. Rubel "Marx, Critique Du Marxisme" (2000)Document25 pagesLouis Janover - Préface Au Livre de M. Rubel "Marx, Critique Du Marxisme" (2000)EspaceContreCimentPas encore d'évaluation
- Présentation de Sacher-Masoch Le Froid Et Le Cruel by Deleuze, GillesDocument107 pagesPrésentation de Sacher-Masoch Le Froid Et Le Cruel by Deleuze, GillesVerònica ManavellaPas encore d'évaluation
- Temporalizacion KoselleckDocument34 pagesTemporalizacion KoselleckmarbuePas encore d'évaluation
- TOSEL, André - Du Materialisme de SpinozaDocument218 pagesTOSEL, André - Du Materialisme de SpinozaBernardo BianchiPas encore d'évaluation
- Critique de l’économie politique classique: Marx, Menger et l’Ecole historique allemandeD'EverandCritique de l’économie politique classique: Marx, Menger et l’Ecole historique allemandePas encore d'évaluation
- Reflexions Sur Le Protestantisme Joseph de MaistreDocument17 pagesReflexions Sur Le Protestantisme Joseph de MaistreNgoma JuniorPas encore d'évaluation
- (Le Sens Commun) Alexander Matheron-Individu Et Communautã© Chez Spinoza-Minuit (1969)Document329 pages(Le Sens Commun) Alexander Matheron-Individu Et Communautã© Chez Spinoza-Minuit (1969)David LatastePas encore d'évaluation
- L Etat Selon Carl Schmitt-JfrobinetDocument30 pagesL Etat Selon Carl Schmitt-JfrobinetADAME ALASSANI TOUREPas encore d'évaluation
- Émile Bréhier Notion de Problème en Philosophie PDFDocument11 pagesÉmile Bréhier Notion de Problème en Philosophie PDFNicolasCaballeroPas encore d'évaluation
- Marx, Bloch Et L'utopieDocument25 pagesMarx, Bloch Et L'utopieClaudio AlbertaniPas encore d'évaluation
- Alexander Neumann - Conscience de CasseDocument116 pagesAlexander Neumann - Conscience de CassevfpuzonePas encore d'évaluation
- Matérialités DiscursivesDocument194 pagesMatérialités DiscursivesJefpherson100% (2)
- BETTELHEIM, Charles - Planification Et Croissance AccéléréeDocument192 pagesBETTELHEIM, Charles - Planification Et Croissance AccéléréeminouchaaddaPas encore d'évaluation
- Tle LLCE Espagnol Specialite Voie G 1136482Document44 pagesTle LLCE Espagnol Specialite Voie G 1136482Alice C.Pas encore d'évaluation
- Herve Oulchen Usages de Foucault PDFDocument414 pagesHerve Oulchen Usages de Foucault PDFstdrangPas encore d'évaluation
- Voix Vox DeiDocument155 pagesVoix Vox DeiAlessandra FrancescaPas encore d'évaluation
- L'échange Symbolique Et La Mort by Baudrillard Jean PDFDocument434 pagesL'échange Symbolique Et La Mort by Baudrillard Jean PDFنضال السعيديPas encore d'évaluation
- Camille Dumoulié-Nietzsche Et Artaud - Pour Une Éthique de La Cruauté-Presses Universitaires de France - PUF (1992) PDFDocument130 pagesCamille Dumoulié-Nietzsche Et Artaud - Pour Une Éthique de La Cruauté-Presses Universitaires de France - PUF (1992) PDFNicoleta AldeaPas encore d'évaluation
- JAPPE, Anselm. La Critique Du Fétichisme de La Marchandise Chez Marx Et Ses Développements Chez Adorno Et Lukács-3Document333 pagesJAPPE, Anselm. La Critique Du Fétichisme de La Marchandise Chez Marx Et Ses Développements Chez Adorno Et Lukács-3zaadig100% (2)
- Sabot - Foucault Macherey NormesDocument18 pagesSabot - Foucault Macherey NormesivandalmauPas encore d'évaluation
- Guy DebordDocument18 pagesGuy DebordJKKKPas encore d'évaluation
- Albert Thibaudet Le Bergsonisme - 30 Ans de Vie Française IIIDocument264 pagesAlbert Thibaudet Le Bergsonisme - 30 Ans de Vie Française IIILaurence Driouch100% (1)
- Boltanski, Luc - Thévenot, Laurent - de La Justification (1991)Document241 pagesBoltanski, Luc - Thévenot, Laurent - de La Justification (1991)Mil TonPas encore d'évaluation
- Radiophonie PDFDocument47 pagesRadiophonie PDFKen ItoPas encore d'évaluation
- Milieux Et Normes de L'homme Au TravailDocument6 pagesMilieux Et Normes de L'homme Au TravailjulienboyerPas encore d'évaluation
- Maurizio Lazzarato Experimentations PolitiquesDocument209 pagesMaurizio Lazzarato Experimentations PolitiquesLeif GrunewaldPas encore d'évaluation
- Frédérique Matonti Intellectuels CommunistesDocument208 pagesFrédérique Matonti Intellectuels CommunistesGeise TargaPas encore d'évaluation
- André Siegfried, L'âme Des Peuples (1950) PDFDocument117 pagesAndré Siegfried, L'âme Des Peuples (1950) PDFAnonymous WE5dIf7BHPas encore d'évaluation
- Désirer Désobéir (Didi-Huberman Georges) (Z-Library)Document685 pagesDésirer Désobéir (Didi-Huberman Georges) (Z-Library)inouPas encore d'évaluation
- Moscovici, S. 1977. Essai Sur L' Histoire Humaine de La NatureDocument694 pagesMoscovici, S. 1977. Essai Sur L' Histoire Humaine de La Naturenelsonmugabe89Pas encore d'évaluation
- Georg Lukacs. Art Sain Ou Art MaladeDocument15 pagesGeorg Lukacs. Art Sain Ou Art MaladeJean-Pierre Morbois100% (4)
- Pour Une Socio Anthropologie de L'imaginaireDocument27 pagesPour Une Socio Anthropologie de L'imaginaireGeorges J-f Bertin100% (1)
- Lukács Et La CIADocument3 pagesLukács Et La CIAJean-Pierre MorboisPas encore d'évaluation
- Rubel - Critique Du Marxisme (Extracto)Document13 pagesRubel - Critique Du Marxisme (Extracto)juanpablognu0% (1)
- LEFEBVRE, Henri. Du Contrat de CitoyennetéDocument40 pagesLEFEBVRE, Henri. Du Contrat de CitoyennetéClara CirqueiraPas encore d'évaluation
- Macherey - Marx 1845Document240 pagesMacherey - Marx 1845Spinoza1974100% (1)
- Moulier Boutang, Yann - Louis Althusser: Une Biographie, Tome 1: La Formation Du Mythe (1918-1956)Document13 pagesMoulier Boutang, Yann - Louis Althusser: Une Biographie, Tome 1: La Formation Du Mythe (1918-1956)gentile02100% (1)
- Socio 2eme QuadriDocument101 pagesSocio 2eme QuadriJulian Andin GregoirePas encore d'évaluation
- Pierre Missac - L'ange Et L'automate. Notes Sur Les "Thèses Sur Le Concept D'histoire" de Walter BenjaminDocument10 pagesPierre Missac - L'ange Et L'automate. Notes Sur Les "Thèses Sur Le Concept D'histoire" de Walter BenjaminEspaceContreCiment100% (1)
- Louis Althusser, Que Faire?Document144 pagesLouis Althusser, Que Faire?Miguel ValderramaPas encore d'évaluation
- Godelier 1964 Mode de Production AsiatiqueDocument54 pagesGodelier 1964 Mode de Production Asiatiquejeanmariepaul100% (1)
- Sortir de L'aporie Du Matérialisme Marxien 2017Document15 pagesSortir de L'aporie Du Matérialisme Marxien 2017Anonymous 6oTdi4Pas encore d'évaluation
- Correspondances D'intellectuelsDocument11 pagesCorrespondances D'intellectuelsGuisepp BancoPas encore d'évaluation
- La Somme Et Le Reste No. 18Document21 pagesLa Somme Et Le Reste No. 18alfredorubiobazan5168Pas encore d'évaluation
- Deleuze - Urstaat Par Guillaume Sibertin-BlancDocument10 pagesDeleuze - Urstaat Par Guillaume Sibertin-BlancdiuhsdknjsdPas encore d'évaluation
- Renaissance Des Philosophies de La NatureDocument12 pagesRenaissance Des Philosophies de La NatureAlberto GualandiPas encore d'évaluation
- L'Impossible PrisonDocument11 pagesL'Impossible PrisondalvmunPas encore d'évaluation
- Marxisme Et Politique - Henri LefebvreDocument26 pagesMarxisme Et Politique - Henri LefebvreAndrés Díez de Pablo100% (1)
- Frédéric Lordon - Impasse Michéa - La Gauche Et Le Progrès PDFDocument84 pagesFrédéric Lordon - Impasse Michéa - La Gauche Et Le Progrès PDFMijuPas encore d'évaluation
- Situation Classe OuvriereDocument270 pagesSituation Classe OuvrierelouiscalafertePas encore d'évaluation
- Claude Lefort Et Cornélius Castoriadis Ont-Ils Seulement Compris Quelque Chose À La Théorie Sociale de La Valeur Chez MarxDocument8 pagesClaude Lefort Et Cornélius Castoriadis Ont-Ils Seulement Compris Quelque Chose À La Théorie Sociale de La Valeur Chez MarxnopePas encore d'évaluation
- LEFEBVRE, Henri. L'État Dans Le Monde ModerneDocument22 pagesLEFEBVRE, Henri. L'État Dans Le Monde ModerneCláudio SmalleyPas encore d'évaluation
- Paul Mattick - Le Marxisme: Hier, Aujourdhui, DemainDocument157 pagesPaul Mattick - Le Marxisme: Hier, Aujourdhui, DemainEtienne SimardPas encore d'évaluation
- 3 Entretiens Pierre Bourdieu Avec Roger ChartierDocument7 pages3 Entretiens Pierre Bourdieu Avec Roger ChartierYosistaPas encore d'évaluation
- Henri Lefebvre - Les Paradoxes D'althesserDocument36 pagesHenri Lefebvre - Les Paradoxes D'althesserMikael RodriguesPas encore d'évaluation
- LEFEBVRE, Henri. Justice Et VéritéDocument29 pagesLEFEBVRE, Henri. Justice Et VéritéCláudio SmalleyPas encore d'évaluation
- LATOUR, Changer de Société, Refaire de La SociologieDocument52 pagesLATOUR, Changer de Société, Refaire de La SociologieThomas GennenPas encore d'évaluation
- Klossowski - La Monnaie Vivante PDFDocument27 pagesKlossowski - La Monnaie Vivante PDFEugenio Santangelo100% (1)
- Bert These FoucaultenlasociologiagrancesaDocument469 pagesBert These FoucaultenlasociologiagrancesaGatoPas encore d'évaluation
- Vandenberghe PosthumanismeDocument47 pagesVandenberghe PosthumanismeEmmanuel BisetPas encore d'évaluation
- A La Recherche Des Villages Socialistes: Frédéric Abécassis Boustil FérielDocument21 pagesA La Recherche Des Villages Socialistes: Frédéric Abécassis Boustil Férielfaiza.soudanePas encore d'évaluation
- Nicolas Gomez DavilaDocument22 pagesNicolas Gomez Davilacerf cPas encore d'évaluation
- BM Governance PID 20110526 FRDocument114 pagesBM Governance PID 20110526 FRZelZelNetPas encore d'évaluation
- L'Art Et La Science Au Temps de William Shakespeare.Document15 pagesL'Art Et La Science Au Temps de William Shakespeare.معلوميات الشبكةPas encore d'évaluation
- Regimes TotDocument9 pagesRegimes Totjao podlPas encore d'évaluation
- Mobilis in Mobile Ou La Poétique Du Livre À Double-Entrée: Only Revolutions de Mark Z. Danielewski À La Lumière de L'œuvre de Michel ButorDocument102 pagesMobilis in Mobile Ou La Poétique Du Livre À Double-Entrée: Only Revolutions de Mark Z. Danielewski À La Lumière de L'œuvre de Michel ButorNoamNorkhat100% (1)
- Globe - Poesie Et PolitiqueDocument37 pagesGlobe - Poesie Et PolitiqueHartmut StenzelPas encore d'évaluation
- Délivrance (Points Essais) (French Edition)Document71 pagesDélivrance (Points Essais) (French Edition)ryanaPas encore d'évaluation
- Les Révolutions IndustrielsDocument5 pagesLes Révolutions IndustrielsluluPas encore d'évaluation
- Astarian, Bruno - Ménage À TroisDocument196 pagesAstarian, Bruno - Ménage À TroisClara100% (1)
- La Liberation Des Peuples PDFDocument237 pagesLa Liberation Des Peuples PDFHelga AeaPas encore d'évaluation
- Histoire - Du - Tribunal - Révolutionnaire T2 PDFDocument593 pagesHistoire - Du - Tribunal - Révolutionnaire T2 PDFyveslunnPas encore d'évaluation
- 1384 PDFDocument24 pages1384 PDFdknewsPas encore d'évaluation
- Le Pouvoir Du Journalisme Antoine SpireDocument14 pagesLe Pouvoir Du Journalisme Antoine SpireRaphaël Boulai SynéaPas encore d'évaluation
- RANCIÈRE, J., (Sobre El Paisaje)Document8 pagesRANCIÈRE, J., (Sobre El Paisaje)EmmanuelPas encore d'évaluation
- Catégories de La Politique Militaire Révolutionnaire: T. DerbentDocument21 pagesCatégories de La Politique Militaire Révolutionnaire: T. Derbentpeire.nova5472Pas encore d'évaluation
- Fourier Émergence D'une Théorie SocialeDocument4 pagesFourier Émergence D'une Théorie SocialexaanaPas encore d'évaluation
- Flusser L'Écriture A Telle Un AvenirDocument16 pagesFlusser L'Écriture A Telle Un AvenirGeorges J-f BertinPas encore d'évaluation
- Sarah Al-Matary - La Haine Des ClercsDocument400 pagesSarah Al-Matary - La Haine Des ClercsDarcio RundvaltPas encore d'évaluation
- Histoire Schéma .DrawioDocument2 pagesHistoire Schéma .Drawiosrhiri.lina2006Pas encore d'évaluation
- Fiche de Cours - Hist1Document9 pagesFiche de Cours - Hist1sadekPas encore d'évaluation