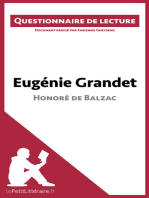Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Theme5 PDF
Theme5 PDF
Transféré par
nanibouh0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
76 vues8 pagesTitre original
theme5.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
76 vues8 pagesTheme5 PDF
Theme5 PDF
Transféré par
nanibouhDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 8
Conseils et suggestions
Lobjectif de ce chapitre est de comprendre comment une ou des
altrations du gnome peuvent conduire une pathologie. Le choix
de la mucoviscidose et du diabte de type 2 permet de distinguer
les maladies dterminisme monognique avec transmission
mendlienne et les maladies multigniques dont le dterminisme
rsulte dinteractions complexes entre gnotype et environnement.
Les raisonnements mis en jeu sont de nature probabiliste. Ltude
de la transmission de la mucoviscidose permet de raliser un calcul
fond sur lanalyse de lascendance familiale et de tableaux de croi-
sement. Ltude du dterminisme du diabte de type 2 repose sur
des notions dpidmiologie et sur le concept de facteur de risque.
Dans les deux cas, la comprhension du dterminisme de la
pathologie et de son mode de transmission justifie les campagnes
de prvention, les stratgies de prise en charge mdicale et fonde
les politiques de sant publique.
Les objectifs de connaissance de cette unit sont de comprendre
une maladie gnique autosomique, donc de comprendre comment
une anomalie gntique porte par un chromosome autosome
peut conduire une maladie svre.
Les lves savent que le fonctionnement cellulaire est assur
grce des protines en gnral et notamment des enzymes
dont la synthse est gouverne par le gnotype. On constate la
frquence leve dune maladie dans une famille sans quelle
soit contagieuse. Ce constat et les connaissances de la classe de
troisime permettent de formuler lhypothse que la maladie est
transmise gntiquement.
La mucoviscidose est suggre par le programme en raison de sa
frquence (cest la plus frquente des maladies gntiques auto-
somiques rcessives en Europe), mais le professeur pourra, sil le
souhaite, choisir un autre exemple.
Une maladie gntique : la mucoviscidose [pp. 248-249 du manuel de llve] 1
U
N
I
T
Connaissances du programme Capacits et attitudes mises en uvre dans lunit
La mucoviscidose est une maladie frquente, provoque par la muta-
tion dun gne qui est prsent sous cette forme chez une personne sur
40 environ.
Le phnotype malade comporte des aspects macroscopiques qui sex-
pliquent par la modification dune protine.
Recenser, extraire et organiser des informations :
pour tablir le lien entre le phnotype macroscopique et le gnotype.
Bien quaucune connaissance concernant une autre maladie
gnique ne soit attendue, un lve doit pouvoir ltudier partir
de documents fournis, lobjectif tant pour le professeur que llve
sache tablir le lien entre le phnotype dune maladie autosomique
et le gnotype.
Le lien entre phnotype et gnotype devra tre tabli diff-
rentes chelles lies les unes aux autres (protine, cellule, organe,
organisme) en comparant le phnotype dun individu malade
celui dun individu sain.
Les lves devront avoir abord auparavant les chapitres du
thme 1 du programme de Premire S qui abordent les relations
gne/protine, mutation/phnotype et le lien entre phnotype
molculaire, phnotype cellulaire et phnotype macroscopique.
Nous prsentons ici les manifestations cliniques dune forme
svre de la mucoviscidose lie la mutation la plus commune
(mutation DF508 exprime ltat homozygote, doc. 3), mais le
professeur doit tre conscient que dautres mutations existent dont
certaines pouvant conduire des formes moins svres de la mala-
die (par exemple, mucoviscidose sans insuffisance pancratique).
En ce sens, il devra veiller choisir des documents en lien avec la
mutation choisie.
Des ressources multimdia sont accessibles en ligne :
www.atlasducorpshumain.fr/thorax/88-mucoviscidose.html.
La page douverture du chapitre, qui prsente un clich dune
cellule scrtrice de mucus borde par deux cellules pithliales
cilies, peut tre utilise pour expliquer le mcanisme de scrtion
et dvacuation du mucus au niveau des bronches dun individu
sain.
THME 5 CHAPITRE 2 70
Conseils et suggestions
Cette unit vise dans un premier temps calculer le risque de
transmission dune maladie gntique. Lexemple trait ici est
toujours la mucoviscidose, maladie monognique transmission
autosomique rcessive.
Conformment au programme, ltude portera sur larbre gna-
logique dune famille atteinte par la mucoviscidose. Ltude
de larbre pourra tre loccasion de rappeler comment se fait la
transmission dun couple dallle (doc. 4) et de confirmer que la
mucoviscidose est bien une maladie autosomique (une proportion
sensiblement gale dhommes et de femmes est touche par la
maladie au sein dune famille) et rcessive (la maladie est trans-
mise par des porteurs sains).
Prvenir et soigner la mucoviscidose [pp. 250-251 du manuel de llve] 2
U
N
I
T
Connaissances du programme Capacits et attitudes mises en uvre dans lunit
Seuls les homozygotes pour lallle mut sont malades.
Ltude dun arbre gnalogique permet de prvoir le risque de trans-
mission de la maladie.
On limite les effets de la maladie en agissant sur des paramtres du
milieu. La thrapie gntique constitue un espoir de correction de la
maladie dans les cellules pulmonaires atteintes.
tudier un arbre gnalogique pour valuer un risque gntique.
Recenser, extraire et organiser des informations :
pour comprendre les traitements mdicaux (oxygnothrapie, kinsith-
rapie) et les potentialits offertes par les thrapies gniques.
Pour le calcul du risque, les lves pourront sappuyer sur leurs
connaissances de mathmatiques sur le calcul de probabilits.
En France, le dpistage nonatal systmatique de la mucovisci-
dose a permis de rvaluer ds 2003 lincidence de la maladie
environ un nouveau-n sur 4 600 naissances, soit une frquence de
sujets htrozygotes (porteurs sains) de lordre de 1 sur 34. Cette
valeur sera la base de tous les calculs de probabilit.
Cette unit aura galement pour objectif denvisager les traite-
ments qui augmentent lesprance de vie des malades et de pr-
senter les espoirs et les limites de la thrapie gnique.
Exploitation des documents par les activits
THME 5 CHAPITRE 2 71
CHAPITRE 2 Variations du gnome
et maladie
VARIATION GNTIQUE ET SANT THME 5
Exploitation des documents par les activits
DOC. 1 ET 2 (Sinformer partir dun schma, mettre en rela-
tion des informations). Les symptmes de la mucoviscidose sont
un encombrement des bronches associ une toux, des expec-
torations voire une insuffisance respiratoire, des troubles digestifs
lis une atteinte de la fonction hpatique et pancratique et
une strilit chez 95 % des hommes malades et chez certaines
femmes (doc. 1). Latteinte respiratoire est due une obstruction
des bronches par un mucus anormalement pais et visqueux qui
est difficilement vacu par le battement des cils de lpithlium
bronchique. De plus, les bactries non vacues sont lorigine
dinfections chroniques qui dtruisent progressivement le tissu pul-
monaire, ce qui amplifie latteinte respiratoire (doc. 2).
DOC. 3 (Sinformer partir dun document). La mutation
consiste en une dltion de trois nuclotides entre les codons 507
et 508. Cette mutation ne provoque ni de dcalage de cadre de
lecture ni de changement dacide amin en position 507 (ATC et
ATT codent pour lisoleucine), mais elle provoque la perte du rsidu
phnylalanine en position 508 de la protine.
DOC. 4 ET 5 (Communiquer par un schma et mettre en rela-
tions des documents). Le schma attendu est donn la page 256
du manuel. Chez lindividu malade, la protine CFTR mutante (canal
ions chlorures), bien que fonctionnelle, est pige dans le cyto-
plasme et dgrade dans sa quasi-totalit avant quelle natteigne
la membrane plasmique apicale des cellules pithliales pulmo-
naires o elle exerce normalement sa fonction. En consquence,
les ions chlorures saccumulent dans les cellules pithliales pulmo-
naires, ce qui provoque indirectement la diminution de la fluidit
du mucus. Celui-ci spaissit, devient difficile vacuer et conduit
la maladie.
EN CONCLUSION (Communiquer en rdigeant une synthse ou
en construisant un schma bilan). Un schma bilan semblable
celui de la page 259 peut tre propos. Lensemble des documents
montre que le phnotype de la mucoviscidose sexprime diff-
rentes chelles : molcule (perte de la phnylalanine en position
508 de la protine CFTR), cellule (diminution de lexpression du
canal CFTR, baisse de la concentration en ions chlorures dans le
mucus, augmentation de la viscosit et paississement du mucus),
de lorgane (obstruction des bronches, destruction des poumons) et
de lorganisme (toux, expectorations, insuffisance respiratoire). Par
ailleurs, les effets observs ces diffrentes chelles sont lis : la
perte dun rsidu phnylalanine provoque une baisse de lexpres-
sion de la protine CFTR au niveau membranaire ; lpaississement
du mucus qui sensuit provoque une obstruction des bronches,
laquelle peut tre lorigine dune insuffisance respiratoire dans
les cas les plus graves.
()
SVT1
re
S ditions Belin 2011 SVT1
re
S ditions Belin 2011
Une maladie mtabolique : le diabte de type 2 [pp. 252-253 du manuel de llve] 3
U
N
I
T
Connaissances du programme Capacits et attitudes mises en uvre dans lunit
Le plus souvent, limpact du gnome sur la sant nest pas un dter-
minisme absolu. Il existe des gnes dont certains allles rendent plus
probable le dveloppement dune maladie sans pour autant le rendre
certain.
Un exemple de maladie (maladie cardio-vasculaire, diabte de type II)
permet dillustrer le type dtudes envisageables.
Recenser, extraire et organiser des informations pour identifier :
lorigine multignique de certaines maladies ;
linfluence des facteurs environnementaux.
Comprendre que dterminer les facteurs gntiques ou non dune mala-
die repose sur des mthodes particulires qui constituent les fondements
de lpidmiologie.
THME 5 CHAPITRE 2 72
Les causes du diabte de type 2 [pp. 254-255 du manuel de llve] 4
U
N
I
T
Connaissances du programme Capacits et attitudes mises en uvre dans lunit
En gnral les modes de vie et de milieu interviennent galement et
le dveloppement dune maladie dpend alors de linteraction complexe
entre facteurs du milieu et gnome.
Comprendre les conditions de validits daffirmations concernant la res-
ponsabilit dun gne ou dun facteur de lenvironnement dans le dclen-
chement dune maladie.
Savoir choisir ses comportements face un risque de sant pour exercer
sa responsabilit individuelle ou collective.
THME 5 CHAPITRE 2 73
DOC. 1, 5 ET 6 (Mettre en relation des donnes). Le graphique
montre que lesprance de vie est de 35 ans pour les enfants qui
sont ns en 2000 [au Canada] alors quelle ntait que de trois ans
dans les annes 1950. Laugmentation de lesprance de vie des
malades depuis 1960 est dabord due lutilisation des antibio-
tiques (vers 1950) puis des soins appropris qui aident mieux
vacuer le mucus (kinsithrapie) ou lutter contre linsuffisance
respiratoire (oxygnothrapie). Le dpistage systmatique de
la maladie depuis 2002 en France permet de traiter les enfants
malades ds le plus jeune ge, ce qui a encore augment les-
prance de vie (elle est de 46 ans en France pour les enfants qui
sont ns en 2008). Enfin, depuis une dizaine dannes, les patients
svres ont la possibilit de subir une greffe pulmonaire pour un
gain desprance de vie de 5 ans environ.
DOC. 2 ET 4 (Calculez un risque de transmission dune maladie).
Le ftus III-5 a dj un frre malade, ce qui signifie que les parents
II-5 et II-6 sont des porteurs sains portant la mutation ltat ht-
rozygote (doc. 2). Dans ces conditions, la probabilit quils donnent
naissance un enfant malade est de (doc. 4).
DOC. 3 ET 4 (Calculez un risque de transmission dune maladie).
Le dtail des calculs de transmission pour chaque cas est donn
dans le tableau de la page 256.
DOC. 7 (Sinformer partir dun schma et dun texte). La th-
rapie gnique constitue un espoir de gurison dans la mesure o
elle consiste faire exprimer le gne CFTR sauvage dans les cellules
de lpithlium bronchique. Pour cela, on introduit le gne sauvage
dans un vecteur viral comme ladnovirus, le virus responsable des
rhumes. Le vecteur doit en outre tre rendu inoffensif par limi-
nation de ses gnes de virulence et demeurer capable dinfecter
les cellules pithliales pulmonaires. Les avantages de la mthode
sont quelle constitue un espoir de correction de la maladie et que
les essais cliniques ont montr quil est possible dintroduire le
gne CFTR dans les cellules pithliales. Les inconvnients sont
que le gne sauvage ne peut pas tre directement introduit dans
les cellules souches de lpithlium pulmonaire (des administra-
tions rptes de vecteur doivent tre ralises) et que la raction
immunitaire du patient diminue lefficacit du traitement.
EN CONCLUSION (Communiquer en rdigeant une synthse).
Voir le rsum de lunit 2, page 256.
Conseils et suggestions
Le programme suggre de traiter un exemple de maladie dter-
minisme multignique, diabte de type 2 ou maladies cardiovascu-
laires. Le choix sest port sur le diabte de type 2, maladie moins
polymorphe que les maladies cardiovasculaires et exemple repris
en classe de Terminale S. Le cas dune maladie cardiovasculaire,
lathrosclrose, est abord sous la forme dun exercice Objectif
bac, p. 283.
Lunit 3 vise prsenter les caractristiques du diabte : bases
physiologiques, tiologie, pidmiologie et consquences. Il est
fait appel au concept de boucle de rgulation abord en classe
de Seconde. Les fondements de lpidmiologie permettent de
souligner le caractre pidmique de cette pathologie. La page de
gauche de cette unit 3 sera donc loccasion de discuter la notion
dpidmie, (augmentation de la prvalence dune maladie dans
une population o elle tait auparavant peu ou pas prsente). Le
caractre pidmique nest donc pas ncessairement associ celui
de contagiosit.
Limportance de la pathologie en termes de sant publique ayant
t dmontre, les lves pourront ensuite aborder les causes
gntiques et environnementales du diabte de type 2.
Exploitation des documents par les activits
DOC. 1 (Sinformer partir dun schma). Le schma prsente
des organes assurant quatre rles : stockage temporaire du glucose,
consommation du glucose, production dun messager : linsuline,
transport du glucose et de linsuline. Le pancras apparat donc
comme un donneur dordres, les vaisseaux et le sang comme trait
dunion entre les organes et les muscles, le foie et le tissu adipeux
comme les effecteurs assurant soit une baisse soit une hausse de la
glycmie. La boucle de rgulation est rsume p. 257.
Le texte de lgende souligne le grand nombre de protines impli-
ques dans la transmission du message port par linsulinmie.
Les connaissances des lves sur la synthse des protines (pp.
48-69 du manuel lve) permettent de formuler lhypothse que
la mutation de lun des nombreux gnes codant ces protines peut
aboutir un drglement de la glycmie.
DOC. 1, 2 ET 6 (Sinformer pour tablir une relation entre
diffrents documents). Le doc. 2 permet de retrouver le fonc-
tionnement normal de la boucle de rgulation (cas tmoin) : une
ingestion de glucose est rapidement suivie dune scrtion impor-
tante dinsuline (insulinmie huit fois plus importante qu jeun)
limitant la hausse de la glycmie ; lorsque la glycmie a diminu,
la scrtion dinsuline cesse. Chez les patients diabtiques de
type 1, linsulinmie reste quasi nulle. La hausse de glycmie trs
importante dmontre la ncessit de linsuline pour viter lhyper-
glycmie. Chez les patients diabtiques de type 2, linsulinmie
volue presque normalement, mme si lamplitude des variations
est plus faible que chez le tmoin ; pourtant la glycmie augmente
fortement et durablement : la prsence de linsuline na pas suffi
empcher lhyperglycmie. Cest donc en aval de la scrtion din-
suline que la boucle de rgulation de la glycmie est perturbe, l
o de nombreuses protines sont impliques dans la transmission
du message. On peut donc localiser (schma p. 257) les dysfonc-
tionnements dans la boucle de rgulation.
Le doc. 6 montre lintrt des traitements qui visent faire baisser
la glycmie en renforant leffet de linsuline (augmentation de sa
scrtion ou sensibilisation des cellules cibles) ou en favorisant la
consommation de glucose (activit physique). Le doc. 2 montre
galement que linsulinoscrtion est plus leve jeun chez le
patient de type 2 que chez le tmoin : linsuline est donc anorma-
lement efficace, et on comprend que les cellules du pancras, en
permanence sollicites, puissent finalement spuiser (doc. 6)
DOC. 3 A 5 (Sinformer partir de graphiques et mettre en
relation des documents). Cette srie de documents prsente une
approche pidmiologique de la maladie et introduit la notion de
prvalence, qui recense tous les malades, rcents ou anciens. Cette
notion est distinguer de celle dincidence, qui ne regroupe que
les cas rcents (pour le diabte de type 2, ceux apparus au cours
de lanne coule). Le doc. 3 montre une forte augmentation de
la prvalence sur 30 ans, donc une pidmie. La carte montre une
ingale rpartition dans le monde. On peut ce stade proposer
que les populations prsentent des susceptibilits diffrentes en
raison de leur patrimoine gntique et/ou de leur environnement
et mode de vie : rgime alimentaire en Amrique du Nord, fac-
teurs gntiques en Arabie Saoudite ou Amrique du Sud. Le doc.
4 montre que le diabte de type 2 reprsente la forme la plus
rpandue de diabte et apparat tardivement au cours de la vie. Ce
facteur ge explique sans doute en partie la faible prvalence du
diabte de type 2 en Afrique.
La France apparat peu touche sur la carte (doc. 3) mais la prva-
lence augmente constamment (doc. 5) : on peut ainsi complter la
notion dpidmie avec extension de la maladie dans une popula-
tion o elle tait auparavant peu prsente.
Le diabte de type 2 est donc une maladie en fort dveloppement,
avec de grandes ingalits selon la rgion du monde et lge de
la population.
DOC. 5 ET 6 (Mettre en relation des documents). Laugmentation
de la prvalence et la gravit des consquences font du diabte de
type 2 une maladie grave. Les dcs quil cause et les handicaps
quil gnre justifient une politique de sant publique. Les per-
sonnes traites sont effet dautant mieux prises en charge quelles
sont diagnostiques un stade prcoce. La prvention, le dpis-
tage, une prise en charge mdicamenteuse et des rgles dhygine
de vie peuvent retarder lapparition ou laggravation de la maladie.
EN CONCLUSION (Communiquer en rdigeant une synthse). Le
diabte se caractrise par des hyperglycmies, notamment aprs
les repas, durables et non rgules. La forme la plus frquente et
en trs forte progression actuellement est le diabte de type 2,
caus par une diminution de lefficacit de linsuline. La forte pro-
gression de la maladie dans le monde et en France justifie que lon
parle dpidmie. Cette pidmie touche principalement des sujets
gs de plus de 45 ans. Elle entrane de graves complications, cau-
sant des handicaps et des dcs prmaturs.
()
SVT1
re
S ditions Belin 2011 SVT1
re
S ditions Belin 2011
Conseils et suggestions
Les raisonnements mis en jeu dans cette unit sont de nature
probabiliste. Lobjectif est de faire dcouvrir la notion de facteur
de risque et notamment dallle de prdisposition. Cette tude
sappuie sur les mthodes statistiques qui fondent lpidmiologie.
La premire page prsente les mthodes de biologie molculaire
et le concept de facteur de risque.
Pour comprendre le principe des animations, on peut utiliser
une animation en ligne : www.cea.fr/var/cea/storage/static/fr/
jeunes/animation/aLaLoupe/biopuce/puceAdn.htm.
Le dterminisme multignique du diabte de type 2 nest pas
simple tablir : cette information est donc donne llve. De
mme, la notion de facteur de risque dpasse les connaissances
mathmatiques des lves. Sa prsentation a donc t simplifie.
La page de gauche prsente plusieurs exemples de facteurs de
risque, gntiques et environnementaux, pour aboutir la notion
dinteraction entre gnome et environnement. Lexercice 4, p. 261
prolonge la rflexion sur leffet cumulatif de plusieurs allles dfa-
vorables et de facteurs environnementaux ou comportementaux.
Exploitation des documents par les activits
DOC. 1 A 3 (Sinformer et mettre en relation des documents).
Le doc. 1 fournit linformation cl : le fonctionnement anormal de
plusieurs gnes est ncessaire pour dclencher un diabte de type
2. Les diffrents allles des gnes du patrimoine gntique humain
sont connus grce au squenage des gnomes. Ils se distinguent
les uns des autres par des diffrences souvent ponctuelles, les
SNP. Ces SNP peuvent tre facilement tudis grce aux puces
ADN (doc. 2). Ces techniques permettent dobtenir rapidement le
gnotype des individus, sans mme avoir squencer les gnes
intressants. Chaque puce ADN permet dtudier le polymor-
phisme gntique de plusieurs milliers de gnes simultanment. Il
est donc possible dobtenir la frquence dun allle donn dans une
population importante (doc. 3). On peut ainsi calculer la prvalence
du diabte de type 2 dans une population possdant un allle
donn et dans une population semblable mais ne le possdant
pas. Lexistence dune diffrence de prvalence entre ces popula-
tions permet dimpliquer le gne tudi dans le dclenchement
de la maladie. La comparaison des prvalences permet ainsi de
caractriser des allles favorisant la maladie ou au contraire effet
protecteur. On parle souvent de gnes de prdisposition, mais il
sagit en fait dallles de prdisposition.
Le doc. 3 prsente la notion de facteur de risque de manire gn-
rale, la possession dun allle donn pouvant tre tudie au mme
titre quun facteur environnemental (comportement alimentaire
par exemple).
DOC. 1 ET 4 (Sinformer pour tablir une relation entre diff-
rents documents). Le doc. 4 montre que certains allles augmen-
tent faiblement le risque de diabte de type 2. Certains gnes sont
directement impliqus dans la rgulation de la glycmie, comme
SLC30A8 dont lexpression favorise la scrtion de linsuline. Pour
dautres comme TCF7L2, on ne peut que formuler des hypothses :
la protine code est peut-tre active en rponse larrive din-
suline pour favoriser le stockage de glucose ; pour dautres enfin,
on doit simplement constater quils constituent un facteur de risque
gntique. La possession de plusieurs allles dfavorables de dif-
frents gnes de prdisposition a des effets cumulatifs complexes.
Si tous ces gnes avaient des effets totalement indpendants, il
suffirait de multiplier les facteurs de risques de chacun des gnes
pour obtenir le facteur de risque global dun individu. Toutefois,
certaines associations sont synergiques ou au contraire ont des
effets compensateurs.
Le graphique complte ce document en montrant que les gnes
de prdisposition sont des gnes dont le fonctionnement est altr
mais pas nul (contrairement au gne CFTR responsable de la muco-
viscidose).
Ainsi, le dclenchement de la mucoviscidose est li la possession
de deux allles non fonctionnels dun seul gne. Le diabte de type
2 rsulte, lui, du dysfonctionnement partiel de nombreux gnes.
DOC. 4 ET 5 (Mettre en relation des documents). Le doc. 4
montre lexistence de facteurs gntiques, le doc. 5 montre quun
changement de mode de vie est galement associ un dvelop-
pement de la maladie. La baisse dactivit physique et lamliora-
tion de lalimentation lie au dveloppement conomique nont
pas t compenses par une adaptation du rgime alimentaire ou
un dveloppement des activits physiques de loisir. Dans le cas de
lInde, cet effet environnemental est amplifi par lexistence dun
terrain gntique dfavorable.
DOC. 5 7 (Mettre en relation des documents). Le doc. 6
montre que 80 % des diabtiques de type 2 sont en surpoids ou
obse. Navement, on peut tablir deux liens entre obsit et
diabte. Le diabte, caractris par une hyperglycmie conduirait
un stockage de glucose, converti en graisses dans le tissu adipeux
(doc. 1, p. 252). Le doc. 7 contredit cette hypothse : lobsit est
un facteur de risque trs important (presque 10 comparer avec
la possession dun allle dfavorable de TCF7L2, seulement 1,35,
doc. 4). Les personnes obses sont des personnes ayant un ds-
quilibre du mtabolisme nergtique. Le glucose tant le principal
mtabolite nergtique, il est normal quun trouble comme lob-
sit perturbe la rgulation de la glycmie. Chez la souris, le tissu
adipeux est dailleurs connu pour scrter une hormone rendant
les cellules rsistantes linsuline la rsistine. Laccumulation de
graisse aboutit donc une baisse de sensibilit des cellules cibles
de linsuline.
EN CONCLUSION (Communiquer en rdigeant une synthse).
Le diabte de type 2 est caus par deux grands types de facteurs
qui ont t mis en vidence par des tudes pidmiologiques. Les
facteurs qui sont associs une plus forte prvalence du diabte de
type 2 sont appels facteurs de risque. Les progrs dans la connais-
sance du gnome humain ont montr que certains allles de gnes
normalement prsents dans nos cellules favorisent lapparition
de la maladie. Ces allles rendent le fonctionnement des cellules
lgrement moins efficaces dans la rgulation de la glycmie.
Certaines populations concentrent un nombre lev de ces allles
prdisposant au diabte de type 2. Par ailleurs, le mode de vie
THME 5 CHAPITRE 2 74 THME 5 CHAPITRE 2 75
et ltat de sant : un rgime alimentaire trop gras ou trop sucr,
la sdentarit, lobsit ou lge notamment sont des facteurs de
risque importants. Chacun de ces facteurs contribue faiblement au
dclenchement du diabte, mais lexposition un nombre lev de
facteurs de risque rend probable la maladie.
CHAPITRE 2 Variations du gnome
et maladie
U
N
I
T
Les caractristiques dun cancer [pp. 264-265 du manuel de llve] 1
Connaissances du programme Capacits et attitudes mises en uvre dans lunit
[] La formation dun clone cellulaire est parfois le commencement dun
processus de cancrisation.
La connaissance de la nature des perturbations du gnome responsable
dun cancer permet denvisager des mesures de protection (vitement des
agents mutagnes, surveillance, vaccination).
Comprendre les causes multiples pouvant concourir au dveloppement
de certains cancers et identifier des mesures de prvention possibles.
Les tumeurs ainsi formes pourront ensuite grossir grce la mise
en place de nouveaux vaisseaux sanguins qui les alimenteront en
nutriments et en dioxygne (doc. 3). Lorsquune tumeur prsente
une taille suffisamment importante, elle est susceptible dentraver
le fonctionnement normal des organes et de mettre en pril la vie
dune personne.
DOC. 4 ET 5 (Sinformer partir de documents). Le doc. 5
montre clairement que le pourcentage de survie cinq ans aprs le
diagnostic est dautant plus faible que le cancer est dpist un
stade avanc. 94 % des patients dont on a diagnostiqu un cancer
superficiel restent en vie 5 ans aprs le diagnostic, alors que ce
pourcentage est de seulement 5 % chez des patients dont on a dia-
gnostiqu un cancer mtastatique. Ce constat justifie les politiques
de dpistage prcoce du cancer qui permet dliminer les lsions
prcancreuses, voire de petites tumeurs (doc. 4).
DOC. 6 ET 7 (Sinformer et mettre en relation des donnes).
Le doc. 6 prsente un clich de cellules cancreuses (cellules HeLa)
en culture dont le noyau a t marqu en bleu et le cytoplasme en
vert laide de molcules fluorescentes. Ces cellules adhrent au
fond de la bote de culture et prolifrent (de nombreuses figures
de division sont visibles). Le doc. 7 prsente les principales carac-
tristiques des cellules cancreuses mtastatiques en culture par
rapport des cellules saines : division indfinie (cellules immor-
telles ), pas dinhibition de la division au contact des cellules
voisines (do un empilement des cellules cancreuses), capacit
migrer dans les tissus. Les cellules cancreuses mtastatiques au
sein de lorganisme prsentent les mmes proprits : prolifration
indfinie au sein dune tumeur, absence dinhibition de contact
(do une prolifration incontrle) et capacit des cellules migrer
et former des mtastases dans les tissus.
EN CONCLUSION (Communiquer en rdigeant une synthse).
Voir le rsum de lunit 1 page 276.
Conseils et suggestions
Les objectifs de cette unit sont de dfinir les diffrentes tapes
de lapparition dun cancer et les caractristiques des cellules can-
creuses, et de justifier la ncessit des politiques de prvention.
Les principales tapes cliniques de lapparition dun cancer pith-
lial (cancer du col de lutrus) sont prsentes, mais le professeur
pourra choisir, sil le souhaite, dautres exemples. Le cancer de la
peau peut tre une bonne alternative dans la mesure o : il est le
seul cancer dont on peut suivre lvolution lil nu ; il permet
dvoquer certaines mthodes de prvention (usages de crmes
solaires, limiter lexposition au soleil, etc.).
Un atelier (p. 285) sur le dpistage prcoce du cancer aborde la
question du diagnostic travers une recherche sur Internet.
Exploitation des documents par les activits
DOC. 1 A 3 (Sinformer partir de documents). Ces documents
mettent en lumire les trois principales tapes de lapparition dun
cancer :
La premire tape correspond lapparition dun cancer non inva-
sif visualis sur le 2
e
clich du doc. 1. ce stade, la prolifration de
certaines cellules de lpithlium utrin produit des tumeurs solides
qui restent toujours localises dans lpithlium.
Au stade invasif, certaines cellules cancreuses acquirent la
capacit de migrer hors de leur tissu dorigine. Elles quittent lpi-
thlium et gagnent un tissu plus profond (ici, le myomtre).
Le doc. 2 prsente le stade le plus avanc : le cancer mtasta-
tique. Sur ce clich de Petscan, de nouvelles tumeurs appeles
mtastases sont visibles au niveau du foie. Elles sont formes
partir dune tumeur primaire localise dans un autre organe, dont
des cellules cancreuses ont gagn la circulation sanguine pour se
fixer dans cet organe.
SVT1
re
S ditions Belin 2011 SVT1
re
S ditions Belin 2011
Conseils et suggestions
La page douverture du chapitre, qui prsente des cellules canc-
reuses exprimant un gne impliqu dans le dveloppement dun
cancer, peut tre utilise comme point de dpart de lunit pour
mettre en vidence des modifications gntiques spcifiques aux
cellules cancreuses.
Cette unit vise montrer que les proprits spcifiques des
cellules cancreuses rsultent de modifications gntiques, que
lapparition dun cancer peut tre favorise par certains agents
mutagnes (comme les UV) et, enfin, que plusieurs types de
mutations sont susceptibles de saccumuler au sein dun clone de
cellules cancreuses.
Les lves ont dj tudi en classe de Seconde et dans le pre-
mier thme du programme de Premire S la notion de mutation
ainsi que les diffrentes tapes du cycle cellulaire.
Lexercice 6 de la p. 281 permet dapprofondir ces notions et
dtablir le lien entre lapparition dune nouvelle mutation, la
modification des proprits des cellules cancreuses et le stade
davancement dun cancer. Cet exercice montre clairement que la
cancrisation est un processus multi-tapes rsultant de laccumu-
lation progressive de plusieurs mutations au sein des cellules.
On dveloppe ici le rle du gne p53 dans lapparition de certains
cancers mais de nombreux autres gnes peuvent tre tudis (pRB
pour le rtinoblastome, par exemple)
Le professeur pourra garder lesprit quil existe deux grands
types de mutations impliques dans les cancers : celles qui condui-
sent linactivation dun gne bloquant normalement le cycle
cellulaire (gnes suppresseurs de tumeurs : p53, pRB, etc.) et celles
qui conduisent la suractivation dun gne impliqu normalement
dans la progression dans le cycle cellulaire (oncognes RAS, rcep-
teur lEGF, MDM2, etc.).
Exploitation des documents par les activits
DOC. 1 (Analyser et interprter des rsultats exprimentaux).
On constate que les souris transgniques super-p53 (qui expriment
une copie supplmentaire du gne p53) sont moins sensibles la
cancrisation que les souris sauvages (40 semaines aprs lexpo-
sition des souris un agent cancrigne, seules 30 % des souris
super-p53 sont mortes, alors que 90 % des souris sauvages sont
mortes). On en dduit donc que le gne p53 protge les cellules
de la cancrisation.
Les bases gntiques des cancers [pp. 266-267 du manuel de llve] 2
U
N
I
T
Connaissances du programme Capacits et attitudes mises en uvre dans lunit
Des modifications accidentelles du gnome peuvent se produire dans
des cellules somatiques et se transmettre leurs descendantes. Elles sont
lorigine de la formation dun clone cellulaire porteur de ce gnome
modifi.
Recenser, extraire et organiser des informations pour identifier lorigine
des facteurs de cancrisation (agents mutagnes).
DOC. 2 ET 3 (Mettre en relation des donnes et interprter des
rsultats exprimentaux). Lanalyse du doc. 2 et du doc. 3 montre
quil existe 2 types de rponse cellulaire en fonction de la dose
dUV (un agent mutagne) :
Lorsque des cellules en culture sont irradies par une
dose moyenne dUV (comprise entre 10 et 20 J. m
-2
), les
cellules ne se divisent plus et elles rparent leur ADN :
on constate en effet une augmentation de lexpression des gnes
p21 (un gne bloquant le cycle cellulaire) et p53R2 (un gne de
rparation de lADN). Lexpression de ces deux gnes est induite par
la protine p53 (doc. 3) qui saccumule dans les cellules exposes
aux UV (doc. 2).
- Lorsque des cellules en culture sont irradies par une forte dose
dUV (comprise entre 20 et 50 J. m
-2
), beaucoup de cellules meurent
(le pourcentage de cellules mourantes est dautant plus fort que
la dose dUV est importante). Cette mort cellulaire est galement
induite par laccumulation de la protine p53 (doc. 3).
Ces deux rponses induites par p53 suite une irradiation par les
UV empchent laccumulation de mutations dans les cellules dans
la mesure o p53 induit une rparation de lADN (pour de faibles
doses dUV) ou induit directement la mort cellulaire lorsque le
nombre de mutations accumules est trop important (pour de
fortes doses dUV). Pour ces raisons, la protine p53 prserve lin-
tgrit du gnome.
DOC. 2 ET 7 (Sinformer et raisonner). Le doc. 7 prcise que
lapparition dun cancer rsulte de laccumulation de plusieurs
mutations affectant certains systmes de rgulation cellulaire (dont
celui impliquant le gne p53, qui conduit soit llimination des
cellules cancreuses soit la rparation de lADN). En permettant
la rparation des mutations spontanes ou induites, la protine p53
protge ainsi les cellules de la cancrisation.
DOC. 4 A 7 (Sinformer et raisonner). Une premire classe
de mutations est illustre par le doc. 4 qui prsente une partie
du caryotype dune cellule cancreuse (issue dun liposarcome,
un cancer du tissu adipeux). On y observe un chromosome gant
surnumraire comportant 50 copies du gne MDM2. Ici, la canc-
risation rsulte dune augmentation du nombre de copies de ce
gne qui code pour une protine dgradant p53. Cette cellule, par
la suractivation de la protine MDM2, a donc acquis la capacit
de contourner le systme de rgulation impliquant p53. Le doc. 5
montre quon a retrouv dans certains cancers du poumon dautres
mutations de ce type, qui conduisent soit la surexpression dune
THME 5 CHAPITRE 2 77 THME 5 CHAPITRE 2 76
protine (mutation du gne du rcepteur lEGF) soit sa suracti-
vation (mutation du gne RAS). Ces mutations activent la voie des
facteurs de croissance, mme en absence de facteur de croissance
(doc. 6), et accroissent donc le rythme de division des cellules
mutes.
linverse, certaines mutations impliques dans le dveloppement
dun cancer peuvent se traduire par linactivation dune protine.
Cest le cas de la protine p53 que lon retrouve inactive dans
50 % dune des formes du cancer du poumon.
Dans tous les cas, on retrouve dans la grande majorit des cancers
plusieurs mutations appartenant lune et/ou lautre des deux
catgories.
EN CONCLUSION (Communiquer en rdigeant une synthse).
Voir le rsum de lunit 2, p. 276.
Conseils et suggestions
Lobjectif de cette unit vise dgager la notion de facteur de
risque du cancer. Dans le chapitre prcdent (chapitre 1, unit
4, pp. 254-255), les lves ont tabli que la possession dallles
dfavorables constituait un facteur de risque pour le diabte de
type II. Dans cette unit, ils auront montrer que des agents qui
perturbent lexpression du gnome en provoquant des mutations,
favorisent la cancrisation. Ainsi, un comportement risque peut
modifier le gnome de certaines cellules et dclencher une patho-
logie. Lexemple choisi est celui du benzopyrne de la fume de
cigarettes, impliqu dans les cancers pulmonaires. Lexemple du
benzne peut tre abord grce lexercice 5 p. 281.
Des ressources complmentaires dintrt peuvent tre mobili-
ses, comme celles publies sur le site www.tabac-info-service.fr.
Exploitation des documents par les activits
DOC. 1 ET 2 (Sinformer et mettre en relation des documents).
Le doc. 1 rvle la grande similitude de lvolution du taux de
tabagisme et de celle du taux de mortalit par cancer du poumon.
Le doc. 2 prouve que le tabagisme est un facteur de risque de
dclenchement du cancer, avec un effet de la dose : le risque relatif
augmente avec la consommation. On peut souligner labsence de
seuil : ds la premire cigarette, le risque augmente. Le doc. 1
rvle un dcalage entre laugmentation de la quantit de ciga-
rettes consommes et la mortalit denviron 30 ans. La baisse du
tabagisme chez lhomme, enregistr depuis 1980 saccompagne
dune baisse actuelle de la mortalit masculine. Chez les femmes,
la tendance est encore malheureusement la hausse, le taux de
tabagisme nayant dcru que rcemment.
Cancers et agents mutagnes [pp. 268-269 du manuel de llve] 3
U
N
I
T
Connaissances du programme Capacits et attitudes mises en uvre dans lunit
Des modifications somatiques du gnome surviennent par mutations
spontanes ou favorises par un agent mutagne.
La connaissance de la nature des perturbations du gnome responsables
dun cancer permet denvisager des mesures de protection (vitement des
agents mutagnes).
Recenser, extraire et organiser des informations pour identifier lorigine
des facteurs de cancrisation (agents mutagnes).
Comprendre les causes multiples pouvant concourir au dveloppe-
ment de certains cancers (cas des cancers pulmonaires) et identifier des
mesures de prvention possibles.
DOC. 3 ET 4 (Sinformer). Le doc. 3 rappelle le flau que
constitue le tabagisme des jeunes : dbuter la cigarette vers 15
ans implique un risque lev de cancer du poumon se dclenchant
vers 45 ans seulement. Le cancer du poumon est alors une cause
de mortalit non ngligeable. Au cours des annes 2005 2010, le
taux de fumeurs quotidiens a augment dans la population gn-
rale. Seul le pourcentage de jeunes filles fumeuses est plus faible
en 2010 que cinq ans auparavant. Les pouvoirs publics peuvent
donc influencer directement lvolution de la mortalit par des
campagnes de prvention, notamment auprs des jeunes.
DOC. 5 (Sinformer et raisonner). Le doc. 5 rappelle que la
fume de cigarettes contient de nombreuses substances nocives
dont le benzopyrne. Sa transformation dans lorganisme conduit
un produit hautement ractif, le BPDE, qui ragit avec la guanine.
Celle-ci sapparie plus avec une cytosine, mais avec une adnine.
On constate alors quen deux tapes de rplication, la modification
dun des brins de lADN conduit au remplacement dune paire G/C
par une paire T/A. Cette modification de la squence en nuclotide
est bien une mutation. Le benzopyrne est donc lgitimement
considr comme un agent mutagne.
DOC. 5 A 7 (Sinformer et raisonner). Lobjectif est ici de
dmontrer que le benzopyrne est effectivement cancrigne. Le
doc. 5 montre que le benzopyrne est mutagne. Plus prcis-
ment, le doc. 7 montre quune exposition au benzopyrne accrot le
taux de guanines modifies, l encore dose dpendante. Le doc. 6
rvle quune exposition au benzopyrne augmente la probabilit
de dvelopper une tumeur, avec un effet de la dose [N.B. : Dans
lexprience originale, il sagit de tumeurs hpatiques en rponse
()
SVT1
re
S ditions Belin 2011 SVT1
re
S ditions Belin 2011
THME 5 CHAPITRE 2 78
du benzopyrne introduit dans la nourriture.] On peut donc en
conclure que le benzopyrne induit des modifications des guanines
et quau-del dun certain seuil, le nombre de guanines modifies
est assez lev pour aboutir la formation de tumeurs. Deux
explications sont possibles, non exclusives : avec trop de guanines
modifies, les systmes de rparation de lADN sont dbords et
des mutations apparaissent ; partir dun seuil de concentration
de benzopyrne, donc de modification de guanines, il y a suffi-
samment daltrations du gnome pour que le dveloppement
cellulaire soit anormal, de type tumoral.
DOC. 8 Les cellules de cancer du poumon, issues de patients
fumeurs comme non-fumeurs, prsentent des mutations du gne
p53 qui peuvent conduire la cancrisation (voir p. 266). Ces muta-
tions sont de type G-C > T-A, dont on sait quil correspond leffet
mutagne du benzopyrne. La spcificit des cancers du poumon
chez les fumeurs rside donc dans la frquence leve de muta-
tions pouvant rsulter de labsorption du benzopyrne.
EN CONCLUSION (Communiquer en rdigeant une synthse).
La fume de cigarette contient de nombreuses substances nocives.
La mieux caractrise est le benzopyrne qui est transform en
BPDE dans lorganisme. Celui-ci est un agent mutagne qui altre
lexpression gntique. Le gne p53 fait partie des gnes altrs
par le BPDE. Il en rsulte une accumulation facilite de mutations
dans tout le gnome : celles qui permettent la survie et la prolif-
ration favorisent la cancrisation et le dveloppement des cellules
qui les portent. Les cellules du poumon tant les plus exposes au
benzopyrne de la fume de cigarette, le tabagisme dclenche tout
particulirement des cancers dans cet organe.
Conseils et suggestions
Aprs lunit 3, consacre aux agents mutagnes, lunit 4
aborde la question des perturbations gnres par une infection
virale chronique. Le choix des papillomavirus et des cancers du col
de lutrus a t guid par lactualit des campagnes de prvention
de ce cancer.
la diffrence de la vaccination contre lhpatite B, qui fait
dsormais partie du calendrier vaccinal (une grande proportion des
lves de lyce a t vaccine ds lenfance), la vaccination contre
les papillomavirus responsables de cancers de lutrus est rcente
et facultative. Les jeunes filles lves de Premire sont directement
concernes par ces campagnes de vaccination.
Il est intressant de saisir loccasion de discuter du lien entre virus
et cancer et du raccourci vaccin anti-cancer souvent voqu
propos de ce vaccin. On pourra galement rappeler lintrt de la
vaccination contre lhpatite B, au moyen dinformations publies
sur le site www.hepatites-info-service.org. Il est aussi possible de
construire des exercices avec des documents trs comparables
ceux prsents dans cette unit, en utilisant les donnes pid-
miologiques prsentes sur le site de lINVS (www.invs.sante.fr).
Des vues de cellules HeLa en culture, issues de mtastases dun
cancer du col de lutrus, sont galement disponibles sur le site
www.exploratorium.edu/imaging_station/research/cancer/story_
cancer4.php. Elles enrichiront lobservation du doc. 5.
Cancers et virus [pp. 270-271 du manuel de llve] 4
U
N
I
T
Connaissances du programme Capacits et attitudes mises en uvre dans lunit
Des modifications somatiques du gnome surviennent par mutations
spontanes ou favorises par un agent mutagne. Dautres sont dues
des infections virales.
La connaissance de la nature des perturbations du gnome responsables
dun cancer permet denvisager des mesures de protection (surveillance,
vaccination).
Recenser, extraire et organiser des informations pour identifier lorigine
des facteurs de cancrisation (infections virales).
Comprendre limportance, en matire de sant publique, de certains
virus lis la cancrisation (hpatite B, papillomavirus) et connatre les
mthodes de prvention possibles.
La question du dpistage du cancer est approfondie par latelier
Enqute, p. 285, qui prend appui sur deux exemples de cancers au
sujet desquels il est utile dinformer les lves : le cancer du sein
et celui de la peau.
Exploitation des documents par les activits
DOC. 1 A 3 (Sinformer et mettre en relation des documents).
Laffiche et sa lgende (doc. 1) rappellent que le cancer du col de
lutrus est le deuxime cancer fminin. Sa frquence dans ses
phases prcoces en fait un cancer souvent diagnostiqu tard, com-
promettant lefficacit des traitements.
DOC. 2 ET 3 (Mettre en relation des donnes et interprter des
rsultats exprimentaux).
Le doc. 2 souligne lassociation trs forte de deux papillomavirus
(HPV16 et 18) et de cancers du col de lutrus : plus de 80 % de ces
cancers se dveloppent chez des femmes ayant t infectes par
lun de ces virus. Linfection constitue donc un facteur de risque
fort. Le doc. 3 peut permettre de rassurer les jeunes filles : il rap-
pelle que linfection par HPV16 ou 18 naboutit que rarement un
cancer. Seulement 2 % (10 % des 20 % infectes) des femmes pr-
senteront une infection chronique, qui dbouchera sur des lsions
prcancreuses chez 0,4 % (20 % des 2 % prcdents) et nabou-
THME 5 CHAPITRE 2 79
tiront un cancer que chez 0,08 % des femmes infectes (20 %
des 0,4 % prcdents). On note que le cancer ne se dclenche que
15-20 ans aprs linfection. Le mcanisme de la cancrisation peut
tre voqu en utilisant le doc. 3 de la p. 266 : la destruction de la
protine p53 par des protines virales confre aux cellules prsen-
tant des lsions la capacit de prolifrer sans rparation, donc en
accumulant des anomalies.
DOC. 3 ET 4 (Sinformer et raisonner). La date de vaccination
est justifie par limpratif de protger les jeunes filles avant toute
exposition un risque dinfection chronique, cest--dire avant
les premiers rapports sexuels (doc. 3), Le premier rapport sexuel
nayant que trs rarement lieu avant lge de 15 ans (doc. 4), la
vaccination chez les jeunes filles est donc recommande ds lge
de 14 ans. Elle peut tre faite dans les quelques annes qui suivent,
au moment de lexposition au risque.
DOC. 1, 5 ET 6 (Sinformer et raisonner). La campagne laffirme
(doc. 1) : le dpistage du cancer de lutrus par frottis est indispen-
sable que lon soit vaccine ou non. Le doc. 5 montre quil est facile
de reprer des cellules prcancreuses et donc dintervenir avant
lapparition de toute tumeur. On repre notamment dans le clich
du bas quelques trs grosses cellules, prsentant des noyaux de
trs grande taille. De plus, les modlisations du doc. 6 montrent
que la vaccination devrait fortement rduire, mais sans les faire
disparatre totalement, les infections par HPV16/18. En parallle,
lincidence de cancers du col de lutrus devrait chuter et tre divi-
se par un facteur 4 5, mais l encore sans totalement sannuler.
La vaccination est donc efficace lchelle de la population, mais
ne permet de protger lensemble des individus. Un dpistage de
contrle est donc indispensable en complment de la vaccination.
Un cancer sera dautant mieux soign quil est diagnostiqu tt.
EN CONCLUSION (Communiquer en rdigeant une synthse).
La plupart des cancers du col de lutrus sont associs une infec-
tion chronique par les HPV 16 ou 18. Ces virus sont contracts lors
des premiers rapports sexuels et dbouchent dans de trs rares cas
et aprs 15-20 ans sur des cancers dont un tiers des patientes dc-
dent. Ces virus favorisent la cancrisation en altrant notamment le
fonctionnement de la protine p53. La vaccination contre HPV16 et
18 assure une trs bonne protection contre ces infections et surtout
contre lapparition du cancer du col de lutrus. Cette vaccination,
associe un dpistage rgulier permettra terme une diminution
de lincidence de cancers de lutrus et de la mortalit associe.
Conseils et suggestions
Pour aborder cette unit, il peut tre utile de rappeler que cer-
taines maladies infectieuses sont causes par des bactries. Une
catgorie de molcules (dorigine naturelle ou synthtique) permet
de lutter spcifiquement contre les bactries : les antibiotiques.
Lobjectif de cette unit est de montrer que certaines bactries
peuvent tre rsistantes aux antibiotiques (doc. 1 4), et que cette
rsistance est dorigine gntique (doc. 5 6).
Lantibiogramme du doc. 1 peut tre ralis avec une culture
dEscherichia coli si on dispose dun incubateur. On peut souligner
cette occasion que ce type dapproche est mis en uvre par le
corps mdical pour proposer un traitement adapt aux patients
dont linfection est rsistante aux antibiotiques utiliss en premire
intention (voir lexemple du doc. 4).
Ltude des doc. 2 et 3 permet de visualiser leffet dun antibio-
tique aux chelles cellulaire et molculaire, sans que ces informa-
tions soient retenir.
Le mode d'action des antibiotiques et leurs limites [pp. 272-273 du manuel de llve] 5
U
N
I
T
Connaissances du programme Capacits et attitudes mises en uvre dans lunit
Des mutations provoquent une variation gntique dans les populations
de bactries. Parmi ces variations, certaines font apparatre des rsistances
aux antibiotiques.
Concevoir et mettre en place un protocole permettant de montrer la sen-
sibilit de micro-organismes diffrents antibiotiques.
Recenser, extraire et organiser des informations pour identifier la sensibi-
lit ou la rsistance de micro-organismes diffrents antibiotiques.
Lors de ltude du doc. 4, on peut faire remarquer que lexistence
de bactries rsistantes aux antibiotiques a t observe des les
premires annes dutilisation des antibiotiques (voir aussi les
complments pdagogiques numriques).
Pour analyser le doc. 6, les lves devront faire appel leurs
connaissances sur lexpression du patrimoine gntique (voir le
thme 1). Il pourra tre utile de leur rappeler que le gnome des
bactries, comme celui des cellules eucaryotes, sexprime sous
forme de protines.
Exploitation des documents par les activits
DOC. 1 (Sinformer partir dun texte et dune photo).
Lantibiotique diffuse partir du disque, donc sa concentration
dcrot en sloignant du disque. Lantibiotique le plus efficace est
()
SVT1
re
S ditions Belin 2011 SVT1
re
S ditions Belin 2011
Conseils et suggestions
Dans cette unit sont abordes les causes de laugmentation de
frquence de bactries rsistantes ainsi que ses consquences pour
la sant humaine.
Les doc. 1, 2 et 3 doivent faire poser lhypothse dune corr-
lation entre lutilisation dantibiotiques et la variation du taux de
rsistance des bactries. On peut proposer que cette corrlation soit
due un lien de cause effet.
Cette hypothse est confirme par le doc. 5. On peut souligner
ici que les mcanismes mis en jeu au niveau des populations bac-
triennes sont universels (apparition de nouveaux caractres par
des mutations spontanes alatoires, puis slection des individus
ayant le phnotype le plus favorable en fonction des conditions
du milieu). Le phnomne de la rsistance bactrienne aux anti-
biotiques sexplique bien par un raisonnement volutionniste. Le
doc. 4, par ailleurs, met en relief limportance historique de lana-
lyse de ces questions chez les micro-organismes.
Le dveloppement de la rsistance aux antibiotiques [pp. 274-275 du manuel de llve] 6
U
N
I
T
Connaissances du programme Capacits et attitudes mises en uvre dans lunit
Lapplication dun antibiotique sur une population bactrienne slec-
tionne les formes rsistantes et permet leur dveloppement. Lutilisation
systmatique de traitements antibiotiques peut augmenter la frquence
des formes rsistantes par slection naturelle.
Pistes. La rsistance aux antibiotiques, les infections nosocomiales.
Comprendre, sur un exemple, lapplication du raisonnement volution-
niste en matire mdicale.
Dans loptique de lducation la sant, les doc. 1, 2, 3 et
lexercice 4 sont loccasion de souligner quun comportement
individuel de prise dantibiotique sans prescription mdicale peut
avoir des consquences graves lchelle de la population. En
prolongement, lexercice 8 illustre un mcanisme qui contribue
augmenter la frquence de bactries rsistantes : le transfert de
gnes entre bactries.
Exploitation des documents par les activits
DOC. 1 (Mettre en relation des donnes). La comparaison de la
carte et du graphique montre que plus un pays est consommateur
dantibiotiques, plus la proportion de pneumocoques rsistants est
leve. Il y a donc une corrlation entre la consommation dantibio-
tiques et la proportion de pneumocoques rsistants.
DOC. 1 A 3 (Sinformer pour tablir une relation entre dif-
frents documents). En plus de la corrlation entre consomma-
THME 5 CHAPITRE 2 79 THME 5 CHAPITRE 2 78
celui qui empche la multiplication bactrienne la plus faible
concentration, cest--dire celui qui cre la plus grande zone dinhi-
bition (ici le c). Les antibiotiques a et b sont un peu moins efficaces,
le d est inefficace.
DOC. 2 ET 3 (Sinformer partir dune photo et dun schma ;
mettre en relation des donnes). Daprs les documents 2 et 3, la
pnicilline empche la formation de la paroi bactrienne, ce qui
induit un clatement des bactries.
DOC. 4 (Sinformer partir dun texte et formuler une hypo-
thse ). Au cours des 3 premiers jours du traitement, la majorit
des bactries est dtruite par la streptomycine. Linfection rgresse.
Au bout de 3 jours de traitement, les symptmes rapparaissent,
suggrant que des bactries sont rsistantes la streptomycine
et continuent se multiplier en prsence de lantibiotique Il faut
donc avoir recours un autre antibiotique pour les dgrader. Ces
bactries rsistantes taient prsentes ds le dbut de linfection
(moment du prlvement), mais ne se sont dveloppes quaprs
lutilisation de lantibiotique.
DOC. 5 (Pratiquer un raisonnement scientifique). Comme pour
le doc. 1, la sensibilit un antibiotique est corrle au diamtre
de la zone dinhibition de croissance sur lantibiogramme. La souche
anctre est sensible aux 4 antibiotiques. La souche drive lest
beaucoup moins. Les bactries de cette souche ont donc acquis un
nouveau caractre au cours des divisions : on peut supposer que ce
nouveau caractre est confr par une mutation apparue au cours
de la culture.
DOC. 6 (Sinformer partir dun tableau et de sa lgende).
La sensibilit de E. coli est corrle la squence de sa beta-lac-
tamase. Le changement dans la squence en acides amins de
cette protine peut sexpliquer par un changement de squence
(mutation) du gne correspondant (cf. chapitre 3, unit 1) . Dans
cet exemple, le changement dun seul acide amin (Arg en Ser en
position 164) confre vraisemblablement lenzyme la capacit de
dgrader lantibiotique (la ceftazidime). La rsistance des bactries
aux antibiotiques repose donc sur une variation de leur gnome.
EN CONCLUSION (Communiquer en rdigeant une synthse).
Les antibiotiques limitent la multiplication des bactries, en dtrui-
sant par exemple leur paroi (cest le cas de la pnicilline). Un anti-
biotique peut devenir inefficace car des mutations dans le gnome
de bactries initialement sensibles peuvent les rendre rsistantes
cet antibiotique.
tion dantibiotiques et rsistance des pneumocoques lchelle
europenne (doc. 1), on observe en France une diminution de la
sensibilit (donc une augmentation de la rsistance) diffrents
antibiotiques chez la bactrie commune E. coli (doc. 2). Cette
augmentation de rsistance est rapide : visible en quelques annes
seulement. Daprs le doc. 3, ces faits peuvent tre relis : si les
antibiotiques ne sont pas utiliss suivant les indications de la notice
leur efficacit est attnue.
DOC. 3 (Communiquer dans un langage scientifiquement
appropri). Comme vu dans lunit prcdente, les antibiotiques
empchent la multiplication des bactries ; ils nont donc pas deffet
sur dautres organismes pathognes comme les virus. Ils doivent
tre seulement utiliss pour lutter contre les infections bact-
riennes. Laugmentation de la rsistance bactrienne, provoque
par lutilisation massive dantibiotiques, a pour consquence de
diminuer leur efficacit, donc de rendre plus difficile la gurison
des maladies bactriennes. Il est donc ncessaire de limiter la
consommation dantibiotiques, en veillant ne pas les utiliser sans
que cela soit mdicalement justifi et prconis par un mdecin.
DOC. 4 ET 5 (Mettre en uvre un raisonnement scientifique).
Les rsultats exprimentaux (doc. 5) montrent quil napparat pas
le mme nombre de colonies de bactries rsistantes dans les
diffrentes cultures. Lhypothse A (les mutations sont induites par
lenvironnement) est donc rejete. Lhypothse B (les mutations
sont alatoires) est retenue : en labsence dantibiotiques, des
mutations apparaissent spontanment chez certaines bactries de
la population ; certaines de ces mutations confrent la rsistance
un antibiotique. En prsence de cet antibiotique, seules les bac-
tries porteuses de la mutation survivent et se multiplient. Elles
deviennent alors de plus en plus abondantes dans la population.
Lantibiotique est donc un agent de slection de certains individus
rsistants dans une population : son utilisation fait croire le taux de
rsistance bactrienne.
EN CONCLUSION (Communiquer en rdigeant une synthse).
Un antibiotique slectionne les bactries qui lui sont rsistantes, ce
qui accrot le taux de rsistance dans une population bactrienne.
Cet antibiotique est alors moins efficace. Lutilisation inapproprie
des antibiotiques (pour des maladies non bactriennes, ou par
non-respect de la dose prendre ou de la dure de traitement)
est donc dangereuse lchelle dune population. Inversement,
une utilisation raisonne des antibiotiques (notamment par une
ducation sanitaire de la population) peut permettre de contenir
lapparition des bactries rsistantes.
Chapitre 1 [pp. 260-262 du manuel]
LES EFFETS DE LACTIVIT PHYSIQUE SUR
LOBSIT ET LE DIABTE DE TYPE 2
Mettre en relation des informations et raisonner.
Rponses attendues :
1. Un gne de prdisposition est un gne dont certains allles
augmentent la probabilit de dvelopper une maladie. Un allle
risque est un allle dun gne de prdisposition qui confre un
risque plus lev de dvelopper une maladie.
2. Les facteurs gntiques se caractrisent par lexistence dallles
risque prsentant un effet cumulatif : plus un individu porte dal-
lles risque, plus son IMC augmente. Cet effet est indpendant
de la pratique dune activit physique rgulire ou non. Ds 6
allles risque, lIMC est suprieur la limite dfinissant lobsit.
La comparaison des deux courbes montre que lactivit physique
rgulire a deux effets bnfiques par rapport lobsit : pour un
mme nombre dallles risque, lIMC est plus faible dune part,
laugmentation du nombre dallles risque est associe une aug-
mentation plus lente de lIMC que chez les individus sdentaires.
3. Le doc. 2 montre que le risque de diabte de type 2 augmente
de manire exponentielle avec lIMC, pour dpasser 80 % pour un
IMC au-del de 35 kg.m
-2
. Lobsit est donc un facteur de risque
pour le diabte de type 2. Lobsit est associe des facteurs de
risques gntiques et des facteurs comportementaux (doc. 1). Le
diabte de type 2, daprs ces donnes est donc caus par une
interaction entre facteurs gntiques (gnes de prdisposition) et
environnementaux. Par ailleurs, lobsit est galement favorise
par des rgimes alimentaires inadapts lactivit physique. On
sait aussi quil existe des gnes de prdisposition au diabte de
type 2. On retrouve donc cette double composante, gntique et
environnementale, dans le dclenchement de lobsit et du dia-
bte de type 2.
1
EXERCICES DU THME 5
Les corrigs des exercices des rubriques valuer ses
connaissances et S'entraner avec un exercice
guid se trouvent la fin du manuel (p. 328).
()
SVT1
re
S ditions Belin 2011 SVT1
re
S ditions Belin 2011
LA RECHERCHE DUN MDICAMENT CONTRE LA
MUCOVISCIDOSE
Sinformer et raisonner.
Rponses attendues :
1. La fluorescence rouge, donc la protine complte, est absente
dans toutes les coupes sauf pour la dose la plus leve de PTC124
(60 mg). Dans ce cas, les cellules de souris ont donc permis
lexpression du transgne humain et la synthse de la protine
complte.
2. La molcule permet dobtenir une scrtion de la protine
humaine complte, donc de saffranchir du codon stop prmatur.
La protine est synthtise dans le bon organe et dtecte dans le
canal o le mucus est scrt. On peut donc penser qu une dose
de 60 mg, le PTC124 permet de corriger le dfaut de fonctionne-
ment du gne CFTR des patients atteints de mucoviscidose.
3. Ce traitement ne corrige que le dficit fonctionnel, pas le dfaut
gntique : il faudrait donc suivre ce traitement vie, ce qui
implique des risques dallergies ou dintolrance, ou de risques de
rsistance au traitement.
LE RSULTAT DUN ESSAI DE THRAPIE GNIQUE
Analyser des donnes et formuler une hypothse.
Rponses attendues :
1. Le principe est dintroduire dans les cellules une version normale
du gne qui est totalement dficient chez les patients atteints de
mucoviscidose. Comme le vecteur est un virus qui infecte nor-
malement les cellules des bronches o le gne CFTR est particu-
lirement important, on peut esprer restaurer lexpression de la
protine CFTR au bon endroit et donc pallier le dfaut gntique
des patients.
2. Trois patients atteignent les 5 % de lexpression normale : le
patient 1 pour 10
8
virus inhals, les patients 1 et 2 pour 10
9
virus
inhals.
3. On constate que cette technique ncessite des doses le-
ves de virus, induisant des risques dintolrance du traitement
(allergie). De plus, tous les patients ne rpondent pas aussi bien
au traitement. Enfin, leffet du traitement nest pas durable et il
faudrait envisager des traitements rpts tout au long de la vie.
Le renouvellement rapide de lpithlium bronchique explique la
faible dure defficacit du traitement : les virus, rendus inoffensifs,
sont limins avec les cellules mortes de lpithlium. Il faut donc
rgulirement rintroduire de nouveaux virus.
LINFLUENCE DE LHRDIT DANS LE CAS DE LA
MUCOVISCIDOSE ET DU DIABTE DE TYPE 2
Sinformer et raisonner.
Rponses attendues :
1. Le tableau 1 montre que certaines familles, dont lun des parents
au moins ou lun des enfants dveloppe la maladie avant 50 ans
prsentent un risque de diabte de type 2 qui est peu prs le
double de la prvalence en France. Ces familles, qui se caractri-
sent par le partage dun patrimoine gntique prsentent donc un
facteur de risque. Ce facteur de risque est gntique.
2. Si un frre ou une sur est malade, alors les deux parents sont
porteurs sains, htrozygotes pour lallle mut. La probabilit
quun enfant reoive deux allles muts est de soit ou
25 %. tre le vrai jumeau dun malade implique un risque de 100 %
de dvelopper la mucoviscidose.
3. Dans le cas de la mucoviscidose, un gne est impliqu : la pos-
session ltat homozygote de lallle mut entrane coup sr
lapparition de la maladie. Pour le diabte de type 2, les frquences
de la maladie dans les situations 3 et 4 sont plus faibles que pour la
mucoviscidose. Il nexiste donc pas un seul gne dont la possession
dune version alllique dterminerait coup sr la maladie. On sait
en effet quil existe un grand nombre de facteurs risques, certains
gntiques et conditionns par des allles risque, qui favorisent
(faiblement en gnral) lapparition dun diabte de type 2. On doit
donc parler de gnes de prdisposition au diabte de type 2.
Chapitre 2 [pp. 281-282 du manuel]
BACTRIES RSISTANTES ET INFECTIONS
NOSOCOMIALES
Rponses attendues :
1. La comparaison des taux dinfections nosocomiales et de bact-
ries rsistantes (doc. 1) montre que ces derniers sont corrls. On
peut donc supposer que les bactries rsistantes aux antibiotiques
sont une cause des infections nosocomiales.
2. En milieu hospitalier, les patients sont soumis de nombreux
traitements antibiotiques pour soigner leur pathologie (si elle est
dorigine bactrienne) ou les protger contre dventuelles infec-
tions. Le staphylocoque dor, prsent naturellement sur la peau et
dans les voies nasales, est donc fortement soumis laction de ces
antibiotiques en milieu hospitalier. Ces traitements slectionnent
donc des formes de staphylocoques dors ayant acquis une rsis-
tance par mutation spontane. La frquence de ces rsistants est
donc plus importante dans les tablissements de sant.
De plus, ces staphylocoques dors, parce quils sont prsents sur
la peau, peuvent pntrer dans le corps lors dune opration si la
peau na pas t bien dsinfecte. Ils peuvent galement remonter
par les conduits naturels et provoquer des infections (notamment
respiratoires).
Enfin, le personnel soignant, qui soccupe de nombreux malades,
peut tre un vecteur des staphylocoques dors.
EXPOSITION AU BENZNE ET RISQUE DE CANCER
Sinformer et formuler une hypothse.
Rponses attendues :
1.
Le risque relatif augmente avec la dose de benzne, particulire-
ment au-del de 10 ppm.an
-1
. Lexposition au benzne est donc
un facteur de risque de dclenchement de cancers des cellules
sanguines. On peut proposer daprs ces donnes que le benzne
est un agent cancrigne.
2. Comme pour le benzopyrne du tabac, on peut expliquer cet effet
cancrigne par la transformation du benzne en composs oxyds
trs ractifs (doc. 1). Ces drivs sont mutagnes ou peuvent altrer
la structure des chromosomes. On peut proposer que ces mutations,
partir dun certain seuil, altrent le fonctionnement cellulaire en
favorisant limmortalisation et la prolifration des cellules.
THME 5 CHAPITRE 2 81 THME 5 EXERCICES 80
UN MODLE POUR TUDIER LE CANCER
DE LSOPHAGE
Pratiquer une dmarche scientifique.
Rponses attendues :
1. Le dpt sur un pithlium sophagien reconstitu in vitro de
cellules cancreuses prleves chez un malade atteint dun cancer
de lsophage conduit aprs plusieurs jours de culture une pro-
lifration des cellules sempilant sur plusieurs couches et une inva-
sion de lpithlium reconstitu. Les cellules cancreuses du clich
n 1 prsentent donc les proprits suivantes : elles prolifrent
de manire indfinie (ce sont des cellules immortelles ), leur
prolifration nest pas inhibe par le contact (elles sempilent sur
plusieurs couches de manire incontrle) et elles sont capables
de migrer dans les tissus voisins.
2. Les cellules de lpithlium sophagien exprimant la seule
mutation n 1 ne prolifrent pas beaucoup (elles sempilent peu et
sont inhibes par le contact avec les cellules voisines) et nenva-
hissent presque jamais lpithlium reconstitu [NB : la mutation
n 1 conduit lexpression du gne de la tlomrase, un gne
conduisant limmortalisation des cellules].
Les cellules exprimant la fois les mutations n 1, 2 et 3 prsen-
tent en revanche les mmes proprits que les cellules cancreuses
du patient atteint dun cancer de lsophage et prsentent un
caractre invasif plus marqu.
3. Le clich 2 montre quune seule mutation (n 1) nest pas suffi-
sante pour dclencher un cancer. La comparaison avec le clich 3
montre que le cancer de lsophage apparat lorsque les cellules
pithliales accumulent plusieurs mutations . Laccumulation de
nouvelles mutations (mutation n 1 puis mutations n 2 et 3) se
traduit par lapparition progressive des caractristiques des cellules
cancreuses : la mutation n 1 conduit une simple immortalisa-
tion des cellules alors que les mutations 2 et 3 conduisent une
prolifration incontrle des cellules cancreuses et lacquisition
de leur capacit migratoire.
LA RECHERCHE DUN TRAITEMENT DU CANCER
DU COL DE LUTRUS
Pratiquer une dmarche scientifique.
Rponses attendues :
1. Dans le cas tmoin (doc. 1), on constate que le nombre de
cellules reste constant : soit elles ne prolifrent pas, soit la prolifra-
tion est compense par une mort cellulaire. Pour les cellules infec-
tes, leur nombre augmente : elles prolifrent donc plus quelles ne
meurent et leur population saccrot.
Pour les cellules infectes, le traitement par des ARN anti-sens
conduit une prolifration plus faible : linhibition de lexpression du
gnome viral fait dcrotre la prolifration de prs de 60 %, celle de
lexpression du gne c-fos de prs de 45 %. Le traitement des cellules
infectes par ces ARN anti-sens attnue donc le phnotype tumoral.
2. Linfection par HPV16 stimule la prolifration des cellules. SI ces
cellules possdent ou acquirent des anomalies les rendant immor-
telles et invasives, on assiste une cancrisation. La stimulation de
la prolifration ncessite lexpression du gnome viral et de gnes
cellulaires comme celui codant la protine c-fos : cest ce que prou-
vent les rsultats de ces expriences (linhibition de ces gnes suffit
limiter la prolifration induite par linfection par HPV16). On peut
proposer que les protines du virus activent lexpression du gne
c-fos par les cellules infectes et que c-fos favorise la prolifration
[N.B. : c-fos est un gne activ par les facteurs de croissance,
codant une protine effectivement implique dans la progression
dans le cycle cellulaire].
3. Ces ARN anti-sens ont comme effet de rduire la prolifration
cellulaire. Ils peuvent donc tre utiliss pour freiner voire stopper
le dveloppement dune tumeur. Ils ne dclenchent toutefois pas
de rduction de la tumeur et ne constituent donc pas eux seuls
un traitement efficace. Il serait donc ncessaire de leur adjoindre
un traitement dtruisant les cellules (chimiothrapie, rayons X,
chirurgie) ou compter sur une rponse immunitaire qui dtruirait
les cellules tumorales.
UN PROBLME DE SANT PUBLIQUE :
LES BACTRIES MULTIRSISTANTES
Sinformer et raisonner.
Rponses attendues :
1. Daprs le doc. 2, la concentration minimale inhibitrice de trois
antibiotiques (ampicilline, piperacilline et cefotaxime) est trs
leve pour la souche 05-560 de K. pneumoniae. Celle-ci est donc
rsistante ces trois antibiotiques : il est justifi de la qualifier de
souche multirsistante.
2. Selon le doc. 2, E. coli seule nest rsistante aucun antibiotique
test. Aprs incubation dune souche dE. coli avec la souche 05-560
de K. pneumoniae, la concentration minimale inhibitrice de lam-
picilline, la piperacilline et la cefotaxime crot considrablement.
On peut alors supposer quil y a eu un transfert de gne confrant
la rsistance ces antibiotiques entre les 2 souches bactriennes.
Le doc. 1 permet de proposer un mcanisme pouvant expliquer ce
phnomne : au cours du processus de conjugaison, par lequel des
bactries changent des gnes, E. coli recevrait de K. pneumoniae
des gnes de rsistance aux 3 antibiotiques.
Objectif Bac [p. 283 du manuel de llve]
LES CAUSES DUNE MALADIE CARDIOVASCULAIRE :
LATHROSCLROSE
Rponse attendue :
Le doc. 1 est une photographie montrant une plaque dathrome
dans une artre. Le doc. 2 est un graphique reprsentant le taux
de mortalit due lathrosclrose dans diffrentes populations en
fonction de la part dacides gras saturs prsents dans leur rgime
alimentaire. On constate que plus la part dacides gras saturs dans
le rgime alimentaire est leve, plus la mortalit par athroscl-
rose est leve (par exemple, un peu moins de 100 morts/10 000
hommes/10 ans avec 3 % dacides gras saturs, mais autour de 300
morts/10 000 hommes/10 ans avec 19 % dacides gras saturs). Le
rgime alimentaire, donc le mode de vie, semble donc influencer
le dveloppement de la maladie coronaire.
()
SVT1
re
S ditions Belin 2011 SVT1
re
S ditions Belin 2011
. DE LIL AU CERVEAU : QUELQUES ASPECTS
DE LA VISION
THME 1
83 THME 6 CHAPITRE 1 83
CHAPITRE 1
U
N
I
T
Le trajet de la lumire dans lil [pp. 292-293 du manuel de llve] 1
Connaissances du programme Capacits et attitudes mises en uvre dans lunit
Le cristallin est lun des systmes transparents de lil humain.
Il est form de cellules vivantes qui renouvellent en permanence leur
contenu. Les modalits de ce renouvellement sont indispensables
sa transparence. Des anomalies de forme du cristallin expliquent
certains dfauts de vision. Avec lge, sa transparence et sa souplesse
peuvent tre altres.
Recenser, extraire et organiser des informations et/ou manipuler
(dissection, maquette et/ou recherche documentaire) pour :
localiser et comprendre lorganisation et le fonctionnement du cristallin ;
comprendre certains dfauts de vision.
Exploitation des documents par les activits
DOC. 1 ET 2 (Manipuler, extraire des informations). La structure
dessine en vert sur la modlisation du doc. 2 doit tre transpa-
rente pour laisser passer la lumire et doit faire converger cette
lumire sur la rtine pour permettre la formation dune image. Elle
doit donc possder les caractristiques dune lentille convergente.
DOC. 2 4 (Extraire et organiser des informations partir de
diffrents documents). La dissection de lil (doc. 1) et le schma
de coupe sagittale de lil (doc. 2) montrent quil existe dans
lil plusieurs milieux transparents traverss par la lumire : la
corne, lhumeur aqueuse, le cristallin, lhumeur vitre. Le cristallin
a une forme de lentille et, plac sur un texte, a leffet dune loupe
(doc. 3) : il se comporte donc comme une lentille convergente.
Une anomalie de forme du cristallin (doc. 4) entrane un dfaut
de vision. Le cristallin est donc trs vraisemblablement la structure
reprsente en vert sur la modlisation du doc. 2.
DOC. 4 A 6 (Sinformer partir dun tableau et de sa lgende).
Plusieurs caractristiques du cristallin contribuent sa transparence :
il est constitu de cellules particulires, vivantes mais dpourvues
de noyau et dorganites ;
ces cellules sont remplies de cristallines, protines solubles pr-
cisment arranges.
La courbure du cristallin peut tre modifie grce aux muscles
ciliaires, dont ltat de contraction modifie la convergence des
rayons lumineux qui le traversent : cest laccommodation, qui
permet de former une image nette sur la rtine lorsque lobjet
observ est proche. Le cristallin est dformable car il prsente une
certaine lasticit, mais conserve sa structure grce ltroite asso-
ciation des fibres cristalliniennes qui le constituent.
Au cours du vieillissement (doc. 4 et 6), le cristallin perd de son
lasticit, provoquant des difficults daccommodation et une
Conseils et suggestions
La page douverture du chapitre peut tre utilise pour aborder
la notion dorgane sensoriel et prsenter dil comme un organe
sensoriel spcialis dans la rception de stimuli lumineux.
Lobjectif de ce chapitre est de comprendre comment lil produit
un message nerveux visuel partir dun stimulus lumineux, en
envisageant des implications en matire de sant et en associant
cette tude une approche volutive permettant de placer lHomme
parmi les primates.
Lors de cette premire unit, llve est amen comprendre les
phnomnes optiques par lesquels une image est focalise sur la
rtine ainsi qu dcouvrir le rle et la structure du cristallin. Il est
noter que celui-ci nest pas la seule structure oculaire dvier
les rayons lumineux : la corne prsente galement un pouvoir de
rfraction lev mais nest pas aborde ici faute dtre mentionne
dans le programme.
La dissection propose (doc. 1) a t ralise sur un il de veau.
Elle peut tre mise en uvre sur des yeux de lapin ( se procurer
auprs dun boucher). Cette analyse peut tre complte avanta-
geusement par lutilisation du logiciel Lil et la vision de Pierre
Perez (voir latelier Informatique p. 326), tlchargeable gratuite-
ment sur le site de lAcadmie de Toulouse.
De nombreuses informations complmentaires sur la vision et le
cerveau sont disponibles sur le site Internet Le cerveau tous les
niveaux, de lUniversit McGill de Montral :
http://lecerveau.mcgill.ca
La comprhension du trajet de la lumire dans lil sappuie sur
des notions du programme de physique : optique gomtrique,
fonctionnement optique de lil.
De la lumire au message nerveux :
le rle de lil
. DE LIL AU CERVEAU :
QUELQUES ASPECTS DE LA VISION
THME 6
Le doc. 3 est un graphique reprsentant le risque relatif dath-
rosclrose en fonction des allles du gne APOE possds par les
individus. Lallle e3 est pris comme rfrence (risque relatif gal
1). On constate que lallle e2 confre un risque relatif dun peu
moins de 0,6 : il diminue donc le risque dathrosclrose. Lallle e4
confre un risque relatif dun peu moins de 1,2 : il augmente donc
le risque dathrosclrose par rapport lallle e3. Outre le rgime
alimentaire, des facteurs gntiques semblent donc influencer le
dveloppement de la maladie coronaire.
Le doc. 4 est un tableau dtaillant les interactions entre gnotype
et environnement dans le dveloppement de la maladie coronaire.
Lallle e3 est toujours pris comme rfrence. Pour un allle donn
(e2 ou e4), on constate quun rgime alimentaire riche en graisses
est associ un risque relatif plus lev de maladie coronaire quun
rgime pauvre en graisses (de 0,38 0,82 pour lallle e2, 1,11
1,28 pour lallle e4). On note galement que laugmentation du
risque cause par le rgime alimentaire est plus importante pour
lallle e2 que pour lallle e4. Au vu des donnes, il semblerait que
la protection confre par lallle e2 soit surtout valable lorsque
le rgime alimentaire est pauvre en graisses.
On peut donc conclure que les facteurs gntiques et les facteurs
lis au mode de vie agissent tous deux sur le dveloppement de la
maladie coronaire. Il semble, de plus, que linteraction entre gn-
tique et mode de vie soit galement considrer pour valuer le
risque de dveloppement de cette maladie.
THME 5 EXERCICES 82 SVT1
re
S ditions Belin 2011 SVT1
re
S ditions Belin 2011
Vous aimerez peut-être aussi
- Devoir 6: Sujet de DissertationDocument3 pagesDevoir 6: Sujet de DissertationYasmine naruto100% (1)
- Contr Le Terminale ES CHAPITRE 3 CLIMATDocument14 pagesContr Le Terminale ES CHAPITRE 3 CLIMATBadr FenjiroPas encore d'évaluation
- Dissert TejenDocument2 pagesDissert TejenTejenMootin40% (5)
- TX Bac 10 Séquence 2Document1 pageTX Bac 10 Séquence 2Falcon SciencePas encore d'évaluation
- Scène 4 Lagarce Analyse LinéaireDocument4 pagesScène 4 Lagarce Analyse LinéaireJeanPas encore d'évaluation
- Fireworks - Livre Du Professeur - 1re Chapitre 9 - The West WindDocument31 pagesFireworks - Livre Du Professeur - 1re Chapitre 9 - The West WindMigaël CARRIAS100% (1)
- Devoir 3: Compréhension de L'oral, Compréhension de L'écrit Et Expression ÉcriteDocument7 pagesDevoir 3: Compréhension de L'oral, Compréhension de L'écrit Et Expression ÉcriteLara ReisPas encore d'évaluation
- LL3 - ManonLescaut-L'évasion deStLazare TEXTEDocument1 pageLL3 - ManonLescaut-L'évasion deStLazare TEXTEsarahPas encore d'évaluation
- Textes Et Cours OuvriersDocument3 pagesTextes Et Cours OuvriersMax FournierPas encore d'évaluation
- Les Bonnes de Jean Genet (Analyse approfondie): Approfondissez votre lecture de cette œuvre avec notre profil littéraire (résumé, fiche de lecture et axes de lecture)D'EverandLes Bonnes de Jean Genet (Analyse approfondie): Approfondissez votre lecture de cette œuvre avec notre profil littéraire (résumé, fiche de lecture et axes de lecture)Pas encore d'évaluation
- Examen BiologiqueDocument10 pagesExamen BiologiqueAnissa CarlierPas encore d'évaluation
- Carnet de Lecture À Réaliser Sur FDocument6 pagesCarnet de Lecture À Réaliser Sur FAziz Ben AbdessalamPas encore d'évaluation
- Corrigé Ses 2de Chapitre 3 Chap6Document5 pagesCorrigé Ses 2de Chapitre 3 Chap6CovenPas encore d'évaluation
- LDP SVT 2de P2C2 1 PDFDocument10 pagesLDP SVT 2de P2C2 1 PDFlea salamehPas encore d'évaluation
- Dom Juan Acte 1 Scene 1 Tabac Plan DetailleDocument2 pagesDom Juan Acte 1 Scene 1 Tabac Plan Detailleayouzyouftn100% (1)
- Sociologie Et Science PolitiqueDocument21 pagesSociologie Et Science PolitiqueRafanomezantsoaPas encore d'évaluation
- Sujet de Réflexion (Rappels Méthode)Document2 pagesSujet de Réflexion (Rappels Méthode)cprabelPas encore d'évaluation
- Le voyage de Monsieur Perrichon d'Eugène Labiche (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvreD'EverandLe voyage de Monsieur Perrichon d'Eugène Labiche (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Eugénie Grandet d'Honoré de Balzac (Questionnaire de lecture): Document rédigé par Fabienne GheysensD'EverandEugénie Grandet d'Honoré de Balzac (Questionnaire de lecture): Document rédigé par Fabienne GheysensPas encore d'évaluation
- Luxations CoudeDocument51 pagesLuxations CoudeSerigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- Devoir de Maison SVT 3èmeDocument3 pagesDevoir de Maison SVT 3èmekady cdPas encore d'évaluation
- Th1 Ch2 Act3 Microscopie + Membrane PlasmiqueDocument5 pagesTh1 Ch2 Act3 Microscopie + Membrane PlasmiqueMusab BilginPas encore d'évaluation
- Es SVT Sujet + CorrectionDocument5 pagesEs SVT Sujet + CorrectionCeline EstephanPas encore d'évaluation
- DST 1 SpéDocument5 pagesDST 1 SpéSpøtííFÿ MødPrēmīūm100% (1)
- 2.2 BrdU CorrecDocument2 pages2.2 BrdU CorrecReyzPas encore d'évaluation
- Cours Immunité Innée - 1ère Spé SVTDocument2 pagesCours Immunité Innée - 1ère Spé SVTHélène DeleuPas encore d'évaluation
- 1SVT 2ndeDocument29 pages1SVT 2ndeJulie MPas encore d'évaluation
- Carnet de Lecture À Réaliser Sur F 1 2Document6 pagesCarnet de Lecture À Réaliser Sur F 1 2Aziz Ben AbdessalamPas encore d'évaluation
- SVT - Sequence-07 PDFDocument16 pagesSVT - Sequence-07 PDFinterPas encore d'évaluation
- Les JO Vus Par L'HGGSPDocument2 pagesLes JO Vus Par L'HGGSPAnnelise NdourPas encore d'évaluation
- Le Soleil Chap 1 Rayonnement SolaireDocument29 pagesLe Soleil Chap 1 Rayonnement Solaireflo bil100% (1)
- S SVT Obligatoire 2017 Polynesie CorrigeDocument8 pagesS SVT Obligatoire 2017 Polynesie CorrigeWilfriedPas encore d'évaluation
- DNB Blanc Novembre 2022 - CORRIGE ELEVEDocument6 pagesDNB Blanc Novembre 2022 - CORRIGE ELEVESophie RolletPas encore d'évaluation
- DS 1ère ES Janvier 2023Document6 pagesDS 1ère ES Janvier 2023sedki007100% (1)
- 1ER-PC-CHAP 09 ExercicesDocument48 pages1ER-PC-CHAP 09 ExerciceshalmoPas encore d'évaluation
- Seance3 Boileau Art Poetique1Document2 pagesSeance3 Boileau Art Poetique1Lebron Fakes100% (1)
- Méthodes Et Corrigés Histoire Tout Le ProgrammeDocument27 pagesMéthodes Et Corrigés Histoire Tout Le ProgrammeSvtBacTerminaleScientifiquePas encore d'évaluation
- S SVT Obligatoire 2015 Polynesie Remplacement CorrigeDocument10 pagesS SVT Obligatoire 2015 Polynesie Remplacement CorrigeDaphnPas encore d'évaluation
- Commentaire IncipitDocument5 pagesCommentaire IncipitRém'Alex BalsamoPas encore d'évaluation
- LP Pere GoriotDocument24 pagesLP Pere GoriotxaviPas encore d'évaluation
- Lecture Analytique de La Scene D Exposition de Dom JuanDocument2 pagesLecture Analytique de La Scene D Exposition de Dom Juanayouzyouftn0% (1)
- DS Corrige Schema2Document1 pageDS Corrige Schema2HooZiii100% (1)
- Cours H2 L' Europe Entre Restauration Et Révolution 1814-1848Document10 pagesCours H2 L' Europe Entre Restauration Et Révolution 1814-1848nathan.pasturel31Pas encore d'évaluation
- Guide Hatier Enseignant de La Pièce de Marivaux Les Fausses ConfidencesDocument21 pagesGuide Hatier Enseignant de La Pièce de Marivaux Les Fausses ConfidencesFrancoise GPas encore d'évaluation
- Les Fragilités Du Lien Social Liées Aux Transformations SocialesDocument9 pagesLes Fragilités Du Lien Social Liées Aux Transformations SocialesRaslene ChellyPas encore d'évaluation
- Correction DNB Epo Et DopageDocument1 pageCorrection DNB Epo Et Dopagesébastien boudarelPas encore d'évaluation
- Nathanhistoire 1 Er 2011 CorrigesmanuelslyceeDocument204 pagesNathanhistoire 1 Er 2011 CorrigesmanuelslyceeMegumin100% (1)
- Liban LV2 ArabeDocument6 pagesLiban LV2 ArabeLETUDIANTPas encore d'évaluation
- BREVET Physique-Chimie 2012Document7 pagesBREVET Physique-Chimie 2012sunnyaumPas encore d'évaluation
- Corrige Histoire-Bb n1 2014 2015 PDFDocument3 pagesCorrige Histoire-Bb n1 2014 2015 PDFAnonymous s90gIPYVe100% (1)
- Déclaration Des Droits de La Femme Et Du Citoyenne PDFDocument32 pagesDéclaration Des Droits de La Femme Et Du Citoyenne PDFpaketinPas encore d'évaluation
- CCie - MaladeImaginaire - Guide PedagogiquepdfDocument49 pagesCCie - MaladeImaginaire - Guide PedagogiquepdfLaureen LarryssaPas encore d'évaluation
- 001-022-Chap 1-LP-HDDocument22 pages001-022-Chap 1-LP-HDjsfeir100% (1)
- Lelivrescolaire LDP EST Ch9Document46 pagesLelivrescolaire LDP EST Ch9samya randera100% (1)
- Histoire Lycee 1re Chap01Document19 pagesHistoire Lycee 1re Chap01mssPas encore d'évaluation
- Colette - Sido ResumeDocument2 pagesColette - Sido ResumeMarya VamanPas encore d'évaluation
- Demain Dès Laube Texte CommentaireDocument3 pagesDemain Dès Laube Texte CommentaireNoura ElPas encore d'évaluation
- LP Term U5Document14 pagesLP Term U5b bPas encore d'évaluation
- L'école Des Femmes Acte II Scène 5Document4 pagesL'école Des Femmes Acte II Scène 5Marlene crazyPas encore d'évaluation
- Activité 2 CorrectionDocument1 pageActivité 2 Correctionnews2foot offPas encore d'évaluation
- Commentaire de Texte Excipit de Thérèse RaquinDocument1 pageCommentaire de Texte Excipit de Thérèse RaquinJust PiretPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 - La Cellule Vivante - Livret ELEVEDocument14 pagesChapitre 3 - La Cellule Vivante - Livret ELEVECarpe D'AsiePas encore d'évaluation
- Dépistage de CancerDocument4 pagesDépistage de CanceroutsiderPas encore d'évaluation
- Pneumologie Polycopie Oedeme de Quincke Et AnaphylaxieDocument13 pagesPneumologie Polycopie Oedeme de Quincke Et AnaphylaxieAbdo BoukhartaPas encore d'évaluation
- Pieges Dans Le DGC ET LE Traitement Du GlaucomeDocument29 pagesPieges Dans Le DGC ET LE Traitement Du Glaucomemidou113Pas encore d'évaluation
- Programme - Colloque Tanger 2023Document4 pagesProgramme - Colloque Tanger 2023Naj AmPas encore d'évaluation
- Échantillon de Certificat MédicalDocument1 pageÉchantillon de Certificat MédicalScribdTranslationsPas encore d'évaluation
- Traiteacute D39anestheacutesie Et de Reacuteanimation 4edpdf PDFDocument1 314 pagesTraiteacute D39anestheacutesie Et de Reacuteanimation 4edpdf PDFCristina Trofimov100% (1)
- Traitement Des Hyponatrmies 3E8B-U078Document31 pagesTraitement Des Hyponatrmies 3E8B-U078eugeria86100% (1)
- Resume Cours EA Converti 1Document9 pagesResume Cours EA Converti 1Hadjer AdaidaPas encore d'évaluation
- 144 - NeuroblastomeDocument9 pages144 - NeuroblastomeRus Paul OvidiuPas encore d'évaluation
- 1 OCCLUSIONS INTESTINALES AIGUËS Ensp-1-1Document10 pages1 OCCLUSIONS INTESTINALES AIGUËS Ensp-1-1Mamane NahantchiPas encore d'évaluation
- 5ème, Thème 3, Chapitre I: Évaluation.: Date: Nom: Prénom: ClasseDocument3 pages5ème, Thème 3, Chapitre I: Évaluation.: Date: Nom: Prénom: Classeyoufi3058Pas encore d'évaluation
- PsychiatrieDocument13 pagesPsychiatrienassim ellouziPas encore d'évaluation
- Imagerie Thoracique de L' e 3ème Édition P GRENIER FLAMMARIONDocument749 pagesImagerie Thoracique de L' e 3ème Édition P GRENIER FLAMMARIONabirhnichi1998Pas encore d'évaluation
- Chorfi Abd El DjalilDocument2 pagesChorfi Abd El DjalilsmartbrainvetPas encore d'évaluation
- AntibiothérapieDocument78 pagesAntibiothérapiehollyPas encore d'évaluation
- RMS 512 640Document6 pagesRMS 512 640Ridha ManaaPas encore d'évaluation
- Physiologie de La DélivranceDocument5 pagesPhysiologie de La DélivranceAni TrghwiPas encore d'évaluation
- Étude Des Cervicites Chez Les Vaches Laitières Dans Une Clientèle Vétérinaire en NormandieDocument95 pagesÉtude Des Cervicites Chez Les Vaches Laitières Dans Une Clientèle Vétérinaire en NormandieshopiceeePas encore d'évaluation
- Papillomatose LaryngeeDocument5 pagesPapillomatose Laryngeeadelmiringui2Pas encore d'évaluation
- Rhumatismes À Début Juvénile (JIRcohorte) Suivi Prospectif D'une Cohorte de Plus de 1800 PatientsDocument2 pagesRhumatismes À Début Juvénile (JIRcohorte) Suivi Prospectif D'une Cohorte de Plus de 1800 PatientskarimaPas encore d'évaluation
- Les Causes Des Maladies Peter DeunovDocument4 pagesLes Causes Des Maladies Peter Deunovjulie vee100% (1)
- Echodoppler Transcrânien PDFDocument79 pagesEchodoppler Transcrânien PDFNdiaga Matar GayePas encore d'évaluation
- Bumed Mesf 2014 Rolin MarineDocument81 pagesBumed Mesf 2014 Rolin MarinemacchioniPas encore d'évaluation
- Les Bienfaits Du Romarin Pour Le CorpsDocument8 pagesLes Bienfaits Du Romarin Pour Le Corpsmahm oudPas encore d'évaluation
- Observation Médical Toux Et HémiplégieDocument3 pagesObservation Médical Toux Et HémiplégieGār ĐënīaPas encore d'évaluation
- Critères Dacceptation Et de Rejet Des ÉchantillonsDocument6 pagesCritères Dacceptation Et de Rejet Des Échantillonsmahmoud rekikPas encore d'évaluation
- N6 Comprehensio OraleDocument7 pagesN6 Comprehensio Oralelaoz80Pas encore d'évaluation
- Caractéristiques Des Infections Respiratoires Basses Chez Les Sujets Agés 2010Document7 pagesCaractéristiques Des Infections Respiratoires Basses Chez Les Sujets Agés 2010amyPas encore d'évaluation