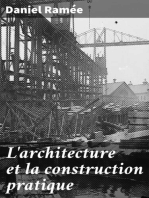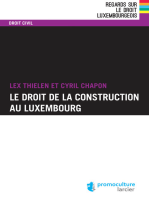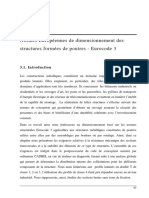Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
CT G12.32 85
CT G12.32 85
Transféré par
jacquetgottfriedTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
CT G12.32 85
CT G12.32 85
Transféré par
jacquetgottfriedDroits d'auteur :
Formats disponibles
31
Chapitre
2
Dimensionnement
des structures
en bton
2.1 Les Eurocodes
2.2 LEurocode 2 (Eurocode bton)
2.3 Le bton arm
2.4 Les armatures pour bton arm
2.5 Lenrobage des armatures
2.6 Le bton prcontraint
2.7 BA-CORTEX
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 31
2.1.1 - Prsentation gnrale
des Eurocodes
Les Eurocodes sont des normes europennes de
conception et de calcul des btiments et des struc-
tures de gnie civil. Elles ont pour objet dharmo-
niser les rgles de conception et de calcul au sein
des diffrents tats europens membres de
lUnion Europenne (UE) et de lassociation euro-
penne de libre-change (AELE) et de contribuer
ainsi la cration du march unique de la construc-
tion (ouverture du march europen aux entre-
prises et aux bureaux dingnierie) et au
renforcement de la comptitivit de lingnierie
europenne.
Ces normes europennes forment un ensemble
cohrent et homogne de rgles techniques. Elles
constituent un langage commun pour tous les
concepteurs europens, bnficiant des connais-
sances les plus rcentes.
Elles font appel une approche semi-probabiliste
de scurit des constructions (mthode des coeffi-
cients partiels) avec des mthodes de dimension-
nement fondes sur le concept des tats limites
(tats limites de service et tats limites ultimes).
Elles sappliquent aux diffrents matriaux (bton,
acier, bois, etc.) et aux diffrents types de construc-
tion (btiments, ponts, silos, etc.).
Lapproche semi-probabiliste consiste dfinir les
valeurs des actions prendre en compte en fonc-
tion de leur occurrence pendant une certaine
priode. Cette priode est respectivement de 50
ans, 475 ans et 1000 ans pour les actions clima-
tiques, les sismes et le trafic,
Elles fournissent une srie de mthodes et de
rgles techniques communes tous les pays euro-
pens pour calculer la stabilit, la rsistance mca-
nique et la scurit incendie des lments ayant
une fonction structurelle dans un ouvrage de construc-
tion. Elles concernent les ouvrages neufs unique-
ment.
Elles harmonisent les codes de calcul des diff-
rents tats membres et remplaceront terme les
rgles en vigueur dans chacun de ces tats.
Nota
En France, pour les ouvrages en bton,
elles se substituent progressivement aux
rgles actuelles de dimensionnement
(rgles BAEL et BPEL).
Elles sont bases sur des principes fondamentaux:
scurit;
durabilit;
robustesse des constructions ;
aptitude au service;
fiabilit.
La scurit structurale est laptitude dune structure
assurer la scurit des personnes lgard des
risques dorigine structurale.
Chapitre Dimensionnement des structures en bton 2
32
2.1 Les Eurocodes
Les tats membres de lUE et de lAELE recon-
naissent les Eurocodes comme documents de
rfrence:
pour prouver la conformit des ouvrages de
btiment et de gnie civil aux exigences
essentielles de la Directive sur les Produits
de Construction (DPC) en particulier lexi-
gence n 1 stabilit et rsistance mca-
nique et lexigence n 2 scurit en cas
dincendie ;
pour tablir les spcifications des contrats
pour les travaux de construction et services
dingnierie;
pour tablir les spcifications techniques
harmonises pour les produits de construc-
tion.
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 32
Les Eurocodes constituent un ensemble de 58
normes regroupes en 10 groupes de normes
(NF EN 1990 NF EN 1999) :
NF EN 1990 Eurocode 0: bases de calcul des
structures
NF EN 1991 Eurocode 1: actions sur les structu-
res
NF EN 1992 Eurocode 2: calcul des structures
en bton
NF EN 1993 Eurocode 3: calcul des structures
en acier
NF EN 1994 Eurocode 4: calcul des structures
mixtes acier-bton
NF EN 1995 Eurocode 5: calcul des structures
en bois
NF EN 1996 Eurocode 6: calcul des structures
en maonnerie
NF EN 1997 Eurocode 7: calcul gotechnique
NF EN 1998 Eurocode 8: calcul des structures
pour leur rsistance aux sismes
NF EN 1999 Eurocode 9: calcul des structures en
alliages daluminium
Liens entre les Eurocodes
Scurit structurale,
NF EN 1990 aptitude au service
et durabilit
NF EN 1991 Actions sur les structures
NF EN 1992 NF EN 1993 NF EN 1994
Conception et calcul
NF EN 1995 NF EN 1996 NF EN 1999
NF EN 1997 NF EN 1998
Calcul gotechnique
et sismique
La durabilit structurale est laptitude dune struc-
ture rester fiable pendant une dure dutilisation
conventionnelle.
La structure doit tre conue de telle sorte que sa
dtrioration, pendant la dure dutilisation de projet,
nabaisse pas ses performances en dessous de
celles escomptes, compte tenu de lenvironne-
ment et du niveau de maintenance escompt.
Les normes Eurocode instaurent un vritable sys-
tme normatif performantiel fond sur des concepts
scientifiques cohrents qui est un gage doptimi-
sation des matriaux et de prennit des ouvrages.
Les normes Eurocode permettent une optimisa-
tion de la durabilit des structures. Elles supposent
que:
le choix du systme structural et le projet de
structure sont raliss par un personnel suffisam-
ment qualifi et expriment;
lexcution est confie un personnel suffisam-
ment comptent et expriment;
une surveillance et une matrise de la qualit ad-
quates sont assures au cours de la ralisation,
dans les bureaux dtudes, les usines, les entre-
prises et sur le chantier ;
les matriaux utiliss sont conformes aux normes
appropries ;
la structure bnficiera de la maintenance ad-
quate;
lutilisation de la structure sera conforme aux
hypothses admises dans le projet.
33
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 33
Les diffrents articles des normes Eurocode se
dcomposent en deux principales catgories.
Les Principes
Les Principes (P) sont des noncs dordre gnral
et des dfinitions ou des prescriptions qui ne com-
portent pas dalternative et qui sont des bases pour
garantir les niveaux de performances structurales.
Les Rgles dapplication
Les Rgles dapplication sont conformes aux princi-
pes. Il est possible dutiliser dautres rgles sous
rserve de dmontrer leur conformit aux principes.
Les Eurocodes dfinissent des exigences fonda-
mentales pour atteindre des niveaux de perfor-
mance appropris en matire de fiabilit des
constructions dont les quatre composantes sont :
la scurit structurale pour les personnes et les
animaux domestiques ;
laptitude au service, fonctionnement, confort
la robustesse en cas de situations accidentelles ;
la durabilit, compte tenu des conditions envi-
ronnementales.
Nota
La dtermination des actions applicables
aux constructions et les rgles de concep-
tion parasismique, communes tous les
types douvrages, se trouvent, respective-
ment, dans lEurocode NF EN 1990, dans la
srie des Eurocodes NF EN 1991 et dans la
srie des Eurocodes NF EN 1998.
Le calcul de la rsistance mcanique et de la
rsistance au feu des ouvrages en bton seffec-
tue partir des Eurocodes NF EN 1992-1-1 et
NF EN 1992-1-2.
2.1.2 - Transposition nationale
des Eurocodes
Les normes europennes Eurocode ne peuvent
tre utilises dans chaque pays quaprs transposi-
tion en normes nationales. Elles sont compltes
par une Annexe Nationale (AN).
Dans chaque pays, lAnnexe Nationale dfinit les
conditions dapplication de la norme europenne.
Elle permet de tenir compte des particularits go-
graphiques, gologiques ou climatiques ainsi que
des niveaux de protection spcifiques chaque
pays. En effet, le choix des niveaux de fiabilit et
de scurit des projets est une prrogative des
tats. Les Eurocodes offrent la souplesse nces-
saire pour que des modulations puissent tre effec-
tues au niveau de clauses bien identifies afin de
les adapter aux contextes nationaux.
Les normes nationales transposant les Eurocodes
comprennent la totalit du texte des Eurocodes
Chapitre Dimensionnement des structures en bton 2
34
LA DIRECTIVE SUR LES PRODUITS
DE CONSTRUCTION
La Directive sur les Produits de
Construction couvre tous les produits
destins tre incorpors durablement
dans un btiment ou un ouvrage de
gnie civil, ds lors quils peuvent avoir
une incidence sur la scurit, la sant, lenvi-
ronnement ou lisolation.
Les produits de construction viss par cette
directive doivent tre conus de telle
sorte que les ouvrages dans lesquels ils
sont utiliss satisfassent aux exigences
essentielles suivantes :
1 La rsistance mcanique et la stabilit;
2 La scurit en cas dincendie;
3 Lhygine, la sant et lenvironnement ;
4 La scurit dutilisation;
5 La protection contre le bruit ;
6 Lconomie dnergie et lisolation
thermique.
Les produits concerns doivent porter le
marquage CE symbolisant la conformit
ces dispositions.
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 34
(toutes annexes incluses), tel que publi par le
CEN; ce texte est prcd dune page nationale de
titres et par un Avant-Propos national, et suivi
dune Annexe Nationale.
LAnnexe Nationale contient en particulier des
informations sur les paramtres laisss en attente
dans lEurocode pour choix national, sous la dsi-
gnation de Paramtres Dtermins au Niveau
National (NDP), il sagit :
de valeurs et/ou des classes l o des alternati-
ves figurent dans lEurocode;
de valeurs utiliser l o seul un symbole est
donn dans lEurocode;
de donnes propres un pays (gographiques,
climatiques, etc.), par exemple carte de neige,
carte de gel ;
de la procdure utiliser l o des procdures
alternatives sont donnes dans lEurocode;
des dcisions sur lusage des annexes informati-
ves ;
des rfrences des informations complmentai-
res pour aider lutilisateur appliquer lEurocode.
2.1.3 - Eurocode 0
LEurocode 0 (norme NF EN 1990 Bases de cal-
cul des structures ) dcrit les principes et les exi-
gences pour la scurit, laptitude au service et la
durabilit des structures et dfinit les bases pour le
dimensionnement des structures.
Le dimensionnement dune structure est associ
la notion de dure dutilisation de projet (dure
pendant laquelle la structure ou une de ses parties
est cense pouvoir tre utilise comme prvu en
faisant lobjet de la maintenance escompte, mais
sans quil soit ncessaire deffectuer des rpara-
tions majeures) et de fiabilit (capacit dune
structure ou dun lment structural satisfaire aux
exigences spcifies, pour lesquelles il ou elle a t
conu(e).
La fiabilit de la structure suppose un dimension-
nement conforme aux normes Eurocode et la
mise en uvre de mesures appropries en matire
dexcution et de gestion de la qualit. Elle sex-
prime en terme de probabilit.
La maintenance couvre lensemble des oprations
effectues pendant la dure dutilisation de la
structure, afin de lui permettre de satisfaire aux
exigences de fiabilit.
Nota
La notion de dure dutilisation de projet
na pas de porte juridique lie des tex-
tes lgislatifs et rglementaires traitant de
responsabilit ou de garantie.
LEurocode 0 pose les exigences de base sui-
vantes.
Article 2.1.1 (P)
Une structure doit tre conue et ralise de sorte
que, pendant la dure dutilisation de projet
escompte, avec des niveaux de fiabilit appro-
pris et de faon conomique:
elle rsiste toutes les actions et influences sus-
ceptibles dintervenir pendant son excution et
son utilisation;
elle reste adapte lusage pour lequel elle a t
conue.
35
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 35
Article 2.1.2 (P)
Une structure doit tre conue et dimensionne
pour avoir une rsistance structurale, une aptitude
au service et une durabilit de niveaux appropris .
Les Eurocodes accentuent la prise en compte de la
durabilit des ouvrages en sappuyant sur la notion
de dure dutilisation de projet.
Larticle 2.4 de lEurocode 0 dfinit la notion de
durabilit de la structure.
Article 2.4.1 (P)
La structure doit tre projete de sorte que sa
dtrioration, pendant la dure dutilisation de pro-
jet, nabaisse pas ses performances au-dessous
de celles escomptes, compte tenu de lenviron-
nement et du niveau de maintenance escompt .
Les exigences de durabilit doivent tre prises en
compte en particulier dans :
les conditions denvironnement, traduites par les
classes dexposition;
la conception de la structure et le choix du sys-
tme structural ;
le choix et la qualit des matriaux;
les dispositions constructives ;
lexcution et la matrise de la qualit de la mise
en uvre;
les mesures de protection spcifiques ;
les inspections et les contrles ;
les dispositions particulires (utilisation darma-
tures inox) ;
les niveaux de la maintenance
Pour atteindre la dure dutilisation de projet requise
pour la structure, des dispositions appropries doivent
tre prises afin de protger chaque lment struc-
tural des actions environnementales et matriser
leurs effets sur la durabilit.
La dure dutilisation du projet doit tre spci-
fie par le matre douvrage.
Proprits des matriaux
Les proprits des matriaux ou des produits sont
reprsentes par des valeurs caractristiques
(valeur de la proprit ayant une probabilit don-
ne de ne pas tre atteinte lors dune hypothtique
srie dessais illimite).
Les valeurs caractristiques correspondent aux
fractiles 5 % (valeur infrieure) et 95 % (valeur
suprieure) pour les paramtres de rsistance et
la valeur moyenne pour les paramtres de rigidit.
Par exemple pour le bton, on distingue deux
grandeurs pour la rsistance en traction:
f
ctk0,05
et f
ctk0,95
Classification des actions (section 4)
Les actions sont :
un ensemble de forces ou de charges appliques
la structure (action directe) ;
un ensemble de dformations ou dacclrations
imposes, rsultant par exemple de variations de
temprature, de tassements diffrentiels ou de
tremblement de terre (action indirecte).
Elles se traduisent sur les lments structuraux par
des efforts internes, moments, contraintes, ou sur
lensemble de la structure par des flches ou des
rotations.
Les actions sont classes en fonction de leur varia-
tion dans le temps, en quatre catgories :
les actions permanentes (G), par exemple le
poids propre des structures, des lments non
structuraux (revtements de sols, plafonds
suspendus), quipements fixes (ascenseur,
quipements lectriques) et revtements de
chausse, et les actions indirectes (provoques
par un retrait et des tassements diffrentiels) et
les actions de la prcontrainte;
Chapitre Dimensionnement des structures en bton 2
36
Tableau 5: la dure indicative dutilisation de projet
selon norme NF EN 1990 tableau 2.1 (NF)
Catgorie Dure indicative
de dure dutilisation
Exemples
dutilisation de projet
de projet (en annes)
1 10 Structures provisoires
2 25 lments structuraux remplaables
3 25 Structures agricoles et similaires
4 50 Btiments et autres structures courantes
5 100
Btiments monumentaux
Ponts et autres ouvrages de gnie civil
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 36
les actions variables (Q), par exemple les char-
ges dexploitation sur planchers, poutres et toits
des btiments, les actions du vent, les charges de
la neige, les charges de trafic routier ;
les actions accidentelles (A
d
), par exemple les
explosions ou les chocs de vhicules ;
les actions sismiques (A
ed
).
Les actions sont galement classes :
selon leur origine, comme directes ou indirectes ;
selon leur variation spatiale, comme fixes ou libres;
ou, selon leur nature, comme statiques ou dyna-
miques.
On distingue ainsi :
les actions statiques (neige, charges de mobilier) ;
les actions dynamiques (trafic, vent, sisme, choc).
LEurocode 0 fixe les coefficients de scurit par-
tiels applicables aux actions (
g
pour les actions
permanentes,
Q
pour les actions variables) et dfi-
nit les combinaisons dactions. Une structure est
soumise un grand nombre dactions qui doivent
tre combines entre elles.
La probabilit doccurrence simultane dactions
indpendantes peut tre trs variable selon leur
nature. Il est donc ncessaire de dfinir les combi-
naisons dactions dans lesquelles, la valeur carac-
tristique dune action dite de base, sajoutent des
valeurs caractristiques minores dautres actions.
Les combinaisons dactions sont dfinies pour des
situations de projets, que la structure va rencontrer
tant en phase dexcution que dexploitation ou de
maintenance: situations de projets durables (cor-
respondant des conditions normales dutilisation),
transitoires (correspondant des situations tempo-
raires telles que lexcution), accidentelles (incen-
die, chocs) ou sismiques (tremblement de terre).
Les combinaisons dactions considres doivent
tenir compte des cas de charges pertinents, per-
mettant ltablissement des conditions de dimen-
sionnement dterminantes dans toutes les sections
de la structure ou une partie de celle-ci.
Principes du calcul aux tats limites
(section 3)
La mthode de calcul aux tats limites se fonde
sur une approche semi-probabiliste de la scurit. Ce
type de calcul permet de dimensionner une structure
de manire offrir une probabilit acceptable ne pas
atteindre un tat limite , qui la rendrait impropre
sa destination. Cette dfinition conduit consid-
rer les familles dtats limites, telles que les tats
Limites de Service, les tats Limites Ultimes.
37
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 37
Un ouvrage doit prsenter durant toute sa dure
dexploitation des scurits appropries vis--vis :
de sa ruine ou de celle de lun de ses lments ;
dun comportement en service pouvant affecter
sa durabilit, son aspect ou le confort des usagers.
La vrification des structures se fait par le calcul aux
tats limites. On distingue deux tats limites :
ELS: tats Limites de Service;
ELU: tats Limites Ultimes.
La mthode de calcul aux tats limites applique
des coefficients de scurit partiels dune part aux
rsistances et dautre part aux actions (et donc aux
sollicitations).
Nota
Les tats limites sont des tats dune
construction qui ne doivent pas tre
atteints sous peine de ne plus permettre
la structure de satisfaire les exigences
structurelles ou fonctionnelles dfinies lors
de son projet. La justification dune struc-
ture consiste sassurer que de tels tats
ne peuvent pas tre atteints ou dpasss
avec une probabilit dont le niveau
dpend de nombreux facteurs.
Les vrifications doivent tre faites pour toutes les
situations de projet et tous les cas de charges
appropris.
La notion dtat Limite se traduit essentiellement
au niveau des critres de calcul par des coefficients
partiels de scurit afin de traiter les diffrentes
incertitudes lies aux proprits des matriaux et
la ralisation de louvrage.
tats Limites de Service (ELS)
Les tats Limites de Service (ELS) correspondent
des tats de la structure lui causant des dommages
limits ou des conditions au-del desquelles les
exigences daptitude au service spcifies pour la
structure ou un lment de la structure ne sont plus
satisfaites (fonctionnement de la structure ou des
lments structuraux, confort des personnes,
aspect de la construction).
Ils sont relatifs aux critres dutilisation courants :
dformations, vibrations, durabilit. Leur dpasse-
ment peut entraner des dommages la structure
mais pas sa ruine.
On distingue les ELS rversibles qui correspondent
des combinaisons dactions frquentes ou quasi
permanentes et les ELS irrversibles associs des
combinaisons dactions caractristiques.
tats Limites Ultimes (ELU)
Les tats Limites Ultimes (ELU) concernent la scu-
rit des personnes et/ou la scurit de la structure
et des biens. Ils incluent ventuellement les tats
prcdant un effondrement ou une rupture de la
structure.
Ils correspondent au maximum de la capacit por-
tante de louvrage ou dun de ses lments par :
perte dquilibre statique;
rupture ou dformation plastique excessive;
instabilit de forme (flambement).
La norme NF EN 1990 dfinit quatre catgories
dtats Limites Ultimes :
EQU : perte dquilibre statique de la structure
ou dune partie de la structure
Chapitre Dimensionnement des structures en bton 2
38
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 38
STR : dfaillance ou dformation excessive
dlments structuraux
GEO : dfaillance due au sol
FAT : dfaillance de la structure ou dlments
de la structure due la fatigue
Analyse structurale (section 5)
Lanalyse structurale permet de dterminer la dis-
tribution, soit des sollicitations, soit des contrain-
tes, dformations et dplacements de lensemble
ou dune partie de la structure. Elle permet diden-
tifier les sollicitations aux divers tats limites dans
les lments ou les sections de la structure.
La gomtrie est habituellement modlise en consi-
drant que la structure est constitue dlments
linaires, dlments plans et, occasionnellement,
de coques. Le calcul doit prendre en considration
la gomtrie, les proprits de la structure et son
comportement chaque stade de sa construction.
Les lments dune structure sont classs, selon
leur nature et leur fonction, en poutres, poteaux,
dalles, voiles, plaques, arcs, coques, etc.
Les modles de comportement couramment utili-
ss pour lanalyse sont :
comportement lastique linaire; lanalyse linaire
base sur la thorie de llasticit est utilisable
pour les tats limites ultimes et les tats limites de
service en supposant des sections non fissures,
un diagramme contrainte-dformation linaire et
des valeurs moyennes des modules dlasticit;
comportement lastique linaire avec distribu-
tion limite;
comportement plastique, incluant notamment la
modlisation par bielles et tirants ;
comportement non linaire.
Nota
Une analyse locale complmentaire peut
tre ncessaire lorsque lhypothse de
distribution linaire des dformations ne
sapplique plus, par exemple: proximit
des appuis, au droit des charges concen-
tres, aux nuds entre poteaux et pout-
res, dans les zones dancrage.
Vrification par la mthode
des coefficients partiels (section 6)
La vrification consiste sassurer quaucun tat
limite nest dpass.
Valeurs de calcul des actions
La valeur de calcul scrit :
Fd =
f
F
rep
F
rep
valeur reprsentative
approprie de laction;
Avec F
rep
= F
k
F
k
est la valeur caractristique de laction;
f
coefficient partiel pour laction;
est soit 1,00 soit
0
,
1
ou
2
.
Valeurs de calcul des proprits des matriaux
La valeur de calcul dune proprit dun matriau
est gale :
Xd =
Xk
m
Xk valeur caractristique de la proprit du
matriau
valeur moyenne du coefficient de conver-
sion
m
coefficient partiel pour la proprit du mat-
riau tient compte:
des effets de volume et dchelle;
des effets de lhumidit et de la tempra-
ture;
et dautres paramtres sil y a lieu.
Combinaisons dactions
Lannexe A1: Application pour les btiments
fournit les rgles pour tablir les combinaisons
dactions pour les btiments.
Pour les ELU expressions 6.10 6.12 b:
combinaisons fondamentales: 6.10 6.10 a/b
pour situations de projet durables ou transitoires
combinaisons accidentelles: 6.11
pour situations de projet accidentelles
combinaisons sismiques: 6.12
pour situations de projet sismiques
Pour les ELS expressions 6.14 6.16 b
Exemples de combinaisons:
1.10G
k,sup
+ 0,90G
k,inf
+ 1,50Q
k1
+ 1,5
o,i
Q
k,i
1.35G
k,sup
+ 1,00G
k,inf
+ 1,50Q
k1
+ 1,5
o,i
Q
k,i
1.15G
k,sup
+ 1,00G
k,inf
+ 1,50Q
k1
+ 1,5
o,i
Q
k,i
Avec
G
k,sup
: actions permanentes dfavorables
G
k,inf
: actions permanentes favorables
Q
k,1
: action variable dominante
Q
k,i
: action variable daccompagnement
39
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 2/12/08 11:54 Page 39
2.1.4 - Eurocode 1
LEurocode 1 (norme NF EN 1991) traite des
actions pour le calcul des structures. Il est compos
de dix normes :
NF EN 1991-1-1: actions gnrales poids volu-
miques, poids propres, charges dexploitation
les btiments
NF EN 1991-1-2: actions gnrales actions sur
les structures exposes au feu
NF EN 1991-1-3: actions gnrales charges de
neige
NF EN 1991-1-4: actions gnrales charges du
vent
NF EN 1991-1-5: actions gnrales actions
thermiques
NF EN 1991-1-6: actions gnrales actions en
cours dexcution
NF EN 1991-1-7: actions gnrales actions
accidentelles
NF EN 1991-2: actions sur les ponts dues au
trafic
NF EN 1991-3: actions induites par les grues et
les ponts roulants
NF EN 1991-4: silos et rservoirs
Ces normes dfinissent les actions pour la concep-
tion structurale des btiments et des ouvrages de
gnie civil, en particulier :
les poids volumiques des matriaux de construc-
tion et des matriaux stocks ;
le poids propre des lments de construction;
les charges dexploitation (uniformment rpar-
tie ou ponctuelle) prendre en compte pour les
btiments et les ponts.
Les Annexes Nationales prcisent les actions
appliquer sur le territoire franais telles que par
exemple les charges de neige et des charges sp-
cifiques dexploitation.
Chapitre Dimensionnement des structures en bton 2
40
Eurocode Partie dEurocode Titre et/ou objet
NF EN 1990:
Bases de calcul des structures
Texte principal
Exigences fondamentales. Principes du calcul aux tats limites par la
mthode des coefficients partiels.
Annexe A1 Application aux btiments (combinaisons d'actions).
NF EN 1991:
Eurocodes 1 - Actions sur les structures
Partie 1-1 Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation des btiments.
Partie 1-2 Actions sur les structures exposes au feu.
Partie 1-3 Charges de neige.
Partie 1-4 Actions dues au vent.
Partie 1-5 Actions thermiques.
Partie 1-6 Actions en cours d'excution.
Partie 1-7
Actions accidentelles (actions dues aux chocs de vhicules routiers,
de chariots lvateurs).
NF EN 1992:
Eurocode 2 - Calcul des structures en bton
Partie 1-1
Rgles gnrales et rgles pour les btiments
(y compris actions dues la prcontrainte).
Partie 1-2 Calcul du comportement au feu.
NF EN 1997:
Eurocode 7 - Calcul gotechnique
Partie 1 Calcul des fondations.
NF EN 1998: Eurocodes 8 - Calcul des
structures pour leur rsistance aux sismes
Partie 1 Rgles gnrales, actions sismiques et rgles pour les btiments.
Partie 5 Fondations, structures de soutnement et aspect gotechniques.
Tableau 6: les Eurocodes pour la conception d'un btiment en bton
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 40
Charges dexploitation des btiments: (section 6)
La section 6 donne des valeurs caractristiques des
charges dexploitation pour les planchers et les
couvertures ; ces valeurs sont dfinies en fonction
de la catgorie dusage des btiments.
A Lieux de vie domestique: habitation et rsi-
dentiel.
B Lieux de travail de bureau: bureaux.
C Lieux de runions : salles de runion, de spec-
tacles, de sport, etc.
D Aires de commerces : boutiques et grandes
surfaces de ventes.
E Aires de stockage: entrepts et archives et
locaux industriels.
F Surfaces de stationnement et de circulation
automobiles dans les btiments : garages et
aires de circulation.
G Surfaces de stationnement et de circulation de
camions moyens dans les btiments : garages
et aires de circulation.
H Surfaces de toitures inaccessibles.
I Surfaces de toitures accessibles.
K Hlistations.
Nota
LEurocode 1 partie 2 dfinit des modles
de charges pour :
les charges dexploitation sur les ponts
routiers ;
les actions dues aux pitons ;
les charges sur les ponts ferroviaires dues
au trafic.
41
Eurocode Partie dEurocode Titre et/ou objet
NF EN 1990:
Bases de calcul des structures
Texte principal
Exigences fondamentales. Principes de la mthode
des coefficients partiels.
Annexe A2 Application aux ponts (combinaisons d'actions).
Annexe E
Exigences et rgles de calcul pour les appareils d'appui structuraux,
les joints de dilatation, les dispositifs de retenue et les cbles.
NF EN 1991:
Eurocodes 1 - Actions sur les structures
Partie 1-1
Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation des btiments
(pour les ponts, partie traitant des actions dues au poids propre).
Partie 1-3
Charges de neige (pour certains types de ponts routiers et de passerelles,
en cours d'excution ou en service).
Partie 1-4
Actions dues au vent (dtermination des forces quasi statistiques dues
au vent sur les piles et les tabliers de ponts de gomtrie classique .
Partie 1-5 Actions thermiques.
Partie 1-6 Actions en cours d'excution.
Partie 1-7
Actions accidentelles (actions dues aux chocs de vhicules routiers,
de bateaux, de trains, sur les piles et les tabliers de ponts).
Partie 2
Charges sur les ponts dues au trafic (ponts routiers, passerelles,
ponts ferroviaires).
NF EN 1992:
Eurocode 2 - Calcul des structures en bton
Partie 1-1
Rgles gnrales et rgles pour les btiments
(y compris actions dues la prcontrainte).
Partie 2 Ponts en bton (rgles de calcul et dispositions constructives).
NF EN 1997:
Eurocode 7 - Calcul gotechnique
Partie 1 Calcul des fondations.
NF EN 1998:
Eurocodes 8 - Calcul des structures
pour leur rsistance aux sismes
Partie 1 Rgles gnrales, actions sismiques et rgles pour les btiments.
Partie 2 Ponts.
Partie 5 Fondations, structures de soutnement et aspect gotechniques.
Tableau 7: les Eurocodes pour la conception d'un pont en bton
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 41
Ce chapitre synthtise les informations fondamen-
tales de lEurocode bton. Il na pas pour vocation
dtre un cours de dimensionnement des struc-
tures en bton. Pour plus de prcisions, il convient
de consulter le site BA-CORTEX (voir page 84).
La norme de base pour le calcul des structures
en bton est lEurocode 2 (norme NF EN 1992
calcul des structures en bton). LEurocode 2 com-
prend quatre normes permettant de concevoir et
dimensionner les structures et les lments struc-
turaux des constructions en bton (btiments,
ouvrages dart, silos et rservoirs) et ou de vri-
fier les proprits mcaniques des lments struc-
turaux prfabriqus en bton.
NF EN 1992-1-1: rgles gnrales et rgles
pour les btiments
NF EN 1992-1-2: rgles gnrales calcul
du comportement au feu
NF EN 1992-2: ponts calcul et dispositions
constructives
NF EN 1992-3: silos et rservoirs
Ces normes permettent le calcul des btiments et
des ouvrages de gnie civil en bton non arm, en
bton arm ou en bton prcontraint. Elles traitent,
en conformit avec lEurocode 0, des principes et
des exigences pour la rsistance mcanique, la
scurit, laptitude au service, la durabilit et la
rsistance au feu des structures en bton.
Nota
Les autres exigences, telles que celles rela-
tives aux isolations thermiques et acous-
tiques, par exemple, ne sont pas traites.
Elles remplacent en concentrant en un texte unique
les rgles de calcul du bton arm (BAEL) et du
bton prcontraint (BPEL). Elles ne rvolutionnent
pas les calculs du bton arm ou prcontraint, car
on y retrouve tous les principes fondamentaux du
BAEL et du BPEL.
2.2.1 - Eurocode 2 partie 1-1
Section 1: gnralits
La norme NF EN 1992-1-1 dfinit les principes
gnraux du calcul des structures et les rgles sp-
cifiques pour les btiments. Les principes relatifs
la durabilit font lobjet de la Section 4 (durabilit
et enrobage des armatures). Ces principes confor-
mes ceux de la section 2 de la norme NF EN 1990
introduisent pour la conception vis--vis de la
durabilit, la prise en compte des actions environ-
nementales et de la dure dutilisation de projet.
Article 4.1 (1) (P) : une structure durable doit
satisfaire aux exigences daptitude au service, de
rsistance et de stabilit pendant toute la dure
dutilisation de projet, sans perte significative de
fonctionnalit ni maintenance imprvue excessive .
Chapitre Dimensionnement des structures en bton 2
42
2.2 LEurocode 2 (Eurocode bton)
Sommaire de la norme NF EN 1992-1-1
Avant-propos national
Avant-propos europen
Section 1 Gnralits
Section 2 Bases de calcul
Section 3 Matriaux
Section 4 Durabilit et enrobage des armatures
Section 5 Analyse structurale
Section 6 tats limites ultimes (ELU)
Section 7 tats limites de services (ELS)
Section 8 Dispositions constructives relatives aux armatures
de bton arm et de prcontrainte Gnralits
Section 9 Dispositions constructives relatives
aux lments et rgles particulires
Section 10 Rgles additionnelles pour les lments
et les structures prfabriqus en bton
Section 11 Structures en bton de granulats lgers
Section 12 Structures en bton non arm
ou faiblement arm
Annexes A J
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 42
43
PRINCIPAUX SYMBOLES ET NOTATIONS DE LEUROCODE BTON
A Aire de la section droite
A
c
Aire de la section droite du bton
A
p
Aire de la section de larmature
ou des armatures de prcontrainte
A
s
Aire de la section des armatures de bton arm
A
s,min
Aire de la section minimale darmatures
A
sw
Aire de la section des armatures deffort
tranchant
E
c
, E
c(28)
Module dlasticit tangent lorigine
E
cd
Valeur de calcul du module dlasticit du
bton
E
p
Valeur de calcul du module dlasticit
de lacier de prcontrainte
E
s
Valeur de calcul du module dlasticit
de lacier de bton arm
F Action
F
d
Valeur de calcul dune action
F
k
Valeur caractristique dune action
G
k
Valeur caractristique dune action
permanente
I Moment dinertie de la section de bton
L Longueur
M Moment flchissant
M
Ed
Valeur de calcul du moment flchissant
agissant
N Effort normal
N
Ed
Valeur de calcul de leffort normal agissant
(traction ou compression)
P Force de prcontrainte
P
o
Force initiale lextrmit active de
larmature de prcontrainte immdiatement
aprs la mise en tension
Q
k
Valeur caractristique dune action variable
Q
fat
Valeur caractristique de la charge de fatigue
R Rsistance
V Effort tranchant
V
Ed
Valeur de calcul de leffort tranchant agissant
f
c
Rsistance en compression du bton
f
cd
Valeur de calcul de la rsistance
en compression du bton
f
ck
Rsistance caractristique en compression
du bton, mesure sur cylindre 28 jours
f
cm
Valeur moyenne de la rsistance en
compression du bton, mesure sur cylindre
f
ctk
Rsistance caractristique en traction directe
du bton
f
p
Rsistance en traction de lacier de
prcontrainte
f
pk
Rsistance caractristique en traction
de lacier de prcontrainte
f
0,2k
Valeur caractristique de la limite dlasticit
conventionnelle 0,2 %de lacier de bton arm
f
t
Rsistance en traction de lacier de bton arm
f
tk
Rsistance caractristique en traction
de lacier de bton arm
f
y
Limite dlasticit de lacier de bton arm
f
yd
Limite dlasticit de calcul de lacier de bton
arm
f
yk
Limite caractristique dlasticit de lacier de
bton arm
f
ywd
Limite dlasticit de calcul des armatures
deffort tranchant
A
Coefficient partiel relatif aux actions
accidentelles A
C
Coefficient partiel relatif au bton
F
Coefficient partiel relatif aux actions F
C,fat
Coefficient partiel relatif aux actions
de fatigue
G
Coefficient partiel relatif aux actions
permanentes G
M
Coefficient partiel relatif une proprit
dun matriau
P
Coefficient partiel relatif aux actions
associes la prcontrainte P
Q
Coefficient partiel relatif aux actions
variables Q
S
Coefficient partiel relatif lacier de bton
arm ou de prcontrainte
c
Dformation relative en compression du bton
cu
Dformation relative ultime du bton en
compression
u
Dformation relative de lacier de bton arm
ou de prcontrainte sous charge maximale
uk
Valeur caractristique de la dformation
relative de lacier de bton arm ou de
prcontrainte sous charge maximale
Coefficient de Poisson
w
Pourcentage darmatures longitudinales
P
w
Pourcentage darmartures deffort tranchant
c
Contrainte de compression dans le bton
cp
Contrainte de compression dans le bton due
une effort normal ou la prcontrainte
Contrainte tangente de torsion
Diamtre dune barre darmature ou dune
gaine de prcontrainte
(t,t
o
) Coefficient de fluage, dfinissant le fluage
entre les temps t et to, par rapport la
dformation lastique 28 jours
(,t
o
)Valeur finale du coefficient de fluage
Coefficients dfinissant les valeurs
reprsentatives des actions variables
o
pour les valeurs de combinaison
1
pour les valeurs frquentes
2
pour les valeurs quasi-permanentes
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 43
Nota
LAnnexe Nationale de la norme
NF EN 1992-1-1 reprend les mmes sec-
tions et paragraphes, soit pour dfinir les
paramtres et mthodes laisss au choix
national dans la partie europenne, soit
pour apporter des commentaires non
contradictoires.
Larticle 7.3 (Matrise de la fissuration) prcise que
la fissuration doit tre limite pour ne pas porter
atteinte la durabilit de la structure. Des limites
douverture des fissures en fonction du type de
bton (bton arm, bton prcontraint) et de la
classe dexposition sont imposes.
La section 8 prescrit les dispositions constructives
relatives aux armatures de bton arm et de bton
prcontraint qui doivent tre respectes pour satis-
faire aux exigences de durabilit.
LAnnexe E prescrit des classes de rsistance mini-
males en fonction de la classe dexposition pour
assurer la durabilit de louvrage. Cette classe de
rsistance la compression du bton peut tre
suprieure celle exige pour le dimensionnement
de la structure.
Section 2: bases de calcul
Cette section prcise que les exigences de base de
la norme NF EN 1990 doivent tre respectes et
que les actions doivent tre dfinies conform-
ment la srie des normes NF EN 1991. Elle
explique en particulier comment prendre en
compte les effets du retrait, du fluage de la pr-
contrainte et des tassements diffrentiels. Elle
donne les coefficients partiels relatifs aux mat-
riaux prendre en compte pour le calcul aux tats
limites ultimes.
Section 3: matriaux
La section 3 regroupe les donnes relatives aux
matriaux. Les proprits des matriaux sont
reprsentes par des valeurs caractristiques.
Nota
LEurocode NF EN 1990 prconise de dfi-
nir la valeur caractristique dune proprit
de matriau par le fractile 5 % lorsquune
valeur basse est dfavorable (cas gn-
ral), et par le fractile 95 %lorsquune valeur
haute est dfavorable.
Bton
Le bton est dfini par sa rsistance caractristique
la compression sur cylindre 28 jours note
(fractile 5 %). fck est compris entre 12 et 90 MPa.
Pour le calcul des sections, deux types de dia-
gramme contraintes-dformations sont proposs:
courbe parabole rectangle;
courbe bilinaire.
Chapitre Dimensionnement des structures en bton 2
44
Tableau 8: coefficients partiels relatifs aux matriaux
Situations
c
s
(acier de
s
(acier de
de projet (bton) bton arm) prcontrainte)
Durable
Transitoire
1,50 1,15 1,15
Accidentelle 1,20 1,00 1,00
c2
cu2
f
ck
f
cd
c3
cu3
f
ck
c
f
cd
tan = E
cm
c1
cu1
f
cm
0,4 f
cm
c
0
0
Contraintes
Dformations
Contraintes
Dformations
c2
cu2
f
ck
f
cd
c3
cu3
f
ck
c
f
cd
tan = E
cm
c1
cu1
f
cm
0,4 f
cm
c
0
0
Contraintes
Dformations
Contraintes
Dformations
Diagramme parabole rectangle
Diagramme bilinaire
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 44
Les rsistances de calcul du bton sont :
en compression f
cd
=
cc
f
ck
/
c
en traction f
cd
=
ct
f
ctk0,05
/
c
Avec
f
ck
rsistance caractristiques sur cylindre
28 jours
f
ctk0,05
fractile 5 % de la rsistance en traction
dfini partir de la rsistance moyenne
en traction f
ctm
c
coefficient partiel relatif au bton
cc
et
ct
coefficients = 1
Aciers passifs
Les armatures sont conformes la norme
EN 10080. Leurs proprits sont dfinies dans
lannexe normative C. La gamme de limite
dlasticit est comprise entre 400 et 600 MPa.
Les armatures autorises sont toutes haute adh-
rence et spcifies selon trois classes de ductilit.
Le diagramme contraintes-dformations de calcul
comporte une branche horizontale sans limite ou
une branche incline.
Aciers de prcontrainte
La norme EN 10138 donne les caractristiques des
armatures de prcontrainte. Les courbes contrain-
tes dformations offrent deux possibilits : une
branche horizontale sans limite et une branche
incline.
Les dispositifs de prcontrainte doivent tre
conformes lAgrment Technique Europen du
procd.
Section 4: durabilit et enrobage
des armatures
Larticle 4.2 reprend les classes dexposition dfi-
nies dans la norme NF EN 206-1. Cette classifica-
tion est fonction des actions environnementales
auxquelles sont soumis louvrage ou les parties
douvrages.
Les exigences relatives la durabilit (article 4.3)
sont bases sur la mise en uvre de dispositions
appropries afin de protger chaque partie dou-
vrage des actions environnementales. Ces disposi-
tions sont prendre tout au long du cycle de
conception jusqu la ralisation de louvrage, en
passant par le choix des matriaux, des disposi-
tions constructives, des procdures de matrise de
la qualit et de contrles dinspection.
45
Diagramme
simplifi
Diagrammes
de calcul
ud
uk
kf
yk
f
yk
f
yd
= f
yk/
s
f
yd/
E
s
0
Contraintes
Dformations
Diagramme contrainte-dformation simplifi
et diagramme de calcul pour les aciers en bton arm
(tendus ou comprims)
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 45
La norme dcrit (Article 4.4) les rgles de dtermi-
nation de lenrobage nominal des armatures qui
reprsente la distance entre la surface du bton et
larmature la plus proche (cadres, triers, pingles,
armatures de peau, etc.). Lenrobage des armatu-
res et les caractristiques du bton denrobage
sont des paramtres fondamentaux pour la ma-
trise de la prennit des ouvrages.
Les recommandations de lEurocode 2 en matire
denrobage des btons de structures sont novatri-
ces. Elles visent, en conformit avec la norme
NF EN 206-1 et les normes des produits prfabri-
qus, optimiser de manire pertinente la durabi-
lit des ouvrages. En effet, la dtermination de la
valeur de lenrobage, qui doit satisfaire en particu-
lier aux exigences de bonnes transmissions des
forces dadhrences et aux conditions denviron-
nement doit prendre compte:
la classe dexposition dans laquelle se trouve
louvrage (ou la partie douvrage) ;
la dure dutilisation de projet ;
la classe de rsistance du bton;
le type de systmes de contrles qualit mise en
uvre pour assurer la rgularit des performan-
ces du bton et la matrise du positionnement
des armatures ;
le type darmatures (prcontraintes ou non) et
leur nature (acier au carbone, inox) et leur ven-
tuelle protection contre la corrosion;
la matrise du positionnement des armatures.
La valeur de lenrobage peut ainsi tre rduite en
particulier :
si lon choisit un bton prsentant une classe de
rsistance la compression suprieure la classe
de rfrence (dfinie pour chaque classe dexpo-
sition) ;
sil existe un systme de contrle de la qualit;
si lon utilise des armatures inox.
LEurocode dfinit des classes structurales , dans
le tableau 4.3 NA qui permettent de dterminer en
fonction de la classe dexposition, lenrobage mini-
mum C
min
satisfaisant aux conditions de durabilit.
Deux tableaux donnent la valeur de C
min
, en fonc-
tion de la classe structurale, lun pour les armatures
passives et lautre pour les cbles ou armatures de
prcontraintes.
Chapitre Dimensionnement des structures en bton 2
46
Lenrobage qui figure sur les plans est lenrobage
nominal C
nom
:
C
nom
= C
min
+ C
dev
C
dev
est la tolrance de pose des aciers. Elle est
prise normalement gale 10 mm.
LEurocode 2 permet aussi de dimensionner lou-
vrage pour une dure dutilisation suprieure en
augmentant la valeur de lenrobage (+ 10 mm pour
passer de 50 100 ans).
Le LCPC a dit un guide technique intitul:
Structures en bton conues avec lEurocode 2
Note technique sur les dispositions relatives len-
robage pour lapplication en France . Les rgles de
calcul des enrobages de lEurocode 2 y sont expli-
cites. Les spcificits nationales telles que la prise
en compte des classes dexposition lies aux envi-
ronnements chimiquement agressifs sont prsen-
tes.
Nota
Le tableau 4.1 dfinit les classes dexposi-
tion en fonction des conditions denviron-
nement en conformit avec la norme
bton NF EN 206-1.
Section 5: analyse structurale
Ce chapitre prsente les principes de modlisation
de la structure qui est constitue dlments < ou
plans (dalles, poteaux, voiles).
Une poutre est un lment dont la porte est
suprieure ou gale trois fois la hauteur totale de
la section. Lorsque ce nest pas le cas, il convient
de la considrer comme une poutre-cloison.
Une dalle est un lment dont la plus petite
dimension dans son plan est suprieure ou gale
cinq fois son paisseur totale.
Un poteau est un lment dont le grand ct de
la section transversale ne dpasse pas quatre fois le
petit ct de celle-ci et dont la hauteur est au moins
gale trois fois le grand ct. Lorsque ce nest pas
le cas, il convient de la considrer comme un voile.
Les effets du second ordre doivent tre pris en
compte. Des imperfections gomtriques sont
pour ce faire dfinies.
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 46
Article 5.1.1
Lanalyse structurale a pour objet de dterminer la
distribution, soit des sollicitations, soit des contrain-
tes, dformations et dplacements de lensemble
ou dune partie de la structure. Si ncessaire, une
analyse locale complmentaire doit tre effectue.
La dtermination des sollicitations et des dforma-
tions peut tre base sur un modle de comporte-
ment :
linaire lastique (sollicitations proportionnelles
aux actions) ;
linaire avec redistribution limite des moments
(pour les vrifications lELU) ;
plastique;
non linaire;
faisant appel une dcomposition en bielles et
en tirants.
Nota
Lanalyse linaire peut tre utilise pour la
dtermination des sollicitations, avec les
hypothses suivantes :
sections non fissures ;
relations contrainte-dformation linaires;
valeurs moyennes du module dlasticit.
La mthode des bielles et tirants dfinit les bielles,
les tirants, les divers types de nuds pouvant les
relier et permet de calculer les efforts et le fer-
raillage correspondant.
Linstabilit des lments principalement compri-
ms est aborde via des mthodes de vrifications
spcifiques.
Section 6: tats Limites Ultimes
Les tats Limites Ultimes (ELU) font lobjet de la
section 6.
Flexion simple et compose
Les hypothses pour la dtermination du moment
rsistant ultime de sections droites de bton arm
sont les suivantes :
les sections planes restent planes ;
les armatures adhrentes quelles soient tendues
ou comprimes, subissent les mmes dforma-
tions relatives que le bton adjacent ;
la rsistance en traction du bton est nglige;
les contraintes dans le bton comprim se dduisent
du diagramme contrainte-dformation de calcul ;
les contraintes dans les armatures de bton arm
se dduisent des diagrammes de calcul.
47
La figure 6.1 de la norme NF EN 1992-1-1 prsente
le diagramme des dformations relatives admissi-
bles lELU.
La dformation en compression du bton doit tre
limite 3,5 pour les btons de rsistance inf-
rieure ou gale 50 MPa.
La dformation en compression pure du bton doit
tre limite 2,0 dans le cas dutilisation du
diagramme parabole rectangle.
La dformation des armatures de bton arm est
limite
ud
, si cette limite existe.
Effort tranchant
Pour la vrification de la rsistance leffort tran-
chant, on dsigne par :
V
Rd,c
effort tranchant rsistant de calcul de ll-
ment en labsence darmatures deffort
tranchant ;
V
Rd,s
effort tranchant de calcul pouvant tre
repris par les armatures deffort tranchant
travaillant la limite dlasticit;
V
Rd,max
valeur de calcul de leffort tranchant maxi-
mal pouvant tre repris par llment, sans
crasement des bielles de compression;
V
Ed
effort tranchant de calcul rsultant des char-
ges appliques ;
V
Rd
effort tranchant rsistant avec des armatu-
res deffort tranchant.
Si V
Ed
V
Rd,c,
aucune armature deffort tranchant
nest requise par le calcul. Un ferraillage transversal
minimal est gnralement ncessaire.
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 47
Si V
Ed
> V
Rd,c,
il convient de prvoir des armatures
deffort tranchant de sorte que:
V
Ed
V
Rd
Le calcul des armatures deffort tranchant est
dtermin en utilisant un modle de type treillis
constitu:
dune membrure comprime correspondant au
bton soumis un effort de compression F
cd
.
dune membrure tendue correspondant aux
armatures longitudinales soumises un effort de
traction F
td
.
des bielles de bton comprimes, dinclinaison
dangle par rapport la fibre moyenne (incli-
naison choisie arbitrairement entre 22 et 45).
darmatures def fort tranchant, dinclinaison
dangle par rapport la fibre moyenne.
La section darmatures deffort tranchant Asw, pla-
ce perpendiculairement la fibre neutre, est don-
ne par la formule:
V
Rd,s
=
A
sw
z f
ywd
cot
s
Avec
s espacement des armatures deffort tran-
chant ;
z bras de levier des forces internes
(z = 0,9 d d: hauteur utile de la
section) ;
tel que 1 cot 2,5;
f
ywd
limite dlasticit de calcul des armatures
deffort tranchant.
Chapitre Dimensionnement des structures en bton 2
48
Poinonnement
Le poinonnement est provoqu par lapplication
dune charge concentre ou dune raction dappui
sur une surface relativement faible, telle quune
dalle appuye ou encastre sur un poteau ou une
fondation.
La dtermination de la rsistance au poinonne-
ment de la dalle permet de vrifier la ncessit
darmatures de poinonnement.
Section 7: tats Limites de Service
La section 7 est consacre aux tats Limites de
Service (ELS). Les ELS sont associs des tats de
la structure, ou de certaines de ses parties, lui cau-
sant des dommages limits mais rendant son
usage impossible dans le cadre des exigences dfi-
nies lors de son projet (exigences de fonctionne-
ment, de confort pour les usagers ou daspect). Ils
sont dfinis en tenant compte des conditions dex-
ploitation ou de durabilit de la construction ou de
lun de ses lments : sans quil puisse en rsulter,
du moins court terme, la ruine de la construction.
Les tats Limites de Service courants concernent :
la limitation des contraintes ;
la matrise de la fissuration;
la limitation des flches.
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 48
Trois types de combinaisons dactions sont
prendre en compte:
combinaisons caractristiques ;
combinaisons frquentes ;
combinaisons quasi-permanentes.
Pour les ELS, les vrifications consistent sassurer
que la valeur de calcul de leffet des actions est
infrieure la valeur limite de calcul du critre
daptitude au service considr.
Le calcul des contraintes est fait :
soit en section homogne, si la contrainte maxi-
male du bton en traction calcule sous combi-
naison caractristique est infrieure f
ctm
;
soit en section fissure, en ngligeant toute
contribution du bton tendu.
Limitation des contraintes:
la contrainte de compression dans le bton est
limite afin dviter les fissures longitudinales ou
les micro-fissures ;
les contraintes de traction dans les armatures
sont limites afin dviter des fissurations ou des
dformations inacceptables.
Matrise de la fissuration:
un enrobage convenable nest pas la seule condi-
tion pour assurer la protection des armatures
contre la corrosion, il faut aussi limiter la fissura-
tion du bton.
la fissuration est limite afin de ne pas porter pr-
judice au bon fonctionnement ou la durabilit
de la structure ou encore quelle ne rende pas
son aspect inacceptable.
Pour limiter la fissuration, il convient de prvoir des
armatures de section suffisante afin que leur
contrainte ne dpasse pas les valeurs convenables
en fonction des conditions dexposition et de la
destination de louvrage.
LEurocode 2 Partie 1-1 formule en 7.3.3 et 7.3.4
les prescriptions visant matriser la fissuration.
49
Elles consistent respecter, au choix, un diamtre
maximal ou un espacement maximal des barres.
La vrification a pour objet de sassurer que lou-
verture maximale calcule des fissures nexcde
pas une valeur limite, fonction en particulier de la
classe dexposition. La limitation de louverture
des fissures est obtenue en prvoyant un pourcen-
tage minimal darmatures passives et en limitant
les distances entre les barres et les diamtres de
celles-ci. Les valeurs recommandes douverture
des fissures en fonction de la classe dexposition
sont indiques dans le tableau ci-dessous.
Une quantit minimale darmature (A
s,min
) est
ncessaire pour matriser la fissuration dans les
zones soumises des contraintes de traction. A
s,min
est fonction de laire de la section droite de bton
tendu et de la contrainte maximale admise dans
larmature.
Le diamtre maximal des armatures et leur espa-
cement maximal sont dtermins en fonction de la
valeur de louverture de la fissure et de la
contrainte de traction dans les armatures. Par
exemple pour une ouverture de fissure de 0,3 mm,
pour une contrainte de traction dans les armatures
de 360 MPa, le diamtre minimal et les espace-
ments maximaux seront respectivement 8 mm et
50 mm.
Limitation des flches
Des valeurs limites appropries des flches sont
fixes, en tenant compte de la nature de louvrage,
de ses amnagements et de sa destination. La
dformation dun lment ou dune structure ne
doit pas tre prjudiciable son fonctionnement
ou son aspect. Il convient de limiter les dforma-
tions aux valeurs compatibles avec les dformations
des autres lments lis la structure tels que par
exemple les cloisons, les vitrages, les bardages.
Tableau 9: valeurs recommandes douverture des fissures en fonction de la classe dexposition
lments en bton arm et lments lments en bton prcontraint
Classe dexposition
en bton prcontraint sans armature adhrente avec armatures adhrentes
Combinaison quasi-permanente de charges Combinaison frquente de charges
XO, XC1 0,4 mm 0,2 mm
XC2, XC3, XC4 0,3 mm 0,2 mm
XD1, XD2, XD3, XS1, XS2, XS3 0,2 mm Dcompression
Extrait du tableau 7.1N de lAnnexe Nationale de la norme NF EN 1992-1-1.
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 49
Section 8: dispositions constructives
relatives aux armatures de bton arm
et de prcontrainte
Cette section donne les rgles pratiques nces -
saires la ralisation des plans dexcution. Elle
traite des exigences relatives la possibilit de
btonnage correct et dfinit les distances minima-
les des armatures permettant la transmission des
forces dadhrence.
Elle prcise les rgles pour la dtermination des :
espacements horizontaux et verticaux, des arma-
tures ;
diamtres des mandrins cintrage des barres ;
ancrages des armatures longitudinales et des
armatures deffort tranchant ;
recouvrements des barres, des treillis et des
paquets de barres ;
ancrages des armatures de prcontrainte par pr-
tension;
disposition des armatures et des gaines de pr-
contrainte;
dispositifs de paquets de barres ;
zones dancrage de prcontrainte.
Section 9: dispositions constructives
relatives aux lments et rgles
particulires
Cette section, prcise quelques rgles complmen-
taires relatives aux pourcentages minimaux dar-
matures, aux espacements minimaux des barres.
Elles sont classes par lments structuraux :
poteaux, poutres, dalles pleines, voiles, poutres-
cloisons, planchers dalles et fondations.
Elle prcise aussi les rgles relatives au chanage et
les rgles darrt des armatures longitudinales ten-
dues. Lpure darrt des barres permet de prvoir
le ferraillage suffisant pour rsister lenveloppe des
efforts de traction en prenant en compte les rsis-
tances des armatures dans leur longueur dancrage.
Il convient de prvoir :
des chanages priphriques chaque plancher ;
des chanages intrieurs chaque plancher ;
des chanages horizontaux des poteaux ou des
voiles la structure;
et si ncessaire, des chanages verticaux, en par-
ticulier dans des btiments construits en pan-
neaux prfabriqus.
Chapitre Dimensionnement des structures en bton 2
50
Les chanages dans deux directions horizontales
doivent tre effectivement continus et ancrs en
priphrie de la structure.
Section 10: rgles additionnelles
pour les lments et les structures
prfabriqus en bton
La section 10 expose les effets des traitements
thermiques sur les caractristiques des btons
(rsistance, fluage et retrait), sur la relaxation des
aciers et sur les pertes par relaxation. Elle prcise
aussi des dispositions constructives spcifiques et
des rgles de conception concernant les assembla-
ges et les joints.
Section 11: structures en bton
de granulats lgers
Cette section regroupe toutes les spcificits rela-
tives aux structures en bton de granulats lgers.
Section 12: structures en bton arm ou
faiblement arm
Cette section fournit des rgles complmentaires
pour les structures en bton non arm ou lorsque
le ferraillage mis en place est infrieur au minimum
requis pour le bton arm.
2.2.2 - Eurocode 2 partie 1-2
LEurocode 2 partie 1-2 Rgles gnrales, calcul
du comportement au feu prcise les principes, les
exigences et les rgles de dimensionnement des
btiments exposs au feu.
Cette norme traite des aspects spcifiques de la
protection incendie passive des structures et des
parties de structures. Elle traite du calcul des struc-
tures en bton en situation accidentelle dexpo-
sition au feu. Elle est utilise conjointement avec
les normes NF EN 1992-1-1 et NF EN 1991-1-2.
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 50
Elle prcise uniquement les diffrences, ou les l-
ments supplmentaires, par rapport au calcul aux
tempratures normales.
Les structures en bton soumises une exigence
de rsistance mcanique sous condition dincen-
die, doivent tre conues et ralises de telle sorte
quelles puissent maintenir leur fonction porteuse
pendant lexposition au feu en vitant une ruine
prmature de la structure et en limitant lexten-
sion du feu.
CIMFEU EC2, le logiciel de calcul au feu
des structures en bton
La norme NF EN 1992-1-2 donne trois mthodes
de calcul pour satisfaire aux exigences requises :
emploi des mthodes tabules ;
utilisation de calculs simplifis (analyse par l-
ments) ;
application de calculs avancs (calcul de la struc-
ture dans son ensemble).
Les exigences ou fonctions concernent :
la fonction porteuse (R) ;
la fonction tanchit (E) ;
la fonction Isolation (I).
Ainsi, un lment structural est class selon ces
exigences et pour une dure requise. Par exemple,
un mur porteur class REI pendant une dure
dtermine (ex: REI 120) reprsente une cloison
porteuse ou un mur coupe-feu qui assure cette
fonction pendant deux heures (120 minutes).
Pour faciliter le travail des
projeteurs et des contr-
leurs techniques, Cimbton
a fait dvelopper par le
CSTB un logiciel de calcul
au feu CIMFEU version
DTU(93) NF P 92-701 .
La version Eurocode 2 du
logiciel CIMFEU EC2
sera disponible courant
2009. Ce logiciel, qui intgre la mthode de calcul
gnral par lments (calcul du champ de temp-
rature dans toute la section), permet de calculer les
poutres rectangulaires et en I, les murs et cloisons,
les poteaux ronds et carrs, les dalles des lments
en bton arm et prcontraints.
51
2.2.3 - Eurocode 2 partie 2
LEurocode 2 partie 2 (NF EN 1992-2) dfinit les
principes, les rgles de conception et les disposi-
tions spcifiques pour les ponts en bton non
arm, en bton arm et en bton prcontraint
constitu de granulats de masse volumique tradi-
tionnelle ou lgers, en complment de ceux de la
norme NF EN 1992-1-1.
Cette partie, dont le sommaire est identique celui
de la partie 1-1, regroupe les articles spcifiques
aux Ponts, soit en les rcrivant, soit en ajoutant un
nouvel article. Les articles inchangs ne sont pas
repris.
Elle prcise section 4 article 4.2 les exigences
sur les conditions denvironnement, en particulier,
relatives aux classes dexposition pour les surfaces
de bton protges par une tanchit ou expo-
ses aux agressions des sels de dverglaage. Ces
exigences ont t compltes dans lAnnexe
Nationale franaise:
classe dexposition pour surfaces protges par
une tanchit: XC3;
distances de leffet des sels de dverglaage par
rapport la chausse (6 m dans le sens horizon-
tal et dans le sens vertical) ;
classes dexposition pour surfaces soumises
directement aux sels de dverglaage: XD3 et
XF2 ou XF4.
La section 8 concerne les dispositions construc -
tives relatives aux armatures de bton arm et de
prcontrainte.
Lannexe B dtaille plus prcisment le calcul des
dformations dues au fluage et au retrait.
2.2.4 - Eurocode 2 partie 3
LEurocode 2, partie 3 Silos et Rservoirs pr-
sente les rgles complmentaires lEurocode 2
partie 1-1 pour le calcul des structures en bton
non arm, en bton arm et en bton prcontraint,
destines contenir des liquides ou stocker des
produits granulaires ou pulvrulents. Elle est
utilise conjointement avec la norme NF EN 1991,
partie 4.
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 51
2.3.1 - Pourquoi armer le bton?
Le bton possde une grande rsistance la com-
pression et une rsistance moindre la traction.
Dans les structures en bton se dveloppe un
ensemble de contraintes gnres par les diverses
actions auxquelles elles sont soumises. La rsis-
tance la compression du bton lui permet dqui-
librer correctement les contraintes de compression.
Par contre, du fait de la relative faiblesse de sa
rsistance la traction, il nen est pas de mme
pour les contraintes de traction. Cest pourquoi lon
dispose dans les parties tendues dune pice en
bton, des armatures (barres ou treillis souds) en
acier (matriau qui prsente une bonne rsistance
la traction). Chaque constituant joue ainsi son rle
au mieux de ses performances : le bton travaille
en compression et lacier en traction. Ce matriau
est appel bton arm.
Lide dassocier au bton des armatures dacier
disposes dans les parties tendues revient
J. Lambot (1848) et J. Monier (1849), qui dposa
un brevet pour des caisses horticoles en ciment
arm. Les premires applications du bton arm
dans des constructions sont dues E. Coignet, puis
F. Hennebique, qui a ralis le premier immeuble
entirement en bton arm en 1900.
La quantit darmatures et leur disposition, dictes
par la rpartition des contraintes, rsultent de cal-
culs qui font appel aux lois de comportement des
matriaux. Les btons sont en majorit employs
en association avec des armatures en acier. Les
armatures sont dans le cas du bton arm appeles
armatures passives en opposition des arma-
tures actives du bton prcontraint.
2.3.2 - Principes du calcul
du bton arm
Les rgles de calcul sont conues de faon garan-
tir la scurit et la prennit des structures. Ils
prcisent le niveau maximal des actions pouvant
sexercer sur un ouvrage pendant sa dure dutili-
sation.
Ce niveau est atteint par la prise en compte dans
les calculs de valeurs caractristiques des actions et
de coefficients de scurit majorant les sollicita-
tions qui rsultent de ces actions. La probabilit
doccurrence simultane dactions indpendantes
peut tre trs variable selon leur nature. Il est donc
ncessaire de dfinir les combinaisons dactions
Chapitre Dimensionnement des structures en bton 2
52
2.3 Le bton arm
Par exemple, une poutre horizontale en
bton reposant sur deux appuis sincurve vers
le bas sous leffet de son propre poids et des
charges quon lui applique. Plus la charge
applique la poutre augmente, plus la pou-
tre sincurve vers le bas et plus la partie inf-
rieure de la poutre sallonge. La partie
suprieure de la poutre se raccourcit, elle est
donc soumise une compression. La partie
infrieure de la poutre sallonge; elle est sou-
mise un effort de traction. Lorsquon aug-
mente les charges sur la poutre, les
dformations saccentuent, de mme que les
tractions dans la partie infrieure et les com-
pressions dans la partie suprieure.
Le principe du bton arm consiste placer
des armatures en acier dans la partie inf-
rieure de la poutre, qui vont rsister aux
efforts de traction. Une poutre en bton
arm peut ainsi supporter des charges beau-
coup plus importantes quune poutre en
bton non arm.
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 52
dans lesquelles, la valeur caractristique dune
action dite de base, sajoutent des valeurs caract-
ristiques minores dautres actions dites daccom-
pagnement.
Des coefficients de scurit minorateurs sont aussi
appliqus aux valeurs des rsistances caractris-
tiques des matriaux utiliss.
Les valeurs de ces coefficients sont diffrentes
selon les principes de calcul adopts. Le calcul dit
aux contraintes admissibles (utilis avant la mise
au point des rgles BAEL) conduisait seulement
vrifier que les contraintes de service dun lment
de structure demeuraient lintrieur dun
domaine dfini par les valeurs bornes des
contraintes ; celles-ci taient gales aux contraintes
de rupture des matriaux, minores par un coeffi-
cient de scurit. Cette mthode ne refltait pas
toujours la scurit relle offerte par les structures.
Cest pourquoi la mthode de calcul aux tats
limites , qui se fonde sur une approche semi-pro-
babiliste de la scurit, lui a t substitue. Cette
dmarche permet de dimensionner une structure
de manire offrir une probabilit acceptable de
ne pas atteindre un tat limite , qui la rendrait
impropre sa destination. Elle conduit consid-
rer deux familles dtats limites : les tats Limites
de Service (ELS) et les tats Limites Ultimes (ELU).
53
PRINCIPES DE DIMENSIONNEMENT
DUNE STRUCTURE EN BTON ARM
Les actions appliques louvrage conduisent
des effets sur la structure:
efforts dformations
qui se traduisent par des sollicitations
(moment flchissant, effort normal, effort
tranchant, etc.).
Les matriaux composant la structure rsis-
tent ces effets.
Principe gnral : les effets des actions doivent
tre infrieurs aux rsistances des matriaux.
Nota
Compte tenu des incertitudes sur les
actions appliques et les rsistances des
matriaux, on introduit des marges de
scurit, sous forme de coefficients de
scurit ou de pondration.
Quatre tapes pour le dimensionnement
1. Modlisation de la structure et dtermina-
tion des actions qui lui sont appliques et des
classes dexposition (pour tenir compte des
actions environnementales).
2. Dtermination des sollicitations et choix
des caractristiques et des rsistances des
matriaux (en fonction des performances
atteindre en phase dexcution: coulage,
dcoffrage, manutention, etc.) et en phase
dutilisation.
3. Dtermination des sections darmatures :
armatures de flexion;
armatures deffort tranchant ;
armatures de torsion;
armatures de peaux
Pour chaque tat limite, pour chaque section
de la structure tudie, il faut montrer, pour
le cas de charge le plus dfavorable, sous la
combinaison daction considre, que la solli-
citation agissante ne dpasse pas la rsistance
du matriau.
4. Dessin des armatures (plans) prenant en
compte les diverses dispositions constructives
et les contraintes dexcution du chantier.
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 53
Rsistances du bton
La rsistance la compression du bton est dsi-
gne conformment la norme NF EN 206-1 par
des classes de rsistance (C) lies la rsistance
caractristique (fractile 5 %) mesure sur cylindre
f
ck,cyl
ou sur cube f
ck,cube
28 jours.
Les rsistances caractristiques f
ck
(mesure sur
cylindre) et les caractristiques mcaniques cor-
respondantes, ncessaires pour le calcul, sont
donnes dans le tableau ci-dessous (extrait du
tableau 3.1 de la norme NF EN 1992-1-1).
Avec:
f
ck
rsistance caractristique en compression
du bton, mesure sur cylindre 28 jours
f
ck,cube
rsistance la compression caractristique
sur cube
f
ctm
valeur moyenne de la rsistance la traction
f
ctk0,05
valeur infrieure de la rsistance caractris-
tique la traction (fractile 5 %)
f
ctk0,95
valeur infrieure de la rsistance caractris-
tique la traction (fractile 95 %)
E
cm
module dlasticit scant du bton
Rsistance du bton en fonction
du temps
La rsistance en compression du bton en fonction
du temps est prise gale :
f
ck
(t) = f
cm
(t) 8 (MPa) pour 3 < t < 28 jours
f
ck
(t) = f
ck
pour t 28 jours.
Nota
Larticle 3.1.2 donne une formule permet-
tant de dterminer plus prcisment la
rsistance en compression et en traction
du bton en fonction du temps selon le
type de ciment.
2.3.3 - Caractristiques du bton
Les proprits pour le dimensionnement du bton
sont dfinies dans la section 3 (article 3.1) de la
norme NF EN 1992-1-1 complte par son Annexe
Nationale.
Chapitre Dimensionnement des structures en bton 2
54
Tableau 10: caractristiques de rsistance des btons
f
ck
(MPa) 20 25 30 35 40 45 50 90
f
ck,cube
(MPa) 25 30 37 45 50 55 60 105
f
ctm
(MPa) 2,2 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 5,0
f
ctk,0,05
(MPa) 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9 3,5
f
ctk,0,95
(MPa) 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 4,9 5,3 6,6
E
cm
(GPa) 30 31 33 34 35 36 37 44
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 54
Dformation lastique et fluage
Les articles 3.1.3 et 3.1.4 de la norme
NF EN 1992-1-1 prcisent les donnes ncessaires
la dtermination respectivement du module
dlas ti ci t et du coefficient du fluage.
Rsistance de calcul
Les rsistances de calcul sont dfinies dans larticle
3.1.6.
En compression f
cd
=
cc
f
ck
/
C
En traction f
ctd
=
ct
f
ctk0,05
/
C
Avec:
C
coefficient de scurit = 1,5 pour les
situations durables et transitoires ;
cc
et
ct
coefficients = 1.
Diagramme contrainte-dformation
Pour le calcul des sections deux types de dia-
gramme sont proposs :
diagramme parabole rectangle;
diagramme bilinaire.
2.3.4 - Actions et combinaisons
dactions
Les actions
Les actions sont constitues par les forces et les
couples rsultant des charges appliques ou les
dformations imposes la structure. On distingue
trois types dactions.
Les actions permanentes dues au poids propre
de la structure et au poids total des quipements
fixes. Les pousses de terre ou la pression dun
liquide (pour les murs de soutnement, les rser-
voirs) sont galement prises en compte comme
actions permanentes.
Les actions variables dues aux charges dexploi-
tation, aux charges climatiques, aux charges appli-
ques en cours dexcution, aux dformations
provoques par les variations de temprature.
Les actions accidentelles dues aux sismes, aux
explosions, aux incendies.
En fonction de la destination des locaux ou des
ouvrages, les actions retenues pour les calculs sont
dfinies par des normes (srie des normes
NF EN 1991).
Les combinaisons dactions
Dans les calculs justificatifs de bton arm, on
considre des sollicitations dites de calcul, qui sont
dtermines partir de combinaisons dactions.
Les sollicitations lmentaires
Les sollicitations lmentaires sont les efforts
(effort normal, effort tranchant) et les moments,
appliqus aux lments de la structure. Elles sont
dtermines, partir des actions considres, par
des mthodes de calcul appropries faisant gn-
ralement appel la rsistance des matriaux ou
des tudes de modlisation.
Efforts normaux
Compression simple
Lorsquun poteau, par exemple, nest soumis, en
plus de son poids propre, qu une charge F appli-
que au centre de gravit de sa section, il est dit
sollicit en compression simple. Ce cas thorique
nest pratiquement jamais ralis, la force F rsul-
tante tant gnralement excentre par rapport
laxe du poteau. Le poteau est aussi en gnral
soumis des efforts horizontaux qui provoquent un
moment flchissant.
Traction simple
Ce cas correspond une pice soumise un effort
de traction (suspentes, tirants). Le calcul permet de
dimensionner les armatures longitudinales nces-
saires pour reprendre cet effort que le bton ne
serait pas mme de supporter.
Flexion
Dans une poutre flchie, les fibres infrieures sou-
mises des contraintes de traction sallongent,
alors que les fibres suprieures en compression se
raccourcissent. Si lon considre une portion de
poutre dont toutes les fibres avaient une longueur
lo avant dformation, chaque fibre prsentera,
55
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 55
aprs dformation, une longueur l
1
= lo + Ky, en
admettant lhypothse que chaque section droite
reste plane aprs dformation de la poutre.
Lquilibre de la rsultante des forces de traction et
de celle des forces de compression dans chaque
section se traduit par lgalit:
N
bc
x z = N
st
x z = M
f
Avec:
N
bc
rsultante des efforts de compression;
N
st
rsultante des efforts de traction (repris par
les armatures) ;
M
f
moment flchissant dans la section consi-
dre.
Z bras de levier du couple de flexion.
Effort tranchant
Leffort dit tranchant entrane, pour une poutre
homogne, une fissuration qui se dveloppe
environ 45 par rapport la ligne moyenne de la
poutre.
Fissuration et amorce de rupture provoque
par leffort tranchant.
Chapitre Dimensionnement des structures en bton 2
56
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 56
Pices flchies hyperstatiques
On rencontre des poutres continues reposant sur
plus de deux appuis (poutres hyperstatiques) com-
portant des porte--faux, des encastrements. Le
cas schmatique suivant permet de comprendre
linversion des moments flchissants (pas ncessai-
rement au niveau des appuis) et montre que les
parties tendues peuvent se trouver dans la zone
suprieure de la poutre.
En reportant la valeur du moment flchissant en
chaque point de la poutre, on obtient un dia-
gramme des moments flchissants qui permet de
visualiser sa variation. Ce moment est nul sur lap-
pui A (lorsquil ny a aucun encastrement), passe
par un maximum dans la trave AB, avant de chan-
ger de signe et passer par un maximum au niveau
de lappui B.
2.3.5 - Modlisation dune structure
Pour le dimensionnement, une structure est dcom-
pose en lments tels que: poutres, poteaux, dal-
les, voiles, etc.
Une poutre est un lment dont la porte est sup-
rieure ou gale trois fois la hauteur totale de la
section.
Une dalle est un lment dont la plus petite dimen-
sion dans son plan est suprieure ou gale cinq
fois son paisseur totale.
Un poteau est un lment dont le grand ct de la
section transversale ne dpasse pas quatre fois le
petit ct et dont la hauteur est au moins gale
trois fois le grand ct. Si ce nest pas le cas, il est
considr comme un voile.
57
DMARCHE POUR
LE DIMENSIONNEMENT DUNE POUTRE
EN BTON ARM ISOSTATIQUE
> Donnes:
caractristiques gomtriques de la poutre;
caractristiques des matriaux: bton et
armatures ;
classes dexposition.
> Charges actions:
charges permanentes ;
charges dexploitation;
charges climatiques.
> Combinaisons dactions
ELS: combinaison caractristique;
combinaison quasi-permanente;
ELU: combinaison fondamentale;
combinaison accidentelle.
> Dtermination des armatures
longitudinales (de flexion)
ELU: flexion mi-trave
calcul des armatures en trave
ELS: vrification limitation de la
compression du bton, matrise
de la fissuration (calcul de louverture
des fissures) et calcul de la flche.
Epure darrt des armatures longitudinales.
> Dtermination des armatures deffort
tranchant
> Dtermination des armatures des zones
dabout
Les normes de dimensionnement fournissent des
rgles pour le calcul des lments les plus courants
et leurs assemblages.
Nota
Larticle 5.3.2.2 de la norme NF EN 1922-1-1
prcise comment dterminer la porte
utile (leff) des poutres et des dalles dans
les btiments pour diffrentes conditions
dappui.
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 57
2.3.6 - lments de dimensionnement
pour les lments courants
Ces exigences sont extraites de la section 9 de la
norme NF EN 1992-1-1: dispositions constructi-
ves relatives aux lments et rgles particulires .
Poteaux
Le dimensionnement des armatures consiste
dterminer :
les armatures longitudinales ;
les armatures transversales.
Armatures longitudinales
Les armatures longitudinales sont rparties dans la
section au voisinage des parois de faon assurer
au mieux la rsistance la flexion de la pice dans
les directions les plus dfavorables.
Chapitre Dimensionnement des structures en bton 2
58
MTHODE DES BIELLES ET TIRANTS
La norme NF EN 1992-1-1 propose la mthode
des Bielles et Tirants pour la justification
aux tats Limites Ultimes (article 6.5).
Cette mthode peut tre utilise lorsquil
existe une distribution non linaire des
dformations relatives, par exemple aux
niveaux dappuis ou proximit de charges
concentres.
Les modles bielles et tirants sont constitus :
de bielles reprsentant les champs de
contraintes de compression;
de tirants reprsentant les armatures ;
de nuds qui assurent leur liaison.
Les efforts dans les lments du modle sont
dtermins pour assurer lquilibre avec les
charges appliques lELU.
Cette mthode est utilise par exemple, pour
le dimensionnement de semelles sur pieux ou
des corbeaux.
> Justification des bielles de bton
La rsistance de calcul dune bielle de bton,
en labsence de traction transversale est
donne par la formule:
Rd,max
= f
cd
La rsistance de calcul dune bielle de bton en
prsence de traction est :
Rd,max
= 0,6 f
cd
avec: = 1
f
ck
250
f
cd
rsistance de calcul en compression
f
cd
=
cc
f
ck
/
c
Avec:
f
ck
rsistance caractristique en
compression du bton mesure sur
cylindre 28 jours
cc
coefficient gal 1
C
Coefficient partiel relatif au bton
> Justification des tirants constitus
darmatures
La rsistance des armatures est limite
f
yd
= f
yk
/
s
Avec:
f
yd
rsistance de calcul en traction
f
yk
contrainte lastique caractristique
s
coefficient partiel de lacier
Les armatures doivent tre convenablement
ancres dans les nuds.
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 58
Il convient de prvoir :
au moins quatre armatures dans les poteaux cir-
culaires ;
une armature dans chaque angle pour les
poteaux de section polygonale.
Chaque armature place dans un angle doit tre
maintenue par des armatures transversales.
La section totale darmatures longitudinales doit
tre suprieure une section minimale. La valeur
recommande est :
A
s, min
= 0,10
N
Ed
, avec un minimum de 0,002A
c
f
yd
avec:
N
Ed
effort normal de compression agissant ;
f
yd
limite dlasticit de calcul des armatures ;
A
c
aire de la section droite du bton.
Elle ne doit pas tre suprieure une valeur maxi-
male A
s,max
(valeur recommande 0,04 A
c
).
Armatures transversales
Les armatures transversales sont disposes en plans
successifs perpendiculairement laxe longitudinal
du poteau. Elles assurent un ceinturage sur le contour
de la pice entourant toutes les armatures longitu-
dinales. Le diamtre et lespacement des armatu-
res transversales font lobjet de limites infrieures.
Voiles
Les quantits darmatures verticales sont compri-
ses entre:
A
s,min
= 0,002 A
c
et A
s,max
= 0,04 A
c
Les armatures horizontales doivent tre sup -
rieures A
s,min
= 0,25 x la section darmatures
verticales avec un minimum de 0,0001 A
c
.
Poutres
Armatures longitudinales
Les efforts de traction maximum en partie basse
sont entirement repris par les aciers longitudinaux
qui sont positionns le plus bas possible, tout en
conservant un enrobage suffisant.
La section darmatures longitudinales doit tre
suprieure A
s,min
.
A
s,min
= 0,26
f
ctm
b
t
d et A
s,min
0,0013 b
t
d.
f
yk
59
Avec:
f
yk
limite caractristique dlasticit de lacier
f
ctm
valeur moyenne de la rsistance en traction
directe du bton
b
t
largeur moyenne de la zone tendue
d hauteur utile de la section droite
La section maximale darmatures est limite :
A
s,max
= 0,04 A
c
avec:
A
c
aire de la section droite du bton
Larticle 9.2.1.3 de la norme NF EN 1992-1-1
prcise les rgles appliquer relatives lpure
darrt des barres.
Nota
Des armatures longitudinales sont aussi
disposes en partie haute. Elles sont desti-
nes faciliter la mise en place des arma-
tures transversales dont la fonction est la
reprise de leffort tranchant.
Dans le cas des poutres hyperstatiques (poutres
continues sur plusieurs appuis, encastrement), des
efforts de traction se dveloppent localement en
partie suprieure de la poutre, ce qui conduit y
prvoir des armatures longitudinales (chapeaux).
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 59
Armatures transversales
Le taux darmatures deffort tranchant est gal :
w
=
A
sw
sb
w
sin
avec
w,min
=
0,08 f
ck
f
yk
avec:
A
sw
section darmatures deffort tranchant sur
une longueur s
s espacement des armatures deffort tran-
chant
b
w
largeur de lme de llment
angle dinclinaison entre ces armatures et
laxe longitudinal de llment
f
ck
rsistance caractristique en compression
du bton, mesure sur cylindre 28 jours
f
yk
limite caractristique dlasticit de lacier
Dalles
Les dispositions des poutres relatives aux pour-
centages minimaux et maximaux et lpure
darrt des barres sappliquent. Larticle 9.10 de la
norme NF EN 1992-1-1 prcise les dispositions
relatives aux armatures des chanages (priph-
riques, intrieurs, horizontaux, verticaux).
Autres lments courants
Dif frents articles ou annexes de la norme
NF EN 1992-1-1 prcisent les rgles de dimension-
nement des armatures verticales, horizontales et
transversales et les dispositions constructives (fer-
raillage minimum, espacement des armatures,
etc.) respecter pour :
les parois flchies;
les planchers dalles;
les consoles courtes.
Ainsi que:
les planchers ouvrages constitus de prdalles
en bton arm, en bton prcontraint ou en
bton coul en place;
les murs en bton banch ouvrages couls en
place leur emplacement dfinitif dans des cof-
frages ;
les murs de soutnement qui sont en gnral
en forme de L ou de T invers et destins sop-
poser la pousse des terres de talus ou de
remblais ; le ferraillage principal de ce type dou-
vrage rsulte du calcul dans les sections critiques
du voile (au tiers et mi-hauteur) et dans les sec-
tions dencastrement voile et semelle.
les fondations ces lments sont destins
transmettre au sol de fondation, les efforts appor-
ts par la structure. Les fondations peuvent tre
superficielles (semelles isoles ou filantes) ou
profondes (fondations sur pieux ou sur barrettes).
Les semelles sur pieux comportent en gnral 2,
3 ou 4 pieux.
2.3.7 - Dispositions constructives
pour les armatures
La section 8 de la norme NF EN 1992-1-1 prcise
les diverses dispositions constructives pour les
armatures ( haute adhrence) de bton arm.
Espacement des armatures
Lespacement des armatures de bton arm doit
permettre une mise en place et une vibration satis-
faisante du bton, afin de garantir ainsi ladhrence
acier/bton.
La dimension maximale des granulats doit tre
adapte lespacement des armatures.
Il convient dadopter une distance libre (horizonta-
lement et verticalement) entre barres parallles ou
entre lits horizontaux de barres parallles sup-
rieure ou gale la plus grande des valeurs sui-
vantes :
k
1
fois le diamtre de la barre
(d
g
+ k
2
) mm
20 mm
Avec:
d
g
dimension du plus gros granulat
et k
1
= 1
et k
2
= 5 mm.
Chapitre Dimensionnement des structures en bton 2
60
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 60
Diamtre admissible des mandrins
de cintrage des barres
Un diamtre minimal de mandrin, fonction du dia-
mtre de la barre, doit tre respect afin dviter
des dommages aux armatures lors du cintrage ou
une rupture du bton lintrieur de la courbure
lors de la mise en charge de larmature.
Ancrage des armatures longitudinales
Les armatures doivent tre ancres par scellement
sur une longueur suffisante afin dassurer une trans-
mission des forces dadhrence au bton et viter
toute fissuration. La longueur dancrage est dter-
mine en tenant compte du type dacier, des pro-
prits dadhrence des armatures et de la
contrainte dans larmature (traction ou compression).
Ancrage des armatures transversales
Il existe plusieurs types dancrages. La partie
courbe des coudes ou des crochets doit tre pro-
longe par une partie rectiligne dont la longueur
est fonction de langle de pliage.
Recouvrements des barres
Les recouvrements des barres doivent tre tels que:
la continuit de la transmission des efforts dune
barre lautre soit assure;
il ne se produise pas dclatement du bton au
voisinage des jonctions ;
il napparaisse pas de fissures ouvertes.
Nota
La rgle de calcul des longueurs de recou-
vrement est donne dans larticle 8.7.3.
La continuit de la transmission des efforts par les
armatures est obtenue par recouvrements, mais
peut aussi seffectuer par soudure ou par cou-
pleurs. Les jonctions par soudure ne sont autori-
ses quavec des armatures de qualit soudable.
Paquets de barres
LEurocode 2 prvoit des dispositions spcifiques
pour lancrage et le recouvrement des barres par
paquets.
Armatures de peau
Des armatures de peau constitues de treillis sou-
ds ou darmatures de faibles diamtres doivent
tre mises en place lextrieur des cadres pour
matriser la fissuration et pour rsister lclate-
ment du bton lorsque le ferraillage principal est
constitu de barres de diamtre suprieur 32 mm
ou de paquets de barres de diamtre quivalent
suprieur 32 mm. Les dispositions constructives
relatives aux armatures de peau sont prcises
dans lannexe J de la norme NF EN 1992-1-1.
61
Tableau 11: longueurs droite aprs courbure
en fonction de langle de pliage
Angle de pliage Longueur droite aprs courbure
90 10
135 10
150 5
180 5
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 61
2.4.1 - Diffrents types darmatures
Les armatures sont obtenues partir daciers pour
bton arm suite des oprations de dressage
(pour les couronnes uniquement), de coupe, de
faonnage et dassemblage. On distingue deux
principaux types dacier selon leur composition
chimique:
lacier au carbone;
lacier inox.
Les aciers se prsentent sous formes de barres de
grande longueur (souvent 12 m) ou de fils en cou-
ronnes :
barres droites lisses : diamtre 5 50 mm;
barres droites haute adhrence: diamtre 6
50 mm;
fils haute adhrence en couronne: diamtre 5
16 mm.
On distingue les armatures coupes-faonnes ,
qui sont obtenues par coupe et faonnage des
aciers la demande (en conformit avec les plans
dexcution dfinis par les bureaux dtudes) et les
armatures assembles dun modle standard,
constitues par assemblage des armatures coupes
faonnes sous forme de cages ou de pan-
neaux et utilises par des applications courantes
(semelles de fondation, poteaux, linteaux, etc.).
Les armatures sont :
soit assembles en usine, puis livres sur le
chantier ;
soit livres sur chantier coupes, faonnes, puis
assembles sur le site, proximit de louvrage
ou directement en coffrage.
Les armatures sont donc utilises sur les chantiers
et mises en place dans les coffrages :
soit sous forme de barres (droites ou coupes-
faonnes en fonction des formes dcrites sur les
plans dexcution) ;
soit sous forme de treillis souds (rseaux plans
mailles en gnral rectangulaires, constitus de
fils ou de barres assembls par soudage et dont
la rsistance au cisaillement des assemblages est
garantie) fabriqus en usine et livrs en pan-
neaux.
soit sous forme darmatures pr-assembles en
cages ou en panneaux.
Les jonctions des barres peuvent tre assures par
recouvrements, par manchons ou par soudure.
En atelier, lassemblage est ralis par soudure
(soudage par rsistance ou soudage semi-auto-
matique). Il sagit uniquement de soudures de
montage dont la fonction est dassurer le bon
positionnement des armatures faonnes entre
elles, y compris pendant les transports, les manu-
tentions et la mise en place du bton.
Sur chantier, lassemblage est effectu soit en ate-
lier forain install proximit de louvrage, soit
directement en coffrage. En gnral, ces deux
solutions coexistent. Il est possible de souder sur
site, mais le plus souvent le montage se fait par
ligatures avec des fils dattache en acier.
Chapitre Dimensionnement des structures en bton 2
62
2.4 Les armatures pour bton arm
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 62
Les dispositifs de raboutage permettent dassurer
la continuit des armatures grce une pice inter-
mdiaire appele manchon ou couples. La liaison
entre le manchon et les armatures est le plus
souvent ralise par filetage ou sertissage.
2.4.2 - Dsignation des armatures
Lacier pour bton arm est dfini par ses caract-
ristiques de forme, gomtriques, mcaniques et
technologiques.
Les spcifications concernant les aciers sont
dtailles dans les normes NF A 35-015 (barres lis-
ses), NF A 35-016 (barres haute adhrence, cou-
ronnes et treillis souds verrous), NF A 35-019
(fils et treillis souds empreintes), XP A 35-025
(aciers pour bton galvaniss).
63
QUELQUES DFINITIONS
> Cadre, trier, pingle: armature transver-
sale assurant une des fonctions suivantes :
rsistance des sollicitations tangentes ;
coutures de recouvrements ;
maintien du flambement de barres
comprimes ;
maintien darmatures soumises une
pousse au vide;
frettage.
> Ancrage par courbure: zone darmature
comportant un faonnage destin
diminuer la longueur darmature (crosse,
querre, boucles plat) assurant la
transmission des efforts par adhrence entre
lacier et le bton. Un ancrage par courbure
est le plus souvent situ une extrmit
darmature. Il peut cependant se trouver
dans une partie intermdiaire, comme par
exemple dans le cas des boucles plat
utilises aux appuis des poutres.
> Coude: partie darmature faonne ne
rpondant pas une des deux dfinitions
prcdentes.
Le respect de tolrances sur la position des arma-
tures, pour assurer leur enrobage correct ou la
reprise des efforts conformment aux calculs,
imposent des prcautions durant toute la phase de
btonnage et de vibration.
Des cales en bton ou en plastique de divers
modles facilitent la mise en place correcte des
armatures et leur maintien, tout en prsentant des
caractristiques adaptes celles du bton.
En gnral, une structure en bton arm est coffre
et btonne en plusieurs phases successives. La
continuit du ferraillage entre les parties contigus
de structure au niveau de la reprise de btonnage
est assure par des botes dattentes et des
dispositifs de raboutage .
Les botes dattentes comportent des armatures
faonnes dont une extrmit est replie lint-
rieur dun volume creux ralis sous forme de
bote ou de profil. Lensemble ainsi constitu est
fix contre le coffrage lintrieur de la partie de
structure btonne en premire phase. Aprs
dcoffrage de cette premire partie, la bote est
ouverte, en gnral retire, et les armatures en
attente dplies. Il est ainsi possible de raliser un
recouvrement avec les armatures de la seconde
phase.
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 63
Linox pour armatures de bton arm doit tre
conforme la norme NF A 35-014 (acier pour
bton inox).
Les aciers sont dsigns par leur limite dlas-
ticit garantie R
e
en MPa, leur nuance et leur forme
(lisse, haute adhrence). Par exemple, un acier
HA FeE500-2 dsigne un acier haute adhrence
(HA) prsentant une limite lastique de 500 MPa et
une classe de ductilit 2.
2.4.3 - Caractristiques des aciers
Caractristiques de forme des aciers
On distingue deux types daciers pour bton arm
en fonction de leur forme et de leur surface.
Les aciers lisses: barres lisses ou fils trfils
lisses. Elles sont de section circulaire sans aucune
gravure.
Les aciers haute adhrence dont la surface
prsente des saillies ou des creux. La surface de
ces armatures prsente des asprits en saillies
inclines par rapport laxe de la barre appele
verrous ou des asprits en creux appeles
empreintes qui sont destines favoriser ladh-
rence des armatures au sein du bton.
Chapitre Dimensionnement des structures en bton 2
64
RFRENCES NORMATIVES
La norme de rfrence des aciers pour
larmature du bton est la norme NF EN 10080
(Aciers pour larmature du bton. Acier sou-
dable pour bton arm. Gnralits).
Cette norme concerne les aciers soudables
pour bton arm sous forme de barres, cou-
ronnes, produits drouls, treillis souds et
treillis raidisseurs. Elle ne contient pas de
niveau de performance des produits et doit
tre utilise en liaison avec une spcifica-
tion de produit . Cette spcification peut
tre dorigine europenne (TS 10081, Annexe
C de lEurocode 2, NF EN 1992-1-1 ou Annexe
N de la norme NF EN 13369), ou dorigine
nationale (NF A 35-015, NF A 35-016,
NF A 35-019 ou NF A 35-014), ou encore tre
propre un producteur ou un utilisateur.
La norme de rfrence pour les armatures du
bton est la norme NF A 35-027 (Produits en
acier pour le bton arm. Armatures).
Les prescriptions de cette norme concernent
lensemble des caractristiques des armatu-
res. Elles ne sappliquent quen absence de
spcifications diffrentes mentionnes sur les
plans ou dans les pices crites visant les
armatures.
Verrou
Cong de raccordement
Verrou
Cong de raccordement
Schmas des armatures verrous
Aciers verrous
A
A
A - A
Schma des armatures empreintes
Aciers empreintes
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 64
Caractristiques gomtriques
des aciers
Les diamtres prvus par la norme NF EN 10080
sont donns dans le tableau ci-contre. En France,
on se limite en pratique aux diamtres 5, 6, 7, 8,
10, 12, 14 et 16 pour les couronnes et 6, 8, 12, 14,
16, 20, 25, 32, et 40 pour les barres.
Nota
Le diamtre nominal dune barre ou dun
fil correspond au diamtre dun cylindre de
rvolution de mme mtal ayant la mme
masse linique. Cest le diamtre nominal
qui est pris en compte pour le dimension-
nement.
La masse volumique des aciers au carbone est
prise gale 7850 kg/m
3
. Pour les aciers inoxyda-
bles, la masse volumique dpend de la composi-
tion de lacier. Elle est comprise entre 7700 et
8000 kg/m
3
.
65
Diamtre
nominal
en mm
Barres
Couronnes
et
produits
drouls
Treillis
souds
Section
nominale
en mm
2
Masse
linique
nominale
en kg/m
4 - x - 12,6 0,999
4,5 - x - 15,9 0,125
5 - x x 19,6 0,154
5,5 - x x 23,8 0,187
6 x x x 28,3 0,222
6,5 - x x 33,2 0,260
7 - x x 38,5 0,302
7,5 - x x 44,2 0,347
8 x x x 50,3 0,395
8,5 - x x 56,7 0,445
9 - x x 63,6 0,499
9,5 - x x 70,9 0,556
10 x x x 78,5 0,617
11 - x x 95 0,746
12 x x x 113 0,888
14 x x x 154 1,21
16 x x x 201 1,58
20 x - - 314 2,47
25 x - - 491 3,85
28 x - - 616 4,83
32 x - - 804 6,31
40 x - - 1257 9,86
50 x - - 1963 15,40
Tableau 12: diamtres des armatures selon la norme EN 10080
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 65
2.4.4 - Liaison acier bton
adhrence
La rsistance dun lment en bton arm et la ma-
trise de la fissuration supposent que lacier ne puisse
pas glisser lintrieur du bton, cest--dire quil
y ait adhrence parfaite entre les deux matriaux.
Ladhrence des armatures est fonction de leur
forme, de leur surface (les saillies ou les creux am-
liorent ladhrence) et de la rsistance du bton.
Le fonctionnement du bton arm suppose une
association entre lacier et le bton qui met en
jeu ladhrence des armatures au bton. Pour
utiliser pleinement des aciers plus performants, il
faut donc aussi que leur adhrence soit amliore.
On a par consquent volu vers des aciers qui
sont la fois Haute Limite dlasticit (HLE) et
Haute Adhrence (HA). La haute adhrence rsulte
de la cration dasprits en saillie ou en creux. La
haute limite dlasticit peut tre obtenue par diff-
rents moyens:
par crouissage, par tirage et ou laminage
froid de barres ou fils dacier doux;
par traitement thermique (trempe et autorevenu)
de barres ou fils dacier doux.
Ladhrence est dfinie par deux coefficients :
le coefficient de fissuration qui est pris en compte
pour les calculs de fissuration du bton;
le coefficient de scellement qui permet de
dimensionner les ancrages des armatures.
Les valeurs de ces coefficients dpendent du type
darmatures (ronds lisses ou barres HA).
Chapitre Dimensionnement des structures en bton 2
66
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 66
2.4.5 - Proprits pour
le dimensionnement
Les proprits et les rgles appliquer aux arma-
tures sont dfinies dans la section 3 (article 3.2
Acier de bton arm) de la norme NF EN 1992-1-1.
Les prescriptions relatives aux aciers se traduisent
dans les normes par les caractristiques spcifies
suivantes :
soudabilit et composition chimique;
caractristiques mcaniques en traction (ft) ;
limite dlasticit;
diamtres, sections, masses liniques et tol-
rances ;
adhrence et gomtrie de la surface (verrous ou
empreintes) ;
non fragilit (aptitude au pliage) ;
dimensions et rsistance au cisaillement des
assemblages souds des treillis souds ;
rsistance la fatigue (caractristique optionnelle) ;
aptitude au redressage aprs pliage (caractris-
tique optionnelle) ;
ductilit.
Soudabilit
Un acier est dit soudable sil est possible de las-
sembler par soudure, par des procds courants,
sans altrer ses caractristiques mcaniques. La
soudabilit dun acier est atteste par sa composi-
tion chimique. Les normes pour les aciers au car-
bone fixent les valeurs qui ne doivent pas tre
dpasses concernant les teneurs en carbone,
soufre, phosphore, azote et cuivre, ainsi quune
combinaison des teneurs en carbone, manganse,
chrome, molybdne, vanadium, nickel et cuivre
appele carbone quivalent. Les inox utiliss pour
les armatures sont soudables.
Des essais permettent de vrifier laptitude au sou-
dage qui, en amont, est matrise au niveau de la-
cirie par des exigences relatives la composition
chimique de lacier. Il est indispensable que les
caractristiques de rsistance, dlasticit et de
ductilit soient maintenues au niveau de la sou-
dure.
Adhrence et gomtrie de la surface
Les normes imposent la gomtrie de surface des
aciers des caractristiques permettant dassurer
ladhrence acier/bton. Les exigences portent sur
des valeurs minimales soit de hauteur des verrous,
ou de profondeur des empreintes, soit de surface
relative des verrous f
R
, ou des empreintes f
p
.
Non fragilit (aptitude au pliage)
Larmature doit sadapter lors des oprations de
faonnage des formes complexes ce qui implique
courbures et pliages ; lacier doit donc prsenter
une bonne aptitude au pliage. Lacier est soumis
un pliage, sur un mandrin dont le diamtre est fix
en fonction de celui de lacier suivi dun dpliage.
Lessai est satisfaisant sil ne se produit ni cassure
ni fissure transversale dans la zone de pliage-
dpliage.
Caractristiques mcaniques en traction
La rsistance mcanique dun acier est dtermine
par un essai de traction normalis, elle est caract-
rise par :
la rsistance maximale la traction: R
m
;
la limite dlasticit ou module dlasticit: R
e
;
le rapport rsistance la traction/limite dlasti-
cit: R
m
/R
e
;
lallongement sous charge maximale: A
gt
.
Limite dlasticit R
e
Le diagramme contrainte-dformation des aciers
lamins chaud comporte un palier de ductilit qui
met en vidence la limite dlasticit suprieure
dcoulement R
eH
qui est aussi la limite dlasticit R
e
.
Le diagramme contrainte-dformation des aciers
lamins froid et des inox ne comporte pas de
palier. Dans ce cas, la limite dlasticit R
e
est fixe
conventionnellement gale R
Po,2
qui est la
contrainte correspondant 0,2 % dallongement
rmanent (ou limite conventionnelle dlasticit).
Actuellement en France, on utilise des aciers de
500 MPa de limite dlasticit. La norme NF EN 1992
Partie 1-1 prvoit une plage de limite dlasticit
comprise entre 400 MPa et 600 MPa.
Caractristiques de ductilit R
m
/R
e
et A
gt
Les normes franaises fixent des valeurs minimales
pour le rapport rsistance la traction/limite
dlasticit (R
m
/R
e
), et pour lallongement sous
charge maximale (A
gt
).
67
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 4/12/08 12:05 Page 67
Rsistance
La limite dlasticit f
yk
et la rsistance la traction
f
t
sont respectivement dfinies comme les valeurs
caractristiques de la limite dlasticit et de la
charge maximale en traction directe, divise par
laire nominale de la section.
Diagramme contrainte-dformation
Un acier soumis une contrainte de traction crois-
sante sallonge de faon linaire et rversible jus-
qu un point correspondant sa limite dlasticit.
Au-del, la dformation non rversible prsente une
courbe du type ductile (selon le traitement de lacier).
Ce diagramme comprend:
une branche lastique: f
yk
/E
s
; f
yk
une branche incline:
uk
, k f
yk
Avec:
f
yk
limite caractristique dlasticit de lacier
de bton arm
uk
dformation relative de lacier de bton
arm
k fonction de la classe darmature
Les proprits des armatures sont prcises dans
lAnnexe C (tableau C1) de la norme NF EN 1992-1-1.
Ce tableau distingue 3 classes de ductilit et pr-
cise les caractristiques correspondant ces trois
classes.
Nota
La valeur de calcul du module dlasticit
E
s
est gale 200 GPa.
Chapitre Dimensionnement des structures en bton 2
68
Extrait du tableau C1 de lAnnexe C de la norme NF EN 1992-1-1.
Nota
La norme NF EN 1992 - Partie 2, prescrit
pour les ponts lemploi daciers de classe
B ou C. LEurocode 8, qui dfinit les rgles
de calcul des constructions pour leur rsis-
tance aux sismes, impose lemploi da-
ciers de classe de ductilit B et parfois C
dans certaines parties des structures assu-
rant la rsistance aux sismes. La classe
exige dpend de la classe de ductilit du
btiment.
Forme du produit Barres et fils redresss Treillis souds
Exigence ou valeur
du fractile (%)
Classe A B C A B C -
Limite caractristique dlasti-
cit f
yk
ou f
0,2k
(MPa)
400 600 5,0
Valeur minimale
de k = ( f
t
/ f
y
)
k
1,05 1,08
1,15
< 1,35
1,05 1,08
1,15
< 1,35
10,0
Valeur caractristique de la
dformation relative sous
charge maximale,
uk
(%)
2,5 5,0 7,5 2,5 5,0 7,5 10,0
Tableau 13: proprits des armatures compatibles avec lEurocode bton
uk
kf
yk
f
yk
s
f
yk/
E
s
s
0
Contraintes
Dformations
Diagramme contrainte-dformation des aciers
de bton arm
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 68
2.4.6 - Certification des aciers
et des armatures
Les aciers et les armatures font lobjet de certifica-
tions gres par lAssociation Franaise de Certi-
fication des Armatures du Bton (AFCAB) qui
couvrent lensemble du cycle des armatures depuis
la production des aciers jusqu la pose des arma-
tures en coffrage. On distingue quatre certifications.
Certification NF Aciers pour bton
arm
La certification NF Aciers pour bton arm, garan-
tit que les produits certifis :
sont conformes leur norme de rfrence: carac-
tristiques mcaniques, masse linique, analyse
chimique, caractristiques gomtriques, non fra-
gilit, soudabilit, aptitude au redressage aprs
pliage (optionnelle), rsistance au cisaillement
des soudures et dimensions des treillis souds;
ont une origine identifiable et sont contrls.
Chaque acier certifi est identifiable par une
marque de laminage spcifique chaque produc-
teur et par un tiquetage NF AFCAB. Il fait lobjet
dun certificat dlivr par lAFCAB qui prcise:
sa dnomination;
lusine productrice;
les caractristiques certifies ;
la marque de laminage;
les conditions de validit.
La liste des certificats est consultable sur le site
www.afcab.org
Certification AFCAB Dispositifs
de raboutage ou dancrage
des armatures du bton
La certification AFCAB Dispositif de raboutage ou
dancrage des armatures du bton, garantit que les
produits certifis :
permettent de raliser des assemblages respec-
tant les critres de la norme NF A 35-020-1;
sont fabriqus conformment des plans, noti-
ces et documents de fabrication prsents lors de
lvaluation initiale;
ont une origine identifiable et sont contrls.
69
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 69
Chaque manchon certifi est identifiable par un ti-
quetage AFCAB. Il fait lobjet dun certificat dlivr
par lAFCAB qui prcise:
sa dnomination;
la socit productrice;
les caractristiques certifies ;
le marquage;
la rfrence des documents de mise en uvre;
les conditions de validit.
Certification NF Armatures
La Certification NF Armatures garantit que les
produits certifis :
sont conformes la norme NF A 35-027 (aciers
de base conformes, non altration des aciers au
cours de la fabrication, dimensions et angles
conformes, conformit du manchonnage) ;
sont conformes aux plans, catalogues ou cahiers
des charges du client ;
ont une origine identifiable et sont contrls.
Chaque fardeau ou paquet darmatures compor-
tent une tiquette sur laquelle sont prsents :
le logo de la marque NF ;
la mention NF A 35-027 ;
la porte du certificat (catgories et oprations
couvertes, par exemple: Armatures sur plan cou-
pes faonnes) ;
le nom de lusine et de la socit titulaire du cer-
tificat ;
le numro de certificat ;
pour les armatures sur plans, les indications sp-
cifies larticle 9 de la norme NF A 35-027 (nom
du client, nom du chantier, numro du plan, rf-
rence de larmature, etc.) ou pour les armatures
sur catalogue, la rfrence du produit.
Dans le cadre de la certification NF-Armatures,
lAFCAB exige des essais de pliage et de traction
pour vrifier les caractristiques des armatures
aprs soudage. LAFCAB supervise aussi la qualifi-
cation des soudeurs.
Certification AFCAB Pose des
armatures du bton
Cette certification garantit que les aciers et les
armatures poss par lentreprise certifie:
sont conformes leurs normes de rfrence;
sont poss en respectant les plans, les rgles de
bton arm, les rgles de mise en place des
accessoires (notamment les manchons) ;
sont parachevs sans altration des aciers ;
sont contrls aprs la pose.
Chapitre Dimensionnement des structures en bton 2
70
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 70
2.5.1 - Incidence de la qualit
de lenrobage
Lenrobage des armatures reprsente la distance
entre la surface du bton et larmature la plus pro-
che (cadres, triers, pingles, armatures de peau,
etc.). Il doit tre suffisant pour garantir :
la bonne protection de lacier contre la corrosion;
la bonne transmission des efforts dadhrence;
une rsistance au feu convenable.
Lenrobage des armatures et les caractristiques du
bton denrobage sont les paramtres fondamen-
taux permettant de matriser la prennit des ouvra-
ges face aux phnomnes de corrosion et donc leur
dure dutilisation. Ainsi, il est possible de placer les
armatures hors datteinte des agents agressifs en les
protgeant par une paisseur suffisante dun bton
compact, ayant fait lobjet dune cure approprie.
Dans des conditions normales, les armatures enro-
bes dun bton compact et non fissur sont natu-
rellement protges des risques de corrosion par
un phnomne de passivation qui rsulte de la
cration, la surface du mtal, dune pellicule pro-
tectrice de ferrite Fe
2
O
3
CaO (dite de passivation).
Cette pellicule est forme par laction de la chaux
libre par les silicates de calcium sur loxyde de fer.
Nota
Lenrobage et la compacit ont un impact
immdiat sur la priode de propagation
qui prcde linitiation et le dveloppe-
ment de la corrosion des armatures. titre
dexemple, il est couramment reconnu
que laugmentation de lenrobage minimal
dune valeur de 10 mm permet daug-
menter la dure dutilisation de louvrage
pour passer de 50 ans 100 ans.
Nota
Des prcisions complmentaires pour la
dtermination de lenrobage pour les
structures en bton conues avec
lEurocode 2 sont donnes dans le Guide
Technique LCPC Note Technique sur les
dispositions relatives lenrobage pour
lapplication en France .
La prsence de chaux maintient la basicit du milieu
entourant les armatures (lhydratation du ciment
produit une solution interstitielle basique de pH
lev de lordre de 13). Tant que les armatures se
trouvent dans un milieu alcalin prsentant un pH
compris entre 9 et 13,5, elles sont protges.
2.5.2 - Enrobage minimal
et enrobage nominal
Cest lenrobage nominal qui est prcis sur les
plans dexcution de louvrage. Il constitue la rf-
rence pour la fabrication et pour la pose des arma-
tures. Lenrobage nominal est gal la somme de
lenrobage minimal et dune marge de scurit
pour tolrances dexcution.
71
2.5 Lenrobage des armatures
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 71
2.5.3 - Philosophie de lenrobage
selon lEurocode 2
Les recommandations de lEurocode 2 (norme
NF EN 1992-1-1) en matire denrobage des
btons de structures sont novatrices. Elles rsultent
dun retour dexprience sur la durabilit des
ouvrages construits depuis plusieurs dcennies et
sur les recherches rcentes en matire de protec-
tion des armatures vis--vis des risques de corro-
sion. Elles visent, en conformit avec la norme NF
EN 206-1, optimiser de manire pertinente la
durabilit des ouvrages. En effet, la dtermination
de la valeur de lenrobage doit prendre en compte
de faon extrmement dtaille:
la classe dexposition dans laquelle se trouve
louvrage (ou la partie douvrage) et qui traduit
les conditions environnementales ;
la dure de service attendue (ou dure dutilisa-
tion du projet) ;
la classe de rsistance du bton;
le type de systme de contrle qualit mis en
uvre pour assurer la rgularit des performan-
ces du bton et la matrise du positionnement
des armatures ;
la rgularit de la surface contre laquelle le bton
est coul;
le type darmatures (prcontraintes ou non) et
leur nature (acier au carbone, acier inoxydable) et
dventuelles protections complmentaires
contre la corrosion.
La valeur de lenrobage peut ainsi tre optimise
en particulier :
si lon choisit un bton prsentant une classe de
rsistance la compression suprieure la classe
de rfrence (dfinie pour chaque classe dexpo-
sition) ;
sil existe un systme de contrle de la qualit;
si lon utilise des armatures inox.
LEurocode 2 permet aussi de dimensionner lou-
vrage pour une dure dutilisation suprieure en
augmentant la valeur de lenrobage.
Loptimisation des performances du bton et de
lenrobage des armatures constitue un facteur
de progrs essentiel pour assurer la durabilit
des ouvrages.
Chapitre Dimensionnement des structures en bton 2
72
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 72
2.5.4 - Enrobage minimal
selon lEurocode 2
Lenrobage minimal est dfini dans la norme
NF EN 1992-1-1, section 4 Durabilit et enrobage
des armatures (article 4.4.1). Il doit satisfaire en
particulier aux exigences de transmissions des for-
ces dadhrences et assurer une protection des
aciers contre la corrosion.
Il est donn par la formule:
C
min,b
C
min
= max C
min,dur
+ C
dur,y
C
durst
C
dur,add
10 mm
Avec:
C
min,b
enrobage minimal vis--vis des exigen-
ces dadhrence (bton/armature).
C
min,dur
enrobage minimal vis--vis des condi-
tions environnementales. C
min,dur
tient
compte de la classe dexposition et de la
classe structurale (qui dpend de la dure
dutilisation du projet).
C
dur,y
marge de scurit (valeur recommande 0);
C
dur,st
rduction de lenrobage minimal dans le
cas dutilisation, par exemple, dacier
inoxydable;
C
dur,add
rduction de lenrobage minimal dans le
cas de protections complmentaires.
Nota
La valeur de C
min,b
est rarement dimen-
sionnante pour la dtermination de C
min
.
2.5.5 - Processus de dtermination
de lenrobage nominal suivant
lEurocode 2
Le processus de dtermination de lenrobage des
armatures dans chaque partie douvrage comporte
les huit tapes suivantes qui vont permettre de
prendre successivement en compte:
la classe dexposition;
la classe structurale et les modulations possibles
en fonction de choix particuliers ;
le type darmatures ;
des contraintes particulires ;
les tolrances dexcution.
tape 1: prise en compte des classes
dexposition
Un bton peut tre soumis plusieurs classes dex-
position concomitantes qui traduisent avec prci-
sion lensemble des actions environnementales.
Les classes dexposition de chaque partie dou-
vrage sont une donne de base du projet. Elles
sont imposes par les conditions denviron-
nement du projet. Elles sont dfinies dans le
tableau 4.1 de larticle 4.2 de lEurocode 2 (norme
NF EN 1992-1-1) en conformit avec la norme
NF EN 206-1.
tape 2: Choix de la classe structurale
Dure dutilisation du projet
LAnnexe Nationale de lEurocode 0 (NF EN 1990
Base de calcul des structures) dfinit la dure
dutilisation de projet : dure pendant laquelle une
structure est cense pouvoir tre utilise en faisant
lobjet de la maintenance escompte mais sans
quil soit ncessaire deffectuer des rparations
majeures.
Les btiments et les ouvrages de gnie civil cou-
rants sont dimensionns pour une dure dutilisa-
tion de projet de 50 ans. Les ponts sont
dimensionns pour une dure dutilisation de pro-
jet de 100 ans.
Ces dures supposent la mise en uvre de btons
conformes aux tableaux N.A.F. 1 ou N.A.F. 2 de la
norme NF EN 206.1. Les documents particuliers du
march peuvent spcifier des dures dutilisation
de projet diffrentes.
Classe structurale
La classe structurale (S1 S6) est un paramtre
permettant doptimiser la valeur de lenrobage.
Les modulations possibles de la classe structurale,
en fonction de choix particuliers pour le projet (dure
dutilisation de projet, classe de rsistance du bton,
nature du ciment, compacit du bton denrobage),
engageant le matre duvre, sont donnes dans
le tableau 4.3 N (F) larticle 4.4.1.2 (5) de lAn-
nexe Nationale de la norme NF EN 1992-1-1.
On admet que la classe structurale S4 correspond
une dure dutilisation de 50 ans.
73
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 73
Ces modulations de la classe structurale, pour dter-
miner lenrobage minimal C
min,dur
sont synthtises
dans le tableau 15 [extraits du tableau 4.3 N (F)].
Une majoration de 2 consiste, par exemple,
passer de la classe structurale S4 S6. Une mino-
ration de 1 consiste passer de la classe structurale
S6 S5.
tape 3: dtermination de lenrobage
minimal vis--vis de la durabilit C
min,dur
Les valeurs de C
min,dur
(en mm) requis vis--vis de
la durabilit sont donnes en fonction de la classe
dexposition et de la classe structurale dans le
tableau 4.4 N pour les armatures de bton arm et
dans le tableau 4.5NF pour les armatures de
prcontrainte larticle 4.4.1.2 (5) de la norme
NF EN 1992-1-1.
Pour les classes dexpositions XF1, XF2, XF3 et XF4.
La valeur de C
min,dur
est dtermine en prenant en
compte les classes dexpositions concomitantes
XC1 XC4 et XD1 XD3.
LAnnexe Franaise de la norme NF EN 1992-1-1
prcise comment tenir compte de cette concomi-
tance de classes.
Pour les classes dexposition XA1 XA3, la valeur de
C
min,dur
est aussi dtermine en prenant en compte
les classes dexposition concomitantes XC ou XD.
Chapitre Dimensionnement des structures en bton 2
74
Tableau 15: valeur de C
min,dur
en fonction de la classe
dexposition et de la classe structurale
dans le cas des armatures de bton arm
Tableau 16: concomitance de classes
Classe dexposition
Classe
structurale
XO XC1
XC2
XC3
XC4
XD1
XS1
XD2
XS2
XD3
XS3
S1
S2
S3
S4
S5
S6
10
10
10
10
15
20
10
10
10
15
20
25
10
15
20
25
30
35
15
20
25
30
35
40
20
25
30
35
40
45
25
30
35
40
45
50
30
35
40
45
50
55
SO: sans objet
*XD1: si le bton est formul avec un entraneur dair
XC4: si le bton est formul sans entraneur dair.
** XD3: pour les lments trs exposs (pour les ponts: corniches,
longrines dancrage des dispositifs de retenue, solins des joints de
dilatation).
Type
de salage
Sous classe dexposition XF
XF1 XF2 XF3 XF4
Peu frquent XC4 SO XD1 ou XC4* SO
Frquent SO XD1 XD3** SO XD2 XD3**
Trs frquent SO SO SO XD3
Tableau 14: modulation de la classe structurale recommande
Critre Classe dexposition
XO XC1 XC2, XC3 XC4 XD1 / XS1 / XA1 XD2 / XS2 / XA2 XD3 / XS3 / XA3
Dure
dutilisation
de projet
100 ans, majoration de 2
25 ans et moins minoration de 1
Classe
de rsistance
du bton
C 30/37 C 30/37 C 30/37 C 35/45 C 40/50 C 40/50 C 45/55
Minoration de 1
C 50/60 C 50/60 C 55/67 C 60/75 C 60/75 C 60/75 C 70/85
Minoration de 2
Nature
du liant
- C 35/45 C 35/45 C 40/50 - - -
- Bton base de CEM I sans cendres volantes - - -
- Minoration de 1 - - -
Enrobage
compact
Minoration de 1
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 74
tape 4: prise en compte
du type darmature
LAnnexe Nationale de la norme NF EN 1992-1-1
dans larticle 4.4.1.2 (7) prcise les cas pour les-
quels lenrobage C
min,dur
peut tre rduit, dune
valeur C
dur.st
ou C
dur.add
. Ce choix engage le ma-
tre duvre. La valeur est fixe par les documents
particuliers du march.
Utilisation darmatures en acier rsistant
la corrosion: armature inox
Sur justification spciale et condition dutiliser
des aciers dont la rsistance la corrosion est
prouve (certains aciers inox par exemple), pour
la dure dutilisation et dans les conditions dexpo-
sition du projet, les documents particuliers du mar-
ch pourront fixer la valeur de C
dur.st
. En outre, le
choix des matriaux, des paramtres de mise en
uvre et de maintenance doivent faire lobjet
dune tude particulire. De mme, lutilisation de
tels aciers ne peut seffectuer que si les caractris-
tiques propres de ces aciers (notamment soudabi-
lit, adhrence, dilatation thermique, compatibilit
des aciers de nature diffrente) sont vrifies et pri-
ses en compte de faon approprie extrait de lar-
ticle 4.4.1.2 (7).
Mise en place dune protection complmentaire
En cas de mise en place dune protection compl-
mentaire, lenrobage minimal nest pas diminu,
sauf pour les revtements adhrents justifis vis--
vis de la pntration des agents agressifs pendant
la dure dutilisation de projet.
tape 5: prise en compte
de contraintes particulires
LEurocode 2 et lAnnexe Nationale franaise pres-
crivent daugmenter lenrobage minimal dans les
cas suivants.
Parements irrguliers
Dans le cas de parements irrguliers (bton gra-
nulat apparent par exemple), lenrobage minimal
doit tre augment dau moins 5 mm.
Abrasion du bton
Dans le cas de bton soumis une abrasion, il
convient daugmenter lenrobage de 5 mm,
10 mm, et 15 mm respectivement pour les classes
dabrasion XM1, XM2, et XM3 (voir lEN 1990
Eurocode 0 Base de calcul des structures).
Bton coul au contact de surfaces irrgulires
Dans le cas dun bton coul au contact de surfa-
ces irrgulires, il convient gnralement de majo-
rer lenrobage minimal en prenant une marge plus
importante pour le calcul. Il convient de choisir une
majoration en rapport avec la diffrence cause par
lirrgularit. Lenrobage minimal doit tre au
moins gal k
1
mm pour un bton coul au
contact dun sol ayant reu une prparation (y
compris bton de propret) et k
2
mm pour un
bton coul au contact direct du sol.
Les valeurs recommandes par lAnnexe Nationale
franaise sont : k
1
= 30 mm et k
2
= 65 mm.
tape 6: dtermination de lenrobage
minimal vis--vis de ladhrence C
min,b
Lenrobage minimal vis--vis de ladhrence C
min,b
est prcis dans le tableau 4.2 article 4.4.1.2 (3) de
la norme NF EN 1992-1-1.
Il convient que C
min,b
ne soit pas infrieur :
au diamtre de la barre dans le cas darmature
individuelle;
au diamtre quivalent dans le cas de paquet
darmatures.
C
min,b
est major de 5 mm si le diamtre du plus
gros granulat du bton est suprieur 32 mm.
75
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 75
tape 7: dtermination de lenrobage
minimal C
min
Lenrobage minimal C
min
est dtermin par la for-
mule donne au paragraphe 2.5.4. en intgrant les
valeurs de C
min,b
/ C
min,dur
/ C
dur,y
/ C
dur.st
et
C
dur,add
tape 8: prise en compte
des tolrances dexcution
Lenrobage minimal doit tre major, pour tenir
compte des tolrances pour cart dexcution
(C
dev
).
La valeur recommande dans larticle 4.4.1.3 (3) est
C
dev
= 10 mm sauf justification particulire. En par-
ticulier cette valeur peut tre rduite sous rserve
de conditions strictes de contrle qualit la fois sur
la conception et lexcution des ouvrages.
Lenrobage nominal est donn par la formule:
C
nom
= C
min
+ C
dev
Si la ralisation ou la conception et lexcution des
lments douvrage sont soumis un systme
dAssurance Qualit (incluant en particulier des
dispositions spcifiques relatives la conception,
au faonnage ou la mise en place des armatures).
Il est possible de rduire la valeur de C
dev
une
valeur comprise entre 5 et 10 mm.
Cette rduction possible de C
dev
permet dinciter
un meilleur contrle du positionnement rel des
armatures et une meilleure qualit de ralisation.
Nota
LEurocode 2 attire lattention sur les deux
points suivants :
les problmes de fissuration du bton
auxquels risque de conduire un enrobage
nominal suprieur 50 mm;
les difficults de btonnage auxquelles
risque de conduire, un enrobage nominal
infrieur la dimension nominale de plus
gros granulats.
Nota
Laugmentation de lenrobage est favora-
ble pour la stabilit au feu. Pour assurer
celle-ci, on peut tre amen prvoir des
dispositions de ferraillage spcifiques tel-
les que:
des enrobages suprieurs ceux impo-
ss par la protection contre la corrosion;
un fractionnement en plusieurs armatu-
res de faibles diamtres. Certaines dentre
elles seront plus loignes des parois
exposes au feu, en particulier prs des
angles saillants o la temprature est plus
leve. Lespacement de ces armatures
sera parfois plus important que celui habi-
tuellement exig pour permettre un
btonnage correct.
Chapitre Dimensionnement des structures en bton 2
76
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 76
Comme le bton arm, le bton prcontraint asso-
cie bton et armatures, mais il sen diffrencie de
faon fondamentale dans son principe. En 1928,
Eugne Freyssinet eut lide gniale qui rvolu-
tionna le monde de la construction en permettant
au bton de ne travailler quen compression. Il
venait dinventer le bton prcontraint.
Il dfinissait ainsi la prcontrainte: Prcontraindre
une construction, cest la soumettre avant applica-
tion des charges des forces additionnelles dter-
minant des contraintes telles que leur composition
avec celles qui proviennent des charges donne en
tout point des rsultantes infrieures aux contrain-
tes limites que la matire peut supporter indfini-
ment sans altration.
La prcontrainte, en effet, a pour but de soumettre
le bton lors de sa fabrication des contraintes pr-
alables permanentes de compression. Une fois
louvrage en service, ce gain en compression va
sopposer aux contraintes de traction cres par les
charges appliques louvrage (poids propre,
charge dexploitation, charge climatique, etc.). Le
bton, matriau qui prsente une faible rsistance
la traction, se trouve ainsi utilis au mieux de ses
possibilits en ne travaillant quen compression.
La prcontrainte est applique au bton grce
des cbles de prcontrainte en acier. Ces cbles
sont tendus par des vrins de prcontrainte.
77
2.6 Le bton prcontraint
Lorsque lon tend les cbles, ils vont par raction
appliquer un effort de compression au bton.
Lintensit de la prcontrainte mettre en uvre
dpend videmment des tractions auxquelles il
faudra sopposer et des raccourcissements instan-
tans et diffrs du bton.
La prcontrainte permet la ralisation douvrages
soumis des contraintes importantes (ponts ou
rservoirs de grande capacit) aussi bien que d-
lments qui, tout en tant de faible paisseur, doi-
vent assurer des portes relativement longues
(dalles-planchers, poutres). Elle est lorigine de
progrs considrables pour lutilisation du bton
dans les ouvrages dart et les structures coules en
place ou ralises partir dlments prfabriqus.
La prcontrainte peut tre applique au bton:
soit par pr-tension (mise en tension des aciers
avant coulage du bton) ;
soit par post-tension (mise en tension de cbles
aprs durcissement du bton).
Nota
Selon lEurocode 2, le procd de pr-
contrainte consiste appliquer des forces
la structure en bton par la mise en tension
darmatures par rapport llment en
bton. Le terme prcontrainte est utilis
globalement pour dsigner lensemble des
effets permanents de ce procd qui com-
portent des efforts internes dans les sec-
tions et des dformations de la structure.
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 77
2.6.1 - Principe du bton prcontraint
Le bton rsistant mieux en compression quen
traction, le but de la prcontrainte est dobtenir des
pices qui ne travailleront qu la compression. Les
forces de traction engendres par les charges
appliques louvrage viendront en dduction des
forces de compression cres par la mise en ten-
sion des cbles de prcontrainte.
Soit par exemple une poutre en bton arm sur
deux appuis simples. Si on la soumet une charge,
elle se dforme. La section transversale, au droit
de lapplication de la charge se trouve comprime
la fibre suprieure et tendue la fibre infrieure.
Lorsque la charge est trop forte, des fissures
apparaissent la partie infrieure de la poutre.
Supprimons dans cette poutre larmature de
traction classique pour la remplacer par une gaine
courbe suivant la dforme de la poutre et conte-
nant des cbles de prcontrainte. En tirant sur les
cbles, on comprime la poutre. Dans la section
transversale, la fibre suprieure va se tendre et la
fibre infrieure se comprimer.
Lors dun chargement, les efforts de traction vien-
nent alors en dduction des efforts de compression
crs par la prcontrainte et toutes les fibres res-
tent comprimes. Cette poutre pralablement
comprime supportera sans dommage les charges
qui provoqueraient la rupture dune poutre en
bton arm de mmes dimensions et porte. Il est
possible de dterminer leffort de prcontrainte
ncessaire pour que la poutre soit toujours compri-
me quelles que soient les charges appliques. En
ralit, dans les grosses poutres, il y a de nom-
breuses gaines. La disposition exacte des cbles et
leur nombre dpendent de nombreux paramtres
(dimensions et forme de la poutre, charges sup-
porter, etc.). Leur position releve vers les extr-
mits est destine amliorer la rsistance
leffort tranchant.
2.6.2 - Prcontrainte
par post-tension
La prcontrainte par post-tension est ralise par
des armatures (cbles ou torons) mises en tension
aprs coulage du bton lorsquil a acquis une rsis-
tance mcanique suffisante (pour lui permettre de
supporter les efforts de compression auxquels il est
alors soumis).
Aprs coulage et durcissement du bton, les
cbles de prcontrainte sont enfils dans des gai-
nes et des ancrages qui sappuient sur louvrage en
bton comprimer, mis en tension laide de
vrins et bloqus tendus dans les ancrages. Les
cbles transmettent leur tension au bton et le
transforment en bton prcontraint.
Il existe deux types de prcontrainte par post-ten-
sion:
intrieure au bton;
extrieure au bton.
Chapitre Dimensionnement des structures en bton 2
78
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 78
79
Nota
Les ancrages de prcontrainte constituent
un organe essentiel puisquils permettent
dassurer le maintien de leffort de pr-
contrainte dans les armatures aprs la mise
en tension.
Dans la plupart des systmes de pr-
contrainte, le blocage des armatures par rap-
port lancrage est obtenu par frottement
(clavetage dans une pice conique).
2.6.3 - Prcontrainte par
pr-tension ou prcontrainte
par fils adhrents
Une poutre est prcontrainte par pr-tension lorsque
la mise en tension des aciers de prcontrainte est
effectue avant le btonnage de la poutre. Ces pou-
tres sont fabriques sur un banc de prfabrication .
Les armatures de prcontrainte sont enfiles dans
des coffrages lintrieur des cages darmatures
passives et sont positionnes grce des gabarits
mtalliques percs faisant galement office de cof-
frage dabout.
Les armatures de prcontrainte (fils ou torons) sont
tendues avant btonnage (dans des bancs de pr-
contrainte de plus de 100 m de longueur) laide
de vrins entre deux massifs dancrage. Le bton
frais est coul au contact des armatures. Lorsquil a
acquis une rsistance suffisante (la monte en
rsistance peut tre acclre par traitement ther-
mique), on libre la tension des fils (par relche-
ment des vrins), qui se transmet au bton par
adhrence et engendre par raction sa mise en
compression (les fils dtendus veulent reprendre
Nota
La prcontrainte extrieure prsente de
nombreux avantages, notamment lall-
gement des structures par rduction des
sections, la facilit de mise en uvre et
surtout les possibilits de remplacement
des cbles endommags ou de renforce-
ment de structures soumises des char-
ges accrues.
La mise en prcontrainte par post-tension est rali-
se par la succession des tapes suivantes :
des conduits (les plus utiliss sont des gaines )
sont positionns lintrieur du coffrage (pr-
contrainte intrieure) ou lextrieur (pr-
contrainte extrieure) avant btonnage;
les armatures sont enfiles dans les conduits
aprs btonnage;
les armatures sont tendues leurs extrmits par
des vrins qui prennent appui sur le bton de la
poutre et ancres par des systmes dancra-
ges; la tension des armatures se transmet au
bton et le comprime;
le contrle de la tension des cbles est effectu
par mesure de leur allongement (lallongement
tant proportionnel leffort de traction exerc
sur les cbles Le calcul de lallongement du
cble doit tenir compte des diffrentes pertes de
tension, par frottement, par dformations instan-
tane ou diffre du bton ou par rentre des
ancrages) ;
les vrins sont ensuite dmonts et les exc-
dents de cbles coups ;
les conduits sont enfin injects par un coulis de
ciment (ou parfois par des cires ou des graisses)
afin de protger les armatures de prcontrainte
de la corrosion.
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 79
leur longueur initiale, mais leur adhrence au bton
empche ce raccourcissement et leffort quil a fallu
exercer pour les tendre se transmet au bton).
Cette technique est uniquement applique la
prfabrication: elle permet de raliser des pou-
trelles, des poteaux, des poutres, des dalles alvo-
les, des prdalles, etc.
2.6.4 - Armatures de prcontrainte
Les armatures de prcontrainte sont en acier
haute rsistance. Elles se prsentent sous forme de
fils, de torons, de barres ou de cbles. Elles peu-
vent tre intrieures au bton:
pr-tendues et adhrentes ;
post-tendues et adhrentes ou non.
Elles peuvent aussi tre extrieures au bton et
relies la structure au niveau des ancrages et des
dviateurs uniquement.
Les torons
Les torons sont un assemblage de plusieurs fils (le
fil est produit par dformation froid (trfilage)
dun fil machine).
Torons 3 fils : 3 fils enrouls sur un axe thorique
commun (utilisation en prcontrainte par pr-ten-
sion uniquement).
Torons 7 fils : 6 fils disposs en hlice autour dun
fil central dun diamtre plus important.
Les torons sont caractriss par leur nombre de fils
(et la section du fil) et leur diamtre. Les classes de
rsistance des torons sont : 1670, 1770, 1860 et
1960 MPa. Les caractristiques des torons les plus
courants sont donnes dans le tableau ci-dessous.
Ils sont dfinis par leur force garantie de rupture
(FRG) qui varie selon la classe de lacier.
Les cbles
Les cbles sont constitus de plusieurs torons en
acier haute rsistance pour bton prcontraint. La
gamme des cbles stend des cbles monotorons
aux cbles de trs grande puissance comportant
jusqu 55 torons.
Les units les plus courantes, pour la prcontrainte
longitudinale, sont les units 12 ou 13 T15 S (compo-
ses de 12 ou 13 torons T15 S) pour la prcontrainte
intrieure et 19 T15 S pour la prcontrainte ext-
rieure.
Un cble est dfini par le type et le nombre de
torons et la classe de rsistance.
Chapitre Dimensionnement des structures en bton 2
80
Dsignation Classe MPa Diamtre (mm) Section (mm
2
)
T 13 1860 12.5 93
T 13 S 1860 12.9 100
T 15 1860 15.2 139
T 15 S 1860 15.7 150
Tableau 17: caractristiques des torons de prcontrainte
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 80
2.6.5 - Conduits pour prcontrainte
par post-tension
Il existe plusieurs types de conduits dans lesquels
sont disposs les cbles :
gaine (mtallique) nervure en feuillard: pais-
seur du feuillard: 0,3 0,6 mm diamtre 25
130 mm;
tube rigide en acier paisseur 1,5 2 mm;
gaine nervure en PEHD;
tube en PEHD.
La gaine en feuillard est la plus couramment
employe en ouvrage dart.
Les conduits, ncessaires uniquement en post-ten-
sion, ont pour rle de:
mnager un passage continu du cble de pr-
contrainte selon le trac et la position prvue lors
du dimensionnement de louvrage;
rsister aux sollicitations lors de linstallation, la
mise en tension (pression localise, abrasion) et
linjection (tanchit, pression dinjection) ;
transmettre les efforts par adhrence (dans le cas
de la prcontrainte intrieure) ;
assurer une protection mcanique de larmature et
une enveloppe (tanchit) du coulis dinjection.
La section du conduit est gale 2 2,5 fois la sec-
tion de larmature afin de permettre son remplis-
sage.
2.6.6 - Injection des conduits
de prcontrainte
Linjection avec des coulis de ciment des cbles de
prcontrainte a pour objectif de protger les aciers
de prcontrainte contre les agents corrosifs ext-
rieurs. En vitant tout contact entre les armatures
et leau ou lair humide, le coulis de ciment consti-
tue une barrire permanente contre la corrosion,
du fait de la passivation des armatures. Il garantit la
prennit de la prcontrainte et donc de louvrage.
Cependant, linjection est une opration dlicate
raliser en raison des tracs fortement onduls des
cbles et de leur grande longueur.
Le coulis, pour assurer convenablement la satisfac-
tion des exigences, doit tre inject de telle
manire que la gaine soit entirement remplie. Il
ne doit pas prsenter de phnomne de sgrga-
tion pendant linjection et pendant la priode avant
la prise. Il est adjuvant, ce qui optimise ses carac-
tristiques rhologiques et lui confre une fluidit
adapte aux mthodes dinjection et une dure
dinjectabilit matrise.
La fabrication du coulis se fait par malaxage dans des
malaxeurs haute turbulence ou des turbomalaxeurs.
Les essais et contrles effectuer sur les coulis de
ciment portent sur :
la composition chimique des constituants qui ne
doit pas rvler la prsence dlments agres-
sifs ;
la fluidit du coulis qui doit tre maintenue
durant une priode en accord avec les conditions
de mise en uvre;
la stabilit du coulis avant prise;
81
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 81
labsorption capillaire dtermine sur coulis durci
diverses chances ;
la rsistance mcanique en flexion et en com-
pression;
le temps de dbut et de fin de prise (sur plage de
temprature dutilisation).
Les spcifications sur les coulis visent leur conf-
rer un maintien de la fluidit et de lhomognit
pendant plusieurs heures, pour une matrise de la
dure dinjectabilit et pour une reproductibilit
des caractristiques pendant toute la dure du
chantier.
La mthode traditionnelle consiste raliser lin-
jection par pompage une extrmit avec mise
lair de lvent lextrmit oppose et ouverture,
au passage du coulis, des vents intermdiaires
situs aux points hauts du conduit.
Aprs linjection de la totalit de la gaine et mise
en pression du conduit 0,5 MPa, on procde la
purge des capots dancrage et des vents, puis au
cachetage des ttes dancrages afin dviter toute
infiltration deau jusquaux ancrages.
Les coulis de ciment base de constituants de qua-
lit, dont les formulations sont optimises, offrent
des performances stables. La rglementation
actuelle permet, grce la procdure davis tech-
nique base sur une srie dessais pertinents, de
contrler parfaitement la chane de fabrication et
dinjection du coulis et den garantir la qualit et la
protection efficace des cbles de prcontrainte.
2.6.7 - Proprits des armatures
de prcontrainte
Les proprits des armatures de prcontrainte
sont dfinies dans larticle 3.3 de la norme
NF EN 1992-1-1.
Les armatures de prcontrainte (fils, torons et bar-
res) sont dfinies en fonction des caractristiques
suivantes :
rsistance, dcrite par la valeur de la limite d-
lasticit conventionnelle 0,1 % (f
p0,1k
), par le
rapport de la rsistance en traction la limite d-
lasticit conventionnelle (f
pk
/ f
p0,1k
) et par lallon-
gement sous charge maximale (
uk
) ;
classe indiquant leur comportement vis--vis de
la relaxation;
section;
caractristiques de surface.
Le diagramme contrainte dformation fait lob-
jet de la figure 3.10 de larticle 3.3.6.
Pour le dimensionnement des sections, lune ou
lautre des hypothses suivantes peut tre faite:
branche incline, avec une limite de dforma-
tion
ud
;
branche suprieure horizontale, sans limite pour
la dformation.
Larticle 5.10 de la norme NF EN 1992-1-1 prcise
toutes les donnes relatives aux forces de pr-
contrainte et aux pertes de prcontrainte instanta-
ne et diffre prendre en compte pour le
dimensionnement. Les forces de prcontrainte
Chapitre Dimensionnement des structures en bton 2
82
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 82
durant la mise en tension sont limites par la
contrainte maximale de larmature et par une com-
pression limite dans le bton.
Nota
Les dispositions constructives relatives aux
armatures et aux gaines de prcontrainte
sont dfinies dans larticle 8.10.1 de la
norme NF EN 1992 partie 1-1.
2.6.8 - Domaines dutilisation
du bton prcontraint
Le bton prcontraint est utilis pour de nombreux
ouvrages.
Les ponts :
ponts pousss ;
ponts en encorbellement voussoirs pr-
fabriqus ;
ponts en encorbellement couls en place,
ponts poutres ;
ponts haubans ;
PSI-DP Passages suprieurs ou infrieurs
dalle prcontrainte;
VI-PP Viaducs traves indpendantes
poutres prcontraintes ;
PR-AD Poutres prcontraintes par adh-
rence*.
Les structures off-shore
Les structures industrielles
Les rservoirs (deau, dhydrocarbures) et les silos
Les enceintes de racteurs nuclaires
Les btiments industriels, commerciaux
ou agricoles :
poutres*, poutrelles*;
dalles alvoles de planchers*;
prdalles*;
poutres et poteaux pour ossatures.
Nota
Dans le domaine du btiment, la pr-
contrainte par post-tension, bien que
moins courante, est utilise pour des pou-
tres de grande porte ou pour des dalles
de planchers de section relativement
mince par rapport leur porte: parkings,
btiments industriels ou commerciaux.
*Prcontrainte par pr-tension.
83
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 83
BA-CORTEX est un outil ddi la formation
au dimensionnement des structures en
bton selon les Eurocodes. Il est en accs
libre sur Internet.
Il est compos de trois familles de modules :
modules de cours ;
modules dapplications ;
modules de projet ;
et compte trois niveaux de formation:
niveau 1: dbutant ;
niveau 2: intermdiaire;
niveau 3: confirm.
www.ba-cortex.com
84
2.7 BA-CORTEX
02 t3 G 12 chapitre 2 FAB:02 t3 G 12 chapitre 2 1/12/08 16:54 Page 84
Vous aimerez peut-être aussi
- Manuel Technique1 PDFDocument50 pagesManuel Technique1 PDFTOURE100% (1)
- Le Projet de Construction Parasismique Ed1 v1 PDFDocument470 pagesLe Projet de Construction Parasismique Ed1 v1 PDFalex47cmfb100% (2)
- L'architecture et la construction pratique: Mise à la portée des gens du monde, des élèves et de tous ceux qui veulent faire bâtirD'EverandL'architecture et la construction pratique: Mise à la portée des gens du monde, des élèves et de tous ceux qui veulent faire bâtirPas encore d'évaluation
- Dimensionnement Des Structures en Béton - CT-G12.32-85 PDFDocument54 pagesDimensionnement Des Structures en Béton - CT-G12.32-85 PDFAndré Germain MbogbaPas encore d'évaluation
- Cours CharpenteDocument69 pagesCours Charpenteben ayed bouraoui100% (1)
- Cours Passage Du Bael Aux Eurocodes 2 2222 PDFDocument44 pagesCours Passage Du Bael Aux Eurocodes 2 2222 PDFIbrahima DIATTAPas encore d'évaluation
- Cours Pratique de Béton PrécontrainteDocument186 pagesCours Pratique de Béton PrécontrainteYassine El Anssari92% (12)
- Béton PrécontraintDocument92 pagesBéton PrécontraintNguyen Dang Hanh100% (46)
- Techniques de L'ingénieur Le Béton PrécontraintDocument56 pagesTechniques de L'ingénieur Le Béton PrécontraintYassine EssoufiPas encore d'évaluation
- Tableaux de Resistance Des Profiles en Acier Ed1 v1Document90 pagesTableaux de Resistance Des Profiles en Acier Ed1 v1Nabil ElHaddouchi50% (2)
- Cours EurocodeDocument122 pagesCours EurocodeMed Hacen MoustaphaPas encore d'évaluation
- Chapitre 18 - Eurocode 2 PDFDocument94 pagesChapitre 18 - Eurocode 2 PDFAhmed Skendraoui100% (1)
- L' Ingénieur et le développement durableD'EverandL' Ingénieur et le développement durableÉvaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)
- Le Béton Précontraint-Thonier PDFDocument279 pagesLe Béton Précontraint-Thonier PDFKarim Zaza60% (5)
- Eurocode 0Document12 pagesEurocode 0Rija RakotondrainibePas encore d'évaluation
- Beton PrecontraintDocument42 pagesBeton PrecontraintmeznizPas encore d'évaluation
- NIT 271 Execution Des MaçonneriesDocument148 pagesNIT 271 Execution Des MaçonneriesEmin HilaliPas encore d'évaluation
- (EUROCODE 2) NF E27-817, NF EN 1992-4: Septembre 2018Document144 pages(EUROCODE 2) NF E27-817, NF EN 1992-4: Septembre 2018Michel Mix TankouPas encore d'évaluation
- Cours Beton Precontraint - BisDocument137 pagesCours Beton Precontraint - BisZ.Jocelyn somda100% (3)
- B67-Murs Coupe Feu PDFDocument108 pagesB67-Murs Coupe Feu PDFOussama OuardaniPas encore d'évaluation
- En 1090 PresentationDocument6 pagesEn 1090 PresentationSebastien Cabot100% (1)
- Guide D'application de L'eurocode 8, CSTBDocument71 pagesGuide D'application de L'eurocode 8, CSTBINGEIGNACIO100% (2)
- Guide D'application de L'eurocode 8, CSTBDocument71 pagesGuide D'application de L'eurocode 8, CSTBINGEIGNACIO100% (2)
- Normes DimensionnementDocument135 pagesNormes DimensionnementFessal KpekyPas encore d'évaluation
- Murs Séparatifs Coupe-Feu Et Façades À Fonction D'écran Thermique en BétonDocument109 pagesMurs Séparatifs Coupe-Feu Et Façades À Fonction D'écran Thermique en BétonOlivier CHANZYPas encore d'évaluation
- Constructions MétalliquesDocument27 pagesConstructions MétalliquesAnis BourabaPas encore d'évaluation
- S0KI Trait de Bton Arm Selon L039eurocode 2 Par Jean Perchat 2281116042Document4 pagesS0KI Trait de Bton Arm Selon L039eurocode 2 Par Jean Perchat 2281116042Jasmin Agri0% (1)
- Recommandations Classes Dexecution-Janvier2015v2Document20 pagesRecommandations Classes Dexecution-Janvier2015v2mihaidelianPas encore d'évaluation
- Introduction Aux EurocodesDocument5 pagesIntroduction Aux EurocodesramyPas encore d'évaluation
- U1-NT11 La Construction MétalliqueDocument56 pagesU1-NT11 La Construction MétalliquefontainePas encore d'évaluation
- Les Armatures Et Les Procédés de PrécontrainteDocument18 pagesLes Armatures Et Les Procédés de Précontrainteeskandar66Pas encore d'évaluation
- Béton PrécontraintDocument12 pagesBéton PrécontraintBella Bercovitch GarbarzPas encore d'évaluation
- Note de Calcul RadierDocument14 pagesNote de Calcul RadierRéda Attouche67% (3)
- Conception Et Calcul À Froid Des Planchers À Dalles Alvéolées Préfabriquées en Béton PrécontraintDocument54 pagesConception Et Calcul À Froid Des Planchers À Dalles Alvéolées Préfabriquées en Béton PrécontraintHamza MamiPas encore d'évaluation
- Cours 1 Ère PartieDocument146 pagesCours 1 Ère PartieAlexandre TézardPas encore d'évaluation
- Cours BP CorrigéDocument36 pagesCours BP CorrigéRamzi Chriyat100% (2)
- Chapitre 3 Normes Europeennes de DimensiDocument26 pagesChapitre 3 Normes Europeennes de DimensibasssemPas encore d'évaluation
- CERIB - Maçonneries en Zone SismiqueDocument53 pagesCERIB - Maçonneries en Zone SismiqueKév InPas encore d'évaluation
- Pylone 45 MetresDocument27 pagesPylone 45 MetresMohieddine Amri100% (3)
- Cours VentDocument28 pagesCours VentadadididaPas encore d'évaluation
- Cours Béton Précontraint Chapitre3 PDFDocument8 pagesCours Béton Précontraint Chapitre3 PDFWilliam KellerPas encore d'évaluation
- Chapitre 6 - Association Acier Béton - BDocument36 pagesChapitre 6 - Association Acier Béton - BTareck Bou JaoudePas encore d'évaluation
- Pathologies Diagnostic Béton ArméDocument186 pagesPathologies Diagnostic Béton ArméTomás MurPas encore d'évaluation
- SoutènementDocument33 pagesSoutènementzikas-linkinPas encore d'évaluation
- Murs de Soutenement - COUR PDFDocument55 pagesMurs de Soutenement - COUR PDFImane EN NACERPas encore d'évaluation
- Beton Arme-Beton Precontraint Cle8d81cdDocument25 pagesBeton Arme-Beton Precontraint Cle8d81cdAbo SambPas encore d'évaluation
- 1 EC01 IntroDocument55 pages1 EC01 IntroFayza BELOUAFIPas encore d'évaluation
- Guide Choix Classes Exposition BétonDocument8 pagesGuide Choix Classes Exposition Bétoninvisibleyop100% (1)
- Les EurocodesDocument7 pagesLes EurocodesAmine BentaloubaPas encore d'évaluation
- Chap1 Introduction Au BA Et EC2Document4 pagesChap1 Introduction Au BA Et EC2Amani MansarPas encore d'évaluation
- Les EurocodesDocument39 pagesLes EurocodesfahimPas encore d'évaluation
- Chap 7Document32 pagesChap 7esselamiPas encore d'évaluation
- Poly Cours Intro Eurocodes - Ch5Document8 pagesPoly Cours Intro Eurocodes - Ch5kintomonhowilfried94Pas encore d'évaluation
- The Different Steps of The Construction With The British StandardDocument51 pagesThe Different Steps of The Construction With The British StandardWazalouaPas encore d'évaluation
- Présentation Des Eurocodes Scilab-Eurocodes Sept 2007Document25 pagesPrésentation Des Eurocodes Scilab-Eurocodes Sept 2007Van Binh NguyenPas encore d'évaluation
- ENV 1998-3-1996 - Tours, Mats Et ChemineesDocument33 pagesENV 1998-3-1996 - Tours, Mats Et ChemineesStefan Ionita100% (2)
- Nor Me S Dimension NementDocument135 pagesNor Me S Dimension NementhananePas encore d'évaluation
- Element - 45 - 1091-8.note de Calcul Du Béton ArméDocument132 pagesElement - 45 - 1091-8.note de Calcul Du Béton ArméJean KouassiPas encore d'évaluation
- Dossier Eurocodes BooksDocument6 pagesDossier Eurocodes BooksOtceliban SarlPas encore d'évaluation
- Règles 4Document14 pagesRègles 4EmmaPas encore d'évaluation
- EurocodeDocument44 pagesEurocodeMed Hacen Med SalemPas encore d'évaluation
- PFC - LPEE - Concepts Normatifs Associes À La Durabilite - DANTEC - VFDocument46 pagesPFC - LPEE - Concepts Normatifs Associes À La Durabilite - DANTEC - VFMed Hédi BANNANIPas encore d'évaluation
- Cours 5Document5 pagesCours 5ameur HerizPas encore d'évaluation
- Eurocodes Comment Et PourquoiDocument10 pagesEurocodes Comment Et PourquoiLaury CHBPas encore d'évaluation
- Cours de BâtimentDocument31 pagesCours de BâtimentBebel AzooPas encore d'évaluation
- Sikla Guide Protection Incendie FRDocument50 pagesSikla Guide Protection Incendie FRsam hadPas encore d'évaluation
- Présentation de L'eurocode 0 À 3Document16 pagesPrésentation de L'eurocode 0 À 3IngenieurPas encore d'évaluation
- Calcul Pratique Douvrages de Batiment Re PDFDocument17 pagesCalcul Pratique Douvrages de Batiment Re PDFAnonymous UYoD4DGPas encore d'évaluation
- BTP008 03 Actions-StructuresDocument28 pagesBTP008 03 Actions-StructuresMarion GaudéPas encore d'évaluation
- TIRE A PART MACONNERIE EUROCODE Mars 2013Document8 pagesTIRE A PART MACONNERIE EUROCODE Mars 2013RobPas encore d'évaluation
- 01 Champenoy PDFDocument27 pages01 Champenoy PDFdimachampionPas encore d'évaluation
- Livres Bureau Veritas A AcheterDocument4 pagesLivres Bureau Veritas A AcheterOlivier ObamePas encore d'évaluation
- 2013 02 08 - Dex Tu 2B RT3040 Sou V01 - Vol1Document118 pages2013 02 08 - Dex Tu 2B RT3040 Sou V01 - Vol1ВероникаСтепановаPas encore d'évaluation
- Barrage en Remblai - Recommandations Pour Le Calcul de StabiliteDocument114 pagesBarrage en Remblai - Recommandations Pour Le Calcul de StabiliteAbdelhay BenaddiPas encore d'évaluation
- Réhabilitation: Exigences Et Conception Parasismique: 1 Et 2 Qui Ont Été Endommagées Par L'incendieDocument3 pagesRéhabilitation: Exigences Et Conception Parasismique: 1 Et 2 Qui Ont Été Endommagées Par L'incendieaaaPas encore d'évaluation
- Dossier Plancher Collaborant INCOPERFILDocument74 pagesDossier Plancher Collaborant INCOPERFILSimo MouaddenPas encore d'évaluation
- CV - Thileli - HASSANI - INFRASTRUCTURE ET GEOTECHNIQUEDocument1 pageCV - Thileli - HASSANI - INFRASTRUCTURE ET GEOTECHNIQUEngonianPas encore d'évaluation
- Maçonnerie Confinee Manual FrancaisDocument29 pagesMaçonnerie Confinee Manual Francaisplanificateur100% (1)
- NF EN 1993-1-5 Mars 2007Document58 pagesNF EN 1993-1-5 Mars 2007fauvyPas encore d'évaluation
- HILTI - Livre Blanc Eurocode2 V2Document15 pagesHILTI - Livre Blanc Eurocode2 V2akerue38320Pas encore d'évaluation
- Debut1 PDFDocument59 pagesDebut1 PDFAnonymous CG0AWQ54Pas encore d'évaluation
- Boulonnerie Construction Metallique BV Ldoc37Document5 pagesBoulonnerie Construction Metallique BV Ldoc37Ayoub SetinePas encore d'évaluation
- Fabrication Et Pose en Coffrage Des ArmaturesDocument63 pagesFabrication Et Pose en Coffrage Des ArmaturesDu Châu100% (1)
- Partie1mecasols PDFDocument47 pagesPartie1mecasols PDFFogouangromiquegmail.fr MamanodettePas encore d'évaluation
- Cmi 2015 Inter 1Document44 pagesCmi 2015 Inter 1cnegrelloPas encore d'évaluation
- 785 Sols Et FondationsDocument58 pages785 Sols Et FondationsSarrauste JulienPas encore d'évaluation
- bncm-cnc2m n0035 Recommandations Ps CM 31 Janv 2013Document17 pagesbncm-cnc2m n0035 Recommandations Ps CM 31 Janv 2013mihaidelianPas encore d'évaluation
- Replacement Table Eurocode National Standard 2010-03-09Document7 pagesReplacement Table Eurocode National Standard 2010-03-09Ingénieur CivilPas encore d'évaluation