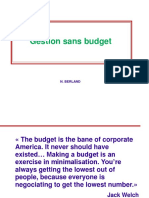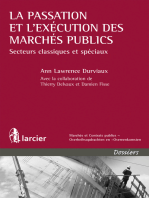Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Chap1 Forget
Chap1 Forget
Transféré par
Mohamed ZoubairCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Chap1 Forget
Chap1 Forget
Transféré par
Mohamed ZoubairDroits d'auteur :
Formats disponibles
Collection les mmentos finance
dirige par Jack FORGET
Gestion budgtaire
Prvoir et contrler les activits de lentreprise
Jack FORGET
ditions dOrganisation, 2005
ISBN : 2-7081-3251-2
Chapitre I
Se rfrer
des notions de base utiles
Le contrle budgtaire nest pas une science. Cest dabord une
pratique qui volue au gr des mutations conomiques, technologiques et culturelles. Si ses fondements restent relativement stables au cours du temps, les techniques mises en uvre doivent
sadapter aux nouvelles technologies de linformation. Lensemble
des indicateurs de gestion est dornavant labor par le systme
dinformation et daide la dcision de lentreprise. Toutefois, il
est ncessaire de connatre les principaux concepts utiliss par le
contrle de gestion pour comprendre ses finalits et interprter
ses rsultats.
Les concepts sont rpartis entre :
ceux qui sont spcifiques au contrle de gestion,
ceux qui sont drivs de la comptabilit,
et ceux qui sont issus de la stratgie.
De quoi sagit-il donc ?
ditions dOrganisation
13
Gestion budgtaire
1. Le contrle de gestion : quelles notions ?
B comme BUDGET
Budget base zro
Cette mthode dlaboration des budgets vise viter que les budgets successifs ne soient que la reconduction des budgets des annes
prcdentes. Elle sapplique la plupart des units priphriques ou
logistiques et vise redfinir les cots de structure (ceux reprsents
par les services gnraux). partir dune analyse cots-services rendus, il est dcid si les budgets allous doivent tre augments,
rduits ou supprims. En fin de compte, chaque unit doit justifier
son maintien au sein de lorganisation, son dveloppement, son
externalisation ou sa suppression. Cest certes une mthode lourde,
mais particulirement bien adapte aux processus de fusions et de
restructurations, car il permet une r-allocation des ressources vers
de nouveaux marchs ou de nouvelles activits.
Budget bas sur lactivit (ou comptabilit par activit)
Mthode budgtaire selon laquelle lallocation des ressources ne se
fait plus seulement en fonction dindicateurs de volume, mais en
fonction des caractristiques des produits ou des services. Sa finalit
est dexpliciter le processus de cration de valeur au sein des centres
de responsabilit de lentreprise. Cette mthode vise comprendre
les activits et les relations qui les unissent la stratgie globale de
lentreprise en ayant recours une analyse en termes de processus.
Elle peut tre conue pour analyser directement la satisfaction des
demandes des clients, savoir :
14
les ressources mobiliser pour satisfaire les demandes normales
des clients ;
ditions dOrganisation
Se rfrer des notions de base utiles
les ressources spcifiques mobiliser pour satisfaire les demandes
discrtionnaires des clients ;
les possibilits de rpondre des demandes atypiques si les
clients paient un supplment de prix.
Les ressources ne sont plus affectes aux activits (ou aux centres de
responsabilit) sur la base de cls de rpartition plus ou moins arbitraires, mais sont estimes sur la base du niveau dactivit rel des
centres dactivit. Les budgets ne sont plus des instruments de
mesure des cots, mais des outils permettant de dterminer les
causes et les effets des variations inattendues des paramtres.
LA.B.C. ( activity based costing ) est une mthode de calcul des
cots prenant appui sur la notion dactivit, et non sur la notion de
produit ou de service. LA.B.M. ( activity based management ) est
la mthode de management prenant appui sur les outils dvelopps
par lA.B.C.
Budget flexible
Prvision budgtaire du cot total dun centre danalyse qui distingue les charges variables, dont le montant est fonction de lactivit
du centre (sans tre ncessairement proportionnel), et les charges
fixes, dont le montant court terme est indpendant du niveau
dactivit. Les budgets flexibles peuvent tre tablis en fonction de
diffrentes hypothses de niveaux dactivit.
C comme CENTRE et CONTRLE
Centre de responsabilit
Unit lmentaire (ou entit de gestion) rsultant du dcoupage de
la structure de lentreprise. La dcomposition de lorganisation en
centres de dcisions lmentaires est une condition ncessaire la
ditions dOrganisation
15
Gestion budgtaire
mise en place dun systme de gestion budgtaire. La mise en place
dun systme de gestion repose simultanment sur la dlgation de
la prise de dcision, sur la mesure dcentralise des performances et
sur un contrle centralis des rsultats : lautocontrle au niveau des
centres de responsabilit se combine avec le pilotage exerc par la
hirarchie.
Les centres de responsabilit se rpartissent entre :
les centres de cots (qui peuvent tre des units de production
ou des units de soutien administratif et logistique) ;
les centres de revenus (services commerciaux) ;
les centres de profit (dans lesquels les rsultats obtenus sont calculs par la diffrence entre le chiffre daffaires et les charges
directement rattaches ces centres).
Les dpenses non directement rattachables des centres de profit
doivent tre ventiles en fonction de principes dcids par
lentreprise. Le suivi des marges dgages par chacun des centres
de profit constitue un des objectifs centraux du reporting financier appliqu lentreprise.
Contrle budgtaire
Cest une modalit financire du contrle de gestion. Tout budget
est compos dun ensemble de postes budgtaires. Lanalyse des
carts budgtaires consiste analyser les diffrences constates entre
les donnes prvisionnelles et les donnes relles.
Trois paramtres sont pris en considration :
- les quantits,
- les prix,
- les rendements.
16
ditions dOrganisation
Se rfrer des notions de base utiles
Les carts trop importants doivent dclencher un processus de correction. Lanalyse des carts a longtemps constitu la mthode privilgie du contrle budgtaire. La rgulation du systme budgtaire
court terme rside dans ces mesures correctives qui, pour leur part,
peuvent dclencher des effets dapprentissage moyen terme.
Les nouvelles mthodes de contrle de gestion visent anticiper les
volutions (planification flexible, mthodes des scnarios), tre
plus ractives (rponses plus rapides aux modifications court
terme de lenvironnement) ou remettre en cause radicalement les
donnes existantes (mthode A.B.C., mthode O.V.A.R.).
Critiques
Le contrle budgtaire est souvent critiqu en raison de sa
focalisation excessive sur les structures existantes et non sur
les relations de lentreprise avec son environnement. Il cherche dtecter les inefficacits plutt que les sources damlioration possibles. Il est parfois peru comme un exercice
formel relativement inefficace. Les rsultats sont trop souvent valus sur une base comptable et non dans le but de
mettre en uvre des plans daction visant amliorer les
performances de lentreprise.
Contrle de gestion
Ensemble de dispositions prises pour fournir aux dirigeants et aux
divers responsables des donnes chiffres priodiques caractrisant
la marche de lentreprise. Leur comparaison avec des donnes passes ou prvues peut, le cas chant, inciter les dirigeants dclencher rapidement les mesures correctives appropries (dfinition du
Plan comptable gnral).
ditions dOrganisation
17
Gestion budgtaire
Situ entre le contrle stratgique et le contrle oprationnel, le
contrle de gestion vise amliorer les performances de lentreprise
grce des indicateurs de rsultat et promouvoir le changement
organisationnel. Le contrle de gestion englobe non seulement le
contrle financier (comptabilit analytique), mais encore lensemble
des facteurs qualitatifs et quantitatifs (tableaux de bord) permettant
damliorer les performances de lentreprise.
Le contrle de gestion repose sur une squence dactions senchanant logiquement :
fixation des objectifs ;
planification stratgique et financire trois ou cinq ans ;
laboration du budget annuel ;
contrle de lexcution du budget ;
analyse des carts entre les donnes budgtes et les donnes
constates ;
laboration et mise en uvre des mesures correctives.
La ralisation des objectifs doit tre obtenue en maximisant lefficacit des ressources employes. Cest donc un systme de pilotage
permettant la fois datteindre des objectifs (systme finalis), de
mesurer les performances effectives (systme incitatif ) et de faire
converger les actions vers les buts fixs (systme coercitif ). Les questions de la cohrence du systme de contrle de gestion et de la
dfinition des critres de performances dune organisation sont tributaires de sa culture, des finalits quelle poursuit, de son histoire,
donc de lensemble des rfrents structurant son identit.
18
ditions dOrganisation
Se rfrer des notions de base utiles
Contrle de gestion appliqu aux services
Le contrle de gestion appliqu aux activits de service ne peut pas
tre une simple transposition des mthodes de contrle de gestion
appliques au secteur industriel.
Originalit
Dune certaine mesure, la socit postindustrielle se caractrise par une industrialisation des services, autrement dit par
une rationalisation sur le mode industriel des activits de service. Les prestations de service sont toutefois dune nature
diffrente de la production des biens matriels. Elles ne peuvent tre values qu partir dune pluralit de critres. Ces
activits sont ralises de manire discontinue et de manire
discrte au sens mathmatique du terme, souvent par des
entreprises dont les activits sont rparties sur plusieurs sites
et qui requirent un contrle dcentralis. Les mthodes
dvaluation des performances doivent donc faire lobjet
dune adaptation spcifique, plutt de nature qualitative, et
doivent sorienter vers des enqutes valuant les attentes de
la clientle et des enqutes mesurant sa satisfaction.
Compte tenu de la diversit des activits de service, il nexiste pas
de mthode de contrle de gestion standard applique ce type
dactivits.
ditions dOrganisation
19
Gestion budgtaire
D comme DYSFONCTIONNEMENT
Dysfonctionnement
Le contrle de gestion est un des processus qui se prte le mieux
lmergence de dysfonctionnements. Toutes ses tapes et toutes ses
procdures sont de nature gnrer des effets pervers (effets contraires ceux attendus par les initiateurs de laction).
Le dcoupage en centres de responsabilits peut tre flou. Les rgles
dimputation des cots indirects peuvent conduire des rsultats
trompeurs, spcieux ou aberrants. La procdure budgtaire peut se
transmuer en routine bureaucratique ayant perdu de vue les objectifs quelle doit thoriquement poursuivre. Les valuations des performances individuelles et collectives peuvent tre confondues ou
bien transformes en rites purement formels. La notion de prvision
peut tre assimile celle dobjectif. Le suivi des carts peut tre
inutilement dtaill, au point de masquer les volutions essentielles.
Systmes de pouvoir
Il faut distinguer les dysfonctionnements organisationnels des
leurres idologiques. Lentreprise nest pas gouverne selon
une logique dmocratique et la croyance des acteurs en un
processus participatif de prise des dcisions et de fixation des
objectifs nengage que leur crdulit. Mme les dlgations
de responsabilit doivent tre examines laune des rapports de pouvoir existant au sein de la hirarchie. Toute
organisation est dabord un systme de pouvoir rgi par la
confrontation et la coopration de volonts individuelles et
collectives. Ce nest pas parce quun systme de contrle de
gestion se dcline concrtement en une srie dindicateurs
20
ditions dOrganisation
Se rfrer des notions de base utiles
quantifis que pour autant ceux-ci sont de nature rendre
compte de manire exhaustive de la ralit des performances de lorganisation.
Le systme de contrle de gestion traditionnel tait relativement
pertinent pour les organisations de masse dans les socits industrielles. Mais son universalit est remise en cause en permanence par
les nouvelles configurations organisationnelles mergeant dans les
socits postindustrielles et dans des pays dont les mentalits collectives sont encore fortement imprgnes par les cultures traditionnelles (primat du collectif sur lindividuel, primat des valeurs
symboliques sur les valeurs matrielles, primat des rationalits
idalistes sur les rationalits technicistes, primat de la tradition et de
la permanence sur la dynamique perptuelle du changement qui
caractrise les conomies en croissance).
G comme GESTION
Gestion budgtaire
Mode de gestion consistant traduire en programmes dactions
chiffres (budgets) les dcisions prises par la direction avec la participation des responsables (dfinition du Plan comptable gnral).
La gestion budgtaire suppose la dfinition dobjectifs ex ante, une
structure englobant lensemble des activits de lentreprise, la participation et lengagement des responsables des centres de responsabilit et la mise en place dun contrle budgtaire.
Les diffrents budgets par fonction comprennent :
le budget des ventes ;
le budget de production ;
le budget des approvisionnements ;
ditions dOrganisation
21
Gestion budgtaire
le budget des autres charges ;
le budget des investissements.
Le budget consolid par fonctions ou par centres de responsabilits
permet dlaborer les tats financiers prvisionnels (bilan, compte
de rsultat, tableau de financement) et le budget de trsorerie.
Gestion prvisionnelle
Elaborer des budgets est indispensable pour modliser des plans
dactions novateurs, pour anticiper, compte tenu des dlais de mise
en uvre, des actions et pour oprer des arbitrages entre projets de
dveloppement.
Un budget permet de valider les options choisies et de mesurer les
performances relles de lorganisation, ainsi que de fixer des objectifs servant de systmes dincitation aux acteurs de lentreprise.
Comparer les ralisations aux prvisions permet de prendre des
mesures correctives (boucles de rgulation ou de rtroaction) et de
remettre en cause les hypothses fondamentales. Les budgets sont la
traduction financire de plans dactions cohrents avec les objectifs
de lorganisation.
Lexercice budgtaire permet de rvler les raisonnements qui ont
conduit au choix des plans daction et doprer la synthse des budgets des diffrents centres de responsabilit. Un budget nest pas, en
thorie, la reconduction des comptes de rsultat passs. En ralit, la
cohrence entre les documents financiers de court terme et les projections financires long terme est toujours problmatique.
Llaboration des documents budgtaires seffectue selon des procdures qui doivent permettre des entits plus ou moins indpendantes de se coordonner et dharmoniser leurs politiques. La finalit
de la procdure budgtaire est lintgration des diffrentes entits en
22
ditions dOrganisation
Se rfrer des notions de base utiles
une seule organisation suppose poursuivre des objectifs unifis et
clairement dcids. La principale difficult rside dans lharmonisation des plans dactions des centres de responsabilit et leur alignement sur les objectifs gnraux poursuivis par lorganisation.
Llaboration in fine dun budget consolid suppose de procder aux
arbitrages et aux choix correspondant la stratgie que lorganisation entend effectivement mettre en uvre. La cohrence entre le
tout (lentreprise) et les parties (les centres de responsabilit) est
toujours une qute hautement problmatique.
M comme MTHODE
Kazen
Mthode dinspiration japonaise damlioration continue des performances dune entreprise et de rduction des cots. Elle passe
souvent par la fixation de cibles successives atteindre, refltant un
processus damlioration permanent des performances.
Kanban
Mthode dinspiration japonaise de production selon le principe
du juste temps . Les kanbans dsignent les fiches disposes
sur des porte-tiquettes ou stockes dans des classeurs, qui accompagnent chaque lot de pices et font office dordre de production ou
de transport : le kanban de transfert permet de transporter les pices
du centre fournisseur vers le lieu de production et le kanban de production dclenche lopration de fabrication.
Mthode O.V.A.R.
(Objectifs, Variables, Actions, Responsabilits)
Mthode permettant de piloter les performances dune organisation
en reliant troitement la stratgie aux plans daction oprationnels
ditions dOrganisation
23
Gestion budgtaire
offrant un cadre commun de rfrences entre niveaux hirarchiques
et fonctions diffrentes. Laction de chaque responsable est dtermine par des objectifs qui sont ralisables grce des variables
dactions traduites en plans daction oprationnels. La mthode
O.V.A.R. constitue un cadre pour llaboration des tableaux de
bord et la dfinition des indicateurs utiliss pour la mesure des performances de lentreprise.
P comme PRIX
Prix de cession interne
Valeurs auxquelles des biens et services font lobjet dun change
entre deux entits appartenant une mme organisation (entre
deux centres de responsabilit dune mme entreprise, ou entre
deux entreprises dun mme groupe conomique et commercial).
Le systme des prix de cession interne dsigne lensemble des rgles
fixes pour valoriser les transactions ne faisant pas lobjet dun
change marchand. Il permet de transformer les centres de cots en
centres de profit en valorisant conventionnellement leur production.
Diversit
Plusieurs mthodes permettent dattribuer une valeur la
production des biens et la prestation de services non
externalises :
llaboration de cots standards ;
la rfrence des prix de march ;
le marchandage entre les centres concerns;
la facturation au cot rel mesur ex post.
24
ditions dOrganisation
Se rfrer des notions de base utiles
Le choix de la mthode dtermine le rsultat obtenu. Les
cots standards sont partiellement arbitraires : les prix de
march nexistent pas toujours et lvaluation au cot rel
neutralise la mesure de la performance.
La question des facturations internes au sein dun groupe
renvoie deux problmatiques diffrentes : loptimisation de
la localisation fiscale des bnfices (maximisation des bnfices dans les pays dans lesquels les taux dimposition sont les
plus bas) et un dilemme stratgique (stratgies dimpartition,
de sous-traitance et dexternalisation des activits considres comme non essentielles, cest--dire comme ne relevant pas du cur de mtier de lentreprise).
S comme SYSTME
Systme de reporting
Action de rendre compte intervalles rguliers des principales donnes comptables et financires, le plus souvent court terme, un
niveau hirarchique plus lev. Ce systme nest pas ncessairement
adapt aux besoins de pilotage des organisations centralises et
dcentralises, et encore moins la dfinition de leur stratgie.
Systme dinformation et daide la dcision
Le dveloppement des techniques informatiques transforme le contrle de gestion en fonction auxiliaire du systme dinformation et
daide la dcision. Les donnes interprtes par le contrle de gestion sont tributaires des systmes informatiques qui les produisent.
Cette relation de dpendance ne fait que traduire la place spcifique
du contrleur de gestion dans lorganigramme de lentreprise. Tout
compte fait, lexercice de sa mission suppose quil ait accs aux
informations dont les services contrls disposent.
ditions dOrganisation
25
Gestion budgtaire
Il est vrai que les systmes dinformations tendent constituer la
structure des organisations postindustrielles. Les E.R.P.,
Entreprise Resource Planing , sont des logiciels de gestion intgrs prenant en charge de faon cohrente ladministration des principaux flux de donnes de lentreprise. Ces systmes oprationnels
intgrs ncessitent un paramtrage minutieux et finissent par
sidentifier avec larchitecture organisationnelle.
Par ailleurs, les systmes de gestion des connaissances permettent de
constituer une vritable mmoire de lentreprise. Lopportunit, la
qualit et la pertinence dune dcision dpendent des informations
dont le dcideur dispose.
Le travail de contrle de gestion consiste collecter, crer, traiter et
analyser les informations ncessaires la gestion oprationnelle de
lentreprise et la mise en uvre de sa stratgie. En revanche, le
traitement des informations de nature prospective permettant
dapporter des modifications radicales aux systmes socio-conomiques ne relve pas de sa mission. Linnovation en matire technologique, conomique, organisationnelle, sociale ou institutionnelle
nest pas du ressort du contrle de gestion.
T comme TABLEAU DE BORD
Tableau de bord quilibr ( balanced scoreboard )
Les outils traditionnels du reporting financier sont complts par
une nouvelle catgorie de tableaux de bord ( balanced
scoreboards ). Ils recensent les informations recueillies le plus rapidement possible et correspondant le mieux aux proccupations des
responsables oprationnels.
26
ditions dOrganisation
Se rfrer des notions de base utiles
volutions actuelles
Leur laboration a t rendue possible par les progrs de
linformatique de gestion qui produit et labore des donnes
quasiment en temps rel. Les indicateurs retenus sont quantitatifs et qualitatifs et ne se rsument pas aux donnes
comptables traditionnelles. Leur interprtation doit, le plus
souvent possible, tre dnue dambiguts et leur calcul
exempt, si possible, de biais. Les indicateurs doivent tre fiables dans le temps et construits partir de donnes faciles
obtenir. Dans lidal, les indicateurs doivent tre pertinents,
contrlables, objectifs et simples. Les indicateurs effectivement disponibles ne recouvrent pas toujours ceux qui
seraient souhaitables dobtenir, voire napprhendent que
partiellement les ralits dont ils sont supposs rendre
compte.
La nouvelle gnration de tableaux de bord, les balanced
scoreboards , a t dveloppe par Kaplan et Norton en
1992. Elle comprend quatre orientations :
1. les rsultats financiers ;
2. les indicateurs de satisfaction des clients ;
3. les possibilits damlioration des processus internes ;
4. les perspectives dapprentissage et daccroissement des
comptences individuelles et collectives.
Ils sont construits partir de la dfinition des missions et des
performances de lentreprise, de lidentification des variables
ou des leviers daction et de llaboration dindicateurs refltant les objectifs et les variables daction.
Les diffrentes catgories sont lies entre elles par une
chane de causalit, la catgorie financire tant considre
comme lobjectif final. Les indicateurs peuvent, par ailleurs,
ditions dOrganisation
27
Gestion budgtaire
recouvrir dautres domaines que ceux strictement concerns
par lactivit de lentreprise, comme les donnes sociales ou
environnementales.
Lattractivit de ces tableaux de bord quilibrs rside
dans le fait quils combinent les approches financires traditionnelles et les approches plus oprationnelles. Toutefois,
les tableaux de bord prsentent de manire synthtique et
ractive les donnes essentielles au pilotage de lentreprise
ou dun centre de responsabilit. Ils structurent la masse des
donnes disponibles et slectionnent les informations effectivement pertinentes.
2. La comptabilit de gestion : quelles notions ?
A comme AFFECTATION
Affectation
Inscription sans calcul intermdiaire dune charge un compte de
cot ou, sans rpartition pralable, des centres danalyse.
C comme CENTRE, CHARGES et COTS
Centre danalyse
Centre o sont analyss des lments de charges indirectes pralablement leur imputation aux cots des produits concerns.
Charges directes (ou frais directs)
Charges quil est possible daffecter sans calcul intermdiaire au cot
dun produit dtermin.
28
ditions dOrganisation
Se rfrer des notions de base utiles
Charges incorporables
Charges dont la direction estime quelles doivent tre prises en
compte pour le calcul des cots.
Charges indirectes
Charges ncessitant un calcul intermdiaire pour tre imputes au
cot dun produit dtermin.
Charges oprationnelles
Charges lies au fonctionnement courant de lentreprise et donc
gnralement variables avec son niveau dactivit.
Charges de structure
Charges lies lexistence de lentreprise et correspondant une
capacit de production dtermine (et donc fixes court terme).
Cot
Somme des charges relatives un lment dfini au sein de lorganisation comptable. Un cot se dfinit par son objet (produit, service), son primtre (ensemble des charges retenues pour le calculer)
et son moment de calcul (cot prtabli et cot constat). Compte
tenu des paramtres qui entrent dans sa dfinition, un cot est plus
une opinion quune mesure objective.
Cot complet (ou cot de revient)
Cot constitu par la totalit des charges qui peuvent lui tre rapportes par toute dmarche analytique choisie.
Cot direct
Cot constitu par les charges qui lui sont directement rattaches
(charges oprationnelles ou variables) et par les charges qui peuvent
lui tre rattaches sans ambigut.
ditions dOrganisation
29
Gestion budgtaire
Cot marginal
Cot constitu par la diffrence entre lensemble des charges
ncessaires pour la production dune quantit donne et lensemble
des charges ncessaires pour la production de cette mme quantit
majore dune unit.
Cot prtabli
Cot valu ex ante pour tablir des documents prvisionnels. Ils
sont utiliss pour le calcul des carts.
Cot variable
Cot constitu seulement par les charges qui varient en fonction du
niveau de lactivit de lentreprise (sans pour autant quil y ait
ncessairement une exacte proportionnalit).
E comme CART
cart
Diffrence entre une norme de rfrence et une grandeur calcule
partir de donnes rellement constates.
I comme IMPUTATION
Imputation
Inscription des cots des centres danalyse aux cots des produits
proportionnellement aux units duvre des centres correspondant
ces produits. Limputation est dite rationnelle lorsque la part des
charges fixes est calcule par rapport un niveau dactivit pralablement dfini comme normal.
30
ditions dOrganisation
Se rfrer des notions de base utiles
M comme MARGE
Marge
Diffrence entre un prix de vente et un cot (marge sur cot
dachat, marge sur cot variable, marge sur cot de production,
marge sur cot direct ou marge sur cot complet, dite marge contributive).
P comme POINT MORT, PRIX et PRODUCTIVIT
Point mort (ou seuil de rentabilit)
Niveau de production qui dgage une marge sur cots variables
gale aux charges fixes. Ce niveau de production est celui partir
duquel lactivit de lentreprise devient bnficiaire.
Prix
Le terme prix se rfre aux transactions dune entreprise avec des
entits juridiques qui lui sont extrieures. Les transactions entre services dune mme entreprise sont factures un prix de cession
interne. Lorsque des transactions sont conclues entre des socits
appartenant un mme groupe, la question se pose de savoir si ces
transactions sont valorises sur la base de prix de march ou sur la
base de standards fixs au sein du groupe.
Productivit
Rapport entre une production et un facteur de production. Il est de
prfrence exprim en unit montaire. Le terme de rendement
exprime galement le rapport entre une production et un facteur de
production. Il est de prfrence exprim en unit physique.
ditions dOrganisation
31
Gestion budgtaire
R comme RPARTITION et RSULTAT
Rpartition
Classement des charges visant leur inscription dans les centres
danalyse : ces charges ne peuvent pas tre affectes autrement faute
de possibilit de rattachement direct une unit duvre. Une
rpartition seffectue laide dune cl de rpartition fonde sur un
raisonnement technique, statistique ou conomique.
Rsultat
Diffrence entre un prix de vente et le cot de revient complet pour
un bien ou un service.
S comme STANDARD
Standard
Norme de cot prvisionnel calcule analytiquement ou statistiquement constituant un objectif atteindre ou une valeur de rfrence
utilise pour tablir les comparaisons avec les donnes effectivement
constates.
U comme UNIT DUVRE
Unit duvre
Unit de mesure dans un centre danalyse (heure machine, heure de
travail, unit de fourniture travaille, unit montaire comme un
cot ou un chiffre daffaires).
32
ditions dOrganisation
Se rfrer des notions de base utiles
3. La stratgie : quelles notions ?
C comme CHANE DE VALEUR
Chane de valeur
Reprsentation de lentreprise sous forme dune srie de fonctions
ajoutant successivement de la valeur aux biens et aux services quelle
produit. Cette valeur ajoute doit tre normalement estime sur la
base de prix de march.
volutions actuelles
Lanalyse en termes de chane de valeur a conduit au dveloppement de la sous-traitance et de lexternalisation des
fonctions auxiliaires ou logistiques de lentreprise (stratgie
dimpartition). Pour chaque fonction, lentreprise doit se
demander sil lui est prfrable de remplir cette fonction en
interne ou bien dacheter le produit ou la prestation de
service un fournisseur extrieur.
E comme TALONNAGE
talonnage comparatif ( benchmarking ) ou parangonnage
Positionnement dune entreprise ou dun centre danalyse stratgique obtenu en comparant ses performances mesures par des indicateurs celles dentits similaires pour lesquelles les mmes
indicateurs ont t calculs. Ltalonnage comparatif est une analyse
des meilleures pratiques, puis, une fois celles-ci identifies, elles doivent faire normalement lobjet dune transplantation au sein de
lorganisation qui cherche amliorer ses performances.
ditions dOrganisation
33
Gestion budgtaire
Ltalonnage comparatif interne sert comparer les performances des entits appartenant la mme organisation. Dans ce cas,
la direction peut facilement avoir accs aux informations requises.
Ltalonnage fonctionnel sert comparer les performances de
services fonctionnels de diffrentes entreprises. Le recours des
cabinets de consultants ayant une connaissance approfondie des
pratiques de ces entreprises est souvent une ncessit pour acqurir les informations convoites.
Ltalonnage concurrentiel consiste comparer les performances
de lentreprise celles de ses concurrents directs. Dans ce cas, il
est assimilable une tude de positionnement stratgique.
G comme GESTION
Gestion par projets
Structure organisationnelle transversale mise en place temporairement afin de rsoudre un problme en combinant des ressources
issues de structures fonctionnelles et oprationnelles diffrentes.
volutions actuelles
Cette nouvelle configuration organisationnelle permet de
coordonner de manire plus rapide et plus efficace des ressources provenant des divisions et des fonctions distinctes au
sein de lentreprise. Ce type de structure nest rellement
efficient que sil poursuit un objectif clairement identifi et sil
est soumis des contraintes clairement explicites (horizon
temporel de ralisation du projet, niveaux des cots et de la
qualit atteindre, niveau de confidentialit de la mission,
recours possible ou non des partenaires extrieurs).
34
ditions dOrganisation
Se rfrer des notions de base utiles
Le pilotage et le contrle des projets supposent la mise en uvre de
mthodes diffrentes de celles applicables aux processus rcurrents
ou routiniers. Ces structures adhocratiques ne doivent normalement se maintenir que pendant la dure de leur mission.
Gestion de la qualit totale ( total quality management )
Systme de gestion organis afin dobtenir un niveau optimal de
qualit. Les standards de qualit ont t spcifis dans des normes
ISO. Lhomologation des produits et des services voire des systmes de production est devenue quasiment une obligation pour les
entreprises pour quelles soient autorises soumissionner la plupart des appels doffres publics et privs.
P comme PLANIFICATION STRATGIQUE
Planification et gestion budgtaire
La stratgie est concrtise par la rdaction dun plan stratgique
ayant un horizon de trois cinq annes. La planification stratgique
consiste en la projection dans lavenir de lentreprise, tant en ce qui
concerne son positionnement concurrentiel que les caractristiques
intrinsques de son mtier.
Critiques
Les critiques relatives la planification portent sur sa rigidit
(elle nuirait la ractivit), sur son formalisme (elle servirait
lgitimer les dcisions dj prises et non anticiper les volutions de lenvironnement) et sur le cloisonnement entre les
diffrentes fonctions quelle renforcerait.
ditions dOrganisation
35
Gestion budgtaire
Le budget est lexpression conomique des plans daction pour
lanne venir afin dallouer les moyens ncessaires pour atteindre
les objectifs fixs. Chaque centre de dcisions se voit assign des
objectifs cohrents avec les objectifs globaux de lentreprise, desquels dcoule thoriquement son budget. Les budgets sont construits la fois selon une logique hirarchique, une logique
fonctionnelle et une approche par projets (le croisement des logiques horizontales et verticales pouvant conduire des budgets
matriciels). Les budgets sont normalement rvisables pour tenir
compte des volutions environnementales non anticipes et survenues au cours de lexercice.
Le schma idal darticulation entre les budgets et le plan correspond une approche rationnelle et hirarchique de la gestion
dentreprise.
La planification stratgique procde une quantification globale
et indicative des objectifs cibls.
La planification oprationnelle comprend des plans daction et
des objectifs dactivit quantifis de manire globale.
Le budget est la traduction annualise des activits prvues par la
planification oprationnelle. Les documents de synthse budgtaire sont ceux dont le degr de dtail et de prcision est le plus
lev.
Critiques
Cette approche assimile implicitement lentreprise un
homo economicus omniscient, rationnel et cherchant
maximiser ses intrts court et long terme. Elle passe
sous silence les autres dimensions qui caractrisent tout
ensemble humain organis.
36
ditions dOrganisation
Se rfrer des notions de base utiles
Les incertitudes majeures sont relatives lavenir. Les volutions
environnementales sont difficiles anticiper et les vnements
alatoires sont imprvisibles par essence. Toute stratgie dentreprise est une dialectique entre le volontarisme conomique et la
prise en considration des contraintes qui agissent en permanence comme un rappel au principe de ralit.
La structure des organisations rside principalement dans les
procdures administratives et dans les systmes dinformation
qui en constituent lossature. Ceux-ci ont leur logique propre de
fonctionnement qui peut parfois entrer en contradiction avec la
logique stratgique. Lide selon laquelle il existe une harmonie
naturelle et une cohrence qui va de soi entre les processus budgtaires et les autres processus en action au sein de lentreprise
(en particulier le processus stratgique) est un postulat idaliste.
Chaque strate hirarchique est porteuse dobjectifs qui ne se confondent pas ncessairement avec les objectifs poursuivis par
lorganisation (pour autant quelle soit en mesure de les formuler
explicitement).
Toute organisation est un ensemble humain organis dans
laquelle les ressources rares (positions de pouvoir, ressources, gratifications matrielles et symboliques) font lobjet dune concurrence pre pour leur appropriation. Elle est galement
caractrise par une culture, ensemble des valeurs et des normes
implicites qui structure son identit. Il serait erron de qualifier
la culture organisationnelle, de part maudite , de part irrductible de lirrationnel propre tout comportement individuel ou
collectif. Il convient en revanche de comprendre les rationalits
multiples qui surdterminent les comportements individuels et
collectifs.
ditions dOrganisation
37
Gestion budgtaire
R comme RINGNIERIE
Processus de ringnierie
( reengineering , downsizing , streamlining )
Restructuration en profondeur des processus fondamentaux de
lentreprise afin dobtenir des augmentations significatives court
terme de ses performances. Ce terme a dsign le processus de restructuration radicale auquel les entreprises amricaines ont t confrontes au dbut de la dcennie 90. La rorganisation de leurs
modes de fonctionnement est la consquence directe de la mise en
rseau gnralise des diffrents postes de travail et a favoris un
accroissement des gains de productivit gnrs par les techniques
de linformation et de la concurrence.
Dune certaine manire, le reegineering consiste transposer au
niveau des fonctions administratives les mthodes dorganisation
industrielle rendues possibles par les applications de linformatique
industrielle aux processus de production (rduction massive des
dlais de production et de stockage, optimisation de la logistique,
amlioration de la qualit et diversification de la production).
Le contrle de gestion, pour sa part, cherche une amlioration des
performances dans le cadre des structures et des processus existants.
Ses propositions damlioration visent accrotre les performances
de lentreprise de manire incrmentale, cest--dire de manire
progressive, en nexcluant pas de procder des tests et de renoncer
des mesures si elles devaient savrer inoprantes ou contreproductives.
38
ditions dOrganisation
Se rfrer des notions de base utiles
S comme SLACK
Slack organisationnel ( jeu caractrisant un systme
mcanique ou mou dans une corde)
Ressources non ncessaires la ralisation des objectifs de lentreprise qui sont demandes par les gestionnaires de centres de responsabilits ou par les oprationnels pour disposer dans leurs budgets
de ressources excdentaires permettant damortir les chocs imprvus
ou de faire face aux vnements fortuits.
Le terme est emprunt la mcanique : un systme mcanique qui
na pas de jeu , est compltement asservi et est souvent paralys.
Il a besoin dune marge de libert pour pouvoir remplir les fonctions pour lesquelles il a t conu, et cela de manire optimale et
durable.
S comme STRUCTURE en rseau
N-forme ( network-form )
Structure en rseau sopposant la structure multidivisionnelle (Mforme). Lentreprise mono-activit est structure selon le principe de
spcialisation fonctionnelle. Ds quune entreprise se diversifie, elle
adopte une structure divisionnelle (la spcialisation soprant alors
le plus souvent par lignes de produits). La structure matricielle est la
synthse des structures divisionnelles et fonctionnelles.
La forme en rseau caractrise les entreprises se structurant linstar
de leur systme informatique et dont les units lmentaires sont
relies par les flux dinformations et de biens matriels quelles
changent.
ditions dOrganisation
39
Vous aimerez peut-être aussi
- Louis Althusser Etre Marxiste en Philosophie 1Document348 pagesLouis Althusser Etre Marxiste en Philosophie 1Conall Cash100% (3)
- La LA GESTION COOPERATIVE - THEORIE ET PRATIQUE: De la spécificité à l’avantage concurrentiel - Émergence d’un nouveau paradigmeD'EverandLa LA GESTION COOPERATIVE - THEORIE ET PRATIQUE: De la spécificité à l’avantage concurrentiel - Émergence d’un nouveau paradigmePas encore d'évaluation
- Contrôle et évaluation de la gestion publique: Enjeux contemporains et comparaisons internationalesD'EverandContrôle et évaluation de la gestion publique: Enjeux contemporains et comparaisons internationalesÉvaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)
- Contrôle de GestionAMLDocument48 pagesContrôle de GestionAMLsalah eddine100% (1)
- Métier de gestionnaire public: Nouveaux rôles, nouvelles fonctions, nouveaux profilsD'EverandMétier de gestionnaire public: Nouveaux rôles, nouvelles fonctions, nouveaux profilsPas encore d'évaluation
- L'effet de Levier PDFDocument19 pagesL'effet de Levier PDFMaNoBeCkSaIdibeckPas encore d'évaluation
- Statistique - Exploratoire - Multidimensionnelle - Lebart - Morineau - Piron PDFDocument456 pagesStatistique - Exploratoire - Multidimensionnelle - Lebart - Morineau - Piron PDFarnoldwiya100% (1)
- Analyse Des Écarts-2Document14 pagesAnalyse Des Écarts-2Jamal MeddadPas encore d'évaluation
- Foucault - Dits Et Écrits (Sommaire Général)Document11 pagesFoucault - Dits Et Écrits (Sommaire Général)SontinettePas encore d'évaluation
- Traité de gestion de portefeuille, 5e édition actualisée: Titres à revenu fixe et produits structurés - Avec applications Excel (Visual Basic)D'EverandTraité de gestion de portefeuille, 5e édition actualisée: Titres à revenu fixe et produits structurés - Avec applications Excel (Visual Basic)Pas encore d'évaluation
- Budget public et performance: Introduction à la budgétisation axée sur les résultatsD'EverandBudget public et performance: Introduction à la budgétisation axée sur les résultatsPas encore d'évaluation
- Abc AbmDocument49 pagesAbc AbmOthmane MaaroufiPas encore d'évaluation
- Algèbre de BanachDocument25 pagesAlgèbre de Banachahmado35641Pas encore d'évaluation
- AstrologieDocument9 pagesAstrologieabdoul7Pas encore d'évaluation
- Cours n°1-LP Controle de GestionDocument25 pagesCours n°1-LP Controle de GestionMouna KhamalPas encore d'évaluation
- L'OCDE face aux défis de la mondialisation: Organisation de coopération et de développement économiquesD'EverandL'OCDE face aux défis de la mondialisation: Organisation de coopération et de développement économiquesPas encore d'évaluation
- Analyse Des Écarts 1Document219 pagesAnalyse Des Écarts 1Zakaria EssalihiPas encore d'évaluation
- L - Efficacité Du Contrôle Budgétaire.Document75 pagesL - Efficacité Du Contrôle Budgétaire.Younes U-nés Benchaira50% (2)
- La Méthode BudgétaireDocument147 pagesLa Méthode BudgétaireMustapha MektanPas encore d'évaluation
- Controle de GestionDocument38 pagesControle de GestionWalidHachoum0% (1)
- Conrole de Gestion Et Gestion Budgetaire-1Document166 pagesConrole de Gestion Et Gestion Budgetaire-1LamssarbiPas encore d'évaluation
- Université My IsmailDocument52 pagesUniversité My IsmailZakia Ait Oufkir100% (1)
- Le Contrôle de Gestion 2020Document314 pagesLe Contrôle de Gestion 2020Moad Em100% (2)
- Dynamique Des Structures ENPCDocument225 pagesDynamique Des Structures ENPCLyes AlgerianoPas encore d'évaluation
- Gestion Budgetaire Et Previsionnelle 2 PDFDocument48 pagesGestion Budgetaire Et Previsionnelle 2 PDFAmine KhalilPas encore d'évaluation
- Cours Contrôle BudgétaireDocument81 pagesCours Contrôle BudgétaireIMANE ENNAJYPas encore d'évaluation
- Le Rolling Forecast - Une Meilleure Alternative Au Budget TraditionnelDocument13 pagesLe Rolling Forecast - Une Meilleure Alternative Au Budget Traditionnelwal100% (1)
- Contrôle BudgétaireDocument12 pagesContrôle BudgétaireRafik LebridePas encore d'évaluation
- La collaboration interorganisationnelle: Conditions, retombées et perspectives en contexte publicD'EverandLa collaboration interorganisationnelle: Conditions, retombées et perspectives en contexte publicPas encore d'évaluation
- 1 Introduction Au Contrôle BudgétaireDocument11 pages1 Introduction Au Contrôle Budgétaireyassir baihaiPas encore d'évaluation
- Dossier La Violence Et Le Sacré René GirardDocument7 pagesDossier La Violence Et Le Sacré René GirardRobert LamothePas encore d'évaluation
- La Gestion BudgétaireDocument33 pagesLa Gestion BudgétaireYassineSadllerPas encore d'évaluation
- Controle Budgetaire..Document2 pagesControle Budgetaire..Lynda AdnylPas encore d'évaluation
- Analyse Des ÉcartsDocument7 pagesAnalyse Des ÉcartsarshakunisPas encore d'évaluation
- Cours Adaptation Du Controle de Gestion - DoxDocument99 pagesCours Adaptation Du Controle de Gestion - DoxMohamed DeraPas encore d'évaluation
- Gestion Budgétaire M LOTFIDocument76 pagesGestion Budgétaire M LOTFIAchraf Gaîzi100% (1)
- Contrôle BudgétaireDocument27 pagesContrôle BudgétaireSami ElbadriPas encore d'évaluation
- S6 Cours N°1 Contrôle de Gestion Et Gestion BudgétaireDocument21 pagesS6 Cours N°1 Contrôle de Gestion Et Gestion BudgétaireSoufiane RiyadPas encore d'évaluation
- Cours Magistral Du Contrôle de Gestion. LoulidDocument91 pagesCours Magistral Du Contrôle de Gestion. LoulidNoure DdinePas encore d'évaluation
- Contrôle de Gestion Analyse Des ÉcartsDocument7 pagesContrôle de Gestion Analyse Des ÉcartsRomaniPas encore d'évaluation
- Cours: Budget Des VentesDocument7 pagesCours: Budget Des VentesopenPas encore d'évaluation
- Cours Controle Degestion FGHNDocument106 pagesCours Controle Degestion FGHNSahbi DkhiliPas encore d'évaluation
- Les Spécificités Du Contrôle de Gestion Public - SihamDocument6 pagesLes Spécificités Du Contrôle de Gestion Public - SihamTaha HejjajPas encore d'évaluation
- contrأ´le de gestionDocument23 pagescontrأ´le de gestionmaryem22100% (1)
- GESTION SANS BUDGET-BerlandDocument18 pagesGESTION SANS BUDGET-BerlandmekdisPas encore d'évaluation
- Leçon N°9 - Les Coûts Variables Et Le Seuil de RentabilitéDocument9 pagesLeçon N°9 - Les Coûts Variables Et Le Seuil de RentabilitéZury84Pas encore d'évaluation
- Articulation BudgétaireDocument3 pagesArticulation Budgétairenohahlm100% (3)
- Budget Des VenteDocument18 pagesBudget Des VenteAkram ChebliPas encore d'évaluation
- #EP 1 Control de GestionDocument10 pages#EP 1 Control de GestionHasnae Ziko100% (1)
- Budget D - Approvisionnement PDFDocument17 pagesBudget D - Approvisionnement PDFHasna KhiZouPas encore d'évaluation
- Le Rôle de La Gestion Budgétaire Dans La Performance de L'entreprise Cas: Générale EmballageDocument177 pagesLe Rôle de La Gestion Budgétaire Dans La Performance de L'entreprise Cas: Générale EmballageImad SouiniPas encore d'évaluation
- SYNTHESE Faut Il Tuer Le Budget 3 TRAVAIL FINAL 4Document12 pagesSYNTHESE Faut Il Tuer Le Budget 3 TRAVAIL FINAL 4Anas HPas encore d'évaluation
- Chapitre 3Document42 pagesChapitre 3oussamaguennounnPas encore d'évaluation
- Determinants Valeur ActionnarialeDocument260 pagesDeterminants Valeur ActionnarialefarahPas encore d'évaluation
- Analyse Des ÉcartsDocument1 pageAnalyse Des ÉcartsAhmed MarmaghPas encore d'évaluation
- Controle de GestionDocument99 pagesControle de GestionJOPas encore d'évaluation
- La Gestion BudgétaireDocument13 pagesLa Gestion BudgétairewayPas encore d'évaluation
- Cours Analyse Financière PDFDocument27 pagesCours Analyse Financière PDFaminhinioPas encore d'évaluation
- Mini Projet Controle de Gestion 2Document31 pagesMini Projet Controle de Gestion 2Youssef Daifi50% (2)
- La passation et l'exécution des marchés publics: Secteurs classiques et spéciauxD'EverandLa passation et l'exécution des marchés publics: Secteurs classiques et spéciauxPas encore d'évaluation
- L'alena et le Mercosul - Volume 1: impacts du régionalisme économique de seconde génération sur les mouvements sociaux et les dynamiques des agriculteursD'EverandL'alena et le Mercosul - Volume 1: impacts du régionalisme économique de seconde génération sur les mouvements sociaux et les dynamiques des agriculteursPas encore d'évaluation
- Controle de GestionDocument4 pagesControle de GestionNajlae AadadPas encore d'évaluation
- Prepa Controle BudgetaireDocument9 pagesPrepa Controle Budgetairesaid nmirowaPas encore d'évaluation
- Contrôle Gestion BOUGHNONDocument99 pagesContrôle Gestion BOUGHNONIkram LAKHDARPas encore d'évaluation
- Théologie de Platon PDFDocument7 pagesThéologie de Platon PDFLycophronPas encore d'évaluation
- Mémoire Finale.Document82 pagesMémoire Finale.Bachir Bchiri50% (2)
- Pciv - DST 4 - CorrigesDocument16 pagesPciv - DST 4 - CorrigesAssociation-adac Adac SenPas encore d'évaluation
- 1 La Figure Du Puzzle Dans LVMEDocument12 pages1 La Figure Du Puzzle Dans LVMEGwen MielPas encore d'évaluation
- VyMf PDFDocument3 pagesVyMf PDFBELSPas encore d'évaluation
- Abensour 1991 Penser L'utopie AutrementDocument19 pagesAbensour 1991 Penser L'utopie AutrementhobowoPas encore d'évaluation
- Reclams de Biarn e Gascounhe. - Deceme 1897 - N°6 (1re Anade)Document32 pagesReclams de Biarn e Gascounhe. - Deceme 1897 - N°6 (1re Anade)Occitanica Médiathèque Numérique OccitanePas encore d'évaluation
- Jacques Lacan L'etourdit 1972Document30 pagesJacques Lacan L'etourdit 1972zgrounchPas encore d'évaluation
- L'Agression TableDocument8 pagesL'Agression TableVincentN'GbessoPas encore d'évaluation
- Serie D'exercices Corrigés - Math - Continuité Et Limites - 3ème Math (2009-2010)Document7 pagesSerie D'exercices Corrigés - Math - Continuité Et Limites - 3ème Math (2009-2010)akremmel100% (1)
- Suites NumériquesDocument25 pagesSuites NumériquesAyoub TalibiPas encore d'évaluation
- MATHDocument5 pagesMATHEloquence WordsPas encore d'évaluation
- La Modélisation en Sciences PhysiquesDocument15 pagesLa Modélisation en Sciences PhysiquesYoussef AouadiPas encore d'évaluation