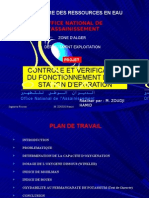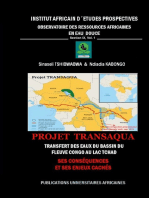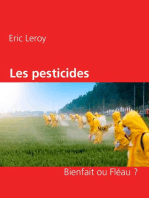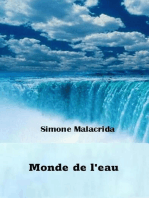Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Traitement Des Eaux Usées Urbaines
Transféré par
Amine AdjaoudCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Traitement Des Eaux Usées Urbaines
Transféré par
Amine AdjaoudDroits d'auteur :
Formats disponibles
TRAITEMENT
DES EAUX USEES
URBAINES
Mai 2002
SOMMAIRE
Pages
Chapitre 1
Le rle des institutions et les politiques en matire deau 2 15
Chapitre 2
Rglementation concernant les ouvrages de collecte,
Les ouvrages de traitement et les dchets 16 54
Chapitre 3
Schma directeur dassainissement 55 81
Chapitre 4
Procdures administratives et techniques pour la
construction dune station de traitement des eaux uses 82 94
Chapitre 5
Mission dingenierie 95 98
Chapitre 6
Gnralits sur les techniques de lassainissement 99 139
Chapitre 7
Prsentation des divers lments des filires de traitement des eaux uses 140 165
Chapitre 8
Prtraitement 166 184
Chapitre 9
Traitement de lazote et du phosphore 185 200
Chapitre 10
Les cultures fixes en traitement deaux rsiduaires 201 218
Chapitre 11
Les lits bactriens 219 236
Chapitre 12
Le lagunage 237 254
SOMMAIRE
Pages
Chapitre 13
Les lits filtrants plants de roseaux 255 264
Chapitre 14
Les technologies de dsinfection des eaux uses 265 284
Chapitre 15
Conditionnement et traitement des boues 285 328
Chapitre 16
Les boues rsiduaires urbaines-volution de la production
et avenir des diffrentes filires dvacuation 329 356
Chapitre 17
Vers une nouvelle gnration de procds de traitement
Biologique des boues rsiduaires urbaines 357 370
Chapitre 18
Contrle centralis et automatismes 371 394
Chapitre 19
Les cots dexploitation du traitement des eaux uses 395 406
Chapitre 20
Glossaire eau & assainissement 407 428
Chapitre 21
Mthode de calcul dune filire de traitement 429 524
Chapitre 1
LE ROLE DES INSTITUTIONS
ET LES POLITIQUES EN MATIERE
DEAU
A. SADOWSKI
Page 2 - Le rle des institutions et les politiques en matire deau
SOMMAIRE
I. FINALITE D'UNE POLITIQUE DE L'EAU ................................................................ 3
II. LES ACTEURS DE LA POLITIQUE DE L'EAU....................................................... 3
II.1. LA C.E.E.......................................................................................................................... 3
II.2. L'ETAT............................................................................................................................. 3
II.2.1. Organisation de l'Etat au niveau national ............................................................... 4
II.2.2. Organisation de l'Etat au niveau du bassin............................................................. 5
II.2.3. Organisation de l'Etat au niveau de la Rgion........................................................ 5
II.2.4. Organisation de l'Etat au niveau du dpartement ................................................... 6
II.3. LES ORGANISATIONS DE BASSIN....................................................................................... 9
II.4. L'ORGANISATION COMMUNALE. ..................................................................................... 10
II.5. LES AUTRES ACTEURS .................................................................................................... 11
III. LES POLITIQUES DE L'EAU.................................................................................. 11
III.1. UNE POLITIQUE DAMENAGEMENT DU TERRITOIRE....................................................... 11
III.1.1. Schma rgional d'amnagement des eaux .......................................................... 11
III.1.2. Le schma dpartemental de vocation piscicole et halieutique ........................... 11
III.2. UNE POLITIQUE FINANCIERE ......................................................................................... 12
III.2.1. Les taxations et redevances .................................................................................. 12
III.2.2. Les aides financires............................................................................................. 12
III.2.3. Autofinancement ................................................................................................... 12
III.3. LES POLITIQUES DENVIRONNEMENT ............................................................................ 12
IV. POLITIQUES SPECIALISEES (POUR MEMOIRE)............................................. 13
IV.1. LES EAUX PLUVIALES (DECRET DU 23.02.1973) ET LES EAUX USEES............................ 13
IV.2. LES EAUX DE CONSOMMATION HUMAINE...................................................................... 13
IV.3. LA POLITIQUE DAMENAGEMENT ET DE GESTION DES RIVIERES (SAGEECE).............. 13
IV.4. LES EAUX DE LOISIRS.................................................................................................... 13
IV.5. LES NAPPES ET GRAVIERES ........................................................................................... 13
IV.6. LES ZONES HUMIDES..................................................................................................... 13
IV.7. LES VOIES NAVIGABLES................................................................................................ 13
IV.8. L'URBANISME ............................................................................................................... 13
GLOSSAIRE....................................................................................................................... 14
Page 3 - Chapitre 1
I. FINALITE D'UNE POLITIQUE DE L'EAU
Toutes les politiques de l'eau satisfont des finalits pouvant tre regroupes en trois
grandes catgories :
Sant-Scurit : il est ncessaire de prserver la sant des personnes (qualit, ...)
et protger leurs biens (inondations, ...).
Eau utile : l'eau et l'environnement sont utiliss pour satisfaire des besoins varis :
transport, nergie, loisirs, AEP, assainissement, pche, dilution de polluants, ...
Ecosystme aquatique et patrimoine : l'eau s'intgre dans un systme vivant et
complexe qu'il faut la fois prserver, utiliser et ventuellement rhabiliter.
Il y a lieu de dfinir un quilibre entre ces trois finalits qui sont relativement
contradictoires.
II. LES ACTEURS DE LA POLITIQUE DE L'EAU
II.1. LA C.E.E.
D'o manent aides financires et directives, dont la plus rcente n 91/271 du 21.05.1991
relative au traitement des eaux urbaines rsiduaires.
Depuis l'acte unique de 1986, une politique globale de l'environnement est en cours de
dfinition. Elle aura prochainement des rpercussions multiples sur la loi et rglementation
nationale.
II.2. L'ETAT
L'Etat est l'origine de lois et codes divers (code rural, code de la sant, code de
l'urbanisme, code des communes, loi sur l'eau, loi pche, lois de dcentralisation, de
protection de la nature)et de textes spcialiss et est source de financements directs et
indirects.
L'intervention de l'Etat en matire de politique et de police des eaux s'appuie
essentiellement sur la loi sur l'Eau (Loi du 16.12.1964 et loi du 03.01.1992) et la loi Pche
(Circulaire n 86.3 du 31.01.1986 en application de l'article 407 du code rural rsultant de la
loi du 29.06.84 non parue au journal officiel). Ce dernier article, qui faisait jusqu'alors
rfrence en matire de protection du milieu naturel, est repris et largi dans la nouvelle loi
sur l'Eau.
Le dcret n 87.154 du 27.02.1987 et la circulaire n 87.91 du 18.11.1987 relatifs la
coordination interministrielle et l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau
prcisent l'action de chaque service au niveau de chaque chelon :
le bassin;
la rgion;
le dpartement.
Page 4 - Le rle des institutions et les politiques en matire deau
II.2.1. Organisation de l'Etat au niveau national
II.2.1.1. Le Comit Interministriel de la Qualit de la Vie
Le comit examine outre les questions en matire d'environnement et de qualit de la vie,
les questions ncessitant une coordination interministrielle en matire d'eau.
Le ministre charg de l'environnement assure, par dlgation du premier ministre, la
coordination entre les ministres intervenant dans le domaine de l'eau, prpare les
dlibrations et suit l'excution des dcisions par les ministres concerns.
II.2.1.2. La Mission Interministrielle de l'Eau
Sous la prsidence du ministre charg de l'environnement, elle runit priodiquement les
reprsentants des ministres suivants :
de lEquipement et du logement, de lAmnagement du Territoire, des Transports, de
l'Economie et des Finances, des Affaires Etrangres, de la Dfense, de l'Intrieur, de
l'Agriculture, du Plan, de l'Industrie, du Tourisme, de la Sant et de la Mer.
Cette mission donne son avis au ministre charg de l'environnement sur les programmes
d'investissement et la rpartition des ressources et moyens, en particulier celle des crdits
affects l'eau, inscrire au budget des divers dpartements interministriels.
La mission examine l'ensemble des projets de directives, lois, dcrets, ... et peut donner
son avis sur toute question que lui soumettra le ministre charg de l'environnement. Les
travaux sont prpars par la mission interministrielle dlgue compose de fonctionnaires
des ministres concerns.
II.2.1.3. Le Comit National de l'Eau
Cr par la loi du 16.12.1964, ce comit est un organe consultatif, donnant son avis sur
tous les projets d'amnagement et de rpartition des eaux ayant un caractre national, sur
les grands amnagements rgionaux et sur les problmes communs plusieurs comits de
bassin.
II.2.1.4. Le Conseil Suprieur d'Hygine Publique
Plac auprs du ministre de la sant, il dlibre sur les questions intressant l'hygine
publique et la protection de la sant publique. Il peut tre saisi de tous projets
d'assainissement la demande d'un prfet intress. Sur certains projets d'assainissement,
sa consultation est obligatoire.
II.2.1.5. Autres organismes
Le ministre charg de l'environnement est responsable de la police des eaux et de la
gestion des eaux par l'intermdiaire du prfet de dpartement et des services extrieurs mis
sa disposition.
Page 5 - Chapitre 1
Pour l'exercice des missions, le ministre charg de l'environnement dispose d'une
"Direction de l'eau et de la prvention des pollutions et des risques", charge :
du secrtariat de la mission interministrielle;
de la protection, de la police et de la gestion des eaux (souterraines et superficielles);
de la protection des eaux marines;
de la prvention des inondations, des pollutions et des risques (activits industrielles
et agricoles);
de l'laboration des rgles relatives aux installations classes.
II.2.2. Organisation de l'Etat au niveau du bassin
La coordination des actions de l'Etat est assure par le Prfet Coordonateur de Bassin
(cr par application de la loi du 16.12.1964) en matire de police et de gestion des
ressources en eau, ainsi que pour l'laboration des schmas d'amnagement des eaux, des
cartes d'objectifs de qualit et des schmas dpartementaux de vocation piscicole. Il a pour
mission d'assurer la cohrence et l'homognit des dcisions concernant le bassin.
Il est prsident de la Mission Dlgue du Bassin (Dcret du 5.4.1968) et assure le
secrtariat du Comit de Bassin. Il a sous son autorit directe la Dlgu de Bassin qui,
l'aide d'une quip lgre et du Service Hydrologique Centralisateur, assure ou coordonne
les actions techniques suivantes communes l'ensemble du bassin :
recueil et exploitation des donnes sur les ressources en eaux superficielles et
souterraines (dbit, qualit des eaux) et sur la connaissance du milieu, de la faune et
de la flore utile la vie aquatique et la mise en valeur piscicole;
tudes particulires du bassin relatives au rgime, la gestion, la rpartition des
ressources en eau, la qualit, l'annonce des crues ou la dfense contre les
inondations;
mission de conseil auprs des services extrieurs de l'Etat dans ces domaines;
rapporteur devant la mission dlgue de bassin des projets d'autorisation relevant
de la police des eaux qui lui sont soumis en application des textes rglementaires.
II.2.3. Organisation de l'Etat au niveau de la Rgion
Le prfet de rgion dirige les actions de l'Etat dans le domaine de l'eau et coordonne les
services de l'Etat dans le cadre d'actions dpassant le cadre dpartemental et cela sans
avoir un pouvoir rglementaire explicite en matire de police des eaux, de police de la pche
et de gestion des ressources en eau.
Il participe aux runions de la Mission Dlgue de Bassin. Il dispose pour l'exercice de
ses missions dans le domaine de l'eau d'un service rgional unique : le Service Rgional
d'Amnagement des Eaux (S.R.A.E.).
Le S.R.A.E. a un double rle (Arrt du 0.06.1987) :
assurer, l'chelon rgional, le relais de l'action du dlgu de bassin;
laborer et mettre en oeuvre une politique rgionale de l'eau.
Page 6 - Le rle des institutions et les politiques en matire deau
Le S.R.A.E. est secrtaire du Comit technique de l'Eau et a pour vocation de participer
auprs du Prfet de Rgion aux organismes de bassin.
Le Comit Technique de l'Eau, sous la prsidence du prfet de rgion, est l'instance
privilgie de concertation et de circulation de l'information entre les services et
Etablissements Publics de l'Etat (DRAF, DRE, DRIRE, DRAE, Agence de Bassin, ...), les
collectivits territoriales (rgion, dpartement, grande agglomration), et les usagers
(association, fdration de pche, ...). Organe de concertation, il procde l'tude des
problmes rgionaux de l'eau et formule un avis la mission dlgue de bassin et aux
projets du B.R.G.M.
II.2.4. Organisation de l'Etat au niveau du dpartement
Le dpartement est la circonscription de base de l'intervention de l'Etat dans le domaine
de la police et de la gestion des eaux.
II.2.4.1. Les services extrieurs de l'Etat
Le dcret du 27.02.1987 maintient la comptence des services antrieurs :
services interdpartementaux agissant sous l'autorit du prfet de dpartement :
le service de la Navigation;
la Direction Rgionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement
(DRIRE).
services dpartementaux :
la Direction Dpartementale de l'Agriculture et de la Fort (DDAF);
la Direction Dpartementale de l'Equipement (DDE);
la Direction Dpartementale de l'Action Sanitaire et Sociale (DDASS).
II.2.4.2. Rpartition des comptences dans le domaine de la police et de la
gestion des eaux.
(Loi n 64-1245 du 16 dcembre 1964 relative au rgime et la rpartition des eaux et la
lutte contre leur pollution).
Les pouvoirs de surveillance qui s'exercent sur les eaux superficielles et souterraines
relvent de la police administrative, plus prcisment de la police des eaux. Les deux autres
polices administratives dans le cadre de la lutte contre les pollutions sont la police de la
pche et la police des installations classes.
Les principaux objectifs de cette police sont le maintien d'un libre coulement, la
conservation quantitative et qualitative des eaux, la scurit publique et la rpartition des
eaux.
La police des eaux doit toujours s'exercer dans l'intrt gnral compte tenu des divers
besoins et des diverses activits en prsence, dans le respect des droits des usagers et des
administrs aussi bien que des textes en vigueur.
Page 7 - Chapitre 1
La police des eaux est dvolue au Ministre de l'Environnement (Dcret n 76-1085 du 29
novembre 1976). Elle concerne l'instruction des procdures d'autorisation ou de dclaration
ainsi que le contrle de la gestion et de l'exploitation :
des eaux souterraines;
des cours d'eau;
des prises d'eau et des ouvrages destins effectuer des dversements permanents
ou temporaires;
des oprations d'entretien (curage, faucardage, rgularisation, ...);
des extractions de matriaux;
des ouvrages hydrauliques soumis autorisation.
Elle concerne galement :
la constatation et la rpression des infractions;
les mesures prendre en cas de scheresse ou de pollution accidentelle.
Pour l'exercice de ces attributions, les services dpartementaux et rgionaux des
ministres comptents sont mis disposition du Ministre de l'Environnement.
Il revient au Prfet de Dpartement le soin de dsigner les services de l'Etat comptents
pour chaque milieu ou fraction de milieu aquatique autre que les eaux maritimes (arrts
ministriels) et les cours d'eau appartenant au domaine public pluvial affect la navigation
(arrts ministriels).
La rpartition des comptences, en rgle gnrale, est la suivante :
Les eaux souterraines (Dcret n 73.218 du 23.02.1973 et arrt du 8.03.1973) :
Les DDAF et le Service de la Navigation sont chargs de la police des eaux pour les
dversements et prises d'eau pour les eaux situes faible profondeur (suivant la rpartition
prfectorale).
Les DRIRE sont charges de la police des Eaux pour les dversements et prises d'eau
pour les eaux situes grande profondeur.
Les cours d'eau (Dcret n 62.1448 du 24.11.1962 relatif l'exercice de la police des
eaux) :
En rgle gnrale, les DDE ou les Services de la Navigation sont chargs du contrle, des
travaux, de la police et de la gestion des eaux sur les cours d'eaux domaniaux (sauf ceux de
la comptence de la DDAF), et des travaux d'amnagement destins l'alimentation ou
l'amlioration des canaux et cours d'eau navigables ou flottables.
Les DDAF sont en rgle gnrale charges du contrle des travaux, de la police et de la
gestion des eaux sur les cours d'eau non domaniaux (sauf ceux viss de la comptence du
service de la navigation).
Page 8 - Le rle des institutions et les politiques en matire deau
II.2.4.3. Rpartition des comptences dans le domaine de la pche
La Loi pche met en place un dispositif complet de protection des milieux aquatiques
assortis de rgles pnales. (Circulaire n 86.3 du 31.01.1986 en application de l'article 407
du code rural rsultant de la loi n 84.512 du 29.06.1984 non parue au journal officiel).
La police de la pche et des milieux aquatiques est galement une police administrative
spciale : elle est exerce en application des articles 401 et 466 du Code Rural. Ses
principaux aspects intressent la prservation des milieux aquatiques (art. 407 413 du
Code Rural), la gestion du patrimoine piscicole (art. 417 424 du Code Rural) et son
exploitation (art. 435 440 du Code Rural).
Les DDAF, Service de la Navigation ou les DDE sont chargs de la Police de la Pche sur
les cours d'eau de leur comptence.
II.2.4.4. Autres comptences
Outre dans le domaine de la police des eaux et de la pche, les services dpartementaux
de l'Etat ont comptence dans des attributions relevant du ministre charg de
l'environnement :
gestion du domaine public fluvial hors voies navigables;
annonces des crues;
plan d'exposition aux risques d'inondation;
gestion des eaux;
contrle des barrages intressant la scurit publique;
l'organisation et le contrle des structures associatives agres de pche;
la lutte contre la pollution des eaux par les activits agricoles et industrielles
(inspection et autorisation des installations classes).
II.2.4.5. Le Conseil Dpartemental d'Hygine
Organisme consultatif plac auprs et sous la prsidence du Prfet du Dpartement, il
comprend des reprsentants des collectivits territoriales, des reprsentants des usagers et
des professionnels et des reprsentants des services dpartementaux.
Il est obligatoirement consult pour toutes les autorisations de rejet relatives aux stations
de traitement des eaux uses domestiques et industrielles. Son avis est ncessaire avant
toute consultation du Conseil Suprieur d'Hygine Publique.
II.2.4.6. Le Service d'Assistance Technique aux Exploitants des Stations
d'puration (SATESE)
Initialement rattach administrativement un organisme dpartemental (DDAF, DDASS,
...), il avait pour but l'amlioration et le suivi du bon fonctionnement des stations de
traitement des eaux uses. Ce but initial se transforme de plus en plus en une mission
exclusive de contrle.
Page 9 - Chapitre 1
Dans chaque dpartement, un comit de gestion dfinit les orientations et les moyens de
chaque SATESE. Ce comit prsid par le directeur d'un service dpartemental comprend
des reprsentants du Conseil Rgional, de l'Agence de l'Eau, des Services Dpartementaux
(DDAF, DDASS, ...). Ils sont en gnral financs par le Conseil Gnral, l'Agence de l'Eau et
le Ministre de la sant.
II.2.4.7. Les Gardes-Pche
Agissant sous l'autorit du Procureur de la Rpublique, agents asserments manant du
Conseil Suprieur de la Pche et mis la disposition des Fdrations Dpartementales des
Associations Agres de Pche et de Pisciculture (F.D.A.P.P.).
En plus d'une mission technique ils sont habilits rechercher, constater les infractions et
dresser des procs verbaux adresss au Procureur de la Rpublique et l'Administration
charge de la Police de la Pche.
II.3. LES ORGANISATIONS DE BASSIN
Le principe de la cration de six Agences Financires de Bassin est pos par l'article 14
de la loi du 16.12.1964. Etablissement public administratif dot de la personnalit civile et de
l'autonomie financire, chacune des six Agences a une organisation identique, mais est
gre de manire autonome sous la tutelle du Ministre charg de l'Environnement.
Chaque Agence est dote d'un organe excutif : le Conseil d'Administration, d'un
directeur, d'un organe dlibratif : le Comit de Bassin et d'une Commission de Bassin.
L'organisation et les modalits d'action des Agences sont dfinies par les dcrets du
14.09.1966, 8.04.1974 et du 28.10.1975.
Le Conseil d'Administration
Le nombre de membre (25 outre le Prsident) est identique pour l'ensemble de 6 Agences
et cela pour une dure de 6 ans. Le Prsident est nomm pour 3 ans par dcret.
Le Conseil d'Admnistration rgle par ses dlibrations les affaires de l'Agence.
Le Directeur de l'Agence
Le Directeur est nomm par arrt du Premier Ministre. Il assure le fonctionnement de
l'ensemble des services, prpare et fait appliquer les dcisions du Conseil d'Administration. Il
signe les contrats et conventions, il est responsable de la prparation des budgets, il est
ordonnateur des dpenses et des recettes et reprsente l'Agence en justice.
Le Comit de Bassin
Compos de reprsentants des rgions et des collectivits territoriales situes en tout ou
partie dans le bassin, de reprsentants des usagers et personnes comptentes, des
reprsentants des milieux socio-professionnels et des reprsentants de l'tat.
Son attribution concerne essentiellement l'action des Agences de Bassin. Il est notamment
consult par le Prsident du Conseil d'Administration sur le taux et sur l'assiette de
redevances l'exclusion de celles mises en raison de la dtrioration de la qualit de l'eau.
De plus, il peut tre consult par ses ministres sur le plan gnral d'amnagement du bassin
, soit par un des ministres concerns, soit par un des prfets membre du comit sur
l'opportunit de travaux ou d'amnagement.
Page 10 - Le rle des institutions et les politiques en matire deau
Le Comit de Bassin lit les membre du Conseil d'Administration de l'Agence l'exception
des reprsentants de l'Etat.
La Commission de Bassin
C'est une assemble compose pour moiti de responsables de la pche et pour moiti
de reprsentants des collectivits, des administration et d'usagers divers.
Elle prpare les orientations de gestion et de protection des milieux aquatiques en veillant
la cohrence entre les divers documents d'amnagement et de gestion.
Les attributions des Agences de l'Eau sont multiples. Lactivit principale est consacre
des interventions financires. Elle reoit en outre des redevances des pollueurs ("redevance
pollution" ou redevance au titre de la dtrioration de la qualit de l'eau) et des
consommateurs (redevance "ressource" ou "prlvement sur ressource") et met en oeuvre
diverses actions au niveau du bassin au travers de contrat pluriannuel d'investissement
signs avec les divers usagers : industriels, agriculteurs, collectivits locales.
II.4. L'ORGANISATION COMMUNALE.
En tant qu'agent de l'Etat dans la commune, le maire s'est vu, de longue date, reconnatre
d'importants pouvoirs dans le domaine de l'eau et des rivires. La commune (ou un
groupement) est le plus souvent le premier chelon territorial sollicit par les problmes de
l'eau et des rivires.
La loi sur la police rurale du 21 juin 1898 prvoit :
(article 21) : "les maires surveillent, au point de vue de la salubrit, l'tat des
ruisseaux, rivires, tangs, mares ou amas d'eau" ;
(article 22) : "le maire doit ordonner les mesures ncessaires pour assurer
l'assainissement et, s'il y a lieu aprs avis du conseil municipal, la suppression des
mares communales places dans l'intrieur des villages ou dans le voisinage des
habitations, toutes les fois que les mares compromettent la salubrit publique, ...".
La loi du 10 juillet 1973 sur la dfense contre les eaux autorise les communes raliser
tous travaux de lutte contre les inondations, si ceux-ci reprsentent un caractre d'intrt
gnral.
L'article 175 du Code Rural, le Code du Domaine Public Fluvial et l'article 315-9 du Code
des Communes prcisent le caractre d'intrt gnral ou d'urgence dans lequel se rangent
les catgories de travaux suivants, pour lesquels les collectivits peuvent se substituer aux
riverains :
lutte contre l'rosion, dfense contre les torrents, reboisement et amnagement des
versants, dfense contre les incendies;
dfense des rives et du fond des rivires non domaniales;
curage, approfondissement, redressement et rgularisation des canaux, cours d'eau
non domaniaux et des canaux de desschement et d'irrigation;
desschement des marais;
assainissement des terres humides et insalubres;
irrigation, pandage, colmatage et limonage;
Page 11 - Chapitre 1
amnagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce
bassin, soit seulement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci.
Du fait de la dcentralisation de l'urbanisme, les communes interviennent dsormais
principalement et frquemment mais d'une manire indirecte dans le domaine de l'eau, ceci,
notamment par la matrise du domaine foncier (POS), instrument essentiel pour la gestion
des zones riveraines des cours d'eau.
II.5. LES AUTRES ACTEURS
Association de protection de l'environnement, A.A.P.P., F.D.A.P.P., les chambres
consulaires (agricultures, industrie) ... sont des partenaires dans les diverses commissions et
pour l'laboration d'une politique locale de l'eau.
De nombreuses commissions permettent l'change d'informations entre les acteurs de
cette politique :
Comit Technique Rgional de l'Eau;
Commission Rgionale de Nappe;
Conseil Dpartemental d'Hygine;
Commission Dpartementale des Sites;
Groupe Dpartemental dans les Primtres de Protection ( crer).
III. LES POLITIQUES DE L'EAU
La politique de l'eau ne se limite pas des actions de police administrative et elle peut tre
organise en trois catgories :
III.1. UNE POLITIQUE DAMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Cette politique non contraignante dfinit des orientations gnrales. Les deux exemples ci-
dessous sont caractristiques de cette dmarche.
III.1.1. Schma rgional d'amnagement des eaux
C'est un schma caractre hydraulique labor en gnral par les SRAE et comprenant
:
l'analyse des besoins actuels;
la confrontation des ressources (rivires, nappes, sources, ...) aux besoins
domestiques, agricoles, industriels en situation prochaine;
lvaluation des politiques de l'eau existant dans une rgion et la dfinition des
problmes : manque d'eau potable, pollution agricole diffuse, qualit insuffisante des
rivires, ...
III.1.2. Le schma dpartemental de vocation piscicole et halieutique
C'est un schma spcialis qui dfinit les potentialits des cours d'eau et propose diverses
actions techniques d'organisation des pcheurs.
Page 12 - Le rle des institutions et les politiques en matire deau
La politique d'amnagement du territoire en matire d'eau est utile pour fixer les
orientations rgionales, dpartementales ou de bassin versant. Elle est gnralement le
rsultat d'un travail commun afin d'entraner l'admission volontaire du maximum d'acteurs de
la politique de l'eau.
III.2. UNE POLITIQUE FINANCIERE
Les politiques financires sont incitatives ou pnalisantes. On peut les regrouper en trois
types :
III.2.1. Les taxations et redevances
Il s'agit de pnaliser les dgts causs au milieu naturel par des taxes spcialises : le
pollueur est le payeur (redevances dues au titre de la dtrioration de la qualit de l'eau).En
fait, les taxes ou redevances ont rarement un caractre dissuasif.
III.2.2. Les aides financires
Les politiques incitatives sont nombreuses et revtent diverses formes faisant appel la
fiscalit, des taxes sur consommation ou des redevances (FNDAE, Agence de l'Eau,
Dpartement, Rgion).
III.2.3. Autofinancement
C'est l'lment essentiel car il faut d'abord qu'un matre d'ouvrage local accepte d'investir
et la politique de l'eau repose donc surtout sur des dcisions dcentralises.
III.3. LES POLITIQUES DENVIRONNEMENT
Ces politiques s'appuient d'abord sur les polices administratives en matire d'eau, de
sant et d'installation classes.
Il existe deux types diffrents de politique de l'environnement en matire d'eau :
la rglementation des activits industrielles, agricoles ou domestiques : installations
classes, normes d'eaux potables, ...;
la gestion des milieux : cration de zones inondables inconstructibles, politique des
objectifs de qualit, charte de zones inondables, documents durbanisme, les
contrats d'agglomration, les contrats ou conventions dpartementaux, les contrats
de rivire, ...
Dans le cadre du plan national pour l'environnement :
cration de Directions rgionales de l'Environnement (D.I.R.E.N.) devant regrouper la
Dlgation Rgionale l'Architecture et l'Environnement, le S.R.A.E., les
Dlgations de Bassin et le Service Hydraulique Centralisateur;
les D.R.I.R. deviennent D.R.I.R.E. (Directions Rgionales de l'Industrie, de la
Recherche et de l'Environnement) coordonnent l'inspection des installations classes
(D.R.I.R.E., Service Vtrinaires, ...);
cration de l'Institut Franais de l'Environnement (I.F.E.N.) : il a pour mission
d'laborer et de diffuser la documentation et l'information caractre scientifique et
statistique, en liaison notamment avec l'Agence Europenne de l'Environnement.
Page 13 - Chapitre 1
IV. POLITIQUES SPECIALISEES (POUR MEMOIRE)
IV.1. LES EAUX PLUVIALES (DECRET DU 23.02.1973) ET LES EAUX USEES
IV.2. LES EAUX DE CONSOMMATION HUMAINE
IV.3. LA POLITIQUE DAMENAGEMENT ET DE GESTION DES RIVIERES (SAGEECE)
IV.4. LES EAUX DE LOISIRS
IV.5. LES NAPPES ET GRAVIERES
IV.6. LES ZONES HUMIDES
IV.7. LES VOIES NAVIGABLES
IV.8. L'URBANISME
Eau et paysage.
Eau et risques : inondations, primtres de protection.
Eau et dveloppement urbain.
Page 14 - Le rle des institutions et les politiques en matire deau
GLOSSAIRE
- COURS D'EAU DOMANIAUX
Autrefois appels voies navigables et flottables, ils font partie du domaine public. L'tat est
propritaire du lit et des berges et dispose de l'usage de l'eau. La domanialit d'un cours
d'eau rsulte soit du critre de navigabilit, soit de la procdure de classement dans le
domaine public. Diffrentes raisons peuvent tre l'origine du classement d'un cours d'eau,
notamment: besoins en eau pour l'agriculture, l'industrie ; besoins en eau potable, ...
- COURS D'EAU NON DOMANIAUX
Autrefois appels voies non navigables ni flottables, le lit et les berges de ces cours d'eau
appartiennent au propritaire riverain qui dispose de l'usage de l'eau.
Un propritaire est riverain d'un cours d'eau si son terrain longe le cours d'eau sans tre
spar par une digue, une rue, un chemin ou un foss appartenant autrui. De cette
proprit dcoule des droits, notamment celui d'utiliser l'eau pour l'irrigation ou pour tout
autre usage, condition de ne pas le rendre impropre, la sortie du fond, l'irrigation ou aux
usages ordinaires de la vie (article 644 du code civil), mais aussi des obligations, notamment
celle de l'entretien du cours d'eau ou de la partie de cours d'eau qui lui appartient.
- D.D.A.F./ D.R.A.F.
La Direction Dpartementale de l'Agriculture et de la Fort et la Direction Rgionale de
l'Agriculture et de la Fort constituent des services extrieurs du Ministre de l'Agriculture.
- D.D.A.S.S./ D.R.A.S.S.
La Direction Dpartementale des Affaires Sanitaires et Sociales, et la Direction Rgionale
des Affaires Sanitaires et Sociales constituent des services extrieurs du Ministre de la
Sant.
- D.D.E./ D.R.E.
La Direction Dpartementale de l'Equipement et la Direction Rgionale de l'Equipement
constituent des Services Extrieurs du Ministre de l'Equipement.
- D.I.R.E.N. : Direction Rgionale de l'Environnement (textes de dfinitions non parus).
- D.E.P.P.R. : Direction de l'Eau et de la Prvention des Pollutions et des Risques.
- D.R.I.R.E.
La Direction Rgionale de l'Industrie, de la Recherche et de L'Environnement constitue un
service extrieur du Ministre de l'Industrie.
- DEBIT : Volume d'eau coul par unit de temps en un point donn.
- EAUX USEES : Eaux rejetes aprs utilisation domestique ou industrielle.
Page 15 - Chapitre 1
- EAUX SOUTERRAINES
Elles regroupent les eaux provenant des nappes aquifres superficielles (ou phratiques)
et profondes (ou captives).
- EAUX SUPERFICIELLES
Elles comprennent les fleuves, les rivires, les canaux, les ruisseaux, les lacs, ...
- EFFLUENT : Flux d'eaux uses urbaines ou industrielles.
- EQUIVALENT HABITANT : Notion utilise pour exprimer la charge polluante dun effluent
par comparaison avec celle dun habitant.
- ETUDE DIMPACT
Cest une tude pralable tout engagement damnagement ou de travaux susceptible
dtre prjudiciable lenvironnement. L'tude d'impact a pour but d'aider le matre d'ouvrage
concevoir un projet plus respectueux de l'environnement, d'informer l'autorit
administrative qui aura approuver ou autoriser ce projet et d'informer le public.
- F.N.D.A.E. : Fond National pour le Dveloppement des Adductions d'Eaux.
- MILIEU RECEPTEUR
Il constitue lexutoire naturel o s'effectue le rejet d'eaux collectes par l'assainissement
(pures ou non) ou d'eaux issues du drainage naturel d'un bassin versant.
- PIEZOMETRE : Instrument servant mesurer la compressibilit des liquides.
- POLLUTION (DE L'EAU) : Altration des qualits physiques, chimiques ou biologiques
de l'eau, nuisant l'un ou l'autre de ses usages.
- P.O.S. : Plan d'Occupation des Sols.
- REJETS
Au sens du dcret du 23.02.1973, les rejets comprennent tous les dversements,
coulements et jets directs ou indirects susceptibles d'altrer la qualit de l'eau dans laquelle
ils se rejettent.
- S.A.T.E.S.E. : Services d'Assistances Techniques aux Exploitants de Stations
d'Epuration.
- SERVICES EXTERIEURS (DE L'ADMINISTRATION CENTRALE)
Appels aussi services dconcentrs, ils constituent les relais dpartementaux ou
rgionaux des diffrents ministres, et sont chargs de la mise en oeuvre de la politique
dfinie par le gouvernement, notamment la D.D.A.S.S. et la D.D.E.
- S.R.A.E. : Service Rgional d'Amnagement des Eaux.
Chapitre 2
REGLEMENTATION CONCERNANT
LES OUVRAGES DE COLLECTE
LES OUVRAGES DE TRAITEMENT
ET LES DECHETS
A. SADOWSKI
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
17
S O M M A I R E
1) - RAPPEL DE LA REGLEMENTATION SUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT......................................................... 19
2) - LE 1ER ARRETE DU 22.12.1884............................................................................................................................... 19
2.1) - CHAMP D'APPLICATION............................................................................................................................................... 20
2.2) - CONTENU DE LA DEMANDE D'AUTORISATION ................................................................................................................... 20
2.3) - LES SOUS-PRODUITS ................................................................................................................................................. 21
2.4) - CONCEPTION & EXPLOITATION DU SYSTEME DASSAINISSEMENT ......................................................................................... 21
2.5) - PERIODE DENTRETIEN ET FIABILITE .............................................................................................................................. 21
2.6) - CONCEPTION DES STATIONS DEPURATION ..................................................................................................................... 22
2.7) - FIABILITE DES INSTALLATIONS ET FORMATION DU PERSONNEL ............................................................................................ 22
3) - LE 2EME ARRTE DU 22.12.1994............................................................................................................................. 25
3.1) - AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ET DES SOUS-PRODUITS ................................................................................................ 25
3.2) - AUTOSURVEILLANCE DU FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DASSAINISSEMENT ........................................................................ 25
3.3) - DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES EVENEMENTS EXCEPTIONNELS.............................................................................. 26
3.4) - CONTROLE DU DISPOSITIF DAUTOSURVEILLANCE ............................................................................................................ 26
4) - REFLEXIONS GENERALES VIS A VIS DE LA NOUVELLE REGLEMENTATION......................................................... 29
4.1) - FIABILITE & SECURITE ................................................................................................................................................ 29
1 - Notion de capacit nominale.................................................................................................................................. 29
2 - Consquence du respect 93% du temps................................................................................................................. 30
3 - Fiabilit................................................................................................................................................................ 30
5) - SYSTEME D'ASSAINISSEMENT SOUMIS A DECLARATION ..................................................................................... 31
5.1) - COMMENTAIRES SUR LARRETE DU 21 JUIN 1996 ................................................................................................ 33
6) - REGLEMENTATION ET PROCEDURES SUR LE DEVENIR DES BOUES DU SYSTEME
D'ASSAINISSEMENT.............................................................................................................................................. 39
6.1) - CADRE DE LA REGLEMENTATION FRANCAISE SUR LE DECHETS ..................................................... 39
6.2) - PRODUCTION ET DEVENIR DES BOUES ACTUELLEMENT.................................................................... 40
6.3) - APPROCHE REGLEMENTAIRE DES DEBOUCHES .................................................................................... 40
6.3.1) - DECHARGE OU CET............................................................................................................................. 40
6.3.2) - INCINERATION........................................................................................................................................ 41
6.3.3) - VALORISATION AGRICOLE ................................................................................................................... 42
6.3.3.1) - Dcret du 8.12 .1997.............................................................................................................................. 42
6.3.3.2) - Larrte du 8.01 .1998............................................................................................................................ 43
6.4) - CONTEXTE REGLEMENTAIRE EUROPEEN ............................................................................................... 43
6.5) - FILIERES DE TRAITEMENT DES BOUES..................................................................................................... 44
PERFORMANCES DES DIFFERENTS DISPOSITIFS DE DESHYDRATATION ........................................................................... 45
6.6) - RESPONSABILITE DES COLLECTIVITES.................................................................................................... 45
6.7) - PROCEDURES ADMINISTRATIVES ............................................................................................................. 46
6.8) - ETUDE DE VALORISATION AGRICOLE DES BOUES................................................................................ 48
6.9) - CONVENTIONS POUR L'EPANDAGE DES BOUES..................................................................................... 49
1.- CONVENTION ENTRE LA COLLECTIVITE ET LES AGRICULTEURS................................................................................ 49
2.- CONVENTION ENTRE L'ENTREPRENEUR ET L'EXPLOITANT ........................................................................................ 50
6.10) - DEMARCHE POUR LA VALORISATION AGRICOLE............................................................................... 50
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
18
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
19
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES
RELATIVES AUX OUVRAGES DE COLLECTE ET DE
TRAITEMENT DES EAUX USEES
1) - RAPPEL DE LA REGLEMENTATION SUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT
Les 2 arrts du 22 dcembre 1994 achveraient la transcription de la Directive CEE du 21 mai 1991.
Les principaux textes de Loi qui ont prcd ces 2 arrts sont ;
La Loi sur l'eau du 3 janvier 1992,
Le dcret du 2 fvrier 1998, concerne les effluents des Installations Classes soumis
autorisation ainsi que l'obligation de convention de rejet avant raccordement au rseau d'assainissement
publique,
Les 2 dcrets du 29 mars 1993, concernent les procdures administratives de dclaration et
d'autorisation ainsi que la nomenclature des oprations soumises dclaration ou autorisation, en
fonction des flux gnr par l'agglomration et englobe en plus des procdures relatives aux rejets aprs
traitement ; les dversoirs d'orage, les rejets d'eaux pluviales, l'pandage d'eau uses, l'pandage de
boues...
Le dcret du 3 juin 1994, dcrit les orientations de la transcription de la Directive du 21 mai
1991, relatif la collecte et au traitement des eaux uses mentionnes aux articles L. 372-1-1 & L. 372-3 du
Code de Communes.
Les 2 Arrts du 22 dcembre 1994 : "Prescriptions techniques relatives aux ouvrages de
collecte et de traitement des eaux uses", mentionns aux articles L.372-1-1 & L.372-3 du Code des
Communes.
Recommandations du 12 mai 1995 pour l'application des arrts du 22 dcembre 1994.
2) - LE 1ER ARRETE DU 22.12.1884
Cet arrt fixe les prescriptions techniques minimales, relatives aux ouvrages de collecte et de
traitement des eaux uses.
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
20
2.1) - Champ d'application
Il vise l'ensemble du "systme d'assainissement" (cf. glossaire ci-aprs), lui-mme compos du
"systme de collecte" et du "systme de traitement".
Concerne les ouvrages de traitement recevant un flux de pollution journalier ou de capacit
suprieurs 120 kg de DBO5 ( ouvrages soumis autorisation ) ainsi que les ouvrages connexes (bassin
de rtention, ouvrages de surverse ventuels...)
Concerne les ouvrages de collecte ainsi que les dversoirs d'orage, les ouvrages de rtention et
de traitement d'eaux de surverse situs sur le rseau.
Concerne les nouveaux tronons (cf. glossaire) du systme de collecte.
Concerne galement les sous-produits du systme d'assainissement, l'exclusion des
prescriptions techniques relatives aux oprations d'limination et de valorisation, en particulier l'pandage
des boues, qui fait l'objet d'un arrt particulier.
Il ne concerne pas :
Les stations de traitement et dversoirs d'orage soumis dclaration,
Les pandages d'eaux uses,
Les rseaux d'eaux pluviales des systmes d'assainissement sparatif,
La surveillance du systme d'assainissement, qui fait l'objet d'un arrt particulier.
2.2) - Contenu de la demande d'autorisation
Le document mentionn larticle 2 du dcret du 29 mars 1993 justifie la compatibilit du projet aux
rglementations et documents de planification en vigueur.
Il comprend :
a) - Lanalyse de ltat initial du site de la station et du milieu rcepteur (sensibilit, usages...),
b) - Ltat du systme dassainissement existant et de ses extensions prvisibles, des dispositions
pour sassurer des branchements au systme de collecte, les mesures prises pour limiter les flux deaux
pluviales dans le rseau unitaires,
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
21
c) - La nature et le volume des effluents collects tenant compte des variations saisonnires,
d) - Les dbits et charges de rfrence retenus pour le dimensionnement des ouvrages (temps sec
et temps de pluie),
e) - Les mesures prises pour limiter les dbits et les charges des matires polluantes vhiculs par
le systme de collecte au-del du dbit de rfrence,
f) - Lvaluation des impacts immdiats et diffrs du projet sur le milieu naturel et le niveau de
protection choisi,
g) - La cohrence du systme de collecte et des installations de traitement,
h ) - Les possibilits dlimination et de valorisation des sous-produits,
i ) - Les dispositions de conception ou dexploitation envisages pour minimiser lmission dodeurs,
de bruits ariens ou de vibrations mcaniques.
2.3) - Les sous-produits
Les prescriptions sappliquent lensemble des sous-produits des systmes de collecte et de traitement, y
compris de prtraitement (curage, dessablage, dgrillage, dshuilage, bassin dorage...)
- larrt dautorisation prcise les filires choisies pour liminer les boues,
- les graisses font lobjet dun traitement spcifique, ainsi que les produits de dgrillage,
- la commune doit pouvoir garantir la conformit de llimination ou de la valorisation des dchets
avec les dispositions de larrt dautorisation et le justifier tout moment.
Lexploitant doit tre en mesure de justifier tout moment de la quantit, qualit et destination des boues
produites.
2.4) - Conception & exploitation du systme dassainissement
Le systme dassainissement doit tre exploit de manire minimiser la quantit totale de matires
polluantes dverse par le systme, dans tous les modes de fonctionnement.
2.5) - Priode dentretien et fiabilit
La commune et son exploitant doivent pouvoir justifier tout moment des dispositions prises pour assurer
un niveau de fiabilit des systmes dassainissement compatible avec les termes de larrt fixant les
objectifs de dpollution.
En outre, des performances acceptables doivent tre garanties en priode dentretien et de
rparations prvisibles.
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
22
A cet effet, lexploitant tient jour un registre mentionnant :
- les incidents et dfauts de matriels recenss et les mesures prises pour y remdier,
- les procdures observer par le personnel dentretien.
Lexploitant informera au pralable le service charg de la Police des Eaux sur les priodes
dentretien et de rparations prvisibles et de la consistance des oprations susceptibles davoir un impact
sur la qualit des eaux.
Il prcise les caractristiques des dversements (flux, charges) pendant cette priode et les
mesures prises pour en rduire limpact sur le milieu rcepteur.
Le service charg de la Police des Eaux peut, si ncessaire, demander le report de ces oprations.
2.6) - Conception des stations dpuration
Les systmes dpuration doivent tre dimensionns, conus, construit et exploits de manire telle quils
puissent recevoir et traiter les flux de matires polluantes correspondant leur dbit et leurs charges de
rfrence.
Ce dimensionnement tient compte :
- des effluents non domestiques raccords au rseau,
- des dbits et des charges restitus par le systme de collecte soit directement soit par
lintermdiaire de ses ouvrages de stockage,
- des variations saisonnires de charge et de flux,
- de la production de boues correspondante.
2.7) - Fiabilit des installations et formation du personnel
Avant sa mise en service, le systme de traitement doit faire lobjet dune analyse des risques de
dfaillance, de leur effets et des mesures prvues pour remdier aux pannes ventuelles.
Le personnel dexploitation doit avoir reu une formation adquate lui permettant de ragir dans
toutes les situations de fonctionnement de la station.
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
23
ANNEXE II
REGLES GENERALES APPLICABLES AUX REJETS EN CONDITIONS NORMALES
DEXPLOITATION POUR DES DEBITS NEXCEDANT PAS LEUR DEBITS DE REFERENCE
Tableau 1
PARAMETRE CONCENTRATION MAXIMALE
DBO5 25 mg/l
DCO 125 mg/l
MES 35 mg/l *
(*) Pour le lagunage, cette valeur est fixe 150 mg/l.
Tableau 2
PARAMETRE CHARGE BRUTE RECUE RENDEMENT MINIMUM
DBO5 Charge brute** 120 600 kg/j 70 %
DBO5 Charge brute > 600 kg/j 80 %
DCO Toutes tailles 75 %
MES Toutes tailles 90%
Tableau 3
PARAMETRE CAPACITE DE LA
STATION
CONCENTRATION
MAXIMALE
zone sensible NGL* Charge brute** 600
6000 kg/j
15 mg/l
lazote NGL Ch. brute > 6000 kg 10 mg/l
zone sensible PT Ch. brute 600 6000 kg 2 mg/l
au phosphore PT Ch. brute >6000 kg 1 mg/l
(*) Ces exigences se rfrent une temprature de leau du racteur biologique arobie de la station dpuration dau moins
12C. Cette condition de temprature peut tre remplace par la fixation de priodes dexigibilit dtermines en fonction des
conditions climatiques rgionales.
Tableau 4
PARAMETRE CAPACITE DE LA
STATION
RENDEMENT
MINIMUM
zone sensible azote NGL Charge brute** > 600 70 %
zone sensible phosphore PT Charge brute > 600 80 %
(**) Charge brute de pollution organique reue, en kg/j (exprime en DBO5).
Les chantillons moyens journaliers doivent respecter :
- soit les valeurs fixes en concentration figurant au tableau 1,
- soit les valeurs fixes en rendement figurant au tableau 2.
Leur pH doit tre compris entre 6 et 8,5, et leur temprature infrieure 25C.
Les rejets dans des zones sensibles leutrophisation doivent en outre respecter en moyenne annuelle :
- soit les valeurs fixes en concentration figurant au tableau 3,
- soit les valeurs fixes en rendement figurant au tableau 4.
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
24
2. REGLES DE TOLERANCE PAR RAPPORT AUX PARAMETRES DCO, DBO5 ET MES
Ces paramtres peuvent tre jugs conformes si le nombre annuel dchantillons journaliers, non
conformes la fois aux seuils concerns des tableaux 1 et 2, ne dpasse pas le nombre prescrit au tableau
6. Ces paramtres doivent toutefois respecter le seuil du tableau 5.
Tableau 5
PARAMETRE CONCENTRATION MAXIMALE
DBO5 50 mg/l
DCO 250 mg/l
MES 85 mg/l
Tableau 6
Nombre dchantillons
prlevs dans lanne
Nombre maximal dchantillons
non conformes
4-7 1
8-16 2
17-28 3
29-40 4
41-53 5
54-67 6
68-81 7
82-95 8
96-110 9
111/125 10
126-140 11
141-155 12
156-171 13
172-187 14
188-203 15
204-219 16
220-235 17
236-251 18
252-268 19
269-284 20
285-300 21
301-317 22
318-334 23
335-350 24
351-365 25
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
25
3. REGLES DE TOLERANCE PAR RAPPORT AU PARAMETRE NGL
Le paramtre peut tre jug conforme si la valeur de la concentration de chaque chantillon journalier
prlev ne dpasse pas 20 mg/l.
3) - LE 2me ARRTE DU 22.12.1994
Surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux uses
Les dispositifs du prsent arrt sont applicables immdiatement aux nouveaux ouvrages : ils sont
applicables aux anciens ouvrages dans les dlais suivants, compter de sa parution (J.O. du 10/02/95) :
- systme dassainissement recevant une charge brute de pollution organique de :
suprieure 6000 kg/j = dlai 2 ans,
comprise entre 601 et 6000 kg/j = dlai 4 ans,
comprise entre 120 et 600 kg/j = dlai 5 ans.
3.1) - Autosurveillance des rejets et des sous-produits
Lexploitant du systme dassainissement, ou dfaut la commune, doit mettre en place un programme
dautosurveillance de chacun de ses principaux rejets et des flux de ses sous produits.
Le mesures sont effectues sous sa responsabilit. Les rsultats de la surveillance sont transmis chaque
mois par la commune au service charg de la Police des Eaux et lAgence de lEau.
Ces documents doivent comporter :
- lensemble des paramtres viss par larrt dautorisation et le tableau 1.
- les dates de prlvements et de mesures.
- lidentification des organismes chargs de ces oprations dans le cas o elles ne sont pas
ralises par lexploitant.
Dans le cas de dpassement des seuils autoriss par larrt dautorisation, la transmission est immdiate
et accompagne de commentaires sur les causes des dpassements constats ainsi que sur les actions
correctives mises en oeuvre ou envisages.
3.2) - Autosurveillance du fonctionnement du systme dassainissement
Lensemble des paramtres ncessaires justifier la bonne marche de linstallation de traitement et sa
fiabilit doivent tre enregistrs (dbits horaires arrivant sur la station, consommation de ractifs et
dnergie, production de boues...).
Le suivi du rseau de canalisation doit tre ralis par tout moyen appropri. Le plan du rseau et des
branchements est tenu jour.
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
26
Un registre est mis disposition du service charg de la Police de lEau et de lAgence de lEau comportant
lensemble des informations exiges dans le prsent article.
Un rapport de synthse est adress la fin de chaque anne ces services.
3.3) - Dispositions particulires pour les vnements exceptionnels
Ces dispositions sont applicables aux systmes dassainissement recevant une charge brute de pollution
organique suprieure 600 kg/j, et aux cas spcifiques fixs dans larrt dautorisation.
Des dispositions de surveillance renforces doivent tre prises par lexploitant lorsque des circonstances
particulires ne permettent pas dassurer la collecte ou le traitement complet des effluents.
Il en est ainsi notamment en cas daccident ou dincident sur la station, ou de travaux sur le rseau.
Lexploitant doit estimer le flux des matires polluantes rejetes en milieu dans ces conditions et valuer
son impact sur le milieur rcepteur.
Cette valuation fait lobjet de la mme exploitation que celle prvue ci-dessus (transmission en service
charg de la Police de lEau et lAgence de lEau).
Elle est en outre largie au service charg de la Police de la Pche et dans certains cas (captage deau
pour lalimentation humaine, pche pied, conchyliculture, baignade) au service charg de lhygine du
milieu.
3.4) - Contrle du dispositif dautosurveillance
Le service charg de la police de lEau vrifie la qualit du dispositif de surveillance mis en place et
examine les rsultats fournis par lexploitant ou la commune.
Lexploitant rdige un manuel dcrivant de manire prcise son organisation interne, ses mthodes
danalyse et dexploitation, les organismes extrieurs qui il confie tout ou partie de la surveillance, la
qualification des personnes associes ce dispositif. Ce manuel fait mention des rfrences normalises
ou non.
Il est tenu disposition du service charg de la Police de lEau, de lAgence de lEau et rgulirement mis
jour.
Le service charg de la Police de lEau sassure par des visites priodiques de la bonne reprsentativit
des donnes fournies et de la pertinence du dispositif mis en place.
A cet effet, il peut mandater un organisme indpendant choisi en accord avec lexploitant.
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
27
Le service charg de la Police de lEau peut procder des contrles inopins sur les paramtres
mentionns dans larrt dautorisation.
Dans ce cas, un double de lchantillon est remis lexploitant.
Le cot des analyses est mis la charge de celui-ci.
Le service charg de la Police de lEau examine la conformit des rsultats de lautosurveillance et des
contrles inopins aux prescriptions fixes par larrt dautorisation.
1. Mesure de dbit :
2. Station pour charge brute > 600 kg : Mesure de dbit + enregistrement amont / aval et des
prleveurs asservis aux dbits et conservation au froid (pendant 24h) dun double de lchantillon
3. Station pour charge brute entre 120 - 600 kg : Mesure + dbit + enregistrement aval et des
prleveurs asservis aux dbits et conservation au froid (pendant 24h) dun double de lchantillon.
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
28
ANNEXE 1
SURVEILLANCE DES OUVRAGES DE TRAITEMENT
PARAMETRES 120
600
601
1 800
1 801
3 000
3 001
6 000
6 001
12 000
12 001
118 000
> 18 000
Cas gnral
Dbit 365 365 365 365 365 365 365
MES 12 24 52 104 156 260 365
DBO
5
4 12 24 52 104 156 365
DCO 12 24 52 104 156 260 365
NTK / 6 12 24 52 104 208
NH4 / 6 12 24 52 104 208
NO2 / 6 12 24 52 104 208
NO3 / 6 12 24 52 104 208
PT / 6 12 24 52 104 208
Boues* 4 24 52 104 208 260 365
Zones sensibles
lazote
NTK / 12 24 52 104 208 365
NH4 / 12 24 52 104 208 365
NO2 / 12 24 52 104 208 365
NO3 / 12 24 52 104 208 365
Zones sensibles au
phosphore
PT / 12 24 52 104 208 365
(*) Quantit et matires sches. Sauf cas particulier, les mesures amont des diffrentes formes de lazote
peuvent tre assimiles la mesure de NTK.
Tableau 1
Frquence des mesures (nombre de jours par an).
Charge brute de pollution organique reue par la station
exprime en kg/jour de DBO5.
(Celles-ci sappliquent lensemble des entres et sorties de la station,
y compris les ouvrages de drivation)
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
29
4) - REFLEXIONS GENERALES VIS A VIS DE LA NOUVELLE REGLEMENTATION
4.1) - Fiabilit & scurit
2 mots distincts dans leur concept
L'on parlera aisment de "fiabilit de l'installation de traitement", mais le terme scurit devrait tre
appliqu exclusivement vis vis du personnel d'exploitation ; "scurit pour le personnel d'exploitation"
1 - Notion de capacit nominale
Une station qui reoit en moyenne 50 60 % de sa charge est sa capacit nominale...
Le dcret du 3.06.1994 introduit conformment la Dir CEE, le flux prendre en compte pour le
dimensionnement devrait tre gal la moyenne de la semaine la plus charge.
Le flux correspondant la capacit nominale ne peut tre valu sur la moyenne, mais sur des valeurs X%
non dpasses, plus proche des valeurs maximales (par ex; 90% non dpass sur l'ensemble des
paramtres, sachant que l'cart-type et le coefficient de variation de chaque paramtre est diffrent, y
compris les rapports entre les paramtres)
Exemple de variation d'effluent sur des installations existantes (ref TSM juillet 1992) ;
Volumes
journaliers
Flux MES
entrant
Flux DBO5
entrant
Flux DCO
entrant
Coefficient de
variation
0,24 0,49 0,39 0,38
Valeur 95%
pour moyenne =
100
140 181 165 163
le coefficient de variation = cart-type/moyenne
La dmarche est d'aller vers une approche industrielle, avec une matire brute traiter minemment
variable.
Cela veut dire que la caractrisation de l'effluent traiter doit tre de type statistique (rpartition normale
jusqu' Log-normale), puisque la sortie doit tre respecte de faon statistique en non pas en moyenne
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
30
2 - Consquence du respect 93% du temps
Respecter une concentration en DBO5 = 25 mg/l en sortie de l'installation 93% du temps (prenons cet
exemple) veut dire qu'en moyenne l'installation doit pouvoir obtenir un effluent avec une concentration en
DBO5 sortie de l'ordre de 13,5 mg/l.
3 - Fiabilit
3.1 - Fiabilit dans le dimensionnement
En prenant 3 exemples, l'on peut approcher l'impact du dimensionnement vis--vis de la variabilit de
l'effluent.
- les besoins en oxygne devrait tre suffisants sur les flux horaires maximum des paramtres de
pollution (DBO5 et N) et non sur une rpartition par exemple sur 14h du flux journalier non caractris
statistiquement (valeur maxi, 70% non dpass ?)
- le clarificateur sera dpendant du rgime hydraulique horaire extrme, d'une part, et de la masse
de boue maxi qui y transitera (dbit x concentration dans le bassin), pour une temps de sjour maxi des
boues dans le clarificateur, d'autre part
- la capacit de traitement des boues - rpartie sur une charge de travail hebdomadaire - doit
permettre de faire face toutes les situations prsentes en amont ( flux traiter, notamment en priode de
pluie) et en aval ( contrainte d'pandage donc de stockage prolong), donc estime sur la production de
boue produite sur la semaine la plus charge (NB de jours de temps secs, de temps de pluie, de vidange
ventuelle de bassin)
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
31
5) - Systme d'assainissement soumis dclaration
Circulaire du 17 fvrier 1997 relative lassainissement collectif pour les communes
de capacit infrieure 2 000 EH (Equivalents Habitants)
Circulaire n97-31 du 17 fvrier 1997 relative lassainissement collectif de communes-ouvrages de
capacit infrieure 120 kg DB05/jour (2000 EH)
Rfrences : arrt du 21 juin 1996 fixant les prescriptions techniques minimales relatives aux ouvrages de
collecte et de traitement des eaux uses mentionnes aux articles L.2224-8 etL.2224-10 du code gnral
des collectivits territoriales, dispenses dautorisation au titre du dcret n 93-743 du 29 mars 1993 relatif
la nomenclature des oprations soumises autorisation ou dclaration, en application de larticle 10 de
la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur leau (J.O. du 9 aot 1996).
Documents abrogs :
Circulaire du ministre de la sant du 10 juin 1976 relative lassainissement des agglomrations et la
protection sanitaire des milieux rcepteurs (J.O.21 aot 1976) ;
Circulaire interministrielle du 4 novembre 1980 relative aux conditions de dtermination de la qualit
minimale dun rejet deffluents urbains (J.O. 29 novembre 1980).
Pices jointes : 2 annexes.
La rglementation technique sur les ouvrages dassainissement a essentiellement pour fondement le dcret
n 94-669 du 3 juin 1994 relatif au traitement des eaux uses mentionnes aux articles L.2224-8 et L.2224-
10 du code gnral des collectivits territoriales (anciens articles L.372-1-1 et L.372-3 du code des
communes). Ainsi le dcret du 2 fvrier 1996 relatif aux conditions dans lesquelles lautorit administrative
peut dicter les prescriptions rgles et interdictions prvues par les articles 8-3 et 9-2 de la loi du 3 janvier
1992, exclut de son champ dapplication les ouvrages dassainissement.
Les articles 19, 20, 21 et 26 du dcret du 3 juin 1994 renvoient des arrts le soin de fixer les
prescriptions techniques applicables ces ouvrages. De manire se caler sur les exigences de la
directive europenne du 21 mai 1991, trois catgories douvrages sont distingues (cf. en annexe I le
tableau de synthse sur le dispositif rglementaire) :
les ouvrages de capacit suprieure 120 kg DBO5/jour, soumis autorisation au titre du
dcret 93-743 du 29 mars 1993 et une exigence de traitement secondaire dans le cas
gnral. Les prescriptions techniques sont fixes par les arrts du 22 dcembre 1994, pris au
titre des articles 19 21 du dcret n 94-469 ;
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
32
les ouvrages relevant de lassainissement non collectif, qui doivent assurer un niveau identique
de protection de lenvironnement , relvent des arrts du 6 mai 1996 pris au titre de larticle 6
du dcret n 94-469
enfin, les ouvrages relevant de lassainissement collectif de capacit infrieure 120 kg
DBO5/jour, doivent faire lobjet de traitements appropris permettant de respecter les objectifs
de qualit retenus . Ce sont ces ouvrages qui font lobjet de larrt du 21 juin 1996 paru au
Journal officiel du 9 aot 1996, pris au titre des articles 19 21 du dcret n 94-469
Schma gnral de la rglementation technique relative aux ouvrages dassainissement
OUVRAGES DISPENSES DE
DECLARATION
capacit infrieure
12 kg DBO5/jour *
OUVRAGES SOUMIS
A DECLARATION
capacit comprise entre
12 et 120 kg DBO5/jour *
OUVRAGES SOUMIS
A AUTORISATION
capacit suprieure
120 kg DBO5/jour
RELEVANT DE
LASSAINISSEMEN
T
NON COLLECTIF
RELEVANT DE
LASSAINISSEMEN
T
COLLECTIF
ARRETE DU 6 MAI
1996
ARRETE DU 21 JUIN 1996 ARRETES DU 22 DECEMBRE
1994
(*)Sous rserve que ces ouvrages chappent aux seuils dautorisation ou de dclaration dfinis par les
autres rubriques de la nomenclature annexe au dcret n 93-743 du 29 mars 1993, notamment la rubrique
2.2.0., et sous rserve des dispositions spcifiques mentionnes larticle 2 du dcret n 93-743 du 29
mars 1993 pour certaines zones de protection spciale.
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
33
5.1) - Commentaires sur larrt du 21 juin 1996
1. Les technologies adaptes au milieu rural
1.1. Inventaire des techniques
Pour traiter les effluents des petites collectivits on dispose essentiellement :
des traitements classiques drivs de lassainissement collectif ;
des techniques par lagunage ;
des procds extrapols des solutions mises en oeuvre pour lassainissement des maisons
dhabitation individuelle.
Lensemble de ces techniques a fait lobjet de nombreuses publications au cours des dernires annes ,
prsentes en annexe III, auxquelles il convient de se rfrer.
Traitements classiques
Ceux-ci sont bien connus et largement divulgus : les boues actives faible charge reprsentant la grande
majorit du parc des stations franaises. Toutefois, faire appel ces techniques ne constitue pas toujours la
meilleure solution pour les petites capacits en raison notamment des contraintes dexploitation et des
cots de fonctionnement.
Dans tous les cas une attention devra tre apporte au stockage des boues, la fiabilit des quipements
lectromcaniques et au bon dimensionnement des clarificateurs. En ce qui concerne les stations
prfabriques, il faudra veiller particulirement privilgier les dispositifs conus pour permettre vis--vis de
lexploitation et de lvaluation des performances , un accs facile aux organes vitaux.
Lagunages
Le lagunage naturel est largement rpandu en France ; il reprsente environ 20% de leffectif des stations.
Il convient dapporter un soin particulier ltanchit des bassins ce qui, dans des conditions locales
dfavorables peut conduire des surcots significatifs compte tenu de lemprise au sol des bassins. Pour
viter les causes essentielles de dysfonctionnement, on rservera prfrentiellement le lagunage au
traitement deffluents peu concentrs (DBO5 < 300 mg/l) et ne prsentant pas de caractre septique.
Epuration par le sol
On distingue principalement lpuration par bassins dinfiltration et par pandage souterrain collectif. Ces
procds fonctionnent sur le principe dune puration biologique arobie sur milieu granulaire fin
Lutilisation du sol en puration permet des rendements pousss vis--vis de la pollution organique, la
nitrification de lazote rduit et, dans certaines conditions, une rduction importante de la charge
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
34
bactrienne. La rtention du phosphore et la dnitrification ne peuvent, en gnral, tre obtenus avec
fiabilit.
Pour assurer une infiltration durable, leffluent doit subir pralablement une dcantation visant rduire au
maximum la charge particulaire de leffluent. Ce pr-traitement sera protg contre toute surcharge
hydraulique pouvant entraner le relargage des matires accumules.
Loxygne ncessaire lpuration est apporte par aration naturelle du massif purateur. Des phases de
repos doivent tre prvues pour assurer son renouvellement et permettre la minralisation des boues
biologiques produites au sein du massif.
Lpuration ne peut tre efficace quen milieu insatur. Des tudes prliminaires devront donc ,
spcialement sur les dispositifs non drains, sassurer de la bonne vacuation de leau traite, et vrifier, si
ncessaire, le niveau de la nappe sous-jacente.
Lexprience montre le rle essentiel dune bonne rpartition .Aussi, compte tenu des surfaces mobilises,
lalimentation gravitaire au fil de leau nest gnralement pas satisfaisante. Il conviendra demployer toute
technique permettant de raliser une bonne distribution de leffluent sur le massif et des apports doss
compatibles avec les processus puratoires.
Bassins dinfiltration
Leffluent est pandu sur un massif purateur non recouvert. Les apports doivent sinfiltrer rapidement. Il ny
a donc pas besoin de digue autour des bassins ; toute stagnation prolonge deffluent est le rvlateur dun
dysfonctionnement grave de louvrage. La dose moyenne applicable est de lordre dune dizaine de
centimtres, ce qui conduit une surface totale minimale denviron 1,5 mtre cube par habitant. Le
dispositif est constitu de plusieurs bassins recevant par rotation leffluent purer. Les oprations
dentretien consistent notamment en une scarification de la plage dinfiltration qui ne doit pas, par
encombrement de la surface dinfiltration (rseau de distribution, etc.), tre rendue complique.
Cette technique pouvant tre lorigine de nuisances (odeurs notamment), elle ne doit tre envisage que
dans des cas trs particuliers.
Epandage souterrain collectif
Le massif purateur est aliment par un rseau enterr. Cette conception qui assure une bonne intgration
dans le site et une protection contre les effets du gel, ne permet pas dintervenir sur la surface dinfiltration.
Il convient donc, en ltat actuel des connaissances, de raliser ces installations sur des rseaux sparatifs
et sur la base dun dimensionnement minimal de 3 mtres carrs par habitant (5cm deffluent par jour). On
privilgiera les solutions techniques permettant une gestion des apports sur plusieurs plateaux. Lutilisation
dun gotextile entre le rseau et le massif purateur, sur la totalit de la surface, est dconseille en raison
du risque de colmatage.
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
35
Domaines dapplication prfrentiels des principales techniques en matire dassainissement
des communes rurales
Population quivalente
0
50
10
0
20
0
30
0
40
0
50
0
1000
1500
2000
Techniques
pandage souterrain
lits macrophytes
lagunage naturel
lagunage ar
disques biologiques (avec
lagunes)
lit bactrien
boues actives en aration
prolonge
Niveaux types de rejet pour les ouvrages soumis dclaration
De manire schmatique, quatre classes de traitement peuvent tre distingues (cf. tableau 2).
Le niveau de traitement D1 correspond aux exigences minimales fixes larticle 14 de larrt et, dun
point de vue technique, une simple dcantation primaire sans ajout de ractifs,
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
36
Le niveau D2 permet davoir recours des solutions techniques varies parmi lesquelles les cultures
fixes, lits bactriens ou disques biologiques paraissent bien adapts aux petites collectivits tant au
point de vue de lnergie dpenser pour le traitement que la simplicit dexploitation, et notamment de
gestion des boues.
Le recours la technique du lagunage ar est prendre en considration, notamment dans le cas o des
activits artisanales sont susceptibles de provoquer des dsquilibres dans la composition des eaux
traiter ou des variations de charges importantes.
Le niveau D3 correspond bien aux performances attendues du lagunage naturel tel quil a t dvelopp
en France. Son adquation la protection du milieu tient notamment ses performances soutenues sur
lazote, mieux assures lorsque trois bassins sont raliss. Lexpression de lefficacit tient au fait quil ny a
pas conservation des dbits dans de telles installations et que la DCO non filtre est le paramtre le plus
reprsentatif et le moins critiquable pour exprimer laction du lagunage naturel sur la charge organique.
Le niveau 4 concide avec le niveau classique de traitement des collectivits dont le systme
dassainissement est soumis autorisation. Ces techniques sont bien adaptes llimination du paramtre
azote ammoniacal qui est gnralement le facteur limitant la qualit du milieu rcepteur.
Les procds choisis pour assurer ces performances devraient donc naturellement tre capables de nitrifier
au rang desquels on peut mettre en avant :
les boues actives en aration prolonges ;
les lots dinfiltration drains aliment par bches.
Tableau 2 : Niveaux types de performances des systmes de traitement
D1 D2 D3 D4
DBO.........
DCO.........
MES.........
Nkj...........
rdt 30%
rdt 50%
35 mg/l
rdt 60%
rdt 60%
25 mg/l
125 mg/l
Ces divers niveaux, applicables des moyennes sur 24 heures, sont exprims soit en rendement [(flux des
eaux brutes) - (flux des effluents purs)]/(flux des eaux brutes), soit en concentrations des polluants dans
les effluents purs dans la mesure o ils font rfrence ces procds qui se jugent difficilement sur les
mmes critres.
2.2 Fixation des objectifs de rsultat en fonction du milieu
Pour les ouvrages relevant du rgime de la dclaration et rejetant dans le milieu superficiel
Dans cette optique, en se fondant sur le cas normal o les objectifs de qualit ont t assigns au milieu
rcepteur et en appliquant de simples rgles de dilution, les niveaux du tableau 3 fixent le rapport maximal
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
37
admissible de la population quivalente lorigine du rejet au dbit dtiage du cours deau rcepteur, en
fonction :
- dune part, de lobjectif de qualit de ce dernier ;
- dautre part, des diffrents niveaux de qualit que permettent datteindre les procds de traitement
habituellement mis en uvre dans la conception des ouvrages considrs.
Les valeurs proposes prennent en compte une marge de scurit affrente aux concentrations qui
caractrisent les diffrents objectifs de qualit, essentiellement lazote ammoniacal et, accessoirement, la
demande biochimique en oxygne.
Tableau 3 - Niveaux dexigence en fonction des objectifs de qualit et de la dilution
Objectif de
qualit
IA
Pe/Qe 1 1 5 > 5
Niveau D1 D2 D3 D4
Objectif de
qualit
IB
Pe/Qe 5 5 10 > 10
Niveau D1 D2 D3 D4
Objectif de
qualit
II
Pe/Qe 10 20 25 > 25
Niveau D1 D2 D3 D4
Objectif de
qualit
III
Pe/Qe 25 50 100 > 100
Niveau D1 D2 D3 D4
Les divers niveaux de qualit de traitement des eaux uses sappliquent des populations quivalentes
raccordes louvrage limites par le rapport Pe/QE. La population quivalente Pe est gale la masse de
Dbo5 produite par jour et exprime en kilogrammes telle que calcule selon le dcret n 94-469 du 3 juin
1994, divise par 0,06. Le dbit dtiage QE est exprim en litres par seconde. Il y a lieu, en principe de se
rfrer au dbit moyen mensuel sec de rcurrence 5 ans (QMNA 5).
3. Commentaires additionnels sur larrt du 21 juin 1996
3.1 Autosurveillance
Les modalits de surveillance dfinies larticle 27 de larrt constituent des exigences minimales qui
devront tre mises en place immdiatement pour les installations nouvelles et dici le 31 dcembre 2005
pour les installations existantes. Il est souhaitable de renforcer les priodicits prvues, soit lorsque les
rejets sont effectus dans des zones fragiles, soit dans les priodes o ltiage est svre ou lorsque des
usages particuliers sont effectus en aval (baignades).
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
38
3.2. Prservation des habitants contre les odeurs et les bruits ariens
Larticle 17 de larrt impose la prise en compte, lors de la conception et du choix dimplantation de la
station, des nuisances auditives et olfactives. Sauf dispositions ou techniques particulires (notamment les
procds de traitement par le sol) il conviendra de retenir une distance de 100 mtres entre les ouvrages et
les habitations, cette distance ne pouvant tre rduite que si des prcautions spcifiques sont prises
(couverture de certains postes).
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
39
6) - REGLEMENTATION ET PROCEDURES SUR LE DEVENIR
DES BOUES DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT
6.1) - CADRE DE LA REGLEMENTATION FRANCAISE SUR LE DECHETS
Loi N92-646 du 13 juillet 1992 relative l'limination des dchets ainsi qu'aux installations
classes pour la protection de l'environnement (J.O. du 14.07.92)
Modification de la loi du 15 juillet 1975 relative l'limination des dchets et la rcupration
des matriaux .
Cette loi introduit un lien juridique troit entre la loi sur les dchets de 1975 et celle de 1976 sur
les installations classes.
Les mesures prsentes dans la loi s'organisent autour des ides suivantes :
2) clarifier les conditions d'exploitation et de surveillance des dcharges,
3) affirmer la responsabilit de l'exploitant et exiger des garanties,
4) amliorer les moyens et les conditions d'intervention de la Puissance publique,
5) crer de nouveaux moyens incitatifs pour financer la politique des dchets,
6) rformer le dispositif pnal.
TITRE I
- les 22 dispositions de l'art 1 compltent les dispositions de la loi de 1975 relative aux dchets -
il s'agit de recadrer les objectifs et les moyens de mise en oeuvre tout en assurant la transposition
de la directive CEE de 18 mars 1991 sur les dchets dangereux.
Notion de dchet "ultime": "Dchet qui n'est plus susceptible d'tre trait dans les conditions
conomiques et techniques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par
rduction de son caractre polluant ou dangereux"
"A compter du 1er juillet 2002, les installations d'limination des dchets par stockage ne seront
autorises accueillir que des dchets ultimes"
"Le transport, les oprations de courtage ou de ngoce de dchets viss l'art 8 sont rglements
et soumis soit autorisation, soit dclaration..."
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
40
La cration de commissions locales d'information et de surveillance des sites d'limination (
l'initiative soit du reprsentant de l'Etat soit du Conseil Municipal de la commune ou de la
commune limitrophe.
6.2) - PRODUCTION ET DEVENIR DES BOUES ACTUELLEMENT
Production Dcharge Agriculture Incinration
France 870 000 t MS / an 27 % 58 % 15 %
CEE 7 400 000 t MS / an 47 % 42 % 11 %
6.3) - APPROCHE REGLEMENTAIRE DES DEBOUCHES
Aujourd'hui les destinations finales des boues sont :
- l'agriculture
- l'incinration directe ou avec des ordures mnagres
- la mise en dcharge - sous certaines conditions (arrt du 09.09.1997) - cependant,
brve chance (2002), les dcharges devenant Centre denfouissement technique
n'admettront que des rsidus ultimes non valorisables.
La valorisation agricole des boues issues des stations de traitement des eaux uses urbaines
apparat encore comme la solution conomiquement la plus avantageuse pour les collectivits,
mme si la rglementation trs contraignante limitera cette filire de valorisation.
6.3.1) - DECHARGE OU CET
a) Dcret du 15.05.1997 - Classification des dchets dangereux
Les dchets provenant des stations dpurations des eaux uses ainsi que les dchets
provenant des installations de traitement des dchets sont classs sous le code : 19 000
b) Arrt du 9.09.1997 relatif aux dcharges de dchets mnagers (classe 2)
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
41
Cet arrt abroge la circulaire de 11.03.1987 qui rgissait les conditions dadmission des dchets
en dcharge de classe 2 ( type ordures mnagres)
Lannexe I & II dfinissent les diffrent types de dchets et leurs conditions dadmission ;
- Dchets admissibles :
la catgorie E : dchets volutifs pendant leur stockage prolong
la catgorie D : dchets peu volutifs pendant leur stockage prolong
Dans la catgorie D nous trouvons ;
- Boues de STEU admissible si la siccit est au moins gale 30%
- Boues de dgrillage sont admissibles ( si la siccit est gale 30%)
Dans la catgorie E nous trouvons ;
- Dchets minraux faible potentiel de polluants (sables ?)
- Dchets interdits :
- dchets liquides ou dont la siccit est infrieure 30%
Date dapplication de larrt du 09.09.1998 ; Octobre 1998
Le terme dcharge est remplac par installations de stockage .
La date de 2002 doit tre considr comme un cap, quon glisserait dj vers 2005 et de toutes
faons, la lgislation sera dcline localement dans le cadre de schmas dpartementaux.
6.3.2) - INCINERATION
Au niveau rglementaire, en ce qui concerne les fumes, on applique soit larrt du 21
.01.1991, soit la norme CEE proche de la BimschV90 ( cette norme nest pas encore rendue
obligatoire).
En ce qui concerne le devenir des cendres volantes, larrt du 10.01.1996 ne dfinit que des
rgles provisoires de classement en mchefer valorisable en remblai routiers .
Concernant la valorisation en tant que filler dans les parpaings, seules des autorisations locales
ont t obtenues de la DRIRE.
Quant aux rsidus de lavage des gaz, ils partent sans ambigut en dcharge pour DIS de classe
1 .
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
42
6.3.3) - VALORISATION AGRICOLE
Deux textes rcents rnovent la rglementation relative lpandage des boues de stations de
traitement des eaux uses ;
1) Dcret N97-1133 du 8.12.1997 (JO du 10.12.1997) relatif lpandage des
boues issues du traitement des eaux uses
2) Arrt du 8.01.1998 (JO du 31.01.1998) Prescriptions techniques applicables
aux pandages des boues sur les sols agricoles pris en application du dcret du 8.12.1997.
6.3.3.1) - Dcret du 8.12 .1997
a) Dfinition de la boue
Sdiments rsiduaires des installations biologiques ou physico-chimiques
Les matires de curage aprs traitement pour diminuer la teneur en sables et en graisses
Les matires de vidange issues des dispositifs non collectif d'assainissement
b) Les boues sont considres comme des dchets au sens de la loi du 15.07.1975
b) Interdiction de mlanger les boues ( notion de traabilite ) sauf avis du Prfet
c) Lexclusion du champ dapplication ; les produits composs en tout ou partie au titre de
la loi du 13.07.1979, bnficiant dune homologation ou, dfaut dune autorisation provisoire
de vente
d) Les exploitants des units de collecte et de traitement sont producteurs de boues ; il
leur incombe ce titre den appliquer les dispositions.
e) Dfinition des conditions dpandage :
- les boues doivent lobjet dun traitement de manire rduire de faon
significative leur pouvoir fermentescible et les risques sanitaires
- leur pandage est subordonn une tude pralable
- un registre dpandage est tenu par les producteurs
f) Les programmes prvisionnels dpandage tablis par le producteur
g) Sanctions ; contravention de la 5 classe
Dlai de mise en conformit au prsent dcret : 2 3 ans suivant les articles
Larrt du 29.08.1998 portant application obligatoire de la norme NFU 44-041 est abrog.
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
43
6.3.3.2) - Larrte du 8.01 .1998
a) Etude pralable dpandage
b) Programme prvisionnel dpandage
c) Bilan quantitatif et qualitatif des boues pandues
d) Boues non stabilises sont enfouies dans un dlai de 48 h
e) Quantit pandre : 3 kg MS / m
2
sur 10 ans
f) Qualit des boues et prcautions dusage ( teneur limite en lments trace :
mtaux et en compos traces organiques)
g) Modalit de surveillance
h) Bilan et programme prvisionnel transmis au prfet
i) Ouvrage dentreposage
j) Dpt temporaire possible sous 4 conditions
Les dispositions du prsent arrt sont applicables aux pandages dont la ralisation est en
cours au 31 janvier 1998.
6.4) - CONTEXTE REGLEMENTAIRE EUROPEEN
Jusqu ce jour, seule la directive 86/278/CEE, relative la protection de lenvironnement et
notamment des sols lors de lutilisation des boues de station de traitement des eaux uses en
agriculture, tait considre.
Cependant dautres textes rglementaires sont applicables pour la valorisation des boues ou des
dchets de lassainissement, notamment :
- Directive 75/442 relative aux dchets,
- Directive 78/319 relative aux dchets dangereux,
- Directive 89/369 & 89/429 relatives lincinration des dchets municipaux,
- Directive 91/156 relative la valorisation et llimination des dchets,
- Directive 91/271 relative au traitement des eaux rsiduaires urbaines,
- Directive 91/676 relative la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
partir des sources agricoles.
Enfin, les boues viennent dtre classes comme dchets.
Ceci implique que la responsabilit du producteur est engage, et ce quelque soit la voie
dlimination ou de valorisation choisie, mme si le dchet est transform en produit.
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
44
6.5) - FILIERES DE TRAITEMENT DES BOUES
Contraintes inhrentes la valorisation agricole des boues :
- ncessit d'un stockage minimum (8 10 mois) compte tenue de la disponibilit des
terrains agricoles (aire pour un stockage de longue dure sur le lieu de production ou les
lieux d'pandage),
- rduction importante des nuisances issues de boues qui ne sont que partiellement
stabilises (stabilisation biologique spare ou la limite chimique),
- adapter la qualit de la boue en fonction des besoins spcifiques du monde agricole
local,
- obtention de boues dshydrates avec une siccit de plus en plus leve,
- boues hyginises dans certains cas,
- intgration des contraintes des pratiques agricoles dans lorganisation de lpandage des
boues.
- filire boue qui puisse sadapter lvolution de la rglementation
Type de traitement Stabilisation Hyginisation
Aration prolonge / /
Stabilisation arobie msophyle / +
Stabilisation arobie thermophyle + + + + + +
Stabilisation anarobie msophyle + + + + +
Digestion anarobie en 2 phases + + + + + +
Chaulage (CaO) + + + + + + + + + + + +
Compostage + + + + + + + +
Schage + + + + + + + +
Incinration + + + + + + + +
Capacit de stabilisation et dhyginisation des filires boues.
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
45
Filire de dshydratation Performance en siccit
Filtre bande / centrifugeuse 20 22 % 2 %
Filtre bande / centrifugeuse + Chaux vive suprieur 30 %
Filtre presse polymre 28 2 %
Filtre presse minral 35 2 %
Centridry 60 2 %
Scheur 90 2 %
Performances des diffrents dispositifs de dshydratation
6.6) - RESPONSABILITE DES COLLECTIVITES
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 rend obligatoire la mise en place d'un systme
d'assainissement (collectif et/ou autonome) ainsi que le traitement de l'eau et l'vacuation des
boues.
L'article 35-1 de la loi sur l'eau du 3.01.1992, insre un nouvel article; l'art L372-1.1 du Code des
Communes :
"Les communes prennent obligatoirement en charge les dpenses relatives aux systme
d'assainissement collectifs, notamment aux stations d'puration des eaux uses et l'limination
des boues qu'elles produisent, et les dpenses de contrle des systmes d'assainissement non
collectif.
" Elle peuvent prendre en charge les dpenses d'entretien des systmes d'assainissement non
collectif".
L'article 35-2 de la loi sur l'eau du 3.01.1992, indique que les prestations ci-dessus doivent tre
assur sur l'ensemble du territoire avant 2005.
Cette approche de la loi sur l'eau est suivie par les textes traduisant en droit franais la directive
CEE du 21 mai 1991, savoir :
1) Le dcret du 3 juin 1994 dcrit les orientations de la transcription de la Directive du
21 mai 1991, relatif la collecte et au traitement des eaux uses mentionnes aux
articles L. 372-1-1 & L. 372-3 du Codes de Communes.
2) les 2 Arrts du 22 dcembre 1994 : "Prescriptions techniques relatives aux
ouvrages de collecte et de traitement des eaux uses", mentionns aux articles L.372-
1-1 & L.372-3 du Code des Communes.
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
46
6.7) - PROCEDURES ADMINISTRATIVES
Les 2 arrts du 29 mars 1993 concernent les procdures administratives de dclaration et
d'autorisation ainsi que la nomenclature des oprations soumises dclaration ou autorisation,
en fonction des flux gnrs par l'agglomration, et englobent en plus des procdures relatives
aux rejets aprs traitement ; les dversoirs d'orage, les rejets d'eaux pluviales, l'pandage d'eau
uses, l'pandage de boues...
L'pandage des boues issues des stations de traitement des eaux uses ncessite donc au pralable
une autorisation prfectorale (cas des STEU de plus de 10.000 Eq.hab).
L'opration d'pandage est soumise autorisation ou dclaration selon les dcrets n 93-742 (art.
2, art. 29) et n 93-743 (rubrique 5.4.0) telles que dfinies ci-dessous :
Autorisation Dclaration Pas de procdure
Volume annuel en
m
3
> 500 000 50 000> V > 500 000 < 50 000
DBO en tonnes/an > 5 0.5 > DBO > 5 < 0.5
Azote en tonnes/an > 10 1 > N > 10 < 1
Contenu 7 exemplaires 3 exemplaires
du Etude d'impact Notice d'impact
dossier Enqute utilit
publique
Pas d'enqute
La demande dpose en Prfecture comprendra :
- Le nom et l'adresse du demandeur.
- L'emplacement de l'installation.
- La nature de l'opration.
- L'incidence de l'opration sur la ressource en eau.
- Les moyens de surveillance.
- Les lments graphiques et cartographiques.
Ces renseignements se trouveront dans le "plan d'pandage" et l'tude ou notice d'impact.
Le service instructeur de cette procdure administrative est un service de l'tat (service Police des
Eaux - DDAF ou DDE / Service de la Navigation - en ce qui concerne l'pandage des boues, la
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
47
DASS instruit la procdure dans certains dpartements vraisemblablement cause de leur
implication au niveau du Rglement Sanitaire Dpartemental).
La procdure ncessite - dans le cas de l'autorisation - une enqute publique, et un passage au
CDH (avant envoi du projet d'arrt au Prfet).
Le dossier de demande d'autorisation comprend au moins :
- Etude de valorisation agricole, incluant le plan d'pandage
- Document d'incidence
- Description du projet et des ouvrages, notamment de stockage
Chaque lment du dossier doit permettre de rpondre au minimum aux points suivants :
Plan d'pandage :
- la rgion est-elle dclare en zone "vulnrable" aux nitrates ?
- Quelles sont les priodes favorables selon le type de boue (C/N) (d'o la dure de stockage
ncessaire) ?
- Identification des parcelles aptes l'pandage en fonction des prescriptions rglementaires, et
des autres plans d'pandage dans le secteur (fientes, lisiers, sucreries, fculeries ).?
- Origine, type et quantits de boues valorisables ?
- Doses pandre en fonction des tudes pdologiques, des exportations des plantes, et des
cultures pratiques ?
- Frquence des analyses de boues, de sols ?
Organisation du transport et du chantier d'pandage :
- Le transport : par qui, dans quelles conditions, avec quel matriel (bordereau
d'accompagnement obligatoire ) ?
- Le stockage : o (station, bout de champ, autre ) et quel type ?
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
48
- La pratique de l'pandage : par qui et avec quel matriel ? avec ou sans rendu-racine ?
- Planning d'pandage selon les priodes favorables et les cultures.
- Tenue d'un cahier de transport et d'pandage et bordereau de livraison.
Suivi agronomique (qui permet la vrification de la bonne pratique du plan d'pandage) :
- Par qui ?
- Quoi ?: surveillance des doses pandues, analyses des sols, suivi des rcoltes
C'est le suivi agronomique qui, en fidlisant les agriculteurs, assurera la prennit de la filire.
Ralisation des investissements ncessaires sur la station d'puration :
- Filire boue en adquation avec la filire eau et avec la valorisation prvue ?
Les "Missions Valorisation Boues" n'ont aucune prrogative en matire de procdure
administrative, leur rle - important - se situe au niveau de toutes les dmarches d'ordre
technique et relationnel avec le milieu agricole :
- proposition de mthodologie pour la valorisation et suivi agronomique
- adaptation des priodes d'pandage en fonction du type de culture et des
contraintes climatiques (proposition d'un calendrier d'pandage adapt aux cas par
cas)
- relation avec les conseillers agricoles et les agriculteurs
- suit le bon droulement de la valorisation agricole
- etc.
6.8) - ETUDE DE VALORISATION AGRICOLE DES BOUES
Cette tude est souvent sous-traite par le Matre d'Ouvrage un bureau d'tude spcialis, ou
des socits comme Agro-Developpement, SEDE , socits spcialises dans l'pandage des
boues.
Elle comprend l'estimation de la quantit de boues vacuer, les besoins en surface agricole,
l'analyse gologique, le type de boues (conditionnement, siccit...) compatible avec l'occupation
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
49
des sols, un plan d'pandage et ventuellement des propositions de filires de traitement de
boues.
6.9) - CONVENTIONS POUR L'EPANDAGE DES BOUES
Les diffrents protagonistes, ayant chacun des responsabilits spcifiques, seront les suivants :
- Le Matre d'Ouvrage
- L'Exploitant de la station de traitement
- L'Entreprise prestataire pour l'enlvement-stockage-pandage des boues
- Le ou les agriculteurs susceptibles d'tre intresss pour recevoir les boues sur leur
champs.
Dans ce domaine, plusieurs montage de conventions se pratiquent :
MAITRE D'OUVRAGE
AGRICULTEURS
Pour l'utilisation des boues
CONVENTION
ENTREPRISE
transport -stockage
pandage des boues
L'EXPLOITANT
CONVENTION
1.- Convention entre la collectivit et les agriculteurs
Sorte de contrat moral, pour la mise disposition des terrains agricoles et l'pandage des boues.
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
50
2.- Convention entre l'entrepreneur et l'exploitant
Pour effectuer la mission d'vacuation, de stockage, d'pandage, de suivi agronomique, et de la
tenue d'un cahier d'pandage en ce qui concerne la mission de l'entrepreneur.
Le suivi analytique des boues (annexe de larrt du 08.01.1998) pour l'exploitant de la station.
6.10) - DEMARCHE POUR LA VALORISATION AGRICOLE
Le schma ci-dessous prsente la chronologie des tapes ncessaires la mise en place d'une
valorisation agricole des boues de stations d'puration urbaines.
Il va de soit qu'avant de lancer cette dmarche on aura vrifi que les boues sont valorisables
effectivement et rpondent larrt du 8 janvier 1998.
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
51
LES DIFFERENTES ETAPES POUR UNE VALORISATION AGRICOLE DES BOUES
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
52
IMPACT DE LA REGLEMENTATION SUR LE DEVENIR DES BOUES
MODES
DELIMINATION
BOUES CONFORMES
la directive 86/278/C.E.E. (annexe 1
B)
BOUES NON CONFORMES
la directive 86/278/C.E.E. (annexe 1 B)
Epandage sur
les terrains
agricoles
POSSIBLE
si les autres conditions nonces par les
directives 91/676/CEE et 86/278/CEE
sont satisfaites (apports en matires
azotes, valeurs limites de concentration
en mtaux lourds de lannexe 1 A, apport
en mtaux lourds dans les sols en de de
lannexe 1 C)
INTERDIT
ces boues entrent dans le catgorie des
dchets dangereux dfinis par la directive
91/689/CEE (annexe 1 B alina 33 de la
directive)
Mise en
dcharge
POSSIBLE (en classe 2)
moyen terme si les conditions nonces
par les directives 75/442 et 91/156/CEE
sont satisfaites
IMPOSSIBILITE PROBABLE
lhorizon 2002 lorsque les dcharges
naccueilleront plus que les dchets
ultimes
INTERDITE
suivant les directives 75/442, 78/319,
91/689/CEE (annexe 1 B), les boues entrent
dans la catgorie des dchets dangereux, la
prsence de matires organiques interdit la
mise en dcharge en classe 1
Incinration POSSIBLE
linstallation doit tre quipe pour
respecter les valeurs limites de rejets
dans latmosphre fixes selon le cas par
les directives 89/429 ou 83/369/CEE
POSSIBLE
linstallation devra correspondre aux
conditions fixes par la directive sur
lincinration des dchets dangereux
Rejet en mer ou
dans tout milieu
aquatique
INTERDIT
partir du 31/12/1998 conformment la
directive 91/271/CEE
INTERDIT
partir du 31/12/1998 conformment la
directive 91/271/CEE
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
53
ANNEXE
Loi du 13.07.1979 relative lorganisation du contrle des matires fertilisantes et des supports
de cultures
Arrt du 3 juin 1998 modifiant larrt du 8.01.1998 (tableau annexe 1 b mg/m3 la place de
g/m3
Arrt du 2.02.1998 portant abrogation de larrt du 29.08.1988 portant application obligatoire
dune norme : NF U 44-041
Avis aux responsables de la mise sur le march de matires fertilisantes et de support de cultures
(JO du 6.O1.1999)
Arrt du 2.02.1998 concernant les installations classes
Arrt du 17 aot 1998 modifiant larrt du 2.02.1998 : cet arrt remplace les articles 36 42
de larrt du 2.02.1998
Circulaire DPPR/SEI du 17 dcembre 1998 relative larrt du 2.02.1998 et modifi par
larrt du 17.08.1998 concernant les installations classes.
Normes relatives aux boues
XP X33-001 : MS par vaporation sous micro-ondes
XP X 33-002 : MS par lyophilisation
NF EN 12176 : dtermination du pH (indice de classement : NF X 33-003)
Pr NF EN12879 ( indice de classement Pr X 33-004) dtermination de la perte au feu de la
matire sche
Pr NF EN 12880 : ( indice de classement Pr X 33-005) dtermination de la MS et de la teneur en
eau
NF EN ISO 5667-13 ( indice de classement NF X 33-006) guide pour lchantillonage des
boues
Pr NF EN 12832 : ( indice de classement Pr X 33-007) Vocabulaire sur les boues
Pr NF EN 13097 : Bonne pratique de la valorisation des boues dans le cadre dun plan
dpandage ( indice de classement : PrX 33-008)
NF U 44-108 (octobre 1982) boues liquide - chantillonnage en vue de lestimation de la teneur
moyenne dun lot
NF U 44-110 (octobre 1982) amendements organiques - support de culture - prparation des
chantillons partiellement secs pour essai
NF U 44-171 (octobre 1982) amendements organiques - support de culture -dtermination de la
matire sche.
XP X 31-210 (mai 1988) dchets - essai de lixiviation
NF U 42-051 ( nov 1968) Engrais - thorie de lechantillonnage et de lestimation dun lot
NF U 42-053 (mai 1979) Matires fertilisantes - engrais - contrle de rception dun grand lot
dengrais
NF U 42-080 ( dc 1981) Engrais solutions et suspensions - chantillonnage en vue de
lestimation de la teneur moyenne dun lot
NF U 42-090 (juin 1983) amendements calciques et magnsiens
U 44-101 (oct 1982) produits organiques - amendements organiques - supports et milieux de
cultures - chantillonnage
Rglementation Assainissement Chapitre 2 page
54
X 31-100 (dc 1992) qualits des sols - mthode de prlvement dchantillons de sol
NF ISO 10390 (nov 1994) Qualit du sol - dtermination du pH
NF X 31-147 ( juillet 1996) Qualit des sols - sols, sdiments - mise en solution par attaque acide
NF ISO 11464 ( dc 1994) Qualit du sol - prtraitement des chantillons pour analyses physico-
chimiques ( indice de classement NF X 31-412)
Chapitre 3
SCHEMA DIRECTEUR
DASSAINISSEMENT
A. SADOWSKI
Page 56 - Chapitre 3
SOMMAIRE
I. LE BUT DE L'ASSAINISSEMENT..........................................................................................................58
II. HISTORIQUE.............................................................................................................................................58
III. L'ETAT DE L'ASSAINISSEMENT EN FRANCE ET DANS LA C.E.E .........................................59
III.1. SITUATION EN FRANCE..........................................................................................................................59
III.1.1. Assainissement collectif et systme de traitement........................................................................59
III.1.2. Assainissement autonome ............................................................................................................60
III.2. SITUATION DANS LA C.E.E. ...................................................................................................................60
IV. NOUVELLE APPROCHE REGLEMENTAIRE................................................................................60
IV.1. LES ELUS ET LA LOI SUR LEAU..............................................................................................................61
IV.1.1. Obligation de mise en place d'un systme d'assainissement .......................................................61
IV.1.2. Rdaction dun schma directeur dassainissement ....................................................................61
IV.1.3. Prise en compte de la pollution pluviale .....................................................................................62
IV.1.4. Procdures, contrle de conformit.............................................................................................62
IV.2. RACCORDEMENT DES INDUSTRIELS ET POLICE DU RESEAU ....................................................................62
IV.3. REMISE A NIVEAU ET FIABILITE DES STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USEES..................................63
IV.4. VALORISATION DES BOUES, EPANDAGE AGRICOLE ................................................................................63
IV.5. LA RESPONSABILITE DES ELUS VIS-A-VIS DES REJETS ............................................................................64
IV.5.1. La responsabilit pnale en matire de pollution........................................................................64
IV.5.2. La responsabilit pnale en cas d'inobservation des textes.........................................................64
IV.5.3. La responsabilit civile................................................................................................................65
V. LES STRUCTURE JURIDIQUES CONCERNEES ...............................................................................65
V.1. INSTANCES TERRITORIALES...................................................................................................................65
V.2. INSTANCES DEPARTEMENTALES PUBLIQUES OU POLITIQUES..................................................................66
V.3. INSTANCES REGIONALES PUBLIQUES OU POLITIQUES.............................................................................66
V.4. INSTANCES PUBLIQUES OU POLITIQUES AU NIVEAU D'UN BASSIN...........................................................66
VI. DOCUMENTS DE SYNTHESE ET D'ORIENTATION....................................................................66
VII. LES DIFFERENTES PHASES DANS L'ELABORATION D'UN SCHEMA..................................67
VII.1. BUT D'UN SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT................................................................................67
VII.2. LES PRINCIPALES PHASES DANS L'ELABORATION D'UN DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT..........................67
VII.2.1. Programme d'assainissement ......................................................................................................68
VII.2.2. Elaboration de l'Avant-Projet de l'tude .....................................................................................68
VII.2.3. Choix ventuellement d'un matre d'oeuvre.................................................................................68
VII.2.4. Constitution ventuellement d'une cellule de travail ...................................................................68
VII.2.5. Elaboration du dossier de consultation des bureaux d'tudes (DCBE).......................................68
VII.2.6. Droulement de l'tude................................................................................................................68
VII.2.7. Mise au point du schma directeur d'assainissement ..................................................................69
VII.2.8. Approbation du schma directeur d'assainissement....................................................................69
VII.2.9. Planification et contractualisation des travaux et financement...................................................69
VII.2.10. Projet des travaux d'assainissement........................................................................................69
VIII. METHODOLOGIE POUR L'ELABORATION D'UN SCHEMA....................................................69
VIII.1. RESSOURCE EN EAU ..........................................................................................................................69
VIII.2. COORDINATION A L'ECHELLE D'UN BASSIN HYDROGRAPHIQUE..........................................................69
VIII.3. ANALYSE DES CONTRAINTES.............................................................................................................69
VIII.4. RECENSEMENT ET ANALYSE DES POLLUTIONS...................................................................................70
VIII.5. DIAGNOSTIC DU RESEAU EXISTANT...................................................................................................70
VIII.6. DIAGRAMME GENERAL POUR L'ELABORATION D'UN SCHEMA (CF. FIGURE 3-1) .................................71
Schma directeur dassainissement - Page 57
VIII.7. DIAGRAMME GENERAL POUR LE DIMENSIONNEMENT D'UN RESEAU COLLECTIF.................................71
VIII.8. DIAGRAMME GENERAL POUR L'APPROCHE DE L'ASSAINISSEMENT AUTONOME ..................................71
VIII.9. PROPOSITION D'APPROCHE METHODOLOGIQUE DES EVENEMENTS PLUVIEUX (ESQUISSE) ..................73
VIII.9.1. Introduction .................................................................................................................................73
VIII.9.2. Proposition d'approche mthodologique.....................................................................................75
IX. TYPOLOGIE DES DIFFERENTS OBJETS DE L'ASSAINISSEMENT.........................................77
IX.1. TYPOLOGIE DES REJETS POLLUANTS......................................................................................................77
IX.1.1. Effluents domestiques ..................................................................................................................77
IX.1.2. Effluents industriels .....................................................................................................................77
IX.2. TYPOLOGIE DES SOUS-PRODUITS ...........................................................................................................77
IX.3. TYPOLOGIE DES OUVRAGES...................................................................................................................78
IX.3.1. Rseaux........................................................................................................................................78
IX.3.2. Bassins .........................................................................................................................................78
X. COUTS DE L'ASSAINISSEMENT ..........................................................................................................78
X.1. RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES......................................................................78
X.2. RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTE DES EAUX PLUVIALES ...............................................................78
X.3. ASSAINISSEMENT AUTONOME COMPLET................................................................................................79
X.4. TRAITEMENT DES EAUX USEES ..............................................................................................................79
X.5. TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES.......................................................................................................79
XI. CONTENU D'UN SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT................................................79
XII. PHASES ULTERIEURES D'UN SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT......................81
XII.1. INFORMATION DES USAGERS SUR L'ENJEU DU SCHEMA..........................................................................81
XII.2. ARTICULATION AVEC LE SAGE.............................................................................................................81
XII.3. CONTRAT D'AGGLOMERATION...............................................................................................................81
XII.4. PROGRAMMATION DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ...........................................................................81
XII.5. CRITERE D'EVALUATION........................................................................................................................81
XII.6. MODE DE FINANCEMENT .......................................................................................................................81
XII.6.1. Ouvrages faisant l'objet d'une subvention...................................................................................81
Page 58 - Chapitre 3
I. LE BUT DE L'ASSAINISSEMENT
Certaines fonctions de l'assainissement sont permanentes (sanitaire, inondation). D'autres
sont apparues en fonction de nouveaux objectifs fixs provenant essentiellement de
l'altration du milieu rcepteur (traitement de la pollution carbone, objectif de qualit des
rivires, cartes piscicoles, ...). Enfin de nouvelles fonctions sont envisages pour les
dcennies prochaines (traitement des nutrients, traitement des eaux pluviales, traitement de
l'ensemble des dchets gnrs par le systme, micropolluants, ...).
Les principaux buts de l'assainissement sont les suivants :
Collecter et vacuer les eaux uses en fonction des exigences de la sant
publique et de l'environnement (assainissement collectif - autonome).
Evacuer les eaux pluviales pour viter l'inondation des zones urbaines avec
stockage et traitement ventuel.
Traitement des eaux uses et ventuellement des eaux pluviales en fonction des
objectifs fixs sur le milieu rcepteur (usage de l'eau, alimentation en eau potable,
intrts piscicoles et conchylicoles, ...).
Matrise des rejets industriels raccords ou non un rseau.
S'assurer de l'vacuation des dchets gnrs par le systme (boues, matires
de vidange, ...)
Amliorer la collecte de la pollution vers le traitement, les ouvrages de dcharge,
l'tanchit des rseaux, ...
Amliorer la fiabilit du "systme rseau - station de traitement" (en marche
normale et en marche dgrade)
Optimiser les cots d'investissement et de fonctionnement de l'ensemble du
systme.
II. HISTORIQUE
Cette historique vous donne quelques points de repre sur l'histoire de l'assainissement. Il
semble intressant de partir de l'histoire de la ville, de ses reprsentations, des histoires des
maladies associes aux sciences de l'hygine, enfin de l'histoire de l'eau.
Le point de dpart de cette longue aventure pourrait tre la conjonction de trois
vnements : la naissance de l'espace urbain oppos la campagne, la dcouverte de
la circulation du sang (accordant l'air un rle dcisif) et l'intervention des mdecins qui
fondent l'hygine publique, c'est dire un rapport entre la maladie, la mort et
l'environnement.
Le thme de la circulation se reporte sur la ville, "la circulation de l'air est la condition
principale de l'hygine publique; la stagnation, qui facilite l'exhalaison des miasmes, le risque
essentiel". Les premires plaintes, enregistres par l'autorit administrative, eurent pour
objet les odeurs. Hippocrate dans son "Des airs, des eaux et des lieux" s'intressa dj
l'hygine individuelle et aux prmisses de l'hygine publique. Au XVII
me
, une analogie se
glisse alors entre le corps humain, le corps urbain et les corps sociaux, analogie se
retrouvant dans la notion de fonction.
Le rseau d'assainissement du corps urbain est l'image de la circulation du sang dans le
corps humain.
Schma directeur dassainissement - Page 59
Les premires dmarches datant du XVII
me
eurent pour origine les puanteurs et donc la
ncessit premire furent l'invention de l'anctre du water-closet et une vacuation partielle
par des rseaux hydrauliques en direction du sol ou d'missaire, mais surtout l'vacuation
par vidange. Ce sont les mdecins hyginistes qui font la relation entre l'eau et les
pidmies de cholra. Mais il faudra attendre fin XIX
me
pour que la solution du "tout--
l'gout" soit adopte.
La dmarche est empreinte de deux logiques : liminer les puanteurs immondes dans
la ville et assurer la population une eau de consommation saine. Logique qui s'est
maintenue jusqu' la deuxime moiti du XX
me
, o apparat alors une autre proccupation;
celle de la protection du milieu rcepteur et de son cosystme aquatique (loi de 1964).
Il nous faudra attendre la fin de ce sicle pour avoir une dmarche systmique dans la
gestion des ressources en eau, la prise en compte des usages contradictoire (baignade,
irrigation, industries, conchyliculture, piscicole, ...) mais aussi dans la gestion de
l'assainissement par la ncessit de prendre en compte le traitement de tous les sous-
produits inhrents la collecte, au transport et au traitement de l'eau et enfin l'impact des
eaux pluviales sur le milieu naturel (loi de 1992).
III. L'ETAT DE L'ASSAINISSEMENT EN FRANCE ET DANS LA C.E.E
III.1. SITUATION EN FRANCE
Des efforts consentis depuis 20 ans ont conduit une volution favorable ces dernires
annes, mais le bilan est insuffisant (valeurs du rapport 1991-1992).
III.1.1. Assainissement collectif et systme de traitement
La France dispose dun parc de 11210 stations environ avec une capacit de 70,17 M EH
soit 96% des besoins, mais une "surcapacit" est ncessaire pour absorber la pollution par
temps de pluie. Ces quelques donnes chiffres donnent un aperu de ltendu des progrs
raliser :
62% de la pollution mise est raccorde, 51% environ de taux de collecte;
rendement des stations infrieures 70% pour les matires oxydables (MOX) et 35%
pour les matires azotes et phosphores (1% et 1,5% du nombre de stations traitent
N et P);
taux de dpollution de 42 % sur les MOX et 48 % sur les MES;
les objectifs de qualit sont respects 35% en moyenne;
production de boue : la production sera multiplie par 3 4 dans les 10 ans venir.
Lobjectif pour l'an 2000 est datteindre 80% de collecte et 80 % de rendement soit un taux
de dpollution de 65%.
Page 60 - Chapitre 3
III.1.2. Assainissement autonome
La part de l'assainissement autonome reprsente 13 M d'habitants (dont 2 M d'habitants
au titre des communes priphriques urbaines). On estime entre 40 et 45 % le nombre
d'installations non conformes la rglementation. Le nombre annuel d'installations
individuelles est de 65 000 150 000 (selon les sources).
Les communes rurales reprsentent 42 % de la population permanente (24,38 M
d'habitants permanents et 13,4 M d'hab. saisonniers).
III.2. SITUATION DANS LA C.E.E.
Grande - Bretagne
Insuffisance d'investissement provoquant un dclin progressif de la qualit de l'eau.
Accroissement rcent important.
R.F.A
92% de la population est raccorde.
Objectif 95% de raccordement et un taux d'quipement de 80% pour l'azote et le
phosphore.
Danemark
Problme prioritaire ; l'eutrophisation.
Objectif : rduction de 50% des rejets en azote et de 80% des rejets en phosphore.
85% de la capacit de traitement comporte un traitement de N/P.
Pays-Bas
75% de la population est raccorde une station biologique
Objectif : traitement de 75% du phosphore et 70% de l'azote
Italie
56% de la population raccorde un rseau.
26% de la population raccorde une station de traitement dont 50% environ sont
hors service.
Une rforme rcente permet aux communes de rpercuter intgralement les cots
d'investissement sur le prix du service.
IV. NOUVELLE APPROCHE REGLEMENTAIRE
Un contexte rglementaire volutif et dont l'orientation gnrale peut tre traduite par les
textes suivants, introduisant de plus en plus une influence de dcisions au niveau europen
:
la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 (continuit de celle de 1964);
la directive CEE du 21 mai 1991 (1 dcret et 4 arrts en attente);
la loi sur les dchets (13.07.1992);
le dcret du 29 mars 1993 concernant les procdures administratives;
Schma directeur dassainissement - Page 61
l'arrt du 1
er
mars 1993 rglementant les rejets industriels (Installations Classes);
les tudes d'impacts (Dcret du 25.02.1993 et Circulaire du 27.09.1993);
la loi sur l'administration territoriale (Loi de 1992);
rglement sanitaire dpartemental ( rglement type de la Circ. du 18.05.1984);
rglement de service d'assainissement (Rglement type de la circulaire du
19.03.1986);
cahier des charges type pour l'exploitation pour affermage d'un service
d'assainissement (Dcret du 16.10.1986).
IV.1. LES ELUS ET LA LOI SUR LEAU
IV.1.1. Obligation de mise en place d'un systme d'assainissement
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 rend obligatoire la mise en place d'un systme
d'assainissement (collectif et/ou autonome), ainsi que le traitement de l'eau et l'vacuation
des boues.
L'article 35-1 de la loi sur l'eau du 03.01.1992, insre un nouvel article de l'article L372-1.1
du Code des Communes :
"Les communes prennent obligatoirement en charge les dpenses relatives aux
systme d'assainissement collectifs, notamment aux stations d'puration des eaux
uses et l'limination des boues qu'elles produisent, et les dpenses de contrle
des systmes d'assainissement non collectif.
"Elle peuvent prennent en charge les dpenses d'entretien des systmes
d'assainissement non collectif".
L'article 35-2 de la loi sur l'eau du 3.01.1992, indique que les prestations ci-dessus doivent
tre assur sur l'ensemble du territoire avant 2005.
IV.1.2. Rdaction dun schma directeur dassainissement
L'article 35-3 de la loi sur l'eau du 3.01.1992, insre une nouvelle rdaction de l'art L.372-3
du Code des Communes :
"Les communes ou leur regroupement dlimitent, aprs enqute publique :
"les zones d'assainissement collectif o elles sont tenues d'assurer la collecte
des eaux uses domestiques et le stockage, l'puration et le rejet ou la
rutilisation de l'ensemble des eaux collectes";
"les zones relevant de l'assainissement non collectif o elles sont seulement
tenues, afin de protger la salubrit publique d'assurer le contrle des dispositifs
d'assainissement et, si elles le dcident, leur entretien".
Le Schma Directeur d'Assainissement, tabli en cohrence avec les SAGE, devient un
document obligatoire, soumis autorisation prfectoral et un pralable tout travaux
d'assainissement d'envergure (art 35-1 de la loi du 3.01.1991 et dcret paratre).
Page 62 - Chapitre 3
IV.1.3. Prise en compte de la pollution pluviale
L'art 35-3 de la loi du 3.01.1992 introduit une nouvelle rdaction de l'article L.372-3 du
Code des Communes, sur de la collecte et le traitement des eaux, autres que les eaux uses
en temps sec :
"les zones o des mesures doivent tre prises pour limiter l'impermabilisation des
sols et pour assurer la matrise du dbit et de l'coulement des eaux pluviales et de
ruissellement;"
"les zones o il est ncessaire de prvoir des installations pour assurer la collecte,
le stockage ventuel et, en tant que besoin le traitement des eaux pluviales et de
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de
nuire gravement l'efficacit des dispositifs d'assainissement ".
IV.1.4. Procdures, contrle de conformit
Auparavant les rejets des stations de traitement des eaux uses taient soumis
autorisation prfectorale, cela s'ajoute maintenant avec le nouveau dcret du 29 mars
1993, une procdure de dclaration ou d'autorisation pour les dversoirs d'orage situs sur
les rseaux ainsi que pour l'ensemble des rejets d'eaux pluviales.
La commune est habilite et est tenue de raliser le contrle de conformit des
branchements particuliers (art 36-3 de la loi sur l'eau du 3.01.1992). La redevance
d'assainissement peut tre perue ds la mise en service d'un gout nouveau, sans attendre
le dlai de 2 ans donn aux riverains pour se raccorder (art 36-1 de la loi du 3.01.1992).
L'art 35-4 de la loi modifie l'article L.372-6 du Code Commune et rappelle que les Services
Publics d'Assainissement sont financirement grs comme des services caractre
industriel et commercial, impliquant un quilibre budgtaire.
IV.2. RACCORDEMENT DES INDUSTRIELS ET POLICE DU RESEAU
L'art 35-8 du Code de la Sant Publique rappelle que le rseau d'assainissement est
essentiellement destin pour des effluents domestiques et que les effluents industriels
peuvent tre tolrs et ce sous certaines conditions. Tout dversement d'eaux uses,
autres que domestiques dans les gouts publics, doit tre pralablement autoris par la
collectivit laquelle appartient les ouvrages, ...".
Le pouvoir de police de rseau donc d'autorisation est du ressort du Matre d'Ouvrage et
ce pouvoir de police ne se dlgue pas.
Le Rglement de service d'assainissement (Circulaire du 19.03.1986) et la circulaire de
Bouchardeau (Cir du 24.01.1984), prcisait la ncessit d'une autorisation pralable
associe la ngociation, puis la signature d'une convention. Depuis l'arrt du 1
er
mars
1993 (arrt concernant les Installations Classes soumises autorisation), cette ncessit
de passer une convention avec un industriel avant tout raccordement au rseau est devenu
une obligation rglementaire.
Les conventions des rejets industriels sont particulirement d'actualit.
Contexte rglementaire : Directive C.E.E, Loi sur l'eau et arrts d'application :
arrt du 1
er
mars 1993 rendant obligatoire les conventions sur les rejets
industriels dans un rseau d'assainissement collectif (art 34);
Schma directeur dassainissement - Page 63
obligation de rsultat (renforcement de la police des eaux dans la logique des
Installations Classes, normes de rejet plus svres et contrle des rejets
accrus);
recherche et constatation des infractions (sanctions pnales leves - art 22 de
la loi sur l'eau, sanctions administratives type Installations Classes, Association
se portant partie civile - art 27 de la loi).
La traduction en droit franais de la directive C.E.E imposera une fiabilit de
traitement et dexploitation 93%.
Un auto-contrle du traitement mais aussi de l'impact sur le milieu rcepteur plus
consquent.
Interdiction en 2002 des dcharges de classe 2 pour les boues "non contamines" et
interdiction terme de la classe 1 pour les autres boues dites "contamines". La
matrise du traitement des eaux uses (fonctionnement et dimensionnement) passe
par la connaissance de l'effluent brut, notamment celui provenant des installations
industrielles.
IV.3. REMISE A NIVEAU ET FIABILITE DES STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX
USEES
L'application et la traduction en droit franais de la Directive Europenne du 21 mai 1991,
ncessitera la mise en place de niveaux de traitement plus pousss, ainsi que l'obligation de
rsultat, savoir le respect de ces normes plus pousses quasi en permanence (93 % du
temps), ceci en priode de temps sec mais y compris pendant des vnements pluvieux non
"exceptionnels".
Ncessit, de traiter l'azote et le phosphore, dans les zones dites "sensibles" et partout o
cela s'avrera ncessaire, en fonction de l'objectif de qualit du milieu rcepteur. Cela
impliquera :
des installations soigneusement dimensionnes pour les charges maximales en
pollution en priode de temps sec mais aussi celle provenant d'vnements pluvieux;
des quipements de traitement des boues suffisamment dimensionns et
compatibles avec la filire de valorisation des boues;
des quipements en secours, plusieurs files de traitement;
une conception de l'automatisation plus volue et associe une gestion des
alarmes distance.
IV.4. VALORISATION DES BOUES, EPANDAGE AGRICOLE
La prise en charge de l'vacuation et de la valorisation de l'ensemble des sous-produits
de l'assainissement (refus de dgrillage, boues de curage du rseau, graisses, sables et
boues du traitement) est la charge du Matre d'Ouvrage (loi sur l'eau : art 35).
Les schmas directeurs d'assainissement doivent aborder la destination de ces refus.
Page 64 - Chapitre 3
De plus, la loi du 13 juillet 1992 relative l'limination des dchets prvoit la
disparition terme des dcharges ( compter du 1
er
juillet 2002). L'ensemble des sous-
produits devront tre valoriss. "Les futures installations d'limination des dchets par
stockage ne seront autorises accueillir que des dchets ultimes".
La ncessit d'obtenir une fiabilit de l'ordre de 93% sur l'ensemble du traitement,
ncessite de prenniser la filire d'vacuation des boues et notamment de privilgier la
valorisation agricole. Dans la cadre actuelle de la rglementation, cette filire de
valorisation est de loin la moins onreuse (4 10 fois moins cher que l'incinration, l'autre
alternative court terme pour liminer les boues).
La traduction de la directive CEE du 21 mai 1991, impliquera la mise en place obligatoire
d'un auto-contrle pour le suivi des installations de traitement et l'obligation du respect du
niveau de rejet 93% du temps, "hors vnements pluvieux exceptionnels".
Suite au dcret du 29 mars 1993, toute pandage des boues est soumis dclaration
(station de plus de 1000 Eq.hab) ou autorisation (station de plus de 10.000 Eq.hab). Cette
procdure implique une tude prcise de valorisation des boues ainsi qu'un plan
d'pandage (dcret du 8.12.1997 et larrt du 8.01.1998).
IV.5. LA RESPONSABILITE DES ELUS VIS-A-VIS DES REJETS
IV.5.1. La responsabilit pnale en matire de pollution
La responsabilit pnale en matire de pollution sapplique sur la base de l'article 232-2
(anciennement art. 407) du Code Rural et de l'article 22 de la loi sur l'eau
Cette condamnation est prononce contre une personne physique (reprsentant du Matre
d'Ouvrage) et non contre une collectivit (personne morale), en cas de pollution sur le milieu
aquatique. Les responsables de services publiques peuvent galement tre poursuivis.
Trs exceptionnellement, des maires ont t reconnus pnalement responsables sur la
base de l'art 232-2 du Code Rural (Trib. Corr. Senlis, 3.11.1967, Trib. Corr. Rennes,
22.03.1973, Trib. Corr. Rennes, 27.05.1993), en raison de pollution engendre par l'absence
de station d'puration, ou le mauvais fonctionnement de celle existante.
La procdure de transaction est prvue par le dcret N89-554 du 2.08.1989 et prcise
par la circulaire modifie du 2.08.1990. L'administration peut transiger avec les dlinquants
conformment l'art L. 238-1 du Code Rural et aprs accord du Procureur de la Rpublique
(Code Rural, art R 238-1 et Circulaire du 31.01.1986).
IV.5.2. La responsabilit pnale en cas d'inobservation des textes
Cette responsabilit est fonde sur l'article 44 du dcret N 93-742 du 29 mars 1993 et les
articles 22, 23, 26 et 30 de la loi sur l'eau du 3.01.1992
La responsabilit pnale peut tre la sanction d'un manquement des textes de
prvention ou d'interdiction et, ce mme s'il n'en a rsult aucun dommage. Des sanctions
pnales sont prvues en cas d'infractions aux rglements municipaux dicts en vue de
protger la salubrit publique.
En cas d'inaction fautive du maire, compte tenu d'un danger grave et imminent, sa
responsabilit pourrait tre engage (Conseil d'Etat du 11 mai 1960, commune du Teil).
Schma directeur dassainissement - Page 65
IV.5.3. La responsabilit civile
La responsabilit civile pour fait de pollution des eaux est principalement fonde sur les
articles 1382 et 1384 du Code Civil et sur une jurisprudence qui devient de plus en plus
abondante. La responsabilit civile pse sur toute personne physique ou morale, prive ou
publique, pour son fait ou celui de ses prposs et notamment sur une socit ou une
commune auteur de dversements.
Une commune ou une communaut urbaine est responsable de l'absence
d'ouvrages publics propres prvenir une pollution (Conseil d'Etat 19.02.1988), du
mauvais fonctionnement de son rseau d'assainissement (CE 10.06.1977, Commune de
Tantonville), du dfaut de dimensionnement du rseau d'vacuation d'eau pluviale (CE
10.05.1983, Charleville-Mzires), ou du dfaut d'entretien du rseau d'assainissement
(CAA Bordeaux 9.06.1992, Commune de Castelnaud-de-Gratecambe).
La Commune est galement responsable des dversements issus de sa station
d'puration (CE 17.02.1978 et 25.10.1978, Commune Urbaine du Mans, CE 5.12.1980,
Ville de Tarbes).
La Commune est galement responsable de la pollution cause par des
dversements industriels qu'elle a accept dans son rseau d'assainissement (Tri Ad
Chlons-sur-Marne 15.02.1965, TA Rouen 24.04.1970, Fdration de pche de la Somme et
TA Clermont-Ferrand 20.01.1976, Commune de Murat).
La commune peut dgager sa responsabilit si la pollution provient de l'envoi
d'eaux rsiduaires industrielles et si elle a t en mesure de s'opposer l'envoi de celles-
ci (CE 15.12.1943, Commune de Chazelles et CE 12.07.1969). Toutefois elle a la possibilit
de se retourner contre l'industriel utilisateur du rseau (TA Besanon 15.03.1968, CE
24.02.1971 et CE 15.10.1976) et tre exonre de toute responsabilit s'il ne rsulte pas de
l'instruction qu'elle a commis, par carence ou dans l'exercice de ses pouvoirs de police, une
faute lourde (CE 13.07.1968, CE 13.03.1970).
Si la pollution est l'oeuvre de plusieurs pollueurs, l'un deux peut tre condamn pour le
tout, sauf se retourner contre les autres coauteurs (TGI Chlons-sur-Marne, 15.06.1973,
Droit Rural, fv.1974).
V. LES STRUCTURE JURIDIQUES CONCERNEES
V.1. INSTANCES TERRITORIALES
Commune.
Commission consultative (Structure d'information pour les usagers, cre par la loi
sur l'administration territoriale).
Syndicat de communes (SIVOM vocation multiple, SIVU vocation unique).
Communaut urbaine (Regroupement de communes de plus de 50 000 hab.).
Communaut de communes (Etablissement public de coopration intercommunale
pour les communes formant un ensemble de moins de 20 000 hab.).
Communaut de villes (Etablissement public de coopration intercommunale pour
les communes formant un ensemble de plus de 20 000 hab.).
Page 66 - Chapitre 3
District (Etablissement public groupant plusieurs communes et exerant de plein
droit un certain nombre d'attribution en leur lieu et place).
Communaut locale de l'eau (Etablissement public pour la ralisation des objectifs
des SAGE).
V.2. INSTANCES DEPARTEMENTALES PUBLIQUES OU POLITIQUES
Conseil gnral.
Direction Dpartementale de l'Agriculture et des Forts (DDAF).
Direction Dpartementale de l'Equipement (DDE).
Direction Dpartementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS).
Chambre dpartementale de l'agriculture.
Fdrations Dpartementales des Associations Agres de Pche et de Pisciculture
(FDAPP).
Conseil Dpartemental d'Hygine (CDH).
V.3. INSTANCES REGIONALES PUBLIQUES OU POLITIQUES
Conseil rgional.
DIrection Rgionale de l'ENvironnement (DIREN).
Direction Rgionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE).
V.4. INSTANCES PUBLIQUES OU POLITIQUES AU NIVEAU D'UN BASSIN
Comit de bassin.
Agence de l'Eau.
VI. DOCUMENTS DE SYNTHESE ET D'ORIENTATION
La rdaction dun schma directeur dassainissement doit se faire sur la base des
diffrents documents suivants (pour autant quils existent) :
Les cartes d'objectif de qualit des cours d'eau.
Les schmas Dpartementaux de vocation Piscicole dterminent les potentialits
piscicoles des cours d'eau, recensent les atteintes faites leur qualit et prconisent
les actions engager.
Les schmas directeur d'amnagement et de gestion de l'eau (SDAGE).
Les schmas d'amnagement et de gestion de l'eau (SAGE).
Les schmas dpartementaux de collecte des ordures mnagres et des matires de
vidanges.
Les schmas dpartementaux d'amnagement urbain (SDAU).
Les plans de protection des ressources ( les primtres de protection).
Les plan d'occupation des sols (POS) ainsi que les annexes (servitudes).
Les plans d'amnagement de zone (PAZ) dans le cadre d'une ZAC (zone
d'amnagement concert).
Schma directeur dassainissement - Page 67
Le plan de surface submersible (PSS).
La carte communale, qui prcise les modalits d'application des rgles gnrales
d'urbanisme (MARGU).
Le plan d'exposition aux risques naturels prvisibles (PER);
...
VII. LES DIFFERENTES PHASES DANS L'ELABORATION D'UN
SCHEMA
VII.1. BUT D'UN SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT
Mise en place d'une orientation moyen et long terme pour amliorer la
qualit, la fiabilit et la capacit d'un systme d'assainissement d'une
collectivit.
IL dfinit pour les situations prochaine et future les modalits de collecte, de traitement et
d'vacuation des effluents et des dchets sur une entit territoriale bien caractrise.
Traduit graphiquement sur des plans, il dfinit une cohrence sur les travaux engager
entre le court terme et le long terme en fonction d'objectifs de protection clairement dfinis.
Il propose une comparaison technico-conomique des diffrentes solutions pour une
efficacit technique associe diffrents objectifs de protection et cela en fonction des
capacits financires de la collectivit pour de objectifs graduels d'une part et d'autre part
en fonction d'une conomie sur les investissements pour un mme objectif.
VII.2. LES PRINCIPALES PHASES DANS L'ELABORATION D'UN DIRECTEUR
D'ASSAINISSEMENT
La chronologie des diffrentes phases est la suivante :
1) Programme d'assainissement dfinissant les objectifs du schma directeur
d'assainissement ainsi que les contraintes.
2) Avant-projet de l'tude et approbation du Matre d'Ouvrage.
3) Mise au point d'un cahier des charges pour l'laboration d'un schma directeur
d'assainissement incluant un cahier des charges pour le diagnostic du systme
d'assainissement
4) Choix du bureaux d'tudes pour la mise en oeuvre de l'tude globale.
5) Mise au point du schma directeur d'assainissement.
6) Approbation du schma par la Matre d'Ouvrage.
7) Passage au CDH et approbation prfectorale.
8) Intgration du schma dans la POS et transmission au SAGE.
9) Information des usagers - matriel de communication.
Page 68 - Chapitre 3
VII.2.1. Programme d'assainissement
Dcision politique d'un matre d'ouvrage dcidant de lancer une rflexion gnrale sur
l'assainissement dans son primtre d'influence et dfinissant les objectifs et les contraintes
prsentes sur son territoire (Objectifs articuls des contraintes parfois antagonistes) :
usagers - "tout l'gout"- inondation;
conception - recherche d'une nouvelle approche du systme;
contrle pollution (mesure prventive pour inciter la limitation des rejets polluants);
traitement de la pollution des eaux uses et des eaux pluviales;
le service charg dexploiter le systme;
le matre d'ouvrage - approche volutive associe la recherche d'un optimum entre
les cots d'investissement et les cots d'exploitation.
VII.2.2. Elaboration de l'Avant-Projet de l'tude
Cet avant-projet est soit labor par un matre d'oeuvre choisit pralablement par le matre
d'ouvrage soit il est labor par les Services techniques du Matre d'Ouvrage, et comprend :
1) les objectifs recherchs par le schma directeur;
2) le cot prvisionnel de l'tude pour l'laboration du schma directeur;
3) le plan de financement prvisionnel de l'tude (l'Agence de l'eau finance 50% par
exemple);
4) lapprobation par la structure dlibrante du Matre d'Ouvrage;
5) la demande d'aide financire (Agence, Dpartement, ...).
VII.2.3. Choix ventuellement d'un matre d'oeuvre
Ce choix ventuel se fait selon un appel d'offre sur concours (dcret du 13.12.1992) et en
application du dcret du 29.11.1993 et de larrt du 21.12.1993.
VII.2.4. Constitution ventuellement d'une cellule de travail
Elle peut tre compose du Matre d'Ouvrage et de ses services techniques, de l'Agence
de l'Eau, des services techniques dpartementaux (Conseil Gnral, Prfecture, ...). Cette
cellule de travail intervient pour :
la dfinition du primtre de l'tude (il y a lieu de diffrencier les eaux uses et les
eaux pluviales);
la centralisation et la mise jour de l'ensemble des documents ncessaires au
pralable l'tude;
llaboration d'une carte d'aptitude des sols l'assainissement individuel
(pdologue - mise au point d'un programme d'tude des sols).
VII.2.5. Elaboration du dossier de consultation des bureaux d'tudes
(DCBE)
VII.2.6. Droulement de l'tude
Schma directeur dassainissement - Page 69
VII.2.7. Mise au point du schma directeur d'assainissement
VII.2.8. Approbation du schma directeur d'assainissement
Cette approbation doit se faire selon le schma suivant :
approbation par la matre d'ouvrage;
passage et avis du CDH;
notification prfectorale;
intgration au POS - SDAU;
communication au SAGE;
information des usagers sur l'enjeu du schma.
VII.2.9. Planification et contractualisation des travaux et
financement
Un contrat d'agglomration est sign avec l'Agence.
VII.2.10.Projet des travaux d'assainissement
Ce projet comporte :
un dossier technique en vue de la ralisation des travaux;
un dossier de consultation des entreprises;
les travaux.
VIII.METHODOLOGIE POUR L'ELABORATION D'UN SCHEMA
VIII.1.RESSOURCE EN EAU
VIII.2.COORDINATION A L'ECHELLE D'UN BASSIN HYDROGRAPHIQUE
Carte d'objectif de qualit des milieux rcepteurs.
Schmas dpartementaux vocation piscicole.
Contrat de rivire - SAGE.
Diffrents partenaires (Agence de l'Eau, M.O. publics et privs, lus locaux, DRIRE,
DIREN, Comit Local de l'Eau, association, APP, ...)
VIII.3.ANALYSE DES CONTRAINTES
Eaux superficielles (cours d'eau, usages en aval de la commune).
Eaux souterraines (lieux de rejet, nappe, AEP).
Primtres de protection des prises d'eau (captage, source, prise en rivire).
Relief, topographie.
Climat (pluviomtrie, temprature, vent, neige, ...).
Aptitude des sols.
Page 70 - Chapitre 3
VIII.4.RECENSEMENT ET ANALYSE DES POLLUTIONS
Mise jour des plan de recollement des rseaux et des quipements existants.
Effluents : domestique, industriel, agricole, matires de vidanges.
Pathologie des phnomnes pluvieux (inondation, pollution).
Pathologie des autres sources d'intrusion dans le rseau (ECP).
Pathologie des raccordements (domestiques, industriels, agricoles, ...).
Inventaire de l'assainissement individuel.
VIII.5.DIAGNOSTIC DU RESEAU EXISTANT
Dgager les insuffisances des structures actuelles de l'assainissement (EU, EP, EI,
ECP, STEP) en temps sec et pluie.
Prvoir l'volution en situation prochaine et future en fonction des prvisions de
l'urbanisation (EU, EI, EP).
Inventaire des industries prsente dans le primtre, des conventions de
raccordement existantes et caractrisation des effluents industriels.
Campagnes d'analyse en vue d'estimer les flux traiter par temps sec et/ou par
temps de pluie.
Evaluation par des campagnes de mesure de l'impact sur le milieu naturel des rejets
directs et indirects (temps sec - temps de pluie).
Evaluation des capacits hydrauliques des collecteurs et modlisation.
Zonage des diffrents mode d'assainissement.
Dfinir les niveaux de rejet provisoires du systme au regard de l'objectif de qualit
du milieu rcepteur.
Etude et valuation d'une destination de l'ensemble des sous-produits (boues,
produits de curage, graisse, ...).
Esquisse des diffrentes filires de traitement (eaux uses, eaux pluviales,
traitement, destination des sous-produits, traitement autonome).
Nature et importance des travaux raliser.
Evaluation financire de diffrents scnarios associant :
plusieurs degrs de dpollution ou de protection;
prconisation technique.
Classement des objectifs par degr croissant d'investissement.
Schma directeur dassainissement - Page 71
Etablissement d'un programme pluriannuel en fonction de leur efficacit vis--vis de
la protection du milieu (technique et financier).
Indication sur la gestion et l'exploitation du systme afin d'optimiser le
fonctionnement et dans garantir la fiabilit ainsi que les scnarios de fonctionnement
dgrad
VIII.6.DIAGRAMME GENERAL POUR L'ELABORATION D'UN SCHEMA (CF. FIGURE 3-
1)
VIII.7.DIAGRAMME GENERAL POUR LE DIMENSIONNEMENT D'UN RESEAU
COLLECTIF
VIII.8.DIAGRAMME GENERAL POUR L'APPROCHE DE L'ASSAINISSEMENT
AUTONOME
Page 72 - Chapitre 3
Figure 3-1 : Diagramme des diffrentes phases de llaboration dun schma directeur
dassainissement.
Diagramme des diffrentes phases de l'laboration
d'un schma directeur d'assainissement
Choix d'un
bureau d'tude
Contrat
d'agglomration
Dcision
Phase 1
Connaissance
du systme
Phase 2
- Diagnostic
- Recollement
- Mesures des rejets
Comparaison
Phase 3
Diffrentes
- Solutions techniques
- Scnarios d'impact
sur l'environnement
Choix
Phase 4
- Solution technique
optimale
- Planning
- Investissement
optimal
Information
Phase 5
- Devis-programme
- Primtre
-Cahier des charges
Programme de
rhabilitation
hirarchis
Document de
dcision
- graphes
- schmas
- tableaux
Programme
pluriannuel de
travaux
Financement
Procdure
administrative
Travaux
- Information des
usagers
- POS (SAGE)
Schma directeur dassainissement - Page 73
VIII.9.PROPOSITION D'APPROCHE METHODOLOGIQUE DES EVENEMENTS
PLUVIEUX (ESQUISSE)
Ce document provisoire a t tabli partir d'un projet de J.L.BERTRAND.K.
VIII.9.1. Introduction
La diversit des situations tant considrable, une approche technique et conomique du
problme ne peut se faire que cas par cas, aprs une analyse fine pralable des
conditions actuelles du fonctionnement du systme d'assainissement et de l'tat du
milieu rcepteur.
Ce fonctionnement tant connu, les problmes lis aux rejets pluviaux tant identifis, il
conviendra de proposer et d'valuer plusieurs solutions rpondant des objectifs
croissants de protection du milieu rcepteur, en insistant sur l'indispensable cohrence
entre le fonctionnement du rseau en termes de dversements et de capacits de stockage
notamment, le fonctionnement des diffrents ouvrages de traitement et les effets des rejets
sur le milieu rcepteur.
Ainsi, il n'est pas possible de dfinir de manire uniforme "l'vnement exceptionnel".
Chaque cas devra faire l'objet d'une analyse spcifique. Une approche au niveau global du
bassin versant d'un milieu rcepteur pourrait galement s'avrer pertinente pour garantir une
cohrence entre les actions menes et les objectifs poursuivis (rfrences aux SDAGE,
SAGE, Schmas Directeurs d'Assainissement).
Toute tude devra mettre l'accent sur les diffrents points suivants.
VIII.9.1.1.La prise en compte du milieu rcepteur.
Cette prise en compte des milieux rcepteurs se fait au moyen :
des objectifs de qualit et des concentrations en polluants correspondantes. Au
cas o un milieu rcepteur n'aurait pas d'objectif de qualit prdfini, on lui affectera
un objectif compatible avec les usages prvus;
des usages actuels ou prvus du milieu, notamment en termes de baignade, de
pisciculture et de ressource en eau potable;
des impacts ngatifs des rejets pluviaux urbains contre lesquels on souhaite
lutter :
les rejets de flottants et la pollution visuelle;
les pollutions bactriologiques, afin de maintenir la qualit des eaux de baignade;
les pollutions cumulatives de type mtaux lourds ou micropolluants, afin de
prserver les ressources en eau potable;
les pollutions effets de choc entranant des mortalits piscicoles (problmes
conjoints d'oxygne dissous et de concentration en ammoniaque).
Selon les cas, les solutions techniques seront diffrentes et les cots pourront varier
dans des proportions considrables;
d'une modlisation de l'impact des rejets en fonction de leur rpartition dans
l'espace (dilution et pouvoir auto-purateur du milieu rcepteur) et dans le temps.
Page 74 - Chapitre 3
la prise en compte de l'ensemble des rejets pluviaux urbains vers le milieu
rcepteur :
rejets directs par les dversoirs;
rejets des ouvrages de stockage-dcantation;
rejets de la station d'puration.
Il ne servirait rien de construire grands frais des ouvrages sophistiqus avec des
rendements puratoires levs en un point (la station d'puration par exemple) si, en
d'autres points, subsistent des dversements d'eaux non traites alors mme que la
capacit nominale des ouvrages de traitement n'est pas atteinte.
Il est indispensable de parvenir une efficacit globale du systme, et d'envisager
des niveaux d'puration adapts la pluviomtrie afin de garantir des traitements
partiels ou moins performants lorsque les pluies deviennent trs importantes.
VIII.9.1.2. Les niveaux de traitement recherchs.:
Les niveaux de traitement recherchs sexpriment en termes :
de frquence de dversements;
de concentrations minimales en oxygne dissous maintenir dans le milieu
rcepteur;
de concentrations maximales en ammoniaque ne pas dpasser dans le milieu
rcepteur;
de nombre et de dure des dpassements autoriss des concentrations en oxygne
et ammoniaque;
de concentrations en germes pour les eaux de baignade;
...
VIII.9.1.3.La pluviomtrie locale.
Toute tude devra se fonder sur la pluviomtrie locale autant que possible :
Quels sont les pisodes pluvieux utiliss comme rfrence ?
Quels seraient les effets sur le systme d'assainissement et sur le milieu rcepteur
d'une succession de quelques pluies, sans qu'aucune d'elles ne soit individuellement
trs importante ?
En tout tat de cause, une protection du milieu rcepteur contre les rejets des vnements
les plus importants (par exemple priode de retour 6 mois un an) sera coteuse, et il
importe d'en vrifier rellement l'utilit et l'efficacit par un suivi des ouvrages.
VIII.9.1.4.La station d'puration biologique ;
Il ne parat pas judicieux (sauf peut-tre dans certains cas particuliers) de
surdimensionner la station dpuration de faon trop importante pour des raisons
d'exploitation (gestion des variations de charge, comportement et adaptation de l'activit
bactrienne).
Schma directeur dassainissement - Page 75
Dans tous les cas, le traitement biologique de la pollution azote sera le facteur
limitant, et il semble d'autant plus prfrable de ne prendre en compte que la pollution
carbone pour les priodes de fortes pluies que les effets de la pollution azote sont plutt
considrer l'chelle annuelle pour les problmes lis l'eutrophisation.
Par contre, dans les cas des mortalits piscicoles, les teneurs en NH
3
et NH
4
dans le
milieu rcepteur sont dterminantes, et dans certaines conditions de pH, de temprature et
de dure, peuvent tre aussi critiques pour la faune que les conditions sur l'oxygne dissous.
Dans ce dernier cas, seule la dilution des rejets permettra de limiter les concentrations.
VIII.9.2. Proposition d'approche mthodologique
Compte tenu des lments prcdents et des possibilits techniques, une approche "
deux niveaux" semble assez bien adapte au contexte :
dfinir un "niveau 1", en de duquel il faudra respecter la directive europenne
dans son intgralit;
dfinir un "niveau 2", tel qu'entre les niveaux 1 et 2, on applique une dmarche
fonde sur un dclassement matris de qualit du milieu rcepteur (par exemple
dclassement d'un rang ou moins). Ce "niveau 2" serait alors considr comme le
vritable niveau "exceptionnel". Au del du "niveau 2", on entrerait dans une zone
de traitement dgrad.
Ces niveaux 1 et 2 devraient tre fixs au cas par cas, en fixant des limites ou des seuils
en dbit instantan, en dbit journalier, en intensit pluvieuse, en lame d'eau ruissele, ...
Plusieurs critres pourront naturellement tre choisis de faon indpendante ou
concomitante pour fixer le passage au dessus du niveau 1. D'autres critres devront tre
fixs de la mme manire pour fixer les seuils de passage au del du niveau 2.
Ces seuils seront tablis au cas par cas et figureront dans les dossiers et cahiers des
charges. Les dclassements autoriss entre les niveaux 1 et 2 devront tre tablis de
manire prcise en fixant :
l'importance du dclassement (en terme de concentrations limites ne pas
dpasser ou de variation autorise par rapport un niveau de base, et ceci pour les
divers paramtres prendre en compte selon la nature du milieu rcepteur : MES,
DBO
5
, NH
3
, NH
4
, O
2
dissous, ...);
le nombre (et/ou la frquence) des dclassements autoriss, ainsi que leur dure
individuelle et/ou cumule.
La pluviomtrie n'est qu'une des causes possibles de moins bonne qualit des rejets. Les
interventions pour maintenance et/ou rparation doivent tre prises en compte
galement. Il est possible alors de dfinir d'autres niveaux seuils 3 et 4 avec des exigences
diffrentes.
Par exemple, et selon la filire de traitement propose, on pourrait fixer comme objectif en
priode de maintenance importante (by pass ou vidange d'ouvrage par exemple) de
respecter les objectifs de qualit tablis pour les situations pluviomtriques entre les niveaux
3 et 4, tout en devant garantir un respect de la directive europenne en de du niveau 3
(maintenance plus rduite).
Page 76 - Chapitre 3
L aussi, les niveaux devraient tre fixs selon des critres mentionns dans les dossiers
et cahiers des charges. Cette dmarche pourrait tre illustre de manire simplifie par la
schma ci-aprs :
respect complet
de la directive europenne
NIVEAU 1
NIVEAU 2
situations exceptionnelles
respect des contraintes
de dclassement
SITUATIONS
PLUVIOMETRIQUES
SITUATIONS
DE MAINTENANCE
ET D'EXPLOITATION
NIVEAU 4
NIVEAU 3
respect complet
de la directive europenne
respect des contraintes
de dclassement
Figure 3-2 : Schmatisation de lapproche mthodologique lors des vnements pluvieux.
Schma directeur dassainissement - Page 77
IX. TYPOLOGIE DES DIFFERENTS OBJETS DE L'ASSAINISSEMENT
IX.1. TYPOLOGIE DES REJETS POLLUANTS
IX.1.1. Effluents domestiques
IX.1.2. Effluents industriels
IX.2. TYPOLOGIE DES SOUS-PRODUITS
Assainissement individuel matires de vidange
Collecte des eaux uses
Branchement Dchets de prtraitement
Transport en rseau Boues de curage
Postes de refoulement Graisses, sables, dgrillage
Collecte des eaux pluviales
Branchement Sables et hydrocarbures
Transport
Bouche, avaloir, grille
Canalisations Boues de curage
Ouvrages spciaux
Stockage - Traitement Boues de curage
Techniques compensatoires Boues de nettoyage
Station de traitement Dchets de prtraitement
Boues
Tableau 3-1 : Typologie des sous-produits.
Dchets au sens de larrt du 9.09.1997 :
BOUES DE STATION DE TRAITEMENT (biologique et physico-chimique)
BOUES D'EAU POTABLE
GRAISSES DE BACS DEGRAISSEURS
BOUES DE CURAGE
MATIERES DE VIDANGE
Page 78 - Chapitre 3
IX.3. TYPOLOGIE DES OUVRAGES
IX.3.1. Rseaux
IX.3.2. Bassins
IX.3.2.1.Bassins contre les inondations
Bassins de retenues, dcrtement, d'talement, ...
IX.3.2.2.Bassins contre les pollutions
Bassins d'orage, de dpollution, de stockage, ...
X. COUTS DE L'ASSAINISSEMENT
X.1. RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES
Un rseau communal peut coter de 3 10 fois le prix d'une station de traitement. Une
rhabilitation de rseau de 3 6 fois le prix d'une station de traitement. Les ordres de
grandeur de prix sont les suivants :
rseau sparatif : 1100 F/ml pour une commune de 3000 6000 Eq.hab;
rseau unitaire : 1600 F/ml;
branchement particulier : 6500 F 13500 F le branchement.
X.2. RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTE DES EAUX PLUVIALES
Les exemples de prix sont extraits du document "Esquisse d'un programme d'action
pour l'assainissement des eaux pluviales en rgion d'Ile de France".
Limitation contre les inondations afin dassurer 10 ans le degr de protection sur la
base d'un taux d'quipement au moins de 170 ml de collecteurs pluviaux par hectare
impermabilis :
4 500 F/ml pour les petites communes;
3 500 F/ml pour les grandes communes.
Suivi de l'urbanisation ou quipement de zones nouvelles avec une solution collecte-
stockage-vacuation estim :
350 m
3
de stockage/ha impermabilis (protection dcennale) 300 F/m
3
soit
105 000 F/ha impermabilis pour les bassins de retenue;
200 000 F/ha imp. pour la collecte et l'vacuation du dbit de fuite (170 ml x 1 200
F/ml de 500 mm)
Amlioration du degr de pollution avec une solution stockage-vacuation :
pour passer d'une priode d'insuffisance de 10 ans une priode de 15 ans avec
40 m
3
/ha imp. :
900 F/m
3
pour un C.O.S > 0,7 (zone trs urbanise);
300 F/m
3
pour un 0,4 < C.O.S < 0,7 (zone moyennement urbanise);
Schma directeur dassainissement - Page 79
100 F/m
3
pour un C.O.S < 0,4 ( zone peu urbanise);
un surcot pour les rseau de 18 000 F/ha imp.
pour passer d'une priode d'insuffisance de 10 ans une priode de 20 ans avec
60 m
3
/ha imp. supplmentaire au mme prix que ci-dessus et un surcot de
30 000 F/ha imp. pour les rseaux.
X.3. ASSAINISSEMENT AUTONOME COMPLET
Le cot dun systme dassainissement autonome varie entre et 20 000 35 000 F H.T.
Ordre de grandeur de prix sur la base d'une fosse de 3000 l pour 4 personnes ;
1 fosse septique 3000 l = 4 000 F (a)
1 fsep + pandage souterrain = 26 000 F (b)
1 fsep + lit filtrant = 28 000 F (c)
1 fsep + tertre filtrant = 32 000 F (d)
1 micro station + pandage = 35 000 F (e)
Cot d'exploitation : 800 F pour a) et b)
1 200 F pour c)
4 000 6 000 F pour d)
X.4. TRAITEMENT DES EAUX USEES
X.5. TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES
XI. CONTENU D'UN SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT
a) Plans et fiches techniques de l'ensemble du rseau et stations.
b) Flux hydraulique et de pollution SA / SP / SF :
Flux hydraulique effluents domestiques;
Flux hydraulique effluents industriels;
Flux hydraulique origine agricole;
Flux hydraulique matires de vidange.
POS- SDAU- ZA- ZI- Dmographie- Lotissement, ...
c) Diffrenciation des flux en temps sec et en temps de pluie
d) Evaluation des eaux claires parasites
e) Dtermination des variations de flux journaliers hebdomadaires et saisonniers
Page 80 - Chapitre 3
f) Comparaison :
capacit / besoin hydraulique des collecteurs
gravitaire / refoulement
raccordement au rseau collectif / assainissement autonome
unitaire / sparatif
rseau communal / intercommunal
carte de zonage des diffrents mode d'assainissement
g) Evaluation des mise en conformit :
branchement domestiques
Industrie raccorder (convention de raccordement)
assainissement autonome
h) Diagnostic de l'incidence : rseau temps sec - temps pluies / missaire
i) Mode de Collecte - transfert - traitement - mesures compensatoires pour la rduction
des dbits de pluie collects
j) Etude de valorisation des diffrents sous-produit de l'assainissement
k) Niveau de rejet - traitement de l'eau
l) Filire traitement EAU et BOUES associe la filire d'vacuation des boues
m) Sites d'implantation des traitements (station de traitements des eaux uses -
traitement dcentraliser des rejets d'eaux pluviales)
n) Evaluation financires des diffrentes filires
o) Comparaison technique / conomique des diffrents scnarios en fonction des
diffrents objectifs de protection du milieu rcepteur
p) Cots d'investissement
q) Programme par tranche fonctionnelle
r) Programme pluriannuel des travaux
Schma directeur dassainissement - Page 81
XII. PHASES ULTERIEURES D'UN SCHEMA DIRECTEUR
D'ASSAINISSEMENT
XII.1. INFORMATION DES USAGERS SUR L'ENJEU DU SCHEMA
XII.2. ARTICULATION AVEC LE SAGE
XII.3. CONTRAT D'AGGLOMERATION
XII.4. PROGRAMMATION DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT
Dossier technique en vue de la ralisation des travaux
XII.5. CRITERE D'EVALUATION
XII.6. MODE DE FINANCEMENT
XII.6.1. Ouvrages faisant l'objet d'une subvention
Ouvrage Adour
Garonne
Artois
Picardie
Loire
Bretagne
Rhin
Meuse
Rhne
Mditerrane
Corse
Seine
Normandie
Station de
traitement
35% 20 45 % 30 50 % 30 40 % 45 % 50 60 %
Assainissement
autonome
2500 F/Eh 35 % 30 % 30 40 % 50 % 50 60 %
Etudes
pralables
50 % 70 % 50 % 70 % 50 60 % 50 100 %
Tableau 3-2 : Taux de subvention des agences de leau pour diffrents ouvrages.
OUVRAGES Dpartement FNDAE* Rgion
Station de
traitement
20 30 % 20 % 30 %
Assainissement
autonome
** ** **
Etudes
pralables
** ** **
* Le FNDAE ne finance que les communes rurales.
** Au cas par cas
Tableau 3-3 : Conditions de financement des ouvrages.
Un autofinancement minimum de 20 % est demand au Matre d'Ouvrage.
Chapitre 4
PROCEDURES ADMINISTRATIVES
ET TECHNIQUES POUR LA
CONSTRUCTION DUNE STATION DE
TRAITEMENT DES EAUX USEES
A. SADOWSKI
Procdures administratives et techniques pour la construction dune station de traitement des eaux uses-Page 83
SOMMAIRE
I. ADOPTION D'UN PROJET GENERAL D'ASSAINISSEMENT............................................................... 84
II. ETUDES PREALABLES POUR L'ELABORATION DU PROGRAMME............................................... 84
III. AVANT PROJET SOMMAIRE (APS) ...................................................................................................... 85
IV. DEMANDE DE FINANCEMENT (AGENCE DE L'EAU, DEPARTEMENT, FNDAE) ..................... 85
V. ELABORATION D'UNE ETUDE OU NOTICE D'IMPACT...................................................................... 85
VI. ELABORATION DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION................................................. 86
VII. ENQUETE (1 MOIS + 15 JOURS) ............................................................................................................. 87
VIII. ACQUISITION DE TERRAIN................................................................................................................... 87
IX. DEVOLUTION DES TRAVAUX ............................................................................................................... 87
ANNEXE I ............................................................................................................................................................. 89
ANNEXE II............................................................................................................................................................ 90
ANNEXE III .......................................................................................................................................................... 91
ANNEXE IV........................................................................................................................................................... 92
ANNEXE V............................................................................................................................................................ 93
Page 84 - Chapitre 4
I. ADOPTION D'UN PROJET GENERAL D'ASSAINISSEMENT
I - ADOPTION D'UN PROGRAMME D'ASSAINISSEMENT (au sens du dcret du 3.06.1994)
ou Schma directeur d'assainissement soumis approbation et notification prfectorale
en cohrence avec le SDAGE - SAGE incluant l'assainissement collectif et autonome
II. ETUDES PREALABLES POUR L'ELABORATION DU PROGRAMME
2-1- Diagnostic du "systme d'assainissement"
- Evaluation des charges et des flux de substances polluantes actuelles et prvisibles
- Variations saisonnires et climatiques - taux de collecte
- Rendement du "systme d'assainissement" (collecte et traitement)
- Estimation des besoins - volution
- Mesures qualit des cours d'eaux (sur 3 ans)
2-2- Indication des objectifs et des moyens mettre en place
- Objectif de qualit du milieu rcepteur
- Objectifs de rduction des flux polluants
- Evolution du taux de dpollution pour assurer le respect des objectifs
- La pluviosit de rfrence qui caractrisera le "systme d'assainissement"
Procdures administratives et techniques pour la construction dune station de traitement des eaux uses-Page 85
- Niveau de traitement - filire - implantation - POS
- Estimation financire
- Echancier des oprations
III. AVANT PROJET SOMMAIRE (APS)
Dlibration du Conseil Municipal ou du Conseil Syndical
IV. DEMANDE DE FINANCEMENT (AGENCE DE L'EAU, DEPARTEMENT,
FNDAE)
V. ELABORATION D'UNE ETUDE OU NOTICE D'IMPACT
L'tude d'impact portera sur l'ensemble du "systme d'assainissement" (comprenant l'tude de valorisation
des boues, les dversoirs d'orage, les rejets pluviaux, les rejets de l'eau traite...)
notice d'impact : capacit inf. 10.000 Eq.hab ou 600 kg de DBO
5
/j
tude d'impact : capacit sup 10.000 Eq.hab ou 600 kg de DBO
5
/j
demande de la D.U.P - capacit sup 10.000 Eq.hab
Page 86 - Chapitre 4
VI. ELABORATION DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
Enqute publique dans le cas de la procdure d'autorisation.(dure totale 6 9 mois)
procdure d'autorisation et de dclaration - dcret du 29.03.1993 (dure 6 mois maxi)
6-1) Station de traitement et dversoir d'orage
1) Procdure de dclaration
suprieure 12 Kg DBO5 et infrieure 120 Kg DBO5
2) Procdure d'autorisation
suprieure 120 Kg DBO5
6-2) Rejet des eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans une bassin d'infiltration
dclaration : suprieur 1 ha et infrieur 20 ha
autorisation : au-dessus de 20 ha
6-3) Epandage de boue
dclaration : suprieur 1 t d'azote par an (1000 Eq.hab) et infrieur 10 t/an
autorisation : au-dessus de 10 t d'azote par an (10.000 Eq.hab)
Procdures administratives et techniques pour la construction dune station de traitement des eaux uses-Page 87
VII. ENQUETE (1 MOIS + 15 JOURS)
- C.D.H. (Conseil dpartemental d'hygine dont le secrtariat est assur par la DASS)
- C.S.H.P.(Conseil suprieur d'hygine publique)
VIII.ACQUISITION DE TERRAIN
Travaux (EDF, tlphone, AEP ...)
IX. DEVOLUTION DES TRAVAUX
- Dossier de consultation des Entreprises (D.C.E).
- Publicit - "Avis d'appel public la concurrence"
- Ouverture des plis
- Dpouillement - Rapport de dpouillement
- Choix constructeur
- Dossier complmentaire d'impact
- Phase de publicit du dossier complmentaire d'impact
- Mise au point du march - demande du permis de construire
- Rapport de prsentation - contrle de lgalit
Page 88 - Chapitre 4
- Notification du march qui vaut ordre de Service de commencer les travaux
- Travaux 12 - 36 mois
- Rception des travaux
- Essais de garanties
- Visite sur les lieux - Conformit des rsultats.
Procdures administratives et techniques pour la construction dune station de traitement des eaux uses-Page 89
ANNEXE I
CONTENU D'UN DOSSIER
D'AVANT PROJET SOMMAIRE (A.P.S)
Mmoire explicatif (objet/niveau de rejet/filire/cot/planning)
Plan de situation
Plan parcellaire
Plan d'implantation
Caractristiques des ouvrages
Page 90 - Chapitre 4
ANNEXE II
CONTENU D'UN DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (D.C.E)
Rglement de la Consultation
Acte d'engagement
Dclaration souscrire
Dclaration prvue l'article 50 du C.M.P
C.C.A.P
C.C.T.P
Programme de la consultation et annexes
Etude d'Impact et analyses des incidences
Etude de valorisation des boues et dchets (plan d'pandage)
Etude gotechnique
Etude de l'impact du traitement des eaux pluviales
Plan de situation
Plan des ouvrages existants (cas rhabilitation ou extension)
Plan parcellaire
Plan topographique
Profil hydraulique du rseau
Listes des fascicules (C.C.T.G & D.T.U) applicables
Campagnes d'analyses (sous forme de disquette).
Procdures administratives et techniques pour la construction dune station de traitement des eaux uses-Page 91
ANNEXE III
CONTENU D'UN DOSSIER DE
DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE (D.U.P)
Dlibration de la commune ou du syndicat
Objet de l'enqute
Avant Projet Sommaire
Etude d'impact
Page 92 - Chapitre 4
ANNEXE IV
CONTENU D'UNE ETUDE D'IMPACT
1/ Prsentation sommaire du projet
2/ Analyse de l'tat initial
3/ Prsentation des tudes menes pour aboutir au projet
retenu et raisons du choix
4/ Analyse dtaille des effets possibles sur l'environnement
5/ Expos des raisons du parti retenu
6/ Prsentation des mesures compensatoires ou prcautions
pour rduire les effets dommageables sur l'environnement
7/ Dossier complmentaire aprs choix du constructeur
- Prsentation de la mthodologie employe
- Prsentation du projet par le Matre d'Ouvrage
- Signature des auteurs de l'tude
Procdures administratives et techniques pour la construction dune station de traitement des eaux uses-Page 93
ANNEXE V
PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT
- CONTENU D'UN COUT D'OBJECTIF -
Achat de terrain
Gomtre
Etude gotechnique
Analyses complmentaires sur le rseau ou station
Etude d'impact ou notice d'impact
Etude sur la destination des boues et autres sous-produits
Amnagement du terrain :
* chemins d'accs
* AEP
* EDF (MT et ou BT avec transformateur)
* Tlphone
Cot de la station de traitement (montant du march constructeur)
Rvision des prix march constructeur
Prime des concurrents (limit 4 ou 5 maxi)
Page 94 - Chapitre 4
Assurance construction Matre d'Ouvrage
Mission complte de contrle ( suivi de la mise en ouvre du Gnie-Civil )
Epuisement (> 50 m/h)
Contrle extrieur bton, voirie, remblai
Essais particuliers
Coordonnateur pour l'hygine et la scurit du chantier
Honoraire Matrise d'oeuvre + rvision
Subventions : Agence de l'Eau, Dpartement, Rgion, F.N.D.A.E. ... (sur le montant H.T.)
Auto-financement...(minimum 20 % du total)
Chapitre 5
MISSION DINGENIERIE
A. SADOWSKI
Page 96 - Chapitre 5
SOMMAIRE
I. MISSION D'INGENIERIE.............................................................................................................97
I.1. DOMAINE FONCTIONNEL ............................................................................................................97
I.2. CLASSE OU NOTE DE COMPLEXITE ..............................................................................................97
I.3. MISSIONS NORMALISEES.............................................................................................................97
II. COUT D'OBJECTIF .......................................................................................................................98
III. LE CONDUCTEUR D'OPERATION .......................................................................................98
Mission dingnierie - Page 97
I. MISSION D'INGENIERIE
La passation d'un march de matre d'oeuvre doit tre prcde d'un recensement
des personnes physiques et morales capables de raliser la mission considre
(article 314 bis et 314 ter du C.M.P.).
Le matre d'oeuvre est responsable de la conception, du contrle de l'excution de
l'ensemble des ouvrages raliser.
En l'absence des dcrets ncessaires l'application de la loi du 12.07.1985 relative
la matrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la matrise d'oeuvre prive, les
collectivits locales fixent librement la rmunration des matres d'oeuvre privs. Il n'en
est pas de mme pour la rmunration des matres d'oeuvres publiques (fixe en
pourcentage par rapport au montant des travaux H.T. et classe de complexit par
arrt - dcret du 28.02.1973 - arrt du 29.06.1973).
La collectivit peut appliquer ce dcret pour la rmunration des matres d'oeuvres
privs (une nouvelle rglementation est en cours d'laboration).
I.1. DOMAINE FONCTIONNEL
Il y a 4 domaines fonctionnels :
infrastructures : rseau d'assainissement et d'eau potable;
btiment;
industrie : station de traitement des eaux uses, eaux potables, station de
refoulement;
gestion.
I.2. CLASSE OU NOTE DE COMPLEXITE
Il y a 3 classes de complexit:
classe 1 : rseau d'assainissement, station de refoulement;
classe 2 : station de traitement des eaux uses urbaines, eaux potables,
rseaux d'eau potable;
classe 3 : station de traitement des eaux uses industrielles, usines
d'incinration, ...;
I.3. MISSIONS NORMALISEES
Le contenu d'une mission classique type m2 est le suivant. Elle est compose de 7
lments de missions parfaitement dissocies :
APS : Avant-projet sommaire (reprsentant 20 % du taux global);
APD : Avant-projet dtaill (reprsentant 20 % du taux global);
DCE : Dossier de consultation des entreprises (reprsentant 10 % du taux
global);
A.M.T : Assistance technique march de travaux (reprsentant 5 % du taux
global);
C.G.T : Contrle gnral des travaux (reprsentant 35 % du taux global);
Page 98 - Chapitre 5
R.D.T : Rception et dcompte des travaux (reprsentant 5 % du taux global);
D.O.E : Dossier des ouvrages excuts (reprsentant 5 % du taux global);
La remise d'un APS sans APD correspond une mission de type : m3.
La remise d'un APD sans APS correspond une mission de type : m6.
D'autres missions peuvent comprendre :
S.T.D : spcifications techniques dtailles;
P.E.O : plan d'excution des ouvrages;
D.C.C : dossier de consultation des concepteurs.
II. COUT D'OBJECTIF
L'engagement sur un cot d'objectif (ou cot prvisionnel) est de rgle. Le cot
d'objectif reprsente : rmunration M.O. + estimation prvisionnelle.
L'engagement sur un cot d'objectif se fait avec une tolrance (ex : 15 %). Les
pnalits sont appliques sur le forfait de rmunration au cas de non-respect du prix
d'objectif.
Le forfait de rmunration tabli une date donne est rvisable en fonction de
l'volution de l'index ingnierie sur chaque lment composant la mission.
III. LE CONDUCTEUR D'OPERATION
La conduite dopration constitue un cas particulier de matrise d'oeuvre. Il s'agit
toujours d'un service technique public (interlocuteur entre le matre d'ouvrage et la
matre d'oeuvre priv).
Chapitre 6
GENERALITES SUR LES TECHNIQUES
DE LASSAINISSEMENT
Gnralits sur les techniques de lassainissement - Page 100
SOMMAIRE
I. PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS ..................................................................................................102
I.1. LES PARAMETRES DE POLLUTION.....................................................................................................................102
I.1.1. Pollution carbone.............................................................................................................................102
I.1.2. Pollution azote et phosphore...........................................................................................................102
I.1.3. Matires en suspension .....................................................................................................................103
I.1.4. Micro-organismes..............................................................................................................................104
I.1.5. Composs spcifiques.......................................................................................................................104
I.1.6. La politique d'objectif de qualit ..........................................................................................................104
I.2. NIVEAU DES REJETS AUTORISES APRES EPURATION ............................................................................................107
II. LE TRAITEMENT DES EAUX USEES.............................................................................................................110
II.1. LE TRAITEMENT DE L'EAU...........................................................................................................................110
II.1.1. Le prtraitement ................................................................................................................................110
II.1.2. La dcantation et les traitements physico-chimiques.............................................................................111
II.1.3. Les traitements biologiques................................................................................................................111
II.1.4. Elimination de l'azote.........................................................................................................................112
II.1.5. Dphosphatation et traitements d'affinage ...........................................................................................113
II.1.6. Les problmes d'environnement .........................................................................................................113
II.1.7. Les filires possibles..........................................................................................................................114
II.2. TRAITEMENT DES BOUES...........................................................................................................................116
II.2.1. L'paississement...............................................................................................................................116
II.2.2. Digestion et stabilisation biologique.....................................................................................................117
II.2.3. La dshydratation..............................................................................................................................117
II.2.4. Le schage et l'incinration ................................................................................................................117
II.2.5. Le compostage .................................................................................................................................117
II.2.6. Conclusion .......................................................................................................................................118
III. EPURATION DES EAUX PLUVIALES.............................................................................................................119
III.1. LA POLLUTION DES EAUX PLUVIALES ............................................................................................................119
III.2. LES PROBLEMES DE TRAITEMENT PAR TEMPS DE PLUIE....................................................................................120
III.3. LE CAS DE TRAITEMENT EN STATION D'UN RESEAU UNITAIRE ..............................................................121
III.3.1. La mise en place d'un bassin tampon au droit du dversoir d'orage ........................................121
III.3.2. Le traitement des eaux pluviales sur un module physico-chimique. ........................................................122
III.3.3. Le renforcement d'un traitement sur cultures libres (Lessard et Beck (rf. 9)) ..........................................123
III.3.4. Adoption complte des ouvrages pour respecter en temps de pluie les normes de temps sec. ..................124
III.3.5. Le traitement des boues pluviales en station ........................................................................................124
III.3.6. Stratgie d'adaptation de la station au traitement des eaux pluviales ......................................................124
III.4. LE CAS DU TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES EN RESEAU SEPARATIF.................................................................126
IV. ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS...........................................................................126
IV.1. FREQUENCE ET DUREE DE L'ENTRETIEN ET DES CONTROLES ............................................................................127
IV.2. FIABILITE DES INSTALLATIONS ....................................................................................................................128
IV.3. ECONOMIES D'ENERGIE.............................................................................................................................129
V. L'ORGANISATION DE L'EXPLOITATION ET DU CONTROLE .........................................................................130
V.1. MOYENS EN HOMMES ET ORGANISATION DE L'EXPLOITATION.............................................................................130
V.1.1. Stations d'puration de taille infrieure 20 000 eqha...........................................................................130
V.1.2. Cas des stations suprieures 20 000 eqha........................................................................................131
V.2. MOYENS DE CONTROLE.............................................................................................................................131
V.2.1. Les mesures et les tests ....................................................................................................................131
V.2.2. Tableau de bord et synoptique............................................................................................................133
V.2.3. L'automatisation................................................................................................................................133
V.3. HYGIENE ET SECURITE..............................................................................................................................135
Page 101 - Chapitre 6
VI. PROBLEMES SPECIFIQUES .........................................................................................................................135
VI.1. ADMISSION DES EFFLUENTS INDUSTRIELS ET SPECIAUX ...................................................................................136
VI.2. TAXATION DES REJETS - AIDE AU FONCTIONNEMENT .......................................................................................136
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ....................................................................................................137
ANNEXES......................................................................................................................................................138
Gnralits sur les techniques de lassainissement - Page 102
I. PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS
I.1. LES PARAMETRES DE POLLUTION
Les milieux rcepteurs des eaux uses urbaines ou industrielles sont le sol (ou la nappe), les cours d'eau, les
lacs et la mer. Dfinir un compos comme polluant se fait par rapport la sensibilit intrinsque du milieu (risque
d'eutrophisation, toxicit vis--vis de la faune, ...) ou par rapport aux usages qui lui sont associs (utilisation
industrielle ou agricole de l'eau, loisirs nautiques, production aquacole, ...).
La pollution reue par un milieu rcepteur provient :
Par temps sec :
des effluents sortant de la station dpuration et ayant subi une puration plus ou moins pousse;
des dbits de temps sec "perdus" ou non collects par un rseau inadapt et vacus sans
traitement.
Par temps de pluie : des rejets sparatifs pluviaux et surtout des surverses des rseaux unitaires qui
viennent s'ajouter aux prcdents.
Des mesures de dbit et de concentration sont indispensables pour dterminer ces diffrents flux polluants.
Les principaux paramtres indicateurs de pollution sont prsents ci-dessous.
I.1.1. Pollution carbone
Cette pollution est caractrise essentiellement par la demande en oxygne qui lui est associe :
DBO
5
"Demande Biochimique en Oxygne sur 5 jours". A titre d'exemple, le tableau 2-1 indique les
valeurs de flux de DBO
5
constates pour deux cas d'agglomrations, exprim en tonnes/jour. La DBO
5
reprsente la pollution carbone biodgradable. On notera que l'apport d'un orage de priode de retour
6 8 mois et d'une dure de 2 jours est d'environ 10 fois celui de la journe moyenne de pluie;
DCO "Demande Chimique en Oxygne". Elle reprsente la totalit de la pollution biodgradable et
rfractaire.
Ses impacts majeurs sont lis l'appauvrissement en oxygne, que son rejet peut entraner dans les zones
faible renouvellement des milieux rcepteurs.
I.1.2. Pollution azote et phosphore
Les composs phosphors et dans une moindre mesure azots (nitrates) sont reconnus pour jouer un rle
majeur dans le dclenchement des phnomnes d'eutrophisation, qui peuvent favoriser le dveloppement
incontrl de certains organismes.
L'ammoniaque entrane la consommation de l'oxygne dissous et par ailleurs, sous sa forme non ionise
(fonction du pH), est toxique pour la faune piscicole.
Page 103 - Chapitre 6
Agglomration 1 Agglomration 2
Population totale 250 000 180 000
Pollution domestique raccordable 6,8 9,6
Pollution industrielle raccordable 3,0 2,9
Pollution raccordable totale 9,8 12,5
Pollution non raccordable actuellement 4,9
Pollution totale 14,7 12,5
Temps sec
Pollution effectivement achemine la station
d'puration
7,5 9,4
Pollution dverse en milieu rcepteur par suite
d'un dfaut de raccordement aux rseaux
existants
2,3
Pollution dverse en milieu rcepteur par suite
d'une extension insuffisante des rseaux unitaires
ou eaux uses
4,9 3,1
Pollution rejete par la station d'puration 0,6 1,2
Pollution totale reue par le milieu par temps sec 7,8 4,3
Temps de pluie
Pollution relative aux dversements de temps de
pluie (1)
0,5 0,8
Pollution totale par temps de pluie 8,3 5,1
(1) apport moyen pendant les jours de pluie
Tableau 2-1 : Exemple de flux de DBO5 exprim en tonnes par jour.
I.1.3. Matires en suspension
Les matires en suspension rejetes ont un impact direct sur le milieu par l'augmentation de la turbidit.
De plus, la fraction organique de ces matires en suspension constitue un support parfait pour la pollution
chimique et surtout microbiologique. Ces lments vont tre incorpors aux sdiments et pourront tre rendus de
nouveau disponibles lors de remises en suspension de la phase sdimentaire.
Le tableau 2-2 donne pour la France des valeurs moyennes de pollution ramenes l'habitant sur lesquelles
on pourra tabler en premire estimation.
Gnralits sur les techniques de lassainissement - Page 104
Dbit DBO5 Matires en suspension (aprs
dgrillage -dessablage)
< 10 000 usagers : 150 l/j Rseau sparatif : 60 70 g Rseau sparatif : 70 g dont 70 %
de MES
10 000 50 000 usagers : 200 l/j Rseau unitaire : 70 80 g Rseau unitaire : 80 g dont 66 %
de MES
> 50 000 usagers : 250 500 l/j Pour un rseau sans industrie 66 % de DBO5 lie au MES et matires
collodales ; 34 % de DB05 "solubles"
Tableau 2-2 : Valeurs moyennes de pollution ramenes l'usager.
I.1.4. Micro-organismes
Les micro-organismes ne sont pas, a priori, nfastes au milieu naturel lui-mme, mais affectent ses usages
(dgradation de l'tat sanitaire). Leur limination est donc une contrainte de qualit forte chaque fois qu'un usage
exigeant sur le plan sanitaire est susceptible d'tre concern : baignades, activits de loisirs, conchyliculture, ...
I.1.5. Composs spcifiques
Ces lments peuvent affecter la qualit du milieu rcepteur et de ses usages, soit par leur toxicit intrinsque
soit en jouant un rle slectif dans la croissance des organismes aquacoles ainsi que de ceux mis en oeuvre dans
les processus d'puration biologique. Leur identification est dterminer au cas par cas.
I.1.6. La politique d'objectif de qualit
La nouvelle loi sur l'Eau de janvier 1992 ne remet pas en cause la circulaire du 17 Mars 1978, qui a fix la
politique gnrale de gestion des cours et plans d'eau en France. Cette circulaire prconise dans les cas
gnraux la mise au point de cartes dpartementales d'objectifs de qualit, qui servent de guide tous les
usagers. Dans les cas complexes ou dlicats, des dcrets d'objectifs de qualit plus contraignants pourront tre
promulgus comme cela a t pratiqu pour la Vire, la Haute Moselle, ...
Les niveaux de qualit recherchs doivent permettre de pratiquer diverses activits lies l'usage de l'eau et
dont la nature doit tre dfinie en fonction de besoins actuels et potentiels. Parmi celles-ci, on peut citer
l'alimentation en eau potable, la baignade, l'abreuvage des animaux, la conchyliculture, la pche et la pisciculture,
la navigation de plaisance, les eaux usages industriels ou agricoles, ...
La dtermination des objectifs de qualit doit tre mene de faon coordonne sur l'ensemble d'un
bassin hydrographique. On distinguera un certain nombre de tronons rputs homognes et sur lesquels un
objectif unique sera fix. La fixation de cet objectif est une tche dlicate. Un moyen terme raliste doit tre
recherch entre des vises utopiques compte tenu de l'activit conomique environnante visant une
dpollution quasi totale et une attitude laxiste se contentant d'entriner la situation actuelle.
La dtermination de l'effort ncessaire pour atteindre les objectifs impliquent la connaissance de l'tat initial du
cours d'eau puis du suivi de son volution. Plusieurs inventaires nationaux de la qualit des eaux
superficielles ont t mens depuis 1971.
Page 105 - Chapitre 6
Quatre niveaux de base de qualit ont t dfinis et sont caractriss dans la grille simplifie ci-aprs (tableau
2-3). On remarquera que les concentrations indiques correspondent l'tiage moyen mensuel quinquennal.
Qualit 1 A 1 B 2 3
Temprature < 20C 20 22C 22 25C 25 30C
O2 dissous en mg/l
O2 dissous en % de saturation
> 7
> 90 %
5 7
70 90%
3 5
50 70%
milieu arobie
maintenir en
permanence
DBO5 en mgO2 /1 < 3 3 5 5 10 10 25
DCO en mgO2/l < 20 20 25 25 40 40 80
Matires en susp. totales en
mg/l
< 30 < 30 < 30 30 70
NO3
-
en mg/l < 44 < 44 < 44 44 100
NH4
+
en mg/I < 0,1 0,1 0,5 0,5 2 2 8
Ecart de l'indice biologique par
rapport l'indice normal
1 2 ou 3 4 ou 5 6 ou 7
pH 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 5,5 - 9,5
Tableau 2-3 : Critres d'apprciation de la qualit gnrale de l'eau.
La grille complte prend en compte de nombreux autres paramtres tels que conductivit, mtaux, produits
chimiques et toxiques, bactriologie et radioactivit. Les seuils correspondants figurent dans la circulaire du 29
Juillet 1971.
De faon complmentaire, la circulaire interministrielle du 17 Mars 1978 a officialis en France les directives
europennes concernant :
la qualit des eaux superficielles destines la production d'eau alimentaire (en prcisant la filire de
traitement ncessaire pour chaque niveau de qualit);
la qualit requise pour les eaux de baignade.
Des correspondances ont t proposes entre la grille "multi-usage" franaise et la grille europenne "eaux de
boisson". Pour les diffrents niveaux dfinis plus haut, on admet habituellement les usages suivants :
Niveau 1 A : eau non pollue apte tous usages.
Niveau 1 B : eau trs peu pollue, galement apte tous usages.
Niveau 2 : eau de qualit passable. Cette eau peut tre utilise pour l'irrigation, les usages
industriels et moyennant un traitement pouss, la production d'eau potable. Le poisson y vit mais sa
reproduction n'est pas assure. La baignade n'y est pas possible.
Gnralits sur les techniques de lassainissement - Page 106
Niveau 3 : eau de qualit mdiocre, ne convenant qu' l'irrigation, au refroidissement et la
navigation. La survie du poisson y est alatoire surtout lors des fortes tempratures d't.
Pour la production d'eau potable, la directive europenne officialise par la circulaire du 17 Mars 1978 prvoit 3
niveaux de qualit dont les tolrances de concentrations pour les divers paramtres sont parfaitement dfinies.
Les traitements ncessaires pour rendre potable chacune de ces 3 catgories d'eau sont les suivants :
A1 : Traitement physique simple, filtration rapide et dsinfection.
A2 : Traitement normal physique et chimique et dsinfection.
A3 : Traitement physique, chimique pouss, affinage et dsinfection.
La pollution reue par le milieu naturel est principalement d'origine humaine, partir des rejets soit
domestiques, soit industriels, soit agricoles, mais s'y ajoute celle provenant du ruissellement des eaux de pluie sur
la ville, les chausses et sur les terres agricoles.
Ainsi, pour chaque paramtre de pollution, la concentration dans le cours d'eau rsulte du quotient des flux
totaux moyens dverss divis par le dbit d'tiage du cours d'eau.
Les flux totaux sont calculs en ajoutant :
l'apport de pollution du cours d'eau lui-mme dtermin l'amont immdiat du tronon considr;
les apports domestiques non purs diffus;
les flux de pollution rsiduelle aprs un traitement plus ou moins pouss;
les apports de pollution industrielle directs ou aprs traitement;
les apports de la pollution diffuse d'origine agricole;
la pollution apporte par la collecte des eaux pluviales.
Dans le milieu naturel, ces polluants subissent des transformations biologiques qui peuvent pour certains
impliquer une auto-puration d'importance trs variable selon les cours d'eau, mais qui dans certain cas allge un
peu le bilan global de pollution.
Pour diminuer la charge globale de pollution rejete, il faut donc :
augmenter le taux de raccordement aux stations d'puration;
amliorer les performances des stations;
piger ou traiter la pollution des eaux pluviales collectes avant rejet;
limiter la pollution diffuse d'origine agricole.
L'ensemble des efforts ncessaires permettant d'atteindre de faon optimise, un objectif de qualit donn,
aboutit un cot qui constitue le cot de l'objectif et doit tre mis en regard avec les profits conomiques ou
sociaux en rsultant.
Page 107 - Chapitre 6
I.2. NIVEAU DES REJETS AUTORISES APRES EPURATION
Les caractristiques des eaux rsiduaires urbaines aprs traitement taient jusqu' prsent dfinis par la
circulaire du 4 Novembre 1980. La Directive Europenne du 21 Mai 1991 redfinit de nouveaux niveaux de rejets.
Sa transcription en droit Franais est acheve (cf. Chapitre2).
Si la circulaire de Novembre 1980 constituait un guide pour le rdacteur d'un arrt portant autorisation de
rejet, elle n'imposait rien sur le choix du niveau de rejet. La dtermination de ce niveau de rejet devait bien
entendu prendre en compte le milieu rcepteur travers sa sensibilit propre et les contraintes des usages qui lui
taient associs.
Cette dtermination se faisait en dduisant le flux maximal de pollution dont le rejet pouvait tre autoris de
manire permettre d'atteindre l'objectif de qualit des eaux superficielles intresses comme indiqu au
paragraphe prcdent. De plus dans le cas d'un canal, d'un lac ou d'un tang, les risques d'eutrophisation lis
la prsence d'azote ou de phosphore taient pris en compte.
Dans le cadre de l'application de la Directive du 21 mai 1991, la dfinition des niveaux de rejet se fait dans
un cadre plus vaste par la dfinition de zones dlimites gographiquement prsentant une sensibilit plus ou
moins importante. C'est donc une approche de l'assainissement beaucoup plus globale incluant pollutions
domestique et pluviale et prenant en considration la sensibilit d'une vaste zone gographique et non
pas seulement l'exutoire ce qui pouvait conduire des niveaux de rejet trs diffrents pour des lieux de
dversement contigus.
Dans le tableau 2-6, les niveaux de rejet, associs la dfinition de sensibilit des zones, tels que dcrits dans
la Directive sont donns.
En outre, la Directive associe ces valeurs de concentration une frquence d'analyses et un taux de
conformit qui peut tre voisin de 93% dans certains cas. Ces critres de fiabilit imposent de concevoir les
installations avec un maximum de scurits (doublement des quipements majeurs) et de prfrer les
systmes multilignes pour les stations de taille importante.
Gnralits sur les techniques de lassainissement - Page 108
CAS GENERAL MILIEUX SENSIBLES
PARAMETRES Concentration Pourcentage
minimal de
rduction (%)
Concentration Pourcentage minimal
de rduction (%)
DBO5* 25 mg/l O2 70 - 90
DCO* 125 mg/l O2 75
MES* 35 mg/l 90
Pt** 2 mg/l P (EH compris
entre 10 000 et 100
000)
1 mg/l P (EH de plus de
100 000)
80
NGL** 15 mg/l (EH compris
entre 10 000 et 100
000)
10 mg/l (EH de plus de
100 000)
70 - 80
* valuation sur un chantillon moyen 24h.
** valuation sur une moyenne annuelle.
Tableau 2-4 : Niveaux de rejet dfinis par la Directive europenne 91/271.
Pour le traitement, la Directive distingue les agglomrations en fonction de leur charge brute (120 600 ou 900
kg/j) et fixe des dates pour leur ralisation, 2000 pour les charges les plus fortes et 2005 pour les autres. Les
dates sont encore plus rapproches lorsque le rejet a lieu en zone sensible (1998 pour les charges suprieures
900 kg/j).
Une autre modification importante concerne la dfinition des "eaux rsiduaires urbaines". Celles-ci
doivent, en systme unitaire, intgrer les eaux de ruissellement qui seront traites en station dans les mmes
conditions que les eaux domestiques. Sont seulement exclues les eaux d'orage exceptionnel.
La loi sur l'Eau du 3 janvier 1992 donne des lments pour la transposition de cette Directive, travers son
article 35, et notamment prcise les domaines suivants :
la dlimitation des zones d'assainissement autonome et collectif;
les dispositions de collecte et de traitement dfinis par la directive;
la dlimitation des zones sensibles par les comits de bassin.
Page 109 - Chapitre 6
La figure 2-1 donne la dlimitation des zones sensibles propose par les six comits de bassin. Elle sera
reprise dans le dcret relatif la collecte et au traitement des eaux rsiduaires urbaines qui doit paratre dbut
1994. Le lecteur devra le consulter ainsi que les arrts d'application. Mais, ds maintenant, quelques prcisions
sur son contenu peuvent tre donnes.
Arrt du 23 novembre 1994 portant dlimitation des zones sensibles
pris en application de larticle 6 du dcret N94-469 du 3 juin 1994
relatif la collecte et au traitement des eaux uses (J.O du 24 dcembre 1994)
Figure 2-1 : Dlimitation des zones sensibles.
Gnralits sur les techniques de lassainissement - Page 110
Les concentrations limites de la Directive seront confirmes comme le traitement en station comportant un
traitement biologique avec dcantation secondaire ou tout autre traitement quivalent. Ces objectifs concernent
les eaux de temps sec. Par contre, pour les eaux de temps de pluie, l'approche sera plus progressive et
pragmatique en se fondant sur les possibilit offertes par la Directive (importance de la pluie et cot valable
conomiquement). Le flux de pollution devra tre acceptable pour le milieu rcepteur et respecter les objectifs de
qualit de celui-ci.
Le dcret prcisera comme suit la charge brute "c'est le poids correspondant la demande biochimique en
oxygne sur 5 jours (DBO
5
) calcule sur la base de la charge journalire moyenne de la semaine au cours de
laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans une anne"
Ce nouveau dcret donnera galement des prcisions respecter pour la rutilisation des eaux uses. C'est
important, car la rutilisation de ces eaux des fins agricoles, industrielles ou autres peut modifier totalement les
schmas de traitement et notamment influer sur les niveaux de qualit atteindre. Ainsi, une utilisation en
arrosage d'espaces verts ou de cultures n'implique pas l'limination des nitrates ou des phosphates mais impose
un souci particulier de la protection sanitaire et donc une action de dsinfection au moins partielle, pralable. Le
sol peut galement constituer un milieu rcepteur condition de regarder plus particulirement les risques de
colmatage par les matires en suspension, le problme de la protection des nappes et la contamination possible
des cultures ventuelles.
On notera enfin que le dcret du 24 mars 1993 applique aux dversoirs d'orage les mmes seuils
d'autorisation pour les charges polluantes que ceux fixs pour les stations (cf. chapitre IV.1). Il en est de mme
pour les rejets des rseaux d'eaux pluviales si la zone concerne dpasse 20 hectares. Sans doute, les
traitements devront permettre de respecter le milieu naturel.
Cependant un domaine de pollution reste mal dfini, c'est celui de la pollution par les micro-organismes. A
priori, il n'existe de normes que pour le milieu naturel (normes pour la baignade, pour la conchyliculture, ...) ce qui
oblige le traiteur d'eau dfinir son propre niveau de rejet en fonction de facteurs complexes : taux de dilution,
courantologie, taux de survie des micro-organismes,... On traitera au paragraphe II des problmes poss par le
traitement des eaux uses urbaines, et au paragraphe III de celui des eaux pluviales.
II. LE TRAITEMENT DES EAUX USEES
Les eaux uses contiennent des matires minrales et organiques en suspension et en solution, ainsi qu'un
certain nombre de dchets divers (vgtaux, plastiques, ...).
L'puration consiste liminer ces diffrents lments de l'eau qui les contient, afin d'obtenir une eau traite
conforme aux normes de rejet indiques au paragraphe prcdent.
L'limination de ces dchets htrognes demandera un ensemble de dispositifs ddis la rtention
spcifique d'une fraction. Nous verrons qu'une grande majorit de ces polluants est en fait transfre de la phase
liquide vers une phase concentre boueuse. Une station d'puration comportera donc toujours des installations
de traitement des eaux et des dispositifs de stabilisation et de rduction de la teneur en eau des boues produites
adapts leur devenir ultrieur (pandage, incinration, mise en dcharge, ...).
II.1. LE TRAITEMENT DE L'EAU
II.1.1. Le prtraitement
La premire phase du traitement consiste retenir les dchets grossiers prsents dans les eaux, elle comporte
successivement :
un dgrillage avec le passage au travers de grilles barreaux plus ou moins espacs, nettoys par des
procds mcaniques;
ventuellement un tamisage, par passage travers de tamis mailles plus ou moins fines;
Page 111 - Chapitre 6
un dessablage-dgraissage qui retient par dcantation les sables grossiers (jusqu' 200 microns) et les
matires flottantes par flottation grce l'injection de fines bulles.
II.1.2. La dcantation et les traitements physico-chimiques
C'est la sparation des lments en suspension par effet naturel de pesanteur soit directement (dcantation
libre), soit aprs avoir agglomr les plus fins par des adjonctions de coagulant ce qui provoque leur
grossissement et leur sdimentation plus rapide (floculation). On peut aussi se servir de la flottation, procd
dans lequel les lments en suspension sont entrans vers le haut par des fines bulles de gaz.
Ces traitements sont bass sur la mise en oeuvre de dcanteurs ou de flottateurs de diverses formes, dont le
mode de reprise des boues est soit par raclage mcanique, soit par pompage. De plus en plus, l'accroissement
de la surface de dcantation est obtenue par l'immersion de lamelles inclines et parallles au sein du volume de
dcantation. Ces dcanteurs lamellaires sont principalement employs dans le cas des traitements physico-
chimiques par coagulation-floculation (cf. RICHARD rf. 1). Les appareils les plus rcents utilisent en plus un
recyclage des boues dans la zone de coagulation, ce qui acclre le processus d'agglutination par l'introduction
de "germes".
Cette phase permet l'limination d'une partie importante des matires en suspension (50 90 % suivant la
technique) sous forme de boues liquides (au mieux 40 g/l de matires sches). De ce fait, une partie de la DBO
5
et de la DCO est aussi retenue, les autres polluants (azote et phosphore) sont peu touchs sauf dans le cas du
traitement physico-chimique o le phosphore peut tre prcipit par des sels mtalliques. Ces traitements
peuvent tre trs utiles dans le cas des stations en montagne (cf. DAUTHUILE rf. 2).
II.1.3. Les traitements biologiques
Les traitements biologiques reposent sur l'utilisation des micro-organismes naturellement prsents dans les
eaux que l'on concentre dans les bassins d'puration par floculation ou par fixation sur des supports inertes.
Diverses techniques sont possibles :
le lagunage ar, qui peut accepter des eaux brutes mais ncessite des temps de sjour longs;
les lits bactriens ruissellement et les disques biologiques;
les boues actives qui comportent un bassin d'aration et un clarificateur et peuvent suivant les
dispositions prises accepter des charges massiques plus ou moins fortes;
des racteurs milieu support granulaire fin fixe ou mobile.
II.1.3.1. Lagunage
La technique du lagunage est base sur le maintien de l'effluent traiter pendant des dures trs importantes
dans le bassin de traitement. L'puration est ralise par voie biologique avec des cintiques lentes. Le temps de
sjour est fonction des objectifs de qualit recherchs et du type de lagunage utilis. En effet, plusieurs types de
lagunage sont possibles : naturels, aids par une aration force ou associs des plantes aquatiques
(macrophytes, ...). La biomasse active non recycle est uniquement fonction du temps de sjour hydraulique et de
la temprature
Outre le fait qu'elle demande des surfaces au sol importantes, cette technique a une efficacit variable en
fonction du lieu gographique d'implantation (ensoleillement, temprature). De plus, elle ncessite, comme tout
autre systme d'puration, une exploitation et un suivi soigns.
Gnralits sur les techniques de lassainissement - Page 112
II.1.3.2. Lits bactriens et disques biologiques
La technique des lits bactriens met en oeuvre des cultures bactriennes fixes sur des supports minraux
(pouzzolane, cailloux) ou plastiques sur lesquelles ruisselle l'eau traiter. Les performances puratoires sont
modestes, mais cette technique peut constituer un traitement suffisant si la sensibilit du milieu rcepteur n'est
pas trs grande.
Les disques biologiques consistent fixer la biomasse sur des disques en rotation autour d'un axe central et
baignant en partie dans le bassin d'puration.
Ces deux techniques ncessitent un traitement primaire (dcantation libre ou assiste) en tte.
II.1.3.3. Epuration par boues actives
La dgradation est assure par voie biologique arobie l'aide de populations bactriennes maintenues dans
le systme puratoire sous forme flocule (boues actives). Ce principe naturel de floculation permet de sparer
l'eau traite de la biomasse par simple dcantation et de recycler une partie de la masse active vers le racteur
biologique pour maintenir une activit biologique optimale.
Les systmes par boues actives ont une action puratoire sur la plupart des polluants (soluble et particulaire),
mais le degr d'efficacit dpend du dimensionnement choisi. La principale difficult est souvent de matriser par
une exploitation soigne la phase de clarification finale et la recirculation de la biomasse active de faon viter
la boue de rencontrer des conditions nfastes (anarobiose), qui affecteraient son activit et ses proprits de
dcantation.
II.1.3.4. Filtration / biofiltration
Les technologies qui appartiennent ce groupe utilisent des supports granulaires fins (quelques mm) mis en
oeuvre dans un racteur sous forme de lit fixe ou mobile. Dans le cas d'un lit fixe, l'eau traiter traverse la masse
filtrante en flux ascendant ou descendant.
Le premier effet concerne la rtention des matires en suspension au sein de la masse filtrante. Les nouvelles
gnrations de racteurs associent cette filtration une activit biologique arobie grce une distribution directe
dair en base de racteur.
La mise en oeuvre de ces traitements ncessite souvent un prtraitement pour rduire les matires en
suspension et donc la vitesse de colmatage du lit. La rgnration du racteur se fait par des squences de
lavage.
Ces traitements possdent une bonne efficacit puratoire et sont caractriss par une compacit extrme, qui
permet de les envisager lorsque des contraintes de place ou de couverture sont essentielles.
II.1.4. Elimination de l'azote
Base sur la raction de nitrification-dnitrification, elle ncessite des traitements plus pousss mettant en jeu
des populations bactriennes varies. Les conditions de dveloppement de ces bactries imposent de concevoir
des schmas de traitement particuliers, qui doivent respecter les contraintes suivantes :
un ge de boue lev pour permettre le maintien des populations autotrophes nitrifiantes;
une fourniture d'oxygne compatible avec la forte demande lie l'oxydation de l'ammoniaque en
nitrate (4,5 mg par mg de N-NH
4
);
des zones exemptes d'oxygne dissous et alimentes en pollution carbone sont, soit isoles
gographiquement (zone anoxie) soit cres par alternance de l'aration, pour forcer la rduction du
nitrate en azote gazeux par les bactries htrotrophes arobies prives d'oxygne dissous.
Page 113 - Chapitre 6
Les schmas de traitements permettant l'limination de l'azote sont donc principalement les boues actives
faible charge ou en aration prolonge avec ou non une zone anoxie en tte. Les biofiltres peuvent assurer aussi
l'ensemble des ractions d'limination de l'azote, mais une nitrification-dnitrification pousse ncessite des
racteurs spars, ce qui oblige un apport de carbone exogne pour l'tape de dnitrification.
II.1.5. Dphosphatation et traitements d'affinage
La dphosphatation peut se faire par prcipitation chimique avec des adjuvants diffrents suivant le pH, soit en
tte du traitement (dcantation primaire), soit en simultan dans le bassin de boues actives soit encore en
traitement tertiaire.
La dphosphatation peut aussi tre ralise par voie biologique. Ce procd est bas sur le passage des flocs
purateurs successivement dans des bassins ars et anarobies (absence d'oxygne dissous mais aussi de
nitrates), dont la rsultante est la slection au sein de la boue de populations bactriennes capables de stocker
de fortes quantits de phosphore.
Pour obtenir une limination encore plus pousse de diffrents composants de l'eau et notamment les
micro-organismes et parasites, diffrents traitements d'affinage sont possibles :
lagunage de finition;
filtration sur sable;
adsorption sur charbon actif;
dsinfection chimique ou physique.
II.1.6. Les problmes d'environnement
Malgr l'option prise gnralement de construire la station d'puration hors de la ville, celle-ci se trouve bien
souvent rattrape par l'urbanisation priurbaine ce qui entrane des plaintes concernant les bruits, les odeurs et
mme les atteintes esthtiques au paysage.
La lutte contre ces nuisances est possible mais reste coteuse.
Les bruits.
Les solutions consistent abriter les machines dans des structures d'insonorisation, rduire si possible les
vitesses, mettre des silencieux, prvoir des montages sur plots antivibratils, dsolidariser les conduites
d'aspiration et de refoulement d'air, ...
Pour les arosols cres par les dispositifs d'aration de surface, les pulvrisations, les chutes et mouvements
d'eau, il faut pour les rduire ou les supprimer prvoir des capotages ou des changements d'quipements
(aration fines bulles de fond par exemple).
Les odeurs.
Elles trouvent leurs origines dans les composs prsents dans l'eau brute ou gnrs lors des diffrentes
tapes de l'puration. Les sources les plus importantes sont (cf. FAYOUX, rf. 15) :
les prtraitements;
les puits boues;
les paississeurs gravitaires;
le conditionnement et la dshydratation des boues;
la rception et le traitement des matires de vidange.
Gnralits sur les techniques de lassainissement - Page 114
L'limination des odeurs doit tout d'abord tre aborde par la recherche et l'identification des sources.
En effet de nombreuses odeurs sont dues des composs rduits (hydrogne sulfure, mercaptans) mis lors de
phases anormales de stockage de l'eau et surtout des boues. La suppression de ces zones amne non
seulement la dcroissance de la pollution olfactive, mais aussi une amlioration sensible du traitement
empoisonn pralablement par les composs rduits. Cependant, des odeurs peuvent persister que seul un
traitement appropri permettra de rduire. Celui-ci est bas sur un lavage contre courant par des ractifs
chimiques du gaz collect par la ventilation des sources (ex : procd de contacteur gaz-liquide garnissage).
Cela implique de prvoir une couverture totale ou partielle des ouvrages de faon les mettre en lgre
dpression.
L'absence de normes de concentrations chiffres et le caractre subjectif des odeurs rendent difficile
l'valuation des performances de la dsodorisation.
Linsertion dans le paysage.
les solutions vont d'un simple rideau d'arbre une couverture totale avec des contraintes de style architectural.
Au total, ces diverses mesures de protection contre les nuisances sont coteuses (ex : lutte contre les odeurs)
notamment pour les installations existantes. Cela a conduit dvelopper des "stations d'puration sans
nuisances" trs compactes entirement couvertes qui peuvent s'insrer en site urbain. Ainsi, la station
d'puration de Colombes prvue pour traiter 240 000 m
3
/j en temps sec et 8 m
3
/s de dbit de temps de pluie dont
la construction vient de commencer en est un parfait exemple.
II.1.7. Les filires possibles
En fonction des objectifs de qualit atteindre pour les effluents, une srie de modules de traitement
successifs bien choisis constitueront la filire retenue.
Le lecteur pourra se reporter lannexe 2.1 o sont dcrites les performances et la technologie d'une
cinquantaine de modules possibles. Il y trouvera des indications sur leurs avantages respectifs et surtout des
prcisions sur les facteurs surveiller par l'exploitant pour obtenir un rendement correct de ces diffrents
maillons.
Le tableau 2-7 rsume les rendements, les teneurs et les niveaux obtenus dans les liminations des composs
polluants par les principales filires types avec une valuation synthtique de la fiabilit du dispositif complet.
Page 115 - Chapitre 6
Tableau 2-5 : rendements, les teneurs et les niveaux obtenus dans les liminations des composs polluants par les
principales filires types.
Gnralits sur les techniques de lassainissement - Page 116
II.2. TRAITEMENT DES BOUES
Celui-ci est indispensable, pour rendre les boues plus vacuables et viter les odeurs. Les boues sont
caractrises par la concentration en matires sches (ou siccit), leur teneur en matires volatiles (pouvoir
fermentescible et calorifique) leur concentration en azote et phosphore (possibilit d'amendement agricole) et la
rpartition de l'eau contenue (eau libre ou lie) et leur viscosit (facilit de dshydratation). Le lecteur pourra se
rfrer Chevance (rf. 4) pour la caractrisation des diffrentes boues de station.
Le tableau 2-8 rsume les diverses qualits des boues produites par la ligne eau.
TYPE DE BOUES MS
(g/ha/j)
Volume
(l/ha/j)
Conc. MS
(%)
MO/MS (%)
PRIMAIRE : Frache
Digre anarobie
50 - 60
30 - 40
1 - 1,2
0,3 - 0,5
5
8 - 10
55 - 70
35 - 60
MELANGEE : Frache
Primaire + lit bactrien Digre
70 - 75
45 - 50
1,4 - 1,5
0,5 - 0,7
5
7 - 9
55 - 70
35 - 60
MELANGEE : Frache
Primaire Digre (ana)arobie therm
+ boues actives. Digre arobie msophile
80 - 100
50 - 65
60 - 70
1,6 - 2,5
0,8 - 1,6
1,2 - 2
4 - 5
4 - 7
3 - 5
60 - 75
45 - 60
50 - 65
BIOLOGIQUE : Frache
Boues actives Digre arobie msophile
45 - 60
30 - 40
2 - 6
0,6 - 2
1 - 2
2 - 5
70 - 85
60 - 75
Tableau 2-6 : Diffrentes qualits de boues produites.
L'objectif final du traitement des boues est de transformer le produit pour le rendre compatible avec une
rutilisation quelconque ou pour assurer sa destruction lorsque sa composition est juge dangereuse et ceci dans
des conditions d'absence de nuisances (odeur) et de respect des normes lies aux usages. Les moyens pour y
arriver sont d'une part la rduction de la matire organique et/ou du pouvoir fermentescible (dgradation
biologique, inactivation chimique) et d'autre part la rduction du volume par limination de l'eau contenue dans le
produit.
II.2.1. L'paississement
Cette phase permet de concentrer la boue des valeurs qui en fonction de l'origine et du procd employ
varie de 3 10% en siccit. Les moyens les plus classiques sont :
la dcantation statique;
la flottation;
l'gouttage sur table perfore.
Le choix se fera en fonction des traitements ultrieurs et de la taille de l'installation.
Page 117 - Chapitre 6
II.2.2. Digestion et stabilisation biologique
II.2.2.1. La stabilisation arobie
Cette technique est de moins en moins employe, elle n'assure qu'une diminution mdiocre de la matire
organique (10 20%) et ncessite un conditionnement chimique (chaux) pour une relle stabilisation qui reste
temporaire.
II.2.2.2. La digestion anarobie
La dgradation se fait par l'intermdiaire de bactries anarobies msophiles, qui transforment la matire
organique en mthane. Le chauffage est indispensable pour maintenir la temprature un optimum de 35-37C.
Le temps de sjour de la boue est de l'ordre de 20 30 jours et la dgradation des matires organiques atteint
50%.
Rcemment dvelopps, des procds en deux tapes (acidognse thermophile et mthanognse
msophile) permettent de diminuer fortement le temps de sjour (12 jours).
II.2.2.3. La digestion arobie thermophile
La monte en temprature (45 50C) se fait naturellement par le dgagement de calories li l'oxydation de
la matire organique. Ce procd implique une forte aration et une couverture des ouvrages pour minimiser les
pertes calorifiques.
II.2.3. La dshydratation
La dshydratation est ncessaire pour vacuer une partie de l'eau libre contenue dans les boues. Les
traitements comprennent gnralement en premire tape un conditionnement chimique de la boue pour faciliter
l'vacuation de l'eau de la boue grce un changement de structure. Les principales technologies de
dshydratation sont :
les lits de schage (pour mmoire);
la filtration sur bande pressante (siccit de 15 35%);
la filtration sous pression (siccit de 35 55%);
la centrifugation (siccit de 15 40%).
II.2.4. Le schage et l'incinration
Les normes de plus en plus svres pour l'vacuation des boues rsiduaires vont limiter puis interdire leur
dversement en dcharge ou centres d'enfouissement. Cette contrainte va obliger la mise en oeuvre de
technologies de destruction des boues non valorisables comme l'incinration.
Le schage est le premire tape avant une incinration mais peut constituer lui seul un mode de
conditionnement permettant par exemple une valorisation horticole des boues. Le schage permet d'obtenir des
siccits de 80 95%. Les principaux fours d'incinration sont sols tags ou lits fluidiss.
II.2.5. Le compostage
Le compostage peut constituer une solution intressante pour la dshydratation des boues et leur modification
de structure par l'apport d'un complment vgtal pour en faire un produit valorisable en agriculture.
Gnralits sur les techniques de lassainissement - Page 118
II.2.6. Conclusion
Les trois tableaux 2-9 et 2-10 rsument les caractristiques et les performances des diffrents procds de
dshydratation, d'paississement et de rduction de la matire volatile des boues.
Boues
primaires
Boues
mixtes
Boues
biologiques
Boues physico-
chimiques
< 50 mg/l FeCl
3
Boues physico-
chimiques
> 100 mg/l FeCl
3
Epaississement
gravitaire
Cm
(kg MS/m
2
/j)
70 120 30 60 20 30 50 70 40 60
Cs 60 100 g/l 35 55 g/l 20 35g/l 60 100 g/l 40 60 g/l
Flottation Cm
(kg MS/m
2
/j)
70 150
Cs 35 50 g/l
Centrifugation Cs 50 70 g/l
Cm = charge massique, Cs = concentration en sortie ou siccit.
Tableau 2-7 : Performances de divers procds d'paississement.
Boues primaires Boues mixtes Boues
biologiques
Boues mixtes
Digestion
anarobie
Boues physico-
chimiques
FILTRE A
BANDES
Cm = 400 700 kg
MS / ml/ h
S = 28 35 %
Cm = 150 400 kg
MS / ml/ h
S = 18 26 %
Cm = 100 150 kg
MS / ml/ h
S = 16 21 %
Cm = 120 300 kg
MS / ml/ h
S = 17 24 %
Cm = 300 700 kg
MS / ml/ h
S = 26 35 %
Centrifugation S = 18 22 %
FILTRE PRESSE
Conditionnement
minral
S = 40 50% S = 36 44% S = 31 37% S = 36 42% S = 33 45%
Cm = Charge massique
S = siccit
Tableau 2-8 : Performances de divers procds de dshydratation.
Page 119 - Chapitre 6
Temps de sjour Concentration en
sortie
% rduction des matires
volatiles
"Stabilisation" are Boues mixtes : 15 jours
Boues moyenne charge : 10 jours
30 40 g/l
15 25 g/l
10 20 %
10 20 %
Digestion arobie
thermophile
5 10 jours 10 20 g/l 45 55 %
Digestion anarobie 10 30 jours 15 25 g/l 45 50 %
Tableau 2-9 : Performances des procds biologiques de rduction des matires volatiles.
III. EPURATION DES EAUX PLUVIALES
III.1. LA POLLUTION DES EAUX PLUVIALES
On rappellera ici que la pollution qu'elle apporte est importante et comparable celle des eaux uses du point
de vue des concentrations (tableau 2-12). Pour les MES, les valeurs sont toujours suprieures, les masses
annuelles sont trs largement suprieures celles des dversements sur la qualit des milieux rcepteurs
(tableau 2-13).
La biodgradabilit des eaux unitaires par temps de pluie est gnralement moins bonne que celle des eaux
uses, ce qui se traduit par un rapport DCO/DBO plus lev. La fraction organique des MES reprsente
seulement 40 60% en masse, contre 70 80% en temps sec. Les fortes concentrations en solides et une plus
faible biodgradabilit caractrisent donc les eaux unitaires par temps de pluie.
Cette pollution varie largement d'un site l'autre sur un mme site et les rapports d'un seul orage peuvent tre
considrables et atteindre une trs forte fraction du rejet annuel de ce site. Enfin les concentrations en mtaux
lourds sont beaucoup plus fortes que pour les eaux uses (tableau 2-12).
Bassin versant Concentration (mg/l) Temps sec (moyennes
journalires)
Temps de pluie
(moyenne)
Mantes-la-Ville (78) MES
DCO
DBO5
hydrocarbures
Pb
379
734
397
9,2
0,16
674
373
93
5,4
0,44
Coteaux (75) MES
DCO
DBO5
hydrocarbures
Pb
111
242
106
1,5
0,037
243
276
78
4,61
0,16
Gnralits sur les techniques de lassainissement - Page 120
Ru Sainte Baudille (93) MES
DCO
DBO5
hydrocarbures
Pb
87
187
73
0
0
323
316
75
3,8
0,36
Ru des Grammonts (93) MES
DCO
DBO5
hydrocarbures
Pb
131
278
106
0
0
243
231
44
3,7
0,165
Tableau 2-10 : Concentrations compares en temps sec et en temps de pluie pour divers rseaux unitaires (Briat rf. 7).
Paramtres de
pollution
Rejet de STEP Surverses unitaires Rejets sparatifs
MES 10 - 17 40 - 200 25 - 100
DCO 30 - 50 40 -150 10 - 50
DBO5 10 - 17 15 - 30 2,5 - 10
Tableau 2-11 : Masses annuelles (en tonnes) rejetes pour une station d'puration et par la surverse en rseau unitaire
compars aux rejets directs pour un rseau sparatif d'une ville de 10 000 habitants. (d'aprs ABSN 1989) (in Valiron rf.17)
III.2. LES PROBLEMES DE TRAITEMENT PAR TEMPS DE PLUIE
Les diffrents modules dcrits au paragraphe II pour les eaux uses peuvent servir au traitement puisque leur
composition est voisine, mais ncessitent gnralement une adaptation cause de la spcificit de ces eaux (cf.
Bertrand-Krajewski rf. 6).
La rapidit de la variation de dbits, lors des pisodes pluvieux, peut provoquer des reprises de matires en
suspension dj dcantes qui peut conduire augmenter le dbit de soutirage des boues primaires. Sur l'tage
biologique, il peut y avoir une fuite des boues vers le clarificateur, corriger par une augmentation de la
recirculation. Pour la nitrification, les bactries nitrifiantes ont un taux de croissance trop faible pour s'y adapter
vite, d'o des pointes dans la concentration de NH
4
la sortie.
On constate aussi une chute du rendement de la dnitrification alors que la dphosphatation physico-chimique
peut tre maintenue son rendement optimum condition d'asservir le ractif au flux de phosphore arrivant.
La production de boues est beaucoup plus forte par m
3
d'eau cause des concentrations en MES, et surtout,
elle se concentre sur les 20 ou 30 jours de pluie significative avec un volume de l'ordre de 40 50% du volume
annuel des boues primaires des eaux de temps sec.
Le manque de donnes sur la composition des apports, le cot et le dlai pour les mesures empchent
souvent de proposer les solutions les plus efficaces pour les traiter. S'y ajoute l'incertitude sur les objectifs de
traitement qui ne seront levs qu'avec la sortie des arrts d'application du nouveau dcret voqu au
paragraphe I pour rpercuter en droit franais les obligations de la directive de mai 1992.
Enfin, on notera, qu'actuellement en France, la plupart des stations d'puration a t dimensionne pour ne
traiter que les eaux de temps sec et les eaux parasites (souvent trs importantes). Un dversoir en tte permet de
Page 121 - Chapitre 6
rejeter au milieu naturel le dbit supplmentaire apport par temps de pluie, ce qui sera exclu maintenant ds la
sortie des nouveaux textes. Un gros effort d'adaptation de ces stations devra donc tre men ce qui ncessitera
de mesurer, les apports et leur composition.
Les solutions devront tre dfinies cas par cas et prendre en compte les possibilits de rduire les apports
l'amont comme cela est expos au paragraphe III.3.
On exposera nanmoins les techniques possibles pour les stations au paragraphe III.3 pour les rseaux
unitaires (de loin les plus frquents) et au paragraphe III.4 pour les rseaux sparatifs.
III.3. LE CAS DE TRAITEMENT EN STATION D'UN RESEAU UNITAIRE
III.3.1. La mise en place d'un bassin tampon au droit du dversoir d'orage
Illustres par les figures 2-2 et 2-3, le bassin tampon peut permettre de rduire ou de
supprimer la rapidit des variation de dbit par temps de pluie et facilite la gestion de la
station. Il peut aussi par l'effet de stockage permettre de limiter le surdimensionnement de la
station.
Figure 2-2 : Bassin tampon en drivation
Figure 2-3 : Bassin tampon avec surverse en tte
Gnralits sur les techniques de lassainissement - Page 122
Figure 2-4 : Bassin fonction multiples (tir de Valiron, rf. 14)
D'aprs Lessard et Beck (rf. 8), les stratgies reprsentes par les figures 2-2 et 2-3, permettent de rduire
de 25% les rejets de MES, de 12 et 11% les rejets de DCO et NH
4
+
dans le cas d'une station dimensionne
3Q
TS
.
Une variante intressante est donne par la figure 2-4 qui renvoie une part des eaux du bassin sur une ligne
spciale affecte au traitement des eaux d'orage.
L'intrt d'un tel bassin est multiple :
d'abord de permettre de dimensionner les traitements pour un dbit infrieur au dbit maximal Q
p
d'apport des eaux pluviales;
d'assurer un dbit faible variation pour la fraction Q
1
des eaux pluviales qu'on souhaiterait voir suivre la
filire normale;
il permet enfin de renvoyer le reste du flux pluvial rgul Q
2
sur une chane de traitement spcifique;
une partie Q
1
du dbit de temps sec peut profiter de la chane de traitement d'un orage (une dcantation
physico-chimique), pour rduire la charge du secondaire.
III.3.2. Le traitement des eaux pluviales sur un module physico-chimique.
En premire phase, la chane de traitement de la figure 2-4 peut se limiter des dcanteurs lamellaires
prcds d'un floculateur ou encore des clarifloculateurs comme ceux installs la station de Marseille, qui sont
en effet beaucoup plus compacts. Le rendement escompt pour un flot d'eau d'orage dont les caractristiques
seraient les suivantes : MES : 250 mg/l, DBO
5
:180 mg/l, DCO : 450 mg/l atteindrait 80% pour les premires et
40% pour la DBO
5
.
En seconde phase pourrait tre ajout un traitement sur cultures fixes par exemple un BIOFOR.
Page 123 - Chapitre 6
En remplaant le clarifloculateur par un Densadeg, les rendements pourraient tre encore amliors. Le
tableau 2-14 tir du mmento Degrmont indique les rendements obtenus la station d'puration de Groux-les-
Bains quipe d'un Densadeg et d'un BIOFOR, dont le dbit varie de 75 400 m
3
/h.
% d'limination Avec Ractif Sans ractif
Densadeg seul Densadeg + Biofor Densadeg seul Densadeg + Biofor
Turbidit
MES
DCO
DCO soluble
66
75
51
11
95
96
82
47
26
51
23
0
88
91
81
43
Tableau 2-12 : Rendement de la station de Groux 75 m
3
/h.
Par exemple, le traitement des eaux pluviales la station de Versailles, qui comporte un module primaire de
traitement du flux pluvial (3000 m
3
/h), comprenant :
dgrillage fin 20 mm,
dessablage dgraissage ar,
tamisage 5 millimtres,
dcantation lamellaire,
s'inscrit dans un espace de 45 x 48 mtres.
III.3.3. Le renforcement d'un traitement sur cultures libres (Lessard et Beck (rf. 9))
Figure 2-5 :
Ces auteurs ont propos un dtournement partiel du dbit directement vers le traitement secondaire. Cela
permet de doubler le dbit trait par la station d'puration en dirigeant 50% du dbit sur les seuls traitements
Gnralits sur les techniques de lassainissement - Page 124
primaires, et 50% sur le seul traitement biologique (figure 2-5). Selon les auteurs, le systme est perturb si une
nitrification est normalement prvue, mais il devrait retrouver un rendement correct relativement vite aprs
l'pisode pluvieux. Le problme majeur consiste dterminer le moment (c'est--dire le dbit et ventuellement le
flux polluant) partir duquel on modifie le fonctionnement de la station.
III.3.4. Adoption complte des ouvrages pour respecter en temps de pluie les normes de
temps sec.
Degrmont a tudi pour le groupe de travail "temps de pluie" de l'AGHTM (cf. Valiron rf. 17), le
dimensionnement d'une station pour trois cas (tableau 2-15) :
Cas I : Temps sec 1 400 m
3
, temps de pluie 3 300 m
3
(2 heures);
Cas II : maximum 6 000 m
3
- 2 heures;
Cas III : maximum 6 000 m
3
- 15 heures (stockage).
III.3.5. Le traitement des boues pluviales en station
Ce traitement doit porter, non seulement sur les boues provenant du traitement des eaux pluviales, mais aussi
sur celles venant des bassins de dcantation au droit des dversoirs, qu'elles soient renvoyes l'gout ou
amenes par vhicule jusqu' la station. Si c'est le cas, cela peut reprsenter un accroissement de l'irrgularit
des arrives et du volume des matires traiter. Au total, le volume annuel de ces produits peut atteindre, comme
on l'a vu plus haut, au moins 40 50 % des boues primaires des eaux de temps sec.
La difficult de traitement vient de l'irrgularit de ces apports qui doit tre rgulariss. L'une des solutions
possibles est la cration d'un ouvrage tampon entre les paississeurs de boues primaires et la digestion dont le
but est double :
procder au mlange des boues primaires et des boues biologiques paissies sparment;
disposer d'un stockage permettant de faire face aux fortes variations de production de boues tout en
assurant une alimentation trs rgulire de la digestion.
Dans le cas de Versailles, cit plus haut, les dispositions prises pour ces boues pluviales sont les suivantes :
doublement de la capacit d'paississement des boues primaires;
ralisation d'un ouvrage tampon entre paississement et digestion;
renforcement d'un tiers de la capacit de digestion.
Cela a conduit une augmentation de l'ordre de 40% de la totalit de la filire boues des eaux de temps sec.
III.3.6. Stratgie d'adaptation de la station au traitement des eaux pluviales
On a vu dans ce qui prcde que l'on dispose de diffrents moyens connus et oprationnels, stockage en tte,
dcantation physico-chimique, ventuellement biofiltration, pour traiter avec des rendements satisfaisants eaux
uses et eaux pluviales. Pour les boues, les dispositifs disponibles peuvent tre utiliss avec un stockage
intermdiaire condition d'tre vigilant sur l'limination des odeurs.
Le choix dpend des normes respecter en particulier pour les eaux de pluie, et de considrations
conomiques en particulier pour le devenir des boues provenant de stockages (dcantation amont). Il ne peut
tre fait que si l'on dispose de donnes suffisantes sur les apports qui peuvent tre trs diffrents
suivant les options retenues l'amont du rseau dans le cadre d'un schma global de la zone de collecte.
Il faut aussi disposer d'hydrogrammes et de pollutogrammes des apports en fonction de diffrentes priodes de
retour de la pluie pour moduler correctement stockage et traitement en fonction des normes de rejet et du budget
disponible.
Page 125 - Chapitre 6
Une tude d'cole faite dans le cadre du groupe AGHTM cit plus haut d'un rseau dans le cas d'une pluie de
frquence (3 mois) d'une dure de 2 heures dans une ville type de 100 000 habitants.
Le rseau est dimensionn pour amener la station les apports pluviaux reprsentant 6 fois le dbit moyen de
temps sec (soit 6 000 m
3
/h). Trois types de stations sont tudis cas (tableau 2-15):
puration biologique pour la pointe de temps sec plus dcantation simple de 6 fois ce dbit pour les eaux
pluviales (rendements en MES et MO : 35 %);
idem mais avec dcantation-floculation sur le complment avec rendement de 90 % sur les MES et de
85 % sur les MO;
puration biologique pour tous les apports.
Ouvrages-fonctions Cas I
Qp = 1400 m
3
/h
Qmax = 3300 m
3
/h
2 heures
Cas II
Qmax = 6 000 m
3
/h
2 heures
Cas III
Qmax = 6 000 m
3
/h
15 heures
Stockage pluie Non Non Oui
Dcantation primaire Surface de 1 (environ 1000
m
3
)
Surface de 0,6 y compris
floculation
Surface 0,6
Type Classique sans ractif Lamellaire avec ractif Lamellaire avec ractif
Biologique Volume de 1 (environ 9000
m
3
)
Volume de 2 Volume de 3
Clarification Surface de 1 (environ 2200
m
2
)
Surface de 2 Surface de 2 2,5
Recirculation variable
(total des recirculations)
jusqu' 80% du dbit
maximum (dbit de 1)
jusqu' 80% du dbit
maximum (dbit de 2)
jusqu' 100% du dbit
maximum (dbit de 3)
Tableau 2-13 : Description des cas tudis.
On a suppos que les eaux pluviales arrivent la station sans stockage pralable en 6 heures (cas colonnes
1-2-3) ou au contraire avec un stockage correspondant la totalit des apports (80 000 m
3
) et un renvoi au
rseau (colonnes 1a, 2a, 3a). Le tableau 2-16 indique la pollution traite par la station, celle provenant des
surverses, et la pollution totale arrivant au milieu naturel (valeur en tonnes).
On note que les gains sans stockage entre 3 et 1 ou 2 sont faibles, notamment entre 3 et 2, et surtout que la
rduction, significative provient des stockages. La solution 3 trs coteuse ne semble donc pas intressante, sauf
peut-tre si le milieu naturel trs sensible impose une trs forte dpollution mais il faut alors conjuguer traitement
pouss en station et stockage.
Il apparat donc vident qu'on doit recommander un quipement progressif en commenant par les traitements
primaires. Cette mise en oeuvre "progressive" devrait permettre de profiter, pour les tranches suivantes, des
progrs dus aux recherches actuelles mais surtout des donnes meilleures sur les eaux traiter.
Gnralits sur les techniques de lassainissement - Page 126
Il convient videmment pour rserver l'avenir de prendre des dispositions foncires pour rendre disponibles les
tensions ncessaires dans le futur. Cela implique qu'on ait tudi sommairement cette solution ultime afin de
connatre les emprises dont elle aura besoin.
Situation 1 2 3 1a 2a 3a
Pollution mise
DCO
MES
41,8
80,6
41,8
80,6
41,8
80,6
41,8
80,6
41,8
80,6
41,8
80,6
Pollution arrivant la
station
DCO
MES
25,4
35,1
25,4
35,1
25,4
35,1
41,8
80,6
41,8
80,6
41,8
80,6
Pollution limine par la
station
DCO
MES
19,5
30,2
22,7
33,6
23,1
34,7
27,0
76,1
35,9
76,1
36,1
78,8
Pollution dverse par le
rseau
DCO
MES
16,4
45,5
16,4
45,5
16,4
45,5
-
-
-
-
-
-
Pollution reue par le
milieu naturel
DCO
MES
22,3
50,4
19,1
47,0
18,7
45,9
14,9
14,9
5,9
4,5
5,7
1,8
Tableau 2-14 : Pollution traite par la station, ou provenant des surverses, et la pollution totale arrivant au milieu naturel.
III.4. LE CAS DU TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES EN RESEAU SEPARATIF
Dans le dernier cas, qui revient dimensionner la station pour un dbit normal de 6 000 m
3
/h, on peut
s'attendre un cot multipli par plus de 4 par rapport la mme station ne traitant que le dbit de temps sec (il
faut y ajouter le cot du stockage).
L'adoption d'une solution d'un tel cot ne peut tre qu'exceptionnelle; ne serait-ce que parce que le collecteur
n'amne que rarement 4 fois le dbit de pointe de temps sec mais plutt 2,5 3 fois.
IV. ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS
Pour faciliter l'examen des modalits d'entretien et de surveillance, sept filires type ont t choisies
correspondant chacune une gamme de capacit offrant une bonne reprsentation des principaux traitements
mis en oeuvre.
Elles sont dfinies ci-dessous (annexe 2-1):
Figure 2-6 : Boues actives en aration prolonge (filire I)
Figure 2-7 : Lits bactriens ou disques biologiques (filire II)
Figure 2-8 : Boues actives moyenne charge (filire III)
Figure 2-9 : Dcantation primaire, boues actives forte charge (filire IV)
Figure 2-10 : Boues actives, limination azote et phosphore (filire VI)
Figure 2-11 : Physico-chimique, biofiltre (filire V)
Figure 2-12 : Boues actives forte charge, filtre presse (filire VII)
Page 127 - Chapitre 6
IV.1. FREQUENCE ET DUREE DE L'ENTRETIEN ET DES CONTROLES
Pour chacune d'elle, le lecteur trouvera en annexe 2-3 le dtail des oprations d'entretien courant, de
maintenance des appareillages lectromcaniques et d'analyses et de contrles pour chacun des modules de
chaque filire. Pour ces diverses oprations dcomposes en actions type (nettoyage, relev test, graissage,
vidange, analyse de tel ou tel type, contrle lectrique, etc.) on y trouve la frquence et la dure.
Ces dures moyennes correspondant des oprations isoles, par module leur regroupement donne
videmment lieu un fort abattement, l'agent responsable pouvant souvent entreprendre simultanment plusieurs
oprations. Il s'agit aussi de temps tablis pour des oprations manuelles non automatises.
FILIERE ENTRETIEN
COURANT
MAINTENANCE ET
DEPANNAGE E.M.
ENERGIE CONSOMMEE
Aration prolonge 1000 -
15000 eqha
250 - 500 H/an 50 en moyenne exception
150 200 H/an
120 Wh/j/eqha raccord
Lit bactrien Disque
biologique 1000 -
10 000 HE
200 - 1000 H/an 20 - 100 H/an exception
200
50 Wh/j/eqha raccord
B.A moyenne charge
5000 - 15 000 eqha
1000 - 1500 H/an 200 - 300 H/an exception
500
80 110 Wh/j/eqha
raccord
Dcanteur primaire + B A
forte charge 20000 -
50000 HE
2000 - 5000 H/an 300 - 800 H/an 70 90 Wh/j/eqha
raccord
B A limination azote et
phosphore > 15000 HE
2000 - 5000 H/an 300 - 800 H/an 140 Wh/j/eqha raccord
Physico-chimique +
biofiltre
500 - 2000 H/an 100 - 300 H/an 130 Wh/j/eqha raccord
B A forte charge + filtre
presse > 50000 HE
Sans condt. des
boues
16000 H/an
Sans condt. des boues
18000 H/an
Sans condt. des boues
Energie elec :
60 Wh/j/eqha
Chauf. Dig (gaz) :
34 Wh/j/eqha
Tableau 2-15 : Tableau des cots - Main d'oeuvre et nergie
Le tableau 2-17 donne globalement par filire les temps moyens pour l'entretien courant, la maintenance et le
dpannage des quipements lectromcaniques et les dpenses d'nergie.
Dans le tableau 2-18 ci-aprs sont donnes les dures de vie moyennes des quipements autres que le gnie
civil qui dterminent les cadences de renouvellement et les provisions inscrire dans les comptes d'exploitation.
Gnralits sur les techniques de lassainissement - Page 128
Equipement Dure de vie Equipement Dure de vie
Poste de relvement Traitement biologique et stabilisation des boues
Paniers de dgrillage 5 7 ans Turbine
Pompes de relvement 5 10 ans Ensemble 15 20 ans
Vis de relvement 15 20 ans Motorducteur 8 15 ans
Rgulateurs de niveau 1 3 ans Brosse d'aration
Prtraitements Ensemble 10 15 ans
Dgrillage automatique 10 15 ans Motorducteur 5 10 ans
Equipements dessablage 10 15 ans Surpresseur et soufflante 10 20 ans
Equipements dgraissage 10 15 ans Systme de diffusion 10 15 ans
Dcanteurs (primaire et secondaire) Membranes de diffusion 5 10 ans
Pont racleur Digesteur
Systme de raclage 5 10 ans Compresseur gaz 15 20 ans
Pont 20 ans Dshydratation mcanique
Poste de recirculation des boues Pompes boues 4 6 ans
Pompes de recyclage 4 8 ans Entranements 5 8 ans
Vis de recyclage 12 15 ans Pompe doseuse 15 20 ans
Poste de reprise des boues fraches Transport et vacuation 5 8 ans
Pompes boues 7 10 ans Filtres 15 20 ans
Equipements divers, capteurs Centrifugeuses 15 20 ans
Oxymtre 10 ans Armoire lectrique 10 15 ans
Dbitmtre 10 ans Lit bactrien et disques biologiques
Sonde Redox 1 an
Sprinkler 20 ans
Hydraulique gnrale 20 30 ans
Motorducteurs biodisques 5 10 ans
Tableau 2-16 : Dures de vie des quipements
IV.2. FIABILITE DES INSTALLATIONS
Sont donnes au paragraphe 2 et dans les annexes 2-4 quelques indications sommaires sur la fiabilit de
chacun des modules constituant l'installation d'une station d'puration. Cependant il apparat clairement que
l'objectif de qualit de l'effluent rejet ne pourra pas tre obtenu pendant 100 % du temps et que les teneurs
rsiduelles varieront en fonction de la fragilit et des possibilits de rponse de chacun des maillons de
l'installation aux divers incidents et arrts.
Aux incidents toujours possibles, tels que panne lectrique, dfaut mcanique, pollution accidentelle, qui
gnreront des arrts pour rparation, s'ajoutent les arrts volontaires pour entretien, tels que nettoyage de
bassin, peinture, ... et ceux provoqus par la mto (orages, crues, ...) ou les grves. Ces arrts peuvent avoir
des consquences graves si l'interruption concerne directement ou indirectement le processus biologique et
Page 129 - Chapitre 6
conduit la diminution ou la disparition des bactries. La remise en route peut alors ncessiter prs d'un mois
pour qu'on atteigne nouveau le rendement nominal.
L'exploitant mais aussi les concepteurs et les services publics assurant la matrise d'oeuvre doivent prendre
diverses prcautions pour limiter ces inconvnients :
Prvoir si possible le fonctionnement des installations ou des modules en plusieurs units de
capacit moiti ou moins pour mieux rpartir les risques.
Disposer de matriel de secours tel que :
groupes lectrognes pour maintenir l'insufflation d'air ou le brassage,
pompes et moteurs,
dispositifs d'aration,
ce qui montre l'intrt d'une homognisation du matriel.
Avoir un stock disponible de pices de rechange, tels que :
roues de pompes - garnitures;
rgulateurs de niveaux;
surpresseurs : filtres air;
vannes et clapets;
matriel lectrique de commande (fusibles, contacteurs);
matriel de rgulation (horloges, minuteries, doseurs);
matriel de mesure (compteurs, ampremtres);
quipements pour appareils de contrle (dbitmtres, oxymtres, redox mtre).
Programmer les arrts pour gros entretien par moiti ou encore des priodes o la protection
du milieu naturel est moins imprative (hautes eaux par exemple).
La figure 2-13 donne en annexe 2-5, extraite d'une enqute de 1983 et 1992 mene par l'Agence de l'eau
Artois-Picardie, fait ressortir les points les plus sensibles des installations une indisponibilit momentane. Il
montre ainsi l'effort que l'exploitant doit faire parfois pour mieux adapter les ouvrages l'objectif qui leur est
assign (en compltant les ouvrages ou en les renforant).
Comme indiqu au paragraphe 1.2, la fiabilit accrue demande par la Directive europenne et le dcret
d'adaptation la lgislation franaise va imposer un important renforcement des installations mais aussi une
gestion et un entretien encore plus rigoureux s'appuyant sur une organisation efficace de l'exploitation et du
contrle.
IV.3. ECONOMIES D'ENERGIE
Les dpenses en nergie reprsentant un poste important des cots de fonctionnement (25 35 %). La
recherche d'conomies sur ce poste peut tre une proccupation importante de l'exploitant. Deux voies
complmentaires sont possibles :
Amliorer le rglage des installations. Par exemple, rgler l'aration au niveau optimum (poste qui
reprsente plus de la moiti des dpenses); celui-ci variant avec la charge, l'asservissement de
l'aration en fonction du dbit d'eau brute, de la charge massique ou d'un paramtre reprsentatif du
Gnralits sur les techniques de lassainissement - Page 130
degr d'oxydation dans le bassin peut permettre des conomies substantielles sans altrer la qualit de
traitement.
Eviter les dperditions thermiques dans les circuits o le chauffage est ncessaire, comme la
digestion et le conditionnement des boues. Pour la digestion anarobie ou le traitement par incinration,
les rcuprations de chaleur sont essentielles pour rester en autonomie nergtique. En cas d'excdent,
elle peut tre utilise pour actionner les moteurs des divers appareils ou produire de l'lectricit,
cependant l'intrt conomique de cette rutilisation doit tre tudi avec prcision et rester en usage
interne.
Souvent, la rentabilit de la rcupration de mthane n'est atteinte que pour des installations importantes.
Dans la station d'Achres en Ile de France on a calcul que la rcupration d'nergie pouvait de faon rentable
couvrir 55 % des besoins d'nergie (400 thermies par m
3
sur 700 thermies) et que la rcupration de chaleur sur
le circuit des boues pouvait faire gagner 150 thermies de plus, donnant une autonomie nergtique de plus de 75
%. L'incinration des boues pourrait enfin permettre thoriquement une autonomie totale.
V. L'ORGANISATION DE L'EXPLOITATION ET DU CONTROLE
V.1. MOYENS EN HOMMES ET ORGANISATION DE L'EXPLOITATION
La complexit de la plupart des ouvrages et de leur conduite ncessite un personnel qualifi et spcialis
form la conduite des ouvrages. Le tableau 2-19 ci-aprs indique les qualifications requises.
Catgorie Qualification Attribution
1 Ouvrier (manoeuvre) Entretien des filires IV et V
1 Conducteur de station (seul) Filire I-II-III
1 Electromcanicien Dpannage filires I-II-III
Chef de filire IV
Agent technique 2-3-4 Contrematre responsable de
secteur
Responsable de secteur
Tche administrative (organisation du
personnel)
Agent technique 2-3-4 Technicien qualifi puration Chef de filire IV
Responsable technique de secteur pour les
filires I IV. Assure la formation du personnel
5 Ingnieur Chef d'un service assainissement
Tableau 2-17 : Qualification du personnel.
Le problme pos pour l'organisation des quipes et leur localisation vient la fois de la technicit des agents
ncessaires et du temps rduit passer sur les ouvrages. Actuellement, il est difficile d'envisager d'implanter un
prpos plein temps dans une station que si sa capacit est suprieure ou gale 20 000 eqha.
V.1.1. Stations d'puration de taille infrieure 20 000 eqha
Pour les stations de cette catgorie, il faut organiser des tournes pour excuter les oprations prvues dans
les tableaux dtaills de l'annexe 2-6, avec la frquence approprie. C'est une sujtion trs contraignante pour les
petits services car leur taille ne permet pas de disposer conomiquement du personnel spcialis ncessaire,
l'exploitation du rseau ne pouvant pas complter de faon rentable leur utilisation. C'est pourquoi ils doivent faire
appel des spcialistes extrieurs ou constituer avec d'autres services voisins une quipe commune d'entretien
et de contrle. Cette dmarche peut tre facilite en s'appuyant sur les services que les dpartements ont
constitus en France avec l'appui des Agences de l'Eau pour suivre l'efficacit des stations d'puration vis--vis
des normes de rejet. Ces Services d'Assistance Technique aux Exploitants de Stations d'Epuration (SATESE)
Page 131 - Chapitre 6
envoient au service responsable un rapport de visite indiquant les rsultats des mesures et le relev des
anomalies de fonctionnement releves.
Nanmoins, il est souhaitable dans de nombreux cas ( partir de 10 000 eqha) que les stations soient munies
d'un systme d'alarme signalant au service spcialis les arrts des lments clefs de l'ouvrage (relvement,
recirculation, aration, ...), ou au moins permettant d'interroger distance la station pour connatre la situation de
ces organes essentiels (ce qui dclenche l'envoi d'une quipe). D'autres tlalarmes peuvent tre ralises en
fonction des risques (pollution accidentelle, milieu rcepteur). Cette transmission des alarmes et des donnes de
fonctionnement au niveau d'un poste central permet non seulement de fiabiliser les systmes d'puration par une
intervention rapide mais en plus de mieux cibler les comptences des personnels envoyer en fonction des
informations sur le type de panne ou de dysfonctionnement. Le personnel de tourne est alors limit aux tches
simples d'entretien courant et de contrle qualitatif du traitement.
V.1.2. Cas des stations suprieures 20 000 eqha
La prsence d'un prpos ventuellement toff d'un aide ou d'une quipe est alors possible et elle se
dveloppe en fonction de la taille de l'ouvrage. Le noyau permanent qui doit s'appuyer sur des moyens de
prlvement et de mesure et ventuellement sur un laboratoire, est parfois utilis pour apporter son concours
des oprations trs techniques faire sur le rseau (mesures, entretien des capteurs et des matriels
lectromcaniques) ou encore pour constituer le service commun indiqu plus haut oprant sur la station o il est
implant et en appui sur d'autres stations.
V.2. MOYENS DE CONTROLE
V.2.1. Les mesures et les tests
Il s'agit de suivre le fonctionnement de l'ouvrage pour dceler les anomalies et agir en consquence soit en
modifiant les rglages, soit en procdant au dpannage. Il faudra distinguer les tests simples ou toute opration
pouvant tre frquemment effectue par l'agent de la station, des analyses qui exigent l'intervention d'un
laboratoire.
C'est la raison pour laquelle il faut dissocier le cas des petites et moyennes stations (jusqu' 50000 eqha) de
celui des stations importantes (plus de 50000 eqha) gnralement quipes d'un laboratoire.
Gnralits sur les techniques de lassainissement - Page 132
V.2.1.1. Petites et moyennes stations
Pour les petites et moyennes stations, la pratique frquente d'un certain nombre de tests doit permettre de
caractriser rapidement l'tat de l'installation.
Les tests et mesures "in situ" fondamentaux portent sur les points indiqus dans le tableau 2-20 :
Points de mesure Paramtres et tests
Eau brute (sortie des prtraitements) - Mesure de la temprature
- Mesure du pH et du EH (potentiel d'oxydo-rduction)
- Aspect et couleur de l'effluent
- Test d'oxydabilit au KMnO4
Sortie dcanteur primaire - Test des matires dcantables
- Mesure de la hauteur du lit de boues
- Mesure du EH sur l'eau et les boues
Boues actives - Test de la dcantation dilue en 30 mn
- Mesure d'oxygne dissous
- Mesure du EH
- Couleur de la boue
- Examen microscopique (ventuel)
Boues recycles - Test de la dcantation dilue en 30 mn
- Mesure du EH
Effluent trait - Test de limpidit en disque de Secchi
- Test d'oxydabilit au KMnO4
- Caractrisation de l'azote NH4, NO3 (colorimtre de terrain)
Boues en digestion - Dtermination du pH
- Vrification de la temprature
- Observation : aspect et odeur de la boue
Lit bactrien - Observation
- Caractrisation de l'azote (NO3)
Tableau 2-18 : Tests et mesures.
Page 133 - Chapitre 6
Ces tests n'ont pas la mme prcision que les critres analytiques, mais ils s'avrent gnralement suffisants
pour permettre de modifier les rglages ou signaler tel ou tel incident tendant dgrader la qualit de l'puration.
Bien videment, ils n'excluent pas les analyses pour valuer la conformit de l'eau traite (12 par an) qui seront
ralises par un laboratoire extrieur au site.
V.2.1.2. Pour les stations importantes (50 000 HE et plus)
Ces stations qui sont souvent quipes d'un laboratoire, permettent par consquent un suivi priodique prcis
du fonctionnement des ouvrages d'puration qui s'ajoute aux mesures terrain prcdemment dcrites.
Les mesures faire portent alors sur les lments suivants :
la charge de la pollution brute traiter en MES, DCO et DBO
5
;
le rendement du dcanteur primaire;
les charges rsiduelles rejetes par la station;
le rendement de la station;
les paramtres qui caractrisent le fonctionnement de l'puration biologique (indice de boue dans le cas
de boues actives, consommation en oxygne);
les conditions de fonctionnement des installations de traitement des boues :
digesteur : production et qualit du gaz, rendement d'limination des matires volatiles;
paississeur : concentration des boues, qualit de la surverse;
dshydratation : siccit des boues, qualit du filtrat.
V.2.2. Tableau de bord et synoptique
Les diffrents lments de contrle et les oprations d'entretien doivent tre regroups sous forme d'un
tableau de bord comportant suivant la taille de l'installation une feuille hebdomadaire ou journalire. Les feuilles
remplies par le prpos sont exploites par le responsable de la station qui en tire des lments statistiques et
une analyse des incidents lui permettant de rectifier ultrieurement les consignes. Cette feuille est appele tre
remplace progressivement pour les installations rcentes de capacit forte et moyenne par un logiciel de saisie.
Ce logiciel permet d'effectuer immdiatement des oprations simples (moyennes, cumul, diffrences) et donne
directement les informations traites.
Dans les stations disposant d'un prpos sur place ou d'une quipe, la salle de commande et de contrle
comporte de plus en plus souvent un tableau synoptique mural schmatisant les diffrents lments de la station
o sont affichs par des voyants la marche ou l'arrt des organes et divers autres lments permettant une vision
synthtique de la marche de l'installation. Ce tableau est complt par un pupitre de commande lorsque, comme
on le verra ci-aprs, la station a t plus ou moins "automatise".
V.2.3. L'automatisation
Elle a pour but l'accroissement de la scurit pendant le week-end et la nuit et la fiabilisation du traitement pour
assurer une constance dans la qualit tout en cherchant diminuer le cot. Utilisant les techniques modernes
dveloppes partir des capteurs et des microprocesseurs, l'automatisation va de la simple commande d'un
matriel par tout ou rien partir d'un niveau ou d'une perte de charge (asservissement) ou encore d'une horloge
(squence de fonctionnement) une vritable rgulation d'une phase du traitement partir de la variation de
plusieurs paramtres mesurs dans diffrents ateliers et influant les uns sur les autres.
Une priorit doit toujours tre donne aux automatismes assurant la scurit de marche, tels que nettoyage
des grilles, alimentation permanente en eau brute, extraction et recyclage des boues, alimentation lectrique. La
Gnralits sur les techniques de lassainissement - Page 134
position marche ou arrt de ces dispositifs est alors gnralement renvoye dans la salle de contrle avec
possibilit d'agir par tlcommande.
V.2.3.1. Les automatismes par postes
Il peut s'agir d'horloges dclenchant la mise en route d'un quipement travers une squence pr
programme.
Il peut s'agir d'asservissements simples reliant le fonctionnement d'un organe un paramtre li son
fonctionnement, tel que niveau, perte de charge, dbit, temprature ou concentration. Le systme est ramene
la salle de contrle et une console programmable permet de passer en commande manuelle ou de modifier les
consignes. Ces automatismes sont couramment utiliss pour grer l'alimentation en eau, le dgrillage, le
dessablage, la dcantation primaire, l'paississement des boues, la digestion anarobie, la dshydratation des
boues, l'incinration et le dosage de ractif. Certains capteurs rcents permettent de sophistiquer les
asservissements. Ces automatismes doivent tre imprativement associs des alarmes capables de dtecter
toute incohrence entre l'action et la raction et viter ainsi une drive incontrle du systme.
Il est galement possible, en utilisant des lois simplifies rgissant les procds (biocintiques, physico-
chimiques, ...), de passer une vritable rgulation visant non plus seulement amliorer la fiabilit et allger
la surveillance, mais optimiser en temps rel les phases de traitement sous des objectifs de qualit et
d'conomie.
A titre d'exemple, peuvent tre mentionns l'automatisme AGAS antisulfure (cf. FAYOUX, rf. 10) ou encore la
conduite automatique de la digestion anarobie en lit fluidis (cf. ESCOFFIN, rf. 11).
V.2.3.2. Rgulation de l'puration biologique
Elle est base sur des capteurs fiables et des modles qui doivent tenir compte de l'volution lente des
phnomnes biologiques et de l'effet rgulateur de la masse en jeu.
Les rgulations les plus courantes concernent la fourniture d'oxygne et la gestion des extractions de boues.
Cependant, le dveloppement de capteurs nouveaux (analyseurs en continue, respiromtre, ...) et le
dveloppement de systmes de traitement des donnes complexes (systmes experts, rseaux neuronaux)
laissent supposer une rapide rvolution dans le domaine des rgulations de l'puration biologique.
La rgulation de l'apport d'oxygne dans la liqueur des boues actives est base sur l'exploitation des mesures
d'oxygne dissous et/ou de potentiel doxydorduction dans le bassin d'aration. Les donnes collectes sont
traites pour en dduire les actions mettre en oeuvre :
marche/arrt des moteurs;
modification de la vitesse par variateur;
modification des recirculations.
La rgulation de la masse des micro-organismes est ralise en utilisant les donnes concernant la variation
de la masse des boues dans la station d'puration et en actionnant l'extraction des boues en excs pour maintenir
cette masse constante. Cette rgulation, a priori simple, ncessite cependant de connatre la masse de boues
prsente dans le clarificateur ce qui oblige mettre des capteurs non seulement dans le bassin d'aration mais
aussi au niveau de la recirculation des boues et dans le clarificateur lui-mme pour valuer le niveau du voile de
boues.
V.2.3.3. Rgulation en fonction de la pollution entrante
C'est la plus difficile et la plus rcente. Elle est base sur des mesures directes (biodgradabilit de l'effluent
par respiromtrie de quelques minutes) ou indirectes comme la mesure de turbidit. Cette valuation de la
pollution d'entre permet en intgrant les donnes prcdemment dcrites (taux et consommation d'oxygne
Page 135 - Chapitre 6
dans la liqueur, masse de boue dans le racteur, niveau des voiles dans le clarificateur, qualit de l'eau pure)
de boucler et valider les automatismes par poste et de mettre en oeuvre des actions anticipant les phnomnes.
Ce dernier point peut tre envisag en effectuant les mesures sur l'eau directement sur le rseau de collecte
permettant un dlai de rponse au niveau de l'installation..
V.2.3.4. Optimisation de la gestion
On commence s'en rapprocher, mais le nombre des paramtres et les limites des capteurs, ne permettent
encore qu'une gestion partir d'un guide de procdures et d'instructions dont l'application se fait
automatiquement. Ce guide est actuellement inclus dans des systmes complexes de traitement des informations
comme les systmes experts ou les rseaux neuronaux. Il procde soit en direct pour prvoir ou anticiper un
probable dysfonctionnement, soit en indirect via le chef d'exploitation auquel il fournit les lments de dcision
pour la mise en oeuvre d'une action. Ainsi, le chef d'exploitation peut, en fonction des lments affichs et
ventuellement d'une vision par tlvision de certains points stratgiques (aspect des boues, ...) modifier au
mieux les consignes.
Evidemment, cette gestion automatise n'est envisageable conomiquement in situ que pour des stations
importantes ( partir de 15 000 20 000 eqha) ou pour des stations de traitement intensif comme le couplage
d'un racteur physico-chimique et d'un biofiltre (cf. MECRIN, rf. 14). Par contre, elle peut tre mise en place pour
grer un parc de petites installations via la tltransmission. Mais ce type de gestion n'est un succs que si
l'exploitant dispose du personnel spcialis pour son entretien et sa maintenance (cf. AUDIC, rf. 16).
V.3. HYGIENE ET SECURITE
Compte tenu des dangers que prsente la concentration d'effluents o se dveloppent de grandes quantits de
virus et de bactries pathognes, les risques pour le personnel doivent tre limits par de svres prcautions sur
le plan de l'hygine et de la scurit.
Sur le plan de l'hygine, les prcautions prventives consistent imposer au personnel des vaccinations
diverses (diphtrie, ttanos, BCG, poliomylite, leptospirose) et au moins deux visites mdicales par an. On doit
galement prvoir un local pour que le personnel puisse se laver et se changer (au moins un lavabo) et une
pharmacie comportant des produits antiseptiques. Enfin, des articles du rglement concernant le personnel
doivent indiquer les prcautions prendre en cas de blessure, d'gratignure ou de chute dans un bassin.
Sur le plan de la scurit, les prescriptions rglementaires sur la protection du travail doivent tre appliques
la lettre et mme renforces et s'appuyer sur les mesures constructives indispensables. A ce titre, les
automatisations devront comporter des systmes d'alarmes et de contrles pour viter des mises en marche
dangereuses lors de la prsence du personnel. Les prcautions dcrites ci-aprs ne sont pas exhaustives mais
donnent un bon exemple des mesures prendre :
les garde corps de scurit le long des circulations et passerelles;
la protection contre les matriels en mouvement par des capots, des capteurs et par des arrts
automatiques en cas de rsistance intempestive (particulirement au dgrillage, au poste de relvement,
l'aration, ...);
le bon isolement des moteurs lectriques;
la prsence d'chelles scelles et protges partout o le personnel doit descendre pour l'entretien
(bassins de dcantation, digesteur, ...).
Enfin, dans les consignes donnes par crit au personnel pour l'entretien, les prcautions de scurit doivent
tre explicites, en particulier le danger des gaz combustibles (digesteur, gazomtres) ou toxiques (rseaux,
postes de refoulement), et de l'lectricit en milieu humide ou gazeux. Ces prcautions doivent tre renforces en
priode de gel o s'accroissent les risques de chute.
VI. PROBLEMES SPECIFIQUES
Gnralits sur les techniques de lassainissement - Page 136
VI.1. ADMISSION DES EFFLUENTS INDUSTRIELS ET SPECIAUX
Les dispositions rglementaires concernant les rejets industriels dans les rseaux de collecte et qui en fixent
les limites quantitatives et qualitatives ont t voques au chapitre 3. Une convention tripartite entre l'industriel,
la municipalit et le gestionnaire des installations d'puration doit dfinir trs exactement les responsabilits de
chacun. L'exploitant de la station d'puration doit suivre son niveau l'effet de ces mesures sur la qualit de
l'effluent qu'il reoit. Les variations de la qualit de celui-ci (rapport DBO
5
/DCO, mtaux lourds) qui peuvent
compromettre le bon fonctionnement du traitement ou l'utilisation finale des boues, lui permettront d'alerter le
responsable du rseau pour qu'il agisse sur les dversements intempestifs permanents ou accidentels.
Les sels de mtaux lourds sont des poisons de la vie arobie. De plus, ils peuvent entraner une augmentation
de leur taux dans les boues en excs ce qui rend impropre ces boues la valorisation agricole. De mme, des
apports importants d'eaux uses septiques qui contiennent des rducteurs de type sulfure et ont un trs bas
potentiel d'oxydorduction (+50 -100mV/ENH) peuvent provoquer le blocage de l'puration par disparition des
conditions arobies et intoxications de la flore ou dveloppements de bactries filamenteuses de type Beggiatoa
ou Thiothrix qui dgradent rapidement les qualits de dcantation de la boue. Le raccordement des fosses
septiques doit donc tre trs surveill.
VI.2. TAXATION DES REJETS - AIDE AU FONCTIONNEMENT
La lgislation franaise impose un contrle des rejets par les services de police et le paiement d'une redevance
de pollution calcule sur les effluents rejets dans le milieu naturel. Cette dernire est assortie d'une aide au bon
fonctionnement des stations d'puration qui en modifie l'effet (Agences de l'Eau). On n'en voquera pas ici en
dtail les modalits, le lecteur pouvant se rfrer aux textes rglementaires, mais on insistera sur les
consquences bnfiques pour l'exploitation que peuvent avoir :
une collaboration fructueuse tablir avec les services de contrle et les services chargs du suivi du
fonctionnement de stations (Satese);
une prise en compte des modalits de calcul des paramtres taxs par l'agence pour grer la station,
afin de diminuer la redevance payer grce notamment au bon choix des priodes d'entretien;
une amlioration du coefficient de charge et de rendement de la station pour augmenter au maximum
l'aide au bon fonctionnement.
Page 137 - Chapitre 6
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Gnralits sur les techniques de lassainissement - Page 138
ANNEXES
Annexe 2-1 : SCHEMA DES DIFFERENTES FILIERES DE TRAITEMENT
Page 139 - Chapitre 6
Chapitre 7
PRESENTATION DES DIVERS
ELEMENTS DES FILIERES DE
TRAITEMENT DES EAUX USEES
J. M. AUDIC
Page 141 - Chapitre 7
SOMMAIRE
I. LES PRTRAITEMENTS.......................................................................................................................142
I.1. DEGRILLAGE........................................................................................................................................142
I.2. DILACERATION ....................................................................................................................................142
I.3. TAMISAGE............................................................................................................................................142
I.4. DESSABLAGE-DEGRAISSAGE ...............................................................................................................143
II. LA DECANTATION PRIMAIRE SIMPLE SANS REACTIFS..........................................................143
III. LES TRAITEMENTS PRIMAIRES AMELIORES .........................................................................144
IV. LES TRAITEMENTS BIOLOGIQUES POUR LELIMINATION DE LA POLLUTION
CARBONEE.......................................................................................................................................................145
IV.1. TRAITEMENTS BIOLOGIQUES CONVENTIONNELS..................................................................................145
IV.1.1. Lagunage ar ...........................................................................................................................145
IV.1.2. Lits bactriens ruissellement ..................................................................................................145
IV.1.3. Disques biologiques...................................................................................................................147
IV.1.4. Les boues actives......................................................................................................................148
IV.2. PROCEDES BIOLOGIQUES SUR MILIEU GRANULAIRE FIN .......................................................................151
IV.2.1. Principe .....................................................................................................................................151
IV.2.2. Lavages......................................................................................................................................152
IV.2.3. Matriau ....................................................................................................................................152
V. LES TRAITEMENTS BIOLOGIQUES POUR L'ELIMINATION DE L'AZOTE...........................153
V.1. GENERALITES......................................................................................................................................153
V.2. MISE EN OEUVRE DE LA NITRIFICATION-DENITRIFICATION A L'ECHELLE INDUSTRIELLE.......................155
V.2.1. Nitrification seule...........................................................................................................................155
V.2.2. Systmes ralisant simultanment une nitrification-dnitrification...............................................156
VI. LES TRAITEMENTS DE DEPHOSPHATATION ..........................................................................157
VI.1. GENERALITES......................................................................................................................................157
VI.2. DEPHOSPHATATION PHYSICO-CHIMIQUE .............................................................................................157
VI.2.1. Prcipitation primaire ...............................................................................................................158
VI.2.2. Dphosphatation tertiaire..........................................................................................................158
VI.2.3. Prcipitation simultane............................................................................................................159
VI.3. DEPHOSPHATATION BIOLOGIQUE.........................................................................................................159
VII. LES TRAITEMENTS DE FINITION................................................................................................161
VII.1. LAGUNAGE DE FINITION ......................................................................................................................162
VII.2. PRECIPITATION PHYSICO-CHIMIQUE ....................................................................................................162
VII.3. FILTRATION.........................................................................................................................................162
VII.4. DESINFECTION.....................................................................................................................................163
VII.4.1. Prcipitation physico-chimique .................................................................................................163
VII.4.2. Lagunage ...................................................................................................................................163
VII.4.3. Infiltration / percolation ............................................................................................................164
VII.4.4. Chloration (chlore gazeux, eau de Javel, ClO
2
) ........................................................................164
VII.4.5. Oxydation (ozone, H
2
O
2
et acide practique) ..........................................................................164
VII.4.6. Traitement par radiations (UV, irradiation) .............................................................................165
VII.4.7. Filtration par membrane ...........................................................................................................165
Prsentation des divers lments des filires dpuration des eaux uses - Page 142
I. LES PRTRAITEMENTS
I.1. DEGRILLAGE
Quelque soit le type de traitement utilis, les eaux rsiduaires doivent subir l'arrive la
station d'puration un dgrillage afin de retenir les matires grossires qui sont susceptibles
de crer des difficults sur la suite du traitement. Selon la nature des eaux, l'espace entre
barreaux varie entre 10 et 30 mm. Si des dbris particulirement grossiers sont craindre,
une prgrille fixe de construction robuste doit tre envisage. Il existe actuellement sur le
march une trs grande varit de modles allant des grilles manuelles aux grilles
mcaniques.
Bien que le dgrillage ne soit pas une partie noble du traitement, c'est un poste
important et souvent nglig en exploitation. Or, une grille encrasse peut entraner un
reflux de l'effluent brut dans le collecteur gravitaire et provoquer ainsi des dpts.
L'encrassement de la grille diminue galement son efficacit par augmentation de la vitesse
de passage entre les barreaux. Pour ces diffrentes raisons, les grilles nettoyage manuel
sont proscrire.
La grille doit tre calcule de telle faon que la vitesse de passage de l'eau soit suffisante
pour appliquer les matires sur les barreaux, sans pour autant crer une perte de charge
importante. Les vitesses sur les dbits moyens sont de l'ordre de 0,6 1 m/s et peuvent
atteindre 1,40 m/s en dbit de pointe.
La quantit de dchets retenus sur une grille dpend largement de l'espacement entre
barreaux. On peut en premire approximation estimer 5 10 dm
3
de dchets/habitant et
par an pour un espacement entre barreaux allant de 15 25 mm. Ces matires assimilables
aux ordures mnagres doivent tre mises en dcharge ou brles.
En fonctionnement normal, le dispositif de nettoyage d'une grille automatique fonctionnera
3 4 h/j. Cependant, pendant certaines priodes de l'anne, au moment de la chute des
feuilles en particulier, la dure de nettoyage peut pratiquement atteindre 24 h pendant
quelques jours.
Dans des conditions normales d'exploitation, une grille automatique correctement
entretenue fonctionne environ 5 ans sans rparation importante.
I.2. DILACERATION
Le but de cette opration est, comme son nom l'indique, de dilacrer les matires
grossires contenues dans les eaux uses, et vite donc l'utilisation d'une grille. Mais les
inconvnients sont si nombreux (matriel dlicat, problmes de bouchage de pompes,
formation de "chapeau" dans les digesteurs), que ce procd n'est plus utilis sur les
nouvelles stations franaises.
I.3. TAMISAGE
Cette technique de filtration sur toile, tle perfore ou sur treillis mtallique est peu utilise
dans les traitements classiques en eau urbaine. Cependant les configurations nouvelles de
type dcantation physico-chimique-biofiltre peuvent justifier son emploi, pour viter le
colmatage trop rapide de l'tage de biofiltration. Par ailleurs, elle est souvent obligatoire pour
les traitements des eaux rsiduaires d'industries agro-alimentaires.
Page 143 - Chapitre 7
I.4. DESSABLAGE-DEGRAISSAGE
Le dessablage a pour but d'liminer les matires lourdes de granulomtrie suprieure
environ 200 microns. Le dgraissage, quant lui, a pour but d'liminer les corps flottants les
plus importants : graisses, fibres, poils. En outre, il peut constituer, s'il est suffisamment
dimensionn, une barrire de scurit contre des dversements accidentels
d'hydrocarbures.
La plupart des dessableurs-dgraisseurs sont maintenant quips d'un systme d'aration
fines bulles rglable permettant de maintenir quelque soit le dbit, des vitesses de
balayage suffisantes (de l'ordre de 0,30 m/h). L'injection d'air permet de raliser dans un
mme ouvrage dessablage et dgraissage.
Les ouvrages sont soit de type tangentiel, soit de type longitudinal. Pour les grandes
stations, l'enlvement du sable est assure par des moyens mcaniques.
Grce un traitement appropri, les sables peuvent tre relativement goutts et
dbarrasss de matires organiques. L'gouttage et l'limination des matires organiques
sont raliss soit :
par un ensemble cyclone et vis courte d'gouttage;
par une vis longue de sparation et d'gouttage;
par un clarificateur oscillant assurant galement les deux fonctions.
Ils ne posent pas de problmes particuliers pour leur mise en dcharge.
La rcupration des flottants est effectue en surface. Suivant leur consistance,
l'extraction des produits rassembls en surface est ralise par vasement ou par raclage
manuel ou mcanique. L'limination des matires flottables est de l'ordre de 80 90 %
condition que la temprature de l'eau n'excde pas 25 26 C. Ces matires sont des
dchets trs difficiles vacuer. Rcemment, des dispositifs de dgradation biologique in-
situ sont raliss sur les stations d'puration.
II. LA DECANTATION PRIMAIRE SIMPLE SANS REACTIFS
Elle prsente l'avantage essentiel de retenir, sans utilisation de ractifs, une forte
proportion des matires en suspension et la partie de DBO
5
qui y est associe ce qui
diminue la charge sur le traitement biologique en aval.
Les rendements sont les suivants :
85 a 95 % des matires dcantables;
50 65 % des matires en suspension;
25 40 % de la DBO
5
et de la DCO.
L'exploitation est trs simple, mais doit respecter imprativement un taux de soutirage des
boues suffisant, pour viter leur mise en anarobiose surtout si ces boues extraites sont
refoules vers un paississeur.
La dcantation primaire impose donc un automatisme pour grer l'extraction des boues.
C'est pourquoi la dcantation primaire est rserve aux stations dj relativement
importantes qui peuvent supporter un tel investissement et qui rduisent les frais
d'exploitation, avec des automatismes d'extraction.
Prsentation des divers lments des filires dpuration des eaux uses - Page 144
Les dcanteurs primaires les plus communment employs sont des appareils circulaires
ou rectangulaires flot horizontal.
L'utilisation d'ouvrages circulaires a plusieurs avantages, ce qui explique leur
gnralisation :
plus faible cot de gnie civil;
possibilit d'extraction des boues en un seul point;
meilleur rendement que les dcanteurs rectangulaires, surtout pour les ouvrages de
grande taille;
faible besoin d'entretien des dispositifs de raclage tournants.
Les ponts racleurs sont gnralement entranement priphrique. Les mcanismes de
raclage entranement central ne sont gnralement adopts que pour des ouvrages de
grand diamtre.
La dcantation primaire peut tre supprime avec des traitements biologiques faible
charge et notamment pour les schmas avec dnitrification. Elle est proscrire dans les
traitements avec dphosphatation biologique.
III. LES TRAITEMENTS PRIMAIRES AMELIORES
Dans certaines conditions, le traitement primaire simple est insuffisant. L'amlioration du
rendement d'puration de la dcantation se fait alors par ajout de ractifs de coagulation
floculation. Pour certains effluents industriels, la flottation peut tre utilise.
La coagulation permet l'agglomration directe de particules collodales, alors que la
floculation, qui suit, fait chuter des agrgats dj forms par coagulation.
Les principaux coagulants minraux utiliss en eaux rsiduaires urbaines sont le sulfate
d'alumine, le chlorure ferrique, le sulfate ferreux et le chlorosulfate de fer.
Les floculants organiques les plus employs sont des polymres synthtiques de haut
poids molculaire. En gnral, des essais de laboratoire sont indispensables pour
slectionner le ou les ractifs utiliser (Jar-test).
Les techniques utilises sont extrmement diverses. Elles vont d'appareils directement
extrapols des dcanteurs primaires (dcanteur-floculateur) des appareils plus complexes
et plus performants (dcanteur lamellaire RPS, Turbocirculator et Densadeg).
Les performances dpendent trs largement de la composition des eaux brutes du choix
et du dosage des ractifs. On obtient en moyenne une rduction de :
DBO
5
: 70 % 80 %;
MES : 90 %.
Cependant, avec le cot des ractifs et la production de boues supplmentaires en excs,
la dcantation primaire avec apport de ractifs est plutt rserve des stations utilisant la
technique du biofiltre. Dans ce cas, les deux traitements sont parfaitement complmentaires,
l'tage de biofiltration assurant la rtention des matires en suspension fines et la
dgradation de la pollution soluble sans risque de colmatage excessif.
Page 145 - Chapitre 7
IV. LES TRAITEMENTS BIOLOGIQUES POUR LELIMINATION DE LA
POLLUTION CARBONEE
Les diffrents procds d'puration biologique peuvent tre classs selon la nature des
micro-organismes mis en jeu (arobies et anarobies). Actuellement en traitement d'eaux
rsiduaires urbaines, seuls les procds arobies sont pratiquement utiliss.
Les procds anarobies sont, quant eux, soit rservs la stabilisation des boues en
excs soit au traitement d'effluents industriels trs chargs. Dans la suite de cette partie, on
distinguera les procds conventionnels (lagunage, boues actives, ...), des procds
utilisant les cultures fixes sur milieu granulaire fin.
IV.1. TRAITEMENTS BIOLOGIQUES CONVENTIONNELS
Ces traitements peuvent se subdiviser a leur tour en traitements intensifs et traitements
extensifs.
IV.1.1. Lagunage ar
Le lagunage ar permet d'purer des rejets peu chargs en matires en suspension dans
des bassins de 2 3 m de profondeur. Comme il n'y a pas de recirculation de boues partir
d'un clarificateur, il se cre un quilibre entre l'apport de pollution biodgradable et la masse
de bactries qui se dveloppe partir de cette pollution. Les dispositifs d'aration sont
calculs sur la base des besoins en oxygne. Compte tenu des grands volumes mis en jeu,
les puissances spcifiques appliques sont faibles (2 5 W/m
3
) ce qui se traduit par une
dcantation des bactries au fond des bassins o elles forment un dpt.
Les rendements d'puration dpendent dans une large mesure de la temprature de l'eau.
Mais, mme avec des temps de 10 jours et plus, il sera difficile d'obtenir a partir d'un effluent
urbain :
moins de 120 mg/l en MES;
moins de 100 mg/l sur effluent filtr en DCO;
moins de 40 mg/l sur effluent filtr en DBO
5
.
Le lagunage demande un contrle soign de l'accumulation des dpts en fond qui
peuvent terme dgrader l'hydraulique des bassins et altrer leurs performances. Le curage
priodique de ces dpts (tous les 3 7 ans) et leur vacuation ne doivent pas tre sous-
estims dans lvaluation des cots d'exploitation.
IV.1.2. Lits bactriens ruissellement
Les procds ruissellement constituent la rponse technologique la plus simple au
concept des cultures fixes. Ce type de procd a vu le jour en mme temps que ceux
boues actives, dans certains pays comme l'Angleterre, il a mme t choisi
prfrentiellement. Son domaine d'application couvre aussi bien les eaux rsiduaires
urbaines que les effluents industriels, mais reste trs li au choix d'un matriau support
adquat.
Prsentation des divers lments des filires dpuration des eaux uses - Page 146
Le liquide traiter ruisselle sur le support sur lequel se dveloppe progressivement la
biomasse puratoire. La dispersion de l'eau traiter en surface du lit est ralise par un
dispositif tournant en contre-raction des jets d'eau. L'aration se fait par ventilation naturelle
travers la masse filtrante, le transfert d'oxygne se ralise travers le film liquide en
ruissellement. Cela suppose donc un coefficient de vide important dans le racteur et
conditionne la fois le type de matriau support utilis et le mode de fonctionnement en lit
merg. L'efficacit d'un tel racteur va dpendre de la surface d'change disponible,
classiquement les valeurs rencontres varient de 50 200 m
2
/m
3
.
Une des grandes contraintes de fonctionnement est lie aux risques de colmatage de ces
procds. Dune part, les eaux traiter vhiculent des matires en suspension et des
graisses qui risquent terme de provoquer un blocage de la porosit interne du racteur.
Cela impose donc la construction d'un prtraitement efficace et d'un dcanteur primaire en
amont du lit. D'autre part, la boue produite lors des ractions de dpollution biologique
acclre ce processus de colmatage. La solution consiste appliquer des vitesses de
passage de l'eau qui permettent un auto-curage du racteur. Ces dbits impliquent parfois
des recyclages du liquide, qui se font aprs transit dans un dcanteur, pour viter le retour
en tte de racteur des matires en suspension vacues.
Lors de l'exploitation de tels ouvrages, il est important de tenir compte de leur sensibilit
aux baisses de temprature et des risques d'odeurs lis aux fermentations dans les zones
de faibles changes (colmatage progressif).
Les matriaux supports doivent rpondre un critre impratif, celui d'un coefficient de
vide trs important pour minimiser les risques de colmatage. A l'origine, les lits bactriens
taient remplis par du matriau vrac naturel de type lave volcanique (pouzzolane), coke
mtallurgique ou cailloux siliceux concasss de granulomtrie moyenne comprise entre 40 et
80 mm et de coefficient de vide voisin de 50%. Ces remplissages, rservs uniquement au
traitement des eaux rsiduaires urbaines, sont de moins en moins employs en raison des
risques levs de colmatage de la masse filtrante et des faibles hauteurs d'ouvrages
(maximum 3 mtres) lies au poids du matriau qui conduisent des surfaces au sol
importantes. D'autres matriaux naturels plus lgers sont utiliss comme les "red wood"
(Australie, Nouvelle Zlande).
Actuellement, les supports plastiques vrac (anneaux, ...) ou ordonns (tubes cloisonns,
structure en nid d'abeille) sont largement utiliss, ils prsentent des coefficients de vide
suprieurs 90%. Ces derniers rpondent donc parfaitement aux contraintes de colmatage
et sont employs par exemple en garnissage pour des lits bactriens utiliss en
prtraitement d'effluents industriels. La hauteur de filtre peut atteindre 4 6 mtres. Suivant
la charge volumique applique, on distingue les lits forte charge et les lits faible charge.
Pour les eaux rsiduaires urbaines, les caractristiques de dimensionnement sont rsumes
dans le tableau 16-1 :
Faible charge Forte charge
DBO
5
kg/m
3
.j 0,08 0,15 0,7 0,8
Charge hydraulique m
3
/m
2
.h < 0,4 > 0,7
Recirculation chasses > 200%
Performances 80 90% 70%
Tableau 16-1 : Caractristiques de dimensionnement pour les eaux urbaines.
Page 147 - Chapitre 7
Pour les lits forte charge, la prsence d'un clarificateur en sortie et la stabilisation des
boues produites en excs sont ncessaires.
Etant peu sensible au colmatage, ces supports plastiques sont mieux adapts au
traitement des eaux rsiduaires industrielles, ils peuvent travailler sous des charges
volumiques leves comprises entre 1,5 et 5 kg de DBO
5
par m
3
et par jour, voire plus. Des
recirculations de l'ordre de 500 600% sont ncessaire pour minimiser les colmatages
hydrauliques.
Dans ces conditions, le rendement d'limination de la DBO
5
n'est pas suffisant pour
produire un effluent de qualit conforme aux normes en vigueur, car il oscille entre 50 et 80%
suivant le type d'eau traiter et la charge volumique adopte. Le lit bactrien remplissage
sera donc frquemment suivi par un traitement conventionnel type boues actives.
IV.1.3. Disques biologiques
Le principe consiste en l'utilisation de disques tournant autour d'un axe horizontal et
baignant en partie dans l'eau traiter. De par la rotation, la biomasse fixe sur les disques
se trouve alternativement en contact avec l'eau traiter et l'oxygne de l'air.
Comme dans le cas du lit ruissellement, la biomasse se dveloppe sur le support et le
transfert d'oxygne se fait directement travers la couche liquide. La rgulation de
l'paisseur du biofilm se fait naturellement ds que l'assise biologique en contact avec le
support passe sous des conditions anarobies lies une limitation de transfert de
l'oxygne. Le dcrochage de la boue en excs ncessite la prsence en aval d'un dispositif
de clarification de l'eau traite.
La vitesse de rotation de ces disques (1 2 tours par minute) ne permet pas de gnrer
des nergies de circulation capables de maintenir en suspension des matires solides. Le
risque de dpts en fond de bassin oblige donc un prtraitement de l'eau brute par
dcantation primaire et empche la recirculation de la boue.
Les disques sont raliss en polystyrne, PVC ou feuilles de polythylne, leur diamtre
est gnralement compris entre 2 et 3 m. Les disques utiliss sont plats ou prsentent des
ondulations ou une rugosit cre par des reliefs de faon accrotre la surface de fixation
de la biomasse. Ils sont espacs de 2 3 cm et leur vitesse de rotation est de 1 2 tours par
minute. Les surfaces developpes sont de 150 200 m
2
/m
3
de disque.
Rcemment de nouvelles configurations ont pntr le march des biodisques. Ce sont
des structures de type cage remplies de matriaux plastiques vracs (anneaux, selles, ...)
identiques ceux employs pour les lits ruissellements. La mise en oeuvre est tout fait
comparable celle effectue avec les disques classiques.
Les disques biologiques peuvent tre appliqus pour l'puration des eaux rsiduaires
urbaines et industrielles et permettent l'limination des pollutions carbones et azotes, elles
ncessitent obligatoirement un prtraitement par dcantation primaire. Suivant que les
disques sont immergs ou mergs, le fonctionnement sera en mode arobie ou anarobie.
Cependant, ces technologies sont souvent limites des stations de taille rduite et le
niveau de qualit en sortie n'est pas toujours compatible avec des rejets en milieu sensible.
La mise en oeuvre requiert une couverture par un btiment et comporte le plus souvent
deux tages spars par un dversoir.
Prsentation des divers lments des filires dpuration des eaux uses - Page 148
En eau rsiduaire urbaine, les charges appliques ce type d'installation ne sont pas
calcules par unit de volume de racteur mais par unit de surface de disque. Elles ne
dpassent pas gnralement 10 g de DBO
5
par m
2
de surface de disque et sont plus
proches de 5 g de DBO
5
par m
2
.
La nitrification partielle sur disques biologiques est possible condition de se situer une
charge en DBO
5
infrieure 5 g par m
2
de disque et par jour. Pour une ERU classique,
aprs dcantation primaire, cela correspond une fourchette de dbits allant de 50 75
litres par m
2
de disque et par jour. Les ralisations industrielles qui utilisent cette technique,
sont conues avec plusieurs tages de disques en srie, ce qui semble permettre une
meilleure efficacit par slection de la flore fixe. Souvent mal dimensionns au dpart, les
disques biologiques ont eu peu de succs en France contrairement aux pays germaniques
ou scandinaves o ils sont largement utiliss pour l'quipement des petites stations.
IV.1.4. Les boues actives
IV.1.4.1.Principe
C'est actuellement le procd le plus rpandu pour traiter des eaux rsiduaires urbaines et
au vue des recherches en cours, on peut penser que cette suprmatie durera encore de
nombreuses annes.
Il s'agit en fait d'un ensemble de procds qui ont tous en commun le dveloppement
d'une culture bactrienne dispose sous forme de flocons (boues actives) dans un bassin
brass et ar (bassin d'aration ou bioracteur), aliment en eau purer : cette eau
pouvant avoir subi ou non un traitement primaire plus ou moins pouss (dcantation avec ou
sans ractif).
Dans le bassin d'aration, le brassage a pour but d'viter les dpts et d'homogniser le
mlange des flocs bactriens et de l'eau use. L'aration a pour but de fournir aux bactries
arobies l'oxygne dont elles ont besoin pour purer l'eau. L'aration est effectue
gnralement partir de l'oxygne de l'air soit par l'intermdiaire d'arateur de surface axe
vertical (turbines lentes) ou axe horizontal (brosses) soit par des dispositifs d'insufflation
d'air (disques poreux et plus rcemment membranes micro perfores). Dans les premiers
cas, brassage et aration sont assurs par un mme dispositif, alors que pour l'insufflation
d'air, des dispositifs de mlange dissocis (hlice vitesse lente) sont immerges pour
assurer le brassage lors des arrts de l'aration. Dans certains cas, on peut tre amen
utiliser un gaz enrichi en oxygne, voire mme de l'oxygne pur.
Aprs un temps de contact suffisant, la liqueur mixte est envoye dans un clarificateur
appel parfois dcanteur secondaire destin sparer l'eau pure des boues. Cet ouvrage
de sparation solide-liquide est un ouvrage capital qui conditionne trs frquemment le bon
ou le mauvais fonctionnement d'une station. C'est pourquoi, sur les grandes stations ou pour
des traitements particuliers comme la dphosphatation biologique, les clarificateurs sucs
sont prconiss, car ils permettent de minimiser et de mieux distribuer le temps de sjour
des boues.
Les boues dposes au fond du dcanteur secondaire sont pour une part recycles dans
le bassin d'aration afin d'y maintenir une concentration suffisante en bactries puratoires,
pour une autre part extraites et vacues vers la ligne de traitement des boues.
Page 149 - Chapitre 7
IV.1.4.2.Charge massique et performances
Un des critres frquemment utiliss pour caractriser les diffrents systmes de boues
actives est la charge massique C
m
qui traduit le rapport entre la masse journalire de
pollution liminer et la masse des bactries puratoires mises en oeuvre. On distingue
ainsi des systmes :
forte charge massique : C
m
> 0,5 kg DBO
5
/kg de boues/jour;
moyenne charge massique : 0,2 < C
m
< 0,5;
faible charge massique : 0,07< C
m
< 0,2;
aration prolonge : C
m
< 0,07.
Chacun de ces systmes prsente des caractristiques bien particulires (rendement,
production de boues en excs, consommation nergtique, ...) rsumes schmatiquement
dans le tableau 16-2 (Ces chiffres donns titre indicatif s'entendent pour une eau
rsiduaire urbaine moyennement charge (DBO
5
= 250 mg/l) sans apports industriels,
comportant une parfaite clarification finale.).
C
m
< 0,07
Aration
prolonge
0,07< C
m
<0,2
Faible charge
0,2< C
m
<0,5
Moyenne charge
C
m
> 0,5
Forte charge
Rendement d'puration
sur la DBO
5
(%)
95 % 95 % 90 % 85 %
Nitrification
(oui = +, non = -)
+ + _
Production de boues
biologiques en excs (kg
boues/kg DBO
5
limine)
0,8 0,9 0,9 - 1,1 > 1,2
Concentration maximale
en boues admissible en
aration (g/l) *
5 4 - 5 3 - 4 2
Temps de sjour de l'eau
dans le bioracteur
(heure)
17 - 18 10 - 15 4 - 8 5
Consommation d'O
2
en
aration (kg d'O
2
/kg DBO
5
limine)
1,5 - 1,7** 1,3 - 1,5 0,9 - 1 0,7 - 0,8
* Cette concentration dpend de la conception gnrale de l'installation (clarificateur, ligne de
traitement des boues) et des caractristiques de dcantation.
** La nitrification peut conduire des consommations spcifiques d'oxygne plus importantes.
Tableau 16-2 : Influence de la charge massique sur les paramtres d'exploitation
Prsentation des divers lments des filires dpuration des eaux uses - Page 150
Le tableau appelle quelques remarques :
Pour les procds forte charge, le rendement d'limination de la DBO
5
chute
moins de 85 %, ce qui, sur une eau rsiduaire urbaine classique n'est plus suffisant
pour produire un effluent 25 mg/l de DBO
5
. Il est alors ncessaire de faire prcder
l'tage boues actives d'une dcantation primaire. Par contre, pour les procds
plus faible charge, du point de vue uniquement rendement puratoire, la dcantation
primaire n'est pas obligatoire.
Dans une rgion tempre, seuls les procds d'aration prolonge ou de faible
charge trs soigneusement dimensionns permettent la nitrification (oxydation des
formes rduites de l'azote en nitrites et nitrates).
Ces diffrentes concentrations en boues admissibles dans les bassins d'aration
s'expliquent par leurs aptitudes diffrentes la dcantation. Ces procds forte
charge donnent d'une faon gnrale des boues plus gonfles (indice de Mohlman
lev) que les procds charge plus faible. Ceci oblige donc, de faon conserver
un volume de boues raisonnable dans les clarificateurs, travailler avec des
concentrations en boues plus faibles.
Les consommations spcifiques oxygne sont plus leves dans les procds
type aration prolonge que dans les procds type forte charge.
L'examen de ce tableau montre que le choix entre tel ou tel type de traitement doit faire
entrer en ligne de compte :
les cots d'investissement;
les cots d'exploitation;
les rendements d'puration souhaits;
les contraintes d'exploitation;
le devenir des boues en excs.
Il n'y a donc pas un type de traitement idal mais des traitements spcifiques
correspondants des besoins diffrents.
IV.1.4.3.Diffrents systmes
Les procds par boues actives peuvent tre diffrencis par la charge massique. Ils
peuvent tre diffrencis galement par la faon dont les diffrents flux sont rpartis sur le
bassin d'aration. On pourra distinguer ainsi :
Les systmes flux piston.
Le systme traditionnel comprend des bassins d'aration allongs dans lesquels arrivent
simultanment l'eau traiter Q et les boues actives R l'amont des bassins.
1.Il prsente l'avantage de fournir une excellente qualit d'eau et de favoriser la
nitrification et ventuellement si des zones d'anoxies sont amnages entre les zones
d'aration, la dnitrification. Par contre, l'inconvnient sera l'existence d'un gradient de
besoins en oxygne le long du bassin, ce qui impliquera une fourniture modulable en
oxygne le long du bassin; qui doit tre asservie aux signaux fournis par des oxymtres. Les
matriels actuellement disponibles sur le marche permettent cependant de rpondre
parfaitement cet impratif mais leur cot rserve le flux piston a des stations de taille
suffisamment importante (cf. ARMINJON, ref 12).
Page 151 - Chapitre 7
Les systmes mlange intgral.
Le mlange intgral (ou encore racteur infiniment mlang) permet d'obtenir les mmes
conditions en tout point du bassin d'aration. Ces systmes rsistent mieux que le flux piston
aux effets de variations brutales de charge polluante (ce qui est souvent le cas sur les petites
stations). A noter que les chenaux qu'ils soient annulaires ou oblongs sont classer dans les
systmes mlange intgral.
Les systmes intermdiaires entre le flux piston et le mlange intgral.
En fait, ds que les stations comprennent plusieurs bassins en srie, en parallle ou
agencs de faon plus complexe, l'hydraulique globale sera intermdiaire entre le flux piston
et le mlange intgral. Cependant la multiplicit des bassins correspond souvent
l'limination de polluants diffrents (ammoniaque, nitrate, phosphate, ...) et l'avancement des
ractions sera fonction de l'hydraulique spcifique du bassin.
IV.2. PROCEDES BIOLOGIQUES SUR MILIEU GRANULAIRE FIN
IV.2.1. Principe
Les biofiltres cumulent les fonctions de filtration et d'puration biologique. Ils doivent donc
rpondre une activit biologique maximale (grande surface de fixation) et un fort pouvoir
de rtention des matires en suspension. Cela implique donc des supports granulaires fins.
Le phnomne de filtration associ la production de biomasse en excs due la
dpollution implique un encrassement progressif du biofiltre et la ncessit de recourir des
squences de lavage pour rcuprer l'intgrit du procd. Cependant, la frquence des
lavages ne devant pas perturber l'activit biologique, la qualit de l'eau admise
(prtraitement), le mode de fonctionnement du racteur (e.g. la vitesse de passage de l'eau)
et le choix du matriau support devront respecter un compromis.
De plus, le principe de la dpollution par voie arobie implique le transfert de quantits
importantes d'oxygne trs suprieures sa concentration de saturation dans l'eau. Cette
demande pourra tre satisfaite par deux principes :
oxygnation indirecte dans une boucle de recyclage;
oxygnation directe dans la masse filtrante.
Les alimentations en fluides peuvent combiner tous les cas possibles :
eau ascendant / air ascendant;
eau descendant / air ascendant;
eau descendant / air descendant (ruissellement avec ventilation force).
Quelque soit le mode d'introduction de l'eau traiter, le dispositif de distribution de l'eau et
le fait que le biofiltre fonctionne en encrassement obligent un prtraitement pouss en
amont. Ce prtraitement consiste en une phase de dcantation amliore (biosorption ou
coagulation floculation chimique) qui limine la fraction particulaire de la pollution. Cette
fraction, si elle tait admise sur le biofiltre, impliquerait un colmatage rapide des couches
proches de la distribution, donc des squences de lavage trs frquentes et une forte
altration des performances biologiques.
Prsentation des divers lments des filires dpuration des eaux uses - Page 152
IV.2.2. Lavages
Le fonctionnement des biofiltres entrane terme un colmatage invitable qui provoque un
accroissement de la perte de charge dans le racteur. Les squences de lavage sont
donc les lments dterminants de la bonne marche de ces biofiltres. Un mauvais
lavage entrane non seulement une diminution de l'efficacit globale du biofiltre (puration
biologique et filtration), mais aussi la persistance de zones de faibles changes avec des
risques progressifs d'anarobiose qui peuvent gnrer des dysfonctionnements plus graves.
Le dmarrage de la phase de lavage est dclench soit sur une base de temps fixe par
des essais prliminaires, soit par une valeur seuil de la perte de charge au sein du filtre. Ce
dernier paramtre permet d'valuer aussi l'efficacit du lavage par le retour ou non la
valeur d'origine. Le lavage se dcompose en plusieurs phases :
dtassage du lit par de l'air;
lavage proprement dit par une association air et eau;
rinage l'eau jusqu' l'obtention d'une concentration en MES correcte.
Les dbits et les vitesses des diffrents fluides de lavage sont fonction du matriau
support (granulomtrie et densit) et du degr d'encrassement du filtre, mais ils doivent
aussi permettre le maintien d'une biomasse active fixe sur le support pour que le
redmarrage du biofiltre en puration biologique soit immdiat aprs la phase de lavage. Ce
dernier critre est particulirement important lors de ractions mettant en oeuvre des
populations vitesse de croissance faible telles que les bactries nitrifiantes. Lorsque les
conditions de lavage sont respectes, la qualit de l'eau traite n'est que peu affecte et
retrouve son intgrit moins d'une demi-heure aprs la fin du cycle.
Le volume des eaux de lavage correspond peu prs 3 fois le volume du biofiltre. Les
eaux utilises sont des eaux traites stockes dans une bche en aval des filtres.
L'ensemble des boues en excs collectes pendant ces phases de lavage est dirig vers
le premier tage de traitement (dcantation statique ou physico-chimique), o elles sont
piges avant d'tre vacues vers la filire de traitement des boues.
IV.2.3. Matriau
Le matriau de remplissage du biofiltre doit rpondre une double exigence : fixation
maximale de la biomasse puratoire et action filtrante vis--vis des matires en suspension.
Ces deux critres dirigent le choix vers des particules de faible diamtre. Toutefois, le
phnomne de colmatage et une frquence raisonnable de lavage (24 48 heures) implique
un compromis vers des granulomtries de 2 6 mm. Cela permet tout de mme d'assurer
des surfaces de fixation de l'ordre de 200 500 m
2
/m
3
.
Page 153 - Chapitre 7
La nature des matriaux supports les plus utiliss est minrale (argiles cuites, schistes),
un exemple est donn dans le tableau 16-3. Des matriaux synthtiques de densit
infrieure l'eau sont en cours d'application.
Composition chimique Silicate d'alumine
Taille effective 3.6 mm
Coefficient d'uniformit 1,3
Densit apparente 0,8
Densit relle 1,5
Porosit intergranulaire 45%
Friabilit <1
Tableau 16-3 : Exemple d'un matriau support : BIOLITE (DEGREMONT).
Le choix dfinitif du matriau support dpendra des objectifs de qualit en sortie et de la
composition de l'eau en entre.
Les stations d'puration construites selon la technologie de la biofiltration vont donc se
composer du prtraitement, d'un traitement de rtention des matires dcantables et des
collodes (ajout de ractif de coagulation-floculation en dcantation ou mise en oeuvre des
phnomnes de biosorption dans des racteurs trs forte charge), d'un tamisage et du
biofiltre proprement dit. Les vitesses de passage au sein du biofiltre de l'eau prtraite seront
au maximum de 10 m/h.
V. LES TRAITEMENTS BIOLOGIQUES POUR L'ELIMINATION DE L'AZOTE
V.1. GENERALITES
L'impact de l'azote sur le milieu rcepteur explique le souci de l'limination de l'azote qui
se retrouve dans les textes rglementant les rejets d'effluents dans le milieu.
L'azote prsent dans les rejets domestiques est essentiellement d'origine urinaire. Il est
apport pour prs des 3/4 par l'ure qui s'hydrolyse rapidement pour donner NH
4
en
prsence d'une enzyme qui est l'urase. Les bactries qui possdent cette enzyme sont en
abondance dans les gouts. Par contre, les formes oxydes de l'azote (NO
2
, NO
3
) seront
toujours en faible concentration, infrieure en gnral 1 mg/l, en entre de station. En plus
de NH
4
, les eaux rsiduaires contiennent dans des proportions variables de l'azote
organique. On rappellera que l'azote total Kjeldahl ou NTK est la somme de l'azote
organique et ammoniacal exprime en N. (Les nitrites (NO
2
) et les nitrates (NO
3
) ne sont pas
pris en compte par ce dosage).
Prsentation des divers lments des filires dpuration des eaux uses - Page 154
AZOTE LIBRE
N atmosphrique
DECHETS AZOTES
ACIDES AMINES
PROTEINES
UREE etc ...
N organique
AZOTE
AMMONIACAL
N-NH4
+
NITRITES
N-NO2
-
NITRATES
N-NO3
-
DENITRIFICATION
BACTERIES
DENITRIFIANTES
NITRATATION
BACTERIES
NITRIQUES
NITRITATION
BACTERIES NITREUSES
AMMONIFICATION
ASSIMILATION
BOUES
NITRIFICATION
Figure 16-1 : Diffrentes tapes de la transformation de l'azote dans une station d'puration.
L'limination de l'azote fait intervenir quatre processus (figure 16-1) :
ammonification : transformation de l'azote organique en azote ammoniacal par des
bactries banales;
assimilation : utilisation d'une partie de l'azote ammoniacal et ventuellement
organique pour la synthse bactrienne;
nitrification : oxydation de l'azote ammoniacal en nitrites et en nitrates. Cette raction
fait intervenir des bactries trs particulires : Nitrosomonas pour l'oxydation de NH
4
en NO
2
, Nitrobacter pour l'oxydation de NO
2
en NO
3
;
dnitrification : rduction des nitrates en azote gazeux qui retournera aprs un stade
intermdiaire NO
2
sous sa forme primitive dans l'atmosphre. Cette raction fait
intervenir des bactries banales, abondantes dans le milieu naturel.
On insistera sur quelques ides importantes :
L'tape limitante dans tout procd d'limination de l'azote est la nitrification.
Cela vient du fait que Nitrosomonas et Nitrobacter sont des micro-organismes ayant
un temps de doublement lev (de l'ordre de 24 h dans les conditions optimales). Par
consquent, si on veut les cultiver dans une station d'puration, on sera amen
travailler avec des ges de boues levs, on devra donc utiliser des procds
faible charge. De plus, le temps du doublement de ces micro-organismes tant trs
dpendant de la temprature, il sera ncessaire de bien prciser la temprature
minimale laquelle on souhaite pouvoir maintenir la nitrification.
La raction de nitrification est une raction arobie et consommatrice
d'oxygne. Il faut fournir aux bactries nitrifiantes de 4,1 a 4,2 g d'oxygne par g de
N-NO
3
form. Il sera donc ncessaire d'en tenir compte lors du dimensionnement
d'une station conue pour la nitrification.
Page 155 - Chapitre 7
La dnitrification fait intervenir des bactries htrotrophes arobies capables
d'utiliser l'oxygne li au nitrate. Ceci a deux consquences :
il faudra fournir ces micro-organismes une source de carbone organique. On
utilisera pour cela dans la majorit des cas le carbone organique de l'eau brute;
pour que la raction de dnitrification puisse se produire dans de bonnes
conditions, il sera ncessaire d'tre dans des conditions d'anoxie, c'est--dire en
absence d'oxygne.
V.2. MISE EN OEUVRE DE LA NITRIFICATION-DENITRIFICATION A L'ECHELLE
INDUSTRIELLE
V.2.1. Nitrification seule
La nitrification seule ne rpond plus l'heure actuelle la qualit des rejets dfinis par la
directive Europenne, elle peut cependant tre demande dans des cas trs particulier
(ex : limination de l'ammoniaque pour la station d'Achres).
Il faut rappeler que tous les procds dits faibles charges, trs utiliss dans le cas des
petites installations sont susceptibles d'effectuer une nitrification, mme si cet objectif n'est
pas recherch en tant que tel. En outre, cette nitrification involontaire s'accompagne trs
frquemment d'une certaine dnitrification au moins dans le dcanteur secondaire, ce qui
peut apporter une nuisance du fait du dgagement d'azote gazeux entranant des remontes
de boues. Des dispositifs de rgulation du squenage de l'aration permettent de grer ces
ractions si la capacit d'oxygnation est suffisante pour amener l'oxygne en moins de 14
heures par jour.
Les lits bactriens ruissellement assurent une nitrification pour des charges assez
leves (entre 0,2 et 0,6 kg DBO
5
/m
3
/j), mais doit se situer au dessous de 0,2 kg DBO
5
/m
3
/j
pour obtenir un rendement de nitrification de 80 %. Cet abbattement est obtenu en
nitrification tertiaire pour une charge infrieure 1,5 g N-NH
4
/j.m
2
de surface.
Les disques biologiques sont susceptibles aussi de nitrifier dans des conditions de
charge en DBO
5
faible (plusieurs tapes), le problme majeur est souvent un dficit en
oxygne.
Les techniques utilisant des micro-organismes fixs sur milieux granulaires fins
permettent de nitrifier des charges trs leves (> 1 kg N-NH
4
/m
3
.j). Si la concentration en
DBO
5
est faible (< 30 mg/l), les ractions d'limination de la pollution carbone et la
nitrification peuvent se faire dans un mme racteur. Cependant, pour assurer la meilleure
fiabilit dans le traitement, il convient de sparer les deux tapes. Ces racteurs peuvent
aussi tre utiliss aprs un traitement par boues actives, ce qui permet, outre de nitrifier,
d'amliorer la qualit de l'eau traite par la rtention des matires en suspension rsiduelles.
Prsentation des divers lments des filires dpuration des eaux uses - Page 156
V.2.2. Systmes ralisant simultanment une nitrification-dnitrification
V.2.2.1. Systmes boues actives bassin unique
Les ractions de nitrification et de dnitrification sont ralises par squenage de
l'aration de faon alternativement crer des conditions fortement ares pour nitrifier et
des conditions anoxiques pour dnitrifier. Ces conditions peuvent tre amnages dans les
systmes classiques quips d'arateurs de surface (turbines ou brosses) si la fourniture
totale d'oxygne (carbone, azote et endogne) peut se faire en moins de 14 heures par jour.
La mise en place d'un agitateur dans le bassin pour homogniser la liqueur mixte pendant
les priodes d'arrt de l'aration permet d'amliorer sensiblement la dnitrification. Les
nouvelles installations quipes de dispositifs dissocis pour le brassage et l'aration (hlice
vitesse lente et membrane caoutchouc micro-perfore) sont particulirement bien adaptes
pour raliser ce processus.
Il est cependant impratif que l'arrt des arateurs n'entrane pas dans le bassin
l'apparition de conditions anarobies nfastes l'activit et la dcantabilit des boues. Il y
aura lieu de limiter les phases d'anoxie 2 heures ou de mettre en place une rgulation par
le potentiel doxydorduction.
De telles installations, dimensionnes en faible charge (0,07 kg DBO
5
/kgMVS.j) permettent
de dlivrer une eau traite conforme pour le carbone et l'azote au rejet en milieu sensible.
V.2.2.2. Systmes boues actives avec zone d'anoxie en tte.
L'exprience acquise depuis plusieurs annes sur des stations d'puration montre que le
systme avec zone d'anoxie en tte prsente les avantages suivants :
apport de l'intgralit du carbone de l'eau brute dans la zone anoxie, ce qui permet
de maintenir les cintiques maximales de dnitrification;
contrle de l'apport des nitrates par le recyclage de liqueur mixte du bassin
d'aration;
certitude d'avoir un taux d'oxygne dissous le plus bas possible (sauf en priode
pluvieuse).
Cependant, ces avantages ne sont pas toujours vidents maintenir car ils ncessitent un
asservissement complexe mettre en oeuvre pour viter une disjonction des flux de carbone
et de nitrates l'entre de la zone d'anoxie pendant les priodes de transition nocturne-
diurne et diurne-pointe. En fait pour la plupart des installations, une partie non ngligeable
de la dnitrification se fait dans le bassin suivant lors des arrts de l'aration.
Pour les grandes installations quipes d'une dcantation primaire , la zone d'anoxie
permet de maximiser l'utilisation du carbone non pig dans cette premire tape pour la
dnitrification uniquement de la liqueur recircule du clarificateur (dnitrification partielle).
Page 157 - Chapitre 7
V.2.2.3. Nitrification-dnitrification par cultures fixes
Le principe mme de la biofiltration ne permet pas de profiter du carbone de l'eau brute
pour la dnitrification, la fois cause de contraintes hydrauliques et cause de la
comptition entre nitrification et dpollution carbone.
Par contre, lorsque une source de carbone extrieure est amene (mthanol), les charges
dnitrifies sur un biofiltre sont trs importantes (3 kg N-NO
3
/m
3
.j).
Des schmas incluant trois tages de biofiltres aprs la dcantation physico-chimique
(limination du carbone + nitrification + dnitrification) assurent l'obtention d'un effluent trait
de trs bonne qualit. Il est bien vident que l'application d'un tel systme est limit des
cas particuliers de contrainte d'espace.
Pour garder la conformit de l'effluent, il est ncessaire d'asservir l'apport de substrat
carbon la teneur en nitrates liminer.
VI. LES TRAITEMENTS DE DEPHOSPHATATION
VI.1. GENERALITES
Le phosphore peut se prsenter sous diffrentes formes :
phosphore organique insoluble contenu dans le matriel cellulaire vgtal ou
animal;
orthophosphates organiques dissocis (sucres phosphats, phospholipides, ...);
phosphates inorganiques condenss (pyrophosphates, tripolyphosphates,
trimtaphosphates, ...).
La principale consquence lie au rejet de phosphore dans le milieu naturel est
l'eutrophisation. C'est surtout pour cette raison que dans certains cas, une limination du
phosphore doit tre envisage.
Deux grandes catgories de techniques peuvent tre utilises pour la dphosphatation,
soit des techniques physico-chimiques, soit des techniques biologiques, soit un couplage
de ces deux techniques.
VI.2. DEPHOSPHATATION PHYSICO-CHIMIQUE
L'limination du phosphore fait appel, dans la trs grande majorit des procds
actuellement utiliss, la prcipitation chimique. On considre gnralement que le
phosphore est essentiellement sous la forme (PO
4
)
3-
. En ralit, la forme prdominante au
pH normal de l'eau d'gout est H(PO
4
)
2-
. Le pH est donc un paramtre fondamental, qui
gouverne les phnomnes d'insolubilisation du phosphore et donc son limination par
prcipitation chimique.
Les anions phosphates et les polyphosphates suprieurs forment naturellement des
complexes chelats et des sels insolubles avec un certain nombre de composes mtalliques.
Les procds limination du phosphore par prcipitation utilisent les espces ioniques Fe
2+
,
Fe
3+
, Al
3+
et Ca
2+
, dans le but de former des prcipits insolubles de phosphates mtalliques.
Dans la pratique, il est souvent plus exact de parler de prcipits hydroxy-metalliques de
phosphates.
Prsentation des divers lments des filires dpuration des eaux uses - Page 158
De nombreuses tudes ont montr que trois mcanismes diffrents peuvent intervenir
selon la forme chimique dans laquelle se trouve le phosphore et selon le pH de milieu :
prcipitation de phosphates mtalliques partir des orthophosphates;
adsorption des phosphates organiques;
coagulation des collodes de l'eau use pouvant piger du phosphore particulaire.
Trois techniques sont utilises pour limination du phosphore :
prcipitation primaire ou prprcipitation;
post prcipitation ou prcipitation tertiaire;
prcipitation simultane, c'est dire directement dans la boue active.
VI.2.1. Prcipitation primaire
La prcipitation primaire est un procd qui s'apparente au traitement physico-chimique
simple constituant une premire tape d'un traitement biologique secondaire. Elle utilise des
floculants classiques : chaux, sels d'aluminium ou de fer. Selon les doses de ractifs utiliss,
les rendements de dphosphatation oscillent entre 70 et 90 %.
Parmi les avantages de la prcipitation primaire on peut citer :
la facilite de mise en oeuvre, sans transformations importantes des installations
existantes;
le soulagement de ltape biologique si celle-ci est surcharge;
lassurance de rendements d'limination de phosphore acceptables.
Parmi les inconvnients, on retiendra :
les risques d'une limination trop pousse du phosphore risquant de perturber l'tage
biologique;
une consommation de ractifs relativement importante par suite d'une comptition
entre le phosphore et les collodes de l'eau brute;
une augmentation importante de la production de boues primaires (surtout avec la
chaux) pouvant atteindre 50 %.
VI.2.2. Dphosphatation tertiaire
La prcipitation tertiaire est ralise partir de l'effluent sortant du traitement biologique.
Comme pour la prcipitation primaire, on peut utiliser soit la chaux, soit les sels mtalliques.
Mais la prcipitation la chaux n'est pas conseille, car elle conduit un effluent dont le pH
dpasse 10 et ncessite une recarbonatation coteuse.
L'aluminium est utilis surtout aux Etats-Unis, le fer ayant la rputation de laisser un
rsiduel trop important dans l'effluent trait. En Europe, et en particulier en France, en
Allemagne et en Suisse, le chlorure ferrique est jug suprieur au sulfate d'alumine.
Page 159 - Chapitre 7
Les techniques utilises en post-prcipitation peuvent faire appel, soit des dcanteurs
classiques, soit des dcanteurs lamellaires, soit la flottation. Cette dcantation peut tre
complte par une filtration rapide qui limine les lments fins chappant la dcantation.
Les rendements de dphosphatation peuvent dpasser facilement 90 %.
Les avantages de la post-prcipitation sont les suivants :
consommation de ractifs en principe plus faible qu'en dphosphatation primaire, ce
qui n'apparat pas toujours vrifi;
amlioration trs sensible de la qualit globale de l'effluent, la floculation liminant
galement des matires organiques carbones.
Les inconvnients sont les suivants :
augmentation trs sensible du cot de l'installation, surtout lorsqu'une filtration est
mise en oeuvre;
contraintes d'exploitation accrues.
VI.2.3. Prcipitation simultane
La prcipitation simultane est une technique trs simple qui consiste introduire
directement les ractifs minraux au niveau du bassin d'aration.
Des rendements de 80 85 % de dphosphatation sont possibles. Le principal avantage
du procd rside dans le fait que sa mise en oeuvre partir d'une station existante ne
ncessite aucune modification profonde. De trs nombreuses ralisations existent en Suisse,
a cause de la lgislation sur le phosphore.
En conclusion, on retiendra des procds de dphosphatation physico-chimique que s'ils
sont dans l'ensemble bien matriss, ils prsentent un certain nombre inconvnients limitant
leur application :
la production de volumes importants de boues souvent difficiles traiter;
une consommation de ractifs chimiques relativement leve entranant des
surcots d'exploitation non ngligeables.
Ceci explique l'intrt croissant suscit depuis peu de temps par les techniques
biologiques.
VI.3. DEPHOSPHATATION BIOLOGIQUE
Le phosphore est un lment constitutif de la biomasse et reprsente en masse, suivant
les stations, de 1 2,5% des matires sches. La dphosphatation biologique entrane un
accroissement consquent de ce pourcentage jusqu' des valeurs de 5 6% et mme plus
lorsque les chiffres proviennent d'essais raliss l'chelle laboratoire.
Le phnomne de suraccumulation de phosphore dans les boues actives sans ajout de
ractifs a t observ dans les stations o existaient des alternances de phases anarobies
et arobies.
Prsentation des divers lments des filires dpuration des eaux uses - Page 160
Les analyses conduites sur les stations quipes de cette alternance de phases ont
montr quen zone anarobie le phosphate est relargu dans le liquide interstitiel, tandis que
en zone are ce phosphore est rabsorb par la boue. Le relargage en zone anarobie est
d'autant plus important que la pollution carbone facilement assimilable est grande dans
l'effluent d'entre.
Des analyses du contenu des flocs bactriens ont montr la prsence de polymres
organiques type polyhydroxybutyrate dont la synthse se fait en zone anarobie. Ces
polymres sont ensuite dgrads sous des conditions ares (ou anoxie) avec comme
consquence un stockage dans les cellules d'un excdent de phosphore.
Les diffrentes tapes de la dphosphatation biologique sont :
Dans la zone anarobie :
synthse partir de la pollution carbone facilement assimilable de polymres
stocks dans les cellules;
relargage de phosphore li la consommation de l'nergie stocke sous forme
de polyphosphates pour la raction prcdente.
Dans la zone anoxie ou are
oxydation des polymres organiques avec production d'nergie stocke par la
synthse des polyphosphates.
La dphosphatation biologique est donc lie l'mergence de populations bactriennes
possdant un mtabolisme capable d'utiliser les conditions particulires d'une alternance de
conditions anarobie et arobie pour stocker de l'nergie. Cette facult leur permet d'tre
plus comptitives que les bactries classiques dans les schmas zone anarobie contrle
en tte, alors que sous des conditions d'aration ou d'anoxie, elles restent trs minoritaires
dans les boues actives.
Les populations dphosphatantes appartiennent aux genres Acinetobacter pour la
plupart et Moraxella. Leurs caractristiques physiologiques restent celles, classiques, des
germes htrotrophes (large gamme de temprature, pH voisin de la neutralit). Leur
dominance dans la boue active ne peut donc tre obtenue que par le biais de la zone
anarobie.
La description des mcanismes impliqus dans la dphosphatation biologique permet
d'extraire les lments qui vont avoir une action prpondrante sur l'efficacit du processus.
Le carbone assimilable est le point cl du processus puisque c'est le dclencheur de
tous les mcanismes de synthse des polymres organiques. La concentration en carbone
assimilable dans l'eau brute va donc directement dfinir la quantit maximale potentiellement
liminable de phosphates par voie biologique.
Il sera donc impratif de limiter toutes les ractions parasites susceptibles de consommer
cette pollution assimilable. Outre le fait d'viter une aration trop intense de l'affluent avant
son admission dans le bassin biologique anarobie, un des problmes majeurs rsoudre
est l'absence de nitrates dans les retours de boues du clarificateur.
Page 161 - Chapitre 7
Il est cependant important de noter que les ractions qui ont lieu en anarobie n'liminent
pas la pollution organique facilement assimilable (en dehors d'une faible fraction rejete sous
forme de CO
2
) mais la transforment en polymres intracellulaire qui vont tre disponibles
pour les ractions de dnitrification en aval. Le mcanisme de suraccumulation du
phosphore peut en effet se faire sous des conditions anoxies, les bactries dphosphatantes
sont donc aussi dnitrifiantes.
Le nitrate doit donc tre maintenu des teneurs les plus basses possibles dans l'eau
traite de la station d'puration de faon ce que la concentration rsiduelle dans les boues
recircules vers la zone anarobie n'inhibe pas les ractions de relargage du phosphate.
La prsence d'un rsiduel d'oxygne dans l'affluent ou la prsence de nitrates en
recirculation ont une consquence supplmentaire la consommation de carbone facilement
assimilable : c'est la remonte du potentiel doxydorduction dans la zone dcrite comme
anarobie. Cette remonte est videmment d'autant plus marque que la teneur en pollution
carbone facilement assimilable est faible. Or, le maintien des conditions anarobies est
obligatoire pour que les ractions de gense de l'actate et de stockage du
polyhydroxybutyrate aient lieu. L'anarobiose pour la dphosphatation biologique se dfinit
dans l'intervalle entre la dnitrification et la sulfato rduction.
Les ractions de rabsorption du phosphore sont lies un mtabolisme arobie
impliquant un transfert d'oxygne vers les bactries. Cela suppose donc un potentiel
doxydorduction gal au moins aux conditions de dnitrification (> +150 mV/EHN).
Les ractions biologiques respectent une cintique (vitesse de raction) dpendante de
l'activit des micro-organismes et de la biodgradabilit des substrats. L'activit biologique
est la rsultante de la composition moyenne de l'affluent et des conditions de fonctionnement
de l'installation. Cela implique qu'une variation de biodgradabilit de la pollution carbone
entre n'aura pas un impact facilement prvisible sur la cintique globale car celui-ci sera li
aux tats de fonctionnement antrieurs.
La dtermination des temps de sjour respecter dans chaque bassin est donc
prpondrante pour assurer un optimum biologique mais trs difficile prvoir.
VII. LES TRAITEMENTS DE FINITION
Les traitements de finition encore appels traitements tertiaires se mettent en oeuvre
aprs le ou les traitements biologiques, c'est dire en gnral aprs le clarificateur. Leur rle
est de rduire des teneurs trs basses certains polluants peu ou pas limins par les
traitements secondaires. Les techniques utilises font appel aux ractions biologiques ou
physico-chimiques.
Parmi ces techniques, il convient de ranger classiquement :
le lagunage;
la prcipitation physico-chimique;
la filtration;
la dsinfection.
Prsentation des divers lments des filires dpuration des eaux uses - Page 162
VII.1. LAGUNAGE DE FINITION
La lagune de finition joue la fois un rle dans l'amlioration de la qualit d'un effluent
clarifi et un rle rgulateur.
L'effluent clarifi traverse une tendue d'eau dans laquelle l'apport en oxygne peut tre
naturel (action photosynthtique des algues de surface) ou acclr au moyen d'arateur de
surface.
Comme les teneurs en matires en suspension et DBO
5
a l'entre sont relativement
faibles, les dpts sont limits et les dragages peu frquents. Une lagune are de 48 h de
temps de sjour permet 15C de ramener de 40 20 mg/l la DBO
5
.
L'action photosynthtique des algues qui se dveloppent dans les lagunes permet
galement une rduction notable mais alatoire de l'azote et du phosphore, qui sont utiliss
pour la synthse des nouvelles algues. Un tel but est recherche dans les "maturations
ponds" sud africains dans lesquels l'eau sjourne une dizaine de jours sans apport artificiel
oxygne. Cependant le contrle de ce procd est difficile et il faut assurer une limination
priodique d'algues, ce qui pose de gros problmes d'exploitation. Enfin les volumes et par
consquent les surfaces mises en jeu sont si importants que ce procd est difficilement
applicable des pays forte densit de population.
VII.2. PRECIPITATION PHYSICO-CHIMIQUE
Elle permet une limination de substances coagulables chimiquement par dcantation ou
filtration. C'est une technique particulirement bien adapte l'limination du phosphore
(voir VI.2.2.).
VII.3. FILTRATION
Son rle essentiel est de rduire la teneur des matires en suspension aprs clarification.
La filtration pourra tre utilise avantageusement avant une dsinfection pour viter les
interfrences.
Le matriau filtrant utilis est le sable. Selon le rsultat dsir, la granulomtrie variera
entre 1 et 2 mm. Les hauteurs de remplissage sont de l'ordre de 1,5 m.
Dans la trs grande majorit des cas, il s'agit de filtre flux descendant pour des raisons
de simplicit de mise en oeuvre, avec lavage contre courant d'air et d'eau. Les eaux de
lavages sont renvoyes en tte de station.
Les efficacits observes dpendent :
des caractristiques de l'effluent traiter;
de la taille effective de sable utilis;
de la vitesse de filtration.
La mise en oeuvre s'effectue soit dans des filtres ferms, soit dans des filtres ouverts type
AQUAZUR. Avec des vitesses de filtration de 10 m/h, et un sable de 1,35 mm de taille
effective, le rendement sur les matires en suspension est de l'ordre de 60 %.
Page 163 - Chapitre 7
Une activit biologique peut se superposer la fonction physique de rtention des
matires en suspension soit naturellement, soit force par aration dans la masse filtrante.
Cela permet, par exemple, d'assurer une oxydation tertiaire de l'ammoniaque.
VII.4. DESINFECTION
Les populations de micro-organismes dans les eaux rsiduaires sont variables en quantit
et en qualit. De plus, ces micro-organismes sont le plus souvent agrgs entre eux ou
adsorbs sur des matires en suspension, ce qui rend souvent leur numration difficile.
Les ordres de grandeur les plus souvent rencontrs sont donns dans le tableau 16-4.
Compte tenu des objectifs de qualit des milieux rcepteurs (nombre guide de
100/100ml pour les coliformes et les streptocoques fcaux) et un maximum de une
deux units Log d'abattement pour les traitements conventionnels, il est impratif de
mettre en place une dsinfection pour tre conforme.
Coliformes totaux 10
7
10
9
/ 100 ml
Streptocoques fcaux 10
6
10
7
/ 100 ml
Coliformes fcaux 10
6
10
8
/ 100 ml
Escherichia coli 10
6
10
8
/ 100 ml
Salmonella 2 10
4
/ 100 ml
Entrovirus 4 460 / 100 ml
Tableau 16-4 : Concentrations en micro-organismes dans les eaux rsiduaires urbaines.
VII.4.1. Prcipitation physico-chimique
Si les traitements physico-chimiques classiques ne permettent pas d'liminer de faon
consquente les pollutions bactrienne, virale et parasitaire (30 60%), la prcipitation par
la chaux des pH levs assure, quant elle, des abattements importants des germes tests
compatibles avec les objectifs de qualit sanitaire (4 units Log). Cependant, compte tenu du
pH optimal (pH=11) maintenir, cette technique est assez peu dveloppe.
VII.4.2. Lagunage
Le lagunage naturel, grce un temps de sjour lev (50, 60 jours), permet d'exposer les
micro-organismes pathognes, normalement adapts au milieu intestinal de l'homme ou des
animaux, aux effets prolongs d'un environnement prjudiciable leur survie. L'limination
des germes pathognes dans les lagunes arobies ou arobies facultatives est
particulirement importante en priode de fort ensoleillement grce aux effets directs et
indirects du rayonnement solaire sur la destruction des germes (3 4 units Log). Son
efficacit peut tre sensiblement rduite en priode hivernale, lorsque la temprature devient
faible. De mme, une altration importante de l'efficacit de dsinfection du lagunage peut
tre not lors de remise en suspension des sdiments par de fortes prcipitations.
Prsentation des divers lments des filires dpuration des eaux uses - Page 164
L'efficacit du lagunage naturel est troitement lie l'ensoleillement, la temprature et
la gestion.
VII.4.3. Infiltration / percolation
Cette technique consiste en l'infiltration vitesse lente (1 m/j) d'un effluent au moins
prtrait travers une couche permable du sol (couche sableuse) naturelle ou rapporte.
L'limination des bactries se fait par pigeage/fixation sur les particules sableuses et
prdation ultrieure.
La mise en oeuvre repose sur l'utilisation de deux bassins, remplis alternativement pour
minimiser les phnomnes de colmatage dans la masse. L'efficacit du pigeage des micro-
organismes est bonne, mais ncessite un dimensionnement correct notamment pour le
calcul de l'paisseur et de la granulomtrie de la couche de sable.
VII.4.4. Chloration (chlore gazeux, eau de Javel, ClO
2
)
La chloration est la technique la plus utilise actuellement, cependant la formation de sous
produits toxiques (chloramine, THM, ...) tend rduire son utilisation ou obliger un
traitement de dchloration avant rejet dans le milieu.
Elle consiste en une phase de mlange rapide du ractif et de l'eau traiter suivi d'une
priode de contact en bassin d'hydraulique de type flux piston pour assurer l'identit des
temps de contact entre le dsinfectant et les veines liquides.
L'efficacit de la chloration est troitement lie la dose mise en oeuvre et au temps de
contact (4 10 mg/l pour 30 minutes de temps de contact). Elle doit tre applique sur un
effluent dbarrass au maximum des composs chimiques fortement consommateurs de
chlore, une nitrification pralable et de faon gnrale de faibles teneurs en matires en
suspension sont donc fortement conseilles.
VII.4.5. Oxydation (ozone, H
2
O
2
et acide practique)
Tous ces oxydants procdent par la libration d'oxygne actif qui ragit rapidement avec
la matire organique. Ils possdent un pouvoir germicide important et la formation de sous-
produits nuisibles prsentant les inconvnients de ceux drivs du chlore n'a pas t note
dans l'tat actuel des connaissances.
La mise en oeuvre est identique au chlore pour les oxydants liquides et est ralise pour
l'ozone dans des ouvrages compartiments o le ractif est inject contre courant du
liquide traiter. La gamme de dosage pour l'ozone est de 4 8 mg/l pour des temps de
contact de 10 15 minutes.
L'efficacit reste bien videmment lie la qualit de l'puration amont. Les matires
organiques oxydables, le nitrite, les matires en suspension sont autant d'lments
perturbateurs, qui peuvent diminuer considrablement le pouvoir germicide de ces
composs.
Page 165 - Chapitre 7
VII.4.6. Traitement par radiations (UV, irradiation)
Le pouvoir germicide des ultraviolets est bien connu. La dsinfection est ralise par la
mise en contact de l'eau avec le rayonnement issu de lampes mercure basse pression (7
8 000 heures de dure de vie).
Outre la puissance des lampes, l'efficacit du traitement est trs lie la qualit de l'eau et
notamment sa concentration en matires en suspension qui altrent la pntration des
rayonnements. Des ouvrages "amont" de filtration sont souvent ncessaires pour appliquer
cette technologie.
L'irradiation par faisceaux d'lectrons est mentionne pour mmoire car elle n'est pas
conomiquement possible l'heure actuelle.
VII.4.7. Filtration par membrane
Les membranes de micro et d'ultra filtration n'ont aucun pouvoir destructeur mais assurent
la rtention des micro-organismes sur le filtre en crant une barrire physique.
Leur efficacit, lie au pouvoir de coupure de la membrane, est reconnue et peut atteindre
100% de rtention en ultrafiltration sur des eaux superficielles destines la consommation
(cf. MANDRA, ref 5). L'influence de la concentration en collodes et en matires organiques
sur la frquence des rtrolavages ncessite un effluent de bonne qualit.
Si, en l'tat actuel de cette technique le cot limite son utilisation des cas trs
particuliers, l'volution future des membranes permet d'envisager leur application un
domaine plus vaste dans un futur proche.
Chapitre 8
PRETRAITEMENT
F. VIRLOGET
Prtraitement - Page 167
SOMMAIRE
I. OUVRAGES HYDRAULIQUES DE PROTECTION, RELEVEMENTS..........................................169
I.1. LIMITATION DES DEBITS ......................................................................................................................169
I.1.1. Fonction .........................................................................................................................................169
I.1.2. Descriptif, dimensionnement..........................................................................................................169
I.1.3. Effets attendus, exploitation...........................................................................................................169
I.1.4. Tests et mesures .............................................................................................................................169
I.2. RELEVEMENT ......................................................................................................................................169
I.2.1. Descriptif........................................................................................................................................169
I.2.2. Dimensionnement...........................................................................................................................170
I.2.3. Exploitation....................................................................................................................................170
I.2.4. Tests et mesures .............................................................................................................................170
II. PRETRAITEMENT..................................................................................................................................171
II.1. DEGRILLAGE ET TAMISAGE..................................................................................................................171
II.1.1. Descriptif........................................................................................................................................171
II.1.2. Dimensionnement...........................................................................................................................172
II.1.3. Effets attendus, rendements, sous-produits....................................................................................172
II.1.4. Exploitation....................................................................................................................................172
II.1.5. Tests et mesures .............................................................................................................................172
II.2. DILACERATION....................................................................................................................................173
II.3. DESSABLAGE.......................................................................................................................................173
II.3.1. Descriptif........................................................................................................................................173
II.3.2. Dimensionnement...........................................................................................................................173
II.3.3. Effets attendus, rendements, sous-produits....................................................................................174
II.3.4. Exploitation....................................................................................................................................174
II.3.5. Tests et mesures .............................................................................................................................174
II.4. DEGRAISSAGE .....................................................................................................................................174
II.4.1. Fonction .........................................................................................................................................174
II.4.2. Descriptif........................................................................................................................................174
II.4.3. Dimensionnement...........................................................................................................................175
II.4.4. Effets attendus, rendements, sous-produits....................................................................................175
II.4.5. Exploitation....................................................................................................................................175
II.4.6. Tests et mesures .............................................................................................................................176
II.5. TRAITEMENT DES GRAISSES.................................................................................................................176
II.5.1. Fonction .........................................................................................................................................176
II.5.2. Descriptif........................................................................................................................................176
II.5.3. Dimensionnement...........................................................................................................................176
II.5.4. Effets attendus, rendements, sous-produits....................................................................................176
II.5.5. Exploitation....................................................................................................................................177
II.5.6. Tests et mesures .............................................................................................................................177
II.6. RECEPTION DES MATIERES DE VIDANGE ..............................................................................................178
II.6.1. Fonction .........................................................................................................................................178
II.6.2. Descriptif, dimensionnement..........................................................................................................178
II.6.3. Effets attendus, rendements, sous-produits....................................................................................178
II.6.4. Exploitation....................................................................................................................................178
II.6.5. Tests et mesures .............................................................................................................................179
II.7. BASSIN DE REGULATION OU BASSIN TAMPON ......................................................................................179
II.7.1. Fonction .........................................................................................................................................179
II.7.2. Caractristiques, dimensionnement ...............................................................................................179
II.7.3. Effets attendus, rendements, sous-produits, exploitation...............................................................180
II.7.4. Tests et mesures .............................................................................................................................181
II.8. NEUTRALISATION................................................................................................................................181
II.8.1. Fonction .........................................................................................................................................181
Page 168 - Chapitre 8
II.8.2. Caractristiques, dimensionnement ...............................................................................................181
II.8.3. Exploitation....................................................................................................................................181
II.8.4. Tests et mesures .............................................................................................................................182
III. NUTRITION (TRAITEMENT BIOLOGIQUE) ...............................................................................182
III.1. FONCTION ...........................................................................................................................................182
III.2. DESCRIPTIF..........................................................................................................................................182
III.3. DIMENSIONNEMENT ............................................................................................................................182
III.4. EFFETS ATTENDUS, RENDEMENTS, SOUS-PRODUITS .............................................................................182
III.5. EXPLOITATION, TESTS ET MESURES .....................................................................................................182
IV. ELIMINATION DES MATIERES EN SUSPENSION.....................................................................183
IV.1. DECANTATION PRIMAIRE.....................................................................................................................183
IV.1.1. Fonction.....................................................................................................................................183
IV.1.2. Descriptif ...................................................................................................................................183
IV.1.3. Dimensionnement (eaux uses urbaines)...................................................................................183
IV.1.4. Effets attendus, rendements, sous-produits................................................................................183
IV.1.5. Exploitation................................................................................................................................184
Prtraitement - Page 169
I. OUVRAGES HYDRAULIQUES DE PROTECTION, RELEVEMENTS
I.1. LIMITATION DES DEBITS
I.1.1. Fonction
La limitation des dbits a pour but d'viter la surcharge hydraulique de tout ou partie des
ouvrages, pour empcher une dgradation dans la qualit du traitement.
I.1.2. Descriptif, dimensionnement
La limitation de dbit est souvent assure par trop plein (surverse, dversoir d'orage).
Toutefois, il peut tre mis en place un pompage spcialis, un diaphragme calibr ou une
vanne automatique commands par contacteur de niveau ou par une mesure de dbit. Le
surplus de dbit est alors vacu directement vers le milieu naturel ou bien dirig vers un
bassin d'orage.
A chaque situation correspond un mode de dimensionnement particulier
(dimensionnement des dversoirs d'orage notamment), le plus simple tant de brider le dbit
du relvement.
I.1.3. Effets attendus, exploitation
Quand il s'agit d'une limitation du dbit par "by pass" direct vers le milieu naturel il est
important de pouvoir disposer d'un systme fiable. En effet, il s'agit de se situer la limite de
la charge hydraulique des ouvrages situs en aval pour limiter les rejets intempestifs. Il est
donc essentiel de maintenir dans un parfait tat tous le matriel et les ouvrages utilis cet
effet.
Il doit tre systmatiquement noter les priodes o le trop plein est activ, certains
ouvrages sont quips de dtecteurs de surverse ou d'appareils de mesure dbitmtrique.
I.1.4. Tests et mesures
Le cas chant, il peut tre intressant de situer la charge polluante dverse par le trop
plein par un chantillonnage rgulier (prleveur chantillonneur automatique asservi un
contacteur de niveau ou un dbitmtre) ou par une mesure continu d'un paramtre
pertinent reprsentatif (turbidit notamment).
I.2. RELEVEMENT
Sa fonction est dassurer lalimentation de la station dpuration.
I.2.1. Descriptif
Le niveau d'arrive du fil d'eau en aval du rseau dassainissement ne permettant pas
toujours un coulement gravitaire des effluents travers la station d'puration pour atteindre
le point de rejet, il est ncessaire d'avoir recours un ouvrage quip pour assurer le
relvement des effluents.
Ce relvement est gnralement assur par des pompes ou par vis d'Archimde, il est
situ gnralement sur le site d'implantation de la station d'puration.
La nature des effluents et la hauteur de relvement vont permettre d'effectuer un choix
dans le type de matriel mettre en oeuvre (vis, pompes sec ou immerges, roues
canaux, effet vortex, ...).
Page 170 - Chapitre 8
L'utilisation de vis de relvement prsente l'avantage d'tre moins sensible au colmatage
(le prtraitement tant souvent situ en aval) et par un fonctionnement continu permet de
"laminer" au mieux les dbits entrant (fonctionnement " sec" possible) ce qui est tout fait
souhaitable pour obtenir des conditions hydrauliques optimales en clarification notamment.
Toutefois, la mise en place de vis s'avre plus coteuse en investissement et en entretien.
I.2.2. Dimensionnement
Le dbit maximum admissible sert de base de dimensionnement, avec le choix d'utilisation
d'une ou de plusieurs pompes pour obtenir, moyennant un fonctionnement simultan (si
ncessaire), le dbit voulu.
Un secours doit tre systmatiquement install. Selon le cas, sa capacit pourra
correspondre au dbit nominal prvu ou celui d'un des organes (secours partiel ou total).
Il est possible de mettre en place des pompes de diffrents dbits pour mieux "coller" au
dbit amont et viter les -coups et les temps trop longs de sjour dans la bche de reprise,
mais cela peut entraner des sujtions au niveau de la mise en oeuvre.
I.2.3. Exploitation
Il s'agit principalement d'assurer un entretien lectromcanique du matriel en place (vis,
pompes, vannes, clapets anti retour, circuits de commande, ...) et un nettoyage frquent du
poste (notamment de surveiller l'absence de dpts et la propret des contacteurs de
niveau).
Pour les pompes, il est important de vrifier l'absence de colmatage au niveau de la roue,
de contrler au moins tous les six mois leur dbit nominal.
La hauteur de marnage est choisir par un compromis entre la limitation du nombre de
dmarrage et le maintien d'un faible temps de sjour; ... Quand la distance entre le point de
dpart et d'arrive est plus importante, l'implantation d'un poste de refoulement va entraner
un temps de sjour des effluents dans la canalisation d'autant plus important que son
volume sera important (longueur, diamtre) et les dbits traiter faibles. Cela s'observe
frquemment dans les situations fortes variations saisonnires (villes touristiques
notamment).
En fonction de l'tat de fracheur initial des effluents et de la temprature du milieu, des
risques importants d'apparition de sulfures sont craindre, avec en consquence des
dgagements nausabonds et dangereux d'hydrogne sulfur (H
2
S), une dgradation des
canalisation gravitaires et des quipements en aval, ainsi qu'un impact non ngligeable sur
le traitement biologique (dveloppement de bactries filamenteuses).
Il est donc important d'tre vigilant et de procder des investigations ds qu'il existe le
moindre doute quant la qualit des effluents traiter.
I.2.4. Tests et mesures
Exceptes les mesures qui permettent de situer le flux polluant traiter (DCO, DBO
5
,
MES, MVS, NTK, N-NH
4
, P
total
) il est intressant, le cas chant, d'effectuer des mesures de
potentiel REDOX, pH, sulfure pour connatre l'tat de fracheur des effluents.
Prtraitement - Page 171
II. PRETRAITEMENT
Le prtraitement, l'entre d'une station d'puration, a pour rle d'assurer l'limination des
lments gnants pour le bon fonctionnement de l'installation :
corps volumineux entranant des bouchages de pompes et de canalisations;
corps denses responsables des dpts au fond des ouvrages;
corps abrasifs qui peuvent provoquer une usure prmature des organes
mcaniques;
corps flottants qui peuvent s'accumuler la surface des bassins, ...
II.1. DEGRILLAGE ET TAMISAGE
La fonction de ces appareils est llimination des corps solides et volumineux.
II.1.1. Descriptif
Selon l'cartement des barreaux ou le dimensionnement des mailles on distingue :
le prdgrillage : espacement entre barreaux 30 50 mm plac gnralement en
amont des pompes;
le dgrillage : espacement entre barreaux 10 30 mm;
le dgrillage fin : espacement entre barreaux 3 10 mm (AQUA-GUARD, ...);
le tamisage : mailles de 0,1 3 mm.
Pour chacun des types il existe un grand nombre de modle de matriel, selon le mode de
nettoyage :
les paniers de dgrillage placs dans les postes de relvement ces paniers sont
suspendus devant l'extrmit aval de la canalisation d'arrive. Ce matriel quipe
souvent les petites installations (< 5000 eH). On peut toutefois les retrouver sur les
plus grosses usines en secours des appareils de dgrillage automatiques;
les grilles manuelles constitues de barreaux en acier, elles sont installes dans un
canal d'amene des eaux, le plus souvent inclines (angle 30 45 par rapport la
verticale);
les grilles mcaniques : elles sont quipes d'un "rteau" motoris et animes d'un
mouvement rotatif (grille courbe) ou de va et vient (grille droite). Leur mise en service
est commande par une horloge (cadence dure) asservie au fonctionnement du
relvement (avec temporisation de retard) ou par dtection d'une mise en charge du
canal amont;
les tamis : ils sont lment filtrant fixe (CLAROMATIC, ...), avec racleur ou
vacuation gravitaire des dchets (HYDRASIEVE, ...) ou lment filtrant mobile
(ROTOSTRAINER, ...). Certains appareils sont quips de rampe de lavage ou de
brosse de nettoyage.
Le dgrillage fin et le tamisage sont utiliss en industrie agro-alimentaire (limination des
matires stercoraires, des soies, ...) et en amont de filire de traitement de type lit bactrien,
pour une maille infrieure celle du garnissage du lit (garnissage plastique ordonn).
Page 172 - Chapitre 8
II.1.2. Dimensionnement
Dgrillage :
La vitesse de passage travers la grille doit tre suffisante pour obtenir lapplication des
matires sur la grille, sans pour autant provoquer une perte de charge trop importante.
Vitesse de passage de l'eau : 0,3 0,6 m/s (sur la section libre de passage, grille
colmate).
Tirant d'eau : 0,1 0,4 m.
Pertes de charges adoptes :
100 mm de CE en prgrilles;
150 mm de CE en grilles fines.
Tamisage : dfinir partir des donnes du constructeur.
II.1.3. Effets attendus, rendements, sous-produits
Selon l'espacement des barreaux ou la maille l'efficacit sera plus ou moins importante,
cela va se traduire par une production de dchets variable :
dgrillage : production de dchets par eH/an - 12 15 l/e (e = espacement inter
barreaux en cm);
tamisage : d'aprs le CEMAGREF un tamisage maille de 0,75 mm limine entre 8
et 18 % (selon la nature des effluents et du rseau d'assainissement, 12 % en
moyenne) des MES.
Les dchets de dgrillage et de tamisage sont composs de 50 80 % de matires
organiques. Le taux d'humidit est de 75 95 %. On considre gnralement que l'incidence
sur la DBO
5
et la DCO est ngligeable. Cependant dans le cas d'effluents industriels,
l'limination des MES peut atteindre 50 % (abattoirs notamment). Dans ce dernier cas, il en
rsulte un abattement de la charge organique.
II.1.4. Exploitation
Sur les installations les plus simples, l'enlvement des dchets s'effectue manuellement
l'aide d'un "rteau" adapt la grille ou aprs remonte du panier l'aide d'un treuil
(rcupration dans des sacs ou des poubelles). Leur nettoyage irrgulier et gnralement
trop peu frquent se traduit par une remonte en charge en amont ou se produisent alors
des dpts (fermentations) o des dbordements des eaux. Ce travail s'effectue dans des
conditions d'hygine souvent prcaires.
Dans le cas de grosses installations, les dchets sont vacus par tapis transporteur ou
compacts pour tre dirigs vers une benne de stockage. En cas de panne de l'appareil de
dgrillage ou de tamisage automatique un "by pass" est alors utilis souvent quip d'un
dgrillage plus grossier, nettoyage manuel. Il est important de vrifier que ce systme est
oprationnel.
La seule destination valable des dchets est le centre de traitement des ordures
mnagres.
II.1.5. Tests et mesures
Aucun test particulier n'est effectuer, il convient seulement d'assurer un suivi rgulier de
la production de dchets.
Prtraitement - Page 173
II.2. DILACERATION
Cette technique vise rduire la taille des solides volumineux en permettant de les
"remlanger" l'eau traiter ce qui a pour effet de limiter une vacuation spcifique.
Ce type de matriel est abandonn car il entrane une augmentation de la charge
polluante et laisse "passer" toutes les matires fibreuses et autres matires inertes.
II.3. DESSABLAGE
Sa fonction est llimination du sable et des matriaux lourds. Il s'agit d'assurer une
limination par sdimentation des sables et des matriaux lourds pour viter l'abrasion des
quipements mcaniques et les dpts dans les tuyauteries et le fond des bassins
(colmatage, rduction des volumes utiles).
II.3.1. Descriptif
Selon la taille de la station, l'ouvrage est indpendant ou associ avec le dgraissage.
Dessableurs couloirs ou canaux de dessablage
Ils sont constitus de chenaux profils o l'eau perd de sa vitesse. Dans certains cas on
maintient la vitesse constante grce un dversoir variation linaire de dbit (dversoir
type "tour Eiffel").
Dessableurs circulaires "escargot"
On maintient une vitesse de balayage suffisante grce une alimentation tangentielle ou
par un brassage mcanique qui va permettre, par effet centrifuge, de plaquer les particules
denses sur les parois et de les recueillir dans le fond conique de l'appareil. Ce type
d'ouvrage malgr son efficacit est abandonn (gnie civil complexe) au profit d'ouvrage
combin de dessablage-dgraissage.
Dessableurs dgraisseurs combins
Ce type d'installation se retrouve trs frquemment sur les stations. Le systme
d'insufflation d'air assure la flottation des graisses et le "lavage" des particules sableuses en
limitant ainsi la sdimentation de matires organiques. Ces ouvrages sont circulaires ou
"couloirs".
II.3.2. Dimensionnement
Charge superficielle : 50 m/h sur Q maxi.
Temps de sjour : 5 15 min.
Ecoulement longitudinal : 20 30 cm/s.
Rapport Longueur/hauteur : 10 15 pour dessableur couloir.
Page 174 - Chapitre 8
II.3.3. Effets attendus, rendements, sous-produits
Il est possible d'obtenir un rendement de 80 % sur les particules lourdes d'une taille
suprieure 0,2 mm.
L'extraction des boues est manuelle sur les petits ouvrages (canaux dessableurs), par
effet de chasse par l'intermdiaire d'une vanne ouverture manuelle pour les ouvrages en
hauteur, par une pompe spcialise (vortex) ou un hydro-jecteur sur les autres ouvrages,
soit fixe, soit mont sur pont racleur pour les ouvrages rectangulaires de taille importante
(commande par horloge).
Sur les petites installations, les sables extraits sont vacus directement dans un bac de
refus. Ppour les installations plus importantes, ils sont dirigs vers une aire d'gouttage ou
mieux vers un systme de classification par vis d'Archimde (les hydrocyclones ont t
abandonns parce que peu performants).
La production de sable varie en fonction de la nature du rseau d'assainissement; dans le
cas d'un rseau sparatif on peut se baser sur 0,1 0,3 l/m
3
eau traite ou 5 15 l/an par
eH. L'humidit des sables varie de 15 35 % avec une teneur en matire organique de 15
25 % pour des sables lavs.
II.3.4. Exploitation
Les tches d'exploitation se rsument assurer autant que de besoin l'extraction des
sables. Ce travail est essentiel puisqu'il va conditionner le bon tat du matriel
lectromcanique et l'absence de dpts dans les ouvrages concerns (bassin d'aration,
digesteur, ...). Il est important de souligner l'effet de retard en cas d'insuffisance
(accumulation progressive). Les sables extraits sont enfouis sur le site (petites installation)
ou vacus en dcharge.
II.3.5. Tests et mesures
Aucun test particulier n'est effectuer, il convient seulement d'assurer un suivi rgulier
de la production de dchets.
II.4. DEGRAISSAGE
II.4.1. Fonction
Le dgraissage a pour fonction d'assurer l'limination des matires grasses et des huiles
(en faible quantit) difficilement biodgradables qui flottent la surface des ouvrages,
perturbent la dcantation des boues et limitent les performances de transfert de l'oxygne
dans les bassins d'aration.
II.4.2. Descriptif
Il existe plusieurs types de dgraisseurs :
dgraisseur statique. Il s'agit d'un bassin gnralement pourvu de chicanes ou
d'une cloison siphode qui retient les graisses et autres corps flottants qui remontent
la surface de l'eau;
Prtraitement - Page 175
dgraisseur ar. Le bassin est gnralement de forme cylindro-conique ou
rectangulaire dans lequel la flottation des graisses est facilite par la diffusion de
fines bulles d'air injectes dans le fond de l'ouvrage. La production d'air est obtenue
avec l'utilisation de surpresseur et de diffuseurs adapts, ou le plus souvent l'aide
de pompes mulsionneuses (type AEROFLOT);
il existe d'autres types de dgraisseurs-dshuileurs qui font appel des techniques
de flottation aprs coagulation (dtente d'air pressuris), de dcantation lamellaire,
l'utilisation de filtre coalescent qui sont en gnral rservs au traitement d'effluents
industriels particuliers.
II.4.3. Dimensionnement
Vitesse ascensionnelle : 15 m/h (sur Q maxi).
Temps de sjour : 10 min.
Diffusion d'air : 4 8 m
3
/h par m
2
de surface.
II.4.4. Effets attendus, rendements, sous-produits
Il est important de rappeler qu'il s'agit d'liminer les graisses et huiles facilement flottables.
Le rendement sur les graisses totales [exprimes en SEC (Substances Extractibles au
Chloroforme) ou MEH], pour un ouvrage performant est au maximum de 15 25 %. Dans le
cas d'ouvrage statique (sans injection d'air) les rendements sont beaucoup plus bas (5 10
% maxi).
Un mg de graisses (lipides par la mesure des MEH) correspond 2,8 g de DCO (d'aprs
le CEMAGREF 1 mg de SEC correspond 2,4 mg de DCO). Il est prfrable d'utiliser la
mesure de MEH pour caractriser la concentration en graisses (mesure intgrant mieux la
totalit des graisses que celle des SEC)
La concentration en graisses d'un effluent domestique varie de 60 150 mg/l. On peut
considrer que les graisses reprsentent 30 35 % de la DCO entrante.
Le rejet d'un habitant correspond approximativement 15 g de graisses par jour (10
20 g/j). Pour un rendement maximum de 20 % le volume de graisses vacuer est d'environ
3 g EH/j soit, pour une concentration des graisses au soutirage approximative de 70 g
MEH/l, un volume annuel maximum de 15 l/an par eH.
Les graisses sont diriges vers une fosse de stockage ou vers un traitement spcifique
(traitement arobie type BIOMASTER G).
II.4.5. Exploitation
Dans le cas de petites installations l'extraction se fait manuellement l'aide d'une
cumoire ou d'une racle. Pour les grosses installations l'extraction est automatique grce
un raclage de surface mcanis fonctionnement continu ou command par horloge.
L'aration quand elle existe doit fonctionner en continue pour limiter la dcantation de
matires organiques surtout quand le dbit trait est faible (la nuit notamment).
Page 176 - Chapitre 8
Les vacuations de graisses sont assurer trs rgulirement pour limiter un temps de
sjour prolong dans l'ouvrage lui-mme (rglage de la marche du raclage pour un systme
automatique ou frquence d'intervention) ou dans la fosse de stockage. Un temps de sjour
trop lev va entraner une importante hydrolyse des graisses et leur retour dans la filire de
traitement des eaux (sous-verse du stockage) avec toutes les consquences que cela induit.
Les graisses (humidit 60 90 %) sont vacues gnralement par camion de vidange ou
par benne, mlanges avec les refus de dgrillage, vers une centrale d'incinration des
ordures mnagres. Il subsiste toutefois encore des filires d'vacuation "douteuses"
(pandage direct ou avec les boues sur les terres agricoles, enfouissement) qui devront
disparatre.
II.4.6. Tests et mesures
Aucun test particulier n'est effectuer, il convient seulement d'assurer un suivi rgulier de
la production de dchets. Toutefois lorsque cela s'avre ncessaire il est possible de
procder des mesures de DCO, MV et de MEH en amont et en aval du dispositif pour juger
de ses performances. Ces analyses pourront tre effectues galement sur les graisses
vacues.
II.5. TRAITEMENT DES GRAISSES
II.5.1. Fonction
Du fait de la difficult de trouver un dbouch acceptable aux graisses vacuer, il est
prfr la mise en place, sur la station d'puration, d'un vritable systme d'limination des
graisses par un traitement biologique spcifique seule technique actuellement fiable.
II.5.2. Descriptif
Le traitement biologique des graisses se caractrise par la mise en place d'un bassin
d'aration spcialis, quip d'un ou plusieurs brasseur(s) mcanique(s), dont l'aration est
assure par injection d'air par l'intermdiaire de diffuseurs "fines bulles"(air fourni l'aide de
surpresseurs). Comme pour le traitement biologique des eaux par boues actives la
biomasse arobie spcifique se dveloppe en utilisant comme substrat les graisses issues
du prtraitement.
II.5.3. Dimensionnement
Comme pour un traitement biologique classique il s'agit de cultiver une masse bactrienne
suffisante pour assurer la dgradation des graisses. Pour une concentration des boues
moyenne de 10 15 g MES/l il est possible de dterminer pour le flux de graisses maximum
traite , le volume de l'ouvrage mettre en oeuvre, c'est dire en respectant une charge
volumique de 2,5 kg de DCO/m
3
soit une charge massique infrieure 0,2 kg DCO/kg MES
par jour.
II.5.4. Effets attendus, rendements, sous-produits
Le rendement possible d'limination des graisses est de:
MEH : > = 80 %;
DCO : >= 50 % (DCO totale sur les boues);
MV : >= 50 % (MV totale sur les boues).
Prtraitement - Page 177
Les boues produites sont vacues par surverse vers le bassin biologique de traitement
des eaux de la station d'puration (production de boues ngligeable par rapport celle de la
station d'puration des eaux).
Il est important de signaler que le volume de boues vacuer du racteur de traitement
des graisses est suprieur celui des graisses d'entre il est donc indispensable d'assurer
un appoint en eau supplmentaire pour maintenir le niveau de l'ouvrage.
II.5.5. Exploitation
L'exploitation d'un ouvrage de traitement des graisses doit tre trs rgulire et assure
avec soin et rigueur. L'aration doit tre suffisante pour permettre le maintien en
permanence d'une concentration en oxygne dissous de 2 mg/l.
Les graisses traiter ne contiennent pas suffisamment d'azote et de phosphore pour
permettre un bon dveloppement de la biomasse. Il est ncessaire d'effectuer des apports
complmentaires de manire maintenir en permanence une concentration rsiduelle de
5 mg P/l et de 20 mg N/l (sur filtrat des boues).
Les extractions des boues doivent tre effectues rgulirement il ne faut pas dpasser
une concentration en boues suprieure 15 g MES/l (l'extraction par surverse s'effectue par
une alimentation en eau de dilution).
La moindre surcharge en graisses ou un dfaut d'aration va provoquer un moussage
important (non biologique), cette observation doit conduire au rflexe d'une diminution voire
d'un arrt de l'alimentation en graisses jusqu' disparition de ces mousses. Le cas chant, il
est possible d'observer une baisse du pH dans le racteur, un rajustement la chaux est
prvoir.
Si ces recommandations sont suivies il ne peut y avoir une incidence sur le traitement des
eaux de la station.
II.5.6. Tests et mesures
Il est essentiel d'assurer un suivi permanent du fonctionnement du traitement :
Racteur biologique : mesures hebdomadaires :
Valeurs de consigne
Test de dcantation
MES 10 15 g/l
MVS
Oxygne dissous 2 4 mg/l
REDOX > 200 mV/H
2
pH 6,5 7,5
Test N-NO
3
> 20 mg/l
Test P-PO
4
> 5 mg/l
Production de boues.
Page 178 - Chapitre 8
Racteur biologique, graisses traiter : analyses bimensuelles :
Valeurs de consigne
MEH (rendement mini 80 %)
DCO nd (rendement mini 50 %)
DCO ad2 (concentration < 500 mg/l).
II.6. RECEPTION DES MATIERES DE VIDANGE
II.6.1. Fonction
Il s'agit d'un ouvrage qui rceptionne les matires de vidanges et le cas chant les
matires de curage de collecteur (aprs tamisage), amenes par des camions hydrocureurs,
en vue d'un traitement ultrieur dans la filire de traitement des eaux pendant la priode o
la charge traiter est faible (priode nocturne notamment).
II.6.2. Descriptif, dimensionnement
Le systme devrait comprendre une fosse de dpotage des camions (volume quivalent
un camion de fort tonnage) permettant un contrle des matires rejetes (prlvement)
avant vacuation vers la fosse de matires de vidange proprement dite (transfert par
pompage).
Cette fosse de matires de vidanges est are pour arrt la fermentation des effluents et
est quipe d'une rcupration de l'air vici pour un traitement des odeurs (charbon actif ou
traitement centralis).
Son volume doit tre tel que le dbit restitu ne dpasse pas 3 % du dbit nominal et la
charge 20 % de la charge nominale de la station. La restitution dans le traitement des eaux
est assure par une pompe commande par une horloge de programmation.
II.6.3. Effets attendus, rendements, sous-produits
Il ne s'agit pas d'un ouvrage de traitement proprement dit mais d'une capacit de stockage
provisoire d'effluents chargs qui seront traits avec les effluents domestiques.
II.6.4. Exploitation
Il est trs important de bien limiter la charge polluante des matires de vidanges dans les
limites rglementaires et d'assurer un contrle systmatique des effluents rejets par chaque
camion (prlvement systmatique). Ceci est particulirement dlicat effectuer quand
l'installation ne comprend pas de fosse de dpotage isole.
Pour un aspect suspect et inhabituel de ces effluents il est strictement obligatoire de
refuser leur traitement en imposant un "repompage" et une vacuation vers une destination
approprie et autorise. Seuls sont accepter les camions uniquement affects
l'assainissement domestique l'exclusion de tout ceux amens transporter des produits
industriels. Le moindre envoi de produit toxique dans la filire de traitement des eaux peut
condamner pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines le traitement biologique.
Le rglage de l'horloge doit tre judicieusement choisie pour permettre une restitution des
matires de vidanges lorsque la charge traite sur la station le permet.
Prtraitement - Page 179
II.6.5. Tests et mesures
Sur les chantillons prlevs chaque dpotage de camion on pourra se contenter dans
un premier temps un examen visuel et olfactif ainsi qu' quelques tests lmentaires tels
que pH, potantiel REDOX, conductivit.
Il est important de situer la charge polluante traiter en effectuant les analyses suivantes
(sur un chantillon reprsentatif prlev dans le bassin de stockage) :
DCO nd, DCO ad2, MES, MVS, N-NH
4
toutes les semaines;
P-PO
4
, DBO
5
nd, DBO
5
ad2, NTK tous les 15 jours;
P
total
.
Une comptabilisation prcise des volumes traits est ncessaire.
II.7. BASSIN DE REGULATION OU BASSIN TAMPON
II.7.1. Fonction
Ce bassin sert la rgulation du dbit et des autres caractristiques des eaux uses
(charge polluante, pH, temprature, ...), afin d'viter les -coups sur les ouvrages de
traitement et d'taler la charge dans le temps, mme en dehors des priodes de rejet.
II.7.2. Caractristiques, dimensionnement
Il existe de nombreuses possibilits de configuration d'ouvrage selon le but recherch,
citons principalement :
Bassin volume d'eau constant.
Ce bassin permet de rguler tous les paramtres l'exception du dbit, de fait ce type
d'ouvrage est peu utilis. Le volume de l'ouvrage est dfinir en fonction du temps de sjour
ncessaire l'obtention d'une concentration quasi constante. Dans certains cas il s'agit d'un
bassin volume d'eau variable avec un volume minimum constant.
Bassin volume d'eau variable.
Pour ce type d'ouvrage la reprise des eaux s'opre dbit constant (vanne flotteur,
vanne rgule sur une mesure de dbit, pompe volumtrique, pompe sur flotteur pour
permettre une hauteur de charge constante) ce qui permet de rguler l'ensemble des
paramtres pour autant que la variation de la qualit des affluents reste limite (notamment
lorsque le remplissage de l'ouvrage est faible).
Le dimensionnement d'un tel ouvrage ncessite la connaissance de l'hydrogramme amont,
il suffit de tracer le graphique des volumes cumuls (m
3
) sur la priode prvue (journe,
semaine) par pas de temps horaire (pour une journe). Le volume total devant tre pomp
pendant la mme priode, la pente de l'oblique qui rejoint les deux extrmits du graphique
va dfinir le dbit de la pompe de vidange.
Une translation de cette oblique pour tracer deux autres droites parallles et passant par
les points de tangence maxi et mini de lhistogramme de cumul va dfinir le volume utile du
bassin : ce volume est l'cart vertical existant entre les deux tangentes.
Page 180 - Chapitre 8
Bassin mixte volume d'eau constant plus un volume d'eau variable.
Il s'agit de pouvoir rguler l'ensemble des paramtres avec en amont un dbit et une
qualit d'eau variable. Il s'agit de combiner les deux ouvrages prcdents (dimensionnement
dfinir en consquence).
Bassin d'orage.
Plac gnralement en drivation, ce bassin permet de stocker provisoirement les eaux
en priode de pointe hydraulique et de les restituer en priode creuse. Cette configuration
est notamment utilise dans le cas de rseau d'assainissement urbain unitaire o il s'agit de
traiter dans la station d'puration le premier flot d'orage rput charg en pollution (point
vrifier systmatiquement).
L'alimentation de l'ouvrage est assure gravitairement (surverse ou vanne flotteur) ou
par l'intermdiaire d'un relvement (pompe, vis) jusqu' un niveau haut (les effluents
supplmentaires tant alors "by pass". La restitution du dbit s'opre gravitairement par
l'intermdiaire d'une vanne (flotteur ou rgulation par une mesure de dbit) ou par pompage.
Le dimensionnement du bassin est dfinir partir de la configuration du rseau
d'assainissement (surface impermabilise, priode o la charge polluante supplmentaire
doit tre prise en compte) et de la capacit maximale de l'installation de traitement.
Pour tous ces bassins, il est essentiel d'assurer une parfaite homognisation des eaux,
d'empcher tout dpt, de maintenir des conditions arobies. Pour ce faire un bassin
tampon doit tre systmatiquement ar et brass. Ces fonctions sont ralises
simultanment par :
insufflation d'air surpress (moyennes bulles : mini 5 10 Nm
3
/h par m
2
de bassin);
installation de turbines flottantes (mini 10 15 W/m
3
).
Remarque : l'ouvrage doit tre configur de manire permettre sa vidange totale et un
entretien minime.
II.7.3. Effets attendus, rendements, sous-produits, exploitation
Il ne s'agit pas d'un ouvrage de traitement proprement dit mais d'une capacit de stockage
provisoire d'effluents chargs qui seront traits ultrieurement. Cet ouvrage doit toujours,
quand il est en eau, tre bien brass et ar. En cas de mauvaise oxygnation, il y aura
fermentation anarobie avec en consquence d'importants dsordres au niveau du
traitement des eaux et des boues.
Quand il s'agit d'un bassin de rgulation uniquement (rgulation sur 24 h ou sur la
semaine du dbit ou de la charge polluante), l'ouvrage doit tre utilis au maximum de ses
possibilits c'est dire en occupant rgulirement la totalit du volume de manire limiter
le dbit de restitution et donc de soulager le traitement aval (hydraulique de la clarification,
faible variation du flux, du pH, de la temprature).
Cela peut permettre dans le cas d'une sous charge de l'installation de ne pas vider
compltement l'ouvrage et donc de bnficier au maximum de l'effet tampon.
Pour un bassin d'orage, l'inverse, l'ouvrage devra tre vid ds que possible (c'est dire
sans prjudice sur la qualit de traitement) pour permettre d'accueillir de nouveaux effluents.
Un nettoyage pour enlever les dpts est trs souvent ncessaire.
Prtraitement - Page 181
II.7.4. Tests et mesures
Il est important de vrifier rgulirement l'absence de fermentation anarobie par une
mesure de REDOX (E H/H
2
> 150 mV) ou le cas chant d'oxygne dissous (O
2
> 1 2
mg/l).
Pour juger de l'efficacit du pouvoir tampon de l'ouvrage il est intressant d'effectuer une
campagne de suivi de la qualit des effluents, en amont et en aval du bassin. Ce suivi peut
selon le cas se limiter un enregistrement du pH de la temprature dans l'ouvrage et des
dbits entre-sortie (ces mesures sont souvent imposes dans le cas de bassin tampon mis
en place sur les rejets industriels) ou bien plus pouss par l'apprhension des flux polluants
amont et aval avec la mise en place de prleveurs chantillonneurs automatiques
(chantillonnage frquent avec analyse d'un paramtre pertinent : par exemple la DCO).
II.8. NEUTRALISATION
II.8.1. Fonction
La neutralisation a pour but de maintenir le pH du milieu une valeur convenable,
compatible avec le traitement ultrieur. Il s'agit la plupart du temps de maintenir un pH
proche de la neutralit (6,5 7,5).
Celle-ci s'impose dans :
le cas de rejet d'effluents industriels pour faire face aux variations souvent brutales
du pH des effluents rejets (nettoyage acide ou basique des cuves en fin de
fabrication, ...);
un racteur biologique peu tamponn (digesteur anarobie, traitement arobie des
graisses, bassin boues actives, ...) pour compenser les effets de ractions
notamment d'acidification pouvant se produire dans le traitement (nitrification
biologique, ajout de ractif chimique de dphosphatation, fermentation acide, ...);
le cas de traitement physico-chimique (aprs coagulation par un sel de fer ou
d'aluminium) avant envoi dans le dcanteur.
II.8.2. Caractristiques, dimensionnement
Il s'agit trs souvent d'injecter des ractifs acides ou basiques (H
2
SO
4
, HCl, NaOH,
Ca(OH)
2
, ...) dans un ouvrage d'homognisation qui peut tre spcialis (temps de sjour
15 20 mn) ou plus souvent dans un ouvrage, souvent de grande capacit, assurant une
autre fonction (bassin tampon, bassin de traitement biologique) ce qui a pour effet de limiter
leur consommation.
Les produits ractifs (souvent liquides) sont apporter par pompes doseuses ou
lectrovannes asservies une sonde pH, au fonctionnement d'une pompe d'alimentation ou
plus simplement une horloge.
II.8.3. Exploitation
L'efficacit de la neutralisation va trs souvent conditionne la qualit du traitement aval,
de ce fait une surveillance rigoureuse doit tre assure. Il faut donc veiller au bon
fonctionnement des appareils lectromcaniques (mlangeurs, pompes doseuses...), de
procder un talonnage frquent de la sonde de pH (il est opportun de disposer d'une
sonde de secours), et d'approvisionner rgulirement les ractifs.
Il est important de suivre galement la consommation en ractifs.
Page 182 - Chapitre 8
II.8.4. Tests et mesures
Le suivi de la neutralisation se rsume contrler trs rgulirement le pH du milieu
concern, par une mesure ponctuelle ou par un enregistrement continu.
III. NUTRITION (TRAITEMENT BIOLOGIQUE)
III.1. FONCTION
Il s'agit d'apporter aux micro-organismes des lments complmentaires (nutriments)
indispensables leurs dveloppements : azote, phosphore.
III.2. DESCRIPTIF
Si les eaux uses domestiques contiennent suffisamment de ces nutriments (rapport
DBO
5
/N/P proche de 100/22/6), certaines eaux industrielles en sont carences. Dans le cas
d'un traitement biologique arobie, le rapport DBO
5
/N/P li la composition de la biomasse
doit tre au minimum de 100/5/1.
Il convient de prendre en compte que ces nutriments doivent tre facilement assimilables
par la biomasse citons principalement :
azote : ure, ammoniaque, nitrate d'ammonium;
phosphore : acide phosphorique;
azote + phosphore : phosphates d'ammonium.
III.3. DIMENSIONNEMENT
L'introduction rgulire dans le racteur biologique s'opre par l'intermdiaire de pompes
doseuses de solutions aqueuses contenant ces composs. Les besoins journalier sont
dfinir pour chaque situation.
III.4. EFFETS ATTENDUS, RENDEMENTS, SOUS-PRODUITS
Ces apports ne doivent pas tre ngligs, une carence en nutriment va gner la
croissance bactrienne et favoriser le dveloppement filamenteux dont la structure permet
d'avoir accs plus rapidement ces produits que les bactries de la floculation.
III.5. EXPLOITATION, TESTS ET MESURES
Il est important dans le cas o un complment en nutriment s'avre ncessaire, d'assurer
le plus rgulirement ces apports par l'intermdiaire d'une horloge ou d'un asservissement
au dbit amont (relvement, dbitmtre).
La prsence dans le milieu biologique d'une concentration rsiduelle en phosphore et en
azote sera le signe d'une compensation suffisante en nutriments (tests : P-PO
4
, N-NH
4
,
N-NO
3
).
Il est important de bien noter les consommation en ractif de complment.
Prtraitement - Page 183
IV. ELIMINATION DES MATIERES EN SUSPENSION
IV.1. DECANTATION PRIMAIRE
IV.1.1. Fonction
La dcantation primaire assure la sparation des particules solides de densit suprieure
celle de l'eau selon les lois de STOKES, NEWTON et ALLERS (gravit, inertie des
particules, viscosit des fluides) dans un ouvrage spcialis appel dcanteur primaire.
IV.1.2. Descriptif
Selon la configuration des ouvrages, on distingue gnralement :
les dcanteurs statiques rectangulaires racls dans lesquels l'alimentation est
faite une extrmit et l'vacuation des eaux traites l'autre extrmit. La reprise
des boues dcantes dans le fond de l'ouvrage est assure par un raclage de fond
vers une fosse de concentration o elle seront extraites;
les dcanteurs circulaires racls (les plus utiliss) alimentation centrale par une
jupe de rpartition (clifford). Ils sont quips gnralement d'un pont racleur
entranement priphrique permettant la collecte des boues dans une fosse centrale
d'o elles sont vacues par une canalisation vers une bche de pompage
adjacente. Les eaux traites sont rcupres la priphrie de l'ouvrage par le biais
d'une lame dversante (lisse ou crnele) rglable en hauteur.
Ces deux ouvrages sont quips de cloison siphode permettant "d'arrter" les corps
flottants ventuels. Un racleur de surface solidaire du pont permet de les vacuer vers une
trmie de rcupration et une fosse de stockage adjacente.
IV.1.3. Dimensionnement (eaux uses urbaines)
Pour une eau donne, le rendement sur les matires en suspension dpend de la charge
hydraulique. A partir dune certaine limite, une augmentation de la surface ne se traduit que
par une faible amlioration du rendement.
Vitesse ascensionnelle : 1 2,5 m/h sur Q maxi (moyenne 1,5 2 m/h) (dbit
traversier/ surface utile au miroir).
Temps de sjour : 1 2 h sur Q maxi (moyenne 1,5 h) (volume utile du
dcanteur/dbit traversier).
Hauteur d'eau mini : 2 m.
IV.1.4. Effets attendus, rendements, sous-produits
Les performances des dcanteurs primaires varient principalement en fonction de la
vitesse ascensionnelle impose. Dans l'hypothse d'effluents urbains domestiques et d'une
vitesse ascensionnelle maxi de 1,5 m/h il est possible d'obtenir un rendement moyen de :
MES : 40 60 %;
DBO
5
: 25 35 %;
DCO : 20 30 %;
NTK : 5 10 %.
Page 184 - Chapitre 8
Il est important de signaler qu'il s'agit de rendements indicatifs, pour un fonctionnement
optimal de la station notamment au niveau du traitement des boues, c'est dire pour un flux
de retour ngligeable par rapport au flux d'entre.
Dans le cas contraire, du fait d'un dysfonctionnement du traitement des boues (mauvaise
gestion de lpaississement, de la digestion, du traitement mcanique des boues), le flux
correspondant aux diffrents retours devient trs important et prpondrant, les rendements
peuvent chuter rapidement.
La production de boues primaires fraches (sans tenir compte de la production de boues
biologiques en excs souvent renvoyes en tte d'ouvrage) est en rapport avec le
rendement puratoire.
L'intrt de la prsence d'une dcantation primaire est de permettre :
un certain lissage de la qualit des effluents (effet tampon souvent nglig);
de disposer d'un effluent dbarrass de particules en suspension, cette opration
est un pralable tout traitement par cultures fixes (biofiltres, lits bactriens, ...). Il
existe encore des installations o le traitement des eaux se limite cette dcantation
primaire!
d'obtenir moindre frais (en apparence) un rendement puratoire intressant.
Toutefois, cette limination partielle de la pollution se traduit par un transfert de boues
dominante organique, trs fermentescibles vers une filire de traitement adapte : digestion
anarobie, stabilisation arobie, stabilisation chimique (dont le cot est prendre en
compte).
IV.1.5. Exploitation
Le plus important est de limiter au maximum le temps de sjour des boues dans le
dcanteur par un fonctionnement quasi continu de la pompe d'vacuation (pompe boues
primaires).
Le volume extrait doit permettre de limiter moins de 10 g MES/l la concentration des
boues primaires. Aucune remonte de bulles, signe de fermentation anarobie, doit tre
observe.
Chapitre 9
TRAITEMENT DE LAZOTE ET DU
PHOSPHORE
J. M. AUDIC
Page 186 - Chapitre 9
SOMMAIRE
I. LA NITRIFICATION ET LA DENITRIFICATION............................................................................187
I.1. RAPPELS THEORIQUES .........................................................................................................................187
I.1.1. Les ractions d'ammonification .....................................................................................................187
I.1.2. Les ractions d'oxydation de l'ammoniaque ..................................................................................187
I.1.3. Les ractions de dnitrification......................................................................................................188
I.2. PRINCIPAUX SCHEMAS EPURATOIRES ..................................................................................................189
I.2.1. Le procd avec N/DN en bassin unique .......................................................................................189
I.2.2. Le procd zone anoxie en tte ...................................................................................................190
I.2.3. Le procd zone endogne (trizones Degrmont) .......................................................................190
I.3. ELEMENTS DE DIMENSIONNEMENT ......................................................................................................191
I.3.1. Dcantation primaire.....................................................................................................................191
I.3.2. Assimilation....................................................................................................................................191
I.3.3. Nitrification....................................................................................................................................191
I.3.4. Dnitrification................................................................................................................................192
II. LA DEPHOSPHATATION BIOLOGIQUE ..........................................................................................192
II.1. RAPPELS THEORIQUES .........................................................................................................................192
II.1.1. Le phosphore dans la cellule, stockage nergtique......................................................................192
II.1.2. Le mcanisme de la dphosphatation biologique ..........................................................................193
II.1.3. Les facteurs d'importance ..............................................................................................................195
II.2. PRINCIPAUX SCHEMAS EPURATOIRES ..................................................................................................196
II.2.1. Le procd avec N/DN en bassin unique .......................................................................................196
II.2.2. Le procd PHOREDOX modifi...................................................................................................196
II.2.3. Le procd zone endogne (trizones Degrmont) .......................................................................197
II.3. ELEMENTS DE DIMENSIONNEMENT ......................................................................................................197
II.3.1. Dcantation primaire.....................................................................................................................197
II.3.2. Zone anarobie ..............................................................................................................................197
II.3.3. Age des boues.................................................................................................................................198
II.3.4. Elimination de l'azote.....................................................................................................................198
II.3.5. Clarificateur...................................................................................................................................198
II.3.6. Traitement des boues .....................................................................................................................199
III. ELEMENTS D'UNE GESTION AUTOMATISEE...........................................................................199
III.1. MAINTIEN DES CONDITIONS OPTIMALES ..............................................................................................199
III.1.1. Conditions anarobies ...............................................................................................................199
III.1.2. Conditions de nitrification / dnitrification ...............................................................................200
III.2. REGULATION ET RESPECT DE LA NORME..............................................................................................200
III.2.1. Rgulation par prdiction ou anticipation.................................................................................200
III.2.2. Rgulation par dosage aval .......................................................................................................200
Traitement de lazote et du phosphore - Page 187
I. LA NITRIFICATION ET LA DENITRIFICATION
I.1. RAPPELS THEORIQUES
I.1.1. Les ractions d'ammonification
I.1.1.1. Equations chimiques
Ce sont les ractions de transformation de l'azote organique, c'est dire lie un radical
carbon, en azote ammoniacal. Elles sont de type hydrolyse, dsamination oxydative et
dsamination rductive.
La raction la plus connue est celle de l'hydrolyse de l'ure, source principale de la
pollution azote en eau rsiduaire urbaine.
NH
2
-CO-NH
2
+ H
2
O 2 NH
3
+ CO
2
Cependant, certains composs complexes tels les htrocycles azots peuvent tre peu
ou pas ammonifiables pendant le temps de sjour de l'eau rsiduaire dans l'ensemble
rseau station. Ils vont donc titrer en azote organique dans l'eau traite (ex : btane).
I.1.1.2. Micro-organismes impliqus
Ce sont surtout des ractions enzymatiques qui se produisent sous des conditions varies
en absence ou en prsence d'oxygne. Ces ractions ne sont que rarement limitantes sauf
pour des stations d'puration avec des temps de sjour trs courts comme les cultures
fixes.
I.1.2. Les ractions d'oxydation de l'ammoniaque
I.1.2.1. Equations chimiques
Raction de nitritation, oxydation de l'ammoniaque en nitrite.
55 NH
4
+
+ 5 CO
2
+ 76 O
2
C
5
H
7
NO
2
+ 54 NO
2
-
+ 109 H
+
Raction de nitratation, oxydation du nitrite en nitrate.
400 NO
2
-
+ 5 CO
2
+ NH
4
+
+ 195 O
2
+ 2 H
2
O C
5
H
7
NO
2
+ 400 NO
3
-
+ H
+
Ces ractions montrent que l'oxydation par voie biologique de l'ammoniaque en nitrate
consomme une trs forte quantit d'oxygne, libre des protons principalement en nitritation
et produit une trs faible synthse de biomasse.
Page 188 - Chapitre 9
I.1.2.2. Micro-organismes impliqus
Les micro-organismes responsables de l'oxydation de l'ammoniaque appartiennent deux
groupes trs spcifiques :
Nitrosobactries (genre Nitrosomonas) : oxydation de l'ammoniaque en nitrite;
Nitrobactries (genre Nitrobacter) : oxydation du nitrite en nitrate
Ces micro-organismes sont strictement arobies mais sont surtout caractriss par un
mtabolisme autotrophe vis--vis du carbone, c'est dire qu'ils synthtisent leur matire
vivante partir de carbone minral (carbonates).
Ce mtabolisme particulier entrane un temps de gnration (temps ncessaire au
doublement de la population) trs long (de l'ordre de 24 heures sous des conditions de
croissance optimales, contre 0,5 2 heures pour les bactries dgradant la pollution
carbone). Ce faible taux de croissance va impliquer des ges de boues levs au sein des
stations d'puration pour que les populations nitrifiantes se maintiennent.
Par ailleurs, ces micro-organismes sont msophiles (optimum vers 30C) et vont donc tre
extrmement sensibles aux baisses de temprature surtout en ce qui concerne leur vitesse
de croissance. Ainsi, une population prexistante pourra maintenir une activit nitrifiante
correcte lors d'une baisse de temprature (< 10C), par contre il est trs difficile de gnrer
de nouvelles bactries.
Le pH devra rester voisin de 7 et ncessitera, lorsque le pouvoir tampon de l'eau est
insuffisant (effluent industriel, terrain trs acide) une rgulation.
I.1.3. Les ractions de dnitrification
I.1.3.1. Equations chimiques
La dnitrification par voie biologique htrotrophe est une rduction du nitrate en azote
gazeux via une srie dintermdiaires :
NO
3
-
NO
2
-
NO N
2
O N
2
Les nitrates jouent le rle d'accepteur final dlectrons la place de l'oxygne. Cela reste
donc un mtabolisme arobie malgr la stricte absence d'O
2
dissous.
Ainsi la dnitrification htrotrophe ncessite pour se raliser la prsence de pollution
carbone qui peut tre puise directement dans l'eau brute ou ajoute (thanol, mthanol,
...). En outre, une dnitrification dite endogne peut se mettre en place base sur la seule
demande en oxygne des boues pour maintenir leur mtabolisme. Il est vident que cette
dernire voie se traduira par des cintiques beaucoup plus rduites que celles obtenues en
prsence dune source carbone, cependant, elle est d'une importance majeure dans
l'efficacit des stations d'puration.
Traitement de lazote et du phosphore - Page 189
I.1.3.2. Micro-organismes impliqus
Les micro-organismes impliqus dans la dnitrification appartiennent aux principaux
genres bactriens htrotrophes. Ainsi les genres Acinetobacter, Pseudomonas,
Alcaligenes, Bacillus ou Moraxella trs frquents dans les boues actives ont une activit
dnitrifiante.
Cette abondance de germes impliqus permet d'assurer la dnitrification dans une vaste
plage de conditions de l'environnement: :
temprature de 0 70 C;
pH de 6,5 8,5;
ge de boues variable;
La principale contrainte est lie au maintien d'une concentration en oxygne dissous nulle.
En effet, l'oxygne intervient la fois en comptition avec le nitrate comme accepteur final
d'lectron et en inhibiteur du systme nitrate respiratoire.
I.2. PRINCIPAUX SCHEMAS EPURATOIRES
I.2.1. Le procd avec N/DN en bassin unique
CLARIF AER SEQ
Figure 7-1 : Schma de principe dun procd avec N/DN en bassin unique.
La nitrification et la dnitrification se font alternativement par le squenage de l'aration. La
dissociation des fonctions brassage et aration est ici obligatoire pour optimiser la rduction
des nitrates. Le bassin unique doit tre dimensionn suffisamment pour permettre la
ralisation successive des deux ractions, c'est un bassin d'hydraulique mlange intgral
type bassin classique rectangulaire ou mieux chenal d'oxydation. Bien videment, une
rgulation des plages de fonctionnement des arateurs doit tre mise en place.
Page 190 - Chapitre 9
I.2.2. Le procd zone anoxie en tte
AER CLARIF ANOX
Figure 7-2 : Schma de principe dun procd avec zone danoxie en tte.
Le procd repose sur le concept de la zone anoxie en tte. Le principe est li au fait que la
dnitrification ncessite une source de carbone organique et que cette source est maximale
dans l'eau brute. Le nitrate est produit dans la deuxime zone are et implique donc un
recyclage pour tre introduit en zone anoxie. Le degr de dnitrification va donc tre
dpendant du taux de recyclage employ (un rendement de 100% entrane un recyclage
infini). Ce principe ne permet donc thoriquement, avec un recyclage maximum de 500%
(400% en liqueur mixte et 100% en recirculation de boues du clarificateur), que 83%
d'limination des nitrates. En fait, une partie de la dnitrification peut se faire dans le bassin
ar lors des squences d'arrt des arateurs. Ce complment de dnitrification endogne
permet, lorsque le dimensionnement est suffisant, d'obtenir des rendements suprieurs
90%. Cependant, plus la concentration en nitrates est faible et plus le flux de nitrates
recirculs vers la zone anoxie est faible. L'quilibre est donc assez dlicat trouver et il faut
prfrer pour les installations importantes le procd suivant.
I.2.3. Le procd zone endogne (trizones Degrmont)
AER CLARIF ANOX ENDO
Figure 7-3 : Schma de principe dun procd zone endogne.
Dans cette configuration, le bassin endogne est clairement identifi pour assurer la
dnitrification endogne complmentaire. Dans ce dernier ouvrage, l'aration est squence
pour permettre la rduction des nitrates sans risque d'anarobiose. Une rgulation base sur
une mesure du potentiel redox est donc obligatoire pour dterminer les plages d'aration.
Traitement de lazote et du phosphore - Page 191
I.3. ELEMENTS DE DIMENSIONNEMENT
I.3.1. Dcantation primaire
Une fraction des composs azots se trouve lie aux matires en suspension. L'tape de
dcantation primaire va donc permettre une certaine rtention de cette pollution. L'efficacit
sera essentiellement lie la vitesse applique sur le dcanteur primaire (taux de capture
des matires en suspension) avec cependant une classification du fait de la plus forte
prsence de matire organique sur les particules de faible granulomtrie.
La concentration en composs azots dans les boues issues de la dcantation primaire
est de l'ordre de 4% par rapport aux matires sches (MS).
I.3.2. Assimilation
L'assimilation concerne le pigeage des composs azots comme lments constitutifs de
la biomasse. La fraction de pollution limine par cette raction est fonction de la quantit de
boues produites. Ce sont donc les flux de DCO ou DBO
5
et de MES qui vont dterminer
l'efficacit d'limination.
L'assimilation reprsente un pourcentage d'azote par rapport la composition de la
matire vivante (C
5
H
7
NO
2
) de 10%. En fait, la moyenne classiquement releve dans les
boues urbaines est de 7% par rapport aux matires volatiles. Dans le cas d'une installation
avec dcanteur primaire, la capture des particules les plus minrales dans ce premier
ouvrage implique souvent une teneur rsiduelle en azote dans les boues biologiques
suprieure.
I.3.3. Nitrification
I.3.3.1. Conditions de nitrification
Dune part, les micro-organismes impliques dans les ractions de nitrification sont
caractriss par un temps de gnration lev dpendant de la temprature. Cela entrane
pour le dimensionnement de l'installation de traitement le respect d'un ge de boue minimum
qui peut tre approch par l'quation suivante :
A = 4,5 0,914
(T-20)
avec T : temprature en C.
D'autre part, l'oxydation de l'ammoniaque en nitrate ncessite une consommation
d'oxygne importante, les besoins spcifiques sont valus :
4,5 mg O
2
/ mg N-NH
4
oxyd
Page 192 - Chapitre 9
I.3.3.2. Cintiques de nitrification
En considrant les conditions prcdentes respectes, le dimensionnement doit permettre
des temps de sjour de l'effluent compatibles avec les cintiques de nitrification. Le calcul
final intgrera l'ensemble des contraintes en se basant sur l'tape limitante.
La cintique de nitrification est dpendante de la temprature et de la concentration en
pollution carbone soluble. Le dernier critre est li la comptition vis--vis de l'oxygne
des populations htrotrophes et nitrifiantes. Ce paramtre est trs important et implique lors
d'un dimensionnement d'une installation de calculer la fourniture instantane d'oxygne pour
rpondre en pointe aux besoins endognes, d'limination du carbone et de nitrification pour
viter une inhibition apparente de cette dernire raction par simple comptition.
I.3.4. Dnitrification
I.3.4.1. Conditions de dnitrification
En dehors de l'absence d'oxygne dissous, il n'y a pas de conditions particulires la
dnitrification. Les populations dnitrifiantes sont des bactries arobies htrotrophes sans
contraintes physiologiques particulires influant sur le dimensionnement.
Concernant le calcul de l'aration, la dnitrification agit comme une fourniture potentielle
d'oxygne avec un coefficient de restitution de 2,7 mg O
2
par mg de nitrate rduit. Ceci se
traduit, en fait, par une consommation de demande en oxygne de 2,7 mg de DBO
5
rapidement assimilable par mg de nitrate rduit.
I.3.4.2. Cintiques de dnitrification
Les cintiques de dnitrification sont les lments de calcul du dimensionnement. Ces
cintiques sont essentiellement dpendantes du carbone biodgradable prsent soit dans
l'eau brute (source exogne), soit dans les flocs (source endogne).
La cintique est relie :
la teneur en carbone assimilable pour la dnitrification exogne;
la respiration endogne pour la dnitrification endogne.
II. LA DEPHOSPHATATION BIOLOGIQUE
II.1. RAPPELS THEORIQUES
II.1.1. Le phosphore dans la cellule, stockage nergtique
Le phosphore reprsente pour la cellule le moyen de stocker de l'nergie sous forme de
liaisons P-P. Les accumulateurs classiques de ces liaisons sont les adnosines tri, di et
monophosphates (ATP, ADP et AMP). L'accumulation d'nergie lors des ractions du
mtabolisme bactrien se traduit donc par la production d'ATP. La mesure de l'ATP ou du
rapport entre les diffrentes formes d'adnosine permet d'valuer l'activit globale d'une
population de micro-organismes.
Traitement de lazote et du phosphore - Page 193
ATP + H
2
O ADP + Pi - 7,3 kcal / mole
ADP + H
2
O AMP + P - 7,3 kcal / mole
AMP + H
2
O Adnosine + P - 3,4 kcal / mole
1 kcal correspond l'nergie ncessaire pour augmenter d'un degr un litre d'eau.
Lorsqu'une cellule se trouve dans un environnement dfavorable, elle va consommer de
l'nergie pour maintenir correct son mtabolisme basal, cela se traduit par l'hydrolyse des
liaisons P-P et le relargage intra ou extra cellulaire d'orthophosphates. C'est typiquement les
phnomnes qui sont observs lorsqu'une boue active de station d'puration arobie se
retrouve en anarobiose lors de dpts dans les bassins ou de stockage dans un
clarificateur ainsi que dans les ouvrages d'paississement gravitaire de la filire de
traitement des boues.
II.1.2. Le mcanisme de la dphosphatation biologique
Le phosphore est un lment constitutif de la biomasse et reprsente en masse, suivant les
stations, de 1 2,5% des matires sches. La dphosphatation biologique entrane un
accroissement consquent de ce pourcentage jusqu' des valeurs de 5 6% et mme plus
lorsque les chiffres proviennent d'essais raliss l'chelle laboratoire.
Le phnomne de suraccumulation de phosphore dans les boues actives sans ajout de
ractifs a t observ dans les stations o existaient des alternances de phases anarobies
et arobies. Le schma puratoire qui a permis comporte, aprs un bassin ar avec zone
anoxie en tte, une zone d'anoxie de finition qui, en fonction des fluctuations de
concentrations en nitrate, se retrouve priodiquement en anarobiose.
Les analyses conduites sur les stations quipes de cette alternance de phases ont montr
que en zone anarobie le phosphate tait relargu dans le liquide interstitiel, tandis que en
zone are ce phosphore tait rabsorb par la boue. D'autre part, ce phnomne de
relargage s'intensifiait progressivement avec l'adaptation de la boue active et
corrlativement l'efficacit de l'limination du phosphore augmentait.
Les mcanismes classiques de relargage et de rabsorption des phosphates via l'ATP ne
permettaient pas d'expliquer les niveaux de concentration. En fait des recherches plus
pousses ont montr que les rserves en phosphore dans les bactries taient sous forme
de granules de polyphosphates (grain de volutine).
Les essais conduits pour accrotre le phnomne de relargage du phosphore dans la zone
anarobie ont permis de mettre en vidence une relation marque entre la concentration en
DCO introduite dans ce bassin et la quantit de phosphates libre dans le milieu.
Cette corrlation montre l'existence de ractions en anarobiose faisant intervenir la
pollution carbone. La poursuite des recherches a rvl que la nature de la pollution
carbone avait son importance et que les rsultats les plus importants concernant le
relargage du phosphore ont t obtenus avec des ajouts dactate.
Page 194 - Chapitre 9
Ce passage oblig vers l'actate implique que seule la partie utile de la DCO est celle
correspondant la partie la plus assimilable.
Des analyses du contenu des flocs bactriens ont montr la prsence de polymres
organiques type polyhydroxybutyrate dont la synthse se fait en zone anarobie. La raction
dans cette zone est donc, via lactate produit partir de la DCO assimilable, une synthse
de polymres intracellulaires. Cette synthse est possible grce l'utilisation des rserves
nergtiques incluses dans les liaisons P-P des polyphosphates.
Cependant, la suraccumulation du phosphore ne peut s'expliquer que par un gain
nergtique entre les ractions ralises en anarobie et celles des zones o l'oxygne est
disponible.
Une explication peut tre vue travers l'exemple du glucose :
fermentation lactique (anarobie) :
GLUCOSE + 2 ADP + 2 Pi 2 LACTATE + 2 H
2
O + 2 ATP - 32,4 kcal / mole;
fermentation thanolique (anarobie) :
GLUCOSE + 2 ADP + 2 Pi 2 ETHANOL + 2 CO
2
+ 2 ATP - 41,9 kcal / mole;
respiration (arobie) :
GLUCOSE + 6 O
2
+ 36 ADP + 36 Pi ---> 6 CO
2
+ 42 H
2
O+ 36 ATP - 413 kcal / mole
L'nergie libre lors de la dgradation arobie du glucose est dix fois suprieure celles
obtenues dans les fermentations anarobies. En prenant comme base la synthse en
anarobie et la dgradation en arobie, nous pouvons voir que la production d'nergie de
dgradation est trs suprieure la dpense de synthse. La rptition de ce mcanisme
permet terme le stockage excdentaire des phosphates intracellulaires.
Les diffrentes tapes de la dphosphatation biologique sont donc :
dans la zone anarobie :
production d'actate partir de la fraction facilement assimilable du carbone de
l'eau brute (bactries arobies anarobies facultatives);
synthse partir de l'actate de polymres type polyhydroxybutyrate et stockage
intracellulaire (bactries dphosphatantes vraies);
consommation de l'nergie stocke sous forme de polyphosphates pour la
raction prcdente avec libration d'orthophosphates (bactries
dphosphatantes vraies);
dans la zone anoxie ou are :
oxydation des polymres organiques avec production d'nergie stocke par la
synthse des polyphosphates (bactries dphosphatantes vraies)
Traitement de lazote et du phosphore - Page 195
La dphosphatation biologique est donc lie l'mergence de populations bactriennes
possdant un mtabolisme capable d'utiliser les conditions particulires d'une alternance de
conditions anarobie et arobie pour stocker de l'nergie. Cette facult leur permet d'tre
plus comptitives que les bactries classiques dans les schmas zone anarobie contrle
en tte, alors que sous des conditions d'aration ou d'anoxie, elles restent trs minoritaires
dans les boues actives.
Les populations dphosphatantes appartiennent aux genres Acinetobacter pour la plupart et
Moraxella. Leurs caractristiques physiologiques restent celles, classiques, des germes
htrotrophes (large gamme de temprature, pH voisin de la neutralit). Leur dominance
dans la boue active ne peut donc tre obtenue que par le biais de la zone anarobie.
II.1.3. Les facteurs d'importance
La description des mcanismes impliqus dans la dphosphatation biologique permet
d'extraire les lments qui vont avoir une action prpondrante sur l'efficacit du processus.
II.1.3.1. Le carbone assimilable
Le carbone assimilable est le point cl du processus puisque c'est le dclencheur de tous les
mcanismes de synthse des polymres organiques. La concentration en carbone
assimilable dans l'eau brute va donc directement dfinir la quantit maximale potentiellement
liminable de phosphates par voie biologique.
Il sera donc impratif de limiter toutes les ractions parasites susceptibles de consommer
cette pollution assimilable. Outre le fait d'viter une aration trop intense de l'affluent avant
son admission dans le bassin biologique anarobie, un des problmes majeurs rsoudre
est l'absence de nitrate dans les retours de boues du clarificateur.
Il est cependant important de noter que les ractions qui ont lieu en anarobie n'liminent
pas la pollution organique facilement assimilable (en dehors d'une faible fraction rejete sous
forme de CO
2
) mais la transforment en polymres intracellulaires qui vont tre disponibles
pour les ractions de dnitrification en aval. Le mcanisme de suraccumulation du
phosphore peut en effet se faire sous des conditions anoxies, les bactries dphosphatantes
sont donc aussi dnitrifiantes.
Le nitrate doit donc tre maintenu des teneurs les plus basses possibles dans l'eau traite
de la station d'puration de faon ce que la concentration rsiduelle dans les boues
recircules vers la zone anarobie n'inhibe pas les ractions de relargage du phosphate.
II.1.3.2. Les conditions doxydorduction
La prsence d'un rsiduel d'oxygne dans l'affluent o la prsence de nitrates en
recirculation ont une consquence supplmentaire la consommation de carbone facilement
assimilable : c'est la remonte du potentiel doxydorduction dans la zone dcrite comme
anarobie. Cette remonte est videmment d'autant plus marque que la teneur en pollution
carbone facilement assimilable est faible. Or, le maintien des conditions anarobies est
obligatoire pour que les ractions de gense de l'actate et de stockage du
Page 196 - Chapitre 9
polyhydroxybutyrate aient lieu. L'anarobiose pour la dphosphatation biologique se dfini
dans l'intervalle entre la dnitrification et la sulfato rduction.
Les ractions de rabsorption du phosphore sont lies un mtabolisme arobie impliquant
un transfert d'oxygne vers les bactries. Cela suppose donc un potentiel doxydorduction
gal au moins aux conditions de dnitrification (> +150 mV/EHN).
II.1.3.3. Les temps de sjour
Les ractions biologiques respectent une cintique (vitesse de raction) dpendante de
l'activit des micro-organismes et de la biodgradabilit des substrats. L'activit biologique
est la rsultante de la composition moyenne de l'affluent et des conditions de fonctionnement
de l'installation. Cela implique qu'une variation de biodgradabilit de la pollution carbone
entre n'aura pas un impact facilement prvisible sur la cintique globale car celui-ci sera li
aux tats de fonctionnement antrieurs.
La dtermination des temps de sjour respecter dans chaque bassin est donc
prpondrante pour assurer un optimum biologique mais trs difficile prvoir.
II.2. PRINCIPAUX SCHEMAS EPURATOIRES
II.2.1. Le procd avec N/DN en bassin unique
ANA CLARIF AER SEQ
Figure 7-4 : Schma de principe dun procd avec N/DN en bassin unique.
Une zone anarobie est simplement place en tte de la chane de traitement permettant la
nitrification dnitrification en un seul bassin. En dehors de la zone anarobie, la description
du procd est identique celle dveloppe dans le chapitre azote. Ainsi, le bassin ar
peut tre d'hydraulique mlange intgral type bassin classique rectangulaire ou mieux
chenal d'oxydation circulaire ou oblong.
II.2.2. Le procd PHOREDOX modifi
ANA AER CLARIF ANOX
Figure 7-5 : Schma de principe dun procd PHOREDOX modifi.
Traitement de lazote et du phosphore - Page 197
Le procd reprend donc le concept classique de la nitrification dnitrification avec zone
anoxie en tte avec en amont la zone anarobie. La simplicit de ce schma et sa
cohrence avec les procds existants a fait de lui le plus employ, notamment en France
o il a t choisi pour l'ensemble des premires installations. Sa principale carence est lie
au concept mme de la zone anoxie en tte qui ne permet pas toujours de maintenir des
concentrations rsiduelles en nitrates suffisamment basses et entrane donc des risques de
retour en anarobiose.
II.2.3. Le procd zone endogne (trizones Degrmont)
ANA AER CLARIF ANOX ENDO
Figure 7-6 : Schma de principe dun procd zone endogne.
Dans cette configuration, la concentration en nitrate est rduite en amont du clarificateur par
passage dans un bassin d'affinage o l'aration est squence pour permettre la ralisation
d'une dnitrification endogne sans risque d'anarobiose. Une rgulation base sur une
mesure redox est ici obligatoire pour dterminer les plages d'aration. Les avantages d'un tel
concept sont vidents puisqu'il cumule la minimisation des nitrates non seulement dans la
recirculation des boues mais aussi dans l'effluent trait.
II.3. ELEMENTS DE DIMENSIONNEMENT
II.3.1. Dcantation primaire
La dcantation primaire est proscrire compltement dans les schmas de dphosphatation
biologique. La rtention de la pollution carbone particulaire est en effet prjudiciable aux
mcanismes de la suraccumulation du phosphore et aux performances de la dnitrification.
L'assimilation abusive de la fraction facilement biodgradable la partie soluble de la DBO
5
(galit quantitative et non qualitative) a entran de telles erreurs de conception.
II.3.2. Zone anarobie
Le dimensionnement de cette zone reste le point cl de la dphosphatation biologique. Le
temps de sjour dans cette zone doit tre suffisant pour permettre la ralisation des
ractions anarobies de la dphosphatation biologique, tout en vitant d'initier des
perturbations dans les quilibres microbiologiques (bactries filamenteuses) ou dans les
transformations biochimiques de la pollution.
Page 198 - Chapitre 9
Le calcul du volume de la zone anarobie se fera sur le dbit moyen temps sec et en
considrant la pollution moyenne. Le temps de sjour rel en anarobiose tient compte de
l'ensemble des dbits transitants dans la zone (eau brute et recirculation des boues), les
valeurs sont donnes en considrant une recirculation de 100%. Les dernires
exprimentations sur site montrent qu'un temps de sjour rel de 2 heures (soit 4 heures par
rapport au dbit moyen de temps sec) permet d'assurer dans le cas des eaux rsiduaires
urbaines classiques les performances optimales en dphosphatation biologique.
II.3.3. Age des boues
Il n'y a pas de contraintes particulires pour la dphosphatation biologique, les populations
impliques sont slectionnes par la prsence d'une zone anarobie et non pas par un ge
de boues spcifique. Cependant, des ges de boues trop importants semblent affecter les
performances, il est donc judicieux de dimensionner sur l'ge de boues critique de l'tape
limitante : la nitrification.
II.3.4. Elimination de l'azote
A priori, il n'y a pas d'interfrences majeures entre la dphosphatation biologique et
l'limination de l'azote en termes de dimensionnement. La zone anarobie n'affecte pas l'ge
de boue critique pour la nitrification. Cependant, les prvisions de l'efficacit de la zone
anoxie devront tenir compte d'une rduction d'environ 10% du carbone assimilable en
dnitrification (bilan des transformations ralises en anarobiose).
Par contre, les conceptions d'installations incluant la dphosphatation biologique doivent tre
bases sur une limination quasi totale des nitrates avant retour dans la zone anarobie.
C'est en effet le point critique pour assurer des performances maximales en
dphosphatation. Cette contrainte implique un dimensionnement pour une eau traite de
qualit NGL
2
(plus prcisment N-NO
3
< 5 mg/l).
Le dimensionnement pour atteindre NGL
2
est bas sur une dnitrification complmentaire
endogne. Cela implique pour le bassin en amont du clarificateur une dissociation brassage
aration permettant une relle optimisation des ractions de dnitrification lors des arrts de
l'aration (bassin unique pour les petites installations ou zone endogne du procd
trizones).
II.3.5. Clarificateur
Les clarificateurs cumulent les fonctions de sparation flocs/eau traite et d'paississement
de la boue pour respecter l'quilibre massique.
Les schmas avec dphosphatation biologique sont plutt caractris par une bonne
dcantabilit des boues et ne modifient pas les critres de dimensionnement de ces
ouvrages pour cette premire fonction.
Par contre, la contrainte principale reste d'viter les priodes d'anarobiose des boues en
fond de clarificateur. Cela implique donc une bonne homognit de la reprise des boues et
la possibilit de pouvoir moduler le dbit de recirculation des boues pour maintenir un temps
de sjour minimum en fond d'ouvrage.
Traitement de lazote et du phosphore - Page 199
Les critres de choix sont donc :
temps de rotation du pont infrieur une heure pour un radial (2 heures pour un
diamtral);
mode de reprise des boues par tubes suceurs;
possibilit de driver tout ou partie des boues recircules vers une zone situe en
aval de celle d'anarobiose.
II.3.6. Traitement des boues
La filire de traitement des boues ne doit possder aucune tape susceptible de crer un
temps de sjour suprieur deux heures en anarobiose. Stockeurs et paississeurs
gravitaires sont prohiber. Le non respect de cette clause implique la mise en oeuvre d'un
traitement par prcipitation physico-chimique de tous les retours en tte.
Les techniques retenir sont donc l'paississement sur table d'gouttage et la flottation.
Cependant, la table d'gouttage prsente une contrainte de concentration minimale
d'alimentation en boue (> 8 g/l) qui peut tre contradictoire celle dicte par les
mcanismes de dphosphatation biologique (temps de sjour des boues en clarification
minimal). Le flottateur, par contre, n'a pas cet inconvnient puisque son alimentation est
directement connecte au bassin d'aration.
III. ELEMENTS D'UNE GESTION AUTOMATISEE
La complexit des ractions mises en jeu pour l'limination des pollutions carbones,
azotes et phosphores et surtout les interfrences entre les diffrents ouvrages d'puration
rendent obligatoire sur ce type d'installation la prsence d'automates capables d'aider la
gestion des ouvrages. Sans rentrer dans les dtails techniques de ces automates, il est
indispensable de dcrire leurs fonctionnalits.
Les deux principaux rles de ces d'automates sont d'assurer, d'une part que les diffrents
bassins ractionnels sont dans les meilleurs conditions possibles pour que les ractions
biologiques se ralisent et d'autre part que l'avancement de ces ractions se fait de manire
satisfaisante.
III.1. MAINTIEN DES CONDITIONS OPTIMALES
III.1.1. Conditions anarobies
La dfinition des conditions anarobies au sens de la dphosphatation biologique se situe
dans l'intervalle dont la borne suprieure est la fin de la dnitrification et la borne infrieure
est l'amorce de la sulfato-rduction, soit entre +100 et -200 mV/EHN. L'valuation du degr
d'anarobiose peut donc se faire par la mesure du potentiel doxydorduction.
Page 200 - Chapitre 9
III.1.2. Conditions de nitrification / dnitrification
L'objectif de l'automatisation sera de faire en sorte que soient maintenus au sein de
l'installation les taux les plus bas en nitrate. Dans la majorit des cas, cet objectif sera sous-
tendu par une conception de station permettant une dnitrification complmentaire endogne
par un squenage de l'aration dans le bassin biologique. La gestion de ce squenage et
le contrle des conditions d'anoxie sont possibles travers le suivi des variations du
potentiel doxydorduction.
D'ores et dj, un logiciel dvelopp par le C.I.R.S.E.E. est capable de mener bien cette
tche : OGAR (Optimisation de la Gestion de l'Aration par le Redox). Il a pour fonction de
distribuer les plages de marche et d'arrt de l'aration sur la journe en rapport avec la
demande biologique en oxygne.
Ceci est d'autant plus important que, en considrant de faon globale la qualit de
l'effluent, la raction biologique la plus difficile rcuprer est la nitrification. Il devient
impratif de protger cette raction, mme au dtriment de la dphosphatation biologique,
lors de circonstances exceptionnelles.
III.2. REGULATION ET RESPECT DE LA NORME
III.2.1. Rgulation par prdiction ou anticipation
Ce mode de rgulation suppose de s'appuyer sur les modles de prdiction bass au
minimum sur la connaissance de la pollution carbone de l'affluent (comptition vis vis de
la nitrification, cintique de dnitrification, performance de la dphosphatation biologique). La
mesure en continu de ce paramtre est difficilement ralisable sous des conditions de cot
et de maintenance raisonnables (DCOmtre, DBO soluble assimilable, COTmtre, etc..).
L'utilisation de turbidimtres pour valuer indirectement cette pollution est, par contre, une
voie intressante mais en tenant compte du fait que la corrlation obtenue est propre
chaque site et diffrente par temps sec et pluvieux.
III.2.2. Rgulation par dosage aval
L'assurance du respect de la norme ne peut tre raliste que par un suivi en temps rel de la
concentration du polluant dans le rejet. Ceci est possible grce aux analyseurs
d'ammoniaque, de nitrate ou de phosphate en continu. Ces appareils restent
malheureusement chers et surtout impliquent un suivi serr notamment pour l'unit de
filtration prcdant le dosage proprement dit par colorimtrie.
La mesure directe de la concentration rsiduelle permet pour le phosphore par exemple
d'asservir la pompe d'injection de ractif pour complter l'enlvement par voie biologique
mais reste dlicate utiliser dans les domaines biologiques.
Chapitre 10
LES CULTURES FIXEES EN
TRAITEMENT DEAUX RESIDUAIRES
J. M. AUDIC
Les cultures fixes en traitement des eaux rsiduaires - Page 202
SOMMAIRE
I. INTRODUCTION ............................................................................................................................................... 203
II. LES PROCEDES A RUISSELLEMENT.......................................................................................................... 204
II.1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT..................................................................................................................... 204
II.2. LES MATERIAUX SUPPORTS ............................................................................................................................ 205
II.3. APPLICATIONS INDUSTRIELLES ...................................................................................................................... 205
II.3.1. Lits bactriens remplissage traditionnel................................................................................................ 205
II.3.2. Lits bactriens remplissage plastique.................................................................................................... 205
III. LES DISQUES BIOLOGIQUES ................................................................................................................... 206
III.1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT..................................................................................................................... 206
III.2. LES MATERIAUX SUPPORTS ............................................................................................................................ 207
III.3. APPLICATIONS INDUSTRIELLES ...................................................................................................................... 207
IV. LES FILTRES A MATERIAUX FINS ......................................................................................................... 208
IV.1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT..................................................................................................................... 208
IV.2. LES MATERIAUX SUPPORTS ............................................................................................................................ 208
IV.3. APPLICATIONS INDUSTRIELLES ...................................................................................................................... 208
V. LES BIOFILTRES .............................................................................................................................................. 208
V.1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT..................................................................................................................... 208
V.2. LES MATERIAUX SUPPORTS ............................................................................................................................ 210
V.3. APPLICATIONS INDUSTRIELLES ...................................................................................................................... 211
V.3.1. Biofiltres avec oxygnation indirecte........................................................................................................ 211
V.3.2. Biofiltres avec aration directe dans la masse ......................................................................................... 212
VI. LES SUPPORTS IMMERGES...................................................................................................................... 214
VI.1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT..................................................................................................................... 214
VI.2. LES MATERIAUX SUPPORTS ............................................................................................................................ 215
VI.3. APPLICATIONS INDUSTRIELLES ...................................................................................................................... 215
VI.3.1. Support fix .......................................................................................................................................... 215
VI.3.2. Lit mobile.............................................................................................................................................. 216
VII. LES LITS FLUIDISES ................................................................................................................................... 217
VII.1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT..................................................................................................................... 217
VII.2. LES MATERIAUX SUPPORTS ............................................................................................................................ 217
VII.3. APPLICATIONS INDUSTRIELLES ...................................................................................................................... 217
VIII. CONCLUSION................................................................................................................................................ 218
Page 203 - Chapitre 10
I. INTRODUCTION
L'puration biologique des eaux rsiduaires urbaines et industrielles peut s'effectuer suivant
deux grands types de procds : les procds dits " cultures libres" et les procds dits "
cultures fixes". La diffrence fondamentale entre ces deux procds rside dans le fait que pour
les cultures libres, la biomasse puratoire, prsente sous forme de flocons de densit trs proche
de l'eau, doit tre spare de l'eau traite par dcantation statique ou acclre puis recycle en
partie dans le bassin biologique (figure 8-1), alors que pour les cultures fixes, la biomasse reste
retenue sur le support indpendamment du flux de liquide traiter.
Dans le cas des procds cultures libres, le schma de principe, toujours le mme dans les
grandes lignes, est le suivant :
REACTEUR BIOLOGIQUE
CULTURES LIBRES
SEPARATION
RECYCLAGE DES BOUES BOUES EXCES
EAU BRUTE EAU
TRAITEE
Figure 8-1 : Schma de principe dunprocd cultures libres.
L'effluent traiter est mis en contact avec les bactries puratoires dans le bassin biologique.
Dans ce racteur, les micro-organismes sont maintenus en suspension en mme temps qu'est
assure gnralement une fourniture d'oxygne. Il y a alors consommation des pollutions
carbones et ventuellement azotes ce qui se traduit d'une part par la satisfaction des besoins
nergtiques des micro-organismes prsents et d'autre part par la production de boues en excs.
Une fois atteint le degr d'puration voulu, il est alors ncessaire de sparer la totalit de la masse
bactrienne dans l'ouvrage de clarification et les boues recueillies sont en partie recycles dans le
racteur biologique pour y maintenir une activit constante et en partie vacues pour viter un
accroissement de la concentration.
Il est clair que le bon fonctionnement d'un tel procd dpend directement des performances de
l'ouvrage de sparation. Ainsi, l'ensemble de la masse bactrienne devant transiter dans cet
ouvrage de clarification, les concentrations en boues actives seront limites quelques grammes
par litre (< 5 g/l), ce qui empchera d'augmenter les charges purer. De plus, ce maximum de
concentration implique une relation directe entre l'ge de la boue active et le volume des bassins
activits biologiques. L'limination de polluants type ammoniaque qui ncessite la contribution de
micro-organismes dveloppements lents ne pourra se faire que dans des ouvrages de taille
importante avec des temps de sjour hydrauliques de l'ordre de la journe.
Cette limite, inhrente aux procds cultures libres, a entran de nombreuses recherches
pour accrotre la quantit de biomasse active au sein du bassin ractionnel. Nous allons voir que
la mise en oeuvre de matriaux comme supports de fixation de la biomasse puratoire permet de
s'affranchir de cette limite de concentration et de dissocier compltement le temps de sjour
hydraulique de l'eau traiter et l'ge de la boue. Cela permet aussi, pour certains procds de
cumuler une fonction de dpollution biologique et une fonction de filtration.
Nous verrons que l'activit biologique des cultures fixes est directement lie la surface
disponible de fixation par m
3
de racteur. Cet objectif de maximiser la surface d'attachement doit
cependant tre tempr par les contraintes hydrodynamiques des racteurs dvelopps.
Les cultures fixes en traitement des eaux rsiduaires - Page 204
II. LES PROCEDES A RUISSELLEMENT
II.1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Les procds ruissellement constituent la rponse technologique la plus simple au concept
des cultures fixes. Ce type de procd a vu le jour en mme temps que ceux boues actives,
dans certains pays comme l'Angleterre, il a mme t choisi prfrentiellement. Son domaine
d'application couvre aussi bien les eaux rsiduaires urbaines que les effluents industriels mais
reste trs li au choix d'un matriau support adquat.
Le liquide traiter ruisselle sur le support sur lequel se dveloppe progressivement la biomasse
puratoire. La dispersion de l'eau traiter en surface du lit est ralise par un dispositif tournant
en contre-raction des jets d'eau. L'aration se fait par ventilation naturelle travers la masse
filtrante, le transfert d'oxygne se ralise travers le film liquide en ruissellement. Cela suppose
donc un coefficient de vide important dans le racteur et conditionne la fois le type de matriau
support utilis et le mode de fonctionnement en lit merg. L'efficacit d'un tel racteur va
dpendre de la surface d'change disponible, classiquement les valeurs rencontres varient de 50
200 m
2
/m
3
.
Une des grandes contraintes de fonctionnement est lie aux risques de colmatage de ces
procds. Les eaux traiter vhiculent des matires en suspension et des graisses qui risquent
terme de provoquer un blocage de la porosit interne du racteur. Cela impose donc la
construction d'un prtraitement efficace et d'un dcanteur primaire en amont du lit. De plus, la
boue produite lors des ractions de dpollution biologique acclre ce processus de colmatage. La
solution consiste appliquer des vitesses de passage de l'eau qui permettent un auto-curage du
racteur. Ces dbits impliquent parfois des recyclages du liquide qui se font aprs transit dans un
dcanteur pour viter le retour en surface de racteur des matires en suspension vacues.
EAU BRUTE
RECIRCULATION
MATERIAU
SUPPORT
EAU
TRAITEE
PRETRAITEE
Figure 8-2 : Schma de principe dun procd ruissellement.
Lors de l'exploitation de tels ouvrages, il est important de tenir compte de leur sensibilit aux
baisses de temprature et des risques d'odeurs lis aux risques de fermentation dans les zones de
faibles changes (colmatage progressif).
Page 205 - Chapitre 10
II.2. LES MATERIAUX SUPPORTS
Les matriaux supports doivent rpondre un critre impratif, celui d'un coefficient de vide trs
important pour minimiser les risques de colmatage.
A l'origine, les lits bactriens taient remplis par du matriau vrac naturel de type lave
volcanique (pouzzolane), coke mtallurgique ou cailloux siliceux concasss de granulomtrie
moyenne comprise entre 40 et 80 mm et de coefficient de vide voisin de 50%. Ces remplissages,
rservs uniquement au traitement des eaux rsiduaires urbaines, sont de moins en moins
employs en raison essentiellement des risques de colmatage de la masse filtrante et des faibles
hauteurs d'ouvrages (maximum 3 mtres) lies au poids du matriau qui conduisent des
surfaces au sol importantes. D'autres matriaux naturels plus lgers sont utiliss comme les "red
wood" (Australie, Nouvelle Zlande).
Actuellement, les supports plastiques vrac (anneaux, ...) ou ordonns (tubes cloisonns,
structure en nid d'abeille) sont largement utiliss, ils prsentent des coefficient de vide suprieur
90%. Ces derniers respectent donc parfaitement les contraintes de colmatage et sont employs en
garnissage pour des lits bactriens utiliss en prtraitement d'effluents industriels. La hauteur de
filtre peut atteindre 6 12 mtres.
II.3. APPLICATIONS INDUSTRIELLES
II.3.1. Lits bactriens remplissage traditionnel
Suivant la charge volumique applique, on distingue les lits forte charge et les lits faible
charge. Pour les eaux rsiduaires urbaines, les caractristiques de dimensionnement sont les
suivantes :
Faible charge Forte charge
DBO
5
(kg/m
3
.j) 0,08 0,15 0,7 0,8
Charge hydraulique (m
3
/m
2
.h) < 0,4 > 0,7
Recirculation chasses > 200%
Performances 80 90% 70%
Tableau 8-1 : Critres de dimensionnement des lits bactriens remplissage traditionnel.
Pour les lits forte charge, la prsence d'un clarificateur en sortie et la stabilisation des boues
produites en excs sont ncessaires.
II.3.2. Lits bactriens remplissage plastique
Etant peu sensible au colmatage, ces procds sont mieux adapts au traitement des eaux
rsiduaires industrielles, ils peuvent travailler sous des charges volumiques leves comprises
entre 1,5 et 5 kg de DBO
5
par m
3
et par jour, voire plus. Des recirculations de l'ordre de 500
600% sont ncessaires pour minimiser les colmatages hydrauliques.
Les cultures fixes en traitement des eaux rsiduaires - Page 206
Dans ces conditions, le rendement d'limination de la DBO
5
n'est pas suffisant pour produire un
effluent de qualit conforme aux normes en vigueur, car il oscille entre 50 et 80% suivant le type
d'eau traiter et la charge volumique adopte. Le lit bactrien remplissage sera donc
frquemment suivi par un traitement conventionnel type boues actives.
Exemple de dimensionnement : station d'puration des eaux de la brasserie d'OBERNAI
(DEGREMONT).
Le dbit traiter est de 10 000 m
3
/j et la charge polluante admise est value 14 500 kg
DBO
5
/j.
Le schma d'puration retenu est le suivant :
prtraitement :
dgrillage + tamisage;
bassin d'homognisation + neutralisation;
lit bactrien :
caractristiques du racteur : surface : 500 m
2
, hauteur : 6 m;
matriau de remplissage ordonn en PVC : 100 m
2
/m
3
;
charge volumique : 5 kg DBO
5
/m
3
.j
charge hydraulique : 3 m
3
/m
2
.h (recyclage)
dcanteur intermdiaire : diamtre 25 m;
traitement biologique final : moyenne charge boues actives.
L'ensemble lit bactrien et dcanteur intermdiaire assure 50% de l'limination de la DBO
5
.
III. LES DISQUES BIOLOGIQUES
III.1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le principe consiste en l'utilisation de disques tournant autour d'un axe horizontal et baignant en
partie dans l'eau traiter. De par la rotation, la biomasse fixe sur les disques se trouve
alternativement en contact avec l'eau traiter et l'oxygne de l'air.
DISQUES
EN ROTATION
BASSIN BIOLOGIQUE
PRETRAITEMENT CLARIFICATION
Figure 8-3 : Schma de principe dune unit de traitement par disques biologiques.
Page 207 - Chapitre 10
Comme dans le cas du lit ruissellement la biomasse se dveloppe sur le support et le transfert
d'oxygne se fait directement travers la couche liquide. La rgulation de l'paisseur du biofilm se
fait naturellement ds que l'assise biologique en contact avec le support passe sous des
conditions anarobies lies une limitation de transfert de l'oxygne. Le dcrochage de la boue en
excs ncessite la prsence en aval d'un dispositif de clarification de l'eau traite.
La vitesse de rotation de ces disques (1 2 tours par minute) ne permet pas de gnrer des
nergies de circulation capables de maintenir en suspension des matires solides. Le risque de
dpts en fond de bassin oblige donc un prtraitement de l'eau traiter par dcantation primaire
et empche la recirculation de la boue.
III.2. LES MATERIAUX SUPPORTS
Les disques sont raliss en polystyrne, PVC ou feuilles de polythylne, leur diamtre est
gnralement compris entre 2 et 3 m. Les disques utiliss sont plats ou prsentent des
ondulations ou une rugosit cre par des reliefs de faon accrotre la surface de fixation de la
biomasse. Ils sont espacs de 2 3 cm et leur vitesse de rotation est de 1 2 tours par minute.
Les surfaces sont de 50 200 m
2
/m
3
de disque.
Rcemment de nouvelles configurations pntrent le march des biodisques. Ce sont des
structures de type cage remplies de matriaux plastiques vracs (anneaux, selles, ...) identiques
ceux employs pour les lits ruissellements. La mise en oeuvre est tout fait comparable celle
effectue avec les disques classiques.
III.3. APPLICATIONS INDUSTRIELLES
Les disques biologiques peuvent tre appliqus pour l'puration des eaux rsiduaires urbaines
et industrielles et permettent l'limination des pollutions carbones et azotes. Elles ncessitent
obligatoirement un prtraitement par dcantation primaire. Suivant que les disques sont immergs
ou mergs, le fonctionnement sera en mode arobie ou anarobie. Cependant, ces technologies
sont souvent limites des stations de taille rduite et le niveau de qualit en sortie n'est pas
toujours compatible avec des rejets en milieu sensible.
La mise en oeuvre requiert une couverture par un btiment et comporte le plus souvent deux
tages spars par un dversoir.
En eau rsiduaire urbaine, les charges appliques ce type d'installation ne sont pas calcules
par unit de volume de racteur mais par unit de surface de disque. Elles ne dpassent pas
gnralement 25 30 g de DBO
5
par m
2
de surface de disque et sont plus proches de 15 g de
DBO
5
par m
2
.
La nitrification partielle sur disques biologiques est possible condition de se situer une
charge en DBO
5
infrieure 10 g par m
2
de disque et par jour. Pour une ERU classique, aprs
dcantation primaire, cela correspond une fourchette de dbits allant de 50 75 litres par m
2
de
disque et par jour. Les ralisations industrielles qui utilisent cette technique, sont conues avec
plusieurs tages de disques en srie, ce qui semble permettre une meilleure efficacit par
slection de la flore fixe.
Les cultures fixes en traitement des eaux rsiduaires - Page 208
IV. LES FILTRES A MATERIAUX FINS
IV.1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Ces racteurs ont t dvelopps pour rpondre l'limination des matires en suspension. Ils
sont particulirement utiliss pour le traitement de l'eau potable ou pour l'affinage de l'eau
rsiduaire pure avant rejet en milieu sensible. Contrairement aux lits bactriens, le colmatage
est ici logique puisque reli une bonne rtention des matires en suspension. Leur exploitation
ncessite donc des squences de lavage pour vacuer les matires captures et rcuprer la
capacit de stockage du filtre.
L'eau traiter traverse en flux ascendant ou descendant la masse filtrante. La prsente d'une
pollution dissoute rsiduelle ainsi qu'une teneur en oxygne non nulle entrane le dveloppement
d'une biomasse puratoire sur le matriau. Cette biomasse reste limite mais permet nanmoins
une activit biologique complmentaire.
IV.2. LES MATERIAUX SUPPORTS
Les matriaux supports sont d'origine minrale et prsentent une taille effective de quelques
millimtres (1 3). Ce sont par exemple des sables, des argiles cuites ou du charbon actif
granulaire. Ils sont choisis pour assurer un maillage suffisamment fin pour la rtention maximale
des matires en suspension tout en prsentant des caractristiques de non friabilit et de densit
compatibles avec les nergies de lavage mettre en oeuvre.
IV.3. APPLICATIONS INDUSTRIELLES
Les applications industrielles sont multiples mais rserves au traitement des eaux trs
faiblement charges (traitements tertiaires des eaux rsiduaires, traitement des eaux potables). La
fonctionnalit premire tant la rtention des matires en suspension, le dimensionnement et
notamment la vitesse de passage de l'eau dans la masse filtrante seront fonction de l'objectif de
qualit et de la teneur en solides dans l'eau traiter.
Les vitesses de filtration seront de quelques mtres par heure une dizaine. Les quantits
limines de pollution soluble seront directement lies la teneur en oxygne dissous, c'est dire
au maximum de 10 mg/l pour la DBO
5
et de 2,5 mg/l pour la pollution ammoniacale.
V. LES BIOFILTRES
V.1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Les biofiltres cumulent les fonctions de filtration et d'puration biologique. Ils doivent donc
rpondre une activit biologique maximale (grande surface de fixation) et un fort pouvoir de
rtention des matires en suspension. Cela implique donc des supports granulaires fins.
Le phnomne de filtration associ la production de biomasse en excs due la dpollution
implique un encrassement progressif du biofiltre et la ncessit de recourir des squences de
lavage pour rcuprer l'intgrit du procd. Cependant, la frquence des lavages ne devant pas
perturber l'activit biologique, la qualit de l'eau admise (prtraitement), le mode de
fonctionnement du racteur (e.g. la vitesse de passage de l'eau) et le choix du matriau support
devront respecter un compromis.
Page 209 - Chapitre 10
AIR
AIR
EAU
oxygnation indirecte dans une boucle de recyclage oxygnation directe dans la masse
filtrante
Figure 8-4 : Schma de principe du dispositif daration des biofiltres.
Par ailleurs, le principe de la dpollution par voie arobie implique le transfert de quantits
importantes d'oxygne trs suprieures sa concentration de saturation dans l'eau. Cette
demande pourra tre satisfaite par deux principes :
oxygnation indirecte dans une boucle de recyclage;
oxygnation directe dans la masse filtrante.
Un cas particulier de biofiltre o l'aration n'est pas ncessaire est la dnitrification des eaux
potables.
Les alimentations en fluides peuvent combiner tous les cas possibles :
eau ascendant / air ascendant;
eau descendant / air ascendant;
eau descendant / air descendant (biofiltre ruissellement avec ventilation force).
Quelque soit le mode d'introduction de l'eau traiter, le dispositif de distribution de l'eau et le fait
que le biofiltre fonctionne en encrassement obligent un prtraitement pouss en amont. Ce
prtraitement consiste en une phase de dcantation amliore (biosorption ou coagulation-
floculation chimique) qui limine la fraction particulaire de la pollution. Cette fraction, si elle tait
admise sur le biofiltre, impliquerait un colmatage rapide des couches proches de la distribution,
donc des squences de lavage trs frquentes et une forte altration des performances
biologiques.
Le fonctionnement des biofiltres entrane terme un colmatage invitable qui provoque un
accroissement de la perte de charge dans le racteur. Les squences de lavage sont donc les
lments dterminants de la bonne marche de ces biofiltres. Un mauvais lavage entrane non
seulement une diminution de l'efficacit globale du biofiltre (puration biologique et filtration) mais
aussi la persistance de zones de faibles changes avec des risques progressifs d'anarobiose qui
peuvent gnrer des dysfonctionnements plus graves.
Les cultures fixes en traitement des eaux rsiduaires - Page 210
Le dmarrage de la phase de lavage est dclench soit sur une base de temps fixe par des
essais prliminaires, soit par une valeur seuil de la perte de charge au sein du filtre. Ce dernier
paramtre permet d'valuer aussi l'efficacit du lavage par le retour ou non la valeur d'origine.
Le lavage se dcompose en plusieurs phases :
dtassage du lit par de l'air;
lavage proprement dit par une association air et eau;
rinage l'eau jusqu' l'obtention d'une concentration en matires en suspension correcte.
Les dbits et les vitesses des diffrents fluides de lavage sont fonction du matriau support
(granulomtrie et densit) et du degr d'encrassement du filtre, mais ils doivent aussi permettre le
maintien d'une biomasse active fixe sur le support pour que le redmarrage du biofiltre en
puration biologique soit immdiat aprs la phase de lavage. Ce dernier critre est
particulirement important lors de ractions mettant en oeuvre des populations vitesse de
croissance faible telles que les bactries nitrifiantes. Lorsque les conditions de lavage sont
respectes, la qualit de l'eau traite n'est que peu affecte et retrouve son intgrit moins d'une
demi heure aprs la fin du cycle.
Le volume des eaux de lavage correspond peu prs 3 fois le volume du biofiltre. Les eaux
utilises sont des eaux traites stockes dans une bche en aval des filtres.
L'ensemble des boues en excs collectes pendant ces phases de lavage sont diriges vers le
premier tage de traitement (dcantation statique ou physico-chimique) o elles sont piges
avant d'tre vacues vers la filire de traitement des boues.
V.2. LES MATERIAUX SUPPORTS
Le matriau de remplissage du biofiltre doit rpondre une double exigence : fixation maximale
de la biomasse puratoire et action filtrante vis--vis des matires en suspension. Ces deux
critres dirigent le choix vers des particules de faible diamtre, cependant le phnomne de
colmatage et une frquence raisonnable de lavage (24 48 heures) implique un compromis vers
des granulomtrie de 2 6 mm. Cela permet tout de mme d'assurer des surfaces de fixation de
l'ordre de 200 500 m
2
/m
3
.
De faon gnrale les matriaux supports granulaires sont caractriss par les grandeurs
suivantes :
Taille effective.
C'est la taille de la maille correspondant au pourcentage 10 de la courbe des % cumuls. Cela
signifie que 90% du matriau a un diamtre suprieur ou gal cette valeur.
Coefficient d'uniformit.
C'est le rapport entre la taille pour le pourcentage 60 et la taille effective. Plus cette valeur sera
proche de 1 et plus l'homognit du support sera grande.
Teneur en fines.
Cette teneur en fines doit tre minimale, elle sera limine progressivement lors des squences
de lavage du biofiltre.
Page 211 - Chapitre 10
Densit apparente et densit relle.
Ces valeurs conditionnent les nergies de lavage mettre en oeuvre
Porosit.
La porosit intergranulaire dtermine la capacit de stockage en matires en suspension du
biofiltre. La porosit intragranulaire permet de relier densit apparente et densit relle.
Friabilit.
Ce paramtre est excessivement important pour valuer la tenue du matriau dans le temps
(constance de forme et de diamtre). Des tests d'attrition acclre sont pratiqus pour estimer ce
paramtre.
La nature des matriaux supports les plus utiliss est minrale (argiles cuites, schistes). Des
matriaux synthtiques de densit infrieure l'eau sont en cours d'application.
Exemple d'un matriau support : BIOLITE (DEGREMONT).
Composition chimique Silicate d'alumine
Taille effective 3,6 mm
Coefficient d'uniformit 1,3
Densit apparente 0,8
Densit relle 1,5
Porosit intergranulaire 45%
Friabilit < 1
Tableau 8-2 : Caractristiques physico-chimiques du BIOLITE.
Le choix dfinitif du matriau support dpendra des objectifs de qualit en sortie et de la
composition de l'eau en entre.
V.3. APPLICATIONS INDUSTRIELLES
V.3.1. Biofiltres avec oxygnation indirecte
L'oxygne peut tre fournie au systme par prdissolution dans l'eau traiter avant passage
dans le biofiltre. Suivant la quantit d'oxygne requise pour le traitement et le mode d'injection,
une recirculation de l'eau dans la boucle de saturation pourra tre ncessaire.
Les cultures fixes en traitement des eaux rsiduaires - Page 212
Exemple industriel : la station d'puration de Brianon avec prdissolution d'oxygne pur.
Cette station conue pour traiter les rejets d'une population quivalente 45 000 habitants en
priode de pointe comporte un traitement physico-chimique avec floculation suivi d'une flottation.
Ce traitement de base permet de ramener la DCO entre 100 et 200 mg/l et la DBO
5
entre 50 et
100 mg/l. Le traitement final se fait par filtration biologique aprs proxygnation par injection
d'oxygne pur sous pression. Cette injection d'oxygne pur permet de maintenir les conditions
arobies dans le filtre et permettre ainsi l'limination de la pollution soluble et particulaire jusqu' la
valeur exige par la rglementation sans recyclage de l'eau pure. Il est clair qu'une praration
classique aurait oblig un recyclage.
Le rendement d'limination varie de 55 65% sur l'tage de biofiltration, le traitement physico-
chimique ayant enlev au pralable 60 75% de la pollution organique de l'eau brute.
V.3.2. Biofiltres avec aration directe dans la masse
La limite inhrente au principe prcdent est leve ici par l'injection directe de l'air dans le
biofiltre. Dans le cas de ces biofiltres, la pollution liminable en un seul passage est lie au rapport
des dbits d'air et des dbits d'eau et au coefficient de transfert de l'oxygne dans un biofiltre.
Exemple de la station d'puration de Mtabief (procd BIOFOR DEGREMONT).
Cette station se compose d'un traitement physico-chimique prcdant la filtration biologique sur
BIOFOR. La caractristique essentielle de cette station est le fait qu'elle dessert une population
fortement variable avec des pointes non seulement saisonnires mais aussi hebdomadaires.
La population quivalente prise en compte pour le dimensionnement est :
2 200 EH pendant la basse saison;
16 000 EH pendant la haute saison.
Ceci donne un dbit moyen journalier de 700 m
3
2 300 m
3
. La qualit de l'eau traite est e,
NK
2
, PT
1
.
La ligne de traitement est la suivante :
relevage;
dgrillage, dessablage, dgraissage;
coagulation, floculation, dcantation lamellaire;
biofiltres.
La biofiltration permet de sortir une eau conforme en matires en suspension sans avoir recours
une clarification finale.
Les BIOFOR comprennent 4 units de surface 10,5 m
2
et de 3 mtres de hauteur de couche
filtrante (matriau de type argile de 3,6 mm de taille effective). Ces units sont alimentes en
parallle, le nombre en opration dpend du dbit admis sur l'installation.
Des rendements d'limination de la DCO et des matires en suspension compris entre 60 et
85% sont obtenus sur l'eau sortie de l'tage physico-chimique. Les filtres sont lavs toutes les 48
heures.
Page 213 - Chapitre 10
Exemple de la station d'puration de PERROY (Suisse).
L'eau traiter se compose d'un effluent domestique provenant d'une population de 2 500 eqha
sdentaire et d'un rejet vinicole particulirement en priode de vendange.
Les caractristiques de charge sont les suivantes :
dbit journalier : 1 000 m
3
/j;;
dbit de pointe : 71,4 m
3
/h;
DBO
5
: 562 kg/j;
MES : 426 kg/j;
P : 28 kg/j.
Le niveau de qualit requis pour le rejet est :
DBO
5
: 20 mg/l;
MES : 20 mg/l;
P : 1 mg/l.
Le principe de traitement retenu est une dcantation lamellaire avec adjonction de ractifs
complte par une biofiltration double tage.
Le traitement physico-chimique est assur par un racteur de type DENSADEG comprenant une
chambre de coagulation de 4 m
3
avec injection de chlorosulfate de fer, une zone de floculation de
volume total gal 24,5 m
3
et d'un compartiment de dcantation lamellaire de surface libre 7,5 m
2
.
Les performances de traitement de cette tape sont les suivants :
ENTREE SORTIE % ELIMINATION
DBO
5
562 353 37
MES 426 64 85
P 28 1 96
Tableau 8-3 : Rendements dlimination de ltape de traitement physico-chimique.
Cela montre bien l'action prdominante de cette tape sur la pollution particulaire et sur le
phosphore qui forme slectivement un prcipit avec les sels de fer.
L'tage de biofiltration est compos de trois units courant ascendant air et eau (type
BIOFOR) de surface unitaire 17,5 m
2
. Ces racteurs sont remplis d'un matriau support de taille
effective 3,5 mm sur une hauteur de 3 mtres. Il est prvu de fonctionner sur deux filtres, le
troisime tant en rserve ou au lavage. Les vitesses de filtration sont de 2,1 5,3 m
3
/m
2
.h.
Les cultures fixes en traitement des eaux rsiduaires - Page 214
Les performances puratoires de la biofiltration sont les suivants :
ENTREE SORTIE % ELIMINATION
DBO
5
353 20 94
MES 64 11 82
P 1 0,5 50
Tableau 8-4 : Performances puratoires de ltape de biofiltration.
D'autre part deux bches de stockage sont prvues, l'une de 160 m
3
recevant l'eau pure pour
assurer le lavage des biofiltres, l'autre de 170 m
3
pour stocker les boues de lavage.
L'tage de biofiltration est conu pour pouvoir fonctionner en deux tapes. Ce mode de
traitement permet non seulement d'affiner les caractristiques de l'eau traite en termes de DBO
5
et de MES, mais aussi de raliser une nitrification. L'oxydation de l'ammoniaque en nitrates ne
peut se raliser de faon complte dans le premier tage du fait de la comptition, entre les
populations bactriennes oxydant le carbone et celles assurant la nitrification, pour les sites de
fixation et pour l'oxygne dissous.
VI. LES SUPPORTS IMMERGES
VI.1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Nous avons vu que les racteurs lits fixes prsentent l'intrt de coupler l'puration biologique
avec la filtration des matires en suspension. Par contre, cet avantage implique un fonctionnement
intermittent et un prtraitement pouss de l'eau brute avant son admission dans le systme de
distribution. De faon viter ces contraintes, le racteur biologique doit prsenter une porosit
suffisamment grande pour viter le colmatage. C'est donc une rflexion similaire celle mene
dans le cadre du lit bactrien, mais avec un nouveau contexte, celui d'un racteur immerg.
La rponse technologique peut tre de deux ordres :
mise en oeuvre d'un matriau fixe avec un trs large pourcentage de vide;
cration d'un mouvement au sein du racteur pour viter le pigeage des particules.
Le premier type regroupe des systmes o sont immergs des structures tridimensionnelles de
type plastiques ordonnes plus ou moins complexes, des lames, des fils flottants ou rigidifis par
un double point d'ancrage, ...
Les lits mobiles correspondent quant eux la mise en oeuvre d'un matriau support dont les
caractristiques de taille et de densit permettent sa mise en mouvement avec une nergie
rduite. Contrairement aux lits fluidiss qui nous le verront, sont bass sur le maintient d'un lit
stable et bien dlimit de particules supports, les lits mobiles concernent tout bassin biologique
remplis de particules support qui parcourent l'intgralit du volume ractionnel.
Page 215 - Chapitre 10
Cette mobilit ou ce large pourcentage de vide bass sur l'absence de phnomne de filtration
impliquent un ouvrage de sparation en aval du bassin biologique dont le but est au minimum de
retenir la boue produite en excs. La fonction recirculation, telle que dcrite pour le procd
cultures libres peut tre vite si la biomasse fixe sur le support est suffisante pour assurer seule
la dpollution.
AIR
SUPPORTS FLOTTANTS SUPPORTS FIXES
BOUES
EXCES
SEPARATION
BIOREACTEUR
Figure 8-5 : Schma de principe dun dispositif de traitement avec des supports immergs.
VI.2. LES MATERIAUX SUPPORTS
Concernant les supports fixs dans le racteur, nous retrouvons des structures ordonnes
similaires celles utilises dans les lits bactriens, des grilles, des gotextiles et des fibres
isoles, en faisceau ou boucles. Les derniers matriaux supposent la mise en place de structures
de soutien pour raliser le faisceau de support.
Pour les lits mobiles, les matriaux supports doivent rpondre aux contraintes de taille et de
densit minimisant l'nergie de mise en mouvement. Ce sont donc, soit des matriaux de trs
faible granulomtrie et de densit forte (sable, argiles, charbons en poudre), soit des matriaux de
taille de quelques millimtres mais de densit faible (mousses, matriaux expanss).
VI.3. APPLICATIONS INDUSTRIELLES
La mise en oeuvre industrielle de ce type de procd reste rare. Elle est trs souvent lie la
rhabilitation d'ouvrages existants fonctionnant sur le principe des boues actives, soit pour ragir
une augmentation de charge, soit pour rpondre un accroissement de la qualit de l'effluent
produit (passage d'une puration carbone l'limination conjointe du carbone et de
l'ammoniaque).
VI.3.1. Support fix
Par dfinition, la prsence de structures fixes dans les bassins n'limine pas compltement le
problme de colmatage, surtout celui partiel, li au pigeage des filasses. Les bassins ne seront
donc quips de ces supports que dans le cas de traitements de finition (affinage carbon ou
nitrification).
Un exemple industriel trs particulier est donn par la station de traitement de l'OHTE CENTER
BUILDING. C'est une station d'puration qui produit une eau recycle au sein de l'immeuble pour
un usage non noble.
Les cultures fixes en traitement des eaux rsiduaires - Page 216
La premire tape du traitement consiste en un tamisage fin (maille 0,5 mm). L'eau tamise est
alors admise dans un bassin boues actives de volume 99 m
3
. La liqueur mixte est envoy par
pompage vers un flottateur. Les boues ainsi spares sont recycles vers la boue active aprs
passage dans un bassin de stabilisation arobie. L'eau clarifie subit alors un traitement de finition
par passage dans un bassin ar de 81 m
3
, garni d'un matriau plastique ordonn, immerg, type
nids d'abeille. Le traitement final s'effectue par passage travers des membranes de
microfiltration.
VI.3.2. Lit mobile
Pour les supports mobiles, l'intgration dans un procd prexistant ne ncessite pas de
modifications particulires. Il est bien vident que l'accroissement de la concentration en boues
actives se traduit par une augmentation de la consommation en oxygne qui devra tre assur
par le matriel existant ou alors impliquera un complment plus ou moins facilement intgrable
dans le bassin biologique. Par ailleurs, l'addition de matriaux dans un bassin oblige dissiper
une nergie suffisante pour viter la formation de dpts qui en fermentant gnreraient des
dysfonctionnements biologiques. Le choix du matriau mobile sera fortement influenc par hauteur
de cette demande nergtique supplmentaire.
Un exemple industriel peut tre donn par le procd dvelopp par la socit LINPOR.
Le principe consiste immerger dans le bassin biologique des cubes de mousse plastique. Ces
particules ont une taille de l'ordre du centimtre et prsentent une porosit trs importante qui
permet la rtention de la biomasse (10 18 kg de matires sches fixes par m
3
de racteur). Le
remplissage avec ce matriau de 15 30% du volume d'aration permet donc de maintenir une
masse de boues actives trs suprieure aux procds classiques cultures libres.
La station d'puration de Munich se compose de trois tranches de 13 100 m
3
chaque. Le
dimensionnement a t ralis pour rpondre une limination de la pollution carbone (DBO
5
et
DCO). La charge volumique moyenne est de 1,5 kg DBO
5
/m
3
.d.
Deux des tranches ont t dopes en cubes de mousse, respectivement 10 et 30%.
Tranche 2 0% Tranche 1 10% Tranche 3 30%
Boues actives (concentration) 2,8 5,1 6,6
Indice de boues 150 140 120
Charge massique 0,58 0,35 0,24
Eau traite (DBO
5
moyenne) 19 12 10
Eau traite (DCO moyenne) 81 65 57
Tableau 8-5 : Exemple de rsultats exprimentaux obtenus pendant mars 1989.
L'intrt majeur de ce dopage est une diminution de la charge massique sur le bassin sans
modification du volume et sans changement important de la concentration en boues libres
sparer sur l'ouvrage de clarification (tableau 8-4). Dans l'exemple dcrit, lors de la priode
considre, les rsultats de l'puration montrent une augmentation de qualit de l'effluent.
Page 217 - Chapitre 10
VII. LES LITS FLUIDISES
VII.1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le lit fluidis repose sur le principe de l'expansion contrle d'un lit de particules par l'eau
traiter. Le phnomne de fluidisation s'insre entre les deux vitesses limites que sont la vitesse
minimale de fluidisation et la vitesse de lessivage. La vitesse minimale de fluidisation calcule par
rapport au racteur vide correspond au dbit minimum de liquide pour entraner la sparation des
particules du lit crant ainsi une surface de passage de l'eau, donc une vitesse spcifique, qui
quilibre leur vitesse de chute, elle se traduit aussi par une stabilisation de la perte de charge. Le
lit ainsi cre se caractrise par une interface nette au sommet. La vitesse de lessivage correspond
la vitesse d'entranement des particules en dehors du lit, elle est gale la vitesse de chute en
ft vide d'un grain support.
L'avantage majeur est la formidable surface spcifique dveloppe par unit de volume du
racteur qui permet de fixer un maximum de biomasse (3000 5000 m
2
/m
3
). Cela permet donc de
dvelopper une quantit de biomasse maximale par unit de volume du racteur.
Le fait que le liquide traiter soit le responsable de la fluidisation du lit oblige concevoir une
distribution de ce fluide la plus homogne possible la base du racteur. Il est vident que ce
systme n'est viable que si l'eau est dbarrasse de tout lment susceptible de crer des
colmatages partiels des dispositifs d'injection. Les vitesses de liquide appliquer sont de l'ordre de
la dizaine de mtres par heure, cela suppose donc pour la majorit des cas un recyclage de l'eau.
VII.2. LES MATERIAUX SUPPORTS
Les supports utiliss sont des matriaux granulaires fins de taille effective de l'ordre de 0,2 0,3
mm. Ce sont des substances minrales de type sable, charbon actif, pierre ponce, etc.. Le cahier
des charges de ces supports est le mme que pour les supports utiliss en biofiltration avec une
attention particulire pour la friabilit.
VII.3. APPLICATIONS INDUSTRIELLES
Les applications de ce procd sont encore trs rares et limits des cas particuliers tels que la
mthanisation. Les problmes rencontrs lors d'une application industrielle sont d'ordre
hydrodynamique.
Le premier point rsoudre est l'homognit de la distribution de l'eau de faon ce que le lit
de particules ne soit pas dsquilibr (risque de spiral flow). Cela implique un prtraitement fiable
de l'eau empchant tout risque de colmatage partiel du systme de distribution de l'eau et limite la
taille des racteurs un maximum de 5 6 mtres de diamtre.
Mais, la contrainte la plus importante reste le maintien de la stabilit du lit de particules. Les
vitesses de fluidisation et de lessivage sont dfinies par rapport au type de support mis en oeuvre.
Or, les caractristiques du matriau voluent dans le temps par la croissance du biofilm.
L'augmentation quantitative de la biomasse fixe conduit un accroissement du diamtre et une
diminution de la densit de la bioparticule ce qui conduit son lessivage du racteur. Les tudes
actuelles sont diriges vers la mise en oeuvre de squences de nettoyage capables de rgnrer
le matriau sans altrer l'efficacit puratoire du lit.
Les ralisations industrielles en mthanisation permettent de contourner cette dernire
contrainte par la croissance trs faible des bactries anarobies et leur propension former des
biofilms denses qui modifient peu les caractristiques primordiales du matriau support.
Les cultures fixes en traitement des eaux rsiduaires - Page 218
VIII.CONCLUSION
L'utilisation de cultures fixes reprsente une solution intressante pour rpondre la
dpollution des eaux rsiduaires. Les diffrentes mises en oeuvre possibles, notamment les
biofiltres et pour le futur proche, les lits fluidiss, permettent de produire des eaux traites de
grande qualit avec une grande souplesse d'utilisation et une compacit extrme des ouvrages
d'puration. La seule limite qui les empche de supplanter les systmes boues actives est bien
souvent d'ordre financier.
Chapitre 11
LES LITS BACTERIENS
F.VIRLOGET
Page 220 - Chapitre 11
SOMMAIRE
I. HISTORIQUE...........................................................................................................................................221
I.1. DIFFERENTES FILIERES DE TYPE "LIT BACTERIEN" ...............................................................................221
II. PRETRAITEMENT..................................................................................................................................222
III. DECANTEUR PRIMAIRE, DECANTEUR DIGESTEUR..............................................................223
III.1. DECANTEUR PRIMAIRE ........................................................................................................................223
III.2. DECANTEUR DIGESTEUR......................................................................................................................223
IV. DEGRILLAGE FIN, TAMISAGE......................................................................................................224
V. LITS BACTERIENS.................................................................................................................................224
V.1. GENERALITES......................................................................................................................................224
V.2. PRINCIPE .............................................................................................................................................224
V.3. BIOLOGIE DES LITS BACTERIENS..........................................................................................................225
V.4. DIMENSIONNEMENT ............................................................................................................................226
V.4.1. Charge surfacique..........................................................................................................................226
V.4.2. Rendements puratoires.................................................................................................................226
V.4.3. Nature du matriau - Surface dveloppe......................................................................................227
V.4.4. Dbit dautocurage et de lessivage................................................................................................228
V.4.5. Hauteur du lit .................................................................................................................................229
V.4.6. Exemple de dimensionnement ........................................................................................................229
V.4.7. Rpartition de leffluent sur le lit bactrien...................................................................................230
V.4.8. Recirculation..................................................................................................................................231
V.4.9. Oxygnation ...................................................................................................................................233
V.5. PRODUCTION DE BOUES.......................................................................................................................233
VI. CLARIFICATION................................................................................................................................234
VII. DYSFONCTIONNEMENT .................................................................................................................234
VII.1. PRINCIPALES CAUSES DE DYSFONCTIONNEMENT .................................................................................234
VII.2. COLMATAGE DES LITS .........................................................................................................................234
VII.2.1. Causes........................................................................................................................................234
VII.2.2. Mesures curatives ......................................................................................................................235
VII.3. PRECAUTIONS DEXPLOITATION ..........................................................................................................235
VII.3.1. Lits bactriens............................................................................................................................235
VII.3.2. Disques biologiques...................................................................................................................235
Les lits bactriens - Page 221
I. HISTORIQUE
Historiquement, les lits bactriens constituent une des premires techniques utilises en
traitement des eaux uses domestiques des agglomrations (bien avant l'avnement des
"boues actives"). Ils reprsentaient en 1960 environ les 2/3 des stations d'puration en
service en FRANCE.
Progressivement, en FRANCE, cette technique a t supplante par les installations
boues actives travaillant en forte charge et moyenne charge, puis par celles travaillant en
faible charge ou aration prolonge. Ainsi, entre 1960 et 1970 les lits bactriens ne
reprsentaient plus que 1/3 des installations construites. Actuellement moins de 15 % du
nombre de stations d'puration ralises sont de type "lits bactriens".
De fait, charge et performance gales, la construction d'un lit bactrien s'avre plus
onreuse qu'une installation " boues actives " (cot de 20 30 % plus lev). Un
phnomne de "mode" n'est galement pas tranger l'abandon de cette technique (et des
techniques associes comme les disques biologiques), mais il faut bien avouer aussi que la
mauvaise conception et le mauvais dimensionnement des ouvrages en sont certainement les
causes principales.
Il faut cependant admettre que cette filire de traitement est facilement exploitable pour un
cot de fonctionnement peu lev ce qui constitue certainement une bonne alternative au
traitement "boues actives" pour les installations de petite capacit (< 2000 eH).
Pour les installations recevant certains rejets industriels, la mise en place d'un traitement
associ lit bactrien/boues actives peut constituer une solution originale et digne d'intrt.
I.1. DIFFERENTES FILIERES DE TYPE "LIT BACTERIEN"
Il y a lieu de distinguer les diffrents procds de traitement par lit bactrien que l'on
retrouve le plus rgulirement en exploitation :
Les installations alimentes exclusivement par des rseaux d'assainissement
urbains (eaux uses exclusivement domestiques) avec une filire de traitement
classique :
prtraitements;
dcanteur primaire associ ou non un digesteur (Clarigesteur, fosse IMHOFF);
lit bactrien garnissage pouzzolane (le cas chant garnissage plastique);
clarificateur.
Les installations alimentes par des effluents urbains et industriels (souvent
des industries agro-alimentaires) dans des proportions variables, avec une filire de
traitement en complment d'une installation de type "boues actives aration
prolonge" :
prtraitements avec un dgrillage fin (1 3 mm) ou tamisage (< 1 mm);
lit bactrien garnissage plastique ordonn;
boues actives aration prolonge (alimentation directe du lit bactrien);
clarificateur.
Page 222 - Chapitre 11
Les installations de type "lit bactrien tournant" ou "disques biologiques"
alimentes exclusivement par des rseaux d'assainissement urbains (eaux uses
exclusivement domestiques) avec la filire de traitement suivante :
prtraitements avec le cas chant un dgrillage fin (1 3 mm) ou tamisage;
dcanteur primaire (facultatif en cas de prsence, lamont, d'un dgrillage fin ou
d'un tamisage) associ ou non un digesteur (Dcanteur digesteur, Clarigesteur,
fosse IMHOFF);
disques biologiques;
clarificateur.
Il peut exister plusieurs autres variantes peu utilises : lit bactrien aprs dcantation
physico-chimique, lit bactrien aprs traitement boues actives, lit bactrien avant traitement
en biofiltration, lits bactriens en srie (avec dcantation intermdiaire) pour assurer un
traitement complmentaire de l'azote, lagune primaire avant disque biologiques, ... Pour ces
filires particulires, le cas chant, les diffrentes remarques formules ci-aprs sont
applicables.
Dans toutes les configurations (cela s'applique aussi pour les disques biologiques), il s'agit
de n'accepter, aprs un premier traitement adapt (dcantation primaire, dgrillage fin ou
tamisage), que des effluents dbarrasss de matires en suspension ou tout du moins de
celles dont la taille est de nature provoquer un colmatage (souvent irrversible) du support
bactrien.
Ces ouvrages sont gnralement aliments par un poste de relvement pour bnficier
d'un dbit instantan suffisant pour garantir l'autocurage du lit (charge hydraulique
superficielle). Pour certaines petites installations alimentes gravitairement, cette charge
hydraulique superficielle est assure par l'intermdiaire d'une cloche de chasse d'eau.
II. PRETRAITEMENT
La mise en place d'un prtraitement efficace est essentielle puisqu'il s'agit de limiter au
maximum les risques de colmatage du support bactrien, et aussi dassurer la sauvegarde
du matriel (bouchage des canalisations de liaison, des vannes diverses, des pompes, ...).
Ceci est particulirement le cas pour le dgrillage et le dgraissage. En aucun cas ne peut
tre admis un "by-pass" du dgrillage ou du tamisage. Il est prudent de limiter moins de
200 mg/l la concentration en graisses des effluents l'entre du lit bactrien (mesure des
lipides par extraction hexane mthanol).
Pour des installations desservant des industries agro-alimentaires il est essentiel de
contrler le pH des effluents admis dans la station. En effet, en fabrication, les oprations
journalires et hebdomadaires de nettoyage des cuves et racteurs s'oprent par ajout de
produits agressifs (acide, basiques). La mise en place d'une rgulation du pH est donc
souvent ncessaire (pH admissible sur le lit : 6 8,5).
Les lits bactriens - Page 223
III. DECANTEUR PRIMAIRE, DECANTEUR DIGESTEUR
III.1. DECANTEUR PRIMAIRE
Dans le cas d'une filire de traitement classique il est essentiel d'obtenir et de garantir des
performances suffisantes de la dcantation primaire. En effet, le dimensionnement du lit
bactrien tient compte de l'abattement obtenu au niveau de la dcantation.
Dans certaines situations les perturbations hydrauliques du fait d'un trop fort dbit de
pompage, d'un sous dimensionnement (vitesse ascensionnelle trop leve) ou d'une
conception dficiente du dcanteur (dcanteurs longitudinaux, ...) vont entraner un dfaut
dans le fonctionnement du dcanteur.
Il s'agit d'adopter un dbit traversier compatible avec la dcantation primaire (vitesse
ascensionnelle pour un ouvrage circulaire : < 1,2 m/h), mais aussi avec le lit bactrien
(charge hydraulique superficielle : cf. V.4.3).
Prenniser et garantir des performances optimales oblige aussi l'adoption d'une gestion
rigoureuse des extractions des boues primaires. Il est important de baisser le plus possible le
temps de sjour des boues dans le dcanteur primaire pour limiter autant que faire se peut
les risques de fermentation. Cette fermentation des boues primaires peut rduire les
performances du dcanteur. Cela se traduit visuellement par des remontes de bulles de
fermentation et de boues grises noires (accompagnes de dpart de boues avec l'effluent
dcant) et par une odeur putride. Une mesure du potentiel REDOX dans les eaux et les
boues rvle dans ce cas des valeurs nettement infrieures celles mesures dans les eaux
brutes traiter (un potentiel infrieur +100 mV/EHN traduit dj des problmes de
fermentation).
Il convient d'tre vigilant en toute circonstance. En effet une fuite importante de ces boues
va entraner un colmatage plus ou moins rapide de la surface du support et va ruiner tous les
efforts de sauvegarde du lit bactrien. Une lgre fuite constante de MES va, quant elle,
elle provoquer un colmatage plus lent mais la longue, beaucoup plus important puisqu'il va
intresser une plus grande hauteur de lit (colmatage en profondeur).
Il est donc important de limiter en permanence 5 10 g MES/l la concentration des
boues primaires, par le fonctionnement adapt de la pompe d'extraction.
III.2. DECANTEUR DIGESTEUR
En ce qui concerne les dcanteurs digesteurs, o les boues primaires accdent
directement dans la digestion, l'observation de remontes de boues va traduire une
insuffisance des extractions des boues au sein mme du digesteur. En effet, dans la partie
digestion (qui n'est jamais brasse) le niveau de boues dpasse alors celui de la lumire de
communication (dcantation/digestion) avec en consquence une monte du voile de boues
qui, avec le rgime hydraulique amont, va provoquer cette perte de boues.
Par dfinition, l'existence d'une communication entre la dcantation et la digestion est de
nature limiter les performances de la dcantation primaire puisque tous les produits de
dgradation de la digestion (hydrosolubles), qui constituent une charge polluante non
ngligeable, sont restitus dans les eaux en sortie de dcantation.
Les performances seront d'autant plus rduites que la digestion sera dficiente. Un
contrle du pH de digestion est effectuer rgulirement (au moins tous les mois), le cas
chant (pH < 7) un apport de chaux peut tre ncessaire.
Page 224 - Chapitre 11
Le volume de la partie digestion d'un dcanteur digesteur est souvent dimensionn pour
permettre un temps de sjour important des boues (2 6 mois). Ce temps est ncessaire
la dgradation de la matire organique (les dcanteurs digesteurs ne sont pas chauffs, il
faut donc compenser les performances forcment limites, par un long temps de sjour des
boues). Un tel temps de sjour permet en outre une grande souplesse au niveau de la
gestion des boues excdentaires puisque gnralement il est possible de jouer sur le niveau
de boues (espacement des extractions). Ceci impose de pouvoir disposer d'un systme de
dtection du niveau du voile de boues (piquages de visualisation et de prlvement,
dtection par capteur de poids de boues).
L'extraction des boues biologiques en excs issues du lit bactrien (qui s'effectue
gnralement par retour en tte) devra tre la plus frquente possible, afin d'obtenir un
maximum d'homognit des boues mixtes et donc permettre un fonctionnement rgulier du
dcanteur.
IV. DEGRILLAGE FIN, TAMISAGE
Dans le cas des installations plus rcentes avec une utilisation d'un lit bactrien
garnissage plastique organis (exemple : tube Cloisonyle) ou pour les disques biologiques,
la section de passage du support peut tre suffisante pour permettre de s'affranchir de la
mise en place d'une dcantation primaire en y substituant un dgrillage fin (1 3 mm) ou
bien un tamisage (< 1 mm).
L'absence de dcantation primaire prsente le net avantage de ne plus avoir grer des
boues primaires, par dfinition trs fermentescibles, qui doivent tre obligatoirement
stabilises (digestion anarobie). Toutefois cela doit se traduire par un dimensionnement du
lit bactrien qui tiendra compte d'un abattement pralable de la pollution limit par rapport
un dcanteur primaire.
V. LITS BACTERIENS
V.1. GENERALITES
Les lits bactriens sont des dispositifs comprenant un support de contact sur lequel se
dveloppe la culture bactrienne (film biologique). Ce matriau support est immerg
alternativement dans l'eau purer (disques biologiques) ou arros par celle-ci (lits
bactriens classiques). L'apport en oxygne est assur par la mise en contact du film
biologique avec l'air atmosphrique le plus gnralement par ventilation naturelle ou par
ventilation force.
V.2. PRINCIPE
La pellicule qui se dveloppe la surface du support (paisseur 0,2 0,3 mm) comporte
de trs nombreuses espces bactriennes dont beaucoup montrent une croissance
filamenteuse trs proche de ce que l'on observe dans le foisonnement en culture libre
(boues actives). On constate, pour les lits non couverts recevant de la lumire, un
dveloppement de champignons infrieurs, d'algues. Lorsque la charge hydraulique est
faible, une faune d'organismes "brouteurs " de la biomasse peut se maintenir (larves
d'insecte, nmatodes).
Avec l'alimentation en eau traiter, la biomasse se dveloppe rapidement, le film
s'paissit progressivement. La mise en service d'un tel dispositif, pour un traitement de la
matire carbone, s'effectue rapidement (une deux semaines dans de bonnes conditions
de temprature).
Les lits bactriens - Page 225
La profondeur, jusqu' laquelle diffuse l'oxygne dans le film biologique, est sensiblement
constante et relativement faible (entre 100 et 150 microns). De ce fait, la biomasse comporte
une pellicule superficielle arobie d'paisseur proche de la constante, surmontant une zone
profonde en anarobiose.
Cette zone d'anarobiose, prsentant une rsistance mcanique moindre que la partie
arobie, va favoriser largement l'autocurage du support de biofilm. En effet, les dgazages
profonds conjugus avec laction rosive du ruissellement vont permettre le dcrochement et
donc la rgnration de la biomasse. Son mtabolisme trs actif aboutit la production de
produits d'excrtion habituels (CO
2
, NH
4
, NO
2
, NO
3
, ...) ainsi qu'aux scrtions
mucilagineuses qui jouent un rle important pour l'adhsion au support du biofilm et la
biosorption des matires en suspension et matires collodales.
Le dveloppement du biofilm va crotre proportionnellement la charge polluante amont
traiter; il sera donc plus important au niveau des premires couches o s'effectue
l'alimentation en substrat. L'paisseur limite dpendra de la charge hydraulique locale tous
les niveaux de hauteur.
Ces remarques vont conditionner les caractristiques gomtriques du lit bactrien
(volume, hauteur maxi, surface).
V.3. BIOLOGIE DES LITS BACTERIENS
La faune et la flore sont beaucoup plus diversifies sur un lit bactrien que sur une station
boues actives. La varit des niches cologiques offertes (ensoleillement, cavits,
substrat, humidit, ...) est l'origine de cette diversit :
Comme dans les boues actives, les bactries sont en majeure partie des
htrotrophes. Dans les couches infrieures il est possible, dans des conditions de
faible charge surfacique, de trouver des autotrophes (nitritation).
Une fraction importante de la biomasse est constitue de mycelium qui colonisent
particulirement la surface en une pellicule rose orange.
Dans des cas de nette sous charge, des mousses vertes (voir mme des herbes)
peuvent couvrir la surface du lit, une chloration de la surface est efficace dans les
cas extrmes.
Des algues filamenteuses peuvent tre observes dans les zones recevant la
lumire.
La faune des protozoaires est riche et varie, on trouve les espces communes au
traitement de type boues actives.
Les mtazoaires sont trs rpandus dans les lits bactriens (nmatodes, annlides
ou lombrics, ...).
Selon la saison des pullulations de d'insectes (mouches notamment) constitue une gne
importante dans l'environnement immdiat.
Page 226 - Chapitre 11
V.4. DIMENSIONNEMENT
V.4.1. Charge surfacique
Comme dans le cas d'un traitement par boues actives, il est possible de qualifier par
principe des valeurs de forte charge, faible charge (tableau 9-1). Cette notion n'est
pratiquement plus utilise.
Faible charge Forte charge
DBO
5
(kg/m
3
.j) 0,08 0,15 0,7 0,8
Charge hyd. (m
3
/m
2
.h) < 0,4 > 0,7
Observations boues stabilises stabilisation des boues
Tableau 9-1 : Caractristiques des lits bactriens remplissage traditionnel.
Auparavant avec l'utilisation gnralise de la pouzzolane, tait souvent utilise la charge
volumique (kg DBO
5
/j par m
3
de matriau), mais actuellement les surfaces spcifiques des
supports tant trs diffrentes il convient d'utiliser la charge surfacique (kg DBO
5
/j par m
2
de
surface dveloppe) comme rfrence. Cette unit de mesure permet rellement de juger
des performances des diffrents procds.
En eaux rsiduaires urbaines, pour une concentration en DBO
5
initiale de 200 250 mg/l
(aprs dcantation primaire ou tamisage) et une charge surfacique de 5 10 g DBO
5
/j par
m
2
de surface dveloppe il est possible d'obtenir un niveau de rejet " e ". Pour une charge
surfacique infrieure, avec une temprature non limitante, il est possible d'obtenir une
nitrification partielle des effluents.
L'utilisation d'un lit bactrien en nitrification tertiaire, pour une charge surfacique de 1
1,5 g N-NH
4
/j par m
2
de surface dveloppe permet des rendements de 80 % sur
l'limination de l'azote ammoniacal.
V.4.2. Rendements puratoires
Les rendements puratoires qu'il est possible d'obtenir sont fonction de la nature et de la
concentration initiale des effluents traiter. Il est important de noter que les meilleurs
rendements sont obtenus avec des effluents collodaux concentrs. La recirculation ne va
pas rellement amliorer les performances puratoires (pour un bon dimensionnement de
l'installation), il ne peut s'agir ventuellement que d'une dilution passagre avec effet tampon
(ce point donne lieu encore des controverses).
Dans le cas d'une filire de traitement o le lit bactrien prcde un bassin boues actives
travaillant en aration prolonge, il est simplement vis un abattement partiel de la pollution
carbone (souvent proche de 50 % en DBO
5
). Les effluents issus de cette premire tape de
traitement rejoignent directement le bassin d'activation sans dcantation intermdiaire. Le
biofilm qui va se dtacher du lit va constituer un support de floc favorable au maintien d'un
bon indice de dcantation des boues. Ceci est observable surtout dans les cas o l'effluent
brut traiter est essentiellement constitu de pollution dissoute ou collodale (laiterie,
fromagerie, quarrissage, ...), ce qui peut tre une solution pour garantir la clarification des
effluents.
Les lits bactriens - Page 227
Le rendement du lit bactrien est calcul en prenant en compte pour l'aval, des rsultats
des analyses aprs dcantation 2 heures (DCO ad2, DBO
5
ad2).
Les besoins en oxygne de la respiration endogne des boues en excs provenant du lit
bactrien (matire organique adsorbe et absorbe) doivent tre pris en compte dans le
calcul de l'oxygnation du bassin d'activation.
Ces besoins diffrent selon la nature des effluents bruts et des prtraitements (il s'agit de
quantifier la part des matires en suspension qui ne sera que trs peu concern par le
traitement sur le lit bactrien). Ils seront trs faibles quand il s'agit d'une pollution
essentiellement dissoute en entre de lit (empiriquement il peut tre pris un coefficient
multiplicateur de 1,1 sur le flux aval ad2 du lit) et plus important dans le cas contraire
(empiriquement il peut tre pris un coefficient multiplicateur de 1,25 sur le flux aval ad2 du
lit).
Exemple de rendement pour le CLOISONYLE.
Les abaques en annexe, situent les rendements qu'il est possible d'obtenir pour le
CLOISONYLE (support mis au point par l'IRCHA) pour diffrents effluents agro-alimentaires
(support trs courant en IAA). Ces valeurs sont utilisables galement, comme rfrence,
pour d'autres supports condition de bien prendre en compte la charge surfacique.
Attention : certains supports sont nettement moins performants dans la ralit. Il s'agit
essentiellement des supports livr en vrac ou la surface active (surface "mouille") est
beaucoup plus faible que pour le Cloisonyle (support prsentant le meilleur rapport surface
mouill/surface totale).
Ces abaques permettent le dimensionnement des lits aliments en permanence par les
effluents traiter (flux polluant constant rparti sur 24 heures). Si la charge traiter n'est
rpartie que pendant X heures/24 heures, le volume du lit est augmenter dans la
proportion 24/X. En fait, la charge limine sur le lit bactrien tant relativement constante, il
faudrait dimensionner son volume sur la charge en pointe (en tenant compte de l'effet de
dilution d la prsence du poste de relvement, de la recirculation, de l'ventuelle
dcantation primaire ou mme d'un bassin tampon).
Le volume de support tant dfini les caractristiques gomtriques (hauteur, section)
sont choisir en fonction de la nature du matriau support, du dbit de pointe traiter (y
compris l'ventuelle recirculation), du dbit minimum d'autocurage, du dbit maximum de
lessivage.
V.4.3. Nature du matriau - Surface dveloppe
LITS BACTERIENS
De la nature du support dpend la surface dveloppe; une grande surface dveloppe va
permettre le maintien d'une importante biomasse.
Les premiers matriaux de remplissage des lits taient pouzzolane (garnissage
traditionnel), cailloux, graviers, galets, bloc de granit, laitier de fonderie, mchefer. Ces
matriaux sont de prix peu lev. Mais ils prsentent les dsavantages davoir des masses
spcifiques importantes (1 300 2 000 kg/m
3
) avec de faibles surfaces dveloppes (45
60 m
2
/m
3
pour des dimensions moyennes de 60/80 mm) et un pourcentage de vide limit
(environ 50 %).
Page 228 - Chapitre 11
Le faible pourcentage de vide va rduire les possibilits de ventilation ce qui oblige une
limitation des hauteurs de lits 2,5/3,5 m (au dessus une ventilation force s'impose), de
plus les risques de colmatage sont importants.
Pour les lits plus rcents se gnralise l'utilisation de support plastique en vrac (anneaux
de Rachig, sphres, ...) ou ordonn (Flocor, Cloisonyle, ...) d'un cot souvent trs lev,
avec des surfaces dveloppes plus importantes (80 200 m
2
/m
3
), des masses spcifiques
plus faibles (60 80 kg/m
3
) et un trs fort pourcentage de vide (90 95%). Les risques de
colmatage sont moins importants avec l'utilisation de matriau plastique ordonn
(Cloisonyle).
DISQUES BIOLOGIQUES
Les disques biologiques sont constitus d'un support en forme de disque ou de tambour
en matriau plastique mont sur un axe horizontal.
Le tambour partiellement immerg (40 % environ) dans une cuve, o est introduite l'eau
purer, est anim d'un mouvement de rotation (1 3 tours/mn dans le sens du courant de
passage), ce qui permet par alternance des phases d'immersion et d'mersion de favoriser
le contact de la biomasse avec le substrat, et de provoquer une oxygnation du milieu par
ruissellement.
En FRANCE, les installations souvent issues d'un mme constructeur. Elles sont
constitues de batteries de disques plats en polystyrne expans dont la surface dveloppe
utile est faible (environ 50 m
2
/m
3
). Ce type de garnissage est actuellement abandonn
(fragilit du support et des organes lectromcaniques, faibles performances du fait d'un
sous dimensionnement) au profit de support de type disques profils (ondulations, alvoles)
beaucoup plus performants (surface spcifique : 150 200 m
2
/m
3
).
Ces installations de deuxime gnration sont trs dveloppes dans certains pays
Europens (SUISSE, ALLEMAGNE, GRANDE BRETAGNE, PAYS SCANDINAVES).
V.4.4. Dbit dautocurage et de lessivage
Le dbit d'autocurage est dfini comme tant le seul dbit admissible sur le lit bactrien,
quelque soit le dbit des eaux brutes traiter. Lorsque le dbit des eaux brutes est faible ou
nul (la nuit par exemple), la recirculation devra apporter un volume complmentaire
permettant de rtablir le dbit d'autocurage.
Le dbit de lessivage du biofilm (arrachement de la majeure partie du biofilm) est dfini
comme tant approximativement le double du dbit d'autocurage.
Dans le cas des disques biologiques l'autocurage est assur par la rotation du tambour
(rosion du fait du ruissellement)
Le dbit d'autocurage du lit est en rapport avec la surface spcifique du matriau, il peut
tre valu en multipliant la surface spcifique du matriau (m
2
/m
3
) par 15 l/h (valeurs
usuelles 12 18 l/h).
Le ratio : dbit d'alimentation / surface horizontale du lit est dfini comme tant la charge
hydraulique superficielle.
Les lits bactriens - Page 229
V.4.5. Hauteur du lit
La hauteur du lit maximale prise en compte gnralement est de 2,5 3,5 m pour un
garnissage traditionnel (pouzzolane, ...) et de 4 6 m pour un garnissage plastique ordonn.
V.4.6. Exemple de dimensionnement
Hypothse de calcul :
charge polluante aprs dcantation primaire : 100 kg DBO
5
/j;
dbit de pointe : 40 m
3
/h;
charge surfacique souhaite : 6 g DBO
5
/j par m
2
;
surface dveloppe ncessaire : 16 666 m
2
.
Pouzzolane (60/80 mm) Cloisonyle (d = 102,5
mm)
surface spcifique 50 m
2
/m
3
150 m
2
/m
3
dbit d'autocurage (*) 0,75 m
3
/h 2,25 m
3
/h
dbit de lessivage (*) 1,50 m
3
/h 4,50 m
3
/h
volume du lit 333 m
3
111 m
3
hauteur 3 m 5 m
section du lit maxi 111 m
2
22,2 m
2
diamtre 11,9 m 5,3 m
dbit d'autocurage 83 m
3
/h 50 m
3
/h
dbit de lessivage 166 m
3
/h 100 m
3
/h
dbit de pompage 150 m
3
/h 90 m
3
/h
(*) Par m
2
de section du lit.
Tableau 9-2 : Dimensionnement dun lit bactrien.
Il est prfrable de choisir un dbit d'alimentation proche des conditions de lessivage pour
garantir tout risque de colmatage (le cas chant, il sera toujours possible de rduire ce
dbit).
En exploitation, il est essentiel de vrifier rgulirement le dbit pratique du relvement.
En effet une usure prmature, un bouchage de la pompe va occasionner une baisse du
dbit d'alimentation du lit jusqu'au non respect du dbit minimum d'autocurage. Le colmatage
progressif du lit devient alors invitable.
Page 230 - Chapitre 11
V.4.7. Rpartition de leffluent sur le lit bactrien
Pour utiliser l'ensemble du support, il est indispensable d'arroser uniformment la totalit
de la surface du lit. Cette rpartition est assure par un tourniquet (sprinkler), ce qui oblige
une forme circulaire de l'ouvrage. Sur certaines petites installations la rpartition s'effectue
par l'intermdiaire d'un rseau de goulottes fixes, par pulvrisation travers des orifices fins,
par projection sur plaques pleines, le lit pouvant tre alors rectangulaire.
Le nombre de bras du sprinkler est au moins de 2 ; il est souvent de 4 pour les
installations plus importantes.
Il est important de ne pas dpasser une vitesse priphrique de 0,8 1 m/s. L encore il
s'agit galement de mnager un dbit instantan suffisant pour assurer un autocurage des
bras du sprinkler et un dbit maximum pour viter un lessivage du lit.
Il peut tre utilis une autre mthode pour vrifier la vitesse de rotation du sprinkler par le
calcul du volume d'eau distribu (en litre), par bras et par tour sur 1 m
2
de surface de lit
(notion de S
k
) :
S
k
= [(Q + R) 1000] / (S a n)
avec :
Q = dbit d'alimentation (m
3
/h).
R = dbit de recirculation (m
3
/h).
NB : Q + R correspond bien au dbit d'entre sur le lit, il s'agit souvent de la capacit du poste de
relvement.
a = nombre de bras.
n = nombre de tour par heure.
La valeur du S
k
doit tre comprise entre 20 et 40 l/m
2
par bras et par tour (pour une
nitrification tertiaire les valeurs de S
k
sont plus importantes soit 60 80 l/m
2
).
En exploitation, il faut surveiller l'absence de bouchage des orifices de distribution. La
rpartition de ces orifices de dversement (le plus souvent des simples trous, de 1 cm mini
jusqu' 3 cm de diamtre, pratiqus dans des tubes) doit tenir compte de la diffrence de
trajet entre le centre et la priphrie du lit (la distance entre trous est plus resserre
l'extrieur du lit qu'au centre).
Nombre total de trous (n) :
n = [(Q+R) 10 000] / [6,3 d
2
(2 h)]
avec :
Q+R : dbit d'alimentation du lit en m
3
/h (dbit des eaux brutes + recirculation).
d : diamtre des orifices en mm (20 30 mm).
h : hauteur de charge au dessus de la surface du bras (gnralement 0,8 1 m).
Les lits bactriens - Page 231
Rpartition des trous :
R
x
= (x a) soit R
1
= (1a), R
2
= (2a), R
3
= (3a), ...
avec :
R
x
: distance du trou x par rapport au centre du lit (en m).
a = R
2
/ n.
R : rayon maxi du bras en m.
n : nombre de trous par bras.
Des bouchons amovibles, doivent quiper les extrmits des bras, ils sont l pour
permettre une vidange rapide (en cas de bouchage) et un nettoyage de l'intrieur du
sprinkler (ramonage).
Pour faciliter l'exploitation il est opportun d'amnager des crneaux sur le gnie civil afin
de purger les bras vers l'extrieur du lit (il convient en effet de ne pas envoyer, au moment
d'un ramonage, les effluents chargs sur la surface du lit).
V.4.8. Recirculation
V.4.8.1. Objectif
Pour garantir les performances d'un lit bactrien, il ne faut jamais tre en situation de
desschement du biofilm. C'est la fonction principale de la recirculation que de maintenir une
alimentation rgulire du lit.
Ce problme ne se pose gure avec les matriaux classiques, le plus souvent assez
poreux pour retenir une humidit suffisante, mme en cas d'interruption d'alimentation
plusieurs heures. Il n'en est pas de mme avec les matriaux plastiques, et cela d'autant
plus que le tirage naturel de l'air est plus important.
En ce qui concerne les disques biologiques, le biofilm est "mouill" en permanence lors de
la phase d'immersion dans le bac de rtention. En cas d'arrt prolong du disque, la partie
emmerge va s'asscher, la partie immerge va s'alourdir (dveloppement de la biomasse)
ce qui va provoquer un balourd avec d'importantes contraintes mcaniques. Sur certaines
installations (desservant des IAA notamment), le lit bactrien est aliment partir d'un
bassin tampon ce qui permet une humidification permanente de la biomasse.
Pour ces deux dernires configurations il est possible de s'affranchir de la mise en place
d'une recirculation d'eau.
Mais gnralement, l'arrive des effluents traiter n'est par rgulire, il est donc
ncessaire de mettre en place une recirculation pour maintenir une humidification constante
du biofilm .
V.4.8.2. Mode de gestion
Sur les lits bactriens classiques la recirculation s'effectue principalement en tte de
traitement (c'est dire en amont du dcanteur primaire ou du dcanteur digesteur, dans le
poste de relvement) partir du cne de sdimentation du clarificateur ce qui permet de
disposer d'un effluent dbarrass de MES (aprs dcantation) et d'assurer l'extraction des
boues en excs et leur traitement avec les boues fraches (digestion anarobie).
Page 232 - Chapitre 11
La gestion de la recirculation s'effectue automatiquement par l'ouverture d'une vanne
flotteur (ou autre systme analogue) place dans le poste de relvement. Pendant les
pointes de dbit des eaux brutes, le niveau dans le poste de relvement tant lev, la
vanne flotteur est ferme, les boues en excs sont provisoirement stockes dans la
clarificateur. La charge hydraulique superficielle est adapte puisqu'elle est fixe par le dbit
de pompage.
Lorsque les dbits traiter sont faibles, le niveau dans le poste de relvement est bas, la
vanne flotteur s'ouvre la recirculation est active ce qui permet l'extraction des boues
excdentaires, le remplissage de la bche et la mise en service du pompage pour une
charge hydraulique superficielle toujours adapte.
En ce qui concerne les lits garnissage plastique ordonn (et non en vrac), notamment
ceux prcdent un bassin boues actives (sans dcantation intermdiaire), il est possible
de recirculer les effluents de sortie du lit eux-mme dans une bche de rtention, quipe
d'un trop plein, en communication avec le poste de relvement amont (figure 9-1).
Cette configuration permet d'alimenter en priorit le lit partir des effluents brutes, les
effluents traits sur le lit tant vacues en aval par la trop plein. En l'absence d'arrive des
eaux brutes le poste de relvement est alors aliment en eaux traites par l'intermdiaire de
la lumire de communication.
Figure 9-1 : Schma de principe dun dispositif permettant une alimentation en continu des lits
bactriens.
La prsence de MES dans la recirculation (qui correspond au biofilm qui se dtache du fait
de l'rosion) ne va pas entraner de colmatage du lit pour autant que le garnissage plastique
ordonn prsente une structure adapt (c'est le cas pour le Cloisonyle, support rencontr le
plus souvent).
Il est rare de trouver une recirculation partir des eaux pures prleves en sortie de
clarificateur.
Les lits bactriens - Page 233
V.4.9. Oxygnation
La diffusion de l'oxygne s'opre partir du courant d'air qui traverse le lit. Le tirage
naturel s'installe du fait de la diffrence de temprature entre l'air extrieur et l'effluent. La
circulation d'air s'effectue donc du haut vers le bas en priode chaude, en sens inverse en
priode froide.
Une faible diffrence de temprature entre l'eau et l'air va diminuer dans une importante
proportion la circulation de l'air (une diffrence de temprature infrieur 10 C diminuerait
par 10 la vitesse de circulation).
Pour les lits traditionnels situs l'extrieur, en priode froide, il est possible de rduire la
surface des lumires situes sous le plancher pour limiter le refroidissement des effluents.
Quand les hauteurs de lits sont importantes les pertes de charge peuvent tre
suffisamment leves pour que la ventilation naturelle soit inefficace. C'est notamment le cas
pour un garnissage faible indice de vide. La mise en place d'une ventilation force est donc
ncessaire (dbit mini 20 m
3
/h par m
2
de section de lit).
Les disques biologiques doivent systmatiquement tre abrits dans un local pour
s'affranchir des problme du au gel. Des ouvertures (soupiraux, fentres, ...) sont
amnages pour permettre un renouvellement de l'air ambiant et ainsi donc lutter contre les
phnomnes d'humidit.
Les consommations lectriques d'un lit bactrien sont beaucoup moins importantes que
pour une installation " boues actives " (2 3 fois moins leve). Une consommation de 0,6
1 kWh/ kg DBO
5
limin peut tre prise comme rfrence, elle sera d'autant plus leve
que la recirculation sera importante et la filire de traitement des boues complexe.
V.5. PRODUCTION DE BOUES
Les productions de boues des lits bactriens sont tout fait comparables celles d'un
traitement par boues actives et se calcul de la mme manire (cf. chapitre 18).
Charge surfacique Equivalence boues actives Production de boues (hors
boues primaires)
faible : < 5/10 g DBO
5
/j par m
2
de surface dveloppe
boues actives trs faible
charge massique
0,6 0,8 kg MES/kg DBO
5
limin
eleve : > 15 20 g DBO
5
/j
par m
2
de surface dveloppe
boues actives moyenne
charge massique
0,8 1 kg MES/kg DBO
5
limin
trs leve : > 30/40 g DBO
5
/j
par m
2
de surface dveloppe
Difficile de dfinir un ratio sur
la production de boues*.
* En effet s'agissant souvent d'un traitement de rejet dominante industriel, les valeurs sont variables
selon la nature des effluents et du prtraitement.
Tableau 9-3 : Production de boues.
Page 234 - Chapitre 11
Quand le lit bactrien est suivi d'un traitement direct sur une filire de boues actives
faible charge (sans dcantation intermdiaire), la production de boues est calculer, pour
simplification, sans tenir compte de la prsence de la premire tape (lit bactrien) c'est
dire sur la base du flux polluant brut aprs pr traitement.
VI. CLARIFICATION
La clarification finale vise sparer les effluents traits des MES qui selon la nature des
effluents et la charge applique sont constitues de matires organiques des eaux brutes ou
du biofilm. La masse de MES correspond donc essentiellement la production de boues.
Cette masse de boues en "transit" dans le dcanteur est donc faible compare celle qui
correspondrait, taille gale, une filire boues actives (15 25 fois moins).
Il s'agit donc d'assurer rgulirement l'extraction de ces boues excdentaires.
Ces boues possdant une bonne aptitude la dcantation, un dimensionnement bas sur
une vitesse ascensionnelle maxi de 1 1,2 m/h et une profondeur en priphrie de 2 2,5 m
est acceptable.
VII. DYSFONCTIONNEMENT
VII.1. PRINCIPALES CAUSES DE DYSFONCTIONNEMENT
Pour les traitements de type lits bactriens (y compris les disques biologiques) o la
biomasse puratoire est fixe sur un support, les dysfonctionnements d'ordre biologique sont
peu frquents.
Il s'agit en fait, d'une rduction plus ou moins brutale du traitement biologique due :
aux arrives illicites de produits toxiques (produits bactricides ,fortement acides ou
basiques, mtaux lourds, solvants, peinture, ...). Dans ce cas on observe une
dgradation immdiate de la qualit du rejet avec un retour progressif la normale.
La premire cause d'arrive de produits industriel ou plus exactement celle qui
apporte le plus de dsordres est le dpotage d'hydrocarbures (fuel). Outre un
dysfonctionnement d'ordre biologique on assiste un colmatage partiel ou total de la
surface du contact, avec un retour la normale difficile (dcolmatage pralable);
au lessivage du support lors d'une surcharge hydraulique (perte du biofilm). Il s'avre
prfrable de limiter ponctuellement (par temps de pluies) le dbit d'entre pour que
lit soit toujours oprationnel;
un schage du biofilm du fait d'une alimentation insuffisante ou irrgulire en
effluent (panne de la recirculation ou du relvement);
au basses tempratures dans le racteur biologique en priode hivernale;
au manque d'oxygnation (colmatage, ventilation mcanique hors service, cart de
temprature eau/air insuffisant).
VII.2. COLMATAGE DES LITS
VII.2.1.Causes
De fait la principale cause de dysfonctionnement d'un lit bactrien est li au colmatage
plus ou moins profond du support :
Les lits bactriens - Page 235
non respect des conditions hydrauliques d'autocurage (bouchage de la pompe, de la
cloche de chasse, mauvais choix du dbit de relvement);
fuites de boues au niveau du dcanteur primaire ou du dcanteur digesteur;
dfaut de fonctionnement des prtraitements (dgrillage, tamisage, dgraissage, ...);
arrives d'effluents visqueux (huiles, hydrocarbures);
traitement physico-chimique des effluents en amont du lit, ou retour important de
polymre de l'atelier de dshydratation des boues;
trop grande vitesse de rotation du sprinkler;
remise en service du lit aprs schage partiel.
Par souci d'conomie, les constructeurs choisissent des dbit d'alimentation proches du
dbit d'autocurage, ce qui est un facteur aggravant.
VII.2.2.Mesures curatives
Quand un dbut de colmatage est constat (flaque d'eau en surface, rpartition
inquitable en pied de lit) , le premier rflexe doit tre de dtecter son origine pour traiter la
cause; ce sera souvent suffisant. Des mesures curatives sont prendre citons
principalement :
augmentation provisoire de la charge hydraulique superficielle (augmentation de la
recirculation : mise en service simultane de plusieurs pompes de relvement);
ralentissement de la vitesse ou arrt localis du sprinkler;
retournement manuel du matriau de surface (sur quelques dizaines de cm).
Il s'agit souvent d'un simple colmatage de surface qu'il est facile de corriger. Dans les cas
les plus critiques, il s'agit d'un colmatage "de fond" ou seule la dpose de l'ensemble du
matriau support et son lavage (lance incendie, ...) permettra une rhabilitation du lit. Il ne
faut pas compter sur un apport massif de soude pour assurer le dcolmatage du lit.
VII.3. PRECAUTIONS DEXPLOITATION
VII.3.1.Lits bactriens
Quand est envisager un arrt du lit bactrien pour une longue priode, il est ncessaire au
pralable de procder, autant que faire ce peut, un lavage du support par une charge
hydraulique massive (lavage haute pression, alimentation en eau claire, arrt localis du
sprinkler).
La qualit du matriau support (et son tat) et le volume du lit bactrien vont conditionner
les performances puratoires de l'installation (il faut aussi tenir compte du traitement
primaire) . Il convient donc de vrifier si la charge surfacique est compatible avec un
rendement puratoire permettant de dlivrer un effluent pur de qualit suffisante.
Dans le cas contraire, s'il est prvu une rhabilitation du traitement, le remplacement du
matriau support existant (pouzzolane par exemple) par un autre support plus performant
(plastique ordonn par exemple) doit obligatoirement s'accompagner d'une remise en cause
du dbit de relvement et de la configuration du sprinkler.
VII.3.2.Disques biologiques
Page 236 - Chapitre 11
En ce qui concerne les disques biologiques les dysfonctionnement sont souvent
conscutifs une mauvaise rpartition des effluents entre les diffrents tages des
biodisques mais le plus souvent un arrt plus ou moins prolong de la rotation des
tambours (pannes lectriques ou mcaniques).
Lors de cette priode d'arrt, la partie emmerge va s'asscher, la partie immerge va au
contraire se charger en biomasse. Ceci qui va occasionner un phnomne de dsquilibre
(balourd) avec des efforts mcaniques tels, qu'il a t observe des ruptures mcaniques
souvent irrversibles. Quand les risques de casse sont importants, une vidange totale de
l'auge sous le tambour, un lavage et un asschement complet (arrt de l'alimentation) des
disques est envisager avant toute remise en service.
Ces expriences malheureuses, lies une mauvaise conception et un mauvais
dimensionnement des ouvrages (il s'agissait souvent d'un mme constructeur), sont
l'origine de l'abandon de cette technique pourtant largement utilise dans des pays voisins
(SUISSE). Les nouvelles gnrations de biodisques tiennent compte de ces contraintes.
Chapitre 12
LE LAGUNAGE
F.VIRLOGET
Page 238 - Chapitre 12
SOMMAIRE
I. PRESENTATION.....................................................................................................................................239
II. PRINCIPE DE TRAITEMENT...............................................................................................................240
II.1 LES BACTERIES....................................................................................................................................241
II.2 LES VEGETAUX MICROSCOPIQUES (ALGUES OU MICROPHYTES) ...........................................................241
II.3 ZOOPLANCTON....................................................................................................................................242
II.4 LES VEGETAUX MACROSCOPIQUES (MACROPHYTES) ...........................................................................243
III. PRINCIPALES FILIERES DE TRAITEMENT...............................................................................244
III.1 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES ...........................................................................................................244
III.2 LAGUNAGE NATUREL ..........................................................................................................................245
III.2.1 Avantages et inconvnients........................................................................................................245
III.2.2 Dimensionnement ......................................................................................................................245
III.2.3 Exemples de dimensionnement ..................................................................................................247
III.3 LAGUNAGE FACULTATIF......................................................................................................................248
III.4 LAGUNAGE AERE.................................................................................................................................249
III.5 LAGUNAGE ANAEROBIE.......................................................................................................................249
III.6 LAGUNAGE DE FINITION ......................................................................................................................250
III.6.1 Dsinfection...............................................................................................................................250
III.6.2 Finition, tampon ........................................................................................................................254
La lagunage - Page 239
I. PRESENTATION
Historiquement, c'est au dbut de ce sicle en Amrique du Nord que le lagunage
rellement t considr comme une technique d'puration, il a fallu attendre la fin de la
deuxime guerre mondiale pour que des recherches srieuses soient conduites ce sujet.
Le traitement des effluents urbains par la technique du lagunage (appel aussi dans
certains pays tang de stabilisation) s'est dvelopp rellement en FRANCE (souvent sous
l'impulsion du CEMAGREF) partir des annes 70 et 75 (la premire installation a t
construite en 1965 au GRAU DU ROI).
Avec la mise en place d'une politique active de construction de stations d'puration
conscutive la cration des Agences Financires de Bassins (aujourd'hui Agences de
l'Eau) leur nombre s'est multipli rapidement. On dnombre actuellement en FRANCE
environ 2 500 installations de ce type pour des capacits nominales presque
systmatiquement infrieures 2000 eH (70 % environ infrieures 500 eH). La technique
du lagunage naturel est la plus utilise (80 % des installations).
Gographiquement, on localise le plus grand nombre de lagunes sur le littoral atlantique
(Normandie et Bretagne notamment) ainsi que sur le bassin Mditerranen (Languedoc-
Roussillon). A contrario, les zones montagneuses et celles forte densit de population sont
peu propices l'implantation d'un tel systme de traitement (grandes surfaces planes
ncessaires, cot du terrain). Il existe cependant quelques ralisations d'installations
d'importance relative dans des rgions touristiques (ROCHEFORT EN MER, ILES de RE et
de NOIRMOUTIER, LEUCATE, GRAU DU ROI, MARSEILLAN, MEZE, ...).
Les performances puratoires de ce procd extensif (temps de sjour de 15 100 jours
selon les configurations) sont moins importantes que pour les installations de type boues
actives faible charge ou autres techniques intensives. Le choix d'une telle filire de
traitement est souvent justifi lorsque l'impact sur le milieu naturel est faible au niveau des
matires organiques, azotes et phosphores ou/et lorsqu'il est vis une certaine
dsinfection des effluents avant rejet (zones de baignade, conchylicoles). De plus les
ouvrages s'intgrent tout fait bien dans des sites naturels.
Certaines industries agro-alimentaires sont encore quipes d'un traitement de leur
effluent par l'intermdiaire d'un dispositif de lagunage ar (avec quelquefois, en amont une
lagune anarobie). Toutefois les performances tant souvent insuffisantes, on assiste
progressivement leur abandon. Du fait de l'importante concentration des effluents traiter,
le traitement s'apparente plus un systme boues actives (flux de boues en sortie de la
lagune are infrieur la production de boues ).
Le lagunage est aussi utilis en complment ou en association avec d'autres procds de
traitement :
lagunage anarobie / lagunage ar;
dcanteur digesteur / lagunage (ar, naturel);
dcanteur primaire ou physico-chimique / lagunage (ar, naturel);
lagunage naturel / disques biologiques / lagunage (ar, naturel);
lit bactrien (avec ou sans clarification) / lagunage naturel de finition;
boues actives-clarification / lagunage de finition;
lagunage / infiltration-percolation.
Page 240 - Chapitre 12
En fonction de la zone d'implantation et des conditions climatiques (temprature,
ensoleillement), de la nature des effluents (concentration, flux), de la filire de traitement
choisie (lagunage naturel, ar facultatif, ar, de finition), et de la configuration et du
dimensionnement des ouvrages, les performances puratoires des installations seront trs
variables.
La circulaire du 4 novembre 1980 prvoit un niveau de rejet adapt cette filire de
traitement, soit les concentrations maximales dans les eaux traites (traitement complet des
effluents urbains domestiques) :
MES : 120 mg/l;
DBO
5
: 40 mg/l;
DCO : 120 mg/l.
Remarque : Les mesures de DCO et de DBO
5
s'effectuent partir d'chantillons
pralablement filtrs, ce qui revient admettre le rejet dans le milieu naturel de
phytoplancton (algues) qui se dveloppe sur les bassins.
L'exploitation se rsume le plus souvent un entretien des ouvrages de prtraitements
(les installations les plus petites sont souvent quipes d'un simple dgrillage manuel), des
abords, le cas chant au rglage du temps de fonctionnement des turbines ou organes
d'aration. Il est donc peu possible d'intervenir activement dans le "process" de traitement.
Dans certains cas cependant, il est possible de faire varier le niveau du plan d'eau dans les
bassins, ce qui peut permettre de matriser le temps de sjour des effluents.
Le curage des lagunes envases constitue la tche la plus lourde (et bien videment la
plus onreuse) effectuer sur ces installations pour une frquence bien plus importante (4
6 ans) que celle prvue initialement par le concepteur (souvent 10 15 ans).
II. PRINCIPE DE TRAITEMENT
Dans un procd de traitement de type lagunage la destruction de la pollution traiter
s'opre grce une succession et une association de processus physico-chimiques et
biologiques extrmement larges.
On prendra comme exemple un traitement par lagunage naturel (filire de traitement la
plus courante), o l'installation est constitue d'une lagune primaire (profondeur totale : 1,5
2 m, surface : 5 m
2
/eH), d'une lagune secondaire (profondeur totale : 1 1,5 m, surface :
2,5 m
2
/eH), lagune tertiaire (profondeur totale : 0,5 1 m, surface : 2,5 m
2
/ eH).
Dans le premier bassin s'effectuera une dcantation des matires en suspension et d'une
partie de la pollution collodale. Au fond de cet ouvrage, des micro-organismes anarobies
vont hydrolyser et solubiliser une partie des matires organiques dcantes. Dans la partie
suprieure existe une zone arobie (aration mcanique, et dans certains cas de sous
charge polluante, oxygnation par photosynthse) o les bactries prsentes dans le milieu,
dgradent les matires organiques solubles ou en suspension selon des processus
identiques ceux qui s'tablissent dans un traitement par boues actives. Loxygnation est
assure par des algues, grce la photosynthse :
La lagunage - Page 241
Dans les bassins suivants, la faible profondeur et l'paisseur limite des sdiments permet
de maintenir des conditions d'arobiose par aration mcanique (effet du vent) et
oxygnation par photosynthse. L encore, les bactries prsentes dans le milieu, dgradent
les matires organiques solubles ou en suspension selon des processus identiques ceux
qui s'tablissent dans un traitement par boues actives.
II.1 LES BACTERIES
Quel que soit le procd biologique mis en oeuvre, les bactries assurent toujours la part
prpondrante, voire la totalit de la dgradation de la matire organique. La ralisation
d'installations d'puration biologique repose donc systmatiquement sur la cration d'une
culture bactrienne grande chelle. Le lagunage n'chappe pas la rgle.
Dans les systmes extensifs, caractriss entre autre par l'absence de recirculation de la
culture bactrienne, il y a rgulation naturelle du dveloppement des bactries, en fonction
de la nourriture qui leur est apporte et d'autres conditions physico-chimiques (oxygne, pH,
temprature, ...). La rgulation de cette masse bactrienne est un quilibre entre sa
croissance et les sorties du systme, par dpart avec l'effluent ou par sdimentation. La
phase liquide reste le lieu de la dgradation de la matire organique en solution ou
collodale.
Du fait du faible brassage et de l'absence d'oxygnation en fond de bassin, les dpts se
trouvent en condition d'anarobiose. Les bactries anarobies ralisent la "minralisation"
de la matire organique des dpts (transformation de la matire organique en matires
minrales et en gaz CO
2
et CH
4
).
Une nette surcharge organique et un dficit en oxygne induisent une prolifration
d'espces bactriennes sulfato-rductrices, puis celle d'espces bactriennes
photosynthtiques sulfo- oxydantes (dans la partie suprieure des bassins) pigment rouge
pourpre qui peut colorer l'ensemble de la surface du (des) bassin(s).
II.2 LES VEGETAUX MICROSCOPIQUES (ALGUES OU MICROPHYTES)
Le rayonnement solaire est la source d'nergie qui permet la production de matire
vivante par les chanes alimentaires aquatiques.
Les substances nutritives sont apportes par les effluents sous forme de sels minraux
dissous et de matires organiques dissoutes collodales ou particulaires (100 mg d'algues =
50 mg en C; 8 mg en N; 1 mg en P).
Cette nergie et les substances nutritives vont permettre la production de vgtaux
(algues), qui vont constitus alors un lment essentiel dans le processus du traitement.
Les algues vont en effet utiliser la lumire solaire et le gaz carbonique durant la priode
diurne (fonction chlorophyllienne), les sulfates, les nitrates et les phosphates pour
synthtiser leur propre matriel cellulaire et produire de l'oxygne comme rsidu (160 mg
d'O
2
/100 mg d'algues). Cet oxygne est alors disponible pour les bactries arobies. Ces
algues sont planctoniques (disperses dans la masse d'eau), priphytiques (fixs sur des
supports immergs) ou pipliques (dposs la surface des sdiments) :
algues bleus (cyanophyces);
algues vertes (chlorophyces);
Page 242 - Chapitre 12
algues brunes (chysophyces, diatomes);
euglniens.
la photosynthse dpendant de lactivit solaire, la lagune arobie est surtout intressante
pour les pats forte insolation. Lintensit de laction solaire conditionne aussi la profondeur
de la lagune (faible pour les faibles insolations et inversement).
Pour une charge importante en matire organique, on observera principalement des
algues brunes, puis des algues vertes quand la charge va diminuer. Certaines algues sont
capables dans des conditions favorables (temprature notamment) de prolifrer trs
rapidement (blooms).
De nombreuses algues rencontres dans les lagunes peuvent utiliser la fois les
substances minrales et les substances organiques.
Ces organismes planctoniques ont une vie trs brve, aprs leur mort, la partie non
consommes par leurs prdateurs va sdimenter et se dcomposer dans les couches
profondes.
Il est important de souligner que l'activit photosynthtique va occasionner, du fait de la
production de CO
2
, une lvation du pH (notamment durant la saison estivale ou en priode
de fort ensoleillement) jusqu' des valeurs pouvant atteindre pH 9 10 (il est possible de
constater entre la priode diurne et nocturne un cart de pH de 0,5 1).
II.3 ZOOPLANCTON
L'importance de la faune zoo planctonique est souvent sous-estime. Certains organismes
vont liminer les bactries, algues, substances organiques particulaires. Ils contribuent donc
pleinement l'puration et l'claircissement du milieu.
Citons principalement :
Les protozoaires (flagells, cilis) : certaines espces bactriophages et dtritivores
sont abondantes dans les eaux les plus charges et dans les sdiments. Leur
prsence indique un effluent peu dgrad; on les rencontre essentiellement dans les
premiers bassins. Les paramcies sont les plus abondantes. D'autres sont algivores
et microphages. Leur densit est troitement lie la charge organique du milieu. Ils
participent l'limination des germes de contamination fcales.
Les rotifres : ceux-ci consomment phytoplancton et bactries (jusqu' 10 fois leur
poids par jour). Certaines espces algivores apparaissent avec le " bloom " algual.
Leur densit est en relation troite avec le taux d'oxygne dissous : leur maximum de
dveloppement concide avec le dveloppement algual maximal. Les protozoaires et
rotifres sont incapables d'assurer la consommation de la production alguale, de ce
fait leur rle en lagunage est rduit.
Les cladocres : les plus abondants appartiennent au genre DAPHNIA. Prdateurs
du phytoplancton et des bactries. Leur capacit de filtration est leve, ils
contribuent l'abattement des matires organiques (lies au MES), des coliformes,
des protozoaires mais aussi des algues les plus petites avec une forte consommation
en oxygne.
La lagunage - Page 243
De fait, on peut considrer qu'en lagunage, on assiste une eutrophisation provoque.
Le plancton se dveloppe prfrentiellement dans la tranche suprieure des bassins ou la
diffusion du rayonnement solaire est possible (jusqu' une profondeur de 1 1,5 m selon la
turbidit de l'eau) avec un maximum en surface ( sur 20 30 cm).
Le rejet du plancton au sein de l'eau pure est invitable sans tape de filtration
complmentaire (filtration sur sable). La qualit de l'puration ne peut tre juge que sur la
qualit de l'eau interstitielle, les normes de rejet sont exigibles ce titre sur des critres
analytiques partir d'chantillon pralablement filtrs.
Toutefois l'impact rel sur le milieu naturel doit tenir compte de la masse planctonique
rejete. Cet aspect souvent "oubli" fait l'objet de discussion polmiques, il faut rappeler que
la dure de vie des algues tant limite, leur dcomposition va gnrer une demande en
oxygne non ngligeable (100 mg d'algues en dcomposition induisent une DBO ultime de
150 mg d'oxygne) .
C'est du dbut du printemps jusqu' la fin de l't que se situe le plus fort dveloppement
algual qui, combin une vaporation maximale, va augmenter considrablement la
concentration dans le rejet avec un impact maximal sur le milieu naturel dans sa priode de
forte fragilit.
II.4 LES VEGETAUX MACROSCOPIQUES (MACROPHYTES)
Les macrophytes sont des vgtaux suprieurs sous formes fixes ou libres que l'on
rencontre en lagunage. Il s'agit gnralement de phanrogrammes (roseaux, scirpes,
massettes, ...).
Leur utilit est assez controverse. En principe ils jouent un rle de support pour d'autres
organismes et favorisent les changes nutritionnels avec le sol, les sdiments, les eaux et
assurent une certaine consommation des lments fertilisants.
On retrouve souvent les vgtaux rhizomes suivants : scirpes, phragmites (roseau
commun), typhas (massettes). Ces vgtaux sont gnralement plants sur une banquette
immerge en bordure de bassin; on constate, dans certaines conditions (faible hauteur d'eau
sur les berges notamment, absence de fauchage, de faucardage), une colonisation naturelle.
Il peut tre mis en place une lagune spcialise dont la vgtation couvre l'ensemble du
bassin (lagune macrophytes). Dans ce cas, la sortie des effluents s'effectue toujours par
surverse.
Pratiquement, l'utilit des vgtaux macrophytes dans l'amlioration du traitement des
effluents reste dmontrer. De plus l'entretien doit tre effectu rgulirement (faucardage
annuel).
Il convient de noter une autre voie beaucoup plus intressante dans l'utilisation de ces
vgtaux macrophytes. Il s'agit d'une technique de filtration verticale (de haut en bas) sur
des lits plants de roseaux (Phragmites communis). Le filtre est constitu d'un
soubassement quip d'une reprise des effluents qui assure galement la ventilation basse
du systme (plancher bton alvol ou cailloux), puis d'une couche de sable et de tourbe o
sont plants les roseaux.
Page 244 - Chapitre 12
Il s'agit d'une technique de filtration, se rapprochant des systmes dits "d'infiltration
percolation". Les roseaux assurent un rle d'oxygnation du milieu et de limitation du
colmatage. Cette technique a t dveloppe tout d'abord en Allemagne (travaux de
madame SEIDEL) et en Grande Bretagne; il existe actuellement plus de 400 installations de
ce type dans la C.E.E. Ces filtres peuvent tre utiliss en substitution une lagune primaire
(les MES retenues sont "compostes" progressivement) et une lagune secondaire
(filtration du plancton).
III. PRINCIPALES FILIERES DE TRAITEMENT
III.1 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
Il s'agit toujours de bassins creuss dont l'tanchit est assure naturellement (aprs
compactage de la terre) ou par l'intermdiaire d'une bche plastique.
Il existe de nombreuses installations o l'on constate une mauvaise tanchit des
lagunes (au moins 50 %) du fait essentiellement d'un manque de srieux dans la
construction (absence d'tude de sol pralable). En ce qui concerne les lagunes quipes
une bche plastique on constate galement des dfauts d'tanchit (mauvaise soudure des
ls) ainsi que des remontes de la bche du fait de l'absence d'un rseau de drainage
assurant le dgazage du sous-sol.
Pour assurer la stabilit du talus une pente (horizontale sur verticale) de 2,5/1 (cot eau)
doit tre respecte avec une hauteur de revanche de 0,50 1 m.
L'entretien des abords par engin mcanis ncessite une bande de roulement d'au moins
trois mtres de largeur. Il faut limiter au maximum le dveloppement de la vgtation dans le
primtre immdiat des lagunes (empierrement, gravillonnage, ...) pour limiter la colonisation
des insectes et rongeurs et le dpt d'herbes et de feuilles dans les bassins. Dans le but de
facilit les oprations de curage des lagunes (lagune primaire principalement), il est opportun
de prvoir la mise en place d'une rampe d'accs pour un engin (mini pelle).
Dans certaines situations, il sera ncessaire d'adopter une profondeur des lagunes
suprieure 1 m pour limiter la prolifration des moustiques (dpt d'oeufs sur les herbes
aquatiques).
Quand les risques de batillage (rosion des berges par les vagues) sont importants (vent,
turbines flottantes) il est ncessaire de prvoir un traitement spcifiques des berges
(fascines, enrochement, bton projet, membrane filtre type BIDIM).
Le raccordement entre les diffrents ouvrages doit permettre une variation de la hauteur
du plan d'eau (gestion des temps de sjour). Accessoirement, cette variation du plan d'eau
va limiter la prsence des rats (immersion des galeries creuses par les rongeurs). Il faut
pouvoir galement disposer d'une cloison siphode amovible (sa mise en place est choisir
pour chaque cas). Il est essentiel de prvoir une canalisation de " by-pass " permettant
d'isoler une des lagunes (au moins la lagune primaire) pour en assurer l'entretien (vidange,
asschement, curage).
La lagunage - Page 245
A la surface utile des lagunes, il faut donc ajouter les emprises des digues, accs,
cltures, btiment, prtraitement. Cela conduit multiplier la surface utile des lagunes par
1,5 2 pour dfinir approximativement l'emprise totale de la station d'puration.
On distingue plusieurs filires de traitement : lagunage naturel, lagunage ar facultatif,
lagunage ar, lagune de finition.
III.2 LAGUNAGE NATUREL
Cette technique est la plus utilise en FRANCE (80 % des cas). Le lagunage naturel se
caractrise gnralement (2 cas sur 3) par la prsence de trois bassins creuss dans le sol
et disposs en srie, pour une surface spcifique de 10 15 m
2
/eH et un temps de sjour
des effluents de 60 90 jours.
III.2.1 Avantages et inconvnients
La lagune arobie est dune exploitation simplifie et ncessite une main doeuvre rduite
et peu qualifie. Sa construction est simple et conomique, si on excepte le prix du terrain.
Les dpenses dnergie sont nulles.
Les effluents en sortie de lagune prsente souvent des teneurs gnralement leves en
MES (au moins 40 mg/l). De plus, des dparts massifs dalgues certaines priodes
peuvent entraner des concentrations en MES suprieures 1 000 mg/l.
La surface ncessaire est importante : 5 m
2
/hab en Isral, 40 50 m
2
/hab dans les pays
froids. Les lagunes sont frquemment la source de nuisances olfactives, du fait de dpts et
dune oxygnation insuffisante.
Les berges souvent herbeuses servent de gtes de reproduction aux moustiques. Il est par
ailleurs ncessaire de curer priodiquement les dpts (environ tous les 5 ans).
III.2.2 Dimensionnement
Plusieurs modes de dimensionnement ont t proposs. Globalement, ces formulations ou
valeurs empiriques dfinissent des surfaces ou des temps de sjour.
Climat kg DBO
5
/j/ha Temps de sjour (j)
Glacial < 10 > 200
Hivers froids et ts temprs 10 50 100 200
Tempr semi tropical 50 150 30 100
Tropical 150 350 15 30
Tableau 10-1 : Dimensionnement des lagunes en fonction des conditions climatiques.
La disparit des valeurs traduisent particulirement bien l'influence des conditions
atmosphriques (temprature de l'eau, insolation) sur les performances du lagunage.
Page 246 - Chapitre 12
RT = (C
0
- C) / KC
soit : C = C
0
/ (KR + 1)
K = vitesse.
R = temps de sjour des eaux (j).
C
0
= concentration entre lagune (mg DBO
5
/l).
C = concentration sortie lagune (mg DBO
5
/l).
Plusieurs auteurs font tat de valeurs du coefficient K en fonction de la temprature
(tableau 10-2).
Il est important de noter la trs grande influence de la temprature sur le
dimensionnement des bassins puisque le volume des bassins peut varier du simple au
quadruple environ entre 10 et 25 C.
Auteur Formule T = 10 C T = 15 C T = 20 C T = 25 C
x K = 0,1811 1,084
t-16
0,11 0,17 0,25 0,37
D.FIHLO K = 1,2 1,085
t-35
0,16 0,23 0,35 0,53
F.SAUZE K = 0,035 1,114
t
0,10 0,18 0,30 0,52
RINGUELET 0,11 en hiver 0,20 en t
MARAIS 0,17 en Afrique du Sud
Tableau 10-2 : Valeurs de K en fonction de la temprature.
Compte tenu des rsultats moyens obtenus sur les installations en FRANCE, pour
dterminer le coefficient k, il est prfrable d'utiliser la formulation la plus contraignante :
K = 0,1811 1,084
t-16
Compte tenu de la surface d'change air / eau et du temps de sjour des effluents dans
les lagunes la temprature de l'eau dans les bassins va tre trs proche de la moyenne de la
temprature de l'air ambiant. La temprature d'air de rfrence prendre en charge est la
plus basse valeur moyenne mesure dans l'anne sur une priode d'un mois. Toutes ces
informations sont disponibles sur serveur Minitel (3615 METEO).
La lagunage - Page 247
III.2.3 Exemples de dimensionnement
Le tableau suivant donne le temps de sjour (j) en fonction de la concentration des eaux
brutes traiter et de la temprature (concentration des eaux traites 20 mg DBO
5
/l) :
Concentration des effluents bruts (mg DBO
5
/l)
Temprature (C) 50 100 150 200 250 300 350
5 20 54 87 120 154 188 221
10 13 35 58 81 103 125 148
15 9 24 39 54 69 84 99
20 6 16 26 36 46 56 66
25 4 11 17 24 31 37 44
30 3 7 12 19 21 25 29
Tableau 10-3 : Temps de sjour en fonction de la concentration des eaux brutes traiter et de la
temprature.
L'alimentation du dispositif s'effectue gravitairement ou aprs refoulement par pompage.
Le prtraitement des effluents est assur par dgrillage et dgraissage statiques ce qui
permet de s'affranchir de toute alimentation lectrique.
C'est dans la lagune primaire que se situe la plus forte demande en oxygne. Il faut
disposer d'une surface suffisante de cette lagune pour permettre le dveloppement
planctonique qui doit fournir l'oxygne ncessaire. Dans la lagune primaire va s'oprer
l'essentiel de l'limination de la pollution carbone.
La lagune primaire reprsente au minimum la moiti de la surface totale pour une hauteur
d'eau utile de 1 1,5 m (hauteur totale moyenne 1,5 2 m). Il est prfrable de ne pas
dpasser une profondeur moyenne de 1,1 m. La tendance actuelle est d'augmenter encore
la surface relative de la lagune primaire pour la porter 60 % de la surface totale.
Afin de mnager une grande souplesse au niveau de l'exploitation, notamment au moment
des oprations de curage, il peut tre opportun de prvoir, surface totale gale, la mise en
place de deux lagunes primaires disposes en parallle avec possibilit de "by-pass" de
chacun des bassins (pour un abaissement de plan d'eau ou une mise sec).
Cette disposition oblige une parfaite rpartition hydraulique qui peut tre facilement
assure quand on dispose d'une alimentation par poste de relvement (alternance des
alimentations par affectation d'une pompe de relvement par lagune).
Page 248 - Chapitre 12
Au niveau de l'alimentation, dans la premire partie de la lagune primaire, peut tre
amnage une surprofondeur (partie d'ouvrage ventuellement btonne) permettant de
recueillir les matires en suspension les plus lourdes (cne de sdimentation) et donc de
faciliter leur reprise par pompage (hydrocureuse, tonne lisier). Ce cne de sdimentation
peut tre dimensionn 5 10 % de la surface de lagune primaire pour une profondeur
maximale de deux mtres. Dans ce cas les vacuations de ces boues "primaires" sont
assures rgulirement ce qui va rduire au maximum les contraintes au moment du curage
de la lagune.
La surface de la lagune secondaire reprsente 20 25 % de la surface totale des bassins.
La hauteur d'eau se situe entre 0,5 et 1 m (hauteur totale : 1 1,5 m).
La surface de la lagune tertiaire reprsente 20 25 % de la surface totale des bassins. La
hauteur d'eau est gnralement infrieure 0,5 m (hauteur totale : 1 m).
Il est possible de trouver des installations avec un plus grand nombre de lagunes et de
plus grandes surfaces. Certaines stations sont quipes de deux lagunes primaires
(alimentes en parallle ou en srie) ce qui peut permettre facilement une mise sec de
l'une d'entre elle avant curage. La lagune tertiaire peut tre plante de vgtaux
macrophytes.
Pour ce type de filire de traitement, une rusticit est vise, l'exploitation se rsume en un
entretien rgulier et indispensable des installations de prtraitement (souvent un simple
dgrillage nettoyage manuel) et des abords (fauchage des berges). Les ouvrages
s'intgrent gnralement bien dans le paysage (pour peu que l'on utilise avantageusement le
relief et les formes du terrain disponible).
Toutefois, les surfaces ncessaires sont importante puisqu'au 10 15 m
2
utile de bassin
par usagers il faut ajouter les surfaces des digues et talus et les emprises divers (accs,
prtraitement, ...) ce qui reprsente 5 10 m
2
supplmentaires (par usagers). Du fait de ces
grandes surface ncessaires ce type d'installation est adapt au collectivit de petite taille.
Thoriquement le cot d'une station d'puration de type lagunage est moins lev que
pour un traitement par boues actives aration prolonge (20 30 %). Toutefois, plusieurs
facteurs peuvent occasionner des surcots non ngligeables comme le prix du terrain, la
mise en place d'une tanchit artificielle ce qui ne rend plus obligatoirement ce type
d'installation concurrentiel au niveau des investissements.
III.3 LAGUNAGE FACULTATIF
Pour ce type d'installation la lagune primaire (profondeur moyenne de 1,5 3 m) est
quipe d'un systme d'aration (turbine, diffusion d'air), qui assure une oxygnation de la
surface du bassin.
La puissance absorbe ne permettant pas un brassage de la totalit du bassin (2
6 W/m
3
) la sdimentation des MES reste possible, on retrouve des conditions d'anarobiose
au fond de l'ouvrage. Les puissances en jeu n'tant pas importantes une protection des
berges contre les effets de batillage n'est gnralement pas assure.
Comme en ce qui concerne le lagunage naturel deux lagunes compltent l'installation (il
peut exister d'autres lagunes supplmentaires). Les temps de sjour sont en gnral plus
courts (30 60 jours).
La lagunage - Page 249
En fonction de la charge polluante traiter et de l'envasement de la lagune primaire le
temps de fonctionnement de l'aration sera variable. Les consommations lectriques
deviennent rapidement trs importantes pour atteindre des valeurs identiques voire
suprieures celles obtenues dans les installations de type "boues actives aration
prolonge" ( charge gale). La mise en place d'un systme d'aration va occasionner un
surcot d'investissement important par rapport une installation de lagunage naturel
(alimentation lectrique, armoire de commande, arateurs) pour atteindre des valeurs
proches d'un traitement par boues actives aration prolonge. On ne plus gure parler de
rusticit du systme.
III.4 LAGUNAGE AERE
Ces installations sont constitues d'une lagune d'aration et d'une lagune de dcantation
(sur certaines stations, il peut exister plusieurs lagunes d'aration et de dcantation). La
lagune d'aration est quipe de turbines flottantes ou fixes (profondeur 2 3 m) ou de
systmes d'insufflation d'air (profondeur 3 5 m).
En toute logique la puissance de l'arateur devrait tre telle que le brassage du bassin soit
efficace (pour des turbines de surface : 20 30 W/m
3
). Presque systmatiquement sur les
installations existantes, la puissance installe ne permet pas un brassage de la totalit du
bassin (puissance installe 5 10 W/m
3
pour assurer les seuls besoins en oxygne) la
sdimentation des MES reste possible, on retrouve des conditions d'anarobiose au fond de
l'ouvrage.
En thorie, les puissances dveloppes au brassage sont suffisamment importantes pour
qu'une protection des berges contre les effets de batillages soit mise en place.
L'puration des effluents se rapproche d'un traitement de type boues actives sans
recirculation ou la concentration des boues est fonction de la concentration des effluents en
entre et du temps de sjour des eaux. Le temps de sjour des effluents est souvent limit
10 ou 15 jours.
En fonction de la charge polluante traiter et de l'envasement de la lagune primaire
(relarguage des produits de fermentation) le temps de fonctionnement de l'aration sera
variable. Les consommations lectriques sont en gnral trs importantes et dpassent
celles obtenues dans les installations de type "boues actives aration prolonge" ( charge
gale).
Comme pour les installations de type lagunage ar facultatif, la mise en place d'un
systme d'aration va occasionner un surcot d'investissement important par rapport une
installation de lagunage naturel (alimentation lectrique, armoire de commande, arateurs)
pour atteindre des valeurs proches d'un traitement par boues actives aration prolonge.
On ne plus gure parler de rusticit du systme.
III.5 LAGUNAGE ANAEROBIE
Dans la majorit des cas, les problmes dodeurs, lis aux faibles rendements obtenus,
font que le lagunage anarobie ne peut tre utilis dans les conditions rglementaires
europennes.
On peut toutefois envisager son utilisation comme prtraitement deaux industrielles trs
chargs condition dtre loign de toute habitation. Les temps de sjour sont suprieurs
20 jours et dpassent frquemment 50 jours.
Page 250 - Chapitre 12
Les charges volumiques appliques sont de lordre de 0,01 kg DBO
5
/m
3
.jour et les
rendements dlimination de la DBO
5
varient entre 50 et 80 %. La teneur en MES dans
leffluent trait est gnralement lev.
III.6 LAGUNAGE DE FINITION
Par dfinition, la mise en place d'un lagunage de finition se justifie chaque fois qu'il est
vis une certaine dsinfection des effluents et un "lissage" de la qualit du rejet (effet
tampon). Cela constitue un trs bon complment derrire une installation boues actives
aration prolonge.
III.6.1 Dsinfection
III.6.1.1 Principe
Les germes pathognes contenus dans les effluents domestiques proviennent
essentiellement de la flore microbienne intestinale. Le dnombrement des coliformes fcaux
et ventuellement des streptocoques fcaux est suffisant pour caractriser le niveau de
pollution bactrienne (germes tests de contamination fcale).
Dans les eaux uses brutes, les dnombrements font souvent tat des concentrations
suivantes :
Coliformes totaux : 7 9 units log/100 ml;
Coliformes fcaux : 6 8 units log/100 ml;
Streptocoques fcaux : 6 7 units log/100 ml;
Salmonella : jusqu' 4 units log/100 ml;
Clostridium (sulf. rd) : 10
6
/100 ml;
Entrovirus : jusqu' 460/100 ml.
L'abattement en coliformes fcaux dans une installation de type boues actives est de 1
ou 2 Ulog. Le risque de contamination direct des baignades par les rejets de stations
d'puration est donc important.
Les directives Europennes fixent pour les baignades des limites microbiologiques :
10 000 coliformes totaux / 100 ml (valeur guide : 500);
2000 coliformes fcaux / 100 ml (valeur guide : 100)
absence de salmonelle / 1 l;
absence de virus entriques / 10 l.
Il faut galement tenir compte de la prsence de virus et mycobactries ainsi que des
formes hautement rsistantes : spores, kystes, oeufs.
La lagunage - Page 251
Sur le plan lgislatif il n'existe pas de norme gnrale prcisant sur la qualit
bactriologique des effluents purs de station d'puration. Validant l'approche de l'O.M.S.,
le conseil suprieur de l'hygine publique de FRANCE (C.S.H.P.F) propose de retenir le
risque parasitologique comme le plus reprsentatif du risque infectieux li l'utilisation des
eaux uses. Ces travaux ont fait l'objet de la diffusion d'une circulaire du Ministre des
Affaires sociales et de l'intgration (DGS / SD1.D. / 91 n 51 du 22 juillet 1991) relative
l'utilisation des eaux uses pures pour l'irrigation des cultures et l'arrosage des espaces
verts.
Dans cette circulaire il est surtout proposer des recommandations en matire de
contraintes bactriologiques et parasitologiques (contrainte de type A cf. p. 38) :
oeuf d'helminthes intestinaux (tnia, ascaris) : infrieur ou gal 1 / litre;
coliformes thermotolrants (fcaux) : infrieur ou gal 10 000 / litre.
Les causes exactes de la rduction du nombre de germes pathognes (germes tests de
contamination fcales) dans un lagunage sont encore mal connues. Plusieurs hypothses
sont avances (facteurs favorables) :
limitation du substrat;
temprature;
temps de sjour lev;
comptition d'espces, prdation;
sdimentation avec les MES;
limpidit des effluents;
hauteur d'eau;
rle germicide des rayons U.V. solaires;
insolation;
coulement dans les bassins.
III.6.1.2 Dimensionnement
Il existe plusieurs formulations concernant la dsinfection bactriologique en lagunage
naturel (MARAIS, GLOYNA, BCEOM RINGUELET) :
Bassin unique N = N
0
/ (KR + 1)
Bassins multiples N = N
0
/ [(KR
1
+ 1) (KR
2
+ 1) (KR
3
+ 1) ...]
N = nombre de bactries par 100 ml aprs temps de sjour en lagune (coliformes fcaux).
N
0
= nombre de bactries par 100 ml dans les eaux l'entre de la lagune (coliformes fcaux).
R = temps de sjour hydraulique dans les lagunes 1, 2, 3 etc (jour).
K = "constante de vitesse"
= 2,6 1,19
t-20
avec t entre 5 et 21 C, 0,8 20 C pour Salmonella typhi (MARAIS)
= 3,9 1,13
t-20
(SAUZE)
Page 252 - Chapitre 12
N = N
0
e
(-K
R)
N = nombre de bactries par 100 ml aprs temps de sjour en lagune (coliformes fcaux).
N
0
= nombre de bactries par 100 ml dans les eaux l'entre de la lagune (coliformes fcaux).
R = temps de sjour hydraulique dans les lagunes 1, 2, 3 etc (jour).
K = "constante de vitesse "
= exp (exp (0,0254 t - 0,948)) pour t > 10 C (BCEOM RINGUELET)
= exp 0,504 = 1,66 pour t < 10 C (LANGUEDOC/ROUSSILLON)
Le coefficient K t galement reli l'nergie reue au sol E (calorie/cm
2
par jour) :
K = exp [(1,138 10
-5
E
6
) + 0,504] si t > 10 C
Il existe d'autres systme de calcul par abaques (GLOYNA O.M.S 20 C ?)
Les tableaux ci aprs montre la disparit des rsultats pour 3 exemples :
Auteur MARAIS BCEOM SAUZE O.M.S
Temprature (C) 20 20 20 20
N
0
(coli. fcaux) 10
8
10
8
10
8
10
8
R (jour) 30 30 30 30
K 3,09 1,9 4,41
N 1,1 10
6
3 10
3
0,8 10
6
1,1 10
6
Tableau 10-4 : Performances avec un seul bassin.
Auteur MARAIS BCEOM SAUZE O.M.S
Temprature (C) 20 20 20 20
N
0
(coli. fcaux) 10
8
10
8
10
8
10
8
R (jour) 90 90 90 90
K 3,09 1,9 4,41
N 1,4.10
2
14 0,5.10
2
< 10
3
(
*
)
(
*
)
hors abaque
Tableau 10-5 : Performances avec 3 bassins en srie avec une rpartition des volumes 1/2, 1/4, 1/4.
La lagunage - Page 253
Auteur MARAIS BCEOM SAUZE
Temprature (C) 10 10 10
N
0
(coli. fcaux) 10
8
10
8
10
8
R (jour) 90 90 90
K 0,46 1,66 1,15
N 2,4.10
6
1,4 1.10
6
Tableau 10-6 : Performances avec 3 bassins en srie avec une rpartition des volumes 1/2, 1/4, 1/4.
Il est important de souligner que ces rsultats ont t obtenu sur des installations de
lagunage sans autre traitement pralable (boues actives, lits bactriens, ...)
Le nombre de facteurs intervenant dans le mcanisme de la dsinfection tant important, il
est difficile d'tablir des rgles fiables pour assurer un dimensionnement prcis du lagunage.
III.6.1.3 Performances
Les diffrents rsultats obtenus en FRANCE montent que pour des temps de sjour de 60
90 jours les abattements de la population bactrienne sont en moyenne de 3 4 units log
dans les conditions mtorologiques favorables (priode estivale). En priode hivernale
selon la rgion et l'ensoleillement les performances sont trs variables, en conditions
dfavorables (basse temprature, couverture nuageuse permanente) l'abattement peut tre
rduit 1 2 units log.
La dsinfection sera d'autant plus efficace que le traitement pralable sera performant au
niveau des MES, DCO/DBO
5
, N, P. Ceci est particulirement vrai dans d'une association
un traitement biologique de type boues actives faible charge capable d'assurer un
traitement de l'azote global et fortiori du phosphore (dveloppement algual limit
permettant une bonne limpidit et facilitant donc la diffusion U.V. solaire). Il est possible,
dans ce cas, de mettre en place des bassins d'une profondeur de 1,5 2 m.
Ainsi, aprs un traitement pralable par boues actives aration prolonge performant
(traitement de l'azote et mieux du phosphore), il est possible d'obtenir un abattement de 4
5 units log en priode favorable avec un temps de sjour de 30 jours.
Les oeufs d'helminthes peuvent tre limins avec une dcantation en lagune moyennant
un temps de sjour minimum de 8 10 jours (une dsinfection chimique au chlore
notamment est considre comme inadapte du fait de sa faible efficacit).
Comme pour l'limination de la pollution organique, la dsinfection est plus efficace avec
plusieurs bassins disposs en srie, un coulement "piston" doit tre systmatiquement vis.
Page 254 - Chapitre 12
III.6.2 Finition, tampon
III.6.2.1 Principe
La mise en place de lagune(s) de finition est particulirement adapte, aprs un traitement
biologique performant, pour garantir en permanence la qualit du rejet dans des milieux
naturels fragiles.
Par un effet de lissage, la lagune tampon permet de rduire l'ampleur des pointes de
pollution au niveau de rejet dans le milieu rcepteur ce qui peut tre prcieux pour la
sauvegarde du patrimoine piscicole. Il est alors possible de faire face d'ventuels
dysfonctionnements de l'installation en amont (coupure EDF, by-pass, pertes de boues, ...)
L'efficacit du bassin tampon sera d'autant plus importante que son volume sera grand et
que le dysfonctionnement sera exceptionnel et limit dans le temps.
En aucun cas l'implantation d'un tel ouvrage doit constituer une solution pour faire face
un dysfonctionnement chronique de l'installation en amont (fuites de boues). Un bassin pige
boues peut tre construit, l'enlvement des boues doit s'effectuer au fur et mesure de
l'accumulation. Il est essentiel de ne pas favoriser le dveloppement algual par un rejet
permanent de substances nutritives.
III.6.2.2 Dimensionnement
Pour un seul effet de dilution, en excluant toute raction biologique complmentaire il est
possible d'utilis la formulation suivante :
C
s
= C
e
+ [(C
i
- C
e
) e
-Q/ Vt
]
C
e
= concentration l'entre de la lagune (exemple : 300 mg DBO
5
/l)
C
i
= concentration initiale dans la lagune (exemple : 20 mg DBO
5
/l)
C
s
= concentration en sortie de lagune (exemple : 29 mg DBO5/l)
Q = dbit pendant le dysfonctionnement (exemple : 150 m
3
/j)
t = temps de dysfonctionnement (exemple : 1 jour)
V = volume de la lagune (exemple : 4500 m
3
pour 30 jours de temps de sjour)
En mettant en place plusieurs lagunes de finition, positionnes en srie (pour une surface
totale quivalente), il est possible de retarder encore la charge rejete lors d'un
dysfonctionnement exceptionnel et de "jouer" au maximum sur l'effet de dilution.
Chapitre 13
LES LITS FILTRANTS PLANTES DE ROSEAUX
ou
LITS A MACROPHYTES
A. SADOWSKI
Chapitre 13 page
256
SOMMAIRE
1) GENERALITES ........................................................................................................................................... 257
2) PRINCIPE..................................................................................................................................................... 257
3) LIT HORIZONTAL..................................................................................................................................... 258
4) LIT VERTICAL........................................................................................................................................... 258
5) PERFORMANCES ...................................................................................................................................... 258
6) DOMAINE DAPPLICATION................................................................................................................... 259
7) ROLE DES ROSEAUX................................................................................................................................ 259
8) LITS DE SECHAGE PLANTES DE ROSEAUX...................................................................................... 260
Chapitre 13 page
257
LES LITS FILTRANTS PLANTES DE ROSEAUX
ou
LITS A MACROPHYTES
1) Gnralits
Diffrents termes pour nommer ce type de filire de traitement cultures fixes :
lits macrophytes ( macrophytes = vgtaux suprieurs ou roseaux)
rhizosphres ( cest ainsi quest appel le milieu biologique et
physicochimique existant autour des racines des roseaux)
Filtres plants de roseaux
Lits filtrants plants de roseaux
2) Principe
Les filtre plants de roseaux se classent parmi les filires de traitement biologique
cultures fixes sur supports fins (sable, gravier), rapports et aliments lair
libre, au mme titre que linfiltration-percolation sur sable.
Dans ce terme gnrique de filtre plants de roseaux nous trouvons 3
techniques, sensiblement diffrentes par bien des aspects ;
1) circulation de trs faible lames deau sur des sols plants de roseaux,
2) circulation deau par cheminement horizontal (appel aussi cheminement
transversal) sous la surface du sol - matriaux plants de roseaux (systme
dit KICKUTH ou filtre horizontal)
3) infiltration deau verticalement dans des sols - matriaux, drains (systme
dit SEIDEL ou filtre vertical)
Ce sont les systme N2 et N3 qui sont les plus utiliss, avec une prfrence
technique pour le systme des filtres verticaux conu par le Dr Seidel (systme
test et valid par le CEMAGREF, son dveloppement a t confi un bureau
dtude priv SINT, dans le cadre dun transfert de savoir-faire)
Chapitre 13 page
258
3) Lit horizontal
Le lit horizontal est sujet colmatage, il est prcd dun traitement primaire
(dcanteur, fosse IMHOF), positionn soit en traitement secondaire ou tertiaire,
avec une alimentation en continu, filtre partiellement ou totalement noy.
Dimensionnement : 1tage et 1 file ou plusieurs files
en secondaire : 5 7 m
2
/Eq.Hab
en tertiaire : 1 m
2
/Eq.Hab
hauteur de matriaux : de lordre de 0,6m
4) Lit vertical
Le lit horizontal est aliment en direct (sans ncessit dun traitement primaire - la
couche superficielle fait office de protection contre le colmatage du premier tage),
lalimentation se fait imprativement par bche et par alternance de phase.
Dimensionnement : 2 tages et 2 files minimum :
1
er
tage : 1 2,5 m
2
/Eq.Hab
2
me
: 1 2,5 m
2
/Eq.Hab
hauteur de matriaux : de lordre de 0,6 0,9m
5) Performances
Ce mode de traitement (filtration verticale) permet de respecter le niveau D4
conformment la circulaire du 17.02.1997, circulaire ( en annexe) dapplication
de larrt du 21.06.1994 relatif aux installations de moins de 12Ok/j de DBO5.
Le niveau D4, ainsi que les performances indiques ci-dessous, ne peut tre
obtenus que sur un installation comportant au moins 2 tages en srie de lits
filtration verticale.
Chapitre 13 page
259
Paramtres
Performances
attendues
Niveau D4 selon la
circulaire
DBO5 25mg/l 25 mg/l
DCO 90mg/l 125 mg/l
MES 30mg/l
NK 10 mg/l en moyenne
pointe de 20mg/l
NGL ngligeable
Ptot ngligeable
6) Domaine dapplication
Traitement des effluents domestiques brutes ( sans dcantation pralable), non
septiques,
pour des agglomrations de lordre de 50 1000 eq.hab.
7) Rle des roseaux
La plantation des filtres avec des roseaux (Phragmites australis ou Phragmites
communis) procure plusieurs avantages :
les racines des roseaux scrtent des acides organiques et dgagent des
quantits limites doxygne, favorisant ainsi le dveloppement des bactries
dans leur entourage (on parle alors de leffet de rhizosphre ) , effet trs
ngligeable dans le processus de traitement
les roseaux favorisent, par le dveloppement de leurs tiges autour desquelles
leau peut percoler, linfiltration de leau et diminuent le risque de colmatage
total des filtres , effet principal des roseaux, savoir maintenir le milieu
filtrant ouvert y compris la surface des lits,
ils gardent lhumidit sur la surface des filtres et ils tiennent la surface des filtres
labri du soleil et des rayons UV., ce qui permet une trs bonne minralisation
des boues retenues sur la surface, qui se transforment en terreau et gardent
une bonne permabilit ,
ils donnent incontestablement un aspect plus esthtique aux filtres et facilitent
leur entretien (plus de dsherbage une fois que les roseaux sont bien tablis,
pas de grattage de la surface des filtres).
Chapitre 13 page
260
Contrairement aux tiges ariennes des roseaux, qui fanent et meurent la fin de
lautomne, les tiges souterraines - les rhizomes - poursuivent leur croissance
pendant tout lhiver, permettant au printemps suivant des repousses assez
loignes des tiges mres .
Les besoins du roseau en azote et phosphore sont trs limits par rapport
aux quantits importantes de ces sels nutritifs amenes sur les filtres avec les
eaux uses. En effet, aucune plante ne peut produire dans nos latitudes
suffisamment de biomasse pour incorporer de telles quantits sur une surface de
quelques mtres carrs, la dnitrification est ngligeable ainsi que le
traitement du phosphore.
La nitrification est obtenu par la prsence dautotrophe, loxygne est issu de lair
par leffet de piston dans lacheminement vertical de leffluent dans le milieu
filtrant.
Contrairement ce quon peut lire parfois, lazote et le phosphore ne sont donc
pas limins par les plantes dans le systme des filtres plants de roseaux
ou dans tout autre systme travaillant avec des surfaces similaires.
Dautant plus que les sels nutritifs absorbs par les plantes sont loin dtre
limins du systme : ils seront remobiliss lorsque la biomasse meurt. Dans un
systme maturit, absorption et remobilisation sont en quilibre.
Pour rompre cet quilibre, il faudrait exporter les plantes du systme avant
quelles ne meurent. Evidemment, ceci nest possible que pour leurs parties
ariennes, quil faudrait alors couper quand elles sont encore vertes.
8) Lits de schage plants de roseaux
Le procd de lits de schage plants de roseaux, ou Rhizocompostage
(marque dpose par la Lyonnaise des Eaux et Rhizophyte marque dpose
par la SAUR) est compos dun massif filtrant constitu de diffrentes couches de
sable de granulomtries diffrentes qui reposent sur un radier.
Des roseaux de type Phragmite communis sont plants (4 au m
2
) sur le massif
quils colonisent en dveloppant un rseau de drainage grce laction de leurs
racines (rizhomes).
Les boues provenant directement du bassin daration sont pandus la surface
du lit selon des cycles alternant des priodes de repos et des priodes
dalimentation ( par exemple : 1 semaine dalimentation et 2 semaines de repos).
A lapplication dune dose de boues, les rhizomes vont favoriser le drainage des
percolats, laration du milieu, et permettre un stabilisation des boues par
compostage.
Chapitre 13 page
261
La frquence de curage des lits est de lordre de 5 ans, avec une hauteur
moyenne utile de boues de 1,5m.
Pour le dimensionnement la charge maxi est de 150 g MES / m
2
.j.
Pour optimiser le fonctionnement, il y a lieu de prvoir au moins 3 lits.
Lalimentation des lits se fait par bche (afin de napper le lit sur des hauteur de
boues de lordre de 5 15 cm par bche) avec environ un nombre de lordre de 1
4 de bches par jour , pour un dbit de pompage de lordre de 0,15 m
3
/m
2
.h.
La surface maximale dun lit est de 100m
2
, avec une largeur maximale de 5m.
Le nombre de point dalimentation sobtient en prenant un point dalimentation
pour une surface unitaire sollicite de 25 m
2
.
Les drains sont disposs sur la largeur de lits raison dun drain pour 15 m
2
.
Une ventilation haute et basse est raccorde sur les drains.
Chapitre 13 page
262
MASSIF FILTRANT
Massif filtrant pour des lits dinfiltration-percolation sur sable
RI ZOSPHERE: P ROCEDE
KI CKUTH
Lit plant de roseaux de type horizontal ou transversal
Chapitre 13 page
263
Lit macrophytes de type SEIDEL
Lit plant de roseaux de type vertical
L IT S D E S E C H A G E P L A N T E S D E RO S E A U X
E h > 1 5 0 / 2 0 0 m V
v = 0 , 8 - 1 ,2 m / s
R m in = 3 0 m m
E va cu a ti o n d e s p e r co l a ts ve r s t t e d e st at i o n
P er c o l at : M ES < 1 00 m g . l
-1
E h > 3 00 m V
N H
4
+
+ N O
3
-
< 1 00 m g . l
-1
2 m
0 ,1 m
0, 2 m
0,1 m
C a il lo u x (3 0 / 8 0 m m )
G r a v ier (2 / 8 m m )
S ab le lav
A lim e n ta ti o n b o u e s
1 5 0 g ME S .m
- 2
.j
-1
D r a in (1 /15 m
2
d e s u r fa ce )
R p ar t i te u r
C h e m i n e
d e v e n t i la t i o n
B OU E
R o s ea u x ( P h r a g m ite s c o m m u n is)
4 p lan t s / m
2
d e l it
P la n t a t i o n d e m a i s e p t e m b r e
N e s u p p o r t e p a s l 'a n a r o b i o s e
Lit plant de roseaux pour le schage des boues
Chapitre 13 page
264
D I S P O S I T I F D E P U R A T I O N P A R L I T S A
M A C R O P H Y T E S
P a n n e s s i e r e s ( J u r a )
D I S P O S I T I F D E P U R A T I O N P A R L I T S A
M A C R O P H Y T E S
P a n n e s s i e r e s ( J u r a )
Chapitre 14
LES TECHNOLOGIES DE
DESINFECTION DES EAUX USEES
F.LEFEVRE
Page266 - Chapitre 14
SOMMAIRE
I. INTRODUCTION.....................................................................................................................................267
II. PROBLEMATIQUE.................................................................................................................................267
III. MICROBIOLOGIE DES EAUX RESIDUAIRES.............................................................................267
III.1. TENEURS EN MICRO-ORGANISMES DANS LES EAUX USEES ...................................................................268
III.2. POUVOIR AUTO-EPURATEUR D'UNE STATION D'EPURATION..................................................................269
III.3. NORMES DE REJET ...............................................................................................................................270
IV. LES TECHNIQUES SPECIFIQUES DE DESINFECTION...........................................................271
IV.1. LES TRAITEMENTS DITS EXTENSIFS......................................................................................................271
IV.1.1. L'infiltration-percolation ...........................................................................................................271
IV.1.2. Le lagunage de finition ..............................................................................................................272
IV.2. LES TRAITEMENTS DE DESINFECTION...................................................................................................273
IV.2.1. Les produits halogns ..............................................................................................................273
IV.2.2. L'ozone.......................................................................................................................................277
IV.2.3. Les U.V. .....................................................................................................................................279
IV.3. LES NOUVELLES TECHNIQUES DE DESINFECTION .................................................................................281
IV.3.1. L'acide practique....................................................................................................................281
IV.3.2. L'ultrafiltration ..........................................................................................................................282
V. RECAPITULATIF DES MOYENS DE DESINFECTION DES EFFLUENTS..................................282
VI. COUTS DE LA DESINFECTION......................................................................................................283
VII. CONCLUSION.....................................................................................................................................284
Page267 - Les technologies de dsinfection des eaux uses
I. INTRODUCTION
La station d'puration a pour rle d'liminer les diverses pollutions prsentes dans l'eau
brute de faon rendre le rejet cologiquement compatible avec le milieu rcepteur.
Si l'limination des matires organiques et minrales est assez bien matrise ce jour, la
rduction de la pollution bactrienne est reste marginale et la mise en oeuvre de traitement
de dsinfection s'est peu dveloppe.
Or, l'heure actuelle, la situation devient critique et la dgradation bactriologique des
zones de baignade ou de conchyliculture ne peut rester sans impliquer un dveloppement
rapide d'une stratgie de dsinfection.
II. PROBLEMATIQUE
Les premiers traitements de dsinfection dcoulent tout naturellement des procds mis
au point pour l'eau potable. Si la dmarche semblait logique, elle se heurte des objectifs
diffrents et un produit de base, l'influent de station de traitement, de matrice beaucoup
plus complexe que dans le cas des eaux potabiliser.
En eau potable, le souci est de rduire au maximum la contamination et d'assurer un
rsiduel de biocide dans le rseau de distribution. Cet effet rmanent du dsinfectant est par
contre, pour les eaux rsiduaires, un lment ngatif car susceptible d'induire une toxicit
directe sur les organismes prsents dans le milieu rcepteur.
Un autre lment prendre en compte est la surestimation du pouvoir auto-purateur du
milieu rcepteur (estuaire, cte, rivire, ...). Il apparat que le temps de survie des micro-
organismes peut atteindre plusieurs jours notamment dans des conditions de fortes teneurs
en matires organiques et/ou lorsque la pntration de la lumire est affecte par une
turbidit importante.
Lorsque les stations de traitement sont situes en zone sensible (captages, baignades,
conchyliculture), le rejet d'eaux rsiduaires plus ou moins traites accrot les risques de
contamination. la dsinfection des eaux uses devient alors ncessaire afin de limiter le
risque de transmission des germes pathognes l'homme. Ces stations sont donc
susceptibles de faire appel un tage de dsinfection.
III. MICROBIOLOGIE DES EAUX RESIDUAIRES
Certaines des bactries, virus et parasites identifis dans les eaux rsiduaires sont
pathognes pour l'homme :
les bactries peuvent entraner des maladies telles que le typhus, le parathyphus, le
cholra, la gastro-entrite et la dysenterie;
les virus peuvent entraner des maladies telles que l'hpatite, la polio et la grippe;
les parasites intestinaux peuvent entraner des maladies telles que la dysenterie
amibienne, la mningite, la gastro-entrite.
Ces maladies sont transmises l'homme aprs consommation de fruits de mer, d'eau
potable. Aucune tude n'a rvl de maladie contracte par baignade en eau "pollue".
Page268 - Chapitre 14
Les doses de germes pathognes susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme
dpendent du germe ingr et de l'tat de sant de l'individu contamin.
Diverses tudes montrent que ces doses sont trs variables. L'infection de 50% des
personnes testes ayant mang des coquillages levs en" eaux troubles" correspond
l'ingestion :
10
5
10
8
cellules pour Salmonelles sp;
10 100 cellules de Shigella seulement;
1 10 kystes de protozoaires Entamoeba coli et Giardia lambia.
Il serait fastidieux et onreux de faire une analyse systmatique de tous les germes
pathognes susceptibles d'tre rencontrs dans une eau use domestique. Gnralement,
la pratique consiste dnombrer les germes indicateurs d'une contamination fcale (GTCF),
savoir :
les coliformes totaux (CT),
les coliformes fcaux (CF),
les streptocoques fcaux (SF),
car leur dnombrement est simple et rapide. On semble admettre que la prsence de virus
et de parasites dans l'influent sera d'autant plus probable que la densit de GTCF sera
leve.
La mesure des taux de CF et CT en entre et en sortie d'une tage de dsinfection permet
d'apprcier l'efficacit du traitement.
III.1. TENEURS EN MICRO-ORGANISMES DANS LES EAUX USEES
Les concentrations en micro-organismes prsents dans les eaux uses sont dpendantes
des variations saisonnires et des variations diurnes. De plus, ces micro-organismes sont le
plus souvent agrgs entre eux ou adsorbs sur des matires en suspension ce qui rend
souvent leur numration difficile.
Les ordres de grandeur les plus souvent rencontrs sont mentionns ci aprs :
Micro-organismes Dnombrements (nb/100 ml)
Coliformes Totaux
Coliformes fcaux
Streptocoques fcaux
Escherichia coli
Salmonella
Entrovirus
10
7
10
9
10
6
10
8
10
6
10
7
10
6
10
8
2 10
4
4 460
Tableau 11-1 : Teneurs en micro-organismes dans les eaux uses.
Page269 - Les technologies de dsinfection des eaux uses
III.2. POUVOIR AUTO-EPURATEUR D'UNE STATION D'EPURATION
Les stations d'puration ne sont pas conues dlibrment pour assurer l'limination de la
pollution des micro-organismes. Cependant un certain abattement des germes peut tre
obtenu tout au long de la filire eau.
La dcantation primaire est trs inefficace vis--vis de l'limination des germes. Les
pourcentages atteints se situent entre 10 et 60 %. La variabilit des rsultats peut s'expliquer
par le fait que les rductions restent lies aux pigeages des particules en suspension et
donc trs dpendants de la gomtrie de l'ouvrage, de la vitesse de dcantation et de la
qualit de l'eau brute.
Les procds biologiques assurent une limination de 90 99 % des micro-organismes
contenus dans les eaux uses. Les performances sont dpendantes du type de station, des
performances du clarificateur puisque tout dpart de boue rduit nant cette puration. Les
racteurs cultures fixes (biofiltres, lits bactriens) donnent des abattements semblables.
La prsence d'une filtration tertiaire assure une rduction supplmentaire d'environ 0,5
unit logarithmique.
Gnralement, les teneurs habituelles d'une eau use diverses tapes du traitement
sont :
Coliformes totaux (nb/100 ml) Coliformes fcaux (nb/100
ml)
Eau brute 10
7
- 10
9
10
6
- 10
8
Sortie primaire 10
7
- 10
8
10
6
- 10
7
Sortie secondaire 10
5
- 10
6
10
4
- 10
5
Sortie tertiaire filtre 10
4
- 10
5
10
3
- 10
5
Tableau 11-2 : Teneurs habituelles en micro-organismes dans une eau use diverses tapes du
traitement.
Page270 - Chapitre 14
Le pouvoir auto-purateur d'une station de traitement peut tre rsum comme suit (les
rsultats sont habituellement exprims par rapport un volume d'chantillon de 100 ml) :
Micro-organismes Abattement d'un
traitement primaire
Abattement d'un
traitement secondaire
Sortie secondaire (nb/ 100ml)
mini maxi
Coliformes totaux < 1 Ulog 2 Ulog 4,5 10
4
2.10
6
Coliformes fcaux < 1 Ulog 2 Ulog 1,1 .10
4
1,6.10
6
Tableau 11-3 : Abattements dune station de traitement.
III.3. NORMES DE REJET
Les normes relatives aux eaux de baignade ont t fixes par la Directive du 8 dcembre
1975 du Conseil des Communauts Europennes. En droit franais, elles ont t rendues
applicables aux baignades amnages par le dcret 81-324 du 7 avril 1981, et tendues
l'ensemble des zones de baignade en application de la "Loi littorale" 86-2 du 3 janvier 1986.
La qualit des eaux de zones conchylicoles est dfinie par la Directive 79-923 du Conseil
des Communauts Europennes du 30 octobre 1979. La qualit microbiologique des
coquillages est soumise l'arrt du 12 dcembre 1979 applicable aux produits d'origine
animale.
Les normes de rejets respecter pour les effluents rejets dans un milieu rcepteur
varient selon la sensibilit du milieu : zone de baignade ou de conchyliculture. A titre
indicatif, les rglementations applicables aux Etats Unis et dans la CEE sont :
ETATS UNIS EUROPE
(3)
Eau de baignade < 200
(1)
CF
(2)
/100 ml < 10 000 CT/ 100 ml
< 2000 CF/100 ml
Eau de conchyliculture < 70 CT/100 ml
< 14 CF/100 ml
< 300 CF/100 ml
(4)
Cours d'eau ordinaire < 1000 CT/100 ml
< 200 CF/100 ml
< 10 000 CT/100 ml
< 2 000 CF/100 ml
(1)
Pour les eaux de baignade aux EU, la moyenne calcule est une moyenne gomtrique. De plus,
moins de 10 % de tous les chantillons prlevs pendant une priode de 30 jours ne doit dpasser
400 CF/100 ml.
Page271 - Les technologies de dsinfection des eaux uses
(2)
CT = coliformes totaux, CF = coliformes fcaux.
(3)
Directives europennes 76/160 et 79/923.
(4)
La concentration est calcule pour 100 ml de chair broye.
Tableau 11-4 : Rglementations amricaine et europenne.
Certains tats des Etats-Unis (ex : Maryland, Louisiane) ont adopt des normes encore
plus svres (< 3 CT/100 ml).
Compte tenu des normes de qualit dfinies pour les milieux rcepteurs concernant les
paramtres microbiologiques, les rductions qu'il faut atteindre pour respecter les objectifs
de salubrit sont de 3 4 units logarithmiques sur l'effluent trait.
Les performances d'auto-puration d'une station de traitement montrent qu'elle ne peut
absolument pas rpondre aux objectifs de qualit en terme de pollution microbienne, un
traitement spcifique complmentaire doit tre envisag.
IV. LES TECHNIQUES SPECIFIQUES DE DESINFECTION
IV.1. LES TRAITEMENTS DITS EXTENSIFS
IV.1.1. L'infiltration-percolation
IV.1.1.1.Gnralits
L'infiltration-percolation est un procd d'puration arobie, qui consiste infiltrer, des
eaux uses urbaines pralablement dcantes ou des effluents secondaires, raison de
quelques centaines de litres par mtre carr et par jour, travers plusieurs mtres de sol
naturel en place ou de sol rapport. Elle est capable de hautes performances sanitaires ;
l'limination des bactries se fait par sdimentation, filtration, adsorption et dgradation
microbienne (prdation, parasitisme, comptition nutritive, ...
Les bactries et les virus retenus dans le sol sont sujets une mort naturelle qui peut
intervenir plusieurs semaines voire plusieurs mois aprs leur rtention. Il est certain qu'un
choc brutal, qui dsquilibre un cosystme contribue leur disparition.
IV.1.1.2.Mise en oeuvre
A la suite d'un traitement secondaire, une installation d'infiltration-percolation assurant un
traitement tertiaire est constitue d'un stockage, d'un systme de rpartition, d'un dispositif
d'alimentation des bassins, du massif filtrant et du dispositif de restitution la nappe ou du
systme de drainage avant le rejet.
La mise en oeuvre de l'infiltration-percolation repose sur l'utilisation de deux bassins de
manire travailler en alternance sur l'un ou sur l'autre. Ce doublement des bassins
d'infiltration est ncessaire pour minimiser les phnomnes de colmatage : colmatage
intervenant en surface par sdimentation des matires en suspension, colmatage dans la
masse rsultant d'un dveloppement de biofilm bactrien. Le repos momentan d'un des
bassins lui permet de se drainer, de se scher dans la masse et donc de rtablir ses
performances puratoires.
Page272 - Chapitre 14
La survie des bactries est assure tant qu'une certaine humidit persiste dans le massif.
Ainsi grce aux priodes d'asschement qui succdent celles de submersion, on contribue
crer des conditions trs dfavorables leur survie.
Un des points essentiels du traitement est l'alimentation du bassin : celle-ci doit se faire
trs rapidement de manire couvrir l'ensemble de la surface d'infiltration. Le principe
d'alimentation le mieux appropri est l'alimentation par bche. Le fractionnement de la
charge journalire traiter en bche permet un gain considrable au regard de la
dsinfection : en augmentant les temps de passage les plus courts, on s'affranchit des
pointes de pollution. L'limination des micro-organismes est directement lie la charge
spcifique traite : c'est la relation "hauteur du massif filtrant - charge applique en
centimtre d'eau" qui dfinit la qualit du traitement.
C'est l'objectif de dcontamination qui fixe l'paisseur des massifs filtrants. Le pouvoir de
dsinfection dpend :
du temps de sjour de l'eau dans le massif filtrant;
de l'efficacit de l'oxydation;
du fractionnement des apports;
de l'homognit de la rpartition des influents sur le massif filtrant.
Pour obtenir une dsinfection performante (abattement de 5 6 Ulog sur les coliformes
fcaux) il faut pouvoir maintenir un temps de sjour dans le massif filtrant de plus de 30
heures.
L'exprience a montr que ce temps minimum est obtenu pour des vitesses d'infiltration de
0,50 m/j et une hauteur de massif filtrant de 4 m (sable dunaire).
IV.1.2. Le lagunage de finition
IV.1.2.1.Gnralits
La technique du lagunage consiste maintenir l'eau brute pendant des dures
importantes dans le systme purateur. Ce sjour permet un abattement consquent de la
population bactrienne puisque des chiffres de 3 4 Ulog sont couramment rencontrs.
Dans un procd de traitement de type lagunage de finition, la dpollution s'effectue par
voie physico-chimique et biologique.
Les causes exactes de la rduction du nombre de germes pathognes sont mal connues,
on reconnat un certain nombre de facteurs et paramtres susceptibles de jouer un rle :
limitation de substrat;
temprature;
temps de sjour lev;
comptition d'espces, prdation;
sdimentation avec les MES;
limpidit des effluents;
hauteur d'eau;
Page273 - Les technologies de dsinfection des eaux uses
rle germicide des rayons solaires, ...
IV.1.2.2.Mise en oeuvre
Une lagune de finition est un bassin peu profond en gnral 0,5 1 m, la surface requise
est de 2,5 m
2
par quivalent habitant. De part sa faible profondeur et l'paisseur limite de
sdiment (les tapes de prtraitement et traitement de la pollution carbone tant effectues
en amont soit par une boue active, soit par un lagunage) des conditions arobies sont
maintenues dans cette lagune de finition.
Les expriences franaises montrent que pour des temps de sjour de 60 90 jours les
abattements en micro-organismes sont en moyenne de 3 4 Ulog. Les variables qui
impliquent ces rsultats sont outre le temps de sjour, les conditions mtorologiques
favorables (priode estivale), la pntration de la lumire. En priode hivernale, les
performances sont extrmement variables : l'abattement peut tre rduit 2, voire 1 Ulog.
En dehors de l'infiltration-percolation et du lagunage de finition, qui ncessitent des
surfaces disponibles importantes, les techniques d'puration classiques ne peuvent pas
rpondre aux normes de salubrit des rejets sans l'addition de ractifs chimiques ou sans
l'effet d'agent physique.
IV.2. LES TRAITEMENTS DE DESINFECTION
Dans les traitements de dsinfection, un agent chimique ou physique est mis en oeuvre
pour assurer la destruction directe des micro-organismes.
IV.2.1. Les produits halogns
Trois produits ont t tests pour la dsinfection d'eaux rsiduaires urbaines : le chlore, le
dioxyde de chlore et le chlorure de brome avec toutefois une nette dominance du chlore.
IV.2.1.1.Principe
L'opration consiste mettre en contact de la faon homogne le ractif avec l'effluent et
de maintenir un temps de raction appropri pour que l'inactivation des micro-organismes ait
lieu.
Le chlore prsent dans l'eau sous forme ionique pntre dans la cellule aprs une
altration de la membrane cytoplasmique, ragit avec les acides amins et enzymes et
bloque ainsi le mtabolisme du glucose. La membrane tant altre et ne pouvant plus
assurer sa "production d'nergie", la cellule meurt.
Ractions :
Cl
2
+ H
2
O HCLO + H
+
+ Cl
-
( pH faible)
NaOCl + H
2
O HCLO + OH
-
+ Na
+
( pH lev)
IV.2.1.2.Mise en oeuvre
La ralisation d'un poste de chloration doit rpondre un dimensionnement prcis. Le
point d'injection du ractif doit tre dans une zone de mlange parfait. De plus, le temps de
contact entre le dsinfectant et l'effluent traiter ne peut tre assure que par une
hydraulique de type flux piston.
Page274 - Chapitre 14
Le dioxyde de chlorure est un ractif trs instable et doit tre fabriqu sur place partir de
l'oxydation de chlorites (ClO
2
-
) par le chlore. Il est alors inject dans l'eau sous forme
gazeuse ou liquide. Le chlorure de brome est livr sous forme de liquide pressuris. Sa
vaporisation s'effectue temprature ambiante. Il est inject sous forme gazeuse.
IV.2.1.3.Efficacit
Il est difficile de dterminer avec prcision la quantit de dsinfectant appliquer et les
abattements en coliformes associs une quantit donne de dsinfectant. Des quations
empiriques, calcules au cas par cas seulement, permettent de fixer les doses appliquer.
Des tudes menes sur les sites de Montpellier, de La Tremblade ont permis de dfinir
des doses mettre en oeuvre :
Site Objectif Qualit de l'eau dosage CL
2
(mg/l)
Temps de
contact (mn)
Montpellier Rduction 3 Ulog
Rduction 3 Ulog
Eau clarifie
Eau filtre
3,5 4
2,5 3,5
30 40
30 40
La
Tremblade
1000 CT/100 ml
100 CT/100 ml
1000 CT/100 ml
100 CT/100 ml
1000 CT/100 ml
100 CT/100 ml
Floculation-Dcantation
Floculation-Dcantation
Epuration biologique
Epuration biologique
Effluent nitrifi
Effluent nitrifi
10
15
8
10
4
6
30
30
30
30
30
30
Tableau 11-5 : Efficacit de la chloration en fonction du dosage et du temps de contact.
Le chlore et le chlorure de brome ragissent avec l'ammoniaque. Un surdosage en
dsinfectant est ncessaire afin d'avoir un rsiduel en chlore libre non combin dans l'eau
traite.
Le dioxyde de chlore ne ragit pas avec l'ammoniac mais oxyde certaines amines,
aldhydes, ctones et alcools.
Page275 - Les technologies de dsinfection des eaux uses
IV.2.1.4.Sous-produits toxiques de la chloration
Le chlore ragit de faon prfrentielle avec l'ammoniaque pour former en cours de
raction des produits intermdiaires que sont les mono, di et trichloramines. En fait,
l'oxydation de l'ammoniaque par le chlore permet la transformation complte en azote
gazeux. Cette raction demande stoechiomtriquement 6 mg de Cl
2
pour 1 mg de NH
4
+
mais
compte tenu des ractions parasites, le dosage pour dpasser le point de rupture ncessite
l'apport de 9 10 mg de chlore. La rmanence des composs comme la monochloramine
pose un problme de toxicit vis--vis de la faune du milieu rcepteur. Des effets toxiques
marqus ont t nots pour des teneurs infrieures 0,1 mg/l.
Production de chloramines :
NH
4
+
+ HOCl NH
2
Cl + H
2
O + H
+
(monochloramines)
NH
2
Cl + HOCl NHCl
2
+ H
2
O (dichloramines)
NHCl
2
+ HOCl NCl
3
+ H
2
O (trichloramines)
La prsence d'ammoniaque dans l'effluent traiter accrot considrablement la demande
en chlore de l'effluent. Le chlore est utilis prfrentiellement pour l'oxydation de la matire
azote. Une fois cette oxydation acheve, le chlore devient disponible la dsinfection. Il est
donc ncessaire d'apporter une dose de ractif telle que la demande en chlore de l'effluent
soit satisfaite : le traitement de dsinfection se sera donc au-del du "break-point"
Le chlore ragit galement avec les molcules carbones induisant la formation de sous-
produits de type haloforme (chloroforme) mais les teneurs dtectes n'ont dans aucun cas
excd 50 g/l.
IV.2.1.5.Phnomne de reviviscence
Ce phnomne de reviviscence a t mis en vidence par certains auteurs. Les
exprimentations menes en laboratoires montrent que des micro-organismes subissant une
chloration sont susceptibles de rcuprer leur potentialit de survie.
Ces rsultats issus d'expriences de laboratoire ne doivent pas tre considrs comme
directement transposables au milieu naturel. Cependant, un tel effet doit tre pris en
considration pour apprcier rellement l'efficacit de la dsinfection.
IV.2.1.6.Avantages
La chloration est une technique simple, fiable et employant trs peu d'quipement. C'est la
technique la plus couramment utilise ce jour car la moins onreuse (cf. VI).
Les cots de construction lis l'emploi de produits halogns sont faibles. L'quipement
ncessaire pour la rgulation de la chloration est un chloromtre permettant le rglage du
dbit de chlore gazeux injecter. La rgulation se fait sur le chlore rsiduel qui doit se
maintenir entre 1 et 2 mg/l.
Page276 - Chapitre 14
IV.2.1.7.Inconvnients
L'efficacit n'est relle que sur les bactries et est troitement dpendante de la
temprature, du pH, de la concentration en MES, en matires organiques et en matires
azotes donc, de l'tat de fonctionnement de la station de traitement amont. Son pouvoir est
nul sur les virus et les parasites.
La chloration gnre des produits toxiques (chlore rsiduel, chloramines) pour le milieu
rcepteur.
Pour supprimer les effets indsirables du chlore, une tape de dchloration, mettant en jeu
un compos rducteur tel que le dioxyde de soufre ou le bisulfite de sodium, peut tre
ajoute. D'autres produits, tel le charbon actif, peuvent remplacer le SO
2
, mais alors le cot
de traitement devient prohibitif. Par contre, les sous-produits halogns sont trs peu
influencs par cette tape de dchloration et se retrouveront donc dans l'effluent rejet.
L'ajout d'une tape de dchloration augmente le cot total de la dsinfection de 30 50 %.
Chlore
Le chlore est un produit dangereux, son transport et sa manipulation sont soumis des
rglementations prcises. L'utilisation d'hypochlorite (forme liquide du chlore) est plus sre
car il ne se volatilise pas en gaz toxique comme le chlore, mais son cot est plus lev.
Dioxyde de chlore
Avantages : Le ClO
2
est utilis en eau potable pour liminer le phnol et les autres
composs entranant une odeur et un got dsagrable. Son effet bactricide est tout aussi
puissant sinon plus que celui du chlore et contrairement aux autres produits halogns, il est
galement virucide. Il ne ragit pas avec l'ammoniaque comme le chlore pour former des
chloramines et s'accompagne d'un taux plus faible en sous-produits halogns.
Inconvnients : Le ClO
2
est extrmement instable et explosif. Son transport est donc
dangereux. Il doit tre produit sur place grce un mlange de chlore et de chlorite de
sodium.
Chlorure de brome
Avantages : Le chlorure de brome , plus soluble que le chlore et le dioxyde de chlore, se
transforme en bromamines lorsqu'il est ajout de l'eau contenant de l'azote. Les
bromamines ont un pouvoir bactricide reconnu. Etant trs instable, le temps de contact est
trs court. Les bromamines rsiduelles ont galement un temps de vie trs court et de ce
fait, ont un effet nfaste limit sur l'environnement.
Inconvnients : Le transport et la manipulation du chlorure de brome demandent les
mmes prcautions que celles suivies pour le chlore. Son emploi pour la dsinfection des
eaux uses urbaines est relativement rcent.
Page277 - Les technologies de dsinfection des eaux uses
IV.2.2. L'ozone
Ce procd est peu appliqu en France, par contre aux Etats-Unis une quarantaine
d'installations sont en service.
IV.2.2.1.Principe
L'ozone est un puissant oxydant dont la fonction bactricide et virucide est marque. Il agit
en dgradant les composs organiques internes constituant les bactries et les virus.
Ractions :
O
3
+ H
2
O H
3
O + OH
-
IV.2.2.2.Mise en oeuvre
L'ozone est un compos trs instable, qui doit tre produit sur site. Sa production
s'effectue soit partir d'air, d'oxygne ou d'un mlange des deux. Dans un gnrateur, les
molcules d'oxygne, sous l'effet d'un arc lectrique, sont dissocies en atomes d'oxygne,
celles-ci rentrent en collision formant des molcules d'ozone.
Le gaz est alors mis en contact avec le liquide traiter, il est inject contre-courant du
liquide traiter. Une partie de l'ozone se dissout alors dans l'eau et agit sur les micro-
organismes prsents. L'excs d'ozone rcupr dans l'air de sortie du contacteur est dtruit
par moyens thermiques ou thermo-catalytiques afin d'empcher toutes possibilits d'effets
irritants ou toxiques sur les exploitants.
IV.2.2.3.Efficacit
Les rsultats sont trs variables en ce qui concerne l'efficacit de l'ozone en dsinfection.
Les abattements varient de 3 6 Ulog. On admet qu'un abattement de 3 4 Ulog de CF est
possible avec des temps de sjour compris entre 6 et 10 minutes.
Les temps de contact sont beaucoup plus courts que pour une chloration mais les doses
mettre en oeuvre sont tout fait similaires.
Page278 - Chapitre 14
Des exprimentations menes sur les stations de traitement de Nancy Maxeville, de
Colombes et de Montpellier permettent de dfinir les doses appliquer :
Site Type deau Objectifs Dosage
(mg/l)
Temps de contact
(mn)
Nancy Maxeville 99,9 % sur CF
1 Ulog sur virus
2 Ulog sur CF
2 Ulog sur SF
5
2,5
2,5
2,5
11
19
19
19
Colombes 3 Ulog sur CF 9,5 14 20
Montpellier
Eau clarifie
Eau filtre
3 Ulog sur CF
1 Ulog sur CF
3 Ulog sur CF
6 Ulog sur CF
5 8
12
4 5
12
14 16
2
14 16
2
Tableau 11-6 : Efficacit de lozone en dsinfection.
IV.2.2.4.Avantages
La ractivit de l'ozone ne semble pas gnrer de sous-produits toxiques pour le milieu
rcepteu,r quoique l'on signale depuis peu l'influence possible des ions bromates.
L'ozone induit plutt une amlioration sensible de la qualit de l'eau traite en augmentant
la teneur en oxygne dissous de l'eau et en agissant sur la couleur.
Le pouvoir germicide de l'ozone concerne, outre les bactries, les virus et les protozoaires.
Aucun phnomne de reviviscence des germes traits n'a t observ ce jour.
IV.2.2.5.Inconvnients
Les cots de construction et de consommation lectrique sont levs. Le procd est
complexe et demande une main d'oeuvre qualifie, surtout si l'oxygne pur est utilis.
Une bonne conception de l'ouvrage de dissolution est ncessaire afin d'viter les courts-
circuits hydrauliques. Par ailleurs, les temps de sjours sont de 6 10 mn.
L'ozone est explosif des concentrations de 240 g/m
3
et toxique pour l'homme 0,6 g/m
3
,
pour une inhalation de plus de 10 minutes. Il demande donc l'installation d'appareillage de
dtection et d'alarme pour la protection du personnel.
Page279 - Les technologies de dsinfection des eaux uses
Les compresseurs de gaz avant les ozoneurs sont une cause de bruit et doivent tre
isols. Les ozoneurs eux-mmes sont une source de bruit de haute frquence.
Comme pour l'oxygne, la solubilit de l'ozone dans l'eau dpend de la temprature :
celle-ci chute quand la temprature s'lve.
L'ozone ragit avec de nombreux produits organiques (acides humiques, pesticides,
composs aliphatiques et aromatiques) et minraux (soufre, azote, fer, manganse). Si la
concentration de ces lments est leve, la demande en ozone de l'influent augmente.
Pour chaque station, les tests en pilote sont ncessaires afin de dfinir la demande en ozone
de l'influent et donc, le taux de traitement optimal.
IV.2.3. Les U.V.
Le traitement par U.V. est trs employ sur le continent amricain, on dnombre plus de
120 stations en service.
IV.2.3.1.Principe
Le rle des U.V. comme bactricide et virucide est bien tabli. Les radiations ( 254 nm)
pntrent la paroi cellulaire, atteignent et modifient les acides nucliques porteuses de
l'information gntique de la cellule et empchent ainsi la division cellulaire. Le germe reste
vivant mais, incapable de se diviser, ne peut engendrer une infection.
La source artificielle d'nergie U.V. la plus rpandue est la lampe mercure. La raison
principale de son utilisation est le fait que 85 % de ses missions s'effectuent une longueur
d'onde de 253,7 mn : longueur d'onde optimale pour la dsinfection.
La radiation est gnre en crant un arc lectrique travers une vapeur de mercure. La
dsactivation des molcules de mercure ainsi excites s'accompagne d'une mission de
lumire U.V.
IV.2.3.2.Mise en oeuvre
Un systme U.V. est constitu d'un rseau de lampes maintenues ensemble sur un
chssis. Ces lampes sont renfermes dans des tubes de quartz ou de Tflon les protgeant
du refroidissement, qui aurait lieu si elles taient en contact avec l'eau.
Ces lampes, qui ressemblent des ampoules tubulaires de 0,75 1,50 m de long et 1,5
2 cm de diamtre, peuvent tre disposes l'horizontale ou la verticale par rapport
l'coulement de l'eau (Figure 5 en annexe). L'eau circule en fine couche entre les tubes.
Il existe deux systmes de dsinfection, les systmes U.V. ouverts et les systmes
U.V. ferms.
L'avantage du type ouvert est l'accessibilit des lampes. Elles peuvent tre changes ou
attaches sans avoir contourner l'tage de dsinfection. Par contre, l'tage tant aliment
en gravitaire, il est important de maintenir un niveau d'eau constant dans le canal de
dsinfection. Si le niveau d'eau est trop haut, une partie de l'effluent passera au-dessus des
lampes et ne sera pas trait. Si le niveau est trop bas, une partie des lampes sera l'air
libre, ce qui entranera la surchauffe et la formation d'un film sur le tube de protection limitant
le passage des radiations U.V. Afin de s'affranchir de ce phnomne, le niveau est maintenu
constant grce une vanne contrepoids.
Page280 - Chapitre 14
Le systme ferm tant en charge, il n'est pas ncessaire de maintenir un miroir d'eau.
Par contre, toute l'installation ferme doit tre arrte en cas d'intervention (nettoyage des
tubes de protection, changement de lampes).
IV.2.3.3.Efficacit
L'intensit de la radiation mise par la lampe diminue avec l'loignement. Ceci est
simplement d un phnomne de dissipation d'nergie.
Une seconde attnuation de l'nergie U.V. est due l'absorption par les composs
chimiques prsents dans l'eau traiter. Ceci est appel la "demande U.V." de l'eau traiter.
Elle est quantifie par une mesure spectrophotomtrique 253,7 nm et exprime en unit
d'absorbance d'nergie par unit de profondeur (u.a/cm). On emploie plus facilement la
transmittance : % transmittance = 100 10
-(absorbance)
.
Les matires collodales, les matires organiques solubles et surtout les MES, aprs un
traitement secondaire efficace, absorbent la lumire U.V. et limitent l'efficacit du procd.
Plus la lumire est absorbe, moins elle pntrera en profondeur et donc plus il sera difficile
d'apporter la dose dU.V. ncessaire une bonne dsinfection.
TRANSMITTANCE ABSORBANCE (u.a/cm)
Eau potable 95 % 0,02
Effluent tertiaire 80 % 0,10
Effluent secondaire bonne
qualit
65 % 0,19
Effluent secondaire mauvaise
qualit
35 % 0,46
Eaux pluviales 20 % 0,70
Effluent primaire 5 % 1,30
Tableau 11-7 : Transmittance et absorbance pour diffrents types deau.
Le nombre de lampes ncessaire augmente de faon exponentielle avec la baisse de la
transmittance d'une eau rsiduaire urbaine : un effluent ayant une transmittance de 50 %
peut demander deux fois plus de lampes qu'un effluent ayant une transmittance de 65 %.
Les doses d'nergie U.V. fournies par ces lampes sont calcules en faisant intervenir
l'intensit U.V. moyenne dans le rseau de lampe (W/cm
2
) et le temps de sjour de l'eau
dans ce rseau, qui est gnralement de l'ordre de quelques secondes. Il s'exprime donc en
W.s/cm
2
de lampe. La dose ncessaire une rduction logarithmique en CF de 4 sera de
30 000 W.s/cm
2
pour une eau use ayant une transmittance de 65 % et une concentration
en MES de 30 mg/l, tandis que 16 000 - 20 000 W.s/cm
2
suffisent aux eaux filtres pour un
mme abattement de coliformes.
Page281 - Les technologies de dsinfection des eaux uses
IV.2.3.4.Avantages
Les avantages principaux d'un procd U.V. sont sa simplicit et sa compacit. Les
temps de contact ncessaires une bonne dsinfection sont de quelques secondes. Le prix
du traitement est comparable avec celui de la chloration/dchloration et tend devenir mois
cher avec la mise au point de lampes et de systmes plus efficaces.
Etant donn qu'il s'agit d'un phnomne physique et non chimique, il n'y a ni transport, ni
stockage ou utilisation de substances nocives, ni prsence de produits toxiques rsiduels
dans le rejet.
IV.2.3.5.Inconvnients
Les dpts de sels (Ca
2
+
, Fe
3
+
, PO
4
3-
), d'huiles, de graisses et de biofilms sur ces tubes
entranent une diminution de la transmittance des U.V. et donc du rendement de
dsinfection. La formation de dpts sur les lampes est plus ou moins rapide et reste
spcifique chaque site. Il est prfrable de l'estimer sur des pilotes afin de dterminer
l'applicabilit d'un procd U.V. l'eau traiter.
Les tubes doivent tre nettoys de faon rgulire : les lavages se font une fois par mois
selon la qualit de l'effluent. Ce nettoyage est soit mcanique, sonique ou chimique. Par
ailleurs, les gaines en quartz ou Tflon s'opacifient avec le temps : elles sont gnralement
changes en mme temps que les lampes U.V.
Les sels de fer absorbent les U.V. Les stations physico-chimiques employant du FeCl
3
comme coagulant devront donc employer des doses en U.V. plus importantes.
Une rparation des dommages causs par les U.V. au niveau de l'ADN bactrien peut
survenir lors de l'exposition des bactries la lumire visible ou mme l'obscurit. Ce
phnomne, appel reviviscence, permet donc une reprise de la croissance bactrienne.
Les yeux sont la partie du corps la plus sensible une surexposition aux U.V. Selon le
National Radiological Protection Board, les effets nfastes commencent aprs 1/6 de
seconde d'exposition aux intensits utilises en dsinfection d'eau. Elles se traduisent par
l'inflammation douloureuse des yeux (krato-conjonctivite) Des expositions de plus longues
dures peuvent entraner des lsions irrversibles de la rtine. Le port de lunette protectrice
est donc obligatoire pour le personnel travaillant sur un systme U.V. en fonctionnement.
IV.3. LES NOUVELLES TECHNIQUES DE DESINFECTION
IV.3.1. L'acide practique
L'acide practique, bien connu en milieu hospitalier et agroalimentaire est apparu depuis
peu en assainissement. Compte tenu de la nouveaut de cet agent, peu d'informations
quantitatives sont disponibles concernant ses activits biocides sur les organismes tmoins
de contamination fcale.
L'acide practique, CH
3
COOH, se forme partir de l'acide actique en prsence d'un
excs de peroxyde d'hydrogne. Sa dcomposition ne gnre aucun produit toxique
susceptible de nuire au milieu rcepteur puisqu'il se dcompose en eau et en acide actique.
Son activit dsinfectante repose sur la libration d'oxygne actif qui dnature la
membrane plasmique bactrienne et plus particulirement par rupture des liaisons (-SH) et
des ponts disulfures (-SS) constituant les composs protiniques et les systmes
enzymatiques. Cette altration entrane une modification de la fonction "transport" des
Page282 - Chapitre 14
membranes et une dislocation des cellules membranaires, affaiblissant ainsi l'activit
bactrienne.
Les exprimentations menes au CIRSEE avaient pour objet de dfinir la dose et le temps
de contact mettre en oeuvre tout en gardant l'esprit que le cot du traitement ne devait
pas tre prohibitif.
Cette relation a t tablie de manire atteindre une rduction des CT de 3 4 Ulog : la
dose mettre en oeuvre est de 5 ppm et le temps de contact respecter est de 60 mn.
Si cette relation se rvle adapte nos objectifs de qualit, elle reste nanmoins
inadapte l'limination des virus : les abattements ne dpassent pas 30 %. Ces rsultats
rejoignent ceux de la littrature qui mentionnent l'application de doses trs importantes pour
inactiver les virus (140 ppm pour une rduction de 4 Ulog).
Des phnomnes de reviviscence ont t observs lors d'exprience de laboratoire. Aprs
l'application de 5 ppm pendant 60 minutes, une reprise de l'activit bactrienne est observe
ds la fin de la premire journe faisant suite au traitement. Toutefois, la transposition au
milieu naturel n'est pas aise puisque l'exprience replaait les bactries aprs traitement
dans un milieu marin reconstitu.
IV.3.2. L'ultrafiltration
Les membranes dultrafiltration n'ont aucun pouvoir destructeur mais assurent
passivement la rtention des micro-organismes par barrire physique.
Lultrafiltration retient 100 % des micro-organismes prsents (bactries, virus, phages, ...).
Il y a videmment absence de sous-produits toxiques et de plus, la qualit de l'effluent est
fortement amliore.
Compte tenu du cot actuel des membranes, il s'avre que cette technique reste adapte
des cas particuliers o les contraintes sont extrmes : rutilisation des eaux uses
envisage, haute qualit de rejet.
V. RECAPITULATIF DES MOYENS DE DESINFECTION DES EFFLUENTS
Le choix d'une filire de dsinfection doit prendre en considration l'ensemble des
lments dcrits ci-avant (inconvnients, avantages, practicit, ...) en tenant compte des
objectifs demands et du contexte particulier chaque station (taille, lieu d'implantation,
intgration dans chane existante, ...). Le tableau ci-aprs donne une comparaison des
diffrents procds de dsinfection.
Page283 - Les technologies de dsinfection des eaux uses
Chlore
gazeux
Eau de
javel
Ozone VU ClO
2
Acide
practique
Membrane
Action bactricide
Action virucide
Reviviscence
Toxicit rsiduelle
Taille
d'installation
Cots
+
-
+
+
toute
taille
faible
+
-
+
+
toute
taille
faible
+
+
-
-
moyenne
grande
lev
+
+
+
-
petite
moyenne
modr
+
+
?
+
moyenne
grande
modr
+
-
+
-
toute taille
modr
+
+
-
-
?
lev
Tableau 11-8 : Comparaison des diffrents procds de dsinfection.
VI. COUTS DE LA DESINFECTION
Une tude dtaille des cots des traitements de dsinfection regroupant les frais de
fonctionnement et les frais d'amortissement des ouvrages et des quipements a t ralise
par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne en 1982. Ces rsultats sont rsums
ci-aprs :
capacit en EH Chloration Ozone Dioxyde de
chlore
U.V.
1000
5000
25000
75000
0,62 2,35
0,21 0,60
0,10 0,17
0,06 0,09
1,55
0,55
0,30
0,25
1,25
0,35
0,15
0,10
0,71
0,26
0,17
0,15
Tableau 11-9 : Cot de diffrents traitements de dsinfection (F/m
3
).
La relation entre l'augmentation de la taille de l'installation et la dcroissance du cot de la
dsinfection est trs sensible pour le traitement par chloration, par contre il apparat que cet
effet est beaucoup moins net pour le traitement par U.V. qui souffre d'une corrlation directe
entre le nombre de modules en service et le cot d'exploitation. L'utilisation de l'ozone en
dsinfection reprsente un cot 2 8 fois plus important que la chloration.
Page284 - Chapitre 14
VII. CONCLUSION
Il est bien vident que la mise en place d'une unit de dsinfection est motive par la
protection d'un environnement sensible. Seule la rponse de ce milieu rcepteur travers
ses critres de qualit permet d'valuer le bien-fond du systme retenu.
Nous avons vu que l'action virucide est trs variable selon le type de dsinfectant.
L'limination de ces micro-organismes se justifie si leur devenir en milieu littoral prsente
des risques sanitaires directs ou via une concentration dans un produit consommable.
Il semble difficile de dissocier le traitement de dsinfection de l'assainissement global d'un
effluent domestique. L'interaction entre les produits rsiduels et la dsinfection est nette,
gnration de sous-produits toxiques : gnration de chloramines et d'haloforme lors d'une
chloration, impact ngatif des matires en suspension sur l'irradiation par U.V.,
consommation d'ozone pour l'oxydation des molcules carbones, ... De plus, la prsence
de matires organiques associes aux flocs bactriens induit une protection vis--vis des
agents bactricides et semble tre responsable des capacits de rgnrescence des micro-
organismes aprs traitement.
Au regard de tous les aspects tudis, il ressort qu' ce jour aucun agent chimique ou
physique ne rpond l'image du dsinfectant idal.
En rsum, on admet qu'en absence de contraintes d'espace les solutions retenir sont :
l'infiltration-percolation,
ou le lagunage,
qu'en prsence de contraintes extrmes la seule solution envisageable ce jour est
lultrafiltration et malheureusement lorsque les contraintes sont moyennes aucun
dsinfectant ne rpond notre cahier des charges savoir :
la destruction de 3 4 Ulog des germes test;
l'absence de toxicit rsiduelle soit directe, soit par raction;
l'absence de reviviscence des micro-organismes dtruits;
des cots d'investissement et d'exploitation minimaux.
Chapitre 15
CONDITIONNEMENT ET
TRAITEMENT DES BOUES DES
STATIONS DEPURATION DES
EAUX RESIDUAIRES URBAINES
ET DES USINES DE PRODUCTION
DEAU POTABLE
R. CORNICE
Page286 - Chapitre 15
SOMMAIRE
I. INTRODUCTION.....................................................................................................................................288
II. QUANTITES ET CARACTERISTIQUES DES BOUES PRODUITES DANS UNE STATION
D'EPURATION URBAINE..............................................................................................................................288
II.1. NATURE DU RESEAU ET DE L'EFFLUENT ...............................................................................................288
II.1.1. Rseau unitaire ..............................................................................................................................288
II.1.2. Eaux parasites................................................................................................................................288
II.1.3. Effluents sceptiques........................................................................................................................288
II.1.4. Rejet d'effluents industriels ............................................................................................................289
II.2. LA FILIERE EAU ...................................................................................................................................289
II.2.1. Boues primaires .............................................................................................................................289
II.2.2. Traitements physico-chimiques (dcantation ou flottation)...........................................................289
II.2.3. Boues biologiques ..........................................................................................................................290
II.2.4. Composition globale des boues et production de boues dune station dpuration deaux uses
urbaines 290
II.3. QUALITES PHYSIQUES DES BOUES........................................................................................................292
III. QUANTITES ET CARACTERISTIQUES DES BOUES PRODUITES DANS UNE USINE DE
PRODUCTION D'EAU POTABLE.................................................................................................................292
III.1. QUALITE DE L'EAU BRUTE....................................................................................................................292
III.2. TYPES DE TRAITEMENT D'EAU, SYSTEMES DE SEPARATION..................................................................292
III.2.1. Les systmes de filtration...........................................................................................................293
III.2.2. Les systmes de dcantation ......................................................................................................293
III.2.3. Les systmes de flottation ..........................................................................................................293
III.3. LES REACTIFS UTILISES........................................................................................................................293
III.3.1. Matires de charge minrale .....................................................................................................293
III.3.2. Ractifs d'adsorption .................................................................................................................294
III.3.3. Ractifs de coagulation-floculation...........................................................................................294
IV. STABILISATION.................................................................................................................................296
IV.1. DIGESTION ANAEROBIE .......................................................................................................................296
IV.2. STABILISATION AEROBIE .....................................................................................................................296
IV.3. STABILISATION CHIMIQUE (CA(OH)
2
) .................................................................................................297
V. CONDITIONNEMENT DES BOUES.....................................................................................................298
V.1. CONDITIONNEMENT PAR AJOUT DE REACTIFS MINERAUX ....................................................................298
V.2. CONDITIONNEMENT AUX POLYELECTROLYTES....................................................................................299
V.3. CONDITIONNEMENT THERMIQUE .........................................................................................................299
VI. EPAISSISSEMENT DES BOUES.......................................................................................................300
VI.1. EPAISSISSEMENT STATIQUE .................................................................................................................300
VI.1.1. Technologie ...............................................................................................................................301
VI.1.2. Dimensionnement d'un paississeur ..........................................................................................301
VI.2. EPAISSISSEMENT PAR FLOTTATION......................................................................................................303
VI.2.1. Principe de fonctionnement .......................................................................................................303
VI.2.2. Dimensionnement d'une flottation .............................................................................................303
VI.3. EPAISSISSEMENT PAR EGOUTTAGE.......................................................................................................304
VI.4. EPAISSISSEMENT PAR CENTRIFUGATION..............................................................................................305
VII. DESHYDRATATION..........................................................................................................................307
VII.1. CENTRIFUGATION................................................................................................................................307
VII.2. FILTRES A BANDES PRESSEUSES...........................................................................................................308
VII.2.1. Principe de filtration..................................................................................................................308
Conditionnement et traitement des boues des stations dpuration des eaux rsiduaires urbaines et des
usines de production deau potable - Page 287
VII.2.2. Performances des filtres bandes presseuses...........................................................................309
VII.3. FILTRES PRESSES .................................................................................................................................310
VII.3.1. Principe de fonctionnement .......................................................................................................310
VII.3.2. Technologie ...............................................................................................................................311
VII.3.3. Droulement du cycle ................................................................................................................311
VII.3.4. Capacit de filtration.................................................................................................................312
VII.4. LITS DE SECHAGE ................................................................................................................................313
VIII. CONCLUSION.....................................................................................................................................314
ANNEXES......................................................................................................................................................315
Page288 - Chapitre 15
I. INTRODUCTION
Les lments polluants et leurs produits de transformation retirs de la phase liquide au
cours de tout traitement d'eau, quelle qu'en soit la nature, se trouvent finalement rassembls
dans la trs grande majorit des cas dans des suspensions plus ou moins concentres
dnommes "boues".
Le caractre commun de toutes ces boues est de constituer un dchet encore trs liquide
de valeur gnralement faible ou nulle. Certaines d'entre elles sont chimiquement inertes,
mais celles qui proviennent de traitements biologiques sont souvent fermentescibles et
nausabondes.
Toutes les boues de caractre organique ncessitent un traitement spcifique qu'elles
soient recycles, rutilises ou remises dans le milieu naturel. L'urbanisation et la protection
de l'environnement rendent de jour en jour plus difficile le retour pur et simple sans
conditionnement pralable de ces produits dans le milieu naturel. Le traitement de la boue
est devenu un corollaire invitable du traitement de l'eau, et il ncessite des moyens
techniques et financiers parfois suprieurs.
II. QUANTITES ET CARACTERISTIQUES DES BOUES PRODUITES
DANS UNE STATION D'EPURATION URBAINE
Les boues vacues d'une station d'puration urbaine sont souvent un bon reflet du degr
de dpollution des effluents. Elles sont incontestablement, des produits mis par
l'assainissement, les plus variables en qualit et en quantit. Les caractristiques de ces
boues sont minemment dpendantes de :
la nature du rseau;
la nature de l'effluent;
des filires de traitement d'eau;
des filires de traitement des boues.
II.1. NATURE DU RESEAU ET DE L'EFFLUENT
Ces deux interactions sont pratiquement indissociables tant l'impact du rseau est
important sur la qualit de l'effluent.
II.1.1. Rseau unitaire
Augmentation des matires dcantables, parfois diminution de la pollution dissoute
(surcharge hydraulique) avec augmentation de Pb et Zn.
II.1.2. Eaux parasites
Diminution de la pollution dissoute. Un effluent dilu produira moins de boues biologiques
pour la simple raison que le flux de MES et DBO en sortie sont plus importants, toutes les
autres conditions tant, par ailleurs, identiques.
II.1.3. Effluents sceptiques
Augmentation du taux de collodes et diminution de la dcantabilit des boues, entranant
des pertes suivant les charges hydrauliques appliques. Nette augmentation du pouvoir
fermentescible des boues.
Conditionnement et traitement des boues des stations dpuration des eaux rsiduaires urbaines et des
usines de production deau potable - Page 289
II.1.4. Rejet d'effluents industriels
Risque important de perturbation de la ligne eau. Apport possible de mtaux lourds.
II.2. LA FILIERE EAU
Elle interfre sur la filire boues, au niveau de ses performances et de la masse de boues
produites. Nous retiendrons 3 types de boues.
II.2.1. Boues primaires
Nous les assimilerons la partie des MES dcantables.
Le dimensionnement des dcanteurs a son importance : essayer d'avoir les meilleurs
rendements de dcantation possibles augmente, certes, la production de boues primaires
mais, en global, favorise la qualit des boues de la station d'puration par un ratio boues
primaires/boues biologiques plus fort. Il faudra cependant viter toute fermentation dans
l'ouvrage sous peine de surcharger le biologique
II.2.2. Traitements physico-chimiques (dcantation ou flottation)
Ils font appel gnralement des sels de fer (ferriques ou parfois ferreux) ou
ventuellement des sels d'aluminium, en combinaison avec des polylectrolytes et parfois
galement de la chaux. Ces ractifs servent piger des fins collodes.
Conditionnement de l'eau
Rendement
d'limination
des MES
MES (mg/l) Poids de MES
produites
(mg/l)
Rapport boues
produites/MES
limines
(dcantation) Eau brute Elimines
FeCl
3
+ Polymre 90 350 315 386 1,22
Al
2
(SO
4
)
3
+ Polymre 90 350 315 396 1,27
FeCl
3
+ Ca(OH)
2
+ Polymre
90
FeSO
4
+ Ca(OH)
2
+ Polymre
90 350 315 630 2
Tableau 12-1 : Caractristiques des boues issues de filires de traitement physico-chimique.
Dans les boues, nous retrouvons donc les produits de transformation de ces ractifs,
principalement des hydroxydes, des phosphates et des sels de calcium. Par rapport la
dcantation simple, l'ajout de ractifs va avoir pour effet d'augmenter la quantit de boues
(tableau 12-1). Les ractifs sont plus ou moins efficaces. Le FeSO
4
(souvent moins cher)
produit nanmoins souvent de fortes quantits de boues.
Page290 - Chapitre 15
II.2.3. Boues biologiques
Les boues biologiques se prsentent gnralement sous la forme de flocs de tailles et de
densits trs diverses : ces flocs contiennent la biomasse excdentaire et des dchets
organiques non biodgradables ou en fin de dgradation.
Ces boues en excs ont une importance capitale pour la qualit des boues globales
produites par la station d'puration.
Pour des eaux forte tendance industrielle, seuls des essais pratiques peuvent donner
une ide de la quantit de boues produites. Nanmoins, pour des eaux urbaines
"classiques", on peut donner, titre indicatif, les fourchettes suivantes de production (tableau
12-2). Celle-ci est dpendante de l'ge des boues, du rapport MES/DBO
5
l'entre du
biologique et de la temprature.
Age des boues 3 jours 10 jours 20 jours
MES/DBO
5
Production de boues kg MES/kg DBO
5
limine
0,6 0,65 - 0,85 0,55 - 0,8 0,45 - 0,65
1 0,8 - 1,1 0,7 - 1 0,6 - 0,9
1,2 0,95 - 1,2 0,8 - 1 0,75 - 1
Tableau 12-2 : Production de boues dune filire de traitement biologique.
II.2.4. Composition globale des boues et production de boues dune station
dpuration deaux uses urbaines
Toute filire de traitement biologique produit un mlange de boues primaires, de boues
biologiques, soit en phase spare (dcantation primaire + biologique) soit conjugues
(aration prolonge).
Globalement, la production de boues d'une station d'puration d'eau urbaine peut tre
estime comme suit :
Type de boue MES en g/eq ha/jour % MES boue paissie l/eq ha/jour boue paissie
Primaire frache 45-60 8-12 0,4-0,75
Primaire digre 30-40 7-11 0,3-0,55
Mixte frache 75-90 4-6 1,2-2,2
Mixte digre 50-60 2,5-4,5 1,1-2,4
Tableau 12-3 : Production de boues dune station dpuration deau urbaine.
Conditionnement et traitement des boues des stations dpuration des eaux rsiduaires urbaines et des
usines de production deau potable - Page 291
Les boues primaires comportent pour l'essentiel des matires minrales, cellulose, fibres
et autres constituants bien structurs (tableau 12-4). Leur traitement ultrieur est facile. Les
boues biologiques sont trs organiques et collodales, donc fortement hydrophiles et
difficilement dshydratables. Cependant, elles comportent la majeure partie de lazote et du
phosphore (tableau 12-4).
Le rapport boues biologiques/boues primaires sera donc dterminant sur la filire boues.
Composants % /MS Dcantation
primaire
Biologique
C
m
> 0,1
Aration
prolonge
Lagunage Chimique
Matires organiques 55-65 70-85 60-75 45-60 35-55
N total 25-3 4-6 4-5 2-3 1,5-2
P 1-1,5 2,5-3 2-2,5 1,5-2,5 1,5-3
K 0,2-0,3 0,2-0,3 0,2-0,3 0,2-0,3 0,1-0,2
Carbone 33-40 38-50 33-40 25-35 20-30
Calcium 5-15 5-15 5-15 5-15 5-30
Magnsium 0,4-0,8 0,4-0,8 0,4-0,8 0,4-0,8 1,7-4,5
Fer 1-3 1-3 1-3 1-3 3-15
Al 0,1-0,3 0,1-0,3 0,1-0,3 0,1-0,3 0,1-15
Pouvoir fermentescible + + + + + - (+ +) (-)
Contamination
bactriologique
+ + + + + + (+ +) (-)
Production de boues + + - - + +
Concentration des boues
en sortie de traitement
d'eau
30-90 g/l 5-10 g/l 6-8 g/l 60-120 g/l en
moyenne
stratification
20-60 g/l
Tableau 12-4 : Evolution de la composition des boues en fonction de la ligne de traitement deau
Page292 - Chapitre 15
II.3. QUALITES PHYSIQUES DES BOUES
Lextraction plus ou moins pousse de l'eau conduit des tats physiques allant du liquide
au solide.
Siccit Etat
jusqu' 8-9 % liquide
12-16 % pteux pelletable
16-25 % pteux gerbable
25-35 % solide avec retrait
> 35 % solide sans retrait
Tableau 12-5 : Etats physiques des boues.
La notion de siccit n'est pas toujours reprsentative de l'aspect physique du sdiment
dshydrat. La rversibilit est toujours possible : thixotropie du sdiment.
III. QUANTITES ET CARACTERISTIQUES DES BOUES PRODUITES
DANS UNE USINE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE
La qualit initiale des boues, c'est--dire leur composition dpend :
de la qualit de l'eau brute;
du type de traitement d'eau;
des ractifs utiliss et de leurs caractristiques physiques.
III.1. QUALITE DE L'EAU BRUTE
La qualit de leau brute est trs diffrente selon l'origine du pompage d'alimentation :
eaux de forages ou eaux de barrages, peu charges en MES;
eaux de surface, rivires, dont la qualit est trs dpendante de la priode de l'anne
:
priodes de crues, eaux charges en limons;
priodes d'algues (printemps, automne), eaux charges en matires organiques
trs fermentescibles;
priodes de basses eaux, eaux peu charges.
III.2. TYPES DE TRAITEMENT D'EAU, SYSTEMES DE SEPARATION
Les systmes de sparation mis en oeuvre interviennent sur :
le volume des boues et leur concentration;
la qualit des boues.
Conditionnement et traitement des boues des stations dpuration des eaux rsiduaires urbaines et des
usines de production deau potable - Page 293
III.2.1. Les systmes de filtration
Ces ouvrages sont caractriss par :
des dbits instantans importants (au moment des lavages);
des concentrations faibles.
Ces caractristiques ont un effet dfavorable sur le fonctionnement du traitement des
boues. Il est possible de rduire ces effets en retournant les eaux de lavages en tte de
station moyennant certaines prcautions.
III.2.2. Les systmes de dcantation
L'effet de ces ouvrages est trs diffrent selon leur principe de fonctionnement :
Les dcanteurs statiques, de part leur faible charge hydraulique, intgrent dans
leur volume la capacit d'paississement. En contrepartie, il est gnralement trs
difficile d'avoir une extraction rgulire de ces boues sans amnagement particulier.
En outre, les temps de sjour importants peuvent conduire une dgradation de la
qualit de l'eau (qualit organoleptique, ...) en raison de la possible fermentation
des boues suivant leur taux de MO.
Les dcanteurs acclrs, gnralement utiliss actuellement en raison de leurs
performances, ncessitent le plus souvent un ouvrage d'paississement spar en
raison de la faiblesse des concentrations des purges de boues ( 3 g/l). Cette
solution, particulirement bien adapte, permet la sparation des fonctions de
clarification et d'paississement. L'optimisation du stade paississement est donc
possible par l'utilisation de conditionnements appropris.
III.2.3. Les systmes de flottation
Les systmes de flottation offrent un bon compromis entre le traitement de l'eau et le
traitement des boues. L'intrt porte avant tout sur 2 points :
sur les eaux difficiles (eaux peu charges en limons) ils permettent d'obtenir des
boues directement paissies;
par ailleurs la flottation permet souvent de diminuer les doses de ractifs mis en
oeuvre, donc d'amliorer la qualit des boues et d'en diminuer la production.
III.3. LES REACTIFS UTILISES
Il faut remarquer que le(s) type(s) de ractifs ont une influence, la fois sur la qualit de
l'eau traite et sur la qualit et la quantit des boues issues du traitement.
III.3.1. Matires de charge minrale
Ces matires sont en gnral constitues par de la bentonite, du kiesselguhr ou des
charges siliceuses, qui ont pour objet d'augmenter la densit des flocs et par la-mme
d'amliorer leur vitesse de dcantation.
En consquence, nous obtenons :
une amlioration de la qualit des boues passant par une augmentation de
l'aptitude l'paississement et la dshydratation;
une augmentation parfois trs importante de la quantit de boues produites
venant contrebalancer les gains apports par ailleurs.
Page294 - Chapitre 15
III.3.2. Ractifs d'adsorption
Gnralement constitu par du charbon actif en poudre, ce ractif a un effet bnfique sur
:
la qualit de l'eau traite;
la qualit gnrale quant l'aptitude des boues l'paississement et la
dshydratation.
L'augmentation de production de boues due ce ractif est compense par son effet
bnfique, d'autant que, dans certains cas, il peut permettre une rduction du taux de
coagulant mis en oeuvre.
III.3.3. Ractifs de coagulation-floculation
En ce qui concerne les coagulants, gnralement constitus par des sels de Fe ou d'Al
hydrolysables, leur action est trs importante sur la qualit et la quantit des boues
produites, ceci pour la bonne raison que ces produits se retrouvent dans les boues sous
forme d'hydroxydes.
Remarques :
La proportion d'hydroxydes peut atteindre 80 85 % (en poids) de la boue produite.
Les comportements des hydroxydes de Fe et Al sont trs diffrents face au systme
de traitement des boues. Globalement, bien que la quantit de boues produites soit
suprieure avec les sels ferriques comparativement au sulfate d'aluminium, la plus
grande facilit de traitement apporte par les sels ferriques conduit un
dimensionnement de la chane de traitement des boues de 1,2 1,5 fois moindre
qu'avec le sulfate d'alumine.
En contrepartie la qualit de l'eau traite par les sels de fer est gnralement moins
bonne que la qualit des eaux traites par les sels d'aluminium.
Au niveau des floculants, seule l'interaction de SiO
2
peut modifier de faon notable la
qualit de la boue obtenue suivant la prsence d'ions Na
+
ou Ca
2+
Comme nous venons de le voir, la production de boues d'eau potable peut tre
extrmement variable. Il faut alors adopter un bilan sens pour ne pas construire une station
de traitement de boues ne fonctionnant que quelques jours par an plein rgime.
Cette dtermination est donc trs importante car elle va permettre :
d'optimiser le dimensionnement de l'installation de dshydratation;
d'amnager les temps d'exploitation.
Le bilan de production journalire de boues doit faire apparatre les variations
journalires de production de boues sur une priode minimale de 1 an.
Ce bilan peut tre dtermin selon 3 mthodes :
par simulation en appliquant le traitement mis en oeuvre sur la station un
chantillon reprsentatif d'eau brute;
par estimation des volumes et concentration des boues produites par les
diffrents ouvrages;
Conditionnement et traitement des boues des stations dpuration des eaux rsiduaires urbaines et des
usines de production deau potable - Page 295
thoriquement en fonction des caractristiques de l'eau brute et en fonction du
mode de traitement appliqu.
La dtermination thorique de la quantit de boues produite est donne par la formule
suivante :
P = V [MES A H K D X M
1
F
1
C ] 10
-3
avec :
P : poids de matires sches journalires exprim en kg.
V : volume journalier d'eau brute traite exprim en m
3
. V est gal au volume d'eau distribue plus le
volume des purges des ouvrages et de lavages de filtres
.
En rgle gnrale, volume d'eau brute =
volume d'eau distribue x 1,15.
MES : taux de matires en suspension dans l'eau brute en g/m
3
.
A : coefficient d la couleur (0,05 0,07).
H : couleur de l'eau brute en degrs Hazen (mesure par la mthode platine-cobalt, 1 Hazen
correspond
1 mg/l de platine-cobalt).
K : coefficient de prcipitation dpendant du type de ractif utilis (voir tableau 12-6).
D : dose de ractif anhydre utilis exprime en g/m
3
.
X : dose de ractif entirement prcipitable exprime en g/m
3
. Il s'agit dans ce cas des ractifs
utiliss en traitement d'eau et se retrouvant intgralement dans les boues (ex : charbon actif).
M
1
: masse de prcipit d'hydroxyde de Mn (en g/m
3
) imputable une dmanganisation (oxydation de
Mn
2+
en Mn
4+
par le dioxyde de chlore ou l'ozone) selon :
Mn
2+
+ 2ClO
2
+ 2H
2
0 MnO
2
+ 20
2
+ 2Cl
-
+ 4H
+
Mn
2+
+O
3
+ H
2
O MnO
2
+O
2
+ 2H
+
F
1
: masse d'hydroxyde de Fe (en g/m
3
) imputable une dferrisation (oxydation de Fe
2+
en Fe
3+
soit
par oxygnation soit par chloration du type :
4Fe
2+
+ O
2
+ 8OH
-
+ 2H
2
O 4Fe(OH)
3
.
Nous avons donc : F
1
= 1,91 Fe
avec Fe = concentration en Fe
2+
de l'eau brute exprime en mg/l.
C : masse de prcipit de carbonate (en g/m
3
) imputable une dcarbonatation partielle par
utilisation de chaux. En admettant que la majorit du TH est calcique, C sera donn par :
C = 20 (TAC -TAC
1
)
avec :
TAC = TAC de l'eau brute exprime en F.
TAC
1
= TAC de l'eau traite en F.
Page296 - Chapitre 15
Nom commercial Formule chimique Densit Concentration (%)
ou masse (g/l)
Valeur
de K
Chlorure ferrique FeCl
3
, 6 H
2
O cristallis 60 % FeCl
3
0,40
Chlorure ferrique FeCl
3
cristallis 99 % FeCl
3
0,65
Chlorure ferrique solution
39.41 %
FeCl
3
, nH
2
O 1,41-1,45 596 g/l FeCl
3
0,39
Chlorosulfate ferrique FeCl SO
4
, nH
2
O 1,6 594 g/l FeCl
3
0,39
Chlorure basique
d'aluminium (WAC)
Al
n
(OH)
m
Cl
3
m-n
1,2 10 % Al
2
O
3
0,19
Sulfate d'aluminium Al
2
(SO
4
)
3
, 18H
2
O cristallis 17,2 % Al
2
O
3
0,27
Sulfate d'aluminium
solution 7,5 8,5 %
Al
2
(SO
4
)
3
, nH
2
O 1,3 8,3 % Al
2
O
3
0,17
Tableau 12-6 : Evaluation du coefficient K en fonction du ractif utilis.
IV. STABILISATION
Les boues de stations, en grande proportion caractre organique, sont instables dans la
mesure o des fermentations sy dveloppent, qui sont lorigine dune mauvaise qualit des
eaux et de nuisances olfactives. La stabilisation vise donc rduire le taux de matires
organiques de manire empcher ou tout du moins limiter les fermentations. Cette
stabilisation est inutile pour les systmes boues actives en aration prolonge
(minralisation du fait du temps de sjour long des boues en aration), et de lagunage
naturel (minralisation anarobie au fond). Limpact des diffrents procds de stabilisation
sur la qualit de la boue est prcis dans le tableau 12-7.
IV.1. DIGESTION ANAEROBIE
Elle ncessite un paississement en amont donc nentrane, en cours de digestion, pas ou
peu de rduction de volume. La digestion agit de la manire suivante sur les caractristiques
des boues :
disparition de 1/3 environ des MES boueuses (45 50 % des matires organiques
disparaissent), d'o la production d'une boue non putride et moins organique;
minralisation de l'azote organique : eau interstitielle riche en NH
4
+
(1 2 g/l);
boue plus collodale, plus homogne (disparition de corps fibreux) plus dilue ce
qui fait chuter la qualit des boues : dosages de ractifs plus levs et siccit un peu
plus faibles en dshydratation (1 3 points).
IV.2. STABILISATION AEROBIE
Elle conduit la production de boues trs dilues et trs collodales, ce qui donne des
qualits de boues bien infrieures celles des boues fraches. De plus, la rduction des
matires organiques est plus faible par rapport la digestion anarobie.
Conditionnement et traitement des boues des stations dpuration des eaux rsiduaires urbaines et des
usines de production deau potable - Page 297
IV.3. STABILISATION CHIMIQUE (CA(OH)
2
)
Les boues, ayant subies une stabilisation chimique, sont assez favorables en
dshydratation, mais souvent difficiles floculer cause des pH levs (> 12).
Arobie Anarobie Chimique (chaux)
M.O. rduction de 0-10 % rduction de 30-50 % pas de pertes sur boues
dshydrates - hydrolyse des
M.O. jusqu' 40 % sur boues
liquides
M.M. constant dans l'absolu constant dans l'absolu augmentation de 10 50 %
suivant ( ) boue
N peu de perte sur M.S.
mais perte en N de la
phase liquide
transformation de 40%
du N organique en
NH
4
stripping du NH
4
de la phase
liquide et ressolubilisation
d'une partie de N organique
P inchang inchang prcipit
Rduction de la
masse de boues
oui 0 7 % oui 15 30 % non augmentation de 10 30
%
Fermentation
ultrieure
oui aprs 72 h d'anoxie
sous forme liquide perte
de 5 15 % des M.O.
entre 1 et 6 mois 30-40 %
N organique + NH
4
nulle trs faible si pH > 10,5 et milieu
non liquide
M.O. 50-65 45-60 35-50
N total 4-5 2-3 0,8-2
P 2-2,5 1,5-2,5 2-5
K 0,2-0,3 0,15-0,25 0,1-0,2
C 28-35 25-35 20-30
Mg 0,4-0,8 0,4-0,8 0,4-2
Fe 1-3 1-3 2-15
Ca 5-15 5-15 15-30
Tableau 12-7 : Impact de la stabilisation sur la qualit de la boues.
Page298 - Chapitre 15
V. CONDITIONNEMENT DES BOUES
Lpaississement naturel des boues est limit par des phnomnes physiques. Des forces
lectriques de rpulsion entre les particules de boues empchent leur rapprochement et en
consquence ne permettent pas lvacuation dune part importante de leau interstitielle.
Pour rendre exploitables les diffrents quipements de traitement des boues, il est donc
ncessaire de procder la floculation de celles-ci pour en casser la stabilit collodale et
pour augmenter artificiellement la taille des particules. C'est le conditionnement qui a recours
des procds de nature physique (thermique), mais plus souvent de nature chimique (ajout
de ractifs minraux ou de polymres de synthse). Un conditionnement adquat de la boue
est la base du bon fonctionnement de l'atelier de traitement des boues.
V.1. CONDITIONNEMENT PAR AJOUT DE REACTIFS MINERAUX
C'est le conditionnement adapt la dshydratation sur filtres presses (schma 1
Annexes), appareils mettant en oeuvre une filtration travers un gteau en formation avec
un support filtrant mailles fines (100 200 m). Ce conditionnement ncessite lemploi de
ractifs minraux conduisant la formation de flocs fins, mais mcaniquement stables.
Pour des raisons d'conomie et d'efficacit, on emploie le plus souvent des sels de fer.
Sur des boues organiques, l'ion Fe
3+
est de loin le plus efficace. L'action de ces sels de fer
est double :
action coagulante (leur charge est souvent oppose celle des particules boueuses);
action floculante (formation d'hydroxydes complexes hydrats tels que (Fe(OH)
3
,
6H
2
O)
n
qui joue le rle d'un polymre minral).
Une introduction de chaux conscutive celle du sel de Fe est toujours ncessaire pour
amliorer la filtrabilit :
pH > 10, pH de floculation correcte;
prcipitation d'un certain nombre de sels de Ca favorables la filtration;
apport d'une charge minrale dense.
Avec les boues organiques, le double dosage Fe et chaux est en gnral indispensable.
En revanche, pour les boues d'eau potable constitues en grande partie d'hydroxydes
hydrophiles, un apport de chaux est gnralement suffisant. Les doses de ractifs mettre
en oeuvre (tableau 12-8) sont dtermins par mesure de la rsistance spcifique la
filtration r
0,5
. Pour un filtre presse plateaux chambrs, r
0,5
doit tre compris entre 5 et 15 x
10
10
cm/g.
Conditionnement et traitement des boues des stations dpuration des eaux rsiduaires urbaines et des
usines de production deau potable - Page 299
Type de boues FeCl
3
% MES Ca (OH)
2
% MES
ERU (Eau rsiduaire urbaine) primaires 2-3 10-15
ERU mixtes 4-6 18-25
ERU stabilises 6-8 25-30
Eau potable (Al(OH)
3
) 30-50
Eau potable (Fe(OH)
3
) 25-35
Tableau 12-8 : Doses de ractif couramment utilises.
Remarque : L'ajout de ractifs augmente d'autant la quantit de boues traiter. Il faut en
tenir compte dans le calcul de la quantit de boues dshydrater.
V.2. CONDITIONNEMENT AUX POLYELECTROLYTES
C'est le conditionnement adapt la dshydratation sur filtres bandes presseuses,
centrifugeuses, parfois en flottation, paississement par gouttage et, sous certaines
rserves, sur filtres presses (schma 2 Annexes).
Les polylectrolytes ont pour effet :
une floculation trs marque par la formation de ponts entre particules grce aux
longues chanes ramifies. Cette floculation est renforce par une action coagulante
dans le cas de polymres cationiques;
une forte diminution de la rsistance spcifique de la boue flocule avec une
augmentation de l'hydrophilie particulaire et du coefficient de compressibilit.
Un grand nombre de polylectrolytes est disposition. Il faut donc effectuer des tests
simples de floculation pour dterminer le produit le mieux adapt la boue traiter. Les
polymres cationiques sont surtout efficaces pour le conditionnement des boues organiques,
les anioniques pour les boues d'eau potable.
V.3. CONDITIONNEMENT THERMIQUE
Ce type de conditionnement n'est actuellement utilis que pour les filtres presses. Il
consiste chauffer les boues entre 150 et 200 C pendant 30 60 minutes selon le type de
boues et la filtrabilit dsire. Au cours de cette "cuisson", les gels collodaux sont dtruits et
l'hydrophilie particulaire diminue (schma 3 Annexes). On assiste galement 2
phnomnes simultans :
solubilisation de certaines MES (hydrolyse de l'amidon avec formation de sucres)
et ammonisation de l'azote organique;
prcipitation de quelques matires dissoutes. Selon le type de boues, la cuisson
solubilise 20 40 % des MO et conduit des jus prsentant des DBO
5
de 3000
6000 mg/l (rapport DCO/DBO
5
de l'ordre de 2,5). L'azote est prsent dans la phase
liquide des taux relativement levs (0,5 1,5 g/l en NH
4
+
), mais le phosphore ainsi
que les mtaux restent prcipits dans les boues. Le recyclage de ces jus de cuisson
apporte une surcharge de 10 25 % de la charge de la station dont il faut tenir
compte dans le dimensionnement de la biologie.
Page300 - Chapitre 15
Il ncessite un nettoyage frquent des surfaces d'change (interdisant la mise en oeuvre
sur certaines boues trs charges en calcium). L'investissement est par ailleurs coteux.
Par contre, ce type de conditionnement prsente les avantages suivants :
universalit d'application toutes les boues organiques;
stabilit des performances quelle que soit la concentration des boues;
paississement rapide et important des boues cuites (120 200 g/l);
amlioration de la structure des boues (filtration possible sans autre
conditionnement);
forte siccit des gteaux de filtre presse (de l'ordre de 50 %);
production de boues dshydrates striles;
rutilisation optimale du biogaz.
VI. EPAISSISSEMENT DES BOUES
Nous verrons, au chapitre dshydratation, que l'ensemble des techniques utilises,
l'exception du lagunage, sont sensibles la concentration de la boue dshydrater. Ceci de
faon plus ou moins marque, certes, rend indispensable le prpaississement pour les
moyens mcaniques de dshydratation.
Si nous observons les modes d'extraction des boues des diffrents ouvrages de traitement
d'eau nous pouvons constater que :
la concentration des extractions des diffrents ouvrages de traitement d'eau
fonctionnant en marche continue ou cyclique est faible et dpasse rarement 10 g/l (4
10 g/l en eau rsiduaire urbaine, 2 5 g/l en eau potable par dcantation);
les ouvrages fonctionnant en chasse priodique donnent des boues plus concentres
mais l'limination globale des MES entrane systmatiquement une dilution
surabondante des fins de purges.
Nous traiterons donc dans ce chapitre des diffrents moyens mis en oeuvre pour
l'paississement des boues. Ces moyens sont de deux ordres :
paississement par dcantation ou paississement statique;
paississement dynamique :
flottation;
gouttage;
centrifugation.
VI.1. EPAISSISSEMENT STATIQUE
Il s'adresse toutes les tailles de station d'puration ou d'usine de production d'eau
potable. Il prsente l'avantage, outre son rle d'paississement, de pouvoir fonctionner, au
moins dans le cas des boues d'eau potable en raison de l'absence de fermentation des
boues, en tant que stockeur intermdiaire des boues. Par contre, en eaux rsiduaires, un
paississeur mal gr peut tre gnrateur d'odeurs.
Conditionnement et traitement des boues des stations dpuration des eaux rsiduaires urbaines et des
usines de production deau potable - Page 301
L'paississement se fait par dcantation en piston des boues. La dcantation est aide
par une herse mouvement lent qui, en faisant rouler les particules de boues les unes sur
les autres, favorise l'coulement de l'eau interstitielle et l'vacuation des gaz occlus. Le
tassement des boues est donc ainsi favoris.
VI.1.1. Technologie
Les paississeurs doivent toujours tre de forme circulaires. La cuve peut tre ralise en
acier pour les petits diamtres, le plus souvent en bton (schma 4 Annexes).
La pente du radier est comprise entre 10 et 20 %. Ils sont quips d'un ensemble herse-
racleur tournant, double bras diamtral, entranement gnralement central. Les
dispositifs d'entranement sont gnralement prvus pour 20 30 m daN/m
2
.
Cet ensemble herse-racleur a un double rle :
assurer le transfert des boues de la priphrie vers le centre de l'ouvrage par un
ensemble de racleurs disposs "en jalousie" immdiatement au-dessus du radier;
faciliter l'vacuation de l'eau interstitielle et des gaz occlus au moyen de la herse
verticale accroche au dispositif tournant.
La hauteur de l'ouvrage doit tre la somme de la hauteur de compression (lit de boue) et
d'une hauteur dite de "revanche" (tranche d'eau) permettant d'avoir une bonne clarification
du liquide interstitiel et une bonne rpartition hydraulique de la liqueur entrante. Sa valeur est
gnralement de 4 5 m.
L'arrive des boues se fait gnralement par le haut l'intrieur d'une jupe de rpartition
plongeant de 1 2 m sous le niveau hydraulique de l'paississeur et permettant d'viter le
passage direct des MES en surverse.
Le soutirage se fait au centre du radier par un pompage gnralement extrieur
l'ouvrage. Il est souhaitable, dans ce cas, de prvoir sur la tuyauterie d'aspiration de(s)
pompe(s), une possibilit d'injection d'eau sous pression pour faciliter un dcolmatage
ventuel. Le surnageant est vacu par une goulotte priphrique.
VI.1.2. Dimensionnement d'un paississeur
La courbe de sdimentation de la boue, en utilisant un rcipient de diamtre suffisant (20
cm minimum) et de hauteur au moins gale 50 cm est un bon guide. Elle permet d'valuer,
au bout de 24 h, la concentration maximum de soutirage.
La thorie de Kynch permet, partir de cette courbe de sdimentation (figure 12 Annexes)
le calcul des paississeurs et, en particulier, la dtermination de la surface correspondant
la concentration de soutirage recherche.
Examinons la courbe de sdimentation (figure 12-1 Annexes). Cette courbe prsente deux
zones :
une zone linaire correspondant une vitesse de chute des particules constante,
c'est la plage de dcantation libre. La vitesse correspondante est la vitesse limite de
dcantation qui ne devra en aucun cas tre dpasse (ici 50 cm en 2 h soit
0,25 m/h);
une zone inflchie o la vitesse de dcantation diminue en fonction du temps, c'est la
zone dite de dcantation entrave.
Page302 - Chapitre 15
Dans la zone d'inflexion de la courbe, nous traons n tangentes qui vont couper chacune
l'axe des hauteurs d'interface en H
n
et l'axe des temps en T
n
.
Nous considrerons que chaque tangente dtermine une boue fictive ayant pour
dcantation libre la partie de la tangente entre le point de contact avec la courbe et l'axe des
hauteurs d'interface, et pour dcantation entrave la partie de la courbe situe gauche du
point de contact. Pour chacune de ces boues fictives, nous pouvons dfinir, si C
0
est la
concentration de la boue initiale et H
0
la hauteur initiale de boue (ici 50 cm) :
concentration initiale C
n
= C
o
x
Ho
Hn
(exprime en kg/m
3
ou g/l);
vitesse de dcantation libre V
n
=
Hn
Tn
;
avec :
H
n
exprime en m.
T
n
exprim en h.
V
n
est alors exprime en m/h.
flux maximum admissible, exprim en kg/m
2
/jour : F
n
= C
n
x V
n
x 24.
On reporte ces n valeurs de flux F
n
obtenues partir des n tangentes sur un graphe, on
trace ainsi la courbe dite courbe de flux ayant l'aspect de la courbe donne sur la figure 13
(Annexes). Une tangente cette courbe coupant l'axe des concentrations au point
correspondant la concentration de soutirage souhaite, coupera l'axe vertical des flux au
point correspondant la valeur maximum du flux massique admissible pour cette
concentration de soutirage.
Le tableau 12-9 ci-dessous donne, titre indicatif, les valeurs de flux massique et de
concentrations de soutirage gnralement obtenues sur diffrents types de boues.
Type de boues Flux massique
(kgMES/m
2
/jour)
Concentration possible de
boues paissies (g/l)
Boues primaires fraches (ERU) 80 120 selon teneur en MO 90 120(60 80 si dgrillage fin)
Boues mixtes fraches (ERU) 45 70 40 60
Selon rapport B primaires/ B biologiques
Boues biologiques seules (ERU) 25 30 20 30
Boues de floculation eau potable avec
hydroxydes mtalliques
15 25 15 30
Tableau 12-9 : Flux massique et concentration de soutirage pour diffrentes boues.
L'paississement par dcantation est gnralement mis en oeuvre sans conditionnement
pralable. Cependant un apport de chaux (de l'ordre de 15 % par rapport au MES des
boues) peut parfois tre appliqu sur des boues fermentescibles, afin d'viter les
dgagements gazeux risquant de perturber la dcantation et de provoquer des mauvaises
odeurs. Il arrive frquemment, en traitement de boues d'eau potable, d'utiliser un
conditionnement par polylectrolytes, voire un conditionnement binaire polylectrolyte plus
Conditionnement et traitement des boues des stations dpuration des eaux rsiduaires urbaines et des
usines de production deau potable - Page 303
chaux. Il faut cependant bien garder prsent l'esprit le fait que ce type de conditionnement,
s'il augmente les vitesses de dcantation donc la charge massique admissible sur
l'paississeur, ne change en rien la concentration finale des boues paissies, l'apport de
chaux prs.
VI.2. EPAISSISSEMENT PAR FLOTTATION
Ce systme d'paississement est particulirement bien adapt aux boues difficiles, boues
biologiques ERU ou boues d'eau potable comportant une forte proportion d'hydroxydes et
donnant des rsultats mdiocres en paississement statique.
Cette technique prsente les avantages suivants :
forte rduction de la surface et du volume des ouvrages par rapport
l'paississement statique (au moins un facteur 3 pour la surface et 6 pour le volume);
obtention sur des boues trs collodales de concentrations nettement suprieures.
Les siccits obtenues sur les boues paissies par flottation sont proches de 3 6 %.
VI.2.1. Principe de fonctionnement
Le principe consiste rduire la masse volumique apparente de la phase solide par
adsorption ou absorption de bulles gazeuses pour en provoquer l'entranement vers la
surface (schma 5 Annexes) avec une vitesse ascensionnelle qui, en modle laminaire, sera
donne par la loi de STOKES :
V = (g/18) md
2
avec
g : acclration gravitaire, : viscosit du liquide.
m : diffrence de masses volumiques phase solide-phase liquide, d : diamtre des particules.
De tous les procds de flottation, le plus utilis est celui par dtente du fluide aprs
pressurisation l'air comprim des pressions de 3 6 bars. Cette technique est utilisable
selon deux principes :
flottation directe : pressurisation de la totalit de la boue elle-mme;
flottation indirecte : pressurisation d'eau (souvent l'eau clarifie du flottateur) puis
injection de celle-ci immdiatement aprs dtente dans la suspension boueuse.
VI.2.2. Dimensionnement d'une flottation
Contrairement l'paississement statique, il n'existe pas pour la flottation de modle
mathmatique valable permettant le dimensionnement de ce systme. On devra en
consquence, soit raliser une srie d'essais, soit dduire la charge admissible en
comparaison de cas connus
Le dimensionnement dpend :
de la charge massique admissible (4 kg MES/m
2
/h sans conditionnement pour les
boues ERU, 6 8 kg MES/m
2
/h pour les boues flocules au polymre de synthse
pour les ERU ou eau potable);
de la charge hydraulique (infrieure 2 m/h gnralement);
de la concentration des boues en amont de la flottation (4 6 g/l maximum).
Page304 - Chapitre 15
Dans les paramtres influenant la flottation, nous pouvons noter :
le fonctionnement sans polymre pour les boues biologiques d'ERU;
la floculation pralable (polymre anionique ou cationique) sur les boues d'eau
potable charges en hydroxydes;
le conditionnement pralable des boues biologiques ERU permet d'amliorer les
charges massiques et les taux de capture;
le type de pressurisation modifie les performances de la flottation :
pressurisation directe offre un meilleur taux d'paississement, mais une moins
bonne clarification;
pressurisation indirecte prsente une capacit de production en gnral plus
faible mais une meilleure clarification;
le taux de recyclage en cas de pressurisation indirecte;
VI.3. EPAISSISSEMENT PAR EGOUTTAGE
Diffrents dispositifs peuvent tre utiliss (tambours, poches filtrantes, grilles d'gouttage),
mais la grille GDE est l'appareil qui allie la fois simplicit d'emploi et fiabilit (schma
6 Annexes).
Cet appareil fonctionnement continu est plac directement au refoulement de la pompe
d'alimentation en boues fraches. La boue, pralablement flocule au polymre de synthse,
est pandue sur un champ horizontal de grille fine racle en permanence par des lames en
caoutchouc.
La concentration des boues augmente progressivement en avanant sur le champ de
grille, le rglage est optimal lorsque la boue ne contient plus d'eau libre en fin de parcours.
Le dbit de la pompe boue, de l'injection du polymre ainsi que la vitesse de raclage sont
rglables. Le lavage de la grille est ralis de faon cyclique au moyen de pulvrisation
d'eau sous pression.
L'apport d'agent de floculation s'effectue travers un mlangeur statique plac en aval de
la pompe boues. La consommation de polymre est relativement leve (5 8 kg/tonne de
MES) mais cette dpense demeure faible sur de petites stations, surtout eu gard aux
avantages que prsente cet paississement :
soutirage direct de boues en excs peu concentres depuis la recirculation en
boues urbaines;
rduction de 2 3 fois du volume de stockage des boues avant leur reprise en
agriculture;
rduction dans les mmes proportions du cot de transport des boues.
Par contre, pour les boues d'eau potable, les purges de dcanteurs doivent subir un
prpaississement rapide.
De la mme faon que pour l'paississement par flottation, il n'existe pas de modle
mathmatique permettant de faire le dimensionnement d'une grille GDE. On devra donc se
rfrer des cas similaires connus.
Conditionnement et traitement des boues des stations dpuration des eaux rsiduaires urbaines et des
usines de production deau potable - Page 305
Le tableau 12-10 prsente les performances globales des grilles GDE.
Nature des boues Concentration en
MES des boues
brutes (g/l)
Capacits en kg MES/h par
mtre de largeur de grille
Siccit des boues
paissies (%)
ERU - Aration
prolonge
< 10 30 70 5 6
> 10 60 200 5 8
ERU - Digestion
anarobie
15 25 70 140 7,5 9
Eau potable -
Hydroxydes
d'aluminium
10 15 25 35 2,5 4,5
Tableau 12-10 : Performances des grilles GDE selon la nature des boues.
Comme il n'y a pas de pressage, le rendement d'extraction est toujours lev (> 95 %
gnralement). La grille GDE peut galement tre utilise comme prpaississeur en amont
immdiat d'un appareil de dshydratation (filtre bandes, centrifugeuse).
VI.4. EPAISSISSEMENT PAR CENTRIFUGATION
L'paississement par centrifugation prsente les inconvnients d'tre lourds en
investissement et en cot d'exploitation (consommation d'nergie 150 300 kWh/tonne
de MES. Par contre, il a l'avantage de n'occasionner que peu de nuisances sonores et
olfactives (car lappareil est ferm) et d'tre trs compact.
L'paississement obtenu est plus important que par flottation (voire trop important en ERU
si nous avons en aval une digestion anarobie).
Par ailleurs, sous peine d'avoir des rendements de capture et des dbits alimentaires
possibles faibles, l'emploi d'un polymre (1 2 kg/t MES) est indispensable. Nous risquons
aussi en cas de fonctionnement sans polymre d'avoir une classification des boues avec
dpart de fines.
La centrifugation consiste en une dcantation acclre par force centrifuge. Cette force
est donne par :
g =
2
R = 0,011 N
2
R
avec
g : face centrifuge en m.sec
-2
.
: vitesse angulaire en rad.sec
-1
.
R : rayon moyen en m.
N : vitesse de rotation en tr/mn.
L'acclration engendre est exprime en nombre de g (9,81 m/sec) de telle sorte que :
G = nombre de g = (2 R) / g = 11,2 x 10
-4
N
2
R
Page306 - Chapitre 15
Les champs centrifuges mis en oeuvre dans les machines industrielles varient de 800
4000 g suivant la taille de la machine.
Les dcanteuses (schma 7 Annexes) comportent essentiellement un bol cylindro-conique
(1) axe horizontal tournant grande vitesse. A l'intrieur de ce bol tourne une vis sans fin
hlicodale (2) dispose coaxialement qui pouse parfaitement la surface interne du bol, au
jeu prs entre bol et filets de vis. Ces 2 rotors, bol et vis, tournent des vitesses diffrentes.
La diffrence entre ces 2 vitesses est appele vitesse relative (V
r
).
Le produit traiter (3) est introduit axialement dans la machine par un distributeur
appropri, (4) il est alors propuls dans l'espace annulaire (5) form par la face interne du
bol et le corps de vis. La dcantation s'effectue essentiellement dans la partie cylindrique du
bol. La vitesse relative de la vis par rapport au bol fait progresser le produit dcant (6)
l'intrieur du bol. Le convoyage des solides le long du cne permet de sortir le sdiment hors
du liquide clarifi : l'alimentation tant continue, un niveau liquide (7) s'tablit en effet dans la
machine suivant une surface cylindrique qui constitue la surface interne de l'anneau liquide.
Lorsque le solide est sorti de l'anneau liquide, la partie rsiduelle du cne jusqu'au diffuseur-
jecteur sert l'gouttage final : cette partie constitue la plage de schage (8). Le liquide
clarifi (9) est rcupr l'autre extrmit du bol (cot grand diamtre) par dbordement au
dessus des seuils (10) rglables qui limitent l'anneau liquide dans la machine. Le rotor est
protg par un capot qui permet galement la rcupration du liquide clarifi et du sdiment.
Comme pour la flottation ou l'paississement par drainage, il n'existe pas de modle
mathmatique permettant de dimensionner une centrifugeuse. La centrifugation n'est
actuellement pratiquement pas utilise en paississement de boues d'eaux potables. Elle est
utilise de prfrence en paississement de boues biologiques.
Pour les capacits des diverses tailles de machines, on se rfrera au tableau 12-11
suivant :
Dbits admissibles
bol Sans polymre Avec polymre
30 - 35 cm 8 m
3
/h 10 m
3
/h
40 - 50 cm 16 m
3
/h 20 m
3
/h
50 - 60 cm 22 m
3
/h 28 m
3
/h
60 - 70 cm 45 m
3
/h 55 m
3
/h
Tableau 12-11 : Dbit admissible en fonction de la taille du bol.
Conditionnement et traitement des boues des stations dpuration des eaux rsiduaires urbaines et des
usines de production deau potable - Page 307
Les paississements obtenus sont de l'ordre de 50g/l sans polymre et 60 90 g/l avec 1
2 kg polymre/t MES. Les rendements de capture avoisinent 70 % sans polymre (1 1,5
g/l de MES dans le centrat) ou 90 % avec polymre (0,2 0,5 g/l de MES dans les centrats)
pour des concentrations d'alimentation de l'ordre de 5 g/l.
VII. DESHYDRATATION
La dshydratation des boues consiste restituer sous forme plus ou moins concentre
l'ensemble des matires en suspension produite par une installation de traitement des eaux.
Cette dshydratation est obtenue par application de diffrentes techniques de sparation
solide-liquide telles que la dcantation (centrifugation) ou la filtration (filtres bande
presseuse ou filtres presse). Elle peut tre suivie d'un post-traitement (chaux vive, schage,
compostage) suivant l'tat final du rsidu dsir. Gnralement la concentration en MS dans
le rsidu obtenu est exprim par la siccit (g MS % g de rsidu) mais il faut se garder de
n'utiliser que cette donne du fait qu'elle ne renseigne nullement sur l'aspect physique du
rsidu obtenu (solide, pteux, liquide).
VII.1. CENTRIFUGATION
Nous avons vu au chapitre IV.4 le principe de fonctionnement des centrifugeuses. Les
machines utilises en dshydratation sont du mme type que celles utilises pour
l'paississement. Seuls les paramtres de marche vont tre diffrents. La vitesse relative, V
r
,
mise en oeuvre sera plus basse que pour l'paississement, afin d'augmenter la siccit du
sdiment, au dtriment cependant du dbit volumique admissible sur la machine. La vitesse
absolue sera maximum, afin d'amliorer compactage et siccit. Enfin la plage d'essorage
sera maximum en fonction de la qualit des boues et du rendement de capture donc
l'paisseur de l'anneau liquide sera rduite.
La centrifugeuse sera utilise sur des boues flocules aux polymres de synthse. La
recherche du meilleur polylectrolyte est primordiale; il faut obtenir un floc trs volumineux et
trs rsistant. Peu importe, dans ce cas, la viscosit du liquide interstitiel, ce dernier ne
devant traverser aucun mdium filtrant.
Il est difficile d'interprter les tests de laboratoire pour prvoir le comportement de la boue
en dcantation dynamique du fait des forces de cisaillement et des turbulences engendres
par la vis convoyeuse. Nanmoins il est possible d'estimer une siccit ( quelques points
prs) ainsi que les dbits possibles en tenant compte du volume occup par le sdiment
sous l'anneau liquide. Il est toutefois pratiquement impossible de prvoir le comportement
rhologique de la boue dcante dans l'enceinte tournante. De ce fait, il est encore procd
de nombreux tests industriels pour cerner les performances optimales.
Les siccits de gteau se rapprochent de celles obtenues sur un filtre bandes
presseuses classiques (voir chapitre VII.2.). La fourchette des siccits possibles est
restreinte mme en modulant les diffrents paramtres oprationnels, le dbit de boues ou le
dosage de ractifs.
Les gteaux obtenus ont gnralement une structure plastique. Comme pour
l'paississement, les capacits sont corrles aux diamtres de machine.
Page308 - Chapitre 15
VII.2. FILTRES A BANDES PRESSEUSES
La taille des flocs obtenus par conditionnement aux polylectrolytes a rendu possible le
dveloppement d'appareils de dshydratation spcifiquement adapts au traitement des
boues rsiduaires : les filtres bande presseuses. Ces filtres sont trs rpandus pour
plusieurs raisons :
grande facilit d'exploitation et bon contrle visuel de la boue en cours de
dshydratation;
faible cot d'exploitation et investissement modr;
continuit du procd et du lavage des bandes filtrantes;
simplicit de la mcanique;
ajout de charge minrale en gnral inutile;
production de boues pelletables.
Ces filtres permettant d'optimiser l'investissement en fonction de l'aptitude la
dshydratation de la boue. Par ailleurs, ils reprsentent un procd quasi universel et le
moins nergivore :
filtre bandes : 15- 20 kWh/t MES;
filtre presse classique : 20- 40 kWh/t MES;
centrifugeuse : 30- 60 kWh/t MES.
VII.2.1.Principe de filtration
Le processus de filtration comporte toujours les tapes suivantes (schma 8 Annexes) :
floculation avec des polylectrolytes dans des floculateurs court temps de sjour ou
parfois en conduite;
drainage de la boue flocule : gouttage sur un support filtrant de l'eau interstitielle
libre. Ceci provoque l'paississement rapide de la boue. Pour obtenir les
meilleures performances, la boue draine doit tre la plus concentre possible;
pressage de la boue draine : celle-ci de consistance suffisante, est alors
emprisonne entre deux toiles filtrantes qui forment un coin et la comprime
progressivement. Le "sandwich" ainsi form s'enroule alors successivement autour
de tambours perfors, puis de rouleaux disposs en quinconce suivant un parcours
qui varie selon le type de filtre.
L'efficacit de la dshydratation dpend de la pression effective P
e
applique sur le
"sandwich" de boue et aussi du temps de pressage. De faon simplifie, la pression P
e
, dite
pression de surface est de la forme :
P
e
= k
2T
LD
avec :
T : effort de tension de la toile.
L : largeur de la toile.
D : diamtre du rouleau.
Conditionnement et traitement des boues des stations dpuration des eaux rsiduaires urbaines et des
usines de production deau potable - Page 309
P
e
est donc obtenue par la tension des toiles autour des rouleaux. Elle reste modre (0,3
1,5 bars) du fait de la rsistance mcanique des bandes filtrantes et des rouleaux. P
e
est
d'autant plus forte que le diamtre du rouleau est faible.
Le temps de pressage dpend de la surface active de presse aux enroulements et de la
vitesse de dfilement. Le dpart de l'eau est facilit par les contraintes de cisaillement de la
boue au passage des rouleaux et peut s'effectuer alternativement d'un ct puis de l'autre du
"tapis" de boues. Dans les filtres bandes presseuses, le pressage s'effectue dans une
enceinte ouverte : le sandwich de boues assure donc lui-mme l'tanchit latrale sous la
pression qu'il peut supporter lors de sa progression ; si la pression est trop forte, la cohsion
du tapis de boue est dtruite et il y a fluage, avec jection latrale, hors de l'espace de
filtration de boues partiellement dshydrates.
La pression provoquant le fluage dpend bien videmment de la structure physique des
boues draines. Les siccits obtenues sur filtres bandes presseuses sont donc infrieures
celles obtenues sur filtres chambres tanches (filtres presses).
VII.2.2.Performances des filtres bandes presseuses
Il n'existe, pour ce systme, aucune relation mathmatique dfinissant la capacit de
production. Le dimensionnement dcoule le plus souvent de l'exprience acquise sur des
boues similaires compltes par quelques tests simples de laboratoire pour connatre :
vitesse de drainage, rsistance au fluage, siccit aprs pressage. Des essais sur pilote
industriel permettent d'affiner les prvisions. Les capacits de production de filtres bandes
presseuses sont donnes en kg de matires sches extraites par m de largeur de bande et
par heure. Le tableau 12-12 fait apparatre la grande diversit des performances (dbits et
surtout siccits) rencontres avec les principales familles de boues.
Page310 - Chapitre 15
Nature et origine de la boue Concentration
de la boue (g/l)
Capacit
(kg MS/m/h)
Siccit (% MS) Polymre
(kg/tonne de MS)
Urbaine primaire digre
MV <= 50 % MES
60-90 400-700 28-35 1,5-3 (C)
Urbaine frache mixte
% primaire >= 65 % des MES
50-60 250-500 23-30 3,5-5,5 (C)
Urbaine frache mixte
% primaire = % des MES
35-45 150-400 18-26 4-6 (C)
Urbaine mixte digre
anarobie % primaire = 50 %
des MES
20-30 120-300 17-24 5-6 (C)
Urbaine aration prolonge 18-25 100-150 16-21 4-7 (C)
Urbaine physico-chimique
dosage FeCl
3
<= 50 mg/l
60-80 300-700 26-35 2-4 (C ou A)
Clarification eaux trs peu
charge - Al(OH)
3
= 40 50 %
des MES
20-30 100-130 16-20 2-3 (A)
Clarification rivires argileuses
MES d'eau brute 50-100 mg/l
Al (OH)
3
= 20 % des MES
50-60 300-450 21-27 3-4 (A)
C = polymre cationique.
A = polymre anionique.
Tableau 12-12 : Performances des filtres bandes presseuses.
VII.3. FILTRES PRESSES
Le filtre presse est un appareil qui permet de filtrer des boues en chambre tanche sous
des pressions de l'ordre de 5 15 bars.
VII.3.1.Principe de fonctionnement
Le filtre est constitu d'une batterie de plaques vides verticales, juxtaposes et serres
fortement l'une contre l'autre par une tte mobile manoeuvre par un ou des vrins
hydrauliques (schma 9 Annexes).
Ces plaques, excutes en fonte ou en polypropylne sont rainures, afin de laisser le
filtrat s'couler et comporte plusieurs bossages rpartis uniformment, qui ont pour but
d'viter les dformations, voire la casse des plateaux au cas o le filtre ne serait pas rempli
de faon homogne. Ces plateaux sont revtus sur leurs 2 faces canneles, de toiles
filtrantes de mailles assez fines (10 300 m).
Les boues filtrer sont envoyes dans le filtre par la partie centrale, noyau et ainsi
rparties dans l'ensemble des chambres de filtration. Les matires boueuses s'accumulent
ainsi dans les chambres jusqu' formation d'un gteau final compact.
Conditionnement et traitement des boues des stations dpuration des eaux rsiduaires urbaines et des
usines de production deau potable - Page 311
Le filtrat est collect dans les cannelures des plateaux et vacu au moyen de conduits
internes situs aux 4 coins des plateaux.
VII.3.2.Technologie
Les filtres se distinguent essentiellement par :
supportage des plaques filtrantes, barres longitudinales ou accrochage 1 ou 2 rails
suprieurs;
le systme de halage des plateaux(lectromcanique ou hydromcanique);
le systme de lavage des toiles.
Les plus grandes units comprennent jusqu' 150 plateaux de 2 x 2 m (surface de filtration
: 1 000 m
2
, volume des chambres 15 000 l pour une paisseur de gteau de 3 cm).
Il existe galement des petites units (20 plateaux de 0,4 x 0,4 m).
Les pressions appliques sont en gnral de l'ordre de 13 15 bars parfois 5 7 bars.
La profondeur des chambres de filtration (paisseur du gteau) dpend de la nature de la
boue; Pour des boues difficiles et peu concentres, on utilisera des paisseurs faibles
(25 mm), pour des boues denses ayant une trs bonne filtrabilit on utilisera de fortes
paisseurs (40 50 mm) afin d'viter les cycles trop courts. L'paisseur couramment utilise
est de 3 3,5 cm afin d'avoir des temps de cycle de 2 4 h.
VII.3.3.Droulement du cycle
Le cycle de filtration comporte les opration suivantes :
fermeture du filtre;
ouverture vanne d'alimentation;
mise en route pompe haute pression;
arrt de la filtration (pompe haute pression). Cet arrt peut se faire :
manuellement sur commande de l'oprateur;
automatiquement sur minuterie prrgle;
automatiquement sur sonde de filtration dtectant un dbit final de filtrat, en
gnral 10 12 l/m
2
/h;
fermeture vanne d'alimentation;
ouverture vanne de purge du boudin central;
purge du boudin central l'air comprim;
fermeture vanne de purge;
ouverture filtre.
Page312 - Chapitre 15
VII.3.4.Capacit de filtration
Le temps thorique de presse peut tre estim par :
T
f
= K x 0,2125
r e c
p
S d
c
s
s
f g 0 5
2
1
2
2
1
, .
. . .
o :
T
f
: temps de filtration exprim en minutes.
.
C : concentration de la boue en kg/m
3
.
d
g
: densit du gteau form en kg/l.
h : viscosit du filtrat en centipoises, en gnral on prendra h = 1,1 centipoises.
r
0,5
: rsistance spcifique de la boue conditionne 0,5 bar exprime en 10
10
cm/g.
s : coefficient de compressibilit de la boue conditionne.
p : pression maximale de filtration en bars.
e : paisseur des chambres de filtration en cm.
s
f
: siccit finale des gteaux en fraction poids (40 % = 0,40)
K : coefficient de colmatage des toiles (sur toiles propres, nous avons K 1,3)
Nous voyons ici que le temps de presse est dpendant :
du conditionnement de la boue (r
0,5
);
du carr de l'paisseur des gteaux;
de la concentration des boues conditionnes;
du coefficient de compressibilit de la boue.
Le temps de cycle (t
cy
) (temps de filtration + temps de dbatissage et temps de prparation
du cycle) est en gnral estim en temps de filtration augment d'une demi heure (t
cy
est
exprim en heures)
La capacit de filtration est alors donne par :
L =
e dg s
tcy
f
. .
, 0 2
en kg/m
2
/h.
Un ordre de grandeur des performances, que lon peut esprer dun filtre presse, sont
prsentes dans le tableau 12-13 pour diffrents types deffluents :
Conditionnement et traitement des boues des stations dpuration des eaux rsiduaires urbaines et des
usines de production deau potable - Page 313
Nature et origine des boues Conditionnement Capacit de filtration Siccit (%)
FeCl
3
%
MS CaO % MS (kg MS/m
2
/h)
Urbaines mixtes fraches
% primaires > 75 % des MS
% primaires = 50 % des MS
2-4
4-7
10-15
15-22
3-4
2-3
40-48
36-44
Urbaines mixtes digres
% primaires indiffrent
% primaires = 50 % des MS
% primaires > 65 % des MS
Thermique
5-8
2-8
Thermique
16-24
15-24
2,5-5
2-3
2-3,5
45-60
36-42
26-33
Urbaines aration prolonge 6-10 18-28 1,5-3 31-37
Urbaines physico-chimiques
Traitement d'eau plus de 100 mg/l
FeCl
3
Eventuel
18-30
1,5-2,5
33-45
Clarification d'eau de surface peu de
limons :
sels d'Al
sels de Fe
18-35
16-28
1,5-2,5
1,5-3
30-38
34-40
Tableau 12-13 : Performances des filtres presses.
VII.4. LITS DE SECHAGE
Le schage des boues sur des lits de sable drains, longtemps la technique la plus
utilise est en rgression continue du fait :
des grandes surfaces de terrain ncessaires;
des dpenses de main-d'oeuvre qu'elle entrane;
des performances trs dpendantes des conditions climatiques ne permettant
pas dans bien des rgions une vacuation rgulire des boues produites.
Ce type de dshydratation n'est retenir que sur des boues bien stabilises (digestion
anarobie ou aration prolonge).
Page314 - Chapitre 15
Les temps de schage varient de 3 semaines 1,5 mois pour scher 30 40 cm de
boues liquides. La dshydratation comporte une premire phase de drainage qui peut
ventuellement tre acclre par ajout de polymre et une seconde phase de schage
atmosphrique. La siccit peut atteindre 40 et mme 60 % en cas d'ensoleillement optimum.
VIII.CONCLUSION
La caractrisation qualitative des boues doit tre bien apprcie lorsque l'on choisit une
destination finale possible des boues : valorisation agricole, dcharge, voire incinration. En
effet, la qualit des boues escomptes va fixer la limite des traitements proposs car les
performances prvisibles des diffrentes filires boues seront bien cernes. Les quantits
massiques peuvent tre calcules assez justement bien que, pour les boues urbaines, la
production relle de biomasse (si importante pour la qualit des boues globales) n'est pas
toujours bien cerne.
Le choix de la filire boue, pour les eaux rsiduaires urbaines surtout, dpend galement
bien videmment, d'un facteur conomique liant l'importance de l'installation de traitement
d'eau la hauteur de l'investissement acceptable. Le tableau 12-14 donne, globalement, le
type d'quipement rencontr en fonction de la taille de la station (en q/ha).
Taille de la station
(q.hab)
0 5000 5001 10 000 10 001
50 000
50 001
150 000
> 15 000
Silo
Epaississeur
Flottation
Systme drainant
Filtres bandes
Centrifugeuse
Filtre presse
Lits de schage
Stabilisation arobie
Stabilisation anarobie
Tableau 12-14 : Type d'quipement rencontr en fonction de la taille de la station.
Conditionnement et traitement des boues des stations dpuration des eaux rsiduaires urbaines et des
usines de production deau potable - Page 315
ANNEXES
Chapitre 16
LES BOUES RESIDUAIRES
URBAINES - EVOLUTION DE LA
PRODUCTION ET AVENIR DES
DIFFERENTES FILIERES
DEVACUATION
P. GRULOIS
Les boues rsiduaires urbaines - Evolution de la production et avenir des diffrentes filires dvacuation -
Page330
SOMMAIRE
I. INTRODUCTION.....................................................................................................................................331
II. PRODUCTION DE BOUES SUR LES STATIONS..............................................................................331
II.1. LE PARC NATIONAL DE STATIONS D'EPURATION...................................................................................331
II.2. LES FILIERES DE TRAITEMENT DES BOUES DE STATIONS D'EPURATION.................................................332
II.3. PRODUCTION DE BOUES RESIDUAIRES URBAINES SUR LES STATIONS DE TRAITEMENT..........................332
II.3.1. Les productions dclares..............................................................................................................332
II.3.2. Les productions mesures ..............................................................................................................335
II.4. EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE BOUES A L'ECHELLE NATIONALE ..................................................336
II.5. DESTINATION FINALE DES BOUES ........................................................................................................338
III. LES PRINCIPALES VOIES D'EVACUATION...............................................................................339
III.1. LA MISE EN DECHARGE........................................................................................................................339
III.1.1. Aspect lgislatif..........................................................................................................................339
III.1.2. Ralisation pratique...................................................................................................................339
III.1.3. Aspect conomique ....................................................................................................................339
III.2. L'UTILISATION AGRICOLE ....................................................................................................................340
III.2.1. La lgislation .............................................................................................................................340
III.2.2. Valeur agronomique des boues .................................................................................................340
III.2.3. Conditions de rutilisation agricole des boues..........................................................................348
III.2.4. Aspect conomique ....................................................................................................................349
III.3. L'INCINERATION..................................................................................................................................352
III.3.1. Aspect rglementaire .................................................................................................................352
III.3.2. Aspect technique ........................................................................................................................352
III.3.3. Cot de l'incinration des boues................................................................................................352
IV. LES PERSPECTIVES - LES EVOLUTIONS ...................................................................................352
IV.1. LA REGLEMENTATION. ........................................................................................................................353
IV.2. LES INCITATIONS. ................................................................................................................................353
IV.3. LES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT BOUES. ......................................................................................353
IV.4. LE COUT DE LA FILIERE EPANDAGE AGRICOLE. ....................................................................................353
IV.5. ORGANISATION ET CONTROLE DE L'EPANDAGE....................................................................................353
IV.6. L'ACCEPTATION PAR L'AGRICULTURE. .................................................................................................353
IV.7. LA FILIERE D'EPURATION. ....................................................................................................................354
V. DES IDEES POUR UN SECTEUR EN PLEINE EVOLUTION..........................................................355
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES............................................................................ 356
Page331 - Chapitre 16
I. INTRODUCTION
L'assainissement est actuellement un domaine en pleine effervescence. La loi sur l'eau du
3 janvier 1992 gnre des dcisions dont les effets sont palpables tant au niveau politique
que technique.
Les dlais impartis pour mettre en oeuvre tous ces changements sont brefs. Une premire
tape aura lieu d'ici 1998, puis une seconde de 1998 2005, cinq ans, dix ans, ..., ces
dures, compte tenu de l'ampleur de la tche et des dcisions prendre, sont pour le moins
courtes.
Un des principaux problmes li ces changements va venir de la quantit de boues
rsiduaires produites sur les stations de traitement et de leur destination finale. La fermeture
des dcharges d'ici 2002 va conduire une rorganisation des filires d'vacuation. La
lgislation volue rapidement, de manire difficilement prvisible et peut, "du jour au
lendemain", entraner des modifications radicales du contexte actuel.
Il convient donc, pour les nouvelles options prendre, de faire posment le point et
d'apprcier la situation en disposant d'un maximum d'lments. Tel est l'objectif de cette
synthse. Aprs avoir fait le bilan des quantits de boues actuelles et de leurs volutions
probables dans les dix annes venir, un examen des filires aujourd'hui mises en oeuvre
sera ralis.
Puis, selon les volutions lgales possibles, deux scnarios seront proposs, visant
valuer le dveloppement des diffrentes voies d'vacuation actuellement rencontres.
Ce document est donc, aprs analyse de la station actuelle, prospectif. Il regroupe des
lments qui permettront au lecteur de mieux cerner un problme sensible, mais ne prtend,
en aucun cas, apporter "des rponses" catgoriques.
II. PRODUCTION DE BOUES SUR LES STATIONS
II.1. LE PARC NATIONAL DE STATIONS D'EPURATION
Le tableau 13-1 montre l'volution du parc national sur trois annes (Ministre de
l'Environnement, 1991) pour les stations de plus de 400 quivalents habitants (eq.hab.).
Stations d'puration 1987 1988 1989
Nombre 10 197 10 516 10 840
Capacit* (millions
eq.hab.)
61,3 62,9 66,4
* ajouter 4 % pour les stations de moins de 400 eq.hab.
Tableau 13-1 : Evolution annuelle du parc franais des stations d'puration de plus de 400 eq.hab.
Le tableau 13-2 indique la rpartition du parc des stations d'puration de plus de
400 eq.hab. par type de traitement en 1989 (Ministre de l'Environnement, 1991).
Les boues rsiduaires urbaines - Evolution de la production et avenir des diffrentes filires dvacuation -
Page332
Stations
d'puration
Traitement
primaire
Lagunage Boues
actives
Lits
bactriens
Divers
biologiques
Physico
chimique
Total
Nombre tot. 561 1929 6406 1605 229 110 10 840
% 5,2 17,8 59,1 14,8 2,1 1 100
Capacit tot
(Millions q.hab)
2,481 1,79 49,452 6,814 0,52 5,244 66,3
% 3,7 2,7 74,6 10,3 0,7 7,9 100
Tableau 13-2 : Rpartition du parc de stations d'puration franais en 1989.
Les filires intensives, par boues actives et lits bactriens, reprsentent 85 % de la
capacit installe pour 74 % du nombre des installations.
Sur la base d'une pollution totale mise par les agglomrations de 72 100 000 x 1,04, soit
74 984 000 eq.hab. (Ministre de l'Environnement, 1991), la capacit globale des
installations d'puration couvre thoriquement des besoins dpuration.
II.2. LES FILIERES DE TRAITEMENT DES BOUES DE STATIONS D'EPURATION
Les principales filires de traitement des boues et les diffrents type de boues sont
reprsentes ci-aprs (figure 13-1 et 13-2) et sont mentionnes celles qui peuvent faire
l'objet d'un pandage agricole l'tat liquide (E.A.L.) ou non (E.A.N.L.).
En dehors de cas extrmes ncessitant l'apport aux boues de produits extrieurs en
quantits importantes (chaulage, compostage), et du cas particulier de la stabilisation
anarobie, les modifications entranes sur la composition chimique des boues sont faibles
au regard des variations couramment rencontres sur une mme station d'puration.
Les expriences de mise en place de dshydratation par machines mobiles telles que
presses bandes n'ont pas t concluantes. La dshydratation des boues de plusieurs
stations sur une seule et mme installation d'puration en place n'a probablement pour
l'heure pas d'intrt non plus au regard de l'pandage agricole, en raison notamment des
deux inconvnients lis plusieurs reprises du produit et du cot du transport des boues
liquides (suprieur au cot de dshydratation par filtre bandes).
II.3. PRODUCTION DE BOUES RESIDUAIRES URBAINES SUR LES STATIONS DE
TRAITEMENT
II.3.1. Les productions dclares
On entend par "production dclare" la valeur annonce par l'exploitant ou dduite des
indications portes par lui au livre de bord. Dans ce paragraphe, les valeurs sont donnes en
kg de Matires Sches (MS), compte tenu de leur obtention par des techniques analytiques
varies.
Page333 - Chapitre 16
Figure 13-1 : Diffrents type de boues.
Eau brute
Prtraitement Dcanteur Primaire Traitement biologique Clarificateur
Epaississeur statique Flottateur
Traitement biologique
Conditionnement
Dshydratation
Evacuation des boues Eau traite
Les boues rsiduaires urbaines - Evolution de la production et avenir des diffrentes filires dvacuation -
Page334
Figure 13-2 : Principales filires de traitement des boues.
Epaississement
Gravitaire Dynamique (flottation)
Stabilisation
Biologique Chimique
Digestion anarobie
Stabilisation arobie
Conditionnement
Organique Minral
Thermique
Dshydratation
Filtre bandes
Filtre presse
Centrifugation
Evacuation
Agriculture Centre d'Enfouissement Technique
Incinration
Page335 - Chapitre 16
Les rsultats de 1120 stations d'puration (13 dpartements) ont t fournis par le
SATESE (figure 13-3) et analyss (CEMAGREF, 1992).
Sur les 1120 stations, la moyenne de production dclare est de 0,44 kg MS/kg DBO
5
limine. Les valeurs se situent dans la fourchette 0,1-1,5 kg de MS/kg DBO
5
limine.
La moyenne trs faible rsulte des pertes accidentelles des boues lies des dbits
excessifs, des lacunes dans l'vacuation des charges by-passes lors des priodes fort
dbit, mais aussi en gnral des effluents dilus (si les effluents bruts ont des
DBO
5
< 100 mg/l, les MES de l'effluent pur reprsentent normalement 20 % et plus de la
production brute).
Seules 30 stations, soit 2,70 % des effectifs, dclarent des productions suprieures 0,9
kg MS/kg DBO
5
limine ; la production dclare crot, en gnral, avec la taille de la station.
Figure 13-3 : Production dclare de boues (kg MS/kg DBO
5
limin) en fonction de la capacit
nominale des stations d'puration.
II.3.2. Les productions mesures
Les estimations des quantits de boues produites peuvent tre ralises de nombreuses
manires. Les incertitudes lies l'estimation des volumes, des concentrations, tant en
gnral un test ne portant que sur des stations recevant des effluents domestiques, en
rseau sparatif et ne perdant pas de boues, a t conduit. L'ensemble des rsultats
individualisables reus (132 stations de 20 dpartements diffrents) montre des productions
Les boues rsiduaires urbaines - Evolution de la production et avenir des diffrentes filires dvacuation -
Page336
mesures variant de 0,1 1,3 kg MES/kg DBO
5
limine en boues actives en aration
prolonge.
Ces rsultats dmontrent l'ampleur des incertitudes lies au problme pos (figure 13-4).
Sur les rsultats bruts, les valeurs sont assez comparables aux productions dclares. Par
contre, les donnes les plus fiables, correspondant des rponses compltes au
questionnaire pos, sont proches en moyenne des valeurs thoriques les plus couramment
cites (0,8 kg MES/kg DBO
5
limine en effluent domestique). Les variations (de 0,1 1,3 kg
MES/kg DBO
5
limine) autour de ces moyennes restent toutefois de forte amplitude.
Figure 13-4 : Productions moyennes mesures ou estimes par le SATESE, en boues actives en
aration prolonge (132 stations).
II.4. EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE BOUES A L'ECHELLE NATIONALE
La production annuelle relle de boues urbaines sur le territoire franais est estime
600 000 tonnes de matires sches (ADEME, 1992), soit environ 500 000 tonnes pour les
stations biologiques par boues actives et lits bactriens.
La production annuelle thorique des stations d'puration par boues actives et lits
bactriens peut tre value comme suit :
capacit des stations boues actives et lits bactriens de plus de 400 eq.hab. (84,8
% du total des stations collectives en 1989) selon le Ministre de l'Environnement
(1991) : 56 266 000 eq.hab;
correction lie la dfinition de l'eq.hab. (57 g de matires oxydables/j);
coefficient correcteur :
pollution entrant sur les stations en 1988
capacit de traitement
= 0,58 (Min. de l' Envir. ,1990) ;
production journalire de boues par eq.hab.: 40 g de MS/j (CEMAGREF, 1991);
Page337 - Chapitre 16
production annuelle thorique: 56 266 000 x 40.10
-6
x 365 x 0,58 = 476 460
tonnes.
Une simple saturation de la capacit des stations actuelles porterait cette valeur 821 483
tonnes.
Remarque : l'incinration d'environ 10 % des boues conduit environ 40 000 tonnes de
cendres.
Sur la base d'une pollution totale mise par les agglomrations (de plus de 400 eq.hab.)
de 72 100 000 eq.hab (Ministre de l'Environnement, 1991) d'une part, d'une proportion
inchange des stations d'puration par boues actives et lits bactriens dans le total des
installations franaises d'autre part, la quantit thorique de boues produites
annuellement pour un parc complet de traitement collectif des eaux uses des
agglomrations est de :
72 100 000 x 40.10
-6
x 0,848 x 365 = 892 655 tonnes MS.
Cette production devrait tre augmente de 10 20 % d'ici l'an 2000 si l'on tient compte
d'une augmentation de la population et d'une introduction trs large de l'limination du
phosphore. Une valeur de 1 100 000 tonnes de MS peut tre retenue en premire
approximation, laquelle il conviendrait d'ajouter les boues rsultant du traitement d'une
quantit d'eau beaucoup plus importante par temps d'orage.
La production de boues des stations biologiques urbaines par boues actives et lits
bactriens pourrait donc passer de 500 000 tonnes de MS environ 1 100 000 tonnes de
MS pour une situation idalise (puration amliore, pertes de boues ngligeables,
populations raccordes = population raccordable aux rseaux collectifs).
Anne.
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
d
e
b
o
u
e
(
t
o
n
n
e
M
S
/
a
n
)
.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1re phase 2nde phase
Figure 13-5 : Evolution prvisible de la production de boues d'ici lan 2002.
Les boues rsiduaires urbaines - Evolution de la production et avenir des diffrentes filires dvacuation -
Page338
La figure 13-5 donne une reprsentation de ce que pourrait tre l'volution de la
production de boues d'ici 2002.
Deux priodes sont discerner :
de nos jours 1998 : une forte augmentation est prvoir du fait de l'obligation des
stations de plus de 10 000 eq.hab. de se mettre conforme la loi sur l'eau du 3
janvier 1992;
de 1998 2002 : une augmentation moins accentue, due essentiellement des
stations de moindre capacit.
II.5. DESTINATION FINALE DES BOUES
Il est difficile de connatre avec exactitude la destination finale des boues rsiduaires
urbaines. Les valeurs donnes fluctuent en effet de manire importante selon les auteurs, et
l'on ne peut que se baser sur des fourchettes d'valuation (tableau 13-3). L'incinration, la
mise en Centre d'Enfouissement Technique (C.E.T.) et l'utilisation agricole se partagent
l'essentiel de l'vacuation des boues, les autres tant le compostage, la lombriculture, ou
d'autres filires, pas toujours trs bien identifies.
Pays Production (10
3
tPS/an)
Destination finale (%)
(1)* (2) (3) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (3)
Autriche 150 - - 47 - - - 20 - -
Belgique 57 29 33 - 27 100 51 - 22 32
Danemark 156 150 - 32 45 27 45 41 10 -
Finlande 130 - - 41 - 37 - - - -
France 510 - 850 24 27 45 53 31 20 -
R.F.A. 1690 2180 - 32 32 56 59 10 9 -
Grce 3 15 - - 3 10 97 - - -
Irlande 21 24 24 5 29 57 18 - - -
Italie 800 800 - 30 34 50 55 20 11 15
Luxembourg 11 15 - 91 80 10 18 - - -
Pays-Bas 258 202 217 58 64 27 27 1 3 3
Norvge 70 - - 40 - 40 - - - -
Espagne 45 281 213 60 62 20 10 - - -
Sude 250 - 200 60 - 30 - - - -
Suisse 170 - 210 71 - - - 29 - 20
Grande
Bretagne
1210 1018 1020 45 46 15 9 4 3 4
Canada 287 - - 42 - 18 - 40 - -
Japon 1000 - - 10 - 38 - 44 - -
Etats-Unis 7000 - - 42 - 15 - 27 - -
Tableau 13-3 : Production et destinations finales des boues dans certains pays (d'aprs Spinosa et
Lotito).
Page339 - Chapitre 16
III. LES PRINCIPALES VOIES D'EVACUATION
III.1. LA MISE EN DECHARGE
Cette filire d'vacuation concerne actuellement environ 40 % des boues vacues.
Compte tenu d'une volution du contexte lgislatif concernant les centres d'enfouissement
techniques, elle devrait, terme de 10 ans, ne plus concerner que les boues dont les
caractristiques sont rigoureusement incompatibles avec un pandage agricole et dont
l'incinration n'est pas possible.
III.1.1. Aspect lgislatif
La lgislation, en matire de mise en dcharge, est prcise. Selon la circulaire du 11 mars
1987, les boues mises en site d'enfouissement technique doivent rpondre des critres de
qualit bien spcifis (pp. 1830-1831) dont le principal est une siccit minimale de 30 %
(teneur en eau maximale de 70 %). Des remarques font tat des odeurs gnres par les
boues, ainsi que des prcautions prendre du fait de leur nature thixotrope.
III.1.2. Ralisation pratique
La contrainte sur la siccit est forte, car cette valeur de 30 % impose quasiment, avant la
mise en dcharge, une dshydratation par filtre-presse. Les autres techniques actuellement
utilises ne permettent pas d'obtenir, sur des boues urbaines, des siccits si leves.
Un palliatif peut tre trouv. Il consiste ajouter de la chaux des fins de stabilisation
chimique de la boue. Quoiqu'il en soit, le caractre thixotrope des boues constitue toujours
un inconvnient majeur face la mise en dcharge.
La contrainte sur la qualit organique du produit intervient fortement sur la ralisabilit de
la mise en dcharge.
III.1.3. Aspect conomique
Selon leurs caractristiques, les boues seront disposes en site d'enfouissement de
classe I ou de classe II. Les cots peuvent tre estims aux valeurs suivantes selon la
destination :
classe II : 125 250 F par tonne de produit brut;
classe I : 350 500 F par tonne de produit brut.
Il est possible alors de dterminer les cots maximum et minimum pour la mise en
dcharge selon la siccit des boues (tableau 13-4) :
Siccit (%) 20 25 30 35 40
classe I maxi 1250 1000 835 715 625
mini 625 500 420 360 316
classe II maxi 2500 2000 1670 1430 1250
mini 1750 1400 1170 1000 875
Ces prix sont amens augmenter.
Tableau 13-4 : Cot de la mise en dcharge en fonction de la siccit des boues (F/t MS, hors
transport).
Les boues rsiduaires urbaines - Evolution de la production et avenir des diffrentes filires dvacuation -
Page340
III.2. L'UTILISATION AGRICOLE
Actuellement, une proportion de 35 40 % de boues est utilise des fins agricoles. Cette
filire, compte tenu de la restriction de la mise en dcharge, est amene se dvelopper,
sauf volution du contexte lgislatif.
III.2.1. La lgislation
La mise en agriculture des boues rsiduaires urbaines est assujettie la norme NFU 44-
041 du 11 juillet 1985.
Certains contraintes peuvent galement tre apportes par les normes NFU 44-051
(dcembre 1981) et NFU 44-071 (dcembre 1981).
III.2.2. Valeur agronomique des boues
La rpartition du mode de prsentation des boues traites en stations d'puration n'est
pas connue.
III.2.2.1.Concentrations en matires sches
Les concentrations ou siccits des boues sont indiques dans le tableau 13-5 pour chaque
systme de dshydratation actuellement rencontr.
Concentrations des boues recircules 8 g/l (rappel)
Boues fraches paissies : paississement statique 25 - 30 g/l
Boues fraches paissies : paississeur hers 30 - 55 g/l
Boues conditionnes gouttes ou draines 60 - 70 g/l
Boues de lits de schage 30 - 35 %
Boues centrifuges 12 - 25 %
Boues presses par filtres bande 15 - 25 %
Boues de filtres presses 25 - 45 %
Boues de schage thermique > 90 %
Ces valeurs correspondent bien sr aux situations actuellement rencontres.
Tableau 13-5 : Concentrations ou siccits des boues pour chaque systme de dshydratation.
Page341 - Chapitre 16
III.2.2.2. Elments fertilisants
Les valeurs de concentrations retenues partir d'une enqute effectue par le
CEMAGREF en Bretagne pour des stations d'puration biologique intensives arobies sont
reportes dans le tableau 13-6. Il s'agit ici de rappeler simplement quelques valeurs
indicatives couramment rencontres dans la pratique, les incidences du mode de
stabilisation des boues (exemple : transformation de N organique en N ammoniacal par
digestion), du conditionnement des boues, des objectifs de traitement de l'eau pour N et P
ne faisant pas l'objet de cette approche grossire. Par ailleurs, le tableau 13-7 donne une
comparaison entre la valeur fertilisante de boues urbaines et de fumier de ferme.
Paramtres Concentration % de la
matire sche
Observations
Matire organique 50 - 60
Azote total (N) 3 - 5 80 % sous forme organique
dans le cas gnral (hors
stockage anarobie
prolong); valeur la plus faible
pour les boues solides
Phosphore total (P
2
0
5
) 4 -10
Potassium hydrosoluble
(K
2
0)
1
Calcium total (CaO) 3 - 7
Magnsium total (MgO) 1,5 hors boues chaules
C/N 7 -10
pH eau 6 - 7
Tableau 13-6 : Caractristiques agronomiques des boues de stations d'puration (CEMAGREF,
1992).
Boues (/t de MS) Fumier de ferme 25% de
siccit (/t de MS)
Matires organiques 400 600 kg 600 kg
Azote total 40 60 kg 10 30 kg
Acide phosphorique 30 80 kg 3 25 kg
Potasse 5 15 kg 25 35 kg
Chaux 35 55 kg 10 15 kg
Tableau 13-7 : Comparaison entre la valeur fertilisante de boues urbaines et de fumier de ferme.
Les boues rsiduaires urbaines - Evolution de la production et avenir des diffrentes filires dvacuation -
Page342
La composition des boues deaux rsiduaires (N et P) en fait une bonne matire
fertilisante. Toutefois, les concentrations en lments fertilisants majeurs ne sont pas
quilibrs au regard des besoins des cultures. Les proportions d'azote et d'acide
phosphorique des engrais sont trs diffrentes de celles des boues.
Lapport de potasse tant considr comme ngligeable, il est toujours ncessaire
dpendre en complment un engrais minral potassique. Les fumures en N et P
2
O
5
partir
des boues entranent des apports organiques trs faibles.
La fraction d'azote organique des boues disponible pour les plantes est limite 40 % (35
% la premire anne). Elle est dpendante de la minralisation biologique, trs lie aux
conditions climatiques.
Les boues chaules peuvent tre utilises comme amendement calcique, l'apport de
fertilisants devant tre considr comme ngligeable dans ce cas.
III.2.2.3. Valeur humique des boues
L'humus form partir de la matire organique des boues d'origine urbaine reprsente
une fraction de 20 40 % de celle-ci. Ainsi, une tonne de matire sche de boue urbaine
contenant environ 50 % de matire organique produira de 100 200 kg d'humus (coefficient
de transformation de la matire organique de la boue en humus stable = coefficient
isohumique dont la valeur est d'environ 25%).
En pratique et compte tenu des doses de boues couramment apportes, l'intrt des
boues urbaines comme amendement humique est limit. Il est possible de compenser les
pertes annuelles en humus du sol (1 t/ha) avec des apports de boues solides et dans une
moindre mesure avec des boues liquides (1 tonne d'humus contenu dans 8 tonnes de
matire sche est apporte par 266 m
3
/ha de boues liquides fournissant 320 x 0,3 = 96
units de N utilisable ou par 26,6 m
3
/ha de boues dshydrates fournissant 160 x 0,3 = 48
units de N utilisable) si les boues contiennent trs peu de phosphore. Par contre, la
correction du taux d'humus du sol (apports ponctuels de 5 quelques dizaines de tonnes
d'humus par hectare) peut tre partiellement ralise avec des boues dshydrates trs
appauvries en azote. Elle est absolument impraticable avec des boues liquides ayant une
richesse en N excessive. Les 4,5 tonnes d'humus/ha ncessaires pour faire passer le taux
d'humus du sol de 1,5 1,6 % (sol de densit 1,5; labour 0,30 m de profondeur; 10000
m
2
x 0,30 m x 1,5 x 0,001 = 4,5) sont apportes par 36 tonnes de matire sche soit 1200
m
3
/ha de boues liquides fournissant 1440 x 0,3 = 432 units de N assimilable par ha ou par
120 tonnes/ha de boues solides fournissant 720 x 0,3 = 216 units d'N assimilable par ha.
Dans la pratique, la seule vraie possibilit d'utilisation des seules boues dshydrates (30
% de matire sche) en correction de taux d'humus pourrait tre assez vite remise en
cause par les concentrations de mtaux lourds.
III.2.2.4. Valeur d'amendement calcique des boues
Les boues chaules (conditionnement chimique avant dshydratation, traitement dans le
cadre d'une amlioration physique ou de la prparation volontaire d'un amendement
calcique) dont la teneur en CaO est voisine de 20 % de la matire sche peuvent tre
utilises en l'tat comme amendement calcique en respectant les conditions agronomiques.
Page343 - Chapitre 16
III.2.2.5. Mtaux lourds
La prsence de mtaux lourds dans les boues est la contrainte la plus importante pour
l'utilisation agricole. Des concentrations en mtaux lourds dans les boues sont donnes
titre indicatif dans le tableau 13-8.
Les valeurs les plus leves correspondent la moiti des valeurs limites de conformit
issues de la norme AFNOR U 44-041.
Mtal Boues urbaines Sols Vgtaux Valeurs limites norme AFNOR
ppm MS ppm MS
(1)
ppm
MS
ppm MS boues
(ppm
MS)
sols
(ppm
MS)
flux calculs pour
les boues
(kg/ha/an)
cadmium 5 -15 3 - 5 0,5 - 40 2 0,06
chrome 50 - 200 40 - 65 200 0,1 - 100 2000 150 3
cuivre 200 - 1000 300 - 400 20 3 - 40 2000 100 3
mercure 2 -8 2,5 - 3,8 0,03 0,001 - 0,01 20 1 0,03
nickel 25 - 100 30 - 45 40 0,1 - 0,5 400 50 0,6
plomb 100 - 300 50 - 250 10 0,05 - 0,2 1600 100 2,4
slnium - < 10 - - 200 10 0,3
zinc 2000 - 3000 750 - 1400 50 15 - 150 6000 300 9
chrome +
cuivre +
nickel + zinc
2275-4300 1120-1910 - - 8000 - -
Tableau 13-8 : Teneurs des boues, des sols et des vgtaux en mtaux lourds. D'aprs LEGRET
M.1984 sauf
(1)
AGHTM. Valeurs norme AFNOR U 44-041.
Les quantits maximales de mtaux lourds susceptibles d'tre pandues partir des
boues sur la base des recommandations de la norme AFNOR U 44-041 (jusqu' 30 tonnes
de MS/ha sur 10 ans pour des boues dont les concentrations en mtaux lourds sont
infrieures la moiti - valeur de rfrence - des valeurs limites de la norme AFNOR) sont
trs infrieures aux flux limites annuels calcules : (valeurs limites 15 t/ha) / 10.
Au cours des prochaines annes, les concentrations en mtaux lourds dans les boues
doivent voluer diffremment selon la provenance de celles-ci (EAWAG, 1990) :
industrie et artisanat (a);
mnages (b);
ruissellements de surface (c);
(agents de prcipations dans les stations d'puration).
Les boues rsiduaires urbaines - Evolution de la production et avenir des diffrentes filires dvacuation -
Page344
(a) doit baisser en raison de rglementations et de meilleurs contrles. (b) le Zn et le Cu
sont les plus concerns, il n'y a pas de modifications attendre. (c) concernent les Pb via
l'atmosphre, le Zn et le Cu.(b) et (c) augmenteront vraisemblablement en raison de
l'accroissement des surfaces mtalliques.
Les boues d'puration reprsentent un convoyeur de mtaux relativement modeste par
rapport aux dchets divers. Les concentrations de nombreux mtaux sont plus leves dans
les boues d'puration que dans le sol.
Les normes tablies sur la base de valeurs relles actuelles pour les mtaux dans les
boues et les sols montrent une saturation du rservoir sol dans un sicle pour les
superficies qui reoivent rgulirement des boues. Malgr une extension possible
l'ensemble des superficies disponibles (environ 1 % des superficies est actuellement
mobilis), cette pratique de "remplissage" du sol jusqu'aux normes actuelles ne peut tre
durablement retenue.
Des actions des matres d'ouvrage ou de leurs dlgus visant diminuer sensiblement
les rejets de mtaux lourds dans les rseaux se dvelopperont au cours des dix
prochaines annes sur la base des expriences russies de plusieurs collectivits. Les
travaux de recherche en cours devraient permettre de dfinir des valeurs susceptibles d'tre
atteintes en fonction des types d'activits rencontres.
Remarque : l'E.P.A. (Environnemental Protection Agency) a fix une rglementation
particulire pour le cadmium fonde sur la capacit d'change de cations du sol.
III.2.2.6. Polluants organiques
Les connaissances relatives aux lments organiques contenus dans les boues
d'puration sont rudimentaires au regard de celles portant sur les substances nutritives et les
mtaux lourds, probablement en raison de la faiblesse des recherches sur leur volution
dans les sols et de difficults analytiques.
Page345 - Chapitre 16
Les valeurs cites par l'EAWAG pour des boues suisses et allemandes figurent au tableau
13-9, titre indicatif.
Produit Concentration dans la matire sche (ppm)
alkybenzne sulfonate linaire
composs organo-tains
hydrocarbures aromatiques polycycliques
polychlorobiphnyles
hexachlorobenzne
lindane
DDT + DDE
polychlorodibenzodioxines
polychlorodibenzofurances
phthalates
1000 - 10 000
1 - 50
0,1 - 50
0,1 - 10
0,01 - 10
0,01 - 10
0,01 - 0,5
0,01 - 0,4
0,001 - 0,01
0,1 - 1200
Tableau 13-9 : Concentrations en polluants organiques dans des boues d'puration (d'aprs EAWAG,
1989).
A titre indicatif, le seuil fix aux USA est de 10 mg de PCB par kg de matire sche de
boues.
Il est tout fait probable que l'effet de recherche des dix prochaines annes sur les
toxiques organiques prsents dans les boues d'puration ne sera pas suffisant pour garantir
une meilleure valuation des risques dans l'utilisation agricole des boues d'puration.
Les boues rsiduaires urbaines - Evolution de la production et avenir des diffrentes filires dvacuation -
Page346
III.2.2.7. Organismes pathognes
Des teneurs de boues en germes pathognes figurent au tableau 13-10, titre indicatif.
Organismes Nombre par g de matire sche
coliformes
coliformes fcaux
streptocoques fcaux
salmonelles
ascaris
trichuris
entrovirus
10
8
- 10
9
10
6
- 10
9
10
4
- 10
8
0 - 10
7
0 - 10
4
0 - 10
4
0 - 10
4
Tableau 13-10 : Organismes pathognes des boues d'puration (d'aprs Pederson, EPA, 1981).
Les mesures appliques actuellement en France :
pandage de boues interdit sur des terrains affects des cultures marachres ou
qui le seront dans un dlai d'un an,
pandage sur pturages limit aux boues ayant reu un traitement appropri avec
une mise l'herbe possible au plus tt 30 jours aprs l'pandage,
ne sont pas susceptibles d'volution rapide au cours des dix prochaines annes.
III.2.2.8. Impact de la stabilisation et du conditionnement des boues en vue
de leur dshydratation
Le tableau 13-11 rsume les consquences de stabilisations des boues par voies
biologiques, arobie ou anarobie, et par voie chimique par adjonction de chaux vive ou
teinte (TSM, 1988).
Le conditionnement, dont l'objectif est d'obtenir une dshydratation plus pousse des
boues, conduit souvent un abaissement du rapport entre matires fertilisantes et matire
sche.
Page347 - Chapitre 16
Paramtres arobie anarobie chimique (chaux)
matire organique rduction de 0 - 10 % rduction 30 - 50 % pas de perte sur boue
dshydrate ; hydrolyse
de M.O. jusqu' 40 %
sur boue liquide
matire minrale constant dans l'absolu constant dans l'absolu augmentation de 10
50 %
N peu de perte sur MS
mais perte en N de la
phase liquide
transformation de 40 %
du N organique en NH
4
stripping de NH
3
de la
phase liquide et
resolubilisation d'une
partie de N organique
P inchang inchang prcipit
masse de boue rduction 0 7 % rduction 15 30 % augmentation 10 30
%
fermentation
ultrieure
oui aprs 72 heures
d'anoxie sous forme
liquide
perte de 5 15 % des
M.O. entre 1 et 6 mois
30 - 40 % N
organique NH
4
nulle trs faible si pH > 10,5
et milieu non liquide
dsinfection non faible oui si pH 11,5
Tableau 13-11 : Impact de la stabilisation et du conditionnement des boues en vue de leur
dshydratation.
La stabilisation relle semble devenir une ncessit au regard d'une demande forte
d'absence de nuisances olfactives de la part de certaines catgories de populations. Les
procds actuels (sauf digestion anarobie dont le dveloppement parat peu probable
grande chelle malgr son intrt) n'vitent pas la reprise de fermentation. Deux solutions se
profilent :
la stabilisation la chaux dose massive. L'tude scientifique des doses
incorporer, c'est--dire des besoins de chaux pour viter les reprises de fermentation,
est probablement encore raliser. Les conditions techniques du mlange sont aussi
amliorer;
le compostage seul but de stabilisation (sans songer une commercialisation).
Les boues rsiduaires urbaines - Evolution de la production et avenir des diffrentes filires dvacuation -
Page348
III.2.3. Conditions de rutilisation agricole des boues
Mois D J F M A M J J A S O N
Epandage liquide
Tonne lisier camion
lger
suivant tat des sols
avant (mas,
pommes de
terre)
terres occupes
sur chaumes + derrire mas,
betteraves
Enfouissement
liquide
Tonne lisier (sauf
terrains durs,
caillouteux)
suivant tat des sols
avant et sur mas,
pommes de terre
terres
occupes
sur chaumes, etc.
Aspersion
grosses gouttes sauf gel avant et sur mas,
pommes de terre
terres
occupes
sur chaumes, etc.
Epandage solide
Epandeur fumier suivant tat des sols avant labour terres occupes sur chaumes, etc.
Tableau 13-12 : Rutilisation agricole des boues sur des terres arables.
Mois D J F M A M J J A S O N
Epandage liquide
Tonne lisier camion
lger
suivant tat des sols Pour boues non urbaines ou boues urbaines, sous rserve de
prcautions sanitaires
Enfouissement
liquide
Tonne lisier (sauf
terrains durs,
caillouteux)
suivant tat des sols
Pour toutes boues
Aspersion
grosses gouttes Pour toutes boues sous rserve de prcautions sanitaires
Epandage solide
Epandeur fumier Pas de boues solides sur ptures
Tableau 13-13 : Rutilisation agricole des boues sur des prairies.
Page349 - Chapitre 16
III.2.4. Aspect conomique
Les cots donns ci-aprs ont t estims sur les bases suivantes :
une station de 5000 eq.hab. utilise 100 % de sa charge nominale avec pandage
liquide et une station de 20 000 eq.hab. avec pandage de boues pteuses;
filire : depuis la sortie du concentrateur situ sur la station d'puration jusqu'aux
interventions de la mission charge de la valorisation des dchets;
stockage de 6 mois;
boues liquides 30 g MS/l ; boues de filtre bandes 15 % de MS;
besoin de stockage de boues liquides : 400 F/m
3
(amortissement sur 20 ans);
aire de stockage couverte pour les boues pteuses : 20 F/eq.hab.;
Le cot moyen de l'pandage ralis par les agriculteurs (ADEME, Agences de l'Eau,
Ministre de l'Agriculture, 1992) est donc de :
boues liquides : 15 F/m
3
( 30 g/l 500 F/t de MS);
boues pteuses : 20 F/t 15 % de MS (soit 150 F/t de MS);
rayon moyen d'pandage : 4 km.
Ces cots sont comparer ceux proposs dans TSM (1988, Tableau 13-14).
Siccit 2 % 5 % 10 % 20 % 35 %
Epandage seul
(F/TMS)
1000-2000 400-1400 200-700 100-350 60-200
Stockage + reprise +
pandage (F/TMS)
2000-3000 800-2000 400-1000 200-500 100-350
Valeur agronomique
(N-P : 3 4 F/kg)
(F/TMS)
80-160 80-160 80-160 80-160 50-100
Tableau 13-14 : Cot de l'pandage ramen la tonne de MS.
Analyses
Nombre d'analyses par an Station d'puration
5 000 eq.hab. 20 000 eq.hab.
Boues
- lments traces + MS
- lments fertilisants
1
1
1
4
Sol 0,3 0,3
Les prix considrer sont ceux couramment pratiqus par les laboratoires "agricoles".
Tableau 13-15 : Nombre d'analyses retenu dcoulant d'une recommandation du 7 juillet 1986
(Ministre de l'Agriculture, de l'Equipement et de l'Environnement).
Les boues rsiduaires urbaines - Evolution de la production et avenir des diffrentes filires dvacuation -
Page350
Mission de valorisation :
deux agents par dpartement;
ralisation des tudes de primtres d'pandage;
suivi agronomique;
information gnrale des agriculteurs.
Station dpuration
5 000 eq.hab. boues liquides 20 000 eq.hab. boues
pteuses
Stockage (20 ans) station 48 000/(20 37)=650
Filtre bande 400 000/(20 148) + 800 = 935
Equipement dpandage
(matriel + temps pass)
tonne lisier + tracteur
pandeur + tracteur
500* 135
Marquage, enregistrement pour mmoire pour mmoire
Analyses de boues
(prlvements + analyses)
40 20
Analyses de sols
(prlvements + analyses)
6 2
Cot filire proprement dite 1196 1092
Faons culturales pour
lenfouissement
pas de faons culturales spcifiques
Intervention, mission de
valorisation des dchets
160 160
Recherche des superficies
disponibles
pour mmoire pour mmoire
Cot total 1356 1252
Valeur retenue 1400 1300
* cette valeur est porte environ 600 F si le matriel est celui de la station d'puration.
Tableau 13-16 : Cot de l'pandage agricole de boues liquides et de boues pteuses (hors
rmunration du capital) en F 92 HT part de matire sche (CEMAGREF, 1992).
Page351 - Chapitre 16
Les cots simuls pour les pandages de boues liquides et de boues pteuses sont trs
proches et voisins de 1 400 F/t de MS. Le cot de l'opration d'pandage proprement dite
est de 546 F/t de matire sche en boues liquides et de 157 F/t de MS en boues pteuses.
Cette dernire valeur est cohrente avec le cot d'pandage, par une entreprise, d'un
engrais minral, soit 110 F/t pandue (CEMAGREF; 1992).
Les montants pour les ensembles "pandage + analyses + interventions de valorisation
des dchets (MVAD, 706 F et 317 F respectivement pour les boues liquides et pteuses,
sont sensiblement infrieures aux valeurs contractuelles pratiques par les entreprises
spcialises dans ce domaine.
Indices de cot des filires boues.
Les cots relatifs des filires de traitement des boues sur la base de l'indice 100 affect
l'ensemble "dshydratation + stockage + pandage tracteur pandeur + analyse
rglementaire + MVAD" indiqus dans le tableau ci-dessous sont calculs sur la base de
cots d'exploitation (hors rmunration du capital) par unit de matires sches de boues.
Neuf filires ont fait l'objet d'estimations sur la base de valeurs calcules pour des
installations adaptes ou volume de boues traiter.
Filire Indice de cot
d'exploitation
stockage + pandage tracteur et tonne + analyses rglementaires + MVAD 150
dshydratation + stockage + pandage tracteur pandeur + analyses
rglementaires + MVAD
100
stockage + pandage matriels spcifiques + analyses rglementaires +
marquage + tude pralable et suivi primtre pandage + suivi agronomique
( l'entreprise)
- liquide
- solide ou pteux
260
100 - 120
dshydratation + dcharge actuelle classe II 110
dshydratation + granulation + pandage tracteur pandeur + analyses
rglementaires + suivi agronomique
210
stockage + compostage + pandage tracteur pandeur (150)
dshydratation + compost avec ordures mnagres (100)
incinration + dcharge 170
incinration + inertage + dcharge 240
valeur des lments fertilisants d'une boue 10 - 15
Les valeurs les plus imprcises concernent les filires avec compost. La valeur des lments
fertilisant d'une boue est rappele titre indicatif. L'hyginisation, dont le cot estim correspond
environ 35 points d'indice, est ralise de fait pour les cinq filires du bas du tableau 13-16.
Tableau 13-17 : Indices de cot d'exploitation de filires de boues avec l'indice 100 pour la filire
liquide (Lyonnaise des Eaux-Dumez, CEMAGREF, ADEME, Agences de l'eau, 1992).
Les boues rsiduaires urbaines - Evolution de la production et avenir des diffrentes filires dvacuation -
Page352
III.3. L'INCINERATION
Actuellement, de 10 15 % des boues rsiduaires urbaines sont incinres,
conjointement ou non des ordures mnagres. L encore, compte tenu de l'volution du
contexte lgislatif, cette proportion ne peut qu'augmenter dans les annes venir afin
dabsorber une fraction des boues qui ne pourra plus tre mise en dcharge.
III.3.1. Aspect rglementaire
La lgislation, en ce domaine, concerne essentiellement la qualit des fumes mises des
installations d'incinration. Les directives 89/429/CEE du 21 juin 1989 et 89/369 CEE du 8
juin 1989 spcifient les limites de concentrations en diffrents composs dans les fumes.
III.3.2. Aspect technique
Laspect technique sera abord dans le cours se rapportant au traitement et la collecte
des ordures mnagres.
III.3.3. Cot de l'incinration des boues
L'incinration des boues, du fait de son caractre marginal, reste une filire assez
onreuse.
Si l'on dtaille l'ensemble des tapes qui conduiraient l'incinration, il est possible
d'arriver aux prix suivants :
dshydratation : 400 600 F/t de MS,
schage : 800 F/t de MS,
incinration : 500 700 F/t de MS,
inertage des cendres : 800 900 F/t de MS,
soit, un prix se situant dans une fourchette de 2 500 3 000 F/t de MS.
IV. LES PERSPECTIVES - LES EVOLUTIONS
Une analyse objective de la situation indique donc que les flux de boues sont amens
augmenter srieusement dans les annes venir.
Paradoxalement, une incertitude surprenante rgne sur la prennit et le dveloppement
des diffrentes filires existantes. Toutes cependant ne sont pas concernes, et l'on peut
ds lors rsoudre le cas de la mise en dcharge, puisque cette filire sera (lgalement)
dfinitivement ferme en 2 002.
Les interrogations concernent essentiellement la mise en agriculture, dont l'volution
dpend de nombreux paramtres. Lors de l'tude entreprise avec le CEMAGREF (1992),
ces paramtres ont t classs par ordre dcroissant d'importance.
Page353 - Chapitre 16
IV.1. LA REGLEMENTATION.
C'est un facteur d'influence cl du dveloppement de l'pandage agricole. Les paramtres
susceptibles d'volution sont les mtaux lourds, les polluants organiques et les germes
pathognes.
Les mtaux lourds.
Les teneurs admissibles en mtaux lourds dans les boues en vue de leur utilisation
agricole sont amenes voluer. A titre indicatif, les valeurs rglementaires actuellement en
vigueur dans quelques pays d'Europe sont mentionnes dans le tableau XIII. Si l'on
considre que ces pays influencent l'orientation des normes l'chelle europenne, ces
valeurs donnent rflchir. D'aucunes, comme la concentration en cadmium au Danemark
par exemple, sont mme proccupantes. En effet, de tel seuil rendrait toutes les boues
impropres l'utilisation agricole.
Les polluants organiques, les germes pathognes.
L'volution concernant ces deux paramtres est plus floue. Rien de prcis n'a t ralis
jusqu'alors, mais le cas est parfois abord. La seule contrainte qui existe actuellement
concerne la restriction des cultures pouvant recevoir les boues rsiduaires urbaines (NFU
44-041).
IV.2. LES INCITATIONS.
Les incitations des Agences de l'Eau principalement et d'autorits publiques (Conseils
Gnraux, Chambre d'Agriculture) secondairement constitueront un levier d'autant plus
important du dveloppement de l'pandage agricole des boues.
IV.3. LES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT BOUES.
Il conviendra de plus en plus de gnrer un produit stable, concentration assez leve
en matire sche, et dont la teneur en lments indsirables sera infrieure aux normes.
IV.4. LE COUT DE LA FILIERE EPANDAGE AGRICOLE.
Cette filire conserve l'avantage d'tre moins chre que l'incinration. L'imputation
comptable des cots lis l'pandage agricole doit conduire leur prise en charge par la
collectivit.
IV.5. ORGANISATION ET CONTROLE DE L'EPANDAGE
Le principal facteur qui va changer est la ncessit d'une capacit de stockage de six mois
environ sur la station. De plus, des structures spcialises rmunres par les matres
d'ouvrage ou sous leur contrle se dvelopperont. Ces services apports aux matres
d'ouvrage soutiendront "la cause" de l'pandage agricole.
IV.6. L'ACCEPTATION PAR L'AGRICULTURE.
La qualit du service apport conditionnera pour beaucoup la perception de cette activit
pour le monde agricole. Il faudra informer et conseiller, suivre et promouvoir l'pandage
agricole, et surtout, il faudra des conditions financires adaptes.
Les boues rsiduaires urbaines - Evolution de la production et avenir des diffrentes filires dvacuation -
Page354
IV.7. LA FILIERE D'EPURATION.
La fiabilit exige en traitement des eaux, du fait de la nouvelle loi sur l'eau va conduire
produire des boues de qualit plus homogne et en quantit plus importante.
L'option politique est un dernier paramtre qui pourrait conditionner l'utilisation agricole
des boues. Cette filire d'vacuation peut tre prsente comme tant la plus cologique et
la plus "naturelle", gnrant ainsi un cycle sduisant de la matire. Les pays nordiques sont
assez favorables cette orientation. Compte tenu de tous des arguments, deux volutions
possibles peuvent tre prsentes (figure 13-6) :
Dans le premier cas, l'utilisation agricole des boues connat un essort jusqu'en 1998
puis retombe jusqu'en 2002. A cette date, les quantits concernes par la mise en
agriculture et par l'incinration sont quasiment quivalentes.
Dans le deuxime scnario, l'pandage des boues connat une progression
croissante, de mme que l'incinration. En 2002, environ 2/3 des boues sont
vacus en agriculture, pour 33 % environ (soit 365 000 tonnes de MS) qui sont
incinres. Logiquement, ce deuxime scnario serait le plus probable. Cependant,
toute modification du contexte lgislatif actuel pourrait conduire l'autre situation.
Page355 - Chapitre 16
Figure 13-6 : Evolutions possibles pour la destination finale des boues.
V. DES IDEES POUR UN SECTEUR EN PLEINE EVOLUTION
Les proccupations suscites par le traitement des boues sont rcentes. Il est mme
possible de dire que les boues sont encore aujourd'hui, un sujet secondaire par rapport au
traitement des eaux. Mais la situation volue rapidement, tant il apparat vident que la
station de traitement doit tre aborde avec une vision systmique, intgrant le traitement
des eaux et des boues.
Des ides manent cependant, proposant des transformations pour le moins originales
des boues rsiduaires urbaines.
Des mthodes de compostage ou de thermocompostage sont ainsi proposes, permettant
d'obtenir un produit final aux qualits multiples. D'autres proposent des solutions alternatives
d'intgration de la boue dans la confection de matriau de construction. Aprs
dshydratation et traitement appropri, la boue pourrait galement servir comme matriau de
remblais(Los Angeles, 1990, IAWPRC).
Toutes ces ides, et d'autres encore, pourraient susciter un intrt dans les annes
venir.
Les boues rsiduaires urbaines - Evolution de la production et avenir des diffrentes filires dvacuation -
Page356
Rfrences
bibliographiques
FAYOUX Ch. (1994). Valorisation et devenir des boues et des dchets (Document
interne CIRSEE).
HAUBRY A. (1989). Quantits et caractristiques des boues produites dans une station
dpuration urbaine. Confrence aux journes de traitement des boues de
Barcelone.
BESEME J.L., Iwema A. (1990). Les caractristiques des eaux uses franaises.
T.S.M. LEAU, n7-8, 340-344.
LAWLER D.F., Singer P.C. (1984). Return flows from sludge treatment. Journal WPCF ;
Vol. 56 ; n2, 118-126.
Groupe de travail SATESE-CEMAGREF. Production et gestion des boues dans les
stations dpuration. Rapport de synthse, anne 1991.
CORNICE R. Conditionnement et traitement des boues des stations dpuration des
eaux rsiduaires urbaines et des usines de production deau potable. Institut
National Agronomique de Paris, cycle Valorisation agricole des dchets des usines
de traitement des eaux, 13-17 avril 1992.
Chapitre 17
VERS UNE NOUVELLE
GENERATION DE PROCEDES DE
TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES
BOUES RESIDUAIRES URBAINES
P. GRULOIS, A. ATTAL, J. MANEM, C. FAYOUX.
Page358 - Chapitre 17
358
SOMMAIRE
I. INTRODUCTION.....................................................................................................................................359
II. UN CONTEXTE EN PLEINE EVOLUTION........................................................................................359
II.1 DES EXIGENCES TOUJOURS PLUS FORTES.............................................................................................359
II.2 LA PRODUCTION NATIONALE DE BOUES RESIDUAIRES URBAINES.........................................................359
II.3 LE MIRAGE DE L'EAU ...........................................................................................................................361
III. NOUVEAUX PROCEDES DE TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES BOUES .............................362
III.1 LA STABILISATION AEROBIE THERMOPHILE AUTOTHERMIQUE.............................................................362
III.1.1 Principe du procd...................................................................................................................362
III.1.2 Performances et avantages de la stabilisation arobie thermophile autothermique.................363
III.2 LA DIGESTION ANAEROBIE EN DEUX PHASES .......................................................................................364
III.2.1 Principe du procd...................................................................................................................364
III.2.2 La sparation des phases...........................................................................................................366
III.2.3 Performances et avantages de la digestion anarobie en deux phases ....................................366
III.3 DES PROCEDES ADAPTES AUX NOUVELLES EXIGENCES........................................................................367
IV. CONCLUSION.....................................................................................................................................368
V. BIBLIOGRAPHIE....................................................................................................................................369
Vers une nouvelle gnration de procds de traitement biologique des boues rsiduaires - Page
359
359
I. INTRODUCTION
L'assainissement est amen subir, dans les annes venir, des modifications majeures.
Les raisons qui sont l'origine de ces changements sont essentiellement d'ordre lgislatif et
environnemental, ce qui entrane une prise de conscience globale du problme. Ainsi, un
traitement plus pouss et plus fiable de l'eau, une augmentation de la capacit puratoire
auront comme consquence directe un accroissement important de la quantit de boues
rsiduaires urbaines produites.
La premire partie de ce texte consistera raliser, de la manire la plus prcise possible,
une valuation de l'volution des flux de boues dans la dcennie venir. Ces donnes
essentielles permettront de mieux apprcier l'importance et la ncessit d'une
reconsidration de la filire de traitement des boues sur les stations de traitement d'eaux
rsiduaires urbaines.
Des solutions existent dj, qui amorcent le changement. Deux procds de traitement
biologique des boues, la digestion anarobie sparation de phases et la stabilisation
arobie thermophile autothermique seront prsentes, avec les diffrences notoires qu'ils
apportent par rapport aux moyens existants.
II. UN CONTEXTE EN PLEINE EVOLUTION
II.1 DES EXIGENCES TOUJOURS PLUS FORTES
La mise en application de la nouvelle loi sur l'eau du 3 janvier 1992 aura des
consquences srieuses sur l'assainissement. BEBIN et al. (1992) analysent les rsultats
d'une tude sur les performances et la fiabilit des stations d'puration d'eau rsiduaires
urbaines. Les donnes manent de 70 installations sur lesquelles 12 mesures entre/sortie
reprsentatives de 24 heures sur les 12 derniers mois sont disponibles. Les mthodes de
prlvement, de mesure de dbit et de concentration ne sont pas entaches de doute (auto-
contrle valid priodiquement par des organismes indpendants : Agences de l'Eau,
SATESE, ...).
Seulement 31% des stations d'puration tudies sont strictement conformes au niveau
normal de la Directive. Sans tenir compte des MES, la situation est peine meilleure et le
pourcentage passe 37%.
Le taux d'puration national actuel des eaux uses se situerait 43% (Ministre de
l'Environnement, 1993) et l'objectif est d'augmenter de 50% cette quantit d'ici l'an 2 000.
Ainsi, la mise niveau des installations existantes et la mise en oeuvre de nouvelles
stations d'puration conduiront une relle augmentation de la production de boues.
II.2 LA PRODUCTION NATIONALE DE BOUES RESIDUAIRES URBAINES
Les donnes actuellement disponibles sur la production nationale de boues rsiduaires
urbaines sont pour le moins disparates. Selon SPINOSA et LOTITO (1988), cette quantit
est comprise entre 510 000 et 850 000 tonnes de Matires Sches (MS) par an. Selon une
valuation de l'ADEME (WIART,1992), il est possible de retenir une valeur de 600 000
tonnes de MS par an. Une production de 700 000 tonnes de MS semble constituer une
bonne approche.
Page360 - Chapitre 17
360
D'une tude ralise conjointement par le CIRSEE et le CEMAGREF (1992), il ressort que
la saturation des installations existantes amnerait une quantit d'environ 890 000 tonnes
de MS par an. Cette production devrait tre augmente d'environ 20% d'ici l'an 2000 si l'on
tient compte d'une augmentation de la population, d'une introduction trs large de
l'limination du phosphore et d'une augmentation de la production de boues due au strict
respect de la lgislation en vigueur.
Un groupe de travail SATESE-CEMAGREF a ralis en 1991 un bilan sur les production
de boue sur les stations d'puration. Cette tude est intressante plus d'un titre :
il ressort que la production de boue dclare, sur 1120 stations dont la capacit varie
entre 0 et plus de 50 000 q.hab est en moyenne de 0,44 kg de MS/kg de DBO
5
limine. Les valeurs dclares varient entre 0,1 et 1,5 kg MS/kg DBO
5
limine.
Seules 30 stations, soit 2,7 % des effectifs, dclarent une production suprieure
0,9 kg MS /kg DBO
5
limine;
en se rfrant aux productions mesures, les rsultats varient de 0,1 1,3 kg MS/kg
DBO
5
limine (132 stations boues actives en aration prolonge, 20
dpartements). Sur les rsultats bruts, les valeurs sont assez comparables aux
productions dclares. En revanche, les donnes les plus fiables, correspondant
des rponses compltes au questionnaire pos, sont proches en moyenne des
valeurs thoriques les plus couramment cites [0,8 kg MS/kg DBO
5
limine (effluent
domestique). Les variations autour de ces moyennes restent toutefois de trs forte
amplitude.
Les productions de boues sur les stations sont donc amenes augmenter
considrablement si la gestion en devient plus rigoureuse. Ainsi, il est probable que le flux de
boue rsiduaire urbaine produit vers 2002 se situerait aux environs de 1 300 000 tonnes de
MS/an.
Vers une nouvelle gnration de procds de traitement biologique des boues rsiduaires - Page
361
361
Cette augmentation pourrait se dcomposer en deux phases (figure 14-1).
Anne.
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
d
e
b
o
u
e
(
t
o
n
n
e
M
S
/
a
n
)
.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1re phase 2nde phase
Figure 14-1 : Evolution possible de la production de boue d'ici 2002.
La premire, jusqu'en 1998, verrait une augmentation importante de la quantit de boue
traiter du fait de l'application de la nouvelle lgislation obligeant les communes de plus de
2 500 habitants disposer d'une station d'puration. La seconde, plus rgulire, serait
imputable l'installation d'une station sur les communes de plus petite taille.
II.3 LE MIRAGE DE L'EAU
Une approche holistique permet de mesurer l'importance des diffrentes tapes qui
composent l'assainissement, de la collecte l'vacuation des boues en passant par la
station d'puration. Ne limiter les objectifs de traitement qu' l'eau conduit aborder le
problme de faon trs partielle. Le suivi de la qualit des rejets dans le rseau de collecte,
le bon fonctionnement de la filire de traitement des boues et une gestion rigoureuse du
traitement des eaux pourront seuls permettre de considrer rellement les performances
d'un systme puratoire.
Il apparat vident aujourd'hui qu'une amlioration de la qualit du traitement des eaux
passera par une optimisation du traitement des boues produites sur la station, les
interactions entre les deux filires tant nombreuses (GRULOIS et al., 1993). Le traitement
des boues est de ce fait en pleine mutation : une meilleure connaissance de la matire
traiter, une comprhension approfondie des ractions mises en oeuvre et une optimisation
des techniques de traitements seront indispensables pour atteindre les objectifs fixs.
Deux problmatiques majeures peuvent de ce fait tre distingues au niveau de la filire
de traitement des boues : l'une concerne l'tape de traitement biologique, qui fera l'objet de
ce texte, et l'autre la phase de dshydratation.
Page362 - Chapitre 17
362
Le traitement biologique des boues vise rduire la quantit de produit vacuer de la
station par une transformation de la matire organique. Il s'agit galement d'obtenir une boue
stabilise et correctement dshydratable, qui puisse tre stocke sans risque de
fermentation ultrieure. Deux procds novateurs de traitements biologique des boues vont
tre prsents, qui marquent le dbut d'une nouvelle approche.
III. NOUVEAUX PROCEDES DE TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES BOUES
III.1 LA STABILISATION AEROBIE THERMOPHILE AUTOTHERMIQUE
III.1.1 Principe du procd
C'est une transformation de la matire organique par oxydation en milieu arobie avec
dgagement de chaleur et production de CO
2
. Les ractions intervenant dans ce type de
procd sont encore assez mal connues, mais il est possible de donner une reprsentation
des diffrentes phases de la dgradation de la matire organique complexe (figure 14-2).
Pour tre optimale, la raction doit se drouler une temprature comprise entre 50 et 55C.
Toute lvation incontrole de la temprature peut entraner des phnomnes d'inhibition
des ractions biologiques.
Les racteurs conus pour la mise en oeuvre de ce type de procd doivent tre clos et
disposer d'une bonne isolation thermique. Il est facile, compte tenu de cette configuration, de
prvoir un traitement des gaz issus du racteur.
Les applications actuelles de ce procd visent deux objectifs diffrents :
raliser un prtraitement (pasteurisation et chauffage) avant une digestion anarobie
(temps de sjour de 18 36 heures). Ceci se rencontre essentiellement en Suisse et
en Allemagne ;
oprer en 6 10 jours un traitement de stabilisation des boues avant leur vacuation.
Cette application n'est pour l'heure que peu rpandue.
La matire organique de haut poids molculaire ne pouvant traverser la membrane
cellulaire, elle doit tre fractionne en monomres avant mtabolisation par des enzymes
extracelluaires libres par les microorganismes. La matire organique ainsi dissoute est
transporte dans les cellules o se droule le mtabolisme. La dgradation de la matire
organique libre de l'nergie (catabolisme) et permet la synthse de la biomasse
(anabolisme).
Vers une nouvelle gnration de procds de traitement biologique des boues rsiduaires - Page
363
363
Matire organique complexe
(biopolymres : cellulose, lignine, lipides, dbris vgtaux, ...)
Lyse cellulaire Exoenzymes bactriennes
Matires organiques simples
(monomres : glucose, acides amins, ...)
O2 O2
Chaleur CO2
Acides gras volatils
(acides actique, propionique, butirique, ...)
Biomasse thermophile
Respiration ADP Synthse
transfert d'nergie
O2
ATP
chaleur
Respiration endogne
Rsidus solubles Biomasse
chaleur O2
Figure 14-2 : Schma de principe de la stabilisation arobie des boues.
III.1.2 Performances et avantages de la stabilisation arobie
thermophile autothermique
La stabilisation arobie thermophile autothermique prsente de nombreux avantages par
rapport au procd conventionnel de stabilisation arobie, qui peuvent se rsumer ainsi :
Paramtre Stab. Aro. Thermo. Procd conventionnel
Elimination matire organique (%) 50 < 15
Temps de sjour (j) 10 > 20
Degr de stabilisation ++ --
Dshydratabilit des boues ++ --
Tableau 14-1 : Performances compares de la stabilisation arobie thermophile et de la stabilisation
arobie conventionnelle.
Il est fort probable que l'limination d'une fraction de la matire organique par le procd
conventionnel soit imputable des dficits en oxygne qui gnrent dans le bassin des
processus de dgradation anarobie. Ces carences sont dues soit une sous-estimation du
dispositif d'aration, soit un syncopage de cette aration, soit, dans la majorit des cas,
une combinaison des deux phnomnes. Cette anomalie explique en partie l'manation
d'odeurs nausabondes qui caractrise gnralement la mise en oeuvre de ce procd sur
les stations de traitement d'eaux rsiduaires urbaines.
Page364 - Chapitre 17
364
La stabilisation arobie thermophile autothermique des boues est ralise dans un
racteur clos. Le temps de raction est divis par deux, et, compte tenu de l'optimisation des
ractions biologiques, il est possible d'obtenir un rendement de dgradation suprieur 50%
en 10 jours de temps de sjour. Des analyses dtailles indiquent que les diffrentes
fractions qui composent la boue sont largement touches par le processus de dgradation
mis en oeuvre. Ont ainsi pu tre mesurs des rendements de dgradation de (AMAR et al.
(1990); GRULOIS et al.(1991)) :
80% sur les lipides;
75% sur les protines;
55% sur la cellulose.
Avec une diminution d'environ 40% des matires sches (MS), ce procd conduit une
diminution non ngligeable de la quantit de boue vacuer de la station d'puration. La
qualit de ces boues est intressante deux points de vue :
la temprature laquelle s'effectue la raction (> 50C) entrane une pasteurisation
du produit trait;
l'limination d'une proportion importante de la matire organique conduit une boue
caractre de stabilit correct. Ceci signifie que les reprises de fermentation sur ce
produit sont limites mais restent suprieures celles d'une boue traite en digestion
anarobie.
Ces rsultats ont pu tre valids l'chelle industrielle du fait de la rhabilitation en
stabilisation arobie thermophile d'une stabilisation arobie conventionnelle sur le site de
Chantilly (60) (GRULOIS et al., 1992).
La stabilisation arobie thermophile est un procd qui prsente des perspectives
d'application relles sur les stations de petite et moyenne taille (< 40 000 q.hab.). La facilit
de maintenance du procd, la taille restreinte du racteur mettre en oeuvre et ses
performances font de la stabilisation arobie thermophile une technique dvelopper.
III.2 LA DIGESTION ANAEROBIE EN DEUX PHASES
III.2.1 Principe du procd
La digestion anarobie est un procd biologique qui permet de tranformer les substances
de la boue en dioxyde de carbone et en mthane. Le processus se droule l'abri de l'air
dans un racteur clos, de faon pouvoir maintenir des conditions d'anarobiose et de
rcuprer le gaz produit .
La digestion anarobie est une succession de ractions biochimiques assures par
diverses populations bactriennes ayant des taux de croissance et des exigences de milieu
de dveloppement diffrentes (figure 14-3). Les tapes qui la composent peuvent tre
regroupes en deux phases distinctes qui sont l'hydrolyse-acidognse et l'actognse-
mthanisation.
Vers une nouvelle gnration de procds de traitement biologique des boues rsiduaires - Page
365
365
Matires organiques complexes
(sucres, protines, lipides, ...)
HYDROLYSE Bact. hydrolytiques
Matires organiques simples
(osides, pectides, acides amins, ...)
ACIDOGENESE Bactries acidognes
Acides Gras Volatils (AGV)
(actate, propionate, butirate, ...)
ACETOGENESE Bact. actognes
Acide actique CO2 + H2
CH3COOH
METHANOGENESE
Bact. actoclastes Bact. hydrognophiles
CH4 + CO2
Figure 14-3 : Schma de principe de la digestion anarobie.
L'hydrolyse-acidognse
Les macromolcules organiques complexes (polysaccharides, protines, lipides, ...) ne
peuvent diffuser travers la membrane cellulaire. Les bactries hydrolytiques secrtent des
enzymes (cellulase, protases, lipases, ...) destines dpolymriser les grosses molcules
(HENZE et al., 1983).
Les bactries hydrolytiques ont un taux de croissance lev, de l'ordre de quelques
heures. Les produits simples rsultant de l'action des exo-enzymes (sucres simples, acides
amins, acides gras) pntrent l'intrieur des cellules bactriennes o ils sont mtaboliss
grce aux enzymes intracellulaires des bactries acidognes. Les bactries acidognes ont
t dnombres par TOERIEN et al. (1967) et seraient, dans les boues msophiles, au
nombres de 10
8
10
9
/g de boue. Leur temps de gnration est infrieur 24 heures.
La plupart des bactries hydrolytiques et acidognes sont anarobies strictes ou
microarophiles (KOTZE et al., 1968). Leur pH prfrentiel de croissance se situe ente 5,7 et
6 37C, et elle peuvent se dvelopper entre 30 et 55C (GOSH et al., 1975).
Page366 - Chapitre 17
366
Actognse-mthanisation
Les produits de la phase prcdente sont transforms par les bactries actognes en
actate, dioxyde de carbone et hydrogne. Ces bactries sont inhibes par de fortes
concentrations en hydrogne gazeux (de l'ordre de 10
-4
atm) ce qui implique la prsence de
bactries hydrognophiles pour leur dveloppement (CONRAD et al., 1985). Les bactries
actognes sont galement sensibles aux fortes concentrations en acide actique : 80
m.moles/l (KASPAR et al., 1978). L'actate produit par les bactries actognes est ensuite
transform par les bactries actoclastes en mthane et dioxyde de carbone.
Les bactries mthanognes ont des temps de doublement longs, qui peuvent aller de 2-3
jours plus de 10 jours (SAHM, 1984). Ce sont des archbactries strictement anarobies
ncessitant un potentiel d'oxydo-rduction d'environ -330 mV/H
2
et un pH compris entre 6 et
8 pour leur croissance (HENZE, 1983). Leur optimum de temprature se situe entre 30 et
38C pour la zone msophile, et entre 49 et 57C pour la zone thermophile (MAC CARTY,
1964).
III.2.2 La sparation des phases
La sparation des phases permet ainsi chaque groupe bactrien de se dvelopper de
faon optimale. La sparation des deux tapes permet de lever l'inhibition des bactries
mthanignes par les acides gras volatils et l'hydrogne rapidement produit au cours de la
premire phase. Il est ainsi possible d'augmenter l'efficacit et la stabilit du procd
(COHEN et al., 1982).
Il semble cependant que sur un substrat complexe comme les boues, l'tape limitante
n'est pas la mthanisation mais la dgradation des macromolcules organiques (DE BAERE
et al., 1984).
En raison des taux de croissance diffrents des populations bactriennes acidognes et
mthanignes, la slection des deux types de biomasse est ralise sur le temps de sjour
hydraulique (POHLAND et al., 1971). Chacune des populations bactriennes doit en effet se
trouver en phase exponentielle de croissance afin d'augmenter les rendements globaux de la
phase concerne.
III.2.3 Performances et avantages de la digestion anarobie en deux
phases
L'tape d'hydroyse de la digestion anarobie en deux phases se droule une
temprature de 50C avec un temps de sjour de l'ordre de 2 jours. Ces conditions ont t
dfinies comme tant optimales pour mettre en oeuvre la premire tape du procd
(PEROT, 1989). La phase de mthanisation est ralise en conditions msophiles 37C,
en 10 jours de temps de sjour.
Vers une nouvelle gnration de procds de traitement biologique des boues rsiduaires - Page
367
367
La comparaison de la digestion anarobie en deux phases avec la digestion anarobie
conventionnelle amne plusieurs constatations :
Paramtre Digestion anarobie en deux
phases
Digestion anarobie
conventionnelle
Elimination matire organique(%) 45 50 45 50
Temps de sjour (j) 12 (2 + 10) 20
Charge volumique (kg MV.m
-3
.j
-1
) > 2,5 1,5 1,8
Stabilit du procd ++ -
Tableau 14-2 : Comparaison des performances de la digestion anarobie en deux phases et de la
digestion anarobie conventionnelle.
Les tudes menes l'chelle pilote ont permis d'apprcier la remarquable stabilit du
procd. Contrairement la digestion anarobie conventionnelle dont le bon fonctionnement
repose sur une stricte rgularit dans la charge d'alimentation, le systme en deux phases
supporte, sans rpercussion notoire sur l'efficacit de la dgradation de la matire
organique, des -coups de charges ponctuels non ngligeables (jusqu' 50%). La phase
d'hydrolyse joue dans ce cas un rle dterminant en faisant office de racteur tampon dont
l'quilibre biologique est moins sensible que la flore mthanigne du second racteur.
La rduction du temps de sjour et la stabilit de la digestion anarobie en deux phases
devrait permettre une extention du traitement des boues par voie anarobie. Ce procd
pourrait ainsi prendre le relais de la stabilisation arobie thermophile autothermique en
offrant des perspectives d'application pour les stations importantes.
III.3 DES PROCEDES ADAPTES AUX NOUVELLES EXIGENCES
Ces deux procds apportent, l'heure o les exigences concernant le produit "boue"
deviennent de plus en plus contraignantes, des lments de rponses parfaitement adapts
en :
ralisant une dgradation pousse de la matire organique, donc en diminuant
d'autant le volume de boues vacuer de l'installation ;
permettant d'obtenir un produit stabilis dont les caractristiques sanitaires, du fait de
la temprature de raction, constituent un avantage certain ;
mettant en oeuvre des installations compactes qui rendront possible l'extension de la
stabilisation des boues sur de plus nombreuses stations.
Ces procds "hautes performances" exigent un suivi et une maintenance rigoureuse.
Ces lments sont les plus srs garants d'une meilleure fiabilit.
Page368 - Chapitre 17
368
IV. CONCLUSION
L'entre en vigueur de la nouvelle loi sur l'eau est en train de modifier considrablement le
paysage de l'assainissement. La construction de nouvelles installations et la mise niveau
des stations existantes vont avoir comme consquences directes une meilleure qualit de
l'eau traite et, de ce fait, une production accrue de boues rsiduaires urbaines. Les
techniques de traitement des boues voluent et doivent elles aussi rpondre de nouvelles
exigences. La stabilisation arobie thermophile autothermique et la digestion anarobie en
deux phases sont deux procds qui apportent des rponses adaptes ce nouveau
contexte.
La stabilisation arobie thermophile, pour les petites et moyennes stations, consiste en
une oxydation pousse de la matire organique en prsence d'oxygne. Une lvation
naturelle de la temprature vers 50-55C dans un racteur adapt conduit un limination
de 50% de la biomasse en 10 jours de temps de sjour.
La digestion anarobie en deux phases, mieux adapte pour les stations de plus de 50
000 eq.hab. consiste en une limination de la matire organique en CO
2
et CH
4
. Le
rendement d'limination de la matire organique est de 50% en 12 jours de temps de sjour.
La premire phase d'hydrolyse est ralise une temprature d'environ 50C ; la seconde
tape se droule en condition msophile (37C).
Ces deux procds conduisent une rduction importante du volume de boues vacuer
de la station, boues dont les critres de qualit organiques et sanitaires sont autant
d'avantages en vue de leur retour au milieu naturel.
Vers une nouvelle gnration de procds de traitement biologique des boues rsiduaires - Page
369
369
V. BIBLIOGRAPHIE
AMAR D., B. SELMI, A. ATTAL and J. MANEM (1990). "The thermophilic aerobic digestion for the
rehabilitation of conventionnal aerobic sludge stabilization".
BEBIN J., D. BALLAY and A. LESOUEF (1992). "Reflexions sur les performances et la fiabilit des
stations d'puration des eaux rsiduaires urbaines". Techniques, Sciences et Mthodes, n 7-8, pp
345-351.
COHEN A., A.M. BREURE , J.G. VAN ANDEL and A. VAN DEURSEN (1982). "Influence of phase
separation on the anaerobic digestion of glucose. II. Stability and kinetic responses to shock
loadings". Water Research, n 16, pp. 449-455.
CONRAD R., T.J. PHELPS, R.J. ZOETEMEYER and A.M. BREURE (1984). "Gas metabolism
evidence in support of the juxtaposition of hydrogen-producing and methanogenic bacteria in sewage
sludge and lake sediments". Applied Environmental Microbiology, n 38, pp. 758-760.
DE BAERE L. and A. ROZZI (1984). "Solubilization of particulate organic matter as the rate-limiting
step in anaerobic digestion loading". Tribune du CEBEDEAU, 484, 37, pp. 75-81.
Ministre de l'Environnement (1993). "Etat de l'Environnement". Edition 1991-1992, 308 p.
WIART J. (1992 ). "Situation franaise sur les diffrentes voies d'limination des boues urbaines et
industrielles". ADEME, 25 p.
Groupe de travail C.I.R.S.E.E.-CEMAGREF (1992). "Elments de reflexion sur l'utilisation des
boues d'puration l'horizon 2000". Document Interne C.I.R.S.E.E., 80 p, 1992.
Groupe de travail SATESE-CEMAGREF (1991). "Production et gestion des boues dans les stations
d'puration". 31 p, 1991.
GRULOIS P., J. AGUILLON, J.M. AUDIC, C. FAYOUX (1991). "La stabilisation arobie thermophile
autothermique des boues". Symposium de l'A.Q.T.E. 1991, Montral, Qubec, 12-14 novembre 1991.
GRULOIS P., A. BOUSSEAU, E. BLIN, C. FAYOUX (1992). "L'impact des retours en tte du
traitement des boues sur le fonctionnement de la station d'puration". L'Eau, l'Industrie, les
Nuisances, n 160, pp. 53-56.
GRULOIS P., B. SELMI, D. AMAR, C. FAYOUX et Y. LESTY (1992). "La digestion arobie
thermophile autothermique des boues. Exemple de la station de Chantilly". Techniques, Sciences et
Mthodes, n5, pp. 261-266.
GOSH S., J.R. CONRAD and D.L. KLASS (1975). "Anaerobic acidogenesis of wastewater sludge".
J.W.P.C.F., 47, 1, pp. 30-45.
HENZE M. and P. HARREMOES (1983). "Anaerobic treatment of wastewater in fixed film reactors ;
a literature review". Water Science and Technology, n 15, pp. 1-101.
KASPAR H.F. and K. WUHRMANN (1978). "Product inhibition in sludge digestion". Microbial
Ecology, n 4, pp. 241-248.
KOTZE J.P., P.G. THIEL, D.F. TOERIEN, W.H.J. HATTINGH and M.L. SIEBERT (1968). "A
biological and chemical study of several anaerobic digestors". Water Research, n2, pp. 195-213.
MAC CARTY P.L. (1964)."Anaerobic waste of acetic, propionic, and butyric acids". Water
Research, vol.20, n3, pp. 385-394.
Page370 - Chapitre 17
370
PEROT C. (1989). "Optimisation de la digestion anarobie en deux tapes des boues de stations
d'puration : tude de l'tape d'hydrolyse de la matire organique". Thse de Docteur-Ingnieur,
Universit de Clermond Ferrand II.
POHLAND F.G. and S. GHOSH (1971). "Developpements in anaerobic stabilisation of organic
wastes, the two-phase concept". Environmental Letter, vol.1, n4, pp 255-266.
SAHM H. (1984). "Anaerobic wastewater treatment". Adv. in Biochem. Engng. Biotechnol., n29,
pp. 83-115.
SPINOSA L., V. LOTITO (1988). "Technical requirements and possibilities of incineration".
Conference "Sewage Sludge Treatment and Use", Amsterdam, 19-23 septembre 1988, pp. 223-235.
TOERIEN D.F., M.L. SIEBERT and W.H.J. HATTINGH (1967). "The bacterial nature of the acid
foarming phase of anaerobic digestion". Water Research, n 4, pp. 129-148.
Chapitre 18
CONTROLE CENTRALISE ET
AUTOMATISME
J.M. AUDIC
Contrle centralis et automatisme - Page 372
SOMMAIRE
I. LES OBJECTIFS ET LEUR APPROCHE ............................................................................................373
II. COMPOSITION DU SYSTEME.............................................................................................................376
II.1. LES CAPTEURS.....................................................................................................................................376
II.1.1. Les mesures de niveaux..................................................................................................................378
II.1.2. Les mesures de dbits en rseau ....................................................................................................378
II.1.3. Les mesures d'oxydo-rduction......................................................................................................378
II.1.4. Les mesures de turbidit.................................................................................................................379
II.1.5. Les capteurs et analyseurs spcifiques...........................................................................................379
II.1.6. Les mesures de pluies.....................................................................................................................380
II.2. LES ORGANES DE COMMANDE - LES ACTIONNEURS..............................................................................381
II.3. LES AUTOMATISMES ET LES ACQUISITIONS DE DONNEES .....................................................................382
II.4. LES TRANSMISSIONS............................................................................................................................384
II.4.1. Les supports de transmission .........................................................................................................384
II.4.2. Les matriels de transmission ........................................................................................................384
II.5. CONCENTRATEUR DE DONNEES ...........................................................................................................385
II.6. LES POSTES CENTRAUX........................................................................................................................385
III. EXEMPLES DE CONTROLES CENTRALISES ET D'AUTOMATISMES ................................386
III.1. L'AIDE A LA GESTION DES BASSINS D'ETALEMENT................................................................................386
III.1.1. Les modles d'aide la dcision................................................................................................386
III.1.2. L'exemple de la gestion des bassins d'talement .......................................................................387
III.2. L'AIDE A LA GESTION DES BASSINS D'AERATION ..................................................................................389
III.2.1. Les capteurs et la validit des informations ..............................................................................390
III.2.2. Rgulation par valeur de consigne ............................................................................................390
III.2.3. Rgulation par valeurs seuils ....................................................................................................390
III.2.4. Rgulation par volution de la valeur .......................................................................................391
IV. L'EXPLOITATION DES CONTROLES CENTRALISES..............................................................391
IV.1. DE LA MAINTENANCE CURATIVE A LA MAINTENANCE PREVENTIVE.....................................................391
IV.2. EVOLUTION ET FORMATION DU PERSONNEL ........................................................................................392
IV.3. L'EFFORT DE STANDARDISATION DES EQUIPEMENTS............................................................................393
V. L'APPROCHE TECHNICO-ECONOMIQUE......................................................................................393
V.1. LES COUTS D'INVESTISSEMENTS ..........................................................................................................393
V.2. L'APPROCHE TECHNICO-ECONOMIQUE.................................................................................................394
Page 373 - Chapitre 18
I. LES OBJECTIFS ET LEUR APPROCHE
L'exploitant d'un systme d'assainissement se trouve confront au problme de la gestion
d'un ensemble d'installations trs diverses et souvent trs disperses gographiquement.
De faon permettre la cohrence entre le fonctionnement de ces diffrentes installations
pour assurer la fiabilit, la fois dans la matrise hydraulique et dans l'optimisation des
traitements de dpollution, il est indispensable de mettre en place un systme de gestion
centralis. En gnral, l'objectif de gestion optimale vis par un tel contrle centralis va
impliquer les tapes suivantes :
une reconnaissance de l'tat de fonctionnement des diffrents organes du systme
d'assainissement;
l'acquisition de donnes concernant le fluide transporter et traiter;
la prise en compte d'une mmoire d'vnements passs;
l'utilisation de donnes extrieures et de modles permettant de prvoir ou d'anticiper
les actions mettre en oeuvre;
la dtermination des actions appliquer;
le contrle et le suivi des consquences de ces actions;
le bouclage vers la premire tape.
On distinguera deux types de gestion trs diffrents :
La gestion des priodes o les phnomnes alatoires sont limits dans le temps
et dans l'amplitude. Dans ce cas, la gestion ne fait appel qu' des routines de calcul ou
des modules de cohrences simples et peut tre assure par des automates dcentraliss,
le poste central n'assurant qu'un rle de supervision. Cela suppose que l'automate dispose
des informations (donnes capteurs directement connectes) et des actionneurs
ncessaires.
La gestion correspondant aux pisodes exceptionnels (orages, dysfonctionnements
majeurs, arrive de toxiques, etc.) qui est peu importante en dure mais qui demande des
prises de dcision rapides faisant intervenir une multiplicit de paramtres.
Dans ces cas, les automates dlocaliss doivent tre shunts, soit directement par
dtection d'une incohrence dans les donnes captes ou le dpassement de seuils soit par
l'intermdiaire du contrle centralis. Ce point est particulirement important, car, par
dfinition, l'automate dcentralis n'a ni les informations d'ensemble ni les capacits
d'interprtation et de prvision lui permettant de rpondre en toute scurit. Son action, a
priori positive, pourrait l'oppos conduire une situation globale plus catastrophique.
C'est donc uniquement le contrle centralis qui va prendre l'ensemble des dcisions
d'actions en utilisant tous les outils possibles disponibles (banques de donnes, modles
dterministes, stochastiques, systmes experts, ...) pour valuer les consquences de ses
actions court, moyen et long terme.
Suivant l'importance de la dcision et la complexit du problme, le systme peut alors
demander la validation par l'exploitant de la stratgie choisie ou mme passer compltement
la main en rduisant son rle la centralisation des informations.
Contrle centralis et automatisme - Page 374
Cette "gestion de crise", o il faut ragir en fonction de paramtres alatoires, rapidement
variables, consquences complexes et ayant tous une interaction les uns sur les autres,
est une spcificit des systmes d'assainissement.
En outre, le cas particulier de l'assainissement va entraner certaines exigences au
niveau du choix de la structure et des matriels de l'automatisation. Ces exigences
peuvent tre dcrites travers plusieurs points principaux et quatre contraintes :
La premire contrainte est lie au nombre limit de capteurs fiables, peu onreux
et qui ne ncessitent qu'une maintenance raisonnable. Cette limitation est la
consquence d'abord de l'environnement de la mesure (humidit, vibrations) et de la
localisation dlicate des ouvrages qui ncessite une grande robustesse et une protection
des matriels utiliss. Cependant, le vritable problme rside d'une part dans le caractre
alatoire des vnements saisir (prcision des capteurs, temps de saisie, transmission et
traitement de l'information, ...) et d'autre part dans la complexit des paramtres mesurer
(paramtres globaux, interfrences, ...). Ce dernier point est particulirement net lorsque l'on
essaie de collecter des informations sur la qualit de l'eau transporte et sur le degr
d'puration (ce sont les grandeurs classiques de DBO
5
, DCO, NTK, Pt, ...). Cela va impliquer
d'une part de multiplier le nombre des informations simples acqurir, et d'autre part
d'utiliser des corrlations ou des tests de cohrence pour approcher, travers ces donnes
indirectes, la valeur d'un paramtre dcrivant l'tat du systme que ce soit dans le rseau,
aux diffrents stades de traitement ou avant son rejet au milieu naturel.
Cela implique une deuxime contrainte qui est l'existence de nombreux moyens
sophistiqus d'exploitation et de gestion des donnes : stockage, archivage, tri des
donnes, exploitation manuelle ou ncessit d'outils informatiques d'aide la dcision. Ces
derniers outils ont fait l'objet de nombreux dveloppements permettant travers un rseau
de causalits entre les vnements de prdire ou d'anticiper les consquences de telle ou
telle action. Ils sont disponibles sous forme de modles dterministes ou stochastiques,
lorsque des lois possibles mettre en quation relient les vnements entre eux, ou de
systmes experts lorsque des relations complexes sont mises en vidence sans formulation
mathmatique approprie. C'est la mise au point de ces outils qui constitue souvent la
vritable rvolution permettant la mise en place d'une gestion automatise des systmes
d'assainissement rpondant rellement aux besoins de l'exploitant dont les matres mots
sont fiabilit et qualit.
La spcificit suivante correspond la structuration mme de l'automatisme. La
gestion automatise d'un systme aussi complexe et aussi dispers qu'est un ensemble
d'assainissement oblige mettre en place une architecture particulire qui respecte les
rgles de scurit et de modularit. Cela peut tre rsolu par l'adoption d'un systme
hirarchis laissant une autonomie "contrle" des automates dcentraliss. Les
fonctions simples sont assures en local par un automate, celui-ci puise ses informations
dans les donnes de ses capteurs associs ou dans une banque de donnes
prenregistre. La remonte des informations des diffrents automates locaux est assure
via la tltransmission vers une structure centralise bnficiant d'une intelligence
(ensemble des donnes collectes, base de modles, information directe de l'exploitant) et
d'une capacit d'analyse trs suprieures. Ce poste central est alors mme de prendre des
dcisions complexes ncessitant un grand nombre d'informations. Lui-mme peut tre un
sous-ensemble d'une structure plus vaste incluant plusieurs systmes d'assainissement
avec des rseaux complexes dbouchant dans plusieurs stations d'puration.
Page 375 - Chapitre 18
Cette structuration permet d'assurer une scurit lors de pannes ou de dysfonctionnements
d'un automate local par le fait que les autres automates ne sont pas affects et que la
dtection de l'anomalie se fait par le systme centralis. Par ailleurs, le travail en couches
successives limite l'intervention des systmes centraux des tches exceptionnelles
demandant un longue analyse (ex : systme expert de dysfonctionnement GEANT), tandis
que les automates dlocaliss assurent en continu la gestion de leur poste (ex : gestion des
phases d'aration OGAR).
La dernire contrainte est lie aux moyens de mise en oeuvre de la dcision
d'action qu'elle soit prise par l'automate dlocalis ou par le systme central. Ces
moyens sont dcrits comme les actionneurs. Ces actionneurs restent en nombre trs
limits sur un systme d'assainissement, ils se rduisent essentiellement aux quipements
lectromcaniques (pompes, turbines, siphons, ...). La mise en oeuvre de ces actions
rpondra deux types de dcisions associs deux types d'valuation des rsultats. Le
premier type d'action est directement li l'actionneur lui-mme, ainsi la dtection d'un
surdbit se traduit par une action qui est la modification d'ouverture d'une vanne et le rsultat
est valu directement par une nouvelle mesure de dbit. Par contre, en aucun cas ils ne
permettront par exemple de modifier directement la qualit de l'eau transporte, ils agiront
plutt de faon indirecte. Ceci oblige alors pour juger de l'efficacit d'une action attendre
les consquences de ractions intermdiaires.
Pour illustrer cette spcificit propre l'assainissement, la figure 15-1 montre trs
schmatiquement une structure pour assurer la gestion automatise d'un systme
comprenant un rseau de collecte, des postes de relvement, des bassins de limitation
hydraulique en priode pluvieuse et une station d'puration. Le milieu naturel de rejet est
aussi incorpor dans la structure travers une surveillance amont aval. Cette structure est
donc base sur le principe de la dcentralisation des dcisions et de la sparation des
fonctions d'automatisme qui permet d'viter ce qui peut tre considr comme la hantise de
l'exploitant : la panne totale du systme.
Figure 15-1 : Exemple de structure pour assurer la gestion automatise.
Contrle centralis et automatisme - Page 376
Un tel ensemble prsente les avantages suivants :
une conception volutive car chaque couche est autonome vis--vis de la couche
suprieure;
une hirarchisation des problmes et des prises de dcision;
une scurit par la dcentralisation des automatismes tche simple;
la dtection chaque couche d'incohrences et de dfauts inconnus par la
couche considre qui se traduit par l'envoi la couche suprieure ou vers
l'exploitant d'un message d'alarme et de l'arrt des prises de dcision. Elle respecte
aussi les contraintes d'volutivit pour permettre d'additionner de nouvelles parties
sans dtruire l'ensemble.
II. COMPOSITION DU SYSTEME
Six paragraphes successifs dcriront en dtail les diffrents lments constitutifs de la
structure :
Capteurs.
Actionneurs - Organes de commande.
Automates.
Transmission.
Concentrateurs de donnes.
Postes centraux.
II.1. LES CAPTEURS
Les capteurs en assainissement doivent travailler dans des conditions difficiles : violence
des coulements, teneur des eaux en graisse et en MES, agressivit de l'eau ou de l'air
ambiant, risque de surtension atmosphrique (foudre), ... En gnral, les constructeurs
connaissent peu ou mal ces contraintes et seule l'exprience de l'exploitant peut permettre
un choix judicieux.
Le choix d'un capteur doit intgrer un ensemble de contraintes et doit toujours se rfrer
l'utilisation que l'on va faire de ces donnes collectes. Il est vident que des besoins aussi
diffrents que le contrle, l'mission d'alarmes ou la dcision d'actions vont ncessiter des
critres de choix trs diverses.
Ainsi lorsqu'on se pose la question : Quelle "densit" de capteurs faut-il avoir ? On
se heurte deux approches un peu contradictoires :
Fonction contrle ou alarme.
L'exploitant souhaite alors avoir la plus grande densit de capteurs possible. La plupart du
temps, il suffit de stocker sur place les mesures et de ne transmettre sur un Poste Central
que les mesures qui s'loignent des valeurs de consigne (fonction alarme) ou des moyennes
pour assurer la fonction contrle. Le stockage permet l'exploitation de ces mesures en temps
diffr, par exemple pour des calages de modles mathmatiques.
Page 377 - Chapitre 18
Fonction gestion en temps rel.
Il est alors impratif que l'information soit rapatrie au poste central. Mais il ne faut pas
qu'il y en ait trop, si l'on veut pouvoir les intgrer et les exploiter en temps rel. Dans ce cas
les informations pertinentes dans le diagnostic pour dfinir une action seront seules
transmises.
Ainsi, pour la gestion en temps rel d'un rseau de collecte des eaux pluviales les
mesures "essentielles" devront tre choisies avec soin par l'exploitant, en fonction :
Des conditions topographiques du rseau : points d'inondations, ...
Des temps de transfert. Une mesure de hauteur ne doit pas tre trop loigne de
l'organe qu'elle est cense rguler. Sur un bassin d'talement 10 15 mn de temps
de transfert semblent tre un maximum.
De la topographie qui conditionne en gnral, l'implantation des pluviomtres, ... Le
choix du site est primordial pour que la mesure faite soit bien significative du
phnomne observe.
Enfin, il faut prendre garde que les conditions d'installations ne modifient pas trop les
conditions hydrauliques et par suite le phnomne mesur. Une fois l'utilisation de la mesure
bien rpertorie, il est alors ncessaire de choisir le capteur. Le tableau 15-1 rsume de
manire trs succincte les types de capteurs actuellement disponibles pour mesurer
diffrents paramtres.
CAPTEUR APPLICATION
MARCHE/ARRET tat de fonctionnement des quipements
lectromcaniques
INTENSITE ELECTRIQUE tout moteur lectrique
dtection d'anomalies
DEBIT toutes eaux,
canalisations fermes, ouvertes
HAUTEUR tous bassins
niveaux d'eau, de boues
TEMPERATURE toutes eaux
CONDUCTIVITE rseau, station
salinit, prsence d'eaux parasites
POTENTIEL OXYDO
REDUCTION
rseau, station
tat d'oxydation de l'eau
risques d'anarobiose
OXYGENE DISSOUS toutes eaux
TURBIDITE rseau, station
MES, concentration boues
niveau lit de boues
ANALYSEURS SPECIFIQUES toutes eaux
NH
4
, PO
4
, DCO, COT, DBO
PLUVIOMETRE eau de pluie
Tableau 15-1 : Types de capteurs actuellement disponibles.
Contrle centralis et automatisme - Page 378
II.1.1. Les mesures de niveaux
Les capteurs de mesure de niveaux sont certainement les capteurs les plus employs en
rseau et dans les ouvrages d'assainissement et ceux sur lesquels ont t faites le plus
d'expriences.
Jusqu' ces dernires annes, le capteur dit "bulle bulle" a t certainement le plus
employ. Mais il demande un entretien et un rglage dlicats. Son cot est relativement
lev si on veut avoir un appareil ayant une bonne prcision et des possibilits de
retransmission distance. Il est peu peu supplant par d'autres types de capteurs,
notamment les capteurs piezo-rsistifs jauges de contraintes et pont de Wheastone.
Rcemment, les capteurs ultrasons sont apparus sur le march, ils permettent sans
contact avec le liquide de dterminer des variations de niveau d'eau ou de boues avec
beaucoup de prcision sur plus de 10 mtres de hauteur par l'analyse fine de l'cho
ultrasonique.
II.1.2. Les mesures de dbits en rseau
Cette mesure est encore difficile apprhender, surtout lorsque l'on se trouve confront
la mesure de dbits pouvant atteindre plusieurs dizaines de m
3
/s sur des collecteurs de
plusieurs mtres de diamtre.
On en est souvent rduit une mesure indirecte : mesure de hauteur d'eau dans une
section de contrle judicieusement choisie et que l'on peut tarer par un procd manuel :
micro-moulinet, traceurs salins ou radioactifs, ... En l'absence de tarage, une hypothse est
faite pour dduire le dbit de cette hauteur d'eau (coulement uniforme par exemple).
Les seuls capteurs que l'on puisse considrer comme de vrais capteurs de dbits en
continu sont de conception rcente : ils combinent la mesure de la hauteur d'eau au droit
d'une section et celle de la vitesse dans un ou plusieurs plans horizontaux celle-ci.
La mesure de la vitesse se fait par sonde lectromagntique ou ultrasons.
II.1.3. Les mesures d'oxydo-rduction
Ces capteurs sont composs d'une sonde double (lectrode de rfrence + lectrode de
mesure) et d'un transmetteur. Les lectrodes sont soit spares, soit combines. Les
lectrodes de rfrence sont choisies prfrentiellement avec un lectrolyte glifi.
L'attention doit tre porte sur les contraintes d'installation (mise la terre soigne) et de
maintenance (la surface de mesure de la sonde doit tre rgnre priodiquement par
polissage).
Ces capteurs sont d'une importance extrme pour le contrle et la rgulation des
processus biologiques qui se droulent dans les bassins de traitement ou le rseau de
collecte des eaux uses. En intgrant l'ensemble des composs rduits et oxyds, ils
renseignent l'exploitant sur les risques de mauvais fonctionnement et lui permettent de
statuer sur le degr d'avancement des ractions de dpollution. Ces informations peuvent se
traduire par des actions correctives sur les conditions de fonctionnement des ouvrages
d'assainissement.
Page 379 - Chapitre 18
II.1.4. Les mesures de turbidit
La mesure de la turbidit se fait par passage d'une mission lumineuse travers
l'chantillon. La lumire (visible, IR, UV) absorbe, diffuse ou rflchie est analyse et
rapporte une courbe d'talonnage en units arbitraires (plaques talons, gouttes de
formazine, gouttes de mastic). Ces units de turbidit peuvent alors tre corrles avec des
paramtres pertinents comme les concentrations en boues dans les bassins de dpollution,
les concentrations en matires en suspension de l'eau brute ou traite ou mme des
paramtres plus indirects comme la demande chimique en oxygne.
Les mesures de turbidit peuvent se faire travers une cellule de mesure, par rfraction
sur la surface du liquide ou travers un filet en coulement. Le choix dpendra bien
videment de l'objectif de la mesure mais devra tenir compte des contraintes de nettoyage,
des interfrences avec d'autres sources de lumire, des risques de colmatage et de la
gamme de mesure (il est souhaitable de rester infrieur 70% de la saturation).
II.1.5. Les capteurs et analyseurs spcifiques
Dans cette classification, rentre l'ensemble des capteurs permettant de mesurer
spcifiquement un ou un ensemble d'lments constitutifs de l'eau transporte ou traite. On
retrouve ici des paramtres classiques comme la conductivit ou la concentration en
oxygne dissous. Il est noter pour ce dernier paramtre l'existence d'appareillage de
terrain capable de quantifier la pression partielle de l'oxygne dans la phase gazeuse par
effet paramagntique. Cela peut permettre d'valuer en continu les transferts d'oxygne
dans les bassins biologiques.
Les analyseurs procdent diffremment. Ce sont souvent des adaptations la mesure in
situ d'analyseurs de laboratoire. Ces analyseurs couvrent les principaux paramtres
dfinissant la qualit d'une eau brute ou traite.
Les principes de mesure des diffrents paramtres sont donns dans le tableau 15-2 :
PARAMETRE PRINCIPE
Ammonium lectrode spcifique,
analyse colorimtrique
Nitrates lectrode spcifique,
absorption U.V.,
ampromtrie
Phosphates analyse colorimtrique
Carbone organique total absorption U.V.
Demande biologique en oxygne respiration biomasse
Demande chimique en oxygne four micro-ondes
Tableau 15-2 : Principes de mesure des capteurs spcifiques.
Contrle centralis et automatisme - Page 380
L'inconvnient majeur de ces systmes rside dans l'obligation d'une filtration de l'eau
analyser en amont des cellules de mesure. Cela entrane l'quipement en systmes de micro
ou d'ultrafiltration avec toutes les sujtions techniques associes mais aussi que seule la
pollution soluble est prise en compte ce qui rduit l'intrt de ces analyses vis--vis des
normes. De plus, leur cot d'achat (100 150 000 F) ainsi que les dpenses couvrant les
oprations de maintenance et la consommation des ractifs freinent aujourd'hui leur
application aux petites et moyennes installations. Ils devraient cependant devenir des
quipements importants pour le suivi de la qualit des eaux traites en sortie des
installations.
II.1.6. Les mesures de pluies
II.1.6.1. Les capteurs
Ils sont de deux types :
Capteurs (ou pluviomtres) augets basculants. Ils ncessitent des visites
frquentes pour nettoyer l'impluvium et l'auget basculeur. De plus, le type de signal
dlivr (1 basculement = 1 top lectrique) n'est pas trs bien adapt une
transmission continue distance et ncessite un "interface" lectronique (comptage
d'impulsion + convertisseur frquence courant). Du fait de leur grande diffusion, ces
capteurs restent d'un prix relativement modr : 5 8 000 F.
Capteurs d'intensit. Pour pallier aux inconvnients des appareils prcdents, des
capteurs intensit ont t dvelopps. Ces appareils mesurent en continu le
remplissage d'un rcipient (par pese ou mesure de niveaux). Ils sont encore d'un
cot relativement lev : 30 000 F environ.
II.1.6.2. Les rseaux de pluviomtres
Pour bien connatre la pluviographie sur la zone d'exploitation d'un rseau
d'assainissement, il faut disposer d'un rseau de pluviomtres dont les mailles soient
suffisamment resserres pour dceler, la fois, les pisodes pluvieux de petites superficies
et leurs dplacements.
Un rseau convenable de pluviomtres doit avoir une maille de l'ordre de 2 5 km, avec
un resserrement possible 1 km dans les zones fort coefficient d'impermabilisation.
Pour tre utiles la gestion, les donnes fournies par ces pluviomtres doivent tre :
acquises et centralises avec rapidit (dans des temps infrieurs quelques
minutes, pour la gestion "temps rel");
mises au format, synchronises et mises sous une forme facilement exploitable
(courbes ou graphes facilement comparables);
stockes pour permettre une exploitation plus fine en temps diffr : les modles
mathmatiques d'interpolation des rsultats (mthode SPLINE, par exemple)
permettent d'avoir une vision prcise de la pluie et de ses dplacements sur des
surfaces relativement rduites de quelques centaines d'hectares.
Page 381 - Chapitre 18
II.1.6.3. Les prvisions donnes par "ECHO RADAR"
Le suivi des masses nuageuses et cellules convectives par RADAR est une application qui
se dveloppe dans tous les pays industrialiss. Elle permet de faire de bonnes prvisions
qualitatives court terme (1 heure). Des tudes sont en cours pour prciser les corrlations
quantitatives entre les intensits des chos radar et les relevs pluviomtriques.
II.2. LES ORGANES DE COMMANDE - LES ACTIONNEURS
Les actionneurs sont des organes permettant de transformer un ordre en une action
aboutissant la modification des conditions de fonctionnement du systme global
d'assainissement. Leur tat doit pouvoir tre modifi par tlcommande. Cette modification
peut se faire par tout ou rien ou par variation graduelle (variateur lectronique,
asservissement lectrique ou hydraulique).
Les actionneurs mis en oeuvre dans le contrle des stations d'puration et dans le
contrle des rseaux sont varis comme le montre le tableau 15-3 :
ORGANE DE CONTROLE FONCTION
CONTROLE Pompes (centrifuge, queue
de cochon, ...) par tout ou
rien ou variateur de vitesse
imposer un dbit (entre, recyclage, boues
en entre filtre bandes, ...)
DES STATIONS Turbines ou brosses raliser simultanment aration et
brassage
D'EPURATION Agitateurs immergs assurer l'homognisation
Compresseurs, surpresseurs,
turbocompresseurs
contrler la fourniture d'oxygne
Vannes, siphons vidange ou aspiration
Moteurs lectriques diverses commandes (prtraitement,
sauterelle, ...)
CONTROLE Stations de pompage avec
pompes vitesses variables
rgulation de dbits
DES Vannes diverses avec
alimentation soutenue
niveau aval ou amont constants
RESEAUX Seuils variables ou barrages
gonflables, siphons
asservissement niveau dbit ou qualit
de l'eau
Tableau 15-3 : Actionneurs divers pour les rseaux et les stations d'puration
Contrle centralis et automatisme - Page 382
Pour tre oprationnels, ces quipements doivent tre soigneusement entretenus : au
moins 3 visites compltes par an, minimum, avec graissage et dgrippage ventuel de
toutes les parties mcaniques. Pour certains de ces matriels qui jouent un rle essentiel
dans le contrle des processus, il est ncessaire, par scurit, de prvoir des secours ou
des doublements de commande.
Les critres de choix entre ces diffrents types de matriel de commande dpendent pour
l'essentiel du problme spcifique traiter et des conditions d'installation. Et il faut
reconnatre que l'on est plus souvent dans le domaine du "sur-mesure" que dans celui du
"catalogue fournisseur".
II.3. LES AUTOMATISMES ET LES ACQUISITIONS DE DONNEES
En assainissement comme en eau potable l'automatisation vise en priorit l'amlioration
de la qualit en prenant en compte rapidement des modifications survenu sur le site ou le
rseau. En effet, seul l'automatisme permet d'adapter en temps rel l'installation aux
variations de la qualit de l'effluent ou aux vnements divers ncessitant une modification
de commandes.
Un automate quip d'une carte de communication ou coupl un systme d'acquisition
de donnes permet galement la transmission d'informations ou des commandes distance
(donnes, tat des quipements, alarmes, ...). L'outil d'acquisition de donnes, par
opposition un automate programmable, supporte peu ou pas de programmation en interne
mais dispose en contrepartie de possibilits de dialogue distance suprieures via le rseau
tlphonique ou une liaison filaire. Certaines versions de ces systme autorisent la prise en
compte de commandes externes.
La liste ci-dessous rcapitule les principaux avantages d'un automatisme quip d'une
liaison distance par opposition des solutions de type lectromcanique :
commande et surveillance accrues par une prise en compte d'un plus grand
nombre vnements;
traitements adapts aux variations de paramtres mesurs ou des vnements
externes comme des dfauts de fonctionnement ou des tarifications EDF;
grande fiabilit de fonctionnement;
renvois distance d'informations diverses y compris d'alarmes permettant
l'intervention sur le site d'un agent d'astreinte;
optimisation des interventions de maintenance;
commandes distance;
possibilit de connexion un outil de gestion centralise (voir chapitre III);
possibilit de connexion un micro-ordinateur assurant des tches plus volues
d'optimisation.
De tous les avantages numrs ci-dessus, l'amlioration de la qualit de traitement
ou de gestion reste un des principaux arguments justifiant une automatisation
d'installations d'assainissement.
La L.E.D. travaille sur plusieurs produits d'automatisme permettant d'amliorer les
rponses du procd aux contraintes extrieures, voire d'optimiser le ou les traitements,
comme le ferait un exploitant prsent en permanence sur le site.
Page 383 - Chapitre 18
A titre d'exemple, deux produits ci-dessous rpondent ces critres :
AGAS ou "automate de gestion antisulfures", permettant la gestion d'un poste de
relvement avec injection de ractifs tout en limitant la production d'H
2
S.
Le produit AGAS se compose d'un automate ALSPA C50 CEGELEC quip d'une carte
programmable en Basic supportant le programme d'optimisation de l'injection des ractifs.
Cet automate assure les fonctions suivantes:
calcul en continu du dbit des pompes de relvement;
calcul de la quantit optimale de ractifs injecter et rpartition des volumes au
cours de la journe;
intgration des priodes dbit nul influenant la rpartition du ractif;
intgration des priodes de pluie;
gestion des pompes de relvement (jusqu' 3 pompes) et des pompes doseuses
d'injection de ractifs (une deux pompes);
dtection de dfauts pompes ou capteurs de niveau;
vidange cyclique du poste;
option de communication, par adjonction d'une carte au protocole JBUS ou par le
raccordement d'un poste d'acquisition de donnes.
OGAR, ou "optimisation de la gestion de l'aration par le redox", automatisme
embarqu sur un automate ddi coupl ventuellement un systme d'acquisition de
donnes.
Le produit OGAR se compose comme AGAS d'un automate ddi de type ALSPA C100
CEGELEC quips en plus des cartes d'entres-sorties, d'une carte programmable en Basic
et d'une carte communication optionnelle au protocole JBUS.
L'optimisation de la gestion des priodes d'aration est ralise sur la carte Basic, une
acquisition de donnes ou un automate existant peut par tre coupl OGAR par le biais de
la carte communication.
Une mini-console de paramtrage permet l'exploitant d'ajuster ou consulter certains
paramtres.
A un automatisme simple, reproduisant un fonctionnement syncop sur seuils ou sur
horloge, est substitu une analyse de la drive du potentiel Redox du bassin. Cette
mthode permet d'adapter le fonctionnement des arateurs la variabilit de l'effluent. En
cas de dysfonctionnement grave une alarme permet de basculer sur un mode de marche
dgrad.
On remarque que dans ces deux exemples, l'amlioration de la qualit est obtenue par
la mise en oeuvre d'automatismes volus constituant une approche d'optimisation et que
l'ouverture des produits sur l'extrieur est assure par des cartes communication.
Contrle centralis et automatisme - Page 384
Cependant, aux avantages de l'automatisation et du renvoi distance d'informations
s'opposent les contraintes ci aprs:
cot de ralisation pour des sites de faible importance;
formation du personnel l'utilisation ou au diagnostic en cas de dysfonctionnement;
modification de l'organisation interne des services.
II.4. LES TRANSMISSIONS
II.4.1. Les supports de transmission
La commande ou transmission distance d'informations partir d'un automate quip
d'une carte de communication ou d'un systme d'acquisition de donnes s'effectue par le
biais de quatre supports ou mdias.
Le rseau commut tlphonique, bien adapt pour une surveillance ou
commande distance ne ncessitant pas une liaison permanente donc de gestion
temps rel de l'information. Ce support est utilis particulirement par les systme
d'acquisition de donnes.
Le rseau filaire des P.T.T. ou lignes spcialises, autorisant la connexion
permanente, utiliss prioritairement sur des rseau de communication important.
Le rseau filaire priv, compos d'un cble install l'intrieur d'une exploitation.
Le rseau radio, qui permet des liaisons proches du temps rel mais est sensible
aux perturbations atmosphriques et dpend des contraintes gographiques. Ce
mdia ncessite des flux de donnes faibles pour respecter des temps de connexion-
dconnexion agres P.T.T. Les vitesses de transmission sont gnralement faibles.
II.4.2. Les matriels de transmission
La transmission des informations sur le mdia s'effectue par des modems
(modulateur-dmodulateur). Les signaux envoys tant moduls par le "modem metteur" et
dmoduls par le "modem rcepteur".
Il existe plusieurs types de modems :
les modems tlphoniques autorisant un dbit maximum de 9600 Bauds ou bits
par seconde;
les modems bandes de base, d'un cot moindre mais rservs aux liaisons
spcialises ou cbles privs. Ces modems codent les signaux numriques par une
suite de niveaux de tension. Le dbit peut atteindre 19200 Bauds.
Ce moyen de transmission doit tre protg des orages par des parafoudres adapts
au support.
Cot automate, la transmission d'informations s'effectue par des cartes spcialises
supportant la plupart du temps un protocole de communication. Un protocole est un
ensemble de rgles dfinissant l'change des informations. Le plus employ reste le
protocole JBUS. D'autres protocoles plus performant font leur apparition dans le monde des
automates comme FIP, Profibus, Ethernet.
Page 385 - Chapitre 18
Cot systme d'acquisition de donnes, la liaison s'effectue presque toujours par
rseau tlphonique commut toutefois, certains matriels offre un port protocol JBUS pour
une liaison filaire. Ils disposent souvent d'une interface Minitel.
Ces systmes datent les informations en station, au moment de leur apparition (donnes
de type horodate) et se connectent avec un poste central priodiquement ou sur monte
d'une information. Ils sont gnralement capables d'appeler en lieu et place du poste central,
un agent d'astreinte sur apparition de dfaut et de raliser du stockage d'informations.
L'objectif de gestion technique impose le mdia utilis. En effet, sur un rseau
d'assainissement sensible aux orages des dcisions doivent tre prises dans les premires
minutes, en fonction des tendances, c'est dire sur analyse de drive des paramtres.
Ceci implique un rafrachissement rapide de l'information, de l'ordre de la minute.
Par ailleurs, un regroupement partiel d'informations dans des postes priphriques
principaux avec stockage ventuel de sauvegarde est prfrer une solution trs
centralise.
II.5. CONCENTRATEUR DE DONNEES
Il se peut que plusieurs dispositifs soient grer dans une mme zone gographique.
Dans ce cas les donnes peuvent tre regroupes avant d'tre renvoyes d'un seul bloc
vers un systme de contrle centralis. Ce travail de regroupement et d'envoi des donnes
est assur pas le concentrateur de donnes appel aussi frontal de communication.
Dans le cadre d'un dispositif de gestion centralise, le frontal de communication peut avoir
les fonctions suivantes :
grer la ou les communications avec les postes centraux;
effectuer un premier niveau d'exploitation;
grer les appels d'astreinte.
II.6. LES POSTES CENTRAUX
Les postes centraux seront plus ou moins complexes et labors, en fonction des objectifs
que l'on s'est fixs. Il est possible de dfinir trois grandes classes de choix techniques :
Objectif n 1 : Simple tlsurveillance distance. Le poste central pourra se limiter a un
"concentrateur de donnes" appel aussi "frontal de tltransmission" coupl a une
imprimante servant de "mouchard", et un dispositif d'appel du personnel d'astreinte.
Objectif n 2 : Meilleure connaissance du rseau et des installations par centralisation
de l'information. Dans ce cas il sera possible d'utiliser un "micro-ordinateur" type PC/386.
Dans ce cas le "micro ordinateur" peut tre quip du systme d'exploitation "Windows"
coupl un logiciel spcialis permettant de gnrer simplement un systme de contrle
centralis. Un stockage sur bandes magntiques permet l'archivage. Cette technique assure
le stockage sr d'un grand nombre de donnes. Elle est plus efficace que l'utilisation de
disquettes.
Objectif n 3 : Gestion technique des quipements "temps rel". Les matriels et les
logiciels mettre en oeuvre pour rpondre ce type d'objectifs sont plus complexes et plus
onreux. En effet on aura tendance dans ce cas se tourner vers des matriels tel que les
stations de travail. Les logiciels choisis seront alors utiliss autour du systme d'exploitation
Contrle centralis et automatisme - Page 386
UNIX. Il s'ensuit deux inconvnients : d'une part ce type de logiciels est plus cher que ceux
vendus pour une utilisation avec "Windows" (TOPKAPI par exemple) et d'autre part,
l'utilisation du systme d'exploitation Unix ncessite l'emploi d'un expert en informatique
(ingnieur systme). Il en rsulte que l'aspect "gestion temps rel" d'un dispositif de
contrle commande a un cot qu'il ne faut pas ngliger.
D'une faon gnrale, les postes centraux rpondant aux objectifs un et deux sont
organiss autour d'une base de donnes qui constitue le coeur du systme. Plusieurs outils
de traitement de ces donnes permettent d'offrir un grand nombre de fonctionnalits parmi
lesquelles :
la gestion des alarmes et des appels d'astreinte;
l'dition des journaux de bord;
l'dition de bilans;
l'affichage de synoptique, et de courbes;
la communication avec les installations contrles.
Un accs rapide aux "actionneurs" par l'intermdiaire de tlcommandes, tlconsignes,
tlrglages n'est possible que dans le cas d'une gestion technique temps rel.
Mais, sur les grands rseaux, on atteint trs vite les limites d'intgration d'un homme seul.
Il convient alors :
de dcentraliser le maximum de dcisions sur des automatismes locaux (automates
programmables);
d'implanter au poste central des outils d'aide la dcision.
III. EXEMPLES DE CONTROLES CENTRALISES ET D'AUTOMATISMES
III.1. L'AIDE A LA GESTION DES BASSINS D'ETALEMENT
III.1.1. Les modles d'aide la dcision
Les modles mathmatiques d'aide la dcision doivent tre des outils spcifiques
conus en vue de la gestion "temps rel". Les quelques expriences o l'on a cherch
adapter des modles utiliss pour la conception des rseaux se sont traduites par des
checs. En effet, ces modles "conception" sont des outils lourds dont les temps de rponse
ne sont pas adapts aux besoins de la gestion "temps rel".
Les modles d'aide a la dcision pour la gestion "temps rel" peuvent trs
schmatiquement prendre les deux formes suivantes :
III.1.1.1. Catalogue de situations types
Elles sont prenregistres en mmoire de l'organe de dcision qui comparera la situation
relle ces situations types. Dans ce cas, les situations types peuvent tre dtermines hors
ligne, partir des modles classiques existants :
Modle de propagation hydraulique
Divers modles mathmatiques existent permettant le calcul pluie-ruissellement-
hydrogrammes et celui des lignes d'eaux par intgration des quations de Barr de Saint-
Venant. Des simplifications peuvent tre apportes ces quations pour faciliter leur
rsolution.
Page 387 - Chapitre 18
Modle de propagation des pollutions
On citera les modles SWMM (USA), MOUSETRAP (SAFEGE), HYPOCRAS et
HYDROPOL (Lyonnaise des Eaux-Dumez), mais en prcisant que ces modles ncessitent
de nombreuses donnes que peu d'exploitant ont en leur possession. L'inconvnient de ces
catalogues de situations types est qu'ils ne couvrent pas toujours la multiplicit des cas
possibles ni la complexit des volutions du systme.
III.1.1.2.Modles de calcul " temps rel"
Ces modles sont bass sur des quations des coulements trs simplifies et une
configuration de rseau trs schmatique.
Ces modles n'ont pas la prtention de traduire la ralit exacte des phnomnes. Mais ils
rpondent rapidement et traduisent bien les tendances. Par contre, pour viter les drives, il
convient que ces modles soient recals "pas pas", en fonction des mesures in situ et
donc que l'on ait un systme boucl.
III.1.2. L'exemple de la gestion des bassins d'talement
C'est un exemple classique en assainissement pluvial. Un bassin d'talement stocke un
volume d'eau en priode de pointe, permettant ainsi de diminuer le dimensionnement des
collecteurs avals.
Le problme est de rgler au mieux le dbit de fuite Q
s
du bassin, en fonction des apports
latraux des bassins versants avals, forcment alatoires, pour utiliser au mieux la retenue
et viter les dbordements au niveau des zones critiques.
Si l'on ne dispose pas de moyen de gestion centralis, on est amen rgler un dbit de
fuite constant, cal relativement bas, par mesure de scurit. Par rapport cette gestion
dbit de fuite constant, la gestion centralise et automatise permet :
pour une mme pluie, d'utiliser moins de volume de retenue : gain de 20 % environ
dans le cas prsent;
surtout de l'utiliser moins longtemps, laissant la retenue davantage disponible pour
l'pisode pluvieux suivant : gain de 400 % environ dans le cas prsent.
Les principes de gestion centralise et automatise des bassins d'talement peuvent tre
les suivants :
III.1.2.1. Mthode de gestion par les dbits calculs (rgulation en boucle
ouverte)
Les ides directrices sont prsentes ci-aprs dans le cas d'un bassin d'talement situ
sur un collecteur o on a identifi un point sensible.
Pour viter les dbordements au point sensible, le principe retenu est de calculer le dbit
prvisible en ce point et d'agir sur les actionneurs disponibles l'amont, de faon maintenir
le dbit, au point sensible, au voisinage de la valeur de consigne fixe avec une marge de
scurit suffisante pour qu'il n'y ait pas de dbordement.
Ce dbit prvisible est chaque instant la somme de deux composantes :
le dbit antrieurement lch par la retenue situe l'amont, convenablement
propag et amorti;
Contrle centralis et automatisme - Page 388
la somme des dbits d'apport intermdiaire entre retenue d'talement et point
sensible aval considr galement propage et amortie de faon adquate.
On constate immdiatement que seule la premire composante peut tre modifie par
action sur les organes de rglage du dbit de vidange, les dbits d'apport intermdiaires ne
peuvent tre modifis en l'absence de dispositifs particuliers sur les collecteurs affluents
(autres retenues d'talement, transfert vers un autre bassin versant, ...).
Le problme consiste trouver un hydrogramme de rglage de la retenue, qui, propag
jusqu'au point sensible tend compenser les apports latraux.
Sur le plan matriel, l'algorithme de rgulation comprendra :
tlmesures pluviomtriques des bassins versants latraux et calculs des dbits
d'apport;
modle de calcul, chaque pas de temps, des dbits prvisibles aux points critiques
(modle de propagation en conduite);
calcul chaque pas de temps, de la position des vannes et du dbit de vidange Q
s
,
compte tenu des temps de propagation entre la vanne et les zones sensibles.
L'inconvnient de cette rgulation est qu'elle est en "boucle ouverte", donc sans possibilit
d'autocorrection en cas de drive des dbits calculs par rapport aux mesures faites sur le
terrain.
III.1.2.2. Mthode de gestion par les hauteurs mesures (rgulation en
boucle ferme)
Le niveau au point sensible dpend des apports latraux et du dbit de la vanne du bassin
de rtention. Seules des manoeuvres sur la vanne peuvent rgler le niveau au point sensible
car on n'a pas de moyen d'agir sur les apports latraux.
On suppose que l'on a au point sensible, une mesure permanente de l'cart entre une
hauteur de consigne et la hauteur relle.
Intuitivement on voit qu'on peut se servir de cet cart D
h
pour agir sur la vanne de vidange
du bassin de rtention :
si cet cart est ngatif on diminuera le dbit de la vanne une certaine vitesse,
gnralement proportionnelle lcart; on augmentera de la mme manire en cas
d'cart positif;
on peut galement manoeuvrer plus ou moins vite suivant que la variation du niveau
est rapide ou pas.
On vient ici de dfinir une rgulation proportionnelle, intgrale et drive (P.I.D.). La
difficult dans ce type de rgulation est de trouver le coefficient de proportionnalit entre
cart en hauteur D
h
et variation de dbit dQ/dt de la vanne :
si dQ/dt est trop petit l'effet ne se fera pas assez sentir et le niveau continuera
monter ou baisser de faon trop importante;
si dQ/dt est trop grand, partir d'un cart par exemple positif on produira un cart
ngatif de plus grande amplitude, qui son tour tendra se compenser par un cart
positif encore plus grand : la rgulation est instable.
Page 389 - Chapitre 18
L'tude de la stabilit est essentielle en rgulation en boucle ferme. L'tude
thorique montre d'ailleurs que ce coefficient de proportionnalit est surtout dtermin par le
temps de propagation entre le bassin et le point sensible.
Cette rgulation s'effectue par des systmes PID ou similaires et comprend
sommairement :
une tlmesure de niveau vers l'automatisme et un calcul des carts entre niveaux
mesures et niveaux de consignes;
une modification de la position des vannes de vidange par pas de temps et par
incrment en fonction des carts constats.
L'avantage de cette rgulation est qu'elle auto corrige. L'inconvnient est que son temps
de rponse est relativement long : plusieurs minutes pour un capteur situ 500-700 m du
bassin d'talement. Or cette rgulation a faire face des variations de hauteurs
extrmement brutales dans les collecteurs, souvent de l'ordre du cm/seconde.
III.1.2.3. Mthode de gestion mixte (boucle ouverte + boucle ferme)
La gestion ou rgulation mixte consiste utiliser les deux types de rgulation dfinis
prcdemment (mthode des dbits et rgulation en boucle ferme). Le principe en est
simple. On additionne les valeurs de la commande de la vanne; ces valeurs sont issues
d'une part du rgulateur de la boucle ferme et d'autre part du rsultat du calcul en boucle
ouverte (mthode des dbits). En d'autres termes, on corrige un dbit de rglage calcul
(mthode des dbits) par un dbit complmentaire issu de l'observation des hauteurs sur le
collecteur aval.
Pour des phnomnes rapides (orages, ...), l'action de la boucle ouverte sera
dterminante, surtout pendant la phase de monte des eaux o il sera possible d'anticiper la
fermeture, grce aux tlmesures pluviomtriques.
Le reste du temps la rgulation en boucle ferme aura en quelque sorte la capacit de
corriger en partie les erreurs de modlisation provenant de la commande en boucle ouverte,
en tendant ramener en permanence le niveau au voisinage du niveau de consigne.
La rgulation mixte runit les avantages des deux solutions prcdentes. Les prcautions
indispensables en ce qui concerne la stabilit demeurent cependant.
L'algorithme de calcul sera videmment dans ce cas un peu plus complexe, ce qui
ncessitera en gnral son implantation sur micro-ordinateur industriel qui sera le coeur du
systme de rgulation. Cette mthode peut tre tendue des cas plus complexes (bassins
d'talement en srie ou en parallle).
III.2. L'AIDE A LA GESTION DES BASSINS D'AERATION
Un des points critiques dans une station d'puration par boues actives est la gestion des
bassins d'aration. L'objectif est de moduler l'apport d'oxygne au sein du bassin biologique
pour respecter le mieux possible la demande. Cette quantit d'oxygne sert en effet oxyder
les pollutions carbones et azotes et maintenir en activit les micro-organismes prsents
dans les boues. Les consquences d'une mauvaise aration sont rapidement dramatiques
non seulement au niveau de la qualit de l'eau traite mais aussi long terme sur l'ensemble
des fonctions de l'puration par la slection de bactries indsirables comme les bactries
filamenteuses. Cette gestion des bassins d'aration par la rgulation de la fourniture d'air
implique le dveloppement d'une stratgie de contrle trs fiable que ne peut assurer au
aucun cas un dispositif de type horloge.
Contrle centralis et automatisme - Page 390
III.2.1. Les capteurs et la validit des informations
Le choix du capteur est dterminant mais doit intervenir aprs la rflexion sur
l'automatisme et la dfinition des paramtres majeurs acqurir. Une fois ce paramtre
identifi, le moyen de le mesurer et donc le type de capteur mettre en oeuvre peuvent tre
rflchis. Dans le cadre de la rgulation de l'aration, les capteurs associs (mesure de
l'oxygne dissous ou du potentiel d'oxydo-rduction) sont de type sonde immerge. Le
problme majeur sera le positionnement de la sonde pour que l'information collecte soit
reprsentative de l'ensemble du systme ou d'une partie suffisamment bien caractrise
pour tre extrapole la totalit via des modlisations cintiques ou hydrodynamiques.
Le signal obtenu par le capteur doit tre d'abord valid lectriquement avant d'tre
transform en grandeur interprtable. Cette valeur doit ensuite tre compare un intervalle
de rfrence pour tre dfinitivement utilis par l'automate. Toute incohrence dtecte lors
de ces deux tests rend la donne invalide et s'il y a persistance entrane l'envoi d'une
alarme.
III.2.2. Rgulation par valeur de consigne
Dans ce type de rgulation, une valeur de consigne sert dfinir les conditions de marche
ou d'arrt du ou des dispositifs de fourniture d'oxygne. Cette valeur de concentration en
oxygne dissous est dfinie comme permettant un quilibre correct entre la fourniture et la
consommation de l'oxygne. En de de cette valeur, il y a des risques de carence par
limitation diffusionnelle ou autre de l'apport d'oxygne vers les boues. Au del, on suppose
que la concentration n'est pas nuisible d'un point de vue biologique mais entrane une
dpense nergtique excessive.
La rgulation se fait par l'analyse de la valeur de concentration releve dans le bassin
biologique des intervalles de temps prdfinis, si celle-ci est infrieure la valeur de
consigne, l'action consiste mettre en fonctionnement le n+1 dispositif d'aration, dans le
cas contraire c'est bien videment n-1 qui sera mis en oeuvre.
Il est cependant important de choisir une base de temps suffisante pour viter des
battements marche/arrt trop rapprochs des quipements sans toutefois risquer des chutes
importantes de la concentration en oxygne dans le bassin biologique. Par ailleurs, dans le
cas des arateurs de surface combinant aration et brassage, la contrainte mlange va
interfrer sur la stratgie de rgulation en obligeant inclure une contrainte de temps
minimum de marche associ une puissance minimale.
III.2.3. Rgulation par valeurs seuils
La rgulation se fait par rapport des valeurs critiques qui bornent la zone de travail.
L'atteinte de la valeur seuil haute implique l'arrt du ou des dispositifs d'aration qui seront
ractivs lors de l'atteinte de la valeur seuil basse. Une telle rgulation permet d'ouvrir le
champs de fonctionnement du systme une vaste zone et de prendre en compte les
vitesses de monte ou de descente du signal. Ainsi plus la vitesse de monte de la
concentration en oxygne dissous sera lente, c'est dire plus la demande en oxygne sera
importante, et plus la dure de fonctionnement des arateurs sera leve.
Ce type de rgulation par seuils est cependant risqu si des temporisations maximum et
minimum ne lui sont pas associes. L'atteinte du seuil bas ou du seuil haut peut ne pas se
faire pour de multiples raisons et le systme se trouve ainsi bloqu dans une position. Des
bornes temporelles permettent alors de faire repartir la rgulation lors de ces stagnations du
signal dans la zone intermdiaire. De mme, des atteintes trop rapides des seuils impliquant
des dmarrages et des arrts trs frquents des dispositifs doivent tre protges par des
Page 391 - Chapitre 18
dures minimales. Si les limites de temps sont trop souvent sollicits, il est alors ncessaire
de rajuster les valeurs seuils critiques.
La limite de la rgulation par seuils se situe dans le fait que l'information collecte est du
type tout ou rien. Le seuil est atteint ou n'est pas atteint. Le dclenchement d'une
temporisation maximum est aveugle par rapport la position relle de la valeur qui est riche
d'enseignement sur le problme rencontr.
III.2.4. Rgulation par volution de la valeur
La rgulation est base ici sur l'information en temps rel de l'volution du paramtre de
contrle choisi pour alimenter l'algorithme de rgulation. Le dveloppement du contrle de
l'aration en respectant ce principe a abouti l'automate OGAR (Optimisation de la Gestion
de l'Aration par Redox) bas sur la mesure en continu du potentiel d'oxydo-rduction. Ce
type de rgulation permet non seulement d'ajuster la fourniture d'oxygne la demande du
systme value partir des variations de potentiel mais aussi de dtecter en permanence
toute incohrence entre l'volution "normale" ou prvue du paramtre de contrle et son
volution relle. Ainsi l'automate renseigne en temps rel de l'tat du systme la fois aux
structures suprieures de l'automatisme global et l'exploitant via la tltransmission et la
supervision. Une telle rgulation s'insre donc parfaitement dans un contrle centralis.
IV. L'EXPLOITATION DES CONTROLES CENTRALISES
Pour utiliser d'une manire efficace un contrle centralis, l'exploitant devra savoir
s'adapter et faire voluer ces techniques de gestion.
IV.1. DE LA MAINTENANCE CURATIVE A LA MAINTENANCE PREVENTIVE
La maintenance curative, souvent un peu improvise, doit voluer vers une maintenance
prventive plus constante et plus efficace. Ceci est particulirement vrai en "assainissement
pluvial", o les quipements ne sont sollicits leur maximum que quelques jours par an.
Mais qu'un incident survienne durant ces priodes de "crises" et c'est toute la philosophie du
systme qui peut tre remise en question.
Au niveau des organes de commande (vannes motorises, stations de pompage), ce
transfert du curatif au prventif, s'il est bien organis, n'engendre pas d'heures de main
d'oeuvre supplmentaire. De plus, on a la possibilit de faire appel une sous-traitance
efficace et spcialise et la fiabilit de fonctionnement est, de toutes faons augmente.
Au niveau des autres quipements du contrle centralis, une maintenance
complmentaire devra tre mise en place.
Pour le nettoyage, l'talonnage et l'entretien des capteurs. Cette tche est
essentielle. Elle est relativement lourde en rseau d'assainissement, du fait de l'agressivit
du milieu dans lequel on travaille et de la grande dispersion des capteurs. Le tableau 15-4
donne titre indicatif une ide du temps consacrer pour l'entretien de capteurs tels que
pluviographes. Sur les grands rseaux, on estime qu'une quipe de deux instrumentalistes
peut assurer l'entretien annuel de capteurs.
Contrle centralis et automatisme - Page 392
FREQUENCE ENTRETIEN HEBDO MENSUEL ANNUEL TOTAL
Contrle heure, tension pile
enregistreur, droulement papier,
impluvium, aspect gnral
0,1 h 5 h
Nettoyage cne, dbouchage,
dpannage sur site,
remplacement rouleau
0,5 h 6 h
Nettoyage des tables, augets,
contrle tanchit, contrle
fonctionnement, tarage avec
prouvette
10 h 10 h
Dpouillement pluviomtrie 1 h 12 h
Saisie de la pluviomtrie aprs
vnement pluvieux
1 h 1 h
total 34 h
Tableau 15-4 : Estimation de l'entretien annuel des pluviomtres.
Pour la maintenance des circuits lectriques et lectroniques. Ces quipements
sont trs fiables et les technologies actuelles de cartes modulaires en facilitent grandement
la maintenance. Sur les grands rseaux, un technicien ayant des connaissances de base en
lectronique, peut facilement assurer cette tche, dans le mesure o il dispose d'un lot de
cartes de rechange, et d'un simulateur pour dtection des dfauts.
Sur les petits rseaux, on pourra faire appel un contrat de maintenance, en gnral
propose par le constructeur.
Pour la maintenance et l'volution des "logiciels", ceci s'applique surtout lorsque l'on
dispose de programme d'aide la dcision que l'on peut faire voluer. L'emploi d'un agent
informaticien temps plein ne se justifie pas, en gnral, et il vaudra mieux faire appel une
sous-traitance.
Par contre, sur les grands rseaux, on aura souvent intrt ce que le personnel en
poste, au poste central ait une formation suffisante en informatique pour assurer une
maintenance de premier niveau.
IV.2. EVOLUTION ET FORMATION DU PERSONNEL
La mise en place d'un contrle centralis entrane les consquences suivantes :
diminution des tches routinires de surveillance, souvent vides d'intrt sur le plan
professionnel et difficiles pourvoir lorsqu'il s'agit de travail par postes (3 x 8 h);
enrichissement des tches lies la dcouverte de nouvelles techniques et la
recherche d'une gestion technique optimum. La tche de lagent n'est plus de
constater puis de rendre compte mais de rechercher l'explication des anomalies puis
d'agir.
Page 393 - Chapitre 18
L'exploitant d'un systme d'assainissement et d'puration devra donc prvoir:
un plan de formation du personnel, d'une ampleur suffisante;
une restructuration de ses quipes, avec, par exemple :
responsabilit de la gestion quotidienne des quipements, centralise sur une
quipe ayant une bonne connaissance globale de l'ensemble des ouvrages et de
leurs interactions;
organisation d'une maintenance prventive sur les quipements lectro-
mcaniques, dcentralise par secteurs gographiques, afin de limiter les temps
de trajets, ...;
cration d'quipes d'astreinte, polyvalentes et trs mobiles, pouvant intervenir
rapidement en cas d'incident imprvu ou sur appel du poste central.
IV.3. L'EFFORT DE STANDARDISATION DES EQUIPEMENTS
Une gestion centralise, surtout lorsqu'elle s'adresse des quipements aussi divers que
ceux que l'on rencontre sur l'ensemble rseau station, ne peut se concevoir sans un effort
important de standardisation des installations.
Ce souci, souvent absent dans notre domaine d'activits, doit devenir une proccupation
majeure de l'exploitant. Cet effort de rflexion sur la standardisation pourra tre men dans
le cadre d'un "bureau des mthodes" comme cela a fait dans d'autres industries.
V. L'APPROCHE TECHNICO-ECONOMIQUE
Combien cote un contrle centralis et que peut-on en attendre en retour ?
Chaque cas particulier doit videmment faire l'objet d'une tude prcise intgrant les
diffrents paramtres cits dans les paragraphes prcdents. Il est possible sur un plan
gnral de dfinir quelques ordres de grandeur et une mthodologie permettant d'orienter
cette tude.
V.1. LES COUTS D'INVESTISSEMENTS
Au niveau d'une dcomposition "fonctionnelle", on peut dire d'une manire gnrale que :
le poste "capteurs" reprsente entre 15 et 20 % du montant des investissements;
le poste "actionneurs" reprsente environ 20 % du montant des investissements;
les quipements de tltransmissions proprement dits sont assez lourds en
assainissement du fait de la dispersion des installations et reprsentent environ 30 %
du budget;
l'organisation du poste central proprement dit (synoptique, gestion de l'information,
...) demande environ 10 % des investissements.
Enfin, la gestion "temps rel" ncessite souvent l'implantation d'automatismes locaux et
dans certains cas d'outils d'aide a la dcision reprsentant environ 25 % du montant des
investissements: 50 % de cette dpense est due l'tablissement des logiciels, qui peuvent
tre amortis sur plusieurs oprations.
Il ne s'agit bien entendu que d'un ordre de grandeur, qui peut varier notamment avec les
effets d'chelle, mais qui montre l'importance de l'enjeu. De plus les volutions rapides des
cots dans le domaine des matriels informatiques et des automates rendent trs
rapidement les valuations financires obsoltes.
Contrle centralis et automatisme - Page 394
V.2. L'APPROCHE TECHNICO-ECONOMIQUE
Comme indiqu dans les paragraphes, la dcision d'implanter un contrle centralis doit
faire suite a une analyse technique prcisant les problmes poss et les objectifs suivis .
En gnral, le contrle centralis se rvlera un outil de gestion technique indispensable
si l'on veut atteindre un double but :
amlioration du niveau de service rendu en termes de qualit et de fiabilit;
raliser ce premier objectif, en optimisant les cots d'exploitation et
d'investissements.
La rentabilit du contrle centralis sera apprcie en tenant compte de ces deux objectifs
divers paramtres :
allgement des tches de surveillance routinires et souvent inefficaces;
optimisation de la gestion technique (gain sur la main d'oeuvre, l'nergie, ...);
possibilits d'adopter des solutions techniques moins coteuses ou plus compactes
que des solutions classiques, et dont la gestion n'aurait mme pas pu tre imagine
sans contrle centralis;
par optimisation de la conception des installations nouvelles (ni surdimensionnement,
ni sous-dimensionnement) due une meilleure connaissance du couple rseau-
station et de ses interractions.
L'ensemble des gains raliss sur chacun de ces diffrents paramtres compensent en
gnral largement les investissements consentis pour un contrle centralis.
Chapitre 19
LES COUTS DEXPLOITATION DU
TRAITEMENT DES EAUX USEES
A. SADOWSKI
Les corts dexploitation du traitement des eaux uses - Page 396
SOMMAIRE
I. INTRODUCTION.....................................................................................................................................397
II. LES DIFFERENTS POSTES INTERVENANT DANS LES COUTS D'EXPLOITATION.............397
III. COUTS UNITAIRES PRATIQUES EN FRANCE...........................................................................398
IV. MAIN D'OEUVRE D'EXPLOITATION...........................................................................................399
V. REPARTITION DES PRINCIPAUX POSTES .....................................................................................399
V.1. EXPLOITATION STRICTE (HORS ENTRETIEN & RENOUVELLEMENT) ......................................................399
V.2. ENTRETIEN ET LE RENOUVELLEMENT DU MATERIEL (Y COMPRIS LA MAIN D'OEUVRE).........................400
VI. EVOLUTION DES COUTS D'EXPLOITATION.............................................................................401
Page 397 - Chapitre 19
I. INTRODUCTION
Nous allons d'abord dfinir :
les diffrents postes qui rentrent dans les frais d'exploitation d'une station de
traitement des eaux uses urbaines.
distinguer les cots d'exploitation stricte et les cots relatifs l'exercice de l'entretien
et du renouvellement du matriel lectromcanique.
l'incidence du niveau de traitement pour la pollution carbone / la pollution azote et
la pollution phosphore (avec ou sans traitement biologique pralable).
l'incidence de la taille de la station sur certains postes comme le personnel
d'exploitation / la consommation lectrique ramene au kilogramme de DBO
5
traite;
l'incidence de la filire de destination des boues;
l'incidence de la filire eau et de la filire boue;
l'incidence des systmes d'aration des racteurs biologiques;
dfinir le cot spcifique d l'entretien et au renouvellement du matriel
lectromcanique.
Pour rendre la lecture aise dans la comparaison des cots, nous partirons sur une taille
de station de 100.000 Equivalents-habitants et cela sur deux types de traitement ; l'une en
cultures libres dites "boues actives" et l'autre en cultures fixes de types "lits biologiques
immergs"
L'incidence de la taille de la station sur les cots d'exploitation sera aborde en comparant
une station de 10.000 Eq.hab / 50.000 Eq.hab et 100.000 Eq.hab
Nous prendrons comme rfrence trois niveaux de traitement :
traitement de la pollution carbone stricte soit 30 mg/l en DBO5 et en MES et 90 mg/l
en DCO;
traitement combin avec l'azote soit 20 mg/l pour l'azote global;
adjonction du traitement du phosphore avec 2 mg /l pour le P
tot
.
De plus nous indiqueront certains cots unitaires : de main d'oeuvre / de consommation
lectrique / de ractifs et d'vacuation des boues (valorisation agricole, dcharge contrle
ou incinration)
II. LES DIFFERENTS POSTES INTERVENANT DANS LES COUTS
D'EXPLOITATION
1) Main-d'oeuvre.
2) Consommation lectrique.
3) Ractifs :
traitement des boues;
traitement du phosphore;
traitement de l'eau dans les cas d'une dcantation primaire physico-chimique;
Les corts dexploitation du traitement des eaux uses - Page 398
traitement des odeurs.
4) Evacuation des boues (transport, valorisation agricole ou traitement particulier).
5) Traitement ventuel des graisses.
6) Enlvement des refus de dgrillage et du sable (dcharge).
7) Analyses sur l'eau et sur les boues( auto-contrle).
8) Produits consommables (huile, graisse, peinture serrurerie, eau potable, ...).
9) Entretien espace vert.
10) Entretien des peintures (gnie-civil).
11) Dsinfection ventuelle.
12) Dsodorisation ventuelle.
13) Frais de gestion locale et frais gnraux.
14) Entretien et renouvellement des quipements lectromcaniques.
III. COUTS UNITAIRES PRATIQUES EN FRANCE
Electricit : 0,40 FF du kWh.
Polymre : 40 FF le Kg.
Chaux : 600 FF la tonne.
FeCl
3
technique : 1200 FF la tonne.
Evacuation des boues : 35 FF la tonne de boue.
Evacuation et valorisation agricole des boues : 80 FF 180 FF la tonne de boue.
Evacuation en dcharge : 300 FF 500 FF la tonne de boue.
Incinration : 600 900 FF la tonne de boue.
H
2
SO
4
(98%) : 2000 FF le m
3
.
NaClO (48Cl) : 1200 FF le m
3
.
NaOH (41%) : 1000 FF le m
3
.
Main d'oeuvre, cot moyen (tout niveau confondu) : 200 250 KF/an.
Page 399 - Chapitre 19
IV. MAIN D'OEUVRE D'EXPLOITATION
Taille (eq hab) Exploitation
directe
Entretien
Renouvellement
Analyse Bilan Encadrement
200-2500 0,4 0,2 0,1 0,1
2500-5000 0,5 0,3 0,1 0,15
5000-10000 1* 0,4 0,1 0,2
10000-20000 1,2 0,6 0,1 0,3
20000-30000 1,6 0,8 0,2 0,4
30000-50000 2,6 1,4 0,4 0,7
50000-100000 4 2,4 1,2 1,1
100000-200000 7 5 2 2
* unit = 1 personne
Exploitation directe = ouvriers
Entretien & renouvellement = ouvriers spcialiss
Analyse & bilan = technicien de laboratoire
Encadrement = matrise
Tableau 17-1 : Rpartition des cot de la main doeuvre pour diffrentes tailles dinstallation.
Ne sont pas compris dans ces ratios :
l'encadrement suprieur;
le personnel administratif;
le personnel d'vacuation des dchets et des boues;
le personnel des bureaux d'tudes.
V. REPARTITION DES PRINCIPAUX POSTES
V.1. EXPLOITATION STRICTE (HORS ENTRETIEN & RENOUVELLEMENT)
main d'oeuvre : 20 35 %;
lectricit : 25 35 %;
ractifs et vacuation des boues : 15 35 %;
divers(enlvement dchets,analyses, produits consommables) :12 20 %.
Les corts dexploitation du traitement des eaux uses - Page 400
V.2. ENTRETIEN ET LE RENOUVELLEMENT DU MATERIEL (Y COMPRIS LA MAIN
D'OEUVRE)
500 5000 Eq.hab : de 6 4% du cot d'investissement total par an;
10000 50000 Eq.hab : de 4 3,5 du cot d'investissement total par an;
50000 200000 Eq.hab : de 3;5 2,5 % du cot d'investissement total par an;
La part entretien reprsente environ 55% dont 72,5% de main d'oeuvre. La part
renouvellement reprsente environ 45% dont 53% de main d'oeuvre.
Page 401 - Chapitre 19
VI. EVOLUTION DES COUTS D'EXPLOITATION
Les corts dexploitation du traitement des eaux uses - Page 402
Page 403 - Chapitre 19
Les corts dexploitation du traitement des eaux uses - Page 404
Page 405 - Chapitre 19
Les corts dexploitation du traitement des eaux uses - Page 406
Chapitre 20
GLOSSAIRE
EAU & ASSAINISSEMENT
A. SADOWSKI
Chapitre 20 Glossaire page
408
GLOSSAIRE
EAU & ASSAINISSEMENT
ACIDITE
Voir dfinition pH
ABSORPTION
Transfert de matire ou d'nergie, transformation d'une nergie en une autre forme d'nergie.
L'absorption d'une substance par un milieu rsulte, par exemple, du remplissage des
interstices d'un matriau poreux ou transfert au travers de la membrane cellulaire de
substances nutritives dissoutes et stockage l'intrieur (intracellulaire).
ADSORPTION
Stockage des substances polluantes non dissoutes la surface d'un corps quelconque ou de
cellules bactriennes (ne pas confondre avec l'absorption qui se fait l'intrieur de la cellule).
AERATION
Opration consistant introduire mcaniquement de l'air dans un liquide.
AEROBIE
Les micro-organismes intervenant dans l'puration des eaux sont dits arobies s'ils empruntent
l'oxygne qui leur est ncessaire l'air atmosphrique ou l'air dissous artificiellement dans
l'eau. On dit qu'ils oprent en phase arobie ou en arobiose.
Prsence doxygne dissous (O2) et doxygne li (nitrates et/ou nitrites) dans le milieu.
AMONT
Ct d'o vient l'eau.
ANAEROBIE
Les micro-organismes sont dits anarobies si leur activit s'exerce l'abri de l'air. Ils
travaillent en phase anarobie ou en anarobiose. Par extension, un milieu anarobie est un
milieu o il n'y pas d'oxygne dissous ni d'oxygne li (nitrates ou nitrites).
ANALYSE
Chapitre 20 Glossaire page
409
Dtermination de laboratoire permettant de mesurer certaines caractristiques des effluents.
ANOXIE
Prsence doxygne li (nitrates et/ou nitrites) dans le milieu mais pas doxygne dissous
(O2).
ASSAINISSEMENT AUTONOME
Dispositif de collecte et de traitement individuel des eaux uses, tabli gnralement sur le
domaine priv, proximit de la maison desservie (normalisation europenne DTU 64.1)
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Rseau de collecte des eaux uses (rseau sparatif) et ventuellement des eaux pluviales
(rseau unitaire) tabli gnralement sur le domaine public, vers les dispositifs de traitement
collectif (station de traitement des eaux uses appele communment puration...)
ATMOSPHERE
Milieu dans lequel nous vivons, compos de gaz (azote, oxygne, gaz carbonique, pour
l'essentiel) .
AUTOCURAGE
Le curage d'un rseau sans intervention extrieure, sous la seule action du courant d'eau. C'est
le rle des rservoirs chasses d'eau lorsque les pentes sont insuffisantes.
AUTOEPURATION
Ensemble des processus physiques, chimiques, biologiques, permettant un milieu naturel
pollu de retrouver son tat de puret originelle sans intervention extrieure.
AVAL
Ct vers lequel s'coule l'eau (foss, ru, rivire, fleuve, mer, ocan, lac).
AZOTE
Gaz (dsign par la lettre "N") entrant pour les 4/5 environ dans la composition de l'air
atmosphrique.
Chapitre 20 Glossaire page
410
AlR LIFT
Bduwe, pompe mammouth, ascenseur air.
BACTERlES
Micro-organisme infrieur form d'une seule cellule (monocellulaire), dpourvu de noyau
(procaryote) gnralement dpourvu de chlorophylle et se reproduisant par scission. Leur
matriel gntique est de l'ADN circulaire diffus dans le cytoplasme de la cellule.
On distingue :
- les organismes hetrotrophes : elles sont chimioorganotrophes et exigent une
source de carbone organique (elles dgradent la matire organiques)
- les organismes autotrophes : parmi lesquels ont distingue :
- les phototrophes : ce sont les algues, les plantes, ainsi que
certaines bactries qui utilisent l'nergie lumineuse pour
synthtiser meur matire organiques partir de CO
2
(ce sont
des photosynthses, ncessitant des pigments)
- les chimiotrophes : dnus de pigment, oxydent des
substances minrales et utilisent l'nergie ainsi libre pour
synthtiser ensuite la matire organique partir de CO
2
, qui
est leur source carbone.
BACTERIES FILAMENTEUSES
Type de bactries se dveloppant parfois dans les bassins d'aration. La prolifration de telles
bactries entrane un foisonnement des boues pouvant provoquer des "accidents" de
dcantation (dpart de boues avec l'effluent pur). Certaines de ces bactries sont en plus
gnratrices de "mousses" stables que l'on retrouve en surface des dcanteurs secondaires.
BACTERIOLOGIE
Partie de la biologie concernant les bactries.
BASICITE
Voir pH.
BASSIN D'AERATION
Ouvrage dans lequel on dveloppe une culture de micro-organisme en suspension dans un
milieu liquide ar (ou oxygn) mcaniquement (turbine, pont-brosse, insufflation d'air).
BASSIN COMBINE
Chapitre 20 Glossaire page
411
Type de station boues actives, dans lequel le dcanteur secondaire et le bassin d'aration
ont des cloisons communes, ce qui prsente l'avantage de diminuer les frais d'investissement
en gnie civil. Le systme est caractris par le fait que la recirculation des boues du
dcanteur secondaire vers le bassin d'aration s'effectue gravitairement par des lumires de
communication situes la partie infrieure.
BIOCHIMIE
Partie de la biologie traitant des phnomnes chimiques de la vie.
BIODEGRADATION
Phnomne de dgradation d'un corps par certains tres vivants.
BIODEGRADABILITE
Aptitude d'un corps tre dgrad biologiquement (par les tres vivants).
BIOLOGIE
Science qui a pour objet l'tude des tres vivants et les phnomnes dont ils sont le si e.
BOUES
Une station de traitement des eaux uses est une usine boues. Les boues sont extraites des
dcanteurs et sont constitues d'un mlange d'eau et de matires en suspension (floc ou
biofilm).
BOUES ACTIVEES
Boues qui se dveloppent sous forme de flocons ou flocs au cours de l'aration des eaux
uses. Elles sont constitues d'espces vivantes assurant la dgradation de la pollution (micro-
organismes) et de matires inertes qui ont la facult de dcanter.
BOUES EN EXCES
C'est l'excdent de boues actives (cultures libres) ou de biofilms (cultures fixes) prsent
dans le systme provenant dune part, du dveloppement des micro-organismes en prsence
de pollution, et dautre part, des matires non biodgradables prsentes dans leffluent. Cet
excdent doit tre extrait quotidiennement.
BY-PASS
Chapitre 20 Glossaire page
412
Canalisation permettant de court-circuiter (by-passer) la station d'puration ou une partie de la
station.
CAPACITE D'UNE STATION
C'est la charge thorique normale pour laquelle la station a t conue. Cette capacit est
gnralement exprime en quivalents-habitants, en DBO5, MES...
CELLULE
Elment fondamental constituant toute substance vivante. Les bactries sont unicellulaires (ou
monocellulaires) c'est--dire constitues d'une seule cellule.
CHAPEAU
Crote forme la partie suprieure d'un digesteur anarobie par les matires flottantes.
CHARGE BRUTE
La charge brute est dfinie par la quantit de DBO5 calcule sur la base de la charge
journalire moyenne de la semaine la plus charge au cours dune anne donne (art. 1 du
dcret du 03.06.1994). La notion de charge brute correspond la totalit de la pollution
thorique produite, que cela soit dans une zone dassainissement collectif ou non collectif
(art. 14 C du dcret du 03.06.1994, o il est considr que la charge polluante dun quivalent
habitant est uniformment gale 60 g DBO5/j).
CHARGE ET DEBIT DE REFERENCE
Valeurs retenues pour le dimensionnement des ouvrages, tenant compte des variations
saisonnires; ce dbit et ces charges sont constitus du dbit et des charges de matires
polluantes produits par temps sec dans la zone dassainissement collectif que les ouvrages de
collecte desservent et de la part du dbit et des charges des eaux pluviales retenues par la
commune.
CHARGE NOMINALE
En rfrence la nomenclature et au classement de la station conformment au dcret du 29
mars 1993 et aux arrts du 22 dcembre 1994.
CHARGE MASSIQUE ( Cm)
Chapitre 20 Glossaire page
413
Charge massique ou facteur de charge (f), dans une station boues actives, c'est le rapport
entre le poids de la DBO5 limine (reue) journellement dans le bassin d'aration (et la zone
d'anoxie si elle existe) et le poids de micro-organismes (MVS) contenue dans ces bassins .
Ex : Cm = 0,1 Kg DBO5 / Kg MVS/j.
CHARGE POLLUANTE
Quantit de pollution transitant pendant un temps dfini, gnralement un jour, dans un
rseau, ou une station d'puration. S'exprime en kg DBO5/j, kg DCO/j, kg MEST/j.
CHARGE VOLUMIQUE (CV)
Rapport entre le poids de DBO5 limin (reue) journellement dans le bassin d'aration (et
la zone d'anoxie si elle existe) et le volume du bassin d'aration (et la zone d'anoxie si elle
existe). Ex : une station reoit 50 Kg DBO5 / j, le volume du racteur biologique (aration et
anoxie) est de 170 m3, la charge volumique CV = 0,3 Kg DBO5/m3.j.
CHENAL
Forme originale de bassins d'aration dans lequel les eaux sont soumises une circulation
permanente.
CHLOROPHYLLE
Substance organique, constituant cellulaire de la plupart des vgtaux ; grce elle, les
plantes sous l'action de la lumire, absorbent le gaz carbonique, en fvcent le carbone pour
l'dification de leurs tissus et rejettent de l'oxygne.
CLARIFICATEUR
En gnral on parle de clarificateur en eau potable et de dcanteur secondaire en eau uses. Le
dcanteur secondaire est la seconde partie du traitement biologique. Il est situ aprs le bassin
d'aration (cas boues actives) et sert sparer les boues de l'eau interstitielle par dcantation.
CLIFFORD
Buse situe au centre d'un dcanteur circulaire, destine assurer la rpartition rgulire de
l'effluent.
CONDITIONS NORMALES
Chapitre 20 Glossaire page
414
Le dbit d'air sec dun surpresseur sexprim en Nm
3
/h (normaux m
3
d'air) en rfrence aux
conditions normales ; 273 K ou 0C, Pn = 1 atm = 10332 mm CE = 1,01325 bars =
1013,25 mbars = 101,325 KPa = 760 mm Hg.
CONDITIONS STANDARD
Les performances des arateurs s'expriment en terme d'apport spcifique brut en eau claire
(ASB) en kgO
2
/kwh absorb dans des conditions dites standard (eau claire, concentration
nulle en O
2 dissous
, T = 10C, pression atmosphrique = 1,013 bars ou 10,33 mCe).
CONCENTRATEUR
Ouvrage destin paissir les boues.
CYTOPLASME
Constituant interne de la cellule ne comprenant pas le noyau.
Le cytoplasme renferme des organites comme les mitochondries, les lysosomes le rticulum
endoplasmique, l'appareil de Golgi, des ribosomes. Il est entour par la membrane cellulaire.
Son compartiment principal vid de ses organelles est le cytosol.
Le cytoplasme est le sige de nombreuses ractions mtaboliques, y compris de la synthse
des protines au cours de la traduction des ARN messagers.
DBO5
Demande biochimique en oxygne. Quantit d'oxygne ncessaire la dgradation par
l'action bactrienne (biodgradation) de matires organiques contenues dans une eau pollu.
La DBO
5
est la mesure de la DBO effectue sur 5 jours.
DCO
Quantit d'oxygne ncessaire la transformation par voie chimique des matires organiques
(biodgradables mais aussi rfractaires) et ventuellement d'une partie des matires minrales.
DECANTATION
Sparation par gravit des matires en suspension contenues dans un effluent.
DECANTEUR-DIGESTEUR
Ouvrage combin dont la partie suprieure assure la dcantation des boues qui sont digres
dans la partie infrieure.
Chapitre 20 Glossaire page
415
DECANTEURS PRIMAIRE ET SECONDAIRE
le dcanteur primaire, lorsqu'il existe, prcde l'puration biologique ;
le dcanteur secondaire (ou clarificateur) fait partie du traitement biologique et est situ
aprs le bassin d'aration (ou le lit bactrien, les disques biologiques).
DEGRAISSEUR
Voir dshuileur.
DEGRILLEUR
Installation de prtraitement permettant de retenir les matires en suspension grossires par
une grille.
DEMANDE BIOCHIMIQUE EN OXYGENE EN 5 JOURS (DBO5)
Voir DBO5.
DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGENE {DCO)
Voir DCO.
DENITRIFICATION
Processus biochimique au cours duquel les nitrates (NO3) sont transforms finalement en
azote (gaz) par des bactries htrotrophes.
DESHUILEUR - DEGRAISSEUR
Ouvrage de prtraitement conu pour piger les huiles et les graisses, il peut tre statique,
ar, racl ...
DESSABLEUR
Ouvrage de prtraitement permettant de sparer de l'eau les matires solides organiques,
sable, gravier, etc...
DEVERSOIR D'ORAGE
Chapitre 20 Glossaire page
416
Ouvrage permettant de rejeter directement dans le milieu naturel un dbit d'eau excdentaire
d aux prcipitations atmosphriques.
DIGESTION
Opration effectue dans un ouvrage appel digesteur et destine transformer les matires
organiques biodgradables afin de les stabiliser et rduire les nuisances qu'elles pourraient
provoquer pour l'environnement (odeurs). La digestion arobie (stabilisation) s'effectue en
prsence d'air, c'est--dire en arobiose.
DILACERATEUR
Appareil destin dchiqueter les matires solides en suspension dans l'eau.
DILUTION
Mlange entre une eau use et une eau non pollue.
DISQUE BIOLOGIQUE
Principe de traitement bas sur le dveloppement de micro-organismes fixs (cultures fixes)
sur des disques rotatifs haute surface d'accrochage demi-immergs dans lesquels l'aration
s'opre par contact avec l'air.
DISQUE DE SECCHI
Instrument form d'une canne gradue au bout de laquelle est fix un disque blanc de 20 30
cm de diamtre. Cet instrument permet d'valuer la transparence de l'eau dans les dcanteurs
secondaires en notant la profondeur d'immersion partir de laquelle le disque n'est plus
visible.
DOSAGE
Dtermination de la concentration de tel ou tel lment dans une solution par un procd
analytique prcis.
Chapitre 20 Glossaire page
417
EAUX PARASITES
Ensemble des eaux propres de temps sec qui surchargent inutilement un rseau, nuisant au
bon fonctionnement d'une station d'puration : eaux d'infiltration, de drainage, de sources,
entre autres. Il peut aussi y avoir des eaux parasites d'origine pluviale, dues de mauvais
branchements (gouttires...).
EAUX VANNES
Eaux domestiques contenant exclusivement les urines et matires fcales.
ECOLOGIE
Science traitant des rapports rciproques des tres vivants entre eux et dans le milieu o ils
vivent.
EFFLUENT, EAU RESIDUAIRE
Synonyme d'eaux uses brutes ou pures, d'origine domestique ou industrielle.
ENSEMENCER
Apporter une station en drainage les micro-organismes qui permettront une mise en route
plus rapide.
ENZYME
Protine produite par un tre vivant pour catalyser des ractions biochimiques spcifiques,
dans des conditions compatibles avec la vie.
Les enzymes sont inactives par des tempratures leves, comme la majorit des protines.
Dans l'organisme, leur action est module par les concentrations du milieu et donc par les
besoins des cellules, par l'action de protases ou de kinases.
Le gnie enzymatique permet la production de ces biocatalyseurs, utilises en particulier
dans les biotechnologies, en gnie gntique.
Les enzymes sont labores dans les cellules, chaque enzyme tant l'expression d'un gne. Ce
sont les catalyseurs hautement spcifiques des ractions chimiques ncessaires la vie :
synthse, dgradation des molcules du vivant, mais aussi activation ou inactivation d'autres
protines (par phosphrylations par exemple : kinases et phosphatases).
EPAISSISSEMENT
Augmentation de la concentration des boues en excs par diffrents procds (gravitaire,
gouttage).
Chapitre 20 Glossaire page
418
EPANDAGE
Opration consistant pandre sur le sol des boues ou de l'eau.
EPURATION BIOLOGIQUE
Traitement de l'eau use (aprs prtraitement et dcantation primaire ventuelle) par des
procds biologiques permettant la transformation de la matire organique dissoute en matire
dcantable, et son limination par dcantation (secondaire).
EQUIVALENT-HABITANT
Notion utilise pour exprimer la charge polluante d'un effluent par comparaison avec celle
d'un habitant. Elle est fixe par arrt ministriel pour 5 ans. Un quivalent-habitant
reprsente 90 g de MES, 57 g de Matires Oxydables, 15 g d'Azote, 4 g de Phosphore...
EXTRACTION
Soutirage des boues d'un digesteur, d'un bassin d'aration, d'un silo boues.
FERMENTATION ACIDE
Premire phase de digestion anarobie des boues provoque par des bactries productrices
d'acides.
FERMENTATION METHANIQUE OU BASIQUE
C'est le second stade de la digestion anarobie des boues provoque par des bactries. Au
cours de cette fermentation, il y a production de gaz mtbane (ch4).
FILM BIOLOGIQUE OU ZOOLOGIQUE
Pellicule de micro-organismes sur les disques biologiques ou sur le matriau constituant un lit
bactrien ou tout support minral (biofiltre).
FILTRE A BANDES
Dispositif mcanique de dshydratation continue des boues par pressage entre 2 toiles.
FILTRE PRESSE
Chapitre 20 Glossaire page
419
Dispositif mcanique de dshydratation discontinue des boues par pressage entre 2 toiles dans
une enceinte ferme.
FLOC
Agglomration des colonies de micro-organismes prsents dans un bassin d'aration.
L'ensemble des grains de floc constitue la boue active ou biologique.
FOSSE IMHOFF
Combinaison d'un dcanteur primaire et d'un digesteur non chauff permettant la digestion
des boues avec un trs long temps de sjour.
GAZ DE DIGESTION
Ce sont les gaz produits au cours de la digestion anarobie : mthane et gaz carbonique.
GRANULOMETRIE
Indique le calibre d'un matriau granuleux comme le sable, le gravier.
GRAVITAIRE
L'alimentation d'une station est dite gravitaire lorsque le niveau du rseau d'gout est plus
haut que le niveau de la station. l'eau pntre donc dans les ouvrages par gravit, sans qu'un
relevage soit ncessaire.
GRILLE G.D.E
Dispositif mcanique d'paississement des boues par gouttage sur une grille inox
longitudinale fente avec apport de polymre permettant la formation de floc.
HYDROGENE
Gaz (dsign par la lettre "H") entrant notamment dans la composition de l'eau.
HYDROGENE SULFURE
Chapitre 20 Glossaire page
420
Gaz nausabond (oeuf pourri) compos d'hydrogne et de soufre, dont la formule est H
2
S. Il
se dveloppe dans les rseaux, les postes de relvement, les refoulements, lorsque le temps de
sjour est long. I1 se combine avec l'humidit pour former de l'acide sulfurique qui provoque
de multiples corrosions et dgradations.
INDICE DE MOHLMAN
Caractrise la facilit la dcantation des boues dans un bassin d'aration.
Lindice de Mohlman correspond au rapport entre le volume de boue(V) aprs 30 minutes de
dcantation en prouvette d1 litre de la liqueur mixte sans dilution et la masse de boue (M)
contenue dans ce volume.
L'indice est destin principalement la caractrisation des boues biologiques et reprsente le
volume de la boue occup par 1 g de cette boue :
IM = V ml/g
M
IM : Indice de Mohlman (en ml/g)
V : Volume de boues aprs 30 min. de dcantation (ml ou cm
3
)
M : MES prsentes dans ce volume (g)
INDICE DE BOUE
Lorsque lIndice de Mohlman tel que dfini ci-dessus ne peut -tre mesur (boue trop
concentre, mauvaise dcantation , etc.), il faut procder une srie de dilutions.
Ces dilutions sont ralises avec de leau traite dsoxygne.
La dilution adquate est retenue quand le volume de boue aprs 30 minutes de dcantation est
infrieur 250 ml (lindice de boue reste constant et nest plus influenc par la concentration
en boue de lchantillon).
IB = V ml/g
M x d
IB: Indice de boue (en ml/g)
V : Volume de boues aprs 30 min. de dcantation (ml ou cm
3
)
M : MES prsentes dans ce volume (g)
d : Taux de dilution (par exp : ou 1/4)
Chapitre 20 Glossaire page
421
INHIBITEURS
Produits ralentissant ou bloquant une raction biochimique. Ex : le Nickel et le plomb ont des
effets nfastes sur un traitement biologique des concentrations de quelques mg/l.
LAGUNAGE NATUREL
Traitement des effluents bas sur des trs longs temps de sjour (environ 2 mois) dans des
bassins de faible profondeur dans lesquels l'aration est assure par photosynthses (UV) au
moyen de micros algues (microphytes).
LAGUNAGE ARTIFICIEL OU AERE
Traitement des effluents bas sur des temps de sjour de lordre de 15 jours dans des bassins
quip de dispositif mcanique pour lapport en oxygne (turbine flottante ou insufflation
dair).
LAME DEVERSANTE
Elle permet l'vacuation de l'eau par dbordement. Sur un dcanteur, elle peut tre plate ou en
dents de scie (crnele).
LIT DE SECHAGE
Ouvrage sur lequel on pand les boues lorsqu'on les extrait des digesteurs, des dcanteurs, des
silos... Le schage s'effectue par drainage d'abord, puis par vaporation naturelle ensuite.
MATIERES DECANTABLES
Substances susceptibles d'tre spares par dcantation.
MATIERES DISSOUTES
Les matires dissoutes sont solubilises dans l'eau, elles ne sont pas extraites par filtration ou
centrifugation mais par vaporation.
MATIERES EN SUSPENSION (M.E.S.)
MATIERES EN SUSPENSION TOTALES (M.E.S.T)
Ensemble des matires solides de diverses natures, insolubles, en suspension dans l'eau use,
susceptibles d'tre spares de l'eau du fait de leur dimension ou de leur poids spcifique par
Chapitre 20 Glossaire page
422
dcantation, filtration ou centrifugation. Pour en faire l'analyse, on fait une filtration ou
centrifugation, elles sont ensuite sches dans une tuve 105C, puis peses.
MATIERES VOLATILES EN SUSPENSION (M.V.S.)
Matires volatiles en suspension : fraction organique ou volatile des M.E.S. C'est cette partie
de ce qui a t dtruit lors de la calcination 550C dans un four.
MATIERES MINERALES
Par opposition aux matires organiques qui voluent dans le temps, les matires minrales
sont stables biologiquement (par exemple le sable). C'est la partie de MES qui a rsist lors de
la calcination 550C.
MATlERES ORGANIQUES
Matires constituant les tres vivants ou qui en proviennent.
METABOLISME
Ensemble des processus physico-chimiques lis la consommation et la dgradation de
substances nutritives chez les tres vivants, permettant de produire de l'nergie (catabolisme)
et de la matire (anabolisme).
Les ractions du mtabolisme cellulaire sont catalyses par des enzymes.
L'nergie issue du catabolisme (notamment des glucides) est stocke au sein de la cellule
grce la phosphorylation (formation d'un ester-phosphate) de l'A.D.P.(adnosine
diphosphate) en A.T.P. ( adnosine triphosphate), et libre par hydrolyse de l'ATP.
Le mtabolisme basal correspond l'nergie minimale consomme par un sujet jeun et au
repos pour assurer les fonctions vitales lmentaires.
METHANE (CH4)
Gaz issu de la digestion anarobie des boues. Ce gaz est combustible et peut tre utilis aprs
stockage dans un gazomtre pour alimenter une chaudire assurant le chauffage du digesteur
(rcupration d'nergie).
MICRO-ORGANISME
Terme gnral englobant l'ensemble des organismes vivants non visibles l'oeil nu.
MILIEU RECEPTEUR
Lieu o sont dverses les eaux pures ou non. Ce peut tre une rivire, un lac, un tang, un
foss, une mer...
Chapitre 20 Glossaire page
423
MINERALISATION
Transformation de la matire organique en matire minrale.
MUCILAGE
Substance visqueuse scrte en particulier par les micro-organismes. Elle facilite
l'agglomration des bactries pour former le floc.
N
Azote
nd
nd : Non dcant
Ad2 : aprs dcantation de 2h
NH4
Reprsentation de l'ion Ammonium.
N-NH4
Reprsentation de l'ion Ammonium exprim en N.
NO2
Reprsentation de l'ion Nitrite.
N-NO2
Reprsentation de l'ion Nitrite exprim en N.
NO3
Reprsentation de l'ion Nitrate.
N-NO3
Reprsentation de l'ion Nitrate exprim en N
NTK
Reprsentation de l'Azote Total mesur par la mthode de KJELDAHL. C'est la somme de
l'azote organique + l'azote ammoniacal.
NGL
Chapitre 20 Glossaire page
424
Reprsentation de l'Azote Global = NTK + N-N02 + N-N03
NEUTRALISATION
Addition de produits chimiques dans le but de ramener une solution au pH de la neutralit
- une solution basique sera acidifie
- une solution acide sera basifie
NITRIFICATION
Processus biologique par lequel l'Azote ammoniacal est transform en Nitrites (N02) puis
Nitrates (N03).
NOUVEAU TRONCON
Toute construction nouvelle, extension ou rhabilitation du systme de collecte ; toute
incorporation douvrages existants au systme de collecte.
OXYGENE
Gaz dsign par la lettre "O" entrant dans la composition de l'eau. Trs rpandu dans la nature
o il reprsente le cinquime de l'atmosphre. I1 est ncessaire la respiration des tres
vivants ( l'tat de gaz dissous dans l'eau pour les tres aquatiques arobies).
PATHOGENE
Gnrateur de maladie. Ex : Bacille de Koch : le BK est l'agent de la tuberculose. Les
Salmonelles provoquent la typhode et la paratyphode.
PHOTOSYNTHESE
Les vgtaux pourvus de chlorophylle transforment des substances minrales en substances
organiques ncessaires leur dveloppement sous l'influence de la lumire (voir
chlorophylle).
POTENTIEL D'HYDROGENE (pH)
Caractrise la diffrence entre les acides et les bases
Acide : pH infrieur 7 (ex : vitriol ou acide actique vinaigre)
Base : pH suprieur 7 (ex : soude caustique)
Point neutre : l'eau distille.
Chapitre 20 Glossaire page
425
POTENTIEL D'OXYDO-REDUCTION
POLLUTION
Altration du milieu naturel par des lments nuisibles son utilisation ou aux tres vivants.
PREDATEUR
Organisme se nourrissant d'individus d'une autre espce, en gnral plus petite. Ex : les
protozoaires sont prdateurs de bactries.
PRESSDEG
Filtre bande Degrmont.
PRETRAITEMENT
Traitement prliminaire ou partiel pouvant intervenir soit :
- sur un effluent industriel qui, s'il tait directement rejet dans le rseau, nuirait celui-ci ou
au fonctionnement de la station d'puration
- En tte d'une station d'puration et destin liminer les plus gros dchets solides, les huiles
et graisses (dgrilleur, dessableur, dilacrateur, dshuileur).
PROTOZOAIRE
Animal unicellulaire -50 000 espces ont t dcrites. Dans les boues actives, la classe la
plus reprsente est celle des cilis qui sont bactriophages, c'est--dire qu'ils se nourrissent
de bactries.
PT
Phosphore total
PT1
Norme sur phosphore ntant plus en vigueur
PT2
Norme sur phosphore ntant plus en vigueur
PROTEINE
Macromolcule organique compose essentiellement d'acides anims polymriss par liaison
peptidique ( liaison carbone-azote : CO-NH)
RADlER
Chapitre 20 Glossaire page
426
Partie infrieure d'un ouvrage.
RECIRCULATION-RECYCLAGE
Cette opration consiste rintroduire dans la partie antrieure d'un circuit la totalit ou une
partie de l'eau ou des boues.
REGLE DE CONFORMITE
Un chantillon moyen journalier est dclar conforme, si lune au moins des 2 valeurs (
concentration au rejet, rendement puratoire) figurant dans lautorisation de rejet, est
respecte. Cette dmarche est conduite paramtre par paramtre.
RENDEMENT
Caractrise l'efficacit d'une station d'puration et s'exprime en pourcentage. C'est le rapport
entre la quantit de pollution limine et la quantit de pollution entrant dans le dispositif
d'puration pendant la mme priode
Ex : entre station : 50 kg DBO5/j
sortie station : 10 kg DBO5/j
Rendement en 24 h sur la DBO5 : ((50-10) f 50) x 100 = 80 %
RESEAU D'ASSAINISSEMENT
Rseau situ dans le domaine public et assurant le transport des eaux uses urbaines, pluviales
et ventuellement des eaux industrielles.
RESEAU SEPARATIF
Il est constitu par deux canalisations. L'une reoit les eaux uses, l'autre les eaux pluviales.
RESEAU UNITAIRE
Rseau d'assainissement assurant, dans la mme conduite, le transport des eaux uses et
pluviales.
Chapitre 20 Glossaire page
427
SILO CONCENTRATEUR
Voir "Concentrateur".
SILO STOCKEUR
Ouvrage de grande capacit, permettant de stocker les boues pendant plusieurs mois, durant
l'hiver ou les priodes dfavorables l'pandage.
STABILISATION DES BOUES
Voir "Digestion arobie" ; "Minralisation".
STEU
Station de traitement des eaux uses (vulgairement appele "station d'puration")
SYSTEME DASSAINISSEMENT
Le systme est compos du systme de collecte et du systme de traitement
SYSTEME DE COLLECTE
Le systme de collecte dsigne le rseau, mais englobe les dversoirs dorage, les ouvrages de
rtention et de traitement deaux de surverse situs sur le rseau
SYSTEME DE TRAITEMENT
Le systme de traitement dsigne les ouvrages dassainissement mentionns la rubrique
5.1.0 (1) du dcret du 29.03.1993 (ouvrage recevant ou de capacit suprieure 120 kg de
DBO5/j soumis autorisation) et les ouvrages connexes ( bassins de rtention, ouvrages de
surverses ventuels...)
TAUX DE COLLECTE
Le taux de collecte est le rapport de la quantit de matires polluantes capte par le rseau la
quantit de matires polluantes gnres dans la zone desservie par le rseau.
La quantit de matires polluantes capte est celle parvenant aux ouvrages de traitement
laquelle se rajoutent les boues de curage et de nettoyage des ouvrages de collecte.
Chapitre 20 Glossaire page
428
TAUX DE RACCORDEMENT
Le taux de raccordement est le rapport de la population raccorde effectivement au rseau la
population desservie par celui-ci.
TESTS
Opration simple pouvant tre ralise sur le terrain et permettant d'apprcier la qualit du
fonctionnement d'une station d'puration. Ex : test de dcantation en 30 mn, test au
permanganate.
TRAITEMENT PHYSICO-CHIMIQUE
Traitement des effluents par dcantation aprs adjonction de ractifs chimique de coagulation
et de floculation.
TURBIDITE
Diminution de la transparence d'une eau due la prsence de matires en suspension.
VITESSE ASCENSIONNELLE
Vitesse de monte de l'eau sans un dcanteur. C'est le rapport entre le dbit exprim en m3/h
et la surface du dcanteur exprime en m2. Ex : un dbit de 100 m3/h surface du dcanteur :
125 m2. La vitesse ascensionnelle est de 100 / 125 = 0.8 m
3
/m
2
.h.
ZOOGLEE OU FILM BIOLOGIQUE
Agglomration des micro-organismes, sous forme visqueuse, sur les bords des bassins ou sur
tout support minral.
Chapitre 21
METHODE DE CALCUL DUNE
FILIERE DE TRAITEMENT
BOUES ACTIVEES - TRES FAIBLE CHARGE -
NITRIFICATION ET DENITRIFICATION
TRAITEMENT DU PHOSPHORE
A. SADOWSKI
Mars 2002
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
430
430
TABLE DES MATIERES
I. CARACTERISTIQUES DE L'EFFLUENT A TRAITER................................................................................. 433
1.1) GENERALITES. .................................................................................................................................................. 433
1.2) ANALYSES DES PARAMETRES DE L'EFFLUENT A TRAITER. ................................................................................. 433
1.3) DETERMINATION DES FLUX POLLUANTS............................................................................................................ 435
1.4) DECOMPOSITION DES ERREURS. ........................................................................................................................ 436
1.5) DETERMINATION DES VALEURS EXTREMES AVEC UNE LOI NORMALE. ............................................................... 438
1.6) DETERMINATION DE LA CAPACITE DE L'INSTALLATION. .................................................................................... 438
1.7) DEFINITION DE L'EFFLUENT EN TEMPS SEC. ....................................................................................................... 440
1.7.1) Definition de la pollution domestique moyenne sur une zone industrielle............................................... 440
1.7.2) Dfinition de la pollution des matires de vidanges. ............................................................................... 440
Paramtres ......................................................................................................................................................... 440
Eaux uses .......................................................................................................................................................... 440
Matires de vidange ........................................................................................................................................... 440
DBO
5
/N /P ......................................................................................................................................................... 440
100 / 25 / 5.......................................................................................................................................................... 440
100 / 62 / 7.5....................................................................................................................................................... 440
1.7.3) Dfinition de la pollution des boues de curage........................................................................................ 440
1.7.4) Dbit de temps sec exprim en m
3
/j : ....................................................................................................... 441
1.7.5) Dbit de temps sec exprim en m
3
/ h....................................................................................................... 441
1.8) DEFINITION DES DEBITS EN TEMPS DE PLUIE...................................................................................................... 442
1.8.1) Typologie des diffrents dbits de pluie (au rseau unitaire) .................................................................. 442
1.8.2) Charge polluante en priode pluvieuse (au rseau unitaire)................................................................... 443
1.9) REGIME HYDRAULIQUE JOURNALIER................................................................................................................. 443
1.10) ROLE DES DIFFERENTS PARAMETRE AINSI DEFINIS. ......................................................................................... 443
2) NIVEAU DE REJET - RENDEMENT A ATTEINDRE................................................................................... 443
2.1) TRADUCTION DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE DU 21.05.1991 EN DROIT FRANCAIS....................................... 445
2.1.1) LE 1er ARRETE DU 22.12.1994 ............................................................................................................. 446
2.1.2) LE 2me ARRTE DU 22.12.1994 .......................................................................................................... 449
2.1.3) LA CIRCULAIRE n97-31 du 17 fvrier 1997......................................................................................... 450
2.2) CRITERES POUR LE CHOIX D'UNE FILIERE DE TRAITEMENT................................................................................. 451
2.3) DIAGRAMME DE CALCUL DU DIMENSIONNEMENT.............................................................................................. 452
III. DIMENSIONNEMENT DE LA FILIERE EAU.............................................................................................. 453
3.1) REMARQUES GENERALES ET HYPOTHESES DE DIMENSIONNEMENT. ................................................................. 453
3.2) RELEVEMENT EN TETE DE L'INSTALLATION. ...................................................................................................... 454
3.2.1) Volume de la bche de relvement. .......................................................................................................... 454
3.2.2) Hauteur manomtrique totale. ................................................................................................................. 455
3.2.2.1 ) Pertes de charge singulires ...............................................................................................................................455
3.2.2.2 ) Pertes de charges linaires..................................................................................................................................456
3.2.3) Puissance de la pompe. ............................................................................................................................ 458
3.2.3.1) Puissance sur arbre moteur..................................................................................................................................458
3.2.3.2) Puissance absorbe aux bornes moteur ...............................................................................................................459
3.2.4) Intensit lectrique absorbe aux bornes du moteur. .............................................................................. 459
3.2.5) Notion d'hydraulique de base................................................................................................................... 459
3.2.5.1) les canaux coulement libre..............................................................................................................................460
3.2.5.2) Les lames dversantes assimiles des dversoir frontaux.................................................................................460
3.3) BASSIN TAMPON................................................................................................................................................ 461
3.3.1) Dimensionnement du bassin tampon........................................................................................................ 462
3.4) BASSIN D'ORAGE OU BASSIN DE DEPOLLUTION.................................................................................................. 463
3.5) CALCUL DU PRETAITEMENT .............................................................................................................................. 463
3.5.1) Dgrilleur................................................................................................................................................. 463
3.5.1.1) Estimation des quantits de refus de dgrillage...................................................................................................465
3.5.2) Dessablage seule...................................................................................................................................... 465
3.5.3) Dessablage combin avec le dgraissage. ........................................................................................... 466
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
431
431
3.5.3.1) Dimensionnement de l'aroflot............................................................................................................................466
3.5.3.2) Estimation des quantits de sables. .....................................................................................................................467
3.5.3.2) Lavage des boues de curage...............................................................................................................................467
3.5.3.3) Estimation des quantits de graisses. ..................................................................................................................468
3.5.3.4) Traitement biologique des graisses .....................................................................................................................468
3.6) CALCUL DE LA ZONE DE CONTACT .................................................................................................................... 470
3.7) CALCUL DE LA PRODUCTION DE BOUES EN EXCES ............................................................................................. 470
3.7.1) Remarques prliminaires ......................................................................................................................... 470
3.7.2) Production de boues en excs biologiques............................................................................................... 471
3.7.2.1. Charge massique de rfrence appliquer en fonction du rendement de la DBO
5
.............................................472
3.7.2.2. Charge massique de rfrence appliquer en fonction de l'ge de boue.............................................................473
3.7.3) Production de boues physico-chimiques.................................................................................................. 474
3.8) CALCUL DU CLARIFICATEUR SECONDAIRE................................................................................................... 475
3.9) COMPARAISON ENTRE DIFFERENTES METHODES DE DIMENSIONNEMENT DES
CLARIFICATEURS............................................................................................................................................... 482
3.9.1) Rappel ...................................................................................................................................................... 482
3.9.2) Approche dimensionnelle......................................................................................................................... 482
3.9.2.1 ) La surface de clarification (approche CIRSEE) .................................................................................................482
3.9.2.2 ) La surface de clarification (approche CEMAGREF) .........................................................................................483
3.9.2.3 ) La surface de clarification (approche ATV A131) .............................................................................................484
3.9.2.4 ) Application des diffrentes mthodes sur lvaluation de la vitesse ascensionnelle ..........................................485
3.9.2.5 ) Volume de clarification (approche CIRSEE) .....................................................................................................486
3.9.2.6 ) Volume dpaississement (approche CIRSEE) ..................................................................................................487
3.9.2.7 ) Volume du clarificateur (approche CEMAGREF) .............................................................................................488
3.9.2.8 ) Volume du clarificateur (approche ATV A 131)................................................................................................488
3.9) DIMENSIONNEMENT DE LA ZONE D'ANOXIE....................................................................................................... 489
3.10) DENITRIFICATION SIMULTANEE (EXOGENE + ENDOGENE) ............................................................................... 492
3.11) DIMENSIONNEMENT DU BASSIN D'AERATION................................................................................................... 494
3.12) CALCUL DES BESOINS EN OXYGENE ................................................................................................................ 495
3.12.1)Capacit d'oxygnation ncessaire en pointe ......................................................................................... 496
3.13) DIMENSIONNEMENT DES AERATEURS.............................................................................................................. 496
3.13.1) Coefficient global de transfert (C.G.T) .................................................................................................. 496
3.13.2) Puissance thorique absorbe................................................................................................................ 497
3.13.3) Aration par turbine ou pont brosse. ..................................................................................................... 498
3.13.4) Aration par insufflation d'air . ............................................................................................................. 499
3.13.4.1) Calcul de dbits d'air: ........................................................................................................................................499
3.13.4.2) Calcul de la puissance consomme des surpresseurs : ......................................................................................501
3.13.4.3) Dbit de ventilation du local de surpression......................................................................................................501
3.14) BRASSAGE DU BASSIN D'AERATION................................................................................................................. 502
3.14.1) Dbit de pompage dun agitateur .......................................................................................................... 502
3.14.2) Expression de la vitesse moyenne de circulation................................................................................... 503
3.14.3) Relation entre la puissance dissipe & la vitesse moyenne de circulation ........................................... 503
3.14.4) Relation entre la puissance spcifique, la vitesse et la gomtrie du chenal......................................... 503
3.14.5) La vitesse horizontale induit par le mobile dagitation ......................................................................... 503
3.14.6) Incidence du spiral flow......................................................................................................................... 505
3.14.7) Synthse sur lapport du brassage dans les performances doxygnation ............................................ 505
3.14.8) Regroupement ou densit des raquettes................................................................................................. 506
3.14.9) Rgles respecter pour le positionnement des agitateurs (optimiser sa pousse) ................................ 506
3.14.10) Optimisation des conditions hydrodynamiques des racteurs ............................................................. 506
3.14.11) Puissance de brassage ......................................................................................................................... 507
3.15) DIMENSIONNEMENT POMPE D'INJECTION DES SELS METALLIQUES .................................................................. 507
3.15.1) Choix des ractifs................................................................................................................................... 507
3.15.2) Volume de la cuve de stockage du ractif (cas du clairtan)................................................................... 508
3.15.3) Bilan TAC avec le traitement de lazote et du phosphore...................................................................... 509
3.15.3.1) Rappel des units employes.............................................................................................................................509
3.15.3.2) Consommation et restitution dalcalinit...........................................................................................................509
3.15.3.3) Stabilit du pH dans le racteur et sur leau triat.............................................................................................510
3.15.3.4) Bilan TAC entre / sortie sur une installation ..................................................................................................510
3.16) CALCUL DES DEBITS DES POMPES DE RECIRCULATION DES BOUES................................................................... 511
3.17) EVALUATION DES CONCENTRATIONS DE LEFFLUENT TRAITE ......................................................................... 513
3.17.1) Evalutation de la concentration de la DBO5 en sortie .......................................................................... 513
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
432
432
3.17.2) Evalutation de la concentration des MES en sortie ............................................................................... 513
3.17.3) Evalutation de la concentration de la DCO en sortie........................................................................... 513
IV. DIMENSIONNEMENT DE LA FILIERE BOUE. .......................................................................................... 513
4.1) FILIERE - EPAISSISSEUR STATIQUE HERSE + STOCKEUR..................................................................................... 514
4.1.1) Volume du stockeur des boues paissies. ................................................................................................. 515
4.1.2) Retour en tte de l'paississeur ................................................................................................................ 515
4.2) FILIERE - EPAISSISSEMENT DYNAMIQUE + STOCKEUR........................................................................................ 516
4.2.1) Volume du stockeur des boues ................................................................................................................. 517
4.3) DESHYDRATATION PAR FILTRE BANDE.............................................................................................................. 517
4.3.1) Retour en tte du filtre bande................................................................................................................... 517
4.3.2) Aire de stockage boues dshydrates....................................................................................................... 518
4.4) CHAULAGE DES BOUES ............................................................................................................................. 518
4.4.1) Raction chimique.................................................................................................................................... 518
4.4.2) Siccit immdiate ..................................................................................................................................... 519
4.4.3) Siccit aprs contact de 30' ...................................................................................................................... 519
4.4.4) Siccit aprs contact de 24 h.................................................................................................................... 519
4.4.5) Exemple de calcul .................................................................................................................................... 519
4.4.5.1) Siccit immdiate avec 52 % CaO......................................................................................................................519
4.4.5.2) Siccit aprs 30' de temps de contact ..................................................................................................................520
4.4.5.3) Siccit aprs 24 h de temps de contact ................................................................................................................520
4.5) DESHYDRATATION PAR FILTRE PRESSE........................................................................................................ 520
4.5.1) Le filtre presse avec conditionnement minral......................................................................................... 520
4.5.1.1) Pourcentage de ractif introduire......................................................................................................................521
4.5.1.2 ) Masse de boues conditionne.............................................................................................................................521
4.5.1.3) Concentration de la boues conditionnes ............................................................................................................521
4.5.1.4) Epaisseur de gteau.............................................................................................................................................522
4.5.1.5) Siccit de la boue presse....................................................................................................................................522
4.5.1.6) Temps de presse ................................................................................................................................................522
4.5.1.7) Volume du filtre presse .......................................................................................................................................523
4.5.1.8) Surface du filtre...................................................................................................................................................523
4.5.1.9) Volume des boues presses .................................................................................................................................523
4.5.1.10) Volume occupe par la boue presse dans une benne .......................................................................................523
4.5.2) Le filtre presse avec conditionnement polymre ...................................................................................... 524
4.5.1.2) Boue actives trs faible charge..........................................................................................................................524
4.5.2.2) Passage FeCl
3
FeCl S0 4..................................................................................................................................525
4.5.2.3) Exemple 15 % FeCl
3
pur ou 5,17 % Fe ..........................................................................................................525
4.5.3) Le filtre presse membrane avec conditionnement polymre ................................................................. 526
4.5.4) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU CONDITIONNEMENT....................................................... 526
4.5.4.1) Debit de la pompe H.P ........................................................................................................................................526
4.5.4.2) Chaine de conditionnement .................................................................................................................................527
4.5.4.3) - Dtermination des doses mettre en oeuvre.....................................................................................................528
Mthode de mesure............................................................................................................................................. 528
Expression de la rsistance spcifique la filtration :....................................................................................... 529
Test de filtrabilit sous pression......................................................................................................................... 529
Dtermination du coefficient de compressibilit ................................................................................................ 531
Conditionnement mettre en oeuvre.................................................................................................................. 531
MISE EN OEUVRE DU CONDITIONNEMENT................................................................................................................. 531
CONDITIONNEMENT AUX POLYELECTROLYTES......................................................................................................... 531
Choix du polymere.............................................................................................................................................. 532
V. BIBLIOGRAPHIE................................................................................................................................................ 533
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
433
433
I. CARACTERISTIQUES DE L'EFFLUENT A TRAITER
1.1) GENERALITES.
L'tude des caractristiques de l'effluent traiter ncessite de se pencher sur les points suivants :
- dfinir une situation actuelle (S.A.).
- dfinir une situation prochaine (S.P.).
- dfinir une situation future (S.F.).
- rseau unitaire ou sparatif, comportement et fonctionnement des dversoirs
d'orage et des stockages intermdiaires.
- populations raccordes en situation actuelle, prochaine et future.
- pollution industrielle.
- pollution artisanale.
- zone artisanale ou industrielle projete dans le SDAU ou le POS.
- matires de vidanges traiter sur le site.
- boues de curage du rseau traiter sur le site.
- graisses extrieures traiter sur le site.
- traitement des eaux pluviales.
1.2) ANALYSES DES PARAMETRES DE L'EFFLUENT A TRAITER.
Les caractristiques des effluents traiter doivent tre obligatoirement
valides par des campagnes de mesure 24 h ( en temps sec et temps de pluie).
Les campagnes des mesures effectues "sur des chantillons prlevs en continu durant 24h
de faon que les volumes de prises soient proportionnels aux dbits instantans de l'effluent
avec constitution d'un chantillon moyen 24h refrigr", permet de dfinir "l'identit" ou la
"morphologie"singulire de l'effluent.
Ces campagnes de mesure 24h permettront en outre de vrifier la cohrence des rapports
entre eux :
DCO
DBO5
,
MES
DBO5
,
DBO5
NTK
,
N- NH4
NTK
,
DCO
Pt
et
MVS
MES
.
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
434
434
Relations entre les paramtres de pollution
Ratio
Effluent Urbain
strict
Signification
DCO
DBO5
2,2 2,4
indiquera la mixit et la biodgradabilit relative de l'effluent
MES
DBO5
0,8 1,2
aura une influence sur le % MVS de l'effluent et la production de boues
en excs
DBO5
NTK
4 - 5
indiquera la mixit relative de l'effluent et influencera le
dimensionnement du racteur biologique en cas de traitement de l'azote
(nitrification)
N- NH4
NTK
0,6 0,8
indiquera le degr d'ammonification ralis durant le transfert de
l'effluent dans le rseau ainsi que de la prsence potentielle d'une
situation "septique" (notamment lors de la prsence de conduite de
refoulement)
DCO
Pt
44 - 50
indiquera la mixit relative de l'effluent , les potentialits et la faisabilit
d'un traitement biologique du phosphore
MVS
MES
0,65 0,75
indiquera "l'organicit" de l'effluent ainsi que sa mixit relative, et aura
une incidence importante sur :
- la production de boues biologiques en excs,
- la qualit mcanique des boues actives (dfinie par son IM
ou IB),
- le taux de MVS dans le racteur biologique,
- le dimensionnement du racteur biologique tant pour le
traitement de la pollution carbone que pour la nitrification
et la dnitrification simultane (dans le mme
bassin),
- le dimensionnement du clarificateur (indirectement par
l'influence sur l'IM),
- le dimensionnement de la filire boue (directement par
l'influence sur la production de boue et indirectement par
l'influence sur l'IM)
DCO
NTK
8,8 - 12
indiquera la mixit relative de l'effluent et aura une influence sur la
dnitrification et sur l'intrt d'une zone d'anoxie dissocie du bassin
d'aration
Les MES dect, DBO
5ad2h
, DCO
ad2h
; les fractions dcantables permettent de dfinir les
performances des dcanteurs primaires et des boues primaires produites.
DBO
5
totale
= DBO
5
particulaire
+ DBO
5
soluble
+ DBO
5
collodale
DCO
totale
= DCO
particulaire
+ DCO
soluble
+ DCO
collodale
DBO
5
ad2h
= 60 67 % DBO
5
tot (pour un effluent domestique)
DCO
ad2h
= 60 67 % DCO tot (pour un effluent domestique)
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
435
435
La T ; le profil de la temprature pour dfinir les cintiques de nitrifications .
Rappel :
NTK = azote Kjeldahl = Azote organique + Azote ammoniacal = Norg + N-NH4
NGL = Azote global = NTK + N-NO2 + N-NO3
Pt = phosphore totale = P organique + P minral
Phosphore minral constitu par les orthophosphates = PO
4
-3
1.3) DETERMINATION DES FLUX POLLUANTS.
La dtermination quantitative de la pollution vhicule par les eaux uses fait appel la notion de
FLUX POLLUANTS.
La masse de polluant transite pendant un intervalle de temps T (pris souvent gal 24h) est le
rsultat de l'intgration sur cet intervalle du produit de la concentration du paramtre analyser
par le dbit de l'effluent pris en compte :
= c(t).q(t).dt
0
24
le flux moyen deviendra
24h 24h moyenne 24h
Q x C
=
avec
24h
Q
= dbit total sur 24h enregistr.
moyenne 24h C
=concentration moyenne des prlvements proportionnels.
Dans certains cas, il y aurau lieu de procder des chantillonnages horaires, pour valuer les
concentration horaires en pointe journalire, en moyenne journalire et en nocturne.
La dtermination des flux horaires, dduits directement de concentrations horaires et d'une courbe
horaire des dbits transitant durant 24 h sur l'installation, nous donnera une indication importante
pour la dtermination des besoins en oxygne en pointe et pour le dimensionnement du volume du
racteur dans le cas du respect sur le niveau en azote.
De plus, les dbits et les concentrations subissent des variations importantes dans le temps et qui
refltent les rythmes donc des pointes horaires (Cp), des pointes hebdomadaires (Ch) et des
pointes annuelles (Ca) ds l'activits domestique et industrielles.
Suivant le type de rseau et l'exigence d'un traitement des eaux pluviales, ces mesures devront tre
dfinies tant en priode de temps sec qu'en priode de temps de pluie, ces dernires devront tre
raccordes une mesure des prcipitations concernes en colonne de hauteur d'eau (pluviomtre
auget basculant).
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
436
436
La dtermination des flux polluants fait intervenir une suite de dmarches ncessitant chacune une
mthode et un matriel particulier :
- mesure de dbit......................... dtermination de q(t)
- prlvement des chantillons.......
- conservations et transports.......... dtermination de c
- analyse des chantillons..............
L'chantillonnage et l'analyse introduisent tous deux une erreur, et le plus souvent la premire est
trs suprieure la seconde.
Un plan d'chantillonnage tant toujours un compromis entre l'information recherche et le cot se
fera en fonction de ce que l'on veut chercher dterminer :
- un tat moyen : une charge moyenne hebdomadaire maximale pour dimensionner
la filire boue, par exemple.
- un percentile : il requiert d'tudier la distribution des valeurs et non les valeurs
elles-mmes.
- les tats extrmes : correspondant des percentiles levs, par exemple mesure des
flux 95 % non dpasss de l'effluent pour dterminer les besoins
en oxygne en pointe ou dimensionner les ouvrages sollicits
hydrauliquement (clarificateur...).
1.4) DECOMPOSITION DES ERREURS.
La moyenne des mesures effectues sur un chantillon vaut:
X=
x
n
i
Les indices centraux de dispersion les plus couramment employs sont :
La variance de l'chantillon :
2
=
( ) x x
n
i
2
L 'cart-type :
=
2
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
437
437
et le coefficient de variation :
CV =
x
100
La premire possibilit pour diminuer l'erreur totate est de multiplier le nombre de mesures.
Mais l'cart-type
x
de la distribution des moyennes d'chantillons ne diminue qu'avec la racine
carre du nombre des mesures :
x
=
n
est l'cart-type de la distribution des mesures individuelles.
Donc, pour doubler la prcision, il faut quadrupler les mesures.
Dcomposition des erreurs, en proddant une analyse sur chaque chantillon ;
totale
2
chantillon
2
analyse
2
= +
Pour des nombres n
e
d'chantillons et n
a
d'analyses sur chaque chantillons, nous avons la
formule plus gnrale :
totale
2
ech
2
e
anal
2
e a
n n .n
= +
Malgr des mthodes analytiques trs prcises, si l'chantillonnage introduit une erreur
importante, ce qui est souvent le cas, il apparait en rgle gnrale :
- qu'il est plus intressant de faire une seule analyse sur 3 chantillons, qu'une analyse en
double sur 2 chantillons .
- qu'il est plus intressant de faire une seule analyse sur 4 chantillons, qu'une analyse en
double sur 3 chantillons.
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
438
438
1.5) DETERMINATION DES VALEURS EXTREMES AVEC UNE LOI NORMALE.
X X +1,645
95%
=
le coefficient de variation tant :
V=
x
X X(1+1,645.V)
95%
=
Pour les autres probabilits avec P= F(u
p
), voir tableau ci-aprs :
u
p
P
0,0000 O,5000
0,2533 0,6000
0,4289 0,6666
0,5244 0,7000
0,6745 0,7500
0,8416 0,8000
1,2820 0,9000
1,6459 0,9500
1,9600 0,9750
2,3263 0,9900
2,5758 0,9900
Pour une probabilit de 90 % nous avons :
X X +1,2820.
90%
=
1.6) DETERMINATION DE LA CAPACITE DE L'INSTALLATION.
Lorsque l'on souhaite indiquer une notion de taille de l'installation dans diffrents documents
(A.P.S ou C.C.T.P...), l'on peut alors ramener lex flux dtermins une capacit exprime en
"Equivalent-habitant " et non l'inverse, c'est--dire dfinir les flux de l'effluent traiter par des
ratios rattachs l'quivalent -habitant.
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
439
439
L'ensemble peut tre ramen une pollution relative un quivalent-habitant (Eq.h.)
La pollution correspondant 1 Eq.h. est dfinie dans l'arrt du 06.11.1996.
Un quivalent-habitant reprsente journellement
Paramtres Valeur
Dbit 80 250 l/j ( boucler avec la consommation
AEP avec 20 30 % de pertes dans le rseau)
DCO 130 145 g
DBO5 60 g
MOX* 57 g
MES 55 70 g
55 g en rseau sparatif
60 70 g en rseau unitaire
NTK 15 g
Ptot 3 4 g
Lipides 15 20 g
Equitox 0,2 de matires inhibitrices
Mtox 0,23
AOX 0,05 g (composs organohalogns sur charbon
actif)
* avec MOX =
3
AD2
DCO
AD2
2DBO5 +
Nota : DBO5
AD2
ou DBO5
AD2h
correspond une DBO5 mesure aprs dcantation de 2h
1 Eq.h n'est pas vritablement un concept de dimensionnement et ne
correspond pas forcment la pollution gnre par un habitant.
Etabli lorigine par une approche statistique des mesures effectues, il sera trs variable
suivant le tissus urbain considr et la prsence d'une pollution industrielle.
C'est une notion plutt fiscale ou de communication pour indiquer la taille dune
installation de traitement des eaux uses.
Larrt du 6.11.1996 dfinit la quantit de pollution prendre en compte pour chaque
habitant.
Caractristiques moyennes des eaux rsiduaires urbaines (ERU) en France
Paramtres Echelle de variation Fraction dcantable
pH 7,5 8,5
Extrait sec 1000 3000 mg/l 10 %
DCO 400 1000 mg/l 30 35%
DBO5 200 400 mg/l 30- 35%
MES 200 400 mg/l 50 67 %
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
440
440
NTK 40 100 mg/l 7 10 %
N-NH4 30 80 mg/l 0%
N-NO2 0 mg/l 0%
N-NO3 0 mg/l 0%
Ptot 10 25 mg/l 5 10 %
Lipides 40 120 mg/l -
Dtergents 6 13 mg/l -
1.7) DEFINITION DE L'EFFLUENT EN TEMPS SEC.
1.7.1) Definition de la pollution domestique moyenne sur une zone industrielle.
Charge de pollution domestique moyenne sur une zone industrielle polyvalente (hors bien
entendu les activits industrielles), exprime en hectare occup (ha) ou en emploi.
Dbit = 6 m
3
/ ha/ j ou 100 l /emploi / j
DBO5 = 3,1 Kg / ha / j ou 57 g / emploi / j
MES = 2,2 Kg / ha / j ou 40 g / emploi / j
DCO ad2 = 60 g / emploi / j
1.7.2) Dfinition de la pollution des matires de vidanges.
Paramtres Concentration en g/l
DCO 6 30 g/l
DBO
5
2 8 g/l
MES 4 12 g/l
NTK 0,5 2,5 g/l
N-NH4 0,4 2 g/l
Ptot 0,1 0,5 g/l
pH 7,7 8,5
Paramtres Eaux uses Matires de vidange
DBO
5
/N /P 100 / 25 / 5 100 / 62 / 7.5
1.7.3) Dfinition de la pollution des boues de curage.
Paramtres Concentration en g/l
DCO 5 g/l
DBO
5
2 g/l
MES 6 g/l
NTK 0,005 0,1 g/l
N-NH4 g/l
Ptot 0,05 g/l
pH 6,8 8
Aprs dcantation de 2h nous avons ;
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
441
441
- 77% dabattement sur la DCO et DBO = 50% (vrifier)
- 88 % dabattement sur les MS
La dfinition du profil hydraulique fait intervenir les grandeurs suivantes :
1.7.4) Dbit de temps sec exprim en m
3
/j :
- Q
EU
(eaux domestiques)
- Q
EI
(eaux industrielles)
- Q
MV
(matires de vidange)
- Q
ECP
(eaux claires parasites ou de drainage permanent)
Notes :
- Le dbit ci-dessus correspond au dbit strictement domestique hors eaux claires parasites
(ECP) ou de drainage permanent.
- Le pourcentage de MVS dans les MES dpend du rapport MES/DBO
5
et de la mixit de
l'effluent (cf tableau ch. 3.4.2).
- N-NH
4
par rapport au NTK varie de 60 70% suivant la longueur du rseau et des
conditons de tansfert de l'effluent dans le rseau (prsence d'H2S ! T de leffluent).
- 1 g de MEH (matieres extractibles l'hexane) = 2,8 g DCO.
1.7.5) Dbit de temps sec exprim en m
3
/ h
- Q
mts
(dbit moyen horaire de temps sec)
- Q
pts
(dbit de pointe horaire de temps sec)
- Q
nocts
(dbit horaire nocturne de temps sec)
Des coefficients et des dures
- C
pEU
(coefficient de pointe de temps sec des eaux uses strictement domestiques).
- C
pEI
( coefficient de pointe de temps sec des eaux uses de type industrielles).
- TEI = Dure moyenne de rejet des eaux industrielles.
- Talim = Temps alimentation du racteur biologique en matire de vidange.
A partir de ces donnes nous pouvons faire les remarques suivantes :
Qpts =
Q
24
.Cp eu +
Q
TEI
Cp EI +
QECP
24
+
QM. V
Talim.
EU EI
.
CpEu = 1, 5 +
2, 5
Q
24
l / s
(avec Qeu exprim en litre / seconde)
EU
.
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
442
442
1.8) DEFINITION DES DEBITS EN TEMPS DE PLUIE.
Ceci concerne les systmes d'assainissement composs d'un rseau unitaire.
Dtermination des pluies considrer associes aux capacits d'autopuration de la rivire
(dclassement d'une classe en priode de pluie ou chute de l'O
2
dissous de y mg/l).
Dtermination d'un nombre de dversement des dversoirs d'orage limit par an.
Par ex : 6 8 dversement par an pour une pluie de 18 mm he / j
Estimation des flux de pollution supplmentaires apports lors des venements pluvieux
considrs, y compris lors des petites pluies comprises entre 3 5 mm he / j.
Une pluie provoquant un coulement dans un rseau se situe aux environs de 2 mm he / j.
Nota :Ces valeurs de Qmax devraient tre dfinies suite une tude sur l'impact des eaux
pluviales sur le milieu rcepteur.
1.8.1) Typologie des diffrents dbits de pluie (au rseau unitaire)
Qmax / j : dbit maximum journalier admis en temps de pluie la station.
Qmax / h : dbit maximum horaire admis en temps de pluie la station.
Qmax prtraitement : dbit maxi horaire admis au prtraitement (cas de la prsence de
bassin d'orage avec dversoir d'orage en amont du prtraitement).
Qmax admis au bassin d'orage : dbit horaire alimentant le bassin d'orage situ la
station.
Qvidange du bassin d'orage # dbit horaire vidange du bassin d'orage.
Qmax biologique : dbit horaire maximum admis en temps de pluie sur le racteur
biologique et sur le clarificateur (hors dbit maxi de recirculation).
Qmax dcanteur primaire : dbit horaire maxi en temps de pluie alimentant le
dcanteur primaire (cela suppose qu'il y a un by-bass en aval de ce dernier).
Qmax prtraitement >> Qmax biologique si il y a un by-pass en aval du prtaitement
ou du dcanteur primaire.
Qmax biologique # Qmax prtraitement si absence de by-pass en aval du prtraitement
ou du dcanteur primaire.
Qmax / h > 3 QMTS (cette valeur risque d'voluer avec l'application de la Directive
Europenne du 21.05.1991). De plus cette valeur de Qmax / h devrait tre dfinie suite
une tude sur l'impact des eaux pluviales sur le milieu rcepteur.
Qmax / h > Q
PTS
+ Qvidange du bassin d'orage
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
443
443
Le clarificateur sera toujours dimensionn sur le Qmax biologique et non sur le
Q
PTS
.
1.8.2) Charge polluante en priode pluvieuse (au rseau unitaire)
1.9) REGIME HYDRAULIQUE JOURNALIER.
La rpartition dans la journe du dbit en priodes (cela en fonction de l'analyse des courbes
d'enregistrement des dbits) : par dfaut, on peut prendre 3 priodes de pointes soit :
Qpts (Qpointe par dfaut 3 priodes de 2 h).
Qd (Qdiurne par dfaut 2 priodes de 5 h).
Qn (Qnocturne par dfaut 1 priode de 8 h).
1.10) ROLE DES DIFFERENTS PARAMETRE AINSI DEFINIS.
- les charges maxi horaires (dimensionnement des capacits d'oxygnation)
- les charges maxi journalires (dimensionnement des racteurs suivant le pourcentage
de garantie demand sur le respect du niveau de rejet)
- les charges maxi hebdomadaires (dimensionnement de la filire boue)
- la charge moyenne hebdomadaire (consommation de ractifs, vacuation des boues...)
La charge moyenne hebdomadaire sera dfinie partir d'un scnario d'une semaine type.Par
exemple :
- charge moyenne journalire temps sec (3 jours/sem)
- charge correspondante une grosse pluie (1 jour/sem)
- charge correspondante la vidange du bassin d'orage (1jour/sem)
- charge correspondante une petite pluie infrieure 5 mm he/j ( 2 jours/sem)
2) NIVEAU DE REJET - RENDEMENT A ATTEINDRE
Dans le "cas gnral" (en rfrence avec la nouvelle directive CEE au 21.05.91) les rendements
atteindre associs un niveau de rejet seront dtermins en fonction de l'objectif de qualit du
milieu rcepteur.
- 4 classes de qualit (1A, 1B, 2, 3) dfinissant des concentrations de rfrence
respecter (Conc. ref. de pollution).
- dbit de la rivire pris en rfrence : QE 1/5. Ce dbit est le dbit d'tiage qui a une
priode de retour de 5 ans.
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
444
444
En amont du point de rejet de la station projete, le flux transport par la rivire doit tre gal
QE 1/5 (en m
3
/j) x Conc ref amont.
En aval du point de rejet de la station projete, le flux transport par la rivire doit tre gal (QE
1/5 (en m
3
/j) + Qstation(en m
3
/j)) x Conc ref aval. O Qstation est le dbit journalier de temps
sec.
Le flux maximum admissible rejet en sortie de station est donc gal au flux en aval de la
station moins le flux en amont de la station.
Le calcul est raliser sous l'hypothse que la classe amont est gale la classe aval moins un.
Dans le cas contraire, on prendre concentrations issues de campagne de mesure dans le milieu
rcepteur.
Ce calcul est fait sur les paramtres : DCO, DBO
5
, NTK, MES, N-NH4 , P.
concentration maxi sortie station =
flux maxi admissible
Qstation m / j
3
.
Les concentration ainsi obtenues sont les concentrations moyenne sur 24 h.
niveau de rejet concentration maxi sortie station
Niveau de rejet minimal exig : arrt du 22.12.94 pour les installations suprieures 120
kg/j de BO5 et larrt du 21.06.96 pour les installations comprises entre 12kg et 120 kg/j de
DBO5.
Nota :
La concentration en NH
4
dans les grilles est exprime en ions ; il y a lieu de tout ramener en [N].
C'est dire, par exemple, NH
4
= 18 g donne N-NH
4
= 14 g.
On a alors :
1A conc = 0,1 mg/l NH
4
soit 0,078 mg/l N-NH
4
+
1B conc = 0,5 mg/l NH
4
soit 0,39 mg/l N-NH
4
+
2 conc = 2 mg/l NH
4
soit 1,56 mg/l N-NH
4
.
+
3
conc = 8 mg/l NH
4
soit 6.2 mg/l N-NH
4
.
+
Le NTK de leffluent domestique brut sera en grande partie ammonifi dans la station de
traitement, hormis la part de N soluble organique non ammonifiable ( de lordre de 3 5% du
NTK entre) et une fraction de N particulaire (moins de 10% sur un effluent us domestique)
NTK = azote organique + azote ammoniacal (azote kjedhal)
NGL = NTK+ N-N0
2
+ N-N0
3
(azote global)
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
445
445
2.1) TRADUCTION DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE DU 21.05.1991 EN DROIT FRANCAIS
Les principaux textes de Loi ;
La Loi sur l'eau du 3 janvier 1992,
Le dcret du 1er mars 1993, concerne les effluents des Installations Classes soumis
autorisation ainsi que l'obligation de convention de rejet avant raccordement au rseau d'assainissement
publique,
Les 2 arrts du 29 mars 1993, concernent les procdures administratives de dclaration et
d'autorisation ainsi que la nomenclature des oprations soumises dclaration ou autorisation, en
fonction des flux gnr par l'agglomration et englobe en plus des procdures relatives aux rejets aprs
traitement ; les dversoirs d'orage, les rejets d'eaux pluviales, l'pandage d'eau uses, l'pandage de
boues...
Le dcret du 3 juin 1994, dcrit les orientations de la transcription de la Directive du 21 mai
1991, relatif la collecte et au traitement des eaux uses mentionnes aux articles L. 372-1-1 & L. 372-3 du
Code de Communes.
les 2 Arrts du 22 dcembre 1994 : "Prescriptions techniques relatives aux ouvrages de
collecte et de traitement des eaux uses", mentionns aux articles L.372-1-1 & L.372-3 du Code des
Communes.
Les recommandations du 12 mai 1995 pour l'application des arrts du 22 dcembre 1994.
Larrt du 21 juin 1996 fixant les prescriptions techniques minimales relatives aux ouvrages de
collecte et de traitement des eaux uses mentionnes aux articles L.2224-8 etL.2224-10 du code gnral
des collectivits territoriales, dispenses dautorisation au titre du dcret n 93-743 du 29 mars 1993.
Circulaire n97-31 du 17 fvrier 1997 relative lassainissement collectif de communes-
ouvrages de capacit infrieure 120 kg DB05/jour (2000 EH)
Schma gnral de la rglementation technique relative aux ouvrages dassainissement
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
446
446
OUVRAGES DISPENSES DE
DECLARATION
capacit infrieure
12 kg DBO5/jour *
OUVRAGES SOUMIS
A DECLARATION
capacit comprise
entre
12 et 120 kg
DBO5/jour *
OUVRAGES SOUMIS
A AUTORISATION
capacit suprieure
120 kg DBO5/jour
RELEVANT DE
LASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF
RELEVANT DE
LASSAINISSEMENT
COLLECTIF
ARRETE DU 6 MAI
1996
ARRETE DU 21 JUIN 1996 ARRETES DU 22 DECEMBRE
1994
(*)Sous rserve que ces ouvrages chappent aux seuils dautorisation ou de dclaration dfinis par les
autres rubriques de la nomenclature annexe au dcret n 93-743 du 29 mars 1993, notamment la rubrique
2.2.0., et sous rserve des dispositions spcifiques mentionnes larticle 2 du dcret n 93-743 du 29 mars
1993 pour certaines zones de protection spciale.
2.1.1) LE 1er ARRETE DU 22.12.1994
Cet arrt fixe les prescriptions techniques minimales, relatives aux ouvrages de collecte et de
traitement des eaux uses.
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
447
447
REGLES GENERALES APPLICABLES AUX REJETS EN CONDITIONS NORMALES
DEXPLOITATION POUR DES DEBITS NEXCEDANT PAS LEUR DEBITS DE REFERENCE
Tableau 1
PARAMETRE CONCENTRATION MAXIMALE
DBO5 25 mg/l
DCO 125 mg/l
MES 35 mg/l *
(*) Pour le lagunage, cette valeur est fixe 150 mg/l.
Tableau 2
PARAMETRE CHARGE BRUTE RECUE RENDEMENT MINIMUM
DBO5 Charge brute** 120 600 kg/j 70 %
DBO5 Charge brute > 600 kg/j 80 %
DCO Toutes tailles 75 %
MES Toutes tailles 90%
Tableau 3
PARAMETRE CAPACITE DE LA
STATION
CONCENTRATION
MAXIMALE
zone sensible NGL* Charge brute** 600
6000 kg/j
15 mg/l
lazote NGL Ch. brute > 6000 kg 10 mg/l
zone sensible PT Ch. brute 600 6000 kg 2 mg/l
au phosphore PT Ch. brute >6000 kg 1 mg/l
(*) Ces exigences se rfrent une temprature de leau du racteur biologique arobie de la station dpuration dau moins 12C.
Cette condition de temprature peut tre remplace par la fixation de priodes dexigibilit dtermines en fonction des conditions
climatiques rgionales.
Tableau 4
PARAMETRE CAPACITE DE LA
STATION
RENDEMENT
MINIMUM
zone sensible azote NGL Charge brute** > 600 70 %
zone sensible phosphore PT Charge brute > 600 80 %
(**) Charge brute de pollution organique reue, en kg/j (exprime en DBO5).
Les chantillons moyens journaliers doivent respecter :
- soit les valeurs fixes en concentration figurant au tableau 1,
- soit les valeurs fixes en rendement figurant au tableau 2.
Leur pH doit tre compris entre 6 et 8,5, et leur temprature infrieure 25C.
Les rejets dans des zones sensibles leutrophisation doivent en outre respecter en moyenne annuelle :
- soit les valeurs fixes en concentration figurant au tableau 3,
- soit les valeurs fixes en rendement figurant au tableau 4.
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
448
448
REGLES DE TOLERANCE PAR RAPPORT AUX PARAMETRES DCO, DBO5 ET MES
Ces paramtres peuvent tre jugs conformes si le nombre annuel dchantillons journaliers, non conformes
la fois aux seuils concerns des tableaux 1 et 2, ne dpasse pas le nombre prescrit au tableau 6. Ces
paramtres doivent toutefois respecter le seuil du tableau 5.
Tableau 5
PARAMETRE CONCENTRATION MAXIMALE
DBO5 50 mg/l
DCO 250 mg/l
MES 85 mg/l
Tableau 6
Nombre dchantillons
prlevs dans lanne
Nombre maximal dchantillons
non conformes
4-7 1
8-16 2
17-28 3
29-40 4
41-53 5
54-67 6
68-81 7
82-95 8
96-110 9
111/125 10
126-140 11
141-155 12
156-171 13
172-187 14
188-203 15
204-219 16
220-235 17
236-251 18
252-268 19
269-284 20
285-300 21
301-317 22
318-334 23
335-350 24
351-365 25
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
449
449
3. REGLES DE TOLERANCE PAR RAPPORT AU PARAMETRE NGL
Le paramtre peut tre jug conforme si la valeur de la concentration de chaque chantillon journalier
prlev ne dpasse pas 20 mg/l.
2.1.2) LE 2me ARRTE DU 22.12.1994
Surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux uses
Les dispositifs du prsent arrt sont applicables immdiatement aux nouveaux ouvrages : ils sont
applicables aux anciens ouvrages dans les dlais suivants, compter de sa parution (J.O. du 10/02/95) :
- systme dassainissement recevant une charge brute de pollution organique de :
suprieure 6000 kg/j = dlai 2 ans,
comprise entre 601 et 6000 kg/j = dlai 4 ans,
comprise entre 120 et 600 kg/j = dlai 5 ans.
1. Mesure de dbit :
2. Station pour charge brute > 600 kg : Mesure de dbit + enregistrement amont / aval et des prleveurs
asservis aux dbits et conservation au froid (pendant 24h) dun double de lchantillon
3. Station pour charge brute entre 120 - 600 kg : Mesure + dbit + enregistrement aval et des
prleveurs asservis aux dbits et conservation au froid (pendant 24h) dun double de lchantillon.
ANNEXE 1
SURVEILLANCE DES OUVRAGES DE TRAITEMENT
PARAMETRES 120
600
601
1 800
1 801
3 000
3 001
6 000
6 001
12 000
12 001
118 000
> 18 000
Cas gnral
Dbit 365 365 365 365 365 365 365
MES 12 24 52 104 156 260 365
DBO
5
4 12 24 52 104 156 365
DCO 12 24 52 104 156 260 365
NTK / 6 12 24 52 104 208
NH4 / 6 12 24 52 104 208
NO2 / 6 12 24 52 104 208
NO3 / 6 12 24 52 104 208
PT / 6 12 24 52 104 208
Boues* 4 24 52 104 208 260 365
Zones sensibles
lazote
NTK / 12 24 52 104 208 365
NH4 / 12 24 52 104 208 365
NO2 / 12 24 52 104 208 365
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
450
450
NO3 / 12 24 52 104 208 365
Zones sensibles au
phosphore
PT / 12 24 52 104 208 365
(*) Quantit et matires sches. Sauf cas particulier, les mesures amont des diffrentes formes de lazote
peuvent tre assimiles la mesure de NTK.
Tableau 1
Frquence des mesures (nombre de jours par an).
Charge brute de pollution organique reue par la station
exprime en kg/jour de DBO5.
(Celles-ci sappliquent lensemble des entres et sorties de la station,
y compris les ouvrages de drivation)
2.1.3) LA CIRCULAIRE n97-31 du 17 fvrier 1997
Circulaire n97-31 du 17 fvrier 1997 relative lassainissement collectif de communes-ouvrages de
capacit infrieure 120 kg DB05/jour (2000 EH)
Rfrences : arrt du 21 juin 1996 fixant les prescriptions techniques minimales relatives aux ouvrages de
collecte et de traitement des eaux uses mentionnes aux articles L.2224-8 etL.2224-10 du code gnral
des collectivits territoriales, dispenses dautorisation au titre du dcret n 93-743 du 29 mars 1993 relatif
la nomenclature des oprations soumises autorisation ou dclaration, en application de larticle 10 de la
loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur leau (J.O. du 9 aot 1996).
Documents abrogs :
Circulaire du ministre de la sant du 10 juin 1976 relative lassainissement des agglomrations et la
protection sanitaire des milieux rcepteurs (J.O.21 aot 1976) ;
Circulaire interministrielle du 4 novembre 1980 relative aux conditions de dtermination de la qualit
minimale dun rejet deffluents urbains (J.O. 29 novembre 1980).
Niveaux types de rejet pour les ouvrages soumis dclaration
De manire schmatique, quatre classes de traitement peuvent tre distingues (cf. tableau 2).
Le niveau de traitement D1 correspond aux exigences minimales fixes larticle 14 de larrt et, dun
point de vue technique, une simple dcantation primaire sans ajout de ractifs,
Le niveau D2 permet davoir recours des solutions techniques varies parmi lesquelles les cultures fixes,
lits bactriens ou disques biologiques paraissent bien adapts aux petites collectivits tant au point de
vue de lnergie dpenser pour le traitement que la simplicit dexploitation, et notamment de gestion des
boues.
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
451
451
Le recours la technique du lagunage ar est prendre en considration, notamment dans le cas o des
activits artisanales sont susceptibles de provoquer des dsquilibres dans la composition des eaux traiter
ou des variations de charges importantes.
Le niveau D3 correspond bien aux performances attendues du lagunage naturel tel quil a t dvelopp
en France. Son adquation la protection du milieu tient notamment ses performances soutenues sur
lazote, mieux assures lorsque trois bassins sont raliss. Lexpression de lefficacit tient au fait quil ny a
pas conservation des dbits dans de telles installations et que la DCO non filtre est le paramtre le plus
reprsentatif et le moins critiquable pour exprimer laction du lagunage naturel sur la charge organique.
Le niveau 4 concide avec le niveau classique de traitement des collectivits dont le systme
dassainissement est soumis autorisation. Ces techniques sont bien adaptes llimination du paramtre
azote ammoniacal qui est gnralement le facteur limitant la qualit du milieu rcepteur.
Les procds choisis pour assurer ces performances devraient donc naturellement tre capables de nitrifier
au rang desquels on peut mettre en avant :
les boues actives en aration prolonges ;
les lots dinfiltration drains aliment par bches.
Tableau 2 : Niveaux types de performances des systmes de traitement
D1 D2 D3 D4
DBO.........
DCO.........
MES.........
Nkj...........
rdt 30%
rdt 50%
35 mg/l
rdt 60%
rdt 60%
25 mg/l
125 mg/l
Ces divers niveaux, applicables des moyennes sur 24 heures, sont exprims soit en rendement [(flux des
eaux brutes) - (flux des effluents purs)]/(flux des eaux brutes), soit en concentrations des polluants dans
les effluents purs dans la mesure o ils font rfrence ces procds qui se jugent difficilement sur les
mmes critres.
2.2) CRITERES POUR LE CHOIX D'UNE FILIERE DE TRAITEMENT
Liste des critres qui devraient intervenir dans le choix de la filire de traitement (eau et boue)
1 - niveau de traitement requis (rendement, concentration, percentile)
2 - capacit de l'installation
3 - destination des boues
4 - surface au sol disponible
5 - variation saisonnire de la charge polluante
6 - contraintes environnementales
7 - cot d'investissement
8 - contrainte d'exploitation
9 - cot d'exploitation
10 - qualit du terrain (lagune notamment)
10 - fiabilit de la filire (sensibilit du milieu et traitement tertiaire spcifique)
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
452
452
Objectif de qualit
Niveau de rejet
Paramtres inffluent pollution + dbit +
tC
Interprtation de la
norme en moyenne-
jour
Dimensionnement
prtraitement
Fixe cm - DBO5 liminer
cm<=0.12 (stabilisation boue)
capacit < 50000 eqhab
Introduire pollution
des retours en tte
de la filire boue
Cm - %MVES eff brut = calcul PB
dfinir %MVS dans PB
Clarificateur :
IM suivant Cm fixe
Sa suivant Sr
Qmax / Qpts
Vol bio total
1) fixant age de boue // niv. NGL1 ou NGL2
2) fixant CV
volume bio = max (ge,cm,cv)
Vrifier vol bio
cintique nitrif
cintique dnitrif
dissociation
Besoin en O2 en
pointe et en jour
cintique nitrif
zone d'anoxie
anaoxie+ ar.
Puissance absorbe
Conditions de
brassage
Sur volume // traitement Pt
Filire boue sur PBb + PBpc
Evaluation pollution de retour en tte
DBO5, MES, NTK
2.3) DIAGRAMME DE CALCUL DU DIMENSIONNEMENT
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
453
453
III. DIMENSIONNEMENT DE LA FILIERE EAU
Prliminaire :
La note de calcul qui suit concerne exclusivement les effluents uss domestiques ou
dominante domestique. Elle permet de dimensionner les ouvrages et les quipements, mais
non de simuler correctement un tat de fonctionnement. En effet, l'approche dimensionnelle
diffre de l'approche de simulation d'une station de traitement, notamment par la prise en
compte d'un certain nombre de scurit dans l'approche dimensionnelle.
3.1) REMARQUES GENERALES ET HYPOTHESES DE DIMENSIONNEMENT.
En rgle gnrale (sauf avis contaire du C.C.T.P) :
- Le prtraitement, clarificateur et le traitement des boues sont dimensionns pour la situation
future.
- Le racteur biologique est dimensionn pour la situation prochaine (si l'cart entre la station
future et la station actuelle est significatif)
- Le clarificateur sera dimensionn pour le Qmax associ un indice de Mohlman, et
concentration dans le bassin d'aration retenu
- En rgle gnrale, la dnitrification endogne dans le cas d'un effluent urbain standard (par
phase d'anoxie sur le bassin d'aration) sera prfre la dnitrification par zone d'anoxie
spare (sauf niveau de rejet trs svre sur le NGL).
- Le dimensionnement de la filire eau (racteur biologique associ son clarificateur) doit
tenir compte de la filire boue - en prenant en compte la pollution apporte par les retours
en tte de la filire boue (surnageant, filtrat, centrat...).
- L'effluent d'entre est homogne en concentration ainsi que la variation des flux de pollution
qui se fait proportionnellement au dbit (ceci pour la priode de temps sec) - sauf mesures
spcifiques des flux horaires ou coefficient de pointe en concentration.
- Les valeurs de dimensionnement obtenues correspondent un minimum pour la charge
entire considre (des paramtres particuliers de scurit peuvent tre appliqus en fonction
de l'analyse des contraintes du projet).
- Le racteur biologique est considr homogne avec diffusion flux et de pollution de faon
instantane dans les ouvrages.
- Les flux en entre considrer pour le dimensionnement (cas d'installation existante ou non
avec campagne de mesure 24h) sont les maximum non dpasss X % du temps ( la
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
454
454
directive CEE et le dcret parlent de charge moyenne sur la semaine la plus charge).
3.2) RELEVEMENT EN TETE DE L'INSTALLATION.
A l'arrive d'une station de traitement des eaux uses, on est contraint d'installer un poste de
relvement, pour assurer un coulement gravitaire sur l'ensemble des ouvrages, et cela jusqu'au
point de rejet.
La cote d'arrive des effluents en aval de la station de relvement sera dtermine par la prise en
compte de l'ensemble des pertes de charges aux travers des ouvrages en partant de la cte des plus
hautes eaux (P.H.E) du point de rejet.
On appellera "poste de relvement", lorsque qu'il sagit de faire acheminer l'eau use uniquement
en hauteur sans grande distance entre le lieu de pompage et le lieu de livraison de l'eau (c'est--
dire que les pertes de charges linraires sont faibles devant la hauteur gomtrique), par
opposition au "poste de refoulement" o la distance est souvent grande, donc les pertes de
charges linaires sont prpondrantes dans le calcul de la hauteur manomtrique totale (H.M.T).
Paramtres ncessaires pour le dimensionnement du poste de relvement :
- dbit maximum relever
- volume utile de la bche de relvement
- volume totale de la bche de relvement
- hauteur manomtrique totale (H.M.T)
- puissance de la pompe
- courbe caractristique et point de fonctionnement.
3.2.1) Volume de la bche de relvement.
Volume utile de la bche :
4.f.n
Q
V
u
=
avec :
V
u
= volume utile de la bche (volume constitu entre les niveaux bas et hauts d'enclenchement
de la pompe)
Q = debit maximum pomper en m/h
n= nombre de pompes en foncttionnement simultan
f = nombre de dmarrages ou d'enclenchement l'heure
f = 4 pour P> 30 kw, f = 6 pour P < 15 Kw, f = 8 pour P < 8 Kw et f = 10 pour P < 4 Kw
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
455
455
Volume totale de la bche :
Cote Tn
Cote Fe (fil d'eau de la conduite d'arrive)
Cote d'enclenchement = Hen
Cote de dclenchement = Hdec
Cote de dclenchement = cote radier + 0,40m environ
Cote de d'enclenchement = cote Fe - 0,20 m environ
Volume utile = S x ( Hen - Hdec) avec Hen - Hdec = de l'ordre de 0,80 m 2,00m
Volume totale = Sx (cote TN - cote radier)
3.2.2) Hauteur manomtrique totale.
H.M.T = H Pdc
go
+
H
go
= hauteur gomtrique = H = cote d'arrive - cote moyenne de dpart
Pdc =
Pertes de charge totales
Pdc =
Pdc Pdc Pdc k x
V
2g
L S L i
2
+ = +
Pdc
L
= pertes de charges linaires
Pdc
L
= J x L avec L = longueur de la conduite et J perte de charge en mm/m ou m/m
Pdc
S
= pertes de charges singulires (coudes, vannes, clapet, entre et sortie de l'eau)
V = vitesse dans la conduite en m/s
g = constance d'acclration = 9,81 m
-2
/s
3.2.2.1 ) Pertes de charge singulires
Valeur de K
i
entre dans la conduite K = 0,5
sortie de la conduite K = 1
coude 90 K = 1,5
coude 75 K = 1
coude 45 K = 0,5
coude 22,5 K = 0,17
vanne K = 0,5
clapet anti retour K = 0,8
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
456
456
T de raccordement K = 1,5
3.2.2.2 ) Pertes de charges linaires
Formule de Colebrook :
J =
D
V
2g
2
en m / m
H =
D
x
V
2g
x L
2
en m
H = perte de charge par frottement en m (pour des conduites pleines)
D = diamtre de la canalisation en m
V = vitesse du fluide dans la canalisation en m/s
g = 9,81 m/s
-2
L = longueur de la conduite en m
= coefficient de perte de charge
=
0,25
log
K
3,7. D
Re
10
0,9
(
,
) +
5 74
2
= coefficient de perte de charge suivant le diagramme de Moody, fonction du nombre de
Reynolds et de la rugosit relative Ks / D
Ks = est la rugosit et Ks/D = /D est la rugosit relative
Ks = 0,1 x
3
10
m pour conduite en inox ou polypropylne
Ks = 0,15 " m " en acier galvanis
Ks = 0,20 " m " en fonte
Nombre de Reynolds ( dtermination de )
Re = Vx
D
= viscosit cinmatique = 1,31 .10
-6
en m/s pour l'eau 10C
V = vitesse en m/s
D = diamtre en m
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
457
457
Diamtre en m Coefficient / D pour une rugosit gale :
K = 1 mm K = 2 mm
0,050 0,985 1,30
0,080 0,512 0,660
0,100 0,380 0,490
0,125 0,284 0,360
0,150 0,223 0,280
0,200 0,153 0,190
0,250 0,114 0,141
0,300 0,090 0,110
0,350 0,0735 0,090
0,400 0,0625 0,0758
0,450 0,0538 0,0650
0,500 0,047 0,0566
0,600 0,0371 0,0477
0,700 0,0307 0,0368
0,800 0,0260 0,0310
Autres formules :
En rgime turbulent - cas o :Re > 4000 - Formule de Nikuradse ;
1
1 74 2
2
= + , log
D
formule en logathime dcimal
en logarhime nprien ou naturel la formule s'crit :
1
0 7544
0 8476
2
= , ln
.
,
x
D
1 3
4 0 85
2
= x
D
x
ln
.
,
Q
H
L
g D
D
2 2 5 2
3
32 0 85
= ( ) ln
.
,
En rgime laminaire - cas o : 2000< Re - Formule de Poiseuille :
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
458
458
1 4
64
64
= =
.
. . .
Q
D
ou
R
e
Q
H
L
g D
= (
.
)
128
4
En rgime intermdiaire - cas o : 2000< Re > 4000 - Formule de Blasius :
1
0 3164
4 1
0 3164
1
4
1
4
= =
R
Q
D
x
e
,
(
. .
)
,
Q
H
L
x x
D
7
4
19
4
1
4
40 63 = ,
La perte de charge est indpendante de la rugosit en coulement laminaire et intermdiaire (de
transition)
Formule de LECHAPT & CALMON (eau & assainissement).
Formule gnrale sous la forme :
J =
L.Q
D
M
N
Q en m/s
D en m
J en mm/m
pour K = 2 mm L = 1,863, M = 2 , N = 5,33
pour K = 1 mm L = 1,801, M = 1,975 , N = 5,25
3.2.3) Puissance de la pompe.
3.2.3.1) Puissance sur arbre moteur
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
459
459
P
arbre
= HMT . 9,81 .
Q m / s
3
pompe
P = puissance absorbe sur arbre moteur en Kw
HMT = hauteur manomtrique totale en m
Q = dbit vhicul en m/s
pompe
= rendement totale de la pompe (hydraulique et lectrique)
3.2.3.2) Puissance absorbe aux bornes moteur
P
borne
= HMT . 9,81 .
Q m / s
3
pompe
x
moteur
P = puissance absorbe aux bornes moteur en Kw
HMT = hauteur manomtrique totale en m
Q = dbit vhicul en m/s
pompe
= rendement hydraulique de la pompe ( de lordre de 0,6)
moteur
= rendement moteur ( de lordre de 0,85)
lectro- pompe
= rendement total du groupe lectro-pompe ( de lordre de 0,6 x 0,85 = 0,5 0,55)
Nota : Pabs aux bornes = Pabs larbre /
moteur
moteur
= rendement du moteur ou du surpresseur
3.2.4) Intensit lectrique absorbe aux bornes du moteur.
I =
P .1000
U. 3 Cos
abs
.
P
abs
= P absorbe aux bornes
Puissance apparente ncessaire (S )
S ( Kva) = Pabs / Cos
phi
P = puissance absorbe aux bornes en Kw
U = tension en volt
Cos = suivant l'installation la qualit de l'installation lectrique (par dfaut prendre 0,85)
3.2.5) Notion d'hydraulique de base.
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
460
460
3.2.5.1) les canaux coulement libre
L' ecoulement est dit libre si, sa partie suprieure, le fluide est soumis la pression
atmosphrique.
Formule de Manning-Strickler :
Q = K . R
h
2 3 /
. I
1 2 /
. S
Q = dbit coul en m/s
K = coefficient de Manning Strickler ( K 70 80 pour le bton rugueux & K 90 pour le bton
avec enduit)
R
h
= rayon hydraulique =
S
P
avec S = surface mouille et P = primtre mouill en m
I = pente du canal en m / m
S = surface mouille en m
Cas d'un canal rectangulaire de largeur = l et de hauteur d'eau = h
S = l x h
P = l + 2h
Cette formule permet de vrifier par itration l'adquation : tirant d'eau, vitesse et dbit appropri
en fonction de la gomtrie du canal propos, notamment en amont du dgrilleur.
3.2.5.2) Les lames dversantes assimiles des dversoir frontaux.
Formule gnrale :
Q =
2
3
. C
e
. 2.g . B .
V
g
h
h
2
2
+
2
3
Q = dbit en m/s
C
e
= coefficient de dbit dpendant du rapport h / p
C
e
= 0,602 + 0,083.
h
p
p = hauteur de la lame dversante
h = charge sur la lame dversante ou hauteur de pelle
B = largeur du canal assimile la largeur de la lame dversante ou longueur de
dversement suivant les cas tudis, en m .
V
h
= vitesse d'approche au niveau de la lame dversante (V
h
est nglige si la zone l'
amont de la lame est tranquilise)
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
461
461
Domaine d'utilisation :
-
h
p
1,0
- 0,03 h 0,75 m
- B ou L
dev
0,30 m
- p 0,10 m
1) Cette formule permet d'approcher une mesure de dbit sur un canal de sortie quip d'un
dversoir paroi mince (paisseur de la lame de 1 2 mm), sans contraction latrale ( NF -
X10 - 311 - sept 1983).
2) Cas des lames dversantes situes en aval du dgraisseur- dessableur, en sortie des bassins
d'aration et sur les clarificateurs (lame paroi mince mais aussi paroi paisse, le degr de
prcision nous suffit pour utiliser cette formule sous la forme simplifie) .
h
p
est ngligeable car p est trs grand devant h, donc C
e
= 0,6
La formule gnrale devient ;
L
dev
= 0,564 .
Q
h
3/ 2
L
dev
= longeur du dversoir ou lame dversante en m
Q = dbit arrivant sur le dversoir en m/s
h = hauteur de charge sur la lame dversante ou pelle en m
Nota : pour les bassins d'aration quips de turbines ou de brosses, la valeur de h maxi (
pour les dbits maxi eaux uses et recirculation) ne devrait pas dpasser 6 10 cm. Il en est
de mme sur le dversoir situ en aval du dgraisseur-dessableur.
3.3) BASSIN TAMPON
Par dfinition, nous parlerons de bassin tampon, par opposition au bassin d'orage ou de
"dpollution", lorsque la fonction du bassin et de "lisser" les dbits arrivant en permanence en
temps sec, et/ou "lisser" les concentrations de l'effluent et cela en fonction des contraintes
imposes par les caractristiques des ouvrages situs en aval du bassin tampon ; bassins d'aration
associ aux capacit des quipements d'aration, ou clarificateurs secondaires associs aux
capacits des pompes de recirculation des boues.
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
462
462
C'est donc un ouvrage qui sera en permanence aliment, fonctionnant niveau variable en
fonction du dbit des pompes de vidange, du volume utile de l'ouvrage et des variation
hydrauliques en amont. Donc en toute logique, il devra tre ar et brass.
3.3.1) Dimensionnement du bassin tampon
- Besoin en capacit daration et de brassage :
Dispositif de type moyennes bulles par Vibrair
Q / Nm3/m2/h :
environ 8Nm3/m2/h 2 m CE
environ 6Nm3/m2/h 3 m CE
environ 5Nm3/m2/h 4 m CE
environ 4Nm3/m2/h plus de 5m CE
Nota : m2 est la surface du radier
Puissance spcifique en w/m3 de bassin:
environ 36 w/m3 2 m CE
environ 27 w/m3 3 m CE
environ 23 w/m3 plus de 4m CE
Dbit unitaire par Vibrair GM : 3 8 Nm3/h
rendement doxygnation = 2,5 3,5 % par m CE (fonction de la densit)
perte de charge de 10 30 mbars
cartement : 0,3 0,8 m
nourrice : 50 100 mm environ
Exemple : Bassin de 100 m2 et hl = 4 m soit 400 m3
Dbit dair = 500 Nm3/h avec 5 Nm 3/m2/h
Puissance thorique ncessaire = 9,2 kw
pression en aval du surpresseur = hl + 0,5 = 4,5 m
puissance thorique par la formule suivante :
P =
3, 89 Q log
P
P
R
n.a
R
A
avec Pa = 10,33 et Pr = Pa + 4,5 = 14,83 m
Q en m3/mn et R environ 0,72
P = 7 kw
Capacit doxygnation quivalente = 10 kg O2/h en boues et 15 kgO2 en
standart ( dans leau)
Un hydro-jecteur a un ASB de lordre de 1 kgO2/kw (en standart) et 0,6
kgO2/kw dans les boues
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
463
463
Pour fournir 15 kgO2/h dans leau il faut une puissance de 15 kw pour lhydro-
jecteur
3.4) BASSIN D'ORAGE OU BASSIN DE DEPOLLUTION
C'est un ouvrage qui doit tre en permanence vide, aliment uniquement durant les vnements
pluvieux, vnements qui sont censs modifier de faon significative les rgimes hydrauliques
caractrisant le temps sec.
3.5) CALCUL DU PRETAITEMENT
3.5.1) Dgrilleur
La vitesse au travers du dgrillage doit tre comprise entre 0,3 et 0,6 m/s. Pour le
dimensionnement on prendra une vitesse de 0,6 m/s pour le Qpts sur une rseau sparatif et 1,2m/s
sur Qmaxi pluie pour un rseau unitaire.
La vitesse maximale admissible dans le canal d'arrive en amont immdiat du dgrilleur sera prise
gale 1,2 m / s et ceci pour le Qmaxi pluie. Ce maximum est fix par rapport aux conditions
hydrauliques d'arrive de l'effluent sur la grille.
On effectue alors le calcul suivant :
S
Qp(m / s)
V. O. C
(ou Qmax / h quand il existe)
3
=
avec :
S = surface mini de la grille en m
V = vitesse de l'influent dans le caniveau
t = tirant d'eau maxi en amont de la grille
C = coefficient de colmatage
C = 0,10 - 0,30 - grille manuelle
0,40 - 0,50 - grille automatique
l = largeur mini de la grille
et
O =
espace libre entre barreaux
espace libre + paisseur barreaux
L'espacement libre entre les bareaux est compris entre 10 15 mm. On prendra 15 mm.
L'paisseur des barreaux sera prise gale 10 mm.
Avec ces valeurs conseilles, on obtiendra :
O =
15
10 + 15
= 0, 60 (nb sans unit)
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
464
464
et
S =
Qp (m s
0, 6 m/ s . 0, 6 . 0, 5
=
Qp (m s
en m
3 3
/ ) / )
, 0 180
Nota : le coefficient de colmatage a t pris 0,5.
Pour complter le dimensionnement du dgrillage, nous utiliserons la figure ci-dessous :
t = tirant d'eau amont
longueur mouille = = Lo
t
sin
Dans le cas du dgrilleur courbe :
= 26, 5 donc sin = 0, 44
On obtient alors :
Lo =
t
0, 44
On prendra pour une grille droite : = 60 - 80
A dfaut de calcul hydraulique prcis, prendre comme valeur indicative les valeurs de t suivantes :
t = 0,10 1000 eq.hab
t = 0,15 5000 eq.hab
t = 0,20 20 000 eq.hab
t = 0,30 50 000 eq.hab
t = 0,40 100 000 eq.hab
Nota : un calcul hydraulique plus prcis devra nous permettre de vrifier la cohrence du
choix du tirant d'eau maxi, avec le dbit maxi, la largeur du canal d'approche et la vitesse
pris dans notre calcul. Une vrification sera ncessaire en calculant les diffrentes vitesses
obtenues avec les diffrents rgimes hydrauliques journaliers, pour d'une part viter de
dposer du sable pour les petits dbits et arriver sur le dgrilleur trop vite pour les dbit
maxi.
La largeur l de la grille sera alors estime par la relation :
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
465
465
l =
S
Lo
=
Qp(m / s)
0,180.t
.0,44=
Qp(m / s).2,5
t
enm
3 3
longueur adopte : largeur commerciale l =
S
Lo
>
3.5.1.1) Estimation des quantits de refus de dgrillage.
On peut estimer le refus annuel de dgrillage par quivalent habitant. V est exprim en litres par
quivalent habitant et par an.
refus annuel de dgrillage par Eqh: V(l / Eqh.an) 8 10 l / e (e = cartement en cm)
espacement de 40 mm : 2 2,5 l / Eqh.an
espacement de 20 mm : 4 5 l / Eqh.an
espacement inf 6 mm : 13 17 l / Eqh.an
valeur hors compactage ( il y a lieu de diminuer de 35% le volume avec compactage)
densit : bruts = 0.7 , compacts = 0.6 0.65
siccit : bruts = 30 % , compacts = 40 50 %
% de matires organiques : 65 80 %
3.5.2) Dessablage seule
La charge superficielle ou charge hydraulique (en m3/h.m2) est calculer pour le dbit de pointe
et pour le dbit maximum.
Pour le dbit de pointe on prend une charge maximale de lordre de 50 m/h (soit 50 m
3
/m.h).
Avec cette charge, les particules de diamtre suprieur 200 m sont retenues 90 %.
On obtient alors la surface :
surface =
Qpts m / h
50 m/ h
3
Valeurs plus prcies:
- Qmoyen temps sec : Ch = 25 m/h avec Ts = 6 mn
- Q pointe temps sec : Ch = 38 m/h avec Ts = 4 mn
- Qmax temps de pluie : Ch = 75 m/h avec Ts = 2 mn
il y a lieu ensuite dharmoniser le dimensionnement en fonction des rapport :
Qmax/Qpts & Qpts/ Qmts
Diamtres de particules intresses ;
- graviers : dia = 3mm
- sable de 0,05 3 mm
- limon de 0,01 0,05 mm
- argiles : inf 0,01 mm
Louvrage de dessablage ne captera que les graviers et le sable
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
466
466
Avec les vitesses cites ci-dessus, lon peut atteindre les taux de captures suivants (sables retenus)
;
- sur Qmts : 80% des particules suprieures 150 microns
- sur Qmaxi : 80 % des particules suprieures 250 microns
3.5.3) Dessablage combin avec le dgraissage.
Le calcul du dgraissage est effectu pour les trois dbits suivants :
- le dbit moyen de temps sec (Qmts),
- le dbit de pointe (QPTS),
- le dbit maximum (Qmax).
Pour chacun de ces dbits, on estime les valeurs indicatives suivantes :
ch = charge applique en m
3
/m
2
/h ou m/H
Ts = temps de sjour dans l'ouvrage en h
-1
pour Qmts prendre Ch < 6 m/h 10 m/h avec Ts = 15 20'
pour Q
PTS
prendre Ch' < 10 m/h 15 m/h avec Ts =10 15'
pour Qmax prendre Ch'' < 15 m/h 30 m/h avec Ts = 5 10'
sables retenus : Q mts 80% granulomtrie suprieure 150 microns
Qmaxi 80% granulomtrie suptieure 250 microns
On peut ensuite calculer la surface du dgraisseur :
m en
m/h 15
/h m QPTS
= r dgraisseu du surface
3
Le volume du dgraisseur sera pris gal :
V = QPTS (m3/h) x 10 (mn) / 60 (ce volume est hors cne de stockage des sables).
Valeur respecter : 1,25 m
V
S
2,5 m environ
3.5.3.1) Dimensionnement de l'aroflot.
- puissance Kw abs de l'aroflot installer : 15 30 w / m
3
d'ouvrage utile ou
65 80 w / m
2
d'ouvrage utile
dbit dair correspond : 1,5 2 Nm
3
/h par
Kw absorb soit 0,15 Nm
3
/h dair par m
2
- dbit d'air en fines/moyennes bulles introduire 1 2 Nm
3
d'air / h . m
2
d'ouvrage
intress.
- diamtre du cliffort pour insufflation = 0,3 0,4 S ouvrage
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
467
467
3.5.3.2) Estimation des quantits de sables.
Ratio : quantit sable/habitant/an : 2 15 l/hab/an
densit : 1,7 2 (suivant le type de lavage)
volume de sable en litre / 1000 m
3
Pluviomtrie 0 mm 1 10 mm 10 50 mm
forte densite de population 4 25 10 45 15 60
faible densit de population 5 20 10 60 20 90
faible densit de population
et bassin fort ravinement
5 20 10 60 30 140
Valeurs mesures : 0,7 l/eqh/an mini 3,8 l/eqh/an maxi et en moyenne = 1,8 l/eqh/an
8litres/1000 m3 mini 40litres/1000m3 et en moyenne = 20litres/1000m3
siccit : 25 % mini 65% maxi et 45 % en moyenne
densit : 1,4 mini 2 maxi et 1,7 en moyenne
% de MV : 30% mini 70% maxi et 50 % en moyenne
Concentration en MES de leau sablonneuse en sortie dessableur : 100 g/l avec une densit de
1,062 g/cm3
Mlange sortie sable + eau : 3 5% de sable dans le dbit deau extrait
sable brut
siccit = 50 % +/- 10 % avec % MV infrieur 50 % (suivant lavage)
lavage par classificateur ( vrifer)
siccit = 70 % +/- 10 % avec 25 % MV+/- 10%
lavage par hydrocyclone (st Aubin les Elbeuf)
siccit = 70 % +/- 10 % avec 15 % MV+/- 6 %
3.5.3.2) Lavage des boues de curage
Caractrisation du produit brut
- Dpoter sur aire ou lits de schage
siccit = 70 % +/- 10 % avec 12 % MV +/- 3 % (Dijon)
- Dpoter en fosse
siccit = 60 % +/- 15 % avec % MV +/- 3 % (Vernon)
Caractrisation du produit aprs lavage
lavage : hydrocyclone + classificateur (Vernon)
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
468
468
siccit = 80 % +/- 10 % avec 10 % MV +/- 3 %
lavage : 2 hydrocyclones + classificateur (Dijon)
siccit = 80 % +/- 10 % avec 5 % MV +/- 3 %
3.5.3.3) Estimation des quantits de graisses.
Calcul thorique :
- Quantit graisse/habitant/an : 1 kg/hab/an exprime en M.E.H (sortie dgraisseur avec
un rendement maxi de 20 % et une concentration de 50 g/l 80 g/l de M.E.H) soit un volume
annuel de 13 l / Eqh.an et 0,5 kg/hab/an et 6,5 l/ Eqh.an pour un rendement de 10% du
dgraisseur
Valeurs mesures sur site :
- 0,6 2,2 l/hab/an soit 1,3 l / hab/an en moyenne
- 6 24 l /1000m3 deau brute soit 14 l /1000 m3 deau brute en moyenne
Concentration des graisses internes : 35 80 g MEH/l soit 100 225 g DCO/l
prendre 225g DCO/l
Concentration des graisses externes : 35 285 g MEH/l soit 100 800 g DCO/l
prendre 500 g DCO/l
siccit de 25 mini 45 maxi soit en moyenne = 35%
densit = 0,8 0,9
% de MV 82% mini et 98% et en moyenne = 80% de MV
viscosit = 2 x celle de leau (v eau = 10
-6
m
2
/s)
3.5.3.4) Traitement biologique des graisses
Si apport de graisses de l'extrieur :
Ncessit d'installer une fosse de dpotage brasse et dsodorise pour rpartir l'apport en graisse
dans le racteur de traitement biologique des graisses.
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
469
469
1
4
5
6
Aration
Traitement
biologique
3 2
Graisses d'
alimentation
1 - fosse de dpotage des graisses extrieures (mlanges aux graisses internes)
2 - Systme intensif de brassage de la fosse de dpotage
3 - pompe d'alimentation du racteur en graisse (pompe volumtrique de prfrence)
4- dispositif d'apport en oxygne (moyennes bulles) associ ou pas brassage
5- apport en eau industriel pour la gestion d'extraction des boues en excs
6- pompe d'extraction des boues en excs (vers le traitement des boues ou le racteur
biologique de la station)
Approche dimensionnelle:
- fosse de dpotage en fonction du nombre de camions par semaine (40w/m3)
- charge volumique moyenne d'alimentation = 2,5 kg DCO.m
-3
.j
-1
- 1kg de graisse (exprim en MEH ou SEC) = 2,8 kg de DCO
- % DCO graisse dans un effluent urbain = 33% 35%
- rendement des dgraisseurs environ 15%
- concentrations en MEH de 15 35 g/l et en DCO de 40 150 g/l (de 30 400 g/l pour les
apports extrieurs : vidangeurs,...)
- concentration dans le racteur = 15 20g/l maxi
- apport en oxygne = 0,7 kg d'O2/kg DCO admise dans le racteur
- production de boues = 0,3 kg de MS / DCO entrante
- rendement sur les graisses = 80%
- rendement sur la DCO AD2h = 95%
- revanche dans le racteur = 1m
- rendement des diffuseurs moyennes bulles = 3,5% par mtre de colonne d'eau
- CGT pour moyennes bulles dans le milieu = 0,5
- perte de charge globale en aval = 50 mbars
- dbit unitaire = 7 Nm3/h par diffuseur moyenne bulle
- brassage = 10 w/m3 minimum
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
470
470
3.6) CALCUL DE LA ZONE DE CONTACT
Le rle de cette cuve de petit volume est d'anticiper sur les risques de dgradation de la qualit de
la boue active dfinie par son IM (cf. annexe) provenant notamment d'un dsquilibre
nutritionnel dans le bassin d'aration (notamment en cas de prsence d'effluent agroalimentaire),
favorisant ainsi le dveloppement de bactries filamenteuses, avec comme consquence
"fcheuse" une mauvaise dcantabilit de la boue dans le clarificateur. Dans cette zone, on met en
contact une fraction des boues actives issues du clarificateur avec du substrat carbon (carbone
facilement assimilable issu de l'inffluent).
Les critres de dimensionnement de la zone de contact sont Qrzc et Tc.
Qrzc : dbit spcifique de recirculation vers la zone de contact.
Tc : temps de contact (de l'ordre de10 15mn sur Qpts 20 25mm minimum sur Qmts ).
Qrzc =
DCO assimilable (mg / l) .Qpts en m / h
Charge DCO mg / g boue. sr (g / l)
en m / h
3
3
Charge DCO en mg par g de boue recircule de l'ordre de 80 130 (fonction de la
charge massique)
sr = concentration des boues recircules en g / l
DCO assimilable = 25 50 % de la DCO brute de l'influent (cela est fonction du type
d'effluent et drevait tre confirm par des analyses).
Le volume de la zone de contact (Vol
zc
) est alors obtenu par :
Vol
Qrzc +QPTS
60
x Tc
zc
=
Nota : Dans le cas de la prsence d'une dcantation primaire en amont du racteur
biologique, il y a lieu d'alimenter la zone de contact - situe en aval de la dcantation
primaire - en effluent brut et non en effluent dcant, en by-passant en amont de la
dcantation primaire une fraction de l'effluent brut (de l'ordre de 25 30 % du total). Le
dimensionnement des besoins en recirculation spcifique et du volume de la zone se fera sur
la fraction by-passe.
3.7) CALCUL DE LA PRODUCTION DE BOUES EN EXCES
3.7.1) Remarques prliminaires
Contrairement aux anciennes mthodes de calcul, le volume du racteur biologique (volume
aration + volume anoxie si cette dernire est retenue) sera dfini par rapport la notion d'ge de
boue d'une part et de la concentration en M.E.S. maintenir dans le racteur d'autre part.
Cette concentration en MES du bassin biologique sera choisie en fonction de la filire eau retenue
et des quipements d'aration et/ou de brassage retenus et permettra le dimensionnement du
clarificateur associ un indice de Mohlman et au rgime hydraulique le plus contraignant.
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
471
471
La concentration en boue active (Sa gale la concentration en MES fois le taux de MV des
MES) associe un volume du racteur biologique (bassin d'aration + bassin d'anoxie si cette
dernire est retenue) nous donne une masse de boue active (en ngligeant la masse de boue
stocke dans le clarificateur). Cette masse de boue active associe des cintiques de dgradation
de la pollution carbone, de nitrification, dnitrification nous permet de dfinir les volumes des
cuves fonction du flux de l'inffluent et des concentrations de sortie.
Le clarificateur quant lui est une cuve de sparation de phase (liquide-solide) dpendant d'autres
paramtres ; les dbits, masse de boue transfre, l'aptitude de la boue dcanter, paissir, temps
de sjour maxi des boues dans l'ouvrage, de sa gomtrie qui altre le moins la qualit de l'eau
interstitielle (celle obtenue en aval du racteur biologique) avec le souci d'vacuer une eau en aval
de cette cuve la moins charge en MES (les MES en sortie renfermant une fraction de DBO
5
, de
NTK et de Ptot que l'on ne pourra pas ngliger dans les traitements pousss - fraction dite
particulaire).
3.7.2) Production de boues en excs biologiques
Les paramtre influenant la production de boues sont les suivants :
Le rapport MES/DBO
5
, la charge massique et le rapport MVS/MES dans l'inffluent (effluent
brut).
La production de boue peut tre approche par la formule suivante :
S = Smin + Sdur + (0,83 + 0,2 x log Cm)DBO
5 + K'Nnitrifi fuite Mes
Dans cette relation le logarithme utilis est dcimal.
La signification des variables utilises est la suivante :
Sdur = partie non biodgradable des matires volatiles en suspension (MVS).
Smin = partie minrale des MES.
Cm = charge massique, exprime en KgDBO5/KgMVS.j.
DBO5 = quantit de DBO5 limine assimile la DBO5 entrante dans le racteur
dans le cas d'un dimensionnement.
K' = 0,17 kg de nitrifiantes / kg de N nitrifi
Fuite Mes = ngligeable sauf dans le cas d'une simulation.
Ces grandeurs sont calcules sur effluent arrivant sur le racteur biologique plus les retours en tte
pour la DBO
5
et les MES.
S est la production de boue biologique en excs dans le racteur extraire par jour (hors
production des boues primaires issues de la dcantation primaire et sans tenir compte des"fuites"
biologiques correspondant au MES sortie du clarificateur).
Nota : Pour les stations de petites tailles et, ce jusqu' environ 50 000 Eq.h, voire au-del, dans le
but d'envisager une filire de traitement de boues simples - sans stabilisation spare avant la
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
472
472
dshydratation - on s'imposera une charge massique < 0,12 kg DBO
5
/ kg MVS.j. Cette valeur sera
utilise en premire aproximation pour le calcul de S. La valeur finale des boues en excs
prendra en compte la Cm dfinitive.
Il est bien entendu que la notion de stabilisation dans le cas d'une boue une charge massique
infrieure 0,12 est toute relative. La boue n'est pas stabilise mais elle volue moins vite que
boue provenant d'une charge massique plus leve.
Hormis une stabilisation anarobie ou arobie thermophile, on ne peut pas vritablement parler de
boue "stabilise" dans le racteur, mme des trs faibles charges massiques (inf 0,1 Kg
DBO
5
/Kg MVS.J).
Les grandeurs Sdur et Smin sont values comme suit :
Sdur = 0,15 0,3 [MVS] effluent brut
Smin = MES x ( 100 - pourcentage de MV des MES) / 100
Le pourcentage de MV dans les MES de l'effluent brut devant tre obligatoirement mesur.
A dfaut (ce qui est fcheux), le pourcentage de MV dans les MES en entre peut tre valu en
fonction du rapport MES/DBO
5
.
Valeur de rfrence :
MES / DBO5 1.5 1.17 1 0.83 0.67
% MVS 60 65 68 70 75
Le pourcentage de MV dans les boues produites est donn par la relation :
pourcentage MV dans boues produites = (1-
Smin
production de boues
)
Cette valeur en MVS sera utilise dans la suite du calcul du volume du traitement
biologique.
3.7.2.1. Charge massique de rfrence appliquer en fonction du rendement de la DBO
5
Prliminaire :
Pour les stations de petite taille, pour une filire de traitement de boues simple, sans
stabilisation pralable, on s'imposera un charge massique < 0.12 kg DBO
5
/ kg MVS.j .
% lim DBO5 99 98 97 95 92 90 85 80
Cm (KgDBO5/kgMVS.j) 0.035 0.09 0.2 0.3 0.5 0.65 0.96 1.3
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
473
473
Cm =
DBO5
Masse de boue active
=
DBO5
Sa . %MVS . V
en kgDBO / kgMVS. j
5
Cm
-
99 5
15
, % rdt
La signification des variables utilises ci-dessus est la suivante :
DBO
5
: Quantit de DBO
5
traiter par jour.
Sa : Concentration en MES dans le racteur.
% MVS = Pourcentage de matires volatiles dans les matires en suspension.
V = Volume du racteur biologique (hors zone d'anarobie) = VAER + VANOX.
VAER = Volume de la zone ar.
VANOX = volume de la zone anoxique.
rdt% = Rendement obtenu sur la DBO
5
soluble.
3.7.2.2. Charge massique de rfrence appliquer en fonction de l'ge de boue
Dans ce paragraphe nous allons voir comment estimer la charge massique de rfrence appliquer
en fonction de l'ge de boue.
Soit A l'ge de boue de rfrence ( valeurs indicatives), cest dire l'ge de boues maintenir dans
la station pour assurer le traitement.
Concentration de 30 mg/l en DBO
5
sortie A = 2j
Concentration de 15 mg/l en DBO
5
sortie A' = 4j
NGL
=
15 mg/l en sortie A 13 j 12C *
NGL
=
10 mg/l en sortie A' 18 j 12C *
* fonction de la cintique de nitrification , valeurs qui tiennent compte de la masse de boues
prsentes dans la clarificateur et reprsentant en quilibre une masse correspondant 2 j d'ge de
boue environ et fonction de la concentration de en NTK sur l'effluent brut.
Cm =
DBO5
Sa . % MVS
ba.
. VBiol
A =
Sa . VBiol
PB
(ge moyen des boues maintenues dans le racteur )
La signification des variables utilises dans ces relations est la suivante :
Sa = concentration MES dans le racteur (g/l).
%MVS
ba
= Pourcentage de matires volatiles dans les matires en suspension du
traitement biologique.
VBiol = Volume racteur biologique (aration + anoxie l'exclusion du bassin anarobiose
et en ngligeant en 1re approximation la masse de boue dans le clarificateur)
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
474
474
PB = Boues biologiques produites en excs (kg MS)
A titre d'information
La production de boues biologiques en fonction de l'ge de boue et du rapport MES/DBO
5
valeur
exprime en kgMS/kgDB0
5
(suivant les prescriptions de l'ATV 131 en usage en Allemagne).
Age en jours
MES/DBO5 4 6 8 10 15 25
0,4 0,74 0,70 0,67 0,64 0,59 0,52
0,6 0,86 0,82 0,79 0,76 0,71 0,64
0,8 0,98 0,94 0,91 0,88 0,83 0,76
1,0 1,10 1,06 1,03 1,00 0,95 0,88
1,2 1,22 1,18 1,15 1,12 1,07 1,00
PRODUCTION DE BOUES BIOLOGIQUES
CM kg DBO/kg MV
k
g
M
S
/
k
g
D
B
O
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
0
.
0
2
0
.
0
4
0
.
0
6
0
.
0
8
0
.
1
0
.
1
2
0
.
1
4
0
.
1
6
0
.
1
8
0
.
2
0
.
2
2
0
.
2
4
0
.
2
6
0
.
2
8
0
.
3
0
.
3
2
0
.
3
4
0
.
3
6
0
.
3
8
0
.
4
0
.
4
2
0
.
4
4
0
.
4
6
0
.
4
8
0
.
5
MES/DBO = 0.4
MES/DBO = 0.6
MES/DBO = 0.8
MES/DBO = 1
MES/DBO = 1.2
MES/DBO = 1.4
MES/DBO = 1.6
3.7.3) Production de boues physico-chimiques
Nous nous plaons dans le cas d'un traitement du phosphore, par prcipitation simultane ou en
tertiaire couple ou pas une dphosphatation biologique (une dphosphatation biologique seule
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
475
475
ne permet pas de garantir la norme la sortie, elle devra tre couple systmatiquement un
traitement physico-chimique en simultane ou en tertiaire).
La production de boues physico-chimiques (PBpc) peut tre estime en premire approximation
par les relations :
PBpc = (P
entre
- Pass - Prejet) x 7 en prcipitation simultane (Pt1)
PBpc = (Pentre - Pass - Prejet) x 8 en traitement tertiaire (PT2)
P
entre = P soluble de l'effluent brut
Pass = phosphore assimil dans les boues soit 1,5 2,5% des matires volatiles des boues
produites.
Prejet = phosphore rejet exprim en soluble (fonction du niveau de rejet).
La production de boues totale est gale la production de boues biologiques plus la
production de boues physico-chimiques.
3.8) CALCUL DU CLARIFICATEUR SECONDAIRE
Le clarificateur devrait se dimensionner avant le racteur biologique, car c'est lui qui impose "sa
loi" dans la distribution de la masse de boue prsente dans le racteur ( volume constant du
racteur , la masse sera dfinie par une concentration en MES ne pas pas dpasser et cela en
fonction de la qualit mcanique de la boue, dfinie par son IM)
En fonction de charge massique (Cm) initiale on dfinit un indice de Mohlman.
Indice de Mohlman = volume occup par un gramme de boue (ml/g) , sans dilution.
ESTIMATION DE L'INDICE DE MOHLMAN
C M (kg DBO/kg MV)
I
M
(
m
l
/
g
)
100
120
140
160
180
200
220
240
260
0.05 0.1 0.15 0.2
IM mini
IM courant
IM fort
Ce graphe donne une tendance de lvolution de IM de rfrence en fonction de la charge
massique.
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
476
476
Cm Besoin besoin IM % MVS Sa
kgDB05/kgMVS mtabolisme respiration de rference dans le en g/l
(a') endogne (b') ml/g reacteur
(KgO2) (KgO2)
0,035 0,7 0,055 150 60 5 ou 3.5 *
0,65 0,7 0,06 150 63 5 ou 3.5 *
0,09 0,7 0,07 150 65 5 ou 3.5 *
0,15 0,68 0,075 170 70 3.5
0,30 0,65 0,085 200 75 3
0,6 0,6 0,1 250 78 2.5
0,9 0,5 0,14 300 82 2
Tableau des variables (a', b', IM, %MVS en fonction de CM)
dans le tableau les valeurs des IM et % MVS sont donnes titre indicatif
* 5 g/l si dissociation aration - brassage & 3.5 g/l si turbine ou brosse seule.
En fonction de l'IM, on dduit une vitesse ascensionnelle maximale appliquer sur le Qmaxi
dfini dans les paramtres de l'effluent.
Valeurs des vitesses correspondantes pour une concentration en MES de 30 mg/l maxi, sur le
rgime hydraulique horaire, sur leffluent trait.
IM en ml/g 75 100 125 150 175 200 250 300 400 500
Va en m/h 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,85 0,8 0,7 0,6
Pour obtenir une concentration maxi de 20 mg/l en MES sur le rgime horaire, un
coefficient de O.66 sera appliqu sur les vitesses du tableau ci-dessus.
La surface utile (hors clifford et pivot central - surface dite au miroir) est gale au rapport
Q
maxi
/V
maxi
.
La concentration en recirculation dpendra de IM, du temps de sjour des boues dans le lit de
boues du clarificateur et du taux de recirculation.
Si l'on admet les dfinitions ci-dessous :
Sr = concentration boues recircules en MES (g/l)
Sa = concentration MES boue bassin d'aration (g/l)
R = taux de recirculation en %
Nous pouvons crire :
R = Sa .100/ (Sr- Sa)
A titre indicatif, nous donnons quelques valeurs de la concentration dans le racteur biologique :
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
477
477
cas de dissociation aration-brassage et/ou dphosphatation simultane
1,5 g/l < sa 5 g/l
cas turbine ou brosse seule
1,5 g/l sa 3.5 g/l
La figure ci-dessous donne le temps de sjour maximum des boues dans le lit de boues du
clarificateur (exprim en mn).
TEMPS DE SEJOUR MAXIMUM DES BOUES DANS LE
CLARIFICATEUR
CM (kg DBO5 /kg MVS)
T
e
m
p
s
d
e
s
j
o
u
r
e
n
m
n
0
20
40
60
80
100
120
140
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
A titre indicatif les temps adopter sont les suivants :
1) traitement nitrification-dnitrification
60 mn pour Cm 0.3:
80 mn pour Cm = 0,1
120 mn pour Cm 0,09
2) traitement nitrification seule
25 mn pour Cm 0,3
40 mn pour Cm 0,1
50 mn pour Cm 0,09
La concentration des boues dans la recirculation (Sr) qui est value par la formule approche
suivante correspond sensiblement un temps de sjour des boues dans le clarificateur de
90 mn ( ne pas confondre avec le temps de sjour hydraulique de l'eau clarifie) :
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
478
478
Sr X
1000
1 3
IM
.
Nota : le facteur 1,3 tient compte de l'paississement des boues dans le clarificateur
pour un temps de sjour moyen des boues de 90 mn.
Nota 1 : A titre d'information, l'ATV 131 utilise la formule ; Sr = K x
1000
ISV
x(ts
h
)
1
3
ISV = assimil IM
ts
h
= temps de sjour exprim en heure
K = facteur dpendant du systme de reprise (variant de 0,5 0,7)
la formule ATV sous-estime la valeur de Sr ; de plus, sa plage de validite correspond
pour des ISV situs entre 70 et 180 ml/g, les taux de recirculation de l'ATV seront
donc plus forts ( en vitant de dpasser 150 % de Qmaxi), ou inversement il y aura
lieu d'appliquer un concentration plus faible en MES dans le racteur.
Valeurs indicatives des relations IM, Sr, Sa :
IM = 250 ml/g -> Sr = 5 g/l, Sa = 2,5 g/l avec R = 100 %
IM = 200 ml/g -> Sr = 6 g/l , sa = 3 g/l avec R = 100 %
IM = 150 ml/g -> Sr = 8 g/l , sa = 4 g/l avec R = 100 %
IM = 125 ml/g -> Sr = 10 g/l , sa = 5 g/l avec R = 100 %
nota 2: R = 100 x Sa / (Sr - Sa)
avec R = taux de recirculation
Le clarificateur doit tre dimensionn avec les mmes hypothses que nous prendrons plus loin
pour le dimensionnement des pompes de recirculation. Ces hypothses dpendront, d'une part, des
conditions d'exploitation, et d'autre part, des caractristiques de la filire eau et boue ainsi que des
quipements choisis.
1) Equipement dissociation aration-brassage et grille d'gouttage + filtre bandes ou
stockage :
IM = IM rfrence + 30 ml/g ou Sa = 5g/l +1 g/l
2) Equipement sans dissociation et paississeur + filtre bandes ou stockage
IM = IM rfrence + 100 ml/g et Sa = 3.5 + 0.5 g/l
Profondeur du clarificateur (mthode type ATV 131 / CEMAGREF)
ht = h1 + h2 + h3 + h4 (hauteur priphrique)
h1 = zone d'eau clarifie 0,5 m
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
479
479
h2 = zone de sdimentation = 1 m (rseau sparatif)
0,8 m (rseau unitaire)
h3 = zone d' paississement =
sa . IM
1000
h4 = zone de stockage (rseau unitaire uniquement ou rseau sparatif "fuyant")
h4 =
sa' .V . IM
1000 Su
(les Allemands prennent 500)
.
avec :
Su = surface utile du clarificateur
V = Volume total du racteur biologique
IM = indice de Mohlman
sa' = 0,5 1g/l (variation de concentration dans le bassin d'aration par temps de
pluie)
Le calcul des sections du clifford et du dgazage sont effectues de faon ce que la vitesse
maximale soit infrieure 2,5 cm/s (soit 90 m/h). Cette vitesse doit tre calcule en prenant en
compte le dbit traversier maximum plus le dbit de recirculation maximum.
Les sections des divers lments du clarificateur peuvent tre estimes en se basant sur les vitesses
suivantes :
V
1
conduite d'arrive : 0,3 < V < 1 m/s
V
2
ft central : 0,75 > V > 0,3 m/s
V
3
passage dans les lumires : V < 0,3 m/s
V
4
sortie boues recircules : 0,6 < V < 1 m/s
La relation qui definit la hauteur du clarificateur en fonction de son diamtre est la
suivante :
hauteur minimale en priphrie = 1,8 + 0,03 diamtre
avec comme valeur de hauteur minimum en priphrie de l'ouvrage de clarification :
h mini = 2 m en rseau sparatif
h' min = 2,5 m en rseau unitaire
Le dbit maximum de recirculation est de 40 m
3
/h/m de pont suc.
Si le dbit maximum de recirculation est suprieur cette valeur; il est ncessaire de passer deux
clarificateurs de section totale quivalente.
La vitesse de rotation du pont est prise approximativement gale 5 cm/s.
Le temps ncessaire pour que le pont fasse un tour du clarificateur doit tre infrieur au temps de
sjour maxi des boues permis dans le clarificateur. Si ceci est impossible, il est ncessaire de
passer un pont racl ou suc de type diamtral.
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
480
480
Le Volume du clarificateur est gal la section intrieure que multiplie la hauteur moyenne.
La pente adopter pour le radier est dfinie comme suit :
pont racl : pente du radier superieure ou gale 10 %
pont suc :pente du radier superieure ou gale 1 %
nota 1 :
Il est conseill de passer d'un pont racl un pont suc lorsque le diamtre du clarificateur est
suprieur 20 m. Ceci devient obligatoire pour des diamtres suprieurs 24 m.
Dans le cas d'un pont suc, au-del de 45 m il y a lieu de passer deux clarificateurs, de section
totale quivalente.
nota 2 :
Les volumes obtenus par les abaques suivantes sont diffrents du calcul prcdent (type
ATV/CEMAGREF) car elles sont obtenues par des calculs en boucle sur micro-ordinateur suivant
d'autres critres (mthode CIRSEE). Alors que fait-on ?
Les courbes ci-aprs donnent un ratio de m
3
de clarificateur par m
3
/h de dbit maxi arrivant sur le
clarificateur (dbit maxi correspondant aux valeurs values sur l'inffluent hors dbit de
recirculation), avec les paramtres suivants :
- Le ratio du dbit traversier maximum sur le dbit de recirculation (Qmax / Qr)
prendre gal un pour le dimensionnement.
- concentration Sa prise dans le racteur biologique (lire MS # MES en g/l)
- IM retenu dans les hypothses de dimensionnement
Nous rappelons qu'il est ncessaire de se situer toujours en-de de la courbe limite "temps de
sjour maxi des boues" dans le lit de boues du clarificateur.
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
481
481
VOLUME DE CLARIFICATEUR (m3 / (m3/h de
dbit max)) Qr= 1.5 x Qmax
V
(
m
3
/
(
m
3
/
h
)
)
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
1
3
0
1
4
0
1
5
0
1
6
0
1
7
0
1
8
0
1
9
0
2
0
0
2
1
0
2
2
0
2
3
0
2
4
0
2
5
0
Limit e pour
t emps de sjour
max.
MS = 2 g/l
MS = 3 g/l
MS = 4 g/l
MS = 5 g/l
MS = 6 g/l
IM
VOLUME DE CLARIFICATEUR (m3 / (m3/h de
dbit max)) Qr=0.5 x Qmax
V
(
m
3
/
(
m
3
/
h
)
)
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
1
3
0
1
4
0
1
5
0
1
6
0
1
7
0
1
8
0
1
9
0
2
0
0
2
1
0
2
2
0
2
3
0
2
4
0
2
5
0
Limit e pour
t emps de sjour
max.
MS = 2 g/l
MS = 3 g/l MS = 4 g/l
IM
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
482
482
VOLUME DE CLARIFICATEUR (m3 / (m3/h de
dbit max)) Qr=Qmax
V
(
m
3
/
(
m
3
/
h
)
)
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
1
3
0
1
4
0
1
5
0
1
6
0
1
7
0
1
8
0
1
9
0
2
0
0
2
1
0
2
2
0
2
3
0
2
4
0
2
5
0
Limit e pour
t emps de sjour
max.
MS = 2 g/l
MS = 3 g/l
MS = 4 g/l
MS = 5 g/l
MS = 6 g/l
IM
3.9) COMPARAISON ENTRE DIFFERENTES METHODES DE
DIMENSIONNEMENT DES CLARIFICATEURS
Nous allons comparer succintement 3 mthodes de dimensionnement des clarificateurs
secondaires : CIRSEE, ATV131et CEMAGREF
3.9.1) Rappel
Le clarificateur secondaire dans un procd boues actives doit assurer en permanence 2 fonctions :
1) Fonction de clarification ( retenir le maximum de particules en suspension) et respecter
une concentration en MES maximale sur leffluent trait,
2) Fonction dpaississement des boues afin de recirculer des boues plus concentres
que celles se trouvant dans le racteur biologique,
Dans le cas du traitement dvnements pluvieux, une troisime fonction doit tre assure :
3) Stocker provisoirement une quantit de boue lors de surcharges hydrauliques
temporaires et prvisibles et cela pendant un temps de sjour des boues matris.
3.9.2) Approche dimensionnelle
Le clarificateur secondaire est dimensionne suivant 3 grands principes :
la surface de clarification
le volume de clarification
le volume d'paississement des boues en recirculation
3.9.2.1 ) La surface de clarification (approche CIRSEE)
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
483
483
La surface de clarification est dtermine par :
Scf = Qefmax / Va
ou :
Qefmax = dbit maximum de l'effluent (m3/h)
Va = vitesse maximum de clarification (m/h)
Classiquement, cette vitesse maximum est dfinie en fonction de la charge massique applique en
traitement biologique, ou dun volume corrig de boue ou dune charge volumique de boue. Or, il nous
semble que cette vitesse est avant tout dpendante :
de la qualit mcanique des boues (soit IM, soit IB des boues),
de la fuite, tolre, en MES dans l'effluent trait sur un chantillon moyen 24h,
sur une base de 30 mg / l de MES dans l'effluent nous avons :
IM en ml/g 75 100 125 150 175 200 250 300 400 500
Va en m/h 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,85 0,8 0,7 0,6
avec :
IM : Indice de Mohlman
IB : Indice de boue
Va : charge hydraulique ( m
3
/m
2
.h) ou vitesse ascensionnelle ou vitesse de Hazen.
Nota : cette vitesse est indpendante de la profondeur de louvrage de sparation
et est gale au rapport du dbit traversier sur la surface horizontal de louvrage.
3.9.2.2 ) La surface de clarification (approche CEMAGREF)
Le CEMAGREF a tabli une courbe pour dterminer la charge hydraulique en fonction du volume corrig,
cette courbe a t obtenue sur des clarificateurs flux verticaux (lentre du flux provenant du racteur
biologique se fait dans le lit de boue ) et dans ce cas de figure la vitesse de chute des particules ou vitesse
de Hazen (ou charge hydraulique) est effectivement dpendante de la concentration locale en particules
(thorie de Kynch).
Hors dans les clarificateurs flux horizontaux les plus courants, cette courbe est trs conservatrice car
larrive du flux provenant du racteur biologique se fait dans leau clarifie bien au-dessus du lit de boue
donc nous sommes en rgime de dilution ( la dcantation est libre - ce qui caractrise lIndice de Boue par
opposition lIndice de Mohlman) et par consquent la vitesse de chutes des particules ou charge
hydraulique est indpendante de la concentration locale donc indpendant de la concentration en boue dans
le racteur.
Cela signifie que la valeur de la vitesse ascensionnelle prise en considration par la mthode CEMAGREF,
prvue pour les clarificateur verticaux et trs conservatrice pour les clarificateurs horizontaux.
Pour dfinir la vitesse (ou charge hydraulique superficielle en m
3
/m
2
/h) appliquer sur le clarificateur la
courbe du CEMAGREF (mthode inspire dune mthode allemande introduite dans lATV A131) indique le
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
484
484
charge hydraulique appliquer en fonction du volume corrig exprim en ml/l (le volume corrig correspond
au produit de la concentration en boue en g/l de MES dans la racteur par lindice de boue en ml/g).
Cette courbe peut tre modlise sous la forme ; Ch = f( IB, Caer) soit ;
Ch en m
3
/m
2
/h = 2,56 x e
( - 0,00193 x IB x Caer)
o ;
Ch = charge hydraulique ou vitesse ascensionnelle en m
3
/m
2
.h ou m/h
IB = indice de boue en ml/g
Caer = concentration dans le racteur biologique en g/l
Vc = IB x Caer en ml/l
3.9.2.3 ) La surface de clarification (approche ATV A131)
Lapproche de lATV A131 est base sur la notion de charge volumique de boue : q
sv
q
sv
= Ch x IB x Caer en l / (m
2
.h)
o ;
Ch = charge hydraulique ou vitesse ascensionnelle en m
3
/m
2
/h ou m/h
IB = indice de boue en ml/g (ISV)
Caer = concentration dans le racteur biologique en g/l
avec ;
Ch en m
3
/m
2
.h = 450 / IBxCaer pour le clarificateur horizontaux
Ch en m
3
/m
2
.h = 600 / IBxCaer pour le clarificateur verticaux
Dans lapproche de lATV A 131, il est considr que lon peut appliquer une vitesse suprieure dans le cas
dun clarificateur vertical par rapport au clarificateur horizontal.
Le nouvelle version en projet de lATV A 131 qui date davril 1999 propose des nouvelles valeurs de q
sv
pour respecter une valeur en concentration en MES sur leffluent de sortie de 20mg/l ;
- Pour un clarificateur horizontal q
sv
= 500 l / (m
2
.h)
- Pour un clarificateur vertical q
sv
= 650 l / (m
2
.h)
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
485
485
Clarificateur flux horizontal
Ancienne dfinition : rapport diamtre (ou longueur) / profondeur suprieur 6, larrive de la boue issue
du racteur biologique se fait dans la partie eau clarifie . La jupe clifford est faiblement immerge, au niveau
du tiers suprieur de la profondeur.
Clarificateur flux vertical
Dfinition de lATV A 131 : La profondeur dimmersion de la jupe clifford est suprieure la moiti du
cheminement de leau clarifie (soit H im suprieure au rayon / 2 dans le cas dun clarificateur circulaire).
Larrive de la boue issue du racteur biologique se fait donc dans lit de boue ( jupe clifford immerge, de
la moiti au tiers infrieur de la profondeur, au milieu de la zone de stockage dite zone 3 ), le lit de boue
aurait un rle de filtration ce qui permet dobtenir un gain de lordre de 30% sur la charge hydraulique
superficielle, pour une mme valeur de la concentration en MES de leffluent trait ( ce qui est formalis par
le rapport 600/450 dans lancienne approche ATV A131 et 650/500 dans la nouvelle approche ATV date
davril 1999).
3.9.2.4 ) Application des diffrentes mthodes sur lvaluation de la vitesse ascensionnelle
Vitesses ascensionnelles obtenues par la courbe de CEMAGREF en fonction de diffrentes valeurs dindice
et de concentration en boue dans le racteur biologique;
Indice de boue ou de Mohlman 4g/l 4,5 g/l 5g/l
Vitesse pour IB = 100 ml/g 1,18 m/h 1,07 m/h 0,98 m/h
Vitesse pour IB = 135 ml/g 0,90 m/h 0,79 m/h 0,70 m/h
Vitesse pour IB = 150 ml/g 0,80 m/h 0,70 m/h 0,60 m/h
Vitesse obtenu selon lapproche ATV A131 pour un clarificateur horizontal, avec Ch m
3
/m
2
/h = 450 / IBxCaer
:
Indice de boue ou de Mohlman 4g/l 4,5 g/l 5g/l
Vitesse pour IB = 100 ml/g 1,13 m/h 1,00 m/h 0,90 m/h
Vitesse pour IB = 135 ml/g 0,83 m/h 0,74 m/h 0,67 m/h
Vitesse pour IB = 150 ml/g 0,75 m/h 0,67 m/h 0,60 m/h
Vitesse obtenu selon lapproche ATV A131 pour un clarificateur horizontal, avec Ch m
3
/m
2
/h = 500 / IBxCaer
:
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
486
486
Indice de boue ou de Mohlman 4g/l 4,5 g/l 5g/l
Vitesse pour IB = 100 ml/g 1,25 m/h 1,10 m/h 1,00 m/h
Vitesse pour IB = 135 ml/g 0,93 m/h 0,82m/h 0,74 m/h
Vitesse pour IB = 150 ml/g 0,83 m/h 0,74 m/h 0,67 m/h
Vitesse obtenu selon lapproche ATV131 pour un clarificateur verticaux, avec Ch m
3
/m
2
/h = 600 / IBxCaer :
Indice de boue ou de Mohlman 4g/l 4,5 g/l 5g/l
Vitesse pour IB = 100 ml/g 1,5 m/h 1,33 m/h 1,2 m/h
Vitesse pour IB = 135 ml/g 1,11 m/h 0,99 m/h 0,89 m/h
Vitesse pour IB = 150 ml/g 1,0 m/h 0,89 m/h 0,80 m/h
Vitesse obtenu selon lapproche ATV131 pour un clarificateur verticaux, avec Ch m
3
/m
2
/h = 650 / IBxCaer :
Indice de boue ou de Mohlman 4g/l 4,5 g/l 5g/l
Vitesse pour IB = 100 ml/g 1,63 m/h 1,44 m/h 1,3 m/h
Vitesse pour IB = 135 ml/g 1,20 m/h 1,07 m/h 0,96 m/h
Vitesse pour IB = 150 ml/g 1,08 m/h 0,96 m/h 0,87 m/h
En priode de pluie, nous assistons une dconcentration en MES dans le racteur pendant quelques
heures en raison du dplacement dune partie des boues dans le clarificateur : la concentration en MES
dans le racteur biologique peut chuter de lordre de 0,3 1 g/l (suivant les dbits traversiers durant les
vnements pluvieux) et le volume corrig baissera dautant. Ce qui permet dappliquer des vitesses
hydrauliques sur le clarificateur durant les vnements pluvieux suprieures aux vitesses appliques durant
les priode de temps sec, et cela pour un mme Indice de boue.
Par contre il y aura lieu de prvoir un volume supplmentaire dans le clarificateur pour le stockage
momentan de ce volume de boue.
3.9.2.5 ) Volume de clarification (approche CIRSEE)
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
487
487
Il correspond un temps de sjour minimum dans la zone de clarification. Ce temps de sjour, de l'ordre de
1h30 2h sur la base du rgime hydraulique de pointe, doit permettre d'atteindre un taux optimum
d'abattement des particules dcantables (en rfrence l' AD
2h
, dcantation aprs 2 h).
- Le volume de clarification est donc :
Vcl Qmaxi x 1,5
avec Qmaxi = dbit horaire maximum traversier (pointe de temps sec ou maxi horaire en priode de pluie)
Nota : Dans lapproche CEMAGREF, inspire par lapproche allemande, le volume du clarificateur est la
somme de 4 hauteurs correspondant chacune une fonction spcifique (eau claire, sparation,
paississement, stockage) et rgit par des quations particulires.
3.9.2.6 ) Volume dpaississement (approche CIRSEE)
Il correspond au volume occup par les boues actives pendant la phase d'paississement :
Volume dpaississement = Masse de boue clarif / Concentration du lit de boues
Masse de boue clarif = dbit de recirculation x Sr x temps dpaississement
soit :
VBcf= Mbcf / ConcLB
avec:
MBcf= Qr * Cr * Ts
Cr = Cba * ( 1 + Qmaxi / Qr )
o :
VBcf = volume de boue dans le clarificateur (M3)
MBcf = masse de boue dans le clarificateur (Kg )
Cba = concentration en boues actives dans l'aration (Kg / M3 ou g /l )
Cr = concentration de recirculation (Kg/M3 ou g/l )
Qr = dbit de recirculation (M3 / h)
Ts = temps d'paississement des boues actives pour atteindre Cr (mn)
ConcLB = concentration des boues dans le lit de boues
Il est vident que Ts ne peut pas prendre n'importe quelle valeur et est dpendant du temps de passage en
anarobiose des boues actives, donc fonction :
des formes oxydantes existantes dans l'eau interstitielle ( O2, NO3,...)
des besoins en O2 endogne des boues, donc l'tat d'oxydation de la matrice organique
de la temprature
pour 20C:
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
488
488
Cm inf 0,065 0,065 0,09 0,15 0,4 0,7
Ts en mn 140 120 100 80 50 30
3.9.2.7 ) Volume du clarificateur (approche CEMAGREF)
Dans lapproche CEMAGREF, inspire par lapproche allemande, le volume du clarificateur est la somme de
4 hauteurs correspondant chacune une fonction spcifique (eau claire, sparation, paississement,
stockage) et rgit par des quations particulires.
Ht = H1 + H2 + H3 + H4
avec Ht = hauteur totale au 2 / 3 de la distance partir de laxe de louvrage
H1 = zone d'eau clarifie 0,5 m
H2 = zone de sdimentation = 1 m (rseau sparatif)
0,8 m (rseau unitaire)
H3 = zone d' paississement =
sa . IM
1000
H4 =
sa' .V . IM
1000 Su
(le coefficient dans l' ATV131 est de 500)
.
H4 = zone de stockage (rseau unitaire uniquement ou rseau sparatif "fuyant")
avec :
Su = surface utile du clarificateur (entre voile)
V = Volume total du racteur biologique
IM = indice de Mohlman ou Indice de boue
sa' = 0,5 1g/l (variation de concentration dans le bassin d'aration par temps de pluie o on
assiste une dconcentration momentane)
3.9.2.8 ) Volume du clarificateur (approche ATV A 131)
Ht = H1 + H2 + H3 + H4
avec Ht = hauteur totale au 2 / 3 de la distance partir de laxe de louvrage
H1 = zone d'eau clarifie
H1 0,5 m
H2 = zone de sparation, de sdimentation et de retour hydraulique
H2 = 0,5 x Va x ( 1+ %R) / ( 1- Vc/1000 )
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
489
489
H3 = zone de concentration et de stockage
H3 =
1,5 x 0,3 x qsv x (1 + %R)
500
H4 = zone dpaississement et de raclage
H4 =
Caer x Va x (1 + %R) x Te
Clb
avec :
Vc = volume corrig = IB x Caer en ml/l ou l/m
3
Va = vitesse ascensionnelle
IB = Indice de boue
%R = pourcentage de recirculation
Te = temps dpaississement des boues dans le clarificateur
Clb = concentration du lit de boue =( 1000* Te^1/3) /IB
qsv = charge volumique de boue
3.9) DIMENSIONNEMENT DE LA ZONE D'ANOXIE
Prliminaire :
On mnagera toujours dans la conception de la zone d'anoxie la possibilit de by-passer cet
ouvrage (cas des stations sous-charges).
Pour dterminer la quantit de N-NO3 dnitrifier en zone danoxie, il y a lieu de prioriser la
dnitrification dans le bassin daration et den dduire la quantit de N-NO3 dnitrifi dans la
zone are pendant les phases de non aration, dduction faite du temps de consommation de
loxygne dissous.
Nous commencerons par estimer la quantit d'azote nitrifier l'aide de la relation :
Azote nitrifier = NTK
EB
- N
ass
- NTKrejet
NTK
EB
= Quantit de NTK dans les eaux brutes.
N
ass
= azote assimil par les boues actives
en 1re approximation N
ass
peut tre pris gal 5 pourcent de la DBO
5
limine.
de faon plus prcise : Nass = 4.8 % . de la production de boues dans le cas d'un effluent
urbain classique. Ou, exprim par rapport aux MVS des boues produites : de l'ordre de 7
%. Il ya lieu de l'exprimer plutt vis vis des MVS surtout dans le cas de la prsence de
boues physico-chimiques.
N rejet :
7-8 mg/l en moyenne si sortie NGL = 15 mg/l
3-4 mg/l en moyenne si sortie NGL = 10 mg/l
Nota :
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
490
490
Dans le cas o il est demand de respecter une norme NGL=20mg/l, c'est dire NTK + NNO3
infrieur 20 mg/l, on admet que l'eau traite comportera 10 mg/l NTK et 10 mg N.NO
3
.
Si l'on doit respecter une norme NGL=10mg/l (soit 10 mg/l de NTK + NNO3), on admet que la
rpartition se fera avec 5 mg/l NTK et 5 mg/l N.NO
3
.
Un pourcentage de N est non biodgradable -"Ndur"- de l'ordre de 3 5 % du NTK des eaux
brutes (cet ordre de grandeur est fonction de l'ge de boue).
Une fraction de N est rattache aux MES des eaux traites : 4,8 pourcent des matires
en suspension des eaux traites. Le N particulaire mesur globalement en sortie mais
n'est pas pris en compte dans la cintique.
Une fois estime la quantit d'azote nitrifier, nous pouvons estimer la quantit d'azote
dnitrifier l'aide de la relation suivante :
Azote dnitrifier = NTK
nitrifier
- N-NO3 ET
Soit encore :
N-NO3 dnitrifier = NTK
EB
- Nass - NTKrejet - N-NO3rejet
Toutefois le processus de dnitrification ncessite une source de carbone assimilable. On dfini
donc, en fonction du carbone assimilable disponible, la quantit d'azote potentiellement
dnitrifiable :
Quantit N potentiellement dnitrifiable =
Carbone assimilable
2, 7
Cette valeur doit tre suprieure "N dnitrifier" ; dans le cas contraire, le restant devra tre
dnitrifi dans la zone d'anoxie.
La quantit de nitrates potentiellement dnitrifiable est dpendante du carbone facilement
assimilable et disponible en amont . Ce carbone assimilable est associ aux MES des eaux brutes
en entre et la DB0
5
des eaux brutes. On peut estimer que le carbone facilement assimilable
constitue 45 pourcent de cette DBO
5
.
Le volume ncessaire de la zone anoxie peut tre dfini par la relation :
Vanox =
Masse de MVS ncessaire en zone d' anoxie
concentration MVS du racteur biologique
Avec en outre :
Masse de MVS. en zone anoxie =
N dnitrifier
Cintique de dnitrification x 24
1000
(1)
h
.
Ces deux relations nous permettent d'crire :
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
491
491
Volume anoxie =
N dnitrifiable x 1000
Cintique de dnitrification . concentration en boues . %MVS . 24
Dans les relations ci-dessus, les cintiques de dnitrification sont exprimes en : mg N-NO3 / g
MVS / h
(1)
Nota :
1) Si le N dnitrifier est trs infrieur au N dnitrifiable
Vanox =
N dnitrifier
u
2) Si le N dnitrifier est trs suprieur au N dnitrifiable
Vanox =
N dnitrifier
+ N- NO restant
3
u
N-NO
3
restant devra tre dnitrifi en zone are.
avec :
u = Cintique dnitrification * sa * % MVS * 24 /1000.
La cintique dpend du ratio NTK/DBO
5
.
Dans la zone d'anoxie, nous pouvons estimer cette cintique de dnitrification comme suit :
NTK
DB0
> 0, 5 k = 1, 7 mg N- N0 / gMVS. h
< 0, 5 k = 2,1 mg N- N0 / gMVS. h
< 0, 4 k = 2, 4 mg N- N0 / gMVS. h
< 0, 3 k = 2, 7 mg N- N0 / gMVS. h
< 0, 2 k = 3 mg N- N0 / gMVS. h
5
3
3
3
3
3
L' abattement de la DB0
5
en zone d'anoxie est nglig dans le dimensionnement du bassin
d'aration et des quipements.
Recirculation de liqueur (ou circulation interne) vers la zone d'anoxie (Rl)
Ce dbit de recirculation est fix de faon satisfaire les contraintes suivantes :
Rb + Rl
N- N0
3
dnitrifier
N- N0
3
ET
=
NTKEB - Nass - NTKET - NN0
3
ET
N- N0
3
ET
Rl
NTK - Nass - NTK
N- NO
- (1 +RB)
0, 8NTK - NTK
N- NO
- 1 + RB
EB ET
ET
EB ET
ET
3 3
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
492
492
Limiter Rl 400 % (le restant sera dnitrifi dans la zone are par arrt des arateurs)
nota:
Rl limit 400 % sur le Qmts
Rb taux de recirculation des boues issues du clarificateur
3.10) DENITRIFICATION SIMULTANEE (EXOGENE + ENDOGENE)
La cintique de dnitrification est appliquer sur le temps d'anoxie stricte. Ce temps d'anoxie
stricte est gal au 24h de la journe moins temps d'aration, moins temps de consommation O2
dissous.
La valeur de cette cintique est approxime comme suit :
k1 = 1,6 mg N-NO
3
/gMVS.h avec dissociation aration / brassage
k2 = 1 mg N-NO
3
/gMVS.h sans dissociation aration / brassage
- Cas sans zone d'anoxie : on doit avoir dans ce cas un temps d'aration maximum de 12 h.
- On a de plus pour chaque cycle d'aration :
Un temps de consommation de l'oxygne dissous de 15 20 mn
Un cycle de consommation de l'oxygne li aux nitrates (NO
3)
de 1h30 2h
- Cas avec zone d'anoxie : o il faut dnitrifier le rsiduel N-NO
3
(s' il reste un rsiduel non
dnitrifiable en anoxie).
Graphique associant la nitrification en fonction de Cm et du rapport DBO5 / NTK
(valeurs considres sur l'inffluent)
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
493
493
ABBATTEMENT EN NGL 12C EN FONCTION DE LA CHARGE MASSIQUE
CM (kg DBO/kg MV)
%
A
b
b
a
t
t
e
m
e
n
t
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15
DBO/NTK = 4.5
DBO/NTK = 3
DBO/NTK = 6
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
494
494
CINETIQUE DE NITRIFICATION EN FONCTION DE L'AGE DE BOUE
Temprature en C
m
g
N
-
N
O
3
/
g
M
V
/
h
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
89
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
25 j
20 j
15 j
10 j
5 j
3.11) DIMENSIONNEMENT DU BASSIN D'AERATION
Cas de dnitrification avec zone anoxie :
Le volume du bassin d'aration est pris gal au volume total de bassin ncessaire diminu du
volume de la zone anoxie.
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
495
495
Cas d'une dnitrification simultane dite endogne :
Le volume du bassin d'aration est pris gal au volume total de bassin ncessaire
L'estimation du volume du bassin d'aration se ramne donc au calcul du volume total de bassin
ncessaire. Ce volume est fix de faon satisfaire trois contraintes : l'une portant sur la charge
massique, l'autre sur la charge volumique et la dernire sur l'ge des boues.
Contrainte sur la charge volumique Cv :
une norme NGL
= 15 mg/l
impose Cv = 0,3 kg DB0
5
/m
3
une norme NGL
= 10 mg/l
impose Cv = 0,23 kg DB0
5
/m
3
Cintique de nitrification de rfrence utiliser pour la vrification (cf tableau en annexe):
K 1,2 mg N/gMVS.h 12 A = 13 j
K' 3,0 mg N/gMVS.h 16 A = 13 j
temps de nitrification est toujours < temps d'aration.
3.12) CALCUL DES BESOINS EN OXYGENE
Prliminaire :
Dans ce qui suit nous utilisrons les notations suivantes :
Le = DBO
5
dgrader (le rendement est nglig).
a' = quantit oxygne ncessaire pour oxyder 1 kg de DB0
5
.
b' = quantit oxygne ncessaire au mtabolisme endogne de 1 kg de matires
volatiles en suspension (M.V.S.) par jour.
SV = masse de MVS dans le racteur biologique (hors zone d'anarobie) soit bassin
d'anoxie + bassin d'aration + clarificateur.
C' = taux de conversion de l'azote ammoniacal (N-NH4) en azote nitrique (N-NO
3
)
C' = 4,53 kg O2/kg N-NH4 nitrifi
C" = taux de conversion de l'azote nitrique en azote gazeux en considrant que la
fraction de l'oxygne rcupre par dnitrification est totale (certains prennent un facteur
de scurit de l'ordre de 0,7).
C'' = 2,86 kgO2/kg N-NO3 dnitrifi
Le besoin en oxygne se compose de la quantit d'oxygne fournir pour liminer la pollution
carbone plus quantit d'oxygne fournir pour liminer la pollution azote.
Besoin pour la dgradation de la pollution carbone :
QO
2
/j = a' Le + b' SV
Besoin pour la dgradation de la pollution azote :
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
496
496
QO2/j = C' N nitrifier - C" N' dnitrifier
Nota :
Ce que nous venons de dire n'est valable que dans le cas o l'on dsire raliser une
nitrification-dnitrification. Si l'on se place dans des conditions o la nitrification n'a pas
lieu, la quantit d'oxygne fournir est gale celle ncessaire liminer la pollution
carbone.
Soit, besoins journaliers totaux :
QO2/j = a'Le + b.SV + C'N nitrification - C''N'dnitrification
En utilisant les valeurs prconises ci dessus, nous obtenons la relation :
Q0
2/
j = a'Le + b'SV + 4,53 Nnitrif - 2,86 Ndnitrif
a' et b' sont fonctions de Cm (cf tableau).
si Cm augmente, a' baisse et b' augmente (cf tableau).
3.12.1)Capacit d'oxygnation ncessaire en pointe
Ce calcul prend en compte une concentration homogne sur 24 h applique au dbit de pointe.
.QpTS
QjTS
4.53.NTK
+
24
SV b'
+ QpTS .
QjTS
Le.
a' =
QO2pointe
) horaire (
3.13) DIMENSIONNEMENT DES AERATEURS
3.13.1) Coefficient global de transfert (C.G.T)
Les performances des arateurs s'expriment en terme d'apport spcifique brut en eau claire (ASB)
en kgO
2
/kwh absorb dans des conditions dites standard (eau claire, concentration nulle en O
2
, T
= 10C, pression atmosphrique = 1,013 bars ou 10,33 mCe).
En boues actives les performances sont diffrentes.
Le facteur correctif appliquer est appel Tp ou : coefficient de transfert eau claire-boues
fonction du type d'quipement
D'autres facteurs correctifs doivent tre appliqus lis la temprature, la pression, la viscosit
et surtout au fait que la fourniture d'oxygne n'est pas ralise concentration nulle en oxygne.
Tt ou = 1,024
T -10 C
Td ou
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
497
497
Rapport entre les valeurs des concentrations de saturation en oxygne en eau uses et en eau
claire.
Td =
CS - C
CS10
CS10 = 11,29 mg/l valeur de saturation en 02 10C(norme AFNOR NF EN 25814)
C = concentration maintenir en O2 dissous dans les boues.
Cs = concentration saturation en O2 dissous la temprature des boues.
Coefficient global de transfert :
C.G.T = Tp x Tt x Td
3.13.2) Puissance thorique absorbe
On obtient alors l'quation :
Puissance thorique absorbe =
QO2 en pointe
A.S.B C.G.T
Dans laquelle :
QO2 en pointe correspond au paramtre prcdement calcul.
CGT = coefficient global de transfert. Prend en compte l'ensemble des coefficients
A.S.B = apport spcifique brut mesur dans les conditions standards en KgO2/Kw.abs
Pabs = Puissance absorbe aux bornes
Les valeurs de l'ABS et du CGT sont donnes dans le tableau ci-dessous :
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
498
498
Systme d'aration Hauteur d'eau ASB CGT Brassage Rendement
maxi kgO2/ kw W/ m3 eau claire sur
absorb 4 m
moyen
agitateur de surface
turbines lentes 2 - 3,5 m 1,8 0,7 45
turbines rapides 1 - 2,5 m 1,25 0,7
brosse avec dflecteur:
diam 700 - 850 mm 1 - 2 m 1,6 0,7 35
diam 950 - 1050 mm 1,5 - 3 m 1,8 0,7
Insufflation d'air
grosses bulles 2 - 3,5 m 0,6 - 1,0 25-40 W/ m3 5-7 %
5,5 - 9m3/ m
moyennes bulles 2 - 8 m 0,8 - 1,5 0,7 20-30 W/ m3 6-12 %
4,5-8 m3/ m2
fines bulles 3 - 8 m 2 - 3,4 0,55 15-25 W/ m3 15-25 %
3,5-5,5 m3/ m2
Systme base de
pompe
Ejecteur atmosphrique 2 - 3 m 0,5 - 0,65
Ejecteur air surpress 3 - 8 m 0,8 - 1,6
Arateur mcanique
immergs 2 - 3 m 0,5 - 0,7
Dissociation
Aration/ brassage 4-10 m 1,3 (MB) Chenal : 14 (MB)
3,2 (FB) 0,6 - 0,7 3w/ m3
bassin ou bassin : 25 (FB)
chenal 10w/ m3
MB = Moyenne bulle
FB = Fine bulle
3.13.3) Aration par turbine ou pont brosse.
Pour assurer un brassage correct, la hauteur d'eau de rfrence dans les bassins munis de turbines
(Kw abs) sont les suivantes :
5 kw h = 1.8 m
10 kw h = 2,3 m
18 kw " 2,6 m
25 kw " 2,8 m
35 kw " 3,0 m
45 kw " 3,4 m
55 kw " 3,8 m
65 kw " 4,2 m
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
499
499
Comme indiqu dans le tableau ci-dessus, les puissances spcifiques de brassage, calcules sur les
puissances absorbes, sont les suivantes :
Puissance spcifique des turbines 45 w/m
3
Puissance spcifique des brosses 35 w/m
3
Aration en dissociation aration-brassage.
Puissance spcifique des agitateurs
Agitateur lent diam > 2 m : 3 - 4 w/m
3
dans un chenal
6 - 8 w/m3 dans un bassin rectangulaire
Agitateur rapide
diam < 1 m : 10 - 20 w/m
3
3.13.4) Aration par insufflation d'air .
3.13.4.1) Calcul de dbits d'air:
dbit d' air :
Qo / h
Rdt x CGT x O g / m x He
2
2
3
- dbit d'air sec exprim en Nm
3
/h (normaux m
3
d'air en rfrence aux conditions normales ; 273
K ou 0C, Pn = 1 atm = 10332 mm CE = 1,01325 bars = 1013,25 mbars = 101,325 KPa = 760
mm Hg)
1 bar = 100 KPa
- QO
2 / h = besoin en oxygne en pointe horaire
- CGT = coefficient global de transfert
CGT # 0,55 (fine bulle)
- He = hauteur de liquide au-dessus des diffuseurs.
- Rdt : rendement en eau claire en fine bulle 3,8 6,8 % par mtre d'eau (suivant type
d'quipement)
- O
2
/ m
3
: quantit O
2
par m
3
dans les conditions normales , soit : 300gO
2 par m
3
d'air
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
500
500
Nota 1 :
Quand la quantit O
2
par m
3
d'air est prise gal 280 g/m
3
Cette valeur de 280 g/m
3
d'O
2
par m
3
d'air est estime 20 c - temprature de rfrence de l'air
aspir dans les catalogues des constructeurs.
(par ex: catalogue HIBON pour les Roots : T de l'air aspir = 20C).
Nota 2 :
L'air "sec" contient 23,19 % d'oxygne en poids (ou 21 % en volume), 1 m
3
d'air 0c et 760
mmHg pse 1,293 kg et contient 300g d'oxygne. Le dbit d'air calcul doit tre exprim en
N.m
3
/h (normaux m
3
d'air l'heure, c'est dire T= 0C et P= 10333 mm CE ).
Pour le calcul de dbits d'air dfinifs, il y a lieu de tenir compte de la variation des tempratures de
l'air extrieur et de la temprature de rfrence adopte par le constructeur (en gnral 15 ou
20C), mais aussi de l'altitude, donc de la pression atmosphrique.
masse volumique de l'air sec ( )
=
P
R T
= masse volumique de l'air sec en Kg / m
3
P= P absolue mm CE
Pn = 760 mmHg = 10330 mm CE = 101,3 KPa
Tn = 273 C
T = 273 C + tc
R = 29,27
Variation de la masse volumique de l'air ;
= n x
Pa P
Pn
Tn
T
+
Pa = pression atmosphrique l'altitude considre en mCE
P = lvation de pression totale provoque par le surpresseur en mCE
n, Pn et Tn = valeur dans les conditions normales
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
501
501
La pression atmosphrique moyenne peut tre approche par la formule de Schassmann :
log p log 101,3
h
18400
10 h 10
=
o
p
h
= est la pression atmosphrique moyenne en Kilopascals, l'altitude h
log p
10 h
= logarithme dcimal
altitude en m Pa en mCE
0 10,33
500 9,74
1000 9,17
1500 8,63
2000 8,10
3000 7,15
3.13.4.2) Calcul de la puissance consomme des surpresseurs :
La puissance consomme des surpresseurs volumtriques est donne par la formule :
P =
3, 89 Q log
P
P
R
n.a
R
A
avec :
P
n.a
= puissance nette l'arbre en Kw
R = rendement isothermique (0,5 0,7)
Q = dbit en N.m
3
/ mn (0c et 760 mm Hg)
Pa , Pr = pressions d'aspiration et de refoulement en mCE absolue
Puissance absorbe aux bornes =
P
Cos .
n.a
m
avec
m
= rendement moteur # 0,85
3.13.4.3) Dbit de ventilation du local de surpression
Hypothses :
- Temprature de l'air aspir = 30C
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
502
502
- Temprature maxi accepter dans le local = 40C (+ 7C avec capotage et 10C sans
capotage = maxi temprature d'lvation)
- Pertes thermiques ou rayonnement du surpresseur = f( Pabs du surpressur) nous allons
prendre par excs 20% de sa puissance absorbe pour cette puissance
- Longueur de la nourrice d'air principale = 8m, avec un vitesse de l'air de l'ordre de 10
m/s nous obtenons un diamtre de 280mm
- Nourrice d'air non calorifuge donc un coeficient de transmission thermique de l'ordre
de 6 w par delta de C par m3 de conduite
- Elvation de la temprature lors de la compression environ 10C par m de Ce de perte
de charge en aval soit 80C environ
- Temprature de l'air surpress en sortie du surpresseur = 110C
- Calcul plus prcis pour lchauffement d la compression = t
t = 13,6 x Pa (kw) x 60 /
1
x Cp x Q
1
= 90 C
1
en kg/m3
Cp chaleur spcifique de lair = 0,24
Q
1
en m3/h
Puissance dgage par les surpresseurs= 0,20 x 73 kW = 14,6 kW
Puissance dgage par les conduites = 0,280m x 8m x 3,14 x 6 x 110C /1000 = 4,6 kW
Puissance totale dgage = 14,6 + 4,6 = 19,2 kW
Calories vacuer = (Pdegsup+Pdegcond)*3600/4,1855 = 16514 Kcal/h
Masse d'air ncessaire = Calories vacuer /(0,24 x (Tintrieure -Textrieure))= 6880 kg
Avec chaleur spcifique de l'air = 0,24 kcal / delta de Tc
Masse volumique de l'air aux conditions relles = 1,293*(273/(273+Text))*Patm = 1,165 kg/m3
Ventilation prvoir dans le local des surpresseurs
Dbit d'air vacuer = Masse d'air ncessaire / Masse volumique de l'air =6880/1,165 = 6000
m3/h d'air
3.14) BRASSAGE DU BASSIN D'AERATION
3.14.1) Dbit de pompage dun agitateur
Le dbit de pompage est le dbit de liquide qui passe effectivement dans le mobile
dagitation
Dbit de circulation
Q
C
= Q
e
+ Q
P
avec Q
e
= dbit dentranement (ou dbit de pompage induit)
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
503
503
Q
C
= dbit de circulation
Cette grandeur (Qc) se dduit de la mesure de la vitesse moyenne V
C
de circulation dans
le bassin
Un tat de mlange dpendra ;
- des diffrentes vitesses le long des trajectoires de circulation
- des longueurs diffrentes de ces trajectoires
- des phnomnes de diffusion molculaire et turbulente
3.14.2) Expression de la vitesse moyenne de circulation
La vitesse de circulation du liquide est un critre de choix dun systme dagitation
Une bonne circulation peut se caractriser par :
- un dbit de circulation aussi lev que possible,
- une rpartition des profils de vitesses rgulire en tout point du chenal
3.14.3) Relation entre la puissance dissipe & la vitesse moyenne de circulation
P = K x V
3
C
Cette expression indique que la puissance dissipe est proportionnelle au cube de la vitesse
moyenne de circulation
3.14.4) Relation entre la puissance spcifique, la vitesse et la gomtrie du chenal
La vitesse dissipe par unit de volume = puissance volumique ou puissance spcifique en
w / m
3
) est fonction ;
1) - des caractristiques du mobile dagitation
2) - des rapport gomtriques H / L
m
et l
a
/L
m
(L
m
= longueur moyenne du chenal, l
= largeur du chenal et H = hauteur liquide du chenal)
3) de la vitesse de circulation au cube V
C
la puissance 3
4) inversement proportionnelle au diamtre du mobile dagitation
La puissance dissipe diminue quand la taille du chenal augmente
3.14.5) La vitesse horizontale induit par le mobile dagitation
Plus cette vitesses est importante plus lon augmentera le temps de sjour des bulles dair
et plus le transfert doxygne sera meilleur
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
504
504
Vitesse horizontale dune fine bulle ( = 2 - 3mm ) en eau claire = 0,23 m /s
Rapport = V
2
moy / Ps
avec ;
- Ps = puissance spcifique exprime en w/m
3
de racteur
- V = vitesse moyenne exprim en cm/s
Plus ce rapport est important plus le couple est performant
Agitateur petites pales Agitateur grandes
pales
chenaux annulaires 100 - 300 400 - 1000
chenaux oblongs 50 -100 200 - 500
Comme le vitesse moyenne est directement lie la puissance dissipe, il y a lieu de
trouver un compromis entre lobtention dune vitesse minimale ( de lordre de 0,20 m /s
0,25m/s ) pour assurer un bon rapport rendement doxygnation et puissance fournie.
Lapport horaire en oxygne est une fonction croissante asymptotique de la vitesse
horizontale de leau, et cela est confirme pour des vitesses suprieures 0,10 m/s
(essais CEMAGREF).
Pour des vitesse infrieures 0,10 m/s , laugmentation du transfert doxygne est faible (
de lordre de 10%) (essais CEMAGREF).
Le gain dapport horaire lorsque la vitesse passe de 0 0,40 m /s est de lordre de
40% ( valeurs CEMAGREF)
Laccroissement de lapport horaire en fonction de la vitesse horizontale de leau
sexplique par limpact du systme dagitation sur les paramtres influenant le transfert
doxygne, savoir ;
a) - la surface dchange
b) - le temps de contact air-eau
c) - lcart entre les concentrations doxygne de lair et de leau
a) la surface dchange est fonction
- de la taille des bulles (taille sortie diffuseur, pb de coalescence,
importance du cisaillement qui est favorable, hauteur deau sur les
diffuseurs)
- forme des bulles qui est fonction de la turbulence du milieu
b) le temps de contact air-eau est fonction de la vitesse de monte des bulles
dair qui est fonction de ;
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
505
505
- la taille des bulles dair
- la vitesse des bulles dair la sortie des diffuseurs
- les spiraux flows qui induisent une rotation verticale de leau donc une
acclration de la vitesse de monte des bulles dair
Limpact majeur dun bon brassage du milieu associ une vitesse moyenne
importante ( 0,3 0,4 m/s) se situe sur la suppression des spiraux flows gnrs par
la monte des bulles, cette suppression permet daugmenter le temps de contact des
bulles dans le milieu.
c) lcart entre les concentrations doxygne de lair et de leau
cet cart est fonction de ;
- lagitation du milieu
- de la concentration en O2 dissous
3.14.6) Incidence du spiral flow
il y aurait 3 sortes de spiral flow = mise en rotation du plan deau ayant un effet
dacclration la vitesse de monte des vitesses.
- les grands spiraux flow : lorsque les surfaces occupes par les
diffuseurs sont de plusieurs m
2
- les petits spiraux flow :qui se produisent entre diffuseur
- le micro spiral flow : qui interviennent entre orifices des diffuseurs
(entre les bulles)
Tous les trois engendrent une mise en rotation verticale de leau qui acclre la
vitesse de monte des bulles dair donc diminue sensiblement le transfert
doxygne dans le liquide (en diminuant le temps de contact bulles/fluide).
3.14.7) Synthse sur lapport du brassage dans les performances doxygnation
Synthse sur lapport du brassage dans laugmentation des performances de
transfert doxygne ;
1) augmentation de la surface dchange ( favorise par la turbulence due
lagitateur, la hauteur deau, la taille de bulles, rduction des phnomnes
de coalescence).
2) augmentation du temps de contact air/eau ( le gain dans lapport en
oxygne dans le liquide est proportionnelle la vitesse horizontale gnre
par le mobile dagitation, diminution de limpact ngatif des spiraux-flows )
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
506
506
3) effet de cisaillement des agitateurs favorable sur les tailles des bulles (
le cisaillement diminue leur taille donc diminue la vitesse de monte de la
bulle et rduit considrablement leffet de coalescence ( lorsque les bulles
de petites tailles sagglutinent pour former des bulles de taille suprieure)
4) rduction notable des phnomnes de spiral-flow qui sont ngatifs sur
le transfert en oxygne puisquils rduisent le temps de contact de la bulle
dans le liquide en jouant sur une acclration verticale du liquide
3.14.8) Regroupement ou densit des raquettes
Le regroupement des raquettes favorise le rendement (K
LA
exprim H
-1
)
.
Ceci est caractris par la densit surfacique : rapport du nombre de membranes sur
la surface totale occupe par les membranes.
Le rendement sera dautant plus grand que cette densit sera leve.
3.14.9) Rgles respecter pour le positionnement des agitateurs (optimiser sa
pousse)
- positionnement des distances minimales ( 0,3 0,5 m environ) des murs
extrieurs et intrieurs ( effet de paroi ngatif sur la vitesse moyenne du au
coefficient de frottement)
- positionnement des distances minimales ( 0,3 0,5 m environ) du plancher et de
linterface air/eau (sachant quil y a un compromis en fonction de la hauteur liquide
totale)
- distance suffisante en aval du systme de diffusion (D
1
sup H
liquide
) pour viter
les phnomne de cavitation sur lagitateur (usure prmature voire casse de ples,
performance de pousse moindre de lagitateur car mlange biphasique air/eau)
-distance minimale avant dattaquer le mur de bulles (D
2
sup largeur du chenal)
pour que le maximum dnergie due la pousse de lagitateur attaque le mur de
bulles = pertes de charges importantes = lvation du plan deau.
3.14.10) Optimisation des conditions hydrodynamiques des racteurs
Quelle forme de bassin ?
- le chenal annulaire : le meilleur compromis en terme de vitesse moyenne
respecter et puissance dagitation installe
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
507
507
- le chenal oblong est moins plus performant que lannulaire (sauf pour des
volumes plus grands o il est souvent utilis, donc plus performant)
Quelle vitesse moyenne (eau / boues) ?
On observe un gradient de vitesse horizontale ( dans le cas des chenaux) entre la
paroi extrieur (vitesse plus leve) et la paroi intrieur, prsence dune mise en
rotation du plan deau.
- vitesse pour reprendre un dpt
- vitesse pour amliorer lapport en oxygne
- vitesse pour un mlange homogne en fonction de la concentration
en boues
- champ de vitesses complexe dans certains cas ( vitesse ngative
sur le mme plan : cas dun nombre insuffisant dagitateurs pour
une largeur de racteur trop importante ou sur diffrents plans dans
le racteur : cas des bassins profonds)
Le compromis se situerait pour une vitesse moyenne en eau claire de lordre de
0,35m/s, soit environ 0,25m/s en boue. ( P = K x V
3
C
)
3.14.11) Puissance de brassage
Bassin de forme chenal circulaire :
- En premire approximation nous prendrons par simplification une puissance spcifique
de l'ordre de 3w/m3 de racteur soit une puissance totale de brassage de 7kW (rpartie en 2
agitateurs suivant le diamtre intrieur de l'ouvrage de la zone de contact associ au
dgazage)
- Agitateur axe horizontal, grandes ples ( 2 m) et vitesse lente (35 55 tours/mn)
3.15) DIMENSIONNEMENT POMPE D'INJECTION DES SELS METALLIQUES
3.15.1) Choix des ractifs
Les produits utiliss sont : le chlorure frique (FeCl
3
), le clairtan (FeSO
4
Cl) ou le sulfate de
ferFeSO4,7H2O...
Cot des ractifs :
clairtan 700 F/Tonne
Fecl
3
1200 F/Tonne
FeS04,7H2O 450 F/Tonne
Concentration en Fe du produit commercial : 200 g/l de Fe (FeCl
3
, FeSO4Cl )
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
508
508
: 180 g/l de Fe (FeSO4CL type H)
densit du FeSO4CL normal (T de conglation -8C) = 1,54 20C
densit du FeSO4CL type H (T de conglation -22C) = 1,48 20C
densit du FeCL3 = 1,42 1,45 et 570 g/l 598 g/l de FeCL3 pur (dit 40%)
Ratio Fe/P en poids : 2,7 4,5 (suivant le rendement souhait sur la prcipitation),
soit en rapport molaire Fe/P = 2 (80% de Rdt) et Fe/P = 2,5 (90% de Rdt)
Pour un rendement recherch de 80 %, prendre en 1re approximation 3,5 kg Fe/kgP
et 4,5 kgFe/kgP pour un rendement de 90 %.
P traiter = P
EB
- "P
BIO
" - Pass - Prejet
P
EB
= Quantit de phosphore entrant dans les eaux brutes.
P
BIO
reprsente la quantit de phosphore limine par dphosphatation biologique. Par scurit,
on prendra un rendement maximum de 50 % sur la zone d'anarobie (quand elle existe dans la
filire).
Pass = Phosphore extrait dans la production de boues.
Prejet = Phosphore rejet dans les eaux traites. On considre que 20 % du phosphore entrant est
rejet si la station doit satisfaire un niveau Pt = 2mg/l. Dans le cas contraire on considrera une
concentration de 2 mg/l dans l'effluent de sortie.
Prejet = soit 80 % de Rdt. si niveau Pt=2mg/l
ou soit 2 mg/l x Qm
3
/j
Cas du clartan de type H 180 g/l de Fe :
dbit ncessaire en pointe = (
(conc moyenne P) QpTS - P
0,180
3,5
)
P =
Pass
24h
- Prejet sur 1 h
Cas du FeCL3 :
avec 80% de Rdt [FeCL3] = 3,5 x1,42 / 0,200g/l = 25 Kg de FeCL3 technique / Kg de Pt
avec 90% de Rdt [FeCL3] = 4,5 x1,42 / 0,200g/l = 32 Kg de FeCL3 technique / Kg de Pt
3.15.2) Volume de la cuve de stockage du ractif (cas du clairtan)
Cuve de stockage du ractif (+ cuve de rtention en bton)
Le Volume de ces cuves sera pris de faon assurer une autonomie de 30 jours minimum.
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
509
509
Volume de la cuve =
P traiter Kg / j x 3,5
0,180 g / l
x 30j en m
3
3.15.3) Bilan TAC avec le traitement de lazote et du phosphore
3.15.3.1) Rappel des units employes
- Milliquivalent par litre : meq/l
Quantit d'lectrolyte dissoute dans un litre de solution gale au millime de l'quivalent-
gramme.
Donc, c'est la concentration d'une solution N/1000.
Soit pour CaCo
3
- masse molaire 100 g
valence 2
1 meq/l = 100 = 0,05 g/l ou 50 mg/l de CaCo
3
2. 1000
- Degr franais
1F correspond la concentration d'une solution N/5000.
Soit pour le CaCo3 : 100 = 0,01 g/l ou 10 mg/l de CaCo
3
2. 5000
donc par dfinition 1 meq/l = 5F et 1F = 10 mg/l de CaCo
3
TAC expression de la teneur en hydrogno-carbonates.
- Degr allemand
1 alllemand = 1,786 F = 17,86 mg/l de CaCO
3
2,8 allemand = 5F = 50 mg/l de CaCO
3
3.15.3.2) Consommation et restitution dalcalinit
1) Nitrification
Le processus biologique de nitrification (transformation de l'ammoniaque en nitrite puis
nitrate) acidifie le milieu.
De plus, l'activit biologique des bactries nitrifiantes est optimale pH 8 - 8,5, et baisse
si le pH baisse.
Cela signifie que si l'on souhaite favoriser la nitrification sans induire une baisse de
l'activit des nitrifiantes, nous devons avoir dans l'eau traiter une quantit suffisante de
carbonates.
1 mg/l de N-NH4 nitrifi consomme 7,1 mg/l de CaCo
3
ou 0,142 meq/l de CaCo
3
.
2) Dnitrification
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
510
510
Le processus de dnitrification (rduction des nitrates en azote gazeux) basifie le milieu,
apporte une certaine alcalinit.
1 mg/l de N-NO
3
restitue 3,55 mg/l de CaCo
3
ou 0,071 meq/l.
3) Dphosphatation physico-chimique
L'introduction de sels mtalliques de type chlorure ferrique (FeCl3) pour prcipiter le
phosphore sous forme de boues minrales inertes (FePo4 + Fe (OH)3) va acidifier le
milieu biologique.
1 mg/l de Fe introduit va consommer 2,67 mg/l de CaCo
3
ou 0,053 meq/l.
3.15.3.3) Stabilit du pH dans le racteur et sur leau triat
La chute du pH a pour consquence :
- diminution substantielle de l'activit des bactries nitrifiantes
- d floculation de la structure de la biomasse favorisant une formation disperse et une
dgradation des caractristiques mcaniques des boues (indice de boue).
Le maintien d'un pH proche de la neutralit sur l'eau traite ncessite un minimum de
tampon carbonat de l'ordre de 5F, soit 50 mg/l de CaCo
3
de disponible en sortie de
station.
La relation entre le pH et le TAC n'est pas directe compte tenu de la prsence de ractions
acides/base trs complexes dans l'eau interstitielle.
3.15.3.4) Bilan TAC entre / sortie sur une installation
1) Traitement de l'azote seul
Volume effluent brut = 600 m
3
/j
TAC sur effluent brut mesur = 28 F
Concentration CaCo
3
= 280 mg/l
Quantit CaCo
3
= 168 kg/j
Quantit d'azote nitrifi = 38 kg
Consommation CaCo
3
= 38 x 7,1 = 270 kg/j
Quantit d'azote dnitrifie = 36 kg
Restitution de CaCo
3
= 3,55 x 36 = 128 kg/j
CaCo
3
consomm = 142 kg/j
CaCo
3
restant = 26 kg/j
Soit en concentration = 43 mg/l
Soit en F = 4,3F
Valeur mesure en sortie = entre 4 et 5F
2) Traitement de l'azote et du phosphore
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
511
511
Quantit de fer inject = 39 kg/j
Consommation de CaCo
3
= 104 kg/j
Bilan total de l'alcalinit en CaCo
3
168 - 270 + 128 - 104 = - 78 kg/j
soit = - 130 mg/l
TAC de l'effluent trait = - 13F
Equivalence en alcalinit rsiduelle ncessaire = 5F
Quantit de CaCo3 introduire = 180 mg/l
Soit = 108 kg/j
3.16) CALCUL DES DEBITS DES POMPES DE RECIRCULATION DES BOUES
Nous prendront les mmes hypothses que pour le dimensionnement du clarificateur.
La concentration de rfrence a t prise pour un systme en quilibre, avec 100 % de
recirculation sur le dbit d'alimentation du clarificateur. Dans ce cas, la concentration de
recirculation (sr) est le double de la concentration dans le bassin d'aration (sa).
TAUX DE RECIRCULATION POUR TS = 90 MN
IM
Q
R
/
Q
a
l
i
m
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320
5 g/l
4 g/l
3 g/l
2 g/l
Les temps de sjour des boues dans le clarificateur au cours de la priode de pointe sont dfinis en
fonction de la charge massique :
50' pour cm 0,3
80' pourCm=0,1
120' pourCm0,09
Le dimensionnement des capacits de recirculation installer devrait tenir compte des conditions
effectives d'exploitation du racteur (idem clarificateur). Pour cela, on doit prendre en compte un
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
512
512
intervalle possible de variation de l'indice de Mohlman et de la concentration en boues. Les
variations de l'indice de Mohlman peuvent tre des au conditions de brassage, la prsence d'une
dphosphatation physico-chimique, la nture de l'effluent traiter, etc.
1 cas : dissociation aration-brassage
L'indice de Mohlman peut alors prendre une valeur suprieure de 30 mg/l la valeur estime
pour le dimensionnement.
2 cas : turbine ou brosse seule
L'indice de Mohlman peut alors prendre une valeur suprieure de 100 mg/l la valeur
estime pour le dimensionnement.
Bien entendu, le pont du clarificateur doit tre adapt aux capacits maximales de
recirculation.
Nombre minimum de pompe de recirculation :
Prvoir au moins 3 pompes minimum ( Qn, Qd, QPts ou Q max) plus une en secours.
Par exemple :
Si l'on suppose les donnes suivantes :
IMref = 150 ml/g,
Cm < 0.1 kg DBO5/kg MVS.j
IM x Sa < 900 ml / l
La valeur de la charge massique nous permet de prendre un temps de sjour des boues dans le
clarificateur de 90 minutes.
1 cas : dissociation aration-brassage
IM
ref
+ 30 = 180 mg/l
Si l'on suppose une concentration de boues dans le bassin de 5 g/l, le graphique ci-dessus
nous donne une ration du dbit de recirculation par rapport au dbit traversier de 200%.
En d'autre termes le dbit de pointe de la recirculation doit tre deux fois suprieur au dbit
de pointe traiter.
2 cas : turbine ou brosse seule
IM
ref
+ 100 = 250 mg/l
Si l'on suppose une concentration de boues dans le bassin de 3.5 g/l (pouvant aller jusqu' 4
g/l), le graphique ci-dessus nous donne une ration du dbit de recirculation par rapport au
dbit traversier de 300%.
En d'autre termes le dbit de pointe de la recirculation doit tre trois fois suprieur au dbit
de pointe traiter.
Vrification des capacits maxi de recirculation du pont suc :
La relation suivante doit tre vrifie :
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
513
513
longueur du pont
40 m3 / h
Dbit maximum de recirculation >
3.17) EVALUATION DES CONCENTRATIONS DE LEFFLUENT TRAITE
3.17.1) Evalutation de la concentration de la DBO5 en sortie
DBO5 totale en sortie = DBO5 ad2h + DBO5 dure + DBO5 mes
Avec :
DBO5 ad2h = DBO5e x (1-(0,5*(1+EXP(-CM)))^0,5) x 1000/QJTS
DBO5 dure = 0,05 x DBO5e x (2,5/(VBIOret*24/QJTS)) x 1000/QJTS
DBO5 mes = b x CMESs x % MVS x 5/100
3.17.2) Evalutation de la concentration des MES en sortie
MES sortie = 30 mg/l x (Vapplique / V thorique)^0,7
Vitesse calculer sur les trois rgime hydraulique :
Sur Qmts V mts Concentration en MES en priode diurne
Sur Qpts V pts Concentration en MES en priode diurne
Sur Qnoct V noct Concentration en MES en priode diurne
3.17.3) Evalutation de la concentration de la DCO en sortie
DCO sortie = 10^((0,97+0,23*LOG(ConMESs)+0,49*LOG(ConDBO5s))
IV. DIMENSIONNEMENT DE LA FILIERE BOUE.
Dans ce qui suit, nous admettrons que la concentration des boues extraire est approximativement
gale la concentration des boues recircules.
A titre indicatif, le tableau ci-dessous reprsente la concentration des boues extraire pour un
temps de sjour de 90 mn dans le clarificateur en fonction de IM.
Sextr.(g/l) 9 7.5 6.5 5.5 4.5
Im (ml/g) 150 180 200 250 300
Dans ce qui suit, nous allons successivement tudier trois filires :
Epaississeur statique hers + stockeur
Epaississeur dynamique + stockeur
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
514
514
Filtre bande
Nota : Le dimensionnement de la filire boue doit tre tabli sur la production de boues en
excs hebdomadaire, en prenant en compte les priode de temps sec mais aussi celles de
temps de pluie, ramenes sur une semaine type (par exemple : 4 jours temps sec, 1 jour de
petite pluie, 1 jour de la pluie projet, 1 jour de vidange des bassins de stockage).
4.1) FILIERE - EPAISSISSEUR STATIQUE HERSE + STOCKEUR
Pour viter des retours en tte chargs - en limitant le temps de sjour du surnageant, il y a lieu
d'implanter imprativement un paississement (statique ou dynamique) avant tout stockage des
boues en silo. Dissociant ainsi la phase d'paississement de la phase de stockage.
Tout paississeur statique, quel que soit sa taille, doit tre obligatoirement hers.
Le dbit d'extraction des boues est approximativement gal au dbit d'alimentation de
l'paississeur. On obtient alors la relation :
Volume de boue extraire =
sr
=
PB +
sr
PB PBpc
Soit encore, en considrant que la production de 7 jours est extraite en 5 jours :
QExt =
sr
7
5
.
l
tfonc h / j
PB
.
Cela suppose qu'on gre l'paississeur de faon le vider la veille du W.E.
Le fonctionnement d'un paississeur est caractris par sa charge surfacique ch. ch est la quantit
de matires sches reues par m
2
/ jour. Elle peut varier de 25 35 kg MS/m
2
/J.
La valeur de l'indice de Mohlman permet de dfinir une concentration repre en sortie
d'paississeur ainsi qu'une charge surfacique optimale.
Im = 100 ml/g -> Conc
ep
= 30 g/l ch = 30 kgMS/m
2
/j
Im = 150 ml/g -> Conc
ep
= 27 g/l ch = 27 kgMS/m
2
/j
Im = 200 ml/g -> Conc
ep
= 25 g/l ch = 25 kgMS/m
2
/j
Im = 250 ml/g -> Conc
ep
= 20 g/l ch = 20 kgMS/m
2
/j
surface paississeur : B .
7
5
.
1
ch
P
Les autres paramtres habituels utiliss pour le dimensionnement de l'paississeur sont les
suivants :
hauteur = 3,5 m (hors cne)
hauteur boue = 1,5 m
hauteur d'eau claire = 2 m
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
515
515
Nour rappelons que :
diamtre= 2
surface
La hauteur du cne de l'paississeur sera dfinie par :
hauteur du cne = diamtre x 0,15
Volume du cne = surface x hauteur du cne x 1/3
La hauteur totale de l'paississeur sera alors calcule suivant la relation :
hauteur paississeur =
vol paississeur - vol cne
surface
( )
4.1.1) Volume du stockeur des boues paissies.
dbit d'alimentation du stockeur
Qalim =
7
5
.
PB
conc ep
.
1
tfonc
Avec :
Qalim : dbit d'alimentation du stokage en m
3
/h.
PB : Production de boues en kg/j.
conc ep : Concentration en sortie d'paississeur en g/l.
tfonct : Temps de fonctionnement de l'extraction de l'paississeur vers le stokage en h/j.
Le volume du stokeur est pris de faon avoir 180 jours d'autonomie :
Volume = PB * 180 / conc ep
La puissance brassage prvoir dans le silo est fonction de la concentration des boues dans le silo
:
40 - 60 w/m
3
de silo 25 g/l
60 - 80 w/m
3
de silo 60 g/l (goutt)
4.1.2) Retour en tte de l'paississeur
Ces retours en tte sont exprims en pourcentage de pollution exprim par rapport au flux de
l'effluent brut (hors dysfonctionnement de l'installation d une mauvaise gestion de
l'paississeur) :
DB0
5
: 8-10 % de la DB0
5
EB
MES : 4 - 6 % des MES EB
NTK : 10 % de NTK EB
N-NH4 : 0,8 [NTK]EB
P : 0
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
516
516
Le volume du surnageant est gal au volume des boues entres diminu du volume des boues
paissies.
vol / j =
sr
-
PB
conc. ep
par jour
PB
Avec :
PB : Production de boues en kg/j.
conc ep : Concentration en sortie d'paississeur en g/l.
sr : concentration des boues dans la recirculation en g/l.
Cette relation permet de dimensionner la pompe de relvement des retours toutes eaux par dfaut (
rajouter filtrat + lavage filtre bandes).
4.2) FILIERE - EPAISSISSEMENT DYNAMIQUE + STOCKEUR
Nous utiliserons un paississement par table d'gouttage ( considrer comme un premier
niveau de dshydratation).
Avantage de ce dispositif :
concentration boues paissies = 60 70 g/l (donc volume stockeur plus faible)
retour en tte : flux en pollution # 0 (car temps sjour des boues dans le circuit faible)
Les dbit hydrauliques correspondant l'alimentation de la table d'gouttage sont les suivants :
Q
alim
= 12 m
3
/h par mtre linaire de table en amont d'un silo. (valeur maximale)
Q'
alim
= 15 m
3
/h par mtre linaire de table en amont d'un filtre bande.
Q
lavage
= 5 m
3
/h par mtre linaire de table
La charge massique est obtenue en multipliant ce dbit par le concentration de recirculation.
Par exemple :
sr = 8 g/l ch arge massique : 8 x 12 = 96 kgMS/h.ml
sr = 7 g/l charge massique : 7 x 12 = 84 kgMS/h.ml
Le temps fonctionnement pour une table automatise est compris entre 8 et 12 heures par jours, et
ce 5 jours par semaine.
La largeur de la table utiliser est calcule comme suit :
largeur table =
7
5 Qalim x sr
.
24
tfct
PB
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
517
517
Dans cette relation, Qalim reprsente comme prcdemment le dbit par mtre linaire de table
soit 12 m
3
/h par mtre linaire de table.
La largeur de bande minimale est de 0,50 m (donne commerciale).
Pour les stations dont la capacit est infrieure 2500 quivalents habitants, l'extraction des boues
se fera directement du puits boue par la pompe d'alimentation de la table d'gouttage. Pour des
problmes d'exploitation un petit ouvrage d'paississement peut tre envisag en amont
(dimensionn pour un temps de sjour de 4 6 h).
4.2.1) Volume du stockeur des boues
Le volume du stokeur est pris de faon avoir 180 jour d'autonomie :
Volume = PB * 180 / conc ep
La puissance brassage prvoir dans le silo est fonction de la concentration des boues dans le silo
:
40 - 60 w/m
3
de silo 25 g/l
60 - 80 w/m
3
de silo 60 g/l (goutt)
4.3) DESHYDRATATION PAR FILTRE BANDE
La largeur du filtre bande est estime par la relation ci-dessous :
largeur du filtre bande =
7
5 capacit en kgMS/ h / m
PB
La capacit massique du filtre bande pour une boue active avec une charge massique cm
infrieure 0,1 kgDBO
5
/kgMVS est la suivante :
filire paississeur + filtre bande : charge massique = 80 kgMS/h par ml de bande.
table d'gouttage + filtre bande : charge massique =110 120 kgMS:/h par ml de bande.
Le dure hebdomadaire de fonctionnement du filtre bande est calcule l'aide de la relation :
dure hebdomadaire =
7 PB
capacit largeur
4.3.1) Retour en tte du filtre bande
Ces retours en tte sont exprims en pourcentage de pollution exprim par rapport au flux de
l'effluent brut (hors dysfonctionnement de l'installation) :
DB0
5
= 10 %
MES = 20 %
NTK = 5 %
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
518
518
P = 2 %
La siccit en sortie du filtre bande est fonction de l'indice de Mohlman :
IM = 125 ml/g siccit = 18 %
IM = 150 ml/g siccit = 17 %
IM = 200 ml/g siccit = 16 %
Les volumes retourns en tte par le filtre bande sont calculs comme suit :
Volume en retour F.B. = volume filtrat + volume eaux lavage
Volume eaux lavage = 7 m
3
x largeur filtre x h fonct
Volume filtrat = volume boues amont - volume boues dshydrates
4.3.2) Aire de stockage boues dshydrates
h = 1,50 m (hauteur moyenne de stockage)
Temps de sjour dans le stokeur = 180 j
Vol =
siccit
x 180
PB
surface de l' aire =
vol boues stocke
m 1 5 ,
4.4) CHAULAGE DES BOUES
4.4.1) Raction chimique
CaO + H
2
O Ca(OH)
2
56 g 18 g 74 g
Pour y kg de CaO, on obtient :
18 y = 0,321 y kg H
2
O
56
Pour y kg de CaO, on obtient :
74 y = 1,321 y de Ca(OH)
2
56
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
519
519
4.4.2) Siccit immdiate
Sf = siccit immdiate sortie malaxeur des boues chaules
So = siccit initiale sortie machine de dshydratation avant chaulage
P = puret de la chaux = 0,92 0,94 (soit 92% 94% de CaO)
% de chaux sur MS (matires sches) ;
( )
[ ]
%
( )
, .
CaO
MS
Sf So
So P Sf
=
+
100
1 0 321
Nota : La siccit immdiate obtenue est due essentiellement la liaison chimique de Ca(OH)
2
.
La siccit augmente en fonction du temps de contact, comme une prise chimique au mme titre que
le bton.
Leffet de la raction exothermique est secondaire dans laugmentation de la siccit (temprature
infrieure 85C environ), mais elle traduit le ractivit de la chaux, en quelque sorte sa qualit (% de CAO,
qualit de la cuisson)
4.4.3) Siccit aprs contact de 30'
Sf Sf
CaO
MS
30
0 05
'
, = +
4.4.4) Siccit aprs contact de 24 h
Sf Sf
CaO
MS
h 24
0 15 = + ,
4.4.5) Exemple de calcul
So = 18 % = 0,18 sortie Filtre Bande
Sf
24h
= 35 % = 0,35 aprs 24 h de contact
Puret chaux = P = 0,92
% chaux = X = 52 %
4.4.5.1) Siccit immdiate avec 52 % CaO
( )
[ ]
Sf
So X P
X So
=
+ +
+
1 1 0 321
1
, .
.
X = 0,52
P = 0,92
So = 0,18
Sf = 0,275 soit 27,5 % de siccit
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
520
520
4.4.5.2) Siccit aprs 30' de temps de contact
Sf Sf
CaO
MS
30
0 05
'
, . = +
Sf
30
= 0,275 + 0,05 x 0,52
Sf
30
= 0,30 soit 30 % de siccit
4.4.5.3) Siccit aprs 24 h de temps de contact
Sf Sf
CaO
MS
h 24
0 15 = + ,
Sf
24h
= 0,275 + 0,15 x 0,52
Sf
24h
= 0,353 soit 35 % de siccit
4.5) DESHYDRATATION PAR FILTRE PRESSE
4.5.1) Le filtre presse avec conditionnement minral
Le conditionnement minral se fera toujours avec un coagulant de sel mtallique comme le
chlorure ferrique (FeCl
3)
ou le chlorosulfate de fer ou "clairtan" (FeClSO4) associ de la
chaux teinte (Ca (OH)2 ) - prpare sous forme de lait de chaux avec une concentrentation de
l'ordre de 80 100 g/l.
Le pourcentage de ractif (exprim par rapport la quantit de boues en MS ) sera dpendant
du type de boue considre dans le filire tudie.
Plus la boue sera difficile filtrer plus il y aura lieu de rajouter des ractifs minraux,
notamment de la chaux.
Par exemple une boue primaire se filtre mieux qu'une boue biologique stricte.
Les diffrentes types de boues que l'on peut rencontrer dans une process en cultures libres ;
- boues primaires (issues d'une dcantation gravitaire avec ou sans de ractifs) - BP
- boues biologiques strictes aprs une dcantation primaire - BBs
- boues biologiques sans dcantation primaires - BB
- boues physico-chimique tertiaire (sur densaged) - Bt
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
521
521
4.5.1.1) Pourcentage de ractif introduire
Pourcentage de ractifs ajouter par rapport la masse de boue exprime en matire sche
(MS) et en fonction du type de boue ;
BP : Ca (OH)2 = 18 % des MS
FeCl
3
= 3,5 % des MS
BB : Ca (OH)2 = 30 % des MS
FeCl
3
= 10 % des MS
Btertiaire : Ca (OH)2 = 15 % des MS
FeCl
3
= 3,4 % des MS
4.5.1.2 ) Masse de boues conditionne
Le calcul de la masse de boue condionne ( masse de boue dshydrater augmente du poid des
ractifs introduits) se fait une dure d'une semaine et correspondant une dure de dshydratation
hebdomadaire.
La masse de Ca (OH)2 = (M
BP
x coef Ca (OH)2) + (M
BB
x coef Ca (OH)2) + (Bouetertiaire x
coef Ca (OH)2 )
La masse de FeCl
3
= MB x coef FeCl
3
La masse de boues dshydrater = masse de boue vierge + M ca(OH)2 x 0,85 + 0,66 x M
FeCl
3
Masse MS1 = Masse CaOH x 0,85 + Masse FeCl3 x 0,66 + Masse hebdo.Boue
(kg/sem (kg/sem) (kg/sem) (kg/sem)
4.5.1.3) Concentration de la boues conditionnes
[MS1] = Masse de boues dshydrater
Concentration = [Con1] = [MS1] / volume des boues dshydrater hebdomadaire
Conc.MS1 = Masse MS1 / Vol. hebdo.Boues
(g/l) (kg/sem) (m3/sem)
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
522
522
concentration de la boue" vierge" = suivant sont traitement en amont
concentration du lait de chaux = 80 100 g/l prendre 100 g/l
concentration de FeCl3 = 560 586 g/l
Volume MS1 = vol boues paissies x 7 + Masse totale Chaux / 100g/l + Masse totale FeCl3/ 586 g/l
Volume retours en tte = Volume MS1 - Volume gateau
4.5.1.4) Epaisseur de gteau
e = paisseur gteau
Epaisseur gteau (e) = 35 mm si il y des B.PRIMAIRES sinon e = 30 mm
Boues biologiques seules e = 30mm
Boues biologiques + Boues tertiaires e = 30mm
Concentration de rfrence des boues conditionnes = 45 g/l
4.5.1.5) Siccit de la boue presse
La siccit de la boue presse sera fonction du type de boue ou de la proportion des diffrentes types
de boues prsentes dans le mlange
Suivant le ratio BP/BB , nous obtenons un coefficient de siccit
Ratio BP/BB = Product BP / Product BB
(kg/j) (kg/j)
Ratio
BP/BB
0,43 0,67 1,5 2,33
Coeff.siccit 0,88 0,92 1 1,08 1,12
Siccit des boues dshydrate = 35 x coeff. siccit
(%)
4.5.1.6) Temps de presse
Temps de presse (minutes) = 30 + (150 x (e/35)
2
x 45/ [Con
1
]
temps de presse = temps de remplissage et dbatissage
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
523
523
Temps de dbatissage = 30 minutes
4.5.1.7) Volume du filtre presse
Nombre de presses/j = nbre d'heures journalierde travail / (temps presse /60)
Nombre de presses / sem = Nb de presses / j x jour d'exploitation
Masse gateau / par presse = MS1 / (Nbre presses hebdo x siccit/100)
Volume gateau / par presse = masse gateau / densit
Volume filtre = Masse Gateau par presse / densit
(l) (kg) (kg/l)
Masse de Boue presse = Masse MS1 / (Siccit Boue x 10)
Siccit 30 35 40
densit des boues
filtres
1,15 1,17 1,21
4.5.1.8) Surface du filtre
Surface filtre = Volume filtre x 2 / paisseur ( il y a 2 faces de filtration)
4.5.1.9) Volume des boues presses
Vol de Boue presse = Masse MS1 / (densit)
4.5.1.10) Volume occupe par la boue presse dans une benne
Nota = Dans une benne,les boues presses de filtre presse accuse un pourcentage de vide
important (foisonnement ) de l'ordre de 30 % , (cas sans destructuration du gteau) et 10
15% ( cas de la prsence de double vis en-dessous du filtrepresse) qu'il y a lieu de tenir compte
dans l'estimation des volumes vacuer en prenant une densit totale de boue de l'ordre de d =
0,8.
si densit = 1.17
pourcentage de vide = 30% soit % d'occupation = 70%
densit relle = 1.17 x 0,70 = 0,82
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
524
524
4.5.2) Le filtre presse avec conditionnement polymre
4.5.1.2) Boue actives trs faible charge
1,5 4 % FeCl
3
pur / t MS 4%
8 14 l polymre / t MS 12l/t MS
- Cuve FeCl
3
+ boue Tc = 10'
- Ajout du polymre en ligne dans la conduite en amont de la pompe
ou en amont de la pompe membrane avec
variation de frquence
Siccit = 28 % 2 (cas gnral)
Siccit = 30 % 3 (cas particulier de boues trs strutures)
- Temps de presse 2h30 3h ( dont dbatissage 30 mn mini 45 mn)
- 2 presses en moyenne/jour
- 3 presses en lanant une presse le soir et dbatissage le matin
-Temps de cycle de remplissage = 120 minutes
- Temps de debatissage = 6 7 secondes par plateaux x 82
Cuve aval GDD = volume minimum 1 volume dune presse
Cuve de maturation = Tc = 15 minutes minimum
- Nbre de lavages haute pression des toiles par semaine = 1 pour polymre
conditionnement avec Ca(OH)2, l frquence peut plus espace
- Duree du lavage: 40/100 secondes par plateaux (selon le taux d'usure des toiles)
40 x 82 = 3280/60 = 55 minutes
100 x 82 = 8200/60 = 137 minutes
Essais Mirecourt (effluent abattoir+domestique)
Densit = 1 1,1 (d=1,1 mesure Kerbach)
polymre = 10 kg / t MS (boue dpaississeur)
FeCL3 pur = 1,5 %
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
525
525
Concentration en boues paissies = 20 g/l
temps de presse = 2h 2h30
temps de dbatissage = 30mn 1h
paisseur gateau = 25 mn maxi
Siccit = 29 31 % (boues particulires prsence de poils issus de labattoir
donnant une bonne filtrabilit la boue)
4.5.2.2) Passage FeCl
3
FeCl S0 4
FeCl
3
= 162,5 g (poid molaire)
% Fe = 56 = 0,345 ou 34,5 %
162,5
15 % FeCl
3
pur /MS soit 5,17 % Fe/MS
Atochem
d = 1,45
FeCl
3 =
560 g/l et Fe
3+
= 193 g/l
Thann - Mulhouse - Clairtan
180 g/l de Fe
3+
et d = 1,48
4.5.2.3) Exemple 15 % FeCl
3
pur ou 5,17 % Fe
Clairtan Thann
1000 kg MS x 5,17 x 1,48 = 425 kg Clairtan commercial
0,180 x 100
Clairtan Kemro
Fe = 185 - 195 g/l 190 g/l
d = 1,52
1000 kg MS x 5,17 x 1,52 = 414 kg Clairtan commercial
100 x 0,190
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
526
526
FeCl
3
Atochem
1000 kg MS x 5,17 x 1,45 = 388 kg FeCl
3
commercial
0,193 x 100
Rapport produit commercial Clairtan 1,07 1,1
FeCl
3
4.5.3) Le filtre presse membrane avec conditionnement polymre
- siccit = 33% avec 7% de FeCL3 ( inject dans la cuve des boues GDD) + 4 6kg / T MS
(mulsion) 1g/l inject en aval de la pompe HP ( rotor excentr - 8bars dimensionne pour 9 bars
avec variation de frquence)
- gteau de 25mm ( 30mm envisag par Diemme)
- temps de cycle :
Remplissage = 45mm
Sqeezing membrane ( lair) 30mm
Dbatissage = 15mm
Total = 90mm soit 6 presses / jour possible (prendre par scurit 105 110mm)
densit = 1,08 1,1
siccit de dimensionnement = 30% 33% ( garantie du fournisseur)
4.5.4) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU CONDITIONNEMENT
4.5.4.1) Debit de la pompe H.P
Type ABEL = H.P membrane ( 15 bars)
exclure la PCM qui lamine la boue et dtruit le floc ( rduit le rendement du Filtre presse)
dbit pompe HP = Volume filtre x coef boues
Coef = 10 si il y a des boues primaires
Coef = 6 si pas de boues primaires
Formule plus prcise :
dbit pompe HP = Volume filtre x coef de pompage x siccitfinale / (temps de prsse x
concentration boues conditionnees)
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
527
527
avec :
coef de pompage : 2 2,5
temps de prsse : temps de prsse total hors dbatissage
- Temps de remplissage du filtre = 6 - 10
- Temps de monte en pression = 30
- Temps de pression ( 15 bars ) = au bout de 1h10 - 1h15
Prvoir un laveur HP automatique ( 100 bars mini)
Eau potable obligatoire
Lavage du filtre = toutes les 40 - 50 presses
4.5.4.2) Chaine de conditionnement
4.5.4.2.1) Cuve de Fecl3
Temps de contact = 10 en moyenne ( 5 mini et 15 maxi)
agitateur lent
Volume cuve FeCl3 = Volume boues hebdo x 10/60 / nb heure fct semaine
Dbit de la pompe FeCl3 = Qt de Fe Cl3 x 2 / ( concentration x nb fct sem)
le facteur 2 est une facteur de scurit
4.5.4.2.2) Cuve avec la Chaux (CaOH2)
Temps de contact = 17 en moyenne ( 10 mini et 25 maxi)
agitateur lent
Volume cuve Ca(OH)2 = Volume boues hebdo x 20/60 / nb heure fct semaine
Dbit dinjection = Qt de chaux sem x 2 / ( 100g/l x fct sem)
2 = coef de scurit
100 g/l concentration du lait de chaux
Dbit de la pompe de recirculation = 10 x le dbit dinjection du lait de chaux
(en fonctionnement canard marseillais)
Qt de chaux injecte = Dbit dinjection x 100 g/l / 1000
4.5.4.2.3) Cuve de stockage
Volume = 1 presse
agitateur lent
Volume cuve stockage = Volume boues hebdo / nb de presses semaine
Puissance de brassage = 250 w/m3
aller jusqu 400 w/m3 avec des boues de GDE ( vrifier!)
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
528
528
Prvoir des agitateur multi-tage = 1 tage tout les mtres
la surface de rvolution du module de brassage = surface cuve /2
Agitateurs lents = 50 60 tr /mn
Eviter les hlices
Prendre des plats incin 45
La bche de stockage ne fonctionner qu en discontinue pour homognser les boues
La bche de stockage sert de volume tampon
4.5.4.2.4) Prparation du lait de chaux
prvoir un trmis intermdiaire aprs la trmie sous le silo chaux
bac avec poires haute et basse
Dosage = piquage sur pente suprieure de la canalisation
Injection = par piquage ( lectrovanne) sur le circuit de recirculation
En amont du piquage prvoir un lyre pour maintenir une charge sur linjection
recirculation avec boucle continue
vitesse dans la canalisation en bouce = 1,5 m/s
Pompe liquide charg centrifuge =
dbit de la pompe = 10 x le dbit dinjection du lait de chaux
canalisation en caoutchouc toil
4.5.4.3) - Dtermination des doses mettre en oeuvre
Cette dtermination se fait, en laboratoire, par mesure de la rsistance spcifique la filtration
0,5 bars de dpression : ; 0,5
Mthode de mesure
Cette dtermination permet de fixer les dosages optimaux de ractifs sur filtre presse, mais
il faut tenir compte du facteur de compressibilit.
La figure 1 dcrit l'appareillage ncessaire au test.
Remplir le buchner de boue filtrer pralablement conditionne.
Etablir un vide de 0,5 b rapidement et veille ce que cette valeur reste constante tout au
long de l'essai.
Ds que le vide est atteint, mettre en route le chronomtre et noter le volume de filtrat dj
recueilli soit Vo (en gnral 20 ml) correspondant au temps to, qui sera soustraire des
volumes rprs untrieurement. Noter les temps pour diffrents volumes de filtrats
recueillis : par exemple pour 30, 40, 50, 60 ml etc...
L'essai est conduit jusqu' essorage du gteau (perte de vide due au craquellement du
gteau).
Les volumes Vo - V
1
- V
2
--- correspant aux temps to - t
1
- t
2
--- sont relevs.
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
529
529
Parter sur un graphique les points ayant pour abscisse V
x
et pour adonne.
t
V - V
x
x o
Ces points sont en principe aligns (sauf en dbut de filtration et pendant l'essorage). La
pente de la partie linaire de la courbe obtenue est gale au coefficient a exprim en
sec
( ) cm
2
Expression de la rsistance spcifique la filtration :
r0 5 , =
2 x a x P x 5
r x c
o
2
P est la pression applique exprime en baryes (1 g/cm
2
= 981 baryes) soit pour 0,5 b, 500
x 10
3
baryes.
S la surface de filtration en cm
2
. Par convention, on utilise un buchner dmontable
(schma 2) d'un diamtre utile de 6,5 cm. On a ainsi 5
2
= 1,1 x 10
3
cm
4
viscosit du fitrat en poises ( 20C = 1,1 x 10
-2
poises)
C concentration en matires sches des boues conditionnes exprime en g/cm
3
.
Calcul simplifi :
Si on exprime la pente de la droite a en 10
-4
et C en g/l, la rsistance spcifique devient:
r cm g 0 5 , / =
a
c
x 10 =
a
c
x 10 m/ Kg
10 11
Test de filtrabilit sous pression
La rsistance spcifique la filtration peut tre mesure en cellule de pression. Cette mme
cellule peut tre utilise pour dterminer, par tude de la variation de la rsistance
spcifique en fonction de la pression, le coefficient de compressibilit d'une boue et pour
dterminer sa siccit limite.
Le principe de la mthode est le mme que celui dcrit pour la r 0,5 (voire plus haut).
L'appareil utilise est celui du schma 3.
On humidifie la papier filtre et on assure une lgre surpression pour assurer l'tanchit
du fond de la cellule et liminer l'excs d'eau retenu par le filtre.
On ajuste l'prouvette gradue sous l'entonnoir de la cellule.
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
530
530
On verse l'chantillon (100 150 ml) de boues conditionnes dans la cellule et on ferme
celle-ci.
On applique la pression choisie (0,5 15 bars) et on procde de la mme manire que pour
la mesure sous dpression.
Remarque :
pour des pressions infrieures 2 bars, l'utilisation du piston est dconseille.
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
531
531
Dtermination du coefficient de compressibilit
Mesurer la rsistance spcifique diffrentes pressions (par exemple 0,5 b, 1,5 b, 4,5 b et 13,5 b)
et tracer la courbe log
2
= f (log P) s'assurer de sa linarit et mesurer sa pente qui est gale au
coefficient de copressibilit.
s =
log 1 - log 2
log P - log P
2 1
2 1
s'est un nombre sans dimension.
Conditionnement mettre en oeuvre
Pour un filtre presse plateaux chambrs, les taux de conditionnement doivent tre
suffisants pour atteindre une rsistance spcifique la filtration de 5 15 x 10
10
cm/g.
Remarque :
l'ajout de ractifs augmente la quantit de boues traiter dans les proportions suivantes:
FeCl
3
: (exprime en pur) injecte
Ca(OH)
2
: 90 % du poids introduit
Il faut donc en tenir compte dans le calcul de la quantit de boues dshydrater.
MISE EN OEUVRE DU CONDITIONNEMENT
Un bon mlange des ractifs avec les boues doit tre recherch. Ce mlange se fait dans des bacs
agits. Le sel de fer doit toujours tre inject en premier. La chaux sera dilue sous forme de lait
de chaux 50 - 100 g/l.
Les temps de contact sont de l'ordre de 5 10 mn et l'nergie d'agitation de 150 300 W/m
3
.
Un temps de murissement du floc est gnralement profitable. Par contre une agitation ou un
temps de stockage trop long peuvent, dans certains cas, dtriorer la filtrabilit des boues
conditionnes.
Le transfert de la boue flocule ne doit pas provoquer la destruction du floc : les pompes
centrifuges sont donc prohibes.
L'atelier de conditionnement peut tre entirement automatis.
CONDITIONNEMENT AUX POLYELECTROLYTES
C'est le type de conditionnement adapt la deshydratation sur filtres bandes presseuses,
paississement par drainage (GDE), centrifugation et, sous certaines rserves, sur filtres presses.
Les polylectrolytes ont pour effet
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
532
532
une floculation trs marque par formation de ponts entre particules, grace aux longues chaines
ramifies. Cette floculation est renface par une action coagulante dans le cas des polymres
cationiques.
une fate diminution de la rsistance spcifique de la boue flocule avec par contre augmentation
de l'hydrophilie particulaire et du coefficient de compressibilit.
Choix du polymere
Un grand nombre de polylectrolytes sont disposition. Il faudra donc effectuer des tests simples
de floculation pour dterminer le produit le mieux adapt la boue traiter.
Pour cela, on utilisera le test ci aprs :
Le matriel utilis est le mme que celui utilis pour la mesure de la rsistance spcifique la
filtration (voire plus haut schma n1).
Les polymres tester sont mis en solution 1 ou 2 g/l.
Pour chaque produit tester, on prpare dans un becher de 500 ml un chantillon de boue de 200
ml.
On lui additionne la solution depolymre tester (de prfrence avec une seringue) en agitant,
jusqu' apparition d'un floc bien form et d'une eau intersticielle claire. On note le volume de
solution de polymre utilise.
La boue ainsi flocule est dpose sur le buchner dans lequel on aura dpos pralablement 2
papiers filtres superposs.
On tablit le vide et on dcleche le chronomtre lorsqu'on a obtenu 20 ml de filtrat. On arrte le
chronomtre lorsqu'on atteint 120 ml de filtrat. On note
Volume de retour en tte
Vol.Boue Sec = Masse MS1 / (Siccit Boue x 10)
(m3/sem) (kg/sem) (%)
Vol. filtrat.= Vol. hebdo Boue - Vol.Boue Sec
(m3/sem) (m3/sem) (m3/sem)
Vol. retour Sec = Vol. filtrat
(m3/sem) (m3/sem)
Mthode de calcul d'une filire de traitement - A.SADOWSKI Ch 21 - page
533
533
V. BIBLIOGRAPHIE
CORNICE Robert. Conditionnement et traitement des boues des stations dpuration des eaux
rsiduaires urbaines et des usines de production deau potable. Institut National Agronomique de Paris,
cycle Valorisation agricole des dchets des usines de traitement des eaux, 13-17 avril 1992.
FAYOUX Christian.LOGICIEL DIMSTEP eaux & boues (Document interne CIRSEE), 1992.
SADOWSKI Antoine. Dimensionnement dune filire de traitement par boues actives
CIRSEE,1992
Vous aimerez peut-être aussi
- L' irrigation avec des eaux usées et la santé: Évaluer et atténuer les risques dans les pays à faible revenuD'EverandL' irrigation avec des eaux usées et la santé: Évaluer et atténuer les risques dans les pays à faible revenuPas encore d'évaluation
- Les Transferts massifs d'eau: Outils de développement ou instruments de pouvoir ?D'EverandLes Transferts massifs d'eau: Outils de développement ou instruments de pouvoir ?Pas encore d'évaluation
- Boues de Step Traitement Valorisation e LiminationDocument36 pagesBoues de Step Traitement Valorisation e Liminationمحمد امين شريف100% (1)
- Hydrologie: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandHydrologie: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- L' Ingénieur et le développement durableD'EverandL' Ingénieur et le développement durableÉvaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)
- Guide Technique de Foisonnement Des Boues ActivéesDocument62 pagesGuide Technique de Foisonnement Des Boues ActivéesDao Meca100% (1)
- Projet Traitement Des EauxDocument47 pagesProjet Traitement Des EauxPauline SentenacPas encore d'évaluation
- Traitement BioDocument87 pagesTraitement BioAbass MarrakchiPas encore d'évaluation
- Gestion Des EauxDocument30 pagesGestion Des Eauxdjamel100% (1)
- Rapport Valorisation Boues LiquidesDocument85 pagesRapport Valorisation Boues LiquidesDiden DzPas encore d'évaluation
- Polluants Organiques Et Inorganiques de EauxDocument30 pagesPolluants Organiques Et Inorganiques de EauxRock Reno SomePas encore d'évaluation
- Traitement de La Boue de L'eau Potable.Document24 pagesTraitement de La Boue de L'eau Potable.Amnay MehlaouiPas encore d'évaluation
- 6 Stratgie Nationale de Gestion Des Boues Des Stations Depuration Au MarocDocument33 pages6 Stratgie Nationale de Gestion Des Boues Des Stations Depuration Au MarocChentouf Mohammed100% (2)
- Vérification D'une STEPDocument15 pagesVérification D'une STEPZOUDJI HAMID89% (9)
- Cours ÉpurationDocument117 pagesCours ÉpurationFousseyni TRAORE100% (1)
- Projet Transaqua : Transfert des Eaux du Bassin du fleuve Congo au lac Tchad: Ses Conséquences, ses Enjeux et Pistes de solutionsD'EverandProjet Transaqua : Transfert des Eaux du Bassin du fleuve Congo au lac Tchad: Ses Conséquences, ses Enjeux et Pistes de solutionsÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Introduction Au Traitement Des Eaux UséesDocument14 pagesIntroduction Au Traitement Des Eaux UséesJulien Ficus Laurent100% (1)
- Eaux Usées Urbaines M1 (Mode de Compatibilité)Document46 pagesEaux Usées Urbaines M1 (Mode de Compatibilité)TofradoPas encore d'évaluation
- Boues ActiveesDocument20 pagesBoues ActiveesChokri Chakiir100% (1)
- 745 PDFDocument120 pages745 PDFLouis Serge GuellaPas encore d'évaluation
- Traitement Eau TTE L3Document369 pagesTraitement Eau TTE L3جعدبندرهم100% (3)
- Traitement de L'eauDocument158 pagesTraitement de L'eauSans Snoq100% (5)
- Epuration Des Eaux IndustriellesDocument41 pagesEpuration Des Eaux Industriellestallef001Pas encore d'évaluation
- Dysfonctionnement D'une Filière de Traitement Des Eaux UséesDocument36 pagesDysfonctionnement D'une Filière de Traitement Des Eaux UséesMeryemPas encore d'évaluation
- Les Eaux Usees UrbainesDocument99 pagesLes Eaux Usees UrbainesStanePas encore d'évaluation
- Etude Reutilisation Des Eaux Usees EpureesDocument67 pagesEtude Reutilisation Des Eaux Usees EpureesBilal OumlabatPas encore d'évaluation
- Traitement Des Eaux Usees Et P - TITAFI Asmae - 219 PDFDocument43 pagesTraitement Des Eaux Usees Et P - TITAFI Asmae - 219 PDFAhmedamine Sabik100% (4)
- DM Dimensionnement PDFDocument61 pagesDM Dimensionnement PDFFIGADEPas encore d'évaluation
- Hydaulique GénéraleDocument185 pagesHydaulique GénéraleAbdelmalek BahijPas encore d'évaluation
- Traitement Des EauxDocument119 pagesTraitement Des EauxAbdelhakim Bailal100% (1)
- Réutilisation Des Eaux Usées Après TraitementDocument38 pagesRéutilisation Des Eaux Usées Après TraitementChaoubi Youssef100% (1)
- Séchage Des Boues D'épurationDocument25 pagesSéchage Des Boues D'épurationMame Thierno Sene100% (1)
- Eie StepDocument18 pagesEie StepFatima-ezzahra laitiPas encore d'évaluation
- Traitement Des Eaux UseesDocument11 pagesTraitement Des Eaux Useesbenderrah taieb100% (2)
- En NawaouiDocument98 pagesEn Nawaouifouadona_resp100% (3)
- Rapport PFE VFDocument75 pagesRapport PFE VFyosraPas encore d'évaluation
- Traitement de Leau M1 TTEDocument349 pagesTraitement de Leau M1 TTEFiras Maitig100% (2)
- Traitement Des Eaux Usees UrbainesDocument34 pagesTraitement Des Eaux Usees Urbainesjolegende100% (1)
- DimensionnementDocument103 pagesDimensionnementAhmed MediouniPas encore d'évaluation
- La Réutilisation Des Eaux Usées Épurées A DesDocument58 pagesLa Réutilisation Des Eaux Usées Épurées A Deszakaria lokmane0% (1)
- Traitements Des Eaux PDFDocument89 pagesTraitements Des Eaux PDFaviero313483% (6)
- Lagunage Aeré PDFDocument1 pageLagunage Aeré PDFjolegendePas encore d'évaluation
- L Utilisation Des Eaux Usees Epurees en IrrigationDocument103 pagesL Utilisation Des Eaux Usees Epurees en IrrigationomardjoukbalaPas encore d'évaluation
- Etude Des Performances ÉpuratoireDocument46 pagesEtude Des Performances Épuratoirehamza100% (5)
- Traitement Des Eaux UseesDocument31 pagesTraitement Des Eaux UseesHoussam Eddine SalamaPas encore d'évaluation
- Presentation Chimie Des Eaux GPEE3 ENSA AgadirDocument23 pagesPresentation Chimie Des Eaux GPEE3 ENSA AgadirstudentPas encore d'évaluation
- Dimensionnement de Station D'épuration PFEDocument100 pagesDimensionnement de Station D'épuration PFETRAORE100% (1)
- Reutilisation Des Eaux Usees en Irrigation - Pnacx004Document86 pagesReutilisation Des Eaux Usees en Irrigation - Pnacx004Dhikrane Nafaa100% (2)
- AEPS Serie D'exxercies Et TDDocument31 pagesAEPS Serie D'exxercies Et TDvieu2Pas encore d'évaluation
- Pfe FinaleDocument99 pagesPfe FinaleMaha Kahlaoui100% (1)
- Introduction À L'assainissementDocument103 pagesIntroduction À L'assainissementAmina Elbakkali100% (1)
- 05-1-Introduction Traitement BouesDocument45 pages05-1-Introduction Traitement BouesOliver Frere100% (1)
- Traitement Eau STE L3Document263 pagesTraitement Eau STE L3Noureddine Merah100% (1)
- Changements climatiques et biodiversité du Québec: Vers un nouveau patrimoine naturelD'EverandChangements climatiques et biodiversité du Québec: Vers un nouveau patrimoine naturelÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Tome1 2Document418 pagesTome1 2صقر القادسية ذئب الواديPas encore d'évaluation
- Mémoire A LouppeDocument98 pagesMémoire A LouppeAmine AdjaoudPas encore d'évaluation
- mémoireTFE FlorenceBOULEAUXDocument106 pagesmémoireTFE FlorenceBOULEAUXAmine AdjaoudPas encore d'évaluation
- guide d - أ©purationDocument44 pagesguide d - أ©purationnassima100% (1)
- Ecoulement A Surface LibreDocument26 pagesEcoulement A Surface LibreSara TahtahPas encore d'évaluation
- Mécanique Des FluidesDocument64 pagesMécanique Des FluidesMarwa KattaniPas encore d'évaluation
- Projet Traitement Des Odeurs Dans Les STEP Amine 2013-2014 Master1Document20 pagesProjet Traitement Des Odeurs Dans Les STEP Amine 2013-2014 Master1Amine Adjaoud100% (1)
- Chapitre 5 - FiltrationDocument90 pagesChapitre 5 - FiltrationAmine AdjaoudPas encore d'évaluation
- Amine UploadDocument18 pagesAmine UploadAmine Adjaoud100% (1)
- 1 Cycle Et Usage de L EauDocument4 pages1 Cycle Et Usage de L EauAmine AdjaoudPas encore d'évaluation
- Notions Mecanique Des Fluides. " Riadh BEN HAMOUDA "Document140 pagesNotions Mecanique Des Fluides. " Riadh BEN HAMOUDA "Salma Brb83% (6)
- Mme - BOUROUBI ANRH AlgérieDocument33 pagesMme - BOUROUBI ANRH AlgérieAmine Adjaoud100% (3)
- RDMDocument87 pagesRDMWissem Ben YahiaPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage Step El KermaDocument20 pagesRapport de Stage Step El KermaAmine Adjaoud60% (10)
- Rapport IrrigationDocument12 pagesRapport IrrigationZinebZnoubaPas encore d'évaluation
- Smi 1Document12 pagesSmi 1vladirivPas encore d'évaluation
- Formation Et Perfectionnement: Amélioration Continue Et Résolution de Problèmes - MESIDocument5 pagesFormation Et Perfectionnement: Amélioration Continue Et Résolution de Problèmes - MESImilou88Pas encore d'évaluation
- CofrmaprogDocument4 pagesCofrmaprogmohamedagendaPas encore d'évaluation
- Bail CommercialDocument17 pagesBail Commerciallaurana68Pas encore d'évaluation
- Liste de Structures Détentrices de Permis EnvironnementalDocument84 pagesListe de Structures Détentrices de Permis EnvironnementalMonefong Albert BricePas encore d'évaluation
- Framework CompDocument1 pageFramework CompyieldsPas encore d'évaluation
- Fiche Technique Inspecteur H SeDocument2 pagesFiche Technique Inspecteur H SeZaki AdamouPas encore d'évaluation
- 6 GuideProfilenTravers JLReynaud - Cle0619b8 PDFDocument24 pages6 GuideProfilenTravers JLReynaud - Cle0619b8 PDFAbdelkhalek BouananiPas encore d'évaluation
- Bouayad & AllDocument15 pagesBouayad & AllEl MehdiPas encore d'évaluation
- Le Problème de Pérennisation Des TPEDocument2 pagesLe Problème de Pérennisation Des TPElassaad ben romdhane100% (1)
- Généralité Sur Gestion BudgetaireDocument3 pagesGénéralité Sur Gestion BudgetaireSara Bou100% (1)
- CV LFDDocument2 pagesCV LFDtouloupePas encore d'évaluation
- Ilot Ouvert de Portzamparc Rapport GE12 Bellego Cazin FournierDocument38 pagesIlot Ouvert de Portzamparc Rapport GE12 Bellego Cazin FournierDaniela VelozoPas encore d'évaluation
- Rapport D'évaluation Final Sur Le Programme de Renforcement Des Capacités Nationales Et Locales en Gestion Des Risques Et Des CatastrophesDocument74 pagesRapport D'évaluation Final Sur Le Programme de Renforcement Des Capacités Nationales Et Locales en Gestion Des Risques Et Des CatastrophesHayZara Madagascar100% (2)
- Fiches Tarifs CPCU-2016Document2 pagesFiches Tarifs CPCU-2016Benoît GuyotPas encore d'évaluation
- Analyse de La Valeur Patrimoniale Maison MolsonDocument54 pagesAnalyse de La Valeur Patrimoniale Maison MolsonandyrigaPas encore d'évaluation
- Formulaire EauxDocument6 pagesFormulaire EauxIlyass El HaouziPas encore d'évaluation
- Rapport de Serge Lagauche - Bilan Et Propositions Sur Le Régime D-Autorisations D-Aménagement Cinématographique Issu de La Loi de Modernisation de L-Économie Du 4 Août 2008Document88 pagesRapport de Serge Lagauche - Bilan Et Propositions Sur Le Régime D-Autorisations D-Aménagement Cinématographique Issu de La Loi de Modernisation de L-Économie Du 4 Août 2008alexandre_brillantPas encore d'évaluation
- 5 Bouregreg-DéfDocument21 pages5 Bouregreg-DéfSiham EllaylPas encore d'évaluation
- Catal 02Document71 pagesCatal 02Pashishi PoP'sPas encore d'évaluation
- 6 6951 8de08feb PDFDocument32 pages6 6951 8de08feb PDFSAEC LIBERTEPas encore d'évaluation
- 2210 Clapets AérateursDocument2 pages2210 Clapets AérateursdescobPas encore d'évaluation
- Les Charges de VentDocument9 pagesLes Charges de Ventyuri2010100% (1)
- Etat Et Apercu de RETScreen Version 5Document19 pagesEtat Et Apercu de RETScreen Version 5Leo le PopsPas encore d'évaluation
- Le Système HACCPDocument3 pagesLe Système HACCPInga JurjuPas encore d'évaluation