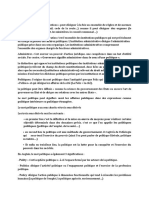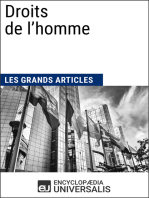Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Deux Lois de L'évolution Pénale - Durkheim PDF
Deux Lois de L'évolution Pénale - Durkheim PDF
Transféré par
Harold Mauricio Nieto CastilloTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Deux Lois de L'évolution Pénale - Durkheim PDF
Deux Lois de L'évolution Pénale - Durkheim PDF
Transféré par
Harold Mauricio Nieto CastilloDroits d'auteur :
Formats disponibles
mile DURKHEIM (1899-1900)
Deux lois
de l'volution pnale
Un document produit en version numrique par Jean-Marie Tremblay, bnvole,
professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi
Courriel: jmt_sociologue@videotron.ca
Site web: http://pages.infinit.net/sociojmt
Dans le cadre de la collection: "Les classiques des sciences sociales"
Site web: http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html
Une collection dveloppe en collaboration avec la Bibliothque
Paul-mile-Boulet de l'Universit du Qubec Chicoutimi
Site web: http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm
mile Durkheim (1899-1900), Deux lois de l'volution pnale
Cette dition lectronique a t ralise par Jean-Marie Tremblay, bnvole,
professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi partir de :
mile Durkheim (1899-1900)
Deux lois de l'volution pnale
Une dition lectronique ralise partir du texte dmile Durkheim (18991900), Deux lois de l'volution pnale in Anne sociologique, vol. IV, 18991900, pp. 65 95, rubrique: Mmoires originaux. Paris: PUF. Texte reproduit
dans Journal sociologique, pp. 245 273. Paris: PUF, 1969, 728 pages.
Collection Bibliothque de philosophie contemporaine.
Polices de caractres utilise :
Pour le texte: Times, 12 points.
Pour les citations : Times 10 points.
Pour les notes de bas de page : Times, 10 points.
dition lectronique ralise avec le traitement de textes Microsoft Word 2001
pour Macintosh.
Mise en page sur papier format
LETTRE (US letter), 8.5 x 11)
dition complte le 22 septembre 2002 Chicoutimi, Qubec.
dition revue et corrige par Bertrand Gibier, professeur de philosophie
au Lyce de Montreuil-sur-Mer (dans le Pas-de-Calais),
bertrand.gibier@ac-lille.fr, le 22 novembre 2002.
mile Durkheim (1899-1900), Deux lois de l'volution pnale
Table des matires
Deux lois de lvolution pnale
Section I :
Section II :
Section III :
Section IV :
Section V :
Loi des variations quantitatives
Loi des variations qualitatives
Explication de la seconde loi
Explication de la premire loi
Conclusion
mile Durkheim (1899-1900), Deux lois de l'volution pnale
Deux lois de
l'volution pnale.
par mile Durkheim (1899-1900)
Retour la table des matires
in Anne sociologique, vol. IV, 1899-1900, pp. 65 95, rubrique:
Mmoire originaux. Paris: PUF. Texte reproduit dans Journal sociologique,
pp. 245 273. Paris: PUF, 1969, 728 pages. Collection Bibliothque de
philosophie contemporaine, 728 pp.
Dans l'tat actuel des sciences sociales, on ne peut le plus souvent traduire
en formules intelligibles que les aspects les plus gnraux de la vie collective.
Sans doute, on n'arrive ainsi qu' des approximations parfois grossires, mais
qui ne laissent pas d'avoir leur utilit ; car elles sont une premire prise de
l'esprit sur les choses et, si schmatiques qu'elles puissent tre, elles sont la
condition pralable et ncessaire de prcisions ultrieures.
C'est sous cette rserve que nous allons chercher tablir et expliquer
deux lois qui nous paraissent dominer l'volution du systme rpressif. Il est
bien clair que nous n'atteindrons ainsi que les variations les plus gnrales ;
mais si nous russissons introduire un peu d'ordre dans cette masse confuse
de faits, si imparfaite qu'elle soit, notre entreprise n'aura pas t inutile.
mile Durkheim (1899-1900), Deux lois de l'volution pnale
Les variations par lesquelles a pass la peine au cours de l'histoire sont de
deux sortes : les unes quantitatives, les autres qualitatives. Les lois des unes et
des autres sont naturellement diffrentes.
I
Loi des variations quantitatives
Retour la table des matires
Elle peut se formuler ainsi :
L'intensit de la peine est d'autant plus grande que les socits appartiennent un type moins lev - et que le pouvoir central a un caractre plus
absolu.
Expliquons d'abord le sens de ces expressions.
La premire n'a pas grand besoin d'tre dfinie. Il est relativement ais de
reconnatre si une espce sociale est plus ou moins leve qu'une autre ; il n'y
a qu' voir si elles sont plus ou moins composes et, degr de composition
gal, si elles sont plus ou moins organises. Cette hirarchie des espces
sociales n'implique pas, d'ailleurs, que la suite des socits forme une srie
unique et linaire ; il est, au contraire, certain qu'elle doit tre plutt figure
par un arbre aux rameaux multiples et plus ou moins divergents. Mais, sur cet
arbre, les socits sont situes plus ou moins haut, elles se trouvent une
distance plus ou moins grande de la souche commune 1. C'est condition de
les considrer sous cet aspect qu'il est possible de parler d'une volution
gnrale des socits.
Le second facteur que nous avons distingu doit nous arrter davantage.
Nous disons du pouvoir gouvernemental qu'il est absolu quand il ne rencontre
dans les autres fonctions sociales rien qui soit de nature le pondrer et le
limiter efficacement. A vrai dire, une absence complte de toute limitation ne
se rencontre nulle part ; on peut mme dire qu'elle est inconcevable. La
tradition, les croyances religieuses servent de freins mme aux gouvernements
les plus forts. De plus, il y a toujours quelques organes sociaux secondaires
qui, l'occasion, sont susceptibles de s'affirmer et de rsister. Les fonctions
subordonnes auxquelles s'applique la fonction rgulatrice suprme ne sont
jamais dpourvues de toute nergie personnelle. Mais il arrive que cette limitation de fait n'a rien de juridiquement obligatoire pour le gouvernement qui la
subit ; quoiqu'il garde dans l'exercice de ses prrogatives une certaine mesure,
1
V. nos Rgles de la mthode sociologique, chap. IV.
mile Durkheim (1899-1900), Deux lois de l'volution pnale
il n'y est pas tenu par le droit crit ou coutumier. Dans ce cas, il dispose d'un
pouvoir qu'on peut appeler absolu. Sans doute, s'il se laisse aller des excs,
les forces sociales qu'il lse peuvent se coaliser pour ragir et pour le
contenir ; mme en prvision de cette raction possible et pour la prvenir, il
peut se contenir de lui-mme. Mais cette contention, qu'elle soit son fait ou
qu'elle lui soit matriellement impose, est essentiellement contingente ; elle
ne rsulte pas du fonctionnement normal des institutions. Quand elle est due
son initiative, elle se prsente comme une concession gracieuse, comme un
abandon volontaire de droits lgitimes ; quand elle est le produit de rsistances collectives, elle a un caractre franchement rvolutionnaire.
On peut encore caractriser d'une autre manire le gouvernement absolu.
La vie juridique gravite tout entire autour de deux ples : les relations qui en
sont la trame sont unilatrales, ou bien, au contraire, bilatrales et rciproques.
Tels sont, du moins, les deux types idaux autour desquels elles oscillent. Les
premires sont constitues exclusivement par des droits attribus l'un des
termes du rapport sur l'autre, sans que ce dernier jouisse d'aucun droit corrlatif ses obligations. Dans les secondes, au contraire, le lien juridique rsulte
d'une parfaite rciprocit entre les droits confrs chacune des deux parties.
Les droits rels, et plus spcialement le droit de proprit, reprsentent la
forme la plus acheve des relations du premier genre : le propritaire a des
droits sur sa chose qui n'en a pas sur lui ; le contrat, surtout le contrat juste,
c'est--dire celui o il y a une quivalence parfaite dans la valeur sociale des
choses ou des prestations changes, est le type des relations rciproques. Or,
plus les rapports du pouvoir suprme avec le reste de la socit ont le caractre unilatral, en d'autres termes, plus ils ressemblent ceux qui unissent la
personne et la chose possde, plus le gouvernement est absolu. Inversement,
il l'est d'autant moins que ses relations avec les autres fonctions sociales sont
plus compltement bilatrales. Aussi le modle le plus parfait de la souverainet absolue est-il la patria potestas des Romains, telle que la dfinissait le
vieux droit civil, puisque le fils tait assimil une chose.
Ainsi, ce qui fait le pouvoir central plus ou moins absolu, c'est l'absence
plus ou moins radicale de tout contrepoids, rgulirement organis en vue de
le modrer. On peut donc prvoir que ce qui donne naissance un pouvoir de
ce genre, c'est la runion, plus ou moins complte, de toutes les fonctions
directrices de la socit dans une seule et mme main. En effet, cause de
leur importance vitale, elles ne peuvent se concentrer dans une seule et mme
personne, sans donner celle-ci une prpondrance exceptionnelle sur tout le
reste de la socit, et c'est cette prpondrance qui constitue l'absolutisme. Le
dtenteur d'une telle autorit se trouve investi d'une force qui l'affranchit de
toute contrainte collective et fait que, dans une certaine mesure tout au moins,
il ne relve que de lui-mme et de son bon plaisir et peut imposer toutes ses
volonts. Cette hypercentralisation dgage une force sociale sui generis tellement intense qu'elle domine toutes les autres et se les assujettit. Et cette
prpondrance ne s'exerce pas seulement en fait, mais en droit, car celui qui
en a le privilge est investi d'un tel prestige qu'il semble tre d'une nature plus
qu'humaine ; on ne conoit donc mme pas qu'il puisse tre soumis des
obligations rgulires, comme le commun des hommes.
Si brve et si imparfaite que soit cette analyse, elle suffira du moins nous
prmunir contre certaines erreurs, encore trs rpandues. On voit, en effet,
mile Durkheim (1899-1900), Deux lois de l'volution pnale
que, contrairement la confusion commise par Spencer, l'absolutisme gouvernemental ne varie pas comme le nombre et l'importance des fonctions gouvernementales. Si nombreuses qu'elles soient, quand elles ne sont pas concentres en une seule main, le gouvernement n'est pas absolu. C'est ce qui arrive
aujourd'hui dans nos grandes socits europennes et particulirement en
France. Le champ d'action de l'tat y est autrement tendu que sous Louis
XIV ; mais les droits qu'il a sur la socit ne vont pas sans devoirs rciproques ; ils ne ressemblent en rien un droit de proprit. C'est qu'en effet non
seulement les fonctions rgulatrices suprmes sont rparties entre les organes
distincts et relativement autonomes, quoique solidaires, mais encore elles ne
s'exercent pas sans une certaine participation des autres fonctions sociales.
Ainsi, de ce que l'tat fait sentir son action sur un plus grand nombre de
points, il ne suit pas qu'il devienne plus absolu. Il peut le devenir, il est vrai,
mais il faut pour cela de tout autres circonstances que la complexit plus grande des attributions qui lui sont dvolues. Inversement, la mdiocre tendue de
ses fonctions ne constitue pas un obstacle ce qu'il prenne ce caractre. En
effet, si elles sont peu nombreuses et peu riches d'activit, c'est que la vie
sociale elle-mme, dans sa gnralit, est pauvre et languissante ; car le dveloppement plus ou moins considrable de l'organe rgulateur central ne fait
que reflter le dveloppement de la vie collective en gnral, comme les
dimensions du systme nerveux, chez l'individu, varient suivant l'importance
des changes organiques. Les fonctions directrices de la socit ne sont donc
rudimentaires que quand les autres fonctions sociales sont de mme nature ; et
ainsi le rapport entre les unes et les autres reste le mme. Par suite, les premiers gardent toute leur suprmatie et il suffit qu'elles soient absorbes par un
seul et mme individu pour le mettre hors de pair, pour l'lever infiniment audessus de la socit. Rien n'est plus simple que le gouvernement de certains
roitelets barbares ; rien n'est plus absolu.
Cette remarque nous conduit une autre qui intresse plus directement
notre sujet : c'est que le caractre plus ou moins absolu du gouvernement n'est
pas solidaire de tel ou tel type social. Si, en effet, il peut se rencontrer indiffremment l o la vie collective est d'une extrme simplicit aussi bien que l
o elle est trs complexe, il n'appartient pas plus exclusivement aux socits
infrieures qu'aux autres. On pourrait croire, il est vrai, que cette concentration des pouvoirs gouvernementaux accompagne toujours la concentration
de la masse sociale, soit qu'elle en rsulte, soit qu'elle contribue la dterminer. Mais il n'en est rien. La cit romaine, surtout depuis la chute des rois, fut,
jusqu'au dernier sicle de la rpublique, indemne de tout absolutisme ; or les
divers segments ou socits partielles (gentes) dont elle tait forme sont
parvenus, justement sous la Rpublique, un trs haut degr de concentration
et de fusion. Au reste, en fait, on observe des formes de gouvernement qui
mritent d'tre appeles absolues dans les types sociaux les plus diffrents, en
France au XVIIe sicle comme la fin de l'tat romain ou dans une multitude
de monarchies barbares. Inversement, un mme peuple, suivant les circonstances, peut passer d'un gouvernement absolu un autre tout diffrent ;
cependant une mme socit ne peut pas plus changer de type au cours de son
volution qu'un animal ne peut changer d'espce pendant la dure de son
existence individuelle. La France du XVIIe sicle et celle du XIXe appartiennent au mme type et pourtant l'organe rgulateur suprme s'est transform. Il
est impossible d'admettre que, de Napolon Ier Louis-Philippe, la socit
franaise soit passe d'une espce sociale une autre, pour subir un change-
mile Durkheim (1899-1900), Deux lois de l'volution pnale
ment inverse de Louis-Philippe Napolon III. De pareilles transmutations
sont contradictoires avec la notion mme d'espce 1.
Cette forme spciale de l'organisation politique ne tient donc pas la constitution congnitale de la socit, mais des conditions individuelles, transitoires, contingentes. Voil pourquoi ces deux facteurs de l'volution pnale
la nature du type social et celle de l'organe gouvernemental doivent tre
soigneusement distingus. C'est que, tant indpendants, ils agissent indpendamment l'un de l'autre, parfois mme en sens oppos. Par exemple, il arrive
qu'en passant d'une espce infrieure d'autres, plus leves, on ne voit pas la
peine s'abaisser comme on pouvait s'y attendre, parce que, au mme moment,
l'organisation gouvernementale neutralise les effets de l'organisation sociale.
Le processus est donc trs complexe.
La formule de la loi explique, il nous faut montrer qu'elle est conforme
aux faits. Comme il ne peut tre question de passer en revue tous les
peuples, nous choisirons ceux que nous allons comparer parmi ceux o les
institutions pnales sont arrives un certain degr de dveloppement et sont
connues avec une certaine dtermination. Au reste, ainsi que nous avons
essay de le montrer ailleurs, l'essentiel dans une dmonstration sociologique
n'est pas d'entasser des faits, mais de constituer des sries de variations rgulires dont les termes se relient les uns aux autres par une gradation aussi
continue que possible, et qui, de plus, soient d'une suffisante tendue 2.
Dans un trs grand nombre de socits anciennes, la mort pure et simple
ne constitue pas la peine suprme; elle est aggrave, pour les crimes rputs
les plus atroces, de supplices additionnels qui avaient pour effet de la rendre
plus affreuse. C'est ainsi que, chez les gyptiens, en dehors de la pendaison et
de la dcollation, nous rencontrons le bcher, le supplice des cendres, la mise
en croix. Dans la peine du feu, le bourreau commenait par pratiquer avec des
joncs aigus plusieurs incisions aux mains du coupable et c'est seulement
ensuite qu'il tait couch sur un feu d'pines et brl vif. Le supplice des
cendres consistait touffer le condamn sous un monceau de cendres. Il est
mme probable, dit Thonissen, que les juges avaient l'habitude d'infliger aux
coupables toutes les souffrances accessoires qu'ils croyaient requises par la
nature du crime ou les exigences de l'opinion publique 3. Les peuples d'Asie
paraissent avoir pouss plus loin la cruaut. Chez les Assyriens, on jetait les
coupables aux btes froces ou dans une fournaise ardente ; on les brlait
petit feu dans une cuve d'airain ; on leur crevait les yeux. L'tranglement et la
1
2
3
Voil pourquoi il nous parat peu scientifique de classer les socits d'aprs leur tat de
civilisation, comme l'ont fait Spencer et, ici mme, Steinmetz. Car, alors, on est oblig
d'attribuer une seule et mme socit une pluralit d'espces, suivant les formes politiques qu'elle a successivement revtues, ou suivant les degrs de civilisation qu'elle a
progressivement parcourus. Que dirait-on d'un zoologiste qui fragmenterait ainsi un
animal entre plusieurs espces ? Une socit est pourtant, plus encore qu'un organisme,
une personnalit dfinie, identique elle-mme, certains gards, d'un bout l'autre de
son existence ; par consquent, une classification qui mconnat cette unit fondamentale,
dfigure gravement la ralit. On peut bien classer ainsi des tats sociaux, non des
socits ; et ces tats sociaux restent en l'air, ainsi dtachs du substrat permanent qui les
relie les uns aux autres. C'est donc l'analyse de ce substrat, et non de la vie changeante
qu'il supporte, qui seule peut fournir les bases d'une classification rationnelle.
Rgles, etc., p. 163.
tudes sur l'histoire du droit criminel des peuples anciens, I, p. 142.
mile Durkheim (1899-1900), Deux lois de l'volution pnale
dcapitation taient repousss comme des mesures insuffisantes ! Chez les
divers peuples de Syrie, on lapidait les criminels, on les perait de flches, on
les pendait, on les crucifiait, on leur brlait les ctes et les entrailles avec des
torches, on les cartelait, on les prcipitait des rochers..., on les faisait craser
sous les pieds des animaux, etc. 1. Le code de Manou lui-mme distingue
entre la mort simple, consistant dans la dcollation, et la mort exaspre ou
qualifie. Cette dernire est de sept espces : le pal, le feu, l'crasement sous
les pieds d'un lphant, la noyade, l'huile bouillante verse dans les oreilles et
dans la bouche, tre dchir par des chiens sur une place publique, tre coup
par morceaux avec des rasoirs.
Chez ces mmes peuples, la mort simple tait prodigue. Une numration
de tous les cas qui la comportaient est impossible. Un fait montre combien ils
taient nombreux : d'aprs un rcit de Diodore, un roi d'gypte, en relguant
les condamns mort dans un dsert, parvint y fonder une ville nouvelle, et
un autre, en les employant aux travaux publics, russit faire construire de
nombreuses digues et creuser des canaux 2.
Au-dessous de la peine de mort, se trouvaient les mutilations expressives.
Ainsi, en gypte, les faux monnayeurs, ceux qui altraient les critures
publiques avaient les deux mains tranches ; le viol commis sur une femme
libre tait puni par l'ablation des parties gnitales ; on arrachait la langue
l'espion, etc. 3. De mme, d'aprs les lois de Manou, on coupe la langue
l'homme de la dernire classe qui insulte gravement les Dwidjas ; on marque
au-dessous de la hanche le Soudra qui a l'audace de s'asseoir ct d'un
Brahmane 4, etc. En dehors de ces mutilations caractristiques, toute sorte de
chtiments corporels taient en usage chez l'un et chez l'autre peuple. Les
peines de ce genre taient le plus souvent fixes arbitrairement par le juge.
Le peuple hbreu n'appartenait certainement pas un type suprieur aux
prcdents ; en effet, la concentration de la masse sociale ne se fit qu' une
poque relativement tardive, sous les rois. Jusque-l, il n'y avait pas d'tat
isralite, mais seulement une juxtaposition de tribus ou de clans plus ou moins
autonomes, et qui ne se coalisaient que momentanment pour faire face un
danger commun 5. Cependant, la loi mosaque est beaucoup moins svre que
celle de Manou ou que les livres sacrs de l'gypte. La peine capitale n'y est
plus entoure des mmes raffinements de cruaut. Il semble mme que,
pendant longtemps, la lapidation seule y ait t en usage ; c'est seulement dans
les textes rabbiniques qu'il est question du feu, de la dcapitation et de
l'tranglement 6. La mutilation, si largement pratique par les autres peuples
d'Orient, ne figure qu'une seule fois dans le Pentateuque 7. Le talion, il est
vrai, quand le crime tait une blessure, pouvait entraner des mutilations ;
mais le coupable pouvait toujours y chapper au moyen d'une composition
1
2
3
4
5
6
7
Ibid., p. 69.
Chap. I, pp. 60 et 65.
THONISSEN, I, p. 160.
VIII, p. 281.
BENZINGER, Hebraeische Archaeologie, pp. 202-203, p. 71 et 41.
V. BENZINGER, Op. cit., p. 333 ; THONISSEN, Op. cit., II, p. 28.
Deut., XXV, 11-12.
mile Durkheim (1899-1900), Deux lois de l'volution pnale
10
pcuniaire ; celle-ci n'tait interdite que pour le meurtre 1. Quant aux autres
peines corporelles, qui se rduisent la flagellation, elles taient certainement
appliques un grand nombre de dlits 2 ; mais le maximum en tait fix 40
coups et mme, dans la pratique, ce nombre se ramenait 39 3. - D'o vient
cette douceur relative ? C'est que, chez le peuple hbreu, le gouvernement
absolu n'a jamais pu s'tablir d'une manire durable. Nous avons vu que,
pendant longtemps, il y manqua mme toute organisation politique. Plus tard,
il est vrai, une monarchie se constitua ; mais le pouvoir des rois resta trs
limit : Le sentiment a toujours t trs vivant en Isral que le roi tait l
pour son peuple et non le peuple pour son roi ; il devait aider Isral, non s'en
servir dans son intrt propre 4. Quoiqu'il soit arriv parfois certaines
personnalits de conqurir, par leur prestige personnel, une autorit exceptionnelle, l'esprit du peuple resta profondment dmocratique.
Cependant, on a pu voir que la loi pnale ne laissait pas d'y tre encore
trs dure. Si, des socits qui prcdent, nous passons au type de la cit qui est
incontestablement suprieur, nous constatons une rgression plus accuse de
la pnalit. A Athnes, quoique, dans certains cas, la peine capitale ft renforce, c'tait, cependant, la grande exception 5. Elle consistait, en principe, dans
la mort par la cigu, le glaive, l'tranglement. Les mutilations expressives ont
disparu. Il semble bien en tre de mme des chtiments corporels, sauf pour
les esclaves et, peut-tre, pour les personnes de basse condition 6. Mais
Athnes, mme considre son apoge, reprsente une forme relativement
archaque de la cit. Jamais, en effet, l'organisation base de clans (gen,
phratries) n'y fut aussi compltement efface qu' Rome o, trs tt, curies et
gentes devinrent de simples souvenirs historiques, dont les Romains euxmmes ne connaissaient plus trs bien la signification. Aussi le systme des
peines tait-il beaucoup plus svre Athnes qu' Rome. D'abord, le droit
athnien, ainsi que nous le disions, n'ignorait pas compltement la mort
exaspre. Dmosthne fait allusion des coupables clous au gibet 7 ; Lysias
cite les noms d'assassins, de brigands et d'espions morts sous le bton 8 ;
Antiphon parle d'une empoisonneuse expirant sous la roue 9. Quelquefois la
mort tait prcde de la torture 10. De plus, le nombre des cas o la peine de
mort tait prononce tait considrable : La trahison, la lsion du peuple
athnien, l'attentat contre les institutions politiques, l'altration du droit national, les mensonges profrs la tribune de l'assemble du peuple, l'abus des
fonctions diplomatiques..., la concussion, l'impit, le sacrilge, etc., etc.,
rclamaient incessamment l'intervention du terrible ministre des Onze 11. A
Rome, au contraire, les crimes capitaux taient beaucoup moins nombreux et
les lois Porciennes restreignirent l'application du dernier supplice pendant
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nombres, XXXV, 31.
C'est ce qui est expliqu dans un passage du Deut., XXV, 1-2.
Josphe, Ant., IV, pp. 238, 248.
BENZINGER, op. cit., p. 312.
V. HERMANN, Griech. Antiq., II (1) Abtheil., pp. 124-125.
HERMANN, Op. cit., pp. 126-127.
C. Midias, 105, Cf. PLATON, Rp., II, 362.
C. Agoratos, 56, 67, 68 et DMOSTHNE, Discours sur l'Ambassade, 137.
Accusation d'empoisonnement, p. 20.
C. Agoratos, 54 et PLUTARQUE, Phocion, XXXIV.
THONISSEN, Op. cit., p. 100.
mile Durkheim (1899-1900), Deux lois de l'volution pnale
11
toute la dure de la Rpublique 1. De plus, sauf des circonstances tout fait
exceptionnelles, la mort n'tait entoure d'aucune torture accessoire, d'aucune
aggravation. La croix tait rserve aux seuls esclaves. D'ailleurs, les Romains
se vantaient de la douceur relative de leur systme rpressif : Nulli gentium
mitiores placuisse pocuas, dit Tite-Live 2, et Cicron : Vestram libertatem,
non acerbitate suppliciorum infestam, sed lenitate legum munitam esse
voluerunt 3.
Mais quand, avec l'Empire, le pouvoir gouvernemental tendit devenir
absolu, la loi pnale s'aggrava. D'abord, les crimes capitaux se multiplirent.
L'adultre, l'inceste, toute sorte d'attentats contre les murs, mais surtout la
multitude toujours croissante des crimes de lse-majest furent punis de mort.
En mme temps, des peines plus svres furent institues. Le bcher, qui tait
rserv des crimes politiques exceptionnels, fut employ contre les incendiaires, les sacrilges, les magiciens, les parricides et certains auteurs de
crimes de lse-majest ; la condamnation ad opus publicum fut tablie, des
mutilations appliques certains criminels (par exemple, la castration dans
certains attentats contre les murs, la main coupe pour les faux-monnayeurs,
etc.). Enfin, la torture fit son apparition ; c'est la priode de l'Empire que le
Moyen Age l'emprunta plus tard.
Si, de la cit, nous passons aux socits chrtiennes, nous voyons la pnalit voluer selon la mme loi.
Ce serait une erreur de juger de la loi pnale, sous le rgime fodal, d'aprs
la rputation d'atrocit qu'on a faite au Moyen Age. Quand on examine les
faits, on constate qu'elle tait alors beaucoup plus douce que dans les types
sociaux antrieurs, si du moins on les considre la phase correspondante de
leur volution, c'est--dire leur priode de formation et, pour ainsi dire, de
premire jeunesse ; et c'est cette condition seulement que la comparaison
peut avoir une valeur dmonstrative. Les crimes capitaux n'taient pas trs
nombreux. Selon Beaumanoir, les seuls faits vraiment inexpiables sont le
meurtre, la trahison, l'homicide, le viol 4. Les tablissements de saint Louis y
ajoutent le rapt, l'incendie 5. C'taient les principaux cas de haute justice.
Toutefois, quoique le brigandage ne ft pas ainsi qualifi, il tait, lui aussi, un
crime capital. Il en tait de mme de deux dlits, qui taient considrs comme particulirement attentatoires aux droits du seigneur ; ce sont les mfaits
de marchs et les dlits de chemin bris (renversement, avec violence, des
bureaux de page) 6. Quant aux crimes religieux, les seuls qui fussent alors
rprims par le dernier supplice taient l'hrsie et la mcrantise. Les sacrilges ne devaient qu'une amende, ainsi que les blasphmateurs; mme, saint
Louis ayant dcid, dans la premire ardeur religieuse de sa jeunesse, que ces
derniers seraient marqus au front et auraient la langue perce, le pape
1
2
3
4
5
6
WALTER, Histoire de la procdure civile et du droit criminel chez les Romains, tr. fr.,
821, et REIN, Criminalrecht der Roemer, p. 55.
TITE-LIVE, I, p. 28.
Pro Rabirio perduellionis reo, p. 3.
Coutume du Beauvoisis, chap. XXX, n 2.
tab. de saint Louis, liv. I, chap. IV et XI.
V. Du Boys, Histoire du Droit criminel des peuples modernes, t. II, p. 231.
mile Durkheim (1899-1900), Deux lois de l'volution pnale
12
Clment IV le blma. Ce n'est que plus tard que l'glise dploya contre ses
ennemis une implacable svrit. Quant aux peines elles-mmes, elles
n'avaient rien d'outr. Les seules aggravations de la peine de mort consistaient
tre tran sur la claie et tre brl vif. Les mutilations taient rares. On
sait, d'ailleurs, combien le systme rpressif de l'glise tait humain. Les
peines qu'elle employait de prfrence consistaient en pnitences et en
mortifications. Elle repoussait la mortification publique, le carcan, le pilori,
quoique de pareilles peines ne lui parussent pas excder sa comptence. Il est
vrai que, quand elle jugeait ncessaire une rpression sanglante, elle livrait le
coupable la justice sculire. Nanmoins, c'tait un fait de la plus grande
porte que la plus haute puissance morale du temps tmoignt ainsi de son
horreur pour ces sortes de chtiments 1.
Telle fut peu prs la situation jusque vers le XIVe sicle. A partir de ce
moment, le pouvoir royal s'tablit de plus en plus solidement. A mesure qu'il
se consolide, on voit la pnalit se renforcer. D'abord les crimes de lsemajest, qui taient inconnus de la fodalit, font leur apparition, et la liste en
est longue. Les crimes religieux eux-mmes sont qualifis ainsi. Il en rsulte
que le sacrilge devient un crime capital. Il en est de mme du simple
commerce avec les infidles, de toute tentative pour faire croire et arguer de
toutes choses qui sont ou seraient contraires la sainte foi de Notre-Seigneur . En mme temps, une plus grande rigueur se manifeste dans
l'application des peines. Les coupables de crimes capitaux peuvent tre rous
(c'est alors qu'apparat le supplice de la roue), enfouis vifs, cartels, corchs
tout vivants, bouillis. Dans certains cas, les enfants du condamn partagent
son supplice 2.
L'apoge de la monarchie absolue marque l'apoge de la rpression. Au
XVIIe sicle, les peines capitales en usage taient encore celles que nous
venons d'numrer. De plus, une peine nouvelle, celle des galres, s'tait
constitue, peine tellement terrible que les malheureux condamns, pour y
chapper, se coupaient quelquefois un bras ou une main. Le fait tait mme
tellement frquent qu'il fut puni de mort par une dclaration de 1677. Quant
aux peines corporelles, elles taient innombrables : il y avait l'arrachement ou
le percement de la langue, l'abscission des lvres, l'essorillement ou arrachement des oreilles, la marque au fer chaud, la fustigation qui se donnait avec le
bton, le fouet, le carcan, etc. Enfin, il ne faut pas oublier que la torture tait
souvent employe, non pas seulement comme un moyen de procdure, mais
comme une pnalit. En mme temps, les crimes capitaux se multipliaient
parce que les crimes de lse-majest taient devenus plus nombreux 3.
2
3
Cette douceur relative de la pnalit s'tait encore beaucoup plus accentue dans les
parties de la socit gouvernes dmocratiquement, savoir dans les communes libres.
Dans les villes libres, dit du Boys (II, p. 370), comme dans les communes proprement
dites, on trouve une tendance changer les pnalits en amendes et employer la honte
plutt que les supplices ou les peines coercitives comme moyen de rpression. Ainsi,
Mont-Chabrier, celui qui volait deux sols tait oblig de porter ces deux sols suspendus
son cou et de courir ainsi tout le jour et toute la nuit et, de plus, il lui tait inflig une
amende de cinq sols. KOHLER a fait la mme remarque en ce qui concerne les cits
italiennes (Dos Strafrecht der italienischen Statuten vom 12-16. Jahrhundert).
V. Du Boys, op. cit., V, pp. 234, 237 et suiv.
Du Boys, op. cit., VI, pp. 62-81.
mile Durkheim (1899-1900), Deux lois de l'volution pnale
13
Telle tait la loi pnale jusqu'au milieu du XVIIIe sicle. C'est alors qu'eut
lieu, dans toute l'Europe, la protestation laquelle Beccaria a attach son
nom. Sans doute, il s'en faut que le criminaliste italien ait t la cause initiale
de la raction qui devait se poursuivre depuis sans interruption. Le mouvement tait commenc avant lui. De nombreux ouvrages, aujourd'hui oublis,
avaient dj paru qui rclamaient une rforme du systme pnal. Il est
cependant incontestable que c'est le Trait des dlits et des peines qui porta le
coup mortel aux vieilles et odieuses routines du droit criminel.
Une ordonnance de 1788 avait dj introduit quelques rformes, non sans
importance ; mais ce fut surtout avec le Code pnal de 1810 que les aspirations nouvelles reurent enfin une large satisfaction. Aussi, quand il parut, futil accueilli avec une admiration sans rserve, non pas seulement en France,
mais dans les principaux pays d'Europe. Il ralisait, en effet, d'importants
progrs dans le sens de l'adoucissement. Cependant, en ralit, il tenait encore
beaucoup trop au pass. Aussi de nouvelles amliorations ne tardrent-elles
pas tre rclames. On se plaignait de ce que la peine de mort, si elle ne
pouvait plus tre aggrave comme sous l'ancien rgime, y tait encore trs
prodigue. On regardait comme inhumain d'y avoir conserv la marque, le
carcan, la mutilation du poing pour les parricides. C'est pour rpondre ces
critiques qu'eut lieu la rvision de 1832. Celle-ci introduisit dans notre
organisation pnale une douceur beaucoup plus grande en supprimant toutes
les mutilations, en diminuant le nombre des crimes capitaux, en donnant enfin
aux juges le moyen d'adoucir toutes les peines, grce au systme des circonstances attnuantes. Il n'est pas ncessaire de montrer que, depuis, le mouvement s'est continu dans la mme direction, puisque aujourd'hui on commence
se plaindre du rgime trop confortable qui est fait aux criminels.
II
Loi des variations qualitatives
Retour la table des matires
La loi que nous venons d'tablir se rapporte exclusivement la grandeur
ou quantit des peines. Celle dont nous allons nous occuper maintenant est
relative leurs modalits qualitatives. Elle peut se formuler ainsi : Les peines
privatives de la libert et de la libert seule, pour des priodes de temps
variables selon la gravit des crimes, tendent de plus en plus devenir le type
normal de la rpression.
mile Durkheim (1899-1900), Deux lois de l'volution pnale
14
Les socits infrieures les ignorent presque compltement. Mme dans
les lois de Manou, il y a tout au plus un verset o il semble tre question de
prisons. Que le roi, y est-il dit, place toutes les prisons sur la voie publique,
afin que les criminels, affligs et hideux, soient exposs aux regards de
tous 1. Encore une telle prison a-t-elle un tout autre caractre que les ntres ;
elle est plutt analogue au pilori. Le condamn est retenu prisonnier pour
pouvoir tre expos et aussi parce que la dtention est la condition ncessaire
des supplices qu'on lui impose ; mais elle ne constitue pas la peine elle-mme.
Celle-ci consistait surtout dans la dure existence qu'on faisait aux dtenus. Le
silence de la loi mosaque est plus complet encore. Dans le Pentateuque, il
n'est pas une seule fois question de prison. Plus tard, dans les Chroniques,
dans le livre de Jrmie, on rencontre bien des passages o il est parl de prison, d'entraves, de fosses humides 2 ; mais, dans tous ses cas, il s'agit
d'arrestation prventive, de lieux de dtention o l'on enfermait les accuss,
les sujets suspects, en attendant qu'un jugement ft rendu, et o ils taient
soumis un rgime plus ou moins svre, suivant les circonstances. Ces
mesures administratives, arbitraires ou non, ne constituaient pas des peines
dfinies attaches des crimes dfinis. C'est seulement dans le livre d'Esdras
que, pour la premire fois, l'emprisonnement est prsent comme une pnalit
proprement dite 3. Dans le vieux droit des Slaves et des Germains, les peines
simplement privatives de la libert paraissent avoir t galement ignores. Il
en tait de mme dans les vieux cantons suisses, jusqu'au XIXe sicle 4.
Dans la cit, elles commencent faire leur apparition. Contrairement ce
que dit Schmann, il parat certain qu' Athnes, dans certains cas, l'emprisonnement tait inflig titre de peine spciale. Dmosthne dit formellement
que les tribunaux ont le pouvoir de punir de la prison ou de toute autre peine 5.
Socrate parle de la dtention perptuelle comme d'une peine qui peut lui tre
applique 6. Platon, esquissant dans les Lois le plan de la cit idale, propose
de rprimer par l'emprisonnement un assez grand nombre d'infractions et on
sait que son utopie est plus voisine de la ralit historique qu'on ne l'a parfois
suppos 7. Cependant, tout le monde reconnat que, Athnes, ce genre de
peine est rest peu dvelopp. Le plus souvent, dans les discours des orateurs,
la prison est prsente comme un moyen d'empcher la fuite des accuss ou
comme un procd commode pour contraindre certains dbiteurs payer leurs
dettes, ou bien encore comme supplment de peine, prostimma. Quand les
juges se bornaient infliger une amende, ils avaient le droit d'y ajouter une
dtention de cinq jours, avec entraves aux pieds dans la prison publique 8. A
Rome, la situation n'tait pas trs diffrente. La prison, dit Rein, n'tait
originairement qu'un lieu de dtention prventive. Plus tard elle devint une
1
2
3
4
5
6
7
8
IX, p. 288.
II. Chron., XVI, 10, et XVIII, 26. Jerem., XXVII, 15 et 16.
Pour tous ceux qui n'observeront pas la loi de ton dieu et la loi du roi, qu'incontinent il
en soit fait justice, et qu'on les condamne soit la mort, soit au bannissement..., soit
l'emprisonnement (Esdras, VII, 26).
POST, Bausteine f. eine allgemeine Rechtsw., I, p. 219.
Discours contre Timocrate, 151.
Apologie, p. 37, c.
Lois, VIII, p. 847; IX, pp. 864, 880.
HERMANN, Griech. Antiq., Rechtsalterthuemer, p. 126.
mile Durkheim (1899-1900), Deux lois de l'volution pnale
15
peine. Cependant, elle tait rarement applique, sauf aux esclaves, aux
soldats, aux acteurs 1.
C'est seulement dans les socits chrtiennes qu'elle a pris tout son dveloppement. L'glise, en effet, prit trs tt l'habitude d'ordonner contre certains
criminels la dtention temporaire ou vie dans un monastre. D'abord, elle ne
fut considre que comme un moyen de surveillance, mais il y eut ensuite
l'incarcration ou emprisonnement proprement dit qui fut trait comme une
peine vritable. Le maximum en tait la dtention perptuelle et solitaire dans
une cellule que l'on murait, comme signe de l'irrvocabilit de la sentence 2.
C'est de l que la pratique passa dans le droit laque. Cependant, comme
l'emprisonnement tait employ en mme temps comme mesure administrative, la signification pnale en resta longtemps assez douteuse. C'est seulement au XVIIIe sicle que les criminalistes finirent par s'entendre pour
reconnatre la prison le caractre d'une peine dans certains cas dfinis, quand
elle tait perptuelle, quand elle avait t substitue, par commutation, la
peine de mort, etc., en un mot, toutes les fois qu'elle avait t prcde d'une
instruction judiciaire 3. Avec le droit pnal de 1791, elle devint la base du
systme rpressif, qui, en dehors de la peine de mort et du carcan, ne comprit
plus que des formes diverses de la dtention. Nanmoins, le simple emprisonnement n'tait pas considr comme une peine suffisante ; mais on y ajoutait
des privations d'un autre ordre (ceinture ou chane que portaient les condamns, privations alimentaires). Le Code pnal de 1810 laissa de ct ces
aggravations, sauf pour les travaux forcs. Les deux autres peines privatives
de la libert ne diffraient gure que par la dure du temps pendant lequel le
condamn tait enferm. Depuis, les travaux forcs ont perdu une grande
partie de leurs traits caractristiques et tendent devenir une simple varit de
la dtention. En mme temps, la peine de mort est devenue d'une application
de plus en plus rare ; elle a mme disparu compltement de certains codes, de
telle sorte que la suppression de la libert temps ou vie se trouve occuper
peu prs compltement tout le domaine de la pnalit.
1
2
3
Criminalrecht der Roemer, p. 914.
Du Boys, op. cit., V, pp. 88-89.
Du Boys, VI, op. cit., p. 60.
mile Durkheim (1899-1900), Deux lois de l'volution pnale
16
III
Explication de la seconde loi
Retour la table des matires
Aprs avoir dtermin la manire dont la peine a vari dans le temps, nous
allons rechercher les causes des variations constates, c'est--dire essayer
d'expliquer les deux lois prcdemment tablies. C'est par la seconde que nous
commencerons.
D'aprs ce que nous venons de voir, la dtention n'apparat d'abord dans
l'histoire que comme une mesure simplement prventive pour prendre ensuite un caractre rpressif et devenir enfin le type mme de la pnalit. Pour
rendre compte de cette volution, il nous faut donc chercher successivement
ce qui a donn naissance la prison sous sa premire forme puis, ce qui a
dtermin ses transformations ultrieures.
Que la prison prventive soit absente des socits peu dveloppes, c'est
ce qu'il est ais de comprendre : elle n'y rpond aucun besoin. La responsabilit, en effet, y est collective ; lorsqu'un crime y est commis, ce n'est pas
seulement le coupable qui doit la peine ou la rparation, mais c'est, soit avec
lui, soit sa place s'il fait dfaut, le clan dont il fait partie. Plus tard, quand le
clan a perdu son caractre familial, c'est un cercle, toujours assez tendu, de
parents. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison d'arrter et de tenir en
surveillance l'auteur prsum de l'acte ; car s'il manque, pour une raison ou
pour une autre, il laisse des rpondants. D'ailleurs, l'indpendance morale et
juridique, qui est alors reconnue chaque groupe familial s'oppose ce qu'on
puisse lui demander de livrer ainsi un de ses membres sur un simple soupon.
Mais mesure que, la socit se concentrant, ces groupes lmentaires perdent leur autonomie et viennent se fondre dans la masse totale, la responsabilit devient individuelle ; ds lors, des mesures sont ncessaires pour
empcher que la rpression ne soit lude par la fuite de celui qu'elle doit
atteindre et, comme en mme temps elles choquent moins la moralit tablie,
la prison apparat. C'est ainsi que nous la trouvons Athnes, Rome, chez
les Hbreux aprs l'exil. Mais elle est si bien contraire toute la vieille organisation sociale, qu'elle se heurte au dbut des rsistances qui en restreignent
troitement l'usage, partout du moins o le pouvoir de l'tat est soumis
quelque limitation. C'est ainsi qu' Athnes la dtention prventive n'tait
mile Durkheim (1899-1900), Deux lois de l'volution pnale
17
autorise que dans des cas particulirement graves 1. Mme le meurtrier pouvait rester en libert jusqu'au jour de la condamnation. A Rome, le prvenu
ne fut d'abord retenu prisonnier qu'en cas de dlit flagrant et manifeste, ou
lorsqu'il y avait aveu ; ordinairement, une caution suffisait 2.
Il faudrait se garder d'expliquer ces restrictions apparentes au droit
d'arrestation prventive par un sentiment de la dignit personnelle et une sorte
d'individualisme prcoce que ne connut gure la morale de la Cit. Ce qui
vient ainsi limiter le droit de l'tat, ce n'est pas le droit de l'individu, mais
celui du clan ou de la famille, ou, du moins, ce qui en reste. Ce n'est pas une
anticipation de notre morale moderne, mais une survivance du pass.
Cependant, cette explication est incomplte. Pour rendre compte d'une
institution, il ne suffit pas d'tablir qu'au moment o elle parut elle rpondait
quelque fin utile ; car de ce qu'elle tait dsirable, il ne suit pas qu'elle tait
possible. Il faut voir, en outre, comment se sont constitues les conditions
ncessaires la ralisation de cette fin. Un besoin, mme intense, ne peut pas
crer ex nihilo les moyens de se satisfaire ; il y a donc lieu de chercher d'o ils
lui sont venus. Sans doute, au premier abord, il parat tout simple que, du jour
o la prison se trouva tre utile aux socits, les hommes aient eu l'ide de la
construire. Cependant, en ralit, elle supposait ralises certaines conditions
sans lesquelles elle tait impossible. Elle impliquait, en effet, l'existence
d'tablissements publics, suffisamment spacieux, militairement occups, amnags de manire prvenir les communications avec le dehors, etc. De tels
arrangements ne s'improvisent pas en un instant ; or il n'en existe pas de traces
dans les socits infrieures. La vie publique, trs pauvre, trs intermittente,
n'a besoin alors d'aucun amnagement spcial pour se dvelopper, sauf d'un
emplacement pour les runions populaires. Les maisons sont construites en
vue de fins exclusivement prives ; celles des chefs, l o il y en a de permanents, se distinguent peine des autres ; les temples eux-mmes sont d'origine
relativement tardive ; enfin les remparts n'existent pas, ils apparaissent
seulement avec la Cit. Dans ces conditions, l'ide d'une prison ne pouvait pas
natre.
Mais mesure que l'horizon social s'tend, que la vie collective, au lieu de
se disperser en une multitude de petits foyers, o elle ne peut tre que
mdiocre, se concentre sur un nombre plus restreint de points, elle devient la
fois plus intense et plus continue. Parce qu'elle prend plus d'importance, les
demeures de ceux qui y sont prposs se transforment en consquence. Elles
s'tendent, s'organisent en vue des fonctions plus tendues et plus permanentes qui leur incombent. Plus l'autorit de ceux qui y habitent grandit, plus
elles se singularisent et se distinguent du reste des habitations. Elles prennent
grand air, elles s'abritent derrire des murs plus levs, des fosss plus
profonds, de manire marquer visiblement la ligne de dmarcation qui
spare dsormais les dtenteurs du pouvoir et la foule de leurs subordonns.
Alors les conditions de la prison sont donnes. Ce qui fait supposer qu'elle a
d prendre ainsi naissance, c'est que, l'origine, on la voit souvent apparatre
l'ombre du palais des rois, dans les dpendances des temples et des tablissements similaires. Ainsi, Jrusalem, nous connaissons trois prisons
1
2
V. article Carcer , dans le Dictionnaire de SAGLIO.
WALTER, Op. cit., 856.
mile Durkheim (1899-1900), Deux lois de l'volution pnale
18
l'poque de l'invasion des Chaldens : l'une tait la haute porte de
Benjamin 1 , et l'on sait que les portes taient des lieux fortifis ; l'autre, dans
la cour du palais du roi 2 ; la troisime, dans la maison d'un fonctionnaire
royal 3. A Rome, c'est dans la forteresse royale que se trouvaient les plus
anciennes prisons 4. Au Moyen Age, c'est dans le chteau seigneurial, dans les
tours des remparts qui entouraient les villes 5.
Ainsi, au moment mme o l'tablissement d'un lieu de dtention devenait
utile par suite de la disparition progressive de la responsabilit collective, des
monuments s'levaient qui pouvaient tre utiliss pour cet office. La prison, il
est vrai, n'tait encore que prventive. Mais une fois qu'elle fut constitue ce
titre, elle prit vite un caractre rpressif, au moins partiellement. En effet, tous
ceux qui taient ainsi retenus prisonniers taient des suspects ; ils taient
mme le plus souvent suspects de crimes graves. Aussi taient-ils soumis
un rgime svre qui tait dj presque une peine. Tout ce que nous savons de
ces prisons primitives, qui pourtant ne constituent pas encore des institutions
proprement pnitentiaires, nous les dpeint sous les plus tristes couleurs. Au
Dahomey, la prison est un trou, en forme de puits, o les condamns croupissent dans les immondices et la vermine 6. En Jude, nous avons vu qu'elle
consistait en basses fosses. Dans l'ancien Mexique, elle tait faite de cages en
bois o les prisonniers taient attachs ; ils taient peine nourris 7. A
Athnes, les dtenus taient soumis au supplice infamant des entraves 8. En
Suisse, pour rendre l'vasion plus difficile, on mettait aux prisonniers un
collier de fer 9. Au Japon, les prisons sont appeles des enfers 10. Il est naturel
que le sjour dans de pareils endroits ait t trs tt considr comme un
chtiment. On rprimait ainsi les petits dlits, surtout ceux qui avaient t
commis par les petites gens, les personae humiles, comme on disait Rome.
C'tait une peine correctionnelle dont les juges disposaient plus ou moins
arbitrairement.
Quant la fortune juridique de cette peine nouvelle partir du moment o
elle fut constitue, il suffit, pour en rendre compte, de combiner les considrations qui prcdent avec la loi relative l'affaiblissement progressif de la
pnalit. En effet, cet affaiblissement a lieu du haut en bas de l'chelle pnale.
En gnral, ce sont les peines les plus graves qui sont les premires atteintes
par ce mouvement de recul, c'est--dire qui sont les premires s'adoucir, puis
disparatre. Ce sont les aggravations de la peine capitale qui commencent
par s'attnuer, jusqu'au jour o elles sont compltement supprimes ; ce sont
les cas d'application de la peine capitale qui vont en se restreignant ; les
mutilations subissent la mme loi. Il en rsulte que les peines les plus basses
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jrmie, XX, 2.
Ibid., XXXII, 2.
Ibid., XXXVII, 15.
V. art. Carcer , dj cit.
V. SCHAFFROTH, Geschichte d. Bernischen Gefaengnisswesens. STROOBANT, Notes
sur le systme pnal des villes flamandes.
Abb LAFFITTE, Le Dahom, Tours, 1873, p. 81.
BANCROFT, The Native Races of the Pacific States..., 11, p. 453.
V. THONISSEN, Op. cit., p. 118.
SCHAFFROTH, Geschichte des Bernischen Gefaengnisswesens.
V. LETOURNEAU, volution juridique, p. 199.
mile Durkheim (1899-1900), Deux lois de l'volution pnale
19
sont ncessites se dvelopper pour remplir les vides que produit cette
rgression. A mesure que les formes archaques de la rpression se retirent du
champ de la pnalit, les formes nouvelles envahissent les espaces libres
qu'elles trouvent ainsi devant elles. Or les modalits diverses de la dtention
constituent les peines les dernires venues ; l'origine, elles sont tout en bas
de l'chelle pnale, puisqu'elles commencent mme par n'tre pas des peines
proprement dites, mais seulement la condition de la rpression vritable, et
que, pendant longtemps, elles gardent un caractre mixte et indcis. Pour cette
raison mme, c'tait elles qu'tait rserv l'avenir. Elles taient les substituts
naturels et ncessaires des autres peines qui s'en allaient. Mais, d'un autre
ct, elles devaient elles-mmes subir la mme loi d'adoucissement. C'est
pourquoi, tandis que, au dbut, elles sont mles des rigueurs auxiliaires
dont, parfois mme, elles ne sont que l'accessoire, elles s'en dbarrassent peu
peu, pour se rduire leur forme la plus simple, savoir la privation de la
libert, ne comportant d'autres degrs que ceux qui rsultent de l'ingale dure
de cette privation.
Ainsi les variations qualitatives de la peine dpendent en partie des variations quantitatives qu'elle a paralllement subies. Autrement dit, des deux lois
que nous avons tablies, la premire contribue expliquer la seconde. Le
moment est donc venu de l'expliquer son tour.
IV
Explication de la premire loi
Retour la table des matires
Pour faciliter cette explication, nous considrerons isolment les deux
facteurs que nous avons distingus ; et comme le second est celui qui joue le
rle le moins important, nous commencerons par en faire abstraction. Cherchons donc comment il se fait que les peines s'adoucissent mesure qu'on
passe de socits infrieures des socits plus leves, sans nous occuper
provisoirement des perturbations qui peuvent tre dues au caractre plus ou
moins absolu du pouvoir gouvernemental.
On pourrait tre tent d'expliquer cet adoucissement par l'adoucissement
parallle des murs. Nous avons de plus en plus horreur de la violence ; les
peines violentes, c'est--dire cruelles doivent donc nous inspirer une rpugnance croissante. Malheureusement, l'explication se tourne contre ellemme. Car si, d'un ct, notre plus grande humanit nous dtourne des chtiments douloureux, elle doit aussi nous faire paratre plus odieux les actes
inhumains que ces chtiments rpriment. Si notre altruisme plus dvelopp
mile Durkheim (1899-1900), Deux lois de l'volution pnale
20
rpugne l'ide de faire souffrir autrui, pour la mme raison, les crimes qui
sont contraires ces sentiments doivent nous sembler plus abominables et, par
suite, il est invitable que nous tendions les rprimer plus svrement.
Mme cette tendance ne peut tre neutralise que partiellement et faiblement
par la tendance oppose, quoique de mme origine, qui nous porte faire
souffrir le coupable le moins possible. Car il est vident que notre sympathie
doit tre moindre pour ce dernier que pour sa victime. Ds lors, la dlicatesse
des murs devrait plutt se traduire par une aggravation pnale, au moins
pour tous les crimes qui nuisent autrui. En fait, quand elle commence
apparatre d'une manire marque dans l'histoire, c'est bien ainsi qu'elle se
manifeste. Dans les socits infrieures, les meurtres, les vols simples ne sont
rprims que faiblement, parce que les murs y sont grossires. A Rome,
pendant longtemps, la violence ne fut pas regarde comme de nature vicier
les contrats, bien loin d'avoir un caractre pnal. C'est du jour o les sentiments sympathiques de l'homme pour l'homme se sont affirms et dvelopps
que ces crimes ont t punis plus svrement. Le mouvement et donc d
continuer, si quelque autre cause n'tait intervenue.
Puisque la peine rsulte du crime et exprime la manire dont il affecte la
conscience publique, c'est dans l'volution du crime qu'il faut aller chercher la
cause qui a dtermin l'volution de la pnalit.
Sans qu'il soit ncessaire d'entrer dans le dtail des preuves qui justifient
cette distinction, on nous accordera, pensons-nous, sans peine que tous les
actes rputs criminels par les diffrentes socits connues peuvent tre
rpartis en deux catgories fondamentales : les uns sont dirigs contre des
choses collectives (idales ou matrielles, il n'importe) dont les principales
sont l'autorit publique et ses reprsentants, les murs et les traditions, la
religion ; les autres n'offensent que des individus (meurtres, vols, violences et
fraudes de toutes sortes). Des deux formes de la criminalit sont assez
distinctes pour qu'il y ait lieu de les dsigner par des mots diffrents. La
premire pourrait tre appele criminalit religieuse parce que les attentats
contre la religion en sont la partie la plus essentielle et que les crimes contre
les traditions ou les chefs de l'tat ont toujours, plus ou moins, un caractre
religieux; la seconde, on pourrait rserver le nom de criminalit humaine.
Cela pos, on sait que les crimes de la premire espce remplissent, presque
l'exclusion de tous les autres, le droit pnal des socits infrieures ; mais
qu'ils rgressent, au contraire, mesure qu'on avance dans l'volution, tandis
que les attentats contre la personne humaine prennent de plus en plus toute la
place. Pour les peuples primitifs, le crime consiste presque uniquement ne
pas accomplir les pratiques du culte, violer les interdictions rituelles,
s'carter des murs des anctres, dsobir l'autorit, l o elle est assez
fortement constitue. Au contraire, pour l'Europen d'aujourd'hui, le crime
consiste essentiellement dans la lsion de quelque intrt humain.
Or, ces deux sortes de criminalit diffrent profondment parce que les
sentiments collectifs qu'elles offensent ne sont pas de mme nature. Il en
rsulte que la rpression ne peut pas tre la mme pour l'une et pour l'autre.
Les sentiments collectifs que contredit et froisse la criminalit spcifique
des socits infrieures sont collectifs, en quelque sorte, un double titre. Non
seulement, ils ont pour sujet la collectivit et, par consquent, se retrouvent
mile Durkheim (1899-1900), Deux lois de l'volution pnale
21
dans la gnralit des consciences particulires, mais encore ils ont pour objet
des choses collectives. Par dfinition, ces choses sont en dehors du cercle de
nos intrts privs. Les fins auxquelles nous sommes ainsi attachs dpassent
infiniment le petit horizon de chacun de nous. Ce n'est pas nous personnellement qu'elles concernent, mais l'tre collectif. Par suite, les actes qui nous
sont commands pour les atteindre ne sont pas selon la pente de notre nature
individuelle, mais lui font plutt violence puisqu'ils consistent en des sacrifices et des privations de toutes sortes que l'homme est tenu de s'imposer soit
pour complaire son dieu, soit pour satisfaire la coutume, soit pour obir
l'autorit. Nous n'avons aucun penchant jener, nous mortifier, nous
interdire telle ou telle viande, immoler sur l'autel nos animaux prfrs,
nous gner par respect pour l'usage, etc. Par consquent, de mme que les
sensations qui nous viennent du monde extrieur, de tels sentiments sont en
nous sans nous, mme, dans une certaine mesure, malgr nous, et ils nous
apparaissent comme tels par suite de la contrainte qu'ils exercent sur nous.
Nous sommes donc ncessits les aliner, les rapporter quelque force
externe comme leur cause, ainsi que nous faisons pour nos sensations. En
outre, cette force, nous sommes obligs de la concevoir comme une puissance, non seulement trangre, mais encore suprieure nous puisqu'elle
ordonne et que nous lui obissons. Cette voix qui parle en nous sur un ton
tellement impratif, qui nous enjoint de faire violence notre nature, ne peut
maner que d'un tre diffrent de nous, et qui, de plus, nous domine. Sous
quelque forme spciale que les hommes se le soient figur (dieu, anctres,
personnalits augustes de toute sorte), il a donc toujours par rapport eux
quelque chose de transcendant, de surhumain. Voil pourquoi cette partie de
la morale est tout imprgne de religiosit. C'est que les devoirs qu'elle nous
prescrit nous obligent envers une personnalit qui dpasse infiniment la
ntre ; c'est la personnalit collective, que nous nous la reprsentions dans sa
puret abstraite, ou, comme il arrive le plus souvent, l'aide de symboles
proprement religieux.
Mais alors, les crimes qui violent ces sentiments et qui consistent en des
manquements ces devoirs spciaux, ne peuvent pas ne pas nous apparatre
comme dirigs contre ces tres transcendants, puisqu'en ralit ils les
atteignent. Il en rsulte qu'ils nous paraissent exceptionnellement odieux ; car
une offense est d'autant plus rvoltante que l'offens est plus lev en nature
et en dignit au-dessus de l'offenseur. Plus on est tenu au respect, plus le
manque de respect est abominable. Le mme acte qui, quand il vise un gal
est simplement blmable, devient impie quand il attente quelqu'un qui nous
est suprieur ; l'horreur qu'il dtermine ne peut donc tre calme que par une
rpression violente. Normalement, dans le seul but de plaire ses dieux,
d'entretenir avec eux des relations rgulires, le fidle doit se soumettre
mille privations. A quelles privations ne doit-il pas tre astreint, quand il les a
outrags ? Alors mme que la piti qu'inspire le coupable serait assez vive,
elle ne saurait servir de contrepoids efficace l'indignation souleve par l'acte
sacrilge, ni, par consquent, modrer sensiblement la peine ; car les deux
sentiments sont trop ingaux. La sympathie que les hommes prouvent pour
un de leurs semblables, surtout dgrad par une faute, ne peut contenir les
effets de la crainte rvrentielle que l'on ressent pour la divinit. Au regard de
cette puissance qui le dpasse de si haut, l'individu apparat si petit que ses
souffrances perdent de leur valeur relative et deviennent une quantit ngli-
mile Durkheim (1899-1900), Deux lois de l'volution pnale
22
geable. Qu'est-ce qu'une douleur individuelle quand il s'agit d'apaiser un
dieu ?
Il en est autrement des sentiments collectifs qui ont pour objet l'individu ;
car chacun de nous en est un. Ce qui concerne l'homme nous concerne tous ;
car nous sommes tous des hommes. Les sentiments protecteurs de la dignit
humaine nous tiennent donc personnellement cur. Assurment, je ne veux
pas dire que nous ne respectons la vie et la proprit de nos semblables que
par un calcul utilitaire et pour obtenir d'eux une juste rciprocit. Si nous rprouvons les actes qui manquent ce respect, c'est qu'ils froissent les
sentiments de sympathie que nous avons pour l'homme en gnral, et ces
sentiments sont dsintresss prcisment parce qu'ils ont un objet gnral. L
est la grande diffrence qui spare l'individualisme moral de Kant et celui des
utilitaristes. L'un et l'autre, en un sens, font du dveloppement de l'individu
l'objet de la conduite morale. Mais, pour les uns, l'individu dont il s'agit, c'est
l'individu sensible, empirique, tel qu'il se saisit dans chaque conscience particulire ; pour Kant, au contraire, c'est la personnalit humaine, c'est l'humanit en gnral et abstraction faite des formes concrtes et diverses sous
lesquelles elle se prsente l'observation. Nanmoins, si universel qu'il soit,
un tel objectif est troitement en rapport avec celui vers lequel nous inclinent
nos penchants gostes. Entre l'homme en gnral et l'homme que nous sommes, il n'y a pas la mme diffrence qu'entre l'homme et un dieu. La nature de
cet tre idal ne diffre qu'en degrs de la ntre ; il n'est que le modle dont
nous sommes les exemplaires varis. Les sentiments qui nous y attachent sont
donc, en partie, le prolongement de ceux qui nous attachent nous-mmes.
C'est ce qu'exprime la formule courante : Ne fais pas autrui ce que tu ne
voudrais pas qu'on te ft.
Par consquent, pour nous expliquer ces sentiments et les actes auxquels
ils nous incitent, il n'est pas ncessaire, au mme degr, de leur chercher
quelque origine transcendante. Pour nous rendre compte du respect que nous
prouvons pour l'humanit, il n'est pas besoin d'imaginer qu'il nous est impos
par quelque puissance extrieure et suprieure l'humanit ; il nous parat
dj intelligible par cela seul que nous nous sentons hommes nous-mmes.
Nous avons conscience qu'il est bien plus conforme l'inclinaison naturelle de
notre sensibilit. Les attentats qui le nient ne nous sembleront donc pas, autant
que les prcdents, dirigs contre quelque tre surhumain. Nous n'y verrons
pas des actes de lse-divinit, mais simplement de lse-humanit. Sans doute,
il s'en faut que cet idal soit dpourvu de toute transcendance ; il est dans la
nature de tout idal de dpasser le rel et de le dominer. Mais cette transcendance est beaucoup moins marque. Si cet homme abstrait ne se confond avec
aucun de nous, chacun de nous le ralise en partie. Si leve que soit cette fin,
comme elle est essentiellement humaine, elle nous est aussi, en quelque
mesure, immanente.
Par suite, les conditions de la rpression ne sont plus les mmes que dans
le premier cas. Il n'y a plus la mme distance entre l'offenseur et l'offens ; ils
sont davantage de plain-pied. Ils le sont d'autant plus que, en chaque cas particulier, la personne humaine que le crime offense se prsente sous les espces
d'une individualit particulire, de tous points identique celle du coupable.
Le scandale moral, qui constitue l'acte criminel, a donc quelque chose de
moins rvoltant et, par consquent, ne rclame pas une rpression aussi
mile Durkheim (1899-1900), Deux lois de l'volution pnale
23
violente. L'attentat d'un homme contre un homme ne saurait soulever la mme
indignation que l'attentat d'un homme contre un dieu. En mme temps, les
sentiments de piti que nous inspire celui que frappe la peine ne peuvent plus
tre aussi facilement ni aussi compltement touffs par les sentiments qu'il a
froisss et qui ragissent contre lui ; car les uns et les autres sont de mme
nature. Les premiers ne sont qu'une varit des seconds. Ce qui tempre la
colre collective qui est l'me de la peine, c'est la sympathie que nous ressentons pour tout homme qui souffre, l'horreur que nous cause toute violence
destructive ; or c'est la mme sympathie et la mme horreur qui allument cette
mme colre. Ainsi, cette fois, la cause mme qui met en branle l'appareil
rpressif tend l'arrter. C'est le mme tat mental qui nous pousse punir et
modrer la peine. Une influence attnuante ne pouvait donc manquer de se
faire sentir. Il pouvait paratre tout naturel d'immoler sans rserve la dignit
humaine du coupable la majest divine outrage. Au contraire, il y a une
vritable et irrmdiable contradiction venger la dignit humaine offense
dans la personne de la victime, en la violant dans la personne du coupable. Le
seul moyen, non pas de lever l'antinomie (car elle n'est pas soluble la
rigueur), mais de l'adoucir, est d'adoucir la peine autant que possible.
Puisque donc, mesure qu'on avance, le crime se rduit de plus en plus
aux seuls attentats contre les personnes, tandis que les formes religieuses de la
criminalit vont en rgressant, il est invitable que la pnalit moyenne aille
en s'affaiblissant. Cet affaiblissement ne vient pas de ce que les murs
s'adoucissent, mais de ce que la religiosit, dont taient primitivement empreints et le droit pnal et les sentiments collectifs qui en taient la base, va en
diminuant. Sans doute, les sentiments de sympathie humaine deviennent en
mme temps plus vifs ; mais cette vivacit plus grande ne suffit pas expliquer cette modration progressive des peines, puisque, elle seule, elle
tendrait plutt nous rendre plus svres pour tous les crimes dont l'homme
est la victime, et en lever la rpression. La vraie raison c'est que la compassion dont le patient est l'objet n'est plus crase par les sentiments contraires
qui ne lui permettaient pas de faire sentir son action.
Mais, dira-t-on, s'il en est ainsi, comment se fait-il que les peines attaches
aux attentats contre les personnes participent la rgression gnrale ? Car, si
elles ont moins perdu que les autres, cependant il est certain qu'elles aussi
sont, en gnral, moins leves qu'il y a deux ou trois sicles. Si, pourtant, il
est dans la nature de cette sorte de crimes d'appeler des chtiments moins
svres, l'effet aurait d se manifester d'emble, ds que le caractre criminel
de ces actes fut formellement reconnu ; les peines qui les frappent auraient
donc d atteindre tout de suite et d'un seul coup le degr de douceur qu'ils
comportent, au lieu de s'adoucir progressivement. Mais ce qui dtermina cet
adoucissement progressif, c'est qu'au moment o ces attentats, aprs avoir
stationn pendant longtemps sur le seuil du droit criminel, y pntrrent et y
furent dfinitivement classs, c'est la criminalit religieuse qui tenait peu
prs toute la place. Par suite de cette situation prpondrante, elle commena
par entraner dans son orbite ces dlits nouveaux qui venaient de se constituer
et les marqua de son empreinte. Tant que, d'une manire gnrale, le crime est
essentiellement conu comme une offense dirige contre la divinit, les
crimes commis par l'homme contre l'homme sont aussi conus sur ce mme
modle. Nous croyons qu'eux aussi nous rvoltent parce qu'ils sont dfendus
par les dieux et, ce titre, les outragent. Les habitudes d'esprit sont telles qu'il
mile Durkheim (1899-1900), Deux lois de l'volution pnale
24
ne parat mme pas possible qu'un prcepte moral puisse avoir une autorit
suffisamment fonde s'il ne l'emprunte ce qui est alors considr comme la
source unique de toute moralit. Telle est l'origine de ces thories, si
rpandues encore aujourd'hui, d'aprs lesquelles la morale manque de toute
base si elle ne s'appuie sur la religion, ou, tout au moins, sur une thologie
rationnelle, c'est--dire si l'impratif catgorique n'mane pas de quelque tre
transcendant. Mais mesure que la criminalit humaine se dveloppe et que la
criminalit religieuse recule, la premire dgage de plus en plus nettement sa
physionomie propre et ses traits distinctifs, tels que nous les avons dcrits.
Elle se libre des influences qu'elle subissait et qui l'empchaient d'tre ellemme. Si, aujourd'hui encore, il y a bien des esprits pour lesquels le droit
pnal et, plus gnralement, toute morale sont insparables de l'ide de Dieu,
cependant le nombre en diminue, et ceux-l mmes qui s'attardent cette
conception archaque ne lient plus ces deux ides aussi troitement que
pouvait le faire un chrtien des premiers ges. La morale humaine se
dpouille de plus en plus de son caractre primitivement confessionnel. C'est
au cours de ce dveloppement que se produit l'volution rgressive des peines
qui frappent les manquements les plus graves aux prescriptions de cette
morale. Par un retour qui doit tre not, mesure que la criminalit humaine
gagne du terrain, elle ragit son tour sur la criminalit religieuse et, pour
ainsi dire, se l'assimile. Si, aujourd'hui, ce sont les attentats contre les personnes qui constituent les principaux crimes, nanmoins il existe encore des
attentats contre des choses collectives (crimes contre la famille, contre les
murs, contre l'tat). Seulement, ces choses collectives elles-mmes tendent
perdre de plus en plus cette religiosit dont elles taient autrefois marques.
De divines qu'elles taient, elles deviennent des ralits humaines. Nous
n'hypostasions plus la famille ou la socit sous forme d'entits transcendantes
et mystiques ; nous n'y voyons plus gure que des groupes d'hommes qui
concertent leurs efforts en vue de raliser des fins humaines. Il en rsulte que
les crimes dirigs contre ces collectivits participent aux caractres de ceux
qui lsent directement des individus, et les peines qui frappent les premiers
vont elles-mmes en s'adoucissant.
Telle est la cause qui a dtermin l'affaiblissement progressif des peines.
On voit que ce rsultat s'est produit mcaniquement. La manire dont les
sentiments collectifs ragissent contre le crime a chang, parce que ces
sentiments ont chang. Des forces nouvelles sont entres en jeu ; l'effet ne
pouvait pas rester le mme. Cette grande transformation n'a donc pas eu lieu
en vue d'une fin prconue ni sous l'empire de considrations utilitaires. Mais,
une fois accomplie, elle s'est trouve tout naturellement ajuste des fins
utiles. Par cela mme qu'elle tait ncessairement rsulte des conditions
nouvelles dans lesquelles se trouvaient places les socits, elle ne pouvait
pas ne pas tre en rapport et en harmonie avec ces conditions. En effet,
l'intensit des peines ne sert qu' faire sentir aux consciences particulires
l'nergie de la contrainte sociale ; aussi n'est-elle utile que si elle varie comme
l'intensit mme de cette contrainte. Il convient donc qu'elle s'adoucisse
mesure que la coercition collective s'allge, s'assouplit, devient moins exclusive du libre examen. Or c'est l le grand changement qui s'est produit au
cours de l'volution morale. Quoique la discipline sociale, dont la morale
proprement dite n'est que l'expression la plus haute, tende de plus en plus son
champ d'action, elle perd de plus en plus de rigueur autoritaire. Parce qu'elle
prend quelque chose de plus humain, elle laisse plus de place aux spontanits
mile Durkheim (1899-1900), Deux lois de l'volution pnale
25
individuelles, elle les sollicite mme. Elle a donc moins besoin d'tre violemment impose. Or, pour cela, il faut aussi que les sanctions qui lui assurent le
respect deviennent moins compressives de toute initiative et de toute
rflexion.
Nous pouvons maintenant revenir au second facteur de l'volution pnale,
dont nous avons jusqu'ici fait abstraction, c'est--dire la nature de l'organe
gouvernemental. Les considrations qui prcdent vont nous permettre
d'expliquer aisment la manire dont il agit.
En effet, la constitution d'un pouvoir absolu a ncessairement pour effet
d'lever celui qui le dtient au-dessus du reste de l'humanit, d'en faire
quelque chose de surhumain et cela d'autant plus que le pouvoir dont il est
arm est plus illimit. En fait, partout o le gouvernement prend cette forme,
celui qui l'exerce apparat aux hommes comme une divinit. Quand on n'en
fait pas un dieu spcial, on voit tout au moins dans la puissance dont il est
investi une manation de la puissance divine. Ds lors, cette religiosit ne
peut manquer d'avoir sur la peine ses effets ordinaires. D'une part, les attentats
dirigs contre un tre si sensiblement suprieur tous ses offenseurs ne seront
pas considrs comme des crimes ordinaires, mais comme des sacrilges et,
ce titre, violemment rprims. De l vient, chez tous les peuples soumis un
gouvernement absolu, le rang exceptionnel que le droit pnal assigne aux
crimes de lse-majest. D'un autre ct, comme, dans ces mmes socits,
presque toutes les lois sont censes maner du souverain et exprimer ses
volonts, c'est contre lui que paraissent diriges les principales violations de la
loi. La rprobation que ces actes soulvent est donc beaucoup plus vive que si
l'autorit laquelle ils viennent se heurter tait plus disperse, partant plus
modre. Le fait qu'elle est ce point concentre, en la rendant plus intense, la
rend aussi plus sensible tout ce qui l'offense, et plus violente dans ses
ractions. C'est ainsi que la gravit de la plupart des crimes se trouve surleve de quelques degrs ; par suite, l'intensit moyenne des peines est extraordinairement renforce.
V
Conclusion
Retour la table des matires
Ainsi entendue, la loi dont nous venons de rendre compte prend une tout
autre signification.
En effet, si l'on va au fond des choses, on peut voir maintenant qu'elle
n'exprime pas seulement, comme il pouvait sembler au premier abord, les
variations quantitatives par lesquelles a pass la peine, mais des variations
proprement qualitatives. Si la pnalit est plus douce aujourd'hui que jadis, ce
n'est pas parce que les anciennes institutions pnitentiaires, tout en restant
mile Durkheim (1899-1900), Deux lois de l'volution pnale
26
elles-mmes, ont peu peu perdu de leur rigueur ; mais c'est qu'elles ont t
remplaces par des institutions diffrentes. Les mobiles qui ont dtermin la
formation des unes et des autres ne sont pas de mme nature. Ce n'est plus
cette vivacit, cette soudainet d'explosion, cette stupfaction indigne que
soulve un outrage dirig contre un tre dont la valeur est incommensurable
avec celle de l'agresseur ; c'est davantage cette motion plus calme et plus
rflchie que provoquent des offenses qui ont lieu entre gaux. Le blme n'est
plus le mme et n'exclut pas la commisration ; par lui-mme, il appelle des
tempraments. D'o la ncessit de peines nouvelles qui soient en accord avec
cette nouvelle mentalit.
Par l se trouve carte une erreur laquelle pourrait donner lieu l'observation immdiate des faits. En voyant avec quelle rgularit la rpression
parat faiblir mesure qu'on avance dans l'volution, on pourrait croire que le
mouvement est destin se poursuivre sans terme ; autrement dit, que la
pnalit tend vers zro. Or, une telle consquence serait en contradiction avec
le sens vritable de notre loi.
En effet, la cause qui a dtermin cette rgression ne saurait produire ses
effets attnuants d'une manire indfinie. Car elle ne consiste pas dans une
sorte d'engourdissement de la conscience morale qui, perdant peu peu sa
vitalit et sa sensibilit originelles, deviendrait de plus en plus incapable de
toute raction pnale nergique. Nous ne sommes pas aujourd'hui plus complaisants qu'autrefois pour tous les crimes indistinctement, mais seulement
pour certains d'entre eux ; il en est, au contraire, pour lesquels nous nous
montrons plus svres. Seulement, ceux auxquels nous tmoignons une
indulgence qui va croissant, se trouvent tre aussi ceux qui provoquent la
rpression la plus violente ; inversement, ceux pour lesquels nous rservons
notre svrit n'appellent que des peines mesures. Par suite, mesure que les
premiers, cessant d'tre traits comme des crimes, se retirent du droit pnal et
cdent la place aux autres, il doit ncessairement se produire un affaiblissement de la pnalit moyenne. Mais cet affaiblissement ne peut durer qu'autant
que durera cette substitution. Un moment doit venir il est presque venu o
elle sera effectue, o les attentats contre la personne rempliront tout le droit
criminel, ou mme ce qui restera des autres ne sera plus considr que comme
une dpendance des prcdents. Alors, le mouvement de recul s'arrtera. Car
il n'y a aucune raison de croire que la criminalit humaine doive rgresser
son tour ainsi que les peines qui la rpriment. Tout fait plutt prvoir qu'elle
prendra de plus en plus de dveloppement, que la liste des actes qui sont
qualifis crimes ce titre ira en s'allongeant, et leur caractre criminel en
s'accentuant. Des fraudes, des injustices, qui, hier, laissaient la conscience
publique peu prs indiffrente, la rvoltent aujourd'hui et cette sensibilit ne
fera que s'aviver avec le temps. Il n'y a donc pas en ralit un flchissement
gnral de tout le systme rpressif ; seul, un systme particulier flchit, mais
il est remplac par un autre qui, tout en tant moins violent et moins dur, ne
laisse pas d'avoir ses svrits propres et n'est nullement destin une
dcadence ininterrompue.
Ainsi s'explique l'tat de crise o se trouve le droit pnal chez tous les
peuples civiliss. Nous sommes arrivs au moment o les institutions pnales
du pass ou bien ont disparu ou bien ne survivent plus que par la force de
mile Durkheim (1899-1900), Deux lois de l'volution pnale
27
l'habitude, mais sans que d'autres soient nes qui rpondent mieux aux
aspirations nouvelles de la conscience morale.
Fin de larticle.
Vous aimerez peut-être aussi
- Du contrat social ou Principes du droit politiqueD'EverandDu contrat social ou Principes du droit politiqueÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (2)
- Droit PublicDocument62 pagesDroit PublicHanan Fernandez-Boulaajoul100% (1)
- Support Cours Controle Fiscal 1Document46 pagesSupport Cours Controle Fiscal 1Doudi kidsPas encore d'évaluation
- Grands Problèmes Politiques ContemporainsDocument91 pagesGrands Problèmes Politiques ContemporainsYouness Ian Rams100% (13)
- Cours - Droit Constitutionnel (IPAG)Document80 pagesCours - Droit Constitutionnel (IPAG)jordan33127100% (3)
- Durkheim (1892) de La Division Du Travail Social IDocument162 pagesDurkheim (1892) de La Division Du Travail Social IFederico Lorenc ValcarcePas encore d'évaluation
- Cours Idéologies Et Systèmes PolitiquesDocument22 pagesCours Idéologies Et Systèmes PolitiquesMiiss WiwiPas encore d'évaluation
- Les Transformations Du Droit Public - Léon DuguitDocument330 pagesLes Transformations Du Droit Public - Léon DuguitEduardo LevinPas encore d'évaluation
- c1 La Notion de PouvoirDocument3 pagesc1 La Notion de PouvoirTazi OumaymaPas encore d'évaluation
- L EtatDocument11 pagesL EtatSaida BekriPas encore d'évaluation
- Les Contrats A Long Terme Traitement Comptable Et FiscalDocument8 pagesLes Contrats A Long Terme Traitement Comptable Et FiscalBraham's Hamid100% (1)
- Emile Durkheim, Les Règles de La Méthode SociologiqueDocument7 pagesEmile Durkheim, Les Règles de La Méthode SociologiqueDuvivierPas encore d'évaluation
- Droits de l'homme: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandDroits de l'homme: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- SAP Codes MouvementsDocument23 pagesSAP Codes Mouvementsdolinedo100% (1)
- Carlos Alberto González Sánchez - Universidad de SevillaDocument34 pagesCarlos Alberto González Sánchez - Universidad de SevillaHenrique Grandinetti de BarrosPas encore d'évaluation
- Le Risque de Taux D'intérêtDocument15 pagesLe Risque de Taux D'intérêtYousra MoufidPas encore d'évaluation
- Hobbes Locke RousseauDocument7 pagesHobbes Locke RousseauGeoffroy OdiPas encore d'évaluation
- Hume, David - Essai Sur Les Premiers Principes Du Gouvernement (Uqac)Document6 pagesHume, David - Essai Sur Les Premiers Principes Du Gouvernement (Uqac)SugarplantationPas encore d'évaluation
- EDurkheim Leçons 56Document16 pagesEDurkheim Leçons 56karolannevlogtvPas encore d'évaluation
- Philodissert L'état Et Les IndividusDocument3 pagesPhilodissert L'état Et Les IndividusGuillaume ChênelPas encore d'évaluation
- DM Résumé MPSI1 Tocqueville (Enregistré Automatiquement)Document4 pagesDM Résumé MPSI1 Tocqueville (Enregistré Automatiquement)Aminata KhoulePas encore d'évaluation
- Durkheim 1900-1905 - L EtatDocument8 pagesDurkheim 1900-1905 - L EtatMitru DumitruPas encore d'évaluation
- (SJC - Clémence) Système-Juridique-ComparésDocument57 pages(SJC - Clémence) Système-Juridique-Comparésalien alienPas encore d'évaluation
- Sociologie Fiche de RevisionDocument13 pagesSociologie Fiche de Revisionmalone GobinaPas encore d'évaluation
- Durkheim - de La Division Du Travail SocialDocument277 pagesDurkheim - de La Division Du Travail SocialAna Belbut100% (1)
- Anthropologie Juridique Et Sociale - YsDocument35 pagesAnthropologie Juridique Et Sociale - YsIdrissa NiassyPas encore d'évaluation
- Controverse PolitiquesDocument6 pagesControverse Politiquescpena06Pas encore d'évaluation
- Émile Durkheim - Une Révision de L'idée Socialiste (1899)Document11 pagesÉmile Durkheim - Une Révision de L'idée Socialiste (1899)RockandoperaPas encore d'évaluation
- Durkheim - de La Div Du Travl Soc IDocument206 pagesDurkheim - de La Div Du Travl Soc IJulio Santos FilhoPas encore d'évaluation
- 1 La Notion DEtatDocument10 pages1 La Notion DEtatflorentbrunet4488Pas encore d'évaluation
- Livre III Du Contrat SocialDocument16 pagesLivre III Du Contrat SocialJeff AmePas encore d'évaluation
- Correction Du Sujet Du 20 Novembre 2023Document6 pagesCorrection Du Sujet Du 20 Novembre 2023tijiso6009Pas encore d'évaluation
- GPPC LCS3Document68 pagesGPPC LCS3atioukpealexPas encore d'évaluation
- Droit ConstitutionnelDocument35 pagesDroit Constitutionnelbenisr1001Pas encore d'évaluation
- Cours Sur Le Droit Et La Justice.Document11 pagesCours Sur Le Droit Et La Justice.Solène C'estToutPas encore d'évaluation
- Cours de Sociologie Politique VAGUE ADocument62 pagesCours de Sociologie Politique VAGUE AElhadji BopPas encore d'évaluation
- TD HPE Dossier 5Document31 pagesTD HPE Dossier 5Violette ViguierPas encore d'évaluation
- l' Etat T5 2022Document9 pagesl' Etat T5 2022Axelle DelportePas encore d'évaluation
- Resumé Esprit Des LoisDocument15 pagesResumé Esprit Des Loisdriss cherradPas encore d'évaluation
- 2012 13.fiche de Lecture - Le ContratDocument6 pages2012 13.fiche de Lecture - Le ContratnephegessimaPas encore d'évaluation
- Etat Et Religions Le Systeme AntiqueDocument37 pagesEtat Et Religions Le Systeme AntiqueMahdi ZrigPas encore d'évaluation
- Cours 1Document7 pagesCours 1hfr928kvk7Pas encore d'évaluation
- c1 La Notion de PouvoirDocument3 pagesc1 La Notion de PouvoirRachid AmiralPas encore d'évaluation
- Dissertation Mieux Vaut Une Injustice Qu'un Désordre - 093608Document4 pagesDissertation Mieux Vaut Une Injustice Qu'un Désordre - 093608Franklin DéborahPas encore d'évaluation
- Etat Corigé Révision Du Bac PhiloDocument7 pagesEtat Corigé Révision Du Bac PhiloQUI SUIS-JE ?Pas encore d'évaluation
- Def Crime Fonction ChatimentDocument14 pagesDef Crime Fonction ChatimentElleDeuxAheuhessePas encore d'évaluation
- Sociologie de La ComDocument5 pagesSociologie de La Comdylanales99Pas encore d'évaluation
- Etat Et JusticeDocument12 pagesEtat Et Justicenoa.blain49Pas encore d'évaluation
- Fichier TD Droit Constitionnel 1 À 4 2023-2024Document58 pagesFichier TD Droit Constitionnel 1 À 4 2023-2024guillouetPas encore d'évaluation
- Le Droit Est LDocument13 pagesLe Droit Est LRachid LaabachiPas encore d'évaluation
- Droit de L'environnementDocument20 pagesDroit de L'environnementYoussef El MakhfiouiPas encore d'évaluation
- La Critique Du Libéralisme (Tome 2)Document580 pagesLa Critique Du Libéralisme (Tome 2)IHS_MAPas encore d'évaluation
- Delsol Etat SubsidiaireDocument234 pagesDelsol Etat SubsidiaireBALLA KEITAPas encore d'évaluation
- Réflexions Sur La Justice PerelmanDocument31 pagesRéflexions Sur La Justice PerelmanDali KPas encore d'évaluation
- Etat LiberteDocument5 pagesEtat Libertebertoade7718Pas encore d'évaluation
- Resume en 10 Pages Des Sciences Politiques CompressedDocument10 pagesResume en 10 Pages Des Sciences Politiques CompressedCakes DesingPas encore d'évaluation
- L1-S1 Culture Juridique 2Document52 pagesL1-S1 Culture Juridique 2mariezaine217Pas encore d'évaluation
- La Production Biopolitique" PDFDocument6 pagesLa Production Biopolitique" PDFcorpanzilPas encore d'évaluation
- S2.1 Les Liens Sociaux Dans Les... - Elève PDFDocument62 pagesS2.1 Les Liens Sociaux Dans Les... - Elève PDFjayseseckPas encore d'évaluation
- Qu'Est-ce Que L'état - AnakalyptoDocument6 pagesQu'Est-ce Que L'état - AnakalyptoiKa LuxicePas encore d'évaluation
- Lochak Denonciation 1996Document16 pagesLochak Denonciation 1996habib-andrePas encore d'évaluation
- Dissertation GuidéeDocument2 pagesDissertation GuidéeSimon DelambrePas encore d'évaluation
- Le Ra Le de L A Tat Civil Dans La Construction de L Etat Ma Langes FP Blanc-MillardDocument11 pagesLe Ra Le de L A Tat Civil Dans La Construction de L Etat Ma Langes FP Blanc-MillardtakinardiPas encore d'évaluation
- Chap 3 La Constitution Et Le Principe de La Séparation Des PVDocument3 pagesChap 3 La Constitution Et Le Principe de La Séparation Des PVKelly0% (1)
- Cours de Philosophie-5Document7 pagesCours de Philosophie-5Benjamin ObiefunaPas encore d'évaluation
- La Cour Internationale de Justice Et La Coutume InternationaleDocument3 pagesLa Cour Internationale de Justice Et La Coutume InternationalewyzychuigunsPas encore d'évaluation
- Les CoursesDocument82 pagesLes Coursesmohamedboumansour1Pas encore d'évaluation
- Generalites Sur LosteologieDocument4 pagesGeneralites Sur LosteologieWissam TizaPas encore d'évaluation
- ChapI - Rappels Stabilité Des SystèmesDocument28 pagesChapI - Rappels Stabilité Des SystèmesibrahimPas encore d'évaluation
- Arrêté Du 23-12-16 - Postes H Et B Tension de Distribution D'énergie ÉlectriqueDocument20 pagesArrêté Du 23-12-16 - Postes H Et B Tension de Distribution D'énergie ÉlectriqueNader GhrabPas encore d'évaluation
- M.cote, G.paradis, Les Dictionnaires Generaux de Philosophie en Langue FrancaiseDocument19 pagesM.cote, G.paradis, Les Dictionnaires Generaux de Philosophie en Langue FrancaisepalatinuxPas encore d'évaluation
- CV Actualisé TYF 3Document8 pagesCV Actualisé TYF 3Tahp Yassine FadoulPas encore d'évaluation
- 1 G en Eralit Es: 222. Exemples D' Equations Aux D Eriv Ees Partielles Lin EairesDocument3 pages1 G en Eralit Es: 222. Exemples D' Equations Aux D Eriv Ees Partielles Lin EairesJean Djibersou BiryangPas encore d'évaluation
- Fiches Pathologies GénétiquesDocument5 pagesFiches Pathologies GénétiquesRomPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 Commande Vectorielle D'une GSAPDocument7 pagesChapitre 2 Commande Vectorielle D'une GSAPzakariamenzer2000Pas encore d'évaluation
- GMAODocument13 pagesGMAOYazid ZireguePas encore d'évaluation
- Barthélemy Charles - Erreurs Et Mensonges Historiques - Tome 03Document287 pagesBarthélemy Charles - Erreurs Et Mensonges Historiques - Tome 03Arwen KellerPas encore d'évaluation
- Algorithmique II Rattrapage 2018 - 2019 CorrDocument3 pagesAlgorithmique II Rattrapage 2018 - 2019 CorrSalma HaouchPas encore d'évaluation
- HTA MaligneDocument6 pagesHTA MaligneSan DeutschPas encore d'évaluation
- Tableaux de Dimensionnement Schöck Isokorb® T Type K-U, K-ODocument7 pagesTableaux de Dimensionnement Schöck Isokorb® T Type K-U, K-ORobertPas encore d'évaluation
- ProductBrochure EC15CtoEC20C FR 31A1006320 201003Document16 pagesProductBrochure EC15CtoEC20C FR 31A1006320 201003jonbzh1Pas encore d'évaluation
- Chapeau! 4 Programmations FrançaisDocument19 pagesChapeau! 4 Programmations FrançaisAlberto Casas RodriguezPas encore d'évaluation
- Conference Bacque PDFDocument11 pagesConference Bacque PDFTourde BabelPas encore d'évaluation
- TD.1 Analyse 2 PDFDocument2 pagesTD.1 Analyse 2 PDFAdem BelhajPas encore d'évaluation
- Définition de La Technologie PDFDocument3 pagesDéfinition de La Technologie PDFNesrine Nes100% (1)
- ATD ConvertiDocument18 pagesATD ConvertiHouria RaibPas encore d'évaluation
- Supply Chain Management NVDocument27 pagesSupply Chain Management NVoumaima labaiouiPas encore d'évaluation
- Analyse Sémiologique Du Graffiti 04160097 PDFDocument69 pagesAnalyse Sémiologique Du Graffiti 04160097 PDFJulio LealPas encore d'évaluation
- Statut Du Mawlid en IslamDocument51 pagesStatut Du Mawlid en IslamSekou Mohamed SamakePas encore d'évaluation
- Poly Adc 1ste Cours 1920 eDocument52 pagesPoly Adc 1ste Cours 1920 eismailPas encore d'évaluation