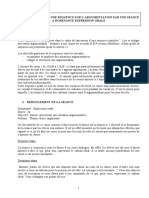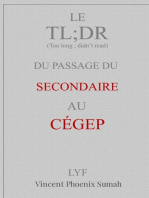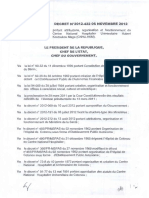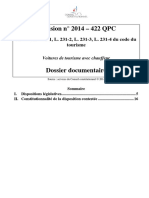Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
PDF Le Conseil de Cooperation
Transféré par
scribdCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
PDF Le Conseil de Cooperation
Transféré par
scribdDroits d'auteur :
Formats disponibles
Apprentissage des rgles - Fiche pdagogique n 02
Le conseil de coopration
Objectifs : - Apprendre aux enfants la coopration, la citoyennet, les principes
dmocratiques par la pratique du conseil de coopration.
- Trouver collectivement des solutions aux conflits et aux problmes de vie dans la classe.
Mots-cls : rgles coopration ducation civique - conseil de coopration
Type de fiche : Outil
Niveau scolaire : cycles 2 et 3 de lcole primaire.
Le conseil de coopration peut tre adapt pour lcole maternelle ou pour le collge.
Dure : La dure est de 15 45 minutes chaque semaine, selon lge des enfants et les points
discuter.
Pour la mise en place en dbut danne, il est possible de faire de petits conseils tous les jours
pour mettre en place le fonctionnement de la classe
Nombre de sances : rgulier
Matriel : Une salle o il est possible de disposer des chaises en cercle pour la tenue des
sances du conseil de coopration. La disposition assise par terre ne semble pas
approprie au conseil de coopration.
Fiche en lien avec la fiche n15 de lapprentissage de la communication : Les messages
clairs
Source :
Danielle Jasmin, Le conseil de Coopration, d. Chenelire/Didactique, 1994. Il existe
galement une vido, illustration directe du livre de Danielle Jasmin, intitule Le conseil
de coopration (diffusion NVA)
Le terme de conseil de coopration a t donn par Danielle Jasmin, au Qubec, la
runion (hebdomadaire) de tous les enfants de la classe, o ensemble et en cercle, sont
gres la vie en classe, ce qui va bien et ce qui ne va pas : lorganisation de la vie en
classe, du travail, des responsabilits, des jeux ; les relations interpersonnelles ; les projets.
Le conseil de coopration sinspire fortement du conseil de cooprative imagin et mis
en uvre par Clestin Freinet et qui connut un essor particulier grce Fernand Oury et
ses collaborateurs sous le nom de conseil
Vous trouverez des amnagements intressants au conseil de coopration tel quil est
dcrit dans le livre de Danielle Jasmin, dans un article de la mme auteure publi dans la
revue qubcoise Vivre le primaire de novembre 1999. Il est possible de tlcharger
cet article ladresse : http://www.csdm.qc.ca/cee/ceici/primaire/jasmin.pdf
Coordination franaise pour la Dcennie www.decennie.org - Rseau Ecole et Non-violence www.ecole-nonviolence.org 1
Apprentissage des rgles Fiche n2
1) Mise en place dun conseil de coopration
1-1- En dbut danne
On prcise aux enfants que pour linstant on fait comme ceci ou comme cela mais quaprs,
on dcidera au conseil de coopration et quils verront ce que cest lors du premier conseil.
Cela suscite de la curiosit et de lintrt.
1-2- Premier conseil
Expliquer quoi va servir le conseil de coopration
Expliquer ce quest la coopration,
Expliquer le rle du journal mural et du classeur de coopration.
1-3- Le journal mural
Cet outil est d Clestin Freinet. Il va servir tablir lordre du jour du Conseil.
Dans la premire colonne, les enfants crivent les flicitations et les remerciements quils ont
envie dadresser : Je remercie Clo et Etienne pour avoir accept de jouer avec moi, sign
Guillaume , Je flicite Franois parce quil a eu le courage de porter ses lunettes, sign
Ingrid. Ils crivent sur un morceau de papier quils fixent dans la colonne laide dune
punaise.
Dans la deuxime colonne, les enfants adressent leurs critiques : Je critique Catherine parce
quelle ma trait de niais, sign Maxime. Au lieu de se quereller, les enfants apprennent
dire Jte critique au conseil.
Une troisime colonne sintitule : Je veux parler de Les enfants peuvent proposer des
sujets qui concernent la vie de classe
Voir un exemple de journal mural en annexe 1.
Chaque fois quun enfant vient se plaindre au matre ou la matresse dun problme, la
rponse est souvent Parles en au conseil de coopration. , et lutilisation du journal mural
devient progressivement naturelle.
1-4- Le classeur du conseil de coopration
Il est important de noter et de conserver ce qui se passe au conseil. On note lordre du jour, les
engagements pris et les lois votes. On y garde galement les remerciements, les flicitations
et les critiques.
A la fin de lanne les flicitations peuvent tre redonnes ceux qui elles taient adresses
et les critiques dtruites dans une action un peu solennelle.
1-5- Ordre du jour : lordre du jour ordinaire est structur ainsi :
- Ouverture
- Retour sur le conseil prcdent
- Flicitations
- Critiques
- Je veux parler de
- Comment va la classe ?
- Fermeture
2) Droulement du conseil de coopration
2-1- Avant le conseil de coopration, les lves assistant-e-s recueillent les flicitations, les
remerciements, les critiques et les points discuter inscrits dans le journal mural. Ils crivent
ensuite lordre du jour au tableau et sur une feuille du classeur du conseil. Ils remettent tous
ces lments au matre ou la matresse.
Coordination franaise pour la Dcennie www.decennie.org - Rseau Ecole et Non-violence www.ecole-nonviolence.org 2
Apprentissage des rgles Fiche n2
2-2- Rituel dentre dans le conseil : Le matre ou la matresse dit : Le conseil
commence Il le rpte jusqu ce que le silence se fasse.
2-3- Relecture des dcisions prises lors du conseil prcdent : Est-ce que les enfants qui
devaient faire quelque chose lont fait ? Si une dcision prise na pas t suivie deffet, le
point est remis lordre du jour du prsent conseil.
2-4- Les flicitations et les remerciements : Le matre ou la matresse lit les messages de
flicitations et de remerciements qui ont t adresss par des lves dautres. Sans sattarder,
souligner les nouveauts dans les contenus de ces messages.
2-5- Les critiques : Le matre ou la matresse lit les critiques. Une critique doit tre date et
signe sinon elle nest pas lue, mme sil sagit dun simple oubli (report au conseil suivant).
- La parole est donne lauteur-e de la critique, puis lenfant critiqu prsente sa version des
faits. Dautres enfants peuvent ensuite ajouter des commentaires.
- Le conseil cherche ensuite des solutions : souvent llve critiqu devra faire des excuses ou
accepter de laide pour amliorer son comportement.
- Quand on dcouvre que le problme concerne plusieurs enfants, il peut tre dcid de voter
une loi.
- Pour que le conseil ne soit pas submerg par les critiques : Le conseil a dcid quil fallait,
avant de faire une critique au conseil, sexpliquer laide dun message clair (voir fiche
n15 : apprentissage de la communication). Dans un autre temps de la classe, le matre ou la
matresse a appris aux enfants formuler des messages clairs cest--dire sexpliquer en
disant lautre quel sentiment son comportement dclenche chez lui. Par exemple : Quand
tu me fais des grimaces exprs, a me met trs en colre et a me fait un peu de peine. As-tu
compris ? , en regardant lautre bien dans les yeux.
- Pour une violence physique : Le conseil peut juger que, pour un coup donn, les messages
clairs, les excuses et les demandes daide pour les agresseurs ne suffisent pas et que la victime
a un droit une rparation. Il sagit bien de rparation et non pas de punition. Llve qui
reoit un coup, par exemple dit : Je demande rparation parce que , plutt que dentrer
dans une escalade de la violence. Le conseil tablit une liste de rparations possibles : Faire
un dessin ; faire une carte dexcuses ; jouer ensemble la prochaine rcration ; aider en
mathmatiques ; laver le pupitre ou le casier ; etc.
- Grer les refus de rparation : Exemple de loi vote au conseil : si un enfant refuse de faire
la rparation demande, on peut faire une critique au conseil et celui-ci donnera deux
rparations faire si lenfant demandeur avait raison dexiger rparation
2-6- Autres points lordre du jour.
La parole est donne lenfant qui a demand de parler dun point particulier.
Il y a une volont affirme de chercher le consensus pour la dcision :
- Le vote sert valuer les opinions ou faire un sondage ; ensuite la discussion est
poursuivie pour essayer datteindre un consensus.
- Si la dcision concerne un rglement de classe et quil est difficile dobtenir un consensus,
je demande souvent aux enfants qui sont contre dessayer de vivre cette dcision durant une
ou deux semaines, dobserver ce qui ne va pas et de revenir, lors dun prochain conseil de
coopration, avec de nouveaux arguments pour nous convaincre de changer notre dcision. Je
demande la mme chose ceux qui y sont favorables pour que nous puissions avoir un bon
change partir de nouvelles donnes.
Coordination franaise pour la Dcennie www.decennie.org - Rseau Ecole et Non-violence www.ecole-nonviolence.org 3
Apprentissage des rgles Fiche n2
2-7- Comment va la classe ?
Intressant pour faire un court bilan de la semaine coule depuis le dernier conseil.
On dit dabord ce quil y a maintenir, ce qui va bien en classe.
On dit ensuite ce quil y a amliorer
Il faut parfois rserver cinq minutes dans lordre du jour pour cette phase-l, en reportant au
prochain conseil les autres points qui nont pas pu tre traits.
Rituel de sortie du conseil : Le matre ou la matresse dit : Le conseil est termin, les points
de lordre du jour non abords le seront lors du prochain conseil de coopration.
3) Quelques remarques
Une triangulation des problmes
Le conseil vient briser la relation de dualit qui existe entre un-e enseignant-e et un enfant. Il
permet de mettre en place une troisime personne symbolique ou morale, le conseil, qui nous
libre sur le plan motif. Par exemple :
Au retour dune rcration, Mlanie vient se plaindre que les autres enfants de la classe ne
veulent pas quelle joue au ballon avec eux.
Ca te fait beaucoup de peine, Mlanie, de te faire traiter comme a ?
- Oui, et je leur ai dit que le ballon de la classe appartenait TOUS les enfants de la
classe, que javais le droit moi aussi de jouer !
- Tu leur as rappel le rglement et malgr cela, ils nont pas voulu. Ca doit aussi te
mettre en colre ?
- Oui, y veulent pas mcouter.
- Ca semble te dcourager.
- Un peu
- Tu devrais en parler au conseil de coopration.
Un exemple de demande daide :
Martin, comment pourrait-on taider ? , dit la matresse
- Peut-tre que jaurais besoin dun enfant qui collerait son pupitre au mien pour maider me
calmer.
La matresse a peur quaucun enfant ne se propose pour cette tche. Elle ose demander :
Qui veut placer son pupitre ct de celui de Martin ?
Une dizaine de mains se lvent. Martin sourit de plaisir et de gne. Il regarde longtemps tous
les enfants qui se portent volontaires et choisit finalement un garon. Puis, dans un lan, il
dclare :
Mon problme est pas mal grand. Jai de laide pour la main gauche, jen aurais besoin aussi
pour la main droite ! Un pupitre coll droite et lautre gauche !
La matresse trouve quil exagre un peu, mais accepte. Les filles demandent que ce soit lune
delles qui soit choisie cette fois pour que ce soit juste. Martin en dsigne une avec fiert.
Une chelle de confiance :
Coordination franaise pour la Dcennie www.decennie.org - Rseau Ecole et Non-violence www.ecole-nonviolence.org 4
Apprentissage des rgles Fiche n2
Pour encourager les lves assumer la responsabilit de leurs actes, leur expliquer :
Chacun de nous a en lui une espce dchelle gradue dchelons de 0 10 pour reprsenter
la confiance que nous avons lgard des autres. Cette confiance diffre selon nos
impressions et nos expriences. Lorsquun enfant entre dans la classe il a la cote 10. Par
contre, un vol ou un mensonge fait tomber la confiance zro. La confiance en lenfant est
perdue, et il est laborieux de remonter chacun des chelons. Quand un mauvais comportement
est avou, on remonte plus vite
Trouver des arguments pour convaincre la matresse :
Cest ainsi que les enfants mont convaincue de les laisser mcher de la gomme en classe.
Ils ont propos que la gomme mcher permise soit sucre laspartame, comme le
recommandent certains dentistes. Ils ont ajout quils devaient la mcher discrtement et que
si je la voyais, ils la mettraient aussitt la poubelle. Tous, nous vivons bien avec ce
rglement. (voir la loi 6 en annexe 2)
Je demande aux enfants de faire mon valuation
A chaque tape de la remise des bulletins scolaires, je demande aux enfants de faire mon
valuation, cest--dire ce que je ne dois pas changer et ce que je peux amliorer. La premire
fois, jai eu peur, mais ce fut un moment intressant .
Par exemple :
- A maintenir : Vous tes assez patiente ; vous expliquez bien ; vous ntes pas trop svre ;
etc.
- A amliorer : Des fois vous nommez trop vite des drangeurs , dautres fois pas assez
vite (voir annexe 2) ; vous parlez fort quelquefois ; etc.
Je dois cependant souvent leur dire que ma responsabilit comme enseignante me demande
parfois des comportements quil mest impossible de modifier.
Annexe 1 : Un exemple de journal mural (classes au Qubec correspondant aux CE1
et CE2 en France)
Coordination franaise pour la Dcennie www.decennie.org - Rseau Ecole et Non-violence www.ecole-nonviolence.org 5
Apprentissage des rgles Fiche n2
Annexe 2 : Un exemple de lois votes par le conseil de coopration au cours
de lanne scolaire 1991-1992
Coordination franaise pour la Dcennie www.decennie.org - Rseau Ecole et Non-violence www.ecole-nonviolence.org 6
Apprentissage des rgles Fiche n2
Loi 1 On ne se moque pas des autres.
Loi 2 On coute la personne qui parle.
Loi 3 Comportements drangeurs
Quand on est nomm
comportement-drangeur-une-fois , on reoit un avertissement;
comportement-drangeur-deux-fois , on quitte le groupe mais on reste en
classe;
comportement-drangeur-trois-fois , on quitte la classe et on travaille dans
le corridor jusqu' la fin de la priode;
comportement-drangeur-quatre-fois , on va s'asseoir ct du bureau de
la secrtaire pour le restant de la journe.
Loi 4 Quand on se fait faire mal, on peut demander une rparation. On prend
la mme liste de suggestions que celle de l'an dernier.
Loi 5 Si un enfant refuse de faire la rparation demande, on peut faire une critique
au conseil et celui-ci donnera deux rparations faire si l'enfant demandeur
avait raison d'exiger rparation.
Loi 6 On peut mcher de la gomme (sucre l'aspartame seulement) pour autant
qu'on la mche discrtement. Si Danielle (la matresse) voit la gomme, elle
le dit et l'enfant va la jeter la poubelle.
Loi 7 On doit faire un message clair avant de faire une critique au conseil.
Loi 8 C'est le gardien du ballon qui choisira l'enfant qui propose le jeu la
rcration de faon alterner garon et fille.
Loi 9 On peut rserver une place pour un ami quand on fait une activit o l'on
s'assoit sur le tapis.
Loi 10 Au travail aux tables, si un enfant nous drange, on lui fait d'abord un
message clair. S'il recommence, on le dit l'enseignante qui le nomme
drangeur.
Loi 11 En file ou en rang, celui qui va la chasse perd sa place
Loi 12 Quand un enfant est nomm drangeur trois ou quatre fois la dernire
priode de la journe, le temps d'exclusion est repris le lendemain.
Coordination franaise pour la Dcennie www.decennie.org - Rseau Ecole et Non-violence www.ecole-nonviolence.org 7
Vous aimerez peut-être aussi
- Améliorez Vos Compétences Interpersonnelles: Ce Que Les Autres Veulent Entendre - Comment Parler À N'Importe Avec Confiance...D'EverandAméliorez Vos Compétences Interpersonnelles: Ce Que Les Autres Veulent Entendre - Comment Parler À N'Importe Avec Confiance...Pas encore d'évaluation
- Tronc Commun: Connaissance Du Système Éducatif Sujet: Dans La Classe de CM1-CM2 Où Vous Enseignez, Plusieurs Élèves Hésitent Manifestement ÀDocument4 pagesTronc Commun: Connaissance Du Système Éducatif Sujet: Dans La Classe de CM1-CM2 Où Vous Enseignez, Plusieurs Élèves Hésitent Manifestement ÀvirginieperchetPas encore d'évaluation
- Une Methode de Resolution Des ConflitsDocument6 pagesUne Methode de Resolution Des ConflitsfaresjoelPas encore d'évaluation
- Notes de Cours SCTP TP 16 Et 17 Autorité Et Gestion de ConflitDocument8 pagesNotes de Cours SCTP TP 16 Et 17 Autorité Et Gestion de Conflitclaire.avenel76Pas encore d'évaluation
- Le Conseil D'élèves en Groupe ClasseDocument6 pagesLe Conseil D'élèves en Groupe ClasseTheLookinesisPas encore d'évaluation
- Hist Geo Article 1512Document4 pagesHist Geo Article 1512Alan LebianPas encore d'évaluation
- Une Aventure AutogestionnaireDocument8 pagesUne Aventure AutogestionnaireLu LarPas encore d'évaluation
- EMC Anim 2 Site CircoDocument50 pagesEMC Anim 2 Site CircoNourhene TurkiPas encore d'évaluation
- Fiches UD2 Mes App 2021 OMAR SERHANIDocument40 pagesFiches UD2 Mes App 2021 OMAR SERHANILahoucine El BaamraniPas encore d'évaluation
- Compréhension de L'oral 3AS P2 S2Document4 pagesCompréhension de L'oral 3AS P2 S2Omar SaotiPas encore d'évaluation
- Dossier Sanction Educative Actualise Sept 20Document14 pagesDossier Sanction Educative Actualise Sept 20emmanuel.wlomainckPas encore d'évaluation
- Compte Rendu de La Reunion Avec Les Parents de La 2D10 Du 15Document3 pagesCompte Rendu de La Reunion Avec Les Parents de La 2D10 Du 15nmezianePas encore d'évaluation
- 198 Les Conflits A lecole-GD44Document3 pages198 Les Conflits A lecole-GD44Bocar CoulibalyPas encore d'évaluation
- Stratégies Pour Créer Un Climat de Classe Motivant OCCEDocument1 pageStratégies Pour Créer Un Climat de Classe Motivant OCCEsahiepiphanie2.0Pas encore d'évaluation
- Pédagogie Milimaitre D'école Le Milimaitre D'ecoleDocument7 pagesPédagogie Milimaitre D'école Le Milimaitre D'ecoleFlorence Gabrielle TCPas encore d'évaluation
- Premiere Problématique Terminée - OdtDocument3 pagesPremiere Problématique Terminée - OdtCyrielle AutardPas encore d'évaluation
- Livret Delegues de ClasseDocument22 pagesLivret Delegues de Classeceliannivart74Pas encore d'évaluation
- Le Travail de Groupe Seminarski PDFDocument12 pagesLe Travail de Groupe Seminarski PDFDijana JovanovicPas encore d'évaluation
- Contes Sur MoiDocument5 pagesContes Sur MoiCTREQ école-famille-communautéPas encore d'évaluation
- Af Ue 8 Communication ProfessionnelleDocument61 pagesAf Ue 8 Communication ProfessionnelleZamZam DjamaPas encore d'évaluation
- Les Rencontres InterDocument5 pagesLes Rencontres InterLlouis PhysicsPas encore d'évaluation
- InstCivique Hachette C3Document64 pagesInstCivique Hachette C3Maitresse NathaliePas encore d'évaluation
- #LaClasse B1-UnitéDocument11 pages#LaClasse B1-UnitépaceinthePas encore d'évaluation
- Guide Du Délègué de ClasseDocument15 pagesGuide Du Délègué de ClassePascal ChaumardPas encore d'évaluation
- Séquence 0, OralDocument2 pagesSéquence 0, OralOuiss ZertPas encore d'évaluation
- Técnicas de Corrección 2Document47 pagesTécnicas de Corrección 2Cristela FrancésPas encore d'évaluation
- Quatre ScenariosDocument35 pagesQuatre ScenariosJanvier OctobrePas encore d'évaluation
- 2002 MermetDocument35 pages2002 Mermetعلى الله متوكلPas encore d'évaluation
- Comparative HibaDocument13 pagesComparative Hibaelqalebibtihal3Pas encore d'évaluation
- Devoir Du Module 4 Denitsa MihaylovaDocument3 pagesDevoir Du Module 4 Denitsa MihaylovaScribdTranslationsPas encore d'évaluation
- 20210325synthese RDV Du Lab Sylvain ConnacDocument3 pages20210325synthese RDV Du Lab Sylvain Connaccscqyr7wryPas encore d'évaluation
- 7 CommunicationDocument58 pages7 CommunicationHøüs SãmPas encore d'évaluation
- Debats Classe PDFDocument24 pagesDebats Classe PDFMohamed SrhirPas encore d'évaluation
- Livret Du DéléguéDocument31 pagesLivret Du DéléguébalthazarjbPas encore d'évaluation
- Resolution de ProblemeDocument12 pagesResolution de ProblemeYassine Sekkaf100% (1)
- Comment Ça Va Après Le ConfinementDocument3 pagesComment Ça Va Après Le Confinementaude.h4112Pas encore d'évaluation
- SDE APP Méthodologie 2024 01 19 05h20Document3 pagesSDE APP Méthodologie 2024 01 19 05h20BobuinPas encore d'évaluation
- Activites Brise GlaceDocument8 pagesActivites Brise GlaceDAGHAYPas encore d'évaluation
- Atelier Climat Scolaire 2Document26 pagesAtelier Climat Scolaire 2Olsen MalagaPas encore d'évaluation
- Détention ÉcriteDocument3 pagesDétention ÉcriteScribdTranslationsPas encore d'évaluation
- Méthode de Résolution Des PBDocument27 pagesMéthode de Résolution Des PBGislain KandaPas encore d'évaluation
- Planning Ados N12Document3 pagesPlanning Ados N12Elena AguileraPas encore d'évaluation
- Argumentation B Ours I ErDocument3 pagesArgumentation B Ours I ErLindeboom CamillePas encore d'évaluation
- Guide Du Parent Delegue CollegeDocument3 pagesGuide Du Parent Delegue CollegeapelsmuPas encore d'évaluation
- Techniques D Animation PDFDocument4 pagesTechniques D Animation PDFSomeonesokaPas encore d'évaluation
- Production ÉcriteDocument4 pagesProduction ÉcriteKhawla MehenniPas encore d'évaluation
- Sanctions Et Punitions Groupe 5 2017 2018Document13 pagesSanctions Et Punitions Groupe 5 2017 2018julientruffier46Pas encore d'évaluation
- QualitéDocument11 pagesQualitéSafae El YounsiPas encore d'évaluation
- Le CodeveloppementDocument3 pagesLe Codeveloppementalexisdouet53Pas encore d'évaluation
- SESION Leemos Un Afiche 21.6.23Document4 pagesSESION Leemos Un Afiche 21.6.23Cristina Matta EspinoPas encore d'évaluation
- Chapitre 2Document15 pagesChapitre 2clara.malardentiPas encore d'évaluation
- Les Réussites Au Cycle 1Document34 pagesLes Réussites Au Cycle 1HizenheimPas encore d'évaluation
- Galand Etude SanctionsDocument86 pagesGaland Etude SanctionsBaha RefuPas encore d'évaluation
- SujetDocument2 pagesSujetCristina Marin100% (1)
- Les Punitions À L'école Primaire: Haute Ecole Pédagogique BEJUNEDocument58 pagesLes Punitions À L'école Primaire: Haute Ecole Pédagogique BEJUNEgervaisg2012Pas encore d'évaluation
- Fiches D'Education Aux Droits de L'Homme Et A La Citoyennete (Edhc)Document24 pagesFiches D'Education Aux Droits de L'Homme Et A La Citoyennete (Edhc)Rogero ManagerPas encore d'évaluation
- CRPE Oral - Questions Et Mises en SituationDocument12 pagesCRPE Oral - Questions Et Mises en SituationHizenheimPas encore d'évaluation
- Livret Des Délégué 2023 2024Document12 pagesLivret Des Délégué 2023 2024tiagomtreport100% (1)
- CM1 Découverte Du ProfessoratDocument9 pagesCM1 Découverte Du Professoratcamille.houtmann.81Pas encore d'évaluation
- Conditions 9293201608290908468810 PDFDocument7 pagesConditions 9293201608290908468810 PDFscribdPas encore d'évaluation
- Se Preparer EUF 2001Document32 pagesSe Preparer EUF 2001scribdPas encore d'évaluation
- A Aaccent PDFDocument5 pagesA Aaccent PDFscribdPas encore d'évaluation
- KaizenDocument54 pagesKaizenEmmanuel Florestant100% (1)
- Ta 1tale Methodologie CompositionDocument3 pagesTa 1tale Methodologie CompositionAnge Aristide DjedjePas encore d'évaluation
- Notice Information Casse Et DommageDocument7 pagesNotice Information Casse Et DommagescribdPas encore d'évaluation
- 2010 13Document20 pages2010 13scribdPas encore d'évaluation
- Correction Francais Adjoint AdministratifDocument3 pagesCorrection Francais Adjoint AdministratifSébastien MunozPas encore d'évaluation
- Cond Facture Electro ENT Mai2015Document2 pagesCond Facture Electro ENT Mai2015scribdPas encore d'évaluation
- Facture Avoir PDFDocument20 pagesFacture Avoir PDFscribdPas encore d'évaluation
- 4 1 1 1 c2 Article Sur Facture Commerciale FRDocument3 pages4 1 1 1 c2 Article Sur Facture Commerciale FRscribdPas encore d'évaluation
- Exemple FactureDocument3 pagesExemple Facturescribd0% (1)
- Problemes Avec Addition Multiplication Et SoustractionDocument1 pageProblemes Avec Addition Multiplication Et SoustractionscribdPas encore d'évaluation
- SatellitesDocument8 pagesSatellitesKhalil BenPas encore d'évaluation
- Flyer Campagne Grippe Assurance MaladieDocument2 pagesFlyer Campagne Grippe Assurance MaladiescribdPas encore d'évaluation
- Audit Site Internet Exemple PDFDocument10 pagesAudit Site Internet Exemple PDFMohamed BourahlaPas encore d'évaluation
- Decret 2012 422 Aof CnhuhkmDocument20 pagesDecret 2012 422 Aof CnhuhkmscribdPas encore d'évaluation
- 2014422QPC2014422qpc DocDocument23 pages2014422QPC2014422qpc DocscribdPas encore d'évaluation
- Notice FreeplugDocument2 pagesNotice Freeplugnazca974Pas encore d'évaluation
- CC VoltaireDocument16 pagesCC VoltairescribdPas encore d'évaluation
- Ptgtzi 0 JW 8 DiaaiDocument2 pagesPtgtzi 0 JW 8 DiaaiscribdPas encore d'évaluation
- Notice Utilisation SLK ExterieurDocument42 pagesNotice Utilisation SLK ExterieurscribdPas encore d'évaluation
- POC FicheSpeTec FlyersDocument3 pagesPOC FicheSpeTec FlyersscribdPas encore d'évaluation
- Introduction À La Croyance Des Pieux Prédécesseurs (Salaf Salih) Envers Les Attributs DivinDocument11 pagesIntroduction À La Croyance Des Pieux Prédécesseurs (Salaf Salih) Envers Les Attributs Divinbismillah03Pas encore d'évaluation
- CR Conseil Ecole 120210Document4 pagesCR Conseil Ecole 120210scribdPas encore d'évaluation
- Six Points Du Parcours Du Prophete PDFDocument16 pagesSix Points Du Parcours Du Prophete PDFabu kayssaPas encore d'évaluation
- 1 Sourate La Fathia PDFDocument10 pages1 Sourate La Fathia PDFAzerty DelegfrPas encore d'évaluation
- Soyez Votre Propre Garde Du CorpsDocument70 pagesSoyez Votre Propre Garde Du CorpskanazikPas encore d'évaluation
- Resume Des Bonnes Regles Pour L Apprentissage Du CoranDocument69 pagesResume Des Bonnes Regles Pour L Apprentissage Du Coranscribd100% (1)
- UdeS Programme 710 20210124Document10 pagesUdeS Programme 710 20210124Wendell LopesPas encore d'évaluation
- Bibliographie Enseignement Maths 2019Document14 pagesBibliographie Enseignement Maths 2019Flash FacebookPas encore d'évaluation
- تقرير التقويم التشخيصي الثاني لغة فرنسيةDocument2 pagesتقرير التقويم التشخيصي الثاني لغة فرنسيةsalah idoubramePas encore d'évaluation
- Porfolio KONE NIOPEDocument44 pagesPorfolio KONE NIOPETechnologie G. Vision100% (1)
- Projet Multidisciplinnaire - 2023Document27 pagesProjet Multidisciplinnaire - 2023James MunagaPas encore d'évaluation
- Manuelcandidattoutes Declinaisons TCFDocument58 pagesManuelcandidattoutes Declinaisons TCFvovoji1355Pas encore d'évaluation
- Magmatisme Et Pétrologie MagmatiqueDocument30 pagesMagmatisme Et Pétrologie MagmatiqueOmatoukPas encore d'évaluation
- Document 2Document30 pagesDocument 2SOUAD BENABBESPas encore d'évaluation
- DHCP VMwareDocument12 pagesDHCP VMwareSOULEYMAN DEMBAPas encore d'évaluation
- CV AymarDocument1 pageCV AymarAymar Sylvère Anyou NnaPas encore d'évaluation
- Microtache D Observation CommentairesDocument3 pagesMicrotache D Observation CommentairesJeanne CarolinePas encore d'évaluation
- 1a - Being Amish - Quizlet List As A PDF Document 2Document2 pages1a - Being Amish - Quizlet List As A PDF Document 2yanis.kourabiPas encore d'évaluation
- Referentiel - Quaf Ac v2 2016 2Document14 pagesReferentiel - Quaf Ac v2 2016 2PhilippeMathieu PonsPas encore d'évaluation
- Exos JavaDocument55 pagesExos JavaMehdi ChoualPas encore d'évaluation
- Équipe de Formation Et Ateliers Jfle 2022Document5 pagesÉquipe de Formation Et Ateliers Jfle 2022Mercedes Caro GutiérrezPas encore d'évaluation
- Chap 1Document21 pagesChap 1Oussama AzPas encore d'évaluation