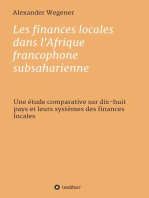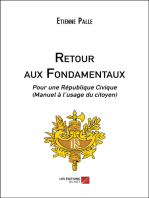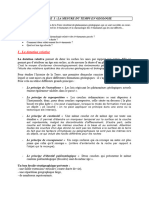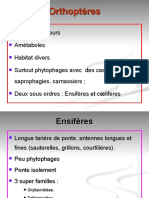Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Decentralisation Maroc PDF
Decentralisation Maroc PDF
Transféré par
SAA KHEMISSETTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Decentralisation Maroc PDF
Decentralisation Maroc PDF
Transféré par
SAA KHEMISSETDroits d'auteur :
Formats disponibles
[Année Universitaire]
Université
Mohammed
V-Souissi [2005]
[UFR Stratégies et gouvernance des organisations
Spécialité management stratégique]
Travail fait par :
Melle Dounia amid
Mme Hayate yadouni
Melle Asmaa el jawhari
Mr Abdellah el mahjoubi
Mr Rabii Wariaghli
2
Mot de l’éditeur
www.ledroitpublicmarocain.com est site marocain (à but non
lucratif) qui s’intéresse aux questions liées au Droit Public
au Maroc. Sa principale mission est la publication des cours
de droit public Marocain sur le Net facilitant ainsi la
recherche aux intéressés par cette discipline.
Si vous avez des cours, des mémoires et des documents
relatifs à ce droit (Marocain) et que vous désirez les partager
avec autrui, envoyez-les à l’adresse suivante :
fikribouchaib@ledroitpublicmarocain.com .
De notre côté, on s’engage à publier le document après
vérification du contenu et bien sûr indiquer la source du
document (Nom, Prénom, Établissement…).
Notre objectif est la constitution de la plus grande base de
données en droit public au Maroc, alors aidez-nous à le
faire.
Fikri Bouchaib : Administrateur du site (Al Waziir : Pseudo
site)
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
3
Sommaire
Introduction
I la décentralisation: aspects théoriques
I.1 les types de décentralisation
I.2 Eléments constitutifs de la décentralisation territoriale
I.2.1 les affaires locales
I.2.2 L’autonomie de gestion
I.2.3 l’indépendance des autorités locales
I.3 la vigilance préventive de l’Etat: le contrôle de la tutelle
II la décentralisation : l’expérience du royaume du Maroc
II.1 la pratique de la décentralisation au Maroc:
II.1.1 la décentralisation territoriale
II.1.2 la décentralisation fonctionnelle
II.1.3 la décentralisation structurelle
II.2 les limites de la mise en œuvre de la décentralisation
Conclusion
Bibliographie
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
4
« La décentralisation n'a pas
seulement une valeur
administrative; elle a une portée
civique puisqu'elle multiplie les
occasions pour les citoyens de
s'intéresser aux affaires publiques;
elle les accoutume à user de la
liberté.
Et de l'agglomération de ces
libertés locales, actives et
sourcilleuses, naît le plus efficace
contrepoids aux prétentions du
pouvoir central, fussent-elles étayées
par l'anonymat de la volonté
collective. »
Alexis de Tocqueville
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
5
Introduction
Au cours de l’histoire, les Etats pouvaient se constituer soit en Etat
unitaire soit en Etat fédéral.
L’Etat unitaire est un des aboutissements de l’affirmation de la
souveraineté royale les révolutions ont certes changé les modes
d’exercice du pouvoir.
Elles n’ont souvent pas modifie la structure centralisée de l’exercice de
celui-ci.
L’opposition entre l’Etat unitaire et l’Etat fédéral s’estompe peu du fait
de l’apparition dans les Etats unitaires d’un phénomène qui marque la
gestion de la chose publique, il s’agit de la décentralisation, si les Etats
fédéraux continuent comme cela semble être la loi de l’histoire dans la
voie de la centralisation et si les Etats unitaires continuent leur évolution
en sens inverse, on assisterait à un rapprochement au niveau de la forme
à un stade donné de ces deux structures.
Lorsqu’on parle des Etats unitaires il est important de signaler que leur
organisation administrative varie entre deux modalités principales :
- on peut dans un premier système nier l’existence juridique des
collectivités territoriales et concentrer dans ce cas la gestion à la
fois des affaires nationales et locales entre les mains du pouvoir
central. A ce système correspond la centralisation.
- On peut aussi au contraire dans un second système, reconnaître à
l’intérieur d’un même Etat, l’existence juridique des collectivités
locales ayant leur propre autonomie financière et disposant en
même temps d’organes propres leur permettant d’assurer la
gestion de leurs propres affaires. On peut parler alors de la
décentralisation.
La décentralisation s’est effectuée en Europe sous la forme de
régionalisation, à titre d’exemple : L’Italie l’Espagne et la France
Pour l’Italie la régionalisation est consacrée par la constitution italienne
de 1947, celle-ci prévoit la création de vingt régions : cinq régions à
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
autonomie spéciale et quinze régions a été lente et ne s’est achevée que 6
dans les années 1970.
Pour l’Espagne la constitution du 29 décembre 1978 institue une
régionalisation donnant aux différentes communautés territoriales le
droit de s’organiser en entités autonomes.
Elle prévoit les modalités d’accès à l’autonomie, l’organisation des
institutions régionales et leurs compétences.
Pour la France, la décentralisation prévue par la loi du 29 mars
1982 est considérée comme l’une des grandes innovations qu’a connues
la république. Cette loi a en réalité introduit des reformes aussi au
niveau communal départementale que régionale.
La France est depuis lors l’un des rares Etats structures à quatre
niveaux. Le département venant s’intercaler entre la commune et la
région.
Si on revient au terme décentralisation on va constater qu’il est
moins précis que ceux qui désignent la même idée " self –government", "
local government" dans les pays anglosaxones ou " selbstverwaltung"
en droit allemand ce qui veut dire littéralement pouvoir s’administrer
soit même ou auto administration.
Cependant la décentralisation se présente comme une politique
dans le quel les pouvoirs de décision sont remis sur l’ensemble du
territoire a des organes qui ne sont pas des agents du pouvoir central
mais qui sont les représentants des sujets intéressés, cette politique
s’inspire des valeurs de la démocratie parce qu’elle permet justement à
faire participer les administres à la gestion des affaires qui les concernent
directement.
Ce manuscrit traitera la décentralisation à deux niveaux, en
premier il touche les aspects théorique concernant les éléments
constitutifs de la décentralisation ces types et en deuxième il surplombe
l’expérience de la décentralisation par ces formes politique fonctionnelle
et structurelle.
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
I la décentralisation: aspects théoriques 7
Etant donné que la décentralisation suppose la reconnaissance par
le pouvoir central d’entités dotées d’attributions leur permettant de
s’autogérer tout en espérant la réalisation d’intérêts propres ou le
développement de ceux déjà existants, il faudrait l’existence sur place de
moyens organisationnels, juridiques et de contrôle de ces entités
décentralisées .
I.1 les types de la décentralisation :
Le vocabulaire pour désigner les différents types de
décentralisation n’est pas bien fixé. Il arrive souvent qu’il y ait confusion
de sens dans les termes utilisés. Le degré de décentralisation variera
selon les différentes modalités d’application des attributions déléguées
aux instances décentralisées. Par ailleurs Il est cependant possible de
ranger la décentralisation en quatre catégories différentes:
- la déconcentration c’est une décentralisation décisionnelle administrative
(à ne pas confondre avec la déconcentration au niveau du palais au Maroc et à
ne pas confondre avec la décentralisation fonctionnelle dont la forme est plus
qu’une déconcentration de sorte que l’entité décentralisée est dotée de la
personnalité morale et néanmoins d’un patrimoine ces deux éléments seront
abordés dans la deuxième partie )
l’entité décentralisée est dépendante du gouvernement central et n’est
pas doté de la personnalité morale, dans les systèmes déconcentrés, des
personnels et des ressources sont transférés du siège vers des bureaux
territoriaux, sous l’autorité de hauts fonctionnaires habilités à prendre
des décisions opérationnelles sans en référer préalablement au siège. Les
bureaux déconcentrés sont responsables devant le pouvoir central et
sont encouragés à proposer des plans et budgets de travail. Toutefois le
pouvoir central a la responsabilité exclusive d’approuver et de financer
ces derniers.
- la délégation des compétences (la décentralisation fonctionnelle)
c’est le transfert des compétences qui était dans le registre du
gouvernement à une entité décentralisée uni sectorielle dotée d’une
personnalité morale, Des agents n’appartenant pas à l’administration
publique peuvent être délégués par le gouvernement central pour
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
exercer des fonctions spécifiques. Les agents délégués jouissent d’une 8
marge appréciable d’autonomie dans l’exercice de leurs fonctions, y
compris en ce qui concerne la passation de marchés et la gestion de
personnel. Ils peuvent disposer de sources de revenu autonomes, et
peuvent emprunter sur les marchés financiers. Le gouvernement central
définit les objectifs des entités décentralisées délégués et transfère des
ressources à leur intention sur la base des plans et des budgets
approuvés.
- la dévolution (la décentralisation politique)
Des responsabilités et des ressources sont transférées aux pouvoirs
locaux qui jouissent d’une autonomie considérable de décision sur la
manière d’utiliser ces ressources dans leur domaine de compétence. Sous
un régime effectif de dévolution, les pouvoirs locaux ont à répondre
devant leurs assemblées élues (plutôt que devant le gouvernement
central) de la manière dont ils affectent les fonds qui leurs sont
transférés, et sont responsables devant l’électorat de l’exécution des
prestations de services. Sous un régime de dévolution, les pouvoirs
locaux sont investis du pouvoir de lever un impôt local, et le transfert
financier du gouvernement central se fait normalement sous forme de
subventions paritaires qui stimulent la mobilisation locale de ressources.
- la privatisation (décentralisation structurelle)
c’est une forme de décentralisation qui tend plus vers l’indépendance de
plus d’envergure et c’est lorsque le gouvernement central procède à
privatiser des établissements publiques, le financement peut provenir du
centre parfois est la l’autonomie n’est pas complète.
On trouve dans les tableaux ci dessous un résumé de l’aspect
théorique des caractéristiques des attributions des organisations
décentralisées ainsi que les situations juridiques des organes non
centraux.
I.1.1 décentralisation politique
I.1.1.1 en quoi consiste-t-elle ?
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
La décentralisation est dite politique ou territoriale lorsque les 9
dirigeants de l'instance décentralisée sont élus au suffrage universel,
lorsque cette dernière est dotée de revenus autonomes et qu'elle exerce
ses responsabilités sur un territoire déterminé.
Pour cerner de manière étroite les traits généraux de la
décentralisation territoriale, une grille d’analyse à trois niveaux
d’appréciation est proposée : niveau politique, niveau institutionnel et
niveau de performance.
1. Sur le plan politique, la décentralisation a un statut privilégié:
consacrée par la constitution, elle façonne la vie démocratique de par
elle est façonnée en y devenant un élément essentiel pour sous-tendre
l’amélioration de l’indépendance à l’égard du pouvoir central en terme
d’investiture et dés investiture, supposant in fine que l’entité objet de
décentralisation renferme un réservoir d’élites qui permet
l’élargissement du cercle des personnes initiées aux exigences que pose
la gestion de chose publique.
2. Sur le plan institutionnel, une politique territoriale diversifiée est
engagée par le Maroc donnant naissance par touches successives à un
édifice à trois étages : niveau communal, provincial et régional.
3. La question de la performance des collectivités locales est sujet de
contraste selon la collectivité concernée. Il s’agit de la capacité de ces
entités à répondre aux besoins individuels et collectifs des populations
dont elles sont en charge dans les limites des compétences légales et des
moyens budgétaires à leur disposition.
I.1.1.2 Quelques interprétations réelles :
• La création des communautés autonomes en Espagne
• Les lois Defferre en France au début des années 1980
• La charte communale au Maroc
I.1.2 la décentralisation fonctionnelle
I.1.2.1 en quoi consiste-t-elle ?
La décentralisation est dite fonctionnelle lorsque le gouvernement
dote un organisme d'une personnalité juridique distincte et lui confère
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
des responsabilités et des fonctions par lois particulières, tout en 10
maintenant des liens de subordination importants.
L’Etat s’en remet souvent à des établissements publics pour relayer
son action. Il s’agit là d’une autre forme de décentralisation puisque
l’Etat transfère à des personnes juridiques distinctes, des compétences
qu’il exerçait. Ces personnes juridiques n’ont pas d’assise territoriale. On
parle alors de décentralisation fonctionnelle.
cette décentralisation est faite par services à des entités dites
établissements publics ; il s’agit d’institutions administratives à caractère
autonome d’un patrimoine distinct, chargées d’assurer un service public
ou un ensemble de services publics.
Deux limites à leur autonomie : le principe de spécialité (leur activité est
limitée au service qui leur est confié) et la tutelle exercée par l’autorité
administrative dont ils dépendent.
I.1.2.2 Quelques interprétations réelles
• Le système scolaire public à Baltimore
• Le système scolaire public en Australie-Occidentale
• Les régies régionales de la santé et des services sociaux au
Québec
I.1.3 la décentralisation structurelle
I.1.3.1 en quoi consiste-t-elle ?
C’est un autre aspect de la décentralisation, La décentralisation
structurelle, ou privatisation, est le type de décentralisation le plus
poussé. Il consiste à transférer dans le domaine privé des organisations
du domaine public. Sous cette forme, l’indépendance est totale. Il peut
également s’agir de confier à des organisations privées des fonctions
habituellement remplies par des organisations publiques.
Les compétences de ces organisations sont la plupart du temps uni
sectorielles et ces dernières disposent de toutes les fonctions dans l’usage
de leurs compétences. Le financement est complètement autonome dans
le cas d’une privatisation complète. Des subventions étatiques
demeurent toutefois possibles. Au Canada, c’est le cas de VIA Rail dans
le secteur du transport de personnes par train au Maroc c’est l’exemple
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
de la régie de tabac. Dans d’autres cas, le financement peut provenir en 11
partie du centre et l’indépendance ne sera alors pas tout à fait complète.
En ce qui concerne l’autorité, l’autonomie est très grande et les dirigeants
sont désignés par l’organisation elle-même.
I.1.3.2 Quelques interprétations réelles:
• La privatisation de British Telecom
• La privatisation de TF1
• La privatisation de la régie de tabac
• La privatisation de Maroc Telecom
• La sous-traitance dans les prisons du Tennessee
Caractéristiques des attributions des organisations décentralisées
Caractéristiq Décentralisation Décentralisation Décentralisation Décentralisation
ues Administrative fonctionnelle politique structurelle
de (déconcentratio (délégation) (dévolution) (privatisation)
l’organisatio n)
n
décentralisée
Statut Organisation Organisation Organisation Organisation
très assez assez plus ou moins
dépendante par dépendante par peu dépendante dépendante par
rapport à une rapport à une par rapport à rapport à une
organisation organisation une Organisation
centrale centrale organisation centrale
centrale
Compétences Généralement Uni sectorielles, Multisectorielle Uni sectorielles,
uni sectorielles, pour s, pour
pour des fonctions pour l’ensemble l’ensemble des
plusieurs bien des fonctions
fonctions définies fonctions
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
Financement Les recettes Les recettes Les recettes, Les recettes12
viennent viennent surtout généralement, viennent du
entièrement du du centre ou viennent surtout centre (sous-
centre Selon le surtout de la de la base traitance) ou de la
cas base base
Autorité Désignation par Désignation par Désignation par Désignation par
le le la le
centre, et centre ou par la base, et sommet, et
pouvoirs base, et pouvoirs dans pouvoirs
dans pouvoirs dans l’adoption (lois dans l’adoption
l’application l’adoption ou règlements) (résolution) ainsi
(lois ou (résolutions) ainsi que dans que
règlements) ainsi que dans l’application dans
l’application l’application
Lemieux, Vincent, Décentralisation, politiques publiques et relations de pouvoir,
Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal,
Situations juridiques des organes non centraux par rapport a l’organe
central
Pouvoir central
Organe non Investiture Desinvestiture Modalités
central
Situation 1 Dépendance Dépendance Déconcentration
Situation 2 Semi
Formule 1 Indépendance Dépendance dépendance
(décentralisatio
Formule 2 Dépendance Indépendance n imparfaite)
Indépendance
(décentralisatio
n imparfaite)
Situation 3 Indépendance Indépendance Décentralisation
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
Jacques Baguenard la décentralisation que sais je ? 1985 (presses 13
universitaire de Fra
Le degré de décentralisation avec l’évolution du transfert de
pouvoir
Reformulation du tableau :
Décentralisation décisionnelle + décentralisation géographique =
décentralisation parfaite pour le périphérique et concentration absente au centre
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
Centralisation décisionnelle + décentralisation géographique = décentralisation 14
légère pour le périphérique et concentration légère au centre (déconcentration
pour le périphérique et décentralisation de vigilance)
Décentralisation décisionnelle + centralisation géographique = décentralisation
absente pour le périphérique mais concentration légère au centre
(déconcentration au sein du centre)
Centralisation décisionnelle + centralisation géographique = décentralisation
absente pour le périphérique et concentration pure au centre
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
I.2 Eléments constitutifs de la décentralisation politique 15
vue son omniprésence dans la littérature qui prend la
décentralisation comme sujet la décentralisation territoriale dans le
cadre de sa théorie juridique la décentralisation territoriale a des
éléments constitutifs.
I.2.1 les affaires locales:
Dans le cadre de la théorie juridique de la décentralisation Parmi ces
conditions , il y a reconnaissance de la loi et de la constitution de la
personnalité morale de droit public autre que l’Etat, cette reconnaissance
implique que les pouvoirs publics admettent l’existence, a cote des
intérêts collectifs communs a tous les citoyens, des besoins locaux
spécifiques dont la gestion est confiée aux intéressés (Ex : transports
urbains, distribution d’eau et d’électricité dans les communes) la
reconnaissance d’une catégorie des affaires locales distinctes, des affaires
nationales comme le précisent certains auteurs est la donnée première de
toute décentralisation, ainsi cette donnée reflète l’existence d’intérêts
locaux dont les décisions de gestion et les moyens a mobiliser impliquent
uniquement la collectivité locale sans l’intervention des pouvoirs
centraux..
Cependant, le problème qui se pose est de savoir comment
déterminer la répartition des affaires et, partant, des attributions entre
l’Etat et les collectivités locales. Deux techniques s’offrent au choix du
législateur :
- La première consiste à réserver des matières limitativement
ennuyeuses à l’initiative locale. Cette solution se heurte cependant
a des difficultés dont la non moins importante tient à
l’établissement d’une liste des affaires locales. Dans ces conditions
ce n’est ni la nature ni l’objet de la matière qui justifie l’attribution
d’une compétence, mais un choix politique.
- La deuxième technique implique que l’on reconnaisse aux
collectivités locales une compétence qui s’étend à toutes les affaires
de caractère local. C’est cette dernière solution qui est
généralement considérée comme la meilleure garantie de
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
l’autonomie locale. C’est celle qui a été retenue par le législateur 16
marocain.
Cependant les difficultés ne sont pas pour autant aplanies car la
précision apparente de cette deuxième technique ne doit pas faire
illusion. En fait, la distinction entre intérêt national et intérêt local ne se
fonde sur aucun critère objectif. Il n’existe pas d’affaires qui soient
"locales" ou "nationales" par nature. La détermination des affaires locales
trouve son fondement dans la loi. Elle dépend de tout un ensemble de
facteurs dont les importants sont la nature du système politique et le
niveau de développement économique et social d’un pays à un moment
donné. De sorte qu’actuellement, aussi bien dans les pays développé que
dans les pays sous développé, on assiste à une imbrication étroite des
intérêts locaux et des intérêts nationaux. L’interpénétration des deux
sortes d’intérêts est cependant plus accentues dans les pays en
développement caractérisés par une insuffisance des moyens et par une
inégalité croissante entre les collectivités locales. Des lors, il n’est pas
étonnant qu’on y insiste beaucoup plus sur l’association des différents
groupements à l’effort du développement national que sur une
répartition rigoureuse des matières entrant dans les compétences de
chaque collectivité.
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
I.2.2 l’autonomie de gestion: 17
L’indépendance des organes locaux du pouvoir central est une
condition pour l’exercice de la gestion des affaires locales, ces organes
doivent disposer d’une réelle autonomie fonctionnelle ainsi que la
personnalité juridique.
I.2.2.1 la personnalité juridique
L’octroi aux collectivités décentralisées de la personnalité morale est une
condition de la décentralisation découlant de la reconnaissance des
affaires locales cette condition permet de distinguer la collectivité locale
de la simple circonscription administrative comme l’arrondissement par
exemple.
De manière très simple, on entend par personne morale, toute personne
juridique, c'est-à-dire tout sujet de droits et d’obligations, autre qu’un
être vivant.
La personnalité morale constitue le fondement de l’autonomie d’une
institution, elle lui permet ainsi d’agir comme sujet de droits public
parmi les autres sujets en ce sens que chaque sujet a ses droits et ses
obligations et ses biens.
La personne morales peut passer des contrats, passer en justice, et elle
peut aussi avoir un patrimoine.
Les éléments de la personnalité morale sont comme suit :
- L’élément humain : une personne morale groupe en effet un
ensemble de personnes qui ont entre elles un lien commun. Ce lien
et constitue par l’existence d’un intérêt collectif qui peut être de
nature très variable.
- La personnalité morale comporte par ailleurs un but à poursuivre,
une mission à accomplir et cet élément est très remarquable dans la
personnalité morale de droit public.
- Toute personne morale suppose une organisation, c'est-à-dire des
organes de direction et de gestion qui lui permettent d’assurer sa
participation à la vie juridique.
- La personne morale n’est pas, comme les personnes physique,
limitée par la durée de la vie toute fois sa participation à la vie
juridique est limitée en fonction de la nature de son activité. Elle ne
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
me peut pas exercer que les activités qui s’accordent avec l’objet et 18
le but de sa mission. Elle est régie par "le principe de spécialité".
Enfin l’attribution de la personnalité morale exige une intervention
d’une autorité publique normalement de l’autorité législative.
L’intervention de l’autorité publique fonde ainsi l’existence de la
personnalité morale soit directement soit en fixant les conditions aux
quelles les particuliers devront satisfaire pour créer une personne morale
d’un certain type.
I.2.2.2 l’autonomie financière
La décentralisation suppose que les collectivités locales objet de
décentralisation disposent d’une autonomie financière celle-ci a une
double signification théorique et pratique :
- Pour la première, l’autonomie financière apparaît comme le
corollaire direct de la personnalité morale : des l’instant qu’une
personne morale est reconnue en droit, elle doit avoir un
patrimoine propre et un budget propre. L’autonomie financière au
sens juridique du terme suit nécessairement la personnalité morale.
- Pour la deuxième, l’autonomie financière signifie aussi sur le plan
pratique la possibilité pour la collectivité décentralisée de se
procurer des ressources et de choisir leur emploi. A ce sujet, on
doit remarquer que les ressources mises a la disposition des
collectivités locales sont la plus part du temps en quantités
insuffisante de sorte qu’elles restent tributaires de fonds provenant
essentiellement de l’Etat et dont l’emploi est contrôle par celui-ci,
ce qui ôte toute signification a la décentralisation au sens vrai du
terme.
On constate ainsi que les subventions de l’Etat représentent une part
très importante dans les budgets des collectivités locales par rapport à
leurs ressources propres.
Les collectivités locales sont également autorises a recourir a
l’emprunt pour la réalisation de projets économiquement ou
financièrement rentables. Elles peuvent demander ainsi des prêts a des
organismes institues spécialement a cet effet comme le fonds
d’équipement communal. Dans un cadre du renforcement des moyens
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
financiers des collectivités locales, on doit signaler l’affectation de 30% 19
du produit de la TVA au budget de ces dernières. L’importance de cet
impôt et le rythme de son évolution, ont permis aux collectivités locales
de réaliser leur autonomie financière et de compter sur une ressource de
péréquation capitale malgré l’irrégularité des distributions effectuées
jusqu'à présent pour des raisons de conjoncture. La TVA procure aux
finances locales un niveau de croissance annuelle très appréciable.
A la fin il faut signaler que même pour les pays ou s’est accentue la
littérature de la décentralisation et le royaume du Maroc comme
exemple (le dahir portant loi de 30 septembre 1976) on constate une série
de contrôles sur le budget des collectivités locales faisant partie d’un
ensemble de contrôles exerces quotidiennement par le pouvoir central
sur ces dernières dans le cadre de ce qu’on appelle communément
tutelle. La tutelle constitue, peut on dire, une limite non seulement a
l’autonomie locale mais aussi a la décentralisation elle-même.
I.2.3 l’indépendance des autorités locales
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
Pour qu’il y ait décentralisation il faut que les affaires locales qui 20
sont gérées d’une façon autonome soient prises par des autorités
indépendantes du pouvoir central c'est-à-dire que les organes locaux
exerce une certaine autorité dans un cadre de compétence qui
correspond aux spécificités de l’affaire locales sont qu’ils craignent une
intervention de la part du pouvoir central pour influencer son
autonomie fonctionnelle , cette indépendance se voit un préalable pour
cette autonomie de ces organes non centraux.
L’agent d’autorité locale a la mission de renforcer la
décentralisation et veiller à la consolidation du processus de
démocratisation des institutions locales, veiller aussi sur la bonne
marche des services publiques le respect des droits de l’homme la
sécurité locale gère l’état d’urgence lors d’une calamite qui affecte aussi
le découpage géographique locale.
Mais une question est soulevée sur la réelle indépendance de ces
autorités dans la réalité empirique de décentralisation du pouvoir
central, du fait de leur nomination et révocation, ces deux derniers et
selon leur combinaison donneront une vue sur cette indépendance.
Par ailleurs on peut faire une analogie pour la décentralisation
fonctionnelle de sorte que les affaires locales deviennent le service public
l’autonomie de gestion et l’autonomie de gestion de l’établissement
public et l’indépendance des autorités locales est l’indépendance du
gérant de l’établissement public et la tutelle reste exercée.
I.3 la vigilance préventive de l’Etat: le contrôle de la tutelle sur
l’entité décentralisée
D’une manière générale la tutelle administrative peut se définir
comme le contrôle administratif exerce par le pouvoir central sur
l’organisation et le fonctionnement des collectivités décentralisées.
L’objet principal de la tutelle administrative est de caractériser l’unité de
l’Etat a travers cette pratique, de veiller au respect de la légalité par les
collectivités territoriales et de protéger enfin les administres contre les
excès possibles des autorités locales.
La tutelle administrative doit par ailleurs se distinguer du contrôle
hiérarchique, celui-ci est exerce par un chef sur ses subordonnes, il a un
caractère inconditionné puisque le supérieur peut donner tous les ordres
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
a la seule condition qu’elles ne soient pas illégaux. Le pouvoir de tutelle 21
implique le rapport d’un contrôleur (autorité de tutelle de l’organe
central) et d’un contrôle (autorité sous tutelle de l’organe non central.
Le contrôle de tutelle peut s’exercer soit sur les personnes soit sur les
actes.
I.3.1 la tutelle sur les personnes :
Le pouvoir central dans le cadre de la tutelle peut perdre des
mesures qui peuvent aller de la suspension à la dissolution.
I.3.1.1 la suspension :
elle touche les personnes qui ont la qualité de gérer l’entité
décentralisée lorsque il y a défaillance qui touche a la bonne marche de la
politique de la décentralisation au sein de cette entité (les conseils
communaux régionaux et les présidents de ces entités)
I.3.1.2 la démission d’office :
si on prend l’exemple du province qui sera aborde dans la
deuxième partie, un conseiller provincial peut en effet être demis par le
gouverneur dans le cas du Maroc, cette mesure dans le même exemple
peut affecter un conseiller communal en cas d’absence a 3 sessions
consécutives
I.3.1.3 la dissolution :
la tutelle s’exerce enfin pour la dissolution qui touche l’ensemble
des membres des assemblées, c’est lorsqu’il y a pas une réussite a la
gestion de l’entité décentralisée
I.3.2 la tutelle sur les actes :
On peut distinguer le contrôle de légalité et d’opportunité.
I.3.2.1 le contrôle de légalité :
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
Il y a lieu de distinguer la nullité de plein droit et l’annulabilité. 22
* la nullité : elle sanctionne les décisions portant sur un objet
étranger aux attributions des conseils des organes décentralisés ou
violant les textes en vigueur
* l’annulabilité : elle concerne la déclaration a la quelle avait pris
par un conseiller intéresse soit en son nom personnel soit comme
mandataire.
I.3.2.2 le contrôle d’opportunité :
l’appréciation de l’opportunité de certains délibérations des
collectivités décentralisées est une autre modalité de contrôle entre les
mains du pouvoir central, il s’agit non pas de savoir si les décision prises
par l’organe décentralisée respectant la loi ou non mais si elles sont
conformes ou non aux objectifs poursuivi par le pouvoir central plus
précisément les actes des collectivités locales ne doivent en aucun cas
s’opposer a l’intérêt général qu’assure le pouvoir central.
I.3.2.3 le pouvoir de substitution :
c’est une forme particulièrement rigoureuse de contrôle de tutelle.
Il concerne principalement le budget des collectivités locales.
Ainsi tout refus par les conseillers de voter une dépense obligatoire
donne droit au pouvoir central la procédure de l’inscription d’office.
Le mécanisme de substitution est mis en œuvre chaque fois que le
président du conseil communal refuse de perdre un acte qui lui est
légalement imparti, dans ce cas l’autorité locale peut se substituer
d’office.
II la décentralisation : l’expérience au Maroc
II.1 la pratique de décentralisation au Maroc:
II.1.1 la décentralisation territoriale
Dans le cadre de la gestion des affaires publiques, le Maroc a connu,
à l’instar des autres payes modernes plusieurs modes de gestion dont la
décentralisation constitue le modèle le mieux apprécié. Cependant avant
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
d’y parvenir, il a comme aussi d’autres procédés qui ont continué à 23
coexister.
A- Aperçu général
Depuis la première précoloniale jusqu’à présent, le Maroc ne cesse
d’améliorer les systèmes de gestion de ses affaires, bien qu’à des degrés
et des manières différents et ce selon les circonstances sociopolitiques.
Il convient alors de donner un aperçu historique de ce processus,
avant d’entamer l’objet principal de cette partie, à savoir le
décentralisation au maroc.
1- Données historiques :
Il y a lieu de distinguer trois périodes principales. Celle d’avant le
protectorat, puis celle du protectorat et enfin celle de l’indépendance.
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
24
L’administration Marocaine d’avant le protectorat, et surtout vers la
fin du 19ème siècle, où le sultan My Hassan premier a introduit des
réformes, se caractérisait par des structures moins diversifiées et moins
complexes aussi bien pour le pouvoir central ou le « Makhzen » que pour
l’administration locale.
Le territoire national était composé de « Bled el Mekhzen » et « Bled
Siba », sans pour autant que des frontières n’y étaient définitivement
fixées.
Si au niveau central, le Sultan déléguait certains de ses pouvoir aux
quelques « vizirs », localement, il y avait deux situations distinctes. Celle
de Bled siba où les tribus géraient leurs affaires elles même par la
« Jmaa » qui était une sorte d’assemblée de chefs de familles et de
notables, choisis souvent par cooptation, dont le président « l’amghar »
était désigné pour une armée et constituait l’organe d’exécution des
décisions de la Jmaâ.
Cette situation d’autonomie ne signifiait jamais que ces tribus
vivaient dans l’anarchie ou qu’elles étaient en dehors de l’empire, mais
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
tout simplement qu’elles s’autogéraient et qu’elles échappaient souvent 25
au paiement des impôts, cependant les attributions de la Jmaâ
s’étendaient uniquement aux questions intéressant le groupe.
Quant au Bled El Mekhzen, le pouvoir central était représenté
différemment à deux niveaux.
Au milieu urbain, le gouverneur ou le pacha, dont les compétences
étaient générales, étaient chargé du maintien de l’ordre public, de
l’exécution des dahirs sultanaires en matières pénales, <etc. cette
autorité étaient assistée par le « Mohtassib », nommé par le seltan parmi
les « Oumana » des métiers, et chargé quant à lui du maintien de l’ordre
public économique, notamment le contrôle de la qualité, la sanction des
contrevenants, la propriété des villes, <etc.
Au milieu rural, c’était le « laid » et ses auxiliaires les « chioukhs »
dont les compétences étaient d’autant plus générales qu’elles n’étaient
pas définies par les textes.
On déduit alors, qu’à l’exception de la Jmaâ où les membres et le
présidents étaient choisis parmi la population locale et par elle même
pour le gestion des affaires locales que les autres autorités dépendaient
directement du pouvoir central et avaient des compétences générales et
des limites indéterminées.
A son entrée au Maroc, le protectorat va préserver le modèle
makhzanien, bien qu’il aille lui juxtaposer son style administratif.
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
26
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
27
Par le traité de Fès du 30/19/12, les autorités coloniales ont entrepris
des réformes administratives dont les conséquences étaient la
juxtaposition d’institutions makhzaniennes et d’autres d’inspiration
étrangère au Maroc.
Si le traité stipulait que l’autorité du sultan ne soit pas contestée et
que soit sauvegardée la valeur d’Etat de l’empire chérifien, il n’en
demeure pas moins que les institutions coloniales aussi bien centrales
que locales ou plutôt régionales, avaient pour finalité beaucoup plus de
servir les intérêts de la puissance dominante que de faire face aux
exigences du développement socio-économique du pays dominé.
Au niveau central, le protectorat a institué de nouvelles structures à
côtés des services traditionnels de l’administration impériale, à savoir les
directions, dont les compétences valent s’élargir au fil des années
parallèlement aux interventions grandissantes de l’Etat dans le domaine
économique.
Pour les services extérieurs, ou trouvait deux niveaux
d’administration, un niveau régional et l’autre local.
Certes la région a été une innovation du protectorat, mais seulement
pour servir ses intérêts et renforcer sa domination, puisqu’à sa tête se
trouvait le chef de région nommé par le résident général sans aucun
représentant du sultan à ses côtés.
Localement, l’administration traditionnelle était représentée par le
pacha ou le caïd. Mais au fil du temps , ces derniers devinrent des
fonctionnaires nommés par le pouvoir central. Leur dépendance se
renforcer par la soumission des arrêts réglementaires qu’ils prenaient en
matière des prix de certains produits aux souks locaux.
Conscient des insuffisances du système traditionnel et des acquis
même du modèle administratif implanté par le protectorat, le Maroc
indépendant devrait opter pour une solution susceptible de relancer le
développement socio-économique déjà retardé par le protectorat voir
même fragilisé.
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
28
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
Depuis l’indépendance, le Maroc était conscient des défis socio- 29
économiques qu’il a à surmonter. Il développerait alors adopter des
politiques adéquates.
Sans opérer des changements radicaux aux structures
administratives héritées du protectorat, progressivement le Maroc optera
des réformes politiques et administratives dont la décentralisation
constitue jusqu’à présent le meilleur moteur de développement social,
économique et culturel.
C’est ainsi qu’en 1960, le processus de décentralisation
administrative sera appliqué au niveau commutions pour qu’en 1963 il
s’étendra au niveau provincial et préfectoral puis enfin vers la fin du
20ème siècle, et plus précisément en octobre 1997 touchera les régions.
Toute fois, il serait nécessaire d’émettre des réserves quant au degré
de décentralisation par rapport à chaque niveau de ces trois entités
administratives que sont respectivement, les communes, les provinces et
préfectures et les régions, aussi bien quant à leurs moyens, que leurs
compétences qu’en fin à leurs réalisations.
Tous les schémas sont tires de la communication du Pr. Saïd CHIKHAOUI
A la CONFERENCE INTERNATIONALE Berlin les 13 et 14 septembre 2000
DIMENSION DE LA DECENTRALISATION AU MAROC entre le poids du passé et
les contraintes de l’avenir
B- Décentralisation territoriale au Maroc :
Si la décentralisation territoriale suppose théoriquement la
possibilité offerte par l’Etat à des groupements humains de se faire
administrer en les dotant de moyens humains et financiers sous un
certain contrôle, au Maroc comme d’ailleurs dans d’autres pays cette
théorie n’est rigoureusement respectée du mois à certains niveaux.
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
1- Au niveau communal : 30
Bien que la décentralisation communale a vu le jour au Maroc en
1960, le dahir du 30 Septembre 1976 a constitué pour les communes un
point d’inflexion mais surtout positif, par rapport aux autres entités
administratives de l’époque, à savoir les provinces et préfectures, tout
pour ce qui est des moyens que pour ce qui est des organes de
fonctionnement.
D’ailleurs, c’est à partir de 1976 que des compétences indispensables
dans le système décentralisé, exercées représentantes du pouvoir central,
seront transférés aux conseils communaux, notamment pour ce qui est
de la police administrative, de l’exécution du budget communal et des
délibérations du conseil et ce par le président élu.
Ce transfert sera renforcé dans la nouvelle charte communale du 03
octobre 2002 surtout par la détermination avec plus de précisions des
compétences des conseil communaux et de leurs organes et l’allègement
de la tutelle.
En ce qui concerne les moyens humains, les communes disposent
désormais de leur propre personnel rémunéré directement sur le budget
communal et portant lié hiérarchiquement à elles.
Quant aux moyens financiers, les communes qui disposent, en
principe, d’un budget, l’élaborent elles même par le biais de leurs
conseils suivant leurs propres ressources et pour la satisfaction des
besoins des populations qui en relèvent, sans que cela les empêche de
bénéficier, le cas échéant, des surventions de l’Etat sous formes de leur
pont dans les impôts ou taxes nationaux comme la TVA. A signaler que
cette part est calculée selon plusieurs critères, notamment la population,
le degré de recouvrement des recettes communales< etc.
Le budget communal étant voté par le conseil, il est exécuté après
approbation par l’autorité de tutelle compétence. L’exécution est confiée
au président du conseil communal lequel est élu parmi les membres du
dit conseil. Ces derniers étant à leur tour élus auparavant au suffrage
universel direct à un tour au scrutin de liste ou nominatif selon les
circonstances électorales, par les citoyens relevant de la commune et
habilités à voter.
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
Toutefois le contrôle de tutelle ne se résume pas à l’approbation du 31
budget, mais concerne également les personnes par le pouvoir de
suspension, de démission d’office de la révocation ou de la dissolution,
ou encore les actes par le contrôle de légalité, d’approbativité ou par le
pouvoir de substitution.
Le contrôle financier est prévu à deux stades, à priori par les
autorités locales ou centrales respectivement et conjointement du
ministère de l’intérieur et du ministère des finances. Le contrôle à
posteriori est exercé par la cour des comptes ou les cours régionales des
comptes.
Si alors l’autonomie des communes quant à leur gestion est eu
principe protégée par la loi, le pouvoir de tutelle peut être parfois opposé
à ce principe.
C’est ainsi que le soumission des délibérations des conseils
communaux à l’approbation, et ne sont exécutoires qu’à cette condition
fait du contrôle de tutelle une sorte de participation.
2- Au niveau provincial et préfectoral :
Bien que le Maroc n’a jamais cessé de vouloir renforcer le processus
de décentralisation considéré comme choix stratégique pour promouvoir
le développement socio-économique et culturel, et comme ce processus
est hiérarchisé territorialement sur trois niveau, il n’ a pas été
homogénéisé quant à son organisation et sur les réalisations.
Si apparemment les provinces et préfectures disposent comme les
communes d’assemblées élues, les premières différent des secondes aussi
bien du régime d’élection de leur membranes que des organes.
Ainsi les communes disposent d’organe législatif qui est le conseil et
d’organe exécutif qui est le président tous les deux élus par populations
et jouissent en principe d’une autonomie d’action et d’initiative dans le
cadre des attributions qui leur sont assignées par la loi. Par contre les
assemblées provinciales et préfectorale ne directement élus par la
population, disposent d’un organe exécutif qui est le Wali ou le
gouverneur, nommé par le roi sur proposition du ministre de l’intérieur
et donc n’est pas élu et ne représente pas la population et ne jouit pas
non plus d’une autonomie d’action.
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
Le wali ou le gouverneur, en tant que dirigeant d’une 32
circonscription administrative de l’Etat et représentant de ce dernier, et
comme organe exécutif de l’assemblée provinciale ou (provinciale)
préfectorale dispose d’une double fonction, bien ordres et instructions.
Il en résulte que la province ou la préfecture est à considéré
beaucoup plus comme un cadre de déconcentration que de
décentralisation.
La nature d’organisation et du fonctionnement des assemblées
provinciales et préfectorales conjuguée aux faibles moyens financiers et
l’ambiguïté des compétences, confirment les faibles réalisations des
provinces et préfectures. Si réalisation il y a, elle n’est autre que grâce à
l’intervention de l’Etat à travers ses services déconcentrés. Le
chevauchement des attributions avec les autres entités administratives
est souvent à la base du double emploi des ressources dans un sens ou
dans l’autre.
Il faut noter aussi que le décentralisation au niveau provincial ou
préfectoral est prédominée par l’aspect administratif au détriment des
préoccupations économiques et sociales.
Alors que plusieurs secteurs socio-économiques auraient pu être
encore eu retard s’ils dépendaient dans leur réalisation directement du
pouvoir central, notamment en ce qui concerne l’électrification,
l’alimentation eu eau potable, la santé, l’éducation<, bien que des failles
de gestion qui entraînent des gaspillages des ressources surgissent
souvent faute de moyens humains qualifiés et des élus bien cultivés, bien
formés et mieux encadrés.
Si la décentralisation suppose l’existence d’un domaine
d’intervention réservé aux autorités décentralisées ayant la possibilité de
réglementer en fonction des besoins de la collectivité, il n’en est pas ainsi
en réalité. Les provinces et préfectures sont presque de simples
structures d’exécution au lieu d’être de véritables cadres conception.
c- au niveau régional :
Bien que consacrée comme collectivité locale qu’en Octobre 1992 par
la constitution (9/10/92) et dont le statut juridique fut fixé par la loi N°47-
96 et mise en application seulement en octobre 1997, la région a vu son
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
édification et son organisation s’accélérer plus, aussi bien pour la 33
commune que pour la province ou la préfecture.
Toutefois, cette organisation est beaucoup plus proche de celle des
provinces et préfecture que celle des communes et ce pour deux raisons.
D’une part, l’élection des membres de la région qui constituent
l’organe législatif qui est l’assemblée régionale, obéit au régime électoral
indirect. Ces membres délibérants sont élus parmi un corps électoral
hétérogène à savoir les membres conseils communaux, les membres des
assemblées provinciales et préfectorales, les membres des chambres
professionnelles et les représentants des salariés. D’autres membres avec
voix consultatives fond partie de l’assemblée régionale à savoir tous les
parlementaires de la régions et les présidents des assemblées
provinciales et préfectorales et ce sans exception.
D’autre part, l’organe exécutif de la région qui est le wali ou le
gouverneur n’est pas élu, mais nommée par le roi sur proposition du
ministre de l’intérieur auquel il est lié hiérarchiquement et en reçoit des
instructions ce qui en fait une autorité à double fonction comme en est le
cas dans le provinces et préfectures.
En effet, la conciliation entre les attentes de la région entant
qu’entité décentralisée et la politique du gouvernement sans déviation
dans un sens ou l’autre est difficile à réaliser. Ce qui supposerait une
définition plus précise des compétences ou simplement une séparation
nette des pouvoirs.
D’autres modes de gestion décentralisée sont pratiqués notamment
au Maroc, pour échapper souvent à la rigidité des procédures
administratives, dont la décentralisation fonctionnelle ou par service.
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
34
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
35
Les 16 régions et leurs différentes provinces ou préfectures
La région d’Oued Eddahab-Lagouira : 1 province (Oued Eddahab)
La région deLaâyoune-Boujdour : 1 préfecture (Laâyoune) et 1 province
(Boujdour)
La région de Guelmim - Es Semara : 5provinces (Assa-Zag, Es-Semara,
Guelmim, Tan-Tan et Tata).
La région de Souss-Massa-Drâa : 5 provinces (Ouarzazate, Zagora,
Taroudant, Chtouka-Aït Baha et Tiznit) et 2 préfectures : Agadir-Ida Ou-
tanane, Inzegane-Aït Melloul.
La région du Gharb-Cherarda-Beni Hssen : 2 provinces (Kénitra et Sidi
Kacem).
La région de la Chaouia-Ouerdigha : 3 provinces (Ben Slimane,
Khouribga et Settat).
La région de l'Oriental : 6 provinces (Oujda-Angad, Berkane, Taourirt,
Figuig, Jérada et Nador).
La région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër : 3 préfectures (Rabat, Salé et
Skhirat-Témara) et 1 province (Khémisset).
La région de Doukkala-Abda : 2 provinces (El Jadida et Safi).
La région de Tadla-Azilal : 2 provinces (Beni Mellal et Azilal).
La région de Meknès-Tafilalet : 2 préfectures (Al Ismailia et Meknès-El
Menzah) et 3 provinces (El Hajeb, Ifrane et Errachidia).
La région de Fès- Boulemane : 3 préfectures (Fès El Jadid - Dar Dbibegh,
Fès-Médina et Zouagha - Moulay Yacoub) et 2 provinces (Boulemane et
Séfrou).
La région de Taza-El Hoceima-Taounate : 3 provinces (Al Hoceima,
Taounate et Taza).
La région du Grand Casablanca : 8 préfectures (Casablanca-Anfa, Aïn
Chock-Hay-Hassani, Aïn-Sebaâ-Hay-Mohammadi, Ben Msik-Sidi
Othmane, Sidi El Barnoussi-Zenata, El Fida-Derb Soltane, Mechouar-
Casablanca et Mohammedia).
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
La région de Tanger-Tétouan : 3 préfectures (Fahss-Bni Makada, Tanger- 36
Asilah et Tétouan) et 2 provinces (Chefchaouen et Larache).
La région de Marrakech-Tensift-El Haouz : 3 préfectures (Marrakech-
Médina, Marrakech-Ménara et Sidi Youssef Ben Ali) et 4 provinces (El
Kelaâ Sraghna, Essaouira, Chichaoua et El Haouz).
II.1.2 la décentralisation fonctionnelle :
Le droit administratif connaît une autre forme de décentralisation
dite technique par service spéciale ou fonctionnelle elle n’a pas pour
assise politique comme celle territoriale mais elle repose sur le fait que
certains services en raison de leur spécificité sont décentralisés de la
compétence du pouvoir central pour en faire une personne morale qui
gère un service spécial public donne sur le plan pratique la
décentralisation fonctionnelle se manifeste sous la formes des
entreprises publics.
II.1.2.1 définition de l’entreprise publique :
L’établissement public retient trois éléments pour sa définition :
1. le service public : dans un sens qui s’accorde avec le concept de
l’intérêt général sans que l’Etat joue un rôle de commerçant et
industriel omniprésent dans l’activité économiques sinon elle
deviendra un terrain parfait d’intervention de l’Etat
2. la personnalité morale : qui distingue cet établissement de
certains services industriels ou commerciaux de l’Etat gérés aussi
de façon relativement indépendante comme l’ex-radiodiffusion
télévision marocaine
3. la vocation spéciale basée sur le principe de la spécialité de
l’établissement public, selon ce principe l’établissement public n’a
de compétence que dans le cadre de l’objet tel que précise dans
l’acte de sa création s’il n ;est pas vague sinon y aura un caractère
permissif c’est le cas de l’OCE qui avait participation dans 40
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
sociétés avant l’intervention de du dahir portant loi n 1-75-228 qui 37
lui ouvrait juridiquement la possibilité de la prise de participation
dans des sociétés relavant de sa compétence et vocation.
II.1.2.2 Classification des entreprises publiques :
Il y a essentiellement deux grandes catégories d’entreprises
publiques
- l’établissement a caractère industriel et commercial et son cadre
juridique est emprunte de base du droit public avec des références au
droit prive. Faut distinguer cette catégorie de l’établissement publics a
caractère administrative même si cette dernière peut avoir une activité
commerciale et /ou industrielle, puisqu’elle est place sous tutelle
administrative c’est le cas de l’ERAC, alors un établissement public
administrative est admis soumis a un régime de droit administratif strict
tandis que le régime de l’établissement public industriel et commercial
s’inspire du droit prive même s’il obéit a des aspects du droit
administratif
- Les entreprises publiques constituées sous forme de société utilise
le droit prive comme cadre juridique avec des références au droit
public on en distingue les sociétés a capitaux exclusivement publics et
les sociétés d’économie mixte.
Quelques entreprises publiques sous forme de SA dont la
participation publique est comprises entre 5% et 50% du
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
capital 38
Quelques établissements publics a caractère administratif
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
Quelques établissements publics a caractère industriel et commercial 39
II.1.2.3 la création de l’établissement public :
Relève de la compétence du législateur, au Maroc déjà avant de se
doter de la constitution de 1962 la création des établissement publics se
faisait par dahir acte le plus élevé dans la hiérarchie des textes au Maroc,
la continuation e1972 a ratifie explicitement cette pratique, mais on peut
assister a la création des établissements public au niveau local mais dans
ce cas la compétence relève dans le cadre de la décentralisation politique
des autorités locales comme des régies pour gérer un service public local.
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
40
II.1.2.4 le fonctionnement de l’établissement public :
Celui-ci est caractérise par deux principes :
-l’autonomie juridique de l’établissement ce qui signifie que
l’établissement a des organes propres constitues d’un conseil
d’administration un directeur charge des décisions du conseil
d’administration et parfois un comite technique ou un comite de
direction, signifie aussi que l’établissement a un budget propre
autonome et indépendant du budget générale et en dernier lieu
l’autonomie juridique veut dire que l’établissement dispose d’une
patrimoine
- le contrôle de l’Etat comme deuxième principe apparaît tout a fait
normale en ce sens que l’établissement public gère une activité qui doit
se voir en conformité avec l’intérêt général, ce contrôle se traduit par la
nomination des organes de l’établissement par l’approbation des
décisions du conseil de l’administration ainsi qu’une tutelle financière
sur les ressources et leur affectation c’est le dahir du 14 avril 1960et celui
de 1979 pour le contrôle juridictionnelle de la cour des comptes .
II.1.2.5-Situation du portefeuille de l’Etat
Domaines d’activité : production et distribution d’électricité,
traitement et distribution d’eau potable, télécommunications, énergie,
construction, santé, transport, mines, agriculture, pêche, industries,
banques, assurances.
Inventaire des établissements publics (fin 2000) : 741 entités dont 51
établissements publics à caractère industriel et commercial, 517
sociétés anonymes et 173 établissements publics à caractère
administratif.
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
II.1.3 la décentralisation structurelle 41
Cette forme de décentralisation très poussée a été lancée en 1993,
conçu comme un outil de modernisation économique et sociale,
Gouvernement marocain voudrait compléter les mesures libérales
prises au début de la décennie 80.
-Ces dernières mesures ont porté notamment sur :
-La libéralisation du commerce extérieur,
-la libéralisation des prix,
-la suppression progressive des subventions,
-l’ouverture de l’économie marocaine aux investissements étrangers,
-la réforme du système fiscal,
-la promotion des exportations,
-et la restructuration des entreprises d’Etat.
-Les entreprises privatisables, autres que les hôtels, ont été
sélectionnées sur la base des critères suivants:
- Opérer dans un secteur concurrentiel, sans prédominance du secteur
public.
- Être rentables ou pouvant l’être potentiellement.
- Ne pas avoir de sureffectifs.
- Etre constituées sous forme de sociétés anonymes.
-Objectifs du programme de privatisation
-Optimiser la modernisation de l’économie marocaine.
-Alléger les charges du budget de l’État.
-Permettre une plus large ouverture sur l’économie mondiale.
-Limiter et gérer la concentration capitalistique.
-Donner des chances à de nouveaux entrepreneurs.
Principales privatisations réalisées :
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
Depuis la mise en œuvre du programme, 36 sociétés et 26 hôtels 42
ont été privatisés. Les recettes cumulées des ventes s’élèvent à 39,9
milliards de Dirhams (DH) et les investissements projetés à 7,24
milliards de DH. Les principaux transferts au secteur privé ont
concerné les entreprises suivantes :
MAROC TELECOM : Télécommunications. FERTIMA : Distributeur
d’engrais. SONASID : Laminoir et distributeur de produits
sidérurgiques. CNIA : Assurance. SAMIR et SCP : Raffineries de
pétrole. SMI, CTT, FPZ, SAMINE et SOMIFER : Mines d’argent,
cobalt, plomb, fluorine, et cuivre. SOFAC/Crédit et Crédit EQDOM :
Crédit à la consommation. SNI : Holding financier. SHELL, MOBIL,
TOTAL, PETROM, CMH, DRAGON, GAZ, SOMAS : Distribution de
produits pétroliers. BMCE : Banque. SNEP : Producteur de chlore, de
soude et de PVC. CTM-LN Transport par autocar. CIOR : Cimenterie.
26 hôtels dont notamment le Hyatt Regency à Casablanca, Dunes d’Or
à Agadir ,Tour Hassan à Rabat, les Mérinides à Fès et Malabata à
Tanger.
Investissements étrangers :
Sur les 36 sociétés et les 26 hôtels privatisés ,18 sociétés et 5 hôtels ont
été partiellement ou totalement cédés à des investisseurs étrangers
(77,9% des recettes de la privatisation). Les investisseurs étrangers sont
: Vivendi Universal, Holderbank, Dragofina, Courtaulds, Lesaffre
,FRAM ,Shell Petroleum International ,Mobil Corporation, Total Outre
-Mer , Corral Petroleum, Arig , Martial Ucin.
Les principaux investisseurs financiers étrangers sont :
Samba Finance , Morgan Stanley, Morgan Grenfell, Quantum
Emerging Growth Fund , Banque Pictet, et Framlington Maghreb
Fund.
- Les prochaines privatisations :
Il est prévu que l’opération de privatisation s’étende à des sociétés qui
ne figurent pas dans le programme en cours. La liste des sociétés à
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
privatiser comprend 16 entités dont 2 hôtels. Le tableau ci- après 43
présenté donne quelques indications sur les entreprises privatisables.
Date de
Nom Secteur d’activité Part à céder en %
création
SNDE 1973 Agriculture-élevage 96.60
Finance-banque-
BNDE 1959 43.53
développement
Finance-banque, crédit
CIH 1919 48.89
immobilier et hôtelier
SOMACA 1959 Industrie automobile 38.00
SUCRAFOR 1971 Sucre 72.16
99.53 (mise en vente
SUNABEL 1975 Sucre
en mai 2002)
SURAC 1979 Sucre 100.00 (idem)
SUTA 1964 Sucre 99.50
11.40 (cédées à
SICOME 1974 Textile et prêt à porter
HOLFIPAR)
Textile ,filature et fils
SETAFIL 1987 59.23
retors de coton
Textile ,filature ,tissage
COTEF 1967 98.52
,teinture fil , impression
SACEM 1929 Mine-manganèse 42.99
Hôtel Localisation :
3 étoiles et 94 chambres
Asmaa Chefchaouen
Hôtel Ibn Localisation :
4 étoiles et 106 chambres
Toumert Taliouine
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
44
Pour certains secteurs dont l’Etat doit conserver la propriété, des
concessions pourraient être conclues avec des opérateurs privés. Au
Maroc, plusieurs opérations de concession ont été réalisées dans
différents secteurs, notamment :
La production de l’électricité, la distribution d’eau, d’électricité,
l’assainissement liquide, les télécommunications et les autoroutes.
En raison de l’importance des projets de concessions, un projet de Loi -
Cadre est en cours d’élaboration.
Source ministre d’économie et de finance et de privatisation
II.2 les limites de la mise en œuvre de la décentralisation au
maroc
L’incapacité des CL à jouer pleinement leur rôle d’acteur de
développement est liée à l’insuffisance de leurs moyens et aux
contraintes d’ordre institutionnel et juridique. Elle a trait, aussi, aux
inaptitudes managériales des élus locaux, au caractère contraignant de
la tutelle et à un niveau de déconcentration très limité.
II.2.1- Problèmes liés au cadre institutionnel et juridique :
II.2.1.1- Pour la région :
La loi sur la région présente les insuffisances suivantes:
- Le rôle prépondérant du représentant de l’Etat. Selon l’article 54
de la loi sur la région, le gouverneur chef lieu de la région est l’organe
exécutif des délibérations du conseil.
- Le maintien d’un régime de tutelle contraignant
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
- L’article 7 de la loi sur la région attribue de larges compétences à 45
la région. Ces compétences interfèrent avec celles des communes qui ont
une compétences générale. Les limites des interventions de chaque
collectivité, ne sont pas précisées. En plus, pour rendre ces attributions
effectives, il a fallu des textes juridiques d’accompagnement pour
permettre à la région de les exercer (exemple : permettre à la région
d’octroyer des prêts aux entreprises en difficultés pour la promotion de
l’emploi ).
II.2.1.2- Pour la Province/Préfecture :
La décentralisation à ce niveau est caractérisée par un
dédoublement fonctionnel et la prééminence du gouverneur. Elle est à la
foie :
- un cadre de décentralisation. C’est une collectivité locale où le
gouverneur est l’organe exécutif des délibérations des assemblées (article
101 de la constitution).
- et un cadre de déconcentration. C’est un espace fondamental pour
l’implantation des services déconcentrés de l’Etat, et de l’encadrement de
l’action des communes. En effet, le gouverneur exerce des compétences
déléguées par les différentes autorités ministérielles, il est le sous
ordonnateur du budget de fonctionnement du Ministère de l’Intérieur et
il est le supérieur hiérarchique de tous les fonctionnaires civiles au
niveau de la province/préfecture à l’exception du personnel des
juridictions et des services extérieurs du Ministère des Habous (article 6
du dahir du 15 février 1977 « le gouverneur contrôle, sous l’autorité des
Ministres compétents, l’activité générale des fonctionnaires et agents des
services extérieurs des administrations civiles de l’Etat en fonction à la
préfecture ou province<<.Sans préjudice des pouvoirs reconnus à
l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, le gouverneur peut exercer le
pouvoir de suspension reconnu à la dite autorité<. »).
Cette ambivalence qui caractérise cette collectivité et la
particularité de l’organe exécutif constitue un grief à la décentralisation
et à la démocratie locale.
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
Dans l’esprit du législateur, tenant compte de la réalité socio- 46
économique et du niveau de développement, c’est surtout confier à un
organe ayant un statut fort (le gouverneur est à la fois le représentant de
sa Majesté et le délégué du gouvernement d’après les articles 1 et 2 du
dahir 15/02/1977 précité) la coordination entre les différentes
administrations à l’échelle locale et veiller à l’application de la loi. La
finalité de ces dispositions ; c’est sauvegarder l’unité de l’Etat et assurer
la cohérence des actions de développement au niveau local.
A notre sens, Ces attributions dévolues au gouverneur peuvent
avoir un effet positif comme elles peuvent avoir un effet négatif sur la
réussite de la décentralisation. Cela dépendra des capacités managériales
du gouverneur (sa capacité à coordonner et à harmoniser les actions des
différends intervenants au niveau local et à créer un climat de synergie
porteur du progrès); et de la politique gouvernementale en générale
(s’inscrire dans une démarche participative et dynamique ou au
contraire dans une approche autoritaire et purement sécuritaire).
II.2.1.3- Pour les communes :
a)- Problématique de l’investissement :
Selon l’article 30 de la charte de 1976, le conseil communal a la
possibilité de définir des plans de développement économique et social
conformément aux orientations et aux objectifs du plan national. Mais la
frontière qui sépare les domaines d’interventions de l’Etat et des
communes n’est pas claire. En plus, rare les communes qui définissent
un véritable plan de développement économique et social. La plupart
des communes se limitent à des programmes annuels d’équipement, et
pratiquent, elles n’arrivent pas à prévoir ces programmes dans leurs
budgets prévisionnels. En outre, les recettes prévisionnelles ne sont pas
maîtrisées. C’est seulement en cours de l’exercice, si des recettes sont
réalisées, la commune recourt à des autorisations spéciales pour exécuter
ces programmes.
A ce là, s’ajoute la structure du budget, pour la majorité des
communes, 80% du budget sert au fonctionnement. Cette situation est
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
d’autant plus alarmante pour les communes rurales ou presque la 47
totalité du budget est affectée au fonctionnement.
b)- Limites d’action des services publics :
Malgré les résultats auxquels ont aboutis les services publics
locaux, leur action demeure confrontée à des problèmes d’ordre
juridique et organisationnel :
La régie directe souffre d’un manque de moyens techniques,
financiers, techniques et d’une gestion archaïque.
La régie autonome, les organes de décision et de contrôle (conseil
d’administration et comité de direction) ne jouent pas pleinement leur
rôle et se limitent à l’approbation des budgets et des marchés.
Pour les concessions et les gestions déléguées, une évaluation de
ces modes de gestion n’est pas encore faite.
En plus de ces problèmes, il y a des problèmes spécifiques à chaque
secteur ayant pour cause l’inadéquation entre l’offre et la demande et
l’absence d’un cahier de charges modèles ou d’une réglementation
spécifique à chaque mode de gestion.
c)- Problèmes liés à l’exploitation du patrimoine communal :
L’absence d’un recensement précis et exhaustif des biens
immobiliers au niveau de chaque collectivité et l’imparfaite tenue des
inventaires constituent les principales carences qui font obstacle à la mise
en valeur de ce patrimoine.
Les finances des collectivités locales sont soumises jusqu’à nos
jours à une comptabilité publique. Le fait de ne pas tenir une
comptabilité patrimoniale obligeant ainsi les collectivités à évaluer leurs
biens et à constituer des amortissements ou des provisions et par
conséquent, dégager une capacité d’autofinancement constitue un
enfreint à une exploitation rationnelle du patrimoine de la collectivité.
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
48
II.2.2- Manque des capacités managériales des élus locaux
Les expériences précédentes ont été marquées par des mauvaises
gestion. Cela est dû en partie au niveau de compétence de l’élu qui
ignore ses responsabilités et les techniques de gestion des affaires locales.
Malgré l’innovation de la nouvelle charte (l’article 28) qui exige au
minimum un niveau d’instruction équivalent à celui de la fin des études
primaires pour être éligible aux fonctions de président, ce niveau
d’instruction ne peut permette à l’élu local de maîtriser les aspects
complexes de la gestion des affaires locales (aspects juridiques,
techniques, procédures, communication, concepts manageriaux<etc).
Les partis politiques ont aussi contribué à l’état actuel de la
décentralisation. Ils ne jouent pas pleinement leur rôle quand au choix
judicieux de l’élu et à la formation d’une élite politique dynamique et
consciente de l’intérêt général. La culture qui a prévalu jusqu’à
aujourd’hui c’est la conception patrimoniale de la chose publique.
Cette situation est d’autant aggravée par le mode de suffrage, le
mode de scrutin et le découpage administratif :
- le suffrage universel uninominal à un tour qui était en vigueur
jusqu’aux dernières élections, et il est toujours applicable dans les
communes ayant une population inférieure à 25 000 habitants ne permet
pas de dégager une majorité sure et stable .D’ou le recours abusif à
l’article 7 de la charte de 1976 pour démettre le président de ses fonctions
(il suffit d’une délibération votée par les 2/3 des membres du conseil en
exercice à l’expiration d’un délai de 2 ans à partir de la date de son
élection).
Le président se trouve obliger de faire des délégations à certains
membres du bureau leur permettant ainsi de superviser des services de
la commune. La prise même de décision reste subordonnée aux enjeux
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
politiques au détriment d’une rationalité quand aux choix des projets 49
d’investissement et à la programmation des interventions.
- L’adoption de scrutin de liste à bulletin unique dans les élections
de 2003 pour les communes dont la population est supérieur à 25000
habitants a permis beaucoup plus au renouvellement de l’élite politique
déjà existante que l’émergence d’une nouvelle classe politique ayant une
nouvelle culture.
- Le découpage administratif et la structuration de l’espace n’était
pas fait selon des critères objectifs (géographique, économique,
sociologique, historique<.) permettant l’émergence des espaces viables,
favorables à la réalisation d’une stratégie de développement durable et
équilibrée. Il a été soumis, principalement, à des préoccupations d’ordre,
de stabilité et du contrôle de l’espace et de la population.
II.2.3- Problèmes des ressources financières et humaines
II.2.3.1- L’insuffisances des ressources propres :
Des réformes importantes ont été entreprises pour doter les CL des
moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
Parmi les réformes les plus importantes :
- La loi cadre de 1984 sur la réforme fiscale de l’Etat qui permis la
rétrocession de la TU et de la patente au profit des CL.
La réforme de 1989 qui prévoit le versement de 30% du produit de
la TVA au profit des CL.
- La loi 30-98 relative à la fiscalité locale prescrit deux types de
taxes, les unes obligatoires, les autres facultatifs.
Ces mesures n’ont pu faire face aux besoins croissants des CL. En
réalité la fiscalité locale reste dominées par les impôts étatiques,
principalement la TVA.
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
Les insuffisances des recettes fiscales locales peut être imputée à 50
plusieurs facteurs :
- Des facteurs relatifs à l’assiette et aux tarifs d’imposition
(complexité des tarifs).
- Les critères de répartition du produit de la TVA entre le CL ne
sont pas liés à des données socio-économiques spécifiques à chaque CL
- La faiblesse des taux de recouvrement
- La multiplicité des intervenants qui gèrent une part importante
des taxes locales (services déconcentrés des Ministères des Finances, du
transport, des eaux et forêts)
- L’insuffisance des moyens de gestion
- L’éclatement de la fiscalité entre plusieurs entités territoriales :
région, province/préfecture, commune, communauté urbaine<etc.
En ce qui concerne le financement par l’emprunt, le seul organisme
habilité à octroyer ces emprunts est le FEC. Le recours à ce moyen de
financement reste limité et hors de portée de la plus part des entités
locales vues les conditions contraignantes d’obtention des prêts dictées
par le FEC surtout après sa structuration ( avoir un taux d’endettement
inférieur à 40%, disposer d’une épargne prévisionnelle mobilisable pour
faire face aux remboursement, avoir un autofinancement au moins de
20% , évaluation du projet <.etc).
II.2.3.2 - Des ressources humaines peu qualifiées et males
réparties :
Des progrès importants ont été consentis depuis la réforme de 1976
pour le renforcement, aussi bien qualitatif que quantitatif de
l’encadrement des services locaux. Cependant, le rythme de l’évolution a
été marquée par une augmentation importante des effectifs, mais d’une
façon déséquilibrée. L’effectif des cadres supérieurs et moyens reste
faible par rapport aux besoins des CL comme l’illustre le tableau ci-
après :
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
51
Répartition du personnel des CL entre 1977 et 2000
1977 2000
Personnel 30 000 142 000
des CL
Cadres 1% 6%
supérieurs
Cadres 1.7% 15%
moyens
Le décret de 1977 portant statut du personnel communal offre les
mêmes droits et obligation que ceux du statut général de la fonction
publique. Mais, il présente les défaillances suivantes :
- le Président de la commune n’a le droit de recruter directement
qu aux échelles entre 1 et 9. Pour les cadres supérieurs, c’est le Ministre
de l’Intérieur qui a la charge de ce recrutement, et les mets à la
disposition des collectivités selon les besoins. En plus, la création des
emplois reste subordonnée au contrôle de la tutelle à travers
l’approbation des tableaux d’emplois à l’occasion de l’approbation des
budgets. Cette cogestion de la carrière communale limite les pouvoirs du
président de la collectivité.
- la mobilité n’est pas prévue. Ce qui rend la fonction publique
locale moins attrayante pour les cadres supérieurs. C’est une des raisons
de la mauvaise spatialisation des ressources humaines surtout entre
communes urbaines et rurales.
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
- la gestion de carrière est peu attractive quant à son déroulement 52
ou aux rémunérations prévues.
Ce sont autant de facteurs qui rendent le recrutement des cadres
qualifiés de plus en plus difficile. D’un autre coté, les jeunes recrus ne
sont pas suffisamment encadrés.
II.2.4- Une tutelle contraignante et un niveau limité de
déconcentration :
II.2.4.1- le caractère contraignant de la tutelle :
l’exercice de la tutelle sur les actes constitue, dans certaine mesure
un contrôle d’opportunité. En outre, les articles 31 de la charte
communale 1976, 64 de la charte provinciale de 1963 et 41 de loi sur la
région, énumèrent un nombre importants d’objets qui ne peuvent
devenir exécutoire qu’après approbation de l’autorité de tutelle.
Il s’agit, donc d’une association implicite des autorités de tutelle au
processus décisionnel. En plus, dans le domaine financier, presque la
quasi-totalité des actes sont soumises au contrôle de la tutelle.
Ce contrôle constitue donc une limite au principe de l’autonomie
des CL, et à la liberté d’initiative des élus locaux en matière de
développement local.
II.2.4.2- Un processus de déconcentration limité :
la déconcentration ne peut être concrète et effective que par:
un transfert d’un pouvoir de décision important aux représentants
locaux des différentes administrations centrales ;
et une représentation de tous les services de l’Etat au niveau local.
Or, la couverture des services extérieurs locaux n’est assurée qu’ à
hauteur de 40 à 60%. La prise de décision reste, cependant, fortement
centralisée. De part les textes, La tutelle est exercée, en général, par le
Ministre de L’Intérieur ; avec association du Ministre des Finances pour
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
certains actes financiers (à l’exception des communes rurales où la 53
tutelle est confiée au gouverneur).
La concentration des pouvoirs et des ressources constitue, à l’heure
actuelle, un grand dysfonctionnement de l’administration marocaine où
presque la totalité des dossiers nécessitent la remontée vers la capitale
pour être étudiées et approuvés.
Cette état de fait se traduit par une lenteur de procédures et une
démotivation des gestionnaires locaux . Feu Hassan a précisé, à ce sujet,
lors de l’ouverture des travaux du Vème colloque national sur les
collectivités locales en Avril 1992, que le pays ne peut être gouverné à
partir d’un centre unique quelles que soient la vitalité de
l’administration, la volonté des hommes et la compétence des
fonctionnaires.
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
Conclusion : 54
Si les limites du cadre institutionnel et l’insuffisance des moyens
financiers constituent les principaux obstacle au développement local, le
mode de gestion des affaires locales et le genre des gestionnaires
conditionnent le sort des entités décentralisées.
Gérer, c’est avant tout, trouver au moment opportun des solutions
adaptées aux besoins de la population en tenant compte des moyens
disponibles pour atteindre les objectifs préalablement déterminés.
Il est temps pour les élus de locaux d’opter pour une approche
managériale des affaires publiques locales et s’inscrire dans les principe
de bonne gouvernance.
Les pouvoirs publics sont appelés à fournir le cadre institutionnel
et juridique nécessaire à la réussite de la décentralisation.
La mise en place des moyens humains et financiers s’avère d’une
extrême nécessité. La décentralisation ne peut être effective si les
gestionnaires locaux ne disposent des outils suffisants pour face aux
besoins croissants des citoyens.
Suggestions :
Pour une consolidation des ressources des CL, un certain nombre
de mesures pourraient être envisagées :
- Optimisation de la fiscalité locale (révision des bases
d’imposition, maîtrise des coûts, adaptation des tarifs aux données
locales).
- Révision de l’approche péréquationnelle de la répartition de la
TVA (tenir compte de la situation financière et des projets socio-
économiques de chaque CL pour corriger les inégalités entre les
territoires).
- Nécessité d’une simplification de la fiscalité locale (réduction des
coûts de gestion, et une maîtrise de la base imposable).
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
- Responsabilisation des CL en matière de gestion fiscale à travers 55
la création de services chargés de l’établissement et du recouvrement des
impôts et taxes.
- Pour faire face à la faiblesse des capacités de financement des
projet d’investissement des communes, Il faut leur laisser une libre
initiative dans la recherche de financement moyennant la garantie de
l’Etat.
- Soumettre les CL à une comptabilité commerciale.
L’amélioration de la gestion des affaires locales est possible si :
Une stratégie de formation, aussi bien pour les élus que pour le
personnel, est mise en place ;
Un intérêt particulier est accordé au développement du partenariat
entre les CL , Etat, sociétés civiles, privés<.etc ;.
adapter les concepts et techniques modernes du management au
CL ;
Établir un schéma directeur de la décentralisation pour garantir la
continuité des actions.
Un niveau de déconcentration très poussé est mis en place.
Enfin, les partis politiques sont appelés à s’organiser pour former
une élite politique à niveau et jouer pleinement leur rôle quand à
l’encadrement politique de la population. Le cadre institutionnel et
juridique (élections, organisation, découpage<.) devra être revu en
tenant compte du besoin de la population, des spécificités
socioculturelles et économiques de la société (éviter le recours à des
réformes sous l’effet des pressions étrangères ; en calant des modèles
étrangers à l’identité de la société marocaine) .
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
Bibliographie (ajouter la bibliographie qui manque s’il te plait) 56
- Droit constitutionnel et institutions politiques Omar bendouro
édition 2003
- Droit administratif Hassan ouazzani chahdi
édition 1997
- Les institutions administratives : Abderahmane zanane
1997
- La décentralisation Jacques baguenard 1980
que sais je ?
- Décentralisation, politiques publiques et relations de pouvoir, Lemieux,
Vincent, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2001.
- Les nouveaux défis de l’administration Pr Abdelouahed
OURZIK 21/05/2003 Dans le contexte nord africain (Cas du Maroc)
- Décentralisation et réforme administrative au MAROC
Brahim Zyani Enseignant Chercheur ISA Rabat -MAROC.
Communication présentée au 4ème Forum méditerranéen du
Développement MDF4 Amman, 8 -10 avril 2002.
- Dimension de la décentralisation au Maroc entre le poids du passé et
les contraintes de l’avenir
Prof. Dr. Saïd Chikhaoui
Workshop II:
The Mediterranean – a region of bright prospects: local
government structures in some selected Mediterranean states
International
Conference
Globalization – Sustainable Development – Local Government:
Challenges of the 21 st . century Berlin, 13. und 14. 09. 2000
- Ministère de l’Économie , des Finances , de la Privatisation et du
Tourisme.
Direction de la Privatisation . Guide de la privatisation. RAPPORT
SUR LE SECTEUR DES ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS
[Publié par : www.ledroitpublicmarocain.com ]
Vous aimerez peut-être aussi
- Livre Muriel Darmon La Socialisation 2010 PDFDocument130 pagesLivre Muriel Darmon La Socialisation 2010 PDFUrsula Monnaie100% (4)
- Schopenhauer, Nietzsche, Deleuze Par Arnaud FrançoisDocument7 pagesSchopenhauer, Nietzsche, Deleuze Par Arnaud FrançoisKyla BruffPas encore d'évaluation
- Formation Sur Fiscalité Locale Final .PPT Version 1Document56 pagesFormation Sur Fiscalité Locale Final .PPT Version 1idboufa100% (1)
- Le Contentieux Administratif - PR El Maki AssarajiDocument80 pagesLe Contentieux Administratif - PR El Maki AssarajiRachidMeslem100% (1)
- Décentralisation Et Deconcentration Opposition Et ComplementaritéDocument17 pagesDécentralisation Et Deconcentration Opposition Et ComplementaritéAmina Zohir100% (10)
- 4 - La Régionalisation Avancée Comme Solution À La Question - FINALISEDocument30 pages4 - La Régionalisation Avancée Comme Solution À La Question - FINALISEAbdelouahab H'snPas encore d'évaluation
- Mots Appris LSQ 1Document14 pagesMots Appris LSQ 1Tommy-Charles BernierPas encore d'évaluation
- Deconcentration Decentralisation MarocDocument8 pagesDeconcentration Decentralisation MaroctalalfdaliPas encore d'évaluation
- Amine Ben Abdellah Decentralisation Territoriale Au MarocDocument14 pagesAmine Ben Abdellah Decentralisation Territoriale Au MarocamranielabidPas encore d'évaluation
- Decentralisation Et DeconcentrationDocument16 pagesDecentralisation Et DeconcentrationZakaria Jmili100% (1)
- Décentralisation 1Document11 pagesDécentralisation 1Oussalem100% (1)
- Cours de Droit Administratif S2Document156 pagesCours de Droit Administratif S2alioui100% (1)
- De la lutte contre la fraude à l'argent du crime: État des lieuxD'EverandDe la lutte contre la fraude à l'argent du crime: État des lieuxPas encore d'évaluation
- Finances Des CT Au MarocDocument2 pagesFinances Des CT Au MarocSoukeîna Alaoui67% (3)
- L'Autonomie Financière Des Collectivités Najat ZerroukDocument15 pagesL'Autonomie Financière Des Collectivités Najat ZerroukbadrelboustniPas encore d'évaluation
- Finances Publiques LocalesDocument69 pagesFinances Publiques Localesالحسنة بعشر أمثالهاPas encore d'évaluation
- DécentralisationDocument5 pagesDécentralisationMehdi MellouliPas encore d'évaluation
- WORD CCDocument21 pagesWORD CCAbdellatifPas encore d'évaluation
- DécentralisationDocument2 pagesDécentralisationRimy Kaede100% (1)
- Déconcentration AdministrativeDocument10 pagesDéconcentration AdministrativezentrumPas encore d'évaluation
- Brochure Sur Les Juridictions Financieres Au MarocDocument24 pagesBrochure Sur Les Juridictions Financieres Au MarocAicha AichaPas encore d'évaluation
- Exposé La Responsabilité Des Ordonnateurs CPDocument13 pagesExposé La Responsabilité Des Ordonnateurs CPHouda El75% (4)
- Le Contrôle Juridictionnel Des Finances PubliquesDocument10 pagesLe Contrôle Juridictionnel Des Finances PubliquesAbdellatif100% (1)
- Cours de Droit Budgétaire IntroductionDocument43 pagesCours de Droit Budgétaire IntroductionIsmail HassaniPas encore d'évaluation
- Décentralisation Et Réforme Administrative Au MAROCDocument11 pagesDécentralisation Et Réforme Administrative Au MAROCKhalil WakilPas encore d'évaluation
- Organisation Territoriale Du Maroc - WikipédiaDocument28 pagesOrganisation Territoriale Du Maroc - WikipédiaMAJDAPas encore d'évaluation
- Exposée Sur La Cour Des ComptesDocument14 pagesExposée Sur La Cour Des Comptesboutayna bendialliPas encore d'évaluation
- Projet de Régionalisation AvancéeDocument1 pageProjet de Régionalisation AvancéeIkram AyachePas encore d'évaluation
- Ensa Module Preparatoire Action TerritorialeDocument22 pagesEnsa Module Preparatoire Action TerritorialeSalem Mrigua100% (2)
- Resume Expose Finance LocaleDocument29 pagesResume Expose Finance LocalekamalPas encore d'évaluation
- La Réforme de L'etat (GRP 1)Document30 pagesLa Réforme de L'etat (GRP 1)Ayyoub DriouechPas encore d'évaluation
- Travaux Sur Les Finances LocalesDocument66 pagesTravaux Sur Les Finances Localesfatiha el yaakoubiPas encore d'évaluation
- Organisation Administrative, 1ère PartieDocument29 pagesOrganisation Administrative, 1ère Partiejihane amraniPas encore d'évaluation
- Audit Des Collectivités TerritorialesDocument2 pagesAudit Des Collectivités TerritorialeskaoutarPas encore d'évaluation
- Reforme de Lolf Saad BougarnDocument33 pagesReforme de Lolf Saad BougarnMehdiChadliPas encore d'évaluation
- Thème 6Document59 pagesThème 6Ayyoub Driouech100% (1)
- A La Nouvelle Lof Et La GFP RemaDocument13 pagesA La Nouvelle Lof Et La GFP RemaHichamPas encore d'évaluation
- Decentralisation Et DeconcentrationDocument8 pagesDecentralisation Et DeconcentrationIssamElRhazalPas encore d'évaluation
- Region Maroc PDFDocument44 pagesRegion Maroc PDFCrystal KlinePas encore d'évaluation
- Avenir Des Collectivites Territoriales Au Maroc A La Lumiere de La Regionalisation AvanceeDocument3 pagesAvenir Des Collectivites Territoriales Au Maroc A La Lumiere de La Regionalisation AvanceeOthmane El HafedPas encore d'évaluation
- L'autonomie Des Collectivités TerritorialesDocument29 pagesL'autonomie Des Collectivités TerritorialesRémy Bres-FeuilletPas encore d'évaluation
- Éxposé de La Procédure de L'éxecution de La Dépense.Document40 pagesÉxposé de La Procédure de L'éxecution de La Dépense.soumaya elhaddadiPas encore d'évaluation
- Le Rôle Des Établissements Publics Au MarocDocument3 pagesLe Rôle Des Établissements Publics Au MarocYahya Azekraoui100% (1)
- La Réforme Administrative Au Maroc À La Lumière Des Exigences Dela Nouvelle Gestion Publique - 2019Document25 pagesLa Réforme Administrative Au Maroc À La Lumière Des Exigences Dela Nouvelle Gestion Publique - 2019Yassine AddahiPas encore d'évaluation
- Décentralisation TerritorialesDocument8 pagesDécentralisation Territorialesbamba moryPas encore d'évaluation
- Réforme Collectivités TerritorialesDocument9 pagesRéforme Collectivités TerritorialesMarianne MonninPas encore d'évaluation
- Fiscalite LocaleDocument143 pagesFiscalite LocaleMouhssine MerrounaPas encore d'évaluation
- Centralisation Et Decentralisation PDFDocument19 pagesCentralisation Et Decentralisation PDFCrystal Kline100% (1)
- L'Organisation Administrative Au MarocDocument31 pagesL'Organisation Administrative Au MarocLoubna Louly MakhoukhiPas encore d'évaluation
- Decentralisation Fiscalite Et Disparites Au MarocDocument49 pagesDecentralisation Fiscalite Et Disparites Au MarocMohammed Fares100% (3)
- Exposé D'execution....Document71 pagesExposé D'execution....AISSAOUI SabrinaPas encore d'évaluation
- Bibliographie Collectivités Locales ENADocument22 pagesBibliographie Collectivités Locales ENAphilippe_weber67% (3)
- La Cour Des Comptes VFDocument34 pagesLa Cour Des Comptes VFadilPas encore d'évaluation
- Instruction Gnrale de La Dpense PDFDocument279 pagesInstruction Gnrale de La Dpense PDFOlympia EncgaPas encore d'évaluation
- La Fiscalite Locale Royaume Du MarocDocument56 pagesLa Fiscalite Locale Royaume Du MarocZakaria100% (1)
- Gouvernance Des Finances Locales PDFDocument6 pagesGouvernance Des Finances Locales PDFRéda Tsouli100% (1)
- La Gestion Déléguée Du Service Public Au MarocDocument7 pagesLa Gestion Déléguée Du Service Public Au MarocYassine GuisserPas encore d'évaluation
- Regionalisation PDFDocument19 pagesRegionalisation PDFCrystal KlinePas encore d'évaluation
- Budget public et performance: Introduction à la budgétisation axée sur les résultatsD'EverandBudget public et performance: Introduction à la budgétisation axée sur les résultatsPas encore d'évaluation
- Les finances locales dans l'Afrique francophone subsaharienne: Une étude comparativeD'EverandLes finances locales dans l'Afrique francophone subsaharienne: Une étude comparativePas encore d'évaluation
- Retour aux Fondamentaux: Pour une République Civique (Manuel à l’usage du citoyen)D'EverandRetour aux Fondamentaux: Pour une République Civique (Manuel à l’usage du citoyen)Pas encore d'évaluation
- L'Ohada et le secteur informel: L'exemple du CamerounD'EverandL'Ohada et le secteur informel: L'exemple du CamerounÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (1)
- Ténès Devoir 4amDocument3 pagesTénès Devoir 4amcem chlef2Pas encore d'évaluation
- Devoir Du Second Cycle 1ereDocument59 pagesDevoir Du Second Cycle 1erenaababaongo052Pas encore d'évaluation
- JKGHJHKGHK 22121 H 5 G 15 KDocument30 pagesJKGHJHKGHK 22121 H 5 G 15 KToon TasticPas encore d'évaluation
- COM2590 - Notes de CoursDocument41 pagesCOM2590 - Notes de CoursjennyPas encore d'évaluation
- Rapport de StageDocument11 pagesRapport de Stageasdif1317Pas encore d'évaluation
- Protocole PÉGASE Avenant N°1Document2 pagesProtocole PÉGASE Avenant N°1edouardPas encore d'évaluation
- Exercices InferencesDocument9 pagesExercices InferencesbrunomarielaurePas encore d'évaluation
- CV Yassine HafianeDocument1 pageCV Yassine HafianeyassinePas encore d'évaluation
- TEMEDocument14 pagesTEMEDenisa EmiliaPas encore d'évaluation
- Top WereDocument16 pagesTop WerezambilinaPas encore d'évaluation
- 4eme Translations CoursDocument13 pages4eme Translations CourswillianotchristianotPas encore d'évaluation
- Correction Exos de RéseauxDocument4 pagesCorrection Exos de RéseauxluqmanPas encore d'évaluation
- Hemorragie Du Post-Partum-3Document9 pagesHemorragie Du Post-Partum-3lammarifati3Pas encore d'évaluation
- Cours Datation RelativeDocument1 pageCours Datation RelativeTondji ZoundeglaPas encore d'évaluation
- Photo-Theoria 37, Avril-Juin 2019Document275 pagesPhoto-Theoria 37, Avril-Juin 2019NassimDaghighianPas encore d'évaluation
- Notice Remplacement Ruban de Levage BSO-NSAV007Document8 pagesNotice Remplacement Ruban de Levage BSO-NSAV007GlopPas encore d'évaluation
- Ait Mouhoub Hiba Annee Universitaire 201Document179 pagesAit Mouhoub Hiba Annee Universitaire 201Pirate078Pas encore d'évaluation
- Dignostic Du BétonDocument29 pagesDignostic Du BétonHouari Benahmed100% (1)
- 06 - VBA Excel Boucles - Exercices - JPGDocument12 pages06 - VBA Excel Boucles - Exercices - JPGcherine.jlPas encore d'évaluation
- Acridiens Du SahelDocument38 pagesAcridiens Du Sahelzangui hamissouPas encore d'évaluation
- Connaissances, Attitudes Et Pratiques en Matiere D'eau, D'assainissement Et D'hygiene Dans Les Provinces D'antananarivo Et de Toliary (Mai 2004)Document133 pagesConnaissances, Attitudes Et Pratiques en Matiere D'eau, D'assainissement Et D'hygiene Dans Les Provinces D'antananarivo Et de Toliary (Mai 2004)HayZara Madagascar100% (1)
- Revue VAYNE Les Grecs Ont Ils Cru A Leurs MythesDocument7 pagesRevue VAYNE Les Grecs Ont Ils Cru A Leurs Mythesmegasthenis1Pas encore d'évaluation
- LDP Es 1re c04Document3 pagesLDP Es 1re c04RAZA LUCPas encore d'évaluation
- De La XénophobieDocument2 pagesDe La Xénophobiefranck lagahi100% (1)
- Atelier 1 Sur ServletDocument11 pagesAtelier 1 Sur ServletjigosetPas encore d'évaluation
- Arrêt Mavrommatis Part 2Document2 pagesArrêt Mavrommatis Part 2Yassine Haj KacemPas encore d'évaluation
- Questionnaire de Satisfaction - Service de SoinsDocument2 pagesQuestionnaire de Satisfaction - Service de SoinskhayisamPas encore d'évaluation