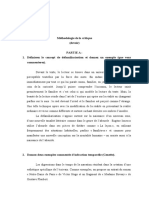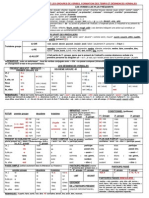Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
A L'epreuve de La Reecriture
Transféré par
James CarroTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
A L'epreuve de La Reecriture
Transféré par
James CarroDroits d'auteur :
Formats disponibles
2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE
Bienvenue sur le site de l'unité mixte de recherche 7171
CAHIER DU CENTRE DE RECHERCHE "ÉTUDES SUR LE ROMAN DU SECOND DEMI-
SIÈCLE" / CERACC
N° 2 - Juin 2003
À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE
SOMMAIRE Ce cahier n° 2 existe
uniquement sous
cette forme
● Johan Faerber : Introduction : Dire la réécriture, redire l'écriture électronique. Les
● Erica Durante : La main invisible : Parcours dans l'œuvre visible de textes en ont été
Borges, Valéry, Dante rassemblés par
● Noëlle Benhamou : Miroir de la parodie : l'exemple de Maupassant Mélanie Colcanap et
● Jean-François Puff : Le modèle des troubadours dans l'œuvre poétique Johan Faerber.
de Jacques Roubaud
● Lioubov Sávova : Entre parole et silence : la traduction-restitution d'un Vous pouvez utiliser
poème perdu de Cendrars ce sommaire ou les
● Johan Faerber : Encore et en corps, ou le baroque de l'écriture au carré flèches internes (>)
pour naviguer dans
● Question d’identité le cahier, ou
simplement faire
défiler la fenêtre.
> Revenir à la liste des cahiers Cliquez sur les
appels de note en
orange pour faire
apparaître la fenêtre
correspondante.
http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (1 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:36
2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE
Lors de la journée d'étude des jeunes chercheurs du 15 mars 2003 qui s'est tenue en Sorbonne dans le cadre de
l'école doctorale de littérature française et comparée, doctorants et jeunes docteurs ont cherché à aborder
ensemble la notion de "réécriture", et à dégager les enjeux et les échos de cette notion clef de la seconde moitié
du vingtième siècle, dans les travaux actuels.
Que soient remerciés ici messieurs Jean Bessière, Michel Collot, et Stéphane Michaud qui ont permis
l'organisation de cette journée; Marc Dambre qui en a autorisé la publication électronique; et Henri Garric et
Hugues Marchal, pour avoir accepté d'en être les modérateurs.
Mélanie Colcanap et Johan Faerber
Johan Faerber
DIRE LA RÉÉCRITURE, REDIRE L'ÉCRITURE
Dire la réécriture, redire l’écriture, ce serait peut-être, tout d’abord, affirmer et réaffirmer trois positions
ancestrales. Ce serait peut-être trouver et retrouver trois figures mythiques par lesquelles se donnerait à lire, à
relire et à relier la réécriture. Dire la réécriture, redire l’écriture, ce serait découvrir et redécouvrir le muthos
comme socle et fonds essentiels de la parole littéraire. Ce serait poser et reposer une parole qui elle-même ne
connaît pas le repos. Trois figures mythiques comme autant de métaphores pour apercevoir la réécriture, ce
serait dire et redire sans fin le mythe qui lui-même ne fait que redire dans un geste d’infinitude. Parole des
commencements qui n’a pas d’origine, le mythe partagerait alors avec la réécriture son souci du dédoublement et
du redoublement.
Trois figures mythiques plutôt que quatre - ou plutôt qu’aucune - pour tenter de dire et de suggérer la réécriture,
c’est d’abord pointer et affirmer que la réécriture est une affaire d’éthique, qu’il existerait ainsi peut-être une
éthique de la réécriture à défaut d‘un codex de la réécriture. Réécrire, ce serait mettre en jeu l’éthique au sens
étymologique, rhétorique et aristotélicien d’ethos : c’est-à-dire mettre en scène l’ethos du chercheur, ce qui est
relatif à sa personnalité, et à ses qualités mêmes. La réécriture permettrait alors de brosser son portrait mais un
portrait qui viendrait à être, en définitive, celui de sa bibliothèque. Traquer le geste du réécrire, ce serait tenter
d’apercevoir que les lignes qui se tracent, les lignes qui sont lues et relues par le chercheur sont celles, en
définitive, des rayonnages de sa propre bibliothèque. Que sa bibliothèque rayonne dans ce qu’il lit comme une
face sombre que d’autres n’aperçoivent pas, un fuscum subnigrum par où le mouvement de réécriture apparaît et
puise ses virtualités dans le sombre fonds de son ethos.
Trois figures mythologiques donc à des degrés divers pour cerner le possible de la réécriture, autant d‘épreuves
physiques et de preuves mythiques : Orphée, le vaisseau Argo et la bibliothèque de Babel.
1. La figure orphique
Réécrire, ce serait peut-être d’abord s’approcher du mythe d’Orphée à l‘imitation de ce qu‘avait déjà su mettre en
évidence Maurice Blanchot selon qui Orphée montre que "Pour écrire, il faut déjà écrire."1 . Il existerait en effet
une possible tentation orphique dans le mouvement de la réécriture, tentation par laquelle celle-ci serait appelée
à se retourner sur elle-même, et cela dès son préfixe même. Le "ré" de la réécriture constitue en latin le préfixe
qui indique un mouvement en arrière : c’est le paradoxe aporétique de l’antéposition de la postériorité : c’est
ramener à un état antérieur tout en cherchant à progresser. En ce sens, le premier poète appellerait et
métaphoriserait ce geste même du réécrire, lui qui, parlant du fatum comme d‘un textus, entend "défaire la
trame" 2. Lors de sa remontée des Enfers, parti à la recherche d’Eurydice, Orphée, on s’en souvient, commet cet
hybris, comme le dit Ovide, de "jeter les yeux derrière lui, avant d’être sorti des vallées de l’Averne"3.
Désobéissant à cette recommandation du Rhodope, le poète thrace fait volte-face, ce qui imprime au Dire et à la
parole ce retournement liminaire, et confère à la réécriture sa première métaphore. Réécrire, ce serait ainsi se
retourner, revenir comme Orphée sur ses pas. Il s’agirait de jeter les yeux en arrière pour traquer son double,
retrouver et redécouvrir sa propre trace avant que cette dernière ne disparaisse, avant qu’elle ne s’efface, telle
http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (2 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:36
2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE
une origine qu‘on ne pourrait assigner. Ou bien au contraire, il s’agirait encore de revenir sur ses pas, non de
peur que ceux-ci ne disparaissent, mais pour les effacer. Dans une tentative comme dans l’autre, le poète et sa
parole se heurtent au même paradoxe aporétique fondateur du retournement que pose plus largement aussi la
réécriture dès sa préfixation : comment faire sans défaire, parfaire sans méfaire ? Comment mettre fin à ce
miroitement d’un langage devenu retour et réflexivité ?
Cependant, outre cette tension du retournement, le préfixe "ré" pointe aussi vers la réécriture comme le
mouvement de la répétition et de la réitération. Orphée, dans les Enfers, croise ces figures mythologiques de la
répétition que sont Tantale, Ixion, Sisyphe, figures qui, au chant d’Orphée, suspendent leurs peines. Comment
alors concilier ce retournement et la répétition ? Qu’est-ce qui permet d’atteindre cet éventuel objet perdu que
serait une perpétuelle Eurydice dans la réécriture : revenir ou ressasser ? A cette question, Maurice Blanchot
paraît répondre que "L’oeuvre dit le mot commencement à partir de l’art qui a partie liée avec le
recommencement."4
2. Le vaisseau Argo
Souvent tenu depuis Roland Barthes et son réflexif Roland Barthes par Roland Barthes 5 pour une métaphore
éclairante du structuralisme, le vaisseau Argo, mené par les Argonautes auquel il donne son nom, et au nombre
desquels Orphée se compte, paraît également pouvoir rendre compte métaphoriquement du travail de la
réécriture sur le texte lui-même, de son action à sa réalisation. Réécrire, ce serait peut-être ainsi trouver et
retrouver les gestes et la geste des Argonautes, finir par construire, sans arrêter de le reconstruire, ce même
navire sur lequel ils prirent place. Ce vaisseau qui, lors de divers épisodes, a traversé un certain nombre de
périples, se constitue lui aussi d’épreuves, d’essais successifs de lui-même. Sa permanence ne s’assure que dans
un mouvement indéfiniment réitéré de reconstruction. Exposé à divers outrages qui l’obligent à être continûment
réparé et refait, le vaisseau Argo adresse une question que ne peut également manquer de se poser la
réécriture : structure mobile qui ne connaît pas le coup d’arrêt, qui ne cesse de se modifier, quel est son rapport
à sa propre identité ? De ce qui est sans cesse repris, refait, quel rapport s’établit avec la structure première,
avec sa première écriture, sa première construction ? S’agit-il du même texte ou d’un autre ? Comme le disait
déjà Barthes à propos de ce navire6, la substitution d’une pièce à une autre entraîne-t-elle l’apparition d’un
nouvel objet ou la continuité d’une nomination identique assure-t-elle la persistance d’une modification à l’autre ?
Le texte réécrit conserve-t-il ainsi un rapport avec le texte premier dont il est issu ? Ce rapport ne peut-il être
maintenu que par le seul jeu d’une identité conférée par le nom, le titre ?
En outre, et enfin, le créateur même de ce vaisseau du réécrire peut lui-même apparaître comme une allégorie de
la figure même du redire, et de son perpétuel roulis entre ce qui est fait, ce qui se fait et ce qui reste à faire.
Argos, en effet, même s’il est souvent confondu avec d’autres, est paré d’un regard que toute réécriture paraît
réclamer : selon la tradition dont le Grimal fait état 7, il possédait quatre yeux : une paire regardant par devant
et l’autre regardant en arrière. Ainsi, à l’instar d’Argos, la réécriture supposerait un écrivain paré d’un tel regard,
toujours double : l’oeil quadruple pourrait se regarder se regarder...
3. La bibliothèque de Babel
Cette dernière figure mythique n’en est pas une à proprement parler. Elle fait écho à la nouvelle de Borges
intitulée "La bibliothèque de Babel" 8 qui elle-même fait écho à la tour de Babel biblique qu‘elle réécrit sans
détours. Ce texte, on s’en souvient, présente un bibliothécaire vivant dans une bibliothèque labyrinthique
supposée infinie, bibliothèque qui possède sur ses rayonnages tous les livres possibles. Cette nouvelle place la
réécriture non comme une possibilité mais comme une nécessité de toute pratique scripturale. Si tous les livres
sont déjà imaginés, l’écriture même ne peut plus se produire et provoquer l’événement. Dire la réécriture, redire
l’écriture revient à poser que dans cette bibliothèque qui promet tous les possibles et qui les accomplit, tout est
écrit si bien que tout ne peut être que réécrit. Tout geste tracé vient à suivre et à seconder un geste toujours-
déjà là, toujours-déjà commencé, toujours-déjà achevé aussitôt que commencé. La bibliothèque de Babel
confisque, par sa profusion inépuisable, l’écriture en l’assimilant à la lecture, posant entre les deux actes une
identité réverbérée. La réécriture serait ainsi selon Borges ce moment où l’on oublie que l’on écrit mais serait
bien plutôt cet âge où on lit, où, surtout, on se souvient d’avoir lu voire de s’être lu... La rhétorique ne sert plus :
la bibliothèque prend sa place comme l’indique Michel Foucault : "La littérature commence [...] quand le livre
n’est plus l’espace où la parole prend figure, mais le lieu où les livres sont tous repris et consumés"9. La
http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (3 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:36
2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE
bibliothèque de Babel donne ainsi naissance à ce que Foucault nommera encore "le moutonnement à l’infini des
mots"10. Si tout a déjà été dit, réécrire reviendrait comme le dit Henri Michaux, à "skier au fond d’un puits"11.
Ainsi donc, dire la réécriture, redire l’écriture, c’est constater que nous sommes tous gagnés par cette pathologie
du second demi-siècle, celle dont Roland Barthes a su mettre en évidence le symptôme le plus manifeste : "J’ai
une maladie : je vois le langage."12
Johan Faerber
Université de Paris 3
> Revenir au sommaire
Erica Durante
LA MAIN INVISIBLE. PARCOURS DANS L'ŒUVRE VISIBLE DE BORGES, VALÉRY, DANTE
Lorsqu’on parle de réécriture, c’est à Pierre Ménard qu’on pense en premier : lui, personnage-clef de la fiction de
la réécriture. C’est Borges qui l’a créé en 1939 ; son histoire est très simple, en dépit de toute la littérature
qu’elle a générée :
imaginez Pierre Ménard, raconte Borges, parvenu à la fin d’une longue carrière littéraire; or il en arrive à un
moment où il s’aperçoit qu’il ne veut plus encombrer le monde de ses œuvres. Et qu’il ne recherche pas la
renommée, bien que son destin soit d’écrire. […] alors il décide de se cantonner dans la plus grande discrétion et
de récrire une œuvre déjà existante, je dirai même tout à fait existante, continue Borges, vu qu’il s’agit de Don
Quichotte 1.
C’est à cette tâche ardue que se consacre Pierre Ménard. Il écrit un livre qui coïncide mot pour mot avec le
Quichotte de Cervantès, mais c’est lui qui en est l’auteur. Lui, un Français de Nîmes, qui se lance dans l’œuvre
"interminablement héroïque" de traduire le Quichotte, et qui finit par écrire le Quichotte lui-même, en faisant
correspondre dans une autre langue un texte qui existe déjà et auquel il adhère complètement 2. Cependant, en
faisant cela, Ménard ne peut éviter de filtrer le texte à travers son propre système linguistique, esthétique,
culturel 3. Entre "la feuille blanche et le bouillonnement des mots ou des histoires qui prennent forme", pour
Ménard, comme pour Silas Flannery, intervient "l’incommode diaphragme […] [du] style, [du] goût, [de] la
philosophie, la subjectivité, la formation culturelle, [du] vécu, [de] la psychologie, [du] talent, [d]es trucs du
métier. […]. Comme j’écrirais bien, regrettait Flannery, […] si je n’étais qu’une main, une main coupée qui saisit
une plume et se met à écrire…" 4. La main de Ménard, elle, est bien dans le prolongement de son bras… et même
de deux bras en même temps. C’est que Pierre Ménard pourrait être en soi la version revue et corrigée de
quelqu’un d’autre. De quelqu’un qui comme lui a publié dans cette revue de fin de siècle, que dirigeait Pierre
Louÿs, et qui s’appelait La Conque, de quelqu’un qui comme lui s’est intéressé au pseudo-problème d’Achille et de
la Tortue selon Zénon. De quelqu’un qui comme lui a cru que "penser, analyser, inventer […] ne sont pas des
actes anormaux, [mais qu’] ils constituent la respiration normale de l’intelligence" 5. Un symboliste de Nîmes, ce
Pierre Ménard, "essentiellement dévot, de Poe, qui engendra Baudelaire, qui engendra Mallarmé, qui engendra
Valéry" 6. Paul Valéry : la vie et l’œuvre de Paul Valéry seraient comme le négatif de la vie et l’œuvre de Pierre
Ménard. Une vie derrière laquelle d’autres ont cru voir l’ombre d’Unamuno ou celle de Louis Ménard, poète et
traducteur, dont une biographie synthétique nous a été livrée par Rémy de Gourmont 7. Cette hypothèse risque
de passer pour une provocation vis-à-vis de Valéry qui tenait pour banales et superflues ces conjectures autour
des personnages :
J’ai toujours trouvé ridicules, disait-il, ces critiques ou glossateurs qui traitent des personnages de roman ou de
théâtre comme si ce fussent des personnes réelles, disputent de leur vraie nature, se demandent si Hamlet ou si
Tartuffe furent tels et tels, spéculent sur les passions et les responsabilités de Phèdre hors de la pièce. Mais tous
ces êtres s’évanouissent à peine sortis de la scène. On ne sait de quoi mange le Cid, ni si Béatrice n’avait mal aux
dents […] 8.
http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (4 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:36
2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE
A ce sujet, Borges s’accordait parfaitement avec Valéry, comme d’ailleurs sur bien d’autres questions. Chez lui
aussi c’est une figure dantesque, le comte Ugolin, condamné parmi les traîtres pour avoir mangé ses propres fils,
qui donne lieu à cette réflexion sur la nature des personnages :
Pour Robert Louis Stevenson (Ethical Studies, 110) les personnages d’un livre sont des suites de mots ; si
blasphématoire que cela nous paraisse, c’est à cela que se réduisent Achille ou Peer Gynt, Robinson Crusoé ou
Don Quichotte. Tout comme les puissants qui régirent le monde : Alexandre n’est qu’une suite de mots et Attila
une autre. D’Ugolin nous dirons qu’il est une texture verbale d’une trentaine de tercets. Devons-nous inclure dans
cette texture la notion de cannibalisme ? Il nous faut […] en avoir le soupçon, incertain et craintif 9.
En ce qui concerne le personnage de Pierre Ménard, "devons-nous inclure dans sa texture" Valéry ? Ne pas le
faire serait aller à l’encontre de la technique qu’emploie Ménard, celles des "anachronismes délibérés et des
fausses attributions". Ce serait exclure des possibles, ce qui n’advient pas dans l’art. Parmi les pièces qui
composent l’œuvre visible de Pierre Ménard, par opposition à son œuvre souterraine, qui est le Quichotte, figure
une "transposition en alexandrins du Cimetière marin". Une transposition, un passage, une variation dans un
autre code, non pas linguistique, comme dans le cas du Quichotte que Ménard lit, et par là réécrit en français,
mais dans un code prosodique. Le Cimetière marin est en effet l’un des rares poèmes modernes de la langue
française à avoir entièrement été écrit en décasyllabes. Si nous remontons vers 1916, lorsque Valéry a très
probablement commencé à écrire les premiers vers du Cimetière, nous voyons comment ce poème s’apparente
intimement à un autre poème, qui est l’un des plus chers à Borges, La Divine Comédie de Dante Alighieri :
Quant au Cimetière marin, dit Valéry, cette intention ne fut d’abord qu’une figure rythmique vide, ou remplie de
syllabes vaines, qui me vint obséder quelque temps. J’observai que cette figure était décasyllabique, et je me fis
quelques réflexions sur ce type fort peu employé dans la poésie moderne ; il me semblait pauvre et monotone. Il
était peu de chose auprès de l’alexandrin, que trois ou quatre générations de grands artistes ont prodigieusement
élaboré. Le démon de la généralisation suggérait de tenter de porter ce Dix à la puissance du Douze. Tout ceci
menait à la mort et touchait à la pensée pure. (Le vers choisi de dix syllabes a quelque rapport avec le vers
dantesque) 10.
Résister à l’alexandrin, lutter contre ce que Valéry appelle "le démon de la généralisation", qui le ramenait vers
l’alexandrin, a donc été l’un des enjeux d’écriture de ce poème qui porte en soi une "illumination musicale"
venant de l’étranger et de très loin dans le temps. Lorsqu’en 1939 il écrivait Pierre Ménard, il est très probable
que Borges savait qu’un des enjeux majeurs pour Valéry, au moment de la composition du Cimetière, avait été
d’atteindre la sonorité d’un vers désuète pour la poésie française : l’hendécasyllabe, le vers de Dante, le vers
italien par excellence, qui, à son tour, dérive du vers de dix syllabes de la poésie provençale. Le Cimetière est
donc un texte qui lui est familier et cher. Il le préface lorsque paraît la traduction argentine du poème, par son
ami, le poète Néstor Ibarra. Et c’est d’ailleurs à ce moment-là, sept ans avant qu’il ait eu l’idée d’écrire Pierre
Ménard, que, toujours à propos de Valéry, toujours à propos du Cimetière, il s’était amusé à renverser, quoique
d’une autre manière, le statut du poème, en anticipant cette manie propre de Ménard de "propager des idées
strictement contraires à celle qu’il préférait" 11. Il l’avait fait dans la même optique : celle de déposséder le
Cimetière de son auteur unique, celle d’en faire un texte a-despote, comme disent les philologues, un texte qui
ne porte pas le nom de l’auteur :
J’invite […] le quelconque sudaméricain -mon semblable, mon frère-, avait-il écrit, à se saturer de la cinquième
strophe du Cimetière dans le texte espagnol, jusqu’à éprouver que le vers original d’Ibarra : la pérdida en rumor
de la ribera est inaccessible, et que son imitation par Valéry : le changement des rives en rumeur n’en rend
qu’imparfaitement l’effet. Soutenir le contraire avec une conviction excessive serait abjurer l’idéologie de Valéry
en faveur de l’homme temporel qu’il a proposée 12.
Contemporain de Paul Valéry, le personnage de Pierre Ménard, qui alexandrinise le Cimetière, ne s’adonne pas à
un simple exercice de transmétrisation, mais se pose le problème primordial de l’écriture en vers, celui du rythme
13. Sa variation ne concerne pas la modification de l’aspect formel du texte, mais consiste dans une inversion
plus profonde, qui touche au labeur de Valéry, et qui en changeant le son, change aussi le sens du texte 14.
Avant d’être auteur du Quichotte, Pierre Ménard serait donc auteur du Cimetière marin, qu’il manie et réécrit
comme s’il s’agissait d’un brouillon et non pas d’un texte définitif. L’opération qu’il conduit sur le texte valéryen
http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (5 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:36
2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE
s’accorde parfaitement avec la célèbre formule de Valéry, d’après laquelle "un texte n’est jamais achevé, mais
toujours abandonné" 15, et se fait l’écho de Borges qui affirme que "tout est brouillon […], l’idée de texte définitif
ne relevant que de la religion ou de la fatigue" 16.
A côté de Pierre Ménard, il y a un autre personnage, cette fois-ci non pas français mais argentin, Hilario Lambkin
Formento, qui apparaît vingt-six ans après dans les Chroniques de Bustos Domecq. Un recueil de textes où l’on a
également l’impression de perdre les traces de l’Auteur, Honorio Bustos Domecq n’étant que l’auteur imaginaire
de ces chroniques, inventé par cet autre auteur qui est Biorges, anagramme de Borges et Bioy. Parmi les
comptes rendus édités par Bustos Domecq, l’un porte sur Hilario Lambkin Formento. Un critique de profession qui
publie des articles reconnus pour leur objectivité, et qui, en 1929, décide d’abandonner sa carrière pour se
"consacrer entièrement à une étude critique de La Divine Comédie". Pour ce faire, il commence à "éliminer le
prologue, les notes, l’index, le nom et l’adresse de l’éditeur", et ne garde que le corps des trois cantiche de la
Comédie, telles que les conçut Dante, en faisant "coïncider [son analyse] mot pour mot avec le poème" 17. Cette
œuvre, dépourvue de tous ces éléments paratextuels et extratextuels, est celle que s’approprie et que livre
Formento, en éditant l’Enfer, le Purgatoire et le Paradis. … C’est ainsi que la main invisible de Dante a atteint
également celle de Borges, outre celle de Valéry. Avant même de le surprendre assis à sa table de travail, c’est
dans sa bibliothèque que le fantôme de Dante effleure la main de Borges ; pour le poète argentin, le moment de
la lecture est en réalité le moment privilégié de la réécriture dantesque. Dans le bus qui l’amène à son lieu de
travail, une bibliothèque municipale à l’autre bout de Buenos Aires, Borges lit et note, au dos de son exemplaire
de poche bilingue italien-anglais de La Divine Comédie, un, deux, trois vers qui pour diverses raisons le touchent
plus que d’autres 18. Alberto Manguel, romancier, historien de la lecture, qui a souvent participé et même animé
par sa propre voix les heures de lecture du poète au moment où il était devenu aveugle, raconte la façon dont les
livres devenaient vite avec Borges des objets parlants, des livres sonores, avec ces apostilles manuscrites qu’il y
apposait. "Souvent, dit-il, [Borges] me demandait de noter quelque chose sur la page de garde à la fin du livre
que nous lisions- la référence d’un chapitre ou une réflexion. Je ne sais pas quel usage il pouvait en faire, mais
j’ai pris, moi aussi, l’habitude de parler des livres derrière leur dos" 19. Certaines des notes de lecture inscrites
sur les exemplaires de la Comédie que possédait Borges, ont récemment été retrouvées. Aujourd’hui encore
inédites, elles sont très intéressantes, parce qu’elles contiennent des remarques, des bribes de réflexion, et parce
qu’elles montrent comment le moment de la lecture de la Comédie coïncide avec le premier jet de la réécriture
qui s’inspire de Dante. Une réécriture qui s’étend sur quarante ans, et qui connaît tous les genres, avant d’aboutir
à la publication d’un recueil monographique sur la Comédie, les Neuf essais sur Dante, paru pour la première fois
en 1982. Quatre de ces notes autographes, inscrites à quatre dates différentes, au dos de quatre éditions
distinctes, se rapportent au cinquième chant de l’Enfer, le chant des luxurieux, de ces esprits condamnés pour
avoir commis le péché de chair, parmi lesquels Dante rencontre deux amoureux infernaux, Paolo Malatesta et
Francesca da Rimini:
[1] [1943, éd. Dent] E paion sì al vento esser leggieri [Enf., V, 75]
[Et qui semblent si légers dans le vent]
[2] [1947, éd. Casini] soli stavamo [sic] (De Sanctis) Cf. Furioso I, 22 [Enf., V, 129 n[ote]]
[nous étions seuls] (De Sanctis) Cf. Furieux I, 22]
[3] [1949, éd. Provenzal]…di quel che in noi si maturava [Enf., V, 129 n[ote]]
[… de ce qui mûrissait en nous]
[4] [1954, éd. Torraca] Notevole l'allitterazione: 142 [Enf., V, 142] 20
[Remarquable l’allitération : 142]
En transcrivant ces fragments, exactement comme Pierre Ménard, Borges se dissimule derrière le texte qu’il
transcrit et enrichit de son œil de lecteur du XXe siècle. La première note consiste dans la reprise littérale d’un
http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (6 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:36
2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE
vers prononcé par Dante-personnage, avant qu’il adresse la parole à Francesca, et atteste de l’impression que
Borges a reçue de la concision et de la force de ce vers. La troisième et la quatrième renvoient au commentaire
contenu dans la note en bas de page, tantôt sur un problème d’interprétation [3], tantôt sur une impression
rythmique [4]. Dans ce vers final du chant, qui est le 142e, Borges apprécie l’effet que Dante arrive à produire
par une allitération qui lui paraît remarquable : "e caddi come corpo morto cade", "et je tombai comme tombe un
corps mort" 21. "Toute La Divine Comédie, dit-il, est pleine de bonheurs de ce genre". Mais c’est surtout la
deuxième annotation qui pose une question plus intéressante. "Soli eravamo e sanza alcun sospetto", "nous
étions seuls et sans aucun soupçon" 22, avoue Francesca, et c’est notamment ce dernier mot, sospetto,
"soupçon" qui fait résonner dans l’esprit de Borges une troisième voix, celle de l’Arioste. En voyant apparaître le
substantif sospetto, l’analogie se fait chez lui avec un vers du premier chant du Roland Furieux : "insieme van
senza sospetto aversi", "c’est ensemble qu’ils vont, sans avoir de méfiance" 23.
D’une écriture à l’autre, d’une lecture à une autre, mais aussi d’une langue à une autre, l’épisode de Paolo et
Francesca parcourt les âges. Comme s’il était conduit par une main invisible, il se glisse des peintures d’Ingres,
aux poésies de Bécquer, D’Annunzio, Unamuno, de la musique de Rachmaninov qui lui consacre un opéra entier,
à la prose de cet autre argentin, Leopoldo Lugones, pour arriver jusqu’à Borges, qui, vers la fin de sa vie,
compose un long poème intitulé Inferno, V, 129 24. Sensible à ce foisonnement d’œuvres qui se développent
autour des deux amants incestueux, Borges récupère, dans le texte de Dante, l’élément qui est à la fois à
l’origine et à l’aboutissement de cette profusion de réécritures diverses. Un élément, le livre, déjà présent dans le
texte dantesque, où il joue un rôle capital dans la révélation de la passion amoureuse :
127 Noi leggiavamo un giorno per diletto
127 Di Lanciallotto come amor lo strinse ;
127 Soli eravamo e sanza alcun sospetto.
130 Per più fïate li occhi ci sospinse
127 Quella lettura, e scolorocci il viso ;
127 Ma solo un punto fu quel che ci vinse.
133 Quando leggemmo il disïato riso
127 Esser baciato da cotanto amante,
127 Questi, che mai da me non fia diviso,
136 La bocca mi baciò tutto tremante.
127 Galeotto fu’l libro e chi lo scrisse :
127 Quel giorno più non vi leggemmo avante 25.
[Trad. : Nous lisions un jour par agrément/ de Lancelot, comment amour le prit:/ nous étions seuls et sans aucun
soupçon/ Plusieurs fois la lecture nous fit lever les yeux/ et décolora nos visages/ mais un seul point fut ce qui
nous vainquit./ Lorsque nous vîmes le rire désiré/ être baisé par tel amant,/ celui-ci, qui jamais plus ne sera loin
de moi,/ me baisa la bouche tout tremblant./ Galehaut fut le livre et celui qui le fit ;/ ce jour-là nous ne lûmes pas
plus avant] 26.
Lancelot du lac, un des romans du cycle de la Table Ronde, un livre, un de ceux qui ont alimenté la folie d’Alonso
Quijano, le futur Don Quichotte. Un livre, voici ce que Dante met entre leurs mains comme aveu de cet amour,
qui est réciproque et malheureux comme celui de Lancelot et de la reine Guenièvre. Tel le philtre dans le Roman
de Tristan, ou le personnage de Galehaut, qui dans le Lancelot se fait l’intercesseur des amoureux, le livre
devient ici un instrument de biographie pour ces "usufruitiers des lettres" qui sont Paolo et Francesca 27, mais,
avant eux, Dante, qui connaissait les romans du cycle arthurien, et qui réécrit un fait ayant réellement eu lieu et
circulant dans la Florence de son temps, à la lumière d’une autre littérature :
De tous les instruments de l’homme, affirme Borges, le plus étonnant est, sans aucun doute, le livre. Les autres
sont des prolongements de son corps. Le microscope et le télescope sont des prolongements de sa vue ; le
téléphone est un prolongement de sa voix ; nous avons aussi la charrue et l’épée, prolongement de son bras. Mais
le livre est autre chose : le livre est un prolongement de sa mémoire et de son imagination 28.
Mémoire poétique et imagination sont d’ailleurs deux dimensions qui régissent la poésie de la Comédie. Dans un
de ses derniers essais sur Dante, Borges écrit que La Divine Comédie "n’est pas le caprice isolé et fortuit d’un
http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (7 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:36
2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE
individu mais l’effort conjugué d’un grand nombre d’hommes et de générations. Rechercher ses précurseurs,
continue-t-il, ce n’est pas se livrer à une misérable tâche de caractère juridique ou policier ; c’est sonder les
mouvements, les tâtonnements, les aventures, les intuitions et les prémonitions de l’esprit humain" 29. Si nous
nous en tenons au chant de Paolo et Francesca, qui est à son tour à l’origine d’une longue descendance de
réécritures multiformes, nous voyons qu’il n’est pas seulement la réinvention d’un épisode de Chrétien de Troyes,
mais qu’il reprend aussi d’autres textes médiévaux, contemporains de Dante, et qui eux aussi abordent le thème
de l’amour, tel les traités d’André le Chapelain, les chansons "stilnovistes" de Guido Guinizelli, ainsi que d’autres
chansons écrites par Dante, et qui étaient déjà contenues dans la Vie nouvelle.
Dans Inferno, V, 129, l’image du livre ressurgit, bien qu’il ne s’agisse pas du Lancelot, mais plutôt de la Comédie,
que Borges tient pour le sommet de la littérature, ou mieux encore il s’agit d’un livre à venir, unique, el máximo,
le plus grand, qui contiendra en soi tous les possibles. Quel que soit ce livre, le geste initial de Paolo et Francesca
est très significatif :
555Dejan caer el libro, porque ya saben
555que son las personas del libro.
555( Lo serán de otro, el máximo,
555pero eso qué puede importarles.)
555Ahora son Paolo y Francesca
555No dos amigos que comparten
555El sabor de una fábula
555Se miran con incrédula maravilla
555Las manos no se tocan
10 Han descubieto el único tesoro
555Han encontrado al otro
555No traicionan a Malatesta,
555Porque la traición requiere un tercero
555Y sólo existen ellos dos en el mundo 30.
[Trad. : Ils laissent de côté le livre, car ils savent/ qu’ils sont les personnages du livre./ (Ils le
seront d’un autre, le plus grand/ mais ils ne s’en soucient guère.)/ Ils sont maintenant Paolo et
Francesca/ et non deux amis qui partagent/ la saveur d’une fable./ Ils se regardent émerveillés,
sans le croire./ Leurs mains ne se touchent pas./ Ils ont trouvé l’unique trésor/ Ils ont découvert
l’autre./ Ils ne trahissent pas Malatesta,/ Puisque la trahison réclame un tiers/ et qu’il n’existe
qu’eux deux au monde] 31.
Borges filtre l’épisode des deux amants en le délivrant de tout fardeau moral. Ni péché ni pitié, ni tourmente
infernale n’apparaissent dans son poème. Une seule allusion au malheur dérivant de cet amour inavouable y est
contenue : le nom de Malatesta, mari légitime de Francesca et frère de Paolo, mais, aussitôt écarté, le ton
clément et harmonieux du texte n’en est pas altéré. Il y a pourtant un élément qui se maintient de Dante à
Borges : le livre, fil conducteur de tout le poème. Il réapparaît peu après, par l’évocation d’Adam et Eve, le
premier couple de pécheurs : c’est la Genèse, le premier de tous les livres qui composent la Bible. Métaphore
textuelle de la réécriture, ce texte sacré est composé de tant de livres d’auteurs différents, appartenant à
différentes époques, et pourtant attribués à un seul Esprit :
15 Son Paolo y Francesca
15 Y también la reina y su amante
15 Y todos los amantes que han sido
15 Desde aquel Adán y Eva
15 En el pasto del Paraíso.
20 Un libro, un sueño les revela
15 Que son formas de un sueño que fue soñado
15 En Tierras de Bretaña
15 Otro libro hará que los hombres,
15 Sueños también los sueñen 32.
http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (8 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:36
2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE
[Trad. : Ils sont Paolo et Francesca/ et puis la reine aussi et son amant/ et tous les amants qui ont
vécu/ depuis le premier Adam et son Eve/ dans la pâture du Paradis./ Un livre, un rêve leur
révèle/ qu’ils sont les formes d’un rêve qui fut rêvé/ en terres de Bretagne./ Un autre livre
accordera aux hommes,/ Rêves aussi, de les rêver] 33.
Cet empilement de rêves, cet emboîtement de lectures, dans cette fin de poème, pourrait faire croire, par ses
bifurcations successives, à une dispersion d’unité, ce qui est peu probable pour Borges qui se figure la Comédie
comme une estampe de portée universelle, comme une œuvre absolue, "où aboutit tout ubi et quando" 34. Le
procédé par enfilade qui voit dériver Paolo et Francesca d’un rêve que d’autres ont rêvé, et dont d’autres
rêverons à partir d’eux, fait penser à la structure d’un arbre généalogique, où tant de dates, tant de noms, tant
de liens en engendrent tant d’autres, qui racontent une seule lignée, une seule histoire qui se transmet de
génération en génération sans pourtant être jamais la même. Pour les textes aussi on peut établir des arbres
généalogiques ; ce sont les philologues qui le font. En écartant les différentes ramifications des témoignages
qu’ils possèdent d’un texte, ils remontent à l’archétype. Ainsi, l’arbre généalogique montre plus qu’une dispersion
du texte original, une ampliation d’unités, pour employer l’expression de Bustos Domecq 35. Une ampliation, une
dilatation, comme celle que depuis Chrétien de Troyes nous avons suivie tout au long de ce parcours.
De Dante, nous ne possédons aucun document autographe, pas de lettres, pas de poèmes, et bien sûr pas de
vers de la Comédie. Il y a pourtant huit cents codices de la Comédie qui nous sont parvenus grâce à l’effort et à
la patience de tant de Pierre Ménard, dont un des premiers fut Boccace, qui copia ce texte, en inaugurant une
nouvelle tradition manuscrite de la Comédie. En comparant, en épurant ces codices de leurs contaminations, on
est arrivé à établir un énorme arbre généalogique et donc un texte souche, qui devrait s’approcher le plus
possible de celui que la main visible de Dante a écrit. Comme tout arbre généalogique, celui de la Comédie est
toujours en évolution, tout en haut de ses branches, il y a désormais le Cimetière Marin, L’Aleph, Inferno, V, 129.
Par cette multitude de réécritures, de branches qui se rejoignent et se croisent, la littérature finit par
correspondre à l’image que Borges s’était fait d’elle : celle "d’une forêt, assez dense d’ailleurs, où nous nous
empêtrons, et en perpetuelle croissance, […] une sorte de labyrinthe vivant […]" 36.
Une forêt labyrinthique, dirait Borges, obscure dirait Dante.
Erica Durante
Université de Picardie, Jules Verne
> sommaire
> début de l'article
> auteur
Noëlle Benhamou
MIROIR DE LA PARODIE : L'EXEMPLE DE MAUPASSANT
La réécriture est au cœur de l’esthétique du XIXe siècle. Flaubert et Zola récrivent intentionnellement et
parodient des textes fondateurs (Bible, mythes…) ou contemporains comme leurs brouillons ou carnets de notes
le prouvent : Phèdre, hypotexte de La Curée ; la Blonde Vénus dans Nana, parodie de La Belle Hélène
d’Offenbach. Nous ne disposons pas toujours d’avant-textes, surtout lorsque l’auteur corrigeait sur le marbre.
C’est le cas pour Maupassant dont l’œuvre même porte la trace de réécritures successives - rien ne se perd, tout
se transforme : des nouvelles sont le point de départ de romans ou sont transposées au théâtre 1. Mais l’écrivain
va parfois plus loin que l’auto-emprunt et l’auto-greffe. Il se parodie. Les Rois, publié dans Le Gaulois en 1887 2,
fait écho à Mademoiselle Fifi : pendant la guerre de 1870, des officiers français occupent une maison bourgeoise
et tuent accidentellement un vieux berger sourd. Si le bref résumé du conte de 1887 présente un vague rapport
avec celui de 1882, leur étude comparée et minutieuse révèle des similitudes étonnantes et un lien étroit, sans
doute voulu par l’auteur, à tel point qu’on peut voir dans ces deux nouvelles sur la guerre une sorte de diptyque.
Maupassant était-il conscient d’avoir ainsi créé un miroir à deux faces ? Pourquoi a-t-il repris son premier récit de
guerre en inversant la situation et les personnages ?
http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (9 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:36
2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE
Analyse de la structure narrative des deux nouvelles
La structure de Mademoiselle Fifi sert de contrepoint à celle des Rois. Dans le château d’Uville qu’ils ont investi,
des officiers prussiens s’ennuient. Il pleut et les jeux de destruction inventés par Fifi - faire la mine, défigurer des
tableaux de maîtres - ne les distraient plus. Ils décident d’organiser une fête et de trouver des femmes. Le vieux
soldat Le Devoir les y aidera. Cinq filles de joie arrivent et des couples se forment. On boit et on se livre à la
débauche. Rachel, révoltée par l’attitude sadique et provocante de son partenaire, Fifi, tue l’officier d’un coup de
couteau et s’enfuit. Les femmes ont peur d’être massacrées et sont sauvées grâce à l’intervention du major qui, "
non sans peine, empêcha cette boucherie " 3. Une battue est organisée pour retrouver la coupable. Les Prussiens
tuent plusieurs des leurs par mégarde et rentrent bredouille. La nouvelle pourrait s’arrêter là. La version
définitive dévoile la présence de Rachel cachée dans le clocher de l’église par le curé et présente une situation
finale morale, digne des contes de fée : son mariage avec un homme de bien, un patriote.
Dans Les Rois, Maupassant reprend la même trame que Mademoiselle Fifi. La situation initiale est identique :
arrivés dans la ville de Porterin, des officiers français de bonne famille prennent possession d’une maison
bourgeoise. Il pleut et comme c'est le jour des Rois, ils veulent préparer un repas pour cette fête et souhaitent la
présence de femmes. Un curé espiègle est censé les aider dans cette mission. En attendant, les soldats exultent.
Quel n'est pas leur étonnement de voir arriver le curé, une religieuse et trois vieilles femmes infirmes ! Les
officiers font contre mauvaise fortune bon cœur ; des " couples " se forment. On boit et on se montre galant. Un
coup de feu retentit. C'est le branle-bas de combat. On ramène un vieux berger moribond qui n’a pas entendu la
sommation car il est sourd. Les femmes apeurées s’en vont. Le dernier mot revient au curé : " Ah ! quelle vilaine
chose ! " 4, sous-entendu " que la guerre " ; le terme " guerre " n’est même plus prononcé.
Mademoiselle Fifi (Gil Blas, Les Rois (Le Gaulois, 23/01/1887)
23/03/1882)
- récit à la troisième personne - souvenirs du comte de Garens à la
- le château d’Uville première personne
- des officiers de bonne famille, - une maison bourgeoise à Porterin
gradés - des officiers de bonne famille
- le major Farlsberg dans le fauteuil - Marchas dans un fauteuil devant le feu
- idée de chercher des femmes pour - idée de chercher des femmes pour les
une fête Rois - aide d’un curé espiègle
- aide d’un vieux sous-officier Le - joie des soldats, attente et préparatifs
Devoir - arrivée d’une religieuse, d’un curé et
- joie des soldats, " mine ", de trois infirmes
préparatifs - présentation des femmes impotentes
- arrivée des cinq prostituées - on boit, on " courtise "
- présentation des filles - on ouvre la fenêtre
- on boit, on se livre à la débauche - coup de feu et branle-bas de combat
- la fenêtre est ouverte - un vieux sourd moribond, tué par
- Rachel poignarde Fifi mégarde - peur des femmes
- Mlle Fifi, raide mort - mot final du curé
- peur des femmes
- coups de feu des Prussiens qui
tuent les leurs par mégarde
- Rachel cachée par le curé
On voit, d’après le tableau ci-dessus, que les deux récits sont construits selon le même schéma narratif. En
Normandie, pendant la guerre franco-prussienne, des officiers de bonne famille occupent un lieu réquisitionné,
s’ennuient et éprouvent la nécessité d’aller chercher des femmes. Ils dînent en leur compagnie et un accident
mortel a lieu gâchant la fête. Des détails et des scènes caractéristiques sont également repris, comme cette pluie
qui accompagne les événements, favorise l’ennui des militaires et par là-même déclenche l’action. La pluie est
http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (10 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:36
2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE
liée à l’idée de fatalité. Dans les écrits maupassantiens, elle annonce presque toujours un malheur et un
bouleversement narratif. La pluie diluvienne de Mademoiselle Fifi marquait la présence d’une puissance divine,
supérieure, permettant le châtiment des Prussiens. Celle des Rois, insidieuse et glacée, ne renvoie qu’au néant et
à l’absence de toute forme de déité. Dieu s’est retiré du monde.
" La pluie tombait à flots, une pluie " La pluie commençait à tomber,
normande qu’on aurait dit jetée par une pluie menue, glacée, qui nous
une main furieuse, une pluie en biais, gelait avant de nous avoir mouillés,
épaisse comme un rideau, formant une rien qu’en touchant les manteaux. "
sorte de mur à raies obliques, une pluie 6
cinglante, éclaboussante, noyant tout,
une vraie pluie des environs de Rouen,
ce pot de chambre de la France. " 5
Délaissé par Dieu, l’homme est étranger à lui-même et à ses semblables : telle pourrait être une autre leçon de
ces fables d’un genre nouveau.
Maupassant a également repris une courte scène de Mademoiselle Fifi où le haut gradé allemand reposait dans un
fauteuil :
" Le major, commandant prussien, " Je trouvai Marchas étendu dans un
comte de Farlsberg, achevait de lire grand fauteuil Voltaire, dont il avait
son courrier, le dos au fond d’un grand ôté la housse, par amour du luxe,
fauteuil de tapisserie et ses pieds disait-il. Il se chauffait les pieds au
bottés sur le marbre élégant de la feu, en fumant un cigare excellent
cheminée, où ses éperons, depuis trois dont le parfum emplissait la pièce. Il
mois qu’il occupait le château d’Uville, était seul, les coudes sur les bras du
avaient tracé deux trous profonds, siège, la tête entre les épaules, les
fouillés un peu plus tous les jours. " 7 joues roses, l’œil brillant, l’air
enchanté. " 8
Il y a une différence entre les forces défensives et les envahisseurs. Même dans un moment d’ennui extrême,
l’armée prussienne garde sa discipline légendaire et symbolise la destruction. Le relâchement sympathique des
Français se retourne contre eux, l’auteur nous montrant les deux extrêmes de l’armée.
Autre scène semblable : dans les deux contes, les soldats tuent leurs compatriotes par maladresse et selon une
ironie du sort.
" Deux soldats avaient été tués, et trois " François a blessé un vieux paysan,
autres blessés par leurs camarades qui refusait de répondre au : "Qui
dans l’ardeur de la chasse et vive ?" et qui continuait d’avancer,
l’effarement de cette poursuite malgré l’ordre de passer au large.
nocturne. " 9 On l’apporte d’ailleurs. Nous verrons
ce que c’est. " 10
On pourrait multiplier les exemples. Depuis Mademoiselle Fifi, la position de Maupassant sur la guerre, cette
boucherie absurde, s’est affermie 11 et sa vision du monde a définitivement sombré dans le pessimisme le plus
désespéré. Les Rois, écrit en 1887 soit dix-sept ans après le conflit franco-prussien, s’est dépouillé de toute
marque de patriotisme. Ce conte n’est ni pro-français ni anti-prussien puisque l’adversaire n’est pas présent. La
Mort seule est l’Ennemie, invisible et sans frontières, contre laquelle on ne peut rien. Le diptyque constitué par
Mademoiselle Fifi et Les Rois montre les deux facettes de l’existence : la vie et la mort. Mademoiselle Fifi est
placé du côté de la vie, de l’optimisme avec une happy end étonnante. La scène d’orgie, remplie de plaisir et de
gaieté, offre une insouciance retrouvée. Les Rois en est le revers et représente la mort, le pessimisme foncier
http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (11 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:36
2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE
étant présent dans la clausule.
Si la structure et le contexte des deux récits sont symétriques, Maupassant a néanmoins changé les registres,
modifié et inversé la situation et les personnages de la nouvelle de 1882 : dans Les Rois, les soldats sont français
(prussiens dans Mademoiselle Fifi), une maison bourgeoise est réquisitionnée (un château dans Mademoiselle
Fifi), les femmes sont de vieilles infirmes et une bonne sœur (des prostituées dans Mademoiselle Fifi).
Mademoiselle Fifi était une attaque contre certaines valeurs mais son récit inversé Les Rois est, lui, caustique,
grotesque et autoparodique. L’inversion carnavalesque invite à réflexion et passe par la reprise de thèmes et de
personnages déformés.
Les thèmes et le traitement des personnages.
Dans Les Rois, plus encore que dans Mademoiselle Fifi et d’une façon différente, sont présents le désir sexuel lié à
la nourriture et à la gastronomie, la mort, la violence guerrière et la fatalité. Avec une précision étonnante,
l’auteur reprend des éléments de sa première nouvelle et les soumet à l’épreuve du miroir. Apparaît alors une
image en négatif, un certain nombre de détails étant conservés mais retournés. Les Rois est placé sous le signe
de la farce et du renversement carnavalesque. Le moment même de l’histoire - le jour des rois - invite à cette
interprétation. Le Carnaval commence en effet à l’Epiphanie et certains personnages sont des figures de
carnaval : le curé paillard ; sa bonne ratatinée, Hermance ; la petite religieuse ridée ; les trois infirmes
annoncées par des bruits de bâtons et de pilons, et pour finir ce berger sourd… Autant de personnages
grotesques et hideux.
Les personnages masculins n’échappent pas à ce processus de transformation. Contrairement à leurs cinq
homologues prussiens caricaturés 12, les Français, six officiers de hussards appartenant tous à l’aristocratie ou
au monde artistique parisien, sont à peine décrits physiquement. Maupassant insiste davantage sur leurs
qualités, surtout sur celles de Pierre de Marchas, sorte de double de l’auteur, la tête pensante de la bande, un
être à part, doué en tout et plein de ressources. Homme de lettres raffiné, il promet à Garens d’écrire leur
histoire s’il peut trouver des femmes : " Je t’en prie, vas-y. Je raconterai la chose en vers, dans la Revue des
Deux Mondes, après la guerre, je te le promets. " 13 Cette mise en abyme du récit fait partie des nombreux clins
d’œil de l’auteur, autant de signaux annonçant la parodie. Si les envahisseurs teutons du château d’Uville étaient
présentés comme des soudards, des vandales, les soldats français des Rois aiment le luxe et le beau en hommes
du monde. Il n’est jamais question de destruction d’objets précieux dans la nouvelle de 1887. Au contraire, les
six officiers français sont des esthètes et respectent le mobilier du lieu qu’ils occupent.
La souplesse des militaires français et leur galanterie leur sont très utiles lors de l’apparition des " invitées
surprises ". L’étonnement et la déception passés, les hommes des Rois accueillent avec aménité ces reines peu
banales, " trois infirmes hors de service "14. Excepté Marchas, les soldats font même preuve d’un sens du fair-
play peu commun face à la blague du curé. Croyant recevoir des compagnes de plaisir, ils se moquent de l’abbé
en acceptant de passer une fête bon enfant avec ces femmes repoussantes. Les paroles de remerciements de la
religieuse prêtent à Garens un esprit de dévouement inattendu et usurpé.
Elle s’était retournée vers ses invalides, pleine de sollicitude pour elles ; puis, voyant mes galons de maréchal des
logis, elle me dit :
" Je vous remercie bien, monsieur l’Officier, d’avoir pensé à ces pauvres femmes. Elles ont bien peu de plaisir dans
la vie, et c’est pour elles en même temps un grand bonheur et un grand honneur que vous leur faites. " 15
Ces paroles de la sœur Saint-Benoît marquent le retournement de la situation : les hommes n’auront pas de
plaisir avec des femmes mais les infirmes goûteront le rare plaisir d’un bon repas et d’une distraction avec une
compagnie masculine.
Dans les deux nouvelles, les femmes sont au cœur de l’intrigue. Elles sont attendues, espérées même. Leur
arrivée auprès des soldats va donner matière à une description truculente. Qu’y a-t-il pourtant de commun entre
les filles de maison de Mademoiselle Fifi et les invalides des Rois ? Rien, si ce n’est que filles et malades,
enfermées dans une maison, sont des caricatures du féminin : les pensionnaires de maison sont sursexualisées,
prêtes à être consommées, tandis que les vieilles éclopées, pensionnaires de " l’établissement hospitalier " 16
http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (12 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:36
2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE
dirigé par la sœur Saint-Benoît, sont impropres à la consommation. Elles représentent les différents âges
extrêmes de la vie : la jeunesse qui attire le désir et la convoitise, et la vieillesse accablée de maux physiques qui
provoquent le dégoût et la répulsion. Toutes se font une joie de sortir de leur cadre habituel pour tromper leur
ennui. De plus, les filles espèrent un gain financier conséquent, tandis que les recluses voient dans cette
invitation l’occasion de bien manger, seul plaisir qui leur reste.
Dans Mademoiselle Fifi, le repas était précédé de la présentation et de l’attribution des filles aux soldats. Tout
cela était orchestré par le capitaine très attaché au décorum. La description des cinq pensionnaires était déjà une
parodie de cérémonie militaire, avec salut et garde-à-vous.
(…) il les aligna par rang de taille, et s’adressant à la plus grande, avec le ton du commandement : " Ton nom ? "
Elle répondit en grossissant sa voix " Paméla. "
Alors il proclama : "Numéro un, la nommée Paméla, adjugée au commandant. 17
Dans Les Rois, la scène est tout aussi ironique puisque c'est la religieuse qui joue le rôle de l’huissier, voire de la
sous-maîtresse traçant un rapide portrait psychologique de chaque pensionnaire :
Elle prit trois chaises contre le mur, les aligna devant le feu, y conduisit ses trois bonnes femmes, les plaça dessus,
leur ôta leurs cannes et leurs châles, qu’elle alla déposer dans un coin ; puis, désignant la première, une maigre à
ventre énorme, une hydropique assurément :
" Celle-là est la mère Paumelle, dont le mari s’est tué en tombant d’un toit, et dont le fils est mort en Afrique. Elle a
soixante-deux ans. " 18
Pourtant, l’exposition des vieilles femmes installées sur des chaises devant le feu n’a pas l’attrait des tableaux
vivants des lupanars. Au contraire, la sœur Saint-Benoît souligne leurs handicaps dûs à des accidents et aux
malheurs de la vie 19. Elle montre des cas médicaux, des phénomènes de foire, des êtres desexués : " Elle nous
montra, enfin, la troisième, une espèce de naine, avec des yeux saillants, qui roulaient de tous les côtés, ronds et
stupides "20. Ces trois femmes sont présentées par des noms ridicules ou des surnoms qui ne sont pas sans
rappeler les " noms de guerre " des filles de joie : la mère Paumelle, " La mère Jean-Jean ", aveugle et " La
Putois ", une idiote.
Le dîner apparaît comme une réception préparée avec soin. Le rituel mondain est conservé malgré le contexte
critique, la guerre, et les créatures présentes, des malades. Après l’étape obligée de la présentation des femmes
par la bonne sœur qui leur sert de garante, de marraine, comme dans la haute société, chaque militaire salue la
dame de son choix et pénètre avec elle à son bras dans la salle à manger.
Je la fis passer devant avec le curé, puis je soulevai la mère Paumelle, dont je pris le bras et que je traînai dans la
pièce voisine, non sans peine car son ventre ballonné semblait plus pesant que du fer.
Le gros Ponderel enleva la mère Jean-Jean, qui gémissait pour avoir sa béquille ; et le petit Joseph Herbon dirigea
l’idiote, la Putois, vers la salle à manger, pleine d’odeur de viandes. 21
Le curé des Rois, bon vivant, goguenard, n’est pas sans rappeler l’abbé Chantavoine qui faisait de la résistance
passive dans Mademoiselle Fifi. Il accepte avec une joie non dissimulée de partager le repas des militaires. Il est
d'ailleurs le seul à savoir couper l’oie, en homme habitué à la bonne chère. Le curé s’amuse beaucoup de la
tournure que prend la petite fête et ne s’oppose pas immédiatement à ce que les trois invalides boivent. Il règne
en metteur en scène, riant dans les coulisses de l’effet produit par sa blague : " J’aperçus le curé, resté dans
l’ombre du couloir et qui riait de tout son cœur. " 22 Son homologue, l’abbé Chantavoine, servait parfois de
médiateur avec les Prussiens et dînait avec eux :
Le curé ne s’était nullement refusé à recevoir et à nourrir des soldats prussiens ; il avait même plusieurs fois
accepté de boire une bouteille de bière ou de bordeaux avec le commandant ennemi, qui l’employait souvent
comme intermédiaire bienveillant (…). 23
La nouvelle Les Rois s’achève sur le personnage de l’abbé, comme dans la première version de Mademoiselle Fifi.
http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (13 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:36
2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE
Devant le malheureux qui vient d’être tué accidentellement, l’homme d’église déplore la fatalité et les lois du
hasard.
Le fête de l’Epiphanie s’achève ainsi sur une note tragi-comique qui représente bien toute la nouvelle. Le repas
des Rois, riche en viandes de toutes sortes - " deux poules, une oie, un canard, trois pigeons et un merle " 24 -
est décrit par Garens, tandis que celui des Prussiens était consommé mais passé sous silence. Maupassant nous
allèche pour nous laisser sur notre faim. Le dîner des Rois n'est pas achevé, la Reine n’a pas été choisie -
d'ailleurs, comment choisir ? - et les officiers sont doublement frustrés. Ceux-ci se sont seulement amusés à
saouler les infirmes, pantins désarticulés, de même que les Prussiens enivraient les filles du bordel rouennais.
Dans les deux récits, le champagne coule à flots :
" On arrivait au dessert ; on versait du " Mais je criai : " Vite le
champagne. Le commandant se leva, champagne !" Un bouchon sauta
et du même ton qu’il aurait pris pour avec un bruit de pistolet qu’on
porter la santé de l’impératrice décharge, et, malgré la résistance
Augusta, il but : " A nos dames ! " 25 du curé et de la bonne sœur, les
trois hussards assis à côté des trois
infirmes leur versèrent de force
dans la bouche leurs trois verres
pleins. " 26
On voit ainsi les jeux de symétrie et de dissymétrie entre les deux nouvelles : ironie et parodie sont ici à l’œuvre.
Au delà de l’aspect ludique, l’autoparodie est créatrice de sens puisque le rapprochement des deux récits Les Rois
et Mademoiselle Fifi enrichit l’interprétation et rend sensible l’évolution de Maupassant. En parodiant sa nouvelle
de 1882, l’auteur a voulu, semble-t-il, rétablir l’équilibre avec Mademoiselle Fifi. Malgré son ironie féroce, cette
dernière apparaît encore comme fondée sur l’esprit revanchard. Elle a pu être interprétée comme une
propagande anti-prussienne et pro-française, un hymne à la résistance et au patriotisme. La confrontation des
Rois et de Mademoiselle Fifi prouve que ces deux récits sont complémentaires et que l’œuvre de Maupassant est
loin d’être simple. On aura pu noter les nombreux clins d’œil et références intertextuelles présents ici, ce qui
démontre, s’il le fallait encore, l’érudition de l’auteur. Par sa structure simple, Les Rois parodie les fabliaux
médiévaux : Les trois aveugles de Compiègne. Cette farce où les trois ordres (clergé, noblesse, Tiers Etat) ainsi
que l’armée sont ridiculisés rappelle les récits parodiques et héroï-comiques, et l’inversion généralisée amène le
lecteur à considérer la venue des trois femmes, des trois reines, comme une réécriture de l’Evangile, une parodia
sacra 27. Contrairement à d’autres oeuvres réécrites et retravaillées formant doublets 28, ces deux nouvelles
constituent un véritable diptyque au sens pictural du terme. Tout invite à les lire en parallèle et à les étudier
ensemble afin d’en dégager un sens nouveau, caché. En donnant un deuxième volet à Mademoiselle Fifi,
Maupassant dévoile l’évolution de l’homme et de l’écrivain. Grâce à un renversement carnavalesque et à une
écriture hautement parodique, il semble tirer un trait définitif sur la guerre de 1870 et son attirail revanchard.
Véritable repentir, Les Rois véhicule sa vision pessimiste et désespérée du monde grâce à l’autoparodie. Tandis
que Mademoiselle Fifi appartient à la période réaliste de l’auteur, Les Rois, recueilli dans Le Horla, se rattache aux
contes de l’horrible et se rapproche des récits fantastiques, miroirs de l’angoisse de l’écrivain. Ils sont pour
Maupassant, " l’homme sans Dieu " 29, sa " nef des fous " 30.
Noëlle Benhamou
IUT de l’Oise, Université de Picardie
> sommaire
> début de l'article
> auteur
http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (14 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:37
2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE
Jean-François Puff
LE MODÈLE DES TROUBADOURS DANS L'ŒUVRE POÉTIQUE DE JACQUES ROUBAUD
Parmi d’autres régions d’un grand œuvre projeté, Walter Benjamin a rêvé composer un ouvrage qui serait
uniquement fait de citations, rêve qui fut destiné à demeurer inaccompli. On pourrait d’ailleurs s’interroger : d’un
tel livre le projet ne suffit-il pas à poser le sens ? Borges en conviendrait sans doute, pour qui il est inutile de
composer de longs ouvrages dès lors qu’on peut les décrire en quelques lignes. C’est là pourtant un risque que le
poète Jacques Roubaud a assumé, en cela qu’il a explicitement placé la naissance de sa propre poésie sous le
signe de la réécriture de la tradition poétique, et qu’il en a effectivement dérivé des livres de poèmes. Au point
que la prise en considération de cette pratique est devenue tout à fait centrale dans la réception de son travail de
poète. Pour l’établir, je partirai de deux énoncés emblématiques de cette revendication d’un travail de réécriture.
Dans la " prose existant oralement " de Dire la poésie : " J’aime lire les poèmes des autres / plus que les miens /
j’aime aussi les écrire / mais ceci est une autre histoire " 1. On appréciera la polysémie du verbe " écrire " dans
ce passage, qui identifie le fait de recopier des poèmes et celui d’en composer. Ce que confirme un autre
passage, issu de la " description du projet " de 1979, dans lequel on voit à nouveau se mettre en rapport les deux
activités, ainsi qu’un certain nombre d’autres : " J’imagine, je lis, je compose, j’apprends, je recopie, je traduis,
je plagie, j’écris de la poésie depuis près de quarante ans. Il m’arrive d’en publier. " 2. Ainsi ce qui relève de la
réception -de la lecture à l’imitation- est-il présenté, jusqu’au paradoxe, comme le ressort même de la création
poétique, de la mise en œuvre de l’imagination.
L’approche de l’œuvre le confirme : Roubaud y met en pratique, souvent à l’échelle du livre entier, des relations à
un hypertexte relevant aussi bien de la transformation d’un texte ou d’un ensemble de textes que de l’imitation
d’un style ou d’un genre donnés (selon les catégories dégagées par Genette dans Palimpsestes3), que ce soit
explicite, indiqué comme tel dans le paratexte, ou que cela demeure implicite. Voici quelques exemples parmi les
plus significatifs de la visibilité d’une pratique : relève de l’imitation explicite la suite intitulée " recourir les rues ",
dans La forme d’une ville change plus vite, hélas, que le cœur des humains 4 , qui se présente comme une
continuation de Courir les rues, de Queneau ; de l’imitation implicite certains sonnets en vers courts de E 5 (signe
de l’appartenance dans la théorie des ensembles), composés à la manière de Mallarmé. Relèvent de la
transformation explicite Mono no aware 6, livre presque entièrement composé de poèmes " empruntés " à la
poésie japonaise classique, via leur traduction anglaise ; Autobiographie, chapitre dix 7, livre qui hormis des "
moments de repos en prose " est tout entier composé de fragments de poèmes en vers libres écrits entre 1914 et
1932, sorte d’immense centon dans lequel l’intention parodique est évidente ; la séquence de poèmes intitulée "
La pluralité des mondes de Lewis" 8, qui se compose en grande partie à partir d’énoncés prélevés dans l’ouvrage
de métaphysique analytique de David Lewis, On the plurality of worlds 9. En ce qui concerne la transformation
implicite, moins évidemment visible, on mentionnera certains poèmes de Quelque chose noir 10, qui sont
composés de propositions issues du traité de L. Wittgenstein De la certitude 11 ou du Journal 12 d’Alix-Cléo
Roubaud, femme du poète.
Dans tous les cas, Roubaud met en jeu notre mémoire, notre culture ou notre inculture ; il exerce, et souvent
déjoue, notre perspicacité ; et parfois il nous trompe, en cela que nous pouvons être amenés à lui attribuer ce
que le sens commun déclarerait " ne pas être de lui " : il pose ainsi à sa manière la question célèbre de Foucault,
" qu’est-ce qu’un auteur ? " 13
A partir de là s’introduisent deux problèmes spécifiques : d’une part celui de l’unité de ce qu’on continuera
d’appeler " oeuvre " par commodité, compte tenu de la critique de Foucault, et d’autre part celui de la pertinence
historique de l’œuvre sus-dite. Sans même s’appesantir sur le recours à la forme sonnet dans appartient, en
1967, nous sommes encore en 1970, au moment où paraît Mono no aware dans une période dominée par la
stratégie avant-gardiste : le groupe lié à la revue Tel Quel est en pleine activité, les revues concurrentes ou
adjacentes Change (revue à laquelle Roubaud participe), puis TXT, ont été fondées. Et l’une des postulations
fondamentales des avant-gardes s’avère toujours effective : il s’agit d’une détermination du nouveau qui en
passe nécessairement par un premier moment de négation radicale des formes héritées. On conçoit dès lors toute
l’inactualité de la pratique de Roubaud. Un regard critique pourrait de fait envisager son œuvre comme une sorte
d’immense lieu de mémoire : la poésie s’étant achevée, non pas au sens où elle se serait réalisée, comme le
voulaient les surréalistes, mais où elle se serait dissoute, en tant qu’une manière spécifique de s’établir dans la
http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (15 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:37
2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE
langue, il ne resterait plus à qui se veut poète qu’à se souvenir, et à parcourir, sans cesse, les diverses formes de
la poésie qui fut. Ce serait faire de l’œuvre de Roubaud une sorte de musée de l’art de poésie, avec ses
différentes salles (salle de la poésie japonaise classique, salle des indiens d’Amérique…) ; musée qu’on irait
visiter, le dimanche, avant de reprendre les activités sérieuses des jours ouvrables. Si jamais l’on prend la peine
d’une visite : car du musée, au mausolée, il n’y a qu’un pas. Dans ce cas, Roubaud n’aurait rien fait d’autre que
d’édifier un gigantesque tombeau de la poésie, et l’unité comme la pertinence historique de son œuvre se
détermineraient relativement à ce caractère monumental. L’œuvre de Roubaud dirait ainsi, négativement, le point
où nous en sommes avec la poésie.
Ce serait là éluder, me semble-t-il, toute une série d’objections. La première objection a été formulée de manière
décisive dans l’œuvre de Borges. L’avant-garde, nous l’avons dit, vise à la création du nouveau par un premier
moment de négation : il s’agit, autant que possible, une fois que la négation a eu lieu et qu’on se trouve en
présence d’une tabula rasa, de produire la différence comme telle. Or ce que nous montre le célèbre récit de
Borges Pierre Ménard, auteur du Quichotte, c’est que la stricte répétition du même est impossible. On en connaît
l’argument : un poète symboliste nîmois, Pierre Ménard, décide de reproduire à l’identique le Don Quichotte de
Cervantès, sans le recopier ; en travaillant de mémoire. Le sens moral du récit nous est donné à la fin, comme il
convient : changer le contexte discursif et/ou historique d’un texte suffit à en révolutionner le sens. La répétition
du même produit la différence. Or la tentative de Ménard n’est rien d’autre, comme nous l’indique Genette 14,
qu’une transformation minimale, ou une imitation maximale, de Don Quichotte : en ce sens, les écrivains qui
procèdent par réécriture, indépendamment même des modifications qu’ils introduisent, produisent
nécessairement du nouveau. Attribuer la poésie japonaise classique ou la poésie vers-libriste du premier
vingtième siècle à Jacques Roubaud aurait pour conséquence d’en renouveler le sens. Quitte à laisser de côté
l’objection à l’objection, qui est qu’il faut bien que se poursuive, parallèlement, le travail de l’Histoire.
Cependant en rester là serait décrire la stratégie de Roubaud de manière beaucoup trop générale et partielle,
comme s’il n’avait jamais écrit qu’en l’un des dix " styles " de poésie de son modèle japonais, l’ermite-poète
Kamo non Chomei, qui est le " style des vieilles paroles en un temps nouveau ". Ce serait aussi passer sous
silence l’objection majeure qu’on peut faire à qui considérerait l’œuvre de Roubaud comme un mausolée. Une
idée récurrente dans le travail de ce poète en effet, est qu’on ne redécouvre une œuvre ancienne qu’à la lumière
d’une œuvre nouvelle. C’est le devenir de l’art qui en éclaire le passé, qui en révèle des virtualités jusqu’alors
inaperçues. En ce sens la nouveauté de l’œuvre moderne a pour corrélat la nouveauté de la tradition. Il faut donc
qu’il se détermine du nouveau dans l’œuvre elle-même, il faut que l’objet change. Faute de quoi, d’une part la
poésie qui s’écrit ne sera en fait rien d’autre qu’une poésie patrimoniale, d’autre part elle s’avérera incapable de
renouveler le sens de la poésie dont elle s’inspire, de la rendre vivante.
Il faut donc mettre en lumière la stratégie de déploiement du nouveau dans l’œuvre poétique de Roubaud, et cela
aura lieu, paradoxalement, en se penchant une fois encore sur le passé. Lorsque nous avons évoqué les différents
modes de réécriture dans son œuvre poétique, nous n’avons pas mentionné ce qui fait pourtant l’objet de cet
exposé, si l’on en croit son titre, à savoir la poésie des troubadours. Or cette poésie est explicitement donnée
comme le grand modèle de l’œuvre poétique. Comme il est écrit dans La fleur inverse, l’essai majeur que
Roubaud a consacré aux troubadours:
Ecrire des poèmes, composer de la poésie dans les conditions contemporaines est un exercice
difficile. S’obstiner dans cette voie suppose le choix d’un modèle, la référence à une époque
favorisée où la poésie fut, et brilla. J’ai choisi la Provence du XIIe siècle. On peut penser la poésie
à travers les Troubadours, leur exemple. La poésie la plus contemporaine, pour survivre, doit se
défendre de l’effacement, de l’oubli, de la dérision par le choix d’un archaïsme. L’archaïsme du
trobar est le mien. 15
La citation lie explicitement un commencement, les troubadours, à la poésie " la plus contemporaine ". En ce
sens les deux points extrêmes s’éclairent l’un l’autre : la poésie des troubadours donne à la fois l’impulsion et les
principes de composition de " la poésie la plus contemporaine ", et ce mouvement crée un effet en retour, dans
lequel la poésie des troubadours devient à nouveau lisible. Il s’agit de comprendre comment le saut a lieu. Or on
serait bien en peine de rencontrer des réécritures au sens strict de la poésie des troubadours dans la poésie de
Roubaud. Il n’y a pas plus dans son travail de transformation de telle ou telle grande canso, c’est-à-dire de la
lettre même du poème, que d’imitation du style des troubadours, sur le mode pseudo-médiéval. On est dès lors
en droit de se demander où se situe le rapport. Le rapport se situe dans le génitif qui selon Roubaud condense
http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (16 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:37
2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE
l’ensemble d’une poétique, qui est l’amour le chant la poésie. Ce génitif vaut pour définition de la poésie, pour un
universel qui permet d’en relier entre eux les moments les plus éloignés.
Il nous faut donc expliciter, de la manière la plus synthétique possible, la définition. Avec ce génitif il s’agit, nous
dit le poète, d’un signe orienté. Le premier terme est l’amour : c’est le premier moteur. Pour les troubadours,
sans l’amour que porte le poète à la dona, et sans la merce que celle-ci lui accorde, il n’est pas de poésie
possible. L’amour est ce qui relie : et c’est précisément cela qui en fait le ressort même du deuxième terme du
génitif, le chant. Le chant est la traduction formelle de cette force qui relie, en cela qu’y sont liés entre eux les
mots et les sons. L’un des concepts centraux de la poésie des troubadours, du point de vue de la forme, est en
effet le concept d’entrebescar, d’entrelacement, dont l’élément de base est la rime. Pour dire l’amour, les
troubadours inventent la rime en langue romane et ils en portent la pratique à un point d’excellence jamais égalé.
Cela signifie aussi que le chant est la dimension du rythme dans la langue, et corrélativement, par la voie d’une
formalisation, du nombre dans la langue. De cela naît, terme final de la série, la poésie. Pour synthétiser : selon
Roubaud lisant les troubadours, la poésie est la traduction formelle du rythme dans la langue, agie par amour.
C’est donc le cœur d’une poétique, qui se situe en position d’écart maximal vis-à-vis des conditions
contemporaines d’exercice de la poésie, qui fait le rapport.
Reste à savoir comment se configure ce rapport dans l’œuvre poétique de Roubaud. C’est que, non seulement
Roubaud ne transforme à la lettre aucune canso, ni n’en imite le style, mais encore il n’en adopte pas la forme.
On peut pourtant admettre en première analyse que, si l’on peut imiter un texte, on n’imite pas une forme,
lorsqu’on l’adopte. Si je compose un sonnet, a priori je n’imite aucun grand sonnettiste. Si je veux pétrarquiser,
par exemple, il faut que j’aille plus loin, et que j’imite le style de Pétrarque. Composant un sonnet, je ne réécris
aucun sonnettiste… certes oui, mais ce faisant, peut-être que je les réécris tous. Telle serait la raison, dont nous
suspendons pour l’instant l’explicitation, pour laquelle Roubaud refuse d’adopter la forme-canso des troubadours.
La forme, collectivement, est signée. Quel rapport dès lors, si ce n’est ni en transformant la lettre, ni en imitant le
style, ni en reprenant la forme ? La solution se trouve une fois encore chez les troubadours eux-mêmes. Ces
poètes qui disent tous la même chose manifestent en effet leur singularité de deux manières : d’une part en
s’exerçant aux formules de rimes des grandes cansos du trobar, d’autre part en inventant eux-mêmes des
formes, dans un même champ de composition. C’est dire que si adopter une forme n’a pas le même sens
qu’imiter un texte, c’est également le cas lorsqu’il s’agit d’un processus de transformation : transformer une
forme potentiellement productive d’une multiplicité de poèmes, cela n’a pas le même sens ni la même portée que
de transformer tel texte singulier. Et telle est la stratégie de Roubaud. Puisant à l’exemple des troubadours il ne
réécrit aucune canso, et il ne compose pas non plus de poème sur une formule attestée chez ces poètes, qui
l’auraient signée. De cela au contraire il y a dans son œuvre une absence aveuglante. Mais à l’exemple des
troubadours eux-mêmes il saisit les principes d’une forme, et en dérive une série de formes neuves : c’est le cas
dans Trente et un au cube ou dans Quelque chose noir par exemple. Mais aussi toutes les pratiques de réécriture
qui sont réellement présentes dans l’œuvre sont gouvernées par des principes formels, issus du trobar. Ce sont
ces principes qui assurent l’unité de l’ensemble.
Pour l’établir je prendrai comme seul exemple le cas limite de la réécriture dans l’œuvre, qui est Autobiographie,
chapitre dix. Le titre s’explique en cela que la période du vers libre choisie par Roubaud pour la composition de ce
livre (1914-1932) est selon lui le dixième chapitre du roman d’Alexandre, c’est-à-dire de l’histoire du vers
français. C’est sous l’influence des grands poètes de cette période que le jeune Roubaud publie ses premiers
poèmes, qu’il reniera par la suite. Si ces poètes (de l’esprit nouveau aux surréalistes en passant par Dada)
représentent à certains égards pour Roubaud une résurgence du trobar, il s’agit d’une résurgence à ses yeux
marquée d’infériorité, du point de vue de la forme. Au génitif l’amour le chant la poésie en effet, les poètes vers-
libristes substituent, selon le titre d’Eluard, L’amour la poésie. C’est-à-dire qu’ils évacuent du poème toute la
dimension métrico-rythmique que recouvre le chant, au profit d’un vers libre dont Roubaud évalue avec sévérité
la forme. D’où la présence dans Autobiographie, chapitre dix du troubadour Marcabru, aussi nommé Pan-Perdut,
pain perdu 16. Ce nom de métier dit quelque chose de la stratégie polémique choisie par ce troubadour : il s’agit
de se saisir des mots mêmes de ses adversaires pour les retourner contre eux, en en composant ses propres
poèmes. Aussi est-ce ce que Roubaud accomplit dans Autobiographie, chapitre dix, en composant ce livre de
fragments de poésie en vers libre. On ne saurait pourtant se borner à l’intention parodique : le livre enveloppe en
même temps un hommage, en cela qu’il reconfigure dans une forme certains de ces énoncés (voir la présence du
sonnet, qui selon Roubaud est mémoire de la canso des troubadours). Les mots de l’amour la poésie font ainsi
entendre en écho l’entrelacement dont ils proviennent, l’amour le chant la poésie. Ainsi, un livre qui se compose
par réécriture dérive en fait, plus profondément, des principes d’une poétique, celle des troubadours.
http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (17 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:37
2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE
Dès lors, rabattre l’œuvre de Roubaud sur des jeux de réécriture, cela procède des lacunes d’une réception qui ne
prend en compte que certains livres toujours les mêmes et en oublie totalement d’autres ; corrélativement cet
oubli conduit à méconnaître une stratégie d’ensemble.
Pour exposer une dernière fois l’un des éléments-clés de cette stratégie, on peut dire que Roubaud ne produit du
nouveau ni par négation, sur le modèle avant-gardiste, ni par répétition, par imitation du style ou transformation
de la lettre, sur le modèle de la réécriture. Il répète, certes, mais en introduisant dans ce qui est répété la
différence formelle nécessaire à sa survie. Cela, de manière à ce que la forme-poésie comme configuration
rythmique de la langue mue par amour soit présente au présent. La valeur de cette présence, tient à ce qu’il ne
saurait y avoir de langue vivante qui n’ait sa poésie. Corrélativement, une langue sans poésie est une langue
morte, une langue sans désir, sans élan. Bref une langue sans subjectivation possible. Telle serait la pertinence
historique de l’œuvre. On est loin du tombeau.
Pour conclure, on peut s’interroger sur l’absence, que j’ai qualifiée d’aveuglante, de réécritures des troubadours
dans une œuvre qui, répétons-le, multiplie ces pratiques. Peut-être y a-t-il quelques poèmes, différents pour
chacun, qu’on ne saurait réécrire. Il y aurait des poèmes qu’on ne touche pas, dont on reçoit simplement
l’impulsion. Réécrire, en ce sens, serait profaner. Cela pourrait signifier qu’on réécrit des poèmes, certains
poèmes ; mais que la poésie, elle, est précisément ce qui ne se laisse pas réécrire.
Jean-François Puff
Université de Paris 3
> sommaire
> début de l'article
> auteur
Lioubov Sávova
ENTRE PAROLE ET SILENCE : LA TRADUCTION-RESTITUTION D'UN POÈME PERDU DE CENDRARS
Prologue — lecture de trois passages choisis de La Légende de Novgorode :
De mes mains j’ai caressé la nuque souple des plus tendres beautés,
j’ai serré entre mes mains mille gorges de marchands suants et gros de fatuité,
moi-même un chevronné marchand qui touche avec tendresse les choses
payées par moi ... Une seule, pourtant, que je n’ai pu toucher –
cette chair si odorante et tendre et chaude
comme la neige... Ni ce creux, tout aussi chaud, tendrement-duveteux,
et vers lequel ma petite bête alerte se précipitait.
Au Nord, là où le ciel est renversé comme un baquet
et tout est inondé de lait, et où sans doute ne tarira jamais
la Voie lactée ; où vogue la lune, motte de beurre frais, –
au Nord, y suis-je vraiment allé ? Ah, ces nuits blanches de Saint-Pétersbourg,
d’un rayonnement pareil aux marges blanches de ma mémoire.
[…]
Tout autour – l’obscurité, comme dans l’âme du moujik. Dehors
le ciel morfondu étincelait de ses clous –
on aurait dit quelqu’un fuyant la sale vie,
et seule sa semelle scintillait dans la nuit.
http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (18 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:37
2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE
[…]
Lorsque demain par le Transsibérien on s’enfuira avec la petite Jeanne
vers Port Arthur, vers Kharbine,
vers l’Amour aux flots de plomb,
où des cadavres jaunes remonteront toujours à la surface comme des troncs d’arbres,
là-bas nous trouverons, enfin, la route qui mène vers soi et vers l’amour,
ne sachant pas que des sentiments déjà morts emplissent cet amour et le débordent.
Car il n’y a de terre plus inconnue et de contrée plus attrayante
que l’âme humaine... J’ai peur d’éclater en sanglots.
Au-dessus de moi pend – en dégueulis des mouches agaçantes – la lampe du wagon,
comme l’énorme morve de quelque pitoyable voyageur 1.
Ecrire sur la grève, entre deux marées hautes
Oubliez… Oubliez...
D’ici la fin de cette prise de parole, vous aurez sans doute oublié les mots — les mots-mêmes de ces quelques
bribes de La Légende de Novgorode que vous venez d’entendre. Que vous soyez auditeurs ou lecteurs, français
ou russes, " Oubliez ! " est un maître-mot, l’appel même de ce poème réécrit. Délesté par la déclamation du
poids de la perte de sa lettre, ce n’est pas à notre œil, mais à notre oreille qu’il s’adresse, et à notre faculté —
pour lui salutaire — d’oublier.
Restituer le texte de Cendrars ? C’était écrire sur la grève, entre deux marrées hautes : écrire avec et contre le
deuil préalable dont La Légende… était frappée — expérience ouvrant sur la pure perte du geste, mais aussi,
comme telle, sur la reprise possible de cette perte même. Restituer Cendrars ? Je l’ai tenté, depuis une zone
franche, un entre-deux : avec George Steiner (Après Babel), j’ai cru un moment partager l’obstination à rendre
ce poème à la culture et à la langue françaises dont il était issu, mais je savais la tentative vaine ; plus proche
sans doute de " l’épreuve de l’étranger " dont parle Antoine Berman, j’ai éprouvé littéralement cette étrangeté de
La Légende…, en acceptant de séjourner auprès de ces deux textes en mouvement : la version russe du poème
qui, après tout, avait été la seule à avoir vu le texte français à l’origine, et la française — que je devais forger,
faire advenir depuis son inconnu, qui était aussi le mien. Comment allait-elle être modifiée, l’étrange figure de
l’auteur — sa présence-absence et ses attributs (langue, signature, autorité) ? Dans quel type de relation auteur
et traducteur allaient-ils devoir se reconnaître, puisqu’il en allait d’une rencontre scellée autour d’un manque — la
langue française de ce premier poème de Cendrars ? Enfin, comment appréhender le texte réécrit — quelle
pertinence donner à toutes nos hiérarchies : original/version, langue/parole, écrit/parlé, auteur/traducteur… ?
Cette expérience-là, si singulière, à quelles alternatives du geste même de la réécriture pouvait-elle rendre
sensible ?
Pourquoi écrire, sur la grève, puisque la mer emportera toujours l’écrit ? De quelle version vouloir sauver la mise,
si toute version n’est plus de mise, dès que tracée ? Insoutenables, toutes ces lignes là, saisies, pouvaient se
retourner sur moi, ou contre moi, me laissant pressentir l’angoisse du néant — néant de ces paroles, prises,
déprises. Paroles prises grâce à l’invitation, mais paroles indues, n’ayant ni garantie, ni justification. Réécriture
comme traduction, comme restitution heureuse des signes, ou réécriture comme une reprise faillible de tout
geste d’écriture — quelles en étaient les ouvertures, quels — les périls ?
Déprise, méprise, reprise
La Légende de Novgorode a été écrite une première fois, en français, en 1907. Cendrars — alias Frédéric Sauser
— a vingt ans. Il vient de rentrer en Suisse après un séjour de trois ans en Russie. Son journal intime contient
des brouillons de lettres qu’il adresse à une jeune Russe — Hélène Kleinmann — qu’il aime, mais dont il vient
d’être séparé par la décision paternelle qui l’enjoint de rentrer. Brutalement, à Berne, Freddy apprend la mort
d’Hélène à Saint-Pétersbourg : elle a renversé la lampe à pétrole de sa chambre, et va bientôt mourir, brûlée
vive. Le Journal de Freddy s’interrompt à ce jour, sur cinq lignes violentes commençant ainsi : " Je crache sur la
beauté… "
http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (19 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:37
2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE
La Légende de Novgorode — dont les initiales LN sont l’incrustation du nom d’Hélène — est sans doute une œuvre
de circonstance (écrite dans l’urgence de ce deuil), et aussi une lettre en souffrance (Freddy envoie le poème
français, sans en garder quelque copie, à un ami russe — l'énigmatique R.R. dont nous lisons les initiales sur la
couverture de l'édition de 1907, et qui est son traducteur). Déprise : c’est à la fois le sens du geste pour Freddy,
mais aussi, aujourd’hui, sa répercussion sur nous, pouvant tout aussi bien ouvrir la voie à une épreuve nouvelle,
que confiner cette aventure dans le cul-de-sac où aiment s’entasser nos vieilles certitudes. Il y aurait deux façons
d’appréhender l’expérience de ce poème : par une méprise (la méfiance — non fondée, en réalité — à l’égard de
son authenticité, parti pris initial qui entraîne un désengagement, une fermeture à l’expérience même à laquelle il
nous invite), ou par une reprise — et c’est ce que nous tenterons ici, survolant rapidement le travail de traduction
lui-même, déjà évoqué dans deux autres articles 2, et l’ouvrant à cette autre question, essentielle : cette épreuve
de la réécriture, qu’a-t-elle engagé, et que peut-elle, aujourd’hui, encore engager ?
De l’auteur, suspendons pour un instant le nom : c’est bien Cendrars qui, toute sa vie durant, nous a parlé de ce
premier titre français, sans que personne n’en voie la couleur ; aujourd’hui, c’est bien Freddy Sauser qui signe la
plaquette russe, mais qui peut dire, d’après le russe, si c’est bien le style de Sauser-Cendrars ? La Légende…,
comme titre, appartient également à ces deux noms palimpsestes. Mais le texte du poème — celui-là même que
vous venez d’entendre — à qui devrions-nous l’attribuer : au jeune homme inconnu qui le composa, au grand
poète Cendrars qui jamais plus ne put revoir son texte, ou à tout autre traducteur — français ou étranger — qui
transfigurerait le texte russe en quelque autre langue ? Comment appeler auteur de La Légende…, celui qui est
sans langue propre, et qui ne peut la garantir, comme œuvre, que dans une traduction (la russe), ou dans une
réécriture faite par un autre (la française) ?
Qu’est-ce qu’un nom d’auteur, si désormais sa signature (en langue originelle) ne signe pas ce qui sera dit —
" dans le texte " — et qui m’invite, dans un rapport à lui, à le re-dire — avec lui, mais aussi à sa place ? Le
Cendrars de La Légende… n’est pourtant pas un auteur anonyme : en m’invitant à le reprendre, il ne se
désengage pas, comme c’est le cas, par exemple, de certaines tentatives contemporaines où l’on voit circuler des
œuvres sans auteur, sans signature. Plutôt qu’exclusive de tout, La Légende est rassembleuse de voix, prêteuse
autant que demandeuse de parole. En ceci, elle est très proche de la perspective de réflexion engagée par le
tableau célèbre de Francis Picabia, L’Œil cacodylate (1921) : l’œuvre reste bien la propriété du peintre, mais elle
est entièrement faite des signatures apposées de ses amis, de dédicaces et de collages. Le nom d’auteur se
redessine alors, ouvert et accueillant, sans que cela l’efface, tandis que sa figure, tout en rejetant son exclusive
autorité, ne conserve pas moins son aura impérieuse.
Entre parole et silence, que voulait dire s’approcher de cette parole disponible, que voulait dire accepter
l’invitation de Blaise Cendrars — réécrire La Légende… une Légende, ni entièrement sienne, ni entièrement à
nous ? Réécriture toujours déjà désespérée à son commencement, poésie en flux et en reflux, bloc-notes
magique, quelles certitudes cette enquête sur " la lettre " allait-elle menacer, reformuler ? Que risquions-nous, en
nous portant responsables de cette parole illégitime ? Qu’interrogeait une telle épreuve de la réécriture ? N’allait-
elle pas nécessairement toucher aux certitudes de son geste fondateur lui-même ?
Mes pas dans les siens, ou la réécriture comme traversée ?
La langue française de La Légende… ? Français langue étrangère. Toujours déjà dépossédée d’elle-même comme
mienne, puisque abandonnée à l’autre, pour être sienne, comme signée par lui. Désir honnête sans doute, mais
plus sûrement désastre — absence de l’astre. Etrangère à elle-même, la langue française que je forgeais, était
dans un non-lieu, sans fondement — sinon l’autorité de cette figure d’auteur muette, ou sinon mon propre dire,
mais dans une relation fantomatique (et pourtant si réelle) à l’auteur. Ce que je n’avais pas moi-même — la
langue française, ma langue étrangère — , je le lui ai donné : dans une cadence prolongée — reprise en bouche
— de ce qui ne tardait pas à se voir biffer… Reprise, encore, après l’écrit, et dans l’espoir secret que ce définitif ne
cesse jamais de vouloir se réécrire. La langue manquante s’était d’emblée mue en parole disponible — parole que
je prenais et reprenais, écartelée entre la soif de la donner à lire, et cet inassouvi que je savais d’essence lui
revenir. Liberté extrême — extrême inquiétude 3.
Parole déléguée — parole prise : à quel prix devenait-on responsable de cette parole écartelée ? Réécrire c’était
comme accepter une traversée avec un inconnu : cœur contre cœur, j’ai voulu m’approcher de lui, de ce qui, au
terme des lectures palpables, demeurait de lui, et qui venait à moi. Partant de la simple traduction, j’étais sans
http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (20 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:37
2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE
cesse à la recherche du mot, de la cadence qui seraient ceux de Cendrars, mais dans une langue qui elle-même
m’échappait. Mes biffures étaient doubles — biffure à cause de Cendrars, et biffure à cause de moi-même. Une
double exigence me guidait — celle de la langue française que je forgeais, en la pesant à la lecture, et cette autre
qui, nourrie de la mémoire des lectures de Cendrars, cherchait les mots, mais plus encore tentait de recréer une
cadence rythmique, des morsures syntaxiques. Pour trancher dans l’hésitation des polysémies du russe et
restituer le mot probable, j’avais parié sur l’imprégnation de ces lectures et la mémoire des œuvres ultérieures 4.
Mais une imprégnation de la cadence prosodique, par la lecture, était-elle possible ?
Plus le poème se taisait, et plus il résonnait, dit et redit — dans sa version en russe, et dans son impossible en
français. Et plus Cendrars, celui des œuvres ultérieures, me devenait présent : et, à force de le désirer, comme
disait Barthes, " [j’avais] besoin de sa figure, comme il [avait] besoin de la mienne. " 5. Nous nous sommes
rencontrés, lui et moi, sur un sol de sables mouvants. Relation d’autant plus forte, qu’elle était scellée autour
d’un deuil étrange — mutisme de la langue française, mais babillement, entre les langues, de toutes ces images
en mouvement.
Que savons-nous, au fond, de nos rencontres de lecture, de ce qu’elles engagent ou désengagent en nous, de ce
qu’elles déposent, silencieuses — plus réelles, parfois, que toutes ces entrevues que nous multiplions, de jour, de
nuit, fébriles, afin de maintenir " l’effet de réel " de nous-mêmes ? Ce qui nous reste d’authentique, au fond,
d’une rencontre — n’est-il pas là ? Ce qui se passe de mots, après les avoir longuement pesé et rejeté, mais se
confirme en gestes : voir Peter Ibbetson, le geste réel de cette main, tendue vers l’autre — par delà ladite
" réalité " — et pourtant si sûrement, si simplement… Une présence…
Ai-je donné une voix à Blaise Cendrars, ou l’ai-je effacé ? Et lui, présent d’autant plus fortement que, par sa
langue, il ne l’était plus, ne me biffait-il pas, aussi, de son surcroît d’autorité — muette, pesante ? L’autorité d’un
nom… J’avais cherché les mots — c’est une cadence qui s’était imposée à moi. Non, ce n’était pas une lettre que
je pouvais donner, c’était seulement une voix, et ce n’était même pas sûr que c’était moi seule qui la donnais.
Echos sonores, allitérations et assonances advenaient, comme par eux-mêmes, dans l’espace de la diction que je
leur accordais — comme si, de les relire, cela les faisait vivre. Quelle meilleure preuve, au demeurant, de ce que
ce poème n’était pas un faux — pas une version russe composée par un faussaire génial 6 ? Seule la pulsation de
la trace évanouie nous donne, de cette réécriture, la portée réelle — une parole qui passe, qui vous traverse,
heureuse de votre faculté de l’oublier en tant que lettre : l’imprimé s’estompe dans l’impression de la lecture, le
texte réécrit est moins un résultat final que son abdication, et dans la prolongée absence des caractères, le
caractère seul, comme une musique, est trace évanescente de cette traversée.
Entre don et abandon : la réécriture comme invention
Entre parole et silence, réinventer Cendrars — en quoi ceci différait-il d’une entreprise de traduction ? La
réécriture de La Légende…, en vérité, est déviante par rapport à toute autre situation de traduction dans laquelle
nous avons : un support premier, stable, qu’est le texte original, correspondant à un nom d’auteur (fût-il parfois
incertain — voir le " pseudo Longin ") et à sa signature, visible dès la couverture, faisant preuve d’autorité, de
responsabilité. Dès lors, tous les discours relatifs aux manières de traduire, se définissent par rapport à ce " texte-
source ", qui sert de référence aussi bien pour mesurer l’écart des traductions dites " belles infidèles ", que la
fausse proximité, prônée par les soi-disant " traducteurs fidèles ", qui confinent bien souvent en
translateurs serviles de mots de dictionnaire. Langue, nom d’auteur et signature confèrent l’authenticité au texte
original, et, partant, définissent toute traduction " ordinaire " 7 autour du support stable du texte-source, face
auquel le texte en langue d’arrivée trouve toujours sa justification, et cela — quels que soient les choix du
traducteur. Qu’il soit effacé ou trop présent, ou qu’il soit juste-ce-qu’il-faut (perle rare !), le traducteur se veut
toujours " un passeur " : la position instable, certes, du migrateur, mais le tracé duquel pourra toujours être
évalué depuis un sol ferme — qu’il l’améliore, le respecte, ou le gâche…
Il y a, d’autre part, dans toute traduction, une consécration de l’objet achevé, imprimé, donné à lire par les soins
du traducteur, et assurant à celui-ci, par un juste retour des choses, une retombée. Entre un tel traducteur, sa
traduction et le texte originel, la relation est celle de l’échange gratifiant — quelque chose qui laisse pressentir
qu’un Jaccottet, traduisant Rilke, joint et son nom et sa traduction au nom et aux poèmes rilkéens, et qu’il peut à
tout instant se référer, pour justifier d’un choix, à tel ou tel vers du poète. Don contre don, l’échange entre
traducteur et créateur est à double sens. Mais cette mesure pour mesure n’est-elle pas ainsi comparable à ce que
http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (21 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:37
2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE
Blanchot appelait un " don sans don ", " le don par lequel on oblige celui qui le reçoit à rendre un surplus de
pouvoir ou de prestige à celui qui donne — ainsi, on ne donne jamais. " ? Bien que sortis de leur contexte, ces
mots distinguent très pertinemment l’échange de dons que représente une traduction, de l’abandon qu’exige la
restitution de ce poème de Cendrars : la relation — intime et inquiétante — change de nature, se fait don sans
retour, " don qui est abandon, poursuit Blanchot, et qui voue l’être abandonné à perdre sans esprit de retour,
sans calcul et sans sauvegarde jusqu’à son être qui donne : d’où l’exigence d’infini qui est dans le silence de
l’abandon. " 8 .
Il va sans dire que cette situation sans situation concerne également les deux côtés qui s’y engagent : nul texte-
source dans le cas de La Légende…, et donc — nul sol stable pour le texte réécrit, nulle retombée pour qui
entreprendrait de réécrire. Nulle référence à un support original, à l’épreuve duquel légitimer le texte nouveau :
ici, c’est bien la même chose que l’on reprend, mais on la reprend… sans qu’elle soit là, dans la certitude même
de son absence. La Légende…, cas particulier (bien que non isolé) de la littérature française9, invalide l’hiérarchie
original/version, au profit d’une égalité, plus inquiétante : des versions originales se regardent, aucune
n’affirmant ni n’infirmant l’autre… Ces versions originales n’ont pas à être " fidèles " ou " infidèles " (pas de
" modèle ") : mais elles ont pour seule mesure — et par delà l’incertitude de toute version — le no man’s land de
l’entre-deux des langues, et, partant, la zone franche de toute langue.
Deux versions originales liées dans leur perte fondamentale — perte qui est précisément leur fondement. A
côtoyer ainsi l’évanescence, ne sommes-nous pas au cœur de ce passage que Jean-Bertrand Pontalis avait saisi
dans ces paroles — " transformer la perte en absence. " ? Conduire l’épreuve de la réécriture à son point limite où
l’incertain lui-même la fonde en certitude, n’est-ce pas donner logement à l’inquiétude, non plus comme force
médusant l’action, mais comme tension apprivoisée toujours ré-initiant son propre geste ?
Per via di porre, per via di levare
C’est François Gantheret qui rappelle, dans Incertitude d’Eros (en reprenant la référence à Freud lui-même 10), la
distinction que Léonard de Vinci faisait entre le travail du peintre et celui du sculpteur. Le peintre, avait-il dit,
procède per via di porre — technique consistant à appliquer des touches sur la surface, alors que le sculpteur, lui,
per via di levare, c’est-à-dire " en enlevant à la pierre brute tout ce qui recouvre la surface de la statue qu’elle
contient. ". La statue est dans la pierre : voir Rodin, et les figures qui quittent à peine la matière brute dont elles
se dégagent pourtant ! Certes, ce travail-là du sculpteur n’était pas sans rappeler celui que réclamait notre
Légende : réinvention de la masse de pierre, révélation de la matière brute à l’intérieur de laquelle la sculpture
était contenue. D’ailleurs, cette certitude que la statue est dans la pierre, n’avait-elle pas de quoi nous rassurer,
nous consoler face à la perte de la lettre ? Alors, pourquoi cette inquiétude persistait ?
Ne le savions-nous pas (quelles vieilles lunes !) qu’une langue, même originale, ne serait jamais la langue
originelle qui viendrait tout subsumer, cause première ou dernière parole de nos tumultes inavoués ? Et si la
vacuité du geste, on la connaissait (jamais le mot ne nous rendra la chose), l’avait-on oubliée, lancés dans la
poursuite d’une lettre en cavale ? Entre parole et silence, celui qui se prendrait au jeu de redire cette Légende,
n’aurait-il pas à affronter l’épreuve du blanc — un blanc premier et dernier, blanc présidant et escortant tout
commencement, un blanc définitif ? Séjourner auprès de ce poème, ne nous mettait-il pas en pure présence de
notre propre " intime étranger " - version de l’inquiétante étrangeté où nous voyions soudain s’incarner la chose
familière que nous tenions dissimulée ?
Mais en quoi donc cette liberté de l’invention était-elle inquiétante ? Etait-ce à cause de l’invention elle-même, ou
à cause de l’invention (en lieu et place) de l’autre ? Simultanément nécessaire et contingente, la réécriture était
invitation à occuper la place vacante, mais interdiction de séjour en elle. Auprès de cette incertitude absolue,
pouvait-on perdre soi-même tout fondement qui présidait au geste de la reprise ? A quoi bon réécrire, si toute
réécriture ne serait qu’une nouvelle épreuve sans preuves ? On pouvait alors, tout aussi bien, laisser tomber.
Cesser d’écrire, se laisser vaincre par la gratuité du geste — c’était donc à portée de main. L’incertitude de la
langue — de toute langue — confinait aisément à un " à quoi bon " fondamental, qui engageait non seulement ce
poème, mais la possibilité même de poème, et, partant, la littérature elle-même. Ce deuil se répandait, égal,
dans un amont et un aval sans apaisement, pure perte de la chose réécrite — perte, n’ayant d’autre visage que la
mort. Car le deuil, certain, pour cette réécriture, convoquait la certitude de tout autre deuil à venir.
http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (22 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:37
2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE
" C’est pour celui qui ne triche pas que le jeu est véritablement dangereux. "
Expérience intime, inversée, inquiète, c’est à l’inédit que La Légende de Novgorode confronte celui qui se
prendrait au jeu. Elle engage, dans son impossible achèvement, les deux versants de la réécriture : le désir et le
désastre, tous deux mêlés dans leur étymologie embrassée — ce constat où " l’astre fait défaut " 11. Au seuil
même de l’invitation d’auteur, il y avait aussi le péril du jeu : une errance fondamentale, à présent concrétisée,
certaine, actualisée. " C’est pour celui qui ne triche pas que le jeu est véritablement dangereux. ", dit dans l’un de
ses cahiers le peintre Picabia, en 1923. Se prendre au jeu — vraiment s’y engager : c’était la condition pour
éprouver, dans l’expérience de la restitution de La Légende, combien elle autorisait et interdisait tout à la fois la
rencontre, combien l’on pouvait se sentir, à la fois, un invité et un intrus.
Sous le nom d’expérience de La Légende…, comprenons, tout à la fois, le processus de la réécriture et la mise à
l’épreuve de son résultat — la version française, une fois " fixée " sur le papier. Pareil au texte réécrit lui-même,
le travail de la réécriture lui-même était, simultanément, couvert et dénudé. Obscurément, je pressentais le lieu
où le langage se défaisait, où la parole de la reprise — sûre et certaine encore hier — pouvait soudain filer, se
dérober. Mais alors, toute version pouvait donc être épuisée ? Elle le pouvait… Réitérer le geste, bien que la
version retourne à son abîme — parole toujours en deuil d’un port d’attache : je ne faisais pas " du Cendrars ",
j’étais avec, et dans l’embarcation toute vacillante — nulle langue, toutes les langues — me voilà rendue sensible
à toutes ces figures d’artistes ayant été aux voisinages d’une langue en péril — langue d’écriture, de musique ou
de peinture.
Quelle est la force qui nous motive à reprendre l’écrit ?
La réécriture, on croit qu’elle a les certitudes de la reprise : or, n’est-elle pas reprise en main de l’absence ? Elle
ne rend pas présente une absence, mais elle l’actualise, en tant qu’absence (voir Blanchot, parfois Mallarmé). La
particule " ré- " semble postuler un déjà là, incontestable : certitude du recommencement. Or, appliquée à La
Légende…, cette même particule ouvre à son impensé, à ce qui reste d’impermanent, de menacé dans tout geste
de réécriture : qu’elle pouvait aussi bien ne pas être, ou que, même en étant accomplie, elle n’avait pas de raison
d’être. En amont, comme en aval, un double désengagement, un jeu à somme nulle. Une défaillance du geste de
la reprise, est-elle envisageable ? Sommes nous certains que, de réécrire, nous en aurons toujours la volonté,
que cela vaudra toujours la peine ? Entre désir et désastre, il y aurait-il, aussi bien, la volonté de reprendre… que
sa défaillance ? Le passage à l’acte de l’écriture peut-il basculer, un jour, en un passage à l’acte définitif ? Non
plus, comme le faisait Blanchot, aux voisinages de Kafka, " écrire pour périr paisiblement ", mais au contraire —
périr… pour n’avoir pas pu réécrire.
Si nous posions que le geste réitéré de l’écriture, tant qu’il s’exerce, est un fil relayant à la vie, que se passe-t-il
lorsque des écrivains, des peintres, des musiciens, cessent de l’accomplir… et se suicident ? Quel ressort se casse-
t-il alors ? Prenons Van Gogh, Nerval, Schumann, Nicolas de Staël, Celan, Tsvétaéva, Pavese… qui lâchent la
plume ou le pinceau qu’hier encore, ils tenaient, et disparaissent dans l’abîme ?
Le combat, on le voit, est de vie et de mort. Tant qu’il exerce, l’artiste sait cette part de manque initial qui
fondera toujours son geste : réitérer, c’est retrouver le face à face avec ce qui, en se disant, pourrait tout aussi
bien ne pas se dire : c’est Giacometti, remodelant sans relâche ses figurines, craignant que, achevées, laissées
en repos, elles ne viennent à s’immobiliser dans la mort… Visage du désir, mais visage du désastre, ce travail du
deuil est inhérent à l’art, par l’exercice duquel ce qui est perdu perd à son tour sa valeur négative dévastatrice, et
devient apte au passage : la perte, maintenue dans le regard, est côtoyée en tant qu’absence. D’une même
situation — celle de " l’étranger dans la maison " - le geste de la réécriture peut témoigner différemment : s’il
persiste, nous sommes sur le versant heureux de l’absence — toujours apprivoisée, appelée, séduite, telle que la
décrit Pontalis 12 :
Pour entendre, pour dire, il faut tout à la fois que l’image, dans sa présence obnubilante, s’efface et qu’elle
demeure dans son absence. L’invisible n’est pas la négation du visible : il est en lui, il le hante, il est son horizon et
son commencement. Quand la perte est dans la vue, elle cesse d’être un deuil sans fin. ;
http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (23 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:37
2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE
mais s’il cesse, nous sommes peut-être en train de faire l’expérience même de l’inhospitalier qui, pour avoir été
tenu dans l’ombre, surgit en la demeure-même qui l’avait refusé — l’intrusion de l’étrangeté radicale, non plus
invitée comme partie exploitable du familier, mais comme sa destruction intégrale. Le propre n’accueille pas
l’étranger, il en est envahi, dépossédé. L’absence, toujours reprise en écrivant, retombe alors dans son
" mauvais " ersatz — la mort, réelle, sans rémission. N’est-ce pas Van Gogh lui-même qui avait éprouvé les deux
versants de la reprise : lui qui, en travaillant sa toile, appelait ce geste une " mélancolie active ", n’a-t-il pas
moins sombré dans le " deuil sans fin " dont parle J.-B. Pontalis ? La perte, dès cet instant, est ressortie du
champ de la vue, elle œuvre dans son invisible, s’oppose au visible en l’annulant, en le dévaluant.
Que nous lie, en tant qu’hommes, aux signes et aux lignes que nous traçons ? L’échec de la reprise symbolique,
conduirait-il à un passage à l’acte " pour de vrai " — passage et chute dans le réel même de ce que l’écriture
prenait en charge, et qui était la mort ? La mort aurait été donc seulement différée, par la reprise de l’écriture, et
non pas tempérée, apprivoisée, comme chez Blanchot ? Redire la mort, est-ce encore ce qui nous lie, relie à
notre vie écrite ? Ne plus redire cette mort, ne plus toucher la plume, le pinceau — nous précipite-t-il à vouloir la
vivre, à la vouloir comme vraie, plus vraie que celle que nous venions de quitter, en bas de page ou au milieu
d’une toile ? Interrogé par le destin de ces figures, l’enjeu de la réécriture se dessinait : l’abdication de la vie, la
vraie, la réelle, venait à l’heure où réécrire s’interrompait…
Pour une éthique de la déprise revisitée
Lettre en souffrance, La Légende le restera, car il y aurait un deuil à faire, pour le lecteur français, s’il désirait
retrouver sa lettre originelle. Mais, dans cette perte imminente, que nous rappelle-t-elle d’authentique, à quel
changement de perspective nous invite-t-elle ? Quelle est la face autre de cette brisure consentie ?
Jouer le jeu, c’est accepter d’être emporté dans un changement de vue — mouvement qui nous demande de
partager une inquiétude, de nous départager nous-mêmes, si nous sommes trop enracinés dans notre langue, et
de la voir, cette langue, se dépayser. Réécrire, aujourd’hui, La Légende… c’est aussi lui reconnaître une voix
actuelle, la lire aujourd’hui — contemporaine à sa réinvention, récusant tout terrorisme de la pensée unique,
d’une langue fermée sur elle-même, d’une lecture pusillanime de tous nos événements (littéraires, mais pourquoi
pas aussi politiques et religieux, souvent clos sur eux-mêmes, assombris dans l’assertion, lorsqu’ils s’accrochent,
tueurs, à quelque lettre pantelante). Vénérer une langue nationale — et sans l’ouvrir à ce qu’elle a d’étranger — ,
se courber devant une lettre (fût-elle biblique) : n’est-ce pas déjà se retrouver, masse massive, à milles lieues de
ce qui fait notre humanité ? Lire, aujourd’hui, La Légende… c’est refuser tout ce qui, dans l’appréhension de
l’étranger, confine à l’annexion ou à l’exclusion (Meschonnic 13) : dans l’expérience de l’étranger dans la maison,
nous éprouvons (et à la lettre — dans son absence, précisément) l’instant où la littérature se redécouvre, plutôt
fragile que forte, en véritable " science humaine " (voir Savoirs et littérature). Rendus sensibles à cette perte
imminente, nous pouvons y lire toute une éthique comparatiste — mais aussi, et plus généralement, une éthique
de l’accueil, connectant la pratique de la littérature à la pratique analytique, toutes deux aux voisinages de
l’étrangeté. S’il y avait une profession de foi, elle ne pourrait se dire qu’en s’effaçant, comme dans ces quelques
mots — et fermes, et délicats — de Pontalis 14 :
Tout me détourne de la croyance, de l’adhésion à une cause, à une doctrine, à un discours qui prétend dicter des
lois, faire autorité, le discours politique n’étant qu’un modèle du genre. Je tiens pour suspecte une pensée qui, tout
en se défendant, a réponse à tout et tient à l’écart sa propre incertitude.
Apparue récemment, c’est bien aujourd’hui que La Légende nous invite à la lire — et non pas, seulement,
réinsérée dans l’histoire littéraire de 1907 15. La lire, dans toutes ses versions originales à venir, c’est accepter,
sans froncer les sourcils, qu’un bout de " patrimoine national français " ait pu être sauvegardé grâce à une langue
étrangère. Russe, française, bulgare, allemande, que sais-je — toute langue étrangère ouvrirait à ce poème sa
coquille de beauté propre, et, par ce don, le réintégrerait (aussi bien, ou aussi peu) comme une réécriture —
toujours mouvante — d’un Cendrars… privé de langue, mais combien plus riche en langues, en langues toutes
étrangères ?
Langue sauvée, ou langue menacée, celle de La Légende… réécrite nous fait participer à sa fragilité : toujours elle
échappera à nos histoires littéraires, tant qu’elles ne prennent pas en compte sa diversité, son différend, sa
différence. " Le poème, disait Char, est l’amour réalisé d’un désir demeuré désir. ". Ainsi de La Légende… qui se
http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (24 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:37
2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE
soutient de son absence, se définit dans son mouvement, et, dans l’oubli de ce que nous venons d’entendre, là
revoici — brume et bruine — dans l’éphémère d’une parole qui nous la restitue.
Plus encore qu’un poème, La Légende n’est-elle pas comme ces objets poétiques en soi, dont parlait Gantheret
16 : " porteurs d’autre chose qu’eux-mêmes, et portés par autre chose, dans l’entrelacs du désir. "? La lettre, à
l’instant de sa disparition et dans son assomption en signifiant, en parole vive : sans doute est-ce là la seule
réécriture authentique de ce poème, celle qui estompe la défaillance de l’imprimé dans l’impression vivifiante de
la lecture. Evanescence de cette nouvelle trace, fortunée, venue relayer la dette du tracé :
Lecture de la séquence finale de La Légende de Novgorode :
Je passe des heures à regarder par la vitre nocturne, brûlante de sueur.
Un cyprès solitaire, tout rongé par la poussière,
regarde dans les fenêtres fermées de la maison de mon père,
comme le moine[-pèlerin] qui me suit par la route, parcourant à pied mille lieues
pour toujours être près de moi, et pour toujours me lire le passage de la légende
de la Nouvelle Ville rayonnante,
légende que moi-même, peut-être, je vous raconterai un jour.
Dans le ciel froid du Nord, tranquille roule le soleil –
l’énorme soleil des Slaves : une roue avec des rais en bois
qui restera toujours la cinquième
de la télègue des peuples.
Mon rêve a la cadence ralentie des songes :
bandages des plaines infinies par-dessus la Russie effondrée,
et soudain quelque petit cheval toujours plus près, toujours plus près – du sang frais
à travers la gaze des neiges.
Lioubov SÁVOVA
Université de Paris 3
> sommaire
> début de l'article
> auteur
Johan Faerber
ENCORE ET EN CORPS, OU LE BAROQUE DE L'ÉCRITURE AU CARRÉ
"Il faut des yeux sur les yeux mêmes, des yeux pour regarder comment ils regardent."1. Il s’agit là d’une
recommandation adressée à son homme de cour par le jésuite espagnol du XVIIe siècle, Baltasar Gracian. Ce
conseil résonne et paraît pouvoir se poser comme une possible définition plus large de l’ensemble d’un âge qui
s’étend selon Jean Rousset de 1580 à 1660, âge épris de miroitement, de réflexivité, de mouvement et
d’infinitude que l’histoire littéraire a fini par nommer "baroque". Mais cet avis donné à l’honnête homme paraît
également devoir désigner et rendre compte de la pratique scripturale d’un certain second demi-siècle, celui qui a
redécouvert le Baroque historique, le demi-siècle du Nouveau Roman. Il semblerait à y regarder de plus près que
les deux âges se réverbèrent et se répondent, que l’un ne va pas sans l’autre, et en définitive, que l’un écrit, et
réécrit l’autre. A ce titre, le Baroque historique paraît être comme une réécriture double, dédoublée, et redoublée
du Baroque néologique et néo-romanesque, comme si la diachronie s’écrivait dans un mouvement de palindrome
et de métathèse par lequel, à la manière d’un Pierre Ménard, le néo-baroque serait la condition sine qua non de
l’âge baroque, et non le contraire voire l’inverse. Dans cette perspective, tenant le Nouveau Roman comme une
réécriture du Baroque que réécrirait le Nouveau Roman, il peut être fécond d’interroger dans le texte néo-
romanesque cette pratique de la réécriture dont il a largement contribué à fonder le succès et qui peut apparaître
comme un de ses critères narratifs distinctifs. De fait, semble s’élaborer ce qu’il conviendrait de nommer une
écriture au carré, une écriture sur l’écriture qui se prend à s’observer, à se répéter : la répétition étant pour
http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (25 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:37
2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE
Lacan l’identité même de l’art baroque qui ne cesse de s’écrier : "Encore !"2. L’écriture devient un geste au carré
par lequel l’art d’écrire interroge dans sa réitération et sa répétition la capacité de son faire mais surtout de son
dire. Il ne s’agit pas là cependant d’un geste carcéral autotélique, où l’écriture serait à elle-même son telos dans
un formalisme pointant un Art pour l’Art ricardolien somme toute. Il s’agirait bien plutôt d’interroger la capacité
de l’écriture à dire le monde et un réel devenu problématique et évanescent après l’effondrement des Savoirs et
un homme relégué dans une excentration. Selon un mot de Claude Ollier, le langage est rejeté dans
l’obscuration : la transparence entre l’homme, les mots et les choses a cessé d’imprimer au langage un rapport
idéal d’équation et d’adéquation au cosmos. : "les mots se sont comme retirés des choses, des visages, de
l’espace même, des bruits"3. Le moment serait donc devenu, comme le suggérait Foucault 4, d’assigner à
l’écriture et à la réécriture une portée ontologique par laquelle l’homme cherche à réinvestir la parole d’une
capacité à cerner son rapport cosmologique. Le texte néo-romanesque proclame bien un désir de
supplémentation, un encore mais qui tend vers une mise en corps du récit vers la chair du langage, sa sensibilité,
et son acuité ontique.
Encore et en corps, c‘est ainsi interroger la spirale de l‘alongeail, la labilité du texte disert, et le mouvement qui
va du durchkomponiert au récit objectile, autant de mouvements qui scellent la réécriture comme modalité
d’écriture même du Nouveau Roman .
1. La spirale de l’alongeail
Le premier visage de l’écriture au carré qui s’attache à elle-même, est celui de la spirale de l’alongeail, ou
comment l’écriture se fait réécriture par un système de renvois internes au récit lui-même. La disposition et
l’agencement narratifs d’un certain nombre de récits néo-romanesques reflètent aussi et ainsi, à leur manière et
dans leur matière, le souci généralisé de cette puissance au double de l’écriture. A l’instar d’une ontologie qui
obéissait à une rhétorique de l’altérité et à une mathématique des moitiés leibnizienne, se tisse, effectivement,
entre certaines scènes un certain nombre d’échos et de parallèles comme si les scènes se doublaient, se
dédoublaient et se redoublaient elles-mêmes. Le texte néo-romanesque déploie ainsi une sui-référentialité
proprement narrative par laquelle les passages dressent entre eux des symétries qu’indiquent leurs réécritures
successives.
Cette écriture sur l’écriture prend une résonance particulière et flagrante chez un auteur comme Alain Robbe-
Grillet. Suivant le titre de son dernier roman paru, sa pratique scripturale paraît répondre au souci de la reprise.
Des Gommes jusqu’à La Reprise, en effet, les récits robbe-grilletiens ne cessent de proposer de se re-prendre, de
se reprendre à nouveau et de multiplier des reprises d’eux-mêmes. Loin de prétendre être uniquement de simples
répétitions, ces reprises participent d’un souci de la réécriture que connaissait déjà à l’aube de l’âge baroque au
travers des Essais de Montaigne. Au coeur de la reprise robbe-grilletienne, se laisserait ainsi peut-être entendre
une résonance et un retour de la pratique montanienne de l’alongeail tel que l’essayiste bordelais la désigne de la
manière suivante, pratique par laquelle l’écriture s’essaye à elle-même : "Laisse, lecteur, courir encore ce coup
d’essai et ce troisième alongeail du reste des pièces de ma peinture. J’ajoute, mais je ne corrige pas."5. Chaque
phrase ajoutée se présente pour Montaigne comme, dit-il, "un emblème du supernuméraire" 6, synonyme de
l‘encore baroque. Il en est de même pour Robbe-Grillet dont le supernuméraire de la reprise augmente le chiffre
d’un texte qu’on ne finit jamais de déchiffrer et de défricher. Il n’est qu’à considérer ce procédé d’une écriture qui
ne cesse de se réécrire dans La Reprise elle-même. Réécriture de la réécriture puisqu’il s’agit d’une réécriture des
Gommes qui réécrivaient Oedipe roi qui lui-même réécrivait plus largement le mythe d’Oedipe, La Reprise
propose dès sa phrase d’ouverture un retour sur une reprise : "Ici, donc, je reprends et je résume." 7. Cette
formule se retourne sur elle-même puisqu’il s’agit d’une reprise intertextuelle d’une phrase déjà apparue sous la
plume du narrateur de La Maison de rendez-vous. Lui aussi écrivait : "Je reprends et je résume." 8. Tout se fonde
ici, à la naissance même du texte dans son incipit sur une renaissance : l’écriture est, dès son inassignable
origine, toujours-déjà répétition de ce qui a été répété dans un miroitement sans fin. A ce titre, il convient de
revenir sur le syntagme même par lequel s’ouvre dans Un régicide, l’oeuvre de Robbe-Grillet, syntagme qui
refuse tout commencement, à savoir "Une fois de plus". Cet "une fois de plus", formule même du supernuméraire
et de l’encore baroques, commande dans Un régicide même une description de l’élément marin qui ne cessera
dès lors de hanter les phrases robbe-grilletiennes. Sans cesse reprise encore et encore, cette description qui
présente "au bord de la mer, à la tombée du jour, une étendue de sable fin coupée de rochers et de trous, qu’il
faut traverser, avec de l’eau parfois jusqu’à la taille" 9, est réécrite dans Le Voyeur ou encore dans Souvenirs du
triangle d’or, image du va-et-vient à l’instar du ressac qu’elle dépeint. Comme par un nouvel effet et effort de
réverbération, ces eaux en mouvement, si chères, on le sait depuis Jean Rousset, à la poésie baroque, dessinent
http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (26 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:37
2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE
un texte happé par le même souci du mouvement et du miroitement qui comme chez D‘Urfé connaît cet
écoulement aquatique perpétuel de "l‘onde dessus l‘onde"10, devenant ici celui de la phrase dessus la phrase. Le
Perpetuum Mobile cosmologique de la mer prête ses qualités au récit : les passages deviennent autant de vagues
successives qui reviennent et qui sont à la fois mêmes et à la fois autres. A l’instar du ruisseau décrit par Saint-
Amant, "Ruisseau qui cours après toy-mesme, / Et qui te fuis toy-mesme aussi" 11, le récit robbe-grilletien
dispose des ondes mobiles qui ne se meuvent qu’en différant l’une de l’autre dans une ressemblance
contradictoire. Ainsi dans les Romanesques qui se proposent de réécrire elles-mêmes les précédentes oeuvres de
Robbe-Grillet, en les renversant et en les reversant dans l’espace autobiographique, la description d’une plante va
et vient comme une vague qui pousse la vague. Elle figure tout d’abord sur une ancienne photographie
représentant la mère de Robbe-Grillet avant la première guerre mondiale : " [...] dans l’angle inférieur gauche du
cadrage - il y a une plante sauvage à fleurs blanches dont j’ignore l’espèce, le genre, et même la famille. Elle est
pourtant bien visible, tout à fait sur le devant et parfaitement au point. L’inflorescence (trois tiges groupées,
partant du sol en faisceau) ressemble à celle du muguet, mais cinq à six plus grande; et les feuilles en rosette,
tout autour, sont larges et molles, fortement lobées, avec une nervure centrale bien reconnaissable, attestant en
tout cas l’appartenance à la classe des dicotylèdones." 12. Cette plante, à quelques détails près, reparaît réécrite
quelques pages plus loin dans une toute autre description, celle d’un tableau symboliste appendu sur le mur en
face du bureau de Robbe-Grillet. S’articule là une oscillation entre mêmeté et ipséité. Il est dit de ce tableau que
"tout en bas, dans l’angle inférieur gauche, une plante sauvage en fleurs a été peinte avec le même souci de
précision que l’ensemble du tableau. Peut-être s’agit-il, cependant, d’une espèce imaginaire, ou bien qui
pousserait seulement dans de lointaines et inaccessibles contrées où je n’aurais pas herborisé jusqu’à présent ?
Les hampes florales, dont trois tiges semblables [...] sont groupées en un faisceau serré partant du coeur font
penser à celle de l’asphodèle commune, bien que les clochettes soient ici d’une éclatante blancheur." 13. Le texte
dans ses méandres devient alors semblable à une eau miroitante intrinsèque au Baroque : il devient ce miroir qui
revient du titre du premier volume de cette trilogie autobiographique. S’approchant du "miroir qui coule" ou
encore du "miroir flottant" 14 d’un Saint-Amant, Robbe-Grillet construit ses romans en miroir, en jeu de
réflexions. Auteur d’un ensemble de trois nouvelles rangées sous le titre de "Trois visions réfléchies" 15, Robbe-
Grillet organise ses scènes comme une série de visions fléchies et infléchies qui engage une relation spéculaire.
Un tel jeu de miroirs, empruntant encore à celui qui hante les ballets de cour au XVIIe siècle, paraît se dessiner
avec le plus de force dans un roman tel que La Jalousie. Chaque épisode dispose de son propre reflet et assure,
par sa réécriture constante, la dynamique narrative même qui repose sur la singulation d’une itération et d’une
réitération généralisées. C’est le cas du célèbre épisode de la scutigère tuée par Franck, épisode décliné dans un
mouvement répété de reflets où, par exemple, "la bête incurve son corps et se met à descendre en biais vers le
sol, de toute la vitesse de ses longues pattes, tandis que la serviette en boule s’abat, plus rapide encore." 16.
Passage qui se réverbère de la façon suivante quelques pages plus loin : "Franck, sans dire mot, se relève, prend
sa serviette ; il la roule en bouchon, tout en s’approchant à pas feutrés, écrase la bête contre le mur." 17. Ce
miroitement au carré des visions infléchies est relayé et lui-même réfléchi, réécrit dans ses miroirs sphériques
mis en abyme que sont le roman africain que lit A... fait de "variations très nombreuses ; les variantes des
variantes encore plus" 18, ou le poème indigène qui se fait entendre, poème fait lui-même de "répétitions,
d’infimes variantes, de coupures, de retours en arrière" 19.
Mais ce vers quoi convergent cette reprise comme alongeail, ces eaux miroitantes du texte, c’est le souci dans
l’écriture au carré, et que permet incidemment la réécriture, d’échapper à toute fixité. De telles figures engagent
la pratique scripturale dans un mouvement qui autorise la possibilité même du dire, car, ainsi que le suggère
Montaigne, ce qui prime dans la technique de l’alongeail, c’est reprendre ce que l’on dit non pour corriger, car,
indique-t-il, "Au demeurant, je ne corrige point mes premières imaginations par les secondes; oui, à l’aventure
quelque mot, mais pour diversifier, non pour ôter." 20. Ce divers et cette variété que la supplémentation baroque
appelle paraît culminer comme au XVIIe siècle chez Robbe-Grillet dans la figure de la spirale qui elle-même
reprend et réécrit les figures précédentes. Qu’il suffise de se reporter ici à ce qui se déploie avec le plus
d’évidence dans un roman tel que Dans le labyrinthe. D’emblée se marque dans l‘incipit, à une micro-échelle, une
écriture au carré qui, encore et encore, se reprend, flue et reflue, s’allonge et miroite. Ces parallélismes d’une
narration qui se renvide sur elle-même s’organisent autour du retour saillant de l’adverbe "dehors" comme suit :
"Dehors il pleut, dehors on marche sous la pluie en courbant la tête, [...] dehors il fait froid, le vent souffle entre
les branches noires dénudées ; le vent souffle dans les feuilles, entraînant les rameaux entiers dans un
balancement, dans un balancement, balancement, qui projette son ombre sur le crépi blanc. Dehors il y a du
soleil [...]" 21. Le récit choisit de se dérouler en s’enroulant en des phrases faites de révolutions et d’involutions
http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (27 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:37
2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE
comme celle-ci encore : "Dehors il neige. Dehors il a neigé, il neigeait, dehors il neige." 22. Les mêmes mots se
reproduisent et se disséminent d’un paragraphe à l’autre. De la sorte, la phrase "dehors on marche sous la pluie
en courbant la tête, s’abritant les yeux d’une main tout en regardant quand même devant soi" 23 va se retourner
sur elle-même peu après. Tel Montaigne, d’une certaine manière, qui constatait que son livre "se reverse en soi"
24, cette phrase se reverse plus loin ainsi en proposant l’image même de ce reversement en quelque sorte,
comme si elle réécrivait ce qui se réécrit : "On marche en courbant un peu plus la tête, en appliquant davantage
sur le front la main qui protège les yeux, laissant tout juste apercevoir quelques centimètres de sol devant les
pieds, quelques centimètres de grisaille où les pieds l’un après l’autre apparaissent, et se retirent en arrière, l’un
après l’autre, alternativement." 25. La narration ne décrit là en aucun cas un cercle qui métaphorise, pour l’esprit
baroquisant, l’archétype de la perfection auquel le dit esprit ne veut et ne peut plus prétendre. Les reprises de
termes empruntent bien plutôt au modèle de la spirale que le texte dans sa constante supplémentation, dans son
goût pour le supernuméraire met lui-même en exergue dans un nouveau miroitement, ou une nouvelle spirale
sans fin. La spirale et ses variantes exprimées par les formes tourbillonnantes se signalent au milieu de ces
essaims de termes enroulés. L’écriture au carré se met elle-même en scène sous la figure du vent qui "dessine
des parallèles, des fourches, des spirales"26. Image elle-même reprise et développée en spirale tel un motif tout
au long du récit comme suit à nouveau : "Le vent chasse sur l’asphalte sombre du trottoir les fins cristaux secs,
qui se déposent après chaque rafale en lignes blanches, parallèles, fourches, spirales, disloquées aussitôt,
reprises aussitôt dans les tourbillons chassés au ras du sol, puis figés de nouveau recomposant de nouvelles
spirales, volutes, ondulations fourchues, arabesques mouvantes aussitôt disloquées."27. Partageant déjà avec
Piranèse ce goût baroque pour les couloirs labyrinthiques, ce roman réaffirme cette généalogie par la
multiplication des spirales qui hante plus largement l’imaginaire d’un certain XVIIe siècle. Une telle prédilection
pour le tourbillonnant transparaît dans ces vers de Crashaw sur la bulle de savon : "Sphère tournoyante, / Corps
ivre de mille couleurs, / Déesse volatile / Soulevée d’un élan charmant, / Tournoyant incertaine, / Se poursuivant
elle-même / En une fuite dansante et hésitante..." 28. Le poète est alors comme Robbe-Grillet fidèle à cette
attirance baroque pour, selon Rousset, "l’instabilité d’un équilibre en voie de se défaire pour se refaire, de
surfaces qui se gonflent ou se rompent, des formes évanescentes , de courbes et de spirales"29. La variété chez
l’auteur de Glissements progressifs du plaisir de l’écriture au carré de la spirale, de la "progression coupée de
boucles et de tourbillons"30 signale comme dans le Baroque ce refus des tracés linéaires, et ce souci de la
multiplication de points de vue pour dire une réalité devenue ondoyante, qui tournoie pour mieux se poursuivre
sans paraître jamais pouvoir se rattraper.
2. La labilité du texte disert
Cependant, cette spirale robbe-grilletienne de l’alongeail n’est qu’un visage parmi d’autres que prend la
réécriture, l’écriture au carré au sein du Nouveau Roman. Si l’alongeail montanien coïncide avec la reprise robbe-
grilletienne dans son souci d’ajouter sans ôter, de préciser sans corriger, tel n’est pas exactement le cas de
Claude Simon dans sa pratique de l’encore baroque.
S’opère chez l’auteur des Corps conducteurs une circulation de la parole qui n’est en rien cependant une
circularité de celle-ci. Le dire simonien n’en vient pas à redire pour répéter dans la synonymie et l’identité
tautologique. Réécrire ne revient pas à ajouter mais bien plutôt dans un geste paradoxal que pratiquait déjà l’âge
baroque à retrancher, à corriger pour préciser. Même si l’expansion se révèle dans un cas comme dans l’autre la
conséquence inéluctable, la parole simonienne choisit de dessiner une écriture au carré qui ne prétend pas à
l’encore plus mais à l’encore moins ou l’encore mieux à la manière de ce qui se suggérait à l’orée du XVIIe siècle
qui posait un paradoxe voisin à travers par exemple L’Epithame de Jean Saint-Samson. Se pose déjà la question
de dire tout en ne disant pas et de dire l’ineffable, ce qui provoque une infinie parole de l’ineffable même si les
prégoratives discursives sont loin d’être semblables entre les deux auteurs et les deux siècles : " [...] en notre
commun repos et jouissance d’eux-mêmes ineffablement ineffables [...] ah ! je deffaux totalement ! Ah ! je n’en
puis plus et expire d’amour [...] en amour par dessus amour, en repos et fruition par dessus le repos et le
fruittion, en simplicité par dessus la simplicité ineffablement ineffable, en l’ineffable par dessus l’ineffable [...]"
31. Se dit là une parole qui ne cesse de revenir sur elle-même qui s’étend comme celle de Simon sur plusieurs
pages faute de pouvoir s’arrêter comme Georges dans L’Herbe en fait l’expérience, lui qui propose une image
éclairante de ce retournement du retournement : " [...] les paroles se détachant de ses lèvres, restant comme la
fumée suspendues au-devant de ses lèvres, une boule grise roulant sur elle-même, les sons prononcés, les mots
roulant les uns sur les autres, c’est-à-dire montrant leurs diverses faces, leurs diverses combinaisons - ce
pourquoi l’on dit sans doute"tourner et retourner des paroles" 32. Ainsi, les récits de Claude Simon accomplissent
http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (28 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:37
2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE
ce mouvement de tourner sept fois leur langue dans leur bouche mais de continuer à parler, faute de mieux,
durant ce même temps. Du Vent jusqu’au Tramway en passant par Histoire, l’écriture au carré, d’une écriture qui
ne cesse d’écrire sur elle, d’écrire à sa propre suite pour s’effacer en proposant autre chose, cette écriture au
carré, donc, procède de ce même divorce foucaldien aperçu déjà plus haut, entre les mots et les choses. Ici
comme là, chez Simon comme chez Saint-Samson, "la profonde appartenance du langage et du monde se trouve
défaite. Le primat de l’écriture se trouve suspendu. Disparaît alors cette couche uniforme où s’entrecroisaient
indéfiniment le vu et le lu, le visible et l’énonçable. Les choses et les mots vont se séparer." 33. Face à une
culture qui s’est effondrée de par son inutilité comme en atteste la destruction de la bibliothèque de Leipzig,
Simon ne peut que constater que "le propre de la réalité est de nous paraître incohérente, du fait qu’elle se
présente comme un perpétuel défi à la logique, au bon sens, du moins tels que nous avons pris l’habitude de les
voir régner dans les livres - à cause de la façon dont sont ordonnés les mots, symboles graphiques ou sonores de
choses, de sentiments, de passions désordonnées [...]" 34. Prenant acte d’une telle crise du savoir, la parole
simonienne adresse, par son souci de la réécriture, cette question : comment fonder une mimèsis en l’absence de
toute mathèsis possible et formulable, comment dire cette oraison (funèbre) de la raison ? L’écriture se livre alors
à une guerre des mots qui s’origine dans un guère de mots pour dire le réel.
A ce titre, l’encore simonien cherche, comme dans le Baroque, à faire corps avec un monde que la parole ne
saurait épuiser, un monde inépuisable et méconnaissable qui condamne à l’essoufflement d’une parole toujours
labile. L’écriture ne cesse d’écrire partagée entre labil et babil si bien que la narration se constitue, elle aussi, de
scènes esquissées qui reviennent pour être spécifiées, précisées, achevées sans pour autant ne connaître que
l’inachèvement. De fait, dans La Route des Flandres par exemple, la diction de l’épisode mettant en scène
Georges et Blum dans le train les menant en camp de prisonniers, s‘en voit affectée. Le constant mobile de la
réitération produit un récit entièrement fondé sur la progression linéaire des similarités, où le voyage est
convoqué comme s’il ne marquait jamais de terme : "maintenant nous étions couchés dans le noir c’est-à-dire
imbriqués entassés au point de ne pas pouvoir bouger un bras ou une jambe [...] le wagon arrêté une fois de
plus dans la nuit on n’entendait rien d’autre que le bruit des respirations." 35. L’épisode est répété, et chacune de
ces répétitions varie autour du laconisme et de l’hypertrophie : "Puis Georges ne l’écoutant plus [Blum], ne
l’entendant plus, enfermé de nouveau dans l’étouffantes obscurité puis quelque chose de violent, des heurts, une
bousculade, des jurons dans l’ombre, puis la porte glissa de nouveau, le loquet de fer se rabattant au-dehors, et
ce fut de nouveau le noir [...]" 36. Tout fixité et tout point final sont abolis en vertu d’une loi que Simon énonce
lui-même et qui apparaît paradigmatique de cette parole de l’encore et encore : "Tiens, il faut que je reparle de
ça, il faut que ça revienne." 37. Cet absence de point fixe aboutit, comme dans la géométrie baroque, à ce que
Leibniz désigne par l’inflexion puisque, selon Deleuze, "l’inflexion en elle-même est inséparable d’une variation
infinie, ou d’une courbure infiniment variable" 38. Le récit simonien certes varie mais dans un élan de
spécification, de correction conjoint au retrait : il essaie de suivre un mouvement continu que contredit la
réécriture, un mouvement continu sans cesse fait de courbures comme chez Leibniz chez qui il n’existe pas de
droite sans courbures entremêlées. L’écriture au carré va donc de pli en pli, et notamment dans la phrase elle-
même et non plus uniquement à une échelle macrostructurale. Cette phrase en question, faite d’un déroulement
que la syntaxe ne paraît plus contrôler, obéit dans ces pliures à une rhétorique de l’épanorthose, c’est-à-dire
selon Pierre Fontanier à cette figure qui consiste à "revenir sur ce qu’on dit pour le renforcer, ou pour l’adoucir ou
même pour le rétracter tout à fait." 39. Cette réécriture, cette écriture sur l’écriture par le pli est guidée par le
"ou plutôt", syntagme de l’encore de Simon comme le "une fois de plus" est le syntagme de l’encore chez Robbe-
Grillet. L’épanorthose peut se signaler ainsi : "Ou peut-être. C’est-à-dire peut-être pas ce sir-là, ou ces mots-là
(sinon le volubile, affolé et inepte bavardage de Sabine), cette sortie. Peut-être simplement, au lieu de cela,
quelques regards (ou même pas : des mots retenus, ou dits une autre fois, ou peut-être jamais dits, seulement
pensé, et non pas un incident d’un jour mais quelque chose de permanent [...] ou peut-être pas." 40. Ou
encore : "non pas en pleine retraite ou plutôt débâcle ou plutôt désastre au milieu de cette espèce de
décomposition de tout comme si non pas une armée mais le monde lui-même..." 41. La labilité d’un réel devenu
centre vide autorise à la formulation comme dans le Baroque d’un "texte disert" selon l’expression de Du Bartas
dans La Sepmaine (1581). Ce texte disert est censé figurer chez Du Bartas la profusion d’une nature végétale
généreuse qui se perd dans ses emboîtements et ses enchevêtrements : elle est aussi sémiotique d‘un texte qui
ne cesse de s‘engendrer par la paraphrase, ce qui peut tendre à le rapprocher des tentatives de Simon même si,
une fois encore, les visées esthétiques ne sont pas semblables, Simon étant sorti du religieux alors que Du Bartas
cherche à en recueillir la pleine lumière. De la même façon, chez Simon, la labilité et le disert se voient figurés
par le végétal et l’arborescence. Si l’image végétale peut être tenue pour un des fondements du Baroque, force
est de reconnaître que la phrase simonienne est métaphorisée, comme chez Du Bartas, par un véritable jardin
des Plantes. L’arborescence de l’acacia est celui d’une phrase qui ne cesse de pousser à l’image de l’herbe.
http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (29 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:37
2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE
Entre profusion et confusion, la pratique scripturale de Claude Simon dessine en définitive l’inflexion d’une
épanorthose végétale qui ne peut connaître que l’infinitude du ressassement, signe même d‘une modernité
baroque dont le Nouveau Roman dévoile une des facettes.
3. Du durchkomponiert au récit objectile
Enfin, l’encore baroque d’une écriture taraudée par sa supplémentation et par sa propension à l’incessante
expansion, conduit dans le texte néo-romanesque - que son mouvement soit correctif ou supernuméraire - au
geste de sa mise en corps. Une corporéité de l’écriture semble apparaître conséquemment aux jeux d’échos et de
symétries, par lesquels cette même écriture va se donner forme. La variation continue peut appeler, de fait, à
une régulation qui passe par une esthétique matérielle où les agencements formels se donnent à voir avec
véhémence. Centrée et concentrée sur les boucles réflexives et les accumulations miroitantes, la narration fait de
sa forme son support discursif même. Cette esthétique du sensible, du corps du récit et de sa matérialité
scripturale va emprunter à l’expressivité musicale de la fugue que Pinget choisit de mettre en lumière à nul autre
pareil.
De Mahu ou le matériau en passant par Le Fiston jusqu’à Cette voix, se manifeste, en effet, la même labilité du
texte disert que chez Simon à ceci près que, dans un ultime miroitement de l’écriture au carré, Pinget en vient à
le théoriser dans le cours même de son texte, et à en souligner les incidences. Dans cet écoulement perpétuel
d’un langage qui ne connaît pas le tarissement de son murmure, le verbe "dire" n’existe pas : tout se tourne vers
un redire car, pour Pinget, au commencement est la répétition du commencement si bien qu’il faut "redire jusqu’à
manquer de souffle" 42. Ici, le narrateur pingétien comme celui de Robbe-Grillet ou de Simon déclare qu’il lui
paraît être "impossible de finir impossible de ne pas finir impossible de continuer impossible d’arrêter de
reprendre" 43. Tout s’accomplit dans une sorte d’in medias res d‘une écriture toujours et déjà en train de se
réécrire. L’encore trouve là également une résonance ontologique : il s’agit avant tout chose de répéter
littéralement jusqu’au pléonasme afin de se reprendre pour se ressaisir cette fois, reprendre son calme, pour
redevenir maître de soi par le verbe tel que ceci peut en donner un aperçu : "Quand ça ne va pas fort, profiter de
me répéter des choses élémentaires que je pense quand je n’écris pas. Répéter ne pas drôle et intéressant à tout
prix, c’est peut-être ça qui a fait foirer mes autres exposés." 44. Ce principe du redire qui se substitue à toute
possibilité du dire est divulgué dans Quelqu’un où s’affirme le refus de toute affirmation : "Encore une chose.
J’écris ça comme ça, comme on parle, comme on transpire. Quand je dis que je ne me souviens pas de ce que j’ai
dit c’est vrai mais je devrais dire écrit. Si je voulais je pourrais relire mais ça ne m’intéresse pas. Ca m’est égal
de me contredire. Ce qui est dit n’est jamais dit puisqu’on peut le dire autrement." 45. Ou encore : "Qu’importe
les redites. Tout redire pour tout renouveler." 46. Ce souci de l’écriture au carré se fait tel qu’il fournit la colonne
vertébrale actantielle de certains récits comme dans Le Fiston où le père ne cesse de réécrire une lettre infinie à
son fils disparu : "Mon cher fiston. Je recommence. La figure défaite, les lacets dénoués, le paletot, la tignasse
hirsute, l’oeil pleurard, la tête vide. Cette prison où je suis. Ca recommence. La main qui t"écrit. Perdu la trace."
47. Ici, se signale un goût intrinsèque au Baroque pour la copia, l’abondance : s’articule chez Pinget un souci
conjoint de la copia rerum (l’abondance des choses à dire) et de la copia verborum (l’abondance des modes du
dire) qui aboutit à une infinitude proche de la cornucopia, la corne d’abondance. Lorsque le narrateur pingétien ne
cesse de répéter qu’il faut "tout redire sous peine de n’avoir rien dit" 48, il rejoint là Du Bartas qui déclarait à
propos de la réécriture des Ecritures : "Mon labeur croist toujours" 49.
Si parfois l’encore est ramené dans le carnavalesque pingétien à la rumination et au radotage, force est
cependant de constater que l’écriture au carré qui trace et porte tout au double, redouble cette propension à la
répétition et à la variation en installant, pour la distribuer, un ensemble de modèles formels fondés eux aussi sur
l’encore. Le plus marquant est délibérément et nommément emprunté à la culture baroque musicale et à son
compositeur le plus saillant, Jean-Sébastien Bach : il s’agit de la fugue, et en particulier, la passacaille, modèle
même de la réécriture en musique. Soulignée dès le titre qui fonctionne comme un énoncé métalinguistique, la
structure du livre se modèle avec force sur la passacaille qui est une pièce musicale à variations. Et cette
passacaille de Pinget, à l’instar de celle de Bach, repose sur le retour d’une même ligne mélodique, une basse
continue dont le premier paragraphe plaque les premiers accords. Les phrases nominales "Le calme. Le gris."
sont comparables à ces arias qui ouvrent à une série de variations comme suit : "Le gris. Le calme. Se serait
assis devant la table." 50. Et se poursuit tout au long du roman ainsi rythmé par des formules telles que "Le
calme. Le gris. Le cadavre est à plat ventre sur le fumier." 51. Il s’agit là d’une première ligne mélodique : le
caractère formel de la réécriture obéit ensuite à la technique du durchkomponiert comme dans les Variations
http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (30 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:37
2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE
Goldberg, technique qui sur-imprime, réécrit en continu une autre ligne mélodique: ce sera là la phrase
nominale : "Quelque chose de cassé dans la mécanique." 52. A cette ligne une autre se sur-imprime encore et
encore qui, par un nouvel effet d’écriture au carré, entretient de cet effort à répéter : "Revenir sur ses pas,
tourner, retourner, revenir. Murmures, formules divinatoires, rabâchage." 53. Ce modèle formel de composition
musicale ne doit cependant pas se ramener uniquement à la célèbre proposition selon laquelle le récit néo-
romanesque est moins l’écriture d’une aventure que l’aventure d’une écriture. Si l’écriture au carré achève donc
de réclamer son encore par une mise en corps qui sait se faire expressive, il faut souligner combien ce corps
renvoie à une portée ontologique et non à une simple visée autotélique. Si, comme dans la sculpture baroque
selon Christine Buci-Glucksmann, "la forme s’expose elle-même en sa darstellung : elle apparaît, se transforme,
disparaît, revient autre dans son départ, dans son mouvement" 54, et la conjugaison répétée de modèles de
répétitions/variations tels que la fugue, la passacaille, la spirale, l’inflexion, l’arborescence, concourt à souligner
l’importance de l’organisation formelle de ces mêmes récits. La forme ne serait ainsi donc pas ici un synonyme
d’artifice et d’artificialité : l’encore va vers le corps même de la nature selon le renversement d’une dialectique
proprement baroque. Il revient à Robbe-Grillet de l’exposer le plus manifestement : il pose une analogie entre la
réécriture - où tout est déjà écrit - et la nature - qui donne les moyens de tout réécrire : "La nature n’a-t-elle pas
construit tous les systèmes vivants, depuis l’amibe jusqu’au cerveau humain, avec seulement huit acides aminés
et quatre nucléotides, toujours les mêmes ?" 55. De fait, un renversement se produit par lequel la nature se voit
responsable de travaux artistiques plus vrais que nature, ce que les Baroques se prenaient déjà à mettre en
évidence. L’art produit la nature et la nature l’art comme Gracian disait : "L’art est l’accomplissement de la nature
et comme son second créateur, il la finit, il l’embellit, il la surpasse même quelque fois ; il a pour ainsi dire ajouté
un autre monde au monde premier." 56. Cette darstellung de la forme aboutit donc à ce corps certain, expression
que les érudits arabes employaient pour parler du texte. Ainsi, la certitude corporelle affectée au texte par
laquelle celui-ci manifeste sa matérialité scripturale est dégagée par Robbe-Grillet qui en vient à rapprocher
forme et corporéité : il y voit "une qualité précise du texte, qui est sa chair : l’oeuvre entretient toujours et avant
tout un rapport sensuel avec le corps de l’homme, et d’autant plus qu’il s’agit d’un travail davantage formalisé."
57. Il n’hésitera pas à réécrire ainsi la phrase suivante : "La chair des femmes a toujours occupé une grande
place dans mes rêves" en "La chair des phrases a toujours occupé une grande place dans mon travail" 58. Se
dévoile ici un récit qui ne se prend pas pour objet, mais qui fait des contours de son objet même son tracé
objectile 59, d’une expression de Deleuze, selon laquelle le formalisme et le corps du récit se font l’âme de celui-
ci.
Arrive ainsi par le souci de la forme dans le texte néo-romanesque, par l’encore de la corporéité, l’avènement de
ce que Leibniz désignait déjà à propos de la musique baroque, de son accumulation du durchkomponiert qui
redécouvrait la nature, "le calcul inconscient de l’âme" 60.
Johan Faerber
Université de Paris III
> sommaire
> début de l'article
> auteur
QUESTION D'IDENTITÉS
Noëlle Benhamou, 32 ans, professeur de lycée, chargée de cours à l'IUT de l'Oise, docteur ès lettres de
http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (31 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:37
2 - À L'ÉPREUVE DE LA RÉÉCRITURE
l'Université Paris III-Sorbonne Nouvelle, spécialiste de Maupassant et de la seconde moitié du XIXe siècle,
rattachée aux centres Zola et Goncourt (ITEM-CNRS). Participe à l'édition du Journal des Goncourt (Champion,
1er tome fin 2003). Travaille avec Yvan Leclerc à une bibliographie Maupassant (Memini, 2004).
> texte complet
Mélanie Colcanap prépare, sous la direction de M. Jean Bessière, une thèse en Littérature générale et comparée
sur le roman occidental des années 1960 à 1980 (R. Pinget, M. Butor, T. Pynchon, J. Cortazar, I. Calvino, U. Eco).
Ses pistes de recherche s'orientent vers les notions d'oscillation, de paradoxe et de contradiction dans la fiction
littéraire. Elle s'intéresse également à la question de l'espace du texte, à la littérature à contrainte et aux enjeux
éthiques de l'œuvre littéraire.
Erica Durante est Doctorante en Littérature Générale et Comparée à l'Université de Paris III. Elle prépare une
thèse en co-tutelle avec l'Istituto Universitario Orientale de Naples, sous la direction de J. Bessière et de M.-T.
Giaveri, dont le thème est "La voix de Dante dans l'écriture de Valéry et de Borges". Elle est l'auteur d'une édition
génétique d'un essai inédit de Valéry sur Mallarmé et de publications sur Borges, Dario, Mallarmé et Valéry. Elle
est par ailleurs membre du Groupe de Recherche sur la Méditerranée de l'AILC. Elle est actuellement ATER dans
le Département d'Italien de l'Université de Picardie, Jules Verne.
> texte complet
Johan Faerber est docteur ès lettres modernes de l'Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle. Ses travaux
portent essentiellement sur l'esthétique baroque du Nouveau Roman mais s'intéressent également à la littérature
contemporaine (Arno Bertina, Tanguy Viel), et à la possibilité d'une poétique des premiers romans. Membre du
centre d'études du roman du second demi-siècle dirigé par Marc Dambre, il est actuellement ATER.
> texte complet
Jean-François Puff est agrégé de lettres modernes, et son travail de doctorat est consacré à l'oeuvre poétique
de Jacques Roubaud dans ses rapports à la lyrique médiévale. Il anime un groupe de recherche qui envisage la
question de la contrainte et de la forme en poésie moderne, dans le cadre d'un partenariat entre l'équipe de
Recherches sur la poésie contemporaine de Paris III et le Centre d'Etudes Poétiques de l'E.N.S. Lyon. Il est
membre du conseil de rédaction de la revue Formes Poétiques Contemporaines.
> texte complet
Lioubov Sávova est Doctorante en Littérature Générale et Comparée à Paris III, sous la direction de Stéphane
Michaud. Partant de l’expérience du déracinement chez trois auteurs singuliers du XXe siècle - Nabokov, Canetti,
Yovkov -, ses recherches sont mues par les points de rencontre entre le déracinement et l’écriture, pris
simultanément comme thème littéraire et comme interrogation de l’acte créatif aux prises avec le trop ostensible
de l’exil. Membre du Centre d’Études Blaise Cendrars à Bern, elle est l’auteur de deux articles sur son approche
très personnelle du premier poème de Cendrars, perdu en français et retrouvé en russe - poème dont elle a tenté
une réinvention. Intéressée par tout ce qui se perd dans les langues et ce qui œuvre, en elles, comme fragilité et
étrangeté, elle aime côtoyer l’écriture sous ses deux formes - la poésie et la traduction -, attentive avant tout à la
voix et au rythme des textes écrits.
> texte complet
> sommaire
dernière mise à jour : 25.09.04 / ces pages soutiennent le programme antispam contre les courriers non sollicités
^
http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/roman_cahiers2.html (32 of 32)22 iunie 2006 joi 18:08:37
Vous aimerez peut-être aussi
- Poésie moderne: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandPoésie moderne: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- À L'épreuve de La RéécritureDocument21 pagesÀ L'épreuve de La RéécritureestorilfilmefestivalPas encore d'évaluation
- 2020 L'imposture Dans Le Condo & 53 JoursDocument121 pages2020 L'imposture Dans Le Condo & 53 Joursxyvan31Pas encore d'évaluation
- Schiavetta Bernado "Sur L'impensé D'une Page Blanche" Colloque Ricardou CerisyDocument8 pagesSchiavetta Bernado "Sur L'impensé D'une Page Blanche" Colloque Ricardou CerisySCHIAVETTA Angel BernardoPas encore d'évaluation
- VB50 Calle JordaDocument16 pagesVB50 Calle JordaFederico Calle JordaPas encore d'évaluation
- (CAPÍTULO) GAUVIN, Lise (2004) Les Littératures Francophones - Manifester La Différence + Du Carnavalesque Au Baroque + ConclusionDocument48 pages(CAPÍTULO) GAUVIN, Lise (2004) Les Littératures Francophones - Manifester La Différence + Du Carnavalesque Au Baroque + ConclusionThiago MattosPas encore d'évaluation
- (插画研究)Les Moutons de Dindenault Ou Lillustration Dans Loeuvre de Francois Rabelais 1532-1977 Prelude Et Coup Dessai by Ahmed-Boukhari, ALIDocument65 pages(插画研究)Les Moutons de Dindenault Ou Lillustration Dans Loeuvre de Francois Rabelais 1532-1977 Prelude Et Coup Dessai by Ahmed-Boukhari, ALICharlie XiPas encore d'évaluation
- D'une Rive L'autre de Nicolas Martin-GranelDocument31 pagesD'une Rive L'autre de Nicolas Martin-GranelVernes WuteziPas encore d'évaluation
- 425 902 1 SMDocument24 pages425 902 1 SMdz.espace06Pas encore d'évaluation
- Antoine Albalat - La Formation Du StyleDocument328 pagesAntoine Albalat - La Formation Du StyleLuiz de CarvalhoPas encore d'évaluation
- Long Longpre Samuel 2018 MemoireDocument158 pagesLong Longpre Samuel 2018 MemoireTarikPas encore d'évaluation
- Roman 0048-8593 1985 Num 15 49 4739Document3 pagesRoman 0048-8593 1985 Num 15 49 4739José LuizPas encore d'évaluation
- Flaubert, La Prose Comme Une PeintureDocument11 pagesFlaubert, La Prose Comme Une PeintureJavier TusoPas encore d'évaluation
- L'imaginaire de La Marche Dans Les Illuminations D'arthur RimbaudDocument116 pagesL'imaginaire de La Marche Dans Les Illuminations D'arthur RimbaudGilles MalatrayPas encore d'évaluation
- Les Fables D'esope: Une Oeuvre Sans Auteur?: Antoine Bisc Er eDocument31 pagesLes Fables D'esope: Une Oeuvre Sans Auteur?: Antoine Bisc Er eRaïs MahoungouPas encore d'évaluation
- BONNEFOY, Yves. Lever Les Yeux de Son LivreDocument22 pagesBONNEFOY, Yves. Lever Les Yeux de Son LivreCandice CarvalhoPas encore d'évaluation
- Yves BonnefoyDocument20 pagesYves BonnefoyNervalina BluesPas encore d'évaluation
- Martin-Gaillard Genres Litteraires RomeDocument248 pagesMartin-Gaillard Genres Litteraires RomeEpistêmôn Empéïrôs100% (2)
- Deleage - Repartir de Zero PDFDocument47 pagesDeleage - Repartir de Zero PDFGustavo GodoyPas encore d'évaluation
- Philippe Lejeune - La Mémoire Et L'oblique - Georges Perec Autobiographe (1991) - Libgen - LiDocument260 pagesPhilippe Lejeune - La Mémoire Et L'oblique - Georges Perec Autobiographe (1991) - Libgen - LiGuilherme Rodrigues LeitePas encore d'évaluation
- Pascal Quignard: Musique Et Poétique de La DéfaillanceDocument512 pagesPascal Quignard: Musique Et Poétique de La Défaillanceநெல்லி டேவிஸ்100% (2)
- Fiche Pedagogique Atelier Ecrire Un Poeme D-Exil A2 BensaadDocument14 pagesFiche Pedagogique Atelier Ecrire Un Poeme D-Exil A2 BensaadSalma MounirPas encore d'évaluation
- Atala2 BensoussanDocument10 pagesAtala2 BensoussanDavid alejandro Reyes morinPas encore d'évaluation
- Le Poète Comme Cortège de Voix - Geoffrey PaulyDocument14 pagesLe Poète Comme Cortège de Voix - Geoffrey PaulyHouvounsadi Damkadi RolandPas encore d'évaluation
- Fiche-Bilan Le Parti Pris Des ChosesDocument12 pagesFiche-Bilan Le Parti Pris Des ChosesfrancisPas encore d'évaluation
- Méthodologie de La Critique-Devoir Sandu M.Document9 pagesMéthodologie de La Critique-Devoir Sandu M.Mariana SarbanPas encore d'évaluation
- farroyas,+NRSC Lepage mise+en+page+LvNDocument11 pagesfarroyas,+NRSC Lepage mise+en+page+LvNTeaze 340Pas encore d'évaluation
- Pierre Missac - Aphorisme Et Paragramme PDFDocument7 pagesPierre Missac - Aphorisme Et Paragramme PDFMark CohenPas encore d'évaluation
- Le Banquet de RimbaudDocument3 pagesLe Banquet de RimbaudSpinozaPas encore d'évaluation
- D'un Lecteur (Modèle) : Verre Cassé D'alain Mabanckou À La RechercheDocument10 pagesD'un Lecteur (Modèle) : Verre Cassé D'alain Mabanckou À La RechercheZïnbē MėäãmërPas encore d'évaluation
- Pagel Art Dee Chou Er 201208Document2 pagesPagel Art Dee Chou Er 201208dahoundoenockPas encore d'évaluation
- L'Oeuvre de L'artDocument260 pagesL'Oeuvre de L'artValéria LourençoPas encore d'évaluation
- Séquence 2Document18 pagesSéquence 2FLORENTINYPas encore d'évaluation
- Roland Barthes Essais CritiquesDocument149 pagesRoland Barthes Essais Critiquesvivanchy100% (3)
- Silo - Tips - Livre Prof fr3 Chap07Document16 pagesSilo - Tips - Livre Prof fr3 Chap07taffach57Pas encore d'évaluation
- 9782402305976Document72 pages9782402305976- DrEy0x100% (1)
- Déclasser Les " Aphorismes de Zürau "Document6 pagesDéclasser Les " Aphorismes de Zürau "yehonathanPas encore d'évaluation
- Fiche Oulipo PDFDocument6 pagesFiche Oulipo PDFCesar LeonePas encore d'évaluation
- Gaydon Memoire PDFDocument110 pagesGaydon Memoire PDFSunaNoWafer100% (1)
- Gaydon MemoireDocument110 pagesGaydon MemoireSunaNoWafer100% (1)
- Poeme D'ici Par Jacques AswadDocument1 pagePoeme D'ici Par Jacques AswadJacques AswadPas encore d'évaluation
- Louis Marin - L'ecriture Fragmentaire de PascalDocument9 pagesLouis Marin - L'ecriture Fragmentaire de Pascalmarkacohen12121Pas encore d'évaluation
- Buen Trabajo en FrancésDocument68 pagesBuen Trabajo en FrancésYORDAN STYVEN ARROYO CARVAJALPas encore d'évaluation
- Butor Le Voyage Et L'écritureDocument17 pagesButor Le Voyage Et L'écritureJosé Luis Rico CarrilloPas encore d'évaluation
- Cómo Leer A VallejoDocument5 pagesCómo Leer A VallejoAlcides TineoPas encore d'évaluation
- Bonne Foy - Les Planches Courbes Dans Le Leurre Des MotsDocument3 pagesBonne Foy - Les Planches Courbes Dans Le Leurre Des MotsMorteza KhakshoorPas encore d'évaluation
- Les Regrets Joachim Du BellayDocument33 pagesLes Regrets Joachim Du BellayDomoina MaholyPas encore d'évaluation
- Proust Combray StructureDocument13 pagesProust Combray Structurejy.16sbPas encore d'évaluation
- Barthes La Mort de L Auteur PDFDocument4 pagesBarthes La Mort de L Auteur PDFAnonymous lhzyQo5Pas encore d'évaluation
- Recueillement. FinalDocument18 pagesRecueillement. FinalRomeoPas encore d'évaluation
- Albèra, Boulez - Pli Selon Pli - Entretiens Et ÉtudesDocument91 pagesAlbèra, Boulez - Pli Selon Pli - Entretiens Et ÉtudesSrPilhaPas encore d'évaluation
- Texte Nâ°1 - Prologue de GargantuaDocument5 pagesTexte Nâ°1 - Prologue de Gargantuafmxfvjhw7tPas encore d'évaluation
- Magdalena Part 2Document6 pagesMagdalena Part 2hownowproPas encore d'évaluation
- Proposition de Contribution Le Dialogue RomanesqueDocument2 pagesProposition de Contribution Le Dialogue RomanesqueKiwy SmilePas encore d'évaluation
- Poésie Et Mélancolie: Claude BeausoleilDocument4 pagesPoésie Et Mélancolie: Claude Beausoleilsenghoraissatou04Pas encore d'évaluation
- DM Ponge CopieDocument6 pagesDM Ponge Copiemelyssamensah3Pas encore d'évaluation
- Seconde Francais Côte D'Ivoire - École NumériqueDocument5 pagesSeconde Francais Côte D'Ivoire - École NumériqueAboubacar KamagatePas encore d'évaluation
- Notre Dame de ParisDocument367 pagesNotre Dame de ParisQuentin RIGALPas encore d'évaluation
- Fragment en littérature et en musique: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandFragment en littérature et en musique: Les Grands Articles d'UniversalisÉvaluation : 1 sur 5 étoiles1/5 (1)
- Style Et Rhetorique 2003Document16 pagesStyle Et Rhetorique 2003James CarroPas encore d'évaluation
- Comment Les Idees de Todorov Ont Obscurci L'etude Du Recit Fantastique, Harry Morgan PDFDocument14 pagesComment Les Idees de Todorov Ont Obscurci L'etude Du Recit Fantastique, Harry Morgan PDFJames CarroPas encore d'évaluation
- La Polyphonie Dans Belle Du SeigneurDocument4 pagesLa Polyphonie Dans Belle Du SeigneurAlice PirotealaPas encore d'évaluation
- Analyse Stylistique - Approche de TexteDocument7 pagesAnalyse Stylistique - Approche de TexteJames Carro100% (1)
- Histoire de La StylistiqueDocument9 pagesHistoire de La StylistiqueJames Carro50% (2)
- Bessiere J. - Litterature Comparee Et Critique Litteraire ContemporaineDocument9 pagesBessiere J. - Litterature Comparee Et Critique Litteraire ContemporaineJames CarroPas encore d'évaluation
- Comment Les Idees de Todorov Ont Obscurci L'etude Du Recit Fantastique, Harry MorganDocument14 pagesComment Les Idees de Todorov Ont Obscurci L'etude Du Recit Fantastique, Harry MorganJames CarroPas encore d'évaluation
- Comment L'ordinateur Peut Servir Dans L'etude Stylistique D'un Texte LitteraireDocument32 pagesComment L'ordinateur Peut Servir Dans L'etude Stylistique D'un Texte LitteraireJames CarroPas encore d'évaluation
- Enonciation Lyrique, Jenny L.Document16 pagesEnonciation Lyrique, Jenny L.James CarroPas encore d'évaluation
- Bibliographie Projet. Dictionnaire Des Figures Et Mythes Litteraires Des AmeriquesDocument4 pagesBibliographie Projet. Dictionnaire Des Figures Et Mythes Litteraires Des AmeriquesJames CarroPas encore d'évaluation
- Bibliographie GénéraleDocument17 pagesBibliographie GénéraleJames CarroPas encore d'évaluation
- Analyse LitteraireDocument12 pagesAnalyse LitteraireJames CarroPas encore d'évaluation
- Aristotle PoeticsDocument2 pagesAristotle PoeticsJames CarroPas encore d'évaluation
- Atelier de EcritureDocument7 pagesAtelier de EcritureJames CarroPas encore d'évaluation
- Syntaxe FrancaiseDocument12 pagesSyntaxe FrancaiseJames CarroPas encore d'évaluation
- Catulle Et Ses LecteursDocument12 pagesCatulle Et Ses LecteursJames CarroPas encore d'évaluation
- Francais Moderne SyntaxeDocument14 pagesFrancais Moderne SyntaxeJames CarroPas encore d'évaluation
- TextulDocument2 pagesTextulJames CarroPas encore d'évaluation
- Autobiog Collective, Étude Féministe Des Instances Narratives Dans Les AnnéesDocument115 pagesAutobiog Collective, Étude Féministe Des Instances Narratives Dans Les AnnéesimenPas encore d'évaluation
- Tableau de PrépositionsDocument7 pagesTableau de PrépositionsAdvocate ShoaibPas encore d'évaluation
- Etude de Paratexte CandideDocument18 pagesEtude de Paratexte Candidenadia guendoulPas encore d'évaluation
- Franc - 4eme - Caracteristiques Du Texte NarratifDocument3 pagesFranc - 4eme - Caracteristiques Du Texte NarratifStephane AdonisPas encore d'évaluation
- 9 Junio 06Document12 pages9 Junio 06Mario GallardoPas encore d'évaluation
- Examen CH 9 Mon Père Nous QuittaDocument1 pageExamen CH 9 Mon Père Nous Quittabatoulkourbani96Pas encore d'évaluation
- Apuntes Clase 1Document7 pagesApuntes Clase 1fanPas encore d'évaluation
- Introduction A La PsycholinguistiqueDocument58 pagesIntroduction A La PsycholinguistiqueDjamel Mg100% (3)
- Biographie Madame de La FayetteDocument2 pagesBiographie Madame de La FayetteVasile StavilaPas encore d'évaluation
- Pronoms RelatifsDocument6 pagesPronoms RelatifsJimmy RamirezPas encore d'évaluation
- Biographie MoliereDocument8 pagesBiographie MolieregfgfgfgfgfgfgfgfgfgfPas encore d'évaluation
- Sansoni Caterina 2016 ED520 PDFDocument339 pagesSansoni Caterina 2016 ED520 PDFGuilherme Malvicini Ponteiro Das CruzesPas encore d'évaluation
- Projet Pédagogique - La Boite À MerveillesDocument37 pagesProjet Pédagogique - La Boite À Merveillesoussama32785% (27)
- Préromantisme - WikipédiaDocument6 pagesPréromantisme - WikipédiaArouna SyPas encore d'évaluation
- Tableau VerbalDocument2 pagesTableau VerbalGrisales DianaPas encore d'évaluation
- Jules Barbey D'aurevilly, 1889Document10 pagesJules Barbey D'aurevilly, 1889Shorena KhaduriPas encore d'évaluation
- Ecole Part en VoyageDocument4 pagesEcole Part en Voyagesarahhassan.4747Pas encore d'évaluation
- Cahiers Octave Mirbeau, N° 16Document376 pagesCahiers Octave Mirbeau, N° 16Anonymous 5r2Qv8aonf100% (2)
- Laclos - Un Roman Feministe 2Document6 pagesLaclos - Un Roman Feministe 2selenelefortPas encore d'évaluation
- La Ornamentación en El Capricho Titulado Prinzessin Brambilla de E.T.A. HoffmanDocument9 pagesLa Ornamentación en El Capricho Titulado Prinzessin Brambilla de E.T.A. HoffmanMeme RamosPas encore d'évaluation
- JENNY Laurent L AutofictionDocument18 pagesJENNY Laurent L AutofictionAndreina TamaniniPas encore d'évaluation
- DocumentoDocument5 pagesDocumentoAnonymous VVmCkQKF100% (1)
- AmantDocument3 pagesAmantdescalebeauPas encore d'évaluation
- Les Enfants Du Monde ParolesDocument1 pageLes Enfants Du Monde ParolesSabri El AbedPas encore d'évaluation
- Eugene IonescoDocument3 pagesEugene IonescoAuraPas encore d'évaluation
- Lire Et Relire Le Merveilleux Voyage de Nils Holgerrson Version Post-Print PDFDocument16 pagesLire Et Relire Le Merveilleux Voyage de Nils Holgerrson Version Post-Print PDFMush RoomPas encore d'évaluation
- DD5 Améliorations de PersonnageDocument1 pageDD5 Améliorations de PersonnageSylvain GambisPas encore d'évaluation
- Les Pronoms Compléments - COD Et COIDocument4 pagesLes Pronoms Compléments - COD Et COIpraquenomePas encore d'évaluation
- Avis Argumenté Sur Manon LescautDocument2 pagesAvis Argumenté Sur Manon LescautvoilaPas encore d'évaluation