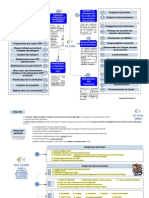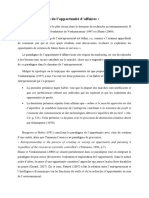Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Wafaa-Rapport - Fin - Detudes Iso 9001 2015 PDF
Transféré par
Abdessamad LamnouarTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Wafaa-Rapport - Fin - Detudes Iso 9001 2015 PDF
Transféré par
Abdessamad LamnouarDroits d'auteur :
Formats disponibles
École Normale Supérieure de l’Enseignement Technique
التقني
Mémoire de التعليم
Projet de ألساتذة
Fin d’Études العليا
effectué المدرسةavec :
en collaboration
LEESERVICE
cole Normale Supérieure de l’Enseignement Technique
MAROCAIN D’ACCRÉDITATION
Ministère de l’Industrie, de Commerce, de l’Économie et de
l’Investissement Numérique
Présenté par : EL KHATIRI WAFAA
Pour l’obtention du :
Diplôme d’Ingénieur d’État en Conception et Production Industrielles
Option : Management de la Qualité et Métrologie
« FI.CPI.MQM »
ÉLABORATION D’UN GUIDE TECHNIQUE
DES RISQUES
Soutenu le : 07/07/2018, devant le jury composé de :
Pr. EL OUATOUATI AHMED ENSET-RABAT Président
Pr. SALIH ABELOUAHHAB ENSET-RABAT Encadrant
Pr. EL MECHRAFI NADIA ENSET-RABAT Examinatrice
Mr. BAIZ ILIAS Organisme : SEMAC Co-Encadrant
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 2017-2018
DÉDICACES
À Mon Dieu
À Allah le clément et miséricordieux, pour la force qu’il nous donne et qu’il donne aux personnes
qui nous ont aidées et nous soutenues. Mon Dieux merci pour tout qui arrive dans notre vie.
À Mes chers parents
Qui ont toujours été près de nous pour nous écouter et nous soutenir et qui n’ont jamais épargné le
moindre effort pour nous aider et nous encourager.
Vous qui avez fait de moi ce que je suis, je ne peux pas le reconnaître en quelques lignes. J’espère
être à l’image que vous vous êtes faite de moi, que Dieu tout puissant vous garde, vous bénisse, vous
préserve et vous procure santé et longue vie.
À Mes chères sœurs et amies
À mes sœurs, à mes amies, à ma petite et grande famille pour l’amour, le respect et le courage qui
m’ont toujours octroyé.
À l’école Normale Supérieur d’Enseignement Technique ou nous avons passé les plus belles
années de mon cursus scolaire.
EL KHATIRI WAFAA
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 2
REMERCIEMENT
Dans le premier temps je tiens à remercier Allah le Tout puissant, généreux et miséricordieux,
d’avoir jouit de la santé pour pouvoir accomplir mes études, et je le prix de même de nous guider dans
le bon chemin pour la réussite prochainement dans la vie.
Je tiens à remercier mon école, l’École Normale Supérieure d’Enseignement Technique-
RABAT ainsi que tout son corps professoral.
Avant de commencer mon rapport de stage, je tiens tout d’abord à remercier monsieur
MOHAMMED BENJELLOUN, le directeur de la DPCSMQ (Direction de la Protection du
consommateur, de la Surveillance du Marché et de la Qualité), Ministère de l’Industrie, de
l’Investissement, du Commerce et de l’Économie Numérique, de m’avoir accueillie comme stagiaire
au sein de sa direction. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à madame JABBAR HALIMA,
la directrice de la division d’accréditation pour m’avoir autorisé d'effectuer mon projet de fin d'études
au sein de son honorable division.
Je tiens à remercier mon enseignant Monsieur SALIH ABDELOUAHHAB mon professeur de
l’enseignement technique à l’ENSET de rabat, pour m’avoir donné l’opportunité d’effectuer ce stage.
Ainsi que pour son aide sa disponibilité et ses précieux conseils. Je le remercie pour sa disponibilité,
sa modestie, ainsi que pour ses connaissances et l’expérience qu’il m’a fait partager.
Je remercie également mon encadrant Monsieur BAIZ ILIAS Le Responsable Qualité, pour avoir
accepté de diriger ce travail, Je suis très touchée par ses qualités humaines et scientifiques qui ont joué
un rôle déterminant dans l’accomplissement de ce travail.
Cependant, je tiens nommément à remercier cher jury pour l’évaluation de ma mémoire ainsi de
leurs disponibilités et leurs encouragements.
Il me serait difficile d’établir une liste exhaustive des personnes ayant, d’une façon ou d’une autre,
contribué à la réalisation de mon sujet au sein de SEMAC. L’absence d’une référence explicite à chacun
d’eux ne saurait, en aucun cas, être interprétée comme un manque de reconnaissance.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 3
RÉSUMÉ
L’environnement des organismes d’évaluation de la conformité (laboratoires d’essais, laboratoires
d’étalonnages, organismes d’échantillonnages) s’est démarqué courant la dernière décennie par
plusieurs évolutions dans le :
Développement technique (Méthodes d’exécution des essais/étalonnages/échantillonnage)
Progrès technologique (Équipements)
Progrès des technologies informatiques (Exemple : usage des systèmes d’information), ayant
influé le fonctionnement des laboratoires (Exemple : la manière dont les enregistrements sont
conservés,…).
Besoin avéré de focaliser sur le résultat des processus au lieu de la description détaillée de leurs
étapes et objectifs.
Pour accompagner ledit changement, la norme ISO/CEI 17025 qui prescrit les exigences de
compétences desdits organismes s’est vu réviser en 2017 pour, non seulement tenir de ces évolutions
intervenues dans ces laboratoires, mais aussi pour les encourager.
Une révision qui a conduit globalement à :
L’introduction de la gestion des risques pour prendre en compte la nouvelle version d'ISO 9001:
2015.
La portée d’accréditation, pour couvrir toutes les activités de laboratoire, y compris les essais,
l'étalonnage et l'échantillonnage associés à l'étalonnage et aux essais intermédiaires ou périodiques.
Une nouvelle approche pour aligner la norme avec les autres existantes telles que ISO / IEC 17000
et ISO 9001 (gestion de la qualité) et se concentrer sur les résultats d'un processus au lieu de la
description détaillée de ses tâches et étapes.
L'incorporation de l'utilisation de nouvelles technologies pour permettre, par exemple, les
enregistrements et les résultats électroniques.
Dans ce contexte, le Service Marocain d’Accréditation (SEMAC) se doit la révision de ses guides
d’accréditation portant notamment sur l’interprétation des exigences de cette nouvelle version de la
norme ainsi que la mise en place d’un guide d’évaluation des dispositions mises en places les
laboratoires en matière d’analyse et de gestion des risques et opportunités en vue d’harmoniser les
pratiques entre évaluateurs.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 4
ABSTRACT
The environment of conformity assessment bodies (testing laboratories, calibration laboratories,
sampling organizations) has distinguished itself over the past decade by several developments in:
• Technical development (test execution methods / calibrations / sampling)
• Technological progress (Equipment)
• Progress of computer technologies (Example: use of information systems), having influenced the
functioning of the laboratories (Example: the way the recordings are kept ...).
• Demonstrated need to focus on process outcome instead of detailed description of their steps and
objectives.
To accompany this change, the ISO / IEC 17025 standard that prescribes the competence
requirements of these organizations was revised in 2017 to not only take into account these
developments in these laboratories, but also to encourage them.
A revision that led globally to:
• The introduction of risk management to take into account the new version of ISO 9001: 2015.
• The scope of accreditation, to cover all laboratory activities, including testing, calibration and
sampling associated with calibration and intermediate or periodic testing.
• A new approach to align the standard with existing ones such as ISO / IEC 17000 and ISO 9001
(quality management) and focus on the results of a process instead of the detailed description of its
tasks and steps.
• Incorporation of the use of new technologies to allow, for example, electronic recordings and
results.
In this context, the Moroccan Accreditation Service (SEMAC) is required to revise its accreditation
guides, notably concerning the interpretation of the requirements of this new version of the standard
and the setting up of a guide to evaluation of the arrangements put in place by laboratories for risk
analysis and management and opportunities to harmonize practices between evaluators.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 5
LISTE DES ACRONYMES
A I
AMDEC Analyse des modes de défaillance, ISO Organisation internationale de
de leurs effets et de leur criticité Standardisation
C IAF Forum International d’accréditation
CEI Commission Électrotechnique Internationale ILAC Coopération Internationale
d'Accréditation de Laboratoires
CASCO Comité d'évaluation de la conformité
O
CSNCA Conseil supérieur de normalisation, de
OEC Organisme d’Évaluation de Conformité
certification et d'accréditation
S
COMAC Comité marocain d’accréditation
SEMAC Service Marocain d’Accréditation
D
SMQ Système de management de la Qualité
DPCSMQ Direction la Protection
Consommateur, de la Surveillance du
Marché et de la Qualité
DAC Division d’accréditation
EA Européen accréditation
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 6
LISTE DES FIGURES
Figure 1: Historique des normes -------------------------------------------------------------------------------- 14
Figure 2: Organigramme de la direction de la qualité et de la surveillance de marché ----------------- 19
Figure 3: Organigramme de la DAC --------------------------------------------------------------------------- 23
Figure 4: Cycle de vie d'une accréditation --------------------------------------------------------------------- 28
Figure 5: Diagramme Gantt -------------------------------------------------------------------------------------- 33
Figure 6: Diagramme des ressources --------------------------------------------------------------------------- 34
Figure 7: Diagramme PERT ------------------------------------------------------------------------------------- 35
Figure 8: Matrice SWOT du projet ----------------------------------------------------------------------------- 36
Figure 9: Schéma planification dynamique stratégique ------------------------------------------------------ 38
Figure 10 : Les étapes de la révision de la norme ISO 17025 ---------------------------------------------- 44
Figure 11: Organisation du processus -------------------------------------------------------------------------- 45
Figure 12: Tableau des risques ---------------------------------------------------------------------------------- 50
Figure 13: Les deux processus stratégiques de l’outil autodiagnostic des risques ----------------------- 54
Figure 14: Approche processus du projet ---------------------------------------------------------------------- 55
Figure 15: Organigramme réalisation de l'outil autodiagnostic --------------------------------------------- 56
Figure 16: Feuille "Sommaire" de l'outil Autodiag.RISK --------------------------------------------------- 57
Figure 17: Feuille "Introduction" de l'outil Autodiag.RISK ------------------------------------------------ 58
Figure 18: En-tête de chaque fenêtre de l'outil Autodiag.RISK -------------------------------------------- 59
Figure 19: Grille d'évaluation des risques de l'outil Autodiag.RISK -------------------------------------- 60
Figure 20: Statistiques des niveaux ----------------------------------------------------------------------------- 60
Figure 21: Feuille "Indicateurs de performance" de l'outil Autodiag.RISK ------------------------------ 63
Figure 22: Processus de l'utilisation de l'outil Autodiag.RISK --------------------------------------------- 64
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 7
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1: Tableau QQOQCP de projet ----------------------------------------------------------------------- 39
Tableau 2: Analyse des risques projets ------------------------------------------------------------------------- 40
Tableau 3: Définitions des éléments de la grille d'évaluation de l'outil Autodiag.RISK ---------------- 61
Tableau 4: Graphiques des niveaux de détectabilité et de vraisemblance --------------------------------- 62
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 8
SOMMAIRE
DÉDICACES ......................................................................................................................................... 2
REMERCIEMENT............................................................................................................................... 3
RÉSUMÉ ............................................................................................................................................... 4
ABSTRACT ........................................................................................................................................... 5
LISTE DES ACRONYMES ................................................................................................................. 6
LISTE DES FIGURES ......................................................................................................................... 7
LISTE DES TABLEAUX ..................................................................................................................... 8
SOMMAIRE .......................................................................................................................................... 9
INTRODUCTION GÉNÉRALE ....................................................................................................... 13
Chapitre 1 PRÉSENTATION DE L’ORGANISME D’ACCUEIL ............................................ 16
I. PRÉSENTATION DU MINISTÈRE ............................................................................................ 17
1- Introduction ............................................................................................................................ 17
2- Missions ................................................................................................................................. 17
3- Les directions du ministère .................................................................................................... 18
II. LA DIRECTION DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, DE LA SURVEILLANCE
DU MARCHÉ ET DE LA QUALITÉ .................................................................................................. 19
1- Introduction ............................................................................................................................ 19
2- Organigramme du ministère ................................................................................................... 19
a- Division de la Protection du Consommateur ...................................................................... 20
b- Division de la Métrologie ................................................................................................... 20
c- Division de la Promotion de la Qualité .............................................................................. 21
d- Division de la Surveillance de marché ............................................................................... 21
e- Division d’Accréditation .................................................................................................... 22
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 9
3- Missions de la DPCSMQ ....................................................................................................... 22
III. SERVICE MAROCAIN D’ACCRÉDITATION SEMAC ........................................................ 23
1- Introduction ............................................................................................................................ 23
2- Organigramme de la DAC...................................................................................................... 23
3- Cadre légal.............................................................................................................................. 26
4- Fonctionnement ...................................................................................................................... 26
5- Système de management de la DAC ...................................................................................... 27
6- Domaine d’application ........................................................................................................... 28
7- Cycle d’accréditation.............................................................................................................. 28
Chapitre 2 CONTEXTE DU PROJET DE FIN D’ETUDE ......................................................... 30
I. PRÉSENTATION DU CAHIER DES CHARGES DU PROJET ................................................ 31
1- Acteur du projet ...................................................................................................................... 31
2- Contexte pédagogique et professionnel.................................................................................. 31
3- Les objectifs attendus ............................................................................................................. 31
4- Contraintes à respecter ........................................................................................................... 32
5- Diagramme de Gantt .............................................................................................................. 33
a- Diagramme des ressources ................................................................................................. 34
b- Diagramme de PERT .......................................................................................................... 35
II. ENJEUX ET PROBLÈMATIQUE ............................................................................................... 36
1- Enjeux..................................................................................................................................... 36
a- Enjeux du projet.................................................................................................................. 36
b- Enjeux personnels ............................................................................................................... 36
2- Étude de la problématique ...................................................................................................... 37
a- Problématique ..................................................................................................................... 37
b- Planification dynamique stratégique .................................................................................. 37
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 10
c- QQOQCP ............................................................................................................................ 38
d- Analyse des risques du projet ............................................................................................. 40
e- Plan d’action ....................................................................................................................... 41
Chapitre 3 CONCEPTION ET SOLUTIONS D’AMÉLIORATION ........................................ 42
I. TABLEAU COMPARATIF DE LA NORME ISO/CEI 17025 ................................................... 43
1- Introduction ............................................................................................................................ 43
2- Pourquoi réviser la norme ISO/CEI 17025 ? ......................................................................... 43
3- Le calendrier du projet de la révision ..................................................................................... 44
4- Les principaux changements .................................................................................................. 45
5- Le tableau comparatif ............................................................................................................. 47
II. TABLEAU DES RISQUES ISO/CEI 17025 ................................................................................ 47
1- Introduction ............................................................................................................................ 47
2- Management des risques ISO 31000 ...................................................................................... 47
3- La notion du risque ................................................................................................................. 48
4- Identification des risques ........................................................................................................ 49
5- A qui la norme ISO 31000 est-elle destinée ? ........................................................................ 49
6- Tableau des risques ................................................................................................................ 50
III. GUIDE TECHNIQUES DES RISQUES SEMAC .................................................................... 51
1- Introduction ............................................................................................................................ 51
2- Guide technique des risques ................................................................................................... 52
a- Objectif ............................................................................................................................... 52
b- Domaine d’application ....................................................................................................... 53
c- Le guide proposé ................................................................................................................ 53
IV. L’OUTIL AUTODIAGNOSTIC DES RISQUES ..................................................................... 53
1- Introduction ............................................................................................................................ 53
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 11
2- Approche processus................................................................................................................ 54
3- Logigramme des actions......................................................................................................... 55
4- Présentation et utilisation de l’outil Autodiag.RISK .............................................................. 57
a- Mode d’emploi ................................................................................................................... 57
b- Grille d’évaluation .............................................................................................................. 59
c- Processus de l’utilisation de cet outil ................................................................................. 64
Chapitre 4 ETUDES DE CAS ......................................................................................................... 66
I. Introduction ................................................................................................................................... 67
II. MISE EN PLACE DE L’OUTIL AUTODIAG.RISK .................................................................. 67
1- Laboratoire QISTASLAB ...................................................................................................... 67
2- Le Centre National d'Études et de Recherches Routières CNER........................................... 68
3- Résultats d’application du l’outil Autodiag.RISK ................................................................. 68
III. CONCLUSION .......................................................................................................................... 69
CONCLUSION GÉNÉRALE ............................................................................................................ 70
Annexe 1 : Le tableau comparatif entre la version 2005 et 2017 de la norme ISO/CEI 17025 ........... 72
Annexe 2 : Le tableau d’identification des risques de la norme ISO/CEI 17025 V2017 ..................... 73
Annexe 3 : Le guide technique des risques ........................................................................................... 74
Annexe 4 : L’outil autodiagnostic des risques Autodiag.RISK ............................................................ 75
Annexe 5 : Résultats d’application de l’outil Autodiag.RISK au sein des laboratoires ....................... 76
BIBLIOGRAPHIE .............................................................................................................................. 77
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 12
INTRODUCTION GÉNÉRALE
Depuis 1999, la norme ISO/CEI 17025 via sa première version s’est imposée comme la référence
à l’échelle mondiale, aussi bien pour les laboratoires d’essais que d’étalonnage, souhaitant mettre en
exergue leur performance et capacité à délivrer des résultats fiables. Cette version a été annulée et
remplacée par une deuxième publiée en 2005. Depuis cette date, des changements ont eu lieu dans
l’environnement des laboratoires, à savoir :
Développement technique (Méthodes d’exécution des essais/étalonnages/échantillonnage)
Progrès technologique (Équipements)
Progrès des technologies informatiques (Exemple : usage des systèmes d’information), ayant
influé le fonctionnement des laboratoires (Exemple : SMART SYSTEM avec zéro papier,…)
Besoin avéré de focaliser sur le résultat des processus au lieu de la description détaillée de
leurs étapes et objectifs.
Ce qui met l’ISO devant un besoin de réviser la version 2005 pour tenir compte de ces évolutions
intervenues dans les laboratoires, mais aussi de les encourager.
Octobre 2014 :
Le comité CASCO (Conformity Assessement Committee) relevant de l’ISO, chargé du
développement des politiques et publication des normes se rapportant à l’évaluation de
la conformité, a approuvé la décision de révision de la norme ISO/CEI 17025 :2005.
Du février 2015 au Juillet 2017 :
Un total de 6 réunions menées par les experts de l’ISO ayant conduit à l’élaboration de
la version finale du projet de norme internationale ISO/CEI 17025.
29 Novembre 2017 :
Publication de la version 2017 de la ISO/CEI 17025.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 13
Figure 1: Historique des normes
La nouvelle révision est démarquée par ses changements, ayant principalement portés sur :
La définition du laboratoire : essais, échantillonnage…
Impartialité, confidentialité : maitrise de la nouvelle terminologie
Accorder une prévention renforcée aux risques et opportunités
Anticiper la responsabilisation des laboratoires et les nouvelles obligations : gestion des
réclamations, règles de décision, qualité des résultats…
L'introduction de la gestion des risques pour prendre en compte la nouvelle version d'ISO 9001:
2015.
La portée, pour couvrir toutes les activités de laboratoire, y compris les essais, l'étalonnage et
l'échantillonnage associés à l'étalonnage et aux essais intermédiaires ou périodiques.
Une nouvelle approche pour aligner la norme avec les autres existantes telles que ISO / IEC
17000 et ISO 9001 (gestion de la qualité) et se concentrer sur les résultats d'un processus au
lieu de la description détaillée de ses tâches et étapes.
L'incorporation de l'utilisation de nouvelles technologies pour permettre, par exemple, les
enregistrements et les résultats électroniques.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 14
Le référentiel ISO 17025 est un outil pour la mise en place et l'amélioration d'activités des
laboratoires. Elle contient l'ensemble des exigences que les laboratoires doivent respecter pour
démontrer à leurs clients et aux autorités réglementaires qu'ils appliquent un système de management
leur permettant de maîtriser entièrement leurs processus, qu'ils ont la compétence technique et sont
aptes à produire des résultats techniquement valides. Les organismes d'accréditation chargés de
reconnaître la compétence des laboratoires utiliseront la norme comme base de leur accréditation.
Objectif de la norme 17025
Selon Alan Bryden, Secrétaire général de l'ISO, "L'ISO/CEI 17025 bénéficie aux entreprises, aux
gouvernements et à la société dans son ensemble. La confiance dans la compétence des laboratoires est
souvent nécessaire pour les entreprises qui essaient de nouveaux produits ou veulent s'assurer que les
produits finis sont prêts pour la commercialisation pour les autorités réglementaires et les responsables
du commerce qui exigent une assurance pour les produits nationaux ou importés destinés au marché,
ou pour garantir la qualité et la fiabilité des essais et analyses se rapportant aux risques pour
l'environnement, la santé ou la sécurité."
L'ISO/CEI 17025 s'applique à tous les laboratoires, quels que soient leurs effectifs et l'étendue du
domaine de leurs activités d'essai et d'étalonnage. Cette norme est destinée à être utilisée par les
laboratoires désireux de mettre au point les systèmes de management de la qualité, organisationnel et
technique régissant leurs opérations.
Elle est utilisée par les clients des laboratoires, les autorités réglementaires et les organismes
d'accréditation engagés dans des activités de confirmation ou de reconnaissance de la compétence des
laboratoires.
Le travail a été subdivisé principalement en quatre chapitres ; le premier chapitre consiste à donner
un aperçu général sur la direction de protection de consommateur, de surveillance de marché et de la
qualité, ainsi que le service marocain d’accréditation comme étant l’organisme d’accueil. Le deuxième
chapitre présente le contexte du projet, la problématique, les enjeux ainsi que les étapes de planification
pour bien amener le projet. Le troisième chapitre concrétise les solutions proposées pour résoudre les
problèmes rencontrés suite à l’évolution de la norme ISO/CEI 17025 et ensuite le quatrième chapitre
abordera les résultats des études de cas effectuées dans certains organismes d’évaluation de conformité.
Enfin ce travail sera achevé par une conclusion générale et des perspectives éventuelles.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 15
C hapitre 1 PRÉSENTATION DE
L’ORGANISME D’ACCUEIL
Dans ce chapitre je vais décrire l’établissement dans lequel j’ai mené mon projet de fin
d’études à savoir le ministère de l’industrie, de l’investissement, du commerce et de
l’économie numérique, ainsi que la Direction de la Protection du Consommateur, de la
Surveillance du Marché et de la Qualité (DPCSMQ), et en particulier la division
d’accréditation comme étant l’entité d’accueil.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 16
I. PRÉSENTATION DU MINISTÈRE
1- Introduction
Le stage s’est déroulé au Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de
l’Économie Numérique, chargé de la conception et de la mise en œuvre de la politique gouvernementale
dans les domaines de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies sous réserve des
attributions dévolues à d’autres départements ministériels par les lois et règlements en vigueur.
2- Missions
Élaborer les stratégies de développement des secteurs de l’industrie, du commerce, des
nouvelles technologies et de la poste, et leur déclinaison en programmes opérationnels.
Valider les stratégies de développement des investissements et d’amélioration de la
compétitivité des PME, ainsi que leur déclinaison en programmes opérationnels.
Piloter et mettre en œuvre les stratégies de développement des secteurs de l’industrie, du
commerce, des nouvelles technologies et de la poste.
Contribuer à la gestion de la relation avec les institutions et les organisations internationales et
nationales dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies.
Produire les statistiques et réaliser les études dans les secteurs de l’industrie, du commerce et
des nouvelles technologies.
Assurer la veille stratégique, le suivi et l’évaluation des stratégies des secteurs de l’industrie,
du commerce et des nouvelles technologies.
Promouvoir et développer l’innovation dans les domaines de l’industrie et des nouvelles
technologies.
Développer et coordonner les espaces d’accueil industriels, commerciaux et technologiques,
ainsi que les pôles de compétitivité.
Contribuer à la définition des plans de formation dans les secteurs de l’industrie, du commerce
et des nouvelles technologies, et participer au suivi de leur mise en œuvre.
Définir le cadre législatif et organisationnel pour les secteurs de l’industrie, du commerce et des
nouvelles technologies.
Émettre des propositions pour la régulation des secteurs de l’industrie, du commerce et des
nouvelles technologies.
Réguler le secteur postal.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 17
Développer les partenariats, coordonner et mettre en œuvre les programmes de coopération.
Promouvoir la qualité et la sécurité dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des
nouvelles technologies.
Assurer le contrôle dans le domaine de la métrologie, de l’accréditation, de la qualité, de la
sécurité en entreprise, de la surveillance du marché et de la protection du consommateur.
Assurer la communication dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des nouvelles
technologies.
3- Les directions du ministère
Le Ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie Numérique
comprend – outre le cabinet du Ministre, une inspection générale et des services déconcentrés – une
administration centrale, laquelle se compose de :
La Direction de l’Industrie.
La Direction du Commerce et de la Distribution.
La Direction de l’Économie Numérique.
La Direction des Statistiques et de la Veille.
La Direction de la Protection du Consommateur, de la Surveillance du Marché et de la Qualité.
La Direction des Technologies avancées, de l’Innovation et de la Recherche et Développement.
La Direction des Espaces d’Accueil.
La Direction de la Coopération et de la Communication.
La Direction des Ressources et des Systèmes d’Information.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 18
II. LA DIRECTION DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR,
DE LA SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET DE LA QUALITÉ
1- Introduction
Plus précisément, le stage a été réalisé au sein de la Division d’accréditation relevant de la
Direction de la protection du consommateur, de la Surveillance du Marché et de la qualité.
La direction de la qualité et de la surveillance du marché a pour mission de :
Maintenir la durabilité de la stratégie nationale, de la normalisation, de la certification, de
l’accréditation et de l’assurance de la qualité.
Renforcer et accompagner les activités des Associations de Protection des Consommateurs.
Renforcer la protection des intérêts économiques des consommateurs.
Assurer un équilibre entre les relations consommateur-Fournisseur.
2- Organigramme du ministère
LE MINISTRE
Scrétariat Inspection
général générale
Direction générale de Direction générale
l'industrie du commerce
Direction du Direction de Direction du Direction de la protection du
commerce défense commerce consommateur, de la
et du commerciale international surveillance de marché et de la
distribution qualité
Division de la Division
protection Division Division de
d'accréditation Division de surveillance
consommateur de la
métrologie la promotion de marché
de la qualité
Service Service
accréditation d'inspection et
des laboratoires certification
Figure 2: Organigramme de la direction de la qualité et de la surveillance de marché
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 19
a- Division de la Protection du Consommateur
La loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur complète le dispositif
juridique existant en matière de protection du consommateur et met en place un cadre favorable pour
la promotion du rôle des associations de protection du consommateur.
Assurer une information claire, objective et loyale au consommateur (prix,
Les étiquetage, conditions de vente).
Renforcer la protection des intérêts économiques du consommateur
objectifs
(interdiction ou réglementation de certaines pratiques commerciales).
de Rééquilibrer les relations consommateur-fournisseur (interdiction des clauses
abusives, garantie, crédit).
la
Renforcer le mouvement consommateur en permettant aux Associations de
loi protection des consommateurs d’être reconnues d’utilité publique et autorisées
à ester en justice.
Le droit à l’information : fournir au consommateur toutes les informations
nécessaires avant la conclusion d’un contrat de vente.
Le droit aux choix : garantir la liberté d’achat en fonction des besoins et des
Les moyens du consommateur.
droits Le droit à la rétractation : offrir, dans certains cas de figure, au
consommateur un délai de 7 jours pour changer son avis.
garantis
Le droit à l’écoute et à la représentation : permettre au consommateur, lors
aux d’un litige avec un fournisseur, d’être conseillé, orienté et de se faire
consommateurs représenter par une association de protection du consommateur.
Le droit à la protection des intérêts économiques : réglementation de
certaines pratiques commerciales comme la publicité promotionnelle, les
ventes avec primes, les soldes, les loteries, les ventes à distance, etc.
b- Division de la Métrologie
La protection des consommateurs repose entre autres sur la justesse des instruments utilisés pour
les mesures de quantité et de qualité des produits de consommation, notamment les produits
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 20
alimentaires en vrac ou conditionnés, les carburants liquides, l’eau potable, l’électricité. La fiabilité de
ces instruments est contrôlée par les services de métrologie relevant du Ministère.
Les services de métrologie relevant du Ministère opèrent un contrôle à l’égard des instruments de
mesure réglementés, des récipients-mesures et des organismes agréés ou candidats à l’agrément.
c- Division de la Promotion de la Qualité
La Semaine Nationale de la Qualité est un événement national de communication sur la qualité,
destiné à sensibiliser les opérateurs économiques à l’importance du management de la qualité dans un
contexte marqué par la mondialisation des échanges et une concurrence exacerbée. Cette rencontre est
organisée chaque année par le Ministère en collaboration avec l’Union Marocaine pour la Qualité
(UMAQ) et les organismes partenaires.
Dans plusieurs villes du Royaume sont proposés des séminaires et des tables rondes sur le thème
de la qualité, des visites d’entreprises, des expositions et des stands. Des chefs d’entreprises sont invités
à témoigner de leurs expériences dans la mise en place des systèmes qualité au sein de leurs sociétés.
La journée du lancement de cet événement est marquée par un forum international et des ateliers de
formation dans le domaine de la qualité.
Le Prix National de la Qualité, organisé chaque année par l’Union Marocaine pour la Qualité
(UMAQ) en collaboration avec les partenaires concernés, a été institué par le Ministère pour
récompenser dans chaque catégorie les entreprises qui se sont distinguées par la mise en place d’une
démarche qualité exemplaire et remettre aux organismes méritants des attestations d’encouragement
ou de reconnaissance. Le Prix National de la Qualité s’adresse à toutes les entreprises quels que soient
leur secteur d’activité et leur taille. Il leur offre un moyen d’auto-évaluation de leurs performances en
matière de qualité et d’identification de leurs axes de progrès. Il constitue aussi pour les organismes de
promotion de la qualité un outil pour inciter les entreprises à adopter des démarches qualité et ainsi
renforcer leur compétitivité.
d- Division de la Surveillance de marché
La surveillance du marché est l’outil fondamental pour l’application des dispositions de la loi n°
24-09 relative à la sécurité des produits et des services.
La surveillance du marché veille à la protection du consommateur des risques liés à l’usage des
produits industriels mis à disposition sur le marché national, autres qu'agroalimentaires et
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 21
pharmaceutiques. Elle permet aussi de préserver les intérêts des différents opérateurs économiques
(fabricants, importateurs et distributeurs) en réunissant les conditions propices à la concurrence loyale
au niveau du marché local, par la veille au respect des obligations qui incombent à chacun et le recours
éventuel aux sanctions pouvant aller jusqu’à la destruction des produits frauduleux.
A ce titre, les opérateurs économiques sont tenus de ne mettre à disposition sur le marché que des
produits répondant aux exigences essentielles de sécurité telles que définies dans la réglementation
technique applicable (normes obligatoires, règlements techniques, …).
e- Division d’Accréditation
L'accréditation est la reconnaissance formelle, par un organisme accréditeur, de la compétence et
de l’impartialité d’un organisme d'évaluation de la conformité (OEC) pour réaliser des prestations
spécifiques d'évaluation de la conformité.
3- Missions de la DPCSMQ
La Direction de la Qualité et de la Surveillance du Marché est chargée de :
Assurer le suivi de la stratégie nationale de la normalisation, de la certification, de
l’accréditation et de la promotion de la qualité.
Assurer le secrétariat du Conseil Supérieur de la Normalisation, de la Certification et de
l’Accréditation.
Définir et suivre les objectifs du contrôle des produits et des services.
Réglementer et contrôler les produits, les services et les instruments de mesure.
Agréer et suivre les organismes d’évaluation de la conformité.
Assister les entreprises industrielles dans le choix, l’utilisation et l’entretien des instruments de
mesure.
Gérer les étalons nationaux de mesure.
Promouvoir la qualité et la sécurité dans les entreprises.
Promouvoir les systèmes de gestion basés sur les normes dans les entreprises.
Assurer les activités d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité.
Contribuer à l’amélioration du cadre juridique, organisationnel et institutionnel de la protection
des consommateurs.
Renforcer et accompagner les activités des associations de protection des consommateurs.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 22
III. SERVICE MAROCAIN D’ACCRÉDITATION SEMAC
1- Introduction
A l’échelle nationale, l’accréditation est délivrée par le SEMAC. Le SEMAC est l’unique
organisme marocain d’accréditation, mis en place sous la responsabilité finale du Ministre chargé de
l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Économie Numérique, représenté par la division
d’accréditation crée au sein de la Direction de la Qualité et de la Surveillance du Marché (DQSM)
relevant du Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Économie Numérique.
Le chef de la division d’accréditation DAC prend les décisions relatives à l’accréditation des OEC
sur avis conforme du groupe d’accréditation compétent après examen du rapport d’évaluation. L’avis
conforme est défini comme suit : le chef de la division d’accréditation DAC doit prendre une décision
qui est conforme à la position préconisée par le groupe d’accréditation concerné.
2- Organigramme de la DAC
Figure 3: Organigramme de la DAC
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 23
Le SEMAC est un organisme gouvernemental, et ses responsabilités juridiques découlant de ses
activités sont couvertes par le gouvernement, conformément aux dispositions légales en vigueur
relatives à la responsabilité civile de l´État. L’accréditation est une activité à but non lucratif.
Le CSNCA, composé des représentants des secteurs public et privé, est principalement chargé des
missions suivantes :
Assister le Gouvernement dans la définition de la politique nationale en matière de
normalisation, de certification, d’accréditation et de promotion de la qualité ;
Mener la politique national en la matière en parfaite concordance avec la politique économique
du pays et les attentes des différentes parties prenantes ;
Assurer une meilleure cohérence entre les stratégies sectorielles de promotion de la qualité.
Le COMAC est un comité consultatif crée par la loi 12.06, placé auprès du Ministre chargé de
l’Industrie, dont l’objectif de sa création est de garantir l’objectivité et l’impartialité des prestations
d’accréditation. Ce comité est constitué d'une représentation équilibrée et sans prédominance de toutes
les parties intéressées (privées et publiques, consommateurs, recherche scientifique…), dont certains
de ses membres sont désignés par le décret N° 2.10.252 pris pour l’application de la loi 12.06 et d’autres
par arrêté du ministre de l’Industrie.
Le COMAC a pour mission :
De définir la stratégie nationale en matière d’accréditation tout en suivant les orientations
stratégiques du CSNSA.
Superviser la mise en œuvre de cette stratégie nationale.
D’établir son propre règlement interne pour préciser la conduite de ses activités.
D’établir les critères et des procédures concernant l’examen des demandes d’octroi, de
renouvellement, de réduction ou d’extension de portée, de suspension ou de retrait des accréditations,
ainsi que les appels concernant les décisions prises.
Constituer des commissions permanentes ou autres, pour étudier toute question relative à ses
missions, notamment pour formuler un avis en matière de procédure d’accréditation d’un OEC,
conformément aux dispositions en vigueur.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 24
Les COMMISSIONS PERMANENTES : Pour mener à bien sa mission, le COMAC constitue
des commissions spécialisées citées ci-après, pour étudier toute question relative à ses missions
conformément aux dispositions en vigueur régissant le système national d’accréditation. Il s’agit
notamment :
Commission d’accréditation
Une commission de qualification des évaluateurs et des experts techniques
Une commission de promotion, communication et site web
Une commission qualité
Une commission d’appel
La COMMISSIONS D’APPEL traitant les appels est constituée des membres désignés par le
COMAC sur proposition de la DAC, pour leurs compétences techniques en fonction des sujets abordés, et
ce, conformément aux dispositions de son règlement intérieur. Elle traite les appels formulés contre les
décisions concernant l’appelant qu’il estime défavorable, conformément aux dispositions en vigueur de la
procédure A 164 « Procédure de traitement des appels et plaintes».
Les COMMISSIONS AD HOC traitent des questions générales et techniques. Les membres des
commissions sont choisis pour leurs compétences techniques en fonction des sujets abordés. La DAC
constitue des commissions ad hoc chaque fois que cela est nécessaire.
Les GROUPES D’ACCRÉDITATION : La composition de chaque groupe d’accréditation, les
modalités de désignation de ses membres, ainsi que les lignes directrices pour rendre un avis conforme
définies dans la procédure d’accréditation A 110 « Procédure d’accréditation des organismes
d’évaluation de la conformité», sont de nature à préserver l’objectivité des décisions d’accréditation
prises par le chef de la DAC, sur avis conforme du groupe d’accréditation concerné. Les modalités de
fonctionnement de chaque groupe d’accréditation définies dans le règlement intérieur de la commission
d’accréditation validé par le COMAC, permettent d’éviter toutes pressions commerciales ou
financières qui pourraient compromettre l’impartialité des avis que le groupe d’accréditation rend.
Les ÉVALUATEURS ET EXPERTS TECHNIQUES : L’objectivité des évaluateurs et des
experts techniques est définie dans la convention A 333, qui doit être signée conjointement entre les
évaluateurs/experts techniques et la DAC. La fiche d’assignation A 339, rappelle aux évaluateurs les
règles de déontologie et d’impartialité. Cette fiche doit être signée par l’évaluateur/expert technique
mandaté avant toute mission. Les évaluateurs et experts ne sont pas soumis à des pressions
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 25
commerciales ou financières dans la mesure où ils sont indépendants des organismes qu’ils évaluent et
qu’ils sont supervisés lors des évaluations qu’ils réalisent par des personnes mandatés par la DAC,
notamment par un membre de la DAC.
3- Cadre légal
Les dispositions législatives régissant le système national d’accréditation des organismes
d'évaluation de la conformité sont notamment :
Dahir n° 1-10-15 du 26 safar 1431 (11 février 2010) portant promulgation de la loi n° 12-06 relative
à la normalisation, à la certification et à l’accréditation, notamment à l’égard de la création du
Conseil supérieur de normalisation, de certification et d'accréditation (CSNCA) et du Comité
marocain d'accréditation (COMAC).
Décret n° 2-10-252 du 16 joumada I 1432 (20 avril 2011) pris pour l’application de la loi n° 12-06.
4- Fonctionnement
Le fonctionnement du SEMAC s'appuie sur un système de management de la qualité mise en place
conformément aux exigences des référentiels suivants :
Dispositions légales nationales.
La norme internationale ISO/IEC 17011 intitulée « Exigences générales pour les organismes
procédant à l'évaluation et à l'accréditation d'organismes d'évaluation de la conformité ».
Les dispositions du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil fixant les
prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation
des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil.
Les guides et documents internationaux (EA : European co-operation for Accreditation, IAF :
International Accreditation Forum et ILAC : International Laboratory Accreditation
Cooperation).
Grace à la représentation équilibrée sans aucune prédominance d’intérêt au sein de son Comité
Marocain d’accréditation (COMAC) et la compétence des membres des commissions mises en place,
le SEMAC est à même de garantir l’impartialité et l’objectivité de ses décisions d’accréditation.
Grace à ses évaluateurs et experts qu'il gère, le SEMAC assure un haut niveau de compétence pour
la réalisation de ses évaluations d’accréditation. Pour la plupart des organismes d’évaluation de la
conformité, l’accréditation est une démarche volontaire sauf lorsqu'une réglementation la requiert.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 26
5- Système de management de la DAC
Le système de management de la DAC est composé des documents suivants, spécialement adapté
à ses besoins :
Documents de références : sont constitués du Manuel qualité et des documents légales (loi,
Décrets, arrêtés), stratégies, politiques et documents normatifs (normes et guides publiés par
l’ISO, ILAC, IAF, EA…). Le manuel qualité (MQ) fixes les dispositions générales de
fonctionnement de la DAC, la politique qualité, les bases légales et normatives, les critères
d'accréditation, ainsi que les moyens nécessaires pour assurer la qualité des prestations. Il fait
référence aux autres documents appliqués au sein de la DAC.
Les procédures sont des documents écrits qui décrivent principalement le fonctionnement
opérationnel de l’accréditation ainsi que la gestion du personnel nécessaires pour accomplir une
action, une mission ou une tâche ayant une incidence sur le management qualité.
Les guides et documents d’exigences fixent un certain nombre de dispositions générales et
techniques relatives à certains aspects des référentiels de l’accréditation et des relations de la
DAC avec les organismes d’évaluation de la conformité et les évaluateurs.
Les formulaires permettent l’enregistrement des activités d’accréditation.
Listes permettent d’identifier notamment, les documents internes et externes applicables, le
personnel internes et externes de la DAC, ainsi que les OEC accrédités.
Les enregistrements résultent du fonctionnement de l’accréditation.
Documents
de référence
Procédures, guides et documents
d'éxigences
Listes / Formulaires
Enregistrements
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 27
6- Domaine d’application
Actuellement, le SEMAC accrédite les organismes d’évaluation de la conformité suivants :
Les laboratoires d'essais et d’analyses selon NM ISO/CEI 17025.
Les laboratoires d'étalonnage selon NM ISO/CEI 17025.
Les laboratoires d’analyses de biologie médicale selon NM ISO 15189.
Les organismes d’inspection selon NM ISO/CEI 17020.
Les organismes de certification.
7- Cycle d’accréditation
L’accréditation est délivrée pour un cycle de cinq (5) ans durant lequel trois évaluations de
surveillance sont réalisées et une évaluation de renouvellement réalisée sur demande du titulaire
concerné. Ci-après une schématisation d’un cycle d’accréditation :
Figure 4: Cycle de vie d'une accréditation
Chaque évaluation d’accréditation comprend une évaluation du système de management de la
qualité et une évaluation de surveillance sur le terrain couvrant les activités techniques définies dans
la portée d’accréditation de l’organisme.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 28
Pré évaluation : Suite à l’examen du rapport du pré évaluation l’organisme d’évaluation de la
conformité visité est informé par la DAC, dans un délai d’une semaine à compter de la date de
réception du rapport, de l’une des décisions suivantes :
soit la phase d'évaluation initiale peut débuter directement
soit la phase d'évaluation initiale ne peut être envisagée raisonnablement que lorsque la
documentation et/ou son application soit mis à niveau.
Évaluation initiale d’accréditation : A la réception du rapport d’évaluation, le Responsable
d’accréditation, sous la supervision du chef de la DAC, procède à la revue technique du rapport, avant
la tenue de la réunion du groupe d’accréditation concerné. Pour l’ensemble des éléments de la revue
technique, le Responsable d’accréditation contacte le responsable d’évaluation pour des explications,
des compléments d’information ou des corrections. Une fois le rapport est jugé techniquement valide,
le responsable d’accréditation convoque le groupe d’accréditation concerné.
Fréquence des évaluations de surveillance : La première évaluation de surveillance est réalisée
au maximum 12 mois à partir de la date de l’évaluation initiale d’accréditation ou de renouvellement.
L’intervalle par la suite entre deux évaluations est de 15 mois.
Renouvellement de l’accréditation : Le renouvellement de l’accréditation correspond à la
réévaluation, normalement tous les cinq ans à compter de la date de l’évaluation initiale, en vue de
vérifier le maintien de la conformité du titulaire aux critères d'accréditation, pour l'ensemble des
activités couvertes par l’accréditation.
CONCLUSION
Ce premier chapitre nous montre le cadre général dans lequel j’ai mené mon stage et mon projet
de fin d’études, premièrement j’ai décri le ministère de l’industrie, de commerce, de l’investissement
et de l’économie numérique, ensuite la direction de la protection du consommateur, de la surveillance
de marché et de la qualité, et puis l’organisme d’accueil qui est le service marocain d’accréditation.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 29
C hapitre 2 CONTEXTE DU PROJET DE
FIN D’ETUDE
Dans ce chapitre je vais lever le voile sur le contexte général du projet de fin d’étude à
savoir les besoins, les missions et principales grandes lignes dans la démarche de travail
ainsi que le plan d’actions suivi le long du travail.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 30
I. PRÉSENTATION DU CAHIER DES CHARGES DU
PROJET
1- Acteur du projet
Maitre d’ouvrage
Le maitre d’ouvrage est la direction de la Protection du Consommateur, de la Surveillance du
Marché et de la Qualité, Ce projet a été proposé par SEMAC le service marocain d’accréditation du
Ministère de l’Industrie, de Commerce, de l’Investissement et de l’Économie Numérique.
Maitre d’œuvre
Le maitre d’œuvre est l’ENSET de Rabat, représenté par Mme EL KHATIRI Wafaa élève
ingénieur en filière d’ingénieur en Conception et Production Industrielle, option Management de la
Qualité et Métrologie.
Tuteur pédagogique Tuteur au sein de SEMAC
Mr SALIH Abdelouahhab Mr BAIZ Ilias le responsable de la qualité
2- Contexte pédagogique et professionnel
Ce projet s’inscrit dans le cadre des projets de fin d’études de la formation ingénieur d’état à l’École
Normale Supérieur d’Enseignement Technique de Rabat, et le plan stratégique du service marocain
d’accréditation au sein du ministère de l’industrie, de commerce, de l’investissement et de l’économie
numérique.
3- Les objectifs attendus
Élaboration d’un comparatif entre la version 2005 et la version 2017 de l’ISO/CEI 17025.
Élaboration d’un tableau d’analyse des risques qui se présentent tout au long de la version
2017 de la norme d’accréditation ISO/CEI 17025.
L’objectif étant d’extraire la majorité des risques qui peuvent émaner au niveau de chaque
partie de la norme, afin d’harmoniser la compréhension pour les organismes d’évaluation
de conformité ainsi que pour les évaluateurs de SEMAC.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 31
Élaboration d’un Guide sur l’évaluation des Risques & Opportunités.
L’objectif étant d’aider les organismes à mettre en place une démarche leur permettant
d’instaurer une approche par les risques au sein de leurs système de management de la
qualité, pour répondre aux exigences de la norme ISO/CEI 17025 ainsi que celles de
SEMAC.
Mise en place d’un outil autodiagnostic pour évaluer les Risques, qui sera mis à la disposition des
laboratoires pour y répondre. Leur retour fera l’objet d’évaluation par les évaluateurs tenant compte
du guide à mettre en place.
L’objectif étant d’évaluer certains risques communs entre les organismes, et qui ont un
impact sur la validité des résultats fournis par les OEC.
Validation du Tableau et de l’outil d’autodiagnostic des risques par lancement en enquête publique
& essai à blanc.
4- Contraintes à respecter
L’avis demandé pour mettre en place une norme proposée doit être raisonnable et bien
justifié.
Les solutions proposées doivent être bonnes et efficientes.
Économiser le temps en éliminant les tâches secondaires et commencer par ce qui est principal
pour fournir le livrable dans un temps précis.
Des efforts de communication à faire pour inspirer la confiance et faire comprendre aux
clients (OEC) les avantages spécifiques de l'offre.
D'informations sur les éventuelles conséquences que pourrait avoir le manque de
connaissance de cette offre sur l'exercice de l'activité.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 32
5- Diagramme de Gantt
Figure 5: Diagramme Gantt
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 33
a- Diagramme des ressources
Figure 6: Diagramme des ressources
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 34
b- Diagramme de PERT
Figure 7: Diagramme PERT
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 35
II. ENJEUX ET PROBLÈMATIQUE
1- Enjeux
a- Enjeux du projet
Le projet consiste à développer l’approche par les risques que la version récente de la norme
ISO/CEI17025 a introduit à travers l’élaboration d’un guide destiné aux OEC et accompagné d’un outil
d’autodiagnostic des risques. Il donnera des informations concernant l’état immédiat du système de
management des risques selon le projet de la norme. Ce projet intéressera les organismes non
accrédités, en cours d’accréditation ou déjà accrédités ISO 17025. L’outil d’autodiagnostic donnera
plus de visibilité aux organismes sur les risques critiques qui ont un impact potentiel sur la validité de
leurs résultats. Il donnera l’occasion aux organismes d’évaluation de conformité de se mettre à niveau
des nouvelles exigences de manière performante.
b- Enjeux personnels
Pour évaluer les enjeux personnels, la matrice SWOT a été mise en place comme suivant
Faiblesses
Forces
- Manque de connaissances détaillées de
- Bonne adaptation et cohésion avec les membres l'ISO 17025:2017
de SEMAC
- Temps court et limité pour réaliser le projet
- Conseil et aide des encadrants
- Nombre très important des documents à
- Disponiblilité des ressources d'informations traiter
- Connaissances dans le domaine de la qualité - Non maitrise de l'outil Macro-Excel
SWOT
Opportunités Menaces
- Maîtrise de l'élaboration d'un mémoire - Non adoption de certaines normes
d'intelligence méthodique
- Etude non exhaustive des risques
- Maitrise de l'ISO 17025:2017 avant sa mise en
application - Modification et/ou ajout d'exigences
- Apprendre la gestion du projet
Figure 8: Matrice SWOT du projet
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 36
2- Étude de la problématique
a- Problématique
Suite aux changements introduits au niveau de la norme ISO/CEI 17025, les OEC qui sont
candidats à l’accréditation selon la nouvelle version de la norme sont demandés à mettre dans leur
système de management de la qualité une nouvelle stratégie à savoir l’approche par les risques.
Les données d’entrée sont multiples, mais si l’on regarde de plus près, les OEC ont tous des
problèmes génériques applicables à leur fonctionnement quotidien, quant aux risques, ils dépendent
surtout de la typologie du laboratoire et des attentes de la direction du laboratoire.
Pour fournir l’accréditation à un OEC, SEMAC exige à ce dernier que son SMQ doit être conforme
aux exigences de la norme ISO/CEI 17025, et celles imposées par lui-même, d’où la nécessité
d’élaborer un guide qui harmonise la compréhension ainsi que la mise en place d’une approche par les
risques.
b- Planification dynamique stratégique
Avant de commencer à résoudre la problématique, la démarche de Planification Dynamique
Stratégique a été adoptée afin d’apporter une stratégie et une vision claire pour mon projet (voir figure
9) :
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 37
Figure 9: Schéma planification dynamique stratégique
c- QQOQCP
Afin d’apporter plus de clarté à ma problématique et par conséquent rendre la problématique plus
compréhensible, l’outil QQOQCP a été utilisé pour cet effet :
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 38
Données d’entrée Élaboration d’un guides d’évaluation des risques accompagnée d’un tableau
des risques liés à la norme 17025, et la conception d’un outil
Sujet général d’autodiagnostic des risques qui ont un impact sur le résultat
Directs Indirects
Qui ?
Émetteurs : FI. CPI, option Émetteurs : Enseignant-chercheurs de la
Qui est concerné par MQM FI en qualité
le problème ?
Récepteurs : Les OEC, les Récepteurs : ENSET-R, Clients
évaluateurs
Quoi ?
Éventuelles modification de l’ISO/CEI 17025
C’est quoi le
Les OEC doivent s’adapter aux changements de la norme ISO 17025
problème ?
Quand ?
Quand apparait le À partir de 2017
problème ?
Comment ? Trouver les informations concernant les modifications
Savoir les principaux changements de la norme
Comment mesurer le
problème ? Fournir les livrables dans les délais prévus
Comment mesurer les Identifier une méthodologie pour la mise en place
solutions ? Réaliser une publication de la recherche
Pourquoi ? Pour permettre aux OEC d’obtenir une nouvelle accréditation 17025
version 2017
Pourquoi résoudre ce Pour répondre aux besoins et attentes de SEMAC et ENSET-R
problème ? Pour situer le niveau de conformité aux risques
Pour maintenir la satisfaction des OEC ainsi que le client
Quels enjeux Pour augmenter la rentabilité des OEC.
Pour harmoniser la notion d’évaluation des risques au niveau
quantifiés ?
Pour faire face aux évolutions du marché et des tendances mondiales.
Données de sortie : Comment aider les OEC à mettre en place une démarche approche par les
risques conformément aux exigences de la version récente de la norme
Question explicite et
pertinente à résoudre ISO/CEI 17025 ?
Tableau 1: Tableau QQOQCP de projet
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 39
d- Analyse des risques du projet
L’objectif du projet est d’élaborer un guide technique des risques accompagné d’un tableau des
risques extraites de la norme ISO/CEI 17025 v 2017, et d’un outil autodiagnostic des risques au sein
des OEC. La synthèse est résumée dans le tableau ci-dessous :
CONTRAINTES RISQUES ALTERNATIVES
Mauvaise interprétation de la - Discussion en groupe avec les
membres de SEMAC.
problématique
- Solliciter l’encadrant.
Respecter le temps fixé
Inadéquation de la méthodologie
- Assurer un sui périodique avec
pour chaque jalon. proposée l’encadrant et la directrice.
Respecter le temps de la Remise des jalons en dehors des
- Utiliser le retro planning.
délais prévus
présentation dans le jalon.
Dépassements temps - Faire des répétitions en
des
Contrainte de temps = impartis lors des présentations présence d’autres collègues
avant la présentation finale.
planning limité sur 4 mois. Absence (maladie,
- Faire une nouvelle
empêchement,…) organisation des tâches.
Une seule personne qui
Absence des outils de travail - Travailler en dehors de
participe dans le projet. (Internet, Ordinateur, l’organisme d’accueil (chez
une autre personne, à
électricité…) l’ENSET, ou autre)
Un encadrant au niveau de
- Utiliser l’utilitaire de
l’organisme : Mr BAIZ sauvegarde en ligne Dropbox.
Perte de données - Sauvegarder les documents sur
d’autre support (clé USB).
- Contacter le service
informatique.
Tableau 2: Analyse des risques projets
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 40
e- Plan d’action
Ayant la problématique globale en vue, j’ai dressé un plan d’action qui représente le fil à suivre au
fur et à mesure que j’avance dans le projet :
Familiarisation avec l’environnement de travail
Connaissance du parcours administratif suivi pour concrétiser un projet
Adaptation au rythme de travail
Recherche et connaissances des normes à utiliser
Participation à la formation fournie par l’équipe de SEMAC sur la norme 17025 version récente
pour bien comprendre ses exigences.
Élaborer un tableau qui mentionne les risques susceptibles de se présenter au niveau de chaque
paragraphe.
Rédaction du guide SEMAC qui harmonisera par la suite l’approche par les risques pour les
OEC.
Conception d’un outil autodiagnostic des risques qui ont un impact sur la validité des résultats.
Tester l’outil Autodiag.RISK dans 2 laboratoires pour assurer sa mise en application et juger sa
pertinence.
CONCLUSION
Dans ce chapitre j’ai cité les différents points que je vais aborder dans ce stage ainsi que les
méthodologies à poursuivre pour achever les objectifs.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 41
C hapitre 3 CONCEPTION ET SOLUTIONS
D’AMÉLIORATION
Dans ce chapitre je vais décrire la mission principale qui concerne l’élaboration d’un
guide SEMAC destiné au OEC pour harmoniser la compréhension des risques et l’approche
par les risques, accompagné d’un tableau identifiant les risques susceptibles de se présenter
au niveau des OEC.
Je vais discuter le long du chapitre l’étude de la conception de l’outil Autodiag.RISK qui
permet aux OEC d’évaluer les risques qui ont un impact sur la validité de leurs résultats
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 42
I. TABLEAU COMPARATIF DE LA NORME ISO/CEI 17025
1- Introduction
Au fil des ans, ISO/IEC 17025, « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires
d’étalonnages et d’essais », est devenue la référence internationale pour ces organisations qui souhaitent
démontrer leur capacité à produire des résultats fiables. Cette Norme internationale, publiée
conjointement par l’ISO et l’IEC (Commission électrotechnique internationale), établit un ensemble
d’exigences permettant aux laboratoires d’améliorer la validité et la reproductibilité des résultats.
2- Pourquoi réviser la norme ISO/CEI 17025 ?
L’environnement de travail des laboratoires a considérablement changé depuis la dernière édition
de la norme, d’où la nécessité de la réviser et d’y intégrer d’importantes modifications. « La dernière
version d’ISO/IEC 17025 date de 2005. Depuis, le marché a évolué et nous avons décidé d’apporter
quelques améliorations à cette norme », explique Steve Sidney, l’un des Animateurs du groupe de
travail chargé de la révision de la norme.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 43
Aligner les normes des séries ISO 17000
facilitation de la démarche d’accréditation
Articuler la norme avec l’ISO 9001 de 2015
Modèle reconnu, en plus de très nombreux organismes sont certifiés ISO 9001 (ou ISO
14001…)
Actualiser le texte (bibliographie, vocabulaire,..)
Tirer bénéfice du retour d’expérience.
Heribert Schorn, Animateur du groupe de travail et membre de l’IECEE (Système d'évaluation de
la conformité des équipements et composants électriques), ajoute : « La révision de cette norme était
nécessaire pour prendre en compte l’ensemble des modifications d’ordre technique et des progrès
technologiques et informatiques que le secteur a connus depuis l’élaboration de la dernière version. De
plus, elle reflète désormais la nouvelle version d’ISO 9001. »
3- Le calendrier du projet de la révision
La révision a débuté en février 2015, à l’initiative conjointe de la Coopération internationale en
matière d’accréditation de laboratoires (ILAC) et du South African Bureau of Standards (SABS),
membre de l’ISO et hôte du comité national de l’IEC.
Figure 10 : Les étapes de la révision de la norme ISO 17025
70 experts sous l’égide de l’ISO Casco « Conformity Assessment Comittee »
30 jours de réunions
4 consultations et 8730 commentaires traités (1760 pages)
Pour aboutir à un texte qui passe de 25 pages à 27 pages.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 44
4- Les principaux changements
La révision d’ISO/IEC 17025 prend en compte les activités et nouvelles méthodes de travail des
laboratoires actuels. Voici les principaux changements apportés :
L’approche processus se conforme désormais à celle des normes plus récentes telles
qu’ISO 9001 (management de la qualité), ISO 15189 (qualité des laboratoires de biologie médicale)
et ISO/IEC 17021-1 (exigences pour les organismes procédant à l’audit et à la certification). La
révision met l’accent sur les résultats d’un processus au lieu de détailler les tâches et les étapes
afférentes.
Comme la version précédente d'ailleurs (NF EN ISO/CEI 17025 :2005), ne fait pas explicitement
référence au concept de processus, ce processus est encore sous-jacent dans la nouvelle version.
Un processus : « Ensemble d'activités corrélés ou interactives qui transforme des éléments d'entrée en éléments
de sortie »
Un processus est une suite ordonnée d'actions destinée à produire un résultat (voir figure 9), il apporte une
valeur ajouté aux éléments d'entrée ; dans le cas d'un laboratoire, il est clair que les résultats transmis au client
demandeur, apporte à celui-ci une information qui a une valeur et qu'il pourra utiliser par ailleurs (constats,
décisions, etc.).
Figure 11: Organisation du processus
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 45
On trouve en fait dans ce processus du laboratoire toutes les tâches accomplies par le laboratoire :
• depuis la prise en compte de la demande.
• la réception de l'objet à tester (appareil à étalonner ou échantillon à analyser).
• sa mise en condition physique (conditionnement).
• administratives (identification, dossier d'essais, etc.).
• la réalisation de la mesure elle-même (essai ou étalonnage).
• l'exploitation des résultats (traitement, interprétation, etc.).
• la rédaction d'un compte rendu (rapport d'essai, certificat, etc.).
• jusqu'à la transmission de ce compte-rendu au client.
Cette Approche processus Par sa dimension structurante, elle constitue le meilleur lien entre
l'approche métier et l'approche système et incite l'organisme à réfléchir sur son métier, son organisation,
ses ressources et ses clients. Elle permet une plus grande lisibilité de l'organisation et facilite l'allocation
des ressources dans une logique transverse, non cloisonnée, et non plus verticale. Elle met l'organisme
dans une posture « apprenante » : le « propriétaire » d'un processus la maîtrise et le pilote dans un cycle
d'amélioration continue.
En se concentrant davantage sur les technologies de l’information, la norme adopte et prend
désormais en compte l’utilisation des systèmes informatiques et des enregistrements électroniques,
ainsi que la production de résultats et de rapports électroniques. Ces technologies s’étant généralisées
dans les laboratoires modernes, le groupe de travail s’est rendu compte de la nécessité de développer
ce sujet.
La nouvelle version contient également un chapitre sur le raisonnement fondé sur le risque et
traite des points communs avec la dernière édition de la norme ISO 9001:2015, Systèmes de
management de la qualité – Exigences.
La terminologie a été modernisée afin d’être plus en phase avec le monde d’aujourd’hui et
refléter l’adoption progressive du format électronique en lieu et place des manuels, enregistrements et
rapports imprimés. Des changements ont ainsi été apportés au Vocabulaire international de métrologie
(VIM) et une harmonisation a été opérée avec la terminologie de l’ISO/IEC, qui inclut un ensemble de
termes et définitions communs à toutes les normes dédiées à l’évaluation de la conformité.
Le domaine d’application a également été revu afin d’englober toutes les activités des
laboratoires, dont les essais, les étalonnages et l’échantillonnage en vue d’essais et d’étalonnages
ultérieurs.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 46
Le recours à ISO/IEC 17025 favorise la coopération entre les laboratoires et les autres organismes.
Il facilite l’échange d’informations et le partage d’expérience, et contribue à harmoniser les normes et
les procédures, comme l’explique Warren Merkel, l’un des Animateurs du groupe de travail. « La
norme ISO/IEC 17025 retentit de différentes manières sur les résultats produits par les laboratoires.
Elle définit un certain nombre de critères d’exigence en ce qui concerne la compétence du personnel,
l’étalonnage et la maintenance des équipements, ainsi que les processus généraux servant à générer les
données. Les laboratoires doivent donc s’assurer que leurs méthodes de travail garantissent la maîtrise
de leurs processus et la fiabilité de leurs données. » Les résultats sont également plus largement
reconnus par les différents pays lorsque les laboratoires se conforment à cette norme.
5- Le tableau comparatif
Le tableau comparatif de l’annexe 1 met l’accent sur les nouveaux concepts de la norme ISO/CEI
17025, ainsi que des évolutions soit des sujets plus détaillés ou réduits. Le document annexe 1 a pour
objectif de :
- Citer aux organismes déjà accrédités les nouveautés de la norme pour qu’il puisse réviser leur
SMQ afin qu’il répond aux exigences de la nouvelle norme.
- Montrer aux organismes candidats à l’accréditation les modifications qui ont été mis en place
au niveau de la norme.
- Faciliter aux OEC la lecture de la version récente de la norme.
- Aider les OEC à mettre en place une démarche qualité pour se conformer aux exigences de la
nouvelle norme ISO/CEI 17025.
II. TABLEAU DES RISQUES ISO/CEI 17025
1- Introduction
Les risques auxquels sont confrontées les organisations peuvent avoir des conséquences en termes
de performance économique et de réputation professionnelle, mais également au niveau de
l'environnement, de la sécurité et de la société. C'est pourquoi la gestion des risques les aide
concrètement à obtenir de bons résultats dans un contexte d'incertitudes multiples.
2- Management des risques ISO 31000
La société se trouve face à deux objectifs qui semblent a priori contradictoires : développer
l’innovation qui est source intrinsèque de risques, et garantir un haut niveau de sécurité aux citoyens.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 47
Pour réconcilier ces objectifs, les risques doivent être maîtrisés et les justifications de cette maîtrise
fournies. De nombreux documents sectoriels proposent des moyens répondant à ces exigences. La
nouvelle norme ISO 31000 fournit un cadre général au management du risque qui englobe la
problématique de la sécurité et l’inscrit au sein des multiples préoccupations des organismes et des
autres parties prenantes. Elle propose une nouvelle définition du risque, elle améliore le processus de
Management du risque, elle favorise l’intégration du management du risque dans le système de
management de l’organisme, elle introduit des principes qui pilotent les choix des activités de
management du risque.
La norme ISO 31000 favorise la prise en compte des risques par l’ensemble de l’organisme et
fournit aux parties prenantes l’assurance d’une meilleure maîtrise de ces risques. L’ISO 31000 est une
« norme chapeau » permettant d’établir un dialogue entre les secteurs d’activité en leur proposant un
vocabulaire et un cadre commun. Cette norme facilitera également le développement des formations
dans le domaine de la gestion des risques qui était jusqu’alors rendu difficile par l’impossibilité de
multiplier les présentations de pratiques sectorielles.
3- La notion du risque
Durant de très nombreuses années, le concept de « risque » a été assimilé à celui de danger. Sa
maîtrise était du ressort des techniciens qui comprenaient les mécanismes. Cette approche conduisait
implicitement à l’ignorance totale ou partielle des effets positifs de l’activité source du risque. Pour
tenir compte de ces apports tout en prévenant les dommages potentiels, la définition du terme « risque
» s’est ensuite déplacée vers celle d’événement probable ayant des conséquences.
La norme ISO 31000 définit le risque comme l’effet de l’incertitude sur l’atteinte des objectifs.
Cette définition déplace de nouveau la question du risque en imposant de spécifier les objectifs d’une
activité dont l’atteinte pourrait être entravée par l’occurrence de circonstances incertaines. Cette
nouvelle définition ne remet pas en cause les problématiques de traitement des dangers ou d’analyse
des événements dommageables. Elle les complète en formalisant l’importance du rôle des décideurs,
qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales (directeurs de sites industriels, autorités de contrôle,
ingénieurs, etc.) ou plus généralement de l’organisme. Elle permet tout d’abord de signifier un état de
fait, à savoir que les objectifs sont multiples, qu’ils concernent non seulement la sécurité mais aussi des
questions économiques et politiques, personnelles ou sociétales.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 48
4- Identification des risques
La nouvelle version de la norme ISO/CEI 17025 à imposer aux OEC d’introduire l’approche par
les risques comme une des exigences qui doivent être appliquées au niveau de l’OEC cherchant avoir
une accréditation, en effet elle a mentionné que chaque OEC doit identifier les risques susceptibles
d’influencer sur l’atteinte des objectifs.
L’organisme doit identifier les sources de risque, les domaines d'impact, les événements, ainsi que
leurs causes et conséquences potentielles. Cette étape a pour objectif de dresser une liste exhaustive
des risques basée sur les événements susceptibles de provoquer, de stimuler, d'empêcher, de gêner,
d'accélérer ou de retarder l'atteinte des objectifs. Il est important d'identifier les risques associés au fait
de ne pas saisir une opportunité. Il est essentiel de procéder à une identification exhaustive, car un
risque non identifié à ce stade ne sera pas inclus dans une analyse ultérieure.
5- A qui la norme ISO 31000 est-elle destinée ?
De nombreuses personnes interviennent dans les diverses activités de Management des risques. La
norme ISO 31000 s’adresse à chacune d’elles qui en tirera des profits différents.
Les personnes en charge de la mise en place des activités de Management des risques au sein
des organismes, trouveront dans cette norme un cadre précisant les questions à aborder et proposant une
structure pour les traiter : principes, cadre organisationnel, processus de Management.
Les personnes définissant des pratiques (modèles, techniques, outils, guides, etc.) pourront
positionner celles-ci dans un canevas générique. Les objectifs auxquels répondent ces pratiques seront
ainsi précisés, limitant clairement les contributions à attendre de celles-ci. Ces personnes identifieront
en outre plus précisément les activités nécessitant l’élaboration de nouveaux moyens et les besoins
auxquels ils doivent répondre. Cette norme s’adresse donc également aux rédacteurs de normes
sectorielles, aux développeurs de bonnes pratiques (guides ou procédures) ou aux créateurs de
techniques ou d’outils.
Les personnes chargées de gérer des risques particuliers disposeront d’un cadre commun
permettant de situer leurs activités et les pratiques qu’elles mettent en œuvre. Elles connaitront ainsi
mieux les rôles et responsabilités de chacun dans la réalisation des multiples tâches indispensables à une
gestion efficace des risques.
Les personnes chargées d’évaluer les pratiques des organismes en matière de Management des
risques comme les autorités de contrôle (organismes de certification, d’autorisation d’exploiter, etc.),
disposeront d’une structure générique permettant de situer les pratiques effectives.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 49
6- Tableau des risques
Pour pouvoir extraire le maximum des risques qui peuvent se présenter dans un OEC, et qui ont
relation avec la nouvelle version de la norme ISO/CEI 17025, j’ai dressé un tableau Annexe 2 qui a la
forme ci-dessous :
Figure 12: Tableau des risques
1. EXIGENCES DE LA NORME PAR CHAPITRE : en balayant tous les chapitre de la norme,
cette première colonne est réservée aux exigences de la norme ISO/CEI 17025 version 2017,
autrement dit, là où le verbe « doit » apparait, cela implique une exigence que l’OEC doit
respecter.
2. SUGGESTIONS À METTRE EN PLACE : dans cette deuxième colonne j’ai proposé aux OEC
des suggestions à savoir mettre en place des procédures, enregistrements, fiches, matrices…
pour répondre à l’exigence de la norme et par la suite pour se conformer à la norme, bien
évidement l’OEC peut envisager d’autres documents autres que ceux cités dans le tableau, à
conditions qu’ils soient convaincants et répondants aux exigences prescrites dans la version
récente de la norme.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 50
3. RISQUES SUSCEPTIBLES DE PORTER ATTEINTE AUX EXIGENCES : comme la
nouvelle version de la norme 17025 incite aux OEC d’identifier les risques, cette colonne
contient les risques qui peuvent retarder ou rendre difficile l’atteinte de l’objectif cité dans
l’exigence correspondante, certes une extraction exhaustive des risques est impossible vu le
développement continu de l’environnement des OEC, donc paragraphe par paragraphe j’ai
mentionné la majorité des risques qui peuvent se présenter au niveau des OEC.
4. PROPORTIONNALITÉS DES RISQUES : on ne peut pas s’arrêter juste parce qu’on a identifié
les risques, mais il faut encore évaluer leurs proportionnalités, comme le montre la figure ci-
dessus cette colonne est divisée en 3 sous colonnes :
a. Majeur : cette sous colonne est cochée lorsque les risques soulevés ont un lien fort avec
le résultat de l’OEC. En effet, si le risque impact significativement le résultat livré par
l’OEC donc il est jugé majeur.
b. Mineur : cette sous colonne est cochée lorsque les risques soulevés rarement où ils se
présentent, ou ont un impact qui peut modifier le résultat d’une manière peu
significative.
c. Absent : cette sous colonne est cochée lorsque la présence du risque n’affecte pas le
résultat.
III. GUIDE TECHNIQUES DES RISQUES SEMAC
1- Introduction
Pour répondre aux exigences relative à la version récente de la norme ISO/CEI 17025, et pour
fournir aux évaluateurs ainsi qu’aux OEC des lignes directrices auxquelles ils se reporteront pour
évaluer la section qui concerne l’approche par les risques, SEMAC doit publier un document destiné
aux évaluateurs et aux OEC pour les diriger et surtout pour harmoniser la manière dont les OEC doivent
respecter pour démontrer leur management des risques. C’est dans ce sens où SEMAC m’a confié la
tâche d’élaborer un guide technique des risques pour gérer toute forme de risque de manière
systématique, transparente et fiable dans l’ensemble de l’organisme, dans tous ses domaines et à tous
ses niveaux, à tout moment, ainsi qu’à des fonctions, des projets et des activités, tout en respectant les
exigences des normes relatives au risque, réglementaires applicables, et celles imposées par SEMAC.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 51
2- Guide technique des risques
Tous les organismes d’évaluation de conformité, désirants avoir une accréditation selon la nouvelle
version de la norme ISO/CEI 17025, sont appelés à répondre en général aux exigences prescrites dans
la norme et qui existaient dans l’ancienne version, et celles qui présentent des nouveautés, en particulier
l’approche par les risques, pour garantir que le risque est géré de façon efficace, performante et
cohérente au sein de l’organisme.
a- Objectif
La mise en place d’une analyse des risques conformément à la norme internationale ISO 31000,
permette à un organisme d’établir un contexte qui lui permettra d’appréhender ses objectifs,
l’environnement dans lequel il poursuit ces objectifs, les parties prenantes et la diversité des critères de
risques, tous ces éléments devant contribuer à révéler et apprécier la nature et la complexité de ses
risques. Or la nouvelle version de la norme ISO/CEI 17025 n’a absolument pas spécifier aux OEC, les
normes ou les réglementations qu’ils doivent appliquer pour gérer ses risques, et donc chaque OEC
sera libre de choisir la méthode qui le convient et qu’il juge pertinente.
Parmi les objectifs de ce guide technique, je cite :
Identifier les principaux éléments qui contribuent au risque ainsi que les facteurs
significatifs associés.
Prendre conscience de la nécessité d’identifier et de traiter le risque à travers tout
l’organisme.
Définir une politique, des orientations et une culture du risque adaptée aux attentes des
parties prenantes.
Se conformer aux obligations légales et réglementaires, ainsi qu’aux normes
internationales.
Fournir aux laboratoires et aux évaluateurs des lignes directrices auxquelles ils se
reporteront pour analyser les risques qui se présentent au niveau des activités de
laboratoire.
Proposer à tous les acteurs une terminologie commune pour éviter toute mauvaise
interprétation.
Permettre aux OEC un management par les risques et les opportunités, source de
compétitivité.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 52
b- Domaine d’application
Le guide SEMAC fournit des principes et des lignes directrices générales sur le management des
risques. En effet ce document peut s’appliquer à tout type de risque, quelle que soit sa nature, que ses
conséquences soient positives ou négatives.
Ce guide ne vise pas à promouvoir l’uniformisation d’une méthode d’identification des risques au
sein des organismes d’évaluation de conformité. La mise en œuvre des plans d’actions d’analyse des
risques devrait tenir compte des divers besoins d’un organisme spécifique, de ses objectifs, son
contexte, sa structure, son activité, ses processus, ses fonctions, ses projets, ses produits, ses services
ou ses actifs particuliers, ainsi que de ses pratiques spécifiques.
c- Le guide proposé
Chaque organisme, quels que soient son secteur d’activité, son historique, son métier, sa taille, est
par nature exposée à une multitude de risques qu’il convient d’identifier, de comprendre et de maîtriser.
Suite à la demande de SEMAC et pour répondre aux besoins des OEC ainsi que ceux des évaluateurs,
j’ai élaboré le guide technique concernant les risques tout en respectant la forme des guides techniques
que SEMAC publie, et aussi le contenu qui doit mettre la lumière sur le management des risques au
sein d’un OEC.
L’annexe 3 représente le guide technique des risques que j’ai élaboré et proposé au service
marocain d’accréditation, qui ne sera publié qu’après sa révision par une commission formée des
évaluateurs que SEMAC les invites pour s’appuyer sur leurs avis et commentaires.
IV. L’OUTIL AUTODIAGNOSTIC DES RISQUES
1- Introduction
Avant le commencement du développement de l’outil d’autodiagnostic des risques dans un
système de management de la qualité, et selon les exigences de la nouvelle version de la norme ISO/CEI
17025, deux choix stratégiques de méthodologie d’élaboration de l’outil se sont présentés : Innover ou
Améliorer (figure 13).
Cet outil peut être considérer comme un questionnaire qui va permettre aux OEC de se positionner
de façon rapide vis-à-vis de certains des risques rencontrés au sein de leurs organismes. Cet outil permet
d'évaluer l'engagement de l’organisme dans ses pratiques de prévention des risques professionnels. Il
peut être utilisé par l'employeur mais également par un consultant qui accompagne l’organisme.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 53
AUTODIAGNOSTIC DES RISQUES
ISO 17025 VERSION 2017
Produit répondant
aux besoins des
Outil
Nouveau OEC
Attentes déjà AMÉLIORER
INNOVER Plus de fonctions
latentes produit existant
Plus d’ergonomie
innovant Attentes
Gratuit
des OEC
Figure 13: Les deux processus stratégiques de l’outil autodiagnostic des risques
La démarche d’innovation consiste à la création d’un nouveau produit de point de vue technique
et méthodologique à partir des attentes des futurs utilisateurs que ce soit auditeurs ou des responsables
au sein d’un organisme. Des nouvelles fonctionnalités ainsi qu’une nouvelle interface seront
nécessaires.
Lors de ce présent projet, la démarche d’amélioration a été optée. Cette alternative permet de rendre les
outils existants plus fonctionnels, ergonomiques et répondant aux attentes latentes des différents utilisateurs.
Cette démarche nécessite, tout d’abord, la recherche des outils disponibles, ensuite, une comparaison et une
analyse critique de ces outils sont nécessaires afin d’extraire les points forts et faibles de chaque type d’outil et
enfin, créer l’outil qui prend en compte les forces et faiblesses des outils existant déjà.
2- Approche processus
Dans un monde incertain, la maîtrise des risques permet de renforcer la pérennité de l’entreprise.
Toutefois, la survie d’une organisation ne dépend pas uniquement de sa capacité à maîtriser les risques.
Chaque individu possède sa propre sensibilité au risque, forgée à partir de son expérience
personnelle, son caractère, sa sensibilité, sa formation, son appétence aux risques. Sans risque, donc
sans prise de risque, il n’y a pas d’entreprise. Néanmoins, chaque dirigeant doit identifier, comprendre
et maîtriser les risques pris ou subis, donc les gérer de manière préventive et curative.
Lors de ce projet, l’approche processus a été réalisée pour l’intégralité du projet comme le montre la
figure 14 :
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 54
- Analyser les données d’entrées
- Iso 17025 - Faire l’étude bibliographique
- Tableau des
version 2005 - Établir u tableau des risques
risques
- Iso 17025 - Élaborer le guide technique
- Guide technique
version 2017 - Définir le support informatique
des risques
- Exemple des - de l’outil autodiagnostic
- Outil
guides et outils - Créer l’outil autodiagnostic
Autodiag.RISK
autodiagnostic - Tester l’outil sur des cas réels
- Valider l’outil par SEMAC
Sources Connaissances
Encadrants et
bibliographique personnelles
enseignants
ENSET
Figure 14: Approche processus du projet
3- Logigramme des actions
Quelle que soit l’activité de l’organisme, la mise en œuvre de ses cycles d’exploitation va
immanquablement provoquer l’opportunité de concrétiser des centaines, pour ne pas dire des milliers
de risques opérationnels. Infrastructure, accès, informatique, processus industriels, enjeux juridiques,
facteurs humains, autant de périmètres d’actions et d’interventions en contact direct ou indirect avec le
client, et qu’il conviendra de maîtriser au mieux dans toute logique de pérennisation de l’organisme.
L'outil d’autodiagnostic des risques permet d'identifier rapidement les marges de progrès avec des
propositions d'amélioration permettant de passer au niveau supérieur. Il peut être également utilisé à
intervalle régulier pour effectuer un suivi des actions engagées. L'analyse des résultats obtenus sert de
support au dialogue dans l’organisme autour des problématiques de prévention.
Suite au choix stratégique du projet, le logigramme des actions avec des ressources a été déterminé. Comme
le montre la figure 15 ci-dessous, il y a 5 étapes principales sont : déterminer le fonctionnement de la direction,
structurer le contenant d’outil, formuler le contenu de l’outil, réaliser, tester, améliorer et publier.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 55
ÉTAPES ACTIONS RESSOURCES
ÉLABORER LA STRATÉGIE
Déterminer le processus de conception de l’outil
DÉTERMINER EL KHATIRI
LA DIRECTION WAFAA
Analyser les Analyser les
risques du projet risques de l’outil
STRUCTURER Analyse critiques des outils existants
LE EL KHATIRI
CONTENANT Élaborer le cahier des charges de l’outil WAFAA
DE L’OUTIL
Analyser les changements entre la version 2005
FORMULER LE
et 2017 de la norme ISO 17025 EL KHATIRI
CONTENU DE
WAFAA
L’OUTIL
Lister les critères de l’outil autodiagnostic
Analyse critique de l’outil EL KHATIRI
RÉALISER, WAFAA
TESTER ET Mettre en place l’outil
SALIH
AMÉLIORER
Tester l’outil dans les OEC ABDELOUAHHAB
L’OUTIL
Améliorer l’outil BAIZ ILIAS
Élaborer et poster l’outil
COMMISSION DES
PUBLIER Publier l’outil ÉVALUATEURS
SEMAC
PRÉSENTER AU PUBLIC
Figure 15: Organigramme réalisation de l'outil autodiagnostic
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 56
4- Présentation et utilisation de l’outil Autodiag.RISK
a- Mode d’emploi
L’outil d’autodiagnostic est présenté via une première page « Sommaire » qui présente les différentes
fenêtres qui existent, ainsi il permet à l’utilisateur d’en accéder à n’importe quelle fenêtre rapidement. Des
boutons liens dans chaque fenêtre permettent de naviguer dans l’outil de manière fluide.
Figure 16: Feuille "Sommaire" de l'outil Autodiag.RISK
Ensuite la fenêtre « Introduction » qui permet d’expliquer l’outil et d’en présenter les différentes
échelles d’évaluation mises de l’outil, qui ne peuvent pas être paramétrées par l’utilisateur vue que tous les
organismes doivent subir le même niveau d’évaluation des risques à prévenir.
L’introduction explique aussi la logique du paramétrage des niveaux spécifiques aux organismes :
Les niveaux de détectabilité correspondent à la détectabilité de présence des risques décrits dans
les fenêtres de l’outil. Le choix de la détectabilité est de 3 niveaux : difficile ; moyen ; et facile.
Les niveaux de vraisemblance correspondent à la probabilité de présence des risques décrits dans
les fenêtres de l’outil. Le choix de la vraisemblance est de 3 niveaux : forte ; médian ; et faible.
Les niveaux de risque résiduel correspondent au niveau de présence du risque décrit dans les
fenêtres de l’outil après mise en place de la parade que l’organisme juge efficace pour maitriser
le risque. Le choix du niveau de risque résiduel est de 2 niveaux : moyen ; et faible.
Ainsi, l’utilisateur peut choisir les niveaux correspondant à l’état actuel de son système de
management de la qualité de l’organisme. L’utilisateur choisit les niveaux, ainsi, les pourcentages
correspondants à chaque choix de niveau sont calculés automatiquement.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 57
1
Figure 17: Feuille "Introduction" de l'outil Autodiag.RISK
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 58
La feuille « Introduction » est divisée en 3 components :
1- L'en-tête : Identification du nom et le type de l’organisme, le responsable pour le système de
management qualité et son contact. Ainsi que les noms de l’équipe de l’évaluation et les coordonnées
du responsable de l’évaluation, plus la date là où l’évaluation a eu lieu.
2-Objectif : Explique quelle sont les objectives de cette outil.
3-Échelles d'évaluation utilisées non paramétrables : Présente les trois niveaux celui de la
détectabilité, de la vraisemblance et du risque résiduel, ainsi que le type d’organisme qui peut être soit
un organisme d’étalonnage, d’essai ou d’échantillonnage.
b- Grille d’évaluation
La grille d’évaluation est constituée de l’item à évaluer, le choix de l’évaluation des risques, le
taux, et le nombre des risques selon leurs niveaux de détectabilité ou de vraisemblance, ainsi que la
parade proposée par l’organisme pour faire face à chaque risque, et ensuite le niveau de risque résiduel.
Figure 18: En-tête de chaque fenêtre de l'outil Autodiag.RISK
Chaque fenêtre de l’outil d’autodiagnostic est constituée d’un en-tête définissant un ensemble
d’information, à savoir les coordonnées de l’organisme ainsi que celles de son responsable, de plus les
noms de l’équipe qui fera l’objet de l’évaluation et les coordonnées du responsable de l’évaluation.
L’outil autodiagnostic proposé fournit un ensemble de risque, ces risques sont sous forme
affirmative. L’utilisateur évalue leurs détectabilités et leurs vraisemblances. Ces ensembles de risque
sont sous une forme synthétique, chaque fenêtre constitue un bloc de la norme ISO/CEI 17025. Un seul
bloc peut résumer plusieurs exigences de la norme ISO/CEI 17025.
Des liens sont disponibles sur la feuille de grille d’évaluation permettant de naviguer dans l’outil.
Ces liens permettent d’accéder directement aux résultats (globaux et de chaque bloc) et aux sommaire
de l’outil.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 59
2
1 4
1
Figure 19: Grille d'évaluation des risques de l'outil Autodiag.RISK
7
6
8 9
Figure 20: Statistiques des niveaux
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 60
Colonne qui représente le nombre des risques qui existent dans l’organisme et qui appartiennent
1
au bloc.
Colonne qui représente le bloc concerné par les risques dans l’organisme et qui est lié à la norme
2
ISO/CEI 17025.
Niveau de détectabilité : Difficile ; Moyen ; Facile
3
Niveau de vraisemblance : Fort ; Médian, Faible
Colonne qui doit être remplie par le responsable de l’organisme concerné par l’évaluation, en
4
décrivant la solution mise en place pour faire face au risque correspondant à la même ligne.
Colonne de Niveau de risque résiduel pour évaluer le risque en présence de la parade exprimée
5
par le responsable du SMQ.
Nombre de cellules réservées aux risques (j’ai réservé 50 cellules)
6
Nombre de cellules non vide : présente le nombre de cellules contenant des risques à évaluer
Parmi le nombre de cellules non vide, ce tableau représente combien de risques sont difficilement,
7
moyennement ou facilement détectables, ainsi que leur contribution en pourcentage.
Parmi le nombre de cellules non vide, ce tableau représente combien de risques peuvent se
8
présenter d’une manière forte, médiane ou faible, ainsi que leur contribution en pourcentage.
Parmi le nombre de cellules non vide, ce tableau représente combien de on a des risques résiduels
9
moyen ou faible, ainsi que leur contribution en pourcentage.
Tableau 3: Définitions des éléments de la grille d'évaluation de l'outil Autodiag.RISK
Les résultats consistent à des schémas donnant une représentation graphique du niveau de
détectabilité et de vraisemblance de chaque bloc de la norme ISO/CEI 17025. A l’issu de l’évaluation
de chaque partie de la norme, l’utilisateur peut noter ses remarques et ses actions prioritaires pour
améliorer son système de management de la qualité.
L’outil permet de visualiser les résultats de chaque bloc séparément. Le fait d’avoir une évaluation
détaillée de chaque bloc de la norme va permettre aux utilisateurs d’avoir une bonne visibilité sur les
points à améliorer et permet également de détecter rapidement les champs d’actions prioritaires.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 61
L’outil permet d’évaluer les risques liés à : l’Impartialité et la Confidentialité ; la Structure ; le
Personnel ; Installations et milieux ambiants ; les Équipement ; les Méthodes et les Échantillons.
DÉTECTABILITÉ VRAISEMBLANCE
Tableau 4: Graphiques des niveaux de détectabilité et de vraisemblance
L’outil permet de synthétiser les différents niveaux de détectabilité et de vraisemblance de
l’ensemble des blocs constitués de la norme ISO/CEI 17025 par des représentations graphiques. Cette
représentation graphique permet aux utilisateurs de prioriser les actions correctives et préventives et
par conséquent le responsable du SMQ peut émettre, à l’issu de cette évaluation, plusieurs plans
d’actions pour pouvoir relever le niveau de détectabilité et de vraisemblance des points sensibles et
critiques.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 62
Cet outil contient les principes, les prescriptions et l’essentiel de ISO/CEI 17025 afin de réunir la
totalité des risques qui ont un impact sur la validité des résultats. L’autodiagnostic se présente comme
une solution rapide pour évaluer la situation du SMQ et en identifier les axes possibles d’amélioration.
Ceci donne la capacité de tracer les pratiques de la qualité ainsi que leurs progrès.
Figure 21: Feuille "Indicateurs de performance" de l'outil Autodiag.RISK
Cette feuille a pour but de synthétiser les résultats du diagnostic des risques au niveau du système
de management de la qualité dans un organisme en balayant 7 blocs. Ce document peut servir comme
un compte rendu de l’évaluation des risques liés aux résultats et peut être utilisé pour la communication
interne sur l’état de santé du système de management des risques.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 63
c- Processus de l’utilisation de cet outil
Un logigramme d’utilisation de l’outil d’autodiagnostic a été élaboré afin de clarifier son
utilisation. Il détaille la démarche à suivre pour l’obtention d’un résultat d’évaluation optimale.
Ouvrir l’outil d’autodiagnostic Autodiag.RISK
Remplir la fenêtre « Introduction » par les coordonnées de
l’organisme ainsi que de l’équipe d’évaluation
Regarder les informations fournies sur la fenêtre « Introduction »
Connaitre l’échelle de l’évaluation dans les blocs
Utiliser les boutons dans le sommaire pour accéder à la grille d’évaluation souhaitée
Choisir le niveau de détectabilité et de vraisemblance pour chaque risque
présenté dans la grille d’évaluation du bloc
Exprimer la parade jugée nécessaire et suffisante pour diminuer ou
maintenir l’effet du risque présenté dans la grille d’évaluation du bloc
Choisir le niveau de risque résiduel après l’application de la parade
NON
C’est la dernière grille d’évaluation
OUI
Retourner au
Visualiser les résultats globaux
sommaire
Déclaration des niveaux pour chaque bloc
Figure 22: Processus de l'utilisation de l'outil Autodiag.RISK
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 64
Pour assurer une méthodologie crédible et transparente afin de donner confiance dans les résultats
obtenus, j’ai utilisé une bibliographie robuste ainsi que la norme ISO/CEI 17025 version 2017. En
outre, un benchmarking des différents types des outils d’autodiagnostics a été réalisé pour élaborer cet
outil d’autodiagnostic.
Les résultats fournis par cet outil Annexe 4 permettent une visualisation directement des points
forts et des points faibles du niveau des risques dans le système de management de la qualité.
L’autoévaluation de la part des organismes permet une mise en place facile des plans d’action pour se
rapprocher de la conformité par rapport à la nouvelle version de l’ISO 17025.
CONCLUSION
Dans ce chapitre j’ai exposé l’ensemble des tâches qui m’ont été confié ainsi que les travaux que
j’ai élaboré pour le service de SEMAC, des OEC et aussi pour les évaluateurs. À titre indicatif le guide
technique des risques, le tableau d’identification des risques liés à la nouvelle version de la norme
ISO/CEI 17025, ainsi que l’outil Autodiag.RISK. L’utilisation de cette diagnostic peut être choisie pour
de multiples raisons mais l’objectif reste avant tout de pouvoir situer la performance actuelle des
organismes d’évaluation de conformité et de pouvoir évaluer le chemin restant à parcourir pour une
meilleure prise en compte des attentes de la norme ISO/CEI 17025, en accord à nouvelle version en
2017.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 65
C hapitre 4 ETUDES DE CAS
L’outil d’autodiagnostic qui est parmi les livrables de mon projet devra être testé par des
responsables de la qualité de quelques organismes qui seront amener à l’utiliser dans le cadre
de l’amélioration de leurs systèmes de management de la qualité. Ensuite, après validation
de l’outil par les évaluateurs de la commission formée par SEMAC et après la prise en
considération de leurs remarques et suggestions, la grille pourra être diffusée largement aux
toutes les parties intéressées. Les améliorations possibles pour cet outil seront mieux clarifiées
après le retour d'expérience de nos utilisateurs.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 66
I. Introduction
De l'importance de l’accréditation via de la norme ISO/CEI 17025 pour les organismes qui
cherchent la reconnaissance de leurs compétences dans un ou plusieurs domaines, et qui cherchent un
niveau de qualité et de l'espace compétitif, la nécessité de suivre l'évolution du marché et les tendances
mondiales, il est nécessaire d'adapter la nouvelle version de la norme ISO/CEI 17025 qui a changé en
en 2017. De là, ce projet utilisera les méthodes d’amélioration continue et outils de management et
contrôle pour réaliser un autodiagnostic de quelles sont les points importants que les organismes ont
besoin d’améliorer et/ou problèmes à résoudre afin de obtenir une nouvelle accréditation selon la
version 2017 de la norme ISO/CEI 17025.
Vu un des objectifs était de réaliser un outil d’autodiagnostic aux risques qui impactent la validité
des résultats selon la nouvelle version de la ISO/CEI 17025 ; 2017, il fallait le tester aux OEC pour les
aider à situer rapidement leurs états initiaux et leur niveau d’évaluation des risques.
II. MISE EN PLACE DE L’OUTIL AUTODIAG.RISK
Après l’élaboration de l’outil d’autodiagnostic des risques Autodiag.RISK, l’étape suivante était
de choisir un laboratoire d’étalonnage et un autre d’essai pour mettre en place l’outil.
L’outil d’autodiagnostic qui est parmi les livrables de mon projet devra être testé par des
responsables de la qualité de quelques organismes qui seront amener à l’utiliser dans le cadre de
l’amélioration de leurs systèmes de management de la qualité. Ensuite, après validation de l’outil par
les évaluateurs de la commission formée par SEMAC et après la prise en considération de leurs
remarques et suggestions, la grille pourra être diffusée largement aux toutes les parties intéressées. Les
améliorations possibles pour cet outil seront mieux clarifiées après le retour d'expérience de nos
utilisateurs.
1- Laboratoire QISTASLAB
Le laboratoire QISTASLAB est une entité de C2MT. L’exactitude, la précision, la fiabilité, la
pertinence, et l’efficacité, voilà les maîtres mots qui ont présidé à la création du
laboratoire QISTASLAB.
L’équipe de QISTASLAB se compose de personnes qualifiées capables de répondre au besoin de
ses clients, de trouver des solutions et de concevoir des outils spécifiques pour chaque situation.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 67
La qualification du personnel est un souci permanent. Elle est assurée par la formation initiale, les
formations continues, les pratiques d’étalonnage, les comparaisons interlaboratoires, les visites et
stages aux entreprises et aux laboratoires de renoms. QISTASLAB offre des services d’étalonnage et
de vérification des instruments de mesure à l’ensemble des laboratoires et entreprises industrielles dans
les domaines :
Chimique
Masse
Électrique
Dimensionnel
Pression
Température & Humidité
Force
Volume
2- Le Centre National d'Études et de Recherches Routières CNER
Le Centre National d’études et de Recherches Routières (CNER), crée en 1979, est un Service de
l’État Géré de Manière Autonome (SEGMA) sous la tutelle administrative de la Direction des Routes
du Ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau. Il a pour principales missions:
L’auscultation des chaussées et des ouvrages d’art.
La réalisation et l’administration de la banque de données routières.
Le développement de systèmes de gestion routiers.
L’établissement d’études et de recherches routières.
Pour ce, le CNER est doté d’un équipement moderne et d’un personnel dynamique, et fait appel à
des méthodes de gestion et exécution d’études et de recherches relatives à l’auscultation routière à
l’expérimentation de nouvelles techniques routières, et à la mise en valeur d’une banque des données
routière, et d’un système rationnel de gestion du réseau routier national.
3- Résultats d’application du l’outil Autodiag.RISK
L’annexe 5 représente les résultats relevés de chaque laboratoire.
Lors de l’élaboration de l’outil, l’idée de crypter le contenu de l’outil est proposée. Ce cryptage
permettra d’éviter les erreurs de manipulations des résultats finaux, alors pour remédier à ces
problèmes, il a été décidé de créer deux versions de l’outil : la première version sera en mode crypté
sans possibilité de modification du contenu ; la deuxième version sera libre de modification.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 68
Cependant, il sera suggéré d’utiliser la version crypté lors de l’évaluation du système de
management de la qualité de l’organisme et la version ouverte pour toute modification des risques
susceptibles d’influencer le résultat.
D’autre part, ces deux versions seront regroupées en un seul fichier compressé. Il sera nécessaire
de saisir un mot de passe afin d’ouvrir ces fichiers. Ce mot de passe sera disponible librement sur la
page web du projet et un lien de la page web du projet sera ajouté dans le fichier compressé. Cette
démarche incitera les utilisateurs à visiter la page web du projet.
III. CONCLUSION
Vu le nombre important des risques, l’outil d’autodiagnostic Autodiag.RISK sera divisé par bloc
afin d’aérer l’outil mais aussi pour faciliter l’utilisation dans le cas d’une évaluation ponctuel.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 69
CONCLUSION GÉNÉRALE
Ce rapport synthétise le travail que j’ai réalisé dans le cadre de mon projet intitulé « Élaboration
d’un guide techniques des risques répondant aux exigences de la nouvelle version de la norme ISO/CEI
17025 ; 2017, accompagné d‘un tableau d’identification des risques liés à la norme, et d’un outil
d’autodiagnostic qui permet d’évaluer les risques qui ont un impact sur la validité du résultat».
La norme ISO/CEI 17025 «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires
d’étalonnages et d’essais» est la norme utilisée pour avoir une accréditation. En 2017 cette norme a été
actualisée et l’objective de ce projet est de proposer un guide technique des risques vérifié et validé par
une commission des évaluateurs, puis publié par SEMAC, un tableau d’identification des risques qui
aidera les OEC à identifier les risques présentés au sein de leurs organismes et un outil d’autodiagnostic
qui permettra aux organismes de s’autoévaluer pour estimer le niveau des risques susceptible
d’influencer leurs résultats. Cela permettra aux OEC de faire un autodiagnostic de la situation actuelle
pour se préparer à l’adaptation de leurs SMQ.
La première partie de ce Mémoire est consacrée à l’explicitation des objectifs et des résultats
escomptés de mon travail. Par la suite, la méthodologie suivie a été détaillée : Mise en place de plans
d’actions, planification des tâches dans le temps, étude de risques et recherche des alternatives
envisageables et enfin la réalisation des jalons qui m’ont été confiés par SEMAC.
Ce projet m’a permis d’approfondir mes connaissances de la norme ISO/CEI 17025. Au cours de
ce projet, l’application des outils enseignés au long de la formation Management de la qualité et
Métrologie m’a été utile pour atteindre les objectifs fixés au début du projet. Les connaissances acquises
concernant aux systèmes de management de la qualité ainsi que les recherches bibliographiques sur ce
domaine constituent une opportunité intéressante pour le développement scientifique et l’entrée sur le
marché professionnel des étudiants.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 70
De point de vue personnel, la réalisation de ce projet s’est avérée très bénéfique. Premièrement, il
a fallu gérer ce projet sur une période courte de 4 mois, établir un planning de travail en fonction des
tâches à accomplir, de leur complexité et des échéances à respecter. Ce fut également l’occasion de
former une équipe riche d’apports techniques et humains ce qui a permis de développer des
compétences en gestion d’équipe multiculturelle, multidisciplinaire et en gestion de projet.
Afin de compléter ce travail, nous proposons, par ailleurs quelques perspectives :
- Mener une étude d’analyse des risques sur la déclaration de conformité des produits en
intégrants d’une part, les risques du premier et de deuxième espèce et d’autres parts, le risque
d’échantillonnage.
- Les études de cas menées dans ce travail ne concernent que les cas des laboratoires
d’étalonnages et d’essais, nous proposerons aux successeurs d’appliquer l’étude au cas des
laboratoires d’analyses.
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 71
Annexe 1 : Le tableau comparatif
entre la version 2005 et 2017 de la
norme ISO/CEI 17025
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 72
Annexe 2 : Le tableau
d’identification des risques de la
norme ISO/CEI 17025 V2017
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 73
Annexe 3 : Le guide technique des
risques
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 74
Annexe 4 : L’outil autodiagnostic
des risques Autodiag.RISK
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 75
Annexe 5 : Résultats d’application
de l’outil Autodiag.RISK au sein
des laboratoires
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 76
BIBLIOGRAPHIE
[1] AFNOR ISO/CEI 17025 les « exigences générales concernant la compétence des
laboratoires d'étalonnages et d'essais »
[2] AFNOR ISO 31000 les principes et des lignes directrices du management des
risques
[3] AFNOR ISO 31010 Gestion des risques — Techniques d'évaluation des risques
[4] http://www.demarcheiso17025.com/index.html
[5] https://www.pimido.com/timeline
[6] https://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/index.html
[7] https://www.iso.org/obp/ui/#home
[8] http://www.mcinet.gov.ma/
[9] Mr Joseph Kélada document AMDEC sous la direction
[10] QUARES Association pour la Qualité en Recherche et Enseignement Supérieur,
La révision de la norme ISO 17025 : Comment faire ?
[11] Guide d’évaluation GLAS 1510E à utiliser avec la norme ISO/CEI 17025
[12] COFRAC 9ème FORUM ACCREDITATION & LABORATOIRES
Mémoire de fin d’étude MQM-CPI 77
Vous aimerez peut-être aussi
- Pfe 4Document94 pagesPfe 4AHBIR100% (1)
- TDR - SMQ ISO 9001 IPT 1601 PDFDocument12 pagesTDR - SMQ ISO 9001 IPT 1601 PDFRim OUACHANIPas encore d'évaluation
- Amelioration Des Indicateurs D - Chaymae FIKRI - 4158Document95 pagesAmelioration Des Indicateurs D - Chaymae FIKRI - 4158AFAFPas encore d'évaluation
- Contribution A La Mise en Place de SMQ FALIA CORP 2017Document70 pagesContribution A La Mise en Place de SMQ FALIA CORP 2017mohibsaif80% (5)
- Pfe-Sewanou - Estimation Des Incertitudes de Mesure Lors Des Etalonnage Des Balance Et L'optimisation de Leur Periodicite de Suivi QuotidienDocument70 pagesPfe-Sewanou - Estimation Des Incertitudes de Mesure Lors Des Etalonnage Des Balance Et L'optimisation de Leur Periodicite de Suivi QuotidienHyacinthe Akakpo100% (1)
- ImpartialitéDocument8 pagesImpartialitéBessem Abid100% (1)
- La Démarche de Mise en Place D'un Système de Management de La Qualité Selon La Norme ISO 9001 Version 2008Document169 pagesLa Démarche de Mise en Place D'un Système de Management de La Qualité Selon La Norme ISO 9001 Version 2008chayma100% (7)
- Mise en Place D'un SMQ Dans Un Laboratoir ISO 17025Document90 pagesMise en Place D'un SMQ Dans Un Laboratoir ISO 17025benkPas encore d'évaluation
- Rapport Final Imt Ref - Inconnu (E)Document82 pagesRapport Final Imt Ref - Inconnu (E)tazi riffi harounePas encore d'évaluation
- Evaluation Des Entreprises Cas de COGB La BelleDocument143 pagesEvaluation Des Entreprises Cas de COGB La BellePPT50% (2)
- L'expert Comptable Face Aux Risques D'audit Des Sociétés D'assurance de Dommages Au MarocDocument121 pagesL'expert Comptable Face Aux Risques D'audit Des Sociétés D'assurance de Dommages Au MarocB.I67% (9)
- L3 AES, Cours ECONOMIE REGIONALEDocument37 pagesL3 AES, Cours ECONOMIE REGIONALEPitchoune628971% (7)
- Analyse Des Risques Selon Le R - Hamza BELMIR - 4337Document67 pagesAnalyse Des Risques Selon Le R - Hamza BELMIR - 4337ARKASPas encore d'évaluation
- Pfe-Zorom - Mise en Place Des Dispositions en Vue D'une Accreditation Cofrac Ou Equivalent Sur La Caracterisation Et La Verification Des Enceintes ClimatiquesDocument73 pagesPfe-Zorom - Mise en Place Des Dispositions en Vue D'une Accreditation Cofrac Ou Equivalent Sur La Caracterisation Et La Verification Des Enceintes ClimatiquesHyacinthe AkakpoPas encore d'évaluation
- PFE Emna SGHAIER v2Document58 pagesPFE Emna SGHAIER v2aziz hajriPas encore d'évaluation
- Talonnage Des Instruments de MesureDocument2 pagesTalonnage Des Instruments de MesureWael Ben Romdhane100% (2)
- Soutenance SMQ CdecDocument48 pagesSoutenance SMQ CdecBilel GhazouaniPas encore d'évaluation
- Contribution A La Mise en Place 17025 - Ouijdan BOURIANE - 3891 PDFDocument57 pagesContribution A La Mise en Place 17025 - Ouijdan BOURIANE - 3891 PDFnihal100% (1)
- Politique Qualite Pour 2021Document1 pagePolitique Qualite Pour 2021aziddine100% (1)
- Rapport PfeDocument48 pagesRapport PfeLouis BiyooPas encore d'évaluation
- Management Qualité Dans Le Secteur AutomobileDocument91 pagesManagement Qualité Dans Le Secteur AutomobilebadriPas encore d'évaluation
- Iso 9001 v2015 OulmèsDocument30 pagesIso 9001 v2015 Oulmèsanas mahPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage Luce Murielle ST02 - 2012 - 3Document53 pagesRapport de Stage Luce Murielle ST02 - 2012 - 3yooyooPas encore d'évaluation
- Demarche AccreditationDocument59 pagesDemarche AccreditationSH MahdiPas encore d'évaluation
- Audit Fonction MetrologieDocument10 pagesAudit Fonction MetrologieAnonh Adiko100% (2)
- ISO 17025 V 2018Document38 pagesISO 17025 V 2018A boukhaledPas encore d'évaluation
- AMDECDocument26 pagesAMDECSH MahdiPas encore d'évaluation
- Analyse Systeme de MesureDocument10 pagesAnalyse Systeme de Mesuremedane_saad6707Pas encore d'évaluation
- Rapport PFE La Version Final.Document116 pagesRapport PFE La Version Final.Mohamed ElhakiouiPas encore d'évaluation
- Verification Et Etalonnage PDFDocument12 pagesVerification Et Etalonnage PDFMartial Art Farid0% (1)
- Pfe-Chigblo - Mise en Place D'une Procedure D'etalonnage Des Jaugeurs Radar A Cocitam PDFDocument66 pagesPfe-Chigblo - Mise en Place D'une Procedure D'etalonnage Des Jaugeurs Radar A Cocitam PDFHyacinthe AkakpoPas encore d'évaluation
- Mise en Place D Un SMQ MarsaMaroc PDFDocument109 pagesMise en Place D Un SMQ MarsaMaroc PDFAli OubayidirPas encore d'évaluation
- L'audit de La Fonction MétroLogieDocument22 pagesL'audit de La Fonction MétroLogiemetrologueha1100% (1)
- Dt03-Bra A Methode 8dDocument17 pagesDt03-Bra A Methode 8dfatima_zahra_1820Pas encore d'évaluation
- Audit Qualité Interne Au Système ManagementDocument157 pagesAudit Qualité Interne Au Système ManagementAbdou ltrPas encore d'évaluation
- TOUIL Fatima-EzzahraDocument108 pagesTOUIL Fatima-EzzahraAsraoui ZakariaPas encore d'évaluation
- 4 - Metrologie en EntrepriseDocument32 pages4 - Metrologie en EntrepriseBarbaraPas encore d'évaluation
- Politique Qualité ISO 17025Document1 pagePolitique Qualité ISO 17025peace peace100% (2)
- Contribution A La Mise en Place 17025 - Ouijdan BOURIANE - 3891 PDFDocument57 pagesContribution A La Mise en Place 17025 - Ouijdan BOURIANE - 3891 PDFnihal100% (1)
- Les Exigences de L'iatf 16949 V 2016 - Max Power - Tranche 1Document170 pagesLes Exigences de L'iatf 16949 V 2016 - Max Power - Tranche 1try100% (2)
- AFNOR Questionnaire Evaluation Fonction MetrologieDocument3 pagesAFNOR Questionnaire Evaluation Fonction MetrologieHicham Terry0% (1)
- PFE Amira Ghrairi 2017 BONTAZ - Copie - Copie - CopieDocument170 pagesPFE Amira Ghrairi 2017 BONTAZ - Copie - Copie - Copieamira100% (9)
- PFE RemarquesDocument134 pagesPFE RemarquesawatefPas encore d'évaluation
- IATF Version 2016Document31 pagesIATF Version 2016Nejm Iddin0% (1)
- Thor JmsDocument148 pagesThor JmsRabii OuardaouiPas encore d'évaluation
- Contribution À La Mise en Place Du Système de Management de La Sécurité Des Denrées Alimentaires Suivant La Norme ISO 22000 - V20Document59 pagesContribution À La Mise en Place Du Système de Management de La Sécurité Des Denrées Alimentaires Suivant La Norme ISO 22000 - V20Kamal WadihPas encore d'évaluation
- 0PR015A1 Audit Produit en ProductionDocument5 pages0PR015A1 Audit Produit en ProductionNizar EnnettaPas encore d'évaluation
- BouzayDocument64 pagesBouzayFatima Zahra El OuardiPas encore d'évaluation
- Exemple Fiche - Rapport 8DDocument1 pageExemple Fiche - Rapport 8DAbdelatif HrPas encore d'évaluation
- ISO17025 TACQI 2021-2022 PPTDocument48 pagesISO17025 TACQI 2021-2022 PPTOthmane HassiniPas encore d'évaluation
- Amelioration Du Processus Logi - FELLAHI Jihane - 3966Document62 pagesAmelioration Du Processus Logi - FELLAHI Jihane - 3966Fatima zahraePas encore d'évaluation
- La Mise en Place de Système de Management de La Qualité Selon ISO 9001 V 2015Document131 pagesLa Mise en Place de Système de Management de La Qualité Selon ISO 9001 V 2015Mohamed Amine MbarkiPas encore d'évaluation
- PDF PDFDocument76 pagesPDF PDFSara AmsidderPas encore d'évaluation
- Implantation Du Lean Manufacturing PDFDocument61 pagesImplantation Du Lean Manufacturing PDFGasmi Mouhamedyosri100% (1)
- Pfe Toufiq, Transition Ohsas 18001 Vers Iso 45001 Chez KoutoubiaDocument103 pagesPfe Toufiq, Transition Ohsas 18001 Vers Iso 45001 Chez KoutoubiaNouhaila SahibPas encore d'évaluation
- These ÉtalonnageDocument198 pagesThese ÉtalonnageEMA54Pas encore d'évaluation
- Memoire Raw ActsDocument75 pagesMemoire Raw ActsApolion DjoundaPas encore d'évaluation
- Pfe-Yao - Mise en Place de La Fonction Metrologie A La SitarailDocument107 pagesPfe-Yao - Mise en Place de La Fonction Metrologie A La SitarailHyacinthe AkakpoPas encore d'évaluation
- Amdec Processus PDFDocument18 pagesAmdec Processus PDFnarimenePas encore d'évaluation
- Fiabilité, maintenance prédictive et vibration des machinesD'EverandFiabilité, maintenance prédictive et vibration des machinesPas encore d'évaluation
- Rapport Final PFE Hamza MabroukDocument72 pagesRapport Final PFE Hamza MabroukAbderrahmane Ben ErajrajiPas encore d'évaluation
- Amelioration Des Performances - Yassine FALEH - 4947 PDFDocument74 pagesAmelioration Des Performances - Yassine FALEH - 4947 PDFSoufiane Nasr EddinPas encore d'évaluation
- Mémoire de Fin D'étudesDocument85 pagesMémoire de Fin D'étudeshafien-mokhtar 02Pas encore d'évaluation
- Procédé D 'Elaboration Des Olives de Tablae PDFDocument4 pagesProcédé D 'Elaboration Des Olives de Tablae PDFAbdessamad LamnouarPas encore d'évaluation
- Microbiologie Cour DeS3 - SVIDocument155 pagesMicrobiologie Cour DeS3 - SVIomar ouffaPas encore d'évaluation
- Haccp Iso 22000 PDFDocument34 pagesHaccp Iso 22000 PDFAbdessamad LamnouarPas encore d'évaluation
- These Doctorat BenrachouDocument112 pagesThese Doctorat BenrachouAbdessamad Lamnouar100% (1)
- Norme Commercial Huile OlivesDocument38 pagesNorme Commercial Huile OlivesAbdessamad LamnouarPas encore d'évaluation
- Incendie Sur Le Lieu de Travail PDFDocument28 pagesIncendie Sur Le Lieu de Travail PDFAbdessamad LamnouarPas encore d'évaluation
- Chimie Alimentation 171Document11 pagesChimie Alimentation 171Abdessamad LamnouarPas encore d'évaluation
- Incendie Sur Le Lieu de Travail PDFDocument28 pagesIncendie Sur Le Lieu de Travail PDFAbdessamad LamnouarPas encore d'évaluation
- Mise en Place D'un Système de Management de La Qualité Au Sein de AFIF CHARITY - QATARDocument66 pagesMise en Place D'un Système de Management de La Qualité Au Sein de AFIF CHARITY - QATARYassine Mafrax100% (1)
- Rapport Daudit LightDocument2 pagesRapport Daudit LightJad Haydar Mohamed BouanguaPas encore d'évaluation
- Document Information General Conservation Des AlimentsDocument28 pagesDocument Information General Conservation Des AlimentsAbdessamad LamnouarPas encore d'évaluation
- Debouch 1103Document147 pagesDebouch 1103Khalil Ben JemiaPas encore d'évaluation
- Analyse AMDEC Processus SupportDocument8 pagesAnalyse AMDEC Processus SupportHafid ErrabiyPas encore d'évaluation
- Procdure Achats GnrauxDocument3 pagesProcdure Achats GnrauxchahiPas encore d'évaluation
- 2016 - Risques Et OpportunitésDocument1 page2016 - Risques Et OpportunitésYacine Madjid0% (1)
- Exemple Denqute de SatisfactionDocument1 pageExemple Denqute de SatisfactionAnouar Aleya100% (1)
- Connaitre HuileDocument4 pagesConnaitre HuileAbdessamad LamnouarPas encore d'évaluation
- Fiche Technique Huile OlivesDocument8 pagesFiche Technique Huile OlivesAbdessamad LamnouarPas encore d'évaluation
- Izoland ISO 22000Document15 pagesIzoland ISO 22000مصطفى أبو عبد الرحمانPas encore d'évaluation
- Référentiels Feux Industriels 1424683126 PDFDocument312 pagesRéférentiels Feux Industriels 1424683126 PDFAbdessamad LamnouarPas encore d'évaluation
- PetitDej CLA 13 Risque Et Opportunités ISO 17025Document31 pagesPetitDej CLA 13 Risque Et Opportunités ISO 17025Anass CherrafiPas encore d'évaluation
- Alahmad Khalaf SMZ0801 PDFDocument187 pagesAlahmad Khalaf SMZ0801 PDFAbdessamad LamnouarPas encore d'évaluation
- Guidindolives FRDocument30 pagesGuidindolives FRAbdessamad LamnouarPas encore d'évaluation
- Question A Poser Sur Iso 22000Document2 pagesQuestion A Poser Sur Iso 22000Abdessamad LamnouarPas encore d'évaluation
- Cornichons Calibre 3Document2 pagesCornichons Calibre 3Abdessamad LamnouarPas encore d'évaluation
- Cours11 Poly TIACDocument28 pagesCours11 Poly TIACAbdessamad Lamnouar100% (2)
- Loi de Finances 2016Document2 pagesLoi de Finances 2016Abdessamad LamnouarPas encore d'évaluation
- Cours Acidification PH Barrierres PWPTDocument30 pagesCours Acidification PH Barrierres PWPTAbdessamad LamnouarPas encore d'évaluation
- Les Taches de Responsable QualitéDocument1 pageLes Taches de Responsable QualitéAbdessamad Lamnouar100% (1)
- Production Etudiant - 3 - PR (Mode de Compatibilité)Document11 pagesProduction Etudiant - 3 - PR (Mode de Compatibilité)Hafiani HichamPas encore d'évaluation
- Corrige Cas PotageDocument3 pagesCorrige Cas PotageSamuel TouganPas encore d'évaluation
- La Gestion de La Trésorerie de L'entrepriseDocument59 pagesLa Gestion de La Trésorerie de L'entrepriseKàrim ßãlöp100% (2)
- Management IIDocument81 pagesManagement IIAssime MouraiPas encore d'évaluation
- Spécial TPME 4592 PDFDocument16 pagesSpécial TPME 4592 PDFyapPas encore d'évaluation
- Compta Des SocietesDocument24 pagesCompta Des Societesbasaliou100% (4)
- March - Et-MarketingDocument24 pagesMarch - Et-MarketingAbir RakbaouiPas encore d'évaluation
- Controle Continu en Droit Pénal Des AffairesDocument3 pagesControle Continu en Droit Pénal Des AffairesDriss SlaouiPas encore d'évaluation
- 1ère Série de TD Principes de Gestion 1Document2 pages1ère Série de TD Principes de Gestion 1chiraz100% (3)
- EssaieDocument4 pagesEssaieEl-amarty AbdelaliPas encore d'évaluation
- Mano FinDocument28 pagesMano FinRima RimPas encore d'évaluation
- Le VacheDocument23 pagesLe VacheHAMZA ELMI YOUSSOUFPas encore d'évaluation
- Stage KPMGDocument4 pagesStage KPMGSofiane AlgerPas encore d'évaluation
- Devoir Comptabilité Nationale 2008 2009Document3 pagesDevoir Comptabilité Nationale 2008 2009Mme et Mr Lafon100% (1)
- StructuresDocument4 pagesStructuresamin1392Pas encore d'évaluation
- Cadre Theorique de LDocument98 pagesCadre Theorique de LUlrich MouafoPas encore d'évaluation
- Résumé GRHDocument10 pagesRésumé GRHomar100% (1)
- Chap. 3 Les Theories Manageriales Des OrganisationsDocument16 pagesChap. 3 Les Theories Manageriales Des OrganisationsLiliane KouadioPas encore d'évaluation
- SYSTEME d'INFORMATION SAP Et ORGANISATION D' ENTREPRISEDocument164 pagesSYSTEME d'INFORMATION SAP Et ORGANISATION D' ENTREPRISEoaga552Pas encore d'évaluation
- Cour RH 1Document81 pagesCour RH 1wiamePas encore d'évaluation
- Applications Audit FinancierDocument2 pagesApplications Audit FinancierFAYZI MOSTAFAPas encore d'évaluation
- Sujet Corrige DCG Ue9 2016 PDFDocument20 pagesSujet Corrige DCG Ue9 2016 PDFOrcel GenesysPas encore d'évaluation
- Manuel HSEDocument14 pagesManuel HSEelamigosolitario100% (3)
- ÉtudeDocument112 pagesÉtudeLaura GutierrezPas encore d'évaluation
- Création de La ValeurDocument11 pagesCréation de La ValeurNoor AmoorPas encore d'évaluation
- Formation Pratique Sur LAudit Interne 1Document154 pagesFormation Pratique Sur LAudit Interne 1Ossama SariaPas encore d'évaluation
- Mémoire Final À ImprimerDocument139 pagesMémoire Final À ImprimerFatine lbPas encore d'évaluation