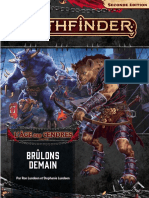Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Traitement Et Conditionnement Des Eaux
Traitement Et Conditionnement Des Eaux
Transféré par
Sarra BÉCHIRITitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Traitement Et Conditionnement Des Eaux
Traitement Et Conditionnement Des Eaux
Transféré par
Sarra BÉCHIRIDroits d'auteur :
Formats disponibles
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT
DES EAUX DES TOURS DE
REFRIGERATION
Objectif :
Ce séminaire vise à apporter des connaissances de base sur le conditionnement de
l’eau de refroidissement des installations industrielles.
Population concernée :
Il est destiné aux techniciens supérieurs, maîtrises et techniciens intervenant dans
l’exploitation des circuits de refroidissement des installations industrielles.
Programme :
I- Notions de chimie relatives aux traitement des eaux.
II- Traitement de base des eaux.
III- Traitement et conditionnement des eaux des tours de
réfrigération.
SH/IAP SKIKDA FORMATION
-1-
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
AVANT- PROPOS
Cet ouvrage à été élaboré dans le cadre des séminaires dispensés par
l’Institut Algérien du Pétrole.
En effet, le traitement et le conditionnement des eaux des tours de
réfrigération est devenu la préoccupation quotidienne des exploitants
d’usines et , particulièrement, de raffineries de pétrole et d’installations
pétrochimiques.
La conservation du patrimoine industrielle ainsi que l’amélioration des
performances constituent pour les industriels des problèmes essentiels et
de nos jours les installations de traitement reçoivent autant de soin et
d’attention que les unités de production.
Cet ouvrage est présenté en trois chapitres :
Le premier aborde le traitement des eaux en s’attardant sur les différentes
définitions et propriétés physico – chimiques nécessaires à la
compréhension des phénomènes intervenant dans le traitement et
conditionnement des eaux de réfrigération.
Le deuxième chapitre est réservé à l’épuration physico-chimique de l’eau et
le troisième est consacré au traitement et conditionnement des tours de
réfrigération.
Afin de rendre cet ouvrage aussi pratique que possible, nous avons inclus
en annexe, sous forme de graphiques et de tableaux, les données
techniques les plus utiles.
SH/IAP SKIKDA FORMATION
-2-
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
--- CHAPITRE 1 ---
NOTIONS DE CHIMIE RELATIVES
AU TRAITEMENT DES EAUX
SH/IAP SKIKDA FORMATION
-3-
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
NOTIONS DE CHIMIE RELATIVES
AUX TRAITEMENT DES EAUX
1-Cycle de l’eau
L’eau joue un rôle de toute importance dans la nature. La vapeur d’eau provenant de
l’évaporation des eaux (mers, lacs, fleuves…) ainsi que de la respiration et de la
transpiration des végétaux se répand dans l’atmosphère et se condense sous forme de
brouillard ou de nuage. Le nuage, formé de fines gouttelettes d’eau liquide, se résout en
pluie. L’eau de pluie ruisselle en partie à la surface du sol, s’infiltre en partie dans le sol.
L’eau de ruissellement corrode les montagnes et creuse les vallées ; l’eau d’infiltration
favorise le développement de la végétation et forme les nappes souterraines qui
alimentent sources, puits...
Nuage Nuage
Pluie
Evaporation
Ruissellement Terrain
Infiltration perméable
Cours Nappe d’eau
D’eau souterraine
Mer
Cycle de l’eau
( Cycle hydrologique)
SH/IAP SKIKDA FORMATION
-4-
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
2- La qualité des eaux brutes
Les caractéristiques des eaux brutes dépendent de leur origine. Pour satisfaire les
besoins des villes et des industries on dispose d’eaux dont les origines peuvent être :
a- Les eaux de précipitation
La pluie, neige, grêle renferment peu d’impuretés on y trouve surtout des gaz dissous
(O2, CO2).
b- Les eaux superficielles
L’eau des rivières, fleuves, lacs et mers se caractérisent par une composition très
variée d’impuretés où l’on trouve gaz, sels, bases et acides.
c- Les eaux souterraines
Puits, sources, geysers présentent une teneur variable en sels dissous qui dépend de la
composition et de la structure des sols et des roches.
3- Propriétés physico-chimiques
3-1 Composition et structure de la molécule de l‘eau
L’eau est un corps composé constitué des éléments oxygène et hydrogène
Molécule Molécule d’eau
H2
+
- +
+
Molécule
O2 105 °
+
- A+
Molécule
H2 A
105°
SH/IAP SKIKDA FORMATION
-5-
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
La molécule H—O – H est coudées, d’angle de valence de 105°.
3-2 Etats physiques
L’eau peut se présenter sous les 3 états physiques solides (glace) ; liquide (eau) ; et
gaz (vapeur d’eau).
a- L’état vapeur
Il est obtenu à partir de 100 °C à la pression atmosphérique. Les molécules sont
indépendantes les unes des autres et correspondent au modèle angulaire.
b- L’état solide
Il est obtenu en dessous de 0 °C, sous la pression atmosphérique. Les molécules sont
disposées suivant un tétraèdre avec une molécule d’eau centrale et quatre autres
disposées suivant les 4 sommets d’un tétraèdre régulier. Le réseau cristallin qui en
résulte est hexagonal.
c- L’état liquide
Au cours de la fusion de la glace, les liaisons hydrogène se rompent, le cristal
s’effondre et les molécules se rapprochent les unes des autres, la masse volumique
augmente jusqu’à une valeur maximale correspondant à une température de 4 °c sous
1 atmosphère.
Masse volumique de l’eau liquide > masse volumique de la glace.
3-3 Propriété physique de l’eau
a- Température d’ébullition
Elle est plus élevée que celle des composés hydrogénés de masse moléculaire du
même ordre. Elle est due à l’existence de liaison hydrogène intermoléculaires dans la
phase liquide.
Corps H2O de masse moléculaire 18 g et de température d’ébullition est de + 100°C.
b- Masse volumique et volume massique
La masse volumique de l’eau est maximale à la température de 4°C (1,000000 ) alors
qu’en phase solide elle n’est que de 0.88.
T °C 4 °C 15 °C 20 °C
Masse volumique (g/cm3) 1,000000 0,999160 0,998259
Volume massique (g/cm3) 1,000000 1,000841 1,001744
SH/IAP SKIKDA FORMATION
-6-
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
c- Tension superficielle
C’est une force de traction qui s’exerce à la surface du liquide en tendant à réduire le
plus possible l’étendue de cette surface.
d- Propriétés électriques
Pouvoir ionisant très important.
Conductivité électrique K= 4,2 10-6 siemens/m à 20 °C correspondant à une
résistivité de 23,8 megohms.cm.
Cette conductivité très faible, mais jamais nulle de l’eau est expliquée par
l’autodissociation
+
2 H2O H3O +OH-
+ - -14
Avec [ H ]. [OH ]= 10 = Ke : produit ionique de l’eau
e- Viscosité
C’est un paramètre important dans le traitement des eaux, on l’appelle souvent
frottement interne. Lorsque la température augmente, la viscosité diminue, le traitement
devient plus facile. Les opérations de sédimentation et de dégazage sont les plus
rapides. La présence des sels dissous augmente la viscosité car il y a augmentation du
degré d’association.
f- Propriétés optiques
La transparence de l’eau est fonction de la longueur d’onde de la radiation qui la
traverse.
L’eau est transparente aux UV.
Opaque aux IR ( vers 4000 cm-1).
Absorbe le rouge dans le visible, ce qui explique la couleur bleue de l’eau.
SH/IAP SKIKDA FORMATION
-7-
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
g- Potentiel chimique [pH]
+
Définit par pH = - Log [H ], il renseigne sur l’acidité ou l’alcalinité d’une eau. Le pH
dépend de la température.
T °C 0 20 50 100
pH (H2O pure) 7,5 7 6,6 6,1
SH/IAP SKIKDA FORMATION
-8-
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
4- Propriétés chimiques de l’eau
a- Généralités
L’eau est un excellent solvant, donc facilement polluée. Le processus de dissolution
d’une substance est une destruction de sa cohésion interne, cohésion qui est due à
des forces
Interatomiques : liaisons chimiques fortes ( covalentes, électrovalentes ou
ioniques).
Intermoléculaires : liaison de cohésion entre molécules
La solubilité des gaz, des liquides et des solides, est la principale cause de la pollution
des eaux.
b- Solutions
Une solution est constituée :
D’un solvant ou milieu dispersif.
De solutés ou substance dispersées.
La quantité d’un soluté présente dans une solution est exprimée par la concentration
de ce soluté ; elle s’exprime par le rapport :
Quantité de soluté
Concentration =
Quantité de solution ou de solvant
c- Solubilité
La solubilité est définie par la concentration maximale d’un soluté pouvant exister en
solution
Cas des gaz :
La solubilité des gaz obéit à la loi de HENRY. Le volume de gaz dissous est :
V = α . C.P Avec α : Coefficient de solubilité du gaz.
C : Concentration du gaz dans la
phase gazeuse.
P : Pression totale du gaz en
contact avec l’eau
SH/IAP SKIKDA FORMATION
-9-
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
-Cas des liquides :
La solubilité des liquides dans l’eau croit avec leur polarité. Les molécules
portant des groupements très polaires (alcools, amines, …) seront très
solubles. La solubilité ou miscibilité peut être partielle et dépendre de la
température. Les liquides insolubles dans l’eau peuvent former des émulsions
lorsqu’ils sont fortement dispersés.
-Cas des solides :
Suivant la taille et la charge du solide on distingue différents types de
solutions et de suspensions.
-Les solutions vraies ou moléculaires : (système à une phase)
Solutions cristalloïdes : les solutés sont des molécules de petites dimensions
Inférieur à 1 mm, ionisées ou non.
Solutions macromoléculaires : les solutés sont des particules de taille
supérieure à 1 mm, ionisée ou non.
-Les suspensions colloïdales : (système à 2 phases)
Les particules dispersées, de tailles comprises entre 10 mm et 20µm, sont des
amas atomiques ou moléculaires.
-Les suspensions : (système à 2 phases)
Les particules dispersées sont visibles au microscope
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 10 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
5- Composition des eaux naturelles
5-1 Les corps dissous
a- Sels minéraux
Toutes les eaux naturelles contiennent en plus ou moins de grande quantité des sels
solubles. Le plus souvent, il s’agit de :
++ ++ --
-Sels de calcium Ca et de magnésium Mg qui sont des carbonates CO3 ,
- -- - -
bicarbonates CO3H , sulfates SO4 , chlorures Cl , nitrates NO3 et plus rarement
- -
nitrites NO2 et silicates SiO3H .
--
-Sels de fer et de manganèse sous forme de CO3H et oxydes.
-
-Sels d’aluminium sous forme de SiO3H et d’oxydes.
-
-Sels d’ammonium sous forme de CO3H .
-Sels de silicium qui, mis à part la forme silicatée , peuvent, et ceci le plus souvent,
présenter la forme moléculaire peu hydrolysée SiO2 + H2O
Les sels dont il est question le plus souvent et que l’on rencontre le plus couramment
sont soulignés. Nous verrons que les autres ne sont pas pour autant sans présenter
d’importance.
Ces sels se trouveront en plus ou moins grande quantité dans toutes les eaux
naturelles :
-Eau de pluie
-Eau de forage
-Eau de surface
5-2 Les micro-organismes
Comme les matières en suspension inertes, les micro-organismes vivants ne se
rencontrent en général que dans les eaux de surface.
Seuls certains forages contaminés par des infiltrations en contiennent lorsqu’il existe
des fissures dans les couches de terrains, permettant aux eaux de ruissellement
d’atteindre la nappe aquifère sans épuration biologique préalable.
Les variétés de micro-organismes sont extrêmement nombreuses (plusieurs milliers
d’espèces) :
-Certaine ne peuvent vivre qu’à la lumière et d’autres à l’obscurité
-Certaines ne peuvent vivre qu’en milieu aéré ( aérobies) et d’autres en milieu non
aéré ( anaérobies)
-Certaines sont mobiles, d’autres immobiles.
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 11 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
Dans les installations industrielles où l’eau est à des températures convenables pour le
développement, ils peuvent avoir des effets très néfastes parmi lesquels on peut citer :
-Corrosion des métaux
-Embourbage, colmatage des tuyauteries et des appareils d’épuration
-Attaque du bois
Dans les eaux naturelles douces, ce sont surtout des micro-organismes du règne
végétal qui posent des problèmes et qui se rencontrent le plus souvent. Ils constituent
ce qu’on appelle le phytoplancton.
On distingue :
a- Les algues
De très nombreuses espèces peuvent vivre dans les eaux douces : algues vertes,
bleues, rouges, brunes, etc…
Toutes, ces algues ont besoin de CO2 libre pour leur développement. La plupart d’entre
elles ont également besoin de lumière.
b- Les champignons
Ils vivent sur un support (bois par exemple) qui subit souvent des dégradations
importantes (attaque de la partie cellulosique). Le plus souvent ; la lumière n’est pas
indispensable à leur développement.
c- Les bactéries
Elles sont des organismes très petits.
Parmi les bactéries qui nous intéressent le plus sur le plan industriel, on peut citer :
a- Les bactéries du fer qui se nourrissent du fer ferreux mis en solution par l’eau
lorsqu’une pile de corrosion s’est formée et entretienne ainsi les phénomènes
d’attaque du métal. Elles sont aérobies.
b- Les bactéries sulfato-réductrices qui, pendant leur cycle métabolique, utilisent
--
l’oxygène des anions SO4 et provoquent l’apparition de souffre naissent et de H2S
qui corrodent le métal par l’acidité. En principe, elles sont anaérobies mais elles
peuvent cependant subsister si l’eau est peu riche en O2.
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 12 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
Les organismes du règne animal ( zooplancton) sont représentés par :
-Les protozoaires
-Les rotifères
-Les crustacés, les mollusques, les nématodes dont la taille varie de 0,1 à
plusieurs mm
Toutes ces espèces se nourrissent du phytoplancton ou de matières organiques. Ils
peuvent, par prolifération en colonies, amener des obstructions des canalisations.
5-3 Les gaz dissous
Dans les eaux naturelles, il y a pratiquement toujours de l’oxygène, de l’azote et du gaz
carbonique. On rencontre de plus, quelquefois, des gaz comme l’hydrogène sulfuré, le
méthane, etc…
La quantité d’un gaz qui se dissout dans l’eau pure est fonction :
a- De la pression
En effet, on constante que la solubilité des gaz s’accroît lorsque la pression exercée par
ces gaz sur la surface de l’eau augmente.
b- De la température
En effet, on constate généralement que la quantité de gaz dissous diminue lorsque la
température s’élève.
c- Du coefficient de solubilité du gaz à la température considérée
( Exprimé en nombre de litres de gaz par litre de liquide.)
Oxygène
On note pour l’eau pure des solubilités de :
A 0 °C 14,56 mg/l
A 10 °C 11,85 mg/l
A 20 °C 9,09 mg/l
A 50 °C 5,50 mg/l
A 80 °C 2,80 mg/l
A 90 °C 1,59 mg/l
A 100 °C # 0 mg/l
Ces chiffres correspondent à la maturation en oxygène.
C’est lors du contact avec l’air (seule source possible) que les eaux sont donc
susceptibles de se charger au maximum d’oxygène.
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 13 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
Gaz carbonique
Le gaz carbonique est beaucoup plus soluble dans l’eau que l’oxygène. Cependant, la
teneur en CO2 dans l’eau qui dépend, tout comme celle de l’oxygène, du pourcentage
de CO2 que contient l’air surmontant le liquide, est très variable et dans certain cas, très
faible.
On trouve en effet :
Dans les eaux de pluie, de 0,5 à 1 mg/l ( car l’air est peu riche en gaz
carbonique).
Dans les eaux de forage, des quantités pouvant atteindre 50 à 100 mg/l selon :
Pression partielle élevée de CO2
Dégradation de matières organiques
Formation de bicarbonates
Le gaz carbonique se dissout, puis se combine. De se fait, son coefficient de solubilité
est beaucoup plus élevée, et il se trouve dans l’eau sous plusieurs formes
CO2 Dissous
CO2 Lié CO2 Libre
Carbonates Bicarbonates CO2 CO2
2- -
CO3 HCO3 Equilibrant Agressif
Le CO2 libre est une valeur intéressante à connaître ; il représente la somme du CO2
équilibrant et du CO2 agressif.
Il s’exprime en mg/l et peut déterminer par dosage en retour de la soude consommé par
une quantité déterminée d’eau.
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 14 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
6-6 Unités de mesure
En chimie de l’eau, on a coutume d’exprimer les résultats des analyses en :
Milligramme par litre ( mg/l )
Parties par million ( ppm )
Equivalents ou milliéquivalents par litre (éq./l ou méq./l)
Degrés français ( °F )
1 Mg/l = 1 ppm = 1 g/m3
L’équivalent = masse atomique / valence
( 1 solution normale contient 1 équivalent par litre )
Le milliéquivalent en est la millième partie
L’unité de concentration est le éq./l ou méq./l
Le degré français est égal à 1/5 de méq./l
Le degrés allemand ( °dH ) correspond à 10 mg/l CaO
1 ° dH = 1,785 °F
Les Américains s’expriment parfois en ∀ ppm as Ca CO3 ∀ = 0,1 °F
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 15 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
6-7 Définitions
TH = Titre Hydrotimétrique, mesure la dureté d’une eau
++ 2+
( Ca + Mg )
++
THCa = Dureté Calcique ( Ca )
++
THMg = Dureté Magnésienne ( Mg )
TA = Titre Alcalimétrique, donne la somme des anions dont les sels
- --
fixent le pH au dessus de 8,3 ( en général OH + ½ CO3 )
TAC = Titre Alcalimétrique Complet, donne la somme des anions dont
- --
les sels fixent le pH au dessus de 4,3 ( en général OH + CO3
- --
ou HCO3 + CO3 )
-
TAOH = Titre Alcalimétrique en hydrogène ( OH )
- -- -
TSAF = Titre en sels d’acides forts ( Cl + SO4 + NO3 )
-
Cl = Teneur en chlorures
-
SO4 = Teneur en sulfates
-
NO3 = Teneur en nitrates
-
HCO3 = Teneur en bicarbonates
SiO2 = Teneur en silice
CO2 = Gaz carbonique
O2 = Oxygène
pH = Potentiel Hydrogène
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 16 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
--- CHAPITRE 2 ---
TRAITEMENT DE BASE
DES EAUX
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 17 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
TRAITEMENT DE BASE
DES EAUX
1- Nature des impuretés de l’eau
Une classification très succincte des éléments rencontrés dans l'eau permet d'obtenir:
1-1 Les matières en suspension
- Les impuretés lourdes visibles à l'œil nu et susceptibles de se déposer par
décantation.
- Les impuretés très fines ou colloïdales qui demeurent en suspension dans l'eau soit
indéfiniment, soit en décantant très lentement.
Dans les deux hypothèses, elles ne peuvent être éliminées qu'après coagulation et
floculation .
1-2 Les matières en solution
On distingue dans ce cas:
- Les sels minéraux: ils proviennent de la solubilisation des roches parcourus par
l’eau de ruissellement.
- Les gaz dissous se sont les gaz de l'air principalement le CO2 et O2.
- Les matières organiques: elles proviennent du lessivage des terrains
superficielles par l'eau, ou éventuellement d'une pollution atmosphérique.
1-3 Les problèmes dus aux impuretés de l’eau
Les principaux ennuis rencontrés découlent des phénomènes suivants :
- Elévation de température de l'eau
- Variation de la salinité de l'eau par augmentation de la concentration en Sels.
- Présence dans l'eau d'éléments peu solubles.
- Présence dans l'eau de gaz dissous.
- Matières organiques.
Ces différents paramètres conduisent à:
- L'entartrage.
- La corrosion.
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 18 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
- Les salissures et bouchages.
2- Techniques de conditionnement:
2-1 L'entartrage
L'entartrage est une précipitation adhérente d'un sel de Ca ou de Mg sur une surface
métallique.
2-2 Corrosion
La corrosion est la disparition d'un métal qui passe en phase ionisée puis
éventuellement sous forme insoluble; il y a donc disparition de métal, donc
détérioration. Elle est due à l'action de l'oxygène dissous, soit à l'attaque directe du fer
par l'eau ou le CO2.
- Corrosion du fer par H2O:
Le fer est corrodé par l'eau en absence d'oxygène car il est moins noble que
l'hydrogène.
Fe+2H2O Fe (OH) 2 + H2 (1)
Le Fe (OH) 2 élève le pH en formant l'ion OH¯.
2+ –
Fe (OH) 2 Fe +2OH
Ainsi, l'eau pure désaérée attaque lentement le fer à la température
ambiante ( réaction).
Aux températures plus élevées , telles que celles rencontrées dans les
générateurs de vapeur, l'attaque s'accélérerait par l'augmentation de la
dissociation des molécules d'eau (influence de la température), s'il n'y avait
une autre réaction débutant à 100°c et dont l'effet s'oppose au précédent,
puisqu'elle conduit à la formation de magnétite protectrice (réaction 2).
Fe+2H2O Fe (OH) 2+H2 (1)
3 Fe + 4 H2O Fe 3O4 + 4H2 (2)
La première réaction qui résulte de deux mécanismes :
L'une anodique:
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 19 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
2+ -
Fe Fe + 2e
L'autre cathodique:
+ -
2H +2e H2
Est fortement liée au pH, alors que la seconde dépend essentiellement de la
température.
- Corrosion en milieu aéré :
En présence d'oxygène, le mécanisme de corrosion du fer s'effectue plus
rapidement. L'hydroxyde ferreux étant instable en présence d'oxygène, ainsi
on peut avoir la formation d'hydroxyde ferrique.
L'état d'équilibre est rompu et la corrosion se poursuit.
Réactions anodiques :
2+ -
Fe +2OH Fe (OH) 2
4 Fe (OH) 2 + O2 + 2H2O 4 Fe (OH) 3
Réactions cathodiques :
2-
½ O2 +2e- O
2- -
O + H2O 2 OH
- Corrosion du fer par le CO2 :
Lorsque le CO2 est dissout dans l'eau, le pH diminue car la concentration des
+
ions H augmente comme on peut le constater sur la réaction ci-dessous :
CO2 + H2O H2CO3 (acide carbonique)
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 20 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
-
H2CO3 H+ +HCO3 (ion bicarbonate)
- + --
HCO 3 H +CO3 (ion carbonate)
+
H2CO3 accélère la corrosion du fer par l'apport des ions H La réaction pourra
s'écrire :
2 H2CO3 + Fe Fe (HCO3)2 + H2
Fe (HCO3)2 bicarbonate ferreux.
Le bicarbonate ferreux est soluble et agit comme l'oxyde ferreux, c'est à dire il
retarde la corrosion, les bicarbonates sont des bases faibles et augmentent la
valeur du pH de la solution.
2-3 L'équilibre calcocarbonique
Les eaux naturelles contiennent différents éléments chimiques dissous dont le plus
fréquent est le bicarbonate de calcium, or le sel qui risque de précipiter dans l'eau est le
carbonate de calcium et les phénomènes de corrosion sont perturbés par la formation
d'une couche de carbonate de calcium.
Le bicarbonate de calcium est instable en solution aqueuse et peut se décomposer
suivant la réaction réversible.
Ca (HCO3)2 CaCO3 + H2O + CO2
Bicarbonate carbonate gaz carbonique
CO2 semi- combiné CO2 combiné CO2 libre
Pour maintenir en solution une concentration donnée de bicarbonate de calcium, il est
nécessaire d'introduire ou d'avoir une certaine quantité de CO2 libre : dit CO2
"équilibrant" qui fait rétrograder la réaction de précipitation du bicarbonate.
Si le CO2 libre est inférieure au CO2 équilibrant, l'eau est incrustante.
Si le CO2 libre est supérieure au CO2 équilibrant, l'eau est agressive.
On peut déterminer un pH d'équilibre ou pH de saturation (pHs) valable pour une
température donnée quand la teneur en CO2 libre est égale au CO2 équilibrant.
[CO2] [H2O]
H2CO3 H2O +CO2 K1 =
H2CO3
[H+] [HCO3¯ ]
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 21 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
+ -
H2CO3 H + HCO3 K/1 = (1)
[H2CO3 ]
+ --
[H ] [CO3 ]
- + --
HCO 3 H + CO3 K/2 = (2)
-
[HCO 3 ]
2+ --
[Ca ] [CO3 ]
2+ --
CaCO3 Ca + CO3 K/s =
[Ca CO3] = 1
2+ --
K/s = [Ca ] [CO3 ] (3)
K’s
--
A partir de la relation (3) on tire : CO3 =
2+
Ca
et on remplace par sa Valeur dans la relation (2)
+ - 2+
[H ] K’s K/ 2 [HCO3 ] [Ca ]
+
K’2 = [H ] =
- 2+
[HCO3 ] [Ca ] K/s
+ 2+
[H ] = K/2 [HCO 3¯] [Ca ]
K/s
+
Le pH = - log [H ]
- 2+
pH = - log ( K/2 / K/s. [HCO 3 ] [Ca ] )
2+ -
pHS = pK’2 - pK’s – log [ Ca ] - log [HCO3 ]
Relation de LANGELIER
pHs : pH de saturation.
K/ 2 : constante de dissociation des bicarbonates.
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 22 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
K/s : constante de dissociation de carbonate de calcium.
Indice de LANGELIER:
Il permet de connaître le comportement d'une eau vis à vis du carbonate de calcium.
I L = pH – pHs
Si IL ›0 l'eau est entartrante
Si IL‹ 0 l'eau est agressive
Les observations de RYZNAR sur de nombreux circuits industriels lui ont permis
d'établir une formule empirique à partir du pH de saturation de LANGELIER.
Indice de RYZNAR :
Il permet de connaître la tendance entartrante ou corrosive d'une eau vis-à-vis de l'acier
à une température donnée.
I R = 2pHs – pH
Si IR‹6 entartrante.
Si IR›7 corrosive.
Si 6‹ IR ‹ 7 L'eau est sensible à l'équilibre tartre - corrosion
Cet indice de stabilité s'est trouvé vérifié aussi bien pour des eaux naturelles que pour
des eaux industrielles de refroidissement.
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 23 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
3- Epuration physique et chimique de l'eau
3-1 Epuration physique
Le but de l'épuration physique est de réaliser :
- La clarification de l'eau
- Le dégazage physique
La clarification consiste en l'élimination des matières en suspension dans l'eau
d'alimentation. Les matières en suspension peuvent consister en des particules de
grande dimension qui se décantent facilement ; dans ce cas l'équilibre ne demande que
l'utilisation de bassin de décantation ou de filtres, mais plus souvent, elles sont des
particules si petites qu'elles peuvent passer à travers les filtres, on procède donc par
une méthode appelée floculation.
La coagulation est un procède par lequel des impuretés finement divisées et
colloïdales se rassemblent pour former de petites masses qui se décantent rapidement
ou peuvent être filtrées. les particules colloïdales présentent de grandes surfaces, qui
les maintiennent en suspension, elles ont des charges négatives (répulsion), nous
utilisons donc des coagulants (les sels d'aluminium ou de fer) dont le rôle est de
neutraliser les charges négatives et de produire des floculants .
Les floculants résultent soit de l'action sur les bicarbonates contenus dans l'eau, soit de
l'action mutuelle de deux réactifs.
Al2 (SO4)3 +3Ca (HCO3)2 2Al (OH) 3 + 3CaSO4+6CO2
Al2 (SO4)3 +3ca (OH)2 Al (OH)3 + 3CaSO4
3-2 Dégazage
Le but de ce procédé est d'éliminer les gaz corrosifs (CO2, O2) dans l'eau pour cela, il
faut que ce dernier soit porté à ébullition vigoureuse ou lavée par des bulles de gaz
condensables ou porteurs.
Il existe deus types fondamentaux d'unité de dégazages:
- Dégazeurs à pulvérisation ( voir schéma 2 ).
- Dégazeurs à plateaux.
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 24 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 25 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
Les différentes conditions qui seront réalisées dans les deux types de dégazeurs :
- La mise en température rapide de l'eau de façon à diminuer sa viscosité et la
solubilité de l'O2
- De réaliser une grande interface de transfert entre l'eau et la vapeur.
3-3 Epuration chimique
Le but de l'épuration chimique est de faire:
- La précipitation chimique des sels durs.
- L'élimination des substances dissoutes, silice comprise.
- Maintenir un pH (10.5 – 11).
3-3-1Décarbonatation à la chaux
Dans cette technique, les bicarbonates de calcium et de magnésium contenus dans
l'eau précipitent en carbonates de calcium et hydroxydes de magnésium à l'aide de la
chaux.
Ca (HCO3)2 + Ca (OH)2 2 CaCO3 +2H2O
Mg (HCO3)2 +2 Ca (OH) 2 2CaCO3 + Mg (OH) 2+ 2H2O
L'eau traitée ayant un pH entre 9,5 et 10,5.
3-3-2 Décarbonatation sur échangeurs d'ions
Procédé :
Ce procédé permet l'élimination de TAC et de la dureté temporaire, mais conduit à la
formation de quantités importantes de gaz carbonique, nécessitant l'emploi d'un
éliminateur de CO2 ( voir schéma 3).
A la sortie de l'échangeur, l'eau est saturée en oxygène et a un pH acide en début de
cycle. Un adoucissement complémentaire peut retenir la dureté permanente.
Les réaction s‘écrivent :
Ca (HCO3)2 + 2RCOOH (RCOO) 2Ca + 2CO2 + 2H2O
Mg (HCO3)2 + 2RCOOH (RCOO) 2Mg + 2CO2 + 2H2O
NaHCO3 + RCOOH (RCOO)Na + CO2 + H2O
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 26 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
DECARBONATATION SUR ECHANGEUR D’IONS
NaHCO3
Ca(HCO3)2 CO2
Mg(HCO3)2 CaSO4
CaSO4 MgSO4
MgSO4 Na2SO4
CaCl2
NaCl
RH CaCl2
NaCl
MgCl2 MgCl2
R2Ca
RNa
R2Mg
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 27 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
3-3-3 Adoucissement sur échangeurs d'ions
Procédé :
Cette technique s'emploie pour éliminer la dureté des eaux potables et industrielles .Ce
traitement permet d'obtenir une eau débarrassée de sa dureté par transformation de
tous les sels de calcium et de magnésium en sels de sodium.Ce qui permet d'éviter
complètement tout risque d'entartrage.
L'échangeur est régénéré avec des solutions de NaCl (10 à 16% de concentration).
Si l'on attribue à l'échangeur de cations la formule générale RNa, les réactions peuvent
s'écrire:
2R(Na) + CaSO4 R2Ca + Na2SO4
2RNa + CaCl2 R2Ca + 2NaCl
2RNa + CaCO3 R2Ca + Na2CO3
2RNa + MgSO4 R2Mg + Na2SO4
2RNa + Ca (HCO3)2 R2Ca + 2Na(HCO3)
Cycle de traitement ( voir schéma 4 )
3-3-4 Déminéralisation totale
Procédé :
La déminéralisation permet d'obtenir une eau de très grande pureté nécessaire à
l'alimentation de chaudière haute et moyenne pression.
La déminéralisation se pratique par échange d'ions. Les cations et les anions sont
successivement remplacés par les ions hydrogènes et les radicaux hydroxydes.
L'eau passe successivement sur une résine cationique forte (RH) et une résine
anionique (ROH).
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 28 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
Les réactions chimiques qui s’établissent :
Echangeurs de cations:
Ca (HCO3)2 + 2RH R2Ca + 2H2CO3
CaSO4 + 2RH R2Ca + H2SO4
MgCl2 + 2RH R2 Mg + 2HCl
Echangeurs d'anions :
2ROH + H2SO4 R2SO4 +2H2O
2ROH + H2CO3 R2CO3 +2H2O
ROH + HCl RCl + H2O
L'eau ainsi obtenue est à TH et TAC nuls, le pH obtenu est proche de la neutralité.
Par déminéralisation totale, il est possible d'éliminer tous les ions contenus dans l'eau,
y compris la silice et le gaz carbonique, seul l'oxygène n'est pas retenu.
Pouvoir d'échange de la résine :
On appelle pouvoir d'échange ou capacité d'échange, la quantité d'ions contenue dans
un litre d'échangeur d'ions et susceptibles de permuter avec d'autres ions.
Débit de l’eau m3/h
CV = = [h-1]
Volume de la résine m3
CV : charge volumique
Masse du réactif (NaOH ou HCl)
Taux de régénération =
Volume de résine
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 29 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
ADOUCISSEMENT
Eau brute
Na2SO4
CaSO4
NaCl
CaCl2
Eau traitée Na(HCO3)
Ca(HCO3)2
RNa
CaCO3 Eau
MgSO4 adoucie
NaCl TH = 0
R2Ca
R2Mg
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 30 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
DEMINERALISATION TOTALE
Dégazage
Ca(HCO3) eventuel
Mg(HCO3)2
CaSO4 CO2 Eau
MgSO4 H2SO4
RH traitée
CaCl2 HCl R’ OH
MgCl2
Eau brute
R2Ca R’2SO4
R2Mg R’ Cl
R’2CO3
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 31 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
REGENERATION
R2Ca + 2HCl 2RH + CaCl2
R2SO4 + 2NaOH 2ROH + Na2SO4
H2SO4
HCl NaOH
HNO3
R’2SO4
R2Ca RH ROH
R’2CO3
R2Mg R’2Cl
Na2SO4
Na2CO3 vers l’egout
Avec HCl NaCl
Avec H2SO4
CaSO4 CaCl2
MgSO4 OU MgCl2
Na2SO4 NaCl
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 32 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 33 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
3-4 Les différents titres d'une eau et analyse
La dureté totale :
La dureté correspond aux sels de Ca et de Mg dissous dans l'eau sous forme de
cations indépendamment de la nature des anions .
2+ 2+
TH (dureté totale) = THCa + TH Mg
La dureté permanente :
- --
Elle mesure les Cl et les SO4 , mesurée sur une eau débarrassée de ses
bicarbonates par ébullition vers 80°c, nous aurons cette réaction :
Ca (HCO3)2 CaCO3 + H2O + CO2
La dureté temporaire:
-- -
Elle mesure les CO3 et HCO3
THT = THt – THp
Les titres alcalimétriques TA, TAC :
- --
TA : Titre alcalimétrique simple, il mesure la totalité des OH , ½ CO3 et
4-
1/3 PO4 .
L'opération d'analyse consiste en une neutralisation de pH = 9 en présence de
Phenolphtaleine.
-
TAC : Titre alcalimétrique complet, il mesure la totalité des OH , totalité des
-- - 4-
CO3 et HCO3 et 2/3 des PO4 .
L'opération de neutralisation se fait à un pH = 4.4 avec le méthyl orange.
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 34 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
TA et TAC s’exprime suivant les réactions :
Ca (OH) 2+H2SO4 CaSO4+2H2O
TA
2CaCO3+H2SO4 Ca (HCO3)2+CaSO4
TAC Ca(HCO3)2+H2SO4 CaSO4+2CO2+2H2O
Si le pH de l'eau < 4,5 TAC = 0
Si le pH de l'eau < 8,3 TA = 0
- --
Si le pH de l'eau > 8,3 TAC = T [OH ] + T [CO3 ]
Les unités :
Milligramme par litre: Quand on veut exprimer la qualité d'un sel présent dans
une eau, on utilise le g/l ou le mg/l = g/m³ = 1 ppm.
Equivalent gramme : On détermine pour chaque corps et chaque ions, le poids
correspondant à sa valence : c'est l'équivalent gramme
[ eq. /g ]
éq. = Masse moléculaire
Valence
On peut aussi utiliser le milliéquivalent :
1 méq. = 1 éq
1000
Degré français: On utilise très souvent un sous multiple du milliéquivalent,
c'est le degré français (°F)
1°F = 1 milliéquivalent
5
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 35 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
--- CHAPITRE 3 ---
TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 36 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
1- Rappel des différents types de circuits rencontrés
1-1 Circuit ouvert ( un seul passage)
L’eau froide est prélevée dans la rivière, le forage ou le réseau de distribution. Elle
traverse la source chaude ( échangeurs, outils à refroidir…), puis est rejetée soit en
rivière soit à l’égout.
1-2 Circuit fermé
L’eau de refroidissement tourne en circuit intégralement fermé, une source froide par
exemple, un deuxième échangeur eau - eau ou eau - air, étant intercalée sur la boucle
du circuit.
Les pertes en eaux doivent être minimes. En principe il n’y a pas de contact avec l’air.
1-3 Circuit semi-ouvert à recirculation sur réfrigérant atmosphérique
Il y a recirculation de l’eau, mais le refroidissement est assuré par évaporation et
convection au contact de l’air dans la tour de refroidissement et tirage naturel ou forcé.
Ce type de circuit est le plus en plus répondu.
2- Les phénomènes physico-chimiques dans les circuits de réfrigération
2-1 Inconvénients liés aux caractéristiques et ou comportement
de l’eau dans les circuits
L’exploitation d’un circuit de refroidissement est confrontée à 3 types de problèmes qui
sont :
- Les salissures et développements biologiques.
- L’entartrage.
- La corrosion
Ces 3 problèmes interférant souvent entre eux et ont une incidence directe sur le
rendement thermique d’échange, le fonctionnement des appareils à refroidir et la durée
de vie du circuit.
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 37 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
2-2 Salissures et développements biologiques
Il faut entendre par salissures, tous les dépôts solides susceptibles de se former dans
un circuit de réfrigération, à l’exclusion du tartre et des produits de corrosion . En ce qui
concerne leur origine, ces dépôts peuvent provenir :
- De l’eau d’appoint :
Celle-ci peut renfermer des micro-organismes, des matières en suspension et des
matières colloïdales et même des composés solubles qui pourront sous l’effet des
conditions particulières rencontrées dans le circuit (Température, concentration,
aération etc…) donner lieu à des dépôts.
- De l’air atmosphérique :
Le principe même du réfrigérant atmosphérique veut que cet appareil se comporte
comme un laveur d’air ; il en résulte que les différentes poussières véhiculées par l’air
ambiant sont retenues dans l’eau de refroidissement.
- Des fabrications :
Lors de son passage dans les différents appareils à refroidir, l’eau peut se charger de
différentes matières de nature très variable, en relation avec le procédé.
En se plaçant du point de vue de leur nature, on peut citer :
- Les matières en suspension :
Poussières, argile, sable …sont susceptibles de former des dépôts dans les zones de
faible circulation ou de petite section.
- Les matières colloïdales :
Elles coagulent avec l’élévation de température sur les surfaces d’échange en formant
une couche isolante s’opposant à un bon transfert thermique.
Elles sont souvent les principales responsables de l’encrassement des circuits, qu’elles
proviennent de l’eau d’appoint ou de l’air atmosphérique.
Les plus dangereuses sont constituées par les déchets du métabolisme des
organismes vivants, algues et bactéries qui produisent des acides gras fortement
adhérents et absorbants des particules en suspension.
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 38 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
- Les matières organiques :
Un circuit de refroidissement constitue un milieu privilégié pour les développements
biologiques, puisqu’on y trouve à la fois la lumière solaire, l’air et la chaleur. Elles sont
des éléments nutritifs des algues et des bactéries.
- Algues :
Ces sont des organismes végétaux autotrophes, capables de fabriquer leur propre
substance à partir d'éléments minéraux de l’eau. Les algues trouvent un milieu
favorable au niveau de tours de refroidissement (O2, CO2, température
ensoleillement…) et se manifestent par la présence de magmas verdâtres accrochés
sur les parois des bassins. Elles peuvent provoquer des bouchages lorsqu’elles
sont entraînées dans l’eau en circulation.
- Les bactéries :
Ce sont des organismes unicellulaires , se multipliant rapidement par
division binaire dans les circuits de refroidissement, seuls les organismes
aérobies peuvent proliférer.
Elles peuvent provoquer des dépôts qui au microscope se caractérisent
par des amas au sein desquels se meuvent les micro-organismes sous
forme de sphères, bâtonnets, chaînettes…
Elles peuvent être génératrices de slimes, corrosion et acidification.
- Les fuites d’hydrocarbures :
Elles proviennent du process et sont des éléments nutritifs pour les
bactéries. Les salissures minérales et organiques forment des
boues ou ( slimes) que l’on rencontre dans les échangeurs de température avec
un aspect visqueux.
Les inconvénients qui résultent sont :
- L’encrassement au niveau des échangeurs de chaleur , des tuyauteries et des
réfrigérants avec comme conséquence des baisses de débit d’eau et une
réduction de l’efficacité du refroidissement.
- La création de dépôts avec les risques de corrosion.
- La possibilité de corrosion de type biologique.
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 39 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
SALISSURES
Types Problèmes poses
Matières en suspension Dépôts
Poussières Erosion
Argile Surconsommation inhibiteurs.
Sable Corrosion sous dépôts
Oxydes de Fer – battitures
Matières colloïdales Encrassement
Matières organiques Nutriment des algues et bactéries
Algues Bouchage
Bactéries Encrassement (Slimes)
Corrosion
Acidification
Colloïdes
Champignons filamenteux et Dépôts gélatineux
levures Attaque du bois
Fuites d’hydrocarbures Encrassement
Nutriment pour micro organismes
Provenance :
- Eau d’appoint - Micro organisme
- Air environnant - Process ( hydrocarbures)
- Corrosion
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 40 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
2-3 Entartrage
L’entartrage concerne la précipitation cristalline sur les surfaces métalliques, avec
formation d’incrustations adhérentes et dures
Cas du carbonate de calcium :
C’est le premier sel qui risque de précipiter dans l’eau selon la réaction :
Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 + H2O
La formation du CaCO3 est influencée par :
L’élaboration de la température qui a une double action
- Elimination du CO2 au niveau du réfrigérant due à la faible pression partielle du
CO2 dans l’air.
- La concentration des sels dissous ( l’incidence du Ca et du TAC )
Cas du sulfate de Calcium :
La solubilité de ce sel augmente avec la température, passe par un maximum à 40°C
puis diminue. Mais dans un circuit de refroidissement ayant des températures
comprises entre 10°C et 80°C , il n y pas de risque de précipitation de sulfate de
calcium si CaSO4 < 15 000 ( en °F) .
Cas de la silice :
La silice peut se trouver dans les eaux sous formes :
-SiO2 ionisée
-SiO2 colloïdale
-Silico-aluminates de Ca ou Mg
La solubilité de la silice est très faible à bas pH et à température élevée. Les tartes
silicatés sont dures.
Dans les circuits de refroidissement fonctionnant à bas pH ( 6,4 / 7 ) on limite la
concentration en SiO2 totale à 150 ppm pour éviter la formation de tartres.
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 41 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
2-4 Corrosion
a- Généralités
On désigne par corrosion la destruction chimique ou électrochimique d’un métal par le
milieu ambiant. Quand il s’agit de détérioration d’origine physique ou mécanique, on
parle d’usure, d ’ érosion, de cavitation…
La corrosion est liée à un phénomène électrochimique.
b- Mécanisme de la corrosion électrochimique de l’eau
Le fer est thermodynamique instable dans l’eau et ne demande qu’à s’y dissoudre. Il
suffit de la moindre hétérogénéité pour que le fer métal ait tendance à passer de l’état
++
Fe à l’état Fe amorçant une corrosion électrochimique
Dans le cas du fer en contact avec une solution aérée ( comme dans les circuits
comportant des tours de refroidissement) il y a formation de micro-piles avec les
réactions d’oxydo - réduction suivantes :
++ -
- à l’anode : Fe Fe + 2e
- -
- à la cathode : 2 e + ½ O2 + H2O 2OH
Ce mécanisme de la corrosion électrochimique est explicité schématiquement dans la
Fig. 5. Le métal fonctionne comme fournisseur d’électrons et joue le rôle d’anode,
l’oxygène capte les électrons et joue le rôle de cathode. Il y a dissolution du métal à
l’anode , alors que la cathode est protégée.
c- Principaux paramètres influants
Ces différents paramètres peuvent difficilement être considérés isolements, ils varient
rarement de façon indépendante.
- Rôle de l’oxygène :
L’oxygène joue le rôle de cathode comme accepteur d’électrons et être ainsi un facteur
important dans le processus électrochimique.
- Rôle du pH :
Dans les circuits de refroidissement le pH doit être considéré en même temps que
d’autres paramètres ( TAC et Ca).
En présence d’oxygène, il ne contrôle pas directement la corrosion ( les eaux sont à
des pH voisins de la neutralité).
Par contre dans le cas d’eaux acides avec des pH < 4,5 , les risques de corrosion sont
très accrus.
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 42 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
- Rôle de la salinité :
La présence des sels dissous dans l’eau favorise la corrosion car la conductivité de
l’eau se trouve augmentée.
La nature des ions présents joue un rôle, et ce sont les anions représentant la salinité
fixe SAF des eaux qui ont une influence prépondérante ( sulfates, nitrates et chlorures).
- Rôle de la température :
L’élévation de la température accélère la corrosion notamment en augmentant la
mobilité des ions et donc le courant de corrosion.
- Rôle de la vitesse de circulation :
La vitesse recommandée dans les tuyauteries et les échangeurs est de l’ordre de 1m/s.
L’excès de vitesse de l’eau peut occasionner une accentuation du courant de corrosion
de différentes façons :
- Perturbation des couches de protection
- Erosion-abrasion si présence de matières en suspension
- Cavitation.
Une vitesse trop faible peut :
- Faciliter la présence de salissures et de corrosion sous dépôt.
- Empêcher la diffusion des inhibiteurs de corrosion à l’interface métal – eau.
- Rôle des états de surface :
Le processus de corrosion impliquant la formation de piles, toute hétérogénéité favorise
l’apparition d’anodes et de cathodes.
- Contact de métaux différents :
Il y a création de couples électrochimiques, le métal le moins noble devenant anode
susceptible d’être corrodée.
- Rôle du milieu environnant :
(Salissures gaz H2S ; SO2, NH3 …)
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 43 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
2-5 Principaux types de corrosion et causes
Les formes de corrosion sont très nombreuses, il est rare d’avoir affaire à un seul
facteur de corrosion, plusieurs paramètres influants. Nous pouvant distinguer :
a- La corrosion de type uniforme ou généralisé
Elle consiste en une attaque uniforme de la surface du métal, il en résulte un
amincissement du métal.
b- La corrosion de type localisé
Cette corrosion est particulièrement brutale et dangereuse. On distingue :
- Les corrosions par plaques, lorsque les surfaces anodiques sont grandes / surfaces
cathodiques.
- Les corrosions par piqûres, lorsque les surfaces anodiques sont petites / surfaces
cathodiques.
Exemples de corrosions localisées :
a- Oxygène ( formation de pustules).
b- Eaux stagnantes ( corrosion en crevasses).
c- Couples bimétalliques ( galvaniques).
d- Bactéries sulfatoréductrices.
e- Cavitation.
Les problèmes engendrés par la corrosion sont repris schématiquement dans le
tableau :
Amincissement Percement métal Fuites
Corrosion
Echange thermique perturbé
Bouchages
Dépôts d’oxydes Corrosion sous dépôt
Nutriment par bactéries
Surconsommations
Il y a donc perte de rendement de l’unité et diminution de la durée de vie des
installations.
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 44 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
3- Protection contre les salissures et les développements biologiques
Les salissures et les dépôts étaient très préjudiciables pour la qualité de l’échange
thermique et la résistance à la corrosion.
Les moyens d’éliminer ces matières colloïdales s’articulent tous autour du phénomène
de coagulation.
3-1 Action au niveau de l’eau d’appoint
Si l’eau d’appoint est source de salissures, l’on pourra agir suivant son niveau de
pollution par :
- Clarification avec coagulation plus filtration.
- Filtration avec coagulation sur filtre
- Chlorations éventuelles
3-2 Action au niveau du circuit
Plusieurs moyens complémentaires sont possibles :
a- La filtration dérivée avec coagulation éventuelle sur filtre
La filtration d’une fraction du débit ( 5 à 10 % du débit général d’eau recyclée) en
circulation est fortement conseillée car il permet de retenir les matières en suspension
( M.E.S). Le taux de M.E.S se trouve ainsi maintenu à des valeurs inférieures à 5 à
10 mg/l.
Si l’eau est colmatante l’emploi de coagulant en amont du filtre est recommandé pour
coaguler les matières colloïdales contenant dans l’eau et permettre ainsi leur rétention
sur le filtre et donc leur élimination du circuit. en amont du filtre est recommandé
b- L’utilisation de dispersants organiques
Le rôle de ces produits est de maintenir en suspension les particules pour empêcher la
formation de dépôts dans les zones de faible circulation et sur les parois d’échange.
Parmi les produits utilisés :
- Les composés sulfonés
- Les polymères acryliques et leurs dérivés
Ces produits sont très souvent anioniques.
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 45 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
c- L’utilisation de la chloration
Le réactif utilisé est l’hypochlorite de sodium ( eau de Javel ).
Le chlore agit :
- Par son pouvoir oxydant : Il détruit les matières organiques qui sont les
éléments nutritifs des algues et des bactéries. Il a aussi un effet coagulant.
- Par son pouvoir biocide : Il peut détruire l’élément vivant.
d- L’utilisation des biocides
La mise en œuvre d’un traitement préventif avec les moyens précédents permet de
limiter ( 1 à 4 fois / ans) l’utilisation des biocides ( algicides et bactéricides ).
Remarque :
En conclusion, il est préférable d’agir préventivement en insistant sur la propreté de
l’eau et la diminution de son pouvoir colmatant. A cet effet l’utilisation d’un filtre dérivé
avec coagulation éventuelle sur filtre apporte une solution à la fois efficace, économique
et écologique.
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 46 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
4- Protection contre les risques d’entartrage et de corrosion
4-1 Rappels sur l’équilibre calcocarbonique et sur l’indice de RYZNAR
Les observations de RYZNAR de nombreux circuits industriels lui ont permis d’établir
une formule empirique à partir de pH de saturation de LANGELIER.
IR = 2pHS - pH
L’indice de RYZNAR permet de connaître la tendance entartrante ou corrosive d’une
eau vis à vis de l’acier à une température donnée :
-Si IR < 6 l’eau à une tendance entartrante
-Si IR > 6,5 l’eau à une tendance corrosive
-Si IR < 6,2 l’eau est sensible à l’équilibre tartre-corrosion
-pHS est le pH de saturation calculé à l’aide d’une abaque à l’aide des valeurs :
-Ca
-TAC
-Salinité totale
-Température
- pH est le pH de l’eau mesuré à la température d’environ 20°C.
Remarque :
Cet indice peut être applicable que si l’eau contient une teneur minimale en O2 ( environ
3
5 g/m ) sans oxygène dissous, la couche protectrice ne se forme pas.
Cet indice de stabilité s’est trouvé vérifié aussi bien pour des eaux naturelles que pour
des eaux industrielles de refroidissement.
Il donne une tendance générale de l’eau. Mais il ne rend pas compte de l’influence de
- -
certains paramètres importants comme les ions Cl , NO3 , NH3 et pollutions
diverses…
4-2 Procédé d’équilibre naturel
Ce procédé consiste à régler, conformément à l’indice de RYZNAR, Les pH, TH et TAC
de l’eau en circulation de façon à ce qu’elle soit à l’équilibre tartre- corrosion.
Ce procédé est simple, mais il présente des limites importantes, en particulier :
- L’eau se trouve en état d’équilibre instable : Les seuls passages au
réfrigérant atmosphérique peut abaisser sensiblement le pH ( absorption du
CO2 de l’air ).
- Il existe un équilibre de l’eau pour chaque température alors que, dans un
circuit de refroidissement, la température de l’eau varie constamment.
Suivant le réglage, on observe ou bien des corrosions aux points froids, ou un
tartre trop important aux points chauds
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 47 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
Ce procédé est appliqué dans certains circuits de centrales fonctionnant pratiquement
en circuits ouverts ( très faibles concentrations) avec des ∆t faibles.
4-3 Procédé inhibiteur d’entartrages ou de stabilisation
Il constitue une amélioration du procédé précédent ; il s’adresse à des eaux à tendance
entartrante, il constitue à introduire dans le circuit des produits chimiques qui retardent
la précipitation du carbonate de calcium aux points chauds.
Ces produits permettent d’élargir la place d’équilibre en autorisant un fonctionnement
avec des indices de RYZNAR qui peuvent descendre jusqu’à 4 et dans certains cas
inférieurs à 4.
Les trois principales familles de base sont :
Les polyphosphates : avec pour caractéristiques principales
- Liaisons P –- O –- P de structure
o
Na O P O Na
O n
Na
- Stabilisation moyenne à la température
- Compatibilité avec les chlorations.
Les phosphates organiques : ( Phosphonates)
Avec pour principales caractéristiques :
- Liaison P –- C –- P ou P –-C –- N –- C–- P …, de structure
–- C –- P –- O –- R2
R1
- Bonne stabilité à la température ( essai > 200 °C ).
- Stabilité moyenne au chlore.
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 48 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
Les polymères organiques : (acryliques)
Avec pour principales caractéristiques :
-Anioniques : Exemple polyacrylates
–- CH2 –-CH –- CH2 –- CH –- CH2 –- CH –-
COOH COOH COOH
3
-Bas poids moléculaires ( environ 10 )
-Bonne stabilité à la température
-Bonne stabilité au chlore
Remarque :
Chaque famille peut comporter des produits plus spécifiques au niveau inhibition au
regard des différents sels CaCO3 et CaSO4 , phosphate tricalcique.
4-4 Avantages et limites des procédés retardateurs de précipitation
Les procédés de stabilisation avec inhibiteurs d’entartrage conduisent à un contrôle de
la formation de la couche protectrice de carbonate de calcium. L’efficacité des produits
anti tartres- dispersants permet d’éviter les dépôts parasites. Mais le film protecteur de
carbonate de calcium peut être très sensible aux variations des paramètres du circuit
( SAF, acidité, panne de réactifs…)
Les risques de corrosion sont limités par le caractère entartrant et le pH de l’eau, mais
le rôle du SAF est prépondérant, les chlorures et les sulfates accélèrent la
dépassivation des films protecteurs, provoquent des complications et accroissent la
conductivité et le courant de corrosion
Il faut rappeler qu’en pH alcalin la lutte contre les développements biologiques doit être
particulièrement étudiée en tenant compte de l’efficacité biocide réduite du chlore au
pH > 8
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 49 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
5- Procédés inhibiteurs de corrosion (à pH contrôlé )
5-1 Principe
Par opposition aux deux premiers types de procédés de protection, ceux-ci
consistent :
- D’une part à placer l’eau du côté corrosif de son équilibre carbonique avec pH
6,5 à 7 ; ainsi il ne peut plus se former de tartre CaCO3.
- D’autre part à introduire dans le circuit un inhibiteur qui s’oppose à la corrosion
par formation d’un film protecteur adhérent , homogène non poreux et ne
perturbant par l’échange thermique.
La plupart de ces inhibiteurs sont à base de composition binaires permettant de bloquer
simultanément les anodes et les cathodes de corrosion. Ils agissent directement sur les
phénomènes électrochimiques de corrosion.
La présence d’un minimum de dureté calcique est en général souhaitable pour favoriser
la formation de la couche protectrice.
5-2 Principales familles d’inhibiteurs de corrosion
Il existe trois familles de base
- Les chromates – Zinc :
Les chromates utilisés seuls sont des inhibiteurs anodiques. Il y a risque de piqûres en
sous-dosage. Dans l’association d’ions Zinc aux chromates, on constate une disparition
des piqûres. Le pH optima d’efficacité se situe au-dessous de 7.
- Les polyphosphates – Zinc :
Les polyphosphates seuls n’inhibent que partiellement la corrosion. L’emploi des
++
polyphosphates alcalins associés à l’ion Zn présente un effet synergétique. Le pH de
travail se situe entre 6 et 7.
- Les organophosphates – Zinc :
L’ion zinc joue ici le rôle d’inhibiteur cathodique et l’organophosphate sert à empêcher
principalement l’entartrage. Ces inhibiteurs sont efficaces à des pH compris entre 7 et 8
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 50 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
5-3 Obtention du pH optimal
L’alcalinité ( TAC ) de l’eau d’appoint doit être réduite pour que le pH de l’eau du circuit
se situe dans la plage voulue. Trois moyens peuvent être utilisés pour satisfaire à cette
condition.
5-3-1 Addition d’acide
L’acide sulfurique est le plus utilisé car moins coûteux et plus facile à mettre en œuvre :
Ca(HCO3)2 + H2SO4 CaSO4 + 2CO2 + 2H2O
3
Il faut 10 g d’ H2SO4 à 66° Bé par m d’eau pour réduire son TAC de 1° F.
En cas d’utilisation d’acide chlorhydrique, nous avons :
Ca(HCO3)2 + 2HCl CaCl2 + 2CO2 + 2H2O
3
Il faut 20 g d’HCl à 22° Bé par m d’eau pour réduire son TAC de 1° F. L’injection
s’effectue dans le circuit lui-même , Mais elle entraîne un accroissement de la salinité et
l’augmentation de la corrosivité de l’eau.
5-3-2 Decarbonatation sur résine carboxylique
Elle permet de diminuer à la fois le TAC et la dureté de l’eau et donc sa salinité sans
introduire de nouveaux sels, suivant les réactions principales :
R – COOH + Na HCO3 RCOONa + CO2 + H2O
R – COO
2R – COOCa(HCO3)2 Ca + 2CO2 + H2O
R – COO
Il s’agit d’une permutation sélective intéressant la partie bicarbonatée de l’eau. Il suffit
de chasse ensuite le CO2 libéré. Lorsque la résine est saturée, elle est régénérée à
l’acide
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 51 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
5-3-3 Decarbonatation à la chaux
Elle permet d’associer dans un même décanteur un traitement de décarbonatation -
adoucissement partiel avec diminution du TAC et du pH et une Clarification-
coagulation avec élimination des matières ( en suspension, organiques et colloïdales).
Les réactions principales s’écrivent :
Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 2CaCO3 + 2H2O
Mg(HCO3)2 + 2Ca(OH)2 2CaCO3 + Mg(OH)2 +2H2O
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 52 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
6- Mise en œuvre de la protection
Il faut insister tout particulièrement sur l’importance de la phase de démarrage : dés que
l’acier est mis en contact avec l’eau, des phénomènes de corrosion irréversibles
peuvent se produire. Il faut donc pratiquer le conditionnement dès la mise en eau du
circuit, en prévoyant les étapes suivantes :
Nettoyage des produits dispersants et détergents
Formation de la couche protectrice avec des dosages renforcés d’inhibiteurs
Entretien de la protection avec un groupe de dosage asservi au débit d’eau
d’appoint.
7- Contrôles
Il est indispensable d’effectuer des contrôles pour s’assurer de la bonne application et
de l’efficacité du conditionnement. Ils porteront principalement sur :
Les consommations en eau et en réactifs
Le fonctionnement des postes d’épuration d’eau et d’injection de réactifs
Les analyses d’eau (appoint et circuit) et en particulier : pH, TAC, Ca, Cl teneur
en inhibiteur
Mesures de la corrosion :
Corrosivimètres
Eprouvettes – Tests
Manchettes – Témoins
Qualité de l’échange thermique.
8- Cas des circuits de refroidissement fermés
8-1 Lutte contre les salissures et l’entartrage
Remplissage en eau noble ( adoucie ou déminéralisée ).
8-2 Lutte contre les risques de corrosion
Procédés inhibiteurs de corrosion
En milieu alcalin avec :
Chromates forte teneur + sel tampon
Nitriles forte teneur + sel tampon
Molybdates
Procédés type réducteurs d’oxygène :
Réducteur d’oxygène ( sulfite, hydrazine)
Elément alcalin ( phosphate trisodique, amine)
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 53 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
9- Rejets
Très souvent les purges ne peuvent être totalement supprimées et pose un problème.
-3
Le rejet d’eaux chromatée est interdit, en général au-delà de 0,1 m en Cr V1; mais
on dispose de procédés industriels éprouvés et relativement peu coûteux pour détruire
et éliminer ces Chromates ; le zinc peut être éliminé simultanément.
Les teneurs habituellement requises dans les circuits en phosphates ( PO4 < 25 mg/l et
Zn < 5mg/l sont en général autorisées dans les rejets.
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 54 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
--- ANNEXE ---
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 55 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 56 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 57 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 58 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
TABLE DES MATIERES
Avant - propos 2
- CHAPITRE 1 –
NOTIONS DE CHIMIE RELATIVES AU TRAITEMENT DES EAUX
1- Cycle de l’eau 4
2- La qualité des eaux de précipitation 5
3- Propriétés physico-chimiques. 5
...
3-1 composition et structure de la molécule de l’eau. 5
3-2 Etats physiques. 6
3-3 Propriété physique de l’eau. 6
a- Température d’ébullition. 6
b- Masse volumique et volume massique. 6
c- Tension superficielle. 7
d- Propriété électriques. 7
e- Viscosité. 7
f- Propriétés optiques. 7
g- Potentiel chimique [ pH ]. 8
4- Propriétés chimiques de l’eau. 9
a- Généralité 9
b- Solutions 9
c- Solubilité. 9
5- Composition des eaux naturelles. 11
5-1 Les corps dissous. 11
a- Sels minéraux. 11
5-2 Les micro-organismes. 11
a- Les algues. 12
b- Les champignons. 12
c- Les bactéries. 13
5-3 Les gaz dissous 13
a- De la pression. 13
b- De la température. 13
c- Du coefficient de solubilité du gaz à la température considérée. 13
15
6- Unités de mesure.
7- Définitions. 16
- CHAPITRE 2 -
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 59 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
TRAITEMENT DE BASE DES EAUX
1- Nature des impuretés de l’eau 18
1-1 Les matières en suspension 18
1-2 Les matières en solution 18
1-3 Les problèmes dus au impuretés de l’eau 18
2 Techniques de conditionnement 19
2-1 Entartrage 19
2-2 Corrosion 19
2-3 Equilibre calcocarbonique 21
3- Epuration physique et chimique de l’eau 24
3-1 Epuration physique 24
3-2 Dégazage 24
3-3 Epuration chimique 32
3-3-1 Décarbonatation à la chaux 26
3-3-2 Décarbonatation sur échangeurs d’ions 26
3-3-3 Adoucissement sur échangeurs d’ions 28
3-3-4 Déminéralisation totale 28
3-4 Les differents titres d’une eau et analyse 34
- CHAPITRE 3 -
LE CONDITIONNEMENT DE L’EAU DES CIRCUITS
DE REFROIDISSEMENT
1- Rappel des différents types de circuits rencontrés. 37
1-1 Circuit ouvert. 37
1-2 Circuit fermé. 37
1-3 Circuit semi – ouvert. 37
2- Les phénomènes physico - chimiques dans les circuits de réfrigération. 37
2-1 Inconvénients lié aux caractéristiques et ou comportement
de l’eau dans les circuits. 47
2-2 Salissures et développements biologiques. 38
2-3 Entartrage. 41
2-4 Corrosion. 42
a- Généralités. 42
b- Mécanisme de la corrosion électrochimique de l’eau. 42
c- Principaux paramètres influants. 42
2-5 Principaux types de corrosion et causes. 44
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 60 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
3- Protection contre les salissures et les développements biologiques. 45
3-1 Action au niveau de l’eau d’appoint. 45
3-2 Action au niveau du circuit. 45
4- Protection contre les risques d’entartrage et de corrosion. 47
4-1 Rappels sur l’équilibre calcocarbonique et sur l’indice de RYZNAR...47
4-2 Procédé d’équilibre naturel. 47
4-3 Procédé inhibiteur d’entartrage ou de stabilisation. 48
4-4 Avantages et limites des procédés retardateurs de précipitation. 49
………….
5- Procédé inhibiteur de corrosion ( à pH contrôlé ). 50
5-1 Principe. 50
5-2 Principales familles d’inhibiteurs de corrosion. 50
5-3 Obtention du pH optimal. 51
5-3-1 Addition d’acide 51
5-3-2 Décarbonatation sur résine carboxylique. 51
5-3-3 Décarbonatation à la chaux. 52
6- Mise en œuvre de la protection. 53
7- Contrôles. 53
8- Cas des circuits de refroidissement fermés. 53
8-1 Lutte contre les salissures et l’entartrage. 53
8-2 Lutte contre les risques de corrosion. 53
…………
9- Rejets. 54
- ANNEXE -
Figure 1 Circuit ouvert 56
Figure 2 Circuit fermé de moteur 56
Figure 3 Principe du circuit avec réfrigérant atmosphérique
Schéma type. 57
Figure 4 Dimensions de diverses particules 58
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 61 -
SONATRACH/IAP SKIKDA TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES
EAUX DES TOURS DE REFRIGERATION
SH/IAP SKIKDA FORMATION
- 62 -
Vous aimerez peut-être aussi
- Introduction À La Philosophie by Jaspers, Karl Hersch, Jeanne (Jaspers, Karl Hersch, Jeanne)Document150 pagesIntroduction À La Philosophie by Jaspers, Karl Hersch, Jeanne (Jaspers, Karl Hersch, Jeanne)Jecrismonlivre mbm67% (3)
- Rapport de Stage AMDEC A3 FLEXDocument76 pagesRapport de Stage AMDEC A3 FLEXManar Chikhi100% (5)
- L'Âge Des Cendres-03-Brûlons DemainDocument100 pagesL'Âge Des Cendres-03-Brûlons DemainVirakocha RG100% (1)
- Les Traitements de L Eau Pour L Ingenieur Procedes Physico Chimiques Et Biologiques Cours Et Proble - SommaireDocument4 pagesLes Traitements de L Eau Pour L Ingenieur Procedes Physico Chimiques Et Biologiques Cours Et Proble - SommaireZEMMOURIPas encore d'évaluation
- Encrassement Des Équipements ThermiquesDocument90 pagesEncrassement Des Équipements ThermiquesSarra BÉCHIRIPas encore d'évaluation
- Encrassement Des Équipements ThermiquesDocument90 pagesEncrassement Des Équipements ThermiquesSarra BÉCHIRIPas encore d'évaluation
- Séance11 Réacteurs Industriels 20-21Document50 pagesSéance11 Réacteurs Industriels 20-2105-BENHAIBA WAFAEPas encore d'évaluation
- La PervaporationDocument7 pagesLa Pervaporationguiguimol100% (1)
- Rapport ONEE-branche EauDocument43 pagesRapport ONEE-branche EauFatima Ezzahraa El JebbariPas encore d'évaluation
- Manuscrit These-Gueye Version FinaleDocument229 pagesManuscrit These-Gueye Version Finaledhouha100% (1)
- Procede Electrochimiques de Dessalement de L'eau de MerDocument13 pagesProcede Electrochimiques de Dessalement de L'eau de Merel mountassir abdellatifPas encore d'évaluation
- Separation de Melange Par Extraction Liquide-LiquideDocument27 pagesSeparation de Melange Par Extraction Liquide-Liquide0000 7Pas encore d'évaluation
- Traitement Et Conditionnement Des Eaux de Process - 111438Document33 pagesTraitement Et Conditionnement Des Eaux de Process - 111438Aisaoua BuobouPas encore d'évaluation
- Chapitre 5 Bilan Matière Bilans Energies C I R2mv-AcqDocument31 pagesChapitre 5 Bilan Matière Bilans Energies C I R2mv-AcqWiame NaimPas encore d'évaluation
- Distillation. Absorption - Contrôle Et RégulationDocument20 pagesDistillation. Absorption - Contrôle Et Régulationdahmani inesPas encore d'évaluation
- Introduction (1) HHHDocument8 pagesIntroduction (1) HHHMerraXes DNPas encore d'évaluation
- Craquage Catalytique PDFDocument15 pagesCraquage Catalytique PDFRaa Nia100% (1)
- GP-L03.Génie Des Procédés - Mme.RAHMANI - Rachida.Cours01.Bilan de Matiere.s06Document10 pagesGP-L03.Génie Des Procédés - Mme.RAHMANI - Rachida.Cours01.Bilan de Matiere.s06Kam KamPas encore d'évaluation
- 2 Presentation Colonnes 05 06Document61 pages2 Presentation Colonnes 05 06Carlos Alberto Torrico Borja100% (1)
- sortieSTEP 6Document15 pagessortieSTEP 6Chaimae MAPas encore d'évaluation
- Descriptif Du MS BlockDocument32 pagesDescriptif Du MS BlockDounia MessifPas encore d'évaluation
- Intro HydratesDocument58 pagesIntro HydratesAyoub Magroud0% (1)
- DOCUMENT RAFFINAGE BTS ReviséDocument55 pagesDOCUMENT RAFFINAGE BTS ReviséBerenice boniPas encore d'évaluation
- République Algérienne Démocratique Et PopulaireDocument117 pagesRépublique Algérienne Démocratique Et PopulairekpmabioticPas encore d'évaluation
- Internes de ColonnesDocument105 pagesInternes de ColonnesyahiPas encore d'évaluation
- TP 2 Désinfection de L'eau: Faculté de Génie Mécanique Et Génie Des Procédés Master 1 Génie de L'environnementDocument5 pagesTP 2 Désinfection de L'eau: Faculté de Génie Mécanique Et Génie Des Procédés Master 1 Génie de L'environnementAhmed BluesPas encore d'évaluation
- Raffinage Et Petrochimie Cours Et ExercicesDocument43 pagesRaffinage Et Petrochimie Cours Et ExercicesAssia BenhouriaPas encore d'évaluation
- Operations Unitaires - La - FiltrationDocument40 pagesOperations Unitaires - La - FiltrationharonaPas encore d'évaluation
- DESHYDRATIONDocument17 pagesDESHYDRATIONفتحيPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage El Bayadh 1Document29 pagesRapport de Stage El Bayadh 1amel amoulPas encore d'évaluation
- Thèse BOUKEZOULA Tayeb Fakhreddine 21-01-2019 PDFDocument154 pagesThèse BOUKEZOULA Tayeb Fakhreddine 21-01-2019 PDFzendaoui aminePas encore d'évaluation
- Mémoires Fin Génie Des ProcédésDocument2 pagesMémoires Fin Génie Des ProcédésAimen D BouzidPas encore d'évaluation
- Expo Traitement Des Eaux S4elon MRJDocument14 pagesExpo Traitement Des Eaux S4elon MRJKouame ArthurPas encore d'évaluation
- IngénieurDocument18 pagesIngénieurnacir triguiPas encore d'évaluation
- Cours CAODocument91 pagesCours CAOcamélia La100% (1)
- TP Extrait SecDocument2 pagesTP Extrait SecMohamed Mohammedi100% (1)
- Synthèse de MéthanolDocument245 pagesSynthèse de MéthanolBessalah MohammedPas encore d'évaluation
- Perspectives de Valorisation Agricole Et Energetique Des Boues Issues Des STEP en Algerie-2Document49 pagesPerspectives de Valorisation Agricole Et Energetique Des Boues Issues Des STEP en Algerie-2عبدو احمدPas encore d'évaluation
- EmmanuelleDocument256 pagesEmmanuelleAimen D BouzidPas encore d'évaluation
- Document TP Extraction Eau-Aac-AeDocument9 pagesDocument TP Extraction Eau-Aac-AeTb AkramPas encore d'évaluation
- Exposé Stage D'embocheDocument46 pagesExposé Stage D'embochelopir120100% (2)
- Henada Sihem Hemaidia Nouha PDFDocument81 pagesHenada Sihem Hemaidia Nouha PDFطيف غريبPas encore d'évaluation
- Traitement Des EauxDocument99 pagesTraitement Des EauxalainPas encore d'évaluation
- TP 1 Eau de Mer DistillationDocument1 pageTP 1 Eau de Mer Distillationazou korba100% (1)
- 4 - PrimageDocument5 pages4 - PrimageilyesPas encore d'évaluation
- TP GDRDocument11 pagesTP GDRLAGP18 Grp03Pas encore d'évaluation
- PREsontation de Production de L'ethanol ÉDocument12 pagesPREsontation de Production de L'ethanol ÉMohamed EL FAKIRIPas encore d'évaluation
- Préparation Des Charbons Actifs À Partir de La Biomasse - Application Dans Le Traitement Des Eaux Usées - ZERRAD AmineDocument49 pagesPréparation Des Charbons Actifs À Partir de La Biomasse - Application Dans Le Traitement Des Eaux Usées - ZERRAD AmineHajar BaraPas encore d'évaluation
- TP MGC 131 N°2Document2 pagesTP MGC 131 N°2Ikram BenPas encore d'évaluation
- HyyyDocument74 pagesHyyytoujeni hamzaPas encore d'évaluation
- TP GR 1 Trinome N°7Document14 pagesTP GR 1 Trinome N°7Mohamed TaanePas encore d'évaluation
- Tox Proc Colonnes Garnissage V0 PDFDocument15 pagesTox Proc Colonnes Garnissage V0 PDFTino KhamphasithPas encore d'évaluation
- AbsorptionDocument14 pagesAbsorptionAmeni mokhtariPas encore d'évaluation
- Listes Des FiguresDocument1 pageListes Des FiguresKrim Issam EddinePas encore d'évaluation
- INGEAU - COURS - Le Traitement Des Eaux UséesDocument24 pagesINGEAU - COURS - Le Traitement Des Eaux UséesBOUSABOUNE MeryemPas encore d'évaluation
- Document 1Document10 pagesDocument 1Honnoré christian souleyPas encore d'évaluation
- La Désinfection Des Eaux Usées-DéverrouilléDocument11 pagesLa Désinfection Des Eaux Usées-DéverrouilléChaoubi YoussefPas encore d'évaluation
- Stage de Initiation BERG NadouuuuuDocument30 pagesStage de Initiation BERG NadouuuuuBargui NadaPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage Step HoceimaDocument22 pagesRapport de Stage Step HoceimaIbtissam AfkirPas encore d'évaluation
- Memoire PUBdéparaffinage ConvertiDocument42 pagesMemoire PUBdéparaffinage Convertimeriem mahidaPas encore d'évaluation
- Charbon 2Document73 pagesCharbon 2fatimaezzahra.ahssiniPas encore d'évaluation
- Traitement Des Essences Aromatiques Pour La Pétrochimie: Réf.: J5920 V3Document21 pagesTraitement Des Essences Aromatiques Pour La Pétrochimie: Réf.: J5920 V3Joulia FezzaniPas encore d'évaluation
- Memotec 17Document2 pagesMemotec 17Amine Jebli100% (1)
- Réalisation D'un Mini Laboratoire Interactif de Calcul Du Gisement Solaire Sous MATLAB (Logiciel GUI)Document109 pagesRéalisation D'un Mini Laboratoire Interactif de Calcul Du Gisement Solaire Sous MATLAB (Logiciel GUI)Sarra BÉCHIRIPas encore d'évaluation
- Étude Des Harmoniques Et Techniques Réparé2018Document123 pagesÉtude Des Harmoniques Et Techniques Réparé2018Sarra BÉCHIRIPas encore d'évaluation
- Essais NormalisésDocument79 pagesEssais NormalisésSarra BÉCHIRIPas encore d'évaluation
- Séparation 01Document33 pagesSéparation 01Sarra BÉCHIRIPas encore d'évaluation
- Séminaire Risque ÉlectriqueDocument98 pagesSéminaire Risque ÉlectriqueSarra BÉCHIRIPas encore d'évaluation
- Généralités RaffinageDocument111 pagesGénéralités RaffinageSarra BÉCHIRIPas encore d'évaluation
- Seminaire Regulation 4-8 Mars 2006 - FinalDocument68 pagesSeminaire Regulation 4-8 Mars 2006 - FinalSarra BÉCHIRIPas encore d'évaluation
- Heat Exchangers3Document91 pagesHeat Exchangers3Sarra BÉCHIRIPas encore d'évaluation
- CH17 - Pompe Centrifuge ÉquilibrageDocument57 pagesCH17 - Pompe Centrifuge ÉquilibrageSarra BÉCHIRI100% (2)
- Séminaire Fours & Chaudieres (2006)Document79 pagesSéminaire Fours & Chaudieres (2006)Sarra BÉCHIRI100% (1)
- Dudgeonnage 2006Document66 pagesDudgeonnage 2006Sarra BÉCHIRI100% (1)
- Turbine À Vapeur 2006Document59 pagesTurbine À Vapeur 2006Sarra BÉCHIRIPas encore d'évaluation
- CH11 - Pompe Centrifuge ClassificationDocument47 pagesCH11 - Pompe Centrifuge ClassificationSarra BÉCHIRI100% (1)
- Support Initiation À La Programmation MATLAB Partie 01-PDocument18 pagesSupport Initiation À La Programmation MATLAB Partie 01-PSarra BÉCHIRIPas encore d'évaluation
- AGRODIVDocument2 pagesAGRODIVSarra BÉCHIRI100% (1)
- CH13 - Pompe Centrifuge Poussées HydrauliqueDocument25 pagesCH13 - Pompe Centrifuge Poussées HydrauliqueSarra BÉCHIRI100% (2)
- Support Initiation À La Programmation MATLAB Partie 01-PDocument18 pagesSupport Initiation À La Programmation MATLAB Partie 01-PSarra BÉCHIRIPas encore d'évaluation
- Exemples TpsDocument20 pagesExemples TpsSarra BÉCHIRIPas encore d'évaluation
- Echangeurs de ChaleurDocument53 pagesEchangeurs de ChaleurSarra BÉCHIRI100% (1)
- Capteurs PDFDocument78 pagesCapteurs PDFSarra BÉCHIRIPas encore d'évaluation
- FeuilleExamenLPISIL Info 2014Document4 pagesFeuilleExamenLPISIL Info 2014AbdelMohaiminePas encore d'évaluation
- PFE Etude D'optimisation Des Logements Sociaux PDFDocument112 pagesPFE Etude D'optimisation Des Logements Sociaux PDFyassine EssoufiPas encore d'évaluation
- Monologue Suivi - L'ado Fume en CachetteDocument3 pagesMonologue Suivi - L'ado Fume en CachetteNguyễn Thu HằngPas encore d'évaluation
- Fiche de Revision Ecm Geo Litt Bac AbcdDocument33 pagesFiche de Revision Ecm Geo Litt Bac AbcdEldin KamgaPas encore d'évaluation
- Cours de Géodynamique InterneDocument44 pagesCours de Géodynamique InterneLaeticiaPas encore d'évaluation
- Cahier de Vacances Gratuit à Imprimer Cm2 Vers La 6à Me JuilletDocument53 pagesCahier de Vacances Gratuit à Imprimer Cm2 Vers La 6à Me JuilletRakotondrafaraPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage PratiqueDocument6 pagesRapport de Stage PratiqueNidal ChiebPas encore d'évaluation
- NFDVKSJRSDDocument4 pagesNFDVKSJRSDAmjed LaritPas encore d'évaluation
- 6e - Me Chapitre IIDocument79 pages6e - Me Chapitre IIh8gsmgkn9bPas encore d'évaluation
- Devoir de Contrôle N°1 - SVT - Bac Math (2010-2011) MR SahmimDocument3 pagesDevoir de Contrôle N°1 - SVT - Bac Math (2010-2011) MR SahmimamineabidiPas encore d'évaluation
- TP 2 BiochimieDocument12 pagesTP 2 BiochimieNihal Krika100% (1)
- CertificateSAFERNF510S Diam4,0 (371218607)Document1 pageCertificateSAFERNF510S Diam4,0 (371218607)gst ajahPas encore d'évaluation
- T 22 FonctionsDocument5 pagesT 22 FonctionsidPas encore d'évaluation
- Seance01TP PratiqueInformatiqueDocument31 pagesSeance01TP PratiqueInformatiqueWilfreed MINFOUNDIPas encore d'évaluation
- TP TD-LPC 2021Document32 pagesTP TD-LPC 2021Ayman SouhaibPas encore d'évaluation
- Agricult Etude NECTAR PDFDocument170 pagesAgricult Etude NECTAR PDFKoffi Richmond KONGOPas encore d'évaluation
- Land Cruiser 150 - 5 Portes - Diesel 177ch - BVM 6 Rapports Finition LoungeDocument14 pagesLand Cruiser 150 - 5 Portes - Diesel 177ch - BVM 6 Rapports Finition Lounge788Pas encore d'évaluation
- Bug BountyDocument13 pagesBug BountyTOULASSI-ANANI Yves LoloPas encore d'évaluation
- TRANSPORTDocument8 pagesTRANSPORTBerami BeniPas encore d'évaluation
- Gaine Technique GazDocument8 pagesGaine Technique GazmohabentrPas encore d'évaluation
- 1-Présentation E1 Et E2 - M - CALGARO PDFDocument100 pages1-Présentation E1 Et E2 - M - CALGARO PDFbrahim_mdPas encore d'évaluation
- Capture D'écran . 2024-04-02 À 16.52.39Document35 pagesCapture D'écran . 2024-04-02 À 16.52.39mnkwayep86Pas encore d'évaluation
- Fwi Catalogue 2016 enDocument110 pagesFwi Catalogue 2016 enIgnacio Francisco Suazo MezaPas encore d'évaluation
- CH6 - Les Equipements D'un Réseau LocalDocument5 pagesCH6 - Les Equipements D'un Réseau Localabdoulayecoulibaly4141Pas encore d'évaluation
- Icaiit2014 Benomar IiDocument6 pagesIcaiit2014 Benomar IiBenomar AminePas encore d'évaluation
- Examens National 2bac STM Sci Ingen 2010 N PDFDocument20 pagesExamens National 2bac STM Sci Ingen 2010 N PDFHanane TounsiPas encore d'évaluation
- Avis Technique - Syst Me Lucem Choc v3Document15 pagesAvis Technique - Syst Me Lucem Choc v3NabilPas encore d'évaluation