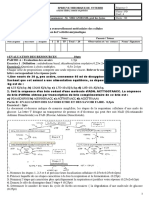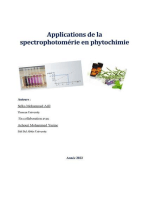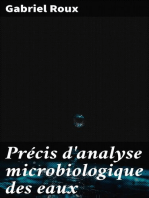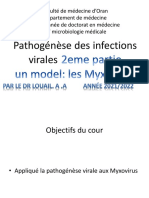Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
At Traitements Thermiques Du Lait
At Traitements Thermiques Du Lait
Transféré par
FATMA YOUCEFITitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
At Traitements Thermiques Du Lait
At Traitements Thermiques Du Lait
Transféré par
FATMA YOUCEFIDroits d'auteur :
Formats disponibles
T BTK
AT de biotechnologies
Contrôles des traitements thermiques du lait
L’objectif de la séance est de réaliser une pasteurisation du lait avec différents protocoles de
chauffage. Au cours du chauffage des prélèvements seront réalisés à différents temps pour
suivre l’efficacité du traitement. On réalisera :
-un contrôle direct de la pasteurisation, par numération des germes totaux au cours du
temps.
à la fin de la pasteurisation, on étudiera la cinétique de décroissance des germes afin de
proposer un barème de pasteurisation temps / température efficace pour chaque protocole.
-un contrôle indirect de la pasteurisation :
La phosphatase alcaline est une enzyme naturellement présente dans le lait non thermisé.
Lorsque le lait est chauffé suffisamment, la phosphatase alcaline est progressivement
dénaturée, donc devient inactive. En conséquence, si la pasteurisation d’un lait a été réalisée
correctement, on ne doit donc pas pouvoir mesurer dans ce lait une activité PAL significative.
La détermination de l’activité phosphatasique permet donc indirectement de
savoir si la pasteurisation a été réalisée correctement.
I-Contrôle direct de la pasteurisation d’un lait cru
1-Réalisation de la pasteurisation (jour 1)
On dispose d’un lait cru dont la contamination bactérienne est estimée à environ 106
bactéries / mL. On réalisera 3 essais de pasteurisation :
-50°C / 30 min (quadrinôme 1),
-60°C / 30 min (quadrinôme 2),
-70°C / 30 min (quadrinôme 3).
La pasteurisation sera réalisée en incubant un flacon en verre à large ouverture contenant
50 mL de lait à traiter dans un bain Marie préalablement réglé à la température de l’étude.
Mode opératoire :
Lorsque la température est correctement réglée dans le bain Marie :
Par quadrinôme :
-introduire le flacon de lait à pasteuriser, et laisser pré-incuber maximum 1 minute,
-déclencher le chronomètre à t=0,
Puis pour chaque binôme :
-en condition aseptique, réaliser immédiatement à t=0, un premier prélèvement de lait de 1
mL, qui sera immédiatement introduit dans un tube d’eau physiologique stérile de 9 mL.
ce tube représente la première dilution décimale du lait traité.
Documents de travail – Lycée Senghor – Evreux - http://biotech.spip.ac-rouen.fr 1
-d’autres prélèvements seront à réaliser et traiter de la même façon au différents temps de
l’étude (t=10 min, 20 min et 30 min) : en condition aseptique, réaliser le prélèvement de lait
de 1 mL, qui sera immédiatement introduit dans un tube d’eau physiologique stérile de 9 mL.
A t=30 min, un prélèvement supplémentaire de 3 mL sera à réaliser : le prélèvement sera
immédiatement placé dans un tube à hémolyse conservé au froid dans l’attente de réaliser le
contrôle de l’activité phosphatasique (voir suite au II).
2-Etude cinétique de la décroissance bactérienne (jour 1)
Pour chaque prélèvement (t=0, 10, 20 et 30 min), à partir de la première dilution décimale
du lait, réaliser le nombre de dilutions décimales nécessaires pour permettre le
dénombrement des germes en masse en gélose nutritive.
II-Contrôle indirect de la pasteurisation d’un lait cru
1-Principe de la méthode de détermination
La détermination de l’activité phosphatasique du lait est réalisée selon la norme européenne
AFNOR ISO 3356:2009.
On fait agir le lait traité sur un substrat synthétique, le phénylphosphate, en respectant les
conditions permettant une mesure d’activité :
- concentration en substrat saturante permettant d’obtenir une Vi m,
- pH et température constant, et proche de l’optimum (pH 10 et 37°C).
La réaction d’hydrolyse du phénylphosphate catalysée par la PAL est la suivante :
Phénylphosphate + H2O Phénol + phosphate
La réaction évolue pendant 1 heure, puis on l’interrompt par dénaturation thermique. On
mesure ensuite la quantité de phénol libéré au cours du temps.
Cette méthode deux points est nécessaire car le phénol n’ayant pas de propriétés spectrales
particulières, on ne peut pas suivre en continu la réaction. Après arrêt de la réaction on
ajoute un réactif de coloration (réactif de Gibbs) permettant la formation d’un complexe
coloré à partir du phénol.
L’absorbance du complexe coloré, qui est proportionnelle à la quantité de phénol, est
mesurée à 610 nm.
Les essais seront comparés à une gamme d’étalonnage de phénol et l’activité sera exprimée
en µg de phénol libéré par heure et par g de lait (à pH 10 et à 37°C).
2-Mode opératoire
2.1-Détermination de l'activité PAL par méthode deux points (jour 1)
Remarque : Les essais sur seront réalisés à l’aide du prélèvement supplémentaire de 3 mL
réalisé précédemment à t = 30 min de chauffage.
Documents de travail – Lycée Senghor – Evreux - http://biotech.spip.ac-rouen.fr 2
Dans une série de tubes à essais plastiques, introduire :
Tubes Essai 1 Essai 2 Témoin 1 Témoin 2
Lait traité (après 30 min de
1 1 - -
pasteurisation) (mL)
Lait non traité (sans pasteurisation) (mL) - - 1 -
Lait UHT (mL) - - - 1
Phénylphosphate à 1 g/L (mL) tamponné
10
à pH 10 et préincubé à 37°C
Homogénéiser et incuber au bain Marie à 37°C pendant 1 heure exactement en
homogénéisant régulièrement. Arrêter la réaction en portant les tubes à 100°C pendant 2
minutes environ. Refroidir sous un filet d’eau froide.
Remarque : chaque membre d’un binôme réalisera un essai et un témoin au choix.
2-Défécation des échantillons de lait (jour 1)
La couleur du lait rend les tubes opaques et empêche d’y mesurer une absorbance. Cette
opacité provient de protéines lactiques (caséines) et d’émulsions de matières grasses. On
élimine ces composés parasites par défécation
Pour cela, ajouter dans les tubes 1 mL de solution défécante. Homogénéiser le précipité
obtenu puis filtrer.
Les filtrats seront collectés dans des flacons de 40 mL annotés et conservés au
froid en attente du dosage colorimétrique en jour 2.
Remarques sur la sécurité biologique :
Le lait testé est contaminé : il est donc nécessaire d’éliminer dans une poubelle
DASRI le matériel jetable en contact avec le lait (tubes plastiques, filtre…).
Le matériel non jetable devra être placé dans un sac à autoclave en prévision
d’une décontamination à l’autoclave (entonnoirs).
3-Dosage du phénol apparu dans les mélanges réactionnels (jour 2)
Dans une série de 4 tubes, introduire :
- 5 mL de filtrat (essai 1, essai 2, témoin 1, témoin 2)
- 5 mL de solution de métaborate de sodium
- 0,04 mL de réactif de Gibbs
Homogénéiser et laisser la coloration se développer 30 minutes à l'obscurité.
Lire l'absorbance à 610 nm.
Documents de travail – Lycée Senghor – Evreux - http://biotech.spip.ac-rouen.fr 3
4-Gamme d'étalonnage (jour 2)
-A l’aide d’une fiole de 50 mL réaliser une dilution au 1/10 d’une solution de métaborate de
sodium.
-Prévoir une gamme étalon comprenant des quantités de phénol allant de 0 à 20 µg :
Tubes 0 1 2 3 4 5
Solution étalon de phénol à 20 mg/L soit 0,002 % (mL)
Solution de sulfate de cuivre (mL) 1
Solution de métaborate au 1/10 (mL) 5
Eau distillée qsp 10 mL
Réactif de Gibbs (mL) 0,04
Laisser la coloration se développer 30 minutes à l'obscurité
Quantité de phénol par tube (µg)
Réflexion préliminaire
Q1. Prévoir les dilutions décimales à réaliser en jour 1 pour l’étude de la cinétique de
décroissance bactérienne.
Q2. Expliquer le rôle des témoins 1 et 2.
Q3. Proposer une solution technique permettant de réaliser l’incubation correctement,
sachant que chacun des 4 tubes (essai 1, essai 2, témoin 1, témoin 2) devra avoir une durée
d’incubation de 1 heure exactement,
Q4. Expliquer le choix des valeurs 37 et 100°C pour le protocole de détermination d’activité.
Q5. Compléter le tableau de gamme d’étalonnage.
A l’aide du document n°1 :
Q6. Proposer les moyens de protection individuels et collectifs éventuellement nécessaires
pour la manipulation du phénol.
Exploitation
Contrôle direct de la pasteurisation
Q7. Proposer un tableau de résultats du dénombrement pour chaque temps testé et pour
chaque dilution.
Q8. Calculer la concentration bactérienne / mL de lait pour chaque temps testé.
Q9. Mutualiser les résultats dans le tableau de synthèse proposé dans le document n°2.
A l’aide du document n°3 :
Q10. Tracer la courbe cinétique de destruction thermique des bactéries UFC/mL = f(t) pour
chaque protocole de pasteurisation testé dans la salle (les tracés seront superposés sur le
même graphique).
Documents de travail – Lycée Senghor – Evreux - http://biotech.spip.ac-rouen.fr 4
Q11. Déterminer graphiquement le temps de réduction décimale pour chaque protocole de
pasteurisation. Quel protocole semble être le plus efficace ?
Contrôle indirect de la pasteurisation
Q12. Tracer la courbe d’étalonnage A à 610 nm en fonction de la quantité de phénol en µg
dans les tubes de gamme (tableur à disposition), puis lire les valeurs de m phénol obtenues
pour les témoins et les essais.
Q13. Imprimer le graphe.
A l’aide des documents n°4 et 5 :
Q14. Exploiter les résultats issus du témoin 2 afin de calculer pour chaque essai et pour le
témoin 1, la masse de phénol apparue dans le tube de coloration suite à la seule action de la
phosphatase alcaline.
Q15. Déterminer l’équation aux grandeurs permettant de calculer l’activité phosphatasique
dans le MR en µg de phénol libéré par heure pour 1 g de lait (on considérera 1g de lait = 1
mL de lait).
Q16. Calculer l’activité phosphatasique du lait non traité et du lait traité. Conclure sur
l’efficacité du protocole de pasteurisation étudié.
Synthèse
Q17. A l’aide de l’ensemble des résultats obtenus, argumenter afin de proposer un barème
de pasteurisation (temps / température) permettant de traiter efficacement le lait.
Documents de travail – Lycée Senghor – Evreux - http://biotech.spip.ac-rouen.fr 5
Document 1 : Extrait de la fiche toxicologique INRS du phénol
Document 2 : Résultats obtenus pour les différents protocoles de pasteurisation
Temps d’exposition (min) 0 10 20 30
Concentration bactérienne
réelle (UFC/mL) à 45°C
Concentration bactérienne
réelle (UFC/mL) à 55°C
Concentration bactérienne
réelle (UFC/mL) à 65°C
Documents de travail – Lycée Senghor – Evreux - http://biotech.spip.ac-rouen.fr 6
Document 3 : Notions théoriques sur la cinétique de destruction thermique des micro-
organismes (source : Opération unitaires, 2-La pasteurisation – P.Chillet – CNDP)
Documents de travail – Lycée Senghor – Evreux - http://biotech.spip.ac-rouen.fr 7
Document 4 : Extrait de la norme AFNOR ISO 3356:2009
… pour un lait convenablement pasteurisé, l'activité phosphatasique doit être inférieure à une masse de 4 µg de
phénol libéré / h / par g de lait à pH=10 et 37°C.
Afin de vérifier que cette masse de phénol provient bien de la catalyse enzymatique par la phosphatase alcaline,
il est nécessaire de vérifier l’évolution spontanée de la réaction non catalysée afin de retrancher éventuellement
la masse de phénol qui apparaitrait spontanément sans lien avec l’action enzymatique…
Document 5 : Notions théoriques sur les déterminations d’activités enzymatiques
1-La notion d’activité enzymatique
Définition : l’activité d’une enzyme est la quantité de substrat qu’elle peut transformer par
unité de temps dans des conditions opératoires précises : lorsque la concentration en
substrat est saturante, pH et t°C constants, non dénaturants et si possible optimum.
Une activité s’exprime en nombre de moles de substrat transformé par unité de temps :
Activité de l’enzyme dans MR = n S transformé dans le MR / unité de temps
2-Expressions dérivées de l’activité enzymatique
• Même si par définition une activité enzymatique s’exprime à l’aide d’un nombre de moles
de substrat transformé, il n’est pas toujours possible d’avoir recours à cette valeur. En effet,
on mesure parfois l’apparition d’un produit :
Activité de l’enzyme dans MR = n P apparu dans le MR / unité de temps
• L’activité peut également être exprimée à partir de grandeur dérivant du nombre de moles
de substrat ou de produit : masse ou concentration de substrat ou produit…
Exemple : Activité de l’enzyme dans MR = m P apparu dans le MR / unité de temps
• Lors de déterminations d’activités enzymatiques, on a recours parfois à des méthodes deux
points : le MR subit dans ce cas l’ajout éventuel de réactifs complémentaires (réactifs d’arrêt,
diluants, réactifs de coloration…) qui entraine une dilution. Le calcul d’activité devra alors
être corrigé par ce facteur de dilution de façon à exprimer l’activité enzymatique dans le MR.
Documents de travail – Lycée Senghor – Evreux - http://biotech.spip.ac-rouen.fr 8
Vous aimerez peut-être aussi
- TP Alpha Amylase 2022-2023 PDFDocument4 pagesTP Alpha Amylase 2022-2023 PDFZINEB ANOIR100% (1)
- Compte Rendu TP Ecologie MicrobienneDocument11 pagesCompte Rendu TP Ecologie MicrobienneHalaleila Leila100% (1)
- 13.analyses MicrobiologiquesDocument37 pages13.analyses MicrobiologiquesTaha Oukase100% (10)
- TP #2 Analyses-Microbiologique-De-La-Viande-Hachée-Et-Le-ThonDocument5 pagesTP #2 Analyses-Microbiologique-De-La-Viande-Hachée-Et-Le-ThonTyler100% (5)
- TP de L'invertaseDocument11 pagesTP de L'invertaseDrissZaoui82% (11)
- BiochimieDocument14 pagesBiochimieolfa100% (1)
- Fiche D'alerte - ShuntDocument5 pagesFiche D'alerte - Shuntabdelhak Aouadi100% (2)
- Control Boisson GazeuseDocument6 pagesControl Boisson Gazeusevague2000Pas encore d'évaluation
- 1ère S PARTIE A Chap.1 TP N°1Document1 page1ère S PARTIE A Chap.1 TP N°1sandra.le.duPas encore d'évaluation
- TP Ndeg 1 Microbiologie Alimentaire Licence Microbiologie Travaux PratiquesDocument8 pagesTP Ndeg 1 Microbiologie Alimentaire Licence Microbiologie Travaux PratiquesKami Daboub100% (1)
- Protocoles 3Document15 pagesProtocoles 3adaar968Pas encore d'évaluation
- Diagnostic Du LaitDocument16 pagesDiagnostic Du LaitNassira EL HASSANIPas encore d'évaluation
- Analyse Microbiologique Des Aliments PETANHANGUIDocument5 pagesAnalyse Microbiologique Des Aliments PETANHANGUIN'tchin Euphrasie CoulibalyPas encore d'évaluation
- Compte Rendu D'analyses BactériologiquesDocument10 pagesCompte Rendu D'analyses BactériologiquesHajar ouajidPas encore d'évaluation
- DosageDocument6 pagesDosageDreamm AllPas encore d'évaluation
- Quide Pratique D%u2019ANALYSES MICROBIOLOGIQUESDocument33 pagesQuide Pratique D%u2019ANALYSES MICROBIOLOGIQUESAL HaniPas encore d'évaluation
- TP Genieenz ImmobDocument4 pagesTP Genieenz ImmobNassimaPas encore d'évaluation
- Test Phosphatase Alcaline Et Peroxydase Lait - 58 - 1978 - 579-580 - 34 PDFDocument11 pagesTest Phosphatase Alcaline Et Peroxydase Lait - 58 - 1978 - 579-580 - 34 PDFFouratZarkounaPas encore d'évaluation
- Caractérisation de Produits Laitiers (M1 MEEF BGB)Document3 pagesCaractérisation de Produits Laitiers (M1 MEEF BGB)muscl972Pas encore d'évaluation
- m1 TP Microbio Alimentaire 2013 2014 PDFDocument6 pagesm1 TP Microbio Alimentaire 2013 2014 PDFRym KocheranePas encore d'évaluation
- Analyses Bactériologiques Du LaitDocument1 pageAnalyses Bactériologiques Du Laitayoubouraoui100% (2)
- PolyTPBR2023 - 2024 BPRDocument9 pagesPolyTPBR2023 - 2024 BPRmahassen meskiniPas encore d'évaluation
- Fiche Technique Gélose Tryptone Sulfite NéomycineDocument2 pagesFiche Technique Gélose Tryptone Sulfite Néomycinenouhaila lgPas encore d'évaluation
- TP Génie EnzymatiqueDocument15 pagesTP Génie Enzymatiquestyle musicPas encore d'évaluation
- Materiel TP Avec PhotosDocument7 pagesMateriel TP Avec PhotosOurida TighiltPas encore d'évaluation
- TP Bioch1 Mol Du Vivant 2014-15Document4 pagesTP Bioch1 Mol Du Vivant 2014-15Pauline SoulierPas encore d'évaluation
- TP 4 Action Temp Et PHDocument3 pagesTP 4 Action Temp Et PHmoustafa0% (1)
- Production D'arôme de RoquefortDocument5 pagesProduction D'arôme de Roquefortkukuxumusu3Pas encore d'évaluation
- C M Des Excipients LudipressDocument8 pagesC M Des Excipients Ludipresshmidat_fr2000Pas encore d'évaluation
- Chapitre II Yasmine Et ImenDocument4 pagesChapitre II Yasmine Et ImenAbdouli RoukayaPas encore d'évaluation
- TP Enzymologie 2021Document9 pagesTP Enzymologie 2021ariellegectelciPas encore d'évaluation
- Travaux Pratique GP4Document15 pagesTravaux Pratique GP4tracy massomaPas encore d'évaluation
- SVI4-M21-Enzymologie Et Biochimie Métabolique-Polycopié TP InvertaseDocument12 pagesSVI4-M21-Enzymologie Et Biochimie Métabolique-Polycopié TP InvertaseSioud Besma50% (2)
- Flore Totale ExposéeDocument5 pagesFlore Totale Exposéeamine 1287% (15)
- TP MicrobiologieDocument5 pagesTP MicrobiologieFousseyni TRAOREPas encore d'évaluation
- TPnéoglucogenèseDocument7 pagesTPnéoglucogenèseLinda KoundziPas encore d'évaluation
- Analyses Des EauxDocument91 pagesAnalyses Des EauxAbdel Hakim M. NadjibPas encore d'évaluation
- CatalaseDocument7 pagesCatalaseLeila MolnarPas encore d'évaluation
- Spe Chimie Dosages TP2 Notre Lait Est Il FraisDocument2 pagesSpe Chimie Dosages TP2 Notre Lait Est Il FraisAbdou aziz fallPas encore d'évaluation
- FT Vérification D'une Immunisation Par Le Test ELISADocument3 pagesFT Vérification D'une Immunisation Par Le Test ELISAmathieu.demange13Pas encore d'évaluation
- Matériel Et MéthodesDocument27 pagesMatériel Et MéthodesOuins OlympePas encore d'évaluation
- TP15 Bille AlginateDocument4 pagesTP15 Bille AlginateBenyoucef AmelPas encore d'évaluation
- Resume TD BM 20 PDFDocument8 pagesResume TD BM 20 PDFassiPas encore d'évaluation
- TP KnoxDocument11 pagesTP KnoxKnox ChaliPas encore d'évaluation
- TP de Biochimie MetaboliqueDocument8 pagesTP de Biochimie Metaboliquea.itatahinePas encore d'évaluation
- TP 20, 21 Et 22 Mars 2024 (M1 AqBio Et M1 ImaCell)Document4 pagesTP 20, 21 Et 22 Mars 2024 (M1 AqBio Et M1 ImaCell)elmasdoukinawfalPas encore d'évaluation
- 2 2 B Digestion MacromoleculesDocument4 pages2 2 B Digestion MacromoleculesTasnim Tas NimPas encore d'évaluation
- Protocole Quantification-Levures 2223Document6 pagesProtocole Quantification-Levures 2223elisamrtntPas encore d'évaluation
- SVT PDDocument3 pagesSVT PDtomeyumPas encore d'évaluation
- Analyse Microbiologique Des AlimentsDocument8 pagesAnalyse Microbiologique Des AlimentsNabilDouadi100% (1)
- TP 2 de M. A. Analyse Microbiologique de La Pâtisserie Responsable de La Matière Dr. MEDJOUDJ Hacène. M.C.Document2 pagesTP 2 de M. A. Analyse Microbiologique de La Pâtisserie Responsable de La Matière Dr. MEDJOUDJ Hacène. M.C.ilyessz ze67% (3)
- Fiches Techniques: Faculté Des Sciences de La Nature Et de La VieDocument8 pagesFiches Techniques: Faculté Des Sciences de La Nature Et de La VieEfquir EfkPas encore d'évaluation
- Chapitre 03Document7 pagesChapitre 03سہاگہتہڤیے پہنڤہسیہےPas encore d'évaluation
- SVT 1ere D - L11 - LA DIGESTION DES ALIMENTSDocument13 pagesSVT 1ere D - L11 - LA DIGESTION DES ALIMENTSAdopoPas encore d'évaluation
- ACT4-Enzymes 2024Document27 pagesACT4-Enzymes 2024ericgalard63Pas encore d'évaluation
- CR3 MicrobioDocument8 pagesCR3 MicrobioiouadahPas encore d'évaluation
- AQ Mycotoxin ELISA FRDocument2 pagesAQ Mycotoxin ELISA FRHanaa IgueldPas encore d'évaluation
- Sam 1Document10 pagesSam 1BIG BESPas encore d'évaluation
- Applications de la spectrophotomérie en phytochimie: sciencesD'EverandApplications de la spectrophotomérie en phytochimie: sciencesPas encore d'évaluation
- Modèle de Statut SARLDocument6 pagesModèle de Statut SARLbouchakour meryemPas encore d'évaluation
- ThseMouniaBenazza 2017 PDocument259 pagesThseMouniaBenazza 2017 Pbouchakour meryemPas encore d'évaluation
- Hygiene AlimentairDocument1 pageHygiene Alimentairbouchakour meryemPas encore d'évaluation
- Statut de Socièté AnonymeDocument21 pagesStatut de Socièté Anonymebouchakour meryemPas encore d'évaluation
- Liste Des Agences CNAC Article - A5135Document14 pagesListe Des Agences CNAC Article - A5135bouchakour meryemPas encore d'évaluation
- Management de La Qualité CoursDocument61 pagesManagement de La Qualité Coursbouchakour meryemPas encore d'évaluation
- Statut EURLDocument10 pagesStatut EURLbouchakour meryemPas encore d'évaluation
- Srtucture Des Acides Nucleiques Part.1Document63 pagesSrtucture Des Acides Nucleiques Part.1bouchakour meryemPas encore d'évaluation
- La ChromatographieDocument3 pagesLa Chromatographiebouchakour meryemPas encore d'évaluation
- La Promotion de La Qualité Écologique Des Produits Et Les ÉcDocument13 pagesLa Promotion de La Qualité Écologique Des Produits Et Les Écbouchakour meryemPas encore d'évaluation
- Tronc Commun 2ème Année Filière BiotechnologiesDocument40 pagesTronc Commun 2ème Année Filière Biotechnologiesbouchakour meryemPas encore d'évaluation
- De L'hydrogène Bientôt Fabriqué - Sobrement - À Partir Des Déchets de BoisDocument9 pagesDe L'hydrogène Bientôt Fabriqué - Sobrement - À Partir Des Déchets de Boisbouchakour meryemPas encore d'évaluation
- Resum - Cours Edd Partie 1Document3 pagesResum - Cours Edd Partie 1bouchakour meryemPas encore d'évaluation
- scenarioTRAAM BioreacteursDocument5 pagesscenarioTRAAM Bioreacteursbouchakour meryemPas encore d'évaluation
- Fiche ANDI Article - A5140Document4 pagesFiche ANDI Article - A5140bouchakour meryemPas encore d'évaluation
- TD de Génétique N 1 Les Divisions Cellulaires: Mitose - MéioseDocument3 pagesTD de Génétique N 1 Les Divisions Cellulaires: Mitose - Méiosebouchakour meryem100% (1)
- Fsba Module 2 Unit 1 Slides FrenchDocument36 pagesFsba Module 2 Unit 1 Slides Frenchbouchakour meryemPas encore d'évaluation
- 17 - MyxovirusDocument28 pages17 - Myxovirusbouchakour meryemPas encore d'évaluation
- 22 - Vaccins Et SerumsDocument31 pages22 - Vaccins Et Serumsbouchakour meryemPas encore d'évaluation
- Emploi S2 AgroDocument15 pagesEmploi S2 Agrobouchakour meryemPas encore d'évaluation
- 19 - Virus À ARNDocument52 pages19 - Virus À ARNbouchakour meryemPas encore d'évaluation
- 20 - Diagnostic VirologiqueDocument29 pages20 - Diagnostic Virologiquebouchakour meryemPas encore d'évaluation
- 09 - Cocci Gram+ Et Gram - Med 2021Document45 pages09 - Cocci Gram+ Et Gram - Med 2021bouchakour meryemPas encore d'évaluation
- 13 - Classification Des Bactéries D'intérêt Médical - Les Bacilles À Gram (-) Non ExigeantsDocument56 pages13 - Classification Des Bactéries D'intérêt Médical - Les Bacilles À Gram (-) Non Exigeantsbouchakour meryemPas encore d'évaluation
- 16 - Pathogénèse Des Infections ViralesDocument15 pages16 - Pathogénèse Des Infections Viralesbouchakour meryemPas encore d'évaluation
- 11 - Rôle Du LaboratoireDocument39 pages11 - Rôle Du Laboratoirebouchakour meryemPas encore d'évaluation
- 12 - Rôle de La Bacteriologie Dans Le Traitement AntibiotiqueDocument27 pages12 - Rôle de La Bacteriologie Dans Le Traitement Antibiotiquebouchakour meryemPas encore d'évaluation
- 18 - Virus À ADNDocument55 pages18 - Virus À ADNbouchakour meryemPas encore d'évaluation
- 08 - BGP Et MycobactériesDocument36 pages08 - BGP Et Mycobactériesbouchakour meryemPas encore d'évaluation
- 06 - La Résistance Bactérienne Aux AntibiotiquesDocument30 pages06 - La Résistance Bactérienne Aux Antibiotiquesbouchakour meryemPas encore d'évaluation
- L'évangélisationDocument2 pagesL'évangélisationdenis auguste nziPas encore d'évaluation
- Traveaux Pratique JavaDocument5 pagesTraveaux Pratique JavaIsmail GhedamsiPas encore d'évaluation
- MonEtiquetteRetour SAV230419222413Document2 pagesMonEtiquetteRetour SAV230419222413Aiman BenchekrounPas encore d'évaluation
- Coloriage Magique de Lete Additions Et SoustractionsDocument2 pagesColoriage Magique de Lete Additions Et SoustractionsnagelzieherPas encore d'évaluation
- Embrayage LagunaDocument9 pagesEmbrayage Lagunabalusio86Pas encore d'évaluation
- Foucault Extraits de L'herneDocument110 pagesFoucault Extraits de L'hernekairoticPas encore d'évaluation
- Manuel MP2-GXDocument37 pagesManuel MP2-GXBenoit BlondelPas encore d'évaluation
- Poesie Rentrée cm2Document16 pagesPoesie Rentrée cm2Maha CissePas encore d'évaluation
- QCM Reseaux Corrige Interne 2008Document9 pagesQCM Reseaux Corrige Interne 2008wasbac100% (1)
- Hocini Nour El Houda PDFDocument116 pagesHocini Nour El Houda PDFZED 2ARTPas encore d'évaluation
- RE 9.2-National Energetic PlanDocument90 pagesRE 9.2-National Energetic PlanCollins DjikePas encore d'évaluation
- DF88 Lout FP Ri Brix 060408Document1 pageDF88 Lout FP Ri Brix 060408CryotechDeicingPas encore d'évaluation
- AccueilDocument5 pagesAccueilcaptcha 1960Pas encore d'évaluation
- Codes Defauts ME 746 V2Document4 pagesCodes Defauts ME 746 V2Hammouda CaPas encore d'évaluation
- Deloitte Cyber-Securite PlaquetteDocument6 pagesDeloitte Cyber-Securite PlaquetteabdelnourPas encore d'évaluation
- Poly OxydoDocument9 pagesPoly OxydoOsman TasPas encore d'évaluation
- Rapport 06AEP07Document60 pagesRapport 06AEP07Mamadou FAYEPas encore d'évaluation
- AFNOR ISO22000 Module n3 ISO 22000 Pas A PasDocument6 pagesAFNOR ISO22000 Module n3 ISO 22000 Pas A PasThe Cash CompanyPas encore d'évaluation
- Dancing QueenDocument4 pagesDancing QueenMatheus TorresPas encore d'évaluation
- Gaze 2Document33 pagesGaze 2mariem jadouiPas encore d'évaluation
- Cas Texmod Notice Pédagogique 4Document17 pagesCas Texmod Notice Pédagogique 4chaima sakhriPas encore d'évaluation
- GEOMORPHOLOGIE Les Formes de Relief Terrestre Notions de Géomorphologie. 6e ÉditionDocument3 pagesGEOMORPHOLOGIE Les Formes de Relief Terrestre Notions de Géomorphologie. 6e ÉditionAbdoulaye BontoPas encore d'évaluation
- AmNord 2021 DNB SVTDocument5 pagesAmNord 2021 DNB SVTMehdouch El ByrPas encore d'évaluation
- L'Huile D'olive Contre Les UlcèresDocument5 pagesL'Huile D'olive Contre Les UlcèresbenetmanoPas encore d'évaluation
- Mode D-Emploi Balance 9880Document16 pagesMode D-Emploi Balance 9880Maxime DegeuserPas encore d'évaluation
- Étude Morphologique de L'appareil Végétatif DesDocument50 pagesÉtude Morphologique de L'appareil Végétatif DesHamid BerradiPas encore d'évaluation
- Joints Dilatation SciageDocument9 pagesJoints Dilatation Sciagesebastien cabotPas encore d'évaluation
- Série de Révision - Synthèse 1Document2 pagesSérie de Révision - Synthèse 1Olfa HamhoumPas encore d'évaluation
- 4 M Série 8 Controle 1 A. S 2021Document5 pages4 M Série 8 Controle 1 A. S 2021nidhalPas encore d'évaluation