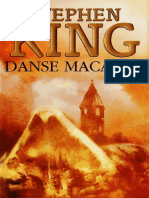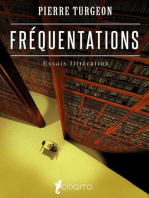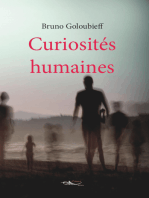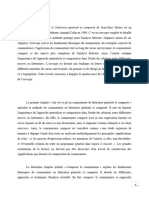Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Premièresparoleswatergang
Transféré par
Cyril Thévenin0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
40 vues4 pagesTitre original
premièresparoleswatergang
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
40 vues4 pagesPremièresparoleswatergang
Transféré par
Cyril ThéveninDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 4
Watergang de Mario Alonso
Watergang est le deuxième livre de la sélection Premières Paroles que
je lis. En premier, j'ai lu Cave 72.
Il y a un point commun avec Cave 72 : le roman s'écrit « devant » nous.
Dans les deux cas, le lecteur lit le roman que l'un des personnages décide
d'écrire. A part cela, Watergang est un peu l'antithèse de Cave 72. L'intrigue
du roman de Fann Attiki est comme un fil qu'on déroule et qui révèle au fur et
à mesure les différents nœuds qui le composent. Il y a des rebondissements.
Dans le livre de Mario Alonso, point de petites étiquettes cachées qui se
succèdent pour tenir le lecteur en haleine. " Il nous fallait un secret. Un nœud
à défaire comme dans les histoires bien ficelées. Vous savez, ces histoires
comme je n'en écrirai jamais, parce que, dans la vie, rien n'est bien ficelé." Il
leur fallait un secret aux personnages. Il m'en fallait un aussi à moi lecteur.
Mais aucun des personnages du livre n'en a trouvé un, moi non plus : "et
surtout, il n'y a rien dans les tiroirs, rien dans les coffres en bois. Rien sous
les matelas, rien dans les bahuts et les placards, rien dans la bibliothèque."
Ne reste que le vide avec lequel on peut vivre quand même. "On a sorti la
langue, on a aboyé sur les passants qui ne passaient pas, on a fait semblant
de pisser sur des arbres qui n'avaient pas encore poussé." Est-ce que Mario
Alonso a composé un livre avec des pages sur lesquelles aucun mot n'a été
écrit ? Ses personnages choisissent de ne pas combler ce vide. Ils ne
s'inventent pas des problèmes hors norme. Ils vivent, les problèmes plus
habituels étant déjà là. Gare au lecteur qui va vouloir débusquer le décoiffant,
qui va exiger que quelque chose se passe et que, si rien ne se passe, il
faudra faire quelque chose.
Mes ambitions de lecteur ont dû être revues à la baisse. Il a fallu bosser
à me laisser aller sans rien attendre d'exceptionnel, m'abandonner à un
inattendu modeste au détour d'une page. Cependant, le voyage en vaut la
peine. S'agissait-il d'une coquetterie de ma part pour me dire que je ne
pourrai ainsi qu'être agréablement surpris ? Peut-être... Mais au final, j'ai
attendu jusqu'au bout en vain (et je pense qu'il n'y aura pas de suite à ce
livre). J'ai appris à me dire qu'il n'y a pas de frustration à avoir. Un presque
rien peut tout à fait être comblant. Un risque d'élévation est donc possible au
bout du chemin. Il ne s'agit en aucune façon de revoir ses désirs à la baisse.
Je perçois plutôt la lecture de Watergang comme un processus qui permet de
distinguer dans nos vies ce qui est de l'ordre de l'essentiel et ce qui est de
l'ordre du superflu.
Watergang est un roman polyphonique comme tant d'autres. Je pense
à Tandis que j'agonise de Faulkner. Comme dans ce dernier, chaque chapitre
se centre sur un personnage qui s'exprime à la première personne du
singulier. Le nom du chapitre correspond au personnage qui s'exprime.
Il y a deux chapitres qui se suivent et qui parlent de la même rencontre.
Ils sont associés à deux personnages. On a donc deux visions différentes
d'un même épisode, pratiquement en simultané. C'est la seule fois dans le
livre (les autres chapitres font un pas de côté, ajoutent, à chaque fois, à leur
façon, une pierre à l'édifice narratif). Je me suis dit que là, c'était l'occasion
qu'il se passe enfin quelque chose, que les nuances apportées par chaque
protagoniste, les différences de perception sur le même événement, soient
l'occasion de révéler un retournement de situation, de ménager un coup de
théâtre : "J'aurais pu me laisser bercer longtemps par le mouvement si Zac
n'avait pas été là. J'aurais pu. Mais Zac était là et il a vu la nuit quelque part
qui menaçait déjà. Il s'est levé et ce fût fini." J'aurais aimé savoir ce que Zac
avait dans la tête à ce moment-là, un truc auquel Paul était loin de s'imaginer
de la part de son ami. Hélas, quand Zac prend la parole, il ne nous apprend
rien. Pourquoi s'est-il levé ? Quelles étaient ses motivations ? Que ressentait-
il ? De quelle nuit parle-t-il ? Il a vu la nuit quelque part qui menaçait et c'est
tout.
Malgré cette multiplicité de perspectives, le livre tourne autour d'un seul
personnage : Paul. Ce qui est assez original c'est qu'il donne aussi la parole
à des objets (Carnet), des personnages imaginaires (une « version » d'un
proche que Paul fantasme), des personnages qui existent mais qui ne sont
pas encore censés pouvoir parler (un bébé qui donne son point de vue), un
élément de géographie (un territoire, un lieu, un paysage...), un aspect du
récit (Action), un groupe de personnes, une couleur, le roman lui-même. Quel
effet cela me fait-il ? J'ai trouvé cela plutôt artificiel. Comme je disais plus
haut, il n'en profite pas pour tisser une trame bien retorse qui mettrait à jour, à
mesure qu'elle se met en place, des rapports de force dissimulés. Ici dans
Watergang, malgré la présence des marais asséchés, tout est transparent.
Le roman raconte donc l'histoire de Paul, un garçon de 12 ans, qui va
devenir écrivain. Il est assez atypique. Sa mère, sa sœur sont souvent
décontenancés par sa façon d'être (il passe son temps dans les marais, il
dort les yeux ouverts...). On va découvrir au fur et à mesure que ce qui
travaille l'adolescent est sa difficulté à comprendre le départ de son père
alors qu'il était tout petit. Ce père n'aura droit à son premier chapitre, son
droit à la parole, que très tard dans le livre. Paul revit cette histoire qui le
ronge de l'intérieur (sans arriver à poser des mots dessus alors qu'il se rêve
écrivain) à travers celle de sa sœur qui attend un enfant non assumé par le
géniteur, dont on se demande d'ailleurs s'il s'agit bien du géniteur. C'est
somme toute une histoire assez classique. Mais cela ne veut pas dire qu'elle
est inauthentique, facile à dépasser. Pourquoi serait-ce le cas ? Pourquoi
devrait-on relativiser un malheur banal ? Pour qui est-il commun ? Quand je
lis Watergang, j'apprends l'empathie, pas une empathie sélective qui se
tourne seulement vers les situations qui en valent la peine, ce qui n'est pas
de l'empathie. Quand je me tourne vers autrui et ses ressentis, je mets de
côté mon propre système de valeurs. J'entends ce qui est important pour
l'autre.
Tout au long de ma lecture, j'ai donc été tenté de trouver autre chose de
plus croustillant à me mettre sous la dent. Mario Alonso éprouve-t-il notre
capacité à ne pas assouvir bêtement nos pulsions de voyeur ? J'ai pensé à
un meurtre : "Un jour, Paul a fait savoir avec le plus grand sérieux qu'il tuerait
quelqu'un.", un inceste : "[Je] monte m'allonger contre Birgit. Ses mains
plongent dans mes cheveux.","Et si on disait que j'étais le père ?", une
relation homosexuelle qui n'arrive pas à être appréhendée de la sorte : "Nous
avons décidé aussi d'embrasser le même jour la même fille. Ce que nous
avons fait, sans y trouver de satisfaction particulière. Juste histoire de. Une
autre fois, nous avons essayé de nous embrasser nous-mêmes. Ce qu'on a
fait, sans véritable goût pour ça non plus. Histoire de."
En réalité, il ne se passera pas grand-chose mais cette absence
signifiera beaucoup, elle produira un vertige. Un vertige à questionner, pour
se faire peur et pour être heureux. "Il ne nous racontera pas, la vie d'ici ne se
raconte pas. Il nous fera simplement parler à tour de rôle et ce sera
suffisant.", "Écrire un livre où seront consignés des tas de trucs qui sont des
trucs de Middelbourg. Des trucs comme par exemple Hier Birgit m'a donné
son téléphone. Des phrases déterminantes qui auront cet à-pic, ce vertige.",
"Je ne suis pas très doué pour l'aventure. C'est Paul qui tient les manettes.
Et l'aventure, ce n'est pas son fort.", " Je pourrais très facilement tuer des
gens et les manger, voyez-vous. Mais je peux aussi arrêter quand je veux de
dire des conneries et parler de ce qui fâche vraiment.", "Mon roman déplaira.
Parce qu'il renverra chacun à sa propre impuissance.", "Il ne se passera rien,
mais rien ne se passera tout à fait normalement."
Le style de Mario Alonso est à la fois simple (on a vraiment l'impression
que ce sont des ados qui parlent) et imagé. Nathalie de la médiathèque m'a
dit qu'elle trouvait l'écriture très poétique. En effet, une autre réalité se cache
derrière celle qui est donnée d'emblée par les mots jetés sur la page. Ce
n'est pas si difficile de l'appréhender. Mario Alonso ne nous abandonne pas
complètement. "Je reprends possession de la pierre de Lieve. Je tiens dans
ma main tout le watergang. Lieve me rassemble, tout éparpillé autour d'elle,
elle fait un petit tas de moi, me récupère. Elle caresse mes os, les soupèse
avant de les poser les uns sur les autres, redresse mon corps, l'articule
comme il était. Elle l'embrasse, lèche mes yeux, me mange. Je ne cours plus
dans les polders mais à l'intérieur de Lieve." Ainsi, si l'intrigue est
transparente, les mondes vers lesquels Mario Alonso nous emmène sont
riches de sens. Comme pour les poésies, j'ai envie de me redire certaines
phrases, j'ai envie de mûrir avec, de les interpréter différemment selon ce que
je traverse dans ma vie. Finalement, il est vrai de penser que Mario Alonso a
écrit avec ses mots un livre rempli de pages blanches. Le lecteur ajoute aussi
son encre invisible. Le roman s'écrit « devant » et « avec » nous.
Quand Paul arrivera à poser des mots sur le fait qu'il a été abandonné
par son père, il ne voudra plus être écrivain. A la place, il sera amoureux. Il ne
saura pas pourquoi son père l'a abandonné. Personne ne sait. "Comment
expliquer que Julia et moi nous nous soyons séparés ?" Cela fait partie des
questions sans réponse. Ce sont des questions auxquelles une quantité
importante de réponses peuvent être apportées. Mohammed Mbougar Sarr
l'explique très bien dans La plus secrète mémoire des hommes : "Chaque
être doit chercher sa question pour toucher du doigt l'épais mystère au cœur
de son destin : ce qui ne lui sera jamais expliqué, mais qui occupera pourtant
dans sa vie une place fondamentale. Des hommes meurent sans avoir trouvé
leur question. D'autres l'identifient tard dans le cours de leur vie." En ce qui
me concerne, je peux dire aujourd'hui que je n'ai pas encore trouvé Ma
question. Par contre, ce que sais c'est que Watergang a posé en moi un
jalon, une façon de saisir mon environnement et la place que j'y occupe (on
pourrait dire d'ailleurs que Watergang est un roman géographique, tant il
s'intéresse aux paysages et à la façon dont ses derniers modèlent nos
existences, davantage que les biens matériels : "Ce que personne ne sait, et
que je sais, c'est que nous n'avons pas besoin de maison. Nous naissons
dans notre propre maison jusqu'à ce que nous la quittions définitivement. Là
où je dors, je suis chez moi. J'ai un lit, des fenêtres, une cave et un grenier,
un jardin, un chemin qui y mène, et des arbres alignés où les oiseaux vont.
Là où je dors, il y a un oiseau qui va et vient en chantant, car lui aussi il a une
maison. Sa maison est son chant. C'est le matin, et je l'entends." On dirait
des phrases tout droit sorties du psaume 22 ("Le seigneur est mon berger...).
Mais un psaume agnostique ancré dans notre monde, un psaume qui nous
demande d'occuper ce monde ici et maintenant. Cette citation ne me quitte
pas, surtout quand je me crois obligé de changer les gouttières de ma maison
parce qu'elles ont une sale tronche : occupe-toi d'abord de ta maison/corps
Cyril !
Est-ce que j'ai aimé ce livre ? Je pense que oui, de plus en plus en tout
cas. Au départ, quand je l'ai refermé, ce n'était pas gagné. Mais il travaille en
moi, c'est indéniable. Je n'ai pas encore lu tous les romans du prix Premières
Paroles. Je ne peux pas être catégorique mais il y a de fortes chances que ce
ne soit pas le livre que je vais défendre. Cependant, je suis presque sûr que
si ce livre est plébiscité par le jury, je ne vais pas chercher à convaincre bec
et ongles les membres qu'ils font fausse route. Je m'inclinerai bien bas
devant le talent de Mario Alonso qui avance simplement mais avec beaucoup
d'élégance dans les polders de nos tréfonds.
Vous aimerez peut-être aussi
- King, Stephen-Danse Macabre (1978) .OCR - French.ebook - AlexandriZ PDFDocument428 pagesKing, Stephen-Danse Macabre (1978) .OCR - French.ebook - AlexandriZ PDFBruno100% (2)
- Français 7e IAM LE EntierDocument224 pagesFrançais 7e IAM LE EntierAnika Truc100% (1)
- 1964 - Situations IV - Jean-Paul Sartre PDFDocument451 pages1964 - Situations IV - Jean-Paul Sartre PDFmendes_breno2535Pas encore d'évaluation
- Longtemps J Ai Reve D Elle Thierry Cohen Thierry CohenDocument702 pagesLongtemps J Ai Reve D Elle Thierry Cohen Thierry Cohenbekkouche30100% (1)
- Critiques de Livres ClasseDocument17 pagesCritiques de Livres ClasseLahcen OtPas encore d'évaluation
- 8 French Werber Bernard Le Livre Du Voyage PDFDocument83 pages8 French Werber Bernard Le Livre Du Voyage PDFmariaPas encore d'évaluation
- Fiche de Lecture Les Contemplations, Le MendiantDocument2 pagesFiche de Lecture Les Contemplations, Le MendiantFatma Bakini0% (1)
- Dany Laferriere - Discours AFDocument18 pagesDany Laferriere - Discours AFVictoria TomaPas encore d'évaluation
- Revue L'atelier Du Roman .: Conférence François TaillandierDocument4 pagesRevue L'atelier Du Roman .: Conférence François Taillandiernarimene beyPas encore d'évaluation
- Les Faux-Monnayeurs d'André Gide - Deuxième partie, chapitre 3: Commentaire de texteD'EverandLes Faux-Monnayeurs d'André Gide - Deuxième partie, chapitre 3: Commentaire de textePas encore d'évaluation
- RésuméDocument3 pagesRésuméAmel ZreliPas encore d'évaluation
- PDF - SEQUENCE L'autobiographieDocument9 pagesPDF - SEQUENCE L'autobiographieIdir Brigui100% (1)
- Arrête de lire et viens à table !: Recueil de nouvellesD'EverandArrête de lire et viens à table !: Recueil de nouvellesPas encore d'évaluation
- Balzac Et La Petite Tailleuse Chinoise 2Document3 pagesBalzac Et La Petite Tailleuse Chinoise 2Joya SanviitoPas encore d'évaluation
- AragonDocument14 pagesAragonSite Commune LanguePas encore d'évaluation
- Leïla Slimani - Le Parfum Des Fleurs La NuitDocument82 pagesLeïla Slimani - Le Parfum Des Fleurs La NuitSarra Wissal100% (1)
- FC Analyse-Sarraute Hors-Des-Mots 1336857Document7 pagesFC Analyse-Sarraute Hors-Des-Mots 1336857ClaudeWelscherPas encore d'évaluation
- Un Été Avec MDDocument7 pagesUn Été Avec MDHugo GuyotPas encore d'évaluation
- Les Secrets de L'AubeDocument26 pagesLes Secrets de L'AubeStéphane GrarePas encore d'évaluation
- Thèmes Les Mots SartreDocument4 pagesThèmes Les Mots SartreSiham BouhaPas encore d'évaluation
- Crimes Manuel de Lenqueteur (10512825) Password Removed Processed VFDocument468 pagesCrimes Manuel de Lenqueteur (10512825) Password Removed Processed VFGahomir100% (1)
- Liam Alexander 6Document60 pagesLiam Alexander 6redalouziriPas encore d'évaluation
- Not A Fuckin Romance Ena L - 1 1Document540 pagesNot A Fuckin Romance Ena L - 1 1loulouPas encore d'évaluation
- Madame BovaryDocument5 pagesMadame BovaryIrinel BuchilaPas encore d'évaluation
- Liam Alexander Veut Écrire 2Document46 pagesLiam Alexander Veut Écrire 2redalouziriPas encore d'évaluation
- Les Mots de Jean-Paul Sartre (Fiche de lecture): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreD'EverandLes Mots de Jean-Paul Sartre (Fiche de lecture): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Faustino: Texte mis en scène avec les élèves du Lycée de BourgesD'EverandFaustino: Texte mis en scène avec les élèves du Lycée de BourgesPas encore d'évaluation
- Entretien Avec George-Luis Borges 1978Document10 pagesEntretien Avec George-Luis Borges 1978helabz100% (2)
- Lost in Connection Derniere Correction PDF Pour Mbs Couverture IncluseDocument219 pagesLost in Connection Derniere Correction PDF Pour Mbs Couverture Inclusebiova FinisherPas encore d'évaluation
- A Comme Association - 1 - La P 226 Le Lumi 232 Re Des T 233 N 232 BresDocument150 pagesA Comme Association - 1 - La P 226 Le Lumi 232 Re Des T 233 N 232 BresCamillePas encore d'évaluation
- Citations Sur Mme BovDocument12 pagesCitations Sur Mme BovLaureKerPas encore d'évaluation
- Dossier L'Etranger D'albert CamusDocument5 pagesDossier L'Etranger D'albert Camusmika.angelina.lrPas encore d'évaluation
- FrançaisDocument4 pagesFrançaisalinemachoupinettePas encore d'évaluation
- Contes de l'homme-cauchemar - Tome 1: Recueil de contesD'EverandContes de l'homme-cauchemar - Tome 1: Recueil de contesPas encore d'évaluation
- Blanche ou l'oubli: Analyse complète de l'oeuvreD'EverandBlanche ou l'oubli: Analyse complète de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Descriptif RomanDocument6 pagesDescriptif Romanmamineesalihin270Pas encore d'évaluation
- Il Était Une Fois RienDocument102 pagesIl Était Une Fois RienWacky cloudPas encore d'évaluation
- Les Points de Vue NarratifsDocument2 pagesLes Points de Vue NarratifsZinat Chams100% (1)
- Personnages Roanesques 4Document3 pagesPersonnages Roanesques 4hownowproPas encore d'évaluation
- Les Mots-Sartre-il y Avait... RondDocument5 pagesLes Mots-Sartre-il y Avait... RondghadaPas encore d'évaluation
- Le - TADJOURI AhmedDocument101 pagesLe - TADJOURI AhmedSãb RïnãPas encore d'évaluation
- Récit de Voyage Compo1 MélodieDocument3 pagesRécit de Voyage Compo1 Mélodielycée curie100% (1)
- Introduction IVDocument33 pagesIntroduction IVMiguel Lasala CaballeroPas encore d'évaluation
- Le Journal Du Confinement, Leïla SlimaniDocument11 pagesLe Journal Du Confinement, Leïla SlimaniSara LangloisPas encore d'évaluation
- Verbes de ParoleDocument2 pagesVerbes de ParoleLyse Chevalier (Moon KimMinKook)Pas encore d'évaluation
- Recherches Sur Jean Anouilh (1910-1987) - Etat Des LieuxDocument14 pagesRecherches Sur Jean Anouilh (1910-1987) - Etat Des LieuxAlexey MelnichenkoPas encore d'évaluation
- ConteMoi FourmiRoiSalomon AppDocument4 pagesConteMoi FourmiRoiSalomon AppPierre CoindreauPas encore d'évaluation
- Les Origines de La Postmodernité, Perry AndersonDocument190 pagesLes Origines de La Postmodernité, Perry Andersonsaintclairchris4Pas encore d'évaluation
- 61h 0aLxfQSDocument3 pages61h 0aLxfQSLaurence GodinPas encore d'évaluation
- UntitledDocument1 pageUntitledmhb thibaudPas encore d'évaluation
- Liste Séries - Mangas - Mise - JourDocument10 pagesListe Séries - Mangas - Mise - JourRodolpho NoukounmonssoPas encore d'évaluation
- Chapitre 1Document18 pagesChapitre 1CaillouPas encore d'évaluation
- Aznavour ExerciceDocument2 pagesAznavour ExerciceSofrench Courses100% (1)
- Devoir Janvier 2022, 4AMDocument2 pagesDevoir Janvier 2022, 4AMNASSER KHERIBECHEPas encore d'évaluation
- Grammaire Juhuri Authier - Gilles - Grammaire - Juhuri - Ou - Judeotat - Langue - IranienneDocument181 pagesGrammaire Juhuri Authier - Gilles - Grammaire - Juhuri - Ou - Judeotat - Langue - IranienneRauf MammadovPas encore d'évaluation
- TX2 Louise LabéDocument2 pagesTX2 Louise LabéEva TUILPas encore d'évaluation
- Adverbes de ModeDocument3 pagesAdverbes de ModemarinelaPas encore d'évaluation
- Compte Rendu de Litt Gle Et ComparéeDocument4 pagesCompte Rendu de Litt Gle Et Comparéemouhabda7Pas encore d'évaluation
- Le Cid (Corneille)Document42 pagesLe Cid (Corneille)Marcelin LANDEKOPas encore d'évaluation
- Findinier Louise Stav1 Commentaire Composé Note ObservationDocument3 pagesFindinier Louise Stav1 Commentaire Composé Note ObservationTaninna LouganiPas encore d'évaluation
- French IDocument6 pagesFrench IvinuPas encore d'évaluation
- Annie Ernaux Le Jeune HommeDocument2 pagesAnnie Ernaux Le Jeune HommeAbdelPas encore d'évaluation
- Flaubert Correspondance Tome IVDocument1 820 pagesFlaubert Correspondance Tome IVMoringaPas encore d'évaluation
- Assez Décodé !: BaudelaireDocument23 pagesAssez Décodé !: BaudelaireMartin M. MoralesPas encore d'évaluation
- Cinquante CinqDocument3 pagesCinquante CinqLe Khanh HoangPas encore d'évaluation
- Texte 18Document4 pagesTexte 18Phia Jallow100% (1)
- Eamac Tech Francais 2009Document2 pagesEamac Tech Francais 2009Anahi MaâroufPas encore d'évaluation
- Contenu Des Fascicules Atlas Le Seigneur Des AnneauxDocument14 pagesContenu Des Fascicules Atlas Le Seigneur Des AnneauxJason HuchotPas encore d'évaluation