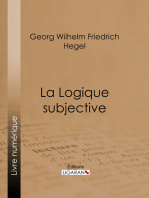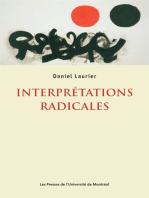Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Marc-Aurèle Philosophie - Epreuve - A - Option - Ecrit
Transféré par
Mathieu Bompoint0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
22 vues7 pagesTitre original
Marc-Aurèle philosophie_epreuve_a_option_ecrit
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
22 vues7 pagesMarc-Aurèle Philosophie - Epreuve - A - Option - Ecrit
Transféré par
Mathieu BompointDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 7
COMMENTAIRE D’UN TEXTE PHILOSOPHIQUE
ÉPREUVE À OPTION : ÉCRIT
Laurent Jaffro, Frédéric Worms
Coefficient : 3 ; Durée : 4 heures
Nombre de copies : 144
Répartition des notes :
<5 : 27
<8 : 53
<11 : 42
<13 : 11
<15 : 7
15 : 1
15,5 : 2
16,5 : 1
Comme le montre ce tableau, l’épreuve écrite de cette année est
d’abord marquée par un grand nombre de notes insatisfaisantes, plus de la
moitié étant inférieures à 8, ainsi que par le petit nombre d’explications
vraiment convaincantes d’un bout à l’autre : une dizaine de notes
supérieures ou égales à 13. Même s’il reste entre les deux un grand nombre
de copies sérieuses, satisfaisantes à des degrés divers, le fait est là.
Rappelons qu’en dehors des trop nombreux devoirs qui accumulent les
confusions et les contresens, une note inférieure à 8 s’explique par une
inattention au contenu et à la forme du texte, qui se traduit soit par sa
paraphrase soit par le « plaquage » d’éléments extérieurs mal maîtrisés. Les
notes de cette année s’expliquent souvent non par la seule difficulté
intrinsèque de l’extrait, mais par la facilité avec laquelle ce dernier semblait
se prêter à un double « plaquage », quant au contenu d’abord, à partir de
généralités stoïciennes, quant à la forme ensuite, à partir d’une explication
ne tenant aucun compte de la forme précise des Pensées.
Le texte proposé (III, 9-11) consistait manifestement en un ensemble de
trois pensées, successives mais disjointes. Cette structure manifeste
interdisait qu’on axe le commentaire sur l’unité vague d’un thème et qu’on
considère le texte comme une matière homogène et non différenciée. Le
découpage en parties n’était pas non plus à la discrétion du candidat.
Bref, il s’agissait de trois pensées distinctes de Marc-Aurèle et non
d’un texte traitant une question de façon simplement linéaire. Chaque
pensée est un tout à sa manière. Il convenait de ne pas surestimer les
« donc » et les « encore » qui commencent les deuxième et troisième
pensées. Ces connecteurs marquent plus la reprise d’un exercice discontinu
de pensée sur (et avec) soi-même (typique de l’œuvre de Marc-Aurèle,
comme beaucoup de candidats l’ont rappelé) qu’une argumentation
simplement linéaire.
Si l’unité du texte ne vient pas d’une continuité argumentative, elle
tient à la présence d’une seule et même question, que Marc-Aurèle aborde
successivement sous trois angles différents et, quoique indépendants,
complémentaires, marquant ainsi sa place centrale dans ce qui est bien, tout
à la fois, le système stoïcien et la philosophie propre de Marc-Aurèle. Il
convenait donc, et les bonnes explications se signalaient ici plus que jamais
dès l’introduction, d’insister à la fois sur la forme particulière du texte et
sur le problème et les notions qui l’occupent.
À la surprise du jury, rares ont été les copies qui ont identifié nettement
l’objet : l’autosuffisance de la faculté de juger en l’homme, contre tout ce
qui prétend s’y ajouter, et les conséquences éthiques et politiques de cette
autosuffisance.
Cet objet était d’une certaine façon présent dans chacune des trois
pensées, mais il y était abordé sous trois angles différents et d’une manière
inégalement détaillée ou explicitée, ce qui imposait une explication
« successive », non pas comme d’un texte linéaire, mais comme de trois
cercles concentriques d’étendue de plus en plus ouverte.
Une fois qu’on avait admis que l’objet (la faculté de juger, sa
souveraineté et de les conséquences pratiques de cette souveraineté) était
traité sous les trois angles de ses normes internes, de son rapport au temps,
enfin de son objet de connaissance proprement dit, l’explication pouvait
être gouvernée par les questions suivantes : qu’a de si particulier le
problème de la faculté de juger, de son autosuffisance et de ses effets
pratiques, pour donner lieu à un tel traitement? Comment ce triple
traitement, plus qu’une solution simplement théorique du problème, met-il
en œuvre sa portée pratique elle-même? Qu’ont enfin de différent et de
complémentaire les trois aspects étudiés, notamment la place
exceptionnelle de la logique et de la théorie de la connaissance dans le §11
(non seulement ici, mais c’était le cas de le rappeler, dans l’ensemble des
Pensées, comme beaucoup de candidats l’ont fait, citant ou non à l’appui
Pierre Hadot et Michel Foucault)?
Reprenons chacune des trois pensées.
Le §9 est sans aucun doute le plus synthétique : sans la définir, Marc-
Aurèle marque l’importance de la faculté de juger en en faisant l’objet d’un
respect (dont la dimension religieuse fut souvent bien commentée). Il
justifie l’autosuffisance de la faculté (son usage effectif par un homme
concret : le « toi » à qui s’adresse la pensée, trop peu commenté) en la
reliant à une double norme ; d’où, enfin, la portée pratique de son exercice :
la conformité à la nature devient conformité en acte à la « volonté des
dieux » – on devait relever ce retour de la notion de conformité.
Ces trois temps d’une même pensée sont certes étroitement liés : en
effet, s’il faut respecter en soi (« ta » faculté) la faculté de juger, c’est parce
qu’elle est fondée sur une norme rationnelle qui nous dépasse, et résulte de
l’accord de droit entre la rationalité du monde et celle de l’homme, la
nature en général et la « constitution de l’animal raisonnable ». L’exercice
concret de cette normativité produit des effets pratiques, un triple accord :
avec soi dans chaque jugement présent, avec les autres qui en fait un bien
proprement humain, et avec les dieux. Il y a donc ici (dans la tension
interne de cette pensée) un écart entre la faculté de juger et le jugement
effectif, entre l’équipement et l’usage que nous devons en faire, entre ce
qu’il y a en droit de divin en nous et un accord de fait avec la divinité dans
l’univers, écart qui dépend de nous pour être comblé et qui est l’objet
propre de l’éducation philosophique (ainsi dans ces trois pensées elles-
mêmes). Pour le comprendre, il fallait déplier les divers éléments de cette
pensée : l’existence en nous d’une faculté directrice, ou hêgemonikon, qui
doit être respectée ; son lien avec le logos à l’œuvre dans la nature et qui
distingue l’homme parmi les animaux ; son aspect par là même moral de
devoir pratique et d’accord avec les dieux. Mais aussi ce qui écarte cette
faculté de son exercice : l’impératif du « respecte », la possibilité d’une
perte (« ne perde plus »), l’obstacle à surmonter en chaque occasion (la
« précipitation »), bref le retour au point central de l’éthique stoïcienne,
l’insistance sur ce qui dépend de nous (par opposition à ce qui n’en dépend
pas), l’usage critique de la représentation, qui devait être ici rappelé. Ici
certes, comme le redira Pascal s’inspirant sur ce point des stoïciens, « bien
penser » est bien « le principe de toute la morale » (Pensées, 347). De
manière plus précise, le rôle « hégémonique » de la faculté de juger devait
être mis au centre, tout en étant relié aux normes qui le fondent, et aux trois
effets pratiques où elle se déploie, montrant ainsi l’unité de cette pensée en
elle-même et avec l’ensemble du système, ainsi que la diversité des
éléments dont pourra repartir chacune des deux pensées suivantes.
L’unité et la diversité des pensées s’explique donc à la fois par
l’importance et la complexité de leur objet, par la place centrale de la
« faculté de juger » en elle-même et l’écart continuel à surmonter pour la
mettre en œuvre. Unité et diversité, écart possible et donc accord
indispensable entre la possession de la faculté et son usage correct, telles
sont les conditions de la philosophie, exemplairement illustrées par la
manière dont la faculté de juger est traitée dans ces trois pensées. Telle
pouvait être, en tout cas, une transition possible vers l’explication de la
deuxième pensée, peut-être la plus maltraitée par les candidats, dans une
réduction trop fréquente à des généralités stoïciennes ou pire à des banalités
moralisantes.
Le risque était soit de forcer cette pensée à n’être qu’un moment de
transition, soit d’en faire un exposé banal sur la petitesse de la vie humaine.
Or l’enjeu essentiel restait ici l’autonomie de la faculté de juger, considérée
d’un point de vue, celui du temps, qui n’a rien d’accessoire. Et au centre de
la pensée se trouve non pas même seulement le « présent » mais bien
comme le montrait Goldschmidt « l’instant » comme tel.
Cette pensée comporte en effet trois moments :
– Un rappel de l’exigence d’autonomie comme concentration sur
l’essentiel, le jugement, en termes lapidaires : « jette donc tout, ne garde
que ce peu de chose ».
– Une traduction temporelle, opposant l’instant présent et le reste du
temps.
– Une conséquence morale enfin concernant l’appréciation de la vie
humaine qui, aussi grande soit elle, reste bien « petite »
Le point important consistait de toute évidence dans la thèse : l’instant
est le moment du jugement, le seul moment du temps qui compte. Plus
encore, loin de seulement « critiquer » la petitesse de la vie humaine du
point de vue d’une supposée éternité intemporelle, ou pire encore, comme
de nombreuses copies ont cru bon de le dire, d’un vague « memento mori »,
Marc-Aurèle ne critique la « petitesse » de la vie humaine que parce qu’elle
est encore trop grande par rapport à la véritable petitesse de l’instant, qui
est seul en notre pouvoir et qui suffit. La vie humaine est prise entre un
faux ou mauvais infini angoissant (crainte, nostalgie, recherche de la gloire)
et ce temps de l’exercice souverain du jugement qu’est l’instant. Il y a donc
au sein de cette brève pensée une inversion des grandeurs (sensible dans le
vocabulaire même – ce qui ne fut guère relevé par les candidats) : le
« tout » que l’on doit jeter se révèle bien « petit », le « peu de chose » que
l’on doit garder, réduit à plus petit encore qu’on ne pense, à l’instant pur,
est le tout véritable. C’est ici que le système d’échos entre les pensées
pouvait jouer ; on pouvait revenir sur la « précipitation » du § 9 et annoncer
la représentation compréhensive du § 11.
Un autre thème, presque entièrement méconnu dans les explications, le
montre dans cette pensée, c’est celui de la « vie » : « chacun ne vit que dans
l’instant présent » (nous soulignons) alors qu’en effet la vie humaine est
courte et tombe dans la mort. Décidément pas de « memento mori » ici,
plutôt un « souviens-toi » de vivre, qui a en commun avec l’épicurisme de
se centrer sur l’instant et la vie, et de critiquer de fausses représentations du
temps, mais s’oppose à lui sur le fait que cette vie est une vie du jugement,
un acte de l’esprit, un accord avec soi-même, les autres et l’univers.
L’instant est donc la condition ontologique de l’autonomie : sans lui nous
ne serions que de passage, ou devrions compter sur l’éternité. Mais dans
l’instant nous sommes, vivons et pensons. C’est le cas de le dire en faisant
écho au § 9 : il y a tout en lui.
Après cette concentration extrême, c’est donc plutôt par contraste
qu’on introduira au déploiement du § 11 – et non en maintenant à tout prix
une impeccable continuité argumentative. Il fallait chercher à déterminer
comment la question du jugement fait l’objet d’une étude logique
approfondie et détaillée ; de quelle manière celle-ci confirme les résultats
des deux premières pensées.
La troisième pensée a été souvent commentée avec précision au moins
dans ses deux premières parties (correspondant à ses deux longues
premières phrases), c’est-à-dire la définition de la méthode correspondant à
l’exercice de la faculté de juger et l’examen de ses conséquences du point
de vue de l’évaluation de ses objets. Les candidats n’ont cependant pas
assez prêté attention au critère de l’utilité ou de la valeur de l’objet. Cette
question a souvent disparu derrière celle de la « représentation
compréhensive » – notion logique certes capitale, mais qu’il fallait
précisément mettre en rapport avec l’idée de valeur ! Marc-Aurèle insiste
sur le lien entre la saisie instantanée qu’est la représentation compréhensive
(par laquelle la représentation se réduit à ce qui est représenté, sans
introduction parasitaire d’une fausse valeur) et la saisie de la valeur réelle
de l’objet au sein de l’univers. Lorsque je purge mes représentations de
toute évaluation parasitaire (par exemple quand je ne me dis plus à moi-
même que telle mort est un mal), je peux enfin appréhender quelle est la
place et l’utilité du représenté (telle mort) dans le Tout.
Ce qui a été encore plus souvent négligé, c’est le troisième moment de
cette pensée, où l’exercice de la faculté de juger est enfin réalisé in
concreto, où le « toi » de ces trois pensées devient pleinement un « je »
(c’est déjà le cas dans le premier verbe de ce paragraphe) qui développe un
véritable discours intérieur, où la question de l’origine métaphysique des
objets et événements est congédiée au profit de l’accord présent avec la
nature et de l’utilité pour la nature. L’unité de la pensée vient donc de ce
lien entre usage intelligent des représentations, représentation
compréhensive, et utilité, au long des trois moments que l’on vient de
résumer.
De fait, l’exercice autonome de l’hêgemonikon se traduit d’abord,
comme beaucoup l’ont bien rappelé, dans la définition et la description
« physiques » et « compréhensives », qui excluent tout ce qui vient de nous,
et notamment toute évaluation superflue. Mais c’est pour libérer (dans la
deuxième phrase) une autre évaluation loin de toute pseudo-neutralité
théorique : rares ont été les devoirs qui s’attaquaient vraiment à l’utilité, à
la hiérarchie des univers, jusqu’à la « valeur pour le Tout » comme « cité
sublime ». Tout était pourtant là à nouveau : cette deuxième phrase
redoutable (peut-être le moment le plus difficile du texte, le plus souvent
évité) nous fait en effet passer de la connaissance à la vertu à travers le
lien entre objectivité et utilité. Une fois l’objet et son utilité connus en eux-
mêmes, la connaissance produit d’elle-même non pas la vertu en général,
mais la vertu appropriée : la parenthèse qui les énumère n’a ici rien de
secondaire, c’est au contraire la garantie de l’accord pratique qui émane de
l’accord logique, c’est la garantie du bonheur individuel, interhumain et
cosmique.
D’où enfin le passage au style direct, au discours intérieur ou au
contrôle effectif des représentations : le sujet s’affranchit des faux
problèmes et sait ce qui dépend de lui, d’agir selon la nature avec les choses
connues selon la nature. Ainsi d’un acte injuste d’un autre homme : la
« représentation compréhensive » que j’en ai me montre qu’il a agi ainsi
par ignorance (on pouvait ici évoquer Socrate). Comment en serait-il
autrement? S’il avait agi selon son hêgemonikon et en connaissance de
cause, il aurait agi justement par définition ! Mais du coup moi (par
opposition à lui), sachant cela (« moi, je le sais »), j’agis avec lui en
conséquence, en tenant compte dans mon savoir de son non-savoir. Ainsi
« l’amitié entre les hommes » n’est pas produite de façon mécanique : je
serai heureux sans effort si les autres agissent selon la justice, mais s’ils ne
le font pas, c’est à moi de m’y accorder et la justice reste possible. De
même pour le sort ou le destin qui lui est toujours juste, de même enfin
pour « les choses indifférentes » où « je vise ce qui a de la valeur » (selon
les préférables).
Le problème épineux, le seul peut-être entre l’ordre de la nature et les
préférables parmi les indifférents, la seule poche d’incertitude résidait au
fond dans l’injustice humaine, et résultait d’un écart dont j’identifiais déjà
la source en moi-même, au cœur de mon jugement. Mais même cette poche
toujours prête à se creuser entre les hommes – le mal – peut être surmontée.
La démonstration est faite par le biais de la logique qui a rejoint l’éthique.
« Il y a tout en elle », la faculté de juger, et donc en nous. Que ce soit par la
norme logique, par l’instant présent, par les objets de connaissance au
nombre desquels il faut mettre les actes humains, nous revenons toujours au
même point : entre le jugement et l’exercice correct du jugement, il y a la
responsabilité du philosophe.
Vous aimerez peut-être aussi
- Expliquer Et Comprendre Ricoeur LouvainDocument23 pagesExpliquer Et Comprendre Ricoeur Louvainredencion2013Pas encore d'évaluation
- 252 - 2021 Culture Gérérale EDHEC - ESSECDocument6 pages252 - 2021 Culture Gérérale EDHEC - ESSECArmel Marc KouchoewanouPas encore d'évaluation
- Gernet RecherchesDocument508 pagesGernet Recherchesvlivreiro100% (1)
- L'être Comme AmourDocument18 pagesL'être Comme AmourMaxime PorcoPas encore d'évaluation
- Foucault - L'herméneutique Du Sujet (6 Janvier 1982)Document41 pagesFoucault - L'herméneutique Du Sujet (6 Janvier 1982)kairoticPas encore d'évaluation
- Zilberberg. Precis de Grammaire TensiveDocument33 pagesZilberberg. Precis de Grammaire TensiveGustavo Osorio De ItaPas encore d'évaluation
- Foucault Hermeneutique Du Sujet PDFDocument460 pagesFoucault Hermeneutique Du Sujet PDFDaniel Toscano López100% (1)
- Morelle - Realisme SpeculatifDocument31 pagesMorelle - Realisme SpeculatifDarko Drašković100% (1)
- EmpirismeDocument8 pagesEmpirismebenrabahPas encore d'évaluation
- Rousselot - 1910 Metaphysique Et Critique de La Connaissance PDFDocument35 pagesRousselot - 1910 Metaphysique Et Critique de La Connaissance PDFabdmisaelPas encore d'évaluation
- Luc Ferry KantDocument9 pagesLuc Ferry KantAdahyire ZuelyPas encore d'évaluation
- Fondements de la métaphysique des moeurs d'Emmanuel Kant: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandFondements de la métaphysique des moeurs d'Emmanuel Kant: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Le Temps N'est Pas Un Produit de L'âme: Proclus Contre PlotinDocument11 pagesLe Temps N'est Pas Un Produit de L'âme: Proclus Contre PlotindoppiapresaPas encore d'évaluation
- La Contingence: Le Maillon Entre L'irréversibilité Du Temps Et Le MalDocument78 pagesLa Contingence: Le Maillon Entre L'irréversibilité Du Temps Et Le MalASFDPPas encore d'évaluation
- Rodier Sur L Evolution de La Dialectique de Platon FRDocument26 pagesRodier Sur L Evolution de La Dialectique de Platon FRDiogenes OrtizPas encore d'évaluation
- Quelques Aspects de L'histoire Du Concept D'intuition D'aristote À Kant PDFDocument13 pagesQuelques Aspects de L'histoire Du Concept D'intuition D'aristote À Kant PDFMezigo VercingetorixPas encore d'évaluation
- Le Pragmatisme américain et anglais: Étude historique et critique suivie d'une bibliographie méthodiqueD'EverandLe Pragmatisme américain et anglais: Étude historique et critique suivie d'une bibliographie méthodiquePas encore d'évaluation
- Spe Humanites Litterature Philo 2022 Centres Etranger 1 Corrige OfficielDocument9 pagesSpe Humanites Litterature Philo 2022 Centres Etranger 1 Corrige OfficielSALOUPas encore d'évaluation
- L'invention Des ExemplesDocument12 pagesL'invention Des ExemplesPierrePachetPas encore d'évaluation
- L'Éclipse de La RaisonDocument108 pagesL'Éclipse de La RaisonJean Desrosiers100% (2)
- ArgumentationDocument153 pagesArgumentationJuliano BonamigoPas encore d'évaluation
- Lexique La Dissertation de PhilosophieDocument48 pagesLexique La Dissertation de PhilosophieÖmer Şentürk100% (1)
- Rueff FacultésDocument23 pagesRueff FacultésFranco FaccendiniPas encore d'évaluation
- Methodo DissertationDocument2 pagesMethodo Dissertation5nkpgpmp4mPas encore d'évaluation
- Argumentation Cartésienne Logos, Ethos, PathosDocument29 pagesArgumentation Cartésienne Logos, Ethos, PathosCharaf Adam Laassel0% (1)
- Théorie Du Prototype - WikipédiaDocument12 pagesThéorie Du Prototype - WikipédiaFuzzywuzzyx100% (1)
- Les+100+Mots+de+La+Philosophie+ +Worms+FredericDocument235 pagesLes+100+Mots+de+La+Philosophie+ +Worms+FredericФйыцвуак ПерноглшPas encore d'évaluation
- Théorie, réalité, modèle: Epistémologie des théories et des modèles face au réalisme dans les sciencesD'EverandThéorie, réalité, modèle: Epistémologie des théories et des modèles face au réalisme dans les sciencesPas encore d'évaluation
- Esquisses morales et littéraires: Réminiscence des études, définition de l'esprit, du goût, des sensations qui s'y rattachentD'EverandEsquisses morales et littéraires: Réminiscence des études, définition de l'esprit, du goût, des sensations qui s'y rattachentPas encore d'évaluation
- Jean-Paul Sartre - Critique de La Raison DialectiqueDocument381 pagesJean-Paul Sartre - Critique de La Raison DialectiqueVinícius dos Santos100% (8)
- Sublime LyotardDocument13 pagesSublime LyotardAdriana López-LabourdettePas encore d'évaluation
- Traité de l'enchaînement des idées fondamentales dans les sciences et dans l'histoire: Tome ID'EverandTraité de l'enchaînement des idées fondamentales dans les sciences et dans l'histoire: Tome IPas encore d'évaluation
- Taylor - Interprétation Et Les Sciences de L'homme PDFDocument58 pagesTaylor - Interprétation Et Les Sciences de L'homme PDFkairotic100% (1)
- Rapport FRPH 22Document11 pagesRapport FRPH 22Dominique DemartiniPas encore d'évaluation
- James, W. - Le Pragmatisme Et Le Sens CommunDocument14 pagesJames, W. - Le Pragmatisme Et Le Sens CommunJohann ChauletPas encore d'évaluation
- Max Scheler Et Helmuth PlessnerDocument21 pagesMax Scheler Et Helmuth Plessnerمحمد بلبشيرPas encore d'évaluation
- MARITAIN, J., Distinguier Pour Savoir, Ou Les Degres Du Savoir, 5 Ed., 1945 (En Francés)Document946 pagesMARITAIN, J., Distinguier Pour Savoir, Ou Les Degres Du Savoir, 5 Ed., 1945 (En Francés)Luciano II de Samosata100% (3)
- L'épistémologie Des Sciences SocialesDocument21 pagesL'épistémologie Des Sciences SocialesPapa Birane TourePas encore d'évaluation
- Simulacres en Construction, LandowskkyDocument10 pagesSimulacres en Construction, LandowskkytranscomunicadorPas encore d'évaluation
- Jean-Claude Passeron - Le Raisonnement Sociologique - Un Espace Non Poppérien de l'Argumentation-Albin Michel (2006)Document674 pagesJean-Claude Passeron - Le Raisonnement Sociologique - Un Espace Non Poppérien de l'Argumentation-Albin Michel (2006)Weslei Estradiote RodriguesPas encore d'évaluation
- BERNS. Puissances Et Faiblesses de L'opinion Commune Chez MontaigneDocument14 pagesBERNS. Puissances Et Faiblesses de L'opinion Commune Chez MontaignedanielmpsaraivaPas encore d'évaluation
- Sartre Critique de La Raison Dialectique OCRDocument757 pagesSartre Critique de La Raison Dialectique OCRJohannesClimacus100% (2)
- Enquete 332Document204 pagesEnquete 332Tia PriscillePas encore d'évaluation
- La Vérité Humaine, un cours d'apologétique, tome I: Quel homme suis-je ?D'EverandLa Vérité Humaine, un cours d'apologétique, tome I: Quel homme suis-je ?Pas encore d'évaluation
- Foucault Hermeneutique Du SujetDocument19 pagesFoucault Hermeneutique Du SujetRosa O'Connor AcevedoPas encore d'évaluation
- Studia - Philosophiae - Christianae r2007 t43 n2 s149 157Document10 pagesStudia - Philosophiae - Christianae r2007 t43 n2 s149 157pass passPas encore d'évaluation
- Lontologie de Merleau Ponty Face A La SCDocument28 pagesLontologie de Merleau Ponty Face A La SCAlain Hilqiyyahu BillPas encore d'évaluation
- Determinism eDocument565 pagesDeterminism eAbdeslam ChihaPas encore d'évaluation
- Déterminisme: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandDéterminisme: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Sog BatDocument64 pagesSog BatAnge Emmanuel KROU100% (1)
- Eloge de La Liberté Isaiah Berlin PDFDocument288 pagesEloge de La Liberté Isaiah Berlin PDFDanielMesaVillegas100% (4)
- Nouveaux Essais sur l'entendement humain de Leibniz - La démonstration (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandNouveaux Essais sur l'entendement humain de Leibniz - La démonstration (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frPas encore d'évaluation
- Méditations métaphysiques de René Descartes: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandMéditations métaphysiques de René Descartes: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Raisons EmotionsDocument298 pagesRaisons EmotionsSimo Aster100% (2)
- Kant Et Les Stoïciens Philosophie - Epreuve - A - Option - OralDocument4 pagesKant Et Les Stoïciens Philosophie - Epreuve - A - Option - OralMathieu BompointPas encore d'évaluation
- Justice Antigone DIOTIMEDocument6 pagesJustice Antigone DIOTIMEMathieu BompointPas encore d'évaluation
- Philosophie Au 17èmeDocument23 pagesPhilosophie Au 17èmeMathieu BompointPas encore d'évaluation
- FichesDocument18 pagesFichesMathieu BompointPas encore d'évaluation
- Travail Corpus de Textes CompletDocument48 pagesTravail Corpus de Textes CompletMathieu BompointPas encore d'évaluation
- Biblio KantDocument14 pagesBiblio KantMathieu BompointPas encore d'évaluation
- Les Révoltes Logiques 5Document106 pagesLes Révoltes Logiques 5Mathieu BompointPas encore d'évaluation
- Le Problème Du Mal Dans La Philosophie StoïcienneDocument10 pagesLe Problème Du Mal Dans La Philosophie StoïcienneMathieu BompointPas encore d'évaluation
- Giorgio Agamben, État D'urgenceDocument3 pagesGiorgio Agamben, État D'urgenceMathieu BompointPas encore d'évaluation
- Epictète LibertéDocument3 pagesEpictète LibertéMathieu BompointPas encore d'évaluation
- NQF - 302 - 0024 L'amitiéDocument11 pagesNQF - 302 - 0024 L'amitiéMathieu BompointPas encore d'évaluation
- Maurice Maeterlinck - La Mort (1920)Document290 pagesMaurice Maeterlinck - La Mort (1920)kaldeterPas encore d'évaluation
- FLACELIERE (R.) - L'Éloge D'isocrate À La Fin Du Phèdre (Revue-Des-Etudes-Grecques-46-1933)Document29 pagesFLACELIERE (R.) - L'Éloge D'isocrate À La Fin Du Phèdre (Revue-Des-Etudes-Grecques-46-1933)aminickPas encore d'évaluation
- PLOTIN TRAITE 2 ÂmeDocument10 pagesPLOTIN TRAITE 2 ÂmeBaptistePas encore d'évaluation
- GertrudeDocument292 pagesGertrudeSaint-Hyacinthe Jeet Kune DoPas encore d'évaluation
- Familiaris Consortio - Jean-Paul II - Exhortation Apostolique (22 November 1981) PDFDocument68 pagesFamiliaris Consortio - Jean-Paul II - Exhortation Apostolique (22 November 1981) PDFpierre.bakry8095Pas encore d'évaluation
- Gouverner Par Les Instruments: Pierre Lascoumes Patrick Le GalèsDocument20 pagesGouverner Par Les Instruments: Pierre Lascoumes Patrick Le Galèsalessia chiavettaPas encore d'évaluation
- La Flèche Du Parthe n°XIII: Violence !Document41 pagesLa Flèche Du Parthe n°XIII: Violence !rayonphiloPas encore d'évaluation
- Soyez Vous Meme RevueDePresseDocument36 pagesSoyez Vous Meme RevueDePresseYoni RenousPas encore d'évaluation
- Eckhart - La Proffondité de L'intimeDocument16 pagesEckhart - La Proffondité de L'intimeSenda SfercoPas encore d'évaluation
- Cours Epistémologie Et Méthodologie de Recherche (Fsjes Marrakech)Document1 pageCours Epistémologie Et Méthodologie de Recherche (Fsjes Marrakech)hajarPas encore d'évaluation
- Le Manuel Pratique de La Méthode Montessori by Maria Montessori - Z Lib - OrgDocument169 pagesLe Manuel Pratique de La Méthode Montessori by Maria Montessori - Z Lib - OrgC AB100% (1)
- Methodologie de La Dissertation PhilosophiqueDocument6 pagesMethodologie de La Dissertation PhilosophiqueThierry HenryPas encore d'évaluation
- L'idole Au RegardDocument11 pagesL'idole Au Regardhassane bouhabbaPas encore d'évaluation
- Les 99 Noms de Dieu OcrDocument427 pagesLes 99 Noms de Dieu OcrArounan DembelePas encore d'évaluation
- Juridictions Compare Et Droit Traditionnel GabonaisDocument3 pagesJuridictions Compare Et Droit Traditionnel GabonaisRabi MBAPas encore d'évaluation
- Razi Critique de GalienDocument8 pagesRazi Critique de Galienhayman6Pas encore d'évaluation
- Emmanuel KantDocument11 pagesEmmanuel KantFernando GarcíaPas encore d'évaluation
- OpinionsDZ-Le Khechinisme-NOUREDDINE BOUKROUHDocument5 pagesOpinionsDZ-Le Khechinisme-NOUREDDINE BOUKROUHHBH MEDPas encore d'évaluation
- Plan DVD Cours Juil 2016Document250 pagesPlan DVD Cours Juil 2016Rodri GoPas encore d'évaluation
- TH Cristea - Strategies de La TraductionDocument201 pagesTH Cristea - Strategies de La Traductionmona_ingeras88% (8)
- Science Et Champ Akashique by Laszlo, ErvinDocument265 pagesScience Et Champ Akashique by Laszlo, ErvinPascale100% (1)
- Les Existences Moindres - David Lapoujade - Z Lib - OrgDocument113 pagesLes Existences Moindres - David Lapoujade - Z Lib - OrgJairo Rocha100% (2)
- Cahier N°2Document91 pagesCahier N°2André OchmanPas encore d'évaluation
- Francois de Sales - Oeuvres Completes - Vol.3Document593 pagesFrancois de Sales - Oeuvres Completes - Vol.3librisPas encore d'évaluation
- YoussoufDocument76 pagesYoussoufTidiane SogobaPas encore d'évaluation
- Beau Proverbe Humour Amour Amitié Argent TravailDocument29 pagesBeau Proverbe Humour Amour Amitié Argent TravailVoip VisaPas encore d'évaluation
- Le Seigneur Et Satan PDFDocument177 pagesLe Seigneur Et Satan PDFJean Peuplus100% (3)
- LedwinaA LesRepresentationsDocument258 pagesLedwinaA LesRepresentationsJulio Aied PassosPas encore d'évaluation
- Largeault La Philosophie de La Nature À L'âge ClassiqueDocument23 pagesLargeault La Philosophie de La Nature À L'âge ClassiquePhilippe GagnonPas encore d'évaluation
- Approche Globale Des Rêveries Du Promeneur Solitaire-RousseauDocument5 pagesApproche Globale Des Rêveries Du Promeneur Solitaire-RousseaureasonwaPas encore d'évaluation