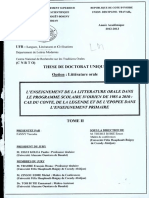Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
FLACELIERE (R.) - L'Éloge D'isocrate À La Fin Du Phèdre (Revue-Des-Etudes-Grecques-46-1933)
FLACELIERE (R.) - L'Éloge D'isocrate À La Fin Du Phèdre (Revue-Des-Etudes-Grecques-46-1933)
Transféré par
aminickDroits d'auteur :
Formats disponibles
Vous aimerez peut-être aussi
- "Un Si Terrible Secret", Lesetagebuch, Matti SchäferDocument5 pages"Un Si Terrible Secret", Lesetagebuch, Matti SchäferCrunchyPas encore d'évaluation
- Dossier AutobiographiqueDocument3 pagesDossier AutobiographiqueNASSA 150Pas encore d'évaluation
- These 636936884325201003Document517 pagesThese 636936884325201003Akissi Eugenie KouassiPas encore d'évaluation
- La Pensee de Pindare Et La 2e OlympiqueDocument172 pagesLa Pensee de Pindare Et La 2e OlympiquepatrserPas encore d'évaluation
- Conte - Les Sept CorbeauxDocument4 pagesConte - Les Sept CorbeauxmartyludoPas encore d'évaluation
- Trédé - Kairos Isocrate Alcidamas PDFDocument21 pagesTrédé - Kairos Isocrate Alcidamas PDFBaruch Von PankäkePas encore d'évaluation
- Catulle Et Ses LecteursDocument12 pagesCatulle Et Ses LecteursJames CarroPas encore d'évaluation
- Article Carmina PriapeaDocument29 pagesArticle Carmina PriapeaMònica Miró VinaixaPas encore d'évaluation
- Detienne Le Territoire de La MythologieDocument16 pagesDetienne Le Territoire de La MythologiePedro GobangPas encore d'évaluation
- Histoire de Mouvements Littéraires XVIDocument5 pagesHistoire de Mouvements Littéraires XVIAnonymous dY4FgLPas encore d'évaluation
- Coign EtDocument16 pagesCoign EtDon MassimoPas encore d'évaluation
- Sens Et Emplois Des Termes Φύσις Et Φυά Chez PindareDocument20 pagesSens Et Emplois Des Termes Φύσις Et Φυά Chez PindareWanderlan PortoPas encore d'évaluation
- Cloche, IsocrateDocument144 pagesCloche, IsocratealverlinPas encore d'évaluation
- Le Panégyrique Ou L'eloge D'athènes Par Isocrate (1817)Document288 pagesLe Panégyrique Ou L'eloge D'athènes Par Isocrate (1817)AriciePas encore d'évaluation
- Lectures de La République de Platon 3-4 - Le Philosophe-Roi PDFDocument1 pageLectures de La République de Platon 3-4 - Le Philosophe-Roi PDFjose fernandezPas encore d'évaluation
- Bardon, H. (1965) Rome Et L'impudeur - Latomus 24.3, Pp. 495-518 PDFDocument25 pagesBardon, H. (1965) Rome Et L'impudeur - Latomus 24.3, Pp. 495-518 PDFVioletaPas encore d'évaluation
- Le Banquet (Platon) - Wikipédia PDFDocument93 pagesLe Banquet (Platon) - Wikipédia PDFcr7 football roodPas encore d'évaluation
- Athénée de Naucratis Livre 15Document56 pagesAthénée de Naucratis Livre 15gustavog1956Pas encore d'évaluation
- L'élégie LatineDocument10 pagesL'élégie LatineBernard BragardPas encore d'évaluation
- Conseils À Démonique - Isocrate JuxtaDocument78 pagesConseils À Démonique - Isocrate JuxtacaligulagermanicusPas encore d'évaluation
- Heracles and PindarDocument29 pagesHeracles and PindarPura NietoPas encore d'évaluation
- Ops Et La Conception Divine de L'abondance Dans La Religion Romaine Jusqu'à La Mort D'augusteDocument348 pagesOps Et La Conception Divine de L'abondance Dans La Religion Romaine Jusqu'à La Mort D'augustemangiacarrubePas encore d'évaluation
- Oeuvres Complètes d'Aulu-Gelle. Tome 1Document496 pagesOeuvres Complètes d'Aulu-Gelle. Tome 1Ahmed Berrouho100% (1)
- Meurant - Romulus, Jumeau Et RoiDocument29 pagesMeurant - Romulus, Jumeau Et RoiMaurizio GallinaPas encore d'évaluation
- b24861054 PDFDocument362 pagesb24861054 PDFPedroPas encore d'évaluation
- Étrennes de Septantaine. Travaux de Linguistique Et de Grammaire Comparée Offerts À Michel Lejeune Par Un Groupe de Ses ÉlèvesDocument6 pagesÉtrennes de Septantaine. Travaux de Linguistique Et de Grammaire Comparée Offerts À Michel Lejeune Par Un Groupe de Ses ÉlèvesJoop-le-philosophePas encore d'évaluation
- Pirenne Aphrodite GrecqueDocument554 pagesPirenne Aphrodite GrecqueNikos HarokoposPas encore d'évaluation
- Genet Ou La Danse Macabre Du Bien Et Du MalDocument18 pagesGenet Ou La Danse Macabre Du Bien Et Du MalIsa LemmypPas encore d'évaluation
- Valentin Nikiprowetzky - La Troisième SibylleDocument12 pagesValentin Nikiprowetzky - La Troisième Sibylle_Giemmeci_Pas encore d'évaluation
- FJODOR MONTEMURRO - MELANIPPE Fr. 506 JfHR-Vol-11-33-67-220818Document36 pagesFJODOR MONTEMURRO - MELANIPPE Fr. 506 JfHR-Vol-11-33-67-220818Maria piaPas encore d'évaluation
- Kernos 1374 15 La Rationalite Des Mythes de Delphes Les Dieux Les Heros Les MediateursDocument25 pagesKernos 1374 15 La Rationalite Des Mythes de Delphes Les Dieux Les Heros Les Mediateursest1949Pas encore d'évaluation
- Mouraviev, Serge N. - Travaux de Serge N. Mouraviev Sur La Philosophie Grecque - 2012Document12 pagesMouraviev, Serge N. - Travaux de Serge N. Mouraviev Sur La Philosophie Grecque - 2012the gatheringPas encore d'évaluation
- L'oeuvre Du Divin Arétin by Pietro AretinoDocument139 pagesL'oeuvre Du Divin Arétin by Pietro AretinoDanKoifmanPas encore d'évaluation
- Athénée de Naucratis IntroductionDocument11 pagesAthénée de Naucratis IntroductionAura de Beleta100% (1)
- Defixiones D IstrosDocument47 pagesDefixiones D IstrosProfessora Amanda MartinsPas encore d'évaluation
- Alain Michel Le Vocabulaire Esthétique À Rome Rhétorique Et Création ArtistiqueDocument21 pagesAlain Michel Le Vocabulaire Esthétique À Rome Rhétorique Et Création Artistiqueze_n6574Pas encore d'évaluation
- Histoirecompar02gr PDFDocument512 pagesHistoirecompar02gr PDFFrancophilus VerusPas encore d'évaluation
- Bourdieu - Clisthène L'athénien Selon Leveque Et Vidal-NaquetDocument3 pagesBourdieu - Clisthène L'athénien Selon Leveque Et Vidal-NaquetDavo Lo SchiavoPas encore d'évaluation
- Aubriot-Sévin, Prière Et Conceptions Religieuses en Grèce AncienneDocument590 pagesAubriot-Sévin, Prière Et Conceptions Religieuses en Grèce AnciennezkjeblPas encore d'évaluation
- Platon2001 2002Document43 pagesPlaton2001 2002ciclojoplejicoPas encore d'évaluation
- Le Songe de Poliphile Ou (... ) Colonna Francesco Bpt6k1073366tDocument651 pagesLe Songe de Poliphile Ou (... ) Colonna Francesco Bpt6k1073366tBailey Fensom100% (1)
- Thèse Yann LerouxDocument293 pagesThèse Yann LerouxYann Leroux100% (2)
- Métrique Et Tropos Dans Les PersesDocument44 pagesMétrique Et Tropos Dans Les PersesJean Pierre Kaletrianos100% (1)
- Le Metier Du Mythe-Lectures D'hésiodeDocument493 pagesLe Metier Du Mythe-Lectures D'hésiodeAlfonso Flórez50% (2)
- Querelles Cartésiennes I (Alquié-Gueroult) : Animé Par Pierre MachereyDocument11 pagesQuerelles Cartésiennes I (Alquié-Gueroult) : Animé Par Pierre MachereyAbdelazizGammoudiPas encore d'évaluation
- Vial Poésie ÉrotiqueDocument31 pagesVial Poésie ÉrotiquetdevolfPas encore d'évaluation
- Brutus Expliqué Littéralement Par É. Pessonneaux,... Et Traduit Par J.-L. BurnoufDocument413 pagesBrutus Expliqué Littéralement Par É. Pessonneaux,... Et Traduit Par J.-L. Burnoufalcyon48100% (2)
- The Strange World of Human SacrificeDocument4 pagesThe Strange World of Human SacrificeTiffany BrooksPas encore d'évaluation
- SIMONDON Sur Kronos & ChronosDocument11 pagesSIMONDON Sur Kronos & Chronosmegasthenis1Pas encore d'évaluation
- Ovide Au Moyen AgeDocument24 pagesOvide Au Moyen AgeAnca CrivatPas encore d'évaluation
- PAUL TANNERY Pour L'histoire Du Concept de L'infini Au VIe Siècle Avant J.-C.Document21 pagesPAUL TANNERY Pour L'histoire Du Concept de L'infini Au VIe Siècle Avant J.-C.ze_n6574Pas encore d'évaluation
- Vie Et Destin de L'ancienne Bibliothèque D'alexandrie - Bulletin Des Bibliothèques de FranceDocument2 pagesVie Et Destin de L'ancienne Bibliothèque D'alexandrie - Bulletin Des Bibliothèques de FranceandreacirlaPas encore d'évaluation
- Gémiste Pléthon Et Cosme de MédicisDocument25 pagesGémiste Pléthon Et Cosme de MédicisDavo Lo Schiavo100% (1)
- Bouché-Leclercq, A - Histoire de La Divination Dans L'antiquité IV (1879) PDFDocument422 pagesBouché-Leclercq, A - Histoire de La Divination Dans L'antiquité IV (1879) PDFdodge666100% (1)
- Chasseur Noir Et Ephebie, Vidal NaquetDocument19 pagesChasseur Noir Et Ephebie, Vidal NaquetVasilis Achilles100% (1)
- Heraclite Et Le CyceonDocument19 pagesHeraclite Et Le CyceonFiorenzo TassottiPas encore d'évaluation
- Anthologie de La Littérature GrecqueDocument1 026 pagesAnthologie de La Littérature GrecqueDanny MukokaPas encore d'évaluation
- Les Perses (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvre d'EschyleD'EverandLes Perses (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvre d'EschylePas encore d'évaluation
- Platon Oeuvres Completes (Z. 13.3 - Dialogues Apocryphes (T. Souilhe) (V. Bude. 1930)Document264 pagesPlaton Oeuvres Completes (Z. 13.3 - Dialogues Apocryphes (T. Souilhe) (V. Bude. 1930)A Fleur de Coeur100% (1)
- Antifonte Decleva CaizziDocument21 pagesAntifonte Decleva CaizziErcilio HerreraPas encore d'évaluation
- Lévêque, P. - Aurea Catena Homeri. Une Étude Sur L'allégorie Grecque PDFDocument84 pagesLévêque, P. - Aurea Catena Homeri. Une Étude Sur L'allégorie Grecque PDFPedro F.100% (1)
- Ordre Et Désordre en Territoire GrecDocument12 pagesOrdre Et Désordre en Territoire GrecJamaa OuarezzamenPas encore d'évaluation
- La Cité Antique: Étude sur Le Culte, Le Droit, Les Institutions de la Grèce et de RomeD'EverandLa Cité Antique: Étude sur Le Culte, Le Droit, Les Institutions de la Grèce et de RomePas encore d'évaluation
- Curiosa: Essais critiques de littérature ancienne ignorée ou mal connueD'EverandCuriosa: Essais critiques de littérature ancienne ignorée ou mal connuePas encore d'évaluation
- Le Sens Du Temps Chez Saint AugustinDocument6 pagesLe Sens Du Temps Chez Saint AugustinaminickPas encore d'évaluation
- L'évolution de La Peinture Religieuse en BucovineDocument6 pagesL'évolution de La Peinture Religieuse en BucovineaminickPas encore d'évaluation
- Notes Sur Des Manuscrits Patristiques Latins, REAug-1971-Nr-1-4Document440 pagesNotes Sur Des Manuscrits Patristiques Latins, REAug-1971-Nr-1-4aminickPas encore d'évaluation
- Gnose ChretienneDocument12 pagesGnose ChretienneaminickPas encore d'évaluation
- L'Oracle, Thérapeutique de L'angoisseDocument19 pagesL'Oracle, Thérapeutique de L'angoisseaminickPas encore d'évaluation
- La Dimension Historique Du Sacré Et de La Hiérophanie Selon Mircea EliadeDocument27 pagesLa Dimension Historique Du Sacré Et de La Hiérophanie Selon Mircea EliadeaminickPas encore d'évaluation
- Une Traduction Française Des Écrits IntertestamentairesDocument11 pagesUne Traduction Française Des Écrits IntertestamentairesaminickPas encore d'évaluation
- L'Eglise Catholique Face À 'Extraordinaire Chrétien Depuis Vatican II PDFDocument433 pagesL'Eglise Catholique Face À 'Extraordinaire Chrétien Depuis Vatican II PDFaminickPas encore d'évaluation
- Sources Chretiennes - Liste LivresDocument5 pagesSources Chretiennes - Liste LivresaminickPas encore d'évaluation
- VIEILLEFOND (J.-R.) - Un Fragment Inédit de Julius Africanus (Revue-Des-Etudes-Grecques-46-1933-4)Document7 pagesVIEILLEFOND (J.-R.) - Un Fragment Inédit de Julius Africanus (Revue-Des-Etudes-Grecques-46-1933-4)aminickPas encore d'évaluation
- Elie During, L'Âme (Résumé)Document4 pagesElie During, L'Âme (Résumé)aminickPas encore d'évaluation
- L'Anthropologie TernaireDocument13 pagesL'Anthropologie TernaireaminickPas encore d'évaluation
- Thomas Romer, Lla Construction D'un Ancêtre. La Formation Du Cycle D'abrahamDocument19 pagesThomas Romer, Lla Construction D'un Ancêtre. La Formation Du Cycle D'abrahamaminickPas encore d'évaluation
- Thomas Romer, 04. Le Dieu Yhwh. Ses Origines, Ses Cultes, Sa Transformation en Dieu Unique (2 Partie)Document26 pagesThomas Romer, 04. Le Dieu Yhwh. Ses Origines, Ses Cultes, Sa Transformation en Dieu Unique (2 Partie)aminickPas encore d'évaluation
- Thomas Romer, 05. La CondItion Humaine. Proche-Orient Ancien Et Bible HébraïqueDocument27 pagesThomas Romer, 05. La CondItion Humaine. Proche-Orient Ancien Et Bible HébraïqueaminickPas encore d'évaluation
- CRITIQUE Résumé TadiéDocument3 pagesCRITIQUE Résumé TadiéVanessa CavallariPas encore d'évaluation
- Carlo Suares - Code Aleph KabbaleDocument4 pagesCarlo Suares - Code Aleph Kabbalecarine3Pas encore d'évaluation
- Marginalia 64Document30 pagesMarginalia 64Norbert SpehnerPas encore d'évaluation
- Examens Boite A Merveilles SefriouiDocument86 pagesExamens Boite A Merveilles Sefriouibb5752804Pas encore d'évaluation
- S Initier Au Catalan Langue Et Litterature 2017Document44 pagesS Initier Au Catalan Langue Et Litterature 2017andrePas encore d'évaluation
- Les 40 Règles de La Religion de LDocument5 pagesLes 40 Règles de La Religion de LRoutcho TaryaouiPas encore d'évaluation
- Sujet de Culture Generale Et Actualites Lp1 Soir ValideDocument3 pagesSujet de Culture Generale Et Actualites Lp1 Soir ValideDatcha Serge PaiteyPas encore d'évaluation
- Se Quence 5 - 6e MesDocument10 pagesSe Quence 5 - 6e MesTaibiabdelAbdiPas encore d'évaluation
- Henri Cornélius Agrippa Sa Vie Et Son Oeuvre D'après Sa Correspondance PDFDocument147 pagesHenri Cornélius Agrippa Sa Vie Et Son Oeuvre D'après Sa Correspondance PDFGérard HauetPas encore d'évaluation
- Orhan Pamuk - La Maison Du Silence - JerichoDocument328 pagesOrhan Pamuk - La Maison Du Silence - JerichoOuassila DjekidaPas encore d'évaluation
- Cours de Cours de Francais Classe de 1ere Memnon Ou La Sagesse Humaine Classe de 1ere Memnon Ou La Sagesse HumaineDocument2 pagesCours de Cours de Francais Classe de 1ere Memnon Ou La Sagesse Humaine Classe de 1ere Memnon Ou La Sagesse HumainePaula BertićPas encore d'évaluation
- Al Chafi'iDocument2 pagesAl Chafi'iazeermanPas encore d'évaluation
- Gil, Péguy Et DeleuzeDocument11 pagesGil, Péguy Et DeleuzeladalaikaPas encore d'évaluation
- Chansons Populaires Des Provinces de France ChampfleuryDocument279 pagesChansons Populaires Des Provinces de France ChampfleuryTARDPas encore d'évaluation
- Baudelaire CorrespondanceDocument129 pagesBaudelaire Correspondanceantonio rincon nuñezPas encore d'évaluation
- Le Paysage Dans Les Vues Lumière - Marco BertozziDocument19 pagesLe Paysage Dans Les Vues Lumière - Marco BertozziFet BacPas encore d'évaluation
- Histoire Ancienne Afrique Du Nord Stéphane Gsell Tome3Document170 pagesHistoire Ancienne Afrique Du Nord Stéphane Gsell Tome3Pascal GibertPas encore d'évaluation
- Sookie Stackhouse - Interlude MortelDocument118 pagesSookie Stackhouse - Interlude Mortelcéline durezPas encore d'évaluation
- TyptxtDocument2 pagesTyptxtعبد الوهاب جبلونPas encore d'évaluation
- Le SuperlatifDocument1 pageLe SuperlatifMaría Ortega MorenoPas encore d'évaluation
- Fiche de Lecture Double Assassinat Dans La Rue MorgueDocument1 pageFiche de Lecture Double Assassinat Dans La Rue MorgueZoé ThéodonPas encore d'évaluation
- La Représentation Des Femmes Dans La Tradition Orale Berbère - Le Chant Rituel Du Mariage Et La Chanson Traditionnelle (Le Parler Tachelhit Du Sud-Ouest Marocain) - Thèse de Yamina EL AOUANIDocument448 pagesLa Représentation Des Femmes Dans La Tradition Orale Berbère - Le Chant Rituel Du Mariage Et La Chanson Traditionnelle (Le Parler Tachelhit Du Sud-Ouest Marocain) - Thèse de Yamina EL AOUANIidlisen100% (4)
- MartineDocument10 pagesMartineLaurariana StoicaPas encore d'évaluation
- Edelman Droit Saisi Par La PhotographieDocument185 pagesEdelman Droit Saisi Par La PhotographieMarcelo Rodríguez APas encore d'évaluation
- Le Heros de La Peau de Chagrin Une VictimeDocument6 pagesLe Heros de La Peau de Chagrin Une VictimelynamamryaPas encore d'évaluation
- Svane Note Terrain PDFDocument22 pagesSvane Note Terrain PDFLemon BarfPas encore d'évaluation
FLACELIERE (R.) - L'Éloge D'isocrate À La Fin Du Phèdre (Revue-Des-Etudes-Grecques-46-1933)
FLACELIERE (R.) - L'Éloge D'isocrate À La Fin Du Phèdre (Revue-Des-Etudes-Grecques-46-1933)
Transféré par
aminickTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
FLACELIERE (R.) - L'Éloge D'isocrate À La Fin Du Phèdre (Revue-Des-Etudes-Grecques-46-1933)
FLACELIERE (R.) - L'Éloge D'isocrate À La Fin Du Phèdre (Revue-Des-Etudes-Grecques-46-1933)
Transféré par
aminickDroits d'auteur :
Formats disponibles
L?
LQGE D'ISOGRAT
A LA FIN DU RHDRE
(1>
De mme
que l'apparition
de
VEuthydme
dans la collection
des Universits de France a t l'occasion
pour
M. G. Mathieu
d'tudier
les
premiers
conflits entre Platon et Isocrate
(2),
je
voudrais m'autoriser de celle du
Phdre,
non
pas pour pr-
tendre donner une solution au
problme
si dlicat et si contro-
vers des
rapports
d'Isocrate et de
Platon,
mais seulement
pour
exprimer
mon
impression personnelle (peut-il, ici,
s'agir
d'autre chose
que d'impressions?)
sur le seul
passage
de l'oeu-
vre du
"philosophe
o Isocrate *soit
dsign expressment par
son nom
Parmi tous les autres endroits de Platon o l'on a voulu
reconnatre des allusions son
contemporain (3),
il en est
un,
cependant, que
l'on ne saurait
ngliger
:
je partage
entire-
ment
l'opinion, exprime
en dernier lieu
par
L. Mridier et
M. G.
Mathieu,
suivant
laquelle
l'interlocuteur
anonyme
de
Criton dans
VEuthydme est,
selon toute
vraisemblance,
Iso-
(1)
Louis
Mridier,
avec sa bont
habituelle,
a
accept
de
lire,
eh
1929,
un
mmoire rest indit, que j'avais
crit en 1923 sur
ce-sujet
: Isocrate et
Platon;
il m'a donn des indications pour que j'en
tire un article destin la Revue des
tudes
grecques.
C'est ce
que
fais
aujourd'hui seulement,
et il n'est
plus
l
pour
l'accueillir. Je voudrais
que
le
prsent
travail ft considr comme un
hommage
d'affectueuse reconnaissance sa mmoire.
(2) Mlanges Glotz,
555-564.
(3)
Voir,
par exemple,
H. D.
Verdam,
dans
Mnemosyne, XLIV, 1916,
373-395.
L'LOGE D'ISOCHATE A LA FIN DU
PHDRE
225
crate
(1).
J'admettrai
pour
ce
dialogue
la date
propose par
L. Mridier : dans les annes
qui
ont suivi la fondation de
l'Acadmie
(387)
(2),
et,
pour
le
Phdre,
celle d
M. Robin :
dans la
priode qui prcde
le
dpart
de
Platon,
au
printemps
de
366, pour
son deuxime
voyag
en Sicile
(3).
^>
Isocrate tait donc
presque septuagnaire quand
Platon,
lui-
mme
g
d'une soixantaine
d'annes,
faisait dire
Sorate
:
Ne'o; ext,
w
SaSpe, To-oXpti;
8
ptvxot :p.avxeop.at
xax'auxo,
Xyetv
s9sXd>... Aoxet
ptot
ovetvwy 'i\
xax
xo;
uepi
Aouav "etvat
Xyou;
'"*
xvj;
cpiiaew;,
xt xe
JjQet
vevvtxwxpcj) xexpwOat.:
"flore
o8v av
yvotxo 8aupt.ao-xv, up'ottioTjg
xvj; riXvxta;,
et
i.spl
xou
xe
xo;
X6you;
ol;
vv
litfy^etpet
TtXov
$
itatSwv
Steviyxot
xwy ittimoxe
(J;apivi>vX6yv
'
ext
xe,
el
aux^ pt; Tro^p)Tat
xaxa,
STCI
pietw
8
xi;
axv
ayot ppvr eioxpa
<p<ret
yp,
M
tpXe,
vea:x
xt;
cptXo-
uotpta x
xo
vSp
Stavota. Taxa
Sy;
ouv:
yw ptv, itapa
xoivSe
xwv
Oev,
w;
pto;
TOXISIXOI;
'iToxpxet
^ayylXXti) (Phdre,
278 e-
279a, b).
Dans la Notice de son
dition,
M. Robin est rest fidle
l'exgse qu'il
avait dfendue dans La Thorie
platonicienne
de
(1)
L.
Mridier,
Notice de
VEuthydme, p.
133
sqq. ;
G.
Mathieu,
Ml.
Glolz,
p,
558-9. Cette
opinion
remonte a
Spengel (Abhandl.
der
bayer.
Akadrder Wis-
sensch., 1855,
p, 165).
Si i'on
remarque q'Isocrate
affectionnait
particulire-
ment les mots de la racine de
Soxio,
l'on sera tent de voir un vritable
pastiche
dans ces
paroles
de
Socrate,
o.
l'on en trouve
cinq exemples
en
quelques
lignes
:.... oovrat S'evi itxvtwv
aoywTOTot v6p_(i7c<uv,itp
8 T slvai xai Soxev
Ttivu
ap TcaXko,
loxe
napi
icw
siSoxi(Ji.ev li*.Tto8<!>v flaw
eiv*t
pSvx
i^Xou
-^ TO;
ittpl (ptXooolav dvSpitou. 'HYOOVTIXI o&v,
iii
TOTOUet;
Sdljav
xocca-
x^dusiv j.iri86vi;
Soxev
d|ou evsi, vot[*i<j6-iTViTiK y.Sj
itap
rcsiv Ta
vtXTiT^pta
Sav otuEiftii
TO<p(aTtpi (Eulhyd..
305
c-d).
(2)
Je
n'accepte
donc
pas l'opinion
de M. G.
Mathieu, qui
veut faire descendre-
la
composition
de
VEuthydme (ou,
tout au
moins,
la rdaction du
passage
en
question)
aux
derniers mois de l'anne
380, c'est--dire
aprs
le
Pangyrique
d'Isocrate. Les
objections
sa
propre
thse ont t
exposes par
M. Mathieu lui-
mme
(Ml. Glolz,
560-1),
et elles me
paraissent
suffisamment fortes
pour que
l'on
prfre
s'en
tenir la date d
L,
Mridier. Je
pense que VEuthydme
est
antrieur au
Pangyrique,
mais
je
ne sais s'il fut
compos
avant ou
aprs
le
Busiris
(qui
doit se
placer
entre 390 et
385,
cf. G.
Mathieu,
Notice du
Busiris,
dans
l'dition
d'Isocrate de la Coll. des Universits de
France, 1,
p. 184-5).
(3)
Je
n'admets cette
date, d'ailleurs,
que
comme
l'hypothse
actuellement la
plus-vraisemblable;
voir ce
qu'en
dit M. Robin lui-mme dans sa
Notice, p.
II-IX
et
aussi
p.
CLXXV : ...
..si
le Phdre n'est
pas
une oeuvre de
jeunesse.
RBG, XLVI. 33. n 218-210 ,
15
226 M. FLACEL1RE
l'amour
(1),
et
qui
est
aussi,
notamment,
celle de Rseder
(2).
Il crivait en 4908 : Le
prestigieux
railleur se donne l'air de
satisfaire l'innocente vanit d'Isocrate
par
des
compliments
qui
ne sont
qu'un persiflage cinglant.
Il crit maintenant:
...pour
un lecteur du
temps
le
compliment
n'tait
qu'une
nasarde, et,
dans un clat de
rire,
il devait savourer la malice
de l'effet
comique
ainsi obtenu
(3).
Si l'on
compare
le
passage
du Phdre celui de
VEuthydme,
antrieur d'une
vingtaine
d'annes
environ,
il me
parat
diffi-
cile d'admettre entirement cette
interprtation.
-
Sauf une
phrase, par laquelle
Socrate se
rsignait
finalement une atti-
tude
plus
sereine
(4),
le
long passage
de
VEuthydme
tait
une
charge
fond contre le
caractre,
la mthode et toute la
position
d'Isocrate et de ses
pareils:
ce
jugement pouvait
rsu-
mer toutes les
critiques portes
:
xptxot
'vxe;
x$
X7}9ea TIXOO-'.
rcpwxoi
Soxetv
etvat, et, par xpixot,
il faut entendre
qu'ils
sont
infrieurs non seulement-aux
philosophes,
mais mme aux
politiques (5).
En
regard,
la
prdiction
de
Socrate,
la fin du
Phdre,
si elle est assurment
empreinte
d'ironie,
me
parat
renfermer au
moins un srieux
loge
du caractre
d'Isocrate,
dont M. Robin fait
peut-tre trop
bon march
(6).
L'ironie est
certaine dans la forme mme de la
prophtie
:
vo;
xt... et dans
les mots (sset et
xt;
qui
diminuent
singulirement
la valeur
philosophique
reconnue
l'es'prit
d'Isocrate,
mais cela
suffit-il
pour
conclure
que
rien,
absolument
rien,
n'est sincre
dans cet
loge (7)
?
'
(1)P.
104-105.
(2)
Platons
philos. Enlwickelung, 1905, p.
275
sqq.
(3)
Notice du
Phdre, p.
CLXXIV.
(4) Euthyd.,
306 c :
EuYy'Yvwcrxeiv
ixv ouv
atJTo
jrp*| z-tfi ittSufita;
x. T. X. Il
faut
remarquer qu'il
n'est
question
ici
que
de
pardon (mfyiyvaKew}
et de la
reconnaissance d'un minimum de
tppvr,<K(.
(5) Euthyd.,
ibid. ; cf. la Notice de L.
Mridier, p.
134.
(6)
Notice du
Phdre,
p.
CLXXIV.
(7)
Cf. G.
Mathieu,
Ml.
Glolz, p.
563 : Isocrate fut
frapp
de la
phrase
du
Phdre
puisqu'il
l'imita
pour
adresser un
loge
au
jeune
Alexandre.
(Lettre V,
5
;
cf. G.
Mathieu,
Isocrate :
Philippe
et Lettres
Philippe, etc., p. 160,
note
7;
L'LOGE D'ISOCRATE A LA FIN DU
PHDRE 227
Les
nuances du
style
et de la
pense
de Platon dans ce
pas-
sage
sont
trop
difficiles saisir
pour que
l'on
puisse
se fier
une
premire impression,
si elle n'est
pas
en accord avec tout
ce
que
nous savons
par
ailleurs des deux crivains. Il semble
lgitime, notamment,
de chercher dans les oeuvres
d'Isocrate,
qui,
la diffrence de celles de
Platon,
sont classes avec une
assez
grande rigueur,
si nous ne trouvons rien
qui puisse jus-
tifier la diffrence
que
nous
croyons
sentir entre le
jugement
du
Phdre'et celui de
VEuthydme.
Prcisment,
H.
Gomperz (1)
me
parat
avoir montr
que
la
pense
d'Isocrate n'est
pas
reste
identique
elle-mme au cours de sa
longue
carrire et
qu'elle
a
volu en se
rapprochant
de
plus
en
plus
de la
pense
socratique;
or,
cette volution me semble
particulirement
sensible dans les annes
qui
s'coulrent
(d'aprs
la
chronologie
que
nous avons
admise)
entre la
composition
de
VEuthydme
et celle Au Phdre. Pour
justifier
cette
affirmation,
je
sais bien
qu'il
faudrait
entreprendre
l'examen dtaill et minutieux de
l'oeuvre d'Isocrate
; je
me bornerai ici
quelques
indications
rapides.
L. Mridier admettait avec raison
que VEuthydme
riposte
aux
allgations
contenues dans le discours Contre les
Sophistes
et dans VHlne
(2),
et il semble inutile de montrer
nou-
veau
que
les
Socratiques,
et Platon
lui-mme,
devaient nces-
sairement se reconnatre comme viss
par l'pre polmique
d'isocrale. Mais ce
qu'il
faudrait mettre
en
lumire,
c'est
que
ces
discours et tous les crits antrieurs
VEuthydme parais-
on se
reportera
aussi au livre du mme auteur sur Les ides
politiques d'isocrale,
p.
177-178).
Si l'on admet
que
la dernire
phrase
de la lettre V d'Isocrate est une
rminiscence de
l'loge
du
Phdre,
il
parait
naturel de
penser qu'Isocrate
lui-
mme a
pris
cet
loge
en bonne
part.
M. Robin
peut rpondre que,
seul des
lecteurs de son
temps,
le
rhteur, aveugl par
la
vanit,
l'a
compris
ainsi, mais
cela
est-il vraisemblable? Comment n'aurait-il
pas
t
dtromp,
en tout
cas,
par
les
sourires,
ou
plutt par
l'clat de rire
qu'aurait soulev,
selon M.
Robin,
le
passage
en
question
?
(1)
H.
Gomperz,
Isokrales
und die
Sokratik,
Wiener
Studien,
1905-6.
(2) Notice de
VEuthydme. p.
141-2. Cf. aussi la notice de l'Hlne dans l'dition
d'Isocrate de la Coll. des Univers, de
France, 1, p.
155,
228 R. FLACEL1R
sent
peu prs exempts
de toute influence
socratique.
Par-
tout, notamment,
nous constatons la
disposition
d'Isocrate
juger
les
hommes
par
l'extrieur :
pour
lui,
le
plus
riche et le
plus
combl de satisfactions matrielles est aussi le
plus
ver-
tueux;
ol
cpaXot,
ce
mot
dsigne
la fois les mchants et les
pauvres.
Celte mentalit
apparat
surtout dans les
plaidoyers,
et c'est
propos
d'une
phrase
du Discours sur
l'attelage,
crit
entre 398 et
395,
que
H.
Gomperz
s'est
exprim
ainsi : Celui
qui pouvait
avoir une telle
pense
n'avait
pas
t mme effleur
par
un souffle de
l'esprit socratique;
car,
d'aprs
cette
concep-
eption,
Socrate lui-mme
.aurait
t
auXxaxo;
-jtvxMv
vBpw-
TCWV
(1).
- .
Le Busiris rend
dj
un son assez diffrent
(2) ;
il ne
contient,
en tout
cas,
aucune trace de
polmique anti-socratique,
non
plus que
le
Pangyrique, compos
vers 380. Son cole tant
maintenant connue et
frquente,
Isocrate
n'prouve plus
le
besoin de
discrditer
des rivaux
qui
ne le
gnent plus.
Mais
voici
qui
est
plus significatif.
Ds la
premire phase
du
Pangyrique,
et aussi dans
plusieurs
autres
passages,
nous
trouvons cette distinction de l'me et du
corps qui
est un des
lieux communs les
plus
chers aux
socratiques (3)
;
dans
l'loge
qu'y
fait Isocrate de la
philosophie,
il
apparat qu'il
ne consi-
dre
plus
celle-ci
uniquement
comme une servante de la rhto-
torique
;
cptXoffOtptav...
\
xwv
a-opttpopwv
x;
xe St'
ptaOav
xal xt;
\
vyxi; ytyvoptva;
SteTXe
(4).
Ce n'est sans doute
qu'un
lieu
commun,
mais
l'expression prouve,
mon
sens,
si l'on
rappro-
che ce
passage
de ceux o Isocrate
parlait
antrieurement de
la
philosophie, que
son
esprit
s'est ouvert des
proccupations
morales,
qui
lui taient
auparavant trangres.
Ces mmes
proccupations
se manifestent d'une manire encore
plus-claire
(1)
Isokrates und die
Sokratik, p. 168,
propos
de Sur
l'Attelage (XVI), par.
33.
(2)
Outre la manire dont Socrate est dfendu
(Busiris (IX), 5-6),
on
pourrait
citer
plusieurs passages,
dont les ides font
penser
celles des
Socratiques,
et
mme celles de Platon : Busiris.
22, 28-29., 38,
39.
(3) Pang. (IV),
1-2
;
92 et
passim.
(i) Pang.,
47.
-
.
L'LOGE D'ISOCRATE A LA FIN DU 'PHEDRE ' _ 229
dans
les trois discours adresss
Nikokls,
roi de
Chypre,
dont
nous ne savons
pas
les dates
exactes,
mais
que
nous
pou-
vons au moins situer
approximativement, puisque
Nikokls
semble
avoir
rgn
Salamine entre
374
et 365
(1).
Le
plus
ancien
est le Discours Nikokls : Isocrate
proclame que pour
aucun
athlte,
il n'est aussi utile d'exercer
son
corps que, pour
les
rois,
de-cultiver leur
me, puis
il crit : xat
p.v) vpue
XT|V
mpiXetav
v
ptev
xot; XXot;
TtpyptaTt yj>-r\<j\.ynv
etvat,
Ttp;
8
xo
jBeXxtou; 'op-S;
xal
oepovtptfcoxpou;yyvea-at u.7iSepi.av Svajjitv
l-^etv
(2).
Isocrate recommande ensuite Nikokls :
"Aoysva.u-
xo
pvrSv
-ixxv
xwv
XXiov,
xal xo'
r,yo
(3a<nXtxxaxov
av
p.y|8e-
pUcfSouXe^;
xwv
TjSoviv
XX
xpaxfl;
xtv
eittOuptiv piXXov
-r
xv
oXtxwv
(3). L'Evagoras
contient
galement
des maximes ana-
logues (4),
de mme
que
le Nikokls
('&),
o on lit notamment :
Il faut
honorer, certes,
ceux
qui
sont naturellement
vertueux,
mais
plus
encore ceux
qui
le sont
par
raison : les
premiers
en
effet
peuvent
venir
changer
de
conduite,
mais les seconds
sont
inbranlables,
Steyvwxxe;
Sxt
pie'ywxv
uxt xv
ayaev
pexvj (6).
-
Il est
juste
de dire
que
l'on trouverait citer
aussi
plusieurs passages qui,
mme dans ces
oeuvres, rap-
pellent
fcheusement l'ancienne mentalit d'Isocrate
(7).
On
pourrait
tendre cet examen aux oeuvres
postrieures (8),
mais
je
le restreins volontairement celles
qui
taient connues
avant la
composition
du Phdre. Je voudrais seulement avoir
rendu
vraisemblable
l'opinion
suivante :
Isocrate,
dans les
(1)
Ce sont les dates donnes
par Drerup,
dans son dition d'Isocrate.
(2)
A Nik.
(Il), 11,12.
(3)
A
Nik. 29.
.
(4)
Par ex.
Evag. (IX), 74,
78.
(5) L'authenticit de cet
ouvrage
me semble avoir t conteste tort.
($)Nik. (III),
47.
(7).Parex. A
Nik., 30; Nik.,
60.
'"'.
(8)
L'Aropagitique
est l'une des oeuvres les
plus significatives
cet
gard.
On
remarquera
combien il semble difficile
qu'Isocrate, malgr
les mots :
w;
ty-o itaiSixo; du
Phdre,
ait t
disciple
de Socrate : il aurait attendu
prs
de
vingt
ans
aprs
la mort de son matre
pour
commencer
s'inspirer
de sa doc-
trine ! H semble
qu'il
n'ait connu le
grand philosophe que par
la lecture des
socratiques contemporains (cf.
H.
Gomperz,
Isokrats und die
Sokralik, 26-27).
230 R. FLACEL1RE
annes
qui
se sont coules entre
VEuthydme
et le
Phdre,
non seulement s'est abstenu de continuer la
polmique engage
antrieurement contre les
Socratiques,
mais encore il a accueilli
de
plus
en
plus
favorablement certaines des ides de ceux-ci
auxquelles
il semblait rfractaire dans la
premire partie
de
sa carrire.
D'ailleurs,
il faut
ajouter
aussitt
qu'il
n'a sans
doute
jamais
assimil
pleinement
le contenu
philosophique
de
ces
ides, puisque
ses
conceptions anciennes,
dont on retrouve
l'cho
plus
ou moins affaibli dans toute son
oeuvre,
ne lui ont
pas paru incompatibles
avec une morale
plus
leve.
H.
Gomperz,
constatant cette volution de la
pense
d'Iso-
crate,
en
pris prtexte pour
btir une thorie fort
peu
vraisem-
blable,
qui
mconnat d'ailleurs la forte dose d'ironie contenue
dans
l'loge
du Phdre
(1).
Mais
pourquoi
ne vouloir admettre
chez
Platon,
au
sujet
d'Isocrate,
que
des
opinions
extrmes?
Pourquoi
serait-il interdit de
penser qu'il
l'a
jug
dans le
Phdre sa
juste
valeur,
en tenant
compte
la fois de ce
qu'il
trouvait en lui de bon et de mauvais?
Peut-tre est-il
possible
de
prciser davantage
en
rappelant
la thorie
platonicienne
de
l'opinion
vraie. Peu
d'esprits
ont en
partage
un rel amour de la
vrit;
les
philosophes
sont en
petit
nombre.
Pourtant,
en dehors de ceux-l il
n'y
a
pas que
des
ignorants
el des sots. Tw ox etSxt
apa rapt
t5v av
pur) etS^j
vewtv
X-yiOe;86ijat
itepl
xoxwv
;
demande Socrate
Mnon,
qui
rpond
affirmativement
(2).
Sans doute ces
opinions
vraies
,
pareilles
aux statues de
Ddale,
peuvent s'chapper,
si elles ne
sont
pas
enchanes
par
le
raisonnement; mais,
dans la
pratique,
elles suffisent aux hommes
politiques
et aux orateurs.
A|a
pa
X-/^;
itpo; op9xv}xa Tipew;
ot>8v
%epv Tiyepiwv cepov-/)-
(1)
H.
Gomperz (op. cit., 29-32)
voudrait
que
Platon et Isocrate se fussent
rconcilis
l'poque
du Phdre en vue d'un but
pratique
: la bonne entente
des deux coles
rivales, galement
utile l'une et l'autre
;
Platon se serait
senti mal l'aise
pour
crire cet
loge
intress et c'est
pourquoi
il nous sem-
blerait
quivoque.
Dans cette
hypothse,
il faut avouer
que
Platon et
t,
en
effet,
bien maladroit !
(2) Platon, Mnon,
85 D.
L'LOGE D'ISOCRATE A LA FIN DU
PHDRE ))
231
o-ew;.
En
effet,
si elles
n'galent jamais
la
science,
elles
per-
mettent du
moins,
dans un certain nombre de
cas,
de
tomber
juste
(1).
Telle est cette thorie
par laquelle
il semble
que
Platon ait voulu attnuer la
rigueur
de son
attitude,
en recon-
naissant une certaine
valeur des
moyens
de connaissance
autres
que
ceux des
philosophes.
Comparons
maintenant ce
point
de vue le
jugement
de
VEuthydme
.-et celui du Phdre. Le
premier place Isocrate,
nous l'avons
vu,
au troisime
rang,
non seulement au-dessous
des
philosophes,
mais mme au-dessous des
politiques, qui
prcisment,
aux
yeux
de
Platon,
font
grand usage
des
opi-
nions vraies
(2) ;
en
outre,
Socrate ne lui reconnat
pas
la
vrit dont ces
opinions
doivent
participer
en
quelque
manire,
puisqu'il
dit : Kat
yp eyet
vxw;...
eitpiTtetav ptXXov
Y] XTGetav.
Dans le Phdre au
contraire,
cette
sorte de
philo-
sophie que
la nature a mise dans son
esprit
,
n'est-ce
pas jus-
tement la source o les
opinions
d'Isocrate,
considres comme
fausses dans
VEuthydme, prennent
une valeur au moins rela-
tive? Le mot oeo<retsemble autoriser cette
interprtation
;
car
les
opinions
vraies
procdent
d'une
inspiration
ou d'une rmi-
niscence
infuse,
tandis
que
le raisonnement seul
peut conduire,
par
la voie de la
dialectique,
la
science
(3);
ces
opinions
proviennent
aussi d'une
impulsion
divine,
elles sont un
pr-
sent des
immortels, obtenu,
comme la
vertu,
eta
ptopa (4)
:
or,
ce
qui pourrait permettre
Isocrate de s'lever
plus
haut,
d'aprs
Socrate,
c'est une
oppi Oetoxpa.
Voici donc en
quoi
le
jugement
de Platon me
parat plus
favorable dans \e Phdre
que
dans
VEuthydme,
tout en
compor-
tant encore des restrictions essentielles : des trois
degrs
d'aprs lesquels
Platon
rpartit
les
hommes,
suivant
qu'ils
(1) Platon, Mnon, 97, E, B,
C. On
pourra rapprocher
de ce dernier
passage
ce
que
dit Isocrate lui-mme des
Sai
dans
VAntidosis, 271;
mais,
pour Platon,
elles ne sont
jamais qu'un pis
aller.
(2) Mnon,
99 C :
si8o|a... ij
ot TOAITIWO'I
vSps jrpwpievot
T4<; it^ei
opBoaiv.
(3) Mnon,
99 D
sqq.
(4) Mnon,
100 B
;
cf. 99 D.
232 R. FLACELIRE
s'approchent plus
ou moins d la connaissance
vraie,
Isocrate
s'est lev du
premier
au
second,
mais
jamais
il n'atteindra le
troisime,
qui
est rserv aux
dialecticiens,
c'est--dire aux
hommes
qui aspirent
possder
de la
ralit,
non
pas
une vue
empirique
et
fragmentaire,
mais une science rationnelle et
complte.
Platon,
entre
VEuthydme
et le
Phdre,
a constat
l'volution
d'Isocrate;
elle est bien loin de le satisfaire
pleine-
ment,
et il tient
marquer
les distances avec un
ironique
ddain, mais,
au lieu de tout condamner en
lui,
comme il
l'avait fait
prcdemment,
il lui rconnat une minente
sup-!
riorit sur ses rivaux et mme une relative lvation de
pense (1).
Telle est
l'interprtation qui
me semble tre le
mieux en accord la fois avec la
chronologie
actuellement
admise,
avec l'oeuvre du rhteur et avec la
pense
mme du
philosophe.
R. FLACELIRE.
(1)
Le
jugement
de Th.
Gomperz (Les
Penseurs de ta
Grce,
trad.
Reymond, II,
p. 439)
sur Isocrate : un
grand
homme born
,
ne rend-il
pas
un
peu
l mme
son
que
celui de Platon dans le Phdre ?
LES FUSEAUX DES MOIRES
M. W. Peek a
publi
rcemment une
pigramme
funraire
conserve au muse de
Mykonos
et
qui provient
de Rhne
'(1).
11 n'en a
pas
donn une traduction
prcise,
mais une
interpr-^
tation suivie d'un commentaire. Of il ressort du commentaire
qu'il
attribue aux deux derniers vers un
sens,
mon
gr,
inadmissible. Voici
l'pigramme
:
T lXov sv
p.opcp^iTt
xal Iv
(ppetv %oyd Xfxtliai,
'lai,
vSpl <pXtpX*Prta
"oQeiv-aTov
;
towrSe
yp
ox'
'[JLat[AO<; yAAeTai
(
uplv 'ATOXXW,
XXot
'ASYI
zb reov
xAAo
voutsinaTO.
Mryr/ip
8'
j;
Slvo
TO)9i[/ivY|v
ire xaXTt-rei
Yl
Ttp'.v
au
1
<>8ivwv T
yXux
8o<ra
cpo.
'Av~
y'
w
Mopai yajjitj/oi;
ITCE^KO^S
ocTpxToi
.ayva,
el
yevTou
itavrl TXOO-I
Twpouv (2).
(1)
4/ften.
Milteil., LVI, 1931, p. 121,
n. 3.
(2)
Comme le v. 3
parait
montrer
que
le mari d'Isias tait en mme
temps
son
rre,
M. Peek
pense qu'Apolls
tait sans doute un
gyptien;
il lui attribue
aussi une
origine juive.
H faut reconnatre
que
le nom
'AitoXXti se rencontre
frquemment
dans les
papyrus d'Egypte (cf. Preisigke, Namenbuch,
s.
v.)
et
qu'il
est assez souvent
port par
des Juifs
;
dans les Actes des
Aptres, 24, 18,
parat
un 'AnoXX&i; 'Ioirao
'AXeljavSpei;
x
TCVO.
Toutefois
Apolls pourrait
aussi tre
originaire
d'Asie-Mineure : cf.
BCtl, XIII, 1889, p. 340,
n. 5
(riza).
"Ojiaijio? peut dsigner
des frres et soeurs
consanguins
entre
lesquels
le
mariage
tait
permis
mme
par
le droit
attique ;
aussi
bien,
en
Asie-Mineure,
la
prohibition
du
mariage
entre frres et soeurs n'existait-elle sans doute
pas
: cf. E.
Weiss,
Zeilshr. Savigny Slift.,
RSm.
Abt., XXIX, p.
340
etsuiv.;
F. Cumont. C. R.
Acad.
Inscr., 1924, p.
53 et suiv.
;
Kornemann,
Die Geschwisterehe in
Altertum,
Mitleil. Schles. Gesellsch.
f. Vlkerk.,XXl\, 1923, p.
17 et suiv.
; Klio, XIX, 1925,
p.
356 et suiv.
REG, XLVl, 1933,
n- 217. 18
274 P. ROUSSEL"
M. Peek
interprte
: Widersinn ist
es,
ihr
Moiren,
wenn
die Eltern den Kindern das Grab riisten miissen
;
ce
qui
cor-
respond approximativement
au sens du
distique
final.
Mais,
dans son
commentaire,
il veut
que
ce
distique
nous montre
les Moires sous
l'apparence
de vieilles
femmes,
inclinant sur
leurs fuseaux leurs
paules
courbes
(yapn|;o..-. atr^va).
Or
je
ne crois
pas que
cette
image
se soit
prsente
l'esprit
de
notre
pote
: il a seulement
exprim,
d'une manire un
peu
laborieuse,
que
les
Moires,
en faisant
prir
les enfants avant
les
parents,
filaient contre-sens.
Ouand
Platon nous dcrit le fuseau de la
Ncessit,
il nous
dit
que
deux des
parties,
la
tige (riXaxT/))
et le crochet
(yxta-rpov)
en sont faites de cette substance
indestructible
qu'on
nomm
Yadamas
(1).
La
plupart
des fuseaux
qui
nous sont
parvenus
ne sont
pas
munis de leur crochet
(2)
;
mais
quelques peintures
de
vases,
o l'on voit une femme
filant,
montrent nettement
ce dtail de
l'objet (3).
Le fil
qui
tombait de la
quenouille
tait
fix ce crochet et
parfois,
une saillie la
gorge
du crochet
servait le mieux maintenir
(4).
Ce sont les
ayxwrpa qui
sont dfinis dans
l'pigramme par
la
priphrase
:
ya^tj/o a^va.
On sait de reste
que
le terme
(1) Resp.,
IX,
616 c.
(2)
Cf.
Blmner, Technologie
u.
Terminologie
d.
Gewerben,
2e
d.,
t.
I, p. 125,
fig.
42-46. L'auteur crit: A ces fuseaux
manque
le crochet conserv dans
beaucoup d'exemplaires
;
mais
je
n'ai
pu
trouver
qu'un
de ces
exemplaires,
figur
dans A Guide to the Exhibition
illuslrating
Greek and Roman
Life
(British Musum, 1908), p. 157,
fig.
160.
(3)
La meilleure
reprsentation
de vase est donne
par
A.
Brckner,
Lebens-
regeln auf
athen,
Hochzeitsgeschenken (62.
Berl. Winckelmanns
Progr., 1907),
pi. I;
cf. C.
Robert,
Arch.
Hermeneutik, p. 126, fig.
95. Il
s'agit
d'un alabastre
du muse d'Athnes
(Corp. Vas.,
Grce
23, 111, le, Style attique
svre
figures
rouges, pi. 1,
n. 5 : la
reproduction
est
peu distincte).
Voir aussi l'oenocho du
Muse
Britannique
dans A Guide
etc., p. 156, fig.
159
(la bibliographie
est donne
par
J. D.
Beazley,
Atlische Vasenmaler des
rotfig. Stils, p.
188,
n.
7).
Je dois
ces indications
l'obligeance
de Mlle G. H. E.
Haspels.
Bliimner, op. laud.,
p.
132 et
suiv.,
donne d'autres
reprsentations
de femme filant : mais le
plus
souvent,
le crochet du fuseau
n'apparat pas
dans les
reproductions que j'ai pu
consulter; par exemple pour
la
coup d'Orvito,
Arch.
Zeit.,
XXXV
(1877), pi.
6
(Bliimner, p. 133, fig. 50).
(4)
La saillie est trs visible sur l'alabastre du Muse d'Athnes.
LES FUSEACX DES MOIRES 275
ot-^vv
ne
s'applique pas qu'au
col des tres anims. Il,
peut
dsigner
dans un
chapiteau
la
partie
troite
oppose
l'abaque
et
reposant
sur le tambour
suprieur
de la colonne
(1).
D'autre
part,
les
comptes
des
pistates
d'Eleusis
pour
l'anne
329/8
mentionnent
:
aii-^ve Sptivoi////
el
TO
V^apeov
xal
TOUevoa-
aou
TO
tet[%]ou rep'oi "psXvot '[el
?/|V
TJpo^iXelav (2).
Vn
Herwerden
interprte
:
paliaut tigni gerius
videtur
(3). Enfin,
on entend
par au^v
la
partie suprieure
de la
hampe
du
gouvernail
dans
laquelle
est
implante
la barre
, et,
par
extension,
le
gouvernail
tout entier
(4).
Ce dernier
emploi
me
parait
avoir dtermin la
mtaphore
dont s'est servi le
pote.
Le crochet
qui
sert fixer le fil
permet
aussi de donner au fuseau le mouvement de rotation nces-
saire
: il est comme le
gouvernail
du fuseau. Sans doute ne
doit-on
pas
chercher une
interprtation trop
stricte en se
demandant comment le crochet du fuseau
peut
avoir t mis
l'envers
(vTa... 7te9ixaTc).
L'auteur
imagine qu'il
est
plac
de telle sorte
que
le fuseau tourne en sens inverse du
sens
normal.
M. E. Steinbach
(5)
a montr
nagure que,
selon la
conception
la
plus ancienne,
la destine de l'homme est
dj
file entire-
ment
par
les
Parques
sa naissance. Plus rcemment on se
reprsente
que
les Moires travaillent au fil del destine
pen-
dant toute la vie de
l'homme,
laquelle
se
prolonge
aussi
long-
temps que
la
quenouille
est
garnie
de laine ou
que
le fil ne se
rompt pas.
C'est cette dernire
conception que
se rattache
plutt
l'auteur de
l'pigramme;
mais on aurait
quelque peine
prciser davantage.
Le terme
votxXwQe'v,
qui indique
l'acte
de
filer
rebours,
s'applique
d'ordinaire une modification de
(1) IG, 112,
n.
1680, 1.
8;
cf.
Caskey,Amer.
Journ.
Arch., IX, 1905, p.
156.
(2) IG, lis,
n.
1672,
1.308.
(3)
Lexic. dial. et
supplet.,
2e
d.,
s. v.
ctvyfiv.
(4)
Cf. A
Cartault,
La trire
athnienne, p.
102 et-suiv.
(5)
Der Fadender
Schiksalsgottheilen (Leipzig. Dissert., 1931)
: cf.
Aug. Mayer,
Moira in
griech.
Inschriften (Giessen. Dissert., 1927);
S.
Eitrern, ap. Pauly-
Wissowa,
t.
XV,
s. v.
Moira,
col. 2475 et suiv.
276 P. ROUSSEL
la destine
(1)
: les Moires n'ont
pas
accoutum d'attenter ainsi
l'ordre fix :
Durae
peragunt pensa
sorores
nec sua rtro fila revolvunt
(2)
Pour relarder le
trpas
d'un
mortel,
elles filent avec
lenteur;
pour
le
hter,
elles acclrent le
rythme
de leurs fuseaux
(3).
La volont des Moires est souveraine : aux
uns,
elles donnent
une
longue
vieillesse,
aux autres
quelques
annes d'existence
seulement. Pourtant il est contraire un certain ordre naturel
que
les
parents
mettent leurs enfants au tombeau
(4)
: c'est ce
sentiment, exprim
dans diverses
pigrammes, qu'a
traduit le
pote
tant bien
que
mal. Les ouvrires de la
mort,
travaillant
rebours,
filent aux humains une destine
illogique
et dcon-
certante.
P. ROUSSEL.
(1) Lucian.,
De hist.
conscr.,
38.
(2) Senec,
Her.
fur.,
183-184.
(3)
Cf.
IG, XII, 7,
n. 117
(Arksin), corrig par
W.
Peek, Herms, 1931, p. 125;
Sil.
Mal., III,
94-95.
.
'
(4)
Cf.
Kaibel,
Epigr. graec,
n. 115 et 190
(cits par
W.
Peek,
Ath.
Mitt., LVI,
p. 121,
note
3).
NOTE SUR LES ADVERBES
EN
-IVSTV, -tvoa,
-ivSov DSIGNANT
DES.
JEUX
Le
grec
possde
un certain nombre d'adverbes en
-Sov, -Sv^v,
-Sa,
du
type
vautaSv,
r^eSv, pS^v, xpy8)v, xpSa, pySa,
etc..
Ces drivs sont obscurs
(v. Brugmann-Thumb,
Griec/iische
Grammatik*,
p. 294)
: on entrevoit seulement
que
nous devons
avoir affaire des formes casuelles de noms affects d'un
suffixe en dentale sonore. La srie a
pu partir
de
quelques
formes
qui
ont constitu le
groupe
initial,
puis
se
dvelopper.
Le
systme
serait
parallle
celui des adverbes latins en -titn
comme
statim,
etc.. Si l'histoire de ces adverbes reste
ignore,
ils se rattachent des racines
gnralement
verbales,
quelque^
fois
nominales,
et se laissent
analyser.
Plus
nigmatique apparat
le
groupe
dfini des adverbes en
-tvSov, -ivSa, -ivo)v
(1) qui dsignent
des
jeux
:
oeatvvSa,
qui
se
rapporte
une
espce
de
jeu
de
balle,
est tir de oeatvew
;
oTTpaxvSa, qui
se
rapporte
une sorte de
jeu
avec une
coquille,
est tir de
oo-Tpaxov. L'origine
de ces adverbes est
claire,
mais
le suffixe
qui s'y
trouve
impliqu prsente
une structure
singu-
lire. Aucune
analyse
ne
permet d'expliquer
le
groupe
-vo-, La
grammaire
de
Brugmann-Thumb
tire le
systme
d'une forme
comme
XwSv,
atteste dans la
glose d'Hesychius
XivSv
Spjiov
et dans celle de
YEtym. Magn.
64,
22 XivSov
Sp|Aov
(1)
Voir les
exemples groups
chez
Frohwein,
dans les Sludien de
Curtius, I,
p.
103.
278 P. CHAKTRAINE
pp.Twv,
et tente de la rattacher
XtvSw,
XtvSiw. Point de
dpart troit,
qui
ne rend
compte
ni de l'extension de ces
adverbes,
ni de leur
signification prcise.
Le
groupe
se dnonce comme
technique
et
populaire
: on
n'est
pas:surpris qu'il
n'admette
gure d'tymologie.
Les mots
qui
le
composent
sont des adverbes
qui dsignent
une manire
de
jouer.
Ils sont librement forms aussi bien sur des racines
ou des thmes verbaux
que
sur des thmes nominaux. Ces
adverbes se
rapportent
la fois des
jeux
d'enfants et des
jeux
d'adultes,
d'ailleurs difficiles a identifier
(v.
l'article Ludus
;.
dans le Dictionnaire des
antiquits (Lafaye),
l'article
Spiel
dans
le
Pauly-Wissowa-Kroll (Hug)
et la
bibliographie
cite
;
le
livre de
Becq
de
Fouquires;
Les
jeux
des
anciens,
est encore
utilisable).
Nous ne nous
occuperons
ici
que
de la structure de
ces mots. La
plupart
des formes ne sont attestes
que par
les
grammairiens
et en
particulier par
Pollux. Voici un
aperu
des
faits : Drivs de verbes :
fjiuwSa
en fermant les
yeux
(Hesy-
chius
; Pollux, IX,
110
;
113),
cf.
[xw
fermer les
yeux
;
sorte
de colin-maillard
;
par
un
calembour,
une variante du
jeu
s'appelle
aussi
x0^5"} f*u*
et l'enfant dont les
yeux
sont bands
crie
%aXx?|v [AUtav Ovips-w (Pollux,
IX,
123);
X^xySa
en
faisant
claquer
(Lucien, Lexiph. 8, Apollonius Dyscole,
De
adverb.
152,
il),
cf.
XY|X<J> ;
tlnriXaalvoa
en ttonnant
(Phrynichus ap. Bekker, Anecdota, 73, 18),
cf.
^Xayw
;
TraiTvSa en
demandant,
en mendiant
(Hrodien
I, 495;
Theognostus,
dans les An.
Oxon.
de
Cramer, II,
p. 164)
semble
tir de
s-nausu;
lorsque
l'adverbe est tir d'un verbe
contracte,
la finale -wSa
s'ajoute simplement
la racine.
Cette finale
s'est
galement
combine avec des thmes de
prsents
: uoSi-
Sp'aav.ivo'a
se sauver
,
sorte de
jeu
de cache-cache
(Pollux
IX,
110
;
117),
cf.
oraoSiopo-xo
;
tpatvvSa
espce
de
jeu
de
balle
(Antiphan,
II,
p.
126 et 283
[Eock]
; Athne,
15
a;
Pollux, IX,
104),
cf. SMM. De
pareilles
formations trahissent
le caractre
populaire
du
systme.
Quelques
adverbes sont tirs
d'adjectifs
verbaux :
xpoTravSa
NOTE SL'R LES ADVERBES DSIGNANT DES JECX 279
sorte de
jeu
de cache-cache
(Theognostus
dans les An.
Oxon.,
de Cramer, II, p. 164,
15) peut
aussi bien tre rattach
xpuitr
qu' xpit-w
;
orpeirtlvS
espce
de
jeu
de
pile
ou
face,
jou
avec des
pices
de monnaie ou des
coquilles
(Pollux,
IX, .110, 117),
cf.
dTpl(f(j);
oeexlvSoc sorte de
jeu
o l'on
jetait
une
coquille
(Cratinos,
I,
p.
124
[Kock];
Pollux, IX,
110, 117; Hesychis),
cf.
'tpsT,Vo-t;
eXxu<TTv8a
(Eustathe,
1111,
24)
et SieXxuirvSa
(Pollux,
IX,
112) jeu jou
dans les
palestres
o les
joueurs
se tiraient les uns les autres
pour
s'en-
traner
,
cf.
Xxuo-^,
SieXxuT-vo;
xwrjTvSa
jeu
du mme
genre,
o il
s'agit
de rester immobile
(Pollux, IX, 110,
117),
cf.
xv7)To ; \ xuv/ivSa
jeu
o l'on s'embrasse
(Grats,
I,
p.
137
[Kock];
Pollux, IX,
110; 117),
cf.
xuveu,
xuv/)t6
ne semble
pas
attest.
4>puyv8a
TiaiSit EIBO
8i
xoapuv (Hesychis ;
voir aussi
Pollux, IX,
110
;
114)
jeu
o l'on
agite
des
coquilles
tenues
dans une main
,
terme obscur : il
peut
tre
rapproch
de
tppuyw,
ce
qui
n'est
gure
satisfaisant
pour
le
sens,
peut-tre
aussi de
<I>pi;.
La finale -IvSa
pouvait,
en
effet,
s'ajouter
des formes nomi-
nales :
^fjjrplvSa
la marmite
,
cf.
yj>^.
;
sorte de
jeu
dcrit
en dtail
par
Pollux, IX, 110,
117
(v.
aussi
Hesychis
et
Suidas),
o l'un des
joueurs, appel xikpa,
doit
attraper
l'un
des autres
joueurs
;
Sparce-rlva
jeu
o l'un des
joueurs
poursuit
les autres
(Theognostus,
dans les Anecd. Oxon. de
Cramer, II,
p.
164;
Et.
Magn.,
286,
48; Suidas;
Hesychis),
cf.
SpaTOiTi
;
oeuylvSa
jeu
o il faut se sauver
(Theognos-
tus,
/.
c),
cf.
f uyrj
;
oo-rpaxlvSa espce
de
jeu
avec une
coquille,
dcrit
par
Pollux, IX, 110, 111,
cf.
arpaxov;
le mot
est
employ plaisamment par Aristophane,
Cav.
835,
avec une
allusion l'ostracisme
;
yc\x.iv%.
TO
el
'^XKOV
xueiisiv
(Hesych.),
cf.
yal-ni;;
TrXeidTooXvSa sorte de
jeu
de ds ou
d'osselets
(Pollux,
IX, 110,
117),
cf.
7cXei<jro6Xo
TrotrlvSa
dire combien
(Theognostus,
l.
c,
correction chez Xno-
phon, Hipparque,
5, 10),
de
TOJTO;
ioelvSa
jeu
de
l'p
280 P. CHANTRAINE
(Theognostus,
/.
c),
cf.
too;
[aatXivSa
jeu
du roi
(Pollux, IX, 110;
Theognostus.
Le.;
Hesychis; Eustathe,
1425,41);
voir sur ce mot
plus
loin.
Quelques
formations sont obscures :
xuvia-lvSa
(Pollux, IX,
122;
Hesychis; Photius)
est ainsi dcrit
par
Pollux.:
6
jilv
TOptyst.
TU
X^P
5
'lS
'OUTOTCxal
auvuTst,
6 Se xon T
yvu:ittHar-
[xevo
aiJTT
tppexai,
TciXacovtav
%spow
~^
o'faXjjiw
Tb
ppovTO.
Il
s'agit,
semble-t-il,
d'une sorte de cheval
fondu,
appel
aussi
v,
xoTXij)
et wtuSa. La forme reste obscure. L
rapport
avec
xu7iaoiv
*
7T*ipav (Hesychis)
ou
xtiio-i
*
x^X-ri
(Hesych.) s'expli-
que
mal. On a
parfois corrig,
sans doute
tort,
en
xuiorvSa;
l'orthographe
du mot semble
garantie par
l'accord de
Pollux,
d'Hesychius
et de Photius.
S'/owooetXlv8a n'apparat gure
plus
clair
;
le
jeu
est ainsi
expliqu par
Pollux, IX,
110 et 115 :
x8|T;a!. xtixXo,
e
os,
ayowlov 'xo>v
^a^"v
TOxp
x(j> T19|TI.
xav
piev yvoTjcip
gxsvo
Ttap' tj>
xevuai,
TOptQwv itepl
TOV xiixXov
TU7tvsTcu,
E\ SE
[xOot,, TtpuXavEt
TV Vua TUTT-:)V.
Le
compos
contient
le mot
(T^ovo,
mais le second lment ne
peut s'interprter.
Ces mots sont des adverbes. Dans un
fragment d'Antiphane
(II, p. 286, Kock)
on lit oeamvSa
itawv. Athne,
14
f,
en citant
ce
fragment d'Antiphane
dit
^
xuvvSa -rcaiSi. En sous-enten-
dant
mxi8t.,
Pollux crit constamment
7| atvlvSa, Tr,v (3ao-!,Xw8a,
etc.. Les adverbes en -tvSa sont videmment
parallles
aux
adverbes en -Sx. Le
systme
a fourni en
grec
des formations
nouvelles :
yuTplvSa,
tir du driv
y-zpa.,
ou
aivlv8a,
constitu
sur le thme de
prsent oeaww,
montrent la libert de cette
drivation. Mais rien
n'explique
!a combinaison -vS-
qui
carac-
trise le
groupe.
Nous avons affaire des
procds semi-argo-
tiques
dont
l'origine
reste,
par dfinition,
une
nigme.
Nous savons
qu'un groupe consonantique
-vS-
apparat
dans
certains
parlers
mditerranens de la cte
asiatique.
On a
observ
depuis longtemps qu'
un
groupe
-rr- ou -vO- de la
NOTE SUU LES ADVERBES DSIGNANT DES JEUX 281
Grce
propre rpond
dans les
langues asianiques
un
groupe
-vS-i Cette
correspondance phontique
a t
signale par
Kret-
schmer, Einleitung
in die Geschichte der
griechischen Sprache,
p.
293
(voir
maintenant l'article de Deeters dans le
Pauly-Wis-
sowa-Kroll,
s. u.
Lydia,
et celui de
Friedrich,
dans Ebert
Realiexikon
der
Vorgeschichte,
s. u.Altkleinasiatische
Spra-
chen).
Aux noms
propres grecs
du
type TpuvQo, KopivOo,
Sfnvo, rpondent
en Asie-Mineure des noms de lieu comme
"AXtvSa,
LtytvSa,
KXwSa. A l'intrieur du
mot,
le
groupe
s'ob-
serve dans
KavSatiX^, SvSavi,
etc..
L'hypothse
d'un
emprunt
est
toujours
une
hypothse pares-
seuse et
dsespre.
Elle est rendue
plus
difficile ici
par
le fait
qu'il s'agit d'expliquer
non un mot
isol,
mais une srie coh-
rente et
productive.
Elle ne mriterait
pas
d'tre
signale,
si elle
ne
s'appuyait
sur un texte bien
connu,
mais dont on n'a
pas
tir
parti.
Si les adverbes en-w8a
comportent
un suffixe
qui
fait
penser
des formations
asianiques,
c'est sans doute
qu'ils
sont affects d'une finale
prise
au
lydien.
Une indication d'Hro-
dote
(I, 94)
confre cette combinaison une
grande
vraisem-
blance : ">aoi 81 axol AuSol xal
x
itaiyvla
T
vv
(ryltrt
TE xal
"EXXvin xaTEffTewira
tutv
etipTjjjia yEvu9at... 'Ei;ps97ivai
87]
a>v TTE xal TWV xiiwv xal TWV
dTpayXwv
xal
T^
Talp7]
xal TOV
XXwv naawv
iEaiyvi.(i>v
ta.
elSea,
TIXT^V
7tTa-wv. Les
Lydiens
disent encore avoir invent les
jeux
en
usage
et chez eux et
chez les Grecs... C'est ce moment
qu'ils
les
ont
invents,
en
particulier
le
jeu
de
ds,
le
jeu
d'osselets,
le
jeu
de ballon
et les autres
espces
de
jeux,
sauf le
jeu
de dames. Nous
savons combien la civilisation
lydienne
tait
raffine,
et nous
entrevoyons
ce
que
les Grecs ont d lui
emprunter.
Comme
ils ont
appris
de l'Asie-Mineure des modes
musicaux,
ils
peuvent
lui avoir
pris
des
jeux
et des divertissements.
On
peut
tenter de
prciser
l'histoire des adverbes en -wSa.
Quelques-uns
de ceux
que
nous avons cits sont btis sur des.
noms
qui
en
grec
doivent tre
emprunts.
Il est
impossible
de
tirer
parti
de
l'nigmatique
xurunvSa.
Mais
;Vj>v8a
est
driv
de
282 P. CHANTRAINE
iltpo, qui
semble tre" un mot
tranger.
BauiXlvSa surtout est
instructif. Ba<n.Xe
est un des termes
pour lesquels l'hypothse
d'un
emprunt
un
parler
mditerranen
apparat
comme
le
plus
vraisemblable. L'adverbe
dsign
un
jeu que
Pollux
(IX, 110)
dcrit en ces termes :
j3acnXlvSa JJ.V
ouv ITTIVoxav Sia-
xXrjpti)9vT
o
(J.EVpaa-iE
xt
wv
TOCTT^
TO
Ttpaxcov,'
S'
UTtr,pT7i
Etvat,
Xa^wv
itv to
xayjiv uitxitov^
dans le
jeu
du
roi,
on tire
au
sort,
celui
qui
a t ainsi
dsign pour
tre le roi donne des
ordres et les
partenaires que
le sort a
dsigns pour
tre les
sujets
excutent ces ordres . Ce
jeu
remonte une trs
ancienne tradition : Hrodote
(I, 114)
nous montre le
petit
Cyrus jouant
au roi
avec les autres enfants du
village.
C'est
cette mme tradition
qu'il
faut relier l'institution d'un
jJa<ri.-
XE
qui prside
au
banquet.
Cet
usage
ne doit-il
pas
venir
d'Asie-Mirieure,
et
singulirement
des
Lydiens,
dont les
pen-
chants
pour
la vie facile et
pour
les
plaisirs
taient
passs
en
proverbe
chez les anciens ?
C'est en
partant
de mots comme ceux-l et sous l'action
analogique
des adverbes en -8a du
type (xiySa que
le
groupe
des
adverbes en -ivSa se serait
dvelopp.
Il a t constitu des
formes
purement hellniques
comme
jiuvSa,
tir de
fxto,
ou
SpaTcevSa,
tir de
SpaTtTTi.
Une
hypothse qui suppose l'emprunt
d'un suffixe
peut
dcon-
certer. Elle se
justifie
dans ce
problme
dfini
par
des donnes
historiques
et
linguistiques prcises.
Un
pareil procs
a
dj
t admis en
grec
mme
pour
le suffixe nominal
-EV
de
{amXeii,
PpaE, qui joue
un rle
beaucoup plus important,
et dans un
cas o aucun texte
historique
ne vient
appuyer
la combinaison
(v. Debrunner,
ap.
Ebert, Reallexicon,
s. u.
Griechen).
A cette srie
importante
d'adverbes en -wSa se rattache un
groupe
cohrent,
qui
se
rapporte
en
particulier
la vie sociale
ou
politique
:
purrtvSriv
en
prenant
les meilleurs
(1. G., I,
61
;
NOTE SUR LES ADVERBES DSIGNANT DES JEUX 283
IX, 1,333
[-8av]
;
loi dans
Dmosthne, XLIII,
57
; Isocrate,
IV, 146; Aristote,
Polit. 1273
a,
Const. d'Athnes
3, 1; Pollux,
1,
176, VI, 173, etc.);
cf.
apwco;
il a t cr en laconien
un nominatif
trange pwxwSa, qui dsigne
une
dignit (7.
G.,
V, 1, 680);
TtAou-c'lvSviv
en choisissant
parmi
les
plus
riches
(Aristote,
Polit. 1273
a,
Const.
d'Athnes, 3, 1);
cf.
-KIOTO;.
-
La manire dont Aristote
emploie
les deux adverbes en
prcise
l sens : Const.
d'Athnes,
3,
1
:'.T
fxv p%
xaSlsratrav
pia--
xlvo-^v
xai
iiXouTlvSriv
on
prenait
les
magistrats
dans les familles
nobles et riches .
Autres adverbes moins attests :
xpaxwvSriv
en choisis-
sant les
plus
forts
(Pollux, I, 176);
cf.
xp-uo-To ;~
y^o"-
TVS-^V
(yap.w)
se marier avec un
proche parent
(Pollux, I,
175; Suidas) ;
cf.
ay^s-xo
j
le mot se trouve en locrien sur le
bronze de
Pappadakis
(Solmsen-Fraenkel, 46)
sous la forme
vx^TivSav;
la lecture est
douteuse;
Pappadakis
et Wilamowitz
dchiffrent
yyj.oTESav
;
enfin
cpapuylvSvjv
semble inclus dans
un
fragment anonyme
d'un
comique
:
oeapuylv8T|V
crxtmTOVTE
T/|V
ya<7Tp'.|jiapytav
TWV
-^OOBVZCJV
''Axrixol
XyouTtv (Photius ;
Meineke,
Com.
Fragm.,
II,
p. 290;
cf.
Etym. Magn.,
788,
38);
mot
comique
tir de
cppuy.
Ce dernier mot mis
part,
le suffixe
-tvSrjV
a t utilis dans
le vocabulaire
juridique
et
politique.
Ici encore on
songe
proposer l'hypothse que
ces formes soient
parties
de termes
asianiques
emprunts ;
le dtail
prendrait place
dans l'en-
semble considrable des faits
qui marquent
l'influence exerce
par
lessocits des
peuples
mditerranens
sur les enva-
hisseurs
grecs
:
pour
nous en tenir au
point
de vue
linguis-
tique,
les anciens noms de chefs
patnEij,
Tiipavvo,
va",
etc.,
sont des mots
d'emprunt.
Mais sur
l'origine
des adverbes en
-WSY)V
il est
risqu
de rien
prciser.
Le
dveloppement
de la
finale a
pu
tre favoris
par
des raisons de commodit
phon-
tique
ou
rythmique.
P. CHANTRAINE.
L'VOLUTION DU SENTIMENT RELIGIEUX
DANS
LES CIYILSATIONS
PRHELLNIQUES
(1)
De la Crte la
Grce,
en
passant par Mycnes,
et
malgr
de
larges
solutions de
continuit,
on
peut
suivre
approximative-
ment et reconstruire dans l'abstrait avec assez de vraisem-
blance la dcroissance du sentiment
religieux (tout
au moins
celui
qui s'exprime officiellement,
si l'on
peut
dire,
par
les
monuments
figurs,
et
par
les textes
partir
de la
priode
homrique,
car le sentiment
religieux
restera
toujours
vivace dans les classes
populaires,
mais aussi
plus proche
de
la
magie).
On
peut
voir
aussi,
par
un mouvement
parallle,
la
conception
du divin se faire
chaque jour plus
humaine. On
dirait
qu'un
des caractres les
plus frappants
de toute socit
civilise est la
rpugnance
admettre un Dieu non
civilis,
un Dieu dont les actes
chappent
la
logique
sociale et dont
la
puissance
irraisonne la domine
par
ses effets
imprvisibles
;
c'est
pourquoi
le
passage
du
primitif
au civilis est en
gnral
l
passage
d'une
religion
en
quelque
sorte
spiritualiste
un
anthropomorphisme toujours plus
tendu
(2).
(1)
Cette courte tude est
tire,
sans modification
apprciable,
des conclusions
d'un mmoire
prsent,
en
juin 1929,
la Facult des Lettres de l'Universit de
Paris, pour
l'obtention du
diplme
d'tudes
suprieures.
Ce travail.tudiait Les
attitudes de l'adoration dans les
religions prhellniques
et
hellniques,
de
l'poque crto-mycnienne
la fin du v sicle avant J.-C.
(2)
Ou du
symbolisme
au
ralisme, ou,
en cherchant
plus
loin encore les rai-
sons de
l'apparition
du Dieu-homme
(c'est--dire
de
l'Ilomme-dieu)
: de
l'impensable
au
pensable.
LE SENTIMENT RELIGIEUX DANS LES CIVILISATIONS PRHELLNIQL'ES
285
Comme
il est
naturel,
ce sont les rites
surtout,
expression
concrte de la
croyance, qui
nous rendent
perceptible
cette
longue
volution,
mais avec
quelque
retard : nous ne devons
pas
oublier
que
rien ne s'immobilise
plus
dans les
religions
que
les
aspects
de
l'adoration,
dont la tradition se nourrit.
La thocratie Cretoise est
empreinte
de la
plus
intense reli-
giosit
et cette domination
menaante
de la
divinit,
matresse
des individus dans leur
corps
et dans leur
me,
est un lment
essentiellement
primitif
au sein dune civilisation
dj
vo-
lue. La
mimique
de l'adoration
y
est
violente,
l'apparition
du
dieu,
terrible et
soudaine;
le fidle bloui se
protge
vivement
afin de n'tre
pas aveugl par
l'clatante lumire divine
(1)
;
toutes sortes de scnes mouvementes
composent
le
rituel,
telles
que l'arrachage
de l'arbuste sacr
(bague
de
Vaphio)
et
surtout les danses
(2).
La danse
rituelle,
c'est l'lment inhu-
main de l'adoration,
qu'il s'agisse
de seconder les forces
naturelles ou de rendre un
hommage quelconque
la
divinit;
on
y
trouve le besoin de
dpenser
une excitation
que
la
prsence
du dieu a fait aller sans cesse
croissant;
du moins
il sembl
que
c'est le fonds
originel
et instinctif
que
l
religion
a
englob
et
interprt.
Durkheim,
rencontrant
parmi
les rites
du culte
totmique
ces
gesticulations
violentes et
dsordonnes,
les relie ce besoin
d'agir,
de se
mouvoir,
de
gesticuler
que
ressentent les fidles
(3)
;
il ne semble
pas
voir la valeur
profonde
de ces manifestations
instinctives, qui
naissent
par
(1) Bague
d'or de Cnossos :
Dussaud,
Les civilisations
prhellniques
dans le
bassin de la Mer
Ege,
2e
dit., p.
376. Statuette en
bronze,
Muse de Berlin :
Perrot-Chipiez,
Histoire de l'art dans
l'antiquit, VI, fig.
349.
Figurines
votives
en
bronze, Haghia-riada
:
Maraghiannis, Antiquits
Cretoises,
lre
srie,
pi. XXVI, 2,
3.
Empreinte
de sceau de Cnossos :
Glotz, Civ, Eg., fig. 40,
dont la
figure
de droite
rappelle
si curieusement le clbre Joueur de flte de
Tylis-
sos,
du Muse de
Leyde.
(2) Bague
d'or de
Mycnes (M. K.)
:
Evans,
The Palace
of Minos, I, p. 161,
fig.
116.
Bague
de
Mycnes (M.
R.
111)
:
Evans,
op. cit., I, p.
432, fig.
310 C.
(3)
Durkheim,
Les
formes
lmentaires de la vie
religieuse, p.
545,
286 DANIEL ISAAC
induction de la
pratique religieuse
et sont bientt recouvertes
du voile rituel.
m
Ainsi la
religion primitive pousse
sans cesse de nouveaux
rameaux,
jusqu'atu jour
o la
religion civilise,
ayant
rfrn
tout instinct
dsordonn,
les fixe en un code rituel et
mytho-
logique.
Grce ces danses sacres de la
Crte,
nous saisissons bien
le caractre intermdiaire des.
religions prhellniques,
o se
combinent curieusement le ftichisme et
l'anthropomorphisme
(au
sens
tymologique
du mot
;
le dieu n'a encore d'humain
que
la
forme).
Mais au sein de la civilisation minoenne
apparaissent
aussi
de curieuses
reprsentations,
o l'attitude si
spontane
des
adorants s'est
dj fige,
o l'instinct
religieux qui inspirait
aux
fidles des rflexes assez dsordonns fait
place
une dis-
cipline
calcule. Le monument le
plus typique
cet
gard
est
une statuette en
bronze,
de
Tylissos, reprsentant
un homme
faisant le
geste
d'adoration . Il
se tient
debout,
le
corps
for-
tement cambr en
arrire,
le
pied gauche lgrement
avanc :
la main
gauche
tombe le
long
de la cuisse et la droite est
place
devant le front comme
pour
se
protger
contre l'clat des
rayons
manant de la divinit
qu'il invoque
(1).
Une autre
statuette
absolument
identique quant
au
geste,
mais d'un art
infrieur,
de forme
beaucoup plus lance,
mais d'une ex-
cution aussi
beaucoup plus sommaire,
a t trouve
Haghia-
Triada
(2)
;
elle
appartient
la
premire poque
du Minoen
Rcent III
(3).
Ce
qui frappe
dans ces deux
statuettes,
c'est la
fixit
rigoureuse
et
pour
ainsi dire militaire du
geste. Quoique
l'interprtation
donne en soit la mme
que pour
les docu-
ments
rappels
ci-dessus,
protection
contre l'clat d'une
lumire
trop
vive,
on sent ici la
disparition
de tout
naturel,
(1)
Hazzidakis-Franchet, Tylissos
l'poque minoenne, p.
58.
(2) Karo-Maraghiannis, Antiquits Cretoises,
lre
sr.,
2e
d., pi.
XXVI.
(3)
Cf. encore une
figurine
de bronze
analogue
trouve
Psychro
:
Evans,
The
Palace
ofMinos, I, p. 682, fig.
501.
LE SENTIMENT RELIGIEUX DANS LES CIVILISATIONS
PRHELLN1QUES
287
de tout mouvement
instinctif,
tel
que
nous en
voyions
l,
o
tait
grande
aussi la libert des attitudes
;
on saisit
l'appari-
tion d'un lment
conventionnel, artificiel,
dont la
rigueur
manifeste
cependant
la
persistance
M'un sentiment
religieux
encore assez brutal.
A
Mycnes,
si l'on
peut
en
juger d'aprs
les
reprsentations
figures,
tandis
que
les
objets
du culte sont rests les
mmes,
les rites d'adoration se sont assez
profondment
modifis. La
religion prend
un
aspect plus
grave
et
plus mesur,
les mani-
festations
extrieureg
du culte sont
plus discrtes,
et
dj
tout
le
simple
rituel de la
Grce se trouve l en
puissance.
Voici
qui
dnote un
changement important
dans la
conception
du
divin,
une familiarit
plus grande
avec le dieu ou
plutt
avec
l'ide du surnaturel.
Le fidle va dsormais rendre
hommage
son dieu devant
l'autel muni des
objets
consacrs
;
toute
expression
de
frayeur
ou
d'aveugle respect
semble avoir
disparu.
Sur une
bague
d'or de
Mycnes,
une crmonie
tranquille s'accomplit,
en
prsence
de la Desse elle-mme
;
toute
agitation,
toute terreur
religieuse
sont bannies. La Grande
Mre,
au
pied
d'un
arbre,
une fleur sur la
tte,
des fleurs dans la
main,
reoit
d'autres fleurs encore et des
fruits,
que
lui offrent des femmes
et des
jeunes
filles .
(1)
En
Crte,
il est
vrai,
sur le
sarcophage
d'Haghia-Triada,
une scne
religieuse
trs
digne
aussi se
droule : c'est
qu'il s'agit
alors du culte
funraire;
la
pr-
sence du mort
impose
une
atmosphre
de recueillement et de
tristesse. Mais on chercherait en vain
parmi
les documents de
l'art minoen une telle
srnit,
ou
plus
une telle
familiarit,
devant la divinit. C'est le
signe
d'un certain relchement du
sentiment
religieux, que
ce calme soudain des adorants et des
adors;
car ce n'est nullement de l'immobilit attentive
(si
du
moins l'on se fie
l'impression qui
se
dgage
des
reprsenta-
(1) Glotz,
La civilisation
genne, p. 274, fig.
37.
288 DANIEL 1SAAC
tions
mycniennes),
mais bien
plutt
une insouciance
qui
commence
poindre
:
or,
le sentiment
religieux exige
une ten-
sion vive de
l'esprit
o du
corps (danse
sacre,
attention boud-
dhique).
Certes,
de nombreuses
pratiques
Cretoises
subsistent,
telles
que l'arrachage
de l'arbuste sacr et la danse rituelle
(1),
encore
que
l'on ne
puisse
dterminer dans
quelle
mesure, les
figurations qui
en sont faites sont
empruntes
l'art crtois
ou
expriment
exactement des scnes du culte
mycnien.
Mais
dans l'adoration
proprement
dite,
nous trouvons bien
peu
de
points
communs entre l'attitude des adorants minoens et celle
des fidles de la
religion mycnienne.
Une
bague d'argent
dor,
trouve
Mycnes,
nous montre trois femmes
qui
marchent
vers un autel
(2).
Celle du milieu lve une main dans le
geste
de l'adoration.
Ce
geste
de la main leve
,
bien
que,
contrairement
tout ce
que
nous offrent les autres docu-
ments,
il soit fait de la main
gauche,
se retrouvera dans de
nombreuses scnes
religieuses interprtes par
la
glyptique
mycnienne.
A
peu prs
inconnu en
Crte,
il sera le
geste
rituel essentiel du culte
mycnien
et vivra encore dans les der-
nires annes de la Grce. Il fournit la
preuve principale
de
l'volution du culte vers une
image plus
humaine des choses :
dsormais un
simple
salut de la main suffit
pour
entrer en con-
tact avec la divinit
(3)
;
et cette
frayeur, qui rejetait
l'adorant
en arrire en une cambrure
violente,
en mme
temps que
ses
mains se
portaient
ses
yeux,
est un rflexe vaincu
par
une
religion plus
humaine
qu'anthropomorphe. L'apparition
du
dieu,
ses effets sur les
prtresses
et les fidles adorants sont
des scnes
que ngligeront
dornavant la
glyptique
et la
(1) Glotz, op. cit., fig.
38. Tsoundas and
Manatt, Mycenaean Age, fig.
112.
(2) Furtwngler,
Die antiken
Gemmen, 1, pi. VI; II, p.
25.
(3)
Cf. la mme attitude dans
plusieurs figurations (glyptique
et
peinture)
:
Furtwngler, op.
cit., I, pi. VI, 2; II, p. 25;
Tsoundas and
Manatt, op.
cit.,
pi.
XX;
chaton de
bague
de
Phylakopi, provenant
de la
priode
ancienne de
la 3e ville : Excavations at
Phylakopi
in
Melos,
J. H. S.,
1904, Suppl. paper U,
p. 193, fig. 162;
Furtwngler, Mykenische Yasen, p.
III.
LE SENTIMENT RELIGIEUX DANS LES CIVILISATIONS
PRHELLNIQUES
289
sculpture
;
par
contre,
l'accomplissement paisible,
devant
l'autel,
du devoir
religieux
fournira l'art
mycnien
le
sujet
de
multiples
crations
(1).
'
Si donc ls lments
primitifs
d la
religion
subsistent
encore
a
Mycnes
dans une
proportion suprieure,
si, par
exemple*
ls rites
mimtiques n'y
Sont
pas
moins
dvelopps
qu'en
Crte et si le ftichisme
y j toujours
un rle domi-
nant
(cornes
de
conscration,
double
hache,
bouclier),
ils
perdent peu
peu
leur contenu o leur substratum
affectif,
cessent,
ce
qu'il
semble,
de
puiser
une force
permanente
dans
.l'inspiration''religieuse,
vivent, lorsque
le culte s'est
humanis,
d'une vie artificielle et
diminue,
et
sont
tout
prts
cder une
place
ncessaire et
logique
un
anthropomor-
phisme intgral.
En un
mot,
disons
que
l'humanisation o la
conception
humaine de la divinit
prcde l'anthropomor-
phisme.
La
pression
de l'humain sur le surnaturel a moul les
objets
de l'adoration.
Tandis
qu'en
Crte et
Mycnes
on
a, lorsqu'on
traite d la
religion, l'impression
de toucher l'essence mme de la civi-
lisation,
en
Grce,
au
contraire,
la
religion
semble se
prciser
et cesser d'envahir les actes individuels et sociaux dans leur
totalit. En
principe,
il
peut y
avoir,
au dbut de tout acte
solennel dans la famille ou dans la
cit,
un
hommage
adress
aux
dieux,
mais il semble
que
ce ne soit
qu'une
formule
traditionnelle,
courte en
gnral, qui
ne confre
pas
lact
accompli
un caractre essentiellement
religieux.
Chez Homre
mme,
liaison ncessaire entr
Mycnes
et la
Grce,
l'anthro-
pomorphisme dj pleinement
ralis
suppose
un univers
lgrement
amlior et
superpos
au
ntre,
qui
fait
que
l'on
hsite
appeler
manifestations
religieuses
les
rapports
sociaux
qui
unissent l'un l'autre
(2).
Tout ce
que
l'on
peut
nommer
vritablement
religieux,
c'est ce
qui
subsiste de
l'esprit primi-
(1) Tsoundas, Muxfivai, pi. V, fig.
3 et
p.
63.
Perrot-Chipiez, VI, fig.
428"(23).'
(2)
Cf. i,
Harrison, Prolegomena
to the
study of
Greek
religion, p.
1.
^
REG, XLVI, 1M3,
n 217. 19
290
DANIEL 1SAAC
tif,
lequel
est
religieux par
excellence. Et encore
y
a-t-il souvent
danger
vouloir
retrouver,
sous une manifestation
fige depuis
les
origines
et
qui
n'existe sans doute
plus qu'
l'tat de
fossile,
le sentiment
premier qui l'inspirait
et
que l'panouissement
de
l'esprit
nouveau a tari. Seuls'les
mystres, auxquels
tait
dvolue une
longue destine,
nous
rvlent,
au sein d'une
humanit civilise et^onfiante en la
raison,
d'tranges
rserves
de forces
religieuses empreintes
d'un caractre d'anciennet
tonnant. Aussi faut-il souvent recourir eux
pour expliquer
de
futures
renaissances de la foi
(1).
Mais s'ils ont
gard
en eux
l'intensit et la fracheur des
premires croyances,
ils le doivent
surtout leur isolement d'avec
l'extrieur,
ces murailles
morales
(et matrielles)
dont ils s'entouraient et
qui
les mirent
l'abri du rationalisme dissolvant de la
priode classique
et
du
scepticisme
artificiel de la dcadence.
Ainsi nous
voyons
s'vanouir
peu
peu
le rituel crtois sur
le chemin de la Grce. Mais
Mycnes
est un trait d'union entr
les cultes crtois et les cultes
grecs.
Homre,
qui
btit son
pope
avec les matriaux de la culture
mycnienne,
nous
transmet l'tat intermdiaire entre
Mycnes
et la
Grce.
On
s'tonne souvent de ne trouver chez Homre
qu'une
allusion
(2);
et encore est-elle trs
discule,
une
image
divine,
objet
d'adoration;
d'autre
part*
les rites ftichistes n'ont laiss chez
Homre
que quelques
traces
peine
discernables. Mais lors-
qu'on.suit
le
dveloppement
du
rituel,
des
origines
de Cnossos
jusqu'au
jx
8,
sicle,
il semble
que
l'on soit en droit de s'attendre
vers cette dernire
priode
un tat o la contradiction entre
la forme de la
religion
et son
esprit produise
un tat d'incer-
titude tel
que
la cration
religieuse
se trouve un moment
suspendue.
A
Mycnes,
en effet, nous avons
remarqu que
les
pratiques
du culte nouvellement modifies
correspondaient
.
(1)
Dans son dernier
ouvrage,
Les deux sources de la morale et de la
religion,
M.
Bergson
a consacr
quelques pages
l'tude du
mysticisme grec;
il en
souligne
la continuit et la
force,
telles
qu'elles s'expriment
aussi bien dans le
culte de
Dionysos, l'orphisme
et le
pythagorisine; que
chez Platon et les no-
platoniciens (cf.
surtout
p. 234).
(2) Iliade, VI,
300.
LE SENTIMENT RELIGIEUX
DANS LES
CIVILISATIONS PRHELLNIQUES
291
une
conception dj
trs humaine de la
divinit,
cependant
que.
les
objets
du culte
dnonaient
la survivance matrielle du
ftichisme.
Il
devait arriver un moment o celte
contradiction
trop
violente entre les
objets
matriels de la
croyance
et la
croyance
elle-mme aboutirait .
un affaiblissement des
pra-
tiques
cultuelles
(1)
: les ftiches
mycniens.avaient perdu
leur
caractre
divin,
sans
pouvoir
encore
devenir
les auxiliaires
des divinits
anthropomorphes,
tant donn la
presque
inexis-
tence de l'art
grec
durant toute cette
priode,.
Mais l'art lit-
traire
avait
dj acquis
une.matrise admira-ble et la cration
anthropomorphe
se donne libre carrire dans ['Iliade
et.daus
l'Odysse.
Ainsi,
tandis
que
les monuments
ipycniensne
nous
montrent
que
des
gestes
d'adoration humaniss s'adressant
de
grossiers
ftiches,
l'pope homrique
nous,
dcrit les mmes
gestes (2),
mais nous
reprsente
aussi l'ador arriv au terme
de son volution
(3),
sans
pourtant,
qu'aucune image
le livre
encore l'adoration dfinitive des fidles.
Quoi qu'il
en
soit,
l'attitude de la main leve est dsormais
le
principal signe
de
l'adoration^
la
prcision
de ce
geste
rituel
est encore une
preuve
de son caractre maintenant artificiel.
On s'attache aux
plus
lgers
dtails
dans
.l'excution
du
geste.:
ce
.qui,/dans
les,
religions, primitives,,
est confiance dans le
pouvoir pour
ainsi dire
magique
des manifestations extrieures
(1)
L seule
logique
de l'volution
religieuse
suffit
expliquer
la
disparition
momentane de nombreuses
pratiques
rituelles,
sans
qu'il
soit besoin d'isoler la
religion homrique
comme le fait E. Ronde dans
Psych.
(2)
Le
geste
de la main leve est souvent
signal
chez Homre :
Od.,
XVII,
239 :
....(isya
S'
Eiaxo'X?'Pa ivaajjvi
XX,
97 :.:...
Ait-S
1
eiato
xe'P v'ixtiytliv.
IX,
294 :
fi(JiE;
SI
xJ.aqvte v?sxi6p}j.ev
AU
^etpa?.
XIII,
355 : Atixa 6
Kji-
IJIT"Tip-fiiTa.Tox^'P3^ vaayj&v. Remarquons que l'expression /ep vaox<&v
forme
presque toujours
fin de
vers;
elle constitue donc une des
multiples
formules
homriques,
ce
qui
en
garantit
l'anciennet. .
.. -,
.:;..
(3)
Sur
l'anthropomorphisme homrique,
cf. M, P.
Nilason,
A
Hisloryof
Grek
Religion, pp.
134-179 : Un
anthropomorphisme pleinement dvelopp,
tel est Je
legs
d'Homre aux
ges postrieurs.
C'tait un
legs splendide,
mais
contradictoire,
que
la
religion
ne
dpassa jamais
et ne
pouvait pas dpasser.
Elle ne le
dpassa
pas, l'anthropomorphisme
tant la conclusion normale de l'volution
religieuse,
mais elle retourna
plus
d'une fois en arrire d'une manire
plus
ou moins
par-'
tielle sous la
pousse
du
mysticisme (cultes
de
Dionysos, d'Apollon, religion
leusinienne, orphisme, priode hellnistique, etc.).
;
292
-'"'".
'
DANIEL ISAC
ne
peut
tre,
dans une
religion
o les
rapports
entre hommes
et dieux'sont
purement sociaux,.qu'une compensation
cherche
dans ls crmonies du culte
par
un
esprit religieux
amoindri.
Nous
voyons
donc Fadoration se modifier
progressivement
au cours de l'histoire
prhellnique
et
hellnique,
et cette lente
volution est le
signe
constant de rvolutions
profondes
dans
l'esprit religieux.
En
Crte,
la
croyance
ftichiste est matresse souveraine des
mes et
faonne
les
institutions;
pas
de
temple,
maison du
dieu; mais,
l'approche
de l'tre
surnaturel,
une terreur sacre
s'empare
des
esprits
et le
geste
n'est d'abord
qu'un
rflexe des-
tin
protger
les
yeux
contre une lueur
aveuglante; pourtant,
dj
la
religion,
oeuvr
sociale,
veille la formation du
rituel,
qui
la
perdra,
et,
sous sa
contrainte,
le mouvement
instinctif
se
fige.
A
Mycnes,
la
passion religieuse
est considrablement
affaiblie;
l'homme commence h se
projeter
lui-mme dans la
divinit;
le rituel est
plus
humain,
mais
plus
minutieux,
plus
rigide. Lorsque
nous
parvenons
en
Grce,
l'homme arriv
la
pleine possession
de la
force
physique
et morale ne fait
qu'adorer
son
image ;
de la
religion,
il ne reste donc
plus que
le
rituel,
vide de toute
inquitude,
mcanisme sans
me;:
la
crainte du surnaturel s'est
efface;
une
tiquette
rgle
dsormais les
rapports
des dieux et des
hommes;
l'adoration
a fait
place
une
politesse respectueuse;
seul le monde de
l'Hads
inspire
encore
quelque
anxit et son rituel
pathtique
est le
signe qu'ici
le sentiment
religieux
n'est
pas
mort.
Du classicisme crtois au classicisme
grec,
tandis
que, par
une marche
rgulire,
Dieu abandonne sa nature divine
pour
une nature entirement humaine
(1),
l'adoration
poursuit, par
une voie
parallle,
l'volution
qui
la rend
plus
humaine et
par
l soumise des lois
plus imprieuses.
Daniel ISAAC.
(1)
Cf. la mme volution visible dans la
mythologie grecque
et nettement
mise en lumire
par
M. P.
Nilsson,
A
Hislory ofGreek religion,
ch.
i, p.
49 the
Greek
myth
has arisen front the follc-tale
throughia process
of humanization .
Vous aimerez peut-être aussi
- "Un Si Terrible Secret", Lesetagebuch, Matti SchäferDocument5 pages"Un Si Terrible Secret", Lesetagebuch, Matti SchäferCrunchyPas encore d'évaluation
- Dossier AutobiographiqueDocument3 pagesDossier AutobiographiqueNASSA 150Pas encore d'évaluation
- These 636936884325201003Document517 pagesThese 636936884325201003Akissi Eugenie KouassiPas encore d'évaluation
- La Pensee de Pindare Et La 2e OlympiqueDocument172 pagesLa Pensee de Pindare Et La 2e OlympiquepatrserPas encore d'évaluation
- Conte - Les Sept CorbeauxDocument4 pagesConte - Les Sept CorbeauxmartyludoPas encore d'évaluation
- Trédé - Kairos Isocrate Alcidamas PDFDocument21 pagesTrédé - Kairos Isocrate Alcidamas PDFBaruch Von PankäkePas encore d'évaluation
- Catulle Et Ses LecteursDocument12 pagesCatulle Et Ses LecteursJames CarroPas encore d'évaluation
- Article Carmina PriapeaDocument29 pagesArticle Carmina PriapeaMònica Miró VinaixaPas encore d'évaluation
- Detienne Le Territoire de La MythologieDocument16 pagesDetienne Le Territoire de La MythologiePedro GobangPas encore d'évaluation
- Histoire de Mouvements Littéraires XVIDocument5 pagesHistoire de Mouvements Littéraires XVIAnonymous dY4FgLPas encore d'évaluation
- Coign EtDocument16 pagesCoign EtDon MassimoPas encore d'évaluation
- Sens Et Emplois Des Termes Φύσις Et Φυά Chez PindareDocument20 pagesSens Et Emplois Des Termes Φύσις Et Φυά Chez PindareWanderlan PortoPas encore d'évaluation
- Cloche, IsocrateDocument144 pagesCloche, IsocratealverlinPas encore d'évaluation
- Le Panégyrique Ou L'eloge D'athènes Par Isocrate (1817)Document288 pagesLe Panégyrique Ou L'eloge D'athènes Par Isocrate (1817)AriciePas encore d'évaluation
- Lectures de La République de Platon 3-4 - Le Philosophe-Roi PDFDocument1 pageLectures de La République de Platon 3-4 - Le Philosophe-Roi PDFjose fernandezPas encore d'évaluation
- Bardon, H. (1965) Rome Et L'impudeur - Latomus 24.3, Pp. 495-518 PDFDocument25 pagesBardon, H. (1965) Rome Et L'impudeur - Latomus 24.3, Pp. 495-518 PDFVioletaPas encore d'évaluation
- Le Banquet (Platon) - Wikipédia PDFDocument93 pagesLe Banquet (Platon) - Wikipédia PDFcr7 football roodPas encore d'évaluation
- Athénée de Naucratis Livre 15Document56 pagesAthénée de Naucratis Livre 15gustavog1956Pas encore d'évaluation
- L'élégie LatineDocument10 pagesL'élégie LatineBernard BragardPas encore d'évaluation
- Conseils À Démonique - Isocrate JuxtaDocument78 pagesConseils À Démonique - Isocrate JuxtacaligulagermanicusPas encore d'évaluation
- Heracles and PindarDocument29 pagesHeracles and PindarPura NietoPas encore d'évaluation
- Ops Et La Conception Divine de L'abondance Dans La Religion Romaine Jusqu'à La Mort D'augusteDocument348 pagesOps Et La Conception Divine de L'abondance Dans La Religion Romaine Jusqu'à La Mort D'augustemangiacarrubePas encore d'évaluation
- Oeuvres Complètes d'Aulu-Gelle. Tome 1Document496 pagesOeuvres Complètes d'Aulu-Gelle. Tome 1Ahmed Berrouho100% (1)
- Meurant - Romulus, Jumeau Et RoiDocument29 pagesMeurant - Romulus, Jumeau Et RoiMaurizio GallinaPas encore d'évaluation
- b24861054 PDFDocument362 pagesb24861054 PDFPedroPas encore d'évaluation
- Étrennes de Septantaine. Travaux de Linguistique Et de Grammaire Comparée Offerts À Michel Lejeune Par Un Groupe de Ses ÉlèvesDocument6 pagesÉtrennes de Septantaine. Travaux de Linguistique Et de Grammaire Comparée Offerts À Michel Lejeune Par Un Groupe de Ses ÉlèvesJoop-le-philosophePas encore d'évaluation
- Pirenne Aphrodite GrecqueDocument554 pagesPirenne Aphrodite GrecqueNikos HarokoposPas encore d'évaluation
- Genet Ou La Danse Macabre Du Bien Et Du MalDocument18 pagesGenet Ou La Danse Macabre Du Bien Et Du MalIsa LemmypPas encore d'évaluation
- Valentin Nikiprowetzky - La Troisième SibylleDocument12 pagesValentin Nikiprowetzky - La Troisième Sibylle_Giemmeci_Pas encore d'évaluation
- FJODOR MONTEMURRO - MELANIPPE Fr. 506 JfHR-Vol-11-33-67-220818Document36 pagesFJODOR MONTEMURRO - MELANIPPE Fr. 506 JfHR-Vol-11-33-67-220818Maria piaPas encore d'évaluation
- Kernos 1374 15 La Rationalite Des Mythes de Delphes Les Dieux Les Heros Les MediateursDocument25 pagesKernos 1374 15 La Rationalite Des Mythes de Delphes Les Dieux Les Heros Les Mediateursest1949Pas encore d'évaluation
- Mouraviev, Serge N. - Travaux de Serge N. Mouraviev Sur La Philosophie Grecque - 2012Document12 pagesMouraviev, Serge N. - Travaux de Serge N. Mouraviev Sur La Philosophie Grecque - 2012the gatheringPas encore d'évaluation
- L'oeuvre Du Divin Arétin by Pietro AretinoDocument139 pagesL'oeuvre Du Divin Arétin by Pietro AretinoDanKoifmanPas encore d'évaluation
- Athénée de Naucratis IntroductionDocument11 pagesAthénée de Naucratis IntroductionAura de Beleta100% (1)
- Defixiones D IstrosDocument47 pagesDefixiones D IstrosProfessora Amanda MartinsPas encore d'évaluation
- Alain Michel Le Vocabulaire Esthétique À Rome Rhétorique Et Création ArtistiqueDocument21 pagesAlain Michel Le Vocabulaire Esthétique À Rome Rhétorique Et Création Artistiqueze_n6574Pas encore d'évaluation
- Histoirecompar02gr PDFDocument512 pagesHistoirecompar02gr PDFFrancophilus VerusPas encore d'évaluation
- Bourdieu - Clisthène L'athénien Selon Leveque Et Vidal-NaquetDocument3 pagesBourdieu - Clisthène L'athénien Selon Leveque Et Vidal-NaquetDavo Lo SchiavoPas encore d'évaluation
- Aubriot-Sévin, Prière Et Conceptions Religieuses en Grèce AncienneDocument590 pagesAubriot-Sévin, Prière Et Conceptions Religieuses en Grèce AnciennezkjeblPas encore d'évaluation
- Platon2001 2002Document43 pagesPlaton2001 2002ciclojoplejicoPas encore d'évaluation
- Le Songe de Poliphile Ou (... ) Colonna Francesco Bpt6k1073366tDocument651 pagesLe Songe de Poliphile Ou (... ) Colonna Francesco Bpt6k1073366tBailey Fensom100% (1)
- Thèse Yann LerouxDocument293 pagesThèse Yann LerouxYann Leroux100% (2)
- Métrique Et Tropos Dans Les PersesDocument44 pagesMétrique Et Tropos Dans Les PersesJean Pierre Kaletrianos100% (1)
- Le Metier Du Mythe-Lectures D'hésiodeDocument493 pagesLe Metier Du Mythe-Lectures D'hésiodeAlfonso Flórez50% (2)
- Querelles Cartésiennes I (Alquié-Gueroult) : Animé Par Pierre MachereyDocument11 pagesQuerelles Cartésiennes I (Alquié-Gueroult) : Animé Par Pierre MachereyAbdelazizGammoudiPas encore d'évaluation
- Vial Poésie ÉrotiqueDocument31 pagesVial Poésie ÉrotiquetdevolfPas encore d'évaluation
- Brutus Expliqué Littéralement Par É. Pessonneaux,... Et Traduit Par J.-L. BurnoufDocument413 pagesBrutus Expliqué Littéralement Par É. Pessonneaux,... Et Traduit Par J.-L. Burnoufalcyon48100% (2)
- The Strange World of Human SacrificeDocument4 pagesThe Strange World of Human SacrificeTiffany BrooksPas encore d'évaluation
- SIMONDON Sur Kronos & ChronosDocument11 pagesSIMONDON Sur Kronos & Chronosmegasthenis1Pas encore d'évaluation
- Ovide Au Moyen AgeDocument24 pagesOvide Au Moyen AgeAnca CrivatPas encore d'évaluation
- PAUL TANNERY Pour L'histoire Du Concept de L'infini Au VIe Siècle Avant J.-C.Document21 pagesPAUL TANNERY Pour L'histoire Du Concept de L'infini Au VIe Siècle Avant J.-C.ze_n6574Pas encore d'évaluation
- Vie Et Destin de L'ancienne Bibliothèque D'alexandrie - Bulletin Des Bibliothèques de FranceDocument2 pagesVie Et Destin de L'ancienne Bibliothèque D'alexandrie - Bulletin Des Bibliothèques de FranceandreacirlaPas encore d'évaluation
- Gémiste Pléthon Et Cosme de MédicisDocument25 pagesGémiste Pléthon Et Cosme de MédicisDavo Lo Schiavo100% (1)
- Bouché-Leclercq, A - Histoire de La Divination Dans L'antiquité IV (1879) PDFDocument422 pagesBouché-Leclercq, A - Histoire de La Divination Dans L'antiquité IV (1879) PDFdodge666100% (1)
- Chasseur Noir Et Ephebie, Vidal NaquetDocument19 pagesChasseur Noir Et Ephebie, Vidal NaquetVasilis Achilles100% (1)
- Heraclite Et Le CyceonDocument19 pagesHeraclite Et Le CyceonFiorenzo TassottiPas encore d'évaluation
- Anthologie de La Littérature GrecqueDocument1 026 pagesAnthologie de La Littérature GrecqueDanny MukokaPas encore d'évaluation
- Les Perses (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvre d'EschyleD'EverandLes Perses (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvre d'EschylePas encore d'évaluation
- Platon Oeuvres Completes (Z. 13.3 - Dialogues Apocryphes (T. Souilhe) (V. Bude. 1930)Document264 pagesPlaton Oeuvres Completes (Z. 13.3 - Dialogues Apocryphes (T. Souilhe) (V. Bude. 1930)A Fleur de Coeur100% (1)
- Antifonte Decleva CaizziDocument21 pagesAntifonte Decleva CaizziErcilio HerreraPas encore d'évaluation
- Lévêque, P. - Aurea Catena Homeri. Une Étude Sur L'allégorie Grecque PDFDocument84 pagesLévêque, P. - Aurea Catena Homeri. Une Étude Sur L'allégorie Grecque PDFPedro F.100% (1)
- Ordre Et Désordre en Territoire GrecDocument12 pagesOrdre Et Désordre en Territoire GrecJamaa OuarezzamenPas encore d'évaluation
- La Cité Antique: Étude sur Le Culte, Le Droit, Les Institutions de la Grèce et de RomeD'EverandLa Cité Antique: Étude sur Le Culte, Le Droit, Les Institutions de la Grèce et de RomePas encore d'évaluation
- Curiosa: Essais critiques de littérature ancienne ignorée ou mal connueD'EverandCuriosa: Essais critiques de littérature ancienne ignorée ou mal connuePas encore d'évaluation
- Le Sens Du Temps Chez Saint AugustinDocument6 pagesLe Sens Du Temps Chez Saint AugustinaminickPas encore d'évaluation
- L'évolution de La Peinture Religieuse en BucovineDocument6 pagesL'évolution de La Peinture Religieuse en BucovineaminickPas encore d'évaluation
- Notes Sur Des Manuscrits Patristiques Latins, REAug-1971-Nr-1-4Document440 pagesNotes Sur Des Manuscrits Patristiques Latins, REAug-1971-Nr-1-4aminickPas encore d'évaluation
- Gnose ChretienneDocument12 pagesGnose ChretienneaminickPas encore d'évaluation
- L'Oracle, Thérapeutique de L'angoisseDocument19 pagesL'Oracle, Thérapeutique de L'angoisseaminickPas encore d'évaluation
- La Dimension Historique Du Sacré Et de La Hiérophanie Selon Mircea EliadeDocument27 pagesLa Dimension Historique Du Sacré Et de La Hiérophanie Selon Mircea EliadeaminickPas encore d'évaluation
- Une Traduction Française Des Écrits IntertestamentairesDocument11 pagesUne Traduction Française Des Écrits IntertestamentairesaminickPas encore d'évaluation
- L'Eglise Catholique Face À 'Extraordinaire Chrétien Depuis Vatican II PDFDocument433 pagesL'Eglise Catholique Face À 'Extraordinaire Chrétien Depuis Vatican II PDFaminickPas encore d'évaluation
- Sources Chretiennes - Liste LivresDocument5 pagesSources Chretiennes - Liste LivresaminickPas encore d'évaluation
- VIEILLEFOND (J.-R.) - Un Fragment Inédit de Julius Africanus (Revue-Des-Etudes-Grecques-46-1933-4)Document7 pagesVIEILLEFOND (J.-R.) - Un Fragment Inédit de Julius Africanus (Revue-Des-Etudes-Grecques-46-1933-4)aminickPas encore d'évaluation
- Elie During, L'Âme (Résumé)Document4 pagesElie During, L'Âme (Résumé)aminickPas encore d'évaluation
- L'Anthropologie TernaireDocument13 pagesL'Anthropologie TernaireaminickPas encore d'évaluation
- Thomas Romer, Lla Construction D'un Ancêtre. La Formation Du Cycle D'abrahamDocument19 pagesThomas Romer, Lla Construction D'un Ancêtre. La Formation Du Cycle D'abrahamaminickPas encore d'évaluation
- Thomas Romer, 04. Le Dieu Yhwh. Ses Origines, Ses Cultes, Sa Transformation en Dieu Unique (2 Partie)Document26 pagesThomas Romer, 04. Le Dieu Yhwh. Ses Origines, Ses Cultes, Sa Transformation en Dieu Unique (2 Partie)aminickPas encore d'évaluation
- Thomas Romer, 05. La CondItion Humaine. Proche-Orient Ancien Et Bible HébraïqueDocument27 pagesThomas Romer, 05. La CondItion Humaine. Proche-Orient Ancien Et Bible HébraïqueaminickPas encore d'évaluation
- CRITIQUE Résumé TadiéDocument3 pagesCRITIQUE Résumé TadiéVanessa CavallariPas encore d'évaluation
- Carlo Suares - Code Aleph KabbaleDocument4 pagesCarlo Suares - Code Aleph Kabbalecarine3Pas encore d'évaluation
- Marginalia 64Document30 pagesMarginalia 64Norbert SpehnerPas encore d'évaluation
- Examens Boite A Merveilles SefriouiDocument86 pagesExamens Boite A Merveilles Sefriouibb5752804Pas encore d'évaluation
- S Initier Au Catalan Langue Et Litterature 2017Document44 pagesS Initier Au Catalan Langue Et Litterature 2017andrePas encore d'évaluation
- Les 40 Règles de La Religion de LDocument5 pagesLes 40 Règles de La Religion de LRoutcho TaryaouiPas encore d'évaluation
- Sujet de Culture Generale Et Actualites Lp1 Soir ValideDocument3 pagesSujet de Culture Generale Et Actualites Lp1 Soir ValideDatcha Serge PaiteyPas encore d'évaluation
- Se Quence 5 - 6e MesDocument10 pagesSe Quence 5 - 6e MesTaibiabdelAbdiPas encore d'évaluation
- Henri Cornélius Agrippa Sa Vie Et Son Oeuvre D'après Sa Correspondance PDFDocument147 pagesHenri Cornélius Agrippa Sa Vie Et Son Oeuvre D'après Sa Correspondance PDFGérard HauetPas encore d'évaluation
- Orhan Pamuk - La Maison Du Silence - JerichoDocument328 pagesOrhan Pamuk - La Maison Du Silence - JerichoOuassila DjekidaPas encore d'évaluation
- Cours de Cours de Francais Classe de 1ere Memnon Ou La Sagesse Humaine Classe de 1ere Memnon Ou La Sagesse HumaineDocument2 pagesCours de Cours de Francais Classe de 1ere Memnon Ou La Sagesse Humaine Classe de 1ere Memnon Ou La Sagesse HumainePaula BertićPas encore d'évaluation
- Al Chafi'iDocument2 pagesAl Chafi'iazeermanPas encore d'évaluation
- Gil, Péguy Et DeleuzeDocument11 pagesGil, Péguy Et DeleuzeladalaikaPas encore d'évaluation
- Chansons Populaires Des Provinces de France ChampfleuryDocument279 pagesChansons Populaires Des Provinces de France ChampfleuryTARDPas encore d'évaluation
- Baudelaire CorrespondanceDocument129 pagesBaudelaire Correspondanceantonio rincon nuñezPas encore d'évaluation
- Le Paysage Dans Les Vues Lumière - Marco BertozziDocument19 pagesLe Paysage Dans Les Vues Lumière - Marco BertozziFet BacPas encore d'évaluation
- Histoire Ancienne Afrique Du Nord Stéphane Gsell Tome3Document170 pagesHistoire Ancienne Afrique Du Nord Stéphane Gsell Tome3Pascal GibertPas encore d'évaluation
- Sookie Stackhouse - Interlude MortelDocument118 pagesSookie Stackhouse - Interlude Mortelcéline durezPas encore d'évaluation
- TyptxtDocument2 pagesTyptxtعبد الوهاب جبلونPas encore d'évaluation
- Le SuperlatifDocument1 pageLe SuperlatifMaría Ortega MorenoPas encore d'évaluation
- Fiche de Lecture Double Assassinat Dans La Rue MorgueDocument1 pageFiche de Lecture Double Assassinat Dans La Rue MorgueZoé ThéodonPas encore d'évaluation
- La Représentation Des Femmes Dans La Tradition Orale Berbère - Le Chant Rituel Du Mariage Et La Chanson Traditionnelle (Le Parler Tachelhit Du Sud-Ouest Marocain) - Thèse de Yamina EL AOUANIDocument448 pagesLa Représentation Des Femmes Dans La Tradition Orale Berbère - Le Chant Rituel Du Mariage Et La Chanson Traditionnelle (Le Parler Tachelhit Du Sud-Ouest Marocain) - Thèse de Yamina EL AOUANIidlisen100% (4)
- MartineDocument10 pagesMartineLaurariana StoicaPas encore d'évaluation
- Edelman Droit Saisi Par La PhotographieDocument185 pagesEdelman Droit Saisi Par La PhotographieMarcelo Rodríguez APas encore d'évaluation
- Le Heros de La Peau de Chagrin Une VictimeDocument6 pagesLe Heros de La Peau de Chagrin Une VictimelynamamryaPas encore d'évaluation
- Svane Note Terrain PDFDocument22 pagesSvane Note Terrain PDFLemon BarfPas encore d'évaluation