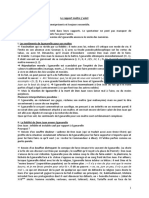Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Foucault Les Mots Et Les Choses Fiche
Transféré par
pierre ChaizyTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Foucault Les Mots Et Les Choses Fiche
Transféré par
pierre ChaizyDroits d'auteur :
Formats disponibles
Michel Foucault, Les Mots et les choses, article paru dans le Monde du 31 juillet 2008
Les Mots et les Choses, de Michel Foucault (1926-1984), commence par un morceau de bravoure
qui a beaucoup contribué à la renommée du livre : la savante description d’un tableau de Vélasquez, Les
Ménines, devenue un classique de l’analyse picturale. Sur ce tableau, que Foucault désigne par son titre
français, Les Suivantes, on aperçoit l’infante Marguerite d’Espagne, entourée de demoiselles d’honneur,
de courtisans, de nains. À gauche, en retrait, le peintre se tient devant une grande toile, dont on ne voit
que le dos. À l’arrière-plan, sur le mur du fond, un tableau, note Foucault, « brille d’un éclat singulier ».
Deux silhouettes s’y dessinent. Ce tableau est un miroir, qui reflète les visages du roi Philippe IV et de
son épouse. Les souverains sont à l’extérieur du tableau, « retirés en une invisibilité essentielle », mais
« ils ordonnent autour d’eux toute la représentation ». Ils en sont la condition de possibilité. « Peut-être y
a-t-il, dans ce tableau de Vélasquez, comme la représentation de la représentation classique », mais on y
lit aussi, selon Foucault, « la disparition nécessaire de ce qui la fonde ». Et l’auteur de conclure : « Libre
enfin de ce rapport qui l’enchaînait, la représentation peut se donner comme pure représentation. »
Pourquoi cette longue ouverture sur l’idée de représentation dans l’œuvre de Vélasquez ? Parce
que cette notion est, selon Foucault, le principe qui organise les savoirs à l’âge classique. Chaque époque
se caractérise par un « champ épistémologique » particulier, qui forme le « socle » des diverses
connaissances et commande leur apparition. Foucault appelle « épistémê » cet « a priori historique » sur
fond duquel se constituent les diverses sciences. Il s’attache à trois d’entre elles (le langage, la vie et les
richesses) pour souligner leur « cohérence », aux XVIIe et XVIIIe siècles, avec la théorie de la
représentation.
La Renaissance, elle, était fondée sur la ressemblance. « Le monde s’enroulait sur lui-même, écrit
Foucault. Don Quichotte en apparaît, sur le mode de la dérision, comme l’incarnation. « Tout son chemin
est une quête aux similitudes », mais celles-ci tournent au délire. Au XIXe siècle vient l’âge de l’histoire,
qui devient « le mode d’être fondamental des empiricités » et qui introduit dans la pensée moderne « cette
étrange figure du savoir qu’on appelle l’homme ». Voici l’homme « au fondement de toutes les
positivités », en cette place du roi « que lui assignaient par avance Les Ménines, mais d’où pendant
longtemps sa présence réelle fut exclue ».
Or cette période, selon Foucault, est peut-être en train de se clore et l’homme, une « invention
récente », en voie de disparaître. Si une nouvelle « épistémê » venait à naître, par l’effet d’un nouveau
changement dans les dispositions du savoir, « alors on peut bien parier que l’homme s’effacerait, comme
à la limite de la mer un visage de sable ». C’est la dernière phrase du livre. « Fin de l’humanisme », titre
Jean Lacroix dans son article du Monde. Celui de Gilles Deleuze dans Le Nouvel Observateur s’intitule
« L’homme, une existence douteuse » et celui de Georges Canguilhem, un an plus tard, dans Critique,
« Mort de l’homme ou épuisement du cogito ».
« ANTI-HUMANISME THÉORIQUE »
En pleine vogue du structuralisme, l’ouvrage de Foucault, publié en 1966, la même année que les
Ecrits de Lacan ou Critique et vérité de Barthes, est perçu par nombre de lecteurs comme un des
principaux manifestes du mouvement, même si l’auteur se défend d’y appartenir. En montrant que la
connaissance ne résulte pas du progrès continu de la raison, mais d’un système de règles propres à chaque
époque, puis en affirmant que l’homme comme objet des sciences dites humaines est peut-être voué à une
« fin prochaine », le philosophe donne la priorité au jeu des structures pour définir les conditions du
savoir. « Mais Foucault ne nous dit pas ce qui serait le plus intéressant, objectera Sartre, l’une des cibles
du livre, à savoir comment chaque pensée est construite à partir de ces conditions et comment les hommes
passent d’une pensée à une autre. »
Les discussions suscitées par « l’anti-humanisme théorique » de Foucault, en écho aux théories
exposées l’année précédente par Althusser dans Pour Marx, assurent au livre un important succès de
librairie. Selon Didier Eribon, biographe de Foucault, les premiers tirages sont vite épuisés. Plus de 20
000 exemplaires sont vendus la première année, plus de 110 000 le seront en vingt ans. C’est beaucoup
pour un ouvrage de sciences humaines, souvent aride, parfois obscur. Le cinéma le consacre : dans La
Chinoise, de Jean-Luc Godard (1967), Les Mots et les Choses, « dernier barrage que la bourgeoisie puisse
encore dresser contre Marx » selon Sartre, est attaqué à coups de tomates.
Quarante-deux ans après sa parution dans la « Bibliothèque des sciences humaines » (Gallimard),
le livre, publié en poche dans la collection « Tel » depuis 1990, continue de se vendre, selon l’éditeur, à
environ 4 000 exemplaires par an. Mais il est resté sans vraie postérité. Foucault en parlera comme
d’ « une sorte d’excursus » dans son œuvre. Certes, le titre de sa chaire au Collège de France (« Histoire
des systèmes de pensée ») sera dans la continuité de ce travail, mais son attention va se tourner vers
d’autres questions qui, sans être en rupture avec celles qu’il posait dans Les Mots et les Choses,
justifieront une approche différente. Avec Surveiller et punir puis Histoire de la sexualité, la réflexion sur
les dispositifs de pouvoir va prendre le pas sur l’analyse des « épistémês ». C’est ce Foucault-là qui
inspire encore nombre de chercheurs à travers le monde plutôt que celui des Mots et les Choses.
Vous aimerez peut-être aussi
- La Légende des siècles de Victor Hugo: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLa Légende des siècles de Victor Hugo: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Humain, trop humain de Friedrich Nietzsche: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandHumain, trop humain de Friedrich Nietzsche: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Philippe Sabot: Savoir, Textes, Langage (Foucault)Document17 pagesPhilippe Sabot: Savoir, Textes, Langage (Foucault)Kyla BruffPas encore d'évaluation
- Annie Le Brun Ethique de L Ecart AbsoluDocument87 pagesAnnie Le Brun Ethique de L Ecart AbsoluCarlosPas encore d'évaluation
- (Epimetée) Michel Henry-Phénoménologie de La Vie, Volume 2 - de La Subjectivité-Presses Universitaires de France - PUF (2011) - CopieDocument222 pages(Epimetée) Michel Henry-Phénoménologie de La Vie, Volume 2 - de La Subjectivité-Presses Universitaires de France - PUF (2011) - CopieEl Yaagoubi Zouhair100% (1)
- Louise Michel - Prise de Possession (2017, Herne)Document84 pagesLouise Michel - Prise de Possession (2017, Herne)nicosiaPas encore d'évaluation
- L'écriture Marxiste de L'histoire Irlandaise - Corps Du MémoireDocument570 pagesL'écriture Marxiste de L'histoire Irlandaise - Corps Du MémoirekarlarthurPas encore d'évaluation
- Evelyne Grossman. Modernes DéshumanitésDocument11 pagesEvelyne Grossman. Modernes Déshumanitésjuliyelin76Pas encore d'évaluation
- La Vie Intellectuelle en France - Des Lendemains de La Révolution À 1914Document660 pagesLa Vie Intellectuelle en France - Des Lendemains de La Révolution À 1914ju2015Pas encore d'évaluation
- HOPKINS RétrofictionsDocument4 pagesHOPKINS RétrofictionsBen FPas encore d'évaluation
- L'Art Et La Science Au Temps de William Shakespeare.Document15 pagesL'Art Et La Science Au Temps de William Shakespeare.معلوميات الشبكةPas encore d'évaluation
- Le Flaneur, Personnage ÉpoqueDocument12 pagesLe Flaneur, Personnage ÉpoqueGilles MalatrayPas encore d'évaluation
- Wouter Hanegraaff - Fiction in The Desert of The RealDocument25 pagesWouter Hanegraaff - Fiction in The Desert of The RealGeorge IoannidisPas encore d'évaluation
- Aurélien Aramini Michelet La Philosophie de L'histoireDocument59 pagesAurélien Aramini Michelet La Philosophie de L'histoiretrofouPas encore d'évaluation
- Conference Mythe Et Science-FictionDocument11 pagesConference Mythe Et Science-FictionMohammed KachaiPas encore d'évaluation
- (Vox Philosophiae) Cristian Ciocan, Peut-On Faire de La Philosophie Quand On Est Privé de Liberté (Constantin Noica Et Alexandru Dragomir)Document15 pages(Vox Philosophiae) Cristian Ciocan, Peut-On Faire de La Philosophie Quand On Est Privé de Liberté (Constantin Noica Et Alexandru Dragomir)Revista Vox Philosophiae http://www.philosophical-review.info/100% (5)
- University of North Carolina Press Studies in PhilologyDocument32 pagesUniversity of North Carolina Press Studies in PhilologyJuan Pablo AriasPas encore d'évaluation
- Marcel Thiry. Postface Par Pascal Durand.Document27 pagesMarcel Thiry. Postface Par Pascal Durand.Davo Lo SchiavoPas encore d'évaluation
- Didier Eribon - Michel Foucault-Flammarion (2018)Document1 139 pagesDidier Eribon - Michel Foucault-Flammarion (2018)Luis Daniel Soto Nuñez100% (3)
- (Collection Folio.) Kundera, Milan - L'art Du Roman - Essai-Gallimard (2010) PDFDocument198 pages(Collection Folio.) Kundera, Milan - L'art Du Roman - Essai-Gallimard (2010) PDFmichkarabierPas encore d'évaluation
- Liste de Lectures Philo 2012Document3 pagesListe de Lectures Philo 2012Bgt AltPas encore d'évaluation
- 9782813201331Document9 pages9782813201331Stéphane FrankovichPas encore d'évaluation
- Jameson Fredric - Le Postmodernisme, Ou, La Logique Culturelle Du Capitalisme TardifDocument602 pagesJameson Fredric - Le Postmodernisme, Ou, La Logique Culturelle Du Capitalisme TardifAMINEPas encore d'évaluation
- ImpossibilityDocument85 pagesImpossibilitym_y_tanatusPas encore d'évaluation
- 2009 Nan 21030Document600 pages2009 Nan 21030Mohammed KachaiPas encore d'évaluation
- Siècle Des LumièresDocument11 pagesSiècle Des LumièresDavid LOPEZ--TOMASPas encore d'évaluation
- Le Siècle Des Lumières Et La Conscience IntellectuelleDocument20 pagesLe Siècle Des Lumières Et La Conscience IntellectuelleKhadija Maama100% (1)
- Baudelaire Sociologue de La ModernitéDocument27 pagesBaudelaire Sociologue de La Modernitégafy utdPas encore d'évaluation
- PostmodernismeDocument5 pagesPostmodernismeRicoPas encore d'évaluation
- Litterature FrancaiseDocument2 pagesLitterature Francaisetlp1ui4mdk2yyhpkyz0Pas encore d'évaluation
- La Verite Anthropologique Sur Les ExtraterrestresDocument21 pagesLa Verite Anthropologique Sur Les ExtraterrestresOkba TaibiPas encore d'évaluation
- Science FictionDocument19 pagesScience FictionyasPas encore d'évaluation
- FRANCESEDocument3 pagesFRANCESElucia brascaPas encore d'évaluation
- Lorenzini - Cogito Et Discours PhilosophiqueDocument15 pagesLorenzini - Cogito Et Discours PhilosophiquedefreitasJHPas encore d'évaluation
- Introduction FrançaissDocument3 pagesIntroduction FrançaissMatteo TouzetPas encore d'évaluation
- Le Siècle Des LumièresDocument7 pagesLe Siècle Des Lumièreslucy8891Pas encore d'évaluation
- Marcolini Patrick - Héritiers Situationnistes (Tiqqun - Comité Invisible)Document4 pagesMarcolini Patrick - Héritiers Situationnistes (Tiqqun - Comité Invisible)caroscribdoPas encore d'évaluation
- Faites Une Dissertation Sur Le Xviième (Dix-Septième) Siècle À Partir de Vos Connaissances LittérairesDocument2 pagesFaites Une Dissertation Sur Le Xviième (Dix-Septième) Siècle À Partir de Vos Connaissances Littérairesİrem AksoyPas encore d'évaluation
- Decadence Et ModerniteDocument5 pagesDecadence Et ModerniteFranck Dubost100% (1)
- Sur HyppoliteDocument21 pagesSur HyppolitefonsiolaPas encore d'évaluation
- Mystification Et Scandales Littéraires en France de Jean-Baptiste Poquelin À Calixthe Beyala - Vina Tirven-GadumDocument18 pagesMystification Et Scandales Littéraires en France de Jean-Baptiste Poquelin À Calixthe Beyala - Vina Tirven-GadumPensées NoiresPas encore d'évaluation
- MAISSIN, Gabriel. Le Postmodernisme Ou La Logique Culturelle Du Capitalisme Tardif PDFDocument8 pagesMAISSIN, Gabriel. Le Postmodernisme Ou La Logique Culturelle Du Capitalisme Tardif PDFMelindaPas encore d'évaluation
- 9782081375123Document34 pages9782081375123Wonder NGPas encore d'évaluation
- Лекція 4Document5 pagesЛекція 4Соня ГалійPas encore d'évaluation
- Siècle Des Lumières - WikipédiaDocument42 pagesSiècle Des Lumières - WikipédialordychancertsieloPas encore d'évaluation
- (Petite Bibliothèque) Héloïse Lhérété (Editor) - Michel Foucault - L'homme Et L'œuvre. Héritage Et Bilan Critique-Sciences Humaines (2017) PDFDocument171 pages(Petite Bibliothèque) Héloïse Lhérété (Editor) - Michel Foucault - L'homme Et L'œuvre. Héritage Et Bilan Critique-Sciences Humaines (2017) PDFricherPas encore d'évaluation
- Les Démons de Fiodor Dostoïevski: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLes Démons de Fiodor Dostoïevski: Les Fiches de lecture d'UniversalisÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (14)
- La Révolte Des Masses by José Ortega y Gasset, José-Luis Goyena, Louis ParrotDocument316 pagesLa Révolte Des Masses by José Ortega y Gasset, José-Luis Goyena, Louis ParrotldlmffslmqPas encore d'évaluation
- Souverainete Gouvernementalite Raison D PDFDocument26 pagesSouverainete Gouvernementalite Raison D PDFekdorkianPas encore d'évaluation
- Kostas Axelos Et La Pensée Planétaire - Philippe SollersDocument2 pagesKostas Axelos Et La Pensée Planétaire - Philippe SollersTuttle Buttle0% (1)
- Chroniques DupuisDocument66 pagesChroniques DupuisDimitris LeivaditisPas encore d'évaluation
- Le NaturalismeDocument21 pagesLe NaturalismeMakachPas encore d'évaluation
- Les Chefs Une Question Pour L Histoire DDocument18 pagesLes Chefs Une Question Pour L Histoire DHichem AbdouPas encore d'évaluation
- Louis Althusser Ecrits Philosophiques Et Politiques Tome I PDFDocument591 pagesLouis Althusser Ecrits Philosophiques Et Politiques Tome I PDFMiguel Valderrama80% (5)
- L'Art Du Roman KunderaDocument22 pagesL'Art Du Roman Kunderaalpha100% (1)
- Pierre Brunel MythocritiqueDocument252 pagesPierre Brunel MythocritiqueNour100% (5)
- Alain Badiou (2004) - Panorama de La Philosophie Française ContemporaineDocument14 pagesAlain Badiou (2004) - Panorama de La Philosophie Française ContemporaineMijuPas encore d'évaluation
- Le Vol de L'histoireDocument2 pagesLe Vol de L'histoirezeineb.guehissPas encore d'évaluation
- La Philosophie Française Contemporaine: Votre Aide Comment Faire ?Document4 pagesLa Philosophie Française Contemporaine: Votre Aide Comment Faire ?Karl ZinsouPas encore d'évaluation
- Musset The A TreDocument7 pagesMusset The A Trepierre ChaizyPas encore d'évaluation
- Musset TragedieDocument2 pagesMusset Tragediepierre ChaizyPas encore d'évaluation
- Cours Sur Annie ErnauxDocument11 pagesCours Sur Annie Ernauxpierre ChaizyPas encore d'évaluation
- Barthes Mort de L'auteurDocument3 pagesBarthes Mort de L'auteurpierre ChaizyPas encore d'évaluation
- Mathilde TranDocument111 pagesMathilde Tranahmed khalfiPas encore d'évaluation
- Une Servante Ecarlate - Odt 0Document2 pagesUne Servante Ecarlate - Odt 0Skye Ray SamanthaPas encore d'évaluation
- GDA Resume A4 v1.2Document2 pagesGDA Resume A4 v1.2anonymePas encore d'évaluation
- Corrigé - Question Interprétation H MichauxDocument2 pagesCorrigé - Question Interprétation H MichauxlyblancPas encore d'évaluation
- Image de La FemmeDocument7 pagesImage de La FemmeWIN CYBER90% (21)
- R S Seo FDocument206 pagesR S Seo FgosmarttoursPas encore d'évaluation
- Écrire Histoire ImageDocument8 pagesÉcrire Histoire ImagecharoPas encore d'évaluation
- Friulair DryerDocument6 pagesFriulair DryerLontong OkePas encore d'évaluation
- Emploi Du Temps CP Ce1Document2 pagesEmploi Du Temps CP Ce1Emmanuelle Rosello100% (1)
- Je Chante Brassens Best ofDocument80 pagesJe Chante Brassens Best ofManonPas encore d'évaluation
- Langue. L'énonciation.2022.Document2 pagesLangue. L'énonciation.2022.jos leePas encore d'évaluation
- Extrait Dantigone DanouilhDocument2 pagesExtrait Dantigone DanouilhLudovica PasiPas encore d'évaluation
- Solfa - Let All Mortal Flesh Keep Silence - Communion - EnglishDocument2 pagesSolfa - Let All Mortal Flesh Keep Silence - Communion - EnglishIyaka JamesPas encore d'évaluation
- Mendiante RousseDocument4 pagesMendiante RousseLyvia FantonPas encore d'évaluation
- La Nouvelle FantastiqueDocument10 pagesLa Nouvelle FantastiqueSalah TigourdiPas encore d'évaluation
- Thèse Publiée. Texte FinalDocument335 pagesThèse Publiée. Texte FinalJk BirahoPas encore d'évaluation
- Chroniques de La Lune Verte (ADD2) : L'auberge Du Lapin BoiteuxDocument12 pagesChroniques de La Lune Verte (ADD2) : L'auberge Du Lapin BoiteuxBenPas encore d'évaluation
- Discours NegritudeDocument4 pagesDiscours NegritudeObed EngbakaPas encore d'évaluation
- HP JDR Carte Du Chemin de TraverseDocument32 pagesHP JDR Carte Du Chemin de TraverseVincent KazmierczakPas encore d'évaluation
- Albert Thibaudet. Le Liseur de Romans: Source Gallica - BNF.FR / Bibliothèque Nationale de FranceDocument304 pagesAlbert Thibaudet. Le Liseur de Romans: Source Gallica - BNF.FR / Bibliothèque Nationale de FranceAntonio Fernando Longo Vidal FilhoPas encore d'évaluation
- Jules Supervielle Poète Intime (... ) Bpt6k6536555sDocument122 pagesJules Supervielle Poète Intime (... ) Bpt6k6536555sSérgio AlcidesPas encore d'évaluation
- UntitledDocument2 pagesUntitledsafire hassaouiPas encore d'évaluation
- Habitus PDFDocument9 pagesHabitus PDFTaous ArezkiPas encore d'évaluation
- Institution OratoireDocument445 pagesInstitution OratoireSimon LiétaertPas encore d'évaluation
- Taifi EDB12 1994Document20 pagesTaifi EDB12 1994tirrasusPas encore d'évaluation
- Harry Potter UAAP VF v13.17Document16 pagesHarry Potter UAAP VF v13.17ElodiePas encore d'évaluation
- Dolor, Furor Et Nefas: Le Chemin Qui Mène À La FolieDocument1 pageDolor, Furor Et Nefas: Le Chemin Qui Mène À La Folieg.valat.rodriguesPas encore d'évaluation
- Dom Juan Le Rapport Maître ValetDocument2 pagesDom Juan Le Rapport Maître ValetI khrouchPas encore d'évaluation
- Citation MUSIQUE 700 Phrases Et Proverbes (Page 2)Document1 pageCitation MUSIQUE 700 Phrases Et Proverbes (Page 2)toby rayanPas encore d'évaluation
- Collège Période 6 Livret ÉlèveDocument97 pagesCollège Période 6 Livret Élèveحكايات من الظلام tales from the dark100% (1)