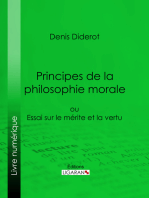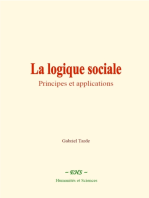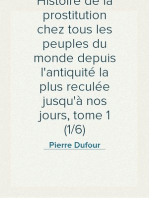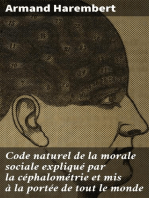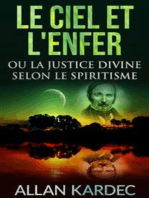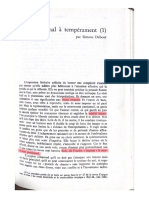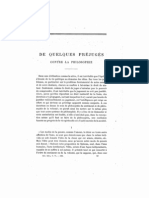Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Chapitre 3. La Version Sadienne de L'universel
Transféré par
Verònica ManavellaTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Chapitre 3. La Version Sadienne de L'universel
Transféré par
Verònica ManavellaDroits d'auteur :
Formats disponibles
Vos mots-clés ! !
% " Connexion# $#
Revues Ouvrages Que sais-je ? / Repères Magazines ! Mon cairn.info
Accueil
%Ouvrages %Les constructions de l'universel %Chapitre 3. La version sadienne...
Chapitre 3. La version sadienne de l'universel & Citer ou exporter
Monique David-Ménard
# Dans Les constructions de l’universel (2009), pages 75 à 97
" Ajouter à une liste
$
Plan Auteur ' Feuilleter
Chapitre
P arce qu’il décide de placer l’excès blasphématoire du plaisir libertin en position d’inconditionné,
Sade fait apparaître par contraste que l’inconditionné, dans la morale kantienne, se réduit à une
place dans un système théorique, et que le contenu de ce système n’est pas nécessairement le respect
1
pour la loi. Le fait de la raison, nous l’avons vu précédemment, formalise sans la fonder une expérience
de la culpabilité que Kant donne comme universelle – bien qu’il ait un instant affirmé que les femmes
l’ignorent – et qui est sans doute spécifique de la sexualité masculine plutôt qu’universelle. Est-ce à dire,
en contrepoint, que l’universel sadien tient ce qu’il promet ?
La Philosophie dans le boudoir s’inscrit à la limite de la pensée kantienne ; elle se propose de montrer que le 2
formalisme de l’idéal des droits de l’homme et de la morale pourrait aussi bien s’accompagner d’une
volonté de détruire la loi, alors que cela paraissait à Kant « manifestement impossible » lorsqu’il en
[1] rencontrait l’éventualité, qu’il s’empressait d’écarter [1].
E. Kant, La religion
dans les limites de la La volonté de détruire la loi peut-elle s’accommoder d’une exigence d’universalité ? Telle est la question 3
simple raison, in… qui guidera notre lecture de l’ouvrage de Sade. Cela revient à examiner comment est mis en œuvre le
principe qu’énonce Dolmancé dans son dialogue avec Eugénie :
EUGÉNIE : « Mais si toutes les erreurs que vous préconisez sont dans la nature, pourquoi les lois s’y 4
opposent-elles ? »
DOLMANCÉ : « Parce que les lois sont faites pour le général, ce qui les met dans une perpétuelle 5
[2] contradiction avec l’intérêt, attendu que l’intérêt personnel l’est toujours avec l’intérêt général. » [2]
Sade, La Philosophie
dans le boudoir, op. On pourrait dire que toute La Philosophie dans le boudoir est l’illustration de cette thèse [3], et 6
cit., p. 176. successivement de deux manières : la fantaisie théâtrale met en scène les plaisirs du libertin, puis le
texte inséré dans le cinquième dialogue – « Français, encore un effort… » – universalise la maxime de la
[3]
volonté mauvaise et décrit le monde social qui en résulterait. Dans la fable théâtrale et pédagogique, on
À la croisée d’une
biologie de partait de l’intérêt personnel qui ne rencontre la généralité de la loi que comme un obstacle existant
l’individuation et
socialement, mais dépourvu de tout fondement pour la logique du plaisir. C’est un obstacle avec lequel il
d’une morale…
faut ruser par la dissimulation. Cette dernière prend diverses formes selon la qualité du personnage
libertin qu’elle concerne : côté femme, la dissimulation concerne surtout l’art de respecter les formes du
mariage. Mme de Saint-Ange, en effet, ne conseille nullement à Eugénie de devenir une prostituée
socialement – c’est Dolmancé qui fait une apologie de principe de la prostitution ; elle l’incite à respecter
cette loi générale du mariage tout en l’enfreignant de fait par des adultères multiples et secrets. Ce dont
il convient de se garder a ici deux visages : la fidélité au mari qui serait une prison, mais aussi l’amour
d’un amant qui en serait une autre. Le secret du bonheur, selon Mme de Saint-Ange, est de multiplier les
amants en payant des laquais pour acheter leur silence, tout en acceptant toutes les fantaisies sexuelles
réclamées par un mari, car cette complaisance garantira la longévité du couple officiel. Dolmancé, lui,
propose de porter la dissimulation plus avant : il affirme avoir été meurtrier, puisque la cruauté est ce
qui ébranle le mieux la masse des nerfs, mais ne révélera pas même à ses amies dans quelles
circonstances il l’a été. Le clivage est pratiqué, donc, selon des manières qui varient selon le sexe et le
tempérament : à l’idée kantienne que le sujet moral se découvre toujours en défaut par rapport à une loi
dont la valeur définit universellement l’humain répond l’art proclamé de pratiquer une double
référence, aux lois générales, d’une part, aux inclinations qui les violent, de l’autre. À vrai dire, dans
cette vulgate libertine, il ne s’agit pas d’une simple séparation entre le général et l’individuel, il ne s’agit
pas non plus du développement de toute une nichée de contradictions privées de pensée, comme le
soutenait Hegel dans la Phénoménologie de l’esprit, lorsqu’il dénonçait l’insuffisance rationnelle de la
vision morale du monde. Avec Sade, le ressort même de l’art de conduire sa vie est de cultiver
l’incompatibilité des lois et des intérêts individuels en multipliant les « clashes », c’est-à-dire les
occasions de leur mutuelle répugnance. Voici comment s’explicite la déclaration de Dolmancé à
Eugénie : « Mais les lois, bonnes pour la société, sont très mauvaises pour l’individu qui la compose ; car,
pour une fois qu’elles le protègent ou le garantissent, elles le gênent et le captivent les trois quarts de sa
vie ; aussi l’homme sage et plein de mépris pour elles les tolère-t-il, comme il fait des serpents et des
vipères, qui, bien qu’ils blessent ou qu’ils empoisonnent, servent pourtant quelquefois dans la
médecine ; il se garantira des lois comme il fait des bêtes venimeuses ; il s’en mettra à l’abri par des
précautions, par des mystères, toutes choses faciles à la sagesse, et à la prudence. Que la fantaisie de
quelques crimes vienne enflammer votre âme, Eugénie, et soyez bien certaine de les commettre en paix,
[4] entre votre amie et moi. » [4]
La Philosophie dans le
boudoir, p. 176. L’art du pharmakon est donc ce qui lie, par la grâce du sage, l’universel et le particulier dont il s’agit de 7
célébrer la dissension par des emprunts momentanés à ce qui répugne à chacun des termes. Aucune
logique ne scellera cette conduite, puisqu’il importe justement qu’elle reste soumise à l’arbitraire
inventif du libertin. Le paradoxe de Sade est là : il attaque la philosophie dans les termes qu’elle définit
elle-même, ici l’universel et l’individuel, le désir et la loi, et, ce faisant, il donne à croire qu’il va réfuter
l’organisation logique de la pensée kantienne puisqu’il en dénonce les failles. Mais tel n’est pas vraiment
le gain qu’on obtient à lire Sade, qui, même s’il proclame qu’il construit un système qui universalise sans
contradiction la volonté du mal, fait en réalité autre chose : dans ses pages les plus écœurantes, forcer le
lecteur à se représenter qu’on est bien dans le mal, selon l’expression de Lacan, et, dans les pages
légères, inventer des arts de faire avec la loi qui mettent fin par un accent humoristique aux déboires de
la conscience malheureuse.
Puisque les lois qui valent pour le général ne subsument jamais l’individuel, il s’ensuit que dans la 8
description des plaisirs il n’y a que de la contrefaçon du général : ainsi, la société libertine est une
société qui fait exception, comme dit excellemment Dolmancé : « … Jamais entre eux ne se mangent les
loups, dit le proverbe, et, si trivial qu’il soit, il est juste. Ne redoutez jamais rien de moi, mes amies : je
[5] vous ferai peut-être faire beaucoup de mal, mais je ne vous en ferai jamais. » [5] Il n’y a donc de
Ibid., p. 116. libertinage que pour une société des amis du crime, amis entre lesquels seulement peut régner la
confiance ou la complicité, puisqu’ils s’entendent sur la particularité des plaisirs et la nécessité, pour les
pratiquer, non seulement d’ignorer les lois, mais de les contredire en secret.
Sade est-il philosophe ?
Toutefois, en principe, chez Sade, il n’y a pas que du théâtre, il y a aussi de la philosophie : « J’ai promis 9
partout la même logique, je tiendrai parole », lance l’auteur de Français encore un effort… Il s’agit donc, en
principe, d’être plus cohérent que les révolutionnaires, et de décrire – en dénonçant l’alliance du
théisme et du despotisme, en revendiquant le blasphème comme ressort de la jouissance, en légalisant
surtout l’inceste, le vol et le meurtre – une société plus consistante et qui n’exclue plus le sexe de
l’organisation commune. Le principe selon lequel ce qui vaut pour le général ne vaut jamais pour le
particulier est illustré « à l’envers » dans Français encore un effort.. ; en effet, avant de recommander une
mesure légale comme l’autorisation du vol ou du meurtre, Sade prend toujours soin de rappeler qu’il ne
faut point légiférer pour la collectivité en partant de points de vue individuels. Pour celui qui est tué, le
meurtre est un mal, mais à l’échelle de la société il est certain, selon Sade, que tous les moyens
d’éliminer la population en surnombre, que ce soient les avortements ou les meurtres, seront les
bienvenus. Le motif économique – une société ne peut survivre que si les citoyens ne sont point trop
nombreux – sert ici de machine pour une apologie de la destructivité, attribuée à la nature. Même un
pouvoir royal avait su parfois déchiffrer cette prétendue justice immanente à la violence : « Je vous
accorde votre grâce, disait Louis XV à Charolais qui venait de tuer un homme pour se divertir, mais je la
donne aussi à celui qui vous tuera… En un mot le meurtre est une horreur, mais une horreur souvent
[6] nécessaire, jamais criminelle, essentielle à tolérer dans un État républicain. » [6]
Ibid., p. 249.
Il s’agit, semble-t-il, de battre la philosophie de la République sur son propre terrain, de montrer 10
comment la démocratie et l’égalité peuvent prendre corps. Cette lecture philosophique de l’ouvrage peut
trouver un appui sur bien des énoncés de Sade : par exemple, c’est par des arguments remarquables
qu’il souhaite l’abolition de la peine de mort, conseillant de s’en tenir à la seule violence passionnelle des
hommes dans le crime, et bannissant une violence instaurée par la loi, « parce que la loi, froide par elle-
même, ne saurait être accessible aux passions qui peuvent légitimer dans l’homme la cruelle action du
meurtre ». En effet, si la cruauté est dans la nature autant que la bonté, que peut être la prétention d’une
loi à en être l’origine légitime ? On est tenté de suivre Sade en appréciant l’audace de l’effort auquel il
invite les citoyens. Ou encore, lorsqu’il envisage avec conséquence les relations de la sexualité et du
politique : puisque la jouissance est despotique, qu’aucune passion n’a plus besoin de toute l’extension
de sa liberté que celle-là, « toutes les fois que vous ne donnerez pas à l’homme le moyen secret d’exhaler
la dose de despotisme que la nature mit au fond de son cœur, il se rejettera pour l’exercer sur les objets
qui l’entoureront, il troublera la paix civile ». Sade, donc, propose une façon meilleure de construire la
paix civile, qui tienne compte de ce que les systèmes juridiques taisent ordinairement : le rapport
métonymique qui lie les objets érotiques aux objets et activités politiques. On pourrait donner d’autres
exemples concernant l’instauration d’un régime politique fondé sur la douceur des lois, seul remède au
fait qu’il ne peut y avoir autant de lois que de singularités dans une société donnée… Pourtant, cette
« sagesse » du marquis ne suffit pas à caractériser sa pensée. Car, en même temps, le texte de Sade rend
un son presque fou et terrifiant, sa volonté de cohérence ayant un accent diabolique. En quoi ? Peut-être
pas seulement parce que, comme l’a affirmé Annie Lebrun, Sade lève avec conséquence les illusions sur
[7] l’humain qui ne découvrent plus qu’un « bloc d’abîme » [7], mais plutôt aussi parce que la décision de
Annie Lebrun, cohérence logique, de cohérence plus accomplie que dans la philosophie républicaine, tourne à une
Soudain un bloc
apologie de la destruction qui emporte le parti pris de logique, et qui a pour effet ou pour fonction – peu
d’abîme, Sade, Paris,
J.-J.… importe l’ordre des facteurs – de supprimer les repères introduits dans l’ordre de la cohérence ; ce n’est
pas que la cohérence ait une valeur de norme absolue, pour la pensée. Mais, comme Sade commence par
dire qu’il va faire œuvre logique en construisant un monde social sur la prémisse de la volonté mauvaise,
le lecteur accepte son propos. Or ce dernier se trouve détourné sans cesse, l’affirmation de la volonté de
meurtre, de crime et de matricide devenant petit à petit la seule raison d’être du discours. Et comme il
s’agit d’une forme littéraire qui se sert du « motif » sexuel pour forcer le lecteur à jouir quand il est
question de jouissance, à être dans la cruauté lorsqu’il s’agit de faire l’apologie de la cruauté meurtrière,
etc., ledit lecteur est emporté dans les détours du texte sans plus savoir où il est, le critère de cohérence
ne faisant plus fonction d’orienteur. Car l’auteur, ou le narrateur, ne cesse de se déplacer dans ce qu’il
affirme, la seule constance étant l’apologie du mal, et non pas la décision logique revendiquée.
Ou plutôt, ce sentiment que l’auteur ne cesse de se déplacer dans son propos est peut-être lié, pour le 11
lecteur de Sade, à l’extrême difficulté qu’il y a à recevoir ce texte de La Philosophie dans le boudoir. Peut-
être est-ce moins l’auteur qui se déplace, qui est inconséquent – dans ce qu’il dit par exemple sur la
nature, indifférente au bien comme au mal, ou essentiellement cruelle selon les pages –, que le lecteur
qui est mis par le texte à une place intenable, et qui paralyse sa capacité de lecture : tout Sade tient dans
la corrélation de deux données : on ne peut lire La Philosophie dans le boudoir sans quitter périodiquement
le texte pour se masturber, et il est presque impossible, sauf à séjourner longtemps dans la violence d’un
texte qui accumule les occasions de faire mal à qui le lit, de se faire une idée synthétique de ses
développements. Et cela parce qu’il faut lutter contre ce texte, dont la réussite est de produire un effet
de souffrance et de jouissance sur le lecteur. Or, ce scénario en quoi consiste la lecture du livre est en
plein accord, cette fois, avec le propos développé par « Français, encore un effort si vous voulez être
républicains » : il s’agit d’instaurer un régime d’égalité où tout individu peut forcer tout autre à jouir, et
d’inscrire dans la législation que telle est la source de l’égalité politique. Tout citoyen en vaut un autre,
car tout homme est un despote quand il jouit, et l’égalité consiste à laisser se développer pour tout
jouisseur le despotisme de la jouissance. Cela suppose cette interchangeabilité absolue des citoyens-
jouisseurs, qui est à l’image de la substituabilité rigoureuse des organes érotiques dans les postures
libertines. L’universel sériel trouve ici son expression la plus crue ; et, paradoxalement, elle s’allie au
privilège de l’inconditionné puisqu’il s’agit de créer une situation d’égalité où tout homme ne connaît
que sa propre jouissance, c’est-à-dire où il réduit tous les autres au rang d’esclaves de son plaisir. D’où la
légalisation souhaitée de l’inceste, du meurtre. On se demandera comment il convient d’entendre ces
recommandations : au n-ième degré, comme le fait de lever un coin du voile sur les ressorts érotiques
dont se nourrit un ordre légal ? Comme une parabole fantastique ou comme un projet de réforme
politique au premier degré ? En fait, ces questions n’ont qu’une importance relative, car ce texte agit sur
son lecteur, et ce n’est pas au nième degré : il force à jouir en racontant des horreurs qui prennent
l’apparence de développements violemment subtils. En psychanalyse, on se demande souvent quel
statut ont les scénarios de jouissance chez les analysants dits pervers : leur complexité, leur nécessité
contraignante pour que la jouissance puisse se frayer un chemin en font des constructions parfois très
proches d’un délire, à ceci près que c’est un délire limité aux matériaux de l’existence sexuelle, et qui est,
par son originalité figée, la caricature des fantasmes de tout un chacun. On se pose la même question en
lisant Sade : lorsqu’il recommande de créer, dans la société des démocrates, des espaces de luxure,
spacieux et confortables, où tout citoyen pourra forcer tout autre à être le moyen de sa jouissance, on se
demande si on a là une métaphore subtile de l’extraterritorialité de la jouissance ou s’il s’agit de
recommander l’instauration pure et simple d’une folie sanguinaire, dans une apologie. de la cruauté
pour la cruauté. L’écriture du texte de Sade est plus que le déploiement d’un fantasme, au sens où
peuvent l’être les écrits de Georges Bataille, précisément parce que Sade met en acte une contrainte à
jouir et définit l’exercice de la pensée rationnelle comme l’approche de ce point de violence.
En fait l’hésitation sur ce dont il s’agit quand on lit Sade ne se résout que par la force : ce texte, selon les 12
moments, fait jouir ou écœure, c’est-à-dire qu’il mobilise un point de l’humain où nulle liberté de lecture
ne tient au regard de la jouissance. Seule l’expérience de la lecture permet donc de trancher sur ce qu’est
ce texte, au-delà de toutes les ambiguïtés sur lesquelles on peut gloser à l’infini concernant son statut : la
jouissance, c’est le forçage, et cela sans métaphore ou déplacement. Telle est la thèse mise en acte plutôt
que développée. Son contenu vaut moins par sa seule explicitation que par cet acte même qui prétend
assimiler la rigueur de la pensée et le forçage de la jouissance des lecteurs. Si on saisit que ce texte est
une machine à produire chez le lecteur – et l’évocation écrite y suffit – cet état de jouissance forcée dont
il s’agit d’aménager la place dans l’ordre social, il n’y a plus d’inconséquence. Car la cohérence et
l’incohérence sont définies, elles aussi, comme des transactions liant l’auteur et les lecteurs du texte : La
cohérence n’est pas seulement une caractéristique concernant l’énoncé ; elle est le régime d’un discours
qui maintient la règle d’une fixité stratégique entre auteur et lecteur. L’incohérence est l’acte par lequel
l’auteur entraîne le lecteur, grâce à des affirmations qui se déplacent, dans une spirale de jouissance
destructrice qui aboutit à la mise à mort de la mère d’Eugénie au cours d’une scène érotique.
C’est à propos de la cruauté supposée de la nature et des plaisirs que les hésitations théoriques de Sade 13
révèlent leur fonction d’entraînement à faire jouir. Dans le registre de la logique du texte, de son sens et
de ses ressources littéraires, on pourra relever des hésitations ou inconséquences qui nous ont fait dire
d’abord que le parti pris de cohérence de Sade, qui veut en remontrer aux philosophes, n’était pas
vraiment assumé. En particulier, le texte hésite : sur ce qu’il convient d’appeler nature, et sur la question
de savoir si le plaisir est solipsiste ou s’il est essentiellement cruel. D’ailleurs, ces deux points n’en font
qu’un : ce qui est attribué à la nature – indifférence au bien et au mal ou préférence marquée pour la
destruction – est aussi bien la marque, caractéristique et ambiguë, des plaisirs : sont-ils pris à la cruauté
exercée sur d’autres ou bien l’autre est-il seulement irréel pour le solipsisme du plaisir ? On remarquera
qu’il s’agit là de la même question qu’à propos de la nature, et qu’elle porte sur l’importance de la
cruauté. Cette dernière n’est-elle qu’un phénomène adjacent dans les actions de la nature ou du plaisir
ou bien la raison d’être de leurs agissements ? Tout le texte met en scène cette question en effaçant la
différence entre les deux possibilités.
C’est bien pourquoi Sade diffère de Machiavel ou de Spinoza, chez qui l’affirmation de la rationalité du 14
mal n’est jamais la raison d’être de la pensée : pour Machiavel, le mal et la cruauté existent dans l’art de
gouverner, il convient qu’un prince sache en user pour pouvoir se faire craindre de ses sujets, ce qui est
de meilleure stratégie politique que de se faire aimer. Mais user d’une cruauté naturelle, pour un prince,
n’est utile qu’autant qu’il s’en sert sans s’y identifier, c’est-à-dire sans s’y « vautrer » même s’il en jouit.
Cette jouissance même risque de se transformer en piège sur la scène du pouvoir, car le but n’est jamais
ici l’expression de la cruauté en elle-même, mais l’exploitation de ses ressources pour assurer, mieux
que ne le fait la bonté, la stabilité d’un rapport de forces. Le texte de Machiavel ne dérape jamais dans
une apologie de la cruauté en politique. Il s’en tient au fait brut de l’existence de cette dernière chez
certains princes, et sur les avantages de son utilisation raisonnée. On dirait de même, à propos du statut
de la nature spinoziste, que l’indifférence de la nature au bien et au mal est affirmée sans que cette thèse
vire jamais à une louange de la destructivité naturelle : les grands poissons mangent les petits par un
droit de nature, selon l’expression du Traité politique, mais cela implique seulement que les idées du bon
et du mauvais sont des notions inadéquates, produites par les idées des affections des corps, et qu’il
convient de ne pas imaginer la nature à leur image. Le bien et le mal n’existent pas dans la nature et il
s’agit de ne pas faire de la nature une instance porteuse d’intentions et qui délirerait avec les hommes
soumis aux affections. Mais cette affirmation de l’amoralité de la nature ne se transforme jamais en
illustration de sa capacité à détruire comme chez Sade. L’éthique consiste bien plutôt à cultiver celles de
nos passions qui favorisent l’exercice de la pensée vraie.
Le recours sadien à la notion de nature est donc très spécifique, si on le compare aux conceptions des 15
autres penseurs matérialistes. Sa particularité la plus criante est d’abord la liaison explicite établie entre
nature et sexe, ou plutôt – car Sade n’emploie pas le mot sexe au sens qui est le nôtre – entre nature et
manières de jouir. Là où Machiavel parlait du désir d’opprimer chez les grands et du désir du peuple de
n’être pas opprimé, là où Spinoza reprenait le terme classique de passion, Sade parle de disposition à
jouir, de luxure, de plaisirs libertins et les identifie aux « mouvements de la nature », en les opposant à
l’éducation et à la loi. Pour naturaliser le plaisir, il s’appuie d’abord sut une conception mécaniste du
mouvement. Cette dernière sert, certes, à mettre en pièces l’idée d’un maître divin de la nature : « Si la
matière agit, se meut, par des combinaisons qui nous sont inconnues, si le mouvement est inhérent à la
matière […] quel sera le besoin de chercher alors un agent étranger à tout cela, puisque cette faculté
active se trouve essentiellement dans la nature elle-même, qui n’est autre chose que la matière en
[8] action ? » [8] Mais ce thème n’est jamais autonome, car, parmi les mouvements sans intention, il
La Philosophie dans le convient au premier chef de compter les désirs sexuels de tous ordres. Ainsi Mme de Saint-Ange expose-
boudoir, p. 70.
t-elle à Eugénie comment elle a conquis sa liberté dans le mariage en satisfaisant les lubies
coprophagiques de son mari ; et Dolmancé ajoute, en réponse à Eugénie qui trouve cette fantaisie bien
extraordinaire : « Aucune ne peut se qualifier ainsi, ma chère ; toutes sont dans la nature ; elle s’est plu,
en créant les hommes, à différencier leurs goûts comme leurs figures, et nous ne devons pas plus nous
[9] étonner de la diversité qu’elle a mise dans nos traits que de celle qu’elle a placée dans nos affections. » [9]
Ibid., p. 93.
À vrai dire, entre la nature conçue comme matière en action sans principe final et la nature conçue 16
comme diversité sans finalité des dispositions à jouir, il y a un intermédiaire : les mouvements de la vie,
libérés eux aussi de toute finalité liée à une création divine qui n’est qu’une chimère « […] depuis que,
mieux instruits des lois et des secrets de la physique, nous avons développé le principe de la génération,
et que ce mécanisme matériel n’offre aux yeux rien de plus que la végétation du grain de blé, nous en
[10] avons appelé à la nature de l’erreur des hommes » [10]. Cet appel à la nature garantit que la procréation
Ibid., p. 123. ne recèle aucun droit de Dieu sur des créatures, et si la contingence règne dans les lois de la procréation,
c’est une raison pour que les hommes se sentent aussi maîtres de leurs produits qu’un humain est libre
de se débarrasser de ces excroissances de son corps que sont ses ongles. Laissons pour la suite ce
parallèle établi entre les enfants et les déchets de nos corps pour noter seulement que la référence à la
nature vivante et au caractère sans mystère de la procréation établit, mieux que ne le faisait la seule
nature physique, que la nature détruit autant qu’elle crée. Tel est le maillon qui articule sous le nom de
nature une physique de la matière en mouvement et une théorie de la jouissance : la biologie nous
garantit que la nature détruit comme nous jouissons de détruire dans les plaisirs. La jouissance est
naturelle précisément parce qu’elle est destructrice comme la vie qui ne se perpétue que par un
mécanisme contingent sur lequel les hommes ont tous les droits, et d’abord celui de l’interrompre par le
meurtre et a fortiori par l’infanticide ou l’avortement.
Un silence de Sade : le plaisir est-il solipsiste ou délibérément cruel ?
Dans ce geste théorique qui réunit par le mot de nature une théorie physique et une description des 17
« mouvements » sexuels qui les place d’emblée au-delà du bien et du mal, Sade se distingue des autres
penseurs matérialistes de la pensée occidentale en exposant sous toutes les coutures l’idée que la nature,
c’est l’impulsion à jouir et que c’est à ce titre que la luxure s’inscrit dans une physique et une science de
la vie. La « démonstration » comporte plusieurs points corrélés :
1. Nature et plaisirs sont ignorants du bien et du mal et pourtant, ils ont une affinité particulière avec
la douleur et la destruction infligées.
2. Les femmes ont, à un degré éminent, le secret de la cruauté dans les plaisirs.
3. La sodomie est la forme suprême du plaisir. Elle garantit son caractère naturel en un sens inédit, à
savoir qu’elle inscrit les violences érotiques dans la destructivité de la nature. Cette dernière, en
effet, bien qu’elle tolère chez les vivants la capacité à se reproduire, n’est jamais aussi naturelle
qu’en la contournant. Et pour Sade, ne pas se reproduire, c’est détruire.
Si on considère comme déterminante pour l’ « éthique » et la métaphysique sadiennes l’idée ambiguë du 18
plaisir pris entre le solipsisme et la cruauté cultivée – le premier des points mentionnés –, la physique et
la biologie sadiennes, c’est-à-dire les deux versants épistémologiques de sa philosophie, apparaissent
comme des relais pour faire passer une éthique de la cruauté. Le premier point commande alors la
position des deux autres. Nul doute qu’il s’agisse là de la véritable cohérence du propos sadien : que la
philosophie s’énonce dans un boudoir a bien pour vérité que le privilège accordé à une certaine
structure de désir – celle nommément de Dolmancé – commande une organisation conceptuelle qui a
l’air de la précéder logiquement. On pourrait donc sans forcer le texte exposer la pensée de Sade sur la
nature en partant de sa doctrine du plaisir, puisque, aussi bien, sa visée est d’assimiler les deux.
Pourtant, si on veut comparer sa philosophie comme système avec celle d’autres penseurs, et en
particulier avec celle de Kant, il peut être utile de respecter l’ordre d’exposition qui consiste à inscrire la
doctrine du plaisir libertin dans une théorie physique et biologique de la nature. On soulignera alors en
quoi le second point à développer, l’importance de la sodomie, joue le rôle d’articulation entre une
épistémologie de la vie naturelle et une éthique de la cruauté. Comme la liberté kantienne était la clef de
voûte de l’édifice critique, la sodomie est chez Sade la clef de voûte du système de la philosophie
libertine, car elle est censée inscrire une théorie du désir dans une théorie de la nature, de même que la
liberté kantienne était censée inscrire une théorie de l’action dans une théorie de la constitution
transcendantale de la nature. Si le lecteur du chapitre second du présent ouvrage nous concède que la
clef de voûte kantienne comporte quelques points de faiblesse qui menacent l’édifice, il sera amené à
reconnaître que Sade n’est pas mieux loti que Kant, c’est-à-dire qu’à la faveur d’un usage glissant de la
référence au terme de nature, Sade transforme en système du monde un acte littéraire qui consiste à
privilégier violemment le désir libertin mis en scène – acte qui n’a d’autre vérité que de se produire,
comme tout désir qui se manifeste en s’exposant.
Partons donc du concept de nature tel qu’il se définit : la nature c’est d’abord la mécanique des corps 19
[11] physiques libérée de toute référence à un créateur ou à un premier moteur [11] et, si le terme en vient à
Ibid., p. 70. qualifier toutes les formes de disposition au plaisir qui relèvent d’une description pure de toute
appréciation morale, c’est par l’intermédiaire d’une référence à la sodomie : « […] c’est dans l’homme que
la nature veut que l’homme serve cette fantaisie ; et c’est spécialement pour l’homme qu’elle nous en a
[12] donné le goût. » [12] Curieusement, à partir du moment où la sodomie comme nec plus ultra de la
Ibid., p. 98. jouissance est invoquée, le texte devient lyrique sur le thème de la nature. Sade, à propos de l’inceste, ira
jusqu’à parler des « divines lois de la nature » [13]. Et dès qu’il évoque la sodomie, il personnifie ladite
[13]
nature : « Il est absurde de dire que cette manie l’outrage. Cela se peut-il, dès qu’elle nous l’inspire ?
Ibid., p. 107.
peut-elle, dicter ce qui la dégrade ? Non Eugénie, non ; on la sert aussi bien là qu’ailleurs, et peut-être
[14] plus saintement encore. La propagation n’est qu’une tolérance de sa part. » [14] Avec cette dernière et
Ibid., p. 98. courte phrase on tient la clef de voûte de l’édifice sadien : la propagation n’est qu’une tolérance de la part
de la nature. Cette affirmation, qui sera répétée telle quelle à plusieurs moments des dialogues – par
[15] exemple « […] la propagation n’est nullement le but de la nature : elle, n’en est qu’une tolérance… » [15] –,
Ibid., p. 122. ne consiste pas à dénaturaliser le pulsionnel, comme ce sera le cas chez Freud ni à distinguer sexe et
nature – ce qui implique en effet que la reproduction ne soit pas la norme du sexe. Non, chez Sade il
s’agit d’affirmer que la sodomie est naturelle parce qu’elle est destructrice comme la nature.
L’invocation de la nature est faite du point de vue d’une apologie de la destruction et la sodomie, parce
qu’elle ne reproduit pas, est posée comme destruction. Quelle que soit la portée historique d’une telle
situation polémique de la sodomie, qui, au XVIIIe siècle était réputée un crime, on ne peut tout de même
que s’étonner du sophisme sadien : ne pas reproduire, c’est détruire. La raison de ce sophisme est
patente dans le texte : c’est parce qu’il s’agit de magnifier une violence interne aux mouvements du
plaisir que la cruauté exercée raffine, que, du coup, la sodomie est qualifiée de destructrice et inscrite
dans la nature physique et biologique, à tel point que l’imagination libertine en vient, dans un
raisonnement tortueux, à représenter une cruauté de la nature elle-même qui, se servant des fantaisies
sodomites, viserait l’extinction de l’espèce humaine : « La propagation n’est qu’une tolérance de sa part.
Comment pourrait-elle avoir prescrit pour loi un acte qui la prive des droits de sa toute-puissance,
puisque la propagation n’est qu’une suite de ses premières intentions, et que de nouvelles
constructions, refaites par sa main, si notre espèce était absolument détruite, redeviendraient des
intentions primordiales dont l’acte serait bien plus flatteur pour son orgueil et sa puissance. » Faut-il
vraiment, pour cesser de condamner la sodomie, imaginer une destruction de la vie et une créativité
biologique qui ne passerait pas par la reproduction sexuée ?
Et, après tout, pourquoi mettre au compte d’une supposée nature, et toute-puissante qui plus est, la 20
jouissance d’un libertin à exercer une cruauté ? Ne suffit-il pas de rappeler que cet exercice est « ce qui
ébranle le mieux la masse de ses nerfs » ? Il y a deux moments dans le délire sadien : le premier consiste
à poser que ne pas se reproduire, c’est détruire, sans apercevoir que c’est là de la mauvaise logique ; et le
second est d’hypostasier en une nature destructrice une destructivité de certains plaisirs qui croient
trouver par là des lettres de noblesse philosophique, alors que cette destructivité se formule seulement
par une métaphore vitale qui la dispense de s’interroger sur l’ambiguïté de la conception des plaisirs
qu’elle met en place : le plaisir est-il solipsiste et par là secondairement cruel, n’ayant cure de ce qu’il
produit sur les objets qui le concernent ou bien est-il, au contraire, pris à la cruauté exercée sur l’autre à
qui le libertin se sent semblable ? Faute d’élucider cette question, Sade fait comme les philosophes font
toujours, à en croire Spinoza ; il fait délirer la nature en prétendant inscrire en elle une logique
passionnelle qui s’exacerbe en s’aveuglant sur elle-même.
Présentons les choses autrement : on est tenté de soutenir qu’en invoquant la sainteté de la nature dans 21
sa destructivité, Sade fait œuvre de pensée rationnelle, qu’il inverse le rôle de l’idée de nature dans les
philosophies juridiques, et que, pour ce faire, il personnifie à son tour la nature. Cela ne serait alors
qu’une tournure de style toute maîtrisée par un propos de théoricien. Or, il en va tout autrement dans ce
texte : l’attribution à la nature d’une destructivité diabolique intervient à la place d’une analyse de la
cruauté des désirs libertins. Inscrire le mal dans la nature de la vie, c’est renoncer à définir la
destructivité du plaisir qui est le véritable thème de l’ouvrage. S’il voulait faire œuvre de philosophe,
Sade aurait dû se prononcer sur le rapport de la jouissance au mal. À la place de cela intervient, comme
un détour ou comme une métaphore qui se prend pour une métaphysique matérialiste, une théorie de
la vie : l’apologie de la sodomie est véritablement l’instrument de ce glissement obscur. Qu’est-ce que
cela veut dire que ne pas se reproduire, c’est détruire ? Qu’il y a dans la jouissance sodomite un forçage
du plaisir qui en est l’accomplissement, ou encore que les humains qui n’ont pas de descendance
participent à une destructivité supposée de la nature biologique qui n’a admis la reproduction que
comme une erreur qu’il conviendrait de corriger ? L’apologie de la sodomie joue sur les deux tableaux
d’une façon confuse. Et, comme on l’a précédemment suggéré, cette confusion a pour fin une indécision
sur la nature du plaisir, que le théoricien, tout animé qu’il est pourtant de la volonté de tout clarifier sur
le rapport du plaisir et du mal, ne parvient pas à résoudre. Écoutons-le : ayant inscrit le meurtre dans la
nature et avec lui l’infanticide et l’avortement, Dolmancé en arrive à la cruauté propre aux plaisirs : « […]
il ne s’agit pas de savoir si nos procédés plairont ou déplairont à l’objet qui nous sert, il s’agit seulement
d’ébranler la masse de nos nerfs par le choc le plus violent possible ; or il n’est pas douteux que, la
douleur affectant bien plus vivement que le plaisir, les chocs résultatifs sur nous de cette sensation
produite sur les autres seront essentiellement d’une vibration plus vigoureuse, retentiront plus
énergiquement en nous, mettront dans une circulation plus violente les esprits animaux qui, se
déterminant sur les basses régions par le mouvement de rétrogradation qui leur est essentiel alors,
[16] embraseront aussitôt les organes de la volupté et les disposeront au plaisir. » [16] Les chocs résultatifs sur
Ibid., p. 127. nous de cette sensation produite sur les autres… Voilà une notation assez subtile : c’est lorsqu’elle est
infligée à un autre que la douleur peut se transformer en volupté pour celui qui l’inflige. Mais, au lieu
d’analyser la particularité de ce plaisir, Sade en fait un système du monde : « Comment la nature qui
nous conseille toujours de nous délecter, qui n’imprime jamais en nous d’autres mouvements, d’autres
inspirations, pourrait-elle, le moment d’après, par une inconséquence sans exemple, nous assurer qu’il
ne faut pourtant pas nous aviser de nous délecter si cela peut faire de la peine aux autres ? Ah ! croyons-
le, croyons-le, Eugénie, la nature, notre mère à tous, ne nous parle jamais que de nous ; rien n’est égoïste
comme sa voix, et ce que nous y reconnaissons de plus clair est l’immuable et saint conseil qu’elle nous
[17] donne de nous délecter, n’importe aux dépens de qui… » [17] Qu’on suive les inflexions de ce texte : parti
Ibid., p. 84. d’une analyse assez fine de ce paradoxal rapport à un autre qui ressent la douleur avant que le libertin
puisse jouir de son contrecoup de plaisir, le texte ensuite projette dans la mère nature un égoïsme
simplificateur qui libère le libertin de ce qu’il fait mais efface en même temps, en se dissolvant dans une
puissance cosmique de destruction, la spécificité de son acte qui, par lui-même, ne faisait pas une
vérité.
Concluons : si l’objectif de Sade est d’approcher une certaine direction de la volupté qu’il nomme son 22
despotisme et qui entretient avec ses objets une relation qui mêle plaisir et cruauté, La Philosophie dans le
boudoir est un texte qui parvient parfois à rendre audible l’enjeu de ce qu’on a nommé sadisme. Mais, si
ce texte vise à faire croire que cette forme violente du désir articule les plaisirs à la vie et à la nature qui
seraient essentiellement destructrices, il n’est plus qu’une projection dans ce qu’on nomme alors nature
en voulant la construire comme un tout, de l’objet inconditionné d’une haine qui se figure comme
matricide. Inscrire la cruauté du plaisir dans la nature, faire de la sodomie un acte qui serait
biologiquement destructeur, rendre le meurtre, le vol et l’inceste à leur spontanéité supposée ne
contribuent pas à expliquer comment les lois générales peuvent coexister avec la particularité des
voluptés ; c’est bien plutôt dissoudre la critique de la notion d’universel dans une apologie de
l’inconditionné qui se sert du mot nature pour s’arrêter de penser.
À ce titre, les limites du texte de Sade ne sont guère éloignées des limites du texte de Kant : on se 23
rappelle que le concept de nature, chez Kant, change de sens de la première à la seconde Critique. Dans
sa période d’intransigeance critique, Kant définissait la nature comme le strict corrélat de l’organisation
du donné par l’esprit : « Par nature (dans le sens empirique), nous entendons l’enchaînement des
[18] phénomènes, quant à leur existence, d’après des règles nécessaires, c’est-à-dire d’après des lois. » [18]
E. Kant, Œuvres Cette restriction nécessaire apportée au sens du mot « nature » semble faire corps avec le kantisme, et
philosophiques I, op.
ouvrir par là une perspective résolument athée sur la nature, car phénoménale et dépourvue de tout
cit., p. 946.
finalisme. Or, lorsqu’il compare, dans la Critique de la raison pratique, la situation de la pensée par rapport
aux données de l’intuition et par rapport à celles du sens commun, Kant se donne la liberté de parler
comme d’une réalité d’une nature suprasensible, alors que la stricte rigueur critique ne devrait lui faire
envisager cette notion que comme une Idée de la raison pratique, que le discours philosophique ne doit
jamais poser comme réelle, mais seulement comme non contradictoire. On sait l’attention que Kant
prêtait, dans la Dialectique transcendantale, à ces raisonnements dans lesquels la pensée raisonne sur le Je,
le monde et Dieu en enchaînant des propositions dans lesquelles ces notions sont parfois posées comme
de purs corrélats de pensée, et parfois à tort, comme des êtres existants. Cette capacité illusoire de nos
raisonnements d’accorder l’existence à de pures Idées par le jeu de l’enchaînement des propositions
d’un syllogisme était, dans la première Critique, le mécanisme même de l’illusion transcendantale. Or,
lorsqu’il définit, dans le chapitre intitulé « De la déduction des principes de la raison pure pratique », la
notion de nature suprasensible, le jeu du discours le fait tomber dans cette même illusion
transcendantale. Le texte commence par mentionner, deux fois de suite, le rapport de la moralité à un
« ordre intelligible des choses », par rapport auquel seul notre action morale prend sens. Cet ordre
intelligible des choses est l’idée d’un monde des volontés rationnelles. Accordons cela : cette notion peut,
en effet, sans incohérence prendre place à côté de la notion de nature qui, seule, peut être créditée d’une
existence. « Car la liberté, si elle nous est attribuée, nous transporte dans un ordre intelligible des
[19] choses. » [19] Au moment même où il a pris soin de préciser que la loi morale ne nous donne aucune vue
E. Kant, Œuvres sur cet ordre intelligible, Kant pose cependant qu’elle annonce un monde de l’entendement pur « et le
philosophiques II, p.
détermine de façon positive et nous en fait connaître quelque chose, à savoir une loi » [20]. On dira que
658.
jusqu’ici nous avions affaire à du travail d’orfèvre, car la loi morale, ce Fait de la raison, peut être connue
[20] dans l’expérience du devoir sans que l’ordre intelligible des choses soit posé par la pensée comme réel,
Ibid., p. 659. c’est-à-dire donné à l’intuition. Cependant, dans la phrase suivante, Kant en vient à parler, à l’intérieur
de phrases construites de la même manière, grammaticalement parlant, de la nature sensible, qui fait
de nous des êtres pathologiquement déterminés, et de la nature suprasensible qui n’est plus seulement
déclarée « déterminable », comme le monde de l’entendement pur, mais qui, par la grâce
malencontreuse de l’usage du verbe « être », est posée comme existante, ce qui est exactement le
mécanisme de l’illusion transcendantale. Dans la phrase qui suit, on sera attentif au fait que ladite
nature suprasensible, d’abord posée comme le corrélat d’un devoir-être est finalement posée comme
étant : « Cette loi doit donner au monde sensible, considéré comme une nature sensible (en ce qui
concerne les êtres raisonnables), la forme d’un monde de l’entendement, c’est-à-dire d’une nature
suprasensible sans pourtant briser son mécanisme. Or la nature, dans le sens le plus général, est
l’existence des choses sous des lois… Et, comme les lois selon lesquelles l’existence des choses dépend de
la connaissance sont pratiques, la nature suprasensible n’est autre chose, autant que nous puissions
nous en faire un concept, qu’une nature soumise à l’autonomie de la raison pure pratique. » Même si
Kant veut dire, dans cette phrase, que la nature suprasensible est une idée, jamais posée comme réelle,
le seul fait qu’il construise un parallèle grammatical entre la nature au sens empirique et la nature
« dans le sens le plus général », confère à cette dernière le statut indû d’une réalité existante. Cette
illusion que Kant nous avait appris à démonter et à reconnaître comme telle s’opère ici à la fois par la
grammaire et l’ambiguïté du verbe « être » et par un glissement sémantique : le texte passe de l’ « ordre
intelligible des choses », la notion d’ordre étant facile à distinguer de celle d’existence, à celle de monde
qui, comme il l’a montré lui-même, laisse plus facilement prise à l’illusion transcendandale, et enfin à
celle de nature qui, malgré les précautions qu’il prend par le contenu de son discours, nous fait sauter,
par sa forme, dans la croyance en l’existence du suprasensible. Le terme à la faveur duquel se réintroduit
la croyance, c’est, ici comme chez Sade, le terme de nature. Nature, posée comme sacrée, car
destructrice chez celui-ci et qui est aussi à détruire dans la figure du maternel ; nature, au contraire, qui
est l’élément même de notre être suprasensible chez celui-là – peu importe, au fond par rapport au point
qui nous occupe : c’est parce que Kant n’aperçoit pas les confusions inhérentes au concept d’universel
qu’il pratique qu’il réintroduit sous le terme de nature, une existence du suprasensible ; et c’est parce
que Sade ne va pas très loin dans le programme qu’il s’est fixé de repenser les paradoxes de la
disjonction entre l’universel et le particulier qu’il sacralise à nouveau, fût-ce par dérision, la nature
destructrice et à détruire. La nature est, chez Sade comme chez Kant, le symptôme de ce qui reste
impensé chez les penseurs de l’universel.
Notes
[1] E. Kant, La religion dans les limites de la simple raison, in Œuvres philosophiques III, Paris, Gallimard, p. 48-49. Et Doctrine
du droit, ibid., p. 586-588, texte et note.
[2] Sade, La Philosophie dans le boudoir, op. cit., p. 176.
[3] À la croisée d’une biologie de l’individuation et d’une morale du singulier et de la loi, on lira : Alain Prochiantz, La
Biologie dans le boudoir, Paris, O. Jacob, 1995.
[4] La Philosophie dans le boudoir, p. 176.
[5] Ibid., p. 116.
[6] Ibid., p. 249.
[7] Annie Lebrun, Soudain un bloc d’abîme, Sade, Paris, J.-J. Pauvert, 1985, et Gallimard, « Folio », 1993.
[8] La Philosophie dans le boudoir, p. 70.
[9] Ibid., p. 93.
[10] Ibid., p. 123.
[11] Ibid., p. 70.
[12] Ibid., p. 98.
[12] Ibid., p. 98.
[13] Ibid., p. 107.
[14] Ibid., p. 98.
[15] Ibid., p. 122.
[16] Ibid., p. 127.
[17] Ibid., p. 84.
[18] E. Kant, Œuvres philosophiques I, op. cit., p. 946.
[19] E. Kant, Œuvres philosophiques II, p. 658.
[20] Ibid., p. 659.
Mis en ligne sur Cairn.info le 01/01/2015
# Chapitre précédent Chapitre suivant $
( À propos ( Abonnement Cairn Pro ( Cairn International (English)
( Éditeurs ( Listes publiques ( Cairn Mundo (Español)
( Particuliers ( Dossiers ( Cairn Sciences (Français)
Avec le soutien du ( Bibliothèques ( Rencontres ( Authentification hors campus
( Organisations ( Contact ( Accès via Université Paris 8
( Aide
Besoin d'aide ?
© Cairn.info 2023 | Conditions générales d'utilisation | Conditions générales de vente | Politique de confidentialité
Vous aimerez peut-être aussi
- L'économie politique et la justice: Examen critique et réfutation des doctrines économiques de M. P.-J. ProudhonD'EverandL'économie politique et la justice: Examen critique et réfutation des doctrines économiques de M. P.-J. ProudhonPas encore d'évaluation
- Principes de la philosophie morale: ou Essai sur le mérite et la vertuD'EverandPrincipes de la philosophie morale: ou Essai sur le mérite et la vertuPas encore d'évaluation
- Au Creux Des ApparencesDocument30 pagesAu Creux Des ApparencesmaxiPas encore d'évaluation
- Chapitre 2. L'universel Chez Sade Et KantDocument2 pagesChapitre 2. L'universel Chez Sade Et KantVerònica ManavellaPas encore d'évaluation
- Morale, Ethique, Deontologie - Michel MaffesoliDocument44 pagesMorale, Ethique, Deontologie - Michel MaffesoliFondapol100% (2)
- Chapitre 1. Aussi Souvent Qu'on Voudra... . Les Structures de Désir Et Le Concept D'universel - CDocument1 pageChapitre 1. Aussi Souvent Qu'on Voudra... . Les Structures de Désir Et Le Concept D'universel - CVerònica ManavellaPas encore d'évaluation
- L’art de la dérobade ou de l’exploration des poubelles philosophiques: Pamphlet de sagesse sur le détournement de fonds…D'EverandL’art de la dérobade ou de l’exploration des poubelles philosophiques: Pamphlet de sagesse sur le détournement de fonds…Pas encore d'évaluation
- Auguste Comte et Herbert Spencer Contribution à l'histoire des idées philosophiques au XIXe siècleD'EverandAuguste Comte et Herbert Spencer Contribution à l'histoire des idées philosophiques au XIXe sièclePas encore d'évaluation
- Destins Du Cannibialisme - Hélène ClastresDocument22 pagesDestins Du Cannibialisme - Hélène ClastresRafael Saldanha100% (1)
- Désir - ResponsabilitéDocument4 pagesDésir - ResponsabilitéRachel RiquierPas encore d'évaluation
- Prejugés Et Crise de Lumières PDFDocument15 pagesPrejugés Et Crise de Lumières PDFdiotimaPas encore d'évaluation
- Lacan. Kant Avec SadeDocument18 pagesLacan. Kant Avec SadeRosi OliveiraPas encore d'évaluation
- SadeDocument13 pagesSadeFranck DubostPas encore d'évaluation
- Kant Et L'éthique Du devoirSupport-Lec - On-3Document5 pagesKant Et L'éthique Du devoirSupport-Lec - On-3sôpe Dabakh SDPas encore d'évaluation
- AntheaumeDromard PDFDocument672 pagesAntheaumeDromard PDFanouck capePas encore d'évaluation
- NANCY, Jean-Luc. L Impératif Catégorique PDFDocument78 pagesNANCY, Jean-Luc. L Impératif Catégorique PDFIolanda Biasi Bragança100% (2)
- Histoire de la prostitution chez tous les peuples du monde depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours, tome 1 (1/6)D'EverandHistoire de la prostitution chez tous les peuples du monde depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours, tome 1 (1/6)Pas encore d'évaluation
- Philosophie Pour Tous: Tome IV Années 2013-2014Document20 pagesPhilosophie Pour Tous: Tome IV Années 2013-2014dagnogojob15Pas encore d'évaluation
- Discours sur les fondements de l'inégalité de Jean-Jacques Rousseau (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvreD'EverandDiscours sur les fondements de l'inégalité de Jean-Jacques Rousseau (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Pierre Simon Ballanche - La Ville Des Expiations - Livre IIIDocument23 pagesPierre Simon Ballanche - La Ville Des Expiations - Livre IIIlapointe gabrielPas encore d'évaluation
- 1b - (1972) Foucault-Mon Corps Ce Papier Ce FeuDocument24 pages1b - (1972) Foucault-Mon Corps Ce Papier Ce FeuMichel GalabruPas encore d'évaluation
- Charles Robin - Tous PhilosophesDocument116 pagesCharles Robin - Tous PhilosophescianPas encore d'évaluation
- Fabien Tarby Seminaire 2022 1Document8 pagesFabien Tarby Seminaire 2022 1Master KushPas encore d'évaluation
- Nietzsche Verite Et Mensonge Au Sens Extra MoralDocument8 pagesNietzsche Verite Et Mensonge Au Sens Extra MoralabbraxasPas encore d'évaluation
- Méditations, cartésiennes et anti-cartésiennes: Still lost in translation 2D'EverandMéditations, cartésiennes et anti-cartésiennes: Still lost in translation 2Pas encore d'évaluation
- Safouan, M-La Parole Ou La MortDocument72 pagesSafouan, M-La Parole Ou La MortMonica PeisajovichPas encore d'évaluation
- (Jean Carbonnier) Flexible Droit Pour Une Sociol PDFDocument498 pages(Jean Carbonnier) Flexible Droit Pour Une Sociol PDFMichele Amaral Dill83% (6)
- Code naturel de la morale sociale expliqué par la céphalométrie et mis à la portée de tout le monde: Le droit humainD'EverandCode naturel de la morale sociale expliqué par la céphalométrie et mis à la portée de tout le monde: Le droit humainPas encore d'évaluation
- Le ciel et l'enfer ou la justice divine selon le spiritismeD'EverandLe ciel et l'enfer ou la justice divine selon le spiritismePas encore d'évaluation
- Fuite de l'Absolu: Observations cyniques sur l'Occident postmoderne. volume IID'EverandFuite de l'Absolu: Observations cyniques sur l'Occident postmoderne. volume IIPas encore d'évaluation
- Sorcellerie, Magnétisme, Morphinisme, Délire Des GrandeursDocument458 pagesSorcellerie, Magnétisme, Morphinisme, Délire Des Grandeurssotybertrand1974Pas encore d'évaluation
- Textes Oral Introduction Cours EthiqueDocument3 pagesTextes Oral Introduction Cours EthiqueBenoît DlfPas encore d'évaluation
- Changer L'identitéDocument3 pagesChanger L'identitéAndreea RoxanaPas encore d'évaluation
- Petite philosophie de l'actualité: Chroniques 2013-2014D'EverandPetite philosophie de l'actualité: Chroniques 2013-2014Pas encore d'évaluation
- La Ruse de La Raison: Jacques D'HondtDocument19 pagesLa Ruse de La Raison: Jacques D'HondtAymen HsPas encore d'évaluation
- Maffesoli, Michel - Le Vitalisme SauvageDocument11 pagesMaffesoli, Michel - Le Vitalisme SauvageFelipeHenriquezRuzPas encore d'évaluation
- TOTEM ET TABOU - PRESENTATION DANS WIKIPEDIA (8 Pages - 115 Ko)Document8 pagesTOTEM ET TABOU - PRESENTATION DANS WIKIPEDIA (8 Pages - 115 Ko)Jean DelphonsePas encore d'évaluation
- La Ressemblance by Pierre KlossowskiDocument57 pagesLa Ressemblance by Pierre KlossowskiVerònica ManavellaPas encore d'évaluation
- Théorie de L'unité Universelle: Fourier Charles (1822)Document1 340 pagesThéorie de L'unité Universelle: Fourier Charles (1822)Verònica ManavellaPas encore d'évaluation
- Leçon D'économie Générale: L'expérience-Limite Chez Bataille-Blanchot-Klossowski - Valeur, MonnaieDocument2 pagesLeçon D'économie Générale: L'expérience-Limite Chez Bataille-Blanchot-Klossowski - Valeur, MonnaieVerònica ManavellaPas encore d'évaluation
- UntitledDocument17 pagesUntitledVerònica ManavellaPas encore d'évaluation
- UntitledDocument39 pagesUntitledVerònica ManavellaPas encore d'évaluation
- 1933 Klossowski Éléments Étude Psychanalytique Marquis de SadeDocument18 pages1933 Klossowski Éléments Étude Psychanalytique Marquis de SadeVerònica Manavella100% (1)
- Entre Marx Et Fourier - KlossowskiDocument1 pageEntre Marx Et Fourier - KlossowskiVerònica ManavellaPas encore d'évaluation
- Chapitre 2. L'universel Chez Sade Et KantDocument2 pagesChapitre 2. L'universel Chez Sade Et KantVerònica ManavellaPas encore d'évaluation
- Critique PDFDocument121 pagesCritique PDFAnis HaniPas encore d'évaluation
- Condillac-Traite Des Sensations PDFDocument256 pagesCondillac-Traite Des Sensations PDFsoyelverboPas encore d'évaluation
- LE MATÉRIALISME PSYCHOLOGIQUE DE GEORGES BATAILLE: DE LA REVUE DOCUMENTS À LA CRITIQUE SOCIALE Aurore JacquardDocument16 pagesLE MATÉRIALISME PSYCHOLOGIQUE DE GEORGES BATAILLE: DE LA REVUE DOCUMENTS À LA CRITIQUE SOCIALE Aurore JacquardVerònica ManavellaPas encore d'évaluation
- Anthologie Des Ecrits de Pierre Klossowski Sur Lart 1990Document51 pagesAnthologie Des Ecrits de Pierre Klossowski Sur Lart 1990Verònica ManavellaPas encore d'évaluation
- Érotisme Et Perversion Dans L'œuvre Picturale de Balthazar Klossowski Ou Balthus de L'autre Côté Du Miroir Étude Psychanalytique Sur La Peinture.Document420 pagesÉrotisme Et Perversion Dans L'œuvre Picturale de Balthazar Klossowski Ou Balthus de L'autre Côté Du Miroir Étude Psychanalytique Sur La Peinture.Verònica ManavellaPas encore d'évaluation
- Charlesfourier DebouDocument1 pageCharlesfourier DebouVerònica ManavellaPas encore d'évaluation
- Instincts Et Institutions by Gilles DeleuzeDocument92 pagesInstincts Et Institutions by Gilles DeleuzePhilippe ZhanPas encore d'évaluation
- Chapitre 1. Aussi Souvent Qu'on Voudra... . Les Structures de Désir Et Le Concept D'universel - CDocument1 pageChapitre 1. Aussi Souvent Qu'on Voudra... . Les Structures de Désir Et Le Concept D'universel - CVerònica ManavellaPas encore d'évaluation
- Int REVEILLER ESPRIT 1-32 165-224Document92 pagesInt REVEILLER ESPRIT 1-32 165-224Verònica ManavellaPas encore d'évaluation
- 1933 Klossowski Éléments Étude Psychanalytique Marquis de SadeDocument18 pages1933 Klossowski Éléments Étude Psychanalytique Marquis de SadeVerònica Manavella100% (1)
- Présentation de Sacher-Masoch Le Froid Et Le Cruel by Deleuze, GillesDocument107 pagesPrésentation de Sacher-Masoch Le Froid Et Le Cruel by Deleuze, GillesVerònica ManavellaPas encore d'évaluation
- À Quoi Pense La Littérature ?Document18 pagesÀ Quoi Pense La Littérature ?Verònica ManavellaPas encore d'évaluation
- Bataille Georges Le Bleu Du Ciel 1957 1971Document62 pagesBataille Georges Le Bleu Du Ciel 1957 1971M Aleja Zpt PrzPas encore d'évaluation
- Le Corps IncurableDocument24 pagesLe Corps IncurableVerònica ManavellaPas encore d'évaluation
- Schérer Sur Fourier DiscussionDocument18 pagesSchérer Sur Fourier DiscussionVerònica ManavellaPas encore d'évaluation
- Foucault, Michel. Dits Et Ecrits I (1954-1969)Document692 pagesFoucault, Michel. Dits Et Ecrits I (1954-1969)smat7000Pas encore d'évaluation
- La Ressemblance by Pierre KlossowskiDocument57 pagesLa Ressemblance by Pierre KlossowskiVerònica ManavellaPas encore d'évaluation
- Georges Bataille, La Mort À Lœuvre - Michel SuryaDocument636 pagesGeorges Bataille, La Mort À Lœuvre - Michel SuryaVerònica ManavellaPas encore d'évaluation
- L'Experience Interieure - Georges BatailleDocument160 pagesL'Experience Interieure - Georges Batailletchouang_zu86% (7)
- Maurice Blanchot - Georges BatailleDocument10 pagesMaurice Blanchot - Georges BatailleVerònica ManavellaPas encore d'évaluation
- Jean-Luc Nancy Une Expérience Au CoeurDocument8 pagesJean-Luc Nancy Une Expérience Au CoeurVerònica ManavellaPas encore d'évaluation
- Philosophie Du Droit VialaDocument40 pagesPhilosophie Du Droit VialaVALENTINA RODRIGUEZPas encore d'évaluation
- Premier Discours Sur La Condition Des Grands. Pascal PDFDocument8 pagesPremier Discours Sur La Condition Des Grands. Pascal PDFBbaggi BkPas encore d'évaluation
- Nietzsche Par Dela Bien Et Mal Eric BlondelDocument43 pagesNietzsche Par Dela Bien Et Mal Eric BlondelaioniPas encore d'évaluation
- (Perspectives Critiques) Paul Audi - Rousseau, Éthique Et Passion-Presses Universitaires de France (1997) PDFDocument214 pages(Perspectives Critiques) Paul Audi - Rousseau, Éthique Et Passion-Presses Universitaires de France (1997) PDFlouise antheaumePas encore d'évaluation
- L'essence de La Modernité Selon Heidegger La RepresentationDocument10 pagesL'essence de La Modernité Selon Heidegger La RepresentationJorge CarrilloPas encore d'évaluation
- Le Régime de Vérité NumériqueDocument28 pagesLe Régime de Vérité NumériqueAntoinette RouvroyPas encore d'évaluation
- Terestchenko Michel, Philosophie PolitiqueDocument9 pagesTerestchenko Michel, Philosophie PolitiqueAdelina AlexandraPas encore d'évaluation
- E Ric Lecler - L'Absolu Et La Litterature Du Romantisme Allemand A Kafka. Pour Une Critique Politique (2013, Classiqu PDFDocument340 pagesE Ric Lecler - L'Absolu Et La Litterature Du Romantisme Allemand A Kafka. Pour Une Critique Politique (2013, Classiqu PDFClaudio DuartePas encore d'évaluation
- Critique de La Raison Pure: Preface A La Seconde EditionDocument19 pagesCritique de La Raison Pure: Preface A La Seconde EditionFraise MandarinePas encore d'évaluation
- Philo de l'art-JM - 2Document7 pagesPhilo de l'art-JM - 2LouischaPas encore d'évaluation
- Sexe Et MoraleDocument20 pagesSexe Et MoraleMariaAlexandraPas encore d'évaluation
- Biblio - Philo Moderne Et ContemporaineDocument9 pagesBiblio - Philo Moderne Et ContemporainegorguyPas encore d'évaluation
- Grand Probleme Jugnet PDFDocument129 pagesGrand Probleme Jugnet PDFdaoseeker100% (1)
- Le Critère de Démarcation de Karl R. Popper Et Son ApplicabilitéDocument400 pagesLe Critère de Démarcation de Karl R. Popper Et Son ApplicabilitéFatiha dahbaniPas encore d'évaluation
- La Doctrine Kantienne Du Droit: (Paru Dans: La Revue de La Recherche Juridique. No XXI, 64e Année, 1996-I, P. 265-279)Document18 pagesLa Doctrine Kantienne Du Droit: (Paru Dans: La Revue de La Recherche Juridique. No XXI, 64e Année, 1996-I, P. 265-279)Paulo AlvesPas encore d'évaluation
- Controverse de DavosDocument66 pagesControverse de DavosPortail philosophique100% (1)
- Corrige Bac S 2014 Pondichery Philo Sujet 1Document3 pagesCorrige Bac S 2014 Pondichery Philo Sujet 1Nestor GrahPas encore d'évaluation
- Philosophie Morale Le ThaumazeinDocument68 pagesPhilosophie Morale Le ThaumazeinMelisa KoksalPas encore d'évaluation
- Dalhaus, Carl - Esthétique Musicale Classique Et Romantique, de Kant À WagnerDocument637 pagesDalhaus, Carl - Esthétique Musicale Classique Et Romantique, de Kant À WagnerValentin AbbatePas encore d'évaluation
- Le Problème de La Connaissance LAFARGUEDocument24 pagesLe Problème de La Connaissance LAFARGUEKORGANCHPas encore d'évaluation
- Ob E1db56 16-L-ArtDocument4 pagesOb E1db56 16-L-ArtMoustapha SarrPas encore d'évaluation
- Llhum432 Seidengart Notes de Cours Sur Kant 2Document36 pagesLlhum432 Seidengart Notes de Cours Sur Kant 2neocortex92100% (2)
- Brunschvicg: de Quelques Préjugés Contre La PhilosophieDocument21 pagesBrunschvicg: de Quelques Préjugés Contre La PhilosophiemathesisuniversalisPas encore d'évaluation
- Ricoeur, Paul - Le Juste (OCR FR)Document110 pagesRicoeur, Paul - Le Juste (OCR FR)140871raphPas encore d'évaluation
- Kant - Qu'Est-ce Que Sont Les LumièresDocument6 pagesKant - Qu'Est-ce Que Sont Les Lumièresmounir.benazouzPas encore d'évaluation
- TOSEL, André. Kant RévolutionnaireDocument127 pagesTOSEL, André. Kant RévolutionnaireVítor VieiraPas encore d'évaluation
- Essai Critique Sur Le Réalisme ThomisteDocument272 pagesEssai Critique Sur Le Réalisme ThomisteMichel CarteronPas encore d'évaluation
- °sommer, Christian - BibliographieDocument64 pages°sommer, Christian - BibliographieAnonymous 6N5Ew3Pas encore d'évaluation