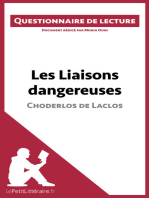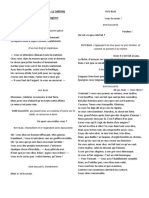Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
La Reconstruction de L'adversaire Chez Emmanuel Carrère
Transféré par
Manuel Millán TortosaTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
La Reconstruction de L'adversaire Chez Emmanuel Carrère
Transféré par
Manuel Millán TortosaDroits d'auteur :
Formats disponibles
Le roman contemporain s’est petit à petit delesté de la charge psicologique
qui l’avait accompagné tout au long du XX siècle et qui avait été l’une des
réusites. Des silhouettes barthlebyennes, vaporeuses, interchangeables,
infiniment disponibles mais éternellement velléitaires, privées à jamais
d’ennemis qui leur donneraient consistance, qui orienteraient leur destin, qui
les rendraient mémorables. Chacun de ces personnages filiformes ou
évanescents apparaît comme le contraire d’un foudre de guerre, et c’est là
tout son paradoxe : son potentiel romanesque est presque nul, et pourtant le
romancier contemporain ne cesse d’imaginer le monde à partir de lui, comme
si cet être sans volonté et sans adversaire, qui fuit vers “autre chose”,
incarnait malgré tout le héros problématique de notre temps.
L’ère de la lassitude prend le relais de l’ère du soupçon. Nathalie Sarraute
reprochait au roman de ne plus être à la hauteur de “la réalité psychologique
actuelle”3. Mais que dire de la nouvelle réalité psychologique un demi-siècle
plus tard ? Si, en 1950, “le personnage n’est plus que l’ombre de lui-même” 4,
que reste-t-il de cette ombre aujourd’hui ? L’écrivain lui-même, quand il se
compare à ses prédécesseurs ou à ses contemporains, ne se décrit plus en
train de lutter pour affirmer sa singularité, comme on a pu le dire de
l’écrivain tout au long de la modernité. La référence au conflit cède la place à
une lucidité mélancolique fondée sur le sentiment d’absence au monde. En
s’effaçant, il marque l’esprit, dirait-on, plus qu’en cherchant à s’imposer. Sa
fuite est pleine de sens, elle nous parle.
Le personnage contemporain sait bien qu’il n’échappe pas lui-même à ce vieil
ordre conflictuel du monde, mais il le vit comme si ce n’était plus vraiment
son affaire, comme si son drame à lui venait plutôt de la perte de
résonance : “Vous aussi, vous vous êtes intéressé au monde. C’était il y a
longtemps ; je vous demande de vous en souvenir” 12, écrit Michel
Houellebecq au début d’Extension du domaine de la lutte. Ce réalisme
contemporain explore les limites de la préposition “avec” : il commence là où
se manifeste la non-relation au monde, d’où la fascination pour un type de
personnage déconnecté, “hors d’atteinte” pour prendre une expression
emblématique de l’œuvre d’Emmanuel Carrère.
Dominique Rabaté a remarqué très tôt la place centrale de cette formule
“hors d’atteinte” chez Carrère, qui l’emploie de diverses manières dans
presque tous ses livres. Il ne s’agit pas seulement d’un “gimmick”, comme le
dira l’auteur13, mais d’un motif structurant, “fantasme majeur de l’œuvre de
fiction”14. Le plus souvent, l’expression est synonyme de grand bonheur, et
même de délivrance : “il ne désirait plus que cela : être hors d’atteinte” 15 ;
“[i]l les enviait presque d’être ainsi déchargés de toute responsabilité, hors
d’atteinte”16 ; “il apprend à se retirer en lui-même et à atteindre la zone où il
est tranquille, hors d’atteinte”17 ; “[l]e bonheur c’est de se mettre hors
d’atteinte”18. Cette quête du non conflit.
Aucun personnage de Carrère ne résonne davantage ni ne marque autant les
esprits que celui de Jean-Claude Romand. L’adversaire demeure encore
aujourd’hui le pivot de toute son œuvre, et pas seulement parce qu’il
inaugure sa nouvelle manière d’écrire. C’est dans ce livre que Carrère donne
à la figure de l’adversaire toute sa grandeur. L’adversaire reprend la question
soulevée dans Hors d’atteinte ?, celle de l’indifférence sociale ou même de
l’absence de toute société – confirmée par la facilité avec laquelle Frédérique
s’est détachée de tous ses liens au prix de quelques mensonges. Sauf qu’ici,
ce qui semblait placé sous le signe du hasard, du jeu et donc de la fiction est
placé sous le signe de la nécessité et révèle tout le potentiel tragique du non
conflit. Comment la famille immédiate et les amis de Jean-Claude Romand
n’ont-ils pas assailli de questions ce faux médecin qui partait chaque jour à
Genève, pendant dix-huit ans, en laissant croire qu’il était chercheur à
l’Organisation mondiale de la Santé alors qu’il n’était rien du tout ? Qu’y
avait-il de si honteux à avouer son échec à l’examen d’entrée, et pourquoi
n’a-t-il jamais osé ensuite avouer son imposture ? Le déficit de volonté du
personnage est à l’évidence celui de sa société, qui ne pose pas de questions
et entretient le silence. Le bien-nommé Jean-Claude Romand représente la
figure concrète et incontestable de l’être hors d’atteinte, muré en lui-même,
prisonnier du personnage qu’il s’est inventé, mais un tel personnage est un
prodigieux analyseur social : ce loser-imposteur-assassin est à l’ère
contemporaine ce que l’exploité-prostitué Lucien de Rubempré fut pour
Lukács à l’ère du capitalisme naissant.
Ce n’est pas la “banalité du mal”, comme l’a décrite jadis Hannah Arendt en
parlant de la Shoah, mais quelque chose de plus mystérieux encore, qui tient
moins à la pure psychose ou à ce qu’on voudrait appeler “l’extraordinarité du
mal” qu’à “l’absence au monde” 32, celle que Jean-Claude Romand incarne
totalement, de façon si stupéfiante, si peu vraisemblable et pourtant si
réelle. Car un personnage aussi fantomatique a besoin, pour exister, d’une
société fantomatique, d’une société où la fragilité du lien social devient non
seulement possible, mais un fait avéré, et même une sorte de révélateur de
la violence telle qu’elle surgit de la douceur même du personnage – car
Carrère insiste sur la non conflictualité du tueur (de l’avis de tous, “un type
gentil”33). Le réalisme de ce reportage romanesque plonge le lecteur au cœur
de la contradiction la plus troublante : dans un monde soi-disant
déconflictualisé surgit la logique du crime le plus barbare.
Au sens étymologique, rappelle-t-il, l’adversaire signifie : “celui qui est situé
en face”, “qui est tourné contre”. Il n’existe donc qu’en relation avec soi,
indissociable de soi. Sans adversaire, le joueur de tennis ne peut pas jouer.
Carrère insiste sur le sens biblique du mot, synonyme du “diable” ou du
“démon”. Mais en choisissant de parler de l’adversaire plutôt que de Satan,
en préférant la litote à l’emphase, souligne Étienne Rabaté, Carrère interdit
de faire du personnage “l’étranger radical” 34. L’adversaire, c’est celui vers qui
on se tourne (ad-versare : tourné vers), et ce vis-à-vis est forcément tout
près de soi; c’est le rival intime, l’ennemi intérieur. Il habite ce que Gilles
Deleuze appelle, en parlant du “devenir animal”, notre “zone de voisinage,
d’indiscernabilité ou d’indifférenciation” 35. L’adversaire n’est pas une entité
du dehors, il ne relève pas du “contre”, mais du “avec” ; c’est le compagnon
terrifiant qui définit la logique relationnelle du “je”, par un jeu de contrastes
et par le mouvement que cette structure narrative permet entre le “je” et le
réel extérieur. Carrère insiste d’ailleurs sur la présence en lui de cet
adversaire.
Le choc de L’adversaire ne tient pas tant au fait divers qu’il met en scène,
dont le romanesque est atténué et relégué aux marges du récit ; il tient à la
notion même d’adversaire, qui est à l’œuvre de Carrère ce que le domaine de
la lutte, pour des raisons similaires, est à l’œuvre de Houellebecq. Le terrain
de l’adversaire ne cesse en effet de s’élargir et d’envahir les zones les plus
familières, les plus protégées de l’être, et de se dissoudre dans le brouhaha
contemporain. Relisons Cioran : “Admettre tous les points de vue, les
croyances les plus disparates, les opinions les plus contradictoires,
présuppose un état général de lassitude et de stérilité. On en arrive à ce
miracle : les adversaires coexistent – mais précisément parce qu’ils ne
peuvent plus l’être”
Vous aimerez peut-être aussi
- Francais Litterature Livre Du ProfesseurDocument135 pagesFrancais Litterature Livre Du ProfesseurNicoletta Pavlou100% (8)
- Le Nouveau RomanDocument17 pagesLe Nouveau RomanMeerim Rysbekova60% (5)
- La Peste d'Albert Camus (Questionnaire de lecture): Document rédigé par Pierre WeberD'EverandLa Peste d'Albert Camus (Questionnaire de lecture): Document rédigé par Pierre WeberÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2)
- DARCOS, X. Histoire de La Littérature FrançaiseDocument3 pagesDARCOS, X. Histoire de La Littérature FrançaiseNicole Dias50% (2)
- Michel Houellebecq-H. P. Lovecraft - Contre Le Monde, Contre La Vie - J'Ai Lu (1999)Document55 pagesMichel Houellebecq-H. P. Lovecraft - Contre Le Monde, Contre La Vie - J'Ai Lu (1999)Oana Andriș100% (1)
- CandideDocument2 pagesCandideChami JemaouiPas encore d'évaluation
- Le Père Goriot - Module 3-1Document2 pagesLe Père Goriot - Module 3-1Фйыцвуак ПерноглшPas encore d'évaluation
- Histoire Littéraire PersonnageDocument7 pagesHistoire Littéraire PersonnageAnge Aristide DjedjePas encore d'évaluation
- L'Amant Entre Autofiction PDFDocument18 pagesL'Amant Entre Autofiction PDFvieru sebastianPas encore d'évaluation
- DISSERTATION Le Roman Doit-Il Accorder La Priorité À La Représentation Du Réel Ou Tout Au Contraire Privilégier L'invention ImaginaireDocument5 pagesDISSERTATION Le Roman Doit-Il Accorder La Priorité À La Représentation Du Réel Ou Tout Au Contraire Privilégier L'invention ImaginaireAme AngéliquePas encore d'évaluation
- Prépa Oral Seconde Partie ("Salina")Document2 pagesPrépa Oral Seconde Partie ("Salina")lyblanc0% (1)
- Roman 1950Document21 pagesRoman 1950planningfamilial246339100% (1)
- Fiche Introduction Aux Grandes Theories Du RomanDocument16 pagesFiche Introduction Aux Grandes Theories Du RomanGwen Miel100% (3)
- Le Nouveau RomanDocument7 pagesLe Nouveau RomanAna Pîslaru100% (1)
- Le Romancier Et Son Personnage - DossierDocument10 pagesLe Romancier Et Son Personnage - DossierpattybellaPas encore d'évaluation
- Le Roman: XemplesDocument3 pagesLe Roman: XemplesNouhaila Sdoud100% (1)
- Les Fonctions Du Roman-1-1Document6 pagesLes Fonctions Du Roman-1-1Herman Malou95% (20)
- Goodbye Yellow Brick Road Notas Sax D - Partitura CompletaDocument1 pageGoodbye Yellow Brick Road Notas Sax D - Partitura CompletaRaul Marquez100% (1)
- Para Ir Del Problema A La Solución, El Camino Más Directo Es Divagar (Moshe Bar)Document7 pagesPara Ir Del Problema A La Solución, El Camino Más Directo Es Divagar (Moshe Bar)Manuel Millán TortosaPas encore d'évaluation
- Le Roman Reflet de La SociétéDocument3 pagesLe Roman Reflet de La Sociétéherve42701640Pas encore d'évaluation
- TFXDocument7 pagesTFXManuel Millán TortosaPas encore d'évaluation
- Landais - M - LE PERSONNAGE DU ROMAN FRANÇAIS CONTEMPORAIN - 2016Document20 pagesLandais - M - LE PERSONNAGE DU ROMAN FRANÇAIS CONTEMPORAIN - 2016andjela7123Pas encore d'évaluation
- Voyage Au But de La Nuit - CélineDocument7 pagesVoyage Au But de La Nuit - CélineMonica Pegorari100% (1)
- Lecture Cursive. Étranger BacdocxDocument4 pagesLecture Cursive. Étranger Bacdocxelenalabat4Pas encore d'évaluation
- Les Types de HérosDocument3 pagesLes Types de HérosmaxencedtvPas encore d'évaluation
- GRIGNON. Écrite Littéraire Et Écriture SociologiqueDocument17 pagesGRIGNON. Écrite Littéraire Et Écriture SociologiqueRose RochaPas encore d'évaluation
- Voyage Au Bout de La Nuit de CelineDocument13 pagesVoyage Au Bout de La Nuit de Celinemariepierre razafyPas encore d'évaluation
- Préparation Dissertation Le Rouge Et Le Noir ÉlémentsDocument26 pagesPréparation Dissertation Le Rouge Et Le Noir ÉlémentsRoomain TartivelPas encore d'évaluation
- Dissertation Sur Le RomanDocument2 pagesDissertation Sur Le Romandiallomouhamadou340100% (1)
- L'autreDocument27 pagesL'autreFILSPas encore d'évaluation
- Roman 0048-8593 1971 Num 1 1 5387Document11 pagesRoman 0048-8593 1971 Num 1 1 5387nicetchiPas encore d'évaluation
- FICHES - VASSEVIERE LitteraireDocument101 pagesFICHES - VASSEVIERE LitteraireMichael AboucayaPas encore d'évaluation
- Dissertations Possibles Sur Bel-AmiDocument9 pagesDissertations Possibles Sur Bel-AmiAnton PautyPas encore d'évaluation
- Personnage Roman 18emeDocument4 pagesPersonnage Roman 18emeOblomov 2.0Pas encore d'évaluation
- Chardin Artículo 1996Document18 pagesChardin Artículo 1996Juli Videla MartínezPas encore d'évaluation
- Fictions en ProcèsDocument28 pagesFictions en Procèsمنه سالمPas encore d'évaluation
- Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos: Questionnaire de lectureD'EverandLes Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos: Questionnaire de lecturePas encore d'évaluation
- Le Theme de L'amour Dans Le Roman A La Recherche Du Temps PerduDocument21 pagesLe Theme de L'amour Dans Le Roman A La Recherche Du Temps PerduGriva75Pas encore d'évaluation
- Devoir de FrançaisDocument3 pagesDevoir de Françaismamadou baPas encore d'évaluation
- Cours Introductif RomanDocument3 pagesCours Introductif RomanjsfeirPas encore d'évaluation
- Lire Le Realisme Et Le NaturalismeDocument8 pagesLire Le Realisme Et Le NaturalismeBojana100% (2)
- Le Roman LibertinDocument6 pagesLe Roman LibertinSousou HibaPas encore d'évaluation
- Romantique Ou Realiste Le Rouge Et Le NoirDocument5 pagesRomantique Ou Realiste Le Rouge Et Le NoirNico OttPas encore d'évaluation
- Georg Lukacs. Franz Kafka Ou Thomas Mann 7 Pages ManquantesDocument16 pagesGeorg Lukacs. Franz Kafka Ou Thomas Mann 7 Pages ManquantesJean-Pierre MorboisPas encore d'évaluation
- La Présence Et Le Fonctionnement de L'absence Dans Le Nouveau RomanDocument14 pagesLa Présence Et Le Fonctionnement de L'absence Dans Le Nouveau Romanndiaye modouPas encore d'évaluation
- Pierre MICHEL, Octave Mirbeau Et Le "Roman Romanesque"Document5 pagesPierre MICHEL, Octave Mirbeau Et Le "Roman Romanesque"Anonymous 5r2Qv8aonfPas encore d'évaluation
- Fernando Cipriani, Cruauté, Monstruosité Et Folie Dans Les Contes de Mirbeau Et de VilliersDocument15 pagesFernando Cipriani, Cruauté, Monstruosité Et Folie Dans Les Contes de Mirbeau Et de VilliersAnonymous 5r2Qv8aonfPas encore d'évaluation
- Voyage Au Bout de La NuitDocument25 pagesVoyage Au Bout de La NuitNouali MedPas encore d'évaluation
- Robert Ziegler, Le Chien, Le Perroquet Et L'homme Dans "Le Journal D'une Femme de Chambre"Document12 pagesRobert Ziegler, Le Chien, Le Perroquet Et L'homme Dans "Le Journal D'une Femme de Chambre"Anonymous 5r2Qv8aonfPas encore d'évaluation
- Lisa SUAREZ, La Condition Des Femmes Et La Question Du Féminisme Dans L'œuvre Romanesque Et Théâtrale D'octave MirbeauDocument5 pagesLisa SUAREZ, La Condition Des Femmes Et La Question Du Féminisme Dans L'œuvre Romanesque Et Théâtrale D'octave MirbeauPierre MICHELPas encore d'évaluation
- Lisa Suarez, Éloge de La Sensibilité MirbellienneDocument3 pagesLisa Suarez, Éloge de La Sensibilité MirbellienneAnonymous 5r2Qv8aonfPas encore d'évaluation
- Pierre Michel, L'Autofiction Façon MirbeauDocument6 pagesPierre Michel, L'Autofiction Façon MirbeauAnonymous 5r2Qv8aonfPas encore d'évaluation
- L'Adversaire D'emmanuel Carrère:: Transgressions Des Limites, Limites de La TransgressionDocument15 pagesL'Adversaire D'emmanuel Carrère:: Transgressions Des Limites, Limites de La TransgressionKylian LPas encore d'évaluation
- Le Roman CatholiqueDocument3 pagesLe Roman CatholiqueKalou6100% (1)
- Dissertation Lisa Nikonoff L1Document2 pagesDissertation Lisa Nikonoff L1Lisa NikonoffPas encore d'évaluation
- Le DésirDocument40 pagesLe DésirBerthier LetourneauPas encore d'évaluation
- La Condition humaine d'André Malraux: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLa Condition humaine d'André Malraux: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- 2 Kundera Pouvoirs Du Roman, Par Guy Scarpetta (Le Monde Diplomatique, Avril 2005)Document10 pages2 Kundera Pouvoirs Du Roman, Par Guy Scarpetta (Le Monde Diplomatique, Avril 2005)Dionisos LudendiPas encore d'évaluation
- DRISS CHRAÏBI, UNE ÉCRITURE DE TRAVERSE Stéphanie DelayreDocument7 pagesDRISS CHRAÏBI, UNE ÉCRITURE DE TRAVERSE Stéphanie DelayreBra khalPas encore d'évaluation
- La Colère Chez Julien SorelDocument14 pagesLa Colère Chez Julien SorelayouzyouftnPas encore d'évaluation
- Anna Gural-Migdal, Entre Naturalisme Et Frénétisme: La Représentation Du Féminin Dans "Le Calvaire"Document9 pagesAnna Gural-Migdal, Entre Naturalisme Et Frénétisme: La Représentation Du Féminin Dans "Le Calvaire"Anonymous 5r2Qv8aonfPas encore d'évaluation
- Julien GracqDocument5 pagesJulien GracqsimonbouriatPas encore d'évaluation
- Grand Entretien (LITTERATURE)Document10 pagesGrand Entretien (LITTERATURE)Vernes WuteziPas encore d'évaluation
- Correction Etude de Texte No Et MoiDocument2 pagesCorrection Etude de Texte No Et MoiJulia RuizPas encore d'évaluation
- 007 PDFDocument72 pages007 PDFAdrian IancuPas encore d'évaluation
- FableDocument24 pagesFableNassima BoumenirPas encore d'évaluation
- ALADIN - Drum SetDocument2 pagesALADIN - Drum SetRodrigo AlquatiPas encore d'évaluation
- Tintin Et Le Secret de La Licorne - Bande-Annonce Fiche Élève A2Document3 pagesTintin Et Le Secret de La Licorne - Bande-Annonce Fiche Élève A2Linda DionPas encore d'évaluation
- Etude D'une Vie de MaupassantDocument10 pagesEtude D'une Vie de MaupassantPapa SarrPas encore d'évaluation
- BAC 2019 Français Techno PondicheryDocument6 pagesBAC 2019 Français Techno PondicheryLETUDIANTPas encore d'évaluation
- Maraudeur22 PDF FreeDocument104 pagesMaraudeur22 PDF FreeaddaPas encore d'évaluation
- LIRE Hors Sã© Rie N.14 - Septembre Novembre 2023Document100 pagesLIRE Hors Sã© Rie N.14 - Septembre Novembre 2023Martial GothierPas encore d'évaluation
- Le Nouveau RomanDocument3 pagesLe Nouveau Romanpapa yoroPas encore d'évaluation
- Janet Paterson - L'altéritéDocument7 pagesJanet Paterson - L'altéritébitev666Pas encore d'évaluation
- 456 Le Seigneur Des Anneaux ParkerDocument25 pages456 Le Seigneur Des Anneaux ParkerDujardinPas encore d'évaluation
- Culture Générale Littérature en 2250 LignesDocument3 pagesCulture Générale Littérature en 2250 LignesStanley PierrePas encore d'évaluation
- Is PDFDocument12 pagesIs PDFN'driPas encore d'évaluation
- IVe Colloque Du Centre D'études Canadiennes - Réjean DucharmeDocument3 pagesIVe Colloque Du Centre D'études Canadiennes - Réjean DucharmeLouise CostaPas encore d'évaluation
- Marcel AyméDocument3 pagesMarcel AyméLights'artsPas encore d'évaluation
- WerkwoordenbundelDocument12 pagesWerkwoordenbundeljenselmajjouti2006Pas encore d'évaluation
- LE MONDE DU SORCELEUR Tome 4: Résumé de Witcher 1Document4 pagesLE MONDE DU SORCELEUR Tome 4: Résumé de Witcher 1Théo BizouairdPas encore d'évaluation
- OJLF - Clasa A 10a Bilingv - BAREMDocument2 pagesOJLF - Clasa A 10a Bilingv - BAREMPrima Tv TrasnitiiPas encore d'évaluation
- Liste Livres Premiere 2Document2 pagesListe Livres Premiere 2Luis LopezPas encore d'évaluation
- EjerciciosDocument4 pagesEjerciciosnicolePas encore d'évaluation
- 13fr5e c1 CeDocument2 pages13fr5e c1 CebousbousPas encore d'évaluation
- Ben Onono - Tatouage Bleu LyricsDocument1 pageBen Onono - Tatouage Bleu Lyricsapi-26006503100% (1)
- Texte 5 - Hugo, Ruy Blas, III, 5 - Texte PDFDocument1 pageTexte 5 - Hugo, Ruy Blas, III, 5 - Texte PDFouatikPas encore d'évaluation
- Devoir 3college FR Session1 Serie2Document2 pagesDevoir 3college FR Session1 Serie2ElHila NaoualPas encore d'évaluation
- La Fête SurpriseDocument28 pagesLa Fête SurpriseCarte La RepPas encore d'évaluation