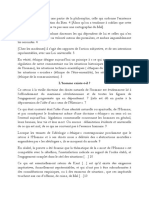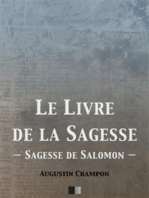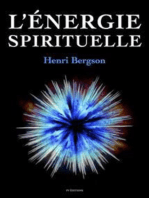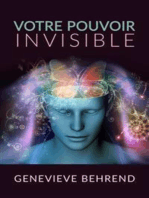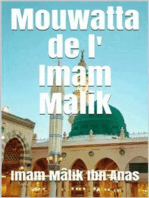Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Nietzsche Est Avant Tout Le Penseur de La Valeur
Transféré par
Celle97gmail.fr CelleTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Nietzsche Est Avant Tout Le Penseur de La Valeur
Transféré par
Celle97gmail.fr CelleDroits d'auteur :
Formats disponibles
Nietzsche est avant tout le penseur de la valeur.
On peut multiplier tant qu’on voudra les
angles d’attaque sur son œuvre comme le font les « nietzschéens » à la mode – la vérité,
l’illusion, l’interprétation, l’art –, c’est bien cette question qui l’emporte dans ses écrits et,
avec elle, la question connexe de la hiérarchie : l’homme est selon lui un « animal
valorisant », qui juge, et donc qui distingue et hiérarchise ce qui vaut plus ou moins.
C’est dans ce cadre que sa critique des valeurs morales, qui sont le principe dominant
de nos évaluations, prend place : en quel sens, pourquoi et peut-on le suivre jusqu’au
bout ?
Sa grande idée, formulée dès Humain, trop humain et qu’on peut considérer comme
étant d’inspiration matérialiste, est que toutes nos valeurs nous viennent de notre vie,
biologique d’abord, mais aussi historique (ce qu’on oublie souvent) et, bien entendu,
psychologique. Elles n’ont donc pas d’objectivité ou de transcendance par rapport à
celle-ci, même si nous le croyons spontanément, elles sont tout entières immanentes et
relatives à la vie qui les secrète (individuelle mais aussi collective) et qu’elles servent :
brièvement dit, nous valorisons ce qui nous est utile, ce qui avantage notre égoïsme,
notre intérêt vital, tel trait de notre idiosyncrasie, même si nous n’en avons pas
conscience. Appliquée à la morale, cette thèse essentielle, qu’on pourrait sans forcer le
trait rapprocher de la conception qu’avait Marx de l’idéologie, ruine évidemment l’idée
même de morale. Celle-ci prétend énoncer des valeurs universelles et désintéressées,
transcendant la vie et s’imposant à elle parce que provenant d’une instance pure, raison
pratique (Kant) ou conscience morale innée (le christianisme, Rousseau) qui n’existe pas
pour Nietzsche : comme tout autre phénomène psychique, la morale est prise
intégralement dans le flux de la vie empirique et déterminée par celui-ci, et la conception
inverse n’est qu’une illusion de la conscience qui s’automystifie. Ainsi appréhendée du
point de vue de la psychologie, qui est intronisée dans Par-delà le bien et le mal « reine
des sciences », capable de débusquer l’origine ultime des phénomènes humains, la
morale est réduite à n’être qu’une « sémiologie » des passions qui s’ignore (§ 187). Mais
son explication relève aussi d’une « histoire naturelle » qui indique les divers types
d’homme qui, historiquement situés, ont engendré les diverses morales que l’histoire a
connues. Dans tous les cas, l’idée kantienne de fonder la morale sur une prémisse
normative universelle n’a plus de signification : elle n’est qu’un phénomène de
conscience qui a une origine que la science peut exhiber sur le plan des faits, mais point
de fondement réflexif. Enfin, le caractère obligatoire des valeurs morales s’en trouve lui
aussi démythifié : l’omniprésence et l’omnipuissance du déterminisme de la vie font que
l’homme ne saurait être doté d’un libre arbitre auquel ladite obligation morale
s’adresserait et qui le constituerait en sujet capable d’échapper au poids de la vie et de
lui commander : ce n’est là qu’une « fable », dit-il, « nous sommes en prison » et, si nous
pouvons nous « rêver libres », nous ne le sommes pas (Humain, trop humain 2, § 33).
Cette analyse est extraordinairement décapante et on doit le reconnaître même si cela
ne nous fait pas plaisir : elle a « le cœur contre elle », avait-il prévenu ! Et son effet
démystifiant (ou démythifiant) est encore plus rude lorsque Nietzsche introduit, assez
tardivement, son concept de volonté de puissance. Étant admis, selon lui, qu’elle est à la
base de tous les comportements humains sous la forme d’une recherche irrépressible
d’une puissance vitale maximale, sa prise en compte permet à Nietzsche de différencier
deux types d’hommes – les forts et les faibles – et de distinguer alors deux types de
morale : celle des forts dans laquelle la vie, dans toutes ses composantes (agressivité,
cruauté, domination, etc.) et dans toute son intensité, s’assume et s’exprime sans
retenue, et celle des faibles – il a en vue au départ les chrétiens – qui, du fait de leur
faiblesse et par ressentiment à l’égard des forts, vont préconiser un système de valeurs
inverse – l’amour du prochain, la douceur, la pitié, etc. – dans lequel ils valoriseront leur
propre faiblesse. D’où ce diagnostic final : ce qu’on appelle « la » morale, à savoir celle
des faibles, est une instance anti-vie : elle dévalorise la vie, la nature, le sensible, au
nom d’un univers normatif illusoire qui, exprimant sans le savoir un déficit vital, le nourrit
en le justifiant ; elle n’est donc qu’une névrose (le terme est chez Nietzsche) qui se
reproduit d’elle-même, empêchant l’homme d’exister pleinement.
C’est en ce point précis, sur fond de référence à la volonté de puissance, que le discours
de Nietzsche change de nature et doit être discuté, voire partiellement mais
vigoureusement récusé. Il change de nature puisqu’il cesse d’être seulement explicatif
pour devenir appréciatif. Il l’a lui-même reconnu dans la Généalogie de la morale quand
il affirme que ce n’est pas seulement l’origine des valeurs qui l’intéresse, mais leur
valeur, la valeur des valeurs et, en l’occurrence, la valeur des valeurs morales qu’il juge
foncièrement négative. Or réfléchissons à cette dernière formule : une critique morale de
la morale n’aurait pas de sens, elle se contredirait en recourant à ce qu’elle va dénoncer.
La critique des valeurs morales ne peut donc se faire que d’un point de vue étranger à la
morale, celui de la vie (ou de la puissance) considérée non comme une valeur morale
mais comme une valeur éthique, la valeur éthique suprême pour lui. Nous touchons ici à
l’intérêt théorique considérable du travail nietzschéen, qui est de nous obliger à
distinguer l’éthique et la morale. Même si ce vocabulaire n’est pas vraiment présent chez
lui, le contenu que cette distinction recouvre est là et il a expressément indiqué que son
approche de la morale, si elle se situe bien « par-delà le bien et le mal », ne se situe pas
« par-delà le bon et le mauvais » : « bien et mal », c’est la morale, « bon et mauvais »,
c’est l’éthique. Et la sienne, qui fait résider le « bon » dans l’épanouissement vital associé
à la puissance et le « mauvais » dans ce qui leur nuit, est au principe de sa critique, qui
en devient parfaitement cohérente, sans contradiction interne : liée à une vie faible, la
morale est une éthique inconsciente d’elle-même et on doit la dénoncer au nom d’une
autre éthique, érigeant la puissance vitale en norme première. L’impuissance n’est-elle
pas, typiquement, une anti-valeur (éthique) ?
Pourtant, si cette critique est cohérente, on ne saurait entièrement la suivre dans le
contenu de valeur qu’elle s’est donné et dont peu de commentateurs de son œuvre ont
su ou voulu apercevoir les dangers qu’elle recèle. Certes, on ne peut qu’approuver son
option en faveur de la vie considérée in abstracto et sa dénonciation de ce qui la mutile :
la morale a bien été, historiquement et pour une part, une antinature qui, si l’on veut,
« castrait » l’homme, et il faut dénoncer cet aspect de son fonctionnement passé. Et qui
ne voit, pour prendre un exemple partisan, que le communisme entend bien promouvoir
la vie considérée ainsi dans sa généralité et qu’en un sens, quoi qu’il en dise, il converge
avec cet aspect-là de l’éthique nietzschéenne, permettant ainsi une appropriation « de
gauche » de son message ? Mais le problème se complique quand Nietzsche définit
concrètement cette vie par la volonté de puissance considérée comme son essence :
celle-ci comporte une dimension inéliminable de discrimination, d’agressivité et de
domination qu’on ne saurait accepter sans cynisme, alors que lui, non seulement
l’estime indépassable, mais la valorise. C’est ainsi que, dans un passage de Par-delà le
bien et le mal, la plupart du temps occulté par ses thuriféraires, il affirme que « vivre,
c’est essentiellement dépouiller, blesser, violenter le faible et l’étranger, l’opprimer »
(§ 259), qu’il refuse de donner à ces termes un sens négatif et qu’il considère comme
des rêveurs ceux qui voudraient éliminer les réalités qu’ils désignent. Cela l’entraîne
alors à prendre des positions politiques qu’on ne saurait non plus admettre : apologie de
l’ordre esclavagiste de la Grèce antique et de la hiérarchie aristocratique, critique
virulente de la Révolution française et de l’égalité des droits, hostilité radicale à la
démocratie considérée comme le triomphe des médiocres et au christianisme qui l’aurait
inspirée, antiféministe, etc.
Or sur quoi repose notre refus, sinon sur des valeurs à caractère moral et liées
incontestablement au critère kantien de l’universel ? La mode a été un temps (trop long
selon moi), à la suite de Nietzsche précisément et à travers un Foucault qui s’en
réclamait, voire un Deleuze, de nier la validité du concept de morale, d’en dénoncer la
dimension répressive, dont on prétendait qu’elle lui était consubstantielle, et de lui
préférer alors le concept plus modeste d’éthique, censé être « libertaire ». Or c’est là une
erreur, dont le philosophe allemand a été l’initiateur. Car s’il a raison de distinguer les
valeurs éthiques et les valeurs morales, de porter un éclairage extraordinairement
intelligent sur l’origine vitale des premières et donc d’insister sur leur relativité et sur leur
arbitraire, et s’il a aussi raison de valoriser la vie en général, il faut admettre que sa
critique de la morale est biaisée. Ce qu’elle vise est en réalité le moralisme, cet
envahissement absurde de la vie individuelle par des normes oppressives et arbitraires,
présentées frauduleusement comme des normes morales – ce fut le cas de la vision
chrétienne de la sexualité, refusant le plaisir comme fin de celle-ci et condamnant
l’homosexualité. La morale authentique, restituée à sa vérité universelle réclamant de
respecter l’humanité et l’autonomie de tout homme, échappe à sa critique et nous
emporte loin de ses positions politiques réactionnaires, nourries de son éthique de la
volonté de puissance qui mérite, elle, une critique morale.
Yvon Quiniou
Vous aimerez peut-être aussi
- Yvon Quiniou - L'émergence de La MoraleDocument6 pagesYvon Quiniou - L'émergence de La Moralelepton50Pas encore d'évaluation
- Philosophie de la Liberté (Tome I) Cours de philosophie moraleD'EverandPhilosophie de la Liberté (Tome I) Cours de philosophie moralePas encore d'évaluation
- Nietzsche La Volonté de Puissance Ou L'exaltation de La VieDocument1 pageNietzsche La Volonté de Puissance Ou L'exaltation de La VieecobaptistePas encore d'évaluation
- Études médico-légales - Psychopathia Sexualis: Deuxième partieD'EverandÉtudes médico-légales - Psychopathia Sexualis: Deuxième partiePas encore d'évaluation
- Deleuze-Nietzsche Et La Philosophie (PUF 1962)Document118 pagesDeleuze-Nietzsche Et La Philosophie (PUF 1962)corcuspin100% (3)
- Généalogie de la morale de Friedrich Nietzsche: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandGénéalogie de la morale de Friedrich Nietzsche: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Bensussan, G. - Éthique Et Expérience. Levinas PolitiqueDocument105 pagesBensussan, G. - Éthique Et Expérience. Levinas Politiquedipoc33Pas encore d'évaluation
- Gilles Deleuze Nietzsche Et La Philosophie PDFDocument118 pagesGilles Deleuze Nietzsche Et La Philosophie PDFunmec1283% (6)
- 1962 Nietzsche Et La PhilosophieDocument118 pages1962 Nietzsche Et La PhilosophieGeo BertazzoPas encore d'évaluation
- Gilles Deleuze Nietzsche Et La Philosophie PDFDocument118 pagesGilles Deleuze Nietzsche Et La Philosophie PDFPaula Srecko Jurisic100% (1)
- Tran Duc Thao - Existentialisme Et Matéralisme DialectiqueDocument10 pagesTran Duc Thao - Existentialisme Et Matéralisme DialectiquemcshaoPas encore d'évaluation
- Classer Dominer Qui Sont Les Autres - Christine DelphyDocument177 pagesClasser Dominer Qui Sont Les Autres - Christine DelphyASMAE BRITELPas encore d'évaluation
- Wotling - La Réalité Comme Jeu de CommandementDocument16 pagesWotling - La Réalité Comme Jeu de CommandementSherlock DestinyPas encore d'évaluation
- Fait Et Droit, Les Valeurs À L'époque ModerneDocument6 pagesFait Et Droit, Les Valeurs À L'époque ModerneGKF1789Pas encore d'évaluation
- La Philosophie TragiqueDocument85 pagesLa Philosophie TragiqueAlessandra Francesca100% (1)
- Notes MarxDocument12 pagesNotes MarxYasser Zguiri (YAZ?)Pas encore d'évaluation
- L Ethique D Alain BadiouDocument7 pagesL Ethique D Alain BadiouGabriela JaquetPas encore d'évaluation
- Le Dénouement de La PenséeDocument9 pagesLe Dénouement de La PenséebernardcretinPas encore d'évaluation
- La Notion de Dette Dans Genealogie de La MoraleDocument20 pagesLa Notion de Dette Dans Genealogie de La MoraleSylvain ArseneaultPas encore d'évaluation
- Variations Sur L'éthique - La Crise de L'humanité Européenne Et L'avènement Des Idéologies Totalitaires - Presses de L'université Saint-LouisDocument39 pagesVariations Sur L'éthique - La Crise de L'humanité Européenne Et L'avènement Des Idéologies Totalitaires - Presses de L'université Saint-Louisbbioman242Pas encore d'évaluation
- Naturalité BienDocument32 pagesNaturalité BienLe Comte de BronzePas encore d'évaluation
- Une PsychanaqueerDocument6 pagesUne PsychanaqueerKrine NARPas encore d'évaluation
- R Bastide Anthropologie Religieuse PDFDocument10 pagesR Bastide Anthropologie Religieuse PDFFernando Silveira RosaPas encore d'évaluation
- Cours AxiologieDocument4 pagesCours AxiologieMamadou Moustapha Sarr67% (3)
- Gille Deleuze-Nietzsche Et La PhilosophieDocument231 pagesGille Deleuze-Nietzsche Et La PhilosophieAla Eddine Benderradji100% (2)
- Le RelativismeDocument3 pagesLe Relativismed.iosifclaudiu3230100% (1)
- Badiou WittgensteinDocument10 pagesBadiou WittgensteinB RhiePas encore d'évaluation
- Alain Badiou - L'éthique Et La Conscience Du MalDocument5 pagesAlain Badiou - L'éthique Et La Conscience Du MalMohamedDjihadPas encore d'évaluation
- Un Traité de Lexistence MoraleDocument10 pagesUn Traité de Lexistence MoraleSaid BegrichePas encore d'évaluation
- Michel Clouscard - Lëtre Et Le Code - Le Procès de Production D'un Ensemble Précapitaliste. (1972, La Haye, Mouton) PDFDocument629 pagesMichel Clouscard - Lëtre Et Le Code - Le Procès de Production D'un Ensemble Précapitaliste. (1972, La Haye, Mouton) PDFyohanes100% (2)
- Contre Nous de La TyrannieDocument380 pagesContre Nous de La TyrannieAlvaro Bosch100% (1)
- Wotling - Les Paradoxes de La GNDocument18 pagesWotling - Les Paradoxes de La GNSherlock DestinyPas encore d'évaluation
- (Lacan Jacques) L'Agressivité en Psychanalyse (CoDocument18 pages(Lacan Jacques) L'Agressivité en Psychanalyse (CoaliodormanoleaPas encore d'évaluation
- Luc Vincenti - Philosophie - Conscience de Soi, Rapport À Soi, Dépassement de SoiDocument14 pagesLuc Vincenti - Philosophie - Conscience de Soi, Rapport À Soi, Dépassement de SoiHoupa HoupaPas encore d'évaluation
- A La Sexualite Et Sa Repression Dans Les Societes Primitives SkiDocument182 pagesA La Sexualite Et Sa Repression Dans Les Societes Primitives SkiAna Maria Paun100% (1)
- La Notion de VictimisationDocument2 pagesLa Notion de VictimisationMohamed Ben MustaphaPas encore d'évaluation
- Narcissisme Et Fétichisme de La MarchandiseDocument4 pagesNarcissisme Et Fétichisme de La MarchandisebordigaPas encore d'évaluation
- La Crise HusserlDocument7 pagesLa Crise HusserlDavid DupontPas encore d'évaluation
- Gilles Deleuze Nietzsche Et La Philosophie PDFDocument236 pagesGilles Deleuze Nietzsche Et La Philosophie PDFDavid HernándezPas encore d'évaluation
- Compte-Rendu de L Esprit de L Athéisme - Par André Comte-SponvilleDocument13 pagesCompte-Rendu de L Esprit de L Athéisme - Par André Comte-SponvillesakhoibPas encore d'évaluation
- Pierre Hassner. La Philosophie Politique de M. Éric Weil (1958)Document10 pagesPierre Hassner. La Philosophie Politique de M. Éric Weil (1958)Umaitan JuniorPas encore d'évaluation
- Métaphysique Des Choses Entre EllesDocument45 pagesMétaphysique Des Choses Entre Ellesjonathan GPas encore d'évaluation
- Topologie de Violence Dissertation. RIOS StephaniDocument17 pagesTopologie de Violence Dissertation. RIOS StephaniStephani Hernandez RíosPas encore d'évaluation
- Théorie de La Connaissance de Nietzsche Critique de La PhilosophieDocument2 pagesThéorie de La Connaissance de Nietzsche Critique de La Philosophiejuliaserranocano07Pas encore d'évaluation
- René BarbierDocument9 pagesRené BarbierjrivierePas encore d'évaluation
- Fondement de La Morale (Schopenhauer) - WikipédiaDocument38 pagesFondement de La Morale (Schopenhauer) - Wikipédiafulbertlamas9Pas encore d'évaluation
- Les 3 Vagues de La Modernite-Leo StraussDocument14 pagesLes 3 Vagues de La Modernite-Leo StraussmalsainePas encore d'évaluation
- Lyotard, Jean François - La Logique Qu'il Nous FautDocument57 pagesLyotard, Jean François - La Logique Qu'il Nous FautWalterBenjamin100% (1)
- Phlou 0035-3841 1951 Num 49 21 4328Document31 pagesPhlou 0035-3841 1951 Num 49 21 4328Thiago Bloss de AraújoPas encore d'évaluation
- Nietzsche Et La PhilosophieDocument117 pagesNietzsche Et La PhilosophieunlecteurPas encore d'évaluation
- Difficultés Du Moi Et Approche Processuelle Des PersonnesDocument18 pagesDifficultés Du Moi Et Approche Processuelle Des Personnespablo aravenaPas encore d'évaluation
- L'éthique BadiouDocument13 pagesL'éthique Badiounicodem2Pas encore d'évaluation
- Christine Delphy - EP 1 - 10 Pour Un Féminisme MatérialisteDocument13 pagesChristine Delphy - EP 1 - 10 Pour Un Féminisme MatérialisteBailleulPas encore d'évaluation
- Article Phlou 0035-3841 1956 Num 54 43 4883Document23 pagesArticle Phlou 0035-3841 1956 Num 54 43 4883storontoPas encore d'évaluation
- José Ferrater Mora, El Sentido de La MuerteDocument6 pagesJosé Ferrater Mora, El Sentido de La Muerteestudosdoleandro sobretomismoPas encore d'évaluation
- Michel. Sur L' Anthropologie Du Nom de SLazarusDocument12 pagesMichel. Sur L' Anthropologie Du Nom de SLazarusGRPas encore d'évaluation
- De L'utilité Du Genre (W. Scott, JoanDocument211 pagesDe L'utilité Du Genre (W. Scott, JoanCílio LindembergPas encore d'évaluation
- Le Coran Corrige La BibleDocument4 pagesLe Coran Corrige La BibleArounan DembelePas encore d'évaluation
- Traité Des 2 Natures JBWDocument22 pagesTraité Des 2 Natures JBWVayracPas encore d'évaluation
- Rapport Sénatorial Sur L'organisation, La Place Et Le Financement de L'islam en France Et de Ses Lieux de CulteDocument578 pagesRapport Sénatorial Sur L'organisation, La Place Et Le Financement de L'islam en France Et de Ses Lieux de CulteFrance Culture100% (1)
- Jacques Mouriquand, Ancien Testament Quelles Vérités Historiques Les Bouleversements Dans La Recherche ActuelleDocument3 pagesJacques Mouriquand, Ancien Testament Quelles Vérités Historiques Les Bouleversements Dans La Recherche ActuelleXencePas encore d'évaluation
- Enfant Dese To I LesDocument60 pagesEnfant Dese To I LesOmkara BannerPas encore d'évaluation
- Oraison Funèbre D'henriette D'angleterreDocument12 pagesOraison Funèbre D'henriette D'angleterreahikar1Pas encore d'évaluation
- BAROKA Mémoire Tourisme 2016Document127 pagesBAROKA Mémoire Tourisme 2016Josué BAROKA100% (1)
- Programme Des Obsèque Madame OBAMA Rosette FinalDocument4 pagesProgramme Des Obsèque Madame OBAMA Rosette FinalTara AthanasePas encore d'évaluation
- HG FaitDocument12 pagesHG FaitAbdoul Aziz Thiombiano100% (4)
- Cours Complet de Fiqh 1 À 25Document87 pagesCours Complet de Fiqh 1 À 25MOULIOM100% (7)
- Fiche Bible 132 Jésus Le Charpentier PDFDocument2 pagesFiche Bible 132 Jésus Le Charpentier PDFCocoPas encore d'évaluation
- Chronique Des Annees EgareesDocument504 pagesChronique Des Annees EgareesAlainzhu100% (1)
- Aventure Mystérieuse Simone Waisbard Tiahuanaco 10000 Ans D'égnimes IncasDocument286 pagesAventure Mystérieuse Simone Waisbard Tiahuanaco 10000 Ans D'égnimes Incasanneavrillaut100% (3)
- Le Moal Claude - La Véritable Histoire D'adam & Ève Enfin DévoiléeDocument670 pagesLe Moal Claude - La Véritable Histoire D'adam & Ève Enfin DévoiléeStarla ShermanPas encore d'évaluation
- L'Éveil Du Corps Sacré - Yoga Tibétain de La Respiration Et Du MouvementDocument115 pagesL'Éveil Du Corps Sacré - Yoga Tibétain de La Respiration Et Du Mouvementboulina25100% (3)
- Concours D'accès Au MASTER: Comptabilité, Contrôle Et Audit Année Universitaire: 2021-2022Document29 pagesConcours D'accès Au MASTER: Comptabilité, Contrôle Et Audit Année Universitaire: 2021-2022imadcasa750Pas encore d'évaluation
- Science Devenir RicheDocument85 pagesScience Devenir RicheWilfriedPas encore d'évaluation
- La Toison D'orDocument1 pageLa Toison D'orMalak JnainyPas encore d'évaluation
- Acclamez Dieu Toute La Terre PDFDocument2 pagesAcclamez Dieu Toute La Terre PDFBonouman ElyséePas encore d'évaluation
- Accomplissez La Vision de Dieu Un Pas À La Foi EbookDocument40 pagesAccomplissez La Vision de Dieu Un Pas À La Foi EbookÉric Laurent AHANNOUGBEPas encore d'évaluation
- En Tant Que: Jésus MaîtreDocument17 pagesEn Tant Que: Jésus MaîtreCharles TossaPas encore d'évaluation
- Le Moine Qui Vendit Sa FerrariDocument244 pagesLe Moine Qui Vendit Sa FerrariHerinanja Nary100% (5)
- Fictions de L'origine, XVIII SiècleDocument23 pagesFictions de L'origine, XVIII SiècleElena SorokinaPas encore d'évaluation
- L'Affaire GaliléeDocument24 pagesL'Affaire GaliléeDomuni UniversityPas encore d'évaluation
- 13 Le Sacrement de PenitenceDocument4 pages13 Le Sacrement de PenitencesedenoPas encore d'évaluation
- Bbeevrecettes Mystique 2015 - Géomancie AfricaineDocument112 pagesBbeevrecettes Mystique 2015 - Géomancie AfricaineBinafou Traore100% (1)
- Alfred Kuen - Le Chant Dans La Vie de L'église - CH 4Document13 pagesAlfred Kuen - Le Chant Dans La Vie de L'église - CH 4Willy V LafleurPas encore d'évaluation
- Adorer en VéritéDocument2 pagesAdorer en VéritéChivain ManfoumbiPas encore d'évaluation
- L'introduction D'alDocument43 pagesL'introduction D'alChristine AnslotPas encore d'évaluation
- Prière Dans La DétresseDocument5 pagesPrière Dans La DétresseAlisonPas encore d'évaluation
- L’Art d’avoir toujours raison: Premium EbookD'EverandL’Art d’avoir toujours raison: Premium EbookÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (2)
- Essai sur le libre arbitre: Premium EbookD'EverandEssai sur le libre arbitre: Premium EbookÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (1)
- Les enseignements secrets de la Gnose: Guide pratique d'initiation gnostiqueD'EverandLes enseignements secrets de la Gnose: Guide pratique d'initiation gnostiqueÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- La Révélation: Le Secret De L'Esprit Est RévéléD'EverandLa Révélation: Le Secret De L'Esprit Est RévéléÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (6)
- Paroles De Mon Âme: Un Dialogue Avec L'Âme Pour Mieux Vivre Sa VieD'EverandParoles De Mon Âme: Un Dialogue Avec L'Âme Pour Mieux Vivre Sa VieÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (3)
- Eckhart Tolle et l'idiocratie : doctrine et effets d'un "grand maître spirituel"D'EverandEckhart Tolle et l'idiocratie : doctrine et effets d'un "grand maître spirituel"Pas encore d'évaluation
- L'Art d'avoir toujours raison (L'édition intégrale): La dialectique éristique - L'art de la controverse qui repose sur la distinction entre la vérité objective d'une proposition et l'apparence de véritéD'EverandL'Art d'avoir toujours raison (L'édition intégrale): La dialectique éristique - L'art de la controverse qui repose sur la distinction entre la vérité objective d'une proposition et l'apparence de véritéÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (177)
- Le Mystère Chrétien et les Mystères AntiquesD'EverandLe Mystère Chrétien et les Mystères AntiquesÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (2)
- Cesser de souffrir à cause de quelque chose qui n’existe pas !: De l'illusion de l'Ego à la Paix dans le monde : la Révolution commence à l'intérieur de nous-mêmeD'EverandCesser de souffrir à cause de quelque chose qui n’existe pas !: De l'illusion de l'Ego à la Paix dans le monde : la Révolution commence à l'intérieur de nous-mêmeÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2)
- Bioénergie et Sciences Occultes: Pour un corps sain et un esprit sain dans un lieu sainD'EverandBioénergie et Sciences Occultes: Pour un corps sain et un esprit sain dans un lieu sainÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2)
- Les Arts Divinatoires: Graphologie - Chiromancie - Physiognomonie - Influences astralesD'EverandLes Arts Divinatoires: Graphologie - Chiromancie - Physiognomonie - Influences astralesPas encore d'évaluation
- Le Langage Métaphysique Des Hiéroglyphes ÉgyptiensD'EverandLe Langage Métaphysique Des Hiéroglyphes ÉgyptiensÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- L'univers est intelligent. L'âme existe. Mystères quantiques, multivers, intrication, synchronicité. Au-delà de la matérialité, pour une vision spirituelle du cosmos.D'EverandL'univers est intelligent. L'âme existe. Mystères quantiques, multivers, intrication, synchronicité. Au-delà de la matérialité, pour une vision spirituelle du cosmos.Pas encore d'évaluation
- Le fa, entre croyances et science: Pour une epistemologie des savoirs africainsD'EverandLe fa, entre croyances et science: Pour une epistemologie des savoirs africainsÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (6)
- KANT: Oeuvres Majeures: Critique de la raison pratique + Doctrine de la vertu + Doctrine du droit + La Métaphysique des mœurs + Qu'est-ce que les Lumières ? + Les Derniers Jours d'Emmanuel Kant + Analyse de sa philosophie…D'EverandKANT: Oeuvres Majeures: Critique de la raison pratique + Doctrine de la vertu + Doctrine du droit + La Métaphysique des mœurs + Qu'est-ce que les Lumières ? + Les Derniers Jours d'Emmanuel Kant + Analyse de sa philosophie…Pas encore d'évaluation