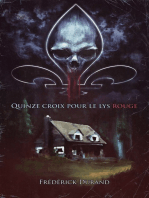Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Carnet de Lecture
Carnet de Lecture
Transféré par
Ali Emre BugayCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Carnet de Lecture
Carnet de Lecture
Transféré par
Ali Emre BugayDroits d'auteur :
Formats disponibles
The Big Lebowski
Joel et Ethan Coen, 1998
Ce que j’ai aimé : J’ai trouvé l’absurdité du film très amusant. Les rêves, les
personnages et l’intrigue étaient tous étranges et ceux-ci ont rendu le film encore plus
intéressant. Le personnage principale, the Dude m’a beaucoup plu car je connaissais d’autres
œuvres de l’acteur, Jeff Bridges et le revoir dans un rôle si éloigné de ce qu’il faisait
d’habitude était fascinant.
Ce que je n’ai pas aimé : J’ai eu l’impression que la fin était un peu rapide, sans vrai
dénouement. Je trouve qu’il manquait une sorte d’épilogue qui aurait du ramener tout
l’histoire ensemble. Je n’ai aussi pas beaucoup aimé le fait qu’on a pas eu d’explication sur le
« narrateur mystérieux » à la fin. Était-il Dieu ? Était-il la voix des créateurs ?
Ce qui m’a touché : La mort du troisième ami à la fin m’a fait du mal car c’était
étrangement le personnage à qui j’étais le plus accroché. Le fait de le voir mourir pour un
simple cause m’a troublé.
Citation préférée : « That rug really tied the room together »
Œuvre à comparer: «Toc Toc », Vicente Villanueva, 2017
Le film « Toc Toc » de Villanueva raconte l’histoire de six personnes qui viennent des
milieux très différentes mais qui ont un point commun : des troubles obsessionnels
compulsifs (TOC). Le film se déroule dans une pièce, dans laquelle les six personnages
attendent leur médecin traitant, et ils commencent à se parler. LE point commun entre ce film
et The Big Lebowski et l’absurdité et l’étrangeté des deux films. En effet, les longues
moment de silences et des personnages excentriques sont le centre du film dans les deux cas.
En revanche, les deux films se différencient entièrement en fonction de leur scénario car les
intrigues ne sont pas du tout similaires. Les deux films se rapprochent donc grâce à leur
exécutions.
Une Chambre à soi
Virginia Woolf
Ce que j’ai aimé : L’utilisation parfaite de l’ironie et de la logique pour
dénoncer une société patriarcale m’a beaucoup plu. J’aime beaucoup le
format de l’essai. Le fait que Virginia Woolf s’adresse à ses lecteurs et
notamment aux femmes directement est très captivant et donne l’envie de
lire la suite. Le sujet de l’essai est bien évidemment très intéressent mais
ce qui m’a vraiment beaucoup attiré dans ce livre c’est le façon de traiter un
sujet si important avec une démarche prenant et intriguant.
Ce que je n’ai pas aimé : Même si la démarche est très intéressante, je trouve
que lire l’œuvre de Virginia Woolf demande beaucoup de concentration. En
effet, il faut suivre toutes les phrases pour ne pas se perdre dans la logique,
ce qui rend la lecture assez difficile. De plus, j’ai lu ce livre en anglais
avant de le relire en français et j’ai remarqué pendant ma deuxième lecture
qu’il y avait beaucoup de fautes ou d’impertinences de traduction. Il y a des
bouts de phrases, ou parfois même des arguments entiers qui manquent, ce
qui devient très perturbant au cours du temps.
Chapitre 3 – Analyses : Dans le chapitre trois, l’autrice cherche à identifier
les raisons pour lesquelles l’ère élisabéthaine n’a donné lieu à aucune
femme écrivaine. Enfin d’une longue démarche, elle reconnait deux raisons
principales : les conditions de vie des femmes qui leur empêche d’écrire, et
le manque des droits des femmes qui leur empêche d’être publiées ou
connues. Pour expliquer ses propos, elle utilise plusieurs exemples comme
la sœur imaginaire du Shakespeare. Elle emploi aussi de nombreux figures de
style comme l’énumération ou l’anaphore qui amplifient l’importance de ses
explication ou la gravité de ses exemples. Elle donne comme argument les
mariages forcés, le manque d’espace privé des femmes ou encore la vision de
la société. Ainsi, Virginia Woolf dénonce les injustices dans la littérature
en fonction du sexe.
Œuvre à comparer : Manifeste des 313, 1971
L’œuvre de Virginia Woolf peut être comparé au Manifeste des 313, une
longue déclaration qui lutte pour le droit à l’abortion des femmes, signée
pas 313 femmes célèbres qui avouent avoir déjà eu une abortion. En effet, les
deux œuvres défendent les droits des femmes qui leur sont privées par la
société. Dans les deux cas, le lecteur peut observer une démarche logique
avec plusieurs exemples et arguments logiques ainsi que des cas personnels.
Même si ces deux œuvres dénoncent des droits entièrement différent et sont
séparés d’une cinquantaine d’années, ils ont tous les deux le même objectif :
donner aux femmes les droits qu’elles méritent.
Vous aimerez peut-être aussi
- Exemple Dissertation Juste La Fin Du MondeDocument3 pagesExemple Dissertation Juste La Fin Du MondeNesarioPas encore d'évaluation
- Six Contes Moraux, D'eric RohmerDocument13 pagesSix Contes Moraux, D'eric RohmerHerne EditionsPas encore d'évaluation
- Critiques de Livres ClasseDocument17 pagesCritiques de Livres ClasseLahcen OtPas encore d'évaluation
- Emily Brontë - Wuthering HeightsDocument6 pagesEmily Brontë - Wuthering HeightsExumerPas encore d'évaluation
- Présentation Bac FRDocument2 pagesPrésentation Bac FRGaget AlexisPas encore d'évaluation
- J L LagarceDocument3 pagesJ L LagarceBernadettePas encore d'évaluation
- Analyse D'oeuvre Intégrale Madame Bovary DP120Document15 pagesAnalyse D'oeuvre Intégrale Madame Bovary DP120General Game15Pas encore d'évaluation
- Oral FrancaisDocument3 pagesOral FrancaisLuck StainPas encore d'évaluation
- DissertationDocument4 pagesDissertationfarahPas encore d'évaluation
- Commentaire Sur Moderato Cantabile:: Romy Berthou Comte 1°esDocument4 pagesCommentaire Sur Moderato Cantabile:: Romy Berthou Comte 1°esOsama MohamedPas encore d'évaluation
- Roman Et Autobiographie Chez StendhalDocument15 pagesRoman Et Autobiographie Chez Stendhalmeia_13Pas encore d'évaluation
- CorrectiiionDocument5 pagesCorrectiiionsalmaahrdPas encore d'évaluation
- Juste La Fin Du Monde Lagarce Fiche de LectureDocument6 pagesJuste La Fin Du Monde Lagarce Fiche de LectureMohamed AlhegagiPas encore d'évaluation
- Dissert Lagarce - France Juin2021Document7 pagesDissert Lagarce - France Juin2021MOHAMED-TAHAR CHATTIPas encore d'évaluation
- Lisa Suarez, Éloge de La Sensibilité MirbellienneDocument3 pagesLisa Suarez, Éloge de La Sensibilité MirbellienneAnonymous 5r2Qv8aonfPas encore d'évaluation
- CitationsDocument5 pagesCitationstiktokthomasthiPas encore d'évaluation
- Corrigé Dissertation - Un Drame IntimeDocument7 pagesCorrigé Dissertation - Un Drame Intimeghalia.mesfiouiPas encore d'évaluation
- Le Voyageur Sans Bagages - Nathan Molho 1.3Document2 pagesLe Voyageur Sans Bagages - Nathan Molho 1.3nathan.molho.lfphPas encore d'évaluation
- Simone de Beauvoir, Une PhénoménologieDocument12 pagesSimone de Beauvoir, Une Phénoménologie42005544Pas encore d'évaluation
- DIDIER, B. Je Et Subversion Du TexteDocument15 pagesDIDIER, B. Je Et Subversion Du Texteluca almeidaPas encore d'évaluation
- Bodily NormsDocument13 pagesBodily NormsealainflPas encore d'évaluation
- Les Valeurs Littéraires Dans Le Roman Les Belles Images de Simone de BeauvoirDocument9 pagesLes Valeurs Littéraires Dans Le Roman Les Belles Images de Simone de BeauvoirAnitaBoerPas encore d'évaluation
- Examen BAC PDFDocument9 pagesExamen BAC PDFJoaquina RomãoPas encore d'évaluation
- Juste La Fin Du Monde - Fiche de LectureDocument3 pagesJuste La Fin Du Monde - Fiche de Lecturevpq5phjh6nPas encore d'évaluation
- L'art de La Fugue PressbookDocument11 pagesL'art de La Fugue PressbookjaouiBacriCentralPas encore d'évaluation
- Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvreD'EverandLe dernier jour d'un condamné de Victor Hugo (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Scénarios Du Vécu Cinéma Histoire Et Récit de Vie - Marie-Claude TarangerDocument23 pagesScénarios Du Vécu Cinéma Histoire Et Récit de Vie - Marie-Claude TarangerFet BacPas encore d'évaluation
- Madame BovaryDocument5 pagesMadame BovaryIrinel BuchilaPas encore d'évaluation
- Documentaire Et FictionDocument132 pagesDocumentaire Et FictionCyrine BousselmiPas encore d'évaluation
- Hiroshima Mon Amour: Aimer en Toute InfidélitéDocument12 pagesHiroshima Mon Amour: Aimer en Toute InfidélitéAnonymous saZrl4OBl4Pas encore d'évaluation
- Jonathan Artaux, "L'Abbé Jules" Et "Les Démons", de Dostoïevski - Quelques Remarques Sur La Dramaturgie Des Deux RomansDocument6 pagesJonathan Artaux, "L'Abbé Jules" Et "Les Démons", de Dostoïevski - Quelques Remarques Sur La Dramaturgie Des Deux RomansAnonymous 5r2Qv8aonf100% (1)
- Questions JFMDocument8 pagesQuestions JFMDamla AktaşPas encore d'évaluation
- DST Confession D'un Gang de FillesDocument4 pagesDST Confession D'un Gang de Fillesshandra.tamilPas encore d'évaluation
- Je Veux Le BacDocument30 pagesJe Veux Le BacSarah BendahmanePas encore d'évaluation
- Ob 85db24 Corrige Tres Important A Lire AbsolDocument11 pagesOb 85db24 Corrige Tres Important A Lire AbsolgeoffroyleleuPas encore d'évaluation
- Exemples Intro Dissert - ComDocument2 pagesExemples Intro Dissert - Comamir.beaunePas encore d'évaluation
- Cours CinémaDocument26 pagesCours CinémaMaryani Fuzetti LoureiroPas encore d'évaluation
- Para Ir Del Problema A La Solución, El Camino Más Directo Es Divagar (Moshe Bar)Document7 pagesPara Ir Del Problema A La Solución, El Camino Más Directo Es Divagar (Moshe Bar)Manuel Millán TortosaPas encore d'évaluation
- Exam c1 FrançaisDocument20 pagesExam c1 FrançaisDaniel González SevillanoPas encore d'évaluation
- Fiche de LectureDocument5 pagesFiche de LectureDiego VianaPas encore d'évaluation
- Analyse CourteDocument2 pagesAnalyse CourtePerrin DianePas encore d'évaluation
- Les Trois Essais Sur La Théorie de La SexualitéDocument24 pagesLes Trois Essais Sur La Théorie de La SexualitéOrlik Ferraud MAISSA MBERAPas encore d'évaluation
- Informações BásicasDocument3 pagesInformações BásicaswhesleycastroPas encore d'évaluation
- 23 Les Mains Sales PDFDocument2 pages23 Les Mains Sales PDFFrédéric SingnibePas encore d'évaluation
- Lejeune - Fessée Aveu Rousseau PDFDocument27 pagesLejeune - Fessée Aveu Rousseau PDFMathieu TrachmanPas encore d'évaluation
- Sándor Kálai, "Le Journal D'une Femme de Chambre" Et Le Roman PolicierDocument11 pagesSándor Kálai, "Le Journal D'une Femme de Chambre" Et Le Roman PolicierAnonymous 5r2Qv8aonfPas encore d'évaluation
- Intertexte, Adaptation Filmiques Des Ouevres LittérairesDocument5 pagesIntertexte, Adaptation Filmiques Des Ouevres LittérairesGood DoctoresPas encore d'évaluation
- Bibliographie Littérature ContemporaineDocument5 pagesBibliographie Littérature Contemporaineqmvk6bhp28Pas encore d'évaluation
- Juste La Fin Du Monde Lagarce Fiche de LectureDocument6 pagesJuste La Fin Du Monde Lagarce Fiche de Lecturebensaidyassine94Pas encore d'évaluation
- Lepopee Vernon SubutexDocument14 pagesLepopee Vernon SubutexKok KokPas encore d'évaluation
- Avis Argumenté Sur Manon LescautDocument2 pagesAvis Argumenté Sur Manon LescautvoilaPas encore d'évaluation
- Le Romancier Et Son Personnage - DossierDocument10 pagesLe Romancier Et Son Personnage - DossierpattybellaPas encore d'évaluation
- 3er ParcialDocument8 pages3er ParcialAnahí FerreyraPas encore d'évaluation
- Pierre Michel, L'Autofiction Façon MirbeauDocument6 pagesPierre Michel, L'Autofiction Façon MirbeauAnonymous 5r2Qv8aonfPas encore d'évaluation
- Francais 2nde Bac Pro Parcours Perso Aissaoui Furcy o Vincent R MarchandDocument42 pagesFrancais 2nde Bac Pro Parcours Perso Aissaoui Furcy o Vincent R MarchandRiyan OujjitPas encore d'évaluation
- Arthur RimbaudDocument3 pagesArthur RimbaudshouaipsPas encore d'évaluation
- COMMENTAIREDocument3 pagesCOMMENTAIREMiguel AttiehPas encore d'évaluation
- 2.exprimer Sentiments Et EmotionsDocument19 pages2.exprimer Sentiments Et EmotionsPaula Andrea Roncancio Marín100% (2)
- Travaux Encadrés DJCDocument3 pagesTravaux Encadrés DJCNadia GuendoulPas encore d'évaluation
- Nouvelles Histoires Extraordinaires by Poe, Edgar Allan, 1809-1849Document135 pagesNouvelles Histoires Extraordinaires by Poe, Edgar Allan, 1809-1849Gutenberg.org100% (3)
- I. Question de Corpus: Bac Blanc 2017 - CorrigéDocument8 pagesI. Question de Corpus: Bac Blanc 2017 - CorrigéKhalil ChhataPas encore d'évaluation
- Le Romantisme Dans SouffleDocument6 pagesLe Romantisme Dans Souffleeliedahou2020Pas encore d'évaluation
- Camille Sourget Rare BooksDocument148 pagesCamille Sourget Rare Booksherve76100% (2)
- Liste Des Textes À Réviser Pour Oraux Blancs de Février 2023Document12 pagesListe Des Textes À Réviser Pour Oraux Blancs de Février 2023TawaPas encore d'évaluation
- FENELON - Le Télémaque, Ou La NostalgieDocument28 pagesFENELON - Le Télémaque, Ou La NostalgielestylobatePas encore d'évaluation
- Lecons de Langue Francaise (Cours Moyen) 000000925Document358 pagesLecons de Langue Francaise (Cours Moyen) 000000925christmas111100% (8)
- Lesson 23 - Directions and Locations in FrenchDocument3 pagesLesson 23 - Directions and Locations in FrenchVincent DurrenbergerPas encore d'évaluation
- CV HananeDocument2 pagesCV HananeallalPas encore d'évaluation
- Analyse linéaire RIMBAUD, Cahiers de Douai, “Ma bohème” 1895Document5 pagesAnalyse linéaire RIMBAUD, Cahiers de Douai, “Ma bohème” 1895Arthus RousselPas encore d'évaluation
- Francais Anticipee Bac GeneralDocument23 pagesFrancais Anticipee Bac GeneralL'Indépendant100% (1)
- Écrits Dhaïti Perspectives Sur La Littérature Haïtienne Contemporaine (1986-2006) (Nadève Ménard)Document472 pagesÉcrits Dhaïti Perspectives Sur La Littérature Haïtienne Contemporaine (1986-2006) (Nadève Ménard)Paula RostanPas encore d'évaluation
- Cahier Reussite Ce1 Ceintures FrancaisDocument2 pagesCahier Reussite Ce1 Ceintures FrancaisSerigne Modou NDIAYEPas encore d'évaluation
- ZariniDocument19 pagesZariniLuca Claudiu-CostelPas encore d'évaluation
- BFDocument6 pagesBFRédasports EchoPas encore d'évaluation
- 12 L2 GrammaireDocument4 pages12 L2 GrammaireChrysolyte GloryPas encore d'évaluation
- My Foolish HeartDocument1 pageMy Foolish HeartLucaAntoniniPas encore d'évaluation
- BLED 1 Cours Superieur D Ortographe OfficielDocument310 pagesBLED 1 Cours Superieur D Ortographe OfficielAnonymous WUuhfvOCOc100% (2)
- 301 - L2 Exercices Et Textes de Dialogues - Aout2020Document3 pages301 - L2 Exercices Et Textes de Dialogues - Aout2020Thomas LE CLOIRECPas encore d'évaluation
- Voici VoilàDocument2 pagesVoici VoilànuiliPas encore d'évaluation
- Bourdeau - Les Maîtres de La Pensée Contemporaine Stendhal Taine RenanDocument195 pagesBourdeau - Les Maîtres de La Pensée Contemporaine Stendhal Taine RenanAndré DeFranciaPas encore d'évaluation
- Le Pont MirabeauDocument2 pagesLe Pont MirabeaulPas encore d'évaluation
- La Poesie Lyrique Des TroubadoursDocument19 pagesLa Poesie Lyrique Des TroubadoursraimonbalaguePas encore d'évaluation
- Fichier Fa51267ba309 Sequence Didactique Autour Des Fables de La Fontaine 1Document54 pagesFichier Fa51267ba309 Sequence Didactique Autour Des Fables de La Fontaine 1Mouhamad Ibn Amine SegnanePas encore d'évaluation
- Se Quence He Le Ne DORIONDocument4 pagesSe Quence He Le Ne DORIONbotangproPas encore d'évaluation
- 3è SAD2 Chant Dream A Little Dream (Paroles+trad Et Partition) PDFDocument2 pages3è SAD2 Chant Dream A Little Dream (Paroles+trad Et Partition) PDFMyriam RanaivosonPas encore d'évaluation