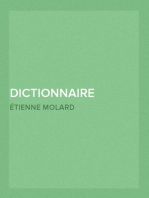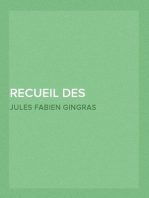Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Correction Le Livre de L'hospitalité
Correction Le Livre de L'hospitalité
Transféré par
friophotography0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
20 vues2 pagesTitre original
Correction Le livre de l’Hospitalité
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
20 vues2 pagesCorrection Le Livre de L'hospitalité
Correction Le Livre de L'hospitalité
Transféré par
friophotographyDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 2
CORRECTION
(en groupe)
"Le livre de l’Hospitalité"
1. Lisez l’exergue : commenter le parallélisme entre mots/bouche et le double emploi du verbe
« changer ».
Les termes « mot », « bouche/langue » sont respectivement en début et à la fin de phrases/texte –
idées de communication et de PAROLE.
Le verbe « changer » est en rapport avec l’acceptation ou non de l’Autre, du problème de
communication qui existe entre les deux et du besoin d’altérité.
2. Quel est donc le(s) thème(s) de ce texte ?
L’hospitalité, la communication, la langue, l’altérité, l’étranger, le livre – symbole de la parole écrite.
3. Soulignez les trois mots les plus répétés. Quel lien faites-vous entre ces mots ?
Langue ; pays et terre.
Langue – le moyen de communication, l’instrument, c’est ce qui rapproche A et B.
Pays – nation, espace géographiquement défini, existence de frontières.
Terre – espace physique, sans frontières, la culture/la langue, le lien affectif qui unit les hommes qui
ont été construits avec elles.
4. Relisez les 5 premières répliques. Que demande A à B et que répond B ?
A demande à B ce qu’il vient faire chez-lui, « dans mon pays ». B lui répond qu’il est dans ce pays
car celui-ci est « le plus cher » : il y a un lien affectif. Il a élu ce pays par amour.
5. La réponse de B satisfait-elle A ?
Non, il lui reproche d’être un étranger et il souligne qu’il le sera TOUJOURS !!!
6. Comment A considère-t-il l’Autre (B) ?
C’est un intrus.
7. Comment jugez-vous l’attitude de A ?
A est xénophobe. Il lui ferme sa porte et il n’y a pas d’hospitalité possible, contrairement au titre.
8. Relire les répliques 6 à 11. Quels liens établissent A et B entre « pays », « langue » et « terre » ?
Pour A, qu’est-ce qui n’appartient pas à B ?
Pour A, pays-langue-terre sont indissociables ; les trois sont refusées à l’étranger.
Pour B, langue et terre sont indissociables. Pour lui, le pays est son pays adoptif. Pour lui, il n’y a pas
de frontières réelles.
9. Que représente le « livre » pour l’étranger (réplique 12) ?
L’étranger admet qu’il n’y a pas de terre, pas de pays, pas de langue où il se sent reconnu, protégé.
Il y a une deuxième manière de comprendre l’existence / ce mot « livre », qui a été utilisé pour exprimer sa
révolte, par les mots qu’il a écrit dans ce « livre ».
10. Répliques 13 à 15.
Que revendique A ? Que refuse-t-il à l’étranger ? Comment comprenez-vous son attitude ?
A revendique l’héritage de la langue (« je suis né avec ») et se présente comme le possesseur exclusif
de cette langue, refusant à B le fait de l’avoir apprise et adoptée.
Pour A, il n’y a pas de partage possible, c’est sa langue – maternelle, sa terre, son pays. Il n’y a donc
pas, une nouvelle fois, d’hospitalité possible.
11. L’écrivain franco-roumain Cioran écrit : « On n’habite pas un pays, on habite une langue. » Que vous
inspire cette parole ?
Pour nous (Larissa et José), cette parole peut signifier que la langue rapproche les gens et quelque
fois elle est la seule chose que deux personnes ont en commun.
12. Réplique 23 : « Moi, j’ai hérité d’elle. » Qu’est-ce qui oppose A et B par rapport à la langue ?
Pour A, la langue naît avec nous, c’est un héritage, et la langue nous donnent le droit d’aimer et de
nous connaître, de mieux nous comprendre. Pour B, l’exercice et la pratique d’une langue ne nous
donnent pas le droit sur elle, mais nous pouvons utiliser la langue parce qu’elle est libre d’attaches,
parce qu’on peut se l’approprier bien plus que la terre.
13. Soulignez le groupe « Doux leurre ». Prononcez-le à voix haute. Que constatez-vous ? Par le jeu
phonie/graphie, qu’est-ce que B rappelle à A ?
L’expression « Doux leurre » ressemble à « douleur ». Par le jeu phonie/graphie B rappelle à A que
la langue est parfois une tromperie, une illusion et que le fait de la dominer est parfois aussi une
douleur, en plus des affiliations affectives.
14. Répliques 17-18. Quel droit sur la langue défend l’étranger ? De nouveau, quelle est la position de
A?
A affirme qu´aucun étranger ne peut s´approprier d´ une langue ou d´une culture qui n´est pas sa
langue maternelle. Une langue peut être apprise mais un étranger ne peut jamais la dominer comme
un natif à cause de sa norme linguistique.
B soutient qu’il est possible d´y avoir des liens entre un étranger et le pays dans lequel il se trouve,
voire d´éprouver une affection particulière pour celui- ci, comme un natif.
15. Réplique 24. Que revendique ici l’étranger ? Commentez les mots « reconnaissance » et « fidélité » ?
- L’étranger explique que la langue lui a été montrée/inculquée par ses parents, qui sont également
étrangers. L’utilisation du mot « révélée » est un mot fort car il peut renvoyer à la révélation divine
et il s’inscrit dans une histoire de générations ;
- Les mots « reconnaissance » et « fidélité » renforcent l’idée que parfois l’étranger défend et
apprécie plus le pays, la langue et la culture d’adoption que le natif. Il y a un sentiment de
gratitude.
16. Réplique 25. À quel « jeu » joue A ? À quelle conclusion veut-elle amener B ? La maison et la
langue sont-elles sur le même plan ?
On ne peut pas mettre, évidemment la maison et la langue sur le même plan, à moins que, comme
A, il se considère le possesseur de la langue, avec un titre de propriété, garantissant que ce bien
est inaliénable pour celui qui l’a acquis et que personne ne peut se l’approprier.
A veut amener B à partager son opinion et son jeu est à la fois subtil et cynique.
17. Réplique 26. Partagez-vous cette opinion ? Justifiez.
Nous pensons qu´avec la réplique 26, le sujet B demande à A de réfléchir à ses actions. Si le sujet
A continue à traiter les étrangers de manière irrespectueuse et à les isoler, il finira aussi par être
isolé, se sentir esseulé. Pour lui la langue est hospitalière donc accueillante.
18. En offrant son livre, de quoi l’étranger fait-il prendre conscience à A, le natif ? Qui a le dernier mot
et quel message est transmis ?
En offrant son livre, l’étranger donne le seul bien qu’il possède. A possède tout et ne donne rien. Il
ferme sa porte et exclut l’étranger, tandis que B répond, à cette inhospitalité (celle de A), par ce don,
celui du partage. Il y a donc un inversement de situation. Et c’est lui qui a le dernier mot : la langue
appartient à ceux qui l’aiment, l’écrivent, la parlent, interrogent et chantent le monde à travers
elle.
Vous aimerez peut-être aussi
- T. 2 Théories Gnrales Sur Apprent. ResumidoDocument7 pagesT. 2 Théories Gnrales Sur Apprent. ResumidoHécuba A SecasPas encore d'évaluation
- Declic2 Livre de L ÉleveDocument130 pagesDeclic2 Livre de L ÉleveJoscivaldo AraujoPas encore d'évaluation
- Foucault - Sept Propos Sur Le Septième AngeDocument57 pagesFoucault - Sept Propos Sur Le Septième Angekairotic100% (1)
- Releve Des Conclusions Forum ZLECAF 2Document13 pagesReleve Des Conclusions Forum ZLECAF 2Odjolo MoutouPas encore d'évaluation
- Ifa Sait, La Parole, L'histoire, Les ProverbesDocument14 pagesIfa Sait, La Parole, L'histoire, Les Proverbesaganju999Pas encore d'évaluation
- Compte RenduDocument4 pagesCompte Rendu• sofyeax •Pas encore d'évaluation
- CastellaniDocument8 pagesCastellaniJuan Carlos AlonsoPas encore d'évaluation
- L'Etranger de Baudelaire CoursDocument6 pagesL'Etranger de Baudelaire CoursIvoPas encore d'évaluation
- Les InterférencesDocument6 pagesLes InterférencesSherine BensPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 Le Signe Linguistique Selon SaussureDocument7 pagesChapitre 3 Le Signe Linguistique Selon SaussureTABETPas encore d'évaluation
- L'Imparfait IIDocument1 pageL'Imparfait IIcarlota.miranda.gPas encore d'évaluation
- La Traduction Littéraire Source D'enrichissement de La Langue D'accueil (Wuilmart FR.)Document10 pagesLa Traduction Littéraire Source D'enrichissement de La Langue D'accueil (Wuilmart FR.)flormanacasPas encore d'évaluation
- Retranscription s2 3 PossessifsDocument2 pagesRetranscription s2 3 PossessifsBrigitte LaveauxPas encore d'évaluation
- Écrire À Un Courrier Des LecteursDocument3 pagesÉcrire À Un Courrier Des LecteursCsákány OlivérPas encore d'évaluation
- Exos Sur Le LangageDocument7 pagesExos Sur Le LangagemaudereichschmidtPas encore d'évaluation
- Cours Langage TEDocument3 pagesCours Langage TELamloumi IbtihelPas encore d'évaluation
- La Philosophie Du Langage L1Document24 pagesLa Philosophie Du Langage L1Djounoumbi Kamdeo100% (1)
- Francais Des Jeunes Des CitesDocument3 pagesFrancais Des Jeunes Des CitesCrina AlexandraPas encore d'évaluation
- Resume de Sciences Du LangageDocument4 pagesResume de Sciences Du LangageClaude PatrickPas encore d'évaluation
- Languematernellejulia Sivis-CeranicDocument4 pagesLanguematernellejulia Sivis-CeranicHafid Tlemcen Rossignol Poète0% (1)
- Des Paronymes À Ne Pas ConfondreDocument8 pagesDes Paronymes À Ne Pas ConfondreMohammed LamhamdiPas encore d'évaluation
- Méthodes 1 Pratiques TCS Français Correction Chapitre 12Document4 pagesMéthodes 1 Pratiques TCS Français Correction Chapitre 12sarah nabilPas encore d'évaluation
- La LiasionDocument6 pagesLa LiasionTam Minh Pham NguyenPas encore d'évaluation
- Article PartitifDocument6 pagesArticle Partitifresa permatasariPas encore d'évaluation
- Epreuve de Littérature Au Probatoire ADocument4 pagesEpreuve de Littérature Au Probatoire ANdjidama youssoufa100% (1)
- Linguistique ExamsDocument6 pagesLinguistique ExamsazertyPas encore d'évaluation
- DICTIONNAIRE DES RACINES BERBERES COMMUNES Suivi D'un Index Français-Berbère Des Termes Relevés - Mohand Akli HaddadouDocument475 pagesDICTIONNAIRE DES RACINES BERBERES COMMUNES Suivi D'un Index Français-Berbère Des Termes Relevés - Mohand Akli Haddadouidlisen75% (4)
- Cours Techniques de Communication Orale Et Ecrite en Francais CorrigerDocument28 pagesCours Techniques de Communication Orale Et Ecrite en Francais Corrigerjospinkahudi94Pas encore d'évaluation
- La Langue Des Oiseaux À La Recherche Du Sens Perdu Des Mots (French Edition)Document279 pagesLa Langue Des Oiseaux À La Recherche Du Sens Perdu Des Mots (French Edition)natacha deer100% (1)
- 1.1 s1 Le DVP LangagierDocument4 pages1.1 s1 Le DVP LangagierHélène MathieuPas encore d'évaluation
- Corrigé Français S ES LDocument5 pagesCorrigé Français S ES LStéphane Moret100% (1)
- Interface Phonologie Et ÉcritureDocument10 pagesInterface Phonologie Et ÉcritureJuarez2009Pas encore d'évaluation
- CE-TEF Les 17 Textes À Trous Avec Correction DétailléeDocument34 pagesCE-TEF Les 17 Textes À Trous Avec Correction DétailléeSukhdeepSinghVirkPas encore d'évaluation
- Ouvrir Langue Du MondeDocument20 pagesOuvrir Langue Du MondeevearjPas encore d'évaluation
- La Parole PerdueDocument4 pagesLa Parole PerdueIvan RazafintsalamaPas encore d'évaluation
- Dictionnaire grammatical du mauvais langage ou, Recueil des expressions et des phrases vicieuses usitées en France, et notamment à LyonD'EverandDictionnaire grammatical du mauvais langage ou, Recueil des expressions et des phrases vicieuses usitées en France, et notamment à LyonÉvaluation : 2.5 sur 5 étoiles2.5/5 (3)
- FrancaisDocument3 pagesFrancais• sofyeax •Pas encore d'évaluation
- Sience Du LanguageDocument12 pagesSience Du LanguageAntoine RodriguezPas encore d'évaluation
- Tableau Sémiologie - Chapitre 1Document15 pagesTableau Sémiologie - Chapitre 1Ben Mehdi NadaPas encore d'évaluation
- Dictionnaire Grammatical Du Mauvais Langagerecueil Des Expressions Et Des Phrases Vicieuses Usitéesen France, Et Notamment À Lyon by Molard, ÉtienneDocument71 pagesDictionnaire Grammatical Du Mauvais Langagerecueil Des Expressions Et Des Phrases Vicieuses Usitéesen France, Et Notamment À Lyon by Molard, ÉtienneGutenberg.org100% (1)
- La Definition de TraductionDocument4 pagesLa Definition de TraductiondinarwinaPas encore d'évaluation
- Langue Parlee Et Langue EcriteDocument8 pagesLangue Parlee Et Langue EcriteHassan ElhassanPas encore d'évaluation
- Une Langue-Une Vision Du MondeDocument2 pagesUne Langue-Une Vision Du Mondejordy espilcoPas encore d'évaluation
- Séance Les InterférencesDocument5 pagesSéance Les InterférencesAli Boutamina100% (1)
- Langues Et IdentitésDocument3 pagesLangues Et IdentitésjihoonexolPas encore d'évaluation
- Politiques Linguistiques en Contexte de MinorisationDocument5 pagesPolitiques Linguistiques en Contexte de MinorisationJessicaPas encore d'évaluation
- Fiches LudiquesDocument18 pagesFiches LudiquesoutaharPas encore d'évaluation
- 6Document218 pages6Achraf RbPas encore d'évaluation
- Test B1.1 - Natalia HillesheimDocument7 pagesTest B1.1 - Natalia HillesheimNatalia HillesheimPas encore d'évaluation
- E3c Langues Vivantes Allemand Premiere t3 02135 Sujet OfficielDocument4 pagesE3c Langues Vivantes Allemand Premiere t3 02135 Sujet OfficielHello HelloPas encore d'évaluation
- DS15 5139 FrenchDocument3 pagesDS15 5139 Frenchwalidbouguenna10Pas encore d'évaluation
- Ens FR Linguistique ContrastiveDocument24 pagesEns FR Linguistique ContrastiveMDPas encore d'évaluation
- GrammaireDocument20 pagesGrammaireMarija ErorPas encore d'évaluation
- Evals LDocument4 pagesEvals Ljdj7dvy4vbPas encore d'évaluation
- 6525bce5a68df8776ae32275 4751055992Document2 pages6525bce5a68df8776ae32275 4751055992pascalbadettePas encore d'évaluation
- Corrigé 1 Français 6eDocument2 pagesCorrigé 1 Français 6eavirapaypalPas encore d'évaluation
- Leçon 4Document7 pagesLeçon 4Sarah LeblancPas encore d'évaluation
- Ling Comp Semaine 3Document15 pagesLing Comp Semaine 3Julia PoPas encore d'évaluation
- Recueil des expressions vicieuses et des anglicismes les plus fréquentsD'EverandRecueil des expressions vicieuses et des anglicismes les plus fréquentsÉvaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (2)
- Dictionnaire grammatical du mauvais langage: Recueil des expressions et des phrases vicieuses usitées en France, et notamment à LyonD'EverandDictionnaire grammatical du mauvais langage: Recueil des expressions et des phrases vicieuses usitées en France, et notamment à LyonPas encore d'évaluation
- Rodolphe: French Reader on the Cumulative Method: The story of Rodolphe and Coco the ChimpanzeeD'EverandRodolphe: French Reader on the Cumulative Method: The story of Rodolphe and Coco the ChimpanzeePas encore d'évaluation
- Technologie CmsDocument126 pagesTechnologie CmssabinebachPas encore d'évaluation
- Am 081523Document35 pagesAm 081523hktfsdrdwnPas encore d'évaluation
- Din 6885 Ab 3Document1 pageDin 6885 Ab 3panalcaPas encore d'évaluation
- Atlas Des SIH 2014-2 PDFDocument116 pagesAtlas Des SIH 2014-2 PDFjolinette pierrePas encore d'évaluation
- Quelques Corriges Feuilles 5 6 2Document6 pagesQuelques Corriges Feuilles 5 6 2Roosevelito MaitrePas encore d'évaluation
- Chapitre 4 Microéconomie CDocument47 pagesChapitre 4 Microéconomie CalaPas encore d'évaluation
- Pfe Memoire - Sur - La - Demande - en - Tourisme - DurableDocument87 pagesPfe Memoire - Sur - La - Demande - en - Tourisme - DurableritabengproPas encore d'évaluation
- Préparation 2024 Série 2Document4 pagesPréparation 2024 Série 2mouadmorchidytbPas encore d'évaluation
- Probabilite 1Document1 pageProbabilite 1MedAmine FilaliPas encore d'évaluation
- Bac Blanc TLDocument2 pagesBac Blanc TLAro GzysPas encore d'évaluation
- Controle Et Corrgie Type TP Chimie 1 SM ZENDAOUI PDFDocument4 pagesControle Et Corrgie Type TP Chimie 1 SM ZENDAOUI PDFMalik Meddah100% (1)
- Couleurs Et Facades 2018Document8 pagesCouleurs Et Facades 2018Hőüđå BĕņPas encore d'évaluation
- Chapitre 6 Etude Des FondationDocument27 pagesChapitre 6 Etude Des FondationSI DouPas encore d'évaluation
- Papesse Jeanne - WikipédiaDocument6 pagesPapesse Jeanne - WikipédiaberhousaPas encore d'évaluation
- 2 Salage PoissonDocument17 pages2 Salage PoissonVincent GouessePas encore d'évaluation
- Chap.2 - Series Entieres Resume19 20Document7 pagesChap.2 - Series Entieres Resume19 20Alaimi SeifPas encore d'évaluation
- Pour 2 À 10 Joueurs À Partir de 10 Ans Durée D'une Partie: Environ 45 MNDocument10 pagesPour 2 À 10 Joueurs À Partir de 10 Ans Durée D'une Partie: Environ 45 MNBABATHEONPas encore d'évaluation
- Excel Et VBADocument568 pagesExcel Et VBAdouyoumerlin7Pas encore d'évaluation
- Protection 2011 PDFDocument34 pagesProtection 2011 PDFImmorthalPas encore d'évaluation
- FPGADocument7 pagesFPGAHazem HaPas encore d'évaluation
- TPs PDFDocument27 pagesTPs PDFZied Ben HamedPas encore d'évaluation
- Fiche Choix de Projet Soutenance Oral DNB 2023Document1 pageFiche Choix de Projet Soutenance Oral DNB 2023Kim RANAIVOSONPas encore d'évaluation
- Les Nouvelles Littéraires讲Toussaint是骗子的一期Document10 pagesLes Nouvelles Littéraires讲Toussaint是骗子的一期Yingna LiiPas encore d'évaluation
- Introduction Aux AlgorithmesDocument60 pagesIntroduction Aux AlgorithmesOuattara BourahimaPas encore d'évaluation
- Bro Fra Fr19Document20 pagesBro Fra Fr19Jon Be GoodPas encore d'évaluation
- "Entreprise Libérée, La Cage de Verre" - Camille Boulate - Courrier Cadres - 1 Avril 2018Document8 pages"Entreprise Libérée, La Cage de Verre" - Camille Boulate - Courrier Cadres - 1 Avril 2018Zacchary DUCPas encore d'évaluation
- Référentiel SSIAP 3Document15 pagesRéférentiel SSIAP 3ayoubPas encore d'évaluation
- Cours Electromecanique Planification Du ProjetDocument64 pagesCours Electromecanique Planification Du ProjetAbderrahmane El HeroPas encore d'évaluation
- Colle S25 PCSI Sujet Thermo E CDocument2 pagesColle S25 PCSI Sujet Thermo E ChadilPas encore d'évaluation