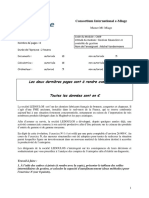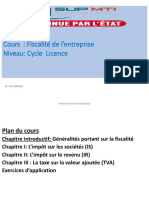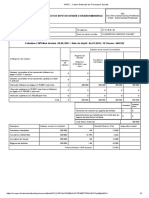Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
IAS 0 - Cadre Conceptuel 2018
IAS 0 - Cadre Conceptuel 2018
Transféré par
Naoufel FroujaTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
IAS 0 - Cadre Conceptuel 2018
IAS 0 - Cadre Conceptuel 2018
Transféré par
Naoufel FroujaDroits d'auteur :
Formats disponibles
Le cadre conceptuel
des normes IFRS
Révision 2018
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
Objectif et contenu du cadre conceptuel
◼ Objectif : fournir une base commune aux normalisateurs
permettant l’élaboration de normes cohérentes
◼ Il traite de :
1. l’objectif de l’information financière ;
2. des caractéristiques qualitatives d’une information
financière utile ;
3. des états financiers ;
4. des éléments à partir desquels les états financiers sont
construits ;
5. de la comptabilisation de ces éléments ;
6. de l’évaluation de ces éléments ;
◼ En cas de conflit entre le cadre conceptuel et une norme,
les dispositions de la norme prévalent sur celles du
cadre.
2 2 décembre 2003
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
1. Objectif de l’information financière
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
L’objectif de l’information financière (1/2)
◼ L'objectif de l'information financière est de fournir des
informations utile pour les investisseurs actuels et potentiels,
les prêteurs et les autres créanciers afin de permettre à ces
derniers de prendre des décisions portant sur :
➢ l'achat, la détention ou la vente d'instruments financiers de
l'entité ;
➢ la fourniture ou le règlement de prêts ou autres formes de
crédits;
➢ l’exercice des droits de vote ou autre mode d'influence sur
les actions des dirigeants.
◼ Si l’information est donc prioritairement adressée à ces
utilisateurs, les autres parties prenantes de l’entreprise
(salariés, clients, fournisseurs, Etat et autres organismes
publics…) peuvent également trouver une utilité dans les états
financiers, même s’ils ne leurs sont pas principalement
destinés.
4 2 décembre 2003
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
L’objectif de l’information financière (2/2)
◼ Si les états financiers ne sont pas conçus pour donner la
valeur de l’entreprise, ceux-ci doivent néanmoins offrir aux
destinataires les informations leur permettant d’estimer cette
valeur.
◼ Dans une large mesure, les états financiers sont fondés sur
des estimations, des jugements et des modèles plutôt que sur
des représentations exactes, le cadre conceptuel ayant
vocation à établir les concepts qui sous-tendent ces
estimations, jugements et modèles.
◼ Les apporteurs de capitaux ont besoin de deux types
d’informations :
- des informations sur les ressources économiques et leurs
contreparties ;
- des informations sur l’efficacité avec laquelle la direction ont
géré les ressources économiques et leur contreparties
5 2 décembre 2003
(« stewardship » ).
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
Comptabilité d’engagement
◼ Les effets financiers des transactions et autres événements
doivent être enregistrés au moment où ils se produisent,
même si les entrées et les sorties de trésorerie
correspondantes ont lieu dans une période différente.
◼ Ce qui signifie en clair que la comptabilité IFRS est une
comptabilité d’engagement (accruals accounting) et non de
trésorerie (cash accounting).
6 2 décembre 2003
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
2. Les caractéristiques qualitatives
d’une information financière utile
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
Caractéristiques de l’information financière
2 qualités
Pertinence Fidélité
fondamentales
Valeur Valeur Importance
Exhaustivité Neutralité Fiabilité
prédictive confirmative relative
4 qualités
de soutien Comparabilité Vérifiabilité Rapidité Compréhensiblité
1 contrainte Avantage > Coût
8 2 décembre 2003
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
Caractéristiques qualitative essentielles
2 caractéristiques qualitatives essentielles
(2 fundamental qualitative characteristics)
Pertinence Fidélité
Relevance Faithful representation
9 2 décembre 2003
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
Pertinence
◼ L’information comptable est pertinente lorsqu’elle est
susceptible d’influencer les décisions économiques des
utilisateurs en les aidant à évaluer les événements
présents ou à venir, ou à corriger les évaluations
passées.
◼ L’information est pertinente lorsqu’elle :
- permet d’effectuer des prévisions et a une valeur
prédictive (predictive value) ;
- permet de confirmer une prévision antérieure et a une
valeur confirmative (feedback value).
◼ La pertinence est fortement lié à l’importance relative
(materiality), selon laquelle une information est
significative lorsque son omission ou son inexactitude est
susceptible d’influencer les décisions que les utilisateurs
prennent sur la base de cette information.
10 2 décembre 2003
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
Fidélité
◼ La fidélité de l’information suppose que les transactions
soient comptabilisés et présentés conformément à leur
réalité économique.
◼ Une image fidèle suppose trois caractéristiques.
◆ Une description complète : les états financiers comprennent
toutes les informations, descriptions et explications nécessaires
à un utilisateur pour qu’il comprenne les phénomènes décrits.
◆ Une description neutre : les états financiers soient présentés
sans biais, parti pris ou manipulations, dans la sélection ou la
présentation de l’information financière. La prudence, qui est
comprise dans la neutralité, signifie qu’en situation d’incertitude,
les actifs et les produits ne sont pas surévalués et les passifs et
les charges ne sont pas sous-estimés.
◆ Une description exempte d’erreurs : ni erreurs, ni omission
dans la traduction comptable des phénomènes économiques.
11 2 décembre 2003
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
Caractéristiques qualitative auxiliaires
4 caractéristiques qualitatives auxiliaires
(4 enhancing qualitative characteristics)
Comparabilité Vérifiabilité Rapidité Compréhensibilité
Comparability Verifiability Timeliness Understandability
12 2 décembre 2003
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
Comparabilité
◼ Une information est plus utile lorsqu’elle peut être comparée à
une information similaire, produite par d’autres entités, ou
produite par la même entité sur une autre période. La
comparabilité est la caractéristique qualitative qui permet aux
utilisateurs de relever les similitudes et les différences entre
des éléments.
◼ La cohérence et la permanence des méthodes (consistency)
permettent d’atteindre l’objectif de comparabilité. Elles
consistent à utiliser les mêmes méthodes et procédés
comptables :
◼ - dans le temps : c’est-à-dire d’une date à une autre (au
cours d’un même exercice comptable) ou d’un exercice à un
autre, de façon similaire au principe de permanence des
méthodes du PCG français ;
◼ - dans l’espace : c’est-à-dire d’une entreprise à un autre.
13 2 décembre 2003
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
Vérifiabilité
◼ La vérifiabilité suppose que différents observateurs bien
informés et indépendants parviennent à un consensus sur le
fait qu’une description donnée est fidèle.
◼ Pour être vérifiable, l’information quantitative n’a pas à être
nécessairement exprimée par un montant unique. Un éventail
de montants possibles assortis de probabilités peut aussi être
vérifié.
◼ La vérification peut être :
◆ directe : en comptant une somme d’argent, en vérifiant le
montant d’une facture ou en consultant un solde bancaire ;
◆ indirecte : en contrôlant la méthodologie de calcul d’une
estimation : actif, provision, dépréciation…
14 2 décembre 2003
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
Rapidité
◼ La rapidité répond à un besoin légitime d’informer les
utilisateurs avant que les états financiers ne perdent leur
capacité à agir sur les décisions.
◼ Plus une information tarde à être fournie, plus elle perd de
sa pertinence.
◼ Pour fournir une information à bonne date, il peut être
nécessaire de la présenter avant que ne soient connus tous
les aspects d’une transaction, ce qui peut nuire à sa fidélité.
◼ Inversement, si l’on retarde la publication d’une information
jusqu’à ce que tous les aspects soient connus, l’information
sera fidèle, mais peu pertinente pour les utilisateurs qui
doivent prendre des décisions rapidement.
◼ Il convient par conséquent de trouver un juste équilibre
entre la pertinence et la fidélité.
15 2 décembre 2003
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
Compréhensibilité
◼ L’information est compréhensible lorsqu’elle est classée,
définie et présentée de façon claire et concise.
◼ La compréhensibilité repose sur l’idée que les états
financiers doivent pouvoir être analysés par le plus grand
nombre d’utilisateurs, sans que ces derniers ne soient
nécessairement des spécialistes.
◼ Les utilisateurs sont néanmoins censés avoir une
connaissance raisonnable des affaires et des activités
économiques et doivent avoir la volonté d’examiner et
d’analyser les informations avec diligence.
◼ Au besoin, ils auront recours à une aide extérieure pour
comprendre certains phénomènes complexes car la
compréhensibilité ne signifie pas qu’il faut exclure des états
financiers les sujets complexes, au motif qu’ils seraient sont
trop difficiles à comprendre par les utilisateurs.
16 2 décembre 2003
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
Contrainte du cadre conceptuel
1 contrainte
Avantages > Coût
Le respect de cette contrainte conduit le préparateur des états
financiers à évaluer s’il est probable ou non que les avantages
procurés par l’information financière justifient les coûts engagés
pour sa production.
Il en résulte la nécessité dans certains cas de sacrifier une ou
plusieurs caractéristiques qualitatives pour ajuster les coûts aux
avantages.
17 2 décembre 2003
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
3. Les états financiers
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
Éntité déclarante
◼ Une entité déclarante peut être une entité unique, une
partie d'une entité ou peut comprendre plusieurs entités, et
n’est pas nécessairement une personne morale.
◼ Parfois, une entité (mère) exerce un contrôle sur une autre
entité (filiale).
◼ Si l’entité déclarante comprend à la fois une mère et ses
filiales, les états financiers de l'entité déclarante sont
appelés « états financiers consolidés »
◼ Si l’entité déclarante comprend deux ou plusieurs entités
qui ne sont pas liés par un lien en capital, les états
financiers de l'entité déclarante sont appelés « états
financiers combinés ».
19 2 décembre 2003
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
Continuité de l’exploitation
◼ L’objectif des états financiers est de fournir des informations
utiles à la prévisions des cash-flows futurs et à l’évaluation
de la gestion des ressources par la direction.
◼ Les états financiers sont établis en présumant que
l’entreprise poursuivra son activité dans un avenir
prévisible. Ce qui permet d’évaluer les actifs à un montant
supérieur à la valeur de liquidation.
◼ Si la continuité d’exploitation n’était plus assurée, les états
financiers seraient établis sur une base différente qui
devrait alors être précisée.
20 2 décembre 2003
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
4. Les éléments des états financiers
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
Éléments des états financiers
◼ Les états financiers retracent les effets financiers des
transactions et autres événements en les groupant par
grandes catégories (éléments) selon leurs caractéristiques
économiques.
◼ Bilan : éléments directement liés à l’évaluation de la
situation financière : actifs, passifs, capitaux propres.
◼ Compte de résultat : éléments directement liés à
l’évaluation de la performance : produits, charges.
22 2 décembre 2003
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
Les actifs (assets)
◼ Définition : Un actif est une ressource économique actuelle
que l’entité contrôle du fait d’événements passés.
◼ Une ressource économique est un droit susceptible de
produire des avantages économiques (flux de trésorerie
positifs).
◼ Ce droit peut être :
➢ le droit de recevoir de la trésorerie.
➢ le droit d’utiliser des ressources économiques (immeubles,
matériels, brevets…) ;
➢ le droit d’échanger des ressources économiques selon des
modalités favorables (option d’achat par exemple) ;
➢ Etc.
23 2 décembre 2003
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
Les actifs (assets)
◼ Il est possible de démembrer les droits attachés à la propriété
d’un bien en distinguant le droit de le louer et celui de le
vendre, ce qui entraîne l’enregistrement du bien à la fois à
l’actif du locataire (droit d’utilisation) et à l’actif du propriétaire
(autres droits) – voir IFRS 16.
◼ Ce démembrement ne s’effectue généralement pas lorsque
tous les droits sur un actif sont détenus par la même personne.
◼ Pour comptabiliser un actif, l’entreprise doit en avoir le
contrôle, c’est-à-dire la capacité de décider de son utilisation
et d’en obtenir les avantages économiques correspondants.
24 2 décembre 2003
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
Les passifs (liabilities)
◼ Définition : Un passif est une obligation actuelle de
transférer une ressource économique résultant
d'événements passés.
◼ Obligation : elle peut résulter de la loi, des statuts, d’un
contrat (obligations juridiques), mais aussi des usages ou de
la simple volonté de conserver de bonnes relations d’affaires
(obligations implicites). Elle peut être certaine (dettes),
probable (provisions) ou éventuelle (mention dans les notes
annexes).
◼ Actuelle et résultant d’événements passés : l’entreprise a
déjà obtenu les droits à l’origine de l’obligation.
◼ Transfert d’une ressource économique : peut prendre
plusieurs formes :
◆ versements monétaires ;
◆ fournitures de biens ou services ;
◆ échange à des conditions défavorables, etc.
2 décembre 2003
25
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
Les capitaux propres (equity)
◼ Définition : les capitaux propres constituent l’intérêt
résiduel dans les actifs de l’entreprise après déduction de
tous ses passifs.
◼ La définition des capitaux propres résulte donc de la
relation suivante :
Capitaux propres = Actifs – Passifs
◼ Bien qu’ils soient définis comme un montant résiduel, les
capitaux propres peuvent être subdivisés : capital,
réserves légales, statutaires, réglementaires. Cette
subdivision apportant des informations supplémentaires
aux utilisateurs.
26 2 décembre 2003
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
Produits et Charges
◼ Produits : Accroissements d’avantages économiques
apparus au cours de l’exercice :
➢ sous forme d’augmentations d’actifs ou de diminutions de
passifs :
➢ ayant pour conséquence une augmentation des capitaux
propres ;
➢ autrement que par apports en capital.
◼ Charges : Diminutions d’avantages économiques apparus au
cours de l’exercice :
➢ sous forme de diminutions d’actifs ou d’accroissements de
passifs ;
➢ qui ont pour résultat de diminuer les capitaux propres ;
➢ autrement que par des distributions de dividendes.
27 2 décembre 2003
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
5. Comptabilisation des éléments
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
Conditions de comptabilisation des éléments
◼ Comptabilisation : processus consistant à incorporer dans
le bilan ou le compte de résultat un des éléments des états
financiers.
◼ L’ancien cadre conceptuel prévoyait deux conditions de
comptabilisation :
◆ L’entrée ou la sortie d’avantages économiques était
probable ;
◆ le coût ou la valeur de l’élément pouvait être estimé de
manière fiable.
29 2 décembre 2003
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
Conditions de comptabilisation des éléments
◼ Le nouveau cadre conceptuel est moins précis. Il indique
qu’un élément est enregistré si sa comptabilisation fournit
une information utile aux investisseurs, c’est-à-dire
pertinente et fidèle des actifs, des passifs, des charges, des
produits et de la variation des capitaux propres qui en
résulte.
◼ Cette imprécision reporte sur les normes elles-mêmes,
chacune dans leur domaine, la fixation de critères plus
précis de comptabilisation.
◼ Décomptabilisation : c’est le retrait d’un élément des états
financiers, qui s’effectue lorsque un élément ne répond plus
à la définition d’un actif ou d’un passif.
◆ Actif : perte du contrôle ou des avantages économiques.
◆ Passif : plus d’obligation actuelle.
30 2 décembre 2003
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
6. Evaluation des éléments
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
Évaluation des éléments des états financiers
◼ Évaluation : processus consistant à déterminer les montants
monétaires auxquels les éléments des états financiers vont être
comptabilisés et inscrits au bilan et au compte de résultat.
◼ Le cadre conceptuel distingue deux bases d’évaluation :
➢ Au moment de l’acquisition : coût historique (historical cost)
➢ A une autre date d’évaluation : valeur actuelle (current
value), laquelle comprend trois conventions d’évaluation :
➢ Coût actuel ;
➢ Juste valeur ;
➢ Valeur d’utilité.
32 2 décembre 2003
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
Coût historique (Historical cost)
◼ Dépenses engagées pour l'acquisition ou la création de
l'actif, comprenant la contrepartie versée majorée des coûts
de transaction.
◼ Le coût historique d'un actif est révisé au fil du temps pour
traduire :
➢ la consommation de la ressource économique (amortissements) ;
➢ les paiements reçus qui éteignent tout ou partie de l'actif
(créances) ;
➢ l'effet des événements qui font que tout ou partie du coût
historique de l'actif ne soit plus récupérable (dépréciation) ;
➢ La capitalisation d'intérêts correspondant à la composante
financement de l'actif.
33 2 décembre 2003
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
Coût actuel (Current cost)
◼ Coût d'un actif équivalent, comprenant la contrepartie qui
serait versée ainsi que les coûts de transaction qui seraient
engagés à cette date.
◼ Lorsque le coût actuel ne peut pas être déterminé
directement en observant les prix sur un marché actif, il doit
être déterminée indirectement par d'autres moyens.
◼ Par exemple, si les prix ne sont disponibles que pour des
actifs neufs, le coût actuel d'un actif usagé sera estimé en
appliquant une décote au prix d'un actif neuf pour tenir
compte de l’usage et de l'état actuel de l'actif.
34 2 décembre 2003
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
Juste valeur (Fair value)
◼ Prix qui serait reçu pour vendre un actif ou payé pour le
transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des
intervenants du marché.
◼ Niveau 1 : Si, pour un actif donné, il existe un marché
suffisamment liquide et profond, alors on prend le prix de
marché comme juste valeur :
◼ Niveau 2 : S’il n’y a pas de marché suffisamment liquide et
profond pour l’actif considéré, mais qu’il existe un actif
comparable pour lequel on a un prix de marché acceptable,
alors on prend le prix de marché de l’actif comparable
comme juste valeur :
◼ Niveau 3 : Dans les autres cas, on construit un modèle qui
va donner une valeur économique pour cet instrument
financier, le plus souvent basé sur les flux de trésorerie
35
attendus. 2 décembre 2003
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
Valeur d’utilité (Value in use)
◼ Valeur actualisée des flux de trésorerie que l’entreprise
s’attend à tirer de l’utilisation de l’actif et de sa cession
ultérieure.
◼ Pour un passif l’équivalent de la valeur d’utilité est la valeur
de remboursement, laquelle correspond à l’actualisation des
flux de trésorerie que l’attend s’attend à devoir transférer
pour éteindre ce passif.
◼ Contrairement à la juste valeur qui qui reflète les hypothèses
des intervenants sur un marché, la valeur d’utilité (ou de
remboursement) reflète le seul point de vue de l’entreprise).
36 2 décembre 2003
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
Le choix de la base d’évaluation (1/2)
◼ Le choix d’une base d’évaluation doit être guidé par la capacité
de celle-ci à satisfaire les qualités fondamentales (pertinence et
fidélité) et dans une moindre mesure les qualités de soutien.
◼ Pertinence : elle dépend des caractéristiques de l’actif et de sa
contribution aux flux de trésorerie futurs.
◆ Lorsque la valeur d’un actif est sensible aux fluctuations du
marché, la juste valeur semble une convention d’évaluation plus
pertinente que le cout historique.
◆ A l’inverse, pour des actifs que l’entreprise n’a pas l’intention de
céder, le coût historique ou la valeur d’utilité semblent plus
pertinents que la juste valeur.
◼ Fidélité : la fidélité d’une évaluation dépend de son degré
d’incertitude. Par conséquent les conventions d’évaluation
reposant sur l’observation de prix sur un marché actif sont à
priori moins fidèles que le coût historique.
37 2 décembre 2003
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
Le choix de la base d’évaluation (2/2)
◼ Comparabilité : l’utilisation de la juste valeur et du coût actuel
accroit la comparabilité car tous les actifs similaires sont
évalués au même moment, quelles que soient la date à laquelle
il ont été acquis et l’entreprise qui les détient.
◼ Comparabilité et Compréhensibilité : plus les bases
d’évaluation sont différentes, moins l’information est
comparable et compréhensible. Seule la pertinence peut alors
compenser ces inconvénients.
◼ Vérifiabilité : elle est favorisée par les bases d’évaluation
pouvant faire l’objet d’un contrôle indépendant, comme le coût
historique ou la juste valeur (lorsque celle-ci est basée sur un
marché actif). Elle est moindre lorsque l’évaluation est assise
sur les propres prévisions de l’entreprise (valeur d’utilité).
38 2 décembre 2003
Jean-Jacques FRIEDRICH - IAE - Université Lyon 3
Vous aimerez peut-être aussi
- Cadre Conceptuel IASBDocument58 pagesCadre Conceptuel IASBmineabedPas encore d'évaluation
- Cadre ConceptuelDocument14 pagesCadre Conceptuellara iplikjePas encore d'évaluation
- Chapitre 2 Cadre ConceptuelDocument63 pagesChapitre 2 Cadre Conceptuelselmi ghadaPas encore d'évaluation
- Cours DauditDocument27 pagesCours DauditchrismoepouatyPas encore d'évaluation
- Section 2Document5 pagesSection 2ayarida285100% (1)
- Chapitre 2 - Cadre - Conceptuel (Vers° Etudiant)Document5 pagesChapitre 2 - Cadre - Conceptuel (Vers° Etudiant)gpq67mc4f4Pas encore d'évaluation
- PART1CH2Document59 pagesPART1CH2Myriam TriguiPas encore d'évaluation
- 1 Cours Audit 2016Document266 pages1 Cours Audit 2016Hamzaoui AbderrahmenPas encore d'évaluation
- Passage Au Nouveau Système Comptable Et Financier Qu 'Est Ce Qui Change ? Les Enjeux de La Mise en ApplicationDocument114 pagesPassage Au Nouveau Système Comptable Et Financier Qu 'Est Ce Qui Change ? Les Enjeux de La Mise en Applicationhejer jelassiPas encore d'évaluation
- Cours Audit FinancierDocument89 pagesCours Audit FinancierSnoussi OussamaPas encore d'évaluation
- Cours Audit 2023Document108 pagesCours Audit 2023Meriem CHERNIPas encore d'évaluation
- CH 1 Objectifs Et Sources de NormalisationDocument9 pagesCH 1 Objectifs Et Sources de Normalisationnabil.dridi800% (1)
- Chapitre 1 AuditDocument12 pagesChapitre 1 AuditCyrin ZaiemPas encore d'évaluation
- Formation en Education FinanciereDocument96 pagesFormation en Education FinanciereTIOLE Simon Daniel100% (1)
- Analyse Financière Et ComptabilitéDocument14 pagesAnalyse Financière Et ComptabilitéGhofrane ZaouiPas encore d'évaluation
- Livre Essenciel Ifrs Sbai Marouen.....Document6 pagesLivre Essenciel Ifrs Sbai Marouen.....STE HS SERVICESPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 Master RCFDocument10 pagesChapitre 3 Master RCFSahar FekihPas encore d'évaluation
- Qualite (De (L'information (ComptableDocument8 pagesQualite (De (L'information (Comptablech RaniaPas encore d'évaluation
- Cours Final de L'audit Financier S9 ACGDocument123 pagesCours Final de L'audit Financier S9 ACGIhssanePas encore d'évaluation
- Audit Comptable Et Financier CoursDocument53 pagesAudit Comptable Et Financier CoursMohammed Bouhjari0% (1)
- 2 - Chap 2 Cadre ConceptuelDocument7 pages2 - Chap 2 Cadre ConceptuelAsma JemaaPas encore d'évaluation
- Cours AcfDocument23 pagesCours Acfousmanoumoussa19b065egPas encore d'évaluation
- G3 Diagnostic Financier PEF-3Document15 pagesG3 Diagnostic Financier PEF-3DAABAJIPas encore d'évaluation
- Cours D'auditDocument77 pagesCours D'auditNGATSE ANDREASPas encore d'évaluation
- Le Cadre ConceptuelDocument15 pagesLe Cadre ConceptuelSami JaballahPas encore d'évaluation
- Le Cadre ConceptuelDocument15 pagesLe Cadre ConceptuelSami Jaballah100% (1)
- Audit Comptable Et FinancierDocument6 pagesAudit Comptable Et FinancierSoukainaPas encore d'évaluation
- Article Casta Stolowy V2 Final 2012Document15 pagesArticle Casta Stolowy V2 Final 2012Barry MamadouPas encore d'évaluation
- Les Attributs de L'audit Externe Pour Une Information Financiere de QualiteDocument22 pagesLes Attributs de L'audit Externe Pour Une Information Financiere de QualiteNouhaila Ait hdaPas encore d'évaluation
- La Théorie ComptableDocument11 pagesLa Théorie ComptableBillah AbdallahPas encore d'évaluation
- Les Etats FinanciersDocument32 pagesLes Etats FinanciersAshraf AMPas encore d'évaluation
- Présentation Processus Et Cadre Conceptuel Des Normes IAS IFRSDocument15 pagesPrésentation Processus Et Cadre Conceptuel Des Normes IAS IFRSŽahra Ňah IdPas encore d'évaluation
- Cours Final de L'audit Comptable Et FinancierDocument128 pagesCours Final de L'audit Comptable Et FinanciersoukainaPas encore d'évaluation
- Exposé IPSASDocument26 pagesExposé IPSASJamila MalihPas encore d'évaluation
- Fiche Résumé Cadre ConceptuelDocument5 pagesFiche Résumé Cadre ConceptuelYosr TliliPas encore d'évaluation
- Pr. Said RADI Cours D'audit Comptable Et Financier LP GECOFI Et MAEDocument63 pagesPr. Said RADI Cours D'audit Comptable Et Financier LP GECOFI Et MAEHamza BoudinarPas encore d'évaluation
- Ucc Cours de Revisorat Comptable Lii 2014Document74 pagesUcc Cours de Revisorat Comptable Lii 2014Félix Ngandu0% (1)
- Remercie MentDocument75 pagesRemercie MentahmedPas encore d'évaluation
- ExtraitDocument8 pagesExtraitBrehima TraorePas encore d'évaluation
- Cours D'auditDocument39 pagesCours D'auditpatrickPas encore d'évaluation
- Scoring Sur Données D'entreprisesDocument19 pagesScoring Sur Données D'entreprisesNassima MessaPas encore d'évaluation
- Finance D'entreprise Mme GUEYEDocument77 pagesFinance D'entreprise Mme GUEYELouis Isaac AndersonPas encore d'évaluation
- SCF Cours #02Document8 pagesSCF Cours #02Nabil LebigPas encore d'évaluation
- Audit Comptable Et Financier3 - CoursDocument49 pagesAudit Comptable Et Financier3 - CourslinaPas encore d'évaluation
- Cours Audit Comptable Et Financier DDocument43 pagesCours Audit Comptable Et Financier Dluzolochancelvie90Pas encore d'évaluation
- Sdoc 02 18 SiDocument49 pagesSdoc 02 18 SiSoulef Igueziri1508Pas encore d'évaluation
- Seance 1Document6 pagesSeance 1Rolande HoundefodjiPas encore d'évaluation
- Cours IAS LicenceDocument62 pagesCours IAS LicencePixel service HosniPas encore d'évaluation
- Audit-Presentation Du Cour - Chapitre 1Document7 pagesAudit-Presentation Du Cour - Chapitre 1De Sales Boni100% (2)
- SchellaDocument8 pagesSchelladesirj0311Pas encore d'évaluation
- Résumé Partie Introduction ADFDocument6 pagesRésumé Partie Introduction ADFmariem MarzoukPas encore d'évaluation
- Cadre ConceptuelDocument13 pagesCadre ConceptuelOuerhani ChaoukiPas encore d'évaluation
- Comptabilité Financiere Selon Le IfrsDocument25 pagesComptabilité Financiere Selon Le IfrsDounia SolaiPas encore d'évaluation
- Les Normes Comptables Internationales (IFRS)Document11 pagesLes Normes Comptables Internationales (IFRS)Nesrine CerinePas encore d'évaluation
- Veille StratDocument7 pagesVeille StratkarimaelPas encore d'évaluation
- Cours Intelligence EcoDocument56 pagesCours Intelligence EcoربےآسألگرضآگوآلجنہPas encore d'évaluation
- 2003-122 L'importance de La Revue Analytique Dans La Mission D'auditDocument4 pages2003-122 L'importance de La Revue Analytique Dans La Mission D'auditbigmourad50% (2)
- SEQ 2 Description de Laudit Financier ComptableDocument20 pagesSEQ 2 Description de Laudit Financier ComptableBEFOUROUACK Hermod JessiaPas encore d'évaluation
- Proposition Chebil Levy 2010Document10 pagesProposition Chebil Levy 2010molka boujnehPas encore d'évaluation
- Note Commune N 35Document3 pagesNote Commune N 35Naoufel FroujaPas encore d'évaluation
- InFirst Avantages Fiscaux 2019 PDFDocument123 pagesInFirst Avantages Fiscaux 2019 PDFNoura BouallaguiPas encore d'évaluation
- Cours Fiscalité Mehdi ELLOUZ VERSION DECEMBRE 2023 4Document420 pagesCours Fiscalité Mehdi ELLOUZ VERSION DECEMBRE 2023 4Naoufel Frouja100% (2)
- Circulaire #201704Document9 pagesCirculaire #201704Naoufel FroujaPas encore d'évaluation
- L'inventaire Intermittent Inventaire PermanentDocument9 pagesL'inventaire Intermittent Inventaire PermanentNaoufel Frouja100% (1)
- Leaders University Examen IFRS IIDocument3 pagesLeaders University Examen IFRS IINaoufel FroujaPas encore d'évaluation
- Le Barometre de La MicrofinanceDocument2 pagesLe Barometre de La MicrofinanceNaoufel FroujaPas encore d'évaluation
- Gestion de La TrésorerieDocument2 pagesGestion de La TrésorerieNaoufel FroujaPas encore d'évaluation
- Les Impôts DifférésDocument23 pagesLes Impôts DifférésNaoufel FroujaPas encore d'évaluation
- Code Général Des ImpôtsDocument1 248 pagesCode Général Des ImpôtsNaoufel FroujaPas encore d'évaluation
- Livre Blanc Options Normes IFRSDocument8 pagesLivre Blanc Options Normes IFRSNaoufel FroujaPas encore d'évaluation
- Examens de Fiscalité Avec CorrigésDocument272 pagesExamens de Fiscalité Avec CorrigésNaoufel Frouja100% (1)
- UE202021 114 MAJ Droit FiscalDocument24 pagesUE202021 114 MAJ Droit FiscalNaoufel FroujaPas encore d'évaluation
- Webzine Cegid ExpertCompatble 2019Document32 pagesWebzine Cegid ExpertCompatble 2019Naoufel FroujaPas encore d'évaluation
- Differences RA Et FairtradeDocument3 pagesDifferences RA Et FairtradeJimmy Rosa AndriantsoaPas encore d'évaluation
- 30 Rules To Master Swing TradingDocument6 pages30 Rules To Master Swing TradingTanda BondoukouPas encore d'évaluation
- Juin 2014 - C409-2014.06Document8 pagesJuin 2014 - C409-2014.06iemakam7377Pas encore d'évaluation
- AsymetrieDocument22 pagesAsymetrieRegis GuenolePas encore d'évaluation
- Avis de Taxe D Habitation CAP 2022Document2 pagesAvis de Taxe D Habitation CAP 2022Sabrina LocatelliPas encore d'évaluation
- GUNDODocument23 pagesGUNDOEL Ghazali HamadaPas encore d'évaluation
- Acte Uniforme Relatif Au Droit Des Societes Comm Et GieDocument154 pagesActe Uniforme Relatif Au Droit Des Societes Comm Et GieBernaldo R. EvangelistaPas encore d'évaluation
- Livret Inscrip 2023 OkDocument79 pagesLivret Inscrip 2023 OkLudo VanbraekelPas encore d'évaluation
- Rapport Aya IdrissiDocument34 pagesRapport Aya IdrissiWissal LachguerPas encore d'évaluation
- Ha 16SPX 05Document220 pagesHa 16SPX 05Bad ChillPas encore d'évaluation
- La Renaissance Des Espaces Productifs en France - Vers Un Nouveau Dynamisme Économique - Google DocsDocument2 pagesLa Renaissance Des Espaces Productifs en France - Vers Un Nouveau Dynamisme Économique - Google Docscain robPas encore d'évaluation
- Presentation-PowerPoint Com Modele 9Document19 pagesPresentation-PowerPoint Com Modele 9Chahrazad Aden100% (1)
- 9416 RFP 49086 Tunisia - SNCFT - NetworkDocument138 pages9416 RFP 49086 Tunisia - SNCFT - NetworkDinkers JeanPas encore d'évaluation
- 486 - La Logistique en 42 Fiches - Morana - Première PartieDocument17 pages486 - La Logistique en 42 Fiches - Morana - Première PartieESSANHAJI Ali100% (1)
- Cours02 OligopoleDocument87 pagesCours02 Oligopoleayoub ayoubPas encore d'évaluation
- Fiscalité Dentreprise ChapitreiDocument23 pagesFiscalité Dentreprise ChapitreiWidad LabdaouiPas encore d'évaluation
- Fiche Standardisee DinformationDocument4 pagesFiche Standardisee Dinformationguerrinalain06Pas encore d'évaluation
- Annexe Exo4 Gestion Previsionnelle Superu 2Document3 pagesAnnexe Exo4 Gestion Previsionnelle Superu 2nohaaittamlihatPas encore d'évaluation
- Audit ComptableDocument49 pagesAudit ComptableJustin Da-alladaPas encore d'évaluation
- S'Enrichir Grace A L'immobilierDocument30 pagesS'Enrichir Grace A L'immobilierFamenontsoa rakotonarivoPas encore d'évaluation
- Eléments de Cours Sur Les ClassiquesDocument44 pagesEléments de Cours Sur Les ClassiquesMehdi BENNISPas encore d'évaluation
- Cours Gestion Des Machines Agricoles Level 3 BMDJKDocument43 pagesCours Gestion Des Machines Agricoles Level 3 BMDJKDuchel Amayana ayangmaPas encore d'évaluation
- Ec 04Document6 pagesEc 04Chance Umba MatangaPas encore d'évaluation
- Guide de L'accompagnateur de Projets de L'économie Sociale Et SolidaireDocument66 pagesGuide de L'accompagnateur de Projets de L'économie Sociale Et SolidaireMejdi BouaginaPas encore d'évaluation
- Création Des Entreprises Au MarocDocument7 pagesCréation Des Entreprises Au MarocSouFiane Safouan0% (1)
- Rappels Concurrence Pure Et Parfaite: Travaux Dirig Es Economie IndustrielleDocument2 pagesRappels Concurrence Pure Et Parfaite: Travaux Dirig Es Economie IndustrielleDonovan meridienPas encore d'évaluation
- Devis Vitrerie Bernard Et Vanhauwe - L AMBIANCE N°06965Document1 pageDevis Vitrerie Bernard Et Vanhauwe - L AMBIANCE N°06965vxdzmr4nzfPas encore d'évaluation
- ComplementDocument4 pagesComplementAhmed BennasrPas encore d'évaluation
- Budget Chéri Mes Conseils de LectureDocument22 pagesBudget Chéri Mes Conseils de Lecturencalba54Pas encore d'évaluation
- Recu de Depot de Dossier Cotisation MensuelleDocument1 pageRecu de Depot de Dossier Cotisation Mensuellepascalhl8Pas encore d'évaluation