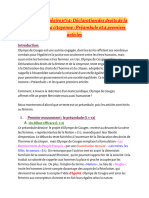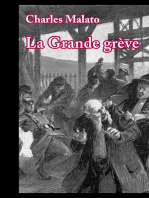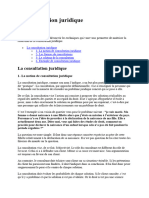Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Corrigé Œuvre de Combat
Corrigé Œuvre de Combat
Transféré par
Elias Gourdin0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
0 vues2 pagesTitre original
Corrigé œuvre de combat
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
0 vues2 pagesCorrigé Œuvre de Combat
Corrigé Œuvre de Combat
Transféré par
Elias GourdinDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 2
En quoi la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d’Olympe de Gouges
est-elle une oeuvre de combat ?
ETAPE 1 : définition des mots-clés
- “en quoi” + “est-elle” : question ouverte, c’est un plan thématique. Le verbe nous montre qu’il s’agit de prouver la
thèse affirmée, pas de la discuter. On doit donc montrer ce pourquoi elle combat.
- “DDFC” : l’oeuvre étudiée
- “oeuvre de combat” : texte combatif, texte qui attaque, qui dénonce. Elle se bat pour l’égalité des sexes, les droits
des femmes, les droits sociaux des plus faibles. Elle se bat aussi contre, notamment contre l'égoïsme des hommes.
ETAPE 2 : reformulation du sujet
Le sujet vise à développer les combats d’Olympe de Gouges dans la DDFC.
On pourrait la reformuler ainsi :
Quels combats, Olympe de Gouges, livre-t-elle dans sa Déclaration?
ETAPE 3 : création du plan
Le sujet appelle à nommer les différents combats ou sujets pour lesquels Olympe de Gouges se bat.La question appelle
un plan plutôt thématique et ne nécessite donc pas de faire trois parties. Un plan en I. & II. est possible. Ce
questionnement appelle à être progressif donc commençons par le premier combat, le plus évident, d'Olympe de
Gouges : le combat pour l'égalité des sexes. Dans un deuxième temps, on développera les autres combats. Un plan en
trois parties est possible, notamment si l'on consacré une partie entière au combat contre.
I. Un combat pour l'égalité des sexes
A. Un texte qui combat pour les femmes et leurs droits
- C'est d'abord une œuvre féministe : le titre qui met en avant les femmes et leurs conditions + le fait qu'elles soient
omniprésentes dans la DDFC. Répétition du terme « femmes», en apostrophe lorsqu'elles sont destinataires ou bien
comme sujet dans les articles. -> oeuvre féministe, pour les femmes, par une femme. + adresse à la Reine en
ouverture de l’œuvre. Elle s’y montre autoritaire, réclamant l’aide de la femme la plus importante de France, mais
aussi flatteuse : « (…) j’ai eu la force de prendre votre défense ».
- Un texte de loi qui veut donner des droits aux femmes : les 17 articles de la Déclaration qui reprennent ceux de la
Déclaration originelle. Par le pastiche de la Constitution du 26/08/1789, elle rédige un texte adressé aux députés
français. Ainsi, elle offre aux femmes, les droits législatifs que la Révolution Française ne leur a pas donnés.
ODG énumère les droits qu'elle désire octroyer aux femmes. L'exemple de l'art 14 : « un partage égal, non seulement
dans la fortune, mais encore dans l’administration publique » Ici, elle pointe du doigt l’égalité économique que
revendique et que mérite les femmes.
- Une œuvre militante : la DDFC réclame des droits dans une époque où la société française évolue. Par le ton employé
par l’autrice, c’est une œuvre combative et militante qui réclame des droits : « Femme, réveille-toi ; le tocsin de la
raison se fait entendre dans tout l’Univers ; reconnais tes droits.»
B. un plaidoyer pour une égalité H/F
- ODG réclame et se bat pour une égalité pure et totale des deux sexes. On le voit dans l'article 3, dans le 6 lorsqu’elle
cite «toutes les citoyennes et citoyens (…)« ou encore dans l'article 13, lorsqu'elle ajoute le pronom féminin au
masculin ou le terme «femme » à celui déjà présent «homme », preuve de l'égalité qu'elle désire et qu'elle demande.
- Le plaidoyer qu’elle fait pour l’égalité H/F passe aussi par une virulent réquisitoire des hommes et leur
comportement. ODG note à plusieurs reprises, l’égoïsme des hommes. C’est le cas notamment dans l’exhortation aux
hommes, qui précède le préambule et qu’elle ouvre par « Homme, es-tu capable d’être juste ? C’est une femme qui
t’en fait la question (…) » ou encore dans ce même texte : « l’homme seul s’est fagoté un principe de cette exception.
Bizarre, aveugle, boursouflé de sciences et dénégéré, dans ce siècle de lumières et de sagacité (…) il veut commander
en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facutés intellectuelles ». Dans ce célèbre passage, elle use de toute sa
rhétorique pour montrer et dénoncer la domination des hommes. De même, dans le postambule, elle affirme que
l'homme « devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne». Ce passage illustre cette idée présente dans la
Déclaration, de l'inaction des hommes et d'une certaine forme d'égoïsme.
La DDFC d’Olympe de Gouges est donc bien une œuvre qui combat pour les femmes, leurs droits mais aussi pour
une égalité des sexes. C'est également un texte qui combat les travers des hommes et leur inaction face à l'injustice
qui touche les femmes. Nous allons tout de même voir que cet écrit est également pour Olympe de Gouges, le lieu
d’un combat plus large, pour la société toute entière.
II. Un combat social
A. Un texte qui se bat contre l'injustice sociale
- ODG écrit aussi pour les plus faibles. Elle mentionne souvent le statut des filles-mères. Ce sont les jeunes femmes qui
ont un enfant sans être mariées. Ce statut est longuement évoqué, ainsi que celui des enfants de ces jeunes femmes,
dans l’article 11 où elle dit « Toute citoyenne peut donc dire librement : je suis la mère d’un enfant qui vous
appartient, sans qu’un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité (…)». On voit ici le souci qu’elle porte à ceux que
la société n’admet pas et l’hypocrisie de cette dernière puisque les hommes en sont en grande partie responsables.
- ODG s’engage aussi contre l’esclavage. Si elle a écrit des textes distincts de la Déclaration pour ce combat, comme la
pièce de théâtre Zamore et Mirza, on retrouve également la mention dans la postambule : « (…) nécessaire que je dise
quelques mots sur les troubles que cause, dit-on, le décret en faveur des hommes de couleur, dans nos îles. C’est là où
la nature frémit d’horreur ; c’est là où la raison et l’humanité, n’ont pas encore touché les âmes endurcies ; c’est là
surtout où la division et la discorde agitent leurs habitants.(…) = ici, ODG rappelle le terrible sort des noirs des Antilles
que les Français réduisent en esclavage. C’est un propos fort et dénonciateur sur cette ignominie qu’est l’esclavage.
Elle mentionne d’ailleurs l’idée de la nature et notamment de l’ordre naturel que les hommes tordent à leur
avantage. : « (…) Les Colons prétendent régner en despotes sur des hommes dont ils sont les pères et les frères ; et
méconnaissant les droits de la nature (…). »
Cette lutte contre l’esclavage inscrit ODG aux côtés de Montesquieu et de son pamphlet aussi virulent qu’ironique De
l’esclavage des nègres mais aussi aux côtés de Voltaire. Dans le chapitre 19 de Candide intitulé, « ce qui leur arriva à
Surinam », le héros éponyme et son camarade rencontrent un homme noir réduit en esclavage et lourdement mutilé.
Dans ce tableau pathétique, Voltaire critique habilement la cupidité et la cruauté des négociants. Il révèle aussi toute
l’hypocrisie de la religion qui sous-couvert de fraternité, participe à l’immonde esclavage. ODG se tient donc auprès de
ses contemporains philosophes des Lumières et se bat, elle aussi, contre l’injustice sociale.
B. Une lutte pour un monde plus juste.
- De même, dans «Forme du contrat social», qui suit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, ODG
propose une mariage plus juste et plus équitable pour les hommes et surtout pour les femmes. ODG réclame donc une
nouvelle société, fondée sur l’égalité et l’équité.
- La diversité des destinataires de la DDFC montre aussi la volonté d’ODG de toucher toutes les parties de la société et
donc de la changer durablement. Elle s’adresse à la Reine, alors symbole de la monarchie, aux hommes (notamment
dans l’exhortation aux hommes et dans le préambule) que ce soient les citoyens les plus simples aux députés les plus
puissants. Elle s’adresse aussi aux femmes, notamment dans le postambule. Cette pluralité, cette richesse montre son
désir de toucher une société toute entière. Rappelons également que la brièveté de l’œuvre (quelques dizaines de
pages) en fait un texte facile à distribuer, une brochure, un tract. Il peut alors être lu rapidement. ODG vise une
diffusion massive.
- Enfin, ODG semble créer une nouvelle condition féminine. Ce serait une erreur de se cantonner à une intégration des
femmes dans les lois et la société déjà existantes. ODG crée une féminité nouvelle que l’on peut voir avec les termes
qu’elle y associe : la création du mot «citoyenne » est déjà en soi une nouveauté, les termes guerriers et le ton militant
« force », « tocsin », « étendard » mais aussi la périphrase du préambule « le sexe supérieur en beauté comme en
courage ». Elle dépeint ici une nouvelle femme, forte et guerrière, une femme d’avenir que l’on peut retrouver dans
les mots de Leïla Slimani dans l’essai « Un porc, tu nais ? »publié en 2018. Cette dernière réclame une liberté totale
des femmes, faisant écho aux propos d’Olympe de Gouges, deux cent ans plus tôt. De même, dans son essai Chère
Ijaewele. Un manifeste pour une éducation féministe, Chimamanda Ngozi Adichie, dans le sillage d’Olympe de Gouges,
propose les conseils pour une éducation féministe. Ces femmes d’aujourd’hui se posent comme les filles, les héritières
du combat d’Olympe.
Vous aimerez peut-être aussi
- Pétrole Et Gaz Au Sénégal Chronique D'une Spoliation by Ousmane SonkoDocument256 pagesPétrole Et Gaz Au Sénégal Chronique D'une Spoliation by Ousmane SonkoYagiyaro. yahaya100% (1)
- Corrigé Dissertation Entrainement.Document3 pagesCorrigé Dissertation Entrainement.anasserekif100% (3)
- DDFC-Olympe de Gouges-Dissertation RédigéeDocument3 pagesDDFC-Olympe de Gouges-Dissertation RédigéeElk484% (25)
- Dissertation Olympe de GougesDocument8 pagesDissertation Olympe de Gougesilae.donnadieubeal66100% (1)
- Expose Soleil Des IndependanceDocument7 pagesExpose Soleil Des Independanceromy100% (5)
- DDFC Fiche DissertationDocument8 pagesDDFC Fiche Dissertationtheoxyder100% (5)
- Olympe de Gouge, Déclaration Des Droits de La Femme Et de La CitoyenneDocument3 pagesOlympe de Gouge, Déclaration Des Droits de La Femme Et de La CitoyennetroallicPas encore d'évaluation
- Corrigé Dissertation OG Et Commentaire DiderotDocument7 pagesCorrigé Dissertation OG Et Commentaire Diderotnora100% (1)
- Dissertation DDFCDocument3 pagesDissertation DDFCLucile Yaker100% (1)
- Dissert Entrainement 3 CorrigeDocument7 pagesDissert Entrainement 3 CorrigeAbdousalam OUMA MAHAMATPas encore d'évaluation
- Corrigé Dissertation OG Et Commentaire DiderotDocument7 pagesCorrigé Dissertation OG Et Commentaire DiderotdaphnéPas encore d'évaluation
- Femme, Réveille-ToiDocument3 pagesFemme, Réveille-ToiMathisPas encore d'évaluation
- 1 - Explication Linéaire Postambule Olympe de GougeDocument3 pages1 - Explication Linéaire Postambule Olympe de GougeBRUNEPas encore d'évaluation
- Olymle de GOUGES - PostambuleDocument7 pagesOlymle de GOUGES - PostambuleChiara StraboniPas encore d'évaluation
- 1GT OdG Pre-Ambule Analyse Line-AireDocument3 pages1GT OdG Pre-Ambule Analyse Line-Airesanthosan.slPas encore d'évaluation
- EgalitéDocument11 pagesEgalitélucas.denuellePas encore d'évaluation
- Dissertation DDFCDocument3 pagesDissertation DDFCheloisemartineau2009Pas encore d'évaluation
- Odg Dissertation Corrigee Bac Blanc Mai 2023Document3 pagesOdg Dissertation Corrigee Bac Blanc Mai 2023louisilic86Pas encore d'évaluation
- Lecture Linéaire - Préambule Et Art.1 Et2Document4 pagesLecture Linéaire - Préambule Et Art.1 Et2Rébéca NsukaPas encore d'évaluation
- Pistes de Correction Sujet Dissertation Olympe de Gouges DDFC Adress e Aux Femmes R Cup Ration AutomatiqueDocument3 pagesPistes de Correction Sujet Dissertation Olympe de Gouges DDFC Adress e Aux Femmes R Cup Ration AutomatiquealmudenagamarPas encore d'évaluation
- Pistes de Correction Sujet Dissertation Olympe de Gouges DDFC Adress e Aux Femmes R Cup Ration AutomatiqueDocument3 pagesPistes de Correction Sujet Dissertation Olympe de Gouges DDFC Adress e Aux Femmes R Cup Ration Automatiquematuszak.carlaPas encore d'évaluation
- Sujet Dissertation RédigéeDocument6 pagesSujet Dissertation RédigéeMathias BPas encore d'évaluation
- DISSERT 1 - Texte EngagéDocument3 pagesDISSERT 1 - Texte Engagédestrucition.machinePas encore d'évaluation
- Olympe de Gouge. 3Document4 pagesOlympe de Gouge. 3cheubeuleurPas encore d'évaluation
- Les Causes Defendues Dans La Declaration D Olympe de GougesDocument5 pagesLes Causes Defendues Dans La Declaration D Olympe de Gougesmixscha personnePas encore d'évaluation
- Orale AlexisDocument39 pagesOrale Alexissylvain.therradePas encore d'évaluation
- Fiche Arguments Dissert OdGDocument4 pagesFiche Arguments Dissert OdGheloisemartineau2009Pas encore d'évaluation
- DDFCDocument5 pagesDDFClynamamryaPas encore d'évaluation
- Declaration Des Droits de La Femme Et de La Citoyenne Olympe de Gouges Fiche de LectureDocument6 pagesDeclaration Des Droits de La Femme Et de La Citoyenne Olympe de Gouges Fiche de Lectureanaisgorce2007Pas encore d'évaluation
- Declaration Droits de La Femme Et Du CitoyenneDocument7 pagesDeclaration Droits de La Femme Et Du Citoyennefotosfrancia2023Pas encore d'évaluation
- Fiche Dissert Olympe de GougesDocument5 pagesFiche Dissert Olympe de Gougesben kramPas encore d'évaluation
- IntroductionDocument6 pagesIntroductionbersanova.markha19Pas encore d'évaluation
- 01247551700Document5 pages01247551700HugoPas encore d'évaluation
- Explication Linéaire N°14 DDFCDocument4 pagesExplication Linéaire N°14 DDFCblossommadelaine05Pas encore d'évaluation
- Corrigé Dissertation OG Et Commentaire DiderotDocument7 pagesCorrigé Dissertation OG Et Commentaire Diderotrimat38Pas encore d'évaluation
- EL 3 - Olympe de Gouges, Déclaration Des Droits de La Femme Et de La Citoyenne, 1791Document3 pagesEL 3 - Olympe de Gouges, Déclaration Des Droits de La Femme Et de La Citoyenne, 1791beudetcameronPas encore d'évaluation
- Le Cri Des Femmes en Faveur de L EgaliteDocument6 pagesLe Cri Des Femmes en Faveur de L EgaliteHeloisePas encore d'évaluation
- Jjcsudtyiz Aopgmglzpp Zieufoozie IebeDocument4 pagesJjcsudtyiz Aopgmglzpp Zieufoozie IebeKylian “Hudson” EdebPas encore d'évaluation
- Les Causes Défendues Dans La Déclaration D'olympe de Gouges - Annales Corrigées AnnabacDocument1 pageLes Causes Défendues Dans La Déclaration D'olympe de Gouges - Annales Corrigées AnnabacAya KPas encore d'évaluation
- Preambule OGDocument4 pagesPreambule OGrim nouriPas encore d'évaluation
- Carnet de Lecteur DDFC - FrançaisDocument21 pagesCarnet de Lecteur DDFC - Françaispaulanriou1105Pas encore d'évaluation
- Dissert Loympe de GougesDocument5 pagesDissert Loympe de GougesLucas MazièresPas encore d'évaluation
- Etude LinéaireDocument7 pagesEtude Linéaireeuniceosadare77Pas encore d'évaluation
- Le Cri Des Femmes en Faveur de L EgaliteDocument6 pagesLe Cri Des Femmes en Faveur de L Egalitemixscha personnePas encore d'évaluation
- BB Dissertation Odg Proposition-De-Corrige WeblettresDocument4 pagesBB Dissertation Odg Proposition-De-Corrige WeblettresseffahPas encore d'évaluation
- Contraction Essai FrancaisDocument3 pagesContraction Essai FrancaisZenabou NassourPas encore d'évaluation
- INTRODUCTIONDocument5 pagesINTRODUCTIONlucas.denuellePas encore d'évaluation
- Corrigé de L'essai - ReluDocument2 pagesCorrigé de L'essai - ReluMini KillerPas encore d'évaluation
- EAF 4 Postambule TXT Et AnalyseDocument5 pagesEAF 4 Postambule TXT Et Analysetexiane974Pas encore d'évaluation
- Dissertation Dialectique ODG 1Document8 pagesDissertation Dialectique ODG 1cemilefatmadenizPas encore d'évaluation
- DDFC 2 Sujets TraitésDocument8 pagesDDFC 2 Sujets TraitésMathias BPas encore d'évaluation
- Séquence 4Document4 pagesSéquence 4VeyaPas encore d'évaluation
- EL 6 ODG Préambule + Les 4 Premiers ArticlesDocument2 pagesEL 6 ODG Préambule + Les 4 Premiers Articleskarimb2007100% (1)
- CoursddfcDocument1 pageCoursddfcRIERA HippolytePas encore d'évaluation
- Lectures LinéairesDocument24 pagesLectures Linéairessoben2005Pas encore d'évaluation
- Olympe de Gouges Et La Revolution 2Document17 pagesOlympe de Gouges Et La Revolution 2zarerPas encore d'évaluation
- Étude Linéaire Postambule GougesDocument3 pagesÉtude Linéaire Postambule GougesgeoffroyleleuPas encore d'évaluation
- 7FR16TE0721 Analyse-PreambuleDocument3 pages7FR16TE0721 Analyse-PreambuleMaram ChabouPas encore d'évaluation
- Synthese GougesDocument8 pagesSynthese GougesNagore RiveroPas encore d'évaluation
- Olympe de GougesDocument2 pagesOlympe de GougestroallicPas encore d'évaluation
- Texte 15Document5 pagesTexte 15julie.corbuPas encore d'évaluation
- Lecture Analytique JLDFM N°3 - Partie 2 Scene 2 - La Dispute NotesDocument6 pagesLecture Analytique JLDFM N°3 - Partie 2 Scene 2 - La Dispute NotesElias Gourdin100% (1)
- TEXTE LECTURE LINEAIRE JLDFM N°3 - Partie 2 Scène 2 - La DisputeDocument4 pagesTEXTE LECTURE LINEAIRE JLDFM N°3 - Partie 2 Scène 2 - La DisputeElias GourdinPas encore d'évaluation
- L'art PoétiqueDocument1 pageL'art PoétiqueElias GourdinPas encore d'évaluation
- Test Louise LabéDocument1 pageTest Louise LabéElias GourdinPas encore d'évaluation
- Le Vocabulaire Du CinémaDocument4 pagesLe Vocabulaire Du CinémaElias GourdinPas encore d'évaluation
- Lecture Analytique #2 Premiere Partie Scene 4 NotesDocument5 pagesLecture Analytique #2 Premiere Partie Scene 4 NotesElias GourdinPas encore d'évaluation
- Texte Lecture Analytique Premiere Partie Scene 4 - Le DimancheDocument4 pagesTexte Lecture Analytique Premiere Partie Scene 4 - Le DimancheElias GourdinPas encore d'évaluation
- Fiche de Cours La Negation + Exercices MajDocument6 pagesFiche de Cours La Negation + Exercices MajElias GourdinPas encore d'évaluation
- Mémoire Master 2 Histoire Alunni Corto Part 1Document6 pagesMémoire Master 2 Histoire Alunni Corto Part 1Cours ParticuliersPas encore d'évaluation
- Questions Fréquentes À Propos de LDocument2 pagesQuestions Fréquentes À Propos de LtirlirePas encore d'évaluation
- Colle Géographe 5 Reines Et RégentesDocument5 pagesColle Géographe 5 Reines Et RégentesVictoria DelaunayPas encore d'évaluation
- Collaborateur Triade NoireDocument2 pagesCollaborateur Triade NoireChersonPas encore d'évaluation
- Le Désir en PhilosophieDocument15 pagesLe Désir en PhilosophiegwompoPas encore d'évaluation
- L'Amant Militaire, de Carlo GoldoniDocument37 pagesL'Amant Militaire, de Carlo GoldoniSurdescu AlexandruPas encore d'évaluation
- Bibliographie Sécurité Dans Le SpectacleDocument3 pagesBibliographie Sécurité Dans Le SpectacleHenri MichelPas encore d'évaluation
- Livre Lc3a9thique Politique v10Document276 pagesLivre Lc3a9thique Politique v10IsmaëlPas encore d'évaluation
- Sadoc Liste Globale Franc3a7aisDocument338 pagesSadoc Liste Globale Franc3a7aisHassan RogaaiPas encore d'évaluation
- Camus Albert Actuelles IIDocument108 pagesCamus Albert Actuelles IINegru CorneliuPas encore d'évaluation
- Panonyme CorrigéDocument7 pagesPanonyme CorrigéMaison L. ElisaPas encore d'évaluation
- Livret Du ParticipantDocument27 pagesLivret Du ParticipantEmmanuel LompoPas encore d'évaluation
- Conditions Generales Cours de Preparation Examens Delf Dalf Oct Nov 2022Document1 pageConditions Generales Cours de Preparation Examens Delf Dalf Oct Nov 2022Isabel CadenaPas encore d'évaluation
- L'amour de Notre Père - Samuel OlivierDocument2 pagesL'amour de Notre Père - Samuel OlivierWadson De la VerdurePas encore d'évaluation
- Mini Mémoire, Dania Reguieg, M2, S2Document13 pagesMini Mémoire, Dania Reguieg, M2, S2Danii RePas encore d'évaluation
- La Consultation JuridiqueDocument4 pagesLa Consultation Juridiquemouazara.assPas encore d'évaluation